

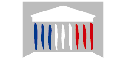
N° 2794
______
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 21 mai 2015.
RAPPORT
FAIT
AU NOM DE LA COMMISSION D’ENQUÊTE (1) chargée d’établir un état des lieux et de faire des propositions en matière de missions et de modalités du maintien de l’ordre républicain, dans un contexte de respect des libertés publiques et du droit de manifestation, ainsi que de protection des personnes et des biens,
M. Noël MAMÈRE
Président
M. Pascal POPELIN
Rapporteur
Députés
——
(1) La composition de cette commission d’enquête figure au verso de la présente page.
La commission d’enquête sur les missions et modalités du maintien de l’ordre républicain dans un contexte de respect des libertés publiques et du droit de manifestation est composée de : M. Noël Mamère, président ; M. Pascal Popelin, rapporteur ; MM. Philippe Doucet, Philippe Folliot, Guillaume Larrivé, Mme Clotilde Valter, vice-présidents ; Mme Marie-George Buffet, MM. Hugues Fourage, Philippe Goujon, Jérôme Lambert, secrétaires ; MM. Jean-Paul Bacquet, Jean-Pierre Barbier, M. Daniel Boisserie, Gwenegan Bui, Mme Marie-Anne Chapdelaine, MM. Guy Delcourt, Pascal Demarthe, Christophe Guilloteau, Meyer Habib, Mme Anne-Yvonne Le Dain, MM. Olivier Marleix, Michel Ménard, Philippe Meunier, Yannick Moreau, Mme Nathalie Nieson, MM. Christophe Priou, Boinali Said, Éric Straumann, Daniel Vaillant et Michel Voisin.
SOMMAIRE
PAGES
AVANT-PROPOS DE M. NOËL MAMÈRE, PRÉSIDENT DE LA COMMISSION D’ENQUÊTE 9
INTRODUCTION 11
I. LE CADRE GÉNÉRAL DU MAINTIEN DE L’ORDRE EN FRANCE 15
A. UN RÉGIME JURIDIQUE TRÈS PROTECTEUR DE LA LIBERTÉ DE MANIFESTER 15
1. Un régime déclaratif libéral pour garantir une composante de la liberté d’expression 15
a. La valeur fondamentale de la liberté de manifestation 15
b. Le régime de déclaration préalable des manifestations 16
c. Les faibles portées de l’obligation déclarative et de l’interdiction de manifester soulignent l’étendue de la liberté de manifestation 17
2. Un cadre de police administrative préventive 20
a. La mission de sécurité publique de maintien ou de rétablissement de l’ordre public est une mission administrative préventive 20
b. Le trouble délictueux à l’ordre public : le régime de l’attroupement 21
B. LA MISE EN œUVRE DU RÉGIME DU MAINTIEN OU DU RÉTABLISSEMENT DE L’ORDRE 22
1. Le recours par principe à des forces dédiées, formées spécifiquement au maintien de l’ordre 22
a. Les forces mobiles et leurs missions de maintien de l’ordre 23
b. Les effectifs et l’organisation tactique des unités 26
c. Le cadre de formation des unités 28
2. La doctrine française du maintien de l’ordre et les moyens qui la servent 31
a. La mise à distance et le recours absolument nécessaire, proportionné et gradué à la force 31
b. Des équipements et armements individuels et collectifs offrant un équilibre mobilité/protection/puissance 38
c. Les exemples étrangers : d’autres types d’organisations, de doctrines et d’équipements 40
C. L’EFFICACITÉ DU MAINTIEN DE L’ORDRE À LA FRANÇAISE 47
1. Une doctrine efficace pour prévenir ou faire cesser les troubles à l’ordre public 47
a. L’efficacité de la protection de l’ordre public 47
b. L’usage de la force comme ultima ratio d’une opération de maintien de l’ordre 48
c. Des données parcellaires sur le nombre de blessés 51
2. Les suites judiciaires, administratives et déontologiques d’une opération de maintien de l’ordre 52
a. Une judiciarisation complexe des opérations de maintien de l’ordre qui ne favorise pas la réponse pénale 52
b. Les mises en cause possibles de l’action des forces de l’ordre et de la puissance publique 56
II. LES CONDITIONS DES TROUBLES À L’ORDRE PUBLIC ONT ÉVOLUÉ 61
A. LA RECOMPOSITION DES ACTEURS PRINCIPAUX DES MANIFESTATIONS A PRIVÉ PROGRESSIVEMENT L’ÉTAT DE SES MOYENS DE RÉGULATION DES TROUBLES À L’ORDRE PUBLIC 61
1. Les conditions d’organisation des manifestations ne permettent plus autant la concertation en amont 62
a. La part décroissante des grands acteurs traditionnels et de leurs services d’ordre dans l’organisation des manifestations 62
b. L’organisation de manifestations… sans organisateurs 63
c. La présence récurrente de contremanifestants ou/et de groupes structurés sans lien avec la manifestation se livrant à des actes délictuels ou cherchant explicitement à troubler l’ordre public 65
2. La recomposition des forces à disposition du préfet 67
a. Les conséquences de la suppression des Renseignements généraux 67
b. La diminution des effectifs des forces mobiles impose un recours accru à des unités non spécialisées dans le maintien de l’ordre 70
B. DES NOUVEAUX TERRAINS DE CONTESTATIONS SOCIALES 75
1. Le déplacement des manifestations vers des territoires ruraux ou de plus en plus étendus nécessite une évolution tactique 75
a. Les problématiques de maintien de l’ordre en espaces ouverts et/ou multiples 76
b. L’intervention des forces de l’ordre sur des terrains aménagés et occupés par les manifestants. 77
2. Le phénomène des zones à défendre (ZAD) : des infractions causant davantage de préjudice à autrui qu’elles ne troublent l’ordre public 82
a. L’installation d’une ZAD est en soi un acte délictueux, mais ne constitue pas par elle-même un trouble à l’ordre public 82
b. Une confusion grandissante entre les opérations de sécurité classique et les opérations de rétablissement de l’ordre face à des attroupements hostiles 84
C. L’ASSIGNATION DE NOUVEAUX OBJECTIFS AUX FORCES DE L’ORDRE, ASSOCIÉE À LA MÉDIATISATION CROISSANTE DES ENJEUX DE SECURITÉ, BROUILLE LA NOTION MÊME DE RÉTABLISSEMENT DE L’ORDRE PUBLIC 86
1. La médiatisation renforce les enjeux associés aux conflits sociaux et aux opérations de maintien de l’ordre 86
a. Une tolérance moins grande à une violence déployée par certains manifestants et davantage exposée 86
b. Des relations plus compliquées entre la presse et certains manifestants dans la production de l’information, qui rendent nécessaire une protection plus importante de la part des forces de l’ordre 87
2. La recherche d’une réponse pénale adaptée aux agissements individuels a complexifié les opérations de maintien de l’ordre 90
a. Une plus grande préoccupation de la sanction pénale des manifestants les plus violents ou délinquants 90
b. La mise en place de dispositifs qui contribuent à brouiller la notion même de maintien de l’ordre 91
III. DÉVELOPPER DES RÉPONSES PLUS GRADUELLES POUR MIEUX CONJUGUER ORDRE ET LIBERTÉ 95
A. REDONNER DES MOYENS À L’AUTORITÉ CIVILE EN AMONT DES MANIFESTATIONS : UN CHANTIER DÉJÀ OUVERT 96
1. Reconstruire et densifier le renseignement de proximité : les mesures déjà prises 96
a. La création du service central du renseignement territorial 96
b. Les évolutions en cours du renseignement de proximité 98
2. Professionnaliser davantage le maintien de l’ordre 99
a. Organiser une formation spécifique du corps préfectoral au maintien de l’ordre : la mission Lambert et ses conclusions 99
b. Envisager un renforcement des compétences en matière de maintien de l’ordre dans certaines préfectures particulièrement exposées 101
3. Réaffirmer l’autorité et la présence indispensable de l’autorité civile 102
a. La réaffirmation de l’autorité du préfet et du partage des rôles entre l’autorité civile et les forces mobiles 102
b. La présence de l’autorité civile doit être permanente pendant les opérations de maintien de l’ordre et non pas seulement pour engager la force 104
B. RECRÉER DES FORMES DE CONCERTATION ENTRE LES AUTORITÉS CIVILES ET POLICIÈRES, D’UNE PART, ET LES MANIFESTANTS RESPECTUEUX DE L’ORDRE PUBLIC, D’AUTRE PART 105
1. Formaliser et diffuser les séquences types d’une opération de maintien de l’ordre et faciliter sa couverture par la presse 107
a. Créer un guide d’action à usage des préfets et le communiquer aussi largement que possible 107
b. Simplifier et rendre plus compréhensibles les sommations et la communication à destination des manifestants 107
c. Faciliter le suivi par la presse des opérations de maintien de l’ordre 108
2. Aménager les procédures judiciaires et administratives afin que des individus isolés ne puissent prendre en otage la liberté publique de manifester 110
a. Les procédures actuelles ayant pour effet d’interdire à un individu de participer à une manifestation 110
b. Les exemples étrangers d’interdiction administrative de manifester 111
c. L’introduction de l’interdiction administrative de manifester 112
3. Organiser une médiation systématique et continue entre les forces chargées du maintien de l’ordre et le public manifestant avant, pendant et après l’événement 113
a. Fixer le principe d’une concertation préalable obligatoire 114
b. Créer de nouvelles unités policières de médiation, intégrées dans les manifestations 116
c. Organiser un accueil permanent et un retour d’expérience de la part des manifestants 116
C. FACE AUX FOULES MANIFESTANTES : FAIRE CONFIANCE À DES FORCES DE L’ORDRE SPÉCIALISÉES, PROFESSIONNELS DU MAINTIEN DE L’ORDRE ET RESPECTUEUX DES LIBERTÉS PUBLIQUES 117
1. Moderniser la formation des forces chargées du maintien de l’ordre 118
a. Ouvrir la formation et la doctrine du maintien de l’ordre aux recherches en sciences sociales 118
b. Chercher à préserver et rendre incompressible le temps de recyclage des unités 119
2. Favoriser l’intervention exclusive d’unités spécialisées pour les opérations de maintien de l’ordre 120
a. Réduire l’emploi des forces mobiles pour des missions ne concernant pas le maintien de l’ordre afin d’accroître leur disponibilité 121
b. Créer une habilitation au maintien de l’ordre pour les unités constituées de la police et de la gendarmerie nationales, hors forces mobiles 122
3. Recentrer l’équipement des forces chargées du maintien de l’ordre sur les besoins liés à la gestion des foules 123
a. Restreindre l’usage du lanceur de balles de défense LBD 40x46 lors des opérations de maintien de l’ordre aux seules forces mobiles et aux forces dûment formées à son emploi dans le contexte particulier du maintien de l’ordre 123
b. Développer de nouveaux moyens intermédiaires visant à disperser les foules 129
c. Renforcer et rénover les moyens mécaniques pour pallier les diminutions d’effectifs et favoriser l’émergence de nouveaux schémas tactiques 129
4. Faciliter la judiciarisation des infractions commises lors ou en marge d’une manifestation 130
a. Privilégier la capacité des unités spécialisées à interpeller des groupes d’individus violents 131
b. Créer de meilleures conditions d’interpellation en cas de commission de délits flagrants lors des manifestations 132
LISTE DES PROPOSITIONS 139
EXAMEN EN COMMISSION 143
CONTRIBUTIONS 163
COMPTES RENDUS DES AUDITIONS 185
PERSONNES ENTENDUES PAR LA COMMISSION D’ENQUÊTE 469
PERSONNES AYANT ADRESSÉ UNE CONTRIBUTION ÉCRITE 473
ANNEXE 1 : Les missions des escadrons de gendarmerie mobile en opération de maintien de l’ordre 475
ANNEXE 2 : Configuration des escadrons de gendarmerie mobile en opération de maintien de l’ordre 478
AVANT-PROPOS DE M. NOËL MAMÈRE,
PRÉSIDENT DE LA COMMISSION D’ENQUÊTE
Le 3 décembre 2014, lors de l’examen en séance publique de la proposition de résolution tendant à la création d’une commission d’enquête « relative aux missions et modalités du maintien de l’ordre républicain dans un contexte de respect des libertés publiques et du droit de manifestation », j’avais rappelé les faits dramatiques à l’origine d’une telle demande de la part du groupe Écologiste : la mort de Rémi Fraisse, âgé de 21 ans, opposant au projet absurde du barrage de Sivens, à la suite de l’utilisation d’une grenade offensive lancée par un gendarme au cours d’une opération, dans des circonstances pour le moins confuses.
J’avais également précisé qu’il n’était évidemment pas question que le Parlement se substitue à l’autorité judiciaire en enquêtant sur des faits soumis à l’instruction du juge. En revanche, j’étais persuadé qu’une telle tragédie nous obligeait en tant que parlementaires et qu’il était de notre devoir de procéder à un travail d’analyse et de réflexion sur l’ensemble des questions relatives au maintien de l’ordre.
Dès l’origine, j’ai estimé que cette commission d’enquête ne devait ni servir à nourrir de vaines polémiques, ni se transformer en caisse de résonance de propos caricaturaux : non, les manifestants et militants ne sont pas, par essence, de dangereux individus qui souhaitent mettre à bas l’ordre républicain et les institutions. Non, les forces de l’ordre ne sont pas, par nature, un instrument de répression aveugle aux mains d’un pouvoir oppresseur. Mais tous les manifestants et militants ne sont pas pacifiques. Et les forces de l’ordre ne conduisent pas toujours leur mission de manière acceptable et conforme au cadre réglementaire et déontologique qui les oblige.
Le nombre et la diversité des auditions menées par la commission dans un calendrier contraint, ainsi que la qualité des échanges qui ont présidé à ses travaux, témoignent d’un souci constant d’écoute et d’équilibre de la part de ses membres. Pour qui souhaiterait se livrer à un exercice de comparaison purement arithmétique, la commission d’enquête a organisé 13 auditions au cours desquelles des représentants des forces de l’ordre, en activité ou non, et du ministère de l’Intérieur – dont le ministre lui-même – ont été invités à s’exprimer. Et 13 auditions au cours desquelles des blessés, des manifestants et militants, des chercheurs, des associations et des représentants de la société civile, d’institutions, d’autorités indépendantes ont pu livrer leur point de vue.
À l’occasion de ces 26 auditions (soit 50 heures de débats), des deux déplacements qu’elle a effectués et grâce aux nombreuses contributions écrites qu’elle a reçues, la commission d’enquête a pu approfondir des problématiques très variées : sur le cadre juridique applicable à la liberté de manifestation, sur la nature des forces susceptibles de participer à des opérations de maintien de l’ordre, sur leurs effectifs, leur formation, leur équipement, leur doctrine d’emploi, leurs schémas tactiques, sur les nouveaux terrains et modalités de contestation sociale, sur les différents modèles européens de maintien de l’ordre, etc. Sur tous ces sujets, la commission d’enquête a apporté des éclairages utiles.
Je ne partage pas, tant s’en faut, l’ensemble des préconisations formulées par le Rapporteur. Aussi, ai-je décidé d’apporter une contribution personnelle au rapport, en annexe, afin de présenter et de préciser ma position, ainsi que les enseignements que je retire de ces travaux. Ils auront eu au moins le mérite de clarifier plusieurs points dans un domaine qui se prête trop souvent à la polémique, aux raccourcis regrettables et aux commentaires partiels.
À une exception près, au demeurant compréhensible, les auditions ont été ouvertes à la presse, retransmises en direct sur le site Internet de l’Assemblée nationale où elles restent disponibles en vidéo à la demande ; leur compte rendu écrit est annexé au rapport.
Chacun pourra donc s’y référer et se forger une opinion en conscience.
Art. X. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la Loi.
Art. XI. La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi.
Art. XII. La garantie des droits de l’Homme et du Citoyen nécessite une force publique : cette force est donc instituée pour l’avantage de tous, et non pour l’utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée.
Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789
La commission d’enquête sur les missions et modalités du maintien de l’ordre républicain dans un contexte de respect des libertés publiques et du droit de manifestation a été créée par l’Assemblée nationale à la suite du décès tragique de Rémi Fraisse survenu lors d’affrontements entre les forces mobiles et certains occupants du site du chantier du barrage de Sivens. Les procédures judiciaires en cours ont interdit à la commission d’investiguer spécifiquement sur ces événements, et ses travaux ont respecté strictement ce principe de séparation des pouvoirs. L’exigence, partagée par tous, de limiter le risque qu’un tel événement puisse se reproduire est demeurée présente à l’esprit du Rapporteur et des commissaires, tout au long des travaux de la commission d’enquête.
Ces derniers ont respecté un cadre qu’il convient de rappeler à titre liminaire. Comme le précise l’intitulé de la commission d’enquête, son champ d’investigation et d’analyse concerne uniquement le maintien de l’ordre et les forces qui en ont la charge. Au-delà de cette mission – essentielle –, les forces de police françaises assurent une multiplicité d’autres missions : sécurité publique générale, lutte contre la délinquance, le terrorisme, les trafics, sécurité routière, etc. Il n’en sera pas question dans le cadre du présent rapport. Si, au cours des auditions, certaines personnes entendues ont pu faire référence, à titre accessoire ou même principal, à de telles missions et aux unités de police ou de gendarmerie qui y participent, la commission ne saurait faire état de ces éléments dans le cadre du présent rapport dont l’objet a été strictement limité au champ défini lors de sa création. On ne s’étonnera donc pas de l’absence de faits ou d’informations rapportés qui, pour intéressants qu’ils puissent être, sont étrangers au cadre déterminé par l’Assemblée nationale lors de l’adoption de la résolution portant création de ladite commission le 3 décembre 2014.
Celle-ci a tenu 26 réunions et auditionné soixante personnes. Certains de ses membres se sont également rendus en Allemagne et au Centre national d’entraînement des forces de la gendarmerie à Saint-Astier, afin de rencontrer professionnels, experts et chercheurs. Au terme de ce travail, le Rapporteur veut souligner l’équilibre français entre liberté de manifester et ordre républicain. Déjà présent au sein même de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen, cet équilibre est toujours pertinent de nos jours.
Aucune personne auditionnée par la commission n’a remis en cause cet équilibre, ni ses principales caractéristiques juridiques et matérielles, qui n’ont pas davantage fait débat parmi les commissaires :
– la force constitutionnelle de la liberté de manifester, garantie par le libéralisme du régime de la simple déclaration préalable ;
– l’exigence, à valeur également constitutionnelle, de préserver l’ordre public, en tant notamment qu’il permet l’expression des libertés individuelles ;
– l’existence de forces spécialisées dans une mission elle-même spécifique : le maintien ou le rétablissement de l’ordre public.
C’est donc davantage la modernité de l’équilibre entre liberté et ordre public que la commission d’enquête a interrogée, que son principe lui-même. En effet, les travaux de la commission ont rapidement fait apparaître le double constat suivant. D’une part, la doctrine française et les moyens qui la servent ont des points forts et des mérites, y compris pour garantir la liberté d’expression et la sécurité des personnes et des biens. D’autre part, les conditions générales des manifestations et du maintien de l’ordre ont beaucoup évolué depuis que le cadre général en a été posé, au lendemain de Mai-68, qu’il s’agisse des conditions d’organisation, de la médiatisation croissante, des lieux de manifestations, etc.
Le maintien de l’ordre et les opérations qui visent à le rétablir s’inscrivent nécessairement, dans le cadre d’une société démocratique et d’un État de droit, dans une philosophie de tolérance à un certain degré de désordre. La démocratie et certaines de ses modalités d’expression impliquent une telle tolérance, qui ne remet pas en cause, en tant que telle, l’ordre public.
Ce n’est que lorsque celui-ci est menacé, lorsqu’une manifestation dégénère en attroupement violent, par exemple, que les forces de police ont vocation à faire usage de la contrainte. Tout État est capable de faire régner l’ordre, mais seuls les États de droit démocratiques peuvent assurer un maintien de l’ordre respectueux de l’expression des libertés publiques. Ce maintien de l’ordre républicain est celui qui se conforme, lui-même, aux valeurs démocratiques, aux principes et aux procédures qu’il protège. À cet égard, le rôle premier des unités chargées du maintien de l’ordre consiste d’abord et avant tout à créer les conditions d’un exercice optimal des libertés publiques et, notamment, du droit de manifestation. S’il s’avère nécessaire, le rétablissement de l’ordre ne s’effectue que dans un second temps et de manière particulièrement encadrée, notamment en ce qui concerne l’usage de la force.
Le maintien de l’ordre n’est donc pas une science exacte qui permettrait d’appliquer au réel des schémas tactiques produisant automatiquement les effets désirés. Il s’agit, au sens littéral de l’expression, d’une science humaine. Une science car le maintien de l’ordre ne s’improvise pas. Il est étudié, fait l’objet d’analyses rationnelles, de recherches approfondies, de réflexions doctrinales, de retours d’expérience. Une science humaine car il repose, en dernière analyse, sur des hommes et des femmes pouvant être amenés à faire face et à gérer d’autres hommes et femmes dans des circonstances parfois extrêmement tendues et particulièrement mouvantes.
Le Rapporteur considère que c’est précisément là que réside l’intérêt et l’enjeu des travaux de cette commission d’enquête : contribuer à moderniser le cadre du maintien de l’ordre pour permettre que la liberté de manifester et l’ordre public se conjuguent sans heurt dans la durée, en préservant la vie et la sécurité de chacun. C’est ainsi qu’il a conçu le présent rapport, comme un outil de diagnostic et de réflexion à destination du pouvoir exécutif. Il suggère très globalement de s’appuyer sur les points forts et les atouts de l’expérience française, tout en adaptant les moyens et la doctrine afin qu’ils soient mieux adaptés aux réalités et aux exigences actuelles de nos concitoyens. Dans ce but, le fil rouge des préconisations que le Rapporteur formule est résumé par l’idée de mieux préserver, demain, la liberté de manifester par davantage de gradation dans la gestion des protestations publiques.
I. LE CADRE GÉNÉRAL DU MAINTIEN DE L’ORDRE EN FRANCE
A. UN RÉGIME JURIDIQUE TRÈS PROTECTEUR DE LA LIBERTÉ DE MANIFESTER
1. Un régime déclaratif libéral pour garantir une composante de la liberté d’expression
Forme spécifique de la liberté d’expression, la liberté de manifester est une liberté constitutionnellement garantie. Elle est également consacrée par la Cour européenne des droits de l’homme. Cependant, c’est dans la mise en œuvre de son régime juridique particulièrement libéral que se révèle la portée de la liberté de manifestation.
a. La valeur fondamentale de la liberté de manifestation
Dans la jurisprudence constitutionnelle, comme dans celle de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), la liberté de manifester constitue un droit fortement garanti, mais qui peut subir des limitations en raison de strictes nécessités d’ordre public.
Le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 18 janvier 1995 sur la loi d’orientation et de programmation relative à la sécurité, n° 94-352 DC, a estimé que la liberté de manifester constituait une forme de combinaison de la liberté d’aller et venir et du droit d’expression collective des idées et des opinions auxquels il reconnaît une valeur constitutionnelle. Dans la même décision, le Conseil a également posé les conditions de limitation de cette liberté de manifester, en indiquant que le législateur devait veiller à en concilier l’exercice avec « la prévention des atteintes à l’ordre public et notamment des atteintes à la sécurité des personnes et des biens qui répond à des objectifs de valeur constitutionnelle ».
La liberté de manifestation apparaît également comme une composante de la « liberté de réunion pacifique » garantie par l’article 11 de la Convention européenne des droits de l’homme. Cette liberté, que la Cour européenne des droits de l’homme analyse de façon constante en lien avec la liberté d’expression des opinions prévue à l’article 10 de la Convention, peut cependant subir des limitations, si celles-ci sont prévues par la législation nationale et poursuivent l’objectif général de sauvegarde de l’ordre public. La CEDH a précisé cet équilibre dans sa jurisprudence en posant comme principe que les ingérences dans l’exercice de la liberté de manifester doivent être justifiées par « un besoin social impérieux » et « proportionnées au but légitime visé ». La Cour a clairement illustré cette approche équilibrée dans sa décision Barraco c/ France du 5 mars 2009 :
« 41. La Cour observe d’emblée que le droit à la liberté de réunion est un droit fondamental dans une société démocratique et, à l’instar du droit à la liberté d’expression, l’un des fondements de pareille société. Dès lors, il ne doit pas faire l’objet d’une interprétation restrictive […]
« 42. La liberté de réunion pacifique, dont l’un des buts est la protection des opinions personnelles, fait l’objet d’un certain nombre d’exceptions qu’il convient toutefois d’interpréter de manière étroite ; de plus, la nécessité des restrictions doit être établie de façon convaincante. […]
« 48. Dans ces conditions, mettant en balance l’intérêt général à la défense de l’ordre et l’intérêt du requérant et des autres manifestants à choisir cette forme particulière de manifestation, et compte tenu du pouvoir d’appréciation reconnu aux États en cette matière, la condamnation pénale du requérant n’apparaît pas disproportionnée aux buts poursuivis. »
Ainsi, en France, manifester – c’est-à-dire exprimer une volonté collective en utilisant la voie publique – est une liberté fortement protégée, qui ne trouve sa limite que dans les nécessités de l’ordre public. Cet équilibre a été parfaitement décrit lors de son audition par M. Christian Vigouroux, président de la section de l’intérieur du Conseil d’État : « En résumé, le régime est celui de la liberté avec un encadrement législatif minimal – la déclaration – et la possibilité d’aller plus loin, par l’interdiction, mais alors sur preuves, en fonction des circonstances étroitement évaluées, et dans les limites strictement nécessaires au rétablissement de l’ordre public. (1)».
b. Le régime de déclaration préalable des manifestations
En pratique, la possibilité de manifester n’est subordonnée qu’à un régime déclaratif. C’est le décret-loi du 23 octobre 1935, codifié à l’article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure, qui a institué une obligation de déclaration préalable pour « tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes et d’une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique ». Comme l’a souligné le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l’Intérieur (2), ce régime juridique « s’applique aussi bien aux veilleurs, qu’aux zadistes ou aux anti-corrida, et aux flash mob qu’aux free parties. »
La déclaration préalable doit être déposée entre quinze jours et trois jours avant la date de la manifestation prévue (art. L. 211-2 du code de la sécurité intérieure). Ce dépôt s’effectue auprès de la mairie, qui délivre un récépissé. Il s’effectue auprès de la préfecture dans les villes où est instituée la police d’État. Enfin, comme le prévoit l’article L. 211-2 du code de la sécurité intérieure : « La déclaration fait connaître les noms, prénoms et domiciles des organisateurs et est signée par trois d’entre eux faisant élection de domicile dans le département ; elle indique le but de la manifestation, le lieu, la date et l’heure du rassemblement des groupements invités à y prendre part et, s’il y a lieu, l’itinéraire projeté. »
Dans la pratique, ce régime de déclaration préalable, en plus de faire naître une responsabilité particulière de l’organisateur de la manifestation, a traditionnellement constitué un outil de dialogue et de concertation entre les citoyens souhaitant manifester et le représentant de l’État dans le département, qui a la charge de veiller à l’ordre public. En effet, le pouvoir de l’autorité civile d’interdire la manifestation projetée (cf. infra), y compris de façon partielle (3), lui confère concrètement le pouvoir d’encadrer ponctuellement le projet qui lui est soumis grâce à une concertation préalable afin d’éviter l’interdiction elle-même. Ainsi que l’a rappelé M. Christian Vigouroux (4), l’ordre public « est autoritaire puisque c’est une décision unilatérale qui encadrera une manifestation ou éventuellement l’interdira, et les autorités administratives assument ce pouvoir de police, mais il est en même temps négocié : il fait l’objet de discussions avec les citoyens auxquels les mesures restrictives s’appliqueront. »
Le juge administratif a ainsi admis que l’autorité administrative puisse, en présence de risques de troubles à l’ordre public induits par une manifestation, conditionner l’absence de prononcé d’une interdiction à un aménagement d’un itinéraire, lorsque celui-ci expose à des risques particuliers (Tribunal administratif de Paris, ord. 24 janvier 2014, Association « La manif pour tous », ou encore 4 septembre 2013, Banasiak) ou bien même interdire l’accès de la manifestation à un certain périmètre (Conseil d’État, 21 janvier 1996, Legastelois). Toutefois, un tel encadrement, même dans la négociation, ne saurait être généralisé pour toutes les manifestations. Sauf à transformer le régime de déclaration préalable en régime d’autorisation, il doit être réservé et justifié, sous le contrôle du juge, aux seuls cas où des troubles sont hautement prévisibles et ce, afin d’éviter l’interdiction pure et simple de la manifestation.
Ce régime déclaratif des manifestations s’applique dans plusieurs pays voisins de la France, comme en Espagne. D’autres États, comme la Suède, ont choisi d’adopter un régime d’autorisation préalable des manifestations par la police ou l’autorité civile. Le Rapporteur observe que, dans une telle comparaison, le régime juridique français peut déjà apparaître comme le plus libéral. Son caractère particulièrement protecteur de la liberté de manifester se révèle encore davantage à la lumière des très faibles moyens de coercition à la disposition de l’autorité civile pour le faire respecter.
c. Les faibles portées de l’obligation déclarative et de l’interdiction de manifester soulignent l’étendue de la liberté de manifestation
Le régime juridique des manifestations prévu par le code de la sécurité intérieure dispose que toutes les manifestations doivent être déclarées, et que « si l’autorité investie des pouvoirs de police estime que la manifestation projetée est de nature à troubler l’ordre public, elle l’interdit par un arrêté qu’elle notifie immédiatement aux signataires de la déclaration au domicile élu » (art. L. 211-4). De surcroît, l’article L. 211-12 de ce même code et l’article 431-9 du code pénal instaurent une responsabilité pénale des organisateurs de manifestations non ou mal déclarées.
Le Rapporteur observe que ces dispositions s’effacent en réalité devant la force qui s’attache à la liberté publique de manifester dans le droit constitutionnel et européen. Ce droit ne prévoit d’autre limitation à la liberté de manifester que celle strictement nécessaire à la préservation de l’ordre public. Il en résulte notamment que l’absence de déclaration ne vaut pas interdiction de la manifestation, que l’interdiction elle-même doit être particulièrement justifiée, et enfin que celle-ci n’a pas pour conséquence directe que l’État peut mettre un terme à la manifestation interdite.
Premièrement, le défaut de déclaration de la manifestation, ou la déclaration incomplète – quoique constitutif d’une infraction pour l’organisateur implicite de l’événement – n’emporte pas automatiquement l’interdiction de celui-ci au sens du code de la sécurité intérieure. Comme l’a jugé le Conseil d’État (12 novembre 1997, Min. intérieur c/ Association « Communauté tibétaine en France et ses amis »), seul un motif explicite de préservation de l’ordre public peut justifier une mesure d’interdiction d’une manifestation, même non déclarée. Ce principe est également affirmé par la CEDH, notamment dans sa décision Barraco c/ France : « la Cour note que la manifestation n’a pas fait l’objet d’une déclaration préalable formelle comme cela est exigé par le droit interne pertinent en la matière. Elle rappelle toutefois qu’une telle situation ne justifie pas en soi une atteinte à la liberté de réunion d’autant qu’en l’espèce, l’événement avait largement été porté à la connaissance des autorités publiques qui disposaient de leur pouvoir de police administrative soit pour l’interdire, soit pour en assurer le bon déroulement. En l’occurrence, lesdites autorités ont pu organiser préalablement à la manifestation les mesures nécessaires au maintien de la sécurité et de l’ordre publics, notamment en plaçant des forces de police en protection et en escorte. La Cour en déduit, comme le requérant, que la manifestation était sinon tacitement tolérée, du moins non interdite ».
Deuxièmement, l’interdiction d’une manifestation, régulièrement déclarée ou non, doit être justifiée par l’existence d’une menace à l’ordre public. L’autorité civile doit notamment établir avec suffisamment de précision les risques de troubles à l’ordre public (qualité de l’organisateur, comportements lors de manifestations précédentes, risques de contre-manifestation au même moment, sur le même parcours ou parcours voisin, risque d’éléments perturbateurs, modalités pratiques, nombre de participants attendus, etc.) mais aussi l’impossibilité de prévenir ces risques par un moyen moins coercitif que l’interdiction de manifestation (configuration des lieux, moyens insuffisants notamment si d’autres événements concomitants, etc.). Le juge administratif exerce sur ces aspects un contrôle sévère à l’encontre des mesures d’interdiction, pouvant aller jusqu’à l’appréciation de l’effectif des forces de l’ordre disponibles afin de réguler les troubles possibles à l’ordre public (Cour administrative d’appel de Paris, 7 mars 2000 – n° 97PA00133) et « parer à tout danger dans le quartier considéré ». Cette stricte condition de légalité des arrêtés d’interdiction de manifestation a été largement intégrée par les préfets, comme en témoignent le très faible nombre de mesures d’interdiction, et la proportion marginale de ces mesures ayant été annulées par le juge administratif. Le ministre de l’Intérieur ne dispose pas de chiffres au niveau national concernant les mesures d’interdiction prononcées mais uniquement pour Paris. En 2013, 3 410 manifestations ont été déclarées à Paris et 27 interdites par le préfet de police tandis qu’en 2014, 2 046 ont été déclarées et 5 interdites, soit respectivement 0,79 % et 0,25 % des cas.
Troisièmement, lors même qu’une manifestation, déclarée ou non, a été valablement interdite par l’autorité civile, il n’est pas possible à l’État d’ordonner sa dispersion, a fortiori par l’emploi de la force, en l’absence de trouble ou de risque certain de trouble à l’ordre public. Conformément aux articles L. 211-9 du code de la sécurité intérieure et 431-3 du code pénal, seuls les attroupements peuvent être dispersés par l’État et non les manifestations pacifiques. Ici encore, seul le critère de trouble à l’ordre public est déterminant pour contraindre l’exercice de la liberté de manifester. Ce principe de la législation française a également été rappelé à plusieurs reprises par la CEDH : « La Cour reconnaît que toute manifestation dans un lieu public est susceptible de causer un certain désordre pour le déroulement de la vie quotidienne, y compris une perturbation de la circulation, et qu’en l’absence d’actes de violence de la part des manifestants, il est important que les pouvoirs publics fassent preuve d’une certaine tolérance pour les rassemblements pacifiques, afin que la liberté de réunion ne soit pas dépourvue de tout contenu » (Barraco c/ France, précité).
En définitive, c’est donc moins le régime déclaratif qui consacre la liberté de manifestation en France que les faibles limitations pouvant lui être apportées, en l’absence de trouble avéré à l’ordre public. Cela entraîne notamment deux conséquences :
– les décisions d’interdiction de manifestation ne sont pas systématiquement respectées. Ainsi, le préfet de police de Paris a interdit le 18 juillet 2014 une manifestation de soutien aux Palestiniens prévue le 19 juillet. Cependant, le 19 juillet des personnes se sont effectivement regroupées à l’endroit prévu. Faute de déclaration préalable identifiant les organisateurs et de moyens légaux permettant de disperser la manifestation illicite, le seul régime de responsabilité pénale prévu par le code de sécurité intérieure paraît bien mince pour garantir le respect des arrêtés d’interdiction ;
– compte tenu des fortes contraintes juridiques et du risque de leur peu d’effet concret, les préfets ne sont donc guère enclins à prononcer des arrêtés d’interdiction. Ceux-ci rompent le lien déjà trop fragile entre un organisateur de manifestation et le représentant de l’État. Lors de son audition, le préfet honoraire Dominique Bur a clairement expliqué cette attitude du corps préfectoral : « Il est toujours moins dangereux pour le préfet d’autoriser une manifestation que de prendre le risque qu’elle se déroule malgré l’interdiction, et de se retrouver démuni. Mieux vaut assumer l’autorisation, à moins, bien entendu, que la manifestation ne viole les grands principes républicains. » (5)
2. Un cadre de police administrative préventive
Compte tenu du régime juridique protecteur de la liberté de manifester, l’action de l’État et notamment des forces de l’ordre à l’occasion d’une manifestation consiste à prévenir l’apparition de troubles à l’ordre public ou, dans les cas difficiles, à rétablir celui-ci. Il s’agit donc d’une mission de police administrative préventive s’exerçant dans des conditions différentes des missions de police judiciaire. Cette nature de la mission ne change pas lorsque l’ordre public est effectivement troublé et que la notion de manifestation disparaît au profit de celle d’attroupement (auquel il est pénalement répréhensible de participer).
a. La mission de sécurité publique de maintien ou de rétablissement de l’ordre public est une mission administrative préventive
Les huitième alinéa de l’article 16 et quatrième alinéa de l’article 20 du code de procédure pénale consacrent une distinction explicite au sein des missions de sécurité. Ils organisent la suspension de la qualité d’officier ou d’agent de police judiciaire des personnels participant en unité constituée à une opération de maintien de l’ordre.
C’est dire la priorité que l’État assigne à son action, lors d’une opération de maintien de l’ordre, en dépit même du fait que le code de sécurité intérieure prévoit des sanctions pénales pour ceux qui ne respecteraient pas l’équilibre juridique entre liberté de manifester et ordre public.
Comme l’a indiqué le préfet honoraire Patrice Bergougnoux : « L’objet du maintien de l’ordre républicain est de permettre l’expression des libertés publiques, dont celle de manifester, dans les meilleures conditions de sécurité pour les personnes et les biens. La force publique a pour mission de faciliter et de permettre l’exercice de ce droit. » (6)
Il en résulte également un partage spécifiquement français des responsabilités en matière de sécurité. Tandis que les missions de police judiciaire s’effectuent sous le contrôle de magistrats avec un certain degré d’autonomie de la part des policiers et gendarmes dont elles constituent le métier, les missions de maintien de l’ordre ne sont réalisées, quant à elles, que sous la stricte et exclusive responsabilité de l’autorité civile, qu’il s’agisse de proportionner l’encadrement des manifestations ou de recourir à la force ou à l’usage des armes. Ce phénomène a été très clairement expliqué par le sociologue Fabien Jobard, directeur de recherches au CNRS :
« Le maintien de l’ordre, d’une certaine manière, n’est pas un métier policier, mais une compétence politique. La police – la police urbaine ordinaire que nous connaissons dans la vie de tous les jours – est fondée sur des principes mêlant discernement de l’agent, connaissance du terrain, dialogue, confiance, appréciation de la situation préalable à la décision et ancrage territorial. Le maintien de l’ordre, à l’inverse, repose non sur des individus mais sur des unités constituées organisées selon un mode militaire, où prévaut le principe de la discipline à travers une chaîne de commandement. La force, dans les opérations de maintien de l’ordre, n’est engagée que sur l’ordre de l’autorité légitime, alors que sa mise en œuvre relève de l’appréciation individuelle du gardien de la paix en police ordinaire. Beaucoup de chercheurs, notamment anglo-saxons, estiment même que le maintien de l’ordre est un métier de type militaire et non policier. […]
Dans les pays de common law, en Grande-Bretagne, aux États-Unis, au Canada, en Australie, en Nouvelle-Zélande, le maintien de l’ordre est envisagé tout autrement qu’en France. Le principe de police autonomy prime : le policier est considéré en tant que professionnel comme seul responsable de la conduite des opérations, dans un cadre général fixé par le politique qui n’est pas censé intervenir ensuite – s’il s’avère qu’il le fait, sa responsabilité peut même être mise en cause. En France, il existe une tradition de méfiance à l’égard des forces de police : le politique doit être au plus près du policier. Cela implique que, d’une certaine manière, le policier est dépossédé de la responsabilité du maintien de l’ordre. » (7)
b. Le trouble délictueux à l’ordre public : le régime de l’attroupement
L’article 431-3 du code pénal définit l’attroupement comme le regroupement des personnes sur la voie publique susceptible de troubler l’ordre public. Cette définition floue est dominée en pratique par le risque de trouble à l’ordre public ou le trouble avéré. La participation à un attroupement constitue, en elle-même, une infraction prévue par les articles L. 211-16 du code de la sécurité intérieure et 431-4 du code pénal, dont la dissimulation du visage est une circonstance aggravante. La participation à un attroupement (ou à une manifestation) en étant porteur d’une arme est également passible de sanction pénale.
Pour autant, le Rapporteur relève que si le code pénal définit l’attroupement, ce n’est pas d’abord pour qualifier pénalement le fait d’y participer, mais pour autoriser administrativement sa dispersion par l’emploi de la force. En effet, l’article 431-3 du code pénal dispose que « Constitue un attroupement tout rassemblement de personnes sur la voie publique ou dans un lieu public susceptible de troubler l’ordre public.
Un attroupement peut être dissipé par la force publique après deux sommations de se disperser restées sans effet adressées dans les conditions et selon les modalités prévues par l’article L. 211-9 du code de la sécurité intérieure. »
Cela illustre la nature particulière de l’action de maintien de l’ordre dans la tradition française, compte tenu de la valeur qui s’attache à la liberté de manifester. Celle-ci ne peut être restreinte que pour maintenir ou rétablir l’ordre public : telle est la mission essentielle de l’autorité civile, qui bénéficie pour la mener à bien du concours de la force publique.
Cette circonstance n’est pas neutre dès lors que le Rapporteur note (cf. infra) les difficultés à judiciariser les agissements délictueux commis à l’occasion de manifestations et/ou d’attroupements. Elle éclaire également les conditions pratiques et concrètes dans lesquelles les forces de sécurité maintiennent ou rétablissent l’ordre public, à travers une doctrine et une tactique principalement collective et de mise à distance des citoyens manifestants.
B. LA MISE EN œUVRE DU RÉGIME DU MAINTIEN OU DU RÉTABLISSEMENT DE L’ORDRE
1. Le recours par principe à des forces dédiées, formées spécifiquement au maintien de l’ordre
Il existe deux institutions policières en France : l’une à statut militaire – la gendarmerie nationale –, l’autre à statut civil – la police nationale. Au sein de ces deux institutions, des forces dédiées ont été créées, sont spécialement formées, équipées et entraînées pour mener des opérations de maintien de l’ordre – mais pas uniquement. Il s’agit, d’une part, de la gendarmerie mobile, organisée en escadrons (EGM), et, d’autre part, des compagnies républicaines de sécurité (CRS), qui forment conjointement la réserve nationale à disposition des autorités publiques.
Si les EGM et les CRS constituent effectivement les unités spécialisées dans le maintien de l’ordre, elles assument, par ailleurs, d’autres missions. En outre, d’autres unités et forces de police non spécialisées en la matière sont susceptibles de participer à des opérations de maintien de l’ordre. Enfin, il convient de rappeler que les forces armées elles-mêmes – armée de terre, marine nationale, armée de l’air, services de soutien interarmées – peuvent, dans certaines circonstances exceptionnelles et selon des procédures particulières, lorsqu’elles en sont légalement requises, prendre part à de telles opérations (8).
Le Rapporteur a jugé utile de décrire à titre principal les deux forces spécialisées et d’en détailler les éléments et caractéristiques essentiels : effectifs, formation, missions, équipements, doctrine, etc. Les informations présentées ci-après s’appuient sur les éléments recueillis par la commission d’enquête au cours des auditions qu’elle a menées et à l’occasion du déplacement effectué par certains de ses membres au Centre national d’entraînement des forces de gendarmerie de Saint-Astier (CNEFG) (9), ainsi que sur les réponses aux questionnaires adressés aux institutions et services concernés (10).
a. Les forces mobiles et leurs missions de maintien de l’ordre
Comme l’a rappelé le général Bertrand Cavallier, ancien commandant du CNEFG, « Le maintien de l’ordre est une spécificité française remontant à la Révolution française, qui a posé les bases du maintien de l’ordre moderne » (11). On peut citer à cet égard la loi du 3 août 1791 relative à la réquisition et à l’action de la force publique contre les attroupements. Initialement remplie par l’armée – la troupe – cette mission sera par la suite confiée à des institutions de nature policière, dont l’action repose sur un recours à la force plus contenu. En effet, la naissance des forces mobiles part du constat de l’inadaptation des forces armées à gérer les conflits sociaux et les manifestations de la fin du XIXe et du début du XXe siècle (12).
En application de la loi de finances du 22 juillet 1921 (13), qui accorde à la gendarmerie les moyens budgétaires nécessaires à la création de pelotons mobiles, et de la circulaire du 15 novembre 1921 (14), les « pelotons mobiles de gendarmerie » – ancêtres des escadrons de gendarmerie mobiles – sont créés et constituent ainsi la première force permanente spécialisée dans le maintien de l’ordre. Le second pilier du maintien de l’ordre français sera bâti en 1944 avec la création par décret (15), au sein de la police nationale, de l’autre force spécialisée en la matière : les compagnies républicaines de sécurité.
● Des missions variées, réalisées par des manœuvres précises.
Pour assurer la mission générale qu’est la préservation ou le rétablissement de l’ordre public, les unités spécialisées sont entraînées à remplir des missions de différentes natures dont chacune se traduit, en opération, par des manœuvres spécifiques (cf. annexe 1). L’énumération suivante présente les quatre types de missions susceptibles d’être effectuées par les EGM et une sélection non exhaustive des manœuvres associées :
– des missions offensives : fixer, évacuer, interpeller ;
– des missions défensives : tenir, protéger, contrôler ;
– des missions de sûreté : couvrir, reconnaître, surveiller ;
– des missions communes : s’interposer, escorter, sécuriser.
Ces missions et manœuvres sont applicables, mutatis mutandis, aux compagnies républicaines de sécurité. En effet, les deux forces partagent la même spécialité et ont vocation, en cas de besoin, à intervenir conjointement au cours d’une même opération et sous la conduite de la même autorité civile ; elles mettent en œuvre des schémas tactiques analogues, nécessaires au bon déroulement de la mission globale. En effet, si les commandants de CRS et les chefs d’escadron de gendarmerie mobile dirigent leurs unités respectives sur le terrain – la mixité des forces n’existant pas –, celles-ci peuvent temporairement être placées sous les ordres d’une autorité qui n’appartient pas à la même institution.
Un exemple de cet indispensable partage des références tactiques a été fourni par le commandant de CRS Christian Gomez, lorsqu’il a évoqué l’intervention de la CRS 40 de Plombières-lès-Dijon à Notre-Dame-des-Landes : « Nous sommes placés sous l’autorité du préfet du département et mis à la disposition du colonel commandant le groupement de gendarmerie qui est l’autorité habilitée à décider de l’emploi de la force, le concepteur du service. Nous sommes temporairement placés sous ses ordres pour toutes nos actions. Selon le nombre des forces présentes, un échelon intermédiaire, un lieutenant-colonel de la gendarmerie, anime et commande des CRS ou des gendarmes mobiles. Lorsque plusieurs unités de CRS sont engagées, il est parfois mis en place un commandement de groupe de compagnies. » (16)
En outre, l’instruction ministérielle portant doctrine d’emploi des forces mobiles de la police et de la gendarmerie nationales (17) prévoit un principe de fongibilité des compétences territoriales entre CRS et EGM. Si la gendarmerie a naturellement tendance à se déployer en milieu rural et outre-mer et les CRS en zones urbaines, chaque force peut être employée dans des missions de maintien de l’ordre public indifféremment dans les deux zones de compétence (police et gendarmerie). La disponibilité des forces et les délais d’acheminement de celles-ci sont des critères à prendre en compte, de même que l’importance des dispositifs à mettre en place, les plus importants d’entre eux nécessitant de déployer les deux catégories de forces mobiles.
● La spécificité du maintien de l’ordre outre-mer : le monopole de la gendarmerie mobile.
Si, en métropole, l’ordre public a vocation à être assuré indifféremment par les CRS ou les EGM, tel n’est pas le cas outre-mer où seules des forces de la gendarmerie mobile sont engagées. Ainsi que le rappelait le général Denis Favier, directeur général de la gendarmerie nationale, un tel monopole d’engagement ne relève pas de l’application d’une norme déterminée de répartition des compétences entre les deux forces mobiles, mais répond à une demande politique (18). De fait, la formation militaire des membres des EGM, leur capacité à mener une action sur le long terme – les opérations pouvant durer plusieurs mois sans relève – et dans des conditions parfois dégradées, expliquent ce recours exclusif aux moyens de la gendarmerie.
Une telle mission est loin d’être marginale pour les EGM, puisque sur les 108 escadrons que comporte la gendarmerie mobile, une vingtaine est déployée en permanence dans les territoires ultramarins, soit 18,5 % des forces mobiles. Ainsi que l’affirme le général Favier, « c’est considérable, si bien que si nous retirions ces 20 escadrons, la sécurité publique générale n’y serait plus assurée. » (19). En effet, en dehors du maintien de l’ordre stricto sensu, les EGM projetés outre-mer permettent notamment d’affermir une présence de terrain dans le cadre de la lutte contre la délinquance et de renforcer l’action de certaines unités territoriales isolées en raison de l’élongation de territoire et de la multi-insularité.
Le maintien de l’ordre public outre-mer ne nécessite pas de formation particulière des unités projetées. S’il est vrai que certains territoires peuvent connaître, de manière ponctuelle, des troubles inhabituels par leur durée ou leur intensité, les EGM sont entraînés à y faire face sans formation complémentaire. Seule la lutte contre l’orpaillage illégal en Guyane, menée dans le cadre de l’opération Harpie, suppose une préparation opérationnelle adaptée compte tenu de sa spécificité.
Le déploiement des EGM outre-mer procède d’un choix gouvernemental ; c’est le Premier ministre qui détermine la nature et l’importance de cette projection (20). Les unités concernées sont déployées pour des périodes de trois mois, un escadron étant, en moyenne, projeté en territoire ultramarin tous les 12 à 15 mois.
b. Les effectifs et l’organisation tactique des unités
● Au 1er janvier 2015, la gendarmerie mobile, composée d’un groupement blindé de la gendarmerie mobile (GBGM) et de 17 groupements de gendarmerie mobile (GGM), comprenait 12 877 hommes en équivalents temps plein (ETP) répartis en 108 escadrons et trois pelotons d’intervention inter-régionaux de gendarmerie (PI2G) (21). Les 108 EGM seuls regroupent 12 751 hommes, soit un effectif moyen d’environ 118 hommes par EGM (22).
Le format et la composition d’un EGM participant à une opération de maintien ou de rétablissement de l’ordre sont déterminés par une circulaire du 22 juillet 2011 relative à l’organisation et à l’emploi des unités de la gendarmerie mobile (23). En application de ce texte, deux configurations sont envisageables en fonction de la mission à exécuter (cf. annexe 2) :
– la configuration Alpha correspond à des opérations de rétablissement de l’ordre, soit un engagement de moyenne à haute intensité, avec pour objectif de faire cesser les troubles à l’ordre public ;
– la configuration Bravo correspond à des opérations de maintien de l’ordre, soit un engagement de faible intensité visant à préserver un ordre déjà établi.
Dans les deux cas, quel que soit le format retenu, la présence d’au moins deux officiers est requise pour chaque opération.
En configuration Alpha, l’escadron comprend 68 gendarmes répartis en :
– un groupement de commandement de quatre militaires : un commandant d’unité, un conducteur, deux transmetteurs ;
– quatre pelotons : un peloton d’intervention et trois pelotons de marche de 16 gendarmes chacun.
L’évolution du contexte opérationnel – notamment en cas d’engagement effectif pour rétablir l’ordre ou de risque d’engagement effectif – peut amener à modifier cette composition. Le cas échéant, le groupe de commandement peut être complété par une cellule image ordre public (CIOP) composée de trois gendarmes prélevés sur les trois pelotons de marche.
En configuration Bravo, l’EGM comprend au minimum 53 gendarmes déployés en trois pelotons.
● Les compagnies républicaines de sécurité sont, quant à elles, composées de 60 unités dont l’effectif moyen est de 130 agents environ, certaines unités comprenant environ 120 CRS tandis que d’autres – les compagnies parisiennes par exemple – sont légèrement mieux dotées avec 136 agents (24). En termes opérationnels, une compagnie dispose a minima des trois cinquièmes de son effectif disponible pour effectuer une mission de maintien de l’ordre, soit en moyenne entre 75 et 80 agents : deux à trois officiers, 30 à 35 gradés et 35 à 40 gardiens de la paix.
L’organisation tactique des CRS repose sur une division de chaque unité en quatre sections, avec deux sections d’appui et de manœuvre (SAM) et deux sections de protection et d’intervention (SPI) menées par un échelon de commandement et de soutien. Chaque unité est sécable et peut former deux demi-unités comprenant chacune un échelon de commandement et de soutien (25), une SAM et une SPI. L’effectif de chaque section est de 15 agents, l’échelon de commandement et de soutien comprenant entre 15 et 20 agents.
Les sections (SAM et SPI) sont composées de trois groupes tactiques A, B et C, ce dernier constituant le groupe de commandement de la section.
● Pour chacune des deux forces, les temps d’engagement opérationnel sont théoriquement de 8 heures, sachant qu’en matière de maintien de l’ordre et pour reprendre l’expression de M. le préfet Philippe Klayman, directeur central des CRS, « nécessité fait loi, le temps de travail n’est pas limité » (26). De fait, gendarmes et CRS peuvent être amenés à maintenir leur posture opérationnelle bien au-delà de ce temps d’engagement théorique, le directeur central évoquant l’exemple d’une compagnie ayant passé 22 heures sur le terrain lors d’opérations de maintien de l’ordre menées au mois de juillet 2014 (27), tandis que, pour la gendarmerie mobile, le chef d’escadron Mélisande Durier a fait référence à des engagements « de près de 14 heures, où les gendarmes [étaient] restés debout sans boire ni manger » (28).
c. Le cadre de formation des unités
Maintenir ou rétablir l’ordre public dans le cadre de manifestations n’est jamais une action de police ordinaire. Il s’agit, par nature, d’une mission extrêmement sensible. D’une part, elle prend corps à l’occasion d’événements consacrant l’exercice concret, par les citoyens, des libertés publiques. D’autre part, de tels événements imposent un changement d’échelle aux forces de l’ordre. Contrairement à d’autres opérations de police où les forces de l’ordre ont vocation à gérer des comportements individuels – interpellations par exemple –, une opération de maintien de l’ordre suppose quasi-systématiquement une présence humaine massive, les gendarmes et policiers devant interagir non pas avec des individus, même nombreux, pris isolément, mais avec une foule.
Ces deux spécificités majeures impliquent la mise en place d’une formation et d’un entraînement adaptés à destination des unités appelées à intervenir dans un tel contexte. Le maintien de l’ordre ne s’improvise pas. C’est un métier auquel il faut être formé et qui ne tolère aucune approximation dans sa mise en œuvre, au risque d’emporter des conséquences potentiellement malheureuses tant pour les manifestants que pour les forces de l’ordre, voire pour les tiers pris dans le tumulte de l’événement.
● La formation des EGM.
La gendarmerie dispose d’un centre unique dédié à la formation des unités mobilisées lors d’opérations de maintien de l’ordre : le Centre national d’entraînement des forces de gendarmerie de Saint-Astier (CNEFG) en Dordogne.
Créé en 1969 et s’étendant sur 140 hectares, le CNEFG a vocation à assurer la formation, initiale et continue – le « recyclage » – des officiers et sous-officiers de la gendarmerie dans le domaine du rétablissement de l’ordre, que ces gendarmes soient déployés sur le territoire national ou en opérations extérieures (OPEX). D’après les informations fournies par le directeur général de la gendarmerie nationale, les escadrons de gendarmerie mobile suivent une formation au Centre une fois tous les trois ans (29), une telle fréquence nécessitant, selon lui, d’être augmentée.
Plus précisément, le recyclage des unités prend la forme d’un stage d’une durée de deux semaines, précédé d’une semaine de formation. Sept stages à six unités – EGM et compagnies de la Garde républicaine – sont planifiés tous les ans, chaque EGM effectuant ce recyclage environ tous les 32 mois.
Comme l’a expliqué le général Bertrand Cavallier, ancien commandant du Centre, aux membres de la commission d’enquête, « Trois notions structurent l’entraînement à Saint-Astier : premièrement, le rappel du sens – pourquoi est-on gendarme et quels sont les enjeux de cette qualité, la réponse étant le fait de servir son pays et de protéger nos valeurs communes, notamment nos libertés – ; deuxièmement, le renforcement des capacités individuelles, car le maintien de l’ordre et les actions de sécurité en général sont de plus en plus exigeants ; troisièmement, le réalisme des entraînements, qui permet de placer les gendarmes dans des situations les plus proches possibles de la réalité, afin de favoriser une certaine maturité psychologique dans la gestion du stress – en effet, face à des situations éprouvantes, il est nécessaire de s’entraîner pour acquérir le sang-froid et la maîtrise de soi qui seront déterminants pour faire un usage abouti de l’emploi de la force.» (30)
Au cours de son déplacement au Centre, la commission d’enquête a pu apprécier concrètement le contenu de cette formation. Elle a pu constater, notamment, le réalisme et l’exigence des entraînements – mission rupture de contact, engagement de haute intensité de nuit, etc. – nécessaires à l’acquisition des savoir-faire complexes qui devront être mis en œuvre au cours d’opérations réelles.
La qualité de la formation dispensée est d’ailleurs reconnue au-delà de nos frontières puisque le CNEFG accueille régulièrement des stagiaires issus de l’ensemble des pays européens.
● La formation des CRS.
Contrairement à la gendarmerie, la police dispose de quatre structures distinctes et complémentaires pour la formation individuelle et collective des compagnies républicaines de sécurité :
– les centres de Lyon et Rennes, qui sont spécifiquement dédiés à l’ordre public ;
– le centre de Dijon, spécialisé dans l’entraînement au tir ;
– le centre de Toulouse, qui a trait à la gestion administrative et financière des unités de CRS.
Ces centres permettent l’acquisition d’une formation uniforme, partagée par l’ensemble des unités, ce qui est indispensable dès lors que celles-ci peuvent être regroupées pour participer aux mêmes opérations. En outre, les unités mettent en œuvre des systèmes de formation interne avec des référents et des sites d’entraînement variés.
Chaque compagnie de CRS est tenue d’effectuer trois semaines de formation par an, auxquelles s’ajoutent dix jours d’entraînement au tir et au maniement des équipements (31). Le commandant Christian Gomez a ainsi précisé à la commission que les agents des CRS suivaient une trentaine de journées de formation annuelles. Environ 25 jours de formation, organisés en trois périodes de recyclage unité de trois jours (PRU) complétées par des journées d’entraînements techniques sont effectués. Par ailleurs et en fonction des besoins individuels, des journées de formation ponctuelle d’entraînement au tir et d’entraînement technique sont susceptibles d’être organisées par section (32).
● Ces formations et recyclages renforcent le sens du collectif et la cohésion, qui sont indispensables au sein des EGM et des CRS pour mener à bien leurs missions. Dans de telles unités, en opération de maintien de l’ordre, il n’y a pas de place pour l’action individuelle, il n’y a que des actions collectives (33). Comme le précisait le commandant de CRS Roland Guillou, « […] le CRS n’est jamais un « gardien lambda » ; il fait partie d’un groupe au sein d’une section elle-même rattachée à une demi-compagnie, la compagnie dans son ensemble étant placée sous l’autorité d’un commandant. » (34), le commandant Éric Le Mabec ajoutant que « Une unité de CRS réunit des hommes qui, au-delà de leurs missions ponctuelles de maintien de l’ordre, vivent ensemble deux cents jours par an. La cohésion entre eux dépasse donc le cadre professionnel […] » (35).
● Au-delà des formations stricto sensu, les retours d’expérience consécutifs aux opérations menées permettent aux forces mobiles de faire évoluer leur doctrine, leurs équipements et l’utilisation qui en est faite. C’est ce qu’a précisé M. Jean-Marc Falcone, directeur général de la police nationale en affirmant que « Ce fut le cas des manifestations de février 2014 à Nantes, qui nous ont conduits à faire évoluer la doctrine d’emploi des lanceurs d’eau et la doctrine paramédicale au profit des tiers et des forces de l’ordre. » (36)
2. La doctrine française du maintien de l’ordre et les moyens qui la servent
a. La mise à distance et le recours absolument nécessaire, proportionné et gradué à la force
Dans son Histoire de la guerre du Péloponnèse, l’homme politique et historien athénien Thucydide assure que « De toutes les manifestations du pouvoir, celle qui impressionne le plus les hommes, c’est la retenue. »
Une telle devise pourrait résumer la doctrine française en matière de maintien de l’ordre. La présence des unités qui en sont chargées est avant tout dissuasive ; il s’agit de montrer sa force – de manière proportionnée par rapport à la situation – pour ne pas avoir à l’exercer. Cette doctrine repose, d’une part, sur l’évitement, aussi longtemps que possible, des contacts physiques entre manifestants et forces de l’ordre et des violences et blessures qu’elles peuvent engendrer. D’autre part, elle suppose la mise en œuvre de la force en dernier recours sachant que, lorsqu’il est effectivement recouru à la contrainte, cette réponse doit être graduée, nécessaire et proportionnée. D’autres pays ont opéré des choix doctrinaux et opérationnels différents.
Cela semble relever de l’évidence mais il convient de le rappeler : policiers et gendarmes responsables du maintien de l’ordre ne font éventuellement usage de la force que dès lors que ce qui était initialement un événement de voie publique où s’exerçaient normalement les libertés publiques dégénère en un attroupement susceptible de troubler l’ordre public. Si aucun risque de trouble n’existe ou si aucun trouble ne se matérialise effectivement, les forces de l’ordre, bien que présentes, resteront dans une attitude préventive et ne feront aucun usage de la force. Leur mission première n’est pas de réprimer, mais de garantir aux citoyens qui l’exercent le droit de manifester en toute sécurité, sans que cet exercice légitime soit troublé par des actions et des comportements qui sortiraient alors du cadre de l’expression des libertés publiques, pour relever de la catégorie des actes pénalement répréhensibles.
C’est ce que confirment les propos que M. Bernard Boucault, préfet de police de Paris a tenus devant la commission : « je citerai ce que je dis toujours lors de la réunion de briefing préalable à une manifestation avec toutes les personnes qui participeront au maintien de l’ordre : "Cet après-midi, nous n’aurons pas devant nous des adversaires mais des citoyens qui veulent exercer leur droit de manifester pour exprimer leur opinion, et notre devoir est de garantir cette liberté, en leur permettant de l’exercer en toute sécurité." C’est cela, selon moi, l’ordre public républicain, et il doit inspirer toutes les décisions que nous prendrons au cours de la manifestation. » (37)
Comme l’a résumé le directeur général de la police nationale, « La doctrine française du maintien de l’ordre […] repose sur deux principes simples : prévenir les troubles pour ne pas avoir à les réprimer et éviter l’usage des armes en faisant preuve, jusqu’aux dernières minutes, de calme et de sang-froid. » (38)
L’usage de la force dans le cadre d’une opération de maintien de l’ordre est – légitimement – contraint par un cadre juridique et des procédures spécifiques prévus notamment par le code pénal (39) et le code de la sécurité intérieure (40). Les deux types de forces mobiles appliquent le même régime juridique et il n’existe aucune différence entre elles sur la doctrine d’emploi de la force en opération de maintien de l’ordre. Schématiquement, celui-ci suppose :
– qu’un attroupement se soit formé ;
– qu’une autorité habilitée à cet effet ait décidé de la dissipation de l’attroupement ;
– que des sommations réitérées aient été prononcées en ce sens afin que les individus constituant l’attroupement se dispersent ;
– que les individus en cause n’aient pas obtempéré et que l’attroupement ne se dissipe pas.
Aux termes du premier alinéa de l’article 431-3 du code pénal, « Constitue un attroupement tout rassemblement de personnes sur la voie publique ou dans un lieu public susceptible de troubler l’ordre public. ». Il se distingue donc de la manifestation ou de la réunion publique par le risque de trouble à l’ordre public qu’il est susceptible de constituer. Contrairement à la manifestation et ainsi que l’a rappelé M. Thomas Andrieu, directeur des libertés publiques et des affaires juridiques au ministère de l’Intérieur, « l’attroupement ne constitue pas l’exercice d’une liberté publique. On ne lui reconnaît pas de finalité politique. » (41). Il ne doit pas être confondu avec la manifestation illicite en raison d’une absence de déclaration ou d’une déclaration incomplète ou inexacte qui, si elle se tient, ne constitue pas ipso facto un attroupement. L’attroupement est un délit qui crée un fait justificatif légal permettant l’emploi de la force pour le faire cesser. Lorsqu’elle est retenue, la qualification d’attroupement a un double effet : elle permet la dispersion de celui-ci et de retenir l’incrimination pénale de participation délictueuse à un attroupement.
● En application du second alinéa de l’article 431-3 du code pénal, « Un attroupement peut être dissipé par la force publique après deux sommations de se disperser restées sans effet adressées dans les conditions et selon les modalités prévues par l’article L. 211-9 du code de la sécurité intérieure. » Les sommations doivent être prononcées par les autorités habilitées mentionnées à l’article L. 211-9 du code la sécurité intérieure, à savoir :
– le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police ;
– le maire ou l’un de ses adjoints (sauf à Paris) ;
– tout officier de police judiciaire responsable de la sécurité publique, ou tout autre officier de police judiciaire.
Le prononcé des sommations est décrit à l’article R. 211-11 du code de la sécurité intérieure. Au préalable, l’autorité habilitée doit avoir annoncé sa présence en énonçant : « Obéissance à la loi. Dispersez-vous. » L’ordre de dissipation devant pouvoir être entendu par tous les individus concernés, celui-ci est effectué par haut-parleur.
À la suite de cette annonce préalable et dans l’hypothèse où l’attroupement ne s’est pas dissipé, il peut alors être fait usage de la force pour y parvenir. L’autorité habilitée doit avertir à deux reprises les individus concernés de son intention de faire usage de la force. Par le même moyen technique, l’autorité procède alors à une première sommation en vue de dissiper l’attroupement : « Première sommation : on va faire usage de la force. » Si elle reste sans effet, une seconde sommation est effectuée : « Dernière sommation : on va faire usage de la force. ».
Les sommations doivent évidemment être audibles et visibles par les participants à l’attroupement. Chaque annonce ou sommation peut être remplacée – si l’utilisation du haut-parleur est impossible ou inopérante – ou complétée par un signal visuel avec le lancement d’une fusée rouge.
En cas de recours à certaines armes mentionnées à l’article R. 211-16 du code de la sécurité intérieure, la dernière sommation et/ou le lancement de la fusée d’alerte doivent être réitérés.
Il convient de noter que le code de la sécurité intérieure ne fixe aucun délai après la première annonce et entre les sommations.
Si les sommations aboutissent in fine à la dissipation de l’attroupement, l’usage de la force n’est plus justifié et le délit de participation à l’attroupement n’est plus susceptible d’être retenu. Le recours à la force n’est donc pas systématique en maintien de l’ordre. Ce n’est qu’en cas d’échec des sommations et de persistance du trouble que l’usage de la force est possible, de manière absolument nécessaire et proportionnée, une gradation des moyens étant, par ailleurs, suivie en la matière.
● L’absolue nécessité et la proportionnalité du recours à la force sont deux conditions strictes et cumulatives rappelées à l’article R. 211-13 du code de la sécurité intérieure, étant entendu que l’emploi de la force doit évidemment prendre fin dès lors que le trouble a cessé (42).
La gradation des moyens et matériels auxquels les forces de l’ordre sont susceptibles de recourir peut être décomposée en quatre phases distinctes. L’appréciation de cette gradation dans l’emploi des moyens coercitifs nécessaires à la dissipation d’un attroupement est du ressort de l’autorité civile, sa mise en œuvre relevant des commandants d’unités. La gradation permet une adaptation permanente de la réponse opérationnelle à la physionomie et à l’évolution de l’événement et une prise en compte différenciée des multiples comportements susceptibles d’être constatés au sein d’attroupements.
Il peut tout d’abord être fait usage de la force physique seule avec, par exemple, le recours à des manœuvres telles que des barrages, des charges (43) ou des bonds offensifs de dispersion (44).
Les unités peuvent, par ailleurs, recourir à la force dite « simple », c’est-à-dire l’emploi de la force physique et des moyens intermédiaires, à savoir les matériels et armements non classés en tant qu’armes à feu : bâtons de défense, boucliers, engins lanceurs d’eau (en dotation dans la police), containers lacrymogènes à main, grenades lacrymogènes à main MP7 ou CM6 par exemple.
Si le trouble persiste ou s’aggrave et après réitération de la seconde sommation, l’usage des armes à feu est possible. Les moyens pouvant être mis en œuvre sont strictement et limitativement énumérés à l’article D. 211-17 du code de la sécurité intérieure. Il s’agit, à l’exclusion de toute autre arme, des grenades en dotation dans les unités et de leurs lanceurs, soit :
– les grenades lacrymogènes instantanées GLI/F4 à effet de souffle. Utilisées dans des situations particulièrement dégradées, elles émettent par détonation un effet sonore et de choc intense de l’ordre de 165 décibels à 5 mètres ;
– les grenades instantanées (sans produit lacrymogène) ;
– les lanceurs de grenades 56 mm et leurs munitions (lanceur dit « Cougar ») ;
– les lanceurs de grenades 40 mm et leurs munitions ;
– les grenades à main de désencerclement (GMD). Elles propulsent 18 projectiles en caoutchouc et émettent un fort effet sonore (150 décibels à 5 mètres).
Si les grenades offensives OF F1 figurent toujours à l’article D. 211-17 précité, l’interdiction de leur utilisation au titre du maintien de l’ordre a été décidée par le ministre de l’Intérieur après les opérations menées dans la nuit du 25 au 26 octobre 2014 à Sivens au cours desquelles le jeune manifestant Rémi Fraisse est décédé à la suite de l’utilisation d’une telle grenade. Rappelons que cette catégorie de grenades était uniquement en dotation au sein de la gendarmerie nationale.
Enfin, dans l’hypothèse ultime d’agression des forces de l’ordre par armes à feu et en application de l’article D. 211-20 du code de la sécurité intérieure, celles-ci peuvent riposter au moyen du fusil à répétition de précision de calibre 7,62 x 51 mm.
Lors d’opérations de maintien de l’ordre, l’usage des armes à feu ne peut s’effectuer que sur ordre exprès des autorités habilitées à décider de l’emploi de la force, celui devant être transmis de telle sorte que sa matérialité et sa traçabilité soient assurées (45). Ces autorités sont : le préfet du département ou le sous-préfet, le maire ou l’un de ses adjoints, le commissaire de police, le commandant de groupement de gendarmerie départementale ou, mandaté par l’autorité préfectorale, un commissaire de police ou l’officier de police chef de circonscription ou le commandant de compagnie de gendarmerie départementale (46).
Au total, la décision de faire usage de la force n’est donc pas prise individuellement par chaque policier ou gendarme membre d’une CRS ou d’un EGM ; il s’agit d’une action collective strictement encadrée et qui relève de la décision d’une autorité supérieure, l’autorité civile, qui doit, en outre, être présente sur les lieux en vue de décider de cet emploi si les circonstances l’exigent (47). En conséquence et hors le cas où celui-ci se retrouverait isolé en cours d’opération, un CRS ou un gendarme mobile en unité ne peut faire usage de la force sur le fondement de la légitime défense telle qu’elle est prévue aux articles 122-5 et 122-6 du code pénal (48).
En dehors de cette échelle de gradation à quatre niveaux, si des violences ou voies de fait sont exercées contre les forces de l’ordre ou que celles-ci ne peuvent défendre autrement le terrain qu’elles occupent, le commandant de la force publique peut décider lui-même de faire usage de la force directement, sans sommation (49), au moyen des armes énumérées à l’article D. 211-17 précitées auxquelles s’ajoute, en application de l’article D. 211-19 du code de la sécurité intérieure, le lanceur de balle de défense de calibre 40 (LBD 40 x 46) avec des projectiles non métalliques. Les projectiles non métalliques tirés par les lanceurs « Cougar », dits projectiles « bliniz », ont été retirés des services sur décision des directeurs généraux de la police et de la gendarmerie nationales (50). Quant au LBD de calibre 44 Flash-Ball, même s’il figure à l’article précité, il n’est pas en dotation au sein des unités spécialisées pour l’accomplissement de missions de maintien de l’ordre.
Le schéma suivant, réalisé par le Centre national d’entraînement des forces de Saint-Astier, reprend strictement les dispositions législatives et réglementaires précitées sans tenir compte des éventuelles décisions de retrait de certains équipements ou de l’absence de dotation pour l’accomplissement des missions de maintien de l’ordre. Il permet toutefois de visualiser de manière synthétique la doctrine d’emploi de la force par la gendarmerie en vertu du principe de gradation de la réponse.
LE PRINCIPE DE GRADATION DANS L’EMPLOI DE LA FORCE
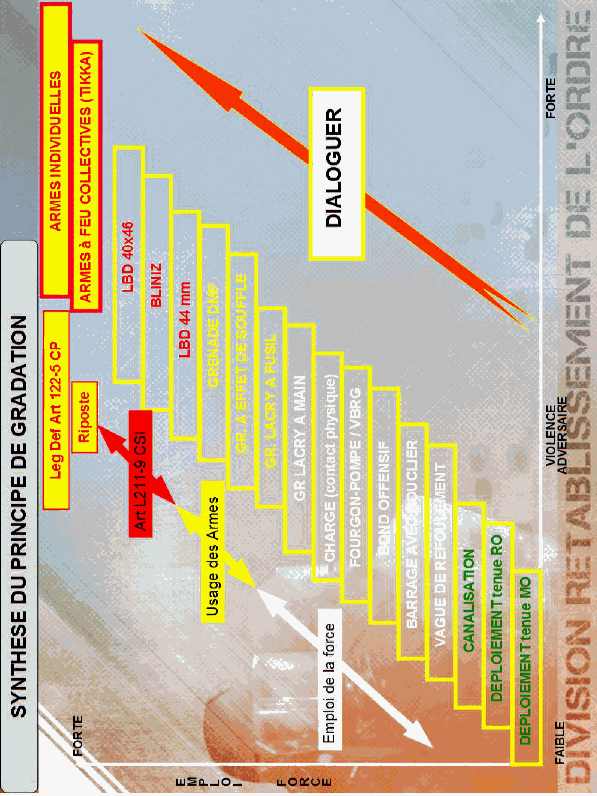
Source : direction générale de la gendarmerie nationale ; réponse au questionnaire de la commission d’enquête.
● Il convient de préciser que, en plus d’être strictement encadré, le recours à la force et sa mise en œuvre sont susceptibles d’être soumis, en dernière analyse, au contrôle a posteriori du juge. Celui-ci pourra être amené, le cas échéant, à apprécier les critères d’absolue nécessité et de proportionnalité au regard des circonstances particulières propres à chaque attroupement. Outre le juge national, le juge européen peut avoir à connaître de l’action des forces de l’ordre. En effet, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) considère qu’un contrôle de l’absolue nécessité et de la proportionnalité du recours à la force susceptible d’entraîner la mort s’impose sur le fondement de l’article 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et les libertés fondamentales (droit à la vie) (51). La France a récemment été condamnée à ce titre, la Cour considérant que, dans le cas d’espèce, l’usage de la force armée par un gendarme n’était pas absolument nécessaire au regard des circonstances (52). Il convient toutefois de préciser que cette affaire ne concernait pas une opération de maintien de l’ordre mais une garde à vue.
Au total, le maintien de l’ordre et les hommes qui l’assurent sont donc soumis à un très grand formalisme et relèvent de deux autorités : l’autorité civile incarnée par le représentant de l’État ou son délégué ; et le juge national (le maintien de l’ordre est une mission qui est en partie définie par le code pénal) ou européen. Dès lors que sont en jeu les libertés publiques et des impératifs démocratiques, un tel encadrement est parfaitement légitime.
Au-delà de ce cadre juridique, les forces de police et de gendarmerie ont développé une éthique du maintien de l’ordre. Le code de déontologie commun aux deux forces, applicable depuis le 1er janvier 2014 et codifié dans la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure dispose, dans son article R. 434-18 consacré à l’emploi de la force que :
« Le policier ou le gendarme emploie la force dans le cadre fixé par la loi, seulement lorsque c’est nécessaire, et de façon proportionnée au but à atteindre ou à la gravité de la menace, selon le cas.
Il ne fait usage des armes qu’en cas d’absolue nécessité et dans le cadre des dispositions législatives applicables à son propre statut. »
b. Des équipements et armements individuels et collectifs offrant un équilibre mobilité/protection/puissance
Les moyens matériels à disposition des forces mobiles – équipements, armements et munitions, voire véhicules – ont vocation à leur permettre d’adapter leur posture en fonction des différentes situations rencontrées en opération de maintien de l’ordre et à assurer un équilibre entre trois contraintes parfois difficilement compatibles :
– la mobilité : essentielle pour assurer la réactivité et effectuer des manœuvres rapides, effectives et efficaces ;
– la protection : les CRS et gendarmes mobiles pouvant être confrontés à des situations de haute intensité et à des comportements parfois extrêmement violents. En outre, un niveau de protection élevé permet de retarder l’emploi de la force par « absorption » de la violence rencontrée ;
– la puissance : la réponse opérationnelle par usage de la force, lorsqu’elle est mise en œuvre, devant permettre un maintien ou un rétablissement rapide de l’ordre public afin d’éviter la persistance durable des troubles et l’envenimement de la situation.
À cet égard, un service spécialisé unique, le service de l’achat, des équipements et de la logistique de la sécurité intérieure (SAELSI) assure, depuis le 1er janvier 2014, le recueil des besoins, la conception, l’achat et la mise à disposition des équipements et des moyens nécessaires à l’exercice des missions des personnels et des services de la direction générale de la gendarmerie nationale, de la direction générale de la police nationale et de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises (moyens mobiles, armement, équipements de protection, habillement, etc.).
D’après les informations communiquées à la commission d’enquête par le SAELSI, il n’existe pas de différences notables sur le plan technique dans l’expression des besoins ou l’utilisation des équipements entre les CRS et la gendarmerie mobile. En effet, un travail de convergence a été opéré par la DGGN et la DGPN depuis plusieurs années. Toutefois, les demandes de chacune des forces peuvent évoluer en fonction de leurs missions spécifiques (engagement en opération extérieure pour la gendarmerie par exemple) ou des priorités fixées par chaque direction quant à l’affectation de ses crédits.
Le Rapporteur a souhaité s’intéresser aux principaux matériels et équipements défensifs et offensifs en dotation dans les CRS et les EGM (53), étant entendu que tous ne sont pas susceptibles d’être utilisés lors d’opérations de maintien de l’ordre (par exemple les bâtons télescopiques ou les pistolets à impulsions électriques ; cf. supra).
En ce qui concerne les éléments de protection, les membres des deux forces mobiles sont dotés de protections individuelles pare-coups – jambières, gants, protection du haut du corps – voire pare-balles – gilets et casque pare-balles, hormis la visière. Les unités disposent également, en dotation collective (54), de boucliers de maintien de l’ordre. Il convient de préciser que les CRS possèdent deux types de tenues pare-coups, ce qui peut poser des difficultés sur le terrain dès lors qu’il n’est pas possible de changer de tenue en cours de service. La gendarmerie a, quant à elle, fait le choix d’une tenue de maintien de l’ordre modulaire, la tenue 4S, qui permet au gendarme de faire évoluer son niveau de protection en fonction des événements, de l’importance de la menace ou de l’effet à obtenir sur les individus troublant l’ordre public.
En ce qui concerne l’armement, il convient de distinguer entre les armes non classées en tant qu’armes à feu d’une part, et les armes à feu et leurs munitions d’autre part. S’agissant des premières, les forces mobiles disposent de bâtons en bois, en caoutchouc, à poignée latérale de type tonfa, de bâtons télescopiques et des aérosols de gaz lacrymogènes. Les armes à feu en dotation sont : les LBD, les lanceurs de grenades, le pistolet automatique en dotation individuelle, le fusil AMD, Famas ou carabine de précision de type Tikka en dotation collective pour le tir de riposte. Les munitions à disposition sont les munitions cinétiques (55) pour les LBD, les grenades lacrymogènes, les grenades lacrymogènes instantanées GLI/F4 (lancées à la main ou au moyen du lance-grenades), les grenades à main de désencerclement et les munitions de calibre 9 mm, 5,56 mm et 7,62 mm.
En outre, des dispositifs spécifiques peuvent être mis en œuvre. Il s’agit des lanceurs d’eau, en dotation au sein des CRS (mais également à la préfecture de police de Paris) et des dispositifs de retenue autonome du public (barrières mobiles).
Les moyens déployés en opération de maintien de l’ordre dépendent de la nature de la mission assignée aux forces. Si l’événement de voie publique se caractérise par son calme, certains équipements et matériels ne seront pas sortis et encore moins utilisés. La modularité et l’adaptation sont essentielles, y compris en termes psychologiques vis-à-vis des manifestants. Ainsi que le soulignait le directeur général de la gendarmerie nationale, « Si [les forces] sont trop équipées, elles donneront une impression guerrière contradictoire avec l’objectif poursuivi » (56) dès lors qu’une manifestation n’a pas été interdite.
Par ailleurs, l’équipement est évidemment évolutif. Ainsi, les CRS ont été dotés de jambières en polyamide (57), d’un nouveau type de bouclier en polycarbonate et d’un gilet pare-coups lourd (dit « Robocop ») à la suite des manifestations de marins-pêcheurs à Rennes en 1994 au cours desquelles de nombreux fonctionnaires avaient été touchés aux membres inférieurs.
c. Les exemples étrangers : d’autres types d’organisations, de doctrines et d’équipements
Une analyse comparative des pays voisins de la France tend à démontrer une grande hétérogénéité des doctrines et modalités du maintien de l’ordre ainsi que de l’organisation des forces qui en sont chargées. Un tel constat n’est guère étonnant dans la mesure où chaque pays possède sa propre perception de l’équilibre entre ordre public et expression des libertés publiques et sa propre sensibilité collective, héritées de son histoire.
Il a semblé utile au Rapporteur de présenter, de manière synthétique, ces différents modèles. Ils se fondent, d’une part, sur les réponses aux questionnaires adressés par la commission d’enquête à un certain nombre d’attachés de sécurité intérieure en poste dans différentes représentations diplomatiques (58) et, d’autre part, sur les éléments recueillis par la commission lors du déplacement de certains de ses membres à Lunebourg (Allemagne) (59).
● Allemagne
Deux forces de police de niveaux différents sont susceptibles d’intervenir : la police fédérale et la police de chaque Land. Leurs compétences sont mises en commun lors d’opérations globales. Les deux polices se concertent pour la définition des mesures opérationnelles et mènent leurs opérations de manière parallèle et sous leurs responsabilités respectives. Dans certains Länder, l’intégration peut être assez poussée. Ainsi, en Basse-Saxe, une direction commune des opérations a été créée afin de gérer les transports de matière nucléaire de type CASTOR (60).
La doctrine allemande du maintien de l’ordre oscille entre, d’une part, le maintien à distance des fauteurs de trouble avec, notamment, l’emploi important d’engins lanceurs d’eau et, d’autre part, la recherche du contact avec des manœuvres de force et de saturation de l’espace, notamment à des fins d’interpellations. Cette seconde tactique est susceptible de provoquer de nombreux blessés, qu’il s’agisse de manifestants ou de membres des forces de l’ordre.
L’éventail des moyens utilisés par les polices allemandes en maintien de l’ordre – et, par conséquent, leur gradation – est plus restreint que celui dont les forces mobiles françaises disposent. Outre les engins lanceurs d’eau, les policiers allemands ont recours aux bâtons de protection et de défense et aux conteneurs de gaz de défense en dotation individuelle ou collective.
● Belgique
Les services de police belges sont organisés et structurés à deux niveaux, le niveau fédéral et le niveau local, qui assurent ensemble la fonction de police intégrée. Ces niveaux sont autonomes, sans lien hiérarchique entre eux, et dépendent d’autorités distinctes.
La police locale assure, à son niveau de compétence, la fonction de police de base, laquelle comprend toutes les missions de police administrative et judiciaire nécessaires à la gestion des événements et des phénomènes locaux sur le territoire de la zone de police (61), de même que l’accomplissement de certaines missions de police à caractère fédéral. Le maintien de l’ordre est l’une des sept fonctionnalités de base qui doivent être exercées dans toutes les zones de police (62).
La police fédérale assure sur l’ensemble du territoire les missions spécialisées et supralocales de police administrative et judiciaire, ainsi que des missions d’appui aux polices locales et aux autorités de police.
Il existe peu d’unités constituées permanentes spécialisées dans le maintien de l’ordre. En font partie le Corps d’intervention de la police fédérale (CIK) et certains pelotons de grandes zones de police avec, le cas échéant, l’appui spécialisé de la police fédérale.
Le maintien de l’ordre s’appuie sur une doctrine spécifique dénommée la gestion négociée de l’espace public (GNEP) qui repose sur les principes de dialogue, de concertation, de responsabilisation et de collaboration. Pour gérer les événements de voie publique, diverses capacités peuvent être mises en œuvre, notamment :
– la capacité hypothéquée de la police locale (Hycap), qui s’analyse comme un mécanisme de solidarité nationale en matière de gestion du maintien de l’ordre. À ce titre, l’ensemble des zones de police du pays sont susceptibles de mettre une partie de leur capacité opérationnelle à disposition d’une autre zone confrontée à des missions qu’elle ne peut assurer seule. Diverses unités peuvent donc être regroupées temporairement pour les besoins et la durée d’une mission ;
– les pelotons d’intervention de certaines zones de police locales : certaines grandes zones disposent de personnels exerçant à titre principal des missions de maintien de l’ordre au sein d’unités constituées quasi-permanentes ;
– le Corps d’intervention de la police fédérale : réserve non spécialisée d’intervention, elle peut remplacer la réserve Hycap et fournir un appui aux polices locales et aux services déconcentrés de la police fédérale ;
– l’appui spécialisé de la police fédérale par la Direction de la sécurité publique (DAS) : elle assure des missions spécifiques avec, par exemple, la mise à disposition d’équipes lacrymogènes (teams lacry), d’équipes d’arrestation et de captation vidéo (teams arrestations et teams vidéo), d’unités de police à cheval, de cellules de commandement spécialisées et de poste de commandement mobile, ou encore la gestion et l’appui en moyens de transports spécialisés (camion sanitaire, bus personnes arrêtées, etc.).
L’usage de la force doit être différé le plus longtemps possible et rester limité au strict nécessaire pour maintenir ou rétablir l’ordre public. Au titre de l’armement individuel, les fonctionnaires de police disposent d’armes à feu courtes (type pistolet automatique calibre 9 mm), d’armes de frappe droite rétractables et de moyens incapacitants. Au titre de l’armement collectif, ils disposent d’armes de frappe droite rigides ou souples et de moyens incapacitants (sprays au poivre naturel ou lacrymogènes). Enfin, un armement particulier peut être utilisé, telles des grenades lacrymogènes lancées à la main ou tirées.
● Espagne
Le système policier espagnol repose sur deux principes.
Le premier principe est celui de la dualité des forces d’État. Comme la France, l’Espagne dispose d’une police à statut civil, le Cuerpo Nacional de Policía (CNP), et une à statut militaire, la Guardia Civil (GC). La répartition des missions repose essentiellement sur la compétence territoriale : le CNP est compétent dans les zones urbaines, la GC dans les zones rurales. Chaque force a la charge du maintien de l’ordre dans sa zone de compétence propre, sauf en cas de crise grave impliquant un renforcement du dispositif opérationnel. La décision en revient alors au secrétariat d’État à la Sécurité (SES), dépendant du ministère de l’Intérieur. La coordination entre les deux forces s’effectue, au niveau national, par le SES et, au niveau des comunidades autónomas, par le délégué du Gouvernement dont le rôle est équivalent à celui du préfet de zone français.
Le second principe est celui de la décentralisation des pouvoirs de police au niveau des comunidades autónomas qui en font la demande. Tel est le cas en Catalogne ou encore au Pays Basque. Les polices « autonomiques » (63) sont alors compétentes pour le maintien de l’ordre au sein de la comunidad. Chaque corps emploie, entraîne et équipe ses propres unités, sans mutualisation d’emploi, de moyens ou de formation entre les comunidades.
En dépit de cette décentralisation très poussée, la doctrine générale qui se dégage en matière de maintien de l’ordre repose sur la canalisation et le maintien à distance des manifestants, même si l’action opérationnelle sera évidemment adaptée en fonction de la physionomie de la protestation et des troubles observés.
L’action générale des forces de sécurité est régie par un texte organique (64). L’action concrète en matière de maintien de l’ordre relève de procédures internes, de directives et de circulaires qui peuvent différer d’un corps à l’autre. Ainsi, le CNP, la GC et les polices « autonomiques » peuvent-ils recourir à des procédés tactiques et mettre en œuvre des moyens différents.
À l’image de la France, l’usage de la force est soumis aux principes d’opportunité – un certain désordre est acceptable –, de proportionnalité et de gradation. Les forces de police utilisent principalement les équipements suivants : bâtons de défense en bois ou en caoutchouc dur ; projectiles fumigènes à main ou à fusil ; projectiles mixtes fumigènes/lacrymogènes à main ou à fusil ; dispositifs sonores à longue portée (65) ; pelotas, des balles en caoutchouc 54 mm lancées à l’aide d’un fusil de précision ; lanceurs de type Flash-Ball avec balles de 44 mm (66).
Les deux forces de police d’État se préparent à l’interdiction des balles de défense de 54 et 44 mm et étudient des moyens alternatifs (containers lacrymogènes, billes de peinture indélébile, projectiles déformables type « bliniz »). La comunidad de Catalogne envisage, quant à elle, l’interdiction des balles de gomme de 44 mm.
Quant à la décision de recourir à la force ou aux armes, il convient de souligner que, contrairement à la France, elle ne relève pas de l’autorité civile. Celle-ci donne uniquement l’ordre de disperser une manifestation au commandant territorial qui le répercute sur les chefs d’unités. Ceux-ci sont seuls juges du degré de contrainte à employer pour exécuter cet ordre, le cas échéant, dans le respect des consignes éventuellement données par l’autorité administrative.
● Italie
Les forces de police italiennes sont divisées en deux catégories distinctes, selon qu’elles disposent ou pas de la compétence générale de police.
La première catégorie comprend deux forces : la Police d’État et l’Arme des Carabiniers qui possèdent une compétence générale de police et sont comparables respectivement à la police et à la gendarmerie nationales françaises. Ce sont elles qui ont normalement la charge des opérations de maintien de l’ordre public.
La seconde catégorie comprend trois forces de police à compétence spécialisée : la Garde des Finances, police à statut militaire dépendant du ministère de l’Économie, la Police pénitentiaire, responsable de la garde des établissements pénitentiaires et des transfèrements dépendant du ministère de la Justice et la Police Forestière, qui réprime les atteintes à l’environnement dans les zones forestières et les parcs naturels et dépend du ministère de l’Environnement. Seule la Garde des Finances dispose d’unités spécialisées au maintien de l’ordre, les deux autres pouvant être amenées ponctuellement à mettre à disposition des unités destinées au maintien de l’ordre lors d’événements de grande ampleur (par exemple des événements internationaux de type G8).
En termes de doctrine, une autonomie est reconnue à chaque force dans l’exécution de la mission confiée par l’autorité de sécurité publique compétente. Il n’y a pas de mutualisation dans l’exécution, chaque commandant de force gérant sa propre mission, en parallèle des autres forces présentes. Les différents textes applicables à chaque force sont toutefois homogénéisés, afin d’assurer une cohérence dans l’action opérationnelle.
L’usage de la force est décidé par le questeur (67) ou son représentant sur le terrain. Il vise, dans un premier temps, à rétablir la distance avec les manifestants et, le cas échéant, leur dispersion et d’éventuelles arrestations. Les équipements mis en œuvre sont :
– défensifs : casques, boucliers, protections corporelles, bâtons de défense, pistolets automatiques dans le cadre de la légitime défense ;
– offensifs : grenades lacrymogènes, fusils lance-grenades.
● Royaume-Uni
Le système britannique présente une grande originalité puisque les unités de maintien de l’ordre ne sont pas structurées de manière permanente, le Royaume-Uni ne disposant pas d’unités spécialisées en la matière. Il s’appuie sur le réseau policier associatif de l’ACPO (68) et du College of Policing pour déterminer des formations et des méthodes communes – avec, par exemple, le manuel de police Keeping The Peace élaboré par l’ACPO et diffusé à l’ensemble des acteurs. L’organisation des forces de l’ordre est très décentralisée, avec quelque 43 polices locales en Angleterre et au Pays de Galles, auxquelles s’ajoutent la police d’Irlande du Nord et la police unifiée d’Écosse.
Le modèle opérationnel situe la police parmi la foule, au contact, ce qui l’expose davantage aux provocations et violences, même si la culture britannique de la manifestation se caractérise par un nombre de débordements et un degré de violence moins importants que dans d’autres pays, dont la France. Il n’est pas recouru à des unités séparées des manifestants ou des unités spécialisées dans le maintien de l’ordre. Exceptionnellement, la séparation physique entre policiers et manifestants s’effectue au moyen de canons à eau (69) ou de bâtons de défense. Dans tous les cas, la force doit être mise en œuvre de manière proportionnée.
La réponse aux troubles à l’ordre public s’exerce souvent a posteriori, les condamnations pénales prononcées étant alors généralement sévères et faisant l’objet d’une grande médiatisation. De la même manière, la responsabilité individuelle des agents est régulièrement mise en cause par les médias en cas d’usage de la force.
● Suède
La Suède dispose d’un service de police national, dépendant du ministère de la Justice, avec des forces de police régionalisées. La « police quotidienne » est l’autorité compétente de droit commun en matière de maintien de l’ordre (70). Elle est composée de forces civiles territoriales qui reçoivent une formation de base sur les tactiques de maintien de l’ordre.
Par ailleurs, l’Organisation nationale de renforcement (NFO) peut être mobilisée par le Département des opérations nationales (71), afin d’apporter son concours aux unités de police locales pour les événements jugés à haut risque de débordement. La NFO se compose d’une structure de commandement, d’unités mobiles en uniforme, d’officiers de police de dialogue et d’agents en civil qui effectuent des recherches et peuvent procéder à des contrôles et des arrestations. Les unités d’intervention mobiles sont composées de commandants et d’officiers de la police civile, spécialement entraînés à la gestion de crise et basés principalement dans les trois plus grands centres de police (Stockholm, Västra Götaland et Skåne).
La doctrine en matière de maintien de l’ordre a été revue en 2004 à la suite des violents affrontements en marge du sommet européen de Göteborg en 2001. La nouvelle stratégie nationale pour les événements à hauts risques de débordement (Special police tactics – SPT) privilégie le dialogue, via des agents spécialisés, la mise à distance et la dispersion. En substance, il s’agit de réduire au maximum les risques de confrontation plutôt que de contrôler physiquement la foule. Dans l’hypothèse où la situation est relativement calme, les forces de l’ordre adoptent une attitude préventive fondée sur trois piliers : la non-confrontation, la désescalade des tensions et le dialogue. Des officiers des unités mobiles sont spécialement formés au dialogue et assurent un lien avec les manifestants avant, pendant et après l’événement. Si la situation est plus violente, les unités cherchent à mettre la foule à distance et à la disperser. L’usage de la force est régi par les principes de nécessité et de proportionnalité, chaque policier étant équipé d’un pistolet, d’une bombe lacrymogène et d’un bâton télescopique.
C. L’EFFICACITÉ DU MAINTIEN DE L’ORDRE À LA FRANÇAISE
1. Une doctrine efficace pour prévenir ou faire cesser les troubles à l’ordre public
a. L’efficacité de la protection de l’ordre public
Le maintien de l’ordre est une matière particulièrement sensible, chaque débordement, manquement ou faute constaté à cette occasion – de la part des manifestants comme des forces de l’ordre – faisant l’objet de débats publics et d’une grande médiatisation. À cet égard, il est intéressant de se replonger dans les archives parlementaires pour constater que, au cours des travaux menés par la commission d’enquête chargée de rechercher les causes et les origines des événements du 6 février 1934, les mêmes interrogations avaient surgi : quel était le degré de violence des manifestants ? L’usage de la contrainte physique par les forces de l’ordre était-il légitime et proportionné ? Les procédures ont-elles été respectées ? Combien y a-t-il eu des blessés parmi les manifestants et parmi les forces de l’ordre ? (72)
Il n’en demeure pas moins que, de l’avis quasi-unanime des personnes auditionnées par la présente commission d’enquête, les forces chargées du maintien de l’ordre exercent leur mission de manière efficace et en conformité avec les textes et procédures applicables. Au regard du nombre d’événements de voie publique donnant lieu chaque année à des opérations de maintien de l’ordre, les conséquences regrettables de telles opérations, de gravité diverse et pour inacceptables qu’elles soient, demeurent statistiquement marginales. La grande majorité des opérations de maintien de l’ordre, qui s’effectuent sans accroc majeur, ne font évidemment pas l’objet de publicité. Rappelons qu’en 2014, d’après les statistiques communiquées par la direction générale de la police nationale, 7 442 opérations de maintien de l’ordre ont été effectuées en zone DCSP (73), soit une moyenne de plus de 20 opérations par jour.
Comme le souligne M. Bertrand Cavallier, « Dans une acception large, le maintien de l’ordre est une fonction centrale destinée à garantir la cohésion de la Nation et la cohérence du corps social sur les fondements de nos valeurs communes. Il doit notamment permettre de régler les contentieux de façon négociée plutôt que par la violence. Comme vous le savez, il repose sur un strict équilibre entre les impératifs de l’ordre public et les exigences du respect des libertés publiques. » (74)
Sur la période récente, il n’est pas exagéré d’affirmer que la France a connu peu de problèmes majeurs liés à des opérations de maintien de l’ordre dans le sens où les forces qui en sont chargées auraient été totalement désemparées ou démunies face à des manifestants, où des dégradations particulièrement lourdes auraient été commises et où des violences extrêmes – de la part des manifestants comme au niveau de la réponse policière – auraient été constatées. Des « pics » conjoncturels et ponctuels se sont cependant produits et se produiront encore à l’avenir, qui heurtent légitimement les sensibilités individuelles ou sociale. Ils ne doivent néanmoins pas masquer la réalité.
Notre pays n’a pas été confronté à des débordements massifs tels qu’on a pu les constater lors du sommet du G8 à Gênes en 2001, où le dispositif de maintien de l’ordre était manifestement sous-dimensionné – environ 15 000 policiers pour quelque 300 000 manifestants – et qui s’est traduit par un bilan très lourd – un mort et 600 blessés chez les manifestants.
Ainsi que l’a rappelé le ministre de l’Intérieur lors de son audition, devant la plus grande crise d’ordre public de la période moderne qu’a constitué Mai-68, « vingt-cinq jours d’émeutes violentes n’ont pas eu en France de conséquences fatales pour les manifestants, tandis que, la même année, aux États-Unis la garde nationale tirait à plusieurs reprises sur la foule, faisant quarante-trois morts à Détroit et vingt-six à Newark. » (75)
Pour n’évoquer que l’exemple de la capitale, qui concentre le plus grand nombre de rassemblements sur la voie publique, et selon les informations communiquées par le préfet de police, « Quelque 3 000 rassemblements à caractère revendicatif se déroulent chaque année à Paris : 3 382 en 2012, 3 411 en 2013, 2 623 en 2014, dont 600 à 700 de manière inopinée, ce qui pose, j’y reviendrai, des problèmes particuliers. Environ 10 millions de personnes défilent ou se rassemblent sur la voie publique parisienne chaque année. À ce chiffre, déjà considérable, il convient d’ajouter les manifestations festives – technoparades, gay prides –, sportives – Tour de France, marathons, matchs de football – et institutionnelles – le défilé du 14 juillet et les nombreuses visites de chefs d’État et de Gouvernement étrangers. Ce sont au total plus de 6 300 événements que le préfet de police doit encadrer annuellement dans la capitale. » (76)
b. L’usage de la force comme ultima ratio d’une opération de maintien de l’ordre
L’usage de la contrainte physique par les unités en charge du maintien de l’ordre à l’occasion d’événements de voie publique ne constitue pas, tant s’en faut, la règle. Il a vocation à demeurer l’exception et, lorsque la contrainte se matérialise, son exercice est encadré par un régime juridique et des procédures légitimement stricts et contraignants, sous le contrôle a posteriori du juge. La présence des forces de l’ordre est avant tout dissuasive et ce n’est qu’en cas de troubles ou de risques de troubles à l’ordre public du fait de la constitution d’un attroupement que l’usage de la force pourra être décidé. M. Patrice Bergougnoux, préfet honoraire, a parfaitement résumé ce principe en assurant que « La règle d’or en matière de maintien de l’ordre est que la force doit se manifester sans s’exercer. » (77)
Le recours à la force n’est donc pas systématique. Il n’est pas non plus immédiat, la contrainte physique ne s’exerçant pas sans avertissement préalable dès l’instant où un attroupement est constitué. C’est ce que démontre l’existence du système des sommations, au demeurant précédées d’une annonce invitant les participants à l’attroupement à se disperser (cf. supra).
La vocation et la mission premières des unités de maintien de l’ordre sont de permettre l’expression des libertés publiques dans un contexte assurant la protection physique de l’ensemble personnes participant à l’événement considéré. Il est essentiel de retarder au maximum l’emploi de la force dans le but de limiter les dommages physiques pouvant en résulter. Comme l’exprime M. Bertrand Cavallier, « […] les gendarmes sont pétris de cette culture du maintien de l’ordre qui veut que l’on retarde le plus possible l’usage des armes : on ne cherche pas à neutraliser l’adversaire en le détruisant, mais simplement à disperser les attroupements, par exemple. » (78)
Une telle attitude présente, en outre, un intérêt tactique évident dans la perspective d’un retour rapide à l’ordre. L’usage de la force pouvant potentiellement entraîner une réponse de la part des participants à un attroupement, il est nécessaire d’épuiser toutes les autres voies non contraignantes de dispersion et de faire de l’exercice de la contrainte physique l’ultima ratio d’un schéma tactique. En dernière analyse, l’action des forces de l’ordre a bien vocation à permettre une désescalade des troubles et un retour à la normale. C’est ce qu’a résumé le chef d’escadron Aymeric Lenoble de la manière suivante : « [Le commandant d’escadron ou de groupement tactique de gendarmerie] s’efforce, en tout cas, de retarder au maximum l’emploi de la force, car on ne sait jamais où s’arrêtera l’escalade. » (79)
Ce recours modéré à la force relève au demeurant d’une évolution réfléchie de la doctrine opérée au cours du XIXe siècle, ainsi que l’a rappelé M. Cédric Moreau de Bellaing, maître de conférence à l’École normale supérieure : « Au début du XIXe siècle, en effet, les forces de l’ordre calaient l’intensité de l’usage de la force sur la violence des protestataires qui leur faisaient face. Cette montée aux extrêmes favorisait l’usage d’armes de part et d’autre, provoquait nombre de blessés et, du reste, se soldait parfois par un nécessaire repli de la force publique.
À la fin du XIXe siècle, la situation s’est parfaitement inversée. Les forces de l’ordre, ayant reçu de nombreuses consignes, ayant été dotées d’une doctrine d’emploi réfléchi, ont cessé d’ajuster leur usage de la force à celui des protestataires. Il s’agissait de contraindre ces derniers à s’ajuster au niveau de violence des forces de l’ordre. Cette doctrine a fonctionné : le nombre d’affrontements a baissé et leur intensité a diminué. Il ne faut pas, bien sûr, commettre d’anachronisme et transposer un raisonnement aussi lointain à la situation actuelle. Il n’en reste pas moins que la doctrine du maintien de l’ordre, en France, s’est constituée sur cette inversion. C’est cette doctrine qui a garanti la compétence des forces de police en matière de gestion des protestations publiques et la création des forces spécialisées – gendarmes mobiles en 1927 et CRS en 1944 – en a été l’aboutissement logique. » (80)
Il convient, par ailleurs, de souligner le fait que les forces de l’ordre ne recourent pas systématiquement à l’ensemble des moyens de contraintes légalement et réglementairement autorisés. Le commandant de CRS Christian Gomez l’a évoqué en ces termes devant la commission : « Outre que la sécurité même des manifestants nous conduit à différer cette riposte [des forces de l’ordre], parfois pendant plusieurs heures – comme à Quimper en 2013 –, les moyens employés restent souvent très en deçà de ceux qui nous sont autorisés par la loi. Notre expérience nous permet de relativiser les situations de violence et de ne riposter qu’avec mesure. » (81)
Des évolutions pourraient être envisagées à ce sujet. Pour ce qui concerne les armes à feu susceptibles d’être utilisées pour le maintien de l’ordre public, l’article D. 211-17 du code de la sécurité intérieure qui les énumère n’établit pas de hiérarchie quant à leurs effets physiques ou leur possible dangerosité. Dès lors, au-delà du respect des principes d’absolue nécessité, de proportionnalité et de gradation, il n’existe donc réglementairement aucune hiérarchie clairement établie dans l’utilisation de ces moyens de force. De même, les munitions pouvant être employées sont classifiées selon le vecteur utilisé et non selon l’effet qu’elles produisent. Interrogé sur ces différents points par le Rapporteur, le directeur général de la gendarmerie nationale a estimé qu’un effort pouvait utilement être entrepris à cet égard (82).
Enfin, il est nécessaire de rappeler que les modalités d’usage de la force font l’objet de réflexions permanentes, afin de les adapter au mieux aux situations opérationnelles et d’éviter au maximum les dommages corporels qui pourraient en résulter. Au-delà de l’interdiction des grenades offensives précédemment évoquée, le ministre de l’Intérieur a décidé d’encadrer de manière plus stricte et sécurisante les modalités d’utilisation des grenades lacrymogènes instantanées (GLI). Leur emploi se fera dorénavant en binôme, avec un lanceur et un superviseur plus à même d’évaluer de manière fine et distanciée la situation, et de guider l’opération (83).
c. Des données parcellaires sur le nombre de blessés
Le rappeler semble une évidence : le maintien de l’ordre est une activité à risque. Ce risque, de dommages physiques notamment, est susceptible de toucher des acteurs de qualités différentes : les manifestants, les tiers, pris par hasard dans un événement de voie publique, mais également, et en dépit de leurs éléments de protection, les forces de l’ordre. À cet égard, le Rapporteur ne peut que souscrire aux propos de M. Christian Vigouroux, président de la section de l’intérieur du Conseil d’État : « Le contentieux n’ignore pas que les fonctionnaires prennent des risques et ne savent jamais devant qui ils se trouveront ni à quelle violence ils auront à faire face. […] Le contentieux marque le courage quotidien de ces personnels. » (84)
La question des blessés est difficile à appréhender dans la mesure où les statistiques disponibles sont plus que parcellaires. Si les deux directions de la police et de la gendarmerie nationales recensent de manière exhaustive les fonctionnaires de police et gendarmes blessés au cours d’opérations de maintien de l’ordre, tel n’est pas le cas en ce qui concerne les manifestants qui, d’après les informations communiquées à la commission d’enquête, se signalent rarement auprès de la police et de la gendarmerie nationales pour faire état de leurs blessures.
À cet égard et comme le suggérait M. Fabien Jobard, il serait sans doute utile de mettre en place un outil de collecte du nombre de blessés – manifestants comme membres des forces de l’ordre –, recensant les cas pris en charge aux urgences et donnant lieu à des interruptions temporaires de travail supérieures à zéro jour (85). Toutefois, concrètement, il ne faudrait pas que cette collecte fasse peser sur les services d’urgence une charge administrative supplémentaire trop lourde : le renseignement et la transmission d’un document seraient en effet nécessaires. En outre, un tel système et la fiabilité des statistiques reposeraient exclusivement, par construction, sur la bonne foi des personnes se présentant aux urgences.
Pour ce qui concerne les seules forces de l’ordre, le tableau suivant retrace le nombre de blessés parmi les gendarmes mobiles et les CRS entre 2008 et 2014. Il fait état d’une augmentation constante pouvant témoigner d’une violence accrue lors d’opérations de maintien de l’ordre.
NOMBRE DE BLESSÉS PARMI LES FORCES MOBILES AU COURS D’OPÉRATIONS DE MAINTIEN DE L’ORDRE
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 | |
Gendarmes mobiles |
19 |
103 |
12 |
20 |
37 |
113 |
163 |
CRS |
98 |
175 |
86 |
69 |
138 |
225 |
224 |
Total |
117 |
278 |
98 |
89 |
175 |
338 |
387 |
Source : directions générales de la police et de la gendarmerie nationales ; réponses au questionnaire de la commission d’enquête.
Au titre des années les plus significatives, 2009 correspond notamment à la tenue du sommet de l’OTAN à Strasbourg avec des affrontements avec les Black Blocs et aux manifestations contre la vie chère outre-mer. Les années 2013 et 2014 ont, quant à elles, vu se dérouler des manifestations et des troubles concernant en particulier des grands projets d’aménagement tels que l’aéroport de Notre-Dame-des-Landes ou le barrage de Sivens.
2. Les suites judiciaires, administratives et déontologiques d’une opération de maintien de l’ordre
Une opération de maintien de l’ordre stricto sensu s’analyse comme l’ensemble des moyens mis en œuvre pour rétablir l’ordre lorsque celui-ci a été troublé. Elle prend fin avec la dispersion des attroupements et l’arrêt des éventuels affrontements. Il est toutefois possible d’élargir le spectre d’analyse en prenant en considération les suites possibles à une opération de maintien de l’ordre. Il s’agit principalement, pour les manifestants, des suites judiciaires – avec les interpellations et la judiciarisation des infractions – et, pour les forces de l’ordre, des poursuites engagées contre elles et des suites disciplinaires. Prend alors forme un continuum du maintien de l’ordre qui s’étend au-delà de l’instant où la manifestation et l’action opérationnelle s’achèvent.
a. Une judiciarisation complexe des opérations de maintien de l’ordre qui ne favorise pas la réponse pénale
Par nature, le maintien de l’ordre se prête difficilement à une judiciarisation pleinement efficace. Le cadre juridique applicable, la doctrine, les schémas tactiques, la vocation première des forces mobiles, la physionomie même des opérations souvent caractérisées par une grande confusion et par l’urgence, rendent la réponse pénale particulièrement complexe en la matière. La commission d’enquête s’est intéressée à quelques-uns des principaux blocages qui ont pu être portés à son attention au cours de ses travaux.
● La judiciarisation : une nouvelle exigence parfois difficilement compatible avec le maintien de l’ordre stricto sensu.
Traditionnellement et très schématiquement, la mission des unités mobiles peut s’analyser de la manière suivante : tenir et subir, de manière collective. Il s’agit d’abord et avant tout d’assurer la gestion démocratique des foules et non d’interpeller, mission qui suppose une posture et des tactiques moins figées et plus dynamiques. M. Grégory Joron, délégué national d’Unité SPG Police FO l’a exprimé de manière très directe : « Quant aux interpellations, ce n’est à l’origine clairement pas la tâche des CRS […] », même si celles-ci se sont adaptées avec la création des sections de protection et d’intervention (SPI) (86). Chaque unité dispose de deux SPI qui travaillent spécifiquement les techniques d’interpellation à l’occasion d’attroupement. Lorsqu’elles doivent s’effectuer, de telles manœuvres sont décidées par le commandant d’unité et conçues dans un dispositif tactique interpellation/appui, le premier volet étant à la charge des SPI et le second à la charge des sections d’appui et de manœuvre (SAM).
Le dispositif est analogue pour la gendarmerie. Au sein de chaque EGM, les interpellations sont assurées par le peloton d’intervention (PI), qui bénéficie de l’appui des pelotons de marche.
M. Cédric Moreau de Bellaing est allé plus loin en évoquant un réel virage doctrinal, accéléré à la suite des émeutes urbaines de 2005 avec « […] la dislocation du principe de base des forces de maintien de l’ordre : celui de l’action collective selon lequel on tient ensemble un site, une rue, on charge ensemble et on s’arrête ensemble » (87). Il estime ainsi que « l’inversion a été totale dans la mesure où l’unité de base de ces services est devenue le binôme afin de rendre plus fluide l’intervention policière et de permettre, le cas échéant, des arrestations. Les policiers chargés du maintien de l’ordre n’avaient donc plus pour unique tâche de tenir un cordon, une rue, un espace mais de se mouvoir et, j’y insiste, d’interpeller. Le fait de demander aux forces de maintien de l’ordre – dont la compétence réside spécifiquement dans la capacité à résister, à défendre un lieu – de revenir à une dynamique beaucoup plus classique, celle de l’arrestation, a changé beaucoup de choses. » (88)
En tout état de cause, la décision de procéder à des interpellations doit s’appuyer sur une analyse d’opportunité de type bénéfices/risques et être prise avec précaution. En effet :
– il est nécessaire de s’assurer que l’imputabilité de la commission de l’infraction ayant justifié l’interpellation pourra clairement être établie ;
– la manœuvre ne doit pas déstabiliser le dispositif tactique d’ensemble ;
– elle peut créer soit un mouvement de panique chez les manifestants, soit un réflexe de protection de la personne interpellée susceptible de placer les forces interpellatrices dans une situation délicate ;
– elle ne permet pas automatiquement une désescalade d’une situation tendue.
Au-delà du strict volet « interpellation », l’appui judiciaire des unités engagées en maintien de l’ordre s’effectue par la mise en place d’équipes spécialisées composées d’agents ayant qualité d’officiers de police judiciaire, totalement dissociés de la composante maintien de l’ordre et qui viennent en appui des unités constituées.
Il convient en effet de préciser que les articles 16 et 20 du code de procédure pénale suspendent temporairement la qualité d’officier de police judiciaire (OPJ) et d’agent de police judiciaire (APJ) pour les fonctionnaires et militaires concernés pendant le temps où ils participent, en unité constituée, à une opération de maintien de l’ordre. Ils ne peuvent dès lors exercer les missions de police judiciaire découlant de cette qualité : constatation des infractions à la loi pénale, recueil des preuves, recherche des auteurs des infractions, établissement des procès-verbaux, placement en garde à vue (OPJ uniquement). Cette interdiction de cumul des qualités se justifie par une exigence d’impartialité.
Au total, si les manœuvres ordre public et police judiciaire peuvent effectivement être combinées, elles ne sont pas confondues :
– elles sont exécutées par des unités distinctes : les OPJ agissent en périphérie de l’opération de maintien de l’ordre et n’y participent pas directement ;
– elles relèvent de deux autorités distinctes : l’autorité civile (préfet) pour le maintien de l’ordre et le procureur de la République pour la police judiciaire.
● Une imputation des faits délictueux et un recueil de preuves parfois problématiques.
Comme l’a indiqué M. François Molins, procureur de la République de Paris, lors de son audition, il est parfois malaisé de recueillir les éléments de preuves nécessaires à l’encontre d’une personne interpellée, « les conditions d’intervention des unités de maintien de l’ordre [n’étant] pas propices à la rédaction de rapports ou de procès-verbaux d’interpellation répondant à nos exigences » (89).
Il est en effet compliqué, pour l’agent ayant procédé à une interpellation, de sortir du dispositif de l’unité constituée pour présenter l’interpellé à un OPJ. En outre, les fiches remises à l’OPJ sont, du fait des circonstances et de l’urgence qui caractérisent une opération de maintien de l’ordre, parfois insuffisamment précises notamment sur les éléments constitutifs de l’infraction (90).
Dans des conditions souvent dégradées, il n’est pas évident à la fois de maintenir l’ordre, de procéder à des interpellations et d’effectuer un traitement procédural correct afin d’assurer la bonne suite de la procédure.
Une autre difficulté tient au fait que les unités des CRS ou les escadrons de gendarmes mobiles proviennent de l’ensemble du territoire et ne sont donc présents que de manière ponctuelle sur le lieu de l’opération de maintien de l’ordre. Il est donc malaisé de les immobiliser davantage sur le terrain à l’issue des opérations pour des questions procédurales.
● Des règles de procédure contraignantes dans le cadre d’une opération de maintien de l’ordre.
Le problème récurrent est celui des délais nécessaires à la notification des droits et à l’éventuel placement en garde à vue. En effet, les droits doivent être notifiés à la personne concernée dès l’interpellation et le placement en garde à vue (91). En outre et sauf « circonstances insurmontables », le parquet doit être avisé de la garde à vue dès le début de la mesure (92) – en pratique, selon la jurisprudence, dans un délai d’une heure quinze au maximum (93). Passé ce délai, l’avis est considéré comme tardif et la procédure est jugée irrégulière.
Afin de gérer de telles contraintes, le parquet de Paris a mis en place une organisation spécifique reposant sur une section dédiée chargée du traitement en temps réel des interpellations en flagrant délit. Cette section dite P12 assure une permanence criminelle effectuée par un magistrat (94). Toutefois, ce qui est possible dans la capitale ne l’est pas probablement pas dans tous les parquets de France, faute des moyens suffisants.
● Des facilitations possibles mais sans doute insuffisantes.
En matière de judiciarisation du maintien de l’ordre, le procureur dispose de certains pouvoirs, notamment la possibilité de délivrer des réquisitions de contrôles d’identité aux fins de rechercher et poursuivre des infractions particulières (95). Ces réquisitions sont délivrées pour des lieux et périodes déterminés, le périmètre pouvant correspondre au trajet et aux abords d’une manifestation et la réquisition étant généralement valable pour une durée de six heures (96), huit heures maximum selon les informations communiquées par la Direction de l’ordre public et de la circulation (DOPC) de la préfecture de police de Paris.
En outre, le recours aux moyens de captation vidéo, qu’il s’agisse de dispositifs statiques présents en permanence sur la voie publique (97), de systèmes provisoires installés lors de manifestations et rassemblements de grande ampleur ou de matériels spécifiques en dotation parmi les forces de l’ordre (caméras portées), peut permettre d’améliorer l’imputation des faits, de consolider ou de pré-constituer des éléments de preuve en matérialisant les commissions d’infractions. Elle peut également constituer une alternative à l’interpellation immédiate, qui peut parfois s’avérer contre-productive et perturber le schéma tactique d’ensemble.
Enfin, la création de fiches d’interpellation type à la suite d’un travail conjoint du parquet de Paris et de la préfecture de police de Paris a permis une sécurisation accrue des éléments de preuve et des procédures. Contenant toutes les mentions nécessaires à la poursuite de la procédure, elle est distribuée à tous les commandants d’unités ayant vocation à intervenir (98).
b. Les mises en cause possibles de l’action des forces de l’ordre et de la puissance publique
L’acceptabilité sociale de la contrainte que sont susceptibles d’exercer les forces de police lors d’une opération de maintien de l’ordre repose sur sa légitimité. Cette notion renvoie au respect scrupuleux, d’une part, des règles et procédures qui encadrent cet exercice et, d’autre part, des règles déontologiques qui s’imposent aux forces de l’ordre.
Certaines personnes auditionnées par la commission d’enquête ont fait état de leurs doutes sur la qualité et l’efficacité des procédures mettant en cause des membres des forces de l’ordre prises de manière globale (pas uniquement les unités opérant en maintien de l’ordre). Ainsi, M. Pierre Tartakowsky, président de la Ligue des droits de l’Homme a affirmé que « les enquêtes sur les plaintes contre des agents de police ou des tenants de l’autorité sont rarement complètes, souvent inefficaces et très souvent partiales ; la plupart du temps, d’ailleurs, on n’en ouvre pas. » (99) M. Jean-Baptise Eyraud, porte-parole de l’association Droit au logement a fait état d’un « sentiment […] que les policiers sont mieux protégés qu’avant […] » (100).
Une telle question est éminemment complexe. Il n’appartient pas à la commission d’enquête de prendre position sur un « sentiment », quel qu’il soit. En outre, elle n’a pas vocation à mettre en doute, sans éléments factuels précis, le travail mené par les différents services et juridictions, ni à commenter des décisions ayant l’autorité de la chose jugée. La commission ne saurait, par principe, se substituer aux professionnels concernés, magistrats notamment (101). Dans l’hypothèse où un tel exercice serait constitutionnellement et légalement possible, elle ne disposerait pas, en tout état de cause, des moyens matériels et techniques nécessaires à l’analyse d’un nombre suffisamment substantiel d’affaires pour en tirer des conclusions statistiques pertinentes.
Elle ne peut, par conséquent, que s’en tenir aux données dont elle dispose et en fournir une présentation objective. À cet égard, il semble nécessaire de faire état des rappels utiles formulés par M. Christian Vigouroux lors de son audition par la commission d’enquête pour ce qui concerne la procédure devant la juridiction administrative. « La responsabilité administrative comporte la responsabilité disciplinaire du policier ou du gendarme, ainsi qu’une forme de responsabilité civile de l’administration par le paiement d’indemnités. […] Comme dans tout système de responsabilité, une série de haies doivent être franchies avant qu’un manifestant victime d’agissements involontaires – si les agissements sont volontaires il s’agit de responsabilité pénale – de la police ou de la gendarmerie puisse recevoir une indemnité. Il faut tout d’abord respecter les délais. […] Il faut montrer que [l’action des forces de l’ordre mises en cause] représente une faute lourde des agents de police. […] Il faut encore, une fois que les faits ont été établis, que les agissements de la victime n’exonèrent pas l’administration. Par exemple, il ne faut pas avoir été imprudent en restant sur les lieux malgré les sommations […] Ainsi, le juge administratif place des haies de procédure, prend en considération le comportement de la victime, ce qui peut conduire à une diminution de l’indemnité, mais il indemnise, soit automatiquement dans le cas d’un attroupement ou d’une émeute, soit lorsque l’administration a commis une faute lourde. » (102)
Mutatis mutandis, des analyses analogues sont effectuées par le juge judiciaire pour déterminer si la responsabilité pénale doit être mise en cause et, le cas échéant, avec quelles conséquences. Même si une telle situation peut parfois sembler difficilement compréhensible pour les plaignants, cela explique que l’ensemble des plaintes déposées à l’encontre de membres des forces de l’ordre ne débouchent pas forcément sur des poursuites et que ces poursuites n’ont pas, par nature, vocation à entraîner automatiquement des condamnations.
Au-delà de cet aspect, une question particulière semble toutefois problématique. Ainsi que l’a souligné le Défenseur des droits, le manque de rigueur dans la rédaction des procès-verbaux établis à la suite de l’usage de la force constitue un problème récurrent. En effet, « Ce manque de rigueur peut conduire, notamment dans le cas de manifestations où les protagonistes sont nombreux, à l’impossibilité d’établir qui est l’auteur d’un tir. Il complique aussi le contrôle des opérations a posteriori, tant par la hiérarchie que par les inspections générales. Dans plusieurs dossiers, le Défenseur des droits a recommandé l’engagement de poursuites disciplinaires pour manque de loyauté à l’encontre de fonctionnaires de police qui avaient omis de signaler l’usage de la force ou qui l’avaient mentionnée de façon inexacte dans les procès-verbaux. Ces insuffisances peuvent contribuer à jeter le discrédit sur l’ensemble des déclarations d’un fonctionnaire qui relate la manière dont il est fait usage de la force au cours d’une intervention. Les règles doivent donc être suffisamment encadrantes et strictes, notamment en matière de rédaction des procès-verbaux, pour qu’il ne puisse y avoir aucune suspicion sur la bonne foi de ceux qui sont interrogés. » (103) Le Rapporteur ne peut que souscrire à un tel constat : pour être légitime, l’action des forces de l’ordre doit être irréprochable, a fortiori lorsque sont mis en œuvre des moyens de contrainte.
● Les statistiques suivantes ont été fournies par les inspections générales de la police et de la gendarmerie nationales (IGPN et IGGN), étant entendu qu’elles ne sauraient prétendre à l’exhaustivité dès lors que ces services ne détiennent pas le monopole des saisines administratives ou judiciaires en la matière. Ainsi l’autorité judiciaire choisit en toute indépendance et en opportunité le service d’investigation pour traiter des plaintes et procédures pénales. En outre, le processus judiciaire s’inscrivant dans le temps long, le suivi des affaires peut s’avérer complexe pour les services d’inspection, d’autant que les suites judiciaires sont rarement communiquées à l’administration par les autorités compétentes (104).
Sur le plan administratif, l’IPGN a recensé, pour l’année 2014, quatre enquêtes liées à un contexte de maintien de l’ordre. Aucune n’est en cours au titre de 2015.
Sur le plan judiciaire et au titre de 2014, l’IGPN a diligenté 41 enquêtes correspondant à 55 plaintes pour des faits relatifs à des opérations de maintien de l’ordre. Parmi ces plaintes, 20 ont fait l’objet d’un classement sans suite, 13 ont été transmises aux parquets compétents pour appréciation ou à un juge d’instruction et 22 sont en cours de traitement. Au cours des trois premiers mois de l’année 2015, aucune plainte n’avait été portée à la connaissance de l’IGPN concernant des opérations de maintien de l’ordre.
Les statistiques communiquées par l’IGGN font état de 14 événements en maintien de l’ordre ayant fait l’objet d’une enquête judiciaire entre 2010 et 2015. Deux condamnations pénales ont été prononcées.
● Quant aux réclamations portées devant l’autorité administrative indépendante (AAI) en charge de la déontologie de la sécurité, le Défenseur des droits, celui-ci recense, au titre de 2014, 40 dossiers liés à la thématique du maintien et du rétablissement de l’ordre (105).
Il relève que « Dans le domaine du rétablissement de l’ordre, le Défenseur des droits est généralement suivi dans ses demandes de poursuites disciplinaires à l’égard de l’auteur d’une violence illégitime ; il l’est beaucoup moins quand les demandes de poursuites disciplinaires visent le donneur d’ordre. En revanche, le Défenseur des droits a été suivi partiellement dans ses recommandations générales concernant les deux LBD qui posent la question de la doctrine du maintien de l’ordre. » (106) Des développements spécifiques à cette dernière problématique figurent dans une partie ultérieure du présent rapport.
● Il convient de rappeler que des mesures ont déjà été prises ou vont être renforcées pour permettre d’assurer ou d’améliorer la transparence dans l’action des forces chargées du maintien de l’ordre – et des forces de police en général.
En premier lieu, et depuis le 1er janvier 2014, l’identification individuelle des policiers et gendarmes de manière visible est obligatoire (107) via le port d’un numéro d’identification (matricule) lisible à une distance de deux mètres (108).
En outre, depuis 2013, tout citoyen peut saisir directement en ligne l’IGPN ou l’IGGN de faits ou de comportements de fonctionnaires de police ou de gendarmes qui seraient contraires à la déontologie (109). Un tel signalement ne se substitue évidemment pas à l’éventuel dépôt de plainte auprès d’un service de police ou de gendarmerie ou, directement, auprès du procureur de la République.
Enfin, le recours plus systématique à l’enregistrement vidéo permettra, outre les avancées précitées en matière de judiciarisation, de mieux sécuriser le déroulement des opérations de maintien de l’ordre, qu’il s’agisse de repérer les éventuels écarts et manquements des forces de l’ordre ou, au contraire, de les mettre hors de cause en cas de fausse accusation. En ce sens, la décision du ministre de l’Intérieur de filmer intégralement les opérations de maintien de l’ordre à risque contribuera à ce légitime impératif de transparence (110).
II. LES CONDITIONS DES TROUBLES À L’ORDRE PUBLIC ONT ÉVOLUÉ
Si le cadre juridique et les grandes lignes de la doctrine applicables au maintien de l’ordre n’ont finalement que peu évolué au cours des dernières décennies, tel n’est pas le cas des troubles à l’ordre public eux-mêmes. Le directeur général de la police nationale, Jean-Marc Falcone, a globalement résumé ces évolutions :
« De nouvelles formes de contestation ont émergé dans les dernières années. Les forces de l’ordre sont aujourd’hui confrontées à des manifestations dont les formes diffèrent, à bien des égards, de celles que nous connaissions il y a une vingtaine d’années. Elles sont plus souvent spontanées, en lien avec l’actualité internationale couverte de manière instantanée par les médias, moins souvent déclarées et encadrées par des organisateurs responsables ; elles sont également le fait de groupes plus structurés et parfois violents ; elles sont enfin plus hétérogènes, mêlant des manifestants pacifiques, des délinquants et des provocateurs organisés tels que les No Borders ou les Black blocs. Dans leur expression violente, ces nouvelles formes de contestation bénéficient d’une couverture médiatique considérable et immédiate, qui les rend encore moins acceptables pour l’opinion publique. » (111)
Disposant à la fois d’interlocuteurs moins structurés ou moins connus et de moyens décroissants, l’autorité civile a dû faire face simultanément à l’apparition de nouvelles formes et espaces de contestation sociale et à des exigences accrues de l’opinion publique.
A. LA RECOMPOSITION DES ACTEURS PRINCIPAUX DES MANIFESTATIONS A PRIVÉ PROGRESSIVEMENT L’ÉTAT DE SES MOYENS DE RÉGULATION DES TROUBLES À L’ORDRE PUBLIC
Comme l’a rappelé le sociologue Cédric Moreau De Bellaing, le dialogue entre l’autorité civile et les organisateurs de manifestations est une des clés de la préservation conjointe des libertés et de l’ordre publics, mais il est devenu plus complexe à mettre en œuvre : « que l’on ait affaire à des groupes moins organisés, à des collectifs plus flous, c’est certain et c’est là que réside le défi principal. En effet, ce qui a permis l’institutionnalisation du maintien de l’ordre, c’est le développement d’une coopération avec les organisateurs des manifestations – de ce point de vue, la CGT a été reconnue par les services de police comme un interlocuteur privilégié pour organiser des manifestations « carrées ». La question qui se pose est dès lors sans doute moins celle de l’arsenal des forces de l’ordre que celle de la capacité à créer de nouvelles coopérations avec des groupes relativement flous mais participant d’un mouvement social plus global. » (112)
Un tel dialogue implique naturellement les deux parties en présence et le Rapporteur relève que si les conditions actuelles d’organisation des manifestations sont moins propices à la concertation, dans le même temps, les forces à disposition des préfets leur permettent moins qu’auparavant d’anticiper les troubles à l’ordre public.
1. Les conditions d’organisation des manifestations ne permettent plus autant la concertation en amont
Du côté des manifestants, les préfets doivent tenir compte de trois grandes évolutions : le recul des événements organisés avec des acteurs traditionnels et structurés, habitués au dialogue avec l’autorité civile ; la recrudescence de manifestations organisées sans déclaration préalable voire inopinées ou spontanées ; enfin l’apparition de plus en plus fréquente de collectifs organisés d’individus violents recherchant systématiquement le trouble à l’ordre public sinon la confrontation avec les forces de l’ordre.
a. La part décroissante des grands acteurs traditionnels et de leurs services d’ordre dans l’organisation des manifestations
Le préfet de police de Paris, dont la circonscription concentre la plupart des manifestations chaque année en France, a souligné lors de son audition (113) toute l’importance qu’il attachait à la concertation préalable : « Le bon déroulement d’une manifestation tient en grande partie à l’existence d’une concertation préalable entre les organisateurs et les responsables des services de maintien de l’ordre, même si – on peut le regretter – les textes relatifs aux déclarations de manifestation ne prévoient pas de négociation avec les déclarants. Dans la réalité, cette négociation a lieu et c’est grâce à elle que les choses se passent bien, dans la très grande majorité des cas. »
Cette concertation a été facilitée pendant plusieurs décennies par la structuration des principaux organisateurs de manifestations – partis politiques ou organisations syndicales pour l’essentiel. Ces acteurs, rompus au cadre juridique et aux méthodes du corps préfectoral, partagent avec celui-ci le souci du dialogue dans le but de garantir des manifestations sans incident. Le préfet honoraire Dominique Bur a évoqué ces conditions (114) presque idéales d’organisation : « Au fil du temps, la nature des manifestations a beaucoup évolué. Les importantes manifestations syndicales, groupées et encadrées, que j’ai connues au début de ma carrière ne donnaient pas lieu à des débordements. Leur parcours avait été fixé avec les organisateurs, leur déroulement était bordé et l’on n’avait pas à redouter les trublions que l’on a vus surgir par la suite. (…) Chaque fois que cela m’a été possible, j’ai établi un contact personnel avec les organisateurs, notamment les responsables agricoles, qui acceptaient de discuter de l’endroit où les manifestants déverseraient de la paille. »
Au cours de son audition, il a également souligné plusieurs évolutions caractérisant les conditions d’organisation des manifestations. « La première tient à une baisse de l’encadrement. Lors des grandes manifestations syndicales des années soixante ou soixante-dix, il y avait des responsables et un service d’ordre. Ceux-ci avaient pris contact avec les forces de l’ordre, par l’intermédiaire des renseignements généraux, et il était facile de leur faire passer un message. La situation est très différente lors des manifestations spontanées. »
Il n’existe pas d’outil statistique permettant au Rapporteur d’objectiver le constat d’une moindre proportion de tels acteurs dans le nombre des manifestations organisées chaque année. Cependant, cette observation a fait consensus auprès de la plupart des personnes entendues par la commission.
b. L’organisation de manifestations… sans organisateurs
Concernant les événements d’ampleur significative, les manifestations contemporaines ne sont donc plus aussi souvent qu’auparavant ces cortèges réglés et régulés par des services d’ordre suffisants et efficaces. De plus en plus de manifestations n’ont pas d’organisateur déclaré en préfecture, et, parmi celles-ci, de plus en plus n’ont tout simplement pas d’organisateur.
Le régime juridique de la déclaration préalable a toujours contenu, en raison de sa souplesse et de l’absence de réelle sanction, le risque d’une telle évolution de la part d’individus devenus moins scrupuleux et respectueux de l’autorité de l’État et du cadre légal. En fait, de nombreux organisateurs d’événements sur la voie publique considèrent, à l’heure des réseaux sociaux et de l’immédiateté de la communication, qu’il n’y a guère avantage à déclarer une manifestation. Non déclarée, celle-ci n’est pas pour autant interdite ; elle ne peut être dispersée par principe par les forces de l’ordre et son organisateur peut même avoir un certain sentiment de sécurité juridique lié à son anonymat. La déclaration préalable de manifestation est le fait de ceux qui partagent le souci de l’ordre républicain, mais n’est qu’une formalité risquée et inutile pour d’autres organisateurs moins légalistes.
De nombreuses personnes auditionnées par la commission ont pointé la fréquence croissante de ce phénomène, à l’instar de M. Dominique Bur : « Il existe en outre des manifestations qui n’ont pas réellement d’organisateurs. […] À Lille, les sans-papiers manifestaient presque chaque semaine sans cadre juridique et sans que nous ayons d’interlocuteurs, puisqu’il n’existait même pas d’association. On a vu également des manifestations spontanées éclater dans les entreprises. […] L’irruption des moyens modernes permet aux manifestants de se mobiliser très rapidement. Avec des téléphones portables, il suffit de quelques heures pour organiser un flash mob de plusieurs centaines de personnes devant une préfecture. ».
Dans de telles conditions, les stratégies de concertation des préfectures – qui reposent sur l’exigence de déclaration préalable – sont très largement mises en échec, comme l’a déploré devant la commission le préfet de Police de Paris, qui a également fourni des chiffres attestant que le phénomène n’est pas marginal : « L’ensemble des projets sont instruits, même ceux qui ne sont pas déposés selon les règles fixées par la loi. Nous ne faisons pas de juridisme pointilleux. […] Nous privilégions le dialogue avec les organisateurs, même s’il n’y a que deux signatures, si les signataires n’habitent pas à Paris, si les délais ne sont pas totalement respectés. Nous sommes pragmatiques. Ces discussions aboutissent dans la majorité des cas à un accord.
Certains organisateurs – c’est une évolution récente – sont toutefois de moins en moins enclins à accepter les itinéraires ou les horaires suggérés, et appliquent le principe de la déclaration préalable dans toutes ses acceptions, en ne laissant d’autre alternative qu’accepter ou interdire. Une autre évolution inquiétante est le nombre significatif de manifestations inopinées qui s’affranchissent du cadre légal de la déclaration préalable : 719 en 2012, 733 en 2013, 576 en 2014. » (115).
Face à cette évolution, la recherche d’un dialogue nécessite que l’autorité civile adopte de nouvelles stratégies. La concertation n’étant plus à l’initiative du manifestant qui se déclare au préalable, le Rapporteur estime qu’elle peut être à l’initiative du préfet s’il parvient à identifier lui-même des interlocuteurs pertinents. En l’absence de respect du formalisme légal, c’est le travail de renseignement qui doit permettre aux préfets de mieux préparer les manifestations, y compris avec des organisateurs de fait mais non déclarés.
M. Patrice Bergougnoux, préfet honoraire, a décrit le rôle facilitateur que les nouvelles technologies de la communication jouent dans l’organisation des manifestations non déclarées et défendu, lui aussi, l’exigence d’adaptation pesant sur l’État dans ce domaine du renseignement territorial (cf. infra) : « il est certain que les manifestations se déploient dans un environnement très différent. Les technologies nouvelles vont très vite, mais les services mettent du temps à s’adapter à la nouvelle donne, alors même que le ministère de l’Intérieur a doté ses services des moyens nécessaires. Dans les domaines de pointe, où les formations sont très coûteuses – je pense au big data –, l’État doit recruter les meilleurs spécialistes pour préserver le potentiel de ses capacités d’information. » (116)
c. La présence récurrente de contremanifestants ou/et de groupes structurés sans lien avec la manifestation se livrant à des actes délictuels ou cherchant explicitement à troubler l’ordre public
Une troisième et dernière évolution concernant les acteurs manifestants a été relevée de façon unanime par les personnes auditionnées par la commission. Il s’agit de la présence, de plus en plus fréquente et nombreuse, d’individus violents animés, peu ou prou, par la seule volonté de troubler l’ordre public, de commettre des exactions (y compris contre les manifestants eux-mêmes) ou de se confronter aux forces de sécurité.
Ces individus diffèrent du modèle historique du « casseur » par deux caractéristiques : d’une part, ils sont structurés en collectifs organisés cherchant délibérément à commettre des infractions et répondant ainsi largement aux critères organiques définissant l’association de malfaiteurs au sens de l’article 450-1 du code pénal (117) ; d’autre part, en s’appuyant sur une plus grande disponibilité de l’information sur les mouvements sociaux, ils se sont pratiquement professionnalisés et se déplacent volontiers – y compris hors des frontières de leur pays – afin d’être présents sur les événements de leur choix, quels qu’en soient les motifs et mots d’ordre.
Cette troisième évolution a été fréquemment rapportée à la commission par les préfets et responsables des forces de l’ordre.
M. Dominique Bur a ainsi déclaré lors de son audition (118) : « Les manifestations que nous avons connues se déroulaient dans l’après-midi, voire dans la journée. Elles se dispersaient le soir, même quand leur fin posait problème. À Toulouse, à la queue de la manifestation contre la réforme des retraites, qui a réuni 30 000 à 40 000 personnes, sont apparus une centaine d’autonomes très mobiles et organisés, avec lesquels s’est engagée une sorte de course-poursuite. » ; décrivant cette évolution comme tenant « à l’apparition de personnes mues par d’autres intentions que celle d’exprimer un point de vue ou une revendication. Le but des autonomes est de casser. On l’a mesuré à Toulouse. Certains éléments, parfois venus d’ailleurs, s’infiltrent dans la masse des manifestants paisibles. »
De son côté, M. Bernard Boucault, préfet de police de Paris, a décrit plus précisément le phénomène tel qu’il apparaît fréquemment à Paris (119) : « Les accès rapides en transport en commun permettent à des individus violents et déterminés de se mobiliser en très peu de temps, via l’utilisation des réseaux sociaux. L’expression des mécontentements peut prendre des formes multiples : envahissement de la voie publique et entrave à la circulation, envahissement et occupation de locaux, prise à partie violente d’opposants lors de manifestations, perturbation des services d’ordre institutionnels, saccage du mobilier urbain et de commerces par des bandes violentes parties à la manifestation ou en marge de celle-ci. » Le préfet de police de Paris en concluait que « la doctrine traditionnelle du maintien de l’ordre, selon laquelle il convient de tenir à distance les manifestants afin d’éviter tout risque de confrontation, ne paraît pas adaptée lorsqu’il se commet des exactions ou des violences sur les personnes en marge ou à l’intérieur d’un rassemblement ».
Gendarmes et policiers ont témoigné devant la commission de cette apparition récurrente des collectifs violents, le général Bertrand Cavallier évoquant même une ère de la « violence globale ». Le lieutenant-colonel Stéphane Fauvelet, chef d’escadron de gendarmes mobiles, a même tenté de caractériser l’évolution historique en la matière (120) : « dès la fin des années quatre-vingt-dix, lors de G20 et de G8, à Évian et à Nice par exemple, nous avions été confrontés à des formes de violence extrêmes ; la nouveauté est qu’elles nous semblaient viser les représentants de l’ordre pour ce qu’ils sont, et non plus se revendiquer de quelque aspiration à la liberté. […] Nous ne sommes pas surpris par la violence de l’adversaire, quand bien même le phénomène est devenu plus fréquent. Avec le temps, les opposants se sont également structurés, acquérant une dimension internationale : à Notre-Dame-des-Landes, nous avons fait face à des éléments radicaux venus d’Espagne, de Grande-Bretagne, de Belgique et d’Allemagne. »
Le ministre de l’Intérieur, Bernard Cazeneuve a fourni lors de son audition (121) le descriptif le plus documenté du phénomène : « Aujourd’hui, notre pays et nos forces mobiles sont confrontés à nouvelles formes de contestation sociale, qui posent des problèmes pour partie inédits. De plus en plus souvent, les rassemblements institutionnels classiques sont marqués par l’intervention séparée de groupes structurés, organisés et violents. Leurs méfaits couvrent un large spectre, du vol au saccage organisé, jusqu’à l’agression caractérisée des forces de l’ordre. Il ne s’agit pas de casseurs au sens traditionnel du terme car les participants à ces actions violentes préparent leurs actions de manière professionnelle et méthodique. Ils suivent des stages de résistance, bénéficient de soutien logistique, d’assistance médicale ou juridique, et s’équipent de dispositifs de protection leur permettant de résister aux moyens employés par les unités de maintien de l’ordre. Rompus aux nouvelles technologies, ces groupes structurés se caractérisent par une intelligence collective développée, construite sur l’anticipation, l’observation des forces et l’expérience. »
Ce phénomène a aussi été rapporté à la commission par les personnes entendues au titre de leur participation à des contestations sociales en tant que manifestants. Ainsi, M. Ben Lefetey, porte-parole du Collectif pour la sauvegarde de la zone humide du Testet (sur laquelle devait être implanté le barrage dit « de Sivens »), a décrit (122) aux membres de la commission le processus qui a vu des semi-professionnels de l’affrontement peupler en partie la ZAD de Sivens : « Voilà comment s’enclenche la spirale de la violence car, lorsque ces images [montrant l’usage de la force par des gendarmes de Gaillac] sont diffusées sur Internet, elles attirent d’autres manifestants sur les lieux, dont certains forts de leur expérience à Notre-Dame-des-Landes. Début mars, une cinquantaine de personnes sont ainsi arrivées en renfort pour organiser la défense de la zone humide, en y installant des barricades. »
Adoptant un point de vue plus général, M. Pierre Tartakowsky, président de la Ligue des droits de l’Homme a témoigné de cette évolution contemporaine des acteurs présents durant les manifestations ou en marge de celles-ci : « L’autre phénomène, plus restreint mais plus spectaculaire, est celui de l’utilisation directe de la violence – violence, et non pas occupation d’espace public – qui surgit au sein de manifestations pacifiques et démocratiques. Elle déplace le sens de ces manifestations sur un autre terrain que celui de la démocratie, à savoir celui de la violence et de la casse. Or il est troublant de constater que dans de telles situations, les forces de l’ordre sont désarçonnées, voire en état de sidération. Je précise que je parle aussi bien en tant que président de la Ligue des droits de l’Homme qu’en tant que citoyen ayant beaucoup manifesté et s’étant trouvé confronté à l’apparition ex nihilo de ces groupes, que ce soit aux États-Unis, en Italie ou en France. »
Enfin, il résulte, sans surprise, des échanges conduits avec les administrations des États voisins de la France que ce double phénomène de violence plus organisée et directement orientée contre l’ordre public est constaté dans la plupart d’entre eux. Son caractère international va de pair avec la mobilité transfrontalière des collectifs concernés, dont ont à nouveau témoigné les violences et dégradations commises lors de l’inauguration du nouveau bâtiment de la Banque centrale européenne à Francfort le 18 mars 2015.
2. La recomposition des forces à disposition du préfet
a. Les conséquences de la suppression des Renseignements généraux
Dans un cadre juridique relativement peu structurant, la déclaration préalable légalement obligatoire constitue le seul outil officiel de concertation prévu entre autorité civile et organisateurs. Celle-ci devant s’effectuer jusqu’à trois jours francs avant l’organisation de l’événement de voie publique, la capacité d’anticipation du préfet peut s’en trouver singulièrement réduite. Celui-ci disposait d’un autre outil, susceptible d’être actionné plus en amont : les Renseignements généraux (RG). Or, la suppression, en 2008, un siècle après sa création en 1907, de la Direction centrale des renseignements généraux en tant qu’institution aura fatalement privé l’autorité préfectorale d’un réseau précieux de remontée d’informations et d’analyse, complexifiant sa tâche en la matière. La reconstitution de ce réseau, sous une forme nouvelle, est particulièrement positive, même si elle prendra du temps.
Il ne s’agit pas ici de revenir de manière détaillée sur les motifs et les motivations techniques et politiques ayant conduit à la suppression des RG, mais d’en présenter succinctement les conséquences pour l’autorité préfectorale au regard de la gestion des manifestations et événements organisés sur la voie publique et susceptibles, à ce titre, de faire l’objet d’opérations de maintien de l’ordre.
● De l’importance d’un renseignement fiable.
Même si un tel constat semble relever de l’évidence, il n’est sans doute pas inutile de le rappeler : l’organisation et la gestion efficace d’une manifestation reposent sur un renseignement fiable, pertinent et aussi précis que possible. Ainsi que l’a résumé M. Patrice Bergougnoux, « L’information est à la base de toutes les solutions qui permettent aux citoyens de manifester dans les meilleures conditions de sécurité. » (123)
Le recueil, l’analyse et la transmission des informations au niveau territorial – le préfet – comme au niveau national – le ministre de l’Intérieur – sont essentiels. Le renseignement passe avant tout par un contact direct et permanent avec les acteurs locaux intéressés. Il s’agit, tout d’abord, d’anticiper ce qui peut l’être : repérer les individus susceptibles de générer des difficultés, disposer d’éléments « d’ambiance » sur l’attitude des futurs manifestants, évaluer autant que faire se peut l’ampleur de la participation à l’événement, identifier les risques de perturbations, de dégradations, voire de confrontations avec les forces de l’ordre, etc.
Par ailleurs et en fonction des éléments recueillis en amont, il s’agit de dimensionner de la manière la plus fine possible le dispositif de maintien de l’ordre qui sera déployé sur le théâtre concerné, en termes d’hommes comme d’équipements. C’est une dimension essentielle du maintien de l’ordre car en la matière, l’aspect psychologique n’est pas à négliger. Un sous-dimensionnement ou, au contraire, un surdimensionnement des unités chargées du maintien de l’ordre peut potentiellement inciter certains individus à créer des troubles, soit qu’ils estiment que la faiblesse du dispositif leur donne l’opportunité de se livrer à des actes répréhensibles et ne permettra pas une réponse efficace ; soit qu’ils considèrent qu’un déploiement trop massif de la force publique constitue une provocation légitimant, à leurs yeux, une attitude violente.
Enfin, la présence d’agents au cours des événements permet l’information, en temps réel, des responsables du maintien de l’ordre avec la transmission de données sur les éléments à risque par exemple. Elle permet d’adapter de manière réactive le dispositif opérationnel.
● De l’avis unanime des acteurs et observateurs du maintien de l’ordre, la disparition des Renseignement généraux a entraîné une perte de connaissances et de savoir-faire.
La suppression de la direction centrale des renseignements généraux (DCRG) par fusion avec la Direction de la surveillance du territoire (DST) pour donner naissance à la Direction centrale de la sécurité intérieure (DCRI) ne s’est évidemment pas traduite par un abandon total des missions assurées par les RG. À sa suite fut créée la sous-direction de l’information générale (SDIG) relevant de la Direction centrale de la sécurité publique (DCSP) et accueillant une partie des agents des anciens RG.
Toutefois, cette « dilution » de la spécificité des RG associée à une diminution de leurs moyens, notamment humains, a conduit à une certaine perte de connaissance du terrain pourtant extrêmement précieuse. Ainsi que l’a précisé M. Jérôme Léonnet, chef du Service central du renseignement territorial (SCRT), la SDIG, chargée des missions classiques des RG, s’est trouvée « en sous-capacité par rapport à la situation antérieure. Alors que la DCRG employait, en 2008, 3 200 fonctionnaires, la SDIG, créée cette année-là, en comptait 1 400 » (124), soit une réduction de plus de la moitié des ressources humaines (- 56,3 %). Commentant cette baisse drastique des moyens alloués au renseignement de proximité consécutivement à la réforme, le directeur général de la police nationale a déclaré que « la capacité d’analyse et de renseignement a été perdue » (125).
Les deux préfets honoraires auditionnés par la commission d’enquête ont fait état d’avis convergents. Selon M. Patrice Bergougnoux, « Une condition capitale du maintien de l’ordre républicain est que les autorités disposent des informations nécessaires pour apprécier la situation et adopter les bons dispositifs. C’est pourquoi je regrette que les réorganisations intervenues récemment dans le renseignement aient réduit la capacité d’information des autorités préfectorales. » (126) Pour M. Dominique Bur, « La question du renseignement est essentielle. Les décisions prises par le politique ont causé sur le terrain séparations et coupures, qui ont entraîné une perte de contact. Les renseignements généraux avaient tissé des liens avec les organisations syndicales et professionnelles, dont ils étaient bien connus. Ils servaient de relais avec la préfecture, à laquelle ils permettaient de faire passer des messages. Il a fallu reconstruire ces liens disparus. Des moyens y ont été consacrés, mais on ne tisse pas un réseau du jour au lendemain. » (127)
Parallèlement et au-delà du cas des RG, service spécialisé, le ministre de l’Intérieur a rappelé lors de son audition que la diminution, durant le quinquennat précédent, des effectifs de la police et de la gendarmerie nationales – qui participent à cette mission de renseignement – a obéré les capacités de détection des « signaux faibles » sur le terrain (128).
Il est intéressant de souligner que les acteurs de l’ordre public ne sont pas les seuls à déplorer les conséquences de la disparition des RG. Ainsi que l’a affirmé M. Fabien Jobard, directeur de recherches au CNRS, « Nous mesurons depuis assez longtemps les effets de la dissolution des Renseignements généraux. Celle-ci a entraîné une perte de connaissance des phénomènes de société à l’échelle territoriale. Les événements de Poitiers, de Strasbourg, de Notre-Dame-des-Landes, mais aussi de Sivens, ont illustré la difficile capacité des pouvoirs publics à anticiper les dynamiques de protestation et de contestation. » (129)
● La spécificité parisienne en matière de renseignement de proximité.
Compte tenu de la spécificité de la capitale et des départements limitrophes, la préfecture de police de Paris dispose de son propre service de renseignement de proximité. Non concerné par la fusion entre RG et DST, il a donc été moins touché par les conséquences de cette réforme.
La direction du Renseignement de la préfecture de police (DRPP) « est chargée de la recherche, de la centralisation et de l’analyse des renseignements destinés à informer le préfet de police dans les domaines institutionnel, économique et social, ainsi qu’en matière de phénomènes urbains violents et dans tous les domaines susceptibles d’intéresser l’ordre public et le fonctionnement des institutions dans la capitale et les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne. » (130) Encore faut-il préciser que le renseignement territorial n’est pas sa seule mission, la DRPP contribuant également à la prévention du terrorisme, à la lutte contre l’immigration clandestine et à la recherche de l’information opérationnelle au profit de l’ensemble des policiers. Selon le préfet de police, les manifestations représentent environ un tiers de l’activité de renseignement de la DRPP (131).
b. La diminution des effectifs des forces mobiles impose un recours accru à des unités non spécialisées dans le maintien de l’ordre
Le propos du Rapporteur ne consiste pas à se livrer à une nouvelle querelle de chiffres concernant les diminutions d’effectifs qui, sous le quinquennat précédent, ont touché la police et la gendarmerie nationales et, pour ce qui concerne le présent rapport, les forces mobiles. Il s’agit simplement de faire état des informations communiquées à la commission d’enquête, par les acteurs du maintien de l’ordre eux-mêmes, sur ces réductions et leurs conséquences opérationnelles.
● Un lourd tribut payé à la révision générale des politiques publiques (RGPP).
D’après les éléments communiqués à la commission d’enquête, ce sont les forces mobiles qui ont supporté la plus grande partie des efforts de réduction des effectifs demandés, tant à la police qu’à la gendarmerie nationales, dans le cadre de la RGPP.
Ainsi, sur 123 escadrons de gendarmerie mobile, 15 ont été dissous, soit environ 12,2 % du nombre total d’EGM. Au 1er janvier 2008, la gendarmerie mobile comptait 22 groupements de gendarmerie mobile (GGM) et un groupement blindé de gendarmerie mobile (GBGM) qui regroupaient 123 EGM. L’effectif total en équivalents temps plein (ETP) était de 15 262 ETP. Au 1er janvier 2015, conséquence des dissolutions d’escadrons intervenues, la gendarmerie mobile comptait 12 877 ETP, soit 2 385 ETP de moins (132) (- 15,6%).
De telles données corroborent les déclarations des personnes auditionnées qui se sont exprimées à ce sujet, et selon lesquelles la gendarmerie mobile s’est vu amputée de 2 000 à 2 500 gendarmes consécutivement aux restructurations (133).
Quant aux compagnies républicaines de sécurité, si le nombre d’unités est resté constant, elles ont eu à subir une déflation de même ampleur (134) entraînant mathématiquement une réduction des effectifs par compagnie et donc une diminution du nombre d’agents présents sur le terrain, en vertu de la règle des trois cinquièmes (cf. supra). Pour reprendre les termes de M. Paul Le Guennic, secrétaire national d’Unité SGP Police FO, « La révision générale des politiques publiques (RGPP) a porté un sacré coup aux effectifs des CRS : au sein de la police nationale, c’est la direction qui a réagi le plus vite et qui a payé le plus lourd tribut. » (135)
Pour sa part M. Éric Mildenberger, délégué général d’Alliance police nationale, a précisé que « Dans l’exercice de leur mission de maintien et de rétablissement de l’ordre, le cœur de leur métier, les compagnies de CRS sont handicapées par la baisse significative de leurs effectifs. Elles peuvent se trouver en situation difficile sur le terrain, quand il s’agit de protéger un site ou de barrer des rues. En quelques années, l’effectif réel d’une compagnie sur le terrain est passé de 90-100 personnes à 70-80 personnes. L’effectif théorique se situe à 130 CRS, mais certaines compagnies fonctionnent avec 118-120 CRS, le nombre fluctuant en fonction des mouvements des personnels. » (136)
Les efforts consentis depuis 2012 par le Gouvernement pour la reconstitution des effectifs de sécurité publique ont été bénéfiques, mais n’ont évidemment pas suffi à compenser les coupes claires massives opérées durant le quinquennat précédent.
● Une réduction couplée à un haut niveau d’engagement opérationnel qui n’a pas vocation à diminuer compte tenu du contexte actuel.
Selon le directeur général de la gendarmerie nationale, les escadrons de gendarmerie mobile sont soumis à une pression opérationnelle forte résultant d’un fort taux d’engagement de plus de 220 jours par an pour chaque escadron (137). La situation est similaire pour les CRS. D’après M. Grégory Joron, délégué national d’Unité SGP Police FO, ce sont en moyenne 45 unités par jour qui sont engagées depuis le mois de janvier 2015, contre 41 à 42 unités auparavant. Ces statistiques ne tiennent en outre pas compte des renforcements d’unité à unité (138).
En plus de leurs missions principales, les forces mobiles sont évidemment mobilisées dans le cadre du plan Sentinelle. Si un tel engagement n’est pas sans poser un certain nombre de difficultés de gestion, il n’est probablement pas amené à se réduire à moyen terme.
● La diminution des moyens humains à disposition des forces mobiles, de même que la contrainte de l’urgence, entraînent le recours à des formations non spécialisées pour des opérations de maintien de l’ordre au sens large.
Par principe, les unités de gendarmerie départementales (GD) ne participent pas aux opérations de maintien de l’ordre. Toutefois et comme souvent en matière de sécurité, l’urgence commande et l’autorité concernée peut n’avoir d’autre choix que de déployer les forces immédiatement disponibles, dans l’attente de l’arrivée des unités spécialisées.
En cas de troubles à l’ordre public et en l’absence des forces mobiles, les gendarmes départementaux peuvent constater les infractions à la loi pénale, intervenir pour les faire cesser et appréhender leurs auteurs. Si la gendarmerie départementale est mobilisée pour participer à des opérations de maintien de l’ordre, son organisation et sa doctrine d’emploi ne permettent pas son engagement en unités constituées. Comme le précisent les réponses de la direction générale de la gendarmerie nationale au questionnaire de la commission d’enquête, la GD n’est ni équipée, ni formée pour répondre aux standards des missions de maintien de l’ordre. Le directeur général de la gendarmerie nationale lui-même l’a exprimé en ces termes : « […] j’y insiste, la règle veut que qu’il n’y ait pas d’engagement d’unités de la gendarmerie départementale, hors situation d’urgence, au maintien de l’ordre. Il n’y a pas à transiger : à chacun son métier. » (139)
Lorsqu’elle est engagée dans une opération de maintien de l’ordre d’ampleur, la GD mène son action en périphérie de celle des forces mobiles (missions de recherche du renseignement, de gestion des flux et d’appui judiciaire). Ce sont généralement les pelotons de surveillance et d’intervention de la gendarmerie (PSIG) qui sont mobilisés et dont les membres, même s’ils ont pu par ailleurs servir au sein d’EGM, ne sont pas spécifiquement formés au maintien de l’ordre. Le recours aux PSIG n’est possible que de manière temporaire et limitative s’agissant des missions qu’ils sont appelés à exercer. Ils peuvent intervenir :
– sous l’empire de l’urgence et dans des situations de violences exacerbées, dans l’attente de l’arrivée d’unités de forces mobiles ;
– dans le cadre de la protection des représentants de la force publique et des tiers pouvant être directement menacés ;
– en appui des unités de forces mobiles engagées : renseignement dans la profondeur, appui judiciaire et interpellation de fauteurs de trouble désignés par le commandant territorial.
D’autres formations et unités de la gendarmerie peuvent également être requises au maintien de l’ordre :
– les unités d’intervention spécialisées : GIGN (140), GPI (141) et PI2G (142), en situation de crise exceptionnelle ;
– la Garde républicaine, qui pourrait participer exceptionnellement et sur décision du ministre de l’Intérieur, au maintien de l’ordre dans la capitale ;
– les gendarmeries spécialisées dépendant du ministre de la Défense (143), exceptionnellement et sur décision de celui-ci. Elles réaliseraient alors des missions comparables à celles de la GD dans les mêmes circonstances.
Les mêmes observations peuvent être faites concernant la participation d’unités non spécialisées de la police nationale avec, selon l’expression de M. Fabien Jobard, « la multiplication de quasi-unités de maintien de l’ordre » (144). Les informations communiquées par la direction générale de la police nationale indiquent ainsi que, contrairement aux CRS, de telles unités sont faiblement équipées en moyens de protection et en armements dédiés et ne sont pas formées à évoluer en unités constituées.
Les brigades anti-criminalité (BAC) sont employées pour assurer des interpellations, ses effectifs intervenant en civil. En outre, les compagnies départementales d’intervention (CDI) en région et les compagnies de sécurisation et d’intervention (CSI) à Paris et en petite couronne peuvent être déployées en opération de maintien de l’ordre. Les circonscriptions de sécurité publique les plus importantes disposent également d’unités d’ordre public et de sécurité routière (UOPSR).
Encore convient-il d’opérer des distinctions parmi les unités « non CRS ». Ainsi, lorsqu’elles participent à une opération de maintien de l’ordre, les sept compagnies d’intervention (CI) de la DOPC de la préfecture de police de Paris peuvent disposer d’un équipement qui présente de nombreuses analogies avec celui des CRS, avec notamment une tenue de maintien de l’ordre et des moyens de protection individuelle (casque lourd, protège-tibias, protection d’épaules, boucliers, bâtons de défense, etc.). L’armement en dotation collective présente, quant à lui, des différences substantielles. Si ces compagnies sont équipées du lance-grenades « Cougar » et de grenades lacrymogènes MP7 ou CM6 (également susceptibles d’être lancées à la main), elles ne disposent d’aucun fusil ou d’arme longue, et les grenades lacrymogènes instantanées ont été retirées de la dotation en 2009. Quant aux moyens de force intermédiaire, ces compagnies ne possèdent pas de Flash-Ball et si le LBD de calibre 40 figure dans leur équipement, une interdiction permanente d’utilisation a été décidée d’après les informations communiquées par la DOPC.
Bien que composées de professionnels aguerris et entraînés, les unités de police ou de gendarmerie non spécialisées ne bénéficient pas, par essence, du même de degré de formation au maintien de l’ordre, ni du même équipement et ne suivent pas nécessairement les mêmes doctrines d’intervention. Le recours à la force par de telles unités peut donc susciter des interrogations. Sans méconnaître les difficultés et la complexité d’une opération de maintien de l’ordre, il s’avère que l’usage de moyens de contrainte dans ce cadre peut s’effectuer dans des conditions moins sécurisées que lorsqu’il est le fait d’unités spécialisées.
En effet, soit certaines unités non spécialisées mettent en œuvre des équipements dont ne sont pas dotées les unités mobiles (et qui, par construction, ne sont pas forcément adaptés dans une situation de maintien de l’ordre), soit la maîtrise de tels équipements dans le contexte d’une opération de maintien de l’ordre est moins assurée du fait de la spécificité de ce contexte, d’une moindre habitude et d’une formation moins spécialisée.
C’est ce dont témoignent les déclarations d’un certain nombre de personnes auditionnées par la commission, notamment les représentants de l’Assemblée des blessés, des familles et des collectifs contre les violences policières (145) ou encore le Défenseur des droits. Celui-ci a en effet affirmé que « Dans les dossiers liés à l’usage de la force et des armes, les unités non constituées, telles que les brigades anti-criminalité (BAC), me semblent davantage mises en cause que les formations spécialisées dans le maintien de l’ordre. Cette impression, qui ressort de l’examen des saisines du Défenseur des droits et de la CNDS [Commission nationale de déontologie de la sécurité], mérite l’attention d’une commission comme la vôtre. Les personnels ne sont pas formés de la même manière et leur action n’est pas encadrée par le même régime juridique : les unités spécialisées obéissent à des règles particulières alors que les unités non constituées relèvent du droit commun. » (146) Le Rapporteur reviendra plus en détail sur ce sujet à l’occasion de développements ultérieurs consacrés à ses préconisations.
B. DES NOUVEAUX TERRAINS DE CONTESTATIONS SOCIALES
Pour M. Pierre Tartakowsky, les violences structurées pour combattre l’ordre public lui-même constituent une des marques caractéristiques de la nouvelle contestation sociale : « Les nouveaux réseaux sociaux ont profondément bouleversé la donne. Certes, il y a toujours des manifestations de type classique, c’est-à-dire négociées avec les pouvoirs publics en amont, avec un rendez-vous précis fixé dans un lieu précis et, de façon implicite, limité dans le temps. Ces formes-là sont aujourd’hui, sinon concurrencées, du moins complétées par des formes plus fragmentées : manifestations décentralisées, qui peuvent avoir un impact extrêmement important sur la vie urbaine, mais aussi, et surtout, manifestations qui défient la légitimité du pouvoir public par l’occupation pérenne de zones, d’où la popularisation du terme de "zone à défendre". » (147).
En effet, les nouveaux conflits sociaux ne se distinguent pas seulement par une recomposition des acteurs, mais aussi par un déplacement de l’action vers de nouveaux lieux – davantage ruraux que par le passé – et de nouvelles méthodes illustrées par les fameuses « zones à défendre » (ZAD).
1. Le déplacement des manifestations vers des territoires ruraux ou de plus en plus étendus nécessite une évolution tactique
Les ZAD de Notre-Dame-des Landes et de Sivens ont constitué une part considérable de l’engagement des forces de maintien de l’ordre depuis 2013. Elles caractérisent, certes, une évolution des problématiques de notre société vers des enjeux associés à la sauvegarde de l’environnement, expliquant que des dossiers locaux et ruraux puissent aujourd’hui cristalliser des conflits sociaux. Cependant, ces ZAD illustrent également une évolution tendancielle des contestations sociales à se déplacer vers des espaces ruraux et ouverts, que les moyens modernes de communication permettent aux manifestants de couvrir avec peu de difficultés mais qui placent, à l’inverse, les forces de l’ordre devant une nécessaire évolution de leur mode d’intervention traditionnel.
Cette évolution a été ainsi résumée par le préfet honoraire Dominique Bur : « Les manifestations se déroulaient rarement en milieu rural. Quand les agriculteurs voulaient marquer leur présence, ils se déployaient en ville, souvent devant la préfecture ou l’hôtel de ville, ce qui pose peu de problèmes majeurs. L’espace urbain est clos par les habitations. On peut toujours fermer une rue et canaliser les manifestants. […] Il est très difficile de maintenir l’ordre dans le milieu rural, qui est très ouvert, et dans la durée. Peut-on même parler de manifestation pour désigner non le regroupement de personnes qui se réunissent un jour pour déposer des revendications à la préfecture ou à la mairie, mais l’attaque dans la durée – jour et nuit – de positions tenues par les forces de l’ordre ? » (148)
Le déplacement de la contestation vers des espaces ruraux pose deux grands types de difficultés nouvelles : d’une part, des difficultés d’ordre tactique pour les forces mobiles en raison des caractéristiques mêmes de la zone d’intervention ; d’autre part, des difficultés opérationnelles et juridiques tenant à l’installation et l’occupation dans la durée d’un espace que les forces de l’ordre doivent donc reconquérir.
a. Les problématiques de maintien de l’ordre en espaces ouverts et/ou multiples
Sur le plan tactique, les nouveaux terrains de contestation posent des problèmes de préparation et de manœuvre aux forces mobiles, mais rendent également plus complexe leur mobilisation.
En zone rurale, a fortiori lorsque le mouvement social précède le dispositif de maintien de l’ordre (cf. infra), les forces mobiles rencontrent des difficultés accrues à anticiper et préparer leur engagement. Le Commandant Christian Gomez, de la CRS 40 de Plombières-lès-Dijon, a livré à la commission (149) une illustration de ces difficultés tirée de son expérience : « Le cas de Notre-Dame-des-Landes présente des différences avec celui des manifestations de grande ampleur au cours desquelles nous avons l’habitude d’intervenir. Il n’est pas facile d’évaluer le nombre des personnes présentes sur les sites occupés, et l’intervention en pleine campagne rend difficile leur localisation. Les réunions préparatoires organisées par la gendarmerie et les dossiers fiables, complets et détaillés dont nous disposons atténuent toutefois les difficultés. Les indications topographiques et les clichés photographiques permettent d’évoluer dans de bonnes conditions de jour comme de nuit. Sur le théâtre d’opérations, l’adaptation de mon unité a pu être immédiate. »
En outre, l’espace rural impose aux unités chargées du maintien de l’ordre un réexamen des tactiques et manœuvres utilisées. Selon le général Bertrand Cavallier (150), « les situations sont de plus en plus complexes, notamment en matière de maintien de l’ordre rural, l’un des plus exigeants en raison du fait qu’il nécessite d’intervenir sur un terrain ouvert, non compartimenté, et de faire face à un adversaire extrêmement mobile. » La description de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes et des missions qui s’y sont déroulées, fournie par le Lieutenant-colonel Emmanuel Gerber (151), du groupement III/3 de gendarmerie mobile de Nantes illustre également ces problématiques tactiques :
« Le projet d’aéroport à Notre-Dame-des-Landes vise une zone occupée par cinq communes, à vingt kilomètres au nord-ouest de Nantes. Cette zone, qui s’étend sur vingt kilomètres en longueur et cinq en largeur, est essentiellement constituée de bocages et de bois. Elle est desservie par de petites routes départementales et des chemins. Cette topographie ne facilite pas l’action des forces de l’ordre, mais, à l’inverse, offre un cadre propice aux opposants. Au cours des opérations menées d’octobre 2012 à avril 2013, nous avons pu identifier, parmi eux, trois types essentiels : les quelque 200 radicaux qui, ignorant les décisions de l’État et rejetant toutes les valeurs, se montrent d’une grande violence qui s’accroît encore ; les associations, notamment d’agriculteurs, qui, même s’ils peuvent aussi faire preuve de violence et freiner l’action des forces de l’ordre, ne sont pas les plus virulents ; les "Robin de bois", autrement dit des défenseurs de l’environnement, retranchés dans des constructions en bois dans les arbres, ce qui ne facilitait pas non plus notre tâche. Le climat humide la rendait plus difficile encore, de même que sa durée, qui nous a cependant permis de mener à bien l’ensemble de nos missions. »
Enfin, certaines nouvelles formes de contestation sur sites multiples posent des difficultés d’engagement aux forces mobiles. Le mouvement dit « des bonnets rouges » a illustré ces nouvelles difficultés. Ainsi, le 5 janvier 2014, une opération a consisté en la mobilisation simultanée de plusieurs centaines de personnes pour bloquer quinze ponts du Finistère, vingt-six ponts dans les Côtes-d’Armor, onze ponts dans le Morbihan, dix ponts en Ille-et-Vilaine et cinq ponts en Loire-Atlantique. De telles formes de contestation, qui nécessitent à l’évidence des opérations de rétablissement de l’ordre républicain, demandent aux autorités civiles une capacité à se projeter rapidement en de nombreux lieux avec des forces de maintien de l’ordre en effectif suffisant. Elles interdisent le recours au processus habituel de concentration d’unités mobiles sur le lieu de contestation et entraînent au contraire un recours accru à des unités non spécialisées pour accomplir des missions de rétablissement de l’ordre.
b. L’intervention des forces de l’ordre sur des terrains aménagés et occupés par les manifestants.
Les ZAD posent une seconde série de difficultés en termes de maintien de l’ordre, qui sont d’ailleurs explicitement recherchées par le recours à ce mode de contestation, et tiennent au fait que celle-ci précède généralement de beaucoup non seulement les réelles manifestations, mais aussi l’intervention des forces de l’ordre. Cette préemption du terrain, ainsi que son occupation dans la durée, instaurent des conditions nouvelles de rétablissement de l’ordre, notamment décrites par le ministre de l’Intérieur lors de son audition (152) : « Il est difficile d’en déloger les occupants illégaux, disséminés sur de vastes terrains, souvent accidentés, situés en pleine nature, pour faire respecter les décisions de justice. Les plus déterminés d’entre eux se sont préparés de façon méthodique à résister à l’intervention des forces de sécurité, en leur tendant toutes sortes de pièges. Ils savent tirer parti de la présence, ponctuelle ou durable, de manifestants ou de sympathisants non-violents, parmi lesquels des femmes et des enfants. Cette situation crée pour les forces de l’ordre des conditions d’intervention très différentes de celles qu’elles connaissent lors des manifestations en centre-ville ou des émeutes urbaines. »
Les lieutenants-colonels Emmanuel Gerber et Stéphane Fauvelet, qui ont commandé à Notre-Dame-des-Landes, ont précisé ces modes d’action rendus possibles par une occupation longue et préalable de la zone par les protestataires. Selon le lieutenant-colonel Emmanuel Gerber, « les manifestants étaient parfaitement organisés, commandés, disposaient d’un réseau de téléphones et avaient même piraté certaines fréquences radio : cela nous a d’ailleurs permis d’écouter leurs échanges, de contrecarrer leurs manœuvres de harcèlement et – n’ayons pas peur des mots – de guérilla. En effet, quand les opérations se prolongent, les opposants s’organisent, durcissent leurs positions et optent pour des modes d’action très proches de la guérilla, le stade ultime étant celui de la victimisation : à Notre-Dame-des-Landes, certains, parmi les opposants les plus radicaux, n’avaient qu’un leitmotiv, obtenir une victime. » Le lieutenant-colonel Stéphane Fauvelet a dit aussi avoir « eu à traiter non seulement avec des agriculteurs, mais aussi, dans les landes de Rohanne, avec des familles – au sein desquelles on voyait des enfants dans des poussettes –, des élus et des riverains. Juste derrière ces manifestants étaient positionnés des groupes radicaux, reconnaissables à leurs équipements, leurs cagoules et leurs casques. »
Le Rapporteur retient des nombreux témoignages et documents reçus que l’occupation durable des ZAD par les protestataires entraîne une préparation accrue de leur part qui complexifie les opérations ultérieures de rétablissement de l’ordre républicain. Cette difficulté ne tient d’ailleurs que marginalement à la construction de cabanes dans les arbres, lesquelles sont loin de résumer le degré de préparation de certains zadistes et leur état d’esprit, contrairement à ce que certaines présentations « bon enfant » de ces zones voudraient faire accroire. Du point de vue du rétablissement de l’ordre républicain, qui ne peut manquer d’intervenir compte tenu du caractère illégal de telles occupations (cf. infra) et qui est fortement anticipé par les minorités radicales présentes sur les ZAD, ce délai de préparation et d’installation des zadistes se traduit surtout par la mise en place d’un arsenal dangereux.
Le directeur général de la gendarmerie nationale a évoqué cet aspect lors de son audition : « nous faisons face à une opposition nouvelle, avec des gens implantés sur un territoire qu’ils défendent selon des modes d’action que nous ne connaissions pas. […] Nous avons été confrontés à des situations de blocage très tendues. L’engagement avec les forces de l’ordre est préparé par les manifestants qui utilisent non seulement des moyens passifs pour empêcher ces dernières d’agir, mais aussi des moyens offensifs – si ce n’est des jets d’acide, en tout cas des cocktails Molotov ou des bouteilles incendiaires de nature plus explosive. » Les matériels et documents saisis par les forces mobiles et les pièces fournies au Rapporteur, notamment par la gendarmerie nationale, attestent de ce degré de violence accru, rendu possible par la durée de l’installation préalable des zadistes.
Sur le plan défensif, la durée de l’occupation de la ZAD permet aux occupants de ne pas s’en tenir aux simples barricades construites rapidement pour freiner la manœuvre des forces de l’ordre. Celles de la ZAD sont régulièrement dotées de mécanismes incendiaires conçus pour blesser gravement les forces de l’ordre lors des franchissements. Le terrain est parfois piégé au moyen d’engins explosifs. Certains de ces engins ont nécessité l’intervention des démineurs, à l’image de cette bouteille de gaz surmontée d’une pancarte « Une explosion = 10 flics » – sans que l’on sache si une telle indication traduisait une réelle volonté d’attenter à l’intégrité physique des forces de l’ordre, ou si elle avait uniquement pour but de produire un effet psychologique sur celles-ci et de les retarder le temps de neutraliser un engin a priori dangereux. En tout état de cause, si certains manifestants n’ont pas la volonté de blesser grièvement, telle peut être la conséquence de l’utilisation d’armes par nature ou par destination.
EXEMPLE D’ENGIN EXPLOSIF ARTISANAL SUR LE SITE DE SIVENS

Source : direction générale de la gendarmerie nationale
Sur le plan offensif, l’occupation des ZAD dans la durée (conjuguée à la convergence sur ces lieux d’individus spécialisés dans l’affrontement) permet aux contestataires de concevoir et de produire un arsenal potentiellement mortel inquiétant, principalement composé de divers engins explosifs et incendiaires. Selon la direction générale de la gendarmerie nationale, déjà lors des affrontements à Notre-Dame-des-Landes, il avait été constaté une certaine maîtrise de la fabrication d’engins incendiaires par certains occupants de la ZAD (153). Or, plusieurs éléments recueillis par les unités du groupement de gendarmerie départementale du Tarn confirment que cette expertise s’est déplacée sur la ZAD de Sivens, où deux manuels de fabrication différents ont été découverts. Le premier a été trouvé le 14 mai 2014 lors de l’expulsion de la Métairie neuve à Lisle-sur-Tarn (81). Le second a été découvert sur le chemin de la Jasse à Lisle-sur-Tarn (81) lors d’une reconnaissance d’axe menée le 29 septembre 2014 par les gendarmes mobiles pour permettre le passage des camions du chantier. Ce second manuel se décompose en 8 chapitres : préparatifs, utilitaires (mèche, rallonge de mèche, détonateur...) ; produits chimiques (nitrate de potassium, acide sulfurique...) ; produits explosifs (poudre noire, chlorate de soude, TNT...) ; fumigènes ; produits incendiaires (napalm, thermites...) ; bombes (bombe tuyau, bombe au chlore …) ; bombes B.S « pour amuser les enfants ».
Outre la découverte de manuels de fabrication d’explosifs et de matériaux de fabrication, les gendarmes ont constaté l’usage de bouteilles remplies d’un mélange d’acide et d’aluminium, de fusées, de cocktail Molotov, de bouteilles de gaz, de lanceurs de type « patator » et ce qui s’apparente à des engins explosifs artisanaux. De nombreuses images et vidéos, captées tant par les forces de l’ordre en opération que par les occupants de la ZAD eux-mêmes, attestent de la réalité et de l’emploi de ces arsenaux explosifs et incendiaires à l’encontre des forces de sécurité, comme le montrent les trois clichés suivants extraits d’une vidéo visible sur Internet :
EXEMPLE D’UTILISATION D’ENGINS INCENDIAIRES CONTRE LES FORCES DE L’ORDRE SUR LE SITE DE SIVENS

Explosion d’un engin incendiaire aux pieds des gendarmes mobiles

Dispersion sur les militaires du liquide enflammé

Certains militaires ont pris feu.
Source : direction générale de la gendarmerie nationale.
2. Le phénomène des zones à défendre (ZAD) : des infractions causant davantage de préjudice à autrui qu’elles ne troublent l’ordre public
Une ZAD consiste en une occupation illégale de parcelles de terrain, appartenant à des personnes publiques ou privées, qui a pour effet ou pour but de rendre impossible la conduite d’un projet ou d’un ouvrage implanté en tout ou partie sur lesdites parcelles. Cette méthode de contestation est une version à grande échelle spatiale et temporelle du barrage humain ou cordon de protection : elle impose à l’État républicain de s’assurer d’abord en toute sécurité des personnes s’étant mises (illégalement) en danger avant de pouvoir conduire son projet.
Cependant, idéologiquement, la ZAD est aussi une source de multiples confusions, que les travaux de la commission permettent au Rapporteur de clarifier ici. En premier lieu, quoique présentée parfois comme une société miniature ou un laboratoire démocratique, une ZAD est d’abord construite sur une violation du droit de propriété et ne peut perdurer qu’au mépris des injonctions administratives et des décisions de justice. En second lieu, considérer qu’une ZAD est une forme d’espace permanent de trouble à l’ordre public impliquant son rétablissement ne serait pas exact : l’essentiel des opérations de sécurité qui y sont conduites visent à mettre fin à la commission d’infractions causant des préjudices à des personnes physiques et/ou morales, lesquelles réclament légitimement justice.
a. L’installation d’une ZAD est en soi un acte délictueux, mais ne constitue pas par elle-même un trouble à l’ordre public
Au plan juridique, l’installation d’une ZAD constitue en elle-même un délit au sens où elle porte atteinte au droit de propriété et à certaines libertés garanties. Toutefois, elle ne trouble pas par elle-même l’ordre public, son statut de « lieu public » demeurant incertain.
● La ZAD constitue un délit causant un préjudice à une personne publique ou privée.
La notion de ZAD recouvre une réalité qui n’est pas juridiquement ambiguë, ni inconnue ou nouvelle. Le « zadiste », au sens d’une personne installée pour une longue durée sur un terrain ou un bâtiment proche d’un projet d’aménagement, peut être qualifié d’occupant sans droit ni titre d’une propriété publique ou privée. C’est sur ce fondement que des procédures d’expulsion sont menées, comme par exemple celle ordonnée le 16 février 2015 par un jugement du tribunal de grande instance d’Albi à l’égard des occupants de la Métairie neuve de la ZAD du Testet.
Quelle que soit la communication organisée sur son caractère politiquement expérimental ou encore sur les vertus de la proximité avec l’environnement, une ZAD est une méthode de revendication politique par l’occupation illicite d’un bien immeuble appartenant à autrui, c’est-à-dire une action bafouant les droits et libertés fondamentaux. Formellement, elle n’est guère éloignée des occupations illégales d’appartements en zone urbaine, et elle est constitutive du délit d’installation en réunion, en vue d’y établir une habitation, même temporaire, sur un terrain appartenant à autrui, prévu à l’article 322-4-1 du code pénal (154).
Cette interprétation est conforme à la circulaire de la Chancellerie du 20 mars 2003 prise en application de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure : « Cette nouvelle disposition tend à répondre aux trop nombreux comportements irréguliers commis par des groupes d’individus qui, sans droit ni titre, au mépris du respect de la propriété privée, décident d’établir sur des terrains communaux ou privés des campements qui peuvent, de surcroît, sur le plan sanitaire ou de la sécurité des personnes constituer de réels dangers ».
Compte tenu de ces éléments, et dès son installation, les autorités doivent faire en sorte que la ZAD s’achève, non pour rétablir l’ordre public, mais afin que cessent l’infraction et le préjudice civil.
● Certains comportements sur une ZAD peuvent troubler l’ordre public, mais ne peuvent être qualifiés d’attroupements au sens du code de la sécurité intérieure.
Quel que soit le statut domanial des parcelles investies par les zadistes, certains cas de troubles manifestes à l’ordre public de nature sanitaire ou tenant à la sécurité des personnes présentes peuvent justifier une intervention de l’État afin de rétablir l’ordre : violences, dégradations, atteintes à la tranquillité publique, risques d’incendie, risques d’épidémie, etc. (155). Hormis dans ces cas plutôt rares, une ZAD trouble-t-elle l’ordre public ?
Le but de la ZAD est d’empêcher la réalisation d’un projet ou d’un aménagement public. La question posée à l’État par le phénomène des ZAD est donc de savoir si l’interposition de ses occupants afin d’entraver les projets concernés (qui est constitutive d’un délit, cf. infra) peut, ou non, être regardée comme un trouble à l’ordre public.
Il n’est pas juridiquement certain que cette action contestataire, y compris sous forme de manifestations spontanées, puisse être considérée comme un trouble à l’ordre public soumis au régime de l’attroupement et donner lieu à une dispersion pure et simple.
En effet, l’article 431-3 du code pénal définit l’attroupement comme le risque à la survenance d’un trouble à l’ordre public « sur la voie publique ou dans un lieu public ». Ce dernier terme fait l’objet d’une interprétation relativement large de la part de la jurisprudence. Peuvent ainsi être considérés comme des « lieux publics » au sens de cet article certains lieux privés ouverts au public, voire des lieux purement privés qui, dans certaines circonstances, sont rendus accessibles à des tiers. Des lieux sont ainsi qualifiés de publics en raison de leur nature ou de leur destination. Ainsi, une petite cour intérieure d’un hôpital où à différentes heures la circulation est possible a été qualifiée de lieu public (Cass. crim. 4 mai 1935, DH 1935.349), de même que la terrasse d’un restaurant (Cass. crim. 15 mars 1983, Bull. crim., no 82).
Les ZAD sont généralement des propriétés privées ou des dépendances appartenant à une personne publique mais non affectées à l’usage direct du public (emprise d’un projet d’aménagement en cours de réalisation) qui n’entrent pas par définition dans le champ du « lieu public » au sens de l’article 431-3, sauf en cas d’ouverture spécifique au public.
M. Thomas Andrieu, directeur des libertés publiques et des affaires juridiques au ministère de l’Intérieur, a indiqué devant la commission (156) : « L’occupation de vastes terrains privés sur lesquels séjournent des personnes s’opposant à l’action de la puissance publique suscite plusieurs interrogations. Est-on totalement démuni au regard de l’application du cadre juridique de l’attroupement ? Non, car l’attroupement se déroule sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public, notion qui peut inclure les vastes terrains privés dont l’accès est assez facile. Seul le juge pénal est compétent pour trancher cette question, mais celle-ci ne me semble pas fermée. »
b. Une confusion grandissante entre les opérations de sécurité classique et les opérations de rétablissement de l’ordre face à des attroupements hostiles
Le Rapporteur note donc une confusion croissante dans les propos et analyses relatifs aux ZAD en général et à celle du Testet en particulier (avant son évacuation). Il relève notamment qu’une partie de l’opinion publique a tendance à considérer que la ZAD serait une longue manifestation, certes d’un genre nouveau, mais soumise au régime classique de l’expression des revendications sur la voie publique.
Au contraire, il rappelle qu’en principe l’intervention des forces de l’ordre sur ces terrains ne constitue pas initialement une opération de maintien ou de rétablissement de l’ordre républicain. Elle peut avoir trois fondements distincts.
● Premièrement, les forces de l’ordre peuvent concourir à l’exécution d’une décision de justice ordonnant l’évacuation des lieux. Ces décisions judiciaires résultent d’une procédure très formalisée (mobilisation du propriétaire, identification de la parcelle concernée, identification des occupants sans titre, respect de la trêve hivernale, etc.) souvent peu adaptée aux pratiques des zadistes. En effet, il n’est pas rare que les zadistes modifient l’emprise de leur installation pour précisément faire échec à l’exécution des décisions de justice. Mme Françoise Mathe, présidente de la commission « Libertés publiques et droits de l’homme » du Conseil national des barreaux, a rappelé lors de son audition (157) le régime de protection qui s’attache au logement : « Une ordonnance est nécessaire pour expulser une personne d’un local dès lors que celle-ci en a fait son logement, si précaire soit-il. Je comprends que l’on puisse être heurté par l’idée que des occupants sans titre se plaignent que leurs propres biens aient été détruits et détériorés, mais c’est la règle générale en matière de logement illégal. Pour expulser des squatters, il faut une décision judiciaire. Aussi longtemps qu’il n’y en a pas, le domicile, même fixé en violation du droit à la propriété d’autrui, est inviolable. Cela ne concerne pas spécifiquement les ZAD, mais le problème plus général de l’équilibre entre la protection de la propriété privée et le droit au domicile ou au logement. »
● Deuxièmement, les forces de l’ordre peuvent également intervenir dans une ZAD pour faire cesser un crime ou un délit flagrant (ou porter assistance à une personne en danger). Outre le délit d’occupation illicite d’un terrain en réunion précédemment mentionné, l’action des activistes présents sur une ZAD est le plus souvent également constitutive du délit d’opposition à l’exécution d’un travail public prévu à l’article 433-11 du code pénal.
● Troisièmement, des manifestations de caractère plus classique se déroulent parfois de manière ponctuelle sur le site d’une ZAD, en soutien ou en opposition au mouvement, avec un tel risque de confrontation entre les deux parties opposées sur le projet qu’il nécessite l’interposition des forces de l’ordre.
Par conséquent, si les motifs d’intervention des forces de l’ordre dans la ZAD ne manquent pas, y compris pour en expulser certains occupants, ils ne sont guidés par le souci de l’ordre public que dans un second temps : après une tentative de faire exécuter une décision de justice ou de faire cesser un délit flagrant.
Il ne faut donc pas regarder l’existence d’une ZAD comme une unique et vaste opération de maintien de l’ordre. Il semble plus proche de la réalité, y compris au regard des unités de police et de gendarmerie mobilisées, de relever que, sur une ZAD, se succèdent des opérations de sécurisation voire de police judiciaire classique, d’une part, et, parfois, des opérations de maintien de l’ordre, d’autre part, lorsque l’attroupement des activistes fait violemment échec aux premières.
C. L’ASSIGNATION DE NOUVEAUX OBJECTIFS AUX FORCES DE L’ORDRE, ASSOCIÉE À LA MÉDIATISATION CROISSANTE DES ENJEUX DE SECURITÉ, BROUILLE LA NOTION MÊME DE RÉTABLISSEMENT DE L’ORDRE PUBLIC
1. La médiatisation renforce les enjeux associés aux conflits sociaux et aux opérations de maintien de l’ordre
La médiatisation des conflits sociaux est utile et, en tout état de cause, incontournable dans un monde hyper connecté. C’est tout naturellement qu’elle fait naître une attention accrue aux troubles à l’ordre public et aux opérations visant à le maintenir ou le rétablir.
L’ensemble des acteurs est confronté à ce phénomène. Cette médiatisation constitue souvent un élément de complexité supplémentaire pour le pouvoir politique et les forces de l’ordre, dont elle accroît la mise en cause de l’action, jugée alternativement – ou simultanément – trop sévère ou trop laxiste. Les manifestants font face à des difficultés similaires. Les actes de violence perpétrés par certains individus faisant l’objet d’une exposition plus rapide et plus massive ils sont, de ce fait, susceptibles de délégitimer l’action et les modalités d’expression de la majorité des manifestants pacifiques. Cette conscience d’une sensibilité sociale plus grande à la violence entraîne, pour les éléments les plus déterminés ou les plus radicaux, la multiplication de tentatives visant à contrôler l’information délivrée par les médias classiques, voire le recours à des actes de contrainte et même de violence qui rendent nécessaire une protection des professionnels de l’information par les forces de l’ordre.
a. Une tolérance moins grande à une violence déployée par certains manifestants et davantage exposée
Les processus d’exclusion progressive et de rejet social de la violence privée, de monopolisation de la contrainte physique légitime par la puissance publique et de pacification sociale ont fait l’objet d’analyses portées par de nombreux penseurs et universitaires – notamment Max Weber (158) et Norbert Elias (159) pour ne citer que les pères de ces champs de recherche.
La plus grande couverture des désordres publics par les médias traditionnels et les nouveaux modes de communication – réseaux sociaux notamment – font ressurgir dans l’espace social, de manière quasi-instantanée et répétée des actes de violence parfois extrêmes qui heurtent la sensibilité collective d’une société devenue moins tolérante à leur égard. Comme le résume le directeur général de la police nationale, « Dans leur expression violente, ces nouvelles formes de contestation bénéficient d’une couverture médiatique considérable, qui les rend encore moins acceptables par l’opinion publique » (160).
La violence constatée à l’occasion d’événements de voie publique est-elle plus importante qu’elle ne l’était par le passé ou est-elle simplement plus connue car plus visible et plus médiatisée ? Cette question et les réponses qui y ont été apportées par les différentes personnes auditionnées ont été régulièrement abordées au cours des travaux de la commission d’enquête.
Si, pour M. Bertrand Cavallier, « nous sommes entrés dans une nouvelle ère, celle de la "violence globale" […] notre société [ayant] adopté une culture de la violence » (161), pour M. Cédric Moreau de Bellaing, « […] la France a connu des épisodes qui peuvent "concurrencer" sans trop de difficulté ce qui s’est passé à Sivens […] si violent que cet épisode ait pu être, cette violence reste très en deçà de ce que connaissent certains des pays voisins comme la Grèce ou l’Allemagne. » (162) Sans remonter aux grandes grèves ouvrières de la fin du XIXe siècle, il a assuré que « En ce qui concerne le caractère plus violent des manifestants auxquels font face les forces de l’ordre, d’un point de vue sociologique, cela reste à voir : la violence des grandes manifestations de 1947-1948, de celles – des viticulteurs – de 1950 ou de celle – de Creys-Malville – de 1977, n’avait rien à envier à la violence des manifestations d’aujourd’hui. » (163)
b. Des relations plus compliquées entre la presse et certains manifestants dans la production de l’information, qui rendent nécessaire une protection plus importante de la part des forces de l’ordre
L’article XI de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen dispose que « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme ; tout citoyen peut donc parler, écrire et imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. ». Il trace ainsi le cadre dans lequel s’inscrivent la liberté de la presse et de la communication audiovisuelle.
Il est intéressant de noter que les libertés de réunion et de manifestation ne sont pas expressément mentionnées, mais découlent de ce même principe de libre communication des pensées et des opinions. On peut considérer que ceux qui s’en prennent aux journalistes à l’occasion de manifestations s’en prennent aussi, indirectement, à la liberté qu’ils exercent et qu’ils dénient aux médias cette même liberté qu’ils revendiquent pour eux-mêmes.
Au regard de cette consécration constitutionnelle sans ambiguïté, il apparaît essentiel que les professionnels des médias puissent exercer leur activité et remplir leur fonction sans entraves, en dépit des circonstances parfois peu favorables dans le cadre de manifestations donnant lieu à des opérations de maintien de l’ordre.
Les journalistes peuvent d’abord se voir empêchés – voire davantage – par les forces de l’ordre. Lors de son audition M. Christophe Deloire, directeur général de Reporters sans frontières France, a ainsi fait état de plusieurs problèmes ayant impliqué des membres des forces de l’ordre (sans qu’il soit possible de déterminer s’il s’agissait de membres des forces mobiles ou d’autres formations) : un journaliste violenté à Albi lors d’une action de protestation contre la destruction de la zone humide du Testet ou encore la retenue de plusieurs journalistes à un barrage de police leur interdisant ainsi l’accès à un site (164). De tels comportements sont évidemment inacceptables et doivent faire l’objet des mesures qui s’imposent.
Pour autant, selon M. Deloire, le comportement des forces de l’ordre « […] n’est pas le problème le plus crucial pour les journalistes qui couvrent les manifestations », celui-ci étant « considéré de manière favorable » (165) par les journalistes interrogés par l’association.
En revanche, « […] bien plus graves sont les comportements des manifestants, ou groupes de manifestants à l’égard des journalistes », ceux-ci « [étant] attaqués de toutes parts, et leur rôle de plus en plus contesté par des gens qui estiment pouvoir se passer d’eux grâce aux nouvelles technologies » (166).
D’après le directeur général de RSF France, il semble que certains individus nourrissent une défiance de principe à l’égard des médias traditionnels, estimant que les faits et analyses délivrés par les professionnels de l’information étrangers à leur cause sont forcément biaisés et désirant, de ce fait, contrôler la production et la diffusion de cette information en empêchant le travail journalistique et en ne fournissant que les éléments choisis par eux-mêmes. Les professionnels du maintien de l’ordre formulent un constat analogue, à l’image de M. Pierre-Marc Fergelot, représentant du Syndicat indépendant des commissaires de police : « Cette violence [exercée par certains manifestants] se banalise car elle s’appuie sur une manipulation de l’image et de l’information, qui passe parfois par l’agression de journalistes. » (167)
Cette volonté de contrôle de l’information, qui peut parfois basculer dans la désinformation pure et simple, s’exerce également à l’encontre de l’action menée par les forces de l’ordre. M. Cyrille Robert, représentant de l’association Gend XXI en a fourni un exemple éclairant à la commission : « À Sivens, un même compartiment de terrain était filmé pendant des heures, montrant des personnes déguisées en clowns, ou ostensiblement sympathiques, femmes, adolescents, nous parlant, nous expliquant pourquoi elles étaient là. Puis, ces personnes s’éloignaient et nous étions alors violemment harcelés par des groupes d’individus conduits par des chefs. La riposte des forces de l’ordre était filmée, mais non l’attaque qu’elles venaient de subir. Cela se passe de la même manière dans d’autres types de manifestations. » (168)
Ainsi qu’en témoignent les exemples évoqués par M. Deloire, l’hostilité de certains manifestants à l’égard des journalistes prend des formes diverses allant de l’intimidation à l’agression caractérisée, en passant par la détérioration de leur matériel. Au-delà des problèmes rencontrés aux abords de Sivens, celui-ci a particulièrement évoqué le cas des manifestations contre le mariage pour tous qui semblent avoir donné lieu à plusieurs débordements. Ainsi, « En avril 2013, alors que le projet de loi était en cours d’examen dans l’hémicycle, deux journalistes de La Chaîne parlementaire Assemblée nationale (LCP) ont été agressés et leur matériel a été détérioré. Quelques jours plus tard, à Rennes, des manifestants anti-mariage pour tous ont attaqué deux journalistes de Rennes TV. Le 26 mai, un journaliste de l’Agence France-Presse a été jeté à terre et roué de coups, en marge de la manifestation. Plus tard, des reporters du Petit Journal, qualifiés de collabos, ont reçu des coups de pied, des coups de poing et des cannettes. » (169)
Autre exemple, les manifestations de l’été 2014 relatives au conflit au Proche-Orient ont vu un photographe de l’AFP « violemment frappé dans le dos par un individu, au point d’avoir l’épaule fracturée et de rester en arrêt de travail pendant vingt et un jours » (170).
Face à de tels agissements, les forces de l’ordre présentes sur les lieux ne restent pas inactives et ont vocation à protéger les professionnels des médias. Comme le soulignait le lieutenant-colonel Gerber, « Lorsqu’une équipe de l’Agence France presse, lorsque des médias nationaux ou internationaux sont présents sur le terrain, il nous faut mettre à leur dispositif une équipe de protection […] » (171). En la matière, la communication en amont entre journalistes et forces de l’ordre est primordiale, afin de permettre aux premiers de faire leur travail dans des conditions de sécurité acceptables. Il ne s’agit évidemment pas de contrôler l’action des professionnels de l’information, mais « si les journalistes ont signalé leur présence, les CRS pourront intervenir plus facilement en cas d’affrontements violents. » (172)
2. La recherche d’une réponse pénale adaptée aux agissements individuels a complexifié les opérations de maintien de l’ordre
a. Une plus grande préoccupation de la sanction pénale des manifestants les plus violents ou délinquants
Les actes de violence sont de moins en moins tolérés socialement. D’une part, le processus de pacification progressive des sociétés démocratiques contemporaines a accru leur sensibilité en la matière. D’autre part, cette sensibilité est exacerbée par une médiatisation croissante, continue et perpétuellement renouvelée des phénomènes violents et délinquants qui nourrit a minima un sentiment – si ce n’est une réalité – de progression statistique de tels actes et d’accroissement de la radicalité.
Au-delà des débordements « classiques » – saccage du mobilier urbain, de commerces, atteintes aux biens (détérioration de véhicules par exemple), etc. – il est toutefois certain qu’une nouvelle violence se déploie et se voit. Ainsi, d’après la direction générale de la gendarmerie nationale, outre les éléments « traditionnels » que constituent par exemple les cocktails Molotov ou l’utilisation d’armes de fortune, dont le nom et la vocation première peuvent prêter à sourire (173), des manuels retrouvés sur le site de Sivens contenaient toutes les indications nécessaires pour procéder à la fabrication d’engins incendiaires ou d’explosifs. Des bouteilles de gaz ont également été utilisées afin de piéger les axes ou les barricades (cf. supra).
Qu’ils soient plus nombreux, simplement plus visibles ou qu’ils soient à la fois en progression et mieux connus, les actes de délinquance et de violence sont par nature répréhensibles, dès lors qu’ils sont constitutifs d’une infraction prévue par la loi et condamnables sur ce même fondement. En ce sens et dans cette hypothèse, la demande sociale, mais également politique, d’une réponse pénale plus systématique à ce type de comportements est non seulement compréhensible, mais totalement légitime.
Pour le préfet de police de Paris Bernard Boucault, les schémas classiques d’intervention des EGM et des CRS ne sont pas adaptés, dès lors que des exactions sont commises à l’intérieur ou en marge de rassemblements. L’organisation opérationnelle et l’emploi traditionnel des forces mobiles n’apporte qu’une réponse partielle à de tels actes (174). Des unités et des dispositifs ont donc été créés, afin de répondre à ce nouvel impératif opérationnel, dont le déploiement n’est pas sans susciter des interrogations.
b. La mise en place de dispositifs qui contribuent à brouiller la notion même de maintien de l’ordre
Au-delà des manœuvres opérées par les formations spécialisées des unités mobiles spécialistes du maintien de l’ordre – pelotons d’intervention des EGM et sections de protection et d’intervention des CRS – afin de procéder à des interpellations, des dispositifs spécifiques ont été mis en place, qui peuvent contribuer à brouiller la notion de maintien de l’ordre dans son acception classique. En effet, le maintien ou le rétablissement de l’ordre qui suppose « simplement » de faire cesser les troubles et de permettre un retour à la normale et la répression active de faits délictueux à des fins de pénalisation constituent deux opérations différentes quant à leur nature, leurs objectifs et leurs modalités de réalisation.
D’après le préfet de police de Paris, il existe trois difficultés principales relatives à l’emploi des unités de la réserve nationale pour des opérations de répression des infractions et violences (175) :
– les EGM et CRS ne peuvent être fractionnés en deçà du demi-escadron ou de la demi-compagnie, ce qui ne facilite pas leur emploi pour traiter les comportements délictueux commis par des groupes détachés ou très mobiles ;
– très efficaces en maintien de l’ordre « classique », ces unités sont moins adaptées pour la gestion des phénomènes de violence urbaine, ce qui rendrait plus compliquée la réversibilité de leur mission ;
– enfin, les conditions dans lesquelles s’effectuent les éventuelles interpellations ne permettent pas toujours un traitement procédural conforme aux attentes et aux exigences de l’autorité judiciaire.
La préfecture de police de Police a donc mis en place un dispositif opérationnel original reposant à titre principal sur les sept compagnies d’intervention (CI) de la DOPC. Leurs agents sont susceptibles d’intervenir en tenue comme en civil et peuvent passer de l’une à l’autre au cours d’une même vacation en fonction des besoins. Les CI se caractérisent par leur modularité et leur souplesse d’emploi, ainsi que par une sécabilité plus grande que les EGM et les CRS. Ainsi la compagnie peut se scinder en section, en groupe et en demi-groupe, les différents éléments d’une même CI pouvant être combinés avec les composantes d’autres CI. Les unités peuvent aussi être composées d’effectifs mixtes regroupant à la fois des agents en tenue et des agents en civil afin, selon le préfet de police de Paris, de « répondre dans la même séquence de temps à l’évolution de la manifestation et [de] faire face aux groupes de casseurs et fauteurs de troubles de tous acabits » (176).
Ce soutien des forces de maintien de l’ordre par des forces de sécurité publique générale est régulièrement mis en œuvre, notamment pour la gestion des événements de voie publique de grande envergure. Il n’est pas réservé à la capitale, ainsi que l’a confirmé le directeur général de la police nationale en évoquant les exemples de Toulouse et Nantes, où des unités en civil ont été déployées en marge des cortèges à des fins d’éventuelles interpellations (177). D’après les informations recueillies par la commission, les brigades anti-criminalité (BAC) sont souvent sollicitées à cet égard.
Toutefois, la coordination des différentes unités et le respect du schéma tactique d’ensemble peuvent s’avérer problématiques dès lors qu’interviennent, de concert, des unités spécialisées dans le maintien de l’ordre et d’autres qui ne le sont pas. C’est ce qu’a souligné M. Éric Mildenberger : « La question des interpellations est à rapprocher de celle, plus générale, de la coordination sur un même théâtre d’opérations, entre unités spécialisées dans le maintien de l’ordre et unités non spécialisées. La vocation des CRS n’est pas aujourd’hui de procéder à des interpellations, même si nous en avons les moyens lorsqu’il s’agit de neutraliser des meneurs. Lors des événements de Nantes, en février 2014, sont intervenues ensemble les CRS, les CDI – compagnies départementales d’intervention –, la BAC – brigade anti-criminalité – et les gendarmes mobiles, ce qui a engendré des problèmes de coordination dans les manœuvres et nous a mis en difficulté. Je persiste donc à penser que le maintien de l’ordre doit être prioritairement confié, en particulier dans des opérations de grande envergure et face à des manifestations qui peuvent dégénérer, aux unités mobiles spécialisées, CRS et gendarmes. » (178)
De fait, même si elles peuvent être complémentaires, la notion de maintien de l’ordre stricto sensu et la notion d’interpellation obéissent à des schémas tactiques, des manœuvres, des postures opérationnelles distinctes et à des temporalités différentes. Elles relèvent de « philosophies » spécifiques – d’un côté la gestion du collectif (la foule) par un collectif (l’EGM ou la CRS) ; de l’autre une individualisation du rapport manifestant/police avec des unités légères, tant dans l’équipement que dans la composition, interpellant des individus identifiés. Elles requièrent des qualités différentes de la part des agents qui les mettent en œuvre. En outre, les unités interpellatrices participant à une opération ne sont pas placées sous l’autorité des forces mobiles et relèvent de leur autorité de référence (par exemple le directeur départemental de la sécurité publique ou son représentant), une situation qui peut s’avérer problématique pour la coordination d’ensemble de forces ne partageant pas forcément les mêmes priorités ni les mêmes contraintes opérationnelles.
Les dispositifs mixtes et les unités mixtes ont évidemment leur utilité, les interpellations effectuées par ces unités non spécialisées dans le maintien de l’ordre (telles les BAC) ou moins spécialisées que les forces mobiles (les CI) contribuant également au rétablissement de l’ordre public dès lors que, par « extraction » et par neutralisation des éléments perturbateurs, elles participent à la cessation des troubles.
Pour autant, leur mise en place peut brouiller la notion de maintien de l’ordre :
– en perturbant le schéma tactique d’ensemble dont la finalité première est la gestion apaisée de foules dans une logique collective et non l’interpellation menée dans une logique d’individualisation, une telle opération ne garantissant en outre pas une désescalade automatique des troubles (179) ;
– en créant de la confusion aux yeux de l’opinion publique sur l’action et la vocation des forces de police en opération de maintien de l’ordre.
Il ne s’agit évidemment pas de renoncer aux interpellations en opération de maintien de l’ordre puisqu’elles contribuent à celui-ci. Les auteurs de dégradations, de comportements et d’agissements délictueux doivent pouvoir être appréhendés et leurs actes punis. Toutefois, dans un souci de cohérence avec la doctrine du maintien de l’ordre et de bonne réalisation de la mission première des unités déployées dans ce cadre, il serait pertinent de procéder à un partage des rôles plus clair entre les différentes forces et unités.
Il s’agirait de s’appuyer à titre principal sur le savoir et le savoir-faire des unités spécialisées ou spécifiquement formées, qui « connaissent » la foule, en leur laissant le soin de procéder au besoin à des interpellations sur le bloc manifestant. Par leur formation et leur expérience, elles sont plus à mêmes d’anticiper l’impact d’une interpellation sur le schéma tactique d’ensemble et sur le déroulement global de l’opération de maintien de l’ordre. Les unités en civil, de formation, de culture et de comportements opérationnels différents, agiraient uniquement à l’extérieur de ce bloc. Pour les comportements les moins graves, n’appelant pas nécessairement une intervention immédiate, les interpellations pourraient, par ailleurs, s’effectuer à l’issue de la manifestation, une fois les tensions retombées et dès lors que les individus auraient pu être repérés grâce notamment aux dispositifs de captation vidéo (cf. infra).
III. DÉVELOPPER DES RÉPONSES PLUS GRADUELLES POUR MIEUX CONJUGUER ORDRE ET LIBERTÉ
Les travaux de la commission ont permis de mettre en évidence les caractéristiques d’un certain équilibre français entre ordre et liberté publics. Rien dans ces travaux n’incite le Rapporteur à recommander de bouleverser cet équilibre, tant du point de vue juridique que de celui des acteurs concernés.
Cependant, si la doctrine française et ses moyens ont des points forts et des mérites (y compris pour garantir la liberté d’expression et la sécurité des personnes et des biens), les conditions générales des manifestations et du maintien de l’ordre ont substantiellement évolué depuis que le cadre général en a été posé au lendemain de Mai-68 (conditions d’organisation, médiatisation, lieux de manifestations, etc.). C’est cette dernière évolution qui fragilise aujourd’hui l’équilibre entre ordre et liberté publics, car l’État a peu adapté les moyens de l’autorité civile aux changements de la société.
Le recours à la force (par des manifestants ou par les forces de l’ordre) et la prohibition constituent, aujourd’hui comme c’était le cas par le passé, les atteintes les plus graves à la liberté de manifester et à la liberté d’expression au sens large. Or, le Rapporteur observe que les seuls moyens concrets dont dispose un préfet confronté à une manifestation sont précisément de prohiber en amont et de réprimer en aval.
Ce maigre arsenal, principalement dissuasif, a pu suffire pendant plusieurs décennies, grâce au professionnalisme des forces mobiles sur lequel le préfet s’appuyait pour ne pas interdire en amont et pour repousser le recours à la force en aval. Il suffisait également face à des acteurs sociaux respectueux de la loi, soucieux du dialogue avec l’autorité civile et sensibilisés aux enjeux du respect de l’ordre républicain.
Aujourd’hui, les nouvelles conditions de manifestation et le rejet plus franc de l’autorité ne permettent plus de se satisfaire d’une stratégie reposant sur la dissuasion. Le non-respect trop fréquent du cadre légal de liberté de manifester, pourtant très libéral, et la violence trop systématique de certains groupes d’individus utilisant les manifestations comme prétexte, laissent trop souvent le préfet devant l’obligation de faire recourir à la force. Ce nouvel équilibre est d’autant moins heureux qu’il ne satisfait pas même les attentes de l’opinion publique en matière d’ordre et de judiciarisation des délits, tout en multipliant les affrontements entre forces de l’ordre et manifestants violents.
Le Rapporteur considère qu’il est possible de préserver l’ordre public et de protéger les personnes et les biens, en réduisant le recours à l’interdiction ou à la force, qui ne doivent constituer que les derniers moyens à la disposition de l’autorité publique. Pour cela, il importe d’offrir davantage d’éléments d’action graduels aux autorités civiles afin que le compromis entre ordre républicain et libertés démocratiques soit en permanence adapté, ajusté, proportionné.
Face au risque permanent de manifestations inopinées, l’autorité civile doit fournir un effort supplémentaire en matière d’information du public, de renseignement et de communication. Lorsqu’il est privé de dialogue légal préalable, le préfet doit rechercher la concertation et la médiation durant les manifestations. Confronté à une escalade trop régulière de la violence, l’autorité civile et les forces de l’ordre doivent disposer de moyens de « désescalade » avant et pendant la manifestation.
A. REDONNER DES MOYENS À L’AUTORITÉ CIVILE EN AMONT DES MANIFESTATIONS : UN CHANTIER DÉJÀ OUVERT
1. Reconstruire et densifier le renseignement de proximité : les mesures déjà prises
Le renseignement est essentiel en amont des manifestations mais également pendant leur déroulement et après leur dispersion. Il permet de concevoir de la manière la plus précise possible la manœuvre d’ensemble, de dimensionner au mieux le dispositif d’ordre public qui sera déployé, de bien l’articuler et de l’adapter en fonction de l’évolution de l’événement.
La régénération du renseignement de proximité, entreprise en 2014 par le Gouvernement, ainsi que les récentes annonces relatives au renforcement de ses moyens, ont été saluées par l’ensemble des acteurs et des observateurs du maintien de l’ordre.
a. La création du service central du renseignement territorial
Créé en mai 2014, le service central du renseignement territorial (SCRT) est, en application de l’arrêté du 1er février 2011 relatif aux missions et à l’organisation de la direction centrale de la sécurité publique (DCSP), l’un des services rattachés à cette direction relevant du ministère de l’Intérieur (180).
Aux termes de l’article 5 du même texte, il est composé d’un secrétariat général et des sept divisions thématiques suivantes :
– division des faits religieux et mouvances contestataires ;
– division de l’information économique et sociale ;
– division des dérives urbaines et du repli identitaire ;
– division de la documentation et de la veille technique ;
– division de l’outre-mer ;
– division des communautés et faits de société ;
– division nationale de la recherche et de l’appui.
Concrètement, le SCRT est en charge de la mission de renseignement qui incombe à la DCSP en application de l’article 21 du décret n° 2013-728 du 12 août 2013 (181). Il s’agit de « la recherche, de la centralisation et de l’analyse des renseignements destinés à informer le Gouvernement et les représentants de l’État dans les collectivités territoriales de la République dans les domaines institutionnel, économique et social ainsi que dans tous les domaines susceptibles d’intéresser l’ordre public, notamment les phénomènes de violence. Cette mission s’exerce sur l’ensemble du territoire des départements et collectivités, en coordination avec la gendarmerie nationale. »
La DCSP exerce cette mission, via le SCRT, sur l’ensemble du territoire national à l’exception de Paris et des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne qui, comme rappelé précédemment, relèvent de la compétence de la direction du Renseignement de la préfecture de police de Paris (DRPP).
Le SCRT est chargé des missions de renseignement territorial à l’échelon central. Pour l’information de l’autorité préfectorale, un service déconcentré du renseignement territorial a été créé dans chaque direction départementale de la sécurité publique (182).
Un service zonal (SZRT) est installé au siège de chacune des six zones de défense et de sécurité de France métropolitaine hors Paris (183) dans le ressort de laquelle le SCRT n’est pas compétent. Occupant les fonctions d’adjoint au directeur départemental de la sécurité publique (DDSP), les chefs du SZRT participent à l’animation et à la coordination des services départementaux du renseignement territorial (SDRT). Ils ont notamment vocation à centraliser et synthétiser les commandes nationales passées par l’échelon central. À l’échelon régional, le chef du service régional du renseignement territorial (SRRT) est l’interlocuteur privilégié du préfet de région. Le SDRT informe, quant à lui, le représentant de l’État dans le département.
Le travail du SCRT se décompose en deux grandes phases, avec un travail d’anticipation qui débouche sur un travail d’analyse concrétisé par des notes à destination des autorités publiques. Comme le résume M. Jérôme Léonnet, chef du SCRT, « Notre mission est d’établir une gamme d’alertes. » (184)
L’effectif du SCRT compte 2 200 policiers et gendarmes, dont 2 000 opèrent sur le terrain. Le renseignement s’effectue d’abord en amont, par le contact humain, par les liens que les services créent ou s’efforcent de créer avec l’ensemble des acteurs pertinents. M. Léonnet a ainsi précisé à la commission que « Pour accumuler des références sur la manière dont se déroulent les initiatives sur la voie publique, le renseignement territorial est ouvert à tout contact. Quand un mouvement se crée, nous allons au-devant des organisateurs, pour discuter avec eux, afin de prendre leur pouls. Quand ils refusent le contact, nous cherchons des informations par d’autres sources. C’est ainsi que nous évaluons les mouvements qui peuvent un jour ou l’autre aboutir à un trouble à l’ordre public, voire à des violences. » (185)
Internet et les réseaux sociaux font également partie des sources d’information potentielles, étant entendu que le SCRT travaille exclusivement selon les méthodes du milieu ouvert. Dans sa mission d’information de l’autorité préfectorale sur la vie économique et sociale, il ne disposera pas des moyens particuliers que pourront mettre en œuvre les services spécialisés de renseignement tels qu’ils sont prévus par le projet de loi relatif au renseignement (186).
La mission du SCRT ne prend pas fin dès lors que la manifestation a effectivement lieu. Des agents peuvent être présents aux abords de l’événement, notamment lorsque celui-ci risque d’entraîner des mobilisations dangereuses. Dans ce cas, des agents de la division de la recherche et de l’appui viennent en observation. Ils pourront réaliser des clichés susceptibles, d’une part, d’aider les services chargés des enquêtes judiciaires à l’identification des auteurs de violences et, d’autre part, de créer des références au profit du SCRT et de l’autorité préfectorale.
Enfin, le travail d’analyse du SCRT se prolonge après que les événements de voie publique ont pris fin, les agents du SCRT établissant un compte rendu et une analyse comprenant un volet prospectif.
D’après les statistiques communiquées par la DGPN, en 2014, les services départementaux du renseignement territorial ont produit quelque 43 182 flashes et brèves relatifs à des initiatives ayant des conséquences en termes d’ordre public.
b. Les évolutions en cours du renseignement de proximité
Le Rapporteur se réjouit du renforcement des moyens, tant humains que budgétaires, affectés au renseignement territorial. Ainsi que l’a rappelé le ministre de l’Intérieur, 500 recrutements seront réalisés au profit du SCRT – soit une augmentation de 22,7 % des effectifs. Parmi eux, 350 agents seront déployés en zone police et 150 en zone gendarmerie.
En outre, une partie des 233 millions d’euros annoncés par le Premier ministre, dans le cadre du plan de renforcement des moyens de la lutte antiterroriste alloués à la police et à la gendarmerie nationales, permettra de renforcer et de moderniser les moyens techniques du renseignement territorial (radio-télécommunication, moyens numériques et téléphoniques) (187).
Une telle mesure est d’autant plus bénéfique dans le contexte d’un recours croissant aux réseaux sociaux par les organisateurs et les manifestants qui favorise une mobilisation rapide ainsi que les rassemblements spontanés. Cette évolution, appelée à perdurer et s’amplifier, implique une adaptation en conséquence des moyens conventionnels de recherche du renseignement afin de permettre la meilleure anticipation possible des situations d’ordre public, de leur ampleur et de leur physionomie, lesquelles dimensionnent la réponse opérationnelle qui y est apportée.
En complément de ces dotations supplémentaires, il convient également que les destinataires privilégiés du renseignement territorial, les préfets, s’approprient totalement cet outil indispensable. Comme l’a souligné M. le préfet honoraire Christian Lambert dans le rapport qu’il a récemment remis au ministre de l’Intérieur (188), l’investissement des préfets dans le domaine du renseignement repose en grande partie sur l’appétence personnelle de certains d’entre eux – mais pas tous – pour la matière. Aussi, une partie seulement possède la « culture du renseignement » nécessaire à l’animation et la coordination effective du dispositif de renseignement dans les territoires (189).
D’après ce rapport, le corps préfectoral a moins besoin de formation que d’une « feuille de route » ministérielle clarifiant sa position, en déclinant précisément le contenu des missions afférentes. Des séminaires thématiques relatifs au renseignement territorial et au renseignement intérieur seront toutefois organisés par le Centre des hautes études du ministère de l’Intérieur (CHEMI).
Les préconisations sont différentes en ce qui concerne le maintien de l’ordre.
2. Professionnaliser davantage le maintien de l’ordre
a. Organiser une formation spécifique du corps préfectoral au maintien de l’ordre : la mission Lambert et ses conclusions
Par lettre de mission en date du 9 décembre 2014, le ministre de l’Intérieur avait chargé M. le préfet honoraire Christian Lambert de mener un travail d’expertise relatif à la formation des préfets et sous-préfets en matière, d’une part, de maintien de l’ordre public et, d’autre part, d’animation du renseignement territorial. Fruit d’une centaine d’entretiens conduits auprès de l’ensemble des acteurs concernés par ces questions et, notamment, quelque 58 préfets dont les treize préfets nommés pour la première fois en 2014 et tous les préfets de zone métropolitaine, le rapport formule 20 propositions susceptibles d’être mises en œuvre à brève échéance. Certaines de ces recommandations ont d’ailleurs d’ores et déjà été traduites en actes.
Les observations et préconisations en matière de renseignement territorial ont été brièvement exposées dans les développements précédents consacrés à cette problématique. Ceux qui suivent porteront uniquement sur la formation au maintien de l’ordre.
Le rapport Lambert dresse un constat relativement sévère en la matière. Il note ainsi que la formation initiale des préfets, dans un domaine qui constitue pourtant l’un des aspects fondamentaux du métier, est inexistante et que leur formation continue demeure très limitée. Par ailleurs, les modules suivis se caractérisent par une faible dimension opérationnelle. En plus d’une formation continue, les sous-préfets bénéficient certes d’une formation initiale, mais celle-ci reste d’une durée très limitée – trois jours et demi au total – et ne s’adresse qu’à ceux appelés à exercer la fonction de directeur de cabinet d’un préfet. Le même constat d’insuffisance quantitative et opérationnelle s’applique à leur formation.
Le rapport préconise de mettre en place des formations obligatoires, présentant un caractère opérationnel plus affirmé et dispensées avant la prise de poste, au cours de la première année, puis tout au long de la carrière des membres du corps préfectoral. Il ne s’agit pas de détailler l’ensemble des préconisations de manière exhaustive dans le cadre du présent rapport, mais de faire état de l’économie générale des recommandations, telle que M. le préfet Lambert l’a présentée à la commission (190). Au-delà des rappels relatifs au corpus juridique applicable ou encore de la fourniture de fiches réflexes sur la conduite à tenir dans diverses situations types et en dehors de modules spécifiques de formation au maintien de l’ordre outre-mer et du module sur le renseignement précédemment évoqué, le parcours de formation des nouveaux préfets s’articulera en six phases :
– avant sa prise de poste, chaque futur préfet sera placé pendant quarante-huit heures en immersion auprès d’un préfet de zone expérimenté au sein d’une préfecture traitant régulièrement d’événements d’ordre public (191) ;
– il participera à des « retours d’expérience » relatifs à des événements d’ordre public majeur avec le préfet concerné. À l’issue de ces modules, une fiche réflexe à destination de l’ensemble du corps préfectoral sera diffusée ;
– il bénéficiera d’une session de formation spécifique organisée par l’École nationale supérieure de la police et portant sur les enjeux de la régulation de l’ordre public. Assurée par des représentants de la police et de la gendarmerie, cette formation fournira aux préfets les bases juridiques essentielles en matière de maintien de l’ordre, leur présentera les moyens et techniques mis en œuvre dans ce cadre et les mettra en situation de gestion de crise ;
– afin de renforcer le lien avec l’autorité judiciaire, il participera également à un séminaire mixte préfets-procureurs de la République relatif à la judiciarisation de l’ordre public ;
– d’autres immersions seront organisées dans les centres de formation des unités spécialisées de la police et de la gendarmerie nationales ;
– enfin, les sous-préfets assurant la fonction de directeur de cabinet verront leur formation totalement refondue : d’une durée de trois semaines, elle se décomposera en une semaine théorique et deux semaines en immersion au sein des services de police et de gendarmerie.
Comme l’a résumé le préfet Lambert, « La professionnalisation dont il est question passe par quatre axes prioritaires : l’amélioration des formations ; l’implication personnelle des préfets en matière d’ordre public, de sécurité et d’animation et de coordination du renseignement territorial ; une articulation renforcée entre le préfet et l’autorité judiciaire ; la mise en place d’un appui méthodologique national dédié prenant la forme de la création d’une cellule de conseil et d’analyse en matière d’ordre et de sécurité publique auprès du secrétaire général du ministère de l’Intérieur. » (192).
Le Rapporteur considère ces préconisations tout à fait pertinentes. Afin de renforcer encore la professionnalisation en matière de maintien de l’ordre dans certaines préfectures plus exposées en la matière, il estime que d’autres pistes de réflexion pourraient être explorées.
b. Envisager un renforcement des compétences en matière de maintien de l’ordre dans certaines préfectures particulièrement exposées
Lors de son audition par la commission d’enquête, le directeur général de la police nationale a évoqué la mise à disposition d’un état-major qui, sans se substituer aux responsables locaux, pouvait aider à la gestion des grands événements organisés en région. Cette idée d’un état-major « ambulant », déployé autant que de besoin est séduisante et il serait sans doute utile d’y recourir plus régulièrement. Elle pourrait, par exemple, s’avérer particulièrement adaptée dans le cas d’événements inhabituels devant être gérés, parfois dans la durée, notamment par des préfectures qui ne disposeraient pas forcément des moyens humains adéquats pour faire face à ce type de mobilisation (en zone rurale par exemple). Pour autant, eu égard à certaines contraintes objectives et notamment la mobilisation des moyens humains et techniques nécessaires, une telle solution semble difficile à systématiser. En outre et par essence, il ne pourrait s’agir que d’un dispositif provisoire (193).
Afin d’assurer une continuité dans la connaissance, les savoir-faire et l’action et à la suite des préconisations du rapport Lambert, le Rapporteur juge que la professionnalisation de la fonction « maintien de l’ordre » au sein de certaines préfectures plus exposées pourrait passer par la création d’une fonction, voire d’une structure permanentes dédiées.
Sans chercher à créer des préfectures de police départementales, il pourrait être envisagé d’adapter à l’échelon territorial l’exemple offert par la direction de l’ordre public et de la circulation de la préfecture de police de Paris. Au sein de chaque préfecture confrontée à des problématiques spécifiques d’ordre public du fait du nombre, de la régularité et de l’ampleur des événements de voie publique, pourrait ainsi être mise en place une cellule « ordre public » permanente, avec à sa tête un référent « ordre public » qui pourrait remplir la fonction de directeur de cabinet adjoint du préfet, chargé de l’ordre public. Il assurerait la continuité de cette mission dans toutes ses composantes – connaissances juridiques, techniques, opérationnelles, contact avec les représentants de la force publique, le chef du renseignement territorial, les acteurs institutionnels de la vie économique et sociale, etc. – et en rendrait compte directement au préfet, améliorant ainsi les compétences et la réactivité de l’autorité civile et l’efficacité de son action.
3. Réaffirmer l’autorité et la présence indispensable de l’autorité civile
Le Rapporteur a fait sienne la conviction, exprimée unanimement tout au long des auditions effectuées par la commission, que le partage des rôles entre l’autorité civile et le commandement des forces de l’ordre doit être non seulement conservé, mais réaffirmé. Compte tenu de la complexité croissante des théâtres de manifestations, ce partage des rôles impose selon lui que l’autorité préfectorale soit physiquement présente au côté du commandement tout au long des opérations de maintien de l’ordre.
a. La réaffirmation de l’autorité du préfet et du partage des rôles entre l’autorité civile et les forces mobiles
Selon le directeur général de la gendarmerie nationale, Denis Favier (194) , « il s’agirait d’affermir le rôle, d’affirmer le primat, même, de l’autorité civile dans les opérations d’ordre public. Le préfet joue un rôle clef. […] De notre point de vue, il appartient au préfet ou à son représentant – le directeur départemental de la sécurité publique ou le commandant de groupement – d’assurer la responsabilité des opérations. Si le préfet définit les effets à produire, il revient au chef opérationnel d’en tenir compte pour concevoir la manœuvre de terrain. »
À ce sujet, le directeur général de la police nationale, Jean-Marc Falcone, estime que « la distinction historique et juridique entre l’autorité civile décidant de l’emploi de la force et le commandant de la force publique chargé de la mettre en œuvre demeure nécessaire. Cette dichotomie garantit le recul nécessaire à l’appréciation la plus juste des situations les plus compliquées ou les plus confuses » (195).
En effet, toutes les dispositions du code de la sécurité intérieure en matière d’ordre public, ainsi que celles du code pénal relatives aux attroupements, consacrent le rôle déterminant du représentant de l’État dans le département. Celui-ci est, en pratique, investi de l’ensemble des pouvoirs de décision réglementaire, à l’exception des cas marginaux d’emploi de la force par une unité constituée victime de violences et voies de fait ou incapable de tenir son terrain (cf. supra). Par déduction, il revient au chef des unités mobilisées en opération de maintien de l’ordre d’exécuter les directives du préfet en concevant une manœuvre et en la lui soumettant, puis en mettant en pratique cette manœuvre avec les effectifs et les équipements dont il dispose.
Deux risques principaux pèsent sur cette répartition : que l’autorité civile n’assume pas pleinement son rôle décisionnaire, ou qu’au contraire elle l’outrepasse en interférant dans la mise en œuvre de la mission qu’elle confie aux forces de maintien de l’ordre. Tous les professionnels auditionnés par la commission ont affirmé que le respect de la répartition historique et réglementaire des rôles est un gage de qualité et de sécurité de l’opération de maintien de l’ordre.
M. Christian Lambert a ainsi estimé que « La répartition des rôles entre le préfet et le commandant opérationnel est centrale. Les opérations se déroulent bien lorsque chacun reste à sa place. Il faut maintenir le système français sous sa forme actuelle : le préfet définit les objectifs, les effets à produire sur le terrain et s’appuie sur le responsable des forces qui, lui, choisit les moyens à employer ; le préfet ne s’immisce donc pas dans la manœuvre opérationnelle. […] L’ordre public est un métier et il faut donc le laisser au responsable commandant la force publique – nous insistons beaucoup sur ce point au cours de la formation des préfets et des sous-préfets. » (196)
Le général Denis Favier a également souligné l’importance du respect des rôles de chaque acteur : « La question de la répartition des rôles entre préfet et commandant opérationnel est centrale. Les opérations se déroulent mal quand ces rôles ne sont pas précisément définis, quand le préfet se mêle de la conduite opérationnelle et quand le commandant, faute de directives claires de la part de l’autorité préfectorale pense qu’il peut aller plus loin qu’il ne devrait. »
Sur cette question, le Rapporteur observe que le corpus réglementaire ne souffre aucune ambiguïté ni lacune. Comme le préfet Lambert, il estime cependant que la formation des membres du corps préfectoral doit inclure une plus grande sensibilisation à la responsabilité éminente et délicate du préfet en matière de maintien de l’ordre. Il suggère, en outre, que le ministre de l’Intérieur rappelle cette responsabilité, son caractère indispensable mais aussi ses limites, à tous les membres du corps préfectoral en activité. Il conviendrait sans doute de compléter ce rappel par une instruction de formaliser de façon claire les directives données aux forces de maintien de l’ordre, afin que ne se présentent plus les situations de flou que certains professionnels ont pu rapporter à la commission (197).
b. La présence de l’autorité civile doit être permanente pendant les opérations de maintien de l’ordre et non pas seulement pour engager la force
La responsabilité décisive du préfet, conjuguée à la complexité croissante des opérations de maintien de l’ordre mais aussi à leur plus grande médiatisation, implique une présence continue auprès des forces de l’ordre au cours des manifestations.
En effet, la responsabilité du préfet ne se dissout pas avec la mise en marche du cortège de manifestants. Au contraire, une fois la manœuvre engagée par les forces de l’ordre, c’est encore le préfet qui a la charge de « l’appréciation la plus juste des situations les plus compliquées » selon les mots de M. Jean-Marc Falcone. Il lui appartient, certes, de décider du recours à la force si elle est nécessaire, mais également de modifier les directives données aux forces de l’ordre, de désengager celles-ci ou au contraire de leur allouer un nouvel objectif, d’engager au besoin un échange direct avec les manifestants, etc. En un mot : de continuer de diriger l’opération de maintien de l’ordre dans ses grandes lignes.
M. Pierre Tartakowsky a résumé lors de son audition le caractère indispensable et essentiel du rôle de l’autorité civile dans la continuité : « Faut-il que les autorités civiles soient présentes là où l’on sent que les choses peuvent déraper ? Je pense que oui. Il revient aux autorités civiles de jouer pleinement leur rôle de représentantes des populations et de la légitimité républicaine, ainsi que d’interface de négociation dans les débats qui ont cours au sein de la société. En effet, avant la confrontation physique, il y a une légitimité de la confrontation politique, dont les termes sont d’ailleurs complexes. » (198)
Afin d’assumer cette responsabilité en continu jusqu’au terme de l’opération de maintien de l’ordre, le Rapporteur estime, à l’instar de la plupart des personnes entendues par la commission (199), que le préfet – ou son représentant – doit être physiquement présent sur les lieux de commandement des forces de l’ordre, afin de pouvoir mesurer et adapter ses propres décisions.
Cependant, il paraît évident que le préfet ne peut, en personne, demeurer au contact du commandant des forces pendant toute la durée d’une opération, en particulier si plusieurs événements ont lieu simultanément. C’est pourquoi le Rapporteur considère que le ministre de l’Intérieur devrait non seulement demander explicitement aux préfets de participer physiquement à l’opération, mais également établir une liste réduite et impérative des personnes à qui le préfet pourra, en cas de nécessité, déléguer ses pouvoirs et sa responsabilité.
B. RECRÉER DES FORMES DE CONCERTATION ENTRE LES AUTORITÉS CIVILES ET POLICIÈRES, D’UNE PART, ET LES MANIFESTANTS RESPECTUEUX DE L’ORDRE PUBLIC, D’AUTRE PART
Le second axe de préconisations que le Rapporteur souhaite formuler concerne le cœur de l’équilibre entre la garantie de la liberté de manifester et l’impératif de préservation de l’ordre public. Cet équilibre demeure pertinent aujourd’hui et le Rapporteur considère comme une priorité de veiller à sa continuité, en dépit des changements profonds et parfois préoccupants qui affectent les conditions de manifestation (cf. supra). Il estime qu’il y a un risque, s’il était accepté que les Français ne soient plus en sécurité dès lors qu’ils manifestent, ou dès lors qu’il y a une manifestation à proximité, que la société soit alors contrainte de choisir entre liberté publique et ordre public.
Pour prévenir ce risque, en s’appuyant notamment sur l’observation de plusieurs exemples étrangers, ainsi que sur les conclusions du groupe de travail européen sur le maintien de l’ordre (cf. encadré ci-après), le Rapporteur suggère de mieux prendre en compte des expressions moins légalistes de la liberté de manifester, grâce à de nouvelles formes de concertation. Le modèle français repose souvent sur le droit et sa primauté, qui doit bien sûr être conservée, y compris, le cas échéant en rappelant à la loi les individus qui confondent liberté de manifester et commission violente d’infractions. Cependant, en complément de ce modèle, malheureusement battu en brèche par de nouveaux acteurs peu soucieux d’aider l’État à préserver l’ordre public, il semble possible de rechercher des processus modernes de communication et d’échange qui peuvent n’être pas moins efficaces pour réguler les manifestations et préserver l’ordre républicain.
Aux nouvelles formes d’organisation des manifestations, l’État peut répondre par de nouvelles formes plus modernes de concertation. L’idée générale des préconisations suivantes peut se résumer dans le fait que, même si certains acteurs encouragent une certaine forme d’escalade de la tension et de la violence à l’occasion des manifestations, l’État peut employer des stratégies et des outils de désescalade afin de faciliter, ensuite, une préservation fluide de l’ordre public et qui garantisse la liberté d’expression.
REVUE EUROPÉENNE DES DISPOSITIFS DE MAINTIEN DE L’ORDRE : LE PROJET GODIAC
Le projet GODIAC (200) a fonctionné durant trois années de 2010 à 2013. Il s’agissait d’un projet de revue par les pairs de certains dispositifs de maintien de l’ordre en Europe, afin d’en dégager des bonnes pratiques pouvant inspirer les États dans la conception de leurs politiques d’encadrement des manifestations. Le projet a été coordonné par la police suédoise, et financé à 70 % par des crédits de l’Union européenne et à 30 % par le ministère de l’Intérieur suédois. Douze services nationaux ou territoriaux de police et huit centres de recherches dans le domaine de la sécurité ont participé au projet GODIAC, représentant au total douze pays européens : Autriche, Allemagne, Chypre, Hongrie, Roumanie, Suède, Royaume-Uni, Danemark, Espagne, Pays-Bas, Portugal, Slovaquie. La France n’a pas participé au projet GODIAC. La revue par les pairs a analysé dix opérations de maintien de l’ordre : | |||
Pays de l’opération |
Objet de la manifestation |
Ville/Région |
Dates |
Allemagne |
CASTOR Transport |
Wendland |
6-7 novembre 2010 |
Portugal |
NATO summit |
Lisbon |
19-21 novembre 2010 |
Autriche |
The WKR Ball |
Vienna |
30 janvier 2011 |
Royaume-Uni |
TUC March for the Alternative |
London |
26 mars 2011 |
Espagne |
Catalonian National Day |
Barcelona |
11 septembre 2011 |
Hongrie |
National Day |
Budapest |
23 octobre 2011 |
Danemark |
European Counter Jihad meeting |
Aarhus |
31 mars 2012 |
Slovaquie |
Dúhový pochod – Rainbow pride march |
Bratislava |
9 juin 2012 |
Suède |
Global Counter Jihad meeting |
Stockholm |
4 août 2012 |
Royaume-Uni |
Cairde Nah Éireann parade |
Liverpool |
13 octobre 2012 |
Le projet GODIAC a abouti à de nombreuses recommandations regroupées sous plusieurs thématiques : base de connaissance ; communication entre les forces de l’ordre et les manifestants ; facilitations des manifestations déclarées et/ou régulières ; différenciation des sous-opérations de maintien de l’ordre (traitement individuel des délits, gradation des ripostes, ciblage fin des zones, etc.). Ces recommandations tirées des expériences de terrain et des documentations fournies par les différents États participants concernent à la fois la politique publique en amont (volet juridique) et l’action des forces de l’ordre en opérations (volet opérationnel). | |||
1. Formaliser et diffuser les séquences types d’une opération de maintien de l’ordre et faciliter sa couverture par la presse
La première des concertations repose, en fait, sur une meilleure communication par l’État sur les conditions matérielles, géographiques et juridiques de la manifestation, et par une intervention facilitée de la presse qui, par son regard indépendant et la transparence qu’elle apporte, incite davantage les acteurs au dialogue et au respect mutuel qu’à l’escalade du recours à la force.
a. Créer un guide d’action à usage des préfets et le communiquer aussi largement que possible
Plusieurs personnes auditionnées ont souligné devant la commission la méconnaissance de trop nombreux manifestants des procédures du maintien de l’ordre, des limites qui s’imposent à eux, et des risques – y compris de condamnation pénale – qu’ils encourent. Or comme l’a indiqué M. Thomas Andrieu, « l’action de l’administration vis-à-vis des manifestants doit être claire, qu’il s’agisse des sommations ou de l’enchaînement qui conduit à l’usage de la force, lequel est placé sous le signe de la plus stricte proportionnalité. Tout cela doit être bien expliqué aux personnes qui participent à la manifestation ; ce point est sans doute susceptible d’amélioration. » (201)
En définitive, les opérations de maintien de l’ordre, notamment en raison du double principe de nécessité et de proportionnalité du recours à la force, sont relativement prévisibles. Elles suivent des schémas graduels qui pourraient utilement être synthétisés de façon lisible et claire, puis communiqués très largement, afin que la population puisse anticiper de façon rationnelle l’action des forces de l’ordre.
Le général Denis Favier y verrait, lui aussi, un gage de bonne conduite des opérations de maintien de l’ordre : « La communication entre acteurs de sécurité doit être claire. J’évoquais précédemment le rôle des organisateurs des manifestations ; il faut que les intentions des forces de l’ordre, de leur côté, soient également présentées de façon explicite. » (202)
b. Simplifier et rendre plus compréhensibles les sommations et la communication à destination des manifestants
Cette communication doit également être modernisée et clarifiée. Les outils contemporains de communication permettent assurément de dépasser le stade du porte-voix, même complété par un tir de fusée rouge. Le Rapporteur observe d’ailleurs, à la suite du général Denis Favier, que les prescriptions en matière de sommations prévues par l’article R. 211-11 (203) du code de la sécurité intérieure ne sont pas dépourvues d’ambiguïté :
« Les trois sommations d’usage ne comportent qu’une seule formule : "On va faire usage de la force !" Ces sommations sont faites à voix haute et sont éventuellement accompagnées de codes sonores, mais il est impossible de distinguer entre les trois sommations.
Que signifie l’expression : "On va faire usage de la force" ? Que l’escadron de gendarmerie mobile peut être amené à faire un bond offensif pour dégager un axe ; cela peut aussi signifier que l’escadron en question peut être conduit à utiliser des grenades lacrymogènes ou, plus grave, d’autres munitions. Or il n’existe pas de gradation entre ces différents stades d’engagement ; ces sommations faites à voix haute ne sont pas intelligibles : personne ne les entend – chacun sait bien que, dans une manifestation, il y a du bruit. Nos intentions doivent donc être mieux perçues. En outre, il est temps de définir un code sonore et visuel – par exemple par le moyen de fusées éclairantes – pour accompagner les sommations orales. Ce code, national, devra être connu des manifestants. »
Le ministre de l’Intérieur a déclaré à la commission vouloir moderniser et clarifier ces sommations réglementaires afin de les rendre plus faciles à interpréter rapidement par les manifestants. Le Rapporteur partage cet objectif.
Plus précisément, il suggère que l’État français suive plusieurs des recommandations en matière de communication et concertation, issues de la revue européenne du maintien de l’ordre par les pairs (GODIAC) : création de sites Internet présentant les dispositifs et les règles du maintien de l’ordre pour chaque événement, ou encore communication sur les horaires, les parcours et les conduites à tenir en utilisant les SMS et les réseaux sociaux.
c. Faciliter le suivi par la presse des opérations de maintien de l’ordre
L’audition par la commission du directeur général de Reporters sans frontières France, M. Christophe Deloire, le jeudi 29 janvier 2015, a permis de dresser un tableau globalement rassurant sur le respect des conditions d’exercice de la liberté de la presse par les forces de l’ordre dans les opérations de maintien de l’ordre.
Journalistes et forces de l’ordre ont tout à la fois un intérêt commun et un devoir de travailler ensemble et, à tout le moins, de ne pas nuire à l’exercice du métier de l’autre. En effet, la transparence sur leur professionnalisme et sur l’attitude violente et/ou délictueuse de certains manifestants ne peut que servir les missions des forces mobiles et, si certains ont déploré devant la commission la diffusion de montages grossiers caricaturant l’action des forces de l’ordre à Sivens (204), elle était le fait des organes de communication « officielle » et monopolistique de la ZAD. De leur côté, les journalistes ont besoin de la sécurité offerte par l’action des forces de l’ordre, et que cette action ne les empêche pas de travailler en toute indépendance.
Comme l’a indiqué M. Christophe Deloire (205), de petits ajustements dans les relations entre policiers et journalistes seraient encore utiles à tous. Aux journalistes : « Les principaux problèmes ne surgissent d’ailleurs pas lors des grandes manifestations mais plutôt lors de petites opérations de ce genre, durant lesquelles du matériel peut être saisi, ce qui pose le problème de la confidentialité des sources des journalistes. […] Certains considèrent que les journalistes sont en dehors de leur champ de légitimité quand ils s’avisent de prendre des images. Nous contribuons à faire savoir à toutes les parties prenantes que la captation d’images est libre, et que seule la diffusion est soumise à des règles. » Mais également aux unités chargées du maintien de l’ordre : « Nous avons interrogé Olivier Pouchin, le chef de la délégation des CRS de l’agglomération parisienne, qui souligne l’importance de la communication entre les journalistes qui couvrent les manifestations et les CRS. Si les journalistes ont signalé leur présence, les CRS pourront intervenir plus facilement en cas d’affrontements violents. Et il arrive que les forces de l’ordre viennent activement défendre des reporters en situation délicate, selon le commissaire. Pour être complet, il précise qu’en certaines occasions, les journalistes ont pu perturber les manœuvres de ses hommes, notamment en se retrouvant entre les CRS et les manifestants. »
Pour le Rapporteur, l’action indépendante de la presse est une source d’objectivation et de débat public et concourt donc activement, pour ce qui concerne la liberté de manifester et le maintien de l’ordre, à la désescalade et au refus de la violence. Il considère que cette action pourrait être encore facilitée par la conclusion d’un protocole ou l’adoption d’une charte commune entre la profession et le ministère, qui rappellerait aux uns et aux autres les principes qui ne font nullement débat, mais nécessitent sans doute une réaffirmation, notamment :
– le matériel journalistique ne peut être saisi par un policier ou gendarme en opération de maintien de l’ordre ;
– la manœuvre des forces mobiles ne doit et ne peut être entravée ou limitée par le positionnement de la presse ;
– les journalistes doivent veiller à proportionner les risques qu’ils prennent pour leur propre sécurité ;
– les forces de l’ordre doivent avoir conscience en permanence que la protection de la presse est une mission essentielle du maintien de l’ordre.
2. Aménager les procédures judiciaires et administratives afin que des individus isolés ne puissent prendre en otage la liberté publique de manifester
Dans l’éventail des outils graduels de gestion des manifestations à disposition des préfets, le Rapporteur estime également que devrait être envisagée la possibilité très encadrée d’interdire à un ou plusieurs individus de participer à une manifestation sur la voie publique. En effet, il est des comportements individuels délictueux qui ne peuvent être assimilés à l’exercice d’une liberté constitutionnelle et doivent au contraire être prévenus, afin que les libertés publiques et l’ordre républicain soient conjointement préservés.
Une telle interdiction s’analyserait donc comme une prévention d’infractions. Elle contribuerait à la désescalade en créant, en amont, de meilleures conditions de sécurité permettant l’exercice de la liberté de manifester. Une telle mesure n’est d’ailleurs pas étrangère au droit français, ni à la pratique actuelle du maintien de l’ordre : l’encadrer offrirait une plus grande garantie de respect des libertés fondamentales, par le contrôle du juge. En outre, il s’agit d’une procédure déjà en vigueur dans plusieurs pays proches de la France, qui n’est contraire ni aux droits et libertés constitutionnels ni à ceux garantis par la Convention européenne des droits de l’homme.
a. Les procédures actuelles ayant pour effet d’interdire à un individu de participer à une manifestation
L’interdiction de manifester existe déjà en droit français, sous la forme d’une peine complémentaire pouvant être prononcée par le juge pénal à l’encontre d’une personne s’étant rendue coupable, lors de manifestations sur la voie publique, de violences à l’encontre des personnes, de détérioration de biens, ou de diffusion de procédés visant à élaborer des engins de destruction. Cette peine complémentaire est prévue par l’article L. 211-13 du code de la sécurité intérieure.
Sans pouvoir naturellement prétendre à l’exhaustivité, le Rapporteur n’a pas pu recenser de décisions de cours d’appel ou de la Cour de cassation se prononçant sur une telle peine complémentaire. Il est donc malaisé de mesurer aujourd’hui la fréquence à laquelle cette interdiction de manifester est prononcée à l’encontre d’un « casseur » reconnu coupable.
En tout état de cause, le Rapporteur suggère qu’une circulaire de la direction des affaires criminelles et des grâces rappelle aux procureurs la possibilité de requérir une telle peine complémentaire.
En outre, les dispositions permettant aux procureurs de requérir des contrôles d’identité en marge des manifestations servent d’ores et déjà aujourd’hui de fondement à des formes d’interdiction de manifester. Le procureur de la République de Paris, François Molins, en a expliqué le processus à la commission : « En amont, [le procureur] est sollicité par les services de police pour délivrer des réquisitions de contrôles d’identité qui correspondent aux heures et au parcours de la manifestation ainsi qu’à ses abords. Ces réquisitions sont délivrées généralement la veille ou l’avant-veille de l’événement et fournissent aux forces de l’ordre un cadre juridique sécurisant sur le plan procédural. En effet, une interpellation réalisée à la suite d’un contrôle d’identité qui serait dépourvu de régularité conduirait nécessairement au classement sans suite par le parquet ou à l’annulation de la procédure par le tribunal saisi de poursuites.
Sur la base de ces réquisitions, les services de police peuvent contrôler l’identité de toute personne quel que soit son comportement dès lors qu’elle se trouve dans le périmètre et le créneau horaire figurant sur la réquisition. » (206)
L’audition du préfet de police de Paris a permis à la commission de mesurer l’usage qui est parfois fait de ces contrôles sur réquisition : « Pour ma part, j’estime préférable de faire confiance aux services de renseignement, qui nous informent efficacement sur les personnes susceptibles de troubler l’ordre public : il nous suffit alors de les attendre à la gare où elles arrivent de province et de les interpeller sur réquisition du procureur de la République. »
Ce type de contrôle « extensif » d’identité ne s’assume pas réellement comme une interdiction individuelle de manifester. Il contribue à nourrir un sentiment de violation arbitraire des libertés fondamentales par les forces de police, comme en a témoigné M. Pierre Tartakowsky, président de la Ligue des droits de l’Homme : « Le deuxième phénomène, tout aussi préoccupant parce qu’il se développe de manière perverse en dehors du cadre juridique, consiste à empêcher les manifestants de manifester, non pas sur le lieu de la manifestation, mais en amont : en les interceptant sur le chemin, sans raison et sans aucune légitimité juridique. On nous dit souvent, après coup, qu’il s’agissait de contrôler les identités… Or cette notion de contrôle d’identité est extrêmement vague. Cela s’est déjà produit à plusieurs reprises. » (207)
b. Les exemples étrangers d’interdiction administrative de manifester
Au contraire, certains pays voisins de la France, comme la Belgique ou l’Allemagne, en dépit de normes constitutionnelles ne protégeant pas moins la liberté d’expression que dans notre pays, ont choisi d’instaurer une possibilité d’interdire à un individu de manifester, en raison de son comportement violent lors des manifestations et du risque – étayé par l’expérience – que cet individu ne trouble gravement l’ordre public par la commission de délits.
En Belgique, la loi sur la fonction de police du 5 août 1992 a organisé un régime d’arrestation administrative préventive, se traduisant même par une privation de liberté temporaire. Cette arrestation d’une personne peut se fonder sur « des motifs raisonnables de croire, en fonction de son comportement, d’indices matériels ou des circonstances, qu’elle se prépare à commettre une infraction qui met gravement en danger la tranquillité ou la sécurité publiques, et afin de l’empêcher de commettre une telle infraction. » Elle obéit au cadre général des mesures de privation de liberté et ne peut excéder 12 heures.
En Allemagne, dans le cadre du maintien de l’ordre et de la sécurité publique, la police dispose d’un éventail de mesures à valeur d’actes administratifs qu’elle met en œuvre de manière autonome, parmi lesquelles la « rétention policière ». Il s’agit pour les forces de police de retenir une personne ou un groupe en vue de prévenir la commission ou la poursuite d’infractions ou d’atteintes à l’ordre public présentant une certaine gravité. Cette rétention est également fondée lorsque l’identité de la personne ne peut être prouvée autrement. Sa durée ne peut généralement pas excéder la journée (sauf en Thuringe).
c. L’introduction de l’interdiction administrative de manifester
Sans aller jusqu’à prévoir de mesures privatives de liberté, le Rapporteur estime donc qu’il est possible et souhaitable d’introduire en France un dispositif interdisant à un ou plusieurs individus de manifester. Comme l’a souligné M. François Molins, « Il ne s’agit pas d’empêcher quelqu’un d’exercer une liberté fondamentale, mais d’empêcher la commission d’une infraction. Il faut entourer la mesure de garde-fous suffisamment solides pour s’assurer que la personne visée n’a pas l’intention d’exercer une liberté mais de commettre une infraction de violence ou de dégradation. Dans le cas contraire, ce serait une grave atteinte à l’exercice des libertés démocratiques. » (208)
Sous le bénéfice d’un encadrement très strict, une telle interdiction est pleinement conforme à la Constitution et à la Convention européenne des droits de l’homme, ainsi que l’ont indiqué les personnes auditionnées par la commission. Le Conseil constitutionnel, se prononçant précisément sur l’instauration de la peine complémentaire d’interdiction de manifester par l’article 18 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 (209) d’orientation et de programmation relative à la sécurité, a jugé que « l’interdiction de manifester prévue par le législateur pour une durée maximum de trois ans est limitée à des lieux fixés par la décision de condamnation ; qu’il incombe ainsi au juge pénal de décider non seulement du principe de cette interdiction mais aussi de son champ d’application ; qu’eu égard à la nature des infractions énumérées par l’article en cause, l’interdiction mentionnée ci-dessus ainsi que les peines sanctionnant sa méconnaissance ne portent pas atteinte au principe de proportionnalité des sanctions et ne sont pas non plus de nature à méconnaître les exigences de la liberté individuelle, de la liberté d’aller et venir et du droit d’expression collective des idées et des opinions ».
Le juge administratif – se prononçant sur l’interdiction du spectacle de Dieudonné à Nantes en 2014 (210) en raison des risques de troubles à l’ordre public – a considéré qu’il « appartient en outre à l’autorité administrative de prendre les mesures de nature à éviter que des infractions pénales soient commises » mais que « les atteintes portées, pour des exigences d’ordre public, à l’exercice de ces libertés fondamentales doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées ».
Pour le Rapporteur, cette proportionnalité serait inévitablement une condition de la légalité de l’interdiction administrative de manifester qu’il suggère. Sous le contrôle du juge, celle-ci résulterait d’un arrêté de police administrative qui :
– ne pourrait frapper que les individus nominativement condamnés ou connus en tant que casseurs violents (selon le même critère matériel que la peine complémentaire) ;
– consisterait en une interdiction de pénétrer, pendant une durée très précise, au sein d’un périmètre également très déterminé à peine de se rendre coupable d’un délit spécifique devant être défini ;
– n’entraînerait pas en lui-même de mesure de rétention administrative ;
– devrait être justifié par l’autorité civile par des risques sérieux et manifestes de trouble à l’ordre public ou par la présence d’indices matériels faisant redouter la commission d’une infraction à l’occasion de la manifestation.
Une telle mesure, outre son caractère dissuasif pour l’individu frappé d’interdiction, permettrait aux forces de l’ordre constatant la présence de la personne dans le périmètre interdit durant la période concernée de l’interpeller immédiatement en flagrant délit et de la faire garder à vue.
3. Organiser une médiation systématique et continue entre les forces chargées du maintien de l’ordre et le public manifestant avant, pendant et après l’événement
Au-delà d’une meilleure communication de la part de l’autorité civile ou policière et des moyens de prévention des délits les plus graves, le Rapporteur considère que le panel des moyens et des procédures à disposition de l’État en cas de manifestation devrait accorder une place accrue au dialogue permanent avec les manifestants. Cette recherche permanente de médiation est, selon M. Fabien Jobard, « le point essentiel de comparaison entre les expériences actuellement menées à l’étranger et les pratiques françaises. La police française a une culture de dialogue avec les manifestants. Le décret-loi de 1935 remplit à ce titre une fonction essentielle : avant la manifestation, la police se concerte avec les organisations appelant à manifester pour fixer l’itinéraire et les modalités d’intervention des services d’ordre. Toutefois, elle n’a pas cette culture de la médiation au cours de l’action, ancienne dans la police anglaise. Les images d’archives de manifestations dans les grandes villes du Royaume-Uni de la période de fortes tensions de 1983-1984 montrent ainsi des policiers en uniforme, défilant avec les manifestants. » (211)
Selon le directeur de recherche au CNRS : « Ce privilège donné à l’uniforme par rapport au camouflage, la présence des policiers parmi les manifestants et la poursuite du dialogue au cours de l’événement constituent une avancée essentielle à conquérir pour la gestion des dispositifs de maintien de l’ordre. À cet égard, il serait bon de se tourner, outre l’Angleterre et l’Allemagne, vers la Suède, pays qui a beaucoup promu des expérimentations en ce sens, qui sont discutées dans le cadre du Collège européen de police ou du projet GODIAC. » (212)
Le directeur général de la gendarmerie nationale a, lui aussi, considéré que la médiation constituait un des points faibles des opérations de maintien de l’ordre en France : « Ce dialogue ne me paraît pas assez affirmé : il faut le développer non seulement en amont mais également au cours de la manifestation. J’y vois une des garanties de son bon déroulement en permettant l’exercice, en sécurité, du droit de manifester. » (213)
a. Fixer le principe d’une concertation préalable obligatoire
Le principe de déclaration préalable se justifie d’ores et déjà par le souci d’une concertation entre le préfet et les manifestants. Il ne serait pourtant pas superflu de renforcer, dans la réglementation en matière d’ordre public, l’exigence de concertation entre organisateurs et autorité civile.
Comme l’a souligné M. Pierre Tartakowsky, il convient de garder à l’esprit que ceux qui ne souscrivent déjà pas aujourd’hui, en dépit des sanctions pénales, à l’exigence de déclaration préalable, risquent de n’être pas davantage sensibles à une incitation ou injonction au dialogue : « Maintenant, faut-il organiser une concertation obligatoire avec les groupes violents ? Si l’on y parvient, cela voudra dire qu’ils sont beaucoup moins violents qu’on ne l’annonçait, et la République ne s’en sortira que mieux… Je souris, mais il est vrai que, si tous les voleurs de banque pouvaient être rendus honnêtes, on pourrait investir beaucoup moins dans la sécurité des banques. Dans la pratique, je ne suis pas certain que ce raisonnement nous mène très loin. » (214)
Pour autant, le Rapporteur considère que l’exigence de concertation pourrait, à tout le moins être réaffirmée ou renforcée, à l’égard des manifestants… comme des préfets. En effet, certains témoignages auprès de la commission semblent indiquer que les pistes de dialogue ne sont pas toujours explorées par l’autorité civile, dont ce serait pourtant le devoir. Ainsi M. Ben Lefetey déclarait-il au sujet de la ZAD de Sivens : « Début mars, lorsqu’une cinquantaine de personnes extérieures ont rejoint les occupants et ont commencé à installer des barricades, nous avons, devant les risques de radicalisation du mouvement, sollicité un rendez-vous auprès de la préfète et du président du conseil général pour discuter avec eux de la manière dont nous pouvions contribuer à apaiser les choses sur le terrain. Le président du conseil général nous a répondu que le maintien de l’ordre n’était pas de son ressort ; quant à la préfète, elle n’a pas donné suite, alors que notre courrier faisait clairement état de nos craintes qu’il y ait des affrontements et des blessés de part et d’autre. Fort heureusement, la situation n’a pas dégénéré à l’époque car les occupants s’en sont tenus à la défense de la zone humide, sans jamais aller au contact avec les forces de l’ordre. Lorsque le successeur de Madame Chevalier a pris ses fonctions, le 1er septembre, j’ai contacté son secrétariat pour obtenir un rendez-vous. Cela n’a pas abouti et, compte tenu de mon expérience précédente, j’avoue ne pas avoir insisté.
Si les forces de l’ordre et le commandant de gendarmerie savent le rôle de médiateur qu’a pu jouer notre collectif et la manière dont, à plusieurs reprises, nous avons contribué à apaiser la situation entre les gendarmes et les occupants, l’État, en revanche, n’a pas su utiliser nos ressources. La situation est heureusement différente aujourd’hui : je suis en contact régulier avec le préfet qui, à travers moi, s’efforce de nouer des relations avec les zadistes et d’apaiser les tensions. » (215)
Ce témoignage a été confirmé par M. Patrick Rossignol, maire de Saint-Amancet (Tarn) : « Quant au préfet – en réalité, deux préfets se sont succédé au cours de la période –, il n’a pas joué dès le début le rôle de conciliation qu’il a désormais endossé. Au départ, influencé par les élus, il a misé sur le rapport de forces pour décaper la zone avec l’aide des forces de l’ordre, au lieu d’assurer d’emblée une médiation. » (216)
De même, M. Albéric Dumont, coordinateur général de la « Manif pour tous », estime que « la clé de la réussite d’une manifestation est sa préparation, en particulier le "calage" des dispositifs respectifs des organisateurs et des forces de l’ordre » (217).
b. Créer de nouvelles unités policières de médiation, intégrées dans les manifestations
Certains professionnels, à l’instar du préfet de police de Paris, ont également fait part à la commission des efforts déjà consentis par l’État en matière de médiation : « Pour les rassemblements les plus importants, un officier de liaison, désigné par le directeur de l’ordre public, est mis en place auprès des organisateurs, afin qu’une liaison permanente puisse s’établir entre ces derniers et les responsables de l’ordre public. » (218)
Ce souci indiscutable, s’il paraît adapté aux organisations de grande envergure par des acteurs responsables, semble cependant moins applicable aux cas de manifestations spontanées ou délibérément non déclarées par les participants, manifestations sans organisateur ou avec des prête-noms sur les documents remis en préfecture (cf. supra). Pourtant, comme le souligne M. Fabien Jobard, ce sont précisément sur de tels événements que les efforts de médiation consentis dans d’autres pays produisent un résultat sensiblement différent que celui de la doctrine française : « Il faut aller au-delà du face-à-face entre l’officier de liaison et ses points de contact habituels au sein des organisations professionnelles. La rue est devenue pour beaucoup un moyen légitime d’expression des revendications, qui ne passe plus forcément par la médiation des organisations professionnelles, syndicales ou associatives. De nombreuses personnes se joignent aux cortèges sans être véritablement encadrées. Cela nécessite de poster des policiers à l’intérieur des manifestations, de manière à pouvoir maintenir un contact permanent entre manifestants et forces de police. » (219)
Le Rapporteur partage cette recommandation du projet GODIAC de créer des unités policières spécifiques de médiation, parfaitement identifiées et connues du public, dans le but d’entretenir (ou de créer) tout au long de l’événement un dialogue avec les manifestants. Ces unités sont également, dans les pays comme l’Allemagne où elles sont déjà utilisées, une source de dialogue avec les forces spécialisées dans le rétablissement de l’ordre. Elles renseignent tout en dialoguant et fournissent un éclairage riche et dense à l’autorité civile et au commandant de la force publique.
c. Organiser un accueil permanent et un retour d’expérience de la part des manifestants
Enfin, dans la continuité des préconisations précédentes suggérant à l’État de s’affranchir du cadre exclusivement juridique, le Rapporteur considère que l’échange administratif de la déclaration préalable contre un récépissé constitue un héritage en léger décalage avec la réalité des communications et des nouvelles technologies.
S’il n’est pas question de remettre en cause l’exigence de déclaration formelle, celle-ci pourrait être complétée par d’autres formes de dialogue s’appuyant sur un accueil physique permanent du public, avant et après les manifestations, par exemple, ou encore sur des plateformes de publication ou d’échange sur Internet avec les préfectures.
En effet, l’écoute des citoyens manifestants, désireux de s’exprimer dans le respect de l’ordre public, n’est probablement pas un vain exercice pour l’autorité civile. S’y étant modestement livrée au cours de ses auditions, la commission a pu constater parfois des convergences avec les points de vue des professionnels de l’ordre public, mais aussi des éclairages originaux. En tout état de cause, il ne serait pas inutile que les préfectures soient en mesure de recevoir (voire de susciter) les commentaires et retours d’expérience des citoyens sur leurs conditions de manifestation. C’est également ainsi qu’un dialogue objectif peut se nouer entre les populations et l’autorité en charge de l’ordre public, même après un événement, qui ne pourrait qu’être bénéfique dans la durée à l’occasion de l’organisation de futurs événements.
C. FACE AUX FOULES MANIFESTANTES : FAIRE CONFIANCE À DES FORCES DE L’ORDRE SPÉCIALISÉES, PROFESSIONNELS DU MAINTIEN DE L’ORDRE ET RESPECTUEUX DES LIBERTÉS PUBLIQUES
Dans la gradation des moyens permettant de conjuguer ordre républicain et liberté de manifester, l’emploi des forces mobiles constitue à lui seul une palette évolutive. Ce véritable point fort de la doctrine française doit être encore mieux utilisé par l’État et, à cette fin, la formation des unités spécialisées dans le maintien de l’ordre doit être encore densifiée et modernisée, pour mieux tenir compte des évolutions sociales.
La spécificité de leur métier doit aussi être reconnue, sans faire injure aux autres unités de la gendarmerie ou de la police nationales. Les personnes entendues, les déplacements réalisés et les documentations et statistiques consultées ont forgé la conviction du Rapporteur que les opérations de maintien de l’ordre doivent, autant que possible, pouvoir être réservées aux unités spécialisées. Cette confiance dans leur professionnalisme et leur capacité d’adaptation, en dépit d’effectifs décroissants, dont il serait vain d’imaginer qu’ils puissent être fortement accrus dans le contexte budgétaire actuel, doit guider la réflexion du ministère de l’Intérieur s’agissant des équipements sur lesquels s’appuient les hommes et les femmes en charge de rétablir l’ordre.
Enfin, le Rapporteur considère que la judiciarisation des délits commis lors d’une manifestation doit être revue, afin de lever les obstacles pratiques qui s’opposent aujourd’hui à l’exigence de justice durant une opération de maintien de l’ordre.
1. Moderniser la formation des forces chargées du maintien de l’ordre
Il importe de souligner la grande qualité du processus de formation initiale et continue des unités spécifiquement chargées du maintien de l’ordre. Le Rapporteur et la commission ont pu constater les efforts déployés afin de s’assurer de la discipline et de la clairvoyance au sein des unités ayant à faire face à des attroupements violents. Pour autant, tant sur le plan qualitatif que quantitatif, ces formations peuvent être renforcées.
a. Ouvrir la formation et la doctrine du maintien de l’ordre aux recherches en sciences sociales
La culture française du maintien de l’ordre est enracinée dans l’histoire et dans le droit. Mais pour parfaitement s’adapter aux conditions de manifestations actuelles, elle doit aussi être plus sensible aux évolutions des mœurs et des attentes de la société.
M. Pierre Tartakowsky a fourni sa vision du regard que l’État projette sur les foules manifestantes par le truchement de ses unités mobiles : « Il me semble que l’hégémonie d’Alain Bauer avait contribué à marginaliser l’idée d’un institut d’études de la sécurité publique, dont nous avons besoin. Il nous faut un lieu de débat entre chercheurs en sciences sociales, quelle que soit par ailleurs la qualité ou l’orientation de leurs travaux. Nous devons débattre de tout cela et rendre publics les débats. C’est déjà une partie de la formation. Et j’insiste sur l’idée que la formation dont je parle n’est pas à sens unique : une police bien formée est aussi une police qui contribue à la formation des citoyens à la citoyenneté. La police n’est pas un corps étranger à la population. De ce point de vue, nous avons tout à gagner. » (220)
Directeur de recherche au CNRS, en poste en Allemagne, M. Fabien Jobard a également éclairé ce retard français par rapport aux pays voisins :
Le maintien de l’ordre, tous les policiers vous le diront, repose sur la connaissance de la société, des groupes protestataires, des dynamiques de contestation, d’escalade mais aussi de désescalade, de l’articulation entre violences et expressions politiques conventionnelles. […]
Reste à améliorer le rapport de la police au savoir. En France, aucun enseignement de sciences sociales n’est dispensé dans les écoles de police alors qu’en Allemagne – comme cela a dû vous être dit lors de votre visite à Lunebourg –, l’Institut de formation des cadres de la police, la Deutsche Hochschule der Polizei de Münster, comprend dans son corps enseignant des chercheurs avec qui je peux écrire des articles publiés dans des revues de sociologie. […]
Reste aussi à la France à s’intégrer dans des instances de réflexion collective auxquels participent déjà nombre de pays européens, en particulier s’agissant des dynamiques d’escalade ou de violence dans les manifestations. La Suède, le Danemark, la RFA, le Royaume-Uni, l’Espagne, le Portugal, l’Autriche, la Slovaquie, la Hongrie et d’autres ont ainsi pris part à la production d’un guide de bonnes pratiques dans le cadre du projet GODIAC – Good Practice for Dialogue and Communication as Strategic Principles for Policing Political Manifestations in Europe – qui repose sur un savoir élaboré en commun par les policiers et les chercheurs en sciences sociales autour du comportement des foules. Tout n’est sans doute pas à prendre mais ce qu’il faut retenir, c’est l’absence de la France de ces dispositifs. » (221)
Pour le Rapporteur, sans rien remettre en cause du contenu actuel des formations des unités en charge du maintien de l’ordre, il serait utile que le ministère de l’Intérieur enrichisse la doctrine française et cette formation d’une vision plus sociologique des populations et de leurs comportements.
b. Chercher à préserver et rendre incompressible le temps de recyclage des unités
Si le Rapporteur est convaincu de la qualité de la formation, notamment opérationnelle, qui est dispensée aux unités mobiles, de nombreuses personnes entendues par la commission ont lancé des alertes sur un risque de diminution du volume de cette formation. Attaché à la nécessité de conserver à ces unités un très haut niveau de compétence, le Rapporteur n’a pu qu’être sensible à de telles alertes.
Le commandant Christian Gomez (CRS 40 de Plombières-les-Dijon) a illustré le poids de ce dispositif de formation et l’arbitrage avec l’engagement opérationnel : « Environ vingt-cinq jours de formation sont dispensés annuellement, notamment sur trois périodes bloquées de trois jours, dites "de recyclage de l’unité", auxquelles sont accolées des journées d’entraînement technique. Ces périodes permettent de travailler les techniques et la cohésion de l’unité. D’autres journées éparses d’entraînement technique ou d’entraînement au tir peuvent être organisées par section au sein des unités en fonction des besoins de chacun. Au total, nos personnels bénéficient d’une trentaine de journées de formation annuelles. Malgré le très fort besoin en emploi, la direction centrale s’attache à bloquer ces périodes afin de garantir la qualité de la formation du personnel. L’emploi est évidemment prioritaire, mais on ne badine pas avec la formation. » (222)
M. Denis Hurth, délégué régional de l’UNSA Police, chargé de la formation a également alerté la commission sur le risque que les recyclages s’espacent excessivement pour les unités en dépit de leur caractère indispensable : « Comme les compagnies tournent énormément sur le territoire national, elles n’ont quasiment plus le temps de faire leurs périodes de recyclage. À une époque, ces périodes de formation étaient vraiment neutralisées ; maintenant, il arrive de plus en plus souvent qu’une compagnie soit rappelée pour un maintien de l’ordre deux jours avant, voire la veille de la session prévue. Il faut alors déplacer la formation. Une formation correcte suppose un programme correct : les formateurs et les officiers doivent pouvoir se réunir pour réaliser toutes les procédures tactiques des périodes de recyclage et de formation. » (223)
Le Rapporteur ne peut que souscrire aux interventions devant la commission qui ont insisté sur l’importance de la formation et de l’entraînement, comme celle du général Bertrand Cavallier (224) : « Or, c’est bel et bien l’entraînement qui conditionne l’efficacité des forces sur le terrain. Plus un gendarme est entraîné, plus grande sera la maîtrise dont il fera preuve au moment d’agir. » C’est pourquoi, compte tenu de la grande diversité des emplois des forces mobiles et de la sensibilité de leur mission de maintien de l’ordre, le Rapporteur souhaiterait que les missions moins essentielles des CRS et gendarmes mobiles (gardes statiques par exemple) soient réduites à due concurrence de l’exigence minimale de formation et de recyclage qui s’impose aux unités afin de conserver leur aptitude à mettre en œuvre la doctrine.
2. Favoriser l’intervention exclusive d’unités spécialisées pour les opérations de maintien de l’ordre
Au gré des travaux de la commission, le Rapporteur a renforcé sa conviction de la spécificité du métier de maintien et de rétablissement de l’ordre public. Le souci de garantir les libertés publiques et les droits fondamentaux alors que la situation impose de faire cesser des troubles à l’ordre public, en recourant parfois à la force et en subissant soi-même des violences, ne peut d’ailleurs que contribuer davantage à rendre ce métier particulièrement délicat.
Pour autant, en dépit de cette spécificité peu contestable, les unités mobiles ou spécialisées dans le maintien de l’ordre n’ont pas le monopole des opérations de maintien de l’ordre. Ceci résulte évidemment d’un certain pragmatisme : la disponibilité et la localisation des unités spécialisées ne permettent pas toujours à l’autorité civile d’y recourir utilement. Toutefois, ces interventions des unités non spécialisées dans le maintien de l’ordre proviennent également d’une multiplication des objectifs assignés à ces opérations. En souhaitant judiciariser davantage les comportements individuels délictueux, l’État a également brouillé l’homogénéité des dispositifs de maintien de l’ordre. Ce phénomène, que le Rapporteur a déjà décrit précédemment, a été rappelé par M. Fabien Jobard lors de son audition : « Cette immixtion du judiciaire dans les dispositifs de maintien de l’ordre conduit des unités en civil – des brigades anti-criminalité (BAC) ou, à Paris, la brigade d’information de voie publique (BIVP) ou la section sportive de la préfecture – à intervenir selon leurs méthodes propres sans considération pour la logique d’ensemble du dispositif de maintien de l’ordre. J’ai pu le constater en 2008 lors des manifestations lycéennes que j’ai observées du côté des forces du maintien de l’ordre. […] D’une certaine manière, je ne comprends pas pourquoi aujourd’hui on a le souci de multiplier les unités en intervention dans les dispositifs de manifestation. Mieux vaudrait consolider le savoir et le savoir-faire des unités constituées, y compris dans le domaine des techniques d’interpellation. » (225)
Ce constat serait d’importance mineure si, parallèlement, les auditions de la commission ne l’avaient pas amenée à envisager que nombre de difficultés de gestion des manifestations ou de blessures irréversibles infligées lors de manifestations résultent spécifiquement de l’intervention d’unités non spécialisées en maintien de l’ordre. À l’évidence, la commission d’enquête n’avait pas pour ambition de se substituer au Défenseur des droits (qui partage cette analyse) et encore moins aux services d’inspection de la police nationale ou de la gendarmerie nationale afin d’établir des responsabilités en la matière. Cependant, le Rapporteur redoute les confusions que peut faire naître dans l’esprit du public cette mixité des interventions. Ainsi, pour ne retenir que cet exemple, est-il compréhensible pour l’opinion publique qu’un manifestant soit blessé de façon irréversible par un tir de Flashball Super-pro, alors que les forces mobiles en charge des manifestations n’en sont pas dotées en raison de son imprécision (cf. infra) ?
Ces considérations amènent le Rapporteur à préconiser que les opérations de maintien de l’ordre ne soient confiées qu’à des unités spécialisées, c’est-à-dire, notamment, spécialement formées pour les assumer sans risque pour la sécurité et en garantissant les libertés, mais aussi entraînées pour être capables d’intervenir ensemble. Une telle proposition n’est pas irréaliste, elle pourrait s’articuler sur deux préalables : l’accroissement de la disponibilité des unités spécialisées, l’instauration d’une habilitation à maintenir l’ordre pour un échantillon d’unités sur l’ensemble du territoire national.
a. Réduire l’emploi des forces mobiles pour des missions ne concernant pas le maintien de l’ordre afin d’accroître leur disponibilité
Comme l’indiquait le général Denis Favier, « certaines missions ne me semblent pas devoir être conduites par les forces mobiles. Trop nombreuses, les gardes statiques, improductives en matière de sécurité, pourraient être assurées par d’autres forces – je pense à la garde d’ambassades, à la garde de différents bâtiments publics, comme le Palais de justice à Paris. Mobiliser des forces de haute compétence pour effectuer des missions de cette nature n’est pas satisfaisant. » (226)
De même, pour M. Éric Mildenberger, délégué général d’Alliance police nationale, « pour que les missions d’interpellation soient confiées aux CRS, il faudrait que leurs forces sur le terrain soient plus nombreuses, ce qui n’est actuellement pas possible puisque nous sommes largement affectés à d’autres missions dans les zones de sécurité prioritaires (ZSP), en renfort à la police aux frontières (PAF) ou dans le cadre du plan Vigipirate. » (227)
Le Rapporteur ne revient pas sur l’éventail des missions étrangères au maintien de l’ordre incombant aux unités mobiles. Il observe qu’il y a toujours une réalité budgétaire à assumer et ne saurait condamner par principe le souci d’optimiser le temps d’emploi des milliers d’hommes et de femmes constituant les unités mobiles. Cependant, il s’interroge sur la pertinence d’un arbitrage qui conduirait trop d’opérations de maintien de l’ordre à devoir être conduites par des unités non spécialisées, en particulier lorsque des risques de troubles à l’ordre public existent, comme ce fut le cas régulièrement lors du mouvement dit des « bonnets rouges » en Bretagne en 2013. C’est pourquoi il recommande au Gouvernement de procéder à une révision des missions hors maintien de l’ordre des unités mobiles de façon à en réduire le poids, afin de parvenir à une disponibilité opérationnelle plus satisfaisante de ces unités.
b. Créer une habilitation au maintien de l’ordre pour les unités constituées de la police et de la gendarmerie nationales, hors forces mobiles
Il convient cependant de rester pragmatique. Dans l’urgence, indépendamment même des problématiques de disponibilité des unités mobiles, il est logique et même souhaitable que l’autorité civile puisse recourir immédiatement aux unités de sécurisation dont elle a la disposition réelle. C’est pourquoi il n’est possible au Rapporteur de recommander l’emploi exclusif d’unités spécialisées en maintien de l’ordre qu’après avoir, au préalable, préconisé d’instituer, pour un nombre restreint d’unités de police et de gendarmerie réparties sur le territoire national, une habilitation à maintenir et rétablir l’ordre. Cette habilitation pourrait être délivrée sous l’égide des unités mobiles, en s’appuyant sur leurs protocoles de formation et en utilisant leurs infrastructures d’entraînement. Pour certaines unités, une telle habilitation ne nécessiterait probablement, d’ailleurs, aucune démarche de formation initiale supplémentaire, compte tenu de leur savoir-faire déjà reconnu en matière de maintien de l’ordre.
L’objectif d’une telle habilitation serait d’offrir à l’autorité civile la garantie de pouvoir recourir, en première urgence et dans l’attente de l’intervention des forces mobiles spécialisées, à un petit volume d’unités parfaitement formées au maintien de l’ordre :
– au fait du cadre juridique et doctrinal du maintien de l’ordre ;
– disposant de l’équipement nécessaire ;
– disposant des habilitations à l’usage des principales armes et munitions du maintien de l’ordre (par exemple lanceur de grenades de type Cougar) ;
– maîtrisant les principales manœuvres des unités mobiles ;
– présentant un haut niveau de discipline collective forgé par un entraînement spécialisé en unité constituée.
Pour le Rapporteur, ce processus d’habilitation présenterait trois avantages principaux.
Premièrement, il apporterait aux préfets une solution immédiate efficace pour maintenir ou rétablir l’ordre face à un risque brutal ou inopiné.
Deuxièmement, pour le préfet et le ministère, l’habilitation de ces unités constituerait une façon de restaurer des marges temporelles. Malheureusement, face à un événement non déclaré, inopiné, souvent très violent, les réactions dans l’urgence de l’autorité civile se font non seulement avec des moyens parfois moins bien formés mais aussi en privilégiant le seul objectif supérieur de défense du terrain. La disposition d’unités habilitées capables de protéger efficacement et dans le respect de la doctrine les objectifs principaux de l’autorité civile, permet à celle-ci de disposer de temps. Ce temps sera logiquement mis à profit pour renforcer le dispositif de maintien de l’ordre au moyen d’unités mobiles mais aussi pour établir un dialogue avec les participants à l’attroupement, que l’urgence ne permet pas habituellement d’établir avant que la dispersion par la force ne s’impose.
Troisièmement, l’habilitation au maintien de l’ordre d’unités de sécurisation devrait favoriser une meilleure coordination avec les unités mobiles. En effet, dans le contexte actuel, la composition des dispositifs de maintien de l’ordre ne va pas sans poser parfois certains problèmes opérationnels, comme l’ont souligné plusieurs personnes auditionnées (cf. supra).
3. Recentrer l’équipement des forces chargées du maintien de l’ordre sur les besoins liés à la gestion des foules
a. Restreindre l’usage du lanceur de balles de défense LBD 40x46 lors des opérations de maintien de l’ordre aux seules forces mobiles et aux forces dûment formées à son emploi dans le contexte particulier du maintien de l’ordre
● D’après les informations recueillies par la commission et comme l’a confirmé le Défenseur des droits (228), il apparaît que la majorité des blessures graves provoquées par l’utilisation, par les forces de l’ordre, de lanceurs de balles de défense (au sens générique) n’ont manifestement pas été infligées par des membres d’unités spécialisées dans cette mission, a fortiori lorsque de telles blessures résultent de tirs de Flash-Ball qui ne sont pas en dotation au sein de ces unités. Or, le maintien de l’ordre étant le seul et unique objet de la commission d’enquête, les développements et préconisations qui suivent ne concerneront que l’usage de certains équipements dans le cadre d’opérations de maintien de l’ordre, la commission n’ayant pas reçu mandat pour investiguer d’autres champs.
Il n’en demeure pas moins que, au-delà du seul champ d’analyse de la commission, les témoignages particulièrement forts des blessés, parents de blessés et professionnels médicaux ayant eu à connaître de telles blessures (229), reproduits en intégralité en annexe du rapport, doivent amener les pouvoirs publics à poursuivre leur réflexion sur les conditions d’utilisation, voire le maintien de tels équipements dans certaines situations opérationnelles. En effet, ces armes peuvent occasionner des blessures dramatiques lorsque le visage notamment et, en particulier, les yeux sont atteints, avec des risques non négligeables d’énucléation, et toutes les conséquences que de telles blessures impliquent aux plans personnel, professionnel, et social. Par nature, aucun dispositif d’expression de la force n’est totalement inoffensif. Toutefois, en dehors de circonstances accidentelles, malheureuses mais imprévisibles, la sanction d’un individu même extrêmement violent ou coupable de dégradations ne saurait être que de nature pénale, sans être doublée d’une mutilation physique irréversible.
Les lanceurs de balles de défense ont été progressivement introduits dans l’équipement des forces de l’ordre il y a 20 ans déjà, à compter de 1995 : Flash-Ball modèle Compact en 1995, puis modèle Super-pro en 2001 et LBD à partir de 2007. Depuis la mise en dotation de ces équipements et d’après les informations fournies par les représentants de l’Assemblée des blessés, des familles et des collectifs contre les violences policières (230), on recense, toutes opérations et toutes forces de l’ordre confondues, 36 cas connus de blessures graves ou de mutilations. Un homme est également mort en 2011 des suites d’un arrêt cardio-respiratoire après avoir été touché par un tir de Flash-Ball au niveau du thorax (231).
● Pour ce qui concerne le seul maintien de l’ordre, le Rapporteur souhaite tout d’abord rappeler succinctement les caractéristiques principales du Flash-Ball et du LBD et présenter leurs différences. Il ne reviendra pas sur les conditions règlementaires d’utilisation de ces équipements, rappelées par l’instruction du 2 septembre 2014 commune à la DGPN et la DGGN (232) et par le rapport du Défenseur des droits consacré à trois moyens de force intermédiaire (233).
Le Flash-Ball modèle Super-pro (ci-après Flash-Ball) est un lanceur manuel à deux coups, sans crosse d’épaule, composé de deux canons superposés basculants et lisses et doté d’une « poignée pistolet » permettant son usage à une main. Les cartouches tirées contiennent un projectile sphérique en caoutchouc souple conçu pour se déformer à l’impact et limiter ainsi le risque de pénétration.
Le LBD 40x46 (234) (ci-après LBD) est une arme mono-coup d’épaule composée d’un canon basculant et rayé. Il s’utilise horizontalement, un genou à terre ou debout et porté à l’épaule. Il est en outre doté d’un dispositif de visée électronique dénommé désignateur d’objectif électronique (DOE). Les munitions tirées se composent d’une douille en polymère et d’un projectile bi-matière (235) également développé pour se déformer à l’impact et limiter le risque de pénétration.
FLASH-BALL SUPER-PRO

LBD 40X46

Le canon rayé et la présence d’un système d’aide à la visée font du LBD un modèle beaucoup plus précis (236) que le Flash-Ball dont les canons lisses affectent la précision et la stabilité de la trajectoire des projectiles. Compte tenu de ce défaut de précision, le Flash-Ball n’est manifestement pas adapté lorsque les forces de l’ordre interviennent lors de manifestations et autres événements de voie publique qui sont l’occasion de rassemblements compacts d’individus et qui peuvent, en outre, dégénérer (237). De fait, le Rapporteur souscrit pleinement à la recommandation du Défenseur des droits de proscrire ou limiter très strictement l’usage du Flash-Ball Super-pro dans le cadre de manifestations (238). Avec sa préconisation tendant à réserver les opérations de maintien de l’ordre aux unités spécialisées ou dûment formées et équipées en conséquence – donc sans Flash-Ball, le Rapporteur va plus loin que cette recommandation puisque les unités de police dotées de cet équipement ne participeraient plus à de telles opérations.
Le cas du LBD appelle des remarques différentes. Certes, et en cela il se rapproche du Flash-Ball, le LBD n’est pas, par essence, une arme dont la mise en œuvre est totalement conforme avec la doctrine traditionnelle du maintien de l’ordre. Alors que celle-ci considère la foule en tant qu’entité à laquelle répond, le cas échéant, la force exercée par les unités de maintien de l’ordre de manière collective, le LBD individualise à la fois les comportements des manifestants et la réponse des forces de l’ordre. M. Joachim Gatti l’a résumé de la manière suivante : « [Les Flash-Ball et LBD] ne s’adressent pas au corps collectif des manifestants mais à une seule personne. Ensuite, ils ne repoussent pas mais frappent. S’ils dispersent, ce n’est pas par l’exercice contenu de la force contre l’ensemble des manifestants mais par l’extrême violence exercée sur l’un d’entre eux. » (239) En outre, une manifestation peut se caractériser par une grande confusion, avec des mouvements de foule ou d’individus rapides et désordonnés qui rendent très difficile, voire aléatoire, la mise en œuvre d’une réponse individuelle de manière sécurisée.
Pour autant, le Rapporteur tient à effectuer quelques rappels importants. Tout d’abord, en maintien de l’ordre et hors cas de légitime défense, le LBD ne peut être employé que lors d’un attroupement et dans l’hypothèse où des violences ou voies de fait sont exercées contre les forces de l’ordre ou que celles-ci ne peuvent défendre autrement le terrain qu’elles occupent (240). Autrement dit, en maintien de l’ordre, le LBD est une arme de défense d’exception, à laquelle les forces ne peuvent règlementairement recourir qu’en situation d’urgence, confrontées à un certain degré de violence et si elles ne peuvent mettre en œuvre aucune solution alternative. Il ne vise pas à disperser des manifestants simplement agités, mais des individus qui se rendraient coupables de violences ou de voies de fait, comportements qui ne sont objectivement pas anodins. De fait et dans certaines situations opérationnelles extrêmes, le LBD constitue parfois le seul recours possible pour permettre la mise en œuvre d’un principe majeur de la doctrine traditionnelle du maintien de l’ordre : le maintien à distance entre manifestants et forces de l’ordre.
Par ailleurs, l’introduction, dans l’équipement à disposition des forces de l’ordre, de moyens de force intermédiaire – dont font partie les lanceurs de balles de défense – est rendu nécessaire pour protéger le droit à la vie consacré par l’article 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et les libertés fondamentales. Ainsi, la CEDH a condamné la Turquie sur ce fondement au motif que les forces de police turques n’étaient pas dotées d’armes de substitution aux armes à feu et n’avaient donc d’autre choix que d’utiliser celles-ci au cours de manifestations violentes (241).
Enfin, même si des interrogations légitimes et des oppositions de principe au demeurant parfaitement compréhensibles persistent, notamment pour les raisons précédemment rappelées, le Défenseur des droits, dont l’indépendance n’est pas à démontrer, n’a lui-même pas recommandé une interdiction absolue de tous les lanceurs de balles de défense en opérations de maintien de l’ordre : il a préconisé le retrait du seul Flash-Ball ou une limitation stricte de son utilisation.
La préoccupation centrale du Rapporteur est de concilier deux exigences : maintenir l’éventail opérationnel le plus étendu possible pour assurer une gradation effective, efficace et sécurisée de la réponse des forces de l’ordre, tout en préservant l’intégrité physique des manifestants. Dès lors il préconise de restreindre l’usage du LBD, en maintien de l’ordre, aux seules forces mobiles ainsi qu’aux forces « habilitées » à cette mission et dûment formées à son emploi dans le contexte particulier que constitue une opération de maintien de l’ordre.
Ce sujet a divisé la commission d’enquête. Certains de ses membres, à l’image de son Président, sont partisans d’une interdiction absolue de l’ensemble des lanceurs de balles de défense, quelles que soient leurs caractéristiques ou leur appellation. D’autres ne sont pas favorables à la perspective de réduire l’équipement des forces de l’ordre. Le Rapporteur a conscience que sa position risque de mécontenter les deux parties, non seulement au sein de la commission mais au-delà – blessés et leurs proches d’un côté, forces de l’ordre de l’autre.
Il l’assume pleinement, convaincu que cette position mesurée est raisonnable, cohérente avec le raisonnement d’ensemble qui a guidé son rapport et ses préconisations, et parfaitement applicable. Elle permet de préserver l’efficacité opérationnelle des forces de l’ordre tout en apportant des garanties de sécurité supplémentaires aux manifestants dès lors que ce type d’équipement serait exclusivement mis en œuvre par des unités spécialisées parfaitement rompues aux manœuvres réalisées dans le contexte particulier des événements de voie publique.
Les tableaux suivants retracent l’utilisation du LBD par les forces de police et de gendarmerie toutes opérations confondues (pas uniquement en maintien de l’ordre). Si l’on constate un recours beaucoup plus fréquent à cet équipement par la police nationale, tel n’est pas le cas pour la gendarmerie avec un usage en constant déclin depuis 2010, au point que celui-ci est devenu marginal. Pour la police, ce recours plus important au LBD va de pair avec une diminution tendancielle de l’utilisation du Flash-Ball (589 utilisations en 2012 contre 785 en 2010). Sur la période considérée, les forces de police ont tiré en moyenne 2,7 munitions par opération et les forces de gendarmerie 2 munitions.
UTILISATION DU LBD 40X46 PAR LA POLICE
2010 |
2011 |
2012 | |
Nombre de situations opérationnelles |
171 |
345 |
623 |
Nombre de munitions utilisées |
480 |
994 |
1 514 |
Nombre de munitions utilisées par opération |
2,8 |
2,9 |
2,4 |
Source : Défenseur des droits, Rapport sur trois moyens de force intermédiaire, 2013 ; calculs du Rapporteur.
UTILISATION DU LBD 40X46 PAR LA GENDARMERIE
2010 |
2011 |
2012 | |
Nombre de situations opérationnelles |
47 |
34 |
21 |
Nombre de munitions utilisées |
84 |
66 |
52 |
Nombre de munitions utilisées par opération |
1,8 |
1,9 |
2,5 |
Source : Défenseur des droits, Rapport sur trois moyens de force intermédiaire, 2013 ; calculs du Rapporteur.
b. Développer de nouveaux moyens intermédiaires visant à disperser les foules
Afin d’assurer l’efficacité de la réponse opérationnelle des forces de l’ordre tout en garantissant une sécurité maximale aux manifestants, le Rapporteur estime nécessaire de poursuivre les analyses, études et développements relatifs à la conception de nouveaux moyens intermédiaires.
À cet égard, l’utilisation de grenades projetant, à faible hauteur, des galets de caoutchouc peut constituer une alternative intéressante, ainsi que le soulignait M. Fabien Jobard (242).
D’autres solutions sont à l’étude. D’après les informations communiquées par le service de l’achat, des équipements et de la logistique de la sécurité intérieure (SAELSI), son centre de recherche et d’expertise de la logistique (CREL) travaille sur les solutions techniques suivantes :
– systèmes lumineux produisant un éblouissement non vulnérant ;
– systèmes sonores diffusant des messages ou utilisant des fréquences provoquant un inconfort.
Dans ses réponses au questionnaire adressé par la commission d’enquête, la direction générale de la gendarmerie nationale a, par ailleurs, indiqué que le SAELSI travaillait à l’expérimentation d’armes non létales telles que des grenades à effet sonore sans effet de souffle ou des grenades à effets multiples (sonore, cinétique, lacrymogène).
c. Renforcer et rénover les moyens mécaniques pour pallier les diminutions d’effectifs et favoriser l’émergence de nouveaux schémas tactiques
Un autre axe de réflexion pourrait consister à renforcer le parc de véhicules de maintien de l’ordre à disposition des forces, soit en procédant à la rénovation et à l’adaptation des véhicules anciens, soit en effectuant des acquisitions de nouveaux moyens. Tout en étant conscient de la contrainte budgétaire, le Rapporteur considère qu’il s’agit là d’une piste intéressante qui pourrait permettre, d’une part, de compenser partiellement les diminutions d’effectifs et, d’autre part, de faire émerger ou de consolider des schémas tactiques cohérents avec la doctrine classique du maintien de l’ordre.
Les 84 véhicules blindés à roues de la gendarmerie (VBRG) sont entrés en service en 1974. Âgés de plus de 40 ans, leur renouvellement est demandé par la gendarmerie depuis de nombreuses années – 20 ans d’après M. Bertrand Cavallier (243). Or de tels véhicules peuvent constituer une aide précieuse lors d’opérations de maintien de l’ordre. Ils sont notamment susceptibles de tenir efficacement une position ou d’en empêcher l’accès en lieu et place de gendarmes mobiles. Ils peuvent dès lors permettre de redéployer au moins une partie des effectifs sur d’autres positions en statique, ou de les employer à des manœuvres nécessitant une plus grande mobilité.
Les véhicules lanceurs d’eau présentent les mêmes avantages de libération des ressources en hommes et d’accroissement de la mobilité, tout en permettant une riposte conforme à la doctrine de maintien de l’ordre puisqu’elle vise la foule en tant que corps collectif. Toutefois, parmi les deux forces mobiles, seules les CRS en sont dotées. Le Rapporteur estime qu’une réflexion pourrait utilement s’engager sur la perspective de doter également les EGM d’engins lanceurs d’eau.
De tels dispositifs mécaniques ne sont certes pas susceptibles d’être déployés sur l’ensemble des terrains de maintien de l’ordre. En outre, pour ce qui concerne les lanceurs d’eau, leur utilisation peut s’avérer dangereuse du fait de la force de projection ou si le canon à eau est actionné à trop courte distance. Toutefois, aucun moyen de riposte à disposition des forces de l’ordre n’est totalement inoffensif et le Rapporteur observe que les lanceurs d’eau sont régulièrement utilisés dans plusieurs pays étrangers.
Au-delà de ces matériels, il conviendrait également de renforcer les moyens statiques de gestion des foules avec notamment les dispositifs de retenue autonome du public (DRAP) et autres « barre-pont » qui permettent de tenir des espaces avec un nombre réduit de personnels tout en offrant une protection renforcée.
Au total, un recours plus large à de tels équipements pourrait s’avérer pertinent en permettant :
– de pallier, dans une certaine mesure, la réduction des effectifs ;
– de redonner de la mobilité aux unités ;
– et de développer de nouveaux schémas tactiques.
4. Faciliter la judiciarisation des infractions commises lors ou en marge d’une manifestation
En conclusion de ses préconisations visant à offrir une palette graduelle d’instruments pour une gestion proportionnée des manifestations, le Rapporteur considère que les conditions de judiciarisation des délits commis à l’occasion de celles-ci devraient également être améliorées. Ce souci de mieux judiciariser n’est pas récent, de même, comme l’a indiqué M. François Molins que « la qualité des procédures n’est pas un problème nouveau. » Selon le procureur de la République de Paris, « la direction des affaires criminelles et des grâces diffuse régulièrement depuis le milieu des années 1990 des circulaires qui appellent l’attention des procureurs sur la nécessité de se rapprocher des préfets et de veiller à l’existence de dispositifs de police judiciaire suffisants lors des manifestations. Si la qualité des procédures pose problème et si tant de procédures tombent, la raison en est simple : le dispositif judiciaire n’est pas au niveau qui devrait être le sien dans le traitement du maintien de l’ordre. Cela ne nécessite pas forcément une modification législative mais peut-être plus de travail en commun. » (244)
a. Privilégier la capacité des unités spécialisées à interpeller des groupes d’individus violents
Le Rapporteur les a évoquées précédemment, les préfets ont déjà tenté d’apporter des solutions aux exigences de judiciarisation des délits commis lors des manifestations, d’une opinion publique de plus en plus attentive et alimentée en images marquantes sur le déroulement des opérations de maintien de l’ordre.
Dans certains cas, le dispositif mis en place par la préfecture mélange unités constituées spécialisées dans le maintien de l’ordre et unités en charge de la mission de police judiciaire, avec parfois les difficultés de coordination évoquées précédemment. Ces tentatives, indubitablement source de confusion sur les opérations de maintien de l’ordre (cf. supra), ont été critiquées par plusieurs personnes auditionnées par la commission, tels que M. Fabien Jobard. Par ailleurs, il est difficile au Rapporteur de dresser un constat de leur efficacité en termes de politique pénale à l’encontre de la délinquance pendant les manifestations.
En tout état de cause, le Rapporteur a été davantage convaincu par les solutions consistant à renforcer l’action d’interpellation des unités spécialisées dans le maintien de l’ordre. Ainsi, à Paris, et dans quelques grandes métropoles, ces solutions reposent sur l’emploi de nouvelles unités d’intervention, intervenant parfois de façon mixte, en civil et en tenue, disposant d’un équipement et de tactiques proches de ceux des unités mobiles, mais également de fraction d’unités formées pour interpeller des individus au sein des manifestations.
C’est ce que propose de généraliser le préfet de police de Paris : « Les modalités d’intervention des forces de sécurité évoluent régulièrement. Nous sommes ainsi en train de rassembler en une seule unité les brigades d’information de voie publique (BIVP) de tous les districts, afin de constituer un groupement capable d’intervenir au sein des manifestations pour interpeller certains individus ou pour extraire des personnes se trouvant en danger – un peu comme le font les unités civiles des compagnies d’intervention. Je suggère que les unités de la réserve nationale, les escadrons de la gendarmerie mobile et les compagnies républicaines de sécurité puissent s’engager dans cette évolution, ce que le droit ne permet pas actuellement. » (245)
Il semble ainsi possible de préconiser que soient abandonnés les dispositifs mixtes, mêlant unités constituées spécialisées dans le maintien de l’ordre et unités en charge de la police judiciaire, au profit d’un renforcement des compétences et des moyens d’action des seules unités spécialisées. Une telle solution garantirait une plus grande clarté des opérations de maintien de l’ordre, en particulier pour le public et les manifestants.
Cependant, elle a également pour effet de subordonner l’action judiciaire à la manœuvre générale des unités spécialisées, c’est-à-dire de faire primer la préservation immédiate de l’ordre public sur la recherche des sanctions pénales individuelles. Pour être pleinement acceptable, un tel compromis devrait donc être complété par un réel développement de manœuvres collectives d’interpellation par les unités spécialisées, c’est-à-dire de schémas tactiques permettant aux forces déployées de poursuivre simultanément une pluralité d’objectifs.
b. Créer de meilleures conditions d’interpellation en cas de commission de délits flagrants lors des manifestations
Le Rapporteur estime que la structuration des unités intervenant en maintien de l’ordre ne réglera pas l’essentiel des obstacles à la judiciarisation, car ceux-ci sont de nature procédurale et en définitive juridique.
● Utiliser systématiquement la vidéo pour nourrir la procédure judiciaire d’autres éléments probants que les procès-verbaux.
M. François Molins a souligné l’exigence de la procédure pénale : « Nous sommes donc soumis à un impératif : disposer des éléments de preuve qui ont pu être retenus contre la personne interpellée et qui vont reposer le plus souvent sur le témoignage de l’agent interpellateur. […] Il est impératif d’améliorer la qualité du traitement judiciaire. De nombreuses réunions ont été organisées depuis deux ans pour améliorer le dispositif. Mais les procédures continuent à tomber parce que les règles procédurales n’ont pas été respectées ou parce que le recueil des éléments de preuve est insuffisant. » (246)
Le général Denis Favier a lui aussi relevé toute la difficulté de mettre en œuvre la procédure pénale et les règles propres aux enquêtes et aux interpellations dans le cadre spécifique du maintien de l’ordre : « Nous devons donc également être capables, en termes judiciaires, de les confondre – d’apporter des éléments de preuve, c’est-à-dire être capables de les identifier et de les lier directement à un fait. Or les individus en question sont souvent casqués, parfois cagoulés. Il s’agit de développer une action cohérente avec l’autorité judiciaire. » (247)
La généralisation de la captation vidéo des opérations de maintien de l’ordre offre aujourd’hui davantage d’éléments probants des infractions que par le passé. Le recours aux nouvelles technologies permet ainsi aux unités chargées du maintien de l’ordre de fournir rapidement des images fixes et des images « en direct » des conditions de la manifestation et, éventuellement, des délits commis. Le recours systématique à la vidéo offre donc, dans le cadre de la procédure judiciaire, une première solution de simplification des constatations.
Or, le Rapporteur observe qu’une fois les individus gardés à vue dans le respect des procédures, leur poursuite ne pose pas de réel problème pour le parquet. Le procureur de Paris a ainsi expliqué que « si la procédure est régulière, nous privilégions, en cas d’infraction commise contre les forces de l’ordre – violences volontaires par jets de projectiles ou rébellions – ou contre les biens – destructions volontaires par incendie ou bris de vitrines –, une réponse binaire : soit les charges ne sont pas suffisantes et la procédure fait l’objet d’un classement sans suite ; soit les charges sont suffisantes, et, compte tenu du trouble à l’ordre public, nous faisons déférer la personne interpellée au parquet pour engager ensuite des poursuites rapides devant le tribunal correctionnel par voie de comparution immédiate ou de convocation par procès-verbal dans un délai de deux mois, assortie d’une mesure de contrôle judiciaire. » (248)
● La procédure pénale est mal insérée dans l’exercice de police administrative qu’est le maintien de l’ordre.
Dès lors, l’amélioration du traitement judiciaire des actes commis lors des manifestations doit se concentrer sur une articulation précise de la procédure : l’interpellation par une unité spécialisée, le placement en garde à vue et la notification des droits par un officier de police judiciaire.
Or, deux principales difficultés ont été signalées sur cette articulation par les personnes entendues par la commission : le nombre de personnes interpellées lors d’opération de maintien de l’ordre qui a une incidence sur le respect ou non des délais procéduraux, d’une part, et le statut des agents réalisant l’interpellation qui a une incidence sur le dispositif tactique de maintien de l’ordre, d’autre part.
En premier lieu, la procédure judiciaire s’adapte difficilement aux grands effectifs. M. François Molins soulignait « que la gestion de cette mission n’est pas la même selon le nombre de personnes interpellées. Dans tous les cas, les contraintes procédurales sont très fortes.
Il peut d’abord être compliqué de contrôler l’identité d’un nombre important de manifestants dans certaines conditions de tension. Ensuite, dès l’interpellation et le placement en garde à vue, les droits doivent être notifiés immédiatement à la personne placée en garde en vue et le parquet doit être avisé dès le début de la mesure. L’expérience démontre que, lorsque l’on est confronté à de nombreuses interpellations, les délais ne sont pas toujours respectés – c’est un euphémisme. Cela nous conduit à décider la remise en liberté de la personne et à procéder au classement de la procédure pour irrégularité, sauf si, compte tenu de l’ampleur du trouble à l’ordre public, nous retenons les circonstances insurmontables qui permettent de déroger aux exigences légales et jurisprudentielles. » (249)
Ce risque de non-respect des délais a également été rapporté par le préfet Christian Lambert : « quand il est procédé à une interpellation, la notification des droits doit être faite immédiatement. Au cours de mon travail d’information et d’expertise, j’ai rencontré de nombreux procureurs qui ont confirmé ce que j’avais pu constater en occupant mes différents postes : la conduite au commissariat d’une personne interpellée est une perte de temps et, bien souvent, le fait de ne pouvoir lui notifier ses droits dans les délais impartis empêche toute poursuite. » (250)
Ce dérapage du temps de la procédure tient naturellement d’abord aux conditions particulières du maintien de l’ordre, que l’entraînement des unités spécialisées devrait permettre de surmonter.
Mais il tient aussi, en second lieu, à la computation d’opérations successives qui pourraient être mieux conjuguées. Ainsi, lorsque les unités en charge du maintien de l’ordre interpellent un individu se rendant coupable d’un délit de façon flagrante, elles doivent le présenter à l’officier de police judiciaire le plus proche, elles-mêmes étant temporairement dépourvues de cette qualité (cf. supra). Or, comme l’a rappelé le procureur de Paris, « la police doit aviser téléphoniquement le parquet et ce, dans de très brefs délais. Le code de procédure pénale exige que le procureur de la République soit avisé de la garde à vue dès le début de la mesure et selon la jurisprudence la plus récente, dans un délai d’une heure quinze. Au-delà de ce délai, sauf circonstances insurmontables, l’avis est considéré comme tardif et la procédure est jugée irrégulière. » (251)
Pour que cet officier de police judiciaire déclenche la garde à vue, notifie ses droits à l’intéressé et alerte le parquet, il importe donc que les agents qui ont interpellé et contrôlé l’identité soient en mesure de joindre un procès-verbal d’arrestation à la procédure… alors même que l’opération de maintien de l’ordre se poursuit avec un dispositif affaibli et qu’à son terme, les agents des unités mobiles quitteront la circonscription.
● Les tentatives de réponses déjà apportées à Paris.
Plusieurs réponses ont d’ores et déjà été expérimentées afin que cet enchaînement de procédures soit donc plus fluide et rapide. Ainsi pour M. Christian Lambert : « Il faut donc prévoir, pour une notification immédiate, la présence sur le terrain d’une petite unité judiciaire dédiée. » (252) Le préfet de Police et le procureur de Paris ont évoqué pour leur part à la fois la spécificité des compagnies d’intervention mixtes (civil/tenue) de la préfecture de police et la mise à disposition d’une « fiche d’interpellation », facile à remplir et conçue pour accélérer la saisie d’un procès-verbal : « Ce schéma permet d’apporter une réponse complète à la problématique des fauteurs de trouble insérés dans les cortèges mais aussi à celle de la délinquance acquisitive lors de grands regroupements. Ces compagnies mixtes permettent en outre d’obtenir un meilleur traitement judiciaire, notamment grâce à l’amélioration de la rédaction des PV de contexte et des procédures d’interpellation. Leur travail est toujours accompagné d’un vidéaste professionnel filmant leurs interventions. » (253)
Pour sa part, le Rapporteur estime que si l’expérience parisienne apporte de meilleures réponses en matière de judiciarisation, c’est par la coordination entre les autorités administrative et judiciaire. Cette complémentarité d’action a été soulignée par le préfet de police de Paris : « Lors des manifestations les plus importantes, nous travaillons constamment sous le contrôle du parquet – avec les magistrats de permanence, mais également avec le procureur de la République si nécessaire. Ce travail se fait en respectant des compétences de chacun, mais dans des conditions permettant de faire face à des situations parfois inédites. […] Je me félicite de la qualité des relations qui existent entre la préfecture de police et le procureur de la République de Paris. » (254)
Ce dernier a fourni à la commission un descriptif précis du partage des rôles et des bonnes conditions de coordination entre les autorités administratives et judiciaires (255) :
« Le procureur de la République n’est pas en charge de l’ordre public. Son rôle consiste, dans le respect des libertés individuelles dont il est le garant, à rechercher et à faire constater les infractions à la loi pénale, à poursuivre leurs auteurs puis à statuer sur la suite à donner à ces procédures. Il s’appuie pour cela sur la direction de la police judiciaire et dispose du libre choix du service de police à qui il va confier l’enquête. Cela ne le dispense pas de travailler en liaison étroite avec l’autorité administrative, notamment le préfet. […] Nous sommes bien évidemment en liaison constante avec la direction de sécurité de proximité de l’agglomération parisienne (DSPAP) et le cabinet du préfet de police qui nous avise de la manifestation et des éventuels problèmes qu’elle a pu poser en amont ou qu’elle est susceptible d’entraîner au vu des renseignements dont ils disposent.
Dès que nous sommes avisés d’une manifestation, particulièrement en cas de risque de dérive violente, nous sensibilisons les services de police à la nécessité de prévoir un dispositif, que je qualifierai de judiciaire, permettant de rassembler les preuves des infractions et d’interpeller les auteurs présumés. Ces échanges ont pour but de s’entendre sur l’utilisation de la vidéo, sur l’équipement de certains personnels avec du matériel vidéo portable et sur la présence en nombre suffisant d’enquêteurs judiciaires.
En aval, le parquet est amené à intervenir si des interpellations ont été réalisées à la suite d’infractions constatées par les forces de l’ordre. (…) Pour gérer ces interpellations, le parquet de Paris s’appuie sur une organisation spécifique qui varie selon l’ampleur de la manifestation.
Nous avons donc travaillé avec la préfecture de police et les services de la DSPAP et de la direction de l’ordre public et de la circulation (DOPC) pour rappeler le cadre juridique du travail de la police qui s’appuie sur trois grandes procédures : le contrôle d’identité, la procédure de dispersion en cas d’attroupement et la garde à vue. »
● Des solutions de meilleure coordination entre la police du maintien de l’ordre et les procédures judiciaires.
D’une manière plus générale, au-delà des bonnes relations de travail devant exister entre elles, le Rapporteur considère que la coordination entre les autorités civiles et le parquet peut apporter de réelles solutions aux difficultés de judiciarisation des délits commis lors des manifestations.
En effet, comme l’a indiqué le procureur de Paris : « Le traitement judiciaire de l’ordre public est intimement lié au choix qui sera fait par l’autorité administrative. Cela justifie un travail en amont et en synergie. En tout état de cause, l’intervention judiciaire dépend du traitement de la manifestation : par exemple, si de faibles moyens sont affectés au recueil des preuves d’infraction, si la manifestation dégénère, et si le préfet décide ne pas intervenir et de laisser commettre les infractions parce qu’il choisit de se concentrer sur d’autres impératifs, le traitement judiciaire n’aura pas lieu d’être. À l’inverse, dans certaines manifestations, priorité peut être donnée à une intervention des forces de l’ordre, de nature judiciaire, pour extraire les fauteurs de troubles de la manifestation et les remettre ensuite à la justice. » (256)
Dans de tels cas, comme le suggère M. François Molins, un dispositif coordonné d’interpellation, de recueil de preuves, de contrôle d’identité, de notification des droits et de placement en garde à vue doit être mis en place afin que le déferrement se traduise ensuite par une procédure pénale efficace.
Toutefois, une telle coordination ne nécessite pas absolument la présence d’un magistrat, qui, par ailleurs, pourrait s’avérer difficile à obtenir sur chaque manifestation : « Je ne suis pas favorable à la présence systématique du parquet. D’une part, l’obligation de présence du parquet n’est pas indifférente en termes de moyens. Si, à Paris, le magistrat de la permanence criminelle est affecté à la salle de commandement, il faudra trouver quelqu’un pour assurer la permanence criminelle. Cela pose donc des problèmes d’organisation et d’effectifs. D’autre part, au vu de mon expérience, la systématisation de la présence du parquet ne s’impose pas car, dans certains cas, elle ne s’avère pas nécessaire.
Nous devons toutefois faire preuve d’une vigilance marquée qui se traduit par une relation constante avec le préfet et la DSPAP. Si la manifestation dégénère, nous prenons la décision d’envoyer quelqu’un dans la salle de commandement pour veiller au respect des contraintes procédurales. » (257)
Pour le Rapporteur, l’articulation entre l’interpellation d’un individu et son déferrement au parquet peut être améliorée par la présence d’un officier de police judiciaire lors de l’intervention des forces de l’ordre visant à faire cesser la commission du délit. Cette présence renforcerait le caractère probant des constatations effectuées et authentifierait les images fournies par l’unité mobile. Elle permettrait aussi, le cas échéant, une notification immédiate des droits (après extraction de la manifestation) et la signification du placement en garde à vue, pourvu que le préfet et le commandant de la force publique aient organisé un local de permanence à proximité de la manifestation. Le Rapporteur préconise donc que soient envisagées et comparées les solutions permettant aux pelotons d’intervention des EGM et aux SPI des CRS d’interpeller les auteurs de délits en présence d’un officier de police judiciaire. Celui-ci pourrait être un officier de police judiciaire de la circonscription. Celui-ci pourrait également être l’officier commandant le peloton ou le SPI, sous réserve que soit levé l’obstacle (article 16 du code de procédure pénale, cf. supra) de la suspension temporaire de sa qualité d’OPJ et qu’il soit habilité en tant que tel par le procureur.
A. REDONNER DES MOYENS À L’AUTORITÉ CIVILE EN AMONT DES MANIFESTATIONS : UN CHANTIER DÉJÀ OUVERT
• Thème n° 1 : Professionnaliser le maintien de l’ordre dans les préfectures les plus exposées
> Proposition n° 1 : Créer soit une task force préfectorale spécialisée dans le maintien de l’ordre et mobile rapidement, soit des professionnels du maintien de l’ordre dans les préfectures les plus exposées.
• Thème n° 2 : Réaffirmer l’autorité et la présence indispensable de l’autorité civile
> Proposition n° 2 : Clarifier les rôles respectifs de l’autorité exclusive du préfet et des forces mobiles
> Proposition n° 3 : Assurer la présence permanente de l’autorité civile pendant les opérations de maintien de l’ordre et non pas seulement pour engager la force
B. RECRÉER DES FORMES DE CONCERTATION ENTRE LES AUTORITÉS CIVILES ET POLICIÈRES, D’UNE PART, ET LES MANIFESTANTS RESPECTUEUX DE L’ORDRE PUBLIC, D’AUTRE PART
• Thème n° 3 : Formaliser et diffuser les séquences types d’une opération de maintien de l’ordre et communiquer sur les bonnes pratiques en matière de manifestation
> Proposition n° 4 : Créer un guide d’action à usage des préfets et le communiquer aussi largement que possible
> Proposition n° 5 : Simplifier et rendre plus compréhensibles les sommations et la communication à destination des manifestants
• Thème n° 4 / proposition n° 6 : Faciliter le suivi par la presse des opérations de maintien de l’ordre
• Thème n° 5 : Aménager les procédures judiciaires et administratives afin que des individus isolés ne puissent prendre en otage la liberté publique de manifester
> Proposition n° 7 : Rappeler le dispositif actuel permettant de prononcer une peine complémentaire d’interdiction ponctuelle de manifester sur la voie publique en cas de condamnation pour des violences commises lors de troubles à l’ordre public (interdiction judiciaire)
> Proposition n° 8 : Permettre la mise en œuvre, par arrêté préfectoral, de mesures de police administrative portant interdiction individuelle de participer à une manifestation (interdiction administrative)
• Thème n° 6 : Organiser une médiation systématique et continue entre les forces chargées du maintien de l’ordre et le public manifestant, avant, pendant et après l’événement
> Proposition n° 9 : Fixer le principe d’une concertation préalable obligatoire
> Proposition n° 10 : Créer de nouvelles unités policières de médiation, intégrées dans les manifestations et dispositifs de maintien de l’ordre
> Proposition n° 11 : Organiser un accueil et un retour d’expérience de la part des manifestants à l’issue des opérations de maintien de l’ordre
C. FACE AUX FOULES MANIFESTANTES : FAIRE CONFIANCE À DES FORCES DE L’ORDRE SPÉCIALISÉES, PROFESSIONNELS DU MAINTIEN DE L’ORDRE ET RESPECTUEUX DES LIBERTÉS PUBLIQUES
• Thème n° 7 : Moderniser la formation des forces chargées du maintien de l’ordre
> Proposition n° 12 : Ouvrir la formation et la doctrine du maintien de l’ordre aux recherches en sciences sociales
> Proposition n° 13 : Chercher à préserver et rendre incompressible le temps de recyclage des unités
> Proposition n° 14 : Densifier la formation et le recyclage des unités chargées du maintien de l’ordre
• Thème n° 8 : Favoriser l’intervention exclusive d’unités spécialisées en opération de maintien de l’ordre
> Proposition n° 15 : Réduire l’emploi des forces mobiles pour des missions périphériques de sécurité afin d’accroître leur disponibilité
> Proposition n° 16 : Créer une habilitation au maintien de l’ordre pour les unités constituées de la police et de la gendarmerie nationales, hors escadrons de gendarmerie mobile et compagnies républicaines de sécurité
> Proposition n° 17 : Restreindre les dispositifs de maintien de l’ordre aux seules unités spécialisées ou habilitées du fait de leur formation
• Thème n° 9 : Recentrer l’équipement des forces chargées du maintien de l’ordre sur les besoins liés à la gestion des foules
> Proposition n° 18 : Restreindre l’usage du lanceur de balles de défense LBD 40x46 lors des opérations de maintien de l’ordre aux seules forces mobiles et aux forces dûment formées à son emploi dans le contexte particulier du maintien de l’ordre
> Proposition n° 19 : Développer de nouveaux moyens intermédiaires visant à disperser les foules
> Proposition n° 20 : Renforcer et rénover les moyens mécaniques pour pallier les diminutions d’effectifs et favoriser l’émergence de nouveaux schémas tactiques
• Thème n° 10 : Faciliter la judiciarisation des infractions commises lors ou en marge d’une manifestation
> Proposition n° 21 : Systématiser le recours à la vidéo afin de faciliter les procédures d’interpellation lors des opérations de maintien de l’ordre
> Proposition n° 22 : Développer la capacité des unités spécialisées à interpeller des groupes d’individus violents
> Proposition n° 23 : Améliorer la coordination entre les autorités judiciaires et préfectorales afin que les dispositifs de maintien de l’ordre permettent de façon plus fluide les poursuites pénales lorsque des délits sont commis
La commission d’enquête a examiné le présent rapport au cours de sa réunion du jeudi 21 mai 2015.
M. le président Noël Mamère. Nous sommes arrivés à la fin de notre commission d’enquête. À l’issue de notre dernière réunion, qui a permis un échange de vues sur les propositions de notre rapporteur, celui-ci a rédigé son rapport, qui sera soumis à votre approbation. À dix heures, nous tiendrons une conférence de presse.
M. Pascal Popelin, rapporteur. Au moment où, après un semestre d’un programme particulièrement dense, il me revient de vous présenter mon rapport, je remercie chacune et chacun d’entre vous, pour la qualité qui a marqué nos échanges.
Je salue notre président, qui a su conduire nos travaux avec toute la mesure et le souci d’équilibre qu’exige cette fonction, tout en conservant sa liberté de parole et de ton. Même si nous ne partagions pas toujours la même approche – « tant s’en faut », pour reprendre l’expression qu’il emploie lui-même dans l’avant-propos du rapport –, nous avons travaillé en harmonie et en confiance, notamment pour arrêter le programme très diversifié de nos auditions.
Nous avons eu l’occasion de le vérifier tout au long de nos travaux : une commission d’enquête permet de faire émerger des constats objectifs, de mettre fin à des préjugés parfois tenaces et répandus, d’acquérir une meilleure connaissance des faits et du droit. Ce processus d’établissement d’un diagnostic objectif concourt naturellement à rapprocher les points de vue.
Nous avons tous progressé dans la connaissance de notre sujet et je ne doute pas que nous avons, les uns et les autres, adapté certaines de nos convictions pour tenir compte de ce savoir approfondi.
Voilà pourquoi je pense que notre commission d’enquête peut aboutir à un consensus très large, sur l’essentiel de ses conclusions. Cette convergence me semble possible, parce que nous pouvons – je crois – partager les trois grands constats qui étayent les préconisations que je formule.
Le premier est que l’équilibre entre liberté de manifester et ordre public n’a guère évolué en cinquante ans. Il repose sur un régime juridique libéral et un maintien de l’ordre plutôt efficace, piloté par les préfets, en s’appuyant principalement sur des forces spécialisées.
Le deuxième constat, c’est que, si l’équilibre entre les concepts de liberté et d’ordre demeure intangible, les conditions des manifestations ont en revanche beaucoup évolué. De nouvelles formes de protestation, moins respectueuses du cadre légal et de l’autorité ont émergé. De nouveaux lieux de manifestation sont investis. Toute forme de contestation est aujourd’hui davantage médiatisée. Une violence parallèle, qui n’est imputable ni aux initiateurs ni à l’immense majorité de ceux qui prennent part aux manifestations, s’est également développée.
Le troisième constat, conséquence des deux premiers, c’est qu’il n’est nul besoin de bouleverser l’équilibre français entre ordre public et liberté de manifester, mais que la France a besoin de moderniser le cadre régissant les manifestations sur la voie publique et d’adapter les modalités du maintien de l’ordre aux nouvelles expressions que recouvre désormais la liberté de manifester.
Tel est le sens du rapport que je vous présente aujourd’hui.
Dans un premier temps, je me suis attaché à décrire le régime juridique et le cadre du maintien de l’ordre, en soulignant la grande stabilité de cet ensemble.
Le régime juridique applicable aux manifestations revendicatives peut être qualifié de libéral. La liberté de manifestation est elle-même de valeur constitutionnelle, sinon dans les textes du moins dans la jurisprudence, tout comme l’objectif de maintenir l’ordre public. L’équilibre entre ces deux exigences trouve ses racines dans la Révolution française de 1789, comme en attestent les articles 10, 11 et 12 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
Clairement favorable à la liberté d’expression conformément aux valeurs républicaines françaises, cet équilibre est consacré par un régime de déclaration préalable des manifestations. Ce régime, plus souple que celui de l’autorisation en vigueur dans d’autres pays européens, vise à amener les manifestants au dialogue, pour permettre à l’autorité civile de s’adapter et de maintenir l’ordre dans les meilleures conditions.
Les travaux de la commission d’enquête ont permis de mesurer précisément toute la portée que ce régime offre à la liberté de manifester. Ainsi, une manifestation non déclarée n’est pas pour autant interdite en elle-même, bien que son organisateur commette une infraction. En soi, une manifestation interdite ne constitue pas non plus un attroupement pouvant être dispersé, bien que sa persistance soit constitutive, là encore, d’une infraction.
La seule limite à la liberté de manifester est le trouble à l’ordre public, au motif que celui-ci empêche alors l’exercice d’autres libertés, comme la liberté de travail, de circulation ou d’expression. Le rôle de l’État n’est donc pas de restreindre les libertés, mais au contraire de les préserver en garantissant que le désordre public ne va pas « trop loin ».
Voilà pourquoi la responsabilité du maintien de l’ordre incombe à l’autorité civile, qui exerce en la matière une police administrative préventive. L’autorité civile régule l’exercice de la liberté de manifester afin de prévenir le trouble excessif à l’ordre public, mais ne peut et ne doit intervenir – le cas échéant en faisant usage de la force – que lorsque ce trouble excessif est caractérisé : la manifestation devient alors un « attroupement » au sens du code pénal.
L’intervention pour maintenir ou rétablir l’ordre doit être toujours proportionnée. Le rapport détaille les conditions de mise en œuvre de la doctrine française du maintien de l’ordre, qui découlent de ces principes de droit et n’ont pas non plus substantiellement évolué durant les dernières décennies.
Cette doctrine est mise en œuvre principalement par des unités spécialisées dans le métier du maintien de l’ordre : les forces mobiles, compagnies républicaines de sécurité (CRS) et escadrons de gendarmerie mobile (EGM). Leur organisation, leur équipement et leur formation constituent les gages d’une mise en œuvre adéquate de la doctrine spécifique de maintien de l’ordre à la française, c’est-à-dire d’une préservation aussi concomitante que possible, aussi longtemps que possible, de la liberté de manifestation et de l’ordre républicain.
Cette doctrine réglemente strictement le recours à la force à l’encontre des manifestants. Il ne peut en effet y être recouru que lorsque c’est strictement nécessaire, toujours de façon proportionnée aux troubles à l’ordre public, de manière graduée. La gradation est un élément fondamental de la doctrine qui vise à mettre à distance manifestants et force de l’ordre, afin que la sécurité des biens et surtout des personnes soit au mieux garantie. En effet, la gradation des moyens de force employés offre toujours une réversibilité à ceux qui troublent excessivement l’ordre public, afin de freiner l’escalade de la confrontation.
La doctrine française et les forces qui la mettent en œuvre ont fait preuve de leur efficacité. En dépit de l’événement dramatique qui a conduit un groupe de l’Assemblée à demander la création de cette commission, et d’autres cas avérés de manquements inacceptables, force est de constater que l’intégrité physique des manifestants, y compris des plus agressifs à l’endroit de l’État et de l’ordre républicain, a été plutôt bien préservée au cours des dernières décennies. Les interdictions de manifestation sont marginales et, comme l’ont souligné de nombreuses personnes auditionnées, de tous profils, l’immense majorité des protestations se déroule sans heurts.
Ce cadre général, qui comporte de nombreux points de force, est toutefois confronté à des évolutions importantes affectant les acteurs, les lieux et les conditions de manifestation.
Ces évolutions concernent tout d’abord les organisateurs des manifestations. Chacun d’entre nous a pu le mesurer, le temps des grands cortèges encadrés par des services d’ordre structurés est globalement révolu. De plus en plus de manifestations se déroulent sans avoir jamais été déclarées et a fortiori sans encadrement civil. Un grand nombre résulte d’échanges sur les réseaux sociaux, sans véritable organisateur responsable, ou qui pourrait être responsabilisé.
Les dernières décennies ont également vu s’affirmer un phénomène récurrent de grande violence en marge des manifestations, dont les manifestants eux-mêmes sont rarement les initiateurs – quoique certaines confusions soient parfois possibles –, et que l’on doit à des groupes d’individus autonomes, structurés pour se livrer à des troubles et des violences. Celles-ci sont parfois orientées contre les manifestants eux-mêmes, le plus souvent contre les biens publics ou privés, assez systématiquement contre les forces de l’ordre.
Ces nouveaux acteurs ont également investi de nouveaux terrains, sur lesquels le rapport apporte quelques éclairages. Tout d’abord, le fait même de manifester en zone rurale ou d’occuper physiquement un espace rural pose aux forces de l’ordre des problèmes nouveaux, d’ordre tactique ou matériel.
Il convient aussi d’évoquer les zones dites « à défendre » (ZAD). Le rapport s’efforce d’éclairer ce phénomène relativement nouveau. Comme vous sans doute, j’ai relevé avant et pendant cette commission d’enquête que ces espaces et opérations faisaient l’objet d’une certaine confusion. D’aucuns considèrent qu’une ZAD s’apparente à une forme de grande « manif » dans la nature, d’une durée exceptionnellement longue, mais comparable dans l’esprit et la finalité à ses pendants en milieu urbain. Les ZAD se heurteraient à l’intervention des forces mobiles appelées à maintenir l’ordre public par l’usage de la force, dans des conditions plus difficiles qu’en ville. Cela ne me semble pas correspondre à la réalité factuelle et juridique.
L’installation d’une ZAD sur des parcelles privées non ouvertes au public ne constitue pas en soi un trouble à l’ordre public. Il s’agit au premier chef d’un délit contre le droit de propriété, à l’instar d’un squat illégal dans un immeuble. Comme le rapport l’explique, la ZAD peut même être constitutive en elle-même d’une succession de délits. Ces infractions causent des préjudices aux propriétaires ou occupants légitimes des terrains concernés et la mission de l’État consiste essentiellement à garantir l’exécution des décisions des tribunaux rendant justice à ces propriétaires ou occupants. Il n’y a là rien de comparable avec les cortèges occupant le pavé des centres-villes.
Il n’en demeure pas moins exact que l’opposition physique, voire violente, de certains zadistes aux décisions de justice transforme, de proche en proche, sur les ZAD, les opérations de sécurité classique en opérations de rétablissement de l’ordre face à des foules hostiles. En outre, l’existence de manifestations de soutien et/ou de contre-manifestations, elles-mêmes parfois violentes, crée un risque de dégénérescence de la paix publique, qui oblige l’État à s’interposer, pour préserver la sécurité des personnes.
Dans tous ces cas, effectivement, l’État intervient sur les ZAD afin de préserver l’ordre, la justice et la paix civile, en recourant le plus souvent aux unités mobiles, dont le métier est précisément de bien proportionner l’usage de la force aux attroupements les plus violents.
À titre personnel, même dans ces cas, je demeure perplexe sur la qualification de « manifestation ». Notre droit et nos valeurs républicaines ne consacrent aucun droit à occuper illégalement la propriété d’autrui ni à s’opposer par la violence aux décisions des tribunaux, même pour protester contre un projet public et quelle que soit l’idée qu’on se fasse du bien-fondé de cette contestation.
Enfin, pour en terminer avec la deuxième partie du rapport consacrée aux évolutions des phénomènes de protestation, les manifestations contemporaines sont également différentes par les attentes qu’elles suscitent dans l’opinion publique. La médiatisation plus systématique des opérations de maintien de l’ordre a rendu l’opinion particulièrement sensible tant à la violence de certains manifestants et à la commission de délits lors des manifestations, qu’aux violences commises, le cas échéant, par les forces de l’ordre. Cette évolution a poussé, et pousse encore aujourd’hui, l’État à chercher une réponse pénale adaptée aux agissements individuels délictueux qui perturbent l’exercice de la liberté de manifester. Force est de reconnaître que cette recherche n’a pas abouti, jusqu’à présent, à des solutions satisfaisantes. Ce chantier est encore largement devant nous.
Le fil directeur des préconisations que j’ai pensé utile de formuler est l’idée que, pour mieux préserver demain la liberté de manifester, il faut davantage de gradation dans la gestion des protestations publiques.
Nous avons procédé entre nous, il y a dix jours, à un échange de vues sur ces propositions. J’ai cherché autant qu’il était possible, tout en préservant la cohérence du rapport, à intégrer dans sa version finale les fruits de nos échanges.
Le recours à la force – par des manifestants ou les forces de l’ordre – et la prohibition constituent les atteintes les plus graves à la liberté de manifester et à la liberté d’expression au sens large. Or quels sont aujourd’hui les seuls moyens concrets dont dispose un préfet confronté à une manifestation ? Prohiber en amont. Réprimer en aval. Je crois qu’il est possible de préserver l’ordre public et de protéger les personnes et les biens, en réduisant le recours à de tels moyens, qui ne doivent constituer que les derniers outils à la disposition de l’autorité publique. Le rapport s’efforce donc d’offrir davantage de solutions d’actions graduelles aux autorités civiles, afin que le compromis entre ordre républicain et libertés démocratiques soit en permanence adapté, ajusté, proportionné.
Le premier axe concerne le rôle même de l’autorité civile. La formation initiale et continue du corps préfectoral doit mieux insister sur les conditions de mise en œuvre du maintien de l’ordre. Ce point me semble faire consensus. Dans le prolongement de cette idée, il pourrait être envisagé de renforcer le dispositif préfectoral de maintien de l’ordre dans certains départements. Certaines préfectures connaissent structurellement davantage de manifestations, d’autres sont confrontées ponctuellement à une série d’événements de type ZAD. Il doit être possible, dans de telles préfectures, de garantir la présence d’une équipe préfectorale aguerrie au maintien de l’ordre. Il me semble également qu’il faut réaffirmer et préciser le rôle du préfet, en mentionnant que sa participation ou celle de représentants explicitement habilités par lui doit être continue durant l’ensemble des opérations de maintien de l’ordre.
Le deuxième axe des préconisations a trait au travail préfectoral, en amont des manifestations ou des troubles à l’ordre public : il s’agit notamment de la concertation. Ce travail a peu ou prou disparu, faute de pouvoir être fait de façon traditionnelle, à cause de l’affaiblissement temporaire du renseignement territorial au cours de la dernière décennie, en raison parfois de l’absence d’organisateurs structurés, ou du fait de l’apparition de nouvelles formes de contestation. Pourtant, il est indispensable au respect des libertés publiques comme de l’ordre républicain. C’est pourquoi il me semble qu’il faut trouver de nouvelles formes de concertation, en s’inspirant notamment de ce qui peut être observé chez certains de nos voisins : communication via des sites web, unités de médiation, etc.
L’État dispose aujourd’hui des moyens de communiquer de façon plus directe et plus moderne à destination des citoyens qui manifestent sur la voie publique : au préalable, en utilisant les nouvelles technologies et les réseaux sociaux, mais aussi pendant les manifestations, en créant des unités policières de médiation ou en adaptant ses messages à notre temps, afin qu’ils soient plus clairs, plus intelligibles. Je pense, par exemple, à la formulation des sommations. Il n’est pas certain que l’expression « Obéissance à la loi » soit très claire. On peut sans doute travailler sur ce point, ce qui répond à une demande du ministre et du directeur général de la gendarmerie nationale.
Je tire aussi de nos travaux la conviction que l’État ne doit pas se priver d’un travail administratif et judiciaire de prévention des troubles les plus graves à l’ordre public. De Ben Lefetey, venu exprimer son point de vue sur le cas de Sivens aux divers commandants d’unités, en passant par le préfet de police de Paris, tous ont confirmé l’existence d’une tendance de plus en plus systématique à la violence organisée en marge des manifestations : violences contre les personnes et les biens, contre les forces de l’ordre, ou violences contre ou entre manifestants eux-mêmes. L’État doit se donner les moyens d’agir contre cette quasi-professionnalisation, itinérante en Europe, qui constitue probablement une des pires menaces contre la liberté de manifester.
Si nous acceptons que nos concitoyens ne soient plus en sécurité dès lors qu’ils manifestent, ou dès lors qu’ils sont à proximité d’une manifestation, nous risquons d’aboutir à une situation qui contraindrait la société à choisir entre liberté publique et ordre public. Il me semble que l’État peut agir préventivement et de façon contrôlée, afin que des individus isolés et connus pour leurs comportements avérés lors des mouvements de protestation ne puissent plus autant nuire à la liberté de manifester. Le Gouvernement et le Parlement devraient explorer la piste consistant à permettre au préfet d’interdire – de façon très encadrée dans le temps et l’espace, et évidemment sous le contrôle du juge – à un ou plusieurs individus déjà objectivement connus pour leur violence lors ou en marge de manifestations, de prendre part à certains événements. Une telle mesure, qui s’inscrit dans l’esprit de la peine complémentaire d’interdiction de manifester que le juge pénal peut déjà prononcer en l’état actuel de notre droit, serait de nature à aider à la préservation de la paix publique, de la liberté d’expression et de l’ordre républicain.
Le troisième et dernier axe des préconisations concerne l’action des forces de sécurité lors des opérations de maintien de l’ordre. En définitive, lorsque la manifestation commence, c’est dans leur professionnalisme que se situe la gradation de l’action publique. Telle est d’ailleurs déjà la doctrine des forces mobiles, CRS et gendarmes mobiles, dont la discipline et les équipements permettent de doser – en permanence et au plus juste – l’action régulatrice ou répressive de l’État. La France doit continuer de s’appuyer, voire s’appuyer davantage sur le point fort que constituent ces unités mobiles. Cela suppose d’adapter leurs moyens et leur doctrine d’emploi, afin que leur action demeure toujours proportionnée. Dans cette perspective, j’ai mentionné plusieurs pistes de travail :
– renforcer et moderniser la formation, déjà très complète, des unités spécialisées dans le maintien de l’ordre,
– chercher à faire intervenir, en opération de maintien de l’ordre, des unités dont c’est précisément le métier, et qui ont été formées spécifiquement pour cela. Les forces mobiles, bien sûr, mais aussi les compagnies de police « mixtes » ou « d’intervention », comme celles de la préfecture de police de Paris, à qui leur formation et leur équipement pourraient valoir une habilitation à maintenir ou rétablir l’ordre. Il serait alors souhaitable de s’assurer d’une présence homogène d’au moins une ou deux unités ainsi formées ou habilitées dans chaque département, afin de permettre aux préfets de disposer d’effectifs de première urgence présentant toutes les garanties requises pour le maintien de l’ordre,
– faire confiance à la discipline collective des unités spécialisées en leur confiant un équipement adapté. Il s’agit de prévoir notamment que seules les unités constituées et habilitées au maintien de l’ordre puissent continuer d’être dotées de lanceurs de balles de défense lors de l’intervention en manifestation, à l’exclusion de toute autre unité des forces de l’ordre susceptible d’intervenir à rencontre de manifestants. Il s’agirait également de développer de nouveaux moyens intermédiaires de type collectif, comme les grenades projetant à faible hauteur des galets en caoutchouc, et de suggérer un investissement plus grand dans des équipements qui permettent de pallier les diminutions d’effectifs des unités et de renforcer leur mobilité tout en préservant leurs missions. Je pense notamment aux systèmes de camion/barrière ou de barre-ponts. On pourrait aussi revisiter la doctrine d’usage des lanceurs d’eau.
Enfin, je préconise d’envisager l’instauration d’une procédure adaptée d’interpellation, pour les cas flagrants de grandes violences durant une manifestation. Une telle procédure s’appuierait notamment sur la généralisation de la captation vidéo et sur des moyens d’accélération de l’interpellation standard : local commun de transfert, magistrat de permanence, numérisation d’un procès-verbal oral instantané. Elle permettrait aux forces spécialisées d’intervenir dans de meilleures conditions pour faire cesser les violences, sans pour autant mettre en péril leur schéma tactique d’ensemble, grâce à la rapidité de remise à disposition des personnels.
Telles sont, brossées à gros traits, les grandes lignes du rapport, que j’ai l’honneur de vous demander de bien vouloir adopter, et qui sera enrichi du compte rendu de nos débats, de quelques annexes et de vos contributions.
M. Philippe Goujon. Le projet de rapport agrée au groupe UMP. Je salue l’esprit constructif qui a présidé à nos travaux, lesquels se sont déroulés dans d’excellentes conditions. Je regrette toutefois que la demande que j’avais formulée, il y a un an et demi, de créer une commission d’enquête sur les conditions d’exercice du maintien de l’ordre, n’ait pu aboutir, et qu’il ait fallu attendre le drame de Sivens pour que nous puissions nous pencher sur le sujet.
La première partie du rapport aurait gagné à préciser que l’autorité civile présente en permanence pendant les opérations ne doit pas interférer dans le commandement opérationnel, et à proposer des pistes concrètes pour assurer une meilleure traçabilité des commandements. Si la doctrine française consiste à maintenir les manifestants à distance, afin d’éviter le plus possible tout contact physique, il faut veiller à ne pas créer de vide défensif, en privant les forces de l’ordre de certains outils dont l’emploi est strictement encadré, comme les lanceurs de balles de défense (LBD). Dès lors qu’on supprime des moyens considérés comme dangereux, il faut développer de nouveaux moyens intermédiaires. Par ailleurs, l’autorité administrative gagnerait à bénéficier d’un soutien juridique renforcé.
D’autres propositions concernent les manifestants. J’avais proposé de responsabiliser les organisateurs de manifestations non déclarées, grâce à un régime de présomption d’organisation de manifestation, étayée par un faisceau d’indices, notamment l’utilisation des réseaux sociaux et l’envoi de SMS. Le procédé permettrait de formaliser leur déclaration de manifestation et de prévoir les dispositifs de secours. Cette proposition, soutenue par le procureur de la République de Paris, aurait mérité de figurer dans le rapport.
Nous approuvons l’interdiction ponctuelle de manifester sur la voie publique pour des personnes condamnées pour des faits graves commis lors de troubles. Ce régime serait assorti de garanties juridiques, à l’instar du dispositif anti-hooligans. Certains d’entre nous considèrent que, pour une meilleure efficacité, l’interdiction pourrait être complétée par une obligation de pointage au commissariat.
Face aux nouvelles formes de manifestation, qui peuvent s’apparenter à une guérilla urbaine, le rapport aurait pu retenir, comme l’avait suggéré M. Vigouroux, l’autorisation de procéder à une évacuation forcée, comme celle qui se pratique sur des campements illégaux. Compte tenu de la lenteur de la procédure judiciaire, qui peut durer deux à dix-huit mois, il serait pertinent de créer une réponse judiciaire et administrative expresse, quand des recours ont été déposés, ce qui faciliterait l’évacuation des opposants.
L’introduction dans notre droit de la notion de subversion violente, proposée par le préfet de police de Paris, permettrait d’utiliser les moyens spéciaux du renseignement à l’encontre d’éléments violents agissant en marge de la manifestation. Le rapport reprend toutefois l’idée d’un protocole d’intervention rapide, en cas d’urgence, afin de systématiser leur arrestation et leur neutralisation.
La garantie supplémentaire résultant de la systématisation de l’enregistrement des opérations et de la présence permanente d’un substitut du procureur, à l’instar de celle d’un représentant de l’autorité civile, sécuriserait davantage les démarches judiciaires.
Globalement, la réponse judiciaire gagnerait à être accélérée et harmonisée. Le Défenseur des droits a en effet relevé une inégalité de traitement judiciaire selon qu’il s’applique au donneur d’ordres – l’autorité civile – ou à l’exécutant – les forces de l’ordre –, ce qui pourrait entraîner une condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH).
La responsabilité des organisateurs dans les dommages causés lors des manifestations peut aussi donner matière à légiférer, afin de créer un mécanisme de responsabilité civile solidaire des organisateurs. Ce mécanisme suggéré par M. Vigouroux autoriserait ceux-ci à intenter une action en réparation auprès des casseurs agissant en marge de la manifestation.
Nous développerons ces pistes dans notre contribution. Cependant, nous ne nous opposerons pas à l’adoption du rapport, conscients que la meilleure sauvegarde des libertés publiques, dont celle de manifester, réside dans l’adaptation du cadre juridique du maintien de l’ordre aux nouvelles formes de contestation et au bon déroulement des manifestations.
M. Daniel Vaillant. Au terme de notre travail, je salue l’état d’esprit constructif qui a prévalu, tout en ménageant la diversité des sensibilités, sur un sujet qui fait régulièrement l’objet de raccourcis, de commentaires partiels, voire de caricatures.
Consécutive au décès dramatique de Rémi Fraisse, le 26 octobre 2014, la création de la commission d’enquête a initié une démarche d’analyse et de réflexion sur le maintien de l’ordre, à l’initiative de M. Mamère. Le rapport de M. Popelin, sérieux, constructif et équilibré, n’appelle aucun commentaire de ma part. Les commissaires socialistes l’approuveront.
S’il est toujours nécessaire pour progresser de prendre du recul, les auditions ont permis de rappeler un élément fondamental : en France, la liberté de manifester est garantie par un régime juridique protecteur, indispensable à une démocratie digne de ce nom.
C’est d’ailleurs la première réflexion du rapport, qui concerne le cadre général du maintien de l’ordre dans notre pays. L’autorité civile doit être présente, autant que faire se peut, sans interférer avec les tâches légitimes des forces de l’ordre. Leur complémentarité est utile.
Les auditions ont mis en exergue des possibilités d’amélioration. C’est dans ce sens que s’inscrivent les vingt-trois propositions. Celles-ci plaident pour un renforcement des moyens donnés à l’autorité civile, dont elles proposent la présence permanente pendant les opérations. M. Bacquet insistera sur ce point dans sa contribution personnelle. C’est en effet un sujet qui doit être précisé.
C’est aussi sur la concertation et la communication que portent certaines propositions, comme la mise en place d’un guide d’action à destination des préfets ou d’une concertation préalable obligatoire. Dans le domaine des raves et des free parties, la procédure trouvée in fine dans la loi sur la sécurité quotidienne, que j’avais fait voter en novembre 2001, a permis de responsabiliser les organisateurs. Une autre préconisation me semble utile : il est bon qu’à Paris, les manifestations soient suivies en amont par le procureur de la République et qu’un substitut soit présent sur le terrain, afin de prévoir d’éventuelles suites juridiques.
La garantie pleine et entière du droit de manifester passe par la sécurité de chacun : manifestants, journalistes ou membres des forces de l’ordre. Si la formation de ces derniers est performante, il est proposé à juste titre de l’ouvrir, tout comme la doctrine, aux recherches en sciences sociales. Il faut aussi doter ces forces de moyens adaptés à leurs missions et à la réalité des situations auxquelles elles font face. Celles-ci étant évolutives, nous préconisons de réduire l’utilisation des forces mobiles à des missions périphériques de sécurité, afin d’accroître leur disponibilité, et de réserver l’usage du LBD aux forces dûment formées à son emploi.
Parce que le droit à l’information est primordial, et qu’il contribue à la nécessaire transparence qui concerne l’action de nos forces, le rapport suggère de faciliter le suivi des opérations de maintien de l’ordre par la presse.
Si ces propositions sont prises en compte, comme je le souhaite, elles renforceront les garanties du droit à manifester, si cher à notre tradition démocratique, tout en assurant la sécurité de chacun.
Mme Marie-George Buffet. Je remercie toutes les personnes auditionnées – militants, chercheurs, représentants des forces de l’ordre – de leur attachement à une conception démocratique et républicaine du maintien de l’ordre. Cette intelligence de lecture, qui garantit le caractère démocratique et républicain des forces de l’ordre, permet de faire évoluer les méthodes dans le sens d’une meilleure garantie des libertés publiques, dont celle de manifester, et d’une plus grande sécurité pour les différents acteurs.
Je remercie le président pour son initiative et le rapporteur pour son travail. L’enjeu de notre commission d’enquête était de moderniser le cadre du maintien de l’ordre afin que la liberté de manifester et l’ordre public se conjuguent sans heurts, dans la durée, en préservant la vie et la sécurité de chacun.
De nombreuses propositions du rapport vont dans ce sens. Toutefois, en nous obnubilant sur le cas pourtant très minoritaire des groupes violents, nous avons détourné le sens de la commission d’enquête et formulé des préconisations qui, qu’on le veuille ou non, limitent la liberté de manifester.
Je conviens que certaines propositions vont dans le bon sens : réaffirmation de la présence permanente de l’autorité civile lors des opérations de maintien de l’ordre, organisation d’un retour d’expérience de la part des manifestants, création d’unités policières dont le cœur de métier est la médiation. Souhaitons que ces dispositifs s’affermissent avec le temps, l’expérience et les progrès scientifiques qu’apportera notamment l’ouverture de la doctrine aux sciences sociales. Je salue aussi la création d’un guide d’action destiné aux préfectures et le fait que les forces mobiles, CRS et gendarmes mobiles, spécialisés dans les missions qui nous intéressent, soient soulagés de missions périphériques, qui les accaparent.
Certaines préconisations pourraient être étendues. L’une d’elles propose de réserver le maintien de l’ordre aux unités spécialement formées. À mon sens, il faut aller plus loin, et le réserver aux unités mobiles, puisque le maintien de l’ordre est le cœur de métier des CRS et des escadrons de gendarmerie mobile. Par ailleurs, si les propositions confirment la fin du recours aux Flash Ball, ce dont je me réjouis, l’utilisation des LBD demeure pendante.
Enfin, quatre propositions me semblent inutiles et inefficaces.
L’une tend à imposer une concertation préalable obligatoire, alors que le régime actuel est celui de la déclaration. Quand une manifestation se déroule de manière démocratique, la concertation se fait naturellement ; quand les groupes sont motivés par le désir de violence gratuite, je vois mal comment procéder à une concertation obligatoire, surtout si l’on ignore l’identité des organisateurs.
L’interdiction administrative de manifester ne semble pas plus convaincante. Le rapprochement avec l’interdiction de stade n’est pas pertinent. On va au stade pour se faire plaisir ; la manifestation appartient aux libertés publiques. Le stade est une enceinte privée ou publique ; la manifestation se déroule dans la rue, qui est un espace de liberté. D’ailleurs, on comprend mal comment la mesure pourrait s’appliquer.
Je suis opposée au recours systématique à la vidéo.
Enfin, le contrôle d’identité collectif ne me semble pas correspondre à l’esprit d’un maintien de l’ordre républicain.
Autant de raisons qui m’incitent à ne pas voter le rapport.
M. Philippe Folliot. Je salue à mon tour l’initiative du groupe écologiste, qui nous a permis un temps de réflexion sur un sujet essentiel. Si, dans l’avant-propos du rapport, le président est libre de juger « absurde » le projet du barrage de Sivens, nous avons aussi la liberté d’affirmer que ce projet était utile.
Le président et le rapporteur nous ont permis d’auditionner des personnes de sensibilités diverses. Je suis sensible à la qualité du rapport, très équilibré, ce qui mérite d’être souligné. La République, c’est aussi le respect, qui permet aux députés de la majorité et de l’opposition de sortir de certaines postures, pour adopter une attitude constructive.
Le rapport rappelle certains fondamentaux de notre démocratie. Le droit de manifester, auquel nous sommes tous attachés, doit être préservé. D’autre part, il faut distinguer ceux qui manifestent de manière pacifique et les groupes des casseurs ultraviolents, qui se greffent, comme des cancers, sur les manifestations.
Nous faisons nôtre l’essentiel des propositions du rapport, à commencer par la professionnalisation du maintien de l’ordre dans les préfectures les plus exposées, par le biais de la task-force préfectorale spécialisée. Nous approuvons aussi les propositions nos 2 et 3 visant à réaffirmer la nécessaire présence de l’autorité civile, ainsi que les propositions nos 4, 5 et 6. Nous soutenons aussi les propositions nos 7 et 8, plus sensibles toutefois, qui visent à instaurer l’interdiction individuelle de participer à une manifestation. Encore faut-il que ces mesures, qui resteront exceptionnelles et ne frapperont que des personnes bien connues des services de police et de sécurité, soient effectives.
Nous ne pouvons être que favorables à l’organisation d’une médiation systématique entre les forces chargées du maintien de l’ordre et le public manifestant. En revanche, l’ouverture de la formation et de la doctrine du maintien de l’ordre aux recherches en sciences sociales nous semble légèrement superfétatoire.
Nous craignons que la réduction de l’emploi des forces mobiles pour des missions périphériques de sécurité ne reste un vœu pieux, car il faut bien effectuer certains choix : l’opération Sentinelle, par exemple, bien que périphérique, est extrêmement utile.
Nous nous interrogeons sur la restriction de l’emploi des LBD, dont nul ne fait usage de manière disproportionnée. L’utilisation de la vidéo semble logique : il faut utiliser tous les moyens actuels.
Malgré les quelques réserves que j’ai formulées, mon groupe votera le rapport sans état d’âme.
M. le président Noël Mamère. Je remercie le rapporteur. Pendant six mois, nous avons essayé de mener un travail constructif, même si nous en avons tiré des conclusions différentes.
L’objet de nos travaux, entre notre demande d’ouverture d’une commission d’enquête et la fin des auditions, s’est subtilement déplacé. Du constat qu’il était possible d’être blessé ou tué lors d’une manifestation en France aujourd’hui et, partant, de la volonté d’enquêter sur les conditions du maintien de l’ordre dans un contexte de respect des libertés et de droit à manifester, nous aboutissons à un rapport qui s’interroge sur la façon d’intégrer la possibilité de manifester dans le cadre de l’ordre public. Il n’est donc plus question de garantir un droit et de comprendre comment il peut être bafoué mais, au contraire, de tenter de le circonscrire pour qu’il s’ajuste au maintien de l’ordre, dont les modalités ont, par ailleurs, déjà été modifiées. Cette inversion du prisme change pour beaucoup le sens et la raison d’être de ce travail.
Ainsi, je n’approuve pas le rapporteur lorsqu’il écrit que les formes de manifestations ont évolué au point d’aboutir à un « rejet plus franc » de l’autorité. Le chercheur Cédric Moreau de Bellaing a souligné, lors de son audition, que c’est « le niveau de tolérance au désordre global [qui] a baissé parmi le public ou chez les policiers, mais aussi chez les manifestants », tout en précisant que la preuve n’est pas apportée que les manifestations d’aujourd’hui sont plus violentes que celles d’hier. En revanche, un changement de doctrine est à l’œuvre. La violence employée par les forces de l’ordre est désormais à la mesure de celle des manifestants, ce qui ne participe pas à la désescalade.
Il en est de même des consignes d’interpellation et de la plus grande mobilité des forces de l’ordre qui, depuis 2005, ont provoqué une dislocation de l’action collective et un rapprochement physique sur le terrain, certes favorable à la judiciarisation des délits, mais néfaste à la réduction de la violence.
Le rapport a abordé la gestion des manifestations non-traditionnelles sous un angle non sociologique, mais sécuritaire. À aucun moment, le rapporteur ne se demande si la société peut et doit s’adapter à ces nouvelles formes de contestation. Sa seule préoccupation est de savoir comment aider les forces de l’ordre et la justice à contenir et judiciariser les éléments perturbateurs, qu’il appréhende d’ailleurs en groupe et non pas individuellement. C’est l’un des nombreux paradoxes de ce rapport. On maintient les lanceurs de balles de défense qui blessent un seul pour disperser l’ensemble, mais l’on souhaite mettre en place des contrôles d’identité collectifs et non plus au cas par cas, comme si les manifestants devaient être pris dans leur individualité et les fauteurs de trouble dans leur ensemble, soit l’exact inverse de la doctrine française en matière de maintien de l’ordre.
Je commenterai les propositions de notre rapporteur en suivant l’ordre dans lequel il les présente.
Que ce soit sous la forme d’une task-force ambulante ou d’une structure dédiée au sein de certaines préfectures, la professionnalisation dans les préfectures est ambiguë. Quid de la chaîne de commandement du maintien de l’ordre dans laquelle le ministre de l’intérieur est responsable juridiquement ? Quel est le rapport hiérarchique entre ce nouveau « réfèrent ordre public » et le préfet, selon qu’il serait membre du cabinet ou dépêché sur place ? Qui demanderait l’emploi d’une task-force, et qui prendrait la décision de l’envoyer ? Enfin, la définition des « préfectures les plus exposées » est trop vague. Celles-ci seraient-elles définies au préalable ou au cas par cas ? Sur quels critères ? Pour combien de temps ?
En revanche, la clarification des rôles de l’autorité exclusive du préfet et des forces mobiles, la présence permanente de l’autorité civile pendant l’ensemble des opérations de maintien de l’ordre, la mise en place d’un guide d’action à l’usage des préfets, la simplification et la meilleure compréhension des sommations à destination des manifestants sont des avancées.
La proposition n° 6 sur les rapports entre les forces de l’ordre et les journalistes rappelle des principes qui sont assez essentiels. Attention, toutefois, à ne pas faire de la non-entrave et de la proportionnalité des risques, des moyens détournés d’attenter au droit de la presse. Il serait également intéressant de mener une réflexion sur les liens entre présence de la presse et degré de violence. Il a été généralement admis au cours des auditions que la première réduisait la seconde. Si la médiatisation des manifestations augmente et que cela induit une diminution de la violence, comment peut-on arguer de l’augmentation globale du niveau de violence ?
Si l’interdiction judiciaire existe déjà, je m’oppose totalement à l’idée d’une interdiction administrative de manifester. Cette proposition doit être rapprochée de la réglementation et de la jurisprudence afférentes à l’interdiction des supporters de spectacles sportifs. Toutefois, un stade n’est pas une manifestation. Limiter l’accès à un lieu clos n’est pas limiter l’accès à une portion d’espace public, étendue et mouvante. Et le droit d’assister à un match n’est pas une liberté fondamentale, contrairement à celui de manifester. Plus spécifiquement, le terme « d’individus connus en tant que casseurs violents » me semble hasardeux et sujet à débat. Si cette interdiction devait être autorisée, elle devrait, au minimum, ne s’appliquer qu’à des individus déjà condamnés.
En outre, la mise en œuvre de ce type de mesures semble hautement improbable. Comment déterminer ab initio que telle ou telle personne pourrait participer à telle ou telle manifestation ? Autant les supporters de football peuvent être individualisés et se voir signifier une interdiction par un arrêté préfectoral, autant il semble improbable de cibler les manifestants de type violent sur l’ensemble du territoire pour tous types de manifestation. Il a été dit à plusieurs reprises au cours de notre travail que l’on compte près de treize manifestations par jour à Paris. Comment pourrait-on techniquement émettre des interdictions ponctuelles dans cette ville ?
Il existe enfin un autre risque démocratique majeur : celui de cibler certains membres d’organisations politiques et syndicales. Le rapporteur écrit que « les dispositions permettant aux procureurs de requérir des contrôles d’identité en marge des manifestations servent d’ores et déjà aujourd’hui de fondement à des formes d’interdiction de manifester ». Légiférer sur un procédé déjà pratiqué, via des biais administratifs, ne rend pas ce procédé légitime. Cela montre également que les contrôles d’identité sont détournés de leur objectif premier.
La médiation entre les forces de l’ordre et les manifestants durant la manifestation, et les retours d’expérience, inspirés des modèles européens, privilégiant le port de l’uniforme et non l’infiltration en civil, sont d’excellentes propositions.
En revanche, fixer le principe d’une concertation obligatoire implique de changer radicalement le fonctionnement du droit de manifester, qui est purement déclaratif. Il y aurait dès lors un contrôle a priori et systématique de toutes les manifestations, ce qui entraînerait une restriction disproportionnée du droit de manifester. Une concertation préalable peut certes être utile et bénéfique, mais les propos cités par le rapporteur ne justifient aucunement la nécessité de rendre cette concertation obligatoire.
Je suis extrêmement favorable à l’idée d’ouvrir la formation et la doctrine du maintien de l’ordre aux sciences sociales, ainsi qu’aux propositions nos 13 et 14.
L’immobilisation de forces par définition mobiles présente une incohérence assez évidente, surtout pour des missions qui ne nécessitent pas l’usage de leurs compétences particulières. La volonté de rationaliser les effectifs est compréhensible, surtout en période de restriction budgétaire, mais il est problématique de voir des forces mobiles assurer des opérations statiques et être remplacées par des forces de sécurité publiques sur certains terrains de maintien de l’ordre. L’habilitation d’unités constituées, hors CRS et EGM, peut ainsi être envisagée, mais à plusieurs conditions, en partie évoquées par le rapporteur.
Interdire effectivement le Flash Ball dans toutes les opérations de maintien de l’ordre est une mesure consensuelle et je suis satisfait que le rapporteur l’ait reprise. Elle sera d’autant plus facile à mettre en œuvre que la mobilisation d’unités, hors EGM et CRS, sera encadrée.
En revanche, comme il l’a souligné, je suis un fervent partisan de l’interdiction des lanceurs de balles de défense dans leur ensemble et, plus généralement, de toutes les armes de quatrième catégorie, ce qui inclut les LBD 40x46 mais aussi les Tasers. C’est une position que j’ai défendue, avec mes collègues Yves Cochet et François de Rugy, en déposant une proposition de loi en ce sens, en juillet 2009. En effet, la présence d’armes sublétales comme le LBD – c’est-à-dire moins létales, mais potentiellement létales tout de même – entraîne une surutilisation par les forces de l’ordre et un risque plus élevé de blessures graves et de décès. C’est dans le cadre des manifestations que ces risques sont les plus importants, en raison des mouvements de foule, des fumigènes et de l’imprécision du tir.
À cet égard, il semble plus judicieux d’imposer que toutes les normes du maintien de l’ordre et de l’utilisation des armes résultent d’un acte réglementaire, pris en application d’une loi, afin d’éviter l’opacité des diverses circulaires et manuels d’utilisation ou de formation. À titre d’exemple, il est particulièrement difficile, dans le cas de la mort de Rémi Fraisse, de déterminer les textes applicables, certains manuels ou circulaires ayant disparu.
Le développement de nouveaux moyens intermédiaires et le renforcement de moyens mécaniques sont attendus, mais il faut là encore être vigilant. Tous deux peuvent créer plus de dangers qu’ils n’en éviteraient. Je me méfie de certains dispositifs comme les lances à eaux.
Une fois de plus, c’est la philosophie générale du maintien de l’ordre qui bouge. Les unités mixtes employées à Paris, avec des policiers en civil chargés des interpellations, sont déjà une forme dévoyée de maintien de l’ordre, qui ne peut qu’entraîner une suspicion de la part des manifestants. Il est impératif d’imposer le port de l’uniforme et les interpellations doivent viser spécifiquement les abords et les individus, et non pas des groupes. La généralisation de la vidéo porte atteinte au droit de manifester et pourrait entraîner l’identification et la constitution de fichier d’opposants politiques ou syndicaux.
Quant à la systématisation d’un local de permanence pour les contrôles collectifs d’identité, elle est contraire au principe de contrôle d’identité qui doit être individualisé et répondre à des troubles préalables. Le secret de la procédure pénale et son caractère individuel, s’opposent à la présentation groupée à un officier de police judiciaire (OPJ).
Au-delà de ces mesures limitées aux modalités du maintien de l’ordre, c’est une réflexion globale qui doit être entreprise dans notre pays sur la place des forces de l’ordre dans la société. Toute société nécessite un ordre et une autorité. Cependant, le monopole de la violence légitime qui définit l’État wébérien n’implique pas la légitimité de toute violence qu’il pourrait exercer.
Nous serons d’accord sur le fait que le rôle premier des forces de l’ordre est de protéger les citoyens, pris au sens de l’ensemble des habitants de la cité. Elles sont ainsi un service public, au service de la population. La police agit au nom du peuple et non en fonction d’entités abstraites comme la Nation – les étrangers seraient-ils exclus de facto de cette protection ? – ou la République, terme dévoyé, qui n’est ni l’apanage ni la condition de la démocratie. C’est au nom de chaque citoyen que la police agit au nom d’une conception non individualiste mais humaniste de l’ordre. En effet, la défense de l’intérêt collectif ne doit pas oublier d’inclure les individus. Il ne peut y avoir de victime collatérale acceptable dans une société qui se veut et se revendique comme démocratique.
Notre société doit entreprendre un travail collectif pour redéfinir la place du pouvoir de police et son rapport à la population. L’ordre pour l’ordre ne résout rien, c’est aussi en améliorant la justice sociale, la démocratie locale, la représentativité du peuple, que l’on réduira les situations conflictuelles, causes et conséquences des limites floues des pouvoirs accordés aux forces de l’ordre. C’est pour cette raison que les écologistes ont proposé de remettre à plat les procédures de déclaration d’utilité publique, afin d’éviter de reproduire « un vieux, très vieux monopole de représentation, des débats de convenance, des pratiques d’entente et des ententes pratiques [qui] ont engendré une confusion regrettable entre la représentation élective et un inamovible banquet de notables multi-reconduits », comme l’a écrit Pierre Tartakowsky, président de la Ligue des droits de l’homme.
Dans une majorité de cas, les forces de police sont blanchies dans les procédures qui les visent pour blessures graves, homicides ou non-assistance à personne en danger. Je n’ai pas à vous rappeler la décision prise récemment à Rennes. Il manque de toute évidence une réelle autorité indépendante chargée de faire la lumière sur les pratiques abusives, non conformes, illégales, commises par certains représentants des forces de l’ordre. La question du statut des gendarmes qui dépendent du ministre de l’intérieur mais n’ont pas le droit de se syndiquer et sont jugés par des cours militaires, se pose également.
Heureusement, les fautes policières ne sont pas la norme. Ceux qui les commettent sont aussi minoritaires que les fauteurs de trouble en manifestation. Ils ne sont qu’un arbre qui cache la forêt du respect des procédures, mais ils ternissent l’ensemble de leur profession et leur impunité laisse un goût amer à une grande partie de la population, qui se sent confrontée à un terrible sentiment de deux poids-deux mesures.
Le rapporteur écrit, en préambule, que l’opinion publique aurait des « attentes [...] en matière de maintien de l’ordre et de judiciarisation des délits ». Mais qui est donc cette opinion publique unanime et uniforme, capable de s’exprimer d’une seule et claire voix ? Ce n’est probablement pas la France de Nassuir, de Quentin et Joachim, de Rémi ou de Zyed et Bouna, celle qui subit les contrôles d’identité quotidiens ou qui a la « bêtise » de mourir pour ses idées, pour citer le mot prononcé en octobre 2014 par un président de conseil général, qui aurait mieux fait de se taire.
Pour toutes ces raisons, je n’approuverai pas le rapport de M. Popelin.
M. Jean-Paul Bacquet. Comme mes collègues, j’exprime mon profond respect pour le président et le rapporteur qui ont mené cette commission d’enquête. Je rappelle toutefois avant le vote que l’intervention du président n’engage que lui.
M. le président Noël Mamère. Elle engage aussi le groupe que je représente.
M. Jean-Paul Bacquet. J’enverrai une contribution. Auparavant je voudrais poser quelques questions. Le rapport tend à faire de la gendarmerie l’intervenant exclusif outre-mer, où 18,5% des effectifs de gendarmerie sont installés en permanence. Peut-on institutionnaliser cette situation, qui risque de poser un problème opérationnel ? Ce n’est pas parce qu’elle correspond à une habitude qu’elle doit devenir une règle.
D’autre part, si la ville dépend généralement de la police, et les zones rurales de la gendarmerie, ce n’est pas une obligation en matière de maintien de l’ordre. Sur ce point, il faut nuancer la rédaction du rapport.
Enfin, celui-ci insiste sur la nécessité de renforcer la formation de la gendarmerie et de la police. Sommes-nous en mesure de compenser l’indisponibilité opérationnelle des forces pendant leur temps de formation, qui se compte non en jours mais en mois ?
M. le rapporteur. Le passage sur l’outre-mer figure dans la partie du rapport qui établit un constat et non dans une recommandation. Il ne s’agit donc pas d’un jugement personnel. Par ailleurs, il n’y a pas de confusion ni d’ambiguïté sur le rôle de la police et de la gendarmerie en milieu rural et en zone urbaine. Je vous invite à relire le rapport : « En outre, l’instruction ministérielle portant doctrine d’emploi des forces mobiles de la police et de la gendarmerie nationale prévoit un principe de fongibilité des compétences territoriales entre CRS et EGM. Si la gendarmerie a naturellement tendance à se déployer en milieu rural et outre-mer et les CRS en zones urbaines, chaque force peut être employée dans des missions de maintien de l’ordre public indifféremment dans les deux zones de compétence (police et gendarmerie). »
M. Guillaume Larrivé. Nos travaux ont été d’une excellente tenue, et je partage le point de vue de M. Goujon, qui a approuvé le rapport. Cependant, notre groupe exprime son profond désaccord à l’égard des propos du président.
M. le président Noël Mamère. Cela ne me surprend pas ; je dois même avouer que cela me rassure.
M. Guillaume Larrivé. Nous ne pouvons accepter, monsieur le président, que vous mettiez en cause certaines institutions de la République, comme vous le faites quand vous vous interrogez sur la déontologie des forces de l’ordre ou le contrôle qu’elles exercent.
Vous avez fait allusion de manière rapide et extrêmement polémique au jugement rendu récemment à Rennes par l’autorité judiciaire dans une affaire bien triste qui a heurté nombre de personnes, il y a dix ans, à Clichy-sous-Bois. Il n’y a pas lieu de remettre en cause, à l’Assemblée nationale, l’indépendance de l’autorité judiciaire et l’autorité de la chose jugée.
Si nous sommes républicains, soyons-le pleinement. Un jugement peut déplaire ou interroger la conscience de tel ou tel, mais notre devoir de député est de ne pas mettre en cause l’autorité de la chose jugée, l’indépendance de l’autorité judiciaire et les instruments de contrôle de l’État de droit.
M. le président Noël Mamère. Je me méfie comme de la peste des directeurs de conscience. Je ne suis pas là pour juger du bien ou du mal. Comme vous, je suis représentant d’une part de la souveraineté nationale, représentant du peuple, et je suis là pour construire l’État de droit.
Pour ce faire, il faut légiférer non dans l’émotion et la précipitation, mais dans le débat et la confrontation. La commission d’enquête a duré six mois. J’ai le droit républicain et démocratique d’exprimer des réserves sur les pratiques de certaines institutions que je respecte. Je n’ai pas à être à genoux devant elles ni, au motif que ce sont des institutions, à renoncer à toute critique.
Quelle que soit notre famille politique, nous sommes ici pour améliorer le fonctionnement des institutions et pour les contrôler. Peut-être serons-nous d’accord pour voter des lois qui nous permettront de contrôler mieux et plus souvent l’action de l’exécutif. En la matière, notre pays pourrait s’inspirer des autres démocraties de l’Union européenne. Les institutions que je critique fonctionneraient mieux si elles respectaient davantage les citoyens.
Mes propos ne sentent pas le soufre. Ils sont guidés par la volonté démocratique et politique d’améliorer l’État de droit et de respecter l’ordre républicain. Il n’y a pas, dans cette salle, de révolutionnaire qui veuille abattre la pyramide républicaine. Nous avons le droit – et nous l’exercerons aussi longtemps que nous aurons un souffle politique – de formuler des critiques et d’apporter des contributions.
La proposition de nous doter d’une autorité indépendante n’émane pas seulement du président farfelu d’une commission d’enquête parlementaire. Elle est reprise par des associations de magistrats ou de policiers, qui souffrent de voir le contrôleur se confondre avec le contrôlé.
La Commission d’enquête adopte le rapport.
M. le président Noël Mamère. En application de l’alinéa 3 de l’article 144-2 du règlement de l’Assemblée nationale, la réunion en comité secret de l’Assemblée nationale peut être demandée pendant cinq jours francs à compter de l’annonce au Journal officiel du dépôt du rapport d’une commission d’enquête, afin de se prononcer le cas échéant sur la publication du rapport. C’est la raison pour laquelle celui-ci doit rester confidentiel jusqu’à la fin de ce délai, soit jusqu’au mercredi 27 mai 2015 inclus.
Contribution de M. Noël MAMÈRE, Président de la commission d’enquête et député Écologiste
Comme je le précisais dans mon avant-propos, malgré la grande qualité des débats et la pertinence d’un certain nombre de points et propositions du rapport, je suis loin de partager l’ensemble des préconisations de notre Rapporteur.
L’objet de nos travaux, entre notre demande d’ouverture d’une commission d’enquête et la fin des auditions, s’est subtilement déplacé. Du constat qu’il était possible d’être blessé ou tué lors d’une manifestation en France aujourd’hui et, partant, de la volonté d’enquêter sur les conditions du maintien de l’ordre dans un contexte de respect des libertés et du droit de manifester, nous aboutissons à un rapport qui s’interroge sur la façon d’intégrer la possibilité de manifester dans le cadre de l’ordre public. Il n’est donc plus question de garantir un droit et de comprendre comment il peut être bafoué mais, au contraire, de tenter de le circonscrire pour qu’il s’ajuste au maintien de l’ordre, dont les modalités ont, par ailleurs, déjà été modifiées. Et cette inversion du prisme change pour beaucoup le sens et la raison d’être de ce travail.
Ainsi, je n’approuve pas le Rapporteur lorsqu’il écrit que les formes de manifestations ont évolué au point d’aboutir à un « rejet plus franc » de l’autorité. Le chercheur Cédric Moreau de Bellaing a souligné, lors de son audition, que c’est « le niveau de tolérance au désordre global [qui] a baissé parmi le public ou chez les policiers, mais aussi chez les manifestants », tout en précisant que la preuve n’est pas apportée que les manifestations d’aujourd’hui sont plus violentes que celles d’hier. En revanche, le changement de doctrine progressif des forces de maintien de l’ordre est radical, puisqu’elles doivent aujourd’hui « caler le degré de force qu’[elles] engagent sur le niveau de violence des manifestants » au lieu de réduire la violence à sa portion congrue, afin de « contraindre [les manifestants] à s’ajuster au niveau de violence des forces de l’ordre ». Ainsi des consignes d’interpellation et de la plus grande mobilité des forces de l’ordre qui, depuis 2005, ont provoqué une dislocation de l’action collective et un rapprochement physique sur le terrain, certes favorable à la judiciarisation des délits, mais néfaste à la réduction de la violence.
Le rapport n’a pas abordé la gestion des manifestations non-traditionnelles sous un angle sociologique, mais sécuritaire. À aucun moment notre Rapporteur ne se demande si la société peut et doit s’adapter à ces nouvelles formes de contestation ; sa seule préoccupation est de savoir comment aider les forces de l’ordre et la justice à contenir et judiciariser les éléments perturbateurs, qu’il appréhende d’ailleurs en groupe et non pas individuellement. C’est l’un des nombreux paradoxes de ce rapport. On maintient les lanceurs de balles de défense qui blessent un seul pour disperser l’ensemble, mais l’on souhaite mettre en place des contrôles d’identité collectifs et non plus au cas par cas. Comme si les manifestants devaient être pris dans leur individualité et les fauteurs de trouble dans leur ensemble, soit l’exact inverse de la doctrine française du maintien de l’ordre.
Concernant les propositions de notre Rapporteur, je les commenterai en reprenant la numérotation avec laquelle elles sont référencées en fin de rapport.
Thème 1 :
Le renforcement des compétences en matière de maintien de l’ordre dans certaines préfectures particulièrement exposées (proposition n°1) peut sembler à première vue, ne pas être une mauvaise idée. Il s’agit cependant d’être attentif, car la notion de professionnalisation est ambiguë. Que ce soit sous la forme d’une task force ambulante ou d’une structure dédiée au sein de certaines préfectures, plusieurs questions se posent : cela pourrait-il perturber la chaîne de commandement du maintien de l’ordre dans laquelle le ministre de l’Intérieur est responsable juridiquement ? Comment serait défini le rapport hiérarchique entre ce nouveau « référent ordre public » et le préfet, selon qu’il serait membre du cabinet ou dépêché sur place ? Dans le cas d’une task force, qui la demanderait et qui prendrait la décision de l’envoyer sur place ? Enfin, la définition de « préfectures les plus exposées » est trop vague. Seraient-elles définies au préalable ou au cas par cas ? Sur quels critères, pour combien de temps ? Une telle proposition remet en cause le principe d’égalité. Pour l’ensemble de ces raisons, je ne peux l’approuver.
Thème 2 et 3 :
En revanche, la clarification des rôles de l’autorité exclusive du préfet et des forces mobiles (proposition n°2) et la présence permanente de l’autorité civile pendant l’ensemble des opérations de maintien de l’ordre (proposition n°3) me semblent tout à fait pertinentes. Tout comme les propositions n° 4 et n°5 qui concernent la mise en place d’un guide d’action à l’usage des préfets, la simplification et la meilleure compréhension des sommations à destination des manifestants. Ces deux avancées, relativement aisées à mettre en place, peuvent permettre de fluidifier la gestion des troubles et de s’assurer d’un plus grand respect des procédures et protocoles en vigueur.
Thème 4 :
La proposition n°6 sur les rapports entre les forces de l’ordre et les journalistes rappelle des principes qui sont assez essentiels. Attention, toutefois, à ne pas faire de la « non-entrave » et de la « proportionnalité des risques » des moyens détournés d’attenter au droit de la presse. Il serait également intéressant de mener une réflexion sur les liens entre présence de la presse et degré de violence. Il a été généralement admis au cours des auditions que la première réduisait la seconde. Cependant, je ne peux que m’interroger sur le raisonnement dans son ensemble. Si la médiatisation des manifestations augmente – ce qu’a évoqué Cédric Moreau de Bellaing et qui justifie que l’on fasse un rappel de principes fondamentaux – et que cela induit une diminution de la violence, comment peut-on, dans le même temps, arguer de l’augmentation globale de ce même niveau de violence ? Enfin, l’évocation de « montages grossiers caricaturant l’action des forces de l’ordre à Sivens » produit par « des organes de communication ‘officielle’ et monopolistique de la ZAD » est assez cocasse quand on sait à quel point les images produites a posteriori par la gendarmerie ont été reprises, avec parfois les mêmes limites concernant leur subjectivité.
Thème 5 :
Si l’interdiction judiciaire (proposition n°7) existe déjà, je m’oppose totalement à l’idée d’une interdiction administrative de manifester (proposition n°8). Cette proposition doit être rapprochée de la réglementation et de la jurisprudence afférentes à l’interdiction des supporters de spectacles sportifs et, notamment, la jurisprudence du Conseil d’État qui a annulé le fichier des supporters ainsi que la loi du 23 janvier 2006 qui a autorisé les interdictions individuelles pour les manifestations sportives. Or, un stade n’est pas une manifestation. Limiter l’accès à un lieu clos n’est pas limiter l’accès à une portion d’espace public, étendue et mouvante. Et le droit d’assister à un match n’est pas une liberté fondamentale, contrairement à celui de manifester. Plus spécifiquement, le terme « d’individus connus en tant que casseurs violents » me semble hasardeux et sujet à débat. Si cette interdiction devait être autorisée, elle devrait, au minimum, ne s’appliquer qu’à des individus déjà condamnés. En outre, la mise en œuvre de ce type de mesures semble hautement improbable. Comment déterminer ab initio que telle ou telle personne pourrait participer à telle ou telle manifestation ? Autant les supporters de football peuvent être individualisés et se voir signifier une interdiction par un arrêté préfectoral, autant il semble improbable de cibler les manifestants de type violent sur l’ensemble du territoire pour tous les types de manifestation. Il a été dit à plusieurs reprises au cours de notre travail que l’on compte près de 13 manifestations par jour à Paris, comment pourrait-on techniquement émettre des interdictions ponctuelles dans cette ville ? Il existe, enfin un autre risque démocratique majeur, celui de cibler certains membres d’organisations politiques et syndicales.
Le Rapporteur écrit que « les dispositions permettant aux procureurs de requérir des contrôles d’identité en marge des manifestations servent d’ores et déjà aujourd’hui de fondement à des formes d’interdiction de manifester ». Or légiférer sur un procédé déjà pratiqué, via des biais administratifs, ne rend pas ce procédé légitime. Cela montre également que les contrôles d’identité sont détournés de leur objectif premier.
Thème 6 :
La médiation entre les forces de l’ordre et les manifestants durant la manifestation (proposition n°10) et les retours d’expérience (proposition n°11), inspirés des modèles britannique, allemand ou suédois, privilégiant le port de l’uniforme et non l’infiltration en civil, sont d’excellentes propositions. Je ne reprendrai pas ici l’argumentaire du Rapporteur avec lequel je suis parfaitement en accord sur ces points.
En revanche, fixer le principe d’une concertation obligatoire (proposition n°9) implique de changer radicalement le fonctionnement du droit de manifester, qui est purement déclaratif. Il y aurait dès lors un contrôle a priori et systématique de toutes les manifestations, ce qui entraînerait une restriction manifestement disproportionnée du droit de manifester. Une concertation préalable peut, certes, être utile et bénéfique, mais les propos cités par le Rapporteur ne justifient aucunement la nécessite de rendre cette concertation obligatoire. Ni Pierre Tartakowsky, président de la LDH, dont la démonstration par l’absurde prouve le scepticisme, ni Ben Lefetey qui regrette de n’avoir jamais réussi à être entendu par la préfecture du Tarn, ne la réclame. Quant à Albéric Dumont, de La Manif pour tous, il souligne l’importance de la concertation, mais ne considère pas son organisation responsable des troubles qui ont émaillé certains de ses rassemblements. On se heurte également à la problématique du choix des organisateurs dans le cadre de manifestations initiées par plusieurs organisations.
Thème 7 :
Je suis extrêmement favorable à la proposition n°12 d’ouvrir la formation et la doctrine du maintien de l’ordre aux sciences sociales, ainsi qu’à celles concernant le temps de recyclage des unités et leur formation, demandées par un certain nombre de représentants auditionnés (propositions n°13 et 14).
Thème 8 :
Les propositions n°15, 16 et 17 vont dans le bon sens. L’immobilisation de forces, par définition mobiles, présente en effet une incohérence assez évidente, surtout pour des missions qui ne nécessitent pas l’usage de leurs compétences particulières. La volonté de rationaliser les effectifs est compréhensible, surtout en période de restriction budgétaire, mais il est problématique de voir des forces mobiles assurer des opérations statiques et être remplacées par des forces de sécurité publique sur certains terrains de maintien de l’ordre. L’habilitation d’unités constituées, hors CRS et EGM, peut ainsi être envisagée, mais à plusieurs conditions, en partie évoquées par le Rapporteur :
- que cela n’empêche pas la mise en œuvre de la proposition n°15. Ce n’est pas parce que plus d’unités sont habilitées qu’il faut continuer à confier des missions aux forces mobiles hors de leur champ de compétence ;
- que le nombre d’unités soit restreint et correctement réparti sur le territoire ;
- que leur usage ne se fasse qu’en cas d’indisponibilité d’unités de forces mobiles ;
- qu’elles soient formées dans les infrastructures d’entraînement des EGM et CRS, dans le cadre d’un protocole stricte, exigeant et précis ;
- qu’elles ne soient dotées que de matériel en usage en maintien de l’ordre ;
- qu’il ne soit désormais plus possible qu’une unité non-habilitée soit amenée à mener une opération de maintien de l’ordre.
Thème 9 :
Interdire effectivement le Flash-Ball (proposition n°18) dans toutes les opérations de maintien de l’ordre est une mesure consensuelle et je suis satisfait qu’elle ait été reprise par le Rapporteur. C’est une disposition qui sera d’autant plus facile à mettre en œuvre que la mobilisation d’unités, hors EGM et CRS, sera encadrée.
En revanche, comme il l’a souligné, je suis un fervent partisan de l’interdiction des lanceurs de balles de défense dans leur ensemble et, plus généralement, de toutes les armes de 4ème catégorie, ce qui inclut les LBD 40x46 mais aussi les Tasers. C’est une position que j’ai défendue bien avant l’ouverture de cette commission d’enquête, avec mes collègues Yves Cochet et François de Rugy, en déposant une proposition de loi en ce sens, en juillet 2009 (n°1875).
En effet, même si j’entends l’argument développé suite à la condamnation de la Turquie par la CEDH, la présence d’armes sublétales comme le LBD – moins létales, mais potentiellement létales tout de même – entraîne une surutilisation par les forces de l’ordre et un risque plus élevé de blessures graves et de décès. C’est dans le cadre des manifestations que ces risques sont les plus importants, en raison des mouvements de foule, des fumigènes et de l’imprécision.
À cet égard, il semble plus judicieux d’imposer que toutes les normes du maintien de l’ordre et de l’utilisation des armes résultent d’un acte règlementaire, pris en application d’une loi, afin d’éviter l’opacité des diverses circulaires et manuels d’utilisation ou de formation. À titre d’exemple, il est particulièrement difficile dans la mort de Rémi Fraisse de déterminer les textes applicables, certains manuels ou circulaires ayant disparu.
Concernant les propositions n°19 et n°20, ce sont plus des pistes que de réelles préconisations, il est donc difficile de les commenter. Mais elles répondent toutes les deux à des demandes entendues lors des auditions, de la part des forces de l’ordre mais aussi de certains représentants de la société civile. Il s’agira toutefois d’être vigilant, afin que ne soient pas mis en service des dispositifs plus dangereux ou moins précis.
Thème 10 :
Une fois de plus, c’est la philosophie générale du maintien de l’ordre qui bouge, les unités mixtes employées à Paris, avec des policiers en civil chargés des interpellations, sont déjà une forme dévoyée de maintien de l’ordre, qui ne peut qu’entraîner une suspicion de la part des manifestants. Il est impératif d’imposer le port de l’uniforme quelle que soit la vocation des forces en présence (maintien de l’ordre ou interpellation). Et ces interpellations doivent viser spécifiquement les abords et les individus et non pas des groupes (proposition n°22).
S’agissant de la généralisation de la vidéo (proposition n°21), elle porte atteinte au droit de manifester et pourrait entraîner l’identification et la constitution de fichiers d’opposants politiques ou syndicaux.
Quant à la systématisation d’un local de permanence pour les contrôles collectifs d’identité (proposition n°23), elle est contraire au principe de contrôle d’identité qui doit être individualisé et doit répondre à des troubles préalables. Le secret de la procédure pénale et son caractère individuel, s’opposent à la présentation groupée à un OPJ (proposition n°23).
Au-delà de ces mesures limitées aux modalités du maintien de l’ordre, c’est une réflexion globale qui doit être entreprise dans notre pays sur la place des forces de l’ordre dans la société.
Toute société nécessite un ordre et une autorité. Cependant, le monopole de la violence légitime qui définit l’État wébérien n’implique pas la légitimité de toute violence qu’il pourrait exercer.
Nous serons d’accord sur le fait que le rôle premier des forces de l’ordre est de protéger les citoyens, pris au sens de l’ensemble des habitants de la cité. Elles sont ainsi un service public, ‘‘au service de’’ la population. La police agit au nom du peuple et non en fonction d’entités abstraites comme la Nation – les étrangers seraient alors exclus, de facto, de cette protection ? – ou la République – terme dévoyé, qui n’est ni l’apanage ni la condition de la démocratie. C’est au nom de chaque citoyen que la police agit. Ce n’est pas une conception individualiste mais humaniste de l’ordre. En effet, cette défense de l’intérêt collectif ne doit pas oublier d’inclure les individus. Il ne peut y avoir de victime collatérale acceptable dans une société qui se veut et se revendique démocratique.
Notre société doit entreprendre un travail collectif pour redéfinir la place du pouvoir de police et son rapport à la population. L’ordre pour l’ordre ne résout rien, c’est aussi en améliorant la justice sociale, la démocratie locale, la représentativité du peuple, que l’on réduira les situations conflictuelles, causes et conséquences des limites floues des pouvoirs accordés aux forces de l’ordre. C’est pour cette raison que les écologistes ont proposé de remettre à plat les procédures de déclaration d’utilité publique, afin d’éviter de reproduire « un vieux, très vieux monopole de représentation, des débats de convenance, des pratiques d’entente et des ententes pratiques [qui] ont engendré une confusion regrettable entre la représentation élective et un inamovible banquet de notables multi-reconduits », comme l’a écrit Pierre Tartakowsky (Hommes & Libertés n°168, décembre 2014).
Dans une majorité des cas, les forces de police sont blanchies dans les procédures qui les visent pour blessures graves, homicides ou non-assistance à personne en danger. Il manque de toute évidence une réelle autorité indépendante chargée de faire la lumière sur les pratiques abusives, non-conformes, voire clairement illégales, commises par certains représentants des forces de l’ordre. La question du statut des gendarmes qui dépendent du ministre de l’Intérieur mais qui n’ont pas le droit de se syndiquer et sont jugés par des cours militaires se pose également. Bien sûr, les fautes policières ne sont, heureusement, pas la norme. Ceux qui les commettent sont aussi minoritaires que le sont les fauteurs de trouble en manifestation, ils ne sont qu’un arbre qui cache la forêt du respect des procédures, mais ils ternissent l’ensemble de leur profession et leur impunité laisse un goût amer à une grande partie de la population, qui se sent confrontée à un terrible sentiment de deux poids-deux mesures. M. le Rapporteur écrit en préambule de ses propositions que l’opinion publique aurait des « attentes […] en matière de maintien de l’ordre et de judiciarisation des délits ». Mais qui est donc cette opinion publique unanime et uniforme, capable de s’exprimer d’une seule et claire voix ? Ce n’est probablement pas la France de Nassuir, de Quentin et Joachim, de Rémi ou de Zyed et Bouna. Celle qui subit les contrôles d’identité quotidiens ou qui a la « bêtise » de mourir pour ses idées, comme disait un président de conseil général en octobre 2014.
Contribution de MM. Philippe GOUJON, Secrétaire, Guillaume LARRIVÉ, Vice-Président, et Olivier MARLEIX et les membres UMP de la commission d’enquête
En préambule, Philippe GOUJON, Guillaume LARRIVÉ et Olivier MARLEIX, respectivement Secrétaire, Vice-Président et les membres UMP de la commission d’enquête, tiennent à rendre hommage au dévouement et au professionnalisme des forces de l’ordre qui assurent une mission essentielle à la vie démocratique de notre pays, en permettant aux citoyens d’exercer leur droit d’expression par la voie de manifestations se déroulant dans le respect de l’ordre public.
Ils regrettent cependant qu’il ait fallu attendre une demande du groupe Écologiste pour que la majorité accepte de créer une commission d’enquête sur ce sujet, alors qu’il y a un an et demi seulement, elle avait profondément dénaturé par voie d’amendement, provoquant ainsi son abandon, les contours de celle que le groupe UMP, par la voix de son rapporteur Philippe GOUJON, avait réclamé en usant de son « droit de tirage » pour faire toute la lumière sur la gestion de la sécurité lors des rassemblements de personnes à Paris, notamment lors des « manifs pour tous » ou des débordements du Trocadéro.
Partageant pour l’essentiel les propositions du Rapporteur, Pascal POPELIN ainsi que l’état des lieux qu’il dresse du cadre juridique du maintien de l’ordre en France, ils souhaitent, par la présente contribution, avancer d’autres pistes de réflexion complémentaires qui auraient mérité de figurer dans ce rapport.
En ce qui concerne les propositions relatives au cœur de métier des forces de l’ordre, à savoir le maintien de l’ordre sur le terrain, les membres UMP souscrivent aux propositions d’améliorer la lisibilité de la chaîne de commandement en clarifiant les rôles respectifs du Préfet et des forces mobiles, ainsi que d’assurer la présence permanente de l’autorité civile ou son représentant pendant les opérations de maintien de l’ordre, sans qu’elle n’interfère dans le commandement opérationnel, et non uniquement, comme c’est le cas à l’heure actuelle, au moment d’engager la force.
Ils regrettent que le Rapporteur n’ait pas retenu la proposition du général Cavallier d’améliorer, au risque de rester dans l’ambiguïté et l’opacité dans laquelle évolue à l’heure actuelle le représentant de l’État, la traçabilité des commandements et directives préfectorales par leur matérialisation, sans pour autant revenir à l’ancien système de la réquisition – trop rigide.
Ils soulignent que, si la restriction de l’utilisation des LDB a été demandée par les représentants des manifestants, leur emploi est soumis à un protocole strict et strictement réservé aux fonctionnaires individuellement agréés. À ce titre, il aurait été pertinent que le rapport propose plutôt l’allongement des durées d’agrément, étant donné les difficultés tenant au report des temps de formation, induisant souvent la perte du renouvellement de l’agrément.
En matière de formation, il serait également pertinent de revitaliser la dominante maintien de l’ordre/défense dans le corps des officiers, afin de compenser la contraction actuelle du vivier des experts du maintien de l’ordre au profit de la sécurité publique et de la police judiciaire, permettant ainsi de les projeter en tant que de besoin sur les opérations sensibles sur tout le territoire, si nécessaire avec un état-major réduit, solution préférable à la sédentarisation des effectifs spécialisés dans les préfectures sensibles.
La complémentarité gendarmerie mobile/CRS doit également être préservée par le maintien de temps de formation, de contenu des entraînements et d’équipements adaptés à ces exigences opérationnelles.
Ils soulignent le risque de priver les forces de l’ordre de certaines techniques leur permettant de tenir les manifestants à distance, conformément à la doctrine française du maintien de l’ordre, si cela n’est pas compensé par de nouveaux moyens intermédiaires et équipements lourds, comme les canons à eau, sur l’exemple allemand, ou le développement des nouvelles technologies comme les dispositifs sonores, électro-magnétiques et optiques.
L’autorisation d’interception des SMS échangés entre les organisateurs et les manifestants permettrait également d’anticiper les mouvements de foule ainsi que d’incriminer les casseurs, comme l’a proposé le Ministre de l’Intérieur Bernard CAZENEUVE.
Aussi proposent-ils que toute modification des instruments du maintien de l’ordre soit impérativement accompagnée d’une solution alternative, afin de ne pas créer de situation de « vide défensif », source d’insécurité pour les forces de l’ordre, victimes d’atteintes physiques en augmentation : l’an dernier, 387 gendarmes mobiles et CRS ont été blessés en France (contre 338 en 2013, 175 en 2012). À Paris, 232 membres des forces de l’ordre ont été blessés durant la même période (contre 203 en 2013 et 68 en 2012).
La nécessité du renouvellement du parc de blindés de la gendarmerie, aujourd’hui obsolète, ne peut être éludée, les forces de l’ordre étant en sous-capacité à l’heure actuelle pour assurer le maintien de l’ordre en situation de troubles insurrectionnels.
Si les difficultés liées à la réforme des renseignements généraux ainsi que les carences budgétaires mentionnées dans le bilan des moyens des forces de maintien de l’ordre ne font pas débat, les membres UMP tiennent cependant à préciser qu’elles ne peuvent être attribuées exclusivement à la précédente majorité, alors que le Ministre de l’Intérieur, avait procédé au recrutement de plus de 13 000 policiers et gendarmes en 2002, a fortiori moins de deux ans avant la fin du présent quinquennat et dans un contexte de recrutement de dizaines de milliers de fonctionnaires dans d’autres secteurs, sans même évoquer la régime des 35 heures qui a supprimé de fait l’équivalent de 8 000 policiers.
À l’heure actuelle, une situation de rupture capacitaire prévaut, alors même que les opérations de maintien de l’ordre nécessitent des moyens importants dès lors qu’une crise éclate ; aussi, faute d’un renforcement des effectifs dits spécialisés, le rapport aurait-il pu préconiser de maintenir, en le clarifiant, l’engagement de moyens non spécialisés comme les PSIG notamment pour les actions de deuxième échelon de type bouclage, sécurité des arrières.
Par ailleurs, le Rapporteur ayant indiqué que le contexte budgétaire ne permettait pas d’engager de nouveaux recrutements dans les forces de maintien de l’ordre, les membres UMP craignent que sa proposition de restreindre l’affectation des unités non spécialisées à cette activité ne conduise à une embolie des forces spécialisées, les privant du temps de formation requis pour maîtriser certains équipements ou obtenir les agréments nécessaires à l’utilisation de techniques ou équipements spécifiques, en les soumettant à une trop forte cadence, susceptible d’accroître le stress situationnel et la fatigue des unités mobilisées dans cette mission particulièrement délicate. L’exemple d’une dizaine d’unités CRS se déclarant en arrêt maladie pour exprimer leur « mal-être » en raison de l’exceptionnelle mobilisation consécutive au relèvement du plan Vigipirate au niveau « alerte attentats », en témoigne.
Enfin, ils rappellent la demande récurrente des syndicats de police et des gendarmes de voir amélioré leur régime de protection fonctionnelle, qui a déjà fait l’objet, depuis 2012, de deux propositions de loi UMP rejetées par le Gouvernement.
En ce qui concerne les propositions relatives aux manifestants, les membres UMP de la commission d’enquête partagent le constat dressé par le Rapporteur concernant l’affaiblissement des moyens de régulation de l’État face à la recomposition des acteurs principaux des manifestations – multitude de nouveaux organisateurs isolés au lieu d’acteurs institutionnels identifiés, comme les syndicats – et l’émergence de nouveaux phénomènes de contestation : organisation de manifestations par les réseaux sociaux, ZAD, occupation de nouveaux terrains de contestation sociale notamment en espaces ouverts et multiples.
Ils approuvent le principe de faciliter les contacts préalables à la manifestation entre les autorités et les manifestants, afin d’organiser au mieux le parcours, comme l’a suggéré le Directeur général de la Police nationale, ainsi que d’assurer la permanence de ces échanges durant la manifestation par des unités policières de médiation et de généraliser les retours d’expérience. Cependant, il serait préférable de qualifier ces unités d’ « unités forces de l’ordre-médiation » (UFOM) plutôt que d’unités policières, afin de pouvoir utiliser ce dispositif en zone gendarmerie.
Ils sont favorables à une rénovation des canaux de communication permettant aux forces de maintien de l’ordre d’adresser leurs consignes aux manifestants, les auditions ayant révélé que leur compréhension laissait à désirer. À ce titre, le rapport mentionne opportunément, outre l’emploi de signaux lumineux de transmission de ces consignes, leur diffusion par SMS aux manifestants, proposition avancée par le Directeur général de la gendarmerie nationale.
Ils regrettent que le rapport se soit limité à dresser le constat d’une tendance à l’organisation de manifestations non déclarées, notamment par le biais des réseaux sociaux, sans en tirer de conséquences juridiques.
Lors des auditions, Philippe GOUJON, auteur d’une proposition de loi encadrant l’organisation de rassemblements sur la voie publique au moyen de réseaux de communications électroniques, avait suggéré de responsabiliser les organisateurs par l’instauration d’un régime de présomption d’organisation de manifestation étayée par un faisceau d’indices (échanges électroniques, Facebook, SMS), permettant à l’autorité civile de les contacter en vue de formaliser leur déclaration de manifestation auprès d’elle, et notamment de mettre en place les services de secours qui doivent obligatoirement être présents à proximité des cortèges.
Cette proposition, fortement soutenue par le Procureur de la République de Paris, aurait dû figurer dans le présent rapport.
Bien que reconnaissant l’absence de sanctions pour les manifestations non déclarées, la souplesse et la capacité d’adaptation dont l’autorité civile fait preuve afin de garantir le droit de manifestation, le présent rapport aurait dû instaurer un dispositif incitant à effectuer cette déclaration, sur le modèle d’une déclaration préalable obligatoire, comme l’a suggéré Olivier MARLEIX.
Ils souscrivent à la proposition-phare consistant à compléter le dispositif portant peine complémentaire d’interdiction ponctuelle de manifester sur la voie publique en cas de condamnation pour des faits graves commis lors de troubles à l’ordre public, à l’instar du dispositif contre les hooligans lors des matches de football.
Si le renforcement des contrôles d’identité ciblés pour ouvrir les possibilités d’interdiction de participer à un cortège est indispensable pour donner toute sa portée à cette mesure, une obligation de pointage en commissariat à l’encontre des fauteurs de troubles identifiés comme tels durant le temps de la manifestation, inspirée du modèle de lutte contre le hooliganisme, aurait pu utilement compléter cette proposition.
Face aux nouvelles formes s’apparentant parfois à la guérilla, et regrettant que le rapport n’ait pas retenu une approche par scénario alors que la commission a bien identifié l’émergence de situations nouvelles relevant du rétablissement de l’ordre, les Députés UMP soutiennent la proposition de Christian VIGOUROUX, Président de la section de l’intérieur du Conseil d’État, d’améliorer les dispositifs juridiques permettant l'évacuation forcée, sur le modèle des campements illégaux (loi de 2000 modifiée en 2005).
Par ailleurs, un accompagnement juridique renforcé de l’autorité administrative commanditaire du maintien de l’ordre serait pertinent, les « ZADistes » disposant notamment de « legal team ».
Une procédure de réponse judiciaire et administrative express quand des recours sont déposés permettrait de faciliter l’évacuation de terrains occupés illégalement tant que les recours ne sont pas épuisés, ce qui prend aujourd’hui entre 2 et 18 mois…
En ce qui concerne la judiciarisation des manifestations et la réponse pénale
Les Députés UMP de la commission d’enquête souhaitent nuancer l’idée avancée par le Rapporteur selon laquelle la médiatisation affaiblirait la tolérance à l’égard des violences déployées par certains manifestants, rappelant que la violence physique est par définition inacceptable dans une société civilisée, d’autant plus lorsqu’elle prend en otage un mode d’expression normalement pacifique en démocratie tel que la manifestation ; l’augmentation du nombre de blessés parmi les forces de l’ordre témoigne de la réalité de ce phénomène.
Ils regrettent à cet égard que le rapport ne préconise pas d’introduire la notion de « subversion violente » dans notre droit, qui permettrait d’utiliser les moyens spéciaux du renseignement à l’encontre des éléments violents agissant en marge des manifestations, comme l’a préconisé le Préfet de Police, Bernard BOUCAULT, lors de son audition.
Cette violence s’exerce aussi bien à l’encontre des forces de l’ordre que des manifestants eux-mêmes ou des journalistes, qui réclament, comme l’ont indiqué leurs représentants, une protection par les forces de l’ordre en cas de dérapage d’éléments extérieurs ou de manifestants, dans un contexte d’affaiblissement des services d’ordre mis en place par les manifestants.
À ce titre, regrettant ce qui peut apparaître comme une certaine passivité des forces de l’ordre à l’égard des casseurs durant une manifestation, bien que ce principe de non-intervention découle directement de la doctrine de maintien à distance et n’empêche pas que des poursuites judiciaires soient menées post-manifestation contre ces délinquants, ils adhèrent à l’idée d’un protocole d’intervention rapide en cas d’urgence, permettant de systématiser l’arrestation et la neutralisation des éléments violents, proposé par le Rapporteur via la création d’un régime de flagrance du trouble à l’ordre public.
Ils regrettent toutefois que la présence permanente d’un substitut du procureur de la République durant la manifestation, à l’instar de l’autorité civile, n’ait pas été retenue, afin de sécuriser les démarches judiciaires contre les fauteurs de troubles et éléments violents, ainsi que, le cas échéant, des membres des forces de l’ordre.
De façon générale, la réponse judiciaire gagnerait à être accélérée dans ce domaine, comme le préconise d’ailleurs le préfet Christian LAMBERT, afin de ne pas laisser impunis des comportements qui non seulement sont délictueux mais, parce qu’ils ont cours dans le cadre de l’exercice du droit d’expression citoyen qu’est la manifestation, portent atteinte à la « démocratie de rue » qui fait l’originalité du modèle français.
Madame Françoise MATHE, présidente de la commission « libertés publiques et droits de l’homme » du conseil national des barreaux, rejoint ce constat, parlant d’ « enkystement lié à la durée de la procédure administrative ».
La complexification croissante des procédures judiciaires, notamment en termes de délais et de procédure, justifierait cette permanence du substitut du procureur, qui serait à même de piloter et d’optimiser les démarches engagées par les officiers de police judiciaire sur le terrain.
Le nombre d’arrestations effectuées pour flagrance du trouble à l’ordre public et le taux de réponse judiciaire de ces arrestations devraient figurer au rang des indicateurs budgétaires annuels...
Une garantie supplémentaire résultera de la systématisation de l’enregistrement vidéo des opérations de maintien de l’ordre, comme indiqué par le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l’Intérieur, qui permettra par ailleurs de poursuivre les fauteurs de troubles à la fin de la manifestation, tout en constituant également un élément de preuve dans toute procédure visant les comportements des forces de l’ordre, sécurisant ainsi leur intervention.
À cet égard, alors que les procédures à l’encontre des fonctionnaires membres des forces de l’ordre sont courantes, le Défenseur des droits a relevé que les sanctions à l’encontre de l’autorité civile étaient quasiment inexistantes, confirmant l’existence d’une inégalité de traitement judiciaire selon qu’il s’applique au donneur d’ordre ou à l’exécutant, risquant d’amener la condamnation de la France sur ce fondement par la Cour européenne des Droits de l’Homme.
La question de la responsabilité des organisateurs à l’égard des dommages causés par les manifestations donnerait également matière à légiférer, en vue de créer un mécanisme de responsabilité civile solidaire des organisateurs, comme l’a suggéré lors de son audition Monsieur Christian VIGOUROUX, citant l’exemple des dommages importants et pourtant prévisibles causés par une distribution de billets de banque sur la voie publique à des fins publicitaires, dont les organisateurs n’eurent pas à répondre. Une telle responsabilité civile solidaire permettrait également aux organisateurs d’intenter une action en réparation auprès des casseurs agissant en marge de la manifestation.
Conclusion
Sous réserve des remarques évoquées ci-dessus et des propositions alternatives qu’ils auraient souhaité voir formulées dans ce rapport, les Députés UMP ne s’opposeront pas à son adoption, conscients que la meilleure protection des libertés publiques, dont la liberté de manifester, réside dans un cadre juridique du maintien de l’ordre adapté aux nouvelles formes de contestation et au bon déroulement des manifestations.
Observations de Mme Marie-George BUFFET, Secrétaire de la commission d’enquête et députée du groupe de la Gauche démocrate et républicaine
Je tiens tout d'abord à remercier les personnes auditionnées par notre commission, leurs apports, remarques et points de vue ont considérablement enrichi ce rapport. Je tiens à souligner tout particulièrement l’attachement de chacun des intervenants, militants, chercheurs et représentants des forces de l'ordre, à une conception démocratique et républicaine du maintien de l'ordre. C'est cette intelligence de lecture de chacun qui est le garant du caractère républicain et démocratique de nos forces de l'ordre, et c'est cette intelligence qui permet de faire évoluer nos méthodes de maintien de l'ordre vers toujours plus de garanties pour les libertés publiques et de sécurité pour les différents acteurs.
Il convient de remercier M. le Président et M. le Rapporteur pour leur travail. Comme l'introduction le souligne, l'enjeu de cette commission d'enquête était de « contribuer à moderniser le cadre du maintien de l'ordre pour permettre que la liberté de manifester et l'ordre public se conjuguent sans heurt dans la durée, en préservant la vie et la sécurité de chacun. »
Au terme de cette commission, de nombreuses propositions vont en ce sens et méritent d'être soulignées. Par contre, d'autres sont extrêmement préoccupantes, en particulier dans le glissement de l'objet de notre commission : nous sommes passés de la volonté d'assurer le respect des libertés individuelles et du droit de manifester au comment manifester dans le cadre de l'ordre public. En se focalisant trop sur les nouvelles formes de mobilisations – dont les Zones à Défendre- nos travaux ont opéré ce glissement alors même que ces questions sont un aspect minoritaire de ce qui nous préoccupe.
Certaines préconisations de ce rapport vont quand même dans le sens originel de notre commission, il faut les souligner pour leur permettre de garantir toujours plus les droits à la mobilisation, à la revendication tels que les portent notre République dans ses fondements mêmes. Ainsi, la réaffirmation de l'autorité civile et la volonté de sa présence permanente pendant les opérations de maintien de l'ordre va en ce sens. De même que l'organisation du retour d'expérience de la part des manifestants, la création d'unités policières dont le cœur de métier est la médiation et la clarification des modalités de sommation à destination de ces mêmes manifestants.
Ces mesures sont à même d'éviter au maximum les confrontations et d'assurer sécurité et respect des droits de chacun. On ne peut qu'espérer que ces mesures iront en progressant avec le temps, l'expérience et les avancées scientifiques promises par ce rapport avec l'ouverture de l'étude des modalités de maintien de l'ordre aux sciences sociales. C'est avec l'étude scientifique, universitaire, citoyenne et impartiale du maintien de l'ordre que l'avenir de cette mission de service publique sera de plus en plus pacifié et équitable.
Concernant l'organisation et l'application du maintien de l'ordre, plusieurs éléments sont également des pistes intéressantes. On peut citer la création d'un guide d'action à destination des préfectures afin qu'elles puissent mieux appréhender ces opérations, la libération des forces mobiles – CRS et gendarmes mobiles, spécialisées dans les missions qui intéressent cette commission – des missions périphériques qui accaparent bien trop leur action.
Je pense que nous pouvons même étendre ces préconisations. L'une d'entre elles nous propose de restreindre le maintien de l'ordre aux unités spécialement formées et reconnues sur cette question. Nous devrions affirmer que les missions de maintien de l'ordre devraient être réservées aux unités mobiles. Ce sont la raison d'être et le cœur de métier des CRS et des EGM (Escadrons de Gendarmes Mobiles). Elles disposent de décennies d'expérience sur ces questions, et ce dans des opérations d'intensité variable. Elles ont fait la preuve – encore pendant l'audition de leurs commandants pendant la tenue de notre commission – de leur compétence en la matière, en particulier en la conjuguant avec le respect des libertés publiques et de l'esprit républicain.
Avant de proposer l'habilitation d'autres unités au maintien de l'ordre, libérons nos forces mobiles des missions statiques et de sécurité publique qui ne sont pas leur cœur de métier.
Dans le même esprit, il faut souligner la confirmation du retrait du flashball des missions de maintien de l'ordre mais la question du Lanceur de Balle de Défense 40 millimètres (LBD 40) se pose. Le rapport préconise de limiter son usage aux forces mobiles lors de ces missions. De part leur spécialisation, ces unités sont les plus à même d'en faire un usage adapté – dans un cadre strict de déploiement. Mais je pense qu'il faut ambitionner le retrait de ces armes des missions de maintien de l'ordre. Le LBD 40 – « arme à létalité atténuée » – est un outil d'exception dans les situations qui nous intéressent, car inadapté à la doctrine d'intervention, comme l'ont confirmé nos auditions. On ne peut traiter la foule en un bloc unique, qu'il faut protéger, en ayant la possibilité de viser individuellement un citoyen qui la compose.
C'est en développant la formation des unités mobiles, en les libérant des missions annexes, en les utilisant sur leur mission exclusive et originelle de maintien de l'ordre, tout en assurant la primauté de l'autorité civile, l'évolution de nos connaissances des nécessités républicaines et démocratiques, la prise en compte des expériences des manifestants que nous pouvons porter cette ambition: le retrait de ces armes qui ont déjà blessé – parfois gravement – des citoyens.
Ainsi, ce n'est pas en renforçant les moyens mécaniques pour « pallier les diminutions d'effectifs » que nous garantirons les droits des manifestants. Des fonctionnaires de police ou des militaires de la gendarmerie en nombre suffisant pour pleinement assurer les organisations tactiques actuelles, régulièrement formés et recyclés, déployés dans des conditions de repos suffisantes et sous l'autorité civile seront toujours plus efficaces et républicains dans leur action que des « moyens mécaniques ».
Je le disais précédemment, certaines préconisations sont particulièrement préoccupantes, je ne peux qu'y être opposée. Tout d'abord, le principe de concertation obligatoire. Ici encore s'opère un glissement, aujourd'hui les manifestations n'ont qu'à être préalablement déclarées, imposer la concertation, c'est imposer un contrôle systématique a priori de toutes les manifestations. C'est une transformation lourde de sens du droit de manifester ! Aujourd'hui, les organisateurs qui déclarent s'engagent quasi-systématiquement dans des procédés de concertation afin d'assurer à tous les meilleurs conditions dans et autour de la mobilisation. Pourquoi donc imposer une mesure qui porte en elle une telle transformation du droit à manifester ? De plus, que dire de certaines mobilisations spontanées, je pense ici à des mobilisations lycéennes telles que nous en avons connues les années précédentes ou encore à certaines mobilisations professionnelles en réaction à des annonces de plans sociaux, qui ne sont pas déposées de par leur spontanéité mais qui ne nuisent pour autant en aucun cas à l'ordre public ? Quelle concertation préalable et obligatoire est-il possible avec ces mouvements qui sont la plupart du temps pacifiques et ne dérangent en rien l'ordre public ?
De même, les modalités d'action contre le hooliganisme ont été transposées aux manifestations dans certaines recommandations de ce rapport. Je pense ici en particulier aux interdictions administratives de manifester. On peut interdire à quelqu'un de rentrer dans un stade, d'assister à une représentation sportive. Mais on ne peut interdire à quelqu'un d'exercer son droit fondamental à la manifestation, d'autant plus si elle se déroule sur la voie publique. C'est non seulement une limitation du principe de libre circulation mais c'est également une mesure inapplicable. On ne peut décréter administrativement qu'un citoyen ne peut participer à une action collective sur la voie publique.
Dans le même esprit, je m'oppose au recours systématique à la vidéo. On ne peut préconiser que chaque manifestant puisse être filmé par les forces de l'ordre, enregistré et potentiellement fiché pour sa simple participation à une manifestation.
Il en va de même pour la mise en place systématique d'un local de permanence pour les contrôles collectifs. La présentation groupée de manifestants à un Officier de Police Judiciaire va à l'encontre des modalités de contrôle d'identité telles qu'en dispose la Loi. Cette mesure présente de graves travers qui vont à l'encontre du droit à manifester.
C'est pour ces raisons que, tout en soulignant la qualité de nos travaux, je ne peux souscrire à certaines de ces propositions et que j'ai donc voté contre le rapport de cette mission.
Contribution de M. Philippe FOLLIOT, Vice-président de la commission d’enquête et député du groupe Union des démocrates et indépendants
Représentant le Groupe UDI, je tiens tout d’abord à saluer le travail réalisé dans le cadre de cette commission d’enquête. Sans esprit partisan, je me réjouis qu’à l’initiative du groupe Écolo, une concertation que nous avons voulue sereine ait été effectuée par notre Assemblée, afin que nous puissions engager une réflexion de fond sur les missions de maintien de l’ordre, qui doivent être réalisées dans les meilleures conditions possibles.
Très attachés aux valeurs humanistes de notre pays, nous tenons à réaffirmer que le droit à manifester, fondement de notre démocratie, doit être préservé. Pour autant, « la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres », et ce principe vaut en particulier pour le droit de manifester.
Dans un État de droit, le point de vue de manifestants qui ne représentent qu’eux-mêmes et celui d’élus au suffrage universel qui représentent leurs concitoyens ne doivent pas être placés sur un pied d’égalité. En effet, il est inacceptable que des militants puissent interrompre et bloquer des projets élaborés, décidés et votés par de larges majorités d’élus locaux, départementaux et régionaux.
Le droit des minorités à s’exprimer ne saurait remplacer celui des majorités à décider. Et en aucun cas, des minorités ne devraient pouvoir, utilisant comme un prétexte leur droit à s’exprimer et à manifester, recourir à la violence.
L’équilibre trouvé par la commission d’enquête, entre le droit fondamental à manifester et le maintien de l’ordre républicain, me parait satisfaisant et c’est pourquoi je soutiens ce rapport.
Sur les 23 propositions formulées, 15 reçoivent mon soutien :
ê Proposition n°1 : Créer soit une task force préfectorale spécialisée dans le maintien de l’ordre et mobile rapidement, soit des professionnels du maintien de l’ordre dans les préfectures les plus exposées ;
ê Proposition n°2 : Clarifier les rôles respectifs de l’autorité exclusive du préfet et des forces mobiles ;
ê Proposition n°3 : Assurer la présence permanente de l’autorité civile pendant les opérations de maintien de l’ordre et non pas seulement pour engager la force ;
ê Proposition n°4 : Créer un guide d’action à usage des préfets et le communiquer aussi largement que possible ;
ê Proposition n°5 : Simplifier et rendre plus compréhensible les sommations et la communication à destination des manifestants ;
ê Proposition n°6 : Faciliter le suivi par la presse des opérations de maintien de l’ordre ;
ê Proposition n°9 : Fixer le principe d’une concertation préalable obligatoire ;
ê Proposition n°10 : Créer de nouvelles unités policières de médiation, intégrées dans les manifestations et dispositifs de maintien de l’ordre ;
ê Proposition n°11 : Organiser un accueil et un retour d’expérience de la part des manifestants à l’issue des opérations de maintien de l’ordre ;
ê Proposition n°13 : Chercher à préserver et rendre incompressible le temps de recyclage des unités ;
ê Proposition n°14 : Densifier la formation et le recyclage des unités chargées du maintien de l’ordre ;
ê Proposition n°16 : Créer une habilitation au maintien de l’ordre pour les unités constituées de la police et de la gendarmerie nationale, hors EGM et CRS ;
ê Proposition n°21 : Systématiser le recours à la vidéo afin de faciliter les procédures d’interpellation lors des opérations de maintien de l’ordre ;
ê Proposition n°22 : Développer la capacité des unités spécialisées à interpeller des groupes d’individus violents ;
ê Proposition n°23 : Améliorer la coordination entre les autorités judiciaires et préfectorales afin que les dispositifs de maintien de l’ordre permettent de façon plus fluide les poursuites pénales lorsque des délits sont commis.
Pour autant, certaines questions peuvent être soulevées :
Comment pourront être mises en œuvre les propositions n°7 et n°8 ? La mise en œuvre de mesures de police administrative portant interdiction individuelle de participer à une manifestation, d’une part, et la possibilité de prononcer une peine complémentaire d’interdiction ponctuelle de manifester sur la voie publique en cas de condamnation pour des violences commises lors de troubles à l’ordre public, d’autre part, sont des mesures nécessaires. Toutefois, afin qu’elles soient réellement effectives, il est essentiel qu’un mécanisme de contrôles d’identité ciblés soit prévu.
ê La proposition n°15, qui consiste à réduire l’emploi des forces mobiles pour des missions périphériques de sécurité afin d’accroitre leur disponibilité, doit être étudiée par exemple à la lumière de l’opération Sentinelle. Je crains que cette proposition ne demeure un vœu pieu, sachant que des forces mobiles de gendarmes et de CRS sont y actuellement très mobilisées.
ê Il en est de même de la proposition n°17 (restreindre les dispositifs de maintien de l’ordre aux seules unités spécialisées ou habilitées du fait de leur formation). Une telle mesure serait bien évidemment souhaitable, mais nécessité faisant loi, ce sont souvent les premières unités arrivant sur place, et en particulier dans le cas de manifestations spontanées, qui doivent parer au plus pressé.
ê Concernant la proposition n°18 (restreindre l’usage du LBD lors des opérations de maintien de l’ordre aux seules forces mobiles et aux forces dûment formées à son emploi dans le contexte particulier du maintien de l’ordre), le cadre actuel me parait satisfaisant. Je regrette cependant l’absence d’étude d’impact préalable sur les conséquences, à terme, de la décision d’interdire les grenades offensives. Je tiens également à souligner que l’interdiction d’une technique devrait être compensée par des moyens alternatifs mis à la disposition des forces de l’ordre, alors même que ces dernières sont la cible d’individus ou de groupes « armés » ou tout au moins utilisant des armes ou engins à tendance de plus en plus létale ;
ê En outre, dans le contexte actuel de tension budgétaire, des doutes sont permis concernant les propositions n°19 et n°20. En effet, le développement de nouveaux moyens intermédiaires visant à disperser les foules, d’une part, et le renforcement et la rénovation des moyens mécaniques pour pallier les diminutions d’effectifs et favoriser l’émergence de nouveaux schémas tactiques, d’autre part, nécessiteront des moyens budgétaires ;
ê La proposition n°12, qui préconise d’ouvrir la formation et la doctrine du maintien de l’ordre aux recherches en sciences sociales, est à mon sens superfétatoire.
D’autre part, je tiens à souligner la nouvelle menace que constitue l’apparition de casseurs, ultra-violents, en marge des manifestations. Ces derniers, qui souhaitent être confondus avec les manifestants, s’inscrivent dans une logique exclusivement violente. Ils constituent une menace évidente pour l’ordre public, et des mesures spécifiques devraient être prises à leur endroit.
Nous constatons également l’apparition de nouveaux troubles à l’ordre public ruraux et pérennes, nommés « ZAD ». Même lorsqu’ils sont situés sur des propriétés privées, les attroupements, par les débordements connexes engendrés, peuvent être assimilés à une forme de trouble de l’ordre public.
Enfin, nous avons tous conscience que confrontés à l’hostilité des manifestants, confrontés à la violence des casseurs, la mission des forces de l’ordre s’avère bien souvent particulièrement délicate. Rappelons que les organisateurs de ces manifestations, le plus souvent de bonne foi, sont aussi victimes de ces casseurs. La République ne serait tolérer de tels comportements.
C’est pourquoi je souhaite ici rendre hommage aux forces de l’ordre et saluer leur action, essentielle au service de la protection des personnes et des biens.
Contribution de M. Jean-Paul BACQUET, membre de la commission d’enquête et député du groupe Socialiste, républicain et citoyen
1/ Le projet de rapport est équilibré et modéré. Il évite ainsi deux écueils, n'étant ni accusateur, ni irréaliste.
Il doit être noté que sur les 23 propositions formulées, la majorité est partagée par le directeur général de la gendarmerie nationale qui a lui-même émis des propositions analogues.
2/ Toutefois, à la lecture du projet de rapport, il apparaît que 3 points doivent être approfondis :
a. L'encadrement du recours à des unités non spécialisées
Le rapport propose la création d'une habilitation des unités non spécialisées qui pourraient être engagées au maintien de l'ordre.
Cette mesure pose deux difficultés :
le choix des unités, la gendarmerie ne disposant pas de l'équivalent des compagnies d'intervention ;
un risque de dérive dans sa mise en œuvre, qui pourrait aboutir à l'inverse de l'effet recherché, en favorisant le recours par le préfet à des unités non spécialisées qui seraient implantées dans son département et donc employables sans avoir besoin de solliciter l'autorisation de la zone ou du ministère (cf. Affaire des paillotes corses).
b. Le renforcement de la judiciarisation des opérations
Le rapport semble proposer que les unités spécialisées puissent à la fois procéder aux opérations et gérer le volet judiciaire des interpellations, en évoquant même la possibilité de faire des commandants de peloton des OPJ.
Une telle mesure serait source de confusion et ne pourrait que conduire à dégrader l'efficacité des dispositifs de maintien de l'ordre, sans pour autant faciliter le traitement judiciaire des interpellations.
Il apparaît indispensable de ne pas créer de confusion entre autorité judiciaire et forces de l'ordre.
c. L'emploi des armes de force intermédiaire
Le Rapporteur propose une mesure de compromis consistant à encadrer le recours aux LBD, en proscrivant par ailleurs toute possibilité d'emploi au flashball.
Or, les intervenants auditionnés ont insisté sur la nécessité de maintenir la possibilité d'emploi des LBD au sein des escadrons, ces armes permettant la mise en place de la réponse graduée.
Il pourrait alors être proposé de substituer à cette mesure l'interdiction d'emploi des flashball au maintien de l'ordre. Ces armes sont celles qui sont mises en cause dans les différents cas de blessure évoquées lors des auditions
3/ Enfin, et sur un plan plus rédactionnel, deux points peuvent être améliorés :
La phrase « si la gendarmerie a naturellement tendance à se déployer en milieu rural et outremer et les CRS en zone urbaine » apparaît tendancieuse. En effet, la formulation semble laisser entendre que chaque force choisit ses zones d'intervention alors que l'engagement des forces mobiles relève de la décision des autorités préfectorales ou ministérielles. Celles-ci peuvent indistinctement être engagées sur toute partie du territoire nationale, qu'elle soit en zone urbaine, rurale ou outremer.
De la même façon, et à la même page, la phrase « la spécificité du maintien de l'ordre outremer : le monopole de la gendarmerie mobile » apparaît également trop définitive. S'il s'agit, aujourd'hui, d'un engagement exclusif de la gendarmerie mobile, sur décision de l'autorité gouvernementale, cet état de fait ne constitue en rien un monopole ou une « chasse gardée ». La situation actuelle ne veut pas dire que demain, en fonction des décisions de l'autorité gouvernementale et/ou des circonstances, cette répartition ne soit pas amenée à évoluer.
– Audition, ouverte à la presse, de MM. Patrice BERGOUGNOUX et Dominique BUR, préfets honoraires (jeudi 15 janvier 2015) 187
– Audition, ouverte à la presse, du général Bertrand CAVALLIER (2e section), ancien commandant du Centre national d’entraînement des forces de gendarmerie (Saint-Astier, Dordogne) (jeudi 15 janvier 2015). 195
– Audition, ouverte à la presse, de M. Cédric MOREAU DE BELLAING, maître de conférences à l’École normale supérieure (jeudi 22 janvier 2015) 206
– Audition, ouverte à la presse, de M. Thomas ANDRIEU, directeur des libertés publiques et des affaires juridiques au ministère de l’Intérieur (jeudi 22 janvier 2015) 215
- Audition, ouverte à la presse, de M. Christophe DELOIRE, directeur général de Reporters sans frontières France (jeudi 29 janvier 2015) 222
- Audition, ouverte à la presse, de M. Ben LEFETEY, porte-parole du Collectif pour la sauvegarde de la zone humide du Testet (jeudi 29 janvier 2015) 231
Audition, ouverte à la presse, de M. Bernard CAZENEUVE, ministre de l’Intérieur (mardi 3 février 2015) 242
- Audition, ouverte à la presse, de M. Bernard BOUCAULT, préfet de police de Paris (jeudi 5 février 2015) 260
- Audition, ouverte à la presse, du général Denis FAVIER, directeur général de la gendarmerie nationale (jeudi 12 février 2015) 279
- Audition, ouverte à la presse, de M. Jean-Marc FALCONE, directeur général de la police nationale, et de M. Philippe KLAYMAN, préfet, directeur central des compagnies républicaines de sécurité (jeudi 12 février 2015) 293
- Audition, ouverte à la presse, de M. Pierre TARTAKOWSKY, président de la Ligue des droits de l’Homme (jeudi 19 février 2015) 304
- Audition, ouverte à la presse, de Mme Françoise MATHE, présidente de la commission « Libertés publiques et droits de l’homme » du Conseil national des barreaux (jeudi 19 février 2015) 317
-Audition, ouverte à la presse, de MM. Bernard COTTAZ-CORDIER, porte-parole de l’Association départementale des élus communistes et républicains (ADECR)-Les Alternatifs du Tarn-Europe Écologie-Les Verts- NPA-PCF-Parti de Gauche, et Patrick ROSSIGNOL, maire de Saint-Amancet (Tarn) (jeudi 25 février 2015) 324
- Table ronde, ouverte à la presse, réunissant cinq commandants (Mohammed BELGACIMI, Christian GOMEZ, Roland GUILLOU, Éric LE MABEC, et René-Jacques LE MOËL) de compagnies républicaines de sécurité (CRS) étant intervenus à Notre-Dame-des-Landes (jeudi 5 mars 2015) 332
- Table ronde, ouverte à la presse, réunissant cinq commandants (Mélisande DURIER, Stéphane FAUVELET, Emmanuel GERBER, Bernard HERCHY et Aymeric LENOBLE) de groupements de gendarmerie mobile étant intervenus à Notre-Dame-des-Landes (jeudi 5 mars 2015) 342
- Audition, ouverte à la presse, de M. Jean-Baptiste EYRAUD, porte-parole du Droit au logement (jeudi 19 mars 2015) 351
- Audition, ouverte à la presse, de Mme Nathalie TORSELLI et de MM. Quentin TORSELLI, Christian TIDJANI, Joachim GATTI, Pierre DOUILLARD et Florent CASTINEIRA, représentants de l’Assemblée des blessés, des familles et des collectifs contre les violences policières, et du Docteur Stéphanie LEVEQUE (jeudi 19 mars 2015) 359
- Audition, ouverte à la presse, de M. Fabien JOBARD, directeur de recherches au CNRS, actuellement en poste au Centre de recherches Marc Bloch à Berlin (jeudi 19 mars 2015) 373
-Audition, ouverte à la presse, de M. Christian LAMBERT, préfet hors classe (jeudi 26 mars 2015) 383
- Audition, ouverte à la presse, de M. François MOLINS, procureur de la République de Paris (jeudi 26 mars 2015) 392
- Audition, sous forme de table ronde, ouverte à la presse, des représentants des syndicats des officiers de police et des commissaires de police et des représentants de l’association GEND XXI (jeudi 2 avril 2015) 402
- Audition, sous forme de table ronde, ouverte à la presse, des représentants des syndicats de gradés et gardiens (jeudi 2 avril 2015) 414
- Audition de M. Jérôme LÉONNET, inspecteur général des services actifs, directeur central adjoint chargé du renseignement, chef du service central du renseignement territorial (jeudi 2 avril 2015) 426
– Audition, ouverte à la presse, de Mme Ludivine DUTHEIL De La ROCHÈRE, présidente de « la manif pour tous » et de M. Albéric DUMONT, coordinateur général (jeudi 16 avril 2015) 431
– Audition, ouverte à la presse, de M. Christian VIGOUROUX, président de la section de l’intérieur du Conseil d’État (jeudi 16 avril 2015) 445
– Audition, ouverte à la presse, de M. Jacques TOUBON, Défenseur des droits (jeudi 16 avril 2015) 455
Audition, ouverte à la presse, de MM. Patrice BERGOUGNOUX et Dominique BUR,
préfets honoraires
Compte rendu de l’audition du Jeudi 15 janvier 2015
M. le président Noël Mamère. Je vous remercie, messieurs les préfets, d’avoir répondu à l’invitation de notre commission d’enquête créée à la suite des opérations qui se sont produites sur le théâtre de Sivens. Une information judiciaire ayant été ouverte, nous ne nous intéresserons pas aux décisions prises par la chaîne de commandement. Nous cherchons à savoir, de manière plus générale, de quelle manière le maintien de l’ordre peut être mieux assuré, soit en amont, par la préparation et le dialogue avec les organisateurs des manifestations, soit sur le terrain, pendant le déroulement des opérations. Nous nous demanderons également s’il existe, dans ce domaine, une spécificité française et comment le maintien de l’ordre est assuré dans les autres pays européens.
Conformément aux dispositions de l’article 6 de l’ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, je dois vous demander de prêter le serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Veuillez lever la main droite et dire : « Je le jure ».
(MM. Patrice Bergougnoux et Dominique Bur prêtent serment.)
M. Patrice Bergougnoux, préfet honoraire. L’objet du maintien de l’ordre républicain est de permettre l’expression des libertés publiques, dont celle de manifester, dans les meilleures conditions de sécurité pour les personnes et les biens.
La force publique a pour mission de faciliter et de permettre l’exercice de ce droit. Elle le fait sous l’autorité du préfet de police à Paris, du préfet de police dans les Bouches-du-Rhône et du préfet de département sur le reste du territoire. L’article 11 du décret 2004-374 du 29 avril 2004 confie en effet au préfet de département la charge de l’ordre public et de la sécurité de la population.
La force publique se compose de formations civiles : les compagnies républicaines de sécurité (CRS), les compagnies d’intervention ou sections d’intervention, les compagnies de sécurisation, les unités de voie publique et les unités mobiles d’intervention et de protection dans les grandes agglomérations. Elle comporte aussi des unités militaires, comme la gendarmerie départementale et la garde républicaine, les escadrons de gendarmerie mobile (EGM) et, dans certaines circonstances, les forces armées de troisième catégorie (FA3). Les CRS et les EGM constituent l’essentiel du dispositif de maintien de l’ordre.
Ces formations sont parfaitement professionnalisées, entraînées et formées. Leur savoir-faire est reconnu de tous. Cependant, leur potentiel opérationnel se trouve dégradé du fait de la réduction massive de leurs effectifs intervenue en 2009 et 2010. Quinze escadrons de gendarmerie mobile ont été supprimés, soit environ 2 000 hommes. Le même effectif a été supprimé dans les CRS, à nombre d’unités constant. Cette situation fragilise les unités, qui comportent désormais soixante fonctionnaires, alors qu’elles en réunissaient une centaine il y a quinze ans.
La règle d’or en matière de maintien de l’ordre est que la force doit se manifester sans s’exercer. Ce n’est que dans l’hypothèse de troubles graves à l’ordre public qu’il en sera fait usage, ce qui peut entraîner le recours à certaines armes en dotation dans les unités de maintien de l’ordre.
Le recours à des opérations de maintien ou de rétablissement de l’ordre public se justifie en cas de trouble à l’ordre public lors d’un attroupement. Il s’agit de prévenir les troubles pour ne pas avoir à les réprimer et, si cela s’avère nécessaire, de disperser les individus présents. En maintien de l’ordre, le recours à la force n’est donc pas systématique. D’ailleurs, dans un premier temps, les responsables de la force publique invitent les manifestants à se disperser par le biais d’une annonce : « Obéissance à la loi, dispersez-vous ».
En cas de persistance du trouble, il est possible de recourir à l’usage de la force de manière « absolument nécessaire » et « proportionnée », conditions mentionnées à l’article R211-13 du code de la sécurité intérieure.
L’emploi de la force est conditionné à une gradation des moyens et des matériels qui peut se décliner en trois phases.
La première prévoit l’usage de la force dite « simple », par opposition à la force résultant de l’usage d’armes à feu. Les moyens et les procédés à utiliser relèvent de l’appréciation du commandant de la force publique engagé sur les lieux ou du chef d’escadron engagé dans l’opération, au sein d’une gamme de moyens autorisés par les textes en fonction des situations rencontrées. Il s’agit de la force physique ou de l’utilisation de divers matériels tels que tonfas, boucliers et grenades lacrymogènes.
La deuxième phase admet le recours aux armes à feu sur la décision de l’autorité civile. Celles qui peuvent être déployées à ce stade sont strictement définies à l’article D211-17 du code de la sécurité intérieure. Il s’agit des différents types de grenades en dotation dans les services et les unités de maintien de l’ordre.
En troisième lieu, dans l’hypothèse où les manifestants ouvrent le feu sur les personnels, ceux-ci peuvent riposter en utilisant leurs armes de service collectives ou individuelles.
En dehors du schéma ainsi décrit, en cas de violence exercée contre les forces de l’ordre ou si celles-ci ne peuvent défendre autrement le terrain qu’elles occupent, le commandant de la force publique peut décider lui-même de l’usage des armes.
Ce rappel trop sommaire souligne la complexité des dispositions réglementaires de maintien de l’ordre. Aucun critère n’est véritablement défini, qui permette de conditionner le passage d’une phase à une autre. Si la transition entre les postures est organisée par le protocole des sommations ou les annonces, les manifestants ne sont pas nécessairement en situation de connaître en permanence la posture adoptée par la force publique.
Le maintien de l’ordre est une prérogative de puissance publique qui incombe au représentant du pouvoir exécutif dans le département, en l’occurrence le préfet. Celui-ci dispose de forces de police ou de gendarmerie mises à sa disposition par le ministère de l’Intérieur et responsables de l’exécution de la mission qui leur a été confiée, sans autre limite que le refus des ordres manifestement illégaux et le respect des lois. Les autorités habilitées à décider de l’emploi de la force sont le préfet, le sous-préfet, le commandant de police, l’officier de police chef de circonscription, le maire et, depuis l’adoption de la loi sur la gendarmerie de 2009, le commandant de groupement de gendarmerie ou le commandant de compagnie de gendarmerie départementale.
Quelle qu’elle soit, l’autorité qui décide du recours à la force en vue de dissiper un attroupement doit être présente sur les lieux « en vue le cas échéant de décider de l’emploi de la force après sommation », comme le prévoit l’article R211-21 du code de la sécurité intérieure.
Cette obligation soulève deux interrogations. La première tient à la permanence de la présence de l’autorité civile, si les troubles s’inscrivent dans la durée. Les opérations de maintien de l’ordre peuvent durer tantôt quelques heures tantôt des jours, voire des semaines, sinon plus. La seconde interrogation découle du fait que l’article R211-21, qui vise la décision initiale d’engagement de la force, n’évoque pas l’évolution de la situation. Or, aux termes de l’article R211-13 du code de la sécurité intérieure, « la force déployée doit être proportionnée au trouble à faire cesser et son emploi doit prendre fin si celui-ci a cessé », ce qui suppose que le contrôle de l’autorité habilitée soit effectif et permanent du début à la fin de l’opération.
Cette double interrogation devrait conduire à préciser le rôle de l’autorité civile et à prévoir sa présence permanente auprès du commandant de la force publique tout au long de l’opération.
Encore un mot, pour répondre à votre question liminaire : oui, il est toujours possible d’améliorer le maintien de l’ordre public.
M. Dominique Bur, préfet honoraire. En quarante ans de service public dans le corps préfectoral, j’en ai passé vingt en administration centrale, dans des postes de direction, dont celui de directeur général des collectivités locales. Pendant les vingt autres, j’ai travaillé sur le terrain, dans le préfectoral territorial. J’ai notamment été préfet, préfet de région et préfet de zone, poste que j’ai occupé à Lille avant de prendre ma retraite en août dernier. Si je n’ai pas exercé de responsabilités au niveau national, comme M. Bergougnoux, j’ai une expérience certaine du maintien de l’ordre public au niveau territorial.
La responsabilité du maintien de l’ordre, qui incombe en grande partie au préfet, n’est ni anodine ni secondaire. Elle touche aux libertés publiques. Elle s’exerce sous le contrôle détaillé du juge, qui en examine la proportionnalité et la mise en œuvre. Une mauvaise gestion peut avoir des conséquences très lourdes sur les personnes ou sur les biens.
Le droit constitutionnel de manifester, que le préfet doit concilier avec le maintien de l’ordre public, me semble garanti dans son principe. En vingt ans de terrain, je ne me souviens pas avoir interdit aucune manifestation. Les dernières mesures de ce type concernaient les « apéros saucisson-pinard », dont le principe avait été largement débattu.
Il est toujours moins dangereux pour le préfet d’autoriser une manifestation que de prendre le risque qu’elle se déroule malgré l’interdiction, et de se retrouver démuni. Mieux vaut assumer l’autorisation, à moins, bien entendu, que la manifestation ne viole les grands principes républicains.
Les moyens dont il dispose lui sont alloués tant au niveau zonal, dans un espace restreint, qu’au niveau national, lors d’arbitrages que Monsieur Vaillant, en tant qu’ancien ministre de l’Intérieur, connaît fort bien. Une région comme Paris se voit attribuer beaucoup plus d’unités que d’autres, plus éloignées. Le préfet doit procéder à des choix, quand il fait face à un cumul de situations. Ainsi, j’ai eu à gérer le maintien de l’ordre lors de la visite simultanée de plusieurs ministres. Les situations sont rarement pures ou nettes. Elles se combinent au sein d’un environnement compliqué. Dans de tels cas, le préfet met à contribution les moyens locaux, comme les compagnies départementales d’intervention, qui sont plus ou moins étoffées.
La gestion de l’ordre public n’est pas une situation théorique. On ne peut prévoir les différents cas de figure susceptibles de se présenter dans le temps ou les territoires. J’ai connu des situations très diverses. Ainsi, quand j’ai été quatre ans en poste en Nouvelle-Calédonie, j’ai fait face, lors de la signature de l’accord de Nouméa, à de grandes tensions créées par des mineurs qui utilisaient d’énormes engins pour troubler l’ordre public.
Au fil du temps, la nature des manifestations a beaucoup évolué. Les importantes manifestations syndicales, groupées et encadrées, que j’ai connues au début de ma carrière ne donnaient pas lieu à des débordements. Leur parcours avait été fixé avec les organisateurs, leur déroulement était bordé et l’on n’avait pas à redouter les trublions que l’on a vus surgir par la suite.
Les manifestations se déroulaient rarement en milieu rural. Quand les agriculteurs voulaient marquer leur présence, ils se déployaient en ville, souvent devant la préfecture ou l’hôtel de ville, ce qui pose peu de problèmes majeurs. L’espace urbain est clos par les habitations. On peut toujours fermer une rue et canaliser les manifestants.
Les manifestations que nous avons connues se déroulaient dans l’après-midi, voire dans la journée. Elles se dispersaient le soir, même quand leur fin posait problème. À Toulouse, à la queue de la manifestation contre la réforme des retraites, qui a réuni 30 000 à 40 000 personnes, sont apparus une centaine d’autonomes très mobiles et organisés, avec lesquels s’est engagée une sorte de course-poursuite. À Nantes ou sur d’autres sites, les forces de l’ordre, confrontées à une sorte de harcèlement, ont eu pour tâche de protéger des lieux dans la durée.
À mon sens, le préfet doit s’impliquer personnellement dans la gestion de l’événement. J’ai toujours porté une grande attention aux opérations de maintien de l’ordre, car toute manifestation risque de dégénérer pour une raison qu’il n’est pas facile d’identifier au départ. Je présidais les réunions préparatoires avec les responsables des forces. Je me faisais expliquer le dispositif, que je discutais. Je cherchais à en connaître les fragilités.
L’obligation de déclaration à la préfecture, que prévoit le code de la sécurité intérieure, est diversement respectée. À cet égard, les Toulousains sont moins obéissants que les Lillois. Il existe en outre des manifestations qui n’ont pas réellement d’organisateurs. Dans le cas des rave parties, ceux-ci s’évanouissent dans la nature. Chaque fois que cela m’a été possible, j’ai établi un contact personnel avec les organisateurs, notamment les responsables agricoles, qui acceptaient de discuter de l’endroit où les manifestants déverseraient de la paille.
Quand une manifestation se déroulait l’après-midi, je me suis toujours rendu disponible afin de pouvoir être alerté à tout moment si la situation devenait difficile ou dramatique, ou qu’il faille prendre une décision. Le territoire du Nord étant vaste, j’ai souvent délégué la responsabilité locale au sous-préfet de Dunkerque ou de Valenciennes, tout en restant à l’écoute, car il est nécessaire que les informations remontent.
À l’origine, la gendarmerie, compte tenu de son statut de force militaire, devait être réquisitionnée, alors que la police nationale dépendait – comme nous – du ministère de l’Intérieur. L’intégration de la gendarmerie au ministère de l’Intérieur, en 2009, a permis d’uniformiser nos relations avec les deux forces. La situation administrative et la relation d’autorité sont désormais clarifiées. J’ai toujours associé le colonel ou le général de gendarmerie aux réunions que j’organisais.
Enfin, comme Monsieur Bergougnoux, je pense que certains éléments peuvent être améliorés. Nous y reviendrons sans doute au cours de la discussion.
M. Pascal Popelin, rapporteur. Comment les atteintes à l’ordre public ont-elles évolué au cours des dernières décennies, lors de manifestations sociales, politiques, sportives, culturelles ou environnementales ? Le cadre juridique est-il adapté aux nouvelles contraintes que rencontre l’autorité publique ?
Les nouvelles manifestations sont-elles moins guidées par le désir d’exprimer des revendications que par celui d’en découdre avec l’ordre public ? Ne sont-elles pas plus violentes et plus désordonnées que les précédentes ? Peut-on distinguer, parmi les actes délictueux, ceux qui relèvent d’une atteinte à l’ordre public – violence et dégradation de biens avec ou sans danger pour les personnes – et ceux qui relèvent du droit commun, comme les vols ?
La possibilité d’interdire une manifestation préalablement déclarée a-t-elle une portée concrète ? Est-il facile pour un préfet de gérer les conséquences d’une interdiction, notamment quand le juge porte une appréciation différente de la sienne ?
M. Dominique Bur. J’ai observé trois évolutions essentielles. La première tient à une baisse de l’encadrement. Lors des grandes manifestations syndicales des années soixante ou soixante-dix, il y avait des responsables et un service d’ordre. Ceux-ci avaient pris contact avec les forces de l’ordre, par l’intermédiaire des renseignements généraux, et il était facile de leur faire passer un message. La situation est très différente lors des manifestations spontanées. À Lille, les sans-papiers manifestaient presque chaque semaine sans cadre juridique et sans que nous ayons d’interlocuteurs, puisqu’il n’existait même pas d’association. On a vu également des manifestations spontanées éclater dans les entreprises.
Une autre évolution tient à l’apparition de personnes mues par d’autres intentions que celle d’exprimer un point de vue ou une revendication. Le but des autonomes est de casser. On l’a mesuré à Toulouse. Certains éléments, parfois venus d’ailleurs, s’infiltrent dans la masse des manifestants paisibles.
Une dernière évolution tient au lieu et à la durée des manifestations. Il est très difficile de maintenir l’ordre dans le milieu rural, qui est très ouvert, et dans la durée. Peut-on même parler de manifestation pour désigner non le regroupement de personnes qui se réunissent un jour pour déposer des revendications à la préfecture ou à la mairie, mais l’attaque dans la durée – jour et nuit – de positions tenues par les forces de l’ordre ?
Des mesures sont prises, en cours de manifestation, pour que les agents de la police judiciaire puissent établir des constats, qui seront ensuite transmis aux juges. Ceux-ci ont besoin d’éléments d’informations tangibles – procès-verbaux et photos – pour déterminer les responsabilités, par exemple si une devanture est brisée ou un local saccagé. Il existe des incriminations spécifiques en cas de manifestation violente ou quand les manifestants passent outre une interdiction. Reste qu’il est très difficile de sanctionner les responsables, à moins que l’on ait décidé en amont d’accentuer fortement le dispositif.
Je le répète, il est exceptionnel qu’une manifestation soit interdite. Du fait de la médiatisation, une telle mesure devient aussitôt nationale et remonte au ministère de l’Intérieur. Le juge peut vérifier si, compte tenu des moyens dont elle dispose, la préfecture est en mesure de faire face à la situation. Il n’est jamais agréable à un préfet de voir sa décision cassée par une décision de justice.
M. Patrice Bergougnoux. Les atteintes à l’ordre public évoluent comme les autres formes de délinquance et de criminalité. Comme on voit apparaître dans les cités un banditisme très différent du banditisme classique, on constate dans les manifestations une violence plus importante et plus spontanée, qui oblige la force publique – CRS ou gendarmerie mobile – à disposer d’équipements de protection plus importants et de moyens particuliers.
Une condition capitale du maintien de l’ordre républicain est que les autorités disposent des informations nécessaires pour apprécier la situation et adopter les bons dispositifs. C’est pourquoi je regrette que les réorganisations intervenues récemment dans le renseignement aient réduit la capacité d’information des autorités préfectorales.
Heureusement, le renseignement territorial s’est développé. Il permet le recueil, l’exploitation et la transmission de l’information au préfet dans le département et, au niveau national, au ministère de l’Intérieur, ce qui permet de choisir les bons dispositifs. L’information est à la base de toutes les solutions qui permettent aux citoyens de manifester dans les meilleures conditions de sécurité.
Si l’on craint des troubles importants à l’ordre public, il est essentiel de prévoir des dispositifs de police judiciaire, ce qui permettra de réprimer les actes délictueux commis à l’occasion de la manifestation, du rassemblement ou de l’attroupement.
Mme Marie-George Buffet. J’ai été très frappée, lors des manifestations contre le contrat première embauche (CPE), de voir surgir des groupes qui attaquaient les manifestants, les battaient ou les volaient. C’est sans doute ce qui explique une certaine disproportion entre les forces déployées et le nombre de manifestants. Récemment, j’ai constaté que dix cars de CRS avaient été prévus pour encadrer une manifestation de quatre-vingts personnes pacifiques. On comprend l’importance d’un meilleur renseignement.
Si les services d’ordre, parfois appelé services d’accueil et de sécurité, des manifestations classiques sont moins efficaces, est-ce en raison d’une perte de leur savoir-faire, ou parce qu’ils sont confrontés à de nouveaux problèmes ?
M. Daniel Vaillant. Il me semble important de favoriser le renseignement territorial, qui possède une dimension humaine. Il vise en effet non à ficher les gens mais à prévenir les heurts et les difficultés.
Nous sommes passés d’une culture de la manifestation réussie au désir de mettre les autorités en échec, ce qui représente une singulière évolution. Le préfet Gaudin a eu raison d’interdire « l’apéro saucisson-pinard » à la Goutte d’or, où la présence musulmane est assez forte, et le préfet Boucault la manifestation prévue à Barbès. Les renseignements montraient qu’il s’agissait moins de manifester sur la question israélo-palestinienne que de casser, de brûler, et de faire dégénérer, voire de s’attaquer à la synagogue de la rue Doudeauville.
Vous n’avez pas évoqué l’évolution des modes de communication. Comment les autorités sont-elles informées en temps réel de la volonté des organisateurs ou des intentions de ceux qui se greffent sur la manifestation ? Peut-on améliorer le renseignement du préfet, notamment grâce aux forces héliportées, ce qui suppose, il est vrai, quelques moyens ?
Monsieur Bergougnoux a souligné à juste titre le rôle de la police judiciaire, qui agit sur mandat. Le flagrant délit permet la sanction, ce qui est essentiel, car toute violence ou tout excès est une atteinte au droit de manifester.
M. Gwenegan Bui. Monsieur Bur peut-il revenir sur la question de la remontée d’information du terrain vers le préfet ? Dans ma circonscription rurale, qui se distingue par sa capacité à incendier les centres des impôts ou de la Mutualité sociale agricole (MSA), ou à prendre d’assaut les sous-préfectures, on n’utilise guère les nouvelles technologies de l’information, mais on peut faire débouler cent cinquante tracteurs en quatre heures sans que nul ne soit prévenu. Comment améliorer le renseignement, dont la défaillance assure l’impunité de ceux qui veulent tout casser ?
M. Guy Delcourt. Dès le début de l’audition, vous avez parlé du juge. Je n’avais pas perçu que celui-ci était en première ligne lors d’une manifestation. Pouvez-vous confirmer que celui-ci n’intervient qu’au cas où des éléments délictuels sont identifiés ?
Compte tenu des évolutions que vous avez signalées, tout organisateur craint aujourd’hui que sa manifestation ne soit infiltrée par des mouvements organisés ou spontanés provenant de quartiers sensibles. Existe-t-il sinon un fichier, du moins un répertoire des personnes, jeunes ou moins jeunes, qu’on retrouve toujours dans les mêmes secteurs ou les mêmes milieux, et qui, quand des mouvements écologistes et pacifistes sont annoncés, se déplacent sur tout le territoire pour occuper les terrains et entretenir la guérilla ? Les juges qui interviennent dans ce type d’affaires sont-ils qualifiés ou le procureur désigne-t-il, en fonction de ses convictions, le juge de permanence ?
Mme Anne-Yvonne Le Dain. Lors des événements de Sivens, un débat s’est élevé dans la presse sur la présence des forces de l’ordre sur un terrain privé. Celle-ci était-elle légitime ? Faut-il modifier notre droit sur ce point ?
M. Patrice Bergougnoux. Je ne sais pas si la qualité des encadrants a baissé. En revanche, il est certain que les manifestations se déploient dans un environnement très différent. Les technologies nouvelles vont très vite, mais les services mettent du temps à s’adapter à la nouvelle donne, alors même que le ministère de l’Intérieur a doté ses services des moyens nécessaires. Dans les domaines de pointe, où les formations sont très coûteuses – je pense au big data –, l’État doit recruter les meilleurs spécialistes pour préserver le potentiel de ses capacités d’information.
La baisse des effectifs est un autre facteur à prendre en compte. Avec moins de personnel, il est plus difficile de maîtriser les situations. Le nombre d’hommes par unité ayant diminué, il faut désormais deux unités pour obtenir l’effet dissuasif qu’on obtenait il y a dix ans avec une seule.
Les dispositifs de la police judiciaire doivent accompagner ceux du maintien de l’ordre public, ce qui permet d’agir immédiatement et de réprimer tous les actes commis pendant les manifestations, en particulier par des groupes extérieurs.
M. Dominique Bur. La question du renseignement est essentielle. Les décisions prises par le politique ont causé sur le terrain séparations et coupures, qui ont entraîné une perte de contact. Les renseignements généraux avaient tissé des liens avec les organisations syndicales et professionnelles, dont ils étaient bien connus. Ils servaient de relais avec la préfecture, à laquelle ils permettaient de faire passer des messages. Il a fallu reconstruire ces liens disparus. Des moyens y ont été consacrés, mais on ne tisse pas un réseau du jour au lendemain.
L’irruption des moyens modernes permet aux manifestants de se mobiliser très rapidement. Avec des téléphones portables, il suffit de quelques heures pour organiser un flash mob de plusieurs centaines de personnes devant une préfecture. Pour peu qu’on leur en donne les moyens, les services spécialisés, qui vont sur Internet, savent sur quels sites il faut se rendre – à Lille, j’étais régulièrement informé des risques de manifestation –, mais il est très difficile de posséder une visibilité sur la totalité du spectre.
Actuellement, les services s’emploient à reconstruire les réseaux d’informations, notamment grâce aux services territoriaux, qui possèdent une connaissance fine et régulière du territoire et de ses habitants. Pour éviter que l’information ne se perde en route, le préfet doit rappeler, au niveau local, l’obligation qu’ont les services de la lui transmettre en même temps qu’à leur hiérarchie policière.
Quand une manifestation est interdite par le préfet, le juge saisi en référé peut le désavouer et annuler l’interdiction. Il intervient ensuite au cours de la procédure judiciaire. Dans toutes les grandes manifestations, des équipes sont dédiées pour établir les constats et déférer les contrevenants au tribunal.
Je n’ai pas suivi la polémique sur l’intervention de la police en terrain privé. À mon sens, la force publique est en droit d’y poursuivre les auteurs d’une infraction ou d’un fait délictueux.
M. le président Noël Mamère. Dans le cadre du maintien de l’ordre, quelles consignes de sévérité ou d’apaisement un préfet peut-il donner ?
M. Patrice Bergougnoux. Le préfet, représentant du ministre de l’Intérieur sur le terrain, donne aux forces de police des consignes générales et particulières pour que la manifestation se déroule dans le bon ordre. Il leur indique l’attitude à adopter. Il prévoit leur temps de réaction, dans le cas où elles doivent intervenir sur des groupes qui perturbent la manifestation. Il y a toujours différentes façons de gérer la situation. Le préfet délivre ses consignes lors des réunions préparatoires qui précèdent obligatoirement le déroulement d’une manifestation sur le territoire d’un département.
M. Dominique Bur. Le premier objectif du préfet est de garantir le droit de manifester sans heurt, car, dans notre métier, les sanctions sont rapides : elles peuvent intervenir dès le mercredi suivant les faits… Si l’on ne sait jamais quelle forme prendra une manifestation ni quels sont les risques de dérapage, on peut cependant donner des consignes. L’interdiction d’entrer dans une préfecture est une règle absolue. Pour le reste, si les forces sont harcelées et si elles subissent une pression, elles peuvent réagir, mais l’intérêt bien compris du préfet – et plus largement l’intérêt public – est que les choses se déroulent bien.
M. le président Noël Mamère. Messieurs les préfets, je vous remercie d’avoir inauguré cette commission d’enquête.
*
* *
Audition, ouverte à la presse, du général Bertrand CAVALLIER (2e section), ancien commandant du Centre national d’entraînement des forces de gendarmerie
(Saint-Astier, Dordogne)
Compte rendu de l’audition du jeudi 15 janvier 2015
M. le président Noël Mamère. Mon général, je vous remercie d’avoir répondu à l’invitation de notre commission d’enquête à être auditionné au sujet du maintien de l’ordre républicain dans un contexte de respect des libertés publiques et du droit de manifestation. L’Assemblée nationale a accepté le principe de la constitution de notre commission à la suite des événements tragiques survenus au barrage de Sivens en octobre 2014. Son objectif n’est pas de revenir sur les faits, qui font l’objet d’une information judiciaire, mais de contribuer, au sein de l’une des institutions construisant l’État de droit, au perfectionnement du maintien de l’ordre, en entendant les experts et les responsables dans ce domaine.
Conformément aux dispositions de l’article 6 de l’ordonnance du 17 novembre 1958, je vais maintenant vous demander de prêter le serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité.
(Le général Bertrand Cavallier prête serment)
Général Bertrand Cavallier. Je vous remercie pour votre invitation et suis très honoré de m’exprimer aujourd’hui devant les membres de la représentation nationale.
Je commencerai par rappeler brièvement mon cursus. Sorti de Saint-Cyr en 1978, j’ai effectué toute ma carrière au sein de la gendarmerie, et ai servi à plusieurs reprises dans la gendarmerie mobile. Parmi les temps forts de mon parcours, je citerai le commandement d’un groupement de gendarmerie mobile, celui d’un groupement de gendarmerie départementale, celui d’une région de gendarmerie, et celui du Centre national d’entraînement des forces de gendarmerie situé à Saint-Astier, en Dordogne. Très récemment, je viens de contribuer à la formation de la gendarmerie jordanienne, à qui nous nous efforçons de transmettre la culture française du maintien de l’ordre.
Dans une acception large, le maintien de l’ordre est une fonction centrale destinée à garantir la cohésion de la Nation et la cohérence du corps social sur les fondements de nos valeurs communes. Il doit notamment permettre de régler les contentieux de façon négociée plutôt que par la violence. Comme vous le savez, il repose sur un strict équilibre entre les impératifs de l’ordre public et les exigences du respect des libertés publiques.
Le maintien de l’ordre est une spécificité française remontant à la Révolution française, qui a posé les bases du maintien de l’ordre moderne, notamment avec le décret du 3 août 1792, dont certains éléments sont repris quasiment in extenso dans le code de la sécurité intérieure créé en 2012 – je pense notamment au principe selon lequel la force militaire est essentiellement obéissante, ainsi qu’aux modalités d’emploi de la force. Au XIXe siècle, George Clemenceau, appuyé par un groupe de députés, estimera que l’évolution de la société, de la démocratie, des libertés publiques et de l’expression des revendications sociales appelle une autre réponse, en matière de maintien de l’ordre, que celle consistant à opérer un déploiement de la troupe : il préconisera une réponse de nature policière, strictement encadrée sur le plan juridique et reposant sur un emploi beaucoup plus contenu de la force, devant se traduire par la création d’une force permanente spécialisée en matière de maintien de l’ordre. La décision de créer cette force sera prise après la guerre de 1914-1918, dans le cadre de la loi du 22 juillet 1921 et de la circulaire du 15 novembre 1921, créant les pelotons de gardes mobiles. La France est alors le premier pays à se doter d’une force permanente spécialisée en matière de maintien de l’ordre, répondant aux nouvelles exigences que j’ai évoquées précédemment. L’expérience montrera que ce choix était extrêmement judicieux, notamment lors de la crise du 6 février 1934, qui vit des ligues marcher en direction de la Chambre des députés.
Cette culture française du maintien de l’ordre s’est confortée au fil du temps et se traduit aujourd’hui par un dispositif global référencé dans le monde entier, reposant sur le concept de force spécialisée – intégré par la police nationale avec la création des Compagnies républicaines de sécurité (CRS) en 1944-1945 – et s’appuyant sur un corpus juridique relevant à la fois du code pénal, qui définit la notion d’attroupement, et du code de la sécurité intérieure qui, par transposition à droit constant des dispositions initialement contenues dans le code pénal, réglemente l’emploi de la force publique pour le maintien de l’ordre.
Pour moi, le maintien de l’ordre ne se résume pas à la simple gestion des attroupements et manifestations. Le dernier rapport d’évaluation de la loi du 3 août 2009, rédigé par le député Hugues Fourage et le sénateur François Pillet, rappelle toute la pertinence du modèle de gendarmerie et évoque l’objectif politique de la représentation nationale, qui s’est manifesté dans le maintien du caractère militaire de la gendarmerie garantissant, par ses capacités de montée en puissance rapide et ses moyens matériels, la liberté d’action du Gouvernement. Bien que tous les gendarmes bénéficient d’une formation initiale au maintien de l’ordre, la gendarmerie mobile constitue une force militaire spécialisée dans cette mission. Actuellement forte de 12 000 hommes, elle comporte toute la variété de moyens nécessaires pour faire face à l’ensemble des situations susceptibles de se présenter, notamment aux plus dégradées.
C’est au Centre national d’entraînement des forces de gendarmerie de Saint-Astier qu’est formée la gendarmerie mobile, dans un cadre très transparent – ce dont peuvent témoigner les députés qui ont pu y séjourner. C’est un motif d’étonnement pour nombre de stagiaires étrangers que de constater que ce centre est complètement ouvert : y sont reçues des délégations de tous milieux, qui viennent se former à la conception française du maintien de l’ordre – nous proposons même aux stagiaires qui le souhaitent de vivre l’expérience du maintien de l’ordre dans toutes ses exigences, y compris les plus pratiques. Le CNEFG de Saint-Astier s’est affirmé comme un centre d’excellence accueillant des stagiaires de l’Europe entière, et constitue un modèle sur lequel se sont alignées la plupart des forces européennes, y compris celles du Royaume-Uni. Ce modèle repose sur les grands principes que sont l’absolue nécessité, la proportionnalité et le respect d’une très stricte gradation dans l’emploi de la force, l’objectif étant de maintenir l’adversaire à distance et d’être capable de l’amener à revenir progressivement au calme.
Trois notions structurent l’entraînement à Saint-Astier : premièrement, le rappel du sens – pourquoi est-on gendarme et quels sont les enjeux de cette qualité, la réponse étant le fait de servir son pays et de protéger nos valeurs communes, notamment nos libertés – ; deuxièmement, le renforcement des capacités individuelles, car le maintien de l’ordre et les actions de sécurité en général sont de plus en plus exigeants ; troisièmement, le réalisme des entraînements, qui permet de placer les gendarmes dans des situations les plus proches possible de la réalité, afin de favoriser une certaine maturité psychologique dans la gestion du stress – en effet, face à des situations éprouvantes, il est nécessaire de s’entraîner pour acquérir le sang-froid et la maîtrise de soi qui seront déterminants pour faire un usage abouti de l’emploi de la force.
Le dispositif actuel est reconnu par l’Union européenne et constitue un moyen pour la France de promouvoir ses valeurs en dehors de ses frontières, notamment sur le continent africain, où plusieurs États s’inspirent de son modèle. Cela dit, il est permis de se demander si ce dispositif est adapté aux nouvelles exigences en matière de sécurité, en termes de moyens et d’effectifs, mais aussi d’évolution dans le comportement des adversaires. Depuis quelques années, nous assistons à une nouvelle phénoménologie de la violence : les contestataires sont souvent aptes, désormais, à organiser et à recourir à des manœuvres globales et cohérentes combinant un ensemble d’actions d’ordre physique, psychologique, juridique et technologique. Les violences sont protéiformes : les gendarmes ne sont plus seulement confrontés aux traditionnels mouvements de foule, mais aussi à des jets d’objets de plus en plus dangereux constituant des armes aux termes de l’article 132-75 du code pénal – et les armes blanches et à feu sont également utilisées de plus en plus souvent. Enfin, il n’est pas rare de devoir faire face à certains modes d’actions proches de la guérilla. Le dispositif actuel de maintien de l’ordre est conçu pour garantir la cohésion de la Nation dans le plein respect de ses valeurs communes, au sein desquelles figurent évidemment les libertés publiques fondamentales.
M. Pascal Popelin, rapporteur. Nous réfléchissons actuellement, avec le président Mamère, à l’organisation dans le cadre de nos travaux d’un déplacement de notre commission – pour un nombre limité de participants – au centre de Saint-Astier, a priori sur deux jours et deux nuits, durant la suspension des travaux de l’Assemblée qui doit intervenir en février prochain.
Comme vous l’avez dit, mon général, on assiste à une évolution du type de manifestations auxquelles l’autorité est confrontée, qu’il s’agisse de manifestations à vocation sociale ou politique, ou de manifestations sportives ou musicales. Considérez-vous que l’état du droit – puisqu’il nous incombe de faire la loi – est adapté à ces nouvelles formes de manifestations collectives, en particulier quand les opérations de maintien de l’ordre doivent se poursuivre dans la durée – je pense notamment au phénomène des « zones à défendre » (ZAD) ?
Alors que les forces de maintien de l’ordre sont en théorie, y compris dans leurs modalités d’emploi, distinctes des forces de sécurité publique, on constate que les forces de maintien de l’ordre sont parfois amenées à assumer des missions de sécurité publique et qu’inversement, les forces de sécurité publique peuvent également assurer le maintien de l’ordre. La distinction initiale entre les deux types de forces est-elle toujours pertinente, ou devrait-elle être adaptée ?
Pourriez-vous nous préciser la hiérarchisation des missions et des priorités assignées aux forces chargées d’une opération de maintien de l’ordre, comprenant la protection des tierces personnes, la protection des biens, la dispersion des manifestants, la préservation de l’intégrité physique des manifestants et celle des membres des forces de l’ordre ?
Les forces mobiles chargées du maintien de l’ordre vous paraissent-elles disposer d’effectifs suffisants – les préfets que nous avons entendus précédemment ont évoqué la réduction du format des escadrons –, être convenablement formées aux nouvelles formes de manifestations et équipées de manière à faire face efficacement et de façon sûre pour elles-mêmes et les personnes qu’elles sont chargées de protéger ?
Enfin, comment jugez-vous le modèle français de maintien de l’ordre par rapport aux modèles étrangers établis selon des doctrines différentes ? Nous envisageons également de permettre à certains membres de notre commission d’effectuer un déplacement à l’étranger, dans un pays ayant une conception différente de la nôtre en matière de maintien de l’ordre.
M. le président Noël Mamère. Notre rapporteur vient d’évoquer les États se basant sur une doctrine différente de la nôtre. On observe, dans les pays dits de common law, une séparation très nette entre la police et l’autorité civile – qui, en Allemagne ou au Royaume-Uni, n’a pas à participer à la gestion du maintien de l’ordre ; que vous inspire la différence de conception entre la France et ces pays où les policiers sont en tenue lors des manifestations ?
Êtes-vous d’avis que le maintien de l’ordre est en train de se militariser, comme on l’entend dire actuellement ?
M. le préfet Bergougnoux a évoqué tout à l’heure la question de la durée des manifestations, souvent beaucoup plus longue qu’auparavant – je pense surtout aux ZAD, que vient d’évoquer M. Popelin – et suggéré la nécessité de revoir la présence de l’autorité civile dans la durée aux côtés du commandant de gendarmerie. Qu’en pensez-vous ?
Général Bertrand Cavallier. Avant de s’interroger sur le cadre juridique, il me semble nécessaire de se poser une question essentielle : la violence est-elle acceptable indépendamment de l’objectif poursuivi ? Pour ce qui est du corpus juridique, il est tout à fait complet. Ainsi l’article 431-3 du code pénal fournit la définition de l’attroupement, et les articles 431-4 et suivants donnent des précisions sur les individus armés et les violences qu’ils exercent au sein d’attroupements. La France est donc déjà dotée d’un corpus juridique qui me semble suffisant mais renvoie toujours à cette question préalable, d’ordre idéologique : peut-on admettre que des groupes, de quelque nature qu’ils soient, recourent à la violence aux fins de promouvoir leurs idées ?
Pour ce qui est des procédures visant au maintien de l’ordre, il me semble que le dispositif actuel mérite d’être amélioré. La première recommandation que je me permets de formuler est que, lorsqu’une force mobile est mise à disposition du représentant de l’État – à savoir le préfet –, celui-ci devrait préciser de façon très formelle en quoi consiste la mission initiale confiée à cette force, ce qui était le cas pour la gendarmerie dans le cadre des réquisitions générales et particulières, mais ne l’est plus aujourd’hui. J’estime par ailleurs que la présence du représentant de l’État devrait être systématique.
Il me paraît également nécessaire de clarifier ce que doivent recouvrir les notions d’emploi de la force et d’usage des armes. À l’heure actuelle, certains équipements devraient relever de l’emploi de la force et non de l’usage des armes. Ainsi, dès lors qu’une grenade lacrymogène est lancée au moyen d’un lanceur de grenades, elle est intégrée à l’usage des armes – alors que la même grenade lancée à la main relève du cadre juridique de l’emploi de la force.
La traçabilité de l’ordre exprès devrait être établie au moyen de sa matérialisation. Sans en revenir aux réquisitions – abandonnées pour différentes raisons en dépit des réticences de certains membres de la représentation nationale, attachés à un dispositif ayant le mérite d’être très clair –, il me semble que nous devrions nous inspirer de ce système afin de disposer d’une meilleure visibilité sur le fonctionnement de la chaîne décisionnelle.
Pour ce qui est de la hiérarchisation des missions, lorsqu’une autorité nous confie une mission, il importe d’en comprendre l’esprit. S’il est inenvisageable que des manifestants investissent l’Assemblée nationale, le palais de l’Élysée ou des installations d’importance vitale, les situations les plus courantes sont soumises à une appréciation portant sur leur étendue et leur contexte et mettant en jeu la notion de désordre acceptable : si quelques dommages matériels n’entraînent pas forcément une intervention – quelques bris de glaces ne remettent pas en cause une République –, les scènes de pillage auxquelles j’ai assisté il y a quelque temps à Montpellier m’ont décidé à intervenir d’autorité. Notre obsession, c’est la protection des personnes. Nous avons pour objectif de limiter constamment l’emploi de la force afin de limiter les dommages corporels pouvant en résulter. C’est la prise en compte de l’ensemble de ces éléments qui détermine l’attitude du chef opérationnel, étant précisé que tout va très vite : une situation peut muter en quelques secondes.
La différenciation des forces est une question très importante. On a créé des forces spécialisées : d’abord la gendarmerie mobile, puis les CRS, partant du principe que le maintien de l’ordre est un métier. Si la gendarmerie et la police partagent le même spectre d’intervention, la gendarmerie mobile a vocation, de par sa nature militaire et ses moyens, à aller au-devant des situations les plus complexes. En matière d’implication des forces de sécurité publique générale, je considère que police et gendarmerie sont complémentaires et que les forces territoriales sont des forces de régulation sociale du quotidien : elles ont un contact avec les personnes et un comportement un peu différents de ceux des gendarmes mobiles et des CRS – j’ajoute que ces forces ne sont pas entraînées au maintien de l’ordre.
En termes de volume, je suis de ceux qui plaident pour que l’emploi de la gendarmerie départementale se fasse en deuxième échelon, pour des missions de bouclage plutôt que pour des missions de force – car, je le répète, le maintien de l’ordre est un métier nécessitant un entraînement approprié et renouvelé.
J’en viens au format des escadrons. Il y a quatre ou cinq ans, dans le contexte de l’époque, il a été décidé de procéder à une réduction très significative des effectifs des forces mobiles. Ainsi la gendarmerie mobile a-t-elle vu quinze de ses escadrons dissous, ce qui représente environ 2 500 effectifs. Discipliné, j’avais cependant émis des réserves à deux titres, considérant que la société évolue dans le sens d’une radicalisation – on assiste à une augmentation de la violence globale sous différentes formes –, et qu’il est donc nécessaire de disposer de volumes importants de forces mobiles, étant précisé que celles-ci peuvent efficacement soutenir la gendarmerie ou la police dans la lutte contre les cambriolages, car gendarmes et CRS savent très bien contrôler un territoire. L’effectif de l’escadron est passé de 75 à 68 personnels, ce qui a été en partie compensé par l’introduction d’un plus grand nombre de véhicules, afin d’améliorer la mobilité des unités. Nous avons également intégré les cellules « image ordre public », composées chacune de deux personnes, afin de garantir les droits des manifestants, mais aussi ceux des forces de l’ordre. Actuellement, au sein d’un escadron, le nombre de gendarmes intervenant effectivement pour le maintien de l’ordre est d’une cinquantaine.
Or, les situations sont de plus en plus complexes, notamment en matière de maintien de l’ordre rural, l’un des plus exigeants en raison du fait qu’il nécessite d’intervenir sur un terrain ouvert, non compartimenté, et de faire face à un adversaire extrêmement mobile. Se pose donc la question de l’équilibre du rapport des forces et de l’insuffisance des moyens, qui concerne notamment les moyens spéciaux. Chacun sait que, du fait des choix budgétaires, la gendarmerie dispose de capacités moindres qu’auparavant : par exemple, elle dispose de moins de véhicules blindés de maintien de l’ordre – qui sont, je le précise, des véhicules bleus à roues, d’une grande importance dans certaines situations très dégradées. Une réflexion peut être engagée sur le format utile et nécessaire des forces de l’ordre et sur les équipements qui leur sont nécessaires.
La France est le pays dont la doctrine est la plus aboutie, et je ne dis pas cela par chauvinisme, mais parce que j’ai pu m’en convaincre en allant visiter les forces de sécurité de la plupart des pays d’Europe. Ainsi, au Royaume-Uni, le policier concentre tous les pouvoirs, ce qui est très étonnant pour un pays s’affichant comme une démocratie. En France, le gendarme ou le policier chargé du maintien de l’ordre relève de deux autorités : d’une part celle du magistrat – le maintien de l’ordre étant une mission en partie définie par le code pénal –, d’autre part, celle du représentant de l’État, donc de l’autorité civile. Le très grand formalisme auquel sont soumises nos forces, cette tutelle constante – qui me paraît logique au regard des impératifs de la démocratie – étonne souvent les stagiaires étrangers.
L’Allemagne a pour tradition de pratiquer des manœuvres de force, de saturation de l’espace, s’effectuant en déployant des policiers surprotégés qui vont au contact. En France, nous nous efforçons au contraire d’éviter systématiquement le contact. En Espagne, quand nous avons formé les premiers effectifs de la Guardia Civil, nous avons dû leur expliquer que l’usage de la gomme-cogne – des projectiles en caoutchouc – était interdit en France, même s’il est systématique au Royaume-Uni.
Pour ce qui est de la militarisation, nombre de pays ne disposant pas de forces spécialisées utilisent ou ont utilisé l’armée à titre principal – je rappelle le Bloody Sunday de 1972 en Irlande du Nord. En la matière, il faut savoir dépasser ce qui peut apparaître comme un paradoxe. Le caractère militaire de la gendarmerie apporte plusieurs atouts en termes de démocratie : une grande disponibilité, la capacité à monter rapidement en puissance, et surtout une très grande discipline – la discipline militaire – qui est peut-être formelle et exigeante pour les individus concernés, mais constitue une garantie pour les citoyens, au quotidien comme lors des actions de maintien de l’ordre.
Mme Marie-George Buffet. Je vous remercie pour votre exposé très riche et je souhaite vous poser trois questions, dont la première a trait aux moyens : quels nouveaux moyens matériels seraient nécessaires à la gendarmerie mobile pour effectuer les missions qui lui sont confiées ? Par ailleurs, j’ai cru comprendre que vous aviez parfois des difficultés à définir avec précision les objectifs qui vous sont assignés par l’autorité civile : pouvez-vous nous expliquer pourquoi ? Enfin, vous avez indiqué qu’il fallait parfois prendre une décision en quelques secondes : quelles sont les décisions pouvant être prises par les officiers en action, et en quoi consiste l’intervention de l’autorité civile durant une intervention ? L’un des préfets que nous venons d’entendre nous disait être très impliqué durant les manifestations, et se maintenir en liaison directe avec les forces de maintien de l’ordre : qu’en est-il habituellement ?
M. Philippe Goujon. Vous avez rappelé la spécificité du maintien de l’ordre à la française, avec la création des forces mobiles, dont nombre de pays se sont inspirés, mais aussi le fait que cette spécificité permet le bon exercice des libertés publiques, dans la mesure où il s’agit de protéger aussi bien les sites concernés que les manifestants dans l’exercice de leur droit de manifester. Vous êtes un spécialiste internationalement reconnu des questions de maintien de l’ordre et avez beaucoup œuvré pour faire évoluer la doctrine qui y a trait, notamment lors de votre passage à Saint-Astier – et l’on peut considérer qu’en matière de maintien de l’ordre en France, il y a eu un « avant » et un « après Cavallier ».
Ne faudrait-il pas réviser la façon dont les sommations sont exprimées ? En effet, dans l’agitation et le stress caractérisant une manifestation, les personnes qui y participent ne comprennent pas toujours très bien la façon qu’ont les forces de maintien de l’ordre de réagir. Si les sommations sont soumises à des modalités définies de longue date, les techniques mises en œuvre pourraient sans doute être modernisées afin que les manifestants comprennent mieux ce qui est en train de se passer : en effet, il peut arriver qu’ils ne se retirent pas faute d’avoir compris le message adressé par les forces de l’ordre.
Pour ce qui est de l’articulation du commandement entre l’autorité civile – préfectorale ou policière – et l’autorité militaire, pourriez-vous nous préciser les modifications qu’il vous semblerait utile d’apporter en termes de présence et de rôle de l’autorité civile durant les opérations de maintien de l’ordre ?
Estimez-vous qu’il soit nécessaire d’améliorer la formation et l’entraînement de la gendarmerie départementale en vue de l’accomplissement de certaines de ses missions secondaires – je pense aux missions de nature à soutenir et faciliter l’action des escadrons de gendarmerie mobile (EGM) – et éventuellement de recentrer ses missions sur le maintien de l’ordre, compte tenu du fait qu’un grand nombre d’escadrons a été dissous et que la force de réserve nationale s’est trouvée diminuée en CRS comme en maintien de l’ordre ?
Pouvez-vous nous dire ce que vous pensez de l’évolution du mode tactique d’intervention des gendarmes, et quels sont les différents niveaux d’action et d’utilisation de la force sur le terrain en fonction de la nature des manifestations ?
Enfin, en ce qui concerne les armes, je note qu’il a récemment été décidé de retirer la carabine Tikka de l’armement des EGM. Comment expliquez-vous cette décision et y voyez-vous une bonne chose ? N’y a-t-il pas des situations extrêmes où cet armement, d’un emploi heureusement rarissime, peut se révéler nécessaire ?
M. Philippe Folliot. Mes questions porteront à la fois sur les moyens, la formation et le cadre.
Pour ce qui est des moyens, vous avez évoqué les difficultés liées aux véhicules blindés à roues de la gendarmerie (VBRG). Je me rappelle qu’il y a une quinzaine d’années, on envisageait déjà de les remplacer par des véhicules de l’avant blindé de maintien de l’ordre (VABMO), ce qui n’a finalement pas été fait. Les VBRG ont donc désormais cinquante ans d’âge en moyenne, ce qui n’est pas sans poser certaines difficultés face à l’évolution du comportement des manifestants ; par ailleurs, on ne compte plus que 120 unités environ de ces blindés – dont le taux de disponibilité, estimé à 50 % il y a quelques années, ne s’est sans doute pas amélioré.
En ce qui concerne la formation, Saint-Astier est une référence au niveau européen, mais aussi international. J’étais il y a quelques semaines au Qatar, où l’on m’a beaucoup parlé des relations et de la transmission de savoir-faire entre les gendarmeries française et qatarie. Estimez-vous que la formation dispensée à Saint-Astier relève toujours autant de l’excellence, ou que des modifications apportées à cette formation pourraient en élever le niveau ?
Je veux également évoquer la pluralité des forces intervenant dans le domaine du maintien de l’ordre. Historiquement, ces forces sont de deux ordres : civil d’un côté – la police –, militaire de l’autre – la gendarmerie –, ce qui est une spécificité latine. En effet, dans les pays anglo-saxons, le maintien de l’ordre est assuré par une force nationale d’une part, et des forces locales d’autre part, mais toutes de nature civile. Pensez-vous que l’engagement sur le terrain des CRS et des gendarmes mobiles se situe au même niveau en termes d’intensité : en d’autres termes, des choix sont-ils effectués pour recourir plutôt aux uns qu’aux autres en fonction de l’intensité des manifestations ou de la période où elles ont lieu ? On sait aussi que les conditions de logement lors d’un déploiement ne sont pas les mêmes pour les gendarmes que pour les policiers : y voyez-vous un problème ?
Enfin, à la suite des tragiques événements survenus la semaine dernière, le Président de la République et le Gouvernement ont lancé une opération intérieure (OPINT) mobilisant 10 000 hommes dans le cadre du plan Vigipirate renforcé. Certes, il s’agit de prévention et non d’une véritable opération de maintien de l’ordre, mais ne risque-t-on pas de voir nos forces armées être amenées à intervenir toujours davantage en matière de maintien de l’ordre, ce qui serait susceptible de remettre en cause sur le plan doctrinal la spécificité de la mission de nos forces armées, qui fait partie des fondements mêmes de notre République ?
M. Guy Delcourt. Mon général, vous avez évoqué la nécessaire professionnalisation des forces de maintien de l’ordre, en indiquant que certaines manifestations justifieraient l’intervention en première ligne des gardes mobiles plutôt que de la gendarmerie départementale – et bien que n’ayant pas votre compétence, j’ai tendance à penser comme vous. En une période où le Gouvernement est amené à mener une réflexion en raison des récents événements, iriez-vous jusqu’à considérer qu’il soit nécessaire de réformer l’ensemble des procédures d’intervention lors de manifestations à caractère risqué, en milieu rural comme en milieu urbain ? Que pensez-vous, en particulier, de la réforme profonde que constituerait l’intervention de la gendarmerie mobile en première ligne sur des zones de police ?
Général Bertrand Cavallier. Madame la députée Buffet, vous avez évoqué la question délicate du positionnement du représentant de l’État lors des manifestations. D’expérience, je dirai que, dès lors qu’il y a déploiement des forces de l’ordre, le commandant du dispositif rencontre le représentant de l’État – si le préfet n’est pas disponible, ce sera le directeur de cabinet. Notre attente première est d’obtenir une formulation claire de la mission que le représentant de l’État souhaite assigner aux forces de maintien de l’ordre : quel est l’effet recherché et quelles sont les limites de l’action requise ? Pour ma part, j’insiste sur la nécessité de voir cette mission rédigée par écrit. Certains préfets sont plus orientés « ordre public » que d’autres, c’est-à-dire qu’ils s’impliquent davantage. En tout état de cause, le commandant du dispositif déployé va systématiquement rechercher l’approbation de sa conception de manœuvre par le représentant de l’État. Nous sommes des militaires, nous préparons nos missions et, dans ce cadre, nous rédigeons une conception de manœuvre faisant apparaître le but poursuivi par l’autorité et les moyens mis en œuvre pour y parvenir. Une fois la conception de manœuvre soumise au préfet, celui-ci peut l’approuver sans réserves, ou demander à ce qu’elle soit modifiée en fonction de sa propre analyse : l’essentiel est de disposer d’une base objective, matérialisée et traçable.
En tant que pays latin, nous sommes un pays de droit écrit, ce qui constitue une raison supplémentaire pour souhaiter favoriser un certain formalisme – qui pourra éventuellement faciliter l’intervention ultérieure de l’institution judiciaire, en fournissant au juge des éléments objectifs et matérialisés établissant qui a fait quoi. Cela dit, le commandant du dispositif doit tout de même disposer d’une certaine liberté de manœuvre en matière de dosage de l’emploi de la force ou d’usage des armes, de manière à pouvoir obtenir l’effet attendu : il doit pouvoir faire son métier, étant précisé que le préfet, tenu informé des manœuvres entreprises et de l’évolution de la situation, peut décider à tout moment de faire cesser l’action de la gendarmerie ou de la police, de modifier l’effet à obtenir, ou de demander à ce que des efforts nouveaux soient produits.
De ce point de vue, le renseignement est essentiel : ce qui va permettre de rédiger au mieux la conception de manœuvre, de dimensionner et d’articuler le dispositif, ce sont les éléments relatifs à la nature de l’adversaire et à sa possible évolution en cours de manifestation. Si la France est un pays où l’on manifeste beaucoup, la plupart des manifestations se déroulent très bien, c’est-à-dire sans mauvaises surprises par rapport à ce qui a été prévu à la suite de la concertation organisée au préalable entre les organisateurs et les forces de l’ordre – dans le cadre de laquelle on explique ce que l’on va faire, et on décide, par exemple, de la place qui sera donnée à la presse lors de la manifestation ; dans ce cas, les dispositifs déployés sont surdimensionnés, mais il vaut toujours mieux être surdimensionné que sous-dimensionné.
Une manifestation bien encadrée donne toujours lieu à une rencontre avec les organisateurs, qui permet de délivrer une information préalable aux opposants. Cela dit, le dispositif des sommations a ses limites face à des individus extrêmement déterminés et armés, qui partent à l’assaut des forces de l’ordre : dans ce cas, il est évident que les individus en question ne se conformeront pas aux prescriptions qui leur seront faites. Classiquement, les sommations peuvent se faire avec un porte-voix ou en tirant une fusée rouge, et je ne vois pas l’utilité de recourir à d’autres moyens.
Pour ce qui est de l’articulation entre autorité civile et militaire, j’estime que le préfet doit prendre toute la place qui lui revient, et y rester. On attend de lui des ordres clairs, des directives formelles et précises : rien n’est plus difficile pour un commandant de dispositif que de devoir rester dans le vague. Au demeurant, il appartient au représentant de l’État, responsable de l’ordre public, de prendre ses responsabilités.
Policiers et gendarmes se trouvent actuellement dans une position difficile, dans la mesure où ils doivent faire face à un adversaire diffus : comme les événements récents l’ont montré, nous sommes entrés dans une nouvelle ère, celle de la « violence globale », pour reprendre une expression que j’utilisais lors des exposés que je faisais à Saint-Astier. C’est au niveau idéologique que le problème de la violence se pose : est-elle acceptable quelles que soient ses motivations ? En fait, le véritable combat est à mener en amont, car notre société a adopté une culture de la violence sous l’effet de l’américanisation de notre mode de vie, et de la banalisation de la violence, notamment au cinéma et dans les jeux vidéo. La délinquance quotidienne devient, elle aussi, plus violente : je suis bien placé pour le savoir, car j’ai une fille gendarme dans une brigade territoriale et j’évoque souvent cette question avec elle.
Pour moi, les gendarmes départementaux doivent être formés comme les policiers de la sécurité publique, afin de leur permettre d’exercer au mieux leur mission au quotidien. Cette mission consiste à être en mesure de faire face à des menaces imprévues, tout en ayant une posture de bonhomie, de sociabilité vis-à-vis des citoyens. Ce compromis difficile à réaliser, c’est le métier même des gendarmes départementaux. Au sein des écoles de gendarmerie, on enseigne que l’« intervention professionnelle » doit se faire en observant trois principes : le principe de légalité, qui correspond au respect des droits premiers de la personne, le principe de sécurité – se protéger et protéger également les autres, notamment la personne que l’on contrôle –, et le principe d’efficacité, selon lequel on est amené à prendre, le moment venu, l’ascendant sur l’adversaire. Dans ce cadre, l’une des exigences fondamentales est le vouvoiement, dont les gendarmes font un usage inconditionnel, car il renvoie la personne contrôlée à une certaine idée du respect qu’elle a pour elle-même.
Cela dit, je considère que la gendarmerie départementale ne doit être utilisée pour le maintien de l’ordre que dans des missions de deuxième échelon, de bouclage, de surveillance de points particuliers. En effet, les missions de force, de premier échelon, demandent un entraînement et une cohésion spécifique. J’insiste sur l’importance de cette cohésion, qui participe d’une culture acquise grâce aux officiers d’encadrement : d’une importance fondamentale, elle s’obtient en travaillant et ne peut en aucun cas s’improviser.
M. Philippe Folliot. Ce que vous dites vaut-il également pour les pelotons de surveillance et d’intervention de la gendarmerie (PSIG) ?
Général Bertrand Cavallier. Pour moi, les PSIG ne sont pas des unités de maintien de l’ordre à proprement parler. Ils effectuent des interventions domiciliaires, mais les quelques opérations de maintien de l’ordre qui leur sont confiées reposent sur un emploi très contenu de la force et une psychologie particulière. Cela dit, les PSIG peuvent tout de même être engagés dans des opérations de maintien de l’ordre dans certaines situations exceptionnelles.
Pour ce qui est des moyens, le code de la sécurité intérieure prévoit que la carabine Tikka figure parmi les moyens dont disposent à la fois la gendarmerie et la police nationale, afin de procéder à un tir sélectif visant à neutraliser un tireur isolé faisant feu sur les forces de l’ordre. J’ai appris que la gendarmerie avait mené une réflexion au sujet de l’emploi de cette arme – réflexion qui, à mon sens, s’inscrivait dans une démarche d’amélioration du dispositif actuel. La possibilité que nous soyons un jour confrontés à un tireur isolé – faisant feu depuis le toit d’un bâtiment ou une fenêtre, par exemple – est bien réelle : cette situation s’est déjà produite et elle se produira à nouveau.
La question des VBRG est effectivement centrale : cela fait vingt ans que la gendarmerie estime qu’un renouvellement de son parc blindé s’impose. Je parle d’un parc de véhicules de maintien de l’ordre, et non de combat. En 2003, quand j’ai reçu des membres de la Bundespolizei à Saint-Astier, je leur ai conseillé de porter du bleu, et non du vert, car dans la psychologie collective, c’est l’une des différences essentielles entre un dispositif de maintien de l’ordre et un dispositif de combat – de même, les véhicules servant à la première de ces missions doivent obligatoirement être équipés de roues, les chenilles étant réservées aux véhicules de combat. Comme l’a indiqué le général Denis Favier, directeur général de la gendarmerie nationale, des choix budgétaires ont été faits dans l’objectif d’assurer la mission de sécurité au quotidien. Cependant, un débat doit être ouvert sur l’urgence de répondre à des besoins en moyens plus spécifiques de la gendarmerie mobile, afin de lui permettre de faire face à toutes les situations – ce qui renvoie à la question de la complémentarité avec l’armée, qui fait partie des forces de troisième catégorie, et demeure régie par le principe des réquisitions.
Il ne faut pas perdre de vue que l’armée de terre a une culture de combat. Dans les années 2000, j’ai participé au sein de la Direction générale à des discussions serrées entre l’état-major des armées et la Direction générale de la gendarmerie nationale, estimant pour ma part que, dans les opérations extérieures, ce n’était pas à l’armée de terre qu’il revenait de faire du maintien de l’ordre. Depuis, ce principe est totalement admis : ainsi, en République centrafricaine, ce sont les gendarmes qui interviennent actuellement en premier échelon dans le cadre des opérations de maintien de l’ordre.
J’insiste sur le fait que les gendarmes sont pétris de cette culture de maintien de l’ordre, qui veut que l’on retarde le plus possible l’usage des armes : on ne cherche pas à neutraliser l’adversaire en le détruisant, mais simplement à disperser les attroupements, par exemple. Cela peut d’ailleurs poser problème, dans la mesure où la réactivité d’un gendarme mobile face à une situation de feu est bien inférieure à celle d’un parachutiste, par exemple. J’ai d’ailleurs déjà eu l’occasion de dire à certains camarades de l’armée de terre que je voyais un non-sens dans le fait de confier des missions de maintien de l’ordre aux parachutistes du 2e REP.
Nous, gendarmes, sommes aptes à assumer des missions difficiles, car nous avons une formation initiale au combat. Le gendarme est d’abord un citoyen ; ensuite un soldat avec ses valeurs spécifiques, son positionnement en tant qu’individu par rapport au collectif – le statut militaire étant très exigeant par rapport au statut civil – et son savoir-faire technique et tactique qui, en le dotant d’une grande mobilité, lui permet de repousser plus longtemps la confrontation avec l’adversaire ; enfin, c’est un uniforme bleu. Un travail considérable est fait dans les écoles de gendarmerie sur les valeurs citoyennes, la tolérance et la constitution de la société.
J’ai eu l’occasion de dire il y a peu de temps, lors d’une rencontre avec un sénateur et des députés, que, pour moi, l’armée devait conserver ses effectifs. Au cours des trois dernières années, j’ai parcouru la plupart des pays du Sahel, et je viens de rentrer de Jordanie, ce qui me permet d’affirmer que nous nous trouvons dans un environnement très instable – et appelé à le rester durablement. Dès lors, notre armée sera de plus en plus engagée, et sa vocation première n’est pas d’être engagée sur le territoire national – étant précisé que certaines menaces sur le territoire national sont initiées en dehors de nos frontières. La complémentarité dans une conception globale de la défense de sécurité appelle une imbrication des différents moyens. Depuis la Révolution française, il est prévu que les armées peuvent être appelées à intervenir comme force de maintien de l’ordre dans le cadre d’une situation d’exception, mais en tant qu’ultima ratio – en dernière extrémité.
Je conclurai en disant un mot de l’entraînement, sur lequel nous devons continuer à mettre l’accent. Quand j’étais chargé de la formation et de l’entraînement en gendarmerie, un budget d’environ 8 millions d’euros était consacré à cette mission ; aujourd’hui, ce budget a été réduit de moitié. Or, c’est bel et bien l’entraînement qui conditionne l’efficacité des forces sur le terrain. Plus un gendarme est entraîné, plus grande sera la maîtrise dont il fera preuve au moment d’agir. Malheureusement, certains choix budgétaires ont été faits, dont l’entraînement pâtit, non sur le plan de la formation doctrinale – bien qu’il faille veiller, sur ce point, à rester en phase avec l’évolution des menaces auxquelles il faut faire face – mais en termes de budget alloué, qui doit rester d’un niveau permettant aux forces de maintien de l’ordre de continuer à exercer leur mission de la meilleure façon sur le terrain : en la matière, je considère qu’une réflexion s’impose.
M. le président Noël Mamère. Au nom de notre commission, je vous remercie, mon général, pour vos réflexions et vos suggestions, qui vont venir enrichir notre travail.
*
* *
Audition, ouverte à la presse, de M. Cédric MOREAU DE BELLAING, maître de conférences à l’École normale supérieure
Compte rendu de l’audition du jeudi 22 janvier 2015
M. le président Noël Mamère. Je vous remercie d’avoir répondu à notre invitation.
Conformément aux dispositions de l’article 6 de l’ordonnance du 17 novembre 1958, je vais maintenant vous demander de prêter le serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité.
(M. Cédric Moreau de Bellaing prête serment)
M. Cédric Moreau de Bellaing, maître de conférences à l’École normale supérieure. Je suis maître de conférences en sociologie du droit et en sciences politiques. Je travaille depuis dix-sept ans sur la police. J’ai commencé par une étude historique sur la genèse des compagnies républicaines de sécurité (CRS) au lendemain de la Seconde guerre mondiale puis j’ai changé de discipline, me consacrant à la sociologie politique, tout en conservant la police comme objet d’étude et notamment la formation policière. Mon doctorat a porté sur l’école de police et sur le contrôle interne – en particulier l’Inspection générale des services (IGS). Après ma thèse, j’ai continué à travailler sur l’institution policière autour de trois axes : les dispositifs policiers de lutte contre le hooliganisme, la gestion des pratiques de dégradation dans les moments de protestation collective et l’introduction des armes dites non létales ou sub-létales dans l’équipement policier.
Je souhaite vous donner quelques pistes de réflexion à propos du maintien de l’ordre, nourries par mes travaux de recherche passés et actuels. La présente commission d’enquête a été constituée à la suite du décès de Rémi Fraisse lors d’une opération de maintien de l’ordre au barrage de Sivens. Une constante du discours officiel m’a alors frappé : l’assurance que, cette nuit-là, les gendarmes mobiles ont affronté une violence hors de toute proportion - certains affirmant même qu’ils n’avaient pas vu cela en vingt ou trente ans de gendarmerie. Ce constat devait avoir pour effet de contextualiser, peut-être de justifier l’usage des grenades offensives.
J’ai été surpris par ce discours, d’abord parce que la France a connu des épisodes qui peuvent « concurrencer » sans trop de difficulté ce qui s’est passé à Sivens, ensuite parce que, si violent que cet épisode ait pu être, cette violence reste très en deçà de ce que connaissent certains des pays voisins comme la Grèce ou l’Allemagne. Les forces françaises de maintien de l’ordre sont réputées dans l’Europe entière pour leurs compétences techniques à assurer des services d’ordre voire des missions de rétablissement de l’ordre difficiles. Surtout, j’ai été surpris car j’y ai décelé un changement de discours, symptôme d’un changement de doctrine. Ainsi, l’intensité de l’engagement des forces de maintien de l’ordre serait justifiée par l’intensité de la violence des protestataires, ce qui signifie que les services de maintien de l’ordre devraient caler le degré de force qu’ils engagent sur le niveau de violence des manifestants.
Or, ce qui semble être devenu un principe technique m’a interpellé parce qu’il est - disons-le franchement – radicalement opposé aux doctrines sous-tendant l’école française de maintien de l’ordre depuis de très nombreuses années. Les historiens ont montré de manière incontestable que les forces de police et les forces de gendarmerie ont progressivement connu, en particulier au XIXe siècle, une évolution essentielle qui a largement contribué à la réduction globale du niveau de violence dans les mouvements de protestation collective. Au début du XIXe siècle, en effet, les forces de l’ordre calaient l’intensité de l’usage de la force sur la violence des protestataires qui leur faisaient face. Cette montée aux extrêmes favorisait l’usage d’armes de part et d’autre, provoquait nombre de blessés et, du reste, se soldait parfois par un nécessaire repli de la force publique.
À la fin du XIXe siècle, la situation s’est parfaitement inversée. Les forces de l’ordre, ayant reçu de nombreuses consignes, ayant été dotées d’une doctrine d’emploi réfléchi, ont cessé d’ajuster leur usage de la force à celui des protestataires. Il s’agissait de contraindre ces derniers à s’ajuster au niveau de violence des forces de l’ordre. Cette doctrine a fonctionné : le nombre d’affrontements a baissé et leur intensité a diminué. Il ne faut pas, bien sûr, commettre d’anachronisme et transposer un raisonnement aussi lointain à la situation actuelle. Il n’en reste pas moins que la doctrine du maintien de l’ordre, en France, s’est constituée sur cette inversion. C’est cette doctrine qui a garanti la compétence des forces de police en matière de gestion des protestations publiques et la création des forces spécialisées – gendarmes mobiles en 1927 et CRS en 1944 – en a été l’aboutissement logique.
C’est pourquoi le retournement que la tragédie de Sivens a contribué à rendre visible est inquiétant : il est potentiellement symptomatique d’une transformation de la doctrine du maintien de l’ordre et cela mérite explication. Il faut s’interroger sur les raisons de ce virage, de cette inversion. Je me contenterai ici d’esquisser quelques pistes d’explication.
La situation actuelle est d’abord le fruit d’une transformation des doctrines d’emploi des forces spécialisées dans le maintien de l’ordre ; cette transformation a commencé dans les années 1970 lorsque les CRS et les gendarmes mobiles ont créé des unités légères en leur sein pour combattre les petits groupes mobiles d’autonomes qui se disséminaient dans les grandes manifestations pour mener une action spectaculaire – bris de vitrines de magasins de luxe… – avant que de se disperser dans la manifestation. L’évolution doctrinale s’est surtout accélérée avec la réforme impulsée pendant les émeutes urbaines de 2005. Cette réforme reposait sur une doctrine visant à rendre de la mobilité aux forces de l’ordre qui n’étaient plus seulement confrontées à des manifestations imposantes organisées par des syndicats rompus à l’exercice mais à des groupes de jeunes évoluant sur un terrain mal connu des policiers : les méandres des grands ensembles.
Le principe a donc consisté en la dislocation du principe de base des forces de maintien de l’ordre : celui de l’action collective selon lequel on tient ensemble un site, une rue, on charge ensemble et on s’arrête ensemble. Or l’inversion a été totale dans la mesure où l’unité de base de ces services est devenue le binôme afin de rendre plus fluide l’intervention policière et de permettre, le cas échéant, des arrestations. Les policiers chargés du maintien de l’ordre n’avaient donc plus pour unique tâche de tenir un cordon, une rue, un espace mais de se mouvoir et, j’y insiste, d’interpeller. Le fait de demander aux forces de maintien de l’ordre – dont la compétence réside spécifiquement dans la capacité à résister, à défendre un lieu – de revenir à une dynamique beaucoup plus classique, celle de l’arrestation, a changé beaucoup de choses.
Depuis la création des forces spécialisées dans le maintien de l’ordre, la doctrine reposait sur la mise à distance des manifestants : tenir un barrage plutôt que de mener ce que les policiers appellent des courses à l’échalote, c’est-à-dire des poursuites individuelles des fauteurs de troubles ; développer des équipements qui protègent les policiers mais qui sont lourds et qui donc rendent difficile cette poursuite ; utiliser des armes qui visent à disperser, à éloigner, le dispositif principal étant ici la grenade lacrymogène. Or le retour des missions d’interpellation signifie l’inverse : moins de patience, plus de risques, avec la nécessité d’un rapprochement physique avec les perturbateurs afin de les interpeller. Évidemment, les CRS et les gendarmes mobiles n’ont pas, du jour au lendemain, perdu ce qui a fait leur grande compétence et les services d’ordre auxquels on assiste aujourd’hui couplent ces dispositifs. Il n’en reste pas moins que cette mutation fondamentale a un effet durable sur la manière dont sont désormais envisagées les situations de gestion de l’ordre et de contention des désordres.
Autre fait significatif : la transformation de l’armement. Depuis une quinzaine d’années, ont été introduites dans l’équipement des forces de l’ordre des armes dites non létales. Il faudrait affiner l’analyse de leurs effets en fonction des services policiers ou gendarmiques. Le développement de ces armes non létales avait pour vocation de remplacer les armes à feu et donc de réduire la létalité globale de la force policière. On sait pourtant, désormais, que ces armes ne sont pas utilisées dans les mêmes contextes que les armes à feu – que les policiers français utilisent peu, ce qui est heureux. Ainsi le flash ball n’a pas du tout remplacé les armes à feu mais s’est ajouté aux moyens déjà disponibles. Le flash ball permet certes de maintenir à distance les protestataires mais il les blesse parfois gravement – chaque année compte son lot d’éclopés et d’affaires médiatisées comme celle de ce manifestant qui avait perdu un œil. Si bien que les flash ball, dont l’« argument de vente » consistait à dire qu’il s’agissait d’armes devant contribuer à réduire le niveau de violence engagée par les forces de l’ordre d’un État démocratique, ont un effet tendanciellement inverse et contribuent à élever le niveau de violence des situations de maintien de l’ordre.
Que serait aujourd’hui un maintien de l’ordre réussi du point de vue des forces de l’ordre : un maintien de l’ordre sans blessés ou avec un niveau d’arrestations élevé ? des forces de l’ordre patientes ou bien qui interviennent rapidement ? Autrement dit, comment faire pour évaluer différemment la qualité de la prestation policière, comment récompenser les policiers et les gendarmes parce que le calme a été maintenu, parce qu’il n’a pas été nécessaire d’intervenir, la pacification ayant été obtenue en amont, plutôt que de les récompenser en fonction du nombre d’arrestations ? Il ne s’agit pas de supprimer cette seconde modalité de reconnaissance mais il paraît nécessaire de réfléchir à la première.
M. Pascal Popelin, rapporteur. Vous avez évoqué, à la fin de votre exposé, l’utilisation du flash ball ; or, à ma connaissance, cet outil n’est pas employé par les forces de maintien de l’ordre – les opérations de maintien de l’ordre et les opérations de sécurité ne recouvrant pas tout à fait la même réalité. Je suis élu dans une circonscription où, malheureusement, se sont déroulés les événements qui ont conduit aux émeutes urbaines de 2005 que vous avez rappelées à la marge – événements qui ne correspondaient pas à une opération de maintien de l’ordre au sens classique de l’expression.
Considérez-vous que l’évolution des formes de manifestations, ces dernières années, permet d’envisager sérieusement la modification – et c’est un peu l’objet de cette commission – de la doctrine d’emploi du maintien de l’ordre ? Nous sommes en effet confrontés à des manifestants plus violents et moins organisés. On est passé de la forme classique d’une manifestation allant d’un point A à un point B, manifestation encadrée par son propre service d’ordre, à des manifestations aux formes plus floues, organisées par des collectifs dépourvus d’interlocuteurs identifiables par les autorités. On pense au phénomène des « zones à défendre » (ZAD), qui évolue en milieu ouvert et qui, forcément, amène la force publique à adapter ses dispositifs.
Quand bien même on poursuit l’objectif de préserver l’ordre public, on est enclin, en autorisant une manifestation, à accepter une dose de désordre public. Y a-t-il, selon vous, une évolution de ce désordre public ? Que peut-on tolérer dans une société démocratique et quel est le degré de tolérance en France en comparaison avec d’autres pays démocratiques ?
Enfin, comment jugez-vous le système de maintien de l’ordre français dans l’absolu puis par rapport à d’autres modèles ?
M. Cédric Moreau de Bellaing. Le maintien de l’ordre est assuré en France par des forces spécialisées – les CRS et les gendarmes mobiles – qui reçoivent une formation spécifique, mais aussi par des compagnies plus ponctuelles – comme les compagnies de district – dont les membres reçoivent une formation moins poussée. Ces dernières sont dotées d’armes de type flash ball – ce qui rend pertinente la question de leur utilisation dans les opérations de maintien de l’ordre. Je rappelle souvent à mes étudiants que les CRS portent sur leur casque deux larges bandes jaunes depuis Mai-1968. Elles ont été apposées à leur demande parce qu’elles en avaient marre de se faire accuser de violences commises par d’autres services et en particulier les compagnies d’intervention.
Ensuite, si c’est bien au cours des émeutes de 2005 qu’a été décidé un renouvellement de la doctrine, celui-ci a été conçu antérieurement.
En ce qui concerne le caractère plus violent des manifestants auxquels font face les forces de l’ordre, d’un point de vue sociologique, cela reste à voir : la violence des grandes manifestations de 1947-1948, de celles – des viticulteurs – de 1950 ou de celle – de Creys-Malville – de 1977, n’avait rien à envier à la violence des manifestations d’aujourd’hui. En revanche, que l’on ait affaire à des groupes moins organisés, à des collectifs plus flous, c’est certain et c’est là que réside le défi principal. En effet, ce qui a permis l’institutionnalisation du maintien de l’ordre, c’est le développement d’une coopération avec les organisateurs des manifestations – de ce point de vue, la CGT a été reconnue par les services de police comme un interlocuteur privilégié pour organiser des manifestations « carrées ». La question qui se pose est dès lors sans doute moins celle de l’arsenal des forces de l’ordre que celle de la capacité à créer de nouvelles coopérations avec des groupes relativement flous mais participant d’un mouvement social plus global.
Il est difficile d’établir un diagnostic général, certains groupes s’étant pacifiés, d’autres durcis. Reste que le niveau de tolérance au désordre global a baissé parmi le public ou chez les policiers, mais aussi chez les manifestants, les organisations condamnant systématiquement les groupes fauteurs de violences – ce point fait l’objet de débats parmi les zadistes sur le fait de savoir ce qui, de leur point de vue, relève ou non de la violence légitime.
Enfin, je n’ai pas moi-même mené d’enquête sur le maintien de l’ordre dans d’autres pays mais, lorsque j’ai travaillé sur les dispositifs policiers de lutte contre le hooliganisme dans les cas de Lyon et Paris, j’ai été frappé de constater la présence très régulière de délégations d’autres polices européennes qui venaient voir comment les forces de maintien de l’ordre françaises traitaient la question, tant il est vrai que la France jouit d’une bonne réputation en la matière. On peut en inférer que le système de maintien de l’ordre français est efficace concernant ce qu’il connaît ; il a en revanche plus de mal à s’adapter à ce qu’il connaît moins bien.
Lorsque j’ai évoqué la transformation de la doctrine d’emploi du maintien de l’ordre, je n’ai pas voulu dire qu’elle était irréfléchie mais qu’elle visait à répondre à des changements des comportements protestataires. Cela étant, cette transformation ne me paraît pas avoir été accompagnée d’une réflexion globale sur ses effets sur le fonctionnement des unités concernées.
M. le président Noël Mamère. À la différence du rapporteur, je ne suis pas convaincu que la violence ait évolué de telle manière qu’elle doive entraîner un changement de doctrine. Vous datez le début de ce changement des années 1970 et décelez un tournant en 2005. En tant que sociologue, pensez-vous que cette évolution soit inéluctable, va-t-elle modifier la conception du maintien de l’ordre en France ? Vous avez évoqué cette capacité à résister, à retenir – ces deux piliers du maintien de l’ordre ; or donner la priorité aux interpellations ne correspond pas à la mission des forces de l’ordre.
J’aborderai ensuite la mauvaise formation des forces supplétives qui sont, pour leur part, dotées de flash ball et de tasers, et qui les utilisent – on compte plusieurs accidents, notamment des énucléations, et on a même déploré la mort d’un manifestant. Quel est votre point de vue sur, non pas une moralisation, mais sur la formation de ces supplétifs ? Je pose la question avec d’autant plus de force qu’en tant que député j’avais demandé que ces supplétifs ne soient pas armés de flash ball ni de tasers. Je souhaite savoir s’il s’agit également de votre opinion et connaître vos propositions en ce sens.
M. Cédric Moreau de Bellaing. Une transformation de la doctrine peut sembler inéluctable. On peut en effet reconnaître que les interventions classiques des forces de l’ordre à l’occasion de manifestations de masse dans un espace urbain connu et quadrillé sont difficilement transposables à ce qu’on désigne sous l’appellation de violences urbaines – le territoire n’est pas le même, le mode opératoire des protestataires n’est pas le même non plus. En revanche, revenir sur la priorité donnée à la préservation d’un territoire sur les arrestations me paraît discutable. Il conviendrait de réfléchir à l’articulation des différentes forces de police qui interviennent dans le cadre d’opération de maintien de l’ordre.
On a vu se renforcer une articulation entre les forces mobiles de maintien de l’ordre et des groupes de policiers en civil qui vont choisir une ou deux personnes identifiées comme des meneurs. Le débat existe depuis un siècle sur la possibilité d’identifier des meneurs alors que la sociologie des manifestations montre que les échauffourées sont très rarement structurées autour de meneurs et de suiveurs. Aussi ne s’agit-il pas à mes yeux d’une transformation inéluctable.
Quant à la question des arrestations, elle renvoie à celle du degré de désordre que peut supporter un État démocratique, sachant que, précisément, la spécificité du maintien de l’ordre dans un État démocratique est d’accepter un certain niveau de désordre.
On doit également réfléchir au moment où les forces de l’ordre doivent savoir se retirer quand c’est nécessaire. Il arrive encore, en effet, que des dispositifs soient mis en place alors que très peu de risques sont encourus, et que cela suscite des tensions entre manifestants et forces de l’ordre. Si ces dernières sont considérées comme les représentantes de l’État, il faut attendre de leur part des propositions stratégiques plus réfléchies que celles constatées.
La question de la formation des forces supplétives se pose aussi du point de vue des policiers. L’anecdote que j’ai rappelée des deux bandes jaunes sur les casques des CRS est à cet égard très significative du souci des forces spécialisées dans le maintien de l’ordre de préserver des compétences qu’elles pensent être mises à mal par l’intervention de ces forces supplétives. On assiste en effet à un mouvement contradictoire qui consiste à considérer que le nombre de manifestations de masse ayant globalement baissé depuis trente ans, il faudrait redéployer les CRS vers des missions de sécurisation alors que, dans le même temps, on confie le maintien de l’ordre à des forces supplétives moins bien formées. On peut s’interroger sur le fait de savoir s’il ne faudrait pas confier à ces forces supplétives des missions de sécurité publique ou des missions de police urbaine et de nouveau confier aux CRS et aux gendarmes mobiles le maintien de l’ordre – spécialité qui a fait leur renommée.
M. Guy Delcourt. La semaine dernière, l’ancien directeur du centre national d’entraînement des forces de gendarmerie de Saint-Astier nous indiquait qu’en matière de maintien de l’ordre, la formation spécifique qui y est donnée révélait que, dans certains cas, on ne devrait pas faire appel, en zone rurale, aux gendarmes départementaux ; il a même ajouté qu’il valait mieux les laisser dans leurs casernements. Je lui ai demandé, dès lors qu’on considère le maintien de l’ordre comme une spécialité qui nécessite un entraînement très particulier – et j’ai lu les différents rapports sur ce qu’on enseigne au centre de Saint-Astier, devenu une référence en la matière –, s’il pensait que l’on devait également se pencher, à l’occasion des grandes manifestations, sur les périmètres urbains. Et nous n’avons pas manqué de grandes manifestations – l’une très pacifiste et les autres beaucoup moins – en territoire urbain et notamment dans la capitale.
Pensez-vous que cette suggestion mérite d’être travaillée sous la forme d’une proposition qui pourrait être faite à l’autorité politique ?
M. Daniel Vaillant. Mon point de vue diverge du vôtre, monsieur le professeur, et de celui du président : bien sûr que la violence a évolué. La société d’aujourd’hui est plus violente – en tout cas on le sait davantage. Les manifestations se sont diversifiées et si l’on cherchait, auparavant, à rassembler le plus de monde possible, on cherche davantage, aujourd’hui, à alimenter son tableau de chasse y compris aux dépens des forces de l’ordre. On a même connu des manifestations où il y avait une forme de jeu entre les manifestants et les forces de l’ordre ; mais chacun évitait l’engrenage. Or on ne peut nier une évolution dans le sens d’une plus grande violence. Il est vrai également que des initiatives ont été prises du côté des forces de l’ordre : je pense à la création des voltigeurs en 1986 – force supplétive dont l’action a connu une issue dramatique.
On note par ailleurs la volonté, vis-à-vis des forces de l’ordre, de créer un effet de surprise, et c’est très ennuyeux. Une manifestation est annoncée, déclarée, éventuellement autorisée mais certains groupes essaient de surprendre. C’est pourquoi je vous interrogerai sur la nécessité de s’appuyer davantage sur le renseignement – et je suis heureux d’apprendre que le renseignement territorial va être renforcé – puisqu’il fait remonter d’autres éléments d’information que ceux affichés par les organisateurs de la manifestation primaire que les groupes en question essaient de « polluer » à travers des démonstrations de violence, de casse ou de vol.
S’ajoute une autre évolution : la dimension internationale. Les sommets nécessitent un renseignement anticipé. Les interceptions de sécurité n’ont pas vocation à priver des individus de liberté mais elles sont parfois nécessaires quand on sait que des groupes extérieurs, y compris étrangers, vont se joindre à des manifestations pour déstabiliser, casser, blesser ou tuer. Ayant été membre de la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité (CNCIS) pendant cinq ans, je puis vous assurer que pendant la préparation d’une manifestation ou pendant la manifestation elle-même, certaines interceptions se révèlent nécessaires pour prévenir les échauffourées ou les drames.
Aussi, plus que jamais, l’anticipation m’apparaît-elle un élément essentiel du maintien de l’ordre. Les forces de l’ordre et notamment l’autorité administrative doivent disposer du maximum d’informations pour mieux maîtriser l’ordre sans que la liberté de manifester soit remise en cause.
Partagez-vous ce point de vue ?
M. Cédric Moreau de Bellaing. Dans le cas des événements de Sivens, fallait-il caserner les gendarmes départementaux ? Depuis plusieurs semaines, des tensions très fortes s’étaient développées entre les manifestants eux-mêmes – étant entendu que l’univers zadiste est très hétérogène – puis entre les manifestants et les gendarmes départementaux. On ne peut pas faire l’économie d’une réflexion sur l’engagement ou non de forces qui ne sont pas du tout habituées à la gestion de mouvements de protestation. J’aurais tendance à abonder dans le sens de la personne qui m’a précédé devant cette commission.
J’en viens à l’intervention de Monsieur Vaillant. La première question à se poser pour savoir si les mouvements de protestation sont plus violents est de déterminer par rapport à quoi et par rapport à quand. Je suis convaincu que le niveau de violence est globalement plus faible que dans les années 1950-1960, qu’il s’agisse de grandes manifestations, d’émeutes ou de résistance à la force publique. Peut-être y a-t-il eu une phase d’apaisement dans les années 1980 – et encore est-ce au cours de cette période qu’apparaît le phénomène des violences urbaines. J’aurai donc tendance à me raccrocher à la seconde partie de votre phrase selon laquelle « on le sait davantage ». On note en effet une plus grande sensibilité à l’illégitimité du recours à la violence au cours des protestations collectives.
En Allemagne, le mouvement autonome, très puissant, n’a jamais rechigné à affronter les forces de l’ordre. Or ces dernières ont trouvé des moyens autres que la réponse oppositionnelle pour réduire la violence : elles ont affaibli leur présence, les espaces urbains ont été modifiés… En Grèce aussi on relève un niveau de violence très élevé mais que l’on parvient à contenir.
En ce qui concerne l’effet « tableau de chasse », je ne dispose pas de données empiriques mais qui remplirait ce tableau ? Relativement peu de policiers sont gravement blessés ou tués – c’est très rare et c’est heureux.
Quant à l’effet de surprise, on gagnerait à préciser de quel groupe on parle. Certains cherchent l’affrontement car ils estiment que le recours à la violence est une modalité d’expression de leurs revendications, voire une modalité d’accès à l’espace public. Il existe deux manières, en effet, de prévenir l’affrontement : l’anticipation et la soustraction à l’affrontement. Dans ce dernier cas, vous me répondrez qu’il faut bien, dans certains cas, protéger des lieux ; mais parfois, ce sont des principes généraux de maintien de l’ordre qui amènent les services de police à se trouver à tel ou tel endroit. Il faudra peut-être réviser ces principes.
La dimension internationale est intéressante. Depuis le sommet de l’OMC à Seattle en 1999 et celui du G8 à Gênes en 2001, des regroupements protestataires internationalisés se sont formés. L’activité de renseignement existe déjà car, si je me souviens bien, à Gênes, de nombreux représentants de policiers n’étaient pas italiens. Cette expertise internationale a également été développée à l’occasion des grandes compétitions sportives, notamment de football, où les policiers spécialistes des phénomènes de hooliganisme des pays engagés dans la compétition se rendent sur place. Je ne suis pas certain que cette dimension internationale provoque un changement de nature des mouvements de protestation collective. Si ce phénomène s’est intensifié, il n’est pas nouveau : lors de la manifestation antinucléaire de Creys-Malville en 1977, au cours de laquelle un manifestant serait décédé à cause d’une grenade offensive, il y avait des militants allemands au point que certains responsables locaux ont déclaré à la presse que c’était la deuxième fois que leur ville était « occupée ». Si cette dimension internationale, donc, n’est pas nouvelle, elle ne s’en est pas moins intensifiée et nécessite une meilleure articulation au niveau européen.
M. le président Noël Mamère. Votre thèse porte sur les institutions de contrôle des forces de l’ordre : l’Inspection générale de la police nationale (IGPN) et l’Inspection générale de la gendarmerie nationale (IGGN). Pensez-vous que ces services fonctionnent de manière satisfaisante ou bien pensez-vous qu’il n’est pas sain que le contrôleur soit également le contrôlé ?
M. Cédric Moreau de Bellaing. Il est toujours difficile d’être bref quand on vous interroge sur votre sujet de thèse. J’ai travaillé sur l’Inspection générale des services (IGS) qui, à l’époque, avait compétence pour Paris et les trois départements limitrophes. J’ai été alors frappé par le très faible nombre de dossiers ouverts à propos d’agissements de policiers spécialisés dans le maintien de l’ordre. Ce phénomène est avant tout lié à un problème d’identification : il était difficile, sinon impossible, à une personne se rendant à l’IGS de décrire le policier incriminé. Peut-être conviendrait-il de rendre visible le matricule – j’y suis pour ma part très favorable.
L’IGS sanctionne majoritairement la « privatisation » des fonctions policières, à savoir l’utilisation à des fins privées des moyens mis à disposition des fonctionnaires de la force publique. Si c’est la préservation du caractère public de la mission policière qui est au cœur des inquiétudes des forces de l’ordre, il faudra accroître l’exigence du contrôle public comme le port du matricule sur les uniformes, éventuellement l’installation de caméras dans les véhicules ou dans les lieux de rétention, non pas en raison d’une méfiance vis-à-vis des forces de l’ordre mais parce que cela compte pour eux.
Pour répondre globalement à votre question sur le fonctionnement des services internes et en particulier sur l’éventuel risque présenté par le fait que le contrôleur est également le contrôlé, ce qui peut apparaître comme un inconvénient présente également des avantages. En effet, les enquêteurs de l’IGS savent déceler les moments où les policiers essaient de contourner un fait ou quand où ils essaient de changer leur version des faits. La question n’est donc pas de savoir s’il faut privilégier le contrôle interne ou le contrôle externe, mais de savoir quelle articulation organiser entre les deux – il s’agit là d’un chantier considérable dès lors que la Commission nationale de déontologie de la sécurité (CNDS) a été dissoute au profit du Défenseur des droits, dont je ne conteste pas la qualité du travail mais qui ne peut pas tout faire. Le contrôle externe a ainsi perdu des moyens qui par ailleurs étaient déjà relativement faibles – la CNDS avait du mal à finir l’année avec le budget qui lui était alloué et ses droits d’investigation n’étaient pas des plus étendus.
M. le rapporteur. Je partage votre point de vue sur l’articulation nécessaire entre contrôle interne et contrôle externe. Dans tous les corps de l’administration française, il y a des organismes de contrôle interne et des enquêtes administratives qui peuvent déclencher des procédures judiciaires.
Vous avez évoqué la question des caméras. Les policiers étaient très réticents, au début, à l’installation des caméras-piétons alors qu’ils adhèrent maintenant complètement à ce système dont ils estiment qu’il les protège.
Par ailleurs, les journalistes remarquent être beaucoup plus rejetés par les manifestants que les forces de l’ordre.
Qu’en pensez-vous ?
M. Daniel Vaillant. Des évolutions positives ont eu lieu concernant les inspections, certains services de contrôle ayant mérité par le passé d’être davantage contrôlés. Plusieurs procédures judiciaires ont montré que l’IGS avait mieux à faire que ce qu’elle a parfois fait. Sa régionalisation a été une bonne réforme.
Vous avez déclaré qu’il était parfois préférable que les forces de l’ordre ne soient pas présentes pour que tout se passe bien. Je comprends bien le sens de votre propos mais, par expérience, je sais que quand on a affaire à une manifestation aux contours incertains, plus il y a d’effectifs pour maintenir l’ordre, mieux ça se passe. Il est toujours dramatique d’envoyer des policiers pour contrôler une manifestation quand le rapport de force n’est pas bon.
Enfin, sans chercher à convaincre le président Mamère d’adhérer à ce système, la vidéo-protection permet, dans des milieux urbains denses, d’avoir des éléments de preuves parfois utiles en dehors des téléphones portables.
M. le président Noël Mamère. Je ne l’ignore pas mais tant que j’en serai maire, il n’y aura pas de police municipale ni de caméra de surveillance dans la commune de Bègles.
M. Cédric Moreau de Bellaing. J’ai pu constater au moins une fois le phénomène décrit par le rapporteur, au moment des manifestations contre le contrat première embauche (CPE). Quelques personnes ont commencé à briser des vitrines et s’en sont pris aux forces de l’ordre et, entre les deux, se trouvait une rangée entière de journalistes casqués. Nul doute que certains manifestants s’en prennent parfois aux représentants des médias. Nous disposons de très peu de données sur ce phénomène. Néanmoins, on pourrait assez facilement montrer que ce n’est pas nécessairement l’ensemble de la presse qui est visé dans ce genre de situation et que les protestataires choisissent leurs cibles : les journalistes de télévision – et certains d’entre eux plus que d’autres selon qu’ils travaillent pour telle ou telle chaîne – sont ainsi plus visés que les journalistes de radio, et eux-mêmes plus que les journalistes de la presse écrite.
Qu’il y ait eu des ratés – et même plus – dans le fonctionnement de l’IGS ne fait aucun doute. On verra les résultats de la régionalisation, qui ne concerne pas seulement les rapports entre l’IGPN et l’IGS mais aussi les rapports entre la préfecture de police et le ministère de l’Intérieur.
J’ai indiqué que les forces de l’ordre pouvaient se retirer ou n’être pas directement présentes sur le site. Il ne fait pas de doute que des manifestations se déroulent bien parce que l’encadrement policier est considérable. Mais il arrive qu’à l’occasion de certaines manifestations on compte plus de policiers que de manifestants – même si c’est rare. Lorsque j’évoque l’idée que des manifestations puissent se dérouler sans que les forces de l’ordre soient présentes, je devrais préciser : sans qu’elles soient visiblement présentes, afin qu’elles restent prêtes à intervenir.
M. le président Noël Mamère. Nous vous remercions pour votre contribution à la réflexion de la commission d’enquête.
*
* *
Audition, ouverte à la presse, de M. Thomas ANDRIEU, directeur des libertés publiques et des affaires juridiques au ministère de l’Intérieur
Compte rendu de l’audition du jeudi 22 janvier 2015
M. le président Noël Mamère. Je vous remercie d’avoir répondu à notre invitation.
Conformément aux dispositions de l’article 6 de l’ordonnance du 17 novembre 1958, je vais maintenant vous demander de prêter le serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité.
(M. Thomas Andrieu prête serment)
M. Thomas Andrieu, directeur des libertés publiques et des affaires juridiques au ministère de l’Intérieur. Je commencerai par replacer la question du maintien de l’ordre et de l’emploi de la force dans l’état du droit, qui protège la liberté constitutionnelle de manifester. Est considéré comme manifestation un groupe de personnes qui utilisent la voie publique pour exprimer une volonté collective. Le terme est donc défini par un fait matériel – la présence de personnes sur la voie publique – et par une intention politique – celle de délivrer un message. La manifestation peut être mobile ou non.
Le régime juridique de la manifestation, qui s’applique aussi bien aux veilleurs, qu’aux zadistes ou aux anti-corrida, et aux flash mob qu’aux free parties, est libéral. La liberté de manifestation est mentionnée pour la première fois en tant que telle dans un décret-loi de 1935 relatif au maintien de l’ordre public, dans un contexte politique particulier. Une décision du Conseil constitutionnel datant de 1995 la consacre comme une des facettes du droit d’expression collective des idées et des opinions. La Constitution ne cite pas la liberté de manifestation, qui est toutefois rattachée à la liberté d’expression, à l’article 11 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Le régime qui s’applique aux manifestations – comme aux associations – est celui de la déclaration, mais l’administration ne peut interdire une manifestation même non déclarée que si celle-ci peut entraîner des troubles graves, et que l’administration ne peut la gérer avec les moyens dont elle dispose. C’est donc un raisonnement en deux temps qui amène l’administration, puis le juge – avec un contrôle entier de proportionnalité – à vérifier que l’interdiction est justifiée. Répétons-le : une manifestation qui reste pacifique et ne trouble pas l’ordre public ne peut être interdite pour le simple motif qu’elle n’aurait pas été déclarée, et seul le motif d’ordre public justifie l’interdiction.
Autre signe du principe de liberté qui entoure la manifestation : la violation d’une interdiction est peu sanctionnée. Seuls ceux qui auraient dû déclarer la manifestation sont passibles de sanctions pénales. Les participants encourent seulement une amende pour non-respect d’arrêté de police, en vertu de l’article R610-5 du code pénal.
Enfin, on ne peut recourir à la contrainte pour faire exécuter un arrêté de police tendant à interdire la manifestation. Même si l’arrêté d’interdiction pris par un préfet ou un maire est légal et proportionné, on ne peut utiliser la contrainte pour disperser les manifestants dès lors que la manifestation est pacifique et ne trouble pas l’ordre public.
En revanche, à la différence de la manifestation, l’attroupement ne constitue pas l’exercice d’une liberté publique. On ne lui reconnaît pas de finalité politique. Son seul critère de définition est matériel. C’est un rassemblement de personnes sur la voie publique ou dans des lieux publics, qui est susceptible de troubler l’ordre public. Aux termes de la loi, le trouble n’a pas à être constaté. Il suffit que l’on sente venir.
Non seulement le code de la sécurité intérieure permet la dispersion de l’attroupement, mais il fait obligation à l’autorité publique de mettre fin à des troubles éventuels. Il faut toutefois, après deux sommations sans effet, une décision administrative de l’autorité compétente, la première décision d’emploi de la force n’étant pas laissée à l’appréciation de la seule autorité opérationnelle. L’article R-211-21 du code de la sécurité intérieure réserve la décision au préfet du département ou au sous-préfet, au maire ou à l’un de ses adjoints, au commissaire de police, au commandant de groupement de gendarmerie départementale ou, mandaté par l’autorité préfectorale, au commissaire de police ou à l’officier de police chef de circonscription.
La décision, qui ne revient en aucun cas au commandant direct des opérations, doit se prendre au plus près du terrain, sachant que les circonstances sont extrêmement fluides et que, ces dernières années, la gravité des violences a augmenté. En même temps, l’autorité – qualifiée d’autorité civile, bien que la décision puisse incomber à un gendarme ou à un policier de haut rang – doit avoir un regard distancié sur les événements. C’est une autorité suffisamment élevée qui recourt à l’usage de la force.
Cette tension, qu’on retrouve dans tout sujet d’ordre public, est au cœur de la réflexion du ministère de l’Intérieur. C’est probablement sur ce chaînage qu’un travail peut être fait. À la différence de ce qui se passe dans les autres États, il faut en France que les forces de l’ordre reçoivent un ordre exprès pour se servir des armes à feu.
Le régime libéral des manifestations fait que les conséquences pénales sont très mesurées. Je ne peux citer aucun exemple récent de condamnation pour manifestation illicite ni d’amende pour participation à une telle manifestation. En revanche, le régime des attroupements est répressif. Le fait de participer à un attroupement en étant porteur d’une arme constitue une infraction à part. La provocation directe à un attroupement armé est également réprimée, et plus encore si elle est suivie d’effet. L’objectif principal de la loi interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public, adoptée en 2010, étant la préservation de l’ordre public, une personne qui dissimule intégralement son visage lors d’un attroupement peut être punie d’amende.
Les infractions de droit commun commises dans ce cadre concernent l’entrave à la liberté du travail ou à la circulation. Le fait de se débarrasser d’objets sur la voie publique est également répréhensible. L’outil pénal existe et peut être employé, pourvu qu’on ait identifié l’auteur de l’acte. Les outils de police judiciaire prennent alors tout leur sens : contrôle d’identité – contrôle d’identité de police judiciaire si l’on soupçonne une infraction, contrôle d’identité de police administrative en amont dans des zones où l’on sent que des troubles peuvent survenir –, vérification d’identité, interpellation et placement en garde à vue.
Je reviendrai si vous le souhaitez sur les fichiers de police utilisés pour prévenir ce type de troubles.
L’action de l’administration vis-à-vis des manifestants doit être claire, qu’il s’agisse des sommations ou de l’enchaînement qui conduit à l’usage de la force, lequel est placé sous le signe de la plus stricte proportionnalité. Tout cela doit être bien expliqué aux personnes qui participent à la manifestation ; ce point est sans doute susceptible d’amélioration. Enfin, dans la chaîne de commandement, il faut résoudre l’équation qui impose à la fois de rester proche du terrain où tout va très vite et de conserver une distance pour savoir s’il faut ou non lâcher prise.
M. Pascal Popelin, rapporteur. Les textes et les procédures relatifs à l’expression des libertés publiques et au maintien de l’ordre sont-ils adaptés aux nouveaux phénomènes de revendication, notamment ceux qui se caractérisent par l’occupation durable de sites privés ? Celle-ci ne constitue-t-elle pas une occupation illicite, relevant du droit de l’expulsion ? Faut-il harmoniser ces domaines du droit ou mieux adapter l’encadrement juridique ?
Les dispositions du code de la sécurité intérieure suggèrent qu’une manifestation interdite ou non déclarée ne bascule pas automatiquement dans le régime de l’attroupement. Est-ce une faille juridique ou une bonne application du principe de liberté ? Sur ces questions très précises, nous vous adresserons peut-être un questionnaire écrit, afin d’évoquer en détail la notion d’interdiction, le dialogue et la coopération avec les organisateurs, ainsi que l’information préalable du public et le renseignement.
Quelle est la responsabilité de la puissance publique, s’il est avéré que celle-ci a insuffisamment prévenu la situation, ce qui a causé des dommages aux personnes ou aux biens ? Quelle est celle des organisateurs ? Leur définition juridique est-elle assez claire ? Comment appréciez-vous les spécificités du modèle français, qui impose de concilier maintien de l’ordre et expression des libertés publiques ? Dans ce domaine, quels enseignements peut-on tirer des autres démocraties ?
M. Daniel Vaillant. Compte tenu de la complexité de ces matières, il serait effectivement utile que nous puissions vous interroger par écrit. Dans le cas des rave et des free parties, qui posent la question d’une occupation illicite de l’espace, l’obligation de la déclaration a permis la responsabilisation, qui a réduit le nombre de décès. La responsabilité des organisateurs constitue un principe essentiel, sachant que l’autorité est sur le fil du rasoir : elle prend un risque tant en autorisant la manifestation qu’en l’interdisant.
Notre régime est libéral, au sens philosophique du terme, sans pour autant être libertaire, de même que chacun est favorable à la sécurité, en se défendant de toute attitude sécuritaire. Lors d’une manifestation, le port de certains insignes – par exemple de croix gammées – justifie l’intervention de la force publique, de même que les appels à la violence. Quelles sanctions encourent des manifestants qui appellent à la violence contre les forces de l’ordre ?
Mme Marie-Anne Chapdelaine. Dans quel cadre juridique s’inscrit l’activité des zadistes, puisqu’on ne peut pas la rattacher à la liberté de manifester ? Il me semble que, sur le terrain, les représentants des forces de l’ordre sont tenus d’arborer leur matricule ; est-ce bien le cas ?
M. Olivier Marleix. Je suis frappé par la différence entre le régime juridique qui s’applique aux manifestations politiques et celui qui régit les manifestations récréatives, sportives ou culturelles. Bien que les unes et les autres soient rattachées au même article 211-1 du code de la sécurité intérieure, les secondes s’inscrivent dans un cadre plus contraint. Un maire qui en organise dans sa commune engage sa responsabilité de manière très lourde. Il est traduit devant un tribunal correctionnel en cas d’accident, par exemple si, lors d’une course cycliste, il manque à un carrefour des gilets de signaleurs. J’ai le sentiment que notre arsenal juridique est assez déséquilibré.
J’ai consulté ce matin le site de plusieurs préfectures. Pour organiser une loterie – démarche assez innocente –, il faut renvoyer un formulaire CERFA très détaillé. Pour organiser une manifestation culturelle sur une zone classée Natura 2000, il faut remplir un formulaire de huit pages dans des délais contraignants. La manifestation à caractère économique ou social s’organise de façon beaucoup plus rapide, avec en quelque sorte une « inversion » de la charge de la responsabilité : dès qu’une manifestation à caractère politique tourne mal, on s’en prend à l’autorité politique, au préfet ou au ministre de l’Intérieur, qui l’a laissée se dérouler. Notre commission d’enquête s’inscrit aussi dans cette logique. Sans aller jusqu’à instaurer un régime d’autorisation, ne faudrait-il pas aller un peu plus loin dans l’encadrement des manifestations, dans ce que l’administration demande aux manifestants, voire établir un régime de responsabilité plus étendu pour les organisateurs, à une époque où l’on considère de plus en plus que les interlocuteurs de l’autorité publique sont quasiment aussi légitimes que celle-ci ?
Mme Nathalie Nieson. Comment réagissez-vous face aux zadistes, qui semblent ne laisser à l’autorité que deux solutions : procéder à une évacuation ou accepter l’occupation illégale d’un terrain, qui devient ainsi une zone de non-droit ?
M. Hugues Fourage. Comment responsabiliser les organisateurs ? Existe-t-il un guide que l’on pourrait remettre aux organisateurs de manifestation ? Serait-il souhaitable d’en rédiger un ? Comment la chaîne de commandement appréhende-t-elle le principe de proportionnalité, qu’il est difficile d’appliquer face à la provocation ?
M. le président Noël Mamère. Sur la chaîne de commandement, il serait intéressant de connaître les pistes que vous pourriez proposer. Sachant que le maintien de l’ordre s’effectue sur la voie publique, comment appréhender les événements de Sivens, qui se sont déroulés sur un terrain privé ? L’intervention des forces de l’ordre relève-t-elle alors de la réquisition ? Récemment, des manifestations ont été interdites à la demande du préfet de police, confirmée par le juge administratif. La décision du préfet et l’interprétation du juge se fondent-elles sur les mêmes motifs ?
M. Thomas Andrieu. À ces questions très complexes, j’essaierai de faire une réponse qui ne soit pas que juridique. En matière d’ordre public et de police administrative, le droit public est infiniment réaliste. L’ordre public est une notion concrète, matérielle. Le trouble se constate, et il appelle qu’on agisse dans l’urgence. « Lorsque la maison brûle, a dit un grand commissaire du Gouvernement au Conseil d’État, on ne demande pas l’autorisation d’appeler les pompiers : on les appelle. »
Le système déclaratif que j’ai rappelé est libéral, au sens philosophique – et non libertaire –, il a vocation à canaliser mais, au bout du compte, l’urgence prime. En d’autres termes, que la manifestation soit ou non déclarée, le trouble est le seul critère réel considéré par le préfet pour savoir s’il doit disperser les gens ou laisser commencer la manifestation. Celui-ci préfère souvent laisser se dérouler une manifestation juridiquement interdite ou des rave parties qui ne respecteraient pas la loi de 2001, si l’interdiction risque de susciter une réaction violente de la part d’un grand nombre de personnes. La jurisprudence l’admet parfaitement : elle est réaliste, concrète et matérielle.
La vraie difficulté, dans ce système, est de responsabiliser les organisateurs, qu’on ne parvient pas toujours sinon à identifier, du moins à qualifier juridiquement, ce qui permet de diriger contre eux une action administrative ou pénale. Si le régime qui s’applique aux rave parties ou aux spectacles et activités culturelles est devenu plus fort, plus exigeant, c’est parce qu’on sait à qui l’on s’adresse. Les rave parties sont désormais un univers structuré dont on connaît les organisateurs. Le défaut d’organisation caractérise les zadistes, qui par essence refusent cette notion ou font de l’absence d’organisation une stratégie politique, une stratégie de combat.
Pour l’instant, le phénomène des zadistes n’est pas une catégorie juridique, mais peut-être le législateur va-t-il s’en emparer.
M. le président Noël Mamère. C’est un terme derrière lequel on peut mettre beaucoup de choses, de même qu’on peut mettre beaucoup de choses derrière « Charlie ».
M. Thomas Andrieu. L’occupation de vastes terrains privés sur lesquels séjournent des personnes s’opposant à l’action de la puissance publique suscite plusieurs interrogations. Est-on totalement démuni au regard de l’application du cadre juridique de l’attroupement ? Non, car l’attroupement se déroule sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public, notion qui peut inclure les vastes terrains privés dont l’accès est assez facile. Seul le juge pénal est compétent pour trancher cette question, mais celle-ci ne me semble pas fermée.
D’autre part, le code de procédure civile prévoit une procédure judiciaire d’évacuation des terrains, qui ne nécessite pas de cibler un organisateur. Ce régime juridique étant mal connu, nous informons les préfets de son existence : on peut demander l’évacuation d’un terrain privé devant le juge civil, alors même qu’on n’est pas en mesure de notifier sa décision à une personne en particulier. Quand la décision de justice est prise, le concours de la force publique peut être accordé, même si l’occupation des lieux est pacifique et, hors de toute procédure, ne justifierait pas d’action de maintien de l’ordre public.
Je rappelle que le concours de la force publique, hors du maintien de l’ordre public, ne peut être accordé que sur décision judiciaire, mais qu’en vertu de la séparation des pouvoirs, le préfet est tenu de faire exécuter les décisions de justice. Il serait en faute s’il ne le faisait pas. L’occupation non violente doit donc se traiter par une décision de justice préalable : une décision administrative pour le domaine public, une décision judiciaire pour les terrains privés.
La question de la responsabilité doit être examinée sous l’angle des organisateurs et de la puissance publique. Il faut pouvoir identifier un interlocuteur si l’on veut créer un régime équivalent à celui des rave parties et des manifestations culturelles. À cet égard, la difficulté est non juridique mais matérielle. De son côté, la puissance publique serait en faute si elle laissait se dérouler des troubles sans intervenir, sauf si elle peut justifier que son intervention aurait créé des troubles supplémentaires. Elle serait également en faute si elle faisait un usage exagéré de la force – ce qui reste difficile à apprécier.
Je ne suis pas compétent pour répondre sur la formation des policiers, mais, dans les écoles de police ou de gendarmerie, les fondements de la procédure pénale et du maintien de l’ordre sont deux piliers de l’enseignement, certaines unités étant spécialisées sur ces questions.
Monsieur Vaillant m’a interrogé sur les messages qui peuvent être diffusés, les insignes qui peuvent être arborés ou portés, les mots qui peuvent être prononcés lors d’une manifestation. Certaines provocations sont sanctionnées par la loi de 1881, qui n’appellent pas de réponse pénale immédiate telle que la comparution immédiate, la mise sous écrou ou la garde à vue. Mais il existe aussi dans le code pénal de nombreuses infractions caractérisées comme « provocation », par exemple la provocation à la violence directe, qui sont sanctionnées pénalement et permettent des interpellations immédiates.
La question des insignes est plus délicate. Cet été, des manifestants ont arboré le drapeau d’organisations reconnues comme terroristes par le droit européen. Sur le plan juridique, il est compliqué de sanctionner le port d’un drapeau, s’il ne s’accompagne pas de slogans ou d’un message direct. En revanche, l’appel à la violence verbal ou écrit est réprimé fermement.
Sur ces questions passionnantes et compliquées, je suis disposé à me lancer, si vous le souhaitez, dans un exercice écrit complémentaire.
M. le président Noël Mamère. Nous vous ferons parvenir un questionnaire. Le but de notre commission d’enquête est de formuler des propositions, en vue d’améliorer le maintien de l’ordre et son exécution, dans le respect des libertés.
M. le rapporteur. Nous devons connaître précisément l’état du droit, sa mise en œuvre, ses limites et la façon dont il doit évoluer pour s’adapter aux situations rencontrées sur le terrain. La responsabilité des organisateurs est une question intéressante : elle fait apparaître une difficulté pratique et rien ne serait pire que d’instaurer un cadre juridique qui ne s’appliquerait qu’à ceux qui jouent le jeu. Peut-on créer un mécanisme de responsabilité civile solidaire des organisateurs à l’encontre des fauteurs de troubles, afin de permettre une action récursoire de l’État, qui est civilement responsable des dommages causés par un attroupement ? Certains pays ont-ils tenté des expériences dans ce sens ? Quel en est le bilan ?
M. Thomas Andrieu. Je ne dispose pas d’éléments de droit comparé. La responsabilité solidaire des fauteurs de troubles pose la question matérielle de l’identification des organisateurs et des personnes que l’on voudrait responsabiliser – sauf à dire que tous ceux qu’on arrête dans un champ sont collectivement responsables du désordre général. La démarche serait inconstitutionnelle en matière pénale. Qu’en est-il en matière civile ? Je vérifierai si le législateur peut retenir cette option.
M. le président Noël Mamère. Je puis rapporter sur ce point mon expérience de faucheur volontaire. Quand j’ai été arrêté, avec quelques autres, nous nous sommes transformés en délateurs, en nommant ceux qui avaient été photographiés, parce que nous voulions tous comparaître, mais la procédure n’impliquait pas de désignation collective. La justice a refusé notre démarche, préférant sélectionner selon son bon plaisir une partie des manifestants, qui ont été traduits au pénal et au civil. Les plus connus ont payé le plus cher, ce qui me semble assez normal.
M. le rapporteur. C’est la rançon de la gloire !
M. le président Noël Mamère. C’est en tout cas un cas de figure intéressant. La manifestation, qui n’avait pas été autorisée, s’était déroulée devant les appareils photos des gendarmes.
M. Hugues Fourage. L’action civile solidaire pose la question de l’assurance des organisateurs, quand ceux-ci sont identifiés. L’absence d’assurance constituerait-elle un obstacle au droit de manifester, et par conséquent une entrave à l’exercice d’une liberté fondamentale ? C’est dans ce sens-là qu’il faut faire porter l’analyse.
M. Thomas Andrieu. Vous soulevez la question de la proportionnalité entre plusieurs libertés constitutionnellement protégées. L’obligation d’assurance, qui représente une atteinte à la liberté contractuelle, existe dans le droit français. La considérer comme une atteinte à la liberté du droit de manifester me semble peut-être excessif. C’est un point que je vérifierai.
Mme Marie-Anne Chapdelaine. Je réitère ma question : lors d’une manifestation, les représentants de la force publique sont-ils tenus d’arborer leur matricule ? Cela peut constituer un élément de garantie s’il survient un incident entre un manifestant et un représentant des forces de l’ordre.
M. Thomas Andrieu. Le port du numéro d’identification est obligatoire depuis le 1er janvier 2014 pour toutes les forces de police et de gendarmerie en tenue, non seulement lors des opérations de maintien de l’ordre mais au quotidien.
M. le rapporteur. Cette obligation s’applique-t-elle aussi aux unités mobiles ?
M. Thomas Andrieu. Oui. Les caractères sont suffisamment grands pour être lisibles à une distance de deux mètres. La mesure, qui est essentielle pour améliorer les rapports entre la police et la population, accompagne le développement du recours à la vidéo. À l’avenir, les caméras piétons tourneront chaque fois que le dialogue s’engagera entre un citoyen et la police urbaine ou que celle-ci procédera à une interpellation. Le recours à la vidéo sera également développé, voire systématisé, lors des opérations de maintien de l’ordre, dans un but de renseignement ou pour déterminer a posteriori, pour des besoins judiciaires, le comportement des manifestants ou des forces de l’ordre. Cette voie, dans laquelle nous sommes engagés, sécurisera tout le monde.
M. le président Noël Mamère. Je vous remercie.
*
* *
Audition, ouverte à la presse, de M. Christophe DELOIRE, directeur général
de Reporters sans frontières France
Compte rendu de l’audition du jeudi 29 janvier 2015
M. le président Noël Mamère. Je vous remercie d’avoir répondu à notre invitation. Au préalable, je précise que, si notre commission a été créée à la suite des événements survenus sur le site du projet de barrage de Sivens en octobre 2014, son objectif n’est pas d’enquêter sur ces faits – qui font l’objet d’une information judiciaire. Il s’agit d’une commission d’enquête sur le maintien de l’ordre.
En votre qualité de directeur général de Reporters sans frontières (RSF), vous recueillez beaucoup de témoignages de journalistes – grands reporters ou autres – sur les conditions d’exercice de leur métier. Vous aurez donc des choses à nous apprendre sur la manière dont ils voient l’évolution de leurs relations avec les forces de l’ordre et avec les organisateurs de manifestations.
Avant de vous entendre, conformément aux dispositions de l’article 6 de l’ordonnance du 17 novembre 1958, je dois vous demander de prêter le serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité.
(M. Christophe Deloire prête serment)
M. Christophe Deloire, directeur général de Reporters sans frontières France. Votre commission d’enquête a pour objet de travailler sur les missions et les modalités du maintien de l’ordre, mais une bonne partie de mon intervention portera non pas sur le comportement des forces de l’ordre elles-mêmes – ce n’est pas le problème le plus crucial pour les journalistes qui couvrent des manifestations – mais sur celui d’autres parties prenantes, à savoir des groupes de manifestants. Nous reviendrons néanmoins au sujet puisque le comportement de certains types de manifestants à l’égard des journalistes peut ou doit susciter une réaction des forces de l’ordre.
Les journalistes, quel que soit leur lieu de reportage, sont attaqués de toutes parts, et leur rôle est de plus en plus contesté par des gens qui estiment pouvoir se passer d’eux grâce aux nouvelles technologies. Ceux-là se disent qu’il suffit d’avoir un site Internet, des caméras et des micros pour maîtriser un média et s’adresser directement à son public. Je m’inscris bien sûr en faux contre cette idée : pour imparfaits qu’ils soient, les médias appliquent néanmoins des procédures et des règles d’éthique qui visent à garantir la fiabilité et l’honnêteté des informations qu’ils délivrent, et on ne saurait les assimiler à des organes de communication purement militants. Pour autant, la confusion s’installe dans l’esprit du public, et les journalistes qui font honnêtement leur travail de collecte et de diffusion d’informations s’en trouvent fragilisés.
La violence à l’égard des journalistes qui couvrent des manifestations est un phénomène mondial. En mars 2014, Reporters sans frontières a fait un exposé écrit sur le sujet, à l’occasion de la vingt-cinquième session du Conseil des droits de l’homme de l’ONU, où notre ONG dispose d’un statut de membre consultatif. Nous avons listé de très nombreux pays et il ne me viendrait évidemment pas à l’esprit de renvoyer dos à dos la Chine ou la Turquie et la France, mais nous avons relevé les dérives observées dans certains États démocratiques. En France, nous avons cité les agressions et intimidations dont ont été victimes des journalistes, notamment lors des manifestations contre la loi sur le mariage pour tous ou lors de la manifestation du 26 janvier 2014.
Lors des manifestations, il peut y avoir des tensions entre journalistes et policiers. En novembre 2014, nous en avons recensé quelques cas dans un communiqué. Le samedi 22 février 2014, un photographe indépendant, cofondateur de Citizen Nantes, a été atteint par le tir de flash-ball d’un CRS pendant une manifestation contre la construction de l’aéroport de Notre-Dame-des-Landes, alors qu’il était en train de filmer. Le 23 septembre, un journaliste du site spécialisé Reporterre, Emmanuel Daniel, a été violenté par la police à Albi, pendant une action de protestation contre la destruction de la zone du Testet. Depuis, le fondateur de Reporterre et ancien journaliste du Monde, Hervé Kempf, nous a signalé que lui-même et les journalistes de son site n’avaient eu d’autre problème que celui d’avoir été retenus pendant vingt minutes à un barrage par la police. Enfin, dans un tout autre contexte, une journaliste de Montpellier Journal a été empêchée de faire son travail, le jeudi 23 octobre, lors de l’expulsion d’un squat situé sur l’avenue de Lodève à Montpellier : un policier lui a arraché des mains le téléphone portable avec lequel elle avait pris des photos.
Les principaux problèmes ne surgissent d’ailleurs pas lors des grandes manifestations mais plutôt lors de petites opérations de ce genre, durant lesquelles du matériel peut être saisi, ce qui pose le problème de la confidentialité des sources des journalistes. Un problème similaire s’est produit lors d’une opération organisée par l’association Droit au logement (DAL). Or ces phases ne sont pas couvertes par la loi de 2010 sur le secret des sources qui, j’en conviens, n’est pas le sujet du jour.
De notre point de vue, bien plus graves sont les comportements de manifestants, ou groupes de manifestants, à l’égard des journalistes. Les manifestations contre le barrage de Sivens ont donné lieu à de très fortes tensions. Le 2 novembre, Éric Bouvet, un photographe qui a couvert les terrains les plus dangereux du monde, a dû quitter la commémoration à la mémoire de Rémi Fraisse, craignant pour sa sécurité : sa photo avait circulé et le bruit courrait qu’il était en réalité un policier infiltré. Il ne s’agissait pas d’une réaction spontanée mais d’une construction destinée à l’empêcher de travailler. D’autres reporters ont été empêchés de prendre des photos à Albi ou à Lisle-sur-Tarn. À quelque 900 kilomètres de là, deux journalistes de La Voix du Nord ont été délibérément agressés, le 27 octobre : ils ont reçu un jet de gaz lacrymogène dans les yeux.
Ces agressions sont souvent le fait de gens qui considèrent qu’il n’y a pas lieu d’avoir d’autres versions des faits que la leur, qu’ils diffusent via leurs propres moyens de communication. La critique des médias est légitime mais, dans leur cas, elle est poussée au point où tout média étranger à leur cause est nécessairement vendu à tel ou tel pouvoir.
Les manifestations contre le mariage pour tous ont produit de semblables comportements. En avril 2013, alors que le projet de loi était en cours d’examen dans l’hémicycle, deux journalistes de La Chaîne parlementaire Assemblée nationale (LCP) ont été agressés et leur matériel a été détérioré. Quelques jours plus tard, à Rennes, des manifestants anti-mariage pour tous ont attaqué deux journalistes de Rennes TV. Le 26 mai, un journaliste de l’Agence France-Presse a été jeté à terre et roué de coups, en marge de la manifestation. Plus tard, des reporters du Petit Journal, qualifiés de collabos, ont reçu des coups de pied, des coups de poing et des cannettes. Je vous épargne d’autres cas d’espèces mais je les tiens à votre disposition.
Je vous ai cité les manifestations hostiles au barrage de Sivens ou au mariage pour tous, mais des actes semblables se sont produits en d’autres occasions : en février, en Haute-Normandie, lors de manifestations des salariés du port de Rouen ou du Havre ; en septembre, à Saint-Nazaire, après une manifestation « Mistral, gagnons ! » organisée par des partisans de la vente de navires Mistral à la Russie ; cet été, pendant les manifestations pro-Gaza et pro-israéliennes, Jacques Demarthon, photographe de l’AFP, a été violemment frappé dans le dos par un individu, au point d’avoir l’épaule fracturée et de rester en arrêt de travail pendant vingt et un jours.
Nous n’avons pas fait d’enquête exhaustive, mais nous avons organisé une table ronde avec des journalistes qui se sont dits préoccupés par le comportement des manifestants et non pas par celui des forces de l’ordre. Au risque de vous surprendre, je dois dire que le comportement des forces de l’ordre est considéré de manière favorable par les journalistes que nous avons rencontrés.
Il existe des textes internationaux sur ce que devrait être le comportement des forces de l’ordre à l’égard des journalistes durant les manifestations. Dans sa résolution 25/38, adoptée le 24 mars 2014, le Conseil des droits de l’homme des Nations unies exprime sa préoccupation face au nombre d’attaques visant les défenseurs des droits de l’homme et les journalistes dans le cadre de manifestations pacifiques. Il souligne « le rôle important que peut jouer la communication entre les manifestants, les forces de l’ordre et les autorités locales dans la bonne gestion des rassemblements. » Il appelle les États « à établir des mécanismes de communication appropriés » et il leur demande « d’accorder une attention particulière à la protection des journalistes et des professionnels des médias qui couvrent les manifestations pacifiques, en tenant compte de leur rôle spécifique, de leur exposition et de leur vulnérabilité. »
Un texte comme celui-là affirme que les forces de l’ordre doivent protéger les journalistes et ne pas se contenter de s’abstenir de commettre des exactions à leur encontre. En outre, il engage les États « à assurer une formation adéquate aux membres des forces de l’ordre et, s’il y a lieu, à promouvoir la formation adéquate du personnel privé agissant pour le compte de l’État. » La France pourrait s’en inspirer.
La catégorie des journalistes ne comprend pas les seuls détenteurs de la carte de presse. Le journalisme est une fonction sociale. Dans son observation générale n° 34 sur la liberté d’expression, le Comité des droits de l’homme a eu l’occasion de rappeler que « le journalisme est une fonction exercée par des personnes de tous horizons, notamment des reporters et analystes professionnels à plein-temps ainsi que des blogueurs et autres particuliers qui publient eux-mêmes le produit de leur travail, sous forme imprimée, sur l’Internet ou d’autre manière. » Certes, dans une manifestation, il est difficile de repérer une fonction sociale et de distinguer certains manifestants de personnes exerçant une activité d’information.
Je voudrais attirer votre attention sur la Résolution 1947, adoptée en 2013 par l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, qui s’intitule « Manifestations et menaces pour la liberté de réunion, la liberté des médias et la liberté d'expression ». Elle appelle notamment les États « à assurer la liberté des médias, à mettre un terme au harcèlement et à l’arrestation des journalistes et à la perquisition de leurs locaux, et à s’abstenir d’infliger des sanctions aux médias qui couvrent les manifestations, conformément à la Résolution 1920, adoptée en 2013, sur l’état de la liberté des médias en Europe. »
Venons-en à la question du droit à l’image, source d’agacement des manifestants et des forces de l’ordre. Certains considèrent que les journalistes sont en dehors de leur champ de légitimité quand ils s’avisent de prendre des images. Nous contribuons à faire savoir à toutes les parties prenantes que la captation d’images est libre, et que seule la diffusion est soumise à des règles.
Il nous semble important que l’État soit particulièrement vigilant, s’agissant de la sécurité des journalistes et de la protection de la liberté d’information, dans le contexte des manifestations. Les forces de l’ordre doivent avoir conscience que, de nos jours, les journalistes se trouvent malheureusement en état de vulnérabilité quand ils font leur travail, quand ils exercent leur fonction de tiers de confiance consistant à rapporter au citoyen ce qui se passe dans une manifestation, le plus honnêtement possible.
Il nous semble essentiel que soient poursuivies en justice et jugées les personnes qui agressent des journalistes ou les empêchent de couvrir une manifestation. Nous proposons d’intégrer dans la législation un délit d’obstruction à la liberté d’information par une personne dépositaire de l’autorité publique, assorti de sanctions pénales. Cette mesure n’est pas prioritaire mais elle mérite d’être soumise à la réflexion pour prévenir de plus grandes dérives que celles constatées.
Nous proposons aussi d’intégrer dans les textes des dispositions relatives au secret des sources et à l’interdiction des réquisitions de matériel journalistique car, comme je l’ai indiqué précédemment, nous avons observé plusieurs cas de saisie de matériel, vidéo ou autre. J’espère que le vide juridique sera comblé à la faveur de l’adoption de la loi sur le secret des sources, puisque le Président de la République a annoncé le réveil de ce texte endormi depuis un an.
Nous pensons aussi qu’il serait pertinent d’assurer une formation adéquate aux agents des forces de l’ordre : le droit à l’image devrait être au programme des écoles de police.
Enfin, il faut reconnaître que le droit à l’information n’est pas conditionné à la détention d’une carte de presse ou d’une accréditation. Des blogueurs, des citoyens et des documentaristes peuvent exercer régulièrement l’activité de journaliste sans avoir la carte de presse. Celle-ci n’a pas à devenir un visa pour pouvoir couvrir les manifestations.
M. Pascal Popelin, rapporteur. Vous avez évoqué des opérations de police, menées dans le cadre d’une évacuation d’un squat ou d’une action du DAL, qui n’entrent pas dans le champ de cette commission travaillant sur le maintien de l’ordre. S’agissant de l’usage du flash-ball, qui n’est pas employé par les unités mobiles, nous allons devoir clarifier les choses : d’autres forces que ces unités spécifiquement dédiées au maintien de l’ordre sont-elles intervenues lors de manifestations ou y a-t-il une confusion ?
Nonobstant quelques cas particuliers que vous avez cités, il semble que ce ne sont pas des gendarmes mobiles mais des manifestants qui empêchent parfois les journalistes de faire leur travail. Avez-vous, au cours des dernières années, constaté une évolution des formes de manifestations et des comportements des uns et des autres ? Les nouvelles formes de protestation, comme les occupations dans la durée, posent-elles des problèmes particuliers aux journalistes ?
Y a-t-il des échanges en amont avec les forces de l’ordre, au moment de l’organisation d’un reportage ? Si oui, des consignes particulières sont-elles données ? Les forces de l’ordre assurent-elles la protection des journalistes ? J’ai cru percevoir une demande de cette nature, au cours de votre exposé. Quelle forme peut-elle prendre, dans une démocratie où les médias sont libres ?
De leur côté, les forces de l’ordre ne considèrent-elles pas la présence des médias comme une forme de protection pour elles-mêmes puisque les images interdiront de raconter n’importe quoi sur leur intervention ? Demande-t-on parfois aux journalistes de fournir leurs images dans le cadre de procédures ?
M. Christophe Deloire, directeur général de Reporters sans frontières France. Mes réponses ne sont pas liées à l’actualité, au fait qu’on a vu des manifestants crier « Je suis Charlie ! Je suis policier ! » Ces dernières années, les journalistes nous ont signalé que les forces de l’ordre avaient un comportement beaucoup plus favorable à leur égard, contrairement à certains manifestants.
S’agissant de la protection par les forces de l’ordre, il ne faudrait pas que le remède aggrave le mal. Comme les journalistes sont pris à partie, certains se retrouvent du côté des forces de l’ordre, ce qui peut renforcer l’acrimonie des manifestants et entraîner en retour des crachats et des insultes, quand ce n’est pas des violences physiques. Il ne faudrait pas que cette protection trouble davantage la perception que certains manifestants ont du rôle et de l’indépendance des journalistes.
Nous avons interrogé Olivier Pouchin, le chef de la délégation des CRS de l’agglomération parisienne, qui souligne l’importance de la communication entre les journalistes qui couvrent les manifestations et les CRS. Si les journalistes ont signalé leur présence, les CRS pourront intervenir plus facilement en cas d’affrontements violents. Et il arrive que les forces de l’ordre viennent activement défendre des reporters en situation délicate, selon le commissaire. Pour être complet, il précise qu’en certaines occasions, les journalistes ont pu perturber les manœuvres de ses hommes, notamment en se retrouvant entre les CRS et les manifestants.
Olivier Pouchin assure aussi que les CRS ne sont pas hostiles au fait d’être filmés par des journalistes – ce dont on peut douter pour certains d’entre eux. D’autres pourront se dire que les images permettront, le cas échéant, de démentir des allégations fallacieuses d’exactions commises par les forces de l’ordre à l’encontre des manifestants.
L’AFP a initié un groupe de travail sur la sécurité des journalistes, auquel participent toutes les grandes rédactions de France, mais dont les préconisations n’ont pas vocation à être publiées. Les premiers échanges ont porté sur les problèmes de sécurité posés par la couverture de la coupe du monde de football à Rio, mais il me semble qu’un travail est aussi effectué sur les dangers encourus lors de reportages sur des manifestations en France.
Mme Anne-Yvonne Le Dain. Il me semble que les conditions d’exercice du métier diffèrent beaucoup selon que le journaliste travaille pour la presse écrite, la radio ou la télévision, du fait qu’il ne se trimbalera pas avec le même matériel et avec le même nombre de gens. Par nature, le rapport au public et aux forces de l’ordre ne sera pas le même. Percevez-vous cette différence dans le comportement des journalistes ?
M. le président Noël Mamère. Notre rapporteur a soulevé la question du flash-ball. Les forces qui maintiennent l’ordre, par opposition à celles qui assurent la sécurité publique, n’utiliseraient pas de flash-ball. C’est un artifice de langage puisqu’elles sont dotées de « gomme cogne », des lanceurs de balles de défense en plastique qui entraînent des risques plus importants que les flash-ball.
De plus en plus souvent, les forces de l’ordre sont aussi dotées de caméras. Avez-vous reçu des témoignages de journalistes qui ont été amenés à confronter leur vérité à celle de la police ? À la lumière de votre intervention, il apparaît que les journalistes ont moins de soucis avec les forces de l’ordre qu’avec les manifestants. Au fil de nos travaux, je pense que nous allons réaliser que les problèmes – énucléations et autres accidents – se posent moins lors de grandes manifestations que lors d’opérations de sécurité publique. Les forces qui interviennent sont mieux formées dans un cas que dans l’autre.
S’agissant du secret des sources, vous avez en face de vous un député qui a travaillé avec ses collègues socialistes sur le projet de loi. Nous considérons qu’il ne va pas assez loin et c’est la raison pour laquelle il est en attente. En fait, si nous voulons vraiment protéger le secret des sources des journalistes, nous devons nous inspirer de la législation belge, la plus protectrice en la matière.
M. Philippe Folliot. Ma première question ne porte pas sur le maintien de l’ordre proprement dit, mais sur une opération médiatique conduite par des manifestants de Sivens, qui ne laisse pas de surprendre. La semaine dernière, des journalistes ont été invités – pour ne pas dire convoqués – à un point presse par des personnes masquées. Quand on parle à un individu masqué, on ne sait pas à qui l’on a affaire.
M. le président Noël Mamère. À des gens du FLNC, par exemple.
M. Philippe Folliot. Il y a d’autres cas, mais je prends l’exemple le plus récent. Non contents d’être masqués, ces individus ont demandé aux journalistes de présenter des pièces d’identité pour vérifier leurs noms et adresses, en leur expliquant que c’était un moyen de savoir où venir les chercher en cas de besoin, autrement dit si leurs écrits n’allaient pas dans le sens voulu. De telles pratiques sont graves ; elles dépassent les habituelles accusations – « les médias sont vendus à tel ou tel lobby » – qui circulent dans les blogs et autres. Une nouvelle limite a été franchie. Face à cela, je voulais vous faire part de mon émotion, en tant que citoyen, et aussi de l’inquiétude des journalistes concernés. S’ils cessent de couvrir des événements de ce type, cela pose le problème du droit à l’information de nos concitoyens. J’aimerais avoir votre réaction par rapport à cela.
M. le président Noël Mamère. Je voulais apporter une précision à notre collègue Philippe Folliot. Tout d’abord, les faits que vous évoquez ne sont pas une manifestation et les journalistes sont libres d’accepter ou de refuser les conditions qui leur sont posées. Ensuite, il serait judicieux que l’on se pose les mêmes questions lorsque des membres de la Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles (FNSEA) tombent à bras raccourcis sur des militants et qu’aucune explication ne leur est demandée, ou lorsqu’ils procèdent à des intimidations qui sont parfois beaucoup plus graves que celles dont vous parlez.
M. Daniel Vaillant. L’image joue un rôle très important dans l’interprétation que l’on peut avoir du succès et du déroulement d’une manifestation, des affrontements qui ont pu s’y produire, de l’attitude des forces de l’ordre et des manifestants. Notre commission qui enquête sur le maintien de l’ordre doit avant tout se préoccuper de la liberté de manifester. Or cette liberté implique aussi que les journalistes puissent faire leur travail sans risque.
Les manifestants sont-ils de plus en plus violents ? Sur ce point, les avis divergent. D’aucuns insistent sur une sorte de diversification des formes de violence et sur la difficulté que rencontrent les forces de l’ordre pour s’y adapter. Quant aux intimidations, elles doivent être, autant que faire se peut, interdites. Menacer un journaliste, c’est porter une grave atteinte à la liberté d’exercer cette profession indispensable.
Quand un journaliste couvre une manifestation, de quelque nature qu’elle soit, sera-t-il perçu de la même manière s’il travaille avec une caméra, un micro ou un simple stylo ? Par expérience, je pense que la caméra provoque de la répulsion chez certains manifestants.
Au cours de leur formation, les journalistes doivent-ils être amenés à s’interroger sur des limites à ne pas franchir dans l’exercice de leur métier, et sur la prise de risques ? Avez-vous travaillé à l’élaboration de règles qui seraient respectées par les journalistes professionnels, y compris pour les protéger ?
La liberté de manifester n’est pas différente de la liberté d’informer. Comme vous l’avez souligné, dans la France actuelle, les journalistes ont moins à craindre des forces de l’ordre que de certains manifestants. À cet égard, notons que les manifestants les plus à redouter ne sont pas ceux qui défilent en faveur de la laïcité ou de certaines catégories sociales, et que le danger vient davantage de formes spontanées, erratiques et parfois violentes de protestation. Pour certains, manifester c’est détruire. On retrouve ici la problématique de l’utilisation de l’image à des fins judiciaires.
M. Gwenegan Bui. Vous avez noté une montée de la radicalisation des manifestants, quel que soit leur engagement : opposants au mariage pour tous ou à la construction d’un barrage, syndicalistes agricoles, etc. Estimez-vous nécessaire d’inciter les journalistes à respecter certaines consignes – se regrouper, signaler leurs déplacements à leurs collègues ou autre – pour que la profession puisse assurer une certaine forme d’autoprotection ? Même si cela peut poser un problème au journaliste qui veut suivre sa propre idée, des consignes collectives sont-elles données ?
Les reporters ont la possibilité de se signaler aux forces de l’ordre avant le début d’une manifestation, nous avez-vous indiqué. Cette procédure doit-elle devenir systématique ? Dans ce cas, cela ne risque-t-il pas d’aller à l’encontre du métier même de journaliste car ce dernier doit pouvoir aller où il veut pour vérifier les informations qu’il donne à la population ?
Constatez-vous une différence d’intensité dans la violence qui s’exprime lors d’une manifestation et lors d’une occupation de locaux ou de sites ? Dans les « zones à défendre » (ZAD), sur des sites tels que celui de Notre-Dame-des-Landes, les tensions seraient plus vives car les relations avec les journalistes s’inscriraient dans la durée.
M. le président Noël Mamère. L’une des questions de Daniel Vaillant conduit à évoquer les journalistes qui n’ont pas de carte de presse, étant entendu que certains détenteurs de cette carte ne se comportent pas bien non plus. Constatez-vous un changement dans l’appréciation du risque par vos confrères, avec la montée en puissance des chaînes d’information en continu qui provoque une sorte de course à l’échalote pour le scoop ? Cette course peut d’ailleurs engendrer des actes condamnables : lors de la tragédie qui nous venons de vivre, certaines télévisions finissaient par indiquer aux preneurs d’otages où se trouvaient leurs otages.
M. Christophe Deloire, directeur général de Reporters sans frontières France. Deux questions portent sur les différences de réaction des manifestants selon qu’ils se trouvent face à tel ou tel média. Les journalistes les plus identifiés – plus le matériel est lourd, plus ils le sont –, et notamment les photographes, sont particulièrement visés.
Monsieur le président, vous m’interrogiez sur les images produites par la police. Le pluralisme ne revient pas à diffuser exactement la même durée d’images de chaque partie prenante, pour ne pas dire de camp. Dans une démocratie, les lignes éditoriales et les images sont variées. Cela étant, ne faisons pas de mauvaises prophéties auto réalisatrices. Il serait très regrettable que les images de la police puissent être un jour utilisées comme peuvent l’être celles de l’armée sur certains théâtres d’opérations extérieures. RSF dénonce le fait que l’armée empêche parfois des journalistes d’accéder à certains endroits et qu’elle aille ensuite proposer ses images dans les rédactions. C’est une dérive qui ne doit pas s’élargir au champ des manifestations.
Monsieur le rapporteur, j’ai oublié de vous répondre sur l’usage que les forces de l’ordre peuvent faire des images des journalistes, notamment dans le cadre d’une procédure judiciaire. Il peut y avoir des réquisitions judiciaires. Néanmoins, je considère extrêmement dangereux pour les journalistes que leurs images puissent être utilisées à des fins d’identification. Pour illustrer mon propos, je vais prendre un exemple qui n’a rien à voir avec les manifestations mais qui est néanmoins valide. Le fait que des journalistes aient témoigné devant le Tribunal pénal international – certains ont refusé et ont eu gain de cause – a changé l’image des médias dans les pays concernés : on leur a reproché de sortir de leur rôle de purs collecteurs et diffuseurs d’informations pour se mettre au service de la justice. Leur image d’indépendance s’en trouve atteinte, à une époque où la critique des médias n’a que trop tendance à se résumer dans le slogan : « policiers, magistrats, journalistes, même combat ! ». Chacun doit garder son rôle et il ne faut surtout pas ajouter au sentiment de confusion.
En matière de protection des sources, le président prône un alignement sur la loi belge. Pour sa part, RSF préconise qu’il ne puisse être fait exception à la protection des sources des journalistes que pour empêcher des faits à venir et non pas pour élucider des événements passés. Sinon, les journalistes devront se contenter de sources vêtues de lin blanc et de probité candide, et leur activité s’en trouvera sacrément réduite.
Sur les personnes masquées, il est très difficile pour moi de vous répondre. Les rédactions sont libres et il semble difficile d’élaborer une règle déontologique générale : les journalistes doivent pouvoir se rendre là où ils le souhaitent. En revanche, le carnage à Charlie Hebdo a renforcé la prise de conscience croissante dans les rédactions, même dans les chaînes d’information en continu que vous évoquiez, que la capacité à faire une image n’implique pas sa diffusion automatique. De l’extérieur, il faut faire la distinction entre le journalisme qui a une fonction sociale et la communication porteuse d’intérêts particuliers. À l’intérieur des rédactions, il ne faut pas se laisser instrumentaliser.
La question de la prise de risque est très à la mode au niveau international. Dans les instances onusiennes, des représentants des plus grands pays – y compris ceux qui briment affreusement les journalistes – s’y déclarent très sensibles. Certains médias favorisent-ils des prises de risque plus grandes ? Je suis incapable de vous répondre. En revanche, je perçois clairement que les dirigeants des rédactions et les journalistes s’en préoccupent beaucoup plus que par le passé, ce qui se traduit par la mise en place de procédures, l’acquisition de matériel, etc. Par ailleurs, la prise de risque n’est pas forcément liée au respect de règles d’éthique et de déontologie.
Les journalistes doivent-ils se regrouper pour être moins vulnérables ? Il serait dommageable – et même absurde – que les journalistes soient cantonnés sur une estrade. Leur rôle est de regarder sous différents angles. Il n’y a pas lieu, non plus, d’avoir des procédures d’accréditation – auprès de qui que ce soit – pour des manifestations publiques. Olivier Pouchin parlait de l’importance de la communication entre les journalistes qui couvrent les manifestations et les CRS. Cette communication doit se faire avec toutes les parties prenantes mais de manière informelle : tout caractère obligatoire aurait in fine des répercussions négatives car la sécurité peut toujours servir d’argument pour restreindre la liberté de l’information.
Certains journalistes, notamment les grands reporters qui partent dans des pays comme la Syrie ou l’Irak, suivent des stages organisés par l’armée et le Groupe d’intervention de la gendarmerie nationale (GIGN). Les groupes de médias se mettent aussi à créer des stages qui intègrent de plus en plus les problèmes liés à la couverture des manifestations en France.
M. Philippe Folliot. Monsieur le président, je voudrais faire une mise au point. Tout d’abord, Sivens et sa « zone à défendre » représentent une forme de manifestation permanente qui dure depuis plusieurs mois. Les journalistes y vont pour rendre compte de ce qu’il s’y passe. Ensuite, je trouve la comparaison avec la FNSEA totalement déplacée et inacceptable. On ne peut pas faire un parallèle entre ceux auxquels je faisais allusion et cette organisation. Je ne nie pas qu’il puisse y avoir des débordements pendant des manifestations organisées par la FNSEA ou d’autres mais, à ce jour, je n’ai jamais vu un de ses responsables arriver masqué à une conférence de presse et se livrer à des intimidations plus ou moins directes sur les journalistes qu’il aurait convoqués.
M. le président Noël Mamère. Nous n’allons pas entamer un débat politique car ce n’est pas l’objet de notre commission d’enquête parlementaire. Nous exerçons ici notre fonction de député ; nous ne sommes pas candidats à des élections cantonales.
Il y a d’autres lieux d’occupation que Sivens, je pense notamment à Notre-Dame-des-Landes, à la forêt de Roybon à côté de Grenoble, à la ville de Gonesse où des gens se battent contre un projet du groupe Auchan. Je ne sache pas que ceux qui occupent des terrains comme à Sivens ou à Notre-Dame-des-Landes se soient livrés à des dégradations de préfectures ou de mutuelles, du genre de celles dont pourrait témoigner notre collègue Bui, puisqu’il a même été pris en otage pendant quelques heures.
On utilise le jargon de « zadistes » pour mettre tout le monde dans le même sac. Or les « zadistes » sont aussi différents que les « Charlie » : certains sont violents, d’autres proposent des solutions très pacifiques. Et d’ailleurs, on peut être masqué sans être violent.
M. Philippe Folliot. En l’occurrence, c’était violent.
M. le président Noël Mamère. Nous sommes dans une commission d’enquête parlementaire sur le maintien de l’ordre et non pas en campagne électorale. Il est assez inconséquent de venir sur ce terrain-là.
M. Philippe Folliot. C’est vous, monsieur le président, qui m’y amenez.
M. le président Noël Mamère. Parce que vous avez évoqué des faits qui n’ont rien à voir avec les manifestations. Les occupations de longue durée et les manifestations ponctuelles posent-elles des problèmes différents en termes de maintien de l’ordre ? C’est sur ce thème que nous devons nous interroger, pas sur le fait de savoir si les gens sont cagoulés ou pas.
M. Pascal Popelin, rapporteur. Pour ma part, je considère cette commission comme un lieu de réflexion qui sied à notre fonction de législateur et de contrôleur de l’action de l’exécutif. Nous devons faire un état des lieux et réfléchir aux évolutions du droit qui pourraient se révéler nécessaires. Sans vouloir anticiper sur les conclusions du rapport, il me semble que si les modes de protestation évoluent, le cadre juridique doit s’adapter, ainsi que les effectifs et l’organisation des forces chargées d’assurer le maintien de l’ordre. Pour ma part, je ne fais pas de distinction entre un manifestant qui casse une sous-préfecture et un autre qui occupe de manière illicite tel ou tel lieu : quand la loi n’est pas respectée, il doit y avoir une réponse proportionnée et adaptée de la part de l’autorité républicaine. Il nous revient de nous interroger sur la pertinence des réponses juridiques et sur la manière dont elles sont appliquées.
M. le président Noël Mamère. Nous vous remercions de votre témoignage.
Audition, ouverte à la presse, de M. Ben LEFETEY, porte-parole
du Collectif pour la sauvegarde de la zone humide du Testet
Compte rendu de l’audition du jeudi 29 janvier 2015
M. le président Noël Mamère. Nous accueillons M. Ben Lefetey, que je remercie d’avoir bien voulu répondre à notre invitation.
Notre commission d’enquête s’intéresse au maintien de l’ordre républicain ; elle ne porte en aucun cas sur les événements survenus à Sivens, qui font l’objet d’une information judiciaire en cours, dans laquelle les parlementaires ne sont pas autorisés à s’ingérer.
Avant de vous entendre, conformément aux dispositions de l’article 6 de l’ordonnance du 17 novembre 1958, je dois vous demander de prêter le serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité.
(M. Ben Lefetey prête serment)
M. Ben Lefetey, porte-parole du Collectif pour la sauvegarde de la zone humide du Testet. Je précise d’entrée que je ne suis guère spécialiste de la question du maintien de l’ordre en France, mais que c’est au titre de témoin des événements survenus à Sivens – j’exclus ici la mort de Rémi Fraisse – que je peux témoigner ce matin devant vous.
Le collectif que je représente a été créé par des associations de protection de l’environnement, des agriculteurs biologiques et altermondialistes en 2011, pour défendre la zone humide du Testet, menacée par le projet de barrage de Sivens. Partisans de modes d’action légalistes, nous avons, dès que nous avons eu connaissance de ce projet, sollicité auprès du conseil général du Tarn concertation, transparence et dialogue, toutes choses qui nous ont été refusées.
Comme la plupart des associations loi de 1901, notre collectif s’efforce de contribuer au dialogue public et milite en faveur d’une bonne utilisation des fonds publics. Dans cette perspective, il a, à partir des éléments dont il disposait, organisé des réunions publiques, des manifestations et des stands d’information. Aucune de ces actions n’a jamais occasionné de troubles à l’ordre public et nous n’avons jamais été confrontés aux forces de l’ordre jusqu’à fin 2013, date où s’est achevée la procédure administrative concernant le projet de barrage.
En octobre 2013, malgré les nombreux avis défavorables émanant de scientifiques, des services de l’État chargés de l’eau, de la Fédération pour la pêche et la protection des milieux aquatiques, malgré les réserves émises par la commission d’enquête publique et malgré, enfin, notre contre-expertise citoyenne montrant que ce projet était surdimensionné et non finançable par l’Europe, l’État, contre toute attente, a donné son feu vert au projet.
Notre collectif a donc déposé plusieurs recours devant les tribunaux. Estimant néanmoins que ces recours ne permettraient pas d’empêcher l’irréversible, c’est-à-dire la destruction de la zone humide du Testet, certaines personnes – adhérents individuels des associations que nous représentons ou n’en étant pas membres – ont décidé de mener leurs propres actions. Ils étaient fondés à agir ainsi, dans la mesure où, à plusieurs reprises, notamment dans le Sud-ouest, les associations ayant déposé des recours devant les tribunaux ont finalement obtenu gain de cause mais trop tard : les ouvrages avaient déjà été réalisés, inaugurés, et ne pouvaient être détruits puisqu’ils avaient été financés sur des fonds publics.
Ces personnes ont donc décidé d’occuper le chantier, afin d’obliger les porteurs du projet à attendre la fin du recours, comme l’a fait le Gouvernement à Notre-Dame-des-Landes, Jean-Marc Ayrault ayant, à l’époque, déclaré dans les médias qu’il était normal, dans un État de droit, d’attendre la fin des recours avant de démarrer les travaux. Nous souhaitions donc l’application de la même règle dans le Tarn, qui nous semble faire partie du même État de droit que la Loire-Atlantique. Cela étant, notre collectif n’a jamais appelé à occuper le terrain, se bornant à l’organisation de manifestations sur la voie publique en vue d’obtenir un débat public.
C’est à partir de ces mouvements d’occupation, en novembre 2013, que les forces de l’ordre ont commencé à intervenir. Je peux, dès lors, vous apporter mon éclairage sur certains faits graves dont j’ai été le témoin direct ou qui m’ont été rapportés, et dont il existe des images enregistrées, qui ont généralement été diffusées sur Internet. Il faut, en premier lieu, distinguer entre ce qui relève de l’attitude individuelle des agents des forces de l’ordre et ce qui relève de la responsabilité politique de leur intervention.
J’ai observé que, dans leur majorité, les forces de l’ordre se comportent de manière proportionnée et adaptée à la situation, essayant même parfois d’instaurer un dialogue et d’apaiser les tensions. Cela a notamment été le cas des gendarmes locaux qui constituaient à Sivens, le gros des troupes d’intervention et dont l’attitude a, le plus souvent, été correcte. En revanche, une minorité de ces forces de l’ordre a tendance à s’écarter des règles à respecter, à faire du zèle et à utiliser la force de manière disproportionnée, ce qui a des conséquences directes mais contribue également à une forme d’escalade de la violence.
En ce qui concerne la responsabilité politique, les consignes d’extrême fermeté peuvent, dans certaines situations, avoir des conséquences dramatiques et, selon moi, inacceptables dans une démocratie comme la France, lorsqu’il s’agit d’une invalidité permanente ou de la perte d’un œil consécutives à un tir de flash-ball. Cela n’a pas été le cas à Sivens, où, si l’on a eu à déplorer de nombreux blessés par flash-ball, personne, à ma connaissance, n’a été touché au visage, mais où ce sont ces mêmes consignes qui ont entraîné la mort de Rémi Fraisse.
Que les manifestations soient déclarées ou non, l’attitude des forces de l’ordre entraîne toujours des blessés : en février 2013, lors d’une manifestation déclarée, à Strasbourg, un syndicaliste belge a perdu l’usage de son œil après avoir été touché par un flash-ball ; en décembre 2013, lors d’une manifestation de sapeurs-pompiers à Grenoble, un pompier a été touché au visage par un flash-ball ; en février 2014, trois manifestants contre l’aéroport de Notre-Dame-des-Landes ont également perdu un œil.
À Sivens, nous étions dans le cas d’une action non déclarée, les opposants au projet ayant décidé d’occuper le terrain suite au refus d’ouvrir un débat public que leur opposait depuis un an le conseil général du Tarn et alors même qu’une grève de la faim – action non violente par excellence – ne leur avait pas permis d’obtenir de réponses à des questions aussi essentielles que le coût du projet pour le contribuable, en financement et en fonctionnement, ou le nombre de bénéficiaires. Cette occupation a motivé le durcissement des interventions des forces de l’ordre à partir de septembre 2014. Une avocate a élaboré, à partir des plaintes qu’elle a reçues, une synthèse destinée à la Ligue des droits de l’homme qui dénonce, entre autres, un usage disproportionné et démesuré de lanceurs de balle de défense et de grenades de désencerclement, des insultes nombreuses, fréquentes et systématiques, une utilisation fréquente et disproportionnée du tonfa et de la matraque, l’usage d’armes en dehors du but à atteindre et des missions à encadrer, des interpellations violentes constitutives d’un traitement inhumain et dégradant, des violations de domicile, des vols d’affaires personnelles, des destructions de lieux de vie.
Pour ma part, j’ai pu observer, tout au long du mois d’octobre, l’attitude disproportionnée du Peloton de surveillance et d’intervention de la gendarmerie, le PSIG de Gaillac, qui a souvent dépassé le cadre dans lequel il devait travailler, notamment en brûlant des effets personnels appartenant aux manifestants ou en frappant à coups de pied des gens, déjà au sol et maîtrisés par des gendarmes mobiles. Le PSIG est impliqué dans l’affaire de la grenade lancée sur une caravane, dans laquelle l’Inspection générale de la gendarmerie nationale (IGGN) a considéré que « le sous-officier a commis une faute d’appréciation qui doit être sanctionnée au plan professionnel ». Mentionnons enfin la charge menée contre cinq manifestants enterrés jusqu’aux épaules sur la piste : une femme, piétinée, a perdu connaissance et a dû être transférée aux urgences par les pompiers. Il y a donc clairement un problème de comportement des forces de l’ordre, qui ont agi de manière disproportionnée par rapport aux gens qu’elles avaient en face d’eux.
J’insiste enfin sur la différence de comportement des forces de l’ordre selon qui manifeste. J’illustrerai mon propos par quelques exemples. Le 30 septembre 2013, à Saint-Pourçain-sur-Sioule, des membres de la FNSEA ont répandu de la paille dans les locaux de l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques (ONEMA), puis déversé du fumier devant le bâtiment, pourtant situé en face de la gendarmerie – une photo montre d’ailleurs un gendarme assistant, immobile, à la scène. Le 22 septembre 2013, une action du même genre est organisée dans le parc du Morvan, avec des dégâts bien pires mais sans aucune intervention des forces de l’ordre, pas plus qu’elles ne sont intervenues lors de récentes manifestations à Montauban ou à Albi, où 800 tonnes de fumier ont été nuitamment déversées dans la ville.
Pour en revenir à Sivens, le 18 décembre dernier, des membres de la FDSEA montés sur des tracteurs ont organisé une action « manche de pioche » et sont venus passer un « coucou franc » aux occupants de la zone. Fort heureusement, l’État avait décidé de leur interdire l’accès au site, autour duquel les forces de l’ordre avaient reçu mission de former un cordon de sécurité. Du coup, les agriculteurs se sont défoulés sur les journalistes présents, les ont molestés et ont cassé un appareil photo, sans être inquiétés par les gendarmes, qui se sont contentés d’inviter les journalistes à passer derrière le cordon de sécurité.
Le 19 janvier, les agriculteurs sont revenus attaquer les occupants, dont l’action n’était pas totalement illégitime, puisque l’État avait reconnu que leurs arguments étaient valables. Les forces de l’ordre ont, pourtant, choisi de tourner le dos aux agriculteurs pour faire face aux occupants, comme si ces derniers étaient les agresseurs.
J’ai moi-même été agressé en septembre par un partisan du barrage, au cours d’une manifestation. Lorsque l’un des gendarmes motorisés qui accompagnaient le convoi d’engins de chantier s’est approché, mon agresseur, qui me tenait par le petit doigt et venait de me le casser, m’a relâché, mais le gendarme – à qui j’ai demandé de l’aide – s’est contenté de me répondre que je n’avais que ce que je méritais puisque j’empêchais les familles en week-end de rentrer chez elles.
Il y a donc des dysfonctionnements qu’il convient de résoudre. Sans être spécialiste, il me paraît évident qu’il faut interdire les grenades et les flash-balls. Il est inacceptable qu’en France, quelqu’un qui défend l’intérêt général et l’application des lois protégeant l’environnement puisse être victime d’un tir de flash-ball. J’irai plus loin : il est tout aussi inacceptable que, dans un pays comme le nôtre, quelqu’un qui détruit un abribus soit sanctionné par une blessure grave. Autant je considère qu’il est normal qu’un casseur soit interpellé, jugé et sanctionné, autant je juge la perte d’un œil une sanction disproportionnée.
M. Pascal Popelin, rapporteur. Vous avez évoqué un certain nombre de faits relatifs au comportement des forces de l’ordre, sans mentionner que celles-ci étaient parfois confrontées à des formes d’extrême violence et devaient essuyer des jets de pierre, d’acide ou de cocktail Molotov. Cela correspond-il, selon vous, à la réalité ? Comment l’expliquez-vous et considérez-vous que c’est acceptable ?
Le processus de mobilisation que vous décrivez met en lumière le durcissement d’une action, à l’origine parfaitement pacifique. Cela laisse supposer la présence, parmi les opposants, de gens aux motivations diverses. Y a-t-il un moyen de gérer les éléments considérés comme les plus radicaux et les plus violents ? Peut-on évaluer la proportion de ces éléments radicaux parmi les manifestants ? Certains considèrent que quelques-uns ces éléments radicaux se déplacent de théâtre en théâtre sur tout le territoire. Est-ce plausible ?
M. le président Noël Mamère. Le PSIG est un peloton de gendarmes qui ne sont pas formés au Centre national d’entraînement des forces de gendarmerie de Saint-Astier. Ils ne sont donc pas formés au maintien de l’ordre et à l’application de la doctrine française fondée non pas sur l’affrontement mais sur la mise à distance. Cela explique peut-être certains des faits que vous nous avez rapportés.
Deux préfets ont successivement été chargés des questions d’ordre public à Sivens. Comment avez-vous travaillé avec eux ? Une réunion à laquelle nous avons participé tous les deux, le 21 octobre 2014, me laisse penser qu’entre les services de la préfecture et votre collectif, l’ambiance n’était pas vraiment à la collaboration, ce qui aurait pourtant permis d’éviter un certain nombre d’événements, y compris les plus tragiques.
Pourriez-vous nous en dire davantage sur la difficulté que peut avoir un collectif comme le vôtre à gérer des éléments violents ?
M. Gwenegan Bui. Notre commission d’enquête ne porte pas sur les flash-balls, et il ne s’agit pas pour nous de nous focaliser sur les moyens dont disposent les forces de l’ordre mais sur le cadre dans lequel elles interviennent et sur les conditions requises pour que les citoyens, quels qu’ils soient, puissent manifester en toute sécurité.
La violence n’est jamais à sens unique. On assiste souvent à une radicalisation des mouvements de protestation et à une montée de la violence chez les manifestants. Cela nous a été signalé par des journalistes, qui ont de plus en plus de mal à couvrir ces manifestations, étant eux-mêmes pris pour cible par les éléments les plus radicaux.
L’occupation d’un lieu nécessite toujours un minimum d’organisation, si l’on entend s’installer dans un rapport de force durable avec l’État ou des tiers. On met en place des services d’ordre pour canaliser les débordements et empêcher le message d’être pollué par la radicalisation du mouvement. Que pouvez-vous nous dire, au regard de votre expérience, des capacités de régulation interne des mouvements comme le vôtre ? Êtes-vous en mesure - même s’il ne s’agit pas, à proprement parler, de manifestations organisées – de prévoir le début et la fin des opérations ? Qu’en est-il de votre aptitude à négocier non seulement avec les services préfectoraux mais également avec les forces de l’ordre sur le terrain pour faire baisser la pression ?
M. Philippe Folliot. Votre présentation des faits me semble quelque peu univoque, ce qui ne m’empêche pas de vous reconnaître toute légitimité pour contester un projet que vous jugez mal mené : je respecte votre droit à manifester et à vous y opposer par les voies de droit. Pourriez-vous, à ce sujet, nous préciser ce qu’il en est des recours que vous avez formés devant les tribunaux et dans quel sens, le cas échéant, la justice les a-t-elle tranchés ?
Vous dites n’avoir jamais appelé à occuper la zone de Sivens, mais quels sont vos liens avec les personnes qui mènent sur le site des actions parfaitement illégales ?
Vous avez admis, dans un premier temps, que la majorité des forces de l’ordre avait eu une attitude correcte, avant de dérouler une litanie de faits, dont certains mettant très directement en cause le PSIG de Gaillac. Or, comme cela vient d’être dit, la violence n’est pas unilatérale. Elle s’inscrit, chez les forces de l’ordre, dans un schéma de réponse à la violence adverse, dont vous n’avez pas du tout parlé.
Vous plaidez pour l’interdiction des grenades, flash-balls, etc., mais quels moyens préconisez-vous pour permettre aux forces de l’ordre de contenir l’extrême violence à laquelle elles sont confrontées sur bien des théâtres de manifestation, et en particulier à Sivens ? Quelles consignes doivent être données ? Quelle attitude leur faut-il adopter ? Comment faire face à des personnes déterminées et ultraviolentes qui usent d’un type de cocktails Molotov similaires à ceux qu’utilisaient les militants de l’IRA en Irlande du Nord, mais qui n’avaient jusqu’à présent jamais été utilisés en France ?
Je voudrais enfin votre sentiment sur la décision à l’origine des faits survenus à Sivens. Ne considérez-vous pas légitime un projet porté par des élus – président du conseil général en tête – qui ont reçu mandat du suffrage universel pour défendre l’intérêt général ?
M. Daniel Vaillant. Vous n’aimez pas la violence, vous la condamnez, tentez de la prévenir et avez évoqué les différentes voies de recours dont vous avez usé. Or, je n’avais, pour ma part, jamais entendu parler du dossier du barrage de Sivens avant les événements tragiques et regrettables que l’on sait. Au-delà des représentants des pouvoirs publics qui refusaient le dialogue, avez-vous saisi d’autres parlementaires, afin qu’ils relaient votre position ? On ne peut évidemment contester la légitimité des élus, mais il est normal que des citoyens puissent contester un projet, et le mieux pour cela est que leur action soit portée à la connaissance de tous. Or il semble que cette affaire nous soit apparue au moment où il était trop tard.
Concernant les faits eux-mêmes, avez-vous eu conscience des débordements dont se rendaient coupables, à un moment donné, des personnes – militants ou agitateurs – extérieures à votre collectif ?
Il y a aussi eu des blessés parmi les forces de l’ordre, et, je le redis, la violence n’est pas à sens unique, comme semblaient l’induire vos propos. J’ai apprécié que vous ayez d’ailleurs précisé qu’au départ les forces de maintien de l’ordre, à l’exception peut-être du PSIG de Gaillac, avaient manifesté leur refus d’user de la violence. Il faut, face à la provocation, faire preuve de discernement. Cela vaut certes pour les forces de l’ordre, mais cela vaut tout autant pour les manifestants, qui doivent rester en alerte et se désolidariser des éléments les plus violents.
M. le président Noël Mamère. Je répondrai à Daniel Vaillant que le projet de Notre-Dame-des-Landes remonte à près de cinquante ans, mais qu’il a fallu attendre les manifestations qui ont eu lieu il y a deux ans pour que l’opinion publique et les responsables politiques s’en préoccupent. Pour ce qui concerne le barrage de Sivens, des élus – et non des moindres : je pense à Gérard Onesta, vice-président du conseil régional de Midi-Pyrenées – s’opposent depuis l’origine au projet, au côté des associations. Sans doute est-ce les médias qui n’ont pas fait leur travail.
Philippe Folliot devrait être plus prudent lorsqu’il parle d’illégalité, car celle-ci n’est pas toujours du côté que l’on croit, puisque le projet du barrage de Sivens a, d’une certaine façon, été déclaré illégal par la Commission européenne, qui lui a retiré ses subventions au motif qu’il portait atteinte à la zone humide. Par ailleurs, je rappelle que notre commission d’enquête n’a pas pour objet de déterminer si certaines décisions politiques sont légitimes ou non.
J’ajoute que M. Lefetey n’a jamais plaidé, comme le prétend Philippe Folliot, pour « l’interdiction des grenades, flash-balls, etc. » Il n’a pas dit « etc. ». Il a, comme certains d’entre nous, dénoncé l’usage des grenades, ce qu’a d’ailleurs décidé le ministre de l’Intérieur. Il s’est aussi opposé à l’usage des flash-balls, comme votre serviteur qui, sous la précédente législature, avait demandé la création d’une commission d’enquête sur l’interdiction des flash-balls et des tasers par les forces de l’ordre.
Ma question suivante a directement trait au maintien de l’ordre. Lorsqu’a eu lieu l’accident dramatique que l’on sait, dans la nuit du samedi au dimanche 26 octobre, 65 membres des forces de l’ordre faisaient face à 150 manifestants. Le préfet savait depuis le vendredi qu’il y avait eu des exactions et des violences et, contrairement a ce qui a été prétendu, le ministre de l’Intérieur, avait donné des consignes d’apaisement. Peut-on considérer que l’on répond à des consignes d’apaisement en envoyant 65 gardes mobiles contre 150 manifestants ? L’intérêt n’aurait-il pas commandé de ne pas être présent, d’autant qu’il s’agissait d’un terrain privé ? Cela pose la question de la responsabilité des gendarmes. Le lieutenant-colonel Rénier et le lieutenant-colonel Andréani, qui n’étaient pas sur le terrain mais donnaient les ordres, ne sont-ils pas sortis du cadre défini par le préfet, lequel maintient, dans un entretien accordé à La Dépêche du Midi, qu’il n’a jamais donné de consignes de fermeté ?
M. Philippe Folliot. Nous sortons, nous, du cadre de notre commission d’enquête !
M. le président Noël Mamère. Il s’agit de maintien de l’ordre, ce qui est exactement au cœur de notre commission d’enquête !
M. Philippe Folliot. Vous menez une contre-enquête, ce qui est clairement interdit par notre règlement !
M. le président Noël Mamère. Il ne s’agit aucunement d’une contre-enquête ! Vos questions, en revanche, n’ont rien à voir avec le maintien de l’ordre mais procèdent d’un procès en règle contre les zadistes.
M. Ben Lefetey. En ce qui concerne l’escalade de la violence, notre position est claire, comme en témoigne notre communication sur le site Internet du collectif : nous avons toujours dénoncé la violence, que ce soit lors des manifestations sur le chantier ou lors de celles qui ont eu lieu en novembre, à Toulouse ou à Albi.
Le premier acte de violence survenu sur le barrage de Sivens a été le fait de gens favorables au barrage, qui, en janvier 2014, sont venus à une vingtaine, en partie cagoulés, saccager la ferme occupée par trois ou quatre opposants non-violents. Le conseil général, propriétaire de la ferme, a porté plainte, mais il ne semble pas que l’instruction ait été menée avec suffisamment de fermeté pour que l’on retrouve les coupables, qui habitent pourtant la région et dont certains se sont vantés de ce qu’ils avaient fait.
Quant au premier acte de violence imputable aux forces de l’ordre, il remonte au 27 février 2014, lors de la première expulsion à laquelle elles ont procédé, sur une parcelle du conseil général occupée par cinq à dix manifestants pacifiques.
M. Philippe Folliot. Cette occupation était-elle légale ?
M. Ben Lefetey. Non, elle était illégale.
M. le rapporteur. Les forces de l’ordre exécutaient-elles une décision de justice ?
M. Ben Lefetey. J’y viens. Cette expulsion d’une parcelle occupée illégalement, à laquelle j’ai assisté en tant qu’observateur, s’est dans un premier temps déroulée de manière normale, les forces de l’ordre agissant, a priori sur la base d’une décision de justice et donc en présence du directeur du cabinet du préfet et d’un membre du conseil général, de manière correcte et proportionnée. S’en est suivi un face-à-face entre forces de l’ordre et manifestants, ces derniers évidemment mécontents mais ne s’en prenant pas aux gendarmes. C’est alors qu’un manifestant a franchi le cordon des forces de l’ordre pour grimper sur un tas de débris. Il était seul, les bras ballants, et la logique aurait voulu que les gendarmes viennent le chercher pour le ramener sur la voie publique : il n’aurait opposé aucune résistance, et tout serait rentré dans l’ordre. Au lieu de cela, un membre du PSIG – le même que celui qui avait jeté la grenade dans une caravane – est arrivé en courant, l’a saisi par le bras, l’a fait tomber en arrière, risquant de le blesser grièvement sur les débris tranchants, avant de le traîner sur le sol. Cela a évidemment suscité la colère des autres manifestants, qui ont débordé le cordon de gendarmes pour porter secours à leur camarade et ont commencé à escalader les pelleteuses. Les images de la scène montrent alors des membres du PSIG et des forces de l’ordre en civil s’en prendre violemment aux manifestants grimpés sur les pelleteuses, au risque de les blesser, tandis qu’un gendarme en civil de la gendarmerie de Gaillac – je peux en témoigner, car c’est le même qui a saisi ma déposition sur la mort de Rémi Fraisse – jetait les manifestants sur les débris. Des gaz lacrymogènes ont enfin été lancés pour évacuer tout le monde.
Voilà comment s’enclenche la spirale de la violence car, lorsque ces images sont diffusées sur Internet, elles attirent d’autres manifestants sur les lieux, dont certains forts de leur expérience à Notre-Dame-des-Landes. Début mars, une cinquantaine de personnes sont ainsi arrivées en renfort pour organiser la défense de la zone humide, en y installant des barricades. Encore une fois, les gendarmes, dans leur grande majorité ne sont pas en cause, et l’on voit sur les images le commandant rappeler à l’ordre le membre du PSIG ayant fait preuve de brutalité. Quoi qu’il en soit, cette expulsion, qui signe le premier acte de violence des forces de l’ordre, a été annulée par la Cour d’appel de Toulouse, qui l’a jugée illégale.
En ce qui concerne la position des élus et sa légitimité, je voudrais rappeler qu’à l’automne 2013, avant que l’État n’autorise le projet de barrage, nous avons adressé un courrier aux deux ministres concernés, avec copie aux députés et sénateurs du Tarn, aux préfets du Tarn et du Tarn-et-Garonne, au préfet de région, au président du conseil régional, aux présidents des conseils généraux du Tarn et du Tarn-et-Garonne, à l’ensemble des conseillers généraux ainsi qu’au maire de Lisle sur Tarn. Ce courrier reprenait les conclusions de notre contre-rapport ainsi que l’ensemble des avis défavorables montrant que le projet était surdimensionné.
Il aura malheureusement fallu attendre un an pour que cette alerte soit enfin entendue par les pouvoirs publics, après que les experts du ministère ont procédé aux mêmes analyses que nous et abouti aux mêmes constats, tout comme la Commission européenne, qui a jugé le projet illégal au regard du droit européen et non éligible aux financements européens. Aujourd’hui, la pertinence du projet est enfin reconsidérée, mais il aura fallu, pour en arriver là et malgré tous nos efforts pour convaincre les pouvoirs publics, en passer par le saccage de la zone humide, un mort et plusieurs blessés, y compris parmi les forces de l’ordre. Cela aurait pu être évité, si les pouvoirs publics, au lieu de vouloir passer en force, avaient tenu compte de nos alertes. Nous considérons que les élus du conseil général n’ont pas défendu l’intérêt général en agissant comme ils l’ont fait et que les citoyens avaient raison d’essayer de sauver 15 à 20 millions d’euros et une zone humide d’importance départementale.
Par ailleurs, en marge de l’attitude disproportionnée des forces de l’ordre qui provoque l’arrivée sur le terrain de gens décidés à en découdre avec elles de façon plus musclée, enclenchant la spirale de la violence, il faut également s’interroger sur le rôle de la presse. En effet, certains font délibérément monter la tension, estimant que c’est le seul moyen d’attirer l’attention des journalistes sur leur combat. Je demande aux médias et aux responsables politiques s’il est normal que, lorsque la FNSEA se livre en guise de protestation à des dégradations, elle soit généralement reçue aussitôt à la préfecture et obtienne du Gouvernement qu’il recule, tandis que, lorsque la Confédération paysanne organise une marche de plusieurs jours entre la Marne et Bruxelles, elle ne bénéficie d’aucune couverture médiatique et ne dispose d’aucun moyen de pression pour faire plier le Gouvernement ?
Les gendarmes ont parlé de jets d’acide. Cela me laisse très circonspect car je n’ai pour ma part jamais eu connaissance de telles pratiques chez les manifestants. L’acide entraîne dégâts et blessures, or rien n’a jamais été constaté de tel. Photographier une bouteille d’acide posée au sol n’est pas la preuve qu’elle a été utilisée, et il faut se méfier de certaines manipulations qui visent à discréditer les manifestants aux yeux de l’opinion publique.
Il y a bien eu en revanche des tirs de cocktails Molotov lors de la manifestation des 25 et 26 octobre – les images en témoignent. Avant cette date, des cocktails Molotov ont également été lancés sur les barricades pour les enflammer et ralentir les forces de l’ordre mais, à ma connaissance, ils ne visaient pas directement ces dernières.
On sait que les éléments radicaux qui infiltrent une manifestation le font pour des raisons qui leur sont propres, et l’on peut fort bien imaginer – mais je n’ai aucune preuve de ce que j’avance – qu’en l’occurrence ils aient été téléguidés par l’extrême droite, voire par l’État lui-même, pour ternir l’image de notre combat.
Quoi qu’il en soit, nous nous étions concertés, avant la manifestation du 25 octobre, avec la préfecture du Tarn, car la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) s’inquiétait en effet de la présence d’éléments radicalisés parmi les manifestants. Nous nous étions engagés à assurer le service d’ordre de notre manifestation, laquelle devait se dérouler à 1,5 kilomètre du chantier, et avions obtenu que, de son côté, la préfecture évacue les engins présents sur le chantier, afin d’éviter que d’éventuels agitateurs s’en emparent. Un groupe électrogène et un Algeco laissés sur place ont malheureusement été incendiés mais, alors qu’il ne restait plus rien à défendre sur ce chantier, était-il raisonnable d’y laisser des vigiles pouvant servir de cible ? Que les consignes aient été données par Bernard Cazeneuve ou par Matignon, fallait-il, le samedi matin, laisser les forces de l’ordre postées sur le terrain ? Le plus grave, ainsi que je l’ai déclaré lors de mon audition dans le cadre de l’instruction judiciaire sur la mort de Rémi Fraisse, est d’avoir laissé les gendarmes face aux manifestants pendant la nuit. Il faut juridiquement quarante-huit heures pour que les occupants illégaux d’un terrain soient protégés d’une expulsion, donc, si les forces de l’ordre avaient quitté le chantier le samedi avant la tombée de la nuit, il aurait été parfaitement loisible aux pouvoirs publics de procéder à l’expulsion des occupants le lundi matin, pour que les travaux puissent redémarrer. Je m’interroge donc sur cette décision d’avoir laissé en place les forces de l’ordre, au risque d’affrontements nocturnes. Quel sens y a-t-il à procéder à des tirs de flash-ball ou de grenade en pleine nuit ?
M. le rapporteur. Il y a eu des tirs de flash-ball ?
M. Ben Lefetey. Bien sûr. Les pouvoirs publics ont, à mon sens, pris un risque énorme, d’autant que les gendarmes étaient dans l’incapacité de respecter les protocoles qui régissent les tirs de grenade : à cause du grillage, ils ne pouvaient les lancer au sol et ont donc dû les envoyer en l’air. Il ne s’agit pas ici de refaire l’enquête, mais on peut s’interroger sur la responsabilité du pouvoir politique, qui expose les forces de l’ordre à des manifestants dont on sait qu’ils sont potentiellement dangereux. S’il s’agissait, comme on me l’a dit, de protéger Gaillac ou Albi, c’est à l’entrée de ces villes qu’il fallait positionner les forces de l’ordre, et non dans un endroit où il n’y avait plus rien à défendre.
M. le rapporteur. Je suis gêné que nous abordions ces sujets, non pour une question de fond mais pour une question de forme, car nous sortons de l’objet de notre commission d’enquête. Sans entrer dans des détails dont nous n’avons pas à connaître, je ferai néanmoins observer que le rapport de l’IGGN, rendu en décembre, fait apparaître qu’il existait un risque de contre-manifestation et qu’il n’était donc pas forcément stupide que les pouvoirs publics positionnent sur les lieux des forces de l’ordre, non pour défendre un grillage mais pour empêcher des citoyens poursuivant des objectifs radicalement opposés de se taper dessus. Et il ne s’agit pas là d’une question que je vous pose, car c’est aujourd’hui à l’autorité judiciaire d’examiner les faits et d’en tirer les conclusions qu’elle entend.
M. le président Noël Mamère. Je partage l’avis du rapporteur, à ceci près que je vous pose, moi, la question : pourquoi les pouvoirs publics ont-ils laissé 65 gardes mobiles face à 150 personnes déterminées et très équipées ? Si des consignes d’apaisement avaient été données, la meilleure manière de les respecter était de les retirer.
Qu’en a-t-il été, par ailleurs, de la coordination avec la préfecture ?
M. Philippe Folliot. On ne sait trop qui vous visez quand vous évoquez à mots à peine couverts l’instrumentalisation des éléments violents présents sur le site. C’est une manière de « théorie du complot » qui me paraît assez grave.
Je constate ensuite que, lorsque vous faites l’inventaire des violences commises, vous ne mentionnez pas le saccage des locaux du conseil général du Tarn. Étiez-vous présent ? Cautionnez-vous ce type d’action ? Qu’avez-vous à dire des manifestations particulièrement violentes qui ont eu lieu à Gaillac et Albi, et qui se sont accompagnées de la profanation d’un monument aux morts et de dégradations diverses ?
M. Ben Lefetey. Notre relation avec la première préfète, Josiane Chevalier, a été inexistante, car, après l’envoi de notre contre-rapport, elle a refusé de nous rencontrer. Lorsque nous avons demandé l’organisation d’un débat public afin que l’État explique pourquoi il autorisait le projet, elle n’a pas daigné nous répondre.
Début mars, lorsqu’une cinquantaine de personnes extérieures ont rejoint les occupants et ont commencé à installer des barricades, nous avons, devant les risques de radicalisation du mouvement, sollicité un rendez-vous auprès de la préfète et du président du conseil général pour discuter avec eux de la manière dont nous pouvions contribuer à apaiser les choses sur le terrain. Le président du conseil général nous a répondu que le maintien de l’ordre n’était pas de son ressort ; quant à la préfète, elle n’a pas donné suite, alors que notre courrier faisait clairement état de nos craintes qu’il y ait des affrontements et des blessés de part et d’autre. Fort heureusement, la situation n’a pas dégénéré à l’époque car les occupants s’en sont tenus à la défense de la zone humide, sans jamais aller au contact avec les forces de l’ordre. Lorsque le successeur de Madame Chevalier a pris ses fonctions, le 1er septembre, j’ai contacté son secrétariat pour obtenir un rendez-vous. Cela n’a pas abouti et, compte tenu de mon expérience précédente, j’avoue ne pas avoir insisté.
Si les forces de l’ordre et le commandant de gendarmerie savent le rôle de médiateur qu’a pu jouer notre collectif et la manière dont, à plusieurs reprises, nous avons contribué à apaiser la situation entre les gendarmes et les occupants, l’État, en revanche, n’a pas su utiliser nos ressources. La situation est heureusement différente aujourd’hui : je suis en contact régulier avec le préfet qui, à travers moi, s’efforce de nouer des relations avec les zadistes et d’apaiser les tensions.
Pour en revenir aux hypothèses que j’ai formulées sur les véritables motivations des perturbateurs, on comprend aisément l’intérêt que peuvent avoir les porteurs de projet à voir dégénérer une manifestation : cela focalise l’attention des journalistes sur les affrontements, plutôt que sur le fond du dossier. Y a-t-il eu manipulation ? L’extrême-droite a-t-elle voulu déstabiliser notre mouvement ? Ce que je sais, c’est que je n’avais jamais vu auparavant les trois quarts des individus qui sont arrivés sur le site le 25 et le 26 octobre. Pour notre part, nous nous étions engagés à assurer le service d’ordre sur les lieux où nous manifestions pendant la journée du samedi. Nous avons tenu notre engagement et évité tout débordement. Ce qui se passait à 1,5 kilomètre de là, ce n’était pas à nous de l’assumer.
Quant au saccage du conseil général, je vous renvoie au Tarn libre, qui a relaté avec précision ce qui s’est exactement passé. Soixante-dix personnes ont investi le conseil général et se sont assises sur les escaliers, dans l’attente de réponses que nous attendons depuis plus d’un an et que même une grève de la faim ne nous a pas permis d’obtenir. À la demande du président du conseil général, elles ont été expulsées manu militari par la police, et, avec elles, des journalistes et des élus de la République. Ne parlons donc pas de saccage. Je déplore simplement qu’une personne ait tagué les murs mais, là encore, je m’interroge : filmée et photographiée par les journalistes, vêtue d’une combinaison qui la rend très visible parmi les manifestants, elle opérait sous le regard du personnel, des forces de l’ordre et de policiers en civil mais n’a pas été arrêtée. Les images des murs tagués en revanche ont été massivement utilisées et diffusées par le conseil général.
Le préfet du Tarn ou son directeur de cabinet vous confirmeront que, lors des manifestations qui ont eu lieu à Gaillac ou à Albi après la mort de Rémi Fraisse, nous avons fait en sorte que les nôtres se comportent bien, n’hésitant pas à nous écarter pour laisser les forces de l’ordre intervenir contre les casseurs. Nous ne sommes pas solidaires des gens qui utilisent la violence pour obtenir gain de cause.
Les pouvoirs publics doivent travailler à la prévention des conflits, ne pas rester sourds aux alertes citoyennes, favoriser le dialogue et la concertation, au lieu de passer en force, avec les risques de conflit que cela comporte. Si, toutefois, le conflit sur le terrain n’a pu être évité, les consignes données aux forces de l’ordre doivent être proportionnées : quand on à affaire à des gens non violents, il est inacceptable d’avoir recours à la violence. Une manifestation n’est pas un lieu où l’on doit perdre un œil ou mourir.
M. le président Noël Mamère. Nous vous remercions pour votre témoignage.
*
* *
Audition, ouverte à la presse, de M. Bernard CAZENEUVE, ministre de l’Intérieur
Compte rendu de l’audition du mardi 3 février 2015
M. le président Noël Mamère. Monsieur le ministre, l’article 6 de l’ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires faisant obligation aux personnes auditionnées par une commission d’enquête de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, je vous demande de lever la main droite et de dire : « Je le jure ».
(M. Cazeneuve prête serment.)
M. Bernard Cazeneuve, ministre de l’Intérieur. Je vous remercie de m’avoir invité à apporter à votre commission d’enquête des précisions sur un sujet aussi important que douloureux.
La vocation première du maintien de l’ordre est de permettre l’exercice des libertés publiques, en particulier du droit de manifester son opinion en toute sécurité. Dans ce cadre, la mission des forces de sécurité consiste à permettre à tous les citoyens, quelles que soient leurs opinions ou leurs revendications, d’exercer leur droit à s’exprimer, à protester et à manifester. À ce titre, les forces mobiles de la gendarmerie et de la police remplissent pleinement une mission républicaine, nécessaire et souvent difficile.
Quelques jours après que la liberté d’expression a fait l’objet dans notre pays d’un attentat d’une exceptionnelle violence, il est bon de rappeler que la liberté de manifester relève, comme la liberté de la presse, de la liberté d’expression telle que définie à l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen : « La libre communication des pensées et des opinions est l’un des droits les plus précieux de l’homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. »
La liberté de manifester, réglée, comme la liberté de la presse, par la norme et le droit, implique que les manifestants eux-mêmes respectent la loi et renoncent à l’exercice de la violence. Cet équilibre n’est pas nouveau. En 1906, Georges Clemenceau, récemment nommé ministre de l’Intérieur, avait parlé en ces termes aux grévistes de Lens : « La grève constitue pour vous un droit absolu et qui ne saurait vous être contesté. Mais j’ajoute que dans une République, la loi doit être respectée par tous. Donc soyez calmes ! Vous n’avez pas vu de soldats dans la rue, vous n’en verrez pas si vous respectez les droits de chacun, si vous respectez les personnes et les propriétés. » Depuis un siècle, les techniques du maintien de l’ordre ont évolué. Les brigades mobiles de gendarmerie ont été créées au lendemain de la Première Guerre mondiale, pour éviter que les régiments de ligne de l’armée ne soient chargés de cette tâche. Mais le principe reste et il permet aux citoyens de manifester librement leurs opinions sans compromettre leur sécurité.
Avant de revenir sur le drame de Sivens et sur les conséquences que j’ai voulu en tirer, je crois utile de rappeler ce qu’est le cadre républicain du maintien de l’ordre, les postures opérationnelles qu’il implique et les formes nouvelles de menaces auxquelles nous sommes amenés à répondre.
La liberté de manifestation s’inscrit dans un cadre juridique précis qui soumet les organisateurs à une obligation de déclaration préalable auprès de l’autorité administrative compétente. Cette dernière peut alors prendre des mesures restreignant l’exercice de la liberté de manifestation allant jusqu’à l’interdiction, mais elle ne peut le faire qu’en cas de risque établi de trouble à l’ordre public, et de manière proportionnée et motivée.
L’interdiction d’une manifestation doit demeurer exceptionnelle. L’an passé, sur le ressort de la préfecture de police de Paris, qui compte de loin le plus grand nombre de manifestations organisées en France, seules cinq d’entre elles ont été interdites sur un total de 2 047 manifestations revendicatives déclarées. Celles qui l’ont été présentaient des risques insupportables, à l’image de trois manifestations dont nous savions qu’elles pouvaient déboucher, à Paris et à Sarcelles, sur des violences antisémites, que leurs organisateurs n’étaient nullement en mesure de prévenir. J’ai pris la décision de les interdire, que j’ai publiquement assumée. Le droit de manifester est sacré, mais dès lors que des risques de débordement antisémites sont annoncés avant même le début de la manifestation, ceux-ci doivent être prévenus.
De la même manière, les forces de l’ordre ne sont autorisées à faire usage de la force face aux manifestants que dans certaines circonstances exceptionnelles : trouble grave à l’ordre public, émeute, voire de l’insurrection. Cet usage est donc soumis à des conditions de nécessité et de proportionnalité, ainsi qu’à un formalisme particulièrement exigeant et protecteur. Conformément à ces principes, la gradation des moyens mis en œuvre permet une adaptation permanente et une prise en compte différenciée des comportements au sein des attroupements. L’emploi judicieux des munitions, dont la portée et les effets correspondent à la progressivité recherchée, et leur maîtrise constante, doivent répondre à cette exigence démocratique.
Le respect de ces principes, mais aussi le souci constant de l’apaisement face aux foules qu’elles doivent protéger, guident l’action quotidienne de nos forces de sécurité, qu’il s’agisse des forces territoriales ou de celles plus particulièrement chargées du maintien de l’ordre. Ces principes sont au cœur de l’enseignement dispensé dans les écoles de formation des compagnies républicaines de sécurité (CRS) et des escadrons de gendarmerie mobile (EGM). Lors de mon déplacement à Saint-Astier, le 6 octobre, j’ai pu me rendre compte de la qualité de l’instruction dispensée au Centre national d’entraînement des forces de gendarmerie, que beaucoup de pays étrangers nous envient. Vous avez prévu de vous y rendre, dans le cadre de vos travaux. Cette visite vous permettra d’entrer dans le cœur de la formation au maintien de l’ordre.
Nous devons rendre hommage, comme l’ont fait beaucoup de nos compatriotes le 11 janvier dernier, à l’engagement, au courage et à l’abnégation des unités de maintien de l’ordre. Durant l’année écoulée, celles-ci ont été régulièrement mises à contribution. Elles sont intervenues dans des situations de conflit particulièrement tendues, comme lors des violentes manifestations qui se sont déroulées en Bretagne – à Morlaix ou contre les portiques écotaxe. Elles se sont également exposées à Notre-Dame des Landes et à Sivens. Elles ont fait face à de nombreux mouvements revendicatifs, en province comme à Paris. Enfin, elles ont œuvré dans des contextes très délicats sur les territoires d’outre-mer, notamment en Nouvelle-Calédonie ou à Mayotte. Le prix qu’elles ont payé pour garantir la liberté de manifester tout en protégeant nos concitoyens contre les violences a été particulièrement élevé, puisque 387 gendarmes mobiles et CRS ont été blessés l’an passé à l’occasion d’un engagement opérationnel en maintien de l’ordre. Signe des temps, le nombre de ces blessés a fortement augmenté ces dernières années : il était de 175 en 2012, et de 338 en 2013.
Sur un plan opérationnel, la doctrine française du maintien de l’ordre repose sur le souci de limiter au maximum les contacts physiques et les violences qu’elles peuvent entraîner. Il s’agit d’abord de maintenir les manifestants à distance des forces de l’ordre pour que, même en cas de violences exercées contre elles, les blessures sérieuses soient évitées de part et d’autre. La doctrine repose aussi sur le principe de gradation de la réponse, proportionnée à l’évolution de la physionomie de la manifestation, lorsque des violences apparaissent. Pour ce faire, depuis des décennies, les forces de l’ordre s’appuient sur une gamme de munitions permettant d’adapter leur posture : grenades lacrymogènes simples, grenades de désencerclement, grenades lacrymogènes à effet de souffle.
Ces postures opérationnelles, et les équipements qui les rendent possibles, ont été perfectionnés peu à peu. Les événements de mai 1968 ont amené à rechercher des solutions nouvelles pour disperser des manifestants agressifs ou regroupés derrière des barricades. Les années suivantes, les premiers véhicules blindés à roues de la gendarmerie sont apparus, les tenues ont été adaptées et une formation dédiée a été mise en place. En 1986, la mort tragique de Malik Oussekine a amené à dissoudre le peloton de voltigeurs motocyclistes. Vingt ans plus tard, les émeutes urbaines de 2005 ont conduit à repenser l’organisation des escadrons de gendarmerie mobile, désormais dotés de quatre pelotons au lieu de trois, ce qui leur permet de gagner en souplesse d’emploi et en réactivité, pour faire face à des fauteurs de troubles de plus en plus mobiles et organisés. L’équipement individuel s’est également amélioré pour renforcer la protection des personnels.
Aujourd’hui, notre pays et nos forces mobiles sont confrontés à nouvelles formes de contestation sociale, qui posent des problèmes pour partie inédits. De plus en plus souvent, les rassemblements institutionnels classiques sont marqués par l’intervention séparée de groupes structurés, organisés et violents. Leurs méfaits couvrent un large spectre, du vol au saccage organisé, jusqu’à l’agression caractérisée des forces de l’ordre. Il ne s’agit pas de casseurs au sens traditionnel du terme car les participants à ces actions violentes préparent leurs actions de manière professionnelle et méthodique. Ils suivent des stages de résistance, bénéficient de soutien logistique, d’assistance médicale ou juridique, et s’équipent de dispositifs de protection leur permettant de résister aux moyens employés par les unités de maintien de l’ordre. Rompus aux nouvelles technologies, ces groupes structurés se caractérisent par une intelligence collective développée, construite sur l’anticipation, l’observation des forces et l’expérience.
Ces manifestants violents ne fonctionnent plus de manière étanche et hermétique. Les catégories auxquelles ils appartiennent se mélangent autour de causes autrefois étrangères à leurs préoccupations. Il n’est donc plus rare de voir des Black Blocs associés dans l’action à des individus a priori moins politisés issus de la mouvance des raveurs, à des adeptes des flash mobs, aussi bien qu’à des altermondialistes ou à des groupes issus des mouvements anarchistes ou radicaux. Dans d’autres cas, comme on l’a vu au cours de certaines manifestations de juillet 2014, certaines franges de l’islamisme radical peuvent faire cause commune avec des groupes de supporters de football liés à des mouvements identitaires. Le Service central du renseignement territorial joue un rôle important pour permettre aux forces mobiles d’anticiper ces regroupements lorsqu’ils surviennent et d’en tirer les conséquences opérationnelles.
Enfin, le phénomène des « zones à défendre » (ZAD), selon la terminologie employée par les militants radicaux, pose des problèmes spécifiques. Il est difficile d’en déloger les occupants illégaux, disséminés sur de vastes terrains, souvent accidentés, situés en pleine nature, pour faire respecter les décisions de justice. Les plus déterminés d’entre eux se sont préparés de façon méthodique à résister à l’intervention des forces de sécurité, en leur tendant toutes sortes de pièges. Ils savent tirer parti de la présence, ponctuelle ou durable, de manifestants ou de sympathisants non-violents, parmi lesquels des femmes et des enfants. Cette situation crée pour les forces de l’ordre des conditions d’intervention très différentes de celles qu’elles connaissent lors des manifestations en centre-ville ou des émeutes urbaines.
C’est en ayant présent à l’esprit le cadre juridique qui régit l’intervention des forces de l’ordre, l’évolution de la doctrine du maintien de l’ordre et l’apparition de formes de contestation nouvelles que nous devons analyser le drame de Sivens, où, dans la nuit du samedi 25 au dimanche 26 octobre, un jeune manifestant, Rémi Fraisse, est mort lors d’une opération de maintien de l’ordre public.
La mort d’un jeune homme de vingt et un ans constitue toujours une tragédie. Nous devons nous incliner devant la douleur de sa famille et de ses proches et leur exprimer notre compassion dans cette épreuve terrible, mais je dois également, en tant que ministre de l’Intérieur, tirer toutes les conséquences de ce drame et faire en sorte qu’il ne puisse pas se reproduire.
C’est pourquoi, tout en veillant à ce que l’enquête judiciaire puisse se dérouler dans des conditions de transparence et d’indépendance exemplaires, j’ai immédiatement déclenché deux enquêtes administratives. La première, confiée conjointement aux inspections générales de la police et de la gendarmerie nationales, portait sur la pertinence et les conditions de l’emploi de munitions explosives dans les opérations de maintien de l’ordre. La seconde, confiée à l’inspection générale de la gendarmerie nationale, concernait le déroulement des opérations de maintien de l’ordre à Sivens. Le général de corps d’armée Pierre Renault, chef de cette inspection générale, a déjà eu l’occasion d’en exposer devant la commission des lois de l’Assemblée nationale, le 2 décembre dernier, les principales conclusions.
Après la remise du premier rapport d’expertise, j’ai rendu publique, le 13 novembre, une première série de décisions que je souhaite rappeler.
La mort de Rémi Fraisse, par l’effet direct d’une grenade offensive, posait clairement la question du maintien en service de cette munition dans la gendarmerie, qui en était seule dotée. Parce qu’une grenade offensive avait tué un jeune homme de vingt et un ans et que cela ne devait plus jamais se produire, j’ai décidé d’en interdire l’utilisation dans les opérations de maintien de l’ordre.
Dans le même temps, j’ai décidé de durcir les modalités d’emploi des grenades lacrymogènes à effet de souffle, dites « GLI » (grenades lacrymogènes instantanées). Des instructions ont d’ores et déjà été diffusées afin que leur utilisation se fasse désormais dans le cadre d’un binôme, composé du lanceur lui-même et d’un superviseur ayant le recul nécessaire pour évaluer la situation et guider l’opération. Moins puissantes que les grenades offensives, mais nécessaires au maintien à distance, elles sont indispensables à la gradation de la réponse pour protéger tout à la fois les forces de l’ordre et les manifestants violents contre les conséquences dommageables d’un contact.
Au-delà de ces mesures concernant les armes, j’ai souhaité poursuivre un travail plus profond sur notre pratique du maintien de l’ordre. Pour partie en cours, les réflexions s’articulent autour de trois axes : la prévention et l’information des manifestants, la modernisation du cadre juridique de notre intervention, la transparence. Mon ministère regardera de près les travaux de votre commission et ses conclusions, qu’il intégrera à sa réflexion.
En premier lieu, nous devons en permanence expliquer les règles juridiques et les moyens employés par les forces pour prévenir les risques de débordement. Avant chaque manifestation, chaque fois que c’est possible, nous devons travailler avec les organisateurs pour mieux étudier le contexte, les enjeux et les risques. Lors des opérations de maintien de l’ordre, le dialogue doit être maintenu avec les manifestants pacifiques et leurs représentants. Dans le souci de les informer clairement sur l’évolution de la posture des forces de l’ordre, j’ai donné instruction de revoir le libellé des sommations lancées au cours des opérations. Il s’agit de mieux faire la distinction entre les différents degrés de réponse des forces, en fonction de l’évolution de la physionomie de la manifestation. Une annonce visuelle complétera cette information clarifiée.
En deuxième lieu, j’ai voulu que les règles du maintien de l’ordre soient harmonisées et s’appliquent indistinctement aux deux forces, police et gendarmerie, notamment en ce qui concerne l’usage des munitions. Par ailleurs, j’ai souhaité que la présence permanente d’une autorité civile spécialement déléguée par le préfet lors des opérations de maintien de l’ordre devienne obligatoire. Elle permettra de réévaluer en temps réel le dispositif, ainsi que sa pertinence et son dimensionnement. Une circulaire réaffirmant le caractère indispensable de la présence, sur ces opérations de maintien de l’ordre, de l’autorité habilitée à décider de l’emploi de la force sera adressée dans les prochains jours à tous les préfets.
Sur ce sujet, j’entends également exploiter les recommandations qui me seront remises dans les prochains jours par le préfet Lambert, auquel j’ai confié une mission de formation du corps préfectoral. La consolidation des connaissances des représentants territoriaux de l’État dans ces domaines constitue une priorité. Leur formation initiale et continue devra comprendre des modules portant tant sur les modalités de maintien de l’ordre public que sur la coordination et l’animation du renseignement territorial en amont des manifestations.
Afin de préciser ces différentes directives et d’en assurer le suivi, j’ai constitué un groupe de travail commun à la police et à la gendarmerie, qui m’a remis ses conclusions intermédiaires le 10 décembre dernier. J’en ai approuvé l’esprit et souhaité qu’il poursuive ses travaux. Il sera chargé d’étudier les techniques de maintien de l’ordre et de travailler à la modernisation de notre doctrine. Il partagera des retours d’expérience pour faire évoluer les pratiques, et travaillera à l’évaluation systématique des munitions utilisées, qu’il comparera à celles qu’emploient les grandes démocraties. Il associera à ses travaux, en utilisant les ressources de l’Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice (INHESJ), des chercheurs en sciences sociales, dont le ministère de l’Intérieur s’est trop coupé. Il étudiera, avec le concours de la délégation ministérielle aux industries de sécurité, la possibilité de recourir à chaque instant à des moyens techniques alternatifs.
Enfin, pour améliorer la transparence de notre dispositif, j’ai décidé que toutes les opérations de maintien de l’ordre à risque seront intégralement filmées, dans le cadre juridique qui organise la prise de vues dans l’espace public. Dans le prolongement de ma démarche d’aujourd’hui, je souhaite que la représentation nationale soit informée en permanence des conditions du maintien de l’ordre en France et associée à la modernisation de notre doctrine. Un rapport annuel sera présenté, à mon initiative, aux présidents de la commission des lois et des commissions en charge de la sécurité des deux assemblées. Les résultats des travaux du groupe de travail que je viens d’évoquer seront, de la même manière, partagés avec vous.
La doctrine française du maintien de l’ordre a fait ses preuves au cours des dernières décennies. Le drame de Sivens constitue à cet égard une exception tragique, dont, je l’ai dit, nous devons tirer toutes les conséquences. J’ai évoqué certaines d’entre elles, mais, d’une manière générale, les accidents graves sont rares, même lors de manifestations au cours desquelles se déchaîne une extrême violence. C’est pourquoi de nombreux pays ou collectivités continuent à reconnaître la qualité de notre modèle, en faisant former en France leurs unités de maintien de l’ordre.
Une telle reconnaissance doit beaucoup au professionnalisme et à l’expérience des chefs comme des gardiens et des gendarmes, au sein de nos unités de maintien de l’ordre. Elle résulte aussi du caractère profondément républicain des hommes auxquels incombe cette mission. En mai 1968, vingt-cinq jours d’émeutes violentes n’ont pas eu en France de conséquences fatales pour les manifestants, tandis que, la même année, aux États-Unis la garde nationale tirait à plusieurs reprises sur la foule, faisant quarante-trois morts à Détroit et vingt-six à Newark. Le 29 mai 1968, le préfet de police Maurice Grimaud avait adressé une lettre personnelle à chaque agent de la préfecture de police de Paris pour les mettre en garde contre les excès dans l’emploi de la force. « Si nous ne nous expliquons pas très clairement et très franchement sur ce point, écrivait-il, nous gagnerons peut-être la bataille dans la rue, mais nous perdrons quelque chose de beaucoup plus précieux et à quoi vous tenez comme moi : c’est notre réputation. »
En prenant les dispositions pour que le drame de Sivens ne puisse se reproduire, en protégeant mieux les forces de l’ordre contre la violence extrême qu’elles doivent stoïquement subir et contenir, en assurant de la manière la plus libérale l’exercice du droit de manifester, nous serons fidèles à cette tradition et à ces valeurs qui sont celles de la République.
Je remercie le Parlement, qui a créé votre commission d’enquête, et les élus qui y participent. Votre réflexion nous permettra de faire progresser la mise en œuvre des opérations de maintien de l’ordre, dans le respect rigoureux des principes généraux du droit et la fidélité absolue à la tradition républicaine.
M. le président Noël Mamère. Le but de notre commission d’enquête, créée au lendemain des événements de Sivens, est de faire contribuer le Parlement à l’amélioration de la doctrine ou à sa révision, en fonction de l’évolution de la société, ainsi qu’à la définition de certaines règles de maintien de l’ordre. Je vous remercie des réponses que vous nous avez déjà apportées.
M. Pascal Popelin, rapporteur. Monsieur le ministre, je vous remercie de vos propos, qui attestent de votre respect pour les travaux de notre commission et de votre esprit d’ouverture. Je m’associe à l’hommage que vous avez rendu au caractère républicain du maintien de l’ordre.
Préserver l’ordre public, c’est par définition accepter, en encadrant l’expression d’une manifestation, un certain degré de désordre public. Le degré de désordre public que peut tolérer une société démocratique a-t-il évolué ? Est-il plus ou moins important en France que dans les autres démocraties ? Le cadre juridique actuel est-il adapté aux nouvelles formes de protestations ?
Faut-il renforcer les moyens du renseignement territorial pour mieux apprécier a priori les situations les plus susceptibles de dégénérer, mieux cibler les éléments radicaux et mieux adapter la réponse des forces de l’ordre en termes d’équipements, d’effectifs et de consignes ? Les nouvelles mesures que vous avez annoncées sur le renseignement et les nouveaux effectifs permettront-elles de renforcer l’information dont disposent le préfet et les forces de l’ordre avant et pendant les manifestations ?
Dans son Dictionnaire des idées reçues, Flaubert écrit : « Police : A toujours tort. » Tantôt, on accuse les forces de l’ordre de molester des manifestants pacifiques. Tantôt, on leur reproche leur passivité face aux casseurs qui dévastent un centre-ville en marge d’une manifestation. Comment jugez-vous – dans l’absolu et par rapport aux systèmes étrangers – le système français, qui tente de concilier maintien de l’ordre et expression des libertés publiques ?
La France, qui dispose de forces spécialisées dans le maintien de l’ordre – les CRS et la gendarmerie mobile – utilise aussi pour remplir cette mission des forces non spécialisées, affectées à la sécurité quotidienne des citoyens. Cette situation présente-t-elle des inconvénients ? La formation des forces non spécialisées est-elle à la hauteur des tâches qu’on leur confie ? La réduction des effectifs opérée sous les deux quinquennats précédents, qui a amené à reconfigurer les unités de CRS et de gendarmerie mobile, a-t-elle réduit l’efficacité du dispositif national de maintien de l’ordre ?
Une certaine confusion semble régner en ce qui concerne l’équipement des forces de maintien de l’ordre, notamment sur le port des armes non létales. Quelles forces sont dotées de Flash-Ball ou de lanceurs de balles de défense (LBD) 40x46 ? Ces armes ont-elles le même usage ? Sont-elles adaptées aux mêmes situations ? Y a-t-il un lien entre la dotation des différentes forces et les caractéristiques opérationnelles de ces armes ?
M. le ministre. Ces questions couvrent quasiment la totalité du champ qui relève du ministère de l’Intérieur.
Il faudrait interroger la philosophie, l’histoire et la géographie, pour savoir s’il existe un lien entre le niveau de désordre public supporté par les pays et leur caractère plus ou moins démocratique. L’histoire nous apprend que le désordre a souvent été organisé, avant d’être toléré, pour rendre supportables certaines contraintes sociales. Ainsi s’expliquent le carnaval, le charivari et autres manifestations locales. L’acceptation d’un certain désordre dans la rue est contrebalancée par une ritualisation des modes de l’expression de la contestation et par une organisation de la contestation en lien avec les forces de l’ordre. C’est ce qu’on a appelé la ritualisation encadrée du désordre, qui a été longtemps le fait des services d’ordre travaillant avec les forces de l’ordre.
Au sein des manifestations, le service d’ordre mis en place par les organisateurs eux-mêmes a permis de faire vivre, à côté de l’État, une démocratie de rue. Parmi vous, certains représentants d’organisations politiques, ayant appartenu à des syndicats, savent de quoi je parle. Certaines organisations très structurées ont pu affirmer vivement dans la rue leur opposition Gouvernement et à l’État, tout en se dotant de moyens permettant d’établir un lien avec les forces de l’ordre.
Le désordre dans la rue est à la fois subi et accepté. Encore faut-il éviter qu’il n’y ait des blessés, compte tenu de la difficulté opérationnelle que rencontrent les forces de l’ordre pour agir dans la foule. C’est ce qui rend une organisation nécessaire, bien que celle-ci soit particulièrement délicate à mettre en œuvre dans le contexte actuel des manifestations radicales. Celles-ci ne sont encadrées par personne. Leur véritable but est la violence, l’expression d’un message ne jouant que le rôle de prétexte.
À Paris, on n’a signalé aucun problème lors des grandes manifestations de juillet 2014 sur la question palestinienne, qui ont été le fait de grandes organisations syndicales ou politiques. Celles-ci ont invité les manifestants radicaux qui dérapaient à se reprendre ou à sortir du défilé. La difficulté est plus grande quand des violences sont annoncées, que des propos, notamment antisémites, sont tenus avant la manifestation, et qu’on sait d’ores et déjà qu’aucun organisateur ne sera capable de faire ce travail. Dans un tel cas, il appartient au ministère de l’Intérieur de prendre des mesures pour protéger les forces de l’ordre et les manifestants, fussent-ils violents. Telle est la position que j’ai adoptée cet été, et que je reprendrai, si nécessaire.
Vous m’avez interrogé sur le cadre légal, qui pose la question des infractions obstacles. La participation délictueuse à un attroupement constitue déjà une infraction, comme le fait de participer à une manifestation en portant une arme pouvant être utilisée pour agresser les forces de l’ordre. Une autre infraction obstacle a été introduite dans le code pénal en 2010 : le fait de participer sciemment à un groupement, même formé de façon temporaire, en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, de violence volontaire contre les personnes ou de destruction et de dégradation de biens.
Cette infraction pénale, qui complète le cadre légal existant, vise les bandes violentes, qui se réunissent pour organiser des affrontements de rue. Une réflexion peut être engagée sur ce sujet afin de réprimer les casseurs. Il faudra cependant caractériser la préparation de leurs actions violentes. Ont-ils échangé des SMS pour se donner rendez-vous sur les lieux de l’affrontement ? Ont-ils prévu les déplacements de bandes convergentes et organisées ? Ces critères permettraient aux forces de l’ordre d’intervenir plus efficacement pour arrêter les individus et les sanctionner pénalement.
D’autres dispositions visent à prévenir la violence dans les enceintes sportives. Celles-ci peuvent être interdites à des personnes qui ont déjà perturbé les manifestations sportives. À partir cette expérience encadrée par le droit, on étudiera la possibilité d’interdire à des manifestants violents multirécidivistes de manifester sur la voie publique, où leur comportement pourrait créer nouvelles difficultés.
Il est nécessaire de renforcer les moyens du renseignement territorial, qui a perdu une grande partie de ses effectifs. La suppression de 13 000 postes en cinq ans dans la police et la gendarmerie a réduit la capacité de détecter sur le terrain des signaux faibles soit avant les manifestations soit pour repérer des acteurs dangereux sur le terrain, par exemple dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Le Premier ministre a prévu de conforter les services du renseignement territorial en procédant à 500 recrutements : 150 en circonscription de gendarmerie et 350 en zone police. Par ailleurs, une partie de l’enveloppe de 233 millions allouée aux services de police et de gendarmerie permettra de doter le renseignement territorial de moyens numériques, téléphoniques ou de radio-télécommunication, ce qui le rendra plus efficace en cas de manifestation violente.
Vous avez cité le mot de Flaubert, selon lequel la police aurait toujours tort. Il lui arrive aussi d’avoir raison. Les événements récents nous ont rappelé son courage et sa culture profondément républicaine. Je n’ai jamais fait partie de ceux qui théorisaient la consubstantialité de la violence aux forces de l’ordre. Celles-ci, confrontées à des violences extrêmes, peuvent commettre des manquements, que je sanctionne avec la plus grande sévérité, mais sa culture profonde est marquée par un attachement viscéral aux valeurs de la République et une volonté de les faire prévaloir, en s’exposant durement. Je rappelle que 387 policiers et gendarmes ont été blessés en 2014.
L’article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales énonce que l’exercice la liberté d’expression « comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions, prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique ». La liberté de manifestation est mentionnée pour la première fois dans un décret de loi du 23 octobre 1935 portant réglementation des mesures relatives au renforcement du maintien de l’ordre public. Sans être considérée de façon autonome comme une liberté constitutionnelle garantie, elle est conçue comme une facette de la liberté d’expression. Une décision du Conseil constitutionnel datée de janvier 1995 consacre un droit d’expression collective des idées et des opinions.
Le droit français cherche à concilier des droits du citoyen et ceux de la société. L’ordre public est l’un des premiers objectifs que le Conseil constitutionnel reconnaît dans sa jurisprudence. En 1980, il juge qu’il faut concilier la liberté individuelle et celle d’aller et venir avec la sauvegarde des fins d’intérêt général ayant valeur constitutionnelle, comme le maintien de l’ordre public. Sur tous ces sujets, ni le citoyen ni le policier ne doivent avoir tort. Les principes de droit inclus dans la législation et constamment rappelés par le Conseil constitutionnel doivent prévaloir.
La France, qui dispose de forces spécialisées dans le maintien de l’ordre, utilise aussi, pour certaines missions, des forces affectées à la sécurité quotidienne. Les unités de forces mobiles sont extrêmement efficaces dans une posture statique de protection des bâtiments ou de refoulement des groupes et des différents cortèges, mais la rigidité de leur équipement constitue un handicap face à des manifestations très mobiles. Lors de votre visite à Saint-Astier, vous constaterez les limites de leurs conditions d’intervention.
Le complément apporté par les forces territoriales de sécurité publique est intéressant. La préfecture de police, comme la direction générale de la police nationale, dispose d’un premier niveau d’intervention avec des unités dédiées, formées de manière spécifique. Les compagnies de district parisiennes et les compagnies des sections d’intervention de la direction centrale de la Sécurité publique sont des unités constituées, mais, à la différence des unités de CRS ou de la gendarmerie, elles ne sont pas projetables sur l’ensemble du territoire. Les policiers des brigades anticriminalité (BAC) peuvent aussi être associés aux opérations dans le cadre de la judiciarisation croissante du maintien de l’ordre.
Ces forces sont complémentaires. Si les unes peuvent intervenir de manière rapide et flexible, et les autres s’employer dans des opérations plus lourdes, toutes sont formées de façon rigoureuse. Regrettant que la direction de la formation ait été supprimée pour devenir une sous-direction de la direction générale, je souhaite remettre l’accent sur la formation des forces de l’ordre et les conditions d’engagement au maintien de l’ordre.
Pour ne pas faire de peine à M. Larrivé, je n’insisterai pas sur les réductions d’effectifs.
Vous m’avez interrogé sur l’usage des munitions. Les escadrons de gendarmerie mobiles et la garde républicaine sont dotés de lanceurs de balles de défense 40x46 (LBD), tandis que les pelotons de surveillance et d’intervention de la gendarmerie (PSIG) et certaines unités périurbaines sont munies de Flash-Ball. En ce qui concerne la police, les compagnies républicaines de sécurité possèdent des LBD 40x46, comme les effectifs de la direction centrale de la sécurité publique, dotés entre autres de lanceurs de balles de défense du type Flash-Ball.
Policiers et gendarmes sont souvent confrontés à la difficulté de maîtriser un ou plusieurs individus dangereux ou de réagir à une prise à partie par des groupes armés ou violents, sans que la situation exige pour autant le recours à des armes à feu. Pour faire face à ces situations dégradées, pour lesquelles la coercition physique est insuffisante, et améliorer la capacité opérationnelle, les unités de la gendarmerie et les services de la police sont en possession d’armes de force intermédiaire, qui permettent, dans le respect des lois et des règlements, une réponse graduée et proportionnée à une situation de danger, lorsque l’emploi de la force légitime s’avère nécessaire.
Le Flash-Ball, arme de légitime défense, est constitué de deux canons courts et non rayés, ce qui limite sa précision. La portée de ses projectiles est réduite à quinze mètres. De conception plus récente, le LBD40 est équipé d’une aide à la visée permettant d’apprécier la distance de l’objectif. Doté d’un canon rayé plus long, il tire jusqu’à quarante mètres avec une précision élevée. Sur ces sujets très précis, je suis disposé à répondre par écrit aux questions de votre commission d’enquête.
Mme Marie-George Buffet. Je m’interroge sur les rôles respectifs, dans la prise de décision, de l’autorité civile et des officiers des forces de maintien de l’ordre. Selon un officier que nous avons entendu, les consignes de l’autorité données oralement avant la manifestation manquent souvent de clarté et laissent place à l’interprétation. Quelle part de décision reviendra à l’autorité civile, dont vous annoncez qu’elle sera désormais présente pendant toute la manifestation ? Quelle part sera attribuée aux officiers ?
Quel est l’état du parc de véhicules ? Celui-ci est-il renouvelé ? Est-il exact que l’on manque de véhicules blindés à roues ?
Après les groupes radicaux des années soixante-dix et quatre-vingt, qui se présentaient en tête des manifestations sociales pour provoquer des incidents, nous avons vu, lors des manifestations contre le CPE, les casseurs attaquer les biens publics comme les manifestants. Il existe aujourd’hui des groupes organisés et structurés où se mêlent différentes sensibilités. Quels sont ceux qui les composent ? D’où viennent-ils ? Est-il exact que certains arrivent de l’étranger ? Combien sont-ils ? Un travail est-il mené avec les organisateurs de manifestations pacifiques afin de prévenir les violences ?
Une fédération des groupes de supporteurs, créée pour prévenir la violence dans les stades, ne suscite guère l’intérêt des fédérations sportives. Le ministère pourrait-il encourager son action ?
M. Guillaume Larrivé. Commençons par vider la vieille querelle des effectifs. En 2002, quand Nicolas Sarkozy devient ministre, son premier souci est de compenser la perte de 8 000 équivalents temps plein entraînée par la réduction du temps de travail dans la police et la gendarmerie. Entre 2002 et 2007, la première loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (LOPPSI) crée 11 500 postes, qui, j’en conviens, font l’objet, sous le quinquennat suivant, d’une rationalisation à la baisse. De ce fait, en 2012, l’effectif des forces de police et de gendarmerie est sensiblement égal à celui de 2002.
Je ne vous interrogerai pas sur les événements de la nuit du 25 octobre, couverts par une enquête judiciaire. On sait cependant que, fin octobre, la tension était telle que les gendarmes ont dû faire face à des intervenants armés. Pourquoi l’autorité de décision n’a-t-elle pas crevé l’abcès dès l’été ? Quels obstacles juridiques, opérationnels ou techniques l’ont empêchée de le faire ?
J’aimerais revenir sur la gestion – sous l’autorité du précédent ministre de l’Intérieur et du préfet de police Bernard Boucault – des manifestations de 2013 contre le projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe. Le défenseur des droits a été saisi, au titre de ses missions sur la déontologie de la sécurité. Quels retours d’expérience tirez-vous de ses premières réponses, parues dans la presse ? Quelle appréciation portez-vous sur Bernard Boucault ?
En réponse à une question écrite que je vous ai adressée, vous m’avez indiqué qu’en 2014, on comptait soixante et une compagnies républicaines de sécurité, composées de 11 194 agents, et 108 escadrons de gendarmerie mobile, composés de 11 670 militaires, dont l’emploi relève non du préfet de département mais du préfet de zone de sécurité. Ces effectifs vous semblent-ils adaptés ? Envisagez-vous de les faire évoluer à hausse ou à la baisse ? Prévoyez-vous de redéployer ces forces vers la sécurité publique ?
Enfin, selon la presse, il aurait été procédé entre 2012 et 2013 à la suppression de 1 720 648 patrouilles de sécurité publique, soit un taux de diminution de 6,36 %. Confirmez-vous ces chiffres ?
M. Gwenegan Bui. Monsieur le ministre, vous avez rappelé la montée de la violence et de la radicalisation à différents endroits : Notre-Dame-des-Landes, Pont-de-Buis, où un manifestant a perdu une main, Sivens, Morlaix, où le centre des impôts a été incendié. La radicalisation frappe tout le champ politique et social.
Si M. Larrivé entend minimiser la réduction des effectifs, je n’ai pas oublié la fermeture de l’escadron de Rennes ou de Nantes. Quand un escadron voit son effectif se réduire de cent à soixante personnes, ce n’est pas sans conséquences sur sa capacité de remplir une mission. La baisse des effectifs n’incite-t-elle pas les hommes à utiliser davantage les outils défensifs dont ils disposent ? Faut-il constituer de nouveaux escadrons et de nouvelles compagnies républicaines de sécurité ?
Le renseignement permet d’adapter efficacement les moyens aux missions. Hélas, les informations ne remontent pas toujours du terrain vers les préfets. Ne faut-il pas retravailler la procédure, pour pallier cette défaillance ?
Enfin, faut-il réviser la doctrine de maintien de l’ordre qui, maîtrisée dans l’espace urbain, semble inadaptée quand la confrontation se déroule dans l’espace rural ? Faut-il revoir l’organisation des escadrons ?
M. le ministre. Mme Buffet m’a interrogé sur la présence de l’autorité civile, ainsi que sur ses responsabilités et celles des forces chargées du maintien de l’ordre. J’ai souhaité, je l’ai dit, qu’on ne puisse plus engager d’opérations lourdes de maintien de l’ordre sans la présence de l’autorité civile, qui seule possède le recul suffisant pour évaluer en permanence l’adéquation des moyens mobilisés aux résultats obtenus.
Rappelons les règles qui régissent le maintien de l’ordre sur des théâtres où la violence est présente. Aux termes d’un décret de 2004, la responsabilité de l’ordre public relève de la responsabilité du préfet. Celui-ci doit faire remonter régulièrement certaines informations au cabinet du ministre de l’Intérieur, qui peut lui donner des instructions sur la manière de conduire les opérations.
M. Larrivé m’a demandé ce qu’on pouvait faire en amont de la manifestation du 25 et 26 octobre, compte tenu des tensions constatées à Sivens. Dès le début de l’été, et plus encore à la fin août, j’ai senti que celles-ci pouvaient aboutir à des difficultés sérieuses. Les informations dont je disposais sur le nombre de blessés dans les rangs des forces de l’ordre m’ont incité à donner au préfet des consignes d’apaisement, que j’ai réitérées jusqu’au dernier moment.
Dès l’annonce de la manifestation du 26, et du risque d’une contre-manifestation des agriculteurs, je lui ai conseillé d’engager un dialogue avec les organisateurs. On pouvait éviter de positionner des forces mobiles sur le site, tant qu’il n’y avait pas de tentative d’occupation, mais, si c’était le cas, on pouvait craindre une contre-manifestation, ce qui obligerait les forces de l’ordre à s’interposer entre manifestants et contre-manifestants. Je vous laisse imaginer les reproches qui auraient été adressés à l’État si la tentative d’occupation du terrain avait été immédiatement suivie d’une contre-manifestation d’agriculteurs.
Les forces de l’ordre n’ont pas été positionnées jusqu’au moment où, dans la nuit du vendredi au samedi, les terrains ont fait l’objet d’une tentative d’occupation. Cette précision me permet de répondre aux affirmations selon lesquelles on aurait cherché à protéger un terrain qui n’avait pas besoin de l’être. Ce n’est pas ainsi que le problème s’est posé, en termes d’ordre public. Dans un souci d’apaisement, j’avais donné l’instruction de ne pas positionner de forces, mais, dès lors que les zadistes ont décidé d’occuper le terrain, on devait le défendre pour éviter un affrontement dans lequel les forces de l’ordre n’auraient pu s’interposer. Toute autre affirmation relève d’une réécriture de l’histoire.
Avant cet épisode, le ministère de l’Intérieur a évité les affrontements en demandant à ses représentants sur place de créer les conditions d’un dialogue permanent. C’est au préfet de coordonner et d’organiser l’engagement des forces. Dans les opérations de ce type, je souhaite – je l’ai dit – la présence permanente d’un représentant de l’autorité civile, qui évalue le climat et conseille aux forces de l’ordre, engagées dans l’action, souvent même agressées, de se repositionner ou de graduer l’engagement de la force. Cette mesure, qui clarifiera les responsabilités, protégera les parties en présence.
Mme Buffet m’a également interrogé sur la nature et l’organisation des groupes de manifestants. Je vous répondrai par écrit dès que j’aurai reçu le résultat d’études menées non seulement par mon ministère mais par des chercheurs et des universitaires. On rencontre sur les ZAD une majorité d’acteurs non violents, environnementalistes, écologistes, parfois scientifiques, qui défendent leur position par la force des arguments. On y trouve aussi d’autres acteurs, qui prennent l’écologie en otage dans un but politique de déstabilisation et de contestation de l’État. Les forces de l’ordre subissent la violence très structurée de groupes organisés et radicaux, qui instrumentalisent les manifestants et cherchent l’incident. Cette situation, qui justifie les consignes d’apaisement que j’ai données, rend notre action extraordinairement difficile.
Monsieur Larrivé, créer 8 000 emplois pour en supprimer 12 000 ne me semble pas la meilleure manière de donner des moyens à la police et à la gendarmerie, qui, dans un contexte d’extrême tension, ont besoin de visibilité et de stabilité. Je vous rejoins cependant sur un point : il n’est pas utile de nous quereller sur le sujet. C’est la raison pour laquelle je ne ferai pas de la question des heures supplémentaires l’alpha et l’oméga de la lutte contre le terrorisme. Ne suscitons pas de mauvais débats, qui entretiendraient de mauvaises polémiques.
Le nombre de patrouilles sur la voie publique a été maintenu à un haut niveau et, dans un souci de rationalisation, des fonctionnaires travaillant dans des bureaux ont été remis sur la voie publique. À cet égard, vos chiffres ne correspondent pas à ceux dont je dispose, mais, vous sachant très précis, je m’engage à vérifier les conditions dans lesquelles s’opèrent ces patrouilles, et à vous en indiquer le nombre.
La révision générale des politiques publiques (RGPP), qui a conduit à réduire les effectifs, a entraîné la suppression de quinze escadrons de gendarmerie mobile. En optimisant la localisation des unités de forces mobiles sur le territoire, nous évitons de consommer en permanence des renforts qui pourraient être déployés soit sur des théâtres d’opérations soit, en complément des forces de sécurité, dans des actions transversales comme la lutte contre les cambriolages. Nous mobilisons en effet des unités de forces mobiles pour compléter les effectifs de sécurité intérieure. C’est ainsi que j’ai décidé d’affecter une demi-unité de force mobile à Calais, en complément des effectifs de sécurité publique, pour lutter contre la petite délinquance ou les cambriolages.
Le nombre de compagnies de CRS n’a pas changé, mais celles-ci se sont adaptées en interne. Elles peuvent fonctionner en demi-section, se séparer et passer à tout moment d’une opération de sécurisation à une opération de maintien de l’ordre. En outre, nous avons adapté les matériels. Certaines compagnies disposent désormais de canons à eau et peuvent mettre des barrages en place. Les équipements individuels, comme les boucliers ou les tenues de protection, ont été renforcés. Autant de mesures qui permettent de faire face aux situations avec des effectifs contraints.
Les événements de 2013 auxquels vous avez fait allusion se sont produits avant que je sois en situation. Le préfet Boucault, que vous allez auditionner, vous donnera à leur sujet toutes les informations que vous souhaiterez. Le défenseur des droits a adressé des recommandations relatives au maintien de l’ordre, au terme de l’opération menée le 14 juillet 2013. À l’époque, le ministère avait reçu des informations alarmantes : on pouvait craindre des perturbations entraînant des troubles graves à l’ordre public et mettant en péril la sécurité des personnes. Des dispositifs rigoureux de filtrage avaient été mis en place, notamment pour l’accès aux tribunes, lors du défilé. Ces mesures sont classiques, compte tenu du nombre important de personnalités présentes.
Le défenseur des droits, saisi par une personne dont le drapeau avait été confisqué, a jugé le dispositif de sécurité trop lourd, et considéré que la confiscation du drapeau pouvait s’apparenter à une interdiction générale et absolue. Je ne partage pas son analyse, puisque, pour peu que l’intéressée renonce à ce qui pouvait être considéré comme un projectile ou une arme par destination, elle aurait pu accéder aux tribunes. Quoi qu’il en soit, il faut répondre précisément et dans les plus brefs délais au défenseur des droits. J’ai donné des instructions dans ce sens au préfet Boucault, qui aura probablement répondu quand vous l’auditionnerez.
M. Meyer Habib. En interdisant des manifestations, en juin 2014, vous avez pris vos responsabilités, ce dont je vous félicite. Ceux qui ont défilé à cette époque en criant « Mort aux juifs » et en brandissant des drapeaux de Daech et du Hamas ont-ils été filmés, interpellés et condamnés ? Je déplore la présence d’élus de la République appartenant à la majorité, lors de certaines manifestations qui avaient été interdites. J’y vois, de leur part, un invraisemblable manque de responsabilité. Plus généralement, quelles instructions sont dispensées aux forces de l’ordre ? Celles-ci doivent-elles intervenir – le cas échéant, à quel moment ? – ou se contenter de filmer les événements ? Comment doivent-elles réagir dans les manifestations de foule ou les stades, où certains font des saluts nazis, des quenelles ou lancent des slogans racistes ?
M. Philippe Goujon. Je regrette que le secrétaire de la commission soit l’un des derniers à pouvoir prendre la parole.
M. le président Noël Mamère. Je donne la parole aux membres de la commission en respectant l’ordre dans lequel ils l’ont demandée.
M. Philippe Goujon. La conception française de l’ordre public a inspiré beaucoup d’États, qui envoient leurs forces s’entraîner à Saint-Astier. Néanmoins, le maintien de l’ordre a posé problème à plusieurs reprises : lors des manifestations de juin, lors de celle du Trocadéro ou lors de la Manif pour tous. Je regrette qu’il n’ait pas été possible de faire la transparence sur les deux derniers événements. La commission d’enquête que j’avais souhaité créer à leur sujet, et dont l’Assemblée nationale avait accepté le principe, a malheureusement été sabordée. Il serait précieux, en tout cas, que notre commission d’enquête puisse entendre le défenseur des droits.
M. le président Noël Mamère. Son audition est prévue.
M. Philippe Goujon. Monsieur le ministre, envisagez-vous de faire évoluer la législation relative au maintien de l’ordre ? Vous avez supprimé des moyens de défense, comme les grenades offensives ou lacrymogènes, qui ont pour objet de tenir les manifestants à distance. Ceux-ci ne risquent-ils pas de se rapprocher des forces de l’ordre ? Envisagez-vous de recourir à de nouvelles techniques ? Quels procédés utiliserez-vous pour reconquérir les terrains occupés par des manifestants violents, comme l’est actuellement celui de Sivens ? Comment appréciez-vous la réponse pénale aux délits et infractions commis par les manifestants ? Allez-vous supprimer certaines missions de sécurisation, compte tenu des besoins qui se dégagent en matière d’ordre public ? Considérez-vous qu’il faille limiter le temps de mobilisation des unités sur un site, afin de réduire les effets du stress situationnel ?
Mme Marie-Anne Chapdelaine. Vous avez plaidé pour un travail préalable avec les organisateurs des manifestations. Que faire quand ceux-ci sont dépassés ? Il arrive que des lycéens organisent une manifestation spontanée. Ne doit-on pas informer davantage les parents, voire l’ensemble de la population sur les risques qui surviennent quand un tel mouvement dégénère ? Enfin, le cadre législatif et réglementaire adapté aux manifestations classiques est-il opérant quand les forces de l’ordre doivent faire face à l’occupation d’une ZAC ?
M. Olivier Marleix. Dans notre cadre juridique, la responsabilité du maintien de l’ordre incombe aux forces de l’ordre, placées sous l’autorité du préfet et du ministre de l’Intérieur, ce qui dispense les organisateurs de manifestation d’une responsabilité effective. Dans le drame de Sivens, la seule information – ouverte le 26 octobre par le parquet de Toulouse – vise les faits commis par une personne dépositaire de l’autorité publique. Quel paradoxe ! Les organisateurs d’une manifestation dont on sait qu’elle risque de dégénérer sont soumis à moins de contraintes que ceux d’une simple course cycliste, auxquels on oppose un arsenal réglementaire très développé…
Dans l’affaire de Sivens, une concertation a eu lieu, dans un esprit d’apaisement, avec les organisateurs. Mais ceux-ci n’ont pas tenu leurs engagements. Le rapport de l’inspection générale de la gendarmerie nationale fait état de jets de pierre, de jets de bouteilles incendiaires et de piégeages réalisés avec des bouteilles de gaz. Faut-il compléter notre cadre juridique pour mieux responsabiliser les organisateurs et les obliger à apporter des garanties supplémentaires ? Dans le dossier de Sivens, envisagez-vous de porter plainte contre les organisateurs, ou du moins de solliciter du parquet, sur la base de l’article 40 du code de procédure pénale, un élargissement de l’information judiciaire ?
M. le président Noël Mamère. Je regrette, monsieur Marleix, que vous n’ayez pas pu assister à l’audition d’un des organisateurs de la manifestation de Sivens.
M. Guy Delcourt. Nul ne se remettra de la mort d’un jeune homme de vingt et un ans, et nul ne se serait remis du fait qu’un gendarme mobile ait eu le visage brûlé par un cocktail incendiaire. Lors de son audition, le général Bertrand Cavallier, ancien commandant du Centre national d’entraînement des forces de gendarmerie, à Saint-Astier, a évoqué avec prudence le rôle du juge. Il n’a pas répondu, quand je lui ai demandé si les juges détachés par le parquet, souvent très jeunes, avaient la compétence requise pour statuer sur une intervention en terrain d’opérations. Il a ensuite indiqué que le maintien de l’ordre était une opération très particulière, nécessitant une formation adaptée, et qu’il vaudrait mieux, parfois, que les forces départementales restent dans leur casernement. Faut-il rappeler que les policiers ne demandent qu’à suivre la formation dispensée aux gendarmes à Saint-Astier ?
M. Jean-Paul Bacquet. Vous avez brutalement mis fin à l’utilisation des grenades offensives. Depuis combien de temps la gendarmerie les utilisait-elle ? Combien d’accidents ont-elles causés, avant celui de Sivens ? Est-il responsable de désarmer les forces de l’ordre, dans un contexte où les manifestations sont de plus en plus violentes et de mieux en mieux organisées ?
M. Daniel Vaillant. Quels moyens envisagez-vous, en lien ou non avec les nouvelles technologies, pour assurer à la police un temps d’avance sur les organisateurs de manifestation ? Comment allez-vous employer le renseignement territorial, afin de gagner en efficacité ?
Faut-il revisiter sur le plan législatif l’équilibre entre déclaration et interdiction ?
Selon une personnalité que nous avons auditionnée, moins les forces de l’ordre sont présentes et visibles, moins il y a de problèmes sur le terrain. L’expérience me conduit à penser l’inverse : quand les forces de l’ordre sont nombreuses, ceux qui veulent détourner une manifestation y parviennent moins facilement.
Nous avons parlé des manifestants, des organisateurs et des forces de l’ordre, mais des tierces personnes peuvent aussi être victimes collatérales de manifestations violentes. Comment faut-il envisager leur droit et protéger leurs libertés ?
J’ai été surpris d’entendre le directeur des libertés publiques nous dire qu’on était peu armé pour poursuivre le port d’insignes ou de pancartes incompatibles avec nos textes fondamentaux. Quelle est votre position à cet égard ?
L’utilisation de photos ou de vidéos peut dissuader ceux qui voudraient recourir à la violence. Dans le même esprit, peut-on utiliser les drones pour suivre les mouvements d’une manifestation ?
M. Philippe Folliot. À mon tour, je rends hommage aux forces de l’ordre, qui exercent leur mission dans des conditions très difficiles. Dès lors que des manifestants ultraviolents portent des armes létales, on ne peut douter de leur volonté de tuer. Dans ce contexte, je vous invite à reconsidérer votre décision d’interdire les grenades offensives, que vous avez peut-être prise à chaud, sous le coup de l’émotion et peut-être dans une certaine précipitation.
Une personnalité que nous avons auditionnée a remis en cause – à tort, selon moi – la capacité d’intervention du PSIG de Gaillac. Comment réagissez-vous à un tel jugement ?
La tradition latine place le maintien de l’ordre sous le double signe de la police et de la gendarmerie. Faut-il conserver cette dualité entre une force de statut civil et une force de statut militaire, ou doit-on fondre celles-ci en une seule et même entité ?
Dans une lettre poignante, la maire de Lisle-sur-Tarn a appelé attention du Premier ministre sur la situation de la ZAD de Sivens, qui constitue une zone de non-droit. Combien y a-t-il de zones de ce type en France ? Comment allez-vous y rétablir l’ordre pour éviter de nouveaux débordements ?
M. le ministre. Monsieur Folliot, je ne prends aucune décision sous le coup de l’émotion. Si j’avais cédé aux pressions, après la tragédie de Sivens, j’aurais dit des choses bien incongrues. Je ne me suis jamais défaussé de mes responsabilités en chargeant les forces de l’ordre non plus que tel responsable administratif. Quels que soient le tumulte, le vacarme et les polémiques, mon rôle de ministre est de chercher la vérité en respectant scrupuleusement le droit des personnes et des organisations. On ne peut pas me reprocher à la fois d’avoir été proche de mes troupes et d’avoir cédé à l’émotion.
Je souhaitais connaître la vérité sur un drame qui m’a affecté, comme tous les Français. Un juge était chargé de l’affaire. Les enquêtes administratives que j’avais engagées contribueraient à faire la lumière. À mon sens, une munition qui avait tué un jeune homme ne pouvait pas être maintenue en service, mais on ne pouvait pas supprimer son utilisation si l’on risquait d’exposer les forces de l’ordre à un danger.
J’ai essayé de prendre une décision juste pour éviter qu’un tel drame ne se reproduise. La caractéristique d’une opération de maintien de l’ordre dans la République est que, quelles que soient les violences auxquelles les forces de l’ordre sont confrontées, il ne peut pas y avoir de mort. J’ai donc réuni gendarmerie et police. J’ai fait l’inventaire des munitions utilisées dans le cadre du maintien de l’ordre. J’ai confié à l’inspection générale de la police nationale et de la gendarmerie nationale le soin d’examiner la question. La grenade en cause a les mêmes caractéristiques que les grenades à effet de soufre, qui, elles, n’ont jamais tué. Par ailleurs, elle est utilisée par la gendarmerie, mais non par la police, qui n’en a jamais eu besoin pour maintenir l’ordre. Sa suppression ne compromet donc pas l’efficacité sur le terrain. J’ai pris, face à un drame qui appelait une réponse républicaine ferme, une décision rationnelle.
Pour rétablir l’ordre dans des ZAD, qui risquent de devenir des zones de non-droit, je ne peux intervenir que dans le respect rigoureux du droit. On ne procède pas à l’évacuation d’un terrain si l’autorité publique ou privée qui en est propriétaire n’a pas appliqué toutes les procédures permettant à la force publique d’intervenir. D’un autre côté, nul ne peut, sous prétexte qu’il estime avoir raison, s’ériger au-dessus de l’État de droit, ce qui serait une forme de violence inacceptable dans une République. Il ne servirait à rien que le souverain vote des lois si certains estiment qu’en raison de ce qu’ils pensent, ils peuvent s’en affranchir.
Si des décisions de justice doivent être appliquées par les forces de l’ordre, mon rôle de ministre de l’Intérieur sera de m’y employer. J’ai lu la lettre de la maire de Lisle-sur-Tarn. Je comprends son exaspération comme celle des riverains. Vivre ensemble dans une société de droit, c’est aussi s’interroger sur les conséquences pour autrui des violences qu’on peut exercer. Cette élue affronte une situation difficile face à laquelle – la ministre de l’écologie l’a indiqué la semaine dernière – une mobilisation est possible, dans le respect rigoureux des procédures.
Monsieur Habib, quand, dans une manifestation violente ou non, des individus exhibent des insignes, tiennent des propos ou brandissent des banderoles qui sont autant d’appels à la haine ou de provocations au terrorisme, ces comportements inacceptables appellent une sanction pénale. Cependant, lors de la manifestation, il n’est pas toujours possible de procéder aux interpellations, qui risquent d’engendrer des violences plus grandes encore. C’est pourquoi j’ai donné des instructions pour qu’on filme le plus possible les manifestations et utilise au mieux la vidéosurveillance. En juillet, il a été procédé à relativement peu d’interpellations sur le coup – même si celles-ci ont été plus nombreuses qu’à l’accoutumée –, et à beaucoup d’interpellations par la suite. Les événements de Sarcelles ont donné lieu à des mises en examen, incarcérations et jugements à mesure que les informations récupérées permettaient la judiciarisation.
Monsieur Goujon, je ne pense pas qu’une action utile passe nécessairement par la loi, compte tenu de l’encombrement du calendrier législatif, de l’urgence qui s’attache aux opérations de maintien de l’ordre et du fait que celui-ci ne relève peut-être pas de l’article 34 de la Constitution. Mieux vaut intégrer les bonnes préconisations, comme celles qui résulteront de votre commission d’enquête, aux consignes données aux forces de l’ordre ou aux préfets, ou aux textes à caractère réglementaire.
En ce qui concerne la reconquête des terrains, il faut être très ferme, éviter l’ambiguïté et envoyer des messages républicains incitant au respect de l’état de droit. La réponse pénale doit être la plus ferme possible. Les sanctions les plus sévères doivent frapper ceux qui cassent ou témoignent d’une violence délibérée à l’égard des forces de l’ordre.
M. Vaillant a cité – sans la reprendre à son compte – la thèse selon laquelle moins les forces de l’ordre sont présentes et visibles, moins il y a de problème sur le terrain. Si celles-ci n’avaient pas été présentes à Nantes, Toulouse et Gaillac, je serais en train d’expliquer à une tout autre commission d’enquête pourquoi le ministère de l’Intérieur a échoué dans ces villes à protéger les biens et les personnes. Comment peut-on considérer que c’est la présence des forces de l’ordre qui crée la violence, alors que cette présence ne se justifie que par la volonté de limiter la violence annoncée ? Ce faux raisonnement est blessant pour les forces de l’ordre, qui s’exposent chaque jour pour assurer la sécurité de tous. Heureusement, les Français ne s’y trompent pas. J’ai trouvé bouleversant le juste hommage qu’ils ont rendu récemment aux forces de l’ordre.
Mme Chapdelaine, M. Delcourt et M. Vaillant se demandent si l’on peut modifier le processus de déclaration et d’autorisation, et entretenir sur le plan contractuel ou conventionnel une relation différente avec les organisateurs, voire les sanctionner davantage. Je ne pense pas qu’il faille remettre en cause le principe de la déclaration, qui correspond à la reconnaissance du droit de manifester.
En France, le pouvoir n’autorise pas une manifestation. On déclare une manifestation parce qu’on est libre de manifester. Cette liberté est intangible et absolue en démocratie. Le cas échéant, l’autorité publique peut interdire la manifestation déclarée, quand celle-ci fait courir un risque grave à l’ordre public – encore cette interdiction s’exerce-t-elle sous le contrôle du tribunal administratif et du Conseil d’État. Il ne faut pas modifier cet équilibre. Le droit de manifestation doit demeurer absolu, la déclaration étant la règle et l’interdiction, l’exception. Cinq interdictions ont été prononcées à Paris, pour 2 047 manifestations déclarées.
Vous m’avez également demandé si l’on peut modifier la relation entre l’organisateur de la manifestation et les pouvoirs publics. Dans le cas de Sivens, ceux-ci ont su mener un dialogue responsable et intelligent, qui nous a permis dans un premier temps de ne pas positionner de forces de l’ordre. Ben Lefetey s’est comporté de manière très convenable. Le problème est qu’il n’était pas seul. À Sivens, comme dans d’autres ZAD, se trouvent des gens organisés au plan européen pour instaurer la violence et faire dégénérer la situation. Dans ces conditions, la discussion avec un organisateur pacifique ne sert pas à grand-chose, d’autant qu’on hésite, dans un tel dialogue, à faire état de tous les renseignements dont on dispose. Le pouvoir public donne l’impression de ne pas vouloir autoriser une manifestation qui pourrait le gêner, alors qu’une manifestation pacifique ne le gêne en rien.
Les groupes radicalisés cherchent la violence et l’incident, dont ils se serviront pour justifier le discours selon lequel la violence est consubstantielle aux forces de l’ordre et l’État, illégitime. Conservons le droit existant. Discutons le plus longtemps possible avec les organisateurs, dans une relation républicaine et respectueuse, pour que toutes les manifestations pacifiques puissent avoir lieu. Informons-les des risques auxquels ils s’exposent quand des débordements sont possibles. Créons le moyen de judiciariser tout ce qui est pénalement répréhensible, ce qui suppose de nous doter de moyens audiovisuels. Cette situation est contraignante, mais nous devons l’accepter, pour pouvoir, malgré les nouvelles formes de violences radicales, continuer à garantir la liberté de manifester.
M. le président Noël Mamère. Ben Lefetey, que nous avons auditionné, a reconnu ne pas avoir pu contrôler la manifestation, pendant la nuit du 25 octobre. Vous avez expliqué la présence des forces de l’ordre par la crainte d’une contre-manifestation. L’enquête judiciaire expliquera pourquoi il n’y avait que soixante-cinq gardes mobiles en face des 150 manifestants qui, la veille, s’étaient déjà rendus coupables de violence.
M. le ministre. Vous imaginez dans quelles affres se trouve un ministre de l’Intérieur viscéralement attaché aux principes républicains, désireux d’appliquer le droit et déterminé à faire respecter l’autorité de l’État. Lors de la tragédie de Sivens, on m’a d’abord sommé de justifier la présence des forces de l’ordre. On me demande à présent pourquoi elles étaient si peu nombreuses. Je le répète : j’ai d’abord considéré qu’il ne fallait pas les positionner. Mais, dès l’ordre que notre interlocuteur, Ben Lefetey, était débordé par des casseurs, et qu’on pouvait craindre une contre-manifestation, on ne pouvait laisser s’affronter des casseurs et des représentants du monde agricole exaspérés. S’il y avait eu des morts et des blessés, c’est non devant vous mais devant une autre instance que je devrais répondre aujourd’hui.
Tous les responsables de la police et de la gendarmerie vous confirmeront que, dans les opérations de maintien de l’ordre, le rapport entre forces de l’ordre et manifestants n’est pas d’un pour un. Comment ferait-on dans une manifestation comme celle du 11 janvier, qui a réuni un million et demi de personnes ? On se sert du positionnement, des munitions et de l’évaluation de la situation. Je vous suggère d’auditionner le plus grand nombre possible de mes collaborateurs, pour aller jusqu’au bout de cette réflexion stratégique.
M. le président Noël Mamère. Monsieur le ministre, je vous remercie de nous avoir répondu si longuement.
*
* *
Audition, ouverte à la presse, de M. Bernard BOUCAULT, préfet de police de Paris
Compte rendu de l’audition du jeudi 5 février 2015
M. le président Noël Mamère. Monsieur le préfet, conformément aux dispositions de l’article 6 de l’ordonnance du 17 novembre 1958, je dois vous demander de prêter le serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité.
(M. Bernard Boucault prête serment.)
Vous êtes accompagné de M. Laurent Nunez, votre directeur de cabinet, et de M. Alain Gibelin, directeur de l’ordre public et de la circulation. Si ces messieurs sont appelés à s’exprimer devant nous, je leur demanderai également de prêter serment.
Je vous invite à faire le point sur les thèmes de cette Commission d’enquête relative au maintien de l’ordre dans les manifestations. M. le rapporteur Pascal Popelin vous posera ensuite la première série de questions, avant les autres commissaires présents.
Cette Commission d’enquête parlementaire a été créée après les événements de Sivens. Elle n’a pas pour objet de revenir sur ce qui s’est passé sur ce lieu, dans la mesure où une information judiciaire est en cours, mais de tenter de contribuer à l’amélioration de l’ordre public, en faisant évoluer la doctrine dans un sens qui corresponde à l’évolution de notre société.
M. Bernard Boucault, préfet de police de Paris. L’ordre public dans la capitale constitue historiquement la première mission du préfet de police, créé dans ce but par le Consulat par la loi du 28 pluviôse an VIII, précisée par l’arrêté des Consuls du 12 messidor an VIII. Nous visons encore ces textes lorsque nous modifions l’organisation de la préfecture de police.
Depuis cette époque, le caractère hautement sensible de cette responsabilité ne s’est pas démenti. Siège des institutions et des représentations diplomatiques, capitale de la cinquième puissance économique du monde, qui assume pleinement ses responsabilités de membre permanent du Conseil de sécurité de l’ONU, perçue dans le monde entier comme la capitale des droits de l’homme, Paris constitue le réceptacle de tous les mécontentements en France mais aussi en provenance de l’étranger. Il faut savoir que 30 % des manifestations n’ont absolument rien à voir avec la France : ce sont des contestations internes à certains pays, Sénégal, Côte-d’Ivoire, Gabon, Congo, ou relatives à des conflits extérieurs, par exemple entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie.
Quelque 3 000 rassemblements à caractère revendicatif se déroulent chaque année à Paris : 3 382 en 2012, 3 411 en 2013, 2 623 en 2014, dont de 600 à 700 de manière inopinée, ce qui pose, j’y reviendrai, des problèmes particuliers. Environ 10 millions de personnes défilent ou se rassemblent sur la voie publique parisienne chaque année. À ce chiffre, déjà considérable, il convient d’ajouter les manifestations festives – technoparades, gay prides –, sportives – Tour de France, marathons, matchs de football – et institutionnelles – le défilé du 14 juillet et les nombreuses visites de chefs d’État et de Gouvernement étrangers. Ce sont au total plus de 6 300 événements que le préfet de police doit encadrer annuellement dans la capitale.
Seul un tout petit nombre ont fait l’objet d’une mesure d’interdiction : cinq en 2014, vingt-cinq en 2013, quinze en 2012. C’est toujours très largement inférieur à 1 %. Dans l’équilibre qui doit être trouvé entre l’exercice de la liberté de manifester ses opinions et les impératifs de l’ordre public, deux objectifs de valeur constitutionnelle, la balance penche ainsi très nettement en faveur de la liberté, ce qui est dans l’esprit de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
Je présenterai dans un premier temps l’organisation dont est dotée la préfecture de police pour assurer ses missions de maintien de l’ordre et, dans un second temps, les nouvelles formes de contestation, les difficultés qu’elles présentent et les mesures que nous avons prises pour y répondre.
Il existe à la préfecture de police une direction spécialisée, la direction de l’ordre public et de la circulation (DOPC), créée en 1999 et issue de la scission d’une partie de l’ancienne direction de la sécurité publique. Les opérations de maintien de l’ordre à Paris se déroulent dans des conditions différentes qu’à Sivens, dans un milieu très urbanisé, à proximité immédiate de centres de décision politiques ou économiques du pays. Les manifestations parisiennes se déroulent dans des secteurs qui continuent de vivre normalement ; des personnes à quelques dizaines ou centaines de mètres d’une manifestation peuvent n’avoir aucune conscience de sa présence.
La préfecture de police s’appuie sur une chaîne de commandement très intégrée, pilotée en première ligne par le directeur de cabinet du préfet de police, et qui assure la continuité de l’ordre public toute l’année, jour et nuit. Chaque événement reçoit un traitement particulier en fonction des risques connus et du lieu où il se déroule. Une ou plusieurs réunions sont organisées en lien avec le cabinet du préfet de police, parfois sous la présidence du directeur de cabinet, et, pour les plus importantes, par moi-même. Il revient à l’état-major de la DOPC de préparer et d’assurer la gestion des événements, selon les directives qu’il reçoit de ma part ou de celle de mon directeur de cabinet. Pour chaque manifestation, un chef d’état-major adjoint de la DOPC, sous l’autorité de M. Alain Gibelin, est responsable de l’ensemble des événements d’une journée considérée. Il assure la préparation de ceux-ci, en étant lui-même présent ou en désignant une autorité qui le représente, par les reconnaissances nécessaires, les discussions avec les organisateurs, et conduit l’exécution des services qu’il a préparés, soit sur le terrain soit, pour les événements les plus sensibles, via une salle de commandement. J’insiste sur le fait qu’il n’y a pas de césure entre les phases de préparation et d’exécution, qui sont confiées aux mêmes personnes.
Sur le terrain, le préfet de police est représenté, pour chaque rassemblement à risque, par un commissaire de police en liaison permanente avec sa hiérarchie, le chef de district de l’ordre public et l’état-major de la DOPC. Ce commissaire est chargé de vérifier que la force est employée en dernier recours et dans le respect des principes de nécessité et de proportionnalité.
En dehors des cas où la force est employée en légitime défense ou pour tenir une position prédéfinie, l’accord de l’autorité préfectorale est toujours demandé pour recourir à cette contrainte contre les manifestants. L’ensemble des événements de voie publique font l’objet d’un suivi continu du directeur de cabinet, par l’intermédiaire des conseillers de police ou de l’officier de permanence. Le directeur de cabinet peut à tout moment évoquer à son niveau le déroulement d’une manifestation, prendre les décisions nécessaires, m’en informer ou me demander la validation de telle ou telle décision. Cette chaîne de commandement permet de limiter au plus juste l’emploi de la force dans les manifestations.
Le deuxième élément de cette organisation, c’est la concertation permanente avec les organisateurs. Le bon déroulement d’une manifestation tient en grande partie à l’existence d’une concertation préalable entre les organisateurs et les responsables des services de maintien de l’ordre, même si – on peut le regretter – les textes relatifs aux déclarations de manifestation ne prévoient pas de négociation avec les déclarants. Dans la réalité, cette négociation a lieu et c’est grâce à elle que les choses se passent bien, dans la très grande majorité des cas. On pourrait, c’est une suggestion que je fais, rendre cette concertation obligatoire.
Il existe un guichet unique vers lequel convergent toutes les déclarations de manifestation : le secrétariat de l’ordre public de l’état-major de la DOPC. L’ensemble des projets sont instruits, même ceux qui ne sont pas déposés selon les règles fixées par la loi. Nous ne faisons pas de juridisme pointilleux. Vous savez qu’est imposée la signature de trois personnes domiciliées à Paris et que la demande doit être faite entre quinze et trois jours francs avant l’événement. Nous privilégions le dialogue avec les organisateurs, même s’il n’y a que deux signatures, si les signataires n’habitent pas à Paris, si les délais ne sont pas totalement respectés. Nous sommes pragmatiques. Nous souhaitons concilier les objectifs des organisateurs, qui veulent exprimer leur opinion sur la voie publique, avec les nécessités de l’ordre public, ou avec d’autres occupations de l’espace public prévues au même moment.
Ces discussions aboutissent dans la majorité des cas à un accord. Certains organisateurs – c’est une évolution récente – sont toutefois de moins en moins enclins à accepter les itinéraires ou les horaires suggérés, et appliquent le principe de la déclaration préalable dans toutes ses acceptions, en ne laissant d’autre alternative qu’accepter ou interdire. Une autre évolution inquiétante est le nombre significatif de manifestations inopinées qui s’affranchissant du cadre légal de la déclaration préalable : 719 en 2012, 733 en 2013, 576 en 2014. Il serait souhaitable d’introduire dans le droit positif une obligation de concertation préalable, qui permette de responsabiliser les organisateurs.
Pour les rassemblements les plus importants, un officier de liaison, désigné par le directeur de l’ordre public, est mis en place auprès des organisateurs, afin qu’une liaison permanente puisse s’établir entre ces derniers et les responsables de l’ordre public.
Le troisième élément de l’organisation, c’est le renseignement. Pour bien préparer une manifestation, il nous faut un renseignement fiable, pertinent et aussi précis que possible. C’est le rôle de la direction du renseignement, dont le responsable, René Bailly, est ici présent, et qui a pour mission de déterminer tous les aspects d’un événement grâce à un travail de recueil d’informations, en milieu aussi bien ouvert que fermé, de veille sur les réseaux sociaux et Internet, de consultation des archives, en reprenant l’historique des manifestations. L’échange d’informations entre services, en particulier avec les autres services de renseignement, le service de renseignement territorial, qui nous donne des informations sur la participation en provenance de province, mais aussi la direction générale de la sécurité intérieure (DGSI), est essentiel. Le but de ce travail est d’identifier les risques de perturbations, de dégradations, voire de heurts avec les forces de l’ordre, de même que les sites les plus sensibles le long de l’itinéraire, et ainsi de fournir une aide à la décision aux responsables de l’ordre public.
Cette direction du renseignement a plusieurs missions au cours de l’événement. Tout d’abord, elle compte les manifestants, selon une méthode rigoureuse qui a fait ses preuves, sous le contrôle d’une commission indépendante composée de trois personnalités : sa présidente Mme Dominique Schnapper, ancien membre du Conseil constitutionnel, M. Daniel Gaxie, professeur à l’Université Paris I, et M. Pierre Muller, jusqu’à il y a peu chef de l’inspection générale de l’INSEE. La direction du renseignement transmet également aux responsables du maintien de l’ordre, en temps réel, l’identification des éléments à risque et des auteurs d’infractions.
Nous sommes aujourd’hui confrontés à de nouvelles formes de protestation. Ces cinq ou six dernières années, ont eu lieu à Paris des événements d’une ampleur et d’une portée médiatique significatives : mobilisations étudiantes et lycéennes très suivies, répercussion quasi immédiate de crises et d’événements internationaux entraînant la réaction non encadrée de diverses communautés étrangères vivant en France, avec le Printemps arabe, les événements du Tibet, ceux de Côte-d’Ivoire, les guerres au Mali, en Syrie, en Irak, le conflit israélo-palestinien. Nous avons vu apparaître aussi de nouvelles habitudes culturelles, difficilement prévisibles et contrôlables : flash mobs, apéros géants, distribution d’argent sur la voie publique organisée au dernier moment… Nous avons par ailleurs assisté à la radicalisation des franges politisées les plus extrêmes et le retour de violences de rue entre différents mouvements, antifas, extrême-droite, Printemps français et ses dérivés… Les accès rapides en transport en commun permettent à des individus violents et déterminés de se mobiliser en très peu de temps, via l’utilisation des réseaux sociaux.
L’expression des mécontentements peut prendre des formes multiples : envahissement de la voie publique et entrave à la circulation, envahissement et occupation de locaux, prise à partie violente d’opposants lors de manifestations, perturbation des services d’ordre institutionnels, saccage du mobilier urbain et de commerces par des bandes violentes parties à la manifestation ou en marge de celle-ci.
Force est de constater que les manifestations ont évolué et dépassé le schéma traditionnel d’un rassemblement massif de personnes encadrées par l’organisateur. La doctrine traditionnelle du maintien de l’ordre, selon laquelle il convient de tenir à distance les manifestants afin d’éviter tout risque de confrontation, ne paraît pas adaptée lorsqu’il se commet des exactions ou des violences sur les personnes en marge ou à l’intérieur d’un rassemblement, particulièrement à Paris, où aucun débordement ne peut être toléré, eu égard aux atteintes graves portées à la fois aux institutions et à l’image de la France dans le monde, notamment en raison de la médiatisation immédiate de tout désordre dans la capitale.
Ces nouvelles formes de contestation ne remettent pas en cause le modèle de commandement que j’ai décrit, mais plutôt l’organisation opérationnelle des forces déployées sur le terrain. L’emploi des forces mobiles traditionnelles, escadrons de gendarmerie mobile (EGM) et compagnies républicaines de sécurité (CRS), n’est pas toujours adapté à ces nouvelles formes, ou plus précisément n’offre qu’une réponse partielle.
Les difficultés d’ordre tactique sont au nombre de quatre. Tout d’abord, le principe du fractionnement des EGM et des CRS est admis en sécurisation mais il reste à développer en maintien de l’ordre. En effet, à Paris, l’engagement des forces de maintien de l’ordre ne doit pas seulement permettre de traiter une manifestation mais aussi un second événement : des exactions commises par des groupes détachés de ce rassemblement quelques rues plus loin. Or l’absence de fractionnement au-delà de la demi-compagnie ou du demi-escadron ne permet pas toujours cette souplesse. La difficulté est encore plus prégnante lorsque nous disposons d’unités à trois escadrons ou trois sections, et non à quatre, car alors le fractionnement par moitié n’est plus possible.
Ensuite, la réversibilité des missions n’est pas toujours possible. Nous sommes très heureux de pouvoir bénéficier des effectifs conséquents des unités de la réserve nationale, qui présentent d’indéniables avantages dans le cadre d’un maintien de l’ordre statique ou défensif, mais ces unités sont plus limitées face à des phénomènes de violence urbaine qui nécessitent une très grande mobilité.
La troisième difficulté est relative aux interpellations et à leur traitement judiciaire. Les interpellations ne sont pas toujours suivies de procédures judiciaires adaptées et efficaces, les conditions d’intervention de ces unités n’étant pas propices à la rédaction de rapports ou de procès-verbaux d’interpellation répondant aux attentes de l’autorité judiciaire.
Enfin, se pose la question de l’articulation des commandements entre la préfecture de police et les unités de la réserve nationale engagées sur l’agglomération. Les services d’ordre de la préfecture de police les plus importants se caractérisent le plus souvent par l’emploi simultané de plusieurs unités de la réserve nationale et donc la présence de coordonnateurs de ces unités, appartenant aux CRS ou aux gendarmes mobiles, distincts des responsables de la DOPC. Pour dépasser cette difficulté, j’ai souhaité, dès mon arrivée, que la DOPC puisse associer les responsables des forces mobiles eux-mêmes à la conception des dispositifs, de façon qu’ils y adhèrent au mieux. Un officier supérieur de la gendarmerie mobile a donc été récemment affecté à titre permanent auprès du directeur de l’ordre public. Un commissaire de police du corps des CRS était déjà installé dans les locaux de la DOPC depuis plusieurs années, participant à la conception de ces dispositifs.
La réponse opérationnelle que nous apportons à ces difficultés réside dans le dispositif d’emploi des compagnies d’intervention de la préfecture de police, sous l’autorité du directeur de l’ordre public, et dans l’implication de l’ensemble des directions de la préfecture de police dans la mise en œuvre des services d’ordre sous un commandement unique assuré par le directeur de l’ordre public.
La préfecture de police a refondé l’organisation, la doctrine d’emploi et les modes d’intervention des compagnies d’intervention. Il s’agit de disposer de compagnies capables d’intervenir comme les unités classiques, CRS et EGM, mais aussi de se scinder en unités multiples, mixant des effectifs en tenue et des effectifs en civil, pour répondre dans la même séquence de temps à l’évolution de la manifestation et faire face aux groupes de casseurs et fauteurs de trouble de tous acabits.
Ces compagnies d’intervention, au nombre de sept, six de jour et une de nuit, avec des effectifs de 110 personnes, bénéficient d’une formation parfaitement similaire, ce qui a pour conséquence que n’importe quelle composante de l’une de ces compagnies, une section, un groupe, un demi-groupe, intervient en parfaite complémentarité avec n’importe quelle autre composante d’une autre compagnie. Par ailleurs, chaque composante est à même, en cours de vacation, d’assurer sa mission en tenue civile, en complément d’autres unités en uniforme. Ces compagnies répondent ainsi à un double objectif d’adaptabilité et de souplesse d’emploi, tout en étant utilisées en formations classiques de maintien de l’ordre.
L’emploi de compagnies mixtes juxtaposant unités civiles d’interpellation et unités légères d’intervention au sein d’une même compagnie d’intervention est un schéma unique en France. Il a été systématisé, depuis 2009, sur toutes les grandes manifestations parisiennes, ainsi que sur un grand nombre d’événements de voie publique. Ce schéma permet d’apporter une réponse complète à la problématique des fauteurs de trouble insérés dans les cortèges mais aussi à celle de la délinquance acquisitive lors de grands regroupements. Ces compagnies mixtes permettent en outre d’obtenir un meilleur traitement judiciaire, notamment grâce à l’amélioration de la rédaction des PV de contexte et des procédures d’interpellation. Leur travail est toujours accompagné d’un vidéaste professionnel filmant leurs interventions.
La souplesse est aussi permise par l’emploi des effectifs des brigades anti-criminalité (BAC) de la direction de la sécurité de proximité de l’agglomération parisienne, qui prennent en charge les flancs ou la périphérie immédiate du cortège, et peuvent se projeter très vite sur le cortège pour mettre un terme aux exactions, avec des unités en civil, voire en tenue. J’ai souhaité que ces BAC, quand elles interviennent, soient placées sous l’autorité du directeur de l’ordre public, pour qu’il n’y ait qu’un seul chef dans des opérations faisant intervenir des unités de plusieurs directions.
Ce modèle n’a pas vocation à se substituer au modèle traditionnel d’emploi des forces mobiles, qui restent nécessaires. S’il correspond aux enjeux de la capitale, il ne paraît pas destiné à être généralisé sur l’ensemble du territoire national.
M. Pascal Popelin, rapporteur de la commission d’enquête. Le ministre de l’intérieur, devant notre commission mardi, a cité le préfet Maurice Grimaud, l’un de vos illustres prédécesseurs. Peut-on légitimement, selon vous, distinguer entre un ordre public, neutre au plan idéologique, et un ordre républicain, davantage porteur de valeurs ? Si c’est le cas, comment peut-on caractériser cet ordre républicain ?
Vous avez évoqué la multiplication des manifestations inopinées, et vous souhaitez qu’une obligation de concertation préalable soit inscrite dans notre cadre juridique. Le code de la sécurité intérieure suggère qu’une manifestation ne bascule pas dans le régime de l’attroupement du seul fait qu’elle serait non déclarée : il faut, pour que ce basculement ait lieu, un risque de trouble à l’ordre public. Considérez-vous que ce dispositif est une faiblesse ou bien est-il adapté au principe de liberté qui gouverne notre société ?
Vous avez insisté sur l’importance de la prévention dans votre travail. La préservation de l’ordre public commence par le dialogue et la coopération en amont entre les organisateurs d’une manifestation et l’autorité investie des pouvoirs de police. Peut-il arriver que ce dialogue contraigne la manifestation à un point tel que le régime de liberté posé par la loi en est contourné, ou bien faudrait-il au contraire renforcer les exigences pesant sur les organisateurs ? Je pense par exemple au modèle appliqué à certaines manifestations sportives. Rencontrez-vous davantage de difficultés avec certaines catégories d’organisateurs ? On a coutume de dire qu’en matière d’organisation de manifestations un certain savoir-faire s’est perdu.
Quelle est la part du renseignement pour besoins d’ordre public dans l’activité de la direction du renseignement, à côté de la prévention du terrorisme, de la lutte contre la criminalité et de la recherche de l’information opérationnelle ? Comment s’organise le renseignement spécifique aux manifestations d’ampleur nationale ?
Les dispositifs de vidéoprotection implantés sur la voie publique constituent-ils une aide pour les forces de maintien de l’ordre, au moment de la manifestation, et a posteriori ? Le ministre a indiqué mardi son souhait que l’ensemble des manifestations soient filmées. Je crois comprendre, dans votre propos, que c’est déjà le cas à Paris.
Enfin, dans l’hypothèse où l’on connaît l’identité d’éléments radicaux, peut-on imaginer d’exclure ces individus des manifestations, par exemple en les obligeant à se présenter auprès des forces de police ou de gendarmerie, une mesure qui pourrait s’appliquer aux individus ayant déjà fait l’objet de condamnations pour violences dans le cadre de manifestations ? Serait-ce, selon vous, conforme à notre droit, et notamment au respect des libertés fondamentales ?
M. Bernard Boucault. Maurice Grimaud est un modèle pour nous. Pour répondre à votre première question, je citerai ce que je dis toujours lors de la réunion de briefing préalable à une manifestation avec toutes les personnes qui participeront au maintien de l’ordre : « Cet après-midi, nous n’aurons pas devant nous des adversaires mais des citoyens qui veulent exercer leur droit de manifester pour exprimer leur opinion, et notre devoir est de garantir cette liberté, en leur permettant de l’exercer en toute sécurité. » C’est cela, selon moi, l’ordre public républicain, et il doit inspirer toutes les décisions que nous prendrons au cours de la manifestation.
La concertation préalable est extrêmement importante, et je souhaite qu’elle s’impose en droit positif. Je pense également qu’il faut prévoir des engagements en matière de service d’ordre. Quand on organise une manifestation, on doit prendre ses responsabilités et prévoir un service d’ordre en conséquence, adapté à la mobilisation que l’on attend. Certains organisateurs n’y manquent pas ; les grandes centrales syndicales, les grands partis politiques ont un grand savoir-faire dans ce domaine, et le travail avec leurs services d’ordre est facile. Ce n’est pas le cas pour des organisations aux structures plus légères, qui n’ont pas les moyens d’assurer le calme dans leurs manifestations. Il me semble important que nous puissions imposer aux organisateurs des engagements précis sur le service d’ordre.
Je fais confiance au juge pour déterminer ce qui est attroupement et ce qui ne l’est pas. On se rend compte assez rapidement si ceux qui refusent de se disperser à la fin d’une manifestation troubleront l’ordre public ou non. Les textes et la jurisprudence sur l’attroupement nous permettent de travailler dans de bonnes conditions.
Les organisations avec lesquelles nous avons des difficultés sont souvent des organisations extrémistes. Les déclarants ne sont pas forcément les responsables en vue, mais des inconnus, qui signent au nom de telle ou telle organisation. Nous avons connu de grandes difficultés lors des manifestations contre le mariage pour tous, l’année dernière. Certaines manifestations se sont très bien déroulées, puis, à mesure que des tensions sont apparues parmi les organisateurs, que des scissions se sont produites, avec la création de nouveaux mouvements comme le Printemps français, et la réapparition de certains groupuscules d’extrême-droite qui avaient plus ou moins disparu de la scène parisienne, certains interlocuteurs n’avaient plus les moyens d’assurer la bonne tenue de leurs manifestations, ou bien ne le souhaitaient pas, l’objectif pouvant être, précisément, de commettre des violences.
Le renseignement territorial est une part importante de l’activité de la direction du renseignement et celle qui mobilise le plus de personnel au sein de la direction, avec des services territoriaux dans les départements de l’agglomération, en Seine-Saint-Denis, en Val-de-Marne et dans les Hauts-de-Seine. Les manifestations représentent à peu près 30 % de l’activité de renseignement. Nous travaillons en étroite concertation avec les autres services de renseignement, y compris ceux qui travaillent en milieu fermé. La DGSI peut nous donner des informations sur les risques présentés par tel ou tel individu. Le service du renseignement territorial demande à tous ses postes départementaux, quand il y a une grande manifestation nationale à Paris, d’évaluer le nombre de personnes qui vont se rendre à Paris et les moyens avec lesquels ils vont s’y rendre. La plus grande manifestation depuis la guerre a été celle pour l’école libre en 1984 : les 6 500 cars de manifestants, garés sur le périphérique, en faisaient le tour complet.
Nous avons plusieurs types de caméras pour filmer les événements : des caméras tactiques sur les lieux de dispersion et des caméras mobiles utilisées par la DOPC ou la direction du renseignement pour filmer des interventions. Ces caméras sont très utiles lors de la phase des enquêtes judiciaires et pour procéder à des interpellations décalées dans le temps.
M. Guillaume Larrivé. Je salue le professionnalisme des fonctionnaires de la police nationale et des militaires de la gendarmerie placés sous l’autorité fonctionnelle du préfet de police.
Je souhaite, monsieur le préfet de police, partager plusieurs interrogations nées ces dernières années sur la pertinence des directives données par la chaîne de commandement et son sommet, c’est-à-dire vous-même et le ministre de l’intérieur. J’ai fait part de ces interrogations mardi à Bernard Cazeneuve, qui, s’agissant de faits remontant à 2013, m’a renvoyé à la présente audition, au motif qu’il n’était pas en fonction à l’époque.
En 2013, un projet de loi présenté par le Gouvernement a suscité un grand débat dans notre pays, provoquant l’émotion de centaines de milliers de nos compatriotes. Il s’agit du projet de loi sur le mariage et l’adoption par des personnes de même sexe. Des manifestations très nombreuses ont eu lieu dans toute la France. Elles ont fait l’objet de saisines du Défenseur des droits au titre de sa compétence en matière de déontologie de la sécurité. J’ai moi-même saisi le Défenseur des droits, au titre de la loi organique du 29 mars 2011, sur des faits intervenus le lundi 27 mai 2013 aux abords du lycée Buffon, visité par le Président de la République ce jour-là.
L’une de ces saisines a fait l’objet d’une décision du Défenseur des droits en date du 24 novembre 2014. Ces faits ne sont pas couverts par une instruction judiciaire, la plainte déposée par les manifestants ayant été classée sans suite. Le 14 juillet 2013, une dame, Mme X., se rend sur les Champs Élysées avec son mari et ses enfants pour assister au défilé militaire et afficher son opposition au projet de loi. Elle agite deux fanions, aux couleurs non pas de je ne sais quel groupuscule subversif mais de la Manif pour tous. Le premier fanion lui est arraché des mains par un militaire de la gendarmerie nationale. Elle range le second dans la poussette du bébé. Une fouille administrative de la poussette est effectuée par une fonctionnaire de police, contraignant cette dame à en retirer l’enfant. La fonctionnaire confisque le fanion, omettant de signaler à sa propriétaire qu’elle pouvait le récupérer à la sortie du périmètre contrôlé. Ces faits sont rapportés dans un article du Monde, qui cite la décision du Défenseur des droits. Ce dernier indique que toute personne portant un vêtement orné du logo de la Manif pour tous avait été priée de l’ôter.
Le Défenseur des droits, dans son avis, pense qu’il y a eu une disproportion de l’emploi de la force ce jour-là. Il ne met aucunement en cause l’action individuelle des militaires et fonctionnaires de police, mais il s’interroge, monsieur le préfet de police, sur les consignes que vous avez données. Il indique que le caractère non dangereux de simples fanions n’est pas contestable et il considère que retirer le fanion à cette dame n’était pas opportun. Il s’interroge donc sur l’équilibre entre le maintien de l’ordre et le respect des libertés.
J’ai quatre questions à vous poser sur ces faits. Quelles instructions vous ont été données par le ministre de l’intérieur de l’époque pour gérer ces manifestations ? Quelles instructions avez-vous ensuite personnellement données à la chaîne de commandement de la préfecture de police ? Avez-vous la conviction, eu égard à ce qu’a écrit le Défenseur des droits, d’avoir respecté l’équilibre nécessaire entre le maintien de l’ordre et la liberté d’expression ? Enfin, quelles conséquences tirez-vous de ce que le Défenseur des droits identifie comme un dysfonctionnement de la chaîne de commandement ?
M. le président Noël Mamère. Je ne suis pas sûr que cette question s’inscrive bien dans le cadre de notre commission d’enquête. Disons que c’est un éclairage particulier, sur la base d’une indignation sélective, puisque M. le préfet a expliqué que les manifestations contre le mariage pour tous ont parfois comporté des éléments incontrôlables qui se sont livrés à des exactions et dégradations, ce dont M. Larrivé ne s’est pas fait l’écho.
Cela me conduit à poser une question sur la manière dont le renseignement doit évoluer face à des organisateurs qui ne sont plus les mêmes que ceux que vos services ont connus, monsieur le préfet de police, notamment avec les grands syndicats. Les événements du Trocadéro ont témoigné de l’existence d’un certain nombre de problèmes.
M. Philippe Goujon. Il ne doit pas y avoir de tabou dans cette commission, et les questions de M. Larrivé entrent tout à fait dans le cadre de nos travaux. Il serait d’ailleurs intéressant d’entendre sur ce sujet le Défenseur des droits, qui sera auditionné dans quelques jours.
La qualité du maintien de l’ordre dans la capitale permet, dans une ville agitée de nombreux soubresauts, un service correct et républicain. Notre commission s’intéresse aux évolutions des rassemblements revendicatifs – flash mobs, cyber-manifestations… – et des violences qu’ils peuvent occasionner, aujourd’hui plus exacerbées, y compris contre les manifestants, avec des phénomènes d’infiltration par des casseurs n’ayant rien à voir avec l’objet des rassemblements et qui le dénaturent.
Depuis la disparition des pelotons voltigeurs motocyclistes (PVM), qu’il fallait certainement dissoudre, il semblerait que la préfecture de police n’ait pu mettre au point des techniques permettant d’isoler et de retirer d’une manifestation des éléments violents. Les camions à eau ont également été retirés de la circulation. Quels seraient les moyens techniques à mettre en œuvre ?
La vidéosurveillance, fort utile dans la lutte contre la délinquance, l’est également pour assurer le maintien de l’ordre, et je pense que nous ne disposons pas d’assez de caméras de vidéoprotection à Paris. Le plan « Mille caméras » est une étape ; vous nous avez annoncé récemment, au Conseil de Paris, l’installation de 250 caméras supplémentaires, mais cela ne fera toujours qu’une caméra pour quelque 2 000 habitants à Paris, contre une pour 260 à Nice. Ce n’est sans doute pas suffisant pour suivre à travers les rues de la capitale les évolutions des manifestants, des contre-manifestants, de groupes très facilement mobilisables.
Des évolutions sont également nécessaires au plan juridique. Je suis favorable à votre proposition de rendre obligatoire une concertation préalable. Il faut également des mesures concernant les mobilisations spontanées par le biais des réseaux informatiques.
Ne conviendrait-il pas, de même, d’aller plus loin au niveau de la réponse pénale ? Que pensez-vous de l’état actuel de cette réponse ? Quelles modifications suggéreriez-vous ? De même, des évolutions ne sont-elles pas nécessaires en ce qui concerne les sommations, car les manifestants ne comprennent pas toujours bien ce qui se passe du côté des forces de l’ordre et cela peut conduire à des dérapages ?
Paris présente, en matière de maintien de l’ordre, un atout qui est peut-être aussi un inconvénient : la structuration de la chaîne de commandement, très lourde, offre une garantie quant aux ordres hiérarchiques, mais elle manque de souplesse. Sans vouloir donner de leçon, je crois que la manifestation au Trocadéro a été un exemple de ce qu’il faut éviter, en termes de temps de réaction entre la prise de décision au sommet et l’application sur le terrain.
Enfin, vous avez indiqué que la formation des compagnies d’intervention était adaptée. Or, lors de manifestations, à Paris, d’autres unités interviennent souvent. Celles-ci sont-elles suffisamment formées ?
Mme Marie-George Buffet. Monsieur le préfet de police, vous avez insisté sur les conditions et les moyens nécessaires pour effectuer avec efficacité vos missions républicaines de maintien de l’ordre, et évoqué le processus de commandement, en particulier le lien entre l’autorité civile et les officiers dirigeant les forces sur le terrain. Le ministre de l’intérieur nous a annoncé la généralisation de la présence permanente de l’autorité civile sur les lieux de manifestation, et exprimé son souhait qu’il soit procédé à une clarification des procédures de sommation : qu’en pensez-vous ?
Pour ce qui est de la concertation avec les organisateurs, que vous proposez de rendre obligatoire, vous soulignez qu’elle se fait très normalement avec les organisations syndicales et politiques traditionnelles. Le fait de la rendre obligatoire va-t-il avoir des conséquences sur la responsabilité des organisateurs ? Cette question en soulève deux autres : d’abord celles des moyens dont disposent les organisateurs pour mettre en place des services d’ordre d’une qualité suffisante – de ce point de vue, l’affaiblissement de certaines organisations leur pose problème ; ensuite, celle de l’émergence de nouveaux groupes, très violents, qui s’immiscent dans certaines manifestations pour y créer des incidents ou pour y jouer les casseurs – le comble étant que ces personnes agissant en intrus se permettent de porter plainte contre les services d’ordre quand ceux-ci ont été contraints d’agir à leur encontre. Envisagez-vous de travailler avec les organisateurs afin de les aider à faire face à ces groupes violents ?
Enfin, je veux évoquer l’évolution de la situation dans les stades, notamment au Parc des Princes. Il semble que l’on assiste, ces derniers temps, à une diminution des phénomènes de hooliganisme : cela a-t-il eu une incidence sur le déploiement des forces de police autour du Parc des Princes ? Pour ma part, je connais mieux le Stade de France, où se trouvent encore déployés des effectifs de police en grand nombre : la mise en œuvre de tels moyens est-elle vraiment justifiée ? D’une manière plus générale, quelle évolution constatez-vous dans le domaine des événements sportifs ?
M. Daniel Vaillant. L’un des objectifs du maintien de l’ordre étant de faire le moins de victimes possible, il me semble qu’il ne serait pas inutile de faire le bilan statistique des manifestations lors desquelles la préfecture de police a effectué des opérations de maintien de l’ordre, afin de voir durant quelles périodes on a déploré le moins de morts et de blessés. Ainsi les manifestations de 1968, pourtant difficiles à gérer, se sont-elles soldées par un bilan très léger grâce à l’excellent travail du préfet Grimaud – ce qui m’a conduit à proposer que son nom soit donné à une rue du 18e arrondissement de Paris, ce qui sera fait en juin prochain.
L’organisation spécifique à la ville de Paris – en ce qu’elle comporte une préfecture de police – est bien rodée et donne d’excellents résultats en dépit du nombre élevé de manifestations ayant lieu chaque année dans la capitale, et de leur diversité : on peut se féliciter que la liberté de manifester y soit constamment préservée, tandis que le maintien de l’ordre y est assuré.
Ce que je disais tout à l’heure au sujet des blessés et des morts vaut aussi pour les policiers : il serait intéressant de savoir quel est le tribut payé par les forces de police et de gendarmerie au cours des manifestations. Je me rappelle qu’au cours d’une grande manifestation organisée à Paris au lendemain du premier tour de l’élection présidentielle de 2002, un commissaire de police a été très grièvement blessé par une personne appartenant à un groupe extrémiste. On passe trop souvent sous silence le fait qu’il y a aussi des blessés et des morts parmi les forces de l’ordre, qui œuvrent à la préservation de la liberté de manifester et de l’ordre républicain – alors que, mis à part le cas de Malik Oussekine en 1986, très peu de victimes sont à déplorer parmi les manifestants au regard du nombre de manifestations ayant lieu à Paris chaque année.
On sait que le dispositif que vous avez développé à Paris n’est pas transposable à d’autres territoires, compte tenu des caractéristiques particulières de la capitale et des moyens spécifiques de la préfecture de police. Néanmoins, le ministère de l’intérieur ne pourrait-il tirer des leçons, au niveau national, de l’expérience parisienne en matière de maintien de l’ordre ?
En termes d’anticipation, le renseignement territorial est heureusement revenu d’actualité et sera renforcé à la lueur des drames vécus dans notre pays. C’est ce qui vous a opportunément permis, en juillet dernier, d’interdire des manifestations à Barbès, dont on savait comment elles se seraient terminées, puisqu’elles étaient motivées par des objectifs antisémites connus. Pour ma part, je suis très attaché à la loi de 1991, désormais intégrée au code de la sécurité intérieure. Je voulais vous interroger au sujet des interceptions administratives effectuées par la préfecture de police ou la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) dans le cadre de cette loi. Si les interceptions de sécurité ont occasionnellement pu donner lieu à certaines dérives, j’approuve le principe de cette pratique nécessitant l’autorisation du Premier ministre et de la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité (CNCIS) – dont j’ai été membre durant cinq ans. Selon vous, serait-il utile de faire évoluer le dispositif législatif relatif à ces interceptions ?
Certaines manifestations sont moins bien maîtrisées que d’autres et donnent lieu à des incidents : on se souvient, par exemple, du passage de la flamme olympique en 2008, des débordements survenus au Trocadéro lors de ce qui aurait dû être la fête célébrant le titre de champion de France de l’équipe du PSG en 2013, ou encore de certains matchs de football. Même les petites manifestations peuvent créer des problèmes : je pense à l’« apéro saucisson pinard » de la Goutte d’Or en 2010, que le préfet Michel Gaudin a eu raison d’interdire, comme je le lui avais conseillé – et qui s’est finalement terminé dans le 7e arrondissement. Je ne suis pas spécialement favorable aux interdictions, mais il faut savoir y recourir en cas de besoin, c’est-à-dire quand les objectifs avoués d’une manifestation sont incompatibles avec les textes fondamentaux de la République.
La manière dont les forces interviennent peut donner lieu à des contestations – allant parfois jusqu’à la saisine de l’Inspection générale de la police nationale (IGPN) – notamment dans le cas de petites manifestations. Je regrette que l’on ne connaisse pas toujours les suites données aux mises en cause de policiers effectuées dans ce cadre, car l’IGPN devrait s’attacher à faire la vérité soit sur les manquements des forces de l’ordre, soit sur l’absence de fondement des mises en cause dont elles ont fait l’objet. La transparence passe par la connaissance de la réalité des faits.
Enfin, puisque notre collègue Larrivé a évoqué des incidents survenus lors des manifestations de 2013, je rappelle que le défenseur des droits ne constitue pas la seule voie de recours pour les manifestants, qui ont toujours la possibilité de porter plainte. En l’occurrence, l’affaire qu’il évoque a-t-elle donné lieu à un dépôt de plainte ?
M. Guillaume Larrivé. Les plaintes déposées ont été classées sans suite.
M. Daniel Vaillant. Pour conclure, je suis convaincu que le système déclaratif est de nature à responsabiliser les manifestants : comme on a pu le constater, ce système distinct de celui de l’autorisation s’est traduit par une amélioration du déroulement des raves et des free parties.
M. Jean-Paul Bacquet. Monsieur le préfet, vous dites qu’il y a en fait deux types de manifestations. Les unes sont organisées par des personnes responsables, douées de maturité politique et d’une grande connaissance des lois de la République ; souvent dotées de leur propre service d’ordre, qui travaillent de concert avec les forces de l’ordre, elles ne vous causent jamais de difficultés. Les autres, spontanées ou venant infiltrer d’autres manifestations, qu’elles soient marquées par une volonté de déstabiliser l’ordre public, donc la République, ou qu’il s’agisse simplement des agissements de bandes de casseurs, sont très difficiles à contrôler – il est même fréquent que l’on y découvre des individus porteurs d’armes.
D’une manière générale, les manifestations sont plus dangereuses qu’autrefois en raison des moyens de communication dont disposent les manifestants – des moyens qui, d’une part, leur permettent de faire circuler l’information plus rapidement, donc d’accroître leur mobilité, d’autre part, ont pour conséquence de favoriser la diffusion de rumeurs parfois sciemment répandues à des fins de manipulation : en tant qu’ancien combattant de mai 1968, je peux vous dire que nous sommes bien loin d’une époque où seuls les cris se propageant de loin en loin nous prévenaient qu’une barricade venait d’être enfoncée ! Je crains fort qu’au cours des années à venir, les événements mondiaux ne soient pas sans conséquences sur l’ordre public en France.
Afin de contrer l’escalade de la violence, nous devons faire des efforts très importants en matière de renseignement, mais aussi améliorer le système d’information, et pas seulement en ce qui concerne les obligations relatives à la déclaration préalable des manifestations. À mon sens, nous devons également nous interroger sur le rôle des chaînes d’information en continu qui, consciemment ou non, ont parfois tendance à mettre de l’huile sur le feu. En 1998, le préfet Magnier avait déclaré à la télévision, avant la nuit du 31 décembre, que le dispositif de sécurité mis en place par ses soins allait se traduire par une nette diminution du nombre de voitures brûlées à Strasbourg. Bien mal lui en prit, car les jeunes virent dans ses propos une incitation à en brûler plus que l’année précédente ! Comme on le voit, une déclaration malheureuse peut avoir des conséquences très dommageables, surtout quand elle est amplifiée par les médias.
Comme je l’ai dit précédemment, l’ordre public, c’est la République. De ce point de vue, sans doute ne devrait-on pas se contenter d’une obligation de déclaration préalable de toute manifestation, mais assortir cette déclaration d’un rappel aux organisateurs des comportements que l’on ne peut se permettre au cours d’une manifestation – une espèce d’éducation citoyenne à la manifestation, en quelque sorte.
J’ai demandé hier au ministre de l’intérieur s’il ne pensait pas que, face à la multiplication des manifestations incontrôlables et au danger qu’elles représentent, la suppression des grenades offensives pouvait donner l’impression que l’on avait désarmé la gendarmerie. Il m’a répondu que le fait que les policiers ne soient pas dotés de grenades offensives n’avait jamais posé de problèmes particuliers. Si j’apprécie beaucoup Bernard Cazeneuve, qui est un ami, j’estime qu’en n’équipant pas les gendarmes de matériels adéquats – en plus de cette décision de retrait des grenades offensives, j’évoquerai également le vieillissement de nos véhicules blindés, dont l’âge atteint parfois cinquante ans –, on ne se donne pas tout à fait les moyens de faire face aux problèmes qui se poseront demain. Le monde est en train de changer et, sur toute la planète, les facteurs de déstabilisation sont de plus en plus nombreux : nous devons en tenir compte et réfléchir aux moyens de préserver notre démocratie.
M. le président Noël Mamère. Cela n’engage que moi, mais je ne pense pas que nous vivions dans un état d’insurrection justifiant que nos forces de l’ordre se muent en une armée devant se tenir prête à mater une révolution – mais M. le préfet nous fera part de son sentiment sur ce point.
M. Jean-Paul Bacquet. Je n’ai pas dit ça, monsieur le président.
Mme Clotilde Valter. Je veux d’abord revenir sur la question de la chaîne de commandement afin de vous interroger sur un point qui n’a pas été évoqué jusqu’à présent, celui de l’articulation de cette chaîne de commandement avec les autorités du ministère de l’intérieur et, d’une manière plus générale, avec le Gouvernement – ainsi que des interférences susceptibles de venir brouiller la transmission des instructions reçues.
Pour ce qui est de l’évolution de la conception du maintien de l’ordre au cours des dernières années, beaucoup de choses ont déjà été dites, et je souhaite simplement que vous approfondissiez la question des éléments incontrôlés.
Enfin, je souhaite vous interroger au sujet d’un phénomène relativement récent et qui me semble modifier de manière significative les conditions d’intervention des forces de police dans les manifestations, à savoir la présence de mineurs, voire de jeunes enfants. Il me semble évident que les forces d’intervention sont contraintes d’adapter leur comportement lorsqu’ils se trouvent face à de jeunes enfants, voire à des poussettes – ainsi que lorsqu’ils sont confrontés à des mineurs âgés de dix à dix-huit ans, qui posent d’autres problèmes.
M. le président Noël Mamère. Je souhaite vous poser moi-même deux questions, monsieur le préfet. Premièrement, de nombreuses manifestations organisées à Paris et en région parisienne donnent lieu à l’intervention de ce que l’on appelle les « forces intermédiaires », c’est-à-dire différents lanceurs de balles de défense, qui ont provoqué plusieurs accidents au cours des dernières années. Quelle est votre doctrine en la matière, et celle-ci a-t-elle évolué au fil du temps ?
Deuxièmement, en ce qui concerne l’interdiction de manifester, pouvez-vous nous indiquer quel rôle joue le juge dans l’appréciation du désordre public susceptible d’être créé, par rapport à la position du préfet, qui représente le ministre de l’intérieur ?
M. Bernard Boucault. Dans la mesure du possible, je vais m’efforcer de répondre en regroupant par thèmes les questions qui m’ont été posées.
Je commencerai par la question que vous venez de me poser au sujet du rôle de l’autorité judiciaire, monsieur le président. Lors des manifestations les plus importantes, nous travaillons constamment sous le contrôle du parquet – avec les magistrats de permanence, mais également avec le procureur de la République si nécessaire. Ce travail se fait en respectant des compétences de chacun, mais dans des conditions permettant de faire face à des situations parfois inédites. Bien entendu, nous observons scrupuleusement les instructions du parquet quand il s’agit de prendre des décisions à l’occasion de désordres et de violences survenant au cours d’une manifestation, ou de procéder à des contrôles d’identité – que ce soit sur place ou dans des lieux où les personnes ont été transférées, éventuellement dans le cadre d’une garde à vue.
Je me félicite de la qualité des relations qui existent entre la préfecture de police et le procureur de la République de Paris. Pour ce qui est du respect des libertés, il fait bien évidemment partie des convictions qui sont les miennes : tous les préfets et les directeurs sont pétris des valeurs républicaines, qui guident leur action lors des opérations de maintien de l’ordre ; cela dit, notre travail se fait sous le contrôle permanent de la justice.
M. le président Noël Mamère. En fait, monsieur le préfet, ma question portait sur l’interdiction des manifestations, qui ne relèvent pas de la compétence du juge d’instruction et du procureur, mais du juge administratif.
M. Bernard Boucault. La très grande majorité des requêtes déposées devant le juge administratif à l’encontre des arrêtés préfectoraux portant interdiction de manifestation sont rejetées. Il en a été ainsi presque systématiquement depuis que je suis en poste à Paris, ce qui me conduit à penser que les interdictions que j’ai décidées étaient justifiées. Je veux m’arrêter un instant sur les circonstances m’ayant conduit à prendre une décision de ce type au sujet de la grande manifestation du 24 mars 2013, organisée en opposition au projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe. Deux jours après l’annonce selon laquelle cette manifestation aurait lieu sur les Champs-Élysées, j’ai écrit personnellement aux responsables de la Manif pour tous pour leur dire qu’ils ne pouvaient pas défiler sur les Champs-Élysées, la tenue de toute manifestation revendicative étant interdite dans ce secteur en vertu d’une tradition respectée par tous les gouvernements, qu’ils soient de droite ou de gauche. Cela n’a pas empêché les responsables de la Manif pour tous de marteler, un mois durant, à Paris et en province, le slogan « Tous aux Champs-Élysées ». L’avant-veille de la manifestation, les responsables de la Manif pour tous portaient encore des tee-shirts affichant ce mot d’ordre, alors même que le tribunal administratif, confirmant une jurisprudence constante, avait donné gain de cause à la préfecture de police. Le fait que nos appels à la responsabilité n’aient pas été entendus, nonobstant la décision de justice rendue en notre faveur, a considérablement compliqué l’organisation de cette manifestation.
La seule solution envisageable – une solution loin d’être idéale, que ce soit pour les responsables de l’ordre public comme pour les manifestants – a donc consisté à autoriser un rassemblement statique sur l’avenue de la Grande-Armée. Malheureusement, il y avait chez les manifestants présents une telle envie de venir sur la place de l’Étoile qu’au bout d’un certain temps, des personnes avec des enfants et des poussettes ont commencé à vouloir franchir les barrages mis en place. À ce moment, j’ai pris la décision de les laisser passer, car il était exclu de faire de l’ordre public en présence d’enfants et de poussettes : je ne pouvais pas faire autrement que de prendre cette décision relevant de ma responsabilité de préfet républicain. Cet épisode constitue une illustration de la nécessité d’avoir pour interlocuteurs des organisateurs connaissant les règles et la jurisprudence, disposés à faire confiance à l’administration et à engager la discussion avec elle, qui est là pour permettre l’exercice du droit de manifester dans le cadre de l’État de droit.
En ce qui concerne les armes, les compagnies d’intervention de la préfecture de police sont dotées de l’équipement habituel, à savoir d’une part les armes individuelles que sont les bâtons de défense et les aérosols lacrymogènes, d’autre part les grenades lacrymogènes. En revanche, elles n’utilisent pas de grenades de désencerclement ni de grenades à effet assourdissant et lacrymogène, dites grenades lacrymogènes instantanées (GLI) ; quant aux grenades offensives, elles n’ont jamais été utilisées à Paris, car il est impossible de les mettre en œuvre sans risque dans un milieu très urbanisé. Les compagnies d’intervention ne disposent pas non plus de lanceurs de balles de défense ni de Flash-Ball : ces armes ne sont utilisées que par les brigades anti-criminalité (BAC) qui interviennent sur les abords et les flancs de la manifestation pour lutter contre les casseurs et les auteurs de violences – des individus qui ont généralement déjà un passé judiciaire, et sont fortement susceptibles de se rebeller.
Les CRS et les escadrons peuvent utiliser des grenades de désencerclement – également appelées « dispositifs manuels de protection » (DMP) – ou des GLI, mais seulement sur mon ordre – à défaut, celui de mon directeur de cabinet ou du directeur de l’ordre public : dans les situations très tendues, nous sommes généralement assez proches les uns des autres, et j’assume toujours la responsabilité de la décision prise. Cette règle de l’ordre préalable ne connaît que deux exceptions : d’une part, la légitime défense – un critère porté à l’appréciation du juge –, d’autre part, la nécessité pour les unités de conserver une position qui leur a été assignée : dans ces deux situations, elles peuvent utiliser sans instruction particulière ce type d’armes.
Pour ce qui est des améliorations que l’on pourrait envisager d’apporter au dispositif actuel, en matière de renseignement, la surveillance des mouvements extrémistes peut nous conduire à avoir recours aux outils du renseignement en milieu fermé, notamment aux interceptions de sécurité. Le problème est que nous nous trouvons parfois confrontés à des agissements susceptibles de menacer gravement notre pays, mais ne relevant pas totalement de l’atteinte à la sûreté nationale ni du grand banditisme ; dans ces situations, il pourrait être fait appel à la notion de subversion violente.
Les modalités d’intervention des forces de sécurité évoluent régulièrement. Nous sommes ainsi en train de rassembler en une seule unité les brigades d’information de voie publique (BIVP) de tous les districts, afin de constituer un groupement capable d’intervenir au sein des manifestations pour interpeller certains individus ou pour extraire des personnes se trouvant en danger – un peu comme le font les unités civiles des compagnies d’intervention. Je suggère que les unités de la réserve nationale, les escadrons de la gendarmerie mobile et les compagnies républicaines de sécurité puissent s’engager dans cette évolution, ce que le droit ne permet pas actuellement. L’idée serait de développer, au sein des escadrons mobiles et des compagnies républicaines de sécurité, des unités en civil disposant d’un équipement différent des unités mobiles classiques, chargées de procéder à des interpellations sur les flancs et en arrière de la manifestation.
Pour vous répondre au sujet de la saisine du défenseur des droits, monsieur le député Larrivé, je voudrais d’abord souligner que, comme toutes les grandes manifestations, celle à laquelle vous faites référence a été très médiatisée et a donné lieu à un certain nombre de plaintes – qui, en l’occurrence, ont toutes été classées par le parquet : seuls les dossiers où il y a eu constitution de partie civile sont toujours entre les mains du juge d’instruction. En ce qui concerne les cas portés à la connaissance du défenseur des droits, j’assume totalement les instructions que j’ai données pour le 14 juillet 2013, ainsi que les responsabilités qui en découlent. Souvenons-nous du climat de grande tension qui régnait alors sur le pays : si les manifestations organisées fin 2012 et début 2013 s’étaient très bien passées – sans interpellations, car mobilisant un public bon enfant venu exprimer une opinion respectable –, les choses se sont dégradées à partir de la manifestation du 24 mars 2013 que j’ai évoquée précédemment, en raison des dissensions et des choix tactiques et stratégiques faits par les différentes parties de cette manifestation. Des violences ont commencé à survenir, notamment aux Invalides où, plusieurs soirs de suite, après la manifestation paisible qui avait eu lieu dans l’après-midi, certaines personnes restaient sur place pour en découdre avec les forces de l’ordre et tenter de marcher sur l’Assemblée nationale, où l’on débattait du projet de loi contesté.
Je n’ai pris connaissance des recommandations formulées par le défenseur des droits que lorsque celles-ci ont été rendues publiques, le droit ne prévoyant pas de procédure contradictoire avec le préfet de police – le défenseur des droits instruit l’affaire, convoque le commissaire de police responsable du secteur, puis fait ses recommandations au ministre de l’intérieur. Il indique ainsi, dans sa décision du 24 novembre 2014, qu’après avoir constaté « que l’interdiction de portée générale faite au public présent dans les périmètres contrôlés de détenir des “banderoles, affiches et tout autre support portant une revendication” (...) » n’est « pas conforme au droit applicable sur le territoire de la République (...) », il recommande au ministre de l’intérieur « de faire supprimer l’interdiction générale faite au public présent dans les périmètres contrôlés à l’occasion du défilé militaire du 14 juillet de détenir des “banderoles, affiches et tout autre support portant une revendication” (...) ».
Je vais vous faire part de ma position sur cette recommandation – ladite position ne préjugeant pas de celle du ministre de l’intérieur – en commençant par rappeler qu’il a été décidé d’instaurer des périmètres contrôlés sur les trottoirs des Champs-Élysées à la suite de l’événement gravissime qui s’est produit le 14 juillet 2002, quand une personne a tiré en direction du cortège présidentiel dans le but d’assassiner Jacques Chirac, qui venait d’être élu. Ces périmètres contrôlés s’inscrivent dans un dispositif plus large visant à concourir à la sécurité du Président de la République et à éviter que les cérémonies du 14 juillet ne soient troublées par une atteinte à l’ordre public. J’ajoute qu’à l’époque des faits, le plan Vigipirate rouge était activé. J’aurais donc répondu, à toutes les personnes qui m’auraient déclaré leur intention de manifester sur les Champs-Élysées ou en leurs abords immédiats le 14 juillet, qu’en raison des cérémonies organisées pour la fête nationale, je leur demandais de modifier le lieu, le jour ou éventuellement l’heure de leur manifestation – une telle demande de changement d’horaire ou d’itinéraire étant de pratique courante. Les mesures préventives que j’ai prises étaient d’autant plus justifiées que le climat était tendu, comme je l’ai dit, et que nous disposions de renseignements laissant craindre des actions de contestation assez dures – certaines personnes avaient l’intention de faire usage de fumigènes et l’on pouvait craindre que d’autres ne cherchent à se projeter sur les Champs-Élysées au passage du Président de la République, comme cela a déjà été le cas –, sans parler de l’action de protestation des salariés d’un grand magasin, prévue pour ce jour-là.
Tout cela a justifié que je donne des instructions très fermes pour que les manifestations non déclarées, mais dont le projet avait été largement relayé par les réseaux sociaux, ne troublent pas l’ordre public : je le répète, personne ne peut manifester le 14 juillet sur les Champs-Élysées.
M. Guillaume Larrivé. Personne ne le conteste, monsieur le préfet.
M. Bernard Boucault. C’est pourtant bien ce que vous faites en me reprochant d’avoir interdit à certaines personnes de s’approcher des Champs-Élysées pour y manifester. Je vous rappelle que le Conseil d’État a récemment jugé en référé, au sujet de l’affaire Dieudonné M’bala M’bala, qu’il appartient à l’autorité administrative de prendre des mesures de nature à éviter que des infractions pénales soient commises : c’est dans ce cadre que je suis intervenu. Au demeurant, contrairement à ce qu’indique le défenseur des droits, je n’ai pas formulé une interdiction générale et absolue, mais une interdiction portant sur un moment bien précis, une rue bien précise, et une manifestation bien précise. Je ne pense donc pas avoir enfreint la loi en en prenant ces mesures.
Un certain nombre de remarques ont été faites, et il m’a été demandé de rappeler aux personnels de police les règles de fouille des sacs et du contrôle d’identité. L’une des règles essentielles en matière de fouille des sacs – c’est le b.a.-ba dans les écoles de police, et même les agents de sécurité privés connaissent cette règle – est que l’on ne peut y procéder qu’avec le consentement des personnes concernées. Ce rappel n’était pas indispensable, d’une part parce que les règles sont parfaitement connues des personnels, d’autre part parce que ce jour-là, nous avions demandé des réquisitions au procureur de la République : nous travaillions donc dans un cadre juridique très clair nous autorisant à procéder à ces contrôles d’identité. Je ne pense donc pas que nous ayons porté atteinte à une liberté particulière au cours de cette journée.
À la question de M. Goujon sur le remplacement des voltigeurs, je pense avoir répondu en faisant part de mon souhait de voir évoluer les unités des forces mobiles nationales. Pour ce qui est des caméras, nous avons fait des propositions consistant en l’installation d’équipements complémentaires, localisés principalement sur les itinéraires les plus utilisés lors des manifestations parisiennes. Les formations des compagnies d’intervention sont très spécifiques à la préfecture de police et diffèrent donc de celles dispensées aux unités des forces mobiles, mais nous pourrions justement développer ce type de formation si les forces mobiles de la réserve nationale s’engageaient sur cette voie.
Mme Buffet m’a interrogé sur la présence permanente de l’autorité civile sur le terrain. La préfecture de police a anticipé cette règle, que j’ai moi-même appliquée à tous les postes que j’ai occupés en province. Comme vous le savez, j’ai acquis une certaine expérience du maintien de l’ordre en Corse, en Seine-Saint-Denis et à Nantes, et j’ai toujours tenu à être présent lors des situations difficiles. À Paris, c’est évidemment un peu différent, mais je suis toujours dans la salle de commandement avec le directeur de l’ordre public, à qui je laisse le soin de diriger la manœuvre – étant précisé que, si nécessaire, je suis là pour prendre les décisions qui relèveraient de ma compétence. Pour une, deux ou parfois trois unités sur le terrain, les directeurs ont toujours à leur côté un commissaire de police. Il n’y a malheureusement pas assez de commissaires de police de la Direction de l’ordre public et de la circulation (DOPC) dédiés à cette tâche, mais nous demandons aux commissaires de police de la Direction de la sécurité de proximité de l’agglomération parisienne (DSPAP) de venir faire un peu d’ordre public le dimanche, ce qui leur permet de ne pas perdre la main – ainsi, ces commissaires jouent le rôle de l’autorité civile ayant la capacité de prendre des décisions au nom du préfet de police. Cette solution satisfait tout le monde, et je me réjouis que le ministre ait décidé de rendre obligatoire la présence permanente d’une autorité civile spécialement déléguée par le préfet lors des opérations de maintien de l’ordre.
Mme Buffet a également évoqué l’incidence sur la responsabilité des organisateurs que pourrait avoir le fait de rendre obligatoire la concertation avec les organisateurs. Sur ce point, il me semble que lorsqu’on organise une manifestation, on doit être assuré de pouvoir la maîtriser : de ce point de vue, la notion d’organisation est indissociable de la notion de responsabilité. Certes, toutes les manifestations ne sont pas forcément en mesure de se doter d’un service d’ordre suffisant, mais il est de plus en plus fréquent de voir certaines grandes organisations, ayant de l’expérience et des moyens, « prêter » leur service d’ordre à des organisations plus modestes et moins structurées.
Pour ce qui est de la situation du PSG, je dois dire qu’elle a beaucoup évolué ces derniers temps – ce dont je ne m’attribue pas le bénéfice, le changement ayant été engagé par mon prédécesseur avec le soutien des responsables du club. Alors qu’à mon arrivée en 2012, le maintien de l’ordre autour du Parc des Princes nécessitait dix ou douze unités, on en est aujourd’hui à trois unités et, de mon point de vue, on pourrait même descendre à deux unités, les matchs étant de plus en plus tranquilles – mais je crois que le directeur de l’ordre public ne partage pas tout à fait mon avis sur ce point.
M. Vaillant a évoqué le nombre de blessés au sein des forces de police. Ce nombre est important et en croissance constante : ainsi, il y a eu 68 blessés parmi les forces de l’ordre à Paris en 2012, 203 en 2013 et 232 en 2014. Je me réjouis qu’il n’y en ait pas autant, tant s’en faut, parmi les manifestants – on compte d’ailleurs également très peu de blessés parmi eux, contrairement à ce qui est parfois annoncé à la fin de certaines manifestations : en réalité, quand on fait le tour des hôpitaux aux fins de vérification, on n’en trouve aucun. Mais pour en revenir à la police, il est incontestable qu’elle paie un lourd tribut à la mise en œuvre du service d’ordre républicain.
Je pense avoir répondu dans mon propos liminaire sur les leçons à tirer de l’expérience parisienne, ainsi que sur la question de M. Bacquet portant sur les grenades offensives.
Mme Valter a évoqué ce qui lui apparaît comme une lourdeur de la chaîne de commandement. De mon point de vue, la chaîne de commandement n’est pas lourde, mais au contraire très efficace, car complètement intégrée : les ordres sont donnés dans la salle de commandement de la DOPC, où tous les services sont présents, qu’il s’agisse des services du renseignement, de ceux de la DSPAP ou encore des représentants des CRS et des gendarmes mobiles. Nous faisons un point de situation avec le ministre de l’intérieur environ tous les quarts d’heure lors des importances manifestations, ce qui, en cas de besoin, me permet de faire valider l’une de mes décisions par le ministre à tout moment. Le préfet de police est en pleine responsabilité : il me revient de proposer un service d’ordre, élaboré par la DOPC et soumis au ministre de l’intérieur uniquement en ce qui concerne les manifestations les plus importantes. Il est de tradition à Paris que le préfet de police ait la confiance du Gouvernement, quel qu’il soit ; à défaut, il peut difficilement accomplir sa mission, et je crois que c’est la meilleure garantie d’un maintien de l’ordre efficace sur un territoire aussi compliqué que celui de Paris.
M. le président Noël Mamère. Merci, monsieur le préfet. Je crois que nos collègues ont encore quelques questions à vous poser.
M. Guillaume Larrivé. En 2006, le Parlement a voté une loi anti-hooligans qui a donné au ministère de l’intérieur et au préfet de police la faculté de prendre des interdictions administratives de stade, qui ont montré leur extrême efficacité. Pourrait-on, selon vous, envisager de réfléchir à l’instauration d’une interdiction individuelle de manifester à l’égard d’un individu qui serait clairement repéré comme étant susceptible de créer des troubles graves à l’ordre public – une telle procédure étant naturellement soumise au contrôle du juge administratif en référé et au fond ?
M. Jean-Paul Bacquet. Sauf erreur, vous n’avez pas répondu à ma question portant sur l’information, monsieur le préfet.
Mme Clotilde Valter. Pour ma part, je rappelle ma question relative aux mineurs et aux jeunes enfants.
M. Bernard Boucault. Si je comprends l’esprit de la proposition de M. Larrivé consistant à créer une interdiction individuelle de manifester, la mise en œuvre d’une telle disposition semble compliquée : s’il est possible d’interdire l’accès d’un stade, donc d’un lieu clos, à une personne, il est beaucoup plus difficile d’interdire à quelqu’un de se joindre à une manifestation, a fortiori dans une ville comme Paris. Une mesure de cet ordre se traduirait par une charge de travail supplémentaire pour les forces de police, surtout si l’interdiction visait plusieurs personnes. Pour ma part, j’estime préférable de faire confiance aux services de renseignement, qui nous informent efficacement sur les personnes susceptibles de troubler l’ordre public : il nous suffit alors de les attendre à la gare où elles arrivent de province et de les interpeller sur réquisition du procureur de la République. L’état du droit et la pratique mise en œuvre avec les parquets nous permettent de gérer de manière satisfaisante les situations que vous évoquez et je crois que, de ce point de vue, un texte poserait sans doute plus de problèmes qu’il n’en résoudrait.
Pour ce qui est des informations données avant les manifestations, il est évident que les choses sont en train de changer. Ainsi, dès que le dispositif de maintien de l’ordre est arrêté, nous communiquons à ce sujet via le site de la préfecture de police et dans la presse quotidienne, mais aussi et surtout au moyen des réseaux sociaux : nous nous efforçons de donner des renseignements d’ordre pratique – en précisant, par exemple, qu’il sera interdit de stationner ou de circuler à tel ou tel endroit –, tout en nous abstenant de formuler des jugements qualitatifs sur ce que permettra ou non le dispositif mis en œuvre. Dans le cas de grandes tensions, nous pouvons éventuellement appeler au calme, mais j’avoue que ce n’est pas une pratique habituelle : en ce qui me concerne, je préfère rester sobre en matière de communication. En principe, si une manifestation n’est pas interdite, c’est que nous estimons que la bonne volonté des organisateurs et leur service d’ordre vont permettre, avec le concours de nos propres moyens, qu’elle se déroule dans des conditions satisfaisantes. Une interdiction, en revanche, doit faire l’objet de mesures de publicité suffisantes – mais en général, c’est une information qui se diffuse très rapidement d’elle-même, ne serait-ce que par le biais des médias – je pense en particulier aux chaînes d’information en continu.
Enfin, pour ce qui est des mineurs, je distingue les jeunes enfants des autres mineurs. Pour nous, le terme de « mineurs » renvoie aux manifestations de collégiens et de lycéens, qui sont la hantise des responsables du maintien de l’ordre en raison de la totale inorganisation caractérisant généralement ce type de manifestations se décidant souvent de manière spontanée – même si, très exceptionnellement, une organisation existante peut prêter son service d’ordre. Dans ce cas, nous mettons en place des dispositifs placés à distance des cortèges, afin d’éviter de donner l’idée à certains jeunes de venir se confronter aux forces de l’ordre. Nous ne pouvons procéder comme nous le faisons habituellement compte tenu des précautions particulières que nous devons prendre, mais nous parvenons tout de même à gérer ces manifestations, en concertation permanente avec le recteur de Paris et les chefs d’établissements – qui apprécient le concours qu’on leur apporte, notamment en matière de renseignements. Il faut, dans ce cas, accepter un certain désordre : c’est le prix à payer pour que nos enfants ne se trouvent pas confrontés à une situation difficile.
Mme Clotilde Valter. Et pour les poussettes ?
M. Bernard Boucault. Comme je l’ai dit, l’apparition de poussettes est exceptionnelle : nous n’y avons été confrontés qu’en 2013 et avons alors réagi en conséquence.
M. le président Noël Mamère. Je vais maintenant donner la parole à M. le rapporteur afin de conclure cette audition.
M. le rapporteur. Monsieur le préfet, j’ai eu plaisir à vous entendre réaffirmer avec force et conviction le caractère tout à fait républicain des décisions que vous avez prises à l’occasion de la manifestation du 14 juillet 2013. Au sujet des compagnies mixtes spécifiques à la préfecture de police, que vous avez évoquées, je souhaite vous demander s’il serait possible d’adresser à la DOPC un questionnaire technique destiné à nous permettre d’en savoir davantage sur la mise en œuvre de ce dispositif – modalités pratiques et nombre annuel des interpellations effectuées, nombre de condamnations prononcées, et caetera.
M. Bernard Boucault. Très volontiers, monsieur le rapporteur.
M. le président Noël Mamère. Au nom de notre commission d’enquête, je vous remercie, monsieur le préfet et messieurs, d’avoir répondu à nos questions. Votre contribution nous sera très utile.
*
* *
Audition, ouverte à la presse, du général Denis FAVIER, directeur général
de la gendarmerie nationale
Compte rendu de l’audition du jeudi 12 février 2015
M. le président Noël Mamère. Je vous remercie, mon général, d’avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que cette commission d’enquête a été constituée à la suite des événements de Sivens. Nous sommes parfaitement conscients de l’impossibilité pour l’Assemblée de mener une enquête sur des éléments relevant de l’instruction judiciaire ; ce qui ne nous empêchera pas, néanmoins, de revenir sur un certain nombre de points.
En vertu de l’article 6 de l’ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, les personnes auditionnées sont tenues de déposer sous réserve, notamment, des dispositions de l’article 226-13 du code pénal réprimant la violation du secret professionnel. Cette même ordonnance exige des personnes auditionnées qu’elles prêtent serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité.
(Le général Denis Favier prête serment.)
Général Denis Favier, directeur général de la gendarmerie nationale. J’ai suivi les travaux et auditions que vous avez conduits et suis globalement en phase avec les avis émis par l’ensemble des personnes qui sont intervenues avant moi. C’est pourquoi je ne reviendrai pas sur les principes généraux du maintien de l’ordre.
Nous faisons face à des situations complexes nouvelles en matière de maintien de l’ordre et devons par conséquent prendre des mesures importantes pour garantir à la fois la liberté d’expression mais également la sécurité. Afin d’entrer dans le vif du sujet, je limiterai mon propos à dix propositions.
La première concerne le renforcement du dialogue entre organisateurs et manifestants. Ce dialogue ne me paraît pas assez affirmé : il faut le développer non seulement en amont mais également au cours de la manifestation. J’y vois une des garanties de son bon déroulement en permettant l’exercice, en sécurité, du droit de manifester. Un important travail reste à réaliser en la matière entre organisateurs et pouvoirs publics et qui conduira à redéfinir le cadre juridique, notamment lorsque les organisateurs ne respectent pas leurs engagements car un vide juridique subsiste en la matière. Il faudra ainsi rappeler certaines règles et pleinement responsabiliser les organisateurs.
La deuxième piste touche à l’interdiction administrative individuelle de manifester. Le cadre juridique actuel permet le libre exercice du droit de manifester pourvu qu’il n’entrave pas le droit de circuler de ceux qui ne manifestent pas et pourvu qu’il ne perturbe pas les conditions générales de sécurité. Le droit de manifester, qu’il ne saurait être question de remettre en cause, doit être encadré par la définition de l’interdiction administrative. Nous avons en effet affaire à des individus connus et qui se montrent déterminés, violents à l’occasion de manifestations dont nous devons pouvoir leur interdire l’accès. C’est par ce moyen que nous sommes parvenus à enrayer les violences dans les stades.
Troisième point, il s’agirait d’affermir le rôle, d’affirmer le primat, même, de l’autorité civile dans les opérations d’ordre public. Le préfet joue un rôle clef. Le décret de 2004 rappelle explicitement quels sont ses pouvoirs. De notre point de vue, il appartient au préfet ou à son représentant – le directeur départemental de la sécurité publique ou le commandant de groupement – d’assurer la responsabilité des opérations. Si le préfet définit les effets à produire, il revient au chef opérationnel d’en tenir compte pour concevoir la manœuvre de terrain. Or la répartition des rôles est marquée d’une certaine ambiguïté. Une clarification s’impose sur l’articulation entre autorité civile et commandant opérationnel, et suppose entre eux un dialogue permanent.
Il faut que le préfet, puisque chargé des opérations d’ordre public, soit très régulièrement présent sur les sites de manifestations. Il faut donc travailler à une meilleure formation et à une meilleure information des préfets aux conditions d’exercice de l’ordre public. Le préfet Lambert conduit d’ailleurs une mission qui vise à mieux former les préfets aux situations délicates. De leur côté, gendarmes et policiers doivent être en mesure d’apporter au préfet des outils destinés à l’aider dans ses décisions. À cet effet, en lien avec le directeur général de la police nationale, nous proposons aux préfets la mise à disposition de cellules de planification lorsqu’ils ont à traiter des situations graves d’ordre public – nous l’avons fait en Loire-Atlantique, dans les Bouches-du-Rhône, à chaque fois avec des résultats positifs.
La traçabilité des directives données par l’autorité civile constitue mon quatrième point. Jusqu’au rattachement de la gendarmerie au ministère de l’Intérieur en 2009, les ordres donnés s’inscrivaient dans le formalisme des réquisitions. Ce cadre, certes trop rigide, n’en constituait pas moins une garantie forte pour contrôler l’emploi de la force. Cela étant, si une évolution s’imposait, on est peut-être allé un peu trop loin.
Il existait alors trois types de réquisition. La réquisition générale mettait une force à disposition de l’autorité administrative. La réquisition particulière, ensuite, assignait une mission à cette force, englobant les questions d’emploi de la force donc, par exemple, le tir de grenades lacrymogènes. Enfin, la réquisition complémentaire spéciale prévoyait l’usage des armes, donc l’emploi de certaines munitions – il s’agissait d’un document papier donné par l’autorité civile au responsable de la force et qui comprenait des termes très forts. Je suis passé par une école d’officiers il y a plus de trente ans et je me souviens très bien du libellé exact d’une telle réquisition : l’emploi de la force comportait l’usage des armes. Sa communication au commandant de la force nous faisait alors bien mesurer l’importance du document qui, aujourd’hui, du fait de la suppression du système général de réquisition, fait défaut. Je souhaite par conséquent que nous travaillions ensemble à la définition d’un cadre souple, adapté à l’urgence – qui permette la réactivité nécessaire en cas de situation « chaude ». Il faudrait corriger ce vide juridique assez rapidement.
J’évoquerai, en cinquième lieu, la lisibilité des intentions des forces de l’ordre, la lisibilité des sommations. La communication entre acteurs de sécurité doit être claire. J’évoquais précédemment le rôle des organisateurs des manifestations ; il faut que les intentions des forces de l’ordre, de leur côté, soient également présentées de façon explicite. Plusieurs dispositions en vigueur du code de sécurité intérieure devraient être précisées. À titre d’exemple, les trois sommations d’usage ne comportent qu’une seule formule : « On va faire usage de la force ! » Ces sommations sont faites à voix haute et sont éventuellement accompagnées de codes sonores mais il est impossible de distinguer entre les trois sommations.
Que signifie l’expression : « On va faire usage de la force » ? Que l’escadron de gendarmerie mobile peut être amené à faire un bond offensif pour dégager un axe ; cela peut aussi signifier que l’escadron en question peut être conduit à utiliser des grenades lacrymogènes ou, plus grave, d’autres munitions. Or il n’existe pas de gradation entre ces différents stades d’engagement ; ces sommations faites à voix haute ne sont pas intelligibles : personne ne les entend – chacun sait bien que, dans une manifestation, il y a du bruit. Nos intentions doivent donc être mieux perçues. En outre, il est temps de définir un code sonore et visuel – par exemple par le moyen de fusées éclairantes – pour accompagner les sommations orales. Ce code, national, devra être connu des manifestants.
Le réexamen des missions des unités de forces mobiles – compagnies républicaines de sécurité (CRS) et escadrons de gendarmerie mobile (EGM) – constituera mon sixième point. Nous avons besoin de ces forces : la vie démocratique suppose que l’ordre règne. Je n’évoquerai que la gendarmerie – que je connais bien puisque je la dirige. Nous comptons 108 EGM soit 12 000 hommes. Il s’agit d’une force considérable employée au maintien de l’ordre quand nécessaire, mais également, au quotidien, pour la sécurité générale. Si nous réussissons en la matière dans les zones de priorité sécuritaires (ZPS), c’est parce que nous avons placé dans chacune de ces zones un peloton de gendarmerie mobile. Si nous obtenons de bons résultats dans la lutte contre les cambriolages, c’est parce que la gendarmerie mobile concourt à sécuriser les territoires.
En complément de ces missions d’ordre public et de sécurisation générale, certaines missions ne me semblent pas devoir être conduites par les forces mobiles. Trop nombreuses, les gardes statiques, improductives en matière de sécurité, pourraient être assurées par d’autres forces – je pense à la garde d’ambassades, à la garde de différents bâtiments publics, comme le Palais de justice à Paris. Mobiliser des forces de haute compétence pour effectuer des missions de cette nature n’est pas satisfaisant. Cette question me conduit logiquement à mon septième point : la formation des unités mobiles.
Ces dernières, réputées y compris à l’étranger, sont soumises à un fort taux d’engagement : plus de 220 jours par an pour un EGM – c’est considérable. Nous devons pouvoir dégager les escadrons de certaines missions pour renforcer leur formation qui n’est pas satisfaisante au vu du rythme évoqué. Les EGM passent en effet une fois tous les trois ans par le centre national d’entraînement des forces de gendarmerie de Saint-Astier – de réputation internationale, au point de recevoir de nombreuses délégations étrangères. Il faudrait que nos escadrons y séjournent au moins une fois tous les deux ans et pour cela, je le répète, les dégager de certaines missions comme les gardes statiques.
Huitième point : l’emploi des armes de force intermédiaire. La gendarmerie mobile a développé différents moyens pour permettre un engagement gradué des escadrons. Je défends fortement les moyens de force intermédiaire, à condition qu’ils soient encadrés – je pense aux lanceurs de balles de défense qui permettent de tirer des munitions en gomme pour éviter d’engager des armes à feu. Je souhaite que ces armes soient équipées de systèmes de visée afin de gagner en précision et de porter le juste coup. Là encore la situation mérite clarification : certaines armes – les munitions lacrymogènes sont également concernées – doivent être consolidées et pourvues de systèmes d’aide à la visée.
J’en viens à mon neuvième point : la judiciarisation du maintien de l’ordre. Il me semble nécessaire de continuer à travailler aux interpellations des individus dangereux – meneurs, casseurs – qui se trouvent en face de nous, même si la mission principale des escadrons est bien d’assurer l’ordre public. Il faudrait engager, devant les escadrons, des équipes plus mobiles à même d’interpeller les responsables de violences particulières. Nous devons donc également être capables, en termes judiciaires, de les confondre – d’apporter des éléments de preuve, c’est-à-dire être capables de les identifier et de les lier directement à un fait. Or les individus en question sont souvent casqués, parfois cagoulés. Il s’agit de développer une action cohérente avec l’autorité judiciaire afin que ces individus soient éventuellement condamnés et, si c’est le cas, faire en sorte qu’ils tombent sous le coup d’une interdiction administrative de manifestation.
Nous devons distinguer, dans une manifestation, les forces de sécurité publique des forces d’ordre public. Je ne suis pas du tout favorable à ce qu’on mélange dans une même unité un engagement en tenue et un engagement en civil, mélange qui nuirait à la lisibilité de l’action des forces de l’ordre. Les forces de maintien de l’ordre doivent être appuyées par des forces de sécurité publique générale qui doivent, elles, conduire des actions de procédure judiciaire dans le plus strict respect de la répartition des missions.
Le dixième et dernier point porte sur les nouvelles technologies. Nous devons anticiper les opérations d’ordre public pour optimiser les capacités offertes par la vidéo-protection à des fins, notamment, de police judiciaire. Par ailleurs, nous ne sommes pas assez performants pour tout ce qui concerne les réseaux sociaux : un travail colossal reste à mener dans l’exploitation des métadonnées pour développer une analyse prédictive des situations d’ordre public – il s’agirait d’examiner les situations avec la plus grande exactitude possible pour mieux dimensionner le nombre de forces engagées.
Nous devons par ailleurs, en cours d’opérations, aller plus loin dans l’exploitation des réseaux sociaux. À l’occasion de manifestations, on observe que, par le biais de Twitter, de textos, des consignes de déplacement de tel point à tel autre sont données et les forces de l’ordre en sont réduites à suivre plus qu’à anticiper. De ce fait, les réactions ne sont pas forcément élaborées tactiquement au point qu’il arrive que des unités se dispersent et perdent leur force opérationnelle – point de départ de situations susceptibles de dégénérer.
L’idée peut choquer mais il faudra examiner les conditions permettant, en situation dégradée, d’être plus contraignants sur les réseaux sociaux, d’examiner, sous le contrôle de l’autorité judiciaire et des autorités administratives, la question du brouillage et celle de l’interception de certains textos.
Enfin, il faudra aller le plus loin possible en matière d’optimisation des dispositifs de vidéo-protection pour confondre les individus coupables de violences.
M. Pascal Popelin, rapporteur. Je vous remercie, mon général, d’avoir privilégié les propositions concrètes : au stade où en sont nos auditions, c’était en effet le choix le plus opportun. Je vous poserai trois séries de questions.
La première concerne les opérations de maintien de l’ordre proprement dites.
Les réductions d’effectifs des années récentes, qui ont touché les unités de CRS et de gendarmerie mobile et conduit à leur reconfiguration, ont-elles entamé l’efficacité du dispositif national de maintien de l’ordre ?
Plus précisément, pour ce qui est des armes, l’article D211-17 du code de la sécurité intérieure énumère les armes à feu susceptibles d’être utilisées pour le maintien de l’ordre public sans toutefois établir de hiérarchie quant à leurs effets physiques ou leur possible dangerosité. Dès lors, il ne prévoit pas de hiérarchie dans leur utilisation. Selon vous, faut-il modifier ces dispositions afin d’assurer une gradation de la réponse des forces de l’ordre en fonction des effets de ces équipements ?
De même, les munitions susceptibles d’être employées sont classifiées selon le vecteur utilisé et non selon l’effet qu’elles produisent. Ne faudrait-il pas inverser cette logique ou affiner la classification en prenant en compte ces deux critères ? J’en profite pour dire un mot sur l’interdiction des grenades offensives. Des réflexions sont-elles en cours sur la conception d’équipements de substitution, sachant que notre préoccupation est de concilier deux exigences : maintenir l’éventail opérationnel le plus étendu possible pour assurer une gradation effective et efficace de la réponse tout en préservant l’intégrité physique des manifestants ?
Ma deuxième série de questions porte sur les « zones à défendre » (ZAD).
Les médias ont évoqué l’existence de guides à l’usage des « zadistes » qui indiqueraient, notamment, comment fabriquer et utiliser des engins explosifs et incendiaires. Les vidéos diffusées sur Internet témoignent de l’utilisation de bonbonnes de gaz explosives mais sans qu’il soit possible de déterminer s’il s’agit de vrais engins explosifs ou d’engins factices destinés à faire perdre du temps aux forces de l’ordre. Selon vous, ces engins, ou du moins certains d’entre eux, sont-ils destinés à réellement exploser et, le cas échéant, pouvez-vous nous détailler la nature de ces engins et préciser s’ils ont été effectivement utilisés par les contestataires à l’encontre des forces de l’ordre ? Accessoirement, si le fameux guide du zadiste existait et si, par un biais ou par un autre, la commission pouvait en récupérer un exemplaire, cela pourrait nous intéresser.
Par ailleurs, un certain flou entoure la nature et le degré de violence auquel les forces de l’ordre sont confrontées. De quel type de violence s’agit-il ? On parle de jets d’acides – démentis. Qu’en est-il réellement ?
Dispose-t-on de statistiques sur le nombre de blessés du côté des manifestants et du côté des forces de l’ordre au cours des opérations de maintien de l’ordre liées à l’existence de ZAD, sur les causes de ces blessures et sur leur gravité ? Je n’attends pas dès à présent une réponse chiffrée mais des compléments d’information pourraient nous être adressés par écrit en la matière.
J’en viens à ma troisième série de questions.
Vous avez évoqué le rôle des préfets. Si j’ai bien compris, vous n’êtes pas favorable au système des réquisitions mais souhaitez qu’existent des écrits à tel stade de l’engagement des forces. Pouvez-vous vous montrer un peu plus précis sur ce point ?
Je terminerai avec l’interdiction individuelle de manifester. Vous avez, à ce sujet, établi un parallèle avec les manifestations sportives. Il se trouve que j’ai soulevé la question lors de l’audition du ministre de l’Intérieur, lequel a expliqué qu’il était plus aisé de procéder à des interdictions de stade parce qu’il s’agissait d’un lieu clos, que de procéder à des interdictions de manifester sur la voie publique. Comment, donc, appliquer cette interdiction individuelle de manifester ? J’avais proposé qu’on oblige un manifestant connu et condamné pour violences à l’occasion de manifestations à se présenter dans un commissariat ou une gendarmerie. Mais qu’en fait-on une fois qu’il s’est présenté ? Le retient-on, le laisse-t-on repartir ?
M. le président. J’ajouterai une question, mon général, sur la présence de l’autorité civile lors des manifestations, en revenant sur ce qui s’est passé à Sivens : pensez-vous que si le préfet avait été sur place, nous aurions pu éviter le drame qui s’est produit ?
Général Denis Favier. Les escadrons de gendarmerie mobile ont consenti le gros des efforts qu’impliquait la révision générale des politiques publiques (RGPP) : nous avons procédé à la dissolution de 15 escadrons sur quelque 120. Parallèlement, nous avons perdu des missions comme celle des centres de rétention administrative. Nous n’en avons pas moins un taux d’engagement important. Aussi les escadrons sont-ils soumis à une forte pression opérationnelle qui n’affecte pas la conduite des opérations mais le temps de récupération et de formation. Au total, nous n’avons pas perdu en efficacité – la gendarmerie mobile a continué de développer des capacités fortes et des savoir-faire reconnus – mais le taux d’engagement, je le répète, est important. Je rappelle au passage notre engagement outre-mer où seuls des escadrons de gendarmerie mobile assurent l’ordre public. Sur les 108 escadrons, 20 sont engagés en permanence outre-mer – c’est considérable, si bien que si nous retirions ces 20 escadrons, la sécurité publique générale n’y serait plus assurée.
Pour ce qui concerne les munitions et les armes à feu, nous devons établir leur hiérarchisation avec plus de clarté. Nous pouvons distinguer quatre niveaux : l’emploi de la force, sans munitions particulières, se caractérise uniquement par des procédés tactiques, un mouvement offensif pour dégager un axe ; ensuite, nous avons les moyens de force intermédiaire – parmi lesquels figureront, par exemple les grenades lacrymogènes –, stade, là aussi, à clarifier ; puis nous avons les munitions assourdissantes – dont il convient de faire une catégorie particulière – ; enfin, nous avons l’emploi des armes, auquel on n’a jamais recours en France. Cette dernière catégorie n’est pas à écarter dans des situations extrêmes de maintien de l’ordre ; le code de sécurité intérieure doit par conséquent la définir clairement. Ces quatre niveaux sont rationnels et personne ne les conteste.
J’en viens aux vecteurs. Une munition, selon qu’elle est lancée à la main ou avec un lanceur, change de catégorie. Le débat doit donc davantage porter sur l’effet de la munition que sur son vecteur. La commission pourrait contribuer assez facilement à clarifier ce point.
Pour ce qui est des ZAD, nous faisons face à une opposition nouvelle avec des gens implantés sur un territoire qu’ils défendent selon des modes d’action que nous ne connaissions pas – vous en avez évoqué un, Monsieur le rapporteur – et sur lesquels nous vous communiquerons des éléments techniques d’appréciation, notamment sur ce qui s’est passé à Notre-Dame-des-Landes et sur d’autres sites. Nous avons été confrontés à des situations de blocage très tendues. L’engagement avec les forces de l’ordre est préparé par les manifestants qui utilisent non seulement des moyens passifs pour empêcher ces dernières d’agir, mais aussi des moyens offensifs – si ce n’est des jets d’acide, en tout cas des cocktails Molotov ou des bouteilles incendiaires de nature plus explosive. Nous vous fournirons des éléments statistiques concernant les blessés : on en compte davantage en 2014 qu’en 2013 ou qu’en 2000.
Le principe du maintien de l’ordre est d’assurer la primauté du préfet ou de son représentant – sous-préfet, directeur départemental de la sécurité publique ou commandant de groupement – qui, très proche de lui, transmet ses intentions. Il faut que l’autorité civile soit imprégnée des conditions d’exercice de la manœuvre, qu’elle connaisse très clairement les conditions d’engagement, les effets des munitions, ceux d’un procédé tactique. Un travail de formation très important est donc nécessaire. Je suis à cet égard tout à fait prêt à accueillir les préfets au centre de Saint-Astier, avant qu’ils ne prennent leurs premières fonctions départementales.
En effet, monsieur le rapporteur, je ne souhaite pas en revenir au système des réquisitions. Le système en vigueur, fluide, fonctionne très bien. Il nous faut toutefois préciser la question des ordres donnés sur l’engagement des munitions à fort effet. Nous devrions sur ce point établir un protocole assez proche de ce qui existait par le passé. Il s’agit de responsabiliser le préfet qui rédige le papier et le commandant de la force qui le reçoit et comprend bien qu’on change de registre.
Pour ce qui est de l’interdiction individuelle de manifestation, il est vrai que les opérations de maintien de l’ordre public se déroulent dans des espaces ouverts et le dispositif de contrôle n’est de ce fait pas facile à assurer. Nous sommes cependant capables de suivre les meneurs et, par le biais d’un dispositif de préfiltrage, de commencer un tri. L’interdiction que je propose permet à coup sûr de contrôler les individus dangereux en amont du déroulement de la manifestation. Un tel dispositif est sans doute difficile à mettre en place mais pas impossible au vu des moyens techniques dont nous disposons.
Enfin, monsieur le président, je continue d’insister sur le rôle du préfet dans la conception, mais également en matière de visites sur le terrain, de conduite opérationnelle.
Mme Marie-George Buffet. Je vous remercie, général, pour la qualité de votre exposé et pour vos propositions.
Je reviens sur les rapports entre l’autorité civile et les forces opérationnelles – débat qui occupe la commission d’enquête depuis sa constitution. À vous entendre, j’ai l’impression que ce qui vous importe, en particulier dans les propositions du ministre d’une présence permanente de l’autorité civile sur les lieux des manifestations, d’une formation des autorités civiles par le préfet Lambert, c’est la clarté des consignes données et l’engagement, à travers un protocole, de l’autorité civile sur le contenu même de ces consignes. Le confirmez-vous ?
Ensuite, votre première proposition me préoccupe. Comment responsabiliser les organisateurs ? On peut certes y parvenir quant au déroulement de « leur » manifestation, ce qui est déjà le cas dans le cadre des négociations préalables habituelles avec les organisateurs traditionnels, historiques même, des manifestations sociales, démocratiques. Mais il faut faire attention à ne pas faire porter la responsabilité aux organisateurs quand ils sont eux-mêmes en butte à ces casseurs d’un nouveau genre, qui pratiquent l’intrusion – on l’a vu lors des manifestations contre le contrat première embauche (CPE). En effet, si les organisateurs répondaient à ces intrusions de manière trop ferme, ils seraient eux-mêmes menacés de sanctions judiciaires.
Ma troisième question porte sur des missions que vous devez assumer et qui ne correspondent pas à ce que vous avez reçu comme formation, notamment ces gardes statiques dans la zone capitale. Faut-il inventer une nouvelle force chargée de ce type de mission ?
Enfin, vous semblez estimer possible l’interdiction individuelle de manifestation grâce aux moyens actuels. Je suis sceptique car nous n’avons pas affaire tout à fait au même public que celui visé par une interdiction d’aller dans un stade. De plus, une telle proposition comporte un risque d’atteinte au droit de manifester.
M. Gwenegan Bui. Mon général, votre décision de ne plus diviser vos escadrons en phase opérationnelle risque-t-elle d’amenuiser les capacités de la gendarmerie mobile à répondre aux sollicitations de maintien de l’ordre ? Et, dans le cadre de votre doctrine d’emploi, cette décision est-elle amenée à perdurer ?
Ensuite, quel est le quotidien d’un escadron de gendarmes mobiles quant à la durée moyenne d’une intervention ? Comment s’opèrent les relèves et de quelle manière sont déterminées les fins de mission ? En effet, quand des hommes sont dans une situation d’affrontement, ils se fatiguent ; or cette fatigue est-elle prise en compte dans les rotations ?
Ma troisième question porte sur la formation de la gendarmerie départementale pour les opérations de maintien de l’ordre. Parfois, à cause d’un événement imprévu, les escadrons de gendarmes mobiles ne peuvent arriver à temps et les gendarmes départementaux doivent effectuer les premières périodes. Or, il me semble que la formation que j’évoque est insuffisante. J’ai pu constater en tout cas, dans le Finistère, que les gendarmes départementaux sont exposés.
Enfin, vous avez rappelé que seule la gendarmerie mobile était présente outre-mer ; or, à ma connaissance, aucun texte ne répartit ces zones entre la gendarmerie et la police. La situation que vous évoquez relève-t-elle d’un droit coutumier et, si ce n’est pas le cas, ne faut-il pas prévoir un texte ?
M. Philippe Goujon. À quel point, mon général, l’affirmation du rôle de l’autorité civile est-elle susceptible d’entrer en conflit avec le commandement tactique ?
Vous êtes revenu par ailleurs sur les mesures préventives – que je soutiens – mais, en aval, pouvez-vous nous donner votre appréciation sur la réponse pénale apportée à l’issue des manifestations ? Les condamnations vous paraissent-elles proportionnées ?
En outre, à force de réduire les armes et moyens qui permettent de tenir les manifestants à distance, ne risquons-nous pas d’aboutir à l’inverse du but recherché, c’est-à-dire à un rapprochement des manifestants et des forces de maintien de l’ordre ? Plus se développent des phénomènes de guérilla urbaine – même si le terme est un peu fort – plus on désarme les forces de sécurité. Cela pose-t-il problème selon vous ?
Comme pour la police, qui mêle forces de maintien de l’ordre et de sécurité générale, maintenez-vous votre position consistant à ne pas vouloir engager d’autres forces de sécurité pour le maintien de l’ordre, notamment pour les interpellations, parfois difficiles à réaliser dans la configuration actuelle ?
La protection fonctionnelle des gendarmes vous paraît-elle suffisante ?
Ensuite, vous avez évoqué les gardes statiques ainsi que nombre de charges indues. La garde du Palais de justice a fait l’objet d’un rapport : en a-t-il été tenu compte ? Pouvez-vous nous informer sur la répartition des missions des EGM entre le maintien de l’ordre, les services d’ordre, la sécurité générale, les renforts en ZSP… ? Car plus on sollicite les EGM, plus leurs interventions pour assurer le maintien de l’ordre sont susceptibles d’être tendues – je pense aux temps de transport, au fait de savoir si l’implantation des EGM sur le territoire est adéquate.
Enfin, considérez-vous qu’il existe une durée d’intervention pour un EGM au-delà de laquelle le stress, la fatigue commencent à poser problème ?
Général Denis Favier. Les escadrons relèvent de la gendarmerie, il s’agit donc d’une force de statut militaire. À ce titre, la notion de temps de travail est prise en compte mais n’a pas de fondement réglementaire. Cette situation pourrait néanmoins changer avec la transposition d’une directive européenne. Reste que nous respectons des temps d’engagement opérationnel : celui d’un escadron est de huit heures ; passée cette durée, la fatigue physique est incontestable, pèse sur les organismes et peut par conséquent avoir une incidence sur l’efficacité opérationnelle. Il existe néanmoins des situations qui, parce qu’elles ne sont pas programmées, s’inscrivent dans la durée et nous empêchent de relever les escadrons engagés. Ainsi, le 31 décembre, si, après le travail réalisé sur les Champs Élysées, des voitures sont brûlées dans les banlieues, il va bien falloir que les escadrons se rendent sur place. Aussi certaines séquences opérationnelles peuvent-elles se révéler plus longues.
Ce statut militaire ne doit pas faire peur car les unités concernées maîtrisent les savoir-faire qui leur permettent de garantir l’ordre public. Et c’est leur formation militaire et leur capacité à agir dans la durée – et la rusticité parfois – qui explique notamment leur présence outre-mer. Je pense au travail considérable des EGM, en Guyane, dans la lutte contre l’orpaillage clandestin – il faut en effet accepter de vivre trois mois à la frontière entre la Guyane et le Brésil dans des conditions difficiles.
J’en viens logiquement à la question de M. Bui. Aucun texte ne prévoit de répartition entre police et gendarmerie outre-mer. Il s’agit d’une demande politique, d’une demande locale : ces unités sont en effet capables de partir longtemps, trois ou quatre mois sans relève.
Autre point, la règle est que les gendarmes départementaux ne participent pas au maintien de l’ordre. Reste que certaines circonstances commandent l’envoi des forces immédiatement disponibles, à savoir, généralement, les pelotons d’intervention des compagnies départementales qui ne sont pas formées au maintien de l’ordre. Elles sont toutefois généralement composées de militaires qui ont servi dans les escadrons de gendarmerie mobile, militaires dont le fond opérationnel est dès lors solide et leur permet d’intervenir efficacement. Mais, j’y insiste, la règle veut qu’il n’y ait pas d’engagement des unités de gendarmerie départementales, hors situation d’urgence, au maintien de l’ordre. Il n’y a pas à transiger : à chacun son métier. En Bretagne, en 2013, des unités territoriales ont dû être engagées en attendant l’arrivée des escadrons, mais cela doit rester exceptionnel et je ne pense pas qu’il faille former la gendarmerie départementale au maintien de l’ordre ni qu’il faille, par conséquent, la doter spécialement même si, dans certains quartiers chauds, pour réagir ponctuellement à une situation inopinée, certaines unités sont équipées de casques et de boucliers.
La question de la répartition des rôles entre préfet et commandant opérationnel est centrale. Les opérations se déroulent mal quand ces rôles ne sont pas précisément définis, quand le préfet se mêle de la conduite opérationnelle et quand le commandant, faute de directives claires de la part de l’autorité préfectorale pense qu’il peut aller plus loin qu’il ne devrait. Le système français fonctionne bien, d’où la nécessité que chacun reste dans son rôle : le préfet définit les objectifs, les effets à produire sur le terrain et, ensuite, il s’appuie sur un patron de forces qui, lui, est libre d’en choisir les moyens. Par exemple, à l’occasion d’une prise d’otage, le responsable de l’opération sera libre des moyens à mettre en œuvre pour atteindre l’objectif dont la définition revient au politique. Nous devons donc engager une réflexion visant à affirmer le rôle de chacun.
En ce qui concerne les gardes statiques, les unités de maintien de l’ordre ne sont pas uniquement dédiées au maintien de l’ordre. Fort heureusement, il existe des périodes calmes et, dans une logique de coût-efficacité, les unités en question doivent participer à des missions de sécurisation, de sécurité publique générale afin de surveiller le territoire, d’occuper l’espace, de rassurer nos concitoyens. Les EGM comme les CRS ont deux missions principales : l’ordre public et la sécurisation. Aussi, les missions de garde statique me paraissent-elles constituer un gâchis de potentiel alors qu’elles pourraient être remplies à moindre coût par des forces locales voire par des sociétés privées. Nous devons également envisager les moyens passifs de protection. Pourquoi sont-ce des gendarmes mobiles qui gardent l’entrée de la Sainte-Chapelle ? Après plusieurs années, je n’ai toujours pas de réponse.
J’en viens à l’interdiction de manifestation. Elle est bien plus complexe à appliquer que l’interdiction de stade. Nous pouvons toutefois nous intéresser à des individus déjà signalés, condamnés et dès lors faire montre de précision dans notre travail d’anticipation et faire en sorte qu’ils ne rejoignent pas un lieu de manifestation.
Il ne s’agit pas, par ailleurs, de mettre en difficulté un organisateur qui met tout en œuvre pour qu’une manifestation se déroule au mieux. Sa responsabilité ne pourra pas être engagée. Ce sont les manifestations inopinées qui nous posent problème et qui sont bel et bien organisées. Il en est ainsi des pique-niques spontanés sur l’esplanade des Invalides, qui certes ne dégénèrent pas ,et où la responsabilité des organisateurs n’est pas engagée . De même , il convient de travailler sur la responsabilité de ceux qui appellent à des rassemblements, des attroupements, et qu’on peut repérer grâce aux réseaux sociaux.
M. Jean-Paul Bacquet. Mon général, vous estimez nécessaire de réviser les méthodes tant l’évolution des techniques et des moyens de communication change la donne. Lors du putsch en Algérie, pendant les événements de Mai-1968, l’élément principal de communication était le poste à transistor qui diffusait des informations en fonction desquelles évoluaient les manifestants. Cette configuration est dépassée : aujourd’hui, nous avons les chaînes d’information continue. Reste que nous avons pu constater, au mois de janvier dernier, le danger que représentait le fait de ne pouvoir maîtriser la communication qui pouvait s’établir entre deux attaques terroristes par le biais des informations données par ces chaînes. Au-delà des textos, des réseaux sociaux, se pose la question du rôle de l’information. On sait très bien que, dans les manifestations, les rumeurs, les manipulations proviennent de fausses informations dont les journalistes à la recherche d’un scoop sont parfois friands.
Ensuite, il existe deux types de manifestations : les manifestations déclarées, organisées par des gens responsables – syndicalistes ou autres –, et les manifestations spontanées – lancées, dans les années 1970, par ceux qu’on appelait les Mao-spontex – avec les organisateurs desquelles il paraît bien difficile d’établir le dialogue.
Vous avez évoqué l’idée de remplacer des gendarmes mobiles par des vigiles. Je comprends bien les problèmes liés aux effectifs mais cela n’a pas tout à fait la même signification. Certains ministères ont été gardés par des vigiles – et Guillaume Larrivé, qui a vécu de près cette situation il y a quelques années, a pu mesurer la différence entre les vigiles et les gendarmes. Si la situation est calme en ce qui concerne les ambassades, cela n’a pas toujours été le cas et je ne suis pas sûr que, dans des conditions délicates, des vigiles puissent remplacer des gendarmes mobiles. Cette considération ne vaut pas, bien sûr, pour la Sainte-Chapelle.
La nécessité du renforcement de la formation de l’autorité civile est évidente, alors que le principe de la délégation va beaucoup moins de soi – si un commandant de groupement a la délégation d’un préfet, cela n’a pas tout à fait la même signification. Il faut à tout prix éviter tout double rôle car, quand surviendront les difficultés, je ne suis pas sûr que chacun assumera pleinement ses responsabilités.
Enfin, vous avez évoqué l’outre-mer où nous savons désormais pourquoi il n’y a plus que des gendarmes et plus de CRS. Je suis très inquiet à ce sujet car la logique de la Cour européenne des droits de l’homme poussera à la syndicalisation des gendarmes qui auront les mêmes exigences que la police et pourront donc ne plus aller outre-mer ou ailleurs. Je souhaite obtenir quelques éclaircissements en la matière.
M. Guy Delcourt. Mon général, vous avez répondu de façon claire et décisive, catégorique même, à la question, soulevée par un ancien directeur du centre de Saint-Astier, de l’intervention de la gendarmerie départementale.
Les CRS bénéficient-ils de la même formation que la gendarmerie ou bien de formations temporaires au centre de Saint-Astier ? Selon certains syndicats, les policiers, dans un contexte de manifestation urbaine, ne sont pas du tout formés aux opérations de maintien de l’ordre mais à des opérations d’interpellation. Qu’en pensez-vous ?
Enfin, vous nous avez présenté dix propositions. Ont-elles été formulées pour cette audition ou bien font-elles partie d’un rapport d’évaluation que vous avez transmis à l’autorité politique ? Si oui, depuis combien de temps, et quels en ont été les éventuelles traductions ?
M. Philippe Folliot. Mon général, je vous apporte un message de soutien à la gendarmerie. On sait que vous travaillez souvent dans des conditions difficiles ; or, en cas de crise grave, la République repose sur deux piliers : la préfectorale et la gendarmerie.
Souvent, les forces de maintien de l’ordre se trouvent face à des situations d’une extrême violence et avec des individus particulièrement déterminés, organisés, avec tout ce que cela implique en matière de protection des forces de l’ordre elles-mêmes. En effet, on utilise contre elles des armes carrément létales. Et même si les manifestants n’ont pas, a priori, la volonté de tuer, la mort peut être la conséquence de l’usage de ces armes. Comment, face à une violence de plus en plus intense, accomplir vos missions dans de bonnes conditions ?
La République se caractérise par la dualité de ses forces de l’ordre, avec, d’un côté, les gendarmes mobiles, à statut militaire, et, de l’autre, les CRS, à statut civil. Or vous nous avez rappelé que cette dualité ne valait pas sur tout le territoire national puisque, outre-mer, seule intervient la gendarmerie mobile. Dans ce cadre, une spécialisation vous paraîtrait-il judicieuse ? Certains ont en effet parlé de « territorialisation » des CRS pour qu’elles soient plus près du terrain et concentrées dans les centres urbains tandis que la gendarmerie mobile conserverait un spectre toujours aussi large.
M. Olivier Marleix. Merci, mon général, pour la grande qualité de votre intervention et pour la pertinence de vos propositions qui illustrent la solidité de votre arme.
Je reviendrai, dans un premier temps, sur la responsabilisation. Le préfet Boucault a évoqué une obligation de concertation préalable – comme elle existe déjà pour les rave-parties. Faut-il aller plus loin, l’organisateur doit-il préciser les modalités de maintien de l’ordre dont il se dote ? S’il ne respecte pas ses engagements doit-on aller jusqu’à interdire la manifestation ? Doit-on renforcer un arsenal de sanctions qui, après tout, existe déjà pour les organisateurs de manifestations sportives qui, aux termes des dispositions du code de la sécurité intérieure, peuvent encourir des peines d’amendes ?
Ensuite, j’ai été convaincu par votre souhait qu’on définisse un protocole : il est évident que l’autorité préfectorale a une responsabilité essentielle puisque c’est elle qui décide d’autoriser ou non la manifestation et puisqu’elle est garante, d’une certaine manière, des accords conclus à l’issue d’une éventuelle concertation préalable obligatoire. Toutefois, la présence physique sur place du préfet ou de son directeur de cabinet me paraît être un élément de confusion dangereux car, par la force des choses, il voudra se mêler du commandement opérationnel pour lequel il n’est pas du tout formé – surtout s’il s’agit du préfet plutôt que de son délégué. J’ai donc du mal à concevoir l’articulation que vous évoquez.
Ma troisième question porte sur l’interdiction administrative de manifester. Le rapporteur s’est lui-même interrogé sur les modalités concrètes grâce auxquelles on empêcherait un individu de se rendre à une manifestation. S’arrange-t-on pour que ledit individu soit convoqué ce jour-là ailleurs ou bien peut-on imaginer un nouveau délit, spécifique, pour ces casseurs, dont la peine garantirait qu’ils ne puissent se rendre sur le lieu d’une manifestation ?
Enfin, j’aimerais en savoir davantage sur la part des effectifs d’EGM affectés aux ZSP et sur la part affectée aux gardes statiques.
M. Guillaume Larrivé. Merci, mon général, d’avoir montré la solidité et le sens du concret qui caractérisent votre arme.
Il était important de rappeler que la réduction du format des EGM engagée entre 2007 et 2012 s’est accompagnée d’une redéfinition des missions – on songe notamment au transfert à la police nationale de l’encadrement des centres de rétention administrative – au point que, vous l’avez souligné, la gendarmerie mobile n’a pas perdu en efficacité.
Pour ce qui est, ensuite, de l’interdiction administrative de manifester, le préfet de police, lors de son audition par cette commission, la semaine dernière, s’est montré très réservé. Comme Philippe Goujon, je pense que nous pourrions élaborer un dispositif prévoyant que les personnes faisant l’objet d’une telle interdiction, à titre préventif – il s’agit bien d’une mesure de police administrative et non d’une mesure de police judiciaire –, soient invitées à pointer dans un commissariat ou dans quelque autre espace administratif afin de s’assurer qu’elles ne se rendent pas sur le lieu de manifestation. Il faut bien insister sur le caractère préventif d’une telle disposition.
Enfin, quelles sont les différences légitimes, utiles, entre le régime d’emploi des armes par la gendarmerie et le régime d’emploi des armes par les fonctionnaires de la police nationale employés fonctionnellement pour des missions de maintien de l’ordre ? Ces différences existent-elles encore vraiment, compte tenu, notamment, de l’effet de la jurisprudence de la Cour de cassation qui les a quelque peu aplanies ?
Général Denis Favier. Incontestablement, monsieur Bacquet, nous devons travailler sur les réseaux sociaux, sur les textos pour éventuellement informer sur les conditions d’exercice du maintien de l’ordre.
Quant au débat sur les informations diffusées en continu, il a commencé en 1994 avec la retransmission par LCI d’images fortes. On a vu le mois dernier à quel point ces retransmissions mettaient les forces de l’ordre dans une difficulté colossale et faisaient par là peser sur nos concitoyens des risques importants. Il faut mener un débat de fond sur la politique générale de communication en situation de crise. Il faudrait définir un protocole très strict entre médias, presse et forces de l’ordre. Ce sujet me tient vraiment à cœur.
M. le président Noël Mamère. Si je puis me permettre, mon général, en tant qu’ancien journaliste je ne pense pas que l’établissement d’un tel protocole règle le problème qui relève bien davantage de l’éthique des journalistes. Il leur revient de savoir quelles informations divulguer et a fortiori dans des situations de crise comme celle que nous avons connues. Il est effrayant de constater qu’on est capable de dire en direct à quel endroit se trouvent les otages alors qu’on sait que le preneur d’otages utilise la télévision. Cette conception du métier est tout à fait condamnable, mais je ne pense pas qu’il soit nécessaire d’établir un protocole avec les forces de l’ordre. C’est bien, j’y insiste, une question d’éthique dans le cadre d’un régime démocratique.
Général Denis Favier. Cette question doit en tout cas faire l’objet de débats vraiment soutenus.
J’en viens à la garde statique. Il est clair pour moi que tout bâtiment qui relève du domaine régalien doit rester encadré par les forces de l’ordre. Pour le reste, on peut faire appel à des sociétés privées qui n’ont certes pas les mêmes prérogatives mais qui, dans certains secteurs, peuvent exécuter la mission de sécurité dans les mêmes conditions.
M. Bacquet a évoqué les récents arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme qui contestaient l’absence de représentation syndicale dans la gendarmerie. Cette absence est palliée par la création d’associations militaires professionnelles.
Le directeur général de la police nationale, qui doit s’exprimer après moi, pourra vous renseigner sur la formation des CRS. Je suis convaincu que leur niveau de formation est identique à celui des EGM. Je suis en tout cas, pour ma part, tout à fait prêt à les accueillir au centre de Saint-Astier qui offre d’importantes capacités d’entraînement.
Pour ce qui est des manifestations urbaines, nous mettons souvent des forces à la disposition du préfet concerné et, à Paris, du préfet de police dont je crois savoir qu’il en est plutôt satisfait. Évoquer cette question revient à évoquer celle des capacités opérationnelles. Ici aussi, il faut se méfier du mélange des genres. Quelle est la vocation première des unités de maintien de l’ordre ? S’agit-il de tenir un compartiment de terrain ou de procéder à des interpellations ? Si l’on s’en tenait au second terme de l’alternative, on produirait de la confusion dans les esprits. Toutefois, si la mission première reste de tenir le terrain, il convient aussi d’être en mesure de procéder à des interpellations.
Les dix pistes que j’ai présentées s’inscrivent dans une réflexion de fond. Vous seriez surpris – et vous vous en rendrez compte quand vous viendrez à Saint-Astier – de constater à quel point nous conceptualisons le maintien de l’ordre. Notre réflexion est permanente. Aussi nos procédés ont-ils évolué : notre pratique actuelle n’a plus rien à voir avec celle de Mai-1968. Nous recherchons le meilleur équilibre possible entre liberté d’expression et efficacité des forces. Nous pensons et agissons suivant une logique d’adaptation permanente.
Ce point me conduit à revenir sur la protection des hommes, évoquée par M. Folliot. Là aussi nous sommes confrontés à des paradoxes. Si nous renforçons la protection de nos forces, elles seront moins mobiles et du coup incapables de procéder à des interpellations. Si elles sont trop équipées, elles donneront une impression guerrière contradictoire avec l’objectif poursuivi quand on autorise une manifestation. Le maintien de l’ordre est donc un exercice délicat, tout de subtilité. La recherche du meilleur équilibre concerne donc aussi l’équipement des forces.
Vous avez ensuite évoqué la question de la dualité entre la police et la gendarmerie. Elle ne fait plus débat en France. Chacune des deux forces est capable, dans son domaine, d’exercer l’ensemble des missions qui lui sont confiées. C’est pourquoi je suis réticent à l’idée de spécialisation même si les escadrons, là où ils sont casernés, peuvent contribuer à la sécurité publique générale. Ainsi, chaque fois que les escadrons ne sont pas employés au maintien de l’ordre, ils participent à des patrouilles avec la gendarmerie départementale à une mission large de sécurisation, ce qui leur permet de s’ancrer localement.
À la question de la responsabilisation posée par M. Marleix, je répondrai par un souhait. Il faudra bien sûr, si le législateur décidait d’aller dans le sens que j’ai indiqué, prévoir des sanctions adaptées. Dans le même temps, le dispositif ne devra pas être un carcan mais rester souple.
Ensuite, le préfet ne peut pas être présent tout le temps sur le terrain – et c’est même souhaitable – mais il a des délégataires. Et ici, sauf à m’opposer à M. Baquet, je considère que le commandant de groupement peut être ce contact et peut lui-même s’appuyer sur un responsable opérationnel. Il faudra veiller à ne pas élaborer des dispositifs trop contraignants car les situations d’ordre public évoluent très rapidement et il faut pouvoir prendre des décisions tout aussi rapides. Il faudra prendre en compte la logique de séparation des pouvoirs et la combiner avec le souci de l’efficacité opérationnelle.
Un travail législatif important reste à mener concernant l’interdiction administrative de manifester. Il faudra bien sûr que les forces de l’ordre soient à même d’appliquer un tel dispositif.
Trois EGM travaillent en permanence dans les ZSP, une présence qui nous a permis d’obtenir des résultats, c’est-à-dire d’inverser la tendance.
J’en viens à l’évocation par M. Larrivé de la RGPP. Le transfert à la police de l’encadrement des centres de rétention administrative a en partie permis d’en atténuer les effets mais nous avons tout de même perdu quelques escadrons qui font aujourd’hui clairement défaut ; et la France doit disposer d’un volume important d’EGM mais aussi de CRS car nous ne sommes pas à l’abri de graves troubles à l’ordre public. Or nous sommes aujourd’hui en deçà du seuil critique.
Enfin, il n’y a pas de différence entre le régime d’emploi des armes par la gendarmerie et le régime d’emploi des armes par les fonctionnaires de la police nationale. Les quelques différences que l’on peut relever dans les textes ne concernent pas l’ordre public.
M. le président Noël Mamère. Vous êtes, mon général, d’une précision horaire toute militaire. (Sourires.) Nous intégrerons certaines de vos propositions dans le rapport que rédigera M. Popelin.
*
* *
Audition, ouverte à la presse, de M. Jean-Marc FALCONE, directeur général de la police nationale, et de M. Philippe KLAYMAN, préfet, directeur central des compagnies républicaines de sécurité
Compte rendu de l’audition du jeudi 12 février 2015
M. le président Noël Mamère. Monsieur le directeur, je vous remercie d’avoir répondu à notre sollicitation. Conformément aux dispositions de l’article 6 de l’ordonnance du 17 novembre 1958, je dois vous demander, ainsi qu’à ceux de vos collaborateurs qui sont appelés à s’exprimer, de prêter le serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité.
(M. Jean-Marc Falcone et M. Philippe Klayman prêtent serment.)
Je vous invite à nous faire part de vos observations sur le sujet qui intéresse notre commission d’enquête, avant de répondre aux questions du rapporteur puis des autres commissaires présents.
M. Jean-Marc Falcone, directeur général de la police nationale. Je vous remercie de me donner l’occasion de participer à cette commission d’enquête pour donner des précisions sur le sujet, très important pour moi et pour mes équipes, du maintien de l’ordre public. Je suis accompagné de M. Philippe Klayman, préfet, directeur central des compagnies républicaines de sécurité.
Contrairement à certains représentants du ministère qui ont été entendus par la commission, comme le préfet de police de Paris, je n’ai pas de responsabilité opérationnelle directe même si j’ai la charge des 140 000 hommes qui composent la police nationale. Il me revient, en qualité de directeur général de la police nationale, de conduire une action dans plusieurs domaines dont les conséquences directes sur les questions d’ordre public intéressent votre commission d’enquête.
Je pense en particulier aux sujets qui touchent à la sécurité des policiers et des manifestants : la formation des policiers au maintien de l’ordre, la déontologie, le contrôle interne, l’équipement des forces de l’ordre et la doctrine du maintien de l’ordre. Ma préoccupation constante est de donner tous les outils et les moyens nécessaires aux policiers afin que l’exercice des missions de maintien de l’ordre respecte scrupuleusement les cadres légaux et réglementaires et permette l’exercice des libertés publiques.
Je considère que le rôle d’un responsable de la police nationale consiste d’abord à créer les conditions d’exercice des libertés publiques. Le rétablissement de l’ordre, en limitant au maximum l’usage de la force, ne doit venir que dans un second temps.
Une fois ces principes posés, je rappelle que la gestion de l’ordre public est fondamentalement complexe et ne peut s’envisager comme une science exacte. Je rends devant vous hommage aux hommes et aux femmes qui exercent cette mission délicate au sein de la police nationale.
Les nouvelles formes de contestation peuvent être de nature à rompre l’équilibre entre l’expression des libertés publiques et la préservation de l’ordre public.
Je tiens tout d’abord à revenir sur le cadre juridique et opérationnel du maintien de l’ordre.
Pour répondre à la double obligation de préservation des libertés publiques et de maintien de l’ordre, la police nationale dispose de ressources et de moyens spécifiques, au premier rang desquels se trouvent les compagnies républicaines de sécurité. La police nationale fait aujourd’hui des efforts particulièrement soutenus en matière de formation, d’équipement et d’amélioration des réponses opérationnelles.
Les interventions des policiers s’inscrivent dans un cadre juridique strict. Hérité de la période révolutionnaire, le cadre juridique de l’usage de la force se fonde sur un nombre limité de règles. Il s’agit notamment de l’appréciation de la matérialité de l’attroupement et de l’opportunité de sa dispersion, du protocole des sommations et du contrôle a posteriori du juge.
Au-delà de ce cadre juridique, une éthique du maintien de l’ordre a été développée au sein de la police nationale. Le récent code de déontologie commun à la police et à la gendarmerie, applicable depuis le 1er janvier 2014, traduit largement cet effort d’encadrement des pratiques sur le terrain. Le recueil sur l’organisation tactique des CRS rappelle l’obligation du respect scrupuleux de ce code de déontologie.
De nouvelles formes de contestations ont émergé dans les dernières années. Les forces de l’ordre sont aujourd’hui confrontées à des manifestations dont les formes diffèrent, à bien des égards, de celles que nous connaissions il y a une vingtaine d’années. Elles sont plus souvent spontanées, en lien avec l’actualité internationale couverte de manière instantanée par les médias, moins souvent déclarées et encadrées par des organisateurs responsables ; elles sont également le fait de groupes plus structurés et parfois violents ; elles sont enfin plus hétérogènes, mêlant des manifestants pacifiques, des délinquants et des provocateurs organisés tels que les No Borders ou les Black blocs.
Dans leur expression violente, ces nouvelles formes de contestation bénéficient d’une couverture médiatique considérable et immédiate, qui les rend encore moins acceptables pour l’opinion publique.
Face à ces évolutions, nous devons donner toute sa place au renseignement et adapter notre engagement sur le terrain pour apporter une réponse appropriée.
Le renseignement doit être placé au cœur de la préparation de la manifestation. La réforme du renseignement en 2014 qui s’est traduite par la création du service central du renseignement territorial (SCRT) permet d’atteindre cet objectif en termes de prévision et d’analyse.
Une plus grande qualité du renseignement doit nous permettre de toujours mieux adapter l’engagement des forces d’intervention, en termes de volume, de spécialisation technique des unités et de manœuvre opérationnelle.
La doctrine française du maintien de l’ordre reste une référence. Elle repose sur deux principes simples : prévenir les troubles pour ne pas avoir à les réprimer et éviter l’usage des armes en faisant preuve, jusqu’aux dernières limites, de calme et de sang-froid.
Plusieurs spécificités de notre modèle méritent d’être rappelées. Je pense tout d’abord aux forces spécialisées et projetables sur l’ensemble du territoire national ainsi qu’aux compagnies d’intervention de la sécurité publique, présentes dans les grandes villes, dont les membres sont eux aussi des professionnels du maintien de l’ordre.
Ensuite, la distinction historique et juridique entre l’autorité civile décidant de l’emploi de la force et le commandant de la force publique chargé de la mettre en œuvre demeure nécessaire. Cette dichotomie garantit le recul nécessaire à l’appréciation la plus juste des situations les plus compliquées ou les plus confuses.
Les modes d’action de nos forces mobiles sont exemplaires, parce que ces forces sont formées, répondent à une déontologie, bénéficient d’un encadrement et d’un équipement adaptés et respectent un cadre d’emploi strict.
La police nationale cherche en permanence à améliorer ses pratiques pour garantir dans la durée le professionnalisme des effectifs et la préservation des libertés publiques.
Ces efforts d’amélioration passent d’abord par une politique de formation initiale et continue volontariste. Des stages communs réunissent désormais les trois corps de la police, du gardien au commissaire, pour la gestion des violences urbaines. Des formations communes entre CRS et escadrons de gendarmerie mobile (EGM) ont été mises en place.
Ensuite, les analyses comparatives avec nos voisins européens nous permettent de tirer profit des meilleures pratiques de ces pays.
Enfin, l’efficacité de notre contrôle interne et la systématisation des évaluations et des retours d’expériences contribuent à l’adaptation constante de nos pratiques.
Plusieurs retours d’expériences de manifestations récentes nous ont permis d’améliorer notre doctrine ou nos équipements. Ce fut par exemple le cas des manifestations de février 2014 à Nantes, qui nous ont conduits à faire évoluer la doctrine d’emploi des lanceurs d’eau et la doctrine paramédicale au profit des tiers et des forces de l’ordre.
De la même manière, au cours des manifestations post-Sivens à Toulouse à l’automne 2014, le directeur départemental de la sécurité publique (DDSP) a expérimenté des dispositifs d’emploi coordonnés de policiers en civil et d’unités d’intervention.
S’agissant du maintien de l’ordre, comme d’autres domaines d’action de la police, rien n’est acquis. La recherche de l’équilibre est une préoccupation constante.
Ainsi, à titre d’exemple, à la suite de sa mission conduite avec 1’Inspection générale de la gendarmerie nationale sur l’emploi des munitions en opérations de maintien de l’ordre, l’Inspection générale de la police nationale a proposé la constitution d’un groupe de travail sur l’évolution de la doctrine de maintien de l’ordre. Ce groupe de travail sera élargi à des membres extérieurs aux forces de sécurité : sociologues, universitaires, etc.
En outre, comme le ministre de l’Intérieur l’a déjà précisé lors de son audition, il nous faut simplifier le processus des sommations afin de les rendre plus compréhensibles pour les manifestants.
Par ailleurs, la place de l’autorité civile doit être confortée.
Ensuite, au vu des événements récents, je pense que l’intensification des échanges avec les organisateurs de manifestations est nécessaire. Cette concertation pourrait même être rendue obligatoire.
Enfin, la formation de l’ensemble de la chaîne décisionnelle et hiérarchique doit être professionnalisée. À cette fin, la mise en œuvre du rapport Lambert portant sur la formation du corps préfectoral au maintien de l’ordre ainsi qu’à l’animation et à la coordination du renseignement, est souhaitable.
M. Pascal Popelin, rapporteur. Je tiens compte dans mes questions de l’état d’avancement de nos travaux et de la spécificité de votre position que vous avez rappelée en préambule.
Vous avez évoqué l’emploi coordonné de CRS et de personnes en civil dans les manifestations. Cette pratique correspond-elle à une nouvelle doctrine ? Des consignes ont-elles été données pour la développer ? Les interpellations au cœur des manifestations ne sont-elles pas de nature à gêner le bon déroulement des opérations de maintien de l’ordre dont l’objectif est de canaliser les foules ?
S’agissant de la neutralisation des fauteurs de troubles qui viennent parfois perturber des manifestations pacifiques aux motifs légitimes, les exigences du maintien de l’ordre peuvent-elles constituer un obstacle à la bonne application des règles de procédure pénale, qu’il s’agisse de l’administration de la preuve ou du respect des droits des personnes incriminées ? Quels progrès ont été accomplis en matière d’imputation des faits, de délais de présentation et de qualité des actes de procédure ? Que peut-on encore améliorer ?
Le rôle essentiel du renseignement pour le bon déroulement des manifestations a été souligné à maintes reprises lors des auditions. Faut-il renforcer le renseignement territorial ? Le ministre de l’Intérieur a annoncé son intention de corriger l’affaiblissement de ce dernier consécutif à la suppression des Renseignements généraux et à la création de la DCRI, qui a vécu depuis. Comment peut-on mobiliser un service de renseignement territorial qui serait redéployé ?
Que pensez-vous de l’idée, sur laquelle les avis sont partagés, consistant à appliquer aux manifestations sur la voie publique le modèle, qui a démontré son efficacité, des manifestations sportives, à savoir l’interdiction administrative ? En matière sportive, l’interdiction de stade est relativement simple à faire respecter. Si l’interdiction de manifester, qui serait strictement encadrée car elle est restrictive des libertés individuelles, vous semble souhaitable, comment peut-on la faire respecter ? Rien ne serait pire qu’une règle inapplicable.
M. Jean-Marc Falcone. La pratique que vous évoquez est de plus en plus répandue dans les manifestations susceptibles de dégénérer ou d’entraîner des troubles graves à l’ordre public. Ce dispositif conjugue la présence de forces de l’ordre en tenue dont la mission première est le maintien et le rétablissement de l’ordre public avec l’intervention d’unités, souvent en civil, dont la mission consiste à interpeller d’éventuels fauteurs de troubles ou casseurs.
Ce dispositif existe certainement à Paris mais il est aussi mis en place en province, à Toulouse ou à Nantes par exemple. Les unités en civil sont déployées en marge des manifestations afin de procéder éventuellement à des interpellations. À la différence des forces de l’ordre qui sont lourdement équipées pour se protéger, ces unités disposent de la mobilité et de l’expérience requises pour interpeller les auteurs d’infractions.
Quant aux moyens de preuve, le recours à la vidéo est de plus en plus fréquent, les images provenant des caméras sur la voie publique mais aussi de matériels spécifiques dont sont dotées les forces de l’ordre. La vidéo est utile pour établir les éléments constitutifs de l’infraction.
En matière d’interpellation, j’encourage les préfets et les DDSP à travailler en amont avec le procureur de la République. Un substitut du procureur est souvent présent dans le poste de commandement opérationnel lors des manifestations sportives pour prendre les dispositions juridiques nécessaires et donner des instructions aux forces de l’ordre. Cette présence conforte la sécurité juridique des procédures.
Nous faisons appel pour les interpellations, aux côtés de forces de maintien de l’ordre, aux brigades anti-criminalité mais aussi aux unités de police judiciaire car l’intervention d’officiers de police judiciaire permet de constater l’infraction par procès-verbal.
La réforme du renseignement a donné lieu à la dissolution de la direction centrale des renseignements généraux, qui comptait alors 3 300 agents, et à la création de la direction centrale du renseignement intérieur et du service d’information générale qui avait vocation à assurer en partie les missions exercées par les renseignements généraux. Mais, avec 1 000 fonctionnaires seulement pour ce service, la capacité d’analyse et de renseignement a été perdue.
Depuis, la création en milieu d’année dernière du SCRT a permis la montée en puissance du renseignement territorial : 2 200 agents y travaillent, auxquels s’ajouteront les 350 postes annoncés par le Gouvernement, qui sont bienvenus. Ces effectifs seront répartis sur l’ensemble du territoire pour assurer un renseignement de proximité. Des sections zonales ont été créées, réunissant 25 à 30 fonctionnaires qui peuvent être affectés à la surveillance de manifestations à risques.
S’agissant de l’interdiction administrative, il est facile d’interdire l’accès à un stade : les personnes concernées sont connues des services de sécurité et ont souvent l’obligation de pointer au commissariat ou à la gendarmerie lors des matchs.
Pour les manifestations, je ne conteste pas la pertinence de ce dispositif. Mais il me semble bien plus compliqué à mettre en œuvre sauf à imposer aux personnes d’aller pointer au moment de la manifestation. Cette solution serait une réponse pragmatique à votre interrogation.
M. Pascal Popelin. Mais une fois qu’ils ont pointé, ils sont libres de repartir…
M. Jean-Marc Falcone. C’est la limite de l’exercice. La durée d’un match est restreinte et une fois les portes fermées, il n’est plus possible d’y assister. Pour une manifestation qui peut durer une demi-journée et se déroule sur la voie publique, la mesure est plus difficile à faire respecter, je vous le concède.
M. Guillaume Larrivé. S’agissant du régime d’emploi des armes, existe-t-il aujourd’hui des différences légitimes entre les fonctionnaires de la police nationale et ceux de la gendarmerie ?
Quelles sont vos propositions pour faire évoluer les protocoles de sommation ?
Le ministre de l’Intérieur souhaite une plus grande implication de l’autorité civile. Une mission relative à la formation du corps préfectoral, dont on connaît la diversité, a été confiée au préfet Christian Lambert. Pensez-vous qu’il appartient au préfet de gérer la manœuvre sur le terrain ? Je ne suis pas sûr que les conseillers d’État, qui peuvent être amenés à occuper des fonctions de préfet, soient formés pour gérer une manœuvre opérationnelle, quelles que soient leurs qualités par ailleurs. La fonction d’autorité civile ne devrait-elle pas dans ce cas être exercée par le DDSP ?
M. Olivier Marleix. Chacun s’accorde sur la nécessité de responsabiliser les organisateurs des manifestations. Lors de son audition, le préfet Boucault a regretté l’absence dans les textes d’obligation de négociation avec les organisateurs. Doit-on instaurer une concertation préalable obligatoire ? Quel devrait en être le contenu ? Faut-il prévoir une sanction en cas de non-respect qui pourrait aller jusqu’à l’interdiction de la manifestation mais pourrait aussi prendre la forme d’amendes infligées lors du déroulement de celle-ci, comme cela existe pour les manifestations sportives ?
Je partage l’inquiétude de M. Larrivé sur le rôle opérationnel confié à l’autorité civile. Celle-ci prend la responsabilité d’autoriser une manifestation, elle est la garante de la concertation. Son implication est donc déjà importante. En revanche, je fais plus confiance à un commandant de groupement de gendarmerie ou à un DDSP pour les missions opérationnelles. L’intervention du préfet me paraît de nature à introduire une ambiguïté dans la chaîne opérationnelle.
M. Guy Delcourt. On entend s’exprimer, pour la gendarmerie, les officiers supérieurs voire le directeur général, pour la justice, le procureur. En revanche, sur les événements faisant intervenir la police, ce sont les organisations syndicales qui prennent la parole…J’en suis toujours étonné.
Mme Marie-George Buffet. L’idée d’une interdiction administrative de manifester est avancée de manière récurrente dans nos auditions. Pourtant, j’ai quelques doutes sur sa faisabilité. Même si la personne visée est obligée de se présenter au commissariat, rien ne l’empêche de participer à la fin de la manifestation dont on sait qu’elle est le moment le plus délicat.
La question des relations entre l’autorité civile et les forces de maintien de l’ordre est abordée dans chacune de nos auditions. J’y vois le signe d’un problème à résoudre. La réponse se trouve-t-elle dans la présence de l’autorité civile sur le terrain ou dans un travail plus efficace sur les consignes ? Même formés au maintien de l’ordre, les préfets n’ont pas vocation à jouer le rôle des responsables opérationnels dont c’est le métier.
Il est envisagé de compléter le régime déclaratoire par une obligation de concertation. Mais dès lors que des organisateurs sont identifiés – manifestations sociales, démocratiques –, la concertation est déjà une réalité. L’obligation viserait d’autres organisateurs plus dissous, moins contrôlables, avec le risque que ceux-ci refusent de se prêter à la concertation et que la manifestation soit finalement interdite. Mesure-t-on toutes les conséquences de cette évolution ?
Enfin, on parle beaucoup des nouvelles formes de contestation très violentes. Dans les zones non urbaines, on comprend à qui renvoie cette expression mais dans les zones urbaines, qui sont ces groupes contestataires ?
M. Jean-Marc Falcone. Le régime d’emploi des armes est identique pour les forces de maintien de l’ordre, qu’elles soient issues de la police ou de la gendarmerie. Depuis l’interdiction des grenades offensives par le ministre de l’Intérieur, les deux forces disposent des mêmes armes, la doctrine et les méthodes étant déjà unifiées.
En matière de sommation, certaines personnes sont des habituées des manifestations, elles sont en quelque sorte formées en cas de dérapage et comprennent le jeu des sommations. Mais d’autres personnes – nous l’avons constaté à l’occasion des manifestations contre le mariage pour tous, par exemple – n’ont pas cette expérience : elles ignorent les règles en la matière et ne sont pas réceptives aux instructions données par l’officier de police judiciaire. Or, le non-respect d’une sommation est constitutif d’une infraction pénale qui peut justifier une intervention des forces de l’ordre.
À partir des retours d’expérience et des audits commandés par le ministre de l’Intérieur aux inspections générales des deux forces, nous réfléchissons à la meilleure manière de faire des sommations afin de lever tout doute sur leur signification dans l’esprit des manifestants. Rien n’est décidé pour le moment. Les sommations pouvaient jusqu’à présent être doublées de fusées mais l’usage s’est perdu. On évoque désormais des ballons ou d’autres signes susceptibles d’attirer l’attention des manifestants.
Sur le rôle de l’autorité civile, soyons précis. Selon moi, il appartient à l’autorité civile – préfet ou personne mandatée par lui – de décider à quel moment il peut être fait usage de la force. Le maintien de l’ordre n’est pas son métier. Toutefois, le rapport Lambert doit être mis en œuvre car les nombreux membres du corps préfectoral qui sont appelés à faire de l’intérim du préfet doivent connaître la chaîne hiérarchique de l’ordre public et les moyens à disposition. L’autorité civile apprécie l’opportunité de l’usage de la force. Lorsqu’elle décide le recours à la force, il lui appartient ensuite d’y mettre fin et d’en donner l’ordre au commandant. L’autorité fixe un objectif au commandement de la force publique à qui revient le choix des moyens à employer pour l’atteindre. Celui-ci peut dans ce cadre solliciter l’autorisation d’utiliser des grenades lacrymogènes instantanées qui nécessite une quatrième sommation. L’autorité civile se prononce alors au vu d’éléments objectifs et d’une analyse politique de la situation.
Les rôles sont bien établis. Le préfet n’a pas vocation à commander les forces publiques. C’est un métier d’assurer l’ordre public et d’engager des hommes qui ont l’habitude de travailler en unités constituées et qui reconnaissent leur chef et le suivent. Les rôles de chacun doivent être délimités. Il faut insister sur ce point lors de la formation des membres du corps préfectoral.
Mon expérience de préfet territorial m’a appris que les défilés du 1er mai ne sont pas un sujet. Les participants ont l’habitude de manifester ; les discussions se limitent à l’itinéraire.
En revanche, certaines personnes ne demandent aucune autorisation pour se rassembler spontanément. Malgré la bonne volonté des services de renseignement, nous pouvons être pris au dépourvu. La concertation est dans ce cas difficile.
Nous avons également affaire à des organisateurs qui viennent nous voir en craignant des perturbations ou des contre-manifestations. La mission du préfet consiste alors à convoquer les personnes, à mettre en garde contre les perturbations et à recommander la mise en place d’un dispositif de service d’ordre. Il m’est arrivé de proposer de désigner des correspondants dans les abords des manifestations pour que les organisateurs puissent signaler des problèmes. C’est ainsi que je conçois la concertation.
Dans les zones urbaines, les groupes sont composés de perturbateurs aux origines diverses : des extrémistes, des voyous.
Vous avez raison, monsieur Delcourt, dans la police nationale, les syndicats s’expriment beaucoup. Il y a une raison à cela : pendant longtemps, ils ont été les seuls à répondre aux médias. Ce phénomène n’est pas nouveau mais il a pris de l’ampleur. Je m’évertue à demander aux directeurs des services de police au niveau territorial de s’exprimer. J’encourage également le porte-parole du ministère de l’Intérieur à intervenir davantage. Je me félicite des progrès en ce sens. J’ai noté comme vous le manque d’expression de l’institution lors des récentes manifestations à Nantes et Toulouse ayant pourtant donné lieu à d’importants troubles à l’ordre public.
J’ai souhaité lors des grosses manifestations en province la présence d’un état-major qui apporte son expertise pour mieux gérer la manifestation sans toutefois se substituer aux responsables sur place. J’ai également sollicité la présence de personnels du service de communication de la direction générale de la police nationale pour faire entendre une voix institutionnelle.
Ce relatif silence des autorités policières n’est pas propre aux manifestations, il s’observe aussi pour les faits divers. J’essaie d’encourager les patrons de la police à prendre la parole mais ils sont très prudents dans leur expression afin de ne pas gêner l’autorité judiciaire. Je leur recommande de s’en tenir aux faits sans entrer dans le détail de la procédure judiciaire.
M. Gwenegan Bui. À la différence de la gendarmerie, les CRS ne disposent pas d’un centre de formation unique. Comment dans ces conditions vous assurez-vous de l’uniformisation des opérations de maintien et de la doctrine ainsi que de l’homogénéité entre les compagnies ?
Quel est le nombre de jours d’emploi annuel pour les CRS ? Quelle est la durée moyenne d’une intervention ? Comment s’opèrent les relèves ? Comment est déterminée la fin d’une mission pour une compagnie ?
M. Philippe Folliot. Votre expérience de préfet vous donne un double éclairage intéressant sur les questions de maintien de l’ordre.
De nombreuses personnes s’interrogent sur l’opportunité de territorialiser les forces de maintien de l’ordre, en particulier les CRS. Cette solution présente l’avantage de faciliter une meilleure connaissance du terrain mais aussi l’inconvénient de limiter la mobilité au gré des besoins. En outre, la frontière entre les missions relevant de l’ordre public, d’une part, et de la sécurité publique, d’autre part, semble un peu floue. Compte tenu de ces éléments, la territorialisation vous semble-t-elle une bonne idée ?
M. Hugues Fourage. Vous avez esquissé une typologie des manifestations. Dans quels cas la concertation préalable obligatoire s’imposerait-elle ? Quelles conséquences seraient attachées à l’échec de la concertation ? Peut-on imaginer une interdiction de la manifestation ?
Peut-on envisager des unités de maintien de l’ordre communes aux deux forces de sécurité marquant l’aboutissement de la mutualisation ?
M. Meyer Habib. Êtes-vous favorable à une systématisation de l’enregistrement vidéo des manifestations ? Nous sommes très en retard, par rapport à l’Angleterre, dans l’équipement en caméras sur la voie publique.
Quel est le protocole pour les interpellations à l’occasion des manifestations ? Ont-elles lieu pendant le déroulement de la manifestation ou à l’issue de celle-ci, une fois les individus repérés ?
M. Philippe Goujon. La gestion du maintien de l’ordre en France a longtemps été, et demeure, un modèle pour de nombreux pays. Les évolutions qu’il a connues sont-elles suffisamment abouties ? Que reste-t-il à faire pour s’adapter aux nouvelles formes de manifestation, des casseurs aux zadistes ?
Si on enlève aux forces de l’ordre les moyens de tenir à distance les manifestants, principe au cœur de la doctrine française du maintien de l’ordre, celles-ci ne risquent-elles pas de se trouver démunies face à des manifestants aujourd’hui très violents ? Les conditions d’emploi des grenades lacrymogènes instantanées sont réduites, les grenades offensives sont interdites, les policiers voltigeurs motocyclistes et les camions à eau ont été supprimés sans que rien ne vienne les remplacer.
Le régime de travail des CRS, différent de celui des EGM, est-il toujours adapté aujourd’hui ?
Pouvez-vous préciser la répartition des missions de la police entre maintien de l’ordre, sécurité publique, présence dans les ZSP et garde statique qui obère le potentiel d’emploi pour le maintien de l’ordre ?
Le centre de formation de Saint-Astier est-il ouvert aux CRS ?
M. Daniel Vaillant. La liberté de manifester est préservée en France, c’est heureux ; le maintien de l’ordre est quant à lui assuré malgré l’évolution des formes des manifestations.
La première n’est pas discutable mais elle doit être encadrée pour être bien exercée. Le second doit s’inscrire dans un cadre réglementaire. La commission d’enquête comme le ministère de l’Intérieur travaillent à cette évolution. Le ministre a pris les décisions qui s’imposaient en la matière après le drame de Sivens.
Je ne reviens pas sur l’expression médiatique de la police nationale. Les choses évoluent puisque le ministère de l’Intérieur est désormais doté d’un porte-parole. Il manque encore sans doute des relais territoriaux. La langue de bois est parfois préférable à la compétition syndicale.
Une réflexion devrait être conduite sur l’évolution des manifestations qui permettrait d’anticiper davantage. À cet égard, le régime déclaratif est une avancée. Il a porté ses fruits car il a permis de responsabiliser les organisateurs. Nous serions bien inspirés d’aller plus loin en instituant une concertation plus méthodique qui permettrait aussi de repérer des éléments perturbateurs.
L’autorité civile prend la décision de recourir à la force mais elle ne doit perturber en rien le commandement sur le terrain. Informée de la situation, elle n’a pas à se substituer aux professionnels. Lorsque certains ont tenté de le faire par le passé, les résultats ont été calamiteux. Ce n’est pas le travail des préfets même s’il est nécessaire de les former à ces situations.
Quelle est aujourd’hui la capacité à exécuter les décisions des autorités juridictionnelles sur l’occupation d’un site ? Que faut-il faire pour éviter l’affrontement ?
Mme Marie-George Buffet. Il faut se garder de toute caricature : il n’y a pas d’un côté les manifestants du 1er mai et de l’autre les manifestations à risques. Certaines manifestations peuvent dégénérer de manière imprévue – je pense à celles liées à des conflits sociaux. D’autres peuvent correspondre à des mouvements spontanés, de la part de lycéens par exemple. La concertation préalable ne peut pas s’appliquer uniformément. Les choses sont plus complexes.
M. Jean-Marc Falcone. La territorialisation des CRS est une question récurrente. Il existe 60 unités de CRS et 108 EGM. En principe, chaque préfet de zone peut compter sur un certain nombre d’unités. Mais, dans les faits, les six préfets de zone sont privés d’unités à leur main car ces derniers sont absorbés par des missions gérées par la direction générale de la police nationale (DGPN) afin de répondre aux besoins des préfets en matière d’ordre public.
La volonté de « fidéliser » les unités sur le territoire est louable. Mais, en l’état, il n’est pas possible de renoncer à la mobilité des unités, impérative au regard des besoins quotidiens. Pour pallier ce défaut de fidélisation, des sections départementales d’intervention implantées dans de grandes agglomérations bénéficient, dans le cadre des effectifs de sécurité publique, d’unités spécialisées pour assurer le maintien de l’ordre. La gestion au quotidien, « à la dentelle » disons-nous, des forces de l’ordre ne permet pas de fidéliser les unités. Toutefois, celles-ci peuvent être envoyées pour une période déterminée faire de la sécurisation en renfort de la sécurité publique en cas de pic de délinquance dans un territoire. Il est très difficile de maintenir ces forces sur un territoire.
On gagne toujours, lorsque cela est possible, à mener une concertation en amont avec les organisateurs, quoique ce terme ne soit pas vraiment adapté à une manifestation spontanée montée grâce à une chaîne de SMS. Mon expérience me fait dire qu’il y a toujours un intérêt à une discussion, ne serait-ce que pour appeler l’attention. La discussion peut ne pas aboutir mais l’emploi de la force se justifie plus aisément lorsque toutes les voies du dialogue ont été explorées.
Quant à la mutualisation des forces entre CRS et gendarmerie mobile, les doctrines et le temps de travail sont presque identiques. Les EGM ont encore un statut militaire grâce auquel ils peuvent participer à des opérations extérieures. Si les deux forces étaient réunies, il est probable que le nouveau statut ne le leur permettrait. En matière de répartition sur le territoire, je ne vois pas d’intérêt à une réunion des forces qui serait le prélude à une mutualisation totale entre la police et la gendarmerie, sur laquelle il ne m’appartient pas de me prononcer. Les deux forces s’en sortent bien telles qu’elles sont.
Je suis très allant pour filmer les manifestations. Le ministre nous a donné des instructions très claires sur ce point. Je rappelle que certains CRS sont équipés de leur propre dispositif vidéo et que les unités peuvent compter en leur sein des fonctionnaires vidéastes. Les images filmées présentent un triple intérêt : pour le bon déroulement de la manifestation, pour la justice et pour la protection des fonctionnaires – elles permettent d’établir la vérité en cas d’accusation de violences.
Monsieur Goujon, je n’ai aucun doute, les forces de l’ordre en France, avec les moyens et la formation – initiale et continue – dont elles disposent ainsi que l’adaptation permanente de la doctrine, sont armées pour intervenir et garantir l’ordre public.
Vous faites référence aux voltigeurs. Ces unités ont été dissoutes après le drame que vous connaissez. Elles n’ont pas été reconstituées car elles ne correspondaient plus à la doctrine du maintien de l’ordre. Celle-ci repose sur le maintien à distance des manifestants. Nous disposons des outils nécessaires – grenades qui peuvent être lancées à longue distance ou lanceurs d’eau. Il faut éviter le corps à corps. Cette doctrine appliquée dans d’autres pays est très dangereuse. Nous obtenons de très bons résultats avec notre méthode.
Quant à l’exécution des décisions de justice, la décision appartient à l’autorité politique. Les obstacles ne sont pas techniques ou matériels. On peut réussir à déloger les occupants de Notre-Dame-des-Landes ou de Sivens en y affectant les effectifs nécessaires pendant le temps nécessaire. La difficulté tient à l’équilibre qu’il faut trouver entre les troubles à l’ordre public que l’on souhaite faire cesser et les résultats de l’intervention pour atteindre cet objectif. Je crois que c’est précisément l’objet des travaux de votre commission.
M. Philippe Klayman, préfet, directeur central des compagnies républicaines de sécurité. La garantie d’une formation initiale de qualité pour tous les grades, après la formation généraliste reçue en école de police, figure parmi nos préoccupations majeures. Dans le même esprit, nous consentons des efforts très importants en faveur de la formation continue.
Chaque année, les unités mobiles mais aussi les compagnies autoroutières et les formations motocyclistes sont astreintes à un minimum de périodes de formation, individuelle et collective. Chaque compagnie de CRS doit ainsi accomplir trois semaines de formation dans l’année auxquelles s’ajoutent dix jours d’entraînement au tir et au maniement des équipements.
Sans méconnaître les qualités du centre de Saint-Astier, nous avons la prétention de penser que nous disposons des infrastructures nécessaires. Quatre centres sont répartis à Lyon, Rennes, Dijon et Toulouse ; les deux premiers sont dédiés à l’ordre public, le troisième, à l’entraînement au tir et le quatrième à la gestion administrative et financière des unités. Nous utilisons également des infrastructures mises à notre disposition de façon ponctuelle, telles que d’anciens sites militaires désaffectés, qui sont très propices à certaines formations en raison des nuisances limitées pour l’environnement, notamment en cas d’entraînement au lancer de grenades lacrymogènes.
Le temps de travail des CRS diffère selon qu’elles remplissent des missions de garde statique ou de sécurisation ou des missions de maintien de l’ordre. Dans le premier cas, la vacation est de 8 heures, du cantonnement au retour au cantonnement, soit une vacation sur le terrain de six heures. Dans le second cas, nécessité fait loi, le temps de travail n’est pas limité. Les dépassements des huit heures sont défrayés en heures supplémentaires. Lors des opérations de maintien de l’ordre en juillet dernier, une compagnie a passé 22 heures sur le terrain. Lorsque les événements se prolongent dans le temps, les forces sont gérées en coordination entre mon service et la DGPN.
M. le président Noël Mamère. Je vous remercie, messieurs.
*
* *
Audition, ouverte à la presse, de M. Pierre TARTAKOWSKY, président
de la Ligue des droits de l’Homme
Compte rendu de l’audition du jeudi 19 février 2015
M. le président Noël Mamère. J’ai le plaisir d’accueillir M. Pierre Tartakowsky, président de la Ligue des droits de l’Homme.
Avant vous donner la parole, monsieur Tartakowsky, je vous demande, conformément aux dispositions de l’article 6 de l’ordonnance du 17 novembre 1958 qui régit le fonctionnement des commissions d’enquête, de prêter le serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité.
(M. Pierre Tartakowsky prête serment.)
M. le président Noël Mamère. Merci, monsieur le président, d’avoir répondu à notre invitation dans le cadre de cette commission d’enquête parlementaire constituée par l’Assemblée nationale à la suite des événements de Sivens.
Je vous précise que, une information judiciaire ayant été ouverte à la suite de ces événements, notre commission d’enquête n’a pas la possibilité de s’intéresser au volet judiciaire de l’affaire de Sivens. Elle a pour objet d’étudier comment améliorer le maintien de l’ordre dans notre pays et de vérifier que la doctrine française, qui vise à contenir et à résister plutôt qu’à aller à l’affrontement, est bien respectée. Nous aimerions savoir comment la Ligue des droits de l’Homme – à l’opinion de laquelle nous attachons beaucoup d’importance – analyse la question du maintien de l’ordre dans notre pays, ses éventuelles dérives, et quelles propositions vous pourriez être amené à nous faire.
M. Pierre Tartakowsky. Monsieur le président, merci de votre invitation. Je me réjouis qu’une information judiciaire ait été ouverte après les événements tragiques de Sivens, et je pense que nous avons effectivement besoin de mener une réflexion générale, républicaine, sur les questions liées au maintien de l’ordre.
Il convient de réaffirmer que le droit de réunion est un droit fondamental, consubstantiel à la démocratie, et de veiller à ce que le maintien de l’ordre reste compatible avec les valeurs fondamentales de la République. De ce point de vue, il faut reconnaître que la tâche n’est pas toujours facile, dans la mesure où les différentes formes de manifestation ont évolué, pouvant poser des problèmes nouveaux aux forces de l’ordre, notamment en matière de gestion de l’espace et du temps.
Les nouveaux réseaux sociaux ont profondément bouleversé la donne. Certes, il y a toujours des manifestations de type classique, c’est-à-dire négociées avec les pouvoirs publics en amont, avec un rendez-vous précis fixé dans un lieu précis et, de façon implicite, limité dans le temps. Ces formes-là sont aujourd’hui, sinon concurrencées, du moins complétées par des formes plus fragmentées : manifestations décentralisées, qui peuvent avoir un impact extrêmement important sur la vie urbaine, mais aussi, et surtout, manifestations qui défient la légitimité du pouvoir public par l’occupation pérenne de zones, d’où la popularisation du terme de « zone à défendre ». Cette pérennité pose des problèmes nouveaux aux forces de l’ordre, notamment en termes de remplacement des équipes, de stabilité de l’encadrement, d’usure nerveuse et physique des hommes. Dans ces conditions, l’usure est un facteur de risque qu’il convient de limiter. En effet, la montée d’une atmosphère confrontative pousse à des pratiques qui peuvent avoir des conséquences tragiques. C’est ce qu’il s’est passé à Sivens, en tout cas d’après les éléments que nous avons recueillis.
La dernière période a été caractérisée, à nos yeux, par des phénomènes assez inquiétants.
Le premier est la banalisation des relevés d’empreintes génétiques, visant de toute évidence à la constitution d’un vaste fichier. Je rappelle que ce fichier, à l’origine, avait été conçu pour les seuls délinquants sexuels, et que nous avions donné notre accord sous cette réserve et moyennant certaines mises en garde. La suite des événements a montré que nous avions eu raison. La justice se trouve placée dans une situation difficile, puisqu’elle est contrainte, a posteriori, d’arbitrer contre les forces de l’ordre. Il n’empêche que la pratique se répand et qu’elle est très préoccupante.
Le deuxième phénomène, tout aussi préoccupant parce qu’il se développe de manière perverse en dehors du cadre juridique, consiste à empêcher les manifestants de manifester, non pas sur le lieu de la manifestation, mais en amont : en les interceptant sur le chemin, sans raison et sans aucune légitimité juridique. On nous dit souvent, après coup, qu’il s’agissait de contrôler les identités… Or cette notion de contrôle d’identité est extrêmement vague. Cela s’est déjà produit à plusieurs reprises.
Le troisième est le recours excessif à la force, non pas de manière incidente ou accidentelle, mais parce qu’il conviendrait de contrecarrer de façon musclée la manifestation considérée comme un facteur de nuisance. L’élément le plus symbolique de l’usage excessif de la force est la banalisation des flash-balls, qui nous semblent ne pas avoir leur place dans l’arsenal répressif nécessaire et légitime, destiné à contenir, le cas échéant, des manifestants. Ce ne sont pas des armes permettant de faire face à une foule, ni d’empêcher un groupe d’avancer : ce sont des armées destinées à arrêter des individus. Il y a déjà eu, en France, dans un laps de temps restreint, assez d’accidents relativement graves pour que nous insistions sur l’idée que les flash-balls devraient être retirés de l’équipement des forces de maintien de l’ordre. Il en va de même des balles en caoutchouc, dont l’impact peut être extrêmement délétère. Ces armes sont adaptées à un affrontement individuel, bien plus qu’au maintien de l’ordre classique. Je rappelle au passage que le Défenseur des droits avait demandé qu’elles soient interdites, ou du moins contrôlées de façon plus stricte.
Cela m’amène à vous faire part de deux dernières sources de préoccupation.
La première porte sur l’encadrement. Il me semble que la qualité de la formation de l’encadrement a baissé ces dernières années. Sans doute est-ce consécutif à certaines réformes qui ont « frappé » le ministère de l’Intérieur. Il me semble qu’il y a là un champ de réflexion à ouvrir afin d’engager des réformes puissantes et structurantes.
La seconde source de préoccupation porte sur la responsabilité des forces de l’ordre. Nous ne pouvons pas partir du principe que les forces de l'ordre ont toujours tort, mais nous ne partons pas du principe qu’elles ont toujours raison. Nous constatons que les enquêtes sur les plaintes contre des agents de police ou des tenants de l’autorité sont rarement complètes, souvent inefficaces et très souvent partiales ; la plupart du temps, d’ailleurs, on n’en ouvre pas. À ce jour, à ma connaissance, aucun policier ayant blessé par balle un ou des manifestants n’a vu sa responsabilité pénale engagée à la suite des accusations portées contre lui. Enfin, les poursuites engagées contre des policiers ayant eu recours à une force excessive envers des manifestants sont extrêmement rares au regard des incidents qui se produisent.
Tel est le tableau de nos préoccupations. Je n’insiste pas sur le fait que la mort de Rémi Fraisse n’a fait que confirmer nos inquiétudes. Nous avons diligenté des enquêtes de terrain qui sont toujours en cours. Elles confirment très largement ce que je viens de vous livrer.
M. Pascal Popelin, rapporteur. Monsieur Tartakowsky, vous nous avez d’abord parlé de l’évolution des formes de manifestation. Considérez-vous également qu’il y ait une évolution dans l’attitude de certains manifestants, qu’il s’agisse du degré d’organisation de ceux-ci ou de leurs pratiques, lesquelles peuvent déroger aux règles régissant traditionnellement les manifestations ? Je pense notamment aux phénomènes de violence.
Parallèlement, quel est votre point de vue sur l’attitude des forces de l’ordre et sur la réponse opérationnelle apportée pour maintenir l’ordre ? Je vise plus particulièrement les nouveaux équipements en dotation.
Vous avez évoqué les flash-balls, et je partage votre point de vue sur la nature de cet équipement, davantage destiné au face à face – et encore, pas trop près… C’est d’ailleurs la raison pour laquelle il n’est pas en dotation dans les unités de maintien de l’ordre – CRS et gendarmerie mobile. Reste qu’il est à disposition d’unités qui, sans être spécialisées dans le maintien de l’ordre, peuvent être amenées à exercer des tâches de maintien de l’ordre. À ce propos, je veux souligner que, dans son rapport 2014, le Défenseur des droits indique que l’usage du flash-ball est en constant déclin dans la police nationale. J’ajoute pour ma part qu’un tel usage est bien plus marginal dans la gendarmerie.
D’un point de vue général, considérez-vous que l’attitude et l’action des forces de maintien de l’ordre se sont plutôt pacifiées au cours des vingt dernières années ? Que pensez-vous de l’emploi qui est fait de la vidéo ? Celle-ci permet de faire la part des choses entre des versions qui ne sont pas toujours concordantes. Il peut s’agir d’une vidéo spécifique mise en place pour une manifestation, ou de dispositifs de protection de voie publique. Lors de son audition du 3 février dernier, le ministre de l’Intérieur nous a fait part de son intention de généraliser l’usage de la vidéo pour les manifestations d’importance. Mais, deux jours plus tard, le préfet de police nous a indiqué qu’à Paris, un tel usage était quasi systématique.
Dans l’absolu, comment jugez-vous, par rapport à des pays comparables, le modèle français de conciliation entre la nécessité du maintien de l’ordre et celle du respect des libertés publiques, ainsi que la doctrine française qui privilégie le maintien à distance des manifestants plutôt que le contact et l’affrontement ?
M. Pierre Tartakowsky. Peut-on parler d’une évolution de l’attitude de certains manifestants, notamment au regard de la violence ? Oui, bien évidemment. Néanmoins, il convient de distinguer deux types de phénomènes.
Le premier participe d’une évolution beaucoup plus globale, propre aux sociétés occidentales, et que l’on pourrait qualifier d’écroulement du principe d’autorité. Cet écroulement s’observe dans les crises – économiques, sociales, morales – qui balaient notre monde, et touche tous les acteurs, à commencer par celui qui se réclame d’une violence légitime. Le phénomène, qui est extrêmement important, n’est pas surprenant. En en parlant et en l’analysant, on se donne les moyens – et on donne à l’État les moyens – de travailler à sa relégitimation. L’État n’est certes pas totalement délégitimé, mais on sent bien qu’il est devenu nécessaire de réexpliquer et de « réenraciner » un certain nombre d’idées sur ce qu’est la République et sur ce qui fait que tel acte est légitime ou non. Cela doit nous amener à un débat politique au meilleur sens du terme, et je ne crois pas qu’il faille en avoir peur. Ce serait le moyen de redéfinir collectivement l’ordre public social.
L’autre phénomène, plus restreint mais plus spectaculaire, est celui de l’utilisation directe de la violence – violence, et non pas occupation d’espace public – qui surgit au sein de manifestations pacifiques et démocratiques. Elle déplace le sens de ces manifestations sur un autre terrain que celui de la démocratie, à savoir celui de la violence et de la casse. Or il est troublant de constater que dans de telles situations, les forces de l’ordre sont désarçonnées, voire en état de sidération. Je précise que je parle aussi bien en tant que président de la Ligue des droits de l’Homme qu’en tant que citoyen ayant beaucoup manifesté et s’étant trouvé confronté à l’apparition ex nihilo de ces groupes, que ce soit aux États-Unis, en Italie ou en France. On a pu voir des casseurs agir à quelques mètres d’agents de la force publique sans que ces derniers – qui étaient caparaçonnés et ne risquaient donc pas grand-chose en cas de contact direct – semblent s’émouvoir de ce qui se passait. Cela donnait le sentiment que des instructions avaient été données, non pas pour favoriser les casseurs, mais pour préciser que ce n'était pas l’affaire de ces forces de police-là.
Tout cela est effectivement très troublant et nourrit une grande confusion : d’abord quant à la dimension publique de la manifestation, ce qui est nuisible à la République et à la démocratie ; ensuite quant au rôle des forces de l'ordre car, si les forces de l’ordre n’assurent pas l’ordre lorsque celui-ci est manifestement agressé, à quoi servent-elles ?
Pour revenir à votre question, il y a eu une évolution indéniable, qui s’est sans doute jouée au cours des trente dernières années. Cela étant, on a connu, dans d’autres périodes historiques, d’autres manifestations extrêmement violentes. Je rappelle que c’est lorsque l’on a cessé de faire assurer l’ordre par l’armée que le nombre de morts a baissé dans les manifestations.
Quelles sont les réponses opérationnelles ? Je pense que la première et la plus importante, pour le Gouvernement comme pour l’État, consiste à ne pas perdre le contact avec la société vivante, et donc à savoir, en amont des manifestations, avec quels interlocuteurs nouer le dialogue. Une fois que la manifestation a commencé, s’il n’y a pas eu d’échange en amont, tout risque de se compliquer. En même temps, ne soyons pas naïfs : il y a un certain nombre d’acteurs avec lesquels il est difficile de nouer le contact et d’avoir un débat politique. Mais, selon moi, c’est un défi posé à la démocratie, bien plus qu’une question strictement technique de réaction des forces de l’ordre.
Je vais botter en touche : je ne pense pas que ce soit au président de la Ligue des droits de l’Homme de donner des conseils techniques à la police... Pour autant, et pour vous faire sourire, je dirai que « j’ai confiance dans la police de mon pays ». Je suis persuadé qu’aux phénomènes nouveaux qui peuvent se produire au sein des manifestations – comme la stratégie qui consiste à se fondre dans la masse – la police saura apporter des réponses adaptées et, surtout, proportionnées – terme que je n’ai pas utilisé jusqu’à maintenant, mais qui me semble extrêmement important.
Cela dit, si l’usage du flash-ball et les problèmes qu’il crée sont en déclin, supprimons-le. Si son usage est en déclin, cela signifie que l’on peut parfaitement assurer l’ordre sans lui, en évitant de faire courir aux forces de police le risque d’être des forces meurtrières.
Les forces de l’ordre se sont-elles pacifiées ces dernières années ? Je pense que, depuis maintenant très longtemps en France, la philosophie qui consiste à tenir les manifestants à distance et à ne pas pratiquer le corps à corps est une bonne philosophie et une bonne stratégie, qui a permis de contenir des situations très tendues. De ce point de vue, l’usage des grenades lacrymogènes ou des grenades assourdissantes n’a rien de choquant « dans des conditions réglementaires ». J’insiste sur cette dernière précision parce que, dans le cas de Rémi Fraisse, les conditions précises de l’affrontement – quasi individuel – ont fait que l’usage de cette grenade était inadapté.
Que dire de l’emploi de la vidéo ? Il y a une double réponse à cette question. Techniquement parlant, l’usage de la vidéo renvoie à une sorte d’objectivation et à un usage neutre de la technique qui permet de dire : s il y a des casseurs, on les reconnaîtra. Il faut d’ailleurs bien reconnaître que l’usage proportionné de la vidéo peut être très positif. On l’a vu pour le maintien de l’ordre dans les stades de foot : identifier un certain nombre d’individus parmi les plus agressifs et les plus entraînants n’a rien de scandaleux, et je pense que cela relève du travail de bonne police. Mais la systématisation de l’emploi de la vidéo pour les manifestations pose un problème autre que technique : elle renforce le sentiment des pouvoirs publics que la manifestation est avant tout un risque, une nuisance, une « casserole sur le feu » qui risque de déborder à tout moment. On finit par généraliser la vidéo pour assurer une surveillance globale, et c’est là qu’il y a, à notre sens, disproportion.
Le fait que des manifestants, dans un certain nombre de cas, soient filmés pour authentifier des situations est tout à fait acceptable. En revanche, l’idée que, dès lors que les citoyens, individuellement ou collectivement, descendent dans la rue, ils seront filmés et que ces films attesteront de leur bonne conduite, me semble totalement disproportionnée, et lourde d’effets délétères sur le comportement des uns et des autres et sur le type de société que l’on veut construire. On risque d’alimenter ainsi ce que les sociologues appellent une « société de défiance ». Et, dans les sociétés de défiance, le rôle des forces de police se durcit irrésistiblement.
M. le président Noël Mamère. Avant de passer la parole aux membres de la commission, je voudrais revenir sur deux aspects.
D’une part, j’ai lu avec attention l’article que vous avez écrit dans le numéro de décembre 2014, après les événements de Sivens, de votre revue Hommes et Libertés, sur l’usage proportionné de la force. Êtes-vous de ceux qui considèrent que la présence des autorités civiles lors des manifestations est absolument indispensable, ne serait-ce que pour assumer la responsabilité de l’État dans le maintien de l’ordre ?
D’autre part, vous avez évoqué l’enquête que la Ligue des droits de l’Homme a menée elle-même sur le terrain. Cela me conduit à évoquer un phénomène que vous avez constaté, et dont nous entendons parler d’audition en audition : l’évolution de la durée des manifestations. Les gardes mobiles étaient habitués à circonscrire des manifestations dans un laps de temps très bref, mais celles-ci peuvent maintenant s’étaler sur trois mois, six mois, un an, deux ans, ce qui pose effectivement des problèmes. On voit bien que les forces de l’ordre n’y sont pas préparées.
Mme Marie-George Buffet. Monsieur le président, vous avez abordé la question de la qualité de la formation des encadrants. Y a-t-il un problème de formation ? Y a-t-il un problème au niveau du renseignement ? Y a-t-il un problème au niveau des directives données par les autorités civiles au cours des manifestations ? Je pense que c’est plutôt cela : les directives peuvent manquer de précision ou être disproportionnées par rapport à la situation.
Comme vous, je considère qu’il faut relativiser l’idée selon laquelle il y aurait une « nouvelle violence » dans les manifestations. Aujourd’hui, la durée des manifestations n’est plus la même, et celles qui ont lieu dans les zones rurales différent de celles qui ont lieu dans les zones urbaines. Mais on a déjà eu à déplorer, dans les décennies précédentes, des interventions violentes à l’intérieur des manifestations, qui étaient le fait d’acteurs extérieurs.
Face à ces nouveaux phénomènes, les personnes que nous avons auditionnées, qu’elles appartiennent au ministère de l’Intérieur, aux directions de la gendarmerie mobile ou des CRS, ont développé deux idées : premièrement, l’obligation d’une concertation avant toute manifestation ; deuxièmement, la généralisation de ce qui se pratique déjà dans les stades, sous forme d’une interdiction individuelle de manifester. J’aurais aimé connaître votre réaction par rapport à ces propositions.
M. Guy Delcourt. Monsieur Tartakowsky, lorsque vous employez le terme de « police », je suppose que vous englobez toutes les forces de police : police urbaine, CRS, gendarmerie, police spécialisée, RAID, GIGN ?
Ensuite, il est clair que des groupuscules viennent se satelliser dans les manifestations, pour provoquer des affrontements physiques, voire davantage. L’emploi de cocktails Molotov, ou même de bouteilles d’acide, comme l’a confirmé le général Favier, directeur général de la gendarmerie nationale, n’est-il pas de nature à influer sur le degré de violence des forces de police ?
Enfin, pensez-vous qu’il faudrait réfléchir à la création de sections spéciales de maintien de l’ordre uniquement affectées à ce type de mission ?
M. le président Noël Mamère. Mon cher collègue, je tiens à préciser que je n’ai pas entendu la même chose que vous. Selon moi, le général Favier n’a pas confirmé que de l’acide avait été utilisé : il a dit que c’était impossible à affirmer.
M. Christophe Prémat. Dans une société démocratique, il faut s’interroger en permanence sur la formation des « gardiens de la cité », pour reprendre l’expression utilisée par Platon dans La République. Il faut être capable à la fois de maintenir l’ordre et de comprendre les enjeux qui se posent.
La question de la formation des forces de l’ordre est assez complexe, et il est vrai que nous allons devoir revenir sur la qualité du recrutement. Dans ma circonscription, qui regroupe les pays de l’Europe du Nord, on travaille à une diversification des recrutements, à une présence beaucoup plus « genrée » des forces de l’ordre, et à l’utilisation de moyens beaucoup moins techniques et plus traditionnels pour calmer les tensions et mieux apprécier les situations.
Sans doute aurait-on besoin, dans les formations, de s’appuyer sur les travaux menés en sciences sociales sur la sociologie des mobilisations- notamment ceux d’Olivier Fillieule et de Pierre Favre, qui caractérisent tous les types de manifestations en fonction de la situation, des enjeux géographiques, etc. Je pense que la question de la formation des forces de l’ordre est essentielle à long terme et doit se poser en permanence, pour faire non pas « juste du maintien de l’ordre », mais un « maintien de l’ordre juste ».
Comment percevez-vous, donc, tant la diversification des profils des forces de l’ordre républicaines que le contenu de leur formation ?
M. le président Noël Mamère. Je précise à M. Tartakowsky que M. Prémat est député des Français de l’étranger, et que c’est à ce titre qu’il a fait quelques comparaisons avec les pays nordiques. Et j’indique à notre collègue Prémat que nous avons justement prévu d’auditionner M. Olivier Fillieule, ainsi que M. Fabien Jobard qui travaille à Berlin, à l’Institut Marc-Bloch.
M. Jean-Paul Bacquet. Je tiens d’abord à dire que les officiers que nous avons auditionnés étaient d’une rare qualité. À les entendre, on ne voit pas comment il pourrait y avoir la moindre difficulté ou le moindre dérapage. Cela étant, il faut effectivement que la formation soit plus adaptée.
Les exécutants vont recevoir les ordres qui sont donnés. Et la vraie question n’est pas de savoir s’il faut un encadrement civil ou un encadrement non civil, mais s’il y a, dans l’encadrement, des gens suffisamment formés, notamment à la sociologie des masses. Il faut y réfléchir, car du commandement dépendent beaucoup de choses.
Ensuite, vous avez parlé de l’usage « mal adapté » des grenades offensives. Qu’entendez-vous par là ? Personnellement, je conteste la suppression de ces grenades offensives. Le fait que le geste ait été mal exécuté ne la justifie pas. À ce propos, le général Favier a clairement dit qu’il était souhaitable que, désormais, il y ait un viseur et un tireur, et non plus un seul exécutant. Souvenons-nous de Richard Deshayes qui avait perdu un œil dans une manifestation en 1971, frappé par un tir de face et à hauteur d’homme.
Le risque de dérapage peut venir des manifestants, mais aussi des forces de l’ordre. Un car de CRS ou de gendarmes mobiles peut rester un certain nombre d'heures devant l’Assemblée nationale, comme on l’a vu lors de la manifestation contre le mariage pour tous. Personnellement, j’ai une certaine admiration pour ceux qui restent enfermés, à se faire insulter, voire caillasser, et je ne sais pas quelle serait ma réaction si je devais sortir du car après un grand nombre d’heures passées ainsi sous tension. Ne serait-il pas important de réfléchir à la gestion du temps ?
Enfin, les forces de l’ordre peuvent être parfaitement encadrées, responsabilisées par l’État. Les polices municipales peuvent être d’une très grande qualité, mais elles peuvent aussi être au service d’un élu, voire d’une idéologie, celle de cet élu. Les milices existent également, et on ne peut pas tout mélanger. La milice locale ne peut être ni une source de renseignements, ni une source d’orientation. Dans ce domaine-là, il a encore beaucoup à faire.
M. le président Noël Mamère. Avant de vous redonner la parole, monsieur le président, je voudrais vous dire que le général Favier, lorsque nous l’avons auditionné, nous a dit qu’il considérait que la formation devrait être plus régulière ; selon lui, un seul entraînement par an ne suffit pas. Il a également évoqué la question des moyens.
Par ailleurs, vous vous êtes sans doute aperçu, à travers les interventions des uns et des autres, que nous ne sommes pas forcément tous du même avis... Pour ma part, au cours de l’ancienne mandature, j’avais proposé la suppression des flash-balls et l'interdiction de l’utilisation de ces outils qui peuvent avoir des effets létaux. Je pensais notamment aux polices municipales, puisque quelques-unes en sont aujourd’hui dotées.
Cela m’amène à faire remarquer que, peu ou prou, le maintien de l’ordre est plutôt bien assuré dans notre pays par des gens plutôt bien formés à cette fin. Le problème se pose pour la sécurité publique, au quotidien, avec des gens qui ne le sont pas. Les gardes mobiles sont formés à Saint-Astier, selon une certaine doctrine. Mais pour les policiers, ce n’est pas du tout la même chose. Il n’y a pas d’harmonisation entre les deux formations, et c’est sans doute regrettable.
Je répondrai à notre collègue Bacquet qu’à l’issue du drame de Sivens le ministre de l’Intérieur a interdit l’utilisation des grenades offensives. On peut espérer que cette interdiction sera permanente.
M. Pierre Tartakowsky. Je vais essayer de répondre aux questions dans l’ordre où elles ont été posées.
Faut-il que les autorités civiles soient présentes là où l’on sent que les choses peuvent déraper ? Je pense que oui. Il revient aux autorités civiles de jouer pleinement leur rôle de représentantes des populations et de la légitimité républicaine, ainsi que d’interface de négociation dans les débats qui ont cours au sein de la société. En effet, avant la confrontation physique, il y a une légitimité de la confrontation politique, dont les termes sont d’ailleurs complexes.
Notre-Dame-des-Landes en est l’exemple parfait. En tant qu’association, nous n’avons pas pris position sur le projet lui-même, parce qu’il nous semblait que cela dépassait notre champ de légitimité, et aussi parce que nous n’avions pas les moyens techniques et d’expertise suffisants. En revanche, nous avons été immédiatement sensibles au hiatus démocratique qui était ainsi révélé. Les collectivités locales ont appuyé le projet mais, en même temps, d’autres ont occupé l’espace public en s’appuyant sur une légitimité venant du « soutien de la population », et donc des « zadistes ». Or ce problème ne peut pas se régler uniquement par l’usage de la force, fût-elle légitime. Il faut articuler un débat politique, un vrai débat où ceux qui ne sont pas d’accord entre eux vont essayer de trouver une solution. Le maintien de l’ordre sans débat ne peut que mener au drame.
Il faut donc des autorités civiles. Indéniablement, dans l’affaire de Sivens, quelque chose n’a pas fonctionné, aussi bien pendant qu’après les affrontements. Nous savons qu’il y a eu un jeu de « patate chaude » entre le ministère et le préfet pour savoir qui allait annoncer le décès de Rémi Fraisse, et le délai qui s’en est suivi dans la communication publique a autorisé toutes les interprétations, à commencer par celle du « complot ». Lorsqu’un jeune Français meurt dans une confrontation avec la police, il est mieux de le dire vite, et de dire dans quelles conditions il est mort, car les gens ont tout simplement besoin de savoir.
Notre commission d’enquête sur Sivens s’est fixé comme cahier des charges de ne pas s’en tenir aux seuls affrontements. Avant l’affrontement, nous avions déjà été saisis à de nombreuses reprises par des citoyennes et des citoyens – et le travail que nous avons mené depuis n’a fait que le confirmer – du comportement extrêmement provocateur des forces de police, comportement qui a nourri des activités de milices en faveur de la construction du barrage. On a le droit d’être en faveur de la construction de ce barrage, mais pas forcément de le défendre en constituant une milice.
Cela nous amène à la question de la gestion des temps – et non pas du temps, ce qui est différent. Que des gardes mobiles s’ennuient dans un car de police durant trois heures, c’est bien embêtant, et ils ont ma sympathie et mon admiration. Mais tant qu’ils restent dans le car de police, il n’y a pas de problème. Et, de toute façon, il n’est pas possible d’organiser une rotation toutes les heures, qui nécessiterait de nombreux effectifs et aggraverait l’empreinte carbone.
La gestion des temps, c’est autre chose. Quand on maintient trop longtemps des forces de l’ordre sur une région face aux mêmes personnes, se produit un double phénomène de proximité et de familiarité. Or la familiarité n’a pas que des côtés sympathiques : les gens commencent à se connaître, à se repérer les uns les autres, à nourrir des contentieux de type personnel, et c’est le début du dérapage.
Donc, proximité et familiarité sont les enfants pervers de la stabilisation des mêmes forces au même endroit. Il faut donc, effectivement, organiser des roulements s’agissant des exécutants, tout en maintenant, j’y insiste, une permanence du commandement. En effet, le commandement a besoin d’être « familier » avec les termes de l’affrontement, avec les « dirigeants » d’en face, avec qui ils ont pris langue et ont construit des rapports de confiance. Or je pense que cela n’a pas été le cas.
Cela nous amène à la question de la formation, sur laquelle vous avez insisté à juste titre. Dans le cas de Sivens, y a-t-il eu un problème de formation ? Je ne sais pas, je ne peux pas en juger. Mais il est très clair que celui qui a lancé cette fameuse grenade offensive était seul et qu’il l’a lancée à un moment auquel il n’avait pas été préparé. C’était la nuit, il n’y avait pas eu de consigne liée au fait qu’il pouvait y avoir des mouvements dans le camp d’en face et qu’il fallait donc se tenir prêt. Et il a lancé cette grenade sans tenir compte des directives qui accompagnent normalement l’usage d’une telle arme.
Quand les gens sont seuls, ils ont peur, même s’ils ont été préparés. L’agent qui a tiré à Gênes au moment des manifestations était un jeune agent peu formé. Il a été coincé avec des manifestants au fond d’un fourgon, il avait une arme, il s’en est servi. À Sivens, la situation était à peu près identique.
Maintenant, faut-il organiser une concertation obligatoire avec les groupes violents ? Si l’on y parvient, cela voudra dire qu’ils sont beaucoup moins violents qu’on ne l’annonçait, et la République ne s’en sortira que mieux… Je souris, mais il est vrai que, si tous les voleurs de banque pouvaient être rendus honnêtes, on pourrait investir beaucoup moins dans la sécurité des banques. Dans la pratique, je ne suis pas certain que ce raisonnement nous mène très loin.
Que penser de la généralisation de l’interdiction qui se pratique déjà pour la fréquentation des stades ? J’aurais tendance à dire « joker ». Dès qu’on lui parle d’interdiction, le président de la Ligue des droits de l’Homme a tendance à se crisper...
Il y a eu des tentatives intéressantes visant à interdire certains individus de stade. C’était relativement légitime dans la mesure où, sur la base de photographies ou de films, on pouvait juger que l’activité de ces individus n’avait que de lointains rapports avec l’amour du sport. Mais, très vite, cette interdiction a été étendue à des groupes. Or, bizarrement, il s’agissait de supporters habitant la périphérie des villes, déjà quelque peu déclassés socialement. Et là, nous devenons méfiants. S’il s’agit d’interdire des lieux à des gens dont on sait, et dont on peut attester, qu’ils vont y avoir une activité délétère, c’est évidemment légitime. Si cela devient une facilité de police pour empêcher tout problème, cela relève d’une pédagogie négative. Il faut donc s’en garder.
Quelles sont les forces concernées par la formation – question que vous avez été nombreux à aborder ? Pas le GIGN, qui est très bien formé. Et d’ailleurs, avec le GIGN, il n’y a pas de dérapage, mais il n’y a pas de maintien de l’ordre non plus. Le GIGN intervient dans des situations extrêmes, en tout cas en France, et les moyens qui sont alors développés sont proportionnés et atteignent les objectifs fixés.
Le problème principal vient de la police du quotidien, de la BAC, des policiers qui sont en contact permanent avec la population, qu’elle manifeste ou non. On sait que la population peut très vite se réunir. Pour avoir habité une cité de Seine-Saint-Denis, je me souviens qu’il suffisait qu’une voiture de police interpelle un jeune de la cité de manière un peu cavalière pour qu’il y ait une réunion, laquelle pouvait tourner à la manifestation. Et il était heureux qu’il y ait un tissu associatif car, sinon, la manifestation aurait pu tourner à l’émeute. Je ne dis pas cela pour que vous augmentiez les subventions parlementaires aux associations, mais pour insister sur le fait que la qualité de la vie démocratique locale est un facteur décisif dans le maintien de l’ordre.
L’un de vous a évoqué la violence des groupuscules et les cocktails Molotov. Je pense qu’il faut répondre de façon proportionnée. À Marseille, il serait désastreux de demander aux forces de police d’affronter les Kalachnikov avec des cornets à glace ! De la même façon, si les forces de police reçoivent des cocktails Molotov, elles doivent développer des stratégies qui leur permettent, dans un premier temps, de ne pas en être victimes et, dans un second temps, d’arrêter ceux qui les lancent, car il y a là une atteinte manifeste à l’ordre public.
Faut-il des sections spéciales de maintien de l’ordre ? J’aurai un peu la même réaction que précédemment. Quand j’entends « section spéciale », j’ai des boutons...
Faut-il des mesures adaptées au maintien de l’ordre ? Oui. Est-ce que cela doit passer par des sections spéciales ? Je n’en suis pas du tout convaincu. Je trouve même l’idée préoccupante. En effet, la démarche qui consiste à isoler les problèmes les uns des autres et à trouver des réponses morcelées, segmentées, comme si chaque problème avait sa propre logique, est mauvaise. Il faut s’approprier les thématiques du maintien de l’ordre comme un tout. Si, à un moment donné, des mesures adaptées sont nécessaires, il faut les prendre, non pas parce qu’elles sont adaptées à telle ou telle situation, mais parce qu’elles s’inscrivent dans une stratégie globale.
Quand on crée des sections spéciales, des tribunaux spéciaux ou des cellules spéciales, on crée des points de fixation extrêmement virulents et on oublie toutes les autres dimensions du problème. Et on se retrouve dans une impasse.
Je répondrai ensuite que nous avons, globalement, une bonne police. Je suis très admiratif, par exemple, de l’évolution rapide de son accueil des femmes victimes de violences : il y a une quinzaine d’années, cet accueil était vraiment catastrophique ; en revanche, maintenant, dans les commissariats, règnent un grand respect, une attention, une empathie – qui tient évidemment à la présence de femmes. La police peut donc évoluer, et je pense qu’elle en a envie.
De ce point de vue, et s’agissant de la formation, il faudrait voir ce que fait le ministère de l’Intérieur. Je crois que la question préoccupe Bernard Cazeneuve, qui a trouvé un ministère très « verticalisé » et très peu sensibilisé aux sciences sociales. Il me semble que l’hégémonie d’Alain Bauer avait contribué à marginaliser l’idée d’un institut d’études de la sécurité publique, dont nous avons besoin.
Il nous faut un lieu de débat entre chercheurs en sciences sociales, quelle que soit par ailleurs la qualité ou l’orientation de leurs travaux. Nous devons débattre de tout cela et rendre publics les débats. C’est déjà une partie de la formation. Et j’insiste sur l’idée que la formation dont je parle n’est pas à sens unique : une police bien formée est aussi une police qui contribue à la formation des citoyens à la citoyenneté. La police n’est pas un corps étranger à la population. De ce point de vue, nous avons tout à gagner.
J’observe que nous serons toujours un peu en décalage avec les pays nordiques, qui n’ont pas la même culture que les pays méditerranéens. Nous n’avons pas la même conception de l’État. Cela dit, il est très intéressant d’étudier ce qui se passe là-bas, car on a besoin de beaucoup de diversité pour penser juste.
Cela m’amène à faire une remarque sur les récépissés de contrôle d’identité, auxquels nous tenons beaucoup, mais que l’actuel Premier ministre, lorsqu’il était ministre de l’Intérieur, a balayé d’un revers de main, refusant même qu’on les teste dans les villes dont les maires étaient volontaires. Le système fonctionne très bien en Espagne. Or, contrairement aux pays nordiques, l’Espagne n’est pas réputée pour la facilité des rapports de sa police à la population. Donc, expérimentons, réfléchissons, ce sera très bien.
Monsieur Bacquet, vous avez affirmé que les officiers que vous aviez reçus étaient de grande qualité, un peu comme si vous faisiez une mise au point. Mais celle-ci n’était pas nécessaire. Je suis persuadé que les officiers de police, ceux que vous avez auditionnés et les autres, sont de grande qualité. Là n’est pas le problème. Pour vous faire sourire, je vous dirais que le préfet Bonnet, quand il a été envoyé en Corse, était un préfet de grande qualité. Mais il a été pris dans un débat qui l’a complètement dépassé, auquel il n’était pas préparé, et il a fait jouer des réflexes qui se sont retournés contre lui, contre la République et, d’une certaine façon, contre les forces de l’ordre. La qualité des hommes ne répond donc pas du résultat. C’est la mise en œuvre des relations entre les divers acteurs, y compris ceux qui manifestent, qui en répond.
Peut-on parler d’un usage mal adapté des grenades offensives ? Nous n’avons pas demandé la suppression des grenades offensives après les évènements de Sivens. Nous sommes très contents que le ministre les ait retirées. Pour autant, nous aurions préféré franchement qu’il prenne l’initiative d’un débat sur l’armement de la police. En effet, dans ces circonstances, l’interdiction de ces grenades apparaît comme une mesure d’ordre purement conjoncturel, et non pas une mesure de principe. Nous craignons donc que, dans une situation inverse, un autre ministre revienne sur cette interdiction.
Ce n’est pas la grenade qui a tué Rémi Fraisse, en tout cas ce n’est pas notre opinion. Est-ce qu’il y a eu un usage mal adapté ? Je répondrai qu’en l’occurrence c’est certain, dans la mesure où cette arme n’est pas faite pour tuer. Est-ce que cet usage mal adapté a été fatal ? La question est ouverte, elle réclame un débat.
L’insistance que vous mettez à dire « il faut un tireur et un viseur » me semble assez judicieuse. Je dirais pour ma part qu’il ne faut pas laisser un homme isolé quand il a entre les mains quelque chose qui peut en tuer un autre. En effet, on ne sait pas ce qui se passe dans la confrontation, surtout quand elle ne correspond pas à ce qu’on attendait. Là encore, on revient à la question de la gestion du temps. Il faudrait mesurer le nombre d’heures qui avaient été effectuées réellement sur le terrain par les forces de l’ordre au moment où l’affrontement a eu lieu.
Enfin, sur les milices locales et les polices locales, vous avez tout mon soutien. D’abord, tout ce qui est milice devrait être interdit, et l’est d’ailleurs de par la loi. La violence légitime appartient à l’État, et je pense que c’est une très bonne chose.
Les polices municipales se sont généralisées à notre grand regret. Il faut reconnaître qu’elles ne sont pas forcément synonymes de dérapages et de situations catastrophiques. Il arrive parfois qu’elles remplissent le rôle que devrait jouer la police nationale, et qu’elles ne s’en portent pas si mal. Il se construit parfois, par l’expérience, des complémentarités qui ne sont pas forcément négatives – comme l’enseignement public et l’enseignement privé. En revanche, le débat a rebondi à l’initiative d’un maire du Front national : l’armement de ces polices locales d’armes à feu me semble extrêmement dangereux et, de notre point de vue, il devrait être totalement interdit.
Mme Anne-Yvonne Le Dain. Monsieur Tartakowsky, je vous remercie pour la fluidité et la précision de vos réponses.
Je voudrais connaître votre analyse sur une tendance qui tend à se généraliser et dont les évènements de Sivens nous donnent un exemple : on est en fin de procédure, les opérations sont en train de se mettre en œuvre et, d’un seul coup, une manifestation très forte éclate. Quelle analyse en faites-vous, socialement et sociologiquement ?
M. Pierre Tartakowsky. Je pense que vous avez magnifiquement cerné un sujet de thèse sur la « crise de la démocratie ». Ce n’est pas une problématique de maintien de l’ordre, mais une problématique, très compliquée, des différents temps du débat public.
À une époque, les représentants représentaient les représentés, qui se sentaient représentés par les représentants. Ils se sentaient plus ou moins bien représentés, mais le débat s’inscrivait dans cet espace consensuel. Aujourd’hui, on ne peut plus parler d’espace consensuel, même si on peut le regretter. On s’en aperçoit à la multiplication des contestations, qui sont légitimées par le soutien des populations locales. Je ne dis pas qu’elles ont raison, mais il y a légitimation de leur part.
Il faut donc que nous remettions sur l’établi la façon dont nous construisons démocratiquement le débat public. Sans doute doit-on s’inspirer des réflexions de certains acteurs politiques ou civiques sur le déficit de proportionnalité et de diversité dans la représentation politique. Si vous prenez la photo des membres du conseil général du Tarn, et que vous la posez à côté d’une photo des manifestants, vous constaterez un réel problème de représentation de genre, de génération et de culture. Je ne dis pas que les personnes qui ont été élues ne sont pas légitimes. Mais, de toute évidence, il y a un décalage considérable avec la réalité des populations qu’elles représentent.
Nous avons un problème de temps et un problème de débat. Les gens ne sont pas forcément saisis de toute la complexité d’un dossier au moment où il est traité. C’est très souvent parce que d’autres tiennent des discours alarmistes, avec de bons ou de mauvais arguments, qu’ils finissent par se réveiller et manifester. Il y a là un problème troublant pour les élus de la Nation.
M. le président Noël Mamère. Nous y réfléchissons. Je précise d’ailleurs à notre collègue Anne-Yvonne Le Dain qu’un certain nombre de députés de la majorité travaillent sur une introduction plus importante des citoyens dans les procédures d’enquête d’utilité publique ; le ministre chargé de ces questions doit même y réfléchir. En effet, tant que l’on n’aura pas réformé les procédures d’aménagement du territoire et des enquêtes d’utilité publique, on pourra s’attendre à ce que des affaires comme celles de Sivens, de Notre-Dame-des-Landes ou de Roybon se reproduisent.
M. le rapporteur. Monsieur le président Tartakowsky, vous avez évoqué le travail que la Ligue des droits de l’Homme a fait sur les évènements de Sivens, travail sur lequel je ne porte aucun jugement, pas plus que je ne porte de jugement sur le rapport qu’a rendu l’Inspection générale de la gendarmerie nationale. Ce n’est d’ailleurs pas notre rôle de le faire. Mais, à la suite la thèse du « pauvre gendarme isolé » que vous avez développée, je veux citer un extrait du rapport de l’Inspection générale :
« Face à la position du groupe Charlie 1 se présente un groupe de manifestants hostiles, équipés de casques et de boucliers, qui lance des projectiles, suivi d’un autre groupe plus important qui occupe le terrain ; l’ensemble est dirigé par un homme dont on entend les ordres. Ils se trouvent à environ une quinzaine de mètres (évaluation nocturne). En accord avec son commandant de peloton, le MDC [maréchal des logis] J. s’apprête à lancer une grenade offensive pour stopper la progression des manifestants.
« Afin de repérer la position des manifestants, le MDC J. utilise les jumelles I. L puis les repose. Il adresse ensuite à haute voix un avertissement destiné aux manifestants puis il lance sa grenade dans le secteur préalablement identifié et réputé inoccupé, par un mouvement de lancer „en cloche” au-dessus du grillage de 1,80 m. Après la détonation, le groupe de manifestants se disperse.
« Dans son audition, le major commandant le peloton Charlie dit ne pas avoir suivi visuellement la trajectoire de la grenade mais que, après la détonation, il aperçoit un manifestant tomber au sol. Il n’est pas en mesure de faire la relation entre les deux situations. »
La justice aura certainement à établir ce qu’elle considèrera comme étant la version la plus plausible. Mais à tout le moins, on peut considérer qu’il y en a de différentes.
M. Pierre Tartakowsky. Celle-ci est accablante.
M. le président Noël Mamère. Absolument, puisqu’il y a eu un tir « en cloche », alors que, selon la directive, ces grenades doivent être roulées sur le sol.
M. le rapporteur. Je réagissais simplement sur un positionnement. Maintenant, la justice suit son cours.
M. Pierre Tartakowsky. Notre propre enquête est d’ailleurs une enquête de documentation, beaucoup plus générale que celle de la justice.
Je remarquerai simplement qu’il faut prendre avec précaution la notion d’isolement. Objectivement, ici, avec vous, je ne suis pas isolé. Mais si vous vous mettiez à parler entre parlementaires, je me sentirais isolé parce que je ne maîtriserais pas le langage utilisé. Bien sûr, je pense que le langage passait bien entre le maréchal des logis en question et son supérieur immédiat, mais on ne peut pas exclure que la rapidité du mouvement ait créé un sentiment d’isolement. L’isolement est une notion très relative. Je dis cela à décharge de celui qui a tiré, notez-le bien…
M. le président Noël Mamère. Merci, monsieur le président.
*
* *
Audition, ouverte à la presse, de Mme Françoise MATHE, présidente de la commission « Libertés publiques et droits de l’homme » du Conseil national des barreaux
Compte rendu de l’audition du jeudi 19 février 2015
M. le président Noël Mamère. Mes chers collègues, nous recevons maintenant Mme Françoise Mathe, présidente de la commission « Libertés publiques et droits de l’homme » du Conseil national des barreaux, qui est accompagnée de Mme Anna Boeri.
Madame Mathe, avant de vous entendre, conformément aux dispositions de l’article 6 de l’ordonnance du 17 novembre 1958, je dois vous demander de prêter le serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité.
(Mme Françoise Mathe prête serment.)
Mme Françoise Mathe, présidente de la commission « Libertés publiques et droits de l’homme » du Conseil national des barreaux. Monsieur le président, mesdames, messieurs les députés, le Conseil national des barreaux est très sensible à votre invitation.
Il est exact que le Conseil, par la nature même de l’institution, a un engagement pour le respect des libertés fondamentales, des libertés publiques et des droits de l’homme, et tel est l’objet de la commission que je préside. Il n’en demeure pas moins que le travail de cette commission est surtout dirigé vers la protection de ces libertés fondamentales au stade des procédures judiciaires et de l’analyse des projets de loi qui sont de nature à avoir un impact sur le respect des libertés fondamentales et l’organisation des garanties judiciaires. C’est pourquoi nous avons été quelque peu déconcertés par votre invitation, bien que sensibles à l’intérêt que vous nous portez. Si nous sommes sensibles à la nécessité d’un équilibre dans le cadre de ces opérations avec la protection des libertés fondamentales, nous n’avons pas vocation à nous prononcer sur les conditions dans lesquelles les opérations de maintien de l’ordre sont conduites, les conditions dans lesquelles les forces de l’ordre sont engagées, la nature des armes utilisées, sauf à envisager les conséquences judiciaires que cela peut entraîner.
Nous avons reçu votre questionnaire et nous avons été très honorés de l’attente que vous aviez à notre égard, même si nous ne sommes pas en mesure d’y répondre, de vous fournir des statistiques sur les poursuites engagées en matière d’atteinte aux libertés imputables aux forces de l’ordre. En effet, le Conseil national des barreaux n’a malheureusement pas les moyens de mener de telles investigations et de tenir de telles statistiques.
J’ai constaté qu’il y avait, dans votre questionnaire, des questions latentes qui pourraient aboutir à des modifications législatives. J’ai noté deux points sur lesquels nous avons des opinions à faire valoir. Vous nous demandez quelle peut être la responsabilité des organisateurs de manifestations qui généreraient des troubles à l’ordre public et s’il est possible d’imaginer un régime d’interdiction individuelle de manifestation à l’encontre d’individus connus comme radicaux ayant fait l’objet de condamnations.
Le Conseil national des barreaux est parfaitement opposé à des mesures qui pourraient ressembler de quelque manière que ce soit à la mise en jeu d’une sorte de responsabilité collective ou de traçabilité des individus ayant causé des atteintes à l’ordre public à l’occasion de manifestations ou d’autres circonstances de ce genre, c’est-à-dire à des mesures préventives qui seraient des obstacles à la liberté d’expression, à la liberté de manifester ses opinions à travers la liberté de manifestation.
Mais nous ne pouvons pas vous donner des opinions sur les conditions d’engagement de la force publique, sauf à dire ce que chacun sait, c’est-à-dire qu’elle doit être proportionnée et que, in fine, tout contrôle de proportionnalité aboutit dans l’escarcelle du juge. La question de savoir si les principes qui régissent cette proportionnalité sont suffisamment définis me paraît difficile à trancher, car il est extrêmement délicat de donner au juge des règles qui iraient au-delà de celles qui lui sont actuellement imposées, et qui sont à sa disposition, pour contrôler qu’il y a bien proportionnalité entre la réaction des forces de l’ordre et la situation de l’ordre public.
Par contre, j’ai essayé d’aller un peu au-delà des investigations spontanées du Conseil national des barreaux à titre général et j’ai eu quelques entretiens avec des avocats qui ont eu à connaître des procédures qui ont abouti aux événements déplorables qui sont à l’origine de la création de votre commission, c’est-à-dire les conditions dans lesquelles se sont déroulées les opérations de maintien de l’ordre sur le site de Sivens et la mort de Rémy Fraisse à la suite d’affrontements nocturnes avec les forces de l’ordre.
Les pistes de réflexion que votre commission pourrait entendre concernent la gestion du temps : le temps des opérations de maintien de l’ordre, le temps des occupations et le temps judiciaire. Je parle du temps judiciaire au sens large, c’est-à-dire que cela concerne aussi la justice administrative.
Que nous disent les avocats qui sont intervenus dans le déroulé de ces procédures ? Qu’il s’agissait d’une occupation territoriale assez inhabituelle. En effet, les forces de l’ordre sont plutôt habituées à des opérations de maintien de l’ordre en milieu urbain, alors que l’on avait affaire à une occupation en zone rurale. Les avocats pensent surtout que la triple gestion du temps a été problématique et qu’elle est probablement à l’origine de ce qui s’est produit, en tout cas c’est un cadre d’explication adapté.
Cette occupation dure car il y a des travaux qui sont engagés en exécution d’un projet initié par des collectivités territoriales et qui fait l’objet de recours. La durée de cette occupation, la durée des manifestations d’opposition aux travaux et au projet sur ce site, sont liées à la durée d’évacuation des recours. Il y a des recours administratifs qui sont pendants, qui ne sont pas réglés. Le référé-suspension qui a été demandé par les opposants au site a échoué. Cela ne signifie pas que, sur le fond, l’échec soit certain. Les opposants considèrent donc qu’ils doivent bénéficier de la possibilité de s’opposer à un projet dont il n’est pas assuré qu’il soit en définitive validé par la justice administrative, mais dont les travaux sont déjà en cours sur des terrains qui, pour la plus grande partie, ont un caractère privé. Nous sommes donc devant un enkystement de l’occupation elle-même comme des opérations de maintien de l’ordre, lié à la durée de la procédure administrative. Lorsque des procédures administratives sont engagées sur des projets susceptibles de causer des problèmes d’ordre public en raison de l’opposition qui s’exprime à leur encontre, peut-être faudrait-il imaginer que la justice administrative suive un rythme plus adapté aux circonstances, les opposants considérant qu’il ne faut pas que se reproduise ce qui s’était déjà passé dans le même département, c’est-à-dire que les travaux ont été réalisés, le projet a été achevé et que, en définitive, il a été invalidé.
La durée est générée par le processus de la justice administrative. Il est probable que l’interruption du processus d’occupation aurait été plus rapide si les recours avaient été évacués dans un sens ou dans un autre. Dès lors que se développe cette occupation qui n’est pas régulière, qui est une situation de fait générée par les opposants, les opérations de maintien de l’ordre se déroulent également dans la durée. Il semble – c’est l’interprétation des conseils des personnes concernées – que les forces de l’ordre ne soient pas adaptées à cette opération de maintien de l’ordre qui se prolonge. Il s’agit là de questions qui nous échappent et qui concernent l’adaptation des forces de l’ordre à ce type d’opération de maintien de l’ordre.
Ce qui est certain, c’est qu’il y a eu des procédures judiciaires aux fins d’expulsion puisque des personnes y avaient installé leur logement, même si celui-ci était précaire, et qu’il a parfois été violé. Des procédures civiles ont été mises en œuvre pour obtenir du juge civil, en l’occurrence le président du tribunal de grande instance statuant en référé, l’expulsion. Nous savons que les autorités judiciaires se sont inquiétées de voir se multiplier les procédures et qu’elles considéraient que la réponse judiciaire par l’ordonnance de référé-expulsion n’était pas nécessairement adaptée. Elles auraient surtout souhaité – et je ne viole là aucun secret, ce sont des propos officieux de magistrats du siège – que soient mises en place des mesures de médiation, des modalités de dialogue, sous l’autorité de la justice ou sous l’autorité administrative, pour essayer d’éviter le recours à des procédures qui n’étaient pas nécessairement adaptées.
Un nombre considérable de plaintes ont été déposées auprès du parquet pour des violences de gravité moindre que celle qui a abouti à la mort de ce jeune homme, mais pour des violences tout de même significatives : violations de domicile, destructions de biens personnels des occupants de la « zone à défendre » (ZAD), violences physiques commises par les services de police, ainsi que, de façon moins significative en nombre mais néanmoins réelles, des violences commises par les opposants les plus incontrôlés à l’égard des forces de l’ordre. Il semble qu’il n’y ait pas eu de traitement spécifique de la part du parquet. Le parquet a traité ces plaintes comme il traite des plaintes pour des faits de gravité moyenne. Je ne veux pas donner ici l’impression que je sous-estime la gravité des violences contre les personnes, mais, jusqu’à la nuit malheureuse, il ne s’agissait pas de violences d’un niveau très élevé. Le parquet a opté pour un traitement relativement routinier. Les plaintes n’ont, semble-t-il, donné lieu ni à des auditions, ni à l’ouverture d’une information, ni à des remontées auprès du parquet général.
Si les alertes avaient permis à l’autorité administrative de prendre conscience qu’une situation de risque pouvant déboucher d’un instant à l’autre sur une catastrophe était en train de se créer, peut-être aurait-on pu éviter ce qui s’est produit. Il apparaît donc que nous manquons de dispositifs adaptés permettant de répondre à des situations qui, au-delà de la simple manifestation d’opinions, sont, par leur durée et par leur caractère atypique, de nature à entraîner des conséquences graves pour les biens et les personnes. D’où le souhait de la mise en place de mécanismes de concertation, de dialogue, d’alerte entre l’autorité judiciaire et les opposants à ce type de projet. Cela constituerait un progrès.
Au-delà, tout ce qui paraît se dégager en filigrane du questionnaire que nous avons reçu, et qui ressemblerait à des mesures d’exception, nous paraît inadapté et à écarter par principe. On ne peut pas remettre en question des équilibres qui ont été mis en place dans la durée, et qui protègent aussi bien les biens, les personnes que les libertés fondamentales. Quant aux mécanismes administratifs et judiciaires, c’est autre chose. Cela pourrait faire partie de pistes de réflexion.
M. Pascal Popelin, rapporteur. Considérez-vous que le cadre juridique relatif à la liberté d’expression et au droit de manifester soit toujours adapté, eu égard à de nouvelles formes de contestation qui se traduisent par l’occupation durable de terrains privés ?
Les auditions que nous avons menées jusqu’à présent nous permettent de dire qu’un certain nombre de sujets sont revenus de manière récurrente. Mais les avis ne convergeaient pas toujours. J’en retiens trois.
Vous avez évoqué l’idée du régime d’interdiction individuelle. Telle qu’elle nous a été présentée, cette idée est calquée sur ce qui existe en matière de manifestations sportives. Naturellement, cela concernerait exclusivement les personnes qui auraient déjà fait l’objet de condamnations pour violence dans le cadre de manifestations. Mais, au-delà de la question principielle, la mise en œuvre pratique d’un tel mécanisme laisse dubitatifs jusqu’à ceux-là mêmes qui l’envisagent. En effet, au-delà de l’obligation de pointer dans un commissariat ou à la gendarmerie, que fait-on après ? On ne peut pas retenir la personne. Quand il s’agit d’une manifestation sportive, la personne entre ou n’entre pas dans l’enceinte, mais si la manifestation a lieu sur la voie publique, que fait-on ?
Une autre piste a été évoquée, qui rejoint ce que vous avez indiqué sur les mécanismes de concertation. Il s’agit de l’instauration, par des contraintes législatives ou réglementaires, d’un dialogue préalable entre les organisateurs de manifestations et les différentes institutions chargées de faire respecter l’ordre républicain. Le problème, c’est qu’il faut qu’il y ait des organisateurs, ce qui n’est plus toujours le cas. Il n’est pas toujours évident d’identifier l’auteur d’un SMS ou d’un message sur Facebook appelant à se rassembler à tel ou tel moment, à tel ou tel endroit, même si c’est parfois pour un apéritif.
Le dernier point concerne les dispositifs d’enregistrement vidéo, qu’il s’agisse des dispositifs mobiles éventuellement mis en place par les forces de l’ordre ou de la vidéoprotection de voie publique lorsqu’elle existe. On sait que ces pratiques se développent. Pour les manifestants comme pour les forces de l’ordre, cela permet d’apprécier plus objectivement la réalité – sans quoi l’on est plutôt dans une situation de « parole contre parole » – et éventuellement d’améliorer la réponse pénale. Quelle est votre position sur ce point ?
M. le président Noël Mamère. Depuis le début de nos auditions, la gestion du temps est évoquée par chacun de nos interlocuteurs. Les responsables du maintien de l’ordre éprouvent manifestement des difficultés à gérer ce que vous avez classé en trois temps : le temps du maintien de l’ordre, le temps de l’occupation et le temps judiciaire. Ce sera sans doute l’un des points importants que notre rapporteur soulignera dans son rapport. Quelles suggestions pourriez-vous faire en matière de médiation dans des cas précis comme les zones à défendre en milieu ouvert, qui n’ont rien à voir avec le milieu urbain ?
Mme Nathalie Nieson. Je veux, moi aussi, rebondir sur cette notion de temps et sur l’évolution des manifestations et des occupations de sites. Ce sujet, qui revient de manière récurrente, donne, s’il en était besoin, toute sa légitimité à notre commission d’enquête. On se trouve devant une nouvelle manière de manifester son opposition et devant de nouveaux procédés auxquels l’État, les forces de l’ordre et la justice n’apportent pas forcément les bonnes réponses.
Pour ma part, je prendrai l’exemple du projet d’implantation d’un parc de vacances Center Parcs sur le site de Roybon, situé à quelques kilomètres de ma circonscription. Un arrêté du 3 octobre 2014 du préfet de l’Isère autorisait le démarrage des travaux. Bien sûr, cet arrêté a été attaqué au tribunal administratif et le juge des référés a suspendu cet arrêté le 23 décembre 2014. Entre le 3 octobre et le 23 décembre, il y a eu une mobilisation, une occupation du terrain et un affrontement entre les différentes positions. Les entreprises qui devaient réaliser les travaux sont venues sur le secteur, mais elles se sont fait attaquer, repousser par les « zadistes ». Nous devons apporter des réponses à de telles situations, car nous sommes dans une sorte de zone de non-droit, dans un temps où les repères de notre société sont déstabilisés.
Mon intervention était plus une remarque qu’une question. Je voulais vraiment réagir à ce que vous avez dit qui est très complémentaire des auditions précédentes.
M. le président Noël Mamère. Il y a toujours un décalage entre le temps politique et le temps de la société. Le phénomène des ZAD n’est qu’une des expressions de ce que, dès les années 1970, Alain Touraine appelait les « nouveaux mouvements sociaux ». On peut citer aussi les Femen, Act Up ou les Faucheurs volontaires. Il a fallu le drame de Sivens pour que nous revenions sur cette question. Nous sommes au cœur d’une nouvelle configuration de la contestation et de la production d’idées dans notre société, qui a beaucoup évolué par rapport à la manifestation classique de la classe ouvrière.
Mme Françoise Mathe. Montesquieu écrivait qu’il ne faut toucher aux lois que « d’une main tremblante »...
Il faut distinguer le cadre juridique et le cadre judiciaire. Le cadre juridique me paraît relativement adapté. Celui qui a donné lieu à la saisine du juge des référés dans l’affaire de Sivens est habituellement utilisé pour les expulsions de squatters. Une ordonnance est nécessaire pour expulser une personne d’un local dès lors que celle-ci en a fait son logement, si précaire soit-il. Je comprends que l’on puisse être heurté par l’idée que des occupants sans titre se plaignent que leurs propres biens aient été détruits et détériorés, mais c’est la règle générale en matière de logement illégal. Pour expulser des squatters, il faut une décision judiciaire. Aussi longtemps qu’il n’y en a pas, le domicile, même fixé en violation du droit à la propriété d’autrui, est inviolable. Cela ne concerne pas spécifiquement les ZAD, mais le problème plus général de l’équilibre entre la protection de la propriété privée et le droit au domicile ou au logement. Faut-il toucher à ce cadre-là ? Nous sommes davantage dans le domaine de la liberté d’expression, de la liberté de manifester.
M. le rapporteur. C’est la qualification de domicile de ces campements qui pose problème.
Mme Françoise Mathe. Quand on est avec ses enfants dans un endroit relativement clos, où l’on mange, où l’on dort, cela ressemble beaucoup à un domicile. À ce stade, il ne s’agit pas d’un problème de maintien de l’ordre, mais d’équilibre législatif entre la protection de la propriété privée et la protection du domicile et le droit au logement.
En ce qui concerne l’interdiction individuelle, j’avais bien compris que les solutions proposées par certains sont calquées sur les interdictions d’accès au stade des supporters incontrôlables, mais la différence tient au fait qu’il existe un droit de manifester, d’exprimer ses opinions sur la voie publique, alors qu’il n’existe pas un droit spécifique d’assister à un match de foot – je dis cela, bien sûr, en respectant tout à fait la passion des amateurs de foot… De plus, au-delà de la question de principe, comment ferait-on respecter une interdiction de participer à une manifestation sur la voie publique ? Cela me semble extrêmement compliqué.
Les forces de l’ordre et les manifestants eux-mêmes ont du mal à prouver l’existence de violences d’un côté comme de l’autre, et plus de mal encore à les individualiser. La solution qui consiste à filmer ce qui se passe sur la voie publique à l’occasion de manifestations qui touchent à la liberté d’expression me paraît infiniment dangereuse.
S’agissant des mécanismes de dialogue, un problème se pose effectivement quand ces mouvements ne sont pas hiérarchisés, qu’ils ne correspondent pas aux modalités d’organisation du centralisme démocratique et que l’on a plutôt affaire à des groupes qui ont une certaine spontanéité dans l’organisation. Cela dit, dès lors qu’il y a saisine du juge pour obtenir des ordonnances aux fins d’expulsion, qu’il y a des procédures pénales, que des plaintes sont déposées, il y a des avocats. Si l’on voulait mettre en place des mécanismes de médiation, on pourrait le faire ne serait-ce qu’à travers leur intervention. Les « zadistes », pour inorganisés qu’ils se veulent, savent prendre le conseil d’avocats lorsqu’ils ont besoin de déposer des plaintes ou de former des recours. Les interlocuteurs d’une médiation qui ne passerait pas par l’organisation structurée que semblent rejeter certains mouvements sociaux, existent. Il pourrait s’agir de conseils ou de mandataires désignés à cet effet qui ne soient pas des dirigeants puisque cette notion paraît être récusée.
M. le président Noël Mamère. Nous vous remercions pour votre participation. Vous aviez le sentiment que les barreaux n’avaient rien d’intéressant à dire, mais votre réflexion va nous inspirer.
M. le rapporteur. Notre problématique englobe à la fois l’amont et l’aval des manifestations. Nous sommes là pour regarder si le cadre juridique est toujours adapté ou s’il doit évoluer, s’agissant de qui se passe avant, pendant et après, et même de la réponse pénale à apporter à certains comportements. Un groupe de casseurs n’est jamais le bienvenu dans une manifestation, car il dévoie le message que voulaient faire passer les organisateurs de cette manifestation. Nous devons donc voir comment on peut améliorer les choses, sachant que l’on ne trouvera jamais les parades idéales aux comportements d’individus qui, dès qu’on invente une règle, s’ingénient à la contourner.
Mme Françoise Mathe. Madame la députée, vous faisiez référence tout à l’heure à une ordonnance de référé qui a été rendue en deux mois. Pour la justice administrative, il s’agit d’un rythme foudroyant !
Mme Nathalie Nieson. Je sais bien !
M. le président Noël Mamère. C’est au législateur de voir comment réformer les procédures d’enquête d’utilité publique et comment associer un peu plus le citoyen. Nous n’en serions pas là si ces procédures avaient été réformées. Si tous les « zadistes » ne se ressemblent pas, ils ont un trait commun, celui de ne pas se reconnaître de chef, ce qui pose un problème à ceux qui sont chargés du maintien de l’ordre puisqu’ils ne savent pas avec qui ils vont discuter. Comme ils sont adeptes de ce qu’ils appellent la « dispersivité », il est assez difficile de trouver un interlocuteur.
M. Jean-Paul Bacquet. Vous avez évoqué une notion fondamentale : le temps. Aujourd’hui, le temps politique ne correspond plus du tout au temps médiatique et se trouve toujours à sa remorque. Dans l’affaire Coulibaly, le temps médiatique est allé beaucoup plus vite que le temps politique dans la gestion de la crise, et il arrive un moment où il impose au pouvoir politique de prendre une décision, de crainte que les conséquences soient plus lourdes s’il ne le fait pas assez rapidement. Lorsque, dans un conseil municipal, vous prenez, par exemple, une délibération pour construire un gymnase, les gens viennent souvent se plaindre, trois mois après, que rien ne soit fait, alors qu’il faut trois ans pour réaliser un tel projet.
M. le président Noël Mamère. C’est la culture de l’immédiat.
M. Jean-Paul Bacquet. Exactement ! C’est un phénomène que nous ne connaissions pas il y a seulement quelques années. S’agissant des ZAD, le temps médiatique est assassin par rapport à la gestion du temps politique.
M. le président Noël Mamère. Dans le dossier Coulibaly, on a bien vu que ces gens-là se servaient des médias. Et on aboutit, avec les réseaux sociaux, à quelque chose d’effrayant. On contrôle très mal les choses, d’autant que les chaînes d’information en continu sont dans une course à l’échalote permanente, au point que l’on a entendu un présentateur indiquer à quel endroit se trouvaient les otages dans l’épicerie casher.
M. le rapporteur. La justice doit travailler sereinement. Il faut réfléchir aux façons d’adapter, quand c’est possible, nos procédures et les outils dont disposent les magistrats. Quand on lit les différents rapports sur le dossier de Sivens, on voit que le caractère extrêmement long et incertain des procédures joue aussi un rôle dans la cristallisation progressive des oppositions.
Mme Nathalie Nieson. C’est la même chose pour le dossier de Roybon.
M. le rapporteur. Dans le dossier de Sivens, il y a, d’un côté, ceux qui ne souhaitent pas que le barrage soit construit et, de l’autre, ceux qui veulent le contraire. Et le risque existe qu’ils se tapent les uns sur les autres.
M. le président Noël Mamère. Vous citiez tout à l’heure Montesquieu qui a dit que l’on ne devait toucher aux lois que d’une main tremblante. Nous avons payé très cher, sous la dernière législature, le fait que le pouvoir en place légiférait en fonction de l’actualité. Or on sait que le législateur doit légiférer à froid. C’est ainsi que l’on a abouti à un certain nombre de lois qui se sont retournées contre les libertés et qui ont contribué à mettre le pays à feu et à sang, si je puis dire.
Mme Françoise Mathe. Il est évident que le temps du législateur doit être lent, mais il est évident aussi que le temps politique doit s’adapter aux nécessités et aux réalités de la société. Quant au temps judiciaire, ce n’est pas un simple cadre, c’est un facteur d’aggravation d’une situation.
M. le président Noël Mamère. Tout à fait !
Mme Françoise Mathe. Il doit être traité comme tel. Il est nécessaire de prendre le temps de débattre, d’échanger de manière contradictoire pour aboutir à une bonne décision de justice. À mon avis, cela doit tout de même pouvoir se faire en moins de dix-huit mois ou de deux ans. Il y a beaucoup de procédures où le temps est un facteur. Dans un divorce, par exemple, le temps de la décision judiciaire est un facteur. C’est même parfois un facteur positif parce qu’il soigne beaucoup de choses. Le temps agit sur les circonstances d’un événement de cette nature et il doit être traité comme tel. Là, par contre, il s’agit davantage d’une question de moyens que de modification du cadre juridique.
M. le président Noël Mamère. Mesdames, nous vous remercions.
*
* *
Audition, ouverte à la presse, de MM. Bernard COTTAZ-CORDIER, porte-parole de l’Association départementale des élus communistes et républicains (ADECR)-Les Alternatifs du Tarn-Europe Écologie-Les Verts- NPA-PCF-Parti de Gauche, et Patrick ROSSIGNOL, maire de Saint-Amancet (Tarn)
Compte rendu de l’audition du jeudi 25 février 2015
M. le président Noël Mamère. Messieurs, merci d’avoir répondu à notre sollicitation.
Cette commission d’enquête a été mise en place après les événements tragiques qui se sont produits à Sivens, mais elle ne peut pas empiéter sur le terrain de l’information judiciaire. Nous n’enquêtons donc pas sur les circonstances de la mort de Rémi Fraisse : notre travail a pour but de contribuer à améliorer le maintien de l’ordre dans notre pays, à la lumière notamment de ce qui s’est passé à Sivens, mais pas seulement.
Conformément aux dispositions de l’article 6 de l’ordonnance du 17 novembre 1958, je vous demande de prêter le serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité.
(MM. Cottaz-Cordier et Rossignol prêtent serment.)
M. Bernard Cottaz-Cordier, porte-parole de l’Association départementale des élus communistes et républicains (ADECR)-Les Alternatifs du Tarn-Europe Écologie-Les Verts- NPA-PCF-Parti de Gauche. Nous vous remercions de nous entendre, à la suite du courrier qui vous a été adressé par les différentes organisations tarnaises que je représente ce matin : l’Association départementale des élus communistes et républicains (ADECR), les Alternatifs du Tarn, Europe Écologie-Les Verts, le Nouveau Parti anticapitaliste, le Parti communiste français et le Parti de Gauche. Je suis pour ma part le co-secrétaire du Parti de gauche dans le Tarn.
Si nous avons décidé de vous écrire, c’est en raison de la tournure inquiétante que prennent depuis quelques semaines les événements qui se déroulent autour de la zone de Sivens. Nous considérons que nous sommes confrontés à un comportement pour le moins ambigu de ceux qui ont en charge le maintien de l’ordre républicain. Notre responsabilité politique était donc, nous a-t-il semblé, de vous interpeller.
Aujourd’hui, les experts ont rendu leur rapport et donné en grande partie raison aux opposants, en affirmant que le projet de barrage n’apparaissait pas comme une solution adaptée ; la ministre de l’écologie a déclaré que ce projet n’était plus d’actualité. Sur place, cela a suscité une mobilisation des partisans du barrage, qui ont décidé de passer à l’action en engageant une stratégie de la tension : cela concerne des personnes sur le terrain, mais aussi des élus et des responsables de syndicats agricoles. Lors des derniers week-ends se sont déroulées différentes actions, notamment des occupations de la voie publique, qui ont interdit la circulation sur un certain nombre de routes autour du site de Sivens.
Il n’est évidemment pas question pour nous de refuser à ces personnes qui ne sont pas de notre avis le droit de manifester, puisque nous revendiquons ce droit pour nous-mêmes. Ce qui pose problème, c’est le comportement des forces de l’ordre : la neutralité, qui devrait être la règle, ne nous paraît pas respectée.
Je voudrais donc faire connaître à votre commission quelques faits que nous avons relevés.
Le 1er février dernier avait été déclaré journée mondiale pour la sauvegarde des zones humides. À cette occasion, des animations étaient prévues sur le site de Sivens, notamment des conférences destinées à sensibiliser le public à cette question. Plusieurs dizaines de personnes ont donc tenté de se rendre sur place, mais, dès l’aube, les routes étaient interdites à la circulation : des blocages avaient été installés par des individus très organisés. Parmi eux, certains étaient équipés de treillis et de brassards : il ne s’agissait pas du tout d’une action spontanée.
La circulation était donc interrompue à différents endroits, et, à chaque fois, les gendarmes étaient présents. Jamais les forces de l’ordre ne sont intervenues pour rétablir la circulation ; elles ont laissé les manifestants parfaitement libres de leurs actions. À plusieurs reprises, les gendarmes, sollicités par des personnes qui souhaitaient se rendre sur le site de Sivens, ont répondu qu’on ne passait pas. Ce blocage s’est poursuivi toute la journée, dans une ambiance pour le moins cordiale entre les personnes qui barraient les routes et les forces de l’ordre présentes, et un peu moins cordiale entre les personnes qui souhaitaient se rendre sur le site et celles qui bloquaient les routes. Des agressions physiques, des menaces verbales ont eu lieu, dont Patrick Rossignol vous parlera tout à l’heure. Certains incidents auraient pu avoir des conséquences graves : un camion de pompiers, appelé pour porter secours à une personne victime d’un malaise – sans rapport avec ces événements –, a été bloqué ; les personnes qui barraient les routes ont arrêté une voiture qui se rendait sur le site, et, constatant qu’elle transportait notamment des cagettes de nourriture, ont soupçonné – à juste titre – que ces denrées étaient destinées aux occupants du site : ils ont alors ouvert les portes du véhicule et se sont emparés des objets. Ils s’en sont même vantés sur leur site Internet, avec un commentaire qui se voulait humoristique : « merci aux collaborateurs des zadistes pour leur “don” ». Ce qui est grave, c’est que la personne à qui ces choses ont été volées précise, dans sa plainte, que les gendarmes présents ne sont pas intervenus pour empêcher ce vol. À notre connaissance, les personnes à l’origine de ces agissements n’ont pas été inquiétées.
Les événements se sont poursuivis : une personne ayant retrouvé son véhicule les quatre pneus crevés est allée déposer plainte au commissariat de Gaillac ; je ne résiste pas au plaisir de vous lire un passage de la plainte telle qu’elle a été saisie : « aucune constatation n'a pu être réalisée par nos soins, car la victime n’a pas amené les roues complètes dégonflées. » Les gendarmes supposaient-ils vraiment que la personne allait apporter ses roues ?
Voilà quelle est l’ambiance sur le terrain. À la suite de ce dépôt de plainte, d’ailleurs, la personne a voulu regagner son véhicule et l’a cette fois trouvé renversé dans le fossé : elle est donc retournée porter plainte. Mais tout cela s’est déroulé dans l’indifférence générale. Les auteurs des faits n’ont pas été poursuivis, alors qu’un groupe de gendarmes se trouvaient en faction à 200 mètres de là. Ces événements ont lieu dans une zone truffée de gendarmes.
Ce même 1er février, une réunion de coordination des opposants au barrage était prévue dans la zone de Sivens mais, en raison des blocages, cette réunion a été déplacée à Gaillac, à une dizaine de kilomètres de là. Elle a eu lieu dans un appartement privé, mis à disposition par une militante, mais elle a été brusquement interrompue par l’arrivée de plusieurs gendarmes, armés, au motif que quelqu’un avait été agressé dans la rue et s’était réfugié dans cet appartement. La scène se déroule sur le palier, dans une très grande tension. Une des personnes qui se trouvait dans l’appartement prend la décision de filmer, mais un gendarme veut l’en empêcher. Alors que je m’interpose, le gendarme pointe son Taser à cinquante centimètres de la personne qui filmait, en lui ordonnant d’arrêter, et en ajoutant que sinon, cela va mal se terminer. Heureusement, un gradé arrive et, devant l’absurdité de cette situation, demande à ses hommes de partir ; tout a pu se terminer dans le calme.
On est là, je le rappelle, dans un immeuble, un lieu privé.
Un peu plus tard dans la journée, différentes exactions ayant eu lieu, plusieurs personnes décident d’aller porter plainte à Gaillac. Nous les accompagnons et une trentaine d’entre nous se retrouvent devant la gendarmerie. Ce sont là que se déroulent les faits les plus graves de la journée. Je vous lis l’une des dépositions – faite auprès du procureur de la République, elle engage celui qui l’a faite, puisqu’une déclaration inexacte est passible de poursuites : « Vers dix-sept heures, nous avons vu débouler trois véhicules, qui se sont garés à proximité du poste de gendarmerie. Cinq personnes en sont sorties et se sont dirigées rapidement dans notre direction ; l’une était armée d’une barre de fer d’environ soixante centimètres de long. […] Nous avons essayé de discuter. La tension est montée d’un cran lorsque la personne armée d’une barre de fer a violemment saisi l’appareil photo d’un journaliste présent sur place pour le fracasser sur le sol. » Nous sommes toujours devant le commissariat : les gendarmes observent la scène depuis la guérite d’accueil, sans intervenir, malgré les demandes répétées faites via l’interphone. Ils ne se décident enfin à s’interposer qu’après l’agression du journaliste. Les personnes sont raccompagnées à leur véhicule et repartent tranquillement. Des plaintes ont été déposées mais nous ne savons pas ce qu’elles sont devenues ; aucune personne n’a été inquiétée.
Ces incidents se poursuivent sur le site : le week-end suivant, une personne arrivant avec son véhicule voit une altercation et fait monter l’une des personnes prises dans cette altercation pour l’emmener : les manifestants favorables au barrage présents sur place renversent le véhicule – avec les passagers à l’intérieur. Une plainte a été déposée, mais aucune suite ne lui a été donnée, à notre connaissance. Tout cela dure sur le site de Sivens – toujours occupé – depuis plusieurs mois au moins. Il y a plus d’un an, déjà, une agression avait déjà eu lieu puisqu’une vingtaine d’individus étaient venus saccager une maison appelée « la métairie neuve », qui abritait des personnes occupant symboliquement le site. Les assaillants avaient tout détruit, cassé portes et fenêtres, répandu du répulsif… avant de repartir dans leurs véhicules dont les plaques d’immatriculation avaient été masquées : il s’agissait bien d’une opération commando. Nul n’a jamais été inquiété pour ces faits ; on n’a retrouvé personne.
Ce qui est constant, dans tous ces cas, c’est l’attitude que l’on peut qualifier de complaisante des forces de l’ordre. Jamais aucun des individus coupables de ces exactions n’a été inquiété. L’impunité dont ils semblent jouir, voire les encouragements de certains élus, renforcent leur détermination, les poussent à l’escalade et à la violence. C’est le fonctionnement même de la démocratie qui est en cause : pas plus tard que dimanche dernier, une candidate à l’élection départementale a été agressée, son véhicule tagué, ses pneus crevés. Là encore, plainte a été déposée. Je ne peux que qualifier ces méthodes de fascisantes ; elles sont, je le répète, le résultat de l’impunité dont certains ont le sentiment de bénéficier, mais aussi de l’attitude de certains élus qui exacerbent les tensions – et la période électorale n'est pas favorable au calme.
Nos organisations ne pensent pas que la violence soit un bon moyen de faire entendre nos voix. Le rôle des forces de l’ordre doit être de faire respecter la loi, pour tout le monde. Ce n’est malheureusement pas ce que nous constatons aujourd’hui autour de Sivens.
M. Patrick Rossignol, maire de Saint-Amancet. Ma position est particulière. Agriculteur céréalier ayant recours à l’irrigation – je cultive du maïs en société avec deux voisins –, membre de la FNSEA, je suis plutôt partisan des lacs collinaires dont l’utilisation me semble moins néfaste que le fait de puiser dans les nappes phréatiques. Au départ, je n’étais donc pas opposé au barrage de Sivens. C’est en tant que citoyen, père de famille et maire d’une petite commune du Tarn que je m’y suis intéressé ; en effet, je trouve choquant qu’alors qu’aucune urgence ne le justifie, l’on mobilise les forces de l’ordre au lieu de négocier avec les opposants au projet. J’ai plusieurs fois indiqué à M. Carcenac – que j’ai rencontré au Conseil général du Tarn et dans ma mairie – que sa position relevait de la folie : ce n’est pas en attisant les tensions par le recours toujours plus massif aux forces de l’ordre que l’on réglera la question. Je comprends le désarroi de Mme Lherm – pour un maire, une telle situation au sein de sa commune est intenable –, mais ce type de réaction ne fait qu’envenimer la situation. En tant qu’agriculteur, je me suis également intéressé au coût du projet, quatre à dix fois supérieur à celui du lac collinaire que j’utilise actuellement. Enfin, on aurait pu éviter d’envisager la construction du barrage dans une zone à protéger. En considérant l’ensemble du dossier, je suis parvenu à la conclusion que les opposants au barrage avaient raison – prise de position qui m’a valu les reproches de la profession agricole, y compris de mes propres associés.
Lors des manifestations qui ont précédé celle du 1er février, notamment les 25 et 26 octobre, j’ai pu constater le rapport de forces entre les opposants et les gendarmes. La présence de ces derniers n’avait rien de nécessaire – il n’y avait ni personnes ni matériel à protéger – et relevait de la provocation. Il faudrait comprendre qui en est responsable, même si l’on ne peut excuser le comportement des jeunes qui ont participé à la confrontation.
Le 1er février, je suis revenu sur le site, à la fois pour continuer à me tenir informé des événements, mais aussi du fait de la Journée mondiale des zones humides – autre enjeu important de mon travail. En effet, je m’occupe également du tourisme, encadrant des activités sportives telles que la spéléologie, le canyoning et la randonnée. Parti en confiance, je suis tombé sur des barrages imprévus ; m’étant garé à distance, je suis allé à la rencontre de ceux que je pensais être des agriculteurs, dans l’idée de discuter avec tout le monde. Si la conversation s’est bien déroulée avec certains d’entre eux – certainement de vrais agriculteurs –, je suis ensuite tombé sur des gens qui m’ont bousculé et menacé avec des barres de fer, promettant de retourner mon véhicule avec la fourche du tracteur. Parmi les insultes que j’ai essuyées : « J’espère que vos électeurs vous cracheront à la gueule quand ils sauront que vous soutenez ces rats ! » Un autre a alors répliqué : « Ce ne sont même pas des rats, c’est même pire, cette merde ! » Voilà le genre de phrases qui interdisent toute discussion.
La présence sur place des gendarmes – qui avaient une attitude correcte et surveillaient la situation – semble dans ce cas se justifier, même si d’autres témoins ont affirmé qu’un peu plus tard, ils ont clairement pris parti pour l’un des camps. En revanche, à Gaillac – où je me suis rendu ensuite –, le comportement ambigu des forces de l’ordre a été réellement révoltant. Venu pour assister à une réunion, j’ai appris l’arrivée sur la place des partisans du barrage ; en tant que maire – et n’étant pas habillé comme un zadiste –, j’ai cru pouvoir m’interposer. Descendant dans la rue, je suis allé à leur rencontre pour leur demander d’arrêter leur action. En réponse, je me suis à nouveau fait insulter et menacer par des individus en treillis armés de barres, le bras décoré d’une bande de scotch. Étonnamment, les gendarmes sont arrivés très vite, mais se sont contentés de discuter avec les partisans du barrage avant de remonter vers l’appartement en me bousculant presque au passage, pour y rejoindre plusieurs autres collègues. Les y voir en si grand nombre, lourdement équipés, était choquant. Quant à l’individu qui prétend avoir été agressé, ayant vu la scène et lu son témoignage dans La Dépêche du Midi, je doute de la réalité des coups qu’il a reçus et du caractère fortuit de sa présence sur les lieux.
Revenu à mon véhicule, je l’ai trouvé fracassé à coups de barres. À la gendarmerie, on a écouté avec attention ma plainte concernant le véhicule, mais l’on a refusé d’enregistrer la partie relative aux menaces. On m’a demandé si je n’avais pas vu quelqu’un se promener avec une arme blanche ; lorsque j’ai émis des réserves sur la réalité de l’agression, on m’a répondu que je n’avais pas à mettre la plainte en doute. La différence de traitement est ici flagrante. Une fois dehors, j’ai vu des voitures arriver et quatre ou cinq personnes en descendre, armées de barres ; j’ai alors appelé à l’aide, demandant aux gendarmes par interphone de venir s’interposer. Le gendarme en faction m’a alors répondu : « Non, ils n’ont rien dans les mains, je ne vois rien ». Les forces de l’ordre ont attendu l’agression du jeune journaliste et de deux autres personnes – visés en raison de leurs origines maghrébines ou à cause de leurs appareils photo ? –, et mon deuxième appel, pour sortir et nous séparer. Se promenant toute la journée avec des barres sans que la gendarmerie intervienne, les partisans du barrage font penser à une milice ; lorsque j’ai indiqué l’un d’entre eux à un gendarme, celui-ci l’a ceinturé gentiment – presque une accolade – et l’individu a jeté sa barre à travers les grilles de la gendarmerie avant d’être relâché. Les gendarmes ont laissé partir toutes ces personnes sans relever les identités. En revanche, lorsqu’un journaliste, membre du groupe, a commencé à s’indigner, un gendarme – sûrement un gradé – s’est mis à l’injurier, criant : « Vous m’emmerdez tous, d’un côté comme de l’autre ! » Cette histoire aurait pu se terminer par un drame et un scandale au niveau national.
Dans l’ensemble, les gendarmes obéissent aux ordres qu’ils reçoivent, même s’ils semblent parfois perdus et qu’il leur arrive de prendre des initiatives malheureuses – j’espère que c’est de cela qu’il s’agit dans l’incident de Gaillac. En revanche, on parle peu de la responsabilité des élus – départementaux ou syndicaux – qui ont incité au déploiement des forces de l’ordre et qui continuent, en cette période de campagne électorale, à attiser le feu et à dresser les uns contre les autres. La ZAD représente pourtant une société en miniature : si l’on y compte des personnes paumées et sûrement des délinquants, l’on y rencontre aussi des jeunes qui pourraient être nos enfants. Certains d’entre eux ont des capacités intellectuelles élevées – j’y ai vu des ingénieurs et une jeune fille qui a étudié à Sciences Po – et sont animés d’un idéal. Je conseillerais d’aller les voir car j’ai été agréablement surpris en les rencontrant. Les élus devraient se montrer plus responsables : le projet étant suspendu, il faut qu’ils reprennent la négociation au lieu d’attiser les tensions, puis d’envoyer les forces de l’ordre dans l’espoir que cette attitude autoritaire leur apporte des bénéfices électoraux.
M. Pascal Popelin, rapporteur. L’abandon définitif du projet de barrage n’est pour l’heure pas certain ! Dans le courriel que vous nous avez adressé le 10 février 2015, sollicitant une audition devant cette commission d’enquête, vous dénoncez les agissements des partisans du barrage, évoquant des interdictions d’accès et des actes graves : violences physiques, menaces, destructions de biens. Pour qualifier ces faits – dont certains, comme le saccage de la voiture de M. Rossignol, semblent avérés –, vous utilisez le terme d’« exactions ». Vous avez également évoqué tout à l’heure la « stratégie de la tension ». Monsieur Cottaz-Cordier, ces faits sont-ils l’apanage des seuls groupes qui revendiquent le soutien au projet ? Quels termes emploieriez-vous s’agissant des modes d’action de certains opposants au barrage – que seul M. Rossignol a brièvement mentionnés ?
M. le président Noël Mamère. J’ai entendu avec beaucoup d’intérêt vos témoignages, qui correspondent assez bien à ce que j’avais moi-même pu observer sur le terrain une semaine avant le drame : une très grande tension et le sentiment, chez ceux qui occupent le site, d’être soumis à des formes d’intimidation et quelquefois d’humiliation.
Nous avons écouté le général qui a dirigé l’école de Saint-Astier ainsi que le général Favier, directeur général de la Gendarmerie nationale, et nous savons que le maintien de l’ordre est assuré par des hommes bien formés qui, normalement, ont pour vocation non d’aller à l’affrontement mais de maintenir à distance. N’avez-vous pas le sentiment que les hommes envoyés sur place ne sont pas formés à une occupation aussi longue – celle de la ZAD dure depuis plusieurs mois, alors que les opérations de maintien de l’ordre sont généralement brèves – et ont du mal à s’y habituer ?
Comme Notre-Dame-des-Landes ou Roybon, Sivens est un cas d’école qui témoigne de la difficulté des élus et des syndicalistes à trouver les moyens de la médiation. Vous qui êtes vous-mêmes élus, comment expliquez-vous cette difficulté, après tant de temps ? À écouter Patrick Rossignol, on a l’impression que nombre d’élus préfèrent à la médiation une stratégie de la tension. Votre témoignage, monsieur Rossignol, est d’autant plus intéressant que vous êtes membre du syndicat agricole majoritaire, extrêmement favorable au projet de barrage. Au-delà des raisons pour lesquelles on en est arrivé là, et que vous avez expliquées, comment trouver des lieux et des outils de médiation lorsqu’une occupation dure aussi longtemps ?
Vos témoignages sur le comportement des forces de l’ordre sont accablants. Ils attestent sinon d’une complicité, du moins d’une facilité donnée à certains et non à d’autres. Notre commission d’enquête les enregistre ; toutefois, notre rôle n’est pas de revenir sur ces questions mais d’entendre ce que vous dites aujourd’hui : vous qui vivez la situation au quotidien – surtout vous, monsieur Rossignol, qui êtes agriculteur irrigant –, quelles pistes suggéreriez-vous pour que ce genre de chose n’arrive plus ? Il en est une que beaucoup évoquent et à laquelle je crois que le Gouvernement travaille : revoir les procédures d’enquête d’utilité publique. C’est à mon avis la clé pour éviter ce type de conflit.
M. Bernard Cottaz-Cordier. Je répondrai au rapporteur que les faits en question ne sont évidemment pas l’apanage des pro-barrage : bien sûr, il y a eu de part et d’autre des affrontements et, si l’on veut utiliser ce terme, des exactions. Le problème – et c’est là que le rôle de l’autorité publique et des forces de l’ordre est important – est la différence d’attitude face à ces actes.
Lorsque des exactions ont été commises par des opposants au barrage, ces derniers ont été plusieurs fois interpellés, ont subi des contrôles d’identité et même des condamnations. Ainsi, le 21 février, lors d’une manifestation organisée à Toulouse en soutien aux zones à défendre et où, selon Le Monde, « le dispositif des forces de l’ordre était particulièrement important », « pas moins de 17 manifestants ont été interpellés », peut-on lire dans ce journal, « principalement des casseurs ». Effectivement, il y a eu de la casse, et loin de nous l’idée de soutenir que c’est en allant casser des vitrines à Toulouse que l’on fera progresser la cause sur ces sujets. Mais le 23, deux jours plus tard, quatre personnes passaient en jugement et étaient condamnées à des peines d’emprisonnement avec sursis, à des amendes : ce n’est pas ce qui arrive aux autres personnes dont j’ai évoqué les agissements. Et c’est aussi ce sentiment d’une différence de traitement qui crée la tension sur le terrain.
Le 18 septembre, à Albi, des agriculteurs pénètrent dans la ville avec des tracteurs traînant des bennes de fumier qu’ils viennent déverser jusque devant les grilles de la préfecture, puis se rendent à la cité administrative où, trouvant porte close, ils brisent les barrières, entrent, déversent des tonnes de fumier qu’ils s’appliquent à faire quasiment entrer dans les bâtiments, ce qui imposera des travaux de nettoyage longs de plusieurs jours, donc coûteux. À aucun moment les forces de l’ordre n’interviennent : tout cela se déroule dans l’impunité la plus totale.
Cette impression qu’il y a deux poids, deux mesures, exacerbe les tensions et durcit les positions. Loin de moi, et des partis que je représente, l’idée de justifier les agissements contraires à la loi. Mais, en ce qui concerne Sivens, il faut reconnaître que, si les opposants n’avaient pas pris ces positions assurément discutables du point de vue de la légalité – en occupant une zone, une maison qui appartient au conseil général, où ils sont encore à ce jour –, si ces lanceurs d’alerte ne s’étaient pas ainsi élevés contre le projet de barrage, dont tout le monde considère désormais qu’il est mauvais, caduc, qu’il ne devra pas être réalisé de la manière initialement prévue, sans compter les problèmes de conflits d’intérêts, bref si ces personnes n’avaient pas franchi les limites de la légalité, ce projet serait aujourd’hui en cours de réalisation.
Comment améliorer les choses et faire en sorte que ces situations ne se reproduisent pas ? M. le président a évoqué la procédure d’enquête publique ; c’est effectivement sur ce terrain que les choses doivent être modifiées. On le voit dans tous les cas qui ont été cités, de tels projets ne peuvent se développer sans concertation locale avec la population, car ils ne peuvent être acceptés sans participation des citoyens à la prise de décision.
M. Patrick Rossignol. On demande toujours aux opposants au barrage de reconnaître les exactions, en particulier celles venant de la ZAD. Elles existent, on ne les nie pas, et moi moins que tout autre : j’ai vu des choses inacceptables. J’aimerais néanmoins que la demande de reconnaissance n’aille pas toujours dans le même sens et que l’on établisse une comparaison entre les différents agissements. Les dégradations de vitrines au conseil général, on les a laissées commettre même si certains les ont jugées bizarres. Mais il faut voir ce qu’ont subi les zadistes, qui sont des parias aux yeux de beaucoup et que l’on fait passer pour tels, un peu comme des Roms qui seraient parqués là et qu’il faudrait éjecter. Ils en ont fourni une liste, et nous avons tout un dossier qu’il nous faudrait la journée entière pour vous lire. La comparaison montre un déséquilibre. Simplement, les zadistes sont de plus petites gens. On a parlé de mon fourgon dans la presse parce que j’ai dit que j’étais maire : si c’était le véhicule derrière moi qui avait été cassé, ce serait passé inaperçu. Il faut donc faire preuve d’honnêteté des deux côtés, et ne pas toujours demander aux mêmes de baisser la tête et de reconnaître ce que font certains parmi eux. Dans la ZAD qui est, je le répète, une mini-société, il y a des bons et des moins bons.
Comment parvenir à gérer de telles situations ? Outre l’enquête d’utilité publique et la nécessité d’une implication accrue du citoyen, il y a peut-être quelque chose à revoir dès le stade des études préalables. Il n’est pas normal que, dans le cas de Sivens, celles-ci aient été confiées à un organisme comme la Compagnie d’aménagement des coteaux de Gascogne (CACG), que l’on connaît bien dans le monde agricole, et que l’on critique même si l’on y recourt – nous l’avons d’ailleurs écartée pour l’un des lacs collinaires que j’utilise. Il aurait fallu, au stade des études, plusieurs intervenants au lieu d’un seul – le constructeur qui plus est !
Toujours à ce stade, un problème se pose qui concerne les élus. Je ne veux pas les accabler : pour participer à des réunions à la communauté de communes, autour du SCOT, etc., je sais que l’on reçoit quantité de « pavés » que l’on a du mal à lire. Je suppose que cela se passe de la même manière au conseil général, même si les élus sont peut-être plus disponibles que je ne peux l’être comme maire d’une petite commune. Je comprends donc que l’on puisse voter un projet en confiance. J’aimerais simplement que les élus reconnaissent leur erreur, admettent qu’ils n’ont pas bien lu le projet et fassent marche arrière. Je suis montagnard, je sais qu’il faut parfois être capable de faire demi-tour. De plus, cette situation nourrit la suspicion alors qu’il serait bon que les élus redorent un peu leur blason en période électorale.
Quant au préfet – en réalité, deux préfets se sont succédé au cours de la période –, il n’a pas joué dès le début le rôle de conciliation qu’il a désormais endossé. Au départ, influencé par les élus, il a misé sur le rapport de forces pour décaper la zone avec l’aide des forces de l’ordre, au lieu d’assurer d’emblée une médiation. Du coup, il ne parvient plus à maîtriser les élus qui continuent de jeter de l’huile sur le feu. Et, actuellement, tout le monde se rejette la balle : l’État dit que c’est au conseil général de prendre la décision, le conseil général estime que l’ordre n’est pas de son ressort, la commune est désemparée car elle manque de moyens. Peut-être faut-il donc réfléchir aussi à la question de savoir qui peut prendre l’initiative d’une négociation en pareil cas.
En ce qui concerne enfin la formation de la gendarmerie, il y a peut-être en effet un problème. Je ne connais pas bien la question, mais il semble qu’il y ait différents niveaux. Certains gendarmes qui relèvent de mon secteur et avec qui j’ai discuté ne me paraissent pas avoir bénéficié d’une préparation avant d’être envoyés sur place. Pour eux, quand ils sont chez moi à Dourgne, il est davantage question de relation humaine que de rapport de forces. Ces gendarmes-là sont désemparés. Tous ne sont donc pas formés à la même école.
M. le président Noël Mamère. En effet, il y a des formations différentes. Plus précisément, les gendarmes vraiment formés sont les gendarmes mobiles, issus de l’école de Saint-Astier, considérée comme l’une des meilleures au monde du point de vue de la conception du maintien de l’ordre. Les autres ne sont pas formés, et peuvent dès lors se trouver dans la situation du gendarme que vous décriviez, qui sort un Taser dans un lieu privé alors que ce n’est pas du tout la règle.
Nous verserons au dossier de notre commission d’enquête tous les éléments que vous nous avez fait parvenir par écrit. Si vous en avez d’autres à nous transmettre, n’hésitez pas à le faire. Nous vous remercions à nouveau d’avoir accepté notre invitation, ce qui nous permet d’être éclairés sur l’avant ainsi que sur l’après, que nous devons aussi intégrer à notre réflexion. Comme vous pouvez le constater, nous avons souhaité entendre tout le monde, y compris ceux qui sont opposés au barrage et qui ont des témoignages aussi importants que les vôtres à nous apporter.
*
* *
Table ronde, ouverte à la presse, réunissant cinq commandants (Mohammed BELGACIMI, Christian GOMEZ, Roland GUILLOU, Éric LE MABEC, et René-Jacques LE MOËL) de compagnies républicaines de sécurité (CRS) étant intervenus à Notre-Dame-des-Landes
Compte rendu de l’audition du jeudi 5 mars 2015
Table ronde, ouverte à la presse, réunissant cinq commandants de compagnies républicaines de sécurité (CRS) étant intervenus à Notre-Dame-des-Landes (commandants Mohammed Belgacimi, Christian Gomez, Roland Guillou, Éric Le Mabec, et René-Jacques Le Moël).
M. le président Noël Mamère. Messieurs, soyez les bienvenus. La commission d’enquête sur les missions et modalités du maintien de l’ordre a été créée à la suite des événements tragiques survenus à Sivens. Nous n’avons évidemment pas le droit d’empiéter sur l’enquête judiciaire en cours, mais nous cherchons à savoir comment s’opère le maintien de l’ordre dans notre pays, et comment il pourrait être amélioré.
Conformément aux dispositions de l’article 6 de l’ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, je vous demande de bien vouloir prêter le serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité.
(Les commandants Mohammed Belgacimi, Christian Gomez, Roland Guillou, Éric Le Mabec, et René-Jacques Le Moël prêtent serment.)
M. Pascal Popelin, rapporteur. Messieurs, les unités que vous commandez ont récemment connu des réorganisations, notamment en termes d’effectifs. Quel impact cela a-t-il eu sur votre organisation interne et sur l’efficacité de vos missions ?
Les équipements et les armements dont vous disposez sont souvent au cœur des débats. Nous serions heureux de recueillir, à ce sujet, l’avis des utilisateurs que vous êtes.
Quelles sont les conséquences des missions de longue durée sur le fonctionnement des compagnies ? Lors de ces missions, qui peuvent durer plusieurs jours ou plusieurs semaines, des consignes doivent être transmises, et des relèves organisées. Il faut aussi gérer la fatigue. En outre, la présence continue sur le terrain implique que se noue une relation avec les personnes que vous êtes amenés à rencontrer, ce qui peut avoir des inconvénients et des avantages. L’évolution des modes de protestation crée aussi sans doute pour vous de nouvelles contraintes. Faut-il y répondre en modifiant votre organisation ou en changeant la façon dont sont engagés les effectifs ?
Avant, avec ou après les vôtres, il est parfois fait appel à des unités qui, contrairement aux CRS, ne sont pas spécialement formées au maintien de l’ordre. Que pensez-vous de cette mixité ? Le préfet de police de Paris nous a indiqué que les unités de police judiciaire participaient quasiment systématiquement aux opérations de maintien de l’ordre se déroulant dans la capitale afin d’interpeller les personnes qui commettent des infractions ou des délits. Comment leurs interventions s’articulent-elles avec votre action ? Cette mixité existe-t-elle dans d’autres cadres ? Le cas échéant, fonctionne-t-elle bien ?
Commandant Roland Guillou, CRS 32 du Havre. Les effectifs ont récemment diminué. Aujourd’hui, une unité de service général de CRS, telle que celle que je commande, comprend environ 132 personnels actifs dont les trois cinquièmes sont affectés à des emplois d’ordre public, soit 81 ou 82 personnels.
Cette baisse des effectifs n’altère en rien notre modus operandi. Nous nous adaptons en obéissant aux mêmes règles qu’auparavant. Nous accomplissons nos missions sans transformer notre mode de fonctionnement.
Il va de soi que, en tant que gestionnaire, je préférerais disposer d’un effectif plus nombreux lors des opérations d’ordre public délicates. Toutefois, celles-ci sont rares et, la plupart du temps, les manifestations sont très paisibles. En général, les CRS ne sont présents qu’en deuxième ou troisième rideau, car les autorités civiles, notamment préfectorales, estiment que la gradation de l’intervention doit d’abord engager des personnels en civil, puis des personnels en tenue du commissariat.
M. le président Noël Mamère. Quelles différences avez-vous constatées entre les opérations ponctuelles que vous menez habituellement lors de manifestations généralement paisibles, et votre intervention à Notre-Dame-des-Landes, site d’occupation longue ? Quelles sont les principales difficultés auxquelles vous êtes confrontés pour maintenir l’ordre dans le respect de la liberté d’expression ?
Mme Nathalie Nieson. En plus de la durée, le cas de Notre-Dame-des-Landes se caractérise probablement par la dispersion géographique des lieux d’occupation. Cela modifie-t-il votre approche du maintien de l’ordre ?
Commandant Christian Gomez, CRS 40 de Plombières-lès-Dijon. La CRS 40 s’est rendue à deux reprises à Notre-Dame-des-Landes. Nous étions placés sous l’autorité du colonel commandant la gendarmerie départementale, et sous les ordres d’un lieutenant-colonel de la gendarmerie mobile. Si nous évoluons principalement en zone urbaine, nous sommes aussi entraînés pour agir en zone rurale où nous ne rencontrons aucun problème particulier. Nos entraînements ont lieu sur des sites très adaptés et divers : villages de combat ou forts militaires, friches industrielles…
Le cas de Notre-Dame-des-Landes présente des différences avec celui des manifestations de grande ampleur au cours desquelles nous avons l’habitude d’intervenir. Il n’est pas facile d’évaluer le nombre des personnes présentes sur les sites occupés, et l’intervention en pleine campagne rend difficile leur localisation. Les réunions préparatoires organisées par la gendarmerie et les dossiers fiables, complets et détaillés dont nous disposons atténuent toutefois les difficultés. Les indications topographiques et les clichés photographiques permettent d’évoluer dans de bonnes conditions de jour comme de nuit. Sur le théâtre d’opérations, l’adaptation de mon unité a pu être immédiate.
M. le président Noël Mamère. À Notre-Dame-des-Landes, vous interveniez en soutien de la gendarmerie mobile, sous son autorité hiérarchique ?
Commandant Christian Gomez. Nous sommes placés sous l’autorité du préfet du département et mis à la disposition du colonel commandant le groupement de gendarmerie qui est l’autorité habilitée à décider de l’emploi de la force, le concepteur du service. Nous sommes temporairement placés sous ses ordres pour toutes nos actions. Selon le nombre des forces présentes, un échelon intermédiaire, un lieutenant-colonel de la gendarmerie, anime et commande des CRS ou des gendarmes mobiles. Lorsque plusieurs unités de CRS sont engagées, il est parfois mis en place un commandement de groupe de compagnies.
M. Noël Mamère. Les dossiers dont vous disposez comportent des photographies : y trouve-t-on celles de manifestants ?
Commandant Christian Gomez. Ces dossiers d’ambiance comprennent des informations topographiques et des planches photographiques des lieux sur lesquels nous sommes amenés à nous rendre. En l’espèce, il s’agissait de photos des axes routiers par lesquels devaient passer les engins de travaux publics que nous étions chargés d’aider à cheminer jusqu’à des bâtiments à démolir. En aucun cas ces dossiers très complets relatifs au déroulement des opérations – rôle de chaque unité, chronologie de l’opération… – ne comportent de photographies d’individus – je n’en ai en tout cas jamais vu.
M. le rapporteur. Dans un cas comme celui de Notre-Dame-des-Landes, les unités sont-elles engagées dans leur entier ? Combien de temps restent-elles sur place ? Qu’en est-il des détails pratiques comme l’hébergement ?
Les modes d’organisation du commandement semblent variables. Ne rencontrez-vous jamais de problèmes d’articulation à ce niveau ?
Commandant Christian Gomez. Il n’y a jamais de problème dans l’articulation du commandement pour la simple et bonne raison que les rôles de chacun sont très précis : le colonel commandant le groupement de gendarmerie est le patron de l’ensemble du dispositif, il a sous ses ordres des officiers de gendarmerie qui commandent les escadrons des forces mobiles de gendarmerie et, parfois, lorsque plusieurs unités de CRS interviennent, un chef de groupement opérationnel qui est soit un commissaire de CRS, soit un commandant fonctionnel qui n’est pas commandant de compagnie. Lors de la première intervention des CRS à Notre-Dame-des-Landes, on a compté jusqu’à douze unités commandées par un commandant fonctionnel.
Commandant René-Jacques Le Moël, commandant à l’échelon fonctionnel de la direction zonale des CRS Ouest. Nous sommes un service spécialisé à vocation nationale, ce qui se traduit par le fait que, la plupart du temps, les compagnies arrivent sur les lieux d’une opération au dernier moment. Évidemment, les missions sont préalablement étudiées du niveau conceptuel à celui de la compagnie. Il revient au groupement opérationnel de préparer la mission en amont. Nous assurons le soutien logistique et la conception d’un dossier qui comporte des éléments contextuels – présentation de l’événement, présence d’opposants, dangerosité… – et une déclinaison de la mission globale au niveau de l’unité qui se voit assigner ses propres objectifs.
M. le rapporteur. Combien de temps dure en général la mission ?
Commandant René-Jacques Le Moël. Cela peut dépendre de la situation. Dans l’hypothèse où la mission se prolonge, le groupement opérationnel est chargé d’assurer la relève de l’unité sur le terrain.
Commandant Mohammed Belgacimi, CRS 19 de La Rochelle. Les missions sont généralement très brèves. Ma compagnie s’est par exemple rendue trois fois à Notre-Dame-des-Landes pour des missions d’une seule journée. Nous n’assurons pas de présence en continu sur le terrain ; les compagnies se relèvent à un rythme très rapide et n’effectuent que des opérations ponctuelles.
M. le rapporteur. Êtes-vous venus en appui de forces présentes en continu, ou la rotation des compagnies est-elle une règle générale ?
Commandant Mohammed Belgacimi. La rotation est la règle générale : aucune ne reste en permanence sur la mission.
M. le président Noël Mamère. Je crois que les compagnies de gendarmes mobiles assurent des missions sur le plus long terme.
Commandant Mohammed Belgacimi. Je ne suis pas en mesure de vous le confirmer.
M. le président Noël Mamère. Vous ne vous parlez pas beaucoup ?
Commandant Mohammed Belgacimi. Tout se passe très bien entre nous sur les missions, mais nous n’avons pas beaucoup l’occasion de nous rencontrer entre unités. Le travail est préparé en amont : nous arrivons avec une mission ponctuelle et précise à effectuer. Nous n’avons pas l’occasion d’échanger à ce stade avec les unités de gendarmerie, même si, en amont, des rencontres ont pu avoir lieu. À Notre-Dame-des-Landes, la veille des opérations, tous les commandants assistaient à une réunion préparatoire avec les services de police et de gendarmerie.
M. Guy Delcourt. Il y a quelques semaines, nous avons entendu le général Bertrand Cavallier, ancien commandant du Centre national d’entraînement des forces de gendarmerie de Saint-Astier, en Dordogne. Les CRS disposent-elles d’un centre de formation équivalent ?
Le général Bertrand Cavallier estime que les forces spéciales devraient intervenir de façon assez précoce sur des sites comme Sivens ou Notre-Dame-des-Landes, et qu’il serait préférable que les unités départementales de gendarmerie restent dans leurs cantonnements. Partagez-vous ce point de vue ?
J’ai bien compris que vous intervenez en force d’appui en milieu rural. Qu’en est-il en milieu urbain ?
M. Philippe Goujon. Sera-t-il possible de disposer de l’un des dossiers de préparation que vous évoquiez ?
M. le rapporteur. Nous ferons cette demande au ministère.
M. Philippe Goujon. L’organisation et les pratiques des CRS, qui constituent un modèle pour nombre de nations démocratiques, sont fondées sur une approche traditionnelle du maintien de l’ordre. Or nous sommes confrontés aujourd’hui à de nouveaux défis. Votre formation et les moyens dont vous disposez, parfaitement adaptés hier, ne le seront peut-être plus demain. Comment évoluerez-vous pour passer d’un maintien de l’ordre à l’autre ?
Les actes violents sont de plus en plus nombreux – vous comptez sans doute davantage de blessés dans vos rangs. Votre organisation et la réglementation sont-elles adaptées à cette situation ? Dans le schéma classique, vous deviez maintenir les manifestants à distance et assurer leur dispersion. Aujourd’hui, sans parler de guérilla urbaine, vous pouvez vous retrouver au contact de personnes prêtes à employer des méthodes violentes pour se maintenir sur le territoire où elles sont retranchées.
Comment qualifieriez-vous votre lien avec l’autorité civile ? Avez-vous parfois le sentiment d’être livrés à vous-même ? Souhaiteriez-vous qu’elle soit plus présente, qu’elle donne des instructions plus claires, qu’elle vous encadre davantage ?
Les sommations telles qu’elles existent aujourd’hui ne devraient-elles pas évoluer afin d’être mieux comprises par les manifestants – je pense à une solution plus visuelle ou sonore ?
Comment se répartissent vos missions entre maintien de l’ordre et sécurisation par exemple ?
Commandant Éric Le Mabec, CRS 25 de Pau. Les unités de CRS sont destinées à gérer le maintien de l’ordre le plus sensible, notamment par la gradation de l’emploi de la force. Elles doivent faire preuve d’une cohésion maximale et maîtriser leurs interventions. Il est donc indispensable que les personnels soient parfaitement entraînés et pleinement informés de la législation relative aux moyens utilisés et aux manœuvres.
Au niveau de la direction centrale des compagnies républicaines de sécurité (DCCRS), la formation individuelle et collective est déclinée sur plusieurs centres de formation, à Dijon, Toulouse ou Rennes. Nous y envoyons en stage les fonctionnaires des différents services pour garantir une uniformité de la formation, particulièrement utile lorsque les unités sont regroupées. Un système de formation interne aux unités est également mis en œuvre avec ses référents, et ses sites d’entraînement de tous types.
Commandant Christian Gomez. Environ vingt-cinq jours de formation sont dispensés annuellement, notamment sur trois périodes bloquées de trois jours, dites « de recyclage de l’unité », auxquelles sont accolées des journées d’entraînement technique. Ces périodes permettent de travailler les techniques et la cohésion de l’unité. D’autres journées éparses d’entraînement technique ou d’entraînement au tir peuvent être organisées par section au sein des unités en fonction des besoins de chacun. Au total, nos personnels bénéficient d’une trentaine de journées de formation annuelles.
Malgré le très fort besoin en emploi, la direction centrale s’attache à bloquer ces périodes afin de garantir la qualité de la formation du personnel. L’emploi est évidemment prioritaire, mais on ne badine pas avec la formation.
M. le rapporteur. Je me permets de revenir sur la question des matériels et des moyens, puisque vous les évoquez. Ont-ils évolué ? Vous paraissent-ils adaptés à l’évolution de vos missions ?
Commandant René-Jacques Le Moël. Le directeur central a voulu que les périodes de formation soient sanctuarisées, ce qui témoigne de l’importance qu’elle revêt pour lui.
Le port et l’utilisation des divers équipements mis à notre disposition sont soumis à une habilitation initiale et à un recyclage régulier afin de vérifier le niveau technique des personnels qui les servent.
Nos matériels me paraissent parfaitement adaptés – mes camarades qui sont en unités vous répondront mieux que moi sur le sujet. Ils sont en tout état de cause parfaitement maîtrisés. Ils évoluent aussi régulièrement avec les risques auxquels nous pouvons être exposés et au fur et à mesure des réponses que l’on trouve face à la menace.
M. le président Noël Mamère. De quel type de matériel les CRS sont-ils équipés ?
M. le rapporteur. La question des lanceurs de balles de défense (LBD) est régulièrement posée. D’autres équipements dont on parle beaucoup, comme les Flash-Ball, sont en dotation dans des unités qui interviennent avant, après ou avec vous, sans être spécialisées dans le maintien de l’ordre. Cela me permet de revenir sur le problème de la mixité des interventions.
M. le président Noël Mamère. La question relative à l’équipement est d’actualité puisque s’ouvre aujourd’hui un procès pour des blessures graves infligées par un tir de Flash-Ball.
Commandant Roland Guillou. Les personnels dont nous devons assurer la sécurité disposent de moyens de protection comme les casques de maintien de l’ordre avec des visières, les lunettes balistiques protégeant des éclats éventuels, les gilets pare-balles, les gilets tactiques avec des coques de protection au niveau des épaules, les gilets pare-coups, les jambières…
Les moyens employés dépendent de la nature de la mission. S’il ne se produit rien durant une manifestation, certains matériels ne sont pas sortis. En cas d’usage, tout se fait sur instruction du commandant de compagnie. Dès le départ, sont établies des fiches de perceptions de moyens et d’armement désignant nominativement les personnels concernés pour chaque équipement. La mise à terre de ces moyens, et a fortiori leur usage, seront, quoi qu’il arrive, décidés par le commandant de la force publique.
Les CRS ne disposent pas de Flash-Ball, mais de lanceurs de balles de défense…
M. le président Noël Mamère. Qui peuvent aussi être dangereux !
Commandant Roland Guillou. Je le reconnais. C’est pourquoi les personnels qui les utilisent sont spécialement formés. Leur nombre est limité – quarante-huit fonctionnaires sont habilités – car il faut avoir suivi une formation d’une journée et subi un examen de passage. Ceux qui ne réussissent pas ne sont pas équipés.
L’usage du LBD est permis dans des situations bien précises. En tout état de cause, un CRS ne peut en faire usage que s’il en reçoit l’instruction pour viser une personne bien déterminée dans des conditions strictes : cette personne doit impérativement se trouver à plus de dix mètres – en deçà, le tir serait trop dangereux – et seul son tronc peut être visé, à l’exclusion du visage et des parties génitales.
La discipline, la cohésion et la formation propres aux unités spécialisées – qu’il s’agisse des compagnies républicaines de sécurité ou des escadrons de gendarmes mobiles –, commandées par des officiers responsables dont le maintien de l’ordre est le métier principal, ont pour conséquence que les personnels ne font pas n’importe quoi.
La mixité n’existe pas. Il nous arrive de travailler à côté d’autres forces, mais le commandant de CRS commande ses effectifs, et le chef d’escadron les siens. L’autorité supérieure agit éventuellement en tant qu’organisateur.
M. le rapporteur. Hormis la présence éventuelle d’officiers de police judiciaire ou de policiers qui procèdent à l’interpellation des casseurs, des unités non spécialisées peuvent aussi être engagées pour exercer des missions de maintien de l’ordre.
M. le président Noël Mamère. Et il s’agit sans doute des cas qui posent le plus de problèmes. Depuis le début de nos auditions, nous constatons que certains personnels, comme les CRS et les escadrons de gendarmerie mobile, sont parfaitement formés au maintien de l’ordre public et qu’ils appliquent une doctrine rigoureuse qui n’a pas varié depuis longtemps. Les accidents, et ce qu’il faut bien appeler les bavures, se produisent lorsqu’il est fait appel à des personnels moins formés.
M. le rapporteur. On nous a répondu que les formations existaient aussi pour ces personnels, mais elles sont sans doute moins poussées que les vôtres. Nous ne faisons à ce stade que nous poser des questions.
Commandant René-Jacques Le Moël. Je ne peux répondre que pour ce qui concerne les CRS.
Notre structure est pyramidale. L’utilisation des moyens, extrêmement encadrée, fait l’objet d’un compte rendu ultérieur. Lorsque nous donnons des instructions, toutes nos conversations sont enregistrées et peuvent être exploitées. Par ailleurs, les interventions sont filmées. Cela offre en effet une alternative à l’interpellation immédiate qui pourrait parfois être contre-productive : il peut être préférable de remettre des images à l’autorité judiciaire qui procédera à des interpellations par la suite.
M. Guy Delcourt. Même si nous savons relativiser les images que diffuse la télévision, nous avons constaté que, après une intervention incontrôlée de la brigade anti-criminalité (BAC), certaines manifestations ont dégénéré. Est-ce sur votre instruction que la BAC intervient pour des interpellations ?
Commandant Mohammed Belgacimi. Les autres services ne sont en aucun cas sous notre autorité. Les interventions effectuées en marge des manifestations par les personnels des commissariats ou d’autres services relèvent du directeur de service présent, le plus souvent le directeur départemental de la sécurité publique ou son représentant. Elles ont toute leur utilité pour traiter les groupes à risque qui posent des problèmes, cassent, agressent…
M. Michel Ménard. Combien y a-t-il de compagnies de CRS au total ?
Après le drame de Sivens, le ministre de l’Intérieur a pris la décision d’interdire l’usage des grenades offensives. Existe-t-il des moyens performants et modernes dont vous ne disposeriez pas et qui seraient utiles au maintien de l’ordre ?
Mme Anne-Yvonne Le Dain. Le temps consacré annuellement à la formation montre que la maîtrise et la compétence sont essentielles, mais je crois utile de poser la question de la réaction instantanée de la personne humaine. Dans le feu de l’action, le sentiment de peur, le danger peuvent provoquer des réactions individuelles très fortes. Cet aspect est-il traité lors des formations ? Apprend-on à gérer ses sentiments et son corps en situation ? La réaction humaine est au cœur du problème. Je ne doute pas que vous mettez tout en œuvre pour la canaliser, mais peut-être progresserons-nous encore dans ce domaine si vous nous en dites plus sur l’aspect psychologique des formations ?
Mme Clotilde Valter. Vous êtes en première ligne pour le maintien de l’ordre lors des manifestations. Estimez-vous que l’intervention simultanée de forces non spécialisées, dont vous avez dit l’utilité, peut, malgré tout, créer une certaine perturbation ? Si l’autorité décisionnaire apprécie mal la situation de terrain, que vous êtes les plus à même de connaître, son choix d’impliquer d’autres forces peut avoir pour effet de faire dégénérer les choses. Dispose-t-elle des informations qui lui permettent de coordonner l’action sans erreurs et d’anticiper correctement les événements ?
Commandant Mohammed Belgacimi. Nous sommes disciplinés et nous obéissons à l’autorité civile présente sur le terrain. Sauf urgence et cas grave – si, agressés, nous ne pouvons pas tenir nos positions –, nous ne modifions pas le dispositif prévu. Nous ne sommes pas directement associés aux interventions qui s’effectuent à sa marge. Tant que l’on ne nous demande pas de bouger, nous ne bougeons pas. Cohésion et discipline, c’est comme cela que se traite le maintien de l’ordre.
M. Guy Delcourt. Les interventions des autres forces sont-elles décidées en coordination avec vos unités, ou l’autorité civile décide-t-elle, sans concertation avec vous, de faire intervenir la BAC par exemple ?
Mme Clotilde Valter. J’imagine que les CRS qui tiennent le dispositif sur le terrain sont les mieux à même de sentir la situation et d’estimer le risque de perturbation supplémentaire que fait courir l’intervention d’autres forces. L’autorité civile n’est peut-être pas autant que vous en mesure d’anticiper les effets collatéraux et le désordre que ses décisions peuvent provoquer ?
Commandant Christian Gomes. Tout au long de l’opération, nous rendons compte de l’évolution de la situation au commandant du groupement opérationnel ainsi qu’au responsable de l’autorité civile – présent sur les lieux en cas d’usage de la force –, auquel nous proposons, en qualité de commandants de la force publique, des modus operandi dont il n’aurait pas forcément décidé seul : si l’autorité civile conserve la maîtrise des moyens mobilisables, nous jouons, à ses côtés, un rôle de conseiller technique. Entre les acteurs de terrain que nous sommes, le commandant de la force publique et les décideurs, le contact est donc permanent : il est très rare que ces derniers n’aient pas une connaissance précise de la situation.
Commandant Roland Guillou. Le maintien de l’ordre public n’étant pas une science exacte, le facteur humain y revêt en effet une grande importance. Cela dit, les réactions individuelles n’ont pas cours dans nos unités. Les personnels qui les intègrent, s’ils proviennent d’autres directions où l’on autorise l’usage individuel de certaines armes, sont formés à notre culture : le CRS n’est jamais un « gardien lambda » ; il fait partie d’un groupe au sein d’une section elle-même rattachée à une demi-compagnie, la compagnie dans son ensemble étant placée sous l’autorité d’un commandant. Au demeurant, les moyens sont attribués en fonction des capacités de chacun : si quarante-huit fonctionnaires doivent être formés à l’usage du LBD, on les choisira bien entendu parmi ceux qui ont la meilleure maîtrise d’eux-mêmes. Pour les éventuels « excités », passez-moi l’expression, il existe des postes de conducteur de véhicule… (Sourires.)
À la différence des forces mobiles regroupées au sein de compagnies ou d’escadrons comprenant chacun jusqu’à une dizaine d’unités, comme à Nantes ou à Notre-Dame-des-Landes, les unités comme la nôtre ont un contact direct avec l’autorité civile, à laquelle elles peuvent donc proposer des solutions, y compris s’il s’agit d’éviter des moyens dont l’usage a pu être autorisé, telles des grenades. Un bond offensif de quinze mètres, par exemple, permet de faire reculer les manifestants de cinquante ou soixante mètres – puisque, a priori, nul n’a envie d’affronter des unités de CRS lourdement équipées.
Bien entendu, des erreurs sont toujours possibles et la tâche est loin d’être simple ; mais nos troupes sont bien formées et composées de personnes aguerries aux missions délicates. Cette expérience, fortifiée au fil de notre carrière et de notre progression hiérarchique, nous sert pour apprécier au mieux les situations. Le maintien de l’ordre relève de l’humain : on ne gère pas une manifestation en Corse de la même façon qu’en Bretagne. Revêtu de l’uniforme de CRS, je représente la force publique, mais je n’en demeure pas moins un citoyen qui, résidant en Bretagne, peut engager avec les manifestants une discussion sur les problèmes d’un territoire qu’il connaît bien : cela permet souvent d’apaiser des tensions, par exemple avec des agriculteurs ou des pêcheurs que, le lendemain des événements, je pourrai croiser dans la rue. Notre objectif est bien entendu d’éviter les incidents et les blessés, aussi bien de notre côté que du côté des manifestants, dont certains peuvent être des proches, des familles ou des enfants. Qui me dit qu’un jour, je ne me retrouverai pas en face de mes propres enfants lors d’une manifestation qu’une minorité aura fait dégénérer ? Notre but est d’assurer le maintien de l’ordre de façon responsable : nos compagnies, républicaines, agissent dans le cadre de la légalité.
Commandant René-Jacques Le Moël. Le responsable du service n’est jamais seul : la plupart du temps, un responsable de l’autorité civile, le directeur départemental de la sécurité publique (DDSP), un représentant des CRS et un autre de la gendarmerie sont présents dans la salle de commandement ; chacun apporte sa pierre à l’édifice. Le commandant de l’unité de terrain peut aussi faire part de son ressenti si une instruction lui paraît peu adaptée.
La DCCRS dispose par ailleurs d’un outil remarquable avec le système autonome de retransmission d’images pour la sécurisation d’événements, dit « SARISE », sorte de car-régie qui, doté de caméras asservies, recueille des images tout au long de l’opération. Il permet donc au DDSP et au préfet de prendre la bonne décision au bon moment.
Quant à l’aspect humain, tout est strictement encadré au sein de nos unités : du commandant jusqu’à l’agent qui lancera le projectile, les personnels ont suffisamment d’expérience pour contrôler leurs réactions.
Commandant Christian Gomes. Comme le rappelait le commandant Guillou, notre principal souci, d’un bout à l’autre de l’opération, est d’éviter les blessés dans nos rangs comme chez les manifestants. La chose est évidemment beaucoup plus simple si la manifestation est tranquille que si elle vient à dégénérer, comme à Quimper fin 2013 ou à Nantes en février 2014, d’autant que nous sommes conduits à déployer des moyens relativement lourds. Aussi retardons-nous, autant que faire se peut, l’emploi de la force : nous sommes entraînés à subir des pressions fortes, voire des agressions physiques, et à recevoir des projectiles de toutes natures, qu’il s’agisse d’objets contondants ou incendiaires, ou d’acide. Ces entraînements, bien qu’ils n’occupent que vingt-cinq jours par an, sont conçus pour nous mettre au plus près de la réalité. La discipline n’est pas moins essentielle : on l’a dit, nul, au sein de nos compagnies, ne peut prendre l’initiative d’une riposte individuelle.
Outre que la sécurité même des manifestants nous conduit à différer cette riposte, parfois pendant plusieurs heures – comme à Quimper en 2013 –, les moyens employés restent souvent très en deçà de ceux qui nous sont autorisés par la loi. Notre expérience nous permet de relativiser les situations de violence et de ne riposter qu’avec mesure.
M. Hugues Fourage. Certaines opérations de maintien de l’ordre sont plus difficiles que d’autres, compte tenu de l’intensité croissante de la violence dans certaines zones. Percevez-vous alors une tension psychologique au sein de vos unités avant leur entrée en mission, par exemple à Sivens ou à Notre-Dame-des-Landes ? Pouvez-vous être conduits à faire des choix dans la mobilisation de certains personnels ?
Le responsable du groupe opérationnel, avez-vous rappelé, décide en lien avec l’autorité civile ; mais un groupe est par définition composé d’individus. Si l’un d’eux vous paraît flancher, pouvez-vous aller jusqu’à l’écarter des opérations, au moins provisoirement ?
Commandant Éric Le Mabec. Une unité de CRS réunit des hommes qui, au-delà de leurs missions ponctuelles de maintien de l’ordre, vivent ensemble deux cents jours par an. La cohésion entre eux dépasse donc le cadre professionnel ; elle nous aide pour constituer des groupes sur la base de compétences techniques, mais aussi par affinités. Des liens d’amitié contribuent aussi, d’ailleurs, à la reconnaissance du lien hiérarchique.
Dans nos formations, nous rappelons aux fonctionnaires les conséquences judiciaires auxquelles les exposent des ripostes individuelles spontanées ; reste que, au cours de déplacements d’une durée moyenne de trois semaines, des défaillances individuelles peuvent intervenir, que nous nous efforçons de déceler en dehors des opérations. Notre système de relève permet aussi de remplacer des fonctionnaires sans porter atteinte au dispositif opérationnel. Si un responsable constate que l’un des fonctionnaires flanche, il décide alors de le mettre à l’abri pour préserver la sécurité de son groupe.
M. le rapporteur. Les explications du commandant Gomes m’avaient suggéré une question à laquelle vous venez en partie de répondre. Les modalités d’emploi de la force, dans les conditions remarquables que vous avez décrites, n’excluent donc pas, si je vous ai bien compris, la légitime défense, seul cas de figure où une réaction individuelle devient admissible au regard du droit.
Commandant Christian Gomes. La légitime défense, visée par les articles L. 122-5 et L. 122-6 du code pénal et souvent évoquée en interne, n’est pas opposable par le fonctionnaire dès lors qu’il se trouve au sein d’une unité placée sous commandement légitime : elle ne joue que si le fonctionnaire se retrouve isolé au cours d’une opération – ce qui peut arriver.
M. Guy Delcourt. Je m’en voudrais d’omettre une question d’actualité, bien qu’elle n’ait pas de lien direct avec l’objet de notre commission d’enquête. Beaucoup de personnels, entend-on dire, sont épuisés par le maintien du plan Vigipirate à son niveau le plus élevé. Quel est votre sentiment sur ce point ? Qu’adviendrait-il si, conjointement, étaient décidées des opérations de maintien de l’ordre de grande ampleur ?
Commandant Christian Gomes. On évoque souvent la fatigue des personnels, fortement mobilisés depuis les attentats de janvier, notamment dans le cadre des missions de garde statique devant des bâtiments sensibles. De fait, le taux d’emploi est plus élevé que d’habitude, mais notre système de gestion interne permet aux fonctionnaires d’étaler leurs congés sur toute l’année, et pour les durées qu’ils souhaitent ; de sorte que le pourcentage des congés reste le même de janvier à décembre. La récupération physique des personnels s’en trouve évidemment facilitée.
M. le président Noël Mamère. Messieurs, je vous remercie.
* *
Table ronde, ouverte à la presse, réunissant cinq commandants (chef d’escadron Mélisande DURIER, lieutenant-colonel Stéphane FAUVELET, lieutenant-colonel Emmanuel GERBER, capitaine Bernard HERCHY et chef d’escadron Aymeric LENOBLE) de groupements de gendarmerie mobile étant intervenus à Notre-Dame-des-Landes
Compte rendu de l’audition du jeudi 5 mars 2015
M. le président Noël Mamère. Madame, messieurs, soyez les bienvenus. Bien qu’elle ait été créée à la suite de la tragédie de Sivens, notre commission d’enquête n’entend en aucune façon interférer avec l’enquête judiciaire sur la mort de Rémi Fraisse.
Nous serons heureux de vous entendre sur votre conception du maintien de l’ordre. Les auditions précédentes ont confirmé que la doctrine enseignée à l’école de Saint-Astier est respectée au sein de la gendarmerie mobile, mais l’évolution du phénomène de la contestation, par exemple avec les « zadistes » qui occupent certains lieux dans la durée, vous oblige à des modes d’intervention différents. Votre retour d’expérience sur la « zone à défendre » (ZAD) de Notre-Dame-des-Landes nous sera d’ailleurs précieux.
Nous nous félicitons de la présence d’une femme parmi vous : le fait que des femmes occupent des fonctions d’encadrement au sein de la gendarmerie est la marque d’un progrès incontestable.
Conformément aux dispositions de l’article 6 de l’ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, je vous demande de bien vouloir prêter le serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité.
(Le chef d’escadron Mélisande Durier, le lieutenant-colonel Stéphane Fauvelet, le lieutenant-colonel Emmanuel Gerber, le capitaine Bernard Herchy et le chef d’escadron Aymeric Lenoble prêtent serment.)
M. Pascal Popelin, rapporteur. Les formes de contestation vous semblent-elles avoir évolué au cours des deux dernières décennies, s’agissant notamment de la violence dirigée contre les forces de l’ordre ? Par ailleurs, des minorités radicales s’infiltrent dans des manifestations qui, pour le reste, rassemblent des individus pacifiques : comment gérez-vous ce phénomène, qu’il s’agisse de manifestations traditionnelles ou, par exemple, de ZAD ? Les deux familles de manifestants – les radicaux et les non-violents – sont-elles bien distinctes ? Observe-t-on des radicalisations ponctuelles d’individus initialement non violents ?
Les conditions du maintien de l’ordre constituent bien entendu un vaste sujet. L’équipement dont vous disposez vous paraît-il adapté et suffisant au regard de vos missions ? Les dispositifs réglementaires et législatifs qui régissent l’usage de la force sont-ils bien compris et perçus par les personnels placés sous vos ordres ? Des évolutions en ce domaine vous paraissent-elles souhaitables ?
Lieutenant-colonel Emmanuel Gerber, groupement III/3 de gendarmerie mobile de Nantes. L’invitation de votre commission d’enquête, dont je tiens à remercier tous les membres, est un honneur pour nous. Après m’être brièvement présenté, j’esquisserai un tableau de la situation à Notre-Dame-des-Landes.
Commandant du groupement de gendarmerie mobile de Nantes depuis août 2012, j’ai derrière moi trente-deux ans d’une carrière commencée dans l’armée de terre. Elle s’est ensuite poursuivie, dans sa quasi-totalité, au sein de la gendarmerie, où j’ai occupé plusieurs postes de commandement en métropole et en opérations extérieures.
Le projet d’aéroport à Notre-Dame-des-Landes vise une zone occupée par cinq communes, à vingt kilomètres au nord-ouest de Nantes. Cette zone, qui s’étend sur vingt kilomètres en longueur et cinq en largeur, est essentiellement constituée de bocages et de bois. Elle est desservie par de petites routes départementales et des chemins. Cette topographie ne facilite pas l’action des forces de l’ordre, mais, à l’inverse, offre un cadre propice aux opposants. Au cours des opérations menées d’octobre 2012 à avril 2013, nous avons pu identifier, parmi eux, trois types essentiels : les quelque 200 radicaux qui, ignorant les décisions de l’État et rejetant toutes les valeurs, se montrent d’une grande violence qui s’accroît encore ; les associations, notamment d’agriculteurs, qui, même s’ils peuvent aussi faire preuve de violence et freiner l’action des forces de l’ordre, ne sont pas les plus virulents ; les « Robin de bois », autrement dit des défenseurs de l’environnement, retranchés dans des constructions en bois dans les arbres, ce qui ne facilitait pas non plus notre tâche. Le climat humide la rendait plus difficile encore, de même que sa durée, qui nous a cependant permis de mener à bien l’ensemble de nos missions.
L’opération « César 44 », commencée début octobre et achevée fin novembre, s’est déroulée en trois phases ; elle venait en appui d’actions d’huissiers chargés d’appliquer des ordonnances judiciaires. Un autre dispositif s’est ensuite installé dans la durée afin de sécuriser deux carrefours stratégiques de routes départementales et d’assurer la viabilité d’un axe nord-sud.
Enfin, l’une des particularités de la zone est de recouvrir deux ressorts judiciaires, séparés par le chemin de Suez : celui du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire et celui du tribunal de grande instance de Nantes.
Lieutenant-colonel Stéphane Fauvelet, gendarmerie mobile de Nîmes. S’agissant de l’évolution des formes de contestation, je ferai appel à mon expérience personnelle.
M. le rapporteur. Notre-Dame-des-Landes offre un bon exemple d’intervention longue ; c’est pourquoi nous avons souhaité vous entendre. Toutefois, l’objet de notre commission d’enquête ne se limite évidemment ni à ces événements ni à ceux de Sivens, tant s’en faut.
Lieutenant-colonel Stéphane Fauvelet. J’ai commencé ma carrière dans la gendarmerie mobile, au sein d’un escadron où j’ai occupé presque tous les postes, avant de devenir officier à la faveur d’un concours. Après avoir été commandant d’escadron, j’ai désormais l’honneur de commander un groupement.
L’évolution des modes de contestation me semble recouvrir deux aspects. Le premier réside dans l’expression même de cette contestation : dès la fin des années quatre-vingt-dix, lors de G20 et de G8, à Évian et à Nice par exemple, nous avions été confrontés à des formes de violence extrêmes ; la nouveauté est qu’elles nous semblaient viser les représentants de l’ordre pour ce qu’ils sont, et non plus se revendiquer de quelque aspiration à la liberté.
Le second aspect, nouveau, tient à l’occupation du terrain dans la durée – jusqu’à présent, les oppositions, ponctuelles et sporadiques, étaient liées à des événements précis, tels que la tenue d’un G20. Cela n’est toutefois pas de nature à nous déstabiliser, car notre expérience militaire nous permet d’anticiper : vous le constaterez sans doute en découvrant nos conditions d’entraînement à Saint-Astier. Nous ne sommes pas surpris par la violence de l’adversaire, quand bien même le phénomène est devenu plus fréquent. Avec le temps, les opposants se sont également structurés, acquérant une dimension internationale : à Notre-Dame-des-Landes, nous avons fait face à des éléments radicaux venus d’Espagne, de Grande-Bretagne, de Belgique et d’Allemagne.
Les opposants, le lieutenant-colonel Gerber l’a rappelé, sont cependant multiples : j’ai eu à traiter non seulement avec des agriculteurs, mais aussi, dans les landes de Rohanne, avec des familles – au sein desquelles on voyait des enfants dans des poussettes –, des élus et des riverains. Juste derrière ces manifestants étaient positionnés des groupes radicaux, reconnaissables à leurs équipements, leurs cagoules et leurs casques. La première action, dans un cas de figure comme celui-ci, est la négociation. Les forces de gendarmerie mobile commencent par informer les opposants de ce qu’ils peuvent et ne peuvent pas faire et, surtout, de la mission qu’elles ont reçue. Cet échange ne revêt évidemment aucun caractère légal ; il correspond, dans notre déontologie, au devoir moral d’informer les manifestants sur la nature de notre action. À Fos-sur-Mer, des agriculteurs camarguais, dans un contexte d’opposition extrême, occupaient le quartier de la Fossette, résolus de s’y installer dans la durée. Nos instructions étaient d’assurer la viabilité des axes routiers pour midi ; ce fut chose faite dès neuf heures, après une heure seulement de discussion : aucun gendarme mobile n’eut à mettre son casque, aucune grenade ne fut tirée.
Ce type de démarche est une sorte de filtre : ne demeurent, lors d’éventuels affrontements, que les opposants radicaux désireux d’en découdre ; les autres, même s’ils continuent de manifester, ne s’opposent pas aux manœuvres des forces de l’ordre et répondent à leurs sommations. Ce scénario correspond exactement à ce qui s’est passé à Nantes, où nous avions à assurer l’exécution de décisions de justice : il est évident que, si les occupants du squat avaient obtempéré aux injonctions des huissiers de justice, les forces de l’ordre n’auraient pas eu à intervenir. Notre action dépend toujours de l’attitude de l’opposant, conformément à trois principes : la légalité, la sécurité et l’efficacité.
Les équipements sont de deux types, individuels et collectifs ; ils assurent d’abord la protection, y compris, dans le second cas, par l’intermédiaire des vecteurs de projection, par exemple des véhicules qui, disposés en barrage, permettent aussi de dissimuler nos forces, toujours dans l’optique d’éviter la confrontation. Un juste équilibre doit cependant être trouvé entre la protection et la mobilité. Si, il y a vingt ans, les équipements individuels se résumaient à une simple veste, ils sont désormais largement à la hauteur des besoins.
Quant aux équipements collectifs – vecteurs de tir tels que les grenades –, ils s’inscrivent dans le cadre légal de l’emploi des armes et des forces. Les moyens dont nous sommes dotés ne servent qu’à appuyer nos manœuvres et jamais, pour ainsi dire, à occuper le terrain. Tout mouvement doit être opéré dans les meilleures conditions de sécurité et en conformité avec le droit.
M. le rapporteur. Lors des auditions précédentes, nous avons entendu dire que la suppression des réquisitions permettait une certaine fluidité, mais qu’un aval clair et formel des autorités civiles pouvait être souhaitable en cas d’engagement de forces très offensives : qu’en pensez-vous ?
Lieutenant-colonel Stéphane Fauvelet. J’ai connu le système des réquisitions aussi. L’important, à mon sens, est la présence, au demeurant de plus en plus fréquente, de l’autorité préfectorale à nos côtés – ce fut notamment le cas à Corte. Les forces de gendarmerie mobile apportent ainsi leur expertise technique à une autorité qui est en quelque sorte leur censeur. Une formalisation écrite n’apporterait rien de plus, à l’exception de la traçabilité, même si l’enregistrement des communications la permet aussi. À titre personnel, je fournis une radio au représentant de l’autorité préfectorale, qui peut ainsi suivre les opérations tout au long de leur déroulement, y compris pour communiquer ses instructions.
Lieutenant-colonel Emmanuel Gerber. Pour notre part, nous demandons à l’autorité civile de remplir un formulaire d’autorisation d’emploi de la force et, surtout, d’usage des armes. Je confirme en tout cas que l’autorité civile, en la personne du préfet, M. de Lavernée, ou de son directeur de cabinet, était systématiquement présente lors des opérations de Nantes que j’évoquais.
J’ai pu constater, au cours des trois dernières décennies, une montée de la violence dans beaucoup de manifestations ; surtout, des individus incontrôlables viennent s’y mêler discrètement : généralement munis de matériels de protection, ils profitent du déploiement du cortège ou de sa dislocation pour commettre des violences dont l’intensité est exponentielle.
M. Philippe Goujon. Merci pour cet aperçu historique des missions de maintien de l’ordre. Sans vouloir vous contredire, on peut observer une certaine difficulté à distinguer, au départ des manifestations, entre les catégories d’opposants. Les éléments les plus radicaux peuvent d’abord se fondre dans la masse avant de passer à l’action au moment qui leur paraît opportun. N’est-il pas alors déjà trop tard ?
Cette question me conduit tout naturellement à celle du renseignement : celui-ci vous paraît-il suffisamment efficace et précis pour préparer vos opérations au mieux ?
Le maintien à distance des opposants est bien entendu l’un de vos objectifs, mais, désormais, des éléments radicaux puissamment armés – de fusées horizontales, d’objets métalliques ou de cocktails Molotov –, parfois retranchés dans des casemates, occupent des territoires qu’il vous faut donc reconquérir par des opérations quasi militaires : êtes-vous suffisamment armés pour le faire ? Rappelons que vous êtes désormais privés des grenades offensives, même si vous disposez d’autres moyens. Une intervention du groupement blindé de gendarmerie mobile (GBGM), par exemple, est-elle envisageable ?
L’aggravation de la violence dans les manifestations n’est-elle pas un effet de l’inadaptation de la réponse pénale ?
Enfin, les effectifs des groupements de gendarmerie mobile vous semblent-ils suffisants ? Vos collègues CRS parlaient tout à l’heure d’effectifs théoriques de 131 ou 132 fonctionnaires par compagnie, contre 80 dans vos groupements : combien cela représente-t-il de personnels sur le terrain ? Si ces moyens s’avèrent insuffisants, sont-ils appuyés par des forces de police ou de gendarmerie non spécialisées dans le maintien de l’ordre ? Dans l’affirmative, comment s’opère l’articulation ?
M. Guy Delcourt. Nous avons bien compris l’importance des garanties apportées par l’autorité civile. De quelle latitude disposez-vous dans vos discussions avec elle ? Les préfets sont de hauts fonctionnaires pour ainsi dire irréprochables, mais, comme chez les parlementaires, il existe des exceptions… Qu’advient-il si un ordre contraire à l’intérêt de la paix civile est donné ? Avez-vous des moyens de résister à cet ordre, sachant que les préfets n’ont pas suivi les mêmes formations que vous ? Des arbitrages ministériels peuvent-ils intervenir pour des manifestations comme celles de Notre-Dame-des-Landes ou de Sivens, que les plus hautes autorités de l’État suivent de près ?
Lieutenant-colonel Emmanuel Gerber. Les missions auxquelles nous participons – « César 44 » à Notre-Dame-des-Landes ou opération écotaxe à Pont-de-Buis – nous sont confiées par l’autorité civile, en l’occurrence le préfet. En général, le dialogue s’engage en amont de la mission : si elle ne nous paraît pas légale – mais ce n’est jamais le cas –, c’est à ce moment que nous pouvons le signaler. En collaboration avec le responsable territorial – le commandant de groupement de gendarmerie départementale –, nous déroulons une méthode de raisonnement tactique qui nous amène à concevoir la manœuvre la plus susceptible d’obtenir l’effet recherché, et nous recevons alors l’aval de l’autorité civile. J’ajoute que celle-ci s’engage à nos côtés sur le terrain lorsque les opérations se durcissent : en tout cas, le lien est au minimum maintenu par téléphone.
Une manœuvre des opposants peut cependant nous conduire, en cours d’action, à donner des ordres afin de modifier une partie de la procédure prévue. Cela n’a pas manqué de se produire à Notre-Dame-des-Landes où les manifestants étaient parfaitement organisés, commandés, disposaient d’un réseau de téléphones et avaient même piraté certaines fréquences radio : cela nous a d’ailleurs permis d’écouter leurs échanges, de contrecarrer leurs manœuvres de harcèlement et – n’ayons pas peur des mots – de guérilla. En effet, quand les opérations se prolongent, les opposants s’organisent, durcissent leurs positions et optent pour des modes d’action très proches de la guérilla, le stade ultime étant celui de la victimisation : à Notre-Dame-des-Landes, certains, parmi les opposants les plus radicaux, n’avaient qu’un leitmotiv, obtenir une victime.
Permettez-moi d’ouvrir une parenthèse sur la médiatisation. Si nous disposons de nos propres moyens de captation d’image, les médias sont aussi systématiquement engagés sur ce type d’opération. Lorsqu’une équipe de l’Agence France presse, lorsque des médias nationaux ou internationaux sont présents sur le terrain, il nous faut mettre à leur disposition une équipe de protection, ce qui mobilise aussi des effectifs. Il y a quelques années, un escadron pouvait engager soixante-quinze hommes sur le terrain, contre soixante-huit aujourd’hui. Nos gendarmes doivent en outre alimenter une cellule image ordre public pour pouvoir matérialiser les infractions commises lors des manifestations, et conduire les engins. Le nombre de véhicules est plus important qu’auparavant, la structure étant désormais quaternaire et non plus ternaire. Les conducteurs sont chargés à la fois de la conduite des véhicules et de leur protection, ce qui n’était pas simple à Notre-Dame-des-Landes, où le terrain n’était pas propice aux manœuvres, où les manifestants nous contournaient et nous harcelaient de toute part.
Lieutenant-colonel Stéphane Fauvelet. Un gendarme mobile n’est jamais aussi bon que dans les grands espaces : c’est un militaire, il s’approprie le terrain sans aucun problème. Le maintien de l’ordre en milieu rural est dans ses gènes. C’est par la manœuvre que nous parvenons à compenser les problèmes liés aux effectifs, et c’est par la manœuvre et la surprise que nous parvenons à déborder l’opposant. À Saint-Astier, chaque opération fait l’objet d’un retour d’expérience : elle est analysée et disséquée avant de devenir un cas concret pour aguerrir ceux qui n’ont pas eu l’occasion d’être confrontés à cette situation, même si, à Nantes, plus d’un quart des effectifs ont pu être éprouvés dans cette mission. Les camarades qui dirigent un escadron partageront sans doute mes propos, puisqu’ils ont été confrontés, en tant que commandants d’une unité élémentaire, à des situations surprenantes, car nouvelles pour eux. Toutefois, ils connaissaient à l’avance le terrain et l’opposant.
Chef d’escadron Mélisande Durier, compagnie de gendarmerie départementale de Mantes-la-Jolie. J’ai la faiblesse de croire que nous sommes bien formés, que notre école de Saint-Astier nous prépare à être engagés dans des opérations variées et que nous disposons de schémas tactiques qui s’appliquent dans toutes les situations. Nous passons très facilement de périodes statiques de défense à des périodes plus offensives avec reconquête du territoire. Nous parvenons à localiser très vite les éléments radicaux, qui ne tardent pas à venir au contact : ils sont malins, arrivent de façon un peu insidieuse à prendre attache avec les gendarmes mobiles, on sent la violence monter rapidement, mais cela nous permet aussi d’essayer de désamorcer la situation.
Nous sommes bien équipés pour faire face aux phases de violence, mais, ce qui fait surtout notre force, c’est le collectif. À Notre-Dame-des-Landes, un gendarme du peloton d’intervention interrégional de la gendarmerie nationale (PI2G) d’Orange a été grièvement blessé : les opposants, très violents, nous harcelaient sans cesse. Le commandement est situé en retrait de la ligne de contact direct, ce qui lui permet de distinguer des choses que ne voient pas ceux qui sont en avant : c’est ainsi que, à un moment donné, nous avons vu 150 bouteilles de verre lancées sur nous. J’ai alors pensé que j’allais avoir quinze blessés dans mon escadron, mais, quand j’ai procédé au débriefing avec mes gendarmes, ils m’ont dit qu’ils n’avaient pas remarqué cette pluie de bouteilles. La cohésion est tellement forte – c’est difficilement explicable – qu’elle nous permet de lutter efficacement contre l’opposant.
Dans un escadron, il n’y a pas d’action individuelle, il n’y a que des actions collectives. Or, même après un engagement statique de près de quatorze heures, où les gendarmes sont restés debout sans boire ni manger, on ne constate pas d’usure du personnel. La connaissance que nous avons de chacun fait que l’on a su extraire à temps ceux qui pourraient avoir envie de répondre aux opposants qui nous harcèlent. Mais nous ne répondons pas à la provocation. Les gendarmes mobiles sont bien formés et ont une exceptionnelle capacité de résilience. Au-delà de la formation militaire, c’est donc tout un esprit de cohésion qui fait qu’un escadron est particulièrement soudé, notamment autour de ses chefs, et que l’on arrive à maîtriser des situations qui pourraient très vite dégénérer.
Chef d’escadron Aymeric Lenoble, escadron 26/5 de Belley. À Saint-Astier, nous avons la chance de recevoir une formation individuelle, à la fois humaine, éthique et technique. J’y étais un mois avant d’être engagé à Notre-Dame-des-Landes et j’ai pu bénéficier du retour d’expérience d’autres escadrons. En arrivant sur place, ensuite, nous n’avons pas été surpris par l’adversaire : nous avions été entraînés à affronter cette situation.
J’ai eu la chance d’aller en Guyane avec mon escadron, en mission Harpie. Nos personnels mènent des opérations en jungle contre l’orpaillage illégal et l’immigration irrégulière, ce qui veut dire que nous avons une connaissance du terrain, que nous sommes capables de nous adapter. Nous savons marcher dans la boue, faire des journées de vingt-quatre heures, nous inscrire dans la durée. Dans le même temps, nous avons la chance de connaître nos personnels et nos subordonnés, puisque la gendarmerie est avant tout une force humaine. Nous savons même quels sont les personnels qui pourraient, sous l’effet de la fatigue ou de l’énervement, commettre une erreur. Dans ce cas, nous avons la possibilité de les mettre en retrait afin qu’ils ne nuisent pas à la manœuvre d’ensemble.
À Notre-Dame-des-Landes, le 3 mars, à un carrefour, c’est-à-dire dans un système défensif où nous n’avons pas besoin de gagner du terrain sur la ZAD, nous avons été pris à partie par quelque 200 opposants qui se sont montrés d’emblée agressifs, lançant sur nous des cocktails Molotov, des bouteilles de verre, des objets incendiaires. Peut-être les sommations doivent-elles être revues pour les manifestants traditionnels, ceux qui défilent en famille et ne sont pas familiers avec le maintien de l’ordre. Moi-même, avant d’entrer dans la gendarmerie, si j’avais entendu des sommations, je n’aurais pas forcément compris de quoi il s’agissait. Cependant, il ne faut pas se leurrer : les sommations faites à des opposants radicaux n’auront absolument aucun effet, puisque ces gens-là viennent pour en découdre.
À Notre-Dame-des-Landes, lorsque nous lançons avertissements et sommations, les opposants nous répondent : ils savent très bien ce que nous allons faire, ils s’y sont préparés. Il faut d’ailleurs distinguer ceux qui sont là dans le cadre de la liberté de manifester, qui veulent faire valoir leur point de vue et sont respectueux de la République, et les éléments radicaux qui sont là pour en découdre et qui ont la volonté de blesser. Notre équipement nous permet d’absorber le choc, mais, à Notre-Dame-des-Landes, nous avons déploré une dizaine de blessés et recensé six casques hors service, ce qui montre la violence des individus qui nous font face.
Les adversaires sont organisés : ils agissent en miroir par rapport à nous, ils connaissent les limites qui s’imposent à nous. Ils peuvent parfois nous mettre en difficulté si nous n’y prenons garde, car ils ont également une certaine capacité à manœuvrer.
Je ne répondrai pas à la question relative à l’adaptation de la réponse pénale, car je ne suis pas compétent en la matière. Toutefois, je peux dire que, lorsqu’on est en flux tendu sur un vaste terrain, on ne peut se permettre de procéder à une interpellation, qui se ferait au détriment de notre schéma tactique, car les éléments interpellateurs devraient ensuite être auditionnés par l’officier de police judiciaire, ce qui affaiblirait le dispositif. Toutefois, à Notre-Dame-des-Landes, j’ai fait effectuer par mon peloton d’intervention une interpellation par ruse à la fin des affrontements. Nos effectifs conditionnent notre mode d’action. Le chef, quel qu’il soit, commandant d’escadron ou de groupement tactique de gendarmerie (GTG), doit sans arrêt composer avec ces différents éléments.
Il s’efforce, en tout cas, de retarder au maximum l’emploi de la force, car on ne sait jamais où s’arrêtera l’escalade. À Notre-Dame-des-Landes, isolé et n’ayant pas d’autorité habilitée sur place, j’ai pris la décision, après avoir fait les avertissements, d’employer la force : mais j’ai attendu, pour cela, d’avoir matérialisé les cocktails Molotov, car, pour se situer dans un cadre légal, on ne peut faire usage des grenades et des explosifs sans avoir matérialisé les infractions qui ont été commises à notre encontre. Nous devons toujours intervenir dans un cadre légal : c’est une idée que nous avons chevillée à l’esprit. Il n’y a pas d’initiative individuelle. L’ensemble des moyens est utilisé sur commandement du commandant d’unité, puis en liaison avec le GTG pour l’action globale.
Lieutenant-colonel Emmanuel Gerber. La force que l’on emploie est systématiquement graduelle et proportionnée face aux actions menées par les opposants. C’est une culture que l’on découvre à Saint-Astier dans le cadre de la formation de toutes les unités de gendarmerie mobile.
Peut-être savez-vous que les opposants radicaux disposent d’un fascicule du « parfait zadiste ».
M. le rapporteur. Nous avons demandé au directeur général de la gendarmerie nationale de nous en communiquer un exemplaire.
Lieutenant-colonel Emmanuel Gerber. Il est important de récupérer tous les éléments qui peuvent fournir des éléments de preuve à l’appareil judiciaire. Ce fascicule comporte de surprenants chapitres sur la fabrication d’explosifs de circonstance, sur les modes d’action des forces de l’ordre, sur l’attitude à adopter en garde à vue, sur le comportement à tenir vis-à-vis du gendarme ou du CRS lorsque celui-ci est amené à vous poser les questions qui figurent dans les procédures d’interpellation, et sur la façon de les contourner. Ils se targuent d’ailleurs de délivrer un certificat pratique du « parfait zadiste » !
Quant aux sommations, elles sont réglementaires, clairement annoncées par divers moyens, notamment par haut-parleur, et répétées à chaque nouvelle action des forces de l’ordre. La seule amélioration, modeste, qui pourrait être apportée – et qui, dans les faits, existe déjà – consisterait à tirer une fusée de couleur. Son usage n’est pas systématique, la fusée étant habituellement réservée au crépuscule.
M. le président Noël Mamère. Je réitère la question de M. Delcourt : est-il arrivé que l’autorité civile vous donne des ordres qu’il vous semblait impossible d’exécuter ou qui, en tout cas, n’étaient pas conformes à l’idée que vous vous faites du maintien de l’ordre ?
Lieutenant-colonel Emmanuel Gerber. Quoique je n’aie jamais eu affaire à un ordre illégal, je me suis toujours préparé à refuser d’en exécuter. Tous les camarades qui m’entourent, et tous les gendarmes en général, sont imprégnés de cette culture et ont été préparés à respecter la réglementation et les lois : nous en sommes les défenseurs et les représentants légaux.
Lieutenant-colonel Stéphane Fauvelet. Ce n’est pas ici le lieu de faire des développements sur la « théorie de la baïonnette intelligente ». Il nous appartient de saisir la lettre des instructions du préfet, représentant de l’État et garant des libertés. Mais – et c’est là que réside la difficulté pour le commandant de groupement de gendarmerie mobile – il nous faut aussi très rapidement comprendre l’esprit de la mission, savoir dans quel cadre nous évoluons. Nous devons avoir connaissance de l’arbitrage ministériel, mais surtout percevoir la personnalité de l’autorité préfectorale : j’ai besoin d’être rassuré lorsque je suis dans l’action, mais j’ai aussi besoin de rassurer mon chef et l’autorité préfectorale.
L’opposant est accompagné de conseillers juridiques : il y a des legal teams sur toutes les ZAD. Pourquoi nos préfets ne sont-ils pas secondés par des conseillers juridiques ? La question de l’ordre contraire à la paix publique ne se poserait plus.
Mme Clotilde Valter. L’autorité civile est-elle systématiquement présente pour les grosses opérations ? Vous est-il arrivé, dans certaines circonstances graves ou difficiles, de devoir agir sans elle ?
Vous avez une vision globale du terrain, des rapports de force, de l’ambiance, etc. Peut-il arriver que l’autorité civile qui vous donne des instructions ne perçoive pas les choses de la même façon que vous et adopte une position qui vous pose problème ?
Vous avez tous insisté sur la formation qui vous permet d’appréhender le registre de la réaction humaine. Même si, dès le début de leur carrière, les préfets exercent des responsabilités qui les mettent en contact avec l’ordre public, ils n’ont pas forcément reçu la même formation que vous en ce domaine. Ne manque-t-il pas là quelque chose ?
Que se passerait-il si l’ordre donné par l’autorité civile présente sur le terrain était contredit par l’intervention d’une personnalité qui ne serait pas sur place et dont l’appréhension de la situation pourrait être mauvaise ?
Lieutenant-colonel Emmanuel Gerber. L’autorité civile, garante et représentante de l’État, engage les forces mobiles sur une opération, fixe une mission globale, définit un effet à obtenir sur le terrain. C’est ensuite au commandant de la force qui mène l’opération de réfléchir à la façon d’aboutir à l’effet majeur demandé. Il échange donc avec l’autorité civile afin que tous s’accordent sur la conduite des opérations. La question que vous évoquez ne se pose donc pas, puisque le dialogue en amont a débouché sur une entente préalable.
Certes, lors du déroulement des opérations, on peut être amené à adopter des variantes au plan initial, suite à des manœuvres des opposants. L’effet majeur peut évoluer dès lors que le contexte lui-même n’est plus le même. Le commandant de la force donne alors des ordres pour parvenir malgré tout à l’effet final attendu par l’autorité.
Il est important d’insister sur la matérialisation des ordres donnés. Les réquisitions s’accompagnaient de formalisme et de rigidité dans l’accomplissement de la mission. Aujourd’hui, nous disposons d’autres moyens et, plus que jamais, en raison de l’accroissement des violences dans ce type de manifestation ou dans un contexte de ZAD, la mission confiée au commandant de la force par l’autorité civile doit l’être sous forme d’un message écrit ou enregistré, afin qu’il ne puisse y avoir d’hésitation sur sa réalité.
Il est parfois difficile pour l’autorité civile de clarifier la mission. Or notre formation existe depuis des décennies et les retours d’expérience ont fait l’objet de nombreuses analyses. Nos missions sont décrites à l’aide de termes tactiques précis offrant un effet sur le terrain. Il suffirait que les autorités civiles nommées maîtrisent ce glossaire. Ces termes sont de plus en plus souvent utilisés dans les grandes entreprises, où il est question de combat, d’offensive, mais on peut douter que leur signification exacte soit bien connue. Sans doute faut-il, dans ce domaine, mener un travail simple qui permettrait à tous de parler le même langage.
M. le rapporteur. Il arrive que, en amont ou en aval de vos interventions, ou pendant celles-ci, des effectifs de gendarmerie départementale soient également engagés. Même s’ils reçoivent eux aussi une formation, ils n’ont pas votre niveau de technicité. Cela pose-t-il des problèmes ?
Les interpellations ne sont certes pas votre mission première et sont inenvisageables dans certaines circonstances. Il arrive toutefois que, sur des théâtres d’opérations plus classiques, des unités de police judiciaire ou de gendarmerie, spécialement dédiées à ce type d’intervention à titre préventif ou en flagrant délit, soient engagées à vos côtés. Cela s’articule-t-il facilement avec vos missions ou cela pose-t-il des problèmes ? Nos concitoyens ne font pas toujours la distinction entre les différents uniformes et ne comprennent pas pourquoi on n’arrête pas tel ou tel individu dont on voit bien qu’il est en train de commettre une infraction.
M. le président Noël Mamère. À Sivens, en dehors des périodes d’affrontement, ce sont des gendarmes locaux ou départementaux qui sont présents. Ils ne bénéficient pas de la formation qui vous est dispensée à Saint-Astier et n’ont pas la même maîtrise que vous du maintien de l’ordre. Je pense en particulier à ce gendarme qui a été filmé alors qu’il jetait une grenade dans une caravane.
Lieutenant-colonel Emmanuel Gerber. Monsieur le président, je n’évoquerai pas ce dernier fait, d’une part parce que je n’étais pas sur place, d’autre part parce qu’une enquête judiciaire est en cours.
M. le président Noël Mamère. Ce sont plutôt les conditions de la mort de Rémi Fraisse qui font l’objet d’une enquête judiciaire, pas l’épisode dont je viens de parler. Je crois d’ailleurs que la personne en question a été sanctionnée par les autorités de la gendarmerie.
Lieutenant-colonel Emmanuel Gerber. Les unités territoriales auxquelles vous faites référence ont un rôle bien défini et un champ d’intervention limité. Je suis un peu surpris d’entendre qu’elles participent au maintien de l’ordre. Le maintien de l’ordre est un vrai métier qui requiert une formation spécifique et régulière, et dont l’expérience s’acquiert au fil des ans. Si, dans les situations de maintien de l’ordre les plus violentes, des unités territoriales viennent en renfort, c’est lors de phases plus calmes. Tout se passe alors en parfaite entente avec le camarade territorialement responsable. Comme l’indique l’appellation de ces pelotons de surveillance et d’intervention de la gendarmerie (PSIG), ils remplissent à la fois des missions d’observation lors de leurs déplacements ou de leurs points de contrôle, et d’intervention, non dans le cadre du maintien ou du rétablissement de l’ordre, mais en appui de décisions judiciaires, d’interpellations domiciliaires ou d’actions de police de la route.
Lors de grosses manifestations, peuvent aussi opérer des agents en civil chargés de recueillir du renseignement et d’interpeller certains individus. Cela ne dégarnit aucunement les effectifs employés pour la mission de maintien ou de rétablissement de l’ordre.
Enfin, je précise que, sur les théâtres d’opérations où je suis intervenu pour maintenir ou rétablir l’ordre, les PSIG étaient utilisés pour de la surveillance spécifique, recueillaient des renseignements sur l’évolution des modes d’action des opposants et renforçaient des dispositifs non exposés à des violences radicales.
M. le président Noël Mamère. Madame, messieurs, nous vous remercions.
*
* *
Audition, ouverte à la presse, de M. Jean-Baptiste EYRAUD, porte-parole
du Droit au logement
Compte rendu de l’audition du jeudi 19 mars 2015
M. le président Noël Mamère. Monsieur Ayraud, conformément aux dispositions de l’article 6 de l’ordonnance du 17 novembre 1958, je vous demande de prêter le serment de dire la vérité, toute la vérité, de lever la main droite et de dire : « je le jure ».
(M. Jean-Baptiste Eyraud prête serment.)
M. le président Noël Mamère. Monsieur, nous vous proposons d’intervenir pendant une dizaine de minutes sur votre vécu, de nous faire part de vos observations et de vos propositions, s’agissant du maintien de l'ordre dans notre pays.
Nous ne sommes pas en mesure de diffuser les images que vous avez apportées, mais vous pouvez les verser au dossier. Elles seront intégrées dans notre rapport comme élément de votre audition.
M. Jean-Baptiste Eyraud. L’association « Droit au logement » (DAL) intervient en faveur des mal-logés et des sans-logis, dans le cadre d’une action collective, de manifestations qui peuvent prendre plusieurs formes : manifestations de rue classiques, campements, occupations ponctuelles en direction d’acteurs du logement pour les amener à prendre en compte la situation des ménages en difficulté de logement, ou occupations ponctuelles d’immeubles vacants pour encourager les pouvoirs publics à recourir à des réquisitions.
Je précise que, conformément aux statuts de l’association, notre action est non-violente. Nous n’avons donc jamais utilisé la violence à l’encontre des forces de l’ordre. La non-violence fait d’ailleurs partie des consignes que nous donnons à nos adhérents : ils risqueraient de se retrouver au commissariat, voire au tribunal correctionnel ; en outre, les procédures pénales étant très longues, c’est autant de temps qui ne peut pas être consacré à la défense des personnes mal logées ou sans logis. Pour autant, nous ne nous considérons pas en conflit avec la police, qui fait le travail que lui demandent les autorités.
Mais l’inverse n’est pas vrai. Dans les années quatre-vingt-dix, il nous arrivait assez fréquemment d’avoir à affronter des violences policières et d’aller devant l’Inspection générale des services (IGS), en ayant pris soin de nous munir de preuves visuelles. De fait, l’utilisation de matériel vidéo permet de faire connaître les brutalités policières et surtout, de se défendre lorsque que les militants eux-mêmes sont accusés d’être à l’origine des violences – ce qui nous est arrivé au moins deux fois.
En mai 1997, à l’occasion de l’occupation d’un immeuble vacant place d’Iéna, à laquelle participaient, notamment, le professeur Léon Schwartzenberg, Mgr Gaillot et Albert Jacquard, quatre militants qui étaient sortis de l’immeuble pour discuter avec les forces de l’ordre ont été brutalisés .Par la suite, ces militants ont été poursuivis pour violences sur agent. Comme nous avions produit des images, une enquête a été ouverte et un policier a finalement reconnu avoir fait un faux témoignage devant le tribunal correctionnel de Paris ; au sein du commissariat, il avait en effet été demandé de faire en sorte que des charges soient retenues contre ces quatre militants afin de « criminaliser » notre mouvement. C’est ainsi qu’en 2000, une décision d’appel condamna des policiers et des officiers de police sur la base de ces faits et de ces faux témoignages.
En décembre 2012, à l’occasion d’une manifestation déclarée devant la préfecture de la région Île-de-France, la police nous a encagés – parce que la visite du ministre de l’Intérieur tombait au même moment. Une telle façon de faire, qui met en cause notre liberté de manifester, est pour nous particulièrement humiliante et dégradante. Il arrive donc que, lorsque deux policiers laissent un espace, l’un d’entre nous se faufile pour exprimer notre désaccord et dénoncer la pratique. À cette occasion, j’ai été personnellement brutalisé : je suis sorti du rang, un policier m’a repris, m’a jeté, une fois, deux fois et finalement, il a glissé à la suite d’un geste maladroit. Pourtant, il n’y avait aucune violence de ma part. À ma grande surprise, il a porté plainte contre moi. Quelques semaines plus tard, j’ai été convoqué au commissariat. J’ai montré les images qui me mettaient hors de cause, tout en refusant le prélèvement d’ADN, mettant en avant – on était en janvier 2013 – que je n’étais pas un délinquant sexuel. Finalement, l’affaire s’est tassée. J’ai été convoqué à nouveau le lendemain, et cela s’est traduit par un non-lieu.
De manière générale, pendant une douzaine d’années, nous n’avons pas déclaré les manifestations que nous organisions sur les trottoirs, et cela ne posait pas de problème. Mais en 2007 et 2008, les autorités préfectorales nous ont demandé de faire des déclarations préalables, et nous nous y sommes mis progressivement. Comme le DAL lance une ou deux initiatives par mois, voire davantage, il était fastidieux de se déplacer à chaque fois à la préfecture de police. Heureusement, en regardant un peu attentivement les textes, nous avons compris qu’il suffisait de procéder à cette déclaration par courrier, par fax ou par mail.
La loi nous oblige donc à faire une déclaration de manifestation. C’est ensuite au préfet, ou au maire, de décider s’il autorise ou non la manifestation. Il peut refuser s’il considère qu’il y a un risque de trouble à l’ordre public, sur la base de textes qui ont été pris après la tentative de coup d’État de février 1934, place de la Concorde.
Ainsi, dans les années quatre-vingt-dix, des policiers ont été mis en cause devant le tribunal correctionnel de Paris pour violences excessives. Plusieurs ont été condamnés pour violences excessives à notre égard, en général à la suite d’une première enquête débutant à l’IGS. Cela nous a permis d’établir des relations relativement convenables avec les autorités de police, c’est-à-dire sans violences. Il arrivait, bien sûr, que l’on se plaigne de coups de pieds donnés à des mères de famille, de chaussures écrasées, d’insultes, mais on peut dire que les choses s’étaient un peu calmées par rapport ce que l’on avait connu au début de notre existence.
Dans le courant des années 2000, nous avons continué de la même façon, en produisant des images, mais cela n’a jamais donné lieu à des poursuites. En réalité, toutes les actions que nous avons engagées pour violences excessives ont été classées sans suite. En outre, la procédure a changé puisque l’on doit maintenant systématiquement passer par l’Inspection générale des services quand on met en cause une autorité de police. Finalement, on se sent moins protégé que dans les années quatre-vingt-dix par rapport à d’éventuelles violences policières.
L’affaire de 2013 est révélatrice de mon propos. En octobre, l’autorité de police nous a évacués à plusieurs reprises, parfois assez violemment, de nos campements, alors que nous avions fait des déclarations en bonne et due forme. Le samedi 19, notamment, la police nous a encerclés et au moment où nous allions quitter la place de la République, nous y a empêchés en nous encageant. Cela a donné lieu à des violences car des manifestants se sont assis par terre, refusant de se retrouver insérés dans le dispositif. Certaines personnes ont été plus ou moins blessées. L’épisode a été filmé. Il est toujours possible de trouver des éléments d’information sur Internet, mais nous pourrons vous laisser une clé USB. L’affaire s’est arrêtée là. 11 personnes sont allées porter plainte à l’IGS et, le 24 mars 2014 nous avons reçu un avis de classement sans suite.
Cette affaire va au-delà des violences policières qui ont été commises. Elle pose la question de la légitimité de l’intervention des forces de l’ordre, dans la mesure où nous avions fait des déclarations préalables et nous étions en règle avec la loi.
Peu de temps après, nous avons saisi le tribunal administratif pour demander que soit respectée notre liberté de manifestation. Le tribunal nous a donné raison, et a enjoint à la préfecture de police de nous laisser manifester pour faire connaître la situation des mal-logés. Nous nous sommes alors réinstallés sur la place de la République jusqu’à ce que des discussions s’établissent avec les autorités. Celles-ci ont été chargées de reloger dans un délai de six mois des familles qui attendaient en vain depuis plusieurs années.
Dans la façon d’intervenir des forces de police, on a bien senti que des instructions avaient été données. Sur cette place de la République, elles sont intervenues à plusieurs reprises pour nous évacuer : une première fois, alors que nous étions sur place, un père de famille s’est fait arracher l’oreille ; une deuxième fois, nous sommes partis parce que nous avons bien senti que nous allions nous faire malmener ; et une troisième fois, à l’occasion de ce rassemblement du 19 octobre, nous avons compris que les forces de police voulaient nous faire peur. À ce moment-là, les policiers semblaient disposer d’une certaine marge de manœuvre. Par ailleurs, ils agissaient de manière illégale, puisque nous avions procédé aux déclarations nécessaires. Reste que tout cela s’est soldé par une décision de classement.
Encore une fois, nous avons le sentiment que les moyens de recours devant la justice sont plus difficiles aujourd’hui que dans les années quatre-vingt-dix. Cela peut paraître paradoxal, mais c’est à cette conclusion que nous conduit notre pratique quotidienne.
Maintenant, la violence à laquelle nous sommes confrontés est relative. Ce sont des coups de pied, des coups de poing donnés en dessous, parfois des étranglements, mais on ne sort pas les matraques et il n’y a pas d’intervention frontale. Ce ne sont pas les brutalités que l’on a pu connaître à Sivens ou ailleurs. En revanche, certaines opérations de maintien de l’ordre en milieu urbain, dans le cadre d’initiatives non violentes, déclarées et reconnues légales par les autorités judiciaires, peuvent être considérées comme disproportionnées – et s’avérer illégales.
En conclusion, ce n’est pas du maintien de l’ordre par rapport à un trouble général causé à l’ordre public. C’est un maintien de l’ordre politique par rapport à un mouvement social. On est davantage dans le cadre d’une répression d’origine politique.
M. Pascal Popelin, rapporteur. Nous avons souhaité vous entendre en raison de la diversité des actions que vous pouvez être amené à initier. Cependant, le périmètre des investigations de notre commission d’enquête concerne le maintien de l’ordre républicain, et non l’ensemble de l’action de la police et de la gendarmerie dans l’exercice de ses missions de sécurité publique. Je vous poserai plusieurs questions.
Avez-vous été confrontés à des unités spécifiquement dédiées au maintien de l’ordre, CRS et gendarmes mobiles, ou bien à des effectifs de sécurité publique plus traditionnels ?
Ces évènements sont-ils intervenus au moment de la dispersion d’une manifestation, moment connu et généralement convenu avec les autorités ? Sont-ils liés à une intervention destinée à mettre fin à une occupation, à la suite d’une décision de justice et en raison d’un refus d’obtempérer ? S’agit-il de violences exercées a priori ?
Si j’ai bien compris, vos relations avec les autorités de police et les autorités préfectorales sont convenables sans être franchement amicales. Vous nous avez dit que, maintenant, votre stratégie consistait à privilégier la procédure de la déclaration préalable. Mais j’imagine qu’elle ne peut pas convenir à toutes les actions que vous menez : si vous décidez d’aller occuper tel ou tel immeuble, vous n’allez pas le dire aux pouvoirs publics car il en va du succès de l’opération. Considérez-vous que le fait de procéder à cette déclaration préalable facilite le déroulement de votre initiative, parce qu’il permet une concertation et l’adaptation du dispositif de maintien de l’ordre qui est alors mis en place ? Ou considérez-vous que c’est plutôt une source de difficulté supplémentaire à la concrétisation de votre action ?
Enfin, vous avez insisté sur le caractère non violent de votre association. Avez-vous eu parfois à gérer la présence d’éléments radicaux, donc d’éléments extérieurs, lors des actions initiées par votre association ? Si oui, comment procédez-vous ?
M. le président Noël Mamère. Monsieur Eyraud, vous nous avez expliqué que pendant longtemps, vous n’aviez pas eu besoin de déclarer vos manifestations, puis qu’on vous avait demandé de le faire. En outre, vous nous avez parlé d’encagement, ce procédé qui consiste à cerner des manifestants et à les empêcher de quitter un lieu. Ce n’est pas conforme à la doctrine du maintien de l’ordre, au respect de la liberté d’expression et du droit à manifester. Considérez-vous donc que, dans ce pays, la liberté d’expression et le droit à manifester sont en train de se dégrader ?
M. Éric Straumann. Vous avez vingt-cinq ans d’expérience. La couleur des gouvernements a-t-elle, selon vous, une incidence sur l’encadrement des manifestations ? Pensez-vous que les conditions d’encadrement se soient durcies depuis 2012 ?
M. le président Noël Mamère. Il est exact que les manifestations que vous organisez n’ont rien à voir avec les manifestations du type de Sivens, où l’on a envoyé des gardes mobiles, qui sont spécifiquement formés au maintien de l’ordre. Cela dit, le nombre de manifestations qui ont lieu en milieu urbain et qui n’entrent pas dans le périmètre strict du maintien de l’ordre sont mille fois plus nombreuses que les manifestations sur lesquelles nous avons à nous pencher.
M. le rapporteur. En dehors des « zones à défendre », dont on a beaucoup parlé dans notre commission, les occupations peuvent faire l’objet d’opérations de maintien de l’ordre qui ne sont pas forcément menées – et c’est pour cela que j’ai posé la question – par des unités spécifiquement dédiées au maintien de l’ordre.
Notre champ de compétences ne se réduit pas au rôle joué par les CRS et les gendarmes mobiles, il s’étend à la nature de l’opération qui est menée et demandée. Et ce n’est pas la même chose de veiller au bon déroulement d’une initiative sur la voie publique, que de faire exécuter une décision de justice.
M. le président Noël Mamère. La formation des personnels chargés du maintien de l’ordre a son importance. Je me suis très trouvé très souvent en face de personnels qui n’étaient pas formés comme le sont, par exemple, les gardes mobiles.
M. le rapporteur. C’est bien pour cela que j’ai demandé à M. Eyraud à quels personnels ils étaient confrontés.
M. Jean-Baptiste Eyraud. Nous avons à faire généralement aux forces de sécurité parisienne, et plus rarement à des gardes mobiles ou à des CRS. Mais cela arrive et je peux vous en donner deux exemples.
En 2007, alors que nous campions rue de la Banque, les autorités envoyèrent un piquet de gardes mobiles pour nous empêcher de nous réinstaller sur la chaussée. À l’époque, il n’était pas nécessaire de faire de déclaration préalable pour mener ce genre d’initiative. Depuis dix-sept ans, nous organisions des campements sans que cela pose de problèmes particuliers. Mais l’autorité préfectorale a décidé de dresser des procès-verbaux et de nous assigner devant le tribunal correctionnel pour avoir abandonné des déchets et des encombrants sur la voie publique. Nous avons été condamnés à 12 000 euros d’amende, mais nous sommes allés en appel et l’association a été relaxée. La cour d’appel a en effet considéré que les tentes n’étaient pas des encombrants. Il est clair que la préfecture avait cherché, par ce biais, à neutraliser notre action.
En revanche, le 19 octobre 2013, place de la République, c’est à des CRS que nous avons été confrontés.
Maintenant, est-ce que les relations, les modes d’intervention et les comportements sont différents selon les corps de police qui interviennent ? Je ne saurais pas vous le dire. Notre sentiment est plutôt que ce sont les officiers qui donnent le ton.
M. le rapporteur. Dans le cadre d’une manifestation, l’engagement de la force publique doit répondre à une instruction donnée par le préfet ou son représentant.
M. Jean-Baptiste Eyraud. En 2007, nous nous sommes aperçus que les commissaires, sur le terrain, n’étaient plus fiables. Nous avions pris l’habitude de discuter avec le commissaire qui se trouvait sur place et la plupart du temps, on parvenait à un accord. Mais les relations ont changé, sans doute parce que l’organisation préfectorale a été modifiée, que le poste de commandement central et l’observation vidéo ont pris plus d’importance. Les instructions sont maintenant directement données par le représentant du cabinet ou du préfet, qui n’est pas forcément sur place, mais qui, de la préfecture, regarde ce qui se passe.
De fait, nous avions remarqué à plusieurs reprises que lorsque nous concluions un accord avec le commissaire, dix minutes après, celui-ci revenait dessus. Nous avons compris que cela se passait au-dessus et qu’il fallait trouver le moyen de s’entendre avec l’autorité supérieure. Nous le déplorons car pour nous, le commissaire est celui qui a l’autorité sur le terrain. Cela va à l’encontre de notre conception de l’organisation du maintien de l’ordre républicain.
Ensuite, il arrive en effet que l’on procède à une évacuation à la suite d’une occupation d’immeuble. Nous ne contestons pas et, en règle générale, nous partons, même si la décision d’évacuation ne nous paraît pas légale : dans un immeuble, il y a de nombreux dangers – par exemple, de chute dans les escaliers – et nous voulons éviter qu’il y ait des blessés. La plupart du temps, d’ailleurs, l’évacuation s’organise avec les autorités sur place.
Il n’en va pas de même des campements. Je vous l’ai dit, avant 2007, il n’était pas nécessaire de faire de déclaration préalable quand on organisait un campement sur le trottoir ou sur une place. À partir de cette date, nous y avons été fortement incités, et nous avons fini par le faire. Le campement est ainsi devenu une forme de manifestation sans parcours, une manifestation statique.
Il suffit de se reporter à une déclaration de campement pour s’en convaincre. En voici un extrait :
« Objet : déclaration de manifestation, place de la République, du 21 octobre 14 heures, au lundi 28 octobre 19 heures.
« Nous organisons, le 21 octobre, à partir de 14 heures, une manifestation statique. Cette initiative a pour objet d’exprimer les conditions d’existence des familles, etc. À cette fin, nous prévoyons des prises de parole, etc. »
Cela me rappelle un épisode sur lequel je souhaite revenir. L’autorité préfectorale s’est rendu compte que nous avions fait une déclaration de manifestation pour le 19 octobre, et qu’elle ne nous avait pas opposé de refus. Nous prenons soin, en effet, de déposer une déclaration au minimum quatre jours avant la manifestation, de sorte que l'autorité puisse nous répondre dans des délais raisonnables, qui nous permettent ensuite, en cas de refus, de contester devant le tribunal administratif.
M. le rapporteur. Ce type de refus vous est-il souvent opposé ?
M. Jean-Baptiste Eyraud. En l’occurrence, le 20 octobre, un dimanche soir, un officier de police judiciaire (OPJ) s’est présenté chez moi pour me signifier l’interdiction de manifester le lendemain, le 21 octobre. Nous disposions ainsi une base juridique pour pouvoir contester. Le 31 octobre, le tribunal administratif a reconnu notre droit de manifester, même de manière statique. Il a donc écarté les arguments du préfet selon lequel « l’occupation du domaine public routier n’est autorisée que si elle a fait l’objet d’une autorisation de voirie ». Ainsi, nous avons pu nous réinstaller librement sur la place de la République, non sans avoir déclaré préalablement les modalités, le périmètre et la durée de l’installation.
Enfin, nous n’avons jamais rencontré de problème particulier à l’occasion des manifestations de rue. Celles-ci ne se terminent jamais par des barricades. Il faut préciser que le public du DAL est majoritairement composé de femmes et de mères de familles, qui sont très préoccupées par les problèmes de logement. Il n’y a jamais eu de débordement.
Un jour, des éléments radicaux s’étaient joints à une manifestation. Elles ont fait elles-mêmes leur service d’ordre et les ont fait partir.
M. le rapporteur. Ils n’étaient pas trop méchants !
M. Jean-Baptiste Eyraud. Nous n’avons jamais été agressés par des mouvements racistes ou d’extrême-droite.
M. le rapporteur. Je pensais à des personnes qui ne sont pas forcément concernées par l’objet de la manifestation, qui ont envie de casser des vitrines ou de provoquer la police et qui s’insèrent dans le mouvement en pourrissant la vie de ceux qui sont venus manifester pacifiquement. Y avez-vous été confrontés ?
M. Jean-Baptiste Eyraud. Nous ne sommes pas très nombreux. Nos manifestations rassemblent 2 000 à 3 000 personnes maximum, parfois 5 000, exceptionnellement 10 000. Leur taille modeste nous permet de mieux maîtriser ce qui se passe. D’ailleurs, la préfecture de police sait bien que dans nos manifestations, il n’y a pas de débordement. Au bout d’un certain moment, on annonce que c’est terminé et on se disperse. Il faut dire que maintenant, tout est annoncé, écrit, en quelque sorte programmé.
M. le rapporteur. Mais par exemple, les coups de pied dont vous nous avez parlé, sont-ils donnés au moment de la dispersion de la manifestation, ou au cours d’une opération ?
M. Jean-Baptiste Eyraud. Cela dépend.
M. le président Noël Mamère. Je suppose que cela dépend de la fébrilité du moment…
M. Jean-Baptiste Eyraud. À une certaine époque, les autorités de police cherchaient à anticiper les actions que nous allions conduire et sur lesquelles nous n’avions pas fait de déclaration préalable. Ainsi, il y a quinze ans, accompagnés d’ailleurs du professeur Léon Schwartzenberg, nous sommes allés au Conseil régional pour demander que l’on construise davantage de logements sociaux. Les Renseignements généraux nous suivaient dans le métro et nous entendions, au-dessus, les sirènes de police. Nous nous doutions bien que nous allions retrouver les forces de police à la sortie. Comme nous le faisions souvent, une fois dehors, nous avons couru pour essayer d’arriver avant elles. Des policiers sont sortis de leurs cars et se sont précipités en courant pour nous attraper. C’était très dangereux, et nous avons d’ailleurs dit à la préfecture de police qu’elle devait contrôler ses hommes et trouver d’autres modalités. De notre côté, nous avons fait attention, et cela fait longtemps qu’on ne nous suit plus en surface. Le développement des téléphones portables dans le métro y est sans doute pour quelque chose.
À quel moment ont lieu les incidents dont je vous ai parlé ? Ce peut-être au moment où l’on arrive, une fois que l’on est arrivé, ou quand on s’en va.
M. le rapporteur. Vous visez des manifestations déclarées ?
M. Jean-Baptiste Eyraud. Oui. Je vous parle des interventions des forces de police qui ont eu lieu place de la République.
M. le rapporteur. Je voudrais confronter la théorie à votre pratique. Imaginons que vous participiez, place de la République, à une manifestation qui n’a pas été interdite. Vous nous dites que vous risquez, dans ce cadre, d’être confrontés à une intervention des forces de sécurité publique – ou de maintien de l’ordre – qui peut se traduire par des violences, alors même que cette manifestation se déroule conformément à ce qui avait prévu – et déclaré – au départ.
Selon la doctrine du maintien de l’ordre républicain, les forces de sécurité, qui doivent se tenir à distance, sont là pour réguler, canaliser la manifestation et s’assurer que la vie se déroule le plus normalement possible. On ne peut recourir à la force qu’à partir d’un moment où il y a eu non-respect de la loi – voies de fait, exactions, dégradations, etc. – ou de consignes de dispersion, après sommations.
Ce que vous vivez parfois n’est donc pas conforme à cette doctrine. J’aimerais savoir à quel moment et comment cela se produit. Il est inacceptable, de mon point de vue de républicain, de refuser, par exemple, de se disperser à la fin d’une manifestation. Mais il est tout autant inacceptable que quelque citoyen que ce soit, dans une manifestation qui n’a pas été interdite, soit bousculé et prenne ne serait-ce qu’un coup de pied …
M. Jean-Baptiste Eyraud. …ou soit encagé. Nous pourrons vous transmettre des documents ou des images qui se réfèrent à cette période.
Les faits qui se sont déroulés place de la République remontent à 2013, époque où, manifestement, la préfecture de police considérait que l’installation d’un campement ne pouvait être que tolérée. C’est pourquoi la déclaration de manifestation du DAL a été remise en cause par les autorités de police, qui ne nous ont pas signifié pour autant d’interdiction de manifester, nous privant ainsi de toute possibilité de contester cette interdiction.
Dans un deuxième temps, un de nos voisins, magistrat à la retraite, nous a aidés. Il est allé discuter avec le commissaire en faisant valoir que nous avions fait une déclaration de manifestation dans les délais, et que les autorités ne l’avaient pas interdite. Voilà pourquoi, le 20 octobre, au lendemain de ces brutalités policières, on nous a signifié en bonne et due forme, une interdiction de manifester pour le 21. Mais celle-ci n’était pas justifiée puisque le tribunal administratif a contesté les arguments de la préfecture de police.
Depuis, nous n’avons pas installé de campement de longue durée. Je ne saurais donc pas vous dire quelle sera la doctrine de la préfecture de police si cela se reproduit. Mais cela risque de se reproduire très prochainement puisque, malheureusement, la situation du logement continue à se dégrader. Dans ce cas, et si votre commission d’enquête siège toujours, nous vous tiendrons au courant.
Enfin, j’aurais tendance à penser que le traitement n’est pas le même selon la sensibilité politique du gouvernement en place. Mais en réalité, je ne le sais pas.
Entre 2002 et 2012, nous avons connu des moments difficiles, des personnes ont été blessées et la procédure a été modifiée. Depuis cette réforme, dès lors que l’on met en cause un policier, il faut passer par l’IGS ; celle-ci fait une pré-enquête, et ce n’est qu’à l’issue de cette pré-enquête que le parquet est saisi et donne un avis de non-lieu ou de poursuite. Auparavant, on pouvait saisir directement le parquet sans passer par l’IGS. Notre sentiment est que les policiers sont aujourd’hui mieux protégés qu’avant, dans le cadre des manifestations que l’on a conduites et des difficultés que l’on a pu rencontrer.
Cela dit, les premières violences policières que l’on a connues remontent à juillet 1992, sous un gouvernement de gauche, celui de Pierre Bérégovoy. Ce jour-là, on avait installé des matelas devant un immeuble vide ; au moment de l’intervention de la police, les matelas ont volé avec les bébés dessus ! Nous-mêmes en avons été surpris.
Je ne suis donc pas sûr qu’il y ait de grandes différences selon le gouvernement en place. Les évènements de 2013 se sont déroulés sous le gouvernement Ayrault. Nous verrons ce qui se passera avec le gouvernement Valls.
Je terminerai sur une remarque, qui est peut-être hors sujet. Un immeuble, un hôtel de chibanis, vient d’être évacué par la police pour des raisons de sécurité. Or la façon dont la préfecture de police procède est toujours vécue, en tout cas par les personnes évacuées, comme brutale et agressive, alors même qu’il s’agit de les protéger.
Nous pensons qu’il faudrait modifier les pratiques lorsqu’il y a évacuation pour péril – risque d’effondrement, d’incendie ou insalubrité. Il faudrait éviter d’envoyer, au petit matin, une centaine de policiers toquer aux portes en demandant aux habitants de prendre leurs affaires et de « dégager », puis de les embarquer dans des cars sans qu’ils sachent où ils sont emmenés. Même s’il y a urgence, il y a moyen de mieux les préparer. Ce sont souvent des gens aux origines modestes, pour une bonne part des migrants, qui ressentent très mal ces modalités d’intervention et d’évacuation.
M. le président Noël Mamère. Merci, monsieur Eyraud, d’avoir accepté de nous répondre.
*
* *
Audition, ouverte à la presse, de Mme Nathalie TORSELLI et de MM. Quentin TORSELLI, Christian TIDJANI, Joachim GATTI, Pierre DOUILLARD et Florent CASTINEIRA, représentants de l’Assemblée des blessés, des familles et des collectifs contre les violences policières, et du Docteur Stéphanie LÉVÊQUE
Compte rendu de l’audition du jeudi 19 mars 2015
M. le président Noël Mamère. Mesdames, messieurs, soyez les bienvenus. Nous sommes très intéressés d’entendre vos témoignages et de recueillir vos propositions et suggestions.
Conformément aux dispositions de l’article 6 de l’ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, je vous demande de bien vouloir prêter le serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité.
(Mmes Nathalie Torselli et Stéphanie Lévêque, MM. Christian Tidjani, Joachim Gatti, Pierre Douillard, Quentin Torselli et Florent Castineira prêtent serment.)
Docteur Stéphanie Lévêque. Médecin hospitalier depuis 1994, j’aimerais vous exposer les conditions dans lesquelles j’ai été amenée à adresser un courrier au préfet de la Loire-Atlantique pour porter à sa connaissance le nombre de blessés que j’ai soignés à Notre-Dame-des-Landes du samedi 24 au dimanche 25 novembre 2012.
Dans la semaine du 17 novembre 2012, une manifestation est lancée pour construire des cabanes sur le site de Notre-Dame-des-Landes : des milliers de personnes y participent dans une ambiance bon enfant et joyeuse. Le samedi 24 novembre, je rends visite à un ami agriculteur de la commune. Nous nous promenons dans la forêt en début d’après-midi et croisons de nombreux promeneurs de tous horizons. À notre grand étonnement, nous entendons des détonations au loin. En fin d’après-midi, je suis sollicitée pour soigner une dame de soixante ans, blessée, choquée, ne comprenant pas ce qui lui arrive. Elle me rapporte que des heurts violents ont eu lieu dans la forêt et qu’elle a vu de nombreuses personnes blessées autour d’elle. Victime d’une bombe lacrymogène qui a explosé près d’elle, elle a besoin de soins. Je m’installe dans le local le plus proche : une grange prêtée par cet ami agriculteur, à qui je demande d’apporter quelques pansements pour secourir cette dame.
Rapidement, des blessés sont acheminés jusqu’à la grange, qui se transforme peu à peu en poste de premiers soins et bientôt en hôpital de campagne. Nous demandons aux personnes qui nous entourent de faire venir du matériel d’urgence et une infirmière est envoyée à la pharmacie pour chercher de quoi suturer quelques blessés. Les premiers secours s’organisent tant bien que mal avec les moyens du bord. Des soignants présents sur la zone viennent nous aider, chacun apportant désinfectant, pansements, matériels. Un autre médecin me rejoint vers dix-sept heures.
De dix-sept heures à vingt et une heures, les blessés se succèdent, nous plongeant mon collègue et moi-même dans la stupeur et l’incompréhension face au nombre et à la sévérité des blessures, certaines entraînant des risques vitaux, et aux conditions dans lesquelles elles ont été infligées. Les blessés sont pour moitié des promeneurs pacifiques et, pour moitié, des jeunes installés sur la zone dans des cabanes. Je précise qu’aucun n’était armé ni menaçant.
Dans la nuit, nous faisons hospitaliser trois personnes : deux sont transportées par les ambulances de pompiers, sollicitées par le Samu que nous avions appelé, et une blessée est transportée par moi-même vers minuit, l’évacuation étant rendue difficile.
Avec mon collègue, nous organisons par la suite une permanence de soins pour la nuit. Le lendemain, les blessés étant moins nombreux, nous prenons quelques photos des blessures : peu, en réalité, car l’urgence de la situation a émoussé le réflexe de garder des traces.
Le dimanche soir, de retour chez moi, j’écoute la radio et j’entends : « Manifestations à Notre-Dame-des-Landes, des gens violents ont été repoussés par la police ; aucun blessé parmi les manifestants et plusieurs blessés parmi les policiers » – blessés que je déplore également, je tiens à le préciser.
Ayant soigné une quarantaine de personnes, je tiens à adresser au préfet un courrier – que je vous ai communiqué – pour lui apporter mon témoignage.
« Monsieur le préfet,
En ma qualité de médecin, je suis intervenue à Notre-Dame-des-Landes samedi 24 et dimanche 25 novembre 2012. J’ai passé deux jours à soigner des blessés. Je tiens à porter à votre connaissance le nombre de blessés que nous avons eu à prendre en charge.
Pour le samedi 24 novembre :
Onze blessures par Flash-Ball touchant : le thorax pour deux personnes avec un doute sur une lésion hépatique ; la joue et la lèvre supérieure pour une personne avec probable lésion dentaire ou maxillaire ; le genou pour deux personnes ; les doigts pour deux personnes ; la cuisse pour deux personnes ; les côtes pour une personne avec un doute sur une fracture des côtes ; le poignet pour une personne. À cela s’ajoutent trois traumatismes de genou, deux traumatismes de poignet, une plaie tympanique avec risque de surdité, un choqué par gaz, une plaie au crâne suturée par deux points, une autre par quinze points ; six blessures par explosion de bombes assourdissantes dont trois impacts dans les cuisses de trois personnes, un impact dans l’avant-bras ; un impact dans la malléole, dix impacts dans les jambes d’une personne, dix impacts dans les jambes d’une autre personne avec probable lésion du nerf sciatique avec risque de handicap, un impact dans l’aine avec suspicion de présence d’un corps étranger près de l’artère fémorale et possible hémorragie.
J’insiste sur la gravité de ces blessures par explosion. Les débris pénètrent profondément dans les chairs, risquant de léser les artères, nerfs et organes vitaux. Nous avons retiré des débris de 0,5 à 1 cm de diamètre, d’aspect métallique ou plastique, très rigides et coupants. D’autres, très profondément enfouis, ont été laissés en place et nécessiteront des soins ultérieurs. Impossible de prévoir les lésions secondaires.
Les hospitalisations n’ont pas été simples. Mon collègue a contacté le Samu et l’ambulance des pompiers a été retardée par les barrages. J’ai donc amené moi-même un deuxième blessé devant être hospitalisé. J’ai ainsi pu avoir des nouvelles d’une troisième personne hospitalisée dans la journée.
Pour le dimanche 25 novembre :
Une blessure par bombe assourdissante avec ablation d’un débris dans le doigt, une réfection d’un pansement de cuisse, une fracture de cheville, une blessure à la main, un impact de Flash-Ball au thorax avec suspicion de fracture de côte et lésion pulmonaire.
Je ne vous fais ici que la liste des patients les plus gravement blessés. Il semble que l’on dénombre une centaine de blessés durant ces deux jours. Je vous précise également que nous tenons à votre disposition les photos des lésions constatées.
En ma qualité de médecin, je souhaite attirer votre attention sur la gravité des blessures infligées par l’utilisation des armes des forces de l’ordre et cela, en dehors de toute considération partisane.
Dans l’espoir que ma description permette un usage plus mesuré de la force, veuillez croire, monsieur le préfet, à ma respectueuse considération ».
À la suite de ce courrier motivé par la disproportion des blessures, j’ai été reçue par le préfet qui a mis en doute mes constatations, me laissant dans l’incompréhension par sa volonté de me persuader que tout cela était nécessaire. Il m’a également adressé un courrier daté du 14 décembre 2012 dont je vais vous citer quelques extraits : « Sur le fond, les forces de l’ordre ont effectivement utilisé un nombre très limité de moyens intermédiaires, grenades de désencerclement et grenades assourdissantes, et parfois Flash-Ball » ; « Cet emploi s’est bien sûr toujours fait suivant les règles » et d’évoquer la proportionnalité ; « C’est dans ce cadre réglementaire que l’autorisation d’emploi a été donnée » ; et en conclusion, « Je ne peux que vous faire part de ma consternation devant de telles allégations, qui traduisent une volonté de désinformation sur la légitimité et la déontologie de l’action de l’État ». Inutile de vous dire que là n’était pas mon but.
Cette méconnaissance des conséquences de l’utilisation de ces armes, qui provoquent de graves blessures pouvant entraîner la mort – ou bien faut-il parler de déni – me pousse à témoigner et à appeler à un usage limité et proportionné des armes. La mort de Rémi Fraisse n’a fait que renforcer ma volonté. Plus jamais ça !
J’ai fermement confiance en l’intelligence et en l’humanité des hommes vivant dans notre pays civilisé. Je ne crois pas en une quelconque violence délibérée de la part de l’État ou des forces de l’ordre. Je n’ai pas rencontré d’opposants violents ou armés. Ce sont les blessures et non le camp auquel elles ont été infligées qui ont motivé mon courrier. Cependant, il me paraît grave de refuser l’évidence de la sévérité des blessures et de la nécessaire réflexion qu’appelle l’usage de certaines armes par les forces de l’ordre.
M. Pierre Douillard, représentant de l’Assemblée des blessés, des familles et des collectifs contre les violences policières. Nous avons élaboré un texte collectif que nous lirons à plusieurs voix.
Avant de commencer mon intervention, je tiens à rappeler que s’ouvre aujourd’hui le procès d’un gendarme qui a mutilé un enfant de neuf ans à Mayotte, Nassur, qui a perdu son œil.
Je vous livrerai d’abord notre sentiment sur la façon dont se déroulent les travaux de la commission d’enquête. La mort de Rémi Fraisse, qui l’a motivée, nous a tous révoltés en tant que blessés, mutilés et proches de personnes blessées : chaque personne blessée ou tuée par la police réveille nos propres blessures. Nous avons été étonnés de constater que de nombreuses auditions se sont transformées en tribunes pour la gendarmerie et la police. Le temps de parole qui leur a été réservé et la complaisance de certains commissaires n’ont pas manqué de nous irriter. L’intervention de M. Denis Favier, directeur général de la gendarmerie, venu exposer en dix points ses exigences en matière de restriction des libertés et de nouvelles dotations d’armes, a été exemplaire à cet égard. Dans cette salle, on a plus entendu parler de la violence supposée des manifestants que de la violence des forces de l’ordre. Pourtant, c’est bien un manifestant qui est mort à Sivens ; pourtant, ce sont bien des manifestants qui ont perdu un œil.
Il faut aussi préciser que c’est parce que des membres de l’Assemblée des blessés, des familles et des collectifs contre les violences policières en ont fait la demande que nous avons été invités. Sans cette démarche, aucun blessé n’aurait été auditionné.
M. le président Noël Mamère. Permettez-moi de vous interrompre. En tant que président de la commission d’enquête, je ne peux accepter de tels propos.
Premièrement, je précise que cette commission d’enquête ne peut interférer avec l’enquête judiciaire sur la mort de Rémi Fraisse. Son objet n’est pas d’établir les conditions qui ont entouré son décès mais d’analyser les modalités du maintien de l’ordre en France, sa doctrine, et les améliorations qu’on peut lui apporter.
Deuxièmement, si les représentants de l’Assemblée des blessés, des familles et des collectifs contre les violences policières n’avaient pas demandé à être entendus, nous les aurions invités comme nous avons invité Jean-Baptiste Eyraud, président de l’association Droit au logement. Nous comprenons votre douleur, nous comprenons votre colère, mais il ne me paraît ni sain ni juste de mettre en cause l’impartialité de la commission d’enquête parlementaire.
Troisièmement, cette commission, composée à la proportionnelle des groupes de l’Assemblée nationale, compte trente membres, mais il arrive bien souvent que seuls quelques-uns soient présents lors des auditions, il arrive même parfois que nous ne soyons que deux, le rapporteur et moi-même. Certains sont obsédés par la violence supposée des zadistes, comme vous l’avez souligné, mais vous avez sans doute constaté qu’entre nous, il y avait des affrontements, des oppositions.
M. Pierre Douillard. Nous avons pris très au sérieux notre participation à cette commission d’enquête et avons pris soin de regarder les auditions précédentes. Nous avons simplement voulu exprimer notre sentiment.
M. le président Noël Mamère. Et moi, je vous réponds que ce n’est pas à des sentiments mais à une réalité que je me réfère. Il est normal que, dans une commission d’enquête parlementaire, tout le monde soit entendu. Ce n’est pas à nous de dire dans quelles conditions Rémi Fraisse a trouvé la mort. On peut critiquer le cadre de cette enquête judiciaire, notamment le rôle qu’y jouent les militaires. Ce n’est pas notre objectif ici.
M. Pascal Popelin, rapporteur. Nous n’avons écarté personne. Nous avons élaboré un programme qui s’est construit progressivement et n’avons refusé aucune sollicitation, même s’il nous a fallu procéder à quelques contorsions dans nos agendas. Le Docteur Lévêque, qui ne représente aucune association mais apporte un témoignage en son nom propre, a souhaité être entendue et nous lui avons donné la possibilité de s’exprimer, malgré un programme chargé.
Par ailleurs, notre commission d’enquête ayant pour objet le maintien de l’ordre public, il me semble normal qu’elle entende ceux qui sont chargés de le mettre en œuvre.
M. le président Noël Mamère. Vous pouvez continuer, monsieur Douillard. Tout ce que vous dites figurera dans le rapport : il n’y a pas de censure dans cette maison, tout au moins dans ce lieu.
M. Pierre Douillard. Ce qui vient de se passer est intéressant, dans la mesure où aucun des colonels de gendarmerie, aucun des responsables des compagnies républicaines de sécurité (CRS), aucun des policiers auditionnés n’a été interrompu.
M. le président Noël Mamère. Aucun n’a remis en cause l’impartialité de la commission d’enquête parlementaire !
M. Pierre Douillard. Eh bien, je vais maintenant présenter notre association, l’Assemblée des blessés, des familles et des collectifs contre les violences policières, qui rassemble plus d’une dizaine de personnes blessées ou mutilées par la police à la suite de tirs de Flash-Ball ou de lanceurs de balle de défense (LBD) à hauteur de tête. Manifestants, supporters de football, habitants de quartiers populaires, nous venons de toute la France. Nos objectifs sont simples : soutenir les personnes blessées par la police ; partager et diffuser nos expériences en matière tant médicale que juridique, médiatique et politique ; lancer des initiatives communes ; se soutenir mutuellement en cas de procès de policiers mis en cause ; participer aux luttes en cours. Une interrogation nous unit : avec l’augmentation continue des blessés au Flash-Ball et LBD, combien serons-nous demain ?
Ces armes que sont le Flash-Ball et le LBD ont été mises à disposition des policiers en deux temps.
Le Flash-Ball Super-Pro a été mis en circulation à partir de 1995, à l’initiative de Claude Guéant. Se manipulant comme un pistolet, à une main, il a été fourni aux unités d’élite, dans une perspective de lutte contre le terrorisme et de répression des braquages. Très rapidement, il a été généralisé, dans les quartiers populaires en particulier – en 1999, un homme a perdu un œil dans une cité de banlieue parisienne.
À partir de 2007, est expérimenté le LBD 40, arme de catégorie A – arme à feu à usage militaire – plus précise et plus puissante que le Flash-Ball Super-Pro. Il est doté d’un viseur Eotech, technologie militaire permettant de viser précisément sa cible.
Progressivement, l’usage de ces armes est allé de la périphérie vers le centre : réservées initialement aux « classes dangereuses », aux populations des quartiers, elles ont été expérimentées lors de manifestations lycéennes. En novembre 2007, à Nantes, à l’occasion d’une manifestation contre la loi relative aux libertés et responsabilités des universités (LRU) – premier mouvement social un peu offensif du quinquennat Sarkozy –, le LBD 40 a ainsi été testé in vivo pour la première fois, de manière non encadrée. C’est à cette occasion que j’ai reçu une balle en caoutchouc au visage qui m’a fait perdre la vision d’un œil.
Depuis 2007, le LBD a blessé de très nombreuses personnes. Accompagnant un processus de militarisation de la police, il a pu être utilisé aussi bien dans les cités qu’à Notre-Dame-des-Landes ou dans des manifestations syndicales ou lycéennes.
Demain, ce seront peut-être vos enfants, vos proches qui seront touchés.
M. Florent Castineira, représentant de l’Assemblée des blessés, des familles et des collectifs contre les violences policières. Je vais tout d’abord rappeler quelques chiffres. Depuis 1995, pour le Flash-Ball, et depuis 2007, pour le LBD, on recense trente-six mutilés ou blessés graves connus. Parmi eux, des enfants de moins de dix ans ont été éborgnés : en 2011, Nassur, âgé de neuf ans, lors d’une intervention à Mayotte, et Daranka, âgée de huit ans, à Corbeil-Essonnes. On déplore également un mort, Mostefa Ziani, tué pendant une intervention policière à Marseille en 2011.
La justice a été à chaque fois saisie mais l’impunité policière est la règle : il n’y a eu qu’une condamnation de policier contre trente-six classements sans suite, non-lieux ou relaxes. Notons toutefois qu’après une plainte déposée devant un tribunal administratif, la responsabilité d’un préfet a été reconnue et l’État condamné à verser des indemnités. D’autres plaintes ont été déposées collectivement et sont en cours d’examen.
Bref, la police mutile et la justice couvre ses actes, quasi-systématiquement.
Nous tenons à préciser notre position sur l’utilisation du Flash-Ball.
Il faut écarter une première contrevérité selon laquelle le Flash-Ball pourrait se substituer à l’arme de service et permettrait d’éviter les homicides. Dans les situations où les policiers ont recours au Flash-Ball, ils n’auraient jamais utilisé leur arme de service. Sur le terrain, le Flash-Ball vient en complément de la matraque et du gaz lacrymogène. En ce sens, il augmente considérablement la violence de la police. D’autre part, le nombre de personnes tuées chaque année par balle par la police n’a pas diminué depuis l’avènement du Flash-Ball et du LBD.
Cet argument de la substitution est systématiquement mis en avant pour justifier l’usage de ces armes. Ici même, M. Denis Favier, directeur de la gendarmerie nationale, l’a invoqué pour demander que les gendarmes mobiles soient dotés de LBD. M. Cazeneuve l’a également utilisé il y a peu, à l’Assemblée nationale : « L’usage d’armes à feu est très fréquemment évité grâce aux armes de force intermédiaire », a-t-il déclaré. Selon ces raisonnements, nous aurions tous pu être tués par balle à l’occasion d’une manifestation, d’un rassemblement, d’un match de foot, d’une expulsion locative ou en attendant un bus.
Le Flash-Ball est l’extension mutilante de la matraque et non le substitut non mortel de l’arme de service. Nous nous opposons à tout usage du Flash-Ball et du LBD.
M. Quentin Torselli, représentant de l’Assemblée des blessés, des familles et des collectifs contre les violences policières. Dans les médias, lorsqu’il est question des manifestants blessés, on oppose souvent le fait qu’il y ait des policiers blessés. Nous avons établi une liste des personnes blessées ou mutilées à cause d’un Flash-Ball ou d’un LBD mais nous attendons toujours une liste des policiers blessés. La seule réponse, qui a été donnée ici même, est que « statistiquement, le nombre de blessés a augmenté chez les policiers », ce qui, vous en conviendrez, n’est pas satisfaisant.
Dans un entretien paru sur le site de Médiapart, à la suite de la manifestation du 22 février 2014 à Nantes, Jean-Christophe Bertrand, chef de la police de Nantes, affirmait : « Ceux qui prennent le risque de s’en prendre aux forces de l’ordre s’exposent eux aussi à des dommages corporels. ». Il évoquait aussi les blessures des policiers et gendarmes présents ce jour-là : « il y a eu des blessures physiques, comme des acouphènes, et d’autres moins visibles, psychologiques. Plusieurs fonctionnaires souffrent de troubles liés à la violence inouïe à laquelle ils ont dû faire face ». Voilà ce que M. Bertrand a à opposer aux trois personnes mutilées pendant ces manifestations : des acouphènes et des blessures psychologiques. Vous serez d’accord avec nous pour dire qu’il s’agit d’atteintes sans commune mesure avec les blessures subies par les manifestants.
Si le Flash-Ball tue rarement, il mutile très souvent. C’est à ce titre qu’il doit être interdit. Parmi nous, certains ont reçu un tir en plein dans l’œil, ce qui l’a fait exploser sur le coup : c’est le cas de Florent Castineira, Joachim Gatti et moi-même ; d’autres ont reçu un tir autour de l’œil, le choc provoquant un décollement de la rétine et une cécité pouvant être complète : c’est le cas de Pierre Douillard et de Geoffrey Tidjani, ici représenté par son père, Christian. Et nous avons aussi tous subi de multiples fractures du crâne et du nez. D’autres ont eu la mâchoire explosée, ont perdu une partie de l’ouïe, souffrent de migraines constantes accompagnées de troubles neurologiques tels que l’aphasie.
Pour ma part, c’est le 22 février 2014 lors d’une manifestation contre l’aéroport de Notre-Dame-des-Landes que je me suis fait tirer dessus. Je m’apprêtais à quitter la manifestation : je n’étais ni armé ni violent, contrairement à ce que veut laisser croire la police des polices – il faut savoir que l’enquête est en cours et que l’instruction n’a toujours pas été ouverte, plus d’un an après les faits. Les médecins ont pu me sauver in extremis : j’ai eu plus de dix-sept fractures autour du visage, le nez cassé, l’œil arraché, ce qui a nécessité une reconstruction faciale. Tout cela a entraîné un bouleversement total dans ma vie. J’étais artisan charpentier et, ce 22 février, c’était mon anniversaire : j’avais réservé une table dans un restaurant pour le fêter avec des amis après la manifestation. Du jour au lendemain, tout s’est arrêté, socialement et professionnellement.
J’espère que l’exposition de mon cas personnel vous permettra de vous interroger sur les conséquences de tels tirs.
M. Christian Tidjani, représentant de l’Assemblée des blessés, des familles et des collectifs contre les violences policières. Nous avons relevé que, dans de nombreuses manifestations, les policiers ne respectaient pas le règlement et visaient explicitement le visage. À Nantes, lors des manifestations du 22 février 2014, les policiers de la brigade anti-criminalité (BAC), armés de Flash-Ball, avaient pour habitude de regarder les manifestants en posant une main sur un œil, pour leur signifier qu’ils risquaient de le perdre. Rappelons que trois personnes ont perdu un œil ou la vue d’un œil et que de nombreuses autres ont été touchées au visage.
Nous estimons toutefois qu’aucune formation, aucun règlement n’est en mesure de prémunir contre ces risques. Quand bien même les policiers ne viseraient pas le visage, cette arme constituerait un conditionnement dangereux. Quelle que soit son utilisation, il existe toujours un risque de mutilation, voire de mort. Mostefa Ziani, à Marseille, a été touché par un tir de Flash-Ball au torse et il est mort d’un arrêt cardiaque.
En matière de maintien de l’ordre, la différence de traitement est aussi de règle. Votre commission a déjà évoqué la différence de traitement entre manifestants, selon qu’ils étaient zadistes ou agriculteurs. Au-delà de la doctrine officielle, l’État met en œuvre un maintien de l’ordre beaucoup plus offensif, qui s’applique à des pans toujours plus larges de la population. La dotation massive en Flash-Ball et LBD entraîne une augmentation mécanique des tirs perpétrés, donc des blessures graves allant jusqu’à la mutilation, l’infirmité permanente et la mort. Ce changement de pratique reflète un changement implicite de doctrine de la police française.
On tire à nouveau sur la foule et c’est insupportable.
M. Joachim Gatti, représentant de l’Assemblée des blessés, des familles et des collectifs contre les violences policières. La simple présence du LBD opère un glissement qui modifie en actes la doctrine appliquée sur le terrain. Si, comme le dit M. Bertrand Cavallier, « la règle d’or en matière de maintien de l’ordre est que la force doit se manifester sans jamais avoir à s’exercer », on doit reconnaître que le Flash-Ball répond à une logique inverse. L’arrivée d’un canon à eau, l’équipement des CRS avant une charge, ainsi que les secondes qui précèdent le lancer des gaz lacrymogènes sont perceptibles par les manifestants. La force se manifeste avant de s’exercer. Le Flash-Ball, lui, ne se manifeste pas ; il frappe. Et pour cause : son déploiement se résume au simple fait d’appuyer sur la gâchette. Les blessés disent d’ailleurs souvent ne pas avoir compris ce qui leur arrivait.
On peut souligner une autre caractéristique du Flash-Ball et du LBD, qui les met en porte-à-faux avec la doctrine française du maintien de l’ordre. Les gaz lacrymogènes, une charge de CRS, un jet de canon à eau s’adressent au corps collectif des manifestants : leur fonction est de les repousser dans le cadre des dispositions relatives à l’attroupement. Le Flash-Ball et le LBD répondent aux mêmes cadres d’usage mais leurs effets sont tout à fait différents. D’abord, ils ne s’adressent pas au corps collectif des manifestants mais à une seule personne. Ensuite, ils ne repoussent pas mais frappent. S’ils dispersent, ce n’est pas par l’exercice contenu de la force contre l’ensemble des manifestants mais par l’extrême violence exercée sur l’un d’entre eux. Pour cette raison, nous disons que le Flash-Ball et le LBD sont des armes de terreur. Leur devise, c’est : « En frapper un pour terroriser tous les autres ».
Aux principes d’absolue nécessité, de proportionnalité, de mise à distance, est associée de manière sous-jacente la responsabilité que les forces de l’ordre ont de l’intégrité physique des manifestants, quelles que soient les manifestations et quels que soient leurs participants. Les jets d’eau repoussent et mouillent. Les gaz lacrymogènes piquent les yeux, le visage et la gorge. Le Flash-Ball et le LBD blessent, mutilent et parfois tuent. Il y a là, en actes, un changement de la doctrine qui ne dit pas son nom, une transformation lourde de significations. Avec le Flash-Ball et le LBD, c’est la possibilité même d’agir collectivement sans prendre le risque d’être mutilé qui est remise en question.
À de nombreuses reprises, les membres de la commission ont mis en équivalence la violence des manifestants et la violence des forces de l’ordre : l’une viendrait justifier l’autre. Cela n’a pas de sens pour nous. D’un côté, il y a un corps armé composé de milliers d’hommes entraînés ; de l’autre, une population civile. On a bien compris qu’avec cette équivalence, ce que l’on essaie de nous faire accepter, c’est qu’une minorité violente s’infiltrerait à l’intérieur de cortèges pacifiques et respectueux de la légalité. Au final, ce seraient eux les responsables de la mort de Rémi.
Ce qui fut la stratégie de défense du Gouvernement trouve une prolongation ici. Cet ennemi intérieur justifierait des armes nouvelles et des lois d’exception. Pour nous, la réalité est tout autre. D’une certaine manière, on la devine dans les mots des policiers eux-mêmes : la police fait face non pas à une augmentation de la violence mais à une augmentation de la conflictualité générale. Qu’ils soient agriculteurs, travailleurs précaires ou zadistes, ceux qui se battent n’ont plus d’autre choix que d’emprunter des formes de lutte sortant du cadre de la simple manifestation. Il n’y a pas de bons ou de mauvais manifestants ; il y a des gens, de plus en nombreux qui, dépossédés de leur activité, de la richesse commune, de leur territoire, de leur environnement, se battent pour les garder, voire pour les reconquérir. Et ils font face à un pouvoir qui ne lâche plus rien car il est entièrement soumis à des intérêts économiques privés.
Mme Nathalie Torselli, représentante de l’Assemblée des blessés, des familles et des collectifs contre les violences policières. Le Flash-Ball et le LBD ne se contentent pas de blesser physiquement un seul individu, ils touchent également familles et entourage. Il est important et nécessaire que cette commission soit informée de ce que des parents ressentent.
Nos enfants ont été éborgnés, marqués à vie, atteints dans leur intégrité par un policier qui, armé d’un Flash-Ball, leur a tiré dans l’œil, alors qu’ils ne présentaient de danger pour personne. Ces enfants, ils auraient pu être les vôtres. Ils sont plus de quarante aujourd’hui à traverser cette épreuve.
À la douleur de voir son enfant démoli, s’ajoute l’incompréhension : comment cela peut-il se produire dans un pays qui se dit civilisé ? S’ajoute aussi la rage : on ne peut pas, on ne doit pas se taire, il faut dénoncer ces faits avec force.
Une blessure reçue dans de telles circonstances n’a rien à voir avec un accident de bricolage ou un malencontreux hasard. Les parents, les frères et sœurs, les proches sont touchés au plus profond d’eux-mêmes. Eux aussi sont abîmés, enveloppés qu’ils sont par une sensation glauque, poisseuse, collante, qui ne les lâche plus et les transforme irrémédiablement. Pour eux aussi, il y a désormais un avant et un après la mutilation.
Ils vont de surcroît devoir vivre avec le ressenti très net que leur fils, leur frère, leur ami est désormais perçu comme un individu dangereux selon l’idée répandue par la police et les responsables politiques, et entretenue par une certaine presse, que s’il a été blessé par la police, c’est qu’il l’a bien cherché et qu’il l’a mérité.
Ils vont aussi devoir traverser de longues et pénibles années de procédure judiciaire à l’issue incertaine – non-lieu, relaxe – et dont la lenteur étudiée suspend le temps et empêche la réparation, la reconstruction. C’est une nouvelle violence.
Il leur faudra enfin soutenir psychologiquement et financièrement celui qui, fragile, est devenu socialement un handicapé et qui devra parfois réorienter sa vie professionnelle ou étudiante.
Avant ce drame, nous faisions partie de la masse des citoyens insérés et engagés dans la société ignorant tout des violences policières durant les manifestations. Nous n’étions pas révoltés, nous le sommes devenus.
M. Pascal Popelin, rapporteur. Je tiens tout d’abord à préciser que personne ici ne peut rester indifférent à vos témoignages, à vos situations personnelles et aux cas que vous avez exposés.
Vous le savez, nous ne sommes pas juges. Nous sommes ici pour construire une réflexion collective sur les manières de garantir la liberté de manifester, qui connaît de nouvelles formes, de plus en plus diverses, dans le respect de l’ordre républicain, nécessaire dans une démocratie comme la nôtre.
Pour ce qui me concerne, monsieur Douillard, je n’ai pas perçu les dix propositions du directeur de la gendarmerie nationale comme un appel à la restriction des libertés publiques, en particulier lorsqu’il invite à renforcer le dialogue avec les manifestants, à améliorer la lisibilité des sommations ou encore à adapter les équipements, notamment les moyens de force intermédiaire, en vue d’une utilisation plus encadrée.
J’ai finalement assez peu de questions à vous poser. Votre exposé à plusieurs voix, très charpenté, a permis de répondre à nombre de celles qui me venaient à l’esprit. Je pense en particulier aux circonstances dans lesquelles vous avez été blessés les uns et les autres, qui ont été marquées, me semble-t-il, par le non-respect de la doctrine et des modalités d’emploi de la force, tels qu’ils nous ont été décrits, ce qui nous pousse à nous interroger sur les possibilités de leur apporter des améliorations, même s’il y a toujours une part d’humain.
Vous nous avez aussi éclairés sur les suites judiciaires. Le pouvoir législatif s’interdit autant que faire se peut de commenter les décisions des autorités judiciaires mais s’efforce de lui conférer la plus grande indépendance possible, si difficile que cela soit, notamment lorsque cela passe par des modifications constitutionnelles.
J’ai bien reçu le message qui était le cœur de vos divers témoignages : l’interdiction de l’emploi des LBD par les unités en charge du maintien de l’ordre et des Flash-Ball par les autres forces de police – mais nous savons que ces armes produisent les mêmes effets. Je nuancerai simplement le propos de M. Gatti qui a distingué l’emploi du Flash-Ball et du LBD de celui d’autres outils comme les gaz lacrymogènes. Le Docteur Lévêque a bien indiqué que tant les gaz lacrymogènes que les grenades assourdissantes blessaient. Ces équipements, dans leur ensemble, ne doivent être utilisés qu’en dernier recours, après sommation, dans des conditions strictement encadrées. C’est un élément sur lequel nous devrons réfléchir.
M. le président Noël Mamère. Ce sont moins des questions que des réactions que suscitent chez moi vos propos.
Les témoignages tant du Docteur Lévêque que des représentants de l’Assemblée des blessés, des familles et des collectifs contre les violences policières sont accablants, il faut le dire. Je fais partie de ceux qui, après ce qui est arrivé à Joachim Gatti, ont demandé l’interdiction des Flash-Ball et des tasers. Je n’ai aucune raison, compte tenu du nombre de blessés par LBD et Flash-Ball, de renoncer à cette demande. Contrairement à ce qu’on veut nous faire croire, les LBD sont encore plus dangereux que les Flash-Ball.
Je constate avec satisfaction que le ministre de l’Intérieur, à la suite de la tragédie de Sivens, a interdit l’utilisation des grenades offensives, après l’avoir suspendue dans un premier temps. Les forces de l’ordre, bien formées comme le sont les gardes mobiles, n’ont pas à avoir recours à des armes à caractère létal, qui contiennent autant de TNT que celles utilisées pendant la guerre de 14.
Cette demande d’interdiction du Flash-Ball et du LBD n’est pas seulement motivée par les blessures et les traumatismes qu’ils peuvent entraîner. Elle se justifie aussi par un argument qu’a fort bien développé Joachim Gatti. Le recours à ces armes induit un renversement de la doctrine du maintien de l’ordre qui repose, en France, sur la mise à distance, l’intervention n’étant envisagée qu’en dernier recours. Il implique qu’il n’y ait plus de sommation, plus de possibilité pour les manifestants de sentir la force se manifester avant qu’elle ne s’exerce. L’argument selon lequel le recours aux armes intermédiaires éviterait d’utiliser des armes plus lourdes ne tient pas. Leur utilisation contrevient à la doctrine qui prévaut depuis plusieurs décennies dans le maintien de l’ordre. Mes collègues se sont rendus à Hambourg : les forces de l’ordre sont dotées de canons à eau mais n’utilisent pas d’armes intermédiaires comme en France.
En revanche, monsieur Gatti, je ne partage pas forcément votre conclusion selon laquelle les gouvernements seraient soumis aux lobbies économiques. Vous dites aussi que certaines catégories de la population sont obligées de recourir à de nouvelles formes de lutte, car elles ne peuvent plus exercer leur activité, citant parmi elles les agriculteurs. Je vous ferai remarquer que l’impunité, si elle bénéficie parfois aux policiers, concerne aussi certaines catégories sociales dans ce pays qui peuvent faire ce qu’elles veulent. Ainsi, les forces de l’ordre sont particulièrement clémentes avec des agriculteurs suréquipés, qui peuvent détruire la préfecture de Morlaix et provoquer de graves dégâts, sans être inquiétés. Il y a aussi cet aspect à prendre en compte.
M. Guy Delcourt. Madame Levêque, je vous remercie de votre témoignage. J’aimerais être sûr de ne pas me tromper : le préfet de l’époque était-il bien Christian Galliard de Lavernée ?
Docteur Stéphanie Lévêque. Effectivement !
M. Guy Delcourt. Je n’aurai pas beaucoup de questions, l’audition ayant été particulièrement bien préparée.
Je partage la position du président. J’ai participé à la commission d’enquête sur l’affaire dite d’Outreau : sa publicité, son ouverture ont permis qu’elle évolue. Il en va de même pour cette commission d’enquête, nous n’avons rien à cacher. Si nous avons pu vous donner l’impression de trop écouter les forces de l’ordre, cela n’implique pas que nous acquiescions. Et même si nous avons posé des questions qui peuvent paraître complices, je peux affirmer qu’elles ne l’étaient nullement.
Dans un autre cadre, j’ai pu rencontrer des syndicats de policiers et des membres de la gendarmerie qui s’inquiètent de la radicalisation de certains fonctionnaires dans leurs rangs. Ce phénomène n’est pas aujourd’hui quelque chose qui nous échappe, c’est même une préoccupation pour nous.
Vous avez pu vous rendre compte que je ne prenais pas de note car cet exercice serait un reflet de ma subjectivité. J’aurai notamment pu être influencé par le fait qu’un ami, sapeur-pompier à Lille, a perdu sa main dans une manifestation.
Avant de porter une appréciation sur le fonctionnement de la commission, je suis obligé de vous demander d’attendre la publication du rapport final. C’est à partir de ce document objectif que la commission sera amenée à se prononcer auprès du rapporteur et du président. Vous aurez de la part des commissaires un véritable jugement, marqué par l’indépendance et la pluralité. Soyez-en assurés.
M. Joachim Gatti. Monsieur le rapporteur, il est un peu étrange de résumer nos propos en disant à peu près le contraire de ce que nous avons dit.
Le problème du Flash-Ball ne renvoie pas simplement aux circonstances ou au non-respect du règlement. Nous considérons que cette arme, du fait de son extrême dangerosité, est toujours susceptible de provoquer de graves blessures et des mutilations, y compris lorsque le cadre d’usage est respecté.
M. Pascal Popelin, rapporteur. Il me faut donc redire que, de mon point de vue, après avoir écouté vos témoignages, les blessures que vous avez décrites résultent d’un emploi des LBD, Flash-Ball, et autres équipements qui se situe en dehors du cadre réglementaire. J’ai aussi dit avoir bien compris que votre message était l’interdiction totale des LBD et Flash-Ball.
M. Joachim Gatti. Je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez bien. Lors d’une manifestation à Grenoble, Quentin, un jeune pompier, a été mutilé au Flash-Ball. L’un de ses collègues avait dirigé le tuyau d’incendie vers les policiers, mais seulement en faisant un jet en cloche. En réaction, les policiers ont répliqué par un tir de Flash-Ball : le collègue a esquivé en se baissant et c’est Quentin qui a reçu le projectile en plein visage. Peut-on dire que, dans cette situation, le cadre d’usage n’a pas été respecté ?
Vous affirmez aussi, monsieur le rapporteur, que toutes les armes sont susceptibles de blesser. Certes, mais on ne peut pas les mettre sur le même plan car elles n’ont pas toutes les mêmes effets. La généralisation du Flash-Ball a entraîné une multiplication des mutilations. Penser que les conditions d’usage du Flash-Ball et d’une bombe lacrymogène sont les mêmes est faux. Cela dit, je suis d’accord avec vous pour dire que les bombes assourdissantes sont aussi dangereuses qu’un Flash-Ball.
S’agissant des agriculteurs, il y en a, je vous l’accorde, monsieur le président, de différents types : ceux de la FNSEA ne sont pas les mêmes que ceux qui sont venus protéger la ZAD à Notre-Dame-des-Landes.
M. le président Noël Mamère. Il n’y a pas qu’une agriculture en France, il y a des agricultures ; en conséquence, il y a plusieurs sortes d’agriculteurs.
M. Joachim Gatti. Bertrand Cavallier, ancien directeur du centre de Saint-Astier, a évoqué lors de son audition devant votre commission le tour de l’Europe qu’il avait fait, soulignant qu’en Espagne, lorsqu’il a participé à la formation des premiers gardes civils, il a insisté sur la nécessité de renoncer à utiliser les pistolets gomme-cogne. Or qu’est-ce qu’un Flash-Ball sinon un gomme-cogne ? C’est exactement la même arme ! Les plastic bullets utilisées en Irlande, qui étaient aussi un genre de gomme-cogne, ont été interdites par le Parlement européen en 1982. Le Flash-Ball n’est pas autre chose que la résurgence de ces armes interdites.
Il m’apparaît important de se poser la question des intérêts économiques qui se cachent derrière le maintien du LBD 40.
M. Pascal Popelin, rapporteur. J’aimerais réagir car c’est la première fois que je suis confronté à une telle transformation de mes propos. Je n’ai pas établi de hiérarchie, je me suis contenté de dire que l’interdiction des Flash-Ball et LBD que vous appelez de vos vœux n’implique pas que les autres armes utilisées lors des manifestations sont anodines. Je vous saurais gré de ne pas me faire dire ce que je n’ai pas dit.
M. Pierre Douillard. Pour compléter les propos de Joachim Gatti, j’ajouterai que la police catalane est désormais équipée de LBD de fabrication française après qu’une très forte mobilisation a abouti à l’interdiction des fusils tirant des balles en caoutchouc, qui ont entraîné des mutilations sur de très nombreux manifestants.
Par ailleurs, il faut rappeler que toutes les grenades explosives n’ont pas été interdites après la mort de Rémi Fraisse : les grenades lacrymogènes de type GLI F4 sont toujours en usage, alors même qu’elles contiennent du TNT et peuvent tuer. Des grenades d’autres types sont elles aussi dangereuses, comme l’a rappelé le Docteur Lévêque.
M. le président Noël Mamère. Je ferai partie de ceux qui en demanderont l’interdiction. Le TNT n’a pas à être utilisé lors de manifestations.
Quant aux intérêts économiques, on peut sans doute cerner leur poids s’agissant des grenades offensives qui sont fabriquées par la même société depuis la guerre de 14.
M. Christian Tidjani. Monsieur Delcourt, lors d’une précédente audition, vous avez demandé de manière insistante si des dérapages incontrôlés de la BAC avaient fait dégénérer des manifestations. À cette question, vous n’avez pas obtenu de réponse.
D’autres questions demeurent sans réponse. Aucun des blessés que compte notre assemblée n’a été secouru par les forces de maintien de l’ordre alors qu’il me semble de leur devoir de le faire. Cela me paraît constituer une forme de non-assistance à personne en danger. Le cas de Quentin est flagrant puisqu’on a empêché les secours d’arriver. Quel est donc l’objectif du maintien de l’ordre aujourd’hui ?
M. Guy Delcourt. Bertrand Cavallier, ancien directeur du centre de formation de la gendarmerie, a indiqué de façon très claire lors de son audition qu’à son sens, il serait préférable, lors des manifestations, que les brigades départementales de gendarmerie restent en casernement et que l’on ne fasse appel qu’aux unités formées à Saint-Astier. Je lui ai demandé s’il estimait qu’il devait en être de même pour les effectifs de police. Certaines enquêtes intérieures – car il y en a – ont révélé que des gendarmes débordés, craignant sans doute pour eux-mêmes, ne s’étaient pas conduits de manière adéquate.
Pour les BAC, je suis soumis à l’obligation de réserve qu’impose le cadre de la commission d’enquête mais j’aurai la réponse à ma question. Je considère que les fonctionnaires de la BAC, à qui je rends un vibrant hommage pour l’exercice quotidien de leurs missions, ont reçu une formation qui ne peut s’adapter aux opérations de maintien de l’ordre lors de manifestations, qui supposent un commandement central. Dans la phase encadrée de la manifestation, ils n’ont pas à intervenir. Et c'est un point de vue que partagent nombre d’entre eux du reste.
À plusieurs reprises, nous avons demandé aux autorités militaires de la gendarmerie et aux officiers de police de nous préciser quelle était la nature de la coordination de l’autorité civile représentée par le préfet. Des dysfonctionnements ont été relevés et nous espérons faire avancer les choses. Pour l’heure, l’affaire n’est pas classée. Cela reste pour nous un sujet de préoccupation.
M. Éric Straumann. C’est avec beaucoup d’attention, mesdames, messieurs, que nous avons écouté vos témoignages, qui sont réellement poignants. Nous pouvons en effet nous interroger sur le recours aux Flash-Ball, plus dangereux que ne le croit sans doute l’opinion publique.
Les représentants de l’Assemblée des blessés, des familles et des collectifs contre les violences policières nous ont remis des photos et je dois dire que la légende de l’une d’elles m’a choqué : « Maintien de l’ordre ou escadron de la mort ? ». Peut-on qualifier les policiers français, même en civil, d’escadron de la mort ? Je ne pense pas que ce type d’excès puisse servir votre cause.
M. Christian Tidjani. Cette photo représente des policiers de la BAC de Nantes en civil, avec des cagoules tête de mort.
M. le président Noël Mamère. On ne peut pour autant les comparer avec les escadrons de la mort de la dictature argentine.
M. Christian Tidjani. Cette manière de cacher son visage nous donne l’impression d’un glissement vers quelque chose de mortifère. Je me demande ce que ces personnes-là, compte tenu de leur attitude, viennent faire dans une opération de maintien de l’ordre.
M. Éric Straumann. Cette photo montre des policiers en uniforme à l’arrière-plan et, au premier plan, des policiers en civil munis du brassard « Police ». S’ils ont le visage masqué, c’est sans doute pour échapper aux gaz lacrymogènes ou, tout simplement, ne pas être reconnus. Il est bon aussi que des policiers soient présents à l’intérieur même des manifestations pour transmettre des informations aux autres forces de police et signaler des éléments qui nécessitent une surveillance renforcée. Qualifier ces policiers d’« escadron de la mort », donc de meurtriers, me paraît complètement surréaliste.
M. Christian Tidjani. Notez que nous avons utilisé ce qualificatif sous forme interrogative.
M. Delcourt a dit qu’il rendait un vibrant hommage aux policiers de la BAC dans l’exercice quotidien de leurs missions. En tant qu’habitant du 93, je peux vous dire qu’ils reproduisent dans les quartiers les provocations dont ils sont familiers dans les manifestations. Quand ils procèdent à un tir, ils ajustent leur procès-verbal sur ce tir au lieu de se conformer à la réalité des faits. C’est la raison pour laquelle il y a autant de non-lieux.
Voilà pourquoi nous accordons autant d’importance à la question du rôle que joue la BAC.
M. Pierre Douillard. Monsieur Straumann, sur cette photo, les policiers en civil de la BAC revêtus d’une cagoule tête de mort ne sont pas simplement infiltrés dans la manifestation, ils chargent les manifestants, brandissant matraques et LBD. Ils ne cherchent pas à se camoufler en manifestants, ils veulent délibérément faire peur. Et cette photo a été prise lors d’une manifestation qui a eu lieu moins d’une semaine après la mort de Rémi Fraisse.
M. Florent Castineira. J’aimerais préciser les conditions dans lesquelles j’ai été blessé. J’étais assis dans une buvette avant un match de foot pour boire un verre avec quelques amis. Une équipe de la BAC a chargé l’un des supporters car il portait un fumigène – ce qui n’était pas interdit car celui-ci était éteint et hors du stade. Certains ont voulu le défendre, d’autant qu’il était avec sa femme et sa fille, mais les policiers ont continué de taper, puis ont reculé et ont tiré au Flash-Ball.
Ils attaquent, ils provoquent la haine et, ensuite, ils plaident la légitime défense ! Le système judiciaire tolère de tels agissements : les policiers peuvent tirer sur les gens sans être inquiétés.
Le peuple exprime son mécontentement à l’égard de l’État en manifestant et la réponse de l’État, ce sont des tirs de Flash-Ball. Il exprime sa rage sans être armé et les policiers lui tirent dessus. La violence, c’est de leur côté qu’elle se trouve.
M. Pascal Popelin, rapporteur. Tout l’objet de notre travail au sein de la commission d’enquête est d’essayer d’apporter des réponses pour que les blessures dont vous avez été victimes ne se reproduisent plus, quelles qu’en aient été les circonstances – je le rappelle, nous ne sommes pas juges. Soyez assurés que nous mettrons tout en œuvre pour formuler des préconisations en ce sens, même si elles ne répondent pas toutes à vos propres préoccupations. Vos cas ne peuvent que heurter notre conscience de républicains.
Un long chemin nous attend. C’est à la fin du mois de mai que nous déciderons de la version finale du rapport. Il ne constituera certes pas le point final de la nécessaire réflexion sur ces questions mais nous espérons qu’il apportera une contribution utile. Vous y aurez participé, au même titre que les fonctionnaires de police et de gendarmerie, et je vous en remercie.
M. le président Noël Mamère. Merci, mesdames, messieurs, d’avoir répondu à cette invitation sollicitée. J’aimerais une dernière fois illustrer le caractère impartial de notre commission d’enquête : après l’audition du président de Droit au logement, Jean-Baptiste Eyraud, et des représentants de votre association, nous allons entendre Fabien Jobard, chercheur en sciences sociales, qui compte parmi les meilleurs spécialistes des questions du maintien de l’ordre. Dans Le Monde du 16 mars dernier, il disait à propos des émeutes de 2005 : « Cette tactique de maintien de l’ordre a servi lors des épisodes suivants, avec l’emploi répété du Flash-Ball et des équipes surarmées. Le politique affiche la reprise en main ostentatoire des quartiers ».
*
* *
Audition, ouverte à la presse, de M. Fabien JOBARD, directeur de recherches au CNRS, actuellement en poste au Centre de recherches Marc Bloch à Berlin
Compte rendu de l’audition du jeudi 19 mars 2015
M. le président Noël Mamère. Chercheur en sciences sociales, vous comptez parmi les meilleurs spécialistes des questions du maintien de l’ordre en France. Nous serons heureux d’entendre votre analyse des évolutions qu’a connues le maintien de l’ordre dans notre pays et de recueillir vos éventuelles observations sur les manières de l’améliorer.
Conformément aux dispositions de l’article 6 de l’ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, je vous demande de bien vouloir prêter le serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité.
(M. Fabien Jobard prête serment.)
M. Fabien Jobard. Monsieur le président, mesdames, messieurs, directeur de recherche au CNRS, je suis actuellement chercheur au Centre Marc Bloch à Berlin après avoir été chercheur au Centre de recherches sociologiques sur le droit et les institutions pénales (CESDIP), principal centre de recherche en sociologie pénale en France, dont j’ai eu la chance d’être le directeur pendant cinq ans. J’ai travaillé sur le maintien de l’ordre à partir de 1995 : d’abord, en menant des entretiens et des observations auprès de compagnies de district à Paris ; puis, en me consacrant à l’étude du maintien de l’ordre en dictature, à travers le cas de la RDA ; plus récemment, en 2008, en retournant sur le terrain à Paris pour suivre des manifestations avec les compagnies de district, notamment des manifestations lycéennes, qui sont parmi celles qui posent le plus de soucis aux forces de l’ordre.
J’introduirai mon propos par quelques considérations de théorie de la police. Le maintien de l’ordre, d’une certaine manière, n’est pas un métier policier, mais une compétence politique. La police – la police urbaine ordinaire que nous connaissons dans la vie de tous les jours – est fondée sur des principes mêlant discernement de l’agent, connaissance du terrain, dialogue, confiance, appréciation de la situation préalable à la décision et ancrage territorial. Le maintien de l’ordre, à l’inverse, repose non sur des individus mais sur des unités constituées organisées selon un mode militaire, où prévaut le principe de la discipline à travers une chaîne de commandement. La force, dans les opérations de maintien de l’ordre, n’est engagée que sur l’ordre de l’autorité légitime, alors que sa mise en œuvre relève de l’appréciation individuelle du gardien de la paix en police ordinaire. Beaucoup de chercheurs, notamment anglo-saxons, estiment même que le maintien de l’ordre est un métier de type militaire et non policier.
Cela a une conséquence très claire : il faut réaffirmer la responsabilité des autorités civiles dans la conduite des opérations de maintien de l’ordre. Certaines des personnes que vous avez auditionnées vous l’ont d’ailleurs dit, notamment des responsables des forces de police ou de gendarmerie. Le préfet est le seul responsable en matière de maintien de l’ordre, en particulier s’agissant de l’ordre d’user de la force ou des armes. Et si l’autorité civile tente de se retrancher derrière les forces de police pour dissoudre la responsabilité, cela ne peut être considéré que comme une manœuvre. J’insiste sur ce point, car dans le cadre d’opérations de maintien de l’ordre, même la notion de légitime défense est une notion fragile.
Ce caractère politique du maintien de l’ordre a une autre conséquence : on ne saurait le concevoir sous un angle exclusivement technique. Le sociologue américain Peter K. Manning parle de « fonction dramaturgique » de la police : c’est aussi une image qui est gérée. Le maintien de l’ordre engage une responsabilité devant des contingences – une foule protestataire, une foule festive – mais aussi la capacité à convaincre que le politique est en mesure de maîtriser une situation donnée, de se montrer fort. Savoir si l’on s’engage dans une stratégie de désescalade ou une stratégie martiale est une question dont la nature n’est ni technique ni policière mais entièrement politique.
Dans les pays de common law, en Grande-Bretagne, aux États-Unis, au Canada, en Australie, en Nouvelle-Zélande, le maintien de l’ordre est envisagé tout autrement qu’en France. Le principe de police autonomy prime : le policier est considéré en tant que professionnel comme seul responsable de la conduite des opérations, dans un cadre général fixé par le politique qui n’est pas censé intervenir ensuite – s’il s’avère qu’il le fait, sa responsabilité peut même être mise en cause. En France, il existe une tradition de méfiance à l’égard des forces de police : le politique doit être au plus près du policier. Cela implique que, d’une certaine manière, le policier est dépossédé de la responsabilité du maintien de l’ordre.
Ce modèle politique du maintien de l’ordre qui caractérise la France n’implique cependant pas que nous soyons régis par une police du prince. Le maintien de l’ordre a été très fortement juridicisé à partir du décret-loi de 1935 et même constitutionnalisé, avec la décision du Conseil constitutionnel de 1995 sur la fouille des véhicules. Il est également régi par des dispositions de l’Union européenne et de la convention de Schengen, dont les pays signataires disposent d’un fichier d’informations commun, le fichier SIS. Et puis, bien entendu, ni le droit ni le politique ne peuvent décider de tout : en face, il y a des manifestants qui disposent de leur propre répertoire d’actions, de leur propre savoir et qui savent faire preuve d’adaptation tactique.
Ce préalable théorique étant posé, je m’attacherai à cerner trois points de tension : l’indétermination croissante de la définition du maintien de l’ordre ; le maintien de l’ordre comme dispositif de connaissance ; le rapport du maintien de l’ordre à la durée.
Première tension : l’extension du domaine du maintien de l’ordre.
Le maintien de l’ordre associe de manière très spécifique une chaîne de commandement et une responsabilité exclusive de l’autorité civile, du préfet, et donc du politique.
Depuis une vingtaine d’années, on observe en France une multiplication des quasi-unités de maintien de l’ordre : compagnies départementales, compagnies de sécurisation, brigades anti-criminalité districtalisées. Autant d’unités ne bénéficiant pas d’une formation analogue à celles des compagnies républicaines de sécurité (CRS) ou des escadrons de gendarmerie mobile, n’ayant ni le même équipement ni la même doctrine d’intervention, à qui, pourtant, l’on confie des missions qui relèvent du maintien de l’ordre.
Pourquoi cette évolution ? D’autres notions à la doctrine très indéterminée, en particulier celle de violences urbaines, sont venues titiller le domaine du maintien de l’ordre et fragiliser les dispositifs policiers. Lorsque l’on estime qu’une opération relève de la violence urbaine et qu’elle met en cause des acteurs qualifiés de « jeunes violents » dans les rapports de police, une définition préalable de la situation va entièrement déterminer l’action des forces de police : certains types d’armes seront employés, par exemple des lanceurs de balle de défense (LBD) ou des Flash-Ball, et certaines des unités que j’évoquais seront mobilisées. Et, dans ces occasions, personne n’est vraiment en mesure de maîtriser l’usage de la force qui peut être fait.
Je voudrais ici insister sur l’outil le plus en cause dans cette indétermination du maintien de l’ordre, le Flash-Ball, aujourd’hui utilisé au cours de rassemblements festifs, de rassemblements protestataires – des lycéens se regroupant devant leur établissement avant de rejoindre un cortège dans leur agglomération, par exemple –, d’opérations aux abords des stades de football. Introduite par un texte du directeur général de la police nationale, Claude Guéant, en 1995, cette arme, à l’origine en dotation collective, a fait de plus en plus l’objet de dotations individuelles. Et c’est à partir de sa généralisation en 2003, à la suite d’un texte du directeur central de la sécurité publique, que le nombre de blessés s’est multiplié : vingt-cinq blessés, quinze personnes énucléées, un mort au total. L’Espagne vit une situation comparable avec une vingtaine de blessés graves depuis 2004, date à laquelle l’usage du Flash-Ball a été généralisé.
Il faut définir une ligne de démarcation très nette entre, d’une part, les opérations relevant du maintien de l’ordre, qui appellent l’intervention d’unités constituées, formées et équipées à cet effet, et qui obéissent à une source de commandement clairement déterminée, et, d’autre part, les opérations relevant de la police urbaine ordinaire, qui ne sauraient reposer sur le recours à de telles armes.
Je n’ouvrirai pas le débat sur la police urbaine en France, cela nous conduirait très loin. Je me limiterai aux unités constituées. Un discours répandu veut que, aujourd’hui, celles-ci soient confrontées à de petits groupes mobiles et déterminés face auxquels elles ne pourraient faire grand-chose. Ce n’est pas vrai. Cette invocation d’un aujourd’hui en rupture avec le passé date de vingt ans au moins. Dans les années quatre-vingt-dix, lorsque je conduisais des entretiens à la préfecture de police avec mon collègue Olivier Fillieule, aujourd’hui en poste à l’université de Lausanne, on nous disait déjà que le public n’était plus le même, qu’il s’agissait de groupes déterminés et mobiles qui échappaient au contrôle des unités constituées, on mettait déjà en place des équipes légères d’intervention de gendarmerie et l’on commençait à réfléchir à ce qui deviendra les sections de protection et d'intervention (SPI) et les sections d’appui et de manœuvre (SAM) des CRS, en gros, au fractionnement opérationnel des unités constituées et à leur capacité à libérer certains de leurs membres pour effectuer des interpellations et ramener les personnes interpellées dans les rangs des forces de police.
Plutôt que de multiplier les unités de para-maintien de l’ordre, appelées aux États-Unis « unités para-militaires », et les équipements aux qualificatifs tous plus délirants les uns que les autres – « non-létaux », « sublétaux », « demi-létaux », comme s’il pouvait y avoir une demi-mort ! –, il importe de revenir aux compétences des unités formées au maintien de l’ordre et d’examiner avec elles jusqu’où travailler dans la constitution d’équipes légères d’intervention.
J’évoquerai un dernier point qui menace la cohésion du maintien de l’ordre : l’intervention de préoccupations relevant de la police judiciaire. Le maintien de l’ordre est une opération politique et le pouvoir politique veut qu’il y ait des interpellations, des déferrements, des comparutions immédiates, voire des condamnations. Cette préoccupation est compréhensible mais il faut bien en mesurer les conséquences : cette logique d’interpellation conduit à l’individualisation du rapport des forces de maintien de l’ordre aux foules qu’elles ont en face d’elles alors que, vous le savez, le maintien de l’ordre repose sur la mise à distance des foules par une action massive, donc dissuasive, et non sur l’intervention sur des corps individuels.
Cette immixtion du judiciaire dans les dispositifs de maintien de l’ordre conduit des unités en civil – des brigades anti-criminalité (BAC) ou, à Paris, la brigade d'information de voie publique (BIVP) ou la section sportive de la préfecture – à intervenir selon leurs méthodes propres sans considération pour la logique d’ensemble du dispositif de maintien de l’ordre. J’ai pu le constater en 2008 lors des manifestations lycéennes que j’ai observées du côté des forces du maintien de l’ordre.
J’en viens à mon deuxième point, que j’estime absolument fondamental : le maintien de l’ordre comme dispositif de connaissance.
Le maintien de l’ordre, tous les policiers vous le diront, repose sur la connaissance de la société, des groupes protestataires, des dynamiques de contestation, d’escalade mais aussi de désescalade, de l’articulation entre violences et expressions politiques conventionnelles.
En ce domaine, la France commence à accuser quelques retards. Nous mesurons depuis assez longtemps les effets de la dissolution des Renseignements généraux. Celle-ci a entraîné une perte de connaissance des phénomènes de société à l’échelle territoriale. Les événements de Poitiers, de Strasbourg, de Notre-Dame-des-Landes, mais aussi de Sivens ont illustré la difficile capacité des pouvoirs publics à anticiper les dynamiques de protestation et de contestation. Toutefois, les autorités publiques ont bien pris la mesure du problème et une réforme du renseignement territorial est en cours.
Reste à améliorer le rapport de la police au savoir. En France, aucun enseignement de sciences sociales n’est dispensé dans les écoles de police alors qu’en Allemagne – comme cela a dû vous être dit lors de votre visite à Lunebourg –, l’Institut de formation des cadres de la police, la Deutsche Hochschule der Polizei de Münster, comprend dans son corps enseignant des chercheurs avec qui je peux écrire des articles publiés dans des revues de sociologie. C’est l’une des raisons pour lesquelles, nous autres universitaires, avions lancé l’alerte face à l’émergence d’une prétendue science criminologique soutenue par l’idée qu’il faudrait payer des gens à répéter ce qu’ils tiennent de la police dans une logique totalement circulaire, qui n’aide ni le savoir ni la police. Pour nous, le savoir doit venir de l’extérieur. On ne saurait se satisfaire de productions internes et auto-référentielles.
Reste aussi à la France à s’intégrer dans des instances de réflexion collective auxquels participent déjà nombre de pays européens, en particulier s’agissant des dynamiques d’escalade ou de violence dans les manifestations. La Suède, le Danemark, la RFA, le Royaume-Uni, l’Espagne, le Portugal, l’Autriche, la Slovaquie, la Hongrie et d’autres ont ainsi pris part à la production d’un guide de bonnes pratiques dans le cadre du projet GODIAC – Good Practice for Dialogue and Communication as Strategic Principles for Policing Political Manifestations in Europe – qui repose sur un savoir élaboré en commun par les policiers et les chercheurs en sciences sociales autour du comportement des foules. Tout n’est sans doute pas à prendre mais ce qu’il faut retenir, c’est l’absence de la France de ces dispositifs.
Des policiers et des gendarmes vous ont sans doute parlé de l’excellence française en matière de maintien de l’ordre et de l’exportation du modèle français. Je suis au regret de vous dire que cette réalité relève du passé. La livraison à la Tunisie dictatoriale d’équipements destinés à réprimer les manifestations avait fait figure d’anecdote lugubre mais ce genre de prestation risque d’être l’essentiel de ce que la France sera capable d’exporter à l’avenir. Les élites policières françaises devraient participer à ces arènes collectives d’élaboration de nouvelles doctrines, non que celles-ci soient nécessairement meilleures, mais parce qu’elles supposent d’échanger avec des pairs, de s’ouvrir à de nouvelles expériences au lieu de se replier sur soi-même et d’en rester à des connaissances vieilles d’un siècle et demi.
Par ailleurs, les polices anglaises et allemandes ne se contentent pas de collecter des renseignements avant les opérations de maintien de l’ordre, elles le font au cours des opérations mêmes. Il s’agit pour elles d’échanger le plus possible avec les manifestants. La France connaît certes un dispositif analogue à travers les officiers de liaison, qui ont une connaissance très fine des interlocuteurs, notamment au sein des organisations professionnelles et des syndicats. Simplement, il faudrait encourager une extension du dialogue au plus grand nombre de groupes possible afin de tenir compte du caractère polymorphe des manifestations, auxquelles prennent part des groupes fort divers.
Je vous donnerai un exemple significatif. Les manifestations lycéennes sont extrêmement pénibles à gérer : l’organisateur dépose l’appel à manifester mais, par la suite, ne maîtrise rien. Il fait bien sûr appel aux services d’ordre des grandes organisations professionnelles, en plus du service d’ordre qu’il aura lui-même constitué, mais des surprises sont toujours possibles. C’est ainsi que lors des manifestations du printemps 2008, les policiers et les services d’ordre ont vu apparaître des gros bras, des jeunes âgés de dix-huit à vingt-cinq ans, qui ont pris place à l’avant de la manifestation. Plus la manifestation approchait de la place de la Nation, plus cela chauffait et le service d’ordre de la CGT a pris le pas sur ces « muscles » d’origine inconnue afin de prendre en charge la conduite du cortège. Mais, à aucun moment de la manifestation, je n’ai vu de policiers engager de dialogue avec ces jeunes, qui, une fois arrivés place de la Nation, sont repartis chez eux sans qu’on ait pu savoir qui ils étaient, alors qu’il aurait peut-être été possible de construire avec eux un dispositif durable pour faire en sorte que les manifestations lycéennes se passent mieux. Cette attitude m’est apparue d’autant plus paradoxale que, depuis vingt ans, les policiers ne cessent de déplorer la baisse des effectifs syndicaux qui réduit leur capacité à s’appuyer sur des services d’ordre forts, du moins à Paris.
Ajoutons une note en bas de page. Lorsque la police ou les pouvoirs publics ont le sentiment de mal maîtriser un phénomène, leur premier réflexe est de créer un fichier. Un responsable policier a même tenté de défendre, devant votre commission, l’idée de créer, à côté des manifestations et des violences urbaines, une catégorie « subversion politique », qui appellerait la création d’un fichier. Cela me paraît être la solution la plus sommaire et la moins efficace qui soit car elle exonère de comprendre les dynamiques de radicalisation individuelle et collective et d’effectuer un travail de renseignement classique, consistant à se rendre dans les clubs de jeunes, les associations culturelles et sociales, les municipalités pour se faire connaître et échanger.
J’en viens à mon troisième et dernier point, le rapport du maintien de l’ordre à la durée.
Les policiers responsables du maintien de l’ordre, les commissaires d’arrondissement à Paris, mettent souvent en avant l’avantage qu’ils détiennent : des réserves de forces quasiment inépuisables puisqu’il leur est possible, sur une durée très longue, de renouveler leurs effectifs. Il leur suffit d’attendre qu’en face, les manifestants s’épuisent et le mouvement se dissout sans qu’il y ait eu recours à la force.
Aujourd’hui, les forces policières se heurtent à un problème technique avec l’occupation. Certes, ces modes d’action ne sont pas nouveaux : nous connaissons les sit-in, les grèves de la faim, les occupations d’églises, d’écoles ou de bâtiments désaffectés. Mais le mouvement planétaire Occupy, les Indignés ou les manifestants de Notre-Dame-des-Landes ont mis en œuvre des formes de protestation où l’occupation est devenue la finalité même du mouvement, et non plus un moyen.
Dans les pays de common law, le politique est tenu le plus loin possible de la décision policière. On attend avant tout que la dimension judiciaire de l’occupation soit épuisée : le juge examine la nature de l’occupation, rend une décision et la police l’exécute selon le modèle du law enforcement. Dans les pays où le politique commande au maintien de l’ordre, deux solutions sont envisageables : la recherche d’une médiation, tactique coûteuse en termes de temps, ou bien l’emploi de la force en vue de déblayer le terrain, comme on a pu le voir à Sivens. Deux philosophies contraires du maintien de l’ordre s’opposent ici.
La durée a toujours été une ressource essentielle de gestion des protestations et de désescalade et toute intervention du politique dans ce type de circonstances comporte le risque, loin d’être négligeable, d’une confrontation violente.
M. Pascal Popelin, rapporteur. Ce qui nous intéressait tout particulièrement dans vos travaux, c’est leur dimension comparative et je vous remercie de nous avoir donné des pistes dans ce domaine.
Vous avez insisté sur le rôle particulier que joue en France ce que vous appelez le pouvoir politique, rôle inconcevable en Allemagne, comme nous avons pu le mesurer lors de notre visite à Lunebourg. J’emploierai plutôt l’expression de « pouvoir civil », incarné par des préfets, qui rendent compte à un Gouvernement, responsable devant l’opinion publique. Lors de leurs auditions devant notre commission, les professionnels du maintien de l’ordre ont souligné qu’ils souhaitaient que le pouvoir civil assume clairement la responsabilité des intentions et la fixation de l’objectif, sans pour autant intervenir dans les modalités d’intervention. Pensez-vous qu’il serait souhaitable d’aller vers un retrait du pouvoir civil des opérations de maintien de l’ordre ?
Quelle est votre opinion sur la mise à distance, doctrine française, face à l’entrée en contact, pratiquée dans d’autres pays ?
S’agissant du LBD, je ne voudrais pas trahir vos propos, mais j’ai cru comprendre que votre critique portait essentiellement sur l’usage qu’en faisaient des unités non spécialisées dans le maintien de l’ordre. Que pensez-vous de leur usage dans les unités spécialisées, étant entendu que tous les cas d’incidents, d’accidents et de blessures qui nous ont été rapportés semblent dériver d’une utilisation en dehors des protocoles prévus ?
Vous avez évoqué la propension des autorités politiques aux interpellations. Il faut préciser que celles-ci portent non sur les manifestants mais sur des individus qui perturbent les manifestations, commettent des voies de fait, cassent des vitrines ou s’attaquent au mobilier urbain. Nos concitoyens peuvent accepter le désordre public quand il renvoie à la possibilité de manifester mais pas quand il résulte de telles actions.
Les unités spécialisées dans le maintien de l’ordre public ne sont pas demandeuses. Elles considèrent que procéder à des interpellations ne fait pas partie de leur métier et conduit même à perturber le bon déroulement de leurs manœuvres destinées à assurer le maintien de l’ordre. C’est la raison pour laquelle les dispositifs de maintien de l’ordre comprennent de plus en plus d’unités de police ou de gendarmerie qui se consacrent aux interpellations. Peut-être serait-il nécessaire de préciser les conditions d’articulation de ces actions, même si les professionnels que nous avons auditionnés considèrent qu’elles sont bonnes.
Enfin, j’aimerais vous interroger sur le degré de violence. Avez-vous des éléments d’appréciation sur le nombre de blessés du côté des manifestants et du côté des forces de l’ordre ? Ceux qui considèrent que les manifestations sont de plus en plus violentes ont tendance à dire que le nombre de blessés parmi les forces de l’ordre est de plus en plus important ; à l’inverse, ceux qui considèrent que le pouvoir réprime davantage mettent en avant un plus grand nombre de blessés parmi les manifestants. Pensez-vous qu’il serait opportun de systématiser un outil de mesure objectif à l’issue de chaque opération de maintien de l’ordre ?
M. le président Noël Mamère. Votre exposé montre qu’il y a un très grand déficit de médiation dans notre pays, et même que celle-ci a connu un recul puisque vous soulignez que la seule chose que la France serait capable d’exporter aujourd’hui, ce serait des armes.
Quelles voies d’amélioration envisagez-vous ? Ne pourrait-on imaginer, à l’instar de l’Allemagne, que la formation des policiers comprenne un cursus de sciences sociales ? Cela pourrait faire partie des préconisations de notre rapport.
M. Pascal Popelin, rapporteur. Un exemple : parmi les responsables de la police qui nous ont accueillis lors de notre visite à Lunebourg figurait un sociologue qui dirige l’un des services de police de la ville.
M. le président Noël Mamère. Par ailleurs, j’aimerais que vous précisiez votre position à propos des Flash-Ball . Considérez-vous qu’ils peuvent être utilisés dans le cadre d’une procédure très précise par des unités dûment formées ou pensez-vous, comme certains d’entre nous, dont je suis, qu’il faudrait en interdire l’utilisation au même titre que les LBD ?
Dans un article du journal Le Monde du 16 mars 2015, consacré aux émeutes de 2005, vous dites : « Cette tactique de maintien de l’ordre a servi lors des épisodes suivants, avec l’emploi répété du Flash-Ball et des équipes surarmées. Le politique affiche la reprise en main ostentatoire des quartiers ». Pourriez-vous nous commenter cette affirmation ?
Enfin, nous voyons bien qu’il est difficile de dissocier la question du maintien de l’ordre de celle de la sécurité publique. Les principales bavures et les principaux accidents relèvent de la sécurité publique et sans doute de l’absence de formation des personnels qui en sont chargés. Quelle est votre analyse à ce sujet ?
M. Guy Delcourt. Je prie M. Jobard de bien vouloir m’excuser car je vais devoir m’absenter mais je souhaite reprendre contact avec lui pour évoquer plus avant ses travaux fort intéressants.
M. Fabien Jobard. Je vous remercie, messieurs, pour ces questions très informées.
Monsieur le rapporteur, s’agissant du rôle du pouvoir civil, vous avez pointé l’écart qui sépare les pays de common law – desquels nous pouvons rapprocher l’Allemagne car, après la guerre, sa police a été formée par les Britanniques qui ont exporté leur modèle – et un modèle plus continental dont la France est assez exemplaire. Les professionnels du maintien de l’ordre ont pu aller jusqu’à évoquer la nécessité de revenir au régime des réquisitions.
M. Pascal Popelin, rapporteur. Ils considèrent qu’il y a plus de souplesse dans le système actuel et que les moyens de transmission sont tels qu’ils permettent d’avoir une traçabilité qui les couvre.
M. Fabien Jobard. La traçabilité de la décision est en effet une question décisive pour eux. Nous avons bien vu, lors des événements de Sivens, l’enjeu qu’a représenté le fait qu’une consigne d’extrême fermeté aurait été donnée ou pas par le pouvoir civil.
Il importe de ne pas en rester à un schéma intermédiaire et indéterminé. Il est bon que le politique assume sa fonction de donneur d’ordre en ce qui concerne le maintien de l’ordre. Le préfet doit endosser clairement cette responsabilité et le Gouvernement répondre des décisions qu’il a prises devant la représentation nationale et l’opinion publique. Or, aujourd’hui, la tentation est forte de reporter sur les forces de police une responsabilité qui est celle du Gouvernement, cette responsabilité pouvant couvrir aussi bien le fait de donner l’ordre d’agir que de s’abstenir d’en donner, de ne pas être présent sur le terrain, de ne pas être à la hauteur de la situation. Tout cela renvoie à la nécessité de donner aux préfets ainsi qu’aux secrétaires généraux de préfecture, qui prennent souvent en main la conduite des opérations de maintien de l’ordre, une formation adéquate.
M. Pascal Popelin, rapporteur. Pour information, je précise que nous allons bientôt auditionner Christian Lambert, chargé d’une mission qui porte entre autres sur la formation des préfets et des sous-préfets en matière de maintien de l’ordre public.
M. Fabien Jobard. Vous avez souligné la distance culturelle qui sépare la France de l’Allemagne. Le fédéralisme est un autre aspect de ces différences. Il n’est pas rare d’assister à des passes d’armes entre le gouvernement d’un Land et une municipalité pour savoir qui doit décider du nombre de forces disponibles pour une manifestation donnée. Ce fut le cas, par exemple, pour les marches de Pegida à Leipzig.
Mieux vaut réaffirmer de manière claire ce qui est, afin que les acteurs puissent évoluer chacun dans leur domaine propre de compétences et de responsabilités.
Vos questions sur les doctrines de maintien de l’ordre et l’articulation entre distance et contact rejoignent le problème des interpellations et l’usage des balles en caoutchouc de diverses natures.
La mise à distance des foules est nécessaire : elle permet d’éviter le contact. La charge est en effet l’un des éléments du maintien de l’ordre parmi les plus difficiles à maîtriser pour les unités constituées. Comment ajuster ce dispositif d’une puissance considérable ? Figurez-vous une quinzaine d’agents très équipés, surtout défensivement, pesant chacun entre quatre-vingts et quatre-vingt-dix kilos, face à des lycéens n’en pesant que cinquante à soixante. Le politique a toujours à craindre le traumatisme qu’il y ait un lycéen étendu sur la pelouse.
Cette difficulté a suscité la tentative d’articuler moyens de mise à distance et moyens de captation des fauteurs de trouble. Souvenons-nous des pelotons voltigeurs mobiles de sinistre mémoire, à l’origine de la mort de Malik Oussekine, qui a été l’événement majeur en France dans l’histoire du maintien de l’ordre depuis 1968. Ils avaient précisément pour fonction de pénétrer une foule sans que les forces aient à prendre le risque de la charge.
Il me paraît indispensable de connaître au mieux l’état d’esprit de la foule que l’on a en face de soi pour mesurer si les conséquences d’interpellations par les forces en civil ne sont pas de nature à solidariser une partie des manifestants avec les fauteurs de trouble, par réaction à ce qu’ils identifient comme la violence de certains policiers.
Comment y parvenir ? Il s’agit de privilégier le recours aux équipes légères d’intervention et aux SPI des CRS pour mener un travail d’interpellation car elles ont pour préoccupation de garder le contact avec le gros des forces. Vous connaissez le fonctionnement des binômes : les agents projetés sont toujours accompagnés de deux agents chargés de leur protection et de leur éventuel rapatriement. Le travail des unités en civil, qui repose sur une culture toute différente, doit à mon sens concerner l’extérieur du bloc manifestant, une interpellation pouvant s’effectuer deux heures après une manifestation.
D’une certaine manière, je ne comprends pas pourquoi aujourd’hui on a le souci de multiplier les unités en intervention dans les dispositifs de manifestation. Mieux vaudrait consolider le savoir et le savoir-faire des unités constituées, y compris dans le domaine des techniques d’interpellation.
Tout cela a des incidences budgétaires, bien sûr : une unité de CRS coûte beaucoup plus cher que trois ou quatre équipages de BAC ou qu’une compagnie de sécurisation. Il s’agit d’unités casernées, dont l’entraînement et la formation sont chers, mais, justement, l’entraînement et la formation constituent l’essentiel de ce qui est en jeu ici.
Les balles en caoutchouc doivent-elles être utilisées comme des moyens ordinaires dans les opérations de maintien de l’ordre ? Vous avez raison de souligner, monsieur le président, qu’elles font plus de dégâts quand elles sont utilisées pour la sécurité publique. Cela rejoint le débat qu’il y a eu en Angleterre voilà une trentaine d’années. La mise en place par Margaret Thatcher d’unités constituées, spécialement dédiées au maintien de l’ordre, avait soulevé un tollé : tout le monde avait hurlé contre cette police dictatoriale à la française. C’était vite oublier que cette police à la française, caractérisée par la discipline et la chaîne de commandement, maîtrisait beaucoup mieux l’usage de la force que les policiers de sécurité publique envoyés face aux manifestations de mineurs dans les années soixante-dix.
À mon sens, le problème du Flash-Ball renvoie d’abord à un problème de police urbaine, qui souffre d’une faille doctrinale d’emploi de la force. Il n’est qu’à rapprocher les situations labellisées « violences urbaines », opposant police et « jeunes violents », et la liste des blessés par Flash-Ball. Rappelons qu’il y a eu deux blessés par Flash-Ball à l’occasion de simples barbecues organisés aux Mureaux et à Villiers-le-Bel. Lors des études de terrain que je menais auprès des brigades anti-criminalité dans les Yvelines, j’avais pu constater que barbecue était devenu synonyme d’intervention possible, de manière complètement disproportionnée.
L’usage de balles en caoutchouc est en rupture avec la tradition du maintien de l’ordre en France. C’est un outil de coup porté, et non de mise à distance, qui individualise. Je serais presque favorable à ce que l’on trouve des moyens qui, en aucun cas, ne permettent qu’un projectile atteigne le visage. Les grenades offensives roulées au sol peuvent constituer une piste car, à moins de circonstances particulièrement défavorables, les galets de caoutchouc qu’elles projettent ne se portent pas à plus de cinq centimètres au-dessus du sol. Le Flash-Ball ne peut pour l’instant permettre une visée précise : il est utilisé à distance, et la masse de la balle en caoutchouc l’emporte sur la trajectoire de tir. Tant qu’on ne pourra éviter les atteintes au visage avec certitude, le recours à cet outil ne me semble pas approprié dans les opérations de maintien de l’ordre. Quinze personnes énucléées en France depuis dix ans, c’est un chiffre intolérable.
Vous évoquiez les chiffres, monsieur le rapporteur : le maintien de l’ordre est une question d’image, mais aussi de batailles de chiffres. Il serait sans doute possible de mettre en place un outil de collecte du nombre de blessés, à condition de ne prendre en compte que les blessures entraînant une prise en charge aux urgences et une interruption temporaire de travail supérieure à zéro jour.
Quant à la médiation, monsieur le président, c’est le point essentiel de comparaison entre les expériences actuellement menées à l’étranger et les pratiques françaises. La police française a une culture de dialogue avec les manifestants. Le décret-loi de 1935 remplit à ce titre une fonction essentielle : avant la manifestation, la police se concerte avec les organisations appelant à manifester pour fixer l’itinéraire et les modalités d’intervention des services d’ordre. Toutefois, elle n’a pas cette culture de la médiation au cours de l’action, ancienne dans la police anglaise. Les images d’archives de manifestations dans les grandes villes du Royaume-Uni de la période de fortes tensions de 1983-1984 montrent ainsi des policiers en uniforme, défilant avec les manifestants. La doctrine sous-tendant ce dispositif est que les manifestants se sentant en danger ou sentant un danger pourront toujours chercher protection auprès du policier le plus proche qui, en contact avec les unités, est en mesure de demander des renforts. Manifester reste un exercice périlleux. Souvenons-nous de l’extrême violence qui a marqué les manifestations lycéennes et étudiantes de mars 2006 contre le contrat de première embauche (CPE) pendant lesquelles des manifestants ont été agressés par d’autres protestataires.
Ce privilège donné à l’uniforme par rapport au camouflage, la présence des policiers parmi les manifestants et la poursuite du dialogue au cours de l’événement constituent une avancée essentielle à conquérir pour la gestion des dispositifs de maintien de l’ordre. À cet égard, il serait bon de se tourner, outre l’Angleterre et l’Allemagne, vers la Suède, pays qui a beaucoup promu des expérimentations en ce sens, qui sont discutées dans le cadre du Collège européen de police ou du projet GODIAC.
Il faut aller au-delà du face-à-face entre l’officier de liaison et ses points de contact habituels au sein des organisations professionnelles. La rue est devenue pour beaucoup un moyen légitime d’expression des revendications, qui ne passe plus forcément par la médiation des organisations professionnelles, syndicales ou associatives. De nombreuses personnes se joignent aux cortèges sans être véritablement encadrées. Cela nécessite de poster des policiers à l’intérieur des manifestations, de manière à pouvoir maintenir un contact permanent entre manifestants et forces de police.
M. le président Noël Mamère. Je vous remercie, monsieur Jobard, pour vos réponses nourries qui vont nous permettre de tirer certaines conclusions avec M. le rapporteur et les membres de la commission d’enquête.
*
* *
Audition, ouverte à la presse, de M. Christian LAMBERT, préfet hors classe
Compte rendu de l’audition du jeudi 26 mars 2015
M. Philippe Doucet, président. Monsieur le préfet, vous avez été chargé par le ministre de l’Intérieur, le 9 décembre 2014, d’une mission d’expertise relative à la formation des préfets et des sous-préfets en matière, d’une part, de maintien de l’ordre public, et, d’autre part, d’animation du renseignement territorial. Vos travaux entrent parfaitement dans le champ d’investigation de la présente commission d’enquête, constituée le 3 décembre 2014, après les événements de Sivens, et chargée de faire des propositions pour améliorer les modalités du maintien de l’ordre républicain.
Conformément aux dispositions de l’article 6 de l’ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, les personnes auditionnées sont tenues de déposer sous réserve, notamment, des dispositions de l’article 226-13 du code pénal réprimant la violation du secret professionnel. Cette même ordonnance exige des personnes auditionnées qu’elles prêtent serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vous demande de lever la main droite et de dire : « Je le jure ».
(M. Christian Lambert prête serment.)
M. Christian Lambert, préfet hors classe. La liberté de manifester est un droit absolu qu’il est essentiel de préserver. Tout citoyen a le droit d’exprimer son opinion et de contester dans le cadre prévu par les lois de la République. Toutefois, le code de la sécurité intérieure permet la dispersion d’un attroupement et fait obligation à l’autorité publique de mettre fin aux troubles éventuels.
Le ministre de l’Intérieur m’a confié une mission particulière sur les conditions dans lesquelles la formation des membres du corps préfectoral, préfets et sous-préfets, pourrait être améliorée en matière de conduite des opérations d’ordre public, compte tenu des nouveaux types de risques auxquels ils sont exposés, afin qu’ils puissent y réagir efficacement.
Pour mener à bien cette mission, je me suis notamment appuyé sur les compétences d’un groupe de travail restreint associant des représentants du Conseil supérieur de l’administration territoriale de l’État, de l’Inspection générale de la gendarmerie nationale, de l’Inspection générale de la police nationale, de la direction générale de la gendarmerie nationale, de la direction générale de la police nationale, et de la direction des ressources humaines et du corps préfectoral.
J’ai également mené une centaine d’entretiens auprès de directeurs de l’administration centrale du ministère de l’Intérieur, de responsables de centres publics de formation, de représentants de l’autorité judiciaire, de préfets et de sous-préfets. Pour cette dernière catégorie, j’ai questionné 58 préfets dont l’ensemble des 13 préfets nommés pour la première fois en 2014, ainsi que tous les préfets de zones métropolitaines.
Le maintien de l’ordre public constitue une fonction régalienne de l’État. Il relève exclusivement du ministère de l’Intérieur. Il est placé par la loi sous la responsabilité du préfet du département. Enfin, il s’inscrit dans le cadre du régime des libertés publiques et se caractérise par un encadrement rigoureux de l’emploi de la force.
Le préfet, dans son département, est le dépositaire de l’autorité de l’État. Il a la charge de l’ordre public, de la sécurité et de la protection des populations. Toutes les situations à risques pouvant, à un moment ou à un autre, dégénérer, le préfet, premier échelon de la réponse de l’État, doit pleinement s’engager en matière d’ordre public, d’animation et de coordination du renseignement à l’échelon territorial. Cet engagement lui permet de connaître, d’anticiper, de prendre des décisions claires et efficaces, et d’assumer pleinement ses responsabilités.
La professionnalisation dont il est question passe par quatre axes prioritaires : l’amélioration des formations ; l’implication personnelle des préfets en matière d’ordre public, de sécurité et d’animation et de coordination du renseignement territorial ; une articulation renforcée entre le préfet et l’autorité judiciaire ; la mise en place d’un appui méthodologique national dédié prenant la forme de la création d’une cellule de conseil et d’analyse en matière d’ordre et de sécurité publique auprès du secrétaire général du ministère de l’Intérieur.
Aucun préfet ne peut faire l’impasse sur la compétence de l’ordre public, dans la mesure où elle exige une prise de responsabilité personnelle et constitue l’un des vrais marqueurs du métier. En outre, la gestion de l’ordre public comporte une dimension psychologique incontournable : l’exercice du maintien de l’ordre n’est pas une science exacte.
La vocation première du maintien de l’ordre est de permettre l’exercice des libertés publiques et le droit de manifester son opinion en toute sécurité.
Notre modèle, fondé sur l’acceptation d’une « démocratie de rue », se caractérise par l’acceptation d’un certain degré de désordre public dans le cadre de l’expression de la contestation, sous le contrôle des forces de sécurité. Mais cette liberté de manifester implique que les manifestants eux-mêmes respectent la loi et renoncent à l’exercice de la violence.
La liberté de manifestation s’inscrit donc dans un cadre juridique précis qui soumet les organisateurs à une obligation de déclaration préalable auprès de l’autorité administrative compétente. Cette dernière peut prendre des mesures restreignant cette liberté de manifester, allant même jusqu’à l’interdiction en cas de risque important établi de trouble à l’ordre public. Cette mesure doit néanmoins rester exceptionnelle. Le maintien de l’ordre républicain a donc pour objet de prévenir les troubles afin de ne pas avoir à les réprimer. Il comporte des mesures préventives avant tout, et, si l’ordre public est troublé, des mesures destinées à le rétablir de manière proportionnée.
Les forces de l’ordre ne sont autorisées à faire usage de la force face aux manifestants que dans certaines circonstances exceptionnelles. Cet usage est soumis à des conditions de nécessité et de proportionnalité. Le respect de ces principes, le souci d’apaisement face aux foules qu’elles doivent protéger, guident l’action de nos forces de sécurité.
Le maintien de l’ordre relève de l’autorité civile, responsable de la préparation et de la mise en œuvre des mesures adaptées. Les préfets et les sous-préfets font partie au premier chef des autorités civiles responsables de l’emploi de la force pour la dispersion des attroupements. Sur place, ils évaluent en temps réel le dispositif et sa pertinence.
L’exercice du droit de manifester en toute sécurité nécessite la connaissance du corpus juridique et un contrôle de l’action menée sur le terrain. Les forces de l’ordre ainsi que l’autorité civile représentant l’État sur le terrain doivent bénéficier d’un parcours de formation adapté, tant sur le plan juridique que sur le plan opérationnel. J’ai ainsi remis au ministre de l’Intérieur, le 3 mars dernier, un rapport sur la formation des membres du corps préfectoral.
Sur la base des recommandations du rapport, un parcours de formation adapté aux différentes étapes de la carrière a été mis en place : la formation des sous-préfets et des directeurs de cabinet est renforcée dès la prise de poste, tandis que les préfets nouvellement nommés bénéficient d’un cycle de consolidation de leurs compétences juridiques et opérationnelles.
Les services du ministère de l’Intérieur, de l’École nationale supérieure de police, les centres de formation à l’ordre public comme les unités spécialisées de la police et de la gendarmerie seront sollicités à cette fin. Les retours d’expérience seront systématisés et partagés. Dans le même esprit, le Centre des hautes études du ministère de l’Intérieur (CHEMI) et l’Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice (INHESJ) organiseront régulièrement des séminaires consacrés à ces matières.
Ces formations, initiales ou continues, accorderont une place particulière à la qualité du renseignement territorial pour mieux anticiper la physionomie des manifestations, favoriser le dialogue avec les organisateurs, prévenir les incidents et assurer ainsi, dans les meilleures conditions possibles, la sécurité des participants, la protection du public et la préservation des biens.
Ces mesures participent de la démarche engagée par le ministre de l’Intérieur depuis plusieurs mois pour mieux prendre en compte les exigences du maintien de l’ordre en assurant à tous le droit inaliénable à l’expression.
Ainsi, le parcours de formation des nouveaux préfets s’articule autour de sept phases :
- avant sa prise de poste, une immersion de quarante-huit heures auprès d’un préfet de zone expérimenté. Cette phase est déjà appliquée auprès des préfets de Rennes, de Lyon et de Bordeaux ;
- la participation à un « retour d’expérience » sur un événement d’ordre public majeur avec le préfet concerné et, à l’issue, la diffusion d’une fiche réflexe à l’ensemble du corps préfectoral ;
- la participation à une session de formation spécifique organisée par l’École nationale supérieure de la police (ENSP), portant sur les enjeux de la régulation de l’ordre public. La première session va se tenir à la fin du mois d’avril à Lyon ;
- la participation à un séminaire mixte préfets-procureurs de la République portant sur la judiciarisation de l’ordre public. Le premier séminaire se déroulera le 30 juin à l’INHESJ ;
- en outre, d’autres immersions sont prévues dans les centres de formation des unités spécialisées de la police et de la gendarmerie nationale. La première session aura lieu les 19 et 20 mai prochains ;
- des séminaires thématiques relatifs au renseignement territorial et au renseignement intérieur seront organisés en juillet et en septembre par le CHEMI ;
- concernant les sous-préfets assurant la fonction de directeur de cabinet, leur formation fait l’objet d’une refonte totale : elle passe de deux jours et demi à trois semaines, à raison d’une semaine théorique et de deux semaines en immersion au sein des services de polices et de gendarmerie.
La mission de la cellule de conseil et d’analyse en matière d’ordre et de sécurité publique auprès du secrétaire général du ministère de l’Intérieur, consiste notamment à suivre la mise en œuvre de toutes ces opérations.
M. Pascal Popelin, rapporteur. Puisque vous avez été, au cours de votre carrière, des deux côtés de la barrière, vous avez sans doute un vécu intéressant à nous faire partager.
Le contrôle des opérations du maintien de l’ordre par les autorités civiles prévaut en France, alors qu’en Allemagne, par exemple, ou dans les démocraties de common law, l’autonomie de la police est en la matière bien plus grande. D’après votre expérience et au terme du travail récent que vous avez effectué, ce principe en vigueur en France est-il accepté et assumé ? Comment a-t-il évolué et comment pourrait-il encore évoluer ?
Le système des réquisitions écrites, par exemple, a disparu. Nous n’avons noté, au cours des différentes auditions auxquelles nous avons procédé, aucune demande de retour en arrière, d’une part parce que la suppression des réquisitions écrites a permis une certaine fluidité dans le déroulement des manœuvres et, d’autre part, parce que les nouveaux moyens de communication assurent aux autorités chargées de mettre en œuvre le maintien de l’ordre, une « traçabilité » des instructions données par les autorités civiles. Quel est votre sentiment sur le sujet ?
Enfin, le corps préfectoral est-il demandeur du type de formation que vous avez exposé ou bien s’y montre-t-il réticent ?
Je souhaite, dans un deuxième temps, vous interroger sur le renseignement territorial. D’aucuns estiment que l’intégration des renseignements généraux au sein de ce qu’est devenue la direction centrale du renseignement intérieur (DCRI) a entraîné une perte de savoir-faire, un éloignement du terrain et une moindre remontée des informations au niveau préfectoral. Je fais bien ici référence à la période précédant la création de la direction générale du renseignement intérieur Partagez-vous cette analyse et, au-delà des mesures annoncées par le ministre de l’Intérieur, faut-il aller encore plus loin dans le renforcement des moyens alloués au renseignement territorial – en tant qu’il contribue, en amont, à l’organisation des opérations de maintien de l’ordre ?
Troisième point, et j’ai là bien conscience de dépasser le cadre de votre mission, je reviendrai sur la question de l’articulation entre les forces spécialisées dans le maintien de l’ordre – compagnies républicaines de sécurité (CRS) et gendarmes mobiles – et des forces amenées à remplir des missions de maintien de l’ordre alors que ce n’est pas leur spécialité – forces de sécurité publique, sécurité urbaine, gendarmerie territoriale. On a parfois en effet le sentiment que les difficultés surviennent, que le protocole de mise en œuvre de l’usage de moyens de force n’est pas respecté, précisément quand ce sont des forces non spécialisées qui sont réquisitionnées. Quel est votre point de vue sur cette articulation et en particulier sur la formation des unités non spécialisées utilisées dans des opérations de maintien de l’ordre ?
Nous avons en outre été confrontés à la question de l’interpellation. Les unités chargées du maintien de l’ordre estiment qu’il ne leur revient pas d’interpeller, que cela complique leur manœuvre. Le préfet de police nous dit avoir des dispositifs mixtes avec des personnels spécifiquement dédiés à l’interpellation aux abords de la manifestation pour tous ceux qui commettraient des voies de fait, détruiraient le mobilier urbain, perpétreraient des violences perturbant les manifestants pacifiques eux-mêmes. Que pensez-vous de l’éventuelle généralisation de la présence de forces spécialement dédiées à l’interpellation ?
M. Christian Lambert. La répartition des rôles entre le préfet et le commandant opérationnel est centrale. Les opérations se déroulent bien lorsque chacun reste à sa place. Il faut maintenir le système français sous sa forme actuelle : le préfet définit les objectifs, les effets à produire sur le terrain et s’appuie sur le responsable des forces qui, lui, choisit les moyens à employer ; le préfet ne s’immisce donc pas dans la manœuvre opérationnelle. C’est l’autorité civile – c’est-à-dire le préfet ou la personne mandatée par lui – qui décide à quel moment il peut être fait usage de la force, et c’est le commandant de la force publique qui la met en œuvre. Les rôles sont ainsi bien établis. L’ordre public est un métier et il faut donc le laisser au responsable commandant la force publique – nous insistons beaucoup sur ce point au cours de la formation des préfets et des sous-préfets.
J’en viens aux réquisitions. Elles ne sont pas nécessaires quand la préparation a été faite dans de bonnes conditions. Le préfet doit connaître et anticiper et, à cette fin, il a besoin de différentes sources de renseignement, qu’il s’agisse du service central du renseignement territorial (SCRT), éventuellement du service du renseignement intérieur, ou encore de ses sources propres qui peuvent être les organisateurs, les secrétaires généraux de différents syndicats. Les réquisitions paraissent d’autant moins nécessaires du fait de l’évolution des moyens technologiques. Quand la vidéo protection assure un maillage complet, la place du préfet n’est pas forcément sur le terrain mais dans la salle de commandement où il peut évaluer en permanence son dispositif et donner éventuellement de nouvelles instructions. On dispose dès lors d’une « traçabilité » suffisante.
Pour ce qui est de la formation, monsieur le rapporteur, elle est demandée par les préfets. Ils sont en effet conscients du défi que représente la sécurité sous ses différentes formes. Nous nous rendrons à Nantes les 2 et 3 avril prochains pour, avec le préfet de région, le préfet de zone et des préfets volontaires, travailler sur les dispositifs, analyser les nouvelles méthodes de contestation. Vous l’avez en effet souligné : à côté des manifestants pacifiques, nous avons des casseurs et nos préfets se rendent bien compte de l’évolution nécessaire en matière de maintien de l’ordre.
J’en viens au renseignement territorial. Il a été remis en place. Nous en avons en effet besoin aux échelons local, régional et zonal. Comme c’était le cas pour les renseignements généraux, son travail est vaste et la part sociale de ce travail est très importante : le préfet a besoin de retours et d’une analyse permanente et doit pour cela entretenir des relations personnelles avec ses chefs de service de renseignement. Ce n’est en effet pas la veille d’une manifestation qu’il faut se mettre à tisser des liens. Dans cette perspective, le SCRT, composé de policiers et de gendarmes, fonctionne bien.
En ce qui concerne l’articulation entre forces spécialisées et forces locales, je rappelais à l’instant qu’à côté des manifestants pacifiques, nous avions des casseurs. Or les unités mobiles – gendarmes mobiles ou CRS – restent sans doute moins souples d’emploi, leurs moyens de protection ne leur permettant guère de courir après des individus qui quittent la manifestation pour aller casser des vitrines à quelques centaines de mètres de là. En 2009, quand j’étais directeur du cabinet du préfet de police de Paris, nous avons fait évoluer notre dispositif et mis en place les unités de la direction de l’ordre public et de la circulation (DOPC), composées de policiers en tenue à même de se déplacer rapidement et de policiers en civil.
Ensuite, quand il est procédé à une interpellation, la notification des droits doit être faite immédiatement. Au cours de mon travail d’information et d’expertise, j’ai rencontré de nombreux procureurs qui ont confirmé ce que j’avais pu constater en occupant mes différents postes : la conduite au commissariat d’une personne interpellée est une perte de temps et, bien souvent, le fait de ne pouvoir lui notifier ses droits dans les délais impartis empêche toute poursuite. Il faut donc prévoir, pour une notification immédiate, la présence sur le terrain d’une petite unité judiciaire dédiée. On peut également, pour éviter certains troubles, ne pas procéder à l’interpellation immédiatement, auquel cas le système de vidéo-enregistrement permet, sous l’autorité du procureur, l’identification des fauteurs de troubles.
Forces spécialisées et forces locales sont donc complémentaires. Pour ces dernières, si j’ai évoqué la DOPC à Paris, des expériences sont également menées en province comme à Toulouse où, sous l’autorité du préfet, a été constituée une unité de marche, composée de policiers – en tenue – de la compagnie de sécurisation et d’intervention (CSI) –, évoluant souvent en dehors de l’itinéraire prévu de la manifestation, là où se dirigent les casseurs, de policiers en civil pour procéder aux interpellations, de policiers du renseignement territorial qui doivent filmer toutes les scènes possibles, enfin d’une petite unité judiciaire. Chacun a sa formation, chacun a sa feuille de route. Une formation est donnée aux policiers des services territoriaux, dans les départements et dans les zones. Cette évolution s’impose du fait des nouveaux risques encourus.
Je n’ai pas noté de non-respect des protocoles, monsieur le rapporteur. Je le répète : le maintien de l’ordre est un métier. Certains l’exercent en permanence, les gendarmes mobiles et les CRS, d’autres non, et nous sommes en train de les former, notamment au sein des CSI.
J’y insiste, nous avons besoin de judiciariser le maintien de l’ordre. Il est important que, dans la préparation d’événements d’importance, le procureur soit mis le plus tôt possible dans la boucle. Une réunion préparatoire est nécessaire avec le préfet, le procureur, des représentants des forces de l’ordre – forces d’intervention et renseignement – et, éventuellement, les organisateurs déclarés. Or de plus en plus de manifestations ne sont pas déclarées et il est donc parfois très difficile d’établir un lien avec des organisateurs.
M. le rapporteur. La disparition des renseignements généraux (RG) a-t-elle conduit à tarir la source d’informations dont pouvait disposer le préfet ? Car si les manifestations déclarées présentent peu de difficultés, ce n’est pas le cas des manifestations spontanées, pour certaines de nature à porter atteinte à la sécurité publique et aux institutions de la République.
M. Christian Lambert. La dissolution des renseignements généraux, remplacés par la sous-direction de l’information générale (SDIG), a posé un problème. En effet, une partie des fonctionnaires des RG est partie à la DGSI et une autre partie est restée à la sécurité publique. Or, tout comme le maintien de l’ordre, le renseignement est un métier. Il a donc fallu former des fonctionnaires. Dans un tel contexte, il a été difficile pour un préfet – je songe ici à mon expérience en tant que directeur de cabinet à la préfecture de police – d’évaluer, par exemple, le nombre de manifestants venant des départements.
Le ministre de l’Intérieur de l’époque, Manuel Valls, a bien compris la difficulté et, de la SDIG, nous sommes passés au SCRT, lequel dépend de la direction centrale de la sécurité publique (DCSP). Le SCRT a repris les structures et l’organisation d’un service de renseignement. Le directeur central adjoint chargé du renseignement territorial est d’ailleurs un pur produit des renseignements généraux de la préfecture de police. Les bons retours dont nous disposons nous permettent de doser l’utilisation des unités mobiles. Nous commençons donc à ressentir l’effet positif de la réforme.
Le rôle du préfet dans l’animation et la coordination du renseignement territorial est d’autant plus important qu’outre l’ordre public, d’autres problèmes se posent comme la prévention de la radicalisation, la lutte contre le djihadisme… Aussi le préfet doit-il veiller à la complémentarité de ces deux services de renseignement dans son département.
Au total, la période difficile est passée, comme le montrent les notes d’ambiance sur les quartiers difficiles. La valeur acquise du renseignement territorial nous permet de travailler en amont, étant entendu que c’est de l’échelon départemental qu’il faut partir pour remonter ensuite à l’échelon national – comme c’était le cas avec les renseignements généraux.
Mme Marie-George Buffet. Vous avez rappelé, dans votre propos liminaire, que le maintien de l’ordre n’était pas une science exacte, d’où l’importance de la chaîne de commandement. Les commandants des forces opérationnelles que nous avons auditionnés ont souligné l’ambiguïté, parfois, des consignes données par l’autorité civile. Vous avez certes répondu au rapporteur que vous ne souhaitiez pas en revenir aux réquisitions écrites mais, dans la formation que vous donnez à l’autorité civile, insistez-vous sur la nécessaire clarté des consignes ?
Ensuite, vous avez indiqué que la présence de l’autorité civile sur le terrain n’était pas toujours nécessaire, le préfet, ou son représentant, pouvant se révéler plus utile dans les lieux de commandement. Or il se trouve que de nombreuses personnes auditionnées ont insisté sur la nécessité de la présence du préfet ou de son représentant au milieu des forces opérationnelles pour leur donner des consignes. Pouvez-vous revenir sur ce point ?
Vous avez abordé la question des casseurs que nous connaissons depuis plusieurs décennies. Ma préoccupation concerne davantage de nouveaux groupes de manifestants, qui viennent parfois de l’étranger et se mêlent à des manifestants pacifistes et démocrates. Comment mieux cerner ces groupes, évaluer leur importance, analyser leur comportement et comment agir pour qu’ils ne remettent pas en cause le bon déroulement des manifestations pacifiques ? Je souhaite connaître votre avis sur les propositions émises à cet égard : rendre obligatoire la concertation préalable – j’ai en la matière un doute puisque l’on a du mal, souvent, à trouver les organisateurs de ces groupes –, interdire des individus de manifestation un peu de la même manière que certains sont interdits de stade – procédé qui a montré son efficacité.
Enfin, comment améliorer le rapport entre l’autorité civile et l’autorité opérationnelle, d’une part, et les organisateurs des manifestations démocratiques de l’autre ? Comment pourrait-on mettre en commun les expériences de ces deux parties afin de se montrer plus efficaces contre les agissements des groupes en question ?
M. Christian Lambert. La formation que nous sommes en train de mettre en place est destinée à renforcer la chaîne de commandement. Chacun doit rester à sa place et, je le répète, le préfet n’est pas là pour, d’un point de vue opérationnel, diriger la manœuvre. La clarté des consignes doit venir du travail des réunions préparatoires que doit présider le préfet. Ensuite, pendant l’événement, il ne faut jamais négliger l’aspect politique de l’action du préfet. Il est donc nécessaire que, pendant les événements, l’autorité civile se rapproche des forces opérationnelles. Il paraît en effet de plus en plus difficile, compte tenu des nouvelles technologies, d’imaginer un préfet rester dans son bureau et se contenter d’une liaison téléphonique au moment des événements. Le préfet doit se montrer très réactif et, pour cela, se trouver au cœur de l’événement.
En agglomération – nous l’avons fait à Rennes, à Nantes, à Toulouse, sans parler bien sûr de Paris – le préfet, grâce à la vidéo protection, est véritablement informé en direct. Il ne perturbe pas, comme c’était le cas auparavant, par des coups de fil permanents le directeur départemental de la sécurité publique ou son collègue de la gendarmerie pour demander des nouvelles. Or il a besoin en permanence, je l’ai dit, de réévaluer ses instructions. Aussi, en zone urbaine, la chaîne de commandement ne pose-t-elle aucun problème. C’est plus difficile en zone rurale où nous ne disposons pas des mêmes moyens techniques. Il est ici, en revanche, nécessaire qu’une autorité civile soit sur place non, certes, pour diriger les troupes mais pour établir un lien permanent avec le préfet et avec les organisateurs s’il y en a. Cette autorité civile a donc un rôle de contrôle et un rôle politique. Au total, il importe que l’autorité civile soit au cœur de l’événement.
Pour ce qui concerne les casseurs et les nouveaux groupes, nous en revenons, madame la députée, au renseignement. Le renseignement intérieur a des liens avec les services de renseignement européens. Ces groupes qui vont d’une ville ou d’un pays à l’autre font l’objet d’un suivi qui nous permet de préparer un dispositif à la mesure de ce qui nous attend. Grâce aux interpellations, grâce au travail de vidéo protection réalisé par les services, nous cernons de mieux en mieux le comportement de ces groupes.
Vous m’avez ensuite interrogé sur l’éventualité de rendre obligatoire la concertation préalable. Il s’agit de créer les conditions d’un dialogue permanent entre les autorités et les organisateurs et, dans cette perspective, l’autorité civile comme le renseignement ont un rôle important à jouer – ce n’est pas au responsable de la force publique d’entretenir ce lien particulier. Ce lien doit être cultivé sur le long terme par le préfet, donc, aussi, en dehors de l’événement. Or, dans certains cas, nous n’avons pas d’interlocuteur et il faut dès lors évaluer la menace, les risques, d’où, ici encore, le rôle important du renseignement sous toutes ses formes. Si les risques sont établis, le préfet peut interdire la manifestation.
J’en viens à l’interdiction de manifestation. Vous savez, du fait de vos fonctions ministérielles passées, madame Buffet, que les interdictions de stade se sont révélées bénéfiques, permettant de ramener le calme dans pas mal d’endroits. Mon avis personnel est que l’adoption d’un système similaire d’interdiction de participer à des manifestations pour des individus reconnus comme des casseurs, aiderait certainement les forces de l’ordre.
M. Philippe Goujon. À quel type de personnels la formation dont il est ici question est-elle destinée : préfets, sous-préfets, administrateurs… ? Pensez-vous qu’elle devrait être élargie à d’autres personnels administratifs et même, peut-être, aux magistrats ? Cette formation doit-elle par ailleurs être prévue dans le cursus des écoles qui forment les fonctionnaires ?
Ensuite, en matière de maintien de l’ordre, vous avez évoqué une sorte de dichotomie entre Paris et la province et, en effet, les camions à eau sont employés en province mais pas à Paris, la vidéo protection est pour sa part utilisée à plein dans la capitale mais pas ailleurs. Un module spécifique est-il dès lors prévu pour la formation au maintien de l’ordre à Paris et à destination de quel public ?
Les instructions données par l’autorité civile aux forces spécialisées vous paraissent-elles suffisamment précises, claires, adaptées ou bien faudrait-il prévoir un cadre plus rigide pour améliorer le processus de maintien de l’ordre ?
Je poserai pour finir une question un peu plus périphérique concernant le projet de loi sur le renseignement. Les violences collectives qui peuvent troubler la paix publique – on pense évidemment bien plus ici au « zadistes » qu’aux manifestants pacifiques – peuvent permettre l’emploi de moyens de renseignement spécialisés – vous voyez à quoi je fais allusion. Ces moyens vous paraissent-ils adéquats ?
M. Christian Lambert. La formation est donnée dans un premier temps aux 101 préfets et, plus précisément, à tous les préfets nouvellement nommés – soit 6 à 15 chaque année. Ainsi, la semaine dernière, un préfet a été nommé dans le Morbihan. Avant sa prise de poste, il est parti en immersion à la préfecture de Rennes – préfecture de zone –, après quoi il suivra une formation continue comportant des modules à la fois d’ordre public et de renseignement territorial. La formation concerne ensuite ceux qui, au quotidien, sont en lien avec les services de sécurité, à savoir les directeurs de cabinet. Je l’ai déjà mentionné : la formation était de deux jours et demi, elle passera à trois semaines dont une de formation théorique et deux auprès de la préfecture, des forces de police et des forces de gendarmerie.
Quand j’ai fait valoir au ministre de l’Intérieur qu’il fallait judiciariser l’ordre public, cela signifiait que les procureurs devaient mieux connaître les problèmes relatifs à la voie publique et aux manifestations. C’est pourquoi, avec l’INHESJ, nous avons mis en place un programme commun qui débutera avant l’été prochain.
Les questions liées à l’ordre public sont déjà très présentes dans le cursus des écoles qui forment les fonctionnaires, de même que dans le cadre de la formation continue. Du reste, la France a toujours été une référence en matière de maintien de l’ordre.
J’en viens à la dichotomie que vous avez évoquée entre Paris et la province. On compte dans la capitale une moyenne de 13 à 14 manifestations par jour, déclarées ou, quelquefois mais de plus en plus souvent, non déclarées. Sont engagées la gendarmerie mobile et les CRS d’un côté, et, de l’autre, les unités de la préfecture de police que sont les compagnies d’intervention de la DOPC qui sont très bien formées. Il est évident que la topographie de Paris et le maillage vidéo permettent une réaction très rapide mais Paris, siège des institutions, demande un traitement très rigoureux du maintien de l’ordre.
Les instructions de l’autorité civile, je le répète, et c’est l’un des objectifs de la formation, sont claires si le travail préparatoire – impliquant les services de renseignement, les organisateurs et les responsables des unités mobiles – est bien mené. Ces instructions peuvent être réévaluées au cours de l’événement mais devront toujours rester précises.
Enfin, concernant le projet de loi sur le renseignement, à côté de manifestants pacifiques, je l’ai déjà dit, d’autres viennent pour casser ou provoquer de sérieux problèmes aux organisateurs eux-mêmes. Les techniques doivent pouvoir prévenir des comportements constituant des infractions très graves à l’ordre public, comportements destinés à déstabiliser l’État.
M. le rapporteur. Dans le cadre de nos travaux, quand nous nous sommes rendus à Lunebourg, en Allemagne, on nous a suggéré que le maintien de l’ordre à la française, qui certes a fait ses preuves, pourrait s’ouvrir davantage aux sciences sociales, comme c’est le cas à l’étranger. Ainsi, à Lunebourg, nous ont reçus le chef de la police, son adjoint, le responsable de la voie publique – et un sociologue qui dirige un service qui permet d’être informé sur le comportement des foules, sur l’évolution des moyens sociaux... Qu’en pensez-vous ?
Tout autre question et qui va faire débat au sein de la commission : celle de l’emploi de certains moyens tels les flash ball et les lanceurs de balles de défense – les unités de maintien de l’ordre étant dotées des uns et pas des autres. Or les blessures graves que l’on peut constater à l’issue des manifestations sont souvent le fait de l’emploi de ces moyens. Selon certains, ces outils – ces armes – sont en contradiction avec la doctrine française du maintien de l’ordre reposant sur la mise à distance et sur une appréhension de la foule dans sa globalité. Le lanceur de balles de défense, en effet, visera une personne en particulier. Je souhaite connaître votre point de vue et ne voyez dans ma question, à ce stade, aucun parti-pris, aucune idée arrêtée : il arrive au rapporteur de devoir se faire l’avocat du diable.
M. Christian Lambert. Au cours de la préparation d’un événement, le préfet est libre de faire venir qui il souhaite. Le groupe de travail commun police et gendarmerie nationales visant à améliorer la doctrine du maintien de l’ordre, mis en place par le ministre de l’Intérieur, comprend des sociologues et des universitaires d’autres disciplines.
La conception française du maintien de l’ordre consiste, il est vrai, à tenir le plus possible à distance les manifestants. Quand tout se passe conformément au travail préparatoire à l’événement, c’est fort simple. Mais certains éléments poussent au débordement et les grenades lacrymogènes ont pour but de continuer de maintenir à distance forces de l’ordre et manifestants. Leur utilisation est par conséquent nécessaire dans certains cas mais très réglementée – le ministre de l’Intérieur a donné des instructions précises sur le lancement de grenades lacrymogènes instantanées.
En ce qui concerne le lanceur de balles de défense, le cadre de son utilisation est également très précis. S’il est respecté, il ne doit pas y avoir de problème. Le policier ne s’en sert vraiment que s’il se sent menacé.
M. Philippe Doucet, président. Je vous remercie, monsieur le préfet, pour vos réponses qui enrichiront la réflexion des membres de la commission.
Audition, ouverte à la presse, de M. François MOLINS, procureur de la République
de Paris
Compte rendu de l’audition du jeudi 26 mars 2015
M. Philippe Doucet, président. Votre audition, monsieur le Procureur, est l’occasion pour la commission d’enquête d’évoquer le traitement judiciaire du maintien de l’ordre.
Conformément aux dispositions de l’article 6 de l’ordonnance du 17 novembre 1958, je vous demande de bien vouloir prêter le serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité.
(M. François Molins prête serment.)
M. François Molins, procureur de la République de Paris. Je tiens d’abord à rappeler un principe : le procureur de la République n'est pas en charge de l'ordre public. Son rôle consiste, dans le respect des libertés individuelles dont il est le garant, à rechercher et à faire constater les infractions à la loi pénale, à poursuivre leurs auteurs puis à statuer sur la suite à donner à ces procédures. Il s’appuie pour cela sur la direction de la police judiciaire et dispose du libre choix du service de police à qui il va confier l'enquête. Cela ne le dispense pas de travailler en liaison étroite avec l’autorité administrative, notamment le préfet.
Le procureur détient également un certain nombre de pouvoirs en matière de contrôles d'identité et de fouilles de véhicules. Je rappelle que toute personne se trouvant sur le territoire national doit accepter de se prêter à un contrôle d'identité dès lors qu'il est effectué dans des conditions régulières.
Dans ce cadre, le procureur de la République a la possibilité de requérir des contrôles d'identité en vue de la recherche et de la poursuite d'infractions particulières, en des lieux et pour une période déterminés, cette dernière n’excédant généralement pas six heures. Le périmètre défini peut correspondre à des quartiers entiers ou au tracé et aux abords d’une manifestation.
À Paris, la délivrance de ces réquisitions de contrôle d'identité est centralisée à mon cabinet, sous ma responsabilité et celle d'un procureur adjoint. Elle intervient régulièrement, notamment chaque fois qu'est organisée une manifestation.
L'ordre public dans Paris revêt une importance particulière dans la mesure où la capitale connaît chaque année environ 3 000 rassemblements à caractère revendicatif dont 600 à 700 qui interviennent de manière inopinée, auxquels s’ajoutent toutes les manifestations festives. Parmi ces manifestations, la quasi-totalité font l'objet, comme l'exige la loi, d'une déclaration à la préfecture de police et sont autorisées. Seule une infime partie est interdite ou se déroule en l'absence de toute déclaration.
Le principe de la déclaration préalable constitue le droit commun de la manifestation, qui se distingue de l'attroupement illicite. Les pouvoirs publics ne peuvent, en droit, s'y opposer qu'à des rares exceptions.
L'article 431-3 du code pénal définit l'attroupement comme tout rassemblement de personnes sur la voie publique ou dans un lieu public susceptible de troubler l'ordre public. Le rassemblement ne devient donc attroupement qu'en cas de menace pour l'ordre public.
En cas de manifestation, le parquet de Paris intervient en amont et en aval.
En amont, il est sollicité par les services de police pour délivrer des réquisitions de contrôles d'identité qui correspondent aux heures et au parcours de la manifestation ainsi qu’à ses abords. Ces réquisitions sont délivrées généralement la veille ou l'avant-veille de l’événement et fournissent aux forces de l'ordre un cadre juridique sécurisant sur le plan procédural. En effet, une interpellation réalisée à la suite d'un contrôle d'identité qui serait dépourvu de régularité conduirait nécessairement au classement sans suite par le parquet ou à l'annulation de la procédure par le tribunal saisi de poursuites.
Sur la base de ces réquisitions, les services de police peuvent contrôler l'identité de toute personne quel que soit son comportement dès lors qu’elle se trouve dans le périmètre et le créneau horaire figurant sur la réquisition.
Nous sommes bien évidemment en liaison constante avec la direction de sécurité de proximité de l'agglomération parisienne (DSPAP) et le cabinet du préfet de police qui nous avise de la manifestation et des éventuels problèmes qu'elle a pu poser en amont ou qu'elle est susceptible d'entraîner au vu des renseignements dont ils disposent.
Dès que nous sommes avisés d’une manifestation, particulièrement en cas de risque de dérive violente, nous sensibilisons les services de police à la nécessité de prévoir un dispositif, que je qualifierai de judiciaire, permettant de rassembler les preuves des infractions et d’interpeller les auteurs présumés. Ces échanges ont pour but de s’entendre sur l’utilisation de la vidéo, sur l’équipement de certains personnels avec du matériel vidéo portable et sur la présence en nombre suffisant d’enquêteurs judiciaires.
En aval, le parquet est amené à intervenir si des interpellations ont été réalisées à la suite d'infractions constatées par les forces de l'ordre.
Il peut s'agir d'infractions que je qualifierai de droit commun – vols, port d'armes, violences volontaires, dégradations, outrages à agent de la force publique ou rébellions , entraves à la circulation routière – mais aussi d'infractions plus spécifiques qui sont celles prévues par le code pénal dans le chapitre intitulé « atteintes à la paix publique » et relatives à la participation délictueuse à un attroupement, aux manifestations illicites ou à la participation délictueuse à une manifestation.
Ce sont les infractions suivantes : le fait de continuer à participer à un attroupement après les sommations – le code pénal érigeant en circonstance aggravante la dissimulation du visage ; le fait de participer à un attroupement en étant porteur d'une arme ou de continuer après les sommations ; le fait de provoquer à un attroupement armé ; le fait d'organiser une manifestation n'ayant pas fait l'objet de déclaration préalable – la notion d’organisation pose aujourd’hui certains problèmes au regard du rôle joué par les réseaux sociaux ; le fait d'avoir organisé une manifestation sur la voie publique ayant été interdite ou d'avoir fait une déclaration incomplète ou inexacte de nature à tromper sur l'objet ou les conditions de la manifestation ; enfin le fait de participer à une manifestation en étant porteur d'une arme.
Le parquet est ensuite compétent pour apprécier la suite à donner aux interpellations réalisées par les services de police, qu'il s'agisse de personnes conduites au commissariat pour vérification d'identité ou de personnes placées en garde à vue par un officier de police judiciaire.
Il est évident que la gestion de cette mission n’est pas la même selon le nombre de personnes interpellées. Dans tous les cas, les contraintes procédurales sont très fortes.
La police doit aviser téléphoniquement le parquet et ce, dans de très brefs délais. Le code de procédure pénale exige que le procureur de la République soit avisé de la garde à vue dès le début de la mesure et selon la jurisprudence la plus récente, dans un délai d’une heure quinze. Au-delà de ce délai, sauf circonstances insurmontables, l'avis est considéré comme tardif et la procédure est jugée irrégulière.
Pour gérer ces interpellations, le parquet de Paris s'appuie sur une organisation spécifique qui varie selon l’ampleur de la manifestation.
Une section est chargée du traitement en temps réel des interpellations en flagrant délit, la section dite P12, au sein de laquelle une permanence criminelle est tenue par un magistrat, de jour comme de nuit, du lundi matin au vendredi matin puis du vendredi matin au lundi matin. Ce magistrat est destinataire de tous les comptes rendus téléphoniques faits par les services de police à la suite des interpellations. Il lui revient d’apprécier les suites à donner.
Le parquet exerce un contrôle à la fois sur la régularité de la procédure et sur le fond. Nous contrôlons d’abord la régularité de l'interpellation et du cadre dans lequel elle est intervenue ; ensuite, nous vérifions l'infraction retenue et les conditions légales de la vérification d'identité ou de la garde à vue. Enfin, nous examinons la qualification juridique de l'infraction par l'enquêteur – il peut nous arriver de la modifier – et des charges pesant sur la personne qui a été interpellée.
En cas d'irrégularité du contrôle ou de l'interpellation, ou de non-respect des droits de la personne dans le cadre de la garde à vue, la personne est remise en liberté et la procédure est classée sans suite. Si l’interpellation est régulière et les charges suffisantes, l’enquête va prospérer.
Nous rencontrons le plus souvent trois difficultés qui sont inhérentes à l'ampleur des manifestations et à leur caractère complexe.
La première difficulté concerne la prise en compte des exigences de police judiciaire dans l'organisation des forces de l'ordre qui vont intervenir pour encadrer et veiller à l'ordre public. Il s'agit le plus souvent d'unités de maintien de l'ordre de la gendarmerie nationale ou de CRS qui sont de passage à Paris pour assurer cette mission de maintien de l'ordre.
Nous sommes donc soumis à un impératif : disposer des éléments de preuve qui ont pu être retenus contre la personne interpellée et qui vont reposer le plus souvent sur le témoignage de l'agent interpellateur.
Or, les conditions d'intervention des unités de maintien de l'ordre ne sont pas propices à la rédaction de rapports ou de procès-verbaux d'interpellation répondant à nos exigences. Pour sécuriser les éléments de preuve et les procédures, nous avons donc travaillé avec la préfecture de police et la police pour établir une fiche d'interpellation type remplie par l'agent interpellateur. Celle-ci contient les mentions nécessaires sur l'infraction commise, sur l'identité de la personne interpellée ainsi que le témoignage de l'agent sur les circonstances précises de l'infraction qu'il a constatée et les charges pesant sur la personne qu'il a interpellée. Une fois remplie, cette fiche doit être remise à la DSPAP. Cette fiche d'interpellation est distribuée par la préfecture de police à tous les commandants d'unités susceptibles d’intervenir pour être utilisée en cas d'interpellation.
La seconde difficulté est la conséquence du nombre des interpellations et des règles de procédure que nous appliquons.
Il peut d'abord être compliqué de contrôler l'identité d'un nombre important de manifestants dans certaines conditions de tension. Ensuite, dès l'interpellation et le placement en garde à vue, les droits doivent être notifiés immédiatement à la personne placée en garde en vue et le parquet doit être avisé dès le début de la mesure.
L'expérience démontre que, lorsque l'on est confronté à de nombreuses interpellations, les délais ne sont pas toujours respectés – c’est un euphémisme. Cela nous conduit à décider la remise en liberté de la personne et à procéder au classement de la procédure pour irrégularité, sauf si, compte tenu de l’ampleur du trouble à l’ordre public, nous retenons les circonstances insurmontables qui permettent de déroger aux exigences légales et jurisprudentielles.
Une autre difficulté peut survenir lorsque les personnes interpellées n'ont pas de papiers d'identité, refusent de la décliner, revendiquent tous le même état civil et refusent de se soumettre aux vérifications et aux opérations de signalisation autorisées par le parquet dans le cadre de la procédure de vérification d'identité.
Nous avons donc travaillé avec la préfecture de police et les services de la DSPAP et de la direction de l'ordre public et de la circulation (DOPC) pour rappeler le cadre juridique du travail de la police qui s'appuie sur trois grandes procédures : le contrôle d'identité, la procédure de dispersion en cas d'attroupement et la garde à vue.
Si la procédure est régulière, nous privilégions, en cas d'infraction commise contre les forces de l'ordre – violences volontaires par jets de projectiles ou rébellions – ou contre les biens – destructions volontaires par incendie ou bris de vitrines –, une réponse binaire : soit les charges ne sont pas suffisantes et la procédure fait l'objet d'un classement sans suite ; soit les charges sont suffisantes, et, compte tenu du trouble à l’ordre public, nous faisons déférer la personne interpellée au parquet pour engager ensuite des poursuites rapides devant le tribunal correctionnel par voie de comparution immédiate ou de convocation par procès-verbal dans un délai de deux mois, assortie d’une mesure de contrôle judiciaire.
M. Pascal Popelin, rapporteur. Nous comptons sur vous pour nourrir notre réflexion sur le versant judiciaire du maintien de l’ordre que nous avons peu abordé jusqu’à présent dans nos auditions.
En premier lieu, s’agissant du cadre juridique général du maintien de l’ordre, les textes et les procédures administratives et pénales sont-ils adaptés aux nouvelles formes de protestation ? Vous venez de décrire longuement les contraintes liées aux interpellations. Ne serait-il pas utile, dans le respect des libertés publiques, de fluidifier ou de simplifier certaines procédures ?
En cas d’occupation de sites dans la durée ou de manifestation sur des terrains privés, les textes sont-ils adaptés et efficaces ?
Pour les ZAD, il semble que, malgré son caractère illicite, l’occupation des lieux permette de revendiquer la qualification d’habitation principale, ce qui ne manque pas de compliquer la tâche des autorités et de soulever des obstacles pour obtenir l’expulsion des occupants. N’y a-t-il pas matière à faire évoluer le droit ?
La responsabilité pénale des gendarmes et des fonctionnaires de police qui peuvent parfois s’écarter des règles auxquelles ils sont soumis et des moyens dont ils disposent pour exercer leur mission est-elle régulièrement mise en cause ? Sur quels fondements ? Peut-on déterminer si les mis en cause appartiennent à des unités spécialisées dans le maintien de l’ordre ou à d’autres forces de sécurité ? En outre, certains parmi les manifestants estiment que les poursuites sont rarement engagées.
S’agissant du fonctionnement du parquet, faut-il systématiser, voire rendre obligatoire, la présence d’un représentant du parquet auprès des autorités chargées d’une opération de maintien de l’ordre afin de leur apporter une expertise juridique en temps réel ? Pouvez-vous caractériser les relations entre le parquet et les forces du maintien de l’ordre ?
Enfin, sur le traitement judiciaire des suites des opérations de maintien de l’ordre, l’objectif en matière d’interpellations est de parvenir à distinguer les manifestants qui viennent exprimer librement une opinion, des individus qui se rendent coupables de violences ou de dégradations à l’occasion ou en marge des manifestations, sans lien avec l’objet de celles-ci.
Vous avez énuméré les contraintes procédurales qui pèsent sur les interpellations. Dans la pratique, pensez-vous qu’il est souhaitable de renoncer à interpeller, de favoriser la mixité du dispositif en associant forces de maintien de l’ordre et les personnes chargées de la police judiciaire, d’autoriser les forces mobiles à assurer elles-mêmes les interpellations dans un cadre juridique rénové ? L’article 16 du code de procédure pénale – la suspension de la qualité d’officier de police judiciaire pendant une opération de maintien de l’ordre – dont chacun connaît le fondement historique est-il toujours pertinent compte tenu des évolutions technologiques ? Quelle est votre opinion sur le recours à la vidéo – vidéoprotection de voie publique ou dispositif mobile ? Quels sont ses avantages et ses inconvénients, pour les manifestants et pour l’efficacité de la réponse pénale ? La vidéo peut-elle permettre de limiter le nombre d’interpellations immédiates en facilitant les arrestations a posteriori ?
M. François Molins. Je le répète, je ne suis pas le meilleur juge du volet de droit administratif du maintien de l'ordre.
Toutefois, il serait, de mon point de vue, périlleux de vouloir soustraire les manifestations au régime de droit commun des libertés publiques pour les soumettre à un régime plus réducteur. Les droits du citoyen doivent rester identiques, quel que soit le cadre dans lequel ils s’exercent, dès lors que la loi est respectée.
J’ai le sentiment, au travers du prisme judiciaire qui est le mien, je le redis, que le cadre juridique général n’est pas inadapté. Il gagnerait toutefois à être précisé car certaines notions du droit des manifestations reposent sur des fondations argileuses. C’est le cas pour la théorie des circonstances insurmontables qui laisse la place à des interprétations très prétoriennes et personnelles.
Même si la Cour de cassation, dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité, a récemment estimé que l’infraction d’organisation de manifestation sans déclaration était définie de manière suffisamment précise, il n’en reste pas moins que, dans la pratique, nous rencontrons des difficultés pour caractériser l’infraction. Avec les évolutions techniques et le rôle des réseaux sociaux, il est parfois très délicat de déterminer qui est l’organisateur de la manifestation. Sur ce sujet, plusieurs poursuites ont abouti à des décisions de relaxe du tribunal correctionnel de Paris, ce qui est le meilleur signe de la difficulté.
Avons-nous les moyens de déloger les personnes occupant un site ? J’ai le sentiment que la réponse est oui. Mais, en la matière, l’intervention judiciaire est éminemment tributaire de la décision administrative. Les instruments juridiques existent mais leur usage appartient à l’autorité administrative et relève de la responsabilité politique. En l’état actuel des textes, rien ne s’oppose selon moi à l’évacuation d’un site. En revanche, la notion de propriété privée ou de domicile soulève des difficultés juridiques. L’interpellation est possible dans le temps de la flagrance. Ensuite, la voie à suivre est celle de la procédure d’expulsion.
M. le rapporteur. Le rapport de l’Inspection générale de la gendarmerie nationale sur les événements de Sivens souligne qu’« il s’agit principalement d’occupation illicite de parcelles en tirant avantage des lourdeurs administratives pour obtenir une ordonnance d’expulsion sur un périmètre géographique restreint ne permettant pas une interdiction de l’ensemble du site du futur chantier… ». Les choses ne sont donc pas si simples.
M. François Molins. Le problème ne réside pas dans les textes mais dans l’organisation. Je ne nie pas les difficultés et la lenteur des décisions de justice relatives à l’expulsion des occupants sans droit ni titre auxquelles sont confrontés les citoyens et les pouvoirs publics. Mais tout dépend de l’usage qui est fait des procédures existantes : la procédure de référé peut être rapide. C’est bien l’organisation et les moyens de la justice civile qui sont en question. La procédure de référé d’heure à heure permet en cas d’urgence d’obtenir l’autorisation d’assigner dans les heures qui suivent ; la décision peut intervenir en 24 heures. Les textes le prévoient. Il faut peut-être revoir la culture et les moyens pour permettre à la justice de rendre son office dans des délais plus brefs.
Le traitement judiciaire de l’ordre public est intimement lié au choix qui sera fait par l’autorité administrative. Cela justifie un travail en amont et en synergie. En tout état de cause, l’intervention judiciaire dépend du traitement de la manifestation : par exemple, si de faibles moyens sont affectés au recueil des preuves d’infraction, si la manifestation dégénère, et si le préfet décide ne pas intervenir et de laisser commettre les infractions parce qu’il choisit de se concentrer sur d’autres impératifs, le traitement judiciaire n’aura pas lieu d’être.
À l’inverse, dans certaines manifestations, priorité peut être donnée à une intervention des forces de l’ordre, de nature judiciaire, pour extraire les fauteurs de troubles de la manifestation et les remettre ensuite à la justice.
En cas de refus de dispersion après sommation et de manœuvres des forces de l’ordre pour isoler un noyau de personnes réfractaires, d’autres problèmes se posent.
Le traitement judiciaire dépend des moyens déployés pour constater l’infraction ainsi que des voies choisies par l’autorité administrative pour la gestion de la manifestation.
Je ne suis pas favorable à la présence systématique du parquet. D’une part, l’obligation de présence du parquet n’est pas indifférente en termes de moyens. Si, à Paris, le magistrat de la permanence criminelle est affecté à la salle de commandement, il faudra trouver quelqu’un pour assurer la permanence criminelle. Cela pose donc des problèmes d’organisation et d’effectifs.
D’autre part, au vu de mon expérience, la systématisation de la présence du parquet ne s’impose pas car, dans certains cas, elle ne s’avère pas nécessaire.
Pour les événements festifs, comme le jour de l’an, la présence du parquet n’est pas nécessaire. Pour les manifestations qui vont invariablement donner lieu à des troubles, comme la fête de la musique, ou pour celles qui se présentent dans de mauvaises conditions – parce qu’elles ont été interdites ou parce que les renseignements recueillis permettent d’anticiper des violences –, un membre du parquet est présent. En revanche, cette présence n’a pas d’intérêt si la manifestation s’annonce pacifique. Nous devons toutefois faire preuve d’une vigilance marquée qui se traduit par une relation constante avec le préfet et la DSPAP. Si la manifestation dégénère, nous prenons la décision d’envoyer quelqu’un dans la salle de commandement pour veiller au respect des contraintes procédurales.
Il est impératif d’améliorer la qualité du traitement judiciaire. De nombreuses réunions ont été organisées depuis deux ans pour améliorer le dispositif. Mais les procédures continuent à tomber parce que les règles procédurales n’ont pas été respectées ou parce que le recueil des éléments de preuve est insuffisant.
À cet égard, la fiche d’interpellation représente un progrès même si nous manquons encore de recul pour apprécier ses résultats. Il s’agit d’une première à Paris qui est le fruit d’un travail associant le parquet, la préfecture de police, la DSPAP et la DOPC.
Il faut également travailler sur le dispositif de recueil des éléments de preuve. La présence en plus grand nombre d’officiers de police judiciaire ou d’agents de police judiciaire aux côtes des forces de maintien de l’ordre, au sein d’unités mixtes ou séparément, apporterait sans doute un plus.
La vidéo peut être utilisée de deux manières : à l’appui des interpellations ou a posteriori – des interpellations ont été effectuées après étude des images pour les manifestations pro-palestiniennes de l’été dans le dix-huitième arrondissement de Paris. Au-delà de l’efficacité et de l’aide dans le recueil des éléments de preuve, la vidéo comporte une autre vertu, celle de sécuriser les interventions des forces de l’ordre ; elle permet d’attester du comportement du policier.
La section de la presse et des atteintes aux libertés au sein du parquet de Paris est compétente pour les infractions commises par des officiers de police judiciaire (OPJ) ou agents de police judiciaire (APJ). Chaque dénonciation donne lieu à une enquête. Si la plainte apparaît sérieuse, l’Inspection générale de la police nationale (IGPN) est saisie aux fins d’enquête, laquelle peut donner lieu à des poursuites pour violences illégitimes.
M. Meyer Habib. L’exhibition de drapeaux d’organisation terroriste ou de symboles nazis est sanctionnée par le code pénal. Cette disposition est-elle appliquée ?
Le fait de manifester en arborant une arme factice constitue-t-il un délit ?
Qu’en est-il pour la gestuelle ? La quenelle ou le salut nazi sont-ils répréhensibles ? Si l’infraction est constatée, les forces de l’ordre sont-elles amenées à intervenir ?
Alors que le recours à la vidéo n’est pas systématique, ne faudrait-il pas le rendre obligatoire dans toutes les manifestations sensibles ?
Enfin, l’auteur d’un appel à une manifestation interdite, lancé via Internet, peut-il être poursuivi ?
M. Philippe Goujon. L’audition de magistrats de province nous permettrait sans doute d’entendre un son de cloche différent car l’organisation à Paris est très spécifique.
Vous dites à la fois que les sanctions et les suites judiciaires sont adaptées et que de nombreuses procédures tombent. Comment résoudre cette contradiction ? Dispose-t-on de statistiques pour les manifestations récentes sur le nombre de condamnations prononcées par rapport au nombre de déferrements ?
J’avais déposé une proposition de loi tendant à responsabiliser les organisateurs de rassemblements sauvages via les réseaux sociaux. Je visais les apéros Facebook pour lesquels il n’existe pas d’organisateurs déclarés. L’idée était de considérer celui qui lance l’invitation comme l’organisateur de l’événement, non pas pour le sanctionner mais pour pouvoir l’organiser avec lui. Je sais que la préfecture de police a communiqué sur Facebook sur ce sujet. Quelles sont aujourd’hui les preuves recevables en justice en la matière ?
Savez-vous quelles formes prend en province la coopération en amont des manifestations entre la justice et les préfectures ?
Les magistrats sont-ils suffisamment formés au maintien de l’ordre ? Cette formation est prévue pour les préfets, pensez-vous qu’elle serait utile pour les magistrats ?
Mme Marie-George Buffet. Le préfet Lambert a évoqué un programme de formation commun aux procureurs et préfets dans le domaine du maintien de l’ordre. Quel en est le contenu ?
Il nous a également rappelé que le maintien de l’ordre n’est pas une science exacte. Je partage son point de vue.
La solution au classement des procédures se trouve-t-elle dans des évolutions du cadre réglementaire ou dans un travail collectif plus en amont entre l’autorité judiciaire, l’autorité civile et les forces opérationnelles ?
Je suis dubitative sur la remise en cause des procédures actuelles. J’adhère entièrement à vos propos sur les droits du citoyen.
M. François Molins. L’apologie du terrorisme, au travers de l’exhibition de drapeaux ou symboles a chaque fois fait l’objet de poursuites. En revanche, l’exhibition du drapeau nazi est réprimée uniquement dans les enceintes sportives. Le traitement judiciaire de certaines situations est malaisé : certains actes apparaissent de manière limpide comme une infraction – c’est le cas aujourd’hui du drapeau de Daech. En revanche, la quenelle demande une analyse du contexte pour déterminer si elle doit être poursuivie ou pas. La réflexion que nécessite ce geste n’est pas toujours compatible avec une interpellation immédiate.
La vidéo est une piste intéressante. Sa plus grande utilisation ne demande pas une modification législative mais plutôt un travail en commun et une meilleure organisation. Le recours à la vidéo présente le double avantage, d’une part, de pré-constituer des preuves, et d’autre part, de stigmatiser les mauvais comportements des forces de l’ordre ou de dédouaner ceux qui sont injustement accusés. Je ne vois que des avantages à la vidéo.
La qualité des procédures n’est pas un problème nouveau. La direction des affaires criminelles et des grâces diffuse régulièrement depuis le milieu des années 1990 des circulaires qui appellent l’attention des procureurs sur la nécessité de se rapprocher des préfets et de veiller à l’existence de dispositifs de police judiciaire suffisants lors des manifestations. Si la qualité des procédures pose problème et si tant de procédures tombent, la raison en est simple : le dispositif judiciaire n’est pas au niveau qui devrait être le sien dans le traitement du maintien de l’ordre. Cela ne nécessite pas forcément une modification législative mais peut-être plus de travail en commun. Partout où je suis passé, j’ai toujours été associé par le préfet à la préparation des manifestations. Quand ce n’était pas le cas, j’ai pris l’initiative de m’enquérir des dispositifs prévus.
Peut-on faire mieux ? Certainement. Je n’ai jamais suivi de formation au traitement judiciaire du maintien de l’ordre. Il existe peut-être des sessions de formation continue sur ce thème, qui n’a sans doute pas été suffisamment travaillé ; les efforts de formation sont bienvenus. Je n’ai pas connaissance de l’existence d’un programme commun de formation avec les préfets.
S’agissant d’Internet, il est difficile d’établir deux corpus juridiques différents pour une même liberté. Pour les manifestations organisées par le biais des réseaux sociaux, la première difficulté tient à l’absence d’interlocuteurs. L’idée de présumer organisateur celui qui lance le message me semble bonne. Cela responsabiliserait les initiateurs et faciliterait le travail de l’autorité administrative.
Lorsque la manifestation n’est pas déclarée, je peux vous citer le cas de poursuites contre quelqu’un qui appelait à manifester qui ont abouti à une décision de relaxe. De la même manière, un tribunal a considéré que le fait de se comporter en organisateur n’était pas suffisant pour considérer quelqu’un comme organisateur.
En la matière, nous sommes dans le droit commun de la procédure pénale, donc dans un régime de totale liberté de preuves.
M. le rapporteur. Je souhaite connaître votre avis sur plusieurs sujets qui ont été soumis à notre réflexion lors des auditions par d’autres interlocuteurs.
En premier lieu, un dispositif d’interdiction administrative individuelle de manifestation existe pour les réunions sportives à l’égard d’éléments radicaux identifiés. Il est relativement facile à faire appliquer dans une enceinte sportive. Il nous a été suggéré d’étendre ce dispositif aux manifestations sur la voie publique. Dans le principe, l’idée se défend mais dans la pratique, elle risque d’être inopérante. Que pensez-vous de cette mesure qui existe dans certains pays, comme la Belgique ? Je précise que cette mesure n’est envisageable qu’à l’encontre de personnes ayant déjà fait l’objet de condamnations pour violences lors de manifestations.
En second lieu, parmi les mesures préventives, le préfet de police de Paris a avancé l’idée d’interpeller en amont, sur réquisition du procureur, les personnes susceptibles de troubler l’ordre public. Quel pourrait être le cadre juridique de cette mesure ? Cette possibilité, semble-t-il, est déjà utilisée.
M. François Molins. Il serait intéressant de disposer d’un cadre juridique préventif permettant, sur la base d’un arrêté, d’obliger les personnes visées par une interdiction à se rendre au commissariat. Cela ne me choque pas.
M. le rapporteur. Mais le commissariat ne pourra pas retenir la personne pendant toute la durée de la manifestation.
M. François Molins. Cette mesure me semble dans la ligne de la décision rendue par le Conseil d’État dans l’affaire Dieudonné qui rappelle qu’il appartient à l’autorité administrative de prendre des mesures de nature à éviter la commission d’une infraction pénale. Dès lors que l’autorité administrative dispose d’informations suffisamment fiables et précises laissant penser qu’une infraction va être commise, son intervention me semble légitime.
En revanche, il me paraît difficile d’interpeller une personne à titre préventif, en l’absence de décision de l’autorité administrative, sur la simple foi de sa mauvaise réputation.
Il est tout à fait concevable d’interpeller celui qui n’a pas respecté un arrêté d’interdiction de manifestation.
M. le rapporteur. Cela relève donc de la police administrative ?
M. François Molins. Dans le premier cas, en effet. En revanche, s’il y a violation de l’arrêté d’interdiction, on bascule dans la police judiciaire.
M. le rapporteur. La décision d’interdiction de manifestation est pour vous une mesure de police administrative ?
M. François Molins. Tout à fait, dès lors qu’on parvient à objectiver les éléments laissant penser à la commission d’une infraction.
Mme Marie-George Buffet. Cette question est très délicate. Quel devra être le degré de condamnation préalable pour justifier la mesure ? Un syndicaliste pourra-t-il se voir interdit de manifestation au motif qu’il a été condamné pour avoir bousculé des ordinateurs dans une préfecture à la suite d’un conflit difficile ?
M. le rapporteur. Cette mesure fait partie des sujets dont nous avons à débattre afin de décider éventuellement de la faire figurer dans les préconisations du rapport.
Une disposition législative semble nécessaire pour la mettre en place. Il appartiendra au législateur de qualifier les faits de manière suffisamment exceptionnelle pour éviter qu’elle ne s’applique trop largement. C’est aussi toute la difficulté d’un autre texte, le projet de loi sur le renseignement. Il faut donner aux forces de sécurité les moyens de remplir leur mission dans un cadre juridique sécurisé sans entraver massivement le libre exercice du droit constitutionnel consistant à pouvoir exprimer librement son opinion, y compris en manifestant sur la voie publique.
M. François Molins. Il ne s’agit pas d’empêcher quelqu’un d’exercer une liberté fondamentale mais d’empêcher la commission d’une infraction. Il faut entourer la mesure de garde-fous suffisamment solides pour s’assurer que la personne visée n’a pas l’intention d’exercer une liberté mais de commettre une infraction de violence ou de dégradation. Dans le cas contraire, ce serait une grave atteinte à l’exercice des libertés démocratiques.
M. Philippe Doucet, président. Je vous remercie, monsieur le Procureur, d’avoir pris de votre temps pour répondre aux questions de la commission d’enquête.
*
* *
Audition sous forme de table ronde, ouverte à la presse, des représentants des syndicats des officiers de police et des commissaires de police et des représentants
de l’association GEND XXI
Compte rendu de l’audition du jeudi 2 avril 2015
M. le président Noël Mamère. Conformément aux dispositions de l’article 6 de l’ordonnance du 17 novembre 1958, je dois demander à ceux qui s’exprimeront de prêter le serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité.
(MM. Jean-Luc Taltavull, Jean-Marc Bailleul, Hervé Emo, Jean-Hugues Matelly, Cyrille Robert, Pierre-Marc Fergelot et Laurent Sindic prêtent serment.)
Comme vous avez souhaité tenir des propos liminaires, je vous donne la parole.
M. Jean-Luc Taltavull, secrétaire général adjoint du Syndicat des commissaires de la police nationale. Je prends la parole au nom de l’Union nationale des syndicats autonomes-Fédération autonome des syndicats du ministère de l’Intérieur (UNSA-FASMI), dont plusieurs représentants sont ici présents.
Je souhaite, en préambule, vous faire part de notre perplexité. S’il peut relever du légitime mécanisme démocratique de questionner les pratiques policières et gendarmistes, le contexte qui a présidé à la mise en place de cette commission d’enquête pouvait laisser craindre qu’il s’agisse d’une entreprise idéologique de déstabilisation des forces de l’ordre. En privilégiant les raccourcis simplistes et une approche caricaturale des problématiques de maintien de l’ordre, certains acteurs médiatiques et – c’est plus regrettable encore – politiques ont pu donner le sentiment de céder à une émotion biaisée, bien qu’elle soit probablement sincère. C’est une injustice, voire une insulte de plus faite à l’engagement et au professionnalisme des hommes et des femmes qui ont mis leur vie au service d’un aspect ardu mais essentiel du bien commun, la défense de l’ordre démocratique.
L’un de nos délégués de Toulouse qui a eu à connaître la gestion de l’après-Sivens pourra témoigner du degré de violence dont sont capables une partie de ceux qui se réclament de la mémoire de Rémi Fraisse, et qui agissent cagoulés, armés de marteaux, porteurs de pavés. Ce retour du terrain devrait être présent à l’esprit des membres de cette commission d’enquête au moment de formuler leurs préconisations.
Notre philosophie du maintien de l’ordre repose sur la notion de désordre acceptable et privilégie, en présence d’un attroupement, une action de dispersion, en maintenant le plus possible une distance entre les forces intervenantes et les participants à l’attroupement. Cette posture, qui a fait ses preuves, et qui suppose d’ailleurs de garantir aux forces d’intervention une large palette de moyens d’action, dont des armes de force intermédiaire, connaît cependant des limites en présence de bandes armées et organisées venues pour casser. Les défilés et cortèges sont pour ces individus des chevaux de Troie qui leur permettent d’accéder aux centres-villes, et les paisibles manifestants font, bien malgré eux, office de boucliers humains.
Confrontée quotidiennement aux manifestations de la violence sous toutes ses formes, la police nationale travaille en permanence sur les réponses à lui apporter, dans un contexte de judiciarisation croissante et avec une profonde culture de la force maîtrisée. Cette réponse à la violence est professionnelle et plurielle. Les brigades anti-criminalité (BAC), les pelotons de surveillance et d’intervention, et les autres unités similaires, d’appui ou d’intervention quotidienne, ont développé, notamment en matière d’interpellation en milieu hostile – que l’on pense à certains de nos quartiers –, des savoir-faire précieux en cas de confrontation avec des bandes de casseurs très mobiles et déterminés à faire un maximum de dégâts, matériels et humains, en un minimum de temps.
Entraînées à manœuvrer et à agir en unités constituées, les compagnies républicaines de sécurité, forces civiles de maintien et rétablissement de l’ordre, ont dû elles aussi adapter leurs tactiques et équipements aux évolutions de la violence. Leurs membres aussi sont préoccupés par le fait que soit évoquée la possibilité de les priver des moyens de se défendre, au nom d’une vision trop déconnectée des réalités du terrain.
Votre commission d’enquête doit être l’occasion de clarifier le cadre légal et réglementaire, pas toujours adapté, d’améliorer une législation et des textes d’application sur l’attroupement difficilement applicables, de lever des limites jurisprudentielles certaines, de modifier un mode trop binaire de l’action publique en amont : il n’y a rien entre le récépissé de déclaration et l’interdiction. Une gradation de l’encadrement de certaines manifestations ne pourrait-elle être envisagée ? Pourquoi pas une autorisation sous réserve qu’un certain nombre de conditions soient remplies, en termes de trajet et de contrôle de l’accès au lieu de départ, comme cela se pratique dans d’autres pays ? L’Allemagne, où j’ai servi quelques années, s’est dotée d’une législation anti-cagoule : la simple détention et le port d’une cagoule sur le trajet d’une manifestation sont des délits. Nous sommes preneurs de toute mesure qui permettrait d’agir le plus tôt possible, avant que les casseurs ne commencent à casser dans la manifestation.
Enfin, l’autorité habilitée à autoriser l’usage de la force ne saurait, selon nous, être que civile, jamais militaire, et le droit de défense collective d’une force jusqu’à l’arrivée de l’autorité civile sur place, si les circonstances ont fait obstacle à sa présence permanente, doit être exploré.
Laissez aux chefs de police les moyens de travailler et nous en ferons un usage éclairé, mesuré, ce qui n’exclut pas un contrôle. Notre ministre, tirant les enseignements de l’après-Sivens, a annoncé des mesures, sur lesquelles nous sommes totalement d’accord.
M. Jean-Marc Bailleul, secrétaire général du Syndicat des cadres de la sécurité intérieure-CFDT. Je représente le syndicat majoritaire chez les officiers de police. La perplexité qu’a évoquée M. Taltavull a été la nôtre également. Nous aimerions voir la même réactivité – la création d’une commission d’enquête – quand des policiers sont blessés dans leur chair lors d’opérations de maintien de l’ordre. Nous avons eu le sentiment, même si ce n’est pas l’affaire de Sivens qui fait l’objet de l’audition d’aujourd’hui, que cette commission est un signe de défiance, alors que la plupart des démocraties reconnaissent la capacité des forces de l’ordre françaises à maintenir le bon déroulement des manifestations.
Nous avons tout de même souhaité participer à cette table ronde parce que les officiers ont, tant chez les CRS qu’en sécurité publique, des propositions à faire. Il est nécessaire de s’adapter à une nouvelle forme de guérilla organisée, menée par des individus qui savent se protéger et se former, et ne rejoignent pas les manifestations afin d’y défendre les idées partagées par les manifestants.
Nous attendons de cette commission qu’elle dégage des pistes pour renforcer la sécurité des fonctionnaires de police et des militaires, et éviter qu’ils soient mis en cause personnellement. C’est là une dérive de ces dernières années : alors que nous sommes en organisation constituée d’ordre public, on cherche à personnaliser les responsabilités, ce qui n’est le cas dans aucun autre pays.
Chaque manifestation est différente, imprévisible. Il faut laisser les moyens aux policiers de garder à distance les manifestants pour éviter qu’il y ait davantage encore de blessés. À Nantes, lors des dernières manifestations, vingt-deux policiers ont été blessés, alors qu’aucun manifestant ne l’a été. Nous aimerions aussi que l’on parle des policiers blessés.
Si rien n’est fait pour les rassurer dans leurs missions, le danger est que de moins en moins de fonctionnaires soient volontaires pour porter les armes mises à leur disposition par le législateur, de crainte d’être mis en cause personnellement.
M. Hervé Emo, secrétaire général du syndicat Union des officiers. Puisque son ombre règne sur cette commission d’enquête, l’Union des officiers tient, sans aucun esprit polémique, à rappeler son émotion à la suite du décès de Rémi Fraisse, et c’est pour éviter qu’un fait de même nature se reproduise que nous appelons de façon urgente à l’établissement des règles que je vais énoncer.
Nous constatons que les analyses diverses et les propositions formulées pour garantir le respect des libertés publiques et le droit de manifester reviennent quasi systématiquement à commenter l’activité des deux forces mobiles de sécurité, leur régime d’emploi, leurs pratiques, leur formation. Or il ne faut pas négliger l’atteinte au respect de ces libertés par plusieurs catégories de manifestants, écologistes radicaux, marginaux, membres de groupuscules d’extrême gauche et autres. Les lois et règlements définissent parfaitement ce que sont une manifestation et un attroupement, voire une émeute. Une manifestation doit être pacifique, ordonnée et contrôlée. Dès qu’il existe un trouble à l’ordre public, la manifestation se transforme en attroupement et des textes répressifs s’appliquent immédiatement.
Nous connaissons cependant les difficultés rencontrées par les forces de l’ordre pour identifier et interpeler les fauteurs de troubles au sein des cortèges, individus qui trop souvent ne seront pas poursuivis par la justice faute de preuves. Pour l’Union des officiers, la véritable opposition au droit de manifester réside dans la multiplication de ces troubles, violences et dégradations qui s’imposent aux manifestants pacifiques et créent un climat global d’insécurité. Ce sentiment provoque un désintérêt pour ce type d’expression de la part du plus grand nombre, qui, par peur des risques courus, préfèrent ne plus exercer cette liberté.
Pour que les manifestations redeviennent des manifestations pour tous et que ce droit légitime soit protégé, l’État doit adopter des textes législatifs supplémentaires permettant d’intervenir contre ces professionnels du désordre qui ont pour seul but de créer des incidents, voire de blesser des policiers ou gendarmes. Les textes qui existent en France s’appliquent dans des situations collectives et figées. Comme en Angleterre et en Allemagne, les textes nouveaux que nous appelons de nos vœux devraient dépasser ce cadre collectif et créer des infractions contraventionnelles ou délictuelles individualisées.
Nous demandons une loi prévoyant des sanctions systématiques pour le fait de participer à une manifestation avec le visage caché ou porteur d’une arme, réelle ou par destination, casque, fusée de détresse, chaîne antivol… Nous demandons l’application de circonstances aggravantes pour les délits, vols et violences, commis durant les manifestations. Dès que cette catégorie d’individus, facilement identifiables par leur tenue ou leur comportement, participent au cortège, ils ne doivent plus être considérés comme des manifestants mais comme des délinquants potentiels, représentant un risque réel d’atteinte à l’intégrité physique des manifestants pacifiques, d’agression des forces mobiles de sécurité et de dégradations de biens. Pour l’Union des officiers, il ne faut pas confondre manifestants et délinquants.
Nous préconisons également de rappeler leurs obligations légales aux organisateurs des manifestations, de les obliger à prévoir un service d’ordre suffisant pour pouvoir dissoudre une manifestation dès qu’ils en reçoivent la demande, et de les poursuivre en cas de manquement.
L’ensemble des missions des services de police ou de gendarmerie placent les personnels face à un contexte incontestablement de plus en plus violent. Les fonctionnaires de police et militaires de la gendarmerie sont contraints de recourir à la force pour exercer leur mission. Si, globalement, l’ensemble de la population, consciente de cette violence, accepte de plus en plus l’usage de la force par les représentants de l’ordre, nous serions sensibles au fait que cette violence légitime soit transcrite dans les textes, acceptée par la loi.
Notre société doit faire des choix, et vous en êtes, mesdames et messieurs les députés, les dignes représentants. Les membres des forces de l’ordre attendent des élus de la Nation une reconnaissance de la dangerosité de leur travail et une solidarité exprimée dans les textes. Nous ne demandons pas l’impunité, loin de là ; nous acceptons les multiples organes de contrôle et de sanction, mais nous osons compter pour les forces de l’ordre aussi sur l’application de la présomption d’innocence.
En conclusion, monsieur le président, vous accepterez l’idée que le syndicaliste que je suis, membre de la confédération Force Ouvrière, soit particulièrement attentif à la préservation des libertés individuelles et au droit de manifester. Mais l’officier de police sait que, pour garantir ces libertés fondamentales, il faut avoir le courage de condamner ceux qui en abusent et en détournent l’esprit.
M. le président Noël Mamère. Je crois que nous avons un problème et je vais essayer de poser les jalons d’un bon fonctionnement de cette audition.
Si nous avons demandé une commission d’enquête parlementaire après les événements de Sivens, qui ont vu la mort d’un jeune homme de vingt et un ans, c’est que cela fait partie des attributions du législateur. Si une enquête judiciaire est en cours pour déterminer ce qui s’est passé, il nous appartient de fixer un cadre afin que la liberté d’expression et le droit de manifester puissent s’exercer normalement dans notre pays, et nous essayons, à ce titre, d’améliorer notre doctrine du maintien de l’ordre.
Nous avons auditionné des victimes de bavures policières. Le bilan de nos auditions est très largement favorable aux représentants de l’ordre, généraux, officiers, syndicats… Il n’y a aucune volonté de notre part d’entacher la réputation de quel que corps d’État que ce soit. Notre volonté est que l’État de droit soit respecté dans notre pays.
Le débat entre ceux qui souhaitent que les forces de l’ordre se dotent d’armes de guerre, comme celle qui a tué Rémi Fraisse, et ceux qui y sont opposés aura lieu. Nous écoutons les uns et les autres, et nous formulerons des prescriptions. M. le rapporteur rendra son rapport ; le président, s’il n’est pas d’accord avec la totalité de ce rapport, peut dire ce qu’il pense, et je ne me gênerai pas pour le faire.
En tant que représentants des syndicats, vous avez protesté contre l’invitation à cette audition de Gend XXI. C’est notre droit d’organiser les auditions comme nous le souhaitons, et les syndicats d’officiers n’ont pas à nous dire ce que nous devons faire. Notre temps est contraint par le règlement de l’Assemblée nationale, M. le rapporteur devant rendre son rapport d’ici aux premiers jours de juin. En outre, nous estimons normal d’entendre des gendarmes. Les représentants de Gend XXI ont d’ailleurs eu des problèmes pour avoir créé cette association. Le rapporteur n’est pas du même avis que moi sur ce point ; comme je suis un démocrate, et non un « écologiste délinquant », ainsi que je l’ai entendu, je lui passe la parole.
M. Pascal Popelin, rapporteur de la commission d’enquête. Je rappelle le processus de constitution d’une commission d’enquête parlementaire. Depuis la réforme constitutionnelle de 2008, chaque groupe politique dispose du droit de demander la création d’une commission d’enquête lors de chaque session ordinaire. Seule une majorité qualifiée des trois cinquièmes est de nature à y faire obstacle. Le règlement de l’Assemblée nationale prévoit, ensuite, que le groupe parlementaire qui a fait la demande dispose soit du poste de président soit de celui de rapporteur. Les membres de la commission sont répartis à la proportionnelle de chacun des groupes.
La pratique de la présente majorité a été de ne faire obstacle par aucune manœuvre dilatoire aux demandes des différents groupes à cet égard. Ainsi, le 3 décembre dernier, ont été créées le même jour une commission d’enquête à l’initiative du groupe écologiste sur le maintien de l’ordre républicain et une commission d’enquête à l’initiative du groupe UMP sur les filières djihadistes.
Nous essayons, dans ces commissions, de travailler dans la meilleure harmonie possible, ce qui suppose que les uns et les autres soient capables de discuter, dans un certain esprit de compromis. Si vous avez été attentifs aux débats de notre commission, qui sont publics, vous admettrez qu’on peut difficilement prétendre que des présupposés ont orienté l’organisation de ses travaux. Les reproches implicitement contenus dans certaines de vos interventions sont à l’exact opposé d’autres reproches qui nous ont été faits, selon lesquels nous serions à l’écoute de la hiérarchie policière. Si des critiques aussi contraires peuvent nous être adressées, c’est sans doute que nous avons convenablement fait le tour des organisations et personnalités qui devaient être entendues.
Les paroles tenues ici sont libres et n’engagent que leurs auteurs. C’est seulement le rapport du rapporteur qui engagera la commission, si une majorité décide qu’il soit publié. Les contributions individuelles des commissaires qui auraient des choses à ajouter, pour marquer leurs différences, les engageront.
M. Guillaume Larrivé. Je m’exprimerai en tant que député de l’opposition et vice-président de cette commission.
Au nom de l’opposition, je me suis exprimé dans l’hémicycle pour m’opposer à la création de cette commission. Dans la mesure où elle a été créée, nous y participons, sous cette réserve importante.
Je tiens à marquer ma confiance à l’endroit des forces de sécurité intérieure, à la force civile qui est la police nationale et à la force militaire qui est la gendarmerie nationale, toutes deux placées sous l’autorité du ministre de l’Intérieur, rapprochées mais non fusionnées, fortes de leurs spécificités juridiques, organiques, historiques, fonctionnelles.
Je suis convaincu de la nécessité de renforcer, aux plans juridique et opérationnel, les modalités de protection des fonctionnaires de police et gendarmes intervenant sur le terrain. Ces modalités sont en partie dans le débat de cette commission d’enquête, mais aussi ailleurs : aujourd’hui même, le groupe UMP défend une proposition de loi sur les règles d’emploi des armes.
Monsieur le président, je m’interroge – c’est peu de le dire – sur le format que vous avez choisi pour cette audition. Nous avons en face de nous des organisations syndicales représentatives des fonctionnaires de la police nationale et, au sein de la même réunion, une association, respectable mais qui n’est qu’une association parmi les dizaines de milliers d’associations loi 1901, et qui réunit par ailleurs des militaires de la gendarmerie nationale. Il ne s’agit pas d’un syndicat de gendarmerie ni d’une association professionnelle militaire, ces deux notions n’existant pas en droit. Il serait utile de recevoir le Conseil de la fonction militaire de la gendarmerie (CFMG), qui est l’instance de concertation légale, donc légitime, au sein de la gendarmerie nationale.
M. le président Noël Mamère. Le CFMG n’a rien de représentatif pour ce qui est du personnel.
M. Jean-Hugues Matelly, président de l’association Gend XXI. Nous sommes venus ici uniquement pour participer aux travaux de réflexion en vue de renforcer la sécurité de nos concitoyens et des agents des forces de l’ordre. Le statut de Gend XXI est encore inexistant au plan juridique puisque, si nous sommes couverts en droit international, nous ne le sommes pas dans la loi française. Mes deux collègues ici présents sont également membres du CFMG.
Notre principal souci en matière de maintien de l’ordre – et nous rejoignons en cela, même si nous n’avons pas vocation à intervenir dans le domaine de la doctrine opérationnelle, les propositions du général Favier –, c’est d’être très clair sur les valeurs républicaines, et notamment sur les principes fondateurs du maintien de l’ordre : la séparation de la responsabilité de l’autorité civile et des autorités opérationnelles, militaires en ce qui concerne la gendarmerie, la nécessaire traçabilité des instructions des autorités civiles et des ordres des autorités militaires, enfin la séparation des opérations de police administrative et de police judiciaire. L’idée, notamment, d’associer dans les mêmes unités des effectifs en civil chargés de police judiciaire et des effectifs en uniforme chargés d’opérations de maintien de l’ordre ne nous paraît pas judicieuse, au nom de la séparation des pouvoirs.
La question très pragmatique des effectifs peut également poser problème. La multiplication des fonctions d’appui au sein des escadrons, et notamment les dispositions qui viennent d’être prises pour « binômer » les lanceurs de grenade ainsi que la nécessité de prévoir des opérateurs vidéos, font que les forces au contact, dans l’organisation de nos escadrons, diminuent. Or le rapport de force visible sur le terrain contribue à faire baisser le niveau de violence. Les meneurs peuvent moins facilement entraîner des manifestants avec eux si le rapport de force visible sur le terrain est en faveur des forces de l’ordre. À ce titre, il nous paraît nécessaire de renforcer les effectifs unitaires des escadrons de gendarmerie mobile.
Mon second point concerne la sécurité de nos personnels et le temps d’activité. La France n’a pas transposé une directive européenne, applicable également, hors temps de guerre, état de siège ou état d’urgence, aux militaires, visant à limiter le temps d’activité. On comprend bien que les capacités d’un gendarme mobile épuisé par un très grand nombre d’heures d’opération sont altérées, et que celui-ci peut dès lors être conduit à avoir une réaction inappropriée, par laquelle serait engagée sa propre responsabilité pénale alors même que l’État n’a pas mis en place les normes qui permettraient de s’assurer que les gendarmes en opération se trouvent dans de bonnes conditions d’emploi.
Je laisse la parole à mon collègue Cyrille Robert sur les problématiques rencontrées par les gendarmes au contact.
M. Cyrille Robert, membre du conseil d’administration de Gend XXI. Actuellement chef de groupe en escadron de gendarmerie mobile, j’ai commencé ma carrière il y a trente ans au moment des événements de Nouvelle-Calédonie. J’ai participé plus récemment au maintien de l’ordre à Sivens, en octobre 2014.
Depuis 2005, les forces mobiles doivent appréhender l’utilisation de moyens vidéo par les manifestants. À Sivens, un même compartiment de terrain était filmé pendant des heures, montrant des personnes déguisées en clowns, ou ostensiblement sympathiques, femmes, adolescents, nous parlant, nous expliquant pourquoi elles étaient là. Puis, ces personnes s’éloignaient et nous étions alors violemment harcelés par des groupes d’individus conduits par des chefs. La riposte des forces de l’ordre était filmée, mais non l’attaque qu’elles venaient de subir. Cela se passe de la même manière dans d’autres types de manifestations. C’est quelque chose qui nous déstabilise énormément. Il faudra développer nos moyens vidéo de façon beaucoup plus importante pour faire face à ces nouvelles pratiques.
Je passe la parole à mon collègue Frédéric Le Louette.
M. le président Noël Mamère. Un instant. M. le rapporteur me dit qu’il ne comprend pas comment nous fonctionnons.
M. le rapporteur. Nous avons signé ensemble une lettre indiquant les modalités du déroulement de cette audition. Ce n’est pas ainsi que cela devait se passer. Nous avons une heure et demie en tout et pour tout ; il nous reste très peu de temps pour poser des questions.
M. le président Noël Mamère. Ce sont les syndicats eux-mêmes qui ont décidé du temps que prendraient leurs propos liminaires.
M. le rapporteur. Trois prises de parole pour une même organisation, cela me semble excessif. Qui plus est, ces interventions devaient avoir lieu en fin d’audition.
M. le président Noël Mamère. Soyons clairs : vous reprochez à M. Matelly et à ses collègues de prendre trop de temps par rapport aux syndicats, vous ne reprochez pas aux syndicats d’avoir fait des déclarations liminaires trop longues ?
M. le rapporteur. Nous manquerons de temps pour poser nos questions.
M. Jean-Paul Bacquet. Monsieur le président, nous avons affaire à une association qui ne s’est pas présentée. Il existe dans la gendarmerie un Conseil national – il a été cité – mais aussi des associations bien plus anciennes et représentatives, qui n’ont pas été convoquées, et je trouve cela inacceptable.
Parmi les valeurs républicaines de la gendarmerie, il y a la militarité, la hiérarchie, l’immersion. C’est ce qui fait que la gendarmerie a toujours manifesté son loyalisme par rapport à la République.
M. le président Noël Mamère. Je pourrais vous citer les courriers d’associations et d’experts qui regrettent de ne pas être invités. Nous n’avons pas assez de temps pour recevoir tout le monde.
M. Jean-Paul Bacquet. Regardez les effectifs !
M. le président Noël Mamère. Nous ne sommes pas des épiciers ou des comptables. M. Matelly a eu de gros problèmes avec sa direction à cause de la création de l’association Gend XXI. Ou bien vous nous faites confiance, au rapporteur et à moi-même, pour les invitations, ou bien vous ne nous faites pas confiance et j’en tirerai les conclusions. Je savais d’ailleurs très bien à quoi m’attendre lorsque le groupe écologiste a demandé la création de cette commission d’enquête.
M. Jean-Paul Bacquet. Ne jouez pas les victimes !
M. le président Noël Mamère. Ce n’est pas mon caractère, ni ma réputation. Je n’ai pas non l’habitude de me faire rouler dans la farine.
Je lis le dernier paragraphe de notre lettre en date du 30 mars 2015 : « Aussi, afin de tenir compte de vos préoccupations, lors de la table ronde à laquelle vous avez été conviés, les organisations syndicales interviendront en premier lieu et disposeront d’un temps de parole plus important. L’association Gend XXI sera invitée à s’exprimer au terme de cet échange. » On peut considérer que les déclarations liminaires étaient un échange.
Puisque nous avons entendu M. Matelly et M. Robert, nous en resterons là pour Gend XXI.
M. Guy Delcourt. Les conditions de cette audition sont tout de même très particulières. De la part de syndicats de commissaires et d’officiers, je m’attendais à une autre entrée en matière. Nous ne sommes pas dans une réunion politique, recevant les délégations de syndicats pour écouter leurs revendications. Cette confusion est inadmissible ; c’est même une faute, en raison des mises en cause complètement déplacées que nous avons entendues. Une commission d’enquête ne doit pas servir à faire part, en profitant d’une retransmission en direct, de ses états d’âme en épinglant les partis politiques.
M. Guillaume Larrivé. En même temps, la parole est libre !
M. Guy Delcourt. Cette commission d’enquête est suivie en direct par bien plus de monde que certains peuvent le penser. De quoi avons-nous l’air ? Dans la commission d’enquête sur l’affaire d’Outreau, les syndicats de magistrats se sont-ils comportés de cette manière ?
J’attendais de ces propos préliminaires, parce qu’en tant qu’élus locaux nous rencontrons les commissaires de police et les représentants syndicaux qui nous font part de la vétusté des matériels, des problèmes d’effectifs et de moyens, qu’ils présentent un état des lieux. Or le ton a tout de suite été donné : il y avait les procureurs et les accusés.
M. Daniel Boisserie. Je souhaiterais que l’on revienne à plus de sérénité. Quelques propositions ont été avancées ; discutons-les. Cela donnera une autre image.
M. le président Noël Mamère. Je donne la parole à M. le rapporteur pour poser la première série de questions.
M. le rapporteur. Il est neuf-heures vingt-cinq, nous avons jusqu’à dix heures, et nous commençons véritablement l’audition… Non, il y a encore une demande de parole.
M. Pierre-Marc Fergelot, Syndicat indépendant des commissaires de police. Je souhaite intervenir pour contribuer au débat sur l’évolution du maintien de l’ordre souhaitée à la suite du décès d’un jeune manifestant. Le niveau et la qualité de nos forces de l’ordre font référence dans de nombreux pays. Les accidents ou dommages collatéraux se produisent très rarement. Il ne faut pas oublier les efforts consentis ces vingt dernières années en termes de modernisation des forces, d’adaptation des équipements et armements, d’évolution de techniques d’intervention.
Nous avons aujourd’hui un problème lié à l’émergence d’une nouvelle forme de violence, professionnalisée, organisée, structurée sur plusieurs pays, voire plusieurs continents, de la part de personnes capables de se mobiliser sur des causes qui ne sont pas forcément liées entre elles. Cette violence se banalise car elle s’appuie sur une manipulation de l’image et de l’information, qui passe parfois par l’agression de journalistes. Je pense qu’un des objets de cette commission devrait être de répondre à cette forme de violence qui ne relève pas du maintien de l’ordre classique, pour lequel nos forces sont équipées et entraînées à un très haut niveau, et dont les opérations se déroulent sans problème tout au long de l’année.
M. le rapporteur. Il nous reste seulement une demi-heure. Dans ces conditions, je ne ferai pas semblant de poser des questions qui resteront sans réponse. Ce que je demanderais aux participants, c’est de nous adresser, s’ils le souhaitent, des contributions écrites, dont je me servirai pour la rédaction du rapport, sur les sujets qui nous préoccupent et qui n’ont pas été évoqués : l’évolution récente du maintien de l’ordre, ses acteurs, ses conditions, les problèmes d’effectifs, la durée des missions, les équipements, les unités mixtes du type des compagnies de sécurisation et d’intervention (CSI), la police judiciaire et la judiciarisation, la présence et le rôle de la presse, la formation…
M. le président Noël Mamère. Nous pouvons ajouter la création d’une autorité indépendante pour le contrôle déontologique, comme cela se pratique avec le contrôleur des lieux de privation de liberté.
M. Gwenegan Bui. Lors d’une prochaine réunion avec les forces syndicales, il faudra prévoir un meilleur maintien de l’ordre pour que nous tenions notre ordre du jour. Je regrette le ton de certains propos liminaires. Vous êtes tous, messieurs, des représentants de l’ordre républicain et, au lieu de mettre en cause les uns et les autres, il vaudrait mieux profiter de ces moments de débat pour progresser ensemble. C’était le sens de cette invitation et je regrette que nous ne puissions entrer dans le vif du sujet.
J’insiste pour que les contributions écrites que vous nous enverrez exposent les problématiques de formation, car il semble qu’il existe des différences entre CRS et forces de gendarmerie mobile. Alors que les responsables CRS m’ont dit qu’il n’y avait pas de problème, le directeur général de la gendarmerie nationale a évoqué un problème de temps de formation. Je souhaiterais également que vous écriviez au sujet de la durée d’emploi des forces sur le terrain et le risque pour le fonctionnaire, quand sa durée de mission est trop longue, d’avoir un comportement déviant de la norme et potentiellement dangereux, pour lui comme pour les manifestants, que vous expliquiez à quel moment vous entrez en mission et à quel moment ces missions s’achèvent et les officiers et hommes de troupe rentrent chez eux.
M. Jean-Paul Bacquet. J’approuve la demande du rapporteur de propositions écrites, mais je souhaiterais que nous n’interrogions pas seulement les organisations ici présentes. Il y a, je l’ai dit, des associations de gendarmes bien plus représentatives. Nous n’avons plus le temps de les recevoir, mais nous pouvons leur écrire.
M. Daniel Boisserie. J’ai cru comprendre que le problème, aujourd’hui, était celui d’une insuffisante adaptation de la législation à l’évolution des manifestations, et je pense que c’est sur cette question que nous devrions nous pencher. J’ai entendu parler de brouillage dans les manifestations, de grenades offensives, de renforcement d’escadrons de gendarmerie mobile, de vidéo : des propositions sur ces points nous seront utiles pour adapter la législation.
M. le président Noël Mamère. Depuis le début de cette commission d’enquête, nous avons tâché de regarder avec tous les acteurs ce qui pourrait être amélioré.
M. Guy Delcourt. Pour compléter les propos de mon collègue, je rappelle que nous avons entendu des préfets et l’ancien directeur général de la police nationale, et que vous pouvez écouter les enregistrements de leurs auditions. Peut-être trouvez-vous que j’insiste grossièrement ? Ayant l’habitude d’assumer mes responsabilités, j’ai été marqué par la première intervention du représentant de l’UNSA : il a donné le ton de la politisation de la commission d’enquête. Si vous aviez écouté toutes les bandes, vous auriez été au même niveau que votre collègue représentant les commissaires indépendants et nous aurions eu un autre débat, plus constructif pour vous-mêmes que les échanges d’écrits auxquels nous allons recourir. D’ailleurs, nous recevons toujours des écrits. Vos organisations syndicales décentralisées saisissent tous les jours les élus locaux et parlementaires que nous sommes, à propos de leurs conditions de travail. L’une de mes questions portait précisément sur l’état psychologique des policiers, compte tenu de leurs conditions de travail actuelles. Je regrette que nous n’ayons pu avoir cet échange.
M. Laurent Sindic, délégué du syndicat des commissaires de la police nationale. Je suis venu spécialement de Toulouse, où je suis commissaire de police et chef du service de sécurité de proximité, pour vous exposer mon expérience des manifestations anti-Sivens, qui ont eu lieu après la mort regrettable et dramatique de Rémi Fraisse. J’ai été amené à gérer ou à participer à la gestion de cinq manifestations très violentes qui ont dégénéré.
Lors de la première manifestation, organisée au lendemain de la mort de Rémi Fraisse, je suis parti à Albi, à la demande de mon directeur central. Les manifestants devaient se recueillir et rendre hommage à la personne décédée. Dans ce genre de situation, comme nous avons pu le constater en janvier après les actes terroristes ignobles commis à Paris, la manifestation est un moment solennel, calme.
Or, à Albi, nous n’avons pas eu affaire à ce type de manifestants. Près de la moitié des 600 manifestants était constituée de gens très déterminés, organisés, cagoulés et armés qui ont immédiatement commis des violences sur les forces de police. Quelle a été la réaction de ces dernières ? Elles ont repoussé le plus longtemps possible l’usage de la force et, c’est important de le souligner, il y a eu quarante et un blessés dans leurs rangs. Comme tous les intervenants l’ont dit, le professionnalisme et le sang-froid de nos forces de l’ordre sont reconnus bien au-delà de nos frontières.
Toulouse a été le théâtre de quatre manifestations violentes : le 1er novembre, le 8 novembre, le 22 novembre, et le 21 février dernier. Pour illustrer mon propos, je voudrais vous faire passer des photos qui vont vous montrer des groupes. Peut-on les qualifier de casseurs ou, compte tenu de leur tenue, de Black Blocs ? Pour moi, ce sont des délinquants, des gens qui n’ont aucune envie de revendiquer, qui rejettent toute forme de société, tout symbole d’autorité. Quand ils noyautent une manifestation, quand ils se mêlent à des gens pacifiques qui exercent leur droit constitutionnel à manifester, ils n’ont qu’une intention : casser et commettre le plus grand nombre de violences possibles sur les forces de l’ordre, voire sur la population, ce qui est très inquiétant. D’où le changement d’approche dans la technique du maintien de l’ordre.
Pendant longtemps, la philosophie française du maintien de l’ordre a consisté à maintenir les manifestants à distance, pour ne pas générer de blessures, puis à les disperser pour contenir et maîtriser les troubles à l’ordre public. Ces groupes qui s’immiscent au cœur d’une manifestation pacifique en profitent pour commettre de nombreuses violences. Comment font les forces de l’ordre pour écarter les manifestants pacifiques tout en allant interpeller ces individus radicaux et casseurs que je qualifie de délinquants ? Acceptez-vous, monsieur le président, que je vous fasse passer des photos qui illustrent mon propos ?
M. le président Noël Mamère. Nous avons vu ces photos, mais nous en avons vu d’autres, par le passé. J’entends vos propos mais il ne semble pas que le phénomène soit nouveau.
M. Pascal Popelin, rapporteur. Excusez-moi, mais j’aimerais vous faire passer un message. Depuis le début du mois de janvier, nous recevons des gens aux profils très variés, qui sont auditionnés seuls ou de manière collective. Pour la première fois, nous avons le sentiment que les personnes auditionnées veulent seulement dire ce qu’elles ont à dire, sans que nous leur posions de questions.
Nous ne pouvons pas travailler de cette manière. Nous nous permettrons de vous poser des questions écrites sur les sujets sur lesquels nous voudrions avoir vos avis et réflexions, compte tenu de votre expérience et de ce que vous représentez. Vous pourrez évidemment enrichir vos réponses de remarques complémentaires qui n’entreraient pas dans le périmètre des questions.
Normalement, devant une commission d’enquête, on répond aux questions qui sont posées. Je déplore qu’il n’ait pas été possible, pour différentes raisons qui ne découlent pas toutes des prises de paroles des uns et des autres, de poser des questions. Ce matin, j’ai le regret de constater que nous avons accumulé les handicaps au point de nous retrouver dans une situation qui ne nous permet pas de travailler normalement. Je le regrette non seulement pour les commissaires présents, mais aussi pour chacun d’entre vous. Vous avez pris sur votre temps, vous vous êtes déplacés.
À partir d’un moment, il faut dire les choses franchement et appeler un chat un chat : c’est un raté. Lorsque j’avais travaillé sur le rapport pour avis de la mission Sécurité du projet de loi de finances, j’avais fait le choix d’éviter les tables rondes et de rencontrer chaque organisation à son tour. Il n’était pas possible de faire le même choix pour ce programme d’auditions qui est vaste et se déroule sur un temps contraint. Nous allons nous adapter.
Quoi qu’il en soit, je souhaite que chacune de vos organisations s’exprime. S’agissant de la gendarmerie, j’ai bien entendu les demandes de notre collègue Bacquet et il n’y a aucune raison de ne pas y faire droit. Vous recevrez très rapidement une série de questions auxquelles je vous demanderais d’apporter des réponses dans les délais. La semaine prochaine, nous nous rendrons au Centre national d'entraînement des forces de gendarmerie (CNEFG) de Saint-Astier. La semaine suivante, nous terminerons nos auditions par celle du Défenseur des droits. Viendra ensuite la phase de rédaction du rapport qui devra être remis à la mi-mai.
M. le président Noël Mamère. Nous allons écouter la voix de la sagesse de M. le rapporteur et lever la séance.
M. Laurent Sindic. Quand vous m’avez interrompu, je voulais vous raconter l’expérience qui pouvait vous éclairer sur les évolutions des techniques du maintien de l’ordre.
M. le président Noël Mamère. Monsieur, je pense que vous n’avez pas compris ce que vient de dire M. le rapporteur.
M. Laurent Sindic. Si, j’ai bien compris. C’est bien dommage parce que je pense que c’était utile pour tout le monde.
M. le président Noël Mamère. Comme l’a très bien expliqué M. le rapporteur, nous considérons que votre compréhension, telle qu’exprimée, est dommageable pour la qualité du travail de cette commission d’enquête parlementaire. C’est pourquoi, si vous avez quelque chose à dire, vous allez l’écrire. Je prends la responsabilité de lever la séance.
*
* *
Audition sous forme de table ronde, ouverte à la presse, des représentants des syndicats de gradés et gardiens
Compte rendu de l’audition du jeudi 2 avril 2015
M. le président Noël Mamère. Je vous remercie d’avoir accepté l’invitation de notre commission d’enquête sur le maintien de l’ordre. M. Pascal Popelin, notre rapporteur, va vous poser la première série de questions. Mais au préalable, conformément aux dispositions de l’article 6 de l’ordonnance du 17 novembre 1958, je dois vous demander de prêter le serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité.
(MM. Paul Le Guennic, Grégory Joron, Éric Mildenberger, Laurent Laclau-Lacrouts, David Michaux et Denis Hurth prêtent serment.)
M. Paul Le Guennic, secrétaire national d’Unité SGP Police FO. Pourrions-nous intervenir avant les questions ? Je sais que la table ronde précédente a été un peu agitée mais, pour notre part, nous n’avons pas l’intention d’envenimer les débats.
M. Pascal Popelin, rapporteur. Si vous souhaitez faire des interventions liminaires, je ne vais pas brider votre parole, mais nous souhaiterions passer directement aux questions pour utiliser de manière optimale l’heure et demie dont nous disposons. Je propose de vous poser une série de questions suffisamment larges pour que vous puissiez intégrer dans vos réponses les messages que vous souhaiteriez faire passer.
M. le président Noël Mamère. La proposition de M. le rapporteur vous convient-elle ?
M. Paul Le Guennic, secrétaire national d’Unité SGP Police FO. Moyennement, mais nous allons nous plier à cette règle. Entre autres choses, nous aurions aimé souligner que nous avons dû insister à plusieurs reprises pour être reçus par votre commission. Je peux comprendre que vous préfériez inviter les commissaires et les officiers, qui sont les responsables des unités, mais je signale que le corps d’encadrement et d’application représente quand même 94 % des effectifs des compagnies républicaines de sécurité (CRS). Cela étant, nous vous remercions de nous accueillir.
M. le président Noël Mamère. M. le rapporteur et moi-même, nous n’avons émis aucune opposition à votre audition. C’est une question d’organisation.
M. Pascal Popelin, rapporteur. Pour ce qui me concerne, dès que j’ai été saisi de la demande de l’une des organisations que vous représentez, j’ai fait en sorte que cette audition puisse avoir lieu, alors que l’organisation des débats était déjà bien calée et planifiée. Ni le président ni moi-même n’avons manifesté la moindre opposition à cette audition.
Reste les questions d’organisation, y compris celles de vos propres centrales syndicales. Nous aurions pu nous adresser aux confédérations, libres à elles d’organiser ensuite la représentation. Cela étant, j’admets une faute d’attention qui a été rectifiée dès qu’elle a été portée à notre connaissance et je comprends que vous ayez souhaité vous exprimer de la manière dont vous l’avez fait.
Instruit de l’expérience de la précédente audition – qui n’était pas dans les canons de la beauté intellectuelle – je vous propose d’aborder maintenant le fond du sujet. Si nous passons encore une heure à parler de la forme, il ne me restera plus qu’à vous demander, à vous aussi, une contribution écrite pour recueillir l’avis de vos organisations syndicales. Nous avons procédé à d’autres types d’auditions, configurées autrement, quand nous avons reçu des commandants de groupements de gendarmerie ou des commandants d’unités de CRS. C’était une manière de recueillir non pas une expression syndicale à vocation généraliste mais des témoignages sur la pratique de terrain.
Si vous le permettez, je vais passer à mes questions. Vous avez toute liberté de réagir : vous n’êtes pas tenu par l’ordre des questions posées ; vous pouvez ne pas répondre à celles qui ne vous semblent pas pertinentes ; vous pouvez répondre par anticipation à d’autres qui n’auraient pas été posées. Ce qui nous intéresse, c’est d’avoir votre sentiment sur un certain nombre de points.
Sur le thème de l’évolution récente du maintien de l’ordre, je voulais vous interroger sur la réduction des effectifs et ses conséquences sur l’organisation interne des compagnies de CRS. Les réorganisations consécutives à ces réductions d’effectifs ont-elles eu un impact sur l’efficacité et les conditions de votre travail ?
Nos travaux étant en phase finale, nous pouvons vous interpeller sur des problématiques qui nous ont été soumises au fil des auditions. On nous a ainsi expliqué que la durée des missions de maintien de l’ordre s’est allongée. Est-ce la réalité ? Le cas échéant, si cela pose des problèmes, comment y remédier ?
Venons-en aux conditions du maintien de l’ordre. L’équipement dont vous disposez vous paraît-il adapté, suffisant, satisfaisant ? Pensez-vous, au contraire, qu’il doit évoluer ?
Beaucoup de débats ont tourné autour de l’engagement, dans des opérations de maintien de l’ordre, d’unités non spécialisées aux côtés – voire en lieu et place – des unités spécialisées que sont les CRS et les brigades de gendarmerie mobile. Quelle appréciation portez-vous sur cette pratique ? Compte tenu des différences de formation et de configuration, cet appel à des unités non spécialisées peut-il poser des problèmes ?
Si le phénomène des casseurs n’est pas nouveau, l’évolution des manifestations conduit néanmoins à envisager l’intervention policière d’une façon différente, en partant de l’amont – le renseignement et la prévention – et en allant jusqu’à d’éventuelles interpellations. Or, des unités spécialisées dans le maintien de l’ordre ne sont pas adaptées aux interpellations et aux procédures judiciaires, nous ont expliqué, de manière quasiment convergente, les différents acteurs du maintien de l’ordre que nous avons auditionnés. Ces unités ne sont pas équipées et formées pour ce faire ; une interpellation peut gêner leurs manœuvres et leur mission de mise à distance.
Comment peuvent-elles alors fonctionner avec des personnels dédiés à des actions de police judiciaire ou de judiciarisation du comportement des manifestants ? À Paris, des unités dédiées à l’interpellation ou à des actions de judiciarisation sont présentes de manière quasi systématique dans les manifestations, nous a indiqué la préfecture de police. Est-ce une bonne ou une mauvaise chose ? Doit-on développer cette pratique ? Quelle serait l’articulation optimale entre les différentes unités d’intervention ?
M. Éric Mildenberger, délégué général d’Alliance police nationale. Dans l’exercice de leur mission de maintien et de rétablissement de l’ordre, le cœur de leur métier, les compagnies de CRS sont handicapées par la baisse significative de leurs effectifs. Elles peuvent se trouver en situation difficile sur le terrain, quand il s’agit de protéger un site ou de barrer des rues. En quelques années, l’effectif réel d’une compagnie sur le terrain est passé de 90-100 personnes à 70-80 personnes. L’effectif théorique se situe à 130 CRS, mais certaines compagnies fonctionnent avec 118-120 CRS, le nombre fluctuant en fonction des mouvements des personnels.
Ce mouvement, qui s’inscrit dans une nouvelle philosophie du maintien de l’ordre, pose un véritable problème de fond. Longtemps, les CRS avaient pour mission de subir. Désormais, leur action est moins figée, plus dynamique : nos tactiques ont changé pour nous permettre d’interpeller. Ce serait sans doute une bonne chose s’il n’y avait pas ce problème du nombre lors des interventions. Il est nécessaire de prendre à bras-le-corps ce problème des effectifs des CRS, à un moment où nos missions deviennent de plus en plus dures et sensibles, comme l’ont montré les nombreuses opérations de maintien de l’ordre qui nous ont été confiées en 2014.
M. Paul Le Guennic. Les CRS ont démontré leur savoir-faire depuis soixante-dix ans, et les évolutions de leurs méthodes et tactiques ne sont pas aussi récentes que vous le dites. Il fut un temps où nous subissions un maintien de l’ordre plutôt statique avec des barrages lourds et une riposte à la manifestation. Néanmoins, depuis de nombreuses années, les CRS se sont adaptées à l’évolution de la délinquance, aux manifestants plus mobiles, aux petits groupes de casseurs.
La révision générale des politiques publiques (RGPP) a porté un sacré coup aux effectifs des CRS : au sein de la police nationale, c’est la direction qui a réagi le plus vite et qui a payé le plus lourd tribut. Alors que de nombreuses compagnies sont exsangues par manque d’effectifs, le Gouvernement a repris les recrutements mais les sorties d’école vers les CRS ne sont pas satisfaisantes. Dans de nombreuses compagnies, les effectifs ne sont pas remis à niveau. Les CRS ne pourront pas continuer à bien évoluer dans ces conditions.
M. Grégory Joron, délégué national d’Unité SGP Police FO. Pour mesurer l’effet de la réduction des effectifs des CRS, il faut bien prendre en compte la manière dont elles fonctionnent au niveau opérationnel. Une compagnie a au minimum trois cinquièmes de ses effectifs disponibles pour effectuer une mission. Moins il y a d’effectif, moins cette part est élevée. Notre schéma tactique repose sur une organisation quaternaire : quatre sections par unité et une « sécabilité », c'est-à-dire une possibilité de diviser, à la demi-compagnie. Cette « sécabilité » maximum garantit l’efficacité de nos tactiques d’emploi sur le terrain mais aussi la sécurité des fonctionnaires.
Malheureusement, certaines unités sont désormais employées dans une formation à trois sections, sans possibilité de division, par manque de personnels. Dans ces conditions, les maintiens de l’ordre deviennent plus compliqués à réaliser et les moyens de force sont engagés plus rapidement. Ce n’est pas une tendance, mais une conséquence : quand on a moins de monde sur les rangs, on peut tenir moins longtemps le barrage et on est obligé d’engager des moyens de force un peu plus rapidement. C’est d’autant plus vrai lors de maintiens de l’ordre plutôt musclés, comme ceux que nous avons vécus ces derniers temps.
M. David Michaux, délégué national d’UNSA Police, chargé des CRS. À l’UNSA Police, nous alertons sur un sérieux problème d’effectif puisque les compagnies fonctionnent avec 133 personnes en moyenne – 136 personnes pour les compagnies parisiennes. Or nous devons appliquer le principe des trois cinquièmes et tenir compte des repos. Avec ces effectifs réduits, nous devons faire face à des débordements qui surviennent non plus en fin de manifestation comme par le passé, mais de plus en plus tôt, parfois même avant que la manifestation ait commencé. Nous devons réagir vite et nous adapter à ce genre d’événement, mais sans un renfort rapide, nous aurons de grosses difficultés à tenir.
M. Denis Hurth, délégué régional de l’UNSA Police, chargé de la formation. Pour compléter les interventions de mes collègues, je signale que lorsqu’une compagnie est en sous-effectif, on va chercher du renfort dans une autre. Ce n’est pas anodin parce qu’il faut très bien se connaître pour affronter ensemble certaines situations.
Chacun a des périodes de formation dans sa compagnie et avec son commandement, mais les procédures tactiques sont identiques au niveau national. Depuis deux ans, ces procédures tactiques ont changé. La nouvelle doctrine d’emploi spécifie que nous devons fixer, déborder, neutraliser et avancer sur coup de feu. Il faut être bien formé pour réaliser ces opérations correctement. Mais pour avancer sur coup de feu, c’est important aussi d’intervenir au sein de d’une compagnie organique, avec ses collègues habituels.
Pour ça, comme l’ont dit tous mes collègues, chaque compagnie doit avoir des effectifs suffisants et ne pas être obligée d’aller chercher du renfort ailleurs. C’est comme une patrouille de commissariat : trois collègues ont l’habitude de travailler ensemble et tout se passe bien ; l’un d’eux est remplacé par une pièce rapportée et tout se complique. Dans une CRS, le policier doit maîtriser les règles tactiques mais il doit aussi avoir l’habitude de travailler avec le groupe.
M. le président Noël Mamère. Avez-vous des propositions à formuler pour améliorer la formation ?
M. Denis Hurth. Actuellement, la formation est faite dès le retour d’un déplacement car nous en sommes à quarante-huit ou quarante-neuf unités par jour. Chaque unité doit réaliser trois périodes de formation ou de recyclage. Pour tout ce qui concerne la validation et l’habilitation aux armes intermédiaires, les formations sont individuelles et le policier ne peut pas y déroger : pour se servir d’une arme, il doit être formé à son maniement. Certaines validations sont annuelles, d’autres biennales.
Comme les compagnies tournent énormément sur le territoire national, elles n’ont quasiment plus le temps de faire leurs périodes de recyclage. À une époque, ces périodes de formation étaient vraiment neutralisées ; maintenant, il arrive de plus en plus souvent qu’une compagnie soit rappelée pour un maintien de l’ordre deux jours avant, voire la veille de la session prévue. Il faut alors déplacer la formation. Une formation correcte suppose un programme correct : les formateurs et les officiers doivent pouvoir se réunir pour réaliser toutes les procédures tactiques des périodes de recyclage et de formation.
M. le président Noël Mamère. Considérez-vous que votre équipement est suffisant ? Nous avons entendu les uns et les autres, des représentants des forces de l’ordre et des manifestants dont certains ont été victimes de tirs de Flash-Ball, par exemple. Il est intéressant d’avoir votre point de vue.
M. Grégory Joron. Notre équipement évolue en fonction des problèmes rencontrés sur le terrain : nous avons eu des jambières suite aux manifestations de marins-pêcheurs, des lunettes de protection après les événements de Villiers-le-Bel. La maison essaie d’adapter ses équipements aux nouvelles violences que doivent affronter ses fonctionnaires sur le terrain.
L’équipement individuel du CRS est évalué en fonction de trois critères : mobilité, protection et puissance de feu. On ne peut en renforcer un qu’au détriment des autres. Équipé d’un gilet de protection de vingt-cinq kilos, vous perdez forcément en mobilité. Il s’agit donc de trouver un équilibre pour que le policier soit protégé et capable de tenir face à certaines violences, tout en restant mobile.
En ce qui concerne la qualité des matériaux, c’est le gilet tactique qui pose problème. Nous attendons un nouveau modèle, qui sera disponible en trois tailles, ce qui réglera peut-être les soucis. Pour le reste, les CRS sont équipés de manière à pouvoir faire face aux risques.
M. Éric Mildenberger. En ce qui concerne les équipements individuels, on pourrait améliorer la protection des coudes et des avant-bras. Mais dans le contexte de baisse des effectifs que nous venons de décrire, il me semble intéressant de parler surtout des moyens spécifiques qui sont mis à la disposition des compagnies : engins lanceurs d’eau, couramment appelés canons à eau, barre-ponts, etc. Lors d’opérations de maintien de l’ordre très dures, comme à Nantes le 22 février 2014 ou à Quimper où manifestaient les bonnets rouges, les engins lanceurs d’eau ont été d’une utilité absolue en termes de protection de l’intégrité physique des collègues. Ces engins permettent de pallier la baisse des effectifs, de se substituer aux hommes.
Soulignons une spécificité territoriale : on n’utilise pas les canons à eau en Île-de-France et dans Paris intra-muros parce que cela pose des problèmes à l’autorité supérieure. Pourtant, je peux vous assurer que c’est un moyen absolument efficace dans la manœuvre des forces mobiles des CRS. Nous sommes d’ailleurs les seuls à en détenir puisque, à ma connaissance, les gendarmes mobiles n’ont pas de tels moyens à déployer sur le terrain.
Il faudrait largement développer ces équipements. Si mes informations sont bonnes, la direction centrale a tenté de récupérer des canons à eau chez nos collègues allemands qui renouvellent leur parc – c’est dans leur culture d’utiliser ces engins – mais l’affaire a échoué. Nous avons deux Camiva, des lanceurs d’eau récents et adaptés. Les autres, récupérés auprès de la sécurité civile à l’époque du préfet Weigel, ne sont plus très opérationnels : les cuves fuient, etc. En tout cas, en période de réduction d’effectifs et d’opérations de maintien de l’ordre de plus en plus sensibles, il nous paraît important de développer ces moyens d’intervention.
M. Paul Le Guennic. Effectivement l’évolution des moyens de protection va de pair avec celle des missions et des tactiques de maintien de l’ordre. En ce qui concerne les lanceurs d’eau, le problème est que, bien souvent, les préfets rechignent à demander des moyens alors que c’est dans l’intérêt des personnels et des manifestants. Même si les engins peuvent faire peur, ils sont moins violents qu’un affrontement entre les manifestants et les forces mobiles. Il faut que les politiques le prennent en compte et que les choses évoluent.
M. Grégory Joron. Une nouvelle note sur l’emploi de la force en maintien de l’ordre public a été rédigée par la direction centrale des CRS en novembre 2012, qui intégrait précisément ces engins, que nous sommes les seuls à avoir développés, comme moyens intermédiaires à la force. C’est dommage que les préfets rechignent, pour des questions d’image, à demander l’intervention de ces sections spécialisées. Attention : le théâtre d’opération doit s’y prêter car ces engins ne sont pas très mobiles. Mais il faudrait sensibiliser les préfets à l’utilisation de ces moyens dans le cadre des manifestations importantes et de gros dispositifs. Ils sont efficaces : ils permettent d’éviter l’affrontement et des blessés de part et d’autre, tout en soulageant les fonctionnaires.
M. David Michaux. Concernant le matériel, nous avons deux gros soucis. Après les événements du début de l’année, les collèges sont obligés de porter le gilet pare-balles lourd, plus l’armement et moyen de défense (AMD) en bandoulière. Avec ce gilet qui bloque le mouvement, il est très difficile d’épauler pour tirer. Il faudrait vraiment un gilet pare-balles lourd plus adapté. À moins que l’arme dont on va nous doter pour remplacer l’AMD ne soit compatible avec le gilet pare-balles lourd.
Deuxième problème : l’habilitation pour le bâton télescopique de défense (BTD), le tonfa et la matraque télescopique. Cette habilitation est valable deux ans mais les collègues ont du mal à repasser les tests de validation dans les délais, faute de disponibilité. Si le collègue ne parvient pas à dégager une journée pour ces tests, il perd son habilitation et il devra trouver quatre jours pour repasser l’intégralité des épreuves. Nous avons adressé un courrier au ministre de l’Intérieur pour demander la prolongation des habilitations jusqu’en septembre, afin que les collègues puissent effectuer leur recyclage dans le cadre des prochaines formations. Je vous signale aussi que nous sommes formés et habilités à l’utilisation de la matraque télescopique mais que nous ne sommes pas dotés du matériel, à l’exception des motards, des autoroutiers et des sections de protection et d’intervention 4 G.
M. Gwenegan Bui. Vous avez évoqué des insuffisances dans la formation, notamment en matière d’avance sur coups de feu. Ce n’est pas le point de vue de votre encadrement, qui a vanté la qualité de la formation reçue par les CRS. J’ai entendu dire par ailleurs que certaines de ces formations s’effectuaient dans des friches industrielles. Ne serait-il pas souhaitable, puisque nous disposons pour cela du centre de Saint-Astier, que le site soit mutualisé et affecté par période, soit à la formation des gendarmes soit à celles des CRS ?
Vous avez également évoqué la nécessité pour les CRS de s’adapter aux nouvelles formes de manifestation, plus dynamiques, et la difficulté à concilier protection et mobilité. Nous avons compris que la réduction des effectifs pouvait compliquer l’interpellation des manifestants. Pensez-vous qu’il faille, dans ces conditions, créer au sein de vos compagnies des escadrons spécialement affectés à ces interpellations ? Doivent-elles être confiées à des unités spécifiques ?
Enfin, qu’en est-il des manifestations immobiles ? Les zadistes en effet ne bougent pas, et vous n’êtes pas forcément formés pour assurer le maintien de l’ordre sur des durées pouvant atteindre plusieurs semaines. Se pose donc la question de votre emploi dans ces circonstances ; elle se pose non seulement en termes d’organisation de votre travail mais également en termes de coût pour les finances publiques.
M. Guy Delcourt. J’aimerais votre sentiment sur l’état psychologique des femmes et des hommes qui composent vos unités. Ayant été maire de Lens, ville dont on connaît l’engagement pour le football, j’ai eu à maintes reprises l’occasion de rencontrer des policiers, chez qui j’ai perçu de la lassitude et qui m’ont fait part, pour certains, des problèmes générationnels qu’avaient posés les conditions de recrutement ces dix dernières années. En d’autres termes, le recrutement et la formation ont, à une certaine période, largement fait écho aux propos d’un ancien président de la République selon qui un policier, ce n’était pas fait pour jouer au football avec les jeunes des cités. Cela a pu heurter les plus anciens qui participaient à la vie de la cité et savaient assurer par tradition la tranquillité des grands ensembles, notamment grâce aux commissariats de proximité mis en place par Daniel Vaillant lorsqu’il était ministre de l’Intérieur. Pour ma part, je n’ai jamais vu de policier en service jouer au football avec des délinquants ; j’ai vu en revanche fonctionner ce que je nomme le renseignement citoyen systématique.
M. Denis Hurth. La formation est en effet le nerf de la guerre, et c’est encore plus vrai depuis la note du 8 novembre 2012, qui fixe une nouvelle doctrine d’emploi, laquelle n’est pas sans poser problème, notamment en ce qui concerne les nouveaux équipements. Nous avons, par exemple, été dotés de visières pare-balles, mais nous avons dû constater, lors des sessions de formation, que ces visières n’étaient pas du tout pratiques : il fallait en effet les ajuster sur les casques traditionnels, se rendre pour cela dans un box, ôter l’ancienne visière et visser la nouvelle. Au-delà de la perte de temps que représentait une telle manipulation, bien souvent elle était inutile car les vis ne tenaient pas. Avertie du problème, la Direction centrale a pris la décision de fournir des casques déjà équipés de visières pare-balles, mais porter un casque sans contrepoids équipé d’une visière de 1,8 kilo provoque rapidement des douleurs cervicales. Il faut donc s’adapter au nouveau matériel, ce qui n’est pas toujours évident. Je prendrai ici un autre exemple, celui de l’AMD – armement et moyen de défense. Les mallettes pédagogiques que nous distribue la Direction des ressources et des compétences de la police nationale (DRCPN) contiennent les procédures permettant d’habiliter un fonctionnaire au port de l’AMD, qui est un fusil d’épaule. Le fonctionnaire doit d’abord tirer cinq cartouches permettant d’évaluer s’il atteint sa cible, puis il procède à un tir couché, à un tir à genoux et à un tir derrière abri. À l’issue de ces tirs, il a vidé son arme et il lui faut donc procéder à une transition d’arme, laquelle est impossible car la sangle de l’AMD est trop courte pour les nouveaux gilets pare-balles et empêche d’épauler.
Enfin, les formations sont également affectées par la baisse des effectifs : lorsqu’une compagnie manque de formateurs, elle va en chercher dans les compagnies voisines. Mais, comme au football, il est difficile pour un entraîneur de travailler avec une équipe qu’il ne connaît pas. Il est donc indispensable de former davantage de formateurs aux techniques de sécurité en intervention, ce que n’accepte pas toujours la Direction centrale, souvent réticente à envoyer les fonctionnaires en formation. Il reste donc beaucoup à faire pour que la formation soit réellement adaptée aux besoins du terrain.
M. Grégory Joron. Il serait très compliqué de rassembler l’ensemble des formations sur un site unique, en lieu et place de friches industrielles, d’abord parce que l’opérationnel prime toujours sur la formation et que les périodes de formation peuvent être décalées dans le temps – elles avaient été interrompues avec la hausse du plan Vigipirate et on a repris il y a un mois . Par ailleurs, le choix d’un site unique impliquerait pour les compagnies de devoir s’y rendre, ce qui signifierait des trajets supplémentaires. Ce n’est souhaitable ni en termes de coûts ni en termes de temps.
M. Paul Le Guennic. La formation continue est un vieux serpent de mer, pas uniquement pour les CRS mais pour la police en général, et il en sera ainsi tant que les chefs de service considéreront que des fonctionnaires en formation sont autant d’hommes perdus sur le terrain.
Quant aux allusions de M. Delcourt aux propos d’un ancien Président de la République qui visaient, me semble-t-il, un directeur départemental de la sécurité publique du sud-ouest, il est vrai que, du fait du manque d’effectifs, la suppression des centres de loisirs de la jeunesse animés par des policiers a contribué à la fracture entre la police et la population. J’ai moi-même connu l’époque où les CRS du Mans organisaient des matchs de football avec les détenus. Ces matchs se déroulaient certes pendant le service, mais ils contribuaient à créer du lien. De là à détacher des policiers pour qu’ils se consacrent à ces activités exclusives, comme semble le suggérer M. le député, cela me semble une idée un peu démagogique, a fortiori en présence de M. Daniel Vaillant.
M. Éric Mildenberger. En ce qui concerne nos interventions sur les ZAD, nous sommes mis à la disposition des préfets, et il ne nous appartient pas de nous prononcer au fond sur la pertinence de ces missions de long terme.
L’une des grandes difficultés à laquelle nous sommes confrontés aujourd’hui, c’est que les compagnies républicaines de sécurité sont devenues un réservoir d’effectifs pour la police nationale dans l’accomplissement de ses missions de sécurité publique. Notre syndicat réclame depuis des années que soient clairement redéfinies les missions des uns et des autres et que chacun se recentre sur son cœur de métier afin que les forces mobiles des compagnies républicaines de sécurité puissent réellement être affectées au maintien de l’ordre. Cette multiplication des emplois – je pense entre autres à l’augmentation du nombre des gardes statiques – n’est d’ailleurs pas sans répercussion sur la qualité de la formation qui, à force de devoir se diversifier, est parfois un peu bâclée.
Nous plaidons – ce qui n’est pas forcément l’avis des autres organisations – pour que les CRS redeviennent des forces très spécialisées, dotées de SMS – sections de moyens spécialisés – et intervenant là où des désordres doivent être prévenus ou endigués. À force d’être employés à des missions de sécurité publique, les CRS ont vu leur image se modifier. La peur du CRS, exprimée en 1968 à travers des slogans comme « CRS = SS », n’existe plus aujourd’hui, et notre présence sur le terrain n’a plus le même impact. Idéalement, une fois l’ordre rétabli, nos compagnies devraient pouvoir se désengager des terrains qui ont été pacifiés, mais chacun sait que le manque d’effectif empêche les forces de sécurité publique d’assurer ces missions sans notre renfort. D’où notre emploi à Notre-Dame-des-Landes, sans parler du barrage de Sivens qui dépendait de la zone d’intervention des gendarmes et où, par définition, les CRS ne sont pas censés intervenir.
La question des interpellations est à rapprocher de celle, plus générale, de la coordination sur un même théâtre d’opérations, entre unités spécialisées dans le maintien de l’ordre et unités non spécialisées. La vocation des CRS n’est pas aujourd’hui de procéder à des interpellations même si nous en avons les moyens lorsqu’il s’agit de neutraliser des meneurs. Lors des événements de Nantes, en février 2014, sont intervenues ensemble les CRS, les CDI – compagnies départementales d’intervention –, la BAC – brigade anti-criminalité – et les gendarmes mobiles, ce qui a engendré des problèmes de coordination dans les manœuvres et nous a mis en difficulté. Je persiste donc à penser que le maintien de l’ordre doit être prioritairement confié, en particulier dans des opérations de grande envergure et face à des manifestations qui peuvent dégénérer, aux unités mobiles spécialisées, CRS et gendarmes. En tout état de cause, pour que les missions d’interpellation soient confiées aux CRS, il faudrait que leurs forces sur le terrain soient plus nombreuses, ce qui n’est actuellement pas possible puisque nous sommes largement affectés à d’autres missions dans les zones de sécurité prioritaires (ZSP), en renfort à la police aux frontières (PAF) ou dans le cadre du plan Vigipirate.
M. Grégory Joron. On peut regretter de ne pas faire assez de maintien de l’ordre mais je ne partage pas tout à fait le point de vue d’Éric Mildenberger. Je m’appuie pour cela sur des chiffres, selon lesquels le maintien de l’ordre effectué par les CRS représente aujourd’hui 35 % de leurs missions, contre à peine 27 % en 2011.
Il est certain en revanche que le désengagement des gendarmes pèse sur nos effectifs et qu’une partie de nos forces effectuent des missions de sécurisation, de renfort ou des gardes statiques qui ne sont pas du maintien de l’ordre. Cela étant, au nom du principe de réversibilité missionnelle, nous pouvons toujours nous désengager de notre mission initiale pour être mis à la disposition de l’autorité d’emploi afin d’effectuer du maintien de l’ordre. La décision en revient à l’Unité de coordination des forces mobiles, et cela se produit tous les jours.
Quant aux interpellations, ce n’est à l’origine clairement pas la tâche des CRS, qui ont pour mission première la gestion démocratique des foules. Nous en avons néanmoins les moyens, notamment grâce au développement, depuis 1995, des SPI, sections de protection et d’intervention, créées à l’origine pour permettre la neutralisation des petits groupes de casseurs. On peut ensuite s’interroger sur les bénéfices politiques qu’espèrent engranger les pouvoirs politiques lorsqu’ils annoncent un grand nombre d’interpellations après une manifestation qui a mal tourné. Quoi qu’il en soit, ce sont des choix qui peuvent gravement déséquilibrer nos dispositifs sur le terrain.
Nous souhaitons donc que soit réellement appliquée la doctrine commune d’emploi des forces mobiles validée en 2009, qui préconise d’associer un représentant des forces mobiles à l’élaboration des dispositifs tactiques. Bien souvent, malheureusement, la préfecture se contente de briefer rapidement, une heure avant la manifestation, les forces qu’elle engage, alors qu’en les consultant en amont elle améliorerait l’efficacité de nos missions, notamment par une meilleure coordination des forces engagées.
M. le rapporteur. Si nous vous avons interrogés sur les ZAD et les opérations de longue durée, c’est qu’elles ont nécessairement une incidence sur vos conditions de travail et vos conditions de vie, même si j’ai compris que vous procédiez à des rotations régulières.
Vous nous avez éclairés sur la question des lanceurs d’eau, que nous avions jusqu’alors peu abordée, mais nous n’avons pas évoqué le problème des lanceurs de balle de défense ou LBD. Les compagnies républicaines de sécurité en sont-elles dotées ?
M. Grégory Joron. Nous disposons de lanceurs de balle de défense de 40 millimètres mais pas de flash-balls.
M. le rapporteur. Si nous nous y intéressons, c’est que, lorsqu’il y a des blessés graves dans une manifestation, c’est souvent lié à l’usage de cette arme. Par ailleurs, je m’interroge sur son usage, dans la mesure où il s’agit d’une arme à visée individuelle alors que la doctrine française du maintien de l’ordre repose sur la mise à distance et le traitement global de la foule, ce qui n’exclut évidemment pas de faire le nécessaire pour neutraliser les individus qui commettent des voies de fait aux abords des manifestations. Quel usage faites-vous donc du LBD, dans quelles circonstances, et vos unités – spécialisées ou non – sont-elles correctement formées à son emploi ?
M. Denis Hurth. La formation, je le répète, est le nerf de la guerre, et chaque tireur bénéficie d’une formation initiale de six heures, sachant qu’une compagnie doit comporter 48 tireurs. Lors de cette formation initiale, le lanceur tirera cinq grenades ; au cours des périodes de recyclage qui ont lieu chaque année, il lancera ensuite trois grenades. La procédure d’emploi est claire : on ne lance pas de sa propre initiative mais uniquement sur ordre du commandant de compagnie, sauf dans le cas d’intervention en groupe, c’est-à-dire à cinq ou six fonctionnaires, cas dans lequel l’usage du LBD est autorisé en riposte à une menace. Pour moi, les lanceurs de balle ne constituent donc pas un danger. Il s’agit d’une arme de défense qui n’est utilisée qu’en dernier recours.
M. le rapporteur. J’entends ce que vous dites sur la doctrine d’emploi, mais il semble que, dans certains cas, cela ne se passe pas comme ça. S’agit-il, selon vous, de situations où cette doctrine d’emploi n’a pas été respectée ?
M. le président Noël Mamère. Nous avons auditionné des victimes énucléées par des tirs de LBD. Selon elles, ces accidents ne se sont pas produits dans les conditions que vous nous avez exposées.
M. le rapporteur. Nous souhaitons votre point de vue d’utilisateur sur les procédures d’emploi. Sont-elles assez sécurisées ? Les accidents sont-ils liés à une utilisation de ces armes hors de leur cadre d’emploi ? Ne perdons pas de vue le facteur humain.
M. Denis Hurth. Je tiens à être clair, les CRS n’usent des LBD que sur ordre, et un commandant de compagnie n’ordonne le lancement d’une grenade que lorsqu’il ne peut pas faire autrement pour repousser la foule, et quand les bonds offensifs lancés au préalable n’ont pas fonctionné.
La procédure interdit également de lancer en tir tendu, ce qui est enseigné lors des formations. Seuls les fonctionnaires ayant validé ces formations sont habilités à se servir des armes sur le terrain, ce que consignent les fiches de perception.
M. Grégory Joron. Il faut distinguer les cas d’emploi de la force armée avec sommation et sans sommation. Les seuls cas où un collègue peut employer son LBD40 sans sommation, c’est lorsque lui et ses collègues sont victimes de voies de fait ou lorsqu’il ne peut plus défendre sa position. Hors de ces cas, les tirs de LBD ne s’effectuent que selon des règles très précises qui reposent sur le principe de gradation de la force et qui imposent l’emploi d’autres moyens avant l’engagement d’un LBD40.
Les LBD sont des armes à létalité réduite – et non des armes non-létales – qui provoquent parfois, malheureusement, de graves blessures. Pour autant, leur usage par les CRS est mesuré et suffisamment encadré, ainsi que cela ressort du rapport rendu par l’Inspection générale de la gendarmerie nationale (IGGN) et l’Inspection générale de la police nationale (IGPN) après la malheureuse affaire de Sivens.
Quant à l’utilité du LBD, c’est une arme de force intermédiaire utilisée dans le cadre de la doctrine française du maintien de l’ordre pour éviter le contact avec les manifestants et garantir ainsi au mieux leur sécurité comme celles des fonctionnaires engagés. Il arrive que des manifestations dégénèrent rapidement, du fait d’une minorité de délinquants, comme ce fut le cas des manifestations propalestiniennes de juillet dernier, obligeant les forces de l’ordre à engager des tirs de LBD40, notamment parce qu’elles étaient à court de grenades lacrymogènes.
M. Éric Mildenberger. Je suis d’accord avec ce qui vient d’être dit. Le LBD40 a toute son utilité, sachant qu’il n’est employé que dans une perspective de gradation de la force. D’ailleurs, il est, à ma connaissance, très peu utilisé.
M. le président Noël Mamère. Comment, dans ce cas, expliquez-vous les accidents provoqués par l’emploi de cette arme qualifiée par euphémisme d’arme à létalité réduite ? Nous nous interrogeons, et j’avais moi-même déposé une proposition de loi visant à interdire l’utilisation des tasers et des flash-balls.
M. le rapporteur. Ces accidents ne sont pas forcément le fait de CRS.
M. Éric Mildenberger. Je ne sais exactement à quels accidents vous faites référence, mais j’insiste sur le fait que les missions des CRS se déroulent dans des cadres stricts et selon des procédures très hiérarchisées. Les compagnies républicaines de sécurité n’utilisent pas le LBD40 pour se faire plaisir mais dans des situations de violence extrême, comme en 2007 à Villiers-le-Bel, où les forces de l’ordre se sont fait tirer dessus. À l’époque, nous n’étions pas dotés du LBD40, qui nous aurait pourtant permis de neutraliser nos agresseurs.
M. le rapporteur. Je constate en tout cas que vous êtes tous d’accord sur cette question.
M. Paul Le Guennic. L’utilisation du LBD40 s’inscrit dans un usage gradué de la force, notamment face à des manifestants violents. Vous avez auditionné des manifestants victimes de tirs de LBD mais vous auriez pu également auditionner des policiers blessés par des tirs de projectile. Il est d’ailleurs probable que sans LBD40, nous aurions à déplorer beaucoup plus de blessés que ce n’est le cas actuellement. Mais notre intention n’est pas de lancer ici un débat politique.
M. le président Noël Mamère. Ce n’est pas faire de la politique que de s’interroger sur l’armement des agents du maintien de l’ordre. C’est une question légitime et notre intention n’est pas de nous livrer ici à des comptes d’apothicaire sur le nombre de victimes de part et d’autre. Je précise d’ailleurs que les personnes que nous avons auditionnées n’ont pas été blessées par des LBD40 mais par des flash-balls. Il ressort par ailleurs de nos auditions que ces accidents se produisent souvent dans le cadre d’opérations relevant de la sécurité publique et non du maintien de l’ordre. Dans l’un et l’autre cas, la formation des fonctionnaires est différente.
M. Grégory Joron. Il faut savoir que le LBD40 a une visée laser, ce qui n’est pas le cas du flash-ball, et sans doute faut-il réfléchir à remplacer les flash-balls par des LBD40. Cela étant, nous pouvons vous fournir des chiffres sur le nombre de balles de défense lancées par les CRS ces quatre dernières années : vous constaterez que cela reste très marginal par rapport aux autres moyens engagés.
M. Denis Hurth. Chaque mission s’accompagne d’un télégramme d’instructions très précises. Lors de la formation au LBD, les fonctionnaires sont dûment avertis que lorsqu’ils interviennent en unités constituées ils perdent momentanément leur qualification d’agent de police judiciaire : ils ne peuvent donc en aucun cas se servir de leur arme sans un ordre de l’autorité, qu’il s’agisse du commandant ou de l’autorité civile.
M. Grégory Joron. Je voudrais revenir en conclusion sur l’état psychologique des CRS. Les conditions d’emploi sont tendues et la fatigue qui en découle est aggravée par le manque de visibilité sur le calendrier des missions. Certaines missions permanentes sont prévues un an à l’avance, d’autres au début de chaque trimestre, mais s’y ajoutent des missions ponctuelles dictées par les besoins du moment et dont la gestion s’opère au niveau ministériel depuis les événements du 7 janvier.
Par ailleurs, le volume d’unités engagées s’établit depuis janvier en moyenne à 45 unités par jour contre 41 ou 42 auparavant, sans parler des renforts d’effectifs, d’unité à unité qui viennent encore gonfler ces chiffres. Les fonctionnaires ne disposent plus que d’une visibilité à trois ou quatre jours, et il peut leur arriver, alors qu’ils avaient prévu un week-end en famille, d’être rappelés le vendredi soir, pour faire un aller-retour à Paris avant de repartir pour une mission de trois semaines le mardi suivant.
Nous déplorons cette situation et, sans naturellement remettre en cause notre participation au plan Vigipirate, qui est une nécessité, nous souhaitons certains aménagements, notamment dans les zones concernées par le plan écarlate. Les CRS sont largement affectés à la surveillance des sièges de médias ou des lieux cultuels. Dix mille militaires ont été appelés en renfort, et le ministère de la défense a réfléchi à alléger les gardes statiques pour privilégier les patrouilles portées. Cette évolution ne semble malheureusement pas à l’ordre du jour pour les policiers qui, outre le manque de visibilité, assument donc des missions extrêmement fatigantes, en particulier lorsqu’il s’agit de gardes statiques, avec port du gilet lourd, s’étendant sur trois semaines. Il me semble donc qu’avant de s’intéresser à la goutte d’eau qui fait déborder le vase, il serait prudent de s’intéresser à toutes celles qui le remplissent.
M. David Michaux. Un mot pour finir sur le recrutement. Nous avons un gros problème, car les élèves qui sortent des écoles de police ne souhaitent plus s’engager dans les CRS. Du fait des contraintes qui lui sont liées, le métier de CRS n’attire plus. Nous nous en sommes ouverts à la Direction centrale des compagnies républicaines de sécurité (DCCRS) le 19 février 2015 et avons demandé qu’une campagne d’information soit lancée dans les écoles. La DRCPN a été saisie de la question pour éviter que seuls les derniers des promotions intègrent nos compagnies. Nous avons besoin de volontaires.
M. le président Noël Mamère. Messieurs, nous vous remercions pour vos interventions.
*
* *
Audition de M. Jérôme LÉONNET, inspecteur général des services actifs, directeur central adjoint chargé du renseignement, chef du service central du renseignement territorial
Compte rendu de l’audition du jeudi 2 avril 2015
M. le président Noël Mamère. Monsieur Léonnet, soyez le bienvenu. À votre demande, vous êtes entendu à huis clos.
En vertu de l’article 6 de l’ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, les personnes auditionnées sont tenues de déposer sous serment. Je vous demande de jurer de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Veuillez lever la main droite et de dire : « Je le jure ».
(M. Léonnet prête serment.)
M. Jérôme Léonnet, inspecteur général des services actifs, directeur central adjoint chargé du renseignement, chef du service central du renseignement territorial. Le service central du renseignement territorial (SCRT) est récent. Il a été créé en mai 2014, pour prendre le relais de la sous-direction de l’information générale (SDIG) créée en 2008, elle-même héritière de la direction centrale des renseignements généraux (DCRG).
La réforme de 2008 a donc supprimé la DCRG et renforcé la direction de la surveillance du territoire (DST). Schématiquement, la lutte contre le terrorisme et le préterrorisme a été confiée à la direction centrale du renseignement intérieur (DCRI), et le domaine classique des renseignements généraux, dont relèvent les événements qui vous intéressent, à la SDIG, en sous-capacité par rapport à la situation antérieure. Alors que la DCRG employait, en 2008, 3 200 fonctionnaires, la SDIG, créée cette année-là, en comptait 1 400.
Notre mandat est défini par le décret du 12 août 2013 : « Dans le cadre de sa mission de renseignement, la direction centrale de la sécurité publique est chargée, sur l’ensemble du territoire national à l’exception de Paris et des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, de la recherche, de la centralisation et de l’analyse des renseignements destinés à informer le Gouvernement et les représentants de l’État dans les collectivités territoriales de la République dans les domaines institutionnel, économique et social ainsi que dans tous les domaines susceptibles d’intéresser l’ordre public, notamment les phénomènes de violence. »
Aux termes de ce décret, je ne suis compétent ni sur Paris ni sur les trois départements de la petite couronne, qui relèvent de la direction du renseignement de la préfecture de police (DRPP). Celle-ci a conservé la compétence en matière de prévention et de lutte contre le terrorisme. Une seconde singularité veut que le SCRT soit hébergé par la direction centrale de la sécurité publique (DCSP).
Si cette situation a suscité des commentaires et créé de l’amertume, elle me semble intéressante tant pour le renseignement territorial (RT) que pour la sécurité publique. On a longtemps reproché aux renseignements généraux de faire cavalier seul, et de parler à l’oreille du préfet et du Gouvernement, sans délivrer toutes les informations dont ils disposaient à l’autorité préfectorale, sur le plan local, ou aux autres directions actives en matière d’ordre public. Aujourd’hui, la question ne se pose plus. En tant que directeur central adjoint chargé du renseignement, je passe mes journées, comme tous les chefs des services départementaux de renseignement territorial (SDRT), à informer en premier lieu l’autorité chargée de la sécurité publique, qu’il s’agisse de l’autorité de police – c’est-à-dire du directeur départemental de la sécurité publique ou, à Paris, du directeur central de la sécurité publique –, ou de la gendarmerie nationale, quand elle exerce sur ces domaines de compétence.
Le renseignement territorial a une compétence globale sur le renseignement du territoire et du département. Les mouvements sociaux sont de son ressort, ainsi que tout ce qui relève de l’ordre public, y compris les phénomènes de violence. La responsabilité qui nous incombe est lourde. Elle nous impose un travail d’anticipation, de suivi, d’analyse, de compte rendu sur l’ensemble des mouvements sociaux, qu’ils soient classiques ou atypiques, comme le sont ceux qui ne sont pas prévus, et qui ne font l’objet d’aucune déclaration. Nous informons le gestionnaire de la sécurité publique des risques ou de l’absence de risque.
Notre travail commence par une anticipation et débouche sur une analyse. Notre présence sur le terrain, à des fins de sécurité publique, nous amène à collecter des références. Au fil des années ou des mois, nous savons où en est tel mouvement, quelles sont ses perspectives et l’état d’esprit de ceux qui le composent. Ancien chef d’état-major aux renseignements généraux parisiens, j’ai acquis la conviction que le renseignement que nous apportons aux gestionnaires de la sécurité publique est une garantie essentielle de la liberté de s’exprimer et de manifester sur la voie publique.
Notre déontologie nous conduit à apporter une information aussi précise que possible, souvent de nature apaisante. Certains mouvements ne méritent pas la mise en place d’un dispositif important, alors que d’autres, dont les représentants pensent qu’ils vont donner lieu à une manifestation traditionnelle, peuvent dégénérer, sous l’influence d’éléments non attendus. Notre mission est d’établir une gamme d’alertes.
Pour accumuler des références sur la manière dont se déroulent les initiatives sur la voie publique, le renseignement territorial est ouvert à tout contact. Quand un mouvement se crée, nous allons au-devant des organisateurs, pour discuter avec eux, afin de prendre leur pouls. Quand ils refusent le contact, nous cherchons des informations par d’autres sources. C’est ainsi que nous évaluons les mouvements qui peuvent un jour ou l’autre aboutir à un trouble à l’ordre public, voire à des violences.
In fine, notre travail se concrétise par des notes, tant dans les départements qu’à l’échelon central. Le renseignement territorial est également présent, en temps réel, sur la voie publique, tandis que le service central se concentre sur l’analyse et la synthèse. Sur un effectif total de 2 200 personnes, 2 000 sont sur le terrain, observent les mouvements sur la voie publique, en rendent compte et informent le gestionnaire de l’ordre public. Sitôt la manifestation terminée, nous établissons un compte rendu, une analyse ainsi qu’une prospective.
Le travail sur la voie publique ne va pas de soi. Le renseignement territorial s’efforce d’observer, mais il lui arrive aussi d’être pris à partie. C’est ce qui est arrivé à deux personnes de notre effectif, à Lyon, alors qu’elles étaient en marge d’un cortège. Cela fait partie des risques du métier. Notre effectif, quoiqu’il n’appartienne pas au dispositif d’ordre et de sécurité, est composé de policiers et de gendarmes.
M. Pascal Popelin, rapporteur. Vous avez si bien planté le décor de votre activité que vous avez répondu par avance à certaines questions que je voulais vous poser.
De quelle manière le renseignement territorial s’est-il adapté aux moyens modernes de communication ? Au-delà des mots d’ordre traditionnels des organisations syndicales, les mobilisations s’effectuent désormais via Internet et les réseaux sociaux, pour déboucher sur l’occupation de lieux, notamment de zones à défendre (ZAD).
Le renseignement territorial contribue-t-il à la judiciarisation du maintien de l’ordre, en permettant le suivi et l’identification de certaines personnes ?
Le SCRT a-t-il été associé à la mission du préfet Lambert, visant à sensibiliser l’autorité civile, notamment les préfets et sous-préfets, au maintien de l’ordre ?
M. Jérôme Léonnet. L’adaptation aux moyens modernes est la marque de fabrique de nos services. Si certaines méthodes continuent d’exister – notamment le contact irremplaçable avec les représentants de la société civile –, nous avons évolué. Le SCRT comprend sept divisions dont une, dite transversale, s’occupe de la veille sur Internet. Je précise, pour dissiper toute ambiguïté, que nous travaillons selon les méthodes du milieu ouvert. Je ne dispose pas des moyens particuliers qui seront offerts prochainement aux services de renseignement du premier cercle.
Le SCRT part du principe qu’Internet et les réseaux sociaux peuvent l’informer. Beaucoup de mots d’ordre, nés dans le clandestin, sont ouverts, ce qui semble logique puisque leurs auteurs veulent toucher le plus grand nombre de personnes. Il n’y a aucune raison que le renseignement territorial n’y ait pas accès. Dans le même esprit, mutatis mutandis, j’ai été jadis un lecteur assidu de L’Humanité, dont les dernières pages signalaient des rassemblements qui n’étaient annoncés nulle part ailleurs.
M. le rapporteur. Maintenant, vous lisez aussi le Figaro magazine.
M. Jérôme Léonnet. Nous sommes très œcuméniques.
Je le répète : la division dédiée à la veille sur Internet et les réseaux sociaux utilise les moyens du milieu ouvert. Les logiciels dont se servent les entreprises permettent d’identifier, par des mots-clés ou des scénarios, des mots d’ordre ou des réactions. Par ce biais, nous glanons beaucoup d’informations sur les ZAD.
Quand certains militants, plus impliqués, sont soucieux de confidentialité, nous employons d’autres moyens, comme le recrutement de sources. Nous avons des contacts même dans le monde de la contestation violente. À cet égard, nous partageons notre compétence avec la DGSI, qui travaille sur la prévention du terrorisme. Le mouvement Action directe, né de mouvements autonomistes, a figuré dans le spectre des renseignements généraux, avant d’évoluer vers le terrorisme.
Nous travaillons conjointement avec la DGSI en discutant avec certains militants. Tous ne sont pas en France. En Allemagne ou en Italie, certains individus tentent de se passer le mot, pour s’informer de certaines initiatives rejoignant la thématique des zones à défendre. Nous essayons par exemple d’obtenir de l’information sur les Black Blocs ou sur NO TAV.
M. le président Noël Mamère. Procédez-vous à des infiltrations ?
M. le rapporteur. L’infiltration est une méthode anglo-saxonne, à laquelle ne recourent pas les services de renseignement français, qui préfèrent recruter des sources. Nous ne demandons pas à un individu de travailler dans un mouvement, mais nous tentons d’obtenir un échange, une discussion avec un membre du mouvement ou un sympathisant. L’infiltration est un exercice périlleux, dont je ne suis pas sûr qu’il porte ses fruits. Il est plus efficace de discuter avec un militant, auquel on fait comprendre qu’il entre dans l’intérêt de son mouvement d’accepter cet échange. Nous lui expliquons aussi que l’agent des renseignements avec lequel il parlera n’est pas un membre du service d’ordre mais quelqu’un qui jouera les intermédiaires avec celui-ci. Je n’ai jamais pratiqué d’infiltration, même dans mes fonctions précédentes.
En 2014, à la naissance du SCRT, nous avons créé la Division nationale de la recherche et de l’appui, rassemblant policiers et gendarmes du renseignement territorial dont la mission est la surveillance. Son domaine de compétence comprend les dérives urbaines, l’économie souterraine et les trafics, sur lesquels nous travaillons, dans le cadre du préjudiciaire, avec nos camarades de la sécurité publique. Elle surveille aussi les mouvements de contestation violente, dans leur expression sur la voie publique.
Quand des manifestations risquent d’entraîner des mobilisations dangereuses, les agents du service de la recherche et de l’appui viennent en observation sur les cortèges, notamment pour faire des photographies qui serviront à identifier les auteurs des violences. La collecte des clichés est destinée aux services chargés des enquêtes judiciaires. Elle permet en outre de créer des références. Nous savons, par exemple que, sur telle manifestation, il y a eu trois membres des NO TAV et douze des Black Blocs, que nous cherchons à identifier, en lien avec les autres services de renseignement.
M. le président Noël Mamère. Les membres des NO TAV et des Black Blocs ne peuvent pas être mis sur le même plan.
M. Jérôme Léonnet. Non, les Black Blocs sont plus dangereux. Mais dans les deux cas, il s’agit de militants que nous connaissons mal. En outre, l’intervention en terre étrangère entraîne une plus grande violence.
Le préfet Christian Lambert est venu me voir. Je lui ai proposé de contribuer davantage à la sensibilisation des préfets et sous-préfets. Ceux-ci bénéficieront désormais d’une journée entière de formation sur le renseignement territorial, ce qui me semble indispensable. La gestion de l’ordre public est un élément fondamental de leur mission.
M. le président Noël Mamère. Notre commission d’enquête a été créée au lendemain du drame de Sivens. Quel rôle avez-vous joué sur ce théâtre d’opération ? Peut-on parler de défaillance ? Quel a été le lien entre les services de renseignement, le préfet et les gardes mobiles ?
M. Jérôme Léonnet. C’est un dossier que j’ai suivi de près, et pour cause. Le RT 81 a été associé en permanence à la gestion de l’ordre public en amont. Il était épaulé par le service central, qui, de Paris, a interrogé tous les services de RT de France. Nous savions, par le RT 44 (Loire-Atlantique, Nantes) que certains militants de Notre-Dame-des-Landes pouvaient venir épauler leurs camarades de Sivens. Nous avons travaillé en lien avec Toulouse ou Lyon. Dans son appui au gestionnaire de l’ordre public, le renseignement ne s’est pas limité au seul service du RT local. À plusieurs reprises, j’ai envoyé sur place des agents des services de la recherche et de l’appui, afin d’identifier des militants, pendant toute la période où des violences ont été perpétrées sur le terrain.
La difficulté était double. D’une part, il s’agissait d’un mouvement très récent. Le phénomène des zones à défendre a commencé avec Notre-Dame-des-Landes. Il prend de l’ampleur. Nous avons vu certains militants naître à l’action. Nous nous sommes familiarisés avec eux grâce à la veille sur Internet et les réseaux sociaux.
D’autre part, le travail sur le site de Sivens était difficile pour des raisons géographiques. Lors de manifestations particulièrement violentes, j’ai donné consigne aux gens des renseignements de se tenir en arrière, ce qui compromettait l’observation directe. Il est plus simple de suivre les événements en ville, dans un cortège, qu’en rase campagne.
Loin de considérer qu’il y a eu défaillance, je pense que notre service a anticipé les différents mouvements. À un moment donné, nous avons connu une situation de quasi-guérilla. Il ne s’agissait non d’une manifestation, car il n’y avait ni autorisation ni parcours, mais d’un combat pied à pied sur un terrain ouvert, en milieu rural.
M. le président Noël Mamère. Les gardes mobiles sont habitués à maintenir l’ordre pendant une période restreinte et dans un périmètre contenu. Dès lors que l’espace et la typologie des manifestants étaient nouveaux, ils devaient pouvoir distinguer casseurs et non-violents.
M. Jérôme Léonnet. Il est toujours difficile de les distinguer, même dans une manifestation classique. Les individus qui veulent faire dégénérer un cortège ont intérêt à se rapprocher des militants spontanés pour compliquer la manœuvre des services d’ordre.
M. le président Noël Mamère. Cette réflexion vaut pour une manifestation qui se déroule sur quelques heures, mais à Sivens, où votre travail s’est inscrit dans la durée, vous aviez le temps de distinguer les pacifistes et les éléments violents.
M. Jérôme Léonnet. Dès que le mouvement a pris la forme d’une occupation de terrain, le renseignement territorial s’est adapté. Il a mis en œuvre l’ensemble de ses sources, y compris le lien avec les autres services de renseignement, mais la topographie rendait l’observation difficile. À certains moments, nous n’avons pu que nous retirer. Les gendarmes mobiles, pas plus que nous, n’ont les moyens d’observer en permanence.
Sur place, les militants, abstraction faite de leur passé récent, nous ont donné l’impression d’être venus faire le coup de poing. Il y avait, à l’encontre de la gendarmerie mobile, des agressions caractérisées, auxquelles nous ne sommes pas habitués en milieu urbain – et pour cause : il est plus facile d’accaparer le territoire à Sivens qu’en ville.
M. Pascal Demarthe. Des voix s’élèvent pour dénoncer certains abus de pouvoir dans le renseignement, comme les écoutes illégales décidées par les plus hautes autorités. Le droit à la vie privée est essentiel. Êtes-vous conscient de la nécessité de mener votre mission avec rigueur et efficacité, sans inquiéter la majorité de citoyens ?
M. Jérôme Léonnet. Les interceptions de sécurité sont réglementées par un texte de 1991, rendu nécessaire par l’existence de pratiques illégales. Depuis lors, le travail des services de renseignement s’inscrit dans un cadre strict, clair et net.
J’ai exercé des fonctions à la surveillance du territoire et aux renseignements généraux, qui disposent de la possibilité de pratiquer des écoutes téléphoniques. Je n’ignore pas les faits auxquels vous faites allusion, il s’agit de faits passés, le SCRT agit dans un cadre strictement légal.
J’ai passé une partie de ma carrière comme inspecteur adjoint à l’inspection générale de la police nationale (IGPN), qui se caractérise par un grand respect de la déontologie. C’est également le cas de mon service, que j’ai retrouvé en septembre 2014. Il faut cependant accepter que le renseignement, par souci de l’ordre, use parfois, dans un cadre contrôlé, de moyens intrusifs. À défaut, l’éclairage que nous fournirons au gestionnaire de l’ordre public sera nécessairement limité.
M. le président Noël Mamère. Ce que vous dites suppose un contrôle a priori plus développé qu’il ne l’est aujourd’hui.
M. Jérôme Léonnet. Actuellement, les interceptions de sécurité font l’objet d’un contrôle a priori et a posteriori. L’utilisation d’autres moyens est discutée dans le cadre du projet de loi sur le renseignement, mais, pour l’heure, elle est illégale, et nous nous contentons, pour remplir notre mission, de travailler avec les outils qui nous sont octroyés.
M. le président Noël Mamère. Je vous remercie.
*
* *
Audition, ouverte à la presse, de Mme Ludivine DUTHEIL DE LA ROCHÈRE, présidente de « la manif pour tous » et de M. Albéric DUMONT, coordinateur général
(Compte rendu de l’audition du jeudi 16 avril 2015)
M. le président Noël Mamère. Merci, madame, monsieur, d’avoir répondu à notre invitation.
Conformément aux dispositions de l’article 6 de l’ordonnance du 17 novembre 1958, je vous demande de prêter le serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité.
(Mme Dutheil de la Rochère et M. Dumont prêtent successivement serment.)
M. le président Noël Mamère. Nous allons d’abord écouter votre exposé – puisque vous avez demandé à être entendus –, après quoi le rapporteur et les commissaires vous poseront leurs questions.
Mme Ludovine Dutheil de La Rochère, présidente de la « Manif pour tous ». Je rappellerai brièvement le contexte avant de laisser Albéric Dumont entrer dans le vif du sujet.
Nous avons organisé des événements de rue à partir d’un message très simple, basique, de bon sens, allais-je dire : tout enfant a besoin d’un père et d’une mère. Or, vous le constaterez au récit d’Albéric Dumont, ce message a suscité d’immenses difficultés, à tel point que, très rapidement, nous l’avons doublé d’un appel au respect des libertés fondamentales. Au printemps 2013, le Conseil de l’Europe a d’ailleurs rappelé la France à l’ordre à ce sujet.
M. Albéric Dumont, coordinateur général de la « Manif pour tous ». Les événements de la « Manif pour tous » s’inscrivent dans un contexte bien particulier : celui de manifestations de grande ampleur qui se sont toujours déroulées de manière pacifique. Puisqu’elles ont parfois été accusées d’avoir causé des dégradations, j’en rappellerai le bilan, dont nous sommes assez fiers : zéro poubelle brûlée, zéro vitrine brisée, zéro véhicule incendié, voire zéro papier gras par terre.
Pour évoquer le rôle qu’a joué la force publique dans les nombreux événements que nous avons organisés sur la voie publique en 2012, 2013 et 2014, je commencerai par aborder la phase de préparation, puis la manifestation en tant que telle et le maintien de l’ordre au cours de son déroulement, enfin le traitement judiciaire qui en est fait.
Sur le premier point, deux ans de relations intenses avec la préfecture nous ont permis de constater que le régime de la déclaration préalable n’était guère respecté dans les faits, voire pas du tout. J’en veux pour preuve les propos tenus par M. Daniel Vaillant au sein de votre commission d’enquête, selon lesquels « il faut savoir recourir [aux interdictions] en cas de besoin, c’est-à-dire quand les objectifs avoués d’une manifestation sont incompatibles avec les textes fondamentaux de la République ». Ce discours n’a rien de surprenant : il rencontre celui du préfet de police de Paris, qui affirmait lors de la même audition « la tenue de toute manifestation revendicative [est] interdite dans ce secteur » – il s’agissait notamment des Champs-Élysées. Sans entrer dans la polémique relative à cette dernière zone, disons simplement que l’interdiction repose sur une tradition, puisque c’est à un régime déclaratif que les manifestations sont en principe soumises. De fait, je vais tenter de le montrer, nous avons été placés dans une situation qui nous a empêchés d’exercer nos droits.
La phase de concertation, dont il a été question dans les précédentes auditions, est essentielle. En effet, la clé de la réussite d’une manifestation est sa préparation, en particulier le « calage » des dispositifs respectifs des organisateurs et des forces de l’ordre. Or, aujourd’hui, à Paris en tout cas, cette concertation n’est possible qu’après une phase de négociation : la préfecture impose que l’on détermine le parcours avant d’aborder les autres aspects techniques. C’est-à-dire qu’avant la signature de la déclaration précisant l’itinéraire et les horaires, il est impossible de travailler avec les services techniques de la préfecture, en particulier la direction de l’ordre public et de la circulation, donc de prévoir avec eux des dispositifs adaptés du côté des organisateurs comme des forces de l’ordre. Pendant deux ans, nous avons été très demandeurs de cette concertation – puisqu’il y a évidemment, au-delà du seul parcours, bien des questions techniques à régler, notamment des autorisations à demander en fonction des différents dispositifs envisagés – et nous avons été mis à plusieurs reprises dans l’embarras.
Pour nous – c’est l’interprétation que nous en faisons depuis deux ans –, le régime de la déclaration préalable créé par le décret-loi du 23 octobre 1935 est aujourd’hui, dans les faits, un système d’autorisation. En effet, le délai imparti pour déposer la déclaration s’étend de quinze jours francs à trois jours francs avant l’événement. Or les arrêtés d’interdiction pris par la préfecture – notre mouvement est l’un de ceux qui en ont été le plus frappés en 2013 – l’ont systématiquement été le vendredi soir à vingt heures, alors que nous manifestons le dimanche parce que la population concernée n’est disponible que le week-end. Le tribunal administratif de Paris étant fermé le samedi, aucun recours n’est possible avant le lundi matin, c’est-à-dire une fois l’événement terminé. L’absence de délai obligatoire imparti à la préfecture pour répondre nous met en difficulté, car elle nous prive de notre droit de déposer un recours contre une décision administrative.
Puisque nous avons la possibilité de formuler des suggestions, nous aimerions que le législateur envisage d’étendre le délai de déclaration préalable. Pourquoi, s’agissant d’un événement de grande ampleur prévu depuis plusieurs mois, la déclaration ne peut-elle être déposée que quinze jours à l’avance alors même que certains dossiers techniques doivent l’être au cabinet du préfet un mois avant la manifestation ? Symétriquement, à l’heure où l’information va très vite, où les gens peuvent avoir besoin de manifester leur émotion rapidement, le délai de trois jours francs avant l’événement, sans doute pratique pour anticiper celui-ci, entrave la spontanéité des mouvements ; sans vouloir évidemment l’abolir, nous proposons donc de le ramener à vingt-quatre heures.
Nous avons souhaité participer à la fête de la Musique le 21 juin 2014. Nous avons déposé les déclarations requises auprès des services de la préfecture. Celle-ci nous a systématiquement répondu que le lieu choisi ne lui convenait pas et nous a demandé d’en proposer un autre. Nous avons fait dix-sept propositions au cabinet du préfet. Lorsque nous avons déposé la dernière, le 20 juin 2014, le préfet nous a tout bonnement répondu qu’étant donné les délais que nous lui imposions il ne pouvait plus satisfaire notre demande, l’événement débutant le lendemain. Nous aimerions donc que la loi oblige également la préfecture à répondre dans un délai donné, par exemple dans les trois jours francs, ce qui permettrait de former le cas échéant un recours.
Pour nous, cette phase de préparation est cruciale car elle permet de travailler sur les aspects techniques de la manifestation. Au demeurant, nous avons noté une évolution de la préfecture à cet égard, notamment après le remaniement ministériel qui a installé Bernard Cazeneuve au ministère de l’intérieur, sans que nous sachions si ces deux changements sont liés. Cela nous a permis de mieux préparer les événements. Ainsi, lors de nos deux dernières manifestations, le 2 février puis le 5 octobre 2014, nous avons disposé de quelques heures supplémentaires, ce qui nous a permis de ne déplorer aucun incident – chose rare s’agissant d’un mouvement d’une telle ampleur –, pas même une évacuation sanitaire. C’est que nous avions eu le temps de nous concerter, donc de positionner notre service d’ordre en fonction du déploiement des forces de l’ordre, bref de nous répartir les rôles conformément aux obligations que la loi impose à chacun.
J’en viens à la manifestation en tant que telle. J’aimerais avant tout saluer le professionnalisme des fonctionnaires de la police nationale et des militaires de la gendarmerie, placés sous l’autorité fonctionnelle du préfet de police. Leur compétence n’est absolument pas en cause. Simplement, nous avons constaté à de multiples reprises un sous-dimensionnement du dispositif policier qui entraînait de facto un usage disproportionné de la force publique : il est plus facile à vingt gendarmes mobiles qu’à cinq de tenir un barrage et leurs réactions n’ont pas besoin d’être aussi fortes. À l’époque, cette question avait d’ailleurs donné lieu à un rendez-vous avec Manuel Valls.
Nous avons notamment été confrontés à ce problème le 24 mars 2013. Notre situation était alors extrêmement délicate. N’ayant pu négocier le lieu de la manifestation, nous nous sommes trouvés cantonnés à l’avenue de la Grande-Armée. Nous avons dénoncé le plan du dispositif proposé par la préfecture avant même de signer la déclaration. En effet, on nous avait imposé de placer notre podium à l’entrée de l’avenue de la Grande-Armée, ce qui ne laissait aucun axe de fuite. Or le mouvement de foule était tel qu’au bout de trois ou quatre heures on piétinait : on ne gagnait que quinze ou vingt centimètres par heure ; au bout d’une heure, tout le monde avait avancé d’un mètre et les gens se sont retrouvés contre les barrages. Les fonctionnaires de police ont alors dû faire usage de gaz lacrymogènes. Vous connaissez les images. Je citerai Laurent Wauquiez : « Il est inacceptable d’envoyer des gaz contre les enfants. Avez-vous l’impression que ce sont des casseurs, des gens violents ? » Jean-François Copé avait lui-même demandé des comptes à François Hollande à ce sujet.
La seule explication que nous ayons trouvée à ces événements, et dont nous espérons qu’elle est la bonne, est que le dispositif prévu par la préfecture a été dépassé par le succès de la manifestation. Nous regrettons que les différents états-majors, la direction du renseignement et la direction de l’ordre public et de la circulation, composés d’experts chevronnés de l’ordre public, ne puissent proposer aux organisateurs les solutions techniques qu’ils ont à disposition tant que le préfet ne les a pas autorisés à leur parler, c’est-à-dire tant que les itinéraires et les horaires n’ont pas été fixés sur le papier. Cela nous oblige à nous réorienter en dernière minute, ce qui suppose que nous soyons très organisés et rend plus fébriles les parties prenantes au sein de chacun des deux dispositifs.
Parmi les problèmes qui se sont posés à nous et à nos associations partenaires en 2013 figure la technique dite de l’encagement. Très fréquemment utilisée par les forces chargées du maintien de l’ordre, elle consiste à organiser un dispositif interdisant l’accès à tel ou tel endroit et permettant de retenir les manifestants en un lieu donné pour une durée déterminée. En l’occurrence, il s’agissait généralement de laisser à une personnalité présente dans les parages le temps de prendre une décision et, le cas échéant, de s’en aller.
C’est ce qui est notamment arrivé au lycée Buffon, le 27 mai 2013. À l’occasion d’une visite de François Hollande dans l’établissement, des manifestants organisaient un « accueil de ministre », sorte de happening lancé par la « Manif pour tous » à partir de l’idée qu’à défaut d’être écoutés par le Gouvernement nous allions nous faire entendre. Il s’agit de profiter des déplacements des membres du Gouvernement pour nous présenter à eux. Ce jour-là, nous avons eu, sans sommation, 93 encagés, pendant plus de trois heures. Il n’en est résulté que deux gardes à vue.
Cette technique a également été utilisée le 9 décembre 2013 lors d’une manifestation dite des Mères Veilleuses à laquelle j’ai participé. Cette manifestation avait été déclarée par mes soins auprès du cabinet du préfet de police de Paris. Nous avons été encagés plus de trois heures, alors qu’il s’agissait d’un rassemblement de mères de famille ; il y a eu des malaises, une poussette a été renversée par l’intervention des forces de l’ordre ; le tout au cours d’une manifestation déclarée, suivant les itinéraires déclarés. Tout ce que le préfet nous a répondu lorsque nous l’avons interrogé, c’est qu’il n’avait pas reçu notre déclaration. J’ai été entendu à ce sujet par le Défenseur des droits ; celui-ci, qui pourra vous le confirmer tout à l’heure, a également auditionné le commissaire de police présent sur place, qui a reconnu avoir utilisé la technique de l’encagement lors de cette manifestation.
J’en viens à une autre affaire – je reste volontairement très technique, afin de vous laisser interpréter vous-mêmes les faits. Le 31 mai 2013, cinq jeunes auditionnés au Palais de justice à la suite d’une vérification d’identité en sortent libres, aucun fait n’ayant été retenu contre eux, dans la tenue de manifestants qu’ils portaient lors de leur interpellation. Ils sont alors de nouveau interpellés devant les grilles du Palais de justice, on les fait entrer dans un camion des forces de l’ordre, et c’est un avocat qui, passant là par hasard, demande à la commissaire de police de les en faire sortir puisqu’il n’existe aucun motif d’interpellation. Il a finalement obtenu gain de cause, comme le montre une vidéo visionnée à plusieurs dizaines de milliers de reprises sur Internet, qui témoigne de l’embarras de la commissaire tentant désespérément de joindre son état-major par radio. Sachez – car cela n’apparaît pas sur la vidéo – que ces jeunes ont été encore interpellés quelques centaines de mètres plus loin, à la station Saint-Michel, alors qu’ils tentaient de rentrer chez eux pour prendre une douche bien méritée après quarante-huit heures de garde à vue.
Un dernier exemple de recours à cette technique de l’encagement. Le 6 août 2013, nous avons organisé un autre accueil lors d’une visite de François Hollande à La-Roche-sur-Yon. Des étudiants sont allés, toujours de manière pacifique, à la rencontre du Président. Des CRS ont alors encerclé le groupe, pendant plus de trois heures. Les manifestants ont eu la bonne idée de faire venir un huissier de justice, qui a constaté cette atteinte à la liberté d’aller et venir – celle-là même que la cour d’appel de Riom a condamnée le 21 janvier 2015, dans une affaire où deux officiers de gendarmerie avaient pareillement retenu un syndicaliste pendant une visite de Nicolas Sarkozy.
J’aborderai en troisième lieu la gestion de la manifestation, particulièrement les procédures judiciaires qui s’ensuivent. Je réagis ici à l’audition du procureur de Paris. Nous avons constaté un détournement de procédures judiciaires, celles-ci ayant été utilisées comme moyens de dispersement. La technique est simple. Les fonctionnaires commencent par demander à la personne de justifier de son identité ; normalement, c’est uniquement en cas de refus ou d’impossibilité d’établir celle-ci que les forces de l’ordre sont autorisées à la conduire au poste et à l’y retenir le temps nécessaire à la vérification.
L’exemple que je vais citer est sans doute le plus marquant ; il a d’ailleurs fait l’objet d’une plainte de la part d’un membre du cabinet du préfet qui était présent sur place. Les Veilleurs, mouvement ultra-pacifique, se rassemble place de la République, sur le terre-plein central, le 26 juin 2013. Et voilà que les participants se retrouvent dans le « GAV bus », selon l’expression employée sur les réseaux sociaux pour désigner ce bus où l’on peut entasser jusqu’à cinquante personnes pour aller vérifier leur identité. Cinquante-deux manifestants sont ainsi embarqués et emmenés au commissariat de la police ferroviaire, rue de l’Évangile, sans que personne ne leur ait demandé au préalable de justifier de leur identité. Tous ont pourtant une carte nationale d’identité sur eux. Ce n’est qu’à l’arrivée au commissariat qu’ils sont prévenus qu’il s’agit d’une vérification d’identité.
Une telle procédure n’a-t-elle pas été utilisée à outrance, dans un but de maintien de l’ordre ? En l’occurrence, n’a-t-elle pas permis d’écarter plus facilement cinquante-deux personnes le temps de la manifestation au lieu de les traiter en manifestants, surtout dans ce contexte pacifique ? Telles sont les questions que nous nous posons, mais vous êtes naturellement libres de votre interprétation.
Nous trouvons par ailleurs assez stupéfiant que le ministère de la justice ait refusé de répondre aux questions du député Poisson sur les statistiques. Nous souhaiterions donc que votre commission demande à la chancellerie le nombre d’interpellations liées à l’opposition au mariage pour tous et le nombre de gardes à vue, de défèrements et de condamnations qui en ont résulté. Nous considérons pour notre part que ce taux est inférieur à 5 %.
Nous avons fait référence aux libertés fondamentales. À cet égard, comment réparer le préjudice subi par une personne qui se retrouve en garde à vue pendant quarante-huit heures, parfois pour rien, sans que personne ne lui dise ce qu’il fait là ni ne lui énonce ses droits ? C’est ce qui est arrivé à l’un des responsables logistiques de notre mouvement, parce qu’il portait un sweat-shirt de la « Manif pour tous » en rentrant d’une manifestation.
Enfin, pourquoi la préfecture s’obstine-t-elle à refuser la transparence ? Alors que nous avions obtenu du tribunal de grande instance de Paris la présence d’huissiers de justice lors de notre manifestation du 2 février 2014, pour vérifier sa bonne tenue et le respect de leurs obligations par les forces de l’ordre comme par les organisateurs, la préfecture a formé un recours pour s’y opposer, avec succès.
Je ne reviens pas sur la résolution n° 1947 votée le 27 juin 2013 par le Conseil de l’Europe, qui concerne les manifestations et les menaces pour la liberté de réunion en France.
J’en terminerai par l’affaire Anna, du nom d’une étudiante de 19 ans en classe préparatoire dans les Yvelines qui avait la malchance d’être russe et de demander sa naturalisation. Plusieurs conférences de presse en ont fait état, elle a été convoquée par un service de police des Yvelines qui lui a demandé d’infiltrer la délégation locale de la « Manif pour tous » et de donner les noms, prénoms et professions de tous les membres du mouvement, sans quoi son dossier de naturalisation serait bloqué. Nous l’avons aidée à déposer une plainte auprès de l’Inspection générale de la police nationale ; nous attendons toujours le résultat.
Aujourd’hui, nous nous interrogeons. Les forces de police peuvent-elles être instrumentalisées à des fins politiques ? Nous partageons votre inquiétude à propos du projet de loi relatif au renseignement, dont Bernard Cazeneuve a bien dit qu’il n’excluait pas les mouvements sociaux : dans quelle mesure ce texte pourrait-il nous viser au même titre que des personnes qui mettraient en cause la sécurité nationale ?
M. Pascal Popelin, rapporteur. Je ne sais pas de qui vous partagez l’inquiétude. Pour ma part, comme porte-parole du groupe socialiste sur le projet de loi relatif au renseignement, je n’ai aucune raison de m’inquiéter après avoir étudié le fond du texte. Nous avons les uns et les autres des opinions diverses, là n’est pas la question ; l’inquiétude que vous dites partager n’est en tout cas pas la mienne.
Par ailleurs, plusieurs des points que vous avez évoqués ne relèvent pas du champ d’investigation de notre commission d’enquête, qui s’intéresse aux modalités de mise en œuvre des opérations de maintien de l’ordre liées à des mouvements de protestation. En particulier, le dernier cas que vous avez signalé, pour intéressant qu’il soit, se situe à la marge de notre domaine d’étude.
J’en viens à mes questions. Trois concernent le régime de déclaration préalable. Je souhaiterais en premier lieu connaître le nombre au moins approximatif d’arrêtés d’interdiction qui vous ont été opposés, disons sur un an, et leur motif. En effet, il ressort plutôt des auditions – qui ont lieu depuis janvier, à un rythme hebdomadaire, et s’achèvent aujourd’hui – que le régime français d’organisation des manifestations est extrêmement libéral et que les décisions d’interdiction sont très rares. Pour plusieurs milliers de manifestations organisées à Paris chaque année – 13 par jour en moyenne –, le nombre d’arrêtés d’interdiction formalisés, donc traçables, est faible.
Un autre constat partagé est l’importance du travail de concertation en amont. Vous ne semblez pas le contredire ; vous demandez même que l’on vous laisse plus de temps pour cela. Je peux le comprendre, surtout s’agissant de grands événements. Mais vous paraît-il vraiment incongru que l’on se mette d’accord sur le parcours de la manifestation avant de déterminer l’organisation, les moyens, les décisions et arrêtés nécessaires à son bon déroulement ?
Vous avez évoqué le 14 juillet – 2013, je suppose. Compte tenu de la force symbolique de la fête nationale et du défilé militaire qui a lieu sur les Champs-Élysées, d’une part, des lourdes contraintes de sécurité qui pèsent sur un événement de ce type, d’autre part – en 2002, on a tout de même tenté d’éliminer physiquement le chef de l’État ! –, la République devrait-elle admettre que l’on manifestât sur les Champs-Élysées le 14 juillet, sous quelque forme que ce soit ?
J’en viens au déroulement de vos manifestations. Celles-ci, dites-vous, n’ont causé aucun dégât, pas même un papier gras. Ce n’est pas aux papiers gras que nous allons nous intéresser, même si c’est important. Mais l’absence d’incident dont vous faites état semble contredire vos explications sur les difficultés des forces de l’ordre à tenir un barrage lorsque leurs effectifs ne sont pas assez nombreux. Car si les gendarmes mobiles peinent à tenir un barrage, ce doit être que certains individus cherchent à le forcer, ce qui me paraît constituer à tout le moins un incident. Pour ma part, ayant le bonheur de fréquenter régulièrement cette auguste maison, il m’a été donné d’être personnellement témoin de scènes se déroulant non loin d’ici, à l’angle de l’esplanade des Invalides et de la rue de l’Université, en fin de manifestation, et qui s’apparentaient davantage à une guérilla urbaine qu’à un rassemblement pacifique de papas, de mamans et de poussettes.
Dans quelle mesure avez-vous été confrontés à ce type d’événements, qui sont souvent le fait, dans n’importe quelle manifestation, de personnes qui ne sont liées ni aux manifestants ni aux organisateurs ? Comment les avez-vous gérés aux abords de la manifestation, pendant son déroulement et lors du dispersement ?
De fait, vous êtes un mouvement nouveau en matière d’organisation d’événements de protestation sur la voie publique. Certaines organisations historiques rompues à ce genre d’exercice disposaient de services d’ordre constitués de longue date. Sans doute avez-vous dû faire face à cette nécessité. Comment avez-vous procédé ? Et, si vous êtes parvenus à mettre sur pied un service d’ordre interne – ce qui, on le sait, n’est pas facile –, comment le lien s’est-il fait en amont, dans le cadre de la concertation, avec les autorités civiles, et surtout sur le terrain, avec les membres et les responsables des unités de gendarmerie mobile, de CRS, etc. ?
Mme Ludovine Dutheil de La Rochère. J’aimerais prendre un peu de recul, si vous le permettez. Certains événements liés au football ont comporté des faits que l’on peut qualifier de très graves. Il convient de remettre les choses en perspective. Nous avons organisé des événements d’une ampleur historique, extrêmement nombreux, quotidiens, par moments, et qui ont eu lieu sur tout le territoire national, donc aussi en région. Nos manifestants ont été calmes, pacifiques, respectueux ; ils ont défilé dans un état d’esprit très bon enfant, et de manière tout à fait respectueuse de l’ordre public. Rappelons le nombre absolument stupéfiant de gardes à vue, qui n’ont d’ailleurs abouti à rien puisqu’il n’y avait rien à reprocher aux personnes concernées. Voilà qui devrait nous permettre de reprendre pied dans un contexte objectif. Albéric Dumont va vous répondre plus précisément, mais l’expérience d’organisation que nous avons acquise est tout de même remarquable.
Il y a eu en effet une difficulté, lors d’une manifestation, celle du 24 mars. Ne généralisons pas. Cette manifestation avait lieu dans un cul-de-sac ; nous avions prévenu M. le préfet de police de ce problème, nous avons même tenté de négocier à la barre du tribunal, mais il avait envoyé quelqu’un qui n’avait pas la capacité de traiter avec nous, et il en est resté coûte que coûte à ce cul-de-sac.
M. Albéric Dumont. En 2013, nous avons été visés par quatre ou cinq arrêtés d’interdiction – pardonnez-moi cette hésitation sur le chiffre exact. Rapporté au nombre total d’interdictions, c’est considérable : un tiers des arrêtés d’interdiction pris par la préfecture de police, d’après les chiffres dont j’ai eu connaissance ! Je détiens ce triste record d’être l’homme le plus touché par ces interdictions à Paris.
M. le rapporteur. Sur combien de demandes ?
M. Albéric Dumont. Pour une quarantaine d’événements à Paris. Aux arrêtés d’interdiction, il convient d’ajouter les courriers administratifs, environ cinq également, dans lesquels le préfet de police de Paris disait « envisager » d’interdire la manifestation, et qui ne pouvaient donc faire l’objet d’un recours. Le motif était le risque de trouble à l’ordre public. En particulier, on nous présentait systématiquement des déclarations d’opposants à nos idées qui projetaient de se rassembler à proximité de nos lieux de rendez-vous, souvent des groupuscules totalement inconnus du grand public.
En ce qui concerne le 14 juillet 2013, je ne voulais pas entrer dans le débat politique sur la question de savoir s’il faut ou non manifester ce jour-là, mais notre réaction a été très claire lorsque des incidents sont survenus à l’occasion de cérémonies officielles. Le général Bruno Dary, qui nous conseille dans ce domaine, a d’ailleurs réagi lui-même assez vivement, condamnant ce qui avait pu se passer. Je m’étonne simplement que l’on puisse dire que « la tenue de toute manifestation revendicative [est] interdite dans ce secteur », c’est-à-dire que l’on formule une interdiction générale, dans un système censé être déclaratif. Même si le contexte est particulier, les Champs-Élysées ne font pas juridiquement l’objet d’une interdiction générale – encore ne s’agit-il même pas des seuls Champs-Élysées, mais de « ce secteur ».
M. le rapporteur. Nous avons interrogé le préfet de police de Paris sur ce point. Il n’y a pas d’interdiction, il n’existe pas de texte en ce sens, mais le préfet de police considère que s’il reçoit une déclaration, d’où qu’elle vienne, concernant une manifestation sur les Champs-Élysées le jour de la fête nationale, il demandera aux organisateurs d’y renoncer.
M. Albéric Dumont. Le préfet de police a parlé du 14 juillet en raison du contexte dans lequel il a prononcé cette phrase, mais nous n’avions absolument pas appelé à manifester ce jour-là : notre manifestation sur les Champs-Élysées était prévue le 24 mars. Je rebondissais simplement sur cette phrase, sans avoir l’intention d’ouvrir une polémique.
M. le rapporteur. C’est vous qui l’avez évoquée.
M. Albéric Dumont. En effet, mais simplement parce que l’idée que les manifestations seraient interdites dans ce secteur, reprise par M. Vaillant, me gênait et qu’il me semblait important de souligner ce point.
En ce qui concerne les incidents – puisque c’est le terme à la mode – qui ont pu survenir au cours des manifestations, toute manifestation sur la voie publique comporte des risques et son lot de fauteurs de troubles. Tous les organisateurs d’événements que vous avez auditionnés en sont d’accord. On le voit lors de la Techno Parade ou de la foire du Trône, qui sont pourtant des manifestations festives. Chacun a son boulet.
Toutefois, la seule manifestation lors de laquelle il y ait eu des incidents pendant les horaires et sur les parcours déclarés par la « Manif pour tous » est celle du 24 mars. Vous pourrez demander tous les rapports de police, vous ne trouverez trace d’aucun incident à d’autres moments.
Pourquoi le 24 mars ? C’est ce que j’ai tenté de vous expliquer tout à l’heure, peut-être maladroitement : à cause du phénomène de poussée naturelle de la foule. Nous étions condensés dans une avenue sans issue de secours. Nous avions prévu deux allées de dégagement, par la rue de Tilsitt et l’avenue Carnot d’un côté, par l’avenue Foch de l’autre. Pour l’anecdote, j’avais même parié avec l’un des hauts fonctionnaires de la préfecture que nous remplirions aussi ces deux avenues, ce qui rendrait l’évacuation impossible. Il m’a répondu : « Si vous remplissez ne serait-ce que l’une d’entre elles, je vous offre une caisse de champagne ! » En définitive, ces deux axes ont été remplis au même titre que l’avenue de la Grande-Armée, personne ne pouvait en sortir, et je peux vous assurer que la compression était intense. Dans une telle situation, naturellement, des gens avancent vers le barrage, des gens s’excitent, ce qui peut entraîner une surréaction des forces de l’ordre. Mais c’est, je le répète, le seul incident que l’on puisse déplorer dans le cadre des itinéraires et horaires déclarés par la « Manif pour tous ».
Il y a eu des problèmes – nous ne nous en sommes jamais cachés – lors des manifestations auxquelles vous avez fait allusion, organisées en semaine puisque nous manifestions tous les jours pendant l’examen du texte à l’Assemblée nationale. Tout se passait très bien jusqu’à l’arrivée de notre cortège au carrefour de la rue de l’Université et de l’esplanade des Invalides, après quoi nous étions rejoints par des groupes de perturbateurs venus dans la seule intention de perturber l’événement et d’esquinter les forces de l’ordre. Mais c’était toujours après la manifestation.
Pour revenir au 24 mars, puisque ce sujet semble tenir à cœur au préfet de police, sachez que celui-ci m’a personnellement appelé ce jour-là pour me demander d’aller déployer notre service d’ordre sur les Champs-Élysées, afin de l’aider à les faire évacuer. Les Champs-Élysées, lui ai-je répondu, nous étaient interdits par une décision de justice ; je n’ai donc évidemment pas pu y engager nos équipes.
Vous parlez de la jeunesse de notre mouvement, qui est d’ailleurs pour nous une source de fierté.
M. le rapporteur. Je ne portais aucun jugement de valeur.
M. Albéric Dumont. Bien sûr ! Simplement, au cours des manifestations de 2013, nous avons aligné 6 000 à 8 000 bénévoles pour assurer l’encadrement : c’est considérable. On m’a objecté à la direction de l’ordre public que 6 000 bénévoles ne valent pas un fonctionnaire formé. Je pense le contraire. Nos bénévoles n’ont pas reçu une formation de deux ans, mais nous avons organisé pour eux, répartis en cantons, en secteurs puis en équipes, une soirée de quatre heures ; c’est très court, mais il est difficile d’en demander plus à des bénévoles, et cela me paraît largement suffisant pour guider la foule, gérer le flux et prévenir des incidents en alertant éventuellement un service d’ordre mieux formé ou les forces de l’ordre.
À ces personnes s’ajoutait le service d’ordre permanent de la « Manif pour tous », composé de ce que j’appelle des semi-professionnels : des anciens des forces de l’ordre ou de l’armée, aujourd’hui reconvertis. La préfecture a salué à plusieurs reprises leur professionnalisme.
Enfin, nous avions systématiquement recours à 80 à 150 agents de sociétés de sécurité privées, pour les endroits les plus difficiles.
Je ne pense donc pas que l’on puisse nous objecter un manque de professionnalisme.
Le procureur de la République a insisté sur la nécessité de travailler à la distinction entre les manifestants qui veulent exprimer leur opinion de manière pacifique et les perturbateurs. C’est ce travail en amont qui ne peut aujourd’hui être fait, parce que nous devons organiser ces manifestations de très grande ampleur en vingt-quatre heures avec la préfecture et que nous n’avons pas le temps d’aborder tous les sujets.
M. Philippe Goujon. Je me réjouis que notre président et notre rapporteur aient suscité cette audition. Je voulais moi aussi entendre les responsables de l’organisation lorsque nous avons fait adopter par l’Assemblée nationale, voilà deux ans, la création d’une commission d’enquête sur le maintien de l’ordre à Paris. Mon groupe considérait en effet que le maintien de l’ordre n’avait pas été assuré dans les meilleures conditions autour de la « Manif pour tous » ni au Trocadéro. Malheureusement, la commission d’enquête a dû se saborder après une unique réunion à cause d’amendements de la majorité qui en dénaturaient la définition même. Je suis heureux que M. Mamère ait eu plus de chance que moi et que nous puissions aujourd’hui nous intéresser au maintien de l’ordre, plus largement d’ailleurs.
La manifestation du 24 mars est un enjeu important. C’était à l’époque le motif principal de ma demande de création d’une commission d’enquête. Pour suivre depuis quelques décennies les questions qui concernent la préfecture de police de Paris, en particulier les manifestations – j’ai été pendant une douzaine d’années adjoint au maire de Paris chargé des questions de sécurité –, je peux témoigner de plusieurs anomalies affectant l’organisation de ce rassemblement par les forces de sécurité. La première, décrite par les organisateurs, était de leur attribuer un lieu qui formait un cul-de-sac, ce qui ne peut que provoquer des troubles. Je ne veux pas du tout dire que c’était volontaire, mais il y a là au moins une erreur technique, qui consiste à faire avancer des manifestants vers un barrage infranchissable. Pour qu’une manifestation se déroule bien, il faut en effet respecter deux principes fondamentaux. Premièrement, faire en sorte qu’elle soit fluide – d’ailleurs, sauf erreur de ma part, toutes les autres manifestations organisées par le mouvement l’étaient puisqu’elles étaient mobiles. Deuxièmement, tenir les forces de sécurité à distance des manifestants, pour éviter tout contact.
Un autre problème est l’intervention de perturbateurs, voire de casseurs – pour reprendre un terme que nous avons utilisé à propos d’autres manifestations. Il n’est pas rare que le déroulement d’une manifestation soit ainsi altéré. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle nous souhaitons donner des pouvoirs supplémentaires aux forces de sécurité. Comment avez-vous appréhendé cette dichotomie entre des manifestants pacifiques – ce qui n’a pas empêché d’en « gazer »certains alors qu’ils étaient accompagnés d’enfants en poussette, manière tout de même assez rare de maintenir l’ordre – et ces casseurs ? J’ai vu à la télévision des images effrayantes filmées en bas des Champs-Élysées et qui montraient des jeunes affrontant volontairement les forces de l’ordre.
À vous entendre, et à entendre d’autres organisations, il m’a semblé que la vôtre faisait l’objet d’un traitement particulier lors de la préparation de la manifestation et dans les contacts avec la préfecture de police de Paris. Le préfet, avec qui j’en ai discuté et que nous avons auditionné ici même, retourne en quelque sorte l’argument, expliquant qu’il est très difficile d’établir des contacts suivis et fiables avec les organisateurs de la « Manif pour tous ». Avez-vous pris part à des réunions avec la préfecture ? Quelles étaient vos relations avec elle ? Vous nous en avez dit quelques mots mais, encore une fois, ce n’est pas tout à fait ce que nous a laissé entendre le préfet de police.
Vous avez évoqué l’incident du lycée Buffon. Maire du XVe arrondissement de Paris, j’assistais à la cérémonie organisée par le Président de la République à l’intérieur de cet établissement au moment où les événements se sont produits. Le préfet de police était d’ailleurs présent et nous avons pu traiter le problème en direct, dans une salle du lycée. J’ai constaté de visu que les personnes interpellées, moins de quelques dizaines, dont j’ai essayé ensuite de voir avec la préfecture de police comment faciliter la libération, étaient des mères de famille, venues – aucune manifestation n’étant organisée – boulevard Pasteur et rue de Vaugirard, peut-être pour rencontrer le Président de la République. Leur interpellation m’a semblé un peu sévère. Je pense d’ailleurs qu’elles ne sont pas restées longtemps dans les commissariats de police où elles avaient été emmenées – à l’autre bout de Paris, soit dit en passant, mais enfin peu importe.
S’agissant enfin du projet de loi relatif au renseignement, je fais partie de ceux qui ont demandé au ministre de l’intérieur si le mouvement était concerné par les dispositions sur la prévention des violences collectives – vous aurez d’ailleurs constaté que la terminologie employée a été modifiée.
M. le rapporteur. Grâce à mon amendement !
M. Philippe Goujon. Le ministre a répondu très explicitement que ce type de surveillance ne concernait pas des mouvements comme la « Manif pour tous ». Je ne sais si cela peut vous rassurer ; pour ma part, je me fie aux propos tenus par le Gouvernement.
M. le rapporteur. J’aimerais faire une brève mise au point. Puisque nos débats sont publics, je tiens à préciser que ce que notre collègue Goujon a qualifié de sabordage de la commission d’enquête dont le groupe UMP avait souhaité la création résulte en fait de la décision prise par le groupe UMP lui-même de renoncer à poursuivre sa mise en œuvre, parce que le groupe majoritaire jugeait intéressant d’étudier ces questions non sur deux ans, comme il était proposé, mais sur une dizaine d’années. Cette précision factuelle me paraît utile pour éviter toute confusion.
M. le président Noël Mamère. Seconde mise au point : nous n’avons pas suscité l’audition de la « Manif pour tous », mais répondu à la demande formulée par la « Manif pour tous », comme par d’autres associations.
M. Philippe Folliot. Je retire donc les remerciements que j’allais vous adresser…
M. le rapporteur. Vous pouvez nous remercier d’avoir accepté cette audition ! Ce qui nous est apparu légitime, vu la place importante que le mouvement a pu occuper dans les opérations de maintien de l’ordre que l’État a eu à conduire. Nous avons donc répondu à cette demande, comme à d’autres. De nombreux mouvements qui organisent des manifestations nous ont sollicités et nous nous sommes efforcés de faire le tri en respectant leur diversité et leur représentativité.
M. Philippe Folliot. Dans ce cas, je rétablis mes remerciements !
Le droit à manifester pour tous est essentiel, même si tous n’ont pas la même culture de la manifestation.
Vous dites avoir été particulièrement ciblés, au stade des autorisations comme lors des opérations de maintien de l’ordre proprement dites. Pouvez-vous étayer plus précisément cette affirmation ?
Vous avez parlé de 6 000 à 8 000 bénévoles chargés d’encadrer vos manifestations. Aviez-vous également votre propre service d’ordre ? Si oui, comment l’avez-vous formé et organisé ? À moins que vous n’ayez « sous-traité », comme on le fait parfois, les fonctions du service d’ordre à d’autres groupes constitués, plus expérimentés ? Si oui, lesquels ?
M. Gwenegan Bui. J’aimerais rappeler que la commission d’enquête n’a pas pour objet la manifestation du 24 mars 2013 et les difficultés ayant affecté les relations entre la préfecture de police de Paris et votre mouvement. Ce dont il s’agit, c’est de tirer les leçons de l’ensemble des difficultés rencontrées dans les relations entre les forces de l’ordre et différentes formes de manifestation – de masse, zadistes ou plus violentes, comme les manifestations agricoles.
Vous vous êtes focalisés sur ces deux dernières années. Pour ma part, j’ai un parcours militant qui n’est pas le vôtre, j’ai connu des difficultés avec les forces de police, mais pas les mêmes que les vôtres, à une autre époque, où nous étions dans l’opposition. J’ai connu les stratégies d’encagement, rue du Dragon ; les coups de matraque et les gaz, employés non contre des mères de famille mais contre le professeur Jacquard, qui n’était pas très vaillant et que nous avions dû évacuer. Nous avons aussi été mis en difficulté lors des mouvements de novembre et décembre 1995, quand les étudiants qui manifestaient en masse, amenés par la préfecture de police aux Invalides, se sont trouvés, comme dans votre récit, dans un cul-de-sac ; l’affaire s’est soldée par de nombreuses interpellations, méthodes d’éloignement à l’appui, et par quelques heures passées au poste ainsi que dans les cars que vous avez décrits et qui n’ont rien de nouveau.
Prenons donc garde de ne pas laisser entendre que des mesures d’exception ont été employées contre vous. Certaines méthodes doivent évoluer, qui concernent vos manifestations comme les autres – étudiantes ou sociales.
Toujours à la lumière de mon expérience, je considère qu’un service d’ordre suppose une formation, des habitudes de travail communes et une relation de confiance avec les forces de police. Quels outils de formation avez-vous créés pour le vôtre ? Je ne vois pas bien comment l’on peut faire se côtoyer un service d’ordre militant et des gens payés pour cela, ni quels peuvent être les rapports des uns et des autres avec les forces de police.
Puisque certaines manifestations ont dégénéré à cause d’éléments extérieurs venus en découdre, comme dans toute manifestation de masse, quel traitement spécifique votre service d’ordre a-t-il réservé à ces groupuscules, et quelles étaient ses relations avec les forces de police ?
Mme Ludovine Dutheil de La Rochère. Je suis heureuse de partager une expérience de manifestation avec vous, monsieur le député. Moi aussi, j’ai manifesté quand j’étais étudiante, ainsi qu’à d’autres occasions. Il y a eu avant la « Manif pour tous » d’autres manifs dans ma vie, et je pense que beaucoup de nos manifestants étaient dans le même cas. Et, en effet, les difficultés que nous décrivons doivent d’autant plus évoluer que d’autres organisations y ont été confrontées.
J’aimerais rappeler que les Champs-Élysées ont tout de même été très largement occupés lors d’une manifestation organisée par les agriculteurs. C’est l’une des raisons pour lesquelles nous avons osé demander à nous y réunir. Nous savions que la manifestation du 24 mars serait très importante et nous avions besoin d’un lieu adapté.
M. le président Noël Mamère. L’événement auquel vous faites référence, madame, et auquel nombre d’entre nous ont assisté, n’était pas une manifestation, mais une opération de promotion de l’agriculture. Ce n’était pas une manifestation de protestation.
Mme Ludovine Dutheil de La Rochère. Albéric Dumont complétera mes propos sur ce point. Il s’agissait d’un événement public de grande ampleur occupant tout l’espace, et tel était bien son objectif.
En ce qui concerne le 24 mars, j’aimerais souligner un point très important. Je l’ai dit, le public se trouvait dans un cul-de-sac, tout l’espace de la place de l’Étoile nous étant interdit et notre podium étant installé en dehors. Au début de l’après-midi, les barrières situées tout en haut étaient ouvertes pour une bonne partie d’entre elles, ce qui explique que le public soit passé sur la place ; puis les barrières ont été refermées et des enfants, des personnes âgées et des femmes enceintes, en nombre important, ont reçu des gaz lacrymogènes. Plusieurs ont été blessés et nous avons dû évacuer un nombre important de personnes selon le dispositif qui avait été prévu pour les accidents sanitaires – comme dans toute manifestation, puisque notre organisation est devenue véritablement professionnelle.
M. Albéric Dumont. Je vais m’efforcer de répondre à toutes les questions posées de manière à la fois concise et technique.
L’objectif n’est évidemment pas de ne parler que du 24 mars, mais c’est cet événement qui fournit la meilleure illustration de nos relations avec la préfecture.
Monsieur Goujon, « perturbateurs », oui, mais « casseurs », non : nous n’avons jamais eu à déplorer la moindre dégradation, le matériel urbain n’a pas été touché, la protection des biens a été totale.
Vous avez soulevé un point très intéressant : le positionnement des forces de sécurité. Nous avons constaté que lorsque les forces de l’ordre étaient présentes en tenue et au contact direct des manifestants, cela provoquait systématiquement des incidents, même avec les personnes les plus pacifiques qui soient. Nous avons donc demandé à la préfecture, ce qu’elle a accepté de faire lors de nos deux dernières manifestations, de placer les forces de l’ordre en retrait. Rien ne sert de faire passer les familles le long des boucliers ; cela crispe tout le monde. En revanche, cela ne coûte rien d’installer les barrages fixes quelques dizaines de mètres plus loin. Notre dernière manifestation s’est terminée au pied de la tour Montparnasse, place du 18 juin 1940 ; il y avait 400 fonctionnaires de police en uniforme sur la place ; vous ne les verrez sur aucune photo, alors qu’ils étaient au cœur de la manifestation. Pourquoi ? Parce que nous avions pu étudier avec le préfet la possibilité de déployer des forces d’intervention lourde à proximité, mais sans contact direct avec la foule. Elles sont d’ailleurs restées sur leurs bases, n’ayant pas besoin d’intervenir.
En ce qui concerne les barrages qui auraient été forcés le 24 mars, le préfet de police l’a dit lui-même devant vous, vu les circonstances il a préféré ouvrir les barrages pour laisser les gens aller sur la place de l’Étoile et sur les Champs-Élysées.
Quant à l’utilisation des gaz lacrymogènes dont nous avons été victimes, je croyais – c’est ce que l’on m’avait toujours dit – qu’on ne lâchait des gaz dans une foule compacte que pour l’obliger à se disperser. Dans le cas dont nous parlons, les gaz ont été utilisés pendant la manifestation sur une foule compacte qui ne pouvait pas s’échapper. Pour moi, il s’agit d’une erreur technique. Il existe de nombreuses méthodes pour faire avancer une foule ou reculer un barrage ; si vraiment cela s’avère nécessaire, on peut utiliser du gel lacrymogène, qui permet de viser uniquement la personne face à laquelle on se trouve et qui est manifestement hostile, au lieu d’asperger une foule – on sait bien qu’un gaz occupe tout l’espace qui lui est offert.
S’agissant de la gestion des perturbateurs, je m’exprime au nom de la « Manif pour tous » mais les organisateurs d’événements de tous ordres, revendicatifs ou festifs, sont confrontés aux mêmes difficultés. Il faut d’abord identifier les individus en amont, ce que seuls les services de renseignement ont le pouvoir de faire, par le biais de notes ; ils peuvent ainsi savoir si tel groupe, représentant un nombre donné de personnes, a prévu de venir, et, si oui, dans quel but. Des groupes ont été repérés de cette manière par la police lors de nos manifestations : quand quarante personnes déjà identifiées par les renseignements sortent d’un train et se dirigent vers la manifestation, il est évident que les services de maintien de l’ordre sur place les suivent, et nous avons pu le vérifier. Pourtant, les forces de l’ordre ne sont jamais intervenues. C’est l’un des griefs que nous avons contre elles : elles ont laissé ces groupes parvenir jusqu’au cœur de nos manifestations et les perturber, pour réprimer ensuite toute la foule. Ne pourrait-on étudier l’éventualité, à laquelle je ne vois aucun obstacle juridique, d’empêcher des éléments identifiés comme potentiellement perturbateurs, connus pour leur dangerosité – et non simplement parce qu’ils ne porteraient pas les bons insignes –, d’arriver au beau milieu de la manifestation, au lieu d’attendre qu’ils agissent pour venir ensuite nous en imputer la responsabilité à nous, organisateurs, qui ne représentons, vous l’avez dit, que des papas, des mamans, de jeunes enfants – même s’ils ne sont pas toujours en poussette – et des personnes âgées ?
En ce qui concerne le nombre de réunions, une manifestation de cette ampleur en suppose en moyenne quatre à six au cabinet du préfet, dont une ou deux en présence du préfet de police, puis cinq réunions techniques à la direction de l’ordre public, dont une avec les partenaires de la préfecture – RATP, SNCF, zone de défense. Chaque réunion dure entre une heure et demie et quatre heures.
Monsieur Folliot, je ne saurais établir aucune comparaison avec d’autres mouvements que je ne connais pas, sinon par voie de presse, et auxquels je n’ai pas participé. Je ne dis pas que nous avons été particulièrement ciblés. Je me fonde sur tous les éléments que nous dénonçons depuis deux ans et que nous vous apportons aujourd’hui. Les méthodes sont certainement courantes et appliquées à tous les mouvements. Simplement, elles étaient exceptionnelles nous concernant, puisqu’elles visaient un public extrêmement pacifique. Voilà ce que nous dénonçons.
Quant à l’organisation du mouvement pendant les manifestations, nous recrutons des bénévoles que nous orientons soit vers la logistique, soit vers l’accueil et la gestion de la foule, soit vers la sécurité – au simple sens de la gestion des flux –, soit enfin vers le service d’ordre, chargé de la sécurité proprement dite, avec le renfort d’une société de sécurité privée. Les agents que celle-ci emploie, et qui ont l’avantage d’être agréés par le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS), sont les seuls qui soient rémunérés pour leur mission. Contrairement à d’autres, en effet, nous ne payons pas notre service d’ordre.
S’agissant de l’articulation entre ces éléments et les forces de l’ordre, nous avons lors des manifestations de grande ampleur un centre opérationnel, placé sous la responsabilité de la direction de la « Manif pour tous », dirigé par des techniciens de chez nous qui gèrent la manifestation : ce sont eux qui donnent au cortège le signal du départ, qui annoncent le dispersement et qui, derrière leur Algeco, utilisent les vidéos du cortège dont ils disposent et les informations que leur transmettent les bénévoles pour prendre des décisions. Dans ce centre opérationnel, il y a deux officiers de police, issus l’un de la direction de l’ordre public, l’autre de la direction du renseignement de la préfecture.
En outre – mais ce dispositif n’a pas été reconduit, en vertu d’une décision que nous n’avons pas comprise –, un responsable de notre organisation restait à la préfecture, avec les autorités, pour faciliter les liaisons. En effet, lors d’un grand rassemblement, les communications téléphoniques ne passent pas et les postes de transmission, ou talkies-walkies, des forces de l’ordre et ceux des organisateurs ne sont pas compatibles. On est donc réduit au contact physique ou à l’utilisation de lignes fixes que nous installons sur le parcours.
La gestion de ces événements comporte plusieurs degrés d’intervention. Les équipes d’accueil, en jaune, accueillent et orientent les participants. Les équipes de sécurité gèrent le flux. Les équipes du service d’ordre agissent en cas d’incident, en lien avec les forces de l’ordre, généralement selon la répartition suivante : à l’intérieur du cortège pour le service d’ordre de la « Manif pour tous », à l’extérieur pour les forces de l’ordre, sauf si une infraction est constatée, auquel cas un officier de police judiciaire intervient en application de l’article 73 du code de procédure pénale. Toutefois, nous n’avons pas la possibilité d’assurer le maintien de l’ordre : ce n’est pas notre métier, nous ne sommes pas formés pour cela. La gestion des groupes dont nous parlions est donc du seul ressort de la préfecture.
Enfin, je lance un pavé dans la mare, sans vouloir créer de polémique : je trouve insupportable que, comme le préfet de police l’a lui-même fait devant vous, l’on qualifie nos manifestations de revendicatives alors que d’autres qui le sont tout autant, sur les mêmes sujets mais de manière divergente, comme les gay pride, sont considérées comme festives.
M. le président Noël Mamère. Merci, madame, monsieur.
*
* *
Audition, ouverte à la presse, de M. Christian VIGOUROUX, président de la section
de l’intérieur du Conseil d’État
(Compte rendu du jeudi 16 avril 2015)
M. Noël Mamère, président. Monsieur Vigouroux, conformément aux dispositions de l’article 6 de l’ordonnance du 17 novembre 1958, je dois vous demander de prêter le serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité.
(M. Christian Vigouroux prête serment.)
Je vais à présent, selon nos habitudes, vous demander un exposé liminaire, avant que notre rapporteur et les commissaires présents vous posent leurs questions.
M. Christian Vigouroux, président de la section de l’intérieur du Conseil d’État. Le rôle de la jurisprudence étant d’assurer la sécurité juridique, elle est par nature constante, et ce qui est constant est connu ; je ne dévoilerai donc pas grand-chose que vous ne connaissiez déjà.
Avant d’en venir aux cinq observations qui constitueront l’objet de mon propos liminaire, je souligne que, s’agissant d’ordre public et donc de liberté, nous pensons que tout n’est pas dans tout, qu’il faut éviter les confusions et que les catégories juridiques ont leur intérêt. La procédure, si elle peut paraître compliquée, est nécessaire pour assurer la liberté, et c’est notamment le cas du code de procédure pénale, qui est à mes yeux un texte fondamental.
Par ailleurs, puisqu’il s’agit d’ordre public et de prévention, la police administrative doit pleinement jouer son rôle, mais l’infraction commise relève, à tout moment, des tribunaux judiciaires. L’ordre public passe par un évitement des confusions.
Première observation : en parlant d’ordre public, il faut commencer par parler de liberté, car l’ordre public n’est qu’une manière de permettre à chacun d’exercer sa liberté. Tout préfet, tout policier devrait avoir dans sa poche la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Si des ministres, à certaines époques, l’ont fait afficher dans les commissariats de police ou les prisons, c’est dans cet esprit.
Dans une décision du 18 janvier 1995, le Conseil constitutionnel, saisi d’une loi modifiant le décret du 23 octobre 1935 relatif aux manifestations sur la voie publique, a rangé parmi les libertés constitutionnellement garanties le droit d’expression collective des idées et des opinions. Il peut y avoir des restrictions – l’ordre public doit permettre à chacun d’exercer sa liberté sans qu’une minorité empêche les autres de s’exprimer – mais, conformément à la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, la liberté est le principe et les restrictions non seulement sont l’exception mais doivent aussi se justifier.
En 1995, le Conseil constitutionnel, ayant à traiter l’interdiction de transporter des objets pouvant servir d’arme, applique ce principe de liberté sauf justifications. Les justifications ont trait aux circonstances faisant craindre des troubles graves. Qui plus est, les restrictions doivent toujours être assorties de limites dans le temps et l’espace, et une définition aussi exhaustive que possible des objets pouvant être une arme doit être formulée.
La liberté peut être encadrée par des régimes d’autorisation ou, dans le domaine qui nous intéresse, de déclaration, qui consistent, s’agissant de ces derniers, en l’information préalable de l’autorité afin qu’elle puisse prendre les dispositions permettant l’exercice de la liberté. S’il n’y a d’autre moyen de préserver l’ordre public et d’empêcher que l’exercice d’une liberté se transforme en infraction, une interdiction peut être prononcée. Le décret de 1935 dispose : « Si l’autorité investie du pouvoir de police estime que la manifestation projetée est de nature à provoquer l’ordre public, elle l’interdit par un arrêté. » Le Conseil d’État, dans l’arrêt du 23 février 2011 Syndicat des enseignants du second degré, a ainsi validé le décret du 19 juin 2009 qui a introduit dans le code pénal un article R. 645-14 créant une contravention de dissimulation du visage dans une manifestation.
En résumé, le régime est celui de la liberté avec un encadrement législatif minimal – la déclaration – et la possibilité d’aller plus loin, par l’interdiction, mais alors sur preuves, en fonction des circonstances étroitement évaluées, et dans les limites strictement nécessaires au rétablissement de l’ordre public.
Les termes de « proportionnalité » et de « strictement nécessaires » se retrouveront tout au long de mon propos. Ils peuvent paraître incantatoires mais ne le sont en réalité pas du tout. C’est justement parce que ce sont des concepts assez souples, qui peuvent s’incarner de différentes manières, qu’ils sont forts. Je ne suis pas un enthousiaste des régimes spécialisés, compartimentés, qui cassent ces grands principes.
Ma deuxième observation concerne, une fois que l’on a parlé de liberté, l’ordre public, une notion fondamentale pour le Conseil d’État puisque le juge administratif en est le gardien, ou le praticien, depuis la décision Benjamin du 19 mai 1933, bien connue des étudiants. Une mesure de police n’est pas normale : elle ne doit intervenir que pour imposer des contraintes strictement nécessaires au maintien de l’ordre public. Ce sont les conclusions du commissaire du gouvernement Corneille sur l’arrêt Baldy de 1917 : la liberté est la règle et la restriction de police l’exception.
Le Conseil constitutionnel, dans une convergence de jurisprudence avec le Conseil d’État, a déclaré objectif de valeur constitutionnelle la notion d’ordre public. L’objectif de valeur constitutionnelle n’est pas une règle, mais le Conseil constitutionnel indique par là au législateur et à ceux qui préparent les lois, dont le Conseil d’État quand nous sommes consultés conformément à la Constitution, que c’est aussi au regard de cet objectif qu’il dira si telle loi est constitutionnelle ou non.
Dans de nombreux propos sur l’ordre public, est citée la pensée de Max Weber selon laquelle l’État détient le monopole de la violence légitime. Mon avis est qu’il faut se préserver de cette phrase : l’État n’a pas à faire de la violence légitime. Le texte de la Déclaration des droits de l’homme parle de « force publique ». Que des actes de force soient nécessaires pour faire respecter l’ordre public, c’est un fait, mais la violence n’est pas un terme qui doit figurer dans les textes de l’État.
Selon la Déclaration des droits de l’homme, toute société a besoin, pour l’exercice des libertés, d’une force légitime. C’est d’ailleurs le même article qui crée l’impôt, car pour payer cette force légitime il faut une « contribution commune », et c’est un autre article sur l’impôt qui crée le Parlement, car voter l’impôt est la prérogative de ce dernier. Toute la construction se fait ainsi à partir de la force publique : ce n’est pas inintéressant pour une Commission qui s’intéresse à celle-ci.
La Cour européenne des droits de l’homme ne parle pas non plus de violence légitime mais de force légitime, notamment dans sa décision du 24 mars 2011 Giulani et Gaggio contre Italie, la grande décision sur le contrôle de la force proportionnée en vue de maîtriser une manifestation.
Cet ordre public est autoritaire puisque c’est une décision unilatérale qui encadrera une manifestation ou éventuellement l’interdira, et les autorités administratives assument ce pouvoir de police, mais il est en même temps négocié : il fait l’objet de discussions avec les citoyens auxquels les mesures restrictives s’appliqueront. Dans l’affaire relatée par la décision du tribunal administratif de Rennes du 31 décembre 2008 SNCF, les forces de l’ordre ont demandé aux manifestants qui souhaitaient interrompre la circulation des trains en Bretagne de bloquer le TER plutôt que le TGV.
La troisième observation, c’est que le contentieux de l’ordre public montre qu’il s’agit d’une activité à risque, à la fois pour les manifestants, quand la force utilisée est susceptible de leur causer des dommages, physiques et autres, pour les tiers, qui peuvent voir leurs biens détruits ou subir eux aussi des dommages physiques s’ils sont pris par hasard dans une manifestation, mais aussi – c’est un sujet dont j’ai traité dans plusieurs de mes écrits – pour les policiers.
Prenons un exemple, sans intérêt jurisprudentiel, mais qui montre bien ce qu’est le travail des hommes de la force publique qui ont à maîtriser des manifestations. Il s’agit d’un arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 16 mars 2004 concernant un fonctionnaire mécontent de ne pas avoir reçu une décoration pour un fait de courage, contrairement à deux de ses collègues. Voilà ce qui est dit : « Considérant qu’il ressort des pièces que les deux fonctionnaires – ceux qui ont reçu la décoration – appartenant à une compagnie républicaine de sécurité, présents sur les lieux dès l’origine de l’incident et qui ont bénéficié d’un avancement exceptionnel de deux échelons, faisaient directement face à l’individu en cause, que ce sont eux qui ont récupéré la goupille de la grenade auparavant jetée à terre par ce dernier et la lui ont rendue après l’avoir convaincu de la remettre en place ; qu’après avoir engagé une conversation avec l’intéressé, lui proposant de fumer une cigarette, ils lui ont proposé du feu et profité de cet instant pour récupérer la grenade et en recrocheter la goupille… » : ce n’est pas un feuilleton de TF1 mais une décision de juge administratif. Le troisième fonctionnaire fait valoir qu’il « assurait avec plusieurs collègues la protection rapprochée de l’opération, se trouvait lui aussi à une distance de moins de six mètres de l’individu et était en conséquence placé dans une situation de danger équivalente, eu égard à la nature de l’arme en cause qui présente un danger mortel à plus de vingt-cinq mètres autour du point d’explosion ». Le contentieux n’ignore pas que les fonctionnaires prennent des risques et ne savent jamais devant qui ils se trouveront ni à quelle violence ils auront à faire face.
Un deuxième exemple de ces mauvaises surprises de l’ordre public est tiré d’un arrêt du tribunal administratif de Caen du 28 mars 2013, Association Percy sous tension. Le préfet de la Manche commandait les forces de l’ordre au cours d’une manifestation bloquant l’accès à un château d’eau en opposition à une ligne à très haute tension en Normandie. Dans le bâtiment, les forces de l’ordre ont découvert entreposés un plan détaillé de l’emplacement des pylônes de la ligne THT, des disques à couper le métal, des liquides inflammables, du matériel d’escalade, du matériel électrique. Par ailleurs, le collectif anti-THT, dans la capture d’écran produite au dossier par l’administration, avait lancé comme mot d’ordre « Sabotons le chantier » : « ces éléments démontrent que l’occupation du château d’eau par l’association requérante avait un but autre que celui de permettre à ses membres de se réunir paisiblement ».
Je vous cite ces deux exemples, non pas pour dire que toutes les manifestations sont dangereuses, mais de manière à ce que chacun adopte un instant le regard des agents des forces publiques qui ont à respecter les instructions reçues en ne sachant pas du tout ce à quoi ils devront faire face. Le contentieux marque le courage quotidien de ces personnels.
Ma quatrième observation, c’est, inversement, le devoir de l’autorité civile de ne pas courir après les forces de l’ordre. On doit croire aux faits et non à la présentation des faits, et savoir si le compte rendu que l’on reçoit, ou son absence, présente la vérité ou non demande beaucoup d’expérience et de discernement.
Les autorités civiles ont intérêt à traiter les questions en amont. Je vous cite les paroles d’un expert de l’ordre public, Victor Hugo, dans Choses vues, qui pense qu’une foule immense va venir écouter sa lecture publique sur Les Châtiments. Il écrit : « On craint une foule immense, tous les faubourgs, plus de quatre-vingt mille hommes et femmes. Trois mille entreront. Que faire du reste ? » Une question pour l’école de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or : comment gérer la foule immense des mécontents qui ne pourront entrer ? Déjà au temps de l’empire romain, Ammien Marcellin a écrit des choses passionnantes sur la gestion des foules. Hugo poursuit : « Le gouvernement est inquiet. Il craint l’encombrement, beaucoup d’appelés, peu d’élus, une collision, un désordre. Il me demande si j’accepte cette responsabilité… Nous avons décidé que les trois mille places seraient distribuées dimanche, veille de la lecture, dans les mairies des vingt arrondissements, à quiconque se présenterait, à partir de midi. Chaque arrondissement aura un nombre de places proportionné au prorata de sa population. Le lendemain, les trois mille porteurs d’entrées feront queue à l’Opéra, sans encombrement et sans inconvénient. Le Journal officiel et des affiches spéciales avertiront le peuple de toutes ces dispositions, prises dans l’intérêt de la paix publique. » La source du trouble est ainsi traitée sans attendre que les 80 000 personnes se présentent.
Une société qui crée un appel d’air, par un spectacle ou une lecture publique, doit prendre sa part de responsabilité et discuter avec les autorités. Dans les faits rapportés par l’arrêt du tribunal administratif de Paris du 29 mai 2012, une société avait créé un tel appel d’air en organisant une distribution publique de billets de cinq euros. Je ne vous cache pas que je ne suis pas enthousiasmé – on a le droit de commenter les décisions de justice – par ce jugement du tribunal administratif, car j’aurais versé la responsabilité première sur cette société. Le jugement dit : « Il est effectivement constant que les organisateurs de la manifestation n’ont pas été en mesure de prévenir les débordements auxquels elle pouvait donner lieu par un dispositif de sécurité approprié », mais « il résulte de ce qui précède que les services de la préfecture de police ont eux-mêmes fait preuve de carence dans l’appréciation des désordres que cette manifestation était de nature à provoquer et se sont trouvés pris au dépourvu devant leur ampleur lorsqu’il s’est agi de les faire cesser, alors pourtant qu’ils avaient été mis en mesure, par le dépôt de déclaration de la société requérante effectué quatre jours auparavant, sinon de prévenir la situation, du moins de prévoir les moyens nécessaires pour y faire face. » Parfaite expression du devoir des forces publiques. Cependant, le tribunal administratif annule le titre de recouvrement que la préfecture de police avait émis à l’égard de la société, et c’est ce que je trouve sévère. J’ai cité ces deux exemples pour montrer qu’il faut traiter les choses en amont.
Tout responsable des forces publiques aura tendance à présenter un dispositif suréquipé par rapport à la réalité. Certains préfets l’ont même théorisé : il convient de montrer une force très lourde pour ne pas avoir à s’en servir. Les responsables doivent cependant en prendre et en laisser, et ne pas cautionner de manière automatique les dispositifs revendiqués par les techniciens.
Ma cinquième et dernière observation porte sur le principe de proportionnalité. L’ancêtre des codes de déontologie, le décret Joxe du 16 mars 1986 sur la police, prévoyait déjà, à son article 9, un usage de la force « strictement nécessaire et proportionné au but à atteindre ». Les ministres des gouvernements successifs ont, et c’est heureux, maintenu et renforcé ce code. Si le mot de « proportionnalité » ne figure pas dans l’arrêt Benjamin que j’ai cité, on le retrouve dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel comme dans celle de la Cour européenne des droits de l’homme.
Je terminerai par quelques mots de la responsabilité. Celle-ci suppose une analyse de la nature de la manifestation. La création de catégories juridiques est, je l’ai dit au début de mon propos, ce qui protège notre liberté. À chaque situation correspondent des mesures et des limites. L’attroupement, défini aux articles L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales et 431-1 du code pénal, est un bel exemple de catégorie juridique. Il s’agit d’une technique de socialisation du risque, faisant supporter à la société tout entière un risque particulier.
La responsabilité administrative comporte la responsabilité disciplinaire du policier ou du gendarme, ainsi qu’une forme de responsabilité civile de l’administration par le paiement d’indemnités. Il arrive que l’on puisse identifier suffisamment la personne à l’origine du dommage pour la faire payer. Dans les faits rapportés par la décision du tribunal administratif de Nantes du 22 novembre 2013, la FDSEA avait lâché dans Le Mans des dizaines de porcelets, ce qui avait occasionné des dommages. Une disposition du code rural indiquant que les animaux errants sont à charge de ceux qui les ont laissé errer, la FDSEA reçut une facture de récupération des animaux et de réparation des dommages causés. Au-delà de l’anecdote, qui peut prêter à sourire, il s’agit d’une question très importante : qui paye les dommages entraînés par la manifestation ?
Dans ce jugement de 2013, l’article 211-20 du code rural sert de base spécifique permettant la mise à charge, mais le plus souvent une telle base fait défaut. Un système de socialisation du risque a été conçu, l’attroupement, en vertu duquel la collectivité publique est responsable des dommages causés par tout rassemblement de personnes sur la voie publique susceptible de troubler l’ordre public. Ce dispositif est la source première des indemnisations versées aux personnes victimes, au cours de manifestations, de jets de grenades, coups de matraque, piétinements…
Comme dans tout système de responsabilité, une série de haies doivent être franchies avant qu’un manifestant victime d’agissements involontaires – si les agissements sont volontaires il s’agit de responsabilité pénale – de la police ou de la gendarmerie puisse recevoir une indemnité. Il faut tout d’abord respecter les délais. Dans un jugement de la cour administrative d’appel de Lyon du 9 juillet 2009, une victime de blessures dues à un tir tendu de grenade lacrymogène ne reçoit pas d’indemnités car elle a laissé courir les délais.
Il faut ensuite prouver qu’il s’agit d’une grenade et non d’un coup porté par une personne isolée : voyez à cet égard la décision de la cour administrative d’appel de Marseille du 10 décembre 2007.
Il faut montrer que la bille de plomb ayant frappé le manifestant représente une faute lourde des agents de police : voir l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 8 mars 2005 Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme. Une telle preuve n’existait pas pour la manifestation à Clichy qui a entraîné les conséquences que chacun connaît.
Il faut encore, une fois que les faits ont été établis, que les agissements de la victime n’exonèrent pas l’administration. Par exemple, il ne faut pas avoir été imprudent en restant sur les lieux malgré les sommations : arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 18 juillet 2006. Il vaut mieux ne pas avoir ramassé une grenade G4 alors que les forces de l’ordre tentent de se dégager : arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 13 décembre 1999. Même pour une grenade à effet de souffle, il faut parvenir à démontrer que l’administration a agi dans des conditions qualifiant la faute lourde, c’est-à-dire contraires soit aux ordres reçus soit aux modalités prévues dans le code de sécurité intérieure et le code pénal : arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 11 novembre 2012.
Mais le juge administratif, une fois que ces haies sont franchies, indemnise. L’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du 24 février 1994 confirme ainsi un jugement du tribunal administratif de Rennes indemnisant un manifestant victime de blessures à l’œil par une grenade lacrymogène lancée par les forces de l’ordre à Brest en 1991. De même, dans un autre arrêt, une personne est indemnisée pour amputation liée à une blessure grave par grenade lacrymogène lors de manifestations à Papeete le 23 octobre 1987.
Cependant, le juge tient compte du comportement de la victime, par exemple dans l’arrêt de la cour administrative d’appel du 29 décembre 1992 : « considérant toutefois qu’en demeurant près du pont de X. alors qu’il avait vu l’incendie qui sévissait dans cette zone et le caractère violent que prenaient les événements, et en se trouvant ainsi mêlé aux manifestants alors qu’après les sommations d’usage les forces de l’ordre procédaient à des tirs de grenades lacrymogènes, M. X a commis une imprudence de nature à exonérer l’État de sa responsabilité à hauteur de 50 %... »
Ainsi, le juge administratif place des haies de procédure, prend en considération le comportement de la victime, ce qui peut conduire à une diminution de l’indemnité, mais il indemnise, soit automatiquement dans le cas d’un attroupement ou d’une émeute, soit lorsque l’administration a commis une faute lourde.
M. Pascal Popelin, rapporteur de la Commission d’enquête. Le cadre juridique que vous venez de présenter, globalement libéral, vous semble-t-il adapté aux nouvelles formes de protestation telles que les zones à défendre (ZAD) et l’occupation de terrains privés ? Lorsqu’il s’agit de demander que cessent ces occupations, les procédures contentieuses sont relativement lourdes et longues. Parallèlement à ces procédures, un conflit s’installe sur le terrain dans la durée, qui justifie la présence prolongée de forces de l’ordre et donne parfois lieu, au moment de l’exécution des tardives décisions de justice, à des opérations de maintien de l’ordre. Ces problématiques ont été pointées dans le rapport de l’inspection générale de la gendarmerie nationale sur l’affaire Sivens. Les nouvelles formes de protestation n’ont pas encore été intégrées dans notre droit. Pensez-vous qu’il serait souhaitable d’envisager des procédures adaptées ?
Pour prévenir la participation de casseurs à des manifestations où leur présence n’est le plus souvent pas souhaitée, et est même déplorée, par les organisateurs eux-mêmes, que pensez-vous, ensuite, de l’introduction dans notre droit d’une mesure de police administrative qui viserait à empêcher un individu de participer à une manifestation ? Ce serait une mesure d’exception dont le législateur devrait définir précisément la cible, une mesure qui concernerait par exemple des personnes ayant déjà fait l’objet d’une condamnation pour des voies de fait dans le cadre de manifestations.
Nous avons beaucoup tâtonné sur les modalités de mise en œuvre. Quand un itinéraire a été retenu, il est assez fréquent que des contrôles d’identité soient réalisés sur l’itinéraire de la manifestation et les voies adjacentes. Pourrait-on envisager de notifier à certains individus une interdiction de pénétrer dans ce périmètre pendant la durée de la manifestation ? Serait-ce, selon vous, conforme aux libertés constitutionnelles ?
Enfin, selon quelle fréquence la responsabilité des agents de l’État, fonctionnaires de police ou militaires, est-elle mise en cause devant la justice administrative pour des faits survenus au cours d’opérations de maintien de l’ordre ? Quels sont les moyens le plus souvent invoqués pour engager de telles procédures ?
M. Noël Mamère, président. Considérez-vous que le droit français du maintien de l’ordre soit conforme à la Convention européenne des droits de l’homme ? L’État français a-t-il déjà été condamné par la Cour en raison de telles opérations ?
Pouvez-vous également préciser la procédure administrative préalable au dépôt d’une plainte à l’encontre d’un agent des forces de l’ordre en raison d’actes commis au cours d’une opération de maintien de l’ordre ?
Enfin, que pensez-vous de la création d’une autorité indépendante pour mener des enquêtes sur ces opérations ? Les inspections générales sont des institutions de contrôle interne. Ne gagnerions-nous pas en confiance vis-à-vis des forces de l’ordre avec la création d’une autorité indépendante ?
M. Christian Vigouroux. Je n’utilise pas le terme de ZAD. Ce n’est pas parce que les manifestants se qualifient d’une certaine manière que nous sommes obligés de reprendre leurs termes. Pour moi, les ZAD sont les zones d’aménagement différé des années soixante. Du côté des manifestants comme de celui des forces de l’ordre, on tire sur le vocabulaire, car le vocabulaire c’est le droit, la qualification juridique.
Je suis sensible à ce que vous dites, monsieur le rapporteur, sur les procédures rapides. C’est pour des considérations du même ordre que la loi de 2000 a créé la procédure de référé devant le juge administratif, qui sert beaucoup pour les interdictions de manifestations. La nécessité, en matière de libertés publiques, de procédures rapides existe pour le juge judiciaire et, depuis 2000, aux articles 511 et suivants du code de justice administrative, pour le juge administratif.
Les occupations de terrains privés ne sont toutefois pas un phénomène nouveau. La jurisprudence Couitéas du Conseil d’État, de 1923, sur le refus des autorités de mettre les forces de l’ordre à disposition du propriétaire qui avait pourtant obtenu un titre de justice, montre bien les difficultés, depuis des années, de l’application du droit en ce domaine. Une chose est d’obtenir un titre de justice pour récupérer son terrain – et la propriété est défendue par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen –, autre chose d’obtenir des autorités civiles la mise à disposition de la force publique pour réaliser l’évacuation, à cause de certaines circonstances. Le juge administratif a reconnu ce pouvoir d’appréciation à l’autorité civile, avec pour conséquence l’indemnisation du propriétaire pourvu d’un titre de justice.
Des procédures rapides ne seraient pas plus contraires que le référé administratif à la Constitution et à la Convention européenne des droits de l’homme. Il existe déjà des procédures particulières d’évacuation de terrains occupés : la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, revue le 5 mars 2007, a prévu des procédures de mise en demeure et d’évacuation. Il est vrai qu’elle a été en partie censurée par le Conseil constitutionnel en 2011, sur le chapitre de l’exécution forcée qui est le point sur lequel vous m’interrogez. Pour créer un dispositif législatif rapide, il faut donc ne pas perdre cette décision de vue ; c’est possible mais la voie est étroite.
S’agissant de la mise en cause de fonctionnaires pour des agissements au cours d’opérations de maintien de l’ordre, il y a deux ou trois affaires par an au Conseil d’État, vingt ou vingt-cinq devant les tribunaux et les cours d’appel.
En ce qui concerne l’interdiction individuelle de manifester, nous sommes dans un domaine très sensible car une telle restriction de la liberté d’aller et de venir est une version diluée de l’assignation à résidence, qui est elle-même une version diluée de la prison.
M. le rapporteur. Cela existe déjà dans le cadre de manifestations sportives. Certaines personnes sont contraintes de se présenter dans un commissariat au moment de l’admission dans le stade ; quand elles ont satisfait à cette obligation, les portes du stade sont fermées. Ou bien une pure et simple interdiction d’entrer dans le stade est prévue. Le cadre est un peu différent puisqu’il s’agit d’enceintes closes et qu’il est assez simple d’empêcher les individus d’y pénétrer, alors qu’une manifestation se déroule sur la voie publique, dans un espace non clos. Mais l’élément de privation de liberté existe.
M. Christian Vigouroux. Il faut prendre en compte le fait que cela a été tenté comme peine complémentaire et que le Conseil constitutionnel l’a validé en 1995. Le précédent sportif auquel vous faites allusion n’a pas non plus été déclaré inconstitutionnel, en 2011. C’est l’idée de faire pointer quelqu’un, plusieurs fois si la manifestation se répète, que j’appelle une assignation à résidence diluée.
M. le rapporteur. Ce n’est pas l’idée que j’ai à l’esprit. Si la personne pointe, cela ne lui prend pas assez de temps pour ne pas pouvoir se rendre ensuite à la manifestation. Quant à l’idée de retenir préventivement la personne, elle nous a paru excessive. Il s’agirait donc plutôt d’interdire l’accès à un périmètre défini ayant une base juridique dans l’arrêté pris par le préfet pour autoriser les contrôles d’identité. Si la personne est contrôlée dans ce périmètre, elle aura de fait commis une infraction.
M. Christian Vigouroux. Je n’y vois pas d’objection constitutionnelle, compte tenu des réponses du Conseil sur les deux versions existantes du dispositif. Que votre hypothèse soit une mesure administrative de police ou une décision prononcée par le juge, il faut que ce soit strictement défini. L’Allemagne s’est dotée d’un dispositif, validé par la Cour fédérale, qui exerce un contrôle très strict. Le Royaume-Uni également. Le législateur a une marge de manœuvre.
Les opérations de maintien de l’ordre, monsieur le président, ne sont pas le domaine où la France est le plus condamnée par la Cour européenne des droits de l’homme, ce domaine étant le milieu pénitentiaire, au titre des articles 2 et 3 de la Convention. En matière d’ordre public, il existe une demi-douzaine de condamnations de la France, dont la plus célèbre est l’arrêt Saoud contre France du 9 octobre 2007 pour une mort par asphyxie au moment d’une interpellation. Dans la condamnation Douet contre France de 2013, concernant des lésions suite à l’usage de bâtons télescopiques par les gendarmes qui ont procédé à l’arrestation de la personne alors que celle-ci avait adopté une attitude de résistance passive, la Cour analyse de très près les faits. Quand elle estime qu’il y a disproportion entre l’attitude du manifestant et les blessures subies, il lui arrive de condamner l’État. Dans l’arrêt Darraj contre France, le requérant a été conduit au commissariat pour un contrôle d’identité, ce qui peut arriver en fin de manifestation, et une fois isolé les policiers ont fait un usage disproportionné de la force à son endroit. En revanche, il n’existe pas, comme en jurisprudence administrative française, de jurisprudence déterminante sur l’usage des grenades, des flash-balls ou des Tasers.
Si la protection du fonctionnaire n’existe plus, le barrage au dépôt de plainte est souvent l’identification du fonctionnaire, la responsabilité pénale n’étant pas collective. La Cour européenne des droits de l’homme, dans ses deux arrêts célèbres contre l’Italie en 2011 et 2015, a reconnu que la responsabilité de l’État italien et la responsabilité pénale du fonctionnaire étaient très difficiles à mettre en œuvre dans la mesure où la police faisait bloc en affirmant que la personne responsable des gestes en cause, au sein de l’équipe d’intervention, n’était pas identifiée. Il faut donc le plus souvent porter plainte contre X. Ce sont les investigations pénales, souvent menées par l’inspection générale de la police nationale, qui détermineront l’identité de l’individu. Une procédure particulière qui faciliterait la plainte contre un agent de police n’existe pas.
M. Noël Mamère, président. Ne pourrait-on exiger que le nom de l’agent soit apparent sur son uniforme ?
M. Christian Vigouroux. C’est une autre question, largement débattue en France et dans plusieurs autres États. La position des gouvernements, en France, balance entre, d’une part, la nécessité, rappelée dans la loi de 2000 sur les relations entre l’administration et les usagers, de faire apparaître le nom des fonctionnaires, donc un principe général d’identification des fonctionnaires, et, d’autre part, des exceptions de plus en plus nombreuses, la dernière étant celle concernant les officiers de protection de l’OFPRA, dans la loi sur l’asile actuellement au Parlement. Afficher le nom des policiers lors d’interventions ne va pas de soi à mes yeux. Je ne sais pas, du reste, si cela faciliterait beaucoup la procédure pénale ; il faudrait que le manifestant ait une particulièrement bonne vue.
Enfin, la première autorité administrative indépendante, c’est selon moi l’autorité judiciaire, et je trouve que cela n’est pas assez rappelé. En tant que citoyen, je suis plus rassuré par l’autorité judiciaire que par des autorités indépendantes, qui restent malgré tout administratives. La police est déjà contrôlée par une autorité administrative indépendante qui est le Contrôleur des lieux de privation de liberté, par une autre AAI qui est le Défenseur des droits, par la justice et par son pouvoir hiérarchique. Je serais donc tenté de dire que c’est plus son commandement qui compte que la multiplication des contrôles. Une AAI n’est pas responsable devant le Parlement, contrairement aux ministres qui rendent compte de leur autorité devant cette institution. Je suis donc prudent sur le sujet, dans la ligne du rapport du Conseil d’État sur les autorités indépendantes et du rapport parlementaire de M. Dosière sur l’évaluation de ces autorités.
M. Noël Mamère, président. Merci.
*
* *
Audition, ouverte à la presse, de M. Jacques TOUBON, Défenseur des droits
(Compte rendu de l’audition du jeudi 16 avril 2015)
M. le président Noël Mamère. Nous vous remercions, monsieur le Défenseur des droits, d’avoir accepté de venir témoigner devant notre commission d’enquête parlementaire sur le maintien de l’ordre. Vous êtes la dernière personnalité que nous entendrons.
Avant de vous laisser la parole pour un exposé liminaire, conformément aux dispositions de l’article 6 de l’ordonnance du 17 novembre 1958, je dois vous demander de prêter le serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité.
(M. Jacques Toubon prête serment.)
M. Jacques Toubon. Notre mission étant de défendre les droits et les libertés fondamentales de tous, nous sommes particulièrement heureux d’intervenir devant votre commission d’enquête sur les modalités du maintien de l’ordre dans la République française, dans un contexte de respect des libertés publiques et du droit de manifester.
Avant de répondre à vos questions , je vais donner quelques indications sur le travail quotidien du Défenseur des droits dans le domaine qui vous intéresse.
Le Défenseur des droits, qui a succédé à la Commission nationale de déontologie de la sécurité (CNDS) en 2011, s’est vu confier quatre missions : la déontologie de la sécurité, les droits des enfants, la médiation avec les services publics, la lutte contre les discriminations. Alors que la CNDS était uniquement consultative et ne pouvait être saisie que par les parlementaires, le Défenseur des droits peut s’autosaisir ou être saisi directement.
Au départ, nous avons été surtout saisis d’affaires liées à l’usage de la force et des armes par des policiers ou des gendarmes, pour se défendre, évacuer un lieu, interpeller une ou plusieurs personnes, dans le cadre d’opérations de rétablissement de l’ordre : rassemblements sur la voie publique, violences urbaines, occupations de terrains, etc. Plus récemment, nous avons commencé à être saisis d’affaires relatives à des actions préventives des forces de sécurité dans le cadre du maintien de l’ordre : interpellations préventives, contrôles d’identité. Ces deux aspects – prévention et rétablissement de l’ordre – me semblent intéressants pour votre commission.
En 2014, nous avons été saisis de près de 700 demandes. Sur les 461 saisines en cours de traitement qui concernent la police et la gendarmerie, quarante dossiers sont liés à la thématique du maintien et du rétablissement de l’ordre. Une quinzaine de saisines, dans les dossiers que nous avons déjà traités, concerne l’usage d’armes – principalement les lanceurs de balles de défense (LBD) – lors d’opérations de maintien de l’ordre.
En matière de maintien et de rétablissement de l’ordre, le taux de suivi de nos recommandations est peu significatif, compte tenu du faible nombre d’affaires. En élargissant le champ à tous les dossiers relevant de la déontologie de la sécurité, nous constatons que nos conclusions sont suivies par les autorités compétentes dans environ 70 % des cas, ce qui tend à montrer que le rôle du Défenseur des droits peut être assez effectif. Si nos recommandations arrivent souvent longtemps après les faits, c’est parce que nous sommes extrêmement scrupuleux dans nos méthodes d’enquête : elles sont évidemment contradictoires, nous organisons des auditions, etc.
Dans le domaine des actions préventives, nous attendons la réponse du ministre de l’intérieur à la recommandation que nous lui avons faite à propos de la personne qui avait subi un contrôle d’identité et s’était vue confisquer un fanion de la Manif pour tous, lors du défilé du 14 juillet 2013.
Dans le domaine du rétablissement de l’ordre, le Défenseur des droits est généralement suivi dans ses demandes de poursuites disciplinaires à l’égard de l’auteur d’une violence illégitime ; il l’est beaucoup moins quand les demandes de poursuites disciplinaires visent le donneur d’ordre. En revanche, le Défenseur des droits a été suivi partiellement dans ses recommandations générales concernant les deux LBD qui posent la question de la doctrine du maintien de l’ordre. Nous réfléchissons à cette doctrine, au-delà des affaires pour lesquelles nous sommes saisis.
Dans les dossiers liés à l’usage de la force et des armes, les unités non constituées, telles que les brigades anti-criminalité (BAC), me semblent davantage mises en cause que les formations spécialisées dans le maintien de l’ordre. Cette impression, qui ressort de l’examen des saisines du Défenseur des droits et de la CNDS, mérite l’attention d’une commission comme la vôtre. Les personnels ne sont pas formés de la même manière et leur action n’est pas encadrée par le même régime juridique : les unités spécialisées obéissent à des règles particulières alors que les unités non constituées relèvent du droit commun.
Comme mon prédécesseur Dominique Baudis, je pense que le Défenseur des droits doit aller au-delà du traitement des demandes quotidiennes et participer à la réflexion sur la doctrine du maintien de l’ordre. J’en donnerai deux exemples.
Mon adjointe, la magistrate Claudine Angeli-Troccaz et la rapporteure de notre direction de la déontologie de la sécurité, Estelle Faury, ont visité le centre d’entraînement de la gendarmerie à Saint-Astier, comme plusieurs d’entre vous.
Surtout, nous avons engagé un travail de comparaison. En 2013, mon prédécesseur a réuni des représentants d’organismes de contrôle des activités de police, plus ou moins indépendants. Pour ma part, le 23 mars dernier, j’ai réuni des représentants d’une dizaine d’organismes dans un réseau baptisé Independent police complaints authorities network (IPCAN), autour de ce thème de réflexion. La question de la doctrine du maintien de l’ordre ne se pose pas qu’à la France mais à tous les pays comparables. Notre pays pourra encore mesurer son caractère international – qui s’est parfois révélé dans des circonstances tragiques – lors de la 21e conférence internationale sur le climat (COP 21) qui va se tenir à Paris.
Quelles problématiques posent les actions préventives des forces de l’ordre ? Nous nous sommes penchés sur cette question à l’occasion d’un dossier qui a donné lieu à une recommandation très commentée : dans le cadre des mesures préventives adoptées lors des cérémonies du 14 juillet 2013, une personne assistant au défilé militaire avait été soumise à un contrôle d’identité et s’était vue confisquer un fanion où figurait le logo du mouvement de la Manif pour tous. À la suite de la saisine de cette personne, nous avons pris position en novembre dernier.
Dans les périmètres contrôlés à l’occasion du défilé militaire du 14 juillet, le public était soumis à une interdiction générale, celle de détenir des banderoles, des affiches ou tout autre support de revendication. Quant aux forces de l’ordre, il leur était demandé de détecter, d’évincer et de signaler toute personne paraissant suspecte ou ne pas jouir de toutes ses facultés mentales. Nous avons estimé que cette interdiction générale et ces consignes n’étaient pas conformes à nos principes sur la liberté d’aller et venir, de manifester et de s’exprimer. Nous avons recommandé au ministre de l’intérieur de veiller à ce que le cadre juridique des contrôles d’identité fasse obligatoirement l’objet d’un rappel à l’occasion de la préparation des effectifs qui participent à la sécurité du défilé militaire du 14 juillet. Nous attendons la réponse du ministre.
Dans nombre de saisines, nous avons eu affaire à plusieurs types de pratiques que nous pouvons considérer attentatoires à la liberté d’aller et venir ou à la liberté d’expression. Ces pratiques, qui ont pour but d’empêcher une personne de se rendre sur les lieux d’une manifestation, prennent trois formes dont aucune ne repose sur un cadre légal. Dans certains pays, comme l’Allemagne ou la Belgique, les arrestations administratives existent et sont strictement encadrées sur le plan juridique. En Belgique, il faut que la personne, porteuse d’une arme ou équipée pour en découdre avec les forces de l’ordre, s’apprête à rejoindre la manifestation.
La première forme de ces actions préventives consiste à dissuader une personne de se rendre sur les lieux d’une manifestation, par exemple en lui rendant visite à son domicile. Nous avons été saisis d’un cas de ce type, où la personne était dissuadée de participer à une protestation contre la visite d’État d’un président.
La deuxième forme consiste à interpeller une personne puis à l’éloigner aux fins – officielles – de procéder à un contrôle ou à une vérification d’identité. Certaines saisines du collectif la Manif pour tous, pour lesquelles nous conduisons des investigations, relèvent de cette problématique : la procédure de vérification d’identité a-t-elle été détournée de sa finalité ? Certaines personnes ont été interpellées et emmenées au commissariat pour une vérification d’identité alors qu’elles étaient porteuses de documents d’identité qu’on ne leur avait même pas demandé de présenter.
Nous avons aussi eu à connaître de la retenue arbitraire d’un syndicaliste par une brigade de gendarmerie pendant toute la durée d’une visite du Président de la République – qui n’était pas François Hollande. Quant à mon prédécesseur, Dominique Baudis, il avait mis en cause les contrôles d’identité délocalisés appliqués aux migrants à Calais. Les contrôles se pratiquaient systématiquement au commissariat et après interpellation, afin, semble-t-il, de décourager les migrants de rester à Calais et ses environs.
Deux saisines en cours d’instruction concernent des contrôles d’identité de police administrative dits préventifs. Le tribunal de grande instance de Paris a prononcé l’annulation des gardes à vue des personnes interpellées dans ces conditions, considérant notamment que les contrôles d’identité n’étaient pas justifiés. Le Défenseur des droits a rédigé un premier rapport en 2012, à l’occasion du débat sur la délivrance d’un récépissé en cas de contrôle d’identité. Pour ma part, je réfléchis aux suites à donner aux conclusions du groupe de travail qui s’est penché sur l’article 78-2 du code de procédure pénale, notamment sur les dispositions relatives aux contrôles préventifs ou sur réquisitions du parquet.
Troisième forme d’intervention préventive dont le cadre légal nous paraît totalement incertain : celle qui consiste à priver plusieurs personnes de leur liberté de se mouvoir à proximité immédiate d’une manifestation, via un encerclement par les forces de l’ordre destiné à les empêcher de s’y rendre. Cette technique – encagement ou kettling – ne fait pas partie des enseignements légaux et, d’après ce que nous savons, elle n’est pas enseignée dans les écoles de police ou de gendarmerie. Elle a néanmoins été utilisée lors de la Manif pour tous et lors d’une manifestation organisée par la Ligue des droits de l’homme (LDH). Nous avons été saisis de cas de ce type.
La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), qui s’exprimait sur des faits survenus lors d’une manifestation organisée au Royaume-Uni, a rendu un arrêt qui semble autoriser cette technique. Dans l’avis circonstancié que je vous ferai parvenir, vous verrez qu’il faut toutefois interpréter cet arrêt avec prudence, tant il semble s’appliquer aux circonstances très particulières de ladite manifestation. De manière plus générale, il faut s’interroger sur la conformité de cette pratique aux principes des droits fondamentaux.
Nous devons aussi nous poser une autre question : les moyens préventifs employés sont-ils en adéquation avec les risques réels de trouble à l’ordre public présentés par les participants à un mouvement ? De nombreuses réclamations nous parviennent où sont dénoncées des opérations de maintien de l’ordre jugées inutiles ou excessives, notamment lors de manifestations pacifiques ne faisant craindre aucun trouble à l’ordre public. Cet argument a été soulevé, par exemple, à propos des veilleurs et des mères veilleuses s’opposant au mariage pour tous. Les considérations de droits fondamentaux doivent être appréciées avec beaucoup de finesse, ce que nous essayons de faire.
Après les actions préventives, venons-en aux opérations de maintien de l’ordre. Depuis la création du Défenseur des droits, un nombre non négligeable de saisines porte sur la manière dont les policiers et gendarmes font usage de la force afin de rétablir l’ordre public, et sur les risques qui en découlent à la fois pour manifestants et pour les forces de sécurité. Ces dossiers concernent divers types d’interventions : dans des manifestations organisées, en marge de manifestations, lors de rassemblements spontanés, au cours de violences urbaines, dans le cadre d’occupations de terrains.
Au fil des dossiers, traités ou en cours, nous avons identifié deux problématiques principales : l’usage des armes de force intermédiaire ; la loyauté de la rédaction des comptes rendus et des procès-verbaux relatifs à l’usage de la force. En mai 2013, Dominique Baudis a rendu un rapport sur les trois moyens de force intermédiaire : le pistolet à impulsions électriques taser X26, et deux LDB communément appelés Flash-Ball superpro et LBD 40-46. Ce rapport comprend de nombreuses recommandations dont certaines concernent le maintien de l’ordre.
De manière générale, nous avons fait part de nos préoccupations concernant l’usage de ces LDB, la première étant liée à l’imprécision des trajectoires du Flash-Ball superpro. Cette imprécision rend inefficaces les conseils d’utilisation théoriques et la formation dispensée : quel que soit le soin du tireur, la balle peut prendre une trajectoire différente de celle qu’il voulait lui donner.
Or les dommages causés par ces armes de force intermédiaire peuvent être graves et irréversibles. En mai 2013, nous avions recommandé de ne pas utiliser le Flash-Ball superpro lors de manifestations sur la voie publique où, par définition, les gens sont en mouvement. Nous avions recommandé de le réserver à des cas très exceptionnels à définir strictement. Le Défenseur des droits avait aussi demandé que l’on fasse figurer explicitement l’imprécision de cette arme dans le cadre d’emploi, afin que les agents qui l’utilisent aient toujours à l’esprit le fort risque collatéral d’atteindre une autre personne que celle visée.
Concernant l’usage du taser X26, le Défenseur des droits n’a jamais été saisi de cas liés à son utilisation lors d’opérations de maintien de l’ordre, mais son emploi est désormais interdit dans ce cadre pour les unités spécialisées de la police et de la gendarmerie. Il peut toujours être utilisé par des unités telles que les BAC lorsqu’elles procèdent à des interpellations. L’achat d’armes de force intermédiaire non munies de dispositifs d’enregistrement vidéo et sonores, annoncé par le ministre de l’intérieur, nous préoccupe. Pour notre part, nous avions recommandé un enregistrement systématique pour de telles armes.
Qu’en est-il de la loyauté de la rédaction des comptes rendus et des procès-verbaux relatifs à l’usage de la force qui figurent dans les procédures ? Dans le traitement de nos dossiers, nous faisons face à un problème récurrent : une absence de rigueur dans la rédaction du compte rendu dès qu’il y a utilisation de la force. Ce manque de rigueur peut conduire, notamment dans le cas de manifestations où les protagonistes sont nombreux, à l’impossibilité d’établir qui est l’auteur d’un tir. Il complique aussi le contrôle des opérations a posteriori, tant par la hiérarchie que par les inspections générales.
Dans plusieurs dossiers, le Défenseur des droits a recommandé l’engagement de poursuites disciplinaires pour manque de loyauté à l’encontre de fonctionnaires de police qui avaient omis de signaler l’usage de la force ou qui l’avaient mentionnée de façon inexacte dans les procès-verbaux. Ces insuffisances peuvent contribuer à jeter le discrédit sur l’ensemble des déclarations d’un fonctionnaire qui relate la manière dont il est fait usage de la force au cours d’une intervention. Les règles doivent donc être suffisamment encadrantes et strictes, notamment en matière de rédaction des procès-verbaux, pour qu’il ne puisse y avoir aucune suspicion sur la bonne foi de ceux qui sont interrogés.
Je vais maintenant répondre aux questions que vous m’avez transmises et qui sont très importantes notamment sur le plan juridique.
Quelle est l’effectivité des enquêtes et des recours juridictionnels dans les affaires liées au maintien de l’ordre ? S’agissant des enquêtes, d’une manière générale, nous avons des difficultés à traiter les saisines lorsqu’il y a simultanément des enquêtes judiciaires. D’une manière plus spécifique, se pose la question du rôle de l’autorité civile, c’est-à-dire du préfet en tant que donneur d’ordre. Dans notre pays, le maintien de l’ordre est clairement une décision à caractère politique.
Dans nombre d’affaires qui nous sont soumises, les forces de l’ordre n'ont pas décidé seules de recourir aux techniques d’interpellation préventives ou à l’usage des armes. J’ai rappelé l’instruction donnée pour le défilé du 14 juillet 2013, dont le caractère général nous semblait porter atteinte aux droits fondamentaux, ou l’évacuation des veilleurs et mères veilleuses.
De ce contexte du maintien de l’ordre, où l’autorité civile donne les instructions, et particulièrement lorsqu’il s’agit d’actions préventives, nous avons des difficultés à obtenir certains documents ou à remonter la chaîne de commandement. Lors de nos enquêtes, nous entendons tous les protagonistes puisque, je le rappelle, nous pratiquons systématiquement une procédure contradictoire. Et la question récurrente est celle-ci : existait-il ou non un ordre ? Nous nous heurtons évidemment au problème des consignes orales qui existent dans bien d’autres domaines. En matière judiciaire, par exemple, les policiers peuvent recevoir la consigne orale de ne plus contacter le parquet à partir d’une certaine heure pour les levées de garde à vue.
Généralement, il est possible de retrouver une conversation radio entre deux membres de force de l’ordre, mais certains échanges ne passent pas par la radio. Tout ordre donné concernant le déroulement d’une opération de maintien de l’ordre, comme toute modification ultérieure de cet ordre, ne devrait-il pas faire l’objet d’un écrit, même succinct, afin que la chaîne de responsabilité puisse être établie en cas contestation ?
Réfléchissons en élargissant nos horizons à d’autres pays. Sans parler des pays anglo-saxons, nous constatons qu’en Belgique, par exemple, ce n’est pas l’autorité civile qui décide de la stratégie de maintien de l’ordre à mettre en œuvre. Les autorités de police consultent les autorités civiles locales mais elles prennent la décision et assument les responsabilités qui en découlent. La doctrine française est-elle la bonne ? Nous nous posons la question de manière pragmatique au vu de nos dossiers.
Quelle est l’effectivité des recours juridictionnels dans les affaires liées au maintien de l’ordre ? Tant sur le plan administratif que pénal, la répression a tendance à se concentrer sur celui qui exécute l’ordre de priver un manifestant de sa liberté ou de faire usage de la force. Le responsable hiérarchique direct, qui a donné l’ordre, et l’autorité, qui a décidé du mode d’action général de l’opération, ne sont pas systématiquement inquiétés.
Prenons l’affaire récente d’utilisation de Flash-Ball à Montreuil-sous-Bois. Le policier qui a tiré a fait l’objet de poursuites et il vient d’être condamné, alors que le supérieur qui l’avait autorisé à tirer n’a pas été inquiété. Nous devons nous interroger sur le partage de la responsabilité entre l’autorité civile et l’autorité policière, et, à l’intérieur de cette dernière, entre le donneur d’ordre et celui qui l’exécute.
En cas de poursuites pénales, ce sont le plus souvent des peines d’emprisonnement avec sursis qui sont prononcées. Prenons deux cas de mutilations provoquées par des lanceurs de balles de défense.
En octobre 2011, lors des émeutes contre la vie chère à Mayotte, un garçon de neuf ans a été très grièvement blessé à Longoni, par un tir de Flash-Ball. En 2012, le Défenseur des droits a établi que l’usage de l’arme n’avait pas été conforme au cadre d’emploi et que son utilisateur n’était pas en état de légitime défense. Le gendarme a fait l’objet d’un blâme sur le plan administratif, et il vient d’être condamné par la cour d’assises de Mamoudzou à deux ans de prison avec sursis pour violences ayant entraîné une mutilation et une infirmité permanente sur mineur de moins de quinze ans. Nous n’avons pas l’intention de nous immiscer dans le fonctionnement de la justice et de commenter ses décisions qui ont l’autorité de la chose jugée, mais celles-ci colorent le sujet dont vous êtes chargé.
En 2010, un adolescent de seize ans avait été blessé au visage par un tir de LBD 40-46 lors d’une manifestation lycéenne sur la réforme des retraites. Le Défenseur des droits a rendu sa décision en 2012. Au moment du tir, les policiers n’essuyaient pas un jet nourri de projectiles et ils n’étaient pas encerclés, contrairement à ce qu’ils avaient déclaré. À ce moment-là, l’adolescent déplaçait une poubelle et ne s’apprêtait pas à lancer un projectile sur les policiers. En conséquence, le Défenseur des droits a recommandé que des poursuites disciplinaires soient diligentées à l’encontre du tireur et aussi de son supérieur hiérarchique qui avait estimé que la situation permettait le recours à cette arme. Le tribunal de Bobigny a condamné l’auteur du tir à un an de prison avec sursis, deux ans d’interdiction de port d’arme et un an d’interdiction d’exercer.
La jurisprudence de la CEDH peut aider à établir une proportionnalité entre les condamnations et les faits. Selon la CEDH, « les instances judiciaires internes ne doivent en aucun cas être disposées à laisser impunies des atteintes graves à l’intégrité physique et psychique des personnes, par exemple, en prononçant contre les agents responsables des peines minimales ou dérisoires avec sursis, sans jamais leur infliger de sanctions disciplinaires, ou en se cantonnant à l’accusation de négligence, sans tenir compte de la dimension d’atteinte à la vie. » Dans des affaires contre la Bulgarie ou contre la Turquie, la Cour a rappelé que la force dissuasive du système pénal devait être parfaitement mesurée.
Il existe un recours judiciaire fondé sur l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire, relatif au fonctionnement défectueux du service public de la justice. Lorsque la personne est objet de l’opération de police judiciaire, elle doit démontrer l’existence d’une faute lourde. Quand les personnes sont des tiers par rapport à l’opération de police judiciaire, la jurisprudence admet que la responsabilité de l’État puisse être engagée pour risque et non pas uniquement pour faute lourde. On peut se demander si l’exigence de la faute lourde répond au critère du recours effectif. C’est l’une des questions que le Défenseur des droits a posée récemment à la cour d’appel de Paris dans le cadre d’un recours fondé sur l’article L.141-1, au sujet de ce que l’on appelle les contrôles d’identité au faciès. Ce recours, le seul ouvert sur le plan judiciaire, répond-il aux exigences de la jurisprudence de la CEDH ?
Il est possible de mettre en cause la responsabilité de l’État devant le juge administratif. On peut ainsi rechercher la responsabilité sans faute de l’État pour des dommages résultant de manifestations ou d’attroupements et des mesures prises par l’autorité publique pour rétablir l’ordre. Dans un arrêt rendu le 17 décembre 2013, le tribunal administratif de Paris s’est prononcé en faveur de l’indemnisation d’une personne blessée par un tir de Flash-Ball, lors d’une manifestation qui s’était déroulée le 21 juin 2009 sur la place de la Bastille à Paris.
On peut aussi rechercher la responsabilité sans faute de l’État, liée aux risques spéciaux créés par l’utilisation d’armes par les forces de l’ordre vis-à-vis de tiers. Une vieille jurisprudence de 1949, Lecomte et Daramy, a été réactivée en 1991. Le Conseil d’État a estimé que, lorsque les victimes de mutilations provoquées par ces armes sont des personnes visées par l’opération de police, la responsabilité de l’administration est engagée à partir de la démonstration d’une faute simple.
Les décisions de 1949 et 1991 valaient pour l’utilisation d’armes à feu, mais le tribunal administratif de Nice vient d’appliquer cette jurisprudence à une affaire résultant d’un tir de Flash-Ball. Dans un jugement du 28 octobre 2014, le tribunal administratif de Nice a considéré que « eu égard au caractère imprécis et à la puissance de cette arme et à sa puissance, un lanceur de balles de type Flash-Ball pro doit être regardé comme comportant des risques exceptionnels pour les personnes et les biens. »
J’en déduis que la responsabilité de l’État va être de plus en plus souvent engagée dans le cas d’usage de la force, notamment des armes de force intermédiaire. En septembre 2014, le ministre de l’intérieur avait pris une circulaire sur l’utilisation de ces armes, qui est insuffisante par rapport à nos recommandations de 2013. Je vais aussi entreprendre un travail d’actualisation qui pourra être utile à l’État et notamment aux forces de sécurité et faire une nouvelle recommandation. L’État doit impérativement encadrer ces pratiques s’il ne veut pas prendre des risques contentieux considérables.
En ce qui concerne l’effectivité de l’enquête, je voudrais ajouter qu’il existe des règles européennes. La CEDH impose aux États des obligations positives : pour qu’une enquête puisse être qualifiée d’effective, elle doit répondre à certains principes essentiels dont l’indépendance des autorités d’enquête : « Il est indispensable que les personnes responsables de l’enquête et celles effectuant les investigations soient indépendantes de celles qui sont impliquées dans les événements. Cela suppose non seulement l’absence de tout lien hiérarchique ou institutionnel, mais également une indépendance pratique. »
La CEDH a estimé que l’indépendance du ministère public en tant que superviseur d’enquête ne saurait être mise en cause du seul fait que la police impliquée se trouvait sous ses ordres, tout en précisant qu’il eût été préférable que l’enquête fût supervisée par un autre membre du ministère public, un autre procureur. Elle a considéré que le degré d’indépendance était suffisant, notamment parce qu’il existe aussi une possibilité de contrôle par un tribunal judiciaire indépendant.
S’agissant de la régularité des enquêtes diligentées par des services d’inspection internes, la CEDH s’est prononcée sur l’affaire Guerdner, le 17 avril 2014. Elle a jugé que les services de l’Inspection générale de la gendarmerie nationale (IGGN) possèdent une « indépendance suffisante » : « La Cour observe que cette inspection a une compétence nationale, indépendante des formations qui composent la gendarmerie, et elle possède sa propre chaîne de commandement. »
Dans le cadre d’une enquête sur une allégation d’homicide illicite commis par un agent de l’État italien, la CEDH a aussi jugé en 2011 que le recours à l’expertise des forces de l’ordre possédant une compétence particulière mais appartenant au même corps que la personne impliquée n’est pas inéluctablement incompatible avec l’exigence d’impartialité.
Au regard de cette jurisprudence, le système qui existe en France me paraît à même de respecter les exigences européennes.
J’en viens, en quelques mots, à nos relations avec les autorités.
Nous manquons de données sur les sanctions prises et sur la nature des faits sanctionnés à la suite de nos recommandations : les autorités nous répondent qu’aucune centralisation de ces données n’est effectuée par les corps d’inspection ou le ministère de l’intérieur. Dans un souci de transparence, il serait pourtant impératif de savoir quelles sanctions sont infligées aux fonctionnaires de police ou les militaires de la gendarmerie et pour quels faits.
Nous avons de très bonnes relations avec les institutions de contrôle, que ce soit l’inspection générale de la police nationale (IGPN) ou l’IGGN. Les délais de réponses et la disponibilité des interlocuteurs du Défenseur des droits dans ces deux corps d’inspection sont très satisfaisants. Nous avons aussi des partenariats avec ces maisons : nous sommes membres du comité d’orientation de l’IGPN, par exemple, et nous sommes associés à certains de ses travaux. Pour notre part, nous associons les inspections à nos groupes de travail sur ces questions. Dans certains pays, des équipes communes d’enquête rassemblent les représentants d’un corps de contrôle indépendant comme le nôtre et ceux des corps internes d'inspection. Ce n’est pas le cas en France.
Je pourrais parler du caractère très difficilement compréhensible des différentes sommations. Il y a peut-être une question à se poser.
Pour terminer, je voudrais revenir sur les armes de force intermédiaire non équipées de vidéo. Dans les comptes rendus de vos précédentes auditions, j’ai noté que la captation de l’image était très controversée. Pour notre part, nous pensons qu’elle est très utile dans les enquêtes relatives aux actions des manifestants comme aux actions des forces de l’ordre. Après la CNDS, nous avons eu à connaître d’affaires concernant la confiscation ou la détérioration d’images prises par des manifestants, en violation d’une circulaire de 2006. Mais nous sommes aussi favorables au développement de la captation d’images par les forces de l’ordre.
En Allemagne et en Belgique, les camions lanceurs d’eau sont dotés de caméras permettant de filmer une manifestation sous différents angles. En France, les escadrons de gendarmes mobiles sont en cours de dotation de caméras GoPro, ce qui nous semble très positif. À condition qu’elles soient utilisées dans un cadre légal, les images pourraient être d’une utilité certaine pour les services de renseignement, en aidant au repérage, à l’identification et à l’interpellation des fauteurs de troubles qui sévissent lors d’une manifestation ou un peu plus tard.
Les travaux que nous conduisons avec certains de nos homologues étrangers du réseau IPCAN sont extrêmement instructifs, notamment quand il s’agit de répondre à la question suivante : peut-il exister un modèle européen de doctrine du maintien de l’ordre qui corresponde à nos valeurs et soit notamment très différent du modèle américain ? Nos échanges font apparaître des différences de culture. Alors que la police allemande utilise le canon à eau de manière systématique, le trouvant très efficace, une telle pratique fait débat en Grande-Bretagne. Le chef de la police municipale de Londres indique qu’il n’est pas encore autorisé à utiliser les quelques canons à eau acquis d’occasion. En France, nous en avons utilisé à une époque mais nous ne le faisons plus.
Cette question de la doctrine de maintien de l’ordre est essentielle pour l’harmonie et la paix dans nos sociétés. Le Défenseur des droits, à sa place, peut aider le Parlement à l’élaborer.
M. le président Noël Mamère. Monsieur le Défenseur des droits, votre intervention, qui a duré une heure, a été très largement supérieure à celles que nous avons entendues jusqu’à présent. Merci d’avoir brossé ce tableau et d’avoir formulé quelques recommandations. La parole est maintenant à notre rapporteur.
M. Pascal Popelin, rapporteur. Monsieur le Défenseur des droits, vous avez été extrêmement exhaustif, ce qui laisse peu de temps à l’échange – qui est quand même un peu le principe dans ce type de commission. Je vais donc centrer mes questions sur deux points importants : l’usage des moyens de force intermédiaire ; les actions préventives.
Commençons par l’utilisation de moyens de force intermédiaire dans les opérations de maintien de l’ordre. Le paradoxe est que les unités spécialement dédiées au maintien de l’ordre – compagnies républicaines de sécurité (CRS) ou escadrons de gendarmes mobiles – ne sont pas dotées de tasers et de Flash-Ball. Ces armes sont néanmoins utilisées dans certaines opérations de maintien de l’ordre par des forces qui en sont dotées et qui ne sont pas spécialisées dans le maintien de l’ordre.
Nous interrogeons nombre des sources divergentes, afin de voir si les informations recueillies sont, elles, convergentes. À ce stade, nous avons le sentiment que les accidents ne résulteraient pas de l’usage du LDB 40 par les unités spécialisées dans le maintien de l’ordre, mais qu’ils seraient plutôt liés à l’emploi d’autres moyens de force intermédiaire par des unités non spécialisées qui interviennent ponctuellement dans des opérations de maintien de l’ordre. Qu’en pensez-vous ?
Quant à l’usage du taser, du Flash-Ball ou du LDB en dehors des opérations de maintien de l’ordre, il sort hors du champ de notre commission et des recommandations qu’elle pourrait être amenée à faire.
Aux forces spécialisées dans le maintien de l’ordre, j’ai posé la question suivante : dans quelles circonstances pouvez-vous être amenés à utiliser ce type de moyen de force intermédiaire puisque vos interventions reposent normalement sur le maintien à distance et la gestion de foule de manière collective ? La réponse qui m’a été faite ne doit pas être écartée d’un revers de main. Quand il est utilisé par un agent dûment habilité et formé à s’en servir, sur l’instruction précise d’une hiérarchie bien organisée et dans un cadre qui est statistiquement rare, cet outil peut nous permettre de neutraliser un individu qui envoie des projectiles, bouteilles d’acide ou engins explosifs sur les forces de l’ordre, m’a-t-on répondu.
Du point de vue de la doctrine, l’emploi de ce type de matériel n’est donc pas à écarter totalement, à condition de respecter le protocole. En ayant en tête la recommandation n° 6 de votre rapport, je voulais vous poser la question suivante : ne pensez-vous pas qu’il faudrait, pour les opérations de maintien de l’ordre, autoriser l’usage de ce moyen aux seuls CRS et gendarmes mobiles ? À ma connaissance, son utilisation par ces forces spécialisées n’a pas provoqué d’atteinte à l’intégrité physique de manifestants.
Venons-en aux actions préventives. De nos auditions – que nous avons commencées début janvier et que nous terminons par vous – il ressort d’une manière assez convergente que les manifestations attirent des individus qui n’ont strictement rien à voir avec les organisateurs, l’état d’esprit des participants ou les mots d’ordre lancés. Comment prévenir ce type de participation qui perturbe tout le monde ? Pour des manifestations sportives, des dispositions ont été trouvées qui ont fait leurs preuves, notamment les interdictions de stade. L’exercice est plus compliqué quand il s’agit d’un événement qui se déroule sur la voie publique et qui suppose le respect de certains principes comme celui de la liberté d’aller et venir.
Certaines actions de prévention qui sont menées actuellement n’ont pas de bases légales, nous avez-vous indiqué. Il y a donc un vide juridique. Pensez-vous que nous pouvons trouver un moyen juridique d’empêcher quelqu’un de participer à une manifestation, qui soit compatible avec le respect des droits fondamentaux que vous avez pour mission de défendre ? Au fil des auditions, nous avons entendu des propos parfois divergents sur le sujet.
Dans mon esprit, une telle disposition législative devrait viser un public strictement défini, par exemple des personnes ayant déjà fait l’objet d’une condamnation définitive liée à leur comportement dans une manifestation. Il faudrait évidemment définir le niveau de gravité des faits et de la condamnation antérieurs.
Pour ma part, je ne crois pas au pointage au commissariat. Quant à la rétention préventive, c’est une mesure privative de liberté. Cela étant, l’autorité civile prend des dispositions concernant l’itinéraire des manifestations ; elle autorise des contrôles et des vérifications d’identité dans le périmètre concerné. Ne pourrait-on pas envisager une mesure d’interdiction administrative, notifiée préalablement à des personnes précisément ciblées ? Celles-ci s’exposeraient à des sanctions – à définir – dans le cas où elles enfreindraient l’interdiction de se rendre sur les lieux de la manifestation aux heures indiquées. Pensez-vous qu’une telle disposition serait compatible avec le respect des droits fondamentaux et des libertés individuelles ?
M. le président Noël Mamère. Il se trouve que je n’ai pas tout à fait la même approche que M. le rapporteur sur les deux questions qui viennent de vous être posées, notamment sur ce que l’on appelle les moyens de force intermédiaire.
Dans sa recommandation n° 6, votre prédécesseur s’était d’ailleurs prononcé de manière assez claire sur l’interdiction de ces moyens, qu’il s’agisse des tasers, des Flash-Ball ou des LDB 40-46. Je suis d’autant plus favorable à cette option que le groupe auquel j’appartiens avait déposé une proposition de loi sur l’interdiction des Flash-Ball et des tasers, sous l’ancienne législature. Des manifestants que nous avons auditionnés ont été blessés de manière irréversible par le LDB 40 utilisé par des forces de maintien de l’ordre formées à leur usage.
M. Pascal Popelin, rapporteur. Des gendarmes mobiles ou des CRS ?
M. le président Noël Mamère. Par des gendarmes mobiles, la preuve en a été apportée au cours des témoignages.
M. Pascal Popelin, rapporteur. Très franchement, je ne pense pas que c’était le fait de ces unités-là.
M. le président Noël Mamère. Je suis d’accord pour que le doute soit instillé dans ma question, mais on peut très bien imaginer que les unités constituées ne puissent pas être dotées de LBD 40-46 – pas plus que de tasers et de Flash-Ball – pour pratiquer le maintien de l’ordre. D’ailleurs comme vous l’avez souligné, monsieur le Défenseur des droits, et comme nous l’avons vu avec M. le rapporteur et les commissaires présents, il y a moins de problèmes lors d’opérations de maintien de l’ordre avec des gens formés que lors d’opérations de sécurité publique.
À ce propos, pensez-vous que les poursuites engagées contre les membres des forces de l’ordre, pour des actes qui sont commis dans l’exercice de leurs fonctions, en particulier lors d’une opération de maintien de l’ordre, peuvent être considérées comme équitables au regard de la Convention européenne des droits de l’homme ? La procédure de saisine préalable du corps d’inspection concerné constitue-t-elle un filtre utile ou, au contraire, restreint-elle abusivement les poursuites ? Quand on regarde les résultats de toutes les actions judiciaires ou administratives qui ont été menées, on constate que nombre d’affaires sont classées sans suite ou se terminent par des condamnations très légères.
Quel est l’état des relations entre le Défenseur des droits et les organismes internes d’inspection, l’IGGN et l’IGPN ? Selon vous, ces organismes internes d’inspection sont-ils toujours utiles ? Est-il toujours sain que le contrôleur soit aussi le contrôlé ? Ne faudrait-il pas leur substituer une autorité indépendante ?
En matière de prévention, je n’ai pas non plus la même approche que M. le rapporteur. Pour ma part, je ne vois pas de justification à imposer une forme de rétention à des gens qui seraient soupçonnés de vouloir participer à une manifestation. On ne peut pas comparer ce qui se passe dans les stades, des lieux fermés, avec des manifestations. Notre commission d’enquête parlementaire se penche sur le maintien de l’ordre dans le cadre du droit à manifester et la liberté d’expression.
Monsieur le Défenseur des droits, je retiens vos comparaisons notamment avec la Belgique. Je retiens aussi toutes les observations que vous avez pu faire, notamment à propos de la retenue d’un syndicaliste par une brigade de gendarmerie pendant toute la durée d’une visite présidentielle, ou à propos de la technique d’encagement, une espèce de dérive qui ne me semble pas correspondre à la doctrine fixée par nos institutions sur le maintien de l’ordre.
M. Boinali Said. Monsieur le Défenseur des droits, à la fin de votre exposé vous avez appelé de vos vœux une réflexion sur un modèle européen de doctrine de maintien de l’ordre. Quelle place peut être faite à la médiation ? Ne pourrait-on l’intégrer dans les solutions préventives afin d’atténuer la montée des radicalités ?
M. Pascal Demarthe. Dans le cadre du maintien de l’ordre, il est important d’affirmer et de préciser la notion de force légitime. Dans une situation d’urgence, à risques avérés face à des individus dangereux et infiltrés à l’insu des organisateurs, les forces de l’ordre peuvent en venir à une certaine forme de violence dont la légitimité peut se comprendre. Selon vous, la responsabilité des organisateurs est-elle dans tous les cas engagée, toute analyse des causes de la situation ayant été impossible ou tout au moins difficile ?
M. Daniel Vaillant. Nous tenons tous à la liberté de manifester mais il existe diverses formes de manifestations : certaines sont déclarées et encadrées ; d’autres sont interdites et elles engendrent des débordements quand elles ont lieu malgré tout. Il est des lieux, tels que les Champs-Élysées ou les abords de l’Élysée, qui font l’objet d’une interdiction de manifester systématique. Qu’en pense le Défenseur des droits ? Est-ce que cette caractéristique donne le droit aux forces de l’ordre d’aller au contact pour empêcher certaines personnes de passer outre et d’y manifester ?
Lors du défilé du 14 juillet 2002, un militant d’extrême droite avait tiré sur le président Chirac. Il a purgé sa peine mais si on le retrouve dans ce type de manifestation, compte tenu de son passif, ne peut-on pas l’éloigner, le retenir pour éviter une éventuelle récidive ? J’aimerais que le Défenseur des droits nous donne son sentiment sur cette question des fauteurs de troubles potentiels.
M. le président Noël Mamère. J’avais une dernière question à laquelle vous n’êtes pas obligé de répondre : avez-vous été saisi après le drame qui s’est produit à Sivens ?
M. Jacques Toubon. La mort de Rémi Fraisse est survenue le 26 octobre et je me suis saisi d’office de cette affaire au mois de novembre. En cas d’autosaisine, nous devons obtenir l’autorisation des ayants droit – en l’occurrence nous avons obtenu celle des parents de Rémi Fraisse – et celle du procureur. Nous faisons notre travail et le juge d’instruction de Toulouse a commencé à nous envoyer certaines pièces du dossier.
Il ne s’agit pas de mener une deuxième enquête judiciaire. Mais cet événement à la fois terriblement douloureux et très complexe, comme le montrent les rapports administratifs, peut alimenter notre réflexion sur la doctrine du maintien de l’ordre. En France comme en Europe, certaines situations posent indiscutablement des problèmes nouveaux dans ce domaine.
Monsieur le rapporteur, s’agissant des cas d’utilisation de moyens de force intermédiaire dont nous avons été saisis, je n’ai pas ici le décompte précis de la répartition entre ceux qui étaient le fait de personnels d’unités spécialisées ou d’autres. Pour autant, je vous confirme que, dans la majorité de ces cas, les personnels concernés n’appartiennent pas à des unités de maintien de l’ordre patentées. Pour participer à la petite discussion que vous avez eue avec le président, je signale que quelques unités de gendarmerie mobiles possèdent des LDB.
M. Pascal Popelin, rapporteur. Des LDB oui, mais pas des tasers ou des Flash-Ball !
M. Jacques Toubon. C’est cela.
Quant à votre question sur les catégories de policiers ou de gendarmes susceptibles d’utiliser ces armes de force intermédiaire, nous nous la posons nous-mêmes. Dans notre recommandation n° 6, nous ne sommes pas allés aussi loin que ne l’a dit le président : nous n’avons pas prôné d’interdiction absolue mais nous avons, par exemple, recommandé que les Flash-Ball ne soient pas utilisés dans le cadre d’opérations de maintien de l’ordre, en raison des risques inhérents à leur imprécision. En ce qui concerne ces armes, il faudrait déjà utiliser au maximum tous les possibilités d’enregistrements qui, le cas échéant, permettront de comprendre ce qui s’est passé.
Quelle action légale pourrait-on entreprendre à titre préventif ? demandez-vous, monsieur le rapporteur, en évoquant ces personnes qui se glissent dans les manifestations mais qui n’ont pas tout à fait les mêmes objectifs que les organisateurs. Pour compléter mon intervention sur ce point difficile, je dirais que c’est exactement le même genre de question qui se pose à cette assemblée, jour après jour depuis lundi après-midi, dans le cadre de l’examen de la loi sur le renseignement. Nous sommes dans la problématique de la proportionnalité : où place-t-on le curseur ? Si un cadre légal comportait des garanties particulières, notamment de contrôle et de recours, le Défenseur des droits pourrait le trouver acceptable.
Pour vous répondre, monsieur Vaillant, je vais revenir à notre recommandation concernant le 14 juillet 2013 : toute interdiction générale nous paraît problématique. Appliquer une instruction générale ou systématique à des lieux, des moments ou de personnes, c’est placer le curseur trop loin en direction de la limitation de la liberté. Il faut faire attention à cet aspect des choses et votre commission aurait raison d’y réfléchir.
Monsieur le président, en ce qui concerne les poursuites judiciaires, j’ai déjà eu l’occasion de livrer deux réflexions : le donneur d’ordre est rarement mis en cause ; en cas de poursuites pénales, les peines prononcées sont souvent de la prison avec sursis. Dans deux affaires que j’ai évoquées – concernant un lycéen et un garçon de neuf ans – j’ai dit que les peines prononcées pouvaient paraître non proportionnées à la gravité des blessures. Mais, je le répète, il ne m’appartient pas de commenter des décisions qui ont l’autorité de la chose jugée.
Je rappellerais aussi que la CEDH a rendu deux arrêts, l’un contre la Bulgarie le 20 décembre 2007, et l’autre contre la Turquie le 30 novembre 2004. Dans ce dernier, qui émane de la grande chambre, on lit : « Les instances judiciaires internes ne doivent en aucun cas être disposées à laisser impunies des atteintes graves à l’intégrité physique et psychique des personnes, par exemple, en prononçant contre les agents responsables des peines minimales ou dérisoires avec sursis, sans jamais leur infliger de sanctions disciplinaires, ou en se cantonnant à l’accusation de négligence, sans tenir compte de la dimension d’atteinte à la vie. » Pour ma part, j’ai signalé l’absence totale de données générales sur les sanctions prises et sur la nature des faits sanctionnés à la suite de nos recommandations.
Monsieur le président, nous avons de bonnes relations avec les inspections auxquelles nous nous adressons systématiquement quand nous avons des saisines de ce genre. Pour le reste, il revient à l’autorité politique de dire comment il faut s’organiser.
Ceci m’amène à vous répondre sur la médiation, monsieur Said. Lorsque j’ai réuni ce petit réseau européen, nous avons été très frappés de voir que la Metropolitan Police de Londres dispose d’une sorte de médiation interne. En fait, c’est au fur et à mesure de l’opération de maintien de l’ordre que se pose la question de savoir si les règles – et notamment celles de la Convention européenne des droits de l’homme dont certains responsables britanniques aimeraient se dégager – sont ou non respectées. Comme dans la police britannique, nous pourrions avoir des officiers qui soient chargés plus particulièrement du respect des règles et de la déontologie. Mais nous avons choisi d’avoir des inspections extérieures, qui interviennent a posteriori, tant pour la police que pour la gendarmerie.
Enfin, s’agissant de la force légitime, monsieur Demarthe, je m’en remettrai à Max Weber : il y a un monopole de la violence légitime. Je pense que ce sera écrit dans votre rapport… Pour notre part, nous appréhendons la situation d’asymétrie qui existe, par essence et par construction, entre une force de sécurité qui est dotée de pouvoirs légaux et d’armes de toutes natures, et un individu qui n’a rien de tout cela. Pour ce qui concerne la défense des droits et des libertés fondamentales, le Défenseur des droits est le contrôleur de la déontologie des forces de sécurité. Son rôle est très important dans une situation où c’est toujours pot de fer contre pot de terre. Mais n’oublions pas que les forces de sécurité font aussi respecter l’État de droit. Lorsqu’un policier fait exécuter une décision de justice, c’est clairement dans ce cadre qu’il agit.
Dans le domaine qui nous occupe, nous avons, d’un côté, ceux qui cherchent à maintenir l’ordre avec tous les moyens dont nous avons longuement parlé, et, de l’autre, ceux qui cherchent à le troubler ou à le mettre en cause. Ces derniers peuvent aussi disposer de moyens de violence qui, en l’occurrence, ne sont pas légitimes. Nous n’avons pas été saisis par des membres de forces de sécurité de faits de violences commis par des manifestants. Je ne peux donc pas vous répondre sur le traitement que nous pourrions faire de tels dossiers.
D’une manière plus globale, nous devons réfléchir à un modèle européen, en ayant à l’esprit les événements qui se sont déroulés lors des sommets de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN) à Strasbourg, Seattle, Gênes ou Copenhague. Nous devons nous préoccuper de la défense des droits de chacun, citoyens, policiers et gendarmes. À un moment où Paris s’apprête à accueillir la COP 21, il est légitime de réfléchir aussi à la question que vous avez posée sur la responsabilité des manifestants. En tant que Défenseur des droits, je n’ai jamais eu à me poser cette question mais je comprends que vous la formuliez.
Le maintien de l’ordre est une question de société et pas seulement de sécurité ou de liberté. Tous – le Parlement, le Gouvernement, les observateurs, les universitaires – doivent réfléchir dans cette optique. Quel visage notre pays veut-il offrir ? La réponse implique de la part de tous les responsables politiques, notamment de la part des parlementaires, des décisions en conscience.
M. le président Noël Mamère. Nous vous remercions, monsieur le Défenseur des droits, ainsi que vos collaboratrices.
*
* *
PERSONNES ENTENDUES PAR LA COMMISSION D’ENQUÊTE
- MM. Patrice BERGOUGNOUX et Dominique BUR, préfets honoraires
- Général Bertrand CAVALLIER, ancien commandant du centre national d'entraînement des forces de gendarmerie (Saint-Astier, Dordogne)
- M. Cédric MOREAU DE BELLAING, maître de conférences à l’École normale supérieure
- M. Thomas ANDRIEU, directeur des Libertés publiques et des Affaires juridiques (Ministère de l’Intérieur)
- M. Christophe DELOIRE, directeur général de Reporters sans frontières France
- M. Ben LEFETEY, porte-parole du Collectif pour la sauvegarde de la zone humide du Testet
- M. Bernard CAZENEUVE, ministre de l’Intérieur
- M. Bernard BOUCAULT, préfet de police de Paris
- Général Denis FAVIER, directeur général de la Gendarmerie nationale
- M. Jean-Marc FALCONE, directeur général de la Police nationale et M. Philippe KLAYMAN, préfet, directeur central des compagnies républicaines de sécurité
- M. Pierre TARTAKOWSKY, président de la Ligue des droits de l’homme
- Me Françoise MATHE, présidente de la commission « Libertés publiques et droits de l’homme » du Conseil national des Barreaux
- M. Bernard COTTAZ-CORDIER, porte-parole de l’ADECR (Association départementale des élus communistes et républicains) – Les alternatifs – NPA – PCF – Parti de gauche, du Tarn, et M. Patrick ROSSIGNOL, Maire de Saint-Amancet (Tarn)
- Table ronde réunissant cinq commandants (Mohammed BELGACIMI, Christian GOMEZ, Roland GUILLOU, Éric LE MABEC, et René-Jacques LE MOËL) de compagnies républicaines de sécurité (CRS) étant intervenus à Notre-Dame-des-Landes
- Table ronde réunissant cinq commandants (Mélisande DURIER, Stéphane FAUVELET, Emmanuel GERBER, Bernard HERCHY et Aymeric LENOBLE) de groupements de gendarmerie mobile étant intervenus à Notre-Dame-des-Landes
- M. Jean-Baptiste EYRAUD, porte-parole du Droit au logement (DAL)
- M. Florent CASTINEIRA, M. Pierre DOUILLARD, M. Joachim GATTI, M. Christian TIDJANI, M. Quentin TORSELLI, Mme Nathalie TORSELLI, représentants de l’Assemblée des blessés, des familles et des collectifs contre les violences policières, conjointement avec le docteur Stéphanie LEVÊQUE
– M. Fabien JOBARD, chercheur au centre de recherches sociologiques sur le droit et les institutions pénales (CESDIP), directeur de recherches au CNRS
- M. Christian LAMBERT, préfet hors classe
- M. François MOLINS, procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris
- Table ronde des syndicats des officiers de police et des commissaires
S.C.S.I.- CFDT (Syndicat des cadres de la sécurité intérieure)
- M. Jean-Marc BAILLEUL, secrétaire général
Synergie Officiers - CFE-CGC
- M. Patrice RIBEIRO, secrétaire général
Union des officiers FSMI - FO
- M. Hervé EMO, secrétaire général
- Commandant Thierry LE MEUR
UNSA Officiers
- M. Philippe LOPEZ, secrétaire général
Syndicat des commissaires de la police nationale (SCPN)
- M. Jean-Luc TALTAVULL, secrétaire général adjoint
- M. Laurent SINDIC, délégué
Syndicat indépendant des commissaires de police – SICP
- M. Pierre Marc FERGELOT, conseiller spécial maintien de l'ordre
Association GEND XXI
- M. Jean-Hugues MATELLY, président
- M. Frédéric LE LOUETTE, vice-président
- M. Cyrille ROBERT, membre du conseil d'administration
- Table ronde des syndicats de gradés et gardiens
Unité SGP Police FO
- M. Paul LE GUENNIC, secrétaire national
- M. Grégory JORON, délégué national
Alliance Police nationale
- M. Éric MILDENBERGER, délégué général
- M. Laurent LACLAU-LACROUTS, délégué national
UNSA Police
- M. David MICHAUX, délégué national, chargé des CRS
- M. Denis HURTH, délégué régional, chargé de la formation CRS
- M. Jérôme LÉONNET, inspecteur général des services actifs, directeur central adjoint chargé du renseignement, chef du service central du renseignement territorial
- Mme Ludovine DUTHEIL DE LA ROCHERE, présidente de la manif pour tous et M. Albéric DUMONT, coordinateur général
- M. Christian VIGOUROUX, président de la section de l’intérieur du Conseil d’État
- M. Jacques TOUBON, défenseur des droits, Mme Claudine ANGELI-TROCCAZ, adjointe chargée de la déontologie et de la sécurité et Mme Estelle FAURY, rapporteure pour le pôle déontologie de la sécurité
Déplacements
- Jeudi 12 mars 2015 – Direction de la police à Lunebourg - Allemagne
- Du mercredi 8 avril au vendredi 10 avril 2015, Centre national d’entraînement des forces de gendarmerie (CNEFG) à Saint-Astier
*
* *
PERSONNES AYANT ADRESSÉ UNE CONTRIBUTION ÉCRITE
- Général de corps d’armée Pierre RENAULT, chef de l’Inspection générale de la Gendarmerie nationale (IGGN)
- Mme Marie-France MONEGER-GUYOMARC’H, cheffe de l’inspection générale de la Police nationale (IGPN)
- M. Michel VILBOIS, directeur du service de l’Achat, des Équipements et de la Logistique de la Sécurité Intérieure (SAELSI)
– Mme Cécile BERTHON, secrétaire générale du syndicat des commissaires de la police nationale (SCPN)
– M. Hervé EMO, secrétaire général de l’Union des officiers FSMI - FO
– M. Paul LE GUENNIC, secrétaire national d’Unité SGP-Police-FO
– Colonel Bruno ARVISET, secrétaire général du Conseil de la fonction militaire de la gendarmerie (CFMG)
– M. Jean-Hugues MATELLY, président de l’association professionnelle nationale des militaires de la Gendarmerie du XXIè siècle (GEND XXI)
- M. Jean Claude MAILLY, secrétaire général de la CGT-FORCE OUVRIÈRE
- M. Benoît MURACCIOLE, président d’Action Sécurité Éthique Républicaine (ASER)
– M. Nordine DRICI, directeur des programmes de l’Action des chrétiens pour l’abolition de la torture (ACAT France)
– M. Ben LEFETEY, porte-parole du Collectif pour la sauvegarde de la zone humide du Testet
– M. Thierry HARTMANN, attaché de sécurité intérieure, Ambassade de France en Allemagne
- Commissaire divisionnaire Olivier LIBOIS, directeur général de la police administrative, Bruxelles (Belgique)
- Lieutenant-colonel Fabrice ARS, attaché de sécurité intérieure, Ambassade de France en Espagne
- Colonel Fabrice GRANDI, attaché de sécurité intérieure, service de sécurité intérieure, ambassade de France en Italie
- M. Pierre-Henri DIGEON, attaché de sécurité intérieure, Ambassade de France au Royaume-Uni
- M. Tanguy DELAMOTTE, attaché de sécurité intérieure, Ambassade de France en Suède
Les missions des escadrons de gendarmerie mobile en opération de maintien de l’ordre
LES MISSIONS OFFENSIVES
Manœuvre |
Objectifs |
Fixer |
Exercer sur l’adversaire une pression suffisante pour lui interdire tout mouvement, toute action ou tout redéploiement de son dispositif. |
Appuyer |
Apporter une aide à une autre unité, spontanément ou sur ordre, par le mouvement ou, en fonction des situations, par le feu. |
Interpeller |
Se saisir de toute personne ayant commis une ou plusieurs infractions. |
Dégager |
Libérer un emplacement, un secteur ou une zone, de tout obstacle et de toute présence adverse. |
Évacuer |
Mettre à l’abri des personnels civils ou militaires menacés, par récupération, regroupement et extraction dans le cadre d’une intervention. |
Neutraliser |
Mettre l’adversaire hors d’état d’agir efficacement pendant un temps déterminé. |
S’emparer de |
S’assurer de la possession d’une zone ou d’un point tenu ou non par l’adversaire et lui interdire tout retour. |
Soutenir |
Intervenir au profit d’un élément par la fourniture de moyens ou de services. |
Source : direction générale de la gendarmerie nationale ; réponse au questionnaire de la commission d’enquête.
LES MISSIONS DÉFENSIVES
Manœuvre |
Objectifs |
Tenir |
Occuper et défendre un point ou un espace de terrain pour empêcher qu’il soit occupé ou utilisé. |
Protéger |
Prendre des mesures préventives pour empêcher tout protagoniste d’exercer des menaces ou de mettre en cause l’intégrité d’un convoi, de populations ou d’individus. Il s’agit d’assurer la sauvegarde du bénéficiaire de la protection et d’interdire l’accès non autorisé aux installations, aux matériels et aux documents du personnel concerné. |
Boucler |
Établir un dispositif continu le long d’une ligne définie, isoler une portion de terrain déterminée en vue d’interdire ou, au minimum, de signaler tout franchissement de cette ligne par l’adversaire. |
Canaliser |
Restreindre l’action de l’adversaire dans une zone étroite par l’utilisation combinée d’obstacles, de feux si nécessaire et de manœuvres ou par la mise en place d’unités. |
Contrôler |
Interdire à l’adversaire la libre disposition d’une zone : – d’une part, en décelant et en suivant toute infiltration ou mouvement adverse à l’intérieur de cette zone ; – d’autre part, en agissant contre cet adversaire. |
Rompre le contact |
Soustraire de la pression adverse, en ordre et en sûreté, tous les éléments engagés en vue de reprendre ou conserver l’ascendant sur l’adversaire. Cette manœuvre nécessite des appuis directs et indirects afin de neutraliser l’adversaire au contact et de masquer les mouvements de l’unité afin d’en accroître la sûreté. |
Filtrer |
Autoriser le franchissement du dispositif des forces de l’ordre en un point donné par une ou plusieurs personnes préalablement identifiées et dûment contrôlées. |
Défendre |
Empêcher l’adversaire de franchir une ligne ou de s’emparer d’un point ou d’une zone pendant toute la durée des délais prescrits. |
Freiner |
Ralentir la progression adverse sur une direction ou dans une zone par l’action de détachements mobiles, si nécessaire par des feux et par des obstacles. |
Jalonner |
Renseigner en permanence sur la progression d’un adversaire en marche en maintenant devant, sur les flancs et sur ses arrières des éléments mobiles en mesure de stopper ou freiner sa progression, de le disperser voire le neutraliser. |
Interdire |
Empêcher l’adversaire d’avoir accès à telle portion de terrain ou de franchir telle ligne ou d’utiliser tel personnel ou telle installation. |
Recueillir |
Soutenir à partir d’une zone ou d’une ligne donnée une unité qui se replie, lui permettre le franchissement de son propre dispositif puis la couvrir pendant un certain délai. |
Se replier |
Rompre le contact avec l’adversaire et exécuter un mouvement rétrograde tout en assurant au sein de l’élément sa propre couverture. |
Source : direction générale de la gendarmerie nationale ; réponse au questionnaire de la commission d’enquête.
LES MISSIONS DE SÛRETÉ
Manœuvre |
Objectifs |
Couvrir |
Prendre l’ensemble des mesures actives ou passives pour s’opposer à une action éventuelle de l’adversaire pouvant menacer le déroulement de l’action principale, à l’échelon considéré. |
Éclairer |
Rechercher le renseignement sans engager le contact, pour contribuer à la sûreté rapprochée du chef et de la troupe. |
Reconnaître |
Aller chercher le renseignement d’ordre tactique ou technique, sur le terrain ou sur l’adversaire, sur un point ou dans une zone donnée, en engageant éventuellement le contact. |
Surveiller |
Déceler toute activité de l’adversaire en un point, sur une direction ou dans une zone, dans le but d’alerter et de renseigner. |
Source : direction générale de la gendarmerie nationale ; réponse au questionnaire de la commission d’enquête.
LES MISSIONS COMMUNES
Manœuvre |
Objectifs |
S’interposer |
Placer une force tierce entre deux parties opposées pour dissuader toute confrontation. |
Relever NB : il s’agit d’un procédé d’exécution de mission et non d’une mission à part entière |
Dans le cadre d’un engagement, remplacer une unité opérationnelle par une autre ayant, en général, les mêmes capacités. La relève d’une unité par une autre peut s’effectuer : – par recueil ; – par dépassement ; – sur position. |
Escorter |
Assurer la sécurité d’une personne, d’un véhicule ou d’un convoi sur un itinéraire déterminé et pendant les haltes. |
Sécuriser |
Par une présence ostensible, contrôler une zone ou un espace pour les protéger afin de permettre la reprise normale de toute activité, et ainsi garantir la libre circulation des unités amies et de la population. |
Source : direction générale de la gendarmerie nationale ; réponse au questionnaire de la commission d’enquête.
Configuration des escadrons de gendarmerie mobile en opération de maintien de l’ordre
ESCADRON DE GENDARMERIE MOBILE EN CONFIGURATION ALPHA
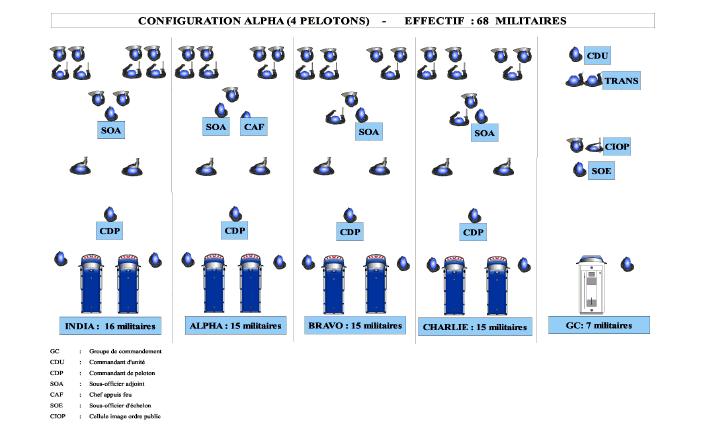
GC : Groupe de commandement
CDU : Commandant d’unité
CDP : Commandant de peloton
SOA : Sous-officier adjoint
CAF : Chef appuis feu
SOE : Sous-officier d’échelon
CIOP : Cellule image ordre public
ESCADRON DE GENDARMERIE MOBILE EN CONFIGURATION BRAVO

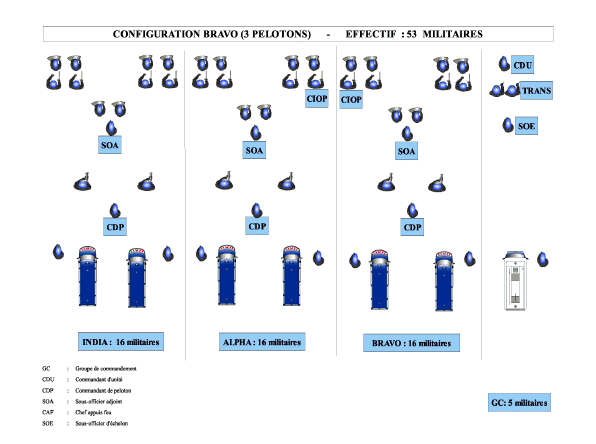
GC : Groupe de commandement
CDU : Commandant d’unité
CDP : Commandant de peloton
SOA : Sous-officier adjoint
CAF : Chef appuis feu
SOE : Sous-officier d’échelon
Source : direction générale de la gendarmerie nationale ; réponse au questionnaire de la commission d’enquête.
1 () Audition de M. Christian Vigouroux, le 16 avril 2015.
2 () Audition de M. Thomas Andrieu, le 22 janvier 2015.
3 () Conseil d’État, 21 janvier 1996, Legastelois
4 () Audition de M. Christian Vigouroux précitée, le 16 avril 2015.
5 () Audition de M. Dominique Bur, le 15 janvier 2015.
6 () Audition de M. Patrice Bergougnoux, le 15 janvier 2015.
7 () Audition de M. Fabien Jobard, le 19 mars 2015,
8 () Cf. notamment les articles D. 1321-3 à D. 1321-10 du code de la défense et l’instruction ministérielle n° 500/SGDN/MPS/OTP du 9 mai 1995 relative à la participation des forces armées au maintien de l’ordre.
9 () Déplacement effectué du 8 au 10 avril 2015.
10 () Direction générale de la gendarmerie nationale, direction générale de la police nationale, préfecture de police de Paris, Service de l’achat, des équipements et de la logistique de la sécurité intérieure (SAELSI).
11 () Audition du général Bertrand Cavallier, le 15 janvier 2015.
12 () Au cours de la tristement célèbre manifestation ouvrière de Fourmies le 1er mai 1891, douze personnes avaient perdu la vie. Lors d’une manifestation de viticulteurs à Narbonne en 1907, cinq personnes étaient mortes.
13 () Loi du 22 juillet 1921 portant augmentation des effectifs de la gendarmerie et créant un état-major particulier de la gendarmerie.
14 () Circulaire du 15 novembre 1921 sur l’affectation des militaires des légions aux pelotons mobiles de gendarmerie.
15 () Décret du 8 décembre 1944 portant création des compagnies républicaines de sécurité.
16 () Audition de MM. Mohammed Belgacimi, Christian Gomez, Roland Guillou, Éric Le Mabec, et René-Jacques Le Moël, le 5 mars 2015.
17 () Instruction ministérielle NOR/IOCT 0929231 J du 4 décembre 2009.
18 () Audition du général Denis Favier, le 12 février 2015.
19 () Idem.
20 () Actuellement, 18,5 EGM comprenant 1 378 militaires sont déployés outre-mer : six EGM en Guyane, quatre en Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna, deux en Guadeloupe, deux en Polynésie, 1,25 à la Réunion, 1,25 à Mayotte, un à la Martinique et un à Saint-Martin.
21 () La gendarmerie dispose de trois PI2G à Dijon, Orange et Toulouse.
22 () Le plus doté, l’EGM 41/7 de Dijon, compte 179 hommes et le moins doté, l’EGM 14/3 de Brest en compte 85.
23 () Circulaire n° 200 000 GEND/DOE/SDOP/BOP.
24 () Audition des représentants des syndicats de gradés et gardiens, le 2 avril 2015.
25 () L’échelon de commandement et de soutien assure les fonctions suivantes : commandement, secrétariat, opérateur radio, armurier, dépannage, véhicule, aide infirmier, pompier, conduite de véhicule, vidéaste, tir de précision.
26 () Audition de M. Jean-Marc Falcone et de M. Philippe Klayman, le 12 février 2015.
27 () Idem.
28 () Audition de Mme Mélisande Durier, MM. Stéphane Fauvelet, Emmanuel Gerber, Bernard Herchy et Aymeric Lenoble, le 5 mars 2015.
29 () Audition du général Denis Favier, le 12 février 2015.
30 () Audition du général Bertrand Cavallier, le 15 janvier 2015.
31 () Audition de M. Jean-Marc Falcone, et de M. Philippe Klayman, le 12 février 2015.
32 () Audition de MM. Mohammed Belgacimi, Christian Gomez, Roland Guillou, Éric Le Mabec, et René-Jacques Le Moël, le 5 mars 2015.
33 () Audition de Mme Mélisande Durier, MM. Stéphane Fauvelet, Emmanuel Gerber, Bernard Herchy et Aymeric Lenoble, le 5 mars 2015.
34 () Audition de MM. Mohammed Belgacimi, Christian Gomez, Roland Guillou, Éric Le Mabec, et René-Jacques Le Moël, le 5 mars 2015.
35 () Idem.
36 () Audition de M. Jean-Marc Falcone et de M. Philippe Klayman, le 12 février 2015.
37 () Audition de M. Bernard Boucault, le jeudi 5 février 2015.
38 () Audition de M. Jean-Marc Falcone et de M. Philippe Klayman, le 12 février 2015.
39 () Articles 431-3 à 431-8 du code pénal notamment.
40 () Articles L. 211-9 et D. 211-10 et suivants du code de la sécurité intérieure notamment.
41 () Audition de M. Thomas Andrieu, le jeudi 22 janvier 2015.
42 () Article R. 211-13 du code la sécurité intérieure : « L’emploi de la force par les représentants de la force publique n’est possible que si les circonstances le rendent absolument nécessaire au maintien de l’ordre public dans les conditions définies par l’article L. 211-9. La force déployée doit être proportionnée au trouble à faire cesser et son emploi doit prendre fin lorsque celui-ci a cessé. »
43 () Manœuvre à caractère offensif visant à obliger par la force une foule hostile à dégager les lieux qu’elle refuse d’évacuer.
44 () Manœuvre visant à repousser vivement des individus hostiles trop proches du dispositif des forces de l’ordre afin de les tenir à distance et réduire ainsi les risques d’affrontement physique.
45 () Article R. 211-14 du code de la sécurité intérieure.
46 () Article R. 211-21 du code de la sécurité intérieure.
47 () Article R. 211-21 du code de la sécurité intérieure.
48 () Audition de MM. Mohammed Belgacimi, Christian Gomez, Roland Guillou, Éric Le Mabec, et René-Jacques Le Moël, le 5 mars 2015.
49 () En application de l’alinéa 6 de l’article L. 211-9 du code de la sécurité intérieure.
50 () Note DRCPN/SDEL/AMT n° 84 du 27 juin 2011 pour la police nationale et note n° 91194 DEF/GEND/OE/SDDOP/BOP du 11 août 2011 pour la gendarmerie nationale.
51 () « […] La mort n’est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d’un recours à la force rendu absolument nécessaire :
a. pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale ;
b. pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l’évasion d’une personne régulièrement détenue ;
c. pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection. »
52 () Cour européenne des droits de l’homme, 17 avril 2014, Guerdner et autres c. France, n° 68780/10.
53 () D’autres matériels sont en dotation : matériels de transmission, jumelles, masques respiratoires, porte-voix, caméscope, etc.
54 () Boucliers utilisables successivement par plusieurs militaires ou fonctionnaires de police.
55 () Effet de choc, non pénétrantes.
56 () Audition du général Denis Favier, le 12 février 2015.
57 () Avant ces événements, seuls les porteurs de boucliers, soit quatre hommes par section, étaient dotés d’une protection des membres inférieurs, sous la forme de simple protège-tibias.
58 () Belgique, Espagne, Italie, Suède et Royaume-Uni.
59 () Déplacement effectué le 12 mars 2015.
60 () Acronyme de CAsk for Storage and Transport Of Radioactive material.
61 () Il existe 194 zones de police dont le ressort peut être constitué d’une ou plusieurs communes (zones monocommunales et pluricommunales).
62 () Les six autres sont : le travail de quartier, l’accueil, l’intervention, l’assistance policière aux victimes, la recherche et l’enquête locales et la circulation.
63 () Mossos d’Esquadra pour la Catalogne et Ertzaintza pour le Pays Basque.
64 () Loi organique LO 2/1986 du 13 mars 1986.
65 () Hauts parleurs pouvant diffuser un son de forte puissance.
66 () Seulement employés par les polices « autonomiques » de Catalogne et du Pays Basque.
67 () Le questeur est l’équivalent du préfet de police français, un questeur étant présent dans chaque province italienne (équivalent du département).
68 () Association of Chief Police Officers.
69 () L’emploi de tous types de moyens de contraintes constitue un enjeu politique. Ainsi, alors que le maire de Londres avait fait l’acquisition de quatre camions dotés de canons à eau, le Home Secretary (ministre de l’Intérieur) n’a jamais publié le décret permettant leur utilisation.
70 () Police Act 1984:387.
71 () Nationella operativa avdelningen (NOA).
72 () Chambre des députés, rapport n° 3383 de M. Marc Rucart fait au nom de la commission d’enquête chargée de rechercher les causes et les origines des événements du 6 février 1934. Voir notamment l’audition de M. Augustin-Lucien-Paul Mesnard, brigadier-chef des gardiens de la paix à la préfecture de police.
73 () Direction centrale de la sécurité publique.
74 () Audition du général Bertrand Cavallier, le 15 janvier 2015.
75 () Audition de M. Bernard Cazeneuve, ministre de l’Intérieur, le 3 février 2015.
76 () Audition de M. Bernard Boucault, le 5 février 2015.
77 () Audition de MM. Patrice Bergougnoux et Dominique Bur, le 15 janvier 2015.
78 () Audition du général Bertrand Cavallier, le 15 janvier 2015.
79 () Audition de Mme Mélisande Durier, MM. Stéphane Fauvelet, Emmanuel Gerber, Bernard Herchy et Aymeric Lenoble, le 5 mars 2015.
80 () Audition de M. Cédric Moreau de Bellaing, le 22 janvier 2015.
81 () Audition de MM. Mohammed Belgacimi, Christian Gomez, Roland Guillou, Éric Le Mabec, et René-Jacques Le Moël, le 5 mars 2015.
82 () Audition du général Denis Favier, le 12 février 2015.
83 () Audition de M. Bernard Cazeneuve, ministre de l’Intérieur, le 3 février 2015.
84 () Audition de M. Christian Vigouroux, le 16 avril 2015.
85 () Audition de M. Fabien Jobard, le 19 mars 2015.
86 () Audition des représentants des syndicats de gradés et gardiens, le 2 avril 2015.
87 () Audition de M. Cédric Moreau de Bellaing, le 22 janvier 2015.
88 () Idem.
89 () Audition de M. François Molins, le 26 mars 2015.
90 () AJ pénal 2013, La judiciarisation du maintien de l’ordre public : des maux… aux actes !, commissaire de police Jean-Pierre Frédéric.
91 () Article 63-1 du code de procédure pénale.
92 () Article 63 du code de procédure pénale.
93 () Audition de M. François Molins, le 26 mars 2015.
94 () Idem.
95 () En application de l’article 78-2 du code de procédure pénale.
96 () Audition de M. François Molins, le 26 mars 2015.
97 () Conformément aux articles L. 251-2 et suivants du code de la sécurité intérieure.
98 () Audition de M. François Molins, le 26 mars 2015.
99 () Audition de M. Pierre Tartakowsky, le 19 février 2015.
100 () Audition de M. Jean-Baptiste Eyraud, le 19 mars 2015.
101 () En vertu du principe de la séparation des pouvoirs, le pouvoir législatif et l’autorité judiciaire sont évidemment distincts.
102 () Audition de M. Christian Vigouroux, le 16 avril 2015.
103 () Audition de M. Jacques Toubon, le 16 avril 2015.
104 () À cet égard, la circulaire JUS D 1506570 C du 11 mars 2015 du garde des Sceaux relative à la communication aux administrations publiques et aux organismes exerçant une prérogative de puissance publique d’informations ou copies de pièces issues des procédures pénales diligentées contre des fonctionnaires et agents publics pourrait faire évoluer les pratiques.
105 () Audition de M. Jacques Toubon, le 16 avril 2015.
106 () Idem.
107 () En application de l’article R. 434-15 du code de la sécurité intérieure.
108 () Audition de M. Thomas Andrieu, le 22 janvier 2015.
109 () http://www.police-nationale.interieur.gouv.fr/Organisation/Inspection-Generale-de-la-Police-Nationale/Signalement-IGPN et http://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/fre/Contacts/Formulaire-de-reclamation2
110 () Audition de M. Bernard Cazeneuve, ministre de l’Intérieur, le 3 février 2015.
111 () Audition de M. Jean-Marie Falcone, le 12 février 2015.
112 () Audition de M. Cédric Moreau de Bellaing, le 22 janvier 2015.
113 () Audition de M. Bernard Boucault, le 5 février 2015.
114 () Audition de M. Dominique Bur, le 15 janvier 2015.
115 () Audition de M. Bernard Boucault, le 5 février 2015
116 () Audition du 15 janvier 2015. Au cours de cette audition, M. Dominique Bur a, pour sa part, modéré les réelles possibilités d’adaptation de l’administration : « Pour peu qu’on leur en donne les moyens, les services spécialisés, qui vont sur Internet, savent sur quels sites il faut se rendre – à Lille, j’étais régulièrement informé des risques de manifestation –, mais il est très difficile de posséder une visibilité sur la totalité du spectre. »
117 () « Constitue une association de malfaiteurs tout groupement formé ou entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’un ou plusieurs crimes ou d’un ou plusieurs délits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement. »
118 () Audition de M. Dominique Bur, le 15 janvier 2015.
119 () Audition de M. Bernard Boucault, le 5 février 2015.
120 () Table ronde de cinq commandants de gendarmerie étant intervenus à Notre-Dame-des-Landes, le 5 mars 2015.
121 () Audition de M. Bernard Cazeneuve, ministre de l’Intérieur, le 3 février 2015.
122 () Audition de M. Ben Lefetey, le 29 janvier 2015.
123 () Audition de MM. Patrice Bergougnoux et Dominique Bur, le 15 janvier 2015.
124 () Audition de M. Jérôme Léonnet, le 2 avril 2015.
125 () Audition de M. Jean-Marc Falcone et de M. Philippe Klayman, le 12 février 2015.
126 () Audition de MM. Patrice Bergougnoux et Dominique Bur, le 15 janvier 2015.
127 () Idem.
128 () Audition de M. Bernard Cazeneuve, ministre de l’Intérieur, le 3 février 2015.
129 () Audition de M. Fabien Jobard, le 19 mars 2015.
130 () Article 2121-9 de l’arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d’emploi de la police nationale.
131 () Audition de M. Bernard Boucault, le jeudi 5 février 2015.
132 () Réponses de la DGGN au questionnaire adressé par la commission d’enquête.
133 () Audition de MM. Patrice Bergougnoux et Dominique Bur, le 15 janvier 2015 et audition du général Bertrand Cavallier, le 15 janvier 2015.
134 () Idem.
135 () Audition des représentants des syndicats de gradés et gardiens, le 2 avril 2015.
136 () Idem.
137 () Audition du général Denis Favier, le 12 février 2015.
138 () Audition des représentants des syndicats de gradés et gardiens, le 2 avril 2015.
139 () Audition du général Denis Favier, le 12 février 2015.
140 () Groupement d’intervention de la gendarmerie nationale.
141 () Groupe de pelotons d’intervention. Il s’agit d’une unité spécialisée prépositionnée dans chaque département d’outre-mer ainsi que dans les principales collectivités d’outre-mer (Nouvelle-Calédonie, Polynésie) qui a vocation à appuyer l’action des forces territoriales.
142 () Peloton d’intervention interrégional de la gendarmerie.
143 () Gendarmerie maritime, gendarmerie de l’armement, gendarmerie de l’air et gendarmerie de la sécurité des armements nucléaires.
144 () Audition de M. Fabien Jobard, le 19 mars 2015.
145 () Audition de de Mme Nathalie Torselli et de MM. Quentin Torselli, Christian Tidjani, Joachim Gatti, Pierre Douillard et Florent Castineira, le 19 mars 2015.
146 () Audition de M. Jacques Toubon, le 16 avril 2015.
147 () Audition de M. Pierre Tartakowsky du 19 février 2015.
148 () Audition de M. Dominique Bur, le 15 janvier 2015
149 () Table ronde réunissant cinq commandants étant intervenus à Notre-Dame-des-Landes, le 5 mars 2015.
150 () Audition du général Bertrand Cavallier, le 15 janvier 2015.
151 () Table ronde réunissant cinq commandants étant intervenus à Notre-Dame-des-Landes, le 5 mars 2015.
152 () Audition de M. Bernard Cazeneuve, ministre de l’Intérieur, le 3 février 2015.
153 () Ainsi, un opposant violent y décrivait dans une documentation comment confectionner ce qu’il appelait un « cocktail au napalm » en utilisant soit des canettes soit des magnums, remplis avec une pâte constituée de polystyrène dissout dans de l’acétone, de l’essence, de l’huile de vidange et d’engrais.
154 () Sauf si le propriétaire des parcelles concernées est une commune n’ayant pas satisfait aux obligations lui incombant en vertu du schéma départemental prévu par l’article 2 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ou qui n’est pas inscrite à ce schéma.
155 () En ces cas de troubles à l’ordre public, l’évacuation des occupants peut être prescrite, voire exécutée d’office par l’autorité de police administrative. Il est de la responsabilité des autorités de police administrative de maintenir l’ordre public, ce qui implique, le cas échéant, le recours à la force publique. Ainsi, si des troubles à l’ordre public sont constatés, l’autorité de police administrative générale est compétente pour agir en vue de l’évacuation des occupants sans titre d’un terrain, quel que soit son statut, public ou privé.
156 () Audition M. Thomas Andrieu, le 22 janvier 2015
157 () Audition de Mme Françoise Mathe, le 19 février 2015.
158 () Le Savant et le politique.
159 () La Civilisation des mœurs et La Dynamique de l’Occident.
160 () Audition de M. Jean-Marc Falcone et de M. Philippe Klayman, le 12 février 2015.
161 () Audition du général Bertrand Cavallier, le 15 janvier 2015.
162 () Audition de M. Cédric Moreau de Bellaing, le 22 janvier 2015.
163 () Idem.
164 () Audition de M. Christophe Deloire, le 29 janvier 2015.
165 () Idem.
166 () Idem.
167 () Audition des représentants des syndicats des officiers de police et des commissaires de police et des représentants de l’association Gend XXI, le 2 avril 2015.
168 () Audition des représentants des syndicats des officiers de police et des commissaires de police et des représentants de l’association Gend XXI, le 2 avril 2015.
169 () Audition de M. Christophe Deloire, le 29 janvier 2015.
170 () Idem.
171 () Audition de cinq commandants de groupements de gendarmerie mobile, chef d’escadron Mélisande Durier, lieutenant-colonel Stéphane Fauvelet, lieutenant-colonel Emmanuel Gerber, capitaine Bernard Herchy et chef d’escadron Aymeric Lenoble, le 5 mars 2015.
172 () Audition de M. Christophe Deloire, le 29 janvier 2015.
173 () Tel le « patator », un lanceur artisanal utilisé pour projeter à grande distance et à grande vitesse un projectile (généralement une pomme de terre, tubercule dont il tire son nom).
174 () Audition de M. Bernard Boucault, le 5 février 2015.
175 () Audition de M. Bernard Boucault, le 5 février 2015.
176 () Idem.
177 () Audition de M. Jean-Marc Falcone et de M. Philippe Klayman, le 12 février 2015.
178 () Audition des représentants des syndicats de gradés et gardiens, le 2 avril 2015.
179 () Cf. supra partie consacrée à la judiciarisation des opérations de maintien de l’ordre.
180 () Article 3 de l’arrêté du 1er février 2011 relatif aux missions et à l’organisation de la direction centrale de la sécurité publique, modifié par l’article 2 de l’arrêté du 9 mai 2014.
181 () Décret n° 2013-728 du 12 août 2013 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur et du ministère des outre-mer.
182 () Article 4 du décret n° 2008-633 du 17 juin 2008 relatif à l’organisation déconcentrée de la direction centrale de la sécurité publique, modifié par l’article 3 du décret n° 2014-466 du 9 mai 2014.
183 () Nord, Ouest, Sud-Ouest, Sud, Sud-Est, et Est.
184 () Audition de M. Jérôme Léonnet, le 2 avril 2015.
185 ( Audition de M. Jérôme Léonnet, le 2 avril 2015.
186 () Projet de loi relatif au renseignement n° 2669, adopté en première lecture par l’Assemblée nationale le 5 mai 2015, TA n° 511.
187 () Audition de M. Bernard Cazeneuve, le 3 février 2015.
188 () M. Christian Lambert, préfet honoraire, Vingt propositions pour rénover les formations à destination du corps préfectoral en matière de maintien de l’ordre public et d’animation et de coordination du renseignement à l’échelon territorial, rapport au ministre de l’Intérieur, février 2015.
189 () Au niveau local, outre les informations relayées par le service départemental du renseignement territorial, le préfet est destinataire des éléments recueillis par le commandant de groupement de la gendarmerie nationale et les services de la sécurité intérieure.
190 () Audition de M. Christian Lambert, le 26 mars 2015.
191 () L’expérience a déjà été menée auprès des préfets de Rennes, Lyon et Bordeaux.
192 () Audition de M. Christian Lambert, le 26 mars 2015.
193 () Audition de M. Jean-Marc Falcone et de M. Philippe Klayman, le 12 février 2015.
194 () Audition du général Denis Favier, le jeudi 12 février 2015.
195 () Audition de M. Jean-Marc Falcone et de M. Philippe Klayman, le jeudi 12 février 2015.
196 () Audition de M. Christian Lambert, le 26 mars 2015.
197 () Audition du général Bertrand Cavallier (2e section), le 15 janvier 2015 : « Pour ce qui est de l’articulation entre autorité civile et militaire, j’estime que le préfet doit prendre toute la place qui lui revient, et y rester. On attend de lui des ordres clairs, des directives formelles et précises : rien n’est plus difficile pour un commandant de dispositif que de devoir rester dans le vague. Au demeurant, il appartient au représentant de l’État, responsable de l’ordre public, de prendre ses responsabilités. ».
198 () Audition de M. Pierre Tartakowsky le 19 février 2015.
199 () Par exemple, le général Bertrand Cavallier, le 15 janvier 2015 (« J’estime par ailleurs que la présence du représentant de l’État devrait être systématique. »).
200 () Pour Good practice for dialogue and communication as strategic principles for policing political manifestations in Europe : bonnes pratiques afin de consacrer le dialogue et la communication en tant que principe stratégique de l’encadrement des manifestations politiques en Europe.
201 () Audition M. Thomas Andrieu, le 22 janvier 2015.
202 () Audition du général Denis Favier, le 12 février 2015.
203 () Article R211-11 : « Pour l’application de l’article L. 211-9, l’autorité habilitée à procéder aux sommations avant de disperser un attroupement par la force :
1° Annonce sa présence en énonçant par haut-parleur les mots : " Obéissance à la loi. Dispersez-vous " ;
2° Procède à une première sommation en énonçant par haut-parleur les mots : " Première sommation : on va faire usage de la force " ;
3° Procède à une deuxième et dernière sommation en énonçant par haut-parleur les mots : " Dernière sommation : on va faire usage de la force. "
Si l’utilisation du haut-parleur est impossible ou manifestement inopérante, chaque annonce ou sommation peut être remplacée ou complétée par le lancement d’une fusée rouge.
Toutefois, si, pour disperser l’attroupement par la force, il doit être fait usage des armes mentionnées à l’article R. 211-16, la dernière sommation ou, le cas échéant, le lancement de fusée qui la remplace ou la complète doivent être réitérés. ».
204 () Audition, sous forme de table ronde des représentants des syndicats des officiers de police et des commissaires de police et des représentants de l’association GEND XXI, le 2 avril 2015.
205 () Audition de M. Christophe Deloire, le 29 janvier 2015.
206 () Audition de M. François Molins, le jeudi 26 mars 2015.
207 () Audition de M. Pierre Tartakowsky le 19 février 2015.
208 () Audition de M. François Molins, le jeudi 26 mars 2015.
209 () Décision n° 94-352 DC du 18 janvier 1995.
210 () Conseil d’État, ordonnance du 9 janvier 2014, Ministre de l’intérieur c/ Société Les Productions de la Plume et M. Dieudonné M’Bala M’Bala.
211 () Audition de M. Fabien Jobard, le 19 mars 2015.
212 () Idem.
213 () Audition du général Denis Favier, le 12 février 2015.
214 () Audition de M. Pierre Tartakowsky le 19 février 2015.
215 () Audition de M. Ben Lefetey, le 29 janvier 2015.
216 () Audition de MM. Bernard Cottaz-Cordier et Patrick Rossignol, le 25 février 2015.
217 () Audition de M. Albéric Dumont, le 16 avril 2015.
218 () Audition de M. Bernard Boucault, le 5 février 2015.
219 () Audition de M. Fabien Jobard, le 19 mars 2015.
220 () Audition de M. Pierre Tartakowsky le 19 février 2015.
221 () Audition de M. Fabien Jobard, le 19 mars 2015.
222 () Table ronde réunissant cinq commandants (Mohammed Belgacimi, Christian Gomez, Roland Guillou, Éric Le Mabec, et René-Jacques Le Moël) de compagnies républicaines de sécurité (CRS) étant intervenus à Notre-Dame-des-Landes, le 5 mars 2015.
223 () Audition, sous forme de table ronde, des représentants des syndicats de gradés et gardiens, le 2 avril 2015.
224 () Audition du général Bertrand Cavallier (2e section), le 15 janvier 2015.
225 () Audition de M. Fabien Jobard, le 19 mars 2015
226 () Audition du général Denis Favier, le 12 février 2015.
227 () Audition, sous forme de table ronde, des représentants des syndicats de gradés et gardiens, le 2 avril 2015.
228 () Audition de M. Jacques Toubon, le 16 avril 2015.
229 () Audition de Mme Nathalie Torselli et de MM. Quentin Torselli, Christian Tidjani, Joachim Gatti, Pierre Douillard et Florent Castineira et du docteur Stéphanie Lévêque, le 19 mars 2015.
230 () Idem.
231 () La justice, saisie de l’affaire, n’a pas encore rendu de verdict définitif, celle-ci ayant fait l’objet d’un renvoi aux assises le 25 novembre 2014.
232 () Instruction INTJ1419474J relative à l’emploi du pistolet à impulsions électroniques (PIE), des lanceurs de balles de défense (LBD) de calibre 40 et 44 mm et de la grenade à main de désencerclement (GMD) en dotation dans les services de la police nationale et les unités de la gendarmerie nationale.
233 () Défenseur des droits, Rapport sur trois moyens de force intermédiaire, 2013.
234 () Ces nombres correspondent respectivement au diamètre et à la longueur, en millimètres, des projectiles utilisés.
235 () Mousse pour l’impact et sabot en plastique pour assurer la prise avec les rayures du canon.
236 () Dans son rapport de 2009, la Commission nationale de déontologie de la sécurité évoquait même « l’excellente précision » du LBD 40x46.
237 () Du reste, comme cela a été rappelé, les forces mobiles ne sont pas dotées de Flash-Ball.
238 () Défenseur des droits, rapport précité, proposition n° 6.
239 () Audition de de Mme Nathalie Torselli et de MM. Quentin Torselli, Christian Tidjani, Joachim Gatti, Pierre Douillard et Florent Castineira et du docteur Stéphanie Lévêque, le 19 mars 2015.
240 () Article D. 211-9 du code de la sécurité intérieure.
241 () Cour européenne des droits de l’homme, Güleç c/ Turquie, requête n° 21593, 27 juillet 1998. « […] Les gendarmes employèrent une arme très puissante car ils ne disposaient apparemment ni de matraques et boucliers ni de canons à eau, balles en caoutchouc ou gaz lacrymogènes. » (§ 71)
242 () Audition de M. Fabien Jobard, le 19 mars 2015.
243 () Audition de M. Bertrand Cavallier, le 15 janvier 2015.
244 () Audition de M. François Molins, le jeudi 26 mars 2015.
245 () Audition de M. Bernard Boucault, le 5 février 2015.
246 () Audition de M. François Molins, le 26 mars 2015.
247 () Audition du général Denis Favier, le 12 février 2015.
248 () Audition de M. François Molins, le 26 mars 2015.
249 () Audition de M. François Molins, le 26 mars 2015.
250 () Audition de M. Christian Lambert, le 26 mars 2015.
251 () Audition de M. Bernard Boucault, le 5 février 2015.
252 () Audition de M. Christian Lambert, le 26 mars 2015.
253 () Audition de M. Bernard Boucault, le 5 février 2015.
254 () Idem.
255 () Audition de M. François Molins, le 26 mars 2015.
256 () Audition de M. François Molins, le 26 mars 2015.
257 () Audition de M. François Molins, le 26 mars 2015.
© Assemblée nationale