

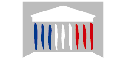
N° 408
______
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 14 novembre 2012
RAPPORT
FAIT
AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES SUR LE PROJET DE LOI n° 90, autorisant la ratification de la convention sur la protection du patrimoine culturel subaquatique,
PAR M. Jean GLAVANY
Député
——
ET
ANNEXE : TEXTE DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
SOMMAIRE
___
Pages
I. LA NÉCESSITÉ DE PROTÉGER LE PATRIMOINE CULTUREL SUBAQUATIQUE 7
A. Le patrimoine culturel subaquatique, une richesse menacée 7
1. Une richesse culturelle pour l’humanité 7
2. Un patrimoine en danger 9
B. Une protection juridique longtemps insuffisante 11
1. L’absence de régime global de protection du patrimoine culturel subaquatique… 11
2. …a été imparfaitement comblée par la Convention de Montego Bay sur le droit de la mer 13
C. L’adoption de la convention de 2001 14
1. Historique des négociations 14
2. La convention aujourd’hui 15
3. Une convention dans la continuité du droit international 15
II. UNE CONVENTION AMBITIEUSE POUR UNE MEILLEURE PROTECTION DU PATRIMOINE CULTUREL SUBAQUATIQUE 17
A. Les principes fondamentaux fixés par la convention 17
1. L’obligation de préserver le patrimoine culturel subaquatique 17
2. La priorité donnée à la préservation in situ 17
3. Le refus de l’exploitation commerciale 18
4. La coopération et le partage de l’information aux fins de protection du patrimoine culturel subaquatique 19
B. Les mécanismes concrets de coopération internationale 20
1. Déclaration et notification 21
2. Protection du patrimoine culturel subaquatique en cas de découverte ou d’intervention 22
3. Le cas des navires ou aéronefs d’Etat et la position de la France 23
4. Mesures et sanctions prises par les Etats Parties pour la mise en œuvre de la Convention 24
C. Les conséquences de la ratification 25
EXAMEN EN COMMISSION 31
ANNEXE 1 : Etats parties à la convention 32
ANNEXE 2 : Les zones maritimes selon la convention de Montego Bay 33
_____
ANNEXE – TEXTE DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES 35
Mesdames, Messieurs,
La convention sur la protection du patrimoine culturel subaquatique, dont il nous est demandé d’autoriser la ratification, a été adoptée à l’issue de la conférence générale de l’UNESCO de 2001.
Ce n’est qu’aujourd'hui que ce texte nous est soumis car la France, avec d’autres pays, s’est alors abstenue. Elle estimait tout d'abord que le projet pouvait aboutir à remettre en cause certains principes traditionnels du droit de la mer, avec notamment un risque d’interprétation en faveur de nouveaux droits conférés aux Etats côtiers. On estimait également que certains articles de la convention ne respectaient pas de manière suffisamment claire le principe d’immunité imprescriptible des épaves des navires d’Etat, admis par le droit coutumier et consacré par la Convention de Montego Bay.
Cela étant, cette position initiale a dû être révisée compte tenu de l’absence d’outils juridiques pleinement satisfaisants pour empêcher les pillages d’épaves au large des côtes. En conséquence, la France a entamé la procédure de ratification.
Le patrimoine culturel subaquatique, qu’il s’agisse d’épaves ou de sites archéologiques enfouis, constitue en effet une richesse culturelle pour l’humanité toute entière, qu’il est important de préserver. La convention qui nous est soumise reste à ce jour le meilleur outil dont dispose la communauté internationale pour répondre aux destructions et aux pillages croissants dont il peut être victime. A titre d’exemple, l’épave du Titanic est désormais sous la protection de la convention depuis le 15 avril dernier, date anniversaire du centenaire de son naufrage.
Tout en s’inscrivant dans le cadre juridique du droit international existant, notamment la convention de Montego Bay sur le droit de la mer, la convention de l’UNESCO fixe tout d'abord des principes généraux inspirés de ceux qui s’appliquent déjà au patrimoine culturel terrestre. Elle met également en place un régime de coopération entre Etats parties pour la protection de ce patrimoine.
I. LA NÉCESSITÉ DE PROTÉGER LE PATRIMOINE CULTUREL SUBAQUATIQUE
A. LE PATRIMOINE CULTUREL SUBAQUATIQUE, UNE RICHESSE MENACÉE
1. Une richesse culturelle pour l’humanité
Le patrimoine culturel subaquatique, au sens de l’article 1er de la convention, désigne « toutes les traces d’existence humaine présentant un caractère culturel, historique ou archéologique qui sont immergées, partiellement ou totalement, périodiquement ou en permanence, depuis 100 ans au moins, et notamment :
(i) les sites, structures, bâtiments, objets et restes humains, ainsi que leur contexte archéologique et naturel ;
(ii) les navires, aéronefs, autres véhicules ou toute partie de ceux-ci, avec leur cargaison ou autre contenu, ainsi que leur contexte archéologique et naturel ; et
(iii) les objets de caractère préhistorique. »
Si les statistiques relatives à l’exploitation du patrimoine culturel subaquatique sont à prendre avec prudence, très peu d’Etats dans le monde acceptant de publier des données officielles, on estime cependant à plus de 3 millions le nombre d’épaves et de vestiges dispersés au fond des mers. Outre les épaves, il existe également des vestiges de sites, tels que des établissements préhistoriques, des habitations ou des sites religieux, submergés lors de tremblements de terre, d’inondations, ou par suite de l’érosion.
Parmi les exemples les plus célèbres, on peut citer les vestiges du phare et du palais de Cléopâtre dans la baie d’Alexandrie, engloutis en 365 par un tremblement de terre suivi d’un raz-de-marée ; le site de Dwarka, en Inde, qui comprend des vestiges d’un port antique, de temples et d’établissements datant de 1500-1400 avant notre ère ; la ville de Port Royal en Jamaïque, détruite par un tremblement de terre en 1692 ; ou encore la fortification de Bulverket à Gotland (Suède), ouvrage médiéval lacustre datant de 1130 après J.-C.
En ce qui concerne la France, qui possède le 2e plus grand domaine maritime au monde grâce à ses départements et territoires d’outre-mer, le Département des recherches archéologique subaquatiques et sous-marines du ministère de la culture, DRASSM, estime à 20 000 le nombre d’épaves situées dans les eaux de la métropole, et 150 000 à 200 000 celles éparpillées sur les 11 millions de km2 de notre zone économique exclusive. Sur la côte atlantique, seules quelque 200 épaves ont été expertisées.
Au même titre qu’un site archéologique terrestre, ces ruines et épaves subaquatiques constituent un témoignage historique précieux sur les civilisations passées, les échanges entre les peuples, ou un événement particulier (naufrage du Titanic, découverte de nouveaux continents)… Une cité engloutie constitue évidemment un site particulièrement précieux pour les archéologues et historiens. En outre, hormis l’aspect historique, une épave est aussi, bien souvent, un lieu de sépulture qui renferme les restes de l’équipage et des passagers, et doit être respecté.
Correctement effectuées, les recherches archéologiques sur les sites subaquatiques sont sources d’un enrichissement des connaissances scientifiques, grâce à l’étude de sources uniques qu’elles offrent. Les exemples sont nombreux qui ont permis une meilleure compréhension d’événements historiques ou de périodes. C’est le cas, par exemple, du HMS Pandora qui, envoyée à la recherche des mutins du Bounty, coula au large de l’Australie en 1791. Les campagnes de fouilles sur le bâtiment, retrouvé quasiment intact, ont donné une vision sans précédent de la culture européenne et de la vie en mer à la fin du XVIIIe siècle. Les scientifiques ont été en mesure de réunir une grande quantité d’informations sur la vie quotidienne et les coutumes sociales à bord. En outre, les fouilles ont grandement contribué à une meilleure connaissance de la mutinerie du Bounty et de la traque des mutins.
L’intérêt historique et culturel n’est pas seulement scientifique. Il rencontre aussi celui du public, en témoigne le succès des actions de valorisation muséologiques entreprises ces dernières années. C’est par exemple le cas en Suède où l’exposition permanente du Vasa, qui coula en 1628 dans le port de Stockholm lors de son voyage inaugural, est aujourd'hui le musée le plus fréquenté du pays, avec chaque année 800 000 visiteurs. C’est aussi le cas en Turquie où le musée de l’archéologie subaquatique de Bodrum, qui présente les collections tirées d’une série d’épaves historiques découvertes sur les côtes méridionales, est l’un des sites de tourisme culturel les plus populaires du pays. De même, au Royaume-Uni, l’exposition de la Mary Rose, à Portsmouth, en Grande-Bretagne, a attiré plus de 4 millions de visiteurs, confirmation jamais démentie de l’énorme intérêt qu’avait suscité le renflouement de cette épave diffusé en direct à la télévision en 1982. S’agissant de notre pays, enfin, on peut rappeler le succès de l’exposition itinérante, entre Normandie, Bretagne et Pays de Loire, « La mer pour mémoire, archéologie sous-marine des épaves atlantiques » : organisée à l’initiative du DRASSM, elle a réuni il y a quelques années plus de 250 000 visiteurs autour d’une collection de 550 pièces majeures issues de plus de 40 épaves, principalement du XVe au XIXe siècles, - instruments de navigation, canons chargés en batterie, trésor monétaire, mais aussi flacon de parfum, chaussure, jeu de dés -, qui présente le quotidien et la matérialité des navires des temps anciens.
Nombre d’autres exemples pourraient être cités de musées subaquatiques ou d’attractions touristiques mettant en valeur ce patrimoine. Certaines sont d’accès limité, réservé aux plongeurs, tels le site du port antique de Césarée, au large de la côte méditerranéenne d’Israël, qui propose un itinéraire subaquatique, ou encore le sanctuaire marin national des Keys en Floride, qui présente différents sites et épaves historiques le long des récifs de corail. D’autres sites existent sur ce principe, en Australie, au Sri Lanka, en Mer rouge ou encore au large de Zanzibar. Des projets de musées subaquatiques permettant un accès au grand public sont actuellement à l’étude ou en phase de réalisation : si des milliers d’objets (statues, sphinx, colonnes et blocs) du site du Phare d’Alexandrie et du palais de Cléopâtre ont été présentés au public à l’occasion d’importantes expositions, le reste des vestiges qui n’ont pas été récupérés et montrés sera laissé dans la baie, à 6 à 8 mètres sous les eaux, et la construction d’un musée subaquatique en coopération avec l’UNESCO est envisagée afin de préserver ces reliques in situ. En Chine, sur le site de Baiheliang, immergé sous le lac du barrage des Trois Gorges, deux tunnels subaquatiques ont été construits depuis la berge pour permettre au public de visiter le site et de voir les plus anciennes inscriptions hydrologiques connues, qui enregistrent 1 200 années consécutives de variation du niveau des eaux.
En d'autres termes, des sites archéologiques et épaves correctement exploités sont source d’enrichissement du savoir de l’humanité tout entière.
Cela étant, ce patrimoine ne présente pas seulement un intérêt historique ou scientifique : il attire aussi depuis longtemps les chasseurs de trésors. Ce sont le pillage et les destructions dont il est victime qui le mettent en danger et justifient sa protection.
Diverses menaces pèsent sur le patrimoine culturel subaquatique. Les sites peuvent être endommagés par des facteurs environnementaux (attaques par les bactéries, séismes sous-marins, modification des courants) ou par l’activité humaine (pêche, extraction de pétrole, pose d’oléoducs…). Ainsi, en France, l’épave de La Juste, vaisseau de guerre de Louis XV qui sombra en 1759, a-t-elle été détruite dans les années 1970 par les dragues nettoyant le chenal de navigation dans l’embouchure de la Loire. Si certaines parties du navire et un grand nombre de canons avaient heureusement pu être récupérés et être exposés au Musée national de la Marine, leur qualité rappelle la perte irréparable pour la recherche archéologique et scientifique que la destruction de l’épave a représentée.
Cela étant, plus que les dommages accidentels, ce sont les progrès techniques qui ont rendu plus aisée l’exploration des fonds marins, et consécutivement, le pillage. Le développement des technologies d’exploration sous-marine a tout d’abord facilité l’accès à de nombreux sites : les bathyscaphes, engins d’exploration sous-marine, sont capables d’aller jusqu’à dix mille mètres de fond ; le scaphandre, perfectionné par Jacques-Yves Cousteau et Emile Gagnan, en 1943, assure une grande autonomie de plongée. Avec une formation et un équipement professionnel, beaucoup de sites autrefois inaccessibles sont par conséquent désormais à la portée des chasseurs de trésors. On assiste donc depuis les années 1970 à une recrudescence des pillages. Faisant fi de l’intérêt culturel et historique des pièces qu’ils découvrent, les pilleurs s’intéressent en priorité à l’or, l’argent, la porcelaine qu’ils revendent, en se débarrassant de ce qui n’est pas monnayable et présente pas d’intérêt à leurs yeux. Ainsi se perdent à jamais des témoignages historiques précieux. Dès les années 1970, on estimait déjà que toutes les épaves connues au large de la Turquie avaient été pillées, de même que 95 % des épaves au large des côtes françaises. 60 % des objets initialement échoués au large d’Israël auraient également disparu, selon les archéologues israéliens.
Cela étant, nous sommes aujourd'hui très loin des modestes moyens que le professeur Tournesol mettait à la disposition de Tintin pour partir à la recherche de l’épave de La Licorne et retrouver le trésor de Rackham le Rouge ! Les pillages sont en effet aujourd'hui le fait d’entreprises puissantes, privées pour la plupart (1), parfois cotées en bourse et bénéficiant, notamment en ce qui concerne les Etats-Unis, du soutien constant du gouvernement. Spécialisées dans les fouilles, elles utilisent les technologies les plus développées, emploient des personnels très qualifiés et mobilisent des moyens à la hauteur des enjeux : il faut par exemple savoir que les experts estiment que les cales des seuls galions espagnols qui ont coulé par centaines au retour des colonies renfermeraient encore des richesses pour un montant dépassant les 100 milliards d’euros. En d'autres termes, la recherche d’épaves est un investissement, et les bénéfices tirés de la vente des objets récupérés sont considérés par ces entreprises comme un juste retour. Ces dernières années, quelques cas ont suscité des controverses importantes.
En 1970, la compagnie « Treasure Salvors » localisait l’épave de Nuestra Señora de Atocha, galion espagnol échoué en 1622 au large de la Floride. Elle obtenait l’autorisation de fouiller l’épave, considérée comme l’une des plus précieuses jamais découvertes. Elle en a récupéré l’or, l’argent, ainsi qu’un grand nombre de rapières, de mousquets et d’armes, des poteries, de marchandises et de pièces de monnaie, en utilisant des techniques qui ont alors été considérées comme destructrices. Plus récemment, une expédition privée britannique découvrait la cargaison du Geldermalsen, qui a ensuite été vendue aux enchères par Christie’s à Amsterdam en 1986, et donc dispersée dans le monde entier. Le Geldermalsen était un navire marchand hollandais qui avait sombré en 1751 au large de l’Indonésie, chargé de thé, d’or, de soie et de porcelaine. Les Etats concernés (les Pays-Bas, l’Indonésie) n’ont pas eu leur mot à dire. L’épave a été détruite. En 1999, à Stuttgart une cargaison inestimable de porcelaine a été dispersée aux enchères. Plus de 300 000 objets avaient été récupérés par la « Ocean Salvage Corporation », entreprise privée, sur l’épave du Tek Sing, l’une des dernières jonques chinoises, dont le naufrage en 1822 est l’une des plus importantes catastrophes de l’histoire de la navigation. Comme d’autres, ce témoignage a néanmoins été détruit.
La mise en péril du patrimoine culturel subaquatique par des attaques aujourd'hui plus fréquentes et plus efficaces, grâce aux progrès technologiques, a justifié une meilleure protection juridique, d’autant plus nécessaire que les sociétés en question exploitent les failles juridiques du droit international et n’hésitent pas aller en justice pour se défendre.
B. UNE PROTECTION JURIDIQUE LONGTEMPS INSUFFISANTE
1. L’absence de régime global de protection du patrimoine culturel subaquatique…
Alors que le patrimoine terrestre bénéficie d’une protection juridique (2), jusqu’à la convention de 2001, le patrimoine culturel subaquatique était protégé de façon très lacunaire. Les diverses dispositions laissaient en effet subsister des vides juridiques dont savent parfaitement profiter les chasseurs de trésors.
Il faut tout d'abord rappeler que les législations nationales ne peuvent assurer seules une protection satisfaisante du patrimoine culturel subaquatique.
En premier lieu, elles sont limitées géographiquement. En haute mer, la législation d’un Etat ne s’applique qu’aux navires de son pavillon. Un Etat qui n’a pas de juridiction sur la zone où une épave est découverte ne peut donc s’opposer au pillage de cette épave. Si un navire pille un site archéologique subaquatique ou une épave à proximité des côtes d’un autre Etat mais hors de sa juridiction, l’Etat côtier ne pourra pas intervenir. L’Etat du pavillon, quant à lui, peut très bien ne rien savoir des agissements des pilleurs et donc ne pas pouvoir non plus y mettre fin, même s’il en avait la volonté. En France, la législation concernant les « biens culturels maritimes » oblige toute personne qui en découvre un à le laisser en place et ne pas y porter atteinte, puis à déclarer sa découverte aux autorités administratives dans les 48 heures (3). Mais cette législation ne s’applique que dans la mer territoriale et la zone contiguë (4). Le droit français n’assure donc pas la protection au-delà de la zone contiguë et l’on verra plus loin que c’est l’absence de moyens juridiques qui a conduit la France a réviser sa position initiale.
En second lieu, les législations nationales ne permettent pas toujours d’assurer la protection du patrimoine culturel subaquatique même dans leur zone d’application. Pour avoir permis brièvement dans les années 1990 la vente d’objets retirés de fouilles archéologiques subaquatiques, le Portugal a vu immédiatement au moins six compagnies internationales de récupération de trésors commencer d’opérer le long de ses côtes (5).
De leur côté, les cours américaines ont longtemps utilisé le concept de la « salvage law » (droit de l’assistance) (6), à l’appui des revendications de découvreurs privés. Ce principe a été posé par la Cour suprême américaine en 1869 dans l’affaire Blackwell. Il s’agit de la compensation accordée à ceux grâce à l’assistance desquels un navire ou sa cargaison a été sauvé, en totalité ou en partie, d’un péril imminent à la mer, ou d’une perte, comme dans le cas d’un naufrage, d’un abandon, ou d’une recapture. Faisant application de la « salvage law », des décisions judiciaires américaines entre 1979 et 1982 ont accordé à des compagnies américaines privées tous les droits sur les épaves et la cargaison de galions espagnols, notamment la Nuestra Señora de Atocha et le San Christo del Valle. De tels jugements ne tiennent aucun compte des droits de l’Etat du pavillon ni de l’intérêt public de l’humanité. Il faut toutefois relever que la jurisprudence a évolué à partir des années 2000, les juges américains considérant désormais que la « salvage law » ne s’applique pas aux choses submergées depuis des siècles.
En l’absence de régime général satisfaisant, certains Etats ont passé des accords bilatéraux portant uniquement sur un élément particulier du patrimoine culturel subaquatique. Ils ne protègent donc pas le patrimoine culturel subaquatique dans son ensemble, mais interviennent de manière ponctuelle. A cet égard, on peut citer l’accord entre les Pays-Bas et l’Australie de décembre 1972, portant sur les épaves des navires de la Compagnie hollandaise des Indes orientales situées au large des côtes australiennes ; entre le Royaume-Uni et l’Afrique du sud en septembre 1989 au sujet de l’épave du Birkenhead, navire de guerre britannique qui sombra en 1852 ; entre le Royaume-Uni et le Canada en août 1997 concernant la recherche des navires Erebus et Terror, pris dans les glaces en 1846. De telles conventions existent aussi entre la France et les Etats-Unis, au sujet de l’épave du CSS Alabama, navire confédéré coulé près de Cherbourg en 1864, ou de l’épave de La Belle, navire auxiliaire de la Marine royale française, coulé en 1686 dans le delta du Mississippi, découverte en 1995, et qui a fait l’objet d’un accord bilatéral le 31 mars 2003, aux termes duquel l’épave reste sous la garde de la Commission historique du Texas, un arrangement administratif entre les deux Parties précisant les conditions de conservation, documentation et d’exposition des objets récupérés .
Ces accords visent à prévenir le pillage de l’épave et à en permettre la conservation et l’étude. Ils permettent à l’Etat du pavillon et à l’Etat territorial de concilier leurs intérêts respectifs. Cependant, en l’absence de régime universel, le sort de certaines épaves est plus incertain, comme l’illustre le cas déjà évoqué des galions espagnols découverts par des compagnies américaines.
2. …a été imparfaitement comblée par la Convention de Montego Bay sur le droit de la mer
En droit international, la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (7), adoptée le 10 décembre 1982 à Montego Bay (Jamaïque) et très largement ratifiée (8), constitue la référence en matière de droit de la mer.
Deux articles seulement de la convention de Montego Bay traitent des « objets à caractère archéologique ou historique » :
Tout d’abord, l’article 149 concerne ceux trouvés dans la Zone : ils « sont conservés ou cédés dans l’intérêt de l’humanité tout entière, compte tenu en particulier des droits préférentiels de l’Etat ou du pays d’origine, ou de l’Etat d’origine culturelle, ou encore de l’Etat d’origine historique ou archéologique ».
Ensuite, l’article 303 stipule que :
« 1. Les Etats ont l'obligation de protéger les objets de caractère archéologique ou historique découverts en mer et coopèrent à cette fin.
2. Pour contrôler le commerce de ces objets, l'Etat côtier peut, en faisant application de l'article 33, considérer que leur enlèvement du fond de la mer dans la zone visée à cet article, sans son approbation, serait cause d'une infraction sur son territoire ou dans sa mer territoriale, aux lois et règlements de l'Etat côtier visés à ce même article.
3. Le présent article ne porte atteinte ni aux droits des propriétaires identifiables, au droit de récupérer des épaves et aux autres règles du droit maritime, ni aux lois et pratiques en matière d'échanges culturels.
4. Le présent article est sans préjudice des autres accords internationaux et règles du droit international concernant la protection des objets de caractère archéologique ou historique. »
Comme le souligne l’étude d’impact réalisée par le ministère des affaires étrangères sur la convention sur la protection du patrimoine culturel subaquatique, les articles de la convention de Montego Bay sont assez imprécis et ne permettent pas d’assurer une protection efficace des objets concernés.
En effet, l’article 149 ne précise pas par qui sont conservés les objets, ni à qui ils sont cédés. Il ne précise pas non plus les « droits préférentiels » des Etats qui ont un lien avec les objets découverts, ni comment ces droits se concilient avec « l’intérêt de l’humanité tout entière », ni en quoi consiste cet intérêt.
L’alinéa 3 de l’article 303, qui mentionne le « droit de récupérer des épaves », est même précisément mis en avant par les Etats-Unis pour justifier l’activité de certaines sociétés privées. Il a même été qualifié par le professeur Tullio Scovazzi (9) de « véritable incitation au pillage du patrimoine culturel ».
L’alinéa 4 de cet article ouvre cependant la voie à une réglementation plus spécifique pour la protection du patrimoine culturel subaquatique.
C. L’ADOPTION DE LA CONVENTION DE 2001
1. Historique des négociations
La convention signée en 2001 est l’aboutissement d’un processus de réflexion ancien sur la nécessité d’une protection supérieure.
En 1956, l’UNESCO a tout d'abord adopté une Recommandation définissant les Principes Internationaux à appliquer en matière de fouilles archéologiques, relative aux sites sous-marins situés dans les eaux intérieures ou territoriales. Les recommandations n’avaient cependant pas de caractère contraignant.
De son côté, en 1976, la commission de la culture et de l’éducation du Conseil de l’Europe a entrepris une étude sur le sujet. Un projet de convention a été proposé en 1985, qui ne sera finalement pas adopté. En 1994, un projet de convention est adopté à Buenos Aires par l’Association de droit international, et transmis à l’UNESCO. Entre temps, en 1996, l’ICOMOS (Conseil international des monuments et des sites) adoptait à Sofia, en Bulgarie, la charte internationale sur la protection et la gestion du patrimoine culturel subaquatique.
En 1997, la conférence générale de l’UNESCO reconnaissait la nécessité d’adopter une réglementation internationale pour protéger le patrimoine culturel subaquatique, pour laquelle une commission d’experts travaillera trois ans. Le 2 novembre 2001, la Convention était adoptée en session plénière de la 31e Conférence générale de l’UNESCO à une forte majorité : 88 voix pour, 4 contre et 15 abstentions (dont celle de la France). Elle contient 35 articles ainsi qu’une annexe, qui détaille les règles relatives aux interventions sur le patrimoine culturel subaquatique. Ces règles sont largement inspirées de la charte adoptée par l’ICOMOS.
La convention est entrée en vigueur le 2 janvier 2009, trois mois après la date de dépôt du vingtième instrument de ratification, conformément aux dispositions de son article 27 (10). On compte aujourd’hui 41 Etats parties (11), dont 7 Etats de l’Union européenne : l’Espagne, le Portugal, l’Italie, la Bulgarie, la Roumanie, la Slovaquie et la Slovénie (12). 14 autres Etats ont engagé le processus de ratification.
Il faut noter que deux nations maritimes majeures n’ont pas avancé dans le processus de ratification : pour les Etats-Unis, l’adhésion à cette convention est indissociable de la ratification de la convention de Montego Bay, laquelle n’a pas abouti au Sénat en juillet 2012 : la ratification d’un traité international requiert une majorité des deux-tiers au Sénat américain et les conditions ne sont pas réunies à l’heure actuelle pour cela. Le Royaume-Uni non plus ne s’est pas encore engagé dans le processus de ratification.
3. Une convention dans la continuité du droit international
Si la convention de 2001 vient combler le vide juridique né du caractère trop vague des articles de celle de Montego Bay, elle n’entend cependant pas remettre en cause le cadre juridique général fixé par cette convention. L’article 3 de la convention de 2001 précise qu’aucune de ses dispositions « ne porte atteinte aux droits, à la juridiction et aux devoirs des États en vertu du droit international, y compris la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. La présente Convention est interprétée et appliquée dans le contexte de et en conformité avec les dispositions du droit international, y compris la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. »
La présente convention est notamment conforme à celle de Montego Bay en ce qui concerne la définition des zones maritimes (13) :
- La mer territoriale désigne les eaux jusqu’à 12 milles marins de la ligne de base.
- la zone contiguë désigne les eaux entre 12 et 24 milles marins de la ligne de base.
- La zone économique exclusive (ZEE) désigne la zone adjacente à la mer territoriale, qui peut s’étendre jusqu’à 200 milles marins de la ligne de base.
- Le plateau continental désigne la mer jusqu’à l’affaissement du plateau continental dans les eaux profondes, ou au moins jusqu’au bout de la ZEE.
- La Zone (ou haute mer) désigne les fonds marins au-delà des limites de la juridiction nationale.
En outre, la présente convention ne peut pas servir à faire valoir ou contester une revendication de souveraineté ou juridiction nationale (14). Elle n’a pas non plus vocation à régler la question de la propriété du patrimoine culturel subaquatique.
II. UNE CONVENTION AMBITIEUSE POUR UNE MEILLEURE PROTECTION DU PATRIMOINE CULTUREL SUBAQUATIQUE
La convention fixe un certain nombre d’exigences minimales, étant entendu que les Etats sont libres de développer, s’ils le souhaitent, des normes de protection plus élevées, notamment en ce qui concerne la protection du patrimoine culturel subaquatique immergé depuis moins de 100 ans, la convention n’intervenant que sur le patrimoine au moins centenaire.
Cela étant, il est surtout important de relever que la convention pose plusieurs principes fondamentaux et organise des mécanismes de coopération interétatiques.
A. LES PRINCIPES FONDAMENTAUX FIXÉS PAR LA CONVENTION
1. L’obligation de préserver le patrimoine culturel subaquatique
En premier lieu, la convention affirme, article 2, alinéa 3, que les Etats parties préservent le patrimoine culturel subaquatique dans l’intérêt de l’humanité. Ils coopèrent et prennent toutes les mesures appropriées à cette fin. Cette préservation porte aussi sur les objets remontés à la surface puisque, aux termes de l’alinéa 6, « les éléments du patrimoine culturel subaquatique qui ont été récupérés sont mis en dépôt, gardés et gérés de manière à assurer leur conservation à long terme. »
La convention exige également que tous les restes humains immergés se voient assurer le respect qui convient, l’alinéa 9 de l’article 2 stipulant que « les Etats parties veillent à ce que tous les restes humains immergés dans les eaux maritimes soient dûment respectés. »
2. La priorité donnée à la préservation in situ
L’article 2 (complété par la règle n°1 de l’annexe) précise en outre, dans son alinéa 5 que « la préservation in situ du patrimoine culturel subaquatique (en sa localisation d’origine donc) doit être considérée comme l’option prioritaire avant que toute intervention sur ce patrimoine ne soit autorisée ou entreprise ». La convention autorise l’intervention sur le patrimoine culturel subaquatique lorsqu’elle est compatible avec la protection du patrimoine et apporte une contribution significative à celle-ci, à sa connaissance ou à sa mise en valeur.
Le concept de préservation in situ est une notion moderne qui présente un certain nombre d’avantages. Elle souligne l’importance du contexte historique et de la signification scientifique de l’objet culturel. Il s’agit aussi d’éviter les erreurs commises pour le patrimoine terrestre, qui a été trop souvent dispersé à l’étranger. Le patrimoine immergé n’est pas vraiment en danger car il y jouit d’une protection naturelle en raison du rythme lent de la détérioration dû au manque d’oxygène. Par ailleurs, les objets récupérés sur les fonds marins nécessitent toute une série de soins pour les conserver, à la fois coûteux et risqués. Tous ces problèmes sont écartés si les objets sont gardés in situ. Dans d’autres cas cependant, l’excavation peut être préférable, soit pour protéger le site, soit à des fins de recherche. Le choix doit donc se faire au cas par cas.
Cependant, la préservation in situ n’est pas incompatible avec l’accessibilité au public à ce patrimoine. Le dixième alinéa de l’article 2 de la convention précise d’ailleurs expressément qu’« il convient d’encourager un accès responsable et inoffensif du public au patrimoine culturel subaquatique in situ à des fins d’observation ou de documentation, afin de favoriser la sensibilisation du public à ce patrimoine, ainsi que sa mise en valeur et sa protection, sauf en cas d’incompatibilité avec sa protection et sa gestion. »
Ainsi que votre Rapporteur l’a évoqué, plusieurs initiatives récentes ont entrepris d’offrir aux visiteurs des expériences in situ, tout en assurant en même temps la conservation et la protection du site originel, en accord avec les principes de la convention. Les plongeurs peuvent déjà accéder à certains sites, - l’épave du Yongala au large de l’Australie, le site du port antique de Césarée au large d’Israël. Les premiers musées subaquatiques sont en train d’ouvrir ou sont en construction. En Chine, à Baiheliang, des tunnels subaquatiques ont été construits pour permettre au public de voir les inscriptions hydrologiques sous le barrage des Trois Gorges. En Egypte, un musée subaquatique devrait être construit dans la baie d’Alexandrie pour présenter le phare et le palais de Cléopâtre.
Dans le même esprit, l’article 20 encourage les Etats à sensibiliser le public à la valeur et à l’intérêt du patrimoine culturel subaquatique : « Chaque Etat partie prend toutes les mesures opportunes pour sensibiliser le public à la valeur et à l’intérêt du patrimoine culturel subaquatique et à l’importance que revêt la protection prévue par la présente Convention. »
3. Le refus de l’exploitation commerciale
Aux termes de l’alinéa 7 de l’article 2, complété par la règle n° 2 de l’annexe, l’exploitation commerciale à des fins de transaction ou de spéculation, ou la dispersion irrémédiable du patrimoine subaquatique, sont interdits comme « foncièrement incompatibles » avec sa protection. Afin de lutter concrètement contre cette exploitation commerciale, la convention invite les Etats parties à adopter des mesures empêchant le trafic illicite de biens culturels trouvés dans les fonds marins. En effet, si les chasseurs de trésor ne peuvent revendre ce qu’ils ont découvert, l’intérêt économique des pillages diminue et donc les pillages aussi.
Cette règle n’empêche évidemment pas la recherche archéologique professionnelle ou l’accès des touristes.
Par ailleurs, la convention de 2001 refuse explicitement l’application du droit de l’assistance, que votre Rapporteur a déjà évoqué, et du droit des trésors (15) (article 4) sauf si cette hypothèse permet d’assurer la protection du patrimoine culturel subaquatique, et dans des conditions limitatives. Elle précise en effet qu’« Aucune activité concernant le patrimoine culturel subaquatique à laquelle la présente Convention s’applique n’est soumise au droit de l’assistance ni au droit des trésors, sauf si : a) elle est autorisée par les services compétents, et b) elle est pleinement conforme à la présente Convention, et c) elle assure que la protection maximale du patrimoine culturel subaquatique lors de toute opération de récupération soit garantie. »
4. La coopération et le partage de l’information aux fins de protection du patrimoine culturel subaquatique
Parmi les principes généraux de la convention, la coopération entre les Etats est la pierre angulaire du dispositif. Elle est traitée de manière détaillée au long du texte.
L’article 2, pose le principe (repris dans la règle n°8) en affirmant dans son alinéa 2 que « les Etats Parties coopèrent à la protection du patrimoine culturel subaquatique ». Dans le même esprit, il est précisé à l’alinéa 4 qu’ils prennent « individuellement ou, s’il y a lieu, conjointement, toutes les mesures appropriées conformément à la présente Convention et au droit international qui sont nécessaires pour protéger le patrimoine culturel subaquatique, en employant à cette fin les moyens les mieux adaptés dont ils disposent, et selon leurs capacités respectives. »
En ce sens, l’article 6 invite les Etats Parties à renforcer leur coopération : « les Etats Parties sont encouragés à conclure des accords bilatéraux, régionaux ou d’autres accords multilatéraux, ou à améliorer les accords existants, en vue d’assurer la préservation du patrimoine culturel subaquatique. » Ces accords doivent « être pleinement conformes aux dispositions de la présente Convention et ne pas en affaiblir le caractère universel ». Elles peuvent opportunément proposer des « règles et réglementations propres à assurer une meilleure protection du patrimoine culturel subaquatique par rapport à celles adoptées au titre de la présente Convention », règles auxquelles peuvent être invités à se joindre « les Etats ayant un lien vérifiable, en particulier un lien culturel, historique ou archéologique, avec le patrimoine culturel subaquatique concerné »
Sur ces bases, l’article 19 prévoit que les Etats coopèrent à l’exploration, la fouille, la documentation, l’étude et la mise en valeur du patrimoine culturel subaquatique. L’article précise tout d'abord que « Les Etats parties coopèrent et se prêtent mutuellement assistance en vue d’assurer la protection et la gestion du patrimoine culturel subaquatique dans le cadre de la présente Convention, notamment, lorsque cela est possible, en collaborant à l’exploration, la fouille, la documentation, la préservation, l’étude et la mise en valeur de ce patrimoine. »
En outre, le partage de l’information est une obligation : « Dans la mesure où les objectifs de la présente Convention le permettent, chaque Etat partie s’engage à partager avec les autres Etats parties l’information dont il dispose sur le patrimoine culturel subaquatique, en ce qui concerne notamment la découverte d’éléments de ce patrimoine, leur localisation, les éléments qui ont été fouillés ou récupérés en contravention de la présente Convention ou en violation d’autres dispositions du droit international, les méthodes et techniques scientifiques appropriées et l’évolution du droit applicable à ce patrimoine. », étant entendu que tant que la divulgation de cette information peut être préjudiciable à la préservation des éléments et présenter un risque ou un danger pour le patrimoine découvert ou localisé, elle reste confidentielle, partagée uniquement entre les services compétents des Etats parties et l’UNESCO.
Enfin, obligation est faite aux Etats Parties de prendre « toutes les mesures opportunes, y compris, lorsqu’il le peut, en utilisant les bases de données internationales appropriées, pour diffuser l’information dont il dispose sur les éléments du patrimoine culturel subaquatique fouillés ou récupérés en violation de la présente Convention ou, par ailleurs, du droit international. »
En outre, aux termes de l’article 21, les Etats Parties doivent également coopérer pour la formation à l’archéologie subaquatique et aux techniques de préservation du patrimoine culturel subaquatique. Ils procèdent à cet effet aux transferts de technologies nécessaires.
B. LES MÉCANISMES CONCRETS DE COOPÉRATION INTERNATIONALE
La convention organise des mécanismes de collaboration et de coopération qui varient selon la localisation du patrimoine culturel subaquatique, en d'autres termes, qui s’articulent sur la base des dispositions du droit de la mer telles que définies dans la convention de Montego Bay.
Aux termes de l’article 7 de la convention, « dans l’exercice de leur souveraineté », les États parties ont tout d'abord le droit exclusif de réglementer et autoriser les interventions sur le patrimoine culturel subaquatique présent dans leurs eaux intérieures, leurs eaux archipélagiques et leur mer territoriale. Ce faisant, ils prescrivent l’application des règles fixées en la matière par la présente convention.
Dans le même esprit, les Etats parties peuvent également réglementer et autoriser les interventions sur le patrimoine culturel subaquatique dans leur zone contiguë, c'est-à-dire de 12 à 24 milles marins, en prescrivant l’application des règles de la convention (article 8).
Pour le patrimoine culturel subaquatique situé dans leur ZEE, sur leur plateau continental ou dans la Zone, les articles 9 à 12 de la convention établissent le régime de coopération entre Etats parties tant en ce qui concerne la déclaration et la notification qu’en ce qui concerne la protection et l’intervention sur le patrimoine culturel subaquatique.
1. Déclaration et notification
La convention rappelle en premier lieu qu’ « il incombe à tous les Etats parties de protéger le patrimoine culturel subaquatique dans la zone économique exclusive et sur le plateau continental conformément à la présente Convention ». En conséquence de quoi, aux termes de l’article 9, alinéa 1-a, les Etats parties exigent que les navires battant leur pavillon ou leurs nationaux les informent d’une découverte ou d’une intervention qu’ils envisagent sur le patrimoine culturel subaquatique se situant dans leur propre ZEE ou sur leur plateau continental.
Dans le même esprit, cette exigence s’impose si la découverte a lieu ou si l’intervention est envisagée dans la ZEE ou sur le plateau continental d’un autre Etat partie (article 9 ; alinéa 1-b) : le national ou le capitaine du navire doit également les en informer, ainsi que l’autre Etat partie. Transmission rapide et efficace de ces déclarations est faite à tous les autres Etats parties, l’Etat Partie notifiant par ailleurs au directeur général de l’UNESCO les découvertes ou interventions effectuées, étant entendu que tout Etat partie peut faire savoir à l’Etat partie dans la ZEE ou sur le plateau continental duquel se trouve le patrimoine culturel subaquatique qu’il souhaite être consulté sur la manière d’assurer la protection effective de ce patrimoine, dès lors que cette demande est fondée « sur un lien vérifiable, en particulier un lien culturel, historique ou archéologique, avec le patrimoine culturel subaquatique considéré. »
Cela étant, l’article 11 de la convention rappelle que l’obligation faite aux Etats Parties de protéger le patrimoine culturel subaquatique s’impose aussi dans la Zone. En d'autres termes, l’exigence posée à l’article 9 est réitérée ici, et si une découverte a lieu, ou si une intervention est envisagée dans la Zone, le national ou le capitaine d’un navire battant pavillon d’un Etat Partie doivent l’informer.
De la même manière que précédemment, les Etats Parties notifient au directeur général de l’UNESCO les informations qui leur sont ainsi transmises, lesquelles sont mises à disposition de tous les autres Etats Parties. En cas de découverte ou d’intervention envisagée dans la Zone, l’information est également transmise au Secrétaire général de l’Autorité internationale des fonds marins. Si un Etat Partie justifie d’un lien vérifiable - culturel, historique ou archéologique - avec un patrimoine subaquatique, il peut faire savoir au directeur général qu’il souhaite être consulté sur la manière d’en assurer la protection.
L’obligation d’informer ne s’applique pas aux navires de guerre et autres navires gouvernementaux ou aéronefs militaires faisant des découvertes dans le cadre de l’exercice normal de leurs opérations. Les Etats veillent cependant à ce qu’ils s’y conforment « dans la mesure du raisonnable et du possible », selon l’article 13, « en adoptant des mesures appropriées » compatibles avec leurs opérations et capacités opérationnelles.
2. Protection du patrimoine culturel subaquatique en cas de découverte ou d’intervention
Comme précédemment, deux cas sont à distinguer, selon que les découvertes ou interventions ont lieu dans la ZEE ou sur le plateau continental ou dans la Zone. En outre, un mécanisme d’« Etats coordinateurs » est institué dans les articles 10 et 12, qu’il convient de présenter.
En premier lieu, s’agissant de la ZEE et du plateau continental, le principe est posé à l’article 10, alinéa 2, de la possibilité pour l’Etat partie concerné d’autoriser ou d’interdire toute intervention sur le patrimoine culturel subaquatique s’y trouvant : « Un Etat partie dans la zone économique exclusive ou sur le plateau continental duquel se trouve le patrimoine culturel subaquatique a le droit d’interdire ou d’autoriser toute intervention sur ce patrimoine pour empêcher toute atteinte à ses droits souverains ou à sa juridiction tels qu’ils sont reconnus par le droit international, y compris la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. »
Lorsqu’une découverte est faite ou qu’une intervention est envisagée, l’Etat Partie concerné consulte les autres Etats Parties qui ont manifesté leur intérêt, sur la meilleure façon de protéger le patrimoine culturel subaquatique. L’Etat Partie agit alors en tant qu’« Etat coordonnateur », à moins qu’il ne le souhaite pas, auquel cas, l’un de ceux ayant manifesté leur intérêt est désigné par les autres.
Lorsque les opérations, découverte ou intervention envisagée, ont lieu dans la Zone, c’est le directeur général de l’UNESCO, selon l’article 12, qui invite les Etats Parties ayant manifesté leur intérêt à se consulter sur la meilleure façon de protéger le patrimoine concerné et à désigner un Etat coordonnateur.
Dans l’un comme l’autre cas, après consultation des Etats qui ont manifesté leur intérêt en raison d’un lien avec le patrimoine subaquatique concerné, l’Etat coordinateur met en œuvre les mesures de protection qui ont été convenues et délivre les autorisations. Dans cette mission, il agit au nom des Etats Parties dans leur ensemble, et non pas en son intérêt propre.
Enfin, la convention a également prévu les cas d’urgence, quel que soit l’endroit où se trouve le patrimoine culturel subaquatique menacé. Il est ainsi précisé, à l’alinéa 4 de l’article 10, que « l’Etat coordonnateur peut prendre toutes mesures opportunes et/ou accorder toutes autorisations nécessaires conformément à la présente Convention, et, au besoin, avant toute consultation, afin d’empêcher tout danger immédiat pour le patrimoine culturel subaquatique, du fait de l’activité humaine, ou de toute autre cause, notamment le pillage. Lors de l’adoption de ces mesures, l’assistance d’autres Etats Parties peut être sollicitée. » Une disposition analogue figure à l’alinéa 3 de l’article 12, pour la protection du patrimoine culturel subaquatique dans la Zone.
3. Le cas des navires ou aéronefs d’Etat et la position de la France
L’article 1, alinéa 8, définit les navires et aéronefs d’Etat avec quatre critères. Il s’agit des navires de guerre et autres navires ou aéronefs qui « appartenaient à un Etat ou opéraient sous son contrôle, étaient exclusivement utilisés, à l’époque où ils ont sombré, à des fins de service public non commercial, qui sont identifiés comme tels et qui répondent à la définition du patrimoine culturel subaquatique. »
On a vu que la convention de 2001, dans son article 2, alinéa 8, précise en outre qu’« aucune disposition de la présente Convention ne peut être interprétée comme modifiant les règles du droit international et la pratique des États relatives aux immunités souveraines, ou l'un quelconque des droits d'un État, concernant ses navires et aéronefs d'État. »
Or, parmi ces règles de droit international, figure la loi du pavillon, reconnue par la plupart des Etats ayant un droit côtier, dont la France et les Etats-Unis, qui stipule que les bâtiments sous pavillons nationaux, appartiennent pour toujours à l’Etat qui les a lancés. Cela est vrai quel que soit le lieu où ils ont été retrouvés, y compris, donc, dans les eaux territoriales d’un autre Etat. En outre, la convention de Montego Bay consacre, à l’article 32, les « immunités dont jouissent les navires de guerre et autres navires d’Etat utilisés à des fins non commerciales. » (16)
Plusieurs dispositions de la convention traitent de la question des navires et aéronefs d’Etat, afin de garantir leur immunité. Il est notamment prévu qu’aucune intervention ne peut être menée sur une telle épave sans l’accord de l’Etat du pavillon et la collaboration de l’Etat coordonnateur. C’est le sens de l’article 10, alinéa 7, s’agissant de la ZEE et du plateau continental, l’article 12 alinéa 7 indiquant dans le même esprit qu’« aucun Etat Partie n’entreprend ni n’autorise d’intervention sur un navire ou aéronef d’Etat dans la Zone sans le consentement de l’Etat du pavillon. »
Pour protecteur qu’il puisse paraître, c’est cependant sur ces dispositions qu’ont porté les réserves de la France qui, avec d’autres Etats17, estimait que certaines stipulations de la convention de 2001 étaient ambiguës quant à la reconnaissance de l’immunité souveraine des épaves de navires et aéronefs d’Etat. La Convention prévoit en effet des règles spéciales qui leur sont applicables et qui varient selon la zone maritime. En effet, en cas de découverte de navires et aéronefs d’Etat dans les eaux archipélagiques et leur mer territoriale, les Etats parties « devraient informer l’Etat du pavillon partie à la présente Convention » (article 7, alinéa 3). En revanche, comme on l’a vu, s’agissant des découvertes dans la ZEE et sur le plateau continental, ainsi que dans la Zone, aucune intervention n’est menée sans l’accord de l’Etat du pavillon (article 10, alinéa 7 et article 12, alinéa 7).
La France était opposée au contenu de l’article 7 alinéa 3, et souhaitait que l’expression « devraient informer » soit remplacée par « doivent consulter ». N’ayant pas obtenu satisfaction, elle s’est abstenue lors de l’adoption du texte. Afin de garantir sa souveraineté sur les navires de guerre de son pavillon, la France envisage d’assortir sa ratification d’une déclaration rappelant la prééminence de la convention de Montego Bay.
4. Mesures et sanctions prises par les Etats Parties pour la mise en œuvre de la Convention
Les dispositions précitées sont complétées par un dispositif de contrôle et de sanctions. Les Etats Parties prennent des mesures pour empêcher l’entrée, le commerce et la possession, sur leur territoire, d’éléments du patrimoine culturel subaquatique illégalement récupérés (article 14). Ils prennent également des mesures pour interdire l’utilisation des territoires sous leur juridiction, et de tout type d’installation, ports, îles artificielles ou autres structures, sous leur contrôle exclusif, à l’appui d’interventions sur le patrimoine culturel subaquatique non-conformes à la convention (article 15).
L’article 16 fait en outre obligation aux Etats Parties de prendre « toutes les mesures opportunes pour s’assurer que leurs nationaux et les navires battant leur pavillon s’abstiennent de procéder à des interventions sur le patrimoine culturel subaquatique d’une manière non conforme à la présente Convention. » A cet effet, ils adoptent des sanctions contre les infractions aux mesures prises en application de la Convention (article 17), étant précisé que « Les sanctions applicables en matière d’infractions doivent être suffisamment rigoureuses pour garantir le respect de la présente Convention et décourager les infractions en quelque lieu que ce soit, et elles doivent priver les contrevenants des profits découlant de leurs activités illégales. ». Ils procèdent à la saisie des objets ainsi récupérés (article 18). A cet égard, on peut considérer comme modérées les sanctions actuellement prévues dans la législation française, puisque selon les indications fournies dans l’étude d’impact, le code du patrimoine, qui définit les sanctions liées aux infractions relatives aux biens culturels maritimes BCM, prévoient les peines suivantes dans ses articles L. 544-5 et suivants :
Article |
Infraction |
Peine |
L. 544-5 |
Défaut de déclarations prévues au deuxième alinéa de l'article L. 532-3 ou à l'article L. 532-4 |
Amende 3 750 € |
Fausse déclaration quant au lieu et à la composition du gisement sur lequel l'objet déclaré a été découvert | ||
L. 545-6 |
prospections, sondages, prélèvements ou fouilles sur des biens culturels maritimes ou déplacement de ces biens ou prélèvement sur ceux-ci en infraction aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 532-3 ou des articles L. 532-7 et L. 532-8 |
Amende 7500 € |
L. 545-7 |
aliéner ou acquérir un bien culturel maritime enlevé du domaine public maritime ou du fond de la mer dans la zone contiguë en infraction aux dispositions des articles L. 532-3, L. 532-4, L. 532-7 et L. 532-8 |
Deux ans de prison Amende de 4500€ jusqu’au double du prix de la vente du BCM |
Notification est faite des saisies au directeur général de l’UNESCO, le patrimoine culturel subaquatique concerné étant mis à disposition de l’intérêt général.
Enfin, pour assurer la mise en œuvre correcte de la convention, l’article 22 enjoint les Etats à créer ou renforcer des services compétents chargés de procéder à l’inventaire du patrimoine culturel subaquatique et d’en assurer la protection, la préservation, la mise en valeur et la gestion (18).
C. LES CONSÉQUENCES DE LA RATIFICATION
Pour les Etats Parties, la ratification de la convention emporte comme conséquences l’obligation de se conformer aux règles établies et la possibilité de bénéficier de l’assistance technique et scientifique apportée par le Conseil consultatif scientifique et technique dont la création est prévue à l’article 23. Composé de 12 experts, il s’est réuni pour la première fois en juin 2010 à Carthagène, en Espagne. De même, les Etats Parties bénéficient du régime de coopération internationale mis en place par la Convention. Même si un Etat n’a pas de juridiction sur un site, il peut, grâce aux stipulations des articles 9, 10, 11 et 12 de la Convention, être informé de l’existence de ce site, et coopérer en vue de la protection, de l’exploration et de la mise en valeur du site.
Cependant, l’efficacité de la Convention dépend évidemment du nombre d’Etats Parties. Plus ceux-ci seront nombreux, plus le schéma de coopération institué sera efficace pour sauvegarder le patrimoine culturel situé sur les fonds marins au-delà de la limite des eaux territoriales.
Le Titanic au regard de la Convention de 2001 Située dans les eaux internationales, l’épave du Titanic, découverte en septembre 1985 par une expédition franco-américaine par 4000 mètres de fond, au large de Terre-Neuve, n’est sous la juridiction d’aucun Etat. En dépit des polémiques, des objets ont été remontés dès 1987. Un accord international concernant le Titanic a été signé en 2003 entre la France, les Etats-Unis, le Royaume-Uni et le Canada, mais à ce jour seul le Royaume-Uni l’a ratifié. Ses règles sont similaires à celles établies par la Convention de 2001, mais cela ne protège cependant pas l’épave de pillages effectués par un national d’un autre Etat. Depuis le 15 avril 2012 en revanche, (soit cent ans après son naufrage), le Titanic est sous la protection de la convention de 2001, celle-ci s’appliquant au patrimoine immergé depuis au moins cent ans. Désormais, tous les Etats Parties à la convention participent à la protection de l’épave du Titanic. Ils peuvent notamment prendre les mesures appropriées contre la dispersion et la revente des objets retrouvés dans l’épave. Cet exemple illustre l’idée que la protection accordée au patrimoine culturel subaquatique sera d’autant plus efficace qu’un plus grand nombre d’Etats auront ratifié la Convention. |
2. Les conséquences de la ratification pour la France
Outre le fait de participer à la protection internationale du patrimoine culturel subaquatique, le fait pour la France de ratifier la convention pourrait avoir des effets économiques et sociaux positifs. L’étude d’impact met en en effet en avant la possibilité de création de nouveaux emplois liés à la protection, à l’étude et à la valorisation des patrimoines, immergés et retirés de la mer. Comme votre Rapporteur l’a indiqué précédemment, les exemples de mise en valeur du patrimoine maritime culturel montrent le grand intérêt du public à cet égard.
Des dégâts environnementaux pourraient aussi être prévenus. Les épaves des deux conflits mondiaux recèlent en effet des cargaisons dangereuses : explosifs, armes chimiques, gaz toxiques… La ratification de la convention permettra à la France d’être mieux informée des découvertes ou projets d’intervention sur un patrimoine immergé dans sa ZEE ou sur son plateau continental. Conformément aux dispositions de l’article 10, paragraphe 2, la France aura alors le droit d’interdire (ou d’autoriser) toute intervention sur ce patrimoine pour empêcher toute atteinte à ses droits souverains ou à sa juridiction. Le DRASSM travaille à ces questions spécifiques depuis le milieu des années 1980.
Si les sanctions en vigueur dans le droit français sont actuellement modérées et pourraient utilement être revues, aux yeux de votre Rapporteur, pour être réellement dissuasives comme l’article 17 de la convention le prévoit, d’autres questions devront aussi être abordées.
Ainsi, un certain nombre de définitions de notre droit, en matière de patrimoine, ne correspondent pas exactement à celles de la convention. La définition des « biens culturels maritimes », par exemple, recouvre « les gisements, épaves, vestiges ou généralement tout bien qui, présentant un intérêt préhistorique, archéologique ou historique, est situé dans le domaine public maritime ou au fond de la mer dans la zone contiguë », selon l’article L. 532-1 du code du patrimoine, et ne correspond donc pas exactement à celle du patrimoine culturel subaquatique proposée par l’article 1 de la convention. D’autres questions, telles celles relatives aux règles relatives aux interventions sur le patrimoine culturel subaquatique justifieront probablement de compléter notre droit interne.
En outre, afin d’assurer l’effectivité de la convention, des dispositions devront être ajoutées en ce qui concerne :
- L’obligation, pour tout ressortissant ou tout capitaine d’un navire battant pavillon français qui fait une découverte ou envisage une intervention sur le patrimoine culturel subaquatique dans la ZEE française ou dans celle d’un autre Etat Partie, de déclarer à l’Etat cette découverte ou intervention (articles 9 et 11);
- La mise en place de mesures de sauvegarde contre tout danger immédiat pour le patrimoine culturel subaquatique, (article 10, alinéa 4) ;
- La lutte contre l’entrée sur le territoire français, le commerce et la possession de patrimoine culturel subaquatique exporté illicitement et/ou récupéré en contravention avec la convention (article 14) ;
- L’interdiction de l'utilisation du territoire français à l'appui d'interventions sur le patrimoine culturel subaquatique non conformes aux dispositions de la convention (article 15) ;
- Les moyens de s'assurer que les ressortissants français et les navires battant pavillon français s'abstiennent de procéder à des interventions sur le patrimoine culturel subaquatique d'une manière non conforme à la convention (article 16),
- La possibilité de procéder à la saisie, sur le territoire français, des éléments du patrimoine culturel subaquatique récupérés illégalement (article 18).
CONCLUSION
La convention de l’UNESCO sur la protection du patrimoine culturel subaquatique illustre pleinement la reconnaissance, par la communauté internationale, de la valeur historique et culturelle du patrimoine culturel subaquatique, et de la nécessité de le protéger.
Pour ce faire, la convention fixe des règles destinées à prévenir la destruction, le pillage ou la dispersion du patrimoine culturel subaquatique, tout en encourageant son étude, sa mise en valeur et son accessibilité au public. La ratification permettra à la France de coopérer plus efficacement avec les autres Etats parties pour protéger le patrimoine culturel subaquatique ou qu’il soit situé.
C’est donc au bénéfice de ces observations que votre rapporteur vous invite à adopter le projet de loi qui nous est soumis.
La commission examine, sur le rapport de M. Jean Glavany, le projet de loi autorisant la ratification de la convention sur la protection du patrimoine culturel subaquatique (n° 90), au cours de sa première séance du 14 novembre 2012.
Après l’exposé du rapporteur, un débat a lieu.
Mme la présidente Elisabeth Guigou. Merci pour votre excellent rapport qui nous a fait voyager, en nous rappelant parfois quelques lectures de jeunesse.
M. Jacques Myard. Les Etats-Unis ont-ils l’intention de ratifier ce texte ? Les compagnies américaines excellent dans l’art d’exploiter les trésors volés.
M. Gwenegan Bui. L’article 17 de la convention demande l’application de sanctions suffisamment rigoureuses. Le niveau de rigueur sera-t-il laissé à l’appréciation des Etats ? J’aimerais également savoir qui bénéficiera du retour de cette manne financière.
M. le rapporteur. Il faut la majorité des deux tiers au Sénat américain pour qu’un traité international soit ratifié. Les Etats-Unis ont la volonté de ratifier le texte, mais les conditions ne sont actuellement pas réunies. Les sociétés concernées exercent notamment un lobbying influent.
Notre pays a un dispositif de sanctions trop modeste. Nous devrons veiller à les renforcer. C’est d’ailleurs à l’étude.
M. Jean-Luc Drapeau. Notre pays est l’un des plus étendu au plan maritime dans le monde.
M. le rapporteur. Nous sommes effectivement au deuxième rang, avec 11 millions de kilomètres carrés.
Suivant les conclusions du rapporteur, la commission adopte sans modification le projet de loi (n° 90).
ANNEXE 1 : ETATS PARTIES A LA CONVENTION
Etat |
Date du dépôt de l’instrument |
Type d’instrument |
Panama |
20/05/2003 |
Ratification |
Bulgarie |
06/10/2003 |
Ratification |
Croatie |
01/12/2004 |
Ratification |
Espagne |
06/06/2005 |
Ratification |
Libye |
23/06/2005 |
Ratification |
Nigéria |
21/10/2005 |
Ratification |
Lituanie |
12/06/2006 |
Ratification |
Mexique |
05/07/2006 |
Ratification |
Paraguay |
07/09/2006 |
Ratification |
Portugal |
21/09/2006 |
Ratification |
Equateur |
01/12/2006 |
Ratification |
Ukraine |
27/12/2006 |
Ratification |
Liban |
08/01/2007 |
Acceptation |
Sainte-Lucie |
01/02/2007 |
Ratification |
Roumanie |
31/07/2007 |
Acceptation |
Cambodge |
24/11/2007 |
Ratification |
Cuba |
26/05/2008 |
Ratification |
Monténégro |
18/07/2008 |
Ratification |
Slovénie |
18/09/2008 |
Ratification |
Barbade |
02/10/2008 |
Acceptation |
Grenade |
15/01/2009 |
Ratification |
Tunisie |
15/01/2009 |
Ratification |
Slovaquie |
11/03/2009 |
Ratification |
Albanie |
19/03/2009 |
Ratification |
Bosnie-Herzégovine |
22/04/2009 |
Ratification |
Iran, République islamique d' |
16/06/2009 |
Ratification |
Haïti |
09/11/2009 |
Ratification |
Jordanie |
02/12/2009 |
Ratification |
Saint-Kitts-et-Nevis |
03/12/2009 |
Ratification |
Italie |
08/01/2010 |
Ratification |
Gabon |
01/02/2010 |
Acceptation |
Argentine |
19/07/2010 |
Ratification |
Honduras |
23/07/2010 |
Ratification |
Trinité-et-Tobago |
27/07/2010 |
Ratification |
République démocratique du Congo |
28/09/2010 |
Ratification |
Saint-Vincent-et-les Grenadines |
08/11/2010 |
Ratification |
Namibie |
09/03/2011 |
Ratification |
Maroc |
20/06/2011 |
Ratification |
Bénin |
04/08/2011 |
Ratification |
Jamaïque |
09/08/2011 |
Ratification |
Palestine |
08/12/2011 |
Ratification |
ANNEXE 2 : LES ZONES MARITIMES SELON LA CONVENTION DE MONTEGO BAY

TEXTE DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
Article unique
(Non modifié)
Est autorisée la ratification de la convention sur la protection du patrimoine culturel subaquatique (ensemble une annexe), adoptée à Paris le 2 novembre 2001, et dont le texte est annexé à la présente loi.
NB : Le texte de la convention figure en annexe au projet de loi (n° 90).
© Assemblée nationale