

______
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 18 février 2015.
RAPPORT
FAIT
AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES SUR LE PROJET DE LOI, autorisant la ratification de la convention internationale de Nairobi sur l’enlèvement des épaves
PAR M. Noël MAMERE
Député
——
ET
ANNEXE : TEXTE DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
Voir le numéro :
Assemblée nationale : 1238.
SOMMAIRE
___
Pages
INTRODUCTION 5
I. UNE CONVENTION NÉCESSAIRE 9
A. LES ÉPAVES MARITIMES : UN PHÉNOMÈNE LOIN D’ÊTRE ANECDOTIQUE 9
B. L’ABSENCE ACTUELLE DE CADRE JURIDIQUE CLAIR ET SÉCURISÉ DES DROITS DES ETATS CÔTIERS SUR LES ÉPAVES DANGEREUSES SITUÉES DANS LA ZONE ÉCONOMIQUE EXCLUSIVE 10
II. LA CONVENTION DE NAIROBI DU 18 MAI 2007 : DES DISPOSITIONS OPPORTUNES SUR LES COMPÉTENCES DES ETATS ET LES OBLIGATIONS DES PROPRÉTAIRES DE NAVIRES ET DES ARMATEURS 13
A. UN VIDE JURIDIQUE QUE VIENT COMBLER LA CONVENTION DE NAIROBI 13
B. LES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION 15
1. Une application à la ZEE même lorsque celle-ci n’a pas été délimitée 15
a. Une application obligatoire à la ZEE, mais qui peut s’étendre au-delà sur option des Etats 15
b. L’absence de difficulté même lorsque la ZEE n’a pas été délimitée 15
2. Une unification utile de la notion d’épave et une clarification de la notion de danger 16
a. Une approche large de l’épave qui s’étend aussi aux navires en difficulté, mais exclut les aéronefs 16
b. Des critères de danger définis avec précision 17
3. Un droit d’intervention sur les épaves reconnu aux Etats côtiers, encadré par le principe de proportionnalité 19
4. Des obligations précises pour les propriétaires des navires 20
a. Un préalable : la déclaration des accidents de mer par le capitaine ou l’exploitant 20
b. La responsabilité civile du propriétaire du navire 20
c. L’obligation de contracter une assurance ou une garantie financière, attestée par un certificat joint aux documents règlementaires de bord 21
d. Une simplification : le droit pour les Etats d’exercer une action directe contre les assureurs pour le remboursement des frais qu’ils ont engagés au titre des opérations d’enlèvement 22
e. Le régime applicable aux navires immatriculés dans des Etats non partie à la convention 22
f. Un régime de règlement des différends 22
C. TROIS LIMITES DU TEXTE AISÉMENT EXPLICABLES 23
1. Une conception de l’enlèvement des épaves limitée à ce qui strictement nécessaire 23
2. Des exceptions à la responsabilité du propriétaire compte tenu des autres textes internationaux applicables en la matière 23
3. Des délais de prescription brefs, mais suffisants 24
D. UNE LIMITATION DE LA RESPONSABILITÉ CONFORME À LA CONVENTION DE LONDRES DE 1976 MAIS QUI NE CONCERNE PAS LA FRANCE 25
III. UNE RATIFICATION MAINTENANT URGENTE COMPTE TENU DE L’ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA CONVENTION ET DES AMÉNAGEMENTS À OPÉRER DANS LA LÉGISLATION 27
1. Une articulation sans difficulté avec le droit européen 27
2. Plusieurs différences d’approche, en revanche, entre le droit français et la convention de Nairobi qui imposent de prévoir un texte d’adaptation 28
a. Les principaux points concernés 28
b. Une articulation à préciser entre le droit interne et la convention, en cas d’extension de la convention à la mer territoriale 29
c. Des adaptations législatives à prévoir 30
EXAMEN EN COMMISSION 33
ANNEXE 1 35
AUDITIONS 35
ANNEXE 37
TEXTE DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES 37
Mesdames, Messieurs,
Longtemps le régime des épaves maritimes a été essentiellement perçu et réglementé au prisme de l’appropriation des richesses qu’elles pouvaient receler. Il fallait notamment arbitrer entre les intérêts, éventuellement opposés, du propriétaire, du découvreur, également appelé inventeur, du sauveteur et même de la collectivité publique.
Cette prédominance de la vision patrimoniale est progressivement passée au second plan face à deux autres objectifs d’intérêt général : la sécurité de la navigation ; la lutte contre la pollution.
Chaque État a adopté sa propre législation en la matière, de manière d’ailleurs largement convergente. Dans le domaine maritime en effet, l’usage, et en particulier l’usage international, tient une large place et se diffuse par-delà les frontières. Ainsi l’ordonnance de 1681 sur la marine établie à la demande de Colbert, et réunissant pour la première fois le droit des affaires maritimes privées et la police de la mer, s’est-elle en partie fondée sur les règles en vigueur dans les ports des Pays-Bas, les plus importants de l’époque, dont Anvers.
Ce cadre national et coordonné a largement suffi tant que la dangerosité des épaves et les conséquences des accidents concernaient essentiellement la proximité des côtes. La réglementation pouvait ainsi se limiter aux eaux intérieures de l’immédiate proximité du littoral et à la mer territoriale, définie par la limite des trois puis douze milles marins et sur laquelle la souveraineté des Etats riverains était reconnue, leur donnant ainsi pleine capacité pour prendre les mesures de police qu’ils estimaient nécessaires.
Ce droit maritime a été codifié lors la conférence de Genève en 1958 qui a adopté quatre conventions portant sur : la mer territoriale et la zone contiguë, zone d’une largeur de douze milles également dans laquelle l’Etat côtier dispose de certains pouvoirs préventifs de police ; la haute mer ; le plateau continental ; la pêche et la conservation des ressources biologiques.
Le développement du transport maritime après la Seconde guerre mondiale s’est accompagné d’un accroissement des risques en raison non seulement du simple effet arithmétique de l’augmentation du trafic, mais aussi de l’accroissement considérable des échanges de produits polluants et dangereux en cas de naufrage, notamment des produits pétroliers et chimiques – et de celui, non moins spectaculaire, de la taille des navires et de leur tiran d’eau. Des épaves en eaux peu profondes qui ne créaient aucune entrave à la navigation sont devenues dangereuses. De même, le développement, au demeurant préjudiciable pour l’environnement et la biodiversité, des techniques de pêche intensive s’est accompagné de la diffusion du chalutage de fond, bien que cette technique porte préjudice tant à l’environnement qu’à la biodiversité.
Il a donc fallu trouver un nouvel équilibre entre le principe de la liberté de la haute mer et les intérêts de la sécurité maritime et environnementale.
Deux ans après la catastrophe du Torrey Canyon, en mars 1967, et ses 120.000 tonnes de pétrole brut déversées à l’entrée de la Manche, au large de la Cornouailles, a été adoptée la convention de Bruxelles du 29 novembre 1969 donnant compétence aux Etats pour intervenir en haute mer en cas de risque de pollution par les hydrocarbures. A ainsi été créé, sans limite géographique, un droit d’intervention certes encadré, mais réel, donnant toute légalité internationale aux mesures prises en amont par les Etats dès le début de la catastrophe, lorsque le navire en difficulté est encore dans les eaux internationales et sans qu’une demande de la part de son propriétaire ou de son équipage ne soit nécessaire.
Ce dispositif a été étendu par le protocole de Londres de 1973 aux cas de pollution par les produits autres que les hydrocarbures.
Cette nouvelle dichotomie entre une haute mer libre de toute souveraineté étatique, où l’intervention légitime des Etats sur des navires ne battant pas leur pavillon est fondée sur une convention internationale, et des eaux territoriales sous souveraineté étatique et prolongées par la zone contigüe pour l’application des règles de police préventive, a été rapidement affectée par la convention des Nations Unies du 10 décembre 1982 sur le droit de la mer, dite convention de Montego Bay ou CNUDM.
Celle-ci a défini la zone économique exclusive (ZEE), qui s’étend jusqu’à 200 milles marins (soit une largeur effective de 188 milles), dans laquelle l’Etat côtier a la maîtrise exclusive de la pêche, de la création d'ouvrages, de la recherche marine et de la préservation du milieu marin, selon son article 60. Ces droits ne valent cependant pas souveraineté et n’entraînent donc pas application des règles de police de l’Etat côtier.
En l’absence de règles de droit international traitant de la question de l’enlèvement des épaves dangereuses dans la ZEE, certains Etats ont pris l’initiative d’adopter et d’appliquer leurs propres de règles de droit interne de manière à disposer d’un droit d’intervention sur ces épaves. Tel est le cas des Etats-Unis, du Canada, du Royaume-Uni, notamment, selon l’étude d’impact qui accompagne le projet de loi. Cependant, une telle solution n’est pas suffisante.
D’une part, la base juridique de ces règles est partielle, car l’article 221 de la CNUDM ne reconnaît à l’Etat côtier un tel droit d’intervention qu’en vue de protéger son littoral, ou des intérêts précis tels que la pêche, contre une pollution ou une menace de pollution. L’objectif de la sécurité maritime n’est donc pas pris en compte.
D’autre part, la question des épaves situées dans la ZEE est d’intérêt collectif, car contrairement aux eaux territoriales, qui ne sont empruntées qu’à l’approche des ports des Etats côtiers, à proximité des caps ou pour le franchissement des détroits, celle-ci est traversée par de nombreux navires qui n’y sont qu’en transit.
C’est pourquoi à partir des années 1990, les Etats membres de l’Organisation maritime internationale (OMI) ont engagé les travaux et la négociation en vue d’un corps de règles internationales sur les épaves, qui tienne compte tant des impératifs de sécurité que des exigences de protection du milieu marin. Ceux-ci se sont achevés, après plus d’une décennie, par la convention de Nairobi sur l’enlèvement des épaves, signée le 18 mai 2007, et dont il est demandé à l’Assemblée nationale d’autoriser la ratification.
La voie législative est incontestable compte tenu de la nature elle-aussi législative des dispositions de la convention qui, d’une part, reconnaît aux Etats une compétence pour intervenir sur les épaves situées dans la ZEE et fixe les règles concernant leur enlèvement lorsqu’elles présentent un risque pour la navigation ou pour l’environnement et, d’autre part, pose le principe de la responsabilité du propriétaire pour les frais résultant des opérations de localisation, de signalisation et d’enlèvement de ces mêmes épaves, ce qui permet ainsi de créer une obligation d’assurance garantissant le remboursement des sommes éventuellement engagées dans ce cadre par les collectivités publiques.
La nature et la teneur des dispositions de la convention de Nairobi recommandent clairement l’adoption du présent projet de loi de ratification.
Si l’opinion publique n’est informée des accidents maritimes que lorsqu’ils prennent une grande ampleur, ou lorsqu’ils s’achèvent par un échouage proche des côtes, ce qui est trop fréquent mais reste néanmoins rare, les fonds marins recèlent un grand nombre d’épaves.
La plupart d’entre elles datent certes de la Seconde guerre mondiale, mais pas toutes. Certaines d’entre elles sont qualifiées par les professionnels de « bombes à retardement » en raison du contenu de leurs soutes.
A défaut de recensement permettant d’établir des données fiables, on dispose de plusieurs estimations. L’UNESCO a pour sa part évalué à trois millions le nombre total des épaves, selon une approche naturellement historique et culturelle.
Pour sa part, dans la résolution n° 1869 de 2012 sur l’impact des épaves engloutis, l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe a estimé que les trois quarts des épaves étaient le résultat des opérations navales de la Seconde guerre, qu’un quart du total se trouvait dans l’Atlantique Nord et 4 % en Méditerranée.
De manière plus directement opérationnelle, le CEDRE, Centre de documentation, de recherche et d'expérimentations sur les pollutions accidentelles des eaux, créé à la suite de la catastrophe de l’Amoco Cadiz, a recensé en 2006 pour les eaux sous juridiction française quelques 8.569 épaves potentiellement polluantes dont 1.583 pétroliers avec des quantités allant, selon les évaluations, de 2,5 millions à 20 millions de tonnes dans leurs soutes. Il n’y a pas que les hydrocarbures qui soient dangereux. Les substances chimiques acides, solvantes, chlorées, bromées, nitrées ou encore fluorées transportées par mer sont particulièrement nocives, sans parler de l’acétone…
Ces épaves constituent également parce qu’elles ne sont pas toujours totalement immobiles et parce que le tiran d’eau de certains navires est très élevé, ou encore parce que le trafic impose de nouvelles routes maritimes, des obstacles à la navigation. Ce sont des pièges pour les chaluts. Il y a aussi les risques d’explosion.
En outre, les risques prennent parfois du temps à se manifester. Le Foucault, échoué en 1940 près de l’île de Ré, a commencé à relâcher d’importantes quantités de fioul en 2000 seulement…
Certaines cargaisons a priori inoffensives ne le sont pas. La cargaison de blé du Fenes, cargo naufragé en 1996 à proximité des îles Lavezzi en Corse, a mis en péril les espaces recouverts d’une épaisse couche de grains, de même que ceux contaminés par les pesticides destinés à protéger la cargaison pendant le transport en mer et, surtout, les plusieurs hectares de fonds marins brûlés ou endommagés par les dégagements des gaz et alcool de fermentation produits avant que l’enlèvement du fret ne soit achevé.
Les coûts de traitement et d’enlèvement des épaves sont très variables. Dans le cas les plus complexes, il y a d’abord les travaux de recherche et de localisation, puis de signalisation de l’épave.
Le Foucault, précédemment évoqué et dont de larges parts avaient été récupérées par des professionnels des métaux compte tenu de la faible profondeur, entre un et cinq mètres, a exigé de l’Etat et des collectivités un effort financier de 2,4 millions d’euros dans les années 2000.
Ce cas est le plus simple car il n’y avait ni à rechercher ni à signaler l’épave, ni surtout à intervenir dans des conditions difficiles.
A l’opposé, les opérations relatives au traitement du paquebot de croisière Costa Concordia à la suite de son naufrage ont été estimées à 1,5 milliard d’euros, pour son redressement, son renflouement, sa stabilisation, son transfert vers Gênes et son démantèlement.
B. L’ABSENCE ACTUELLE DE CADRE JURIDIQUE CLAIR ET SÉCURISÉ DES DROITS DES ETATS CÔTIERS SUR LES ÉPAVES DANGEREUSES SITUÉES DANS LA ZONE ÉCONOMIQUE EXCLUSIVE
Les eaux territoriales ou la mer territoriale, qui s’étendent jusqu’à la limite des douze milles marins à partir de la ligne dite de base, dont le tracé suit celui de la côte en le simplifiant, relèvent de la souveraineté de l’Etat côtier. C’est donc de plein droit et sans contestation juridique possible que les Etats y fixent les règles concernant la navigation et, par conséquent, les épaves.
Au-delà en revanche, la compétence de l’Etat ne s’exerce en principe plus que sur les navires battant son pavillon, c’est-à-dire immatriculés auprès de lui. Cette loi du pavillon, directement liée au principe de la liberté des mers, est très ancienne. Elle est exigeante car c’est une compétence exclusive. Aucun autre Etat ne peut en principe contrôler ou adopter des sanctions à l’égard d’un navire étranger afin de le contraindre à respecter les règles de droit, notamment lorsque des règles de droit international ne sont pas opposables au pays du pavillon.
C’est d’ailleurs cette compétence exclusive qui a conduit au développement des pavillons de complaisance, moyen d’échapper non seulement au plus grand nombre de règles en matières fiscale, sociale ou de sécurité, mais aussi aux contrôles en haute mer.
Cette construction juridique a vite montré ses limites.
D’abord, dès le XVIIIe siècle, a été reconnue par l’usage, au-delà de la mer territoriale, la zone contigüe, de même largeur, permettant à l’Etat riverain d’agir à titre préventif contre toute infraction d’ordre douanier, fiscal, sanitaire ou d’immigration. Cette zone contigüe a été formellement reconnue par le droit international maritime lors de la conférence de Genève en 1958, dans le cadre de la convention du 29 avril de la même année sur la mer territoriale et la zone contigüe.
Ensuite, le développement du transport des matières polluantes et dangereuses a montré la nécessité d’agir encore plus en amont de cette ligne des 24 milles marins définies par l’addition de la largeur de la mer territoriale et de celle de la zone contigüe.
L’échouement du Torrey Canyon en mars 1967 au large des îles Scorlingues (ou Scilly en anglais), à l’entrée de la Manche, a déversé en mer 120.000 tonnes de pétrole, dont une grande partie est venue polluer sur les côtes britanniques et françaises. La nappe s’est en effet étendue de la Cornouailles aux Côtes d’Armor.
Ainsi la convention de Bruxelles de 1969, sur le droit d'intervention en haute mer en cas d'accident entraînant ou pouvant entraîner une pollution par les hydrocarbures, a-t-elle reconnu le droit pour un Etat côtier de « prendre des mesures appropriées » pour assurer sa protection à l'égard de tout navire naviguant en haute mer, lorsqu’il y a « danger grave et imminent » de pollution susceptible d’avoir des « conséquences dommageables très importantes ». Tel est le cas même si ce navire relève d’un Etat non signataire de la convention.
En 1973, le protocole de Londres l’a étendue aux substances dangereuses autres que les hydrocarbures.
Ce dispositif a paru suffisant puisque la convention des Nations-Unies sur le droit de la mer (CNUDM) du 10 décembre 1982, dite de Montego Bay, n’a pas apporté d’élément nouveau. Son article 221 reconnaît aux Etats un droit d’intervention en haute mer pour éviter les pollutions engendrées par les accidents marins.
Par conséquent, les droits des Etats sur la zone économique exclusive (ZEE), qui est l’une des innovations majeures de la Convention, se limitent selon son article 58, à des droits « souverains » aux fins d'exploration et d'exploitation, de conservation et de gestion des ressources naturelles, biologiques ou non biologiques, des fonds marins et de leur sous-sol, ainsi qu’en ce qui concerne d’autres activités tendant à l’exploration et à l’exploitation de la zone à des fins économiques, telles que la production d'énergie à partir de l’eau, des courants et des vents, de même qu’à des droits de juridiction en ce qui concerne la mise en place et l'utilisation d’îles artificielles, d’installations et d’ouvrages, la recherche scientifique marine, la protection et la préservation du milieu marin, sans s’étendre aux compétences de police.
Certains pays ont cependant adopté des règles de droit national, notamment les Etats-Unis, le Royaume-Uni et le Canada, mais celles-ci doivent en répondre à des considérations environnementales. Leur application aux épaves au seul titre de la sécurité de la navigation ne peut en principe intervenir.
Pour la France, les mesures relatives à la police maritime d’urgence sont mentionnées non pas dans le code des transports, mais dans le code de l’environnement, à l’article L. 218-72.
C’est pour combler ce vide juridique et donner aux Etats riverains un droit d’intervention au titre de la sécurité de la navigation que l’OMI a engagé dès les années 1990 des travaux en son sein.
Ceux-ci ont abouti après plus d’une décennie à la convention de Nairobi sur l’enlèvement des épaves signée le 18 mai 2007.
II. LA CONVENTION DE NAIROBI DU 18 MAI 2007 : DES DISPOSITIONS OPPORTUNES SUR LES COMPÉTENCES DES ETATS ET LES OBLIGATIONS DES PROPRÉTAIRES DE NAVIRES ET DES ARMATEURS
La Convention de Nairobi vient donc combler un vide juridique en fixant le droit des épaves mettant en cause la sécurité maritime au-delà de la limite des eaux territoriales.
On observe deux éléments de différence par rapport aux mesures issues de la convention de 1969 sur les pollutions maritimes et insérées dans le code de l’environnement :
– l’objectif n’est pas le même ;
– il en est de même du champ territorial, car les mesures d’interventions de lutte contre la pollution permettent aux Etats côtiers d’intervenir en haute mer, au-delà de la ZEE, dans les eaux internationales.
Le tableau suivant récapitule ces éléments.
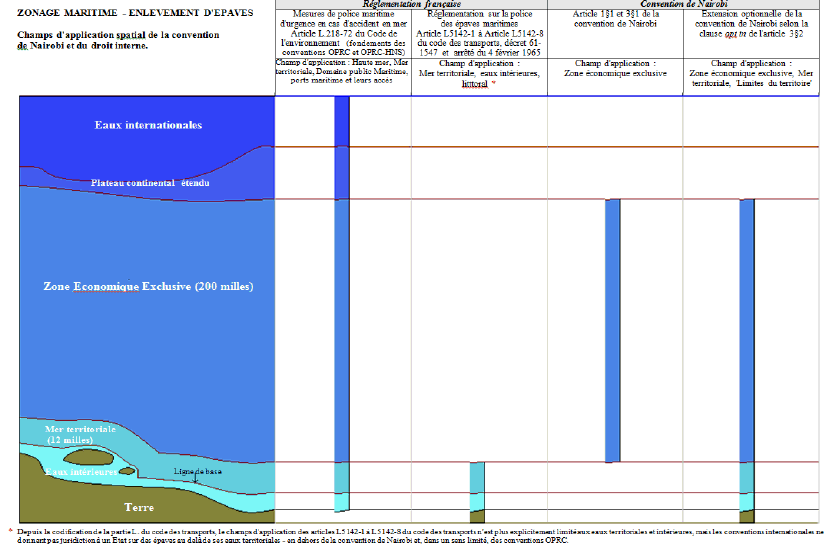
Source : Ministère des affaires étrangères et du développement international
La convention de Nairobi s’applique aux épaves maritimes situées dans la ZEE, qui s’étend jusqu’à 200 milles marins (370 kilomètres), au-delà de la mer territoriale elle-même large de douze milles (22,22 kilomètres). C’est ce que prévoient l’article 3 et le point 1 de l’article premier.
Cependant, le point 2 de ce même article 3 prévoit que les Etats membres peuvent aussi opter pour l’application de ses dispositions à la mer territoriale.
Cette faculté permet ainsi d’unifier le droit des épaves. La France a, selon les éléments mentionnés dans l’étude d’impact annexée au projet de loi, l’intention de procéder à une telle extension, dans les termes suivants : « Conformément à l'article 3 paragraphe 2 de la Convention qui prévoit la possibilité pour un Etat Partie d'élargir la portée du champ d'application de la Convention, la France déclare que la Convention s'applique aux épaves se trouvant dans son territoire, y compris sa mer territoriale ».
Cette option est le fruit d’un compromis entre les Etats opposés, au nom du respect de la souveraineté, à l’inclusion de la mer territoriale dans le champ de la convention, parmi lesquels les pays du groupe des 77, et ceux au contraire favorables à une telle inclusion, dont la France. La plupart des épaves se trouvant dans la mer territoriale, le régime dont elles relèvent aurait ainsi été unifié.
Dans le cas d’une telle extension, la convention ne s’applique pas en totalité au territoire et à la mer territoriale. D’abord, les dispositions sur la responsabilité du propriétaire et à l’obligation d’assurance ne peuvent concerner que l’objet de la convention : localisation, signalisation et enlèvement des épaves. Ensuite, les dispositions sur la consultation de l’Etat d’immatriculation du navire, les mesures d’enlèvement et le règlement des litiges selon le droit international ne sont pas applicables.
Certains Etats n’ont pas établi leur ZEE en raison de la difficulté à en fixer les limites avec leurs voisins, ce qui est notamment le cas lorsque les côtes sont face à face.
Tel est notamment la situation de la Grèce, en Europe, compte tenu des difficultés des tensions avec la Turquie et de la différence d’approches sur la Mer Egée. D’autres Etats n’ont pas non plus procédé à la revendication de leur ZEE.
La convention de Nairobi a prévu ce cas de figure. Le point 1 de son article premier prévoit que son dispositif s’applique à une zone de mêmes caractéristiques de la ZEE, lorsque sa délimitation n’est pas intervenue.
La convention de Nairobi est le premier instrument international traitant spécifiquement de la question des épaves et des interventions qu’elles exigent.
Il lui incombe par conséquent de définir et par là-même d’unifier les notions essentielles : l’épave et les critères permettant, ou non, de la qualifier de dangereuse. Il lui revient également de poser les règles relatives à la localisation, la signalisation et l’enlèvement des épaves qui constituent des obstacles à la navigation et à la sécurité maritime.
C’est un premier avantage de la convention de Nairobi, d’ordre technique, mais essentiel.
a. Une approche large de l’épave qui s’étend aussi aux navires en difficulté, mais exclut les aéronefs
Stricto sensu, une épave est un navire naufragé ou échoué. L’article premier de la convention de Nairobi, relatif aux définitions, retient opportunément une approche plus large.
D’abord, son point 4 qualifie également d’épave les parties des navires naufragés ou échoués, notamment les objets trouvés à bord ou s’étant trouvés à bord de ces navires, ainsi que tout objet perdu en mer.
Quitte à être un peu redondante, cette définition permet de viser notamment les conteneurs qui tombent des navires en pleine mer.
Ensuite, le texte inclut dans la notion d’épave les navires en difficulté, c’est-à-dire ceux qui sont soit en train de couler ou en train de s’échouer, comme ceux « dont on peut raisonnablement attendre le naufrage ou l’échouement », si aucune mesure n’est déjà en train d’être prise pour tenter de l’éviter.
Enfin, la notion de navire est elle aussi définie au point 2 de manière large : sont visés non seulement les bateaux de mer, mais l’ensemble des bâtiments de mer, y compris les hydroptères, les aéroglisseurs, les engins submersibles, les engins flottants et les plates-formes flottantes.
Pour ces dernières, les plates-formes se livrant sur place à des activités d’exploration, d’exploitation, de production des ressources minérales des fonds marins, c’est-à-dire les plates-formes pétrolières et gazières, sont exclues. Les plates formes pétrolières et gazières, et de façon générale les installations destinées à l’exercice d’une activité économique en ZEE relèvent d’un cadre juridique spécifique prévu par la CNUDM, qui n’est pas celui des navires. Ces installations relèvent de la juridiction exclusive de l’Etat côtier, y compris pour ce qui concerne leur enlèvement (article 60 de la convention).
Il faut aussi mentionner l’exclusion visant les navires de guerre et les navires appartenant aux Etats ou exploités par ceux-ci lorsqu’ils sont exploités à des fins gouvernementales et non commerciales, sauf s’ils en décident autrement.
Ceux-ci bénéficient d’une immunité de juridiction reconnue par la coutume et inscrite dans le droit international par la CNUDM (article 32). La plupart des conventions maritimes excluent ce type de navires de leur champ d’application.
Par ailleurs, la convention lie la notion d’épave à celle d’accident de mer, lequel est aussi défini au point 3, d’une manière assez large, comme l’abordage, l’échouement et tout autre incident de navigation à bord ou à l’extérieur du navire entraînant pour lui-même ou sa cargaisons des dommages matériels ou des menaces quant à de tels dommages.
La version française est particulièrement précise, car c’est l’échouement qui est mentionné et non l’échouage, le premier étant involontaire alors que le second l’est.
Par conséquent, les navires coulés ou échoués à fin d’exploitation ne relèvent pas non plus du champ d’application de la convention, à défaut d’origine accidentelle.
La convention ne vise pas non plus les aéronefs tombés dans la ZEE. Il n’existe d’ailleurs pas d’instrument de droit international définissant le régime des aéronefs tombés en mer. En droit national, le régime applicable est le même que celui applicable aux épaves des navires (articles L.5142-1 et suivants du code des transports et décret n° 61-1547 du 26 décembre 1961). Ce régime, qui ne s’applique pas au-delà de la mer territoriale, prévoit une obligation (avec mise en demeure si nécessaire) pour le propriétaire de l’épave d’effectuer toute opération de nature à supprimer son caractère dangereux. A défaut, ces opérations sont effectuées par l’Etat aux frais du propriétaire lorsque celui-ci est connu.
Le point 5 de l’article premier donne la liste des critères qui permettent de caractériser le danger d’une épave. Ce sont les suivants :
– un danger ou un obstacle pour la navigation ;
– une situation telle que l’on peut raisonnablement attendre des conséquences préjudiciables graves pour le milieu marin ou des dommages pour le littoral ou les intérêts connexes d’au moins un Etat côtier.
Cette notion clef d’intérêts connexes est précisée au point 6 d’une manière qui n’est d’ailleurs pas limitative.
Sont ainsi mentionnés :
– les activités maritimes, côtières ou estuariennes, y compris la pêche, qui constituent un moyen d’existence essentiel pour les personnes intéressées ;
– le tourisme et les autres intérêts économiques, de la manière suivante : les attraits touristiques et autres intérêts économiques de la région en question ;
– la santé des populations riveraines et la prospérité de la région en question, y compris la conservation des ressources biologiques marines, de la faune et de la flore ;
– les infrastructures au large et les infrastructures sous-marines, ce qui vise par exemple les câbles et conduites posés sur le fond marin.
Globalement, les intérêts connexes d’un Etat côtier désignent l’essentiel, mais on doit regretter qu’à l’exception de la mention des conséquences préjudiciables graves pour le milieu marin, c’est dans le cadre d’une approche indirecte que le risque environnemental est mentionné, par l’intermédiaire des trois éléments suivants : le tourisme, la santé des populations et la prospérité de la région.
C’est conceptuellement regrettable, car le risque environnemental est un risque en lui-même majeur, et non un risque secondaire qui ne résulte que d’autres catégories de risques eux-aussi dignes d’intérêt.
L’article 6 mentionne aussi naturellement des éléments de risque propres à l’épave. Pour déterminer si une épave présente ou non un danger, l’Etat concerné doit tenir compte d’une batterie de quinze critères tenant aux caractéristiques de l’épave, à sa localisation, aux conditions du moment et à la nature du fret.
Sont ainsi mentionnés le type, la dimension et la construction de l’épave, sa hauteur, ainsi que ses profils acoustiques et magnétiques, de même que la nature et la quantité de sa cargaison. S’agissant de la localisation de l’épave, la convention impose de prendre en compte :
– la profondeur d’eau, l’amplitude des marées et courants, de même que la topographie sous-marine ;
– la vulnérabilité de la zone maritime, s’il s’agit d’une zone identifiée comme telle par l’OMI ou bien d’une zone avec des mesures spéciales obligatoires prévues par la convention des Nations Unies sur le droit de la mer ;
– la proximité d’une route maritime, ainsi que la nature, la densité et la fréquence du trafic ;
– la vulnérabilité des installations portuaires ;
– la proximité d’installations vulnérables comme les pipelines, gazoducs, câbles ou ouvrages analogues.
Enfin, le texte prévoit la prise en compte des conditions météorologiques ou hydrographiques du moment comme de toute autre circonstance pouvant justifier l’enlèvement de l’épave.
3. Un droit d’intervention sur les épaves reconnu aux Etats côtiers, encadré par le principe de proportionnalité
L’article 2 de la convention sur ses objectifs et principes généraux rappelle que celle-ci vise avant tout l’enlèvement des épaves qui présentent un danger selon les critères précédemment évoqués.
Les mesures prises doivent être conformes au principe de proportionnalité, qui les encadre strictement :
– non seulement elles doivent être proportionnées au danger ;
– mais elles ne doivent également ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour enlever l’épave concernée ;
– et elles doivent prendre fin dès que cet enlèvement est intervenu.
En outre, il est précisé que les opérations ne doivent pas porter atteinte de manière injustifiée aux droits et intérêts des autres Etats, y compris l’Etat d’immatriculation du navire, ni à ceux de toute personne physique ou morale intéressée.
Lorsque plusieurs Etats sont affectés, le principe est qu’ils doivent s’efforcer de coopérer.
Sur le plan opératoire, la convention prévoit à son article 7 que l’Etat procède d’abord à la localisation de l’épave, en informant notamment en urgence les navigateurs et les Etats intéressés par l’emplacement de l’épave, puis, à l’article 8, à sa signalisation, par balisage, si celle-ci présente un danger.
Enfin, l’Etat veille à ce que l’épave soit bien enlevée.
L’article 9 prévoit ainsi diverses mesures pour faciliter cette opération qui incombe en effet au propriétaire du navire.
D’abord, l’Etat côtier doit immédiatement avertir l’Etat d’immatriculation du navire, et le propriétaire inscrit, et consulte le premier, ainsi que les autres Etats susceptibles d’être affectés sur les mesures à prendre.
Ensuite, il fixe un délai raisonnable au propriétaire pour qu’il procède à l’enlèvement.
Cette notion de délai raisonnable traduit ce que le droit français considère comme les circonstances tenant à la nature de l’épave et aux difficultés des opérations à effectuer sur elle.
A défaut de respect de ce délai, ou si le propriétaire ne peut être contacté, ou s’il y a urgence, l’Etat peut procéder d’office, et aux frais du propriétaire, aux opérations d’enlèvement de l’épave.
Indépendamment des obligations du propriétaire du navire, l’article 5 de la convention exige du capitaine ou de l’exploitant du navire battant pavillon d’un Etat partie à la convention qu’il adresse « sans tarder » un rapport lorsque ce navire a été impliqué dans un accident de mer à l’origine d’une épave.
L’exploitant du navire est, en droit français, l’armateur, désigné par l’article L. 5411 du code des transports comme « celui qui exploite le navire en son nom, qu’il en soit ou non propriétaire ».
Ce rapport est le préalable nécessaire à la mise en jeu des obligations du propriétaire inscrit. Il doit, en effet, mentionner le nom et l’établissement du propriétaire inscrit, ainsi que les éléments permettant d’appréhender s’il peut y avoir danger au sens de la convention : l’emplacement de l’épave ; son type, ses dimensions et sa construction ; la nature des dommages causés à l’épave et son état ; la nature et la quantité de sa cargaison, en particulier les substances nocives et potentiellement dangereuses ; les quantités et types d’hydrocarbures qui s’y trouvent, y compris les hydrocarbures de soute et les huiles de graissage.
L’article 10 pose le principe de la responsabilité du propriétaire inscrit du navire, de manière à justifier le paiement par lui des frais de localisation, de signalisation et d’enlèvement de l’épave.
C’est une obligation générale qui permet de mettre en recouvrement les frais engagés par des tiers, notamment par les autorités publiques, en cas d’urgence.
Quelques cas d’exonération sont prévus mais n’appellent pas d’observation particulière, car identiques à ceux prévus par la convention de 1992 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures : actes de guerre, hostilité, guerre civile, insurrection ou phénomène naturel de caractère exceptionnel, inévitable et irrésistible ; fait délibéré d’un tiers, ce qui engage alors la responsabilité de ce tiers ; négligence ou autre action préjudiciable d’un gouvernement ou d’une autorité responsable de l’entretien des feux et autres aides à la navigation.
Comme l’observe l’exposé des motifs du projet de loi, le cas du terrorisme n’est pas mentionné.
c. L’obligation de contracter une assurance ou une garantie financière, attestée par un certificat joint aux documents règlementaires de bord
Le principe de la responsabilité du propriétaire du navire étant posé, l’article 12 de la convention prévoit une obligation d’assurance ou de garantie financière, de manière à faire échec aux cas d’insolvabilité.
La garantie financière peut notamment prendre la forme d’un cautionnement de la part d’une banque ou d’une institution financière similaire.
Cette obligation ne s’impose cependant qu’au-delà d’une certaine capacité minimale, de 300 tonneaux de jauge brute, soit 850 mètres cubes environ. Il s’agit d’unités de dimensions réduites, qui opèrent seulement dans le cadre d’opérations de petit cabotage national (vedettes de passagers, bacs de petite taille). Elles ne représentent donc aucun enjeu en matière d’épaves.
De manière à ce qu’elle soit effectivement respectée, cette obligation est assortie d’un contrôle : l’Etat d’immatriculation doit délivrer un certificat d’assurance ou de validité de la garantie financière.
Ce certificat est nécessaire à l’exploitation du navire. A défaut d’un tel certificat, un navire du pavillon d’un Etat partie ne peut être exploité.
Ce certificat doit comporter un certain nombre d’éléments selon le modèle annexé à la convention.
L’Etat peut décider de confier la délivrance de ce certificat à un organisme habilité, mais dans c’est lui qui reste en tout état de cause responsable et garant de la validité des certificats délivrés, ce qui lui impose ainsi sans que cela soit explicite de contrôler l’organisme concerné. En contrepartie, et de manière classique, la convention prévoit le principe de la reconnaissance mutuelle des certificats délivrés.
Le cas des navires qui ne sont pas immatriculés dans l’un des Etats partie à la convention n’est pas méconnu : un certificat peut leur être délivré ou être simplement visé par l’autorité compétente de l’un des Etats parties.
De manière que le contrôle en mer ou par les autorités portuaires soit possible, le certificat est inclus dans les documents de bord obligatoire et l’autorité qui tient le registre d’immatriculation du navire, ou pour les Etats non parties à la convention, qui a délivré ou visé le certificat, doit en détenir une copie.
d. Une simplification : le droit pour les Etats d’exercer une action directe contre les assureurs pour le remboursement des frais qu’ils ont engagés au titre des opérations d’enlèvement
Le droit pour l’Etat de se tourner vers l’assureur ou la garantie financière pour le recouvrement des frais qu’il a engagés est la troisième pièce essentielle de la convention de Nairobi.
En effet, le principe de responsabilité du propriétaire du navire permet de fonder l’obligation d’assurance ou de garantie financière, lequel permet à son tour de prévoir une action directe de l’Etat contre ce tiers, action de toute évidence plus facile que contre le propriétaire du navire.
Sur la question du cas des navires immatriculés dans des pays qui ne seraient pas partie à la convention et qui auraient un accident en empruntant une route maritime traversant la ZEE de la France, les éléments suivants ont été communiqués au rapporteur.
Les droits d’intervention reconnus par la convention ne dépendent pas du fait qu'un navire ait un certificat d'assurance ni ne soit un navire d’Etat partie.
En effet, le champ d'application de la convention est ainsi défini : « Sauf disposition contraire de la présente convention, celle-ci s'applique aux épaves se trouvant dans la zone visée par la convention ».
Le rattachement d'un navire à un Etat partie n’intervient que pour déterminer les obligations d'assurance. La seule conséquence de l’absence de certificat est donc que l’Etat ne pourra exercer le recours direct contre l’assureur prévu par la convention, et ne sera donc pas assuré d'être remboursé des frais éventuellement engagés.
Selon les éléments communiqués, aucun Etat maritime significatif n’a cependant exprimé son intention de ne pas adhérer à la convention.
Pour le règlement des différends, la convention prévoit de manière classique à son article 15 un dispositif qui prévoit le recours prioritaire à la négociation, à l’enquête, à la médiation, la conciliation, l’arbitrage, le règlement judiciaire ou le recours à des organismes ou dispositifs régionaux.
A défaut de règlement dans les 12 mois, le dispositif général prévu par la CNUDM, dans sa partie XV, pour le règlement des différends s’applique.
La notion « d’enlèvement » d’une épave telle que définie par la convention n’est pas exactement celle du sens commun.
Le point 7 de l’article premier précise en effet qu’elle désigne toute forme de prévention, d’atténuation ou d’élimination du danger.
L’enlèvement ne signifie pas le renflouement ni le démantèlement complet de l’épave, mais uniquement, dans la droite ligne du principe de proportionnalité, ce qui est nécessaire à l’élimination du danger.
2. Des exceptions à la responsabilité du propriétaire compte tenu des autres textes internationaux applicables en la matière
La convention de Nairobi intervenant dans un domaine déjà couvert par des textes internationaux, son articulation avec leurs dispositions fait l’objet de trois précisions.
La première fait l’objet de l’article 16 et concerne le droit international de la mer : celui-ci prévoit que la convention de Nairobi ne porte pas atteinte aux droits et obligations des Etats en application de la convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982, ni le droit coutumier de la mer.
Lui fait écho le point 4 de l’article 2 qui dispose que la convention ne permet à un Etat partie de revendiquer sa souveraineté ou ses droits souverains sur quelque partie que ce soit de la haute mer.
La deuxième précision est essentielle, car elle concerne le droit d’intervention prévu par la convention de Bruxelles de 1969 sur l’intervention en haute mer en cas d’accident entraînant ou pouvant entraîner une pollution par hydrocarbure et le protocole de 1973 relatif au cas des substances polluantes autres que les hydrocarbures. Elle dispose que ce sont ces deux textes spécifiques, et antérieurs, qui priment.
Ainsi, pour les opérations sur les épaves, c’est la convention de Nairobi qui devra prévaloir, tandis que pour celle sur les secours aux navires en difficulté et transportant des hydrocarbures ou d’autres substances dangereuses, ce sera celle de Bruxelles.
C’est en matière de responsabilité civile des propriétaires de navire que la troisième précision, et pour être plus exact la troisième catégorie de précisions, est essentielle, car elle vise à éviter les risques de conflit juridique avec les textes déjà applicables, à des cas spécifiques, avec ses difficultés insurmontables si plusieurs textes sont applicables à un même cas.
L’article 11 prévoit ainsi que le propriétaire inscrit n’est pas tenu de régler les frais de localisation, de signalisation et d’enlèvement des épaves lorsque cette obligation est incompatible avec les autres instruments internationaux applicables.
Tel est le cas pour la convention de 1969 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, pour la convention de 1996 sur la responsabilité et l’indemnisation pour les dommages liés au transport par mer des substances nocives et potentiellement dangereuses, pour la convention de 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de l’énergie nucléaire, ou pour celle de 1963 sur la responsabilité civile en matière de dommages nucléaires ou la législation nationale régissant ou interdisant une limitation de responsabilité en la matière, et la convention dite Bunkers sur la responsabilité civile pour les dommages par les hydrocarbures de soute.
De même, la question de la rémunération ou de l’indemnisation des services des opérateurs privés, le point 2 de l’article 11 renvoie aux conventions et règlementations existantes.
Aucune de ces dispositions ne crée de difficulté à la France, selon les éléments communiqués.
L’article 13 de la convention prévoit deux prescriptions.
La première, de trois ans, concerne les droits des Etats à remboursement des frais qui relèvent de la convention, à savoir ceux de localisation, de signalisation et d’enlèvement de l’épave.
Elle court à partir de la date à laquelle la dangerosité de l’épave a été établie.
Elle ne s’applique naturellement pas lorsqu’une action en justice a été intentée.
La seconde prescription est absolue, de six ans et s’applique aux actions en justice qui pourraient être intentées. Elle court à compter de l’accident de mer à l’origine de l’épave, et en cas de succession de plusieurs faits, du premier d’entre eux.
Ces délais reprennent ceux prévus notamment par la convention sur la responsabilité civile pour les pollutions par hydrocarbures de cargaison de 1992 (Article VIII) et de la convention sur les pollutions par hydrocarbure de soute de 2001 (article 8). Les obligations financières des assureurs ne peuvent en effet persister pour une durée illimitée après l'évènement ayant causé le naufrage.
D. UNE LIMITATION DE LA RESPONSABILITÉ CONFORME À LA CONVENTION DE LONDRES DE 1976 MAIS QUI NE CONCERNE PAS LA FRANCE
Le point 1 prévoit une limite à la responsabilité du propriétaire inscrit du navire, non pas directement, mais de manière indirecte en se référant aux limites prévues par les règles nationales et internationales et en prévoyant aussi comme limite absolue celle prévue par la convention de Londres, dite convention LLMC (Limitation of Liability for Maritime Claims), du 19 novembre 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes, modifiée par le protocole de 1996.
Le principe de la limitation des créances en matière maritime est issu d’un principe ancien qui veut que l’on ne puisse perdre en mer davantage que ce que l’on y risque. Les propriétaires de navire étaient par conséquent autorisés à abandonner le navire à leurs créanciers, ce qui plafonnait leur responsabilité.
La France n’est traditionnellement pas favorable à ce principe.
C’est pourquoi elle a assorti sa ratification de la convention LLMC d’une réserve précisant que la limitation de la responsabilité des propriétaires de navires ne lui serait pas opposable pour les remboursement des frais engagés pour « avoir renfloué, enlevé, détruit, ou rendu inoffensif un navire coulé, naufragé, échoué ou abandonné, y compris tout ce qui s’y trouve ou s’est trouvé à bord ».
Cette réserve a été rappelée et réitérée pour le protocole du 2 mai 1996 modifiant la convention.
Pour qu’il n’y ait pas d’ambiguïté, le Gouvernement a mentionné dans l’étude d’impact annexée au présent projet de loi de ratification qu’il assortirait l’instrument de ratification de la convention de Nairobi d’une déclaration ainsi formulée : « Dans le cadre de l'article 10 paragraphe 3 de la Convention relatif au droit de limitation de responsabilité du propriétaire, la déclaration que la France avait exprimée lors de la ratification du Protocole du 2 mai 1996 modifiant la Convention de Londres du 19 novembre 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes est rappelée :
« En application des dispositions de l'article 7 du présent Protocole modifiant l'article 18, paragraphe 1, alinéa a, de la Convention de 1976 sur la limitation de responsabilité en matière de créances maritimes, le Gouvernement de la République française réitère sa décision exprimée lors du dépôt de son instrument d'approbation de cette dernière d'écarter tout droit à limitation de responsabilité pour les créances visées à l'article 2, paragraphe 1, alinéas d et e de ladite Convention. »
Selon les éléments communiqués au rapporteur, les frais de localisation et de signalisation des épaves engagés au titre de l’application des dispositions de la convention de Nairobi correspondent a priori à des « créances pour avoir (…) rendu inoffensif un navire coulé, naufragé, échoué ou abandonné » et entrent de ce fait dans le champ d’application de la réserve, qui s’appliquera donc a priori à toutes les sommes mises en recouvrement au titre de la convention de Nairobi.
III. UNE RATIFICATION MAINTENANT URGENTE COMPTE TENU DE L’ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA CONVENTION ET DES AMÉNAGEMENTS À OPÉRER DANS LA LÉGISLATION
D’une manière classique pour une convention internationale négociée dans le cadre des travaux d’une organisation internationale, c’est le secrétariat de cette organisation qui est dépositaire de la convention. Il s’agit en l’espèce de l’Organisation maritime internationale, l’OMI, comme le prévoit l’article 17.
On observera que selon l’article 17, l’exemplaire original de la convention comprend une version française qui fait foi.
La convention de Nairobi est prévue pour entrer en vigueur un an après la date à laquelle elle aura été signée sans réserve quant à la ratification, l’acceptation ou l’approbation par dix Etats, ou à laquelle un même nombre d’Etats auront transmis leur instrument de ratification au secrétariat général de l’OMI.
Selon les éléments communiqués sur le site Internet de l’OMI et confirmés à votre rapporteur, elle doit entrer en vigueur le 14 avril prochain.
Pour les Etats qui la ratifie, l’entrée en vigueur intervient trois mois après la date du dépôt de l’instrument correspondant, sauf pour les dix premiers Etats qui doivent naturellement attendre l’entrée générale de la convention.
En l’état, la convention a été ratifiée par treize Etats (Allemagne, Bulgarie, Congo, Danemark, Iles Cook, Iles Marshall, Inde, Iran, Malaisie, Maroc, Nigeria, Palau, Royaume-Uni) et signée par cinq Etats (Allemagne, Danemark, Estonie, France, Italie, Pays-Bas).
Ces Etats représentent environ 14 %, en tonnage brut, de la flotte mondiale.
Dans sa résolution précitée n° 1869 de 2012, adoptée sur le rapport de Mme Elisavet (Elsa) Papadimitriou (Grèce), l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe s’est prononcé pour la ratification de la convention de Nairobi.
La convention de Nairobi ne soulève aucune difficulté quant à son articulation avec le droit européen.
D’une part, la directive 2002/59/CE du 27 juin 2002 relative au système communautaire de suivi du trafic des navires, intervenue après la catastrophe du pétrolier Erika, adoptée dans le cadre du paquet Erika II, prévoit un système d’information entre les Etats pour les navires transportant des matières dangereuses et polluantes. Elle renvoie au droit international et notamment aux règles de l’OMI, dont la convention de Nairobi, pour les interventions sur les épaves aux fins de localisation, signalisation et enlèvement.
D’autre part, la directive 2009/20/CE du 29 avril 2009 relative à l’obligation d’assurance des propriétaires de navires crée une telle obligations pour les créances visées par la convention LLMC, et mentionne explicitement que ses dispositions ne font pas obstacle aux régimes d’assurance prévus par d’autres instruments internationaux, parmi lesquels la convention de Nairobi.
2. Plusieurs différences d’approche, en revanche, entre le droit français et la convention de Nairobi qui imposent de prévoir un texte d’adaptation
Le droit français et la convention de Nairobi ont des approches différentes sur plusieurs points significatifs.
Le droit français traite de la question des épaves aux articles L. 5142-1 à L. 5142-8 et L. 5242-16 à L. 5242-18 du code des transports. Son champ d'application et les mesures qu’il vise à prendre ne recouvrent que partiellement le régime tel qu’il est prévu par la convention.
C’est en raison d’approches différentes. Tel est d’abord le cas, sur le plan général, en raison de l’objectif du code des transports, qui est d’établir un pouvoir de police en matière d’épaves et de régler les questions patrimoniales (droits du propriétaire du navire ou de tout autre objet devenu une épave), et qui ne comporte en outre pas de volet relatif à la responsabilité civile des propriétaires d’épaves ou à l'obligation d'assurance. Tel est ensuite le cas sur le détail, car les points de vue de notre législation et de la convention divergent sur certaines notions clefs.
Sur la définition de l’épave d’abord, deux critères servent à la caractériser en droit interne : l’état de non flottabilité du navire et son abandon par l’équipage.
Avec le seul critère de la non-flottabilité, on ne peut donc pas qualifier d’épave un navire sur le point de couler ou de s'échouer ou dont on peut raisonnablement attendre le naufrage ou l’échouement si aucune mesure efficace n'est prise, alors que c’est justement ce que prévoit la convention.
Ainsi la convention qualifie-t-elle d’épaves ce que droit interne considère comme navires en difficulté. La distinction des épaves et de navires en difficulté est cardinale en droit français, avec des dispositions spécifiques pour les navires en difficulté. S’agissant des navires qualifiés d’épaves par la convention et qui sont en fait des navires en difficulté, le droit français comprend des dispositions spécifiques autres que celles du régime des épaves.
De même, le critère de l’abandon par l’équipage retenu par le droit national induit une définition plus restrictive que celle de la convention, et les articles L. 5142-1 et suivants du code des transports ne précisent non plus ni la notion d'accident de mer, ni la notion de danger, ni celle d'intérêts connexes des Etats côtiers, précisément prévus par la convention.
Sur la dangerosité d’une épave, cette dernière énonce, comme on l’a vu, 15 critères à partir desquels celle-ci peut être appréciée. Un tel dispositif n’existe pas en droit français.
De même, la notion d’enlèvement n’est pas expressément définie en droit interne. De plus, il résulte du décret n°61-1547 du 26 décembre 1961 que l’enlèvement ne correspond pas, en droit national, à toutes les actions visées dans la convention (notamment les opérations de prévention ou d’atténuation des risques).
Enfin, la convention prévoit l’obligation de déclarer l’épave pour le capitaine ou l’exploitant d’un navire, alors que l’obligation similaire prévue en droit français est à la charge de la personne qui découvre une épave ou du capitaine d’un navire se portant au secours d’un autre navire victime d’un accident de mer, dès lors que ce dernier transporte des hydrocarbures et navigue à moins de 50 milles marins des côtes françaises (article D. 218-5 du code de l’environnement).
b. Une articulation à préciser entre le droit interne et la convention, en cas d’extension de la convention à la mer territoriale
Le régime des épaves prévu par le code des transports ne s’applique pas au-delà de la mer territoriale, tandis que le régime de la convention de Nairobi concerne en principe la seule ZEE.
Dès lors que l’on admet que les règles puissent ne pas être les mêmes en fonction de l’endroit où se trouve l’épave, il n’y a pas de difficulté.
En revanche, l’extension de la convention à la mer territoriale va-t-elle créer une difficulté, dès lors que la France en aura exercé l’option.
Ainsi, les mécanismes de la convention concernant l’intervention de l’Etat, la responsabilité objective du propriétaire du navire et le recours direct à l'assureur, sont subordonnés, même dans les eaux territoriales, à l’existence d'un danger créé par l'épave. La convention est en cela plus restrictive que le droit national, offrant en contrepartie de meilleures garanties financières.
Cependant, selon les éléments de l’étude d’impact, on peut considérer que la possibilité d'intervenir dans les eaux territoriales sur la base de la convention n’empêcherait pas de recourir aux instruments du droit interne pour des actions non prévues par elle (par exemple l’enlèvement d'une épave en dehors d’un danger avéré).
Par conséquent, pour éviter tout risque d’incohérence, une adaptation du droit interne est nécessaire.
Le champ territorial de la convention ne sera pas limité à la métropole et à certaines collectivités d’outre-mer : aucune réserve n’étant prévue, la convention s’appliquera à toute la ZEE française, y compris celle délimitée au titre des collectivités du Pacifique et les Terres australes et antarctiques françaises (TAAF). La future loi concernera donc l’ensemble de la République.
Outre l’adaptation de la notion d’épave, déjà évoquée, la principale adaptation concerne les obligations du propriétaire inscrit en matière d’assurance ou de garantie financière.
Le régime actuel de la police des épaves maritimes, qui résulte des articles L. 5142-1 et suivants du code des transports, ne traite pas non plus de la responsabilité du propriétaire du navire. L’adoption de nouvelles dispositions sera nécessaire pour instaurer une obligation d’assurance et de certificat, assortie d’une sanction.
Suivant le modèle des conventions existantes, il conviendra d'insérer à l'article L. 5123-2 du code des transports, un paragraphe ainsi rédigé : « IV. Le propriétaire inscrit d'un navire, au sens du paragraphe 8 de l'article 1er de la convention internationale de 2007 sur l’enlèvement des épaves, faites à Nairobi le 18 mai 2007, souscrit une assurance ou une autre garantie financière satisfaisant aux exigences de cette convention lorsque ce navire est exploité sous pavillon français, ou touche ou quitte un port français ou une installation située dans la mer territoriale. Un certificat attestant que la garantie est en cours de validité doit se trouver à bord du navire.»
Ce certificat sera délivré par l’administration des affaires maritimes.
Par ailleurs, pour sanctionner cette obligation, le I de l’article L. 5123-6 du même code serait complété par un 4° ainsi rédigé : « 4° Le fait pour le propriétaire inscrit d'un navire, au sens du paragraphe 8 de l'article 1er de la convention internationale de 2007 sur l'enlèvement des épaves, faites à Nairobi le 18 mai 2007, de ne pas respecter les obligations prévues au IV de l'article L. 5123-2 ; »
Il est, en effet, nécessaire que le code des transports reprenne explicitement l’obligation incombant au propriétaire inscrit de fournir à l’autorité administrative de l’Etat affecté par l’épave, conformément à l’article 9 paragraphe 3 de la Convention, la preuve de l’assurance ou de la garantie financière lorsqu’il a été établi que l’épave présente un danger.
Le régime de l'intervention de l’Etat dans les situations visées par la convention devrait être prévu, comme le fait l'article L. 218-72 du code de l'environnement pour les accidents de mer au sens de la convention Bruxelles du 29 novembre 1969, en faisant une distinction entre navires en difficulté et navires qui ne sont plus en état de flottabilité, pour conserver la structure des codes, la confusion des deux sous le terme d’épave n’ayant pas que des avantages.
La commission examine le présent projet de loi au cours de sa séance du mercredi 18 février 2015, à 9h45.
Après l’exposé du rapporteur, un débat a lieu.
M. Jean-Paul Dupré. Bien que ce ne soit pas le sujet, je crois utile de rappeler que le problème des épaves concerne aussi le domaine terrestre. On le constate sur notre territoire, avec même des épaves industrielles.
M. Thierry Mariani. La convention concerne-t-elle les pays particulièrement vulnérables, comme le Pakistan et le Bangladesh, où les épaves sont traités dans des conditions que l’on connaît bien.
M. Philippe Cochet. La déconstruction des épaves dans certains pays se fait en effet dans des conditions alarmantes.
M. Noël Mamère. La dégradation de notre territoire par l’accumulation d’épaves concerne le ministère de l’écologie et le ministère de l’industrie, mais est hors du champ de la convention de Nairobi.
La question du démantèlement des navires est traitée par d’autres instruments internationaux, avec un amendement à la convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, et la convention de Hong Kong, adoptée en 2009 avec l’appui de l’OMI et de l’OIT, sur le recyclage sûr et écologiquement rationnel des navires.
Suivant les conclusions du rapporteur, la commission adopte sans modification le projet de loi (n° 1238).
Néant
TEXTE DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
Article unique
(Non modifié)
Est autorisée la ratification de la convention internationale de Nairobi sur l’enlèvement des épaves, adoptée le 18 mai 2007, et dont le texte est annexé à la présente loi.
NB : Le texte de la convention figure en annexe au projet de loi (n° 1238).
