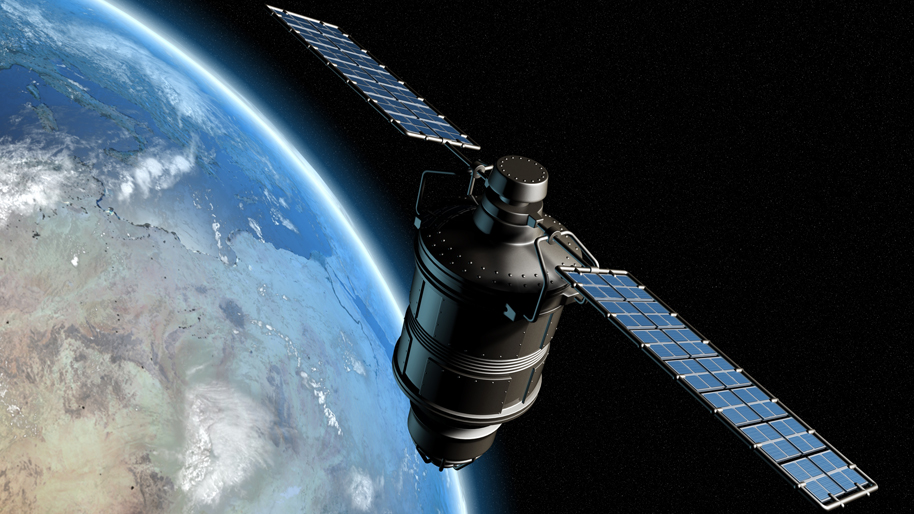
Lors de sa réunion du 14 mai 2025, la commission de la défense nationale et des forces armées a autorisé la publication du rapport d’information en conclusion des travaux de la mission flash sur les satellites : applications militaires et stratégies industrielles, présenté par ses rapporteurs M. Arnaud Saint-Martin (LFI, Seine-et-Marne) et Mme Corinne Vignon (EPR, Haute-Garonne).
Alors que 2025 constitue une année charnière pour le spatial, ce rapport doit permettre de nourrir la stratégie spatiale nationale, qui définira les objectifs et priorités de la France dans le spatial d’ici 2040 sur le volet militaire et civil et devrait être présentée durant l’été.
La France occupe une place singulière dans l’industrie du satellite. Elle est présente sur l’ensemble de la chaîne de valeurs grâce à un tissu industriel solide, au sein d’un marché de plus de 11 milliards d’euros et employant 70 000 personnes.
L’industrie s’appuie sur une politique volontariste, conduite par le Centre national d’études spatiales (CNES) et financée sur ses volets civils et militaires à partir de la commande publique.
Le spatial industriel européen s’est construit sur la coopération entre nations, sous l’égide de l’Agence spatiale européenne (ESA), et a permis de créer un accès autonome à l’espace avec Ariane et des grands programmes en orbite. La France représente un pays moteur au sein du spatial européen et fait partie des premiers financeurs.
La France est également l’un des rares pays qui dispose d’un accès souverain à l’espace pour la défense, permettant aux armées d’observer, détecter et communiquer. Des satellites en orbite assurent à la défense française des capacités autonomes, malgré un recours grandissant à des partenariats étrangers et à des achats de service. La stratégie spatiale de défense de 2019 et la loi de programmation militaire de 2023 ont permis d’accroître ces capacités nationales.
Toutefois, le spatial est confronté à un grand bouleversement économique dans le sillage du New Space, ce qui suscite des vifs débats sur la stratégie à mener. Ainsi, le déploiement de constellations de satellites en orbite basse a des conséquences majeures, qu’elles soient économiques, environnementales ou stratégiques.
Alors que les industriels sont confrontés à des difficultés majeures, l’efficacité du plan France 2030 est questionnée. Le soutien doit être axé à l’avenir sur la commande publique pluriannuelle. Les rapporteurs recommandent de sécuriser les financements prévus, de les exécuter dans les temps et de cibler le soutien public sur des marchés dont l’intérêt économique ou souverain est déjà bien identifié. Par ailleurs, l’opportunité de la création d’un géant européen du satellite, ou projet Bromo, divise les rapporteurs.
Les rapporteurs invitent la France à défendre au niveau européen la bonne réalisation du programme IRIS², qui doit permettre la mise en orbite d’environ 300 satellites d’ici 2030 pour sécuriser les communications gouvernementales.
Sur le plan de la gouvernance, les rapporteurs appellent à une clarification des rôles respectifs de l’Agence spatiale européenne (ESA) et de la Commission européenne et du mandat du CNES. S’agissant des financements, les budgets du spatial portés par l’ESA et par l’Union européenne doivent poursuivre leur montée en puissance pour faire face aux compétiteurs stratégiques.
En parallèle, les rapporteurs alertent sur l’arsenalisation accrue de l’orbite circumterrestre, devenue une zone de conflictualité à part entière et un appui indispensable aux opérations militaires. Dès lors, les rapporteurs formulent une série de recommandations pour prendre en compte les évolutions stratégiques pour nos armées. Les rapporteurs insistent particulièrement sur la nécessité de déployer rapidement les satellites patrouilleurs YODA et TOUTATIS puis la constellation EGIDE, de mettre en œuvre les programmes d’appui spatial aux opérations (IRIS, CELESTE) et de développer Galileo PRS. Il s’agit aussi de définir une doctrine claire pour répartir les moyens entre les capacités patrimoniales, partenariales et commerciales.
Enfin, à l’échelle internationale, il s’agit pour la France et l’UE de promouvoir un modèle spatial plus vertueux, c’est-à-dire visant un usage durable et raisonné de l’espace. Les rapporteurs proposent la signature d’une convention internationale sur les débris pour garantir la sécurité en orbite ou d’étudier la création d’une agence intergouvernementale du spatial pour promouvoir la pacification des usages.
Consulter l’intégralité du rapport
Contact presse : Guillaume Zanin – guillaume.zanin@assemblee-nationale.fr