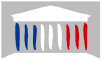_______ ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 DOUZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 12 avril 2006. RAPPORT FAIT AU NOM DE LA MISSION D'INFORMATION (1) SUR L'EFFET DE SERRE
Président M. Jean-Yves Le DÉAUT, Rapporteure Mme Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET, Députés. -- TOME II AUDITIONS (1) La composition de cette mission d'information figure au verso de la présente page. La mission d'information sur l'effet de serre est composée de : M. Jean-Yves Le Déaut, Président, MM. Jean Lassalle, Serge Poignant, Vice-Présidents, MM. Philippe Tourtelier, André Chassaigne, Secrétaires, Mme Nathalie Kosciusko-Morizet, Rapporteure, M. Jacques Bascou, Mme Martine Billard, MM. Serge Blisko, Christophe Caresche, Richard Cazenave, Mme Geneviève Colot, MM. Christian Decocq, Francis Delattre, Michel Destot, Eric Diard, François Dosé, Alain Gest, François Grosdidier, Francis Hillmeyer, Jacques Kossowski, Robert Lecou, Jean-Louis Léonard, Mme Martine Lignières-Cassou, MM. Lionnel Luca, Denis Merville, Jean-Pierre Nicolas, Vincent Rolland, Philippe Rouault, Jean-Claude Sandrier, Mme Michèle Tabarot. TOME SECOND SOMMAIRE DES AUDITIONS Les auditions sont présentées dans l'ordre chronologique des séances tenues par la Mission. ─ Audition de M. Jean JOUZEL, Directeur de l'Institut Pierre Simon Laplace (extrait du procès-verbal de la séance du 15 novembre 2005) 11 ─ Audition de M. Robert KANDEL Directeur de recherche au CNRS (Laboratoire de météorologie dynamique) (extrait du procès-verbal de la séance du 23 novembre 2005 ) 21 ─ Audition de M. Eric BRUN, Directeur de la recherche à Météo-France (extrait du procès-verbal de la séance du 23 novembre 2005) 35 ─ Audition conjointe de MM. Paul VERGÈS, Président, Marc GILLET, directeur, et Mme Pascale BABILLOT, responsable de l'adaptation, de l'Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique (ONERC) (extrait du procès-verbal de la séance du mercredi 30 novembre 2005) 45 ─ Audition de M. Jean-Marc JANCOVICI, ingénieur (extrait du procès-verbal de la séance du 30 novembre 2005) 55 ─ Table ronde sur les effets sanitaires du changement climatique réunissant : - M. Jean-Pierre BESANCENOT, directeur de recherche au CNRS, Faculté de Dijon, - Professeur François RODHAIN, Institut Pasteur, président du groupe de travail de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) sur l'impact du réchauffement climatique sur les maladies animales, - Mme Martine LEDRANS, responsable du département Santé-Environnement à l'Institut national de veille sanitaire (INVs) - M. Paul REITER, Institut PASTEUR, ─ Table ronde sur les effets du changement climatique sur le milieu naturel, la biodiversité, l'agriculture et la forêt, réunissant : - Professeur Robert BARBAULT, Museum National d'Histoire Naturelle, - M. Jean-François SOUSSANA, directeur, INRA, - M. Pierre-Olivier DREGE, directeur général, de l'ONF, - M. Philippe DUCHENE , chef du département milieux aquatiques, du CEMAGREF - M. Jean-Philippe PALASI, chargé de mission outre mer et méditerranée, UICN, ─ Table ronde sur la dimension internationale et européenne de la lutte contre le changement climatique, réunissant : - M. Denys GAUER, ambassadeur délégué à l'environnement, - Mme Odile ROUSSEL, direction des affaires économiques, sous-directrice en charge de l'environnement, Ministère des Affaires étrangères, - Mme Sandrine BOUCHER, direction générale de la coopération internationale et du développement (DGCID), sous-directrice, Ministère des Affaires étrangères, - M. Nicolas LAMBERT, direction générale de la coopération internationale et du développement (DGCID), Ministère des Affaires étrangères (extrait du procès-verbal de la séance du mardi 13 décembre 2005) 85 ─ Audition de Mme Corinne LEPAGE, ancien ministre (extrait du procès-verbal de la séance du 13 décembre 2005) 99 ─ Audition de M. Yves COCHET, ancien ministre, député (extrait du procès-verbal de la séance du mardi 13 décembre 2005) 107 ─ Audition conjointe de MM. Jean-Claude GAZEAU, président, et Paul WATKINSON, chargé des relations internationales, Mission interministérielle de l'effet de serre (MIES) (extrait du procès-verbal de la séance du 14 décembre 2005) 117 ─ Table ronde sur le coût des effets du changement climatique et leur prise en compte par l'assurance et la réassurance, réunissant : - M. Gérard de la MARTINIERE, Président de la Fédération Française des Sociétés d'Assurance (FFSA), - et M. Stéphane PENET, directeur des marchés, responsable de la mission risques naturels, - M. Jean-Louis MARSAUD, directeur du Comité Européen des Assurances (CEA), - M. Jean-Luc BESSON, directeur technique central monde, groupe SCOR, - Mme Claire DORLAND-CLAUZEL, directrice de la communication, de la marque et du développement durable du groupe AXA, - M. Michel SÉGARD, sous-directeur de la prévention des risques majeurs, Ministère de l'Ecologie et du développement durable (extrait du procès-verbal de la séance du 14 décembre 2005) 127 ─ Table ronde sur l'impact du changement climatique en montagne réunissant : - MM. Robert DELMAS et Patrick WAGNON, Laboratoire de glaciologie et de géophysique de l'environnement (LGGE) de Grenoble, - M. Greg GREENWOOD, « The Mountain Research Institue » à Berne, - M. Eric BRUN, directeur de la recherche, Météo France (extrait du procès-verbal de la séance du 20 décembre 2005 ) 143 ─ Audition de M. Christian BRODHAG, délégué interministériel au développement durable (extrait du procès-verbal de la séance du20 décembre 2005 ) 155 ─ Audition de M. Christian de BOISSIEU, Président du Conseil d'analyse économique, et responsable du groupe « facteur 4 » (extrait du procès-verbal de la séance du 20 décembre 2005) 163 ─ Audition conjointe de M. Bernard MEUNIER, Président du CNRS, et de M. Ludovic VALADIER, Responsable de programme, secteur énergie durable et environnement, Agence nationale de la recherche (ANR) (extrait du procès-verbal de la séance du 20 décembre 2005 ) 167 ─ Audition de M. Marcel DENEUX, sénateur (extrait du procès-verbal de la séance du 20 décembre 2005) 175 ─ Audition conjointe de Mme Michèle PAPPALARDO, Présidente de l'ADEME, et de M. François MOISAN, directeur scientifique et directeur exécutif de la stratégie et de la recherche (extrait du procès-verbal de la séance du 20 décembre 2005) 183 ─ Audition de M. Pierre RADANNE (extrait du procès-verbal de la séance du 20 décembre 2005) 195 ─ Table ronde sur l'action des organisations non gouvernementales, réunissant : - M. Philippe QUIRION, Président de Réseau Action Climat-France, - M. Michel MOUSEL, Président de l'association 4D, ─ Audition de M. Claude MANDIL, Directeur exécutif de l'Agence internationale de l'énergie (AIE) (extrait du procès-verbal de la séance du 10 janvier 2006) 219 ─ Table ronde sur « la réduction des émissions de gaz à effet de serre dues aux transports » réunissant : - M. André DOUAUD, directeur technique du Comité des Constructeurs Français d'Automobiles (CCFA), - Mme Chantal DUCHENE, directrice générale du Groupement des Autorités Responsables de Transport (GART), ─ Table ronde sur le rôle de l'agriculture dans la lutte contre le changement climatique, réunissant : - M. Hervé BICHAT, Président d'Europol'agro, - M. Claude ROY, coordonnateur interministériel pour la valorisation de la biomasse, - M. Bernard SEGUIN, Responsable de la mission changement climatique et effet de serre, INRA, - M. Guy VASSEUR, Président de la commission environnement de l'APCA, ─ Audition de M. Jean-Louis ETIENNE, médecin - explorateur (extrait du procès-verbal de la séance du 11 janvier 2006) 257 ─ Table ronde sur le rôle du bâtiment et de l'habitat dans la lutte contre le changement climatique, réunissant : - M. Didier LENOIR, Président du CLER, - M. Pascal EVEILLARD, Directeur du marketing et du développement de Saint-Gobain et responsable du collectif « isolons la terre contre le CO2 », -M. Régis MEYER, chargé de mission Bâtiment - Energie, MIES, - M. Alain MAUGARD, Président du Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB), - Mme Dominique RIQUIER SAUVAGE, Présidente d'honneur de l'Union Nationale des Syndicats Français d'Architectes (UNSFA), - M. Michel LAVIALE, ancien directeur du développement durable de la Société Générale, chargé d'une mission par l'ADEME sur l'implication des banques, ─ Table ronde sur la « Production d'électricité dans le contexte du renforcement nécessaire de la lutte contre le changement climatique », réunissant : - M. François JACQ, directeur de la demande et des marchés, Direction générale de l'énergie et des matières premières (DGEMP), - MM. Thierry SALOMON, Président de l'association Negawatt - et Benoît LEBOT, vice-Président, - M. Christian NGÔ, délégué général, association ECRIN, - Mme Claude NAHON, directrice des énergies renouvelables et du développement durable, EDF ─ Table ronde sur la production de chaleur réunissant : - M. Daniel CAPPE, Vice-Président de l'Association Technique Energie Environnement (Atee), - M. Patrick CANAL, Club cogénération, ─ Audition de M. Nicolas Hulot, Président de la Fondation Nicolas Hulot pour la Nature et l'Homme (extrait du procès-verbal de la séance du 18 janvier 2006) 331 ─ Table ronde sur l'action des entreprises en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, réunissant : - M. Bertrand COLLOMB, Président de Lafarge, - M. Jean-Yves GILET, Conseiller auprès du Président et responsable des aciers inoxydables monde, Arcelor, ─ Table ronde « Instruments économiques » - M. Serge LEPELTIER, ancien ministre, - M. Guillaume SAINTENY, directeur des études économiques et de l'évaluation environnementale, Ministère de l'Ecologie et du développement durable, - M. Henri LAMOTTE, chef du service des politiques publiques à la direction générale du Trésor et de la politique économique, Ministère de l'Economie et des finances, ─ Table ronde : Pays émergents et pays en voie de développement, réunissant : - M. Jean-Michel SEVERINO, directeur général de l'Agence française de développement (AFD), - M. Paul WATKINSON, chargé des relations internationales, MIES, ─ Table ronde sur l'adaptation, réunissant : - M. Gilles PENNEQUIN, chargé du développement durable à la Délégation interministérielle à l'aménagement et à la compétitivité des territoires (DIACT), ─ Audition conjointe du Centre national d'études spatiales (CNES) et de l'Agence spatiale européenne (ESA), réunissant : ─ Table ronde avec les organisations syndicales, réunissant : ─ Table ronde sur « l'information et la sensibilisation du public », réunissant : - M. Philippe GILLET, Ecole Normale Supérieure de Lyon, - M. Patrice JOLY, directeur de la communication, de la formation et du développement, ADEME, - Mme Marie-Jeanne HUSSET, directrice de la rédaction « 60 millions de consommateurs », - Mme Catherine LABORDE, journaliste, TF1, -Mme Geneviève GUICHENET, chargée du développement durable à France Télévisions, - Mme Marie JAUDET, en charge de la communication à la MIES, - Mme Odile MEUVRET, journaliste (extrait du procès-verbal de la séance du 21 février 2006) 425 ─ Table ronde sur le bilan carbone des biocarburants, réunissant : ─ Table ronde sur la nouvelle économie du changement climatique, réunissant : - M. Olivier GODARD, économiste, Laboratoire d'économétrie de l'Ecole Polytechnique, - M. Richard BARON, «principal administrator», Agence Internationale de l'Energie ─ Table ronde sur « L'après 2012 » réunissant : - M. Nicolas THERY, direction générale de l'environnement de la Commission européenne, conseiller auprès du directeur général, ─ Audition de M. Dominique PERBEN, Ministre des Transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer (extrait du procès-verbal de la séance du 22 février 2006) 481 ─ Audition de Mme Nelly OLIN, Ministre de l'Ecologie et du développement durable (extrait du procès-verbal de la séance du 28 février 2006) 493 ─ Audition de M. François GOULARD, Ministre délégué à la Recherche et à l'enseignement supérieur, accompagné de MM. Pierre Trefouret, conseiller auprès du ministre, et François Clin, directeur-adjoint du département énergie de la direction de la technologie (extrait du procès-verbal de la séance du mardi 7 mars 2006 ) 505 ─ Audition de M. Yves MARTIN (extrait du procès-verbal de la séance du 7 mars 2006) 515 ─ Table ronde sur le rôle des collectivités territoriales, réunissant : ─ Table ronde sur le rôle des constructeurs automobiles dans la lutte contre le changement climatique, réunissant : - Mme Thérèse MARTINET Directrice de l'environnement et du développement durable, PSA Peugeot Citroën, - MM. Luc-Alexandre MENARD, directeur des relations extérieures, Renault - M. Daniel COPPENS, directeur de Volkswagen Groupe France, - M. Michel GARDEL, vice Président, directeur général, Toyota France, (extrait du procès-verbal de la séance du 8 mars) 539 ─ Audition de M. François LOOS, Ministre délégué à l'Industrie (extrait du procès-verbal de la séance du 8 mars 2006) 553 Audition de M. Jean JOUZEL, Présidence de M. Jean-Yves LE DEAUT, Président M. le Président : Mes chers collègues, nous avons le plaisir d'accueillir, pour cette première audition de notre mission, M. Jean Jouzel, président de l'Institut Pierre Simon Laplace, dont l'exposé introductif nous permettra de faire le point des connaissances actuelles sur les problèmes liés à l'effet de serre. M. Jouzel, vous avez la parole. M. Jean JOUZEL : Je vous remercie de votre invitation, au nom de toute la communauté scientifique, qui est très demandeuse d'un dialogue avec les décideurs politiques et je suis naturellement très honoré d'être votre premier invité. Mon exposé consistera en un tour d'horizon général des questions soulevées par l'accroissement de l'effet de serre, certains développements étant plus détaillés afin de répondre aux questions que vous m'avez posées par écrit. Nous avons la chance d'avoir commencé l'étude du phénomène de l'effet de serre dès les années 1970, si bien qu'à la fin des années 1980 existaient déjà des programmes scientifiques sur ce que les Anglo-Saxons appellent « global change » et qu'a pu être constitué, en 1988, à l'initiative de l'OMM et du PNUE, le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, appelé couramment le GIEC, qui est vite devenu un lieu de dialogue entre scientifiques et politiques du monde entier et auquel je participe activement. Le GIEC a publié trois rapports successifs, en 1990, 1995 et 2001. Chacun d'eux se compose de trois documents, élaborés par les trois groupes de travail constitués au sein du GIEC : le premier sur les éléments scientifiques, le deuxième sur les conséquences, l'adaptation et la vulnérabilité, le troisième sur les mesures d'atténuation possibles. Chacun de ces trois documents comprend une dizaine ou une douzaine de chapitres, rédigés par des scientifiques, puis relus, selon un processus assez long et très codifié, par la communauté scientifique, qui émet des remarques dont les rédacteurs tiennent compte - ou non - en motivant leur avis. Il est joint à chacun d'eux un résumé technique d'une cinquantaine de pages - au lieu de quelque neuf cents pour le document lui-même -, et un document plus concis dit « résumé pour décideurs ». Il existe également une synthèse et un résumé pour décideurs portant sur l'ensemble du rapport, c'est-à-dire sur les trois documents. Les gouvernements émettent également leurs propres observations, et c'est le résumé pour décideurs qui est soumis, ligne par ligne, à leur approbation. Nous sommes en train de rédiger le quatrième rapport, dont les deux premières phases sont déjà achevées et dont la publication est prévue pour 2007. Il y a de fortes chances que son approbation, pour la partie technique, ait lieu en France au début de 2007. Le rôle du GIEC est d'établir un diagnostic. Il appartient ensuite aux politiques de prendre - ou non - les décisions, dans le cadre de la convention cadre des nations unies sur le changement climatique, qui a été approuvée à Rio de Janeiro en 1992. Une « conférence des parties » a lieu chaque année ; la plus connue est celle qui a adopté en 1997 le fameux « protocole de Kyoto » ; la prochaine aura lieu à Montréal. C'est grâce à cette conférence des parties qu'un véritable dialogue international a pu s'établir avec le GIEC. L'effet de serre est un phénomène physique naturel, à la fois simple et bien connu. C'est aussi un phénomène bénéfique sans lequel la vie sur terre ne serait pas celle que nous connaissons. L'atmosphère est principalement constituée d'oxygène et d'azote, mais aussi d'autres composants qui « piègent » une partie du rayonnement solaire réfléchi et le transforment en chaleur : la vapeur d'eau, le gaz carbonique, le méthane, etc. Toutefois, parmi ces composants, certains, comme les chlorofluorocarbones, seraient en quantité insignifiante sans l'intervention de l'homme. Le problème n'est donc pas l'effet de serre lui-même, mais son augmentation liée à l'activité humaine. Nous pouvons la mesurer de deux façons. D'abord grâce à des stations, réparties sur toute la planète, qui mesurent chaque jour la concentration de CO2, de méthane et d'oxyde d'azote sous des latitudes et longitudes diverses, nous permettant de connaître son évolution au cours des cinquante dernières années. Si l'on veut remonter plus loin dans le temps, on peut analyser la composition des bulles d'air emprisonnées dans les glaces polaires : c'est ainsi que nous savons que, depuis le début de l'ère industrielle, la concentration de CO2 est passée de 280 à 377 parties par million, soit une augmentation de 30 %, tandis que la concentration d'oxyde d'azote a augmenté de 15 % et que celle de méthane a été multipliée par 2,45. Les analyses comparatives nous apportent la certitude que c'est essentiellement la combustion du charbon, du pétrole et du gaz naturel qui est à l'origine de l'augmentation observée pour le CO2. La quantité d'énergie disponible pour « chauffer » les basses couches de l'atmosphère s'est accrue de 1 % depuis le début de l'ère industrielle, passant de 240 à 242,5 watts par mètre carré. Pour qu'il n'y ait pas réchauffement, il faudrait qu'il existe un mécanisme compensateur ; or tel n'est pas le cas, il y aurait plutôt, au contraire, un mécanisme amplificateur, dans la mesure où le gaz carbonique, qui explique 60 % de cette augmentation - contre 20 % pour le méthane - reste en effet plus longtemps dans l'atmosphère. Il s'ensuit que la stabilisation de l'effet de serre suppose la stabilisation du CO2. Actuellement, quelque 7 milliards de tonnes sont émises chaque année, soit plus d'une tonne par habitant ou six mètres cube de CO2 par jour et par habitant. Cette quantité, qui plus est, n'est pas répartie uniformément : elle est de 5 à 6 tonnes par habitant aux Etats-Unis, de 200 à 300 kilogrammes en Afrique. La France, avec 2 tonnes environ par habitant, est dans les « bons élèves » de sa catégorie, notamment grâce au nucléaire, qui représente les quatre cinquièmes de l'électricité produite. Parmi les facteurs aggravants de l'effet de serre figure notamment la déforestation, car la végétation permet de « piéger » le CO2 : environ un quart du CO2 émis va dans l'océan, un quart dans la végétation, ce qui ralentit la progression de l'effet de serre. L'agriculture joue également un rôle aggravant, notamment à travers les ruminants, s'agissant de l'émission de méthane, et les pratiques agricoles, comme le recours intensif aux engrais qui dégage des oxydes d'azote. En France, le CO2 contribue pour plus de 70 % à l'augmentation de l'effet de serre observée depuis dix ans. En 2001, quatre grands secteurs contribuaient pour un peu plus de 20 % chacun aux émissions : agriculture et sylviculture ; résidentiel et tertiaire ; transports ; industries manufacturières. Un recours accru à la biomasse et aux biocarburants est une des pistes à explorer et le monde agricole est d'ailleurs très sensibilisé à cette question. Face à l'augmentation de l'effet de serre le climat se réchauffe, comme en témoigne l'évolution des courbes de température depuis un siècle et demi. L'année 1998 a été l'année la plus chaude de toute cette période, et neuf des dix dernières années - 1996 faisant exception - ont été plus chaudes que toutes celles qui les ont précédées. Nous pouvons aussi nous fonder sur d'autres indices, comme la fonte des glaces de mer, celle des glaciers, ou la température de surface des océans. Cela dit, une corrélation ne signifie pas forcément qu'il y ait un lien de cause à effet et l'on objecte souvent aux scientifiques qu'une augmentation d'un degré ou d'un degré et demi peut être due à des causes naturelles. On sait que l'Europe a connu de petites périodes glaciaires, notamment aux XVIIe et XVIIIe siècles, et aussi une période plus chaude qu'actuellement, au cours de laquelle les Vikings sont allés au Groenland. La réponse apportée par la communauté scientifique à la question du rôle joué par l'activité humaine dans le réchauffement du climat a beaucoup évolué et la position qu'elle a prise en 1995 a joué en faveur de la signature du protocole de Kyoto. Le dernier rapport du GIEC, en 2001, a été encore plus affirmatif quant aux conséquences de l'activité humaine au cours du dernier demi-siècle et aucun élément n'est venu, depuis, le remettre en cause. Au contraire, les zones d'ombre ont plutôt été gommées. L'effet de serre continue d'augmenter, le climat de se réchauffer, même si la canicule de l'été 2003, où les températures ont été supérieures de trois à quatre degrés à la moyenne du XXe siècle, est un phénomène trop exceptionnel pour être expliqué par le seul changement climatique. Il en va de même, d'ailleurs, pour d'autres phénomènes extrêmes, comme les cyclones - qui ne sont pas plus fréquents, mais sont plus violents -, les sécheresses ou les inondations. Pour l'ensemble de ces phénomènes, le diagnostic scientifique n'est pas établi. De nouveaux éléments ont permis de passer du « peut-être » de 1995 au « sans doute » de 2001. Le premier a été le progrès accompli dans la connaissance de la variabilité naturelle du climat, c'est-à-dire de son évolution sur plusieurs millénaires grâce à l'étude des arbres, des calottes glaciaires ou des coraux. Dans l'hémisphère nord, c'est au cours des huit dernières années que le réchauffement a été le plus important et c'est sans doute la décennie 1990 qui aura été la décennie la plus chaude. Mais pour dire cela nous nous fondons, non seulement sur l'évolution passée du climat mais aussi sur une modélisation, car il ne s'agit pas simplement d'extrapoler des tendances mais d'élaborer des modèles théoriques afin de les vérifier ensuite - ce que font, en France, Météo France et l'Institut Pierre Simon Laplace. Nous avons affiné ces modèles en couplant l'évolution des océans et celle de la végétation, nous les avons vérifiés par des recoupements avec les évolutions climatiques des cinquante dernières années. Je précise qu'il faut tenir compte à la fois des forçages naturels - volcans, rayonnement solaire - et des forçages anthropiques, c'est-à-dire liés à l'activité humaine. Mais il en ressort dans tous les cas que l'augmentation de la température est bien liée à celle de l'effet de serre. Je dois signaler au passage que cette modélisation nécessite d'importants moyens de calcul ; c'est même sans doute l'un des domaines de la recherche scientifique qui en nécessite le plus. Il faut ensuite se faire une idée de ce que pourra être la composition de l'atmosphère au XXIe siècle, en faisant des prévisions quant aux émissions de CO2 et de méthane, en collaboration avec des économistes car tout cela dépend largement des évolutions démographiques, de la production d'énergie et de la façon d'utiliser celle-ci. C'est ainsi que nous avons échafaudé divers scénarios : B1, A2, etc. Si aucune limite n'est mise à l'utilisation des combustibles fossiles, l'émission totale de CO2 pourrait passer, d'ici la fin du XXIe siècle, de 7 à 28 milliards de tonnes par an. Mais même le scénario le plus « vertueux », le plus optimiste, c'est-à-dire le maintien en moyenne des émissions à leur niveau actuel, aboutit à un doublement de la concentration à la fin du XXIe siècle, du fait que les rejets, même stabilisés, s'accumulent dans l'atmosphère année après année. Et il n'y a guère de surprise : plus les émissions sont élevées, plus les concentrations le sont, plus l'effet de serre augmente. Et plus l'effet de serre augmente, plus l'atmosphère se réchauffe. Je parlais tout à l'heure d'une augmentation de 1 % du nombre de watts par mètre carré en cent cinquante ans ; elle pourrait bien être de 4 % au bout des cent ans qui viennent, ce qui est véritablement énorme. Après l'élaboration de scénarios, l'étape suivante est celle des simulations à l'aide de modèles. Les résultats obtenus sont de deux types. Pour l'ensemble de la planète, l'augmentation moyenne de la température pourrait être comprise entre 1,4 et 5,8 degrés d'ici à 2100. Si la fourchette est aussi large, c'est d'abord parce que nos comportements sont susceptibles de varier, c'est aussi parce que le comportement du système climatique lui-même dépend de rétroactions qui ne sont pas aisées à prévoir : il est difficile, par exemple, de mesurer le rôle exact des nuages. D'autre part, même en retenant une augmentation moyenne de trois degrés, correspondant à peu près au milieu de la fourchette, les disparités seraient très fortes entre les différentes zones du globe. L'Arctique, par exemple, se réchaufferait deux à trois fois plus que la moyenne, soit, toujours dans cette hypothèse, de huit à dix degrés. Quant aux océans, ils se réchaufferaient moins que les continents, et parmi ceux-ci l'Europe de l'Ouest connaîtrait le phénomène sous une forme amplifiée. Et n'oublions pas que trois degrés, c'est une variation représentant la moitié du changement global que la terre a connu à l'âge glaciaire, époque où la calotte polaire descendait jusqu'au nord de la France, et après laquelle il a tout de même fallu cinq mille ans pour que la température remonte de quatre ou cinq degrés. D'une certaine façon, le monde politique a pris assez rapidement la mesure du phénomène. La convention cadre de Rio, dont le protocole de Kyoto n'est jamais que le bras séculier, a été signée par tous les pays, y compris les Etats-Unis, et son article 2 stipule qu'il faut « stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère à un niveau qui empêche toute perturbation dangereuse du système climatique » et ce « dans un délai convenable pour que les écosystèmes puissent s'adapter naturellement aux changements, que la production alimentaire ne soit pas menacée et que le développement économique puisse se poursuivre d'une manière durable ». Mais il faut bien comprendre que cela suppose un changement complet de notre façon de produire et d'utiliser l'énergie. Stabiliser les émissions de CO2 est impératif, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faille pas stabiliser aussi les émissions de méthane. Mais si nous voulons limiter, à l'horizon de la fin du XXIe siècle, la concentration de CO2 à 450 parties par million au lieu de 380 actuellement - ce qui représenterait tout de même, en cent ans, une augmentation équivalente à celle observée au cours des deux siècles précédents -, il nous faudra redescendre à 2 ou 3 milliards de tonnes d'émissions par an, et probablement moins encore à long terme. L'objectif visé par l'Union européenne est d'éviter un réchauffement global de plus de deux degrés, ce qui passe par une stabilisation à ce niveau de 450 parties par million. Le message, qui s'inscrit dans un discours scientifique, est bien passé, mais je me dis, quand je vois le Plan Climat, que c'est loin d'être gagné d'avance, et que diminuer les émissions d'un « facteur 4 » sera très difficile. Au demeurant, il n'y a pas hiatus entre le message de la communauté scientifique et le message affiché des autorités politiques. Il faut bien se pénétrer du caractère irréversible de l'évolution actuelle et abandonner l'idée que les générations à venir trouveront une solution pour réduire l'effet de serre. Nous faisons aujourd'hui le climat de demain et quand bien même nous arrêterions complètement les émissions, le XXIe siècle n'en connaîtrait pas moins un réchauffement équivalent à celui du XXe siècle, compte tenu de ce qui est déjà « emmagasiné », c'est-à-dire d'un demi à un degré. Les pays occidentaux sauront sans doute s'y adapter mais il serait égoïste de laisser le reste du monde aux prises avec un climat très difficile dans la deuxième moitié du XXIe siècle. Cette inertie du système climatique est encore plus nette en ce qui concerne la contribution de la dilatation de l'océan à l'élévation du niveau de la mer, à raison de 20 à 30 centimètres par siècle, et ce inéluctablement. A cela risque de s'ajouter une fonte partielle du Groenland, qui porterait à trois ou quatre mètres l'élévation du niveau des mers au milieu du troisième millénaire. Il serait difficile, dans cette hypothèse, de préserver toute la prospérité des villes et des zones côtières et il serait temps que les architectes et urbanistes tiennent compte de ce risque. Tous les gouvernements se sont mis d'accord sur un objectif de stabilisation de la concentration de CO2 à la fin du siècle, avec une décrue s'amorçant vers 2020-2030. Mais quand bien même nous y arriverions, la température continuerait de s'élever et le niveau des mers également. C'est un message que la communauté scientifique tient absolument à faire passer. L'Europe pourra sans doute s'accommoder de deux degrés de plus ; reste qu'elle vivra sous un climat extrêmement différent de celui que nous connaissons. Nous avons deux certitudes : premièrement, l'activité humaine contribue à l'augmentation de l'effet de serre et au réchauffement du climat ; deuxièmement, l'effet de serre va continuer de s'accroître. Mais nous avons aussi beaucoup d'incertitudes. La première tient à l'amplitude du changement climatique, qu'il s'agisse de la température ou du niveau de la mer. Une deuxième incertitude tient aux variations régionales - dont Serge Planton saura mieux vous parler. Nous sommes également dans l'incertitude quant au régime des précipitations, aux extrêmes climatiques tels que tempêtes ou tornades, aux autres forçages climatiques, ainsi qu'aux rétroactions, notamment chimiques et aux couplages, par exemple avec la biosphère, l'océan. Enfin, il existe des surprises possibles, liées à l'inertie du système. La France s'oriente sans doute vers des étés plus secs, avec moins de précipitations et plus d'évaporation, et une accélération de l'assèchement des sols, et vers des hivers plus humides. Au milieu du XXIe siècle, si nous ne modifions pas nos comportements, un été sur deux devrait être aussi chaud que l'été 2003, selon une étude de Greenpeace sur l'évolution du climat. En revanche, ce qu'on ne sait pas, c'est si les tempêtes, qui actuellement ne sont pas plus fréquentes qu'avant, ne vont pas le devenir. Or la capacité destructrice des cyclones, on l'a vu notamment en Amérique ou aux Antilles, a été multipliée par deux en trente-cinq ans. Ce phénomène semble, pour une large part, imputable au réchauffement des océans dont se nourrissent les cyclones. On ignore également les interactions entre la chimie de l'atmosphère, les aérosols - artificiels ou naturels -, les nuages. En un an, la décomposition accélérée des matières organiques du sol, sous l'effet du réchauffement, a fait perdre à la Grande-Bretagne le bénéfice de tous les efforts qu'elle avait réalisés au cours des années précédentes. Et en Europe de l'Ouest, durant la canicule de l'été 2003, la végétation a trop souffert pour jouer son rôle de piège à carbone, de sorte qu'il y a eu accélération du réchauffement. Parmi les surprises climatiques possibles figure l'éventuelle disparition du Gulf Stream, dont l'existence explique en grande partie le fait que le climat, à latitude égale, soit plus clément en Europe qu'en Amérique du Nord - qui subit il est vrai, inversement, l'influence de la Cordillère des Andes. Le mécanisme serait le suivant : si l'eau douce provenant de la fonte des calottes glaciaires adoucissait notablement l'océan en surface entre l'Equateur et la mer de Norvège, cette eau de surface risquerait d'être trop légère pour descendre au fond de l'océan comme actuellement, et la disparition de ce mouvement perpétuel entraînerait celle du Gulf Stream. Ce qui est certain, c'est que si le climat est plus chaud de trois degrés, il y aura plus d'eau douce du fait de la fonte des glaces et du fait des précipitations, y compris, éventuellement au Groenland, ce qui accroît le risque d'adoucissement des eaux de l'Atlantique Nord et donc, de disparition du Gulf Stream au-delà du XXIème siècle. Dans cette hypothèse, le climat de nos régions reviendrait rapidement à des conditions proches du climat actuel, mais d'autres endroits de la planète, comme l'Afrique, connaîtraient un réchauffement bien supérieur, avec des effets profondément déstabilisateurs pour toute l'économie et pour les modes de vie en général. M. le Président : Je vous remercie de votre exposé, et avant de donner la parole à Mme la Rapporteure pour qu'elle vous pose ses questions, je vous en poserai une première. Vous nous avez dit que l'objectif était de diviser les émissions par quatre et que ce n'était pas gagné d'avance. Vous êtes resté discret sur les décisions politiques que cela suppose, mais pensez-vous, compte tenu des mesures prises en France au cours des dix dernières années, que nous y arriverons, et si oui, à quelle échéance ? M. Jean JOUZEL : Il y a en France une mission qui travaille sur le « facteur 4 », et chacun peut imaginer la difficulté de l'exercice. Dans un premier temps, il s'agit de revenir, d'ici à 2010, au niveau d'émissions de 1990. Le Plan Climat semble permettre d'atteindre cet objectif, sans doute d'extrême justesse, mais après 2010 il faudra réduire chaque année de 3% les émissions, et je ne vois rien venir encore qui aille dans ce sens. Cela demandera beaucoup d'efforts à tous, notamment dans le domaine des transports et dans celui de l'isolation des logements. Une autre piste est celle du « piégeage » du carbone à la sortie des centrales thermiques, qui permettrait son stockage dans des couches géologiques. En tout cas, c'est une très bonne chose que d'avoir affiché comme objectif le « facteur 4 », car c'est la seule façon d'entraîner les pays en voie de développement dans un cercle vertueux, et d'espérer ainsi parvenir, au niveau mondial, à un « facteur 2 ». Mais on voit bien que la chose est rien moins que simple, et que la dynamique, sans vouloir mettre en accusation qui que ce soit, n'est pas encore engagée. Un des bénéfices du protocole de Kyoto aura été de susciter au moins une prise de conscience. Mme Nathalie KOSCIUSZKO-MORIZET, Rapporteure : Quand on regarde les cartes correspondant aux projections, on est impressionné par l'ampleur de la fonte des calottes glaciaires. Considérez-vous que, sous nos latitudes, le risque maximal soit celui de l'élévation du niveau de la mer ? Et à quelle échéance celle-ci pourrait-elle intervenir ? M. Jean JOUZEL : Si le phénomène de réchauffement est amplifié aux pôles, c'est principalement à cause de la disparition des glaces de mer, de la fonte des glaces d'eau douce et de la disparition des surfaces réfléchissantes. Mais, même en Europe de l'Ouest, le réchauffement est plus marqué que la moyenne mondiale. Dans le quart sud-est de la France, il serait de quelque cinq à six degrés en été. Les conséquences de l'élévation du niveau de la mer sont probablement limitées en France métropolitaine : cinquante centimètres d'ici la fin du siècle. Pour les Pays-Bas, en revanche, il s'agit du problème numéro un, mais ses responsables affirment qu'ils peuvent gérer le risque. D'autres pays sont bien plus menacés, comme le Bangladesh, qui pourrait voir 20 % de sa superficie disparaître sous les eaux. A l'échelle de toute la planète, ce sont 200 millions d'êtres humains qui pourraient être obligés de migrer. A l'échelle de la France, les effets seront forcément importants sur l'économie touristique, du fait de la fonte des glaciers alpins, mais surtout, il y aura un clivage entre le nord et le sud du pays, ce dernier connaissant un risque de sécheresse en été, comme la péninsule ibérique. Des simulations ont été faites grâce au modèle Arpège de Météo-France et au modèle LMDZ de l'Institut Pierre Simon Laplace. Mme la Rapporteure : Vous avez également évoqué la question des rétroactions. Avez-vous une idée du délai dans lequel, compte tenu de la moindre capacité d'absorption des océans, le phénomène pourrait s'emballer jusqu'à devenir incontrôlable ? A quel stade, par exemple, le permafrost serait-il susceptible de dégeler ? M. Jean JOUZEL : Beaucoup de gens affirment qu'avec huit ou dix degrés de plus pendant de longues années, le permafrost pourrait en effet être affecté et libérer des matières organiques qui à leur tour libéreraient du CO2, du méthane, etc. Il peut y avoir beaucoup de surprises à l'échelle d'un siècle et dans la modélisation, la prise en compte de la végétation peut conduire à envisager une augmentation de la concentration de CO2 pouvant aller jusqu'à 250 parties par million. M. Serge POIGNANT : J'ai été très intéressé par votre exposé, et j'ai, moi aussi, plusieurs questions à vous poser. Vos simulations relatives aux émissions de CO2 sont-elles déclinées au niveau des différents continents, voire de pays importants comme la Chine ou l'Inde ? D'autre part, à quelle date peut-on craindre que le niveau des mers monte du fait de la fonte des calottes glaciaires - et peut-être du Groenland ? Enfin, quelles seront les conséquences du réchauffement climatique sur l'Afrique, où le climat est déjà chaud ? M. Jean JOUZEL : S'agissant du niveau des mers, il faut savoir qu'il y a aussi plus de précipitations sur le Groenland et l'Antarctique quand il y fait plus chaud, ce qui peut contrecarrer la fonte des glaces. Mais une élévation de cinquante centimètres d'ici la fin du siècle est considérée comme probable. La seule dilatation de l'océan provoquera en effet une élévation inéluctable de trente centimètres par siècle, même si l'effet de serre devait être stabilisé. Reste que le risque n'est pas prévu d'ici la fin du XXIe siècle. La Chine constitue naturellement un enjeu très important, et nos scénarios sont déclinés par région du monde, et même par pays. On ne peut pas imaginer maîtriser l'effet de serre sans la participation de la Chine, de l'Inde et du Brésil. Il y a, au niveau des élites de ces pays, une véritable prise de conscience et lorsque nous les rencontrons, leurs représentants nous disent « aidez-nous ». C'est tout le problème des transferts de technologie. Il y a donc une lueur d'espoir, et l'on peut très bien imaginer que la Chine, très riche en houille, développe une technologie du charbon propre grâce au piégeage du CO2. Il ne faut pas partir battus d'avance ! Il y a aussi une vraie prise de conscience au sein des grands groupes industriels, où plus personne ne nie la réalité du problème. De toute façon, un moment viendra forcément où on se dira qu'on ne peut plus continuer comme ça, et qu'il faut faire quelque chose ! S'agissant de l'Afrique, où le climat est certainement l'une des causes du non-développement, le risque de sécheresse est encore accru, et il est donc à craindre que les choses ne s'améliorent pas. Les précipitations auront en effet tendance, d'une façon générale, à se raréfier là où elles sont déjà faibles et à s'intensifier là où elles sont déjà fortes. Au total, le changement climatique ne fera pas de gagnants, quoi que dise M. Vladimir Poutine à propos de la Sibérie. M. Alain GEST : Nous avons eu beaucoup d'inondations en France ces dernières années, notamment dans mon département, la Somme, qui a connu il y a trois ans des pluies abondantes et répétées. A vous entendre, il y aura plus de chaleur et de sécheresse dans le sud de la France, mais depuis trois ans, justement, le temps est plus sec aussi au Nord. J'aimerais savoir quelle est, selon vous, la bonne période de référence pour apprécier l'évolution des précipitations. Ceux qui se sont penchés sur les données concernant la Somme au cours des cent ou cent cinquante dernières années ont constaté qu'il y avait des cycles, mais peu de constantes, sinon, peut-être, le fait qu'il pleut plus chez nous quand il pleut aussi ailleurs en France. M. Jean JOUZEL : Serge Planton est plus à même de vous répondre de façon détaillée sur ce point, et je lui transmettrai votre question. Le nord de l'Europe s'oriente plutôt vers des pluies plus fréquentes et plus intenses en hiver, mais les modèles ne vont pas jusqu'à dire si le nord de l'Europe commence à la Somme ou plus haut ! Un climat plus chaud signifie aussi plus d'évaporation et plus de précipitations et celles-ci devraient augmenter de 10 %, au niveau de toute la planète, à la fin du XXIe siècle. Mais certaines régions du monde seront plus sèches l'été. Mme Geneviève COLOT : L'épuisement des sources d'énergie fossiles n'est-il pas susceptible de ralentir l'accroissement de l'effet de serre ? M. Jean-Louis LEONARD : Ma question va dans le même sens : quand les énergies fossiles seront quasiment épuisées, rejetterons-nous encore 4 milliards de tonnes de CO2 dans l'atmosphère ? M. Jean JOUZEL : Les réserves de pétrole et le gaz naturel sont appellées à s'épuiser, c'est vrai, mais celles de charbon sont considérables. Le bon sens voudrait que toutes ces sources d'énergie soient réservées aux usages pour lesquels elles sont indispensables. Tous les scénarios intègrent, bien entendu, la perspective de l'épuisement des réserves et ce n'est pas de là, malheureusement, que nous pouvons attendre notre salut : il faudra que nous prenions soin de les épuiser le plus lentement possible. M. le Président : J'ai une question assez technique, relative à un article que j'ai lu aujourd'hui dans la presse. Selon deux géographes suisses, le réchauffement climatique ne serait pas dû au CO2 pour 60 %, mais à la vapeur d'eau. Ils reconnaissent toutefois, dans la conclusion de leurs travaux, que s'il y a plus de vapeur d'eau, c'est parce que l'atmosphère se réchauffe. Qu'en pensez-vous ? M. Jean JOUZEL : La vapeur d'eau est le premier des gaz à effet de serre et l'un des premiers mécanismes d'amplification de celui-ci. Dans les modèles, cette augmentation de la vapeur d'eau est bien prise en compte. La part de la vapeur d'eau est supérieure à celle du CO2, mais son origine tient à l'augmentation du CO2. Ce que disent les deux scientifiques suisses est donc vrai, mais ne nous dispense nullement de réduire les émissions de CO2, car le mécanisme d'amplification n'existerait pas à CO2 constant. M. le Président : Ma seconde question peut paraître politique mais elle est technique également. Les Etats-Unis, qui consomment un quart du pétrole produit dans le monde, n'ont pas signé le protocole de Kyoto, et continuent de faire prospérer une sorte d'insouciance énergétique. Vous avez dit qu'une des solutions possibles consistait à « piéger » le carbone à la sortie des centrales thermiques. Pourront-ils se contenter de cela pour respecter l'engagement de réduire leurs émissions de CO2, et, d'une façon générale, quelle pourrait être la contribution de cette technique à la réduction des émissions ? M. Jean JOUZEL : Elle pourrait y contribuer à hauteur de 20 %. Elle n'est possible, en effet, qu'à la sortie des centrales thermiques, pas à la sortie des véhicules. On ne pourra donc pas faire autrement que d'économiser l'énergie, réfléchir aussi au nucléaire, au solaire, qui peut être une solution en Afrique notamment, à l'hydraulique, à l'éolien, et concevoir un habitat non consommateur d'énergie. Comme l'a dit Jean-Marc Jancovici, « nous avons le choix entre choisir la façon de nous limiter ou nous la laisser imposer ». M. le Président : Je vous remercie d'avoir accepté d'être le premier à répondre aux questions de notre mission, et espère vous revoir bientôt, dans le cadre du comité de pilotage que nous souhaitons mettre en place. Audition de M. Robert KANDEL Présidence de M. Jean-Yves LE DEAUT, Président) M. le Président : Mes chers collègues, nous avons le plaisir d'accueillir, pour cette deuxième audition de notre Mission, M. Robert Kandel. Né à New York en 1937, astrophysicien, diplômé de l'Université de Harvard, vous vous êtes tourné depuis 1978 vers l'étude des climats et l'observation spatiale de la terre, au service d'aéronomie du CNRS à Verrières-le-Buisson. Vous avez enseigné l'astrophysique à Boston University, la télédétection spatiale à l'Université Pierre-et-Marie Curie, la physique du climat au Virginia Polytechnic Institute. Vous êtes depuis une vingtaine d'années au laboratoire de météorologie dynamique de l'École Polytechnique. Vous avez beaucoup travaillé en collaboration avec le CNES, l'Agence spatiale européenne, l'Agence spatiale japonaise et bien d'autres organismes. Spécialiste du réchauffement de la terre, vous avez publié aux PUF un petit ouvrage intitulé Le réchauffement climatique, le grand risque. C'est ce qui nous a conduit à vous auditionner dans les premiers afin de nous aider à faire un état des lieux. Nous vous avons également demandé que vous fassiez partie de notre comité de pilotage, c'est-à-dire que vous aidiez notre Mission en tant qu'expert extérieur. Je vous donne sans plus tarder la parole afin que vous nous présentiez le tableau actuel du réchauffement climatique, non seulement au niveau du sol, mais aussi dans la stratosphère et dans les océans, que vous nous en montriez les conséquences pour notre pays et que vous dressiez un premier tableau avant que le Groupement international sur l'étude des climats ne rende son prochain rapport, en 2007. M. Robert KANDEL : Je vous remercie d'avoir pensé à moi pour faire partie de ce groupe de travail. Je vous présente ce matin un point de vue personnel, bien évidemment éclairé par les travaux de mes collègues, afin de vous montrer qu'il s'agit d'un problème mondial, qu'il y a une intensification de l'effet de serre par l'action de l'homme, et que cela risque de produire un changement climatique majeur. Alors qu'il y avait une stabilité relative des climats depuis mille à deux mille ans, on constate, maintenant qu'on dispose, depuis 1860, d'un réseau d'observation météorologique, une augmentation de la température moyenne sur la surface du globe. La tendance est déjà remarquable à ce jour, mais ce qui nous attend est encore bien plus important. En effet, le réchauffement prévisible de cinq degrés au cours du XXIe siècle est équivalent à celui qui a mis fin aux glaciations il y a quinze mille ans, la différence étant que ce qui avait pris plusieurs milliers d'années va prendre cette fois moins d'un siècle, et c'est bien là le problème. Je suis pour ma part spécialiste de l'observation des éléments du climat à l'aide de satellites artificiels, mais j'utilise également les recherches effectuées par d'autres méthodes, en particulier l'observation du présent et du passé récent. Jean Jouzel, que vous avez auditionné la semaine dernière, est un des grands spécialistes de l'étude des climats du passé. La modélisation permet de faire le lien entre ce qu'on observe dans le présent et ce qu'on attend dans l'avenir. On peut tester les modèles en voyant s'ils rendent bien compte des climats passés. La modélisation climatique est fondée sur les lois de la physique, de la thermodynamique - conservation de l'énergie de la matière - et sur les lois de Newton. La difficulté est surtout de traiter les processus de petite taille. Peut-être convient-il de commencer par expliquer comment fonctionne l'effet de serre dans le système climatique. Globalement, c'est le soleil qui chauffe la planète, en moyenne de 342 watts par mètre carré. Toutefois, par ce que j'appelle l'« effet parasol », qui dépend surtout des nuages mais aussi d'autres particules dans l'atmosphère, la terre réfléchit vers l'espace à peu près 30% de ce flux radiatif. Ce sont les 70% qui restent, soit 243 watts par mètre carré, qui sont absorbés et transformés en chaleur. Il faut s'en débarrasser en permanence, et c'est seulement par le rayonnement infrarouge vers l'espace que la planète peut maintenir un certain équilibre. C'est là qu'intervient l'effet de serre naturel. Heureusement, car nous aurions sinon une température moyenne de moins 18 degrés Celsius et non de plus 15. Certaines molécules relativement rares dans l'atmosphère - H2O en premier lieu - piègent le rayonnement infrarouge, et c'est cela qui produit l'effet de serre. Si nous modifions cet équilibre, c'est parce que, depuis quelques siècles, nous salissons l'atmosphère avec du dioxyde de soufre et avec de la suie. Mais cette perturbation du parasol n'a qu'un effet régional, limité dans l'espace et dans le temps. En revanche avec la combustion de carburants fossiles, surtout depuis une cinquantaine d'années, nous envoyons dans l'atmosphère du CO2, qui s'accumule et renforce l'effet de serre. On a donc une bonne chose, l'effet de serre, mais on est en train de le renforcer, et c'est là tout le problème. En outre, dès qu'on change quelque chose dans l'atmosphère, on modifie le cycle de l'eau : évaporation, précipitations, ruissellement. Or c'est extrêmement important pour la vie sur les surfaces émergées. Ce qui complique les choses, c'est que la vapeur d'eau, l'eau sous forme gazeuse, est un gaz à effet de serre. Si le réchauffement conduit à humidifier davantage l'atmosphère, on amplifie donc le réchauffement, ainsi que plusieurs modèles semblent confirmer. En outre, la condensation produit des nuages, qui sont importants pour l'effet parasol, mais aussi pour l'effet de serre. On mesure bien toute la complexité de ces phénomènes, qui est une source d'incertitude dans la modélisation. Par ailleurs, on ne peut pas seulement parler de la température moyenne à la surface du globe. Si on compare Montpellier à Lille, on sait bien qu'il fait généralement plus chaud dans la première, et plus chaud en été qu'en hiver. Mais il y a aussi une variabilité météorologique assez forte d'une semaine à l'autre, et on peut avoir une vague de froid à Montpellier. Ces différences sont également observables pour les précipitations. Mais, en dépit de cela, on reste dans la même région climatique du globe. Autre élément de variabilité, la pluie n'arrive pas en moyenne mais par paquets. Ainsi, si on observe des excédents en mai 2004 à Montpellier, c'est en raison des grosses chutes de pluie intervenues en novembre 2003, qui avaient entraîné des inondations. J'en viens à l'altération de l'atmosphère. On brûle des carburants fossiles depuis 1750 et on a commencé à parler du problème du renforcement de l'effet de serre dès 1896. Mais, alors qu'à l'époque 500 millions de tonnes de carbone étaient converties en CO2, depuis lors les émissions ont été multipliées par quatorze, essentiellement par la combustion du charbon, puis du pétrole, puis du gaz naturel. Aujourd'hui, plus de 7 milliards de tonnes de carbone sont émises chaque année vers l'atmosphère sous forme de CO2. La moitié de ce carbone s'accumule dans l'atmosphère, ce qui signifie que la nature suit seulement en partie cette perturbation par les activités humaines. Grâce à des mesures faites à Hawaï, on a observé qu'il y a un cycle annuel dû à la photosynthèse et à la respiration des forêts de la zone tempérée de l'hémisphère Nord. Mais en Antarctique, là où il n'y a pas de photosynthèse, l'accumulation de CO2 progresse, de même qu'en Scandinavie, en Alaska, sur l'île de la Nouvelle-Amsterdam et dans bien d'autres stations climatiques observées. Depuis le début de ces mesures, en 1957, on est passé de 315 parties par million de CO2 dans l'atmosphère à plus de 380 aujourd'hui. Pour donner une image, si on prenait la totalité du CO2 pour en faire une couche au niveau de la mer, en 1900 elle aurait été épaisse de 2 m 40, aujourd'hui elle serait supérieure à 3 m. D'où viennent ces émissions ? Si on prend le tableau de la fin du XXe siècle, on constate qu'elles viennent essentiellement des États-Unis, de l'Union européenne, de l'ancienne Union soviétique, mais aussi de la Chine, du Japon, de l'Inde, de l'Australie, de l'Afrique du Sud, du Canada et du Mexique. Quelles sont les activités émettrices ? Depuis 1970, à l'échelle mondiale, la production de l'énergie électrique a détrôné l'industrie, surtout parce que cette dernière dépend de plus en plus de l'électricité. Le secteur domestique et le tertiaire n'augmentent pas tellement. C'est dans le secteur des transports routiers que l'on observe la plus forte augmentation. La situation est différente en France, pays riche, où le premier émetteur n'est pas la production électrique puisqu'elle repose essentiellement sur le nucléaire et sur l'hydraulique, mais bien les transports routiers, dont l'augmentation des émissions est préoccupante. Le fait que les émissions de l'industrie diminuent montre qu'elle apprend à faire mieux avec moins d'émissions. Pour le domestique et le tertiaire, les choses bougent peu. Côté climat, pour la température moyenne à la surface du globe, nous avons vu un réchauffement certain depuis la fin du XIXe siècle. Même si nous ne comprenons pas encore toutes les raisons du réchauffement entre 1900 à 1940, ni de la pause qui a suivi jusqu'en 1970, nous voyons que désormais le réchauffement est très rapide, 1998 étant l'année record, qui devrait toutefois être dépassée, selon mes collègues de la NASA, par 2005. Les années 2001, 2002, 2003 et 2004 ont aussi été des années très chaudes. Il s'agit donc bien d'un phénomène remarquable. Si on essaie de modéliser tout cela, on s'aperçoit que l'explication par l'activité du soleil et des volcans ne suffit pas, car elle ne peut justifier le réchauffement récent. En revanche, si on modélise à partir des activités humaines, on explique relativement bien ce qui s'est passé depuis 1850, même si les modèles ont peut-être exagéré l'impact de certaines éruptions volcaniques, d'autant que les particules retombent au bout de deux ans. On peut donc dire qu'on ne comprend pas le réchauffement récent sans tenir compte du renforcement de l'effet de serre dû aux activités humaines. Il y a aussi beaucoup de problèmes liés aux aérosols, en particulier à la suie et aux gouttelettes d'acide sulfurique qui résultent des émissions de dioxyde de soufre. Le renforcement de l'effet de serre augmente la température jusqu'à une altitude de quelques kilomètres, mais refroidit la stratosphère (10 - 50 km), ce qui complique les analyses ainsi que la question de l'ozone. C'est ce qui a pu entraîner une certaine polémique sur le réchauffement, qui est aujourd'hui close. Les données montrent que l'humidité absolue en altitude augmente, ce qui confirme que la rétroaction de vapeur d'eau amplifie le réchauffement. Une étude récente montre que l'élévation en chaleur des couches océaniques correspond bien à ce que prédisent les modèles pour la pénétration du réchauffement dans l'océan à cause du renforcement de l'effet de serre. Il y a d'autres observations : la couche de glace flottante de l'océan Arctique est en train de diminuer, les glaciers de montagne reculent - si vous voulez voir les glaciers alpins, ne tardez pas trop ! -, la saison de croissance s'allonge, on observe de nombreuses modifications écologiques, par exemple des populations de poissons. Les incertitudes tiennent à deux types de questions : qu'allons-nous faire à l'atmosphère et comment cette dernière va-t-elle réagir ? Mais, quoi qu'il en soit, le réchauffement sera plus important qu'il ne l'a été jusqu'ici. Si la politique de George W. Bush était adoptée par la Chine et l'Inde, les émissions de CO2 seraient multipliées par dix. Mais on peut aussi envisager l'utilisation de technologies de séquestration, de piégeage du CO2, ainsi que le développement des énergies renouvelables, qui peuvent conduire à des émissions négatives. Je ne suis toutefois guère optimiste sur ce point. Si la concentration de CO2 n'avait pas beaucoup changé depuis mille ans, elle a désormais beaucoup augmenté et on se dirige vers plus de 550 parties par million. C'est pour moi un seuil critique, mais s'il paraît difficile de faire moins, il ne faut certainement pas aller jusqu'à 1000 parties par million. Un scénario de réchauffement inférieur à 500 parties par million donne une hausse, non négligeable, de 1 à 3 degrés des températures. Un degré, c'est vivable, quoique parfois pénible. Avec 3 degrés, les choses deviennent vraiment difficiles, avec des changements importants dans de nombreux aspects de la biosphère. Au-delà, on va vers des changement plus radicaux, et on est alors entre le très difficile et le catastrophique. Parmi les incertitudes, les nuages occupent une place importante. J'ai fait beaucoup pour promouvoir une mission conjointe de l'Agence spatiale européenne et de l'Agence spatiale japonaise pour les étudier. Les nuages contrôlent la concentration de la vapeur d'eau, qui est le premier gaz à effet de serre. Ils interviennent pour réfléchir le soleil. C'est d'eux que viennent les pluies. Or on ignore si leur réaction au réchauffement va encore l'amplifier ou le limiter. C'est une des grandes limites des modèles actuels. Pour donner quelques exemples de ce qui peut se passer, on peut regarder une photographie satellite de l'Europe prise le 3 août 2003, sur laquelle il n'y a pratiquement aucun nuage. On sait, grâce aux dates de vendanges, pour lesquelles on a des archives depuis 1370, qu'aucun été n'a jamais été aussi chaud en France. Il y a eu depuis 1860 des étés très chauds, par exemple en 1947 et en 1976, mais 2003 a été vraiment très, très chaud. Or un modèle montre qu'un tel phénomène ne serait plus du tout extraordinaire à la fin du siècle, puisque la moitié des étés seraient concernés. Une analyse de collègues suisses montre que le réchauffement pourrait atteindre 5 degrés dans le midi de la France à la fin du siècle, et que la variabilité en Europe centrale pourrait augmenter de 100 %. On aurait ainsi des étés plus chauds de 3 degrés en moyenne. Le réchauffement est également probable autour de la Méditerranée, mais aussi de la mer Baltique. Il faut donc tenir compte à la fois des moyennes et de la variabilité, qui sont des éléments importants du climat. Ces évolutions vont affecter la biosphère naturelle, mais aussi l'eau, dont on sait l'importance pour l'agriculture et pour l'approvisionnement en eau potable, la situation pouvant être catastrophique dans les pays pauvres. Le troisième rapport du GIEC, en 2001, montre qu'on maîtrisait mal les modèles utilisés : un modèle donnait davantage d'eau ici, moins d'eau ailleurs, et un autre modèle donnait des résultats contradictoires. Une récente publication dans Nature, que le prochain rapport du GIEC devrait détailler, montre désormais une plus grande cohérence : on a l'impression que l'Europe s'assèche tandis que l'Inde a plus d'eau. Mais il reste beaucoup à faire dans ce domaine. D'autres études montrent un assèchement de 10 à 20 % en France. Cela doit amener l'INRA à s'y préparer. La montée annoncée de 60 cm du niveau de la mer provoquera l'inondation de certaines plaines et posera surtout des problèmes en cas de tempêtes, pas seulement dans les régions frappées par les cyclones des tropiques, mais aussi en France, aux Pays-Bas et en Allemagne. Après le passage de Katrina, il y a eu beaucoup de débats pour savoir si cela allait arriver plus fréquemment avec le réchauffement. Mais on savait depuis des dizaines d'années que si un ouragan de force 4 ou 5 frappait la Nouvelle-Orléans, ce serait un désastre. Pourtant, on n'a pas pris ces avertissements au sérieux et on ne s'est pas préparé. L'intensification du cycle de l'eau est presque certaine, ce qui signifie que la carte des risques va changer, pour les tempêtes, les cyclones, les pluies fortes, les inondations, les sécheresses. Mais on ignore si des événements extrêmes, comme la tempête en France de la fin 1999, seront plus fréquents. De même, les événements de type cévenol sont fréquents près de la Méditerranée et amènent à des phénomènes celui que montre cette photographie (M. Robert Kandel montre une photographie d'une maison en partie détruite par une inondation, dans l'Aude). Je ne sais pas si on a autorisé la reconstruction de cette maison. M. Jacques BASCOU : Je suis député de l'Aude. Le permis n'a pas été donné mais, la semaine dernière, des maisons ont à nouveau été inondées, qui n'avaient pas pu être transférées en raison de l'opposition de l'architecte des bâtiments de France. M. Robert KANDEL : L'Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique (ONERC) recense les tempêtes, les avalanches, les inondations, les sécheresses. On a l'impression que les risques s'accroissent. Ce qui me navre, c'est que malgré ce qu'on sait déjà sur le climat et sur les risques extrêmes, on a de nombreux exemples, aux États-Unis, en Allemagne, en France, de non-prise en compte de ces risques. Même si je suis devenu Français, j'ai encore la nationalité américaine et je suis désolé qu'on rechigne aux États-Unis à l'idée de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Pourtant, un pays aussi technologiquement avancé doit savoir faire mieux avec moins d'émissions. On doit réduire la part des carburants fossiles, on doit diminuer les autres gaz à effet de serre, notamment le méthane, dont les émissions, même si elles plafonnent désormais, ont doublé depuis deux siècles en raison des activités humaines. On doit aussi séquestrer le CO2 produit lors de la combustion des carburants fossiles. Jusqu'il y a seulement dix ans, aucun ingénieur ne se souciait de piéger le CO2 qui sort de la cheminée d'une centrale, puisque ce n'est pas un gaz toxique : dans les avions, surtout les plus récents quand ils restent au sol, on dépasse souvent les 3000 parties par million. La réduction d'utilisation des carburants fossiles passe par le nucléaire et les énergies renouvelables, mais aussi par les économies d'énergie. Avec ce qu'on sait faire aujourd'hui, on pourrait produire deux fois plus avec deux fois moins de ressources. L'Europe pourrait faire beaucoup dans les domaines de l'urbanisme et des transports. Les émissions de CO2 par habitant sont importantes aux États-Unis et en Arabie saoudite, mais aussi en Australie et en Europe. Le problème est de savoir à quel niveau se situeront la Chine, le Brésil, l'Inde en 2050. Mais il ne faut pas trop se focaliser sur les émissions par habitant. Une autre question très importante est celle du CO2 lâché dans l'atmosphère par dollar de production de biens. De ce point de vue, la France est dans une meilleure position grâce au nucléaire et à l'hydroélectrique. Aux États-Unis, l'administration Bush annonce un objectif de réduction de l'intensité carbonique de l'économie américaine. Il a du pain sur la planche, puisqu'elle est deux fois supérieure à celles de la France ou du Japon. Et c'est une véritable horreur dans les pays de l'ancien monde soviétique. Dans de nombreux cas, on peut améliorer le niveau de vie sans augmenter les émissions de CO2, en réduisant cette intensité carbonique. Dans les prochaines décennies, les émissions risquent d'entraîner un fort réchauffement climatique, sans compter l'incertitude qui pèse sur les réactions du cycle de l'eau. On critique souvent les chercheurs qui demandent davantage de crédits, mais il est vraiment indispensable de conduire davantage de recherches pour savoir dans le détail à quoi nous allons devoir faire face, comment y faire face, comment nous adapter à ce qui va arriver et comment éviter que ce qui arrivera n'aille trop loin. Le fait que certaines incertitudes pèsent encore ne saurait justifier les gaspillages. La terre est quand même plus agréable que la lune, mais le temps presse parce que ce que nous déciderons dans les prochaines années aura une influence sur ce qui se passera au cours des prochaines décennies. Mais il ne sera pas facile d'inverser la tendance actuelle. M. le Président : Merci beaucoup pour cet exposé passionnant. Vous nous avez fait part des certitudes, en ce qui concerne le réchauffement, le fait qu'il est dû à l'activité humaine, ses conséquences sur la fonte des glaciers et l'élévation du niveau de la mer, mais aussi des incertitudes sur le risque hydrologique, sur le lien avec les événements extrêmes et sur le cycle de l'eau. Vous en avez conclu qu'il fallait renforcer la recherche et réagir maintenant, car demain il sera trop tard. Vous avez aussi montré qu'il fallait se maintenir en dessous de 550 parties par million de dioxyde de carbone (CO2) dans l'air. Mais quel est selon vous le plafond de température à ne pas dépasser pour éviter un bouleversement climatique tel que la vie deviendrait difficile ? Par ailleurs, vous avez dit que la part du résidentiel et du tertiaire dans les émissions n'augmentait pas en France. Or j'avais compris qu'en dépit des efforts accomplis dans l'urbanisme et l'habitat - on est ainsi passé de 300 kWh par mètre carré pour le chauffage il y a trente ans à 120 kWh aujourd'hui -, les émissions augmentaient en raison de la multiplication des appareils ménagers. Je souhaite donc savoir si vous disposez de données récentes qui étayent votre exposé sur ce point. M. Robert KANDEL : Il ne s'agit pas vraiment de mon domaine d'expertise. Je suis parti de données réparties par catégorie d'émissions dans le monde entier et ce que j'ai trouvé pour la France semble donner les résultats que je vous ai présentés. Ce qui est clair, c'est que les transports routiers représentent la première source d'émission. M. le Président : Nous demanderons à d'autres experts d'affiner cette analyse. M. Robert KANDEL : Pour les températures, il est très difficile de donner des chiffres. J'ai pris celui de 550 parties par million pour ne pas me montrer trop pessimiste, car on est déjà à 380 et je vois mal comment on s'arrêterait à 400 ou même à 450. Cela dépendra de la façon dont les sociétés vont réagir et des impératifs du développement dans le tiers-monde. Mais à 550 parties par million, les choses seront déjà difficiles, puisque cela mettra Lille dans la situation actuelle de Montpellier, si on a de la chance, et dans celle de Tamanrasset si on n'en a pas. J'ajoute qu'un degré de réchauffement moyen à la surface du globe impliquerait 1,5 à 2 degrés de plus en France car les zones tempérées vont se réchauffer plus vite. Il y a d'autres inconnues très importantes, notamment sur ce qui va se passer pour l'eau douce : un assèchement supplémentaire de l'Europe, du Moyen-Orient, de l'est et du sud-ouest des États-Unis, ainsi que de l'Afrique australe posera des problèmes très importants. De même, l'augmentation des précipitations dans des zones comme la Sibérie entraînera des difficultés : on peut penser qu'il serait bon que la taïga gagne sur la toundra, mais quand le pergélisol commencera à fondre, cela posera des problèmes considérables pour les infrastructures, avec l'affaissement des routes, des voies ferrées et des immeubles. Mme Nathalie KOSCIUSZKO-MORIZET, Rapporteure : Vous avez bien montré la sensibilité particulière du pourtour méditerranéen. S'agissant de la côte atlantique, on évoque parfois une modification du Gulf Stream qui entraînerait plutôt un refroidissement. Or cela n'apparaît pas sur vos modèles. Est-ce parce que vous ne l'envisagez que dans un avenir plus lointain ou dans un scénario vraiment catastrophique, ou tout simplement parce que vous n'y croyez pas ? Par ailleurs, vous avez donné l'impression de privilégier le critère d'émission par point de PIB plutôt que par habitant. Cela signifie-t-il que vous pensez que c'est ce critère qui devrait nous guider dans les négociations pour la suite du protocole de Kyoto ? M. Robert KANDEL : Les pays de l'annexe II, c'est-à-dire les pays en voie de développement, ou même déjà relativement avancés comme la Chine et l'Inde, ont signé le protocole de Kyoto, mais sans prendre l'engagement de réduire leurs émissions, considérant qu'elles sont très faibles par habitant. Ce sont ces pays qui ont mis en avant l'idée d'équité, selon laquelle tous les pays doivent avoir le même droit d'émission par habitant. Cela paraît grotesque si on observe les disparités dans l'intensité carbonique. En fait, il faut transférer les technologies qui permettent aux pays émergents de produire mieux avec moins d'émissions. C'est déjà ce qui se passe pour la Chine : quand ce pays construit une nouvelle centrale, même au charbon, son efficacité énergétique est de 45 %, contre 25 % pour les vieilles centrales. Il faut accélérer ce mouvement. En fait, le modèle de développement doit être plus moderne. Il est peut-être vrai qu'on consomme davantage parce qu'on utilise plus d'appareils, mais chaque appareil consomme moins qu'auparavant. Cela étant, la climatisation va poser un problème très important, car la demande est de plus en plus forte depuis 2003. En effet, je n'ai pas traité cet autre problème qui tient au fait que si les mers nordiques sont envahies par des eaux douces en raison de la fonte des glaces et de l'intensification des précipitations, cela peut conduire rapidement à un blocage de la dérive nord-atlantique. Il y a, dans le système climatique actuel, un énorme courant qui crée un appel d'eau moins froide, qui remonte l'Atlantique et qui est un facteur important de la douceur du climat du Nord et de l'Ouest de l'Europe, surtout en hiver. Quand l'eau de mer gèle, celle qui reste est encore plus salée et plus dense. Si une partie des glaces du Groenland fond, cela va donner de l'eau douce, et de même s'il y a davantage de pluie et de neige. Il y a eu à ce propos un film catastrophe, mais on y cumule différents scénarii et en seulement six jours. Il est très difficile de modéliser ce qui se passe en profondeur dans l'océan, mais les dernières modélisations montrent que si l'on ne va pas trop loin dans le réchauffement, le risque semble faible pour ce siècle. Mais il est évident que si on atteint 800 parties par million de CO2, c'est-à-dire 5 à 6 degrés de réchauffement moyen, ce risque ne sera plus négligeable, même si le blocage ne pourrait intervenir qu'en dix ou vingt ans, et les conséquences pourraient être dramatiques, avec des hivers extrêmement froids, y compris en France. Il faut donc garder ce risque à l'esprit, même s'il n'est pas immédiat. En fait, les modèles du changement climatique supposent que le système s'ajuste graduellement aux perturbations très rapides que nous provoquons, mais, à force de le modifier, quelque chose peut changer radicalement. C'est pour cela que je dis que pour moi l'incertitude est entre des changements difficiles à vivre et des changements réellement catastrophiques, car il ne faut pas escompter qu'un miracle va tout arranger d'un seul coup. M. Richard CAZENAVE : Le fait qu'on soit incapable d'expliquer la stagnation des émissions entre 1940 et 1970 ne devrait-il pas inciter à relativiser les modèles que vous nous présentez et à nous demander si ce que nous pourrons faire pour limiter les émissions sera suffisant, dans la mesure où il existe manifestement d'autres causes ? On parle beaucoup par exemple des effets d'une modification de la rotation de la terre sur les émissions de CO2. Quelle est la part de ces phénomènes naturels ? Pourriez-vous par ailleurs nous en dire un peu plus sur la séquestration ? Y a-t-il des pistes à explorer et peut-on escompter des résultats importants en investissant beaucoup dans ces technologies ? M. le Président : J'indique simplement que nous aurons beaucoup d'autres auditions sur ce sujet. Nous accueillerons en particulier l'Institut français du pétrole, qui travaille beaucoup sur cette thématique. M. Robert KANDEL : Je ne suis absolument pas expert sur ces questions de séquestration. De nombreux travaux sont menés dans le monde. J'ai souvent été plutôt sceptique sur la possibilité de séquestrer des milliards de tonnes de CO2, mais je me dis que si les Chinois sont capables de doubler ou tripler l'extraction de charbon, quelqu'un parviendra peut-être à développer les technologies nécessaires pour la séquestration, ce qui lui procurera en outre un profit considérable. Pour en revenir au réchauffement, on sait que la variabilité du soleil est très faible et la pause pourrait être liée à une plus faible activité volcanique, aucune éruption significative n'ayant eu lieu entre 1910 et 1950. Mais il y a eu ensuite ce qu'on a appelé parfois le « volcan humain », c'est-à-dire le développement d'une industrie très polluante dans les années 1950 - 1960, période au cours de laquelle on ne se souciait pas des émissions de SO2, qui provoquent les pluies acides. C'est à partir des années 1970, quand les Scandinaves ont commencé à protester, que l'OCDE et les États-Unis ont adopté des mesures de restriction des émissions et de piégeage du SO2. Cette forte pollution a peut-être joué un rôle de masse dans la pause dans le réchauffement entre 1950 et 1970. L'orbite et la rotation de la terre jouent sur une autre échelle de temps. Milutin Milankovitch a développé, entre 1920 et 1940, l'idée de petites variations de l'orbite de la terre autour du soleil, de l'axe de rotation de la terre et de l'excentricité de l'orbite, qui affectent la répartition de l'énergie solaire en fonction de la saison et de la latitude. Il y a des périodicités, qui ne sont pas absolument régulières, de 20 000 à 400 000 ans dans ces variations. Pour Milankovitch, se sont ces variations astronomiques, absolument pas contrôlées par l'homme, qui donnent, depuis deux millions d'années, le rythme de l'alternance des glaciations et des périodes interglaciaires sur la terre. Il y a eu d'autres variations. Il y a beaucoup de débats autour du rôle qu'aurait joué le soleil dans le petit âge glaciaire. Peut-être a-t-on trop médiatisé certaines idées sur le rôle de l'activité solaire. Quand on regarde de manière précise ce qui s'est passé, et pas seulement pour la luminosité du soleil qui est mesurée de manière précise depuis 1970 et qui n'a pas bougé, mais aussi pour l'activité solaire, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de corrélation entre ce qui se passe pour le soleil et ce qui se passe pour le climat. Mais il est vrai que si la luminosité solaire était plus faible de 0,5 % au XVIIe siècle, cela pourrait expliquer le froid à cette époque. Mais cela non plus, nous ne le contrôlons absolument pas. Ce qui est clair, c'est que depuis quelques décennies et, selon toute probabilité, pour les siècles à venir, la responsabilité du réchauffement vient de l'accroissement des émissions, et ne peut pas être imputée au soleil, pas plus d'ailleurs qu'aux volcans. Il est vrai que si nous avions dix éruptions de type Krakatoa l'an prochain, les choses pourraient changer, mais il n'y a pas plus de raisons que cela survienne qu'un brutal arrêt de toute l'activité volcanique. Tout cela, nous ne pouvons ni le prédire ni le maîtriser, en revanche, puisque nous sommes intelligents, nous pouvons maîtriser ce que nous faisons nous-mêmes à notre atmosphère. M. Christian DECOCQ : On a vu qu'il pouvait y avoir ce que j'appellerai des effets d'emballement, qu'il s'agisse du pergélisol, du Gulf Stream, de la climatisation, de la raréfaction de l'eau douce. Comment ces effets peuvent-ils être intégrés dans les modélisations ? M. Robert KANDEL : On essaie de les intégrer au mieux, et certains figurent désormais dans les modèles, en particulier la rétroaction positive de la vapeur d'eau qui amplifie le réchauffement. Pour la végétation, l'échelle de temps est peut-être un peu plus longue, mais une des raisons de la résorption de 50 % des émissions, limitant la montée du CO2 dans l'atmosphère, est qu'une partie du CO2 est captée par la végétation pour fabriquer de la matière organique. De ce point de vue, la reprise des forêts dans la zone tempérée des pays riches a peut-être joué un rôle, en dépit de la déforestation des zones tropicales qui a produit l'effet inverse. Il y a quelques semaines, une équipe a analysé ce qui s'est passé en France et en Europe au cours de l'été 2003 : avec la chaleur extrême et la sécheresse, la réaction des sols a plutôt été de dégager davantage de CO2. Dans une autre étude récente, des chercheurs britanniques se sont intéressés à ce qui s'est passé pour les sols en Grande-Bretagne depuis 1978 : là aussi, avec le réchauffement, il y a eu dégagement supplémentaire de CO2. Avec le réchauffement, en particulier si des événements extrêmes mettent à l'épreuve la végétation, il y a un risque qu'au lieu de freiner l'augmentation du CO2, la végétation contribue aussi à l'accélérer. Dans les nuages, il y a la transition de la vapeur d'eau (eau à l'état de gaz) vers les gouttelettes liquides ou les cristaux solides. Cela joue un rôle important pour la réflexion de l'énergie solaire, pour le piégeage des rayonnements infrarouges et pour les pluies. Mais cela dépend à la fois du transport de vapeur d'eau dans l'atmosphère sur des milliers de kilomètres et de phénomènes microscopiques dans les nuages, en particulier la présence de noyaux de condensation qui modifient la formation des nuages. Certaines pollutions rendent les nuages plus blancs, plus réfléchissants. Il y a donc là aussi énormément d'incertitudes à cause des différences d'échelle. On a aussi un modèle qui dit que le débit du Danube va diminuer d'ici à cinquante ans, tandis que la probabilité d'avoir une crue dangereuse va augmenter. Cela montre que ce ne sont pas uniquement les moyennes qui comptent dans nos rencontres avec la météorologie, mais aussi les écarts, qui sont difficiles à inclure dans les modèles. Sur le pergélisol, la grande inconnue est de savoir à quel moment il risque de dégager beaucoup de méthane, ce qui renforcerait encore l'effet de serre. Certains chercheurs pensent que ce type de phénomène a déjà joué un rôle important il y a plusieurs dizaines de millénaires. On essaie d'inclure tout cela dans les modèles, mais il est évident qu'on n'en est qu'aux débuts et qu'il y a encore beaucoup de travail à faire en matière de recherche. M. Serge POIGNANT : Quelle est selon vous l'influence de la déforestation, en particulier de l'Amazonie, sur la captation du CO2 et quels en sont les dangers ? Par ailleurs, vous avez indiqué les différents scénarii selon que la température augmentera de 1, 3 ou 5 degrés, mais M. Jean Jouzel nous a dit que, quoi qu'on fasse maintenant, on va vers 1,5 à 2 degrés de plus d'ici la fin du siècle. Est-ce votre avis ? Enfin, quid de l'ozone, que vous avez juste évoqué ? M. Robert KANDEL : J'ai fait allusion à une déforestation importante dans la zone tropicale qui semble se poursuivre et qui s'accompagne le plus souvent de l'incendie de la végétation, ce qui produit du CO2. Ensuite les sols se transforment et peuvent dégager plus de CO2. Ceux qui détruisent les forêts font souvent une mauvaise affaire car les sols sont particulièrement fragiles une fois que le couvert végétal a été enlevé. On a dit peut-être un peu rapidement que l'Amazonie était le poumon de la terre, car si une forêt prend du CO2 pour pousser, elle en dégage pendant la morte saison. Il est vrai que la déforestation tropicale, comme celle aux États-Unis au XIXe siècle, a été un des premiers facteurs d'augmentation du CO2 dans l'atmosphère. Il y a aussi un débat sur une éventuelle modification de la courbe du CO2 dès les débuts de l'agriculture, il y a huit mille ans. En zone tempérée, l'évolution actuelle de l'agriculture conduit à l'abandon de terres moins productives et à la reprise de la forêt. C'est cet ensemble de phénomènes qui fait que le bilan du carbone n'est pas parfaitement établi à l'échelle mondiale. Selon certaines études, contestées, ce serait, dans les zones tempérées, l'Amérique du Nord qui absorberait du carbone tandis que l'Eurasie en dégagerait. On voit bien les effets d'une telle théorie sur les droits d'émissions dans le cadre du protocole de Kyoto. Il y a des tas de choses qu'on ne comprend pas encore parfaitement. Certaines modélisations montrent que, d'une manière générale, la biosphère mondiale agit comme un puits à carbone pour quelques décennies encore, mais que si le réchauffement va trop loin, les forêts stagnant, la même biosphère pourrait devenir une source de carbone vers 2050. L'idée qu'on puisse planter des forêts pour retenir le CO2 est bien jolie, elle peut être un petit élément de la solution, mais absolument pas résoudre le problème dans son ensemble. Cela étant, il y a d'excellentes raisons ne pas vouloir « déforester », ne serait-ce qu'en raison du rôle que jouent les forêts tropicales d'Amazonie et d'Afrique centrale dans le cycle de l'eau. Quand on va vers l'ouest de l'Amazonie, l'analyse isotopique montre que la pluie qui tombe est composée d'eau qui est passée plusieurs fois par la forêt amazonienne : l'eau qui est venue de l'Atlantique est tombée sur l'Amazonie, s'est évaporée et est retombée plus loin. Autres questions sans réponse, qui dépendent de la gestion des terres : quand on fait de la déforestation en Amazonie et qu'on crée des champs ou des pâturages, est-ce qu'on augmente ce recyclage ou est-ce qu'on le diminue ? Quelles sont les implications pour l'eau qui tombe plus loin ? J'en viens à votre question sur les scénarii. Même si par miracle on arrêtait aujourd'hui d'émettre du CO2, le réchauffement des océans en profondeur, jusqu'à 750 m, qui a jusqu'ici limité le réchauffement à la surface, ressortira. Cela signifie qu'on est déjà engagé dans un scénario de réchauffement de 0,5 à 1 degré en moyenne, donc un peu plus en Europe. Même en étant très ambitieux pour limiter les émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, je vois mal comment on serait à moins de 2 degrés sur notre continent. Cela entraînera des difficultés mais ouvrira aussi des opportunités, il faut s'y préparer, et c'est ce que fait l'INRA. Si la pression en faveur d'émissions moindres devient plus forte, ce que j'espère, il y aura aussi des chances à saisir dans le domaine de la production d'énergies propres, comme dans celui du piégeage du CO2, des transports moins émetteurs et de l'organisation urbaine. C'est quand on a découvert le trou de la couche d'ozone en 1985 qu'on a commencé à se soucier de l'appauvrissement de cette couche et qu'on s'est aperçu que la nature était plus compliquée que ce que montraient les modèles. Il a été relativement facile de réagir parce que les chlorofluorocarbures ne jouaient pas un rôle majeur dans l'économie mondiale et parce qu'on disposait de produits de remplacement. En 1987, le protocole de Montréal a stoppé la fabrication des CFC, qui ont aujourd'hui commencé à diminuer. Le renforcement de l'effet de serre par le CO2 et par le méthane complique le problème parce qu'il augmente l'opacité infrarouge de l'atmosphère. L'infrarouge s'en va donc plus facilement réchauffer le bas, mais aussi refroidir le haut, c'est-à-dire la stratosphère, ce qui prolonge la période de destruction de l'ozone et ralentit le retour engagé vers la bonne santé de la couche d'ozone dans la stratosphère. Mais, il y a un autre problème, au niveau du sol, avec l'augmentation de l'ozone en tant que polluant nocif pour la santé, mais aussi en tant que gaz à effet de serre. On est là dans des questions de chimie atmosphérique qui sont extrêmement complexes et qui interagissent avec la météorologie, l'ozone devenant particulièrement dangereux au cours des périodes de canicule. Mme Martine BILLARD : Ma première question a trait aux origines de l'effet de serre, et plus particulièrement aux émissions de l'industrie. La diminution constatée dans les pays riches ne vient-elle pas simplement du fait que les industries polluantes sont transférées vers les pays du Sud ? Ne faudrait-il pas en tenir compte quand on essaie de calculer la responsabilité de chaque pays dans l'effet de serre ? J'aimerais également que vous donniez quelques précisions sur les conséquences du réchauffement sur les espèces animales. M. le Président : Je vous indique qu'une table ronde sera spécifiquement dédiée à ce sujet. Mme Martine BILLARD : Enfin, on sait qu'il y a réchauffement, mais avec des incertitudes sur son niveau et sur ses conséquences. A-t-on commencé à bâtir des modèles pour savoir si une intervention très rapide permettrait de reculer l'échéance à laquelle nous serons confrontés ? Nous en aurions sans doute besoin pour vaincre les pesanteurs politiques et économiques. M. François DOSE : Pour insister sur le fait qu'il y a une tendance lourde mais assortie d'incertitudes, j'aimerais savoir à partir de quand les adaptations nécessaires vont devenir inéluctables. Par exemple, quand il y une canicule, on manque d'eau, les personnes âgées sont en difficulté et même le nucléaire connaît des problèmes parce que l'eau nécessaire au refroidissement des centrales est trop chaude. Pouvez-vous nous dire à quel moment ce ne sont plus des adaptations qui s'imposent, mais une transformation radicale ? M. Robert KANDEL : La question d'un report du CO2 du Nord vers le Sud est parfois posée. En France, quand l'industrie est passée à l'alimentation électrique, le problème du CO2 a été surtout transféré à l'industrie qui produit l'électricité, laquelle a plutôt bien répondu puisque notre énergie est essentiellement d'origine nucléaire et hydroélectrique et ne produit pas de CO2. Il y a aussi de réels progrès dans les procédés industriels, d'autant que les prix du pétrole sont une forte motivation pour les industriels à faire mieux avec moins d'énergie. Aussi, l'industrie américaine devient également plus économe dans l'utilisation d'énergie. Il est vrai aussi qu'avec l'ouverture du marché de droits d'émission, il y aura un problème d'exportation des émissions de CO2 vers le tiers-monde. Bien sûr, en cas de délocalisation le personnel est payé moins cher, mais le coût de l'installation elle-même demeure et on peut donc penser que s'il faut construire une usine, on optera pour des procédés modernes et que l'intensité carbonique n'augmentera donc pas. Les effets sur les animaux varient en fonction des espèces. On constate déjà des modifications des populations de poissons, mais elles tiennent aussi à l'épuisement de la ressource halieutique. De même que les arbres peuvent se déplacer, lentement, en fonction des variations climatiques, les animaux peuvent être amenés à bouger. J'observe d'ailleurs que si l'on crée des couloirs pour faciliter leur migration, on proteste dans le même temps contre l'implantation d'espèces exotiques. Là non plus, les choses ne sont pas simples. Une des grandes questions est de savoir sur quoi agir d'abord. Ainsi, aux États-Unis, on a mis en évidence la nécessité de réduire les particules émises par les moteurs diesel, mais en Europe, on produit des moteurs non polluants. Les questions de concurrence jouent donc également dans ces affaires et peuvent perturber les jugements. S'agissant des modèles et des stratégies, un travail important a été fait pour intégrer les effets de modifications rapides des comportements. Je crois qu'un certain nombre de choses qui vont être faites tout de suite auront des effets dans les vingt ou trente prochaines années. Le prix de l'énergie jouera, mais aussi la peur du réchauffement, de la canicule, de l'obligation pour les stations de ski d'utiliser beaucoup plus les canons à neige, etc. Un certain nombre d'adaptations doivent être annoncées dès maintenant pour être préparées. M. André CHASSAIGNE : Il est une source d'émission dont vous n'avez pas parlé, c'est l'agriculture, alors que l'excellente revue de presse que nous a adressée le secrétariat de la Mission montre qu'elle représente 19 % des émissions françaises, talonnant l'industrie et ses 20 %. Ces émissions seraient dues pour 40 % à l'élevage, pour 50 % aux engrais organiques issus des déjections de l'élevage, aux engrais chimiques et aux pesticides, et pour 10 % aux machines agricoles et aux transports. M. Robert KANDEL : Les machines et les transports contribuent aux émissions de CO2. Mais il faut tenir compte d'autres gaz à effet de serre et c'est là que l'agriculture est très émettrice. En effet, le méthane est beaucoup plus rare dans l'atmosphère que le CO2, mais une tonne de méthane de plus a un effet beaucoup plus important qu'une tonne de CO2. Mais le CO2 reste plusieurs dizaines d'années tandis que le méthane met environ dix ans à s'oxyder. En France, mais aussi dans les pays du tiers-monde, l'élevage et la riziculture sont des émetteurs importants de méthane, car des bactéries produisant du méthane vivent dans des milieux sans oxygène : marécages, rizières inondées, système digestif des ruminants. Peut-être l'INRA parviendra-t-il à développer une vache qui ne produira plus de méthane. Mais la population mondiale a doublé et, pour nourrir les gens, il fallait à la fois accroître la surface cultivée et développer l'élevage, ce qui entraîne potentiellement une forte augmentation du méthane. Mais peut-être est-on aujourd'hui arrivé à un point de saturation, et il n'est pas certain que le méthane va continuer à augmenter. Le protoxyde d'azote, N2O, est également lié à l'agriculture et à la façon dont les sols et les bactéries traitent les engrais chimiques. Il s'agit aussi d'un gaz à effet de serre dont les émissions ont augmenté. M. Christophe CARESCHE : Vous avez beaucoup parlé du transport routier, mais pouvez-vous dire aussi quelques mots du transport aérien, dont j'ai le sentiment qu'il peut être une source importante d'émissions ? M. Robert KANDEL : Le transport aérien est une source d'émissions encore faible mais qui va augmenter de façon rapide. En fait, le CO2 émis actuellement par les avions et par les bateaux n'est pas bien comptabilisé dans le système de suivi du Sommet de Rio. Par ailleurs les avions, qui volent pour la plupart dans la stratosphère, région naturellement sèche, posent aussi problème parce que la combustion d'hydrocarbures donne lieu à l'émission d'H2O. Ce qui est négligeable dans la basse atmosphère, où il y a énormément de vapeur d'eau, l'est sans doute beaucoup moins dans la stratosphère. Il y a aussi les traînées de condensation des avions, qui sont parfois importantes dans les zones de fort trafic, et qui peuvent entraîner une augmentation des cirrus, au moins localement. Il est difficile de dire si cela une importance à l'échelle planétaire. Mme la Rapporteure : Si tel était le cas, ces traînées aggraveraient-elles l'effet de serre ou auraient-elles un effet bénéfique en termes de réflexion du soleil ? Cela pourrait-il avoir une incidence importante au niveau local, près des grandes plates-formes aéroportuaires ? M. Robert KANDEL : Les effets sont surtout évidents à l'échelle locale, mais il semble qu'ils existent aussi à une échelle beaucoup plus grande. Certes, les cirrus bloquent un peu le rayonnement solaire, mais leur effet le plus important est de bloquer les infrarouges et de renforcer l'effet de serre. Ce phénomène joue donc plutôt en faveur du réchauffement. À la suite des attentats du 11 septembre 2001, tout le trafic aérien commercial ayant été arrêté sur le territoire de 48 États américains pendant trois jours, une étude a montré une baisse par rapport à la moyenne de l'amplitude du cycle diurne des températures. Or l'effet de serre joue jour et nuit, mais l'effet parasol seulement le jour. Cela confirme un certain nombre de recherches, en particulier en France, qui montrent que le réchauffement intervient surtout pour la température des nuits. Ainsi, le nombre de nuits de gel diminue, ce qui peut être satisfaisant pour la sécurité routière, mais qui pose problème à un certain nombre d'espèces végétales. M. le Président : Puis-je me permettre de vous demander si vous nous avez dit tout ce que vous savez à ce jour, ou si vous avez connaissance de certains éléments du rapport 2007 du GIEC, qui seraient encore confidentiels ? M. Robert KANDEL : J'ai fait, comme des milliers de scientifiques, des commentaires sur certains chapitres de ce rapport, qui est rédigé en comité, tandis que je vous ai fait part ce matin de mes convictions et de mon point de vue personnels, en sortant même souvent de mon champ de compétences. Mais si j'avais dû tout vous dire de mes propres préjugés et de ce que je crois savoir, j'aurais parlé pendant des heures. M. le Président : Nous aurons l'occasion de nous entretenir encore puisque, je l'ai dit, vous allez faire partie de notre comité de pilotage. Je vous remercie sincèrement pour cet exposé passionnant et très pédagogique sur les certitudes comme sur les incertitudes. Vous avez même évoqué la question des transferts de technologie vers les pays du Sud, qui fera l'objet d'une table ronde. L'exemple des CFC et de la convention de Montréal de 1987 montre bien que si nous, pays développés, disposant de substituts qui permettent de régler un certain nombre de problèmes techniques, ne transférons par ces technologies vers les pays du Sud, ceux-ci continueront, pour avoir accès à la chaîne du froid, à recourir à des produits aux effets néfastes. Audition de M. Eric BRUN, Présidence de M. Jean-Yves LE DEAUT, Président M. le Président : Nous poursuivons nos travaux en accueillant M. Éric Brun, directeur du Centre national de recherches météorologiques, que je remercie d'avoir accepté de remplacer M. Serge Planton. Il va nous parler des conséquences avérées et prévisibles des changements climatiques sur le climat de notre pays, ainsi que sur celui de nos départements d'outre-mer. Il se posera la question des évolutions naturelles et anthropiques. Il s'interrogera sur les modifications déjà constatées des températures et de l'enneigement, ainsi que des liens avec les événements climatiques extrêmes. M Éric BRUN, je vous donne sans plus tarder la parole. M. Éric BRUN : Je vais donc présenter l'exposé préparé par Serge Planton, qui sera complémentaire de celui que vous a fait la semaine dernière M. Jean Jouzel. Ce dernier a posé le problème général de l'augmentation des gaz à effet de serre et du changement climatique global sur notre planète, tandis que je me concentrerai davantage sur les conséquences du changement qu'on observe aujourd'hui en France métropolitaine et outre-mer ainsi que sur les projections qui constituent ce qu'on appelle la régionalisation du changement climatique. Je commencerai par ce qu'on peut tirer des informations dont on dispose. La France fait partie de ces quelques pays qui ont une longue tradition d'observation météorologique. Nous disposons donc de séries de mesures suffisamment longues pour les traiter statistiquement et pour éliminer les perturbations qui pourraient être dues à la proximité des points de mesure et des villes, en particulier au moment des débuts des observations météorologiques. Je partirai des paramètres les plus critiques pour définir un climat, qui sont les températures et les précipitations, mais je parlerai aussi des événements extrêmes comme les canicules et les tempêtes. Nous disposons d'une centaine de séries, qui représentent un siècle de mesures. Sur une carte présentant les températures minimales et maximales moyennes de la France, toutes les observations montrent un réchauffement. Pour les températures minimales, la partie nord-ouest du pays présente des augmentations de 1,5 degré, la partie est et sud-est étant proche d'un degré. Pour les températures maximales, le sud s'est réchauffé d'un degré et le nord de 0,3 à 0,4 degré. Je reviendrai sur ces éléments, qui correspondent aux modèles de prévisions climatiques, car la différence entre les températures minimales et maximales peut vraiment être attribuée au changement climatique dans la mesure où, en dépit de la variabilité naturelle des climats, un signal observé sur un siècle doit vraiment attirer notre attention. Et le signal dont je parle montre bien que c'est l'activité humaine qui est responsable de ce réchauffement. Les courbes de température pour la Guyane, la Martinique, la Guadeloupe, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française montrent que les températures augmentent également, mais deux fois moins vite, dans les régions tropicales où la France est présente, à l'exception de la Réunion, qui ne figure pas sur ce graphique car les évolutions n'y sont pas significatives. Les modèles montrent l'intensification du changement climatique dans les régions septentrionales, ce qui fait que nous sommes aussi touchés en tant que région tempérée, les régions tropicales y étant moins sensibles en raison de leur environnement marin. On sait que tel a déjà été le cas dans le passé, par exemple au moment des glaciations. S'agissant des précipitations, les graphiques sont un peu plus difficiles à interpréter, la variabilité étant plus forte que celle des températures. Il faut donc être beaucoup plus prudent pour dégager un signal statistique significatif. On peut constater un tel signal pour l'augmentation des précipitations hivernales, mais seulement dans certaines régions. Il est donc difficile d'en tirer des conclusions quant à une tendance importante. Le renforcement des précipitations apparaît également en automne, sauf dans le sud de la France. Aucune tendance vraiment significative n'est observable au printemps. En été, on note une baisse des précipitations sur l'ensemble du territoire. Il s'agit également d'observations caractéristiques du changement climatique correspondant aux modèles pour l'avenir. S'agissant des tempêtes - le seuil retenu est celui de 100 km/h -, on constate, à partir d'éléments observés en France entre 1950 et 2000, que leur nombre est extrêmement variable d'une année sur l'autre. Ainsi, il y a eu énormément de tempêtes hivernales entre 1960 et 1965. Globalement, on note une légère diminution sur l'ensemble de la période, mais qui ne semble pas significative. Depuis celle de 1999, il n'y a pas eu de forte tempête sur la France. Les pluies diluviennes - la définition retenue est de 190 mm par jour - sont d'autres événements extrêmes qui frappent régulièrement la France. De 1958 à 2003, on observe une grande variabilité mais aucune tendance marquée, même s'il y a eu des pluies importantes ces dernières années. Il faut distinguer l'observation des précipitations de celle des dommages qui leur sont liés, pour lesquels les assurances sont à même de fournir des statistiques. On sait que la vulnérabilité a augmenté : pour une même fréquence d'événements pluvieux, la densification urbaine, en particulier dans le sud de la France, fait qu'on a plus de catastrophes. Il faut aussi tenir compte de la médiatisation et de la sensibilité de notre société aux événements extrêmes, qui donne plus de résonance aux catastrophes survenant actuellement. Les historiens se sont penchés sur les grandes crues cévenoles des derniers siècles, mais on ignore si l'histoire a gardé la trace de la totalité de ces événements ou seulement des plus marquants. Mais, pour la période dite instrumentale, je répète qu'on n'observe aucune tendance marquée. M. Lionnel LUCA : Vous ne disposez pas de données fiables avant 1960 ? M. Éric BRUN : Si. Mais, alors que pour les températures, on sait par exemple que, s'il fait très chaud à Paris, il fait aussi très chaud à Orléans, la tendance des précipitations est relativement homogène pour le nord de la France, tandis que dans les régions méditerranéennes, les précipitations intenses sont liées presque exclusivement à des phénomènes orageux concentrés sur une dizaine de kilomètres. Pour pouvoir dégager des tendances statistiques, il faut donc disposer d'un réseau d'observation très dense, ce qui n'était pas le cas avant 1960. Aujourd'hui, le réseau s'est densifié pour répondre à une demande sociale. M. Lionnel LUCA : Je regrette la brièveté de la période d'observation. Il m'aurait semblé plus intéressant de se concentrer sur un point de mesure, par exemple Montpellier, et d'en retracer l'évolution sur un siècle. M. Éric BRUN : C'est tout à fait possible et je vous ferai volontiers parvenir ces informations. Il faut toutefois faire attention au fait que les précipitations peuvent être extrêmement fortes tout près du point de mesure sans le toucher directement. C'est une caractéristique de ce type d'événements. M. Robert LECOU : Vous avez parlé des précipitations, mais pas des crues. Dispose-t-on de données à leur propos ? M. Éric BRUN : Météo France n'a pas de mission de surveillance des crues, mais les informations existent, sans doute au sein du ministère de l'écologie et du développement durable, et je demanderai qu'elles vous soient adressées. Il faudra toutefois prendre ces données avec prudence en raison de l'anthropisation des bassins versants dans ces régions et des ouvrages de protection destinées à limiter les effets des crues. M. Christian DECOCQ : Il me semble que notre mission porte davantage sur les précipitations diluviennes que sur les crues et leurs conséquences. Il s'agit de problèmes complètement différents. M. Éric BRUN : Après avoir dressé le bilan de l'observation de ce qui s'est déjà passé en France, j'en viens aux projections pour l'avenir que permettent les scénarii climatiques que nous calculons. Je vais essentiellement présenter des résultats découlant du scénario A2, dont Jean Jouzel vous a parlé. C'est un scénario qui a longtemps été considéré comme pessimiste, avec comme hypothèse de base une augmentation encore forte des gaz à effet de serre, à un rythme voisin du rythme actuel, qui aboutit pratiquement à un triplement de la concentration en gaz carbonique à la fin du siècle en cours. Systématiquement, les modèles établissent des comparaisons avec ce qui s'est passé au cours des trente dernières années du XXe siècle. Le ministère de l'écologie et du développement durable, à travers le programme GICC - Gestion et Impacts du Changement Climatique - et l'Europe, avec des programmes du cinquième et du sixième budget civil de recherche et développement, ont soutenu des recherches en régionalisation du changement climatique qui permettent, à partir de modèles de simulations climatiques très grossiers, de développer des méthodes permettant de projeter à une échelle plus fine. Les résultats que je vais vous présenter proviennent du GICC, du projet PRUDENCE - Prediction of Regional scenarios and Uncertainties for Defining European Climate change risks and Effects - et de travaux propres à Météo France. Pour les prévisions de température, de nombreux modèles montrent une forte augmentation en été, non pas que l'augmentation globale soit très différente de celle de l'hiver mais en raison principalement de l'assèchement des sols. Pour la période 2070-2100, on aurait une augmentation de plus de 2 degrés de la température moyenne sur les trois quarts sud du pays en hiver et au printemps, de plus de 3 degrés en automne pour la quasi-totalité du territoire - à l'exception de l'extrême nord, du Cotentin et de la Bretagne où l'augmentation ne serait que de 2 degrés - et de 4, voire de 5 degrés en été sur une très grande partie de la France. Les modèles font parfois partir les simulations de 1860, afin de montrer qu'ils sont capables de représenter correctement le climat depuis l'ère préindustrielle jusqu'à la période actuelle. Dans ces simulations, on augmente progressivement les gaz à effet de serre, conformément aux observations, jusqu'aux années 2000. Ensuite, on a différents scénarii, qui correspondent à des augmentations plus ou moins fortes des gaz à effet de serre et des aérosols sulfatés. Pour chacun de ces scénarii, on a une simulation à l'échelle globale sur la planète, avec un point tous les 100 à 200 km, puis on utilise les sorties de ces modèles pour en alimenter d'autres, à plus haute résolution et à caractère régional, et on fait les mêmes calculs. Enfin on compare ce qu'il y avait au début, en 1970-2000 à ce qu'il y aura en 2070-2100. C'est la différence entre les deux périodes qui est représentée sur les cartes que je vous présente. M. le Président : M. Robert Kandel a considéré tout à l'heure que le seuil de 550 parties par million était celui qu'il ne fallait pas dépasser. A combien se situe le modèle A2 ? M. Éric BRUN : À la fin, on arrive à 1000 parties par million. M. le Président : Ce scénario a longtemps été considéré comme pessimiste. Peut-on dire aujourd'hui qu'il l'est moins ? M. Éric BRUN : Il est toujours considéré comme un scénario probable. Quand j'étais jeune chercheur, on n'envisageait qu'un doublement du gaz carbonique, et le scénario de triplement n'était même pas évoqué. Il est apparu au milieu des années 1990, plutôt comme un exercice académique destiné à voir comment les modèles se comportaient, mais il devient aujourd'hui la référence pour calculer ce que pourraient être les conséquences du changement climatique. Si vous le souhaitez, je pourrai vous adresser des graphiques avec 500 et 1000 parties par million. L'essentiel, c'est l'activité économique, la croissance de la population et la sensibilité aux questions environnementales. Quand on voit comment notre planète évolue, personne n'est capable d'accorder une probabilité plus forte à tel ou tel scénario ou d'affirmer que nous connaîtrons une terrible catastrophe, que tout va s'arrêter, qu'il y aura des conflits, de graves problèmes de ressources en eau. Mais l'évolution de la société depuis un siècle n'incite guère à l'optimisme sur ce que sera la situation dans cent ans, d'autant que tout va plus vite qu'auparavant. Ce qu'on peut dire, c'est que ce que nous calculons avec les modèles a beaucoup de points communs avec l'observation de la période récente. Si nous nous étions rencontrés il y a dix ans, je vous aurais montré des graphiques similaires - car malgré tous les progrès qui ont été enregistrés, on continue à calculer ce qu'on calculait déjà il y a quinze ans - mais je ne vous aurais jamais dit que le changement climatique avait commencé. Aujourd'hui, plus personne ne le conteste, les signaux sont au rouge partout : l'enneigement diminue ; les glaciers fondent ; le niveau de la mer monte à la vitesse colossale de 3 mm par an ; les températures augmentent très vite. Et, même si on ne peut pas exclure ce scénario, je suis pour ma part bien incapable de faire des projections pour savoir si, en fonction de l'efficacité du protocole de Kyoto et de l'après-Kyoto, l'ensemble de la planète aura une politique énergétique différente. J'en viens aux modèles de changement des précipitations. On constate, pour le nord, l'ouest et le sud-est la France, une augmentation significative en hiver ; une augmentation dans le nord et le nord-est et une baisse dans le sud en automne ; une diminution, à l'exception du nord et de l'est au printemps ; une forte diminution sur tout le territoire en été. Il s'agit de projections des modèles, qui ne se servent pas de ce qu'on a observé, mais on voit bien l'analogie avec la carte des observations que je vous ai présentée tout à l'heure. Il est rassurant pour les scientifiques de constater que les caractéristiques de répartition régionale et saisonnière des modèles sont très proches de ce qu'on est capable de déduire des observations de ce qui s'est déjà passé. Les étés paraissent donc devoir cumuler chaleur et sécheresse, ce qui posera problème pour les ressources en eau. Un paramètre très important en matière de climat est la variabilité : autour d'une moyenne, on peut avoir des étés chauds et des étés plus froids. De 1900 à 2003, la température moyenne des étés a fluctué de 4 à 5 degrés autour d'une moyenne de 18 degrés, avec des étés à 21 degrés et d'autres à 16 degrés. C'est ce qu'on appelle la variabilité interannuelle. On observe une augmentation des températures à partir des années 1980, l'année 2003 apparaissant tout à fait en dehors de la norme. Si on ne savait pas qu'on est déjà sur une pente ascendante, la probabilité statistique du retour d'un tel phénomène serait de l'ordre de la dizaine de milliers d'années : si on m'avait dit au début de mes études qu'on aurait en France une moyenne de 23 degrés pendant trois mois d'été, je ne l'aurais jamais cru. En revanche, en commençant à prendre en considération l'augmentation depuis 1980, cette probabilité restait faible mais elle n'était plus nulle. Si on prolonge cette courbe avec les données des modèles, en partant de 1960, et même si la variabilité empêche bien sûr d'obtenir des résultats conformes à la réalité, on constate que les variations sont voisines de celles observées naturellement, avec des années plus chaudes et des années plus froides. Mais ensuite, les projections sont celles qui ont permis l'an dernier à Météo France d'annoncer que, selon le scénario A2, la température de l'été 2003 serait la moyenne à partir de 2070. Évidemment, comme il s'agit d'une moyenne, cela signifie qu'il y aura des étés plus froids et d'autres plus chauds, la température moyenne en France pendant un été pouvant atteindre 26 degrés à la fin du siècle. Cela signifie que certaines journées, la température atteindra 45 à 50 degrés. Cela n'entraînera peut-être pas une catastrophe humaine comme en 2003 car on connaît désormais le danger, mais on ne pourra pas protéger des dégâts la végétation, et il est évident, par exemple, qu'après quelques jours à 45 degrés, les chênes mourront. On peut décliner ces résultats en mettant l'accent sur des points particuliers. On peut ainsi observer le nombre de jours de canicule estivale, à partir d'une anomalie de plus 5 degrés pendant au moins six jours consécutifs dans une région. C'est cette notion qui est d'ailleurs retenue dans le plan canicule, car on considère que 30 degrés pendant six jours dans le nord de la France, c'est aussi grave que 40 degrés dans la région toulousaine. Dans la carte de référence, entre trois et dix jours par an répondent à cette définition. Avec le scénario A2, on arrive à trente à quarante jours sur une large moitié sud est, aucune région n'étant totalement épargnée. De même, le scénario montre une forte augmentation aussi bien du nombre de jours de pluies fortes en hiver, c'est-à-dire avec des précipitations supérieures à 10 mm, que du nombre maximum de jours consécutifs sans pluie en été. Le nombre de jours de gel devrait diminuer de façon considérable. On peut en voir les effets bénéfiques sur le plan énergétique, mais il y aurait aussi de fortes conséquences sur les écosystèmes. Le nombre de jours avec chute de neige serait aussi réduit. Ainsi, on passerait d'une dizaine de jours actuellement en région parisienne à moins de deux, seules les zones de montagne restant au-dessus de dix jours. Une autre étude montre qu'avec une augmentation de 1,8 degré de la température, le nombre de jours d'enneigement au sol à 1500 m dans les Alpes françaises serait également en régression. Même dans les Alpes du Nord, on aurait de la neige au sol pendant trente à quarante jours de moins qu'actuellement. On peut aussi envisager l'impact sur le débit de la haute Durance à proximité de Serre-Ponçon : l'étiage d'hiver serait plus important à cause de la faiblesse de l'enneigement, le débit printanier serait moins fort et apparaîtrait trois semaines plus tôt, le débit estival serait fortement réduit. S'agissant enfin des cyclones tropicaux, si on compare la période 1979-1988, au scénario intermédiaire B2, pour la période 2090-2099, on ne constate pas de forte augmentation de leur fréquence, les précipitations sont plus intenses et les trajectoires sont modifiées, avec des cyclones qui remontent vers le nord beaucoup plus tôt dans l'Atlantique. J'observe à ce propos, que, si on a connu un grand nombre de cyclones en 2004 et en 2005, personne ne peut prétendre que ce soit une conséquence avérée du changement climatique, d'autant qu'avant l'observation par satellite, seuls étaient repérés les cyclones qui affectaient les populations. Alors que la moyenne mondiale du réchauffement est de 0,6 degré, la France s'est réchauffée d'environ un degré au cours du siècle dernier. Le réchauffement est aussi sensible outre-mer, à l'exception de la Réunion. On n'observe pas, au cours de la deuxième moitié du XXe siècle, de tendance marquée pour le nombre de tempêtes et d'épisodes de pluies diluviennes. Il est probable que, quoi qu'on fasse, la France va continuer à se réchauffer pendant deux ou trois décennies, l'enjeu étant donc maintenant ce qui va se passer après. Les précipitations vont continuer à augmenter en hiver et à diminuer en été ; le nombre de jours de gel et de neige va diminuer. Les vagues de chaleur estivale seront probablement plus fréquentes, plus longues et plus intenses. Les pluies intenses augmenteront en hiver et les périodes de sécheresse estivale seront plus longues. Ce qui est moins certain, car on n'en est qu'aux études préliminaires, c'est une faible augmentation de la fréquence de vents forts sur le nord de la France. Sur l'Atlantique, les trajectoires des cyclones pourraient changer et l'intensité des pluies qui leur sont associées pourrait augmenter. Enfin, il n'est pas encore possible de se prononcer sur l'influence du changement climatique sur les événements de type cévenol. La communauté scientifique déploie beaucoup d'efforts pour étudier ces phénomènes, car les régions méditerranéennes sont parmi les plus sensibles aux changements climatiques. M. Lionnel LUCA : On entend toujours parler de l'impact de l'homme sur les modifications climatiques, mais mesurez-vous aussi la part des accidents naturels ? Je pense en particulier aux éruptions volcaniques intenses, mais aussi au tsunami, ou plus exactement au tremblement de terre qui l'a déclenché, dont la violence aurait eu des répercussions sur l'axe de la terre par rapport au soleil. M. Éric BRUN : Les modèles tiennent compte des aérosols provenant de l'activité volcanique telle qu'on la connaît depuis cent cinquante ans. Évidemment, les prévisions sont plus difficiles en la matière que pour la météorologie. C'est pourquoi les scénarii de changements climatiques ne partent pas de l'hypothèse d'une activité volcanique dix fois plus importante. Comme pour les cyclones, il est difficile de savoir exactement ce qui se passait avant les satellites, car l'histoire ne garde de traces que des éruptions qui ont pu être observées : on ne connaît l'existence de certains volcans que par les poussières qui ont été retrouvées dans les carottages de neige en antarctique. Mais je ne crois pas que les spécialistes des sciences de l'univers considèrent qu'on soit aujourd'hui dans une période d'activité ni plus ni moins importante qu'auparavant. L'ampleur du tsunami a bien modifié légèrement les paramètres orbitaux de la Terre, mais on n'en a parlé que parce que c'est symbolique de la puissance du phénomène, les effets en matière de climat étant extrêmement faibles. Aucun scénario ne repose sur un changement des paramètres orbitaux de la Terre. Il est vrai que c'est la variation de ces paramètres qui est à l'origine des glaciations, mais on se situe là sur une échelle de temps très différente. Les recherches sur les températures permettent maintenant de remonter jusqu'à il y a 800 000 ans, mais on voit que le changement de températures du siècle dernier s'est produit à une vitesse sans précédent dans les enregistrements climatiques. M. le Président : Je crois que M. Robert Kandel nous a bien montré tout à l'heure que les changements sont si importants et si rapides qu'on ne peut les expliquer désormais que par les effets des activités humaines. M. Vincent ROLLAND : Attribuez-vous le recul des glaciers à l'augmentation des températures ou à celle des précipitations ? Par ailleurs, vous nous avez montré une augmentation des précipitations en hiver, alors que j'avais l'impression que les derniers hivers avaient été assez peu humides dans le nord des Alpes. M. Éric BRUN : On constate une augmentation des précipitations dans le nord des Alpes depuis un siècle. Les glaciers sont formés de l'accumulation de neige mais aussi de la fonte de cette neige. J'ai personnellement travaillé sur la fonte de la neige. Nous avons simulé quelle augmentation des précipitations pourrait compenser l'augmentation de la fonte due à l'élévation des températures. A la période à laquelle la neige disparaît et où les glaciers commencent à fondre, il y a beaucoup de lumière et la fonte est extrêmement forte. Donc, même en ajoutant 10 % de chutes de neige, on ne retarde que de quelques jours le moment où la neige disparaît pour laisser apparaître la glace. Seule une augmentation de 30 % des précipitations, soit bien plus qu'il n'est envisagé dans les différents scénarii, pourrait permettre de contrecarrer les effets de la fonte. L'étude menée conjointement par le Centre d'étude de la neige de Grenoble et le Laboratoire de glaciologie et géophysique de l'environnement sur le glacier de Saint-Sorlin montre qu'il est déjà en déséquilibre complet, c'est-à-dire qu'il fond chaque année plus de glace que le glacier n'en accumule. Si on poursuivait simplement avec le climat d'aujourd'hui, la plupart des glaciers des Alpes disparaîtraient. M. le Président : Il y a une polémique à ce propos, car on a déjà observé dans l'histoire des variations des glaciers - on cite l'exemple du passage des armées d'Hannibal par les Alpes - et certains affirment donc que la fonte actuelle n'est pas due au réchauffement climatique, mais à des variations saisonnières plus importantes que d'habitude. Nous pourrons revenir sur cette question, qui intéresse particulièrement nos collègues des Alpes, dans le cours de nos travaux. Mme Martine LIGNIERES-CASSOU : Vous avez pris parti pour un réchauffement des océans. M. Éric BRUN : Je n'ai pas pris parti, j'ai fait état des calculs de modèles qui, à partir d'un état initial, simulent de façon complète l'évolution de l'océan et de l'atmosphère. Mme Martine LIGNIERES-CASSOU : On a tout à l'heure interrogé M. Robert Kandel sur les effets de la fonte de la calotte glaciaire et sur l'hypothèse d'une inversion des courants qui pourrait refroidir considérablement les littoraux en hiver. Or je n'ai pas retrouvé cette hypothèse dans votre présentation. M. Éric BRUN : Un nouveau scénario est en cours d'élaboration pour le quatrième rapport du GIEC, qui sera publié en 2007. Pour le Gulf Stream, les modèles ont des comportements différents, mais aucun ne calcule l'arrêt de ce courant. Peut-être cette idée s'est-elle répandue en raison du film Le Jour d'après. Même si nos régions méditerranéennes sont sèches et peuvent rappeler par certains aspects l'Afrique du Nord, même si le nord-est peut rappeler le climat continental, la France a un climat tempéré, et elle est avant tout une sentinelle qui pointe vers l'océan. Même si le Gulf Stream devait s'arrêter, nous serions toujours dans un climat océanique. La seule chose qui pourrait nous en priver serait un changement météorologique complet, avec davantage d'anticyclones que de dépressions sur l'Islande. Notre pays serait alors soumis de manière assez permanente a de l'air continental venant de l'Est et, même dans un climat plus chaud, il pourrait faire encore plus froid. Mais, si la situation climatique demeure ce qu'elle est, même si la température de l'océan Atlantique baissait de 3 ou 4 degrés, ce que ne calculent pas les modèles, cela ne suffirait pas à inverser la tendance qu'on observe déjà. Mme Geneviève COLOT : Avez-vous une explication à l'exception que semble constituer la Réunion dans le réchauffement climatique ? M. Éric BRUN : Non. Les résultats pour l'outre-mer ont été présentés aux Journées climat il y a une dizaine de jours et quand j'ai posé la question, on m'a dit qu'il n'y avait pas de tendance affirmée pour la Réunion. Je le ferai vérifier et je vous tiendrai informés. M. le Président : Pourquoi la température moyenne en France augmente-t-elle d'un degré alors que celle du monde augmente de 0,6 degré ? Cela signifie-t-il que les régions tempérées vont subir des variations plus fortes que les régions tropicales ? M. Éric BRUN : C'est la question fondamentale : allons-nous payer deux fois le changement climatique ? L'Europe de l'Ouest est une des seules régions où le taux de réchauffement observé soit plus fort qu'ailleurs. M. Philippe ROUAULT : Avez-vous des explications ? M. Vincent ROLLAND : Et qu'en est-il des États-Unis ? On les accuse d'être les principaux pollueurs et émetteurs de gaz à effet de serre. S'ils ne sont pas aussi touchés que nous par le réchauffement climatique, on a peu d'espoir que les choses changent. M. Éric BRUN : L'Alaska subit de plein fouet le changement climatique, avec des sécheresses et avec la fonte du pergélisol qui transforme en boue la terre, jusqu'alors gelée, qui supportait les constructions. Et, même si cela conserve un caractère événementiel, tout comme la France a été particulièrement sensibilisée en 2003 à la canicule, les États-Unis observent avec une grande attention l'activité cyclonique. En dehors de la politique du gouvernement américain, il y a désormais une prise de conscience de la population, et surtout de la communauté scientifique qui se désole de voir ainsi son pays mis au ban des nations. J'ajoute que les États ont une politique très différente de celle du gouvernement fédéral et que plusieurs d'entre eux, y compris la Californie, ont en matière d'environnement des objectifs aussi ambitieux que ceux de l'Europe. J'en reviens à la question sur l'influence plus forte du changement climatique sur notre pays. Les continents vont se réchauffer plus que les mers, pour lesquelles l'inertie est bien plus grande. L'eau est un fluide caloriporteur, elle se mélange et représente une masse colossale. Même si toute l'énergie du soleil était transférée aux océans sans qu'on la renvoie vers l'espace, la température moyenne des eaux n'augmenterait que d'un degré par an. Le changement climatique va donc être moindre pour les régions maritimes, en particulier insulaires. Par ailleurs, le climat de la France est un peu particulier en ce qu'il est fortement influencé par la dépression d'Islande et l'anticyclone des Açores. C'est ce qui fait que nous avons tantôt des régimes d'ouest fort avec des tempêtes qui se succèdent, tantôt des grandes périodes anticycloniques, tantôt des descentes d'air froid du nord. Un tout petit décalage de la dépression et de l'anticyclone change considérablement notre climat. La tendance qu'on observe aujourd'hui à une augmentation du caractère dépressionnaire de l'Islande et des hautes pressions va-t-elle se poursuivre ? C'est ce que semblent montrer les modèles et c'est bien l'enjeu essentiel du changement climatique pour nous car, si cette tendance se poursuit, c'est non seulement l'élévation de la température moyenne de la terre, mais aussi l'augmentation de la fréquence des hautes pressions qui vont nous amener des climats plus chauds. M. le Président : M. Robert Kandel, souhaitez-vous ajouter quelque chose en tant que membre de notre comité de suivi ? M. Robert KANDEL : Ce que vient de nous dire M. Éric Brun confirme que les sciences du climat en sont arrivées à un point où il n'y a aucun doute sur le réchauffement engagé déjà pour quelques décennies et sur le changement radical qui nous attend si on continue sur la pente du scénario A2. Il ne s'agit évidemment pas de souhaiter que la croissance s'arrête dans les pays émergents, mais il faut être conscient que cela va conduire à un changement considérable de nos conditions d'existence. M. le Président : M. Éric Brun, je vous remercie chaleureusement pour votre présentation. Audition conjointe de MM. Paul VERGÈS, Président, Marc GILLET, directeur, et Mme Pascale BABILLOT, responsable de l'adaptation, Présidence de M. Jean-Yves LE DEAUT, Président, M. le Président : Mes chers collègues, nous recevons aujourd'hui M. Paul Vergès, président de l'Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique, M. Marc Gillet, son directeur, et Mme Pascale Babillot, responsable de l'adaptation. Je salue d'autre part la présence de membres du comité de pilotage, notamment M. Christian Ngô, délégué général de l'association Écrin, M. Michel Petit, qui travaille sur le réchauffement climatique et a été le représentant de la France au bureau du GIEC de 1992 à 2002, et Mme Cécile Ostria, directrice de la fondation Nicolas-Hulot. Je rappelle que l'ONERC a été créé par la loi du 19 février 2001, à la suite d'une initiative parlementaire. Nous souhaitons entendre votre point de vue sur quelques questions qui nous paraissent essentielles. Quel bilan peut-on dresser des effets du réchauffement climatique ? Compte tenu de notre vulnérabilité aux changements climatiques, quelles sont selon vous les mesures d'adaptation indispensables ? Les DOM-TOM sont-ils confrontés à des problèmes spécifiques ? Comment mobiliser les acteurs concernés ? Quels moyens financiers sont mis au service de l'adaptation ? Comment développer la coopération européenne et internationale ? Comment l'action de l'ONERC s'articule-t-elle avec celle des autres acteurs, notamment de la Mission interministérielle de l'effet de serre ? M. Paul VERGES : La proposition de loi créant l'ONERC a été votée à l'unanimité par les deux chambres. D'initiative sénatoriale, elle avait été signée par les représentants de tous les groupes parlementaires. Le réchauffement climatique est un problème essentiel, qui concerne tous les États. Les scénarios n'excluent pas un changement de température entre le début et la fin du XXIe siècle comparable à celui qui a eu lieu à la fin de l'ère glaciaire, qui s'est étalée sur une durée de 13 000 ans. C'est dire que nous avons à faire face à des changements fondamentaux. Nous pensions, surtout après la tempête de décembre 1999, que l'information devait être mise à la disposition du public le plus large possible, afin d'éviter à la fois la sous-estimation du danger et le catastrophisme. Il convenait de rassembler et de diffuser les résultats de recherches menées dans des secteurs très divers. Il importait également de s'adresser aux responsables des différentes institutions, nationales et territoriales. Comme vous le savez, l'approche du problème est gouvernée par deux grands concepts, celui de l'atténuation et celui de l'adaptation. Pour ce qui est de l'atténuation, il s'agit de savoir quelles mesures permettraient de diminuer à l'avenir la pollution de l'atmosphère. L'adaptation est d'une autre nature. Le réchauffement climatique provoque dès maintenant des phénomènes extrêmes auxquels il convient de faire face. Les problèmes se posent dans des domaines très différents. Les inondations, les crues, les tempêtes, les cyclones appellent des mesures touchant à l'urbanisme, à la construction des bâtiments, à la politique de santé, aux assurances, au tourisme, étant entendu que cette liste est loin d'être exhaustive. En ce qui concerne la Réunion, l'adaptation au réchauffement climatique a été intégrée dans le contrat de plan Etat-région ainsi que dans le document unique de programmation présentant les programmes éligibles aux fonds structurels européens. La Réunion est une région montagneuse, au climat tropical marqué par de fortes pluies. Si les cyclones doivent être sinon plus nombreux du moins plus violents, en déplaçant des masses d'eau beaucoup plus grandes, il est évident que l'endiguement des ravines doit être une priorité. Cela a un coût qui doit peser sur le contenu de l'ensemble du contrat de plan. Le problème de l'adaptation trouvera sa traduction budgétaire à tous les niveaux, de la commune à l'État en passant par le département et la région. La fonte des glaciers alpins, avec toutes ses conséquences, pose la question de l'alimentation en eau de tout notre littoral méditerranéen. Il est important qu'il existe un organisme chargé d'une responsabilité transversale qui puisse s'appuyer sur un conseil d'orientation comprenant des chercheurs, des représentants des différents ministères, des élus nationaux et locaux, des représentants des grandes organisations qui s'occupent des problèmes d'environnement. L'ONERC est donc un lieu de débat, de concertation, où nous pouvons traduire ces approches transversales dans des programmes d'action, qu'il s'agisse, par exemple, des conséquences du réchauffement climatique sur l'activité viticole ou sur la promotion immobilière en zones de montagne. Les régions nous demandent d'établir une cartographie mettant en évidence les zones où les risques sont les plus graves, L'Europe est l'un des plus petits continents mais aussi celui qui a le plus grand nombre de façades maritimes ; les côtes de l'Europe sont extrêmement découpées. Or, l'une des conséquences du réchauffement climatique serait la montée du niveau des océans, avec toutes les conséquences qui en résulteraient sur les infrastructures et les activités économiques. Les pays européens doivent donc prendre des mesures en termes d'aménagement du territoire. Nous avons réussi à faire partager cette inquiétude aux responsables des régions européennes périphériques et maritimes, qui, sur proposition de l'ONERC, se réuniront à Marseille au mois de février prochain. Un autre séminaire sera consacré aux problèmes de santé qui se poseront. Les maires, les conseillers généraux et les conseillers régionaux seront informés par une revue destinée à faire le point de la recherche sur différents domaines. L'Europe a également des massifs montagneux. Or, les conséquences en montagne du réchauffement climatique posent des problèmes considérables, par exemple sur les ressources en eau ou les activités touristiques. La France est enfin concernée par les zones intertropicales, où naissent et agissent les grands courants marins qui ont des conséquences considérables sur le changement climatique. Nous devons faire face au danger des cyclones, dont la violence sera peut-être accrue, et en tout cas à l'augmentation du volume des pluies. Dans une île comme la Réunion, cela pose tout le problème de l'érosion. A la fin de l'année dernière, les chefs d'État et de gouvernement de la Commission de l'Océan Indien se sont réunis à Tananarive, la France y était représentée par le Président de la République. L'un des problèmes posés était de savoir comment le développement durable était possible sous la menace constante des cyclones. Les pays concernés ont demandé à l'ONERC d'établir un diagnostic. Le phénomène est d'autant plus inquiétant que l'industrie touristique peut être menacée. Les plages de sable blanc, aux Seychelles, à l'île Maurice ou à Madagascar, sont protégées par des barrières coralliennes. Or, celles-ci sont en train de mourir. À la Réunion, plus de 50 % des coraux sont déjà menacés. Au large du Mozambique, les îles éparses, sous souveraineté française, ont parmi les plus beaux sites sous-marins du monde. Nous avons envoyé une mission d'universitaires et de chercheurs à Juan de Nova afin d'évaluer l'état du corail. Ils nous ont ramené un film montrant un cimetière de coraux. Il n'y a pas que la disparition des barrières de coraux. Des îles risquent de disparaître. Les Maldives sont menacées, comme le sont tous les atolls du Pacifique. Parce qu'elle est présente sur l'ensemble de la ceinture intertropicale, la France est la mieux placée pour étudier les conséquences du réchauffement climatique. S'agissant de la pêche, l'IFREMER nous a indiqué que l'on pêche déjà dans le golfe de Gascogne des poissons tropicaux. Les pêcheurs écossais ont déjà ramené dans leurs filets des tarpons. Si les grands pélagiques changent d'itinéraire, les investissements faits depuis vingt ans dans l'océan Indien ne serviront plus à rien. Si la mangrove est attaquée, c'est le moyen de survie de populations entières qui sera mis en cause. N'oublions pas qu'un autre problème va se poser en même temps que le réchauffement climatique, je veux parler de la transition démographique. Selon l'ONU, la population de l'Europe, de 725 millions d'habitants en 2004, sera de 630 millions en 2050. Celle de l'Afrique passera, dans le même temps, de 869 millions à 1,8 milliard. Cette augmentation de population s'effectuera dans un contexte marqué par le sous-développement et le changement climatique. La Fédération de Russie passera, elle, de 142 à 101 millions, et les États arabes de 314 à 631 millions. Si nous rapprochons le réchauffement climatique de la transition démographique, nous voyons que nous n'en sommes qu'au début d'une évolution potentiellement dramatique. C'est pourquoi l'information, l'atténuation, l'adaptation au réchauffement climatique doivent être une priorité nationale. M. Marc GILLET : L'ONERC, qui fédère et valorise les travaux d'un important réseau de partenaires - scientifiques, mais aussi techniques et institutionnels -, mène une action distincte de la politique d'atténuation des émissions de gaz à effet de serre, laquelle est coordonnée par la MIES. Son conseil d'orientation, créé par décret, comporte 26 membres titulaires, incluant des élus, des scientifiques et des représentants de plusieurs ministères ; son équipe administrative compte trois personnes. Les deux axes stratégiques sont complémentaires : l'atténuation vise à lutter contre les causes du réchauffement climatique ; l'adaptation vise à se prémunir contre ses effets. En ce qui concerne les principales actions de l'ONERC, nous avons tenté de concentrer notre effort d'information en direction des collectivités locales, pour lesquelles nous avons rédigé un guide. Deux colloques ont été organisés, consacrés aux événements extrêmes et à l'adaptation. Des actions de formation ont été conduites en direction des élus et des assureurs. Des expertises ont été menées pour le compte de diverses régions. D'autres travaux, plus techniques, ont été effectués, notamment avec le Conservatoire du littoral. L'ONERC a contribué, en lien avec les ONG, à une étude sur la biodiversité, éditée à 20 000 exemplaires. Des travaux de coopération sont conduits avec les pays en développement, notamment avec la Commission de l'Océan Indien. La principale production de l'ONERC a été le premier rapport au Premier ministre et au Parlement. Il a confirmé que des changements étaient en marche, et décrit des effets de différentes natures. Il a mis en évidence la nécessité de s'adapter à la dérive du climat, ainsi que de faire intégrer ce facteur par tous les acteurs et tous les centres de décisions. Le réchauffement observé en France est plus important que le réchauffement global moyen - un degré, contre 0,6 degré. On observe déjà de nombreuses conséquences sur la nature, qu'il s'agisse des glaciers, des coraux, de la productivité forestière, ou encore de la phénologie. Il nous a paru important de faire la distinction entre les phénomènes extrêmes de grande échelle - sécheresses, inondations - et ceux de plus petite échelle, pour lesquels les données sont plus incertaines. Tout en nous gardant de tout catastrophisme, le rapport a souligné la nécessité d'élaborer dès à présent une véritable politique d'adaptation impliquant les ministères, les collectivités locales, les chercheurs et les milieux socioprofessionnels. Mme Pascale BABILLOT : La notion d'adaptation demande à être précisée. L'adaptation ne recouvre pas seulement l'ensemble des mesures qu'il convient de prendre pour se prémunir contre les effets catastrophiques du réchauffement climatique. Elle intègre également la prise en compte, dans les décisions de long terme, du changement climatique. La vulnérabilité évolue elle-même en fonction des données climatiques. Une stratégie d'adaptation a été définie. Elle a été préparée par un groupe interministériel associant plusieurs hauts fonctionnaires au développement durable et des organismes techniques publics. Nous avons identifié les éléments de contexte dans lesquels s'insère cette stratégie, ainsi que quatre grandes finalités : protéger la santé et les biens, réduire les inégalités, limiter les coûts, et assurer la protection du patrimoine naturel. Le groupe a également identifié neuf axes stratégiques : développer la connaissance ; consolider et pérenniser le dispositif d'observation ; informer et sensibiliser tous les acteurs ; promouvoir une approche adaptée aux territoires ; financer les actions d'adaptation ; utiliser les instruments législatifs et réglementaires ; favoriser les approches volontaires et le dialogue avec les acteurs privés ; tenir compte de la spécificité de l'outre-mer ; contribuer aux échanges internationaux. Nous avons conduit des analyses croisées, par thèmes, secteurs ou milieux. Le document lui-même sera adopté, nous l'espérons, avant la fin de l'année. Une réduction drastique de nos émissions de gaz à effet de serre n'empêchera pas les effets majeurs que sont l'élévation de la concentration de CO2, celle de la température et celle du niveau de la mer. Le système climatique commence dès aujourd'hui à répondre aux émissions du passé. Pour s'adapter au changement climatique, il sera nécessaire de repenser les seuils et les critères qui sont actuellement retenus, pour s'adapter à la variabilité actuelle de nos climats. M. le Président : M. Éric Brun, de Météo-France, que nous avons auditionné, nous a dit que les effets du réchauffement climatique seraient constatés dans pratiquement toutes les régions du monde, mais qu'il n'avait rien détecté pour l'instant en ce qui concerne la Réunion. Est-ce votre sentiment ? M. Paul VERGES : La Réunion a connu des cyclones en 1932 et en 1948, qui ont causé des dizaines de morts. Le village de Grand-Sable a été englouti. Aujourd'hui, comment se présente la situation ? Afin d'augmenter la productivité de la canne à sucre, l'Union européenne a subventionné une technique consistant à dépierrer des terrains pour permettre la mécanisation. Or, le maintien de cette culture est actuellement menacé. En cas de disparition de la filière, des dizaines de milliers d'hectares ne seront plus protégés, puisque tous les obstacles à l'érosion ont disparu. Un cyclone aurait des effets dramatiques. Autre exemple, 40 % de nos coraux sont morts. La dimension démographique doit également entrer en ligne de compte. La Réunion comptera un million d'habitants en 2025. Mme Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET, Rapporteure : Vous avez évoqué une forte demande d'expertise de la part des régions. Or, nous avons le sentiment que la régionalisation de l'expertise est difficile, les modèles étant peu adaptés. Avez-vous développé une méthodologie ou récolté des informations vous permettant d'analyser de manière fine les effets possibles du réchauffement climatique, région par région ? D'autre part, Mme Babillot a mentionné des axes stratégiques d'adaptation. S'agissant des instruments législatifs et réglementaires, elle a semblé considérer que les instruments existants seraient suffisants, et qu'il suffirait d'appliquer les dispositions existantes. Cela m'a surprise. Aurions-nous, pour ainsi dire, anticipé les exigences de l'adaptation aux effets du réchauffement climatique ? M. Paul VERGES : D'ici à 2025, la population de la Réunion connaîtra une augmentation de l'ordre de 250 000 à 300 000 habitants. Allons-nous construire les 180 000 logements nécessaires sur le modèle de ce qui a été jusqu'ici, et qui a été un gaspillage d'énergie, ou nous faut-il inventer la maison du XXIe siècle ? La difficulté est de répondre à des changements climatiques dont on ne cerne pas avec précision tous les impacts. Il est évident que ce problème ne se pose pas dans les mêmes termes à la Réunion et dans le Pas-de-Calais. Un autre problème de la Réunion est qu'elle compte très peu de rivières pérennes. Lors du cyclone de 1948, les services de l'État ont calculé que le volume d'eau charrié par un petit lit de rivière a correspondu à celui du Rhône en crue à Lyon. Le danger est beaucoup plus la destruction par un cyclone qu'une inondation étale. Les régions nous demandent une cartographie régionale des impacts. Mais comment évaluer avec précision le volume des précipitations à tel endroit ? S'agissant des dispositions législatives et réglementaires, l'ONERC a rédigé un document intitulé Stratégies d'adaptation au changement climatique, qui a été transmis à la délégation interministérielle du développement durable. Il fait la synthèse de nos propositions. Mais c'est à la MIES qu'il appartient de proposer au Gouvernement des mesures législatives ou réglementaires, notamment dans les domaines de l'urbanisme et de l'énergie. Quelles que soient les difficultés, on peut trouver des solutions. Actuellement, on installe à la Réunion deux fois plus de chauffe-eau solaires que dans toute la France. D'ici 2025, chaque maison devra avoir son propre chauffe-eau solaire. De même, nous installons des panneaux solaires photovoltaïques, sur les toitures des sièges administratifs et dans les zones industrielles. Nos premières fermes éoliennes sortent de terre. Nous réutilisons l'énergie des vagues les plus violentes qui échouent sur nos côtes pour la production d'électricité. Nous entreprenons l'exploitation des ressources volcaniques pour alimenter des centrales géothermiques. Enfin, nous projetons de capter l'énergie de la houle de l'Antarctique, les fameux quarantièmes rugissants. Notre mot d'ordre est l'autonomie énergétique de la Réunion en 2025. Nous avons pour cela le soutien d'EDF. Nous ne négligeons pas non plus la bagasse, résidu fibreux issu du raffinage de la canne à sucre, qui est brûlée dans deux centrales thermiques. Cette ressource représente 25 % de la production d'énergie électrique de l'île. Vous le voyez, il importe de s'adapter aux conditions locales en sortant des modèles traditionnels. Churchill a dit, rendant hommage aux pilotes de la Royal Air Force engagés dans la bataille d'Angleterre, que jamais le sort d'un si grand nombre d'hommes n'avait dépendu d'un si petit nombre. Peut-être les chercheurs actuels apparaîtront-ils, dans quelques décennies, comme les acteurs décisifs de la sauvegarde de l'environnement de la planète. M. Serge POIGNANT : Selon vous, à partir de quel niveau de réchauffement pourrons-nous parler d'un véritable drame ? M. Paul VERGES : La Réunion comptait 250 000 habitants en 1950, elle en compte 780 000 aujourd'hui, et en comptera un million en 2025. Malgré l'aide considérable de Paris et de Bruxelles, nous n'arrivons pas à résoudre nos problèmes, à commencer par celui du chômage, qui touche 30 % de la population active. Avec une croissance pourtant forte, de l'ordre de 5 % par an, nous ne répondons qu'à la moitié des demandes d'emplois des jeunes entrant sur le marché du travail. Madagascar comptait 4 millions d'habitants en 1947, elle en compte 18 millions aujourd'hui et en comptera 30 millions en 2025. Comment, dans l'état de sous-développement qui est le sien, pourra-t-elle faire face à sa croissance démographique, surtout si elle reçoit chaque année deux ou trois cyclones dévastateurs ? Je ne sais pas à partir de quelle augmentation de température la situation deviendra ingérable, mais je sais que les problèmes actuels vont s'aggraver. Mme Geneviève COLOT : Vous avez dit que la température augmentait plus en France que dans le monde. Quelle en est l'explication ? M. Marc GILLET : Plus on va vers les pôles, plus le réchauffement est important. Il est vrai que les modèles n'ont pas encore la résolution qu'on pourrait souhaiter. Des méthodes sont cependant développées pour mieux refléter les conditions météo locales. En outre, les impacts régionaux ne dépendront pas seulement des données météorologiques, mais aussi de toutes les particularités régionales, car les régions n'ont pas toutes la même vulnérabilité. Afin de dresser un tableau des différences entre régions, on peut soit recruter une armée de géographes au niveau central, soit s'adresser aux régions elles-mêmes pour leur demander de réfléchir à ce que seront pour elles les conséquences du réchauffement climatique. M. Christian DECOCQ : Vous indiquez dans vos notes d'orientation qu'il existe déjà toute une série de dispositifs législatifs et réglementaires qui pourraient contribuer à réduire nos difficultés et qui ne seraient pas appliqués. Pouvez-vous nous donner des exemples ? Mme Pascale BABILLOT : Beaucoup d'instruments législatifs sont très bien adaptés pour répondre aux problèmes posés par la variabilité climatique. Je pense en particulier aux inondations. Mais 4 millions de personnes vivent dans des zones inondables. Le document sur la stratégie d'adaptation que vous évoquez est un document de cadrage et reste donc assez général. Nous n'avons pas approfondi tous les points. Cela dit, le ministère de la justice nous a fait part de son souhait d'examiner l'ensemble de l'appareil législatif et réglementaire afin de savoir comment l'adapter aux nouvelles donnes climatiques. M. Christian DECOCQ : Pour prolonger ma question, je dirai qu'il serait peut-être temps d'interrompre les instructions qui ont été données en vue de l'établissement des atlas des zones inondables en période classique. Il faudrait les réviser en fonction des difficultés qui s'annoncent. M. Jacques BASCOU : La difficulté est aussi de sensibiliser les administrations. L'installation de panneaux solaires rencontre parfois l'opposition de l'architecte des Bâtiments de France. Lors de la définition des plans locaux d'urbanisme, on n'étudie pas toujours les sols, de sorte que l'on doit faire face aux conséquences sur le bâti des phénomènes de sécheresse. De même en ce qui concerne les inondations : on travaille sur des statistiques anciennes, qui ne permettent pas d'avoir une idée juste de la fréquence des sinistres à venir. Il est dommage que l'administration se fonde sur de vieux schémas. Les textes votés par le Parlement doivent trouver leur traduction concrète dans les régions. M. Jacques KOSSOWSKI : Nous avons le pouvoir de soumettre les nouveaux plans locaux d'urbanisme (PLU) à de nouvelles contraintes en fonction des régions. Nous avons les moyens de mettre les architectes des Bâtiments de France face à leurs responsabilités. Mais plus profondément, il me semble que, s'agissant du réchauffement climatique comme de bien d'autres problèmes, tout vient de l'homme. La prise de conscience du problème est la clé de la réussite. Si cette prise de conscience n'est pas possible pour notre génération, tentons au moins de faire en sorte que les nouvelles générations soient plus conscientes que la nôtre des problèmes environnementaux. Les collectes sélectives, par exemple, ont été une réussite là où elles ont été accompagnées d'un effort de sensibilisation dans les écoles. Ce n'est pas en légiférant que nous réglerons tous les problèmes. Nous les réglerons en ayant une vision d'ensemble des difficultés auxquelles nous avons à faire face. La construction de logements nouveaux ne saurait être envisagée indépendamment de la question des transports et des moyens de communication. Je ne suis pas sûr que, dans nos villes, nous ayons tous pris conscience de l'ampleur des problèmes. M. Paul VERGES : Vous avez raison de souligner qu'il n'y a pas de petites solutions. Tout ce qui peut permettre de sauvegarder l'environnement et de réaliser des économies d'énergie est d'une importance capitale. La sensibilisation des jeunes générations est en effet essentielle. Nous avons à la Réunion un lycée équipé d'un panneau photovoltaïque. À la fin de la journée, tous les élèves doivent vérifier que la consommation d'électricité photovoltaïque et est supérieure à celle du courant classique. Ils ont pris conscience de l'importance de cette nouvelle source d'énergie, dont l'usage est traduit en termes de tonnes de carburants économisées. Cela dit, c'est bien la génération actuelle, et non pas les générations futures, qui doit contribuer à la mise en œuvre des mesures destinées à faire face au réchauffement climatique. N'oublions pas que beaucoup des enfants qui viennent de naître connaîtront la fin du siècle. M. Philippe TOURTELIER : Je voudrais revenir à la question des zones inondables. Les administrations prennent des précautions énormes, mais en se fondant sur l'expérience passée. Vos interlocuteurs ont-ils conscience que la protection des zones inondables doit tenir compte des données nouvelles ? M. Marc GILLET : S'agissant des crues, les études font appel aux données climatiques et hydrologiques. Le ministère de l'environnement a procédé à des études sur le Rhône et la Seine, qui ont mobilisé des équipes importantes. Je ne pense pas que les résultats soient déjà utilisables par le public ou dans le cadre de la définition des PLU. De manière générale, on constate qu'il n'y a pas toujours de lien entre les recherches qui sont conduites et l'application pratique de leurs résultats. M. Philippe ROUAULT : Le changement climatique concerne l'ensemble de la planète. Le président Vergès a évoqué la spécificité du continent européen. Quels sont vos échanges sur la stratégie d'adaptation au niveau européen et au niveau planétaire ? M. Marc GILLET : Nos contacts ont eu lieu essentiellement dans le cadre de la convention-cadre des Nations unies sur le changement climatique. Dans le cadre du GIEC, nous assistons à des réunions régulières. La France est représentée au bureau du GIEC par Jean Jouzel. Au niveau européen, nous avons des contacts fréquents, notamment pour préparer les réunions de la Convention sur le changement climatique. Nous avons également participé à la conférence des petits États insulaires en développement, à Maurice, en 2005. L'OCDE lance actuellement un programme d'études sur l'adaptation, et notamment sur son coût. L'Union européenne elle-même est en train de préparer une stratégie d'adaptation. Un grand nombre de groupes de travail ont été mis sur pied qui devraient proposer, d'ici la fin de l'année, une stratégie européenne. Deux pays européens ont déjà défini une stratégie. Au Royaume-Uni, le UK Climate Impacts Programme est chargé d'aider les régions, les collectivités, les corps de métiers à évaluer dans quelle mesure ils peuvent être affectés par le changement climatique et à s'y préparer. Cet organisme emploie onze personnes. A l'UKCIP s'ajoutent les organismes de recherche, comme le Tyndall Centre for Climate Change Research, basé à Norwich, et dont la compétence est reconnue dans ce domaine. En Allemagne, l'accent est mis sur la recherche, de façon centralisée plus qu'en réseaux. Un centre important existe à Postdam, qui emploie 140 personnes. Le ministère finlandais de l'agriculture et de la forêt a publié un document présentant une stratégie nationale d'adaptation, « Ilmastonmuutoksen kansalliren sopeutumisstrategia », (en finnois), qui existe aussi en versions suédoise et anglaise (Finland's National Strategy for Adaptation to Climate Change). Elle est disponible sur l'Internet. M. Paul VERGES : J'ajoute que la conférence qui réunira à Marseille, en février prochain, la totalité des régions européennes périphériques et maritimes marquera le début d'une action commune européenne. Je suis satisfait du fait que c'est un organisme qui ait eu l'initiative d'une telle rencontre. Je suis profondément convaincu que la France peut jouer un rôle considérable dans la définition d'une stratégie planétaire. M. Denis MERVILLE : Je voudrais souligner les difficultés auxquelles se heurte l'application par nos administrations d'un certain nombre de textes, d'ailleurs trop nombreux. Prenons l'exemple des inondations et de l'écoulement des eaux pluviales. Il y a vingt-cinq ans, à Sainneville-sur-Seine, dont j'étais maire, un centre EDF avait été construit. Afin de répondre aux problèmes d'érosion des sols qui commençaient à apparaître, j'ai demandé que l'on élargisse les bassins de retenue. On m'a répondu qu'ils étaient aux normes. Il a fallu se battre pour qu'on les agrandisse, et ils sont encore trop étroits. Les administrations, même quand elles appliquent les textes, ne vont pas au-delà et n'anticipent pas les problèmes à venir. L'application de la loi sur l'eau se heurte également à des difficultés considérables. Il faut sept ou huit ans de réunions pour arriver à l'agrément d'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux. S'agissant de la sensibilisation, je rappelle que le Congrès des maires a organisé sur les effets du changement climatique une réunion qui n'a pas attiré beaucoup d'élus. Lorsque l'on évoque la possibilité de faire des économies, par exemple par le chauffage solaire, il y a un peu plus de monde. M. Alain GEST : L'un des tableaux que vous nous avez remis fait apparaître que le réchauffement climatique n'aurait pas un effet significatif sur le nombre de tempêtes observées en France. Comment l'expliquez-vous ? M. Marc GILLET : La sensibilisation des maires est en effet très importante. L'ONERC a été présent au Congrès des maires de France l'an dernier. Nous menons des actions ponctuelles avec quelques mairies, pour les informer mais aussi pour nous former nous-mêmes sur les questions relatives aux règles d'urbanisme, que nous ne connaissons pas forcément très bien. Nous avons collaboré avec la DATAR sur ces questions. C'est un très vaste chantier auquel nous devons nous atteler afin de diffuser l'information. S'agissant des tempêtes, on ne constate pas aujourd'hui de tendance sur le nombre des tempêtes observées. Mais on ne peut rien affirmer pour l'avenir. Les modèles sont encore contradictoires. Pour ce qui est des cyclones, beaucoup de scientifiques avancent l'idée qu'ils ne seront pas plus nombreux qu'aujourd'hui mais qu'ils seront plus violents. M. le Président : Météo-France a fait apparaître que les cyclones frapperaient sans doute des zones très différentes, et viendraient mourir en Europe plutôt qu'en Amérique du Nord. M. Michel PETIT : Je voudrais revenir à la question des prévisions climatiques locales. Il est vrai qu'elles sont très difficiles. Cela n'empêche pas de prévoir à l'échelle d'une région quels pourraient être les effets d'une période de précipitation intense de 48 heures. Suivant la géographie locale, elle ne causerait pas les mêmes effets. Ce travail de prévision doit être mené avec les municipalités. Cela rejoint la question des lois qui ne sont pas appliquées. Car les catastrophes naturelles dont il est question sont connues. Elles prendraient simplement une dimension nouvelle. M. le Président : Madame, Messieurs, nous vous remercions pour votre contribution aux travaux de notre Mission. Audition de M. Jean-Marc JANCOVICI, ingénieur Présidence de M. Jean-Yves LE DEAUT, Président M. le Président : Mes chers collègues, nous accueillons aujourd'hui M. Jean-Marc Jancovici. Dans la première phase des travaux de notre mission, nous avons souhaité entendre un certain nombre de grands témoins. Le point de vue de M. Jancovici, dont nous avons tous consulté le site Internet consacré au réchauffement climatique, nous est donc particulièrement précieux. Je salue d'autre part la présence de membres du comité de pilotage, notamment M. Christian Ngô, délégué général de l'association Écrin, M. Michel Petit, qui travaille sur le réchauffement climatique et a été le représentant de la France au bureau du GIEC de 1992 à 2002, Mme Cécile Ostria, directrice de la fondation Nicolas-Hulot, et M. Raymond Leban, professeur au CNAM. M. Jean-Marc JANCOVICI : Je me propose de vous présenter, sous forme de diapositives commentées, quelques éléments de cadrage sur la question du changement climatique. Le premier aspect que je voudrais souligner est d'ordre démographique. Encourager une politique nataliste pour financer les retraites, c'est, par la force des choses, accroître le problème du réchauffement climatique, du moins à consommation constante. D'autre part, la hausse perpétuelle de la consommation de combustible fossile viole les lois mathématiques : cette hausse s'arrêtera nécessairement. J'appelle votre attention sur le fait que les énergies que nous utilisons sont extrêmement anciennes. Ce qui change, c'est l'ordre de grandeur de leur utilisation. Les seules énergies véritablement nouvelles qui soient apparues au XXe siècle sont l'énergie photovoltaïque et l'énergie nucléaire. Chaque forme d'énergie connaît sa propre croissance. Le charbon n'est pas du tout, pour notre plus grand malheur climatique, une énergie du passé, contrairement à l'idée que l'on peut en avoir en France. Les premiers consommateurs de charbon au monde sont les Australiens et les Américains. Les deux tiers du charbon extraits sur Terre servent à produire de l'électricité, la forme d'énergie finale qui croît aussi vite que le PIB. Il est important de souligner que l'on n'a jamais su assurer la croissance économique sans faire croître les émissions de CO2. La corrélation est valable à la hausse comme à la baisse. Tant que cette corrélation est valable, appeler à la croissance économique, c'est, toutes choses égales par ailleurs, appeler à une hausse des émissions de CO2. Les émissions de CO2 ne sont pas seules responsables de l'effet de serre. Les émissions de méthane sont pour l'essentiel liées aux pratiques agricoles. Le N2O est un sous-produit de l'utilisation des engrais azotés. Les chlorofluorocarbones, qui sont des halocarbures, sont maintenant interdits d'utilisation, mais ont été remplacés par des substituts qui sont des gaz à effet de serre assez puissants. Les industries de l'énergie, c'est-à-dire les centrales électriques et les raffineries, constituent un quart du problème, tous gaz à effet de serre inclus. La sidérurgie est sans doute responsable de près du tiers des émissions de l'industrie manufacturière. Les émissions de l'agriculture augmentent avec la part de protéines d'origine animale dans la ration alimentaire. Car l'animal est un « concentrateur » de végétaux. Au vu de l'ensemble de ces données, on doit conclure que le problème du changement climatique n'est pas un problème d'environnement classique, qui pourrait être traité indépendamment du reste. Tous les aspects de la vie humaine sont concernés. Cela signifie que les instruments de régulation doivent être plus économiques que techniques. L'augmentation des gaz à effet de serre est irréversible à l'échelle de quelques vies humaines, et a fortiori à l'échelle d'une mandature. Il faut souligner que, même avec des émissions constantes, l'augmentation de température au cours du XXIe siècle produira un changement d'ordre de grandeur par rapport aux variations naturelles du climat de la planète depuis 10 000 ans. Le système climatique est non linéaire : il faut se garder de raisonner de manière proportionnelle. On peut le comprendre à la lumière d'un exemple simple, celui de notre propre corps. Si celui-ci connaît une élévation de température d'un degré, il se portera mal, mais s'il connaît une élévation de température de six degrés, il ne se portera pas six fois plus mal : il sera mort. De même, si l'élévation de la température moyenne globale au cours du XXe siècle a été de 0,6 degré et a produit des effets somme toute limités, il ne faudrait pas s'imaginer qu'une élévation six fois supérieure produira des effets qui ne seraient que six fois plus importants. Il est clair que la science ne peut pas dresser un tableau détaillé de tous les risques que nous courons. Elle ne peut que donner des ordres de grandeur qui orientent notre réflexion. Les échanges naturels de CO2 entre l'atmosphère et les autres compartiments de la planète (écosystème terrestres, océans) sont à peu près équilibrés, mais ils dépendent de la température. Le CO2 est un gaz qui se dissout mieux dans l'eau froide que dans l'eau chaude. Les sources océaniques de CO2 sont donc constituées de masses d'eau en train de se réchauffer. Les puits océaniques de CO2 sont quant à eux constitués de masses d'eau en train de se refroidir. Si la température océanique s'élève, ces puits vont s'affaiblir. En ce qui concerne les écosystèmes continentaux, le flux descendant est celui de la photosynthèse, qui dans un premier temps a plutôt tendance à s'accroître avec l'augmentation de la quantité de CO2, de la température et de la pluviométrie. Mais le flux montant, dû à la décomposition du carbone contenu dans l'humus et dans les végétaux morts, croît lui aussi. Or la croissance du flux montant sature moins vite que celle du flux descendant. Si l'augmentation de la température dépasse un certain seuil, le flux descendant sera inférieur au flux montant : la décomposition du carbone des sols et des végétaux prendra le pas sur le flux descendant lié à la photosynthèse. Ainsi, les écosystèmes commencent à déstocker du carbone, ce qui enrichit l'atmosphère en CO2, produisant une augmentation de la température, laquelle conduit les écosystèmes à déstocker encore plus de carbone, ainsi de suite. Cette boucle infernale pourrait se déclencher dans quelques décennies. Nous n'avons donc pas l'éternité devant nous pour réagir. La consommation de combustibles fossiles par l'humanité ne peut pas croître de 2 % par an jusqu'à la fin du XXIe siècle. Elle atteindra très probablement un maximum au cours du présent siècle. Mais ni le maximum de CO2 dans l'atmosphère, ni le maximum de température ne seront atteints au moment où nous passerons par le maximum des émissions. L'un comme l'autre continueront à s'élever des décennies à des siècles ensuite. Autrement dit, il est vain d'espérer que notre action pourra supprimer le problème à bref délai quand nous nous déciderons à agir dans les bons ordres de grandeur. Nous ne pouvons donc pas nous permettre d'attendre, avant d'agir, que le niveau d'émissions devienne insupportable. Si c'est la pénurie de combustibles fossiles qui se charge de réguler les émissions, nous aurons à faire face simultanément à une baisse de l'énergie disponible et à une hausse de la perturbation climatique. On ne saurait résoudre ces deux problèmes à la fois. Nous ne pourrons affronter le changement climatique que si nous disposons d'une quantité d'énergie suffisante. Diviser par deux les émissions de CO2 implique de ramener la moyenne mondiale d'émissions au niveau actuel d'un Indien. La France, malgré son énergie nucléaire, est encore très loin de satisfaire aux exigences du développement durable. Elle devrait pour cela diviser par quatre les émissions par habitant. L'énergie renouvelable la plus importante -dans le monde, comme en France- est le bois. Mais au niveau d'utilisation actuelle, elle n'est déjà plus renouvelable. La deuxième est l'hydroélectricité. Les autres sont négligeables. Leur niveau est tellement bas que même une augmentation annuelle de 15 % les porterait à un niveau toujours négligeable si l'ensemble de la consommation énergétique continuerait à croître de 2 % par an. Si l'énergie éolienne croît de 10 % par an à partir d'aujourd'hui pendant cinquante ans - et aucune source d'énergie n'a connu une telle croissance sur une telle durée, sauf le pétrole à ses tous débuts - et que la consommation énergétique mondiale continue à croître de 2 % par an, l'énergie éolienne représentera dans cinquante ans moins de 1 % de la consommation mondiale. Le premier problème est donc de faire baisser la consommation mondiale d'énergie, et non d'augmenter le recours aux énergies non renouvelables. La consommation mondiale de biocarburants représentent aujourd'hui environ 15 millions de tonnes équivalent pétrole, alors que la consommation mondiale de pétrole est de 3 500 millions de tonnes par an. Autant dire que le développement des carburants issus du colza et de la betterave est un intéressant problème de politique agricole, mais n'est qu'un élément négligeable d'une politique énergétique. Le Brésil, que l'on cite souvent en exemple, a une surface égale à 17 fois celle de la France, et un parc automobile deux fois inférieur. Il est évident que la baisse de la consommation d'énergie ne sera significative que si elle porte sur les postes de consommation les plus importants. Au niveau individuel, il s'agit du chauffage, de l'achat des produits manufacturés et des transports. Et il est tout à fait clair que la consommation d'énergie ne baissera que si elle est plus chère. Réaliser des économies sur un appareil consommateur d'énergie de caractéristiques données (par exemple une voiture de 40 CV) ne garantit pas pour autant la baisse de la consommation d'énergie globale liée à cette catégorie d'appareils. On peut toujours mieux isoler les bâtiments, mais si, dans le même temps, le parc de bâtiments à chauffer double en surface, il faut plus d'une division par deux de la quantité d'énergie consommée par mètre carré pour obtenir une diminution globale des émissions. De même, la consommation d'un véhicule de caractéristiques données a baissé, mais le parc automobile a doublé en France entre 1973 et 2000, et les voitures ont gagné en masse et en puissance, ce qui fait plus qu'annuler l'impact des progrès techniques : la consommation de carburants routiers a doublé en France entre 1973 et aujourd'hui. De même, un appareil électroménager consomme moins d'énergie à caractéristiques identiques, mais le nombre d'appareils, leur performance et leur variété ont fortement augmenté. Il n'y a pas eu d'économie globale. Au début des années soixante-dix, c'est une période d'un siècle de pétrole peu cher qui a pris fin. Dans le même temps, le PIB n'a jamais cessé de croître. Cela signifie que le prix de l'énergie rapportée au pouvoir d'achat n'a cessé de baisser pendant un siècle. Le choc pétrolier a eu un effet quasiment immédiat : les émissions de CO2 ont baissé dans presque tous les secteurs. Seul le transport routier a augmenté ses émissions. La raison en est que sa consommation d'énergie est très peu élastique. Il faut que les prix montent de manière durable pour que les comportements changent. M. le Président : Je reviens brièvement à un point précis que vous avez évoqué. Il me semble que malgré l'augmentation du nombre de logements, l'amélioration de l'isolement a fait baisser la consommation d'énergie due au chauffage. Et nous pouvons encore faire des progrès dans ce domaine. M. Jean-Marc JANCOVICI : La « mère de toutes les mesures » est d'augmenter la fiscalité sur l'énergie. Je sais que c'est difficile à faire admettre à l'opinion publique. C'est pourquoi la prise de conscience du problème est essentielle. Les ordres de grandeur qui permettent d'appréhender la réalité du changement climatique ne sont notamment pas enseignés dans nos collèges et nos lycées, pas plus qu'à l'ENA. L'information donnée par les médias est, quant à elle, très insuffisante, quand elle n'est pas totalement inexacte. L'efficacité énergétique dépend essentiellement du prix de l'énergie. Si celui-ci croît plus vite que le pouvoir d'achat, l'efficacité énergétique est affectée à une diminution de la consommation globale. Si le prix de l'énergie décroît par rapport au pouvoir d'achat, l'efficacité énergétique est affectée à une hausse des usages, qui va plus vite que l'amélioration technique, et entraîne une hausse de la consommation globale. Tant que le prix de l'énergie ne croîtra pas par rapport au pouvoir d'achat, seules des économies individuelles seront réalisées. M. Alain GEST : Autrement dit, comme pour le tabac, la consommation ne baissera que si le prix augmente ? M. Jean-Marc JANCOVICI : Oui. C'est exactement la même chose. Il me semble que le discours public sur le changement climatique doit amener la population à considérer comme socialement acceptable que le prix de l'énergie croisse plus vite que le pouvoir d'achat. M. Serge POIGNANT : Votre raisonnement vaut à l'échelle mondiale, et pas seulement pour la France. M. Jean-Marc JANCOVICI : Absolument. M. Serge POIGNANT : Or, nous sommes dans un contexte de concurrence économique mondiale. M. Jean-Marc JANCOVICI : Nous avons d'autant plus de raisons d'augmenter le prix de l'énergie que les autres pays ne le font pas. Les acteurs de l'industrie pétrolière nous disent que le maximum de production pétrolière sera atteint d'ici une quinzaine d'années au plus tard. Moins les autres font des efforts, plus le choc est certain et proche, et donc plus nous avons intérêt à en faire. La hausse de la TIPP amortit les chocs. D'une manière générale, la hausse de la fiscalité permet de conserver de l'argent en France. Un choc pétrolier est un appauvrissement net du pays, alors que la taxe est un recyclage national de l'argent. Cela dit, la mesure que je préconise fera des perdants. Et l'on sait que ceux-ci se font toujours plus entendre que les gagnants. Par ailleurs, si nous nous engageons dans une politique qui apparaît intelligente et pertinente, il n'est pas exclu que d'autres pays s'engagent dans la même voie. J'ajoute que des mesures vigoureuses suscitent souvent des craintes qui se révèlent infondées. Lorsque les États-Unis ont mené des campagnes anti-tabac extrêmement dures, les restaurateurs et les cafetiers n'en ont pas pâti, contrairement à ce que l'on craignait. Mme la Rapporteure : Notre mission va être amenée à se pencher sur la négociation des objectifs post-Kyoto. Avez-vous un point de vue sur le mécanisme d'échanges de quotas ? D'autre part, pensez-vous qu'il conviendrait de négocier les objectifs en termes d'émissions par habitant, ou par point de PIB ? M. Jean-Marc JANCOVICI : Tant qu'on n'a pas dit comment doit varier le PIB, la négociation sur les points de PIB s'arrêtera au milieu du gué. Cela ne peut en aucun cas constituer un objectif final. Au demeurant, le PIB est un indicateur de flux. Pour l'essentiel, il agrège des salaires et des rentes. Il ne mesure pas l'état de la planète. S'agissant des quotas, je pense qu'il faut être pragmatique. Il existe toute une série d'activités pour lesquelles la fixation de quotas n'est guère possible, parce qu'elles correspondent à des usages trop diffus. Je pense aux émissions de CO2 par l'agriculture, par les bâtiments, par les transports. En outre, avec un système de quotas individuels attribués sur des durées courtes, il sera toujours difficile de demander des efforts globaux très importants, parce que le niveau de contrainte sera limité par ce que pourra supporter l'entité la plus fragile. Des quotas sont possibles pour quelques grosses industries lourdes, mais en tout état de cause, ils ne seront pas suffisants. M. Denis MERVILLE : Si je comprends bien, vous n'avez qu'une seule recommandation à nous faire. M. Jean-Marc JANCOVICI : Non. Je pense simplement que toute mesure est vaine si on ne commence pas par augmenter significativement le prix de l'énergie. Tous ceux qui se sont penchés sur le problème en sont arrivés à cette conclusion. Imaginez que la TIPP augmente progressivement jusqu'à ce que le prix de l'essence atteigne 3 euros le litre. L'État encaissera environ 200 milliards d'euros, en supposant que la consommation ait baissé de 30 à 40 %. Ce n'est pas une petite somme. Si le pouvoir politique propose aux Français une vision à long terme, ce qui n'est pas le cas actuellement, sommes-nous sûrs que nos concitoyens refuseront cette mesure ? M. Christian NGÔ : J'approuve presque tout ce qui a été dit. On arrive d'ailleurs aux mêmes conclusions si l'on envisage uniquement le problème énergétique. Notre civilisation est fondée sur l'utilisation des combustibles fossiles. Entre 1400 et 1820, un Français a doublé son pouvoir d'achat. Entre 1950 et 2000, il l'a multiplié par quatre, parce qu'il a consommé durant cette période beaucoup plus de combustibles fossiles. Or, toute perturbation de l'économie, notamment par les guerres, fait diminuer le pouvoir d'achat. Celui d'un Français a atteint un maximum en 1913, qui n'a été retrouvé qu'en 1968. Le manque d'énergie peut conduire à des crises de civilisations. La déforestation massive a provoqué la disparition des Sumériens. Nous aurions pu disparaître à la fin du Moyen Âge en raison de la déforestation. Nous avons été sauvés grâce au charbon. La disparition progressive des combustibles fossiles va donc nous poser un problème majeur, même en faisant abstraction de l'effet de serre. Le prix de l'énergie doit être augmenté. Le baril de pétrole, déduction faite des taxes, n'est pas plus cher que l'eau minérale. Quand on le paie 60 dollars, il sort d'Arabie Saoudite à 3 ou 4 dollars, et le prix du transport le porte à 5 dollars. Il est vrai que nous ne sommes pas seuls et que nous évoluons dans le contexte d'une économie internationale concurrentielle. Les premières augmentations de taxes devraient concerner les consommateurs captifs, qui ne peuvent pas se délocaliser. M. Jean-Marc JANCOVICI : J'ajoute que ne pas augmenter volontairement le prix d'une énergie qui est appelée à se raréfier ne nous garantit, au mieux, que l'envolée de son prix. M. Alain GEST : Votre vision quelque peu apocalyptique est fondée sur l'hypothèse de la raréfaction du pétrole. Or, sur cette question, les avis des spécialistes divergent. Ils s'accordent, sur le fait que le pétrole restera disponible pendant un certain nombre d'années, mais à un prix très élevé. Dans ces conditions, est-il vraiment utile d'augmenter les taxes alors que le prix du pétrole lui-même est appelé à augmenter ? D'autre part, il m'a semblé que vous ne preniez guère en considération ce que l'on peut déjà faire pour limiter l'émission de CO2. J'ai été assez surpris de votre position sur les énergies renouvelables, non pas sur l'énergie éolienne, car je partage votre point de vue, mais sur les biocarburants. Ceux-ci pourront bientôt alimenter les avions, qui sont une source importante d'augmentation des émissions. J'ai également du mal à vous suivre dans votre comparaison entre le Brésil et la France. M. Jean-Marc JANCOVICI : Il faut un hectare de terre pour produire une tonne de biocarburant, en rendement net. En France, nous consommons 95 millions de tonnes de pétrole. La France compte 50 millions d'hectares. Quelle que soit l'augmentation de notre production de biocarburants, elle ne couvrira jamais qu'une part négligeable de notre consommation de pétrole. M. Raymond LEBAN : Il faut tout de même essayer de montrer les différentes facettes des mesures que l'on peut prendre. Il importe d'accélérer la prise de conscience de nos concitoyens. On ne peut se contenter d'un discours prônant l'augmentation de la fiscalité. M. Jean-Marc JANCOVICI : Je ne peux tout de même pas tenir un discours qui occulte des réalités physiques incontournables : il faut un hectare de terre pour produire une tonne de biocarburant. S'agissant de la taxe et de l'évolution du prix de l'énergie, je répète que la taxe est un recyclage national. Si vous attendez que le prix de l'énergie augmente, cet argent n'entrera pas dans les caisses de l'État français, mais dans celles de l'État russe, ou d'un autre. M. Alain GEST : Comment une augmentation des taxes en France produirait-elle un effet d'évangélisation mondiale ? M. Jean-Marc JANCOVICI : Le problème n'est pas là. Je suis en train de vous dire que si nous n'augmentons pas le prix de l'énergie volontairement, nous subirons de plein fouet un choc pétrolier extrêmement rude. M. Michel PETIT : Je précise que M. Jancovici n'a pas préconisé une augmentation de la pression fiscale, mais de la fiscalité sur les carburants. Cette recette fiscale supplémentaire peut être consacrée à diminuer les charges sociales pesant sur le travail, ce qui permettrait de lutter contre les délocalisations. Elle peut également être compensée par la diminution d'autres taxes. M. Jean-Marc JANCOVICI : J'ajoute qu'il est parfaitement possible d'instaurer des droits de douane sur les importations en provenance de pays qui taxent insuffisamment leur énergie si nous la taxons plus. M. Denis MERVILLE : Je remarque que ce discours est celui que l'on entend à Bruxelles. M. Jean-Marc JANCOVICI : Mais qu'il soit clair que je ne pense pas qu'il faille brutalement augmenter le prix du carburant. L'idée est de donner de la visibilité à une politique instaurant une nouvelle règle du jeu : rapporté au pouvoir d'achat, le prix de l'énergie augmenterait chaque année de 5 ou 6 %. M. Serge POIGNANT, Président : Monsieur, je vous remercie de votre contribution aux travaux de notre Mission. Table ronde sur les effets sanitaires du changement climatique réunissant : Présidence de M Jean-Yves LE DÉAUT, Président M. le Président : Nous accueillons M. Jean-Pierre Besancenot, directeur de recherche au CNRS et responsable du laboratoire climat et santé à la faculté de médecine de Dijon, M. François Rodhain, professeur honoraire à l'Institut Pasteur, spécialiste en épidémiologie, président du groupe de travail de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA), Mme Martine Ledrans, responsable du département santé-environnement de l'Institut national de veille sanitaire (INVS), M. Paul Reiter, professeur à l'Institut Pasteur, chef de l'unité insectes et maladies infectieuses, et M. François Moutou, vétérinaire de formation, membre du groupe de travail de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, épidémiologiste à l'AFSSA et membre du conseil d'orientation de l'Observatoire national des effets du réchauffement climatique (ONERC). M. Besancenot va d'abord nous brosser un tableau général des effets sanitaires du changement climatique. M. Jean-Pierre BESANCENOT : Le temps qu'il fait et le climat influencent notre santé, la plupart des études scientifiques confirment cette corrélation. Si la fréquence des variations de types de temps évolue, des répercussions sur la santé paraissent inévitables. Or il est aujourd'hui acquis que la variation naturelle du climat se double de nouvelles modalités de changement, liées à l'homme et à ses activités. Le changement climatique paraît inéluctable pour les décennies à venir, même si ses caractéristiques et son amplitude comportent encore bien des incertitudes et qu'il serait simpliste de le limiter à l'évolution des températures. Des spécialistes reconnus nous enseignent que le climat pourrait évoluer dans telle ou telle direction. Comment cela risque-t-il de se traduire sur la santé humaine et animale ? Quelles mesures pouvons-nous et devons-nous prendre pour minimiser les conséquences négatives de ce changement et éventuellement profiter de ses aspects positifs ? Les impacts sanitaires du changement climatique seront envisagés sous deux angles : les effets directs et indirects, les premiers concernant un peu plus les climats tempérés et les sociétés développées, les seconds la zone intertropicale et les pays pauvres. Le drame de 2003 reste très présent dans nos mémoires. Si de tels phénomènes deviennent plus fréquents ou plus intenses, il faut s'attendre à une augmentation des problèmes sanitaires pendant la saison chaude. À l'inverse, la surmortalité hivernale, dont l'ampleur n'est pas fondamentalement inférieure à celle de l'été 2003, ira diminuant. Le pic de mortalité ne se situerait donc plus en hiver mais en été. Tout dépendra de la résultante de cette double évolution. Il conviendra de s'y préparer en adaptant la capacité des structures de soins et en évitant de relâcher les efforts en plein été. Changement climatique ou pas, la probabilité est forte que les vagues de chaleur de l'avenir fassent davantage de victimes, du seul fait du vieillissement de la population, c'est-à-dire de l'accroissement du nombre de personnes vulnérables. Nous sommes là au cœur du problème : le risque sanitaire est toujours le produit d'un aléa - ici, l'agression climatique - et d'une vulnérabilité des individus ou des populations appelés à y faire face. Cette vulnérabilité dépend aussi de critères sociaux. N'envisager que l'un des deux termes, c'est s'exposer à prendre des décisions totalement inadaptées. Les effets indirects s'expriment par l'intermédiaire de micro-organismes pathogènes, parasites, bactéries ou virus, des mollusques, des rongeurs ou des oiseaux leur servant de réservoirs et des insectes ou des acariens leur servant de vecteurs. Chacun de ces êtres vivants a ses préférences, son optimum écologique. Le climat constitue à cet égard un élément important : s'il change, telle ou telle maladie peut s'étendre en latitude ou en altitude. Mais ce raisonnement simpliste s'avère largement faux. La présence d'un moustique vecteur potentiel n'entraîne pas automatiquement l'extension de la maladie. Son incidence n'est pas proportionnelle à la densité du vecteur. Une maladie infectieuse ou parasitaire évolue selon une équation à cent variables, que personne ne sait donc résoudre : les scientifiques, pour simplifier, mutilent la réalité en éliminant ce qui est difficilement quantifiable et modélisable et en ne retenant qu'un tout petit nombre de variables, voire une seule, la température. Beaucoup de faux problèmes sont donc soulevés alors que de vrais problèmes restent négligés ou mal identifiés. M. Reiter me permettra de le citer : « L'histoire est remplie de décisions inadéquates fondées sur des idées fausses. » Compte tenu de l'inertie de l'atmosphère et de la durée de vie de nombreux gaz à effet de serre, le climat va changer. Prendre des dispositions pour limiter ce phénomène est indispensable mais insuffisant. Il faudra apprendre à vivre avec le nouveau climat, ce qui suppose une surveillance microbiologique, entomologique, épidémiologique, mais aussi un développement de la prévention. Des crises d'ampleur ne peuvent être gérées dans l'urgence et doivent être anticipées. Comme disait Winston Churchill, « si l'avenir ne se prévoit pas, il se prépare. » Et l'adaptation n'est pas seulement biologique mais également technologique, comportementale, voire culturelle. M. le Président : Nous allons maintenant aborder le thème des maladies transmissibles. M. François RODHAIN : Quand on parle de température, de quoi s'agit-il ? De la température diurne ou nocturne ? Hivernale ou estivale ? Surtout, les évolutions ne se résument pas au réchauffement ; elles touchent aussi le degré d'humidité ou de sécheresse, peut-être plus important encore. Il conviendrait donc plutôt d'employer l'expression « changement climatique », qui traduit la complexité du problème. Le changement climatique peut produire des effets sur les différents composants des systèmes biologiques complexes, c'est-à-dire les agents infectieux, les vertébrés qui les hébergent et les vecteurs. De nouveaux cycles de transmissions et échanges de gènes vont donc se mettre en place. Cela peut en second lieu se répercuter sur les maladies transmises, avec des modifications des zones d'endémie ou d'épidémie, de l'intensité ou des saisons de transmission et par conséquent de l'immunité de la population. Les conséquences sont tantôt positives, tantôt négatives. Ces phénomènes sont très difficiles à appréhender et requièrent une approche naturaliste. Mais les médecins et même les épidémiologistes ne sont malheureusement plus des naturalistes depuis bien longtemps. Le contexte à considérer est à la fois bioclimatique, économique, social et politique. Les conséquences sanitaires sont certaines mais très difficiles à prévoir. En tout cas, il ne faudrait pas mettre tout phénomène anormal ou inhabituel sur le dos du réchauffement climatique. Les spécialistes du catastrophisme, dans la presse et ailleurs, laissent entendre que les maladies tropicales vont arriver chez nous à cause du réchauffement climatique. Encore faut-il en apporter la preuve ; la nature est infiniment plus sophistiquée, très loin de ces schémas simplistes, fondés sur des convictions ou des impressions. Existe-t-il des exemples de conséquences du changement climatique ? Nous avons au moins des soupçons sur des maladies en expansion : il est possible que l'apparition de la leishmaniose dans le nord de l'Italie ou en Allemagne soit imputable au changement climatique. Le risque porte aussi sur les maladies animales transmissibles. En règle générale, des effets sur les maladies infectieuses se manifesteront certainement mais progressivement, durablement, en profondeur, plutôt que par les épidémies massives parfois annoncées et sur les franges altitudinales ou latitudinales des zones endémiques actuelles. Devant cette menace, cinq axes prioritaires devraient être privilégiés pour lutter contre l'effet de serre et, surtout, se préparer à l'imprévu. Premièrement, mettre en place une surveillance épidémiologique permanente, fiable, sensible, très en amont, pour détecter tout phénomène inhabituel. Deuxièmement, la coordonner avec des systèmes d'alerte rapide, car, en santé publique, après coup, c'est trop tard. Troisièmement, améliorer la communication entre scientifiques, entre organismes scientifiques nationaux et internationaux, entre administrations, mais aussi en direction de la population afin d'éviter les rumeurs, les comportements irrationnels et les paniques. Quatrièmement, accentuer l'effort de recherche en climatologie, pour mieux comprendre la machine climatique, qui recèle encore beaucoup d'incertitudes, mais aussi en biologie, en systématique, en entomologie, en écologie, en épidémiologie, en socioépidémiologie et en techniques de communication. Cinquièmement, accomplir un effort en matière de formation pour se doter des compétences faisant actuellement défaut, notamment dans les disciplines en voie d'extinction. M. François MOUTOU : Je m'appuierai sur le rapport rendu public par l'AFSSA en avril 2005, qui a étudié les impacts économiques et sanitaires d'un changement climatique et s'est donc penché non seulement sur les maladies animales mais également sur les zoonoses, transmises de l'animal à l'homme, qu'elles soient déjà présentes en France ou non. Nous nous sommes efforcés de ramener le problème à l'échelle de la France en adoptant des outils adaptés. Le Midi méditerranéen pourrait devenir aride ; quant au Midi occidental et à l'Aquitaine, ils resteraient plus chaud d'un degré que le reste du pays, quels que soient les changements. Nous avons passé en revue les maladies en fonction des moyens de transmission - par l'intermédiaire des arthropodes, des mollusques ou des vertébrés sauvages, mammifères ou oiseaux - car nous considérons que, dans leur cycle, c'est à ce niveau que l'effet du changement climatique peut se faire sentir. N'oublions pas non plus que les maladies peuvent évoluer en fonction du comportement de l'homme. Nous avons ainsi fait ressortir six maladies : quatre zoonoses et deux maladies strictement animales ; quatre affections virales, une parasitaire et une bactérienne ; cinq maladies transmises par les insectes et une liée à l'eau. La fièvre de la vallée du Rift, maladie virale africaine absente d'Europe, est parvenue il y a quelques années sur la côte méditerranéenne de l'Égypte. Les mouvements humains pourraient favoriser son transfert, sans compter le rôle de vecteur joué par les insectes. La fièvre du Nil occidental, anciennement connue dans l'Ancien Monde, a émergé en Amérique après avoir vraisemblablement traversé l'Atlantique dans un avion de ligne, par le truchement d'un oiseau d'ornement infecté. D'une manière générale, le commerce planétaire des animaux exotiques ou de compagnie, qui paraît anodin, est complètement irresponsable. D'une façon très générale, plus on recherche une maladie, plus on la trouve. En revanche, si l'on cherche beaucoup et que l'on trouve peu, c'est rassurant. En résumé, il ne faut pas s'alarmer à partir d'un seul cas et toujours pouvoir interpréter par rapport à des éléments de référence, tout nouveau cas déclaré. La fièvre catarrhale ovine, ou blue tongue, est une maladie strictement animale qui est arrivée en Corse il y a quatre ou cinq ans, sans doute avec un insecte d'Afrique du Nord, via la Sardaigne. On la trouve maintenant dans la péninsule ibérique et elle apparaîtra bientôt dans le sud de la France continentale. Nous nous sommes alors rendu compte qu'un seul scientifique français - un retraité du musée de Strasbourg - était capable d'identifier l'insecte vecteur, du genre Culicoides. À l'heure où la biologie moléculaire a fait tant de progrès, quel paradoxe ! Il faut former des virologistes, des bactériologistes, des biologistes moléculaires, mais aussi des entomologistes et des naturalistes. La peste équine, propre aux équidés, en particulier aux zèbres qui en sont le réservoir, a failli remettre en cause les épreuves équestres des Jeux olympiques de 1992 à Barcelone. La leishmaniose est un parasite transmis par de petits insectes et dont les réservoirs sont les canidés - par exemple les chiens domestiques ou les renards. Dans les zones de garrigue du sud-est de la France, l'impact du climat se conjugue certainement avec les modifications de l'habitat pour favoriser son développement. La leptospirose est une bactérie transmise par les rongeurs, dont l'eau est le vecteur. Si le temps se réchauffe, l'usage de l'eau changera et le risque de transmission vers l'homme augmentera. Des cas mortels ont déjà été enregistrés en France. M. le Président : Nous avons entendu votre message sur les disciplines en extinction. M. Paul REITER : Dans la plus grande partie de l'Afrique sub-Saharienne, comme montré en rouge sur la carte, le paludisme est appelé « stable ». Cela signifie que de forts taux de transmission se produisent chaque année. Les gens survivent cependant assez bien car ils ont développé un certain degré d'immunité. Les épidémies sont peu fréquentes mais les nouveaux arrivants, comme nouveaux-nés ou les expatriés, sont particulièrement sujets à une infection qui peut-être fatale. Dans une relativement petite proportion du continent, comme montré sur la carte, le paludisme est appelé « instable ». Cela signifie que le niveau de transmission varie d'une année à l'autre. L'immunité de la population n'est pas maintenue à un haut niveau et ainsi, de sérieuses épidémies accompagnées de forts taux de mortalité peuvent se produire. Ce sont ces régions qui nous intéressent du point de vue du changement climatique. Dans toute l'Afrique, hormis en haute altitude, les températures sont favorables à la transmission du paludisme puisque quinze ou seize degrés suffisent. La pluviométrie affecte aussi la transmission de la maladie : Jean Mouchet a mis en évidence que la sécheresse, en Afrique occidentale, faisait reculer la maladie, non seulement à cause de la baisse du degré d'humidité mais aussi des changements d'espèces. Le paludisme fut une maladie très importante en Europe, y compris à Paris, encore à l'époque d'Haussmann. La plus grande épidémie a eu lieu en 1920, en Union Soviétique et en Pologne, et s'est étendue jusqu'à Archangelsk, aux confins du cercle arctique : on estime que 16 millions de personnes ont été atteintes et que 600 000 d'entre elles sont mortes. L'Organisation mondiale de la santé a déclaré l'Europe libre du paludisme en 1976 ; l'un des derniers pays concernés était les Pays-Bas, bien connus pour leur climat tropical. J'ai d'ailleurs écrit un article sur l'histoire du paludisme en Angleterre pendant la « petite époque glaciaire », qui s'est écoulée du milieu du XVIe siècle au XVIIIe siècle. Contrairement à ce que s'efforcent de nous faire croire les activistes en discordant la vérité, ces maladies ne sont pas étrangères à l'Europe ; elles ne viennent donc pas des « tristes tropiques ». Deux maladies urbaines sont transmises par les moustiques. La dengue, proche du virus West Nile et de la fièvre jaune, est le virus le plus répandu dans les pays tropicaux. En 1999, j'ai réalisé une étude sur la transmission de la dengue à Laredo/Nuevo Laredo, une ville à la frontière entre le Texas et le Mexique, et divisée en deux par le fleuve Rio Grande. La population de moustiques du côté Texan était bien plus importante que du côté Mexicain. Cependant, le nombre de cas de dengue du côté Mexicain était 16 fois supérieur au nombre de cas du côté Texan. La population y est en effet très exposée, tandis que les Texans ne sortent de leur voiture climatisée que pour entrer dans leur maison climatisée. Les comportements sociaux sont donc déterminants. Le virus de l'encephalitis West Nile est très intéressant, considéré comme une maladie émergente en Europe. Les premières isolations du virus en Europe ont été réalisées par deux entomologistes français travaillant sur une petite épidémie en Camargue. Depuis, on a observé des petites épidémies dans plusieurs pays Méditerranéens, mais deux épidémies importantes se sont produites à Bucarest en 1996 et à Volgograd en 1999. Elles n'étaient évidemment pas dues au changement climatique mais à l'œuvre de l'homo sovieticus : les caves des immeubles, inondées par les remontées d'égouts, s'étaient transformées en usine à moustiques. Le virus, isolé par une équipe anglaise en Ouganda en 1937, présente la plus grande distribution du monde, en Europe, en Afrique, en Asie, en Amérique et même en Australie, où une forme proche s'est développée. Je fais partie du steering committee d'un projet international monté par l'Union européenne et j'ai la responsabilité des équipes étudiant le virus du Nil occidental. L'objectif est de mieux connaître, d'ici à cinq ans, les relations entre changement climatique, changement environnemental et prévalence de cette maladie. Mme Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET, Rapporteure : Vous avez fait remarquer à plusieurs reprises que le critère de la température n'est pas le plus pertinent. Les données que vous fournissent les experts climatiques vous aident-elles dans vos propres recherches ? Est-il possible, en dépit de toutes les incertitudes, de faire le tri entre les perspectives plus ou moins inquiétantes et d'établir une échelle des risques ? Au moment des cadeaux de Noël, si 500 millions d'euros étaient dégagés, dans quoi recommanderiez-vous de les investir ? Sur la prévention en vue de réduire les émissions de CO2 ? Sur la recherche ? Sur l'adaptation sanitaire aux changements climatiques ? M. François DOSÉ : Depuis notre enfance, le changement climatique n'est pas une évidence en extérieur mais il a incontestablement joué sur nos comportements à l'intérieur : dans les écoles, les demeures et les autres lieux de vie, nous nous sommes habitués à une température supérieure de trois ou quatre degrés. Ces mutations sur trente ou quarante ans ont-elles fait l'objet d'observations ? M. Serge POIGNANT : Les scénarios des climatologues varient : certains prévoient une hausse d'un degré et demi ou de deux degrés, d'autres craignent une progression de cinq ou six degrés, voire plus, avec notamment une incidence sur le niveau des océans. Quels sont les risques sanitaires si les changements climatiques s'avèrent aussi radicaux ? M. Philippe ROUAULT : L'essor de ces maladies ne serait pas simplement lié au climat mais également à l'action humaine. Et certaines maladies seraient qualifiées de « tropicales » car nous avons progressivement éliminé les sources d'infection. Ai-je bien compris ? M. Serge BLISKO : Les nouvelles maladies sont en effet souvent liées à l'activité humaine, y compris le sida, apparu en 1974, lors du match de boxe entre George Foreman et Cassius Clay : 500 000 personnes s'étaient alors rendues à Kinshasa. Je vous invite donc à toujours distinguer les facteurs culturels - en particulier la modification des comportements humains due au progrès technique - des facteurs naturels. M. Paul REITER : Dans les années 1980, j'ai pris connaissance d'un commerce mondial de pneus usagés. Il se trouve que ce commerce a été responsable de la dissémination à travers le monde du moustique Aedes albopictus, un vecteur de la dengue. Ce moustique est devenu une nuisance importante en Italie et est maintenant détecté dans le sud de la France, au niveau de la Côte d'Azur. Je ne vois cependant aucune raison qui favoriserait son arrivée potentielle à Paris. Mais je suis tout aussi sûr que d'aucuns incrimineront le réchauffement global ! La dengue est une maladie transportée à travers le monde par l'intermédiaire des voyageurs en avion. J'ai même trouvé une fois qu'elle était transportée autour de la région Pacifique par les surfers ! Et songez que 17 millions d'Allemands voyagent chaque année dans les pays tropicaux ! On me taxe toujours de scepticisme mais, contrairement aux activistes, je me refuse, en bon scientifique, à parler sans connaître les détails. Les facteurs les plus importants de diffusion des maladies sont l'augmentation de la population, les changements de pratiques agricoles, la déforestation, l'urbanisation, la pauvreté, la guerre, la croissance de la prévalence du sida, la résistance aux antipaludiques et aux insecticides. Au lieu de chercher à changer le temps, il faudrait combattre ces fléaux. M. François RODHAIN : Les voyageurs ont radicalement changé, en rapidité comme en nombre. Ce résultat du progrès technologique a fait tomber les barrières écologiques - océans, chaînes de montagne, déserts - qui nous protégeaient autrefois. La discipline de la biogéographie va par conséquent disparaître : nous sommes en plein dans la mondialisation. Au demeurant, nous sommes dorénavant informés en quelques jours ou en quelques heures de l'apparition d'une maladie sur un autre point du globe. M. François MOUTOU : Opposer l'homme a la nature revient à soulever la question suivante : sommes-nous naturels ? Il existe un paradoxe entre le développement économique attendu par tous et le respect des règles sanitaires : si nous allons moins vite que les camions ou les avions, nous serons toujours en retard par rapport aux épidémies et aux épizooties. Il a suffi de trois personnes pour propager en quelques jours le syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) sur les cinq continents. Mettre en cause son voisin, les animaux sauvages migrateurs ou le changement climatique est bien confortable car cela ne remet pas nos habitudes en cause. Or nous sommes aussi parties prenantes. Les Etats-Unis ont la psychose du bioterrorisme mais continuent à importer des animaux d'Afrique sans aucun contrôle sanitaire. En 2003, une épidémie de poxvirus a été provoquée par des rongeurs africains. Pourtant, si vous débarquez à New York avec un camembert, vous aurez droit à un comité d'accueil ! En termes de santé publique, c'est incohérent. Mais je dois ajouter que la France ne fait guère mieux. Les experts climatiques ont été les premiers à expliquer que la température n'était pas le seul paramètre en cause. L'investissement le plus rentable consisterait sans doute à financer l'information, l'éducation et le développement économique dans les pays du Sud. M. Paul REITER : Nous, scientifiques, ne savons pas très bien communiquer avec le public, contrairement aux activistes, qui se permettent de tenir des propos apocalyptiques. Quand un expert fait des prévisions terribles, je vous invite à examiner sa bibliographie. Plusieurs membres du Groupe d'experts eux-mêmes ne sont pas des spécialistes. M. le Président : Chaque profession a ses oiseaux de mauvais augure, des scientifiques commettant des ouvrages sur des sujets comme le passage des virus entre espèces, et ils sont très présents à la télévision. M. Jean-Pierre BESANCENOT : Les projections climatiques les plus nombreuses et probablement les plus fiables concernent les températures. Des modèles relativement précis sur les précipitations commencent à sortir mais l'échelle spatiale doit être considérablement affinée. S'agissant de l'humidité, Météo France reconnaît que ses prévisions à quarante-huit heures ne sont pas fiables du tout ; à échéance de quelques décennies, c'est pire ! M. François RODHAIN : Les prévisions climatiques concernent généralement les zones rurales et s'appliquent mal au milieu urbain alors que plus de la moitié des êtres humains vivront bientôt en ville. Les climatologues et les sociologues devraient étudier l'impact des changements climatiques en ville. Les modèles mathématiques sont encore très insatisfaisants, notamment parce que l'on ne sait pas intégrer tous les facteurs humains, dont l'importance est pourtant considérable. L'un des effets principaux du changement climatique concernera la répartition des eaux de surface et l'utilisation des ressources en eau. Ce problème me semble beaucoup plus important en lui-même que les changements climatiques car il provoquera des affrontements humains, des guerres de l'eau. M. le Président : Nous en venons maintenant aux événements extrêmes. Mme Martine LEDRANS : Depuis la vague de chaleur de 2003, nous avons beaucoup travaillé pour documenter au maximum les facteurs de risques responsables de la surmortalité, dans un souci scientifique mais surtout pour orienter les plans de prévention mis sur pied dès l'été 2004. Les personnes les plus touchées ont évidemment été les personnes âgées, avec une différence selon qu'elles vivaient à domicile ou en établissement. S'agissant des personnes âgées résidant à domicile, nous avons comparé les caractéristiques d'un échantillon d'individus de soixante-cinq ans et plus décédés dans les régions Île-de-France et Centre entre le 8 et le 13 août avec celles d'une population témoin. Une personne confinée au lit ou au fauteuil présentait un OR - odds ratio, facteur de multiplication du risque - de dix, ce qui signifie que la probabilité de son décès était décuplée, toutes choses égales par ailleurs. Les personnes atteintes d'une affection étaient également plus vulnérables. En revanche, les comportements d'adaptation à la canicule se sont avérés protecteurs. La question des caractéristiques de l'habitat est intéressante. Vivre sous les toits et dans un immeuble ancien mal isolé entraînait un OR de 4,1. Nous avons utilisé des photos satellites pour examiner l'influence des indices thermiques. La température mesurée à la station météo est insuffisante pour connaître les effets de la chaleur en ville : celle-ci se ressentira davantage dans les logements situés dans des îlots de chaleur, zones dépourvues de végétation et aux immeubles resserrés. Nous avons constaté qu'une augmentation d'un degré de la température moyenne mesurée dans un rayon de 200 mètres autour du logement doublait pratiquement la probabilité de décéder. Or les écarts de températures entre deux quartiers allaient jusqu'à quatre degrés. Nous avons donc formulé des recommandations en matière d'habitat et de réaménagement de l'urbanisme, qui demande un effort de longue haleine et doit démarrer dès maintenant. S'agissant des personnes âgées hébergées en établissement, nous avons pris comme référence les structures marquées par la plus forte mortalité. Nous avons retrouvé les mêmes facteurs de risque individuel que dans l'autre étude, notamment en ce qui concerne l'autonomie, l'intensité des contacts sociaux, l'existence d'une pathologie affaiblissante, l'isolation du logement et l'accès à la climatisation. Il semblerait néanmoins qu'en établissement les hommes aient été plus vulnérables que les femmes alors que, dans la population globale, l'inverse avait été constaté. La canicule était accompagnée d'une vague de pollution atmosphérique significative, notamment à l'ozone, gaz dont les effets sur la santé sont parfaitement connus et documentés. Il nous a été demandé de déterminer si les causes de la mortalité avaient subi un déplacement immédiat, un harvesting effect. Les parts relatives de l'ozone et de la température dans la surmortalité enregistrée en août 2003, étudiées dans neuf grandes villes, se sont avérées très différentes. À Strasbourg et à Toulouse, la part de décès imputables à l'ozone a été très élevée mais la surmortalité y a été relativement faible ; en revanche, dans les villes où la surmortalité a été exceptionnelle - plus 174 % à Paris -, l'effet de l'ozone a été plus limité. L'enseignement principal porte sur les caractéristiques de l'habitat et de l'urbanisme. Le système d'alerte national mis en place dès 2004, unique en Europe, basé sur les prévisions de température, a pour objectif de déclencher un plan d'action préventive agissant surtout sur des facteurs individuels et comportementaux ainsi que d'améliorer la prise en charge des personnes âgées sensibles. Il importe maintenant de travailler sur des mesures à long terme concernant l'habitat et l'urbanisme ; tel est le message que nous essayons de faire passer dans le service après-vente de nos études, notamment auprès du ministère chargé du logement. Mme la Rapporteure : Avez-vous établi un document de propositions spécifique ou avez-vous seulement formulé des recommandations générales ? Mme Martine LEDRANS : Nous nous sommes bornés à des recommandations générales car nous ne disposons pas de l'expertise en matière d'habitat. Mais d'autres agences sont compétentes sur cette question. Les rapports et les articles de référence sont réunis sur un cédérom dont je vous laisserai un exemplaire. M. le Président : Votre analyse sur la variabilité annuelle est intéressante ; elle corrobore ce que nous avons retenu d'auditions de climatologues. Mme Martine LIGNIÈRES-CASSOU : Est-il prévu que nous rencontrions des représentants du Centre scientifique et technique du bâtiment ? M. le Président : Absolument. Notre Mission d'information traitera, parmi bien d'autres sujets, celui de l'urbanisme et de l'habitat. Je remercie nos invités pour les messages forts qu'ils nous ont adressés. Table ronde sur les effets du changement climatique sur le milieu naturel, la biodiversité, l'agriculture et la forêt, réunissant : Présidence de M. Jean-Yves LE DEAUT, Président) M. le Président : Nous accueillons maintenant le professeur Robert Barbault, directeur du département écologie et gestion de la biodiversité du Muséum national d'histoire naturelle, M. Jean-François Soussana, du département écologie des forêts, prairies et milieux aquatiques de l'Institut national de recherche agronomique (INRA), et expert auprès du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC), M. Pierre-Olivier Drège, directeur général de l'Office national des forêts (ONF), M. Philippe Duchène, chef du département milieux aquatiques de l'Institut de recherche pour l'ingénierie de l'agriculture et de l'environnement (CEMAGREF), M. Jean-Philippe Palasi, chargé de mission pour l'outre-mer et la Méditerranée au comité français de l'Union mondiale pour la nature, et M. Édouard Toulouse, chargé du programme changement climatique au WWF. M. Robert BARBAULT : La biodiversité, tissu vivant de la planète, est constituée d'un ensemble de systèmes complexes qui interagissent. La diversité se situe au niveau des gènes, des organismes, des populations, des espèces et des écosystèmes. Les espèces ne peuvent se concevoir sans milieux, sans espaces pour les abriter, dans lesquels elles sont en concurrence avec l'homme. Ces entités sont liées entre elles, directement ou indirectement, dans la chaîne alimentaire. De surcroît, elles sont capables d'évoluer et même de co-évoluer, ce phénomène étant particulièrement rapide pour les micro-organismes. Les changements climatiques produisent une cascade d'effets - immédiats, différés et à long terme - sur la biodiversité, avec des échelles d'espace très diverses. Les réponses des espèces sont étudiées depuis assez longtemps car l'écologie s'est toujours intéressée aux relations entre climat et fonctionnement biologique. Les organismes apportent des réponses physiologiques ou comportementales : des variations d'aires géographiques, avec la remontée progressive d'un grand nombre d'espèces vers le nord, très précisément documentées ; des variations phénologiques, c'est-à-dire dans les rythmes de reproduction, de fructification ou de floraison, qui se quantifient également, par exemple en nombre de jours par dizaines d'années. À l'échelle des populations, les changements climatiques se traduisent par des phénomènes de pullulation ou au contraire de déclin vers l'extinction, mais ces réponses démographiques sont moins documentées. À l'échelle des systèmes, se produisent des effets de cascade, avec des seuils imprévisibles. Déterminer ces répercussions nécessite de la modélisation, des simulations et des expérimentations. Même si les approches sont fragmentaires, la documentation est importante et des études quantitatives à base de modélisation se sont développées depuis quelques années afin de relier les données sur le changement climatique à la dynamique de la biodiversité. L'article le plus célèbre est celui publié en 2004 dans Nature par Chris Thomas : à partir de trois scénarios climatiques, il prévoyait des taux d'extinction de très grande ampleur d'ici à 2050. Les effets climatiques se surajoutent à d'autres phénomènes. L'attention a depuis longtemps été attirée par la « sixième crise d'extinction », caractérisée par la déforestation, la modification, la dégradation et la fragmentation des milieux, les pollutions, les invasions biologiques, la surexploitation humaine. Pour estimer les taux d'extinction de façon solide, il convient de préciser le champ d'étude. En tout cas, la taille des populations est corrélée à la superficie de leur milieu. M. Philippe DUCHÈNE : Mon intervention portera davantage sur la qualification du milieu et sur les challenges de recherche appliquée auxquels le CEMAGREF est confronté que sur la biodiversité. La directive-cadre sur l'eau, qui a traduit un véritable changement de philosophie, pousse tout le monde en avant depuis 2000 : il s'agit d'atteindre un bon état écologique en 2015. Nous évaluons cet état en mesurant les assemblages biologiques des cours d'eau. Les outils fabriqués antérieurement, les bio-indicateurs, étaient généralement des relevés d'espèces prenant en compte la dimension biodiversité. Dès lors que des listes d'espèces sont dressées et que le climat change, un problème de référentiel apparaît et les anciens travaux deviennent caducs. La qualité du milieu écologique est liée au fond, ou hydrochimie, ainsi qu'au régime hydrologique, c'est-à-dire le débit du courant et la fréquence d'inondation. La température de l'eau, ces dernières décennies, s'est davantage élevée qu'elle ne le fera sous l'effet du changement climatique : dans le Rhône, elle progresse d'un degré tous les dix ans, parce que l'homme ralentit les cours d'eau et fabrique des barrages. Mais il ne faut pas pour autant décréter que l'eau est dans un état écologique moins bon ; elle est simplement dans un état différent. Il faut fonder l'analyse sur les fonctionnalités de la faune, c'est-à-dire des invertébrés benthiques - larves d'insectes vivant sur et dans le sédiment des rivières -, des diatomées, algues microscopiques, et éventuellement aussi des poissons. Le milieu aquatique n'est toutefois pas le plus étudié et nous ne connaissons pas la faculté d'adaptation des invertébrés benthiques à un changement de conditions environnementales : nous disposons de moins de données que sur la mésange ! À l'échelle géologique, les variations sont considérables : la dernière glaciation, pour simplifier, avait fait disparaître tous les poissons des cours d'eau du territoire correspondant à la France. La majorité des espèces ont été introduites. Il est donc utopique et insensé de vouloir revenir aux conditions qui prévalaient avant que l'homme ne commence à influer sur le milieu naturel. Des études sont entreprises sur le chabot, espèce de milieu froid parmi les plus menacées. Le poisson pouvant difficilement remonter vers le nord en passant d'un bassin-versant à l'autre recherche la fraîcheur en remontant vers la source. Mais la fragmentation des milieux ne lui permet pas toujours de recoloniser des secteurs suffisamment vastes. Nous n'avons des données scientifiques suffisamment fines que depuis trois ans, grâce au soutien de l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse. L'étude des poissons requiert un suivi sur dix ans, à cause de la variabilité du temps et de l'hydrologie et, quand les conditions sont changeantes, plus de dix ans sont nécessaires pour dégager des données compréhensibles. Sur les espèces symboliques, les résultats ne seront obtenus que dans assez longtemps et il sera difficile d'en tirer des conclusions générales, même avec le recours à la modélisation. Quels seront les effets du changement climatique sur des espèces symboliques comme le saumon, qui passe une partie de sa vie en mer et l'autre en eau douce ? Les décideurs politiques prêtent une grande attention au saumon, comme en témoigne sa réimplantation dans la Loire. Mais, si sa rivière devient trop chaude pour lui, il est probable, petit à petit, par essaimage ou repeuplement entropique, qu'il colonise des rivières plus septentrionales. Cependant, les bassins n'ont pas été aménagés et il ne retrouverait pas de frayères. Nous réfléchissons à ce problème. M. Jean-Philippe PALASI : Le changement climatique fait peser un risque de destruction massive d'espèces : dans l'hypothèse la plus négative du rapport de Chris Thomas, un million d'espèces disparaîtraient de la planète d'ici à 2050. Je signale que les évaluations du nombre d'espèces existant aujourd'hui dans le monde oscillent d'un peu plus de 10 millions à 100 millions, cette grande marge d'incertitude étant notamment liée à la faible connaissance des organismes du milieu marin. M. Philippe DUCHÈNE : La notion d'espèce n'est pas claire : elle englobe parfois les bactéries mais pas toujours. M. Jean-Philippe PALASI : Quoi qu'il en soit de très nombreuses espèces sont menacées, par exemple un tiers des oiseaux disparaîtraient à l'échéance 2050. L'étude de Chris Thomas a démontré la situation de cul-de-sac dans laquelle se retrouveraient les espèces inféodées à un lieu particulier, à l'instar du crapaud doré de Monteverde, joyau d'un parc national du Costa Rica qui a totalement disparu en deux ans. Voici une des explications possibles : il occupait autrefois toute la plaine forestière alentour et s'est replié sur la colline au fur et à mesure que le climat se réchauffait, jusqu'au jour où il n'a pu monter plus haut. Le réchauffement climatique d'origine anthropique intervenant alors que la planète est déjà dans une phase relativement chaude de son cycle naturel, nombre d'espèces endémiques risquent de se retrouver dans une situation de cul-de-sac comparable. C'est particulièrement inquiétant pour l'outre-mer français, nos territoires de l'Océan Indien, du Pacifique, des Caraïbes et d'Amérique latine abritant 3 450 plantes et 380 vertébrés uniques au monde, la plupart d'entre eux inféodés à des milieux extrêmement réduits. Au-delà de l'impact sur le patrimoine, avec la perte d'espèces emblématiques, les conséquences économiques pourraient être dramatiques. Ainsi, en Polynésie française, la hausse de la température provoque un blanchiment préoccupant des coraux. La dégradation de ce milieu vivant provoquerait le déclin des trois activités clés, à savoir le tourisme, la perliculture et la pêche lagonaire, et pourrait de surcroît se combiner avec la montée du niveau de la mer et l'accélération de la fréquence de phénomènes météorologiques extrêmes comme les cyclones. Le sort des écosystèmes vivants est aussi une question de sécurité pour de nombreuses populations, et je rappelle au passage que la France possède 20 % des atolls de la planète. Des fluctuations climatiques importantes ont toujours existé. C'est ainsi que les passes actuelles de la barrière de corail néo-calédonienne, l'un des milieux les plus fabuleusement riches du monde, sont d'anciennes moraines glaciaires. La nature a toujours su s'adapter mais les changements d'aujourd'hui sont beaucoup plus rapides, ce qui complique l'adaptation des écosystèmes vivants, et se combinent avec d'autres menaces. En Amazonie, le rythme de croissance des végétaux se modifie et un risque de sécheresse apparaît. En Méditerranée, mer fermée, les possibilités de déplacement des espèces sont faibles, ce qui rend les écosystèmes particulièrement vulnérables. La France a un potentiel d'étude énorme puisqu'elle couvre la plupart des grands écosystèmes européens en métropole et une bonne partie des types d'écosystèmes mondiaux en outre-mer. Un devoir d'action lui incombe. Nous invitons les responsables politiques des collectivités d'outre-mer à se mobiliser sur la thématique du changement climatique et à faire preuve d'exemplarité, notamment en favorisant le développement des énergies renouvelables. Il est crucial d'agir en amont en réduisant les émissions de gaz à effet de serre sans attendre le résultat définitif des études relatives à leur impact sur le vivant. M. Édouard TOULOUSE : Le changement climatique a d'ores et déjà des effets concrets : des oiseaux migrateurs ne migrent plus, des populations de poissons se déplacent de manière étonnante. L'organisation de cette table ronde est une bonne initiative, qui témoigne d'une prise de conscience, alors que plusieurs revues consacraient récemment leur titre au sujet. Pour notre part, nous tâchons d'en faire le plus possible en commanditant des rapports et des audits scientifiques. Je vois deux pistes concrètes sur lesquelles il serait possible d'avancer. Premièrement, l'Observatoire national des effets du réchauffement climatique pourrait être chargé de recueillir et de coordonner les données pour élaborer des scénarios locaux ; alors, de grâce, Mesdames, Messieurs les députés, ne l'assassinez pas. Deuxièmement, le développement de la résilience, c'est-à-dire de la capacité des écosystèmes à faire face aux bouleversements climatiques, demande de revoir intégralement les politiques publiques de conservation de la nature car les espèces vont se déplacer ; il est particulièrement important de ménager des corridors écologiques pour leur permettre de se frayer un passage entre les infrastructures humaines afin de retrouver leurs conditions climatiques habituelles. Mme Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET, Rapporteure : Des mesures simples peuvent-elles être imaginées pour favoriser l'adaptation biologique ? M. Robert BARBAULT : Les espèces s'adaptent au changement mais, face à l'accumulation des pressions et à la réduction des espaces, leurs marges de manœuvre se réduisent. Les espèces indésirables - bactéries, virus, bactéries - seront les premières à s'adapter tandis que les animaux de grande taille - mammifères, oiseaux et poissons - seront les plus menacés. Mme la Rapporteure : Est-il certain que les espèces les moins intéressantes et éventuellement les plus nuisibles seront celles qui survivront et se développeront le mieux ? M. Robert BARBAULT : La question est délicate, d'autant que le développement des espèces pathogènes n'est pas forcément lié au changement climatique. L'isoler par rapport aux autres phénomènes exerçant une pression sur les systèmes vivants est une stratégie erronée. La capacité d'évolution rapide des pathogènes est bien avérée dans le cas de la résistance aux antibiotiques. Il faut retenir que l'espèce humaine porte une grande responsabilité dans le contexte de déstabilisation actuel et surtout que nous ne devons pas nous comporter comme des primates bornés, faute de quoi nos enfants et nos petits-enfants nous demanderont des comptes. Le défi va au-delà de la comptabilisation des petits oiseaux et des jolies plantes ; il n'est pas arithmétique mais philosophique. M. Lionnel LUCA : Il faut se méfier de la tendance au catastrophisme car les espèces ont toujours dû s'adapter à l'environnement et aux bouleversements climatiques. Pourquoi en serait-il différemment aujourd'hui ? Votre réponse donne plus l'impression d'une opinion que d'une démonstration scientifique. M. Édouard TOULOUSE : Le réchauffement actuel est extrêmement rapide au regard des temps biologiques ; c'est même le plus brutal de l'histoire de la terre. Les espèces entrent donc dans une stratégie de survie ; or les oiseaux peuvent toujours voler, mais les arbres ne pourront pas se déraciner pour changer de forêt. Les activités humaines s'en ressentiront aussi dans la mesure où certains parasites, comme la chenille processionnaire du pin, sont normalement éliminés par le gel en hiver. M. Christian DECOCQ : Les mesures physico-chimiques des cours d'eau prévues par la réglementation ne sont en effet pas forcément représentatives de la réalité biologique. Quoi qu'il en soit, faut-il lutter dès aujourd'hui, même modestement, contre le réchauffement des cours d'eau ? M. Philippe DUCHÈNE : Le principal facteur de réchauffement des cours d'eau, depuis la seconde guerre mondiale, est la création de petits plans d'eau privés ou récréatifs augmentant le temps de séjour de l'eau à faible hauteur ; mais leur interdiction ne serait sans doute pas une mesure très populaire. Les prélèvements agricoles constituent un autre facteur de réchauffement des cours d'eau car ils ont pour effet un ralentissement de la vitesse d'écoulement. Nous appelons donc à la cohérence des mesures sectorielles avec la politique de l'environnement : en clair, quand cesseront les passe-droits en faveur d'une agriculture qui détruit l'environnement ? Quant aux barrages hydroélectriques, la phase d'équipement est derrière nous. M. Christian DECOCQ : Et les rejets d'EDF ? M. Philippe DUCHÈNE : Là où sont effectués des rejets, la température augmente de 0,7 ou 0,8 degré. Ce facteur reste relativement modéré en ampleur mais s'ajoute aux autres. Cette cause pourrait être en grande partie supprimée par le recours au refroidissement atmosphérique, et le virage semble amorcé. Mme Martine BILLARD : Certains proposent de construire beaucoup plus de centrales nucléaires. Mais quels sont les effets de leurs rejets sur la température des cours d'eau ? M. Serge POIGNANT : La problématique de l'adaptation est-elle différente selon les scénarios de réchauffement climatique, qui prévoient des nombres de degrés supplémentaires différents ? M. Robert BARBAULT : Compte tenu de la dynamique générale amorcée, les risques d'extinction sont tels que ce niveau de finesse ne présente guère d'intérêt. De toute façon, des micro-évolutions génétiques interviennent chaque année et même chaque jour. M. Édouard TOULOUSE : Au-delà de deux degrés de réchauffement global de la planète, l'impact sur les écosystèmes les plus fragiles sera manifeste. Une hausse d'un degré a déjà été enregistrée mais il serait possible, quoique difficile, de ne pas dépasser cette limite de deux degrés en maîtrisant les émissions de gaz à effet de serre. M. Richard CAZENAVE : Parmi les mesures que l'homme peut encourager pour contrecarrer les changements climatiques sans précédent, certaines sont réalisables, d'autres sont utopiques. Les corridors écologiques, par exemple, auraient des résultats tangibles sur certains sites mais, sur d'autres, leur aménagement est impossible. Au-delà du constat, notre mission devra déboucher sur des propositions d'actions. M. Robert BARBAULT : La nature des autres exposés de la table ronde sera plus favorable à la formulation de propositions concrètes. M. le Président : Il semblerait que la situation soit meilleure en France que dans le reste de l'Europe ou du monde grâce aux centrales nucléaires mais que leurs rejets d'eau aient des effets sur le réchauffement des fleuves en bordure desquels elles sont implantées. M. Philippe DUCHÈNE : Je répète que le réchauffement, sur les avals, est inférieur à un degré. Le nombre d'implantations a jusqu'à présent été proportionnel au débit des cours d'eau : sur le Rhône, qui se caractérise par un débit très fort, il y en a plusieurs. De toute façon, le linéaire concerné - 1 000 kilomètres - est extrêmement faible par rapport au total des cours d'eau français. M. Jean-Philippe PALASI : Il est tout de même dommage de rejeter de l'eau chaude dans les rivières alors qu'elle pourrait être utilisée, par exemple pour réchauffer des serres. M. le Président : Nous passons aux exposés sur la forêt et l'agriculture. M. Pierre-Olivier DRÈGE : Le milieu forestier est particulièrement important dans notre pays, d'abord parce qu'il recouvre un tiers du territoire métropolitain, sans compter la Guyane et sa forêt équatorienne. Les forêts du monde sont dans des situations très diverses. Si la déforestation est inquiétante dans bien des pays tropicaux, les forêts tempérées et singulièrement la forêt française, connaissent une expansion rapide, plus rapide que jamais. Outre que la forêt, en France, est protégée, elle profite de la déprise agricole. Notre pays a connu des périodes de déforestation active, notamment à l'époque des moines défricheurs, pour atteindre un point bas à la fin du XVIIIe siècle ; ensuite, la reprise a été lente, pour s'accélérer très fortement dans la période récente. Bref, la forêt ne court aucun danger quantitatif. La forêt est un milieu très sensible aux changements climatiques mais participe spontanément à la lutte contre l'effet de serre par sa capacité à capturer le carbone. Le changement climatique a un effet visible : la multiplication et l'accélération des événements exceptionnels comme la canicule de 2003 ou les deux grandes tempêtes de 1999. Mais il affecte aussi la croissance des forêts, même si cet effet est plus lent et plus progressif : la période de végétation s'allongeant, la vitesse de croissance des forêts progresse en moyenne de 1 % par an - même s'il existe des différences d'une essence à l'autre -, ce qui signifie, en gros, qu'elles poussent 20 % plus vite qu'il y a vingt ans. L'ONF travaille avec les instituts de recherche pour élaborer des référentiels et entretient lui-même un réseau d'observation depuis 1992. Pour anticiper ces phénomènes, il faut les comprendre. S'agit-il d'un réchauffement général du climat méditerranéen ou d'une évolution susceptible d'aller jusqu'à l'inversion du Gulf Stream ? Quoi qu'il en soit, certains peuplements dépérissent, plutôt dans des forêts privées où des essences ont été plantées en dehors de leurs stations les plus performantes : c'est le cas des épicéas dans les premiers plateaux du Jura. Nous assistons aussi, sur les terrains les plus pauvres et les plus filtrants de la grande forêt ligérienne, à des dépérissements de chênes inexpliqués. Nous réagissons en essayant de faire évoluer les essences pour adapter les peuplements aux stations : ainsi, dans la forêt normande de Lyons, la baisse des précipitations nous conduit, au fil des régénérations, à faire évoluer les hêtraies vers des chêtraies. La forêt contribue indubitablement à atténuer les effets du changement climatique grâce à ses fonctions de séquestration du carbone et de production de biomasse utilisable comme énergie renouvelable. Une forêt non exploitée ne séquestre ni n'émet de carbone. Mais les forêts métropolitaines ont été modifiées de longue date par l'homme qui les exploite depuis le néolithique. Aujourd'hui, elles stockent 12 % de la totalité des émissions de gaz carbonique des secteurs de l'industrie, de l'habitat et de l'agriculture, ce qui représente le volume considérable de 65 millions de tonnes de CO2 par an alors que l'objectif de la première phase du protocole de Kyoto, la stabilisation des émissions, nécessite un effort de l'ordre de 60 millions de tonnes. Je précise qu'une forêt naissante séquestre deux tonnes de CO2 par hectare et par an, et que ce chiffre monte à neuf tonnes lorsqu'elle est adulte. L'Europe serait bien inspirée de mettre à profit les articles 3-3 et 3-4 du Protocole de Kyoto, qui évoquent la contribution de la forêt et de l'agriculture à la résorption des gaz à effet de serre. Est-il légitime d'entrer dans la logique du marché international des réductions d'émissions ? Il conviendrait de poser la question en termes politiques. D'autres mécanismes existent et seraient des leviers puissants d'un point de vue environnemental et social. Les enjeux sont considérables : rappelons-nous que le Président de la République a fixé comme objectif, à l'échéance du milieu du siècle, la division par quatre des émissions. La production de biomasse par la forêt est énorme mais seul 60 % du surcroît forestier annuel est utilisé : le système est donc sous-exploité. Même si, pour la santé des forêts, il faut laisser pourrir un peu de bois sur place et conserver du bois mort dressé, la capacité de mobilisation supplémentaire significative de la biomasse pourrait apporter une contribution essentielle à la réalisation des objectifs que l'Union européenne s'est fixés, en attendant que des énergies de remplacement soient développées. Le bois énergie, c'est l'utilisation de plaquettes forestières comme pseudo-fluides pour alimenter des chaufferies industrielles, communales ou individuelles procédant de technologies sophistiquées. La France est très en retard, y compris par rapport à des pays beaucoup moins forestiers comme l'Italie, car elle fait face à des blocages. L'ONF a d'ailleurs reçu mission du Gouvernement de mettre au point un programme de développement du bois énergie. M. Jean-François SOUSSANA : Le réchauffement est déjà perceptible par ses conséquences sur la phénologie, des données sur les dates de floraison des poiriers ou sur les dates des vendanges à Châteauneuf-du-Pape en témoignent. M. Michel DESTOT : Est-ce positif ou négatif ? Nous aimerions avoir votre opinion et pas seulement des informations que nous connaissons par cœur ! M. Jean-François SOUSSANA : D'accord, j'y viendrai. Il est prévisible que l'augmentation de la température moyenne se combine avec une plus grande variabilité du climat et des événements exceptionnels plus fréquents : les jours de très forte chaleur seront donc très nombreux. La canicule de 2003 a eu pour effet une chute de la production de 25 % pour les cultures estivales, de 15 % pour les cultures hivernales et de 50 % pour les prairies. Par ailleurs, alors que les écosystèmes européens stockent habituellement du carbone, en 2003, ils en ont rejeté : les rejets anormaux de CO2 ont atteint 0,5 gigatonne, soit environ 40 % des émissions anthropiques, à cause d'une baisse de productivité de 21 %. Des inquiétudes pèsent également sur la pluviométrie - avec un risque de déficit en eau dans le sol mais également un risque d'excès en hiver, au moins dans certaines régions d'Europe -, le rayonnement, l'humidité de l'air, la variabilité climatique, sans oublier des surprises possibles comme un affaiblissement du Gulf Stream. L'augmentation du CO2 atmosphérique accroît la photosynthèse en interagissant avec le changement climatique. Or les données internationales indiquent, pour les cultures, une augmentation des rendements de 7 à 15 %, le taux étant plus élevé dans les pays à climat chaud. Les effets de l'enrichissement en CO2 sont donc plus faibles que ce qui était annoncé. Des économies en eau sont possibles tandis que les besoins en azote s'accroissent un peu. C'est à la température optimale que le bénéfice du CO2 est le plus grand. En cas de déficit en eau, le CO2 tend à avoir un effet plus bénéfique. Pour les plantes à cycle déterminé comme les cultures annuelles, si le réchauffement est modéré et uniforme, on peut imaginer que le cycle de végétation se raccourcira, que les dates de floraison et de récolte seront plus précoces mais qu'il n'y aura pas d'effet négatif majeur sur les rendements. En cas de variabilité accrue des températures et des précipitations, la baisse des productions estivales sera assez importante, de même que les risques de gelée, à cause d'une dormance hivernale insuffisante. Pour les plantes fourragères, à cycle indéterminé, le déficit estival de croissance pourra être compensé par un allongement de la saison de végétation, au printemps et à l'automne. Les études, pour le blé dur, ne mettent pas en évidence une modification significative du rendement mais une diminution de la teneur en protéine du grain, une réduction de l'extensibilité du volume de la pâte et une moindre aptitude à la panification de la farine. Pour les fourrages, il y aurait une plus forte teneur en sucres, une plus faible teneur en protéines et une augmentation de la lignification. Pour la vigne et le vin, nous avons noté une augmentation de la teneur en sucre et en alcool. Sous CO2 enrichi, la concentration en oligoéléments diminue toujours, ce qui n'est pas sans effets sur la nutrition humaine, mais cet aspect reste encore très peu étudié. S'agissant des dommages aux cultures, l'aire de distribution de certaines maladies majeures s'étend. Les adventices les plus agressives, mieux adaptées aux températures chaudes et favorisées par l'augmentation du CO2 atmosphérique, remontent vers le nord. Les populations d'insectes comme les pucerons se développent plus vite sur des plantes riches en CO2. La vague de chaleur de 2003 a provoqué une mortalité de 2 % des volailles d'élevage. Par ailleurs, des maladies tendent à remonter du sud au nord de l'Europe, ce qui appelle des mesures de prophylaxie. Pour atténuer les conséquences négatives du changement climatique, il convient d'adapter le matériel végétal - en substituant par exemple le sorgho au maïs dans certaines régions - les espèces et les itinéraires techniques, ainsi que d'anticiper les besoins accrus en irrigation, car l'enjeu de l'eau sera majeur. La partie labellisée de notre agriculture n'est par définition pas délocalisable. Un réchauffement de trois degrés transporterait à Reims le climat de Bordeaux, ce qui ne serait pas sans effets sur les produits de la vigne. Toutefois, en 2003, la production viticole n'a pas été affectée ; on peut donc espérer que les conséquences seraient moins catastrophiques que prévu. Comment réduire les risques face aux événements extrêmes ? Il faudra adapter le secteur agricole et réduire la contribution nette à l'effet de serre, notamment en jouant sur les intrants azotés et les énergies fossiles employées. Des sécheresses récurrentes aux États-Unis ou au Brésil auraient un impact majeur sur les marchés internationaux ainsi que sur la sécurité alimentaire des pays en développement, particulièrement dans les zones déjà arides ou semi-arides. Mme la Rapporteure : Pourquoi l'efficience de l'eau augmente-t-elle en fonction du taux de CO2 ? M. Jean-François SOUSSANA : Ce phénomène est dû à un mécanisme physiologique. Lorsque le taux de CO2 atmosphérique monte, la plupart des plantes tendent à réduire leurs pertes en eau, ce qui amenuise les impacts négatifs de la sécheresse. M. le Président : Les mécanismes d'émission de carbone sont complexes. Une croissance modérée de la température a certes un effet bénéfique sur le stockage de carbone mais une croissance plus forte risque de provoquer un déstockage. Pouvez-vous nous donner des précisions sur ce point ? M. Pierre-Olivier DRÈGE : Les années de canicule, davantage de carbone est émis. Les végétaux, en particulier les arbres, ont des réactions de défense spectaculaires en cas de stress hydrique ou thermique, allant jusqu'à la perte des feuilles dès l'été pour limiter l'évaporation ; les espèces inadaptées à leur station sont évidemment amenées à réagir plus vite que les autres. Il n'en demeure pas moins que la production de bois et le stockage de carbone ont augmenté de 20 % en vingt ans. L'homme peut favoriser ces processus naturels d'amortissement en employant des techniques de sylviculture adaptées et en réorientant le mode de traitement des peuplements forestiers. Quoi qu'il en soit, le maintien de la biodiversité ne doit évidemment pas être négligé. M. Jean-François SOUSSANA : Si nous ne conservions pas les stocks de carbone, le taux de CO2 atmosphérique serait beaucoup plus élevé. Il faut se montrer très prudent car la biosphère interagit avec l'homme. M. Serge POIGNANT : Pour la biomasse, il faut mesurer la production de carbone d'un bout à l'autre de la chaîne. Les chiffres qui ont été donnés sur le CO2 stocké prennent-ils en compte les émissions ? M. Pierre-Olivier DRÈGE : Oui. Il s'agit d'un bilan net. Mme Geneviève COLOT : L'utilisation de la biomasse de la forêt pour le chauffage n'aurait-elle pas l'effet inverse de celui recherché à cause des rejets de CO2 ? M. Pierre-Olivier DRÈGE : En brûlant du bois, on rejette évidemment en une seule fois dans l'atmosphère tout le CO2 qui avait capté, mais c'est un cycle neutre, tandis que le pétrole, par exemple, est non renouvelable. Le stockage du carbone suit une courbe asymptotique : il est d'abord modeste lorsque l'arbre est jeune puis s'accélère avant de décroître pour devenir nul lorsque l'arbre arrive à l'âge adulte. Et des arbres qui ne seraient pas prélevés rejetteraient aussi leur CO2 dans l'atmosphère. Si la cueillette est effectuée dans le cadre d'une gestion durable de la forêt, au bon moment, on obtient une source d'énergie gratuite et renouvelable tout en réamorçant la pompe à stockage de carbone grâce à de nouvelles plantations. M. François DOSÉ : Le bilan énergétique doit aussi prendre en compte le transport. M. le Président : Les centrales thermiques mixtes, fonctionnant au bois et au charbon, n'apportaient aucun gain lorsqu'il fallait aller chercher les plaquettes trop loin. M. Pierre-Olivier DRÈGE : Le bilan est peut-être nul, voire négatif, d'un point de vue financier, mais le gain énergétique reste significatif. Le transport, fort heureusement, ne consomme pas la totalité du chargement, même si le matériau est pondéreux et non anhydre. M. Jean-Philippe PALASI : D'autres usages sont encore plus intéressants : intégrer du bois dans les constructions revient à stocker du carbone définitivement ou en tout cas durablement. M. Philippe ROUAULT : En matière de gestion forestière, il est indispensable de distinguer le stock du flux. L'INRA dispose-t-il de données sur l'évolution du stockage de carbone dans les sols au cours des dernières décennies du fait des modifications des pratiques agricoles et de l'accroissement des surfaces cultivées ? M. Jean-François SOUSSANA : Les stocks de carbone des sols agricoles français ont diminué à compter des années soixante, à cause de l'intensification de l'agriculture et du retournement des prairies, mais cette tendance s'est un peu inversée avec les mises en jachère consécutives à la politique agricole commune. L'INRA, qui a réalisé une expertise collective sur les possibilités de stockage de carbone dans les sols agricoles, a identifié deux pistes : l'implantation de prairies permanentes et la culture par semis direct, qui consiste à utiliser des herbicides lors de semailles - mais la prudence s'impose car cela aurait des conséquences environnementales et il faudrait que les agriculteurs s'engagent à ne pas labourer pendant une durée longue. Ce stockage pourrait atteindrait jusqu'à 3 à 4 % des émissions annuelles de la France, ce qui n'est pas négligeable, mais cela supposerait des actions très volontaristes. M. Philippe ROUAULT : Le Chicago Climate Exchange a mis en place des mécanismes de bourse de réduction d'émission du carbone, notamment dans le domaine agricole. Il serait intéressant que la Mission, lors de son déplacement aux États-Unis, puisse auditionner cet organisme. Mme Martine LIGNIÈRES-CASSOU : Si le planning de la Mission n'est pas complètement bouclé, je souhaiterais que nous abordions spécifiquement le thème de l'agriculture. M. le Président : Une table ronde est prévue sur ce thème, en principe le 31 janvier. M. Pierre-Olivier DRÈGE : Je suis tout à fait partisan de l'utilisation prioritaire du bois pour la construction et d'autres modes de stockage intermédiaire. Mais, dans le domaine du bois énergie, le petit bois et les branches constituent aussi un gisement formidable actuellement inexploité. M. le Président : À propos du Gulf Stream, les spécialistes nous ont recommandé d'être très prudents. Un moyen rapide d'adapter le matériel végétal au changement climatique serait de recourir aux biotechnologies. Des gènes de résistance à la sécheresse sont déjà connus. Je sais que le sujet des OGM est polémique et que certains pourront me rétorquer que je cherche à justifier une technique qu'ils désapprouvent pour d'autres raisons, mais la question mérite d'être posée. M. Édouard TOULOUSE : Des expérimentations sont d'ores et déjà en cours afin de créer des eucalyptus qui absorberaient davantage de CO2, dans l'optique d'ouvrir de grandes plantations industrielles dans les pays du Sud. J'y suis absolument défavorable car cela va à l'encontre des mécanismes de développement propre : les pays du Sud ne doivent pas devenir de grandes plantations dont la population locale ne tirerait aucun bénéfique. M. François DOSÉ : Et si ces plantations étaient envisagées en France ? Votre réponse est politique ou éthique, ce qui est respectable, mais absolument pas scientifique. M. Édouard TOULOUSE : Je n'ai pas d'avis scientifique car je ne suis pas spécialiste du sujet. M. Jean-François SOUSSANA : Il n'est pas démontré que des matériels résistant durablement à la sécheresse au champ puissent être créés ; c'est possible mais pas encore certain. M. le Président : L'expérience en champ que Biogemma a menée à Marsat sur du maïs pourvu d'un gène résistant à la sécheresse a été concluante, mais ces cultures font partie de celles qui ont été détruites. En revanche, pour les arbres, je ne sais pas ce qu'il en est. D'un point de vue éthique, qu'en pensez-vous ? La technologie des OGM peut-elle être utilisée pour traiter le problème ? M. Pierre-Olivier DRÈGE : Ce projet d'exploitation d'eucalyptus est plus proche du champ de maïs ou de canne à sucre que de la forêt ; c'est de la culture d'arbres. La question ne se pose en aucune façon pour la forêt métropolitaine ou même guyanaise. Les espèces y sont le plus souvent autochtones et, pour la sélection, nous récupérons les semences sur place. L'objectif est d'adapter les essences et les pratiques sylvicoles au contexte pédoclimatique du lieu. M. Jean-Philippe PALASI : L'ONF, en partenariat avec Peugeot, a mené au Brésil un projet de puits de carbone dont les objectifs étaient de stocker du carbone et de favoriser la biodiversité : ces deux problèmes planétaires ne pourront être résolus l'un séparément de l'autre. Planter de grands champs d'arbres génétiquement modifiés ne contribuera pas à sauver la biodiversité ; personne ne créera jamais une barrière de corail génétiquement modifiée. M. Pierre-Olivier DRÈGE : Nous avons effectivement, en liaison avec le groupe PSA, acheté une ancienne exploitation de 10 000 hectares qui avait été épuisée. Notre démarche est à la fois scientifique et éthique puisque nous avons cueilli des semences de plusieurs dizaines d'essences amazoniennes afin de les réimplanter. M. le Président : Le changement climatique aura des effets dans un grand nombre de domaines et il ne s'agit pas de prétendre qu'une technique unique permettra de résoudre tous les problèmes. Néanmoins, pourquoi se priver des moyens existants pour adapter un arbre ou une plante à des événements extrêmes, qu'il s'agisse de modifications génétiques, de techniques naturelles ou d'un passage par les OGM pour revenir ensuite à des recherches naturelles ? M. Édouard TOULOUSE : Le vrai enjeu est le maintien de la diversité de l'agriculture pour faire face aux futurs coups du sort. Un réchauffement global de deux degrés rendrait impossible la culture du café en Ouganda. Que deviendraient alors les populations locales ? M. Pierre-Olivier DRÈGE : Je répète qu'il est risqué de planter des essences inadaptées à la station. Un forestier de la fin du XIXe siècle a introduit dans le Ventoux des cèdres de l'Atlas, essences réputées exotiques mais qui semblent très adaptées à l'évolution climatique actuelle. Attention à une radicalisation manichéenne : les essences exotiques ne sont pas forcément mauvaises et les essences locales ne sont pas forcément bonnes. M. le Président : Absolument : des séquoias et des pins de Douglas ont été introduits en Bretagne. Messieurs, je vous remercie. Table ronde sur la dimension internationale et européenne de la lutte contre le changement climatique, réunissant : Présidence de M Jean-Yves LE DEAUT, Président M. le Président : Mes chers collègues, nous accueillons aujourd'hui M. Denys Gauer, ambassadeur délégué à l'environnement, qui revient du sommet de Montréal et pourra donc nous en faire le bilan, ainsi qu'éclairer les principaux enjeux. Je souhaite également la bienvenue à Mme Odile Roussel, sous-directrice en charge de l'environnement à la direction des affaires économiques du ministère des affaires étrangères, à Mme Sandrine Boucher, sous-directrice à la direction générale de la coopération internationale et du développement, et à M. Nicolas Lambert, de la direction générale de la coopération internationale et du développement (DGCID). M. Denys GAUER : La sensibilisation à la question climatique a progressé très vite, ces dernières années, au niveau international, mais l'écart entre la disposition à agir et les mesures nécessaires reste malheureusement très grand. Ainsi que l'avait résumé lord May, le président de la Royal Society, équivalent britannique de notre Académie des sciences, le problème de la coopération est que la science nous dit clairement que nous devons agir, mais que si nous n'agissons pas dans des proportions équitables, les vertueux seront économiquement désavantagés tandis que tous subiront les conséquences de l'inaction des fautifs. Je présenterai successivement les positions des différents groupes de pays, les instruments juridiques dont nous disposons, les enjeux et perspectives de l'après Montréal. Parmi les différents acteurs, les plus dynamiques et les plus ambitieux sont l'Union européenne, le Japon et le Canada. Tous ces pays ont ratifié Kyoto et s'imposent des objectifs chiffrés, qu'ils s'efforcent de respecter, en développant le marché du carbone et les mécanismes de flexibilité. A l'opposé, les Etats-Unis sont le premier émetteur de gaz à effet de serre, tant en valeur absolue que par habitant. Ils refusent tout objectif chiffré de réduction, n'ont pas ratifié le protocole de Kyoto, et ont même nié pendant longtemps la réalité du problème. Ils ne sont pas inactifs pour autant : ils consacrent des financements considérables aux programmes de recherche sur l'économie de l'hydrogène et sur la séquestration géologique du CO2 et ont lancé en juillet dernier un partenariat Asie-Pacifique sur la recherche et les transferts de technologie, dont le contenu reste toutefois à définir. Nombreux sont d'autre part les Etats et les collectivités locales des Etats-Unis à avoir pris des initiatives, mais l'absence d'objectif chiffré ôte un stimulant essentiel, y compris pour le développement technologique. Le constat est sans appel : en 2003, l'Union européenne avait réduit ses émissions de 4 % par rapport à 1990 - et l'objectif de 8 % en 2010 semble donc à sa portée - tandis que les Etats-Unis les avaient accrues de 20 %. Les pays émergents sont l'un des principaux enjeux. Leur situation est paradoxale à bien des égards. Ils font valoir qu'ils ne sont pas responsables des émissions passées, qu'ils sont dépourvus de moyens d'actions et qu'ils ont un objectif légitime de croissance. C'est d'ailleurs à leur demande que figure dans la convention la notion de « responsabilité commune mais différenciée ». Mais les émissions de ces pays, pris tous ensemble, vont bientôt dépasser celles des pays industrialisés. En outre, ils sont à la fois les plus exposés au changement climatique et les plus dépourvus des moyens d'y faire face. La Chine affiche une réelle volonté d'agir - à condition de garder la maîtrise de ses décisions - et marque son intérêt pour toutes les formes de transferts de technologie en vue d'un « développement propre ». L'Inde affiche le même intérêt pour les transferts de technologie, mais tient un discours plus traditionnel, rejetant les responsabilités sur les pays développés. Quant aux pays les moins avancés, les PMA, africains en particulier, ils ont été très peu présents jusqu'à présent dans le débat, et on a tendance à considérer qu'ils sont peu partie au problème comme à sa solution. C'est une erreur, car ils sont en réalité un émetteur important de CO2 du fait de la déforestation, qui représente entre 20 et 25 % des émissions totales de CO2 selon les experts. C'est une réalité qui est d'ailleurs trop peu connue. Les pays du bassin du Congo avaient demandé à Kyoto que le rôle des forêts soit pris en compte. Ils n'ont guère obtenu satisfaction, car dans la première phase, seuls les projets d'afforestation et la reforestation sont éligibles au mécanisme de développement propre, le MDP. Une notion nouvelle et prometteuse, celle de « déforestation évitée », a cependant été retenue à Montréal, et en tout état de cause, le rôle des forêts et des sols devra être davantage pris en compte dans la prochaine étape. J'en viens aux instruments juridiques. La convention-cadre a été l'un des acquis essentiels du sommet de Rio en 1992. Tous les pays, y compris les Etats-Unis, l'ont ratifiée. Ce sont donc 188 Etats qui se sont engagés sur un objectif : stabiliser la concentration de gaz à effet de serre à un niveau empêchant toute perturbation entropique dangereuse du système climatique. Les pays développés se sont engagés, en outre, à montrer l'exemple et à rendre compte de l'effort fait pour revenir en 2010 au niveau de 1990. J'insiste là-dessus parce qu'il s'agit des engagements pris à Rio même, et que Kyoto n'a fait que préciser, en mettant en place un mécanisme et un protocole d'observance. Kyoto est un instrument à la fois révolutionnaire et insuffisant. Révolutionnaire, parce que, pour la première fois dans un accord international, des pays ont souscrit un engagement volontaire les obligeant à un changement économique de grande ampleur, et se sont soumis à un mécanisme quasi juridictionnel de contrôle et de sanctions. Tout aussi novateurs sont les instruments concrets, tels que les quotas d'émissions par entreprise, la mise en place d'un marché de ces quotas et le recours à des mécanismes de flexibilité afin d'aider les pays en voie de développement à réduire leurs émissions à moindre coût. Mais la faiblesse du protocole de Kyoto tient d'abord à celle des réductions, très inférieures à l'effort nécessaire. Ce n'est qu'un premier pas, et le plus difficile est à venir, faute qu'ait été donné le signal à long terme qui serait nécessaire. Les pays développés de l'annexe I ne représentent que 30 % des émissions totales, et leur effort perd de son sens si les autres pays ne les rejoignent pas. L'effort des pays qui se sont engagés deviendra même insupportable si leurs partenaires n'y sont pas astreints, c'est-à-dire si l'on reste dans le cadre participatif actuel. Nous étions partis pour Montréal avec trois objectifs : mettre en place tous les instruments du protocole de Kyoto, mettre en place les mécanismes de flexibilité, lancer la discussion sur l'évolution du régime après 2012. Montréal a été la première réunion après l'entrée en vigueur de Kyoto, et l'occasion d'évaluer les dispositifs provisoires mis en place par les accords de Marrakech, et en particulier le mécanisme d'observance permettant le contrôle du respect des engagements. Tout a été adopté, y compris le mécanisme d'observance, malgré les réticences manifestées au départ par l'Arabie saoudite. Le débat a notamment porté sur le point de savoir si l'adoption devait se faire par amendement au protocole, ce qui aurait été plus solennel, ou par simple décision. C'est finalement cette seconde option qui a été retenue, la possibilité de procéder ultérieurement par voie d'amendement restant ouverte. Le deuxième objectif était de consolider les mécanismes de flexibilité, en renforçant l'unité de gestion du MDP pour faciliter la gestion des quelque 300 projets. L'accord s'est réalisé, et un financement de 8 millions d'euros a été promis, dont 1 million versé par l'Allemagne et 1 million par le Canada ; la France, quant à elle, versera 200 000 euros en 2006, mais elle avait été le premier contributeur jusqu'à présent, et reste très bien placée en total cumulé. Mais le principal enjeu était le lancement de la discussion sur l'évolution du régime après 2012. Il y avait de bonnes raisons pour la lancer rapidement. La première était le besoin de continuité, la nécessité de préserver l'impulsion donnée au projet MDP, alors qu'il n'existe aucune garantie de pérennité du système après 2012. La deuxième était la nécessité de définir un « sentier de réduction à long terme » afin d'orienter les investissements, sachant que l'on évalue à 16 000 milliards de dollars les sommes qu'il faudrait investir selon l'Agence Internationale de l'Energie, dans le secteur énergétique au cours des 20 prochaines années. Mais il y aurait eu aussi un certain risque à vouloir forcer les choses. Aux termes de l'article 3.9 du protocole, seuls les pays développés de l'annexe I sont censés lancer dès maintenant la réflexion sur leurs futurs engagements, mais cette réflexion perdrait beaucoup de son sens s'ils n'étaient pas rejoints par les autres principaux acteurs. Les pays émergents sont plus ouverts qu'il y a trois ou quatre ans, mais ne sont pas encore prêts à prendre des engagements substantiels, sans même parler d'engagements chiffrés et contraignants. Il ne faudrait donc pas figer aujourd'hui les positions, mais au contraire les faire progresser par un dialogue. Quant aux Etats-Unis, ils affichaient jusqu'à présent un refus total de s'engager dans un quelconque débat sur l'évolution du régime après 2012. Après, donc, une négociation qui fut, comme d'habitude, longue et difficile, et grâce à une implication très active, et qu'il faut saluer, de la présidence canadienne, nous avons obtenu les deux processus parallèles que nous souhaitions : l'un dans le cadre du protocole, afin de définir ce que pourraient être les engagements des pays de l'annexe I, ce qui permet de lancer un signal sur la pérennité du régime après 2012 ; le second, le plus difficile, car il s'inscrit dans le cadre de la convention elle-même et porte sur les actions futures de toutes les parties prenantes, sera un dialogue informel et non contraignant, visant à encourager les pays à prendre des mesures appropriées. Les Etats-Unis, qui avaient déclaré à l'avance qu'ils n'accepteraient rien sur l'après 2012, se sont finalement ralliés au texte, ce qui a permis son adoption. Les pays émergents ont insisté, de leur côté, pour que soit exclu tout processus débouchant sur des engagements contraignants. Le texte, de ce fait, est un peu plus édulcoré, mais c'est à ce prix qu'il a pu être adopté, y compris par l'Inde, longtemps réticente. On peut donc considérer que Montréal est une étape importante. Les mécanismes de Kyoto sont pleinement opérationnels et nous allons pouvoir commencer à définir nos propres engagements dans le cadre du protocole, tout en discutant des efforts que d'autres pourront faire dans le cadre de la convention. Nous insisterons plus particulièrement sur deux points. Le premier est le maintien d'engagements contraignants de réduction des émissions comme élément essentiel du dispositif, afin d'orienter les choix d'investissement. La tonne de carbone non émise, en effet, n'a pas de valeur intrinsèque : sa valeur résulte d'un choix, et ce choix, notamment dans les pays émergents, a besoin d'être stimulé par les contraintes introduites par les engagements relatifs aux émissions. Le second point est la participation la plus large possible, avec l'implication des pays émergents dans une coopération à long terme pour exploiter l'expérience acquise et renforcer les mesures d'aide et d'adaptation à la vulnérabilité. En conclusion, il faut comprendre toute la difficulté de l'action internationale, mais aussi mesurer à quel point la gestion de cette problématique est susceptible de faire progresser l'ensemble de la gouvernance internationale de l'environnement, gouvernance dont le climat sera la locomotive dans les années qui viennent. M. le Président : Monsieur l'ambassadeur, je vous remercie. Je vais maintenant donner la parole à Mme Roussel, puis nous aurons un échange avant les exposés de Mme Boucher et de M. Lambert. Mme Odile ROUSSEL : Je vais donner quelques précisions sur les deux processus parallèles qui viennent d'être lancés à Montréal, ainsi que sur le versant européen de la politique de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre. Le premier processus, dit « processus de l'article 3.9 », s'inscrit dans le cadre du protocole de Kyoto, qui stipulait que la conférence des parties entamerait l'examen des engagements futurs des parties à l'annexe I sept ans au moins avant la fin de la première période d'engagement, soit en 2005. Ces engagements de deuxième période prendront la forme d'amendements à l'annexe B du protocole, relative à la limitation ou à la réduction des émissions en pourcentage des émissions de la période ou année de référence. Ils doivent être adoptés par consensus, et avec le consentement écrit de la partie concernée. Il a été décidé à Montréal que ce processus serait engagé sans délai, dans le cadre d'un groupe ad hoc ouvert qui fera rapport chaque année, devra avoir achevé ses travaux dès que possible, et fonctionnera selon un mécanisme flexible de façon à assurer - c'est très important - la continuité entre le régime actuel et le nouveau régime. Les soumissions des parties devront être adressées avant le 15 mars 2006 et la première réunion du groupe ad hoc aura lieu en mai 2006. Il s'agit d'une décision particulièrement importante, car elle pérennise les mécanismes de flexibilité de Kyoto et démontre la bonne foi et le sérieux des parties de l'annexe I, notamment vis-à-vis des pays en développement. Lors de la négociation, nous avons eu des difficultés de dernière minute avec la Russie, qui a ratifié Kyoto à la fin 2004, permettant ainsi au protocole d'entrer en vigueur, mais dont la position, à ce stade, est quelque peu imprévisible, et dont les demandes ne sont pas toujours aisées à comprendre, ce qui complique les choses. Elle a d'abord souhaité que le processus soit ouvert non pas à toutes les parties, mais seulement aux pays soumis à des engagements contraignants - évinçant donc les « 77 ». Puis elle a renoncé à cette demande et demandé que le groupe ad hoc élabore un processus d'approbation des engagements volontaires des parties. Une explication possible, mais non certaine, de cette demande est que la Russie souhaite relayer les demandes d'anciennes républiques soviétiques qui voudraient voir prises en compte les réductions d'émissions résultant de l'effondrement de leurs industries, et éventuellement pouvoir commercialiser leurs excédents de réduction d'émissions sur le marché du carbone. Elle a renoncé in extremis, en séance plénière, à son amendement, ce qui a permis d'aboutir à un accord, mais c'est une question qui reviendra sûrement dans les mois à venir. Est également prévu, au titre de l'article 9, le réexamen périodique du protocole au regard des nouvelles données scientifiques, techniques, sociales et économiques. Le premier de ces examens périodiques n'interviendra cependant à la prochaine qu'à la conférence des parties, c'est-à-dire fin 2006. Au titre de la convention-cadre elle-même, il a été décidé à Montréal, par toutes les parties à la convention, de lancer un deuxième processus, grâce au ralliement tardif des Etats-Unis au texte négocié par la présidence canadienne avec les autres pays de l'annexe I et les « 77 » - comprenant les pays en développement, y compris les grands pays émergents. L'objectif est d'instaurer un dialogue informel et non contraignant « qui n'ouvrira pas de négociations conduisant à de nouveaux engagements » - cette précision a été ajoutée à la demande des Etats-Unis. Cette décision est très importante, car elle indique clairement qu'il s'agit de préparer un processus multilatéral de négociation. Il s'agit d'encourager et d'aider les Etats à prendre les mesures appropriées pour lutter contre le changement climatique et ses impacts, par exemple en facilitant l'accès des pays en développement aux technologies sobres et à celles permettant l'adaptation. Les soumissions des parties seront adressées avant le 15 avril 2006, et il pourra être organisé jusqu'à quatre ateliers en 2006-2007, ouverts à toutes les parties, sous la houlette de deux facilitateurs, l'un choisi parmi les pays de l'annexe I, l'autre en dehors. Au vu des rapports faits à la conférence des parties de fin 2007, celle-ci décidera de lancer le processus proprement dit. Il s'agit donc, à ce stade, d'un dialogue très informel, qui permet de rallier les pays en développement destinés à devenir de gros émetteurs, tels que la Chine, l'Inde, le Brésil, le Mexique ou l'Afrique du Sud, mais aussi les PMA sensibles à la problématique de la déforestation évitée, voire les Etats-Unis eux-mêmes. L'ancien président Clinton a plaidé, en marge de la conférence, en faveur d'une l'approche qui concilie la démarche top down de Kyoto et une démarche bottom up, de façon à conjuguer les efforts locaux, nationaux et internationaux en matière d'énergies renouvelables ou de nouvelles technologies. Les « engagements » au titre du futur régime pourraient prendre d'autres formes que les engagements actuels au titre du protocole de Kyoto : politiques sectorielles éligibles aux mécanismes de flexibilité et génératrices de crédits d'émission, objectifs chiffrés exprimés en termes relatifs d'intensité énergétique par point de PIB, etc. Les travaux commenceront dès le printemps 2006, à raison de deux ateliers par an en 2006 et 2007. Comme vous le savez, l'Union européenne, de son côté, a commencé d'appliquer le protocole de Kyoto avant même son entrée en vigueur, en adoptant notamment la directive de 2003 sur les dispositifs d'échanges de droits d'émission et celle de 2004 qui permet d'établir un lien entre ce marché et les mécanismes de Kyoto. Selon l'Agence européenne de l'environnement, la tendance observée dans l'Union européenne en matière d'émissions de gaz à effet de serre est plutôt encourageante. En 2002, ces émissions ont en effet diminué de près de 3 % dans l'Union à quinze et de 9 % dans l'Union à vingt-cinq. Malgré une légère inversion conjoncturelle en 2003, année où leur volume a respectivement augmenté de 1,3 % et de 1,5 %, la tendance de fond est à la baisse, et la part de l'Union européenne dans les émissions devrait, de 14 %, descendre à 10 % en 2010. En février 2005, la Commission européenne a publié une communication intitulée « Vaincre le changement climatique planétaire », qui pose les jalons d'une stratégie communautaire en vue de limiter à deux degrés l'élévation de la température moyenne à la surface du globe, sans toutefois définir d'objectifs spécifiques pour l'après 2012. Cette communication souligne l'importance d'un partage équitable des efforts entre tous les acteurs, le niveau d'engagement de chacun devant être fonction de sa contribution aux émissions. Elle recommande que l'Union explore des options de stratégie commune avec les partenaires majeurs avant de décider d'une position pour l'après 2012, plaide pour le maintien des éléments du protocole qui se sont révélés fructueux, et rappelle le principe de « responsabilité commune mais différenciée ». Plus récemment, le débat au sein de l'Union a porté sur la responsabilité d'autres secteurs, notamment ceux des transports aérien et maritime, dans les émissions. Le transport aérien est en effet responsable de la majorité des émissions liées aux transports dans le monde, or l'aviation civile est exclue du système d'échanges de permis de Kyoto. Il est donc question de les inclure dans le système interne à l'Union européenne : la Commission a présenté une communication à ce sujet en septembre 2005, et le Conseil lui a demandé le 2 décembre dernier de présenter avant la fin de 2006 une proposition de révision de la directive « permis ». M. le Président : J'ai une question qui résume sans doute nos interrogations : vous présentez comme encourageants les résultats de Montréal, mais seuls les pays de l'annexe I sont censés lancer leur programme d'action, et les Etats-Unis, quant à eux, ont simplement accepté - ce qui est certes un progrès - de participer à des groupes de travail. Or, huit ans ont passé depuis Kyoto, et il ne reste que sept ans d'ici à 2012. Peut-on vraiment tabler sur une amélioration globale, quand l'accord de Montréal semble concerner un nombre si limité de pays ? M. Denys GAUER : Vous avez bien résumé le problème. Aujourd'hui, seuls les pays de l'annexe I ont accepté des objectifs contraignants, et ces pays ne représentent qu'un peu plus de 30 % des émissions. Les autres, ce sont notamment les Etats-Unis, qui en représentent près de 25 %, et les pays émergents, dont la part est appelée à croître fortement. On voit bien la difficulté : si nous continuons tous seuls dans le cadre participatif actuel, l'exercice perd de son sens. Il faut donc faire monter les autres à bord, d'une façon ou d'une autre. L'élément positif essentiel, c'est l'évolution des pays émergents, comme la Chine, qui ne voulait pas en entendre parler il y a seulement trois ou quatre ans, et qui est désormais plus ouverte. L'Inde a fini, elle aussi, par accepter de s'engager dans le dialogue, malgré un langage encore très traditionnel. Il y a donc une évolution, mais qui ne va tout de même pas jusqu'à accepter des engagements substantiels. Et il y a le problème spécifique des Etats-Unis. S'il fallait décider dès aujourd'hui pour l'après 2012, ce serait évidemment impossible d'associer tout le monde. Ce que nous pouvons espérer, c'est que l'évolution des pays émergents se poursuive, et nous devons encourager cette évolution de façon qu'ils soient prêts à accepter, le moment venu, des engagements plus substantiels. Cela suppose notamment que l'on ait élaboré des mécanismes plus souples que ceux de Kyoto. Et il faut aussi espérer, naturellement, une évolution des Etats-Unis. Nous sommes obligés, donc, de jouer avec le temps, mais ce qui est important, c'est que nous ayons pu lancer à Montréal un processus permettant de débattre et de faire évoluer les positions. Mme Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET, Rapporteure : Je m'interroge sur la formule juridique de la participation des Etats-Unis. Est-ce une formule du type du protocole de Carthagène sur les OGM, où il s'agit de donner seulement son avis ? M. Denys GAUER : C'est assez différent, car ils ne sont pas membre du protocole de Carthagène ni de la convention sur la diversité biologique, et ont seulement une position d'observateur. Mme la Rapporteure : Ils n'ont pas non plus ratifié le protocole de Kyoto, mais ils ont signé la convention de Rio. M. Denys GAUER : Ils ne sont pas dans Kyoto, ils n'y participent même pas comme observateur, mais ils sont partie à la convention. Or c'est dans la convention que figurent les principaux engagements, et c'est dans le cadre de la convention qu'a été prise la décision de lancer un processus de dialogue, auquel ils sont donc pleinement associés. M. Serge POIGNANT : Vous dites que le temps nous est compté, mais 2012 n'est que dans sept ans, ce qui est assez loin. Les Etats-Unis ont les moyens de faire un effort s'ils le veulent, mais les pays en voie de développement ? A-t-on une idée de la part qui sera la leur dans les émissions en 2012, compte tenu de l'évolution de leur production et de leur consommation d'énergie ? Mme Odile ROUSSEL : Si la date de 2012 a été retenue, c'est parce que Kyoto prévoyait un engagement sur la période 2008-2012. Cela paraît loin, en effet, mais c'est plus proche lorsqu'on voit combien les négociations sont difficiles. Celles de Kyoto avaient duré un certain temps. Il ne reste donc pas tant de temps que cela d'ici à 2012. C'est en 2025, je crois, que les émissions des pays émergents devraient dépasser celles des Etats-Unis. Il est donc absolument impératif de les avoir « à bord », sous une forme ou sous une autre, car ils accepteront difficilement de brider leur croissance. Il y aura, espérons-le, un « Kyoto 2 », qui pourrait comporter des engagements contraignants au-delà de 2012, y compris pour les autres pays, et même pour les Etats-Unis s'ils sont d'accord. M. François DOSE : On connaît la position du gouvernement fédéral des Etats-Unis, mais quel est l'état de l'opinion américaine ? Y a-t-il dans le pays un débat qui permettrait d'augurer d'une évolution favorable ? Les Etats-Unis n'attendent-ils pas en fait, pour accepter de s'engager, que leur très substantiel effort de recherche leur ait procuré les technologies adéquates, qu'ils pourront en outre commercialiser ? Quant à l'Union européenne, vous avez fait état d'une certaine inversion de tendance. Y a-t-il lieu, selon vous, de s'en inquiéter ? Est-elle due au fait que les Etats ont relâché leur effort, ou s'explique-t-elle par un phénomène purement mécanique ? M. Denys GAUER : La position officielle des Etats-Unis est ce qu'elle est, mais on observe dans le pays une évolution très intéressante. Selon les sondages, une grande majorité de citoyens considère qu'il faut agir davantage, et il existe une véritable mobilisation au niveau des villes, des Etats, des entreprises. Ainsi, quelque 160 municipalités ont déclaré qu'elles entendaient appliquer le protocole de Kyoto - ce qui n'a certes guère de sens de la part d'une municipalité, mais qui témoigne d'une certaine effervescence de la société. La presse est de plus en plus critique, les ONG sont vigoureuses. Tout cela rend la position du gouvernement central de plus en plus difficilement tenable, et le fait que les Etats-Unis aient accepté de participer au dialogue le prouve. Il faut jouer sur le temps, et se placer dans une perspective où ils rejoindront le processus. Il est vrai aussi que les Etats-Unis comptent beaucoup sur la technologie pour résoudre le problème, et qu'ils dépensent beaucoup d'argent à cette fin. Le « facteur 4 » suppose évidemment une percée technologique majeure, mais le président Chirac , dans son message adressé par vidéo à la conférence de Montréal, a appelé les participants à se méfier de l'illusion technologique, qui peut être un alibi pour l'absence d'action immédiate. Avec les techniques d'aujourd'hui, on peut déjà faire beaucoup de choses. Et même le développement des nouvelles technologies ne se fera pas tout seul : il faut un stimulant, et l'un de ces stimulants possibles est le marché du carbone, marché qui ne peut exister que s'il y a un prix de la tonne non émise. L'Union européenne a connu, c'est vrai, un petit dérapage en 2003. Ce n'est pas encore très grave, et l'objectif de réduire les émissions de 8 % en 2010 reste à portée de main. Mais pour l'atteindre, il nous faudra prendre des mesures supplémentaires dans les prochaines années. Mme Martine LIGNIERES-CASSOU : J'aimerais que nous disposions d'un glossaire et de tableaux, car si nous voulons faire de la pédagogie auprès de nos concitoyens, il est nécessaire que nous y voyions nous-mêmes un peu plus clair dans ces choses complexes. Pour ma part, je trouve le résultat de Montréal très encourageant. Nous étions partis de positions relativement divergentes au sein de l'Union européenne : Tony Blair voulait lâcher du lest aux Etats-Unis, disant qu'on n'obtiendrait rien d'eux par la contrainte. Mais la diplomatie canadienne a prouvé que des efforts convergents pouvaient aboutir positivement. Je vois aussi une sorte de paradoxe dans le fait que le gouvernement américain refuse de s'engager tandis que la société américaine, elle, se mobilise, alors qu'en Europe ce sont les politiques qui s'engagent pour réduire les émissions, alors que la prise de conscience est faible et la société civile quasi absente. M. Philippe ROUAULT : Y a-t-il une corrélation, selon vous, entre la baisse des émissions dans l'Union européenne et l'atonie de la croissance du PIB ? M. Richard CAZENAVE : Je souhaiterais que nous disposions, pour éclairer les enjeux, d'évaluations des différents volumes d'émission selon les divers scénarios, notamment dans l'hypothèse d'un « Kyoto 2 » évoquée par Mme Roussel, ainsi que de la part de chaque pays ou groupe de pays. M. Denys GAUER : Il est vrai que les Canadiens ont été remarquables, à la fois très engagés et très efficaces - et ils ont exercé une pression très forte sur leur voisin du Sud. Le discours du Premier ministre canadien, M. Paul Martin, a surpris par sa netteté, les Etats-Unis ont même fait des remontrances à l'ambassadeur canadien. Au sein de l'Union européenne, la présidence britannique a parfaitement joué le jeu, et tous les pays ont fait front commun, sauf peut-être l'Italie, avec laquelle le dialogue est un peu difficile sur ce sujet depuis plusieurs années. Le résultat, c'est vrai, est très satisfaisant, et même un peu inespéré. Nous craignions de n'obtenir qu'une simple déclaration politique, or les Etats-Unis ont accepté de se joindre à un processus de travail. S'agissant du lien entre l'évolution du PIB et celle des émissions, il est vrai que la croissance est plus forte aux Etats-Unis qu'en Europe, mais cela n'explique pas tout, loin de là. Entre 1990 et 2003, nos émissions ont tout de même baissé de 4 %, malgré la croissance. M. le Président : Et la France, au sein de l'Union européenne ? M. Denys GAUER : C'est l'ensemble de l'Union européenne qui s'est engagée à une baisse de 8 %, la France s'engageant à stabiliser globalement ses émissions en 2010 par rapport à 1990 ; étant donné qu'elle les a stabilisées à ce jour, elle est dans la ligne qu'elle s'est fixée. Mme Odile ROUSSEL : La principale inquiétude que l'on peut avoir tient au secteur des transports, dont les émissions pourraient progresser au point de contrecarrer les efforts accomplis dans les autres secteurs. En revanche, le léger dérapage constaté en 2003 est dû, paradoxalement, au secteur de l'énergie, en raison d'une consommation accrue de charbon par les centrales électriques - pas en France, bien sûr. M. Denys GAUER : On connaît les parts respectives des différents facteurs et des différents pays, ainsi que les tendances, mais il est plus difficile de dessiner des scénarios pour l'avenir, dans la mesure où on commence seulement à négocier sur les engagements. M. Philippe ROUAULT : Certains pays, comme la Suède, la Belgique ou l'Allemagne, ont décrété un moratoire sur le nucléaire. Cela les amènera-t-il à accroître leurs émissions ? M. Denys GAUER : L'objectif général posé par la convention est la stabilisation de la concentration des gaz à effet de serre à un niveau tel que la température moyenne de la planète n'augmente pas de plus de deux degrés en moyenne. Mais pour y arriver, il faudrait diviser par deux les émissions d'ici à 2050. Comme celles des pays en développement sont appelées à augmenter, cela signifier que nous devons diviser les nôtres par quatre, le fameux « facteur 4 ». Toute la difficulté est donc de répartir l'effort entre les uns et les autres. Si l'on voulait assigner aux pays émergents un objectif trop rude, il y aurait un blocage. Le nucléaire est un des éléments de l'équation. L'Allemagne a accepté pour la première phase, une réduction de 20 % des émissions et, avec un renoncement à l'électricité nucléaire, l'équation en est rendue d'autant plus complexe, même si, parallèlement, le pays développe beaucoup les énergies renouvelables. Mais cela relève des choix de chaque Etat. M. le Président : En Suède, le moratoire est de peu d'effet, car il remonte à vingt-cinq ans et les centrales nucléaires tournent toujours. S'il doit en être de même en Allemagne, les effets seront très tardifs. Je donne maintenant la parole à Mme Boucher. Mme Sandrine BOUCHER : Si les grands émetteurs de gaz à effet de serre, responsables du changement climatique, sont très majoritairement les pays industrialisés, que rejoindront dans les décennies à venir les pays émergents, les conséquences de ce changement climatique sont plus à craindre dans les pays en développement et dans les pays les moins avancés en particulier. Les populations de ces pays, parce qu'elles vivent dans des écosystèmes extrêmement fragiles et dans des conditions économiques et sociales déjà pour beaucoup à la limite du supportable, sont les plus vulnérables aux impacts du changement climatique. Les pays du Sud, déjà très largement touchés par les catastrophes naturelles d'origine climatique - cyclones, sécheresses, inondations -, devront également affronter des problèmes de désertification, de stress hydrique, d'élévation du niveau de la mer - certaines îles du Pacifique et de l'Océan Indien sont en train de disparaître, créant ainsi les premiers « éco- réfugiés » -, d'érosion en zone côtière, de réapparition de la malaria et d'autres maladies dans certaines régions, de pertes de rendement de l'agriculture, et probablement des phénomènes climatiques extrêmes plus nombreux. Dans les pays émergents, la priorité est aujourd'hui de promouvoir un développement sobre en carbone : la Chine et l'Inde sont déjà aujourd'hui respectivement les deuxième et cinquième émetteurs mondiaux de gaz à effet de serre, Dans les secteurs du bâtiment, de l'industrie ou de la production d'énergie, il y a de gigantesques gisements d'économies d'énergie. Il s'agit pour ces pays d'un enjeu important du point de vue environnemental, mais aussi du point de vue économique. L'énergie, lorsqu'elle est à base de pétrole, est à la fois une cause essentielle du changement climatique et un enjeu majeur de développement. On a affaire avec le pétrole à une triple contrainte : les réserves vont s'épuiser d'ici cinquante ans environ ; le pétrole est l'un des principaux responsables des émissions de CO2 ; son prix, enfin, est soutenu par la relative faiblesse des réserves et de la demande croissante. Plus largement, cela appelle de notre part une réflexion plus poussée sur le secteur de l'énergie. Un mode de développement trop centré sur les énergies fossiles n'est pas soutenable, car il brûle le capital énergétique de la planète tout en déréglant son climat. Nous serons sans doute contraints d'en changer dans un délai relativement bref : quelques dizaines d'années, et cette conversion suppose le réaménagement de plusieurs secteurs structurants de nos économies, aussi bien dans les pays développés que dans les pays en développement, qu'il est de notre devoir d'aider à faire face au changement climatique, d'autant que nous avons une forte responsabilité historique dans les émissions. Les interventions de la France dans le cadre international s'inscrivent dans plusieurs contextes : celui de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et du protocole de Kyoto, celui du marché européen d'échanges de quotas d'émissions, celui des Objectifs du Millénaire pour le développement et de l'ensemble du dispositif d'aide publique au développement ; celui du G8 de Gleneagles, qui a retenu le changement climatique et l'Afrique comme priorités. Notre action au plan national s'inscrit notamment dans la stratégie « Comité interministériel de la coopération internationale et du développement » (CICID) environnement, ainsi que dans les autres stratégies CICID sectorielles ayant un lien avec le changement climatique, que ce soit en amont ou en aval : eau, santé, agriculture, etc. Elle se traduit aussi par les documents-cadres de partenariat avec les pays dans lesquels nous menons des actions de coopération dans les pays - actions qui, jusqu'à présent, concernaient assez peu l'environnement, et encore moins le climat. Le Plan Climat comporte, par ailleurs, un volet international. Les objectifs sont : promouvoir un développement sobre en carbone, lier la problématique globale aux préoccupations locales, accompagner les populations vulnérables en leur permettant notamment de mieux mesurer le changement climatique et ses effets. Les besoins étant différents selon les pays ou groupes de pays, nos interventions sont également différentes : dans les pays émergents l'accent est mis sur la réduction des émissions, dans les PMA sur les stratégies d'adaptation et les techniques de séquestration de carbone dans les forêts. Il faut cependant éviter que l'effort que nous faisons pour associer les pays en développement à nos inquiétudes sur le changement climatique soit ressenti par eux comme l'imposition d'une contrainte supplémentaire, alors que leur priorité légitime est le développement et l'accès de la population aux biens et services de base. Il s'agit donc d'inscrire nos actions dans la mise en œuvre du développement durable et de la réalisation des Objectifs du Millénaire, qui lient préservation de l'environnement et développement économique et social. En matière de financement, la France est un bailleur de fonds majeur dans le domaine du changement climatique. Au plan multilatéral, nous contribuons aux fonds spécifiques mis en place par la convention-cadre des Nations unies, tel le Fonds pour les pays les moins avancés, ainsi qu'au Fonds pour l'environnement mondial, dont 30% des actions portent sur la lutte contre le changement climatique, et aux organismes « généralistes » comme le Fonds européen de développement, la Banque mondiale, la FAO, le PNUD, les banques régionales de développement etc. Au plan bilatéral, notre participation a représenté, ces dernières années, plus de 150 millions d'euros par an, mis en œuvre de façon complémentaire par les différents acteurs institutionnels. La Direction générale de la coopération internationale et du développement (DGCID) du ministère des affaires étrangères coordonne le volet climat de l'aide publique au développement, définit les stratégies et participe aux initiatives régionales et mondiales. L'Agence française de développement est le principal maître d'œuvre des projets, et a d'ailleurs mis au point des indicateurs d'impact pour évaluer l'efficacité des actions sur le climat. La direction générale du Trésor et de la politique économique (DGTPE) du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie promeut le MDP et met en œuvre l'aide publique au développement dans les pays émergents en valorisant le savoir-faire français. La Mission interministérielle sur l'effet de serre, la MIES, coordonne la politique française en matière de climat. L'Office national sur les effets du réchauffement climatique (ONERC) coordonne les actions sur l'adaptation au changement climatique. L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) apporte son expertise en matière de politique énergétique et d'efficacité énergétique. Le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (CIRAD) et l'Institut de recherche pour le développement (IRD) mettent en œuvre des programmes de recherche. Le ministère de l'écologie et celui de la recherche interviennent également. Un outil spécifique a été créé par la France pour répondre aux problématiques environnementales mondiales. Il s'agit du Fonds français pour l'environnement mondial, le FFEM, qui intervient dans le domaine du changement climatique en finançant des projets innovants, tels que l'amélioration de l'efficacité énergétique dans les bâtiments en Chine - à hauteur de 5 millions d'euros sur la période 2000-2005 -, la conversion de bus au gaz naturel au Mexique - à hauteur de 3,5 millions d'euros sur la période 2001-2007 -, ou encore l'électrification rurale décentralisée au Maroc - à hauteur de 2 millions d'euros sur la période 2001-2005-. A l'avenir, la France aura un engagement supplémentaire à respecter : dans le cadre des « accords de Bonn » en 2001, elle s'est engagée avec les quinze pays de l'Union européenne et cinq autres pays industrialisés à augmenter de 410 millions de dollars au total, dont 40,8 millions de dollars pour la France, les financements pour les actions climatiques dans les pays en développement. L'enjeu majeur de notre coopération sera d'intégrer la problématique du changement climatique dans les politiques sectorielles nationales et dans les projets de développement associés, afin d'obtenir la meilleure appropriation de cette problématique par l'ensemble des acteurs. Pour chaque projet que nous mettons en œuvre, nous devrons à la fois nous assurer de sa résilience aux effets du changement climatique et faire en sorte qu'il émette le moins de gaz à effet de serre possible. En particulier, nous devrons rechercher une plus grande synergie avec nos programmes sur l'eau, la forêt et la désertification. Enfin, l'« échange dette-nature » peut être une piste intéressante pour mobiliser de nouveaux financements pour la lutte contre les changements climatiques, en complément de l'APD « traditionnelle » et du MDP. M. le Président : Je vous remercie. Notre collègue Claude Birraux et moi-même avions été chargés, il y a cinq ans, d'une mission sur les énergies renouvelables. Quand nous avions demandé au ministre de la coopération, Charles Josselin, le montant de l'effort bilatéral de la France dans le domaine de l'énergie, il avait fait état d'une somme équivalant à 500 000 euros par an. Mais il avait insisté sur le fait que ce n'était pas la demande première de nos partenaires, avant tout intéressés, et c'est normal, par la question de la santé et par celle de l'autosuffisance alimentaire. Aujourd'hui, la priorité des PMA va moins à l'atténuation qu'à l'adaptation et à la lutte contre la déforestation. Ma question est la suivante : ne craignez-vous pas que, si on ne développe pas les énergies renouvelables dans les pays du Sud, ils fassent une consommation accrue d'énergies fossiles ? En d'autres termes, allons-nous droit vers la catastrophe annoncée ? Par ailleurs, je trouve, à la lecture du tableau qui nous a été fourni, que les aides de la France semblent très disparates, et qu'on n'en mesure pas bien les effets, alors même que certaines actions bilatérales représentent un effort financier considérable. M. Richard CAZENAVE : Certaines actions menées sont remarquables. J'ai vu, par exemple, un reportage à la télévision sur des immeubles économes en énergie en Chine. A Madagascar, en revanche, on continue de brûler des arbres pour faire chauffer les aliments. Il faut mettre l'accent sur les transferts de technologie. Mme Sandrine BOUCHER : D'une façon générale, ce sont des problèmes que nos partenaires n'abordent pas spontanément. Par ailleurs, nous sommes dans une logique de concentration de l'aide, de façon à en améliorer l'efficacité et la lisibilité. Nous avons donc engagé le dialogue avec ces pays, en essayant de sélectionner les secteurs d'intervention qui leur semblent les plus judicieux - mais il est vrai que la pesanteur joue en faveur des secteurs traditionnels, et nous sommes bien conscients de cette faiblesse. Nous nous efforçons donc de mettre en œuvre une politique de sensibilisation, d'appropriation de cette thématique par les postes et les agents locaux, et aussi de formation de nos partenaires. Nous avons également mené des actions emblématiques, non pas à l'échelle d'un pays, mais d'une région - le bassin du Congo, par exemple, dont Nicolas Lambert pourrait vous parler - , avec un impact important et un effet d'exemplarité. M. Denys GAUER : A côté de l'aide publique au développement, qui permet de soutenir des projets spécifiques - entre autres dans le domaine des énergies renouvelables - et la création de capacités, il y a maintenant le MDP, le mécanisme de développement propre, qui intéresse énormément les pays du Sud car il s'agit à la fois d'investissements considérables et de transferts de technologie. Mais dans la mesure même où c'est de l'investissement, il bénéficie surtout aux pays émergents, comme la Chine, l'Inde, le Brésil ou la Colombie, et presque pas aux PMA, notamment africains. Il y a donc un gros effort à faire pour qu'ils accèdent au MDP. Les forêts du bassin du Congo sont un bon exemple d'action spécifique. Malgré les demandes des pays africains, les forêts n'avaient pas été prises en compte à Kyoto. En février 2005 s'est réuni à Brazzaville un sommet des chefs d'Etat et de gouvernement de la région, avec la participation du président Chirac. Un partenariat a été mis en place, et les Etats-Unis ont joué le rôle de facilitateur pendant les deux premières années, la France lui succédant au début de cette année. Nous avons constitué un groupe de travail pour imaginer des financements innovants, prenant en compte la déforestation évitée, et pour intégrer celle-ci dans la prochaine phase de Kyoto. M. Nicolas LAMBERT : Si l'on ne faisait pas grand-chose il y a cinq ans pour les énergies renouvelables, c'est parce que, dans les années 1990, le dogme était qu'en matière d'énergie, il fallait laisser faire le marché. Aujourd'hui, on en est revenu, et nous dépensons 130 millions d'euros par an pour l'énergie, dont 30 millions pour les énergies renouvelables. M. le Président : Oui, mais quelle a été l'évolution de ces sommes sur sept ou huit ans, et à quels projets précis ont-elles été consacrées ? On s'aperçoit parfois que cela n'a pas contribué à réduire les émissions. M. Nicolas LAMBERT : En effet, le but de l'aide au développement, jusqu'à présent, n'a pas été la réduction des émissions, mais l'accès à l'énergie, car nous n'avons pas le droit d'interdire à ces pays les énergies fossiles ou de leur imposer tel ou tel autre type d'énergie. Notre approche est une approche d'adaptation aux besoins, de valorisation des énergies locales, souvent renouvelables au demeurant, mais non pas d'interdiction des énergies fossiles. Mme la Rapporteure : Je pensais, au départ, que les pays du Sud seraient les plus fortement « impactés » par le changement climatique. En fait, il ressort des précédentes auditions auxquelles nous avons procédé que les zones tempérées le seraient davantage, notamment celles du pourtour de la Méditerranée. Or, vous nous dites que ce sont bien les pays du Sud qui sont les plus vulnérables. Est-ce une simple question de vocabulaire, dans la mesure où leurs structures les rendent plus vulnérables à un choc même moindre, ou y a-t-il un vrai débat sur le point de savoir qui sera la première cible du changement climatique ? M. Nicolas LAMBERT : De fait, vulnérable et « impacté » ne sont pas forcément synonymes. Les pays en développement ont une capacité d'adaptation économique très faible, et peuvent donc être plus vulnérables que nous à un impact qui serait pourtant plus faible. Et il y a des zones d'autant plus vulnérables que les conditions de vie sont déjà précaires, et où un tout petit changement suffirait pour qu'elles deviennent catastrophiques. M. le Président : Mesdames, messieurs, je vous remercie. Audition de Mme Corinne LEPAGE, ancien ministre Présidence de M Jean-Yves LE DEAUT, Président M. le Président : Madame, vous avez été ministre de l'environnement et vous suivez depuis longtemps les problèmes qui y sont liés. Vous avez décrété l'urgence écologique. Quelles sont, selon vous, les nouvelles priorités publiques ? Quels sont les moyens d'action à privilégier ? Comment les hiérarchiser ? Mme Corinne LEPAGE : Ainsi que la conférence de Montréal l'a encore une fois montré, il existe une discordance entre des connaissances scientifiques de plus en plus précises, et de plus en plus alarmantes, et notre très grande difficulté à remettre en cause des choix économiques dictés par l'urgence. Ces choix ne nous permettent pas de nous préparer à ce qui nous attend, et ce à deux niveaux : au niveau de la lutte contre les changements climatiques et au niveau de l'adaptation contre les changements climatiques. J'avais eu l'occasion d'aborder ce sujet il y a deux ou trois ans, lorsque j'avais été auditionnée par une précédente mission qui étudiait le changement climatique. M. le Président : Elle était menée par le sénateur Marcel Deneux. Mme Corinne LEPAGE : La difficulté est évidemment de savoir à quoi s'adapter : au chaud ou au froid ? Sommes-nous menacés par la disparition du Gulf Stream ou par un réchauffement de quatre degrés ? Cela nous oblige à avoir une vision assez ouverte des choses. Nous pouvons travailler sur tout ce qui concerne l'endiguement et le littoral, en prévision d'une remontée des eaux. Nous savons à peu près à quoi nous en tenir dans les zones septentrionale et méditerranéenne. Je précise que notre pays a connu une augmentation de la température de 1,2 degré au cours des cinquante dernières années, ce qui est bien supérieur à ce qui s'est passé en moyenne sur la planète auparavant. Tout cela mérite une étude de fond. Greenpeace vient d'en publier une très intéressante à ce sujet. En 1995, en tant que ministre de l'environnement, j'avais lancé une étude sur l'impact du changement climatique en France, à l'instar de ce qu'avait fait l'Angleterre. Je m'étais alors heurtée à une hostilité amusée. Malgré tout, cette étude a été menée à bien et elle est sortie en 1999 et en 2000, dans le cadre de la mission « effet de serre », sous la plume de Michel Mousel. Mme Nathalie KOZCIUSCO-MORIZET, Rapporteure : Nous n'avons pas cette étude. Nous avons une version provisoire du rapport de l'ONERC, actuellement en cours de rédaction. Mme Corinne LEPAGE : Il existe deux rapports Mousel, de 1999 et de 2000, qui sont disponibles à la Documentation française. Je n'imagine pas que l'on puisse mener aujourd'hui des politiques d'aménagement du territoire sans faire de l'adaptation au changement climatique une priorité. S'agissant de la lutte contre l'effet de serre, je suis très sensible aux propositions que fait l'association Negawatt. Au-delà de son aspect anti-nucléaire qu'on n'est pas obligé de cautionner, le scénario Negawatt est très intéressant : il permet de parvenir à l'objectif qui est de diviser par quatre nos émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050 - cela s'apparente à une véritable révolution industrielle - en gageant 50 % de l'effort par des watts économisés. Il est très important de revisiter complètement l'économie au regard de ces nouvelles priorités et de planifier le type de recherche développement à encourager, le type d'industries à favoriser ou à accompagner dans leur évolution. Il convient de travailler sur un secteur majeur, celui de l'habitat, qui est probablement l'un de ceux grâce auxquels on peut faire le plus d'économies en créant le plus d'emplois. Restent la question du transport et celle des entreprises fournissant des énergies nouvelles et les produits qui vont avec. Personnellement, je suis très sensible au scénario de Lester Brown. Je vous conseille son ouvrage sur l'« écoéconomie ». Il est extrêmement intéressant, dans la mesure où il montre bien la direction dans laquelle il faut aller et le nouveau mariage économie-écologie auquel il faut parvenir - l'écologie étant entendue au sens d'écosystème. Selon Lester Brown, aujourd'hui, le système, c'est l'économie, et le sous-système, c'est la ressource : au lieu de se poser la question de la ressource en aval du choix économique, il faut changer de paradigme et se poser, dès le départ, la question de la ressource disponible, avant d'effectuer les choix économiques. Cela suppose une véritable révolution, avec des industries et des métiers qui disparaissent et d'autres qui apparaissent. Cet ouvrage donne d'ailleurs des listes de nouvelles industries et de nouveaux métiers, comme les spécialistes de météo pour les éoliennes. Un tel exemple, qui peut paraître anecdotique, illustre cette nouvelle manière de penser. Comment la France va-t-elle pouvoir faire évoluer son économie, alors que nous sommes confrontés à des problèmes de désindustrialisation et de délocalisation, et que nous nous demandons ce que nos enfants feront demain pour vivre ? Il se trouve que l'écotechnologie constitue un secteur de développement formidable. Malheureusement, nous n'arrivons pas à développer correctement ce secteur. C'est un thème sur lequel je travaille d'ailleurs, en parallèle, avec le Centre des jeunes dirigeants d'entreprise. Et cela se vérifie dans tous les domaines : les déchets ou les énergies renouvelables, qu'il s'agisse de l'éolien ou du photovoltaïque. Samedi dernier, le journal Libération traitait de la façon dont l'Allemagne avait utilisé le secteur des énergies renouvelables pour relancer les industries, au point que, dans cinq ans, l'éolien serait rentable sans subventions. L'Allemagne est devenue aujourd'hui, de fait, un des leaders mondiaux sur le marché de l'éolien. Elle est en train de faire de même s'agissant de l'énergie solaire. Dans ces domaines-là comme dans les autres, on sait que les premiers arrivés seront les premiers servis. Ce sont les entreprises qui seront les premières capables de se positionner sur un marché en tant que leaders qui seront à même de développer le marché en question, lequel ne cessera de croître. La Chine s'est donné comme objectif de produire 10 % d'énergie renouvelable hors hydraulique en cinq ans. C'est colossal, même si leur régime autoritaire leur permet sans doute de faire ce que nos pays démocratiques ne peuvent pas faire. Nous qui vendons des centrales nucléaires à la Chine, nous pourrions lui vendre de l'éolien ou du solaire. Malheureusement, il y a peu d'entreprises sur le marché français, et comme il n'y a pas eu de commandes publiques pendant des années, celles qui existent vivent de l'export. Nos choix publics et notre industrie se trouvent donc « réinterrogés » par cette priorité. Cela dit, il est très stimulant de pouvoir en retirer un avantage à la fois écologique et économique. L'ennui, c'est que nous avons du retard. Saurons-nous le combler ? Je m'interroge sur ce que font les Américains. Nous sommes sans doute nombreux à penser la même chose de la position du président Bush vis-à-vis du changement climatique. Mais la politique américaine ne se résume pas à la politique de Bush. Autrement dit, qu'en est-il des investissements colossaux qui sont faits sur les nouvelles technologies, et pas seulement l'hydrogène ? Qu'en est-il des réglementations mises en place au niveau des États fédérés ? Une quinzaine d'États se sont en effet engagés dans cette voie. Ne serions-nous pas, en Europe, trop axés sur la réglementation, même s'il en faut, et pas assez sur l'investissement dans les technologies disponibles ? M. Le Président : La problématique que vous avez posée est très intéressante. L'objectif que l'on s'est donné, d'ici à 2050, est de diviser par quatre nos émissions de gaz à effet de serre. Selon vous, si j'ai bien compris, la moitié de ce résultat pourrait être obtenue grâce aux énergies renouvelables et l'autre moitié grâce à des économies ? Mme Corinne LEPAGE : Entre 40 et 60 % de chaque, monsieur le Président. Il faudrait d'ailleurs que vous auditionniez les représentants du réseau Negawatt, car ils sont très intéressants. M. le Président : C'est prévu. Étant donné le nombre de TEP qui sont consommés aujourd'hui dans notre pays, il nous faudrait réduire notre consommations d'environ 150 millions de TEP : 60 à 75 millions grâce aux énergies renouvelables et autant grâce à des économies. Dans notre rapport, Claude Birraux et moi-même avions parlé de 10 millions de TEP pour la biomasse, et autant pour toutes les autres formes d'énergies renouvelables, notamment le solaire thermique. Or certains chercheurs avaient dit que c'était impossible. Et maintenant on parle de trois ou quatre fois plus ! Comment y parvenir ? Vous avez raison de dire que l'habitat est le secteur sur lequel il faut agir. On dépensait 300 kWh par mètre carré il y a vingt ans. Aujourd'hui, la moyenne est de 80 ou de 100, même si, dans des maisons expérimentales, on arrive à descendre à 10. Les efforts à faire sont donc fantastiques. Malheureusement, le processus est très lent : 1 % seulement du parc neuf est concerné chaque année ! Il faudrait également travailler sur l'habitat ancien. A-t-on des solutions techniques pour y parvenir ? Je crois qu'il nous faudra organiser une table ronde sur ce sujet majeur. Mais pouvez-vous déjà nous répondre ? Mme Corinne LEPAGE : On peut imaginer que certaines découvertes vont nous y aider. Mais si l'on regarde simplement ce qui se fait déjà en Allemagne ou en Espagne dans le domaine de l'habitat, des améliorations considérables sont possibles. S'agissant de l'habitat, je distingue le dedans du dehors. Le dedans, c'est tout l'appareillage. A ce propos, savez-vous que la France dépense pour la chaîne du froid deux fois ce qu'elle dépense en énergie pour faire rouler les trains ? Les chiffres sont de l'ordre de 17 à 18 terawatts. Actuellement, entre les frigos économiques et ceux qui ne le sont pas, il peut y avoir une différence de consommation allant de 1 à 20 ! S'agissant de l'habitat ancien, on peut distinguer l'individuel et le collectif. Dans l'individuel, on peut prévoir des chauffe-eau solaires, du chauffage au bois. C'est ainsi que l'Alsace a lancé un programme de chauffage au bois. La région subventionnera les habitants qui changeront leur mode de chauffage. Mieux vaut créer un fonds qui permettra aux gens de faire des emprunts à taux zéro pour changer de mode de chauffage, d'autant que cela fait marcher le système économique dans son ensemble, plutôt que de verser une subvention couvrant le surcoût du fuel. Il y a une réflexion de fond à mener sur la fiscalité, sur ce qui est subventionné et sur ce qui ne l'est pas. La situation se présente différemment pour l'habitat collectif. Au-delà de l'isolation thermique, il y est plus difficile de faire des économies. Mais c'est encore possible, en jouant sur les matériaux, en façade notamment. Aujourd'hui, il existe des systèmes de « bacs acier » qui sont des systèmes photovoltaïques intégrés. Bien sûr, il faut payer l'installation, mais le temps de retour de l'investissement n'est que de quinze ans, au lieu d'un siècle et demi auparavant ! On pourrait déjà faire le point sur les bonnes pratiques disponibles un peu partout dans le monde, d'où l'intérêt d'organiser une table ronde. On pourrait aider les entreprises françaises à se lancer dans telle ou telle direction, ou aider des entreprises étrangères à créer des succursales chez nous. Malgré tout, cela pose une question à laquelle, monsieur le Président, vous ne serez pas insensible : celle de la centralisation ou de la décentralisation de la production électrique. On ne pourra pas l'éviter. Si on s'engage vers un modèle de production décentralisée, avec du photovoltaïque et des maisons à énergie positive, notre organisation sociale de la fourniture d'énergie sera remise en cause. M. le Président : J'ai été président de l'OPAC il y a quatre ans. J'ai inauguré vendredi un groupe de logements sociaux à Auboué. Grâce à des capteurs solaires, on va pouvoir économiser 36 % en chauffage et 50 % en eau chaude. Mais le prix est élevé : 1 730 euros par mètre carré de logement - et il y a 60 000 mètres carrés - plus un surcoût de 300 euros le mètre carré pour le bioclimatique. Ces réalisations, qui existent également dans l'Aude, la Savoie ou l'Isère, constituent malgré tout un début de réponse en matière de logement. Mme la Rapporteure : Au début de votre propos, vous avez parlé d'adaptation. Vous avez souligné la difficulté qu'il y avait à s'adapter, dans la mesure où l'on ne savait pas bien à quoi il faudrait s'adapter. Puis, très vite, vous êtes passée à l'atténuation - j'entends par là la lutte proprement dite contre l'effet de serre - . Depuis la création de cette mission, d'ailleurs, nous faisons des allers et retours constants entre la logique de l'adaptation et celle de l'atténuation. Considérez-vous que l'atténuation doive constituer l'essentiel de notre politique sur le sujet, tandis que l'adaptation serait ce qu'on ferait en plus ? Il nous faudrait trouver les investissements d'atténuation nous permettant, pendant un temps, de nous adapter. Ou bien considérez-vous plutôt que l'adaptation doive faire l'objet d'une politique spécifique ? Dans ce cas-là, dites-nous ce que vous y mettriez. Mme Corinne LEPAGE : Je crois que nous sommes malheureusement contraints de faire les deux. Le changement climatique est là. Nous n'avons pas besoin de chercher si nous devons nous y adapter, nous y sommes obligés. Le rapport auquel je faisais allusion, et qui date déjà de six ans, montrait les adaptations nécessaires s'agissant des types de céréales : certaines bénéficient d'une augmentation de la température et d'autres non. Il nous faut absolument travailler et avancer sur des points aussi simples que celui-là. S'agissant de l'adaptation, il faut examiner plusieurs domaines, qui seront influencés par le changement climatique : l'agriculture, le tourisme, la santé. La santé sera doublement « impactée » : par des phénomènes comme celui de la canicule, dont le scénario figurait d'ailleurs dans le rapport de 1999, et par des maladies nouvelles apparaissant dans nos régions tempérées : malaria, dengue, maladies liées aux moustiques. Mais l'aménagement du territoire sera lui aussi concerné. Aujourd'hui, la France travaille beaucoup sur les risques liés aux inondations. En cas de remontée des eaux, les scénarios envisagés risquent de devenir beaucoup plus graves. Imaginez une ville ancienne, en zone inondable à 80 %, imaginez les grandes villes du littoral, etc. Toute la politique d'aménagement du territoire, notamment en matière de grandes infrastructures, va se trouver remise en cause. Plus vite on s'y emploiera, mieux ce sera. Il faut éviter de faire des choix contreproductifs, tout en sachant que tout retard à mettre en place des politiques publiques sera coûteux. L'Agence européenne de l'environnement avait fait mention, dans un de ses rapports, d'une étude menée aux Pays-Bas. Ceux-ci avaient calculé ce que leur avait coûté un retard de trente ans dans l'interdiction de l'amiante, soit 19 milliards d'euros, entre les frais de construction et de déconstruction, et les frais de sécurité sociale. Il nous faut donc prendre l'habitude d'intégrer ce type de considérations dans l'évaluation des politiques publiques. Les questions économiques sont essentielles. M. Le Déaut parlait tout à l'heure d'un surcoût de près de 20 % pour le bioclimatique. Cela peut paraître cher. Mais dans cinq ou dix ans, lorsqu'on paiera la tonne de carbone rejetée - et on sera bien obligés d'y venir -, on s'apercevra des économies ainsi réalisées. Nous sommes dans une période difficile : nous ne disposons pas de tous les outils économiques ; ce n'est pas dans notre culture et nous manquons de paramètres. Enfin, je répondrais à Mme la Rapporteure que les deux aspects - adaptation et atténuation - sont absolument indispensables l'un et l'autre. M. Richard CAZENAVE : On nous a dit que les percées technologiques étaient incluses dans l'objectif fixé pour 2050, mais qu'il ne fallait pas céder à l'illusion technologique. J'ai entendu aussi que nous étions tournés plutôt vers les réglementations, alors que les Américains faisaient des investissements en écotechnologie. Il y a certainement des modèles qui nous permettent d'intégrer dans l'objectif un certain pourcentage de résultats que la technologie va produire. On dispose, pour cela, de l'observation du passé : une automobile aujourd'hui consomme et produit beaucoup moins de rejets qu'il y a quinze ans. Est-ce que, dans l'objectif « facteur 4 - 2050 », on a intégré les progrès potentiels en matière de technologie ? Et si oui, à quelle hauteur ? M. Christian DECOCQ : Est-ce que notre grand programme national de rénovation urbaine prend en compte, outre l'isolation thermique, les réflexions menées sur les structures ? On parle toujours d'une maison bien étanche où il n'y aurait pas de perte d'énergie. Moi qui ai une maison, je chauffe le cubage d'air et pas les murs ! On parle également de chauffage au bois. Mais on sait déjà faire et résoudre les problèmes qui se posent, comme au Danemark ou en Suède. Le problème, c'est que personne ne croit en rien, pas même à la catastrophe annoncée ! Je suis un peu surpris d'apprendre qu'on fait beaucoup de réglementation et peu d'incitation. Depuis quarante ans, au contraire, j'ai l'impression qu'on fait beaucoup d'incitation. Prenez la loi sur l'eau, par exemple : nos codes contenaient déjà tout un ensemble de dispositifs qui auraient pu suffire. Mais on s'était aperçus que le réglementaire ne fonctionnait pas assez bien, et qu'il fallait passer à l'incitatif. C'est très bien, mais expliquez moi comment, aujourd'hui, on va empêcher, par la seule incitation, les semi-remorques de 35 tonnes de circuler sur l'autoroute A1 pour transporter, depuis le centre de la France jusqu'aux pays nordiques, des billes de bois ? Il faudrait qu'on se penche sur de tels problèmes. M. Jean-Pierre NICOLAS : Vous avez constaté une certaine discordance entre les connaissances et la remise en cause des choix économiques. Je pense en effet qu'on est là au cœur du problème. Vous avez parlé du mariage de l'économie et de l'écologie et cité des secteurs où il faudrait être pugnaces et performants, en particulier l'habitat et les transports. S'agissant de l'habitat, on a parlé du chauffage au bois. Vous avez par ailleurs dit qu'il fallait partir de la ressource. J'ai participé à des campagnes de chauffage au bois et je ne suis pas sûr que le parc forestier français, voire européen, soit à même de répondre à l'engouement que peut susciter le chauffage au bois. On arrivera en effet assez rapidement à une dérive des prix qui rendra ce mode de chauffage économiquement dissuasif. S'agissant de l'éolien, je souhaite que votre optimisme se concrétise. On pouvait espérer que les panneaux solaires permettraient d'économiser de l'énergie, mais les propos du président Le Déaut nous ont un peu « douchés » en raison du surcoût qu'ils entraînent. La raison est peut-être qu'on n'en est qu'à l'expérimentation. M. le Président : Ces surcoûts avaient été intégrés et acceptés. M. François DOSÉ : Je suis favorable à toutes ces innovations, mais il convient de rester réaliste. Des initiatives formidables ont été lancées dans le domaine du chauffage au bois. Mais une compétition a surgi entre les papeteries et ceux qui achètent le bois de chauffage. Résultat : le prix du bois est en train de monter et le retour sur investissement n'est pas tout à fait celui qu'on avait imaginé. Il faudra donc être vigilant. M. Alain GEST : La question posée par le Président, tout à l'heure, sur notre capacité ou non à baisser notre consommation de 150 millions de TEP, est fondamentale. Croyez-vous vraiment qu'il soit pertinent de se donner un tel objectif, compte tenu de l'ensemble du dispositif que vous avez évoqué en partie, de l'évolution technologique et de l'adaptation économique ? Les prévisions sur l'éolien font l'objet d'appréciations pour le moins divergentes. Ces données sont-elles compatibles avec l'enjeu que vous avez vous-même défini ? Mme Corinne LEPAGE : A votre question sur la pertinence de l'objectif, je répondrai par une autre question : a-t-on vraiment le choix ? La réponse est non. Entre ce qu'on nous disait en 1996, en 2001, et ce qu'on prévoit pour 2007, il y a de quoi s'affoler. Si on pouvait se donner un objectif plus ambitieux, il faudrait le faire. Je pars de l'idée qu'il faut faire le maximum pour éviter la catastrophe, sans savoir d'ailleurs si on parviendra à l'éviter. S'agissant des énergies renouvelables, nous avons un problème de représentation intellectuelle. La culture du XXe siècle a été une culture du progrès technique et technologique, symbolisée par de grandes installations. Avec l'air, le soleil, le vent, on a le sentiment qu'on en revient au moulin à vent. On a beaucoup de mal à admettre que la technologie qui leur est attachée puisse être sophistiquée. Nous avons donc un effort à faire en termes de représentation de la modernité et du progrès technologique. Bien sûr, certains chiffres divergent. Mais nous avons besoin de tout. Et si nous décidons que nous allons mettre en recherche-développement et en investissements tout ce que nous sommes capables de mobiliser pour ITER, nous trouverons des solutions. C'est une question de volonté. Cela dépend également de la façon dont nous « flécherons » les crédits dont nous disposons et dont nous travaillerons avec le privé pour orienter les investissements dans un sens ou dans un autre. Monsieur Nicolas, les élus des communes forestières se plaignent beaucoup de la sous-utilisation du bois français. Ils se plaignent d'être concurrencés, dans le domaine, non du chauffage mais du matériau bois, par les pays du nord de l'Europe, qui pratiquent des prix plus compétitifs. Je pense que nous avons un effort à faire dans ce secteur. Cela étant, mesdames et messieurs les députés, vous avez voté en 1996 une loi sur l'air et sur l'économie rationnelle de l'énergie. Cette loi prévoyait, entre autres, une mesure qui concernait les conduits de cheminée, de manière à permettre de choisir un autre moyen de chauffage que le chauffage électrique dans les habitations, et une mesure qui concernait le bois. Les décrets d'application sont sortis ces jours-ci. Il aura fallu neuf ans ! De la même manière, dans la loi du 13 juillet 2005 sur l'énergie, le Parlement a revoté des dispositions qui n'avaient jamais été appliquées, notamment depuis la loi de 1996 sur l'affichage des consommations énergétiques. S'il faut voter plusieurs fois la même loi. Monsieur Decocq, je ne voudrais pas qu'on se méprenne. Quand j'ai comparé le système européen et le système américain, ce n'était pas pour en conclure qu'il fallait ne faire que de l'incitation. Je pense que nous avons besoin plus que jamais de l'État et de nous appuyer sur la réglementation et la fiscalité. Mais nous avons un peu trop tendance à penser que la réglementation sera forcément respectée. En revanche, les Américains ont davantage tendance à privilégier une approche technique et financière, en pensant que le reste suivra, ce qui n'est pas non plus le cas. Au niveau français et européen, la réglementation concernant le changement climatique est probablement ce qui se fait de mieux. Mais l'investissement et la commande publique n'ont pas suivi. D'où un certain déséquilibre. S'agissant de la loi sur la rénovation urbaine, je n'ai pas le sentiment qu'elle prenne en considération les sujets que vous évoquiez. Monsieur Cazenave, dans mon esprit, le saut technologique, c'est la cerise sur le gâteau, la bonne surprise qu'on espère mais sur laquelle il ne faut pas compter. Autrement dit, les objectifs que nous devons nous fixer et les manières d'y parvenir doivent s'appuyer sur l'existant. Si déjà, nous étions capables de faire en France ce que l'Allemagne et l'Espagne, voire les pays du Sud et du Nord, sont en train de faire, nous aboutirions à des transformations très importantes. Ce qui est très intéressant dans le réseau Negawatt, c'est précisément qu'il travaille à partir des technologies existantes, faisant le benchmarking de tout ce qui se fait de mieux dans les différents domaines. Il est évident que si nous mettons tous nos œufs dans le même panier et que nous n'investissons pas dans ces secteurs, nous ne réussirons pas. M. le Président : Merci de vos réponses claires et volontaristes. Audition de M. Yves COCHET, ancien ministre, député Présidence de M. Jean-Yves LE DEAUT, Président M. le Président : Mon cher collègue, merci de votre présence. Vous avez démontré dans un récent ouvrage intitulé Pétrole Apocalypse que se dessine un nouveau choc pétrolier. Quelles conséquences en tirez-vous ? Quels liens établissez-vous avec les mesures à mettre en œuvre contre le réchauffement climatique ? Sera-t-on condamné à changer de comportement, au point de ne plus prendre l'avion ? M. Yves COCHET : Avant de vous donner mon opinion sur l'effet de serre et tout ce qui touche au cycle du carbone, je tiens à vous citer quelques lignes de la préface d'un ouvrage écrit collectivement en 1974, notamment par René Dumont, au moment de la campagne présidentielle, et qui s'intitulait A vous de choisir : « Par l'épuisement des réserves minérales et pétrolières, par la dégradation poussée des sols, l'érosion, le lessivage, la latérisation, par la pollution insoutenable de l'air et des eaux, des rivières aux littoraux marins, enfin par une altération des climats dus à l'accumulation du gaz carbonique ou à l'attaque de la précieuse couche d'ozone. » : voici ce qui était écrit aux pages 7 et 8 de cet ouvrage. Je précise que, lorsque nous avons fait campagne sur ces points-là, à droite comme à gauche la risée était générale et personne ne nous prenait au sérieux. Maintenant, la situation est devenue beaucoup plus sérieuse et les gens n'évitent plus la discussion. S'agissant des gaz à effet de serre, vous avez sans doute eu beaucoup d'informations de type factuel, scientifique et phénoménologique. Je vais en tirer une dizaine de caractéristiques. Premièrement, il est désormais avéré que les activités humaines ont modifié la composition de l'atmosphère depuis deux siècles. L'origine de ce qu'on appelle le changement climatique, et que j'appelle plus volontiers le chaos climatique, est donc essentiellement anthropique, malgré un déni qui a duré des dizaines d'années. Deuxièmement, ce ne sont pas des moyennes qu'il faut parler. Ce qui est catastrophique, politiquement, financièrement et économiquement inquiétant, et humainement ravageur, ce sont les événements extrêmes. Bien sûr, on peut toujours dire qu'il ne faudrait pas dépasser deux degrés centigrades de plus en un siècle ; mais ce qui fait du mal, ce sont les inondations de l'Elbe de l'été 2002, la canicule et la crue centennale du Rhône de l'été 2003, etc. Troisièmement, c'est une situation globale, planétaire, mondiale et mondialisée. Le taux de CO2 est quasiment uniforme dans l'atmosphère, quel que soit le lieu de l'émission. Il est possible que les molécules émises à Paris se retrouvent dans six mois au-dessus de l'Antarctique. C'est un problème mondial dans la mesure où il existe des milliards d'émetteurs, et mondialisé parce que les préoccupations et la réponse sont politiquement globales. Remarquez que le problème de l'eau est un problème mondial, mais qu'il n'est pas du tout mondialisé : la réponse à un tel problème est différente à Paris, à Marseille ou en Mésopotamie. Quatrièmement, les évolutions climatiques sont rapides, elles s'accélèrent, et ce de manière non linéaire : des effets de rétroaction positive ou des effets de seuil sont possibles. Par exemple, l'océan se réchauffe un tout petit peu depuis le XIXe siècle, mais l'on sait que les océans chauds absorbent moins le CO2 que les océans froids. Il en est de même de la fonte des glaces, qui sont plutôt réfléchissantes, tandis que l'eau absorbe plus qu'elle ne réfléchit. Cinquièmement, cette perturbation climatique perturbe tous les grands cycles géobiophysiques : non seulement le cycle du carbone, mais aussi le cycle de l'azote, celui de l'eau et le cycle biophysique animal et végétal. La perturbation entraînée par les émissions exagérées de gaz à effet de serre a donc un caractère systémique. Sixièmement, la plupart de ces perturbations sont irréversibles, imprévisibles et non maîtrisables. Septièmement, la composition de l'atmosphère n'est pas directement perceptible par nos sens. C'est pourquoi nous avons le plus grand mal à l'intégrer dans notre vie quotidienne. En matière de chaos climatique, il faut une intermédiation scientifique pour saisir la réalité biophysique. Huitièmement, cette crise climatique est objective et ne résulte pas d'un conflit d'intérêts entre groupes humains. La composition de l'atmosphère, grâce à l'intermédiation scientifique, se mesure et on n'a pas à en discuter : il y a plus de gaz carbonique qu'il n'y en avait il y a deux siècles et demi. Alors qu'on pourrait discuter du bon taux directeur de la Banque centrale européenne. Neuvièmement, il n'y a pas pour l'instant d'instance de régulation mondiale forte. Il n'y a pas d'organisation mondiale de l'environnement, dont le statut juridique et la force politique seraient comparables à ceux de l'OMC. Dixièmement : les neuf caractéristiques précédentes sont nouvelles. La situation climatique est inédite du point de vue de l'humanité. Jamais nous n'avons eu à affronter une telle situation planétaire. Venons-en aux conclusions de la Conférence de Montréal, qui a duré quinze jours et s'est terminée samedi dernier. Le premier enjeu consistait à discuter de l'après Kyoto, c'est-à-dire de l'après-2012, selon l'article 3, alinéa 9 du protocole de Kyoto. Trois voies étaient possibles : soit on revenait à la convention climatique de Rio, à laquelle j'ai participé en 1992, sachant que les États-Unis ont adhéré à la convention mais n'ont pas signé le protocole ; soit on s'en tenait au protocole, ce qui excluait les États-Unis ; soit on faisait les deux, et c'est ce qu'on a finalement décidé, sans doute à l'initiative du président canadien de la conférence, Paul Martin. Je ne sais pas si c'était la bonne solution. Je précise en tout cas que le protocole de Kyoto a des objectifs très modestes et qu'il faudrait faire bien davantage pour ne pas dépasser les deux degrés Celsius supplémentaires avant 2050. J'ai noté un certain unanimisme. Pratiquement plus personne n'est aujourd'hui dans le déni ou dans l'incrédulité. Souvenez-vous du livre ridicule de Bjorn Lonborg il y a encore quatre ans ! Et je ne vous parle de certains de nos amis dans les années 1970 ou 1980. Munich Re ou Swiss Re, qui sont parmi les grands réassureurs mondiaux, ont chiffré les dégâts dus au chaos climatique à 35 milliards de dollars en 2004 et à 65 milliards en 2005 - et je ne sais pas quels seront les chiffres en 2006. Quoi qu'il en soit, les participants de Montréal ont compris que le chaos climatique n'était pas une sorte d'amusette « écolo » anecdotique, mais une question de sécurité collective mondiale et une nécessité économique. On pourrait parler du tournant de Montréal s'agissant de la représentation du monde. Le niveau de précaution est maintenant clairement établi : il ne faut pas dépasser deux degrés Celsius de réchauffement. Va-t-on y arriver ? Car on risque des emballements, avec des effets de seuil, etc. C'est très compliqué du point de vue scientifique. Il faut diviser par quatre nos émissions de gaz à effet de serre de manière équitable : ce qui signifie qu'aux États-Unis, il faut les diviser par douze ! Mais tout le monde triche et personne n'y parvient. Je me demande même si l'Europe, entre 2008 et 2012, parviendra à baisser ses émissions de 8 %, comme elle est censée le faire. Je n'en suis pas sûr. Nous entrons aujourd'hui dans la négociation de Hong-Kong à l'OMC. Or les négociations climatiques sont plus importantes que les négociations commerciales. L'intégrité environnementale du protocole de Kyoto devrait primer sur les règles du commerce. La manière dont on alloue les quotas d'émissions devrait avoir pour premier objectif l'environnement et non la protection de nos industries, qu'il s'agisse de Lafarge, d'Arcelor ou d'autres. Il faut aussi élargir le protocole de Kyoto au transport aérien. J'espère que l'Europe, qui prépare une directive, fera preuve de sévérité en la matière. Le mécanisme de développement propre, dont on parle beaucoup, doit aussi avoir pour objectif l'intégrité environnementale. L'énergie nucléaire doit être exclue de la liste des énergies renouvelables et donc échapper totalement au MDP, contrairement à ce qu'a dit l'AIEA, qui a reçu le prix Nobel de la paix il y a quelques mois. Elle a fait une sorte de lobbying pronucléaire à Montréal, ce qui est scandaleux. Je ne crois évidemment pas aux vertus d'un nucléaire civil qui serait séparé du nucléaire militaire. Mais ce n'est pas notre propos. La séquestration du carbone ne doit pas être prise en compte dans le MDP pour l'obtention de crédits de carbone. Enfin, le MDP ne doit pas dépasser la moitié des efforts nationaux de réduction des gaz à effet de serre dans les pays de l'annexe I, c'est-à-dire dans les pays industrialisés. Dernier constat sur Montréal : les leviers financiers sont tout à fait insuffisants. Heureusement que ce qu'on appelait en 1992 à Rio le Fonds mondial pour l'environnement existe, et a d'ailleurs été sauvé par le protocole de Kyoto. Reste que ces petits milliards de dollars ou d'euros sont dérisoires et qu'il faudrait multiplier considérablement ces leviers financiers pour que le protocole de Kyoto puisse s'appliquer. Depuis le rapport Brundtland, depuis Rio, depuis Montréal, une sorte de conscientisation s'est fait jour. C'est d'ailleurs la première fois que l'Assemblée nationale crée une mission d'information sur l'effet de serre, alors que nous en parlions depuis trente ans. Reste que je n'ai abordé jusqu'ici que la moitié du problème. L'autre moitié se situe, non plus en aval, mais en amont du carbone. Et à ce niveau, on est encore dans le déni, comme on l'était il y a dix, quinze ou vingt ans à propos du chaos climatique. Dans quelques années, la production mondiale d'hydrocarbures va décliner. Cela modifiera, dans tous les domaines, toute notre vie sur tous les continents. Or on nie le peak oil. Je me souviens avoir passé des heures d'explication devant M. Sarkozy et M. Devedjian, puis devant leurs successeurs : personne n'y croit ! Il s'agit d'un triple choc, très différent de ceux de 1973 ou 1979, un choc d'origine géologique, économique et géostratégique. Il se mesure en années, alors que le chaos climatique se mesure en décennies. Thierry Breton a eu le bon goût de m'inviter à faire partie de la commission pour la transparence de la fiscalité pétrolière, avec M. Hervé Mariton, M. le rapporteur général et quelques sénateurs. A cette occasion, nous nous sommes aperçus que la hausse des prix de l'essence, du gazole et du fioul domestique avait fait perdre de l'argent à l'État, contrairement à ce que tout le monde croit. En effet, si la TVA est mieux rentrée, la TIPP est moins bien rentrée. Par ailleurs l'État, étant lui-même consommateur, doit acheter l'essence au prix du marché. Le peak oil, ou pic de Hubbert, à savoir la contraction puis le déclin définitif de la production mondiale d'hydrocarbures, arrivera très bientôt. Avec nos amis australiens, suédois, irlandais, américains, dans l'association internationale ASPO, nous avons mis au point le protocole de Rimini, qui est l'équivalent du protocole de Kyoto pour l'amont du carbone. Il consiste à dire qu'il faut une gestion onusienne de la production, de la consommation et du commerce des énergies fossiles, qui représentent à l'heure actuelle 80 % de la consommation mondiale. Imaginez-vous entendre dire cela à M. Thierry Desmarest, à Exxon, à BP ou à l'homme le plus important du monde, M. Ali Al Naïmi, le ministre saoudien du pétrole qui se trouve à la tête de l'entreprise Saudi Aramco, dont le chiffre d'affaires est de 1 000 milliards de dollars par an ? M. le Président : Merci de ce brillant exposé. S'il y a un désaccord sur le peak oil, il porte sur la date à laquelle il va arriver. Il y a quatre ans, lors d'un débat, vous nous aviez dit qu'il se produirait dans les cinq ans. Est-ce qu'on y est déjà, contrairement à ce qu'on nous a dit ? On nous avait en effet indiqué qu'on trouverait des ressources fossiles au fur et à mesure de l'augmentation du prix du pétrole. Il est exact qu'aujourd'hui, les fossiles sont la source de l'énergie, et ils continueront à l'être. Pour résoudre le problème de l'effet de serre, il faudra traiter la question des énergies fossiles. Il est assez facile de se servir d'un livre de 1974. Je suis sûr que dans tous les partis politiques, à la même époque, quelqu'un a posé la problématique du réchauffement climatique et de l'utilisation des énergies fossiles. Seulement, les partis se sont focalisés soit sur la croissance, sur le développement économique et l'emploi, soit sur le nucléaire, ce qui a complètement noyé ces questions. Le nucléaire peut-il contribuer à la diminution de l'émission des gaz à effet de serre ? Dans une situation donnée et dans certains pays, oui. Mais il ne peut pas constituer une solution au niveau mondial. Quoi qu'il en soit, y compris dans les partis politiques que vous représentez, on a tellement surdimensionné le nucléaire que l'on n'a pas perçu la menace. Le problème actuel reste la perception globale de la menace par la totalité de nos concitoyens. M. Yves COCHET : Il est toujours difficile de faire de la prospective. Je ne suis pas Nostradamus, mais un scientifique qui a enseigné pendant vingt ans à l'université de Rennes. On a tenté de savoir quand aurait lieu le peak oil, s'agissant du pétrole conventionnel. Je pense que nous en sommes tout proches : cette année ou l'année prochaine. C'est l'opinion moyenne des géologues et des géophysiciens que je fréquente. Mais cette opinion est très controversée par un certain nombre de personnes : Thierry Desmarest pense plutôt à 2025 ou 2030. Je précise que j'entends par « pétrole conventionnel » le pétrole facile à extraire. En Mésopotamie, c'est-à-dire en Irak, il suffit de gratter le sol pour trouver du pétrole, et il vous en coûte 1 ou 2 dollars le baril. En Alaska ou dans l'offshore profond, à 6 000 mètres, c'est beaucoup plus difficile. On fait remarquer que lorsque le prix du pétrole conventionnel augmente, les autres pétroles, non conventionnels deviennent plus compétitifs. C'est vrai du point de vue économique, mais c'est faux du point de vue thermodynamique. Le pétrole est un ensemble de molécules merveilleuses. C'est un vrai cadeau du ciel. Il permet de tout faire. L'intensité énergétique du pétrole est très forte, de même que l'efficacité économique du pétrole conventionnel. Le pétrole conventionnel coûte 2 dollars le baril au pied du puits. Et pour avoir un litre dans votre réservoir, il ne vous faut qu'un vingtième de litre en amont pour l'y amener. Le pétrole n'explose pas, il n'est pas dangereux, il est très dense, facile à transporter, et permet des applications multiples. Son bilan énergétique est très bon : de l'ordre de un pour vingt. Il n'en est pas de même du pétrole non conventionnel, dont le bilan est de l'ordre de un pour trois ou de un pour cinq. Au point de vue du rendement et de l'énergie nette, il est beaucoup moins intéressant. Prenez l'exemple des sables asphaltiques d'Athabasca ou celui des huiles extra-lourdes de l'Orénoque. Prenez l'exemple des schistes bitumineux, dont les réserves sont considérables et se trouvent d'ailleurs aux États-Unis. Personne ne les développe, parce que cela coûterait trop cher au point de vue financier, thermodynamique et économique. Remarquez qu'on peut faire du pétrole avec un arbre. On peut liquéfier la biomasse, le charbon. La technologie ne pose pas de problème. Le procédé Fischer-Tropsch de liquéfaction de la biomasse existe depuis quatre-vingts ans. On sait donc tout faire. Le problème, c'est le coût environnemental, thermodynamique et financier. On peut avoir beaucoup plus de pétrole à 150 dollars le baril. Mais à ce prix-là, on change de monde. Voilà d'ailleurs pourquoi je pense que dans les dix, ou plutôt vingt ans, il y aura beaucoup moins d'aviation commerciale de masse. Même Air France, British Airways et Lufthansa - qui ne tiennent que grâce à la classe économique - auront du mal à survivre dans les années 2020-2030 parce que le kérosène, qui n'est pas du tout taxé dans le monde, suit mécaniquement le cours du baril. Il n'y aura plus qu'un transport d'affaires, qui se fera par jet privé. Quand je pense que certains rêvaient de faire un troisième aéroport en Ile-de-France. Le transport aérien mondial va décliner. Mme Nathalie KOCIUSKO-MORIZET, Rapporteure : Vous ne proposez pas beaucoup de solutions ! M. Yves COCHET : Mais si, il y en a ! Mme la Rapporteure : Un tel discours conclut à l'augmentation du prix de l'énergie. C'était d'ailleurs la conclusion à laquelle aboutissaient plusieurs de nos auditionnés précédents qui ne voyaient que cette solution. A l'époque où Dominique Voynet était ministre de l'environnement, a été créée la TIPP flottante, qui était le contraire de ce qu'on aurait dû faire. Aujourd'hui, que doit-on recommander ? M. Yves COCHET : La TIPP flottante n'était pas une bonne solution. Je regrette qu'un gouvernement de gauche, auquel j'appartenais aussi, ait pu y penser. On l'a appelée à un moment le « stabilisateur Migaud », car c'était Didier Migaud qui était alors rapporteur général du budget. C'était un double mauvais message vis-à-vis de nos concitoyens, et vis-à-vis des pétroliers. Aux premiers, on disait : continuez à faire le plein de votre voiture, ce sont les contribuables qui paieront. Aux seconds : continuez à augmenter le prix du baril, ce sont les contribuables français qui paieront. Depuis un siècle et demi, la croissance tient essentiellement à l'énergie abondante et bon marché. C'est ce qu'on appelle la civilisation des pays de l'OCDE. Or nous passons à une autre civilisation, où l'énergie est à la fois plus rare, plus polluante et beaucoup plus chère. Tous les domaines seront touchés sur tous les continents. J'ai pourtant entendu mon ami et partenaire François Hollande déclarer en septembre dernier proposer de rétablir la TIPP flottante ! C'est une bêtise économique, écologique et politique. Ce n'est pas ce qu'il faut faire. Je ne veux pas faire de publicité pour mon dernier livre, mais j'y développe une cinquantaine de propositions politiques très précises pour habituer nos sociétés, française et européenne, à s'adapter à ce changement de civilisation, à cette ère où l'énergie sera à la fois moins abondante et beaucoup plus chère. Il y a deux mois, M. de Villepin et M. Perben trouvant le prix du baril trop élevé, ont proposé de limiter la vitesse sur autoroute à 115 km/heure maximum. Au bout d'une journée, le Gouvernement a cédé. Car M. Peugeot, M. Total, M. Renault, les automobile-clubs, les poujadistes les plus étroits d'esprit ont protesté au nom de la liberté ! Ce sont donc nos enfants, voire nous-mêmes, qui paieront les pots cassés. Pourtant, une telle mesure est très efficace. L'OCDE propose, dans un ouvrage intitulé Saving oil in a hurry, publié au mois d'avril 2005, 100 km/h sur autoroute, 60 km/h sur les routes nationales et 30 km/h en ville. Rien qu'avec cela, qui peut se faire du jour au lendemain, vous économisez 15 % de la consommation de pétrole de la France. Mais je propose d'autres mesures : par exemple, que dans les cinq années qui viennent, il soit interdit, dans l'Union européenne, d'importer, de fabriquer et de commercialiser les voitures de plus de 1 500 cm3. A quoi servent de telles voitures ? Certainement pas à rouler plus vite et mieux, mais uniquement à se différencier socialement par une sorte de regard croisé. D'ailleurs, mes chers collègues, il suffit de descendre au quatrième sous-sol de ce bâtiment et d'examiner les voitures des députés. A part la mienne, qui cube 1 100 cm3 et qui a quatorze ans d'âge, mais dont la carburation est parfaite, il y a des Safrane, des Vel Satis, des 607, etc. Le système actuel de transports de l'Europe est le plus inefficace qui ait jamais existé dans toutes les civilisations : sous Louis XIV ou César, du point de vue énergétique, le système était beaucoup plus efficace. Les 450 millions d'Européens possèdent actuellement 200 millions de véhicules. La moyenne est de 1,2 passager par véhicule, soit à peu près 75 kg de chair humaine pour une tonne et demie de ferraille et de plastique. C'est ridicule ! On pense être champions du monde de la technologie et de l'industrie de pointe. Mais du point de vue des transports, que ce soit par poids lourds, par avion ou par voiture, on n'a jamais été aussi inefficaces ! Nous ne sommes pas les meilleurs du monde : nous sommes les plus aberrants du point de vue thermodynamique. M. Serge POIGNANT : Un peu dans l'esprit de notre Rapporteure, je remarquerai que notre collègue est constant dans ses positions. Il est possible de faire des économies de pétrole et de favoriser tel ou tel comportement. Mais que faire au-delà, sachant que notre collègue exclut le nucléaire et qu'il considère que les biocarburants ne servent à rien ? J'aimerais savoir s'il croit à d'autres technologies que la fusion ITER, et s'il croit à l'énergie hydrogène. A-t-il des propositions pour les prochaines décennies ? M. Yves COCHET : Je remarque que même dans la loi d'orientation agricole, nous avons voté, à droite comme à gauche, des amendements sur les biocarburants. Il faut écarter d'emblée l'éthanol. D'abord, parce qu'il y a trop d'essence en Europe et que la productivité végétale n'est pas du tout celle du Brésil. En revanche la filière des huiles végétales pures est intéressante. Je regrette même qu'on ne soit pas allé plus loin. Nous avons autorisé l'autoconsommation agricole, mais pas la vente en circuit local. Le Gouvernement y réfléchit néanmoins. Autre avantage des huiles végétales pures : on peut récupérer les tourteaux de soja ou de tournesol ou de colza pour l'alimentation animale. Je suis donc plutôt favorable aux huiles végétales pures, aux circuits courts, du type cantonal ou départemental. Je ne crois pas à une grande filière de diester industriel européenne. Je ne pense pas qu'on aura 10 % de biocarburants en 2015, comme le souhaite le Premier ministre. Quant à la fusion ITER, c'est un rêve d'alchimistes, qui, à l'échelon industriel, n'aboutira jamais. Evidemment, comme disait Enrico Fermi en 1942, c'est « de la belle physique » ! Mais ne tombons pas dans l'illusion et dans la croyance quasi religieuse à la corne d'abondance éternelle et bon marché. Je précise qu'en 2050, on aura d'autres préoccupations que de savoir si on continue ITER ou pas. Sur l'hydrogène, mon ami Jeremy Rifkin a écrit un livre tout à fait stupide. Il faut dire que c'est un économiste qui met en avant les grandes lois de l'économie comme celle de l'offre et de la demande, loi qui, en matière de pétrole, n'a jamais existé. L'hydrogène n'est pas une énergie, c'est un vecteur, tout comme l'électricité. La molécule d'hydrogène est la plus abondante du cosmos, mais il faut la rendre utilisable. Son bilan thermodynamique est négatif. Plus vous fabriquez d'hydrogène, plus vous perdez de l'énergie en amont. M. Serge POIGNANT : Ce n'est pas vrai ! M. Yves COCHET : Bien sûr que si. Soit on brise la molécule d'eau par électrolyse, soit on va chercher l'hydrogène dans les sucres ou les hydrocarbures, et cela demande de l'énergie. Pour obtenir un kWh utile, il en faut 1,5 voire 2 de plus en amont ! Alors qu'avec le pétrole, on en gagne vingt fois plus. L'hydrogène peut servir à des applications ponctuelles. Par exemple en mettant au point des piles pour les téléphones mobiles qu'on ne chargerait que tous les deux mois. Mais il serait vain de croire à une ère de l'hydrogène, à une économie de l'hydrogène qui viendrait remplacer le pétrole. Il faut penser économie et efficacité. La moitié de l'électricité de la France pourrait simplement être économisée, ne serait-ce qu'en utilisant d'autres ampoules et en cessant le chauffage électrique. Il est facile de faire des économies d'électricité et donc de diminuer les émissions de gaz à effet de serre, et ce du jour au lendemain ! Je suis évidemment favorable aux éoliennes et au photovoltaïque, etc. Mais cela demande beaucoup d'investissement et beaucoup de temps. Quel est le plus grand et le plus beau programme d'investissement énergétique, voire industriel que la France ait fait depuis trente ans ? Le programme électronucléaire, décidé par le gouvernement de Pierre Messmer en 1974 : on y a investi 250 milliards d'euros et on a poursuivi la même politique pendant trente ans ! J'y ai toujours été opposé, mais cela a été fait. Il faudrait faire la même chose pour les énergies renouvelables. Mais qui va le faire ? Nous avons voté la loi électrique du 10 février 2000. Six ans après, où en est-on ? On n'a pas fait grand-chose. On n'a même pas calmé les « écolos ». Il faut investir massivement. A moins de 100 milliards d'euros, une politique énergétique est sans intérêt. M. Christian DECOCQ : Est-ce que l'entrée des scientifiques dans le jeu politique est efficace eu égard aux objectifs qui sont les nôtres et à la difficulté qu'il y a à mettre en œuvre des politiques pour essayer de les atteindre ? Aujourd'hui, tout le monde se souvient de Marie Curie en 1902, alors que nous ne savons plus quel était le ministre de l'intérieur de l'époque. Est-ce une bonne démarche, de la part d'écologistes scientifiques comme vous ? M. Yves COCHET : Il y a des écologistes scientifiques, mais je n'en suis pas un. Cela dit, je ne pense pas que les savants puissent être rois. Je pense qu'en tant que citoyens, ils doivent faire entendre leur voix auprès des politiques. Je n'ai rien contre le fait qu'on discute avec des industriels comme M. Desmarest, ou avec l'Office parlementaire. Si ce n'est que ce dernier a une vision productiviste de la science et du progrès, dont il convient maintenant de revenir. La foi inconsidérée dans le progrès doit être réinterrogée. Les scientifiques sont de plus en plus nombreux, notamment dans le domaine climatique ou énergétique, à se poser des questions. Je remarque par ailleurs que la plupart des gouvernants sont de formation littéraire, économique ou juridique, et qu'il y a peu de gens de formation scientifique parmi eux. Je le regrette. M. le Président : Votre exposé était intellectuellement brillant. Mais il se trouve qu'aux incertitudes qui planent sur ces sujets, s'ajoutent des certitudes qu'il est difficile de s'approprier. On entend « ITER ne marchera pas » ou « on en est déjà au peak oil ». Mais on entend aussi l'inverse. Il nous faut donc trouver une solution compliquée à un problème lui-même complexe. Certains préconisent de baisser la vitesse sur autoroute de 130 à 100 km/h, sur les routes de 90 à 60 km/h et en ville de 60 à 30 km/h. C'est une solution. Mais cette solution entraînerait un certain nombre de contraintes économiques et sociales. Nous sommes conscients de l'importance de l'environnement et de la menace que représente le changement climatique. Mais nous devons aussi nous préoccuper de l'emploi. Il nous faut donc traiter des problèmes dont nous discutons ici tout en traitant celui de l'activité économique et de l'emploi. Comment la croissance peut-elle continuer sans s'accompagner de rejets de gaz carbonique ? Il est possible de construire des moteurs qui consomment trois fois moins d'essence. Si on ne l'a pas fait jusqu'à maintenant, c'est du fait du lobby pétrolier. C'est à mon avis une meilleure idée que celle consistant à réduire les flux de transport individuel. Il faut en tout cas en discuter. Vous dites que ce qui vous intéresse, ce sont les 100 milliards de dollars. Mais nous aussi ! Sauf que l'argent est une ressource rare. Pour moi, le grand programme sur lequel il faut mettre de l'argent, c'est le stockage de l'électricité. Si on n'a pas résolu la question, les éoliennes ne seront que des moulins à vent. Certes, on pourra installer beaucoup de gaz, avec des centrales à gaz combinées. Mais celles-ci émettront elles aussi des gaz à effet de serre. Sur de tels sujets, on ne peut pas avoir de certitudes. On doit explorer toutes les voies, compris la voie d'ITER. Je ne suis pas contre, même si je ne sais pas si on y arrivera un jour. Nixon avait dit un jour que le cancer était une question de technologie médicale. Or, même si on a fait de grands progrès, le problème n'est pas résolu aujourd'hui. S'agissant du stockage, il faudrait que nous nous mettions d'accord sur certains grands sujets pour y consacrer de l'argent. Car les grands chantiers qui ont été lancés dans les années 1960-1970 manquent cruellement aujourd'hui. Mon cher collègue, je vous remercie. Audition conjointe de MM. Jean-Claude GAZEAU, président, Présidence de M Jean-Yves LE DEAUT, Président M. le Président : Mes chers collègues, nous avons le plaisir d'accueillir M. Jean-Claude Gazeau, président de la Mission interministérielle de l'effet de serre (MIES), et M. Paul Watkinson, chargé des relations internationales. Je salue également la présence à cette audition publique, de fonctionnaires du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), qui ont souhaité y assister à l'occasion d'un stage qu'ils effectuent à Paris. Depuis le début de nos travaux, il y a bientôt un mois, nous avons procédé à un certain nombre d'auditions et nous avons mis en place notre comité de pilotage, dont un certain nombre de membres sont présents ce matin. Nous souhaiterions, Messieurs, que vous fassiez le point des actions de la MIES et que vous nous indiquiez les principaux éléments de la politique menée par la France, dans le contexte européen, en matière de changements climatiques. Quels sont les résultats en termes de stabilisation des émissions ? Quelles sont les perspectives pour la prochaine période ? Pourriez-vous aussi nous indiquer de quels moyens vous disposez et les comparer à ceux des autres États membres ? Enfin, puisque vous étiez à Montréal, au sein d'une forte délégation française, pouvez-vous nous dire comment vous voyez la suite des événements ? M. Jean-Claude GAZEAU : La MIES, créée en 1992, est compétente à la fois dans un cadre national, où elle est chargée de piloter et d'élaborer les plans nationaux de lutte contre le changement climatique, et dans un cadre international, où elle dirige la délégation française lors des négociations et assiste la ministre dans les discussions au niveau ministériel. Elle participe aussi aux débats et aux travaux menés au sein de l'Union européenne. Tout ce travail s'adosse aux recherches qui montrent la réalité du changement climatique du fait des activités humaines. Ainsi, la MIES est active, avec l'observatoire National sur les effets du réchauffement climatique (ONERC), au sein du Groupe international de recherche qui produira son quatrième rapport en 2007. Notre feuille de route comporte un indicateur simple : le total des émissions de gaz à effet de serre de la France, avec la flexibilité introduite par le protocole de Kyoto. Toujours dans le cadre de ce protocole, ratifié par la France et mis en œuvre en 2005, notre objectif consiste à veiller à stabiliser les émissions de gaz à effet de serre, pour la France, au niveau de 1990. Cela signifie bien évidemment que des efforts importants doivent être accomplis puisque l'économie poursuit sa croissance. La stabilisation suppose une réduction de l'ordre de 10 % des émissions. Les mécanismes de flexibilité permettent aux pays rencontrant des difficultés de respecter leurs engagements en accédant à des crédits de CO2. Pour autant, la France n'entend pas privilégier ce mécanisme pour respecter ses engagements mais maîtriser les émissions sur son territoire. De ce point de vue, le dernier « rendez-vous climat » de novembre 2005 a fait état des projections aux horizons 2010 et 2020. Pour tenir ces objectifs, différents outils et plans très importants ont été présentés ces dernières années. Le Plan Climat 2004 rassemble, au niveau aussi bien national qu'international, toutes les mesures à mettre en œuvre pour respecter les engagements. Il est en étroite interaction avec toute la stratégie des politiques énergétique et de climat qui ont conduit à l'adoption de la loi de programme du 13 juillet 2005 fixant les orientations dans le domaine de la politique énergétique, qui plante le décor jusqu'en 2030, de manière très détaillée, y compris en matière de stratégie climatique. Il est très utile de se référer à ce document de synthèse fort dense. Il indique que le Plan Climat a vocation à être régulièrement actualisé, ce qui sera fait en 2006 ; il fournit l'état des travaux par rapport au fameux « facteur 4 », c'est-à-dire à la nécessité, si on veut stabiliser la concentration des gaz à effet de serre, que la France comme les autres pays industrialisés divisent par quatre ces émissions. Plusieurs plans sectoriels ont également été adoptés dans le cadre du Plan Climat. Ils visent des activités grosses émettrices comme les transports et le bâtiment. On peut ainsi citer le plan véhicules propres de 2003, qui a permis d'ouvrir plusieurs chantiers afin que nous ayons un parc routier de véhicules particuliers aussi sobres que possible en émissions de carbone ; le plan biocarburants, lancé dans le cadre de la mise en œuvre d'une directive européenne ; le plan déchets, puisque ces derniers peuvent être des combustibles aptes à fournir de l'énergie. À partir de cette feuille de route, il faut voir si nous allons ou non respecter la première échéance de 2010. Le Plan Climat nous invite à des rendez-vous annuels pour établir le bilan des mesures mises en œuvre, pour regarder vers l'avant et pour voir si certaines doivent être infléchies ou renforcées. Le rendez-vous des 14 et 15 novembre a été l'occasion de rendre compte de données objectives nous dont nous ferons état devant la Commission européenne comme devant la communauté internationale à l'occasion de notre quatrième communication nationale. Nous disposons en particulier d'une projection sous forme d'un faisceau, entre l'hypothèse d'une mise en œuvre de l'ensemble des mesures et ce que nous appelons une mise en œuvre interne raisonnée. Elle montre que le respect de nos engagements pour 2010 suppose la mise en œuvre résolue et soutenue de toutes les mesures. Il ne faut donc surtout pas baisser les bras. Avant même l'actualisation du Plan Climat, un certain nombre de mesures ont déjà été revues en 2005, à l'occasion du séminaire gouvernemental sur le développement durable du 23 mars et des annonces faites par le premier ministre le 1er septembre. Pour répondre à votre question sur les moyens, je rappelle que notre mission est interministérielle et qu'il sera assez facile de vérifier si les objectifs en termes de CO2 ont été respectés. En sa qualité de mission, elle est adossée sur les moyens existant déjà dans les différents ministères et cela paraît normal puisque la lutte contre l'effet de serre est une politique de la totalité du Gouvernement. Une meilleure transversalité apparaît toutefois souhaitable, nous nous y employons. Nos effectifs restent inférieurs à dix « équivalents temps plein » et, même si la comparaison avec les autres pays est difficile, nous avons sans doute une certaine marge de progrès. Deux maîtres mots caractérisent notre action. Le premier est la cohérence de la politique de lutte contre l'effet de serre, à laquelle nous attachons une grande importance ; le second est la transparence. Il me semble que nous pourrions aller, au-delà de la logique de programmes de la LOLF, vers un document de politique transversale, qui équivaudrait à un jaune budgétaire, et qui donnerait une bonne visibilité de tout ce qui se fait en matière de lutte contre le changement climatique. C'est un chantier auquel nous allons nous atteler. M. le Président : Merci M. Paul WATKINSON : Je souhaite porter à votre connaissance quelques éléments relatifs à l'action internationale de la MIES, à la façon dont nous organisons les négociations et aux conséquences de la conférence de Montréal sur nos travaux à venir. L'organisation des négociations passe par une phase de préparation communautaire, par une phase de préparation française et par d'autres actions. Dans le cadre de la préparation des négociations futures, nous nous intéressons aux conséquences de Montréal et aux travaux 2006-2008, ainsi qu'à la mise en œuvre internationale des textes antérieurs. Les négociations internationales dans lesquelles nous intervenons sont : - la convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, signée à Rio de Janeiro en 1992 et entrée en vigueur en 1994, dont vient de se tenir la onzième conférence des parties - COP ; - le protocole de Kyoto, entré en vigueur en février dernier, pour lequel une réunion des parties - COP/MOP - vient d'avoir lieu ; - les organes subsidiaires communs à la Convention et au Protocole, destinés aux travaux techniques, qu'il s'agisse de la mise en œuvre - SBI - ou du conseil scientifique et technologique - SBSTA - qui s'intéresse aux questions méthodologiques. Nous tenons chaque année deux semaines de réunion des organes subsidiaires, à Bonn en mai/juin, ainsi que deux autres semaines en novembre/décembre pour les COP, COP/MOP, organes subsidiaires et segment à haut niveau. Dans la négociation, l'Union européenne joue un rôle clé. Ainsi, elle est directement partie, ainsi que les États membres, à la convention climat et au protocole de Kyoto. L'Union négocie en bloc et la France participe pleinement à l'élaboration de cette position. La compétence n'est pas uniquement communautaire mais partagée. Par ailleurs l'Union des Quinze - car elle n'était pas encore l'Europe des Vingt-Cinq au moment de la ratification du protocole - participe à la « bulle européenne » pour 2008-2012. Ses positions et celle de la France sont préparées parallèlement. À Bruxelles, le Groupe environnement international « changements climatiques » se réunit au moins une fois par mois. Il traite à la fois des questions d'environnement international et de changement climatique. Il prépare les conclusions du Conseil environnement ainsi que les documents de position pour les négociations internationales. Le groupe climat se réunit également au moins une fois par mois à Bruxelles ; il assure également la coordination de dix groupes d'experts - actions futures, mécanismes de Kyoto, pays en développement, questions juridiques, questions méthodologiques, politiques et mesures, aviation et transports maritimes, science et recherche, éducation, puits de carbone - ; il se transforme en coordination communautaire lors des négociations de la convention climat et du protocole de Kyoto ; il tient au début de chaque présidence un atelier informel destiné à préparer le semestre. Pour préparer la position française, la MIES anime un réseau interministériel sur le climat international. Environ quatre réunions interservices sont organisées chaque année. La prochaine fera le debriefing de Montréal. La MIES propose également des instructions pour les réunions du Groupe climat à Bruxelles, ainsi que pour les séances de négociations. Elle assure la concertation avec la société civile, les ONG, les entreprises, les chercheurs. Nous participons également aux autres rencontres internationales sur le climat : - réunions de dialogue, notamment sur l'évolution future du régime climat ; - groupe des experts de l'annexe I de l'OCDE et de l'AIE ; - dialogue international « actions futures » du Center for Clean Air Policy ; - conférence informelle organisée par le Japon et le Brésil ; - initiatives communautaires ; - initiatives des pays francophones. J'en viens à Montréal, qui a été marqué par le lancement de deux processus. Le premier est l'examen des engagements au titre du protocole de Kyoto pour la période après 2012 des pays de l'annexe 1, ce qui est un signe que tout ceci se poursuivra après l'échéance prévue. Nous avons mis sur pied un groupe ad hoc qui se réunira deux fois par an, avec pour objectif qu'une nouvelle période d'engagements succède dès 2013 à celle-ci. Le deuxième engagement est celui d'un dialogue entre toutes les parties à la Convention sur la coopération à long terme destinée à renforcer sa mise en œuvre. C'est dans ce cadre que sont envisagés les moyens de renforcer ce qui se fait dans les pays du Sud. Je rappelle que sera déclenché fin 2006 l'examen global des dispositions du protocole de Kyoto avec soumissions en septembre 2006. Cela permettra de revenir sur le contenu même du protocole de Kyoto et non pas seulement sur nos engagements, afin de faire progresser, grâce à une série d'ateliers, les programmes liés au travail technique et à la connaissance scientifique. Notre charge de travail est sans doute appelée à s'alourdir. En effet, la gestion des négociations existantes est déjà excessivement complexe puisqu'il y avait au moins trente thèmes à Montréal. Or, nous devons suivre les nouvelles négociations sur l'après 2012 et y participer activement. Nous sommes tenus d'articuler cette action avec les initiatives nationales, facteur 4, élaboration d'engagements nationaux intermédiaires pour 2020, renforcement du Plan Climat, système d'allocations de quotas, etc. Qui plus est, la France exercera la présidence de l'Union européenne de juillet à décembre 2008. Dans la mesure où en Slovénie, qui présidera l'Union au cours du semestre précédent, une seule personne travaille sur le climat, sans doute serons-nous appelés à jouer un rôle dès le début de 2008. Je rappelle qu'en 2005, sous la présidence britannique, entre 40 et 80 personnes ont travaillé sur ce sujet. Nous avons aussi pour tâche d'améliorer la communication internationale sur les activités de la France - c'est dans ce cadre que nous avons organisé six conférences parallèles à Montréal - et de renforcer l'implication des chercheurs français dans les négociations, en particulier sur l'après 2012. La France participe bien sûr à un certain nombre de processus parallèles, qu'il s'agisse des suites de Gleneagles et du futur G8, du renforcement des contacts avec les nombreux acteurs sous fédéraux aux États-Unis, ou d'autres processus multilatéraux comme la conférence sur le développement durable en 2006 et 2007, et même les discussions avec l'OMC, qui commence à prendre en compte Kyoto. Un débat doit aussi avoir lieu sur le financement des actions de lutte contre les changements climatiques, notamment dans les pays émergents et en développement, sur le rôle des bailleurs et sur le choix des investissements. Enfin, un certain nombre de choses restent à faire dans le domaine international : - élaboration et mise en œuvre des politiques communautaires ; - soutien au mécanisme de Kyoto ; - respect des engagements en matière de suivi, de communication d'informations, et de vérification ; - financement du régime multilatéral sur le climat ; - contributions obligatoires du ministère des affaires étrangères ; - contributions volontaires au fonctionnement du système ainsi qu'au GIEC ; - respect de la déclaration de Bonn et abondement des fonds de Marrakech. M. le Président : Vous avez campé le dispositif, mais vous ne nous avez pas donné votre appréciation sur les résultats. Or ce qui nous intéresse, c'est de savoir si ça marche ou si ça ne marche pas. Lors de la réunion des 14 et 15 novembre, on a semblé porter une appréciation mitigée sur nos résultats nationaux ; mais on nous a dit hier que les résultats européens étaient plutôt bons et qu'on pouvait parler de stabilisation. Confirmez-vous ces analyses ? Par ailleurs, tout le monde dit qu'il va falloir appuyer sur l'accélérateur pour réduire les émissions et ne pas dépasser cette limite de 2 degrés d'augmentation de la température moyenne au-delà de laquelle il y aurait de fortes conséquences. Mais peut-on le faire sans que les États-Unis soient dans le jeu, même s'il y a eu quelques avancées à Montréal ? Enfin, on dit très souvent qu'à la différence des États-Unis et de la Grande-Bretagne, les scientifiques et les techniciens sont peu présents aux côtés des négociateurs français. Avez-vous des liens avec les scientifiques français et européens et quelles sont vos articulations avec le GIEC ? M. Jean-Claude GAZEAU : Si le bilan en termes de réduction de CO2 après un an de Plan Climat est moyen, on peut porter la même appréciation de plusieurs pays voisins. Faisons donc un peu de benchmarking à partir du respect des engagements. La bulle européenne prévoit un effort global de moins 8 %, ce qui conduit la France à 0 % (du fait de notre part d'énergie nucléaire qui n'émet pas de CO2 et ne ménage donc pas de réduction potentielle) et l'Allemagne et la Grande-Bretagne à moins 20 %. Un modèle, qui résulte des travaux de l'Agence européenne de l'environnement et qui a été présenté en octobre dernier à Bruxelles, part des derniers résultats connus, ceux de 2003, et montre que si on met tout le monde sur la même base 100, il y aura en 2010 des pays comme l'Allemagne, le Royaume-Uni et la France qui respecteront leurs engagements tandis que les choses apparaissent plus difficiles pour d'autres, comme l'Espagne et l'Italie, qui n'y parviendront que grâce au recours aux crédits de CO2. On distingue dans ces projections l'hypothèse « AMS+ », dans laquelle toutes les mesures les plus sévères seraient mises en œuvre, de celle d'une application raisonnée de ces mesures. Bien évidemment, une composante essentielle de ce modèle est le bouquet énergétique. C'est parce que 70 % de notre électricité est d'origine nucléaire que notre engagement a été fixé à 0 %, à la différence de pays qui peuvent beaucoup plus intervenir dans ce secteur comme le Royaume-Uni ou l'Allemagne. M. le Président : Au risque de faire réagir Mme Martine Billard, je constate sur ce dernier tableau que les pays les plus mal placés - Espagne, Portugal, Danemark, Irlande, Slovénie, Autriche, Italie - sont tous des pays non nucléaires. M. Jean-Claude GAZEAU : Un autre tableau, à partir de l'état d'exécution de chaque État membre et où zéro est l'objectif de chaque pays, nous montre qu'en 2010 certains pays vont rester au-delà de leur objectif, avec la possibilité pour quelques-uns de l'atteindre en adoptant des mesures additionnelles. Ainsi la France serait à moins deux avec des mesures additionnelles mais à plus neuf si rien n'était fait. L'ensemble de ces résultats montre que nous sommes dans le même peloton que plusieurs autres pays de l'Union européenne. Vous nous avez aussi demandé comment travailler mieux avec nos scientifiques. Nous y participons, soit directement, soit par l'intermédiaire de l'ONERC à différents groupes de travail au sein du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC). Mais il est vrai que, si on fait le décompte par nation sur certains sujets ou dans certains groupes du GIEC, la présence française est sans doute insuffisante. Mme Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET, Rapporteure : Vous avez parlé incidemment du groupe qui a été lancé sur le facteur 4, mais son articulation avec les travaux et les missions de la MIES n'est pas très claire. Reconnaissez-vous ce processus et l'intégrez-vous dans vos travaux ? D'autres pays sont-ils engagés dans cette voie ? Avez-vous des échanges avec eux ? Par ailleurs, dans la mesure où les objectifs négociés dans le cadre du protocole de Kyoto sont ceux de l'Europe, qui elle-même est présente de façon globale dans les négociations, je m'interroge sur l'influence réelle de la France. Faut-il considérer que cette dernière a négocié une fois pour toutes l'objectif de 0 % et qu'elle se contente désormais de participer à un processus qui lui échappe largement ? N'est-il pas paradoxal de négocier unis pour la détermination des objectifs et de rechercher ensuite des solutions qui sont très largement nationales ? M. Jean-Claude GAZEAU : La MIES est totalement partie prenante dans la démarche du facteur 4. Ce sont les ministres de l'industrie et de l'écologie qui ont commandé les travaux ; nous sommes co-rapporteur du groupe que préside Christian de Boissieu et qui a tenu sa quatrième réunion hier. Le facteur 4 est évoqué dans le Plan Climat. Il suppose un effort bien plus important de réduction des émissions que ce qu'on avait imaginé jusqu'en 2010, afin de les diviser par quatre, ce qui pourrait nous conduire à les réduire de 3 % chaque année. Cela suppose d'autres scénarii. Dans ce cadre, on ne peut pas tout attendre des technologies et même si on ne cherche pas à s'inscrire dans une logique de rupture pour parvenir à une réduction sensible de nos émissions, il faut pour cela parvenir à modifier considérablement les comportements des citoyens, et aussi tenir très largement compte des acteurs intermédiaires. Pour les secteurs gros émetteurs, notamment le bâtiment, si on veut exercer une influence durable, réglementer les équipements lourds pour ne pas être prisonnier des décisions individuelles, être vraiment efficace, l'horizon 2050 semble le plus adapté. Il y a des enjeux parfaitement articulés entre ce que mène la MIES pour 2010 et pour 2050. Nos réflexions dans le cadre du Plan Climat 2006 porteront aussi sur des composantes lourdes comme le bâtiment. S'agissant de l'influence de la France dans les processus, je dirai que les négociations sont comme des poupées gigognes : la France participe à l'élaboration de la position de l'Union européenne, qui présente ensuite un front uni qui fait sa force dans les négociations internationales. Mais nous ne sommes en aucun cas captifs de ces négociations : notre pouvoir d'influence et d'intervention est réel. Il ne faut notamment pas que la volonté de l'Union européenne d'aller toujours de l'avant nous pénalise dans les négociations internationales : il pourrait être dangereux d'abattre toutes nos cartes et de dire dès maintenant ce que nous voulons faire à l'horizon 2020 ou 2030. Vous dites que l'essentiel passe par les mesures nationales, mais il ne faut pas oublier les mécanismes de flexibilité, qui ouvrent la possibilité de recourir aux crédits de CO2 et qui donnent une réalité à un marché du carbone aussi large que possible. Nous apportons donc un soutien actif à ces mécanismes même si la France en tant que Partie au protocole souhaite privilégier les diminutions d'émissions sur son territoire. Nous attachons une grande importance aux projets menés au niveau international et aux coopérations, y compris bilatérales. La dimension internationale est bien une composante essentielle du plan conduit par chaque gouvernement. Mme la Rapporteure : J'ai commencé ma vie professionnelle comme négociatrice pendant quatre ans sur l'effet de serre. Il y avait avec un débat très vif entre les gouvernements pour savoir si on devait prendre des mesures pour réduire les émissions chez soi ou les réduire ailleurs. Je comprends qu'on a tranché en faveur de la première solution, sans même d'action coordonnée au niveau européen. Là, vous allez encore plus loin en disant qu'on s'interdit de recourir aux mécanismes de flexibilité par rapport à notre objectif national. A-t-on de même définitivement renoncé à élaborer des directives européennes ? M. Jean-Claude GAZEAU : Je n'ai parlé que de la France en tant que Partie au Protocole, qui n'entend pas avoir recours directement à l'acquisition de crédits CO2, mais le recours direct aux mécanismes de flexibilité peut intéresser d'autres pays. Le recours au marché du CO2 peut aussi concerner tous ceux qui sont mis sous contrôle et sous contrainte dans chaque pays, dont la France, en particulier les industriels. S'agissant de la France, j'ai simplement dit que, logiquement, quand vous respectez votre objectif vous n'avez pas besoin de compensation. Mais il s'agit là de l'ensemble de notre pays en tant que partie au protocole. Si on prend secteur par secteur, par exemple pour le bâtiment et les transports, des directives européennes ont bien été mises en œuvre. Ainsi, la directive 2003-87 instaure un mécanisme d'allocations de quotas qui permet de mettre sous contrôle les plus gros émetteurs de CO2. En France, cela prend la forme du plan national d'allocation de quotas : nous avons pris 20 % de nos émissions totales qui couvrent la production d'énergie et les industries les plus émettrices ; nous les avons mises sous contrôle, avec un objectif pour chaque entreprise. Chacune peut donc avoir intérêt à utiliser la flexibilité, c'est-à-dire à monter des projets hors du territoire national pour utiliser les crédits de CO2. Même si la France n'utilise pas directement le mécanisme, nous avons intérêt à faire en sorte que ce marché devienne réalité. M. le Président : Je vous invite à répondre avec plus de concision aux questions afin que chacun de nos collègues qui souhaitent vous interroger puisse le faire. M. Serge POIGNANT : La question que je souhaitais poser l'a déjà été par notre Rapporteure : je souhaitais me voir préciser la coordination et la cohérence entre les positions françaises et européennes car, même si la subsidiarité joue, il faut bien une vision globale de l'Union européenne. M. François DOSE : Qui valide les mesures additionnelles qui apparaissent sur le schéma que vous nous avez présenté ? Car à force de fragmenter, on peut imaginer qu'une disposition excellente pour lutter contre l'effet de serre soit bien moins bonne d'un autre point de vue. C'est tout le débat sur les biocarburants : à partir de quel moment une intervention validée pour l'effet de serre peut avoir d'un autre côté des impacts négatifs que pourront nous reprocher nos petits-enfants. Ainsi, les cimenteries peuvent brûler des huiles et des farines, ce qui permet de réduire de 30 % les émissions, mais qui fait le bilan sociétal de ce processus ? Pour moi, la politique c'est porter un regard global. Y a-t-il en France une institution qui en soit capable ? Vous-même ne vous intéressez-vous qu'à l'effet de serre ? M. Serge BLISKO : Quand vous nous dites que nos industriels sont sous contrôle, cela signifie-t-il qu'il y a des conventions de branches et d'entreprises ? Par qui sont-elles signées, avec qui, au nom de qui ? Sont-elles publiques et transparentes ? Un contrôle est-il exercé ? Par ailleurs, je comprends mal pourquoi, si le bâtiment est un gros producteur de CO2, on ne se fixerait des objectifs que pour 2050. Pourquoi ne pas le faire plus tôt ? Si des annonces étaient faites dès l'an prochain on accélérerait sans doute les transformations. C'est un sujet qui nous intéresse beaucoup en tant qu'aménageurs. Mme Martine BILLARD : La MIES doit-elle uniquement tenir compte des objectifs fixés à la France, ou peut-elle faire des propositions pour aller plus loin ? Par ailleurs, je n'ai pas bien compris les réponses sur les résultats et je me réjouis que les documents qui ont été produits nous soient communiqués. Vous nous avez parlé de la production d'énergie, mais on sait bien que tout le CO2 ne vient pas de là. Il serait donc intéressant d'avoir des données secteur par secteur. J'aurais également aimé que le schéma montrât pour chaque pays la part du nucléaire car, parmi ceux qui se situent au-delà de leur objectif, tous n'ont pas du nucléaire. M. le Président : Il paraît indispensable que les tableaux qui nous ont été présentés nous soient fournis, avec des résultats secteur par secteur qui seraient en effet très intéressants. M. Jean-Claude GAZEAU : Bien évidemment, l'ensemble des données, qu'on peut trouver sur notre site Internet, vous seront communiquées, secteur par secteur, ainsi que, en avant-première, la projection qui fera partie de la quatrième communication nationale, qui ne sera pas publique avant le début de l'année prochaine. La question de la cohérence entre les différentes politiques est essentielle. Avant de rejoindre la MIES, je m'occupais d'atmosphère et de polluants locaux, qui ont un impact direct sur la santé, et j'ai bien vu que des mesures pourraient avoir des effets contradictoires, c'est-à-dire réduire les polluants locaux tout en augmentant le CO2. Bien évidemment, la MIES n'a pas des œillères qui l'empêcheraient de s'intéresser à autre chose qu'à l'effet de serre. D'ailleurs le bilan qui a été présenté au rendez-vous climat faisait état des autres politiques. Et il est très important de se demander si tout le monde va dans le même sens. On voit bien par exemple pour les transports, qui sont également de gros émetteurs, que la politique de sécurité routière a aussi des effets très bénéfiques sur la diminution des émissions de CO2. Vous avez aussi évoqué les biocarburants, qui figurent dans le Plan Climat. Quand on aborde cette question, il faut bien sûr s'interroger sur l'utilisation des sols et sur la finalité alimentaire de l'agriculture. Qui décide, avez-vous demandé. Les plans sont portés par chaque département ministériel et les décisions sont prises en réunions interministérielles. Ce sont 1 100 installations françaises qui se sont vu fixer un objectif d'émissions et chacune est traitée individuellement dans le cadre du périmètre national d'allocations de quotas qui résulte d'un décret de février 2005, validé par la Commission européenne, laquelle vérifie si les contraintes imposées aux différentes installations sont cohérentes d'un pays à l'autre. Je comprends que 2050 vous paraisse lointain mais, comme pour tout exercice de planification, envisager les objectifs à cette date ne signifie nullement qu'on n'agit pas immédiatement. Si vous vous lancez dans une marche de 50 kilomètres, penser à l'arrivée ne vous empêche pas de regarder où vous mettez les pieds maintenant. Les mesures du Plan Climat n'ont pas 2050 pour unique finalité. Si j'ai évoqué cette échéance, c'est parce que nous avons le souci de garantir la cohérence entre Kyoto et les plans pour cinq ans d'une part et ce qui est envisagé dans le cadre du facteur 4 d'autre part. Pour le bâtiment, on n'atteindra pas les objectifs de 2050 simplement en additionnant chacune des étapes. Il faut avoir une vision à long terme et donc s'interroger sur la conception même de la ville. Cela n'empêche bien sûr pas de prendre des mesures immédiates en faveur de la régulation thermique dans les immeubles neufs ou des diagnostics de performance. Le Plan Climat 2004 avait pour objectif d'aller au-delà de la satisfaction du protocole, puisque, en faisant l'addition de l'efficacité des différentes mesures, on aboutissait en dessous des 564 millions de tonnes. Il nous est tout à fait possible de proposer de renforcer des mesures. Ainsi, le premier ministre a annoncé le 1er septembre que nous atteindrions en 2008 l'objectif de 5,75 % d'incorporation que la directive biocarburant ne fixait que pour 2010. Nous ne limitons donc pas nos ambitions au seul protocole de Kyoto, d'autant que nous entendons être cohérents avec nos objectifs à l'horizon 2050. Sans attendre cette date, c'est pour la période 2015-2020 que se posent toutes les questions importantes, notamment en ce qui concerne notre parc de production d'énergie et l'arrivée effective des nouvelles technologies, en particulier dans les transports. L'objectif le plus ambitieux est donc de partager la vision de ce qu'on doit faire à cette échéance. Ce sera l'essentiel des travaux du Plan Climat 2006. M. Paul WATKINSON : Je reviens sur la question de la cohérence entre la position globale de l'Union européenne et celle de la France. Peut-être recherche-t-on trop systématiquement cette cohérence alors qu'il serait parfois préférable d'agir de notre côté. En fait, à la fin des années 1990 l'Union a sans doute eu une position trop rigide. Or je crois qu'il faut être flexible sur la mise en œuvre communautaire et nationale. La Commission a publié le 1er décembre un « rapport sur les progrès vérifiables dans l'application du protocole de Kyoto », dans lequel on trouve la liste des mesures déjà adoptées au niveau communautaire dans le cadre du système d'échange de quotas, ainsi que de nombreuses autres actions. La réflexion se poursuit autour des nouveaux programmes sur les changements climatiques comme celui sur la séquestration géologique du CO2. Il y a une articulation à trouver entre ces programmes et les actions de chaque État membre, qui est responsable des émissions sur son propre territoire. Afin d'assurer la cohérence, un mécanisme de surveillance a été prévu, en particulier avec le groupe de travail piloté par la Commission, qui a préparé le graphique sur le respect de leurs engagements par les États que je vous ai présenté. Il s'agit de contrôler les actions des États membres pour faire en sorte que chacun respecte individuellement ces engagements, mais aussi pour que l'Union européenne les respecte collectivement. Pour aller vers une vision à long terme, la Commission a fait en février dernier une communication intitulée « Vaincre les changements climatiques ». Le Conseil européen a apporté une première réponse fin mars ; le Parlement européen vient aussi de répondre et la Commission continue ses travaux, notamment sur les coûts des actions à long terme de réduction des émissions de gaz à effet de serre, mais aussi sur les coûts de l'inaction. Sans doute faut-il renforcer le travail sur la gestion des transformations vers des économies « zéro carbone », y compris pour en réduire les impacts néfastes. M. le Président : Je vous remercie pour ces exposés très intéressants. Table ronde sur le coût des effets du changement climatique et leur prise en compte par l'assurance et la réassurance, réunissant : Présidence de M. Jean-Yves Le Déaut, Président M. Jean-Yves Le Déaut, Président : Mes chers collègues, nous sommes heureux d'accueillir ce matin plusieurs intervenants dont nous attendons qu'ils nous éclairent sur le coût des effets du changement climatique et leur prise en compte par l'assurance et la réassurance. Madame, messieurs, je vous souhaite la bienvenue. Je salue également les membres du comité de suivi présents ce matin, dont M. Marc Gillet, directeur de l'ONERC et M. Robert Kandel, directeur de recherche au laboratoire de météorologie dynamique du CNRS. Sans plus tarder, je donne la parole à M. de La Martinière, qui va nous livrer son point de vue sur la double implication des assureurs vis-à-vis des effets du réchauffement climatique, quant aux dommages causés par les risques naturels, d'une part, et quant à leur action sur la réduction de l'effet de serre, d'autre part. M. Gérard de LA MARTINIERE : Les assureurs se sentent très concernés par le changement climatique, et ce de deux manières, que je dirai complémentaires. D'un côté, nous sommes les payeurs d'un certain nombre de dommages causés par les agents naturels, dont on peut sérieusement penser qu'ils sont eux-mêmes influencés, dans leur fréquence ou dans leur intensité, par le changement climatique. D'un autre côté, nous participons, à travers les relations que nous nouons avec les entreprises, que ce soit comme assureurs ou comme investisseurs, à une démarche de prise en compte des efforts faits pour réduire le phénomène de l'effet de serre. À cet égard, le rapport annuel des AGF est considéré comme exemplaire de ce que peut être cette démarche, comme le sont les initiatives de Generali, ou encore du groupe AXA. Les assureurs ont trois types d'indemnisation en fonction de la nature des événements naturels qui peuvent provoquer le dommage. La première catégorie, « tempêtes, grêles et poids de la neige », correspond à une activité classique, qui est devenue partie intégrante des contrats d'assurance de dommages aux biens pour la partie tempête depuis 1990. Entre 1990 et 2003, nous avons dépensé environ 10 milliards d'euros afin d'aider des entreprises, des particuliers, des exploitations agricoles. Le coût global assuré de la tempête 1999, en particulier, a été de 6,7 milliards d'euros, entièrement à la charge des assurances, en l'absence d'intervention publique. La deuxième catégorie d'engagement des assureurs concerne les dommages causés aux récoltes qui ne sont pas couverts par le régime des calamités agricoles. Jusqu'en 2004, nous ne couvrions que les dommages causés par la grêle, les autres risques étant couverts par le fonds des calamités agricoles alimenté par une taxe parafiscale. Depuis 2004, sous l'impulsion des pouvoirs publics, a été lancé un nouveau type de contrat, le contrat d'assurance récolte, destiné à permettre aux exploitants agricoles de bénéficier d'une couverture générale pour l'ensemble des risques auxquels leurs récoltes sont exposées : 65 000 contrats de ce type ont été commercialisés cette année. L'objectif, partagé par le ministère de l'agriculture, est d'arriver, à terme, à 200 000 exploitations assurées contre les aléas climatiques. Ce système est favorisé par la mise en place d'une subvention qui permet aux agriculteurs de payer cette garantie. On estime à environ 800 millions d'euros les dommages qui pourraient être couverts par ce type de contrat. Enfin, le régime dit des catastrophes naturelles concerne les dommages causés aux biens par « l'intensité anormale d'un agent naturel ». Créé en 1982, ce régime est un régime de solidarité organisé à l'échelle nationale, dont le déclenchement est entre les mains des pouvoirs publics, à travers les arrêtés interministériels. Il comporte une garantie plafond de l'État, à travers la Caisse centrale de réassurance. Cette garantie n'a joué qu'une seule fois, en 1999. Entre 1990 et 2003, ce régime a versé 11 milliards d'euros, soit une moyenne de 770 millions d'euros par an. Deux années ont été particulièrement lourdes : l'année 1999, avec 1,2 milliard d'euros, correspondant essentiellement aux inondations du Gard, et l'année 2003, avec 2,7 milliards d'euros, en raison d'inondations importantes dans le sud-est et des désordres liés à la sécheresse. Au total, le flux d'indemnisations a été de 21 milliards d'euros entre 1990 et 2003, soit 1,5 milliard d'euros par an en moyenne. Tout cela est-il lié à l'effet de serre ? Il est relativement difficile d'établir un lien de causalité. Nous ne sommes pas encore capables de faire la part des choses, dans l'évolution du rythme des indemnisations, entre ce qui tient à une concentration - et donc une vulnérabilité - plus forte des populations et des biens et ce qui tient à une intensité plus forte des événements naturels. Nous considérons néanmoins que la relation de cause à effet peut être établie en ce qui concerne les phénomènes de sécheresse. À l'évidence, ce sujet devrait pouvoir être pris en charge de façon plus cohérente et plus achevée au niveau européenne. L'Union européenne offre une diversité d'expositions et une capacité de mutualisation qui est sans commune mesure avec celles de l'Hexagone. M. le Président : M. Stéphane Penet va à présent nous exposer le rôle de la mission risques naturels et les principales conclusions que l'on peut apporter aujourd'hui en matière de changement climatique, du point de vue des assureurs. M. Stéphane PENET : Après l'année particulièrement noire pour les assureurs que fut l'année 1999, qui avait cumulé les tempêtes et les inondations, pour près de 8 milliards d'euros d'indemnisations, la profession a décidé de se doter d'un organisme, la mission risques naturels. Cette association régie par la loi de 1901 est administrée conjointement par la FFSA et le GEMA, le groupement des entreprises mutuelles d'assurance. L'objectif qui a été assigné dans un premier temps à la mission risques naturels était d'être l'interlocuteur des assureurs auprès d'un certain nombre de directions, d'associations ou d'organismes avec lesquels nous estimions n'avoir pas de relations assez régulières : le ministère de l'environnement, les établissements territoriaux publics de bassin, l'ensemble des associations locales qui travaillent dans le sens de la prévention contre les risques naturels. Deux objectifs, plus spécifiques, se sont ajoutés à celui-ci. Le premier est de faire une analyse critique et objective des politiques de prévention menées par les pouvoirs publics en matière de risques naturels, notamment les plans de prévention des risques naturels. Il se trouve que nous sommes partie prenante d'un régime d'assurance, le régime des catastrophes naturelles, qui est très imbriqué avec les politiques de prévention menées par les communes, les régions ou l'État. La MRN a commencé une étude dans trois départements, Alpes-Maritimes, Loiret et Tarn-et-Garonne, en analysant la pertinence des plans de prévention menés dans chaque commune de ces départements et en tentant de vérifier leur application. Le second objectif est d'apporter des éléments d'anticipation sur les effets du réchauffement climatique et ses conséquences pour la profession d'assureur. À ce titre, la MRN a participé à l'élaboration du rapport de l'ONERC en indiquant le point de vue des assureurs sur les stratégies d'adaptation que préconisait ce rapport. Il est souhaitable que la mission établisse des simulations économiques, afin que la FFSA puisse réagir en conséquence pour adapter ses régimes d'assurance, et notamment le régime catastrophes naturelles. M. le Président : Monsieur Marsaud, des travaux sont menés au niveau européen sur la question du changement climatique et sur le rôle du Comité européen des assurances en la matière. Pourriez-vous nous en parler ? M. Jean-Louis MARSAUD : Je rappellerai tout d'abord quelques chiffres. On constate que 650 événements naturels se sont produits en 2004, 700 en 2003. Nos études montrent que, pour les dix prochaines années, on estime le nombre de ces événements à 800 par an au minimum. Quelle est la part exacte du réchauffement climatique ? C'est une question scientifique, à laquelle nous ne pouvons répondre. Nous constatons seulement cette évolution, qui se traduit par un accroissement considérable des pertes économiques, puisqu'on estime qu'elles pourraient passer, dans les dix prochaines années, à 125 milliards d'euros, les pertes assurées représentant entre 35 et 40 milliards d'euros par an. D'ici à 2080, une étude que nous avons menée au niveau européen montre que des tempêtes extrêmes du type de celle de 1999 pourraient augmenter les coûts de 5 %, de 25 à 30 milliards d'euros. Le coût des inondations pourrait être accru de plus de 100 milliards d'euros. Le coût pour les assureurs a été de 15 milliards d'euros en 2003, et de 44 milliards en 2004. Il est important de souligner que la quasi-totalité des branches d'assurance sont concernées. L'assurance des biens l'est au premier chef, mais le phénomène touche aussi bien les assurances santé, les assurances de personnes en général, les assurances de risques agricoles, l'assurance construction, les risques professionnels, les pertes d'exploitation, l'assurance transport, et même l'assurance automobile ou la responsabilité civile générale, puisque demain, la responsabilité de certaines entreprises sera peut-être mise en cause parce qu'elles n'auront pas pris toutes les mesures adéquates pour limiter l'effet de leurs activités sur le climat. Beaucoup d'initiatives ont été prises au niveau européen. Un programme sur le changement climatique a été lancé, dont la première version date de mars 2000, et dont la deuxième version vient d'être proposée par le Commissaire à l'environnement en octobre dernier. Le Parlement européen a publié un rapport, également en octobre dernier. La Commission européenne a rendu une communication en février 2005 en vue de compléter des directives centrées sur le système d'échanges de quotas d'émission de gaz à effet de serre. Quelles sont les initiatives des assureurs européens ? Tout d'abord, nous analysons les systèmes de couverture des événements naturels qui existent actuellement dans les États membres. Nous développons également des études en matière de cartographie des risques, et tout particulièrement des risques d'inondations. Nous préparons un rapport sur le changement climatique, dont l'un des objectifs est d'analyser les conséquences de l'intensification de différents types d'événements naturels en fonction du développement de l'assurance sur les différents marchés concernés. Il s'agit notamment de déterminer qui, au bout du compte, supportera la charge des coûts supplémentaires. Le CEA a formulé des recommandations, qui visent tout d'abord à rappeler le rôle que peut jouer l'industrie de l'assurance. Au niveau national, elle peut alerter les différentes parties concernées, informer et faire connaître la réalité de ce risque. Elle peut exercer une influence à travers son rôle d'investisseur ou d'aide aux entreprises. Nous mettons aussi l'accent sur un certain nombre d'actions en matière de prévention : celles qui vont dans le sens de la réduction du risque, qu'il s'agisse du soutien au protocole de Kyoto ou de la promotion des énergies renouvelables ; celles qui vont dans le sens de l'adaptation, par exemple les systèmes d'information géographiques, le développement des systèmes d'alerte précoce, les programmes de surveillance des inondations, la définition de certaines normes techniques, notamment en matière de construction. Nous recommandons également le développement des partenariats public-privé. S'agissant de la prévention, nous insistons tout particulièrement sur la modélisation des risques et sur l'organisation de la gestion des catastrophes et des systèmes de réassurance. M. le Président : M. Besson va maintenant nous parler du rôle des réassureurs. M. Jean-Luc BESSON : Sans revenir sur tout ce qui a été excellemment dit, et que je reprends à mon compte, je me concentrerai sur les aspects touchant spécifiquement à la réassurance. La couverture des événements naturels par les assureurs repose largement sur le fait qu'ils puissent céder ces risques en réassurance, en mutualisant à un échelon le plus large possible ces risques souvent très lourds. Cette mutualisation ne peut se réaliser qu'à l'échelon mondial. Il est extrêmement difficile de mutualiser ces risques de pointe à un échelon régional. Au niveau mondial, la profession de la réassurance a pris une position d'avant-garde, qui n'était probablement pas complètement fondée sur le plan scientifique à l'époque où elle l'a prise. Elle a considéré que le changement climatique était une réalité, avant même le protocole de Kyoto. Tout ce qui s'est passé depuis nous a confortés dans cette position. Les conséquences du changement climatique qui concernent les assurances sont l'augmentation de la fréquence et l'augmentation de l'intensité des événements climatiques extrêmes. Les deux années qui viennent de s'écouler nous donnent une idée de ce qui pourrait arriver dans le futur de manière récurrente : typhon en Asie en 2004, inondations en Europe et en Asie en 2005, cyclones dans le golfe du Mexique en 2004 et en 2005, sécheresse en France. Les ouragans Katerina, Rita et Wilma, qui s'inscrivent tous trois dans la liste des dix plus importants événements de l'histoire mondiale de la réassurance, ont eu des conséquences financières très lourdes. Les sociétés de réassurance ont été obligées de faire face à des besoins de recapitalisation pour restaurer la solvabilité d'un certain nombre d'acteurs qui avaient été trop durement malmenés par ces trois événements. Des sociétés ont été obligées de compléter leur capital pour restaurer leur solvabilité. De nouveaux acteurs sont également intervenus sur le marché. Malgré ces deux années exceptionnelles, la profession de la réassurance a pu faire face à ses engagements. Il n'y a pas eu de défaut de crédits, ni de faillite réelle. Les réassureurs ont tenté de commencer à intégrer le changement climatique dans leur tarification. Ils ont, d'autre part, renforcé les outils de modélisation. En troisième lieu, ils ont renforcé le suivi et le contrôle du risque management. Je signale au passage que les trois grandes agences mondiales de modélisation sont toutes les trois américaines. La modélisation des inondations est un peu en retard sur les travaux conduits au sujet des événements dûs aux vents. On ne peut pas parler de la réassurance sans parler de la rétrocession. Les réassureurs sont en effet obligés de se réassurer pour les événements de pointe. Le marché de la rétrocession est extrêmement réduit, et une grande partie en est tenue par quelques acteurs. Il est, en outre, particulièrement perturbé par les deux années que nous venons de vivre, on y observe une certaine rétraction, et les acteurs ont modifié leur comportement. Un certain nombre ont réduit leurs engagements ; d'autres, malmenés par Katerina, ont été « sanctionnés » par les agences de notation, ce qui les met en difficulté sur le marché de la rétrocession. Aux Bermudes, 25 milliards de dollars ont été mobilisés pour recapitaliser des sociétés ou pour créer de nouvelles sociétés de réassurance, essentiellement pour la réassurance des catastrophes. Cette somme est très inférieure aux pertes occasionnées par la série d'ouragans Katerina, Rita et Wilma. Les extrapolations que l'on peut faire confirment ce que l'on a observé dans le passé. Les événements majeurs sont suivis d'une hausse des prix sur le marché de la rétrocession, donc sur celui de la réassurance, et, de manière un peu plus amortie, sur celui de l'assurance. Mais après une certaine période, on revient à des prix inférieurs. Autrement dit, le marché de la réassurance des catastrophes est extrêmement cyclique. Il faut bien reconnaître qu'il est difficile de faire passer des prix d'équilibre à long terme tenant compte du changement climatique et de l'accroissement des risques dans les années futures. Assez curieusement, les principaux acteurs anticipent une très forte augmentation des dépenses pour les réassureurs, mais ont une certaine difficulté à la traduire dans les prix pratiqués. Cette difficulté perturbe le fonctionnement du marché, car la succession de hausses et de baisses n'est pas toujours facile à supporter par les acteurs. Les réassureurs, je le répète, sont conscients du changement climatique et l'ont intégré dans leurs vues stratégiques, au moins sur le plan théorique et sur celui de l'organisation. Ils renforcent la gestion du risque, le contrôle des risques, le contrôle des cumuls, la diversification géographique. Récemment, l'agence Standard & Poor's a décidé d'introduire dès 2006, dans ses critères de notation, un nouveau pilier, qui la conduit à observer et à analyser de manière extrêmement serrée la gestion du risque et le suivi des engagements par les sociétés d'assurance et de réassurance, en particulier en matière d'événements climatiques. En outre, et sans porter aucun jugement de valeur, je souligne que l'accroissement des risques entraîne une intervention accrue des pouvoirs publics, dans beaucoup de pays. Le partage entre le public et le privé a tendance à se déplacer, au détriment du privé. On a vu par exemple que l'inondation qui a touché la Nouvelle Orléans a été couverte par un fonds public de l'État de Louisiane. Les tempêtes qui ont touché la Floride sont en partie couvertes par un fonds d'État, lui-même réassuré. Dans ces conditions, les réassureurs risquent de disposer d'une masse de manœuvre plus faible pour étaler les événements de pointe. Mais il faut reconnaître que l'intervention des pouvoirs publics a souvent été motivée par le fait que le marché ne parvenait pas à répondre de manière satisfaisante à tous les besoins. L'un des moyens de ne pas être exagérément tributaire du marché de la rétrocession, lequel est extrêmement cyclique et concentré, est de constituer, sous une forme ou sous une autre, des provisions d'égalisation, qui permettent, durant les années fastes, de mettre de côté, en franchise d'impôt, des sommes permettant de faire face à l'accroissement des dépenses dans les années néfastes. Il est clair que les sociétés de réassurance dont le siège est situé dans un pays où l'impôt sur les sociétés est inférieur à celui qui est en vigueur dans la plupart des pays de l'Union européenne ont un avantage compétitif. C'est une simple observation. L'impôt sur les sociétés est de 16 % en Suisse. Il est extrêmement marginal aux Bermudes. Les autres acteurs, européens ou américains, sont obligés de compenser cet aspect des choses. M. le Président : Messieurs, votre métier est de mesurer le risque. Pouvez-vous nous indiquer les mesures d'adaptation que nous pourrions prendre, outre la mesure d'ordre fiscal que M. Besson vient de nous suggérer ? D'autre part, j'observe le contraste entre le discours des scientifiques, qui soulignent la grande incertitude de la corrélation entre les événements extrêmes et le réchauffement climatique, et le discours des assureurs, qui constatent une explosion de la facture depuis 1990. M. Alain GEST : Les chiffres qui ont été donnés gagneraient à être comparés avec ceux d'une période antérieure. M. le Président : Les Américains l'ont fait. Des articles récents montrent que les risques ont été multipliés par dix dans certains cas. M. Gérard de LA MARTINIERE : Nous pouvons tenter de vous fournir des chiffres sur une période plus longue, mais il ne fait pas de doute que nous sommes en présence d'un phénomène d'augmentation de l'intensité et de la fréquence des événements naturels. Avant 2005, le dernier grand cyclone dans le golfe du Mexique était Andrew en 1992. L'année 2005 a connu trois cyclones, dont chacun a eu un coût supérieur à celui d'Andrew. En France, il faut remonter quatre cents ans en arrière pour imaginer, d'après certaines traces dans les forêts françaises, des tempêtes aussi violentes que celles de 1999. D'autre part, même si nous ne disposons pas des démonstrations scientifiques les plus incontestables, il y a un consensus chez les assureurs et les réassureurs pour considérer qu'une part significative de la causalité de ces phénomènes réside dans le réchauffement climatique. Quelles propositions pouvons-nous faire ? Tout ce qui, au plan de la gestion internationale de la problématique de l'effet de serre, est de nature à limiter le développement des émissions va dans le sens d'une limitation potentielle du coût du risque, envisagé globalement. Nous sommes naturellement enclins à soutenir les actions qui vont dans ce sens. Que pouvons-nous faire, nous assureurs, de plus spécifique ? Je crois d'abord qu'il faut être modeste. Une prise de conscience progressive est en train de se faire, au moyen de colloques, d'échanges, de délibérations professionnelles. Tout cela ne se fait pas en un jour. Cela dit, nous pouvons participer à ce combat de deux manières : l'une concerne l'identification et la souscription du risque ; l'autre concerne le comportement d'investisseur. Il est clair que nous devons davantage investir dans tous les éléments qui nous permettent une meilleure appréhension, et surtout une meilleure projection, de l'évolution possible des risques. C'est tout le travail qu'ont évoqué M. Penet et M. Besson, et qui porte sur l'investissement statistique, l'investissement de mobilisation, l'investissement de technologie de gestion du risque. Le deuxième volet de notre action concerne notre relation avec les acteurs des émissions de gaz. Il s'établit une dialectique, d'ailleurs classique, entre assureurs et entreprises au sujet de l'identification et de la couverture du risque. Nous avons sûrement des progrès à faire. Nous avons besoin de nous appuyer sur des normes internationalement reconnues. Car le dialogue entre l'assureur et une très grande entreprise est toujours un dialogue musclé. Le courtier cherche en permanence à tirer le meilleur prix pour la couverture la plus large. S'il n'y a pas un consensus fort sur les standards minimaux qui doivent être respectés en matière d'émission de gaz à effet de serre, il nous sera difficile de peser dans le sens de la prévention. Il existe un troisième volet possible d'action. Il s'agit de la prise en compte, au titre de la fonction d'investisseur des entreprises d'assurance, de critères de différenciation. Dans les politiques d'allocation d'actifs, dans les politiques de choix des véhicules investissement, il est possible d'introduire un facteur discriminant, la conformité avec les standards en matière de contribution à la réduction des risques climatiques. Cette prise en charge est en train de se faire. Elle n'est pas déjà inscrite de façon significative dans les politiques d'investissement de tous les assureurs. Aux États-Unis, les entreprises sont fortement questionnées sur leur politique à cet égard. Elles le seront également en Europe dans les mois qui viennent. M. le Président : Cela signifie-t-il que, par exemple en matière d'assurance automobile, on pratiquerait des prix différents en fonction de la carburation du véhicule ? M. Gérard de LA MARTINIERE : C'est tout à fait envisageable. Cela suppose un consensus fort entre tous les assureurs automobiles d'un pays. M. le Président : C'est une piste intéressante. Nous devrons y revenir. M. François DOSÉ : Je suis maire depuis trente ans. À tous ceux qui auront agi pour la prévention et l'adaptation, par des travaux de cartographie, des PPR, des actions sur l'habitat, à tous ceux qui auront contribué, à leur échelle, à relever le défi du changement climatique, qu'avez-vous à dire ? Vous avez souligné votre action au niveau national et international, mais qu'en est-il au niveau local ? Lorsque nous, élus ou agriculteurs, réfléchissons à la cartographie des barrages de la Meuse, les assureurs pourraient-ils nous aider, par exemple en nous proposant une baisse de cotisation si nous menons telle ou telle action ? J'aime bien que la politique devienne quotidienne. Les débats que nous avons ici sont intéressants, mais la démocratie passera par une appropriation collective des questions politiques. M. Stéphane PENET : Le régime des catastrophes naturelles est assis sur la solidarité. C'est le principe de base de ce régime. Il n'y a pas de sélection du risque. Tout le monde paie et tout le monde est assuré. Ce fut le choix du législateur en 1982. Celui qui n'a aucun risque d'être victime d'une avalanche paie une partie de sa prime pour le risque avalanche. Ce régime a connu des évolutions, notamment par l'introduction d'un système de modulation de franchise. Si, après qu'une commune a subi plusieurs inondations et a été visée par trois ou quatre arrêtés de catastrophe naturelle, il n'y a toujours pas de plan de prévention des inondations, nous appliquerons une franchise plus élevée. Cela permet théoriquement de mobiliser les communes. Mme Martine LIGNIERES-CASSOU : C'est l'État qui commande les plans de prévention. M. Stéphane PENET : En effet, mais le système que je décris a été voulu par le législateur. Cela étant, on peut effectivement se demander si le pauvre assuré qui est victime d'une inondation est responsable du fait qu'un plan de prévention ait été défini ou pas. Pour en revenir aux mesures d'adaptation à très court terme, l'engagement des assureurs est de faire en sorte que le régime catastrophes naturelles continue d'être à l'équilibre, et que le prix payé par les assurés ne soit pas prohibitif. Deux éléments nous paraissent particulièrement importants. D'une part, le risque sécheresse peut mettre à mal l'équilibre du régime : 1,562 milliard d'euros ont été payés pour la canicule de 2003, sur le seul risque sécheresse, sur les seuls désordres créés pour les constructions. Et l'on sait que cela n'a pas été suffisant puisque le législateur a adopté une procédure exceptionnelle dans le cadre de la loi de finances pour 2006. Le risque sécheresse est un risque très particulier, sans unité de lieu, ni d'action, ni de temps. La difficulté qu'a eue l'État à appuyer ses arrêtés de catastrophe naturelle à la suite de la sécheresse 2003 montre bien l'inadaptation des textes à ce type de risque. D'autre part, il nous semble important que, s'agissant de la sécheresse, et au-delà des PPR, il soit établi un zonage très clair des zones à risque, qui sont des zones argileuses, et qu'une fois cette cartographie achevée, des normes minimales de construction soient précisément définies. M. le Président : On a vu le nombre de communes qui ont sollicité un arrêté de catastrophe naturelle. Certaines ont connu des désordres qui étaient presque du niveau de ceux causés par les effondrements miniers. La proposition que vous venez de formuler mérite d'être discutée. M. Jacques BASCOU : Vous avez dit, M. Penet, que la mission risques naturels était chargée d'analyser la pertinence des mesures mises en place par les pouvoirs publics. S'agit-il de définir des responsabilités, d'où découlerait la prise en charge des dommages ? S'agit-il de participer à la prévention ? Si tel est le cas, je signale que, alors que les PPRI sont censés inclure le déménagement éventuel de personnes résidant dans des zones inondables, le fonds Barnier n'est pas suffisant. Dans ma circonscription, cent personnes doivent déménager. Nous ne trouvons pas les financements. Les assureurs seraient-ils prêts à aider au financement de la prévention, ce qui supposerait, je vous l'accorde, un changement complet de la philosophie de l'assurance ? Si les personnes concernées ne peuvent pas déménager, elles ne pourront pas être indemnisées en cas de dommages parce qu'elles ne rempliront pas les critères. Elles pourront se retourner contre l'État ou les maires qui leur auront accordé le permis de construire. M. Gérard de LA MARTINIERE : Je vais être très prudent dans ma réponse. Nous avons toujours essayé de conjuguer l'évaluation du risque, sa tarification, et la participation aux actions de prévention. Nous le faisons beaucoup en matière d'assurance automobile, à travers la sécurité routière, ou encore, en ce qui concerne les risques industriels, à travers la certification de matériels. La participation à la prévention fait partie du métier d'assureur. S'agissant du régime des catastrophes naturelles, nous sommes dans une situation un peu particulière. Nous ne sommes pas dans le marché de l'assurance. Nous sommes gestionnaires d'un régime public qui nous échappe complètement : nous ne fixons pas les prix, nous ne fixons pas les franchises, nous ne fixons pas les critères. Les risques sont déterminés par l'État. C'est donc un domaine ou nous serons donc moins naturellement enclins à jouer la carte de la prévention, puisque nous ne sommes pas du tout sûrs de pouvoir récupérer le « retour sur investissement » de la prévention. Cela étant, nous aurons en 2006 une discussion avec plusieurs ministères autour d'une modification du régime des catastrophes naturelles. À la faveur de cette réflexion, l'économie de ce régime évoluera-t-elle ? C'est possible. Il nous semble, pour notre part, que ce régime n'est pas suffisamment incitatif en termes de prévention des risques. La question est de savoir où il convient de fixer le point d'équilibre entre le principe de solidarité nationale et l'incitation à travers la tarification. M. Stéphane PENET : Je précise que sur les 12 % de surprime obligatoire d'un contrat d'assurance, deux points alimentent le fonds Barnier. Les assureurs alimentent ainsi un fonds qui est censé être un fonds de prévention. M. Alain GEST : Vous avez évoqué la mise en place d'un système d'évaluation de la pertinence et de l'effectivité des PPR. Est-il trop tôt pour vous demander ce que vous en pensez ? M. Stéphane PENET : Nous avons un premier rapport d'étape, d'où il ressort que les PPR sont un instrument extrêmement puissant. Ces plans peuvent permettre de travailler à la fois sur les constructions nouvelles, sur l'existant, sur les réparations. Ils peuvent concerner plusieurs risques ou un risque particulier. Cela dit, nous constatons une certaine lenteur dans la mise en place des PPR. Le rythme auquel ils se déploient n'est pas à la hauteur des enjeux. Il nous paraît souhaitable que l'État assume davantage ses responsabilités dans l'accélération de la mise en place des PPR. Dans le Loiret, où 50 % des arrêtés de catastrophe naturelle sont liés à la sécheresse, il n'y a pas un seul plan de prévention sécheresse. M. Philippe TOURTELIER : Lorsque le Président a évoqué tout à l'heure la possibilité d'un traitement différencié des véhicules, il a été dit qu'une telle mesure nécessiterait un consensus entre les acteurs. Dans le domaine de la construction, la loi a prévu des améliorations thermiques du parc existant, mais aucune obligation pour le propriétaire de faire les travaux. La profession serait-elle prête à envisager des avantages, en termes d'assurance, aux propriétaires qui réaliseraient des travaux visant à limiter l'émission de gaz à effet de serre ? D'autre part, M. Besson a évoqué le caractère cyclique du marché de la rétrocession, ainsi que la difficulté d'adopter des prix d'équilibre à long terme. Compte tenu du fait que le changement climatique est inéluctable, ces prix d'équilibre à long terme se situent-ils à l'intérieur des fourchettes actuelles ou au-dessus du maximum déjà atteint ? Autrement dit, monsieur Besson, n'êtes-vous pas en train de nous annoncer une hausse structurelle du prix de l'assurance ? M. Gérard de LA MARTINIERE : Pour répondre à la première question, je ne crois pas que nous ayons, à ce jour, réellement travaillé sur le problème des logements. Nous allons sans doute devoir examiner la possibilité que se dégage un consensus chez les assureurs. Mais là encore, il faut que la conscience des enjeux soit suffisamment partagée. S'agissant du prix d'équilibre, je vais laisser à M. Besson le soin de vous répondre, mais je voudrais souligner un paradoxe. Tout le monde s'accorde à dire que nous allons devoir faire face, dans les années qui viennent, à un alourdissement de la charge globale des conséquences des événements climatiques. Mais dans le même temps, les nouveaux standards comptables imposées par l'Union européenne, sur la base des propositions de l'IAS Board, ont supprimé toute espèce de provision d'égalisation. Sous prétexte de prévenir toute tentation de lissage des résultats, on empêche les assureurs et les réassureurs d'intégrer dans leur tarification la probabilité de survenue d'événements exceptionnels. Ce n'est pas l'intérêt de l'économie en général que de fonctionner par à-coups violents, en hausse ou en baisse, ce qui désorganise la programmation des investissements des entreprises à moyen terme. M. le Président : Il serait bon que vous nous fassiez parvenir une petite note sur ce point, qui fasse bien apparaître les enjeux, et peut-être en l'assortissant de quelques exemples. M. Jean-Louis MARSAUD : Pour confirmer ce que vient de dire M. de La Martinière, je rappelle qu'en matière d'assurance contre la grêle, les provisions d'égalisation ont été très largement utilisées pour assumer la couverture de ce risque sur de longues périodes. M. Jean-Luc BESSON : M. de La Martinière a parfaitement répondu à la question. J'ajouterai qu'à mes yeux, le problème de savoir si le prix d'équilibre se situe un peu plus haut ou un peu plus bas n'est pas d'une importance capitale. L'important est de pouvoir lisser les catastrophes naturelles sur de longues périodes. Le problème est ce caractère exagérément cyclique, pour ne pas dire exagérément spéculatif, du marché. La réforme des normes comptables aura pour effet de renforcer ce phénomène. J'ajoute que les hedge funds s'intéressent actuellement à la couverture des catastrophes naturelles. Cela ne va pas contribuer à réduire le caractère cyclique du marché. M. le Président : Le prix est tout de même un problème. Supposons que la sécheresse ait coûté 1,2 milliard d'euros. En estimant à 20 millions le nombre de foyers assurés, cela fait plus de 50 euros par foyer. Dans un certain nombre de foyers, c'est une somme qui peut compter. Si les événements exceptionnels se répètent de plus en plus, la situation peut devenir difficile. Les réassureurs intègrent-ils la probabilité des événements dans leur stratégie de mutualisation au niveau mondial ? M. Jean-Luc BESSON : Oui. Depuis deux ans, la plupart des grands réassureurs ont commencé à durcir les modèles dans le sens d'une amplification de la fréquence et de l'intensité des grands événements. M. le Président : Nous allons à présent entendre Mme Claire Dorland-Clauzel, du groupe AXA, qui va nous présenter un exemple concret de projet, Carbon disclosure, visant à participer à la diminution de l'effet de serre. Mme Claire DORLAND-CLAUZEL : AXA a choisi de participer au Carbon disclosure project dans le cadre d'une stratégie de développement durable. Nous considérons qu'en tant qu'assureur et investisseur - nous collectons environ 78 milliards d'euros de primes dans le monde, dont 18 milliards en dommages, et nous gérons à peu près 900 milliards d'euros d'actifs dans le monde -, nous devons intégrer dans notre métier les principes du développement durable. Le Carbon disclosure project procède, depuis mai 2002, à une enquête auprès des 500 plus grandes entreprises du monde en termes de capitalisation boursière, afin de collecter des informations concernant leurs émissions de gaz à effet de serre. Il s'agit de savoir comment elles envisagent les enjeux du réchauffement de la planète et comment elles comptent y répondre. Nous considérons qu'il est important, pour piloter nos investissements, de disposer d'informations précises sur l'exposition des entreprises au risque climatique, sur leurs besoins en énergie, sur le coût et le respect des quotas depuis l'application du protocole de Kyoto. AXA a adhéré au CDP en 2004, et a organisé en octobre dernier la présentation des résultats devant un parterre de spécialistes et de journalistes, afin de donner plus de visibilité à cette initiative et inciter le maximum d'entreprises à répondre à ce questionnaire. En tant qu'entreprise, nous répondons nous-mêmes au questionnaire. Nous avons notre propre bilan environnemental. Nous avons intégré dans notre stratégie de développement durable une gestion environnementale de nos sites, de façon à baisser notre propre impact sur l'effet de serre. Dans la plupart des entités d'AXA dans le monde, nous avons instauré un reporting environnemental - conformément, d'ailleurs, à la loi NRE -, de façon à connaître notre consommation d'énergie, d'eau, de papier. En tant que gestionnaire d'actifs, nous mettons en place un certain nombre de politiques. Premièrement, nous avons renforcé nos équipes de recherche de façon à intégrer progressivement des critères de développement durable dans nos gestions d'actifs sur fonds propres. Nos filiales de gestion d'actifs commencent à intégrer dans nos décisions d'investissement la manière dont les entreprises dans lesquelles nous investissons prennent en compte ou non l'effet de serre. En second lieu, nous avons établi des règles de gouvernance en matière de gestion d'actifs, dans lesquelles nous prenons en compte des critères de responsabilité sociale. Troisièmement, nous avons intégré dans notre gestion d'actifs immobiliers des chartes environnementales. Tous les programmes d'investissement immobilier auxquels nous participons doivent répondre aux normes HQE - haute qualité environnementale -. En matière assurancielle, nous développons un certain nombre d'axes de prévention. Au niveau du diagnostic environnemental, des ingénieurs spécialisés aident les PME et PMI à dresser leur propre diagnostic environnemental. Nous procédons également à des audits de risque et formulons des recommandations, grâce à des équipes dédiées. Nous réfléchissons également à la manière dont nous pourrions améliorer l'indemnisation en nature en cas de sinistre. Je pense ici à tout ce qu'il est possible de faire en matière de remplacement écologique des dommages. Nous travaillons actuellement avec nos ingénieurs à intégrer dans nos réparations en nature des peintures qui évitent de développer l'effet de serre. Sur le plan technique, nous avons intégré dans la gestion de risque de portefeuille la recherche sur les risques émergents. Nous avons créé un Climate Group pour développer les outils d'analyse et de modélisation de l'impact climatique dans notre risque management. Nous renforçons les actions collectives de prévention en nous associant à la recherche climatique du CEA. Par l'intermédiaire de notre filiale britannique, nous participons à un programme de recherche lancé par le gouvernement britannique. En 2006, nous avons l'intention d'aller plus loin. En association avec l'ADEME, nous allons lancer auprès des entreprises du SBF 120 la même enquête que celle menée par le Carbon disclosure project. Les résultats seront publiés en septembre prochain. L'ADEME développe un certain nombre d'outils en matière de diagnostic environnemental et de bilan carbone. Mme Martine LIGNIERES-CASSOU : Vous n'avez pas évoqué les collectivités territoriales. Celles-ci ont pourtant un patrimoine immobilier extrêmement important. Il serait intéressant d'analyser comment elles intègrent à leur gestion les préoccupations environnementales, notamment celles relatives à l'effet de serre. Mme Claire DORLAND-CLAUZEL : Il est vrai que les initiatives auxquelles nous participons n'incluent pas les collectivités territoriales. Mais c'est une idée qui ne doit pas être écartée. Je ne vois pas pourquoi, même si je ne peux pas m'y engager, ce type de questionnaire ne pourrait pas être également adressé aux collectivités territoriales. Mme Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET, Rapporteure : Lors du salon POLLUTEC qui s'est récemment tenu à Paris-Nord Villepinte, le groupe MAAF Assurances a reçu un prix, notamment pour avoir décidé, avec le « Pur bonus auto », de soutenir les conducteurs ayant choisi une voiture « écologique ». Il compte développer cette démarche en lançant d'autres produits, « Pur bonus maison » par exemple. Qu'en pensez-vous ? Mme Claire DORLAND-CLAUZEL : Cette démarche est également la nôtre. Nous sommes en train de réfléchir à la manière d'intégrer à nos produits une dimension incitative à la consommation de biens économes en termes d'émission de gaz à effet de serre. Nous avons déjà intégré la prévention dans des produits comme « Coaching retraite » ou « Coaching santé ». Nous ne l'avons pas encore fait dans le domaine de l'assurance dommages, mais nous y réfléchissons activement. M. le Président : Vous avez évoqué les programmes de qualité environnementale que vous appliquez dans votre gestion d'actifs immobiliers. Ces programmes vont-ils plus loin que les normes HQE ? Dans l'immobilier haussmannien, la consommation d'énergie est de 300 kWh au mètre carré. La moyenne française est de 120 kWh au mètre carré. Certaines maisons expérimentales consomment 10 ou 20 kWh au mètre carré. Quand on sait que le parc immobilier se renouvelle au rythme de 1 % par an, on voit qu'il existe de grandes marges. Mme Claire DORLAND-CLAUZEL : Je ne peux pas vous fournir de réponses précises maintenant. En revanche, je peux vous dire que nous avons introduit des critères environnementaux dans notre politique d'investissement immobilier. Dans tous les nouveaux programmes, la qualité environnement a été intégrée, le but étant de produire un véritable impact sur l'émission de gaz à effet de serre. M. le Président : M. Michel Ségard est sous-directeur de la prévention des risques majeurs au ministère de l'écologie et du développement durable. Il va nous parler des principes de la politique menée par le ministère en matière de risques naturels et de la manière dont cette politique prend en compte le changement climatique. M. Michel SÉGARD : Je soulignerai d'abord que la politique du ministère repose sur la recherche d'un équilibre entre la mise en œuvre du système d'indemnisation des catastrophes naturelles et la réduction de la vulnérabilité. Le risque, c'est un aléa multiplié par une vulnérabilité. La question est de savoir si l'augmentation des risques à laquelle nous assistons résulte d'une augmentation de l'aléa ou d'une augmentation massive de la vulnérabilité. En matière d'inondations, il est clair que nous allons malheureusement vers une augmentation de la vulnérabilité. En second lieu, nous prenons comme référence, dans la politique de prévention des risques, l'occurrence centennale d'un risque. Cela signifie qu'à l'échelle d'une vie humaine, on a une chance sur deux de voir ce risque se réaliser. Troisièmement, la politique que nous menons ne vise pas seulement de réduire les dommages aux biens, mais d'abord les pertes en vies humaines. Notre feuille de route comprend sept composantes : la connaissance de l'aléa, la surveillance et l'alerte, l'information préventive et l'éducation aux risques, la maîtrise de l'aménagement, la réduction de la vulnérabilité, la préparation de la crise et le retour d'expérience. Il est essentiel d'informer les habitants, sans quoi un PPR n'aurait guère d'utilité. La politique de prévention des risques liés au réchauffement climatique est très controversée. La première difficulté est de faire admettre la réalité des risques et la nécessité des mesures de prévention. La deuxième concerne la notion de risque acceptable. Il arrive assez souvent que des personnes réclament le droit de prendre des risques : laissez-moi construire en zone inondable, j'en prendrai la responsabilité. Quelques jours après le sinistre, ces mêmes personnes se tournent vers le maire : vous m'avez accordé un permis de construire, vous me devez une indemnisation. Il y a un déficit dans l'élaboration collective des politiques de prévention. Même si la loi de 2003 a prévu une meilleure concertation avec les collectivités territoriales, d'énormes progrès restent à faire. Il faut être conscients du fait que les conséquences du réchauffement climatique sont parfois niées. Au sein de la fonction publique comme au de certaines collectivités, il y a des contestations fortes de ces conséquences, et parfois du phénomène lui-même. Il convient d'éviter l'écueil inverse, qui consiste à prendre en compte de manière excessive des événements à probabilité faible et dont les enjeux sont importants. Les services du ministère mettent en œuvre une veille active ; dans le respect du principe de précaution. Les risques que nous surveillons plus particulièrement sont le risque inondation, le risque incendie de forêt, le risque sécheresse, et surtout les « effets domino » engendrés par le réchauffement climatique, qu'il s'agisse de risques naturels ou de risques technologiques. Je citerai un exemple ponctuel, celui d'un embâcle glaciaire qui menaçait de se rompre, dont nous avons été alertés en 2004. Nous en avons été informés presque par hasard, ce qui est assez inquiétant. Un groupe de recherche surveillait le glacier dans un tout autre objectif. 800 00 m3 d'eau menaçaient d'inonder quelques villages, il a été possible de contrôler la vidange du lac grâce à deux campagnes pendant les étés 2004 et 2005. Le programme DISCOBOLE - Données pour le dimensionnement des structures côtières et des ouvrages de bord de mer à longue échéance - est mené par le CNRS. Son objectif est d'améliorer l'estimation de l'évolution à moyen et long terme de certaines conséquences du changement climatique. On sait que le niveau moyen de l'océan est en hausse, mais que cette hausse est très variable selon les lieux. Il est important de localiser ce phénomène. Des surcotes sont connues, et sont en augmentation. Plusieurs phénomènes contribuent à la surcote marine : le vent, la pression atmosphérique, l'amplitude de la marée, la houle. En termes cartographiques, l'accent doit être mis sur la Manche, où des mesures de prévention plus fortes doivent être prises. La Méditerranée ne présente pas de réelles difficultés liées aux surcotes, mais les protections côtières y sont beaucoup moins résistantes - c'est là un exemple du rapport complexe entre aléa et vulnérabilité. Quelles mesures peut-on prendre ? En premier lieu, il convient d'assurer une bonne diffusion des résultats scientifiques. Il est important de localiser le phénomène sur le territoire. Il faut ensuite réévaluer l'occurrence et l'intensité des événements naturels. Il faut enfin conduire des travaux relatifs aux règles de construction. Après la tempête de 1999, cette dernière question avait été posée, comme elle l'a été à l'occasion de la sécheresse de 2003. On constate que les normes de construction sont convenablement définies. Le problème est de les faire respecter. Enfin, toute notre action doit être guidée par le principe de précaution, au sens de l'article 5 de la Charte de l'environnement. Mme la Rapporteure : Comment les travaux de votre sous-direction s'articulent-ils avec ceux de la Mission interministérielle de l'effet de serre et ceux de la direction de études économiques et de l'évaluation environnementale ? M. Michel SÉGARD : Dans la sous-direction que j'anime, le métier des chargés de mission est d'examiner les travaux menés par la D4E, de l'ONERC, de la MIES, et d'en tirer les conséquences concrètes pour l'élaboration des PPR. Inversement, les questions que nous nous posons nous conduisent à interroger la recherche. Cela dit, il est extrêmement difficile de traduire les travaux scientifiques en termes de localisation des risques. M. Marc GILLET : Il est apparu au cours de cette table ronde que nous souffrons d'un manque de modélisation. Il y a quelques années, la DPPR avait souligné que le travail économique sur l'évaluation des risques était encore insuffisant. J'ai le même sentiment en ce qui concerne la modélisation des coûts du réchauffement climatique. Certains coûts ont été évoqués ici, mais il y en bien d'autres, qui doivent être mieux cernés, notamment par la recherche. M. Robert KANDEL : Les scénarios de modification de l'atmosphère sont marqués par un certain nombre d'incertitudes. Ce que l'on peut affirmer de manière certaine, c'est, d'une part, qu'un réchauffement climatique est en cours et qu'il va s'aggraver plus ou moins nettement, et d'autre part, qu'un réchauffement climatique global entraîne nécessairement des modifications dans le calendrier, la localisation et l'intensité de différents risques. Je ne dirai pas que tous les événements extrêmes vont augmenter partout. Mais la carte de ces événements va changer. Cela étant, il est évidemment beaucoup plus difficile d'analyser les choses de manière plus spécifique, au niveau d'un pays, d'une région, d'une collectivité. M. Serge POIGNANT, Vice-Président : Madame, messieurs, je vous remercie de votre contribution aux travaux de notre Mission. Table ronde sur l'impact du changement climatique en montagne réunissant : Présidence de M. Jean-Yves Le Déaut, Président M. le Président : Mes chers collègues, nous accueillons, pour cette table ronde consacrée à l'impact du changement climatique en montagne, M. Robert Delmas, à qui je vais demander de présenter nos autres invités ainsi que lui-même. M. Robert DELMAS : Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais vous remercier d'avoir organisé cette table ronde. Pour nous, scientifiques, votre démarche est particulièrement bienvenue. Nos recherches nous conduisent en effet à la conclusion qu'il est urgent de tirer la sonnette d'alarme et de mieux informer la société et les politiques des risques encourus. Pour vous informer, vous disposez désormais des rapports du GIEC, et je sais que vous avez également entendu d'autres scientifiques vous parler du changement climatique et de ses impacts. Je ne reviendrai donc pas sur les aspects généraux du phénomène. Vous avez devant vous trois spécialistes du changement climatique en montagne. Greg Greenwood dirige le MRI, Mountain Research Initiative, institution qui se trouve à Lausanne et s'efforce de rassembler toutes les informations disponibles sur les multiples facettes du changement climatique dans les différentes zones montagneuses du globe et de promouvoir les recherches sur les problèmes spécifiques à ces régions, qui concernent tout de même 720 millions d'être humains ! Le MRI vient de publier un volume de 650 pages intitulé Global Change and Mountain Regions, une compilation de 62 contributions individuelles sur le sujet. Justement, une de ces contributions portait sur les glaciers tropicaux des Andes en tant qu'indicateurs de la variabilité climatique à l'échelle du globe. Patrick Wagnon, du laboratoire de glaciologie de Grenoble, en était l'un des auteurs. Aujourd'hui, ce chercheur de l'IRD, par ailleurs alpiniste réputé puisqu'il vient cette année de réussir une première dans l'Himalaya, est ici pour vous informer et répondre à vos questions sur le fonctionnement des glaciers de montagne, sur la relation glaciers-climat, et sur les risques liés à leur retrait. Le troisième intervenant sera Éric Brun, directeur de la recherche à Météo France, que vous connaissez et que vous avez déjà questionné sur les variations du climat observées en France. Mais avant de rejoindre l'équipe de direction de Météo France, il a dirigé le centre d'étude de la neige de Saint-Martin-d'Hères. Les Alpes et le manteau neigeux n'ont donc pas de secrets pour lui. Quant à moi, je suis chargé de mission à la direction de la recherche du ministère de la recherche, mais je préside aussi le comité national français sur le changement global, le CNFCG. Ce comité est le correspondant en France des quatre grands programmes internationaux relevant du changement global : PMRC et PIGB pour les mécanismes physiques et biogéochimiques, IHDP pour les dimensions humaines du changement climatique, et DIVERSITAS pour la biodiversité. Je veux souligner par là que les changements globaux ne relèvent pas seulement des sciences du climat au sens strict, c'est-à-dire physique du terme, mais aussi d'autres facteurs plus complexes, comme la biosphère et la présence de l'homme sur terre. Le fonctionnement du système climatique est loin d'être pleinement compris. Les rapports du GIEC doivent donc être considérés comme des rapports d'étape, nullement comme des rapports finaux et définitifs. Enfin, je voudrais utiliser ma casquette de chercheur grenoblois pour indiquer que la région Rhône-Alpes a certes pris des initiatives pour structurer la recherche à l'échelle régionale avec le plan Envirhonalp et un cluster sur l'environnement alpin, mais que, curieusement, le changement climatique n'a pas à ce jour émergé comme une priorité. Elle dispose pourtant de laboratoires de premier plan dans ce domaine. Il existe aussi un Institut de la montagne à Chambéry, mais cette initiative ministérielle tarde à définir sa vraie feuille de route. M. Gregory GREENWOOD : Je vous remercie, Madame et Messieurs les députés, de m'accorder cette occasion de vous fournir des aperçus sur le changement climatique et ses effets sur les régions montagneuses. Le MRI, un programme de coordination de recherches dont j'assume la direction, est financé par le Fonds national suisse, et vise à faire progresser la recherche sur ces questions. Depuis 2003, son projet le plus important est un projet financé par le 6e programme-cadre de recherche de la Commission européenne, le programme GLOCHAMORE, Global Change in Mountain Regions. Quatre ateliers ont été mis en place, une conférence organisée, et une stratégie de recherche élaborée, dont je vous parlerai tout à l'heure. Les changements climatiques que nous avons vécus au cours du siècle passé ont déjà affecté la haute montagne, non seulement en Europe, mais partout dans le monde. Voici une photo du sommet du Kilimandjaro dans les années 1930, tout couvert de glaciers ; voici sa photo aujourd'hui, qui montre combien ils ont fondu en trois quarts de siècle ! Cette fonte n'est pas seulement due au réchauffement climatique : il s'agit d'un ensemble de modifications d'éléments du climat - pluviométrie, insolation, température - qui doit aboutir inéluctablement, paraît-il, à la disparition de ces glaciers vieux de 11 000 ans. Le réchauffement climatique est amplifié par l'altitude. Vous voyez, sur cette carte, le réchauffement moyen selon l'altitude le long de la Cordillère américaine, tel que prédit par des modélisations climatiques sur la base d'un doublement la teneur en dioxyde de carbone. Si le réchauffement était uniforme quelle que soit l'altitude, la courbe serait uniforme aussi. Mais ce n'est pas le cas : le réchauffement attendu à 4 000 mètres sera double de celui attendu à 1 000 mètres. La disparition de glaciers est assurément un signal qui choque notre sensibilité. Vous voyez ici le recul des glaciers de l'Oberland bernois : le tracé rouge est celui des limites glaciaires en 1850, le bleu celui de 1973. Compte tenu du réchauffement attendu, les glaciers sont appelés à reculer encore, et il en résultera un régime hydraulique fortement modifié. Une étude récente de Bettina Schäfli pour l'École polytechnique fédérale de Lausanne met en évidence certaines conséquences de ce nouveau régime sur la production d'hydroélectricité dans le bassin versant de Mauvoisin, aujourd'hui recouvert à 40 % par un glacier. L'auteur s'est appuyé sur des scénarios climatiques élaborés dans le cadre du projet PRUDENCE de la Commission européenne, selon lesquels la température augmenterait au plus de 3 degrés, éliminant la quasi-totalité de la couverture glaciaire du bassin. La perte de ce « tampon » glaciaire aurait pour conséquence qu'une baisse de 8 % des précipitations provoquerait à son tour une perte de 36 % de la production hydroélectrique. Que deviendrait alors l'approvisionnement en eau par les montagnes ? La réponse est variable selon chaque région. Mais en Californie, où une étude a été faite, elle est inquiétante. Des chercheurs du Scripps Research Institute ont en effet estimé l'impact d'une hausse de la seule température, sans même faire varier la hauteur des précipitations. La Californie est, on le sait, un État très montagneux, dont l'approvisionnement en eau provient largement des montagnes du Nord et de l'Est. L'État a certes fait construire un grand nombre de réservoirs, mais le principal est encore la couverture neigeuse, qui jusqu'à présent tenait jusqu'en été. En outre, une grande partie de cette eau transite par le delta californien, juste en amont de la baie de San Francisco. Le croquis de gauche fait apparaître la hauteur d'eau moyenne au 1er avril dans le bassin versant alimentant la baie, hauteur qui varie de 10 ou 20 centimètres en basse altitude à près d'un mètre en haute altitude. Le croquis de droite montre la réduction, en pourcentage, de l'eau stockée sous forme de neige, dans l'hypothèse d'une hausse de température de 1,6 degré. Cette réduction est faible en haute altitude, mais s'accroît sensiblement à mesure que l'on descend. Là où, actuellement, il y a peu de neige, il n'y en aura plus du tout. Plus troublant encore : dans les zones plus élevées, là où il y a 40 à 50 centimètres, il n'y en aura plus que 20 à 25, soit une réduction de moitié au moins. Ces phénomènes accentueront le ruissellement pendant l'hiver, et donc la complexité de la gestion des réservoirs et le risque d'inondations. Par contre, le complément d'eau apporté par la fonte de neige en été sera réduit, provoquant une incursion plus profonde des eaux marines dans le delta, et mettant en danger la qualité de l'eau consommée par l'agriculture et par les villes du Sud de l'État. Un autre exemple, concernant la Californie, est l'effet du changement climatique sur les incendies de forêt, qui pourraient se généraliser. Une étude faite en 2003 par Fried et autres fournit des résultats pertinents et des leçons importantes. Ses auteurs ont construit un modèle de prédiction des incendies, à partir de paramètres physiques comme le type de combustible, sa teneur en humidité, la pente, permettant de prévoir le comportement du feu selon les conditions météorologiques, mais aussi un modèle du fonctionnement du service des forêts et incendies, tenant compte des ressources en hommes et en matériels, des règles d'engagements, du nombre de pare-feux, etc. Un modèle de production des incendies, donc, et un modèle pour la lutte contre les incendies, l'objectif étant de mesurer les indices de performance sous l'effet du changement climatique, en se servant, comme Schäfli, des scénarios climatiques comme troisième élément du puzzle. Tous ces résultats ont une leçon à nous apprendre : celle de la surprise. Lorsque les chercheurs ont fait tourner les trois modèles, ils ont trouvé des impacts assez sévères là où le combustible consistait en prairies et en strates arbustives basses, mais aucun impact en forêt. Ces résultats s'expliquent par l'influence du vent : même si beaucoup de paramètres météorologiques ont changé sous l'effet du doublement de la teneur en CO2, le vent l'emporte encore sur tous les autres facteurs pour expliquer le comportement du feu. Il n'y a donc pas que le réchauffement et les précipitations, il y a aussi bien d'autres variables. J'en viens maintenant au projet GLOCHAMORE. Je ne m'étendrai pas sur ce qui concerne la cryosphère, car nous avons ici de très bons experts qui vont vous en parler tout à l'heure. Je parlerai davantage d'hydrologie. Il faut s'employer à mieux comprendre le cycle de l'eau dans les montagnes, car les glaciers et la neige ne suffisent pas à expliquer tous les phénomènes hydrologiques. Il y a aussi l'apport de la pluie, qui est primordial, et qui pourrait connaître de grands changements dans l'avenir. Et il y a aussi la façon dont cheminent les gouttes d'eau, quelle que soit leur origine, à travers les paysages montagneux, vers les ruisseaux et les nappes phréatiques, produisant crues et étiages selon le lieu et le moment. Chaque maillon du cycle de l'eau en montagne est perçu par la société soit comme un bénéfice, soit comme un coût. Dans la mesure où le changement climatique affecte le cycle de l'eau, il change aussi l'ampleur et la répartition des coûts et des bénéfices au niveau de la société. Les écosystèmes de montagne nous fournissent, de par leur fonctionnement, des biens et des services, dont la valeur peut être modifiée par le changement climatique. J'en prendrai deux exemples. Les forêts de montagne, tant qu'elles poussent, stockent du carbone dans le bois et dans le sol, fixent celui-ci et nous protègent des avalanches. Ce sont des services qui ont une valeur non négligeable. En outre, lorsqu'on exploite la forêt, on perçoit non seulement la valeur du bois, mais aussi celle des emplois qui font vivre la région. Et l'on peut dire la même chose des pâturages. Les espèces qui composent les écosystèmes ont une valeur qui va au-delà de leur simple contribution au fonctionnement de ceux-ci. Il est donc important de suivre non seulement l'évolution de la forêt, mais celle des espèces d'arbres. Il est possible, par exemple, que l'alternance de colonisation et de mortalité qui fait remonter la forêt en altitude ait aussi pour effet d'en changer la composition. Nos connaissances paléo-écologiques nous confirment cette possibilité. Par ailleurs, il existe des espèces ayant une valeur psychologique, voire spirituelle, dont la perte, si elle avait lieu, serait aussi choquante pour nous que la fonte totale des glaciers. Inversement, le changement climatique peut ouvrir la porte à la prolifération d'espèces envahissantes. Autre exemple, sur lequel je glisse très rapidement car il vous est familier : l'importance économique de la neige pour le tourisme, qui est l'industrie principale des montagnes en Europe. Et maintenant, que faire ? Quelle réponse adéquate apporter ? Ne nous faisons pas d'illusions : le changement climatique est engagé et ne s'arrêtera pas dans les décennies qui viennent. Nous pouvons éventuellement l'amortir, mais il faut surtout que nous nous y adaptions. Or il n'est que partiellement quantifié, et nous ne savons pas avec précision la trajectoire future du climat. Devant l'inconnu, la réponse traditionnelle est double. Il faut d'une part que nous nous forcions à en apprendre davantage, afin de mieux identifier les trajectoires probables. Munis d'une meilleure compréhension, nous serons plus capables de nous adapter. Il nous faut d'autre part constituer les ressources, les réserves nécessaires pour faire face au changement le moment venu. Le raccourci peut paraître un peu abrupt et sibyllin, mais en dire plus m'entraînerait trop loin. Comment nous forcer à en apprendre davantage ? C'est une tâche à laquelle j'ai été confronté en tant que conseiller technique du ministre des ressources naturelles de l'État de Californie. Nous avons demandé aux services techniques de l'État de préparer les deux premiers morceaux du puzzle dont je parlais tout à l'heure, le modèle de la nature et celui des hommes, en considérant le climat comme une variable et non comme une donnée. Dans un premier temps, nous avons pu convaincre les services des transports, de l'énergie et de l'eau. Récemment, en Californie, la politique climatique s'est accélérée. L'État a créé un centre de recherche sur le changement climatique, doté d'un budget, qui s'est attelé à élaborer des scénarios climatiques régionaux, sur lesquels devra s'appuyer la planification stratégique dans différents domaines, tels que l'eau, la neige, la végétation, les économies d'énergie. Je trouve cette démarche très prometteuse, et j'y vois un encouragement à agir pour d'autres gouvernements. Je vous remercie de votre attention, et me tiens à votre disposition pour répondre à vos questions. M. le Président : Je vous remercie pour votre présentation. Vous avez souligné que le doute n'est plus permis, mais il y a encore des polémiques, notamment à propos de l'évolution des glaciers. Certains disent qu'il y a déjà eu, dans le passé, de mini-variations des glaciers, sans quoi Hannibal n'aurait pas pu passer par les Alpes. Est-on certain que le changement climatique aura des incidences fortes sur les montagnes, au point que leur situation soit très changée à la fin du XXIe siècle ? Sur la réalité du réchauffement, il y a très peu de contestation. Il y a un certain scepticisme quant à ses conséquences, mais il fait peu de doute que le changement climatique soit en marche. Cela ne veut pas dire que le climat ait été stable dans le passé, au contraire, mais ce qui, aujourd'hui, fait la différence, c'est que l'action de l'homme a une force égale aux autres forces climatiques, et que la température moyenne, dont les variations autrefois n'ont jamais été sinusoïdales, est clairement sur une pente ascendante. Comment cela se traduit-il pour les glaciers ? On voit qu'ils reculent en Suisse, mais dans le Karakoram, au Pakistan, certains, au contraire, avancent. Ce n'est pas forcément contradictoire avec le changement climatique : peut-être descendent-ils parce que leurs bases sont lubrifiées ? En Norvège, les glaciers avancent parce qu'il y a plus de précipitations, et cela ne contredit pas non plus la théorie du changement climatique. M. Patrick WAGNON : Au cours des siècles, il y a eu des époques où les glaciers étaient plus petits qu'aujourd'hui, par exemple entre 1100 et 1400, ou au contraire plus grands, comme entre 1650 et 1850, sous ce qu'on appelle le petit âge de glace, quand leur surface faisait 40 % de plus que maintenant dans les Alpes. Pour l'instant, nous restons dans les limites de variation naturelle, mais il y a, pour la première fois, une part de responsabilité humaine dans le processus. Et lorsqu'on fait des projections pour l'avenir, on descend à des niveaux inconnus à ce jour. Nous sommes donc dans le bas de la fourchette des limites naturelles, mais l'évolution vers le bas est appelée à se poursuivre, et nous entrons dans une période inconnue, ce qui rend impossible de faire une prévision générale pour l'ensemble des glaciers du monde. Mme Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET, Rapporteure : J'ai lu, sur l'avant-dernière photo, qu'il était question de « constituer une réserve » pour se prémunir de l'imprévisible. M. Gregory GREENWOOD : J'avais d'abord écrit « une assurance ». Quand on connaît la probabilité de l'événement, on peut choisir les moyens techniques d'y faire face. Mais face à l'inconnu irréductible, il faut s'assurer, comme on le fait auprès d'un agent pour couvrir des pertes éventuelles. L'idéal serait évidemment que nous ayons une idée précise de la trajectoire prévisible du climat, grâce à des modèles quantitatifs. Mais le climat est un phénomène chaotique, et il y a donc une limite à la prévision théorique. Il faut donc que l'État, ou la société, constitue une « réserve ». En Californie, par exemple, on connaît la probabilité des incendies de forêt, et je peux donc prendre des mesures pour protéger ma maison, mais si le vent est trop fort, je ne pourrai rien faire. Il faut donc que je m'assure. Voilà l'idée qu'il faut transposer du niveau individuel à celui de la société et de l'État. M. Serge POIGNANT : Existe-t-il des simulations permettant de moduler les conséquences en fonction de l'ampleur du réchauffement ? Est-ce qu'on peut dire, par exemple, qu'avec un degré de plus il y aura telle conséquence, avec deux degrés telle autre, avec trois degrés telle autre encore, etc. ? M. Éric BRUN : Oui, j'en donnerai des exemples tout à l'heure en parlant de l'enneigement. Mais la température n'est pas le seul facteur. M. le Président : Nous avons vu une modélisation graduée de la couverture neigeuse de la Californie. M. Gregory GREENWOOD : Il en existe une autre, par exemple, sur les glaciers du Rhône suisse. Un chercheur de Zurich a fait des simulations avec un réchauffement d'un degré, d'un degré et demi, de trois degrés, et a même testé l'hypothèse d'un refroidissement. C'est le stade auquel en est la science pour l'instant : on arrive à faire des modélisations quantitatives. Mais il faut gagner encore en précision, et relier les modèles les uns aux autres afin d'obtenir un modèle global se déclinant en modèles régionaux, avec les conséquences sur le pergélisol, la neige, les glaciers, le système hydraulique, etc. M. François DOSÉ : Ma question prolonge celle de M. Poignant. Certains phénomènes sont évidents, et leurs effets impossibles à stopper, à l'horizon de quelques décennies au moins. Mais des chercheurs, ou des industriels, ont-ils tenté de prévoir ce qui se passera, dans trente ans, pour les barrages des Alpes, et quelle sera leur production d'électricité ? M. Éric BRUN : Nous avons monté un projet de simulation du débit de la Durance en amont du barrage de Serre-Ponçon. Mais il est paradoxalement beaucoup plus facile, même si c'est très frustrant, de dire ce qui se passera à la fin du XXIe siècle que dans dix ou vingt ans, compte tenu de la variabilité interannuelle, on n'en est pas à ce stade. Nous avons une grosse incertitude sur les précipitations, et globalement les prévisions ne sont pas encore très fiables. Mais ce qui est sûr, c'est que le pic de fonte sera décalé de trois ou quatre semaines à un mois. M. Vincent ROLLAND : Rétrospectivement, la fonte des glaciers des Alpes, au cours des cinquante dernières années, est-elle liée à la hausse des températures, à un déficit de précipitations, ou aux deux ? M. Éric BRUN : J'en parlerai tout à l'heure dans mon exposé. Ce qui est frappant, c'est que la diminution est très rapide depuis 1982, et qu'elle s'explique presque totalement par la fonte en juin, juillet et août. Or, il n'y a pas de baisse des précipitations à cette époque de l'année, c'est même plutôt le contraire. M. le Président : Il existe un Institut de la Montagne à Chambéry, il y a le MRI à Lausanne. L'État et les régions se sont-ils donné les moyens d'avoir des centres de recherche soutenant la comparaison avec les institutions étrangères ? M. Robert DELMAS : La question est délicate. L'institut de Chambéry a été créé par une décision unilatérale du ministre Claude Allègre. C'était une bonne idée, dans la mesure où il existe des problèmes spécifiques aux régions de montagne. L'institut a reçu de l'argent, mais pour l'instant il ne tourne pas à 100 % de son potentiel, notamment parce que sa feuille de route n'est pas encore totalement définie, alors qu'il y a dans la région un potentiel de recherche important, notamment à Grenoble. M. le Président : Si je comprends bien, et pour formuler la chose en termes diplomatiques, il y a encore des progrès à faire ? M. Patrick WAGNON : Je serai moins diplomatique : le problème de fond est celui des compétences scientifiques, dont l'essentiel se trouve à Grenoble, qu'il s'agisse de l'hydraulique, de l'enneigement, des glaciers. Il y a certes des coopérations possibles, mais les forces vives sont à Grenoble. M. le Président : Je vais maintenant vous donner la parole pour votre exposé, après quoi nous entendrons M. Brun. M. Patrick WAGNON : J'appartiens à l'Institut de Recherche pour le Développement et je travaille au laboratoire de glaciologie et géophysique de l'environnement de Grenoble, et je vais vous parler des fluctuations glaciaires. Les glaciers reculent depuis la fin du petit âge de glace. Voici des photos du glacier d'Argentière, au-dessus de Chamonix, en 1864, 1896 et 1995 : il a reculé, depuis 1864, de 1,4 kilomètre. Mais l'ampleur du recul est propre à chaque glacier, à sa dynamique, laquelle est fonction de son écoulement, de sa géométrie, de la pente du socle rocheux sur lequel il s'écoule. Ce qu'on étudie par conséquent, c'est le bilan de masse, mesurant la variation en volume. Un glacier comporte en effet, dans sa partie amont, une zone dite d'accumulation, où il tombe plus de neige qu'il ne fond de glace, et où le bilan de masse est donc positif, et, dans sa partie aval, une zone dite d'ablation, où c'est le contraire. Pour mesurer la variation de volume sur une année, qu'on divise ensuite par la surface du glacier de façon à obtenir un résultat en mètres d'eau permettant de s'affranchir du problème de la densité, on procède à des carottages manuels en divers points de la partie haute du glacier, on fait la même chose dans la partie basse à l'aide de balises, et on mesure de nouveau un an après. La différence d'émergence nous donne la quantité de glace perdue. On obtient ainsi la variation de volume sur un an, ou sur une saison. Pour le glacier de Saint-Sorlin, entre 1900 et 2000, le glacier a perdu en cumulé l'équivalent de 30 mètres d'eau répartis sur toute sa surface. Mais il y a eu plusieurs phases : la perte de masse a été faible entre 1900 et 1940 et entre 1955 et 1982, mais forte après 1940 et depuis 1982. Les précipitations n'ont pas baissé, et ont même plutôt légèrement augmenté. Ce qui explique la différence, c'est donc l'ablation, la fonte au cours de la période estivale. Pour comprendre la relation entre cette fonte et le climat, on fait le bilan des différents processus climatiques à la surface du glacier. La fonte ne s'explique pas par la seule température, mais aussi par le rayonnement solaire, qui est en partie réfléchi et en partie absorbé par la surface du glacier ; par le rayonnement thermique de l'atmosphère, qui envoie de l'énergie au glacier, lequel renvoie en contrepartie des radiations dans l'atmosphère ; par l'humidité de l'air, par la vitesse du vent, etc. On fait donc l'inventaire de tous ces flux énergétiques, mesurés sur le glacier par des stations météo automatisées. Entre la période 1954-1981 et la période 1982-2002, il y a eu plus de 60 centimètres d'ablation supplémentaires pendant la période estivale, ce qui correspond à 20 watts par mètre carré en plus. C'est énorme. Parallèlement, la température estivale moyenne s'est élevée de 0,8 degré, ce qui correspond à 13 watts seulement par mètre carré. La différence, c'est-à-dire 7 watts par mètre carré, s'explique par le rayonnement, la nébulosité, etc. Donc, il ne faut pas s'intéresser seulement à la température, mais à toutes les variables du climat. La comparaison avec les autres glaciers du monde sur les cinquante dernières années fait apparaître un recul assez semblable au Canada, ainsi que dans le Tian Shan et le Pamir. Elle est impossible avec l'Himalaya, faute de séries de données. On en dispose pour les Andes tropicales, mais elles sont plus courtes, et font apparaître un recul rapide, sans doute lié à El Niño. En Scandinavie, au contraire, où il s'agit de glaciers maritimes, le volume a augmenté dans les années 1990 sous l'effet de précipitations accrues, mais l'ablation est supérieure pendant la période estivale. Quel avenir pour les glaciers ? Si l'on retient un scénario moyen, c'est-à-dire un réchauffement de 3 degrés d'ici à 2100, le glacier de Saint-Sorlin perdra, à l'horizon 2030, 40 % de sa surface du seul fait de l'élévation de la température, se réduira, à l'horizon 2050, à sa partie la plus épaisse, et aura complètement disparu à l'horizon 2100. Cela ne signifie pas que tous les glaciers des Alpes soient appelés à disparaître dans la même hypothèse. Celui de Saint-Sorlin est un cas parmi d'autres, il culmine à 3400 mètres, et sa zone d'ablation est assez basse par rapport à celle d'autres glaciers qui culminent à 4000 mètres. Soulignons encore que ces projections ne tiennent pas compte des précipitations, dont l'accroissement pourrait avoir un effet modérateur. Reste qu'avec 3 degrés de plus, il faudrait 75 % de précipitations supplémentaires pour contrecarrer les effets du réchauffement, ce qui est peu vraisemblable. Ce recul des glaciers risque d'être lourd de conséquences sur la ressource en eau, notamment dans les Andes. La Paz, à 3 800 mètres d'altitude, est alimentée en totalité par les glaciers pendant la saison sèche. L'IRD a une station à trente kilomètres de la capitale bolivienne, dans le glacier Zongo, dont la superficie est de 2 kilomètres carrés, et y mesure les précipitations. Si le glacier disparaissait, son effet régulateur, qui consiste à capter l'eau pendant la saison pluvieuse - de novembre à mars - et à la redistribuer pendant la saison sèche - de mai à août -, disparaîtrait aussi et il n'y aurait plus d'eau pendant la saison sèche. Or, dans les Andes, les précipitations tombent pour l'essentiel sur le versant Est, et presque pas sur le versant Ouest, où se trouvent beaucoup de grandes villes, comme Lima, La Paz ou Quito, qui sont tributaires des glaciers pour leur approvisionnement en eau et en électricité - sans oublier l'irrigation des surfaces agricoles. Et l'on prévoit que ces glaciers auront perdu la moitié de leur surface d'ici vingt ans. A brève échéance, 40 millions d'habitants sont concernés en Amérique du Sud, et un sixième de la population du monde entier, par ce problème, si l'on considère les glaciers et les couvertures neigeuses saisonnières. Autres risques importants : les risques naturels d'origine glaciaire. Lorsque les glaciers reculent, ils laissent des lacs, qui occupent les moraines. Il suffit d'une vague provoquée par une chute de glace ou par un séisme pour qu'en quelques minutes une brèche s'ouvre et qu'une lave torrentielle dévaste tout sur son passage, comme dans la vallée du Rio Santa, au Pérou, où l'on dénombre 10 000 victimes depuis 1725. Les Péruviens sont devenus experts en matière de prévention, et vidangent artificiellement les lagunes. Mais dans l'Himalaya, le Bhoutan et le Népal, où en moins d'un demi-siècle se sont formés des lacs dont certains mesurent plusieurs kilomètres carrés, vivent sous la menace. Il existe une cinquantaine de lacs potentiellement dangereux, dont un seul est vidangé. On s'attend donc à une catastrophe majeure en Himalaya d'ici cinq ou dix ans. M. Éric BRUN : Contrairement à d'autres pays comme la Suisse, la France n'a pas de tradition ancienne de la mesure de l'enneigement, et nous ne disposons d'aucune série de mesures quotidiennes sur un siècle. Les seules séries que nous ayons et qui remontent au début du XXe siècle, dans la Tarentaise ou le Vercors par exemple, outre qu'elles ont quelques trous, ne mesurent pas la hauteur de neige, mais les chutes de neige fraîche, jour après jour et en cumulé, et ne sont pas représentatives de l'enneigement total. La seule longue série relative à l'enneigement dont nous disposons résulte des données recueillies depuis quarante-cinq ans au col de Porte, à 1 320 mètres d'altitude. Depuis une trentaine d'années, nous disposons d'un réseau de cinquante à cent points de mesure - selon les périodes de l'année - situés dans des stations de ski ou en haute altitude, mais à partir desquels il est très difficile d'extrapoler, à cause des effets de versant, de pente, d'altitude, de distribution de la neige par le vent - qui peut, par endroits, déblayer la neige au point qu'il arrive parfois qu'il n'y en ait plus à un col - et aussi de la forte variabilité interannuelle. Le laboratoire du col de Porte, dans la Chartreuse, à proximité de Grenoble mais qui n'est pas sous l'influence climatique de l'agglomération, est en service depuis les années 1960, et assure le suivi quotidien de la hauteur de neige et de tous les paramètres d'évolution du manteau neigeux : pluie, neige, température, vent, rayonnement solaire et infrarouge, humidité, etc. Si nous retenons, par exemple, la deuxième décade du mois de février, qui correspond au pic de la fréquentation des stations, nous observons, sur quarante-cinq ans, une forte variation interannuelle de la hauteur de neige moyenne : il n'y avait presque pas de neige, par exemple, durant l'hiver 63/64. Reste que les années à faible enneigement sont de plus en plus fréquentes, et la droite de régression que l'on peut tracer à partir des données recueillies montre une très nette tendance à la baisse, qui, j'insiste, est statistiquement fiable et n'est pas le fruit du hasard. Inversement, les hivers à fort enneigement sont de plus en plus rares. Au cours des années récentes, la moyenne de la hauteur de neige durant la deuxième décade de février n'a jamais atteint un mètre au col de Porte, alors qu'autrefois elle dépassait assez souvent un mètre cinquante ou deux mètres. Le nombre de jours de neige au sol a une variabilité légèrement plus faible, avec une tendance moins nette à la baisse, mais tout aussi fiable statistiquement. Nous avons donc peu de longues séries de données en moyenne montagne, ce qui est frustrant, et en outre celles que nous avons valent pour les Alpes du Nord, pas pour les Alpes du Sud. Nous avons cependant, depuis les années 1970 et surtout depuis les années 1980, des données destinées à la prévision des risques d'avalanche, recueillies grâce à une coopération entre Météo France et les stations de sports d'hiver. Elles font apparaître des comportements légèrement différents, avec une même tendance à la baisse, mais du fait même que les séries sont plus courtes, elles sont statistiquement moins probantes. Quel sera l'impact du réchauffement attendu sur la climatologie nivale ? Nos modèles sont élaborés à l'aide d'ordinateurs, à partir des lois de la physique, des processus d'accumulation de masse et d'échanges d'énergie sous forme de rayonnement ou de chaleur. Si l'on veut appréhender l'impact des conditions météorologiques sur le manteau neigeux, il faut aussi prendre en compte ce qui se passe à l'intérieur de celui-ci. Si, par exemple, la neige fond dans la journée, mais que l'eau regèle en surface la nuit suivante avant d'avoir eu le temps de s'écouler, il n'y aura pas de réduction de la masse. Si l'on ne tient pas compte de cela, on s'expose à des erreurs importantes. Il y a trois séries de facteurs : en premier lieu, la température et les précipitations, la première influant sur la seconde en déplaçant la limite pluie-neige, et la neige payant donc, en quelque sorte, un double tribut au changement climatique ; ensuite, le rayonnement solaire et infrarouge, le premier jouant toutefois davantage pendant la période estivale, où la luminosité est plus forte que pendant la période hivernale ; enfin, le vent et l'humidité de l'air. La première étude réalisée à partir d'une modélisation de ce type remonte au début des années 1990, avec trois scénarios correspondant respectivement à un réchauffement de 1,5 degré, 3 degrés et 4,5 degrés. Il est ainsi apparu, pour la première fois, qu'avec 4,5 degrés de plus le manteau neigeux disparaîtrait presque complètement au col de Porte, et qu'il était extrêmement sensible à la moindre hausse des températures. L'étude a été étendue à d'autres sites, en retenant l'hypothèse d'un simple réchauffement de 1,8 degré : la durée d'enneigement à 1 500 mètres se trouve réduite de 40 jours environ, quel que soit le massif, et la hauteur maximale de neige de 30 à 40 centimètres, aussi bien dans le Chablais, où la valeur de référence est de 1,7 mètre, que dans les Alpes de Haute-Provence, où elle atteint à peine un mètre. Quant à la durée d'enneigement à 3 000 mètres, elle passe, dans les mêmes conditions, de 300 jours à 270 dans les Alpes du Nord, et diminue de 30 à 40 jours également dans les Alpes du Sud. Enfin, une hausse modérée des précipitations ne jouerait pas, comme on l'avait envisagé, de rôle compensateur. Selon la simulation effectuée à 3 000 mètres dans le massif du mont Blanc, à partir une durée de référence du manteau neigeux de 310 jours, un surcroît de précipitations de 10 % aurait certes un fort impact, de l'ordre de 30 à 40 centimètres, sur la hauteur de neige, mais n'allongerait la durée d'enneigement que de quelques jours, car ce surcroît viendrait en fin de saison, à une période où la fonte est très rapide sous l'effet du rayonnement solaire. La sensibilité aux précipitations est donc relativement faible. Et elle l'est encore plus à la température même si le réchauffement n'est que de 1,5 degré, du fait que les précipitations prennent plus la forme de pluie et moins celle de neige. Si l'on ajoute à cela les effets du rayonnement infrarouge, on tombe à moins de 3 mètres de hauteur de neige, et la durée d'enneigement se réduit de 30 ou 40 jours. M. le Président : Merci beaucoup, messieurs, pour ces exposés très intéressants. J'ai une petite question, d'ordre économique : quelle sera, selon vous, l'incidence de ces phénomènes sur le tourisme en montagne ? Investiriez-vous, par exemple, dans une station de sports d'hiver des Vosges ? M. Éric BRUN : J'ai des données, concernant la région de Grenoble, pour la troisième décade de décembre et pour la deuxième quinzaine d'avril - deux périodes critiques pour la fréquentation des stations. Que ce soit à 900 ou à 1 200 mètres, sur les vingt ans à venir, il y aurait encore de temps en temps de la neige et il neigerait, en conservant le climat actuel, entre le 20 et le 31 décembre, et si la température moyenne s'élevait de 1,8 degré, il n'y aurait même pas systématiquement de neige à 2 500 mètres. En avril, la tendance est encore plus marquée, car il s'ajoute l'effet cumulé de la fonte. M. le Président : On dit qu'au cours du XXe siècle, la température moyenne s'est élevée de 0,6 à 0,8 degré - mais davantage en montagne. Or, vous avez fait état d'un réchauffement de 0,8 degré pour la seule seconde moitié du siècle. M. Éric BRUN : Au col de Porte, il y a eu près d'un degré de plus en quarante ans. M. Patrick WAGNON : Les séries statistiques montrent que l'augmentation est concentrée presque exclusivement sur la deuxième moitié du siècle, et les 0,8°C dont j'ai parlé correspondent aux Alpes, l'été. Mme la Rapporteure : Considérez-vous qu'il y ait une rétroaction positive sur le climat du fait de la baisse de la radiation liée à la diminution de l'enneigement, ou est-ce seulement pertinent pour l'Arctique et pas pour les Alpes ? M. Éric BRUN : Mon propos concernait l'enneigement hivernal. A priori, les Alpes françaises ont, à cause des régimes d'Ouest, un climat très proche de celui de la masse d'air, sauf les fonds de vallées, qui peuvent être très marqués par la présence de neige. Du fait de la taille réduite des Alpes françaises, il y a très peu de modifications du climat lui-même par la présence de neige. La rétroaction due à une réduction du manteau neigeux serait donc très faible, contrairement à l'Est de l'Europe, à la Sibérie et au Canada, où la présence même de la neige est une grande source de refroidissement. M. Patrick WAGNON : Si les glaciers de l'Antarctique et du Groenland disparaissaient totalement, il ne pourrait plus jamais se reformer de glaciers à la surface de la terre, à cause du surplus de rayonnement capté. Mais on n'en est pas là. M. Serge POIGNANT : Je voudrais revenir sur les catastrophes annoncées dans l'Himalaya. Ne pourrait-on y parer en aménageant des retenues d'eau ? M. Patrick WAGNON : Certains gouvernements le font. L'Inde, par exemple, construit de grands barrages dans les zones de piémont de l'Himalaya. Mais il n'y a rien de prévu en Amérique du Sud, et il nous faut donc alerter les dirigeants. Construire des barrages serait un moyen possible de contrebalancer le retrait des glaciers, malgré les problèmes d'évaporation ou autres qui pourraient surgir. M. Vincent ROLLAND : L'intensité des précipitations hivernales se modifie-t-elle ? Nous avons connu, si je me souviens bien, un hiver 1998-1999 très neigeux, mais où les chutes étaient surtout concentrées entre fin novembre et début décembre, avec un hiver plutôt sec. Y a-t-il un décalage des chutes de neige dans le temps ? Interviennent-elles davantage en début ou en fin de saison ? La question est d'importance pour le maintien du manteau neigeux et l'activité touristique. Dernière question, incidente : pourra-t-on encore skier en 2050 ? M. Éric BRUN : Le département de Savoie s'est penché sur la question en mai dernier. S'agissant des précipitations, nous avons étudié en détail ce qui se passe au col de Porte. Il n'y a pas de tendance quantitative, significative sur quarante-cinq ans, pendant la saison hivernale. Par contre, on observe qu'il y a un peu moins d'épisodes de précipitations, mais un peu plus intenses. C'est un phénomène sans doute lié à l'augmentation de la fréquence de l'oscillation nord atlantique depuis une cinquantaine d'années : la pression tendant à baisser en Islande et à monter aux Açores, il y a plus de perturbations venant du sud-ouest que du nord-ouest. Il y a donc plus de précipitations dans les Alpes du Sud et les Pyrénées, mais moins dans les Alpes du Nord, et les précipitations sont plus chaudes et la limite pluie-neige remonte plus haut en altitude. Il ne neige pas plus tôt qu'avant, et peut-être même plus tard. En 1969, au col de Porte, la première neige était tombée fin septembre, alors qu'actuellement il n'y en a même pas début décembre ! Et en 1970, la neige a tenu jusqu'au 3 juin, et ce à 1 300 mètres ! C'est impensable aujourd'hui : s'il tombe de la neige en mai, elle ne tient pas plus de quelques jours. Il est très difficile d'extrapoler de tout cela des tendances quantitatives en matière de précipitations. En février 1999, il y a eu des épisodes neigeux continus de fin janvier à fin février, des avalanches catastrophiques à Chamonix, en Suisse, en Autriche. C'est un phénomène qui revient tous les quinze ou vingt ans, à cause de la circulation atmosphérique générale sur la planète, qui canalise les perturbations depuis l'Islande jusqu'aux Alpes, avec des précipitations colossales pendant trois semaines ou un mois. Nous n'avons pas assez de statistiques pour savoir si cela se produira plus ou moins souvent à l'avenir. Nous savons seulement que ce qui s'est produit en 1970 et en 1999 se reproduira, mais dans un environnement un peu plus chaud, et qu'il pleuvra plus et neigera moins à des altitudes de plus en plus élevées. Quant à savoir si l'on pourra toujours skier en 2050, j'escompte bien que oui. Les choses ne vont tout de même pas si vite ! A 1 300 mètres, la tendance ne devrait pas changer avant longtemps, car elle est d'origine anthropique : il restera, bon an mal an, 60 à 70 centimètres de neige au col de Porte. Il y aura plus de neige un peu plus haut, mais elle durera moins, et si l'on veut skier plus longtemps, il faudra aller encore plus haut. Quant aux Vosges, je suis désolé de ne pas pouvoir vous répondre, car les études portent surtout sur les massifs sujets aux risques d'avalanche. M. Philippe TOURTELIER : Vous avez dit qu'on pourrait construire des barrages pour parer à la fonte des glaciers, mais vous avez ajouté tout de suite après qu'il y avait un risque d'évaporation, et donc de renforcement de l'effet de serre. Est-ce seulement un risque marginal, ou sommes-nous dans un cercle vicieux ? M. Patrick WAGNON : Je ne suis pas compétent pour comparer l'évaporation d'un glacier et celle d'un barrage. J'imagine seulement que celle du glacier est inférieure, compte tenu des surfaces d'eau libre et de l'écoulement. Mais je ne saurais pas dire de combien. M. Éric BRUN : En été, la température du glacier est de zéro degré maximum, et l'air, qui est toujours un peu humide, a tendance à condenser l'eau sur les surfaces glacées. Le barrage que l'on construirait, étant à une altitude plus faible, aurait des eaux plus chaudes, et donc, sans doute, une évaporation plus forte. Mais cela dépend aussi d'autres facteurs, comme l'humidité de l'air. Reste que les barrages peuvent contribuer à faire ce que la nature ne ferait plus : fournir de l'eau aux hommes. M. le Président : Vous avez évoqué le pergélisol. Le réchauffement aura-t-il des conséquences sur ces sols, gelés en permanence, dans des zones qui ne sont pas montagneuses à proprement parler ? Et cela rejaillira-t-il sur le reste du continent européen ? M. Patrick WAGNON : Ce n'est pas mon domaine de spécialité. Je sais seulement que les surfaces de pergélisol diminuent actuellement, expulsant des gaz à effet de serre, mais je ne sais pas quelles sont les conséquences. M. Gregory GREENWOOD : Ce n'est pas mon domaine de spécialité non plus, mais j'ai cru comprendre qu'il y aura des zones étendues, en Russie, au Canada, en Alaska, où le pergélisol va disparaître, et que cela libérera beaucoup de méthane et d'autres gaz à effet de serre. En quelles quantités ? Je ne sais pas. Certains espèrent, en Russie notamment, que ce réchauffement permettra d'accroître les surfaces habitables et cultivables, mais c'est oublier toutes les infrastructures construites sur ces sols dont on pensait qu'ils resteraient gelés pour l'éternité. S'ils fondent, les routes risquent fort de fondre aussi, et on a constaté, en Alaska, une érosion énorme du fait de la fonte du pergélisol et de la banquise, obligeant les habitants des zones côtières à migrer. Mais en montagne, le risque est surtout celui des éboulements, notamment sur les faces nord des sommets alpins. M. le Président : Messieurs, je vous remercie de vos propos très clairs, qui nous ont permis, à défaut de nous rassurer, de mieux comprendre certaines évolutions inquiétantes. Audition de M. Christian BRODHAG, Présidence de M. Jean-Yves LE DÉAUT, Président M. le Président : M. Brodhag a accepté de venir nous parler ce matin de la lutte contre le changement climatique. Monsieur le délégué, je vous souhaite la bienvenue. M. Christian BRODHAG : Je suis très heureux d'être parmi vous et d'essayer de faire passer un message stratégique s'agissant de ces changements climatiques, qui auront un impact sur nos activités économiques et nous amèneront à adopter une économie à bas niveau de carbone. Sur le plan scientifique, les choses sont claires. Quelles que soient les politiques que nous pourrons mener, il y aura une augmentation de la température, et un certain nombre de changements auxquels il faudra s'adapter. Nous disposons d'un document finalisé sur la stratégie d'adaptation, qui est achevé et sera prochainement publié. Il pourra servir de base à certaines discussions avec le Parlement. Sur la limitation des émissions, les chiffres sont assez clairs : si l'on prétend limiter le réchauffement à deux degrés au maximum, il faudra être en dessous de 500 parties par million, ce qui nécessite d'aller assez rapidement vers une division par deux des émissions u niveau mondial. Cela devrait conduire les pays industrialisés à diviser les leurs par quatre à l'horizon 2050, soit un rythme de 3 % par an. Je rappelle simplement que le secteur des transports accroît aujourd'hui les siennes de 2 % par an. Nous sommes donc devant des changements de trajectoire de développement assez importants. Il faudra essayer d'en optimiser les effets sociaux et économiques, transformer cette anticipation des problèmes en une façon de trouver de nouvelles opportunités économiques. C'est dans cette perspective que j'essaie de me situer. A Kyoto, l'objectif était de diminuer de 5 % les émissions entre 1990 et 2012. On est loin du compte ! Kyoto n'est qu'un premier rodage d'un système à venir de régulation des questions climatiques, avec des mécanismes de permis d'émissions particulièrement innovants. A la différence de certaines politiques, notamment fiscales, le processus de Kyoto fixe des objectifs, dont le résultat est théoriquement garanti. En revanche, il ne garantit pas à quel prix ils seront réalisés. C'est le marché qui ajuste le prix de l'adaptation et on ne peut pas prévoir ce que sera le prix du carbone. Aujourd'hui, il est stabilisé un peu au-dessus de 20 euros la tonne de carbone. Le Canada a ratifié Kyoto, mais l'État fédéral a plafonné le coût de la tonne de carbone à 15 dollars canadiens, soit une dizaine d'euros. Mais cela pèse sur les finances publiques, puisque ce sont elles qui devront écrêter le surcoût. Nous sommes donc devant des mécanismes nouveaux, qu'il nous faudra rôder et maîtriser. Certains pensent que la technologie va tout régler : par exemple, que demain, grâce à la séquestration du carbone et à son stockage dans les centrales thermiques, on pourra continuer à brûler du charbon sans que cela contribue à l'effet de serre. Une telle approche a un effet très démobilisateur et pourrait dissuader de faire des efforts au quotidien. L'Agence internationale de l'énergie a montré qu'en optimisant le coût individuel dans le secteur domestique, on pourrait diminuer dès aujourd'hui de 15 % la consommation d'énergie. Il faut donc mettre en place une politique en profondeur. Enfin, il faut veiller à rester en phase avec les grandes évolutions internationales et éviter de s'engager dans des impasses technologiques. S'agissant des biocarburants et de l'utilisation de la biomasse, on aura tendance à investir dans certaines filières seulement, mais il faut savoir qu'à moyen et long terme, on utilisera l'ensemble de la plante et donc la cellulose. Il faudra se garder de faire comme avec le minitel, qui fut une grande fierté pour nous, mais a fini par constituer un handicap par rapport à l'Internet. Comment agir et avancer ? Le protocole de Kyoto est un système en rodage. Une fois qu'on aura augmenté les contraintes et donc diminué les émissions de gaz à effet de serre, le prix de l'énergie montera. D'où l'importance d'adopter des stratégies collectives pour éviter des surcoûts et des pertes de compétitivité. Nous devons développer des outils pour faire des bilans carbone à tous les niveaux, dans toutes les organisations, les entreprises, les collectivités, pour les produits. Des actions sont menées en ce sens à l'ADEME. Il est important de suivre cette question du carbone. Chaque acteur doit savoir où il en est. C'est l'étape actuelle de déploiement de notre système d'information. J'espère pouvoir monter un système de reporting de l'État et de l'administration pour qu'on puisse rendre compte, à tous les niveaux, des émissions. Il faut bien connaître les solutions disponibles, évaluer leur coût pour disposer d'éléments économiques en amont des politiques publiques. Or pour l'instant nous n'avons ni l'appareil technique ni la structure administrative pour être efficaces. Nous devons disposer d'outils de modélisation qui nous permettent de faire des simulations de politiques et de faire un lien entre la définition de tel ou tel type de politique et les résultats sur le terrain. Pour l'instant, nous utilisons des modèles qui sont dérivés de modèles énergétiques mais qui ne sont pas spécifiques. Nous avons besoin de piloter de façon plus précise les politiques et de pouvoir garantir : qu'on atteindra nos engagements, notamment ceux de Kyoto ; que les dispositions prises seront les moins chères et les plus efficaces. L'ensemble des pays étant confronté aux mêmes problèmes, ceux qui trouveront plus rapidement les solutions économiques verront leur compétitivité renforcée. Avec Kyoto, nous mettons l'accent sur les outils financiers. Tout un travail est à mener sur l'ingénierie financière. Un rapport, commandé par la Caisse des dépôts et consignations et récemment déposé, traite du développement des mesures domestiques, dans des domaines qui ne sont pas touchés aujourd'hui par le plan d'allocation des quotas. En effet, par anticipation sur le système Kyoto, l'Union européenne a pris une directive sur les quotas et mis en place des allocations pour un certain nombre d'industries ; un marché s'est créé au niveau européen. Mais cela ne concerne qu'un certain nombre d'installations industrielles. De nombreux secteurs ne sont pas concernés. Une des solutions consisterait donc à créer, sur d'autres types de programmes, par exemple dans le domaine agricole, dans celui des transports, dans celui de la construction, des systèmes d'accès à des quotas. Cela permettrait de créditer le coût de la tonne de carbone sur les marchés pour des opérations ayant lieu en Europe ou en France. Notez que ce type de projets existe avec les pays en développement. Des systèmes financiers sont donc à mettre en place. Dans le domaine du logement, on voit très bien que la courbe « facteur 4 » est tout à fait à notre portée. En outre, elle est « gagnante gagnante » : elle permet de créer de l'emploi, pour faire des travaux, notamment de réhabilitation. Nous savons financer ces travaux par les économies faites sur le combustible et sur le carbone en aval. Encore faut-il programmer des outils financiers, des outils de formation et donc mener une politique d'accompagnement. J'organiserai d'ailleurs au mois de janvier une réunion sur ce sujet avec des entreprises. Nous avons mis au point un référentiel sur la mise en œuvre des « agendas 21 » locaux. C'est en fait une prescription de la conférence de Rio qui vise à faire sorte que les collectivités locales se dotent de stratégies de développement durable. Les changements climatiques figurent dans ce référentiel, qui est aujourd'hui expérimenté dans plusieurs régions. Nous espérons que les futurs contrats de plan seront conditionnés à la mise en œuvre de stratégies de développement durable. C'est tout à fait conforme à l'article 6 de la Charte de l'environnement, qui recommande que l'ensemble des politiques publiques contribue au développement durable. Les marchés publics sont un levier essentiel, utilisé dans plusieurs pays pour promouvoir les technologies, les comportements et les services les plus innovants en matière d'environnement. Je rappelle que les marchés publics représentent 15 % du PNB. Maintenant, nos moyens sont-ils à la hauteur de nos ambitions ? Je considère que non. Je ferai une comparaison avec l'administration britannique, qui dispose de cinq fois plus de personnes que nous. Les Britanniques ont monté par ailleurs un important fonds carbone, avec une équipe de 80 personnes. Investir sur les fonds carbone, c'est suivre tout ce qui se passe sur le marché, connaître la stratégie des acteurs. En ayant une vision réelle de ce qui se passe, on dispose d'une capacité de négociation au niveau européen et international et d'éléments chiffrés pour les futures distributions de quotas. Aujourd'hui, en France, une personne «et demie», au ministère de l'environnement, suit de façon administrative les quotas. On ne peut donc pas parler de suivi stratégique." Il se trouve que la personne qui est en charge de ce fonds carbone, James Cameron, un écologiste historique, a lancé une initiative, le Carbon disclosure project. Ce projet a été repris et soutenu par 155 organismes financiers internationaux, qui représentent 22 trillions de dollars d'investissements, parmi lesquels AXA en France. Un questionnaire a été envoyé aux 500 premières entreprises mondiales, celles de l'UFP 500. Il comprend neuf questions, dont la plus simple est : « Combien émettez-vous de gaz à effet de serre ? », mais aussi : « Quelles réponses technologiques apportez-vous à ces changements climatiques ? » On demande aux entreprises de rendre compte de façon transparente de leur stratégie en matière de technologies. Et la dernière question est : « si on vous obligeait à diminuer vos émissions de 20 % en sept ans, avec un prix du carbone de 50 dollars la tonne, comment cela affecterait-il votre bénéfice ? » Avec les éléments que peut apporter cette enquête très approfondie et avec le fonds carbone, on a la capacité d'identifier les stratégies des entreprises et ce qui se passe sur le marché du carbone. Nous n'avons pas la même capacité en France. Un changement de posture est tout à fait indispensable. Nous sommes devant une question fondamentale : les gaz à effet de serre vont créer des rentes de situation pour ceux qui disposeront des technologies et qui pourront offrir les services de cette nouvelle économie à bas contenu en carbone. Le nucléaire est une solution, même si nous avons des progrès à faire pour l'insérer dans les réseaux internationaux. Mais ce n'est pas la seule. Il faut que nous nous intéressions à l'ensemble des secteurs comme les transports et les secteurs domestiques, et pas seulement au secteur de l'offre d'énergie, qui reste cependant important. M. le Président : Vous avez dit qu'aujourd'hui, notamment dans le domaine des transports, on pouvait contribuer à la réduction des émissions. Est-ce qu'une réduction de 3 % serait tenable ? Si oui, où porteriez-vous votre effort dans un premier temps ? M. Christian BRODHAG : J'ai déjà évoqué le secteur du bâtiment. On peut citer aussi le secteur industriel, qui a déjà fait beaucoup d'effort. Mais attention : mettre trop de contraintes en Europe, et pas dans les autres pays, risque d'aboutir à des délocalisations. Cela nécessite d'être présent dans les négociations internationales pour éviter tout dumping de la part des pays en développement. L'agriculture peut elle aussi apporter une importante contribution. La PAC devrait évoluer en s'appuyant sur des réflexions plus globales. En revanche, le domaine des transports, qui augmentent de 2 % par an, nous inquiète énormément. Le transport aérien est en croissance. Nous sommes par ailleurs très dépendants du transport routier de marchandises. Il nous faut réfléchir en termes de mobilité ou de structures urbaines, car on ne voit pas quelle technologie pourrait être efficace dans ce secteur. Des prises de conscience sont indispensables au niveau global. Si on veut atteindre le facteur 4 dans vingt ou trente ans, il faut être conscient que les structures de production seront touchées. Permettre aujourd'hui l'étalement urbain, c'est investir dans des infrastructures qui seront encore là dans cinquante ans. Il faudra intervenir dans le structurel et dans l'organisation des activités. Or c'est là où le consensus est insuffisant. Par exemple, on a du mal à faire admettre à l'équipement qu'il faut maîtriser la mobilité, alors qu'elle est toujours considérée comme un facteur de progrès. Mme Nathalie KOSCIUSCO-MORIZET, Rapporteure : Vous avez évoqué les moyens affectés par la France. Les problèmes rencontrés sont-ils des problèmes de quantité ou des problèmes de structures ? Par ailleurs, est-ce que la nouvelle position de la MIES depuis quelques années a eu des effets bénéfiques ? De manière plus générale, l'éclatement des structures n'est-il pas à l'origine des difficultés que vous décrivez ? Nous n'avons pas d'équivalent au Carbon disclosure project, mais certaines personnes travaillent sur le sujet, même si on n'en parle pas. M. Christian BRODHAG : C'est à la fois un problème de quantité et de qualité. Les Britanniques sont tout de même cinq fois plus nombreux que nous. Ensuite, ils ont regroupé ces questions dans deux services dans le même ministère, ce qui permet une coordination stratégique beaucoup plus forte. On souffre en France d'un certain cloisonnement administratif, le Quai d'Orsay gardant toujours la main sur les négociations internationales. Cela étant, le délégué interministériel que je suis considère qu'il n'est pas facile non plus de mettre au point des stratégies avec d'autres ministères quand la structure interministérielle est placée dans un ministère et vue comme telle. S'il est ainsi intéressant d'être placé au ministère de l'écologie et du développement durable, cela rend un peu difficile les relations avec les autres ministères, la MIES étant alors un peu considérée comme appartenant au ministère de l'écologie. M. le Président : Y a-t-il, dans les négociations internationales, une véritable collaboration ? Est-ce que le délégué interministériel joue un rôle à ce niveau ? Le fait que le ministère des affaires étrangères ait la main implique-t-il une bonne collaboration avec les autres ministères ? M. Christian BRODHAG : La question est un peu embarrassante. En nombre, nous sommes à peu près dans la moyenne. Mais nous sommes peut-être un peu plus sous représentés dans le domaine scientifique. Dans les réunions internationales, il y a à la fois les représentants des pays et les organismes scientifiques accrédités auprès de la convention. J'avais noté qu'à Buenos-Aires, où j'étais présent, 180 organismes scientifiques étaient accrédités par l'organisme de recherche : 55 pour les États-Unis, un peu plus de 30 pour la Chine, aucun pour la France. M. le Président : C'est ce que vous traduisez par « nous sommes un peu sous-représentés ». M. Christian BRODHAG : Nous sommes tout de même représentés dans le GIEC, le Groupe international d'experts sur le climat. Mais moins dans la partie mesures d'atténuation et solutions. Or on sait aujourd'hui que tous les scénarios à venir, toutes les négociations s'appuient sur du lobbying d'organismes, de fondations américaines ou d'organismes de recherche. Et là, nous sommes absents. Par exemple, nous avons eu un problème pour envoyer Jacques Varret, du BRGM, à la négociation sur le stockage du carbone. Nous n'avions pas de budget pour le prendre en charge, et le BRGM a considéré que ce n'était pas dans sa mission. Pour ma part, et la remarque est un peu perfide, j'ai dû rester en France pour rattraper un amendement sénatorial qui nous avait privé d'un million d'euros sur le budget climat. S'agissant de la coordination des délégations, nous avons l'avantage de compter parmi nous Paul Watkinson, qui est très compétent et qui dirige la négociation. Son autorité est reconnue, ce qui nous aide beaucoup lors des négociations internationales. Reste que nous avons encore une certaine marge de progrès. Je remarque enfin que nous avons été peut-être un peu suivistes lors de cette négociation, notamment sur le post 2012. Je souhaiterais que nous soyons plus offensifs et qu'on sache vers quoi on veut aller. Les entreprises nous ont d'ailleurs sollicités, s'agissant notamment de scénarios avec des pays émergents comme la Chine ou l'Inde. Nous sommes en effet un peu courts, nous manquons de visibilité à long terme. M. Philippe TOURTELIER : Je trouve que l'on traite la question des transports de manière bien trop globale. A-t-on un suivi quantitatif et d'évolution entre les différents secteurs, transports aériens, transports routiers et le reste ? Dans le secteur routier, a-t-on la même chose entre le transport des marchandises et le transport des particuliers ? On parle beaucoup de l'étalement urbain. Mais n'est-ce pas l'arbre qui cache la forêt, à savoir la très forte augmentation du transport routier ? Il existe différentes façons de faire de l'étalement urbain : il y en a un qui, socialement, est responsable et l'autre, qui est complètement irresponsable. Il en est de même, d'ailleurs, de la concentration urbaine. En conclusion, je n'aime pas beaucoup qu'on parle d'étalement urbain, car j'ai l'impression que cela permet d'éviter de nous poser les vraies questions. M. Christian BRODHAG : Vous avez sans doute raison. Il existe des suivis des différents systèmes de transport. Il est vrai qu'on rencontre certaines difficultés à organiser les transferts modaux et à intégrer le transport ferré des marchandises dans un monde concurrentiel. Une amélioration de l'offre ferrée serait sans doute nécessaire. Mon propos sur l'étalement urbain était peut-être caricatural. Disons plutôt qu'en termes de répartition des activités sur le territoire, un étalement urbain fondé uniquement sur la voiture et sur l'accès à la voiture, pose problème. Des réflexions sont d'ailleurs menées sur d'autres modes de transport comme tram-train, qui permet à la fois d'utiliser le réseau ferré et de rentrer dans les villes. Il serait sans doute plus intéressant de s'orienter vers un archipel d'habitats que vers une dilution complète. Or, en ce domaine, nous n'avons pas de stratégie. Les stratégies de planification anciennes n'ont pas eu les effets escomptés. C'est plutôt une question de gouvernance et d'organisation de la ville. Je crois beaucoup aux plans de déplacement d'entreprises, aux approches où chaque acteur est appelé à se poser le problème de son insertion dans le système. M. Serge POIGNANT : Monsieur le délégué, vous nous avez déclaré que vous aviez dû rester en France pour récupérer un amendement qui vous privait de certaines ressources. Je regrette la façon dont vous nous avez présenté les choses. C'est bien le rôle du Parlement de se poser des questions, comme notre rôle, aujourd'hui, est de vous interroger sur la pertinence des moyens mis à disposition de l'ensemble des organisations qui travaillent sur le développement durable. Cela dit, ma question portera sur le document finalisé de la stratégie d'adaptation : quand pourrons-nous y avoir accès ? M. Christian BRODHAG : Une enquête a été lancée au mois d'août et nous avons procédé à des affinements au fur et à mesure du temps. Nous en sommes encore aux arbitrages. Mais je suis prêt à vous communiquer dès maintenant ce document, à titre d'information. Mme la Rapporteure : Nous avons une version provisoire, que nous pourrons transmettre aux collègues qui le demandent. Nous ne l'avions pas diffusée pour les raisons que vous venez d'indiquer. Mais la dernière version nous intéressera, dès qu'elle sera sortie. M. le Président : Nous avons souhaité que les auditions de ce matin ne soient pas publiques, pour être plus libres de parole. Ce que nous venons d'entendre est important. Je me souviens d'autres négociations sur les taux de micro-toxines tolérés dans l'alimentation, où l'intervention permanente des scientifiques qui accompagnaient d'autres délégations avait abouti à modifier ces taux et, par là même, à modifier la présence de certains pays sur le marché international. La suppression de l'ONERC, proposée par un collègue et acceptée dans un premier temps, sans qu'il y ait eu de discussion générale sur un sujet aussi important, était, il faut bien le dire, une connerie ! Et il est bon qu'elle ait pu être rattrapée. Mme Martine BILLARD : J'ai apprécié que vous ayez fait remarquer qu'il ne pouvait pas y avoir de solution technologique miracle. J'aimerais savoir par quels dispositifs on pourrait en convaincre l'ensemble des acteurs et la population. Tout le monde est d'accord sur le fait que le secteur du bâtiment est l'un des secteurs où il est possible de diminuer les émissions. Mais ce n'est pas le cas des autres secteurs, notamment celui des transports. Je voudrais savoir si on a commencé à travailler et à réfléchir à ce problème. Car il faudra bien un jour se confronter aux conséquences sociales qu'entraîneront inéluctablement certaines décisions. Les bilans carbone devraient permettre d'engager des actions en mettant en place certains outils. Mais a-t-on fixé des échéances ? Faut-il rendre obligatoires ces bilans ? M. Christian BRODHAG : Je suis peu enclin à recourir trop vite à l'obligatoire. On ne peut pas fixer des obligations sur des critères qui ne sont pas encore stabilisés. On en est encore à une phase expérimentale. Il est surtout important de déployer des outils sur la base du volontariat et de multiplier les expériences. Par exemple, l'entreprise Véolia propose de mettre en place des modèles de suivi des émissions par les systèmes urbains. Ce qui n'empêche pas de surveiller tout ce qui se passe et de suivre de façon beaucoup plus précise le marché du carbone. Il est exact que le secteur des transports est difficile. La logique est qu'on ne peut pas intervenir sur un seul maillon de la chaîne. La question se pose en aval, du côté des chargeurs. On ne peut pas mettre la pression sur les transporteurs, alors qu'ils ne peuvent pas répercuter les éventuelles fiscalités sur les chargeurs. Comment responsabiliser ces derniers ? Actuellement, on essaie d'impliquer les entreprises sur leur bilan carbone en intégrant les transports. Cela devrait permettre, tôt ou tard, d'obtenir pour chaque produit un contenu en carbone et de s'orienter vers des systèmes d'optimisation internalisés dans les entreprises. Aujourd'hui, la mobilité de la marchandise à tout prix reste une valeur positive. On m'a ainsi signalé que les blocs de marbre de Carrare qui descendent de la montagne sont chargés sur des bateaux, transportés puis tronçonnés en Chine et reviennent à Carrare. Cela signifie qu'on ne paie pas le vrai prix du transport. Le système est devenu absurde. M. le Président : Je m'étais étonné de la présence de granit chinois dans certaines villes. J'ai appris que lorsque l'on transporte des jouets qui ont un fort volume par rapport aux cargaisons, il est nécessaire de lester les bateaux. On le fait en utilisant des produits qui sont très lourds et qui sont ainsi transportés presque gratuitement. M. Philippe TOURTELIER : Je confirme. M. Serge BLISKO : Le granit en France provient d'une seule carrière, où tout le monde se fournit. La direction de la concurrence était toujours très réticente parce que tous les groupements d'entreprises présentaient le même granitier breton. Le jour où les Chinois l'ont compris, ils ont proposé un granit de qualité à peu près équivalente mais un peu moins bien, à des prix inférieurs malgré le transport. La concurrence a alors pu jouer à plein. Voilà un des effets pervers du code des marchés publics ! M. François DOSÉ : Je confirme ce qui a été dit : si le granit est moins cher, c'est parce qu'il leste les bateaux et que le prix des livres ou des jouets paie déjà le voyage. Je suis persuadé que la technologie nous permettra de faire mieux et d'être plus efficaces. Mais si on divise par deux le pétrole nécessaire pour faire 100 kilomètres et qu'on en profite pour en faire 200, on n'aura pas avancé. C'est aussi un problème de comportements. Vous avez été un peu optimiste en nous présentant deux chantiers nécessaires et facilement accessibles, à commencer par celui logement. En effet, même si on est capable d'en améliorer la qualité, son coût reste élevé. Si l'État ne fait pas un effort financier, on ne pourra décoller ni engager de plan significatif. Le marché public constitue parfois un piège pour le mieux disant. Il faudrait changer les textes. Mais qu'est-ce que le mieux disant dans le domaine écologique ? Il faudrait le définir. M. Christian BRODHAG : Je ne suis pas un pratiquant quotidien des marchés publics. Mais je sais qu'il existe un dispositif mis en place par le groupe permanent d'étude des marchés sur le développement durable. Théoriquement, il répond aux questions que vous avez évoquées. M. François DOSÉ : Dans ce cas, c'est le directeur de la concurrence et des prix qu'il s'agit de convaincre. M. le Président : Merci, M. Brodhag. Audition de M. Christian de BOISSIEU, Présidence de M. Serge Poignant, Vice-Président M. Christian de BOISSIEU. S'agissant de nos travaux « facteur 4 », nous sommes vraiment au milieu du gué. Notre commission a débuté en septembre. Les deux ministres concernés, M. Loos et Mme Olin, nous ont demandé un rapport vers le printemps. Je pense qu'il sera possible de le déposer au mois de mai. Le Parlement est étroitement associé à nos travaux, de même que les différentes parties concernées. Dans le cadre de cette commission, nous avons présenté un certain nombre de scénarios à l'horizon 2050 Par exemple, lors de notre dernière réunion, un chercheur allemand qui travaille, en liaison étroite avec Greenpeace, dans un centre de recherche aéronautique a développé un scénario basé sur une hypothèse « zéro nucléaire ». En revanche, lors d'une des premières séances, on nous avait présenté un scénario du ministère des finances qui n'est pas dans cette mouvance. Nous couvrons donc un spectre assez large. Les scénarios qu'on peut faire à l'horizon de 2050 reposent sur des hypothèses de taux de croissance. Or je ne sais pas ce que sera le taux de croissance de l'économie française, a fortiori ce qu'il sera en 2050. Sans compter qu'entre un taux de croissance à 1,5 % et 2,5 %, la situation change du tout au tout. Les facteurs démographiques sont également importants. Or, là encore, on ne connaît pas les soldes migratoires de la France dans trois ans, et a fortiori en 2050. Notre groupe est pluraliste. Il y a des personnes qui défendent des points de vue différents, avec des scénarios différents. Mon intuition est que les scénarios nucléaires ne sont pas nécessairement les plus intéressants. La question est de déterminer quel est le bon « mix » du point de vue énergétique. Il n'est pas de déterminer des solutions extrêmes, mais des bonnes combinaisons. Nous en débattons entre nous. Je ne peux pas vous donner de conclusions, mais je pense qu'on pourra y voir plus clair au mois de mai. Nous avons essayé, dans les quatre réunions qu'on a eues, d'articuler des approches sectorielles ou verticales du sujet avec des approches transversales. Il faut les deux pour essayer de faire des projections à long terme. Des experts nous ont parlé de la consommation énergétique, selon différents scénarios, dans le secteur du bâtiment et de la construction. Il en a été de même dans le domaine des transports. C'est ainsi qu'une de nos dernières séances a été consacrée en partie au secteur agro-alimentaire. Nous avons ainsi décliné la demande possible des différentes formes énergétiques et leurs conséquences sur le CO2 à un horizon long. Selon les chiffres qui m'ont été donnés par les spécialistes, l'énergie aujourd'hui, et peut-être dans les années qui viennent, est à l'origine de 70 % des émissions de CO2. Les approches sectorielles ont été combinées avec des approches transversales. Une fois que l'on a décliné des scénarios secteur par secteur, il faut en effet tester la cohérence de l'ensemble. A propos de l'agriculture et de la filière agro-alimentaire, certains débats ont été engagés. Tout le monde considère que les biocarburants et la biomasse vont être importants. Sans doute est-on obnubilé par le passé récent. On a tendance à considérer qu'on est entré, pour une durée indéterminée, dans une ère de pétrole relativement cher. Mais c'est une hypothèse, et on peut totalement se tromper. Il y a deux ou trois ans, qui avait prévu qu'on atteindrait 70 dollars le baril cette année ? Pas grand monde parmi les économistes ! La difficulté de l'exercice est qu'il faut se projeter à quarante-cinq ans, alors qu'on est obnubilé par l'évolution des derniers mois. Mme Martine LIGNERES-CASSOU : Il y a tout de même des réserves. M. Christian de BOISSIEU : Je ne connais pas les réserves de pétrole de la Chine. Je ne sais pas à partir de quel niveau ce pétrole sera rentable. Si vous le savez, vous êtes bien meilleure que moi. Compte tenu du poids de ce pays sur les équilibres pétroliers, tout ce qu'on pourra dire de la Chine dans les quarante prochaines années en matière de bilan énergétique est fondamental, au plan mondial, par rapport aux prix d'équilibre et aux conséquences des prix d'équilibre sur l'offre et la demande et les comportements. J'avoue mes ignorances. Quand je fais des hypothèses pour 2006 sur un baril à 60 dollars, je peux totalement me tromper. Car la vie économique est faite de surajustements. Ce matin, on en était déjà à 55 ou 56 dollars, parce que l'hiver aux États-Unis est plus clément que prévu. Et ce n'est pas 2050, c'est du très court terme. Nous avons beaucoup de difficultés dans la mesure où nous sommes conditionnés par le passé le plus récent. Il faut en tenir compte, mais il faut arriver à le pondérer. S'agissant de l'agriculture et de l'agro-alimentaire, nous sommes tous d'accord pour dire que la biomasse est importante. Mais une question se pose, à laquelle je ne sais pas répondre : à partir de quel moment et de quel niveau de développement des biocarburants y aura-t-il conflit entre l'utilisation alimentaire et l'utilisation énergétique de l'agriculture ? Nous travaillons actuellement dans le groupe « facteur 4 » sur la problématique suivante : si jamais, à partir d'un certain seuil d'utilisation des biocarburants, nous rencontrions des problèmes de conflit entre nourrir les gens et leur permettre de se transporter, comment les réglerions-nous ? Quel est le potentiel d'une agriculture beaucoup plus intensive que celle qui est pratiquée aujourd'hui ? Toutes ces questions sont à débattre. Comme nous sommes un groupe pluraliste, nous entendons tout le monde. Tous les arguments sont les bienvenus. Il est une quatrième question, sur laquelle nous n'avons pas beaucoup avancé mais à laquelle nous allons consacrer les séances de janvier et février : les modifications de comportement. Lorsqu'on fait des prévisions à 2050, on a tendance à extrapoler les comportements d'aujourd'hui. Or ces comportements vont se modifier en raison des prix, des volumes, des évolutions de la société. Je vous en donne un exemple : nous avons travaillé sur la question des modes de chauffage dans le bâtiment. Or l'attitude par rapport aux modes de chauffage est aussi affaire de pédagogie. Nous avons le sentiment d'avoir un gros travail à faire en la matière. Et c'est maintenant qu'il faut le faire. Malgré les efforts de l'ADEME et d'autres institutions, il faudrait se focaliser sur la pédagogie des comportements. Demander aux gens de se mobiliser pour 2050, ce n'est pas évident. Déjà qu'ils ont du mal à se mobiliser pour les retraites, dans dix ou vingt ans. L'ennui, c'est que la pédagogie est nécessaire, mais pas suffisante. Ma cinquième remarque portera sur un point qu'on n'a pas abordé jusqu'à présent : les politiques publiques. Notre groupe, qui est par définition pluraliste, est peut-être plus facilement en accord sur le diagnostic. Mais à partir du moment où nous allons arriver à des questions de politiques économiques ou de politiques publiques, les désaccords deviendront plus nets. Nous sommes conscients que l'État doit jouer un rôle, s'agissant d'un engagement qu'il a pris lui-même. Cela dit, pour l'instant, nous n'avons pas chiffré ni détaillé les politiques publiques liées au « facteur 4 ». Sixième et dernière remarque : y a-t-il un sens à ce que la France aille seule, ou trop seule, vers cet objectif si les autres pays ne jouent pas le jeu ? Aujourd'hui tout le monde ne partage pas cet objectif ; même à l'intérieur de l'ancienne Europe, l'Europe à quinze, il n'y a pas d'harmonisation. Au plan mondial, au-delà de Kyoto et de l'horizon 2012, il y a encore moins accord, non seulement entre pays développés, mais avec les pays en développement. Ce qui se passera en Chine dans les années qui viennent sera très important pour le reste de la planète. Je pense que nous devrions, assez rapidement, essayer de nous mettre d'accord, à quelques pays européens, pour rappeler le contexte international. Qu'un pays aille tout seul vers le « facteur 4 » n'a pas de sens, compte tenu des externalités et de la globalisation. Le « facteur 4 », tel qu'il a été exprimé par le Président Chirac, n'avait de sens que par rapport à l'objectif mondial de « facteur 2 », compte tenu des hypothèses sur les émissions et la répartition des émissions entre pays développés et pays en développement. L'objectif premier avait une dimension mondiale. Il faudrait au moins retrouver une dimension européenne. Je considère que ce sujet fait partie des dossiers européens pour les douze mois qui viennent. Nos voisins allemands devraient clarifier leur position, ce qui ne sera pas facile dans le cadre de la coalition CDU-SPD. M. Serge POIGNANT, Président : D'abord, les contacts que nous pouvons avoir au niveau européen me semblent en effet fondamentaux. Ensuite, vous avez dit que vous remettriez votre rapport vers le mois de mai 2006. Or notre mission doit rendre le sien au mois d'avril. Avez-vous prévu des rapports d'étape ? Enfin, le « facteur 4 » est visé à l'horizon 2050. Avez-vous engagé une réflexion sur des années intermédiaires, par exemples 2020 ? M. Christian de BOISSIEU : Les contacts européens ne sont pas suffisants. La commission est franco-française de par sa composition. Mais il faut savoir que lorsqu'on fait appel à des experts européens comme membres permanents, assez vite on ne les voit plus ; il n'est pas évident pour des Allemands, des Anglais ou des Italiens de venir tous les mois à Paris. Voilà pourquoi nous avons sollicité des experts étrangers au coup par coup. Je vous parlais tout à l'heure de l'expert allemand qui dirige le centre de recherche de l'aéronautique allemande et qui était venu nous présenter un scénario « facteur 4 » avec l'hypothèse zéro nucléaire. D'autres viendront. Reste que la composition de la commission devrait être plus européenne. Je ne suis pas contre le fait de mettre à votre disposition notre documentation, à condition que les gens soient prévenus. Certains éléments sont publics, d'autres le sont moins. Je suis favorable à la circulation de l'information, car il n'est pas utile de faire le même exercice partout - or c'est un peu ce qui se passe en France. Par l'intermédiaire de Mme Kosciusco-Morizet, qui participe aux deux instances, il doit être possible d'améliorer la coordination entre nous. Vous avez enfin parlé d'étapes intermédiaires. Nous avons en effet travaillé sur certains scénarios dont certains s'arrêtent en 2020 ou 2030. Nous avons entendu l'autre jour un exposé fait par Pierre Radanne, qui a beaucoup travaillé sur ces scénarios de « facteur 4 », et qui propose des étapes intermédiaires. Ce passage par des points d'étape est en effet important. Il conditionne le réalisme des scénarios. Mme Nathalie KOSCIUSCO-MORIZET, Rapporteure : Depuis le début de nos auditions, un sujet revient régulièrement : c'est celui des transports. Avez-vous l'intention d'en parler dans votre rapport, ou n'avez-vous pas encore d'idée arrêtée là-dessus ? M. Christian de BOISSIEU : Lors de notre dernière séance, nous avons entendu un représentant du Conseil général des ponts et chaussées, qui travaille là-dessus. Le débat a été ouvert. Mais on a plus balayé les pistes qu'affiné le raisonnement. On est revenu sur des questions que vous connaissez : les moteurs hybrides, le covoiturage, le rôle des transports en communs, les avions. Pour l'instant, je n'en ai tiré aucune conclusion précise. Lorsqu'il nous faudra faire des recommandations, les différences qui existent entre nous seront plus importantes que lorsqu'il s'agit de raisonner sur du cadrage. Il me faudra voir, en tant que responsable, comment déboucher sur des conclusions intéressantes sans remettre en cause la cohérence du groupe. Mais si le rapport doit mentionner dix avis divergents, cela n'aura pas grand intérêt. Je ne suis pas spécialiste des transports ni ingénieur de formation, mais j'ai l'impression que, même sur les diagnostics d'expert, il y a débat. Prenez l'exemple de la biomasse et des biocarburants : quand j'entends les ingénieurs agronomes discuter, je m'aperçois qu'ils sont comme les économistes : qu'ils ne sont pas d'accord entre eux. M. Serge POIGNANT, Président. Je vous remercie. Audition conjointe de M. Bernard MEUNIER, Président du CNRS, Présidence de M. Jean-Yves Le Déaut, Président M. Bernard MEUNIER : Je désire revenir sur le rôle du CNRS et de la recherche scientifique en général, s'agissant de l'effet de serre et des problèmes de consommation d'énergie. Lorsqu'on parle des futures sources d'énergie, on parle d'hydrogène. En fait, nous vivons dans une société d'hydrogène sans nous en rendre compte depuis plus de cent cinquante ans. L'hydrogène que nous utilisons, ce sont des liaisons carbone-hydrogène sur des énergies fossiles. Il y a l'atome d'hydrogène et le carbone. Dans la mesure où le carbone est un résidu de notre consommation d'énergie à partir du pétrole, il se transforme en CO2. Voilà l'origine de nos problèmes : nous avons vécu facilement et confortablement les 120 dernières années en récupérant de l'énergie fossile accumulée au cours des centaines de millions d'années précédentes. Nous sommes tous conscients que nous arrivons à un tournant essentiel dans cette évolution. L'énergie peu coûteuse, facile à récupérer, que ce soit sous forme de gaz naturel où il y a quatre liaisons CH, ou sous forme de pétrole où il y a deux ou trois liaisons CH, c'est presque fini ! L'ensemble de la population mondiale souhaitant obtenir le même standard de vie que les populations qui bénéficient de cette consommation d'énergie depuis longtemps, le processus se trouve accéléré. Si, brutalement, la totalité de la population chinoise se mettait à consommer à un même niveau que les habitants de la France ou de l'Allemagne, les réserves pétrolières connues seraient asséchées en moins de dix ans. Cela signifie que nous allons basculer très rapidement dans les difficultés. Un collègue présentait au président Nixon, il y a plus de vingt-cinq ans, un rapport sur les nouvelles sources d'énergie. Comme le président lui avait demandé de conclure rapidement ce rapport qui devait faire plusieurs centaines de pages, il répondit : la première source d'énergie dans le futur, aux États-Unis, sera la réduction du gaspillage. On peut considérer que 30 % de notre énergie est gaspillée. Il faudra réapprendre les gestes citoyens. Jusqu'au XIXe siècle, la consommation d'énergie était précieuse et le comportement des citoyens vis-à-vis de l'énergie était très efficace. Est-ce que les chercheurs du CNRS peuvent apporter quelques miracles technologiques pour résoudre tous les problèmes d'effet de serre et d'énergie ? Probablement non. Car cette civilisation de l'hydrogène issu des hydrocarbures fossiles était pratique, mais elle n'est pas réutilisable. Nous devrons nous lancer dans des solutions technologiques beaucoup plus difficiles et compliquées. Comme l'hydrogène n'est pas un produit naturel, il faudra trouver de l'énergie pour faire de l'hydrogène. Or cette énergie, on ne l'obtiendra pas à partir du pétrole, on devra l'obtenir à partir d'autre chose. Certes, on a le soleil. Mais la transformation de l'énergie solaire en énergie disponible pour l'ensemble de la population de la planète demandera un effort d'innovation et de technologie bien au-delà de ce que nous avons l'habitude de faire. Certes, on a le nucléaire. Mais il faut qu'on puisse utiliser l'énergie nucléaire en évitant les problèmes que nous connaissons sur les filières actuelles. On peut rêver et imaginer d'utiliser, non plus l'uranium 235, mais l'uranium 238 comme produit de départ et de n'avoir pratiquement aucun déchet de longue vie à la sortie des réacteurs. Si nous maîtrisions cette technologie, nous aurions là des sources d'énergie intéressantes. Tout cela ne peut passer que par une recherche et une innovation courageuse, mobilisant le monde de la recherche au-delà même de ce qu'il peut imaginer. Je passe mon temps à dire au CNRS que l'enjeu de la recherche sur l'environnement et le développement durable, l'effet de serre et l'énergie est tel qu'il provoquera un choc pour la communauté scientifique probablement équivalent à ce qui s'est produit au XIXe siècle lorsqu'on a cherché à améliorer l'état d'hygiène et de santé des populations. Les communautés scientifiques, dans leur ensemble, devront se mobiliser beaucoup plus qu'elles ne l'ont fait jusqu'à présent. Et mobiliser, ce n'est pas seulement étudier, regarder, contempler. C'est agir ! Il faudra mettre en place des programmes de recherche qui ne soient pas basés uniquement sur la description des phénomènes dus à l'effet de serre, mais sur l'action. Le législateur, de son côté, devra faire un effort important de réflexion avant de prendre certaines mesures. Je vais faire une remarque, en tant que citoyen : lorsque j'ai appris la disparition de la vignette, j'ai prévu une explosion de la consommation d'énergie due à l'utilisation de voitures complètement inadaptées à la conduite urbaine. Or c'est bien ce qui s'est passé : la technologie du 4X4 est merveilleuse, mais celui-ci n'est pas adapté aux transports urbains. Tout le monde devra donc faire des efforts : les chercheurs, le législateur et les citoyens. Comment le CNRS peut-il agir ? Nous avons des collaborations avec les universités, les autres EPST et les EPIC. Nous collaborons aussi avec l'Agence nationale pour la recherche. Nous entretenons avec elle des rapports très suivis s'agissant des programmes de recherche relatifs à l'effet de serre et les nouvelles énergies. Dans tous les domaines, nous avons deux possibilités : soit créer de nouvelles agences et de nouvelles structures, soit faire fonctionner celles qui existe déjà. Je pense qu'on peut déjà faire fonctionner celles qui existent. Avec les établissements de recherche, l'ANR et l'Agence pour l'innovation industrielle, nous disposons des trois étages nécessaires pour faire une percée dans le domaine de la technologie et de l'innovation. Si nous utilisons intelligemment ces trois outils, nous aurons la possibilité d'avancer. Encore faut-il qu'il y ait la volonté d'avancer ensemble, en appréciant globalement l'effort de la puissance publique, en liaison avec celui du secteur industriel. Je ne vais pas vous détailler les programmes sur l'énergie, le photovoltaïque, etc. Un numéro spécial du Journal du CNRS, qui est diffusé à 30 000 ou 40 000 exemplaires, faisait le point sur ce qu'on pourrait imaginer. Une maison à consommation d'énergie zéro est envisageable à partir du moment où on aura la volonté de le faire. Je ne suis pas spécialiste des problèmes de transports, mais je peux vous répondre sur les questions d'énergie et de pétrole. M. le Président : Plusieurs intervenants nous ont mis en garde vis-à-vis de l'illusion technologique, qui risquait d'être démobilisatrice. Comment parvenez-vous à concilier la nécessité de travailler sur ces programmes pour trouver des solutions, et la fait qu'il ne faut pas croire que la science et la technologie vont tout régler ? Vous avez dit que nous devrions travailler sur d'autres filières, dont la filière hydrogène. Or quelqu'un nous a dit la semaine dernière que c'était un défi au principe de Carnot et qu'une telle filière ne pouvait pas se justifier, au niveau thermodynamique. Est-ce exact ? Nous aimerions, sur cette question pratique, avoir une réponse qui corresponde à l'état actuel de la science. M. Bernard MEUNIER : Dans les cent cinquante dernières années, nous avons vécu sur un petit nuage s'agissant de l'énergie. Mais la découverte du pétrole et l'utilisation du pétrole et du gaz naturel comme sources d'énergie sont un accident à l'échelle de notre vie sur la planète. Et il va falloir nous désaccoutumer de l'idée que l'énergie est accessible, facile et peu chère. L'hydrogène n'est pas un produit naturel. Il faut donc le fabriquer. Pour cela, il faut de l'énergie. Le problème est donc : quelles seront les nouvelles sources d'énergie dans l'avenir ? Si vous me demandez ce que sera la société de l'hydrogène dans le futur, je vous répondrai en tant que chimiste. La législation sur l'utilisation de l'hydrogène dans les laboratoires de chimie est très stricte. J'imagine que le stockage de l'hydrogène dans les moyens de transport sera intéressant. Tout le monde se souvient de ce qui s'est passé lorsqu'on l'utilisait pour les dirigeables : l'hydrogène brûle très bien et très vite. C'est un non-sens de dire que la société de l'hydrogène est à portée de main. Nous utiliserons de l'hydrogène dans certaines conditions, mais le phénomène n'aura pas la même ampleur qu'avec le pétrole. L'utilisation de l'hydrogène sera beaucoup plus difficile à maîtriser. Nous ne pouvons pas dire à nos citoyens qu'il suffirait de nous accorder quelques sous supplémentaires pour qu'on leur apporte des solutions. Il y a des problèmes fondamentaux et des verrous technologiques, qui ne seront pas faciles à faire sauter, et qui ne seront pas uniquement liés à l'argent. La créativité ne se décrète pas. Dans notre pays, il y a certainement des milliers de personnes qui peuvent décrire les peintures de la chapelle Sixtine. Mais il y a certainement beaucoup moins de Michel-Ange. Mme Nathalie KOSCIUSCO-MORIZET, Rapporteure : Il se dit, au sein du groupe « facteur 4 », que la recherche sur l'hydrogène ne devrait pas être la première, et que la recherche sur le stockage de l'énergie était beaucoup plus intéressante à court ou moyen terme, notamment pour résoudre le problème posé par les transports en matière d'émission de gaz à effet de serre. Qu'en pensez-vous ? De ce point de vue, est-ce que les moyens de la recherche française sont-ils bien distribués ? M. Bernard MEUNIER : Il ne faut surtout pas faire rêver nos concitoyens sur la filière hydrogène. Les médias annoncent l'arrivée de la civilisation de l'hydrogène. Mais cela ne décrit pas la réalité. Méfions-nous. Cela pourrait nous conduire à un réveil difficile. Si on n'a pas de réponse sur la question des sources d'énergie, on n'a pas de réponse sur l'hydrogène. L'utilisation de l'hydrogène n'est pas facile. Remplir un réservoir avec de l'essence est facile. Pas avec de l'hydrogène. Où trouver de l'énergie ? On a des capacités de conversion de l'énergie solaire et je souhaite qu'on fasse davantage d'efforts en ce sens. Les filières silicium peuvent probablement être améliorées. S'agissant de l'énergie nucléaire, les experts du CEA seraient plus à même de vous répondre. Il ne faudra pas se pencher seulement sur les filières classiques. Car l'utilisation de l'uranium 238 comme produit de départ est intéressante. Disposer de réacteurs dont les déchets, à la sortie, seraient réduits à très peu de chose ou à des choses facilement manipulables à l'échelle d'une vie humaine, serait très important. On n'aura pas trente-six solutions. L'une de ces solutions sera constituée d'économies d'énergie. Les contraintes qui pèseront sur les citoyens seront beaucoup plus fortes. L'énergie deviendra chère. Un pétrole à un coût équivalent à celui des années 1905 ou 1910 vaudrait 200 à 300 dollars le baril. Tous les enjeux de la société future passent par la réponse à la question : comment produire de l'énergie et comment l'utiliser le plus raisonnablement possible ? L'enjeu de la filière hydrogène ne vient qu'en annexe. M. Serge POIGNANT : Vous avez cité le solaire et le nucléaire. S'agissant du solaire, on peut espérer faire des progrès technologiques, qui devront nécessairement s'accompagner de progrès en termes de coûts. Pouvez-vous nous en parler davantage ? S'agissant du nucléaire, vous avez évoqué l'uranium 238. Il est évident que le problème est toujours lié aux déchets. Que pensez-vous, au CNRS, de l'éventuelle technologie de fusion ? M. Bernard MEUNIER : Ce qui caractérise la situation actuelle, c'est que l'énergie n'est pas chère, pas plus que son transport. On l'a vu dans la discussion sur le marbre de Carrare ou sur le granit. Une grande partie de nos problèmes vient d'ailleurs du fait que le transport ne coûte pratiquement plus rien par rapport à ce qu'il coûtait il y a cinquante ou cent ans. Mais si le pétrole passe à 300, 400 ou 500 dollars le baril, le coût du transport du marbre de Carrare sera modifié. S'agissant du solaire, c'est plus un problème d'innovation technologique que de coût : il y a des rendements qu'il faudra dépasser, il y a des nouveaux matériaux à mettre en place pour sortir du silicium. Je pense qu'on n'a pas été jusqu'à présent assez motivé. Mais comment voulez-vous motiver des personnes et des industries alors que l'énergie fossile est si bon marché ? Et il n'a jamais été aussi bon marché, même à 60 dollars le baril. Passons à l'énergie nucléaire et à la fusion. Nous ne pouvons pas nous dispenser d'envisager le programme ITER et de faire le travail nécessaire, sachant que ce sera très coûteux et que nous ne sommes pas sûrs d'avoir un résultat positif dans vingt, trente ou quarante ans. Les problèmes techniques sont très compliqués à résoudre. L'utilisation des matériaux résistants dans le programme ITER est un enjeu majeur. L'ensemble des scientifiques, au niveau de la planète, ont compris que le programme ITER était un enjeu international. Nous sommes en train de sortir des horizons nationaux ou régionaux pour regarder si cette éventualité peut aboutir. M. le Président : Quels sont les verrous technologiques aujourd'hui ? Et, s'il est possible de les déterminer, faut-il que nous engagions des recherches dans les domaines correspondants ? Je pense au stockage de l'électricité, très important pour les énergies renouvelables, ou à la transformation de la biomasse et des filières cellulosiques. Pourriez-vous nous dresser une liste de ces verrous technologiques ? Cela pourrait avoir un impact sur l'ANR et sur notre politique de recherche, dans la mesure où nous serions amenés à mettre de l'argent dans des secteurs où l'on constate des blocages. M. Bernard MEUNIER : Je ne saurais vous donner la liste des verrous et vous dire que, pour tant de millions d'euros, vous aurez une solution. Dans certains domaines, à partir d'un certain niveau de connaissance, il est possible d'estimer le développement industriel et de dire qu'avec telle somme, dans les conditions actuelles, on passera du prototype à un outil industriel fiable. Mais il y a des domaines où l'on est dépendant de la créativité. Les solutions viendront du cerveau d'un certain nombre de personnes, et parfois d'un nombre limité de personnes, qui ne sont d'ailleurs peut-être pas encore nées. On n'aurait pas pu développer tout le domaine de l'énergie atomique si certaines personnes, au début du XXe siècle, n'étaient pas passées de la physique classique à la physique quantique. S'agissant des filières « nouveaux matériaux » et de la transformation de l'énergie solaire, est-ce en perfectionnant le silicium ou en découvrant d'autres matériaux qu'on aura la solution ? Je ne sais pas et je ne peux pas vous donner la liste des nouveaux matériaux qui permettront des conversions de photovoltaïques bien supérieures à celles du silicium. Cela ne signifie pas qu'il faut consacrer moins d'argent à la recherche. Mais qu'au-delà des volumes financiers et du nombre de personnes impliquées dans la recherche, on se heurte aux barrières de la créativité humaine. M. Alain GEST : Vous avez déclaré qu'il était envisageable d'obtenir une maison à consommation zéro. Pouvez-vous nous en dire un peu plus ? M. Bernard MEUNIER : Zéro, non, mais presque zéro. Selon la grande presse et les spécialistes de la construction, un individu vivant dans une pièce produit 100 watts d'énergie. Certains pensent qu'il est raisonnable d'imaginer un habitat où la consommation d'énergie serait divisée par dix ou vingt par rapport à ce qui existe. M. le Président : M. Valadier va maintenant nous dire quels sont les programmes de recherche en matière de changement climatique et de réduction des gaz à effet de serre. Une première campagne a déjà été lancée. Pouvez-vous nous la décrire ? Comparativement à d'autres grands programmes, est-ce que l'argent qui y est consacré est important ? M. Ludovic VALADIER : Je suis responsable de programmes à l'ANR sur les transports terrestres, le bâtiment et le solaire photovoltaïque. L'ANR a été créé récemment, il y a maintenant neuf mois. Elle a aujourd'hui un statut provisoire de groupement d'intérêt public, mais elle deviendra très bientôt un établissement public administratif. Ce GIP est piloté par un conseil d'administration dont le président est le directeur de la technologie du ministère de la recherche. Un certain nombre d'organismes de recherche y sont représentés, ainsi que l'OSEO-ANVAR qui sert d'expert financier. L'ANR est une toute petite structure, avec 25 responsables programmes à temps plein et 15 personnes pour les aspects administratifs, relations internationales et mise en œuvre des programmes de recherche. Avec un si petit nombre de personnes, il est difficile de mettre en œuvre les 700 millions d'euros d'autorisations d'engagement 2005. C'est pourquoi l'ANR mandate des établissements supports pour la gestion des projets. C'est ainsi que le CNRS est un grand acteur du « programme blanc », qui est entièrement géré au sein de l'USAR. Dépendent de la direction cinq départements thématiques, dont le département énergie durable et environnement, auquel j'appartiens et qui est dirigé par le climatologue Laurent Turpin, mais aussi un programme transversal, qui regroupe l'ensemble des programmes du CNRS, le programme blanc, et la charte d'excellence qui est le programme des jeunes chercheurs. En 2005, l'ANR représentait 350 millions d'euros de crédits de paiement et 700 millions d'autorisations de programme. L'objectif est d'atteindre 3 % du PIB en matière de R et D en 2010, un des objectifs de Lisbonne. En régime de croisière, cela correspondra à 1,3 milliard d'euros de crédits de paiement. L'Agence met en œuvre des processus d'évaluation de projets. Un comité de premier niveau, ou comité des pairs rassemble des scientifiques qui ont la connaissance du sujet. Un comité stratégique de deuxième niveau gère les aspects technico-économiques. En 2005, le département énergie durable et environnement a reçu 120 millions d'euros. Pour déterminer sa programmation, l'ANR s'est basée sur la réflexion des différents ministères qui ont produit certains documents en 2003 et 2004. Trois nous intéressent : le plan « climat 2004 » ; le plan « véhicule propre et économe », lancé en 2003 par le Premier ministre de l'époque ; le rapport Chambolle sur les nouvelles technologies de l'énergie, qui a donné naissance au rapport Gagnepain à la direction de la technologie. Le département fonctionne sur trois axes de travail : la sobriété énergétique - transport, bâtiment - ; les nouvelles sources d'énergie décarbonées - hydrogène, solaire thermique, solaire photovoltaïque et éventuellement stockage - ; éviter le rejet de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Trois programmes sont rattachés de près ou de loin à cette problématique : la capture du CO2 dans le cadre de l'industrie ; le programme « éco-technologies », dont la vocation est de développer des procédés industriels évitant les rejets de CO2, voire de polluants ; un programme biomasse. Un tableau retrace la répartition des crédits affectés au département énergie et développement durable. N'y figurent pas les problématiques agricoles. Le programme « énergie dans le bâtiment » correspond aux prémisses du programme interministériel qui est en train de se construire, le PREBAT, qui sera bientôt signé. En 2005, on a tiré des conclusions du rapport Chambolle un certain nombre d'axes de travail avec l'ADEME, qui est cofinanceur de ce programme pour lancer une consultation sur les briques technologiques dans le bâtiment. On étudie un bâtiment qui consomme très peu et qui, en outre, fabrique de l'énergie ; le bilan global peut être nul, dans la mesure où le bâtiment produit plus d'énergie qu'il n'en consomme. La consultation de 2005 a porté sur l'isolation, les équipements énergétiques qui consomment peu d'énergie ou en produisent - solaire thermique ou solaire photovoltaïque - et sur des approches transversales : aide à la conception, modèles, qualité de l'air. En effet, il est très important de gérer la dynamique des flux dans un bâtiment afin d'optimiser la répartition des sources d'énergie et du chauffage. S'agissant du programme « transports terrestres », cette année nous n'avons pas lancé de programme particulier directement lié aux gaz à effet de serre dans la mesure où, en parallèle, existait le plan « véhicule propre et économe ». Nous avons donc lancé deux consultations sur la sécurité des transports et sur la sécurité des sites, qui peuvent être rattachées à la problématique des GES. Je rappelle que la baisse de consommation des carburants enregistrée ces dernières années est liée à la baisse de la vitesse, et que la compétitivité des nouveaux modes de transport - notamment l'intermodalité, voire le transfert modal - peut contribuer à la réduction des GES. Le programme « hydrogène » : le réseau PACO - piles à combustible - est devenu un programme national sur l'hydrogène dit PANH, coordonné au niveau international, plate-forme européenne, IPHE. Les priorités de cet important programme ont été focalisées sur un cahier des charges autonome. C'est la PEMFC, c'est-à-dire la pile à membrane échangeuse de protons, qui a été retenue. Il s'agit d'une pile qui fonctionne à basse température et qui semble bien adaptée à un usage automobile. D'autres piles sont étudiées, mais à un moindre niveau. On étudie également dans ce programme : la production propre H2, le stockage embarqué, le transport et la distribution, et les aspects transverses, voire socio économiques afin d'appréhender les problématiques de la société de l'hydrogène. Le programme solaire photovoltaïque avait deux grands objectifs pour 2005 : la réduction des coûts et l'intégration au bâtiment. Plusieurs axes de travail ont été choisis : le silicium cristallin, qui est actuellement à l'état de marché, mais des recherches sont encore nécessaires pour essayer d'utiliser au maximum le matériau, qui est en effet cher ; la filière « couches minces » : filière CIS, silicium allemand et filières de composés organiques. Ce programme a utilisé des systèmes complets qui sont des annexes au panneau solaire photovoltaïque, onduleurs, éléments de stockage. Le programme « éco-technologies et développement durable », ou programme PRECODD, s'intéresse aux procédés industriels qui peuvent éviter des émissions de GES ; il s'intéresse également au recyclage de matériaux et à la pollution de l'eau. Le programme PNRB, ou programme « biomasse », est destiné à développer des carburants de deuxième génération en utilisant la filière ligno-cellulosique, à savoir le bois, la tige, les déchets de la forêt. Trois axes de travail ont été choisis : évaluation des ressources et des filières de production ; conversion thermochimique - gazole par gazéification - ; conversion par voie biologique - bioéthanol par fermentation alcoolique -. Enfin, le programme « capture et stockage du CO2 » portera en priorité sur la réduction de coût et de consommation d'énergie des procédés, ainsi que sur la sûreté des sites. Les perspectives de l'ANR pour 2006 passent par : le programme « véhicule propre et économe » qui a été terminé en 2005 et dont l'ANR se fera le relais ; le programme « climat et milieux » ; le programme PREBAT qui doit monter en puissance ; le programme PREDIT. L'ANR sera mathématiquement le plus gros financeur de ces deux derniers programmes interministériels. Il convient de rappeler les objectifs du programme « véhicule propre et économe » en 2006. Nous avons prévu de travailler sur les moteurs thermiques, la consommation des auxiliaires, la climatisation, les architectures hybrides et électriques. Enfin, le programme « climat et milieux » comporte un volet climat et un volet ressources. Il vise à traiter les problématiques régionales, avec deux axes de travail, qui sont les pays du Sud - problèmes dits de ressources en eau - et les problématiques polaires. Ce programme tombe bien en phase avec l'année polaire internationale 2007-2008. M. le Président : J'ai observé, sur les transparents que vous avez commentés, que c'est la filière hydrogène qui reçoit les crédits les plus importants. Mme Martine BILLARD : J'ai noté moi aussi le poids des programmes sur l'hydrogène. J'ai noté également, s'agissant du programme « véhicule propre et économe », qu'on fait des recherches sur la climatisation. Compte tenu des conséquences qu'a la climatisation sur l'émission de GES, doit-on continuer à proposer à nos concitoyens des automobiles climatisées ? Enfin, s'agissant des bioénergies, je constate qu'on va travailler sur l'éthanol et le méthanol. Mais mène-t-on des études sur l'utilisation directe du tournesol et du colza ? M. Ludovic VALADIER : Il est exact que les machines agricoles peuvent utiliser certaines huiles végétales. En revanche, ce n'est pas possible avec les moteurs modernes, car ce type de composés ne respecte absolument pas les normes d'émission de polluants « euro 3 », « euro 4 », voire « euro 5 ». Ils sont quasiment inutilisables en direct. La répartition des fonds fait apparaître cette année la priorité accordée, pour la première fois, aux recherches sur l'hydrogène, à la suite des conclusions du rapport Chambolle. L'ANR étant d'abord au service des pouvoirs publics, sa programmation a été dirigée par les conclusions de ce rapport qui nous vient du ministère de l'écologie, de l'industrie et de la recherche. Les programmes de recherche sur la climatisation sont basés sur une climatisation qui utiliserait des fluides frigorigènes avec des pouvoirs de réchauffement de l'atmosphère beaucoup plus faibles qu'aujourd'hui. Les systèmes actuels utilisent des composés très nocifs. Avec une climatisation au CO2, on pourrait résoudre à peu près le problème de la climatisation embarquée dans les véhicules. M. Serge POIGNANT, Président : Merci beaucoup pour cet échange très intéressant. Audition de M. Marcel DENEUX, sénateur Présidence de M. Jean-Yves LE DEAUT, Président M. le Président : Nous accueillons aujourd'hui notre collègue sénateur, M. Marcel Deneux. Cher collègue, vous connaissez bien le sujet du changement climatique, dont vous êtes un pionnier. Sur ce thème, vous avez rédigé en 2002 un rapport pour l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques. C'est donc avec le plus grand intérêt que nous vous écoutons. M. Marcel DENEUX : Je vous remercie de m'avoir invité. Il est toujours agréable de constater qu'une mission d'information de l'Assemblée nationale juge important d'entendre un sénateur. Je vous remercie également, monsieur le Président, d'avoir bien voulu rappeler le rapport que j'ai rédigé pour l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques. Il avait été précédé d'un rapport de Claude Birraux et Jean-Yves le Déaut, L'état actuel et les perspectives techniques des énergies renouvelables, qui est toujours d'actualité. Que vous dire en l'espace de quinze minutes ? Je résumerai mon propos en quatre mots : conviction, communication, Parlement, propositions. Mes convictions sont fortes. Premièrement, la concentration des gaz à effet de serre s'accélère de plus en plus depuis le début de la révolution industrielle, et atteindra sans doute des seuils très élevés, jamais connus à ce jour. Deuxièmement, ces niveaux critiques auront des effets marqués sur le climat, entraînant des conséquences majeures : extinction d'espèces animales ou végétales ; extension des zones de certaines maladies ; déplacement des zones de culture ; pénuries d'eau ; modification de la pluviosité ; multiplication et renforcement des événements météorologiques extrêmes ; ralentissement ou arrêt de la dérive nord-atlantique ; élévation du niveau des océans. L'ensemble de ces mutations climatiques provoquera sans doute la croissance rapide du nombre d'écoréfugiés : 25 millions en 2005, 50 millions en 2010, 150 millions en 2050. Troisièmement, cette intensification de l'effet de serre est causée par les activités humaines. Pour la première fois dans l'histoire, l'homme est devenu un agent climatique global. Quatrièmement, cette nouvelle donne climatique produira des gagnants et des perdants, mais il est clair que l'humanité dans son ensemble et la planète seront perdantes. Cinquièmement, l'homme ne possède que certains feuillets du mode d'emploi de la machine climatique terrestre. Sixièmement, en dépit de ces menaces graves, les gouvernements du monde entier comme les entrepreneurs continuent à voir la solution de tous nos maux dans une accélération encore plus forte de la croissance, ce qui revient à dire que les gouvernements fuient la réalité et aggravent ainsi sans le savoir un problème dont la solution les dépasse. Enfin, les politiques internationales ou nationales, comme les actions individuelles ou collectives engagées, lorsqu'elles sont engagées, ne correspondent ni au rythme ni à l'échelle du problème posé. Dans ce contexte de gravité et d'urgence, il importe de bien distinguer la communication de l'action. Celle-là doit être au service de celle-ci, et non l'inverse. A cet égard, permettez-moi de m'interroger sur l'objectif de votre mission d'information. Créer une mission d'information sur l'effet de serre en 2005, n'est-ce pas un peu tardif ? L'intitulé de votre mission devrait être « Mission sur l'intensification de l'effet de serre ». Ce serait pédagogiquement plus efficace. En cette fin de l'année 2005, ni l'effet de serre ni son intensification accélérée ne sont plus ni ignorés, ni mis en doute. La question qui se pose est celle de la sensibilisation aux changements climatiques. Sera-t-elle assez rapide et convaincante pour déclencher une action d'envergure contre les changements climatiques provoqués par les activités humaines, c'est-à-dire pour modifier sensiblement ces activités afin de diviser par quatre les émissions de gaz à effet de serre ? A mes yeux, il n'y a plus aucune incertitude scientifique d'envergure sur le lien entre l'action humaine et la concentration des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. De même, les conséquences des changements climatiques semblent véritablement inquiétantes, et leurs causes maintenant bien identifiées. En revanche, tous les doutes sont permis quant à la possibilité d'une sensibilisation aux dangers des changements climatiques, quant à la naissance d'une volonté politique réelle au niveau mondial et aux niveaux nationaux pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre, et quant à l'émergence d'actions qui soient à la hauteur du phénomène en cause. Dès 1999, chargé par l'Office parlementaire d'un pré-rapport sur le cycle de l'eau, j'ai proposé une lettre de mission différente, qui a débouché sur la publication d'un rapport en 2002, lequel fut adopté à l'unanimité. Ce fut le premier rapport parlementaire à avoir été gravé sur CD-ROM. Nous en avons diffusé 20 000, en direction de différents publics. Mais qui a lu ce rapport ? En cette fin de l'année 2005, la question n'est plus, pour le Parlement, de s'interroger sur l'effet de serre ou sur son intensification accélérée, mais bien de parer aux dangers des changements climatiques qui en découlent. Par ailleurs, au-delà des élus nationaux, la sensibilisation a tenté d'atteindre les élus locaux : 5 000 CD-ROM ont été distribués à travers l'Association des maires de France ; 5 500 l'ont été dans les lycées. Ce rapport est agréé pour les Travaux Personnels Encadrés (TPE) des classes de Première et de Terminale. J'ai écrit aux vingt-six recteurs. Neuf d'entre eux m'ont répondu. J'ai participé à quatre-vingts réunions sur ce thème depuis trois ans. La canicule de 2003 a fait 15 000 morts. Or, le rapport avait publié, un an plus tôt, les statistiques américaines relatives à trois vagues de canicule et aux mesures qui avaient été prises. On le voit, s'il est bon de rédiger des rapports, il faut surtout trouver des moyens de sensibiliser l'opinion publique. On ne pourra plus, dans l'avenir, parler de l'effet de serre sans aborder l'ensemble du problème du « mixte énergétique » français. Les conséquences néfastes des changements climatiques ne seront ni atténuées sensiblement par les nouvelles découvertes d'énergie fossile, ni gommées suffisamment par des ruptures technologiques majeures. C'est pourquoi je voudrais rappeler quelques propositions parmi la centaine que formulait mon rapport, et qui sont encore d'actualité. A l'échelon international, il faut que quelqu'un affirme l'existence d'une solidarité planétaire et en tire les conclusions. Il faut faire le lien entre les discussions sur l'environnement et celles de l'OMC, celles relatives aux rapports Nord-Sud, et celles des institutions financières. On ne peut plus discuter des problèmes à l'échelle de la planète en les sectorisant comme on le fait actuellement. À l'échelon national, l'objectif est de désenclaver l'écologie, qui est un problème transversal. C'est pourquoi, si j'osais une proposition hardie visant à marquer les esprits, je préconiserais la suppression du ministère de l'écologie et du développement durable. Tous ceux qui prennent des décisions économiques ou politiques doivent être imprégnés en permanence des problèmes écologiques. Si l'on ne va pas jusque-là, il faudrait nommer dans chaque ministère un conseiller spécial auprès du ministre chargé du développement durable. Il faudrait également réfléchir à la possibilité d'intégrer l'écologie dans la comptabilité nationale, car aujourd'hui, toutes les entorses que nous faisons aux exigences écologiques restent impunies. Et pour une action dans la durée, sans doute faudrait-il élaborer une loi de programmation relative à la réduction des émissions, ainsi qu'adopter une fiscalité écologique plus fine, prenant en compte l'aspect énergétique. Mais mieux appliquer les textes existants permettrait déjà d'accomplir d'immenses progrès. Il faut enfin, si nous voulons préparer l'après-pétrole, augmenter les crédits de la recherche, en nous rappelant que 80 % de l'énergie que nous consommons aujourd'hui n'était pas connue il y a deux siècles. Il est nécessaire, j'y insiste, d'approfondir les actions de sensibilisation auprès du grand public comme auprès de tous les acteurs de changement. Car toutes les activités humaines, surtout économiques, sont concernées. Il faut mener des études sur la compatibilité nécessaire entre l'écologie et le développement. Le Parlement devrait, dans chacune des deux chambres, désigner un parlementaire chargé des problèmes écologiques, et qui interviendrait, dans la discussion de chaque texte, pour pointer du doigt les aspects écologiques. Limiter la vitesse des véhicules dès leur construction est une nécessité. La fiscalité écologique doit être moins timide. Il est indispensable, dans tous les établissements de formation, de l'école primaire à l'enseignement supérieur, que chacun prenne conscience de l'impact écologique des activités humaines. Le Plan Climat a été adopté, mais les architectes n'en ont pas été avisés. On continue, dans les écoles d'architecture, à former des étudiants sans attirer leur attention sur les problèmes énergétiques. Il est indispensable aussi de sensibiliser tous ceux qui doivent montrer l'exemple. Or, les collectivités locales investissent parfois à contre-courant. Notre pays est confronté à deux problèmes essentiels, aussi négligés l'un que l'autre : la dette publique et l'environnement. Si l'on ne règle pas ces deux problèmes, les générations qui viennent le paieront très cher. Nous vivons à crédit, sur le plan financier comme sur celui de l'environnement. Si je ne devais lancer qu'un seul message, je dirais : ne gaspillons plus l'énergie. La question que nous devons tous nous poser est celle de savoir quel type de développement nous voulons promouvoir, avec quel type d'énergie, et à quel prix. Si nous répondons intelligemment à cette question, nous aurons rendu service à nos enfants et nos petits-enfants. Enfin, il nous faut beaucoup de courage politique, sans quoi aucune solution ne pourra être apportée. Je ne suis pas désespéré, parce que j'ai appris qu'on ne peut pas être à la fois désespéré et responsable. Et je me sens responsable de l'avenir de la planète. M. le Président : Je vous remercie, cher collègue. La sensibilisation est en effet essentielle. Le réchauffement climatique est une grande menace, peut-être la plus grande du XXIe siècle. J'ai deux questions à poser. D'une part, pensez-vous qu'on a tenu compte de votre rapport ? Certaines de vos propositions ont-elles été retenues ? D'autre part, quelle appréciation portez-vous sur l'organisation de l'État ? Est-elle satisfaisante pour faire face à cette menace ? Si vous pensez que non, que faudrait-il faire ? M. Marcel DENEUX : J'ai constaté avec satisfaction l'impact de mon rapport sur les différents ministres chargés du développement durable. L'autorité de l'Office y est sans doute pour quelque chose. Cela étant, sur le plan pratique, j'ai quelques motifs de déception. J'ai proposé à l'une des grandes institutions publiques de ce pays de dresser un bilan énergétique. Dans les deux mois qui ont suivi ma proposition, un directeur de cette grande institution est venu me voir et m'a dit : nous ne savions pas, monsieur le sénateur, que vous aviez un tel sens de l'humour ! Cet homme ne savait pas ce qu'était un bilan énergétique. S'agissant des actions de l'État, l'important est que tout le monde prenne conscience de la nécessité de changer nos habitudes, et d'abord sur des points qui peuvent paraître des détails et qui n'en sont pas. Si toutes les ampoules d'éclairage étaient à basse consommation, la moitié des centrales thermiques pourraient fermer aux heures de pointe. Des actions ponctuelles, ajoutées les unes aux autres, peuvent déboucher sur des résultats significatifs. Que l'État ne s'engage pas suffisamment, c'est une évidence. La discussion des crédits de la mission « Écologie et développement durable » a été inscrite à l'ordre du jour du Sénat dans la nuit du samedi 3 au dimanche 4 décembre. Nous devions commencer à 23h30. Nous avons commencé à 1h10. Nous étions onze en séance. C'est dire que le sujet n'est pas considéré comme essentiel. M. le Président : Ma question portait plutôt sur l'organisation de l'action de l'État. Nous avons un délégué interministériel, et une mission interministérielle qui n'est pas placée auprès de lui ! Le ministre des affaires étrangères participe aux négociations internationales sans que le moindre scientifique soit présent dans les commissions. On n'arrive pas à payer un billet d'avion à un membre du Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) pour participer à une négociation internationale ! L'action de l'État me semble morcelée et atomisée. M. Marcel DENEUX : C'est un fait. Pour prendre un exemple que j'ai vécu, après que nous avons été battus par les États-Unis sur la question du bœuf aux hormones, j'avais rencontré notre ambassadeur à Washington. Nous étions convenus de nommer dans les ambassades des vétérinaires de haut niveau. C'est par des mesures de ce genre que nous progresserons. Car nous ne sommes pas bien préparés à des négociations internationales sur les sujets techniques. Les actions de l'ONERC, de la MIES, des diverses instances qui travaillent sur le réchauffement climatique devraient être coordonnées. Les crédits d'études et de recherche devraient également être renforcés. Mme Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET, Rapporteure: Les milieux écologiques débattent beaucoup de la question de la sensibilisation. L'effort doit-il porter d'abord sur la prise de conscience des peuples, ou le discours sur la sensibilisation est-il un alibi destiné à retarder l'action ? M. Marcel DENEUX : Il me semble évident que, s'il y avait une énorme pression politique de l'opinion, les décideurs politiques y attacheraient une grande importance. Toutes les actions que l'on peut conduire sont, d'une manière ou d'une autre, contraignantes : elles ne seront comprises et admises par les citoyens que si la prise de conscience s'est faite au préalable. Soyons clairs : si les 60 millions de Français étaient convaincus de l'importance du problème, les 900 parlementaires le seraient aussi. Ce qui nuit à l'action politique quand elle oublie d'être courageuse, c'est le problème de la réaction. Quel candidat est prêt à se présenter devant les électeurs en leur vantant les mérites d'un programme contraignant en matière de développement durable ? Il est vrai que, parlant devant un parterre d'industriels à qui je faisais valoir que le développement durable implique des nouvelles technologies et des investissements, je n'ai pas été contredit. Mais proposer des mesures sans avoir fourni un grand effort de sensibilisation, c'est s'exposer à une levée de boucliers, car notre pays est prêt à manifester pour un oui ou pour un non. M. Serge POIGNANT : Vous soulignez à juste titre la nécessité de sensibiliser nos concitoyens. C'est effectivement la meilleure chose à faire dans l'immédiat. Pour l'avenir, pensez-vous que nous pouvons nous orienter vers des techniques nouvelles ? M. Marcel DENEUX : J'en suis convaincu. Le problème de la France, c'est d'abord les transports terrestres et le pétrole. Les politiques de rechange existent. La voiture électrique peut se développer. La pile à hydrogène est également une piste à explorer. Ne pas développer le transport fluvial en France est un crime écologique. Notre pays peut donc progresser. En outre, il a la chance de pouvoir compter sur l'énergie nucléaire. Cela étant, je le répète, il faut absolument augmenter les moyens consacrés à la recherche, au niveau national comme au niveau européen. A cet égard, le budget adopté par les chefs d'État et de gouvernement la semaine dernière n'est pas satisfaisant. Voilà encore un exemple de ce que nous ne disons pas aux Français : c'est leur mentir que de leur annoncer une grande politique européenne avec un budget n'excédant par 1,06 % du PIB communautaire, surtout si 45 % de ce budget est consacré à la PAC. M. le Président : Dans la conclusion de votre rapport, vous appeliez de vos vœux l'ouverture d'un vrai débat public, au-delà du cercle des spécialistes. Comment pouvons-nous faire naître ce débat ? Mme la Rapporteure : Pour compléter cette question, je rappelle que France 2, en juin 2003, avait tenté l'expérience d'une émission consacrée à l'effet de serre, comparable au Téléthon. Cette émission, le Climaction, avait pour but d'alerter le grand public, de manière ludique, sur l'impact que peuvent avoir les comportements quotidiens sur le climat. Ce fut un échec total. M. Marcel DENEUX : C'est sans doute parce qu'on n'y a pas mis les bons moyens de communication. Il y a quelques années, lorsqu'on a voulu sensibiliser les agriculteurs à l'importance de l'installation des jeunes générations et à l'investissement à y consacrer, on avait diffusé un feuilleton télévisé, Sylvie des trois ormes, qui avait eu beaucoup de succès. Mme la Rapporteure : En juin dernier, France 2 a diffusé un docu-fiction d'anticipation. L'intrigue se situait en Camargue, autour de 2025. Une famille vivait au rythme de l'effet de serre, et devait faire face aux phénomènes nouveaux provoqués par l'effet de serre. Une fois encore, ce fut un échec. M. Marcel DENEUX : Avec un peu d'imagination, on devrait pouvoir convaincre le grand public. M. le Président : Nous avons vu ce matin des images spectaculaires mettant en évidence le recul du glacier d'Argentière. De même, nous avons vu comment la carte des cyclones était en train de se modifier, avec des parcours plus larges dans l'Atlantique et des queues de cyclone qui pourront échouer en Europe. M. Marcel DENEUX : Du point de vue pédagogique, l'augmentation du prix du pétrole et la survenue de terribles cyclones dans le golfe du Mexique ont fait plus pour sensibiliser l'opinion que tout ce que nous avons pu dire depuis cinq ans. M. le Président : La semaine dernière, les assureurs que nous avons auditionnés ont fait apparaître de manière très nette l'augmentation, au niveau mondial, des indemnisations versées pour des dommages résultant d'événements naturels extrêmes. Pour la première fois, des dérèglements environnementaux se produisant à un endroit donné touchent la totalité de la planète. Dans ces conditions, la question est de savoir comment dépasser le cénacle de quelques parlementaires pour frapper les esprits et leur faire admettre des mesures contraignantes. M. Marcel DENEUX : Le point culminant du Mont-Blanc est officiellement à 4 807 mètres. Pour ma génération, il avait toujours été de 4 810 mètres. Il faudrait souligner que cette diminution, comme la fonte de la calotte glaciaire, s'expliquent par le réchauffement climatique. De même, la présentation des prévisions météorologiques à la télévision devrait être l'occasion d'un commentaire pédagogique. M. Michel DESTOT : Les Français se disent qu'il y a une corrélation entre la consommation énergétique et la croissance. N'y a-t-il pas dans l'esprit de nos concitoyens la peur que l'effet de serre remette en cause ce modèle ? En outre, certains se demandent pourquoi les pays en voie de développement et les pays émergents devraient se développer selon une voie différente de celle que nous avons empruntée. En somme, la pédagogie du réchauffement climatique ne se heurte-t-elle pas à des présupposés de nature profondément politique, plus qu'à une ignorance des données techniques ? M. Marcel DENEUX : En effet. Il faut mener une réflexion approfondie sur la différence entre croissance et développement, alors que ces deux notions sont souvent confondues. La France est très en retard sur ce sujet. En Suède, 6 000 voitures roulent avec le carburant E85, qui contient 85 % d'éthanol. Elles consomment 8 litres aux cent kilomètres, dont seulement 1,2 litre d'essence. Ce carburant n'est toujours pas disponible en France, même si les obstacles réglementaires ont été levés le 26 novembre dernier. Les choses changent très lentement, en raison de l'absence dans l'opinion publique d'un vrai lobby de l'environnement. M. le Président : Monsieur le sénateur, je vous remercie de votre contribution aux travaux de notre Mission d'information. Audition conjointe de Mme Michèle PAPPALARDO, Présidente de l'ADEME, et de M. François MOISAN, directeur scientifique et directeur exécutif de la stratégie et de la recherche Présidence de M. Jean-Yves LE DEAUT, Président M. le Président : Mes chers collègues, nous accueillons aujourd'hui Mme Michèle Pappalardo, présidente de l'Agence gouvernementale de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME), et M. François Moisan, directeur scientifique et directeur exécutif de la stratégie et de la recherche. Mme Michèle PAPPALARDO : Je dois préciser tout d'abord que la lutte contre l'effet de serre ne fait pas partie, explicitement, des missions de l'ADEME, telles qu'elles sont définies dans les textes qui la concernent. Mais l'Agence a pour mission de favoriser les économies d'énergie et l'utilisation des énergies renouvelables. C'est à travers ces deux missions qu'elle joue un rôle important dans la lutte contre le changement climatique. Accessoirement, les actions qu'elle mène dans le domaine de la gestion des déchets ont également des conséquences sur le changement climatique. D'une manière plus générale, l'ADEME s'efforce de développer pour elle-même et pour ses partenaires des démarches de développement durable qui intègrent « obligatoirement » la lutte contre l'effet de serre. Dans le cadre de la mise en œuvre du Plan Climat, l'ADEME utilise l'ensemble de ses moyens et de ses méthodes d'intervention. En premier lieu, l'Agence agit dans le domaine de la recherche-développement. Les priorités, dans le domaine de la lutte contre le changement climatique répondent aux enjeux de moyen et long terme identifiés par les différents travaux récents de prospective et d'évaluation - rapport Chambolle et rapport Gagnepain sur les nouvelles technologies de l'énergie -. Le plan de recherche 2005-2010 de l'ADEME est ainsi structuré, dans ce domaine, autour des sept programmes à caractère technologique. Le premier programme concerne les véhicules pour les transports, y compris les piles à combustibles. Il vise à répondre aux défis portant sur le couple véhicule-carburant à l'horizon 2030-2050 et recouvre plus particulièrement les recherches conduites dans le cadre du PREDIT et la mise en œuvre du programme véhicules propres et économes (VPE). Au-delà de l'amélioration de l'efficacité énergétique des véhicules classiques, ce programme s'adresse aux enjeux de plus long terme concernant les véhicules alternatifs : hybrides, carburants alternatifs, hydrogène et piles à combustibles. Les enjeux résident dans la dépendance pétrolière, les émissions de gaz à effet de serre et d'autres polluants, la présence d'une forte capacité industrielle en France et la nécessité d'explorer de fortes ruptures technologiques. Le deuxième programme, PREBAT, concerne le bâtiment. Ce domaine constitue un enjeu important en terme de maîtrise des consommations d'énergie et de réduction des émissions de gaz à effet de serre. La relative dispersion du milieu industriel de la construction avec de nombreuses PME impose de structurer l'espace de recherche rassemblant les compétences publiques et les entreprises du secteur. L'objectif est de démontrer la faisabilité de bâtiments à énergie positive, consommant moins d'énergie qu'ils n'en produisent en valorisant les apports des énergies renouvelables thermiques et électriques, y compris dans les bâtiments existants. L'enjeu est une appropriation des technologies les plus performantes par l'ensemble des acteurs de la construction. Le troisième programme porte sur la capture, le transport et le stockage du CO2. Cette option de recherche est importante dans la mesure où l'enfouissement géologique du CO2 peut permettre d'assurer une transition avec les technologies sans carbone de plus long terme et de limiter les émissions de grandes installations de combustions plus particulièrement dans les pays émergents ayant recours de façon massive au charbon. Le quatrième programme concerne les technologies avancées de production d'électricité renouvelable, en particulier le photovoltaïque. Le cinquième programme, le Programme national de recherche sur les bioénergies (PNRB), concerne les bio-ressources et les biocarburants. Les biocarburants constituent une option majeure, et les objectifs de la directive européenne en la matière nécessitent de développer les procédés performants améliorant le bilan énergétique de la transformation de la biomasse et permettant de recourir à la partie ligno-cellulosique des plantes. Cette option de recherche vise à substituer une part significative des carburants d'origine pétrolière et constitue donc un enjeu majeur. Il s'agit également de développer l'utilisation de la biomasse pour les autres usages, encore dépendants des hydrocarbures. Le sixième programme porte sur les réseaux et le stockage de l'énergie. Le développement des productions décentralisées d'énergie, notamment renouvelables et intermittentes, confère un enjeu important aux technologies de stockage. Le septième programme, PRECODD, porte, plus globalement, sur les éco-technologies et les procédés sobres et propres. Il recouvre non seulement les dispositifs de lutte contre la pollution en aval, mais aussi les technologies « intégrées » réduisant les émissions de polluants, les procédés de production économes en énergie et en ressources, les systèmes d'optimisation pour la gestion des émissions et des ressources. Ce programme doit notamment contribuer à améliorer la position compétitive des entreprises françaises dans le domaine des technologies de l'environnement et des procédés propres. Enfin, dans le cadre des études socio-économiques, les recherches s'effectuent sur les modèles prospectifs, ainsi que sur l'efficacité et la complémentarité des divers instruments économiques de la puissance publique : permis, certificats, subventions, fiscalité. Les recherches sociologiques sont centrées quant à elles sur les représentations sociales de l'effet de serre, et l'acceptabilité des modifications de modes de vie susceptibles d'apparaître dans le futur. Ces actions de recherche de l'ADEME ont été financées en 2005 : par le budget de recherche de l'ADEME directement, soit environ 50 millions d'euros, dont les deux tiers sont consacrés à la thématique énergétique liée à l'effet de serre ; par la dotation spécifique destinée au programme « véhicule propre et économe » financée par un compte d'affectation spéciale alimenté par le produit des privatisations et qui s'est élevé à 40 millions d'euros, par les crédits de quatre programmes de l'Agence nationale de la recherche - transports, bâtiment, bioénergie, écotechnologies - délégués en gestion à l'ADEME, pour un montant d'environ 45 millions d'euros. Le deuxième axe de l'action de l'ADEME est l'expertise. En premier lieu, l'agence fournit une expertise en amont des politiques publiques. C'est ainsi qu'elle a participé activement à l'élaboration du Plan Climat. Pour la prochaine réglementation thermique des bâtiments, l'ADEME a apporté son expertise et a préparé les acteurs de la construction à l'adoption de nouvelles techniques répondant à ces exigences. Dans le cadre de la transposition de la directive européenne sur les performances énergétiques des bâtiments, elle prépare les dispositions relatives à l'étiquetage des logements. Dans le cadre de la mise en œuvre de la directive européenne sur les permis d'émission, l'ADEME a participé à l'élaboration du plan national d'allocation des quotas, le PNAQ, en apportant son expertise sur les gisements d'économie d'énergie dans l'industrie. Par ailleurs, l'ADEME intervient pour définir les typologies d'équipements ou seuils techniques qui permettent de mettre en œuvre des dispositions fiscales incitant à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Enfin, l'ADEME conduit des études prospectives à moyen et long terme afin d'évaluer les perspectives de réduction des émissions de gaz à effet de serre des différents secteurs d'activité. En deuxième lieu, l'ADEME mobilise son expertise en faveur des entreprises et des collectivités territoriales, afin de les aider à intégrer la lutte contre le changement climatique dans leur propre stratégie. A cette fin, elle développe des outils et des méthodes qui leur sont destinés et qui facilitent leur prise de décision pour réduire les émissions. Le Bilan Carbone est une méthode, développée par l'ADEME et lui appartenant juridiquement qui permet à une entreprise d'évaluer les émissions résultant de son activité au-delà de son strict périmètre juridique et de prendre ainsi en compte les émissions résultant des activités de ses fournisseurs, des transports de marchandises et de produits en amont et en aval, des déplacements de ses employés, de la fin de vie des produits qu'elle commercialise dans une logique « du berceau à la tombe ». L'ADEME a formé des bureaux d'étude à cette méthode, et plus d'une centaine d'entreprises ont d'ores et déjà utilisé l'outil. Le développement de la méthode pour les collectivités territoriales est en cours avec l'expérimentation auprès de 16 collectivités. Cet outil complète la panoplie des « aides à la décision » promues par l'ADEME auprès de l'ensemble des acteurs. L'ADEME a élaboré avec le ministère de l'écologie et du développement durable et la MIES un guide « Plan Climat Territorial » afin d'inciter les collectivités territoriales à s'engager dans une démarche de prévention et d'adaptation au changement climatique prenant en compte non seulement l'action sur leur patrimoine, mais également leur rôle « d'aménageur » au travers des outils de planification territoriale ou de l'utilisation de clauses d'éco-conditionnalité, dans leurs politiques d'aide au logement par exemple. L'ADEME met également à disposition des outils spécifiques comme les PDE, les plans de déplacements entreprises, qui permettent aux entreprises comme aux collectivités territoriales ou aux administrations d'évaluer les émissions de CO2 générées par les déplacements des employés et de mettre en œuvre des alternatives. L'ADEME a en outre évalué les conditions d'insertion des équipements au niveau territorial susceptibles de déclencher des réactions de rejet de la part des populations. Plus récemment, elle a mis en chantier un partenariat avec les banques visant à définir de nouveaux mécanismes financiers permettant aux réseaux bancaires de promouvoir les investissements des particuliers au regard de la performance énergétique de leur logement. L'ADEME participe par ailleurs à l'étude des nouveaux mécanismes susceptibles de se développer plus rapidement depuis l'entrée en vigueur du protocole de Kyoto, comme les mécanismes de développement propre (MDP), la mise en œuvre conjointe (MOC), et les permis domestiques, pouvant accompagner la mise en place d'un fonds carbone français. En troisième lieu, l'expertise de l'Agence en matière d'efficacité énergétique est sollicitée par différents organismes et instances internationales. Elle préside le comité efficacité énergétique du Conseil mondial de l'énergie et réalise, dans ce cadre, une étude mondiale des politiques mises en œuvre. Elle est sollicitée par la Commission européenne en amont de la formulation de directives, par exemple la directive services d'efficacité énergétique. Cette insertion internationale lui permet de conduire de connaître et de comparer les instruments mis en œuvre en France et dans les autres pays et d'évaluer les marges de manœuvre dans la logique du « facteur 4 ». Le troisième axe de l'action de l'ADEME est la diffusion des « bonnes pratiques ». En matière de lutte contre le changement climatique et d'aide à la réalisation des projets des différents acteurs économiques, l'action de l'agence prend des formes multiples. Il s'agit, en premier lieu, d'actions de sensibilisation, de promotion et d'explication. Afin de convaincre les différents acteurs socio-économiques, chaque « cible » fait l'objet d'une politique de « communication » spécifique. Un effort particulier a été fait cette année en direction des entreprises. Cette action passe par le développement des actions de partenariat et la signature d'accord cadre avec des organismes « fédérateurs », tels que l'Assemblée française des chambres de commerce et d'industrie (ACFCI), l'Assemblée permanente des chambres de métiers (APCM), l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture (APCA), la Fédération nationale des coopératives d'utilisation de matériel agricole (FNCUMA), avec des grandes collectivités locales, comme le Grand Lyon, ou des grandes entreprises, qui ont un rôle d'entraînement par rapport à leur secteur économique. A travers la contractualisation avec les conseils régionaux, qui ont tous un chapitre sur la maîtrise de l'énergie, l'ADEME incite les collectivités à conduire des politiques territoriales de réduction des émissions de CO2 et de développement des énergies renouvelables en cofinançant les projets. Des documents d'information spécifiques sont élaborés et l'agence utilise tous les moyens de communication disponibles pour jouer son rôle de centre de ressources, notamment en mettant à disposition les résultats des études et recherches, mais aussi les exemples de réalisation de leur mise en œuvre. Il s'agit, en deuxième lieu, d'aides financières. Pour les économies d'énergie, l'ADEME finance des aides à la décision pour aider les entreprises et les collectivités territoriales à connaître leurs consommations et à définir leurs plans d'action, notamment en utilisant les outils et méthodes élaborés par l'agence. Pour les énergies renouvelables, des aides à la décision ainsi que des aides à l'investissement s'adressent aux entreprises et aux collectivités, pour des installations solaires thermiques et de bois énergie. Pour encourager des démarches globales, 35 contrats : actions territoriales pour l'environnement et l'efficacité énergétique (ATenEE) ont été signés, qui permettent d'accompagner les collectivités dans leur politique d'efficacité énergétique. L'objectif est d'atteindre 70 contrats. D'une manière générale, l'ADEME cherche à soutenir des opérations exemplaires qui permettent d'expérimenter des installations innovantes ou de faire connaître les « bonnes pratiques » dans le secteur de l'industrie et dans le secteur bâtiment et tertiaire notamment. En troisième lieu, l'Agence propose d'autres types d'aide, par exemple en intervenant sur le terrain pour soutenir, par ses conseils, le développement de l'efficacité énergétique. Elle soutient notamment le développement de l'électricité renouvelable, en conseillant à la fois les porteurs de projets et les collectivités territoriales qui souhaitent créer des parcs éoliens. Elle est également partenaire des collectivités en ce qui concerne la prise en compte de la lutte contre l'effet de serre dans les décisions d'urbanisme. Le quatrième axe de l'action de l'ADEME est le partenariat en matière de sensibilisation et d'éducation. En 2004, l'ADEME a lancé la première phase d'une campagne de sensibilisation du grand public au réchauffement climatique : « Economies d'énergie : faisons vite, ça chauffe ! ». Au-delà du plan média cette campagne s'est traduite par 1 400 actions concrètes dans le cadre du club « Planète gagnante ». En 2005, cette campagne s'est poursuivie dans une logique de mobilisation et 2 500 nouvelles initiatives partenariales nationales et locales ont été réalisées. Les évaluations indépendantes réalisées montrent que cette campagne a un impact considérable puisque, selon IPSOS, 64 % de ceux qui ont vu ou entendu la campagne déclarent avoir modifié au moins un geste au quotidien, portant sur l'éclairage, le chauffage, ou l'utilisation de l'eau chaude. L'initiative du « Défi pour la terre », lancé en partenariat avec la Fondation Nicolas Hulot a d'ores et déjà entraîné plus de 310 000 « engagements » individuels, mais aussi d'entreprises ou de collectivités. Le « défi pour la terre » a donné lieu à un concours lancé lors du Congrès des maires de France et avec le partenariat de l'association des maires de France (AMF) et du groupe « Le Moniteur » destiné aux communes et visant à récompenser les collectivités qui auront su entreprendre les actions de mobilisation des citoyens les plus exemplaires. Au-delà de la sensibilisation et de la mobilisation des particuliers, il importe qu'ils disposent d'une information fiable et impartiale sur les différents types d'investissements qu'ils peuvent réaliser, notamment dans leur logement. A cette fin, l'ADEME a mis en place un réseau d'Espaces Info Énergie au niveau local et en partenariat avec les collectivités locales. Véritables services d'information et de conseil de proximité, ces points d'information sont maintenant au nombre de 180 et animés par 300 conseillers. Près de 800 000 personnes ont été conseillées en 2004 et un nouvel accroissement de 50 % est estimé en 2005, avec près de 1,2 million de personnes conseillées. L'ADEME développe également son activité de conseil auprès du public avec ses guides grand public, la plateforme téléphonique de réponses aux numéros vert et azur, son site internet. S'agissant maintenant des résultats et des perspectives, je noterai, en premier lieu, que des progrès sensibles ont été accomplis depuis deux ou trois ans. L'ensemble des politiques mises en œuvre commence à avoir des résultats concrets, même s'il est encore trop tôt pour mesurer les gains réels en termes d'efficacité énergétique et de réduction des émissions. Il faudra attendre les bilans définitifs de 2005 pour pouvoir vérifier si les évolutions sur les deux dernières années, 2004 et 2005, marquent bien une inflexion. Il faut souligner, en outre, que l'augmentation du prix du pétrole et, corrélativement, de toutes les énergies, est un facteur très favorable au développement de ces politiques. Sans chercher à être exhaustif, on peut souligner quelques résultats concrets. En termes de sensibilisation, on note une évolution très forte de la prise de conscience de l'importance du sujet, de la part de tous les acteurs de la société. Les médias sont désormais très présents sur ce thème. Les grandes entreprises sont, dans leur grande majorité, convaincues de la nécessité d'agir et d'anticiper les futures réglementations. Les collectivités territoriales commencent à s'interroger sur le rôle qu'elles peuvent jouer. Le grand public est très sensibilisé, même si, en termes de compréhension du phénomène, il reste encore beaucoup de travail à faire. Dans le domaine de la recherche, les nouvelles technologies de l'énergie ont fait l'objet de réflexions stratégiques qui sont actuellement mises en œuvre. Elles font partie des priorités des deux nouvelles agences, l'Agence nationale de la recherche (ANR) et l'Agence de l'innovation industrielle (AII) et restent, bien sûr, au cœur des préoccupations de l'ADEME. En matière de diffusion, la mise en place, en 2005, d'un crédit d'impôt de 25 % pour les matériels performants en termes d'économies d'énergie, et de 40 % pour les énergies renouvelables, a été très efficace. L'année 2005 devrait connaître une augmentation de 70 % des chauffe-eau solaires, par exemple, et les autres matériels devraient s'inscrire dans une progression de même nature. Ce crédit d'impôt est encore amélioré en 2006. La réglementation thermique 2005, applicable en 2006, permettra une forte amélioration de l'efficacité énergétique des bâtiments neufs, et une meilleure intégration des énergies renouvelables. Le développement de l'étiquette énergie pour les véhicules et les logements facilitera l'information des consommateurs et donc leur prise de conscience. Les décisions prises en matière de développement des biocarburants vont permettre leur progressive intégration dans les carburants classiques. L'ADEME ne saurait négliger, enfin, la sensibilisation des différents ministères. Les principaux ministères sectoriels s'efforcent, parfois encore un peu timidement, d'intégrer la lutte contre le changement climatique dans leurs politiques. Le ministère de l'agriculture prend en compte comme une politique à part entière le développement des biocarburants, et plus généralement de l'utilisation énergétique de la biomasse. Il a désormais une structure interne pour traiter du sujet. Au ministère du logement, la prise en compte des économies d'énergie dans le logement neuf et dans le parc existant est désormais bien comprise, et ses aspects sociaux ne sont pas négligés, même si les réticences sont encore nombreuses, la prise en compte du coût global n'étant pas encore généralisée. S'agissant du ministère des transports, les résultats les plus importants sont conditionnés par des changements lourds dans les infrastructures : train-route ; train-avion ; voie fluviale-route. Sur tous ces thèmes, on constate des inflexions positives. La poursuite de toutes ces évolutions devrait permettre de respecter les engagements du protocole de Kyoto, dont il faut rappeler toutefois qu'ils ne sont pas extrêmement ambitieux, puisqu'il s'agit pour la France de maintenir l'émission de gaz à effet de serre entre 2006 et 2012 au même niveau qu'en 1990. Pour atteindre les objectifs du « facteur 4 », il faut « changer de braquet ». Plusieurs conditions doivent pour cela être remplies. La première est la généralisation des actions de diffusion à toute la population. Pour la plupart des actions de maîtrise de l'énergie, nous sommes aujourd'hui sortis de « l'ère des pionniers », mais nous ne sommes pas encore entrés dans celle de leur généralisation. Pour atteindre ce résultat il faudra mobiliser l'offre : face à une augmentation sensible de la demande en matière d'énergies renouvelables et d'économie d'énergie, il faut éviter les goulets d'étranglement liés à l'offre ainsi que les contre-performances. Deux secteurs sont aujourd'hui particulièrement vulnérables à ce type de problèmes. D'une part, le développement des bio-énergies nécessite de mobiliser au mieux nos ressources de biomasse, ce qui passe par une meilleure utilisation de la forêt française. Dans le bâtiment, d'autre part, atteindre les objectifs du facteur 4 implique une généralisation des travaux de rénovation intégrant les économies d'énergie, ce qui suppose une forte mobilisation du secteur du bâtiment, à la fois en termes de recrutement et de formation. La deuxième condition à remplir est le développement des moyens de financement adaptés. La division par trois des consommations d'énergie du parc français de logements et de bureaux nécessite des investissements dans le parc actuel qui sont compris entre 400 et 600 milliards d'euros. Cela suppose de déployer des moyens de financement à la hauteur de l'enjeu. Les crédits d'impôt ont fait la preuve de leur efficacité ; ils pourraient être élargis et complétés par la TVA à 5,5 %. Il conviendrait également de mettre en place des produits bancaires adaptés à ces besoins d'investissements immobiliers un peu particuliers, lesquels permettent des économies de factures énergétiques qui facilitent les remboursements des prêts correspondants. La troisième condition à remplir est la démultiplication des moyens d'information. Même si la connaissance de ces sujets progresse dans l'opinion, il faut encore faire des progrès importants pour passer de la sensibilisation à l'action concrète. Cela suppose qu'on s'adresse aux consommateurs et qu'on les aide à faire les bons choix, tant en matière de bâtiment que de transports, qu'il s'agisse du grand public ou des autres acteurs. Un tel résultat n'est possible qu'en mobilisant des moyens importants et répartis sur l'ensemble du territoire pour faire du conseil pratique de proximité. Le développement du réseau Espace Info Énergie ou de structures qui s'en inspirent est donc indispensable, au-delà d'un développement des réseaux de relais partenariaux que l'ADEME s'efforce de mettre en place autour de sa fonction de centre de ressources. Il importe, enfin, de systématiser l'intégration de la lutte contre l'effet de serre aux différentes politiques. La cohérence des politiques est une condition indispensable à la généralisation des actions de lutte contre le changement climatique. Cela suppose que les différentes politiques sectorielles placent cet objectif en tête de leurs priorités de résultats, qu'il s'agisse de politiques nationales ou locales. Cette systématisation est nécessaire pour que tous les acteurs socio-économiques adaptent leurs propres actions à cet objectif. Cela peut prendre, par exemple, la forme de clauses systématiques d'éco-conditionnalité, particulièrement en matière de consommation d'énergie, dans la mise en œuvre des politiques de soutien financier public. Ces pratiques commencent à se développer, notamment au niveau régional. Au-delà des changements de comportements et d'une mobilisation des consommateurs pour une utilisation des meilleures techniques disponibles en matière de maîtrise de l'énergie, atteindre les objectifs du « facteur 4 » ne sera possible que si l'on développe de nouvelles technologies ou si l'on réduit fortement le coût de certaines technologies existantes pour rendre leur développement plus aisé. Ces évolutions supposent que l'on soutienne fortement la recherche dans le domaine des nouvelles technologies de l'énergie dans les décennies à venir. L'ensemble de ces efforts devra porter sur deux secteurs prioritaires : les transports et le bâtiment. S'agissant des transports, il faut non seulement travailler à développer des véhicules et des carburants adaptés à la lutte contre l'effet de serre, mais aussi réfléchir en termes d'organisation des transports et d'urbanisme. Pour ce qui est du bâtiment, il convient de développer des « bâtiments à énergie positive » pour les bâtiments neufs, et surtout travailler à réduire fortement les consommations du parc de bâtiments existants, car 60 % du parc de 2050 est déjà construit. Cela passe par une généralisation des rénovations « énergétiques ». M. François MOISAN : Je souhaite préciser deux points. S'agissant des véhicules, à l'horizon 2030, et a fortiori 2050, il existe une incertitude assez forte sur le point de savoir quelles seront les technologies disponibles. Les travaux portent sur l'amélioration des moteurs actuels, avec de nouveaux cycles de combustion. Différentes options sont envisagées à plus long terme, qu'il s'agisse des véhicules hybrides ou des véhicules à traction électrique. A plus long terme encore, l'utilisation de l'hydrogène fait l'objet de nombreuses recherches. S'agissant du bâtiment, on dispose d'une panoplie de technologies qui réduisent considérablement la consommation d'énergie. En Suisse, des bâtiments sont commercialisés sous le label Minergie, qui consomment la moitié de la consommation réglementaire. La difficulté est de faire adopter ces technologies par l'ensemble de la profession. Comme l'a dit Mme Pappalardo, l'ANR délègue à l'ADEME la gestion de quatre programmes. S'agissant du programme PREBAT, en 2005, nous avons réalisé un appel à propositions commun en utilisant à la fois des crédits de l'ANR et des crédits budgétaires de l'ADEME. Le programme PREDIT a également été financé par l'ANR. Le programme Biocarburants vise à développer des procédés de production qui n'utilisent pas la partie la plus noble de la plante mais la partie ligno-cellulosique. Cette matière première moins coûteuse permettrait d'atteindre plus rapidement l'objectif de compétitivité des biocarburants. Le programme PRECODD vise un ensemble de technologies de moindre impact sur l'environnement. Nous avons, pour ces quatre programmes, préparé les appels à propositions dans le courant de 2005. Les dernières conventions sont en cours de conclusion. Mme Michèle PAPPALARDO : En matière de recherche, nous avons deux modes d'intervention : le financement, bien sûr, mais aussi l'animation de la recherche. Nos ingénieurs effectuent un travail de mise en connexion et de visibilité de l'ensemble des travaux réalisés en France par différentes partenaires. Par exemple, le programme PREBAT est le résultat de trois années d'appels à propositions organisés par l'ADEME sur ce qui s'appelait à l'époque le programme Bâtiment 2010. Nous avons pu ainsi réunir les différents partenaires pour faire converger les idées et les objectifs des uns et des autres. L'ANR nous a apporté des moyens de financement supplémentaires. Elle n'anime pas les programmes qu'elle nous délègue. Mme Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET, Rapporteure : Vous n'avez pas évoqué la question de l'adaptation. Entre-t-il dans les missions de l'ADEME d'intégrer l'adaptation aux recherches, soit à titre accessoire, soit à titre principal ? S'agissant des biocarburants, vous savez que le milieu écologique voit se dessiner une certaine opposition, les biocarburants étant réputés positifs en termes d'émission de CO2 mais plutôt nocifs pour l'eau, à travers les cultures industrielles qu'ils supposent. L'ADEME est-elle impliquée dans ce débat, d'une manière ou d'une autre ? Mme Michèle PAPPALARDO : Pour répondre à votre première question, le positionnement de l'ADEME est d'abord la prévention. Cela étant, nous insistons sur l'importance de l'adaptation, même si elle n'est pas pour nous l'objet de missions spécifiques. D'autre part, lorsque nous travaillons sur le bâtiment, nous intégrons les données du changement climatique : il est clair que le bâtiment de 2050 devra être adapté aux évolutions. M. François MOISAN : Construire des bâtiments dont les besoins en refroidissement sont moindres, c'est aussi s'engager dans l'adaptation. Mme Michèle PAPPALARDO : S'agissant des biocarburants, il est vrai qu'un certain nombre de politiques pourraient, si l'on n'y prend garde, ne pas être cohérents avec d'autres politiques et d'autres objectifs. Les problèmes de pollution des eaux ne doivent pas être négligés. De même, des véhicules peuvent être économes tout en n'étant pas très propres. Il convient bien sûr d'éviter que la lutte contre l'effet de serre nous conduise à abandonner les autres objectifs environnementaux. Nous nous efforçons d'être cohérents. Dans nos analyses de cycle de vie, nous intégrons l'ensemble des impacts sur l'environnement, y compris la qualité de l'eau et de l'air. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous avons signé des accords cadres avec l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture et la Fédération nationale des CUMA. Nous travaillons avec ces partenaires sur les déchets, sur l'énergie, mais aussi sur la gestion environnementale. Historiquement, les cultures industrielles liées aux biocarburants ont été les premières à adopter des chartes définissant les bonnes pratiques. Nous les aiderons autant que nous le pourrons à aller plus loin dans cette démarche, qu'il s'agisse de l'eau, de l'air ou de la consommation d'énergie. M. François MOISAN : J'ajoute que l'utilisation de la biomasse ligno-cellulosique aura un impact positif, puisque beaucoup moins d'intrants sont nécessaires. M. le Président : Vous n'avez pas évoqué le stockage de l'électricité. Un programme est-il envisageable en la matière ? Deuxièmement, s'agissant des biocarburants, nous avons l'impression que la démarche qui prévaut vise plutôt la transformation de certaines cultures - la betterave, le blé, le colza - qu'une réelle valorisation de la biomasse. Que pensez-vous, notamment, de la filière sèche en gazéification à partir de la ligno-cellulose ? Troisièmement, s'agissant du bâtiment, après le rapport que j'ai rédigé en 2000 avec mon collègue Claude Birraux, j'ai lancé, dans l'OPAC que je présidais, des opérations bioclimatiques, et notamment de valorisation du solaire. Or, nous ne sommes pas aidés ! Pour une maison de 120 000 euros, les surcoûts s'élèvent à 25 000 euros, dont la moitié seulement est couverte par des aides. Cela veut dire que dans le logement social, ce sont les locataires, c'est-à-dire les gens les plus pauvres de notre société, qui financent les équipements écologiques. Et encore faut-il souligner que ces surcoûts sont ceux qui correspondent à l'orientation de la maison, au solaire passif, au solaire thermique actif pour l'eau chaude et le chauffage. Avec des technologies plus complexes, les surcoûts doubleraient sans doute le prix d'une maison. Qui va payer ? J'ajoute que le parc français est ancien, qu'il se renouvelle au rythme de 1 % par an. Mme Michèle PAPPALARDO : L'habitat ancien est en effet un objectif prioritaire, puisque 60 % du parc de 2050 est d'ores et déjà construit. C'est pourquoi il est essentiel qu'aux aides publiques s'ajoutent des systèmes de financement bancaire qui aident les locataires et propriétaires à amortir les surcoûts dans le remboursement des emprunts. La difficulté est d'intégrer dans des outils financiers le coût global qui résulte des investissements, d'une part, et des économies d'énergie, d'autre part. Nous tentons de convaincre les banquiers que c'est possible, comme le montrent plusieurs exemples à l'étranger. Les aides de l'ADEME soutiennent des opérations exemplaires, mais il est clair que nous ne pouvons pas aider l'ensemble du secteur social avec les moyens dont nous disposons. Reste que le logement social est la priorité sur laquelle nous allons travailler. Pour en revenir aux surcoûts, ils sont compris entre 5 et 10 % pour des normes HQE. Les recherches visent à développer de nouvelles technologies, mais aussi à diminuer le coût de celles que nous connaissons déjà. C'est aussi pourquoi il importe d'améliorer la formation des professionnels du bâtiment. S'agissant de la biomasse, je ne partage pas le sentiment qu'elle ne ferait pas l'objet d'un programme ambitieux. S'il est vrai que les biocarburants ne sont qu'un élément parmi d'autres, car ils ne résoudront pas le problème à eux seuls, il n'en reste pas moins que le PNRB correspond à une politique d'ensemble cohérente. M. François MOISAN : Le PNRB fait suite, en effet, à une période dans laquelle l'ADEME s'était investie par le biais d'Agriculture pour la chimie et l'énergie (AGRICE), groupement d'intérêt scientifique fondé en 1994 par les ministères chargés de l'agriculture, de l'environnement, de l'industrie et de la recherche. Jusqu'à 2003, AGRICE s'était orienté vers la valorisation de la biomasse, notamment des molécules à haute valeur ajoutée, plutôt que sur les biocarburants. Le PNRB comprend un programme sur les biocarburants. Il s'appuie sur deux filières. La première est la voie « sèche » : gazéification de la biomasse ligno-cellulosique, puis production de carburants liquides directement substituables par le procédé Fischer-Tropsch. La seconde est la voie « humide », qui relève à nos yeux du plus long terme, à l'horizon 2020. Il faut préciser, toutefois, que la France n'est pas aussi avancée que d'autres pays européens dans la maîtrise des procédés de gazéification. M. le Président : Ce domaine de recherche est-il bien une priorité ? Ceux qui travaillent sur ce sujet disent qu'ils ont du mal à obtenir des subventions. M. François MOISAN : C'est environ 8 ou 9 millions d'euros qui ont été attribués en 2005 par l'ANR, dans le cadre de la procédure d'appels à propositions, sur ces deux filières, voie humide et voie sèche. Un troisième volet du PNRB porte sur des études économiques relatives à la mobilisation de la biomasse. On estime qu'actuellement que l'utilisation de la biomasse ligno-cellulosique permettrait de couvrir environ la moitié de la consommation actuelle de carburants dans les transports. S'agissant des bâtiments, je précise que le programme PREBAT concerne non seulement les bâtiments neufs, mais aussi des technologies applicables dans les bâtiments existants. En ce qui concerne le stockage de l'électricité, il apparaît que les réseaux électriques n'auront plus pour fonction première de délivrer de l'énergie, mais de mutualiser des besoins et des productions. Cela appelle une réflexion sur ce qu'on appelle les réseaux intelligents, mais également sur des technologies comme le stockage de l'électricité. L'autre problème est le stockage de l'électricité embarquée sur les véhicules électriques ou hybrides. Dans ce domaine comme dans tous ceux qui touchent aux nouvelles technologies de l'énergie, il faut préciser que les entreprises apportent des innovations constantes, contrairement au programme nucléaire, par exemple, où c'est l'Etat qui est prescripteur de la technologie. L'ADEME se situe à l'articulation entre les entreprises et les laboratoires publics, puisqu'un tiers de ses crédits financent ceux-ci alors les deux tiers financent les projets de recherche de celles-là. Or, il n'y a pas en France d'industriels spécialisés dans les batteries pour véhicules. Cela explique en partie la réticence des constructeurs automobiles à investir fortement dans la recherche sur les véhicules électriques. L'ADEME donne la priorité aux domaines où des entreprises françaises sont capables de porter des technologies en aval de la recherche. Nous ne finançons pas des recherches publiques là où le tissu industriel ne serait pas à même de s'associer aux laboratoires pour développer des produits. En outre, les phénomènes électrochimiques à l'œuvre dans le fonctionnement des batteries sont encore mal connus et mal maîtrisés. Le problème est celui de la fiabilité des batteries plus encore que leur autonomie. M. le Président : Je reviens, sans esprit polémique, à la question des surcoûts dans le bâtiment. Quand on reste dans des normes de type HQE classique, ils sont effectivement de l'ordre de 5 %. Mais quand il s'agit d'installer du solaire thermique, avec un réseau de chauffage au niveau du sol, avec des puits de lumière, avec un chauffe-eau thermique, avec une vingtaine de mètres de carrés de capteurs solaires sur le toit, les surcoûts sont d'un tout autre ordre. D'autre part, on ne peut plus dire qu'on est dans une habitation à loyer modéré quand les surcoûts liés au chauffage électrique dans des maisons mal conçues sont très importants. Les surcoûts baisseront si des filières industrielles se créent. On peut regretter que ce ne soit pas le cas. Mme Michèle PAPPALARDO : Je partage votre regret. Mais certains industriels investissent dans l'énergie solaire, même s'il faut soutenir le marché. Des perspectives commencent à s'ouvrir. M. Serge BLISKO : Dans le cadre d'un projet dans lequel s'investit une société d'aménagement à Paris, je constate que les surcoûts sont élevés, en raison des techniques de construction, en raison du type d'orientation, en raison du coût très élevé des études, en raison enfin des systèmes de sécurité. Nous pensions monter le projet en prêt locatif social (PLS). Etant donné ces surcoûts, nous allons être obligés de passer en logement libre. Cela nous gêne du point de vue social. Mme Michèle PAPPALARDO : Je précise que les surcoûts de l'ordre de 5 % sont ceux qui correspondent à des logements haute qualité environnementale (HQE) à bonne performance énergétique, et non pas à des équipements extrêmement innovants. Les projets pionniers s'accompagnent évidemment de surcoûts d'un tout autre ordre. Il convient qu'ils soient aidés, ne serait-ce que pour montrer ce qu'il est possible de faire. Nous nous efforçons de démontrer que des bâtiments à énergie positive sont possibles. On peut espérer que les coûts, aujourd'hui très élevés, diminueront au fur et à mesure que des constructions de ce type se généraliseront. M. le Président : Madame, Monsieur, je vous remercie de votre contribution aux travaux de notre Mission. Audition de M. Pierre RADANNE Présidence de M. Jean-Yves LE DÉAUT, Président M. le Président : Au terme d'une journée marathon, nous avons le plaisir d'accueillir Pierre Radanne, qui fut président de l'Agence gouvernementale de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) de 1998 à 2002. Expert internationalement reconnu dans le domaine des changements climatiques, il vient de publier un livre sous le titre Énergies de ton siècle ! des crises à la mutation. M. Pierre RADANNE : J'ai assisté à la conférence de Montréal, où je travaillais pour l'agence de la francophonie à la formation des négociateurs africains, ce qui est un bon prisme pour analyser la question. Je vous ai ramené la brochure que j'ai rédigée à cet effet. La conférence de Montréal a permis une clarification, mais seulement transitoire. On pouvait penser qu'à la suite de certains événements récents, à commencer par les ravages de Katrina à la Nouvelle-Orléans, l'administration américaine adopterait une attitude plus allante sur un point ou un autre de la négociation. En fait, elle a clairement affiché une position de refus non seulement sur le protocole de Kyoto, mais sur toute avancée de la convention de Rio. Ce que voyant, tous les pays, Australie comprise, se sont résolus à travailler sans participation américaine dans le prolongement du protocole de Kyoto et de ses deux bases, telles que fixées dans le mandat de Berlin en 1995 : premièrement, la fixation d'objectifs de réduction contraignants en matière d'émissions de CO2 - autrement dit, nous entrons, avec la confrontation aux limites de la planète, dans l'ère du rationnement des émissions de CO2 -, deuxièmement, l'intégration dans le processus de mécanismes financiers destinés à mobiliser l'ensemble des acteurs économiques à côté du nécessaire engagement des pouvoirs publics. Mais derrière le calendrier se profilent d'énormes difficultés. Le protocole de Kyoto arrivant à son terme le 31 décembre 2012, un nouveau régime devra prendre la suite dès le 1er janvier 2013, et être connu suffisamment à l'avance pour que l'ensemble des partenaires puissent planifier leurs actions et leurs investissements, ce qui suppose que sa ratification par les deux cents parlements nationaux intervienne au plus tard dans l'année 2012 ; autrement dit, il faudra impérativement mettre au point, courant 2009, non seulement le contenu du protocole proprement dit, mais également les petites lignes de mise en œuvre des accords de Marrakech. Le calendrier suivi pour la première période était le suivant : le départ avait été donné à Berlin en 1995 ; le protocole de Kyoto est intervenu deux ans plus tard, mais il a fallu quatre ans ensuite pour boucler les petites lignes complémentaires de l'accord de Marrakech, et encore trois ans pour obtenir les dernières ratifications, notamment la ratification russe. Autrement dit, il a fallu du temps. Cette fois-ci, le calendrier est beaucoup plus court puisque les négociations devront être terminées en 2009. Or le départ a été donné à Montréal sans qu'aucun point du contenu de la prochaine négociation n'ait été mis dans la corbeille, sinon le feu vert sur le principe même, ce qui est on ne peut plus modeste. La vraie négociation commence l'année prochaine à Nairobi, avec un élément de calendrier que chacun a bien compris : les élections présidentielles américaines de novembre 2008. D'ici là, l'ensemble de la communauté internationale aura commencé à négocier sans les Etats-Unis ; il faudra bien que ceux-ci reviennent dans le jeu, pour trois raisons. D'abord parce qu'ils représentent 25 % des émissions de CO2 ; deuxièmement, parce qu'il sera très difficile d'obtenir un engagement des acteurs de la société, y compris des plus modestes, et des pays en voie de développement, si les pays les plus émetteurs restent en dehors du jeu ; troisièmement, parce que jamais les grands pays émergents, et particulièrement la Chine et l'Inde, ne signeront le prochain protocole sans les Etats-Unis. Leur retour est donc une nécessité ; or on ne voit pas, en l'état actuel des choses, de retour programmé avant le premier mardi de novembre 2008. De ce fait, la négociation va se dérouler en deux temps : une préparation officieuse d'ici à la fin 2008, suivie d'une négociation officielle au forceps, au finish en 2009 en visant l'adoption de l'ensemble du dispositif à la fin de l'année afin d'avoir suffisamment de temps derrière pour les ratifications. Quant à l'état actuel de l'engagement des différents pays dans la réalisation du protocole de Kyoto, il est plutôt de nature à semer le doute, tant l'étagement des performances est considérable. Certains pays, comme le Royaume-Uni ou l'Allemagne, ont des engagements très forts, mais n'atteignent l'essentiel de leurs objectifs qu'en substituant à une production électrique au charbon une production électrique au gaz naturel ; d'autres pays comme la France, ont des objectifs plus faibles mais, faute de disposer de la même marge de manœuvre, auront le plus grand mal à tenir leurs engagements, quand bien même certains - le Japon, les Pays-Bas - font de réels efforts ; d'autres enfin n'ont rien fait pour mettre en œuvre le protocole qu'ils ont signé. Le pays hôte de la convention de Montréal présente à cet égard un spectacle parfaitement terrifiant. Les Canadiens ont un niveau de consommation énergétique par habitant double du nôtre ; ils devaient faire moins 7 %, ils en sont à plus 24 % ! Pour respecter le protocole, il leur faudrait réduire leurs émissions de 30 % d'ici à la fin de 2012 ! C'est évidemment impossible, et ils devront payer pour recourir aux mécanismes de flexibilité, notamment dans les pays émergents. Plusieurs pays européens comme l'Italie et la Belgique sont en délinquance totale, complètement hors des clous, et d'autres, comme l'Espagne, le Portugal ou la Grèce, bien que bénéficiant d'augmentations d'émissions pour cause de décollage économique, sont en dérapage absolu : +40 % pour l'Espagne qui avait droit à +25 %. Le bilan du « Plan Climat », en France comme ailleurs, est des plus mitigés. Les objectifs ne sont clairement pas à la hauteur du sujet. La France n'est pas en situation de dérapage, mais avec un objectif de stabilisation, elle a été particulièrement bien servie dans la distribution : si nous avions eu la situation du Japon - 6 % alors que son efficacité énergétique est bien supérieure -, nous ne tiendrions pas. Le dispositif français pèche de plusieurs façons, et d'abord au niveau du pilotage : alors que les négociations sur le Plan Climat sont conduites par le ministère de l'environnement, les grands ministères refusent clairement de coopérer. Au moment du premier plan, dit plan national de lutte contre le changement climatique PNLCC, mis au point en janvier 2000, le ministère des finances a imposé une règle, jamais infirmée depuis : aucun impact budgétaire en termes de dépenses. Mais le PNLCC comportait également un volet de recettes fiscales, notamment sur les carburants, lui aussi totalement remis en cause, par le Conseil constitutionnel notamment qui s'est opposé à l'extension de la TGAP à l'énergie ; depuis, on a clairement refusé les décisions fiscales liées aux plans de changement climatique. Ni dépenses, ni recettes. Les plans, pour l'essentiel, se limitent à du réglementaire avec une portée très faible et une mise en œuvre très variable : on a ainsi imposé un niveau d'efficacité énergétique sur la construction neuve, mais faute de disposer d'un service chargé de contrôler la réglementation en matière de construction, celle-ci n'est pas appliquée - le dérapage entre les réglementations et la réalité serait de l'ordre de 20 %. A cela vient s'ajouter la franche hostilité, osons le dire, du ministère en charge du transport : n'oublions pas que 70 % des émissions françaises - bâtiment et transports - relèvent de son domaine de compétences. Le secteur des transports, en dérapage permanent, absorbe à lui seul les gains réalisés dans les secteurs de l'énergie et de l'industrie, dont l'action apparaît à cet égard exemplaire. Aucune disposition sérieuse n'a été prise pour l'habitat ancien, hormis certaines mesures de pur affichage sur la consommation d'énergie, au demeurant difficiles à mettre en œuvre. Pas de programme de réhabilitation thermique, aucune réglementation sur les composants du bâtiment, aucune obligation de mise aux normes des émissions pour les bâtiments réhabilités, absence totale enfin de dispositions dans le domaine du transport, qu'il s'agisse de la taxation du kérosène, du soutien aux transports collectifs urbains, du transfert des transports routiers vers le rail ou la voie d'eau, ou encore de la limitation de la puissance des véhicules mis en vente. Je suis quant à moi partisan d'une directive européenne fixant un niveau de vitesse maximal des véhicules mis en vente, conforme aux limitations de vitesses, ce qui aboutirait à réduire d'environ 20 % les consommations et les émissions de gaz à effet de serre desdits véhicules. Il faudra y passer un jour ; autant que le débat s'engage le plus rapidement possible. Le dispositif institutionnel pèche d'autant plus que la mission sur l'effet de serre a perdu sa dimension interministérielle, ce qui s'est immédiatement traduit - j'en ai moi-même été témoin - par le durcissement des positions de tous les ministères au cours de la négociation sur le Plan Climat, ce qui valut à celui-ci d'être adopté un an plus tard, après l'abandon de plusieurs mesures en cours de route. Alors que nous sommes en période de choc pétrolier, on ne voit aucune politique de réponse du côté de l'Etat. Situation paradoxale : les chocs pétroliers des années soixante-dix, dits « chauds » parce que faisant suite à des épisodes guerriers, avaient donné lieu à des politiques nationales très fortes qui ont rendu la France exemplaire en termes de capacités de réponse. Le choc que nous vivons aujourd'hui n'est pas lié à un épisode guerrier, mais à un problème d'approvisionnement autrement plus grave, parce que découlant de l'insuffisance de l'équipement de production et de la perspective à plus long terme de la raréfaction des ressources pétrolières, puis gazières les plus accessibles. Or ce choc « froid » ne donne lieu à aucune réponse de l'Etat, d'autant que celui-ci a été conduit, du fait des mouvements de dérégulation et de libéralisation, à abandonner une bonne part de leviers dont il disposait en matière de politique énergétique. Qu'il s'agisse du pétrole ou de l'énergie en général, il faut s'engager dans une re-régulation du secteur, qui devra évidemment s'effectuer le plus possible au niveau européen et non dans le seul cadre national. Toujours est-il que, nos consommations de pétrole étant probablement amenées à se réduire d'ici à 2010 en raison du choc pétrolier, la France sera à peu près en conformité avec le protocole de Kyoto. A ceci près qu'il ne me paraît pas sain de faire supporter l'essentiel du poids de l'effort à des familles modestes que l'inflation des loyers a chassées des centres-villes vers les banlieues et qui se retrouvent obligées de payer de plus en plus cher leurs déplacements domicile-travail, souvent effectués en voiture. Nous avons besoin d'une politique de maîtrise de l'énergie clairement relancée, à même de venir en soutien de ces familles fragiles tout en rationalisant davantage notre politique énergétique prise dans son ensemble. Le vrai problème des plans français, compte tenu du fait que nous serons sans doute en conformité en 2010, c'est qu'ils ne préparent pas la suite. Un scénario de « facteur 4 » devrait aboutir pour la prochaine période d'engagement à des objectifs de l'ordre de 25 % de réduction pour la France, impossibles à tenir sans politiques structurelles enclenchées très tôt à l'avance : or les deux les plus nécessaires à ce jour sont la réhabilitation des bâtiments et les politiques de transport, deux secteurs dans lesquels on ne fait rien en moins d'une, sinon de deux générations. La construction de notre actuel réseau TGV, encore loin d'être achevé, a pris une génération. Développer du fret ferroviaire, réhabiliter un parc bâti dont la durée de vie moyenne est de cent ans, tout cela doit se planifier sur une longue période. Il est très difficile de rattraper le temps perdu, sauf au prix d'investissements extrêmement coûteux. L'optimisation économique commande d'agir rapidement et régulièrement. Quant à l'information du public, elle est en France inexistante. L'élaboration des plans Climat se limite pour l'essentiel à un bras de fer entre ministères. L'absence de participation de la société n'est pas de nature à faciliter la mise en œuvre des solutions ainsi élaborées. Il devient urgent de réfléchir à ce que pourraient être des consignes données par le CSA aux grands médias. Face à un vrai problème d'intérêt général, les chaînes qui obtiennent l'autorisation d'émettre devraient avoir une mission de culture populaire et d'éveil du particulier aux enjeux importants. Or, pour le moment, aucune obligation de ce genre n'est imposée aux médias et particulièrement aux télévisions dont l'essentiel du message se résume pour l'instant aux messages des publicités - consommez davantage et jouissez sans entrave -, totalement contraire à l'objectif visé. Par ailleurs, on ne peut sur des enjeux aussi majeurs empiler des plans nationaux, puis territoriaux, départementaux, voire communaux derrière sans devoir accepter une avancée démocratique majeure en termes de démocratie participative. Une région que je ne citerai pas a constitué un panel de 350 citoyens, réunis en groupes de travail, auxquels est posée la question suivante : comment notre région gagnera-t-elle la bataille de l'effet de serre ? Ce panel travaille à l'élaboration de lettres - une à l'Etat, une aux collectivités territoriales, une aux entreprises, une enfin aux particuliers - expliquant ce que, d'après eux, les uns et les autres devraient faire. L'ensemble de ce travail sera compilé sous forme d'un livre blanc distribué dans l'ensemble des collectivités, écoles, entreprises, expliquant à chacun comment se mettre en mouvement, à charge pour celles-ci de répondre au message envoyé. Ajoutons que ces 350 personnes sont, chacun dans leur milieu professionnel et personnel, de véritables ambassadeurs sur le sujet. Il faut des initiatives sérieuses dans ce domaine : or les plans élaborés jusqu'à présent se sont limités à une vague sensibilisation très générale, loin de la mise en mouvement de la société dont nous avons grand besoin. Mme Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET, Rapporteure : La fiscalité revient régulièrement dans vos propos ; vous semblez déplorer qu'on ne fasse pratiquement que du réglementaire. Êtes-vous toujours partisan d'une fiscalité transversale sur l'énergie ou vous êtes-vous finalement rabattu sur les fiscalités multiples ? M. Pierre RADANNE : La brièveté de mon exposé m'a conduit à une omission majeure : la confrontation aux limites, qui rend ce siècle totalement différent des deux précédents, modifie radicalement les instruments économiques. Au moment même où, à Kyoto, ont été pour la première fois acceptées les limites de la planète, des mécanismes de flexibilité ont été adoptés, que je veux défendre avec force devant vous : c'est l'accouplement du dirigisme d'Etat et de l'économie de marché. L'Etat impose et distribue dans la société des objectifs de réduction, sanctionnables par des amendes en cas de non-atteinte, mais ces objectifs peuvent être atteints soit par des investissements, soit par l'achat de réductions à d'autres partenaires qui, eux, investissent. Autrement dit, ce dispositif ne passe pas par la case « ministère des finances » ni par des subventions publiques, mais par des échanges sur le marché, ce qui lui confère beaucoup plus de souplesse que les précédents. Depuis Kyoto, la panoplie s'est enrichie : ainsi, la représentation nationale a adopté au printemps le système des certificats blancs d'économie d'énergie associés à la loi sur l'énergie. Ces nouveaux outils sont devenus nos moyens d'action privilégiés ; mais il faudra forcément y ajouter de la dépense publique pour la recherche et pour l'accompagnement et la formation des acteurs. Or le budget de la délégation ministérielle en la matière est loin d'être à la hauteur des besoins, d'autant qu'il n'est aucunement tenu compte du choc pétrolier. Derrière, la fiscalité reste à l'évidence nécessaire dans les secteurs où les mécanismes de marché ne peuvent pas jouer : c'est notamment le cas pour les transports et les consommations énergétiques des ménages. Je ne suis pas pour le « tout fiscal » ; les mécanismes de Kyoto assurent dorénavant une réelle efficacité sans qu'il soit besoin de recourir au gourdin fiscal, à condition que les mécanismes de flexibilités soient utilisés par l'Etat avec des objectifs de réduction crédibles, ce qui pour l'heure n'est pas le cas. La mise en œuvre de la directive européenne à travers le plan national d'allocations de quotas s'est faite sur la base d'objectifs trop faibles. Pour ce qui est du débat, enclenché mais non encore conclu, sur les certificats d'économie d'énergie, les objectifs sont très proches du tendanciel : l'amélioration des performances énergétiques du fait des progrès techniques entraîne peu d'actions complémentaires. M. Alain GEST : Vous avez parlé de raréfaction du pétrole à long terme. Qu'entendez-vous exactement par là ? Sur quels éléments vous fondez-vous ? Par ailleurs, la France reste à vos yeux un élève médiocre, voire mauvais, mais avez-vous l'exemple de bons élèves, en matière de transport automobile ou de taxation du kérosène, par exemple ? M. Pierre RADANNE : Vos deux questions sont liées. Pour ce qui est du pétrole, le peak oil n'est pas pour demain. M. le Président : Vous êtes en désaccord avec Yves Cochet. M. Pierre RADANNE : Totalement. Nous ne sommes pas dans une situation où les nouveaux gisements ne viendraient plus compenser les gisements en cours de tarissement - c'est déjà le cas des gisements américains, de ceux de mer du Nord, d'Algérie ou d'Indonésie. L'actuel choc pétrolier n'est pas la conséquence du peak oil, mais d'un déficit d'investissements. Il y aura une rémission si l'on investit, mais ce n'est pas le cas pour l'instant. Le choc pétrolier lié à la dépression devrait se produire, d'après la direction de Total, aux alentours de 2020-2030. Cette hypothèse me semble réaliste. Pour l'heure, les entreprises et les Etats sont devant un chameau à deux bosses : la hausse des cours actuels, une rémission entre les deux et une bosse future. Les acteurs du monde pétrolier essaient de mettre une planche entre les deux bosses, autrement dit cherchent à maintenir des prix élevés pour valoriser au mieux un capital en réduction. Ils sous-investissent afin de ne pas prendre le risque de se retrouver, pour cause de surinvestissement, en surcapacité comme en 1985. C'est un débat que la représentation nationale doit prendre sérieusement en compte. M. le Président : Le bas de la bosse se situe à combien de dollars le baril ? M. Pierre RADANNE : Il ne faut plus compter en dessous de 40 dollars. M. le Président : Nous sommes d'accord. C'est une bosse haute. M. Pierre RADANNE : Les prix bas des années quatre-vingt-dix se situaient autour de 20-25 dollars, avec un prix « technique » moyen du pétrole mondial autour de 7 dollars, soit 18 dollars pour la rémunération des intermédiaires. Il n'y a aucune chance que celle-ci baisse aujourd'hui ; or le prix technique du pétrole tourne autour de 15 ou 20 dollars le baril. Additionnez la marge et vous arriver à quelque chose de l'ordre de 40 dollars, à quelques mouvements de yo-yo près. Le prix actuel de 60 dollars le baril correspond à la valeur moyenne du siècle. Vous aurez remarqué que 52 % du pétrole mondial va dans le transport. La vraie question aujourd'hui n'est pas celle d'un choc pétrolier, mais d'un choc transport. Je répète, et je l'assume, que face à cette grande difficulté du siècle que sera le changement climatique, nous ne sommes qu'au début de l'effort et nous y allons à reculons. Mais si nous sommes médiocres, il n'y a malheureusement pas de bons élèves, notamment dans le secteur des transports. Nos amis allemands, meilleurs que nous sur les autres sujets, sont très mauvais sur les transports avec leurs automobiles haut de gamme ; les meilleurs en matière de voitures mises en vente sont de loin les Japonais, suivis des Français, mais nous ne sommes pas à la hauteur de l'enjeu. Méditez ce calcul très simple. En 2050, nous serons neuf milliards « à table », sur terre. Imaginez que pour ces neuf milliards d'habitants, il y ait deux milliards d'automobiles, contre 800 millions aujourd'hui. C'est tout à fait possible, et bien inférieur au taux d'équipement français. Eh bien, ces deux milliards d'automobiles feraient, sur la base actuelle, sept litres au cent et 15 000 kilomètres par an : la quantité de carbone émise par ces seules automobiles atteindrait deux milliards de tonnes, c'est-à-dire le niveau maximal de stabilisation du climat de la planète, autrement dit sa capacité d'absorption, grâce aux océans pour l'essentiel. Autrement dit, si l'on gardait le formatage actuel, les seuls véhicules automobiles mangeraient la totalité du potentiel ! Il faut donc une rupture sur les véhicules ; or nos constructeurs nationaux comme les politiques publiques sur le sujet ont contourné jusqu'à présent l'échéance. Il n'y a aucun bon élève en dehors de Toyota. Mme la Rapporteure : Cela ressemble fort à de la publicité. M. Pierre RADANNE : Pour la bonne raison que Toyota n'est pas cotée en bourse. C'est une entreprise familiale qui réinvestit la totalité de ses bénéfices dans la recherche, ce qui lui donne des capacités inégalées. Avec le véhicule hybride, elle vise un objectif de long terme et a incontestablement pris de l'avance. Devant la représentation nationale, il faut parler clair. M. le Président : Vous n'avez pas de contrat avec Toyota. On a dit également que pour mettre les Chinois sur quatre roues, il faut cinq planètes. M. Pierre RADANNE : Le constructeur automobile qui gagnera sera celui qui fera les véhicules adaptés à ce siècle. M. Alain GEST : Est-il économiquement imaginable d'instituer une taxe sur le kérosène franco-français ? M. Pierre RADANNE : On vient déjà d'en décider une, mais pour un autre propos. M. Alain GEST : On peut tenir le même raisonnement. M. Pierre RADANNE : Pour avoir énormément travaillé sur l'économie de ces sujets, je puis vous dire que les pays qui gagneront économiquement seront ceux qui prendront le virage les premiers. Il en a toujours été ainsi dans l'histoire : les innovateurs sont rémunérés, pas les carabiniers de casting. Les pays qui orienteront petit à petit leur économie dans l'optimisation des ressources rares et dans la réduction des émissions polluantes seront ceux qui gagneront ; et le champion de ce point de vue reste le Japon, qui, entre 1973 et 2004, a réduit de 47 % sa consommation d'énergie par point de PIB, contre 30 % pour la France. Autrement dit, il l'a divisée par deux. Dans un monde où l'énergie sera devenue rare et disputée, cette « dévulnérabilisation » des économies sera la nouvelle définition de l'indépendance nationale, le véritable objectif, une affaire absolument vitale. Les pays qui traîneront les pieds perdront. Les pays industrialisés se divisent en deux camps opposés : les pays « pleins » et les pays « vides ». Les pays pleins, aux densités de population élevées, sans ressources possibles, à la nature fortement atteinte et qui ont profondément souffert des chocs pétroliers acceptent, à reculons certes, l'affaire climatique : c'est l'Europe et le Japon. La liste des pays vides est plus étonnante : Etats-Unis, Canada, Australie, Russie. Tous ont des densités de population faibles, une nature sauvage importante, des ressources fossiles considérables, aucune motivation à réaliser des économies d'énergie. Ils n'ont pas souffert des chocs pétroliers, mais sont pour la première fois de leur histoire confrontés à une limite et refusent de l'admettre. L'Australie n'a pas signé, les Etats-Unis non plus, la Russie a signé au bout de trois ans et à contre-cœur, le Canada a signé sans agir. Mais durant ce siècle, ce sont les pays « pleins » qui gagneront, et l'Inde et la Chine iront dans leur camp : ils ont les mêmes problèmes structurels que nous. C'est là un point fondamental, et qui explique la division du monde post-Kyoto. Mme la Rapporteure : Mais il y a un passager clandestin : l'effet de serre. Les pays pleins auront beau être les premiers à mettre en œuvre les bonnes technologies, nous l'aurons tous dans le nez si les pays vides continuent sur leur lancée. M. Pierre RADANNE : Leur exception restera longue, mais la négociation climatique a vu se dessiner un axe de structuration des relations internationales pour le moins improbable : Europe et le Japon ensemble, plus les pays émergents et les pays en voie de développement ! Je me souviens qu'après l'échec de la conférence de La Haye, le président Jan Pronk avait organisé un debriefing post-négociation, et le représentant de l'Inde avait déclaré : « J'ai au moins appris quelque chose : nous n'aurons jamais le mode de vie américain. C'est l'Europe qui représente notre avenir. » D'où cette alliance Europe-Japon, plus le Sud dans ses multitudes, à travers la seule voie de développement possible pour l'Inde, économe en énergie et à bas profil d'émissions polluantes. Cette ligne stratégique s'est confirmée à Montréal : les Chinois regardent clairement vers l'Europe, c'est le seul modèle qui les intéresse en termes de technologie. Je tenais à vous le dire avec enthousiasme : si nous ne sommes pas au niveau de ce qu'il faudrait faire, nous n'en sommes pas moins sur la bonne route, et les seuls. M. Serge POIGNANT : La Chine regarde vers l'Europe, dites-vous ; reste qu'elle dépend, sur le plan énergétique, de son charbon. Vers quelle technologie européenne peut-elle s'orienter ? Comment peut-elle devenir rapidement vertueuse compte tenu du rythme de croissance de son économie ? Par ailleurs, je vous ai trouvé bien affirmatif lorsque vous avez parlé d'abandon pur et simple de notre stratégie interministérielle. Qu'est-ce qui vous rend si catégorique ? M. Pierre RADANNE : Tout simplement l'abandon du caractère interministériel de la mission sur l'effet de serre, redevenue un service du ministère de l'environnement. Force est de constater que depuis, les autres ministères n'acceptent plus aucun cadrage sur le Plan Climat, le dispositif de « bonus-malus » prévu pour les transports dans le Plan Climat 2003 est du jour au lendemain passé à la trappe, le ministère de l'équipement et des transports refusant toute mesure contraignante. A vous de trouver le dispositif adéquat ; je ne plaide pas pour le retour à l'ancien statut de la MIES, mais il y a réellement un problème. La Chine n'a pas d'hydrocarbures et sa population est très dense. Du fait de sa structure urbaine, elle ne peut pas adopter un habitat pavillonnaire avec une voiture pour chacun sur le monde américain ; elle suivra inévitablement un modèle proche de celui du Japon. La question charbonnière est effectivement un élément fondamental ; j'avais plaidé, à l'occasion du rapport Chambolle, pour la séquestration du carbone, mais j'étais bien le seul. Autant l'hydrogène est un luxe pour riche, sans portée mondiale, autant la séquestration du CO2 dans des gisements pétroliers, gaziers ou aquifères profonds est une nécessité pour les pauvres. La Chine et l'Inde consommeront leur charbon ; les aiderons-nous à le faire dans des conditions non nocives pour le climat ? La mutation de civilisation dans laquelle nous sommes engagés sera difficile ; toute solution de transition propre à faciliter le chemin est nécessaire. M. Robert LECOU : Il faudra de l'interministériel et de la mondialisation. Pour ce qui est du premier, nous saurons régler le problème, mais pour ce qui est de la seconde ? Croyez-vous que nous parviendrons à une prise de conscience et à une réglementation au niveau mondial dans les délais que vous avez fixés ? M. Pierre RADANNE : Un constat simple m'a frappé lorsque j'ai écrit mon livre, auquel je n'avais jamais songé auparavant : personne n'aime ce siècle, tout le monde voudrait refaire le match du précédent. J'ai dédié mon bouquin à ma fille de vingt ans ; il faut l'aider à réussir son siècle, marqué par un accroissement sans précédent de la population et par la confrontation aux limites. Il faut de la parole là-dessus : qu'est-ce qu'être un honnête homme ou une honnête femme dans ce XXIèmesiècle pour que les choses s'y passent bien et qu'il ne soit pas violent ? Cette idée reste pour l'instant confuse, et portée essentiellement par les ONG, les médias et les milieux scientifiques, mais fort peu par les Etats. La parole publique court un grave risque de discrédit si les Etats, à commencer par les Etats-Unis, ne se mettent pas en empathie avec l'humanité. Nous avons un devoir de réussite globale ; or les négociations internationales voient en permanence se répéter une stratégie du bord du gouffre. Les conférences sur le climat s'arrêtent toujours le lendemain du dernier jour, vers sept ou huit heures du matin, lorsque les négociateurs des pays les plus pauvres doivent prendre leur avion et qu'ils ont des billets non échangeables. S'il n'y a pas d'accord à sept heures, c'est fichu. À Montréal, il est intervenu à six heures trente. On va jusqu'au dernier moment pour ne pas décider et c'est par peur que l'on fait un tout petit pas juste à la fin. Mais sur cette question-là, on n'a pas encore décidé de gagner. Il faut présenter dans les enjeux de vie de ce siècle la nécessité de réussir une société conjuguant bonheur de vivre, développement personnel et une certaine forme de croissance économique, mais beaucoup plus économe. Or ce débat n'est clairement commencé ni dans les opinions publiques, ni au sein des Etats. Nous sommes très loin du but. Diviser par quatre les émissions de CO2 sur deux générations, c'est faisable, mais cela représente une énorme mutation. M. le Président : Nous serons tous d'accord, au-delà de nos sensibilités, sur le fait que la convergence des actions de l'Etat constitue un sujet majeur. La disparition du caractère interministériel de la MIES, l'éclatement entre la MIES, le délégué interministériel, l'ADEME et les affaires étrangères n'est pas à mon sens l'idéal dans les négociations. Pour mener une guerre, il faut un général, et de préférence du grade le plus élevé possible. Le fait de dépendre du Premier ministre me paraît à cet égard une excellente chose, et le refus de consacrer à cette lutte tous les crédits nécessaires un problème majeur. Je suis enfin assez d'accord sur le fait que la crise pétrolière actuelle tient d'abord à nos approvisionnements, et tout particulièrement à nos capacités de raffinage insuffisantes. Mme la Rapporteure : C'est une pierre dans le jardin d'Yves Cochet. M. le Président : Pas du tout. Nos capacités de raffinage sont tout simplement inférieures de 10 % à ce qu'elles étaient dans les années 1980. Et comme nous continuerons à utiliser du pétrole et du charbon, la séquestration et le blocage du CO2 sont un enjeu important. Mme la Rapporteure : Monsieur Radanne, où pouvons-nous retrouver les chiffres et les calculs dont vous avez fait état ? M. Pierre RADANNE : Dans le rapport officiel que j'ai remis à la MIES en mars 2003. M. le Président : Votre calcul de tout à l'heure notamment était tout à fait intéressant. M. Pierre RADANNE : C'est une simple multiplication : cela tient en une note de dix lignes. M. le Président : Ce qui explique que la crise du pétrole soit pour vous la crise du transport. M. Pierre RADANNE : C'est le seul secteur appelé à muter profondément durant ce siècle. Or nous n'avons pas de solution aujourd'hui. M. Serge BLISKO : Je comprends l'image du chameau à deux bosses avec la planche au milieu, mais pas la stratégie des groupes pétroliers : ils n'ont jamais réalisé autant de profits que depuis que le pétrole est devenu plus cher. Pourquoi ne développeraient-ils pas leurs capacités de raffinage et de production dès lors que certains gisements jusqu'alors difficiles et coûteux à mettre en exploitation deviennent soudain beaucoup plus intéressants, à l'image de ces puits du Texas que l'on ouvre et que l'on referme au gré de la conjoncture ? Pourquoi ne se remettent-ils pas à investir alors qu'ils y ont et l'intérêt et la capacité financière ? M. Pierre RADANNE : Ce que vous dites est juste, mais il y a derrière tout cela une ambivalence, qui tient à l'extrême fragilité de ces entreprises vis-à-vis de leur actionnariat, qui réclame des marges bénéficiaires très élevées. Entre garder des prix élevés pour s'assurer des rémunérations fortes et investir pour conserver ses parts de marchés et accéder aux nouveaux gisements avant les concurrents, le pilotage est des plus délicats. Ce à quoi vient s'ajouter le fait que les groupes pétroliers n'ont de contrôle direct que sur 15 % des gisements, et seulement sur 4 % du foncier qui, à l'exception du foncier américain, reste propriété des Etats. Dans la plupart des pays, le véritable contrôle de la ressource est le fait des États producteurs ; or ceux-ci suivent une logique de maximisation des flux financiers. Tout le monde, dans le secteur pétrolier, veut éviter la baisse des prix de 1985. Mme la Rapporteure : Nous auditionnerons les groupes pétroliers les 17 et 18 janvier, lors des tables rondes « énergie », ainsi que leurs experts. M. le Président : Il ne nous reste plus qu'à remercier Pierre Radanne pour son exposé particulièrement intéressant et à vous souhaiter à tous une bonne soirée. Table ronde sur l'action des organisations non gouvernementales, réunissant : Présidence de M. Jean-Yves LE DÉAUT, Président M. Jean-Yves LE DEAUT, Président : Mes chers collègues, nous accueillons aujourd'hui des représentants de diverses organisations non gouvernementales, qui, à l'exception de la fondation Nicolas-Hulot, sont toutes membres du Réseau Action Climat. Le RAC est partie prenante du comité de suivi, où trois de ses représentants sont présents, MM. Olivier Louchard, Daniel Delestre et Édouard Toulouse. D'un commun accord avec les participants, cette table ronde s'organisera autour de quatre thèmes - les transports, le résidentiel-tertiaire, l'industrie, les mesures transversales -, qui ont été choisis comme des « entrées » clés de la lutte contre le changement climatique. Ces axes, mesdames, messieurs, ont été choisis par vous-mêmes. Plus que l'information de la mission sur l'action des associations - beaucoup d'éléments écrits sont disponibles à ce propos -, il s'agit aujourd'hui de réfléchir avec vous aux voies d'un renforcement nécessaire des actions engagées en matière de lutte contre le changement climatique. Nous commençons, donc, par le thème des transports. M. Philippe QUIRION : Nous avons choisi, en raison de la contrainte de temps, de ne pas aborder tous les thèmes. En particulier, nous n'aborderons pas ici la question de la fourniture d'énergie. Vous aurez sans doute l'occasion d'auditionner le comité de liaison des énergies renouvelables, association membre du Réseau Action Climat. De même, nous n'aborderons pas le thème de l'agriculture. M. Édouard TOULOUSE : Je vous demande tout d'abord de bien vouloir excuser l'absence du directeur général du WWF, Cédric du Monceau, que vous aviez invité à cette table ronde, mais qui a malheureusement été dans l'obligation de répondre à un autre impératif. Le secteur des transports est d'une importance capitale. Un rapport de l'OCDE datant de 2000 estime que « les transports, en l'an 2030, s'éloigneront plus qu'ils ne se rapprocheront de la viabilité écologique ». Ce constat est aujourd'hui largement partagé. Il s'agit d'un secteur dont le poids est croissant dans les émissions de gaz à effet de serre. Les politiques publiques comportent des aspects positifs, mais sont marquées par des incohérences et par un certain manque d'audace. Parmi les aspects positifs, on peut relever la politique menée depuis quelques années en matière de sécurité routière, puisque le respect des vitesses permet d'émettre moins de gaz à effet de serre, même si ce n'était pas l'objectif initial. On relève également la création de l'étiquette Énergie, mesure qui est progressivement mise en œuvre, mais qui devrait être accompagnée d'une fiscalité orientée vers la maîtrise des émissions de gaz à effet de serre. Ce n'est pas la petite taxe instaurée sur la taxe grise qui changera réellement les choses. Au niveau local, on peut saluer les initiatives de quelques villes, qui ont mis en place des plans climat. Les aspects négatifs doivent cependant être soulignés. Le développement routier et aéroportuaire conduit à une hausse du trafic. En matière de fret, les politiques publiques ne font guère progresser les choses. Les aides aux transports collectifs dans les collectivités locales ont été supprimées pendant deux années, même si elles ont été partiellement rétablies en 2006. On note également une frilosité d'un certain nombre d'acteurs face à certains intérêts. Le Plan Climat, la loi d'orientation sur l'énergie, les certificats d'économie d'énergie font une maigre place aux aspects qui concernent les transports. Des points d'interrogation demeurent sur les biocarburants. Une politique ambitieuse semble se mettre en place, mais nous nous interrogeons sur la surface agricole qui sera concernée comme sur les impacts indirects des cultures. Par ailleurs, les constructeurs automobiles expliquent que l'hydrogène et la pile à combustible vont régler le problème. En réalité, l'hydrogène n'a pas un bon bilan énergétique global. Il ne saurait être considéré comme une solution miracle. Que font les ONG ? À notre modeste niveau, nous réalisons des études, comme « Transports et changement climatique », menée en collaboration avec le RAC France et la FNAUT, la Fédération nationale des associations d'usagers des transports. Nous avons également établi un classement des véhicules dont l'impact environnement est le plus faible (Topten, disponible sur le site www.wwf.fr). Quelles sont les mesures qu'il nous semble important de prendre ? Je n'évoquerai pas ici toutes les possibilités en matière de fiscalité, de réglementation, d'incitation, d'aménagement du territoire. Je n'évoquerai que trois mesures concrètes. En matière de report modal, une vraie politique de développement devrait être mise en œuvre, qui pourrait être financée par les externalités de la route, c'est-à-dire tout ce que le transport routier ne paie pas directement aujourd'hui. Deuxièmement, un accord « volontaire » européen entre constructeurs automobiles vise à réduire progressivement les émissions de gaz à effet de serre des véhicules mis sur le marché. Cet accord ne sera probablement pas respecté. Il serait bon de mettre en place des quotas. Chaque constructeur aurait pour obligation de mettre sur le marché des véhicules qui, en moyenne, sur l'ensemble de leur gamme, n'émettent pas plus de 120 grammes de CO2 par kilomètre, par exemple. Les constructeurs pourraient procéder à des échanges de quotas. Troisièmement, on pourrait envisager de diminuer de 10 km/h la vitesse maximale autorisée sur route et sur autoroute. Ces mesures auraient un quadruple bénéfice : elles permettraient de réduire les émissions, elles renforceraient la sécurité routière, elles protégeraient la santé publique, elles diminueraient la facture pétrolière. L'aviation ne doit pas être négligée. Ses émissions sont en forte croissance. La Suède vient d'instaurer une taxe environnementale sur les billets d'avion. Le Président de la République avait lui aussi suggéré l'instauration d'une taxe, mais sans l'inscrire hélas dans une politique de lutte contre le changement climatique. À plus long terme, il faudra bien sûr atteindre les objectifs du facteur 4, ce qui nous imposera d'être beaucoup plus ambitieux. Il nous faudra notamment totalement revoir notre politique en matière d'urbanisme et d'aménagement du territoire, afin de rapprocher les hommes de leurs lieux de travail et de loisir. Nous serons probablement contraints de relocaliser, au moins partiellement, un certain nombre d'activités économiques. Enfin, pour chaque besoin de transport, il faudra choisir des modes de déplacement sobres et optimisés. Mme Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET, Rapporteure : S'agissant des véhicules légers, nous avons compris que vous étiez sceptiques quant aux perspectives que pourrait ouvrir l'utilisation de l'hydrogène. Pensez-vous à d'autres voies de recherche ? On parle beaucoup du véhicule hybride, et donc de la nécessité de mettre l'accent sur la recherche en matière de stockage de l'électricité. M. Édouard TOULOUSE : La voie hybride nous semble effectivement la plus intéressante. Le diesel hybride permettrait, dit-on, de réduire encore plus les émissions que l'essence hybride. La mise en place de quotas d'émissions pour les constructeurs automobiles favoriserait ces voies technologiques d'avenir. Cela étant, il ne faut pas croire que les avancées technologiques résoudront à elles seules le problème. L'expérience montre, par exemple, que les progrès en matière d'efficacité des moteurs ont été contrebalancés par l'équipement des véhicules en gadgets électroniques divers, par l'alourdissement des véhicules, par la montée en puissance des gammes, ainsi que par l'augmentation du trafic. La technologie ne peut être qu'une part de la solution. Dans le plan national de lutte contre le changement climatique, l'innovation technologique ne permettait d'assurer que 10 % des réductions d'émissions du secteur. M. le Président : S'agissant des biocarburants, tout dépend de celui que l'on va favoriser. Certains sont produits dans des conditions telles qu'il n'est guère souhaitable de les favoriser. M. Édouard TOULOUSE : L'avantage des biocarburants est qu'il est possible de les incorporer progressivement aux carburants actuels sans modifier tout le système d'approvisionnement énergétique. Nous avons une préférence pour les filières courtes, par exemple les huiles brutes, qui peuvent être utilisées dans les exploitations agricoles. Le rendement global est satisfaisant. Par contre, certains biocarburants industriels nécessitent de nombreuses phases de transformation et sont indirectement source d'émissions importantes. L'utilisation de l'hydrogène exigerait, quant à elle, de modifier tout le système de motorisation et d'approvisionnement dans toutes les stations-service du pays. Même les plus fervents partisans de l'hydrogène pensent que cela ne sera pas possible avant 25 ou 30 ans. M. Serge POIGNANT : Que la perspective de l'utilisation de l'hydrogène soit encore lointaine, c'est un fait. Mais ce n'est pas une raison pour s'opposer à la recherche. M. Édouard TOULOUSE : Nous ne sommes nullement opposés à la recherche. Mais l'hydrogène ne doit pas être un alibi pour ne rien faire. Nous contestons l'idée qu'il ne serait pas nécessaire de prendre des mesures difficiles sous prétexte que l'hydrogène résoudra un jour tous les problèmes. M. le Président : Vous avez évoqué la réduction de la vitesse maximale autorisée. Lorsque nous l'avons proposé, nous nous sommes heurtés à une levée de boucliers de la part d'un certain nombre de lobbies. L'un des arguments avancés était que la première chose à faire était d'imposer aux constructeurs la mise sur le marché de voitures consommant peu. Si des voitures peuvent consommer 4 litres aux 100 kilomètres à 120 km/h sur autoroute, est-il nécessaire de réduire la vitesse maximale autorisée ? M. Édouard TOULOUSE : La réduction de la vitesse maximale autorisée est une mesure qui pourrait être prise rapidement, et qui concernerait l'ensemble du parc. Des véhicules plus sobres existent, mais le parc actuel ne se renouvellera que progressivement. M. Yannick JADOT : Il faut également se pencher sur la faisabilité de la mesure. Une mesure de réduction de la vitesse maximale autorisée pourrait être prise très rapidement par le Gouvernement. La réduction des seuils d'émission au kilomètre nécessiterait, elle, une approche européenne. L'industrie automobile doit être contrainte d'aller dans ce sens. On n'aboutira pas en s'en remettant à la démarche volontaire des constructeurs. En Californie, ceux-là mêmes qui disaient adopter une démarche volontaire ont attaqué l'État quand il a voulu les contraindre à réduire les émissions des véhicules. Des mesures réglementaires ambitieuses sont nécessaires. Mme Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET, Rapporteure : Quel regard portez-vous sur le mouvement actuel des transporteurs routiers en Alsace ? Ils protestent contre la fameuse taxe sur les poids lourds de 12 tonnes et plus en transit dans la région, qui a été introduite par voie d'amendement dans la loi du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement des transports ? M. Édouard TOULOUSE : Nous sommes bien conscients que ceux qui s'opposent à des mesures de ce genre ont à leur disposition des moyens puissants. On a souvent entendu dire que, lorsque le Gouvernement manifestait des velléités de mesures sur les transports, les députés s'y opposaient, peut-être sous la pression d'intérêts locaux. Lorsque le ministre Serge Lepeltier a lancé l'idée d'un bonus-malus écologique, il semble que des parlementaires s'y soient opposés. Nous voudrions savoir quels lobbies ont fait pression. M. Michel MOUSEL : Un autre aspect des choses est que seule une politique européenne est possible en matière de transports de marchandises. Dans le cas de l'Alsace, l'objectif de cette taxe était de maîtriser le trafic international des poids lourds, notamment celui en provenance d'Allemagne ou transféré de l'axe badois Mannheim - Bâle. En effet le 1er janvier 2005, l'Allemagne avait instauré une taxe kilométrique s'appliquant aux poids lourds de 12 tonnes et plus circulant sur le réseau autoroutier fédéral. C'est cette taxe qui a entraîné un report significatif du trafic des poids lourds en transit sur le réseau routier alsacien et lorrain. Même si les déplacements de longue distance ne sont pas encore majoritaires dans le transport des poids lourds, l'ouverture des frontières est telle que la politique en la matière doit être européenne. Sans oublier l'effet des disparités sociales : Il n'y a pas que les plombiers polonais qui posent problème, il y a aussi les conducteurs hongrois, slovaques, etc. M. le Président : Pouvez-vous évaluer la part de la voiture individuelle dans les émissions de CO2 dues aux transports ? M. Philippe QUIRION : La voiture individuelle représente un peu plus de la moitié des émissions dues aux transports. M. André CHASSAIGNE : Chacun s'accorde pour dire qu'il est nécessaire d'adopter des politiques publiques. Mais comment adopter des politiques publiques alors que toutes les politiques conduites au niveau européen vont dans le sens de la privatisation du transport ferré, par exemple ? Il y a là une énorme contradiction. On veut agir par des politiques publiques, mais la volonté dominante est d'aller vers toujours plus de privé, toujours plus de profit. Dans le nord du Massif Central, je prends parfois la route Centre-Europe Atlantique, la RCEA. Elle traverse la Saône-et-Loire, le nord de l'Allier et la Creuse. C'est terrible ! Des trains de camions, sans interruption ! Dans quelques années, la vallée du Rhône sera complètement asphyxiée, tout le monde le sait. Or, quand certains avancent l'idée de développer une ligne de fret ferroviaire qui traverserait le Massif Central, on leur oppose que cette ligne n'est pas rentable, et qu'il faut donc l'abandonner. Peut-on conduire des politiques publiques sans remettre en cause la recherche d'un profit, qui est toujours la recherche d'un profit immédiat ? M. Édouard TOULOUSE : J'ai évoqué des incohérences. Vous en soulignez une. On peut être démoralisé quand on constate, en matière de transports, les contradictions entre ce que dit la direction générale de l'environnement de la Commission européenne et ce que dit une autre direction générale. Nous souhaiterions que le Commissaire aux transports s'exprime un peu plus sur les questions d'environnement. M. Philippe QUIRION : Le principe d'intégration de l'environnement dans toutes les politiques européennes est inscrit dans le droit européen. Il est resté lettre morte. M. Yannick JADOT : Les politiques publiques sont de la responsabilité ultime du pouvoir politique. M. André CHASSAIGNE : Vous avez une responsabilité de citoyen. Vous avez d'ailleurs, à ce qu'il me semble, approuvé certain traité. M. Yannick JADOT : Il y a une responsabilité politique extrêmement forte. Quand on continue à faire des investissements sur les axes autoroutiers, on fait un choix, celui du transport routier. Quand on définit un schéma d'aménagement urbain, on fait un choix, dont l'enjeu est de savoir quels sont les besoins de mobilité et comment on y répond. Mme Martine BILLARD : Je suis heureuse que la question du transport routier soit abordée. En général, on se concentre plus sur les performances de tel ou tel type de véhicule en termes d'émissions. Le problème essentiel est celui du trafic et de son organisation. Il est d'ailleurs à rapprocher du problème des relocalisations. Quand l'activité économique est dispersée, pour un même produit, entre différents points de la planète, les besoins de transports se multiplient. Tant que l'on ne remettra pas en cause ce modèle, on aura du mal à réduire le trafic routier. Peut-être sera-t-on amené à se poser enfin certaines questions lorsque l'accès à certains carburants sera devenu plus difficile. Certains prétendent que le transport routier ne pose pas véritablement de problème dans la mesure où l'on passera au 40 tonnes, ce qui réduira les émissions. Qu'en pensez-vous ? Deuxièmement, des recherches sont-elles menées sur la manière de rendre les camions moins polluants ? Enfin, l'Europe est en pleine incohérence. Le Parlement français a définitivement adopté en juillet 2005 la loi ratifiant l'ordonnance du 12 novembre 2004 portant transposition de directives communautaires et modifiant le code du travail en matière d'aménagement du temps de travail dans le secteur des transports. Ce texte ne fait qu'élargir les possibilités d'augmenter la durée des transports. Cette dérégulation a pour effet de favoriser l'emploi de chauffeurs venant du fin fond de l'Europe à des salaires défiant toute concurrence, donc de faire baisser le coût du transport de marchandises par camion, donc d'augmenter le trafic routier. Je ne sais pas ce que sera le rapport de notre mission d'information, mais il serait contradictoire de recommander une politique routière plus cohérente tout en votant, dans l'Hémicycle, des textes allant dans le sens de la libéralisation du transport routier. M. Édouard TOULOUSE : Chaque jour, en Europe, 70 kg de marchandises par Européen sont véhiculés. Ce chiffre n'a pas beaucoup augmenté depuis les années 1960. Il n'y a pas plus de marchandises transportées par personne, mais elles sont transportées plus loin, et de plus en plus par la route. C'est ce qui explique le quadruplement, en trente ans, des émissions de gaz à effet de serre dues aux transports. D'autre part, un camion sur quatre roule à vide, et beaucoup sont loin d'être remplis au maximum. L'augmentation du trafic est telle que les progrès technologiques envisageables ne permettront pas de maîtriser la situation. M. Michel MOUSEL : La question sur le 40 tonnes illustre parfaitement le paradoxe auquel nous assistons. Le tableau des émissions montre que le 40 tonnes est assez bien placé entre le camion classique et le chemin de fer. Mais c'est quand il roule à 110 km/h sur les autoroutes qu'il a de bonnes performances. Or s'il a rarement l'occasion de faire beaucoup plus, il a souvent l'occasion de faire beaucoup moins. Lorsqu'il est lâché dans le réseau des routes, et encore plus en zone urbaine, son niveau d'émissions par kilomètre parcouru s'élève dans des proportions catastrophiques. Autrement dit, s'il est vrai que plus le camion se rapproche du chemin de fer en puissance, vitesse et infrastructure, plus il sera performant en termes d'émissions, il est également vrai que pour ne pas perdre ces performances, il faudrait: qu'il s'abstienne de rouler sur le réseau secondaire.et présente donc les mêmes handicaps que ceux attribués au chemin de fer sur plan logistique : problèmes de transport terminal, de rupture de charge. M. le Président : Nous abordons à présent le deuxième thème de notre table ronde, le résidentiel-tertiaire. M. Jadot va introduire le débat. M. Yannick JADOT : Nous pensons que l'enjeu essentiel, comme pour les transports, est la réduction des consommations. Ce n'est pas en nous reposant sur des technologies qui ne seront opérationnelles qu'au milieu ou en fin de siècle que l'on résoudra le problème des émissions de CO2. Le secteur du bâtiment rejette chaque année 20 % du total des émissions de CO2. Entre 1990 et 2001, les émissions du secteur des bâtiments "résidentiels et tertiaires" ont progressé de 14 %. Dans le neuf, la réglementation vise à ramener la consommation à 100 kWh par an et par mètre carré. Dans le logement ancien, il y a très peu de réglementation et beaucoup d'efforts à faire si l'on veut véritablement agir sur le niveau des émissions. Nous proposons de fixer, dans le neuf, l'objectif de passer en dessous de 50 kWh d'énergie primaire par mètre carré et par an au plus tard en 2015. Cela suppose d'agir par la réglementation thermique. Dans les bâtiments construits avant 1975, la rénovation thermique devrait être rendue obligatoire en cas de vente, ce qui concernerait 400 000 logements par an. Cette rénovation devrait avoir elle aussi pour objectif d'atteindre à terme les 50 kWh d'énergie primaire par mètre carré et par an. Cette mesure créerait 120 000 emplois par an pendant 20 ans, et 96 000 emplois au-delà. M. le Président : Environ 30 millions de mètres carrés sont construits chaque année. Si l'on évalue entre 200 et 250 euros le mètre carré les surcoûts liés au respect de normes plus exigeantes, on voit que l'effort financier nécessaire est tout à fait à la portée d'un pays comme le nôtre. Mais sans volonté politique, rien ne se fera. Dans le logement social, on ne peut pas faire supporter les surcoûts par les locataires du parc existant. Mme la Rapporteure : Quelles sont vos propositions en matière d'accompagnement financier ? M. Yannick JADOT : L'idée est de faire porter la charge des travaux de rénovation thermique sur l'acheteur. L'État interviendrait pour lisser le coût de cet investissement. L'objectif est que le bilan de trésorerie de l'acheteur soit positif dès la première année. L'aide de l'État jouerait le rôle de tampon entre l'investissement initial et le remboursement par les économies d'énergie massives pour l'acheteur. L'instrument financier adapté est le crédit bonifié, ou tout autre instrument analogue. M. Serge POIGNANT : Dans le logement neuf, les travaux visant à réduire les émissions augmentent le coût, mais l'acheteur s'y retrouve au bout du compte. Dans l'habitat ancien, l'obligation pour l'acheteur de réaliser des travaux dont le coût est important peut poser des problèmes. Sans l'intervention de l'État, une telle mesure échouera, car les surcoûts sont très supérieurs à ce qu'ils sont dans le neuf. Mme la Rapporteure : Il faut ajouter les contraintes esthétiques. Et les choses se compliquent singulièrement quand il faut obtenir l'accord des architectes des Bâtiments de France. Dans les centres-villes, on ne peut pas installer un chauffe-eau solaire si facilement ! M. Serge BLISKO : Les ABF, qui laissent passer beaucoup d'horreurs mais qui s'acharnent parfois pour défendre un chien-assis, ont tout de même réussi à empêcher la prolifération des appareils extérieurs de climatisation. C'est à mettre à leur crédit. Lors d'une vente, la loi impose un bilan termites et un bilan amiante. Ne serait-il pas opportun d'ajouter à ces obligations un bilan thermique ? Ce bilan pourrait être accompagné de recommandations touchant aux travaux de rénovation. M. Édouard TOULOUSE : En application d'une directive européenne de 2002 et de la loi du 9 décembre 2004, un diagnostic de performance énergétique sera exigé à compter du 1er juillet 2006 sur le marché des transactions. La mise en œuvre de cette disposition mobilisera un grand nombre d'ingénieurs thermiciens. Il est dommage de ne pas avoir prévu, par la même occasion, l'obligation d'engager des travaux. Pour revenir à l'ingénierie financière, il faut souligner que les milieux économiques sont en train de se saisir de la question des travaux de rénovation thermique. La Banque populaire d'Alsace a déjà mis en place un prêt écologique visant à financer des travaux de ce type. Les autres banques pourraient suivre le mouvement plus rapidement qu'on ne le pense. S'agissant des contraintes esthétiques, le collectif « Isolons la Terre contre le CO2 », qui réunit plusieurs industriels, a lancé des expérimentations pour montrer qu'il est possible de mener des travaux tout en respectant ces contraintes, y compris sur un bâtiment haussmannien. M. François DOSÉ : Ces difficultés de caractère architectural ne doivent pas nous faire oublier l'essentiel. Des millions d'appartements ne sont pas soumis à ces contraintes et peuvent être rénovés. A-t-on estimé le coût de l'intervention visant à une meilleure maîtrise de l'énergie en le comparant au retour financier que l'on peut raisonnablement en attendre ? Car en définitive, le problème est bien là : le surcoût qu'occasionne ces travaux peut-il être rentabilisé sur une durée de vingt ans ? M. Michel MOUSEL : Energie-Cités, l'association des autorités locales européennes pour une politique énergétique locale durable, qui a tiré beaucoup d'enseignements de l'expérience des pays d'Europe du Nord, est capable de répondre à cette question. Les données qu'elle a recueillies ont d'ailleurs été utilisées lors de la préparation du Plan Climat territorial. Elle a conclu à la faisabilité de ces opérations, qui peuvent être financées par des bonifications d'intérêts. M. Philippe QUIRION : Cette estimation a été faite par l'association Negawatt. Mme Martine BILLARD : Je me demande si nous ne sommes pas en retard par rapport à l'opinion publique, et peut-être même aux collectivités locales. Nous pourrions fort bien définir un plan s'étalant sur plusieurs années. Est-il absurde de définir plusieurs obligations en les étalant dans le temps ? On pourrait peut-être, par exemple, instaurer, dans un premier temps, des travaux d'isolation pour les portes et fenêtres. Par ailleurs, avez-vous réfléchi sur le parc privé locatif ? Actuellement, le propriétaire n'a pas l'obligation de changer les fenêtres si elles ne ferment plus. M. Philippe QUIRION : Nous proposons que l'obligation de réaliser des travaux de rénovation thermique intègre le parc locatif. Cela serait facilité par le fait que, grâce au diagnostic de performance énergétique, le prix du loyer variera selon la performance énergétique, donc selon les dépenses de chauffage prévues. Une rénovation en plusieurs étapes, même si elle est moins avantageuse qu'une rénovation d'ensemble. M. Yannick JADOT : De fait, la rénovation thermique complète est plus chère si elle est réalisée par étapes. Je voudrais souligner que nous proposons une rénovation thermique du bâtiment ancien sur une durée de 40 ans. Les données existent sur les coûts, et sur les dépenses que l'État peut y consacrer. Cela dit, il est clair que diviser par quatre nos émissions de CO2 à l'horizon 2050 ne peut pas être une opération blanche pour l'État. La question est de savoir quelle priorité l'on choisit. Je ne parlerai pas des 3 milliards que coûte un EPR puisque vous ne souhaitez pas aborder ce sujet ici. Je me contenterai de mentionner les 100 millions donnés à des groupes automobiles pour créer une automobile qui consomme peu. J'aimerais savoir quel est le budget de développement cumulé de Peugeot et Renault pour leurs 4 x 4, sur un marché urbain. M. le Président : Nous passons maintenant au troisième thème, celui de l'industrie. M. Philippe QUIRION : Les industriels mettent souvent en avant la baisse de leurs émissions depuis 1990. En réalité, cette baisse n'est pas due à un « effort » qu'ils auraient consenti. Elle est naturelle, elle a lieu dans tous les pays développés. Elle est due au renouvellement des équipements et au passage à l'électricité. Cela étant rappelé, s'agissant du CO2, la directive relative aux quotas d'émissions échangeables a commencé à s'appliquer en 2005. L'allocation des quotas nous semble trop généreuse, et nous déplorons un manque de transparence. En effet, on ne dispose de quasiment aucun chiffre. On ne dispose pas des émissions individuelles par installation. Les émissions historiques par secteur ne sont plus disponibles. Aux États-Unis, où ont été expérimentés des marchés d'émissions négociables pour d'autres polluants, les émissions individuelles sont disponibles en ligne. En outre, le PNAQ n'est pas contraignant. Cela a été masqué par le fait que le Gouvernement a annoncé un scénario tendanciel prévoyant une hausse des émissions. Il a mis en avant le fait que les autorisations d'émissions définies par le PNAQ étaient au total inférieures au chiffre du scénario tendanciel. Mais celui-ci ne reflétait pas du tout la tendance. Le plafond du PNAQ est de 147 millions de tonnes de CO2 par an. Les émissions « de référence » sont de 135 millions de tonnes. À 20 euros la tonne, c'est une sur-allocation de 400 millions d'euros. Prenons l'exemple du raffinage. Entre 1990 et 2003, on constate une augmentation des émissions de 1 % par an. Or, le PNAQ autorise une augmentation de 2 % par an entre 2003 et 2006. Ce pétrole raffiné, il va bien falloir le brûler dans des voitures et des chaudières, ce qui va forcément se traduire en émissions de CO2. Par ailleurs, je rappelle que le Plan Climat prévoit, lui, des mesures de réduction dans les transports et l'habitat. En ce qui concerne les autres gaz, la loi de 1976 sur les installations classées a très bien fonctionné. Il est dommage qu'elle ne soit plus utilisée pour ces gaz. Entre 1997 et 2002, on a réduit des deux tiers les émissions de N2O, c'est-à-dire de protoxyde d'azote, dans l'industrie chimique. Cette réduction a été le résultat de réglementations prises dans le cadre de la loi de 1976, des aides de l'ADEME compensant une partie du surcoût. Pourquoi cette réduction a-t-elle cessé ? En raison d'un effet pervers du marché des quotas de CO2. Les industriels ont demandé l'intégration des autres gaz dans le dispositif. Réduire des émissions de N2O coûte beaucoup moins cher que de réduire celles de CO2, parce qu'une molécule de N2O équivaut à 300 molécules de CO2, en termes de pouvoir de réchauffement global. Un exemple concret : le 27 novembre 2005, le conseil exécutif du MDP, le Mécanisme pour un développement propre, a approuvé un projet de destruction du N2O dans une usine de Rhodia en Corée. L'action de Rhodia est passée de 1,30 euro à 1,9 en un mois. On comprend que les industriels souhaitent l'intégration du N2O dans le champ de la directive européenne. Il est dommage que la perspective de cette éventuelle intégration ait eu pour effet de suspendre l'application de la réglementation. M. Serge POIGNANT : Le changement de sources d'énergie peut se traduire dans les pays industriels par un gain d'émissions de CO2. Est-ce le cas dans tous les pays ? M. Philippe QUIRION : Les chiffres baissent parce que les émissions dues à la production d'électricité sont comptabilisées à part. M. Serge POIGNANT : L'industrie indienne ou chinoise émet de plus en plus de gaz à effet de serre. Dispose-t-on de chiffres ? M. Philippe QUIRION : L'industrie de ces pays émet en effet de plus en plus. Elle est, la plupart du temps, moins performante. M. le Président : Nous en arrivons au quatrième thème, celui des mesures transversales. Mme Cécile OSTRIA : Mon intervention portera essentiellement sur la perception du phénomène par les citoyens, ainsi que sur les moyens de les mobiliser dans leur vie quotidienne pour réaliser des économies d'énergie et réduire les émissions. Je rappelle que 50 % des émissions de CO2 proviennent des usages privés de l'énergie, donc concernent l'habitat, le déplacement des personnes et la production d'électricité domestique. Quand on les interroge sur les « menaces possibles », 51 % des Français disent redouter le changement climatique, 69 % pensent que le réchauffement de la planète constitue une menace pour les générations futures est une certitude, tandis que 71 % affirment que le réchauffement climatique est une certitude. S'agissant par contre de la compréhension du phénomène, on constate beaucoup de confusion. Quand on demande aux Français en quoi consiste l'effet de serre, 25 % répondent « la pollution, les déchets » et 25 % « la couche d'ozone ». Interrogés sur les causes du réchauffement climatique, ils sont 82 % à citer la déforestation, 75 % les transports routiers, 52 % l'exploration spatiale, 47 % les ondes électromagnétiques. Il est intéressant de noter que 62 % des Français pensent que la solution la plus efficace est l'engagement de chacun au quotidien, tandis que 75 % d'entre eux affirment que la réduction de l'effet de serre passe par la modification des modes de vie de chacun. Comme acteurs crédibles, ils sont 45 % à citer les organisations internationales, 44 % les États, 38 % les citoyens. Si les Français semblent prêts à changer de comportement au quotidien, des mesures incitatives doivent les conforter dans cette démarche. La fondation Nicolas-Hulot et l'ADEME ont lancé en mai 2005 une campagne de sensibilisation et d'engagement, Le Défi pour la Terre. À ce jour, 315 000 personnes ont adhéré, en s'engageant à mettre en pratique, au quotidien, des gestes qui vont dans le sens de la réduction des émissions de CO2. Ces engagements correspondent potentiellement à 150 000 tonnes de CO2 non émises. Les informations et les aides aux consommateurs sont également importantes, de même que la sensibilisation, l'éducation et la formation. S'agissant des équipements électriques, il importe d'étendre les crédits d'impôts pour l'habitat - isolation, chauffage, etc. - à tous les types d'habitat, y compris les résidences secondaires, et aux locataires. Étendre l'étiquette énergie à tous les appareils électriques est également une mesure qui irait dans le bon sens. Il faut normaliser les veilles, en termes d'énergie consommée comme de possibilité technologique de les couper. En ce qui concerne les autres produits et services, il conviendrait de favoriser les produits et services moins générateurs de gaz à effet de serre, d'améliorer l'information du consommateur sur l'impact énergétique des produits et services, et de rechercher, comme on le fait actuellement au Royaume-Uni, la possibilité de créer des quotas d'émissions de CO2 par citoyen. La sensibilisation, l'éducation et la formation devraient mettre en évidence le fait que les sources d'économies d'énergie au niveau des individus sont importantes. La mauvaise compréhension du phénomène de l'effet de serre d'origine anthropique est un frein pour amplifier les changements de comportements. Des moyens importants doivent être mobilisés pour informer les citoyens de l'urgence et de la gravité de la situation. La sensibilisation passe par des campagnes de communication beaucoup plus offensives. L'effort d'éducation passe par l'introduction de l'éducation au développement durable dans les programmes scolaires, mais aussi dans les programmes universitaires et les formations professionnelles Il convient, enfin, de favoriser l'accès à des formations continues s'appliquant à tous les corps de métier. M. Michel MOUSEL : « 4 D » partage bien sûr toutes les observations de ses partenaires du RAC, qui m'ont demandé d'ajouter un mot sur l'aspect financier. En bref les moyens budgétaires consacrés à la lutte contre le changement climatique sont soit inexistants, soit illisibles. Il me semblait pourtant que la LOLF était de nature à accroître la lisibilité de ces moyens par nature interministériels. Sa mise en œuvre était d'autant plus opportune qu'une politique cohérente en la matière doit s'inscrire dans toute une série de d'actions publiques qui ne sont pas directement ou uniquement consacrées au climat. Quatre problèmes doivent trouver une réponse pour mieux agir transversalement. Le premier est celui du pilotage de la politique d'ensemble. Le deuxième est celui de la recherche et développement. Le troisième est l'accompagnement des acteurs. Le quatrième est le problème des politiques sectorielles elles-mêmes. S'agissant de ces quatre problèmes, on a du mal à discerner une cohérence entre l'ampleur du défi et les moyens que l'on met en œuvre. En ce qui concerne le pilotage, la MIES travaille sur la politique internationale, elle est le point central d'évaluation des politiques internes, elle gère le fonctionnement des mécanismes d'échanges de quotas. Or, elle dispose, avec l'ONERC, de 1,5 million d'euros, auxquels il faut ajouter quelques emplois de personnels mis à disposition. Il n'est pas nécessaire que la MIES soit un organisme énorme. Pour remplir des missions équivalentes, le Royaume-Uni dispose de 80 personnes, de même que l'Allemagne. Ces équipes peuvent faire un travail efficace sans avoir d'effectifs pléthoriques. Il reste qu'avec 10 personnes, les meilleures années, la MIES a un potentiel humain très inférieur à ce qui serait nécessaire. La recherche-développement et l'accompagnement des acteurs correspondent pour l'essentiel au champ de compétences de l'ADEME. On peut dire que les moyens qu'elle pourra consacrer au changement climatique tourneront en 2006 autour de 140 millions d'euros, ce qui est sans rapport avec l'ampleur des missions qui sont les siennes. Quant aux actions sur des programmes spécifiques comme le logement ou les transports rien n'est fait pour les identifier en matière de moyens comme de résultats, ce qui rend quasiment impossible toute évaluation. Que peut-on envisager de faire ? Je pense tout d'abord qu'il nous faudrait pouvoir disposer d'un instrument qui permette à la MIES, ainsi qu'à d'autres organismes, de mieux fonctionner. Un fonds de l'ordre de 50 millions d'euros avait été annoncé par le précédent Premier ministre. Qu'en est-il advenu ? Pourtant le changement climatique se prête à la création de moyens qui sollicitent très modérément les finances publiques. Ainsi, on pourrait utiliser à cette fin les mécanismes créés dans le cadre de Kyoto. Je pense au PNAQ, et au certificat d'économies d'énergie. La directive européenne autorise l'État à récupérer en valeur 10 % des quotas qu'il émet. Une ressource allant jusqu'à 500 millions d'euros est envisageable en l'état des anticipations sur les flux et les prix du carbone. Les bonifications d'intérêt constituent aussi un outil parfaitement adapté à certaines actions. Je propose, en outre, de constituer un lieu de dialogue où tous les acteurs concernés pourrait réfléchir ensemble à des propositions et des moyens cohérents avec la politique mise en œuvre, sorte de « bourse de projets » complétant les mécanismes d'échange Je n'ai pas parlé de la dimension internationale, pourtant essentielle. Les pays du Sud doivent pouvoir être non seulement des utilisateurs de haute technologie mais des créateurs de technologies adaptées à leur situation, et nous devons les y aider. Je n'ai pas non plus parlé des collectivités territoriales. Je n'ai pas souligné, en particulier, que le projet d'ateliers régionaux ne peut pas être réalisé, parce que le Plan Climat territorial n'a aucun financement. Les collectivités territoriales peuvent beaucoup pour l'efficacité des politiques sectorielles. Une bonne partie de la réussite d'un plan d'action pour le climat dépend d'elles. Cela n'exige pas forcément des moyens considérables. Pour une structure intercommunale, la mise en place de politiques efficaces nécessite, selon Energie-Cités à peu près 400 000 euros par an. M. Serge POIGNANT : Estimez-vous qu'en matière de recherche-développement, les moyens dont nous disposons sont bien utilisés ? D'autre part, pensez-vous, au-delà du financement public, que nos entreprises pourraient faire plus, et si oui, comment les y inciter ? M. Michel MOUSEL : Il y a des domaines où nous sommes actuellement incapables de faire des travaux pourtant absolument nécessaires. Nous ne disposons pas, par exemple, de modèles nécessaires pour éclairer les options qui vont se présenter à nous aux niveaux européen et mondial. Quel est l'avenir du protocole de Kyoto ? Quels mécanismes peut-on imaginer pour le poursuivre ? Nous n'avons pas les moyens de faire travailler des équipes sur ces questions, ne serait-ce que pour préparer les dossiers sur lesquels les négociateurs français pourraient s'appuyer. M. Yannick JADOT : L'insuffisance de moyens est flagrante. Lorsque nous avons réalisé notre étude sur l'impact du changement climatique en France, qui n'était pourtant que la synthèse de la recherche existante, tous les scientifiques ont souhaité y collaborer, précisément parce que ce travail n'avait pas été fait depuis cinq ans. Je ne pense pas que les entreprises aient le souhait d'apporter une solution au changement climatique, car ce n'est pas leur vocation. Leurs enjeux de rentabilité à court terme sont en partie incompatibles avec les enjeux du changement climatique, qui se situent à plus long terme. En dépit de leurs discours, les entreprises font d'ailleurs tout pour éviter tout cadre réglementaire contraignant. C'est à la puissance publique de se saisir du problème, car le coût que supporte la société est énorme. Déjà, des chercheurs affirment que la canicule de 2003 est liée au changement climatique. M. Robert KANDEL : Il est toujours difficile de raisonner sur un événement, en affirmant qu'il est « dû » au changement climatique. Ce que l'on peut dire avec certitude, c'est que le réchauffement climatique accroît de manière très importante la probabilité de la survenue d'événements climatiques extrêmes, tels que la canicule de 2003. J'ajoute que le bilan carbonique des sols en Europe occidentale a montré qu'un événement de ce type aggrave l'effet de serre. C'est un facteur qui n'a peut-être pas été pris suffisamment en compte. M. François DOSÉ : Admettons que vous disposiez d'une tirelire limitée. Quels choix faites-vous entre les trois grandes familles d'actions possibles, celles qui concernent les transports, la résidence, l'industrie ? Le retour sur investissement sera-t-il plus rapide sur l'un de ces trois problèmes, ou faut-il jouer sur les trois registres ? De même, entre la recherche technologique, la réglementation et l'incitation à changer les comportements, quel domaine vous semble-t-il prioritaire ? M. Philippe QUIRION : Certaines mesures coûtent de l'argent public, d'autres rapportent de l'argent à l'État, d'autres encore sont neutres. Pour stabiliser le système climatique, il est nécessaire de s'attaquer à tous les grands secteurs d'émission de gaz à effet de serre. Les deux secteurs dans lesquels les émissions augmentent le plus sont le transport et l'habitat, mais je ne dirai jamais qu'il ne sert à rien de s'attaquer aux autres problèmes tant qu'on n'a pas réglé ces deux-là. S'agissant de la nature des moyens, je pense qu'il faut se méfier des débats idéologiques entre les défenseurs des permis d'émission négociables et ceux qui s'y opposaient avec acharnement, ou entre les défenseurs de la réglementation et ceux qui jugent cette démarche dépassée. Quand on entre dans le détail des politiques, on se rend compte que le problème ne se pose pas en ces termes. La proposition de quotas d'émissions pour les voitures neuves est un mélange de réglementation et de permis d'émissions négociables, et elle ne résoudra pas tous les problèmes. Il faut aussi modifier les comportements, et pour cela agir sur le prix de l'énergie, donc sur la fiscalité, ainsi que sur les vitesses maximales autorisées. Puisque j'évoque la fiscalité, il peut paraître provocateur de proposer d'augmenter le prix de l'énergie par une réforme fiscale. Mais il faut savoir que ce que le prix, en carburants, d'un trajet de 100 kilomètres est inférieur en 2005 qu'en 1973, avant le premier choc pétrolier. Le problème est que lorsqu'on faisait 100 kilomètres en 1973, on en fait beaucoup plus en 2005. Les distances se sont allongées, ce qui est en partie dû au fait que l'énergie est peu chère. On ne résoudra pas le problème si on n'augmente pas le prix de l'énergie. M. Ghislain GOMART : Il faudrait découpler la hausse du pouvoir d'achat du coût de l'énergie. Nous arriverons à minorer nos émissions de gaz à effet de serre le jour où la croissance du coût de l'énergie sera plus forte que celle du pouvoir d'achat. M. André CHASSAIGNE : M. Mousel a déploré un manque de lisibilité de l'action publique. À mon avis, il n'y a rien à attendre de la LOLF de ce point de vue. Un programme peut financer une étude du CEMAGREF ou de l'INRA sur les biocarburants. Un autre concernera le transport. Bref, la politique de lutte contre le changement climatique est trop transversale pour que la LOLF puisse suffire à la rendre lisible. Quels sont, selon vous, les moyens d'introduire plus de lisibilité dans cette politique ? M. Yannick JADOT : Une réponse possible est la pérennité des signaux qui sont envoyés par l'État. En Allemagne, le prix de rachat des énergies renouvelables est garanti pendant 20 ans. Il serait bon d'afficher un prix de rachat des énergies renouvelables supérieur à ce qu'il est aujourd'hui, qui puisse déclencher des logiques d'investissement pérennes. M. Édouard TOULOUSE : Il faudrait une tirelire plus importante consacrée à la coordination des politiques ayant un impact sur le changement climatique. L'effet de décuplement serait potentiellement énorme. Le but est que l'on puisse, dans toutes les politiques, orienter les dépenses dans le bon sens. M. Michel MOUSEL : Les politiques, ce sont aussi des assemblages d'action. Cela interdit l'incohérence. Un Gouvernement ne peut pas à la fois souligner l'importance de la lutte contre l'effet de serre et supprimer la vignette à un moment où celle-ci vient d'intégrer le CO2 émis. Les citoyens ont certes été très contents de cette suppression, mais cette mesure ne les a certainement pas aidés à comprendre la logique de la politique gouvernementale d'alors. Il me semble que l'on peut rendre lisibles les politiques interministérielles, en affichant clairement leur contribution au développement durable. Mme Cécile OSTRIA : Pour répondre à M. Dosé, je pense qu'on ne peut pas opposer la recherche, l'éducation et l'information du citoyen. S'il fallait choisir, il conviendrait de consacrer des moyens à tous les domaines d'intervention, quitte à les réduire. Mais il faut absolument éviter de laisser un domaine à l'abandon. M. le Président : Madame, messieurs, je vous remercie pour votre contribution aux travaux de notre Mission d'information. Audition de M. Claude MANDIL, Présidence de M. Jean-Yves LE DEAUT, Président M. le Président : Mes chers collègues, nous accueillons aujourd'hui M. Claude Mandil, directeur exécutif de l'Agence internationale de l'énergie. Je salue d'autre part la présence de membres du comité de suivi, notamment M. Christian Ngô, délégué général de l'association Écrin, M. Michel Petit, qui travaille sur le réchauffement climatique et a été le représentant de la France au bureau du GIEC de 1992 à 2002, et M. Raymond Leban, professeur au CNAM. MM. Philippe Quirion et Édouard Toulouse, que nous avons eu le plaisir d'entendre dans le cadre de la table ronde ONG qui vient de s'achever, sont également restés parmi nous. M. Claude MANDIL : Je précise d'emblée que je me présente devant vous sans avoir apporté de documents pouvant étayer mes dires. La raison en est que, la France n'ayant adhéré à l'Agence internationale de l'énergie qu'en 1991, dix-sept ans après sa création, la seule langue de travail de l'AIE est l'anglais. Cela dit, c'est avec plaisir que je vous ferai parvenir, si vous le souhaitez, quelques documents dans cette langue. L'Agence procède tous les quatre ans à la « peer review », la revue par les pairs. Chaque État membre subit une analyse détaillée de sa politique énergétique par une équipe comprenant des experts de l'AIE, mais aussi des experts désignés par les autres États membres. Selon quels critères cette politique est-elle évaluée ? Le conseil de l'Agence a défini des objectifs partagés, qui peuvent se résumer dans ce que nous appelons les trois E : l' « energy security of supply », la sécurité énergétique ; l' « economic growth », la croissance économique ; l' « environment protection », la protection de l'environnement. Ces trois sujets sont à nos yeux également importants. Une bonne politique énergétique doit à la fois assurer la sécurité de l'approvisionnement en énergie jusqu'au consommateur final, ne pas contrarier la croissance économique et garantir la protection de l'environnement, en particulier en luttant contre le changement climatique. L'AIE publie chaque année ses perspectives énergétiques, en envisageant différents scénarios. Le premier d'entre eux est le scénario tendanciel : que se passerait-il si plus aucune décision de nature énergétique ou environnementale n'était prise ? Dans ce cas, la demande globale en énergie augmenterait de plus de 50 % entre 2004 et 2030, le secteur du transport continuerait de dépendre à plus de 95 % du pétrole, la dépendance serait accrue envers un nombre décroissant de zones de production, essentiellement le Moyen-Orient et l'ex-URSS, ce qui entraînerait une croissance significative des prix, et les émissions de CO2 augmenteraient de près de 60 %. Tout cela ne serait cohérent avec aucun des trois E, puisque la sécurité de l'approvisionnement suppose la diversité des combustibles et des sources d'approvisionnement, la croissance économique supposant quant à elle des prix modérés, et la lutte contre l'effet de serre étant incompatible avec l'augmentation des émissions. Ce résultat désastreux ne permettrait pas non plus de régler le problème de la pauvreté énergétique. Il faut rappeler qu'à l'heure actuelle, 1,5 milliard de personnes, soit le quart de l'humanité, n'a pas accès à l'électricité. C'est une honte absolue. Ne pas avoir accès à l'électricité, c'est ne pas pouvoir apprendre à lire et à écrire, parce qu'on ne peut pas travailler le soir, c'est ne pas pouvoir se soigner, parce qu'on ne peut pas conserver les médicaments et les vaccins, c'est ne pas pouvoir lancer la moindre activité artisanale, parce qu'on n'a pas de moteur. Voilà où nous en sommes, et nous ne voyons pas clairement ce qui pourrait inverser la tendance. Le scénario tendanciel est donc totalement inacceptable. Les dirigeants politiques mondiaux en sont maintenant convaincus, même le président des États-Unis, serais-je tenté de dire en forçant le trait, car il a cosigné, à l'issue du G8 de Gleneagles, la déclaration finale sur le changement climatique, par laquelle les participants soulignaient que « le changement climatique constitue un défi grave et à long terme qui est susceptible d'affecter tous les points du globe », et qu'il nécessite des « actions urgentes ». Que peut-on faire ? À court terme, nous pensons que les technologies existantes permettent de faire beaucoup, en particulier dans le domaine de l'efficacité énergétique, ce que l'on appelle vulgairement les économies d'énergie. Nous sommes convaincus qu'il existe une marge considérable à des coûts modérés, et même souvent à des coûts négatifs, l'économie réalisée sur la consommation faisant plus que compenser le surcoût d'investissement qui est parfois nécessaire. Par exemple, l'AIE a mené il y a deux ans une étude sur les appareillages électriques dans les habitations. Nous nous sommes posé une question simple : que se passerait-il si, dans l'ensemble des pays de l'OCDE, les consommateurs choisissaient systématiquement l'appareil qui, à performance égale, est celui qui a le moindre coût sur sa durée de vie ? Ce coût total intègre le coût d'achat initial et le coût des consommations. Le résultat serait une économie de 30 % de l'électricité consommée par ces appareils. C'est dire que nous disposons d'une marge de progrès considérable. Pourquoi cette hypothèse ne se réalise-t-elle pas ? Parce que le consommateur ne se préoccupe pas beaucoup de la consommation des appareils qu'il achète. Il a bien d'autres critères de choix. Cela signifie qu'il appartient aux gouvernements d'édicter des normes afin de chasser du marché les appareils qui consomment trop. De manière plus générale, nous estimons que 15 % de la consommation mondiale d'énergie pourrait être économisée si l'on faisait, avec les technologies existantes, les progrès d'efficacité énergétique qu'il nous paraît possible de faire. En d'autres termes, alors que dans le scénario tendanciel, la consommation mondiale serait en 2030 de l'ordre de 15 milliards de TEP, il serait possible, avec les économies d'énergie que les technologies existantes rendent possibles, de réduire cette consommation à 13 milliards de TEP. Cette économie est très loin d'être négligeable. Elle serait supérieure à la production de pétrole actuelle de l'Arabie saoudite. Mais elle ne suffirait pas à assurer un développement durable. D'autres évolutions sont donc nécessaires, dans le long terme, et elles ne sont possibles qu'au prix de percées technologiques importantes. Dans quels domaines ? Il me semble qu'il n'est pas souhaitable de miser exclusivement sur les énergies renouvelables, ou exclusivement sur le nucléaire. Il nous faudra faire feu de tout bois, en ayant recours à toutes les technologies, en explorant toutes les pistes envisageables. Outre les progrès dans le domaine de l'efficacité énergétique, qui sont absolument indispensables, la première piste à explorer est celle des énergies renouvelables. Il convient de privilégier celles qui sont les plus proches du seuil de compétitivité. Car si nous allons peut-être manquer de pétrole, il est certain que la denrée la plus rare au cours des prochaines années sera l'argent, et notamment l'argent public. Il faut donc commencer par ce qui est rentable, ou le plus proche de la rentabilité. Je pense à l'éolien, ainsi qu'à un usage accru de la biomasse, mais en tablant sur des processus de fermentation utilisant la matière ligneuse. Des expériences très intéressantes sont menées dans le monde. La France a eu raison trop tôt. La plate-forme expérimentale de Soustons a été fermée. Aujourd'hui, une grande usine expérimentale située au Canada donne des résultats prometteurs. Le photovoltaïque pourrait également être développé, mais à condition que ses coûts diminuent dans des proportions considérables. J'ajoute que la biomasse est sans doute la meilleure façon d'obtenir du combustible liquide, ce qui est important pour remplacer partiellement l'usage du pétrole dans les transports. Cela dit, les énergies renouvelables ne peuvent à elles seules résoudre le problème, pour des raisons de coût, de disponibilité, et parce que, pour certaines d'entre elles, il n'est possible de les insérer sur le réseau électrique que dans des proportions limitées, en raison des problèmes d'intermittence. La deuxième piste est celle du nucléaire. On a parfois reproché à l'AIE de ne pas croire assez au nucléaire. Nous avons cessé d'être excessivement prudents, et nous disons haut et fort que le nucléaire est indispensable dans le monde entier si nous voulons un développement durable à long terme, à prix modéré. Sans nucléaire, le développement durable est possible, mais à un prix très élevé. Cela étant, il faut convaincre l'opinion publique mondiale que le nucléaire est acceptable. Il faut donc tenir un discours convaincant sur ce qui est aujourd'hui le principal handicap du nucléaire, à savoir la gestion à long terme des déchets. Il n'y a pas de pays au monde qui puisse affirmer avoir réglé ce problème de manière convaincante pour son opinion publique. Mais le nucléaire ne peut, lui non plus, constituer à lui seul une solution. Aujourd'hui, les émissions mondiales de CO2 atteignent environ 24 milliards de tonnes. L'augmentation annuelle des émissions est de l'ordre d'un milliard de tonnes. Il faudrait, au bas mot, stabiliser le niveau des émissions, donc les réduire d'un milliard de tonnes par an. Cela représente chaque année le remplacement de 140 centrales de 1 000 mégawatts charbon par 140 centrales de 1 000 mégawatts d'origine nucléaire. C'est un objectif qui sera très difficile à atteindre, pour toutes sortes de raisons, liées à l'acceptation publique, au financement, à la disponibilité de l'outil industriel. Nous aurons donc à vivre pendant de très longues années encore avec les énergies fossiles. Le pétrole est pour l'instant difficile à remplacer dans les transports. Le charbon a tous les avantages sauf un : il est extrêmement répandu à la surface du globe, sa production est peu coûteuse, dans des zones qui ne posent pas de problèmes politiques. Son grand inconvénient est qu'il est un énorme émetteur de CO2. C'est pourquoi il est important de rendre concurrentielle la technologie expérimentale de capture et de séquestration du CO2. Il est donc urgent de mener des expériences à très grande échelle. Nous n'en sommes qu'au stade du laboratoire, au Canada et en Norvège, une troisième expérience étant lancée en Algérie. En résumé, nous pensons qu'un développement durable est sans doute possible à coût modéré. Mais cela exige de n'abandonner aucune des grandes pistes technologiques qui s'offrent à nous, qu'il s'agisse des énergies renouvelables, du nucléaire, ou des techniques de capture et de séquestration du CO2. Cela exige des percées technologiques et de la coopération internationale. Il conviendrait donc de ne pas être trop pingre dans les dépenses de recherche et développement dans le domaine énergétique. L'ampleur de la tâche nécessite également beaucoup de travaux complémentaires. En ce qui la concerne, l'AIE conduira cette année des scénarios à plus long terme, en incluant des hypothèses alternatives en matière technologique. Je voudrais, avant de conclure, répondre à trois questions que vous vous posez peut-être : pourquoi ne parlez-vous pas de l'hydrogène ? Pourquoi ne parlez-vous pas de la fusion ? Pourquoi ne dites-vous pas que l'on va bientôt être à court de pétrole ? L'AIE croit à l'hydrogène. Mais il faut se rappeler que l'hydrogène doit être fabriqué, et que sa fabrication consomme plus d'énergie que celle qu'il peut ensuite produire. Il faut donc être capable de le fabriquer d'une façon qui soit économiquement acceptable et qui n'aboutisse pas à un surcroît d'émission de CO2. La fabrication de l'hydrogène n'est donc compatible qu'avec la capture et la séquestration du CO2. En outre, il faut savoir à quelles utilisations cet hydrogène est destiné. Les piles à combustible ont l'avantage d'avoir un très bon rendement, mais elles ont un coût qui devrait être divisé par 50 ou 100, et une durée de vie qui devrait être significativement accrue. Nous n'en sommes donc qu'au tout début d'un processus qui nécessitera beaucoup de temps et d'argent. Enfin, le recours à l'hydrogène ne réglera pas tous les problèmes, ni celui de l'émission de CO2, ni celui de la dépendance vis-à-vis des combustibles fossiles, puisque, au moins dans un premier temps, on le produira à partir des combustibles fossiles. L'AIE ne considère pas la fusion comme un programme énergétique, mais comme un programme de science fondamentale, qui débouchera peut-être, mais certainement pas avant la fin du siècle, sur un programme énergétique. Ne comptons pas sur la fusion pour régler les problèmes de développement durable qui se poseront avant le milieu de ce siècle, qui se posent déjà aujourd'hui. Allons-nous manquer de pétrole ? Des gens extrêmement sérieux défendent la théorie du «peak oil» à partir de la constatation suivante : depuis un certain nombre d'années, l'exploration pétrolière ne donne plus les résultats escomptés, on ne trouve plus de gisements géants, et surtout, on a cessé de remplacer, année après année, les productions de l'année précédente. Les réserves connues commencent à diminuer. Tout cela est vrai. Mais je n'en tire pas tout à fait les mêmes conclusions. Car cela ne correspond pas à un phénomène géologique mais à un phénomène politique. Vous connaissez l'histoire de cet homme qui, ayant perdu ses clés dans la rue, la nuit, les cherche autour d'un réverbère. À son ami, qui lui demande s'il est bien sûr que c'est bien là qu'il les a perdues, il répond que non, mais que c'est le seul endroit où il a une chance de les voir. Les compagnies pétrolières explorent autour du réverbère. De l'aveu de tout le monde, où sont les grandes ressources pétrolières non encore découvertes ? Au Moyen-Orient, en Sibérie, dans l'Arctique, et à des très grandes profondeurs, au-delà de 3 000 mètres. Les compagnies n'explorent ni dans l'Arctique ni à de très grandes profondeurs, parce que les technologies existantes ne leur permettraient pas d'exploiter un gisement éventuel. Or, on exploitait il y a trente ans par 200 mètres de profondeur, on exploite aujourd'hui par 2 000 mètres de profondeur, et je ne vois donc pas pourquoi pas on ne serait pas capable d'exploiter dans quelques années par 3 000 mètres de profondeur. Les compagnies n'explorent pas au Moyen-Orient, soit parce qu'il leur est formellement interdit de le faire, comme en Arabie saoudite ou au Koweït, soit pour des raisons de sécurité, comme en Irak, soit parce que la politique locale est marquée par le malthusianisme ou l'incompétence, comme en Iran. Elles n'explorent pas en Russie, parce que la politique de M. Poutine est de plus en plus contraire à l'intérêt des investisseurs. Elles explorent donc sous le réverbère, c'est-à-dire là où elles savent que si elles trouvent des gisements, elles pourront les exploiter. Elles explorent donc aux États-Unis, en Europe, en Afrique, mais ce n'est pas là que se trouve le plus de pétrole. Ce qui est vrai, par contre, c'est que nous allons vraisemblablement devoir vivre avec un pétrole qui proviendra d'un petit nombre de zones, qui ne sont pas nécessairement celles qui nous enthousiasment le plus - le Moyen-Orient, la Russie -, sauf si les progrès technologiques permettent d'exploiter dans l'Arctique, d'aller à très grandes profondeurs, ou d'exploiter sur une grande échelle les sables bitumineux de l'Athabasca, ceux-ci posant toutefois un autre problème, celui du CO2. M. le Président : Outre la nécessité d'accroître les économies d'énergie, qui fait l'objet d'un large consensus, l'AIE estime que toutes les sources d'énergie sont nécessaires. S'agissant des énergies renouvelables, vous croyez plus à l'éolien et à la biomasse qu'au photovoltaïque. Mais l'éolien n'a-t-il pas une limite ? N'oblige-t-il pas à utiliser le gaz dans les périodes de grand froid ou de grande chaleur ? Cela impose de doubler les investissements tout en continuant d'utiliser des énergies consommatrices de gaz à effet de serre. M. Claude MANDIL : Je suis tout à fait d'accord. C'est d'ailleurs une raison pour laquelle nous insistons sur le fait qu'il n'y a pas de panacée, pas de « silver bullet », comme on dit en anglais. L'éolien ne peut à lui seul résoudre tous les problèmes. Cela dit, dans la plupart des pays, en particulier dans le nôtre, nous sommes extrêmement loin de la limite. M. le Président : Où situez-vous la limite ? M. Claude MANDIL : Cela me gênerait de vous donner un chiffre, qui correspondrait à une estimation très grossière et très aléatoire. Si j'étais obligé d'en donner un, je dirais 20 % de la puissance installée. Mais ce n'est qu'une intuition. J'ajoute que certaines critiques que l'on adresse à l'énergie éolienne sont caricaturales. Il n'est pas nécessaire d'installer une centrale à gaz derrière chaque éolienne. Il y a d'autres moyens de stocker l'électricité, notamment les stations de pompage. Il y en a quelques-unes en Espagne et en Californie. Nous en avons une importante dans les Alpes, celle de Grand-Maison, qui est destinée à écrêter les pointes : on pompe en heures creuses et on turbine en heures pleines. Cela dit, encore une fois, l'éolien est très loin d'être une panacée, c'est incontestable. M. Serge POIGNANT : Pourriez-vous nous donner une fourchette d'estimation des réserves en ce qui concerne les énergies fossiles et l'uranium ? Les chiffres sont pour le moins fluctuants. M. Claude MANDIL : S'agissant du pétrole, le problème n'est pas global. En moyenne, on peut dire que les réserves représentent entre 60 et 80 ans de consommation annuelle. Mais ces réserves peuvent assez rapidement être épuisées dans certaines zones, comme l'Amérique du Nord, l'Afrique, la Mer du Nord, et rester très importantes dans d'autres zones, en Arabie saoudite, au Koweït ou en Iran. Le problème est similaire en ce qui concerne le gaz. Il y a deux énormes réserves dans le monde, réparties entre trois États, la Russie, l'Iran et le Qatar. Elles représentent sans doute une centaine d'années de leur production. Les réserves de charbon correspondent à plusieurs siècles de consommation. S'agissant de l'uranium, l'actuel ministre de l'environnement allemand me disait récemment que les réserves d'uranium n'excédaient pas vingt ans. Je pense au contraire qu'elles sont en réalité plus importantes. Nous avons connu un hiver nucléaire de vingt ans, pendant lequel il n'y a pas eu d'exploration d'uranium. Pourquoi des compagnies auraient-elles exploré de nouveaux gisements, alors que l'uranium à leur disposition leur suffisait largement pour le maigre marché qui était le leur ? Je suis absolument convaincu qu'en cas de reprise sérieuse du nucléaire dans le monde, les explorations reprendront également. Or des zones entières de la croûte terrestre sont encore totalement ignorées M. le Président : Entre les vingt ans dont vous parlait le ministre allemand et les quatre siècles dont on nous parle souvent, il y a une marge. M. Claude MANDIL : Je préfère ne pas avancer de chiffre. Pour procéder à une estimation sérieuse des réserves, il faudrait tenir compte de la possibilité de ce que l'on appelle la génération 4, c'est-à-dire de la surgénération. M. Raymond LEBAN : Les réserves actuelles correspondraient, avec des réacteurs à eau légère, à une durée comprise entre 30 et 50 ans. Ce sont les estimations généralement avancées. Les 200 ans correspondent à une autre hypothèse, incluant la génération 4 et les recyclages. M. Christian NGÔ : Il est vrai qu'il existe sans doute des réserves inconnues d'uranium. On n'a pas trouvé beaucoup d'uranium parce qu'on n'en cherchait pas. Tous les géologues qui travaillaient pour la COGEMA ont été mis au chômage. L'ordre de grandeur des réserves est sans doute de 100 ou 200 ans, avec la technologie actuelle. Avec des réacteurs à neutrons rapides, il faut multiplier ce chiffre par 150. Et il serait encore supérieur si l'on utilisait le thorium, qui est entre deux et trois fois plus abondant que l'uranium. La fission, avec des réacteurs à neutrons rapides, c'est donc plusieurs dizaines de milliers d'année, soit plus que la fusion, si l'on parvient un jour à maîtriser le deutérium-tritium. M. le Président : Si je comprends bien, vous n'êtes pas d'accord. M. Philippe TOURTELIER : Pensez-vous qu'il faille que l'énergie reste bon marché ? D'autre part, si l'argent public est une denrée appelée, comme vous l'avez dit, à devenir de plus en plus rare, il nous faudra bien faire des choix entre les différentes énergies qu'il convient de développer. Dans le passé, l'argent consacré à la recherche nucléaire a manqué, en France, à la biomasse et au solaire. N'avons-nous pas intérêt à rééquilibrer les financements de la recherche afin de rendre possibles des sauts technologiques dans les énergies renouvelables permettant de mieux répondre, de façon plus décentralisée, à la pauvreté énergétique dont vous avez parlé ? M. Claude MANDIL : On me dit souvent que les prix actuellement élevés du pétrole sont une bonne chose. Cela permettrait de faire des économies d'énergie, de développer plus facilement les énergies renouvelables. Je ne suis pas du tout d'accord avec ce raisonnement, que je trouve extraordinairement égoïste. Les pays de l'OCDE peuvent, certes, se payer une énergie à un prix plus élevé, même si cela peut réduire notre croissance d'un demi-point de PIB. L'énergie ne coûte plus grand-chose dans le panier de la ménagère. Mais pour un pays en voie de développement, une augmentation du prix de l'énergie peut être une charge absolument insupportable. Le chef économiste de l'AIE a calculé que, pour les pays africains qui ont obtenu un effacement de leur dette, le surcoût annuel de l'accroissement du prix du pétrole entre 2003 et 2005 représentait dix fois le service annuel de la dette. Il a pu se tromper, mais pas dans l'ordre de grandeur. Nous devons donc être capable de réaliser des économies d'énergie et développer des énergies de substitution même avec un prix du pétrole modéré. Je ne dis pas qu'il faut en revenir à 10 dollars le baril, comme en 1998. Ce prix était absurde, il ne permettait aucun investissement. Mais nous ne devons pas nous réjouir d'un baril à 65 dollars. Nous pouvons faire de grands progrès en efficacité énergétique, même avec des prix très inférieurs aux prix actuels. S'agissant de votre deuxième question, je pense en effet qu'il faut investir dans le nucléaire, dans les énergies renouvelables, mais pas de façon aveugle. Il faut investir en priorité dans les domaines où l'on est le plus proche de la rentabilité. Il faut se garder de consentir des dépenses de déploiement pour des technologies qui ne sont pas encore compétitives. Il me semble que le type même de la chose à ne pas faire est ce qu'a fait l'Allemagne il y a une dizaine d'années en lançant un programme massif de toits photovoltaïques, avec des subventions massives du Trésor. L'Allemagne s'enorgueillit aujourd'hui d'une production significative d'électricité photovoltaïque. Mais cela lui a coûté des sommes faramineuses. Et surtout, ce qui devait arriver est arrivé : un beau jour, le Trésor s'est lassé et a coupé les crédits, après quoi le programme s'est arrêté net. L'Allemagne aurait été mieux avisée de dépenser cet argent en recherche et développement pour faire baisser le coût du photovoltaïque. On ne peut pas tenir à bout de bras, à coups de subventions, des technologies qui ne sont pas compétitives, cette compétitivité étant appréciée en tenant compte du prix des permis d'émission. M. Philippe QUIRION : Vous avez évoqué, monsieur le président, un consensus sur la nécessité d'accroître les économies d'énergie. Ce consensus existe sur le principe, mais quand il s'agit de mettre en œuvre des politiques, on se rend compte qu'il s'effrite assez rapidement. M. le Président : Je parlais du consensus entre tous ceux que notre mission d'information a auditionnés. M. Philippe QUIRION : J'ai lu l'ouvrage qu'a mentionné M. Mandil, « Cool Appliances : Policy Strategies for Energy-Efficient Homes », consacré aux appareils électriques domestiques. Il ne montre pas seulement l'existence d'un potentiel d'économie. Il fait également apparaître à quel point il serait opportun d'instaurer des seuils minimaux d'efficacité énergétique pour les appareils électroménagers. L'Union européenne ne l'a fait, à la différence d'autre pays de l'AIE, y compris les États-Unis, que pour les réfrigérateurs, les congélateurs ou les ballasts de tubes fluorescents. Aux États-Unis, au Canada, en Australie, au Japon, en Corée, ces seuils ont été définis pour un beaucoup plus grand nombre d'appareils, avec des résultats très significatifs. Il existe maintenant un instrument juridique permettant d'adopter la même démarche en Europe, je veux parler de la directive cadre établissant un cadre pour la fixation d'exigences, en matière d'éco-conception, qui soient applicables aux produits consommateurs d'énergie. Nous attendons maintenant que la Commission fixe les seuils pour les principales catégories d'appareil. La France pourrait l'y inciter. S'agissant de la dernière remarque de M. Mandil, je voudrais souligner qu'il y a deux manières de développer les technologies. La première est le « technology push » : on consacre de l'argent à la recherche, en espérant qu'elle aboutira à l'élaboration de techniques qui trouveront leur place sur le marché. La seconde est le « demand pull » : on crée les conditions de marché pour développer la demande d'un certain produit, ce qui pousse les industriels à développer leur recherche afin de devenir compétitifs. L'histoire montre qu'il y a des succès et des échecs dans les deux cas. L'éolien ne s'est pas développé grâce aux programmes publics de recherche et développement, mais lorsque le Danemark a instauré un tarif d'achat garanti. Dès lors, des constructeurs de machines agricoles se sont lancés dans la production d'éoliennes, qui sont progressivement devenues de plus en plus performantes. Je ne dis pas que c'est là un modèle universellement applicable, mais c'est une démarche qui peut être efficace. M. Claude MANDIL : Je souscris entièrement à tout ce qui vient d'être dit. Si j'ai pris l'exemple du photovoltaïque en Allemagne, c'est pour montrer que l'on va à l'échec quand on finance une technologie qui est beaucoup trop éloignée du seuil de compétitivité. En revanche, dans le cas de l'éolien, il est tout à fait possible de tirer le marché, précisément parce que cette technologie est suffisamment proche de la compétitivité. S'agissant des normes, vous avez tout à fait raison. L'Europe est en retard dans ce domaine. Ce retard a d'ailleurs un effet pervers. Chaque fois que les normes se durcissent dans les pays de l'OCDE n'appartenant pas à l'Union européenne, les industriels de ces pays s'empressent de déverser sur le marché européen leurs stocks de produits les moins performants. C'est ce qu'on a constaté en 2003, lors de la canicule. L'Europe n'avait pas de normes sur les climatiseurs individuels alors que le Japon et la Corée du Sud avaient édicté des normes sévères. Les constructeurs japonais et sud-coréens ont inondé le marché européen de matériels très peu performants. La Commission doit utiliser les pouvoirs qu'elle a pour fixer des normes. Il serait bon que les gouvernements insistent sur ce point. La Commission est traversée par un débat entre le Commissaire à l'énergie, M. Andris Piebalgs, et sa collègue chargée de la concurrence, qui tend à considérer que les normes sont une entrave à la libre concurrence des entreprises. M. le Président : Vous avez écrit dans La Tribune que les pays développés sous-estimaient l'ampleur des conséquences du réchauffement climatique. Est-ce vrai de la France ? Et que faudrait-il faire pour tendre vers la réalisation des objectifs du facteur 4 ? M. Claude MANDIL : Lorsque j'ai écrit cet article, il est évident que je pensais aux États-Unis. Je précise, au demeurant, que tout n'est pas négatif dans la politique américaine, qui définit par exemple des normes de consommation beaucoup plus strictes que les normes européennes. Dans le domaine des énergies renouvelables, leurs initiatives sont extrêmement intéressantes. Le problème est qu'ils ont une regrettable addiction aux transports. Je crains que le consensus sur les économies d'énergie, dont vous parliez tout à l'heure, soit un consensus de la parole et qu'on éprouve encore des difficultés à passer aux actes. Par exemple, vous savez que les appareils électriques qui peuvent être mis en veille consomment en général une dizaine de watts lorsqu'ils sont en veille. Si l'on multiplie ce chiffre par le nombre d'appareils qui existent dans le monde, cela représente un grand nombre de gigawatts. On sait que les technologies existantes permettent d'abaisser à 1 watt la consommation en veille. Mais ces appareils ne se vendent pas plus que les autres, tout simplement parce que la consommation en veille n'est pas un critère d'achat, ce qui est compréhensible. Il importe donc d'instaurer une norme. L'AIE a formulé une proposition allant dans ce sens. À notre grand émerveillement, le dernier sommet du G8 l'a reprise à son compte. Le plan d'action de Gleneagles sur le changement climatique prévoit en effet de « promouvoir l'application de l'Initiative 1 watt de l'AIE ». Cela n'a été suivi d'aucune décision concrète. Cette initiative permettrait pourtant d'économiser 20 gigawatts de puissance de pointe. M. le Président : Monsieur Mandil, je vous remercie de votre contribution aux travaux de notre Mission d'information. Table ronde sur « la réduction des émissions de gaz à effet de serre dues aux transports » réunissant : Présidence de M. Jean-Yves LE DEAUT, Président M. le Président : Le sujet de cette première table ronde est particulièrement large puisque la MIES nous indique que le secteur des transports contribue à hauteur de 27 % au total des émissions françaises de gaz à effet de serre et de 34 % du total mondial. Nous l'aborderons sous plusieurs angles : état des lieux en matière de véhicules propres et économes ; organisation des déplacements en zone urbaine et réduction des émissions de gaz à effet de serre ; réduction des émissions liées au transport de fret. Enfin, nous entendrons le point de vue des associations. Le temps nous étant compté, je demande à chacun d'être bref et je donne sans plus tarder la parole à M. André Douaud, directeur technique du Comité des constructeurs français d'automobiles. M. André DOUAUD : Je veux tout d'abord insister sur la nécessité de bien distinguer la question de la pollution locale de celle de l'effet de serre. Les premiers règlements européens destinés à lutter contre la première datent des années 1970, et les progrès obtenus depuis lors sont supérieurs à 95 %. On observe toutefois qu'avec un âge moyen du parc automobile de huit ans et une durée de vie des véhicules supérieure à dix ans, les véhicules les plus anciens ne répondent, dans le meilleur des cas, qu'aux normes de leur époque. Si, par un coup de baguette magique, tous les véhicules respectaient demain la norme « Euro 4 » en vigueur depuis le 1er janvier dernier, on gagnerait encore 70 % sur les émissions de l'ensemble des polluants. La Commission européenne réfléchit d'ailleurs actuellement à une norme « Euro 5 », qui entraînerait notamment la généralisation des filtres à particules sur les véhicules diesels pour passer de 25 à 5 microgrammes par kilomètre. Le bilan que la Commission dresse de toutes les sources d'émission dans les 25 pays de l'Union montre que la première source est aujourd'hui, et demeurera en 2020, la combustion de bois dans les foyers domestiques, l'automobile venant très loin derrière. De 1990 à 2005, la part de la route a été réduite pour l'ensemble des polluants, le problème le plus important demeurant aujourd'hui l'oxyde d'azote, avec plus de 30 % des émissions totales, contre 20 % pour les autres polluants. Ces chiffres sont donnés par le CITEPA (Centre Interprofessionnel Technique d'Etudes de la Pollution Atmosphérique), qui a la confiance de l'ensemble des parties. Mais je rappelle qu'il s'agit ici de qualité de l'air et non d'émissions de gaz à effet de serre. D'ailleurs, je ne parle jamais du CO2 qui n'est pas en soi un gaz toxique et qui n'est pas mauvais pour la santé puisque l'être humain en fabrique cent fois plus par sa respiration qu'il n'y en a dans l'air. Le CO2 est un produit normal de la combustion de tous les produits qui contiennent du carbone, qu'il s'agisse du charbon, du gaz naturel ou du pétrole. Quand on les brûle de la façon la plus parfaite qui soit, le résultat de cette combustion est de l'énergie, de la chaleur et du CO2. Malheureusement, cela aggrave l'effet de serre, dont il faut toutefois rappeler que s'il n'existait pas, la température moyenne sur la Terre serait de moins 18 degrés et que toute vie serait impossible. La crainte tient donc surtout à l'aggravation de l'effet de serre par l'augmentation de la concentration de CO2 dans l'air et aux dérèglements climatiques qu'elle peut entraîner. De 1990 à 2000, il y a eu une forte croissance aussi bien du nombre de véhicules, que du kilométrage de notre parc automobile et de nos émissions de CO2 liées à la consommation de pétrole, dont sont issus 90 % des carburants. Et on voit bien que si le mouvement se poursuit, on arrivera en 2020, 2030 ou 2050 à une situation insupportable. Mais on observe depuis 2000 des changements significatifs, liés aux progrès des véhicules, à la sagesse récente des conducteurs, à la réduction de l'utilisation des véhicules ainsi qu'aux effets de l'augmentation du prix du pétrole. Si on compare le CO2 de la route aux autres sources, il convient de distinguer le CO2 des voitures particulières et des poids lourds, le second devant être attribué davantage au processus industriel et agroalimentaire. Les constructeurs se sont engagés en 1997 à réduire leurs émissions. Ce sont les moteurs diesels qui ont permis de progresser fortement en Europe et particulièrement en France, qui est 10 grammes en dessous de la moyenne européenne, PSA et Renault étant pour leur part à 148,5 g de CO2, c'est-à-dire significativement en dessous des moyennes française et européenne. Il est vrai que les constructeurs français ont une longue tradition d'excellence dans les petits véhicules à basse consommation. Le marché français est-il vertueux ou irresponsable ? On parle souvent des 4x4 qui envahissent nos routes et les Champs-Élysées, mais ce n'est guère représentatif de la réalité puisqu'on observe, de 2000 à 2004, une forte croissance des véhicules avec des émissions inférieures à 140 g de CO2, tandis que le marché des véhicules au-dessus de 140 g est en forte décroissance. Il convient de s'intéresser davantage au CO2 moyen par constructeur qu'au CO2 du véhicule le plus performant que chacun met en avant. Pour le premier, Renault est au premier rang et PSA au troisième, tandis que Daimler, qui présente avec la smart diesel un véhicule à moins de 90 g, se retrouve en queue de peloton avec une moyenne de 181 g. Une hirondelle ne fait pas le printemps ! Une analyse par type d'énergie confirme que les moteurs diesels sont très performants. Il s'est vendu en France en 2004 près de 290 000 véhicules à moins de 120 g, qui ont permis d'économiser 211 000 tonnes de CO2 en un an. C'est très important car le CO2 est une question globale : si on veut avoir un effet CO2, il faut un impact massif, en nombre de véhicules bénéficiant de technologies performantes. On voit aussi que les 5000 véhicules GPL vendus, qui bénéficient d'un crédit d'impôt, ont de très mauvais résultats, supérieurs à 181 g. Ce n'est guère étonnant puisque le gros bataillon des ventes est constitué de Lada Niva qui viennent de Russie, avec un niveau d'émission à 250 g, même avec alimentation au GPL. Ces chiffres sont donnés par l'ADEME. Il est essentiel de montrer aux citoyens qu'il existe de bonnes pratiques et de bons choix. Avant-hier, Mme Nelly Olin a présenté l'étiquetage des véhicules en fonction de leurs émissions de CO2 désormais appliqué dans toutes les concessions et qui sera obligatoire à partir du 10 mai prochain. Si on observe la typologie du parc automobile français, on constate que la part des véhicules anciens, gros pollueurs et gros consommateurs, demeure importante, tandis que celle des véhicules récents, qui respectent les normes « Euro 3 » et « Euro 4 », est encore bien faible. C'est tout le problème du renouvellement du parc. Vous pourrez si vous le souhaitez me poser des questions sur les biocarburants car je préside une commission interministérielle qui fera des propositions en la matière le 31 janvier prochain. Mais, ayant montré jusqu'ici ce qui se passe à très court terme, je souhaite terminer en évoquant la problématique de la division par quatre des émissions de CO2 par les pays développés d'ici 2050. C'est un défi considérable, qu'on ne saurait relever en restant dans un cadre franco-français. Les émissions des États-Unis, de la Chine, de l'Inde sont gigantesques et leur progression est catastrophique. Alors que les émissions françaises sont de 72 millions de tonnes pour les voitures particulières, la totalité du CO2 émis par les États-Unis étaient de 4 milliards de tonnes en 1990 et de 5 milliards en 2004. Si les plus gros émetteurs, que je qualifie de « climatiquement sous-développés», à commencer par les États-Unis, ne font rien, tous nos efforts reviendront en fait à nous tirer une balle dans le pied. Il est donc très important de voir comment les technologies d'excellence que nous possédons dans les domaines des transports et de l'énergie, notamment avec le diesel et le nucléaire, peuvent être diffusées dans le monde, pour jouer un effet de levier sur les pays gros producteur de CO2. Dans son rapport sur « la voiture du futur, moins polluante et plus économe », l'Office parlementaire des choix scientifiques et technologiques écrit « Préserver le potentiel de croissance économique par la fourniture d'énergie abondante, à prix raisonnable, et par le libre usage des moyens de transport apparaît comme un objectif politique majeur ». Les constructeurs automobiles français adhèrent totalement à cette idée. M. le Président : Merci. Je rappelle que le CO2 à basse concentration n'est pas toxique, mais qu'il le devient lorsqu'il augmente. Celui qui provient de la combustion des cellules est évacué par l'hémoglobine et il reste à 250 à 300 parties par million. C'est au-delà que le danger apparaît. Mais j'en reviens à l'effet de serre : même si on constate une inversion de tendance, il semble que la réaction n'a pas été très rapide entre 1990 et 2002, alors que Rio date de 1992 et Kyoto de 1997. On comprend l'effet retard lié à l'ancienneté du parc automobile. Les efforts n'auraient-ils pas pu être fait plus tôt ? Ne pourrait-on pas aller plus vite vers des véhicules qui consomment moins ? On a entendu dire que le monde automobile avait été longtemps réticent à développer des moteurs consommant peu. M. André DOUAUD : L'automobile est un produit qui doit se vendre. Il importe qu'elle respecte non seulement les impératifs environnementaux, mais aussi ceux de sécurité et d'agrément d'utilisation. Aujourd'hui, le poids des automobiles augmente - de 100 kg entre la Clio 2 et la Clio 3 - parce que les clients exigent des standards de sécurité qui vont au-delà des obligations réglementaires. Tant que le prix du carburant est resté relativement bas, il n'y a pas eu de pression forte sur la consommation. Aujourd'hui, on assiste à une prise de conscience qui change la donne et les constructeurs font de la consommation et du CO2 des questions prioritaires. En ce qui concerne le CO2, il y a deux voies d'action. La première est le rendement du véhicule. Si on prend un véhicule qui produit 130 à 140 g et qui consomme 5 litres aux 100 km, on ne peut à l'évidence pas multiplier par quatre le rendement du moteur. Celui des meilleurs moteurs, les diesels à injection directe, est de l'ordre de 25 % et c'est déjà une prouesse thermodynamique. Même une pile à combustible n'a pas un rendement supérieur à 50 % et on voit donc mal comment atteindre 100 %. C'est pour cela que la seconde piste, celle du carburant, est essentielle. Il faut travailler sur les énergies qui ne contiennent pas de carbone fossile. La piste la plus prometteuse à court terme est celle des biocarburants parce qu'on peut, à partir de la biomasse, fabriquer des biocarburants totalement compatibles avec les 36 millions de véhicules existants. Bien sûr, il faut prendre en compte l'utilisation de carbone fossile dans la production de ces biocarburants, par exemple quand les tracteurs qui récoltent les betteraves fonctionnent au diesel. Mais tout le monde travaille sur cette question du « puits à la roue » des énergies alternatives. Mme Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET, Rapporteure : J'ai été déçue que vous ne traciez aucune perspective, notamment en ce qui concerne les nouveaux types de moteurs, par exemple les hybrides électricité-biocarburant. On peut toujours organiser les graphiques pour mettre en relief les mérites certains des constructeurs français, mais le « facteur 4 », c'est d'abord diviser par quatre les émissions en France, avant d'exporter nos technologies dans un monde qui aura pris la mesure de l'effet de serre. Pour cela, il ne faut pas se contenter d'introduire 10 ou 20 % de biocarburants dans la consommation des voitures classiques, mais bien aller vers des nouveaux moteurs comme ces hybrides. Pourquoi les constructeurs ne se mobilisent-ils pas davantage ? M. André DOUAUD : Le 31 janvier, un groupe automobile va présenter ses travaux sur l'hybride diesel. Jusqu'ici, en motorisation thermique simple, c'est le moteur diesel qui a le meilleur rendement et c'est donc à ce moteur qu'il faut associer l'hybridation pour obtenir le véhicule qui produira le moins de CO2. L'objectif est de parvenir à moins de 100 g de CO2 par kilomètre pour un véhicule familial. Les constructeurs français sont fortement engagés dans le développement de ces motorisations. Avant-hier, un constructeur a aussi présenté ses travaux communs sur l'hydrogène et la pile à combustible. On ne peut donc pas dire que les constructeurs français ne se préoccupent que du diesel. Ils développent activement des technologies futuristes à l'horizon 2050. Mais il est clair que les solutions hybrides ne donneront leur plein potentiel que quand on aura franchi l'étape de ce qu'on appelle le plug-in hybride, c'est-à-dire des véhicules avec une prise de courant. Aujourd'hui, la seule ressource d'énergie de tous les véhicules hybrides du monde est le carburant qu'on met dans le réservoir. Tous les constructeurs envisagent une bi alimentation, mais le problème tient à la limite de la charge des batteries. M. Serge BLISKO : Les efforts des constructeurs pour sortir des véhicules produisant moins de CO2 sont tout à fait louables, mais il y a quand même une contradiction entre les travaux du laboratoire d'études et la politique commerciale des marques. Ainsi, Renault souhaite relancer les véhicules hauts de gamme qui rapportent beaucoup d'argent, alors que vous nous avez montré que ce sont les marques allemandes, qui proposent de tels modèles, qui produisent en moyenne le plus de CO2. Cette politique, qui va à l'inverse des efforts vertueux, ce qui ruine la première partie de votre exposé et, surtout, fait l'impasse sur le facteur 4. M. André DOUAUD : J'ai montré qu'en France, depuis cinq ans, le marché des véhicules à bas CO2 est en croissance tandis que celui des véhicules à CO2 élevé diminue. J'ai aussi parlé de l'effet de masse : la vente de quelques voitures haut de gamme ne contrebalance pas celle de dizaines de milliers de modèles plus vertueux. En outre, les constructeurs ont le devoir économique d'assurer leur bonne santé financière. Les constructeurs français doivent aussi répondre à la demande mondiale. Ainsi, le total de leurs ventes est de 5,6 millions de véhicules, alors qu'ils ne couvrent que 50 à 60 % des 2 millions de voitures vendues en France. Le marché mondial est donc vital pour eux. Un grand constructeur mondial généraliste doit présenter toute une gamme de véhicules. M. André GASTAUD : Il y a au moins deux acteurs dans cette bataille : les constructeurs et les acheteurs. On ne parviendra donc aller vers le « facteur 4 » qu'en sensibilisant massivement le public à la menace climatique et à la question des émissions des véhicules qu'ils achètent. André Douaud a parlé de l'étiquette CO2, qui s'inscrit dans cette démarche. Il faut que cette initiative soit relayée par des campagnes massives, donc suffisamment financées pour pouvoir répondre aux campagnes publicitaires des constructeurs automobiles. M. Serge POIGNANT : La question des nouvelles technologies me paraît également prioritaire pour réduire les émissions de CO2, mais je me demande s'il ne s'agit en fait d'un gadget aux yeux des constructeurs. Ainsi, M. Douaud ne nous a parlé ni du GPL, ni de la pile à combustible embarquée. J'aimerais par ailleurs savoir pourquoi il a parlé des chaudières à bois. A-t-il des informations particulières sur leurs émissions de particules polluantes ? M. André DOUAUD : Les données à ce propos viennent de la Commission européenne. Toute sa stratégie en matière de qualité de l'air est fondée sur une approche intégrée, c'est-à-dire qui tient compte de toutes les sources de polluants. Le dossier CAFE - Clean Air For Europe -, qui permet de disposer de toutes les sources d'émission par les 25, montre que l'utilisation du bois par les foyers domestiques est aujourd'hui et restera en 2020 la première source d'émissions de particules. Je n'ai pas parlé des deux-roues, qui sont une source majeure de pollution en ville et qu'on oublie très souvent. Heureusement, l'ADEME a mis le doigt sur cette question en 2005, mais il faut faire de gros efforts pour réduire des émissions dix fois supérieures à celle des automobiles à la norme « Euro 4 ». S'agissant des moteurs hybrides, deux approches visent le même objectif. Celle de Toyota dite full hybrid, consiste à utiliser à la fois toutes les possibilités : une partie électrique combinée aux moteurs thermiques, la récupération de l'énergie au freinage, l'arrêt du moteur lorsque le véhicule est immobilisé. Cela permet de gagner de l'ordre de 30 % par rapport à un moteur classique et d'arriver au même niveau qu'un moteur diesel, mais c'est très onéreux et le marché n'est pas suffisant pour permettre à cette solution de concurrencer le diesel. On peut aussi commencer par des choses peu coûteuses comme le stop and start, c'est-à-dire l'arrêt du moteur lorsque le véhicule est immobilisé, qui permet des gains de 10 % en circulation urbaine. Le surcoût étant marginal, cette solution, proposée par Valeo, peut concerner d'emblée des milliers de véhicules. Le constructeur qui a équipé un de ses modèles va généraliser cette technique sur un deuxième modèle. L'étape suivante sera le stop and go : on demandera à ce petit auxiliaire électriques qui n'avait jusqu'ici comme fonction que de démarrer le moteur, d'apporter un peu plus d'énergie, pour aider le moteur thermique, lorsqu'il a un mauvais rendement, à faire avancer le véhicule. Ensuite, on augmentera encore la puissance de la machine électrique pour récupérer de l'énergie au freinage. Cette démarche progressive semble préférable parce que l'état actuel du marché mondial des véhicules hybrides est plutôt décourageant. Ainsi, ceux qui font du full hybrid abandonnent les véhicules bas et milieu de gamme et se concentrent sur les 4x4. En revanche, les constructeurs français pensent que l'option stop and start, peu onéreuse, peut être généralisée. M. André GASTAUD : L'erreur qu'on commet souvent en France est de réduire la question du défi climatique aux véhicules propres et je pense qu'il est temps de passer à un autre débat. M. Christophe CARESCHE : Pendant que les constructeurs français hésitent, Toyota, premier constructeur mondial, développe la technologie hybride. Manifestement, pour la société japonaise, il y a un marché ! On a le sentiment que pour les constructeurs français, la seule solution envisageable est le diesel propre, et rien d'autre. Pourquoi cette réticence ? Le résultat de cette politique, c'est que la Ville de Paris est obligée d'acheter des Toyota. C'est dommage. M. Jacques BASCOU : Vos objectifs de vente de véhicules en France et en Europe tiennent-ils compte de l'impact en termes de rejet de CO2 ? N'y a-t-il pas une contradiction à faire de la vitesse un argument commercial si l'on veut vendre à l'étranger ? M. le Président : Le temps nous manque pour poursuivre le débat sur ce point. Je vous serais obligé de nous transmettre par écrit vos réponses aux questions de mes collègues, et aux miennes : qu'en est-il de la réduction de la consommation des poids lourds ? Pourquoi semble-t-on n'avoir pas donné la priorité à la conception d'aciers plus sûrs et plus légers, alors que les véhicules s'alourdissent ? Que fait-on ce sujet ? Je donne maintenant la parole à Mme Chantal Duchêne, directrice générale du Groupement des autorités responsables de transports. Mme Chantal DUCHENE : Le GART est une association d'élus. Nos adhérents sont les autorités organisatrices de transports urbains : les agglomérations et les communautés d'agglomération, les communautés urbaines, les départements et les régions. Nos responsabilités portent principalement sur le transport collectif des personnes, mais nos membres pensent que le système doit évoluer. L'automobile est à ce jour le moyen de transport dominant pour les déplacements. Je souligne à ce sujet que tous les progrès techniques relatifs à la consommation unitaire des véhicules sont effacés par l'augmentation du kilométrage parcouru. C'est un grand problème et cela me conduit à souligner que l'on ne peut dissocier politique de déplacements, aménagement du territoire et urbanisme. Par ailleurs, l'utilisation des véhicules particuliers - le transport d'une personne seule - ne correspond pas à l'usage pour lequel ils ont été conçus : le transport de quatre ou cinq personnes et de bagages. Le système est donc inefficace, et le rôle des pouvoirs publics est de fournir des alternatives à l'utilisation de la voiture particulière en solo partout où cela est possible et pertinent, notamment en zone urbaine et pour les déplacements quotidiens. La politique de déplacement des personnes est désormais décentralisée. Depuis la loi d'orientation des transports intérieurs de 1982, les collectivités urbaines sont tenues d'élaborer des plans de déplacements urbains. Depuis la loi sur l'air de 1996, ces plans sont obligatoires pour toute agglomération de plus de 100 000 habitants, mais près de 100 agglomérations moins peuplées se sont dotées d'un tel plan. Je l'ai dit, les liens sont très étroits entre politique de déplacements et politique d'aménagement du territoire. Grâce à l'extension du nombre des communautés d'agglomération, on est davantage en mesure de mettre au point des politiques coordonnées, puisque les compétences d'aménagement et celle des transports collectifs sont entre les mêmes mains. Mais les collectivités urbaines, qui sont à présent responsables de l'organisation des transports collectifs, souhaitent que les compétences évoluent, dans l'esprit des PDU. Elles veulent être responsables d'un service public de la mobilité durable, ce qui permettrait des politiques coordonnées pour tous les modes de déplacement, y compris les nouveaux modes d'utilisation de la voiture et notamment l'auto-partage, thème d'un colloque organisé en décembre dernier par le sénateur Roland Ries. Le principe d'un tel dispositif est de dissocier l'usage et la propriété de l'automobile, pour qu'elle redevienne un outil de déplacement et non plus un outil de contemplation de soi. Un tel système permettrait de disposer d'un parc de véhicules toujours aux normes les plus récentes, bien entretenues et donc plus sûres. Mais, actuellement, les collectivités ne peuvent rien faire à ce sujet, puisqu'elles ne sont qu'organisatrices de transports collectifs. C'est un domaine dans lequel le législateur devrait intervenir. Il devrait intervenir aussi dans la politique du stationnement, principal levier du comportement car selon que vous disposerez ou non d'une place de stationnement à destination, surtout si elle est gratuite, vous utiliserez ou non votre automobile. C'est pourquoi nous soutenons l'idée de la décentralisation et de la dépénalisation du stationnement payant de surface, et c'est aussi pourquoi nous regrettons amèrement que M. Christian Philip ait une nouvelle fois dû retirer l'amendement qu'il avait déposé à ce sujet lors de l'examen de la loi "sécurité et développement des transports". Nous espérons que cette disposition sera enfin votée un jour. Nous déplorons tout aussi vivement que, depuis la loi de finances pour 2004, l'État ait retiré toutes ses aides à la mise en œuvre des PDU et au développement des transports collectifs en site propre. Le budget n'était pourtant que de 120 millions d'euros, mais il avait un effet de levier puissant. Il relève de la responsabilité des parlementaires de rétablir ces crédits, minimes au regard du budget de l'État, mais qui permettaient aux collectivités de s'inscrire dans la politique nationale de réduction de l'effet de serre. S'agissant du transport des personnes, la réglementation est très fournie, les moyens de transport collectifs devant toujours émettre moins de gaz à effet de serre par personne transportée. Nous sommes d'accord pour donner l'exemple mais il faut prendre garde à ne pas trop charger cette barque, car cela alourdit considérablement les coûts. J'observe, comme M. Gastaud, que les constructeurs automobiles disposent de gigantesques budgets de communication qui leur permettent en particulier de diffuser des publicités attrayantes à la télévision. Malheureusement, les collectivités n'ont pas de tels budgets pour promouvoir les alternatives à l'utilisation de la voiture particulière en solo. Cela relève de la responsabilité de l'État. J'en viens au transport des marchandises, pour signaler que 40 % des émissions de gaz à effet de serre en milieu urbain trouvent là leur origine et que cette proportion progresse fortement. Les transports de marchandises sont indispensables à la vie économique de la cité, et la flambée du prix du foncier en ville a, entre autres conséquences, celle de réduire toujours plus les surfaces de stockage, ce qui multiplie les livraisons ; on constate une nouvelle fois l'impact de l'augmentation du prix du foncier sur le transport. On ne sait pas remplacer les transports de marchandises en ville, mais il existe des marchés de niche pour les poids lourds, qu'il est très important de renforcer. Nous y travaillons avec les constructeurs, les transporteurs et les chargeurs, sachant que tous les efforts faits pour que les personnes se déplacent moins en voiture tendent aussi à créer un meilleur équilibre dans l'utilisation de l'espace, rare, de voirie pour le transport de marchandises avec des véhicules propres. Mais, actuellement, les collectivités n'ont d'autre compétence, en matière d'organisation du transport de marchandises, que la réglementation de voirie. Cette compétence devrait leur être conférée dans le cadre des PDU. Présentement, certes, le pouvoir de police des maires réglemente les livraisons, mais les horaires de livraison diffèrent d'une commune à l'autre, ce qui rend la réglementation totalement inapplicable. Mme Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET, Rapporteure : Votre exposé était remarquablement intéressant et il nous serait utile que vous nous transmettiez vos propositions par écrit. J'observe que l'on s'intéresse beaucoup à la technologie des véhicules légers et individuels mais assez peu à celle des transports de marchandises. Serait-ce que les contraintes techniques - la puissance - sont telles qu'elles empêchent d'envisager des moteurs propres dans ce secteur ? Mme Chantal DUCHÊNE : On aurait besoin d'une flotte « propre » en ville, mais le problème tient à ce que les constructeurs jugent le marché inexistant. Et comme les collectivités n'ont pas de compétence en cette matière, elles ne peuvent aider les constructeurs qui s'engageraient à développer des véhicules de livraison « propres ». Si l'on parvient à créer un marché réel, quelque chose se fera. Voyez les bennes à ordures : le marché des bennes électriques commence à se développer. Mme Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET, Rapporteure : La politique consistant à réserver au transport « classique » des marchandises des plages horaires très réduites et d'en laisser l'essentiel aux véhicules de livraison « propres » permettait-elle d'augmenter ce marché ? Mme Chantal DUCHÊNE : Sans aucun doute. Ces mesures se développent largement en Italie et aux Pays-Bas, et nous les analysons avec intérêt au sein de groupes d'échanges européens. En matière de transports de marchandises en ville, nous n'en sommes qu'aux balbutiements, car les premiers programmes de recherche ont été lancés il y a une dizaine d'années seulement, mais la voie que vous indiquez est intéressante. M. André GASTAUD : La consommation des véhicules lourds est optimisée. Ce n'est pas le cas pour les utilitaires légers, auxquels la Commission européenne entend, à terme, imposer les mêmes contraintes relatives au rejet de CO2 qu'aux véhicules individuels. M. Pascal MIGNEREY : Le ministère des transports s'intéresse à la question du transport des marchandises, responsable d'un tiers des émissions de CO2. Mais il ne faut pas s'obnubiler sur les poids lourds, car exprimée en tonne par kilomètre, la moitié de ces émissions provient des coffres des acheteurs. Cela étant, un programme de recherche a été lancé sur le « poids lourd du futur », et les poids lourds sont compris dans le programme « véhicule propre et économie ». A ce sujet, la difficulté tient à ce que si on rend leurs moteurs propres, ils ne seront pas forcément économes, il faut donc trouver une convergence. Dans tous les cas, la question de la pénétration de la marchandise en ville deviendra cruciale. Certaines collectivités ont mis au point des expériences intéressantes de modes de livraison de proximité, que le programme national « marchandises en ville » valorise. M. le Président : Je vous serais reconnaissant de nous transmettre tous documents à ce sujet. M. Pascal MIGNEREY : Je le ferai. Je reviens au transport des personnes pour rappeler l'utilité du covoiturage, notamment pour les trajets entre domicile et lieu de travail. La pratique, encore peu fréquente en France, peut se développer. M. François DOSÉ : J'aimerais quelques précisions sur l'explosion des kilomètres parcourus au cours des deux dernières décennies. Parvient-on à distinguer ce qui relève de l'obligation, à savoir les trajets entre domicile et lieu de travail, et ce qui s'explique par la récréation ? Quelle est la part du comportement et celle de l'obligation économique ? Mme Chantal DUCHÊNE : Cela relève principalement du comportement. Le prix du foncier conduit les gens à arbitrer et, quoi qu'on en pense, le prix des déplacements est sous tarifé, si bien qu'il demeure intéressant d'aller habiter toujours plus loin. Mais la part des déplacements obligés diminue dans la masse des déplacements. De plus, en raison de la désynchronisation des rythmes de travail, les déplacements de loisir sont toujours plus diversifiés. Cela oblige les collectivités à des adaptations coûteuses si elles veulent proposer une palette d'alternatives de transport collectif performantes et permanentes à l'utilisation de la voiture particulière. Voilà pourquoi je plaide en faveur d'un service public de la mobilité durable, exercé par les collectivités. M. André CHASSAIGNE : Les compétences étant partagées entre différents niveaux de collectivités territoriales, jusqu'où peut-on aller dans le respect du principe de la libre administration ? Des blocages législatifs doivent être surmontés, vous l'avez souligné, mais on a tout intérêt à définir une structure fédératrice. Mme Chantal DUCHÊNE : Les impératifs sont en effet apparemment contradictoires, puisqu'il faut d'une part articuler les politiques des différents niveaux institutionnels et d'autre part les politiques de déplacement et d'aménagement du territoire. Il faudra donc tenir les deux bouts de la corde pour parvenir à une parfaite complémentarité des politiques de déplacements collectifs. M. le Président : Malheureusement, dans les très grosses agglomérations, le développement des zones d'activités se fait très loin des lieux de résidence, ce qui rend très difficile d'agir. Mme Chantal DUCHÊNE : Dans l'agglomération francilienne, la réforme du STIF a été une occasion manquée, et nous regrettons de n'avoir pas été suivis lorsque nous avons proposé d'articuler le pouvoir des agglomérations structurantes et celui des autorités organisatrices de proximité. Nous espérons qu'une réforme ultérieure le permettra. M. le Président : Je donne la parole à M. Alain Gille, président du Conseil national des transports, qui introduira la question de la réduction des émissions de gaz à effet de serre liées au transport du fret. M. Alain GILLE : Le transport de fret éligible à l'intermodalité (transport par camion sur longue distance) représente 9 % des émissions de gaz à effet de serre du transport global. Le sujet est donc assez restreint. Mais il illustre ce qui peut être fait pour le reste. Je ne parlerai ni des camions propres, qui existent et dont l'usage se développe, ni des livraisons de marchandises en ville, dont il vient d'être question, car ce n'est pas l'objet de mon propos. Je rappelle qu'il n'est de politique française qui ne s'inscrive dans le contexte européen et international. C'est dire l'importance du Livre blanc sur la politique européenne des transports. Mais les politiques européennes de découplage et de transport modal, qui avaient laissé sceptiques, ont en effet partiellement échoué. Si le découplage ne s'est pas produit, c'est que le transport est si bon marché que les industriels n'en intègrent pas le coût dans leurs projets d'implantation, admettant qu'ils n'en tiendraient même pas compte si ce coût était multiplié par quatre ! La faiblesse de ce coût entretient le gaspillage, et constitue une incitation à délocaliser. L'attitude du consommateur entre aussi en jeu, car il veut de plus en plus des produits sur mesure et disponibles immédiatement, demande qui va à l'encontre de toute massification. Devant l'échec des objectifs européens en matière de transport, le Livre blanc a été révisé à mi-parcours, la question à nouveau posée étant de savoir si l'on peut maîtriser le trafic lié au transport de fret en privilégiant la co-modalité, selon le terme du commissaire Jacques Barrot. Le contexte de la politique de découplage va changer car le coût du transport va croissant de par l'augmentation du prix de l'énergie, le besoin d'harmonisation induit par des raisons sociales et de sécurité et la prise en compte de l'effet de serre. Le renchérissement du prix du transport touchera davantage le transport routier que les transports alternatifs, si bien que l'internalisation des coûts externes finira par se faire. Autrement dit, le coût du transport va commencer à compter et l'on aura tendance à moins gaspiller. En matière de transport intermodal, l'efficacité globale, qui se traduit dans le bilan des émissions de CO2, est le produit de l'efficacité unitaire par le taux de captation du trafic. Pour assurer cette efficacité, plusieurs conditions doivent être réunies : un bon taux de remplissage, le recours à l'électricité, éviter l'allongement des parcours, une bonne fréquence et un coût raisonnable. M. de Robien et M. Goulard ont donc demandé au CNT de réaliser une étude tendant à définir les axes pertinents du transport intermodal. Le rapport rendu aux ministres montre que, dans les couloirs pertinents, des possibilités d'amélioration existent, et formule des propositions à cet effet. Mais si l'on en restait à ces seuls axes « pertinents », l'impact environnemental serait confidentiel. Dans un couloir pertinent, on compte un à deux trains par jour, soit 40 à 80 camions, ce qui est très peu si l'on considère que 6 000 camions roulent chaque jour dans le seul couloir rhodanien. Il faut donc parvenir à augmenter le taux de captation, ce qui suppose des hubs où se croiseront les flux de transit. Si l'on passe de relations point à point à l'aménagement de lieux de transbordement, on peut multiplier les fréquences par cinq ou six, ce qui modifie la donne du tout au tout. C'est la voie qui doit être explorée. Nous faisons sept propositions, qui doivent être analysées du point de vue tant français qu'européen : Premièrement, renforcer la capacité de lucidité et d'expertise économique, pour permettre une meilleure connaissance des marchés potentiels et de ce qui est « captable » par le transport combiné et pour donner aux collectivités une connaissance améliorée du coût des externalités. Deuxièmement, créer un lieu de dialogue permettant à l'ensemble des acteurs du transport d'apprécier les enjeux, de s'accorder sur les objectifs et de trouver ensemble les modalités de la fiabilité et de la performance, dans un esprit « gagnant gagnant ». Troisièmement, demander à la puissance publique de définir de manière précise, prévisible et permanente ses modalités d'intervention pour prendre en compte la composante « transport » dans le mode de production et promouvoir les modes alternatifs au « tout routier » : régulation, système éventuel d'aides, développement des biocarburants, place du nucléaire. Quatrièmement, atteindre des standards européens dans les conditions d'exploitation de nos grands ports et plates-formes d'échange, afin de permettre un transfert et un partage modaux entre l'ensemble des modes de transport, et mettre en application les recommandations du CNT sur les axes pertinents de transport intermodal - autoroutes de la mer, autoroutes ferroviaires, liaisons de transport combiné point à point. Cinquièmement, déterminer au niveau européen les « nœuds » des réseaux européens de transport et des plates-formes intermodales d'échange. Sixièmement, définir les standards européens permettant d'opérer la massification (unités européennes de charges intermodales). Septièmement, intégrer au réseau de transport européen des axes dédiés fret ou à priorité fret, à l'instar des grands projets européens comme la Betuwe Line. Nous nous situons sur une portion très étroite de production de gaz à effet de serre, de l'ordre de 9 % du gaz émis par le transport, mais nous devons nous montrer plus efficaces dans une démarche qui illustre ce qui peut être fait pour lutter contre l'ensemble des émissions. M. le Président : Vous avez décrit les objectifs et les priorités qui ressortent des recommandations du CNT relatives au transport intermodal, ainsi que des documents de synthèse que vous avez transmis à la mission. Malheureusement les évolutions réelles divergent fortement de ces recommandations. Ainsi, les lieux de collecte de la SERNAM sont supprimés les uns après les autres, ce qui oblige les transporteurs routiers à faire des dizaines de kilomètres pour mettre un produit sur le train. L'avenir est potentiellement positif, mais pas le présent. M. Jean SIVARDIERE : La FNAUT regroupe 40 000 adhérents - usagers des transports et habitants concernés par l'impact environnemental des transports - au sein de 150 associations. On sait aujourd'hui de manière sûre que le réchauffement climatique n'est pas une hypothèse mais une réalité, qu'il est lié aux activités humaines, à commencer par les transports, qu'il est irréversible et qu'il s'accélère rapidement et peut conduire à de véritables catastrophes. Il faut donc agir vite. Le « facteur 4 » est un véritable défi puisqu'il suppose une diminution de 3 % des émissions chaque année alors que la tendance actuelle est à une augmentation de 2 %. Pourtant, on ne fait pas grand-chose puisqu'on ne trouve dans le Plan Climat aucune mesure véritablement contraignante, le bonus malus proposé par Serge Lepeltier ayant été remplacé par la taxe sur la carte grise, « mesurette » inefficace. Le Gouvernement mise donc essentiellement sur la technologie, puisque 43 % de l'objectif qu'il s'est fixé serait atteint grâce aux biocarburants et 18 % grâce aux éventuels progrès de la motorisation, 5 % seulement provenant des transferts modaux. Or, pour notre fédération, le progrès technologique est nécessaire, parce qu'on aura toujours besoin de la voiture, de camions et d'avions, mais c'est un pari risqué. En effet, les résultats de la recherche sont incertains. Par exemple, on nous promettait monts et merveilles des supraconducteurs à haute température, mais on n'a jamais vu venir la révolution annoncée dans la distribution de l'électricité. Même dans la simple innovation technique, les progrès sont difficiles, on l'a vu par exemple à Bordeaux avec l'alimentation du tramway par le sol. C'est pour ces raisons que, quand on parle de la pile à hydrogène à l'horizon 2020-2030, je crois qu'on se fait quelque illusion. S'agissant de la voiture propre, André Douaud nous a dit que la pollution diminuait. Or l'organisme qui mesure la pollution de l'agglomération grenobloise, où j'habite, m'a assuré que, depuis dix ans, la pollution urbaine stagnait. En outre, qu'il s'agisse de pollution locale ou d'émissions de gaz à effet de serre, il faut être conscient que les progrès seront annihilés par l'alourdissement des véhicules, la généralisation de la climatisation, l'utilisation des feux de jour et la croissance du kilométrage parcouru. Enfin, si certains progrès, comme les biocarburants, semblent intéressants, ils présentent aussi des aspects pervers car leur production à grande échelle suppose des pratiques agriculturales intensives, fortes consommatrices d'espace, d'engrais, d'énergie et d'eau, alors que la ministre de l'environnement nous annonce une année 2006 particulièrement sèche. Dans ces conditions, il convient à l'évidence de ne pas se désintéresser de la piste du transfert modal. On objecte souvent que les Français ne changeront jamais de comportements. Mais n'a-t-on pas observé des changements massifs, spontanés ou sous l'effet de la pédagogie ou de la contrainte, dans la consommation de vin et de tabac, dans le tri des déchets, dans la consommation de produits biologiques ? Pourquoi penser que c'est à tout jamais que, comme l'aurait dit le président Georges Pompidou, « les Français aiment la bagnole » ? Même dans le domaine des transports, des transferts modaux massifs ont déjà été observés quand l'offre s'est modifiée. Le plus spectaculaire est sans doute le basculement du trafic aérien vers le TGV. Aujourd'hui, plus de 70 % du trafic entre Paris et Londres est assuré par le train. Les TER connaissent aussi depuis peu un véritable succès. Ainsi, en région Rhône-Alpes, depuis la rentrée 2005, leur taux de croissance annuelle est supérieur à 13 %. Autre exemple : dès qu'on organise ce qu'on appelle le « pédibus » et le « vélobus », plus de la moitié des parents renoncent à accompagner leurs enfants à l'école en voiture. La piste du transfert modal est d'autant plus intéressante qu'on sait exactement où on va. Tout d'abord, on sait sur quels trafics agir : trafic automobile en ville, trafic de camions à longue distance, trafic aérien à courte distance. Ensuite, on dispose d'une panoplie de moyens fiables et éprouvés pour provoquer ces transferts : moyens physiques avec le partage de la voirie et la limitation du stationnement ; moyens techniques, sans qu'il soit nécessaire d'inventer un quelconque tapis volant, avec le vélo ou le tramway par exemple ; moyens réglementaires, en particulier en agissant sur la vitesse automobile ; moyens financiers, avec les tarifs des transports collectifs et du stationnement, avec la taxation du transport routier, sur le modèle de ce qui se fait en Suisse, en Allemagne et en Autriche, avec une éventuelle écotaxe sur l'avion, avec les péages urbains. Un grand nombre de moyens sont encore presque inexploités en France : cadencement horaire des TER, train-tramway, autoroute ferroviaire, auto-partage, péages urbains, densification urbaine. En outre, en provoquant des transferts modaux, on intervient simultanément dans de nombreux domaines : on agit contre la congestion des infrastructures routières et aéroportuaires, on améliore la sécurité routière, on réduit la pollution de l'air et le bruit - problème à mon avis aussi grave que la pollution de l'air en milieu urbain -, on limite la dépendance pétrolière et, bien sûr, on lutte contre les émissions de gaz à effet de serre. Certaines mesures tarifaires que l'on peut prendre pour provoquer les transferts modaux permettent aussi de limiter le gaspillage du pétrole et de réduire la demande de transport : en Suisse, la taxe sur le camionnage a permis de réduire de 30 % les parcours à vide des camions. J'y insiste donc, le progrès technologique ne doit en aucun cas occulter l'intérêt du transfert modal, qui suppose une réorientation des choix qui sont faits aujourd'hui en matière d'infrastructures de transport, car ils déterminent les trafics de demain. M. Jean-Marie GERBEAUX : Je crois que l'idée de co-modalité est très importante si on veut faire les choses de manière intelligente, car ni le train ni le camion ne peuvent seuls répondre à l'ensemble de la demande. M. le Président : Mais pourquoi les choses ne s'améliorent-elles pas ? M. Jean-Marie GERBEAUX : Il ne faut pas être trop pessimiste : beaucoup est fait actuellement pour comprendre, analyser et mettre en place les structures nécessaires. L'internalisation des coûts externes est fondamentale pour une bonne appréhension des véritables coûts des transports et pour permettre ainsi de meilleur choix. Avec l'aide des pouvoirs publics, qui croient beaucoup au fret ferroviaire, un plan a été lancé en 2004, année très difficile au cours de laquelle il a fallu faire des choix drastiques, avec des décisions parfois difficiles à supporter au niveau local par les chargeurs et par les élus. Mais nous l'avons fait avec courage car cela nous est apparu indispensable. 2005 a été une année de remise à plat des méthodes, des coûts et des méthodes pour que nous soyons plus compétitifs et plus performants. En 2006, vous allez véritablement pouvoir pour rendre compte des progrès réalisés, y compris sur le plan économique, puisque le fret SNCF devrait équilibrer ses comptes. Il y a dans le fret ferroviaire des métiers très différents : on ne parle pas de la même chose quand on évoque un wagon isolé, le transport combiné et les autoroutes ferroviaires. Le transfert de la route vers le ferroviaire est un enjeu très important pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Nous devons être capables de mettre le plus grand nombre possible de camions sur les trains. Des choses sont en train de se faire, comme l'autoroute alpine, qui a eu du mal à démarrer car il est très difficile de changer l'habitude des chargeurs et des conducteurs de traverser les Alpes grâce aux tunnels. M. le Président : Combien y a-t-il d'années que l'Autriche a fait cela ? M. Jean-Marie GERBEAUX : Avec des aides énormes. M. le Président : Je me souviens d'une réunion avec la SNCF sur le ferroutage, en 1989 alors que je présidais l'Office parlementaire des choix scientifiques et technologiques. Rien n'a été fait en plus de quinze ans ! Par ailleurs, sans concertation avec les régions, le ministre des transports a annoncé que le ferroutage de la partie Est du pays partirait du Luxembourg. Chaque jour, 100 000 frontaliers et des centaines de camions empruntent déjà des autoroutes surchargées pour se rendre dans ce pays. Pourquoi vouloir accroître ce trafic alors qu'à 20 ou 30 km de là, l'implantation de la garer n'aurait posé aucun problème ? Mme Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET, Rapporteure : Cette mission, sensible à l'urgence d'agir pour limiter l'effet de serre, est tout à fait prête à entendre un discours sur les moyens nécessaires pour atteindre les objectifs, mais par sur les raisons pour lesquelles on ne peut pas agir. M. Jean-Marie GERBEAUX : Je n'ai pas dit qu'on ne pouvait pas : des projets comme celui de l'autoroute alpine sont très ambitieux, mais il faut régler un certain nombre de problèmes, par exemple celui du gabarit différent des tunnels, et trouver des solutions techniques. Il y aura en 2007 la liaison Luxembourg-Perpignan. M. le Président : Localiser la gare à Luxembourg ville est une aberration ! M. Pascal MIGNEREY : La technologie française des autoroutes ferroviaires est unique en Europe, car elles seront non accompagnées, ce qui est très intéressant d'un point de vue économique et écologique. Il n'existe pas d'autoroute ferroviaire de longue distance dans le monde. Celle entre Perpignan et non pas Luxembourg-ville mais Bettembourg sera donc une première. Elle se fera en plaine, sans franchissement de montagne. C'est un pari très important, mais le projet sera au départ bien modeste : ce n'est pas avec un train par nuit qu'on va désengorger l'autoroute du Sud. Même dans nos prévisions pour 2050, la part de la route restera majoritaire. Pour le fret, le report modal de bout en bout n'est donc pas la seule réponse à l'effet de serre. Il faut donc apporter des réponses nouvelles, c'est le cas de l'autoroute ferroviaire en ce qu'elle permet de cumuler la finesse et la souplesse de la route pour la desserte terminale et la massification des modes intermédiaires. C'est aussi ce qu'on retrouve avec les autoroutes de la mer. Ce système intéresse les transporteurs routiers et ce sont eux qui ont estimé que Bettembourg s'y prêtait bien. M. Philippe AYOUN : L'aviation représente entre 3 et 4 % des émissions de CO2 du secteur des transports. La DGAC est consciente que cette part est appelée à croître en raison du dynamisme du transport aérien. L'augmentation de la part du pétrole dans les charges totales, qui est passée de 12 à 14 % jusqu'en 2003 à plus de 20 % aujourd'hui, incite également fortement le secteur à améliorer sa productivité énergétique. Les avions sont de plus en plus économes : on arrive pour un long-courrier a une efficacité énergétique de 3 litres de carburant/100 passagers/km. Le taux d'emport progresse aussi fortement, avec des avions de plus en plus gros et de mieux en mieux remplis, Air France et quelques autres compagnies ayant dépassé, en 2005, 85 % de taux de remplissage. M. le Président : Jean-Marc Jancovici nous a expliqué qu'en effectuant un aller simple Paris-New York, on utilisait son quota de CO2 annuel. M. Philippe AYOUN : Vous placez la discussion sur un autre plan : j'évoquais les efforts de productivité énergétique, je ne me posais pas la question plus philosophique de la nécessité de voyager, que je laisse aux sociologues et aux politiques. Mais des efforts peuvent être faits, en particulier dans la recherche, pour améliorer de 40 à 50 % la productivité énergétique au cours du prochain quart de siècle. On peut aussi prendre des mesures d'accompagnement, par exemple en ce qui concerne l'accès aux aéroports. La question des instruments économiques a été évoquée par M. Sivardière. Il y a eu beaucoup de travaux sur ce sujet. Un mémorandum du gouvernement français montre qu'une taxe internationale ne peut pas être envisagée immédiatement mais qu'une intégration de l'aviation dans le système européen d'échanges serait possible. M. le Président : Je remercie tous ceux qui ont participé à cette table ronde. Le débat que nous avons eu ce matin était intéressant, mais sans doute trop bref. Table ronde sur le rôle de l'agriculture dans la lutte contre le changement climatique, réunissant : Présidence de M. Jean-Yves LE DEAUT, Président M. le Président : Nous en venons à notre seconde table ronde de cette matinée, qui sera articulée autour de trois thèmes : Comment réduire les émissions de gaz à effet de serre liées aux activités agricoles ? Quel avenir pour les bioénergies agricoles ? Comment développer le stockage biologique des gaz à effet de serre en agriculture. Je donne sans plus tarder la parole à M. Hervé Bichat, Président d'Europol'agro, qui va nous exposer l'état des lieux, les enjeux et les priorités. M. Hervé BICHAT : J'ai sans doute autant de mal à comprendre le phénomène dont je vais parler que le pape de la Renaissance en a eu à comprendre la théorie de Galilée : les agronomes ont l'expérience des forces gigantesques avec lesquels ils doivent ruser et il leur est difficile d'admettre que leurs pratiques peuvent perturber le climat. L'Office parlementaire des choix scientifiques et technologiques a fait sur la question un excellent rapport signé par le sénateur Marcel Deneux. L'agriculture est une activité économique qui produit un certain nombre de gaz à effet de serre mais elle joue aussi un rôle tout à fait particulier, notamment grâce à la photosynthèse, qui fait qu'elle produit des molécules et absorbe du CO2. Pour ma part, je traiterai des effets, c'est-à-dire des gaz à effet de serre. La part de l'agriculture dans leur émission est tout à fait raisonnable, mais, sur les six gaz dont on a dressé la liste à Kyoto, nous avons une responsabilité particulière pour deux d'entre eux : le méthane, qui est produit pour moitié de façon naturelle et pour moitié par les activités humaines : bas fonds, rizières, fermentation entérique des ruminants, effluents d'élevage ; le protoxyde d'azote, lié à la richesse organique de nos sols et aux pratiques de fertilisation. Je vais passer en revue les principales émissions liées à l'activité agricole et mettre en regard les mesures qu'il convient de mettre en œuvre afin de limiter leur production car, même si nous en produisons peu, nous avons une marge de manœuvre pour produire encore moins. Il y a trois sources de production de CO2 à partir de l'agriculture. La première est l'écobuage, avec les feux de paille et de bois. On retrouve, dans les glaces du Groenland, la trace des grands feux de forêts qui ont déboisé les pays méditerranéens dans l'Antiquité et l'Europe au Moyen Âge. Ces pratiques ont disparu en Europe : on ne brûle plus la paille, qui est devenue une source de richesse importante. La deuxième est la motorisation. Nous pouvons agir dans trois domaines : meilleur réglage des moteurs de tracteur, auquel pousse aussi le prix actuel de l'énergie, techniques de culture, en particulier avec la production sans labour, biocarburants, qui pourraient à terme rendre les exploitations autonomes en énergie. La troisième est le chauffage, qu'il s'agisse des serres ou des céréales, pour lequel des progrès peuvent être réalisés grâce à la cogénération et aux ressources de la biomasse. Il est plus difficile de lutter contre les émissions de méthane, que ce soit en changeant le système digestif des ruminants ou en limitant importance des troupeaux. Les voies qui peuvent être suivies sont donc surtout celles de la culture pluviale et de la valorisation des effluents d'élevage par la méthanisation, pour laquelle notre pays est en retard. Pour le protoxyde d'azote, il faut maîtriser la fertilisation et promouvoir les nouvelles techniques culturales. L'agriculture produit relativement peu de gaz à effet de serre, mais ces phénomènes sont encore mal connus. Dans les batailles qui vont s'engager entre experts et entre pays, il ne faudrait pas que nous nous fassions imposer des normes qui ne respecteraient pas la réalité de l'agriculture européenne. Il faut donc développer les recherches, afin que nos négociateurs disposent de toutes les données nécessaires pour imposer des solutions qui aillent dans le sens de nos intérêts collectifs. Il convient aussi de promouvoir à la fois une agriculture durable, « économe et autonome », qui produit peu de gaz à effet de serre, et une agriculture à haute valeur ajoutée biologique, qui sera de moins en moins appel à des facteurs de production externes, en particulier aux énergies fossiles. M. le Président : Il faudra parvenir à s'accorder sur les chiffres, car le Centre interprofessionnel technique d'études de la pollution atmosphérique (CITEPA) évalue à 18 % la contribution de l'agriculture aux émissions de gaz à effet de serre. Chacun, en entrant dans cette salle, expose que son secteur « contribue peu » aux émissions polluantes. Quoi qu'il en soit, tous les secteurs devront réduire leurs émissions si nous voulons parvenir à notre but commun, qui est la division des émissions par quatre ! Je donne la parole à M. Claude Roy, coordonnateur interministériel pour la valorisation de la biomasse, pour traiter de l'avenir des bioénergies agricoles. M. Claude ROY : Qui parle de biomasse parle au moins de cinq ressources et de huit filières de valorisation. Les ressources sont les déchets organiques, les déchets et sous-produits lignocellulosiques fatals, les bois et assimilés, les cultures lignocellulosiques et la conchyliculture, et enfin les cultures spécifiques - graines et tubercules -. Les filières de valorisation sont, dans un ordre logique, les amendements organiques des sols, l'alimentation, les matériaux renouvelables traditionnels, les néomatériaux, les biomolécules, les biocarburants, la biochaleur et la bioélectricité cogénérée. Valoriser la biomasse, c'est économiser du gaz carbonique, éviter d'en émettre, et en séquestrer ; c'est produire de la nourriture, des matériaux et des énergies renouvelables ; c'est contribuer à l'aménagement du territoire, à la production de valeur ajoutée ; c'est créer des emplois peu délocalisables et des recettes publiques et améliorer le contexte environnemental et sanitaire. C'est aussi éviter des risques et des conflits, mettre au point des solutions applicables partout dans le monde et faire émerger des potentiels de recherche et développement, de technologie et d'organisation exportables. A tout cela, il y a deux conditions : une gestion durable et non minière des ressources et une mise en valeur des terres agricoles et forestières. En effet, les défis auxquels la population du globe est confrontée sont très sérieux et connus : accroissement démographique, développement de la consommation, réduction des surfaces agricoles, rareté de la ressource en eau douce, rythme accéléré d'épuisement des énergies non renouvelables, et changement climatique dont l'emballement pourrait avoir des effets cataclysmiques. Si la pression sur la surface agricole est forte, de vastes surfaces forestières pas ou mal mises en valeur pourraient se libérer ; en particulier avec le réchauffement du climat : ainsi, en France, 4 millions d'hectares de forêt en pleine production suffiraient à produire ce qui est actuellement produit sur quinze millions d'hectares. En revanche, s'agissant de l'énergie fossile, la « caverne d'Ali Baba » sera vide à la fin du siècle. Il faut donc espérer que l'on aura, d'ici là, des sauts technologiques majeurs en ce qui concerne, par exemple, le photovoltaïque et la photosynthèse,véritables bases «renouvelables » de notre avenir. Pour prévenir les causes et pallier les effets du changement climatique, il faut réduire les émissions de carbone d'un « facteur 4 » dans les pays développés en économisant les sources d'énergie fossiles, en substituant des ressources renouvelables aux sources d'énergie et matières premières fossiles, comme notamment la biomasse énergie, les biomatériaux, les biomolécules, les biocarburants. Pour ralentir l'effet de serre, il faut aussi augmenter la séquestration du carbone par différentes voies dont la biomasse et des sols (bio-séquestration), et tirer parti de tout ce qui peut l'accélérer. En d'autres termes, la valorisation des bioressources, notamment par une agriculture et une sylviculture performantes permettront de « nettoyer » l'atmosphère de la planète du CO2 en excès. Aujourd'hui, en France, la production de biomasse représente 10 millions de tep/an, soit 4 % de la consommation d'énergie primaire. On peut parier que l'on parviendra assez facilement à une production valorisée de 40 millions de tep/ an en 2040, sans détruire les sols et sans détruire ni les filières matériaux - bois et papier - ni l'industrie agroalimentaire. De cette production, 20 millions de tep pourraient aller à la consommation de carburant, ce qui correspond à la moitié de la consommation actuelle ; le biocarburant sera fabriqué à partir de déchets et fibres lignocellulosiques gazéifiés puis reliquéfiés (BTL). Le développement des différentes filières de la biomasse en France entraînerait, à cet horizon 2040, la création nette de 150 000 à 200 000 emplois directs de production et transformation « attachés à la terre » et donc non délocalisables. Autant dire qu'en matière de politique agricole, la stratégie malthusienne laisse « sur sa faim » quand on sait qu'il va falloir nourrir 9 milliards d'humains - et surtout s'ils se mettent tous à manger de la viande. En effet, pour nourrir un homme à base de féculents, il faut 5 fois moins d'hectares que pour une alimentation à base de viande blanche, et 9 fois moins d'hectares s'il s'agit de viande rouge. Agriculture et sylviculture conduites dans une logique de performance accrue, et de préservation des facteurs de production (sols, eau) sont donc indispensables, le problème étant celui de la pérennité des sols et des ressources en eau et en intrants minéraux, singulièrement les phosphates, sauf à systématiquement réutiliser les cendres, comme c'était le cas dans le passé. Dans ce schéma d'intensification, 7 à 8 millions d'hectares en France, 15 à 20% du territoire agricole, seraient consacrées, en 2040, à la production de biomasse, c'est-à-dire à une production qui ne serait ni tout à fait agricole ni tout à fait forestière. On retrouve la logique qui prévalait au XVIIIe et au XIXe siècle, quand 30 % des surfaces agricoles étaient réservées à la production de l'alimentation des animaux de trait, le fourrage et le picotin, autres biocarburants, etc. Un tel schéma peut être appliqué sans bouleverser ni le régime d'assolement, ni les grands équilibres des sols entre terre et forêt. La production et l'utilisation de la biomasse ainsi décrites auraient pour effet, en 2040, d'éviter l'émission de 100 millions de tonnes de CO2 par an et d'en séquestrer 40 millions de tonnes/an soit, en tout, un tiers du chemin à parcourir pour le « facteur 4 ». Voilà qui montre le rôle fondamental de la production de biomasse et qui suggère que la fin du siècle pourrait voir la renaissance de l'agriculture et de la sylviculture. M. Bernard SEGUIN : Pour stocker le carbone, il faut procéder à la reforestation puis utiliser le bois-matériau, ou stocker le carbone dans les sols. L'INRA a rendu une étude d'expertise collective à ce sujet au ministère de l'écologie en 2003. La forêt française s'étend de 70 000 hectares par an par accrus spontanés, et sa productivité progresse notablement sans que l'on sache exactement quelle est la part, dans ce phénomène, de l'élévation des émissions de gaz carbonique, du réchauffement et de la fertilisation due aux pluies azotées. Le stockage annuel de carbone est évalué à 18 millions de tonnes, soit plus de 10 % des émissions de gaz à effet de serre en France, mais il y a trois ans encore, il était estimé à 10 millions de tonnes, ce qui signifie que l'on connaît à peine les ordres de grandeur. L'agriculture modifie le taux de carbone dans le sol, entraînant pour longtemps une chute rapide des stocks par photosynthèse, en fonction des processus de biodégradation microbiens. Le mode d'occupation du sol est donc le premier facteur de séquestration du carbone. C'est principalement sous les végétations forestières que l'on trouve du carbone en France. L'augmentation des surfaces cultivées aux dépens des prairies, ainsi que la jachère nue imposée un temps par la PAC ont réduit les stocks de carbone dans le sol. Cette dernière pratique a été abandonnée. Les scénarios que j'ai entendus évoqués sont loin d'être facilement réalisables car ils supposent une profonde modification de l'utilisation des sols. L'autre aspect de la question est en effet celui des techniques culturales, le non-labour et le semis direct permettant, selon les estimations, un stockage de carbone dans le sol assez important, évalué à 1 million de tonnes par an pendant vingt ans si 50 % des terres arables sont converties au semis direct. Il est donc possible de stocker du carbone dans le sol, en convertissant la terre arable en forêt ou en prairie, en passant au semis direct, en enherbant les cultures permanentes et en s'attachant à une bonne gestion des prairies. Mais j'insiste sur le fait que ce stockage suppose une application des modifications sur vingt ans au minimum. Le plus important est donc de préserver les stocks existants plutôt que d'en créer de nouveaux. A cet égard, il est important de savoir qu'une décrue de 10 millions de tonnes du carbone stocké dans les sols du Royaume-Uni a eu lieu en trente ans, pour des raisons inconnues. D'autre part, l'augmentation de la température va peser sur le bilan. En réalité, on éprouve toujours des difficultés à adopter un point de vue suffisamment large pour ne pas aboutir à un résultat inverse de celui qui est escompté. Non seulement le stockage supplémentaire suppose des changements de pratiques massifs mais certains scientifiques estiment que les émissions de N2O devraient être au moins autant surveillées que celles de gaz carbonique. Or, il semble que le passage au semis direct les accroîtrait - mais tous ne sont pas d'accord avec cette hypothèse. De même, augmenter les surfaces de prairie signifie probablement élever davantage d'animaux, qui émettront plus de méthane. On a aussi parlé d'agriculture intensive, ce qui suppose de l'eau mais aussi des engrais, dont la fabrication demande du CO2 et qui émettent du N2O - et encore faut-il tenir compte de leur transport -. Une vision d'ensemble est donc nécessaire, mais elle est assez difficile à former. Que l'on se rappelle le méthane : on a cherché à le réduire en jouant uniquement sur l'alimentation du bétail, ce qui a conduit à la mise au point des farines animales. Ce faisant, on n'a tenu compte que de l'alimentation par tête, estimant que si l'on souhaitait la réduire il fallait l'enrichir. Mais si l'on considère le système d'élevage complet, on parvient à de tout autres conclusions. On ne peut donc s'en tenir à l'appréciation ponctuelle d'un seul élément de la chaîne ; il faut une vision intégrée pour une analyse globale. M. André CHASSAIGNE : Dans le Massif central, où je vis, la situation est grave en montagne et en moyenne montagne, car on arrive au stade où les multiples plantations faites au lendemain de la guerre sont coupées à blanc. Elles sont arrivées à maturité et ne sont plus exploitées. Les deux tempêtes successives ont suscité un immense découragement, tel que beaucoup de propriétaires forestiers ont baissé les bras. De plus, l'exode rural a fait que de 20 à 30 % des propriétaires ne sont pas connus. La conséquence, c'est une surface importante occupée par des plantations coupées et restées en l'état, des déchets laissés sur place, des racines brûlées qui fument pendant des mois au lieu d'être broyées et enterrées. Aucune politique volontariste n'est définie, aucun accompagnement n'est prévu alors qu'il y a là une richesse en biomasse considérable. Ne faudrait-il pas progressivement équiper les propriétaires forestiers de broyeuses, ce qui permettrait la production de plaquettes ? Si l'on veut parvenir à des activités agricoles complémentaires, il faut aller plus loin que le crédit d'impôt, qui est la seule aide actuelle. La prise de conscience collective doit s'accompagner de mesures d'accompagnement ciblées. M. Serge POIGNANT : Les coûts d'investissement dans la filière ligno-cellulosique ont-ils été étudiés ? Un bilan énergétique a-t-il été fait ? M. Claude ROY : Le futur plan de valorisation des ressources lignocellulosiques est fondé sur un travail de recherche et d'analyse partagé par plus de quarante pays. Des incertitudes demeurent sur le bilan carbone et sur le bilan énergétique de la filière B.T.L. (biocarburants de 2ème génération), mais l'on sait que l'on pourra mobiliser beaucoup plus de biomasse utile à l'hectare qu'avec l'éthanol, et a fortiori avec le biodiesel - ce qui ne signifie pas que l'on mettra une croix sur ces filières qui seront aussi valorisées en Chine - pour un coût qui devrait être compétitif avec celui qu'aura atteint le pétrole à l'horizon considéré. Cela étant, telle plante ne sera pas destinée à fabriquer tel produit : les gisements iront à ceux qui les payeront le plus cher, qu'ils soient pétroliers, papetiers ou chimistes. On envisage des contrats de livraison à terme, qui permettraient notamment le préfinancement des investissements et la garantie des approvisionnements. M. Hervé BICHAT : En réalité, il y a deux stratégies possibles : la première est agro-industrielle, la seconde est celle des territoires ruraux, avec l'objectif de les rendre autonomes en énergie, et l'on peut y parvenir. M. Pierre CUYPERS : En décembre dernier, les représentants de la communauté internationale réunis à Montréal ont défini un plan de bataille contre l'effet de serre. Si 34 Etats ont ratifié le protocole de Kyoto, les Etats-Unis et l'Australie, pollueurs géants, vont se développer sans trop de contraintes. Mais les pays qui ont ratifié le protocole de Kyoto n'ont pas abandonné le droit de se développer. De plus, la Chine et l'Inde émettront bientôt plus de gaz à effet de serre que les Etats-Unis. Demain, et même demain matin, nous devrons donc relever trois défis : celui de l'eau et de l'air ; celui de devoir nourrir 9 milliards d'êtres humains ; celui de l'énergie. Les agriculteurs ont pour devoir de protéger l'écosystème et de faire que, demain, la planète vive sereinement. Ils ont donc un rôle fondamental, hyperpositif et incontestable à jouer. L'agriculture est donc une chance pour notre pays, mais une agriculture moderne est une agriculture qui raisonne sur son efficacité et son économie. Si l'âge de pierre a pris fin, ce n'est pas faute de pierres mais parce qu'un projet a été défini pour l'agriculture, cette agriculture qui peut maintenant contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre par le stockage du carbone. Il convient, pour mener ce projet à bien, de réfléchir à l'institution d'un « crédit carbone ». Par ailleurs, l'utilisation de biocarburants pour le transport réduirait les émissions de 75 %. Aussi la FNSEA souhaite-t-elle le lancement de l'OPEB, autrement dit l'Organisation des paysans exportateurs de biomasse. M. François DOSE : L'agriculture, nous dit-on, contribue pour 12 % seulement aux émissions de gaz à effet de serre. Mais j'aimerais que l'on parte d'un produit alimentaire fini, qu'il soit d'origine laitière, carnée ou céréalière, et que l'on me dise ce qui, dans son élaboration, a été le plus consommateur d'énergie. Est-ce l'agriculture, la transformation, l'emballage, le transport ? Voilà ce qui m'intéresse ! M. Jacques PASQUIER : L'accélération des émissions de gaz à effet de serre contraint à aborder des questions d'ordre technique telles que la remise en cause des labours ou la production de biogaz. Cette piste est intéressante car la production de biogaz permet d'utiliser des déchets générateurs de gaz à effet de serre pour en faire une source d'énergie tout en économisant les carburants d'énergie fossile. Mais il y a aussi des modes de culture plus économes que d'autres et je suis en désaccord complet avec M. Claude Roy lorsqu'il présente l'intensification de la production comme indispensable. Il faut prendre le sol pour ce qu'il est, un support vivant. Or la stratégie d'intensification, à ce jour, a toujours envisagé le sol comme un support inerte. De plus, l'effet de serre dû à l'agriculture tient au moins autant à la production de protoxyde d'azote qu'à celle de gaz carbonique. Il est donc aggravé par l'agriculture intensive, qui utilise des engrais azotés, lesquels présentent le double inconvénient d'être fabriqués à partir d'énergie fossile et de générer l'émission de protoxyde d'azote. Il faut prendre garde que les solutions n'aggravent les problèmes. De ce point de vue, la filière actuelle des biocarburants est une arnaque intellectuelle onéreuse. Ainsi, la filière de l'éthanol ne produit rien, elle est coûteuse économiquement et écologiquement. Il faut donc remettre en cause la filière maïs - blé, la filière brésilienne de la canne à sucre ne présentant pas les mêmes caractéristiques. Cela amène à se poser la question de l'approche politique et stratégique et il me paraîtrait souhaitable que votre mission s'intéresse particulièrement au type d'agriculture souhaitable ainsi qu'aux mécanismes qu'elle doit mettre en œuvre. En particulier, si les biocarburants sont destinés à favoriser l'autonomie énergétique des régions, il faut en tirer les conséquences en termes de localisation des productions. N'oublions pas en outre que, pour 1 ha de maïs cultivé en France, 1 ha de soja est cultivé en Amérique, auquel il faut ajouter le transport. Ce mécanisme incohérent n'est en rien durable ! Il est temps aussi de se rendre compte que, du point de vue de l'effet de serre, la course à la productivité est une impasse. Mais j'insiste pour qu'on n'oublie pas la question de l'eau, qui me paraît plus importante encore. M. le Président : Je me réjouis que vous nous ayez fait entendre un point de vue différent. Il est évident que la question de l'eau est aussi essentielle. Je pense qu'il convient en particulier de s'intéresser aux plantes qui poussent spontanément sans eau en Afrique, ce qui fait qu'on dispose des gènes de résistance à la sécheresse. Les grandes firmes agrochimiques internationales travaillent trop peu sur ce sujet. Mme Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET, Rapporteure : J'aimerais que notre rapport nous permette de faire un bilan des biocarburants, à partir de plusieurs sources. Quels organismes pourraient nous y aider ? M. Claude ROY : Un éco-bilan certifié, carbone et énergie, réalisé par Price Waterhouse Coopers « De la charrue à l'essieu », sur la base de l'allocation massique en consommation énergétique, fait l'accord des organismes concernés aussi bien dans le secteur pétrolier que dans ceux de l'industrie et de l'agriculture. Même si certains contestent ce choix méthodologique, c'est celui qui est en vigueur pour tous les bilans de ce type. J'observe d'ailleurs que les éco-bilans du pétrole et du gaz ne sont pas aussi à jour, ni complets, que celui des biocarburants. Mme la Rapporteure : Si certains des participants à cette table ronde contestent le bilan de Price Waterhouse Coopers, je souhaite qu'ils me fassent parvenir leurs observations. M. Philippe TOURTELIER : Derrière cette question, il y a celle de la validité de la théorie des avantages comparatifs dans la production. Le maïs est un bon exemple et j'aimerais que nous approfondissions ces sujets du coût en transports et en CO2. M. le Président : Nous aurons l'occasion d'en parler lors des deux tables rondes consacrées aux questions internationales. M. Philippe TOURTELIER : N'oublions pas l'aspect économique ! M. André CHASSAIGNE : J'ai travaillé un peu, dans le cadre de la LOLF, sur l'évaluation des biocarburants. Si on ne tient pas compte de toutes les données, en particulier du coût en énergie de leur production, je crois qu'on pourra en effet parler de « fumisterie ». Or, des représentants de l'Institut de recherche pour l'ingénierie de l'agriculture et de l'environnement (CEMAGREF) et de l'INRA m'ont assuré que la recherche n'avait pas assez de moyens pour conduire les études dont nous avons besoin pour porter un regard transversal sur l'utilisation des biocarburants. M. Claude ROY : Ce n'est pas vrai. Je l'ai dit, il existe une étude d'Ecobilan désormais reconnue, et qui fait référence, toutes données incluses. Elle utilise la méthode éprouvée de l'allocation massique des « inputs » énergétiques. J'ajoute que le pétrole consommé est perdu pour tout le monde, tandis que le biocarburant est produit à nouveau l'année suivante et son coût intègre bien celui de son renouvellement, ce qui crée de la valeur ajoutée et de l'emploi supplémentaires. En outre, on n'intègre pas dans le coût des ressources fossiles celui des risques et des conflits géostratégiques et celui de la protection des gisements, payés par le contribuable. On ne peut donc vraiment pas comparer le coût économique des biocarburants et des carburants fossiles. M. le Président : Je propose que nous demandions directement leur avis à Price Waterhouse Coopers. Monsieur Schilansky, l'industrie pétrolière rejoint-elle cette comparaison des bilans énergétiques des biocarburants et des produits pétroliers ? La parole est à la défense. M. Jean-Louis SCHILANSKY : J'ai l'habitude de ne pas être très populaire dans ce genre d'enceintes. Je vous transmettrai ce qu'a réalisé notre centre européen de recherche en matière d'évaluation, mais je ne suis pas certain que nous ayons complètement approuvé l'étude de Price Waterhouse Coopers. Nous comprenons très bien la nécessité des énergies renouvelables : nous savons pertinemment que la place des énergies fossiles est appelée à diminuer et qu'il faut réduire les émissions de CO2. C'est pourquoi nous avons dit que nous étions prêts à participer au plan annoncé par le gouvernement pour augmenter la proportion de biocarburants dans les essences. Lors d'une table ronde en présence du ministre de l'agriculture, nous nous sommes engagés à créer des bases qui permettront d'incorporer de l'éthanol et d'utiliser des diesters. Je rappelle que l'industrie pétrolière traite 300 000 tonnes de produits par jour, qu'elle est complètement transparente, que tous ses prix sont connus, qu'elle est extrêmement compétitive, que ses marges de manœuvre sont très faibles - 1 centime par litre en raffinerie - distribution pour l'ensemble de la filière -, qu'elle vit sans subvention, qu'aujourd'hui, un litre de carburant vendu à la pompe est moins cher qu'un litre d'eau minérale hors taxe. C'est tout cela qu'il faut avoir en tête quand on parle de produits de substitution à l'industrie pétrolière, afin que les consommateurs ne paient pas plus que ce qu'ils paient aujourd'hui. Pour nous, qui sommes des opérateurs de terrain, la question fondamentale est celle de l'arbitrage entre la croissance économique, pour laquelle l'énergie fossile est prédominante, et les risques liés à l'effet de serre. Manifestement, les États-Unis ont choisi la première. M. Joseph RACAPE : Compte tenu de mes fonctions à la MIES, je vais essayer de recadrer le débat. Les émissions de l'agriculture ont été de 107 millions de tonnes équivalent CO2 en 1990, soit plutôt 20 % que 12 ou 18 % du total français de 542,7 millions de tonnes. On prend en compte essentiellement les émissions de méthane et de protoxyde d'azote. Pour le méthane, 19 millions de tonnes viennent des déjections animales. Dans le cadre du Plan Climat, si on réalisait 50 installations de captage de méthane de taille moyenne, on réduirait ces émissions de 0,5 million de tonnes. Pour la fertilisation, en diminuant de 10 % la dose d'azote, on économiserait un million de tonnes de CO2 sur un total de 50 millions de tonnes d'émissions. Voilà deux pistes d'action. Les forêts présentent la capacité de stocker du carbone, à hauteur de 41,7 millions de tonnes. Mais ce stockage s'arrête lorsque les arbres arrivent à maturité et il faut tenir compte des aléas climatiques et des incendies. Les Canadiens, qui fondent de grands espoirs sur leurs forêts pour stocker du carbone dans le cadre du protocole de Kyoto, ont ainsi connu de gigantesques incendies ces dernières années. Le carburant utilisé par agriculture représente 10 millions de tonnes équivalent CO2. Le Plan Climat prévoyait le réglage de tous les tracteurs. Cela n'a été que fort peu réalisé, alors que régler la totalité du parc aura permis de réduire les émissions de 0,4 million de tonnes. M. le Président : Nous avions soutenu cette proposition. D'où est venu le blocage ? M. Joseph RACAPE : Les crédits de l'Agence gouvernementale de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) n'ont pas été engagés. Il s'agissait d'un dispositif fondé sur le volontariat, mis en œuvre par les coopératives d'utilisation de matériel agricole (CUMA) qui disposent de bancs pour contrôler les tracteurs. Mais elles ne parviennent à en contrôler que 2 000 par an, ce qui est très peu. Le coût n'est pas très important, l'économie pour les agriculteurs est réelle, mais il n'y a pas eu ce petit coup de pouce qu'aurait donné un soutien public. On évalue à 7 millions de tonnes les émissions de gaz de serre qui ont pour source la fabrication des engrais minéraux, dont une partie de la production n'est pas faite en France ; ce tonnage est comptabilisé hors agriculture. Quant au bois de chauffage, il représente 19,7 millions de tonnes équivalent CO2, volume qui pourrait aisément être doublé ou triplé car tous les rapports font état de bois pourrissant en forêt dans des proportions considérables. M. le Président : La question du transport demeure. M. Claude ROY : Les quantités d'intrants utilisées en agriculture augmentent, certes, en valeur absolue, mais diminuent régulièrement, de plus de 1% par an, si elles sont rapportées au volumes produits. De même le volume de bois énergie domestique régresse lentement mais, grâce à la performance accrue du parc installé, l'énergie utile finalement substituée augmente. M. Joseph RACAPÉ : Les émissions liées aux bâtiments agricoles sont également comptabilisées hors agriculture, et l'on peut aussi agir dans ce domaine. Quant à la production actuelle de biocarburants, elle équivaut à quelque 1,2 million de tonnes équivalent CO2, je rappelle que le Plan Climat fixe un objectif indicatif de 7,3 millions de tonnes équivalent CO2 en 2010. Enfin, si 10 millions d'hectares de terres agricoles bénéficient de pratiques culturales améliorées, elles permettent un stockage de 4 millions de tonnes équivalent CO2, et il existe des synergies environnementales additionnelles. M. le Président : J'aurais préféré vous entendre dire ce avec quoi la MIES est d'accord et ce avec quoi elle ne l'est pas. M. Arthur RIEDACKER : Pour répondre aux interrogations qui ont surgi, seule vaut une approche intégrée, sans laquelle on peut dire des choses à moitié justes ou complètement fausses qui ne peuvent conduire à une action cohérente. Voilà pourquoi l'INRA a publié un document intitulé « Elaborer des approches intégrées pour réduire les émissions de gaz à effet de serre de l'agriculture, des forêts et de leurs produits jusqu'en fin de vie ». C'est la seule étude française qui tient compte des dimensions spatiale et temporelle de la question. Or, une vision globale est indispensable, tant au niveau national qu'international et nous souhaitons poursuivre ce travail commencé avec l'ADEME avec des moyens accrus, en hommes notamment. Nous envisageons aussi une coopération avec les Canadiens concepteurs du modèle d'évaluation des émissions de gaz à effet de serre provenant de l'agriculture que nous avons utilisée. Une approche intégrée est essentielle sur le plan planétaire et la France a une responsabilité particulière en ce domaine. Nous plaidons pour qu'elle continue à aider les pays d'Afrique subsaharienne à intensifier leur agriculture, sans quoi le déboisement conduira au renforcement de l'effet de serre. En résumé, davantage de moyens sont nécessaires pour une approche intégrée et pour aider l'Afrique subsaharienne à intensifier son agriculture et à valoriser la biomasse. M. Guy VASSEUR : Le dossier est très complexe, car les sources d'évaluation de ce qui se passe en France sont divergentes. Dans ces conditions, on peut s'interroger sur les moyens de parvenir à la mise au point de solutions efficaces. Je plaide en faveur d'une approche exhaustive, ce qui suppose le renforcement de la recherche car, en matière agricole, la solution ne se résume pas aux biocarburants, mais inclut la valorisation de toutes les potentialités de la biomasse. Ainsi, si l'on encourageait la méthanisation à partir des effluents d'élevage en France comme on le fait en Allemagne ou comme on encourage l'éolien, on aurait des réponses plus rapides. S'agissant du réglage des tracteurs, on ne peut que déplorer que si peu sont passés au banc d'essai. Des chambres d'agriculture se sont impliquées dans la démarche, mais elle a un coût et ne rencontre quelque succès que lorsque les collectivités font levier. Pour ce qui concerne la construction des bâtiments, l'isolation devrait permettre des économies d'énergie. J'en viens aux biocarburants pour dire que, non, l'éthanol n'est pas une « arnaque intellectuelle ». Nous vous transmettrons les bilans que vous nous avez demandés, qu'il s'agisse des méthodes culturales et de production ou de la consommation d'eau. Vous constaterez que nous avons défini des chartes relatives au diester et à l'éthanol. Certes, nos méthodes de production doivent évoluer pour résoudre les problèmes de sol et d'eau, mais il est trop facile d'accuser en permanence le maïs de tous les maux car il ne consomme pas plus d'eau que d'autres productions. S'agissant du non-labour, la recherche doit encore progresser pour éviter que la généralisation d'une telle méthode crée d'autres problèmes, comme une plus grande utilisation de pesticides. Une vision d'ensemble est indispensable. La France ayant la chance d'avoir l'INRA, le législateur doit donner des moyens supplémentaires à la recherche. M. le Président : M. Hervé Bichat a expliqué que l'on peut valoriser le méthane. En sa qualité de président du groupe de développement du biogaz en Lorraine, M. Christian Thiébaut va nous décrire son expérience en la matière et nous dire quels sont les freins au développement de la filière. M. Christian THIÉBAUT : J'insiste à mon tour sur la nécessité d'une approche globale ; les chercheurs doivent nous donner les outils qui permettront d'éviter les erreurs. Ainsi, il serait aberrant de procéder à une méthanisation dont la réalisation induirait une consommation équivalente à « l'économie » réalisée. A notre niveau - local -, nous nous sommes donc fondés sur les 3 000 à 4 000 expérimentations conduites en Allemagne et dans certains pays d'Europe centrale et orientale, mais en tenant compte des erreurs commises quant à l'effet de serre. S'agissant du biogaz, tout reste à faire en France. M. le Président : Combien d'expérimentations ont lieu en France, en tout ? M. Claude ROY : On recense 220 sites de méthanisation industriels ou collectifs opérationnels pour une production utile de 200 000 Tep/an. M. Christian THIÉBAUT : Mais seules deux installations de méthanisation à la ferme viennent de s'ouvrir, en Lorraine et Champagne-Ardennes. Pourtant, avant de songer à supprimer les élevages bovins pour contribuer à la réduction des effets de serre, on pourrait peut-être mettre en œuvre des méthodes de gestion des effluents qui contribueraient à réduire les gaz à effet de serre. Sur le plan local, les freins sont le manque d'expérience, puisque toutes nos références sont européennes, mais aussi les considérations économiques. Le bilan des installations agricoles n'est pas équilibré car le niveau de rachat de l'électricité est trop bas. Ce doit être un objectif politique de les augmenter pour rendre les exploitations viables. Actuellement, nous sommes soumis à deux seuils puisque le prix de rachat, déjà faible, est divisé par deux au-delà de 36 kVA. En bref, les freins au développement de la filière sont l'insuffisance de la recherche ; le seuil de 36 kVA, qui doit disparaître car il n'a plus de raison d'être ; le prix de rachat de l'électricité, à revoir pour que des installations de taille modeste puissent prospérer. Il n'y a actuellement pas de développement, quelle que soit la taille des installations. M. le Président : Je me félicite que cette table ronde ait permis de déterminer les points de blocage. Peut-on considérer la méthanisation comme une activité viable pour le secteur rural ? M. Claude ROY : L'ADEME a tenté, pendant cinq ans, de faire sortir un plan « méthanisation » en France. Mais six directions d'administration centrales différente, dans trois ministères, ont à voir avec cette question. D'où les difficultés. Il existe plusieurs types de méthanisation. La première, « à la ferme » ou « sur site industriel », est la valorisation des effluents. C'est une méthode agricole, ce qui n'en fait pas véritablement une politique énergétique, mais c'est une excellente manière d'assurer une certaine autonomie à l'exploitation et à la gestion, et c'est une excellente voie de dépollution et de désodorisation, par exemple dans le cadre du Programme de maîtrise des pollutions d'origine agricole (PMPOA). Il y a aussi la co-méthanisation qui produit à la fois électricité et chaleur en grosse puissance à partir de la collecte de proximité de tous les déchets fermentescibles d'un territoire donné. Un magnifique projet avait été conçu à cette fin à Lannilis, dans les Côtes d'Armor, par des associations et partenaires locaux, et l'on pourrait construire trente installations de ce type en France. Comme l'a dit M. Thiébaut, la difficulté tient au tarif de rachat de l'électricité. Actuellement, ce tarif est le même pour l'électricité produite par une unité de méthanisation construite de toutes pièces que pour le biogaz de décharge, qui est fatal et dont la récupération est légalement obligatoire. Cet exemple montre de manière flagrante que le sujet n'a pas été traité globalement alors qu'il y a là un enjeu très important de structuration du territoire. M. Christian THIÉBAUT : En réalité, comme nous touchons à de nombreux domaines, nous intéressons tout le monde et personne. Une table ronde spécialisée devrait être réunie pour faire avancer les choses. M. Claude ROY : La leçon à tirer, c'est que le développement de la méthanisation doit être promu au niveau des régions et non de celui des administrations centrales. Ce doit être une politique territoriale animée, certes, sur le plan technique, au niveau central. M. le Président : Si le prix de rachat de l'électricité n'est pas décidé au niveau central, on ne s'en sortira pas. Mais nous vous avons entendus et nous essayerons de vous aider. M. Claude ROY : Le futur plan Combustibles sera un élément clé de définition de la politique en cette matière. Les enjeux sont très forts. M. Hervé BICHAT : Les situations sont très diverses selon les régions et, dans ce domaine, c'est la Bretagne qui devrait être région pilote, sur le modèle de ce qui se fait au Danemark. M. Joseph RACAPÉ : Pour l'instant, nous dotons nos concurrents étrangers d'installations de méthanisation que nous n'avons pas encore. M. Arthur RIEDACKER : Puis-je faire observer qu'aussi longtemps le prix de rachat de l'électricité demeurera trop bas, tout cela tiendra du rêve ? M. Serge POIGNANT : Et aussi longtemps que le seuil de 36 kVA ne sera pas abrogé. M. Claude ROY : Selon moi, le prix de la bio-électricité ainsi produite devrait être doublé. J'insiste sur l'inventivité qui prévaut en Bretagne, où l'on a déjà, par exemple, construit une serre alimentée en « quinqua-génération », où tout est valorisé à partir d'une bio-centrale d'alimentation : chaleur, froid, électricité, cendres et . CO2 (comme fertilisant gazeux pour les plants). M. le Président : Je remercie tous les intervenants, dont la Mission attend maintenant la documentation écrite qui lui permettra de tenter de faire lever les blocages au développement de la biomasse et des biocarburants. M. Claude ROY : Je tiens à redire que la première condition d'une agriculture et d'une sylviculture performantes, c'est la préservation du sol et de la ressource en eau. Passer outre serait ignorer l'avenir. Audition de M. Jean-Louis ETIENNE, Présidence de M. Jean-Yves LE DEAUT, Président M. le Président : J'ai le plaisir d'accueillir M. Jean- Louis Etienne, médecin et explorateur. Observateur privilégié, il a accepté de nous exposer sa vision de l'impact du réchauffement, de nous faire part de ses convictions et de nous indiquer quels moyens permettraient de sensibiliser la population aux phénomènes à l'œuvre. Monsieur Etienne, la mission vous entendra avec un grand intérêt. M. Jean-Louis ETIENNE : Pour être un observateur de terrain, je puis témoigner que les régions polaires que je fréquente sont les témoins à la fois du changement climatique et de l'impact des activités humaines sur ce changement. Au pôle Sud, l'Antarctique est une étendue vaste 28 fois comme la France, nappée d'une couche de glace de 2,5 km ; il s'agit d'eau douce gelée, et l'on trouve là 70 % de la réserve d'eau douce de la planète. Quant au pôle Nord, il est au centre d'un océan gelé ; l'épaisseur moyenne de la banquise qui le recouvre est de 2,70 mètres, une coquille d'œuf dérisoire rapportée aux 4 000 à 5 000 mètres de profondeur de l'océan Arctique. La machine climatique terrestre fonctionne grâce à l'équilibre entre l'extrême chaleur équatoriale et le froid des deux régions polaires. Au Sud, la pérennité du froid est donc assurée par un immense glaçon, au Nord par une banquise fine et fragile. Il y a chaque année quatre mois d'ensoleillement efficace au pôle Nord mais, par effet d'albédo, il demeure gelé parce que le blanc de la calotte polaire réfléchit dans l'espace les rayons du soleil. Le phénomène actuel, qui ne fait que s'accélérer, est le rétrécissement de la surface de la banquise. Cette structure est soumise à une tectonique permanente qui, de tout temps, a été à l'origine de fractures suivies de regel. Mais le délai de regel est désormais beaucoup plus long et dans les fractures apparaît le noir de l'océan, qui capte les rayons solaires et fait fondre la glace alentour. Il s'ensuit une accélération du processus, et le pôle Nord est la région qui souffre le plus du changement climatique. Pour moi, qui fréquente ces lieux depuis vingt ans, il s'agit là d'une réalité certaine, qui trouve des traductions pratiques. Ainsi, les pilotes d'hélicoptères n'acceptent plus de se poser sur la banquise si l'on ne s'est pas d'abord assuré par sondage que la couche gelée est suffisamment solide ; cette prise de garantie n'avait pas lieu d'être il y a quinze ans. Un amincissement très marqué de la banquise a donc eu lieu, conséquence du réchauffement. La signature humaine se retrouve aussi dans l'Antarctique, puisque des bulles d'air sont enfermées dans l'épaisseur des glaces, qui enregistrent 650 000 années de mémoire de la composition de l'air. Or, les derniers forages glaciaires faits dans le cadre du programme européen EPICA sur le site de Dôme Concordia montrent une accélération prodigieuse du taux de CO2 atmosphérique au cours des deux derniers siècles. Les peuples de ces régions, qui sont des peuples de chasseurs, subissent ces phénomènes. Au Groenland, la glace est devenue incertaine au point d'être parfois infréquentable. On assiste aussi à la fonte du permafrost en Sibérie et dans les régions septentrionales du Canada, où toutes les infrastructures sont abîmées, qu'il s'agisse des maisons sur pilotis, désormais bancales, ou des routes. En Alaska, la circulation des camions est maintenant interdite pendant certaines périodes, ce qui induit des pertes pour les sociétés pétrolières. Sur le plan biologique, certaines espèces qui dépendent de la banquise sont extrêmement menacées. Il en est ainsi de l'ours, qui se nourrit à 80 % de phoques mais qui n'est pas un bon nageur. La faune est aussi affectée par la migration vers le Nord d'espèces qui n'y vivaient pas auparavant ; par exemple, le renard roux fait reculer le renard blanc. Cela étant, les conséquences du réchauffement ne sont pas néfastes pour tout le monde, car il a aussi pour effet de libérer une partie du plateau continental en Sibérie et au Canada, ce qui donne accès à de nouvelles richesses minières et pétrolières et permettra l'ouverture de nouvelles voies navigables au Nord et au Nord-Ouest avec, en corollaire, des gains de temps de transport considérables. Le Canada et la Norvège s'y préparent ; ainsi des acquisitions de terrains ont déjà lieu à Churchill en prévision d'installations portuaires de grande envergure. L'ouverture de ces nouvelles voies navigables sera facteur d'économies considérables, mais l'on voit déjà qu'elle créera des problèmes de souveraineté car le Canada considère être chez lui et les Etats-Unis tiennent pour leur part qu'il s'agit d'eaux internationales. Au-delà de ces questions d'ordre diplomatique, on ne peut ignorer que ces nouveaux passages auront un impact sur des territoires déjà fragiles. En bref, ceux qui ne croient pas à l'impact du réchauffement climatique devraient se rendre sur place et parler avec ceux qui y vivent des phénomènes en cours. Chacun se rappelle la polémique relative à la couche d'ozone. Qui s'allonge dans un champ et regarde le ciel a du mal à imaginer que l'activité humaine puisse avoir un impact sur la couche atmosphérique qui enveloppe la Terre. Pourtant, celle qui est utile à la respiration ne représente qu'une fine pellicule, constituée à 79 % d'azote, à 20 % d'oxygène - qui ne participe en rien à l'effet de serre - et à 1 % de gaz rares dont le gaz carbonique. Mais cet insignifiant pourcentage peut aisément être renforcé par nos activités. Sur ce qui se passe actuellement, il n'y a aucune polémique au sein de la communauté scientifique ; les seules divergences portent sur l'appréciation des conséquences. En réalité, nous sommes en train de procéder à une sorte de double vitrage en renforçant progressivement la protection atmosphérique de la planète. La machine climatique terrestre est ainsi faite que la moitié de la surchauffe équatoriale est évacuée par l'air et l'autre moitié vers les pôles par les océans. Qu'en est-il actuellement ? Certains estiment qu'en 2050 la majorité de la banquise du pôle Nord fondra en été ; il en résultera, entre autres conséquences, la fonte du Groenland et la modification de la salinité des eaux. Le Gulf Stream pourrait infléchir sa trajectoire et la façade atlantique de l'Europe connaîtrait alors un climat plus froid dans un contexte global de réchauffement climatique. Il faut en effet s'attendre à des modifications climatiques régionales, auxquelles nous sommes particulièrement exposés si la température augmente de 3 à 6 degrés dans un siècle. Ce ne sont, certes, que des prévisions, mais nous nous acheminons vers l'accident climatique de l'humanité. Deux défis devront donc être relevés : lutter contre l'aggravation de l'effet de serre en limitant la production de gaz carbonique et trouver d'autres sources d'énergie que les énergies fossiles. Il y a une urgence climatique, mais elle ouvre des perspectives formidables puisqu'il faut mettre au point d'autres techniques, et au plus vite. Considérons la filière pétrolière : entre recherche, prospection, découverte, raffinage, distribution et consommation, nous sommes pris dans une sorte de toile d'araignée. Il faudra pourtant trouver de nouvelles ressources énergétiques, à tous les niveaux, car même si nous faisons des économies les besoins vont croître, puisque nous serons de plus en plus nombreux. Voilà qui a de quoi enthousiasmer les jeunes, car c'est bien un changement de civilisation qu'il faut concevoir et mettre en œuvre. M. le Président : Je vous remercie pour cet exposé. Quelle est la situation de l'atoll de Clipperton ? M. Jean-Louis ETIENNE : A Clipperton, le corail est en très bonne santé, si bien que le récif progresse de 1 à 2 cm par an, ce qui compense la montée des eaux. Il en ira ainsi aussi longtemps que la température de l'océan n'augmentera pas car à partir de 30 degrés le corail meurt. La pellicule corallienne vivante est d'une extrême finesse ; lorsqu'elle meurt, ne subsiste en dessous que de la craie. Voilà pourquoi le réchauffement des eaux peut-être néfaste. On l'a vu en Polynésie, quand des phénomènes du type El Ni__n_o ont rendu l'eau de surface arrivée d'Asie beaucoup plus chaude - alors le corail meurt, et l'île avec lui. Mais si l'atoll Clipperton n'est pas affecté par le réchauffement climatique, on y constate deux altérations à l'environnement : des centaines de tonnes de sachets en plastique s'échouent sur les côtes et la surpêche a pour conséquence que les oiseaux de mer meurent de faim en nombre. Mme Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET, Rapporteure : Selon vous, la sensibilisation au changement climatique est-elle la même dans tous les pays et peut-on espérer parvenir au salut par le biais de négociations internationales ? M. Jean-Louis ETIENNE : La prise de conscience est universelle et elle a été renforcée par les nouvelles technologies de communication, diffusées dans tous les pays, même les plus pauvres. Mais les moyens et les priorités diffèrent. Que feront les Etats-Unis, pays dans lequel les véhicules 4x4, énormes au regard de ceux qui circulent en Europe, consomment jusqu'à 25 litres au 100 km ? Que le pic de production soit ou non déjà atteint, les réserves d'énergie fossile sont comptées pour tous puisque les stocks ne sont pas renouvelables. Qui aura accès à la réserve maximale ? Ces questions doivent être débattues. On se félicitera donc que le Protocole de Kyoto ait été mis au point, aussi difficile soit-il à appliquer, car il est contraignant. La couche d'ozone a été, en quelque sorte, la première star de l'environnement dans les années 1985 et 1986, et aussi l'un des moteurs de la prise de conscience à l'échelle internationale. Mais, dans ce cas, on connaissait la molécule « coupable » et ses producteurs. Les questions en jeu dans le Protocole de Kyoto sont autrement plus complexes mais il est déjà formidable que le texte existe. Le Traité de l'Antarctique, conclu en décembre 1959, accordait à l'Antarctique le statut de zone internationale et la protégeait des convoitises en la réservant à la seule coopération scientifique internationale. Mais lorsque ce texte merveilleux est arrivé à échéance, en 1989, Japonais, Australiens et Américains ont commencé à parler de l'accès aux richesses de ces territoires. Jacques-Yves Cousteau a alors conduit une action résolue contre les menaces qui pesaient sur l'Antarctique, la France a refusé le projet de nouveau protocole et, au cours des négociations qui ont repris à Madrid, les Etats-Unis ont accepté un moratoire, jusqu'en 2041, pour l'exploitation des richesses de l'Antarctique. C'est un exemple parmi d'autres qu'il est difficile de convaincre un pays qui se pense en roi du monde. Il faut parler de ces choses aux enfants, eux qui, dans le futur, prendront les décisions, et faire comprendre à tous que c'est aujourd'hui qu'il faut agir. M. Serge POIGNANT : J'apprécie votre approche, à la fois alarmiste et porteuse de perspectives. Certains scientifiques nous ont exposé qu'une augmentation de 2 degrés des températures moyennes supposera des adaptations mais qu'elle serait supportable. Mais quelles seraient les conséquences d'une augmentation de la température de 6 degrés ? Faut-il s'attendre à la fonte des glaciers ? M. Jean-Louis ETIENNE : Au cours du XXe siècle, l'augmentation de la température moyenne a été de 0,6 %, mais, en soixante ans, elle a été de 3 degrés en été et de 5 degrés en hiver en Alaska et au Canada de l'Ouest. Le niveau des mers dépendra de la dilatation et de la fonte des glaces. La grande réserve est celle de l'Antarctique, qui est très bien protégée mais qui flotte sur un océan dont la température est actuellement de moins un degré en hiver et de 0,1 degré en été. Il y a donc un grignotement du glacier, ce qui risque de faire monter le niveau des océans. Voilà la seule réponse que je puisse vous offrir. M. le Président : En votre double qualité de scientifique et d'explorateur, vous avez vérifié les indices du réchauffement et réfléchi à ce que devraient être les priorités d'action. Pourriez-vous les préciser ? Quelle est votre opinion sur les utilisations respectives du pétrole, du charbon, de l'énergie nucléaire et des énergies renouvelables ? M. Jean-Louis ETIENNE : A mon avis, toutes les énergies renouvelables sont bonnes à prendre. C'est ce qui m'a conduit à accepter l'érection de six éoliennes à côté de chez moi, dans le Tarn. Puisqu'il faut en passer par là, on ne peut tenir un double langage. D'ailleurs, il faut mettre les choses en perspective : si l'on observe les forêts de pylônes qui supportent les câbles de l'électricité à haute tension à l'entrée de certains villages, on se dit que quelques éoliennes ne sont rien ! De surcroît, nous sommes en période de transition. Les éoliennes contribuent, en ce moment, à ce qui peut être fait, et l'on aurait tort de s'en priver. Le thermique solaire est dramatiquement sous-développé en France, ce qui n'est le cas ni en Italie ni en Grèce, ni même en Allemagne maintenant. L'énergie photovoltaïque peut être une énergie d'appoint dans les zones isolées ; l'utilisation de la biomasse doit participer du mouvement général puisqu'il faut, si l'on peut dire, faire feu de tout bois. La question cruciale est celle du nucléaire. Si l'on tient compte de l'augmentation prévisible des besoins des générations futures et du coût croissant de l'accès au pétrole, au gaz et au charbon, et sachant que la mise en œuvre effective du projet ITER n'aura lieu que dans un futur lointain, je pense que l'on n'y échappera pas. De plus, l'industrie nucléaire est encore dans une phase « adolescente » mais les perspectives d'évolution existent, qu'il s'agisse du traitement des déchets ultimes ou des nouveaux générateurs. On ne peut se priver d'appliquer la merveilleuse découverte d'Einstein, que ce soit pour la fusion ou pour la fission. Evidemment, il y a une forte connotation militaire à l'évocation du nucléaire, avec les illustrations dramatiques que l'on sait, mais il y a aussi un manque de communication et une mauvaise information. Pour autant, étant donné l'écheveau complexe dans lequel nous sommes pris, nous n'avons pas le droit de reculer devant l'exploitation de la ressource nucléaire pour produire de l'électricité mais aussi de l'hydrogène, vecteur de première importance, et ceux qui s'y opposent imposent la prise de mesures délicates pour tenter de prévenir détournements et risques y afférents. S'agissant du pétrole, il est difficile d'appréhender avec précision l'état des réserves car les compagnies pétrolières ne disent pas ce qu'elles sont réellement, mais le pic de production pourrait être atteint aux environs de 2015. Jusqu'à présent, on a dépensé en enfants gâtés une ressource très bon marché que l'on a considérée comme éternelle ; elle va entrer en phase de décroissance alors que les besoins augmentent. Qui aura accès à une ressource inéluctablement appelée à se raréfier ? Qui va payer ? Ce qui s'est passé en Irak est un exemple de mainmise sur ces réserves. Or, c'est un pot commun à partager. Comment ? Décidera-t-on d'attribuer un quantum aux pays pauvres ? Nous aurons accès aux piles à combustible, mais qu'adviendra-t-il de la moitié de l'humanité, celle qui survit grâce à l'ingéniosité de bricoleurs de génie ? Comment passeront-ils de lampes à pétroles améliorées à l'hyper-sophistication des piles à combustible ? Voilà qui appelle une réflexion de fond, avant que les pays riches n'érigent de nouveaux murs de protection. Voyez, déjà, les dépenses d'armement colossales engagées par les Etats-Unis pour protéger leurs navires de transport de ressources énergétiques ! Va-t-on revenir au bois ? Les panneaux solaires, en tout cas, permettront sûrement d'aider cette moitié de l'humanité à se fournir en nouvelles ressources énergétiques. Mme la Rapporteure : Comment fixez-vous le pic de production du pétrole à 2015 ? M. Jean-Louis ETIENNE : En prenant pour référence La vie après le pétrole, que l'ingénieur Jean-Luc Wingert a rédigé en prenant pour consultants des retraités des compagnies pétrolières qui se sont sentis libérés de leur devoir de réserve. Il évoque un pic de production à 2015 ou 2030. M. le Président : Le directeur exécutif de l'Agence internationale de l'énergie (AIE) estimait hier devant nous que le pic de production serait atteint dans vingt à vingt-cinq ans, faisant allusion à des réserves de pétrole en Arabie saoudite, en Sibérie et dans le grand Nord canadien, et au fonds des océans. Pour sa part, M. Yves Cochet considère que le pic est déjà atteint. Que penser de ces divergences d'appréciation ? M. Jean-Louis ETIENNE : Dans tous les cas, c'est aujourd'hui ! Alors que nous devons faire face à une double urgence, climatique et énergétique, ce n'est vraiment pas la peine de discuter pour quelques décennies. L'humanité est à un grand tournant, et je recommande vivement à tous les jeunes biologistes qui souhaitent s'occuper de la préservation de l'environnement d'entreprendre des études d'ingénieur. Ce qui importe, c'est de fabriquer les moteurs qui consommeront le moins d'énergie possible, ou de travailler au recyclage des effluents. La préservation de l'environnement suppose de résoudre des problèmes technologiques de haut niveau. Mme Martine BILLARD : Votre manière de présenter les choses est passionnante. Il en ressort que l'important est de faire comprendre que l'ère du tout-pétrole est terminée et qu'il faut agir maintenant. Je ne me retrouve pas dans votre approche du nucléaire, mais je ne m'attarderai pas sur ce point. Je note cependant que vous n'avez pas évoqué le choix d'une civilisation plus économe, qui utiliserait les ressources de manière plus planifiée - étant entendu que je ne parle pas d'une planification à la soviétique -. S'agissant par exemple de l'utilisation du pétrole, on parle des routes, des bâtiments, de l'agriculture, mais on ne dit rien du plastique qui a envahi notre univers. Ne pourrait-on concevoir un modèle de société dépassant la civilisation du pétrole tout en laissant un mode de vie agréable ? M. Jean-Louis ETIENNE : Qu'il faille économiser l'énergie va de soi, c'est indispensable. Pour autant, si l'on peut, à titre personnel, décider de changer de mode de vie, il semble très difficile d'amener tout un pays à faire profil bas. Mais cela ne dispense pas d'en venir à une culture de l'économie d'énergie et de rechercher un progrès technologique orienté en ce sens. Ainsi, si l'on construit des voitures qui consomment 3,5 litres aux cent kilomètres, on continuera à se déplacer mais de manière économe en énergie. Faut-il deux voitures pour une famille ? Je ne le pense pas. Le train est un mode de transport très développé en France, ce qui est très bien. Pour ce qui est des avions, cela peut paraître une erreur de construire des A380, dont la consommation de pétrole sera considérable, mais elle sera significativement plus basse que celle de deux A320. Les nouvelles technologies de la communication, qui permettent le télétravail, sont aussi un facteur d'économie d'énergies. Mais si l'indispensable régime amaigrissant ne s'accompagne pas d'un progrès, cela ne fonctionnera pas. Il est difficile de transformer les comportements, mais je crois à l'éducation. Ma génération, celle des sexagénaires, n'a pas eu, dès sa naissance, conscience de la fragilité de la nature. Un outil pédagogique est maintenant nécessaire pour créer au sein des jeunes générations une attitude de respect de l'environnement. Il faut susciter une conscience environnementale dans des esprits neufs, pour lesquels ce sera une priorité permanente, et je suis persuadé que l'éducation est un outil essentiel à cette fin. M. André CHASSAIGNE : J'apprécie également votre manière d'aborder la question. J'aimerais vous entendre préciser les conséquences de la fonte de la banquise pour la façade atlantique de l'Europe. M. Paul Vergès nous a expliqué que l'augmentation d'un degré de la température moyenne aurait pour conséquence l'inondation de kilomètres de terres bordelaises. Qu'en pensez-vous ? Quelles seraient d'autre part les conséquences de l'inflexion du parcours du Gulf Stream ? M. Jean-Louis ETIENNE : La montée des océans est liée à la dilatation et une érosion se produit déjà, dont il faut tenir compte. Nous ne sommes pas exposés à ce phénomène comme le sont les pays de deltas, sinon en Camargue, mais des digues y ont été érigées. A ce sujet aussi, l'alerte est lancée, et il faut agir vite. M. Alain GEST : Etes-vous assez optimiste pour penser que l'on pourra répondre dans des délais suffisants à l'urgence que vous décrivez comme avérée par la seule sensibilisation ? M. Jean-Louis ETIENNE : Je suis condamné à l'optimisme ! Mais je note que l'humanité a évolué par successions de chaos, comme le montrent les guerres. Dans le cas qui nous occupe, il faudrait agir avant que le chaos ne se produise. Or, la situation est à peu près celle d'un troupeau de bisons qui arrive à une falaise alors qu'il est lancé en pleine course. Pour que nul ne tombe, l'ensemble du troupeau doit ralentir de manière homogène avant de faire « arrière toute » ; la manœuvre est complexe. Pour ce qui nous concerne, une éducation permanente à l'environnement est indispensable ; pour moi, elle relève de l'instruction civique. Je n'ai pas d'autres réponses, sinon de dire que les hommes politiques ont le devoir d'informer et que je me félicite que l'éducation à l'environnement en vue du développement durable soit officiellement inscrite dans les programmes de l'Education nationale depuis l'an dernier - ce qui dit le retard pris, mais qui rend optimiste. On commence à dire « arrière toute », mais il faudra du temps pour que la machine s'arrête. M. Alain GEST : Sans aller jusqu'aux mesures radicales qui ont été énoncées devant nous - tripler, par exemple, le prix du carburant - peut-on s'en tenir à la seule sensibilisation ? M. Vincent ROLLAND : Nous sommes tous convaincus de la nécessité d'informer, mais des politiques restrictives et contraignantes ne sont-elles pas nécessaires pour les carburants ? Pour le traitement des ordures ménagères, faut-il privilégier le « tout incinération » et imaginer des politiques fiscales incitatives ? M. Jean-Louis ETIENNE : S'agissant du traitement des déchets, il m'est arrivé de décevoir en soutenant un projet industriel, après avoir expliqué qu'il fallait considérer ces déchets comme une matière première. Puisque l'on n'évitera pas de devoir traiter les déchets même si on limite les emballages, nul ne peut dire « pas de ça chez moi ». En revanche, il est légitime de formuler de fortes exigences de qualité quant au projet lui-même. J'ai conscience que ces questions sont difficiles à traiter sur le plan politique, mais le médecin généraliste titulaire d'un CAP d'ajusteur que je suis sait qu'entre l'utopie et la nécessité d'agir pour répondre à l'urgence, il y a place pour le pragmatisme. M. le Président : Monsieur Etienne, je vous remercie. Table ronde sur le rôle du bâtiment et de l'habitat dans la lutte contre le changement climatique, réunissant : Présidence de M. Jean-Yves LE DEAUT, Président M. le Président : Je souhaite la bienvenue à M. Didier Lenoir, président du CLER, à M. Pascal Eveillard, directeur du marketing et de développement de Saint-Gobain Isover et responsable du collectif « Isolons la terre contre le CO2 et à M. Régis Meyer, chargé de mission Bâtiment - Energie à la MIES, ainsi qu'à M. Alain Maugard, président du CSTB, Mme Dominique Riquier-Sauvage, présidente d'honneur de l'UNSFA, M. Michel Laviale, ancien directeur du Développement Durable de la Société générale, chargé d'une mission par l'ADEME sur l'implication des banques et M. Serge Contat, de l'ANH. La table ronde traitera des trois thèmes suivants : développement des énergies thermiques - solaire, biomasse, individuel et collectif - ; isolation thermique du parc immobilier existant et, plus largement, réduction des consommations d'énergie et des émissions pour l'existant comme pour le neuf ; mobilisation des acteurs - lisibilité, affichage de la performance, offre technique et offre financière, valorisation sociale. M. Didier LENOIR : Je vous remercie de m'avoir invité pour vous faire part de mon expérience de terrain. Je vous prie de m'excuser si je choque : ce ne sera pas par volonté de provocation, mais pour refléter une expérience de vingt à trente ans d'interventions sur le terrain. Je ne parlerai que de la consommation d'énergie nécessaire au chauffage des immeubles et à la préparation d'eau chaude sanitaire, utilisations thermiques à basse température et non de la cuisson des aliments, qui exige des températures nettement supérieures mais dont la consommation énergétique est très inférieure - de l'ordre de 10% des besoins précédent. En France, la consommation annuelle d'énergie pour la production de chaleur basse température est d'environ 52 millions de tep, dont 20,5 tep pour le gaz naturel, 17,4 pour le pétrole, 9 pour les énergies renouvelables, 4,8 pour l'électricité et 0,5 pour le charbon. Si l'on tient compte de ce que l'électricité est elle-même produite pour partie par des énergies fossiles, on constate que les besoins sont couverts aux trois quarts par des énergies fossiles dont la presque totalité est importée. Le coût de ces importations s'établit actuellement à quelque 11 milliards, et cette consommation énergétique à pour conséquence l'émission de 114 millions de tonnes de CO2. Cette situation est accablante, car rien n'est plus facile que d'obtenir de la chaleur à basse température sur tout notre territoire. Mais, en dépit de l'évolution des sciences, des techniques et du commerce, on en est resté là à ce jour. La prise en compte récente des risques de changement climatique devrait permettre une évolution comme le montrent, sur le plan national, l'adoption du Plan Climat et la loi sur l'air et, sur le plan international, la ratification du Protocole de Kyoto, qui fait que nous sommes théoriquement sous le régime du « facteur 4 ». Des premières mesures ont été prises, sous la forme de crédits d'impôt prévus dans la loi de finances pour 2005 et renforcés par la loi de finances pour 2006, et les décrets relatifs aux certificats d'économies d'énergie sont en cours d'élaboration. La démarche tendant à la sobriété énergétique est indispensable, car à quoi bon investir dans les énergies renouvelables si l'on continue de gaspiller l'énergie ? On commence à avoir une idée de l'effet des crédits d'impôt. Selon les premières indications données par une enquête ADEME - Observ'ER, environ 62 000 mètres carrés de capteurs solaires ont été posés en 2004, pour 15 000 installations. Mais si l'on rapproche ces chiffres des 25 millions de résidences principales et des 3 millions de résidences secondaires qui composent le parc immobilier français, on se rend compte que l'échelle des réalisations est de 1 pour 1 000. D'autre part, 7 millions de ménages utilisent le bois énergie, mais les rendements sont déplorables, inférieurs à 50 %. Si l'on veut, dans les dix ans qui viennent, faire rendre aux 9 millions de TEP d'énergie finale biomasse ce qu'il doivent rendre, l'objectif de plus de 500 000 renouvellements d'installations par an correspondrait à une simple mise à niveau, sans compter bien entendu la construction existante. Venons-en aux raisons pratiques de la stagnation des énergies renouvelables thermiques. D'abord, des contradictions profondes entre les déclarations d'intention et les textes sur le « facteur 4 », d'une part, et l'action des entreprises nationales, d'autre part. Les plans d'entreprises EDF-GDF qui ont été établis en 2004 ignorent complètement ou à peu près la maîtrise de l'énergie et les énergies renouvelables. Ils ont été établis dans une optique de croissance des ventes d'électricité et de gaz. La commission Roulet ne semble avoir fait aucune hypothèse basée sur la réussite d'une politique d'économie d'énergie ; ni aucune hypothèse d'investissements par des acteurs locaux pour de l'électricité renouvelable, du biogaz, des énergies renouvelables diverses. Le plan d'entreprise de Gaz de France prévoit deux millions supplémentaires d'abonnés pour le chauffage au gaz entre 2005 et 2007. Rajoutons-y le fait que EDF se glorifie chaque année de faire du chauffage électrique dans plus de la moitié de la construction neuve. La part restante pour quelque énergie renouvelable que ce soit est totalement ridicule. Ensuite, il y a une disproportion considérable en termes de moyens entre l'excellente campagne de l'ADEME, à laquelle nous participons, « Faisons vite, ça chauffe », et toutes les campagnes de publicité des entreprises nationales, notamment celles qui tournent autour de la mise sur le marché d'une part de leur capital. Ces campagnes sont faites dans une optique de consommation croissante d'électricité et de gaz. Enfin, au niveau local, où j'ai une expérience de plus de vingt ans, on constate que les services commerciaux des entreprises nationales diffusent la culture de croissance de l'électricité et du gaz. On peut noter une bonne volonté naissante de la part des personnels de ces entreprises à l'égard de la sobriété énergétique et des énergies renouvelables, mais, par manque de formation, un certain nombre d'entre eux s'adressent aux espaces « info énergie » pour leur demander des informations sur la maîtrise de l'énergie, la sobriété énergétique et les énergies renouvelables !!! La recherche de croissance de l'électricité et du gaz conduit toujours actuellement les entreprises à lutter contre la croissance des énergies renouvelables. L'exemple de la géothermie en Ile-de-France est significatif ; une filiale de Gaz de France a pris en concession plusieurs opérations de géothermie et cherche, à travers une action technique, à réduire la production de géothermie au profit de la cogénération gaz et du gaz d'appoint. Quels changements opérer ? Lors du rendez-vous Climat, la majorité des participants a insisté sur la priorité à donner aux changements de culture « climat - énergie - territoires ». Il y a une complémentarité absolue entre les responsabilités et l'action nationales d'une part, les responsabilités et l'action locales d'autre part. Il faut faire comprendre que des millions d'actions locales sont aussi importantes que des grands projets nationaux, et qu'un équilibre entre les deux est nécessaire. On ne fera rien contre la culture centralisatrice des entreprises nationales. Elles doivent changer de culture, notamment pour ne pas rencontrer, dans les années à venir, des difficultés considérables pour s'adapter effectivement à une volonté de prise en main par les acteurs locaux. On ne fera rien sans prise de responsabilité des collectivités territoriales, des entreprises et des simples citoyens en matière d'énergie. Une vraie décentralisation est nécessaire et urgente. De nombreux acteurs locaux - syndicats d'énergie, agglomérations, petites communes, entreprises - montrent qu'elle est possible. M. le Président : Je vous remercie. Nous allons maintenant entendre les trois exposés introductifs. M. Pascal EVEILLARD : Je vous remercie de nous avoir invités à vous présenter notre vision de l'efficacité énergétique et de la lutte contre le CO2 dans le secteur du bâtiment. Le travail qui est fait en ce domaine est primordial et il est à l'origine du collectif industriel « Isolons la terre contre le CO2 ». Ce collectif a été créé pour sensibiliser et informer sur les enjeux liés au CO2 dans la filière du bâtiment. Il faut convaincre les leaders d'opinion de l'importance de la formation dans le secteur de l'existant et faire connaître les solutions existantes. L'objectif est de diviser par quatre les consommations énergétiques et les émissions de CO2 associées. C'est possible dès maintenant, d'un point de vue technique et économique. Et c'est indispensable, d'un point de vue politique et social. Pour y réussir, il y a deux conditions fondamentales : d'abord, jouer la complémentarité et les synergies entre l'isolation, la ventilation, les équipements et les énergies renouvelables ; cela demande de sortir de la logique française consistant à opposer les uns et les autres et d'adopter une conception globale du bâtiment. Ensuite, impliquer l'ensemble des acteurs de la filière qui ont tendance, aujourd'hui, à travailler de façon éclatée et sans continuité. Il est fondamental que l'ensemble des acteurs - maîtrise d'œuvre, maîtrise d'ouvrage, entreprises, industriels, mais aussi pouvoirs publics et institutions financières - participent à la démarche. Des solutions sont à trouver dans tous les domaines. Quelqu'un a dit tout à l'heure que les énergies renouvelables s'inscrivaient dans une économie de sobriété énergétique. En l'occurrence, cela signifie des bâtiments qui consomment peu, avec une excellente isolation thermique. Aujourd'hui, nous avons un large choix de solutions possibles : isolation par l'extérieur, par l'intérieur, isolation intégrée, entre ossatures, etc. Il faut parler de l'étanchéité à l'air, au niveau de l'enveloppe. Or ce sujet est pour ainsi dire absent du débat actuel en France. Il faut en même temps mettre au point des systèmes de ventilation performants. Aujourd'hui notre pays est à la traîne par rapport à ses voisins nord européens en la matière. Dans cette enveloppe particulièrement performante, on peut introduire des équipements de production de chaleur efficaces avec récupération de chaleur et les énergies renouvelables, et intégrer les éléments bioclimatiques. C'est en travaillant sur cet ensemble qu'on pourra avoir des bâtiments sobres en consommation énergétique. Il faut savoir qu'il n'existe pas de solution constructive unique. Il faut savoir aussi, et c'est très important, qu'un bâtiment a une durée de vie moyenne supérieure au siècle. Cela signifie que lorsqu'on le construit ou qu'on le rénove, il faut anticiper considérablement. S'il est mal conçu, son impact sur l'environnement sera très long. Cela signifie aussi qu'en 2050, un tiers des logements présents auront été construits depuis l'année 2000, et deux tiers avant l'année 2000. Le parc existant est absolument incontournable. La singularité du bâtiment est que si l'on met en œuvre un plan d'action ambitieux, on peut jouer sur de très nombreux leviers « gagnant-gagnant ». Un plan ambitieux en matière d'efficacité énergétique, en particulier dans l'existant, sera un facteur d'évolution pour les entreprises du secteur. Il créera des emplois. Il favorisera l'innovation et le progrès aussi bien dans les maîtrises d'œuvres que chez les industriels pour les produits ou les équipements de construction. Ce sera également un progrès pour les occupants qui pourront faire des économies. Nous avons fait une simulation pour montrer que si l'on s'attaquait uniquement au neuf, compte tenu des mesures actuelles, on n'atteindrait pas les objectifs de Kyoto pour le bâtiment, encore moins l'objectif de division par 4. Les mesures prévues, essentiellement sur le neuf, permettraient de stabiliser au mieux l'évolution des rejets de CO2. Un plan ambitieux dans l'existant, consistant à rénover l'équivalent de 400 000 logements par an jusqu'en 2050, constitue la seule façon d'atteindre l'objectif de division par quatre des émissions dans le secteur du bâtiment. L'enjeu du « facteur 4 » dans le bâtiment est d'arriver à une moyenne de l'ordre de 50 kWh pour le chauffage en énergie primaire au plan national. Cela reviendrait à diviser par trois la consommation dans l'existant et par six ou sept dans le neuf. La problématique pour le chauffage est la même que pour l'eau chaude sanitaire. Au plan législatif et réglementaire, les choses vont dans le bon sens pour le neuf. La loi d'orientation sur l'énergie a acté un certain nombre de choses, en particulier la réduction des consommations de 40 % d'ici à 2020 et le développement des logements à énergie positive. Ces 40 % ne pourront pas être gagnés avec les énergies renouvelables. Pour que les énergies renouvelables prennent tout leur sens, il faut d'abord diminuer le besoin en énergie. Ce n'est qu'ensuite qu'on les introduira dans des bâtiments plus sobres en énergie. La RT 2005 nous a un peu déçus. Nous avions le sentiment que nous pouvions aller beaucoup plus loin. Cela ne changera pas grand-chose sur le marché en termes de pratiques et aucun bouleversement. Dès aujourd'hui, avec des techniques courantes sur le marché, on pourrait déjà, si on le voulait, atteindre les objectifs fixés. Diminuer de 40 % dans le neuf est d'ores et déjà faisable, au point qu'on peut dire qu'il faut maintenant allers vers le bâtiment passif ou à énergie positive. D'un point de vue technique, on sait déjà faire des bâtiments qui répondent aux objectifs de 2020 et des bâtiments qui ne consomment pas. S'agissant de l'existant, il y a un début de réglementation. La LOE acte les directives européennes. Mais leur transposition se fait a minima et on aurait pu, là encore, aller plus loin. La mise en place du « certificat énergie » et du diagnostic va dans le bon sens. Nous sommes convaincus que cela contribuera à la formation et à la pédagogie sur le marché ; c'est une incitation supplémentaire à agir. En revanche, il ne nous paraît pas de nature à déclencher un vrai mouvement de fond sur le marché français susceptible de nous permettre d'atteindre le « facteur 4 ». Il n'y a pas d'objectif quantifié sur les performances à atteindre, pas d'échéances chiffrées et pas d'obligation de travaux annoncée à court, moyen ou long terme. Le « facteur 4 » est possible dans tous les bâtiments existants. Avec une enveloppe de qualité, on peut diviser par deux ou trois les consommations. Maintenant, il faut passer à une phase « grande échelle » pour se confronter à la réalité et voir où se situent les difficultés. Il faut également adapter quelques solutions qui n'existent pas en France, mais qui existent à l'étranger. Du point de vue économique, les exemples que l'on a et les simulations que l'on peut faire montrent qu'on peut arriver à un coût moyen tout à fait réaliste, avec un retour sur investissement très court. Les économies réalisées peuvent permettre de rembourser dès la première année les mensualités d'emprunt. Dernier point : à l'instar de ce qui s'est fait à l'étranger, le collectif s'est associé avec d'autres pour mettre en place une offre de qualité. Il est important d'anticiper les évolutions réglementaires, de montrer ce qu'il est possible de faire, de lever les objections sur la faisabilité technique et économique et d'accélérer la diffusion des meilleures pratiques. L'objectif principal est de faire baisser les coûts et de permettre à l'ensemble des acteurs du marché de se positionner et de descendre la courbe d'expérience. Nous nous sommes inspirés des expériences PassivHaus et Minergie en Allemagne, en Autriche et en Suisse. Ces deux exemples vont au-delà des exigences réglementaires, ils ont pour particularité d'impliquer l'ensemble des acteurs de la filière, industriels, maîtrise d'œuvre, maîtres d'ouvrages, pouvoirs publics et institutions financières. Minergie est une démarche collective de labellisation d'ouvrages à faible consommation énergétique, aussi bien dans le neuf que dans l'existant. PassivHaus, ce sont des bâtiments qui consomment pratiquement zéro, avec des besoins très réduits en énergie pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire. Les bâtiments de Minergie ne vont pas aussi loin. L'étape suivante sera le bâtiment à énergie positive. Sur ces bâtiments qui consomment pratiquement zéro, on peut installer des équipements aménagés en énergie renouvelable, pour produire de l'énergie au-delà des besoins, et constitués en réseaux. Ces deux expériences démontrent la faisabilité, aujourd'hui, de constructions neuves et de rénovations de bâtiments à faible consommation énergétique. Les solutions sont donc disponibles, sinon en France, du moins dans des pays très voisins. Elles sont économiquement viables. L'une des conditions de leur succès est l'instauration d'une vraie dynamique entre les acteurs du marché, et d'une dynamique de communication. Elles ont été fortement soutenues au niveau national et au niveau local, avec une communication visant à valoriser la démarche. Un dossier vient d'être agréé dans le cadre du PREBAT. Nous nous sommes associés avec le CSTB et des régions françaises, en l'occurrence l'Alsace, la Franche-Comté, Rhône-Alpes, la région PACA et le Languedoc-Roussillon, ainsi qu'avec la Banque populaire et des bureaux d'étude pour travailler sur la promotion d'un label ou du moins d'un programme de performance énergétique allant dans le même sens que PassivHaus ou Minergie. Il s'agit de promouvoir une telle politique en France et de démontrer qu'elle est faisable. M. Régis MEYER : Comme l'ont démontré les deux exposés précédents, des solutions techniques sont disponibles. Certains industriels, comme ceux regroupés au sein du collectif « isolons la terre contre le CO2 » souhaitent relever le défi. Il convient de les soutenir. La mobilisation de l'ensemble des acteurs du bâtiment est essentielle, au-delà du secteur industriel, pour mobiliser de façon efficace l'immense potentiel d'économie d'énergie fossile des bâtiments. Je rappelle que les émissions de l'habitat en France égalent les émissions des véhicules personnels. M. le Président : On considère en général que le bâtiment serait à l'origine de 20 % des émissions ; les véhicules, globalement, de 25 % ; dont près de 14 % pour les véhicules personnels. Si on y ajoute les véhicules utilitaires légers, on arrive à peu près à votre chiffre. M. Régis MEYER : On pourrait rajouter aussi aux 18 % d'émissions directes, les émissions indirectes, c'est-à-dire 1% par le chauffage urbain et 3% pour la consommation électrique. M. le Président : Chacun a tendance à dire que sa part à lui est moins importante. M. Régis MEYER : Disons que le niveau est équivalent. Il existe déjà un précédent de mobilisation. Le monde de l'industrie via l'AERES et le Groupe Action CO2 a montré que l'entreprise peut se mobiliser sur l'enjeu climatique de façon efficace. Un élément puissant de mobilisation des producteurs d'énergie a été introduit par le dispositif des certificats d'économie d'énergie. Mais nous pensons que ce n'est pas suffisant. Où est la mobilisation du monde du bâtiment sur l'effet de serre ? Mis à part le Club de l'amélioration de l'habitat piloté par l'ANAH, elle est embryonnaire, dispersée et peu lisible. Dans le monde du bâtiment, nous avons besoin de l'engagement des principaux acteurs : les financiers, car l'immobilier est d'abord une question de financement ; des promoteurs, des entreprises de travaux et, surtout, des artisans qui sont les principaux prescripteurs face à des clients non professionnels ; des distributeurs ; des conseils en ingénierie et en architecture ; des agents et des gérants immobiliers. Il s'agit de s'engager dès maintenant autour d'actions fédératrices. La seule notion clé à retenir de mon intervention, c'est le renforcement de la lisibilité à tous les niveaux. Premièrement, il s'agit de renforcer la lisibilité des objectifs et des moyens des actions publiques. Les initiatives publiques ne manquent pas : crédits d'impôt, mesures de défiscalisation pour les entreprises, aides de l'ANAH, aides du 1 %, important dispositif d'aide à la rénovation. Mais qui, dans cette salle, connaît l'objectif d'amélioration énergétique du parc immobilier, l'ensemble des aides disponibles et leurs conditions d'éligibilité ? Nous voudrions assurer, au sein d'un plan de rénovation énergétique du parc immobilier, la clarté des objectifs poursuivis et la cohérence des moyens mis en place. Cela permettrait de communiquer sur les enjeux et de faire remonter la priorité énergétique face aux autres priorités sociales du logement. Cela dit, il ne faut pas se contenter du niveau national. Par des aides conditionnées de l'État auprès des collectivités locales, on pourrait favoriser la création de plans de rénovation locaux et assurer une dynamique locale cohérente. Deuxièmement, il s'agit de renforcer la lisibilité de la performance énergétique. Qui connaît, dans cette salle, la performance énergétique ou CO2 de son logement ou de son bureau ? L'introduction prochaine du diagnostic de performance énergétique lors des transactions ou locations immobilières est l'élément central de cette politique tant vers les particuliers que vers les professionnels. Cet étiquetage énergétique en sept classes, de A à G, est déjà reconnu dans le domaine de l'électroménager par les deux tiers de la population. La référence à l'étiquette énergie doit devenir usuelle pour les politiques des pouvoirs publics, mais aussi dans les offres commerciales. Par exemple, le Plan Climat proposait de laisser aux collectivités locales la liberté de décider d'une exonération temporaire de taxe foncière en cas d'amélioration de la performance énergétique des bâtiments jugée à partir de cette échelle. Certains produits bancaires pourraient utiliser cette référence. La crédibilité et l'utilisation de cette étiquette sont à construire avec les professionnels de l'immobilier. Rien ne garantit que les agents immobiliers, la FNAIM, les gestionnaires de biens ou la CNAB les promoteurs de la FNPC ou de l'UNCMI vont porter cet index énergétique comme un vecteur commercial. Il faudrait les amener à en promouvoir la diffusion. On peut les y inciter. S'il ne se passe rien, faut-il instituer une obligation d'affichage de cet index énergétique dans les annonces et les publicités des professionnels ? Le Plan Climat prévoit la généralisation de l'étiquetage énergétique dans les véhicules, mais aussi, s'agissant du bâtiment, sur les fenêtres. Si un artisan propose la pose de fenêtres « Acotherm 11 », personne ne sait ce que cela signifie. S'il précise que cette fenêtre dispose d'un index A, tout le monde comprend que c'est la meilleure. On peut ainsi traduire clairement la performance énergétique. Troisièmement, il s'agit de créer les conditions d'une lisibilité des offres commerciales. En effet, la carence de l'offre technique énergétique lors des travaux de rénovation réhabilitation est flagrante : les réponses sont souvent tardives, confuses incomplètes et peu rassurantes. En outre, les experts techniques en énergétique du bâtiment sont très peu nombreux, peut être une centaine. C'est insuffisant, dans le cadre d'une politique de masse, pour réduire les émissions de CO2 en France. Il s'agit de former et de proposer des « packages » de solutions simplifiées portés par les énergéticiens EDF-GDF et les réseaux bancaires. Le secteur bancaire est incontournable, dans la mesure où il diffuse sur le territoire, auprès de la population. De nombreuses rénovations se font grâce à des prêts. Mais les réseaux bancaires ne pourront déployer une offre de masse visant à la réduction de la consommation énergétique des bâtiments sans ressources supplémentaires. On pourrait, par exemple, définir un compte d'épargne CO2 finançant principalement des actions de réduction de CO2 dans le bâtiment. Ce pourrait être un moyen de mobiliser des ressources et de diffuser une culture sur le CO2 auprès des particuliers et des investisseurs. Car nous visons surtout le propriétaire occupant d'une maison individuelle. L'orientation du 1 % logement à des fins énergétiques ne doit pas non plus être oubliée. Les pouvoirs publics, tant l'État que les collectivités, par leur commande, ont également une responsabilité dans l'émergence d'une offre. Une circulaire du Premier ministre au mois d'octobre précise les engagements de l'État, mais il faudrait que l'ensemble des pouvoirs publics, lorsqu'ils rénovent leurs bâtiments, visent au moins une fois sur deux les 50 ou 60 kWh par mètre carré. Enfin, la valorisation sociale des efforts d'efficacité énergétique est indispensable. Si l'attrait des ENR solaire et bois est indéniable, différentes études montrent que l'efficacité énergétique du chauffage n'accroche aucune symbolique positive. Comment faire reconnaître une vertu à l'efficacité énergétique ? Les initiatives des collectivités locales sur la thermographie des bâtiments sont intéressantes à cet égard, car elles permettent de visualiser les fuites énergétiques. Une valorisation des actions individuelles dans les médias est incontournable. Dans d'autres pays, par exemple, il y a des concours où l'on récompense les familles qui ont fait des travaux. L'animation au niveau local, pour les particuliers et les artisans, l'est tout autant. Pour cela, il faut mobiliser des ressources adaptées. Une valorisation des professionnels du bâtiment, qui s'engagent à promouvoir l'efficacité énergétique, devrait également être étudiée. Enfin, la discrimination de l'offre peut avoir une vertu d'entraînement. En conclusion, la mobilisation des acteurs du bâtiment dans le cadre d'un plan de rénovation énergétique du parc immobilier est porteuse d'une dynamique d'emplois locaux et participe de l'adaptation de l'économie à une monde sous contrainte énergétique croissante. M. François DOSÉ : Je suis président d'un mouvement HLM. Je décide de relever le défi, les fameux 50 kWh par an et par mètre carré. Vous connaissez les prix plafond. Je vais négocier avec le ministère. Quel déplafonnement pensez-vous qu'il me faudra demander ? Sur la marge établie par les économies d'énergie, quel sera le temps d'amortissement de ce dépassement de plafond ? Quelqu'un a-t-il fait ce calcul ? Avez-vous une adresse à me donner ou un témoignage à me communiquer ? Quel coût ? Quel amortissement ? Quel retour ? La discussion politique viendra ensuite et on verra si l'État doit donner un coup de pouce. M. Alain MAUGARD : Premièrement, pourquoi commencer par le logement social ? C'est ce qu'on suggère de faire en France, dès lors qu'il y a un problème. Les ordres de grandeur sont très intéressants. Pour la réhabilitation des bâtiments, on a parlé de 200 à 300 euros du mètre carré, et personne n'a réagi. Je voudrais que l'on remette ce chiffre en situation par rapport à la hausse générale des prix des logements. M. le Président : Personne n'a réagi, parce que personne ne pouvait réagir pendant la première période. M. Alain MAUGARD : Nous avons assisté en France, en l'espace de trois ou quatre ans, à une hausse généralisée du prix des logements existants, qui a été en province de 500 euros du mètre carré et à Paris de 1 500 euros le mètre carré. Je demande juste que les parlementaires qui sont ici la comparent au coût d'une réhabilitation qui aurait divisé par deux ou par trois la consommation énergétique, et qui est de 200 ou 300 euros le mètre carré. Nous avons en effet constaté qu'avec 200 ou 300 euros le mètre carré, on pouvait réhabiliter des logements existants et obtenir des baisses significatives de consommation d'énergie. J'observe maintenant que cette hausse a été tout à fait possible puisque le prix du logement existant, c'est-à-dire sans travaux, sans aucune amélioration, a pu augmenter de 1 500 euros en moyenne du mètre carré en région parisienne. Cela signifie que l'économie française, par la solvabilisation des ménages, a mis ces sommes dans le foncier et non pas dans l'amélioration du bâtiment. Aujourd'hui, se pose un problème central : techniquement, nous savons faire des bâtiments plus performants du point de vue énergétique ; pour la construction neuve, nous savons faire des bâtiments à énergie positive. Seulement, ce n'est pas viable économiquement. Je réponds que le secteur du bâtiment est un secteur où le foncier occupe plus de la moitié du prix en moyenne et qu'on dispose d'une marge de manœuvre tout à fait importante si l'on veut se donner les moyens d'une politique d'amélioration de la consommation énergétique. Cette marge de manœuvre est indépendante de notre compétitivité économique ; on ne peut pas craindre d'handicaper nos industries ou la logistique de transport. Les HLM sont en partie financés par une péréquation sur les charges foncières. Il est donc possible dès maintenant de mobiliser le transfert de charges foncières au profit de bâtiments plus performants énergétiquement. Et il n'est pas nécessaire de passer des heures sur les taux de retour. Si nous ne mettons pas ces ambitions nouvelles dans le bâtiment, c'est le foncier qui « empochera ». Ce serait une hérésie, car le foncier ne contribue pas à la lutte contre l'effet de serre. M. François DOSÉ : Vous n'avez pas répondu à la question ! Je ne peux pas m'occuper de mes 8 000 propriétaires fonciers qui font ce qu'ils veulent, mais je peux intervenir dans le domaine dont je suis responsable. Vos propos n'étaient pas délicats. Par ailleurs, le prix du foncier dans une petite ville de 7 000 habitants, dans un territoire rural de Lorraine, ne vous conduit pas à aller rechercher chez d'autres ce que vous pouvez mettre sur le social. M. le Président : Monsieur Maugard, je partage ce que vous avez dit sur le fait que le foncier ait augmenté et que ce n'est pas en augmentant le prix du foncier qu'on traite le problème de l'effet de serre. Mais ce sont deux questions différentes. Je ne vous suis pas lorsque vous dites qu'à chaque fois qu'on a un problème en France, on demande à l'État d'intervenir. J'ai été président d'un organisme d'HLM il y a quelques années. J'ai lancé il y a cinq ans, après mon rapport avec Claude Birraux sur les énergies renouvelables, un programme de construction de bâtiments d'habitat bioclimatique, qui ont été inaugurés aujourd'hui à Auboué. Le coût, pour chacun des huit pavillons de 70 mètres carrés, a été évalué à environ 120 000 euros. Le surcoût d'énergie renouvelable, avec ponts thermiques, avec du solaire thermique passif et chauffant, avec l'orientation des bâtiments, a été de 20 %. L'ADEME, la région, l'État en ont financé la moitié, l'autre l'a été par des fonds propres. Il s'agit d'un habitat social. Cela signifie que ce sont les gens les plus pauvres de notre société qui, globalement, ont financé. Je tiens à dire qu'il est important de commencer par le logement social, dans la mesure où l'État doit montrer l'exemple. Mais le privé doit aussi donner l'exemple. L'action du public et celle du privé doit être concomitante. Ensuite, il faut trouver les moyens sur du logement social. La création d'une taxe sur les plus-values est peut-être une solution. La question demande à être traitée. Je ne suis pas en désaccord avec vous, sauf s'agissant de votre première phrase. Par ailleurs, vous n'avez pas répondu à la question précise de François Dosé. M. Serge CONTAT : Il y a, dans le bâtiment, un mécanisme un peu pervers : celui qui fait les investissements n'est pas celui qui bénéficie des économies de charges. Le décret « charges » est fait de telle manière que les investissements ne sont pas récupérables. C'est vrai dans le locatif social comme dans le secteur privé. Le mécanisme économique conduirait à avoir cette stratégie gagnant-gagnant dont vous parlait Pascal Eveillard, mais il ne peut pas se mettre en œuvre. La proposition qu'avait faite Philippe Pelletier, le président de l'ANAH, lorsque Gilles de Robien lui avait confié un rapport sur les charges, consistait à pouvoir déroger à la liste des charges récupérables par un accord collectif. Cette proposition allait très loin, dans la mesure où Philippe Pelletier envisageait que cet accord collectif puisse déroger à n'importe quel poste de charge locative. On pourrait très bien imaginer qu'une partie non négligeables des charges - énergie ou économie d'eau, ; dont les factures augmentent considérablement elles aussi - puisse être répercutée à quittance « loyer plus charges constantes ». Je n'ai pas de réponse à votre question précise sur le temps de retour des investissements. Néanmoins, les quelques calculs de coins de table qu'on avait fait sur certaines aides de l'ANAH, et sur des équipements spécifiques « énergie renouvelable » montrent que les temps de retour peuvent être très courts par rapport à la durée de vie des bâtiments - de l'ordre de cinq ou sept ans - dès lors qu'on accepte l'idée de maintenir le couple « loyer plus charges constatées ». Certains parlementaires ont réfléchi à la question et il y a beaucoup d'articles dessus dans la loi ENR. Cette proposition figurait d'ailleurs dans le Plan Climat. Si on adopte une mesure de cette nature, on change du tout au tout le ressort économique qui préside à la mise en place d'équipements performants. Je pense qu'Alain Maugard a raison de remettre les valeurs foncières en perspective par rapport aux masses financières. C'est un peu un autre sujet parce que les acteurs ne sont pas les mêmes. Les mécanismes de transfert sont compliqués. Il a raison d'insister et de nous dire que cette politique est à portée de main, comme nous l'a exposé Pascal Eveillard, et je crois qu'il y a des recettes tout à fait pragmatiques pour y arriver. Mme Dominique RIQUIER-SAUVAGE : C'est bien de penser au bâtiment. Mais celui-ci se place dans un contexte. En fait, chaque élu, quand il donne un permis de construire, a une responsabilité très forte. Ce bâtiment va consommer de l'énergie et émettre du CO2. Mais sa position même sur le territoire va jouer. Une réflexion en amont doit intervenir sur les choix urbanistiques. Elle est importante et ne doit pas être dissociée du bâtiment. M. le Président : Nous avons déjà abordé la question. Mme Dominique RIQUIER-SAUVAGE : Si vous en avez déjà pris conscience, c'est important. Avec le souci de prise en compte de la problématique du développement durable, en ce qui concerne le bâtiment, on ne peut plus ne pas réfléchir en coût global : à savoir réfléchir sur le coût du bâtiment lui-même, auquel on doit ajouter le coût de son exploitation, de son entretien, de sa réhabilitation, de sa destruction. D'où la nécessité de bien programmer et bien concevoir en amont ; c'est-à-dire investir dans la matière grise ! Il ne faut pas oublier non plus aujourd'hui que les familles changent, elles ont des enfants, elles évoluent, elles se séparent, se recomposent, que ce soit dans le logement social ou l'accession. Difficultés d'adaptabilité des logements auxquelles peuvent s'ajouter des problèmes liés au handicap, au vieillissement de la personne, à son autonomie. On doit réfléchir dès l'amont (dès les phases de programmation et d'études) à ces évolutions auxquelles le bâti doit être capable de s'adapter et au coût induit « du mal vivre » si le bâtiment est mal conçu (coûts sociaux, coûts de maladies induites si pour ce qui nous concerne les problèmes de chauffage, ventilation, chaleur d'été, etc. ont été mal étudiés). M. Meyer a parlé de conception intégrée. On a dit qu'il y avait peu de bureaux d'études qui travaillaient sur l'énergie et l'isolation. Mais on ne peut pas laisser un bureau d'études réfléchir seul sur le thermique, même dans le cadre de réhabilitation sans penser aux autres incidences. Un bâtiment, c'est un tout ! Si on isole complètement un bâtiment ancien, il peut pourrir suivant le support auquel on a à faire. Une mauvaise ventilation du bâti peut induire des problèmes de moisissure qui auront un impact sur le bâti bien sûr, mais aussi sur la santé des occupants. Un bâtiment, c'est comme un être humain. Il faut penser à la façon dont il vit, dont il respire. Par exemple, changer une chaudière même en choisissant la plus performante ne sert à rien si vous n'isolez pas correctement aussi bien les murs que les fenêtres et si vous n'assurez pas une ventilation correcte . Avant d'entreprendre des travaux de chauffage ou d'isolation, il faut un diagnostic complet pour voir les incidences éventuelles ; avoir une vision globale du bâti est nécessaire. M. Serge POIGNANT : On ne peut pas tout demander au public. Nous sommes dans une économie de marché. Certes, il y a des choix sur lesquels nous pouvons intervenir. Mais c'est aux professionnels aussi de proposer de nouveaux bâtiments, y compris aux architectes. Comment voulez-vous qu'on puisse dire à telle ou telle personne de faire ceci plutôt que cela ? Nous pouvons intervenir dans le social, et peut-être dans les ZAC où nous avons notre mot à dire sur son économie. Après, la question est technique. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce qui est le plus efficace. Le chauffe-eau solaire n'est pas très cher, il est facile à installer et la LOE permet d'obtenir un crédit d'impôt. Après, c'est surtout une question d'information et de formation des artisans. Ensuite, quand on passe au chauffage de la maison, qu'est-ce qui est le plus rentable à terme ? Le chauffage électrique avec, derrière, une pompe à chaleur ? Où devons-nous porter notre effort, pour qu'il soit lisible et efficace en retour sur investissement ? Voilà ce que j'attends des professionnels : qu'ils nous disent ce qui est efficace, avec un retour le plus rapide possible, et si le consommateur est prêt à investir. Mme Dominique RIQUIER-SAUVAGE : Chaque bâtiment s'inscrit dans un cycle différent, chaque bâtiment est un prototype. On veut faire des généralités, mais à chaque fois le site n'est pas le même, l'orientation n'est pas la même, les usages ne sont pas les mêmes, et à chaque fois la conception est différente. Il faut aussi donner aux concepteurs les moyens de travailler correctement. M. Pascal EVEILLARD : En France, le parc social est plus performant, du point de vue énergétique, que la moyenne du parc privé. Je rejoins tout à fait les propos de Serge Contat sur le raisonnement global. Il est valable dans le social comme dans le privé, notamment pour le primo accédant. Je remarque que dès qu'on parle de réglementation, certains constructeurs nous répondent que sur la maison du primo accédant, on ne peut pas augmenter les coûts. Sauf que globalement, cela se fait au détriment de sa solvabilité future. Lorsque l'énergie sera beaucoup plus chère, l'intéressé ne pourra plus rembourser le prêt qu'il avait contracté. Augmenter les exigences au départ, c'est améliorer sa solvabilité par la suite. Il faut raisonner de manière globale, y compris au niveau du financeur. Et il faut intégrer l'ensemble des charges dans la solvabilité. Combien de temps pour un retour sur investissements ? Cela dépend de la situation de départ. Si vous faites un saut de performance significatif, votre retour sur investissement sera très court : on a des exemples de réhabilitation de collectif en moins d'un an, avec des économies au mètre carré de 300 euros. Je ne suis pas complètement d'accord avec Mme Riquier-Sauvage. Il y a des principes de construction qui sont : une enveloppe performante, avec des règles à respecter, quel que soit le bâtiment. Et quel que soit le bâtiment, l'enveloppe durera vingt, trente ou cinquante ans. On ne change pas tous les jours les murs, ni même l'isolation. Le meilleur retour sur investissement tiendra à une enveloppe performante - murs, parois vitrées, etc -. Ensuite il faudra y placer des équipements adaptés. Comme le faisait remarquer Mme Riquier-Sauvage, l'isolation n'est pas tout ; il ne faut pas négliger l'aspect ventilation et aération. Les règles existent donc. Dans tous les pays voisins, la physique du bâtiment est maîtrisée par l'ensemble des acteurs. Idéalement, on commence par une enveloppe performante avec une bonne ventilation, ensuite on passe aux équipements qui doivent être bien dimensionnés en termes de production de chauffage, où l'on peut introduire les énergies renouvelables. Ces règles connues, universelles, ne sont pas forcément maîtrisées par tous les acteurs, et je constate qu'il y a des efforts de formation à faire. M. André CHASSAIGNE : La volée de bois vert qu'a reçue Alain Maugard pouvait peut-être se justifier par ses propos sur le logement social, mais je considère qu'il a été très pertinent. On est souvent pris dans tout un « baratin » technique, mais il ne faut pas oublier de poser les questions de fond. Il nous dit que de l'argent a été libéré au niveau du coût du foncier. Cela signifie que lorsqu'on est capable d'augmenter, au nom de la loi du marché, de 30 %, en quelques années le prix des loyers, on doit être aussi capable de libérer ces mêmes 30 % pour atteindre les objectifs qu'on se fixe. Derrière tout cela, il n'y a pas que des questions financières, mais le mal-vivre de certains. Je suis député de province. Certains jeunes de ma circonscription viennent habiter Paris, et je suis effaré de constater qu'il est impossible d'y trouver un logement social. Ma propre fille paie très cher moins de 30 mètres carrés sans aucune isolation ! Il serait bien de mettre face à face tous les avantages fiscaux qui peuvent être apportés en cas d'investissement locatif et le mépris inacceptable que l'on a pour tous ceux qui se trouvent dans ces logements. On leur impose des contraintes terribles pour pouvoir louer et des prix à vomir, alors qu'en face aucune contrainte n'est posée, au nom de la liberté du marché ! J'y vois un problème de fond qu'il s'agit de dénoncer. Il ne faut pas s'enfermer dans des approches uniquement techniques, au risque de passer à côté de l'essentiel. Mme Martine BILLARD : Il est vrai que les prix de l'immobilier ont flambé. Mais on n'a pas le choix : soit on réduit sa surface d'achat, soit on augmente son prêt et sa durée. D'où de nombreuses contraintes. Une fois dans la maison, se pose la question de son isolation thermique et de l'amélioration de son efficacité énergétique. Et c'est là que cela devient difficile du fait, notamment, d'un déficit d'information. On ne connaît pas le retour sur investissement et on ne sait pas si telle ou telle installation en vaut la peine. Et puis, s'il existe des mécanismes légaux de réduction d'impôts, il faut faire l'avance. Or il n'est pas évident de contracter un prêt pour travaux après un premier prêt immobilier. Si on reste à prix constant, loyer plus charges, il n'y a pas de problème. Mais prenez l'exemple des réhabilitations HLM par le système PALULOS. Celles-ci se sont traduites par une flambée des loyers, même si les locataires de ces HLM y gagnaient en termes de confort et d'isolation et sans doute, à terme, de charges. Je pense qu'il faudrait développer de manière très importante les points énergie, pour que les personnes puissent trouver l'ensemble des informations. Il faudrait améliorer la formation des artisans du bâtiment, notamment en matière d'isolation et de ventilation, et les amener à être beaucoup plus incitatifs. En effet, aujourd'hui, s'agissant par exemple de fenêtres, on vous dit bien qu'il vaudrait mieux prévoir une aération, mais sans vous donner ni précision ni explication, si bien qu'on finit par ne pas le faire. M. Alain MAUGARD : J'étais venu pour participer à un débat sur l'énergie. Vous avez entendu quelles étaient les possibilités du secteur industriel, du secteur des transports. Je crois qu'il faut qu'on parle de celles du secteur du bâtiment. Le bâtiment est, à ma connaissance, le secteur qui pourrait, si on en a la volonté politique et économique, arriver à un effet « zéro effet de serre ». C'est une mise en perspective d'une importance fabuleuse. Or cela n'est jamais présenté ainsi. D'ailleurs, vous nous recevez en fin de soirée. Vous avez traité de l'industrie. Or l'industrie est mondialisée et les marges de manœuvre sont faibles. Vous avez traité des transports : les transports privés et les transports de logistique. Vous ne modifierez pas une politique de transports de logistique, qui est elle aussi internationale. La seule marge de manœuvre possible se trouve dans le bâtiment. Le secteur du bâtiment est en effet celui qui offre potentiellement les plus grandes marges de manœuvre pour lutter contre l'effet de serre. Or on ne le dit pas assez. C'est également le seul secteur qui fait des gens des producteurs d'énergie et pas seulement des consommateurs d'énergie. On ne le dit jamais assez : lorsqu'on installe un chauffe-eau solaire ou du solaire photovoltaïque ou lorsqu'on construit une baie vitrée bien orientée, on produit de l'énergie. Le changement mental est fondamental : nous avons été abêtis dans une économie où l'on fournit une énergie abondante, à laquelle nous avons « droit ». Voilà ce à quoi nous avons été habitués depuis un siècle et demi. L'arrivée du monde moderne et du développement durable nous amène à nous poser ces questions : comment ne pas gaspiller l'énergie, comment la produire de façon décentralisée ? Si on veut la produire de façon décentralisée, il est évident qu'il faudra passer par les énergies renouvelables, qui sont partout. Ces énergies peuvent aboutir à de vrais résultats en termes d'effet de serre et responsabiliser l'ensemble de la population. Comment s'y prendre ? J'ai peut-être été tout à l'heure un peu provocateur, et je m'en excuse publiquement. Je ne suis pas contre le fait qu'on commence par les HLM, mais il se trouve que nous ne sommes pas prêts et qu'il est difficile de trouver des artisans compétents. Et j'ai le courage de dire ici que pour créer un secteur économique, il n'y a aucune raison que ce soit une fois de plus le secteur social qui essuie les plâtres et qui fasse tout. Car, sinon, ce seront les locataires HLM qui risquent de payer, en France, le démarrage de la filière. Je ne suis pas d'accord ! Des solutions existent, il y a des marges de manœuvre, il y a du foncier. Lorsqu'on a laissé faire des logements à la découpe à Paris, on n'a établi aucune contrainte. Ces logements vont coûter en moyenne 1 500 à 2 000 euros de plus au mètre carré. On aurait décidé de consacrer la moitié de la plus-value réalisée par ceux qui vendent à la découpe à l'amélioration du bâtiment, la consommation énergétique de ces bâtiments aurait été divisée par quatre ! J'ai été surpris, ces derniers temps, par l'allongement des prêts. Les banquiers peuvent faire des taux plus bas ou allonger les prêts. On aurait pu imaginer un système selon lequel les prêts les plus longs seraient consacrés aux bâtiments « développement durable ». On m'explique que la société du développement durable pense aux générations futures. Quand la reprise du foncier sera là, pourquoi ne pas adopter des politiques orientées : des prêts longs pour les bâtiments en développement durable ; des transferts fonciers ou des COS supérieurs pour les bâtiments qui consomment moins. C'est possible. M. le Président : Qu'entendez-vous par transferts fonciers ? M. Alain MAUGARD : J'entends une péréquation des charges foncières. Par exemple, dans une ZAC, vous pouvez décider que les charges foncières seront abaissées pour les bâtiments très performants énergétiquement, qui ont obtenu des labels. Et on décide de faire payer le maximum pour les bâtiments qui n'en sont qu'à la réglementation thermique. C'est une façon de faire participer le foncier. Certains ont proposé des politiques d'allègements d'impôts. Il faudrait les diriger en indiquant qu'on accorde un avantage compétitif aux bâtiments performants. C'est toute une économie du développement durable et du financement du bâtiment qui est en jeu. Quand un banquier calcule le taux d'effort des ménages en ne faisant pas de différence entre un bâtiment très économe en énergie et un autre qui répond simplement à la réglementation thermique, je trouve que c'est dommage. Je ne vois pas pourquoi le surcoût ne serait pas sorti du taux d'endettement. En Suisse, les surcoûts de Minergie sont financés par des financements séparés de l'immobilier principal. On pourrait même imaginer une sorte de leasing pour installer chez les particuliers des chauffe-eau solaires ou le solaire photo voltaïque, ceux-ci ne payant qu'un loyer correspondant aux économies de charges. On ne peut pas demander toujours aux particuliers de faire des efforts d'investissement et c'est à la collectivité d'aider à prendre en charge ces surcoûts immédiats, pour les générations futures. Et ce n'est pas non plus aux locataires de HLM de faire plus d'efforts que les autres. M. le Président : Il est bon que cet échange un peu rugueux ait eu lieu, car il a permis de discuter des vraies questions. Nous sommes tous convaincus du fait que c'est dans le bâtiment qu'on va faire des efforts. De là à dire qu'on arrivera ainsi à « zéro effet de serre ». Quand on voit qu'aujourd'hui on consacre trois fois plus d'argent à la défiscalisation qu'à l'aide au logement social, il convient de s'interroger si l'on veut donner la priorité à la lutte contre l'effet de serre. Je tiens à indiquer à M. Maugard que nous n'avons institué aucune priorité entre les personnes que nous entendons, et que les dates et heures auxquelles elles ont été convoquées dépendaient de leurs disponibilités. M. Michel LAVIALE : Je précise que je ne suis pas représentant du secteur bancaire, même si j'y ai travaillé. Je parlerai en tant qu'expert spécialiste, chargé d'une mission par l'ADEME. Je cherche à rapprocher le point de vue des banquiers et celui de l'ADEME sur cette question du bâtiment durable. J'ai par ailleurs été directeur du développement durable à la Société générale et je continue à animer des groupes de banquiers sur ces sujets. Le système bancaire français actuel, au travers de ses produits classiques, offre déjà des possibilités aux acquéreurs ou aux personnes qui veulent faire des rénovations. Je ne pense pas que les banques aient refusé de prêter à des clients qui venaient avec un dossier pour une maison HQE ou disposant d'un autre label. Par le biais des prêts travaux ou des prêts à la consommation, il n'y a pas non plus de problèmes pour financer des dossiers de rénovation thermique ou autre. Les taux sont d'ailleurs très attractifs. On peut critiquer le mode de fonctionnement du secteur bancaire, mais ce n'est pas la question d'aujourd'hui. La question est : quels seraient les avantages d'une offre bancaire dédiée pour assurer la promotion du bâtiment durable ? Sans doute une meilleure attractivité, surtout si cette offre est assortie de conditions préférentielles, notamment au niveau des taux s'agissant de prêts. Si on compare la situation bancaire française à celle de certains pays européens, on s'aperçoit d'un certain décalage, sauf pour les entreprises et les collectivités locales. De fait, l'offre bancaire dédiée aux particuliers est encore naissante, même si elle a eu tendance à se développer au cours de ces derniers mois. En Allemagne et en Hollande, les offres sont beaucoup plus importantes. En Allemagne, celles-ci sont supportées par des crédits publics, et ce sont les banques commerciales qui relaient ces prêts à taux bonifiés. En Hollande, le système, qui repose sur des comptes d'épargne « verts », fonctionne très bien, et c'est pourquoi nous réfléchissons à une solution équivalente pour notre pays. D'une façon générale, j'ai l'impression qu'en l'occurrence, chacun attend l'autre, les banquiers comme les autres. Si on veut convaincre les banquiers d'aller au-delà, il faut éclairer le débat. Nous avons besoin d'éléments de cadrage économique et de savoir : quels sont les biens à financer, ce qui pose des problèmes de référentiels et de performances ; quels sont les investissements qui sont derrière ? Comme toute entreprise, le banquier a besoin de connaître les perspectives du marché. On met en avant des objectifs techniques, qui sont sans doute très intéressants, on aligne dix ou quinze référentiels et on demande au banquier de faire le tri ! Il faudrait éclairer le débat économique, transformer les objectifs techniques en objectifs économiques. A ce moment-là, les services marketing des banques pourront travailler à la conception d'une offre dédiée. On peut s'adresser au banquier et lui demander de faire une offre. Il répondra : dites-moi d'abord quel est le marché, je vous ferai ensuite une offre. Mais il faut aussi stimuler la demande en informant mieux le public et disposer de professionnels capables d'inciter et d'accompagner. Certains ont pensé que les banquiers pourraient jouer le rôle de conseillers. Mais les banquiers n'ont ni le temps ni les compétences pour le faire ; ils peuvent simplement jouer un rôle d'incitateurs et renvoyer les clients vers des professionnels compétents. Au plan technique, des solutions existent. Nous sommes en train de les lister. Mais le problème, pour la banque, n'est pas de trouver la meilleure solution technique, il y aura sans doute un panachage de solutions à base de crédits publics et privés. Il est de convaincre les différents acteurs et de faire en sorte qu'ils travaillent ensemble. M. Serge CONTAT : Je réhabilite à peu près 500 000 logements par an. Je suis tout à fait d'accord avec cette analyse de poule et d'œuf. Aujourd'hui, qu'est-ce que le marché ? Ce n'est pas un marché HLM/parc privé. Dans le parc locatif privé, il y a les mêmes structures d'occupation sociale que dans le parc HLM. L'ensemble du gisement est constitué par 4 millions de logements HLM, et 20 à 25 millions de logements privés, résidences secondaires comprises. Dans ce stock, le logement HLM pèse un quart. C'est un marché très atomisé : 50 milliards d'euros de chiffre d'affaires « entretien et amélioration ». Il faut savoir que 80 % des commandes sont passées par des particuliers, pour des opérations qui font moins de 10 000 euros et à des entreprises de moins de 10 salariés. Il faut savoir aussi que depuis le coup d'accélérateur de l'effet tempête et de la TVA à taux réduit, l'activité n'a pas progressé en volume. Aujourd'hui, les dépenses d'amélioration de l'habitat sont moins que linéaires en fonction des revenus. Ces dépenses ont moins d'attrait que les dépenses d'habillement ou d'automobile. Il faut y travailler. Venons-en à la partie du parc en très mauvais état, avec une population très sociale et à l'intervention de l'ANAH sur le très mauvais logement. Aujourd'hui, il y a encore 4 millions de logements qui ne sont pas aux normes de confort les plus élémentaires. Nous y travaillons tous les jours. Aujourd'hui, 300 000 ménages sollicitent une aide sociale pour payer leur énergie. Nous avons fait par ailleurs un petit sondage avec le club « Amélioration de l'habitat » et nous avons appris qu'avec l'augmentation du prix de l'énergie, 40 % des ménages envisageaient de réduire leurs dépenses d'énergie. Je ne reprendrai pas ce qui a été dit. Il faut donner de la lisibilité et de la rationalité au marché, car la situation est incompréhensible. Nous sommes confrontés tous les jours à ce problème en tant qu'ANAH. Celui qui finance l'investissement n'en a aucune contrepartie. Je suis assez en phase avec ce que vous disiez sur la quittance totale « loyer plus charges ». En matière de communication, il est absolument nécessaire de travailler sur le national et la communication de proximité. Faisons un parallèle avec la sécurité routière : tous les gouvernements qui se sont succédé ont fait des campagnes ; à un moment, l'opinion a été mûre et après quelques mesures symboliques comme celle des radars, on a dénombré 100 000 morts de moins par an sur les routes. Dans le domaine du développement durable et des économies d'énergie, on parlerait plutôt de « stop and go ». L'ANAH qui, depuis cinq ou six ans, s'était concentrée sur trois priorités, a failli tout arrêter. Or sur un sujet comme cela, je crois à la continuité du message. Il faut absolument accompagner le propriétaire privé qui est aujourd'hui le donneur d'ordre, qui est le plus souvent perdu par rapport à l'offre, par rapport aux techniques et aux montages financiers. Il faut qu'ensemble : le concepteur de bâtiments, le banquier, le technicien fassent du marketing de manière très poussée pour lui offrir des solutions techniques clés en main et des solutions financières. M. le Président : M. Maugard nous a dit qu'on pouvait se donner comme ambition « zéro émission » dans le domaine du bâtiment. Vous avez dit que le chauffage et l'eau chaude sanitaire représentaient aujourd'hui 52 millions de TEP aujourd'hui. A l'horizon 2015, selon vous, combien y aura-t-il d'énergie possible en millions de TEP dans ce domaine ? Ma question n'est pas neutre. Un débat a eu lieu il y a quelques années avec certains de vos collègues, qui considéraient que nous étions trop ambitieux. M. Didier LENOIR : D'une part, il y a eu une croissance de la construction. D'autre part, il y a des améliorations possibles qui dépendront, entre autres, des certificats d'économies d'énergie. Raisonnablement, on peut obtenir 20 % d'économies par des investissements tout à fait modérés, c'est-à-dire qu'au lieu de 52 millions, on pourrait n'en avoir que 42 millions pour les extensions et les constructions neuves. Mais ces dernières peuvent dès maintenant consommer pratiquement « zéro énergie ». M. le Président : Vous voulez dire que l'on peut économiser 10 millions de TEP ? M. Didier LENOIR : Sur le thermique, oui. M. le Président : C'est ce que nous avions écrit, Claude Birraux et moi, dans notre rapport et certains de vos collègues pensaient que ce n'était pas possible. Je leur dirai ce que vous venez de me dire. A l'époque, cela avait provoqué une polémique. M. Didier LENOIR : Monsieur le président, je souhaite en venir à une question dont on n'a pas parlé : la décentralisation. Plusieurs personnes ont dit que chaque bâtiment était unique, chaque solution devait être adaptée et que les réactions devaient correspondre aux situations locales. Or l'État ne peut pas être un acteur majeur sur le terrain. Ce sont les collectivités qui doivent être des acteurs majeurs. Les collectivités sont des prescripteurs à travers tous leurs marchés, avec leurs cahiers des charges, et à travers les documents d'urbanisme. Mais pour des raisons que j'ignore, elles n'ont pas la liberté de fixer des normes différentes ou plus contraignantes que les normes nationales, comme c'est possible en Italie, en Allemagne, en Espagne ou ailleurs. Or le climat, la géographie et la géologie sont totalement différents d'un endroit de la France à l'autre. C'est bien la collectivité qui a la continuité, la pérennité et la connaissance fine du milieu local. Les agences locales de l'énergie, les espaces info énergie, les agences d'urbanisme, les CAUE sont des conseils évidents mis en place par les collectivités locales. Il faut qu'ils s'imprègnent d'une culture « énergie climat ». Une bonne partie du territoire de l'agglomération de Montpellier se trouve près de la mer. Or les termes « changement climatique », « élévation du niveau de la mer » ne sont pas cités dans le SCOT. Les personnes qui investiront en bordure de mer ne savent pas que dans dix, vingt ou trente ans, ils seront inondés ! C'est assassin et scandaleux. Le ministère de l'équipement n'en a rien dit. Le rôle de l'État est nul dans cette affaire. M. Serge POIGNANT : Tous les acteurs ont leur rôle à jouer. Il y a des choses que vous pouvez demander à l'État, d'autres que vous pouvez demander aux collectivités. Même si celles-ci ne peuvent pas aller au-delà des règlements, elles sont autorisées par la loi SRU à définir des orientations. Je suis tout à fait preneur de propositions de la part des professionnels, à tous les niveaux : les architectes, les industriels, les artisans. Une fois l'enveloppe conçue, il va falloir l'équiper. Et c'est à nous, parlementaires, de nous demander ce qui sera le plus efficace, quel sera le retour, combien cela coûtera, notamment en crédits d'impôts, etc. Sans oublier la formation des artisans et l'information dispensée, notamment, par l'ADEME. Mme Dominique RIQUIER-SAUVAGE : En tant qu'Union des syndicats français d'architectes, nous nous étions rapprochés d'organismes bancaires. Nous avions demandé que les banques aident les pétitionnaires, ceux qui veulent faire des travaux, à obtenir des crédits plus intéressants s'ils faisaient appel à des architectes qualifiés compétents en ce domaine. S'agissant des documents d'urbanisme, je suis tout à fait d'accord. On peut, au travers des documents d'urbanisme, procéder à des incitations. On n'a pas parlé des panneaux solaires. Il y a chez nous un problème de culture architecturale. Aux Pays-Bas, en Suisse, même dans des centres anciens, on arrive à installer des panneaux solaires. En France, on se heurte au lobbying des architectes des Bâtiments de France, qui nous empêchent, dans certains cas, d'intégrer ces éléments. Nous ne devons pas avoir peur de concevoir des bâtiments contemporains dans des centres anciens avec des techniques un peu novatrices. Il faut oser en parler. M. André CHASSAIGNE : Ne ramenons pas tout à la décentralisation. En prenant l'exemple du SCOT de Montpellier, vous avez vous-même montré les limites de la décentralisation et certains comportements de potentats locaux. Je crois beaucoup à l'exigence de politiques publiques au niveau national. Cela n'empêche pas de les décliner et de mettre en œuvre des volontés politiques au niveau territorial. Si on veut inciter au développement durable et intervenir en matière de vente à la découpe, par exemple, les décisions qu'on prendra ne pourront l'être qu'au niveau national. Ces décisions impliquent des choix politiques, des exigences qu'il faudra imposer et qui toucheront aux lois du marché. Nous avons besoin de leviers pour mener nos politiques. Si nous avions conservé un pôle bancaire public, peut-être aurions-nous pu davantage utiliser le levier bancaire. Malheureusement, les banques ne font pas d'angélisme et elles cherchent, à terme, à faire le maximum de profit. De la même façon, maintenant que le capital d'EDF a été ouvert au privé et que ses actionnaires vont veiller à leurs profits, on ne pourra pas mener la même politique que si elle était restée une entreprise publique. On a parlé des architectes des Bâtiments de France. Mais ce n'est pas au niveau local qu'on résoudra le problème qui a été soulevé. C'est au niveau national, à travers les orientations qu'on aura fixées. Conservons donc des politiques publiques nationales, dans la mesure où l'on considère encore que l'État peut jouer son rôle, ce que le libéralisme ambiant ne permet pas toujours. M. Alain MAUGARD : Je voudrais compléter le propos de M. Serge Poignant. Il faut un effort continu de recherche développement. Mais cela ne viendra pas tout seul. Monsieur le président, vous avez dit que le bâtiment serait à l'origine de 20 % des émissions. D'autres ont parlé de 24 %. Cela dépend si l'on compte la consommation d'électricité domestique. Or le bâtiment peut fournir des réponses à la diminution de l'électricité domestique. Je remarque en passant que les chiffres français sont les plus bas de tous les autres pays parce que nous avons le nucléaire. Je comprends très bien les choix français, mais nous devons nous inscrire aussi dans un vaste mouvement de recherche et développement à l'échelle mondiale. Car si nous ne le faisons pas, tout le secteur sera pris par d'autres pays. Or c'est un secteur porteur d'emplois. Pour exécuter des travaux dans le bâtiment, on emploie des salariés sur place. Je m'adresse aux parlementaires que vous êtes pour vous inciter à bien regarder les choix qui seront faits en matière de recherche et développement. Certes, un programme spécifique qui s'appelle PREBAT a été mis en place, qui ouvre des perspectives de recherche en matière d'énergie bâtiment. Mais 5 millions d'euros seulement seront consacrés à programme et seront amenés par l'ANR, laquelle est dotée de 400 à 500 millions d'euros. Je pense, et cela n'engage que moi, que ce n'est pas la bonne proportion. Vous allez entendre dire que ce n'est plus un problème de recherche développement, puisqu'on sait déjà comment faire. C'est un peu comme si, au début de l'aviation, parce qu'on avait fait voler le premier avion, on avait arrêté toute recherche développement en matière d'aviation ! Or ce ne fut que le début d'un vaste programme. On a tout intérêt à faire un très grand travail de RD. Le bâtiment est un secteur où l'on peut mobiliser la recherche industrielle, privée et publique. Si on fait cet effort, on abaissera les prix. Par exemple, le solaire thermique n'est pas encore arrivé au prix le plus bas ; le solaire photovoltaïque non plus. J'entends dire que le solaire est dix fois plus cher que le nucléaire et qu'il n'a donc aucune chance. C'est une erreur d'analyse. C'est exact si on s'en tient à la production d'électricité. Mais il faut savoir que le solaire photovoltaïque joue le rôle d'une couverture, d'un toit, d'ailleurs tout à fait esthétique. En comparaison, les plaques de pierre apparente ou de marbre, posées sur des façades coûtent à peu près le même prix sans avoir aucune efficacité thermique. C'est une voie tout aussi essentielle que celle de la fission nucléaire. Sans dire qu'il faut y consacrer des sommes aussi importants qu'à la fission nucléaire, consacrons-lui des sommes suffisantes. Sinon, on ne comprendra pas qu'on en a fait une priorité politique. Il y a un problème de lisibilité. La plupart des gens pensent qu'on amuse la galerie, et qu'on n'y croit pas. Or, dans un débat sur l'énergie, c'est une option fondamentale, même si elle n'exclut pas les autres. En cas de coupure d'énergie, c'est là-dessus qu'on aura des marges de manœuvre. Il nous faut donc un vaste programme de RD mobilisant tous les acteurs. C'est un magnifique projet ! M. Pascal EVEILLARD : À l'instar de Minergie, nous avons lancé une initiative privée avec les régions. Nous l'appelons Effinergie pour le moment. Nous nous sommes adressés au PREBAT parce que le soutien public nous semblait important. Il s'agit de commencer à créer un référentiel qui va aider les banques à savoir quels projets financer et vers quelles solutions s'orienter. Il s'agit d'apporter de la lisibilité et de faire de la mercatique afin de faire connaître cette offre et de communiquer efficacement. Cette initiative ne suffira pas à faire basculer tout le marché. Le rôle d'une politique publique peut être de donner un cadre et une perspective. C'est de mettre une pression sur la collectivité, pour qu'on sache où l'on va avancer, et faire en sorte que tous les acteurs veuillent y aller. En Suisse, Minergie est financée par des banques avec des prêts à des taux bonifiés. Cela montre que les banques peuvent suivre ce type de démarche. Des exemples venant de l'étranger nous permettent d'être optimistes. Nous savons que si on a un référentiel, les banquiers seront capables d'y attacher une offre de prêts bonifiés. On ne peut pas ignorer l'aspect formation professionnelle de la filière. L'enjeu est colossal. On manque et on manquera de plus en plus de main d'œuvre qualifiée en France. Or, demain, on aura besoin d'artisans qualifiés. Il faut donc réhabiliter les métiers du bâtiment, et ne plus orienter les élèves dont on ne sait pas quoi faire vers les filières du bâtiment des lycées professionnels. Nous avons besoin d'artisans en nombre et en qualité. Aujourd'hui, cet aspect n'est pas du tout mis en avant et cela risque de nous limiter, bien plus que les problèmes de financement. Mais personne n'y pense suffisamment. M. Régis MEYER : Je voudrais revenir au « facteur 4 ». Actuellement, toute la politique du bâtiment est basée sur l'incitation. Nous travaillons sur une réglementation sur l'existant. Il faudrait être certain que l'impact de cette réglementation atteigne bien ses objectifs. Si on se rend compte dans trois, quatre ou cinq ans, qu'on n'est pas arrivé à nos fins, il faudra se poser la question d'une réglementation obligeant à faire de la rénovation à un certain niveau de performance. On a fait beaucoup de rénovations dans le passé. Mais maintenant, il faut une activité de masse, avec un niveau de performance élevé. L'incitation peut marcher, mais à un certain moment il faut en évaluer l'efficacité. M. le Président : Je vais donner la parole à un membre du comité de pilotage, M. Raymond Leban. M. Raymond LEBAN : Vous avez évoqué un marché de masse, supposant une standardisation des produits, ce qui me semble totalement contradictoire avec certains propos selon lesquels chaque cas est un cas particulier. Si on veut mener une action publique sur le parc existant, il faut qu'on dispose d'une typologie des produits option rénovation, et des taux de rendements sur investissements. Il s'agit de connaître les actions qui sont rentables et celles qui ne le sont pas, pour .savoir celles qu'il faut aider. Car ce n'est pas en regardant la collection des aides de l'ADEME qu'on pourra se déterminer : on n'y comprend rien ! M. le Président : Merci à toutes et à tous d'être venus. Notre débat a été solide et nous a apporté beaucoup de suggestions. On a dit que le bâtiment était le secteur qui permettrait d'obtenir les résultats les plus importants. Nous en sommes persuadés et il nous faudra proposer des solutions qui pourront jouer au niveau national, et peut-être européen, si nous sommes convaincants. Il nous faudra des professionnels, y compris des architectes. Quand on fait un appel d'offre, force est de constater qu'on a « de tout ». Les artisans doivent se former aux techniques nouvelles : pour l'instant, il s'agit surtout de solaire passif et de solaire thermique ; mais il faudra aussi s'intéresser à d'autres techniques comme les échanges de chaleur. Cela concerne aussi bien les constructions neuves que le parc existant, le secteur privé que le secteur public car les deux sont importants. Il nous faut donner l'exemple, mais je suis d'accord avec M. Maugard : ce n'est pas aux habitants du parc HLM de payer. Dans un certain nombre de domaines, nous ne sommes pas au niveau. Nous pouvons comparer nos 65 000 mètres carrés de capteurs solaires aux 2 millions de mètres carrés de l'Allemagne. Il faut travailler avec les collectivités locales. Les régions, qui constituent sans doute le bon échelon pour développer des politiques, sont déjà engagées - notamment la région Alsace et la région Lorraine. Mais elles ne doivent pas être abandonnées par l'État qui, déjà, leur transfère un certain nombre de charges. Reste à régler les questions de financement, public ou privé. Certaines solutions sont homéopathiques, d'autres non. Vous nous avez fourni plusieurs pistes. Ce n'est parce que nous avons rencontré des problèmes dans le domaine social et dans le domaine de l'habitat qu'il nous faut négliger la qualité alors qu'on s'est donné comme priorité la réduction des gaz à effet de serre et la lutte contre le réchauffement de la planète. Les deux aspects sont conciliables. Table ronde sur la « Production d'électricité dans le contexte du renforcement nécessaire de la lutte contre le changement climatique », réunissant : Présidence de M. Jean-Yves Le Déaut, Président M. le Président : Nous avons débattu la semaine dernière des principaux secteurs de la demande d'énergie : transports, agriculture, bâtiment et habitat et des émissions de gaz à effet de serre en examinant les principales voies susceptibles de réduire ces émissions. Aujourd'hui, nous envisageons de faire le point sur l'offre d'énergie électrique, en fonction des besoins prévisibles en électricité, les économies de consommation nécessaires et possibles, et les possibilités de développement des différents modes de production. Je vais demander à chacun de nos intervenants de bien vouloir se présenter brièvement. M. Philippe GARDERET : Je suis directeur de l'innovation à AREVA. Je m'intéresse aux technologies de production d'électricité. Par les réacteurs nucléaires, mais aussi par d'autres moyens, notamment les piles à combustible, ainsi qu'à la manière dont se constituent et se régulent aujourd'hui les grands réseaux. M. Jean-François LUCIANI : Je suis conseiller auprès du Haut commissaire à l'énergie atomique et si je suis là aujourd'hui, c'est que je mène une réflexion sur l'ensemble des énergies non nucléaires. M. Benjamin DESSUS : Je suis responsable de « Global Chance », une association de très petite taille composée d'experts et de chercheurs qui travaillent essentiellement sur les problèmes d'énergie et d'environnement, et s'occupent des systèmes énergétiques. M. le Président : Et vous avez été corédacteur d'un rapport célèbre. M. Benjamin DESSUS : J'ai en effet rédigé un rapport avec le Commissaire au Plan de l'époque, Jean-Michel Charpin et le Haut Commissaire à l'énergie atomique de l'époque, René Delat, rapport destiné à Lionel Jospin, qui était Premier ministre. Ce rapport portait sur l'avenir, notamment économique, de l'énergie nucléaire. Mme Claude NAHON : Je suis directrice des énergies renouvelables et du développement durable à EDF. A ce titre, je m'intéresse bien entendu aux changements climatiques. M. Benoît LEBOT : Je représente l'association Negawatt, qui regroupe un certain nombre de praticiens des économies d'énergie, de la maîtrise d'énergie et des renouvelables. Nous communiquons surtout par l'Internet. Nous avons décidé de capitaliser nos connaissances pour savoir ce que nos idées pèsent dans le débat énergétique. Nous avons eu l'occasion de proposer, en 2003 et en 2006, un scénario énergétique pour la France. M. François JACQ : Je suis directeur de la demande et des marchés, à la Direction générale de l'énergie et des matières premières, la DGEMP. M. Christian NGÔ : Je suis le délégué général de l'association Ecrin, qui essaie de rapprocher les laboratoires de recherche de l'industrie. Nous étudions notamment les problèmes d'énergie, de transport et d'environnement. M. le Président : M. François Jacq s'exprimera sur les perspectives à moyen et à long terme de la production d'électricité, en fonction de l'évolution prévisible des besoins dans le contexte des changements climatiques. M. François JACQ : Sur cette planche, j'ai rappelé des éléments de contexte déjà parfaitement connus de vous : la loi de programme et d'orientation du 13 juillet 2005 sur la division par 4 et les différents engagements correspondants ; la sécurité de l'approvisionnement et l'équilibre du réseau électrique ; la maîtrise des prix et la compétitivité. La hausse des prix de l'électricité sur les marchés de gros, actuellement, est pour nous une difficulté. Cette planche fait le pont entre la question du changement climatique et celle de l'électricité. Vous voyez là les origines des émissions par secteur, d'après les données de l'Agence internationale de l'énergie. J'appelle votre attention sur la partie bleue, qui correspond aux émissions du secteur électrique : au plan mondial, le secteur électrique représente un gros tiers, et en France 11 % seulement, du fait de l'usage du nucléaire. Quelle que soit la place que l'on assigne à l'électricité, la maîtrise de l'électricité est un facteur important, face aux enjeux climatiques. Mais ce n'est pas le seul. D'où l'idée de conjuguer les actions sur les différents modes de production, afin de les rendre les plus sobres possibles, et sur la demande. En termes de bilan et de perspectives, l'affaire n'est pas que française. Elle est surtout européenne. Si on regarde quelques chiffres qui sont donnés à la fois par l'ETSO, l'association des réseaux de transport et l'AIE, on s'aperçoit, au plan européen, de besoins tout à fait considérables en termes de capacités de production sur la période 2007-2015 ; et plus encore sur la période 2015-2030. Les besoins de 100 000 MW anticipés à moyen terme correspondent par exemple peu ou prou au parc français. D'où la nécessité de renouveler les moyens dans les années qui viennent. En termes de demande, il faut bien voir que les outils dont on s'est doté en France pour apprécier cette demande sont liés à des considérations sur l'équilibre du réseau électrique. Un des outils prévu par la loi est le bilan prévisionnel du réseau de transport d'électricité, qui essaie d'évaluer la demande pour obtenir une couverture raisonnable de la demande par l'offre. Le bilan de l'année 2005 montre une progression de la demande de 0,5 % par rapport à 2004. Notez que si cette progression n'est que de 0,5 % au total, elle est de 2 % pour le résidentiel et le tertiaire. La demande d'électricité continue à progresser au fil des années. Néanmoins, la pente s'infléchit. Les hypothèses adoptées lors de l'exercice de programmation pluriannuelle et d'investissement et de bilan provisionnel RTE sont indiquées ici : 1,7 % par an jusqu'en 2010, 1,3 % ensuite, de manière à refléter cette tendance à la baisse de la croissance d'une part, et à prendre quelques marges de précaution par rapport à la sécurité du réseau d'autre part. S'agissant de l'offre et de l'équilibre entre offre et demande, différents éléments ressortent du travail du bilan prévisionnel et de la programmation pluriannuelle et d'investissement. Que faudrait-il mettre, en regard, au niveau français, pour maintenir à peu près les capacités d'export actuelles ? En matière de renouvelables, l'analyse est claire : l'éolien est le secteur le plus dynamique. Le dernier chiffre est de plus de 750 MW en fonctionnement, donc plus de 60 % de hausse par rapport à 2004. Même si on est encore loin de l'Allemagne, la progression est sensible. L'hydroélectricité et la biomasse sont également à développer, les autres énergies renouvelables (ENR) électriques étant plus marginales. Dans le cadre du travail fait autour du bilan prévisionnel et de la programmation pluriannuelle, plusieurs hypothèses assez volontaristes ont été faites s'agissant du développement de l'éolien, avec une fourchette entre 10 et 15 GW à l'horizon 2010. Autre hypothèse, qui figure dans la PPI : la mise en service d'un EPR à l'horizon 2012. De cela on tirera plusieurs éléments sur la sécurité de l'approvisionnement et sur l'état actuel du réseau français : jusqu'à l'horizon 2010, on ne devrait pas connaître de difficultés particulières de sécurité d'approvisionnement. Certains besoins, en semi-base et en pointe, apparaîtront à partir de 2008-2009, mais ils sont déjà en partie couverts par la remise en service, par EDF, d'un certain nombre d'installations thermiques à flammes. On prévoit évidemment l'extinction de la plupart des centrales à charbon et leur substitution par les sites combinés gaz, ce qui devrait avoir également un effet favorable en termes d'émissions et nous permettre de boucler l'équilibre sur la période 2005-2015 au moins. J'en terminerai avec une dernière planche sur les perspectives plus lointaines. La division par 4 revient à économiser de l'ordre de 7 fois les émissions actuelles du secteur électrique. On voit bien qu'il est crucial de maintenir notre effort sur le secteur électrique, même si ce n'est qu'une partie du problème, à côté des transports. La solution ne passera que par une combinaison : maîtrise de l'énergie, substitution éventuelle entre énergies et action sur l'équilibre des modes de production. La situation dépendra aussi de l'évolution de la demande, qui passera par un effort crucial dans le domaine de la maîtrise de celle-ci. Nous avons tout intérêt à maîtriser la consommation d'électricité. Ensuite, il faudra procéder à des dosages plus ou moins subtils suivant le volume de capacité nucléaire que l'on souhaite ou que l'on est capable de gérer, conforter les hypothèses actuelles sur le développement des énergies renouvelables ; s'interroger à propos des combustibles fossiles et du basculement du charbon vers le gaz. Cela ouvre des pistes de réflexion pour trouver un chemin vers le facteur 4 à horizon 2050. M. le Président : Mais plutôt que le « facteur 4 », nous avons en perspective, pour 2010, les objectifs de la directive européenne. Est-ce que nous sommes « dans les clous » ? Comment comptez-vous faire pour y arriver, sachant que nous avons pris beaucoup de retard dans le domaine de l'éolien ? Peut-on rattraper ce retard d'ici 2010 ? Les autres énergies renouvelables sont assez faibles pour l'instant. M. François JACQ : Sur la directive et les 21 %, mettons que nous soyons aujourd'hui autour de 14 % et que la situation soit assez fluctuante d'une année sur l'autre, en raison du niveau d'hydraulicité et de consommation intérieure. Il est évident que l'objectif de 21 % est ambitieux et qu'il sera difficile à atteindre. Il passera par un développement vigoureux de l'éolien, à hauteur d'environ 13 GW. La partie biomasse avec cogénération de production d'électricité peut venir en complément, mais il faudra s'appuyer avant tout sur l'éolien et le maintien de l'hydraulique, qui a pourtant tendance à baisser. Les 13 GW sont donc envisageables, mais avec un effort très volontariste. M. le Président : On en était à combien, fin 2005 ? M. François JACQ : A 745 MW, soit 0,745 GW. On peut espérer bénéficier du dispositif voulu par la loi des zones de développement de l'éolien. Cela offre un cadre pour travailler en termes d'acceptation locale et de connexion au réseau. Il est en effet aussi compliqué de construire la ligne qui va évacuer le courant que de construire une éolienne. Bon an mal an, avec un gros effort de maîtrise de l'énergie, nous devrions pouvoir tenir les 21 %. Les calculs actuels tiennent compte d'une progression de la demande, alors qu'on peut raisonnablement espérer que la consommation progressera moins que les 1,3 ou 1,7 % prévus. De toute manière, ce sera difficile. Mme Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET, Rapporteure : Vous n'avez pas parlé du peak oil ? Est-ce que vous l'intégrez dans vos réflexions ? On a entendu divers points de vue. Quel est le vôtre ? Selon certains, il serait derrière nous, devant nous, à trente ans, etc. M. François JACQ : Ce matin, nous faisions le bilan de l'année énergétique. Claude Mandil, le directeur exécutif de l'Agence internationale de l'énergie, disait qu'il se garderait bien de prendre des positions définitives sur la survenue du peak oil, car il ne savait pas ce qu'il en serait. Est-ce que le peak oil interviendra en 2015, 2020 ou 2030 ? C'est un débat d'experts géologues qui passe par l'interprétation des gisements. Par exemple, Matt Simon prédit une survenue plus précoce qu'escompté, en fonction de données relatives aux gisements d'Arabie saoudite, la quantité d'eau extraite en même temps que le pétrole devant annoncer un tarissement précoce des gisements. Les géologues le démentent. Pour autant, l'ensemble du sujet reste matière à débat. Il faut savoir que le problème des ressources gazières risque de se poser tout autant. Avant l'augmentation des prix, il y avait une nette tendance à une substitution par le gaz pour les moyens de semi-base ou de pointe. Cela fait partie du paysage global de réflexion et cela ne fait que rendre indispensable l'effort de maîtrise d'énergie. Mme la Rapporteure : Le prix du gaz est-il corrélé avec le prix du pétrole ? Y aura-t-il un découplage, au moment du peak oil, si peak oil il y a ? Est-ce qu'à la crise de l'un correspondra la crise de l'autre ? M. François JACQ : Vous avez raison. Actuellement, il existe un mécanisme de marché, pour le calage des prix du gaz. C'est d'ailleurs un problème, que la mission mise en place par M. Thierry Breton et qui est composée de MM. Durieux, Brochant et Chevallier, doit examiner. Aujourd'hui, il n'y a pas de corrélation physique et absolue entre le prix du pétrole et le prix du gaz, même s'il peut y avoir co-exploitation sur certains gisements. Mais pour éviter la volatilité des marchés, on a procédé à un calage sur les prix du pétrole et on a trouvé commode d'articuler les prix de l'un sur les prix de l'autre. Selon les experts, dès que le marché aura acquis un peu plus de souplesse et que certaines voies, telles que le GNL, se seront développées, une déconnexion devrait se faire petit à petit et le marché du gaz devrait trouver sa régulation propre. Mais sans doute pas avant dix ans. M. Serge POIGNANT : 13 GW pour 2010, cela nous fait gagner 5 % de notre consommation. A 2 000 ou 2 200 heures, cela fait 27 TWh. Or un document des syndicats fait état de 35 TWh. Par ailleurs, avez-vous les chiffres sur l'éolien installé en Allemagne ou au Danemark ? Ceux sont nous disposons remontent à 2003 ou 2004. Mme Claude NAHON : Je pense que cela n'a pas bougé par rapport à l'année dernière. Les Allemands ont atteint 9 % d'énergies renouvelables, avec à peu près 4 à 5 % d'hydraulique et 4 à 5 % d'éolien. Ils n'arrivent plus à installer d'éoliennes, pour des raisons de réseau. J'ai lu qu'ils avaient besoin de renforcer leur réseau de lignes à haute tension et qu'ils avaient besoin, pour continuer à se développer, de construire autant de nouvelles lignes. M. François JACQ : De mémoire, ils en sont autour de 10 000 MW. Mme Claude NAHON : Pour moi, c'est plus : 16 000. M. Benjamin DESSUS : C'est plus ! M. Benoît LEBOT : 17 000. M. Christian NGÔ : Je crois que c'est 13 000. Mais j'ai les chiffres dans mon ordinateur. M. le Président : Finalement, on n'a pas répondu à M. Poignant. M. François JACQ : Je confirme les 2 000 heures. M. Benjamin DESSUS : Je voudrais renforcer ce que disait M. Jacq à propos des 21 %. C'est bien un numérateur sur un dénominateur. Il faut comparer l'objectif de 25 TWh à l'augmentation prévisible de la consommation d'électricité, qui se situe entre 6, 7 et 8 %, je suppose par an. Autrement dit, tout effort sur la consommation d'énergie électrique a une influence très rapide sur cette évolution. Faire 13 GW d'éolien avant 2010, ce ne sera pas facile et on n'y arrivera probablement pas. Tout effort que nous pourrons faire sur la consommation d'électricité nous permettra d'y arriver beaucoup plus rapidement et beaucoup moins difficilement. Consommer moins, c'est produire plus et je crois que nous ne l'avons pas suffisamment en tête. Or nous avons plus de marges de manœuvre du côté de la consommation que du côté de la production. M. Christian NGÔ : Selon le rapport 2003 des Allemands, il y avait en Allemagne 14 300 MW d'installés, qui produisaient 18,6 TWh, ce qui correspond à un rendement de 14,8 %. M. Serge POIGNANT : Oui, mais ce sont les chiffres 2003. Mme Claude NAHON : Dans les 21 %, il y a l'hydraulique. Je me permets d'insister, car il y a un problème de cohérence entre les lois et les directives européennes. On assiste aujourd'hui à des réductions significatives de l'hydraulique. Je pense notamment à ce qui se passe à l'étang de Berre. Je voudrais faire remarquer que tous les KWh ne se valent pas. S'ils se valent à la consommation, ils ne se valent pas à la production. Cela induit un certain nombre de conséquence au niveau des réseaux. En Allemagne, l'éolien marche mieux que ce qu'on a l'habitude de penser, mais il faut apprendre à le gérer. Sinon, cela coûte plus cher que les Allemands ne veulent bien le dire. Pour revenir à la notion de prix de l'électricité, je pense qu'il est important de voir qu'on n'intègre absolument pas tous les coûts liés à un certain nombre de facteurs. Je pense au CO2. Quand on a vu le prix du CO2 sur les marchés de l'électricité et qu'on regarde les conséquences que cela pourrait avoir demain sur le prix de l'électricité pour les particuliers en France, en Allemagne ou en Europe ; quand on voit l'augmentation du prix de l'énergie et qu'on constate que celui de l'électricité est relativement stable, on se dit bien qu'il y a un problème. Même si ce n'est pas possible à court terme, il faudra bien que le prix de l'électricité pour les particuliers augmente un jour ou l'autre en Europe. Le CO2 coûtera presque aussi cher que l'électricité. C'est un problème global de rentabilité des investissements de maîtrise de l'énergie. M. le Président : Pourriez-vous nous faire la démonstration, sur un document, de la phrase que vous venez de prononcer, sur le fait que le CO2 va coûter presque aussi cher que l'électricité ? Mme Claude NAHON : On va arriver à doubler le prix de l'électricité. M. Philippe TOURTELIER : Dans l'hypothèse du maintien des capacités à l'export, que représente justement cette part export ? Est-ce lié à la structure de notre parc et au fait que nous ne savons pas quoi faire de notre électricité à certains moments ? Des négociations ont lieu avec RTE à propos des grandes fermes éoliennes. Est-ce qu'il y a des négociations pour faire en sorte jqu'on récupère l'électricité plus diffuse ? Le réseau est très adapté à une distribution centralisée, mais complètement inadapté à une collecte décentralisée. Y a-t-il une réflexion de fond pour qu'on puisse s'en sortir et développer l'éolien autrement que dans les grandes fermes ? M. François JACQ : Un certain nombre de contrats à long terme nous lient à plusieurs de nos voisins. L'hypothèse qui est prise autour du bilan prévisionnel et du projet de PPI est le maintien de ces contrats à long terme. En termes de volume net d'exportation, on en était à 62 TWh nets exportés. Il n'y a pas à proprement parler d'excédents du parc. Il faut savoir que sur quelques journées de l'année 2005, dont deux en février et mars, nous avons été assez significativement importateurs nets. Lors de l'incident réseau qui a eu pour effet la déconnexion des quatre tranches de la centrale de Paluel, nous nous sommes trouvés les 30 et 31 décembre dans une situation un peu tendue et nous avons eu recours à l'interconnexion, mais cette fois-ci dans l'autre sens. Ce que nous pouvons apporter à nos voisins, ils nous le rendent dans certains cas. S'agissant des fermes éoliennes, vous avez raison. Il y a un problème de réseau et les situations sont extrêmement compliquées en termes de raccordement. Au plan local, un raccordement est toujours difficile. La DGETIP a dû résoudre un certain nombre de problèmes au niveau des lignes. Le dernier dossier instruit en date a été celui de la ligne qui va alimenter la région PACA (Boutre Carros). Ce dossier « cheminait » depuis dix ou quinze ans. C'est dire si c'est compliqué. Autour des fermes d'éoliennes, l'idée est d'éviter le mitage et d'avoir une concentration. Selon la loi, la ZDE se définit par une limite basse et une limite haute. Dans le travail qu'on a commencé à faire en partenariat avec RTE, nous sommes partis de l'idée que la réalisation des branchements prend souvent plus de temps que le montage des projets. Nous réfléchissons à la possibilité d'aménager, autour des zones de développement, des renforcements de réseau préventifs pour que, le jour venu, il y ait à peu près concomitance entre l'installation et la ligne qui permet d'évacuer son énergie. Ce n'est pas évident, car lorsque vous devrez justifier la ligne auprès de la population, on vous dira : oui, mais est-ce qu'il est sûr que l'éolien se fera là ? C'est un peu le serpent qui se mord la queue, mais nous cherchons des solutions. M. François DOSÉ : Ce ne sont pas les masses ni les pourcentages qui m'intéressent, mais la tendance. L'objectif est de 21 %. On a dit qu'on en était à 15 %. Je pensais que nous n'étions plus là et qu'on avait enregistré un repli. Quelle est la tendance actuelle ? Est-ce qu'on se rapproche ou est-ce qu'on s'éloigne de ces 21 % ? M. François JACQ : Ces dernières années, la tendance ne va pas dans le bon sens, parce que c'est l'hydraulique qui occupe la plus grande place. Or l'hydraulique est dépendant de deux phénomènes : la ressource en eau peut manquer ; d'autre part, s'agissant du partage de l'usage de l'eau, chaque fois que nous renouvelez une concession, vous devez veiller à un certain nombre de contraintes : passe à poissons, débit réservé, .. Mon rôle est de promouvoir l'usage énergétique de l'eau. Je n'ai pas à juger s'il est bon ou pas que les saumons ne puissent pas remonter tout en haut de l'Allier. Mais quand vous effacez un barrage, c'est autant de perdu. Mme Claude NAHON : On ne peut pas donner les chiffres, mais ils sont très mauvais : de l'ordre de 20 à 25 % de moins que la normale. M. le Président : Pas en puissance installée. Mme Claude NAHON : Non, c'est un problème de sécheresse. M. le Président : L'hydraulique est cyclique et dépend de la quantité d'eau. Mme Martine BILLARD : Je voudrais poser une question sur les taux de croissance annoncés. Lorsque vous annoncez ces taux de croissance, prenez-vous en compte une politique globale de réduction et d'économie d'énergie ? Vous basez-vous sur la consommation actuelle ? M. François JACQ : Ces taux incorporent les mesures de maîtrise décidées aujourd'hui. Dans le bilan prévisionnel, vous avez trois variantes, avec des taux plus ou moins élevés. L'outil est d'ailleurs bien adapté à la sécurité du réseau : on est sûr de ne pas assister à un effondrement du réseau, dans la mesure où l'on peut s'assurer une marge dans la demande qu'on aura à satisfaire, afin de ne pas être trop court. Dans une politique de maîtrise d'énergie, il est clair qu'il faudrait faire des taux plus bas, tout en évitant un effondrement du réseau. D'où l'effort que l'on conduit et les mesures que l'on va continuer à prendre : je pense au dispositif des certificats d'économie d'énergie, qui sera en place à partir de cette année. Or ce dispositif n'est, en effet, pas encore intégré. M. Jean-Pierre NICOLAS : Vous semblez nourrir beaucoup d'espérances sur l'énergie éolienne. Mais à quel prix ? M. François JACQ : Aujourd'hui, vous avez deux modalités tarifaires, qui évolueront avec la mise en place des ZDE : ou obligation d'achat au titre de la loi de 2000 avec des installations inférieures à 12 MW ; ou ce qui ressort des appels d'offres. C'est assez compliqué : par exemple, en cas d'obligation d'achat, le tarif est décroissant au bout d'une première période. Pour vous donner un ordre d'idée, sur l'off-shore, on dépasse la centaine d'euros le MW et sur le terrestre, on est autour d'un tarif d'achat moyen de 75 euros le MW. Si vous faites le delta par rapport à la production de base à 32 euros, vous avez le montant de la compensation financée par laCSPE. M. le Président : Nous aborderons dans la troisième partie la question du nucléaire et de l'externalités des coûts. Nous passons maintenant au deuxième thème : la maîtrise des besoins en énergie. M. Benoît LEBOT : Je focaliserai ma présentation sur l'électricité et la demande d'électricité et j'insisterai sur l'importance de la maîtrise de la demande. La démarche Negawatt a été élaborée par un groupe d'une vingtaine d'experts qui, comme moi, travaillent au quotidien soit sur les problèmes d'économies d'énergie, soit sur les énergies renouvelables. A titre d'exemple, je suis actuellement au Programme des Nations unies pour le développement, je travaille pour l'Unité du fonds pour l'environnement mondial ou FEM, et mon métier est de financer les programmes d'économies d'énergie dans les pays en développement. J'ai été préalablement ingénieur à l'ADEME et j'ai passé six ans à l'Agence internationale de l'énergie. La démarche Negawatt s'appuie sur trois étapes, que sont : la sobriété énergétique, l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables. La sobriété consiste à attaquer tous les gisements d'économie d'énergie dus à des gaspillages. L'efficacité énergétique passe par l'amélioration des rendements sur toute la chaîne de production, tant au niveau de la production que de la distribution et de l'utilisation de l'énergie électrique. Enfin, quand cet effort est fait et uniquement à ce moment-là, les énergies renouvelables ont vraiment leur place et l'on peut envisager, à l'horizon 2030-2050, un avenir compatible avec le « facteur 4 ». Nous avons réalisé un scénario pour la France, qui porte à la fois sur les transports, sur la chaleur et sur l'électricité. En orange, vous avez le tendanciel, qui correspond globalement aux propositions de la DGMP. En rouge vous avez la sobriété énergétique. Revenir à des gestes simples et arrêter certains gaspillages est à notre portée. Nous l'avons quantifié. En jaune, vous avez l'efficacité énergétique. Quand vous combinez les deux, vous arrivez au scénario Negawatt en bleu. Nous pensons aujourd'hui qu'il est à notre portée de stabiliser la demande d'électricité. Cela suppose un certain nombre d'éléments. Je vous livre les résultats d'une étude qui a été financée par la Commission européenne il y a quelques années. Une vingtaine de foyers ont fait l'objet d'une enquête particulière : on a analysé leur consommation de chaque usage pendant deux ans, sachant que certains consomment beaucoup plus que d'autres. A la fin de la première année, on a remplacé les appareils utilisés par les appareils les plus performants que l'on trouvait à l'époque sur le marché. La différence apparaît en vert : ce sont les « negawatts ». On constate que l'on peut envisager aujourd'hui de diviser par 3,2 la consommation des réfrigérateurs et congélateurs. Dans la plupart des cas, leur usage a été amélioré et les appareils sont plus grands. On peut penser que les réfrigérateurs et les congélateurs ne représentent pas grand-chose. Or, lorsqu'on compare leur consommation et celle du parc SNCF avec son réseau électrique et ses TGV, on constate que la première est plus de deux fois supérieure : environ 18 TWh d'électricité consommés annuellement par le parc des réfrigérateurs et congélateurs contre 7 TWh pour la SNCF. Cela signifie que si l'on parvient à mettre en place des programmes qui diffusent ces appareils performants qui existent aujourd'hui, on pourra doubler la consommation destinée aux transports sans plus de capacités. Vous avez sans doute entendu parler de cette étiquette « énergie » qu'on trouve en France et en Europe sur les appareils électroménagers. J'ai participé à son élaboration, lorsque j'étais à l'ADEME et auprès de la Commission européenne. On peut se demander si cette étiquette a un impact. En 1992, lorsqu'on a démarré les études, on a fait le schéma de la distribution des réfrigérateurs et congélateurs en pourcentage des ventes pour chacune des catégories, de A à G, sur le marché européen. L'étiquette a été introduite en 1995. Avant même qu'elle ne soit apposée partout, on a refait le même schéma en 1996. Et on s'est aperçu de l'effet de transformation du marché que pouvait avoir un tel outil parce qu'il était devenu obligatoire et systématique. 1992 apparaît en rouge et 1996 en jaune. Depuis, l'étiquette est rentrée dans les mœurs. Elle a eu un impact sur les fabricants, les distributeurs et les consommateurs. On s'en est aperçu en 1999. Les derniers chiffres à notre disposition datent de 2003. Nous avons réussi à transformer le marché comme jamais nous ne l'aurions espéré. Cette transformation s'est accompagnée d'une réduction moyenne du coût des appareils. Aujourd'hui, un appareil consomme 40 % de moins qu'il y a dix ans, pour un coût inférieur. Cette mesure d'affichage des consommations s'est accompagnée, en 1999, de l'introduction d'un seuil de performance énergétique pour nettoyer le marché des appareils les moins performants. On peut observer de la même manière l'évolution du marché des lave-linge et celle des lave-vaisselle. L'Agence internationale de l'énergie est allée beaucoup plus loin que nous-même dans nos analyses Negawatt. Elle a estimé la demande d'électricité en secteur résidentiel européen à l'horizon 2030, et ce pour chaque usage. Elle a pu ainsi mesurer l'impact des politiques actuelles - étiquettes sur certains appareils, seuils de performance, programmes imposés à certains opérateurs énergétiques. Cet impact sera de 8 et 10 %. C'est bien, mais la demande n'en continue pas moins d'augmenter. En 2003, l'AIE a imaginé un scénario consistant à pousser l'ensemble des marchés vers les technologies performantes que l'on connaît et qui sont rentables pour le particulier. On s'aperçoit qu'on pourrait, en démarrant des programmes massifs, réduire de 31 % en quelques années la demande d'énergie électrique. Il est surprenant de voir quelles sont les économies d'énergie possibles dans le secteur des technologies de l'information : Internet, télévision, etc. Il y a une grande différence entre faire quelque chose - je pense à cette fameuse veille, qui ne cesse de se multiplier sur certains appareils - et ne rien faire. Une projection des économies d'électricité par usage à l'horizon 2030 a été également réalisée. Je précise que, dans un tel exercice, on n'a pas fait de substitution d'énergie : le chauffage et l'eau chaude sanitaire restent électriques. Deux mesures phares contribueront à la maîtrise de la demande d'électricité : l'affichage systématique des consommations, l'introduction d'un seuil minimum de performance énergétique. Il faut généraliser l'étiquette A à G sur tous les équipements. Aujourd'hui, la directive européenne de 1992 limite le nombre d'appareils sur lesquels on peut apposer cette étiquette « énergie ». La liste est longue des appareils qui attendent d'être étiquetés. Mais on n'a pas la volonté de le faire. Il faut rendre obligatoire sur tous les supports commerciaux et publicitaires les catégories de performance énergétique ; renforcer au niveau national et européen les équipes et les moyens de définition de ces outils de transparence et de transformation des marchés. L'étiquette est un outil structurant de la maîtrise de la demande d'électricité. C'est parce qu'on aura une étiquette que ces certificats d'économie d'énergie seront plus faciles à organiser ; et qu'on pourra organiser, si on le souhaite, une TVA réduite sur les appareils les plus performants, des crédits d'impôt, des campagnes de communication. Introduire de façon obligatoire sur tout support publicitaire et commercial l'appartenance de la catégorie par un simple logo, de A à G, ne coûterait rien au législateur français ou européen. Je ne sais pas quelle économie d'énergie il en résultera, mais il en découlera un certain nombre de réactions. Cette étiquette sera bientôt introduite sur les automobiles et sur les bâtiments, dans le cadre du diagnostic de performance énergétique. Imaginez l'impact que cela peut avoir. Les enjeux de la lutte contre l'effet de serre méritent qu'on introduise plus de transparence dans toutes les décisions qui seront prises au quotidien. Comment voulez-vous que nos concitoyens s'y retrouvent, si on ne leur donne pas de signaux ? Généraliser l'étiquette « énergie » va bien au-delà de l'automobile, des bâtiments et des équipements, car il y a des équipements liés au matériel de construction, les pneus, les appareils électroniques, etc. Les seuils minimaux de performance énergétiques sont l'autre pilier de la maîtrise de l'énergie à grande échelle. Ils concernent tout type d'équipement. Les normes de sécurité sont l'exemple à suivre. Aujourd'hui, au quotidien, vous achetez un ordinateur, une ampoule, un réfrigérateur. Vous posez-vous la question de savoir si cet appareil sera sûr et que vous n'aurez pas de choc électrique en le branchant ? Aujourd'hui, plus personne ne se la pose, parce qu'il y a des normes, destinées à protéger la vie humaine, qui s'appliquent à tous les appareils électriques. Il faudrait qu'on parvienne demain à imposer des normes de consommation d'énergie, pour évacuer du marché les appareils les moins performants et faire que, par défaut, l'appareil que vous achetez soit performant ; éventuellement, on pourrait indiquer que celui-ci est plus performant que celui-là. Des milliers de vies humaines ont été sauvées en Chine, là où l'on fabrique un certain nombre de nos appareils électriques, grâce à l'institution de normes de sécurité au plan international. La directive européenne 2005/32/EC permet de développer ces seuils minima de performance. Mais nous ne voyons pas de moyens, ni financiers ni humains pour que cette directive vive et serve la cause des économies d'énergie à grande échelle. Introduire un seuil minimum de performance énergétique, c'est mettre au rebut les technologies obsolètes. Nous n'avons plus besoin, par exemple, de lampes à incandescence, technologie inventée par Edison en 1876. La veille des équipements électriques est de plus en plus conséquente. La production d'électricité éolienne en Allemagne est de 18 TWh. En 2001, la veille était à 20 TWh ! Ce qui signifie que les éoliennes, en Allemagne, ne suffisent pas à compenser le gaspillage d'électricité que constitue la seule veille des équipements électriques des ménages et des bureaux. Pour supprimer cette veille, une norme au moins européenne, sinon internationale comme le propose l'AIE, est à notre portée. Les industriels sont d'accord ; ils veulent seulement que la mesure soit globale. Il y a des marges de manœuvre énormes dans tout ce qui est transformation d'électricité. Les rendements des transformateurs, des plus petits aux plus grands, peuvent être améliorés et il y a donc des gains très significatifs à faire, au niveau d'un pays. Il faut mettre au rebut les moteurs les moins performants et les systèmes d'air conditionné inefficaces, etc. On a déterminé cinq étapes de maîtrise de la demande d'électricité. Première étape : connaître les enjeux, et se donner les moyens de faire les études. Par exemple, dans un bâtiment comme celui où nous nous trouvons, on ne s'est jamais donné les moyens de savoir où passait l'électricité. Tant qu'on n'améliorera pas nos connaissances, on ne pourra pas prendre de décisions. Il faut donc que nous nous donnions les moyens de bien connaître les enjeux. Deuxième étape : informer et communiquer. Troisième étape : stimuler la recherche et le développement dans le bon sens. Il est très important de continuer à les financer. Celui qui trouvera la technologie permettant d'atteindre des rendements lumineux de 120 à 150 ou 200 lm par watt pour l'éclairage aura plus d'influence que toutes les éoliennes et les centrales nucléaires qu'on pourra installer sur l'ensemble de la terre ! Quatrième étape : réglementer. La réglementation est utilisée dans tous les pays de l'OCDE en dehors de l'Europe. L'Europe est à la traîne parce que, malgré une directive qui date d'il y a deux ans, elle ne s'est pas donné les moyens de mettre en place ces seuils de performance réglementaires. Il est curieux de constater que la Chine, qui a vraiment besoin de faire des économies d'énergie, impose aujourd'hui sur son territoire des appareils à air conditionné et des moteurs et transformateurs ayant un certain niveau de performance. et exporte les plus mauvais en Europe. Cinquième étape : diffuser. On doit pouvoir imposer les certificats de performance énergétique et les obligations aux opérateurs que sont l'administration et les collectivités nationales, lesquelles doivent donner l'exemple lors des achats publics. On pourra ainsi diffuser les technologies. Pour conclure, je vous livre ce graphe sur l'évolution des consommations d'électricité par habitant en Californie, comparée à celle de chaque habitant des États-Unis, depuis 1960. Il se trouve que la sixième puissance mondiale qu'est la Californie a depuis toujours des contraintes en alimentation en énergie électrique. Depuis longtemps, elle a pris à bras-le-corps le potentiel « negawatt » d'économie d'énergie. Et vous voyez quel en est le résultat : depuis bientôt vingt ans, la consommation d'électricité par habitant est restée quasiment stable. Nous connaissons même le détail des programmes engagés : c'est une combinaison de seuils obligatoires de performance, de réglementation thermique et d'obligations faites aux fournisseurs d'énergie pour économiser l'électricité avec, en gros, un surcoût de 1 % sur les factures. La carte des étiquettes « énergie » dans le monde montre qu'un certain nombre de pays ont adopté l'étiquette européenne : la Russie, la Chine, l'Afrique, l'Amérique latine. Il est peut-être difficile d'y exporter le nucléaire ou l'éolien. Mais il y a là un exemple d'exportation de negawatts. Il faut enfin mettre les technologies obsolètes au rebut ou dans les musées. Mais ne nous trompons pas d'enjeu ni de moyens. M. Christian NGÔ : Sur l'ensemble de la planète, sur les 10 milliards de TEP que l'on consomme, on en perd 40 % dans les transformations, et l'utilisateur final n'a donc à sa disposition que 6 milliards de TEP, qui se répartissent en électricité, transports et chaleur. Si l'on veut limiter notre consommation d'énergie et l'émission des gaz à effet de serre, il faut jouer sur les trois facteurs, et notamment la chaleur. On s'aperçoit qu'on peut fabriquer de l'électricité à partir d'à peu près n'importe quoi. Ce n'est pas le cas de la chaleur. Quant aux transports, ils sont essentiellement basés sur l'utilisation du pétrole - celle du gaz et de la biomasse étant marginale. Si on se focalise sur la production d'électricité, notre monde étant dominé par des sources carbonées, si l'on veut réduire les GES, on devra essayer de séquestrer le CO2. Mais en dehors des problèmes de sécurité, se pose un problème de séparation chimique. Les technologies actuelles ne pourraient pas être utilisées car on aurait des pertes de rendement de l'ordre de 20 à 25 %. Il faudra donc mettre au point une technologie spéciale, par exemple en brûlant des combustibles fossiles avec de l'oxygène pur. Seulement, il faudra fabriquer ce dernier à partir de l'air, ce qui coûtera de l'énergie. Bien que toutes les mines soient fermées en France, il faut savoir que le charbon est une énergie d'avenir. Même dans quelques siècles, on fabriquera du pétrole à partir du charbon. Parmi les sources non carbonées qui permettent de fabriquer de l'énergie sans émission de GES, il y a le nucléaire qui fournit près de 80 % de l'électricité en France. Son intérêt est le faible coût du KWh, et son prix qui est stable pendant cinquante ou soixante ans. Malheureusement, les réserves ne sont que d'une centaine d'années. Dans l'avenir, il faudra développer des réacteurs à neutrons rapides, qui permettront de multiplier par plus de 150 les réserves et d'atteindre plus de 10 000 ans de réserves d'uranium ; mais il faudra les faire fonctionner à haute température, car actuellement, la pollution thermique est énorme. Il y a aussi la fusion thermonucléaire. Mais on ne peut espérer avoir de résultats au niveau industriel que dans un siècle. Parmi les autres sources non carbonées qu'il faut absolument développer, il y a les énergies renouvelables, comme l'hydraulique. Il faut se focaliser sur les sources d'énergie dans le domaine desquelles il existe, en France, des industriels. C'est pour cela que l'éolien et le photovoltaïque ne sont pas forcément les plus intéressants ni les plus compétitifs. En revanche, la biomasse et la géothermie sont des énergies d'avenir. Cela dit, s'agissant de la biomasse, la fabrication d'électricité n'est sans doute pas la meilleure idée ; d'autres valorisations sont bien plus intéressantes : fabrication de biocarburants, de chaleur ou de matériaux. Les énergies renouvelables et le nucléaire demandent des financements dont on n'avait pas l'habitude avec les énergies fossiles. Les investissements initiaux sont lourds, mais, ensuite, le coût de fonctionnement est faible. Pour les énergies renouvelables, la technologie ne suffit pas. Elle doit être complétée par l'éducation et la formation. Sinon, on rencontrera des échecs qui ralentiront leur développement. Il est donc très important de disposer de professionnels compétents pour installer ces énergies renouvelables, ce qui n'est pas toujours le cas en France. Il est souhaitable enfin que, pour ces EnR, existe une industrie nationale associée. Nous sommes capables de produire de l'électricité à 90 % en France sans émissions de GES. Malheureusement, il y en a 10 % qui sont produits dans des centrales à charbon ou des centrales thermiques, ce qui provoque des émissions de l'ordre de 70 grammes de gaz carbonique par KWh - 30 millions de tonnes sont ainsi émises dans l'atmosphère. Il faut essayer de diminuer ces émissions par effet de pointe. Il faut lisser la production - ce que permettent déjà les cumulus - et voir comment utiliser l'électricité produite sans émission de gaz à effet de serre, grâce aux énergies renouvelables et au nucléaire. Pour cela, il faudra des moyens supplémentaires de production d'électricité. L'évolution des émissions de CO2 au cours du temps est très liée à l'évolution économique. Sur cette courbe, vous voyez que ces émissions ont fortement diminué pendant les deux guerres mondiales parce qu'il n'y avait plus d'activité économique - et avec le démarrage du nucléaire. Une manière de mieux utiliser l'électricité, quand on produit de la chaleur, est d'utiliser les pompes à chaleur. Il est dommage qu'en France, on le fasse si peu. Il existe des pompes à chaleur de type air-air, qui permettent des amplifications de l'ordre de 4 : cela signifie qu'une famille qui chauffe sa maison avec une pompe à chaleur paie à peu près quatre fois moins de facture d'électricité. Il faudra développer ce moyen de production dans l'avenir, mais cela demandera de l'électricité supplémentaire. Dans le secteur des transports, il faudra fabriquer des biocarburants avec apport extérieur d'énergie. Actuellement, on en est à 1 tonne de pétrole biocarburant par hectare. Si on apporte de l'énergie extérieure en utilisant de la biomasse, en la gazéifiant et en apportant de l'hydrogène qu'on a fabriqué par électrolyse à partir des EnR ou du nucléaire, on peut arriver à doubler le rendement. Dans les dix, vingt ou trente ans qui viennent, on pourrait réfléchir à un scénario dans lequel les émissions de GES du secteur électrique seraient complètement éliminées, tout en diminuant par deux les émissions du réseau des transports. Il suffirait de développer des véhicules hybrides avec des batteries qui assurent environ 50 km d'autonomie et qui soient rechargeables. On pourrait ainsi récupérer 30 % de l'énergie des transports, à partir de l'électricité et donc sans émission de GES. 20 % de l'énergie du moteur thermique pourrait venir des biocarburants. On pourrait faire au total 50 % d'économie d'énergie et 50 % des émissions de CO2. Cela demanderait des énergies renouvelables et une dizaine de réacteurs supplémentaires. Au niveau du secteur électrique, on n'aurait plus besoin de centrales thermiques de pointe. On calerait le dispositif de manière à produire entièrement l'électricité par les énergies renouvelables et par le nucléaire. La pointe se gérerait au niveau des automobilistes. Quelques jours dans l'année, ils n'auraient pas le droit de recharger leurs batteries et seraient obligés d'utiliser l'essence ou le diesel de leur réservoir. On gagnerait ainsi les 30 tonnes de gaz carbonique qui sont émises. L'hydrogène n'est pas une source d'énergie, mais un vecteur énergétique, au même titre que l'électricité. Il faut de l'énergie pour le produire. L'idéal serait d'utiliser de l'électricité pour faire de l'électrolyse à partir de renouvelables ou du nucléaire pour éviter la production de CO2. Cet hydrogène peut servir dans la pétrochimie, pour améliorer les carburants. Il peut permettre de fabriquer des carburants de synthèse. Il peut être utilisé directement dans les avions, à la place du kérosène, ce qui aurait un bon impact au niveau de l'effet de serre. Il peut être utilisé dans des piles à combustibles stationnaires - immeubles, hôpitaux -, l'avantage étant qu'on peut utiliser, au départ, le réseau de gaz. Pour les transports, l'hydrogène est encore trop cher. Il n'existe pas d'infrastructures. On ne peut pas envisager de l'utiliser dans un avenir proche, avant une décennie. L'hydrogène peut enfin permettre le stockage de certaines énergies renouvelables comme l'éolien. En conclusion, outre les économies d'énergie qui ont été évoquées et d'autres propositions existant dans le domaine de la chaleur et des transports, la France a un énorme potentiel pour diminuer ses émissions de gaz à effet de serre. On peut produire de l'électricité à partir de sources non carbonées pour des applications dans le domaine de la chaleur et des transports. Pour vous donner un ordre de grandeur, en France, cela correspond à 450 TWh d'électricité ; 500 TWh pour les transports, 1 000 TWh pour la chaleur, dont 500 qui servent à faire de l'eau chaude. Il va falloir introduire des technologies qui sortent un peu de l'approche « business as usual » : pompes à chaleur, véhicules hybrides rechargeables, carburants de synthèse BTL. M. Philippe TOURTELIER : C'est la première fois que j'entends dire aussi nettement que l'hydrogène peut être une réponse aux problèmes d'intermittence et de pointe. M. Christian NGÔ : Cela pourrait s'appliquer au stockage de l'électricité produite par les éoliennes. Lorsqu'il y a du vent, il n'y a pas forcément un besoin d'électricité associé. Ce n'est pas simple : il faut utiliser cette électricité pour fabriquer de l'hydrogène, ce qui fait perdre de l'énergie. Ensuite il faut stocker cet hydrogène, c'est-à-dire le comprimer, ce qui fait perdre également beaucoup d'énergie. Ensuite, soit on l'utilise sur place pour produire de l'électricité au moment de l'appoint avec une pile à combustible, soit on le transporte, ce qui n'est pas forcément la meilleure solution. Actuellement, pour stocker l'électricité du grand éolien, il n'y a guère que l'hydraulique. Cela veut dire que l'éolienne doit être bâtie près d'une montagne. Le stockage hydraulique est par ailleurs de faible densité : il faut 3 600 litres d'eau à une hauteur de 100 mètres pour fabriquer un KWh. L'hydrogène pourrait donc être une solution, mais cela nécessiterait une véritable usine à gaz. Après, c'est une question de rentabilité économique. M. Philippe TOURTELIER : A quelle échéance ? M. Christian NGÔ : Pour le moment, les piles à combustible ne sont pas encore rentables, mais on pourrait penser que ce sera le cas dans dix ou vingt ans. Mme Claude NAHON : A cette échéance, il y aura peut-être d'autres renouvelables que l'éolien. qui seront vraiment importants. Il faut faire la différence entre les renouvelables thermiques et les renouvelables électriques. Je remarque que nous n'avons pas encore utilisé sérieusement notre potentiel renouvelable thermique avec les technologies existantes. Aujourd'hui, on peut construire en France une maison qui consomme 40 % de l'énergie d'une maison « normale ». Il y aura peut-être d'autres formes de production d'énergie renouvelable électrique. Par exemple, dans la Manche, on pourrait faire de l'« hydrolien », avec des « éoliennes » dans l'eau, en utilisant les courants. M. Benjamin DESSUS : Aujourd'hui, nous savons faire de l'hydrogène par électrolyse, même si cela coûte relativement cher. Mais on sait le faire en continu. Avec des énergies intermittentes, ce n'est pas évident. Les procédés industriels dont nous disposons ont du mal à s'accorder à un dispositif discontinu. C'est justement pour cela que nous voudrions stocker, par exemple, de l'éolien. Manifestement, ce n'est pas pour tout de suite. Et plutôt dans vingt ans que dans dix. Dans les différents exposés relatifs à la production, il me semble qu'on n'a pas suffisamment insisté sur le problème « centralisé-décentralisé ». L'une des évolutions actuelles, c'est que le petit en grand nombre est en train de remplacer le gros et son effet de taille. Les piles à combustible et les turbines à gaz ont des rendements qui n'évoluent pas beaucoup en fonction de leur taille, alors que c'était le cas pour les grosses centrales thermiques. On compte donc sur l'effet de série et non plus sur l'effet de taille pour obtenir des gains commerciaux. Dans ces conditions-là, il faut se poser très sérieusement la question de savoir quelle sera, à l'horizon 2020 ou 2030, la part d'électricité décentralisée. Cette part, qui permet en outre des cogénérations importantes, est de nature à révolutionner complètement l'idée qu'on se fait de notre système électrique. M. Jean-François LUCIANI : S'agissant de l'hydrogène, il nous paraît difficile de restituer l'énergie après stockage en obtenant mieux qu'un facteur un tiers. Après l'exposé de M. Ngô, il me semble utile de revenir sur les projections qui ont été présentées, s'agissant notamment de la maîtrise et de l'amélioration de l'usage de l'électricité dans ses usages traditionnels - la chaleur, les transports et l'utilisation industrielle. Certaines des mesures qu'il a évoquées doivent être appuyées. Mais il est possible que dans les décennies qui viennent, l'électricité sorte de ses usages traditionnels. Il est assez difficile de faire des projections tendancielles énergétiques si on n'a pas en tête qu'il est possible que les usages de l'électricité se diversifient et s'amplifient qualitativement. M. Serge BLISKO : Sur la production de chaleur par géothermie, on lit des choses contradictoires. Certaines expériences ont échoué. De nombreux exploitants et sociétés de construction ou collectivités locales ont abandonné la géothermie et vous mettent en garde. Vous nous avez présenté un schéma faisant apparaître l'évolution des consommations d'électricité par habitant aux États-Unis et en Californie. Vous nous avez dit que, pour des raisons à la fois climatiques et de relief, la Californie ne pouvait pas produire plus de 8 000 kWh et qu'il lui avait fallu s'adapter. Mais nous savons aussi qu'elle a connu de gigantesques pannes d'électricité, parce que certains pics de demande ne pouvaient pas être satisfaits, et parce que son réseau de production était vétuste. Ne pensez-vous pas qu'il faudrait inverser le raisonnement et partir de ce qu'il est possible de produire ? Partir de l'offre et non plus de la demande ? J'ai l'impression que nous sommes en train de courir derrière une demande qui ne fait qu'augmenter. M. Serge POIGNANT : Vous avez dit que les énergies renouvelables ; dont le photovoltaïque, étaient négligeables. Certains ont dit qu'il faudrait que nous améliorions le rendement des piles photovoltaïques, même si ce n'est pas envisageable dans l'immédiat. Qu'en pensez-vous ? Mme Claude NAHON : Nous faisons beaucoup de recherche sur le photovoltaïque parce que nous pensons qu'il peut devenir déterminant. C'est ainsi que nous avons un plateau de recherche sur le photovoltaïque, en collaboration avec le CNRS. M. le Président : Quel est le fabriquant national ? Mme Claude NAHON : Nous avons une usine à Toulouse, avec une filiale TEMASOL qui construit une usine de capteurs. Aujourd'hui, nous sommes dans le métier. Nous avons un plateau de recherche et nous y croyons pour l'avenir. Est-ce qu'on atteindra les bons rendements, les bons prix, on ne sait pas. Mais on ne peut pas laisser la piste photovoltaïque de côté. M. Benjamin DESSUS : Depuis vingt ans, le prix du photovoltaïque s'effondre, d'un facteur 2, tous les cinq ou six ans. On peut très raisonnablement considérer que ce phénomène continuera. On a dit que le photovoltaïque était bon pour le tiers monde et qu'on allait sauver ainsi les 2 milliards d'habitants privés d'électricité. Mais on a oublié que dans un système photovoltaïque décentralisé, 80 % du prix étaient hors photopile. Si la pile ne coûte plus rien, cela ne change pas grand-chose, et cela reste beaucoup trop cher. Notre chance est de pouvoir utiliser le réseau à la place des batteries et d'intégrer dans le bâtiment, dans la construction, la photopile qui sert en même temps de tuile. A condition de disposer d'un réseau, on a des chances honorables de parvenir à des coûts convenables. On peut espérer y parvenir dans trente ans. M. Christian NGÔ : Je suis tout à fait d'accord. Le KWh photovoltaïque coûte actuellement 45 centimes d'euro, contre 3 centimes d'euro pour le gaz ou le nucléaire. Il faut y rajouter la pile, soit 1,50 euro. Actuellement, le photovoltaïque n'est qu'une énergie de survie. Même si la cellule était gratuite, il serait encore trop cher. Le photovoltaïque n'est donc pas économiquement compétitif pour le moment, et encore moins que l'éolien. Dans le domaine de la géothermie, certains ont en effet rencontré des problèmes de corrosion. 99 % de la planète étant à plus de 200 degrés, les ressources sont énormes. Il y a des ressources à basse température : on fait un trou de 50 à 100 mètres et l'on récupère la chaleur qu'on utilise avec une pompe à chaleur ; à moins qu'on ne reste en surface, mais, dans ce cas, il faut exploiter une plus grande surface. En France, on connaît mal la carte des ressources de chaleur en profondeur. Certains pays comme l'Australie font des études systématiques pour connaître les bons endroits. Chez nous, le BRGM n'a pas eu les moyens d'investir dans une cartographie de chaleur. Il faut savoir aussi qu'un forage en géothermie est différent d'un forage pétrolier. La réponse à la question « centralisé-décentralisé » sera sans doute intermédiaire. L'avantage du centralisé est que les prix sont souvent moins chers et que l'on peut plus facilement dépolluer. L'avantage du décentralisé est que l'on produit de l'électricité chez soi, donc sans nécessité de transport. Cela dit, lorsque vous avez cent convives, ce n'est pas cent fois un convive ; et lorsqu'il s'agit d'énergie décentralisée, il faut 7 à 10 fois plus de puissance installée pour satisfaire le client. En cas de grande densité de population, il vaut mieux faire du centralisé. En queue de réseau, le décentralisé devient intéressant. Le décentralisé est également intéressant pour produire de la chaleur. Actuellement, en France, il est anormal qu'on n'utilise pas suffisamment les chauffe-eau solaires, car ce serait rentable. M. Benoît LEBOT : J'ai pris l'exemple de la Californie pour montrer la différence entre un pays qui se donne les moyens de faire des économies d'énergie et un territoire comme le reste des États-Unis où ce n'est pas le cas. Cela étant, la Californie a ses caractéristiques en terme de ressources et ses propres limitations. Je n'ai pas du tout évoqué l'aspect « offre » dans le scénario Negawatt et je n'ai dit à aucun moment que le photovoltaïque était négligeable. Nous avons étudié de près les courbes d'apprentissage de l'énergie photovoltaïque. Nous avons fait des comparaisons avec des scénarios présentés, par exemple, par le ministère de l'environnement en Allemagne et d'autres partenaires et nous avons calé nos scénarios Negawatt sur l'offre disponible. Nous pensons qu'il y aura une montée en puissance de l'électricité photovoltaïque à partir de 2030. M. Philippe GARDERET : Il faut prendre garde dans nos analyses au fait que nous ne sommes plus dans un système planifié où des gens, autour d'une table, décident de ce qu'il y aura comme nucléaire, comme photovoltaïque, etc. Nous qui fournissons des technologies - nucléaire, éolien - et qui développons des piles à combustible, nous voyons que le dialogue a lieu entre les producteurs de technologies et les opérateurs qui ont ou non une certaine capacité d'investissement. Les producteurs de technologies cherchent à développer leurs activités, à rentabiliser ces technologies et à mettre en place des capacités industrielles adaptées à la demande. Or un certain nombre de technologies dont on parle aujourd'hui n'ont pas de capacités industrielles, dans la mesure où l'on ne peut pas encore les rentabiliser. Il est intéressant de savoir qui est prêt à acheter les diverses technologies énergétiques et pourquoi. Les Indiens, par exemple, vont à la fois acheter des centrales nucléaires et développer des réseaux locaux à partir de cogénérations de biomasse. Ils ont l'objectif de construire un réseau centralisé, en particulier pour produire de l'électricité pour les grandes zones urbaines ; en même temps, nous discutons avec eux de l'installation de dizaines de petites centrales de cogénération à biomasse qu'ils interconnecteront ensuite en réseau. Se mettra ainsi en place un réseau complexe incluant de petits réseaux locaux. Les stratégies sont de fait le résultat de cette confrontation de points de vue entre des productions industrielles et des technologies et des acteurs qui ont ou non, à un moment donné, la volonté politique et les capacités d'investir. C'est sur le comportement de ces acteurs qu'il faut jouer pour influer les tendances. Par ailleurs je voudrais aussi signaler combien, aujourd'hui, la technologie de gestion des réseaux évolue. En gérant les réseaux d'une manière plus intelligente, on peut aussi approcher les problèmes de la consommation. On peut même espérer un jour pouvoir piloter les pointes de consommation en utilisant l'intelligence du réseau. Pour autant, on ne peut pas dire que, grâce à l'intelligence d'un réseau, on effacera les pointes en mettant automatiquement en marche votre machine à laver quand on jugera que c'est le moment utile dans la nuit. Mais il ne faut pas voir les réseaux de production et de transmission que comme des réseaux de puissance, mais comme des réseaux qui vont gérer l'intelligence de la consommation. M. Philippe TOURTELIER : Vous avez parlé de la diversification de l'électricité et de ses trois usages « chaleur, transport, industrie ». S'agissant de la chaleur, cela me surprend. En effet, j'ai entendu dire qu'il était aberrant de faire de l'électricité à partir de la chaleur, pour la retransformer en électricité à l'arrivée, et que les rendements étaient déplorables. Pourriez-vous préciser votre propos ? M. Jean-François LUCIANI : Quand j'ai parlé de cela, j'avais en tête des systèmes thermodynamiques qui permettent, à partir d'une quantité X d'électricité, de récupérer, suivant leur efficacité, 2 X, 3 X, 4 X, voire 5 X en chaleur. Le réservoir de calories froides à notre disposition est gigantesque. Je crois que ces systèmes là ne sont pas assez considérés ni développés en France, en comparaison avec des exemples étrangers comme celui de la Suède, qui est tout à fait édifiant. Mme la Rapporteure : Nous ne comprenons pas de quelle solution technique il s'agit M. Jean-François LUCIANI : Ce sont des systèmes thermodynamiques. Globalement, il s'agit des pompes à chaleur. Si je me suis référé à l'exemple suédois, c'est parce que les Suédois mélangent l'usage de la pompe à chaleur dans des maisons individuelles, ce qui suppose de disposer de suffisamment de place, et l'usage de la pompe à chaleur dans les réseaux de chaleur à Stockholm et dans les grandes réalisations résidentielles tertiaires. Aujourd'hui, sur le plan économique, l'usage de la pompe à chaleur n'atteint pas encore la rentabilité. Il peut l'atteindre dans de grandes structures tertiaires comme les universités, lorsqu'on a un besoin réversible chaud-froid. Aux États-Unis, des collèges et des universités se refroidissent par des systèmes de pompes à chaleur réversibles. Je pourrai vous envoyer des exemples chiffrés. M. Christian NGÔ : Après la canicule, on a dit qu'il fallait équiper les maisons de retraite de climatiseurs. Or il serait plus intéressant d'installer des pompes à chaleur qui chaufferaient l'hiver, avec un facteur 4 en termes de consommation d'électricité et qui, parce qu'elles seraient réversibles, permettraient une climatisation les quelques jours où il fait très chaud. Avec le même dispositif on diminuerait la facture d'électricité par 4 l'hiver et on aurait la climatisation l'été. M. François DOSÉ : Avez-vous constaté si l'amélioration de la maîtrise des énergies s'accompagnait d'une maîtrise comportementale ? Si un objet est moins dépensier d'énergie, est-ce qu'on en achète deux ? Si on s'offre un petit plus, est-ce que le total de l'opération pour la communauté reste globalement positif ? M. Benoît LEBOT : Vous parlez de l'effet rebond, sur lequel beaucoup d'études ont été faites. Prenez l'exemple du nouveau réfrigérateur qui chasse le premier, lequel se trouve relégué à la cave, mais qui reste branché. Dans ce cas, on n'a rien gagné. Pour l'éviter, il faudrait se donner les moyens de communiquer massivement et à bon escient. On pourrait agir comme on l'a fait avec le tabac : dans un premier temps, on a interdit la promotion par voie publicitaire et dans un second temps, on a apposé des étiquettes sur les paquets, du style : le tabac vous tue. Mais ce n'est pas envisageable, tant que l'ambiance générale est à la consommation tous azimuts. Il faudrait réfléchir à cette communication globale qui nous invite à rouler en 4X4, à nous équiper en air conditionné avant même d'essayer de nous protéger du soleil en prenant des mesures simples et qui ne coûtent pas grand-chose. Comme l'a fait remarquer Mme Nahon, l'électricité va coûter plus cher. C'est plutôt une bonne nouvelle par rapport à nos enjeux climatiques et énergétiques. Mais la transition ne pourra se faire que si, en même temps, les autorités mettent en place des programmes, qui limiteront cet effet rebond. On pourrait même anticiper la hausse à venir des prix de l'énergie en général, pour dégager des marges de manœuvre afin de mettre en place des programmes d'économie d'énergie. M. François DOSÉ : Quand vous avez fait ce graphique montrant la différence de consommation entre la Californie et le reste des États-Unis, est-ce que vous l'avez quantifié ? Est-ce que la politique menée en Californie amène les gens à aller un peu plus loin que les autres Américains ? M. Benoît LEBOT : Cela n'a pas été quantifié. Malheureusement, c'est assez complexe. On s'est en effet aperçu que ce qu'on avait gagné sur les frigos ou les appareils à air conditionné ou les moteurs, on l'avait perdu sur les technologies de l'information. Même chez vous, le deuxième ordinateur n'a pas chassé le premier. M. Thierry SALOMON : Il y a une dérive comportementale, un peu inquiétante, qu'on arrive à mesurer. Elle concerne la température des logements, qui monte progressivement par rapport aux années précédentes. Or celle-ci a un effet significatif sur la consommation. L'homme n'accepte plus de vivre en dessous de 20-24 degrés. Auparavant, il acceptait des variations beaucoup plus importantes. On a pris un degré ou un degré et demi en cinq à dix ans. Il n'accepte plus non plus de vivre au dessus de 24 degrés. D'où la dérive de la climatisation. Or l'inconfort ne commence que vers 30 degrés. Et tout degré en moins, par climatisation, fait très vite augmenter la consommation, d'électricité notamment : un degré en moins, c'est 30 à 40 % de consommation supplémentaire sur la période estivale. On constate un certain laisser faire, notamment en matière de publicité : « c'est l'hiver, il neige, et les gens sont pratiquement nus. » Pour cela, il faut bien chauffer à près de 30 degrés. De telles images incitent à la consommation et il faudrait s'interroger là-dessus. Il nous faut maintenant passer à une culture de la sobriété énergétique, qui correspond à une vision différente de l'énergie qui est un bien rare et précieux. M. le Président : M. Lebot a parlé sobriété, efficacité énergétique puis énergies renouvelables. Si ce n'est qu'en matière d'énergies renouvelables, on ne se rapproche pas des objectifs de 2010. Leur part est globalement très faible. Elles demandent des investissements importants. En outre, nous ne disposons pas, chez nous, de filières économiques de développement des énergies renouvelables. Pensez-vous, à Negawatt, qu'on pourra atteindre les objectifs 2010 en restant sur ces lignes ? Que faut-il pour arriver au facteur 4 ? Quelles politiques faudrait-il mettre en œuvre, en priorité ? Selon M. Ngô, pour y parvenir, il n'y a que deux voies : les renouvelables et le nucléaire. Qu'en pensez-vous ? M. Benoît LEBOT : Ce n'est pas tout à fait ce que j'ai entendu du débat de cet après-midi : nous avons tous souligné l'importance de la maîtrise de la demande d'énergie. M. Benjamin DESSUS : Dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, les questions de substitution d'énergie. M. le Président : Je ne dis pas l'inverse. Mais on n'en est pas à la maîtrise de la demande d'énergie. Les courbes continuent à augmenter. M. Benoît LEBOT : Parce qu'on ne se donne pas les moyens nécessaires. C'est d'ailleurs pourquoi j'ai précisé dans mon exposé qu'il ne fallait pas se tromper ni sur les enjeux ni sur les moyens pour y parvenir. Au sein de Negawatt, à force de réfléchir et avec notre expérience, nous ne pouvons pas nous contenter de déclarations ou de micro mesures. Nous avons fait l'analyse de ce qui marchait dans certains pays. Les démarches réglementaires systématiques sont hélas à l'origine des rares cas de succès de politiques de maîtrise de l'énergie. Je ne sais pas quel ton adopter en France et en Europe. Est-ce qu'on attendra que l'Europe devienne le dépotoir du monde pour les moteurs et l'électronique dont même les Chinois ne veulent plus ? Il y a des choix à faire. On pourrait obtenir des résultats en quelques années si on s'en donnait les moyens. Voyez ce qui s'est passé en Californie. Voyez ce qui s'est passé au Brésil où, à la suite d'une crise, une réduction de 20 % a été obtenue en deux mois ! En Nouvelle-Zélande, on a connu une réduction de 10 % en quelques mois. Les gens ont réappris certains comportements. La vraie marge de manœuvre se situe du côté de la maîtrise de la demande. Sachons réglementer, intervenir de façon systématique pour transformer les marchés, encadrer la publicité. Des décisions sont à prendre au niveau français ou européen qui, sans coûter grand-chose, pourraient avoir un impact important Il faut mettre au point des politiques et se donner les moyens de les mettre en œuvre. Mme la Rapporteure : N'a-t-on pas tendance à considérer que le nucléaire n'a pas les mêmes impacts sur l'environnement et qu'il est infini ? Ne sommes-nous pas, en France, inconsciemment, moins portés vers la sobriété énergétique ? M. Benoît LEBOT : Bien sûr que si. Depuis vingt ans, l'opérateur national EDF communique massivement sur le fait que l'électricité est abondante, pas chère et non polluante. La plupart de ses campagnes de publicité y ont contribuent. Il est plus difficile, en France, de parler d'économies d'électricité. En France, l'électricité, et notamment le nucléaire, c'est 17 % des ressources énergétiques, et 100 % du débat. Voilà pourquoi nous avons du mal à faire passer nos arguments, pourtant très simples. M. Benjamin DESSUS : Nous sommes dans un pays à tradition très jacobine, qui a permis l'élaboration d'un programme nucléaire. Il y a peut-être une certaine antinomie entre un système très centralisé, et les problèmes d'énergies renouvelables ou d'économies d'énergie. Dans un pays comme l'Allemagne, les collectivités locales se sentent concernées par les problèmes liés à l'énergie, qu'il s'agisse de sa production ou de sa consommation. Nous avons beaucoup plus de mal à en faire prendre conscience à une commune française, qui considère que l'énergie lui parvient et qu'elle n'y peut pas grand-chose. Or le comportement d'une collectivité peut avoir une importance considérable sur la dépense d'énergie, à travers ses investissements, ses infrastructures, etc. Dans les pays qui ont une organisation très décentralisée, les mœurs de production et de consommation d'énergie peuvent être assez différentes. A cela se rajoute le fait que, pendant longtemps, EDF nous a présenté l'énergie électrique et nucléaire comme propre et abondante. Mais elle a oublié de nous dire qu'en termes d'effet de serre, aujourd'hui, un chauffage électrique représente à peu près la même quantité de CO2 qu'un chauffage au gaz bien fait. En effet, pendant la pointe d'hiver, elle doit utiliser pas mal de charbon et de pétrole, etc. Mme Claude NAHON : En France, nous avons la chance d'avoir un parc nucléaire. Il faut savoir qu'en Allemagne, le secteur électrique émet 250 millions de tonnes de CO2 par an, et la France 35 millions de tonnes ! Nous avons donc des décisions à long terme à prendre, pour maintenir un secteur électrique très faiblement polluant dès aujourd'hui. Nous ne pouvons pas perdre notre avantage. Nous avons discuté pour savoir si les Allemands avaient 15 000 ou 20 000 MW d'éolien. Reste qu'ils produisent toujours 250 millions de tonnes de CO2 dans leur secteur électrique. S'agissant de l'énergie répartie ou l'énergie centralisée, je crois qu'on fera un « mix » entre les deux. L'énergie répartie comme la cogénération à partir de gaz émet 400 grammes de CO2 par KWh. Si bien que lorsqu'on intègre l'obligation d'achat d'EDF sur les cogénérations, cela fait monter le contenu carbone de l'offre de KWh. A terme, la cogénération aura un sens, si elle est à partir de biomasse ou de renouvelables. Ce sont des choses qui en terme de traitement nécessitent des tailles suffisantes pour ne pas avoir de polluants. Car nous avons des exigences en la matière. Il y a un équilibre à trouver entre les renouvelables non polluants comme l'éolien ou l'hydraulique et les productions de cogénérations qui peuvent être polluantes. Ce ne sont pas seulement des économies d'énergie qu'il faut faire, mais des économies de CO2. Le problème de la planète est double : elle a un univers limité de ressources énergétiques et un univers aujourd'hui extrêmement chargé en CO2. L'industriel a besoin d'une visibilité à long terme des politiques, à la fois pour l'offre et pour la demande. Comment pourrons-nous mobiliser les secteurs diffus comme l'habitat ? On parle du comportement. On peut faire de la publicité. On peut aussi voir si le système des certificats d'économie d'énergie mis en place par les pouvoirs publics français et qui devrait démarrer dans les mois qui viennent va aboutir à quelque chose. Je crois que, grâce à cela, nous allons pouvoir nous engager vers un modèle où nous irons avec les collectivités territoriales, avec un certain nombre d'acteurs, vers des économies d'énergie. Nous sommes en train de mettre en place des moyens. Nous attendons la finalisation des règles du jeu. Il y a sans doute plusieurs expérimentations à mener. En tout cas, c'est un sujet qui nous tient à cœur. Nous avons deux ans ou deux ans et demi pour voir si ça décolle. M. Serge POIGNANT : Pensez-vous que le Danemark peut ne pas s'engager dans le nucléaire, avec 80 % d'énergies fossiles ? Pensez-vous que l'Allemagne, avec 60 % d'énergies fossiles, reviendra ou non sur sa décision de sortir du nucléaire ? Présidence de M. Serge Poignant, vice-président M. Benoît LEBOT : Cela dépend du chemin de sobriété et d'efficacité énergétiques sur lequel s'engageront le Danemark et l'Allemagne. Une résidence allemande consomme déjà en moyenne 20 % de moins qu'une résidence française. Cela dépend aussi s'ils décident de mettre en place de politiques telles que celles que nous en proposons. On peut dire en tout cas que ces pays sont mieux partis que la France. M. Jean-François LUCIANI : J'ai regardé avec beaucoup d'attention le scénario Negawatt s'agissant de la production d'énergie. Ce scénario pousse au maximum les économies et la contribution des renouvelables. Il mobilise malgré tout près de 40 millions de TEP de gaz naturel. Partant d'émissions de CO2 de 30 millions de tonnes par an, avec ce scénario dont ont peut penser qu'il est le plus économe quant à la demande et le plus vertueux quant aux énergies renouvelables, on multiplie par 4 nos émissions de CO2 dans le domaine électrique. Avec un scénario un peu moins vertueux, un peu moins optimiste s'agissant des énergies renouvelables, intermédiaire entre le scénario Negawatt et celui présenté par François Jacq, on revient d'emblée à 100 millions de TEP en gaz naturel en 2040. On annule ainsi l'ensemble des économies qu'on doit pouvoir faire sur l'automobile, les transports et le logement. On a dit que le secteur électrique produisait 17 % de l'énergie et qu'il émettait 10 millions de tonnes de carbone par an. Il faut savoir qu'il émettrait 100 millions de tonnes de carbone en plus si la France avait la structure électrique de l'Allemagne et du Danemark. Il faut savoir aussi que l'électricité, dans le monde, n'est pas responsable de 15 % de l'effet de serre, mais de 40 à 50 %. Autrement dit : attention, les schémas recourant massivement aux énergies renouvelables n'ont aucune souplesse et nous condamnent, si nous supprimons l'option nucléaire, à recourir massivement à des énergies fossiles, sans doute le charbon, à la fin du siècle. M. Philippe TOURTELIER : Sait-on à quelle date paraîtra le décret relatif aux certificats d'économie d'énergie ? M. François JACQ : Les trois décrets sont au Conseil d'État, j'ai bon espoir qu'ils soient pris en avril. M. Christian NGÔ : Le vrai problème est qu'au niveau de la planète, on va manquer d'énergie. Il est probable qu'en 2050 on produira à peu près la même quantité de pétrole que maintenant, alors que les besoins seront deux fois supérieurs. Il manquera alors 20 % d'énergie. Même si l'on construisait une centrale nucléaire par semaine pendant cinquante ans, on n'arriverait pas à compenser ces 20 %. De toute manière, il faudra racler les fonds de tiroir et utiliser à la fois les énergies renouvelables et le nucléaire. Même ainsi, on n'y arrivera pas. Voilà pourquoi il faut trouver des solutions ailleurs. Ces solutions passent par la sobriété et l'efficacité énergétiques, et par l'économie sur la chaleur et sur les transports. Nous avons la chance, en France, de produire de l'électricité sans émettre de gaz à effet de serre, sauf dans ces fameuses centrales de pointe. Il faut profiter de cet avantage et l'utiliser, de manière intelligente, dans le domaine de la chaleur - pompe à chaleur plutôt que convecteur - et dans le domaine des transports - véhicules hybrides, qui permettent à l'automobile de ne pas tomber en panne. M. Thierry SALOMON : Je suis à votre disposition pour examiner de plus près les chiffres du scénario Negawatt. Mais ce que vous avez dit n'est pas exact. Dans la partie qui relève de l'électricité, il y a une relative stabilisation de l'émission de carbone par rapport à la situation actuelle, avec quelques fluctuations : une légère poussée autour de 2030 et de 2040, et un retour à peu près au niveau d'aujourd'hui en 2050. Cela s'explique par la substitution par les renouvelables, qui ne produisent pas de gaz à effet de serre ; par la diminution de l'offre et de la demande ; par la stabilisation, par rapport au tendanciel, de la consommation d'électricité. Par ailleurs, s'agissant de l'électricité proprement dite, on recourra fortement à la cogénération et à des centrales gaz cycle combiné à haut rendement. Globalement, quand on utilise mieux le gaz, qu'on recourt à la cogénération et qu'on utilise de façon plus rationnelle et efficace l'énergie primaire à notre disposition, on arrive à cette relative stabilisation. Celle-ci est de toutes façons très largement compensée par la diminution sur la chaleur et sur les transports. Il est clair qu'une des façons de parvenir au facteur 4 est de laisser les émissions de CO2 à un niveau à peu près comparable, voire à un niveau un peu supérieur, dans la mesure où, dans le scénario global, en termes de chaleur et en termes de transports, on a une diminution très forte. Cela dit, il y a mélange de CO2, d'où qu'il vienne, et la problématique est mondiale. Mon souci, notamment au niveau du nucléaire, est dû à la très faible efficacité énergétique de l'ensemble de la production d'électricité, qu'elle soit nucléaire ou vienne du thermique classique. Vous êtes dans un rapport de 3. Avec une pompe à chaleur, vous partez de 3 en énergie primaire, vous produisez 1 en électricité et vous remontez à 3. De 3, on revient à 3. Avec les renouvelables et une pompe à chaleur derrière, vous partez de 1 en énergie, pour remonter à 3. C'est infiniment plus efficace. Notre réseau électrique est très peu efficace. On perd actuellement en chaleur, par l'intermédiaire des centrales de production thermiques ou nucléaires, deux fois la quantité d'énergie qui est produite en électricité. M. Jean-François LUCIANI : Encore une fois, si on dérive vers le haut en ce qui concerne la demande d'électricité et vers le bas en ce qui concerne les objectifs renouvelables, on creusera un « gap » qu'il faudra combler avec le gaz, ce qui, dans les années 2030 et 2040, peut représenter un risque majeur. Voilà pourquoi il serait suicidaire pour la France de supprimer l'option nucléaire. S'agissant de la cogénération, nous sommes d'accord sur un point : si celle-ci est très séduisante, elle nécessite un développement massif des réseaux de chaleur. Aujourd'hui, ils assurent 7 à 8 % du chauffage en France. Il faudrait qu'ils desservent environ la moitié des clients. Pour cela, il y a un effort à faire, qu'on ne pourra pas réaliser en cinquante ans. Et nous sommes d'accord sur un second point : il faudrait arriver, par des mesures fiscales adaptées, à développer les véhicules hybrides. M. Serge POIGNANT, Président : Madame, Messieurs, Je vous remercie. Table ronde sur la production de chaleur réunissant : Présidence de M. Jean-Yves LE DÉAUT, Président M. le Président : Il s'agit ce matin de faire le point sur la production de chaleur dans la perspective de la réduction des gaz à effet de serre, tant du point de vue de la chaleur non émettrice - géothermie, pompes à chaleur. - que de la bonne utilisation de la chaleur produite - cogénération, réseaux de chaleur. Les sujets évoqués croisent naturellement certaines problématiques de tables rondes précédentes, par exemple sur l'habitat ou sur la production d'électricité. La chaleur représente environ la moitié de l'énergie produite au niveau mondial, soit 3 GTEP contre 2 GTEP pour les transports et 1 GTEP pour l'électricité. On évoquera en particulier la cogénération, ainsi que la géothermie. Je demanderai à chacun d'être bref, afin de laisser du temps pour les échanges. Avant de donner la parole à MM. Cappe et Canal, qui vont nous entretenir de la cogénération, je vais demander à chacun de nos autres invités de se présenter. M. Bernard SAINT-ANDRÉ : Je suis directeur de la stratégie de Dalkia, Véolia Environnement. M. Jean-Louis BAL : Je suis directeur des énergies renouvelables, des réseaux et des marchés énergétiques à l'ADEME. M. Frédéric HUG : Je suis conseiller auprès du président de l'association FG3E, Fédération des entreprises de services d'efficacité énergétique, et du président de l'EFIEES, qui fédère ces entreprises au niveau européen. M. Patrick FAISQUES : Je suis secrétaire général du Syndicat national du chauffage urbain et du Syndicat national de l'exploitation climatique, deux syndicats qui sont membres de laFG3E. M. Nicolas GARNIER : Je suis délégué général d'AMORCE. M. Daniel CAPPE : Je vais vous parler, avec Patrick Canal, délégué du Club Cogénération, de la cogénération. L'ATEE, Association Technique Énergie Environnement, rassemble les acteurs intéressés par les économies d'énergie au niveau national, les informe à travers le journal Énergie Plus, et leur propose des actions, comme elle l'a fait en 2003, dans le cadre du débat national sur l'énergie, avec un Livre blanc dont plusieurs préconisations ont été retenues, notamment la diminution de 2 % de l'intensité énergétique et la création des certificats d'économies d'énergie. L'ATEE anime également deux clubs : le club Biogaz et le club Cogénération. M. le Président : Nous avons abordé la question du biogaz lors de notre table ronde consacrée à l'agriculture. M. Patrick CANAL : La cogénération est la production combinée, à partir de gaz naturel, d'énergie mécanique et d'énergie thermique, avec un rendement global utile atteignant 82 % pour les installations récentes, dont 37 % sous forme d'électricité et 45 % sous forme d'eau chaude ou de vapeur entre 90 et 130 degrés. Il s'agit toujours d'un dimensionnement calé sur les besoins thermiques du site, et associant l'électricité. M. Daniel CAPPE : Les émissions sont réduites par rapport à la production séparée, d'une part avec la chaudière à combustible gaz et fioul, d'autre part pour la production d'électricité classique. Par rapport à la cogénération gaz, l'électricité thermique gaz émet plus de 20 % de plus, l'électricité thermique fioul plus de moitié plus, l'électricité thermique charbon plus de deux fois plus. La cogénération est donc un outil indispensable à l'Europe pour tenir les objectifs du protocole de Kyoto. M. Patrick CANAL : Parmi les autres atouts de la cogénération figurent son excellent rendement énergétique, permettant des économies d'énergie primaire de 10 à 30 %, son caractère délocalisé près des sites de consommation, qui réduit les pertes réseau, estimées entre 5 et 8 %, limite les contraintes et les infrastructures de transport et renforce la sécurité d'approvisionnement ; la disponibilité garantie et continue, aussi bien en fonctionnement privé climatique que dans l'industrie ; la facilité et la rapidité d'intégration et de mise en œuvre. La cogénération a connu trois grandes périodes. Entre 1991 et 1997, on a observé un frémissement de l'activité, grâce aux contrats d'achat et aux garanties apportées par EDF pour des installations inférieures à 8 MVA, 189 installations ont été créées, pour un total de 820 MW. De 1997 à 2000, le développement s'est intensifié, avec 3 600 MW supplémentaires, portant le nombre d'installations à 480 ; le principe était de rémunérer l'opérateur sur la base des coûts évités par EDF, ce à quoi s'ajoutait une garantie calculée sur les prix du gaz plafonnés. A partir de 2000, cependant, la dynamique a été brutalement freinée : seuls 580 MW supplémentaires ont été installés, soit un total de 5 GW, en service cinq mois par an, et assujettis pour 95 % des contrats à l'obligation d'achat. 36 % de la puissance installée alimente les réseaux de chaleur, 58 % l'industrie, 7 % le tertiaire. M. Daniel CAPPE : Malgré le développement récent, si on compare la puissance électrique produite par cogénération avec la puissance électrique totale du pays, on n'arrive qu'à 3,4 %, soit moins que la plupart des autres pays d'Europe, et bien moins, en particulier, que le Danemark, les Pays-Bas, la Finlande ou l'Autriche. M. Patrick CANAL : La conjoncture est cependant jugée favorable. L'intérêt de renforcer la part de la cogénération dans le bouquet énergétique français a été confirmé dans la loi de programme du 13 juillet 2005 et par la directive Cogénération en cours de transposition. Les besoins électriques croissants ont été confirmés par RTE : une sous capacité est annoncée dès 2008, et devrait atteindre 1 GWh par an à partir de 2010. Enfin, le gisement thermique cogénérable est important : les besoins thermiques sont évalués à 6,5 GWth, et la moitié de ce besoin pourrait être satisfait par 250 MWh par an de nouvelles cogénérations pendant les dix prochaines années. Malgré cela, le développement actuel est quasiment stoppé, à cause de contraintes fortes : la puissance installée en 2005 n'a été que de 50 MW, soit un sixième de la programmation 2003. Les contraintes sont : la limitation à 12 MW de l'obligation d'achat, qui pénalise les collectivités locales et l'industrie ; l'ajustement du mécanisme de plafonnement du prix du gaz, inadapté en raison de la hausse importante des tarifs gaz ; les contraintes, délais et coûts de raccordement ; les incertitudes sur la fiscalité, sur la transposition des directives sur le CO2 ou sur la cogénération, sur le renouvellement du contrat d'obligation d'achat après rénovation. Il est pourtant intéressant de relancer l'activité. C'est un moyen efficace de production combinée, présentant de nombreux atouts, notamment en termes d'émission et d'efficacité énergétique. Le potentiel de développement est encore important, à hauteur de 250 MWh par an pendant dix ans. Les moyens d'y parvenir sont : pérenniser le mécanisme d'obligation d'achat ; mettre en place un nouveau contrat d'achat en 2006, qui lève la barrière de 12 MW pour les réseaux de chaleur et ajuste dans la durée le mécanisme de plafonnement ; optimiser les conditions de raccordement au réseau public ; lever les incertitudes que je viens de citer. Et promouvoir, enfin, la cogénération au-delà de l'obligation actuelle, afin de faire progresser sa place dans le bouquet énergétique français. M. le Président : Merci beaucoup. Vous avez cependant été un peu rapides sur les contraintes et sur les solutions, en particulier celles liées à la durée du mécanisme de plafonnement. Peut-être Serge Poignant, qui fut rapporteur de la loi d'orientation sur l'énergie, a-t-il bien suivi tout cela, mais je souhaiterais, quant à moi, plus de détails. Il ne faut pas perdre de vue la question des rendements, quand on parle de ce à partir de quoi on fait de la cogénération. Se dirige-t-on vers une cogénération à partir de la biomasse ? Certains préconisent d'y passer directement. J'aimerais savoir aussi s'il reste de la cogénération à partir du pétrole : si oui, ce n'est pas de nature à faire baisser les émissions. Enfin, je rappelle que, si l'on avait fixé a limite à 12 MW, c'était pour éviter la création de niches très rentables sur certains secteurs, d'installations qui sont en fait des « rideaux de fumée », gagnant de l'argent avec l'électricité seulement. Mme Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET, : Je trouve que votre graphique du début n'est pas tout à fait convainquant, car vous comparez les émissions avec celles de systèmes de production qui ne sont pas les plus utilisés en France, et qui ne sont donc pas ceux avec lesquels la cogénération est en concurrence. M. Serge POIGNANT : Les serristes se posent de plus en plus la question des chaudières bois. Quel intérêt y voyez-vous ? Est-ce qu'on peut aller plus loin, évoluer même vers la trigénération ? M. Patrick CANAL : Le mécanisme de plafonnement introduit en 1996 visait à ajuster la rémunération du cogénérateur suite à la très forte augmentation des prix du gaz. Il y a une part fixe, qui correspond au coût évité par EDF, et qui représente environ 50 % de la rémunération. L'autre moitié, variable, est représentée par le remboursement au cogénérateur de son achat de gaz, plafonné à un certain seuil - qui est aujourd'hui de 75 % du prix du gaz, sur la base du tarif STS, c'est-à-dire du tarif grand transport de GDF. Or, ce coefficient ne correspondait plus à l'évolution des prix du gaz, et il y avait même un gros écart, de sorte qu'il a été porté, pour la campagne 2005-2006, à 92,5 %. Il s'agissait de fixer un niveau qui soit à la fois économiquement cohérent et raisonnable pour le cogénérateur comme pour le consommateur final. Ai-je été clair ? M. le Président : C'est objectivement compliqué, mais vous avez été clair. M. Patrick CANAL : Nous avons le contrat le plus compliqué du monde, même les cogénérateurs ne s'y retrouvent pas toujours ! Mme la Rapporteure : Sur quelle base a-t-on recalculé le plafond ? M. Patrick CANAL : Sur une base négociée. Le coefficient de 75 % - voire 67 % pour les derniers contrats signés - rendait impossible la poursuite de l'activité sur une base d'équilibre économique. Donc, de deux choses l'une : soit on stoppait les projets et la production de chaleur elle-même, soit on faisait supporter le surcoût au client, ce qui n'était pas forcément supportable par le consommateur final. Toute la difficulté était de trouver une pondération raisonnable - pondération qu'il faudra reconduire pour les campagnes suivantes -, afin de donner une bonne visibilité pour les décideurs. M. Bernard SAINT-ANDRÉ : Je voudrais répondre à quelques-unes des questions posées et apporter un éclairage prospectif sur ces questions Pour un investisseur, l'incertitude que fait peser le caractère aléatoire du mécanisme de plafonnement sur ses rentrées financières au cours des douze années de vie de l'installation, est extrêmement pénalisante. Nous avons donc, à cause de cela, les plus grandes réserves sur les projets présentés. Pourquoi a-t-on mis en place un mécanisme de plafonnement ? Parce que les pouvoirs publics voulaient éviter qu'une hausse très forte du prix du gaz aboutisse à bloquer celui la chaleur à un niveau élevé. Ce principe demeure. Il n'est pas logique, en effet, que la collectivité paie le prix de l'électricité plus cher que le prix de marché. Or, aujourd'hui, ce prix de marché n'est plus nécessairement déterminé par le nucléaire : quand la limite du parc est atteinte, ce qui est assez fréquent, ce sont les combustibles fossiles qui le fixent. Il est donc logique que le plafonnement soit reconnecté au prix de marché. Les 92,5 % devraient être, dans l'avenir, réexaminés, de façon à ce que le système soit économiquement rationnel. En second lieu, un des avantages de la cogénération est qu'elle peut utiliser n'importe quel combustible : cela peut être le charbon, comme en Europe centrale ; cela peut être aussi la biomasse, sur laquelle nous fondons beaucoup d'espoirs, car les gisements sont importants et les technologies variées - directement en chaudière, méthanisation de résidus agricoles, gazéification. Ce sont des technologies sur lesquelles nous travaillons, et qu'il faut continuer de nous aider à développer. Il est dommage que l'on n'ait pas encore atteint le stade industriel, comme le ratio de production d'électricité à partir de la biomasse est très rentable. Pour peu que des efforts soient consentis, tous les cogénérateurs sont ouverts à l'idée de recourir davantage à la biomasse. Je voudrais insister, au passage, sur l'importance de l'organisation des filières d'approvisionnement. Il y en a aujourd'hui qui se mettent en place, mais la fiabilité de l'approvisionnement est une question essentielle. J'ajoute un dernier élément, d'ordre économique. Si rien n'était fait aujourd'hui pour permettre aux installations existantes de continuer à fonctionner à l'avenir, le parc tomberait à zéro ou presque dans les années 2011-2013, étant donné que la durée de vie d'une installation est de douze ans. Il faut donc trouver une solution pour le renouvellement du parc en 2011-2013, moderniser le système d'obligation d'achat, mettre à plat la question du plafonnement ainsi que d'autres contraintes, comme la durée de fonctionnement estival, qui ne sont plus de mise. Un groupe de travail de la DIDEME doit livrer ses conclusions d'ici trois mois sur ces questions capitales pour l'avenir de la cogénération. M. le Président : Vous dites que la biomasse est un gisement important et qu'il n'y a pas encore de filière industrielle, mais je voudrais savoir si de gros industriels membres de l'ATEE sont engagées dans des pôles de compétitivité sur ces questions. Je n'ai pas l'impression que les grandes équipes de recherche soient très mobilisées, notamment pour la gazéification « filière sèche ». M. Bernard SAINT-ANDRÉ : Véolia est engagée dans cinq pôles de compétitivité, dont trois au moins seront mobilisés sur ces problèmes d'énergies renouvelables M. le Président : Oui, dans le pôle de Reims, mais y a-t-il des équipes françaises sur ces sujets ? M. Bernard SAINT-ANDRÉ : Nous avons une équipe de recherche et développement, nous travaillons aussi avec des universités. Il n'y a pas encore, c'est vrai, une grosse mobilisation, mais cela intéresse de plus en plus les chercheurs. M. Daniel CAPPE : Il y a aussi un aspect économique, lié aux tarifs d'achat de l'électricité. Ces tarifs étant beaucoup trop bas, deux fois plus bas que partout ailleurs en Europe, cela explique qu'il n'y ait pas de cogénération à partir de la biomasse. Ils sont en renégociation et vont changer, ainsi que l'a annoncé Mme Olin. C'est un élément très important car, malgré tous les espoirs qu'on peut placer dans cette filière, malgré la mobilisation de l'ADEME, l'aspect économique reste primordial. Les appels d'offres récents sont sortis à des prix très au-dessus des tarifs, ce qui prouve que les tarifs ne sont pas adaptés. Sur la gazéification, l'ATEE a suivi de très près l'installation de Güssing, en Autriche, près de la frontière hongroise. C'est un projet très important de l'université de Vienne, qui a développé un prototype puis un pilote industriel, mais il reste encore des problèmes sur cette installation de 2 MW seulement. M. Nicolas GARNIER : AMORCE, que tout le monde ici ne connaît pas forcément, est l'Association nationale des collectivités locales et des professionnels pour la gestion des déchets d'énergie. Elle couvre 45 millions d'habitants, dont ceux de toutes les grandes agglomérations françaises. Il y a deux sources de cogénération qu'on oublie souvent : les déchets, comme les usines d'incinération, et le biogaz. On oublie régulièrement la valorisation des déchets. Or, nous avons en France 40 usines d'incinération qui font de la cogénération, plus 60 qui ne font que de la chaleur ou que de l'électricité. La difficulté majeure est de les conserver et d'en créer d'autres à proximité des zones de consommation, dont on a au contraire tendance à les éloigner. Il faut aussi travailler à l'évolution des tarifs de rachat, car il est saisissant de constater que l'éolien est racheté à 9 centimes le kWh, et que dix-huit mois après le tarif a été fixé à 4,5 centimes pour le biogaz, la biomasse et les déchets, sans qu'il y ait de véritable explication à cela. Si on veut développer la cogénération, il faut favoriser le transport de la chaleur. Il y a actuellement un très gros projet de méthaniseur à Montpellier, qui pourra traiter 150 000 tonnes de déchets pour produire de l'électricité et alimenter le réseau de chaleur de la ville. M. Frédéric HUG : Je voudrais répondre à la fois aux inquiétudes du Président sur la cogénération « rideau de fumée » et à la question de Mme la Rapporteure sur la référence de comparaison pour les émissions évitées. D'un point de vue réglementaire, il ne peut y avoir de rideau de fumée, puisque le rendement est obligatoirement vérifié et que l'installation est dimensionnée sur les besoins thermiques, tant pour l'investissement initial que pour l'exploitation. Par construction, il s'agit de valoriser à la fois le thermique et l'électricité. Quelle est la bonne référence ? D'abord, on a globalement besoin d'électricité supplémentaire, et lorsque des tranches thermiques sont remises en service par EDF et que la programmation prévoit de nouveaux cycles combinés à échéance rapprochée, la référence doit être une référence fossile, étant donné que le nucléaire ne peut être développé du jour au lendemain. Il faut donc recourir à des cycles combinés au gaz, et telle est bien la référence choisie pour les différentes tarifications. Le tarif 1997-2001 a été construit sur la comparaison avec ce qu'aurait coûté le cycle combiné pour la partie électricité, correspondant aux meilleurs technologies de l'époque et, pour le côté chaleur, aux meilleures chaudières thermiques. D'un point de vue économique, il faut comparer avec l'alternative réelle, et il faut donc bien voir quelle aurait été la situation réelle s'il n'y avait pas eu la cogénération, redémarrée pendant la période de la canicule, avec, en outre, cet avantage environnemental considérable que, contrairement à toutes les autres sources d'électricité non renouvelables, la cogénération ne rejette pas de chaleur et ne chauffe pas nos fleuves. M. Laurent LE BEL : J'en parlerai tout à l'heure à propos de la géothermie, mais l'Allemagne et le Danemark ont développé des démonstrateurs couplant cogénération et géothermie, ce qui permet d'utiliser la géothermie en hiver comme contributeur d'énergie et l'aquifère en été comme stockage thermique. M. Jean-Louis BAL : S'agissant de la gazéification de la biomasse, un certain nombre de projets ont été retenus dans l'appel d'offres du ministère de l'industrie ; nous attendons les résultats. Cette gazéification est l'un des thèmes de recherche du Programme national de recherche sur les bioénergies, lancé par l'Agence nationale de la recherche. Il fat aussi rappeler que la biomasse est une ressource limitée, dont l'usage principal est alimentaire. On estime qu'elle pourrait fournir, sans toucher aux débouchés alimentaires, 40 millions de TEP en énergie primaire. C'est à la fois considérable, et faible par rapport à notre consommation d'énergie primaire, qui est de 275 millions de TEP. Il faut donc se fixer des priorités, en sachant que la biomasse est la seule énergie renouvelable qui peut satisfaire aux trois besoins que sont la chaleur, les transports et l'électricité. Pour l'ADEME, la biomasse a d'abord vocation à servir de carburant pour les transports, dans un premier temps à partir de cultures alimentaires, et bientôt à partir de la ressource ligno-cellulosique ; la deuxième priorité la chaleur seule, la troisième la cogénération. Ce que nous voulons surtout éviter, c'est la production d'électricité sans cogénération, car le rendement, même avec gazéification, car le rendement serait de 40 % dans le meilleur des cas, ce qui constituerait un gaspillage de la ressource. Je suis, bien entendu, tout à fait d'accord sur les problèmes de structuration de l'approvisionnement qu'a évoqués Bernard Saint-André. La question du transport n'est pas facile à résoudre, car la biomasse ne se transporte pas comme le gaz. Il faut que l'usage chaleur soit à proximité de la ressource : on ne va pas transporter des camions de bois sur des centaines de kilomètres. Cela limite tout de même le champ des applications possibles. Nous espérons qu'au prochain appel d'offres du ministère de l'industrie, qui porte sur 300 MW, la cogénération sera davantage favorisée, car il y avait, dans le premier, un gaspillage de la ressource. S'agissant enfin des émissions de CO2 évitées, il est toujours caricatural de comparer avec le nucléaire, ou avec le cycle combiné gaz, ou avec la production à partir de fioul lourd : la cogénération va nécessairement se substituer à un « mixte ». C'est le même problème qu'on a pour l'éolien ou l'hydraulique au fil de l'eau : à l'horizon 2010 ou 2015, compte tenu de l'évolution des besoins de consommation d'électricité, ce qui va augmenter est la production à partir de centrales « combiné gaz ». La question est donc de savoir à quelle production la cogénération et l'éolien, si on veut les développer, vont se substituer, et quel volume d'émissions de CO2 sera évité. Le RTE pourrait faire cette étude si on le lui demandait, mais il n'y a pas de réponse simple. M. le Président : Nous allons passer à notre deuxième thème, qui est la géothermie. M. Laurent LE BEL : Le BRGM et l'ADEME ont coproduit une étude intitulée « Le point sur le développement de la géothermie dans le contexte énergétique et environnemental mondial», ainsi qu'un ouvrage plus « grand public » sur le même sujet. La France, dans les années 70-80, a été pionnière dans le développement de la géothermie, grâce à la présence, dans le bassin parisien, d'un aquifère très productif à 1 500 ou 2 000 mètres de profondeur, le dogger, d'une température moyenne de 75 degrés. La chaleur est utilisée directement, avec de simples échangeurs pour alimenter les réseaux de chaleur à partir d'un certain nombre de centrales - une cinquantaine à l'apogée de leur développement, en 1988. Il y a certes eu des problèmes techniques, dus à la corrosion ou à des dépôts dans les puits, mais des mesures correctives relativement simples ont été prises : il suffisait de déposer un film de fluide organique le long des tubages. Il y a eu également des difficultés financières : les collectivités locales ayant emprunté à des taux très élevés, il leur était difficile de rentabiliser leurs installations. Puis la cogénération est arrivée, et a investi les réseaux de chaleur - un peu aux dépens de la géothermie, susceptible de produire par installation 50 000 MWH, mais qui n'en produit, de ce fait, que 28 000 MWH en moyenne. Au début, le taux de couverture des besoins par la géothermie avoisinait les trois quarts. Actuellement, avec les 31 ou 32 installations qui restent, il est de l'ordre de 50 % seulement. Notre analyse est que l'arrivée de la cogénération a permis aux collectivités de résoudre certains problèmes de financement, grâce à la garantie d'achat de l'électricité produite. Aujourd'hui, cependant, la géothermie s'est lancée à la reconquête des réseaux de chaleur en région parisienne. Un groupe de travail de l'ADEME examine quels sont ceux, actuellement alimentés par des combustibles fossiles, qui pourraient l'être par une chaudière géothermique, avec un forage de production et un forage de réinjection - pour un investissement de 4,5 millions d'euros qui permettrait de produire, sur vingt ans, de la chaleur à 1,5 centime d'euro le kWh au lieu de 3,8 centime pour une chaudière à gaz. Compte tenu de ces éléments, le bassin parisien est prêt, me semble-t-il, à recevoir de nouvelles installations. Il convient de regarder s'il existe d'autres aquifères aussi énergétiques, à haute température, susceptibles de contribuer au développement de réseaux de chaleur. Je pense à des aquifères argilo-gréseux comme le trias, qui est un terrain propice également, à condition que l'on surmonte la difficulté posée par les effets chimiques au point de réinjection. Il existe également des aquifères qui ne sont pas à 70 ou 80, mais à 40 ou 50 degrés. Ils ne peuvent donc être directement exploités dans des réseaux de chaleur, mais les récents développements industriels en matière de pompes à chaleur, utilisant l'affinité du bromure de lithium avec la vapeur d'eau, permettent un couplage très souple entre l'aquifère et l'énergie thermique produite en surface. C'est ainsi qu'au Danemark, entre 1982 et 1988, le premier couplage entre géothermie - avec exploitation d'un puits à 44 degrés - et cogénération - à partir d'une usine d'incinération d'ordures ménagères - a permis de développer un système hybride transférant au réseau de chaleur de la petite ville de Thisted 10 MWth, dont 4 provenant de la géothermie et 6 de la chaleur fatale de l'usine d'incinération. Même faiblement énergétique, donc, cette source d'énergie peut contribuer à un système hybride. Les Allemands ont également développé un couplage entre géothermie - 50 degrés - et cogénération à cycle combiné à gaz à Neubrandenburg en 1998, et à 65 degrés et Erding en 1990. Deux centrales géothermiques existent en Pologne, alimentées par des fluides à 40 et 60 degrés, depuis respectivement 1996 et 2000, et un gros projet est en cours à Klaïpeda, en Lituanie, avec de l'eau à 38 degrés. Citons également l'installation hybride du Reichstag de Berlin, qui fournit de l'électricité, de la chaleur et du froid, stockés alternativement en aquifère supérieur et inférieur, et fonctionnant toute l'année, avec un assez bon rendement énergétique. Mais le stockage d'énergie en aquifère n'a pas été développé en France, alors même qu'il permet de stocker de l'énergie fatale au-delà de la saison de chauffe. Il faut aussi parler des géostructures énergétiques. Un certain nombre de bâtiments ont des soubassements ou des fondations sur pieux, lesquels sont soit ancrés soit flottants, et stabilisent la construction. En Autriche et en Suisse, on a développé des systèmes de collecte d'énergie par pompe à chaleur, en recourant à de tels soubassements ou fondations : c'est notamment le cas d'une aile nouvelle de l'aérogare de Zurich. Le sol apporte l'énergie nécessaire, et peut en outre stocker du froid et du chaud au gré de l'alternance des saisons, jouant, tel un aquifère, un rôle de tampon énergétique en système complexe. Enfin, au niveau des locaux d'habitation ou de bureaux, les pompes à chaleur connaissent un certain développement en France, l'ADEME a fait le point sur le développement des diverses techniques, permettant à chacun d'équiper sa maison personnelle. M. François DOSÉ : Vous avez peu parlé finances, or cette question intéresse les responsables de collectivités locales, qui ont à comparer et à choisir. Pouvez-vous nous dire un mot de la rentabilité immédiate ? De la durée d'amortissement ? Autre question, s'adressant l'intervenant précédent : la cogénération dessert-elle surtout les locaux d'entreprises, ou résidentiels ? J'ai l'impression, autour de moi, que cela concerne surtout les entreprises, les scieries par exemple, mais je n'ai pas de vision globale du phénomène. M. Patrick CANAL : De la révision du mécanisme de plafonnement dépendront les conditions économiques de la rentabilité des projets. Comme il n'y a pas d'opérations en cours, on peut supposer que le plafond actuel du prix du gaz n'assure pas l'équilibre économique. Mais j'ose espérer que ça s'améliorera. S'agissant des installations existantes déjà amorties ou préamorties, il est clair qu'il faut trouver un équilibre économique global en fonction du prix de marché, sachant que les prix de l'électricité évoluent rapidement : en semi-base, le prix de marché du MWh est actuellement supérieur à 70 ou 75 euros. L'exercice en cours à la DIDEME veut que le nouveau contrat 2006 tienne compte de critères économiques et de rentabilité, et que toutes les filières soient évaluées à l'aune de ce critère, afin de trouver un bon équilibre entre elles. Nous sommes très peu implantés dans le résidentiel ou le tertiaire, sauf peut-être les chaufferies hospitalières, les serres - qui permettent en outre de récupérer le CO2 émis - et quelques projets dans l'industrie. Le résidentiel est complètement ignoré, mis à part les réseaux de chaleur où le gisement thermique est supérieur à 1 GWh. Il y a donc un fort potentiel de développement de la cogénération de ce côté-là.. M. Bernard SAINT-ANDRÉ : Les réseaux de chaleur représentent un bon un tiers de la puissance installée totale, et le gisement est encore important. Il existe aussi la possibilité de faire des mini réseaux de chaleur, par la connexion de réseaux collectifs à une chaufferie centrale à cogénération. C'est quelque chose qui peut être catalysé par certains grands projets de ville. En résumé, si, aujourd'hui, pour des raisons essentiellement économiques ou liées au mécanisme d'obligation d'achat, il n'y a plus beaucoup de cogénération dans le résidentiel, le potentiel reste important. M. Patrick CANAL : On l'évalue à près de 1 GWh, ce qui n'est pas négligeable. M. Jean-Louis BAL : Laurent Le Bel a fait état d'un coût de production très compétitif : 1,5 centime le KWh. Mais le problème du géothermique aujourd'hui, c'est moins la rentabilité que le risque pris par le maître d'ouvrage, qui lance un forage sans avoir la certitude qu'il sera fructueux, que ce soit du point de vue de la température ou du débit. Jusqu'en 1995, il y avait un fonds de garantie, alimenté à la fois par les maîtres d'ouvrage et les pouvoirs publics, et qui prémunissait les opérateurs contre les forages infructueux. Il a malheureusement été supprimé, et une mesure bienvenue consisterait à le rétablir. Il faudrait, d'autre part, éclaircir la question du certificat d'économie d'énergie, dont on ne sait toujours pas si la production d'énergie renouvelable pour les réseaux de chaleur y sera éligible ou non. La DIDEME nous dit que oui, mais nous n'avons pas vu le décret. M. Nicolas GARNIER : Un tiers des réseaux de chaleur sont alimentés par la cogénération ; celle-ci concerne donc beaucoup l'habitat. Quant aux certificats, la loi dispose que la chaleur renouvelable y est éligible, mais le projet de décret prévoit que l'économie d'énergie doit se faire à l'intérieur du logement, alors que le réseau, par définition, lui est extérieur. Il y a là une ambiguïté à lever. M. Daniel CAPPE : La version présentée au Conseil supérieur de l'électricité et du gaz avait été mal rédigée. On nous a dit que le décret serait réécrit de façon à viser la chaleur « pour » le bâtiment et non « dans » le bâtiment. Mais nous attendons que le Conseil d'État valide cette rédaction. Le processus devrait s'achever dans la deuxième moitié de février, et il y a tout de même un risque non négligeable. M. le Président : Vous nous avez décrit, Monsieur Le Bel, un certain nombre d'expériences auxquelles nous sommes tout à fait prêts à adhérer, mais il ressort du premier exposé introductif que la part de la cogénération dans la production totale d'électricité n'est que de 3,5 %. Pouvez-vous nous dire quelle est la part de la géothermie ? Je devine, je sais même que c'est epsilonesque, mais la question est de savoir pourquoi on en est resté là, pourquoi, hormis la Guadeloupe et un peu le bassin parisien - quoique moins que par le passé - ce n'est pas plus développé. Quels sont les blocages ? M. François DOSÉ : Je suis maire depuis trente ans d'une ville de 8 000 habitants, qui ont de l'eau chaude sous leurs pieds et qui le savent, mais quand je dis au conseil municipal que nous devrions financer nous-mêmes un forage de vérification, je passe pour un doux dingue. M. Laurent LE BEL : La géothermie est en effet epsilonesque au sein de la production de chaleur : les 30 installations du bassin parisien produisent 950 GWh, soit une très faible part, sans doute, de la consommation de la région. M. Jean-Louis BAL : La production annuelle totale d'énergie d'origine géothermique est de 130 000 TEP, sur une consommation d'énergie finale de 54 millions de TEP, soit 0,25 %. M. Régis MEYER: Il faudrait rapporter ce montant au chauffage urbain. M. le Président : Même ainsi, cela fait à peine 1 %. Mais je voudrais qu'on évoque les contraintes. M. Jean-Louis BAL : La principale est le risque de forage. Il y a aussi la mauvaise image de la géothermie, notamment en région parisienne, mais tous les bilans qui ont été faits devraient nous permettre de repartir sur de nouvelles bases. De nouveaux projets sont en train d'émerger. Si seulement on pouvait nous donner un petit coup de pouce. Nous sommes assis sur une grande marmite d'eau chaude, qui pourrait chauffer toute la ville de Paris. Certes, le niveau de température n'est pas forcément en cohérence avec la disponibilité de la chaleur géothermique, mais beaucoup de réseaux de chaleur existants pourraient être facilement alimentés à partir de la géothermie. M. Patrick FAISQUES : Il faut distinguer deux types de géothermie. La première, la plus importante, est celle qui alimente les réseaux de chaleur. Trois grandes raisons font qu'elle ne progresse guère. Il y a d'abord les problèmes techniques : on n'est pas sûr que le forage sera fructueux, ni que la température de l'eau suffira pour être réutilisée immédiatement par des réseaux de chaleur. Le second aspect est l'acceptation par la population et les élus : il y a eu des contre-performances au début, à un moment où la technique était mal maîtrisée, et qui pèsent encore lourd ; en outre, les investissements sont coûteux, on commence par faire de grands trous, les conseils municipaux sont donc réticents, si bien que ces projets ont besoin, plus que d'autres, d'être accompagnés. Enfin, la gestion quotidienne des installations est complexe : il ne s'agit pas d'appuyer sur un bouton, mais de suivre l'évolution du forage et de la ressource. Il existe, cela dit, une seconde sorte de géothermie, individuelle, que l'on voit foisonner, avec tous ces packs qu'on voit dans les salons du bâtiment, où des gens vous expliquent qu'il suffit de creuser à quelques centimètres du sol pour chauffer une maison. Mais cela nécessite un entretien régulier, et les produits disponibles ne sont pas toujours à la hauteur du marché : peut-être sera-ce un frein au développement de la géothermie. M. Jacques BASCOU : Pensez-vous qu'il y ait une marge de progression des technologies, justifiant une aide des pouvoirs publics, ou bien la priorité est-elle de garantir un prix d'achat ? M. Bernard SAINT-ANDRÉ : Ce qui vient d'être dit sur les obstacles est vrai. Mais je puis quand même témoigner, fort de nos quelque trente ans d'exploitation - puisque nous avons foré notre premier puits à Melun en 1977 et que nous avons maintenant une quinzaine de sites - que malgré les difficultés techniques du début et le déficit d'image de la géothermie, tout fonctionne désormais de façon très satisfaisante. Il y a naturellement des progrès à faire pour mieux exploiter l'énergie existante, mais l'obstacle principal au développement de la géothermie est économique. Aujourd'hui, pour une installation nouvelle, le prix de revient du kWh produit est très sensiblement supérieur au prix de base. Notre expérience nous montre que sur la totalité des projets concrets que nous aurions pu étudier, le prix de revient de la chaleur produite était quasi-systématiquement substantiellement supérieur à celui correspondant à une installation classique. Ce surcoût est naturellement variable suivant le projet. Ces projets doivent être aidés pour exister. C'est une question de volonté politique : veut-on aider ce type de technologie, même si cela doit coûter un peu cher ? M. le Président : Avant de passer à notre dernier thème, qui est le développement des réseaux de chaleur, je voudrais signaler qu'il y a aussi des sources froides que l'on n'utilise pas. En Lorraine, par exemple, on a ennoyé les anciennes mines de fer, si bien qu'il y a des millions de mètres cubes tout près du sol, dont on pourrait tirer parti. Je donne maintenant la parole au délégué général d'AMORCE, que nous sommes très heureux d'entendre. M. Nicolas GARNIER : A l'échelle mondiale comme à celle du pays, la chaleur est le premier poste de consommation d'énergie : en France, le chauffage consomme 56 millions de TEP, contre 50 pour les transports, 40 pour l'industrie, et 18 pour l'électricité spécifique, c'est-à-dire celle qui ne peut être remplacée par aucune autre énergie. Donc, qu'il s'agisse de définir la politique énergétique de la France ou sa politique de lutte contre l'effet de serre, la première question à se poser est : comment nous chauffons-nous ? La facture moyenne annuelle de chauffage (en coût global), en France, est de 1 000 euros environ par logement, à rapporter à celle d'eau ou de télécommunications, de 300 euros chacune. Il s'agit, à 80 %, de modes individuels : chaudières à gaz, à fioul, inserts bois ou bois de cheminée, convecteurs électriques. Les 20 % restants sont du collectif : chaudières de bas d'immeuble, ou réseaux de chaleur chauffant plusieurs immeubles, équipements, quartiers. C'est de cela que je vais vous parler. Il y a en France quelque 450 réseaux de chaleur, qui alimentent 2 millions d'habitants, et 3 millions d'« équivalents habitants », compte tenu du fait qu'une partie des locaux ainsi chauffés sont des locaux de bureaux, appartenant notamment à des collectivités locales. M. le Président : Dont quel pourcentage en région parisienne ? M. Nicolas GARNIER : Le quart de Paris est alimenté par le réseau de chaleur de la Compagnie parisienne de chauffage urbain, et la région parisienne compte une centaine de réseaux de chaleur, dont une majorité de logements sociaux. C'est aussi une question sociale, d'autant plus aiguë que le nombre d'impayés de chauffage va croissant. Un véritable piège est en train de se refermer sur une partie de la population, et il est urgent d'agir ; nous allons nous joindre au Secours catholique, à la fondation Abbé Pierre et au Comité de liaison des énergies renouvelables pour une initiative sur le thème « habitat, chauffage et précarité ». Les réseaux de chaleur ne représentent que 6 % du chauffage en France, soit bien moins qu'en Europe du Nord : sans même aller jusqu'en Islande, où le taux est de 100 % comme chacun sait, les villes d'Europe du Nord sont souvent structurées autour du réseau de chaleur lui-même, et le pourcentage décroît à mesure qu'on va vers le sud, même si l'Italie et l'Espagne ont-elles aussi leurs réseaux de chaleur. Il y a eu trois vagues historiques : l'immédiat après-guerre, où il fallait avant tout économiser la ressource ; puis l'après-choc pétrolier, où cette nécessité s'est fait sentir de nouveau ; puis la période actuelle, où s'ajoute la double préoccupation de l'instabilité des prix de l'énergie et du changement climatique. Sur 450 réseaux de chaleur, 32 sont alimentés par la géothermie, 80 par des usines d'incinération, 120 par des cogénérateurs et 80 - c'est nouveau - par le bois-énergie. Sous cette dernière rubrique, il y a d'une part de grands réseaux anciens qui passent du charbon au bois, comme à Vénissieux, à Lyon, à Paris d'ici dix ans sans doute, et d'autre part de petits réseaux en milieu semi-rural, dont la puissance est comprise entre 1 et 5 KW et non pas entre 30 à 100 MW, et qui alimentent principalement les mairies, les hôpitaux, les maisons de retraite, plus quelques clients privés. Donc, 70 % des réseaux de chaleur utilisent les énergies renouvelables ou la cogénération, mais il y a des marges de progression possibles. Le réseau de chaleur de Dunkerque, par exemple, est alimenté par la chaleur fatale des aciéries Sollac, récupérée pour desservir deux quartiers. C'est très intéressant en termes de captage. Un réseau de Valence est alimenté de la même façon, par une centrale bien connue. M. le Président : Si je fais le total, j'obtiens seulement 312 réseaux sur 450. Et le reste ? M. Nicolas GARNIER : Les autres réseaux sont alimentés par des énergies anciennes, classiques : fioul, gaz, un peu de charbon. Montpellier a un projet de développement du biogaz, Grenoble a un réseau de chaleur alimenté par la combustion de ces fameuses farines animales qui nous ont posé tant de problèmes. C'est marginal, mais ce sont des pistes intéressantes. Il y a trois ans, lors du débat sur l'énergie, nous avions proposé un débat particulier sur la chaleur, et nous avons largement contribué à ce que soit fixé l'objectif de 50 % de chaleur renouvelable. Ce n'est pas un pourcentage sorti de notre chapeau, mais des calculs que nous avions faits Energie Cités, le Comité des énergies renouvelables et d'autres organisations. Comment y parvenir ? Aujourd'hui, dans le bouquet énergétique français, la production d'énergie renouvelable thermique représente 12 millions de TEP pour la chaleur et 7 seulement pour l'électricité. Le bois en représente 9 millions. M. le Président : Lorsque Claude Birraux et moi avions rédigé notre rapport, il y a cinq ans, on en était déjà à 10 millions de TEP. M. Nicolas GARNIER : La valorisation énergétique des déchets représente 600 000 TEP, ce qui en fait la deuxième énergie thermique renouvelable en France. Nous venons de mettre aux normes tout le parc d'incinérateurs ; reste à montrer qu'il y a une marge de développement. La géothermie représente 130 000 TEP, la biomasse 139 000 TEP, le biogaz 63 000 TEP, le solaire thermique 34 000 TEP. Si nous essayons d'avoir une vision prospective, nous pensons qu'en 2010 le bois peut atteindre 12 millions de TEP, la valorisation des déchets 900 000 TEP, la géothermie 200 000 TEP, le biogaz 600 000 TEP - en tenant compte des déchets agricoles, comme au Danemark où ce sont les coopératives qui les gèrent, ainsi même que les déchets organiques des collectivités ! - et le solaire 200 000 TEP. Au total, on peut espérer arriver à 4 ou 5 millions de TEP - même si ce ne sera pas facile d'y arriver dès 2010. Quels sont les obstacles ? Le premier est fiscal. La fiscalité énergétique, en dépit du crédit d'impôt pour les économies d'énergie, est totalement contraire à nos objectifs énergétiques. Le problème principal est celui de la TVA. En individuel, l'abonnement à EDF-GDF est taxé à 5,5 % depuis 1999, alors que l'abonnement collectif à un réseau de chaleur l'est à 19,6 %. C'est-à-dire que l'usager paie 14 points de TVA en plus s'il se chauffe au bois collectif que s'il se chauffe au gaz individuel, soit une différence de 45 euros par logement. Ce n'est pas la faute au Parlement, qui nous a toujours soutenus depuis six ans, mais à la directive TVA, réécrite en 1992 et qui a oublié la chaleur sur la liste des biens et services éligibles au taux réduit de TVA. M. le Président : Nous rencontrons le commissaire Stavros Dimas à Bruxelles lundi 29. M. Nicolas GARNIER : Je vous remercie d'avance de lui porter ce message-là. Nous venons de rencontrer, de notre côté, M. Loos et le cabinet de M. Breton, qui nous ont confirmé leur soutien. Il y a trois dossiers fiscaux sur la table : la restauration, les travaux à l'intérieur du logement, et la chaleur, dont on parle beaucoup moins que les trois autres, on pourrait se demander pourquoi. Au cas où le problème ne serait pas réglé au conseil « Ecofin » du 24 janvier, nous avons demandé à M. Loos un dispositif de compensation, qui est celui que vous avez proposé sous forme d'amendement, c'est-à-dire une prime à la cuve de fioul de 45 euros pendant un an. Ce n'est évidemment pas une solution satisfaisante : c'est une mesure transitoire, car avant de développer les réseaux de chaleur, il faut maintenir ceux qui existent, et que certaines collectivités envisagent d'abandonner. La TVA sur le bois est également défavorable aux réseaux de chaleur, car il est taxé à 5,5 % quand vous l'achetez directement pour vous, mais à 19,6 % quand vous le consommez par l'intermédiaire du réseau de chaleur. Même chose pour la TVA sur les travaux à l'intérieur du logement, même chose aussi pour le crédit d'impôt, qui ne bénéficie en outre qu'aux propriétaires, même chose encore pour la remise GDF, pour la taxe locale ainsi que pour les quotas, auquel les chaudières individuelles, à la différence des collectives, ne sont pas soumises. Les exigences réglementaires sont également pénalisantes, notamment pour le traitement des fumées, car contrairement à ce qu'on croit, les petites chaudières polluent plus que les grandes, généralement équipées. Si on fait le total de tout cela, on constate, entre le chauffage individuel au gaz et le réseau de chaleur alimenté par le bois, une différence de 275 euros sur une facture de 1000 euros. Il y a donc une vraie réforme de la fiscalité du chauffage à mener. Un autre motif de préoccupation est constitué par les opérations de renouvellement urbain. On détruit des logements, on en construit d'autres - de meilleure qualité, certes, mais les habitants ne seront pas les mêmes, et les contrats non plus. A Vénissieux, le réseau de chaleur va perdre ainsi le tiers de ses clients. Si l'on ne fait rien, des réseaux vont disparaître. M. Jean-Louis BAL : Je voudrais préciser que la différence entre 5,5 % et 19,6 % correspond grosso modo à la subvention de l'ADEME aux projets de chaufferie au bois des réseaux de chaleur. L'État reprend donc d'une main ce qu'il donne de l'autre ! Le plan bois-énergie de l'ADEME apporte une contribution supplémentaire en énergie primaire de 50 000 TEP pour chacune des six années du plan, soit un total de 300 000 TEP. Nous devrions retrouver cette progression dans les bilans réalisés, mais il y a érosion dans le parc de logements individuels. Le nombre d'appareils de chauffage diminue, le chauffage de base par des chaudières ou cuisinières fait place à des usages partiels, du type poêles ou inserts. Ce qu'on gagne dans l'habitat collectif et le tertiaire, on le perd - et sans doute au-delà - dans l'habitat individuel, où on a négligé le chauffage au bois. C'est toutefois en train de changer grâce au crédit d'impôt, qui porte notamment sur les appareils de chauffage au bois les plus performants, consommant moins de bois et émettant moins de substances polluantes. Nous avons établi des scénarios de progression de ces appareils. Si la tendance observée en 2005 se poursuit, c'est-à-dire une progression de 50 à 60 %, nous devrions avoir moins d'émissions de CO2 et moins de consommation de bois, libérant à l'horizon 2020 quelques 3 à 4 millions de TEP, qui pourront être utilisées à d'autres usages, notamment les biocarburants. M. le Président : Je crois que vous sous-évaluez le solaire thermique. Selon la loi et plan « Face Sud », on doit arriver, toutes utilisations confondues, à 10 millions de TEP, grâce à une meilleure orientation, au solaire passif et au solaire actif - chauffage, eau chaude. Or, notre pays n'en est qu'à 85 000 mètres carrés de capteurs installés, contre 2 millions de mètres carrés en Allemagne. Ces résultats très inférieurs aux objectifs de la loi sont-ils bien ce que vous souhaitez ? M. Christian DECOCQ : Élu du Nord, j'ai présidé une association de développement des cultures énergétiques qui avait un certain poids politique, puisque y étaient représentés pour moitié les chambres d'agriculture et les gros agriculteurs de la région, d'une part, et des membres Verts du conseil régional que présidait alors Mme Blandin. L'objectif était de développer la filière bois-énergie autour des TTCR - taillis à très courte rotation - avec récolte tous les trois ans sur de petites superficies. J'ai fini par jeter l'éponge, car malgré notre partenariat avec l'État les choses n'ont pas progressé, notamment parce que l'idée fausse s'est répandue qu'on pouvait récolter le tout-venant là où il se trouvait. J'ai nettement senti une certaine réserve de la part des agriculteurs, qui voulaient bien nous confier des friches, des sols pollués, etc., mais pas des surfaces cultivables. Le TTCR a marché en Suède, pourquoi n'aurait-il pas marché en France ? Mme Martine LIGNIERES-CASSOU : Ma question sera très simple : comment atteindre l'objectif de 50 % d'énergies renouvelables dans le chauffage ? M. Nicolas GARNIER : Sur le solaire, je ne suis pas le mieux placé pour répondre. Le chiffre nous a été donné par le Syndicat des énergies renouvelables, mais je crois qu'il s'agit seulement du solaire à usage collectif, à quoi il faut ajouter l'usage individuel. M. le Président : Pouvez-vous faire parvenir ce document ? Le solaire thermique est epsilonesque, mais si on l'intègre au bâtiment, notamment dans le logement social, on peut économiser 50 % sur le chauffage, de 35 % sur l'eau chaude, et ce toute l'année. M. Nicolas GARNIER : Il y a eu plusieurs amendements à la loi sur l'énergie pour que les communes ou leurs groupements ayant une compétence élargie - et nous sommes intervenus pour que les intercommunalités aient cette compétence - puissent, dans leurs documents d'urbanisme, imposer le recours aux énergies renouvelables, en particulier le solaire thermique, ou le raccordement au réseau de chaleur au bois, comme en Espagne. La production d'électricité est régie par des tarifs de rachat, ce qui signifie que nous ne sommes pas dans une logique de marché. Mais pour la production de chaleur, nous sommes bel et bien dans le marché, puisque nous sommes en concurrence avec le gaz naturel, l'électricité, le fioul. Il est donc important de faire passer l'idée que les collectivités, dans leurs SCOT ou leurs PLU, doivent pouvoir imposer le recours aux énergies renouvelables sur telle ou telle partie de leur territoire : par exemple le solaire thermique dans telle ZAC, le raccordement au réseau de chaleur dans telle autre Sinon, on n'arrive pas à monter de projets, faute de savoir qui sont les clients, quelle sera la taille du réseau, le point d'équilibre financier, la compétitivité de la facture finale. C'est l'éternel problème de l'œuf et de la poule. Au sein du bois-énergie, il y a trois grandes ressources : la moins chère, mais qui est en voie de raréfaction, ce sont les déchets de l'industrie du bois ; il y a ensuite le forestier issu de la sylviculture ; mais la plus importante est la gestion des forêts, qui permet de faire d'une pierre deux coups en remédiant aux carences d'entretien, en pratiquant les éclaircies nécessaires, en nettoyant et en structurant les surfaces boisées. La TVA à 5,5 % sur l'abonnement aux réseaux de chaleur et sur les sources d'énergie renouvelable elle-même est une question d'équité. De même qu'il y a un dispositif de compensation des charges du service public d'électricité, il faut un dispositif de soutien aux énergies renouvelables, qui passe par l'extension du CCSPE à toute l'énergie, et pas seulement à l'électricité. Il faut aussi gérer le problème des impayés de chauffage, notamment dans le logement social, et intégrer dans les opérations de renouvellement urbain la question des réseaux de chaleur. Il faut, surtout, avoir un vrai débat sur les modes de chauffage des Français, car cela touche à trois problèmes essentiels : le problème social, celui de l'approvisionnement énergétique et celui du changement climatique. M. Jean-Louis BAL : Une précision sur le plan « Face Sud », dont le président Le Déaut a été l'un des pères : l'objectif fixé signifie un rythme annuel d'un million et demi de mètres carrés de capteurs installés en 2010. M. le Président : Si je comprends bien, on n'y est pas ? M. Jean-Louis BAL : Non, mais peut-être n'en est-on pas si loin. En 2005, nous avons sans doute dépassé les 150 000 mètres carrés, en additionnant la métropole et les DOM, avec une progression de 70 % en métropole. Avec un tel taux de progression, dû notamment à un crédit d'impôt de 40 % qui va de surcroît passer à 50 %, on devrait s'en rapprocher. M. le Président : Nous avons donc eu raison d'insister ? M. Jean-Louis BAL : Oui, et nous vous en serons longtemps reconnaissants. M. le Président : Messieurs, je vous remercie de votre contribution aux travaux de la Mission d'information. Audition de M. Nicolas Hulot, Présidence de M. Yves LE DEAUT, Président M. le Président : Mes chers collègues, nous avons le plaisir d'accueillir M. Nicolas Hulot, que je remercie d'être venu devant cette mission dont les membres, issus de tous les groupes politiques, souhaitent être des relais auprès du Gouvernement des mesures qu'il faut prendre pour lutter contre ces graves menaces du XXIe siècle que sont le réchauffement climatique et l'effet de serre. Malheureusement, certains, y compris parmi les députés, mettent en avant d'autres menaces, ce qui entraîne un brouillage dans l'opinion publique sur les risques réellement encourus, même si les scientifiques sont très clairs à ce sujet. C'est pour cela que l'implication de gens comme vous, dont l'audience médiatique est grande, en fait des relais très importants. Nous avons souhaité recueillir votre avis car vous avez été un pionnier en vous efforçant d'alerter nos concitoyens par vos émissions de télévision, vous plaçant ainsi à côté des scientifiques, des responsables associatifs et des techniciens qui essaient de diffuser l'information. M. Nicolas HULOT : Je vous remercie de me donner occasion de m'exprimer, devant vous, mais je ne vois pas ce que je vais pouvoir vous dire que vous ne sachiez déjà, surtout quand il y a à vos côtés Nathalie Kosciusko-Morizet, qui n'a pas grand-chose à apprendre sur ces sujets. Vous avez laissé entendre qu'il flotterait encore une sorte de scepticisme sur la gravité des menaces écologiques en général et climatiques en particulier. J'ose espérer que ce temps est révolu. Car si on part du principe que le préalable à l'engagement individuel et collectif est la conviction, espérons au moins que ces dernières années ont servi à diffuser le diagnostic planétaire. Car devant cette incertitude, on a doté les communautés nationales et internationales d'organismes destinés à valider ou infirmer ce qui pouvait apparaître comme une inquiétude chronique de quelques écologistes obscurantistes. Aujourd'hui il n'y a plus de débat et j'ai envie de dire malheureusement, car nous nous serions bien passés de ce péril supplémentaire, qui vient amplifier toutes les autres difficultés auxquelles nous sommes confrontés. Et tout le monde est désormais d'accord sur le diagnostic, sur le fait que la part entropique de l'effet de serre va certainement induire et amplifier des changements climatiques qui avaient commencé naturellement mais qui deviennent, par leur rapidité, totalement inhabituels. Il est important de se fier à ceux qui ont en charge cette mission, car certains scientifiques, sans doute pour exploiter une niche médiatique, vont parfois à l'encontre des alertes des climatologues. Mais le diagnostic du GIEC paraît imparable et, même si les climatologues sont prudents sur la modélisation, on s'aperçoit qu'ils revoient régulièrement à la hausse la branche la plus basse de la fourchette. Je comprends ceux qui en conçoivent un tel effroi qu'ils se détournent de révisions qui ne leur semblent plus à leur échelle. Mais nous savons tous ici que le monde de demain sera radicalement différent, de gré ou de force. S'il l'est de force, le tribut des uns et des autres sera plus lourd que s'il l'est de gré, c'est-à-dire si nous, sociétés occidentales, l'organisons. Et si nous devons le faire, c'est parce que pour proposer une logique différente aux pays émergents, nous devons commencer par nous l'appliquer à nous-mêmes. Prétendre qu'on pourra faire face à ce défi écologique et climatique par un traitement à la marge est une imposture. Chacun doit donc prendre sa part de responsabilité, de réflexion et de proposition, car personne ne détient à lui seul toutes les solutions. Dès lors qu'on a besoin de l'adhésion de l'opinion pour repérer les mutations indispensables, il serait bon que nous cessions, nous écologistes identifiés, d'être les seuls à porter ce message d'alerte, au risque de le marginaliser. Car les gens se disent que si les hommes politiques ne le relaient pas, c'est sans doute parce que la situation n'est pas aussi grave que nous le disons. Convaincre totalement nos concitoyens de l'importance des enjeux m'apparaît donc comme un préalable à l'action politique, car cela provoquera chez eux un appétit aux changements que nous aurons ensuite à organiser. C'est d'autant plus important qu'on voit bien qu'il va falloir orchestrer, dans une société dont on sait combien elle est figée, des mutations fondamentales auxquelles le doute peut rendre résistant. Il faut donc bien faire passer le message que nul ne sera immunisé contre les conséquences du changement climatique. Autre message très important : les premières victimes de ces changements sont toujours les mêmes, les plus exposés, c'est-à-dire les pays du Sud, mais aussi les plus fragiles dans nos pays, on l'a vu à la Nouvelle-Orléans. Mais personne ne sera l'abri. Les précédents changements climatiques qui ont affecté l'homme se sont produits alors qu'il vivait dans une société nomade. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, pourtant les changements climatiques et les effets sanitaires et écologiques qu'ils induisent légitimeront des déplacements massifs de populations. Il convient par ailleurs de ne pas comparer le défi du changement climatique avec les autres difficultés : ils ne se comparent pas, ils s'ajoutent. Surtout, le changement climatique va accentuer ces difficultés. Et nous avons changé d'échelle en passant de la vision environnementaliste des années 1970, qui restait à la dimension du génie humain, aux équilibres climatiques, qui nous incitent à une grande humilité. Quand on écoute les experts du GIEC et ceux qui ont en charge la biodiversité, on comprend que les changements vont prendre de court l'ensemble du vivant, que nous allons être confrontés à des désordres climatiques et à des problèmes sanitaires à très grande échelle, en raison de l'effet d'emballement. On a aujourd'hui quelques exemples visibles des premiers dérèglements. Les climatologues annoncent une amplification des extrêmes : l'atmosphère devenant de plus en plus instable, les typhons et les tornades, les précipitations comme les sécheresses seront plus intenses. On observe déjà des changements, y compris sous nos latitudes : cet été, l'Europe du Nord était sous les eaux tandis que le Sud brûlait. Nous allons changer d'échelle parce que ce qui fait aujourd'hui office de puits le carbone et de stocks des gaz à effet de serre vont en devenir des sources. C'est ce qui explique l'emballement. Ainsi, les océans sont aujourd'hui un des principaux puits de carbone, mais leur capacité de stockage diminue avec l'élévation de la température. Autre exemple, les zones de pergélisol stockent du méthane, gaz résiduel de la décomposition organique. Or, ces zones repassant de plus en plus souvent en température positive, la décomposition reprend et ces sols dégagent le pire des gaz à effet de serre. On nous annonce par ailleurs que la banquise arctique estivale aura totalement disparu au milieu du siècle. Ainsi, au lieu de cette surface blanche qui réfléchit une quantité importante d'énergie vers l'espace, il y aura un océan sombre, dont la capacité d'absorption calorifique sera douze fois supérieure. En outre, la disparition de la banquise risque de provoquer des perturbations colossales de la formation des courants océaniques qui sont les gardiens des équilibres climatiques et qui prennent naissance dans la zone arctique au moment de la formation des glaces, en raison de la précipitation du sel. On sait aussi qu'à cause de la déforestation, il n'y aura plus en 2050 un seul hectare de forêts humides, pourtant essentielles à la biodiversité et au stockage du carbone. Tout cela confirme qu'on a changé d'échelle et que si on veut un jour revenir à la capacité naturelle de stockage des gaz à effet de serre, Kyoto n'est qu'un petit pas, bien insuffisant, puisque c'est par quatre qu'il faudrait diviser nos émissions. Et quand on voit les difficultés que nous avons à atteindre les objectifs de Kyoto, on se rend bien compte qu'on y parviendra pas sans un engagement cohérent de l'ensemble de la société. C'est pour cela que je me bats pour créer une synergie, pour que tout le monde aille dans le même sens, en particulier au sein du Gouvernement et du Parlement. Car atteindre ces objectifs va nous imposer une révision fondamentale de nos logiques. Un certain nombre d'outils me paraissent indispensables pour faire face à ces enjeux et pour conjuguer les impératifs économiques et sociaux et le développement durable, qui consiste à respecter les impératifs d'aujourd'hui en préservant les nécessités de demain. Dans une société de production et de consommation, on doit donc prendre en compte que, la terre étant ronde, donc fermée, il va bien falloir trouver les mécanismes de régulation entre ce qu'elle peut nous donner et ce que nous lui demandons, ce qu'elle peut encaisser et ce que nous lui faisons subir. En 150 ans, nous avons presque épuisé les ressources que la biosphère s'était constituées pendant des centaines de millions d'années. Tous les spécialistes, le professeur Edward Osborne Wilson en tête, disent qu'à la fin du siècle la moitié du vivant, c'est-à-dire de nos ressources élémentaires, sera sans doute définitivement compromise. On mesure l'importance du défi, qui ébranle nos certitudes, qui remet en cause notre puissance. Mais notre plus grand ennemi est notre aveuglement. Si nous mobilisons le génie humain pour relever ce défi, si nous orientons convenablement notre recherche, nos outils, nos comportements, notre production, notre consommation, nous pouvons y parvenir. Même si elle s'en serait bien passée, ces changements climatiques sont peut-être une chance extraordinaire pour l'humanité, car ils nous obligent à redonner du sens au progrès. Que notre croissance arrête de n'avoir d'autre logique qu'elle-même, que l'on cesse de confondre progrès et performance, voilà des perspectives enthousiasmantes ! Parmi les outils, la fiscalité écologique et énergétique me paraît indispensable, pour peu qu'elle touche l'ensemble des biens de consommation et des services. Car la vertu ne se décrète pas, elle se suscite, elle s'encourage. Si on veut que nous, consommateurs, rationalisions nos choix et que nous allions vers une société non pas de privation mais de modération, il va falloir guider ces choix, mais aussi encourager la créativité industrielle. Le deuxième outil, c'est la norme. Car si on ne peut pas demander à l'industrie d'être vertueuse spontanément, elle peut le devenir pour peu qu'on l'y incite. Peut-on, par exemple, continuer d'admettre cette incohérence de l'industrie automobile qui crée chez les consommateurs le désir de posséder des véhicules puissants et énergétivores, tandis qu'on les culpabilise d'autre part en leur parlant sécurité routière, consommation d'énergie et pollution atmosphérique ? Bien sûr, on peut réduire encore un peu la vitesse autorisée, mais ne conviendrait-il pas surtout d'imposer à l'industrie de nous proposer des véhicules qui prennent en compte ces réalités ? Je suis convaincu qu'en quelques années elle serait capable de faire apparaître des éléments attractivité autres que la puissance et la vitesse. Si on veut que le citoyen, le consommateur aille plus loin, il faut lui donner le choix sans qu'il soit pénalisé. Or, aujourd'hui, quand on veut faire un petit effort en choisissant des biens de consommation qui pèsent moins lourdement sur l'environnement, on doit supporter un surcoût d'au moins 30 % : c'est ce que coûtent en plus un produit issu de l'agriculture biologique, une machine à laver qui consomme moins d'eau et d'énergie. La recherche me paraît très importante pour faire surgir des alternatives, car nous sommes aujourd'hui dans une impasse dans des domaines comme les transports, l'énergie ou l'écologie industrielle. On voit bien que nous avons besoin que tous les acteurs de la société se mobilisent et aillent dans le même sens. C'est pour cela qu'il m'apparaît impossible qu'au sein du Gouvernement, un simple ministère puisse relever à lui seul ce défi transversal. Cet enjeu est au-dessus de tous les autres. Nous allons connaître au cours du siècle des crises environnementales, sociales, sanitaires, humaines, géopolitiques de plus en plus importantes. Plus nous attendons, plus il sera difficile d'y répondre. Nous avons déjà perdu beaucoup de temps dans la prise de conscience, sans doute parce que nous étions légitimement obsédés par la précarité de l'emploi. Nous sommes capables d'engager des budgets très importants pour faire face à d'hypothétiques menaces militaires ; j'aimerais que nous soyons capables de faire autant face à une menace avérée. Certains experts disent même craindre plus la menace climatique que la menace terroriste, mais cette comparaison est sans doute inopportune puisque, je l'ai dit, l'une s'ajoute à l'autre. Je le rappelle, les pays les plus exposés sont ceux du Sud : un seul degré d'élévation de la température dans la bande sahélienne aurait des conséquences considérables. Les problèmes d'approvisionnement en eau douce vont être amplifiés par les changements climatiques, la diminution de la biodiversité va s'accélérer, tandis que se profilent les échéances successives des pics pétrolier, gazier et charbonnier. Pour se préparer à tout cela, nos sociétés doivent réviser en profondeur leurs logiques. M. le Président : Merci beaucoup. Redonner du sens au progrès et réorienter la recherche me paraissent des idées majeures. Quand je disais en introduction qu'on ne prenait peut-être pas assez en compte la réalité de la menace, je parlais moins des membres de cette mission que de l'opinion publique. Sur la sobriété et l'efficacité énergétiques comme sur les énergies renouvelables, le bilan français n'est pas bon puisque nous consommons plus, notamment dans les transports et dans le résidentiel tertiaire. Certes, l'efficacité énergétique est un peu plus grande, mais on nous a dit, encore il y a un instant, que les objectifs de Kyoto ne seraient pas atteints. Je me demande donc ce que nous devons proposer concrètement dans notre rapport qui permettrait d'aller rapidement vers l'objectif de division par quatre des gaz à effet de serre. M. Nicolas HULOT : Nous, écologistes, avons sans doute atteint le plafond de notre efficacité, il paraît donc nécessaire que tous les parlementaires soient porteurs du même message, au moins sur le diagnostic, pour que l'opinion en mesure toute la portée. C'est très important car si la maturité écologique est plus grande qu'auparavant, il y a encore du travail. S'agissant de ce qu'il est possible de faire, je distingue l'action immédiate du moyen terme et du long terme, pour lequel la recherche devra faire apparaître des alternatives. On pourrait rapidement, par la volonté politique générale, sortir de la civilisation du gâchis. Nos gisements d'économies de ressources et d'énergie sont beaucoup plus importants que ce qu'on imagine. Dans toute stratégie énergétique, une politique offensive d'économies constitue un préalable, afin non pas de paralyser notre société mais d'aller, comme le disait Jean-Baptiste de Foucauld, vers une société « d'abondance frugale ». Le deuxième chantier, dont je vous parlais tout à l'heure, est celui de la fiscalité écologique et énergétique, pour inciter, pour dissuader, pour créer de nouvelles filières, pour faire en sorte que l'intérêt des producteurs et consommateurs soit un journal vers une consommation plus rationnelle est plus raisonnable. À plus long terme, il faudra bien à un moment s'interroger sur les racines du mal, sur la façon de faire en sorte que l'augmentation des flux économiques n'entraîne pas une augmentation équivalente des flux d'énergie et de matière. Car il y a aujourd'hui un certain nombre d'aberrations. Ne devrait-on pas s'interroger sur cette véritable débauche énergétique qu'a illustrée la collision, dans le tunnel sous Fourvière à Lyon, de deux camions chargés l'un de tomates du nord de l'Europe à destination du Portugal et l'autre de tomates espagnoles à destination de la Scandinavie ? Tenir compte du véritable coût énergétique de la réfrigération et du transport dissuaderait sans doute de telles aberrations. Mme Nathalie KOSCIUSZKO-MORIZET, Rapporteure : Je vous remercie pour votre intervention passionnée. Votre fondation Pour la Nature et pour l'Homme a lancé avec l'ADEME l'opération « Défi pour la terre - Dix gestes pour le climat », peut-on en tirer des idées d'actions que nous reprendrions dans notre rapport ? L'émission télévisée sur le modèle du Téléthon, en faveur de la lutte contre l'effet de serre n'avait pas trop bien marché, est-ce que les choses se passent mieux cette fois-ci ? M. Nicolas HULOT : Des idées, je ne sais pas, un message sans doute. Quand, par des opérations comme « Un défi pour la terre », nous essayons de sensibiliser l'opinion à ces enjeux, nous recevons toujours la même réponse : je suis convaincu, mais que puis-je faire ? C'est à cette question de l'action individuelle que nous proposons des réponses : dans leur comportement et dans leur consommation de tous les jours, les gens disposent quand même d'une panoplie de choix qui leur permet de modifier leurs automatismes comportementaux et consuméristes, simplement en prenant le temps de la réflexion sur la façon de pénaliser moins lourdement l'environnement. Nous avons ainsi recensé dix gestes pour le plus grand nombre, et des centaines d'autres sur notre site Internet, nous avons demandé aux gens d'y adhérer et nous avons calculé avec l'ADEME, pour chaque geste, l'économie d'émission de gaz à effet de serre. Le jour où nous avons lancé l'opération, notre site a explosé parce qu'il a reçu un million de demandes. Nous allons aujourd'hui vers 400 000 engagés, qui consacrent un quart d'heure à choisir les gestes. Je vois surtout cela comme le signe que les gens sont prêts à bouger, à prendre leurs responsabilités et même à aller plus loin pour peu que la société leur offre plus de choix et que ces choix ne soient pas économiquement pénalisés. Voilà qui contredit les responsables politiques, qui me disent souvent que j'ai raison mais que la population n'est pas prête. Sans doute était-ce vrai il y a trois ou quatre ans, mais, malheureusement, les événements, en particulier climatiques, ont confirmé nos messages d'alerte. Je pense qu'aujourd'hui, la maturité et la disponibilité sont plus grandes et que la marge de manœuvre des hommes politiques l'est aussi. M. Christian DECOCQ : Vous êtes un formidable homme de communication et vous affirmez qu'il faut changer les comportements individuels, mais quelles sont exactement vos idées pour cela ? Bien sûr, il y a la fiscalité écologique, qui suppose une volonté politique, mais ce n'est pas franchement une nouveauté. Il y a pourtant un génie français. La loi sur l'eau de 1964, c'était quand même quelque chose ! Quant à l'idée qu'un consensus politique est indispensable, outre qu'il n'est pas facile d'y parvenir, ne courons-nous pas aussi le risque d'être mal compris et considérés comme tous complices car tous d'accord, d'autant que, dans cette société de communication, des gens comme vous sont plus crédibles que nous ? Comment améliorer la communication institutionnelle politique ? Faudrait-il organiser des auditions contradictoires comme cela se fait dans les pays anglo-saxons ? M. Nicolas HULOT : Je crois qu'il n'y a pas de reniement politique à parvenir à un consensus sur des enjeux d'une telle importance. Nous entrons quand même dans une expérience planétaire grandeur nature mais c'est nous qui sommes dans l'éprouvette et ce qui est en jeu, c'est rien moins que l'avenir de l'humanité. Ce constat nouveau mériterait au moins consensus, même si je suis favorable à un débat permanent sur les solutions à mettre en œuvre. Je souhaite d'ailleurs qu'à l'occasion des prochaines échéances électorales nous, écologistes, soyons dépassés par la compétition des uns et des autres. J'aimerais une surenchère mais par conviction, pas par stratégie. On nous dit souvent que la France ne peut pas tout. Mais, à un moment où l'Europe se cherche, il me semble que les questions environnementales peuvent être un dénominateur commun de la jeunesse et même de l'ensemble de la population européenne. Pour ma part, je rêve que la France joue un rôle déterminant. Ce sera possible si elle est un minimum exemplaire. Hélas, c'est loin d'être le cas. S'agissant des moyens je crois qu'il faut se demander au préalable avec quel type d'architecture gouvernementale on fait du développement durable. Alors qu'on a eu pendant longtemps un ministère de l'environnement essentiellement technique, depuis quelques années - j'y ai été pour quelque chose -, on lui a ajouté la dimension du développement durable mais tout en réduisant son périmètre et ses moyens. Imaginer que le dernier wagon du cortège gouvernemental puisse impulser et coordonner une mission transversale alors qu'on sait qu'il est toujours le dernier servi dans les arbitrages gouvernementaux et que les Transports, l'Équipement, l'Agriculture peuvent annihiler toutes ses velléités, relève de l'imposture. Une première chose à faire serait donc de donner à ceux qui ont en charge cette coordination les moyens de leur mission car dans les conditions actuelles, on peut nommer n'importe qui à la tête du ministère : quels que soient sa conviction, son courage et ses connaissances, sa mission sera impossible. On observe d'ailleurs que les locataires sortent en charpie au bout de quelques mois, après avoir été malmenés par leur propre camp politique et absents sur les enjeux politiques. Il faut, là aussi, sortir de l'incohérence : soit on décide de mener une politique de développement durable et on s'en donne les moyens, soit on renonce à utiliser ce vocabulaire. Pour ma part, c'est en particulier sur cette question que je jugerais la sincérité et la volonté des uns et des autres. Mme Martine BILLARD : La Verte que je suis prend plaisir à entendre de telles interventions ! On fait toujours porter la responsabilité sur l'opinion publique, mais je me demande si elle n'est pas finalement plus avancée que le pouvoir politique et en particulier que le parlement. Car j'ai l'impression qu'émerge dans la société une volonté de prendre les choses en main mais que nous avons du mal à suivre. Je crois par ailleurs que vous avez raison : il faut sortir d'une attitude strictement moralisatrice et parler plutôt d'un défi à relever. J'espère que, comme vous nous y avez appelés, à l'issue de cette mission nous nous retrouverons, indépendamment de notre couleur politique, au moins sur le constat. Je crois comme vous qu'il faut poser la question de l'architecture gouvernementale, mais si un ministère alibi est inutile, on sait aussi que, s'il n'y a plus de ministère, il ne se passera rien. Comment voyez-vous des choses ? Vous avez beaucoup parlé, par ailleurs d'incitation, de normes, de recherche, mais ne pensez-vous pas qu'il faut aussi parfois passer par l'interdiction, y compris par la voie législative, en particulier pour éviter que les politiques locales ne viennent contredire l'impulsion donnée au niveau national ? M. Nicolas HULOT : En ce qui me concerne, je ne délègue aucune responsabilité aux citoyens et j'ai bien conscience que si la volonté individuelle ne rencontre pas l'organisation collective, on n'y arrivera pas. Je l'ai dit, les gens sont prêts à aller plus loin pour peu que la société leur offre de vrais choix, qu'elle ne les mettent par dans des impasses environnementales. Si on ne trouve pas de substitut au pétrole, il va bien falloir leur offrir une alternative car on ne peut pas se contenter de leur demander ne plus utiliser leur voiture. S'agissant des parlementaires, il me semble que c'est jusqu'à présent à l'Assemblée qu'on a rencontré le plus de résistance vis-à-vis des enjeux et des initiatives, probablement parce que votre position est délicate, parce que vous êtes parfois à la croisée d'intérêts contradictoires. On a bien vu l'énergie qu'il a fallu déployer pour la charte de l'environnement, pourtant plus symbolique que contraignante, dont on a entendu dire ici qu'elle allait paralyser la recherche et favoriser l'obscurantisme. On a vu aussi à quelles difficultés a été confronté Serge Lepeltier quand il a voulu instituer un bonus-malus sur les 4x4, même si stigmatiser une catégorie de la société ne me paraissait pas une bonne idée, la fiscalité écologique devant porter sur l'ensemble des biens de consommation. On constate aussi que certains députés se mobilisent vigoureusement pour fragiliser le peu de textes fondamentaux qui figurent dans notre arsenal législatif, comme la loi « montagne » et la loi « littoral ». Il est quand même temps de comprendre que l'intérêt général doit primer sur la somme des intérêts particuliers. Nous avons besoin de vous pour que l'énergie des ONG serve à provoquer des avancées plutôt qu'à empêcher des reculs ! Quelles que soient nos différences idéologiques, ne pourrait-on au moins se mettre d'accord sur les enjeux ? Si l'exécutif et le législatif ne vont pas dans la même direction, on ne peut pas avancer. On me demande souvent pourquoi on n'est pas allé plus loin alors que le Président de la République lui-même s'est engagé. Mais il faut reconnaître que son propre camp n'a pas fait preuve de la même maturité sur ces sujets, que l'opposition a cherché avant tout à s'opposer et que, au bout de quelques années, on n'a finalement pas fait grand-chose. Peut-être, après tout, ce temps était-il nécessaire pour que nous partagions la même conviction, mais il faut maintenant passer aux actes, tous ensemble, pour ne pas léguer un monde impossible à nos enfants. Les tensions sont déjà vives pour des problèmes idéologiques ou religieux, on imagine ce qu'elles seront sur des enjeux aussi importants que les ressources halieutiques, l'accès à l'eau potable ou la réémergence de foyers épidémiques. Pour l'organisation ministérielle, je dirai, même si la disparition du ministère me paraîtrait un mauvais signal, « tout sauf ce qui existe ». Il me semble qu'il ne serait pas aberrant qu'un vice-premier ministre soit chargé de ces enjeux et qu'on fusionne économie et écologie. Il conviendrait qu'au moins un ministre d'État ait la capacité d'impulser et de coordonner. On pourrait aussi séparer l'écologie du développement durable, qui relève quand même d'un autre ordre de grandeur. M. Alain GEST : Vous avez sans doute raison d'insister sur la nécessité d'un consensus, même si vous nous faites trop d'honneur en pensant que, dans cette société médiatique, nous avons un pouvoir supérieur au vôtre. Quand on parle fiscalité écologique, on pense davantage à des pénalités qu'à des incitations par la voie de déductions fiscales, qui répondent pourtant mieux à votre volonté d'aller vers un monde de modération et non de privation. Car si la fiscalité doit consister à acheter des droits à polluer, je suis pour ma part extrêmement réservé. Pouvez-vous nous dire, sans que nous entrions dans un débat technique, quelle forme pourrait prendre la fiscalité écologique pour éviter de trop charger la barque ? M. Nicolas HULOT : A pression fiscale égale, on peut au moins cesser de taxer en permanence le travail et taxer davantage l'énergie. Je crois qu'il faut en fait combiner incitation et dissuasion. Sans doute ne sera-t-il pas facile de bâtir l'indice écologique qui le permettra, mais il faudrait que sur chaque service et sur chaque bien de consommation, depuis la cerise jusqu'au véhicule et au billet de train, on tienne compte de la réalité du coût énergétique et environnemental. C'est ainsi que la fiscalité pourra inciter à la vertu et guider nos choix. Je voulais aussi dire un mot d'une autre piste importante, dont on parle trop peu, qui est celle de l'écologie industrielle. Son objectif est de permettre de passer d'une économie linéaire à une économie circulaire. Aujourd'hui, dans notre société de consommation effrénée, la majeure partie de ce que nous produisons est destinée à une utilisation unique pour une durée inférieure à 24 heures. Or, en particulier grâce aux emplois de service et de maintenance, on peut briser cette logique qui veut qu'on produise et que dès qu'un produit est en panne on en change. Mme Martine LIGNIÈRES-CASSOU : Il semble que la faiblesse de la prise de conscience soit une spécificité française. Pouvez-vous l'expliquer ? Par ailleurs, alors que le diagnostic écologique et climatique était posé dès 1972, quels ont été les freins qui ont empêché d'avancer davantage en trente ans ? Enfin, partagez-vous le sentiment qu'on va progresser à court terme en matière d'efficacité et d'économie énergétiques mais qu'il y aura ensuite blocage au moment où on arrivera au cœur des comportements individuels - je pense en particulier à ce qu'engendre la maison individuelle en termes de déplacement, de consommation d'espace, d'énergie - ou au cœur des comportements économiques ? M. Nicolas HULOT : Je partage votre inquiétude car les phénomènes que vous décrivez ne vont cesser de s'amplifier et car je crains que les pics démographique, de pollution, de consommation et d'érosion de la biodiversité ne se rejoignent. Il y a vingt ans, les inquiétudes diffuses des écologistes n'étaient pas encore des certitudes scientifiques. La communauté scientifique a sans doute une part de responsabilité car elle a tardé à valider le faisceau de présomptions important dont elle disposait sur la part entropique de l'effet de serre. Et ce doute a laissé perdurer tous les excès. Les verrous qui empêchent notre société de passer à l'acte sont culturels, ils tiennent à la confiance qu'on met dans les sciences, dans les techniques et dans les institutions. On peut aussi comprendre que cette grande tragédie sociale qu'est le chômage ait jusqu'ici préempté toutes les énergies et que le sentiment d'insécurité qu'il engendre empêche de prendre en compte une menace tellement énorme qu'elle paraît lointaine. En outre, si on cherche les racines du mal, c'est-à-dire si on touche aux fondements de notre société de consommation et de production, on est impressionné par l'ampleur de la tâche et on se demande par quel bout prendre le développement durable. Sans doute y a-t-il une maturité supérieure dans les pays scandinaves, qui tient sans doute à leur proximité avec la nature. Mais ce qui importe aujourd'hui chez nous, à la veille d'échéances importantes, c'est de savoir si cette préoccupation va devenir centrale. Je n'en ai pas le sentiment. Je comprends aussi que, localement, il soit difficile de résister à des intérêts particuliers. Mais il en va de la vitalité de notre démocratie. Le pouvoir est-il aujourd'hui aux mains des élus, au service de l'intérêt général, ou bien des lobbys pétrolier, automobile, céréalier ? Si les mutations considérables qui sont devant nous vont pouvoir s'opérer progressivement, il faut toutefois commencer par fixer des objectifs radicaux. Ce n'est pas encore le cas. M. Robert LECOU : Vous espérez que le temps du scepticisme est passé. Je pense pourtant qu'il y a encore beaucoup à faire pour aller jusqu'au choix de vie des individus, on le voit avec la maison individuelle ou avec l'usage unique. Vous appelez à un consensus politique. Mais chez nous, les scientifiques, les observateurs avertis sont entrés dans le jeu politique et cela amène à se demander si les formations politiques traditionnelles sont aptes à relever ces défis. Je suis convaincu que si la classe politique se met aux côtés des ONG et des hommes de communication comme vous, la prise de conscience sera meilleure. Vous considérez que la France et l'Europe peuvent être exemplaires, mais on nous a aussi dit que les États-Unis étaient un pays sous-développé en matière environnementale. Comment analysez-vous la situation ? M. Nicolas HULOT : Le fait que le constat sur la menace soit aujourd'hui davantage partagé m'incite à un relatif optimisme. Il faut toutefois prendre garde à ne pas se donner bonne conscience en se contentant de cela et passer à la phase suivante en trouvant des solutions. Elles sont complexes, car elles passent à la fois par la technique et par des révisions comportementales. Mais déjà si vous vous mettez d'accord sur la nécessité d'opérer des mutations, si vos voix ne sont pas discordantes, vous jouerez un rôle important. Que chaque camp fasse ensuite ses propres propositions, qu'il y ait un vrai débat, je n'attends que cela, car tout ne viendra pas des ONG et de la communauté scientifique. Et, s'agissant de problèmes de société, je suis étonné par la démission de notre élite intellectuelle sur une question aussi importante que la finalité du progrès. S'agissant des États-Unis, le gouvernement Bush n'est pas représentatif de l'ensemble de l'opinion américaine, d'autant que la pollution et les changements climatiques ne sont pas une infraction pour ce pays. Certains États ont pris l'initiative, unilatéralement, de se conformer aux objectifs de Kyoto. Les Américains ont aussi une stratégie économique, qui consiste à faire émerger des techniques pour occuper ces nouveaux marchés. Considérer, par antiaméricanisme primaire, qu'ils ont uniquement une position idiote serait bien réducteur. Mais l'important est que l'Europe se positionne différemment sur la question du développement durable, qu'elle soit elle-même exemplaire avant de se tourner vers les pays émergents, qui ont d'ailleurs une vraie réflexion sur ces sujets - je pense en particulier à la Chine et à l'Inde. M. le Président : Nous avons choisi de nous rendre en Inde, pays émergent à forte population. Pour que ces questions deviennent centrales, il me semble qu'il faudrait que nous arrivions à établir une échelle des risques, ce qui éviterait aussi que les médias ne s'emballent sur des risques finalement moins importants. On parle par exemple parfois plus des OGM que du réchauffement climatique, alors que leur responsabilité dans la perte de la biodiversité est bien moins grande. Je ne veux pas dire qu'il faut renoncer à traiter de tels sujets, mais que s'en préoccuper au même titre que du réchauffement climatique entraîne un brouillage dans l'opinion. M. Nicolas HULOT : Le risque climatique est transversal, il influe sur tous les autres, il me semble même échapper à la dimension humaine et il doit donc être placé tout en haut de l'échelle. Mais les OGM, les pollutions chimiques, les relations entre santé et environnement ne doivent pas être négligés pour autant. M. Jacques BASCOU : Il est évident que le consensus a un effet sur l'opinion publique, mais les enjeux ne se situent-ils pas ailleurs, au niveau international. Aussi, dans la mesure où la réflexion des politiques est pratiquement nulle, les ONG peuvent-elles faire avancer le débat ? La nécessité de remettre en cause le progrès tel qu'il est conçu depuis des décennies est-elle partagée par tous ? Les groupes industriels mènent-il une réflexion à ce propos ? Peut-on contrecarrer l'action des grands groupes de pression internationaux ? Peut-on aller à l'encontre de la prépondérance de l'économie et de l'idée américaine que la technologie permet de répondre à tout ? M. Nicolas HULOT : Si la France ne peut pas tout, elle peut beaucoup, et son influence peut être fondamentale. Le fait que le Président de la République se soit exprimé à un certain nombre de tribunes sur ces enjeux a eu un effet pédagogique et diplomatique qui nous a beaucoup aidés. Si la France devenait un laboratoire et organisait la vertu, cela aurait selon moi un impact considérable. Mais il y a vraiment du pain sur la planche car pour l'instant les bons signaux viennent bien davantage de Bruxelles que de Paris et nous sommes souvent les derniers de la classe européenne pour la transposition des directives. Du temps de la commissaire européenne à l'Environnement, Margot Wallstroem, il y avait une vraie dynamique, que je ne retrouve pas depuis quelque temps, comme si le référendum avait cassé quelque chose. Bien sûr, les ONG peuvent jouer un rôle et j'ai demandé à rencontrer José Manuel Durão Barroso, pour essayer de faire en sorte que l'Europe affirme clairement les enjeux et les objectifs. Je crois qu'il ne faut pas chercher systématiquement à se positionner par rapport aux États-Unis, où les choses et les mentalités peuvent changer assez vite, y compris au sein du gouvernement Bush. Dans un certain nombre de domaines, comme les transports ou l'énergie, soyons conscients qu'il n'y aura pas de remède miracle et que tout passera par la variété des solutions. Le minimum serait d'aller vers un bouquet énergétique car il n'est pas sain d'avoir mis tous nos œufs le dans le même panier, on le voit avec le nucléaire. Il faut donc favoriser l'émergence de techniques diverses. M. Philippe TOURTELIER : Je pense aussi qu'il serait extrêmement important, en termes d'affichage, de créer ce poste de vice-premier ministre dont vous avez parlé, d'autant que cela permettrait aussi de ne pas affaiblir le concept de développement durable, souvent dévalorisé et ramené à la question environnementale. Dans notre système, c'est en fait le premier ministre qui est responsable du développement durable ; charger un vice-premier ministre du changement climatique permettrait d'avoir une autre échelle de temps et donc d'être plus efficace. Une telle organisation favoriserait aussi la distinction entre développement et croissance, afin d'en particulier de remettre en cause le concept de produit intérieur brut. Si la loi sur les responsabilités locales était soumise aujourd'hui à notre mission, je suis persuadé qu'on aurait aucun mal à y faire inclure un chapitre sur l'énergie, ce que je me suis efforcé en vain d'obtenir lors du débat, il y a moins de trois ans. Cela signifie tout simplement que nous n'avons pas été alors capables de convaincre nos collègues, au sein de nos groupes respectifs, de la nécessité de cela. Or, si nous parvenons à un consensus sur le diagnostic mais pas sur les actions minimales, nous allons complètement nous déconsidérer. M. Nicolas HULOT : Je rencontre beaucoup de monde dans le cadre du défi pour la Terre et je mesure l'attente de nos concitoyens, dans toutes les catégories sociales, sur ces enjeux. Ils attendent des réponses ou du moins qu'on donne un véritable écho à leurs préoccupations. Et je puis persuadé que le fait que les grandes formations politiques n'aient pas apporté de réponse à ce propos est une des explication de l'absentéisme. Si ce débat n'est pas au cœur des prochaines élections - et je serai moi-même attentif à ce qu'on ne fasse pas de l'écologie et du développement durable un argument politique parmi les autres - nous saurons dire les choses clairement. La création du poste de vice-premier ministre serait un signal considérable donné en France comme à l'extérieur. C'est indispensable quand on sait que Jean-Louis Borloo s'apprête à annoncer la construction de logements sociaux mais qu'il n'est pas prévu un seul critère environnemental et énergétique. C'est pourtant un secteur où il est possible de réaliser 60 % d'économies d'énergie. Mais il faudrait peut-être avoir une vision à un peu plus long terme. M. le Président : Je vous remercie. Vous nous avez convaincus, mais il est vrai que ceux qui sont ici suivent déjà ces questions depuis un certain temps. Pour ma part, j'ai été président d'un office HLM, je n'ai fait que de l'habitat bioclimatique et j'ai pu en mesurer les surcoûts. Notre Rapporteure me glisse qu'un amendement au projet Borloo sera déposé à ce propos, c'est très important car il faut commencer par l'habitat social, ne serait-ce que pour faire en sorte que l'augmentation des charges n'annihile par la modération du loyer. Nous sommes prêts à un consensus politique sur le diagnostic. Le problème, comme toujours en politique, c'est que du diagnostic il faut passer à l'action. M. Nicolas HULOT : Je pense que vous parviendrez à distinguer des autres les actions qui sont vraiment incontournables et qui peuvent être menées rapidement. M. le Président : Les auditions de ceux qui, comme Jean-Louis Étienne et comme vous, sont des catalyseurs et parviennent à accélérer les réactions, ont été très importantes car elles ont permis de mettre en perspective nos travaux plus thématiques. Merci encore. Table ronde sur l'action des entreprises Présidence de M. Jean-Yves LE DEAUT M. le Président : Je vous remercie d'être venus nombreux à cette table ronde dont l'objet est d'informer notre mission sur l'action des entreprises en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, sur leur point de vue sur le Plan Climat et sur le Plan national d'allocation de quotas, le PNAQ, ainsi que sur les moyens d'atteindre le « facteur 4 ». Il sera également utile d'entendre les entreprises présentes - qui sont des groupes internationaux - sur les perspectives de développement de la lutte contre le changement climatique au plan international, après la conférence de Montréal, en particulier sur le « post 2012 », sur les questions de compétitivité avec des concurrents qui n'appliquent pas les mêmes règles et sur la façon d'associer le plus efficacement possible les États-Unis et les grands pays émergents. Je rappelle que nous tiendrons le 31 janvier une table ronde spécifique sur les instruments économiques au cours de laquelle nous traiterons de la fiscalité mais aussi, d'une façon plus spécifique qu'aujourd'hui, des marchés de droits d'émission. Dans le même ordre d'idées, nous aurons le 21 février une table ronde sur la nouvelle économie liée au changement climatique, notamment en termes de chances pour l'emploi, la croissance et les marchés extérieurs. Ce sont d'ailleurs des sujets que nous avons abordés hier à Bruxelles, Nathalie Kosciusko-Morizet et moi-même, avec le commissaire européen Stavros Dimas. Je donne sans plus tarder la parole à Mme Tutenuit, pour un exposé introductif d'ensemble, sur les entreprises et la lutte contre le changement climatique. Mme Claire TUTENUIT : C'est en 1990 que l'effet de serre est apparu dans notre paysage industriel. Mais les obligations des entreprises sont récentes, la directive de l'Union européenne créant le marché des quotas ne datant que de 2005 et le protocole de Kyoto ne devant entrer effectivement en vigueur que le 1er janvier 2008. Au cours de sa première période, 2008-2012, les émissions ne devront pas augmenter par rapport à 1990. Le graphique qui présente les émissions, en France, de l'ensemble des secteurs d'activité, est très intéressant puisqu'il montre que l'industrie, qui était le premier contributeur en 1990, n'est plus que le deuxième aujourd'hui, derrière les transports, et qu'elle a fortement réduit ses émissions. Cela amène ses représentants à se demander s'il est normal que la politique actuelle porte principalement sur un secteur qui a déjà fait beaucoup d'efforts en réduisant de plus de 20 % - et même de 23 % ces dernières années - ses émissions de gaz à effet de serre. Cela tient sans doute au fait que les grands établissements émetteurs sont très connus de l'administration et du grand public, qui s'attache surtout aux chiffres les plus impressionnants, et qu'ils sont donc la première cible des critiques. Mais précisément, sous la menace d'une réglementation, de nombreuses entreprises ont conduit des actions volontaires et, dès 1992, a été créé Entreprises pour l'environnement, qui regroupe aujourd'hui 40 grandes entreprises et dont la commission « changements climatiques » mène une réflexion, à partir de l'échange de bonnes pratiques, sur les possibilités d'actions efficaces. Sa réalisation la plus récente a été la création de FONDDRI, la Fondation pour le Développement Durable et les Relations Internationales, qui mène un travail de recherche sur des modèles d'émission sectoriels et régionaux afin de prévoir à très long terme les moyens d'atteindre une division par quatre. Ses premières communications seront disponibles en mars prochain. La deuxième grande initiative volontaire a pris la forme de l'AERES, l'Association des Entreprises pour la Réduction de l'Effet de Serre, qui réunit 33 groupes industriels représentant 56 % des émissions de l'industrie française, production d'énergie incluse, mais 12 % seulement du total des émissions nationales. Ces entreprises ont pris, avant même d'être soumises à une quelconque obligation réglementaire, un ensemble d'engagements de réduction. La première période couvrait les années 2003-2004, soit avant la mise en œuvre de la directive européenne ; la deuxième vise les années 2005-2007, soit avant la mise en œuvre du protocole de Kyoto. Les résultats de la première période ont été publiés et je les tiens à votre disposition. Ils montrent que les industriels ont pris des mesures plus importantes que celles qui étaient nécessaires au respect de leurs engagements, en réduisant de 23 % leurs émissions, par rapport à la référence 1990 fixée par la directive européenne. Le premier gisement industriel d'économies d'émissions a ainsi été largement exploité depuis dix ans. Les résultats de la deuxième période seront publiés en temps utile. La deuxième catégorie de mesures volontaires concerne l'établissement de protocoles de mesure, de reporting et de vérification. Les entreprises ont en effet cherché de façon collégiale qu'elle était la meilleure façon de compter les émissions, en particulier afin de savoir exactement ce qu'elles devaient faire quand on fixait des objectifs de réduction. Le premier protocole REGES, Réduction des Émissions de Gaz à Effet de Serre, a été publié en 2001 pour les installations fixes. A la fin de l'année dernière nous en avons publié un deuxième, qui mesure les émissions liées aux transports pour les entreprises, qu'il s'agisse de l'acheminement des matières premières ou de la livraison de leurs produits. Le protocole relatif aux déchets sera publié cette année. Le système européen de quotas d'émissions négociables présente comme qualités de contribuer : à la prise en compte du problème du changement climatique, dans un système non pas de Gosplan mais de marché ; à la mise en œuvre de procédures et de méthodes ainsi qu'à l'inventaire des émissions ; à l'apprentissage du commerce des émissions. Mais il a aussi un certain nombre d'inconvénients : il ne s'agit pas d'un système mondial, ce qui peut entraîner des effets pervers sur les flux de production en Europe, certains secteurs étant tentés de produire en dehors de l'Union ; il peut conduire en fait à une augmentation des émissions par l'allocation gratuite de quotas aux nouveaux entrants ; par son manque de visibilité à long terme, il n'incite pas aux bonnes décisions d'investissement ; faute d'une harmonisation des plans nationaux d'allocation de quotas, il entraîne des disparités de traitement entre les industries des différents États membres ; il rassemble dans un même marché deux secteurs - énergie et industrie - dont les logiques et les conditions de concurrence sont différentes et pour lesquels les émissions de gaz à effet de serre n'ont pas les mêmes implications. On le voit, l'industrie est consciente du problème et assume ses responsabilités. Elle agit concrètement et volontairement pour réduire ses émissions, pour améliorer son efficacité énergétique, réduire ses coûts, faire progresser ses procédés et profiter de nouveaux marchés. Mais elle a besoin d'un cadre à long terme, en particulier d'une politique favorisant la recherche, le développement, l'innovation et l'investissement, d'une visibilité à long terme des politiques suivies et des mesures prises, d'une architecture mondiale du système de contrainte carbone. Il faut surtout être conscient que l'essentiel des efforts qui restent à faire concernent en fait le transport et les bâtiments résidentiels tertiaires, même s'il y a bien sûr des interactions, par exemple les effets pervers des délocalisations en termes de transport. C'est pourquoi l'industrie souhaite que les problèmes soient abordés de façon plus globale. Le bâtiment est dans une situation très difficile. De nombreuses entreprises sont présentes à divers titres, mais la complexité du marché comme de l'organisation du secteur devrait conduire à un effort particulier. C'est un chantier que nous avons ouvert cette année. M. le Président : Nous en venons au premier des trois thèmes de cette table ronde : la mise en œuvre du protocole de Kyoto du point de vue des entreprises, en particulier sous l'angle des règles européennes et de leur mise en œuvre en France, du Plan Climat et du PNAQ. Pour chacun des thèmes, la discussion commencera par un bref exposé du point de vue des entreprises. M. Bertrand COLLOMB : Les entreprises ont soutenu dès le départ la lutte contre l'effet de serre en engageant peu après Rio, et donc avant Kyoto, des actions de réduction de leurs émissions, estimant que c'était stratégiquement important, qu'il n'était pas idiot de faire des économies d'énergie et cherchant aussi à éviter, cela vient d'être dit, une intervention plus directe. Le tableau qui vous a été présenté montre les résultats obtenus grâce à ces efforts. Pour sa part, Lafarge a essayé, à travers toute une gamme d'actions, de consommer moins d'énergie dans ses usines, d'améliorer son efficacité énergétique, de diversifier ses énergies au profit de celles produisant moins de CO2, d'utiliser des déchets évitant de consommer les énergies fossiles, d'ajouter dans ses produits des composants ne consommant pas d'énergie. Le groupe a aussi pris l'engagement mondial unilatéral, avec le WWF, le World Wildlife Fund, de réduire de 20 % la consommation d'énergie entre 1990 et 2010, par tonne de ciment produite. Tout cela montre que nous avons pris le problème au sérieux. Nous avons vécu ensuite la mise en œuvre du système européen dont je ne pense pas qu'on puisse dire, même si ce n'est pas le Gosplan, qu'il s'agit d'un système de marché. En effet, on part d'une allocation administrative de quotas, avec ce qu'elle peut comporter de complexité, d'arbitraire et de contrainte, et ce n'est qu'ensuite que le marché sert à optimiser les efforts de réduction des uns et des autres. De fait, quelles qu'aient été la bonne foi et la compétence de ceux qui ont instauré les quotas, contrairement à ce qui avait été promis, ils n'ont pas tenu compte des actions précoces. On a aussi constaté que, dans deux pays différents, l'industrie cimentière était traitée de manière différente. Si les choses se sont assez bien passées, c'est donc surtout parce que les entreprises avaient engagé des actions à long terme et parce que nous étions dans un contexte de croissance faible. Dans ces conditions, le groupe Lafarge en Europe sera peut-être marginalement vendeur de quotas. Mais, alors que nous pensions que, compte tenu des efforts considérables des industriels, le prix du CO2 allait être assez bas, il atteint aujourd'hui 27 euros la tonne. Cela tient au prix de l'énergie et au différentiel entre les prix de l'électricité, du gaz et du charbon. Aussi sommes-nous assez inquiets pour la deuxième partie de Kyoto, en particulier dans la mesure où on atteint les limites des efforts faits jusqu'ici et où de nouvelles évolutions technologiques vont prendre plus de temps. Nous craignons donc de rencontrer un problème de compétitivité si la Commission serre la vis de nos industries. Déjà, les importateurs de ciment démarchent les ports et les collectivités locales en leur disant que les producteurs sont fichus et que les importations représentent l'avenir. La réussite de la deuxième période de Kyoto dépendra donc du niveau d'exigence, de la croissance, et du prix du CO2. Nous avons la volonté de continuer à progresser, mais le système européen paraît dangereux car il n'y a pas de limite à la pénalité encourue par une entreprise : si tout le monde veut des quotas, le prix de marché montera très haut. En outre la pénalité de 100 euros par tonne n'est pas libératoire, l'obligation d'acheter des quotas persistant l'année suivante. Enfin, il est vrai que de gros progrès peuvent être faits dans le bâtiment, mais c'est l'État qui a les cartes en main, puisque ce sont ses règlements qui fixent les performances énergétiques dans ce secteur. À lui d'exploiter ce gisement. M. Jean-Yves GILET : Les entreprises sont favorables à Kyoto, pas forcément à toutes les manières de l'appliquer. Pour notre part, nous avons intégré la lutte contre l'effet de serre dans la gouvernance interne d'Arcelor. Mais les pays ayant ratifié Kyoto ne représentent que 25 % des émissions mondiales et le système des quotas ne concerne que 25 % des émetteurs en France et 30 % en Europe. On parle donc de gouvernance mondiale alors qu'elle ne porte que sur 4 à 5 % du CO2 émis. Les efforts d'une entreprise comme la nôtre sont liés à sa compétitivité économique, notamment à sa consommation d'énergie. Il y a donc un intérêt bien compris à fixer un objectif mondial et un objectif d'entreprise. Pourquoi dès lors vouloir tout réglementer ? D'autant qu'on se situe en effet dans une logique qui s'assimile à celle du Gosplan, puisqu'on définit par décret la production maximale d'une entreprise dans les trois ans à venir. Les pénalités sont tout à fait rédhibitoires et, si acheter du CO2 est envisageable pour certaines industries, quand on sait qu'il faut deux tonnes de CO2 par tonne d'acier, on voit bien qu'augmenter de 54 euros le coût ajouté à la tonne alors qu'il est de 150 euros par tonne, priverait l'industrie de l'acier de sa compétitivité. Et, alors qu'on n'a pas encore mesuré les premiers effets de ces mesures, on parle déjà d'une deuxième tranche dont on ignore tout. Bien évidemment, ce que je dis ne remet nullement en cause la volonté des entreprises de s'engager résolument dans la lutte contre le changement climatique. Contrairement à ce qui était prévu dans la directive, ce système ne tient par ailleurs pas compte des efforts réalisés jusqu'en 2002-2003. Or les possibilités de gains supplémentaires sont logiquement moindres pour ceux qui ont mené des actions précoces, comme Arcelor avec ses hauts-fourneaux, que pour ceux qui n'ont encore rien fait. Le système est également trop fragmenté par usine, ce qui empêche d'optimiser globalement entre usines et pays. De même on ne prend pas en compte l'efficacité de la chaîne économique, comme quand, en réduisant l'épaisseur de la tôle, nous contribuons à diminuer le poids des véhicules. Le fait que toutes les industries ne sont pas concernées pose également problème. Ainsi l'électrométallurgie et la pétrochimie ne figurent pas dans le champ d'application, au risque d'une distorsion de concurrence entre les matériaux. Il est aussi vraiment dommage, alors qu'il s'agit d'un sujet mondial, qu'à force de tout réguler, installation par installation, on finisse par oublier l'importance d'une vision d'ensemble et à rendre ainsi impossible une optimisation interne à un groupe résolument européen. Globalement, le mécanisme mis en place pour favoriser des actions auxquelles nous sommes attachés présente donc de nombreux risques, en particulier s'il doit être prolongé dans des conditions encore inconnues Mme Claude NAHON : Il y a bien une différence entre l'énergie et les autres industries, mais aussi entre les traitements réservés par la France et par ses voisins au secteur électrique, ce qui peut poser problème. Il y a aujourd'hui quelque chose qui ressemble à un marché du CO2. La prise en compte des conséquences sur l'environnement de l'activité industrielle dans les coûts est aussi un succès. Et on constate que le prix du CO2 - 27 euros par tonne - se retrouve dans le prix de gros de l'électricité. C'est pour cela que la question qui a été posée l'été dernier d'une soupape de sécurité pour les prix mériterait vraiment être débattue. Mais ce coût ne se retrouve absolument pas dans les prix du marché de masse et il n'y a pas de système équivalent pour les autres énergies. Or si le dispositif vise effectivement à réduire les émissions de CO2, il faut qu'il influe sur les choix des utilisateurs. On retrouve là le problème de la concurrence entre l'Europe et les pays où ces coûts ne sont pas pris en compte. Le secteur de l'électricité présente un certain nombre de spécificités. Deuxième émetteur dans le cadre du PNAQ français, EDF est loin derrière ses concurrents européens. Notre situation est particulière car 95 % de notre électricité est aujourd'hui sans CO2. Une variation de 1 % de la production représente donc une variation de 20 % des émissions. L'électricité ne représente que 36 millions de tonnes d'émissions sur un PNAQ de 155 millions, alors qu'en Allemagne le total est de 500 millions, dont 250 millions pour la production d'électricité. On mesure l'importance du choix du nucléaire. Dans la mesure où notre production se fait essentiellement sans CO2, il conviendrait que la question des modalités de la réduction exigée soit abordée dans les discussions européennes. Mme Françoise GUICHARD : Mme Tutenuit a eu raison d'insister sur la nécessité d'une pression équivalente sur tous les secteurs car jusqu'ici seules l'industrie et l'énergie ont été soumises à des contraintes, alors qu'elles ont commencé à réduire leurs émissions dès 1990. Il conviendrait donc d'inciter les secteurs qui ne sont pas couverts par le PNAQ - administrations, collectivités locales, tertiaire, transports, autres industries - à réduire leurs émissions dès maintenant par des engagements volontaires, sur le modèle de ce qui est fait par l'AERES. Il faudrait aussi engager une réflexion pour donner, au-delà de 2012, de vraies contraintes chiffrées à ces secteurs. Il convient aussi d'agir sur la demande pour favoriser les réductions effectives des émissions. Comme l'affirme l'ADEME, la meilleure énergie est celle qui n'est pas consommée. Dans la mesure où les industriels doivent répondre à la demande des consommateurs, on ne peut pas, dans des marchés ouverts, contraindre indéfiniment l'offre. On doit aussi agir sur la demande : à la suite du choc pétrolier de 1972, des économies réelles ont été réalisées, les comportements des consommateurs ont changé, sans que cela n'affecte la croissance économique. Par ailleurs : permettre et faciliter le retour des crédits liés aux MDP et MOC aurait des effets positifs sur nos exportations de technologies et sur notre compétitivité. M. Jean-Michel GIRES : Total est à la fois un grand industriel et un grand acteur du secteur de l'énergie, notamment dans le domaine des hydrocarbures dont la consommation contribue beaucoup aux émissions de gaz à effet de serre. Dès 1995, Total a pris l'engagement public mondial de réduire en dix ans ses émissions de 30 % pour les activités d'exploration et de production, de 20 % pour le raffinage et de 45 % pour la chimie. Ces engagements ont été tenus. Il n'est pas facile de faire mesurer et vérifier les émissions dans un parc industriel aussi important le nôtre. Nous cherchons à améliorer nos performances grâce à l'efficacité énergétique, à laquelle nous pousse aussi l'augmentation du prix de l'énergie. Nous travaillons aussi sur d'autres gaz à effet de serre, en particulier les gaz nitrés, importants dans l'industrie des engrais, et les gaz fluorés, très présents dans la chimie. Nous déployons également nos efforts dans les pays en développement, où des mécanismes de développement propres, ou MDP, sont prévus par le protocole de Kyoto. Mais nous ne savons pas si tout ceci sera suffisant pour satisfaire aux exigences de la deuxième phase 2008-2012. Nous nous inquiétons, nous aussi, que le prix du CO2 ne soit pas plafonné : 100 € la tonne, c'est énorme pour une société comme la nôtre, qui émet 30 millions de tonnes en Europe. Nous espérons donc fortement qu'une partie de ces quotas sera allouée gratuitement car on voit bien les problèmes de compétitivité que pourraient entraîner de telles pénalités. Nous insistons donc pour qu'on ne fasse pas de l'industrie un bouc émissaire, faute de pouvoir intervenir sur les autres secteurs. M. le Président : Certains des propos qui viennent d'être tenus nous paraissent défensifs. Il est bien évident qu'il faudra intervenir dans tous les secteurs, mais l'importance de l'industrie ne saurait être niée quand on a à la fois comme objectifs de maintenir l'emploi et de lutter contre le réchauffement climatique, qui apparaît comme la plus grande menace de ce siècle. Un des problèmes tient au fait que les pays qui sont en concurrence avec nous ne font pas les efforts au même moment. Mais si l'Union européenne ne montre pas l'exemple, personne ne le fera, en particulier pas les pays en développement qui sont actuellement à des taux correspondants au facteur 4 que nous souhaiterions atteindre pour nous-mêmes en 2050. Vous venez de nous indiquer de vraies difficultés. Je pense en particulier qu'il faut tenir compte des efforts déjà accomplis dans le passé et distinguer industrie et énergie. Le tableau que nous a présenté Mme Tutenuit montre qu'en partant de 149 millions de tonnes de CO2 en 1990, l'industrie est arrivée à 125 aujourd'hui, hors déchets. Jusqu'où pensez-vous qu'il serait possible de descendre, en particulier avec une meilleure efficacité énergétique, sachant que le Commissaire européen nous a dit vouloir parvenir à 6 % de réduction supplémentaire dans la deuxième phase ? M. Bertrand COLLOMB : C'est sans doute parce que, notre temps de parole étant contraint, nous avons dû insister sur nos inquiétudes plutôt que sur tous nos motifs de fierté que vous avez eu l'impression que nous étions défensifs. La grande difficulté est que nous parlons en niveaux absolus. La première variable sera la croissance européenne entre 2008 et 2012 : les choses seront très différentes selon qu'elle atteindra 1 % ou 3,5 % par an. En cas de forte croissance, la seule façon de contrôler les émissions serait d'arrêter toute production au sein de l'Union et de tout faire venir d'ailleurs, ce que certains analystes financiers recommandent d'ailleurs. Je suis sûr que nous pouvons continuer à faire des progrès, sans doute moins rapides que de 1996 à 2001. Mais sans l'apport de nouvelles technologies pour le développement desquelles quinze ans sont nécessaires, je doute que nous puissions aller au-delà de 2 % par an. Ce qui était le plus important et le plus facile a déjà été fait et ce qui vient maintenant sera donc plus difficile, plus coûteux et plus long. À l'horizon 2050, il est clair que nous ne pourrons pas aller au-delà sans rupture technologique. Aussi, au lieu de se serrer la vis sur les objectifs de Kyoto, mieux vaudrait que l'Union européenne s'engage dans de grands programmes de recherche dans lesquels les entreprises sont prêtes à s'investir, mais qui demandent d'énormes efforts. M. Thierry CHAMBOLLE : On l'a dit, depuis plusieurs années, les entreprises ont joué un rôle dynamique et les grands industriels ont été parmi les premiers dans la société française à reconnaître le problème du changement climatique et la nécessité de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Depuis 2000, le MEDEF a pris une position très claire en disant non à une taxe purement française qui pénaliserait nos entreprises, mais oui au protocole de Kyoto, oui à des accords volontaires - c'est à partir de là que l'AERES a été créée -, oui aux mécanismes de marché. Il est vrai que nous pensions plus à la possibilité d'acheter et de vendre du CO2 qu'à un système de quotas imposé aux industriels par décret. Les engagements volontaires, s'ils n'ont pas suffi à éviter la fixation de quotas, ont eu une vertu pédagogique forte, amenant tous les industriels membres de l'AERES à une vraie comptabilité du carbone, ce qui a permis à l'administration de disposer de données fiables pour le premier PNAQ. La première phase s'est bien passée, d'abord parce que l'administration et les ministres nous ont relativement bien écoutés. Mais il y a une différence entre mettre en place un dispositif de marché et s'en servir pour obtenir un certain taux de réduction des émissions. Si au cours de cette première phase on n'a pas trop serré la vis aux industriels, d'autant que la France n'avait pas de cap à respecter, la deuxième phase est beaucoup plus inquiétante, puisque nous devons respecter le cadre du protocole de Kyoto et conserver le même volume d'émission en 2010 qu'en 1990. Cela va être difficile dans la mesure où, compte tenu de la difficulté à réduire les émissions de GES dans les transports et dans l'habitat, on va demander encore plus à l'ensemble industrie - énergie. Mais on va s'apercevoir alors que l'énergie ne peut pas faire plus, faute de pouvoir contrôler certains usages énergivores et, au bout du compte on va peut-être demander plutôt 20 que 10 % à la seule industrie. Or, dans la mesure où la plupart des secteurs industriels souhaitent connaître une croissance, où ils ne disposent pas de levier technologique puissant, le risque est grand que cette deuxième phase ne soit très difficile pour le gouvernement, qui n'a nulle envie d'aggraver le chômage, comme pour les industriels. Il est bien évident que si on lui impose trop de contraintes et si elle décline, l'industrie française atteindra les objectifs de Kyoto, mais au prix d'un accroissement du chômage. Il vaudrait bien mieux que la France introduise le plus de souplesse possible dans le dispositif, qu'elle pèse bien davantage sur l'habitat et sur les transports, industriels comme individuels, qu'elle soutienne les MDP, qui permettent d'introduire les pays en développement dans le système, qu'elle fasse fonctionner les projets domestiques associant des secteurs qui ne sont pas dans le mécanisme de marché, voire qu'elle renonce à sa position de principe initiale et qu'elle s'inspire des Pays-Bas, qui ont accepté d'acheter du CO2 au nom de l'État, afin de desserrer la contrainte pesant sur les industries. Nous devrions tous ensemble, en particulier industriels et parlementaires, faire pression sur la Commission afin que la pénalité devienne libératoire, que son montant soit abaissé, que d'autres gaz soient concernés par le mécanisme et que les différents plans soient harmonisés. M. Jean-Louis SCHILANSKY : Tous les groupes pétroliers sont engagés dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre, en France comme dans le monde. Nous sommes toutefois dans une situation un peu particulière dans la mesure où nous fabriquons des produits dont on nous demande d'améliorer les spécifications, par exemple d'enlever le soufre, parce que cela permettra à l'industrie automobile de produire des véhicules qui consommeront moins d'énergie et qui, finalement, émettront moins de CO2. Mais pour enlever le soufre il faut consommer de l'énergie : remplacer le fioul domestique par du gazole, qui ne contient pas de soufre, est souhaitable mais entraînera la production de CO2. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre et le législateur doit donc faire des choix. Mme Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET, Rapporteure : Lors des discussions que nous avons eues hier à Bruxelles, nous avons évoqué en particulier la question de la mise aux enchères d'une partie des quotas. Et nous avons senti que la Commission aurait été favorable à une harmonisation des plans d'allocations entre les pays mais sur des bases qui ne sont pas celles que souhaite l'industrie. Selon vous, vaut-il mieux aller vers une harmonisation qui interdirait des marges de manœuvre nationale ou s'en tenir à la solution actuelle, qui serait un moindre mal ? M. Thierry CHAMBOLLE : Ce sont deux sujets différents. Nous parlons d'une harmonisation entre les quotas attribués à l'industrie et à l'énergie dans les différents pays, en tenant compte en particulier des efforts déjà faits et des émissions spécifiques. Il est évident par ailleurs que tous les industriels préféreraient bénéficier de quotas gratuits. La mise aux enchères de 5 ou 10 % peut présenter des avantages, notamment celui de rapporter de l'argent, mais ce n'est pas un facteur d'harmonisation. Mme la Rapporteure : Je me suis mal expliquée. La Commission a des idées sur de bons systèmes d'allocations des quotas et sur la mise en œuvre de lignes plus directrices, ce qui est actuellement impossible dans la mesure où on n'a pas modifié le cadre juridique entre les deux périodes. On peut envisager ultérieurement des méthodes obligatoires d'allocation, avec une partie mise aux enchères, comme le souhaite, je crois, le Royaume-Uni. M. Bertrand COLLOMB : Cela semble montrer que la Commission est plus éloignée des réalités concrètes que les pays. Elle met en avant des mécanismes juridiques sectorisés sans se préoccuper réellement de la compétitivité industrielle. Tout ce qui renforcerait la rigidité du système à Bruxelles me paraîtrait donc présenter plus d'inconvénients que d'avantages. Mme Claude NAHON : Il est aussi important vis-à-vis de la Commission que les pays soient capables de fixer des cibles qui peuvent être atteintes. Il est également essentiel d'aller vers une véritable prise en compte des choix d'investissement qui permettront d'économiser du CO2 et qui nécessitent une visibilité à long terme que n'offre pas le système actuel. M. Jean-Yves GILET : La négociation pour la deuxième phase entre la Commission européenne, les États membres et les entreprises va être redoutable, mais je répète que nous ne parlons que de 30 % de l'ensemble des émissions en Europe. Il conviendrait donc surtout d'aller vers des programmes incitatifs sur les comportements des usagers dans les domaines de l'habitat et des transports. Comme l'a dit Bertrand Collomb, un des défauts du système est qu'on raisonne en valeur absolue et non pas en efficacité réelle. Certains pays ont attribué les quotas de la première tranche sur la base de l'efficacité énergétique : les entreprises qui ne se trouvaient pas très éloignées du benchmark se sont vu attribuer les quotas dont elles avaient besoin pour leur plan de production, tandis que les autres étaient incitées à faire des efforts par l'attribution de quotas moindres. Cette utilisation des allocations de quotas paraît plus intelligente car plus incitative. Par ailleurs, les entreprises ont fait énormément de progrès depuis 1990 - 18 % de réduction des émissions pour la sidérurgie - et on est allé aussi loin que la technologie le permettait. Nous travaillons aux futures ruptures technologiques, mais nous n'en verrons pas les effets avant dix ans au plus tôt. Pour sa part, Arcelor investit 15 millions dans un projet européen ambitieux ULCOS, Ultra Low CO2 Steelmaking, qui vise à réduire encore de 20 % ses émissions. M. le Président : Nous avons reçu avant vous les représentants du secteur du bâtiment, des transports, de l'agriculture et, à chaque fois, on nous a dit, à partir de graphiques similaires à celui que nous a présenté Mme Tutenuit : « Ce n'est pas nous, ce sont les autres ! ». J'attache donc plus d'importance à ce qui vient d'être dit sur la possibilité, en fonction de l'efficacité énergétique et des efforts qui ont déjà été accomplis, de trouver d'autres critères de répartition. Cela ne semble pas très simple et nous serions donc ravis que les organisations patronales nous fassent parvenir leurs critères, qui pourraient constituer un point de départ. M. Jean-Yves GILET : Telle était bien l'idée de l'AERES : un engagement volontaire des entreprises dont on a constaté ensuite qu'il répondait aux objectifs. M. le Président : S'agissant des équipements domestiques, dont il n'est pas anormal que je parle aux industriels puisque ce sont eux qui les fabriquent, on voit bien, par exemple avec les réfrigérateurs, que les normes donnent des résultats. Or, souvent pour des raisons financières, les adhérents de vos associations importent des produits fabriqués ailleurs, dont les performances sont bien moins bonnes. Enfin, je suis d'accord avec vous, Monsieur Gilet, pour dire que ce n'est pas tout de suite qu'on peut y arriver. Mais on travaille à de nouvelles techniques et à de nouveaux matériaux qui devraient permettre d'atteindre les réductions escomptées. Soutenir de tels efforts est le rôle des pouvoirs publics. Il est en particulier possible de faire beaucoup dans le domaine du bâtiment, moins dans la construction que dans la rénovation du parc. Je pense que nous ferons des propositions en ce sens. Mais l'industrie aussi a sa part, sans qu'elle soit la seule variable d'ajustement et même si nous avons tout à fait conscience de ce qu'elle a déjà fait. Ne vous repliez donc pas sur une attitude strictement défensive et dites-nous plutôt dans quels domaines vous pouvez encore progresser. M. Jean-Yves GILET : Celui que vous venez de citer : le bâtiment et plus particulièrement la rénovation. Les entreprises industrielles, en tant que fournisseurs de solutions et de matériaux contribuent à de telles améliorations. Un certain nombre des entreprises représentées aujourd'hui ici se sont d'ailleurs déjà réunies au sein d'une Fondation Bâtiment-Energie dont le but est précisément de trouver des solutions et des concepts alliant plusieurs matériaux et permettant d'aller dans ce sens. Les statistiques donnent un résultat, elles ne montrent pas la totalité de l'effort qui a été accompli, en particulier ce que fait l'industrie, en amont, pour que les autres secteurs améliorent leurs performances. M. Thierry CHAMBOLLE : Dans la période 2008-2012, les entreprises feront des progrès de 0,8% à 1,5 % dans leur efficacité énergétique et certaines activités pourront atteindre 1,5 %, mais cela se traduira aussi par une augmentation des émissions : si vous combinez croissance et progrès normal de l'efficacité énergétique, vous aurez donc plutôt une augmentation des émissions de gaz à effet de serre. On n'arrivera donc à des réductions que si on parvient vraiment à des ruptures technologiques, soit dans la conception des produits soit dans les processus de fabrication. Mais cela ne s'obtiendra pas par un coup de baguette magique, il faudra des efforts de recherche très importants. Le MEDEF se mobilise dans le tertiaire et dans l'habitat pour essayer de fédérer l'ensemble des acteurs en faveur de la recherche et de parvenir plus rapidement à des résultats, mais il ne semble pas possible d'aller encore plus vite. M. Serge POIGNANT : M. José Manuel Durão Barroso, que nous avons reçu cet après-midi même dans l'hémicycle, nous a parlé de l'énergie, mais aussi de l'emploi et de la compétitivité. Je crois donc que la Commission est capable de porter ce double regard que vous semblez appeler de vos vœux. J'aimerais par ailleurs que vous nous précisiez de quelle visibilité vous avez effectivement besoin, dans la mesure où vous avez souligné que les ruptures technologiques ne pourraient intervenir à court terme. M. Bertrand COLLOMB : Il me semble que nous sommes là davantage sur les autres thèmes prévus pour cette table ronde. M. le Président : En effet et je vous propose d'y venir sans plus tarder, en les abordant d'ailleurs conjointement. Nous avons tout d'abord choisi de vous demander : et maintenant comment aller plus loin ? Comment s'orienter vers le « facteur 4 » en France en 2050 ? Quels peuvent être les objectifs et les moyens intermédiaires à l'horizon 2020 / 2030 ? Dans le dernier thème, nous souhaitions vous demander comment, après la conférence de Montréal, envisager l'« après 2012 » ? Comment intégrer les États-Unis et les grands pays émergents si l'on veut stabiliser les concentrations et les températures à un niveau « supportable » à l'horizon 2050 et vers la fin du siècle ? Comment voyez-vous le décalage entre des pays ne répondant pas aux mêmes normes ? M. Bertrand COLLOMB : Face un problème global, la solution ne peut être que globale. Nous avons soutenu Kyoto quand on croyait que les États-Unis signeraient et parce que l'idée de montrer l'exemple n'était pas dénuée d'intérêt, pour peu qu'on puisse entraîner les autres. A contrario, si la signature du protocole entraîne des problèmes de compétitivité et d'emploi, elle joue alors comme un contre-exemple et c'est ce que je crains pour 2012 si la croissance économique européenne est bridée. Il paraît donc essentiel d'aller vers un système qui, même si la signature des 200 États membres des Nations Unies n'est pas nécessaire, inclurait au moins les États-Unis, la Chine et l'Inde. La condition est de parvenir à ce qu'il n'y ait pas contradiction entre croissance économique et réduction des émissions de CO2. En effet, jamais la Chine n'acceptera de réduire sa croissance pour réduire ses émissions. Mais cela ne conduit pas nécessairement à une impasse puisqu'on peut, par exemple, diviser par deux les émissions par tonne de ciment dans ce pays. Il faut donc dire aux Chinois et aux Américains que l'objectif n'est pas de limiter le CO2 en volume mais d'améliorer leur efficacité énergétique et leur efficacité en termes de CO2 ce qui, de facto, entraînera une limitation en valeur absolue. Prenons l'exemple d'un groupe comme Lafarge. Les contenus en CO2 des produits de nos 150 usines dans le monde sont différents car les structures sont différentes. On peut très bien imaginer un objectif global et un accord sectoriel mondial, avec un benchmark pour l'ensemble de l'industrie, car il ne sert à rien de demander les mêmes efforts de réduction aux cimenteries allemandes et chinoises. C'est cela qu'il faut absolument parvenir à lancer avant 2012 pour créer une dynamique. Par ailleurs, à l'évidence ni les Français ni les Européens ne vont pouvoir développer seuls des nouvelles technologies qui requièrent des investissements très importants. Et, comme on a besoin d'une visibilité de dix à quinze ans pour développer un programme de recherche - je répond ainsi à la question de M. Poignant -, il serait là aussi plus facile de fixer un objectif mondial qu'une succession d'objectifs nationaux élaborés tous les trois ans au terme de négociations de marchands de tapis avec l'administration locale. Si je ne suis pas certain qu'on puisse diviser par quatre les émissions de CO2, je suis persuadé qu'on peut développer la séquestration, dont on n'a pas parlé jusqu'ici, qui suppose également des investissements très importants, et dont le coût n'est sans doute pas prohibitif compte tenu de celui des techniques de réduction des émissions. Mme la Rapporteure : 25 dollars la tonne, soit presque l'équivalent du coût du CO2 émis. M. Bertrand COLLOMB : Le développement de cette technique permettrait sans doute d'en réduire le coût. S'agissant du facteur 4, peut-être peut-on y parvenir dans le bâtiment, car tel est l'écart entre le pire et le meilleur, mais pour l'industrie, si des gains importants peuvent être obtenus en Chine, je doute qu'en France on puisse aller au-delà de 1,2. Pour progresser, il faudrait se mobiliser non pas en faveur d'une réglementation tellement compliquée qu'elle ferait de la limitation de la production la seule solution en Europe, ce qui serait horrible, mais d'une dynamique mondiale de recherche et de développement, associant secteurs public et privé. M. le Président : Vous dites qu'il faut dix ou quinze ans, mais n'avez-vous pas commencé au lendemain de Kyoto ? Par ailleurs, vous étiez président du World Business Council for Sustainable Development, qui regroupe tous les industriels du monde oeuvrant en faveur du développement durable et dont je suppose qu'il a aussi déjà réfléchi à tout cela et proposé un certain nombre de solutions. M. Bertrand COLLOMB : Nous vous avons montré que l'industrie avait fait beaucoup depuis 10 ans. Les 160 membres que compte le WBCSD dans de nombreux pays ont tous mené des actions, y compris les groupes industriels américains, qui considèrent que l'attitude actuelle du gouvernement de leur pays n'est pas appelée à se perpétuer et que le maintien de leur compétitivité les pousse à réduire leurs émissions de CO2. Après les hésitations du début, la mise en œuvre concrète de Kyoto est récente. Et je crains qu'on ne se consacre plus à résoudre les problèmes liés en particulier aux mécanismes européens, qu'à tracer une nouvelle perspective pour les dix à quinze ans qui viennent. M. François GROSDIDIER : Je suis un peu dépité par le discours du tout ou rien. Je n'ignore pas que les contraintes supplémentaires pesant sur les entreprises entravent leur compétitivité. Pour autant, s'il avait fallu attendre les Américains pour fixer des normes, je crois qu'on pourrait attendre longtemps. Que je sache, dans le domaine social, on n'a jamais attendu que tous les pays respectent les mêmes contraintes pour commencer à poser nous-mêmes des règles. La situation n'est pas la même dans tous les secteurs économiques : si pour la production de biens d'équipement ou d'acier, on est dans un marché complètement mondialisé, dans l'utilisation des techniques du bâtiments et des travaux publics, la compétition est davantage régionale voire locale et les contraintes peuvent donc être posées avec plus de sévérité des lors qu'elles correspondent au marché effectif et non pas théorique. Je regrette donc que cette discussion ne nous permette pas d'avancer vers la détermination d'objectifs environnementaux compatibles avec la viabilité des entreprises. J'ajoute que les États-Unis n'ont pas signé le protocole de Kyoto, mais qu'un certain nombre d'États américains adoptent des mesures contraignantes. Mme Morgane CREACH : Il ne faut pas prendre prétexte de l'attitude des Américains pour ne rien faire, d'autant qu'ils ne vont pas tarder à arriver, au plus tard en 2009. Nous rencontrons actuellement un problème avec l'administration Bush, pas avec les États-Unis. D'ailleurs, neuf États du nord-est viennent de créer leur propre marché de quotas d'émissions et plus de 180 villes américaines, démocrates comme républicaines, ont adopté les objectifs de Kyoto. Par ailleurs, je rappelle que si l'Inde et la Chine émettent beaucoup de CO2, par habitant, un Indien émet 18 fois moins qu'un Américain. M. Bertrand COLLOMB : Je suis désolé si mes propos ont paru négatifs. Je suis persuadé que les Chinois, les Indiens et les Américains entreront dans le débat, mais pas qu'ils ratifieront le protocole de Kyoto. Hillary Clinton l'a d'ailleurs récemment confirmé clairement. Je ne crois donc pas qu'il faille s'accrocher à tout prix à ce système mais plutôt en rechercher un autre, accepté par tous et compatible avec la compétitivité. J'ai évoqué le bâtiment : rien n'empêche le gouvernement français de prendre les normes qu'il veut en matière d'isolation. De même, la Californie a adopté, seule, des normes automobiles différentes de celles des autres pays. Mais il y a aussi des domaines dans lesquelles les États ne peuvent pas décider seuls. Nous, industriels, fabriquons des produits qui voyagent. Aussi, si nous devons payer 30 euros la tonne de CO2 émise en Europe, nos produits viendront tout simplement d'ailleurs. Si je parle d'un accord global, ce n'est pas pour botter en touche mais pour délivrer un message d'optimisme, parce que je suis persuadé que c'est la solution. M. le Président : Pour éviter le dumping écologique, on peut envisager dans le futur dispositif un système de taxation spécifique à l'entrée lorsqu'il y a des différentiels de compétitivité. M. Thierry CHAMBOLLE : En dépit de ses faiblesses, je ne crache pas sur le protocole de Kyoto car il s'agit d'une des premières tentatives pour réguler un problème global par la gouvernance mondiale. On parle de « facteur 4 » en France mais de « facteur 2 » dans le monde : les scientifiques s'accordent sur l'idée que la nature peut recycler la moitié de ce que nous émettons. Pour parvenir à une gouvernance mondiale, il faudrait que les politiques du monde entier se pénètrent de l'idée qu'ils auront une responsabilité énorme s'ils ne conduisent pas les différents pays vers ce « facteur 2 ». Cela signifie que les émissions vont diminuer dans certains pays et augmenter dans d'autres, la France s'étant fixé généreusement à elle-même cet objectif de « facteur 4 ». Pour aller vers le « facteur 2 », on pourrait accepter que les moyens diffèrent selon les pays et cela peut amener à remettre en cause les règles de l'OMC, éventuellement, comme vous venez de le proposer, en taxant les produits en provenance d'un État qui n'aurait pas tenu son cap. Il y a en fait énormément de ressources technologiques : le nucléaire plus l'hydrogène plus la pile à combustible, cela peut représenter une réduction considérable dans une bonne trentaine d'années. Ces solutions demandent des investissements énormes, mais ce serait quand même plus simple que d'aller s'installer sur une autre planète habitable que l'on n'a pas encore découverte. Dans le secteur des transports, il y a des leviers extraordinaires, comme le passage partiel du transport individuel au transport collectif. On ne le fait pas plus dans l'industrie parce que les transports collectifs lourds sont débiles en France et vous savez très bien pourquoi. Mais cela peut très bien changer un jour. Il y a aussi des marges sur le transport des personnes, comme sur les véhicules, par exemple avec les biocarburants ou avec un plafonnement de la vitesse, qui, en réalité, ne toucherait par les industriels mais les individus. La partie n'est donc pas désespérée, mais elle relève des hommes politiques et des citoyens, qui devront accepter des contraintes, des changements de comportement pour sauver l'humanité. Les politiques sont plus à leur place en essayant ainsi de transformer les mentalités qu'en invoquant de prétendues résistances de l'industrie par crainte de réduire ses profits. Mme Claude NAHON : Les États-Unis sont restés à Montréal après la clôture de la conférence parce qu'ils cherchent comment entrer dans le dispositif. Je ne crois pas non plus qu'on fera signer le protocole de Kyoto au prochain président américain. Il ne faut donc pas attendre un hypothétique messie, mais rechercher une convergence entre les mécanismes dont les américains parlent (autour des meilleures techniques disponibles) et le MDP (mécanisme de développement propre) du protocole de Kyoto, en respectant leur façon de voir les choses. Il en va de même des relations avec les Chinois. N'excluons pas des mécanismes de développement propre les techniques qui permettent de réduire tout de suite les émissions de CO2. C'est le cas du nucléaire, puisque l'électricité française émet en moyenne entre 70 à 80 g de CO2, contre 440 pour le kWh allemand et près de 500 g pour le kWh moyen européen. C'est aussi un domaine où on aura besoin, comme ailleurs, d'une gouvernance mondiale dans laquelle la France a un rôle particulier à jouer car on va inévitablement assister à un renouveau du nucléaire. Les industriels y sont prêts, les politiques ne sauraient passer à côté. Ne pas savoir deux ans à l'avance quelles seront les règles du jeu économique ne permet pas de réaliser les investissements à long terme dont on a besoin. Ainsi, le renouvellement du parc de production électrique va atteindre 700 GW, ce qui est énorme. Or, si on laisse les choses se faire, on va assister à un développement du charbon et du gaz, alors qu'on aurait vraiment besoin d'une vision à long terme qui permette de réduire les émissions de CO2 du secteur. Et, dès lors que la production d'électricité à partir du charbon sera largement dominante dans le monde de demain, il est impératif de travailler à la séquestration du carbone, ce qui suppose aussi une vision à long terme. Même en termes de coût, ce n'est que quand on aura lancé une quinzaine d'expérimentations qu'on saura vraiment où l'on va. Les groupes industriels travaillent aussi à améliorer les synergies entre leurs activités. C'est pour cela que nous avons lancé, avec un certain nombre de groupes représentés ici et avec le MEDEF, un groupe d'action sur le CO2. Il faut aussi que l'Europe soit plus active dans la recherche et développement, pour les énergies renouvelables comme dans d'autres domaines, en particulier les énergies marines et le nucléaire. Mais tout ceci suppose aussi une visibilité à long terme. Mme Morgane CREACH : Le protocole de Kyoto n'est pas un instrument figé, il est amené à évoluer. Et ce n'est pas un messie que nous attendons, mais un président américain qui prenne en compte ce que veulent ses concitoyens. Les pays en développement sont déjà investis dans la Convention cadre sur le climat de 1992. Ils ont intérêt à faire de même avec le protocole de Kyoto, via le MDP et les transferts de technologie. S'agissant enfin de la séquestration, je rappelle que les énergies renouvelables existantes sont sous utilisées et que c'est sans doute dans ce domaine qu'il conviendrait d'investir en priorité. M. le Président : Il faut faire les deux. Vous avez raison de dire que certaines techniques sont sous-utilisées. Cela vaut en particulier pour le solaire thermique, faute d'une filière industrielle digne de ce nom. Ainsi, nous n'avons que 85 000 mètres carrés de capteurs contre 2 millions en Allemagne. Je m'étonne par ailleurs que Mme Nahon n'ait pas évoqué parmi les objectifs de la recherche le stockage d'électricité, qui ouvrirait des voies à d'autres énergies. Je me souviens que lorsque je préparais mon rapport sur les énergies renouvelables, vous m'avez emmené aux Glénans, où j'ai été frappé par la taille des bâtiments nécessaires pour remplacer les piles nécessaires au stockage de la maigre électricité dont l'archipel a besoin. Mme Claude NAHON : Il y a en effet de nombreux efforts de recherche à faire en la matière, en particulier pour obtenir des piles correctes. M. Luc de MARLIAVE : Le leadership européen sur le protocole de Kyoto a donné des résultats impressionnants, mais la poursuite d'un système avec l'Europe seule en tête ne paraît pas viable, en particulier pour la compétitivité de son industrie. Peut-être les États-Unis sont-ils prêts à s'associer à quelque chose de différent, mais je ne les vois pas s'intégrer dans le système actuel, or la Chine n'y entrera pas sans eux, et réciproquement. On pourrait même craindre que ces deux pays s'entendent sans nous. On peut imaginer un autre système, avec ces pays mais aussi avec des pays émergents comme l'Inde et le Brésil, dont le succès reposerait sur la réalité du transfert de technologies car, s'il y a beaucoup à faire en matière de recherche-développement, le potentiel des technologies existantes est très grand. Il faudrait aussi prévoir une certaine flexibilité, par exemple avec un prix du carbone permettant des échanges d'un système à l'autre. Ensuite, il conviendra de disposer d'un portefeuille de technologies de rupture, afin de pouvoir jouer sur plusieurs tableaux. Nous croyons ainsi beaucoup à la capture et au stockage géologique du CO2. Il paraît difficile d'extrapoler jusqu'en 2050, mais on peut envisager à l'horizon 2020 la poursuite de la maîtrise de nos opérations par le renforcement de l'efficacité énergétique, l'amélioration des procédés, la remise en cause de notre façon de travailler. On pourrait aussi aider nos clients à maîtriser leurs émissions, adapter nos produits. Notre groupe peut également contribuer à préparer les évolutions du système énergétique pour aller du pétrole vers le gaz naturel et les énergies renouvelables. Nous nous engageons aujourd'hui dans l'éolien, la biomasse, le solaire et le photovoltaïque. M. le Président : Je croyais que vous aviez abandonné votre filiale dans ce dernier domaine. M. Luc de MARLIAVE : Non, nous avons même réalisé des investissements assez importants. Au-delà, le développement de la technologie de capture et de stockage passera largement par la diminution des coûts et par l'acceptabilité. C'est donc à des fins de démonstration que nous nous sommes engagés dans le projet de Lacq. M. Thierry CHAMBOLLE : Quand on compare l'effort de recherche aux États-Unis, au Japon et en Europe, on s'aperçoit que l'écart de financement n'est pas très important et que la différence tient surtout à l'existence aux États-Unis d'une véritable coordination en matière de recherche. Je plaide donc pour une maîtrise d'œuvre européenne de l'ensemble de la recherche dans le domaine énergétique, actuellement particulièrement dispersée. Le système européen d'allocation des crédits est aussi assez déficient, l'éparpillement sur plusieurs projets conduisant parfois à attribuer à chacun moins que ce qu'a coûté la constitution du dossier. Pour renverser les choses, il faudrait que quelques grands sujets soient réellement pilotés par l'Europe. C'est le cas de la fusion mais pas encore de la séquestration. Il faudrait que l'Europe utilise directement ses crédits pour financer des programmes de recherche dans les domaines de l'hydrogène, de la séquestration, de la pile à combustible et qu'elle abandonne pour l'énergie le système actuel d'allocation pour abonder les programmes Eurêka dans le « cluster » énergie, qui présentent l'avantage d'être proposés par les industriels européens entre eux et donc d'être très « bottom up », et qui ont beaucoup de mal à se réaliser parce qu'il faut pour l'instant que tous les pays disposent simultanément des crédits nécessaires. Des progrès pourraient donc être réalisés en acceptant un leadership européen sur ces quelques grands sujets et en modifiant les règles d'allocation des crédits. M. Jean-Yves GILET : S'agissant des puits de carbone, nous sommes en train de planter beaucoup de forêts dans des zones arides du Brésil pour produire du charbon de bois avec lequel nous faisons de l'acier. Dans le cadre du MDP, cette technologie permet de créer de la richesse locale. Par ailleurs, la question mondiale peut être abordée aussi sous l'aspect sectoriel. Dans certains métiers, on commence à réfléchir à ce que pourrait être à terme, face aux changements climatiques et indépendamment de la perspective de vivre un jour dans une société d'hydrogène, une gouvernance mondiale dans le domaine de l'acier. Il y a déjà eu des initiatives en ce sens. Une table ronde a été récemment organisée par l'OCDE. C'est ce qu'il faut essayer de promouvoir même si les difficultés seront grandes : je rappelle que cela fait bientôt six ans que nous essayons de trouver une gouvernance mondiale pour la limitation des surcapacités dans le domaine de l'acier. M. le Président : Merci à tous d'avoir accepté de vous prêter aux questions des parlementaires. Sans doute nos travaux nous amèneront-ils à revoir un certain nombre d'entre vous. Table ronde « Instruments économiques » Présidence de M. Jean-Yves Le Jean-Yves LE DÉAUT, Président M. le Président : Je souhaite la bienvenue à tous les participants à cette table ronde, dont l'objet est de réfléchir à l'utilisation des instruments économiques pour contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, qu'il s'agisse de la fiscalité, du marché de droit d'émission ou, éventuellement, d'autres instruments comme les marchés publics. Où en sommes-nous et que conviendrait-il de réformer ? Certaines dispositions fiscales ont-elles un effet plutôt négatif ? Faut-il réformer la fiscalité de l'énergie et des transports ? Comment peut évoluer le système des marchés de quotas ? Doit-il inclure de nouveaux gaz, de nouvelles activités industrielles, de nouveaux acteurs tels que les collectivités, l'agriculture, les particuliers ? Ce sont autant de questions auxquelles nous vous demanderons de répondre après que M. Serge Lepeltier puis M. Guillaume Sainteny et M. Philippe Quirion auront pris la parole. M. Serge LEPELTIER : «Maîtriser les émissions de gaz à effet de serre : quels instruments économiques ? » : tel était le thème du rapport d'information que j'avais présenté à la délégation du Sénat pour la planification en mai 1999. Il était tombé dans un relatif oubli, dont les tempêtes de fin 1999 l'ont fait sortir. J'aurais tendance à dire que le meilleur outil de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre, c'est la hausse du prix du pétrole. Mais le rapport allait bien au-delà. Il présentait deux types d'instruments, les outils dits de flexibilité - l'écotaxe et ce que l'on appelait à l'époque les permis d'émission - et les normes contraignantes. L'analyse économique montre que le coût des premiers est inférieur de moitié à celui des secondes. Cela tient au choix de l'allocation des ressources, puisque, dans le premier cas, on réduit les émissions là où cela coûte le moins cher, alors que les normes contraignantes obligent à la réduction quel qu'en soit le coût. L'écotaxe consiste à taxer les émissions de gaz à effet de serre à la tonne de CO2 émis. Elle peut être appliquée dans un pays à condition que ce soit à des secteurs protégés de la concurrence internationale, sous peine de créer des difficultés majeures, et à des secteurs qui comptent un grand nombre d'entreprises. Elle vaut donc pour le bâtiment, les transports intérieurs et les matériaux non exportables - particulièrement les matériaux pondéreux. L'écotaxe a l'avantage d'être assez facile à appliquer, l'inconvénient est que l'on ne connaît pas le résultat obtenu en quantité. Elle est aussi assez risquée, je l'ai dit, dans un contexte de concurrence internationale exacerbée. Mais l'on doit garder à l'esprit la notion de « double dividende ». En effet, la combinaison d'une taxe sur les émissions de CO2 et d'allégements de charges sociales sur les salaires contribuerait à la création d'emplois en favorisant les secteurs très employeurs. Le calcul avait été fait à l'époque que le transfert de 1,5 milliard d'euros par une écotaxe permettrait de créer 10 000 emplois, chiffre qui reste toutefois à confirmer. Les quotas d'émission, puisqu'ils sont échangeables, concernent les secteurs caractérisés par la présence de grosses entreprises que l'on peut cibler et, en leur sein, les entreprises très exposées à la concurrence internationale et grosses consommatrices d'énergie. Le mécanisme a pour avantage qu'il permet le contrôle des quantités, l'inconvénient qu'il est d'application beaucoup plus facile pour de grosses unités industrielles que dans les secteurs diffus que sont par exemple le transport et l'agriculture. Le prix de la tonne de gaz à effet de serre a été fixé à quelque 7 euros quand le système a été adopté ; il est de 26 euros aujourd'hui. Certaines entreprises sont désormais valorisées en fonction du quota qu'elles détiennent, ce dont on se réjouira. Si les normes contraignantes sont économiquement plus coûteuses et d'une efficacité moindre que les outils de flexibilité, elles sont politiquement plus faciles à appliquer. Ainsi, lorsque les normes Euro 4, qui concernent principalement le secteur de l'automobile, sont entrées en vigueur, personne n'en a parlé. Elles entraînent pourtant un risque de distorsion de concurrence, aux frontières d'abord, et pour toutes les entreprises soumises à la concurrence. Je suis convaincu que la meilleure solution consisterait à utiliser un outil global, la modulation de la TVA en fonction de l'impact environnemental. Actuellement, en agriculture, les produits « biologiques » coûtent environ 15% plus cher que les autres. Le taux de TVA appliqué aux produits « biologiques » pourrait être inférieur à celui appliqué aux produits « non biologiques ». Lorsque j'étais ministre de l'écologie, tous mes homologues européens étaient favorables à cette solution ; je ne dis pas que tous les ministres de l'économie l'étaient. La réflexion doit se poursuivre car c'est l'outil à la fois le plus simple et le plus efficace. Enfin, il faut corriger les distorsions fiscales que notre système réglementaire laisse perdurer. Certes, des actualisations ont eu lieu, mais le charbon et le gaz sont toujours beaucoup moins taxés que d'autres énergies et l'énergie hydro-électrique demeure surtaxée. Ces dispositions sont aberrantes, comme était aberrante, à l'époque où la vignette existait encore, le fait que les automobiles anciennes en étaient exonérées alors qu'elles sont, de toutes, les plus polluantes. M. le Président : Je vous remercie de nous avoir rappelé ce que sont l'écotaxe d'une part, les normes contraignantes d'autre part, normes dont vous nous avez dit qu'elles sont plus coûteuses, ce qui reste à démontrer. M. Guillaume SAINTENY : L'intérêt de l'écofiscalité, d'utilisation récente, est réel. Jusqu'alors, les États ont fixé des règles, des interdictions et des normes et se sont attachés à les faire respecter, avec l'inconvénient qu'elles étaient mal adaptées aux sources de pollution diffuses. L'écofiscalité présente l'intérêt économique d'égaliser le coût privé d'une action et son coût social, coûts auparavant dissociés. Elle est plus utilisée dans les pays scandinaves et en Angleterre qu'en France. Elle améliore aussi l'efficacité économique, puisque l'on obtient un résultat analogue pour un coût moindre que celui produit par la norme réglementaire. Mais il existe deux types d'écofiscalité. L'écofiscalité à vocation financière vise à rapporter des ressources. L'écofiscalité à vocation incitative vise à modifier les comportements et les processus de production. La première doit avoir une assiette large et un taux très bas, la seconde une assiette étroite, un taux élevé, avec si possible un produit de substitution. Or, en France, les écotaxes ont généralement une vocation financière, si bien qu'elles sont le plus souvent calculées en fonction du revenu attendu. C'est que, historiquement, le but de l'impôt consistait à lever assez d'argent pour permettre à l'État d'assurer ses tâches régaliennes ; il n'était pas question d'interventionnisme. Mais même dans le second type d'écofiscalité, les choses ne sont pas si simples. Prenons l'exemple du gazole. Certains estiment que l'écart de taxation avec l'essence est anormal. S'il s'agit de l'effet sur la santé, le gazole est plus nocif que l'essence, puisqu'il émet des particules qui sont ensuite inhalées La sous taxation n'est donc pas justifiée au contraire. Mais si l'on traite des émissions de CO2, il faudrait le sous-taxer davantage encore. En matière de changement climatique, je voudrais dire que l'utilisation de la fiscalité est 1) possible, 2) rentable et 3) très insuffisante. 1) Elle est possible, bien que certains le récusent en invoquant la neutralité fiscale et le principe d'égalité devant l'impôt. Par exemple, la décision du 28 décembre 2000 du Conseil constitutionnel, dont on a retenu, à tort, que son invalidation de la TGAP, constitutionalise le principe de la fiscalité écologique. Je rappelle par ailleurs que le Protocole de Kyoto recommande la suppression des subventions aux activités ayant des effets dommageables pour le climat. Il en est de même des recommandations de l'OCDE. 2) Elle est rentable d'abord parce que le coût global du changement climatique est évalué à 74 000 milliards d'euros. Ensuite parce que le coût de l'achat de crédits carbone sur la période 2008-2010, si la France ne respecte pas ses engagements d'émission en 2010 pourrait être de l'ordre de 180 millions d'euros par an. Enfin parce que les Etats continuent à subventionner beaucoup plus les énergies conventionnelles (85% des 25 milliards d'euros de subventions à l'énergie dans les pays de l'UE) que les ENR ou que ne leur coûte l'application du protocole de Kyoto. De même, les dépenses fiscales favorables à l'effet de serre sont plus élevées que celles qui incitent à lutter contre lui. 3) Elle est très insuffisante, d'abord pour la raison que je viens dénoncer. La TIPP, parce qu'elle a une finalité budgétaire, n'est pas incitative, et comprend des exonérations peut justifiées. La vignette a été supprimée en 2000 alors qu'elle avait été réformée en 1999 pour tenir compte, précisément, de la lutte contre l'effet de serre. La TVA sur l'achat des véhicules a été réduite sans être compensée par l'augmentation de la fiscalité sur leur usage. Si l'on observe quelques exemples à l'étranger, on peut citer la Climate Change Levy appliquée en Grande-Bretagne, qui rapporte 1,2 milliard et dont le produit est largement reversé aux entreprises sous d'autres formes. Le niveau des émissions a baissé deux fois plus vite que prévu dans le pays. Elle aurait aussi eu pour conséquence la création de plus de 14 000 emplois dans le secteur des services. Mais la fiscalité peut aussi influer sur le changement climatique de façon directe. Par exemple, l'étalement urbain est un facteur indirect d'accroissement des émissions de gaz à effet de serre en ce qu'il multiplie les besoins de transport entre centres et périphéries. Or il est parfois favorisé par la fiscalité locale. Autant dire qu'une vision globale du problème est indispensable. M. le Président : Je vous remercie. M. Philippe QUIRION : Pour atteindre les objectifs du Protocole de Kyoto, un outil réglementaire est indispensable, en particulier dans le secteur du bâtiment, mais une fiscalité environnementale est aussi nécessaire. Elle doit d'abord tendre à la suppression des subventions à la pollution. Dans le transport aérien, on citera l'exonération de TVA pour le kérosène et les billets internationaux, la TVA fixée à 5,5 % pour les billets nationaux et les subventions aux compagnies et aux aéroports low-cost. Pour les véhicules particuliers, il s'agit du remboursement des frais réels en fonction de la puissance du véhicule dans le calcul de l'impôt sur le revenu. Pour le transport routier, sont en cause le remboursement partiel de la TIPP et le dégrèvement de la taxe professionnelle. S'agissant des déchets, il faut en finir avec une taxe d'enlèvement des ordures ménagères sans lien avec les quantités enlevées. Pour ce qui est des institutions financières internationales, l'action des banques multinationales et de la COFACE devrait être orientée vers les économies d'énergie et les énergies renouvelables, alors que ces institutions financent aujourd'hui surtout les énergies fossiles. Il faut enfin revoir les crédits de la recherche qui, dans ce domaine, sont presque tous orientés vers les énergies fossiles et l'énergie nucléaire. Mais l'on ne peut s'en tenir à cela. Une réforme fiscale écologique consiste aussi, pour améliorer le bien-être général, à taxer l'énergie. Si l'on se garde de l'illusion monétaire, on se rend compte qu'en euros constants l'énergie est de moins en moins chère, et si l'on met en relation le prix de l'énergie pour le résidentiel et le revenu brut par habitant, on constate que, pour le même prix, on pouvait acheter deux fois plus d'énergie en 2004 qu'en 1978. De même, pour le transport automobile, le coût du carburant était plus bas en 2005 qu'en 1973. La taxation de l'énergie ne s'oppose pas à la justice sociale. En effet, selon l'OCDE, les ménages pauvres sont davantage victimes des problèmes environnementaux et des catastrophes naturelles. De plus, les recettes des taxes peuvent servir à réduire d'autres impôts inégalitaires et, pour l'énergie distribuées en réseau, on peut concilier équité et économie d'énergie en supprimant la part fixe et en instituant un tarif progressif, méthode qui a fait la preuve de son efficacité en Italie pour la consommation d'électricité. Enfin, une politique efficace de réduction d'émissions de gaz à effet de serre pourrait être favorable à la création d'emplois si, pour réduire les émissions, on oriente la demande la plus forte vers les secteurs fortement employeurs. Il faut savoir que pour un million d'euros de demande finale adressé à la branche bâtiment, dix emplois sont créés, contre 0,5 seulement dans les produits pétroliers raffinés. Je conclus par un mot sur les normes imposées aux constructeurs de véhicules. L'État de Californie a institué une norme flexible, en fixant pour chaque constructeur un objectif valable pour la moyenne des véhicules qu'ils mettent sur le marché, assortis de quotas échangeables pour ceux qui font mieux. Ce mécanisme, qui permet une réduction assez significative des émissions, présenterait un avantage pour les constructeurs français puisqu'ils sont plutôt spécialisés sur des véhicules peu émetteurs. M. Serge LEPELTIER : Je tiens à préciser que je ne suis pas contre les normes contraignantes mais que je suis persuadé de l'utilité de les combiner avec d'autres outils moins coûteux. Mme Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET, Rapporteure : Nous éprouvons en effet le plus grand mal à créer un système mixte. Les entreprises demandent l'institution d'un plafond, une pénalité libératoire qui leur permettrait de bénéficier des avantages des deux dispositifs. Ne faudrait-il pas travailler à une meilleure articulation ? Mais il y a aussi des blocages culturels ou institutionnels, puisque certains pays ont créé, avec succès, une green tax commission, ce que nous ne sommes pas parvenus à faire. Quelles sont vos recommandations à ce sujet ? M. Serge LEPELTIER : Il est exact que l'on ne travaille pas suffisamment à la mixité des dispositifs. Cela dit, je me méfie beaucoup de l'idée du plafonnement. Lorsque le mécanisme a été institué, on ignorait quel prix on atteindrait puisque l'on créait un marché. Plafonner reviendrait à vider le dispositif de sa substance, puisque rien n'empêche d'envisager que le prix de la tonne de CO2 s'établisse un jour à 100 euros. La création de l'équivalent d'une green tax commission est indispensable. Au printemps 2005, alors ministre, j'ai cosigné avec l'actuel ministre de l'économie une lettre de mission commune à ce sujet. Même si elle n'est pas appliquée, elle demeure d'actualité. M. Henri LAMOTTE : La réunion inaugurale du groupe présidé par M. Jean-Pierre Landau devait se tenir dans trois jours mais elle a dû être reportée au 22 février. La réflexion va donc d'engager, avec un certain retard, c'est vrai, pour formuler des propositions de création d'outils fiscaux. Quatre parlementaires - Mme Keller et MM. Laffineur, Miquel et Saddier - participeront aux travaux, ainsi qu'un représentant de l'AMF. M. Serge LEPELTIER : Il est indispensable que de telles décisions soient prises en commun, et au niveau européen. Les parlementaires doivent absolument s'investir dans cette réflexion. M. le Président : A ce sujet, on peut se demander pourquoi nos collègues députés membres de ce groupe de travail n'ont pas demandé à participer aux travaux de notre mission. M. Serge POIGNANT : On semble subventionner les émissions de gaz à effet de serre plutôt qu'autre chose. Comment et à quel rythme peut-on espérer inverser cette tendance ? Ne pourrait-on s'inspirer, pour la consommation d'électricité, du dispositif non linéaire italien que M. Quirion a décrit comme vertueux ? M. Philippe QUIRION : Je n'en connais pas le détail. M. Serge LEPELTIER : La même interrogation vaut dans l'élaboration de loi sur l'eau : faut-il ou non autoriser un forfait de départ, quelle que soit la consommation ? Le sujet est d'une extrême importance pour les collectivités locales. M. Guillaume SAINTENY : S'il est si difficile de faire évoluer l'esprit de notre fiscalité, c'est parce qu'elle s'est structurée au fil des siècles dans le respect de la neutralité des finances publiques et de son but initial : rapporter de l'argent à l'Etat. S'agissant des niches fiscales, le Parlement, qui vote l'impôt, a un rôle déterminant à jouer, encore accru par la LOLF. Il peut contrôler les dépenses fiscales défavorables à l'environnement et critiquer le fait qu'elles soient plus élevées que les dépenses consacrées à la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre, voire réduire les premières. M. le Président : Il nous a été dit que si le système des quotas a bien fonctionné en Angleterre, c'est parce qu'il y avait d'importants gisements d'économies à réaliser lorsqu'il a été institué, mais qu'à présent il patine alors que les normes contraignantes continuent de donner de bons résultats. On a, par exemple, évoqué le remplacement du parc des réfrigérateurs. Qu'envisage-t-on à ce sujet en France ? Il apparaît que, dans le secteur automobile, le passage à des normes contraignantes ne se fait pas assez vite. Dans le bâtiment, on sait ce qu'il faut faire et les techniques existent. Le surcoût est réel, mais la création d'emplois est certaine. Envisage-t-on de fixer des normes contraignantes d'émissions, tant pour le logement neuf que pour les réhabilitations ? M. Philippe MEUNIER : On parle là de nuisances diffuses, dans les secteurs où on a le plus grand mal à agir. Des normes doivent être introduites, mais elles ne pourront l'être que progressivement. Pour le logement ancien, la rénovation se prête à la mise aux normes. Il faudra donc en édicter et prévoir un accompagnement fiscal incitant l'acquéreur à faire les travaux nécessaires. C'est dans l'intérêt général. Pour le logement neuf, il n'y a guère de problèmes, puisque nous suivons les directives européennes. M. Jean-Christophe BOCCON-GIBOD : C'est ainsi qu'une réglementation thermique plus stricte que la réglementation actuelle va entrer en vigueur. M. Christian de PERTHUIS : S'agissant particulièrement de la réglementation thermique, il faudrait coupler une norme et une incitation économique à aller au-delà de la norme. M. Philippe QUIRION : Nous devons réduire les émissions de gaz à effet de serre de 3% par an pour parvenir au « facteur 4 » en 2050 et si nous n'agissons pas dans le bâtiment, nous ne le ferons pas ailleurs, car c'est là que le potentiel de réduction à coûts faibles est le plus grand. On évalue à 20 millions le nombre de logements à rénover, soit 500 000 par an en quarante ans. C'est au moment des ventes que les travaux de rénovation se font le plus aisément, et il y a 650 000 ventes de logements par an. La réglementation doit donc imposer l'isolation des bâtiments existants à ce moment-là. Cette norme contraignante entraînant un coût immédiat et un gain de long terme, elle doit être assortie d'une incitation fiscale sous la forme de prêts bonifiés. La directive européenne relative à la performance énergétique rend bien la rénovation obligatoire, mais seulement pour les rénovations de plus de 1 000 mètres carrés. Certains diront qu'il n'est pas possible de réglementer. Non seulement c'est inexact, comme le montrent les effets des diverses réglementations relatives aux termites, à l'amiante ou au plomb, mais si l'on veut être sérieux on ne pourra pas faire autrement. Mme Martine BILLARD : Il faudra le faire parce que cela va dans le sens de l'intérêt général, mais l'Assemblée évolue manifestement moins vite que le CSTB ! Dans nos murs, le débat devient schizophrénique : si les spécialistes d'un sujet sont là pendant un débat, on ne les questionne pas ! Le temps n'est-il pas venu de conditionner le dépôt des textes de loi qui ont une conséquence sur l'environnement à l'avis du ministre de l'environnement ? A force de morceler, on n'a plus de vision d'ensemble des conséquences d'une décision ou d'une absence de décision. M. Christian DECOCQ : Chaque audition successive nous convainc un peu plus qu'il faut changer de braquet. Mais, alors que les normes et les incitations devraient viser à modifier les comportements, M. Sainteny a souligné que les dispositifs ont souvent un objectif fiscal. Ne faudrait-il pas sensibiliser davantage l'opinion publique aux objectifs visés et mieux signaler les résultats obtenus au regard des mesures prises ? Le moment n'est-il pas venu d'instituer au ministère de l'environnement des tableaux de bord permettant de suivre aisément l'évolution de la situation pour l'eau, l'air, l'effet de serre et de faire comprendre que des mesures un peu plus radicales devront être prises un jour ou l'autre ? M. Philippe TOURTELIER : Que pensez-vous de la proposition faite par Nicolas Hulot de nommer un vice-premier ministre chargé du développement durable ? M. Sébastien GODINOT : L'association « Les amis de la terre » travaille à responsabiliser les acteurs financiers. S'agissant du bâtiment, l'enjeu est de savoir comment obtenir le facteur 4 dans la rénovation. Selon l'ADEME, le coût pour les ménages s'établira entre 400 et 600 milliards. Or les banques gèrent 4 400 milliards, soit trois fois le PIB de la France. Autant dire que les moyens financiers existent. Ce n'est donc pas uniquement par la taxation qu'il faut intervenir, mais aussi en impliquant les établissements financiers. Cela se justifie d'autant plus qu'avec 26 000 agences bancaires et les 17 000 guichets de la Banque postale, la France est le pays le plus bancarisé au monde. Tous ces guichets peuvent sensibiliser, informer et faire des prêts aux ménages, prêts rentables au demeurant. Pourtant, les établissements financiers ne sont pas impliqués dans cette démarche. Chacun constatera qu'il est beaucoup plus facile d'obtenir un prêt à un taux attractif pour acheter un véhicule 4x4 que pour acheter un chauffe-eau solaire. Le secteur bancaire, actuellement conservateur et frileux, doit être poussé par le législateur et par le gouvernement à un partenariat avec l'ADEME, le CSTB et le ministère de l'environnement. M. Serge LEPELTIER : L'objectif de consommation de 50 kWh par mètre carré et par an de la consommation de chauffage fixé pour le bâtiment résidentiel et tertiaire est difficile à atteindre mais il peut l'être si l'on privilégie la haute qualité énergétique et non, seulement, la haute qualité environnementale. Il faut donc créer un mécanisme incitant à la réalisation de travaux d'économie d'énergie dans l'habitat ancien, sinon nous n'atteindrons pas le « facteur 4 ». C'est bien au moment des mutations qu'il faut agir, mais il ne sera pas facile de rendre ces travaux, très coûteux, obligatoires. Il y a là un enjeu de liberté, d'autant que, très souvent, les acquéreurs s'installent sans faire aucuns travaux. Mais l'habitat, c'est aussi le neuf. A cet égard, je déplore que les logements que vont construire les organismes HLM dans le cadre du plan de rénovation urbaine de Bourges ne puissent, faute de moyens, être conformes à la norme « haute qualité énergétique ». Comme on le sait, les loyers HLM sont plafonnés, ce qui empêche de répercuter le coût de la construction selon cette norme. C'est profondément regrettable, car il faudrait qu'au moins ce que nous construisons aujourd'hui soit aux normes. La question de l'avis que devrait donner, au plus haut niveau, le ministre chargé des questions environnementales et du changement climatique au sein du Gouvernement est cruciale, puisque tout ce que nous faisons contribue à accroître le changement climatique. La Charte de l'environnement est un début de réponse puisque, si elle est bien utilisée, elle emporte l'obligation de respecter certains objectifs. Quant à la prise de conscience de la population, elle se fait par l'application de normes, de contraintes et d'incitations, mais on ne peut lui demander d'adopter un comportement écologique et que cela lui coûte plus cher. Or, à ce jour, paradoxalement, les produits polluants sont moins taxés que les produits non polluants. Il faut, au moins, rétablir l'équilibre et, mieux encore, inverser la situation en modulant la TVA et en surtaxant les produits polluants. Il s'agit d'un problème général, qui doit être réglé au niveau européen, mais l'on voit aujourd'hui un seul pays en bloquer 24 autres précisément sur une question d'ordre fiscal. Je suis persuadé de l'utilité qu'auraient des tableaux de bord et j'aurai moi-même souhaité qu'il en soit réalisé au ministère. C'est un travail de longue haleine. Faisons-le. Je ne sais si un poste de vice premier ministre serait créé aisément, car cela supposerait de modifier la Constitution. Mais, si l'on considère que le développement durable et le changement climatique sont des problèmes d'intérêt général, la position du ministre de l'écologie doit effectivement être renforcée. Le ministre lui-même doit avoir une place hiérarchique déterminante au sein du Gouvernement - qu'il soit, par exemple, ministre d'Etat - et son périmètre d'action doit être élargi au secteur de l'énergie, comme c'est le cas en Allemagne. Je sais que cela pose la question du nucléaire - mais pourquoi pas ? Cela rendrait la politique énergétique de la France cohérente et si l'on ne procède pas ainsi, on n'y arrivera pas. Enfin, il ne faut pas commettre l'erreur de noyer le ministère de l'écologie dans un grand ministère. M. Henri LAMOTTE : Le mécanisme des permis négociables a une justification économique, tant parce qu'il est cohérent avec le Protocole de Kyoto qu'en raison de la nature du phénomène contre lequel on cherche à lutter, qui implique de privilégier la réduction de gaz à effet de serre là où le coût marginal est le moins élevé pour minimiser le coût global de la stratégie de lutte contre le changement climatique. Puisque l'approche retenue dans le Protocole de Kyoto est quantitative, la logique économique commande d'introduire la flexibilité par l'échange de quotas entre les États. L'institution de permis négociables ne signifie pas pour autant que le recours à la fiscalité n'est pas possible au niveau des États. Le dispositif fonctionne-t-il ? La réponse à cette interrogation doit être nuancée, mais elle est globalement affirmative puisqu'en 2005, 145 millions de tonnes de CO2 ont été échangées. Le marché des quotas fonctionne lui aussi, avec un prix de 26 euros à l'échéance de décembre 2006, 12 % des allocations initiales ayant été échangées en 2005. Le marché, en sa première année d'existence, est donc actif. Dans l'Union européenne des Vingt-cinq, il couvre 40 % des émissions de CO2, et 30 % pour la France. Comment améliorer le dispositif ? Je m'exprimerai, à ce sujet, à titre strictement personnel. Trois directions sont envisageables : élargir le marché, harmoniser les conditions d'allocation des permis, maîtriser les effets prix en combinant taxe et permis. Les projets domestiques permettraient l'élargissement du marché, et la centralisation de l'allocation initiale au niveau communautaire permettrait l'harmonisation des conditions d'allocation des permis; il resterait à harmoniser aussi les systèmes nationaux de taxation des combustibles fossiles. Mais faut-il plafonner le prix, comme les entreprises le demandent, alors que l'intérêt du mécanisme est précisément de le révéler ? Si l'on s'en tient à la logique économique pure, ce n'est pas souhaitable, mais si l'on souhaite tenir compte de l'acceptabilité du système à long terme et éviter une hausse et une volatilité excessives du prix du permis, le plafonnement est envisageable. Dans ce cas, la pénalité devra, pour être dissuasive, être supérieure au prix du permis et, si elle est libératoire, il faudra anticiper l'évolution des prix. M. Christian de PERTHUIS : Pour qui traite du système européen d'échange de quotas, trois questions essentielles se posent. La première a trait au régime qui sera appliqué aux nouvelles installations qui entreront dans le dispositif. Paradoxalement, conserver le régime de gratuité des allocations reviendrait en quelque sorte à subventionner les nouveaux entrants alors qu'ils produisent du CO2 parce qu'actuellement il est plus rentable d'investir dans du charbon que dans du gaz. La question se pose aussi de savoir comment élargir le « signal prix » adressé aux secteurs qui ne sont pas couverts par le système des quotas. En France, 27 % des installations seulement sont soumis au système des quotas, mais il n'est pas raisonnable de dire que l'on peut étendre très largement le dispositif aux petites installations, car c'est compliqué et très coûteux. Mieux vaut éviter de rendre le système plus complexe encore, et se limiter à élargir le dispositif aux installations qui émettent d'autres gaz que le CO2. Enfin, le Protocole de Kyoto a institué le couplage des permis d'émissions avec des mécanismes de projets fondés sur la capacité d'innovation des acteurs. Dans ce cadre, on améliorerait considérablement le fonctionnement du marché des quotas en élargissant la gamme des projets aux projets domestiques. Aujourd'hui, je peux acheter des quotas pour réduire les émissions de méthane au Chili, mais pas en Bretagne, où ce serait pourtant grandement nécessaire. Nous préconisons donc un système de crédits domestiques destinés à valoriser les réductions d'émissions faites en Europe, sur nos territoires. A la demande de M. Serge Lepeltier et de M. Thierry Breton, la mission Climat de la Caisse des dépôts a rédigé un rapport à ce sujet, remis aux pouvoirs publics en novembre 2005. Je suis convaincu que c'est une voie pertinente d'amélioration du marché, qui devrait permettre de réduire les émissions de CO2 de 10 à 15 millions de tonnes supplémentaires pendant la première période. M. le Président : Pour résumer, 27 % seulement des installations sont concernées par le marché des quotas en France, parce que l'on agit sur les grandes entreprises. M. Lamotte nous a dit que le marché fonctionne, les Anglais aussi, mais les entreprises qui sont sur ce marché considèrent que les quotas sont une fausse valeur car, après avoir monté pendant trois ans en Angleterre, leur prix s'est effondré. Bien sûr, certaines entreprises ont pu vendre au plus haut mais le risque de perte apparaît très élevé et il n'y aura jamais de vrai marché, expliquent-elles, si un objectif de cours n'est pas fixé à relativement long terme. Sur le marché français, Rhodia qui, à un moment, voulait attaquer l'institution même de l'échange de quotas, ne dit plus rien et pourrait même bénéficier du dispositif, ce qui montre son impact. Enfin, il se dit que des entreprises se seraient délocalisées vers des pays qui allouent des quotas assez largement, choisissant donc d'aller produire ailleurs en polluant davantage ; nous comptons d'ailleurs interroger RTE sur la fluctuation éventuelle de la consommation de ses gros clients. Tout cela est-il vrai ou faux ? Peut-on améliorer l'efficacité du système ? M. Philippe ROSIER : Rhodia a, dès l'origine, encouragé le système. L'entreprise a été l'un des rares chimistes français à le faire car le dispositif participe de sa politique stratégique de développement durable, qui se traduit aujourd'hui par des résultats salutaires. Le groupe a investi en Alsace avec l'objectif de réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 20 millions de tonnes, soit l'équivalent de la hausse des émissions dans le bâtiment en France entre 1990 et 2004. Nous avons voulu utiliser à cette fin tous les mécanismes de flexibilité et nous avons obtenu l'agrément du secrétariat de la Convention Climat pour nos projets de développement durable au Brésil mais aussi en Corée du Sud, où l'installation qui commencera de produire fin 2006 permettra une réduction des émissions de 15 millions de tonnes par an. S'agissant de la réduction des émissions de CO2, les décisions françaises ont été très cohérentes, qu'il s'agisse du « mix » énergétique ou de la constitution du consortium électrique qui permet de préserver la compétitivité de installations industrielles situées en France. Notre intérêt commun est de pousser tous les pions. Nous sommes donc très favorables à tous les projets, MDP ou MOC, autorisés par le Protocole de Kyoto, nous considérons que les projets domestiques doivent être lancés en priorité, et nous approuverions la mise au point de certificats blancs, qui permettraient la création d'un marché des émissions diffuses. M. Sylvain de FORGES : Pour Veolia, le sujet est d'ordre ontologique. Comme Rhodia, nous considérons que le système français est cohérent. Il faut le sauver et développer des projets domestiques pour faire passer le taux de couverture de 27 % à 35 %, voire 40 % des installations. Quoi qu'il en soit, le marché fonctionne, comme nous l'avons constaté nous-mêmes puisque nous avons mis au point un projet MOC avec la Lituanie. Certes, nous avons des préférences quant à l'organisation d'un futur marché des projets domestiques, mais elles importent peu. L'enjeu, c'est bien la réduction des émissions. Mais ce que nous demandons c'est, par pitié, que les systèmes nationaux soient harmonisés. Quand ils sont trop différents, ils contraignent à des échanges d'expérience difficiles. M. Jean-François CONIL-LACOSTE : Je me trouve dans la difficile position d'être juge et partie. Rarement un marché a aussi bien démarré que celui de l'échange des quotas d'émission, outil efficace qui peut très vite apporter à la collectivité, et beaucoup plus simple à mettre en œuvre qu'un système de taxation. On peut être surpris par la volatilité des prix, mais ce qui fait la qualité d'un marché, c'est sa liquidité. Pour l'améliorer, il faut donc élargir le socle de l'offre de quotas ; éviter la dispersion qu'entraînerait la multiplication des outils et, à cet égard, les certificats blancs présentent un risque d'atomisation ; élargir l'offre sectorielle à l'aéronautique ainsi que l'offre géographique puisque la Norvège et la Suisse se sont portées volontaires ; favoriser la fongibilité des projets domestiques. Ainsi renforcera-t-on la liquidité du marché, ce qui permettra l'établissement du plus juste prix possible. Par ailleurs, il faut impérativement éviter le piège du plafonnement qui fausserait le marché. Que le dialogue prévale, que le spectre du marché soit le plus large possible, mais ne laissons pas place à l'arbitraire. A quel niveau faudrait-il fixer une pénalité libératoire? Il est tout aussi dangereux d'imaginer pareille mesure que de décréter, par exemple, que la majorité sortante ne peut obtenir moins de 40% des votes. Le marché donnerait vite tort à un tel dispositif. Enfin, les acteurs français jouent un rôle éminent dans ce marché. Il y a là un gisement de compétences à faire fructifier. M. Jérôme MALKA : Je partage le point de vue exprimé par M. Conil-Lacoste. Notre domaine de compétence, c'est le fonctionnement du marché des quotas, qui doit rester liquide. Fin 2004, avant que la Fédération de Russie ne ratifie le protocole de Kyoto, quelques milliers de tonnes s'échangeaient chaque mois ; les échanges portent maintenant sur 3 à 4 millions de tonnes par jour. Cette considérable accélération des volumes traités est le signe de la vigueur et du bon fonctionnement du marché. M. le Président : Cela signifie donc qu'un milliard de tonnes ont été échangées en un an ? M. Jérôme MALKA : En 2005, année de montée en puissance du marché, les échanges ont porté sur 300 millions de tonnes. Pour améliorer le marché, il faut que les acteurs s'engagent. L'ensemble de nos clients européens prennent le sujet très au sérieux, d'autant que, comme l'a dit M. Rosier, il est parfois pour eux d'une importance stratégique. Le plafonnement de quotas libératoires serait immédiatement arbitré par le marché ; ce n'est pas une bonne idée. Enfin, nous sommes submergés par des strates de réglementations complexes, et nous avons besoin d'une visibilité à long terme. Or, pour l'instant, le monde s'arrête en 2012, ce qui rend le développement de projets assez difficile. M. le Président : Comment expliquez-vous l'effondrement continu du marché anglais où, après être monté à 12 livres, le prix est retombé à 2 livres ? M. Christian de PERTHUIS : Les deux dispositifs ne sont pas comparables car il existait en Angleterre un marché domestique antérieur. Le marché européen est fondé sur l'engagement de réduire les émissions de gaz pris dans le cadre du protocole de Kyoto et c'est de ce paramètre que dépend la valeur du CO2. Le comité des risques de la Caisse des dépôts, laquelle nous a permis d'investir 25 millions d'euros sur ce marché, car nous sommes convaincus que les États maintiendront la contrainte tendant à la réduction des émissions. Les informations les plus récentes montrant que les risques ont été surestimés plutôt que sous-estimés, le prix va monter, sauf si l'on pense que les États ne s'engageront pas au-delà de 2012. M. le Président : La contrainte actuelle est connue et se traduit pas les permis déjà alloués, mais les allocations nouvelles envisagées sont beaucoup plus faibles. Si cela signifie que, pour la première phase, on a alloué trop de permis par rapport à l'activité industrielle, au point que certaines entreprises se sont délocalisées - ce que nous vérifierons, je l'ai dit -, alors le prix s'effondrera. M. Henri LAMOTTE : Le système d'allocations gratuites a permis de ne pas toucher au coût moyen : seul le coût marginal joue. On ne peut donc pas faire davantage, sauf à décider que la tonne de CO2 est gratuite. M. le Président : Ce qui me gêne, c'est l'idée que le dispositif puisse avoir pour conséquence qu'une grande entreprise française acquiert des droits en achetant une usine pourrie en Ukraine et en y produisant. M. Christian de PERTHUIS : Si l'entreprise en question est un opérateur, elle peut monter un projet tendant à la réduction des émissions. Elle acquerra ainsi des crédits, ce qui est différent d'acquérir des droits. M. Henri LAMOTTE : L'objectif est bien de permettre l'émergence de projets ayant le plus faible coût possible. Mme la Rapporteure : Certes, le coût moyen n'est pas touché, mais une entreprise a envie de se développer. Or, elle ignore combien elle devra payer la tonne de développement. N'y a-t-il pas là une incitation à la délocalisation ? M. Sylvain de FORGES : Le Plan national affecte les quotas aux installations ; si elles sont fermées, il n'y a plus de quotas. Quant à l'entreprise française achetant une usine en Ukraine, elle devra prouver qu'elle fait mieux que les Ukrainiens. Essayons donc de réduire le coût marginal d'entrée dans le dispositif. Le problème est celui des ressources humaines, et on ne sait pas l'affronter. M. Serge LEPELTIER : La délocalisation est une question centrale. Ainsi, les cimentiers sont touchés de plein fouet. Mme la Rapporteure : Nous avons reçu leurs représentants, qui sont de grands partisans du plafonnement libératoire. M. Serge LEPELTIER : Le coût du transport ne pèse pas beaucoup dans les prix, ce pourquoi les cimentiers sont très inquiets. S'agissant de Rhodia, si l'objectif est effectivement de parvenir à réduire de 20 millions de tonnes les émissions de CO2 par le biais d'une seule usine alors que le plan Climat dans son ensemble tend à une réduction de 73 millions de tonnes, il est considérable. Je soulignerai pour finir qu'étant donné les relations entre collectivités concédantes et délégataires de services publics, le bénéficiaire à quinze ans de la vente des quotas sera l'exploitant et non la collectivité. Cela pose un problème juridique. M. Raymond LEBAN : Le plafonnement du prix des permis, qui prête à controverse, doit être envisagé de manière dynamique. Pour investir, tout industriel a besoin de prédictibilité. On pourrait donc imaginer un plafonnement croissant dans le temps, ce qui permettrait de fixer des objectifs en évitant les effets pervers. M. le Président : Messieurs, je vous remercie. Table ronde : Pays émergents et pays en voie de développement, réunissant : Présidence de M. Jean-Yves LE DÉAUT, Président M. le Président : Quel sera l'effet de la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre sur les pays qui n'ont pas accès au développement économique, et utilisent des ressources énergétiques très inférieures aux nôtres en quantité ? Et quel sera cet effet sur les pays émergents, qui ont des besoins de développement, et disposent parfois de ressources fossiles très importantes ? Tel est le double thème de cette table ronde, qui regroupe les pays en voie de développement et les pays émergents. Les problématiques, différentes dans l'un et l'autre cas, impliquent à la fois notre diplomatie, notre coopération, l'engagement des ONG et l'action des entreprises - notamment à travers les mécanismes de développement propre, ou MDP. J'ai vu en 1986, tout jeune député, les premières réactions des industriels au problème des chlorofluorocarbones et de la couche d'ozone, et leur changement d'attitude l'année suivante, au moment du protocole de Montréal, quand des substituts aux CFC ont été trouvés - mais qui étaient couverts, bien sûr, par des brevets. J'ai vu de même à Rio, en 1992, au Sommet de la Terre, l'attitude des pays en voie de développement sur l'accès à la chaîne du froid, leur refus d'acheter des technologies auxquelles ils pouvaient accéder par des procédés certes polluants et anciens, mais qu'ils maîtrisaient. Nous avons invité, pour parler de ces questions, Jean-Michel Severino, directeur général de l'Agence française de développement, Paul Watkinson, de la MIES, Franck Jésus, de la direction générale du Trésor et de la politique économique, Nathalie Chartier-Touzé et Nicolas Lambert, de la direction générale de la coopération internationale et du développement au ministère des affaires étrangères, Guy Reinaud, président de l'association Pro Natura, François Falloux, vice-président d'Eco Carbone et ancien de la Banque mondiale, Michel Colombier, directeur adjoint de l'Institut du développement durable et des relations internationales, Christophe Rynikiewicz, économiste à l'association Hélio International, qui travaille notamment sur l'évaluation des MDP, Antoine Decitre, directeur général de Velcan Energy, Gilles David, vice-président Energie renouvelable et distribuée d'Areva, Arthur Riedacker, directeur de recherches à l'INRA. Nous allons d'abord entendre les exposés introductifs de MM. Watkinson et Jésus, de Mme Chartier-Touzé et de M. Severino, puis nous aurons un débat tous ensemble. Je devrai, dans un quart d'heure environ, vous quitter brièvement, puis vous rejoindrai pour le débat. M. Paul WATKINSON : Je commencerai par quelques chiffres. Pour maîtriser l'effet de serre et limiter le réchauffement à 2 degrés, il faut réduire les émissions mondiales de 15 à 50 % d'ici 2050. En 2000, la France représentait environ 1,5 % des émissions mondiales de CO2, l'Europe 16 %, les pays de l'annexe I qui ont ratifié Kyoto 30 % seulement. Les pays industrialisés, Etats-Unis compris, représentent un peu plus de la moitié des émissions mondiales, mais leur part va mécaniquement décroître, et d'ici dix à vingt ans, les émissions des pays en développement dépasseront celles des pays développés. Les dix plus gros émetteurs étaient responsables de 77 % des émissions mondiales de CO2 en 2000, les vingt plus gros de 88 %. Parmi ces vingt pays figurent tous les pays émergents : la Chine avec 14,5 %, l'Inde avec 4 %, la Corée du Sud avec 2 %. M. le Président : Quelle est la part des Etats-Unis ? M. Paul WATKINSON : 24 %. Le chiffre peut varier un peu selon que l'on inclut ou non les autres sources, les puits de carbone, etc., mais j'ai retenu une définition simple. Il ressort de tous ces chiffres que la participation des pays en développement ou émergents est essentielle. Le premier des facteurs de croissance des émissions est l'énergie. Selon l'Agence internationale de l'énergie, l'investissement dans le secteur énergétique s'élèvera, au niveau mondial, à 17 000 milliards de dollars entre 2004 et 2030, dont environ la moitié dans les pays du Nord et l'autre moitié dans ceux du Sud, soit quelque 325 milliards investis chaque année dans les pays émergents ou en développement. Si l'on suit le scénario de référence - et la hausse du prix du pétrole ne fait que renforcer la part du charbon dans les politiques d'investissement -, les émissions mondiales de CO2 augmenteront de 60 % d'ici 2030. Mais l'énergie, même si elle est au cœur du problème, n'est pas le seul facteur. La Chine, par exemple, produit aujourd'hui 40 % de la production mondiale de ciment, et l'utilise, car elle n'en exporte presque pas. L'avenir est donc « bétonné » pour longtemps, si j'ose dire, car les choix en matière d'infrastructures, d'équipements, de transports, d'urbanisme, de logement rendront très difficile, par la suite, toute politique volontariste de réduction des émissions. C'est donc d'ici dix à vingt ans qu'il faut agir. Le protocole de Kyoto, qui a instauré un prix du carbone et établi le MDP, ne concerne, nous le savons, que 30 % des émissions. Il faut donc utiliser le MDP au mieux, le renforcer, élargir son champ d'action, car l'intérêt particulier de cet instrument est qu'il s'adresse surtout à l'investissement privé. Il faut aussi intégrer l'aspect climatique aux politiques des bailleurs de fonds internationaux et aux actions de coopération, en exploitant les synergies avec le traitement des autres problèmes liés au développement, comme la pollution, ou l'alourdissement de la facture énergétique du Sud. L'autre volet, c'est l'impact du changement climatique sur les pays du Sud. En effet, tous les pays du monde sont concernés, mais l'impact sera plus fort sur ceux qui sont plus pauvres et plus vulnérables. Il y a une action de partage de l'information à mener au niveau régional. Il y a aussi une nécessité absolue d'intégrer cette préoccupation dans les politiques d'investissement, d'infrastructures, afin de rendre les sociétés plus résistantes au changement climatique. Il faut aussi traiter au niveau international certains dossiers, comme la déforestation, qui est le fait de certains pays, comme le Brésil et l'Indonésie, mais aussi d'autres comme ceux du bassin du Congo. Nous n'avons pas encore les moyens juridiques de le faire, mais nous commençons à explorer le sujet. L'une des difficultés est aussi que, dans beaucoup de pays en développement, la politique du climat est souvent du ressort de spécialistes, au sein des ministères de l'environnement, qui ont une bonne connaissance des données, mais peu d'influence sur les décisions. Enfin, il est nécessaire de trouver un moyen de mieux associer les acteurs économiques au débat. M. le Président : Merci d'avoir respecté votre temps de parole. M. Franck JÉSUS : Le rôle des pays émergents est croissant dans le total des émissions mondiales de gaz à effet de serre comme dans les négociations internationales sur le climat. Ils ont un développement économique très rapide, qui est pour nous une source d'opportunités, de marchés, d'investissements, mais aussi de concurrence. Ces deux éléments sont liés dans la question climatique. Les pays émergents représentent 14 des 25 principaux pays émetteurs, et 40 % des émissions en 2000. En 2025, ils en représenteront 55 %, et 70 % de la croissance des émissions d'ici là. Ils ont, pour l'essentiel, ratifié le protocole de Kyoto, sans engagement contraignant, et bénéficient du MDP, qui permet, en participant à des projets « sobres en carbone », de bénéficier de crédits d'émission. Ils apprécient ce mécanisme, mais lui reprochent d'être trop ponctuel, de ne pas avoir d'effet « macro » et de n'entraîner que peu de transferts de technologie. Ils sont prêts à envisager des actions non contraignantes de réduction des émissions dans le cadre de la Convention Climat des Nations unies. Aucune action globale efficace de réduction des émissions n'est possible sans eux, mais ils sont représentés par le G77, sans qu'il y ait différenciation entre eux et les autres pays en développement plus pauvres. Certains d'entre eux, au demeurant, comme le Mexique ou la Corée du Sud, sont plus riches que les pays d'Europe de l'Est. Leur croissance économique est forte, sans contrainte environnementale, et ils ont parfois l'illusion que le progrès technologique résoudra tout sans changer de cadre d'action. Leur niveau d'émission par habitant est actuellement plus faible qu'en Europe : 2 à 4 tonnes d'équivalent CO2, contre 8 à 14 en Europe. Leur principal facteur d'augmentation des émissions est leur croissance économique. Leur efficacité énergétique est faible : 800 à 2 000 tonnes d'équivalent CO2 par million de dollars de PIB, contre 350 à 500 en Europe. Certains pays, toutefois, comme la Chine, l'Inde ou la Russie, ont grandement amélioré leur intensité énergétique, même si l'Inde se plaint traditionnellement de l'absence de transfert de technologie. Pour les entreprises françaises, le MDP est un moyen d'améliorer ou de maintenir la compétitivité de technologies sobres en carbone : 70 projets MDP - ou MOC en Europe de l'Est - ont été recensés. La direction générale du Trésor et de la politique économique sensibilise et soutient les entreprises qui développent ces projets. L'aide bilatérale liée est gérée par le Trésor, à travers le Fonds d'études et d'aides au secteur privé (FASEP) pour l'étude des projets et le RPE pour les prêts concessionnels. Près de 75 millions d'euros par an sont dépensés pour des projets favorables au climat dans les pays émergents. Quant à l'aide bilatérale déliée, l'Agence française de développement est intervenue en Chine, en Afrique du Nord et du Sud pour un montant de 17,5 millions d'euros en 2004, et le Fonds français pour l'environnement mondial (FFEM) finance des projets favorables au climat pour 4 millions d'euros par an. Le soutien de la France aux projets Kyoto se concentre sur trois points clefs : l'appui institutionnel, le montage de dossiers MDP, le financement de projets MDP. Les pays émergents sont de plus en plus présents dans les négociations internationales. C'est grâce à l'accord intervenu entre les pays d'Europe et eux qu'il y a eu une avancée à Montréal, et que les Etats-Unis ont fini par se joindre au consensus. Mais il faut dépasser les limites du MDP. Une réflexion est en cours, aux ministères des affaires étrangères, des finances, de l'environnement, pour soutenir des politiques sectorielles, dans des secteurs comme l'aluminium, l'acier, l'aviation, les transports, l'industrie, le bâtiment, ou la production d'énergie (s'agissant en particulier de l'efficacité énergétique, de la gestion des déchets, des énergies renouvelables, ou du stockage du carbone). Une autre piste importante est de prendre en compte la déforestation évitée : c'est une proposition de la Papouasie-Nouvelle Guinée, mais elle peut intéresser aussi l'Indonésie et le Brésil, et l'on doit souligner qu'un tiers des émissions des pays émergents sont dues à la déforestation. C'est une voie qui permettrait d'amener ces pays à prendre des engagements non contraignants, dans la perspective d'obtenir des crédits carbone. Enfin, le cadre formel du dialogue international lancé à Montréal doit être mis à profit. Présidence de M. Serge POIGNANT, vice-Président M. le Vice-Président : Je vous remercie, et souhaite que vous donniez à la mission les documents dont vous disposez sur ce sujet Mme Nathalie CHARTIER-TOUZÉ : Je vais vous parler rapidement de la contribution des pays en développement au changement climatique, des enjeux de ce changement pour eux, des orientations et acteurs de la politique de développement de la France et des perspectives. Les pays dits en développement sont ceux dont la liste a été dressée très précisément par l'OCDE, et qui comprennent à la fois les pays dits « les moins avancés », ou PMA, et les pays dits « à revenu intermédiaire », comme l'Afrique du Sud, l'Inde, la Colombie ou le Brésil. Les pays émergents sont des pays à revenu intermédiaire. Je vais vous parler des PMA, situés pour les deux tiers en Afrique, et des pays émergents. Il y a deux politiques d'aide à mener, différentes, en matière de lutte contre le changement climatique. La contribution des PMA aux émissions est faible : une tonne d'équivalent CO2 par personne, contre 8 tonnes en France et 24 tonnes aux Etats-Unis. Ils contribuent, en revanche, à la déforestation, et donc au problème. Les Etats-Unis sont le premier émetteur, avec 7 milliards de tonnes, soit 20 % du total, puis vient la Chine avec près de 15 %, l'Inde est cinquième avec 5,6 %, mais dans dix ou vingt ans, ces deux pays seront les deux principaux émetteurs. M. le Vice-Président : On dit parfois dans dix ans, parfois dans vingt ans. Qu'en est-il au juste ? M. Franck JÉSUS : Les émissions vont doubler d'ici 2025, alors que la tendance des pays développés est plutôt à une augmentation de 20 %. Mme Nathalie CHARTIER-TOUZÉ : En terme d'émission de CO2 par habitant, la Chine n'occupe que la centième place. Le premier effet des émissions est le réchauffement climatique, qui sera surtout important au Nord, dans l'Arctique. Dans les autres parties du monde, cependant, même si l'impact proprement dit est moindre, les pays sont à la fois plus vulnérables, et moins à même de réagir ; c'est notamment le cas des petits Etats insulaires en développement. Mais l'élévation de la température n'est pas le seul impact du changement climatique : il y a aussi la fréquence accrue des phénomènes extrêmes. Il faut savoir que les PMA sont très dépendants du pétrole. Leur facture pétrolière augmente et pèsera de plus en plus sur leur économie. Certains consacrent déjà la moitié de leurs recettes d'importation pour acheter des produits pétroliers. La remise de dettes consentie par le G8 de Gleneagles représente 1,5 milliard de dollars par an, mais l'augmentation de la facture pétrolière va coûter à ces mêmes pays 10,5 milliards par an, soit sept fois plus. Les pays émergents, pour leur part, veulent maintenir leur croissance avec une énergie économiquement compétitive. Ils sont également vulnérables au changement climatique, qui entraîne sécheresse, inondations, etc. Sur le plan diplomatique, ils souhaitent prendre toute leur place dans le dialogue international sur l'après-2012. L'efficacité énergétique est à améliorer, Franck Jésus en a parlé. Les pays les plus efficaces, à cet égard, sont ceux de l'Union européenne, mais la Chine est assez bien placée par rapport aux Etats-Unis, qui ont un énorme effort à faire. Il y a d'immenses gisements d'économies possibles en Chine et en Inde, et Jean-Michel Severino vous présentera tout à l'heure l'action de l'Agence française de développement en matière d'efficacité énergétique. Quelle est l'implication respective de ces pays dans la négociation internationale ? Les pays émergents défendent activement leur droit à la croissance sans contrainte. Les PMA, jusqu'à présent, sont assez peu présents dans le débat international, mais auraient avantage à un nouveau mécanisme international qui rémunérerait le « service environnemental » offert par l'existence d'une forêt en croissance. Les pays africains ont montré leur intérêt pour une telle idée, mais leurs forêts sont matures, et leur contribution à la déforestation est très inférieure à celle du Brésil ou de l'Indonésie. La question est donc complexe. L'aide publique au développement (APD) de la France doit donc jouer sur les différents leviers. D'un point de vue environnemental et économique, il est indispensable de travailler sur l'atténuation des émissions de gaz à effet de serre par l'amélioration de l'efficacité énergétique, par le recours aux énergies renouvelables et à des technologies comme la séquestration du carbone - l'Agence française du développement (AFD) vous présentera tout à l'heure ses projets. D'un point de vue politique, social et diplomatique, nous devons aider les PMA à s'adapter au changement climatique ; il en va de notre responsabilité, même si nous travaillons aussi sur l'atténuation. Il y a deux projets de MDP labellisés en Afrique : au Maroc et en Afrique du Sud - qui sont cependant des pays à revenu intermédiaire. Le principe est que l'aide publique sert le développement, mais à travers des actions différenciées. Je ne reviens pas sur le cadrage de l'aide française, déjà évoqué par des représentants du ministère des affaires étrangères lors d'une précédente table ronde. Les objectifs de l'APD française sont : promouvoir un développement sobre en carbone grâce aux transferts de technologies, aider les pays à intégrer la dimension climatique dans leurs politiques et leurs projets, associer la lutte contre le changement climatique à la réduction des pollutions atmosphériques locales, soutenir les activités de séquestration de la biomasse. Pour cela, il faut réussir à faire mieux prendre en compte le problème par les décideurs, ce qui suppose d'améliorer la mesure du phénomène. Il faut enfin aider les populations et les pays les plus démunis à s'adapter aux effets négatifs induits par le changement climatique. Les petits Etats insulaires en développement (PEID) se sont beaucoup démenés pour faire valoir leur vulnérabilité ; ils sont plus présents dans le débat que les autres PMA. Les axes d'intervention sont l'adaptation aux impacts, l'atténuation, mais aussi l'aide aux pays de la Zone de solidarité prioritaire (ZSP) à être présents dans la négociation. Dans le domaine multilatéral, la France contribue au fonds PMA mis en place par la Convention Cadre, au Fonds pour l'environnement mondial, dont 30 % des actions portent sur le climat, soit 15 millions de dollars par an pour la France, ainsi qu'au Fonds européen de développement, à hauteur de 25 %. L'AFD contribue au Bio Carbon Fund de la Banque mondiale, ainsi qu'au programme Africa Assist avec le FFEM. En bilatéral, la France verse environ 150 millions d'euros par an. Les principaux acteurs institutionnels de l'APD climat sont la Direction générale de la coopération internationale et du développement (DGCID) du ministère des affaires étrangères, l'AFD, qui en est le maître d'œuvre principal, la Direction Générale du Trésor et de la politique économique du ministère de l'Economie et des Finances, qui promeut le MDP et soutient des projets d'aide à l'exportation, la MIES qui coordonne la politique française relative au climat, l'ONERC qui coordonne les stratégies d'adaptation, le MEDD et l'ADEME. Notre action a vocation à aller croissant, et l'engagement de Bonn prévoit une contribution de la France accrue de 41 millions de dollars par rapport à 2001. Le 4 avril, se tiendra une réunion des ministres de l'environnement et du développement de l'OCDE, qui devraient adopter une déclaration sur la nécessité de renforcer l'aide à l'adaptation. Il s'agit aussi d'améliorer la synergie avec les programmes sur l'eau, la forêt, la désertification, et de renforcer le MDP. Parmi les nouvelles pistes de financement figurent l'« échange dette-nature » et la rémunération de la déforestation évitée sur le marché du carbone. M. le Vice-Président : Je vous remercie. J'espère que vous nous laisserez vos documents. M. Jean-Michel SEVERINO : Compte tenu de ce qui a été dit, je consacrerai mon propos à l'activité propre de l'AFD. J'évoquerai rapidement sa stratégie Climat, puis prendrai quelques exemples concrets. Nous sommes venus sur ce terrain par la problématique des ressources naturelles, en constatant que la dégradation de l'environnement pèse de plus en plus sur la mise en œuvre des actions de développement, et que le facteur climatique est en passe de jouer un rôle déterminant. Nous nous sommes impliqués au niveau micro-économique d'abord, macro-économique ensuite. Cela nous a conduits à élaborer un cadre d'intervention stratégique, présenté l'an dernier à notre conseil de surveillance, et qui comporte trois objectifs : promouvoir un développement sobre en carbone, lier les problématiques locales et globales, accompagner les populations vulnérables. Nous nous efforçons, pour cela, d'introduire la dimension du climat dans l'ensemble des activités stratégiques de l'Agence, autour de deux thèmes - la réduction des émissions et l'adaptation -, dans une stratégie à la fois géographique et sectorielle, et ce dans chacune de nos opérations, qui ont souvent une dimension climatique cachée. Ce travail est largement entamé, et se poursuit à mesure que nous renouvelons nos stratégies sectorielles. En outre, nous avons commencé à mener des opérations consacrées spécifiquement au changement climatique. Toute notre stratégie en Chine et en Thaïlande lui est entièrement vouée, mais nous faisons également des opérations ponctuelles, « opportunistes » - nous avons par exemple un projet MDP en Afrique du Sud -, et menons une politique de pénétration des fonds internationaux consacrés à ce sujet, comme le Carbon Fund de la Banque mondiale. Nous prendrons d'ailleurs cette année une participation dans un fonds international centré sur la problématique de la biodiversité et de la conservation des milieux naturels. Nous contribuons également à l'élaboration de politiques internationales, en articulant notre action aux objectifs globaux et en alimentant la position de la France à partir de notre propre expérience de terrain. Enfin, et c'est très important pour nous, nous mobilisons des financements additionnels à travers le FFEM, qui consacre entre un quart et un tiers de son activité à cette problématique, en utilisant des instruments à effet de levier. Notre statut hybride d'établissement public et d'entreprise nous permet de pénétrer les milieux non souverains qui traitent de ces questions, comme le World Council for renewable energy, et d'être adhérents du Global Compact, où se rencontrent de grandes entreprises pour en discuter. En 2005, nous avons consacré plus de 300 millions d'euros à notre activité Climat, soit vingt fois plus que l'année précédente, et la progression va rester vive, notamment à cause de nos programmes en Chine et en Thaïlande. Je ne parlerai que du premier, qui a commencé il y a trois ans, mais le second lui est en tous points analogue. Nous recourons à trois instruments financiers : des prêts concessionnels à l'Etat chinois, des prêts non souverains et sous-souverains à des régions ou provinces chinoises et au secteur privé, mais aussi des prêts non concessionnels à des entreprises pour créer de l'industrie propre ou de l'activité économie propre. Nous intervenons dans trois secteurs. Le premier est le développement urbain, première cause d'émissions en Chine et premier gisement, donc, d'économie, qu'il s'agisse d'urbanisme, de transports, d'efficacité énergétique dans le logement ou de production locale d'électricité. Le deuxième est le ferroviaire électrique comme alternative à la route : il ne faut pas oublier que la Chine est le premier bâtisseur d'autoroutes de la planète. Le troisième est la production d'énergie elle-même. L'an dernier, trois grandes opérations structurantes ont été approuvées par notre conseil de surveillance : l'électrification de la ligne de chemin de fer Luo Zhang - Zhangjiajie, d'une longueur de 1 000 kilomètres, pour un coût de 80 millions d'euros, doit générer une économie annuelle de 440 000 tonnes de carbone par an, soit six mois de trafic aérien Paris-Pékin ; à Wuxi, dans une région enclavée et pauvre, seront construites six centrales de 60 MW au fil de l'eau, pour un coût de 40 millions d'euros et une économie annuelle de 200 000 tonnes ; enfin, un projet de cogénérateur au gaz naturel à Wuhan doit permettre une économie annuelle de 500 000 tonnes. Au total, notre action climatique en Chine devrait aboutir à une économie structurelle d'un million de tonnes par an. J'ajoute à cela que nous sommes en train de finaliser, avec trois ou quatre banques chinoises partenaires, une ligne de crédit d'efficacité énergétique, afin d'inciter les entreprises clientes de ces banques à reconvertir leurs process industriels. On n'en connaîtra le bilan que dans cinq ou six ans, quand la ligne aura été entièrement utilisée. Avant de conclure, je citerai deux opérations menées dans d'autres pays, et qui témoignent de la diversité de notre action. Il y a deux ans, à Durban, en Afrique du Sud, nous avons financé un projet de méthanisation des ordures ménagères en vue de la production d'électricité. Il n'était pas rentable dans le cadre d'un montage classique, mais nous avons réussi à vendre des crédits carbone du fonds de la Banque mondiale dont nous sommes co-actionnaires, ce qui a permis à la ville de rentabiliser l'opération. Dans les forêts du bassin du Congo, nous activons des lignes de crédit des banques privées locales, et la concessionnalité finance les surcoûts des entreprises forestières qui établissent des plans de préservation de la forêt. Un problème vient de ce que l'opération n'est pas éligible au MDP parce qu'il ne s'agit que de « déforestation évitée », mais l'intérêt est grand, du fait qu'il existe un double dividende grâce à la préservation de la biodiversité. C'est une problématique qui vaut également pour la zone sahélienne : si nous pouvions y faire venir des entreprises pour investir, il y aurait même un troisième dividende, je veux parler de la lutte contre la grande pauvreté. J'ai mis l'accent, dans mon exposé, sur l'économie de carbone, mais les mécanismes d'adaptation sont tout aussi essentiels, quoique moins spectaculaires. Une des difficultés est justement la faible visibilité de ces stratégies, car nous n'aurons le soutien des Etats que si nous savons en rendre visibles les effets. M. le Vice-Président : J'ai bien compris que les pays en développement signataires de Kyoto refusent des contraintes à leur développement, mais certains s'interrogent-ils sur des mesures qui seraient plus adaptées à leur problématique ? Les pays émergents s'orientent-ils vers d'autres systèmes ? Adhéreront-ils à Kyoto ? Et quid du développement du nucléaire ? Je pense à la Chine. M. Jean-Michel SEVERINO : J'apporterai une réponse partielle. Si je prends les deux pays où nous travaillons le plus sur ces questions, la Chine et la Thaïlande, le Gouvernement y est très sensibilisé, ce qui nous facilite la tâche. Dans le cadre du 11e Plan, le Parti communiste chinois a publié un document préliminaire d'une vingtaine de pages, fixant en tout et pour tout deux objectifs quantitatifs, le premier relatif à la croissance du PIB, le second à la réduction des émissions de carbone. C'est très significatif. Un autre sujet auquel ils sont très sensibles est celui de l'épuisement des ressources fossiles, compte tenu de la croissance très rapide de la consommation. C'est un biais de responsabilisation très puissant, et je n'ai donc pas beaucoup d'inquiétude sur le fait que les stratégies nationales seront responsables. Mais cela ne veut pas dire que ces pays accepteront des contraintes au niveau multilatéral, ne serait-ce que par nationalisme, et aussi parce qu'ils considèrent que c'est nous qui avons créé le problème. M. le Vice-Président : Il nous reste environ trois quarts d'heure pour le débat. Je demande dont à chacun d'être aussi concis que possible. Mme Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET, Rapporteure : Que pensez-vous de la place et de l'engagement des entreprises françaises dans la lutte contre le changement climatique dans les pays en voie de développement et dans les pays émergents ? Sont-elles au courant des mécanismes existants ? Les utilisent-elles ? En tirent-elles parti ? Sont-elles en retrait ? Comment les inciter à s'engager davantage, notamment en Chine et en Inde, qui sont non seulement des enjeux, mais des marchés. M. Antoine DECITRE : Nous sommes la seule entreprise française à avoir un projet de MDP en Inde. Il y a quatre projets MDP en tout, dont trois menés par de très grosses entreprises, et le nôtre. Il consiste à installer des méthaniseurs dans 35 000 familles paysannes indiennes, qui les alimenteront en bouse de vache le soir, et pourront ainsi cuire la nourriture le lendemain sans avoir à abattre d'arbres pour alimenter le feu. Nous n'avons pas besoin d'argent : nous pensions lever 3 millions d'euros en Bourse, on nous en a proposé 50, nous en avons pris 25. Ce dont nous avons besoin, c'est seulement un soutien juridique important, car une entreprise comme la nôtre ne peut suivre par ses propres moyens les lois qui régissent le crédit carbone dans tous les pays. M. Arthur RIEDACKER : Dans les règles d'éligibilité au MDP, il existe une forte incertitude sur la biomasse. Or il faudrait ne pas se limiter aux ordures ménagères, qui sont utiles mais qui ne sont pas du développement. M. Guy REINAUD : Je voudrais dire un mot des entreprises françaises. Pro Natura est une association qui promeut un développement rural participatif, et l'une de nos entreprises partenaires, curieusement, est Areva. Nous soutenons l'opération « charbon vert » qui consiste en quelque sorte à faire du charbon de bois sans bois. Au départ, l'usage était uniquement domestique, et nous espérons passer à un usage industriel éligible au MDP. Areva nous y aide en Afrique, où le charbon de bois est le deuxième combustible après le pétrole. Il faut savoir que chaque tonne de charbon de bois brûlé émet 2,5 tonnes de CO2 et que la déforestation tropicale dégage, à l'échelle planétaire, autant de gaz à effet de serre que le pétrole. Les 14 et 15 mars aura lieu un colloque à l'UNESCO sur la séquestration du carbone, la déforestation évitée et l'énergie biomasse associée. M. François FALLOUX : Eco Carbone est une petite société, dont le gros de l'activité s'exerce en Chine. Il s'agit de capturer le méthane dans les mines du charbon. L'appui du FASEP est bien ciblé. Nous avons un contrat sur six mines de charbon, qui permettra de produire plusieurs millions de tonnes par an. Mais nous avons aussi beaucoup de projets, plus difficiles à réaliser, dans la bande soudano-sahélienne, pour le développement des biocarburants. Nous travaillons beaucoup à l'étranger, au Brésil, ailleurs dans le monde, mais il est très difficile de travailler en France sur les usages domestiques. Notre seul projet européen est en Suisse. M. Franck JÉSUS : Les entreprises françaises sont en retard par rapport aux entreprises nordiques, notamment parce que nous avons interprété le message de Kyoto comme signifiant « Tenons nos engagements par des mesures internes », tandis que d'autres cherchaient davantage à racheter des crédits carbone grâce au MDP. Depuis quelques années, le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie fait un effort très important de sensibilisation des entreprises. Nous avons environ dix pays partenaires, où nous organisons des séminaires d'information, des rencontres avec des entreprises françaises. De plus en plus d'entreprises se mobilisent, mais il reste du chemin à faire. M. le Président : Gilles David va nous parler de ce que fait Areva dans ce domaine. Jusqu'à présent, la part non nucléaire des activités de l'entreprise était assez réduite. Est-ce en train de changer ? M. Gilles DAVID : Je viens d'Areva T. et D., ancienne filiale d'Alstom rachetée par Areva. Areva s'emploie sérieusement à développer son action dans les énergies renouvelables. Notre chiffre d'affaires est d'environ 40 millions d'euros par an, et notre objectif est de le porter à 100 millions d'euros d'ici quelques années. Nous faisons des centrales à biomasse, à biogaz ou à gaz de mine, et de la récupération de chaleur. Nous étudions aussi la question des biocarburants. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de marché en France : on est seulement en train de démarrer, et je n'ai malheureusement pas encore réussi à faire de centrales en France. L'Inde a lancé un programme de centrales à biomasse il y a dix ans, mais tout y est indien, le matériel comme le personnel. En Allemagne, il y a des activités biogaz et gaz de mine. En France, le gaz de mine est recompressé, et n'alimente directement aucune centrale, sauf bientôt une toute petite en Lorraine. Nous sommes présents au Brésil parce qu'il y a un marché, mais avec des financements allemands, car les Allemands, eux, acceptent de financer à 100 % même si la part des équipements étrangers dépasse 50 %. Aujourd'hui, dans le Tiers-monde, il est totalement illusoire d'imaginer faire des affaires où 50 % des équipements viennent d'un pays développé. C'est pourquoi Areva a créé une business unit sur les énergies renouvelables, telles que l'éolien ou les piles à combustible. Notre souhait n'est pas de recevoir des aides à l'export, mais d'avoir des possibilités de financement même si la part exogène est très importante, et aussi d'avoir aussi un marché en France pour vendre notre technologie à partir de la France. M. le Président : Ce que vous venez de dire est très intéressant, car c'est notamment l'absence de filière en France même qui a freiné, jusqu'ici, le développement du renouvelable. Mme la Rapporteure me disait en aparté, et je suis d'accord avec elle, que nous devrions structurer toute la filière biomasse ; elle n'est peut-être pas la plus importante, mais cela donnerait de la cohérence à notre politique en matière d'énergies renouvelables. M. Gilles DAVID : Nous faisons de la recherche-développement sur la biomasse avec une université française et des centres de recherche en Inde, pays où les chercheurs sont très avancés sur ce sujet. M. le Vice-Président : Nous allons justement en Inde en mars dans le cadre de cette mission. M. François DOSÉ : J'ai plusieurs questions, qui s'adressent à tout le monde, car je n'ai pas de réponse, et suis curieux de toutes celles qu'on pourra me donner. Peut-on envisager qu'un jour les aides publiques au développement soient assorties d'une condition d'efficacité énergétique ? La diversité des acteurs, telle qu'elle se manifeste ce matin dans cette salle, est-elle une source de richesse, ou bien faudrait-il davantage de coordination afin qu'il n'y ait pas besoin de rencontrer vingt-cinq interlocuteurs pour monter un dossier ? Enfin, je voudrais connaître le total de notre aide publique aux PMA et aux PRI, en additionnant le bilatéral, le multilatéral, l'européen, le décentralisé. Je suis militant de la coopération décentralisée depuis un quart de siècle, et à l'époque nous investissions surtout le champ de la santé et celui de la formation. Aujourd'hui, c'est plutôt l'eau et l'assainissement. Peut-être faudrait-il que ce soit, demain, l'efficacité énergétique ? Mme Nathalie CHARTIER-TOUZÉ : Le problème est complexe, et les réponses multiples, car il faut combiner les approches avec des acteurs différents. Depuis la réforme de l'aide publique au développement, la coordination est assurée par le ministère des affaires étrangères, et la mise en œuvre au sein de la ZSP est principalement assurée par l'AFD. Quant à la conditionnalité de l'aide, la démarche que nous avons choisie est d'examiner chaque projet en intégrant la dimension climatique. C'est d'ailleurs l'engagement que devraient prendre les ministres de l'environnement et du développement de l'OCDE en avril. M. Jean-Michel SEVERINO : Je reviens sur la question des entreprises françaises. Nous sommes impliqués dans un grand nombre de partenariats public-privé, nous sommes bien placés pour observer ce qui se passe, et mon optimisme est très relatif. Je considère qu'il est nécessaire de structurer la filière des énergies renouvelables en France même, car on n'est bon à l'exportation que si on l'est sur son propre marché. Parmi les entreprises qui contribuent à la lutte contre le changement climatique dans leur activité internationale, il y en a un petit nombre qui sont très mobilisées, comme Lafarge, qui reconstruit la cimenterie d'Aceh en Indonésie, il y en a d'autres qui font de petites opérations ponctuelles, que l'on pourrait qualifier d'opportunistes, et il y a la grande masse des entreprises qui se sentent peu ou pas concernées et ne connaissent guère le MDP. Il y a un gros travail public d'information et de sensibilisation à mener. Le système d'aides français est incomplet. Dans les pays émergents, les seuls instruments existants sont conditionnés à une part substantielle d'offre française, ce qu'un nombre croissant de pays est en train de refuser pour toutes sortes de raisons. L'aide liée ne sera donc bientôt plus l'instrument principal. Nous voulons donc promouvoir une aide déliée, consacrée spécifiquement à la problématique du changement climatique dans les pays à revenu intermédiaire. M. Christophe RYNIKIEWICZ : Hélio International travaille dans les pays émergents notamment dans le cadre du consortium SouthsouthNorth. Le MDP est un mécanisme qui doit contenter à la fois l'acheteur et l'investisseur, mais qui, dans certains cas, ne satisfait pas le second, et le consortium s'emploie justement à y remédier. C'est ainsi que le projet Le Cap a été primé par l'institution britannique REEEP (Renewable Energy & Energy Efficiency Partnership - Partenariat issu de Johannesburg) et vendu au G8 parce que l'on acceptait de payer trois fois le prix du marché. Le marché du carbone dépend de l'offre et de la demande, mais pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de demandes de crédits carbone. M. le Vice-Président : Pourtant, les prix sont en train de monter. M. Christophe RYNIKIEWICZ : Le prix sur le marché européen n'est pas le même que sur le marché gris. Si on veut avoir un effet d'entraînement sur l'investissement, il faut que la tonne soit à 20 ou 25 euros. M. le Vice-Président : C'est le cas. M. Christophe RYNIKIEWICZ : Mais les crédits carbone ne sont pas achetés à ce prix-là. Nous avons besoin de codévelopper des projets, notamment dans le cadre de la coopération avec la communauté scientifique et universitaire. M. Antoine DECITRE : Le marché du carbone en provenance du MDP était jusqu'ici structuré ainsi : des producteurs indiens vendaient à des brokers, avec plusieurs intermédiaires, si bien qu'une quinzaine d'euros par tonne se perdaient en ligne. C'est pour cela que nous avons une filiale là-bas, car jusqu'à 5 euros la tonne, un projet n'est pas viable. Nous achetons des centaines de milliers de tonnes, on ne peut donc pas dire qu'il n'y a pas de demande. Mais s'il y a cinq ou six intermédiaires, le projet n'est pas viable. M. Michel COLOMBIER : Ce que nous avons essayé avec le FFEM, c'est de rechercher des synergies. Dans les pays émergents, la question de l'aide est de plus en plus marginale. Nous nous situons, nous, sur le terrain de l'activité économique, et recherchons les moyens d'influencer le comportement des entreprises. Le développement de nos exportations de technologie dépend de nos politiques internes, notamment en matière de rachat de l'électricité. Or, il y a en France une forme de monoculture qui est préjudiciable. Le MDP est un instrument limité, notamment parce qu'il passe entièrement sous silence la question des infrastructures. Il faut dialoguer avec la Chine ou l'Inde sur ces questions, car ces pays ont les moyens de se doter d'un modèle d'énergie chère et efficace. M. Franck JÉSUS : Je ne reviens pas sur la coordination de l'aide publique française, sinon pour dire que la lutte contre l'effet de serre est l'un des domaines où elle est le mieux employée, grâce à la MIES - bien que celle-ci soit de moins en moins bien dotée. M. le Vice-Président : M. Rynikiewicz a parlé de la coopération, notamment universitaire, avec les pays les moins avancés. Mais ne faudrait-il pas s'assigner certains objectifs, dans des domaines comme l'accès à l'énergie, le solaire, la maîtrise de la chaîne du froid ? J'avais été choqué, il y a cinq ans, d'entendre Charles Josselin, alors ministre de la coopération, me dire que la priorité n'était pas là, qu'elle allait à la santé et à l'autosuffisance alimentaire. Si l'on pense aujourd'hui que c'est bien une priorité, il faut soutenir ces projets, qui ont d'ailleurs un effet positif sur la santé. Enfin, nous avions un champ classique de coopération avec certains pays. Tout ce qui a été dit sur la biomasse, la déforestation, est important. Peut-on répondre là-dessus en une dizaine de minutes ? M. Antoine DECITRE : Tout ce que nous demandons, c'est la mise en place d'un cadre légal nous permettant d'investir chez eux. Aujourd'hui, on ne peut pas, faute de pouvoir racheter des crédits carbone. M. Arthur RIEDACKER : Il faut évidemment soutenir les PMA, mais on ne s'y prend pas bien. Il y a une sensibilité très forte des agriculteurs, or il n'en a presque pas été question ce matin. L'intensification de l'agriculture peut à la fois réduire la déforestation et développer la biomasse. Mais il faut aussi investir dans les mécanismes existants. Le MDP ne répond pas à tout, et ne permet notamment pas de lutter contre la désertification, du simple fait qu'on ne peut pas mesurer ses effets. On va dépenser beaucoup d'argent pour des choses qui ne sont pas mesurables, qu'on ne peut pas mettre sur le marché. Or, il y a des instruments pour lesquels la France, comme d'autres pays industrialisés, s'est engagée à augmenter ses moyens. Je pense aux différents fonds sous la Convention ; - le « fonds spécial de la convention climat », le « Fonds Français pour l'Environnement Mondial », etc., ou des aides bilatérales. Ce sont ces instruments qui doivent également être mobilisés. A travers eux on peut aider au développement et à la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans ces pays sans exiger les mêmes précisions et dépenses pour les mesures de ces réductions d'émissions et sans exclure, comme dans le cas pour le MDP, les cofinancements avec l'Aide publique au développement. M. Jean-Michel SEVERINO : L'énergie fait partie du « fonds de commerce » de l'AFD, et je suis un peu étonné du propos rapporté de M. Josselin, car l'énergie a toujours été une part non négligeable de l'activité de coopération de la France. M. François DOSÉ : Il y a 36 000 collectivités locales qui ne connaissent pas l'AFD, et qui s'adressent directement aux Cités Unies ou au ministère de la coopération. M. Jean-Michel SEVERINO : Il est vrai que développer les énergies alternatives au sud du Sahara est difficile, parce que les prix ne sont pas favorables. La plupart des solutions mises en œuvre sont traditionnelles et reposent sur le pétrole, si l'on excepte l'hydroélectricité, qui pose d'ailleurs des problèmes d'environnement difficiles à maîtriser. Je partage évidemment tout ce qui a été dit sur l'importance, pour les pays en développement, d'avoir une meilleure efficacité énergétique, tant sur le plan de la production que sur celui de la consommation. C'est un principe qui est au cœur de notre action, quel que soit le secteur, y compris agricole. Pour les pays émergents, je considère que, contrairement à ce qui a été dit, l'aide est le seul moyen d'entrer en contact et de travailler avec eux de façon crédible sur les problèmes énergétiques. Si nous présidons cette année la commission Energie du groupe environnement chinois, c'est parce que nous sommes identifiés comme un opérateur engagé concrètement sur la question climatique. Dans le cas contraire, nous n'aurions jamais été invités à la table de discussion. M. le Président : Cela mériterait un débat ultérieur, car j'ai cru voir que les industriels présents ne partageaient pas votre sentiment. M. Paul WATKINSON : Le MDP, dont on a dit beaucoup de choses, est un outil important et novateur. Mais il ne représente que 1 à 10 milliards de dollars par an, sur quelque 300 à 350 milliards de dollars à investir dans le secteur de l'énergie. C'est franchement trop peu, et il faut essayer d'élargir cet instrument, car le financement carbone ne suffit pas. Nous sommes aux tous débuts du marché, il faut associer des bailleurs de fonds internationaux, sachant que le volume de la demande repose sur nos engagements, et a aussi des effets sur notre compétitivité à long terme. M. Nicolas LAMBERT : Grâce à la médiatisation de la question du changement climatique et du récent problème de sécurité énergétique, il y a une forte montée en puissance du thème de l'énergie dans l'Agenda du développement. La semaine dernière, s'est tenue à Vienne une très importante réunion des vingt-cinq représentants des Etats membres de l'Union européenne, qui en ont discuté concrètement. Il y a beaucoup à faire, mais il y a un espoir. M. le Président : Si vous avez des documents, nous en sommes évidemment preneurs. M. Guy REINAUD : J'insiste à nouveau sur l'importance de l'agriculture et de l'agro-forestier dans la lutte contre le changement climatique en Afrique. Le ministère des affaires étrangères apporte d'ailleurs une aide efficace à l'action de formation que nous menons auprès des petits paysans pour développer la séquestration du carbone et éviter la déforestation. M. le Président : Monsieur Falloux, pouvez-vous nous dire quelques mots en guise de conclusion de cet échange ? M. François FALLOUX : Premièrement, si nous laissons fonctionner le MDP tel quel, sans lui apporter de correctifs, les gros clients seront l'Inde, la Chine, le Brésil, le Mexique ou l'Indonésie, mais les pays d'Afrique ne seront guère concernés. Deuxièmement, le Gouvernement a annoncé la création d'un fonds carbone, mais nous n'en avons encore guère vu la couleur. Enfin, j'insisterai sur l'importance des projets en France même : comment expliquer demain que les agro-industries du Brésil puissent bénéficier de crédits carbone, mais pas les Français parce qu'il n'y a pas de mécanisme pour les projets nationaux ? M. le Président : Vous avez très bien résumé les choses, et je vous en remercie. Les pays émergents sont importants, mais les PMA aussi. Nous demanderons à M. Severino et à Mme Chartier-Touzé de nous fournir un bilan chiffré de l'aide bilatérale, européenne et multilatérale. M. Franck JÉSUS : Il existe une plaquette de la MIES. M. le Président : Nous avons besoin de chiffres précis, surtout concernant l'aide aux PMA, car nous avons cru observer une réorientation vers les pays à revenu intermédiaire. Si les PMA sont réduits à la portion congrue, ils n'auront pas les moyens d'éviter la déforestation. Mme Nathalie CHARTIER-TOUZÉ : Nous vous ferons passer une note. M. le Président : Nous avons bien entendu ce qui a été dit sur le fonds carbone et sur les projets en France même. Vous n'êtes pas les premiers à le dire, et c'est quelque chose de très important. Il est évident que, sur tous ces marchés, il y a des effets d'aubaine, d'opportunité, voire d'opportunisme, qui ne font pas forcément une politique. Madame, Messieurs, je vous remercie. Table ronde sur l'adaptation, réunissant : Présidence de M. Jean-Yves LE DEAUT, Président M. le Président : Je vous souhaite la bienvenue à cette table ronde dont l'objectif est de faire un point sur les actions d'adaptation aux effets du changement climatique et sur les réflexions menées dans ce sens. Nous avons précédemment débattu, avec l'appui de scientifiques et d'experts, des conséquences du changement climatique : hausse du niveau des mers, modification du régime des eaux, sécheresses et inondations, événements climatiques extrêmes, effets sur l'agriculture, la forêt, le tourisme, la santé. A présent, il convient d'examiner les politiques engagées à cet égard, ce que nous avons déjà fait partiellement, en ce qui concerne les politiques de santé, avec l'Institut national de veille sanitaire (INVS). Il s'agit donc pour nous ce matin de voir dans quelle mesure les acteurs, publics et privés, l'Etat, les collectivités, les associations ont pris en compte les conséquences avérées ou probables, du changement climatique, comment l'action est organisée dans ce domaine et ce qu'il conviendrait de compléter. Le volet « adaptation » des stratégies de lutte contre le changement climatique est encore peu développé. L'Observatoire national des effets du réchauffement climatique (ONERC) est en train d'élaborer une stratégie d'adaptation. Il sera intéressant de voir au cours de nos débats, où nous en sommes par rapport aux différents axes d'action recommandés. Une autre table ronde, prévue le 22 février, sera consacrée spécifiquement à l'action des collectivités territoriales. Après un exposé liminaire de M. Gilles Pennequin, chargé du développement durable à la Délégation interministérielle à l'aménagement et à la compétitivité des territoires (DIACT), ex-DATAR, et de Mme Violaine Allais, responsable des études scientifiques du Conservatoire du littoral, les participants à cette table ronde seront : - M. Pascal Lelarge, directeur-adjoint à la Direction générale de l'urbanisme et de la construction, ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer ; - MM. Patrice Lefebvre et Koumaran Pajaniradja, de la direction de la défense et de la sécurité civile, sous-direction de la gestion des risques, ministère de l'intérieur ; - M. Alexis Delaunay, direction de l'eau, sous-direction de l'action territoriale, de la directive cadre et de la pêche, ministère de l'écologie et du développement durable ; - M. Jacques Dedieu, Ingénieur général du génie rural des eaux et forêts, haut fonctionnaire développement durable, ministère de l'agriculture et de la pêche ; - M. Jean-Michel Abiven, direction des affaires économiques, sociales et culturelles, ministère de l'Outre Mer, sous-direction des affaires économiques ; - M. Marc Gillet, directeur de l'ONERC, que nous avons déjà entendu. M. Gilles PENNEQUIN : L'adaptation est un sujet qui préoccupe beaucoup la DIACT, anciennement DATAR. Dès mon arrivée, j'ai créé des groupes de travail pour débattre de ces questions de changements climatiques et d'évolution énergétique. L'un d'entre eux vient d'ailleurs de connaître son aboutissement avec la publication de Territoires 2030, rapport sur le changement climatique, l'énergie et le développement durable des territoires, que l'ensemble des parlementaires devrait recevoir prochainement. Voilà maintenant trois mois que vous organisez auditions et tables rondes et je puis donc passer rapidement sur les éléments sur lesquels vous avez déjà beaucoup travaillé, pour me concentrer sur l'état d'avancement des travaux de la DIACT. Quels sont les enjeux à venir pour les territoires ? Tout d'abord engager une double stratégie d'adaptation et d'atténuation du réchauffement climatique. La stratégie d'adaptation est nécessaire comme le confirment un certain nombre de données qui vous ont sans doute déjà été présentées. On voit par exemple que le schéma de la canicule de 2003 représentera la moyenne des étés dans cinquante ans et que les périodes caniculaires seront fréquentes. Cela doit amener à anticiper la modification des paysages et les risques pour les forêts. La modélisation des conséquences du réchauffement sur l'état de la forêt en 2100 montre une forte réduction de la diversité des paysages en France, dans la mesure où un degré de réchauffement revient à situer notre pays géographiquement 100 km plus au sud. En 2100, le paysage méditerranéen occuperait donc la moitié du territoire et les chênes traditionnels auraient pratiquement disparu au profit des pins. Logiquement, le risque d'incendie sera bien plus important, similaire à ce qu'il était en août 2003, et on peut penser que le représentant de la sécurité civile aura en conséquence des choses à dire sur l'adaptation. Mais cela doit aussi conduire, tout comme d'ailleurs l'augmentation de la fréquence des tempêtes, à adopter des stratégies spécifiques en matière de plantations et d'analyse des risques. Le réchauffement aura aussi des effets sur notre production vinicole. On a déjà avancé d'un mois la date des vendanges. Selon l'INRA, l'évolution des vignobles offrirait une revanche aux Britanniques, puisqu'en 2100 on produira le bordeaux et le champagne dans le sud de l'Angleterre, tandis que notre viticulture sera dominée par le chianti et le sidi brahim. Un travail important devra donc être fait sur les cépages si l'on veut maintenir les productions là où elles sont actuellement. Nous travaillons aussi, en particulier dans le cadre du plan Rhône, à la question du refroidissement des centrales électriques. Engager une stratégie d'adaptation, c'est aussi anticiper les menaces liées à l'eau : d'abord les sécheresses, la désertification, l'augmentation lente du risque d'incendies de forêts ; mais aussi des inondations plus fréquentes et plus graves, avec la modification de la pluviométrie et des vents ; ainsi que l'augmentation lente du niveau des océans et le réchauffement, qui aura des conséquences dramatiques pour la faune et la flore aquatiques. L'adaptation, c'est également anticiper la disparition des glaciers et la réduction des périodes d'enneigement, qui auront déjà diminué considérablement dans les Alpes en 2050. On peut donc se demander s'il convient encore de bâtir des stations de ski en moyenne montagne, sauf à faire usage des canons à neige, avec les risques que cela comporte pour les nappes phréatiques. Sans doute convient-il d'aller vers un tourisme plus diversifié et vers des équipements adaptables, voire démontables. Au-delà de l'adaptation, nous proposons aussi d'engager une stratégie d'atténuation du réchauffement climatique. Le premier défi énergétique est bien sûr de réduire les émissions de CO2 pour limiter le réchauffement. Si on regarde la part des différents secteurs dans les émissions de gaz à effet de serre, on voit que l'industrie domine, et que les transports sont préoccupants, ainsi que le bâtiment et même l'agriculture, en raison des émissions de méthane. Si on veut aller vers le « facteur 4 » préconisé par le plan Climat de 2004 et la loi sur l'énergie du 13 juillet 2005, il faut faire des efforts considérables, notamment en matière de transports. Le deuxième défi énergétique consiste à réduire la vulnérabilité des territoires face au renchérissement et à la disparition progressive des énergies fossiles. En effet, la seule des énergies fossiles encore largement disponibles est le charbon, mais il rejette beaucoup de gaz à effet de serre et on ne peut donc miser sur lui que si on est capable de stocker le carbone et de maîtriser les rejets. Qu'on parte des réserves énergétiques prouvées - 900 milliards de tonnes - ou supposées - 4000 milliards -, la probabilité d'une augmentation des prix et d'un accroissement du poids de la facture énergétique par rapport au PIB est forte. Le peak oil devrait intervenir au plus tôt en 2010, au plus tard en 2030, ce qui est demain à l'échelle de l'aménagement du territoire, avec les conséquences que l'on imagine pour notre compétitivité. Tout l'intérêt de la stratégie d'anticipation par la réduction de la dépendance énergétique est donc de nous préparer au mieux aux chocs prévisibles, de réduire la vulnérabilité des territoires. Dans ces conditions, que peut-on attendre d'une politique territoriale de développement durable ? D'abord qu'on se préoccupe bien davantage de la durée de vie des constructions humaines. Je faisais récemment observer que le viaduc de Millau serait toujours debout alors qu'on n'aurait à coup sûr plus de pétrole, de gaz et même de charbon. Je ne veux pas dire qu'il ne fallait pas construire le viaduc, mais qu'il était nécessaire de réfléchir à la durée de vie de ce que nous engageons aujourd'hui. Il faut aussi repenser le lien entre urbanisme et mobilité. Voyez l'approvisionnement des ménages : si on prend en compte la consommation en énergie, la production de CO2, la surface occupée, les polluants et le bruit, on s'aperçoit que le commerce de proximité est plus intéressant que la livraison à domicile et, surtout, que la grande surface en périphérie. Une telle analyse va à contre-courant de la stratégie menée depuis plusieurs années. Il convient aussi de prendre bien davantage en compte la problématique des transports. Les déplacements des Français en 2003, ce sont : 195 milliards de kilomètres parcourus tous modes de transport confondus ; plus du tiers des voyages sous forme d'allers-retours effectués dans la journée ; un déplacement en voiture sur quatre inférieur à 1 km, un sur deux inférieur à 3 km ; plus de la moitié des kilomètres parcourus en voiture, 31 % en avion, 11 % en train ; une consommation d'énergie très forte pour les déplacements en avion moyen courrier et en voiture, très faible pour le vélo et la marche à pied. Si on s'intéresse aux quatre composantes de la prospective transport, on voit qu'on mise beaucoup sur le progrès technique, avec l'objectif d'un gain de 50 %, mais on aurait tort de négliger la maîtrise de la mobilité et le transfert modal, qui permettraient chacun de gagner 15 %, et les substitutions d'énergie, avec un gain potentiel de 10 %. Ce qu'a fait la ville de Lorient en matière d'économies d'eau et d'énergie me paraît un bon exemple de ce qu'on peut attendre d'une politique territoriale de développement durable. La diminution de la consommation dans les écoles a permis un retour sur investissement en moins de trois ans. La sensibilisation de la population a fait gagner vingt jours de consommation en quatre ans. Les économies en eau et en énergie dans les bâtiments publics représentent désormais près de 2,5 millions d'euros par an et leurs émissions de CO2 ont atteint l'objectif de Kyoto. On voit bien que le développement durable n'est pas une charge mais une opération « gagnant-gagnant » et que les investissements initiaux permettent rapidement des économies budgétaires importantes. C'est pourquoi nous préconisons que les surcoûts éventuels ne soient pas couverts par des subventions, mais par des prêts bonifiés, qui prendraient en compte l'idée de rentabilité. Un autre exemple connu est celui de la ville de Fribourg, qui a mené très tôt une vraie politique de déplacements afin de favoriser les transports en commun et les déplacements piétons ou cyclistes, ainsi qu'une réflexion sur la place de la voiture. Cette politique a conduit à un rééquilibrage entre l'usage de la voiture particulière, des transports en commun et du vélo. Je rappelle en outre que cette ville compte à elle seule autant de capteurs solaires que toute la France. On peut aussi citer l'exemple de Beddington et du site Bedzed - zed pour zéro défaut -, où on essaie de réduire l'empreinte écologique, c'est-à-dire ce qui fait, comme l'a dit le Président de la République à Johannesburg, que si tout le monde vivait comme nous vivons en Occident, il faudrait aujourd'hui trois planètes. Dans cet endroit expérimental à 20 km de Londres, où les habitants viennent de toutes les classes sociales, si la part de l'alimentation reste à la moitié de l'empreinte, ce qui peut poser des problèmes en termes de transport puisqu'on a calculé que les produits constituant une assiette moyenne avaient effectué 3000 km, en revanche les parts des déplacements, des biens et services et du bâtiment ont été réduites de 30 à 40 %, grâce à des constructions intelligentes de type HQE et à énergie positive, c'est-à-dire qu'ils en produisent plus qu'ils n'en consomment. Dans la perspective des jeux olympiques de Londres, l'idée est de parvenir à des constructions de type OPL - One Planet Living. Il convient d'aller non plus vers un aménagement des territoires mais vers un « ménagement » durable. Ceci suppose de réaliser des scénarios de l'inacceptable et vivre avec le risque, c'est-à-dire de développer une culture du risque et déterminer les risques et les vulnérabilités. De travailler sur la notion de territoires exposés et sur son articulation avec les territoires de gestion de risques. De bâtir, face aux incertitudes, des scénarios de l'inacceptable et les considérer comme probables. De définir une stratégie d'action qui cherche à empêcher que le scénario de l'inacceptable devienne une réalité. De territorialiser des politiques énergétiques par : la cartographie des gisements locaux d'énergies, des vulnérabilités énergétiques, des gisements de MDE, des risques cumulés naturels et technologiques. De favoriser les stratégies « sans regret » qui renforce la compétitivité et l'attractivité du territoire, en appliquant la règle « des six D » : « dédramatiser, décarboniser, dématérialiser, diversifier, dévulnérabiliser, découpler ». De réduire la vulnérabilité énergétique de la France. De définir une stratégie d'action qui cherche à développer des infrastructures d'aménagement du territoire adaptables et multifonctionnelles dans le temps. D'utiliser le développement durable du territoire comme un support de production, mais aussi de commercialisation et de séduction du consommateur. De promouvoir l'intelligence territoriale durable. Dans ce contexte, le développement durable doit être, aux côtés de la cohésion sociale territoriale et de la compétitivité, au cœur du Cadre de référence stratégique national, des programmes opérationnels régionaux, et des futurs contrats de projet État régions, qui seront lancés en 2007. M. le Président : Je vous remercie pour cet exposé très long mais très intéressant et j'invite Mme Allais à un peu plus de concision, afin que nous ayons le temps de débattre avec tous nos invités. Mme Violaine ALLAIS : Je vais donc essayer de vous faire part rapidement des réflexions du Conservatoire du littoral, à partir des travaux réalisés par le conseil scientifique de notre établissement et d'une étude publiée l'an dernier sous la forme d'une note technique de l'ONERC, documents qui peuvent être consultés sur www.conservatoire-du-littoral.fr et sur www.onerc.gouv.fr. Nous nous sommes particulièrement intéressés à deux effets potentiels du réchauffement sur les 175 000 ha que représente le total des sites déjà acquis et de nos projets d'acquisition : l'élévation probable du niveau de la mer, qui, selon le GIEC, devrait atteindre 44 cm en 2100, et l'augmentation de la force et des fréquences des tempêtes. L'objectif du Conservatoire est d'anticiper les effets du changement climatique sur son patrimoine comme sur ses modes d'intervention. Pour cela, nous nous sommes plus particulièrement intéressés à l'étude de deux effets potentiels : l'accélération de l'érosion des falaises et des plages et l'extension des submersions, temporaires et permanentes, des côtes basses. L'étude de l'érosion repose sur la quantification du recul ou de l'avancée du trait de côte et sur le calcul de la surface perdue ou gagnée à l'horizon 2100. Par exemple, on s'aperçoit que la falaise de la valleuse d'Antifer, en Seine-Maritime, devrait reculer de 20 mètres d'ici la fin de notre siècle. Nous avons mené des travaux similaires pour l'ensemble des terrains du Conservatoire en utilisant la méthode historique. L'étude de la submersion des sites endigués repose sur trois critères : le niveau marin, la hauteur du sommet de la digue et son état, le niveau des polders. Pour sa part, l'étude de la submersion des marais non endigués se fonde sur la mesure de leur altitude et sur l'estimation de la résistance des cordons littoraux qui les protégent. Au total, l'érosion devrait être de 1 à 1,2 %, et concerner ainsi 650 ha de notre patrimoine actuel et 1500 de notre patrimoine futur, la submersion totale devrait atteindre 10,6 à 21,1 %, soit 5 000 ha du patrimoine actuel et 30 000 ha du patrimoine futur, la submersion hors sites endigués serait quant à elle de 2,6 à 3 %, c'est-à-dire 1 300 ha du patrimoine actuel et 3 000 ha à l'avenir. À partir de ce travail, nos perspectives sont : d'étendre le travail engagé à l'outre-mer, deux études pilotes venant d'être engagées à Mayotte et en Guadeloupe à cette fin ; d'adapter la stratégie de l'établissement en réfléchissant aux modalités d'intervention et de gestion des terrains sensibles à l'élévation attendue du niveau marin. Pour cela, nous entendons, sans chercher nullement à minimiser les changements en cours, poser les termes du débat de façon apaisée afin d'adopter les stratégies les mieux adaptées à des espaces naturels fortement fréquentés ; de proposer un ensemble cohérent d'actions sur ces milieux, en dépassant l'analyse purement physique de l'évolution du trait de côte et en intégrant les facteurs humains et socio-économiques, afin d'aller, avec nos partenaires, vers des modes d'intervention et de gestion adaptés au changement global. M. le Président : Le tableau a été bien brossé par ces exposés complémentaires. Nous aimerions que les discours comme ceux que nous venons d'entendre servent de base aux politiques qui sont menées, mais ce n'est pas toujours le cas. Compte tenu de l'augmentation des risques d'incendie et d'inondations liés à la modification des climats, il me paraît intéressant de savoir comment va réagir la Sécurité civile. M. Patrice LEFEBVRE : Le changement climatique est une préoccupation de la sécurité civile, même si elle intervient un peu en bout de chaîne. Dans sa démarche de modernisation engagée par la loi du 13 août 2004, le changement climatique et ses effets trouvent un certain nombre d'applications. Nous souhaitons en particulier promouvoir, avant, pendant et après, une démarche globale de gestion de crise reposant sur : la prévention, pour avoir une meilleure connaissance des risques ; la prévision, afin qu'un dispositif de veille et de vigilance permette de mieux alerter la population ; une planification rénovée ; des modalités d'intervention fondées sur l'unité de commandement et la solidarité ; une intégration du retour à la normale dans la gestion de crise ; un retour d'expérience permettant d'analyser les compétences mises en œuvre et de réadapter le dispositif. La prévention et la meilleure connaissance des risques liés aux phénomènes extrêmes font l'objet de travaux menés en partenariat avec Météo France au sein de la commission de sécurité civile du Conseil supérieur de la météorologie. Même si nous ne disposons pas d'élément très précis permettant de localiser et de quantifier ces phénomènes, nous cherchons à tenir compte de la vulnérabilité dans le cadre de toutes les politiques de prévention menées conjointement avec le ministère de l'écologie et du développement durable. En fait, notre souci est d'être en état de veille permanente pour mieux anticiper le risque et de développer un concept de vigilance qui s'appuie sur la vigilance météorologique permettant d'informer la sécurité civile, les autorités en charge de la gestion de crise, ainsi que la population, du risque qui pourrait survenir. Nous cherchons constamment à adapter ce concept de vigilance aux phénomènes. C'est le sens de son extension à la canicule et au grand froid, de la réflexion sur une nouvelle articulation des risques météorologiques et hydrologiques, des travaux conduits avec le ministère de l'écologie sur la surveillance des crues, de l'extension envisagée au Sud-Ouest du pays du dispositif d'indicateurs de feux de forêt actuellement appliqué dans le Sud. L'adaptation a une dimension plus forte et plus opérationnelle dans notre démarche de planification depuis la loi de modernisation de la sécurité civile. Le nouveau dispositif de type ORSEC peut s'appliquer à tous les événements, même les moins prévisibles. À partir d'un recensement des risques, nous voulons pouvoir apporter une réponse unique de gestion de crise mais avec un dispositif modulaire, progressif, permanent, adapté et adaptable. M. le Président : Notre rôle est de faire des recommandations, et nous souhaitons que vous nous y aidiez sans entrer, faute de temps, dans le détail des politiques que vous menez mais en insistant surtout sur ce qu'il faut faire pour le futur. Dans ce domaine, la précision de l'information débouchant sur la décision de l'autorité publique est particulièrement importante, on le voit bien lorsque les autoroutes sont bloquées : on reproche tout autant à l'Equipement de les bloquer trop tôt que trop tard. Mme Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET, Rapporteure : J'ai trouvé très intéressant le graphique sur la durée de vie des équipements. En tirez-vous la conclusion qu'il faut changer de priorités et réorienter certaines politiques comme le Plan Climat, par exemple du subventionnement de certaines cultures, qui ne durent qu'un an, vers l'habitat, qui dure au moins cent ans ? M. Gilles PENNEQUIN : La question est difficile. En fait, ce graphique est d'abord destiné à favoriser une prise de conscience et j'aimerais qu'on le lise à l'éclairage des objectifs du « facteur 4 ». Par exemple, quand on engage la construction d'une route, il me paraît nécessaire de réfléchir au carburant qu'utiliseront les voitures qui l'emprunteront demain, et même de se demander si on aura encore besoin de tels équipements quand l'énergie sera devenu très chère et que cela aura eu des effets sur la mobilité de la population. Quand on s'intéresse à la durée de vie, il faut chercher à mesurer le besoin réel. Mme la Rapporteure : Vous recommandez donc en fait des transferts entre différentes parties du Plan Climat. M. Gilles PENNEQUIN : La question mérite en tout cas d'être posée, comme nous le faisons d'ailleurs dans Territoires 2030. M. le Président : Quand on entend M. Pennequin, on peut en effet se demander par exemple si l'argument d'une augmentation prévisible du trafic européen suffit à justifier le doublement les autoroutes A31 et A32. Quel est votre avis, Monsieur Lelarge ? M. Pascal LELARGE : Je ne représente pas le ministère des transports et de l'équipement, mais la direction générale de l'urbanisme. Pour notre part, nous adhérons à l'idée qu'il faut raisonner à partir des équipements structurants, se demander à quoi seront voués les sites qu'on construit, quel sera l'usage des valeurs urbaines et foncières collectives ainsi créées, et bâtir de la sorte la planification, au lieu de mettre la charrue avant les bœufs. Nous devons en particulier interroger les territoires sur ce que sont leurs « business plans » et sur la façon dont ils veulent s'équiper. Il convient dès lors d'envisager l'aménagement, en fonction des enjeux d'accessibilité, de la vocation des programmes immobiliers et des équipements, notamment d'un point de vue économique. Cela revient en fait à reprendre la méthode ABC des Hollandais, les lettres A, B et C caractérisant des niveaux de desserte ou d'accessibilité d'un territoire donné, qui présente un intérêt méthodologique marqué. Les équipements sont lents à mettre en place, créent des valeurs collectives, ne peuvent être privatisés, présentent une rigidité très forte, et les choix qui sont faits ont des conséquences pour l'avenir. On doit donc en particulier s'interroger sur les infrastructures urbaines, et c'est bien là que se pose la question du choix du mode, par exemple pour les grandes infrastructures de transport, entre l'interurbain, le transport longue distance, les autoroutes, et les équipements structurants pour les transports en commun et les déplacements collectifs. Par ailleurs, plus les taux d'actualisation sont élevés, plus on est dans une logique de court terme, plus les taux sont bas, et plus ce qui se passe au-delà de trente ans prend du sens. Il s'agit donc de questions très importantes, au-delà de savoir s'il faut ou non construire une autoroute, et on a certainement intérêt à revoir la méthodologie qui fonde aujourd'hui le travail de planification. M. le Président : S'agissant du bâtiment, tout le monde dit qu'il faut économiser l'énergie sur les constructions neuves, mais cela ne sera évidemment pas suffisant puisqu'on ne renouvelle guère qu'un pour cent du parc chaque année. Il faut donc travailler essentiellement sur la rénovation de l'ancien, mais ni la production d'énergie ni la haute qualité environnementale ne paraissent aujourd'hui des priorités. M. Pascal LELARGE : Autant je suis critique sur la politique d'équipement, autant je considère qu'il n'y a aucune raison de s'auto flageller en ce qui concerne l'immobilier car beaucoup a été fait. Ainsi la régulation thermique progresse rapidement. M. le Président : Celle de 2002 n'était pas suffisante et celle de 2005 n'est pas encore en œuvre. En tant qu'ancien président d'un office HLM, je sais bien que nous n'avons pas eu une seule aide pour la haute qualité environnementale et que ce sont donc les locataires du mouvement social qui ont payé pour cela. Bien sûr, alors qu'on était à 300 kWh/m2/an, on est aujourd'hui à 120 ou à 150 en moyenne, mais on pourrait être à moins de 50 pour tous les bâtiments ! M. Pascal LELARGE : Je réponds simplement à votre question qu'en effet il se passe des choses : la régulation thermique 2005 est en train de sortir et elle sera mise en œuvre cette année. Elle prolonge ce qui se fait déjà pour tous les travaux de réhabilitation. M. le Président : Quel soutien concret ? Combien d'euros par mètre carré ? M. Pascal LELARGE : Je récuse l'idée que c'est par principe la redistribution nationale qui doit supporter l'intégralité de cet effort. Il y a ce qui relève de l'évolution des normes, qui s'impose à tout le monde, et ce qui est du domaine de l'incitation, qui peut bénéficier d'un crédit d'impôt. Mais vous savez bien que ce qui importe aux locataires, ce sont leurs quittances et leurs charges, et les investissements qui sont faits visent bien à une réduction de ces dernières. Peut-être l'Etat n'insiste-t-il pas assez sur ce point, mais la rentabilité de ce qui est fait actuellement dans l'ancien est forte. Et il ne s'agit pas seulement d'une rentabilité socio-économique : chaque locataire peut en tirer directement profit. M. Serge POIGNANT : Je ne suis pas persuadé que les prêts bonifiés soient suffisant pour l'ancien, qui constitue pourtant le principal gisement. M. Pascal LELARGE : Il est vrai que c'est dans l'ancien qu'on pourra réaliser le plus de gains, les ministères de l'équipement et de la cohésion sociale en sont persuadés. Une première série de mesures sera prise cette année, en particulier pour obliger à utiliser certains matériaux. Cela pose toutefois le problème de ceux qui réalisent eux-mêmes les travaux. M. Gilles PENNEQUIN : Il y a en effet ce qui relève de la régulation thermique pour le neuf mais l'essentiel de l'effort doit porter sur l'ancien. Le problème est que dans le parc social, à coups de petites réhabilitations, les occupants ont atteint le plafond de loyer. Le coût de travaux supplémentaires réalisés par les offices HLM ne serait donc pas récupérable sur les loyers. Il faudrait donc soit revoir le décret charges afin de réenvisager l'augmentation des loyers en fonction de l'investissement réalisé par le promoteur, soit passer en effet par des prêts bonifiés. M. Philippe TOURTELIER : Je veux revenir à la fois sur l'intérêt du commerce de proximité par rapport à l'hypermarché et sur le fait que les transports représentent la moitié de l'empreinte écologique de l'alimentation. Je regrette que nos auditions ne nous aient pas permis d'aborder la question de fond du transport des marchandises. Nous avons simplement parlé un peu du fret, mais nous ne nous sommes pas du tout penchés sur le commerce européen et international. Or je suis de plus en plus persuadé que la théorie de l'avantage comparatif devrait être remise en cause pour y intégrer le coût du carbone et le trajet entre les lieux de production et de consommation. Cela amène aussi à poser autrement la question de l'agriculture, qu'a illustré l'exemple cité par Nicolas Hulot de cette collision entre deux camions chargés de tomate, l'un venant des Pays-Bas et se dirigeant vers le Portugal, l'autre allant d'Espagne vers le nord de la France. M. le Président : Je propose précisément que nous en venions à l'agriculture. M. Jacques DEDIEU : L'adaptation aux changements climatiques dans les domaines qui relèvent du ministère de l'agriculture ne date pas d'aujourd'hui mais d'hier car ces changements sont perceptibles dans des phénomènes qui se produisent depuis déjà quelques décennies, telles les grandes tempêtes qui ont abattu une partie importante des forêts européennes depuis une trentaine d'années ou les sécheresses estivales récurrentes. L'impact du changement climatique n'est toutefois pas uniquement négatif dans les domaines agronomiques et sylvicoles. Ainsi, on constate déjà, en matière de dendrométrie, qu'un certain nombre d'espèces ont accru leur rendement de bois de 30 % par an. Cela peut toutefois entraîner des carences en magnésium et en calcium dans les zones les plus pauvres et aux limites de l'aire naturelle d'une espèce. Dans le domaine agricole aussi, on observe un accroissement des productions de céréales. Tout ceci repose sur la capacité d'adaptation des milieux et des espèces végétales elles-mêmes à une certaine variation du climat. Mais on ne saurait bien sûr se reposer sur cette seule capacité pour s'exonérer de réfléchir aux conséquences plus lourdes qui résulteraient de l'amplification des évolutions climatiques attendues, notamment en matière forestière, avec une réduction probable de la durée de vie de certains peuplements et le risque de nouvelles attaques parasitaires. La stratégie du ministère de l'agriculture suppose que plusieurs axes d'adaptation soient empruntés simultanément. La veille scientifique apparaît comme une priorité, afin de bien observer tous ces phénomènes, dont certains sont paradoxaux. Ainsi l'adaptation à la sécheresse conduit à consommer moins d'eau, ce qui fait que les plantes ont un réflexe positif par rapport à l'une des plus graves pénuries qui nous menacent. Autre axe important, la gestion des crises, avec l'apparente augmentation d'occurrence et d'amplitude des phénomènes cataclysmiques, avec des pics : gelées tardives, réchauffements ou de refroidissements locaux. Il s'agit en fait de phénomènes extrêmement complexes et, toutes les productions naturelles étant étroitement liées aux évolutions des écosystèmes, les efforts de recherche sont fondamentaux. Il est également essentiel de développer les bonnes pratiques. Ainsi, en agriculture, des progrès peuvent être faits dans la conservation des sols, les économies d'eau et l'utilisation des produits phytosanitaires. C'est tout l'enjeu de la stratégie de développement durable de notre ministère, qui doit pousser à ce que l'agriculture évolue favorablement. L'effort de recherche doit aussi permettre de se projeter vers l'avenir, en particulier pour modifier plus fondamentalement les rotations et les systèmes de culture. Bien évidemment, l'agriculture s'inscrit dans un contexte international qui peut conduire, en fonction des avantages compétitifs des diverses régions agricoles du monde à une spécialisation des espaces. Va-t-on, par des stratégies internationales, européennes ou nationales, favoriser ce mouvement ? Il faut se garder de visions simplistes, comme par exemple dans l'exposé de la DATAR, la carte sensée représenter l'évolution prévisible des aires de répartition des principales essences forestières de l'hexagone. Il me semble en effet qu'elle fait trop abstraction d'un certain nombre de phénomènes, en particulier de l'intervention humaine, qui aura un effet considérable pour faire en sorte que ce que montre cette carte ne se produise pas. M. le Président : Cette carte découle de la transposition d'un modèle de températures. Mais la canicule de 2003 a déjà montré que des arbres qui n'étaient pas dans leur aire naturelle et même des chênes avaient beaucoup souffert. M. Jacques DEDIEU : C'est bien pour cela que nous devons dès aujourd'hui adopter une stratégie, notamment pour la forêt, où l'investissement réalisé à l'occasion du renouvellement des peuplements ne portera ses fruits qu'au bout d'un siècle. Le choix des essences doit s'appuyer sur la cartographie des types de stations dont la description a été entreprise il y a plus de vingt ans. Nous savons bien qu'on a pu, à l'occasion de reboisements antérieurs, privilégier des espèces qui n'étaient pas totalement adaptées et qui se trouvaient en limite d'aire naturelle. Le chêne pédonculé est en recul depuis une vingtaine d'années. Des réajustements vont s'opérer et il faut faire très attention dans les introductions d'espèces exotiques, afin par exemple de ne pas installer dans des milieux alluviaux de plaine, où les fluctuations de nappes peuvent être importantes, des espèces qui seraient trop sensibles à un excès ou à une pénurie d'eau. Les choix politiques et les méthodes de culture seront fondamentaux. Je souhaite enfin rappeler l'importance de l'utilisation de la biomasse dans le processus d'adaptation de l'agriculture. M. le Président : Nous en venons à l'eau. M. Alexis DELAUNAY : Je ne vais pas entrer dans le détail de l'adaptation dans la politique de l'eau, vous renvoyant pour cela à la note écrite que je vous ai adressée, mais plutôt insister rapidement sur la sécheresse et les inondations. La sécheresse est toujours d'actualité, puisque, faute de pluies cet automne et cet hiver, certains préfets n'ont pas encore pu lever les mesures de restriction de l'an dernier. Nous menons de gros effort d'information en direction des agriculteurs sur les choix de semences afin qu'ils s'orientent vers des plantes moins gourmandes en eau. Dans le projet de loi sur l'eau qui devrait être examiné par l'Assemblée nationale mi-mars, nous engagerons une profonde réforme de la politique de l'eau afin d'encourager la gestion collective et les économies et de mobiliser de nouvelles ressources, si cela est compatible avec le milieu et si l'impact global sur les bassins versants est positif. Sur le plan de gestion de la rareté de la ressource en eau, je vous renvoie aux informations que je vous ai fournies. On l'a vu, les inondations risquent d'être plus fréquentes. Dans le bassin de la Loire, il y avait, avant 1850, 30 000 habitants dans des zones inondables, il y en a aujourd'hui 300 000. La vulnérabilité est donc beaucoup plus grande alors que les épisodes au cours desquels la Loire est passée au-dessus des digues sont appelés à se reproduire. Ceci explique les efforts qui sont faits avec le plan Loire, mais aussi avec le plan Rhône. Nous essayons de faire de même pour la Seine et la Garonne. S'agissant du littoral, l'élévation du niveau de la mer obligera à une planification à long terme dans les zones sensibles. M. le Président : Monsieur Abiven, un mot sur l'outre-mer ? M. Jean-Michel ABIVEN : L'outre-mer, est le domaine des extrêmes, des pôles aux tropiques. Les départements, territoires et collectivités produisent peu de gaz à effet de serre, si ce n'est par le biais des transports, la continuité territoriale appelant d'importants déplacements de marchandises qui ne sont pas toutes produites sur place. En outre, les réseaux d'énergie ne sont pas connectés et des améliorations paraissent donc possibles pour les énergies fossiles. M. le Président : Où en est l'interconnexion des réseaux de la zone caraïbe, que Claude Birraux et moi-même avions préconisée il y a cinq ans dans un rapport, en particulier parce que les ressources en géothermie sont importantes ? M. Jean-Michel ABIVEN : Un projet entre la Dominique, la Martinique la Guadeloupe est à l'étude Les Départements et collectivités d'outre-mer doivent s'adapter aux effets des changements climatiques et à l'intensification, en puissance comme en fréquence, des phénomènes météorologiques. Nous travaillons en premier lieu au renforcement de la sécurité des habitants, la densité étant particulièrement forte dans les zones littorales, les plus menacées. Le maintien de la biodiversité est aussi une préoccupation. Ainsi, les coraux seraient menacés par le réchauffement. Mais nous avons aussi besoin de mieux connaître l'ensemble de ces phénomènes - nous nous y sommes attelés, avec l'ONERC et avec le Conservatoire du littoral - et de développer des réseaux d'intégration régionaux pour l'observation des phénomènes météorologiques. Les autres actions sont pilotées directement par les ministères qui en sont responsables, qu'il s'agisse de l'énergie, des transports ou du logement. Pour sa part, le ministère de l'outre-mer utilise le levier de la défiscalisation, le critère environnemental pouvant être substitué à celui des créations d'emplois. M. le Président : A l'issue de ces exposés, peut-être pouvez-vous, Monsieur Gillet, faire le point de ce qui fonctionne et de ce qui ne fonctionne pas dans les ministères et nous dire ce qu'il convient de faire pour que ça aille mieux. Je ne suis pas persuadé pour ma part que l'importance de la stratégie d'adaptation soit totalement prise en compte. M. Marc GILLET : Il me semble que nous avons identifié de bons interlocuteurs dans pratiquement tous les ministères et que le dialogue est maintenant engagé. Nous avons balayé ici de façon très large des effets du réchauffement, mais la stratégie d'adaptation vise à ce que chaque ministère et chaque collectivité prépare un véritable plan d'adaptation qui permette d'éviter de trop grosses impasses. Ce qui fait largement défaut, ce sont des analyses économiques sur les impacts des changements et il y a donc là un important chantier à lancer pour aller au-delà de la simple analyse des risques. Par ailleurs, beaucoup a déjà été fait pour la gestion des crises, par exemple avec le plan canicule, mais il faut s'intéresser davantage aux structures. Ainsi, quand on parle de bâtiments, on pense aux économies d'énergie mais peu à la protection contre la chaleur, alors que le rapport de l'Institut national de veille sanitaire insiste sur les dommages que la canicule a infligé en raison d'une protection insuffisante apportée par les bâtiments et l'espace urbain. L'aspect européen est également important. L'Union européenne lance un programme sur l'adaptation qui donnera lieu à la fin de l'année à un livre vert. La France y contribuera. Des mesures seront donc prises aussi à ce niveau. Je rappelle enfin que l'ONERC organise à la fin de la semaine, avec la Conférence des régions périphérique et maritime d'Europe, un colloque sur l'adaptation dans ces régions. M. le Président : Merci à tous. Nous n'avons fait qu'aborder certaines questions, mais nous aurons d'autres tables rondes et nous recevrons les ministres de l'environnement, de l'industrie, de l'outre-mer, de la recherche, de l'agriculture, de l'équipement et des transports. N'hésitez donc pas à les y préparer en leur faisant part de notre attachement à la réduction des émissions et aux stratégies d'adaptation. Audition conjointe du Centre national d'études spatiales (CNES) Présidence de M. Jean-Yves LE DÉAUT, président M. le Président : Après nos dernières tables rondes, tournées vers les politiques engagées en matière de changement climatique et l'action des différents acteurs concernés, nous revenons à l'approche scientifique puisqu'il s'agira aujourd'hui de faire le point sur les changements climatiques en cours vus de l'espace. Quel est l'apport des observations spatiales pour la compréhension des évolutions climatiques mais aussi pour la prévision et le suivi des évolutions météorologiques, de la banquise, du niveau des mers, des courants marins, de l'extension des déserts ? Est-il possible d'en tirer des enseignements sur le rôle des océans, de la forêt, des volcans ? Comment s'organise l'action dans ce domaine ? Quelle est l'action du Centre national d'études spatiales, le CNES, et de l'Agence spatiale européenne, l'ESA ? M. Philippe Ciais, du laboratoire des sciences du climat et de l'environnement, fera le point sur les observations spatiales. M. Stefano Bruzzi, de l'ESA, chef du bureau de coordination de la direction des programmes d'observation de la terre, décrira la mission de l'agence spatiale ainsi que le programme européen Global Monitoring of Environment and Security (GMES) et le programme international Global Earth Observation System of Systems (GEOSS) M. Hervé Jeanjean, du CNES, responsable des programmes environnement et développement durable et observation de la terre, qui nous rejoindra dans quelques instants, abordera les missions du CNES et les éléments d'information susceptibles d'en être retirés s'agissant du changement climatique. M. Philippe CIAIS : Je vais vous présenter l'ensemble des processus qui contrôlent l'augmentation du CO2 et les observations qui nous permettent de mesurer, de comprendre et de prédire les évolutions futures de ce gaz à effet de serre. Les clés de l'avenir sont entre les mains de l'homme mais aussi entre celles de la nature puisque 50 % des rejets de carbone fossile sont réabsorbés par la biosphère terrestre et les océans : sans cette subvention naturelle, l'effet de serre additionnel serait deux fois plus élevé et le réchauffement du climat serait bien plus prononcé. L'enjeu consiste par conséquent à comprendre le fonctionnement du cycle bio-géophysique global qui régule les échanges de CO2 entre l'atmosphère, la végétation, les sols et l'océan. Voici les quatre grandes questions scientifiques : Quelles régions ont absorbé du CO2 depuis le début de l'ère industrielle ? Quels sont les processus associés ? L'effet des politiques climatiques sur les sources et puits régionaux de carbone est-il vérifiable ? Comment prédire l'évolution future du cycle du CO2 et du climat ? Il existe des programmes de recherche nationaux mais aussi européens et internationaux, avec GMES et GEOSS. Sur le plan plus politique de la comptabilité des sources et des puits de carbone, les Nations unies disposent d'un secrétariat, basé à Bonn, l'United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) qui reçoit les déclarations. Les mesures océaniques nous permettent de tracer l'entrée de l'excès de carbone fossile dans l'océan. Les océanographes ont mis en évidence un accroissement du taux de carbone, entre 1975 et 1990, dans certaines zones, notamment l'Atlantique nord : ce réceptacle a absorbé un tiers des rejets fossiles. Les observations atmosphériques montrent que tout l'air de l'hémisphère nord passe dans l'hémisphère sud en un an. Ce magnifique intégrateur permet de suivre les variations de CO2 à la surface du globe mais des séries longues sont évidemment nécessaires. Nous utilisons aussi des outils de simulation dérivés des modèles de météorologie pour traduire les mesures de concentration de CO2 atmosphérique sur un réseau de stations en bilan de carbone à l'échelle nationale. La France participe à cet effort international avec son solide réseau de veille atmosphérique. La croissance du CO2 évolue au cours du temps, modulée par les variations du climat, notamment le phénomène El Niño. Les écosystèmes sont très hétérogènes et il est impossible de poser des capteurs partout pour faire la somme de tous les flux. Des méthodes micro-météorologiques de petite échelle (1 kilomètre carré) nous permettent cependant de prendre le pouls de certains écosystèmes, pour mieux y suivre les échanges de CO2 mais aussi de vapeur d'eau et d'énergie. Des régions immenses, comme les permafrosts sibériens ou les forêts équatoriennes africaines, restent complètement blanches sur la carte. Le défi auquel nous sommes confrontés consiste à intégrer ces connaissances dans un ensemble unique cohérent des sources et des puits de carbone. Comment les différentes observations peuvent-elles être combinées ? Un exemple est donné avec la canicule de 2003. Les mesures spatiales et atmosphériques, en suivant la propagation de l'onde de chaleur ont caractérisé avec une grande précision la distribution spatiale et temporelle de la baisse spectaculaire de l'activité végétale, et mis en évidence, à l'échelle du continent européen, une perte de carbone correspondant pratiquement à la moitié des rejets fossiles annuels liés à l'activité humaine - électricité, transport et chauffage. Nous sommes au seuil de la possibilité de mettre les observations et les simulations en commun pour construire un système opérationnel de suivi, de compréhension et de vérification des flux de CO2. La grande canicule de 2003 s'est traduite, en Europe, par une perte de 500 MT de carbone ; si l'on part du principe que, sur le marché des échanges de carbone, la tonne vaut 20 euros, le manque à gagner équivaut à une valeur de l'ordre de 10 milliards d'euros. La connaissance du cycle du CO2 est donc un enjeu scientifique mais aussi stratégique pour aider la décision publique et définir la position d'un pays lors de la négociation des traités internationaux sur la réduction de l'effet de serre. Beaucoup d'incertitudes demeurent et les séries à long terme revêtent une grande valeur. L'enjeu consiste à mettre les analyses en commun et à confronter les mesures in situ, effectuées sur terre, et celles enregistrées depuis l'espace. Celles-ci pourraient être combinées en une seule infrastructure opérationnelle de recherche, sorte de grand instrument voué au suivi et à l'étude des perturbations ; les Européens, en particulier les Français, ont là un rôle stratégique très important à jouer. M. Stefano BRUZZI : J'ai choisi aujourd'hui d'insister sur le rôle que les Européens jouent et devraient jouer davantage encore dans les domaines de la recherche climatique et de la surveillance de l'environnement. Ce domaine est dominé par les doutes et l'un de nos objectifs, dans ce genre de présentation, doit être de soulever des questions et de donner des lignes directrices plutôt que des réponses. Le dossier est en effet très compliqué. Nous sommes harcelés, dans la presse et à la télévision, par des événements, parfois tragiques, liés au changement climatique, à la dégradation de l'environnement, au détournement du comportement du système terre ; ces informations ne sont pas toujours aussi indépendantes et objectives qu'il serait souhaitable. Il faut se donner les moyens de comprendre, surtout en se donnant accès à une information indépendante et fiable. Cela ne signifie cependant pas qu'il faut se rallier à M. Bush et proclamer que les engagements de Kyoto ne sont pas obligatoires. Au contraire, l'Europe doit se doter d'une autonomie intellectuelle pour assurer la sécurité des citoyens. Y a-t-il un changement ? Oui, bien sûr mais lequel ? Surtout, ce n'est pas le premier. Je vous invite à lire le très beau livre Gros temps sur la planète, de Pierre Morel et Jean-Claude Duplessy, qui donne un aperçu des évolutions de la terre à travers les millénaires, en particulier au cours des 2 000 ou 3 000 dernières années. Il ne faut donc pas craindre le changement dès lors qu'il n'est pas abrupt. Notre connaissance des phénomènes qui gouvernent et influencent l'environnement et le climat, étonnamment, est assez limitée, et, pour protéger la terre, nous avons tendance à agir par à-coups. L'une des séries de mesures les plus longues concernant le réchauffement de la planète est celle de la température de la surface marine, suivie par le bureau météorologique britannique depuis 150 ou 160 ans. Cette série a été complétée par des données satellitaires à compter de 1991. Des indicateurs attestent de la dégradation de la banquise en Antarctique : il est clair que la planète se réchauffe. Le taux de CO2 dans l'atmosphère augmente et nous sommes impliqués mais nous traversons aussi une phase de réchauffement naturel, succédant à ce que nous appelons le « petit âge glaciaire », qui démarra il y a quatre cents ans et s'acheva dans la première moitié du xixe siècle. Par malchance, la fin de cette période a coïncidé avec le début des activités industrielles à grande échelle. Il importe que la recherche suive de près les évolutions, en particulier la hausse du niveau de la mer, qui, au xxe siècle, a oscillé entre 1,5 et 2 millimètres par an. En combinant toutes les mesures satellitaires aujourd'hui disponibles, l'on arrive à une progression moyenne de l'ordre de 3 millimètres par an entre 1992 et 2005. Trois satellites européens effectuent ces mesures et nous mettons en place les moyens nécessaires pour poursuivre la série au-delà de 2009 ou 2010, lorsqu'ils cesseront de fonctionner. Mais j'ai parfois l'impression que le seul moyen d'observation globale à portée de chacun est la télévision et c'est très dangereux car ces perceptions ne sont pas toujours validées scientifiquement. Les 3 millimètres par an constituent une moyenne à l'échelle du globe : en certains endroits de la planète, le niveau de la mer s'est élevé ; en d'autres, il s'est abaissé. Je précise que ces satellites mesurent aussi bien les variations du niveau de la mer que celles du niveau des zones émergées puisque les appareils utilisés sont des radars altimétriques calculant la distance qui les sépare de la surface terrestre. Le premier satellite de ce type était d'ailleurs militaire : il était censé reconstituer les surfaces pour injecter les cartes tridimensionnelles dans l'ordinateur de missiles ; ses données ont été déclassifiées et mises à disposition des scientifiques civils en 1991. Avec les satellites, nous effectuons des mesures systématiques des composants atmosphériques. Il apparaît ainsi que le taux de dioxyde d'azote autour de la Chine du Nord est très élevé, ce qui confirme l'importance du niveau de pollution dans la région très industrialisée de la métropole pékinoise. Le trou de la couche d'ozone, depuis quinze à vingt-quatre mois, a disparu des médias ; il évolue, à la hausse et à a baisse, selon des cycles, et cet élément doit être considéré dans l'évolution du climat. Les satellites ont été très utiles dans le cas du tsunami : ils ont livré aux secouristes - malheureusement pas toujours dans les temps - des cartes mises à jour des sites affectés. Ils nous permettent aussi de surveiller l'environnement urbain, par exemple les effondrements imputables aux réseaux de métro. Personne ne sait comment évoluera le processus de réchauffement dans les cent prochaines années. Pour se forger des certitudes et parvenir à des décisions politiques, il faut améliorer les modèles de prévision du climat et les valider sur des périodes de dix à vingt ans. En attendant, la prudence s'impose, hormis pour des choix comme la réduction de l'utilisation des combustibles fossiles, afin de limiter les pollutions urbaines, devenues simplement intolérables. Au fur et à mesure que les satellites ont été utilisés et que les modèles économiques ont été peaufinés, la probabilité d'exactitude des prévisions météorologiques a atteint 95 % à trois jours et, surtout, la précision a convergé sur l'ensemble du globe, alors que les résultats, auparavant, étaient nettement inférieurs dans l'hémisphère sud, à cause du manque de stations météorologiques. La gestion de la terre appelle une approche systémique, globale et nécessite d'éviter les confrontations. Les mesures ponctuelles, locales, les interdictions à effets médiatiques ont souvent de conséquences inimaginables et incontrôlables. Il importe de préserver l'indépendance de la recherche. GMES est une initiative européenne lancée en 1998 par l'Union européenne et l'Agence spatiale européenne, à laquelle se sont rapidement associées les autres agences spatiales, de même que les ministères de l'environnement et de la recherche. GMES, actuellement dans sa phase de construction opérationnelle, a pour objectif, à partir de 2008, de mettre systématiquement l'information opérationnelle à disposition des pouvoirs publics pour le soutien des choix politiques, dans les domaines de la diplomatie de l'environnement, de la sécurité civile, de la gestion des ressources, de l'aide humanitaire, de la sécurité alimentaire et sanitaire. Les informations collectées sont relatives à la désertification, l'état de la végétation, la déforestation. Le lancement d'une série de satellites - les sentinelles de la terre - a été approuvé en décembre en conseil des ministres européens ; ils sont chargés d'assurer la continuité après les satellites actuels, européens et nationaux. Les premiers à s'intéresser à GMES ont été les États-Unis, qui, immédiatement après sa création, ont proposé leur Global Earth Observation Initiative, GEO, afin d'essayer de récupérer la démarche dans un cadre plus gérable pour eux. Nous préconisons en effet la mise en commun des informations dérivées des satellites et la planification conjointe des moyens à déployer, comme cela se fait déjà en matière météorologique. Trois sommets ont été organisés. Lors du dernier, à Bruxelles, en février 2005, a été adopté un plan à dix ans pour un système d'observation des systèmes terrestres. La position européenne a donc permis de rééquilibrer la position américaine et d'adopter une démarche conjointe et paritaire. GMES est devenu à la fois le drapeau de l'indépendance européenne pour l'accès à des sources de données sur l'environnement, le climat et la sécurité de façon indépendante, et le moyen de contribuer à un système international d'observation de la terre. M. le Président : En ce qui concerne les émissions de CO2, ce qui a été perdu une année donnée peut-il être rattrapé ultérieurement ? Autre question : si les variations du taux de CO2 sont cycliques, comment expliquer que la quantité mesurée augmente régulièrement ? M. Philippe CIAIS : Aux années pluvieuses correspondent généralement des puits de carbone plus importants. Nous ne savons pas encore ce qui détermine le comportement du système à long terme mais il semble que la biosphère éprouve plus de difficulté à se remettre d'événements intervenant à une fréquence rapide, par exemple des stress hydriques extrêmes répétés. Si les sécheresses se répètent trop souvent, nous nous acheminerons sans doute vers une altération de la végétation, en particulier dans les stations tempérées ; les essences comme le hêtre étant plus vulnérables à la sécheresse, elles pourraient perdre leur utilité pour la sylviculture. Au-delà de la variabilité de la croissance du CO2, elle-même modulée par la variabilité du climat, un changement de tendance dans les rejets entropiques absorbés par l'océan et la végétation est-il observé ? Depuis quarante ans qu'existent les mesures atmosphériques, le pourcentage moyen de carbone ramené aux émissions anthropiques qui s'accumulent dans l'atmosphère est resté constant : 45 % des émissions restent dans l'atmosphère, causant un surcroît d'effet de serre, et les 55 % restants sont piégés dans l'océan et la végétation. Par contre, entre 1960 et 1990, les émissions de carbone sont passées de 1,5 à 7 milliards de tonnes. Il est donc remarquable que l'océan et la végétation aient pu « tenir le coup » et continuer à absorber le même pourcentage d'émissions. Toutefois, depuis cinq ans, le taux de CO2 non absorbé augmente plus vite qu'au cours des trente-cinq années précédentes et, même s'il est encore beaucoup trop tôt pour conclure à un changement du cycle du carbone, les modèles numériques montrent que le réchauffement du climat peut avoir un impact défavorable sur les puits naturels de carbone : le pourcentage de carbone anthropique demeurant dans l'atmosphère risque d'excéder 50 % en 2050 et d'atteindre 70 à 80 % en 2100. Nous ne sommes donc pas sûrs de continuer à bénéficier des subventions naturelles des puits de carbone dans les décennies à venir. Mme Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET, Rapporteure : Ce processus est-il additionnel ou bien assimilable à celui des rétroactions positives ? M. Philippe CIAIS : Les puits et sources de carbone sont réactifs au climat. L'incidence des sécheresses, depuis cinq ans environ, a été déterminante dans le phénomène de croissance du taux de CO2, mais je répète que nous ne disposons pas de séries de mesures suffisamment longues pour conclure à un changement définitif du cycle du CO2. M. Serge POIGNANT : Vos réserves sur la fiabilité des séries courtes concernant la hausse du niveau de la mer vous sont-elles dictées par une prudence de scientifique ou bien estimez-vous que les modèles mis en avant par certains peuvent être faux ? M. Stefano BRUZZI : Cette question est valable pour le niveau de la mer mais aussi pour les puits de carbone ou le gaz carbonique dans l'atmosphère. Vingt ans de mesures satellitaires, à l'échelle climatique, ne représentent rien. Nous identifions une tendance, nous la mesurons, nous la confirmons, nous l'injectons dans les modèles et nous cherchons à valider ces derniers. Les réponses commencent à arriver et les progrès continueront dans les dix ou vingt prochaines années. Cela ne signifie pas qu'il faut rester inactif : la déforestation, l'augmentation de la température de la mer et la progression du niveau de gaz carbonique sont des faits. Ce qu'il reste à faire, c'est la connexion entre tous les éléments : comment interagissent-ils et influenceront-ils le processus ? M. le Président : Votre invitation à douter des certitudes des journalistes mais aussi de celles des experts nous interpelle. Certains experts, contrairement à vous, nous ont dit qu'il était possible de distinguer ce qui relevait de l'entropique et de l'activité humaine. Êtes-vous en désaccord avec des affirmations justifiant les politiques menées dans certains pays ? Existe-t-il une corrélation entre l'absorption de CO2 par les océans et les variations du niveau de la mer ? Que savez-vous de la déforestation au niveau mondial ? M. Stefano BRUZZI : Quoique n'étant pas un vrai scientifique, je vais vous donner un exemple. La télévision a pris l'habitude de donner les prévisions météo pour toute la semaine. Quand le présentateur est honnête, il assortit ces commentaires d'un paramètre de confiance, compris entre un et cinq. Au-delà de quatre ou cinq jours, les prévisions, à l'échelle locale, sont assez aléatoires. La climatologie est un sujet d'une difficulté énorme. La théorie sur le processus de constitution du trou de la couche d'ozone n'a été validée que quinze ans après avoir valu le prix Nobel à son auteur ; la causalité entre les chlorofluorocarbones et la destruction de l'ozone a été prouvée au terme de vingt ans de travail. Or ce n'est qu'une partie de tout ce qui influence le climat. Les tendances de la prévision climatologique sont claires mais il faut continuer à chercher pour savoir ce qui se passera. M. Philippe CIAIS : La corrélation entre le réchauffement océanique et l'absorption du carbone par l'océan est (pour le moment) presque nulle. Il existe cependant un processus commun : le signal du CO2 fossile, comme celui du réchauffement, provient de l'atmosphère et essaie d'envahir l'océan, à commencer par sa surface. Les régions dans lesquelles les perturbations peuvent pénétrer plus profondément dans l'océan sont donc celles où ce dernier est moins stratifié, où la force des courants marins favorise les échanges entre la surface et les abysses, en particulier l'océan austral et l'Atlantique nord. Si le climat se réchauffe, la stratification de l'océan peut augmenter et limiter en retour l'absorption du CO2 future. M. Michel PETIT : Les rapports du groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat, le GIEC, mettent très clairement en avant les parts d'erreur qui affectent leurs différentes affirmations et estimations. M. Philippe CIAIS : Pour la prévision du temps, il suffit d'attendre un jour ou deux pour savoir si le météorologue avait raison. Pour la prévision du climat, il faut se montrer un peu plus patient. Cela dit, le réchauffement climatique a été annoncé devant le sénat américain, en 1988, avec trois scénarios d'émission de CO2 et de réchauffement associés. Cette théorie, élaborée à l'époque avec une puissance de calcul très faible et une connaissance des processus climatiques bien moindre qu'aujourd'hui, était alors très contestée mais le scénario médian produit en 1998 est extraordinairement proche de ce que mettent en évidence les modèles actuels. Les climatologues, il y a vingt ans, ne se sont donc pas moqués de nous. M. Robert KANDEL : La démarche de la prévision déterministe et numérique du temps s'améliore très nettement et les résultats à quatre ou cinq jours sont à peu près bon, mais ce n'est pas valable au-delà de quinze jours. La projection climatique est différente et il est possible de remonter bien au-delà de vingt ans : en 1896, il avait été prévu que le taux de gaz carbonique dans l'atmosphère augmenterait à cause de la combustion du charbon à grande échelle - ce qui s'est vérifié en 1975 - et qu'un effet se ferait aussi sentir en matière de température. En 1975, la National Defense University a réuni des climatologues pour réfléchir sur l'avenir. Un rapport de la CIA craignait alors un possible retour des glaces et un article évoquait un éventuel refroidissement dû à l'augmentation de l'effet parasol et poussière des aérosols sulfatés. Après discussion, ce groupe de climatologues est arrivé à la conclusion qu'un réchauffement se produirait autour de 2000. En 1982, l'agence américaine pour la protection de l'environnement a publié un rapport prévoyant le réchauffement de la planète dans les années quatre-vingt-dix. Le renforcement de l'effet de serre et le réchauffement accéléré imputables aux activités humaines sont certains. L'incertitude porte sur le cycle de l'eau et sur la rétroaction positive du cycle de carbone, ce qui appelle des efforts importants de la part des agences spatiales afin d'obtenir des informations et de valider les modèles. M. Michel PETIT : Ma prudence portait sur la prévision de ce qui se passera dans l'avenir. Les émissions humaines de gaz à effet de serre jouent un rôle dans le réchauffement climatique actuel, c'est de plus en plus sûr : nous en sommes maintenant virtuellement certains. M. Christian DECOCQ : Il y a une vingtaine d'années, les hydrauliciens, hydrogéologues et autres ingénieurs spécialistes des problèmes de l'eau avaient déjà conscience de l'existence de cycles, avec des années sèches ou humides. Les mesures enregistrées par le passé sont-elles recoupées avec les cartes de la production de gaz à effet de serre et du réchauffement climatique ? M. Robert KANDEL : Il est probable que le réchauffement entraînera une rétroaction de vapeur d'eau positive. En revanche, pour la répartition des précipitations et le ruissellement, les résultats sont contradictoires et il reste encore beaucoup de travail à accomplir. Les satellites ont décelé des variations de la quantité d'eau dans le sol, en particulier, pendant la canicule de 2003, une perte de masse sur le continent européen, ou plutôt sur ce que j'appelle la presqu'île européenne. En raisonnant en valeurs moyennes, on perd de vue nombre de problèmes significatifs spécifiques à une période ou une région. Quoi qu'il en soit, l'effet de serre et le renforcement planétaire auront des effets extrêmement importants sur l'opération du cycle de l'eau. M. Stefano BRUZZI : La certitude, aujourd'hui, porte sur les tendances : nous sommes en mesure de vérifier des prévisions datant d'il y a quinze ou vingt ans. Mais le climat est une affaire de longue haleine ; quelle que soit la justesse des intuitions, nous ne comprendrons pas tout en cinq, dix ou vingt ans. Nous devons par conséquent nous assurer un accès aux informations - par le biais des satellites, mais pas seulement -, de façon continue, à long terme, pour disposer de séries. Les prévisions non déterministes se vérifient parfois mais la démarche ne s'arrête pas là : il faut être en condition d'assurer une recherche continue et indépendante. M. le Président : Le quatrième rapport du GIEC conclurait à l'existence d'un lien entre les activités humaines et le réchauffement et prévoirait, pour le xxie siècle, une tendance de réchauffement moyenne supérieur à celle du xxe siècle. N'est-il pas démobilisateur de mettre en avant les activités entropiques ? Cela ne risque-t-il pas d'empêcher la prise de décisions politiques ? M. Stefano BRUZZI : Je ne voudrais pas que nous nous arrêtions au peu de certitude que nous détenons aujourd'hui ; il est indispensable de continuer à chercher, indépendamment des autres facteurs. M. le Président : Vous ne préconisez aucune mesure politique ? M. Stefano BRUZZI : Si. Le taux de CO2 dans l'atmosphère, ces dernières années, a fortement augmenté, mais le système doit être modélisé dans sa totalité car la fonte des glaces polaires ou l'inversion du Gulf Stream, par exemple, affecteront aussi les cycles du carbone et de l'eau. Nous lançons pour la première fois des satellites qui nous permettront de dresser une cartographie hydrographique de la planète. La première décision politique à prendre est de ne pas stopper la recherche et de lui donner les moyens de fonctionner. M. Philippe CIAIS : Le taux de CO2 a augmenté de 30 % et est plus élevé qu'il ne l'a jamais été pendant les 25 millions d'années précédents ; c'est une certitude, un « known-known ». Il existe des « known-unknown » : le cycle de l'eau va se réajuster sous l'influence du réchauffement mais nous ne savons encore quelles régions du monde seront les plus touchées. Enfin, des phénomènes sont potentiellement capables de complètement déstabiliser le système et peuvent constituer des surprises, ce sont des « unknown-unknown » : par exemple, les sols gelés, en Russie, contiennent 400 milliards de tonnes de carbone, et nous ignorons comment ce stock monstrueux résistera au changement hydrologique et climatique. Mme Geneviève COLOT : La fonte des glaciers sera-t-elle plus ou moins importante que l'évaporation ? Le niveau des mers continuera-t-il de s'élever ou le mouvement va-t-il s'inverser ? M. Robert KANDEL : Le cycle de l'évaporation est très rapide. Le principal problème, au xxIème siècle, sera celui du réchauffement des 100 ou 200 mètres de la couche supérieure des océans. La hausse du niveau de la mer de 30, 50 ou 70 centimètres d'ici à 2100 sera surtout imputable à une dilatation thermique. La plupart des glaciers du monde sont en repli, en particulier dans les Alpes et les Andes, et cela contribuera aussi à élever le niveau de la mer. La glace flottante de l'océan arctique disparaîtra sans doute mais cela ne modifiera pas le niveau de la mer. Concernant l'Antarctique, si la quantité de glace qui fond est supérieure à la quantité de neige qui tombe, le niveau montera ; si, au contraire, les précipitations neigeuses font plus que compenser les pertes, l'inverse se produira. En tout cas, la sécheresse constituera le grand problème de l'avenir et nécessite énormément de recherches. M. Hervé JEANJEAN : Je vais vous présenter l'action du Centre National d'Etudes Spatiales, le CNES, en ce qui concerne la problématique du changement global. Les observations à partir de l'espace sont répétitives, en principe facilement intercomparables et suivent toutes les échelles, du global au local. Elles fournissent des estimations de paramètres physiques, chimiques ou biologiques complémentaires aux mesures effectuées au sol : le dispositif spatial, seul, ne peut aboutir à rien. Les observations spatiales constituent néanmoins un élément essentiel ; elles permettent dans bien des cas d'alléger des réseaux au sol coûteux en investissement humain et matériel. Mais attention de ne pas vouloir remplacer le terrain par le spatial. Ces informations sont utilisées pour évaluer les conséquences de scénarios de politiques d'environnement. Le CNES n'est pas chargé d'élaborer les politiques environnementales : Il tente de répondre à une demande en mettant en œuvre des missions spatiales pour aider la communauté scientifique à faire tourner ses modèles et à transformer les données d'observation de la terre en informations utiles pour les décideurs. Les données obtenues par satellite et in situ sont assimilées dans des modèles numériques Les missions du CNES peuvent être classées en trois catégories. Les missions sur les processus environnementaux sont destinées à mieux comprendre un processus, aux interfaces ou au sein des grands domaines. Elles sont souvent uniques et dotées d'une instrumentation sophistiquée. Les missions observatoires sont destinées à suivre sur le long terme des phénomènes dont on sait que l'évolution est centrale pour notre compréhension des changements actuels et pour l'anticipation du futur. C'est une des priorités clairement exprimées par la communauté scientifique, au-delà du changement global. Elles ont une vocation opérationnelle : les modèles tournent en continu ; c'est exactement la logique de GMES. Des missions d'opportunité, de curiosité intellectuelle, sont destinées à répondre à des questions scientifiques ponctuelles. Les deux premières missions sont extrêmement utiles pour avancer sur la question du changement climatique. Les programmes d'observation utiles à l'étude du changement climatique sont les suivants : en matière de météorologie, le CNES contribue à la filière Meteosat gérée par Eumetsat, en particulier avec le programme IASI, instrument de nouvelle génération qui équipera les satellites METOP. Les programmes SPOT, Végétation, POLDER/PARASOL et, demain, Pléiades haute résolution permettent d'observer les surfaces terrestres à toutes les échelles (suivi de la déforestation par exemple). L'étude des nuages, de la vapeur d'eau, du rayonnement et des aérosols est couverte par des programmes de la filière « grand champ » avec POLDER/PARASOL et SCARAB. La physico-chimie de l'atmosphère est accessible aux travers des instruments de la filière ballons, ainsi que de la filière sondage atmosphérique (ENVISAT mis en oeuvre par l'ESA, CALIPSO, etc.). En matière de circulation océanique le suivi de la hauteur des océans est assuré par la filière altimétrique (TOPEX-POSEIDON, JASON 1 et bientôt JASON 2). Pour les missions de recherche, le CNES privilégie une collaboration européenne au travers de l'ESA et en collaboration avec d'autres pays, principalement les États-Unis, le Japon, Israël et prochainement l'Inde et la Chine, deux pays émergent sur le plan spatial. Le CNES, agence de recherche et développement, cherche à confier le financement et la gestion récurrente des missions opérationnelles à des agences de vocation. Nous travaillons aussi sur des missions à clients multiples, ce qui requiert des politiques de diffusion particulières. La question du changement global intègre la problématique du développement durable, assez complexe à concevoir et à mettre en œuvre, avec les trois piliers écologie, économie et social. Les enjeux de l'espace vont au-delà de l'observation de la terre. Le positionnement par satellite permet de suivre les espèces animales. La télédétection offre une large gamme d'informations sur l'état et l'évolution de la terre. La télé-épidémiologie produit des indicateurs environnementaux liés à des maladies ré-émergentes comme la grippe aviaire ou la dengue, qui peuvent être corrélées au changement climatique. La télécommunication s'ouvre sur la télémédecine et la téléconsultation. M. le Président : Plutôt que ses programmes, nous aimerions connaître les résultats auxquels parvient le CNES. M. Hervé JEANJEAN : Le CNES ne produit pas d'information scientifique directement ; il contribue à la recherche en mettant à disposition les données obtenues par les missions d'observation. Il cofinance également des programmes de recherche, et s'associe avec d'autres organismes au sein de pôles thématiques pour développer des chaînes de traitement destinées à fournir à la communauté scientifique des produits dérivés du spatial plus élaborés que la donnée de base. Quelques agents CNES sont détachés dans des laboratoires mixtes pour conduire des travaux de recherche. Voici quelques exemples. L'étude du bilan radiatif est un paramètre clé dans la compréhension du climat et de ses variations. Les aérosols ont probablement un effet rétroactif négatif sur le réchauffement climatique mais il faut continuer à mieux les caractériser. Les feux de forêts contribuent également aux aérosols. Les aérosols affectent la constitution des nuages, ce qui a aussi une influence sur le cycle de l'eau. S'agissant de l'océanographie spatiale, l'élévation du niveau des océans de quelques millimètres par an est due à la dilatation thermique et certainement, dans une moindre mesure, à la fonte des glaces. Des images satellitaires ont montré l'impact de la sécheresse en France, vu de l'espace, en se fondant sur les variations de la verdeur de la végétation entre 2002 et 2003, symptomatique de la dégradation de l'activité photosynthétique. Cet outil peut être utilisé pour déterminer le périmètre des zones sinistrées. Le changement climatique a une influence sur l'occurrence des catastrophes naturelles - sécheresses, tempêtes, feux de forêt, inondations, cyclones. Les agences spatiales se sont entendues pour mettre en commun leurs moyens au travers d'une Charte internationale sur les risques, opérationnelle depuis le 1er novembre 2000 : en cas de nécessité, elles programment leurs satellites afin de fournir en temps réel des informations aux sécurités civiles pour procéder en particulier à des cartographies rapides des dégâts. Les catastrophes sont nombreuses - peut-être de plus en plus - et la charte doit malheureusement être assez souvent activée. GMES est un programme très important aussi bien dans son aspect service opérationnel que pour la continuité des observations à destination des scientifiques. M. Serge POIGNANT : Comment travaillez-vous avec les scientifiques ? Agissent-ils en quelque sorte comme des donneurs d'ordre ? M. Hervé JEANJEAN : Les demandes émanent des scientifiques. Après vingt ou trente ans de technologie spatiale, nous avons démontré nos capacités, nous nous sommes approprié la technologie et il s'agit maintenant de répondre au plus près de la demande. La demande scientifique reste la plus importante et très bien structurée. Des comités ad hoc évaluent les propositions et émettent des recommandations. Nous organisons régulièrement des séminaires de prospective scientifique. Enfin, un comité des programmes scientifiques, dans lequel siègent des spécialistes français et européens de renom, sélectionne des priorités parmi la panoplie d'actions proposées. C'est sur la base de ces recommandations que nous décidons d'engager des programmes, qui doivent impliquer une communauté d'utilisateurs. M. Christian DECOCQ : La connaissance du cycle de carbone est stratégique et doit aider à prendre des décisions politiques. Pouvez-vous nous donner quelques pistes ? M. Philippe CIAIS : Je vais vous faire part de mon expérience personnelle à la suite des accords de Kyoto. Les pays industrialisés, compte tenu de la diversité de leurs situations, éprouvaient des difficultés énormes à concilier leurs positions. Ils se sont accordés sur un texte a minima, ce qui est positif politiquement, mais les puits de carbone qu'ils reconnaissent sont en partie décalés de la réalité appréhendée par les scientifiques, lesquels disposent d'instruments plus perfectionnés pour mesurer les émissions. Jusqu'à quel point le besoin de consensus politique pourra-t-il rester déconnecté de la science ? Si les efforts accomplis par les différents pays correspondent aux exigences de Kyoto mais n'aboutissent pas à une baisse réelle de CO2, il faudra bien considérer, dans les futurs accords internationaux, les données scientifiques les meilleures possible. C'est d'ailleurs un peu la position adoptée par les États-Unis. M. le Président : Le raisonnement à partir des puits de carbone n'est valable que dans une vision dynamique de la planète, avec des rotations végétales et une assimilation plus rapides. Il est peu probable que la capacité de stockages de CO2 réponde au problème tel qu'il est posé aujourd'hui. La réponse politique, qui procède de la diplomatie, a donc une valeur douteuse. M. Stefano BRUZZI : Même la diplomatie de l'environnement doit de plus en plus s'appuyer sur des données soigneusement préparées par les scientifiques, solides, cohérentes, de longue durée, provenant des satellites mais pas uniquement. L'organisme européen de satellites météorologiques (Eumetsat) coopère avec nous ; nous lui fournissons une sorte d'assistance technique. Par ailleurs, notre prochaine série de satellites météorologiques en orbite basse embarquera des instruments fournis par nos collègues américains. Ceux-ci viennent de demander d'établir une liste d'organismes auxquels les données ne seront pas accessibles, pour des raisons de sécurité. La diplomatie de l'environnement a besoin de garanties de pouvoir accéder aux informations clés. Il est important que les scientifiques et les politiques ne soient pas aveuglés par des résultats isolés. M. François DOSÉ : Lorsqu'une maison brûle, les pompiers qui tiennent la lance d'incendie n'ont pas intégré la problématique de la pression de l'eau mais ils s'efforcent tout de même de sauver la maison. Il est légitime que vous cherchiez à prouver que ce qui est possible se vérifiera ou ne se vérifiera pas ; c'est votre contribution à l'investigation scientifique. Mais j'ai le sentiment que, comme la ligne d'horizon, le probable sera au rendez-vous. Dans vingt-cinq ans, il faudra que nous puissions dire que, même dans l'état de connaissance où nous nous trouvons actuellement, nous avons pris des dispositions pour apaiser un peu la situation. Je suis très admiratif de votre travail mais, en vous écoutant, je crains que nos deux mondes ne se rencontrent jamais ; je ne puis attendre des documents supplémentaires. Nous devons apprendre à vivre dans l'anticipation et l'urgence. M. le Président : Quels renseignements les États-Unis souhaitent-ils ne pas voir communiqués ? M. Stefano BRUZZI : Les satellites météorologiques sont tous connectés en réseau et les informations, considérées comme un bien global, sont échangées librement entre les services météorologiques, afin de favoriser la prévision à toutes les échelles et dans tous les pays. Cette démarche est très récente, nos collègues américains n'y sont pas étrangers, mais, pour que leurs instruments soient installés sur les satellites européens, ils demandent que soit établie une liste d'organismes auxquels les données ne seront pas accessibles, pour un motif de protection de la sécurité nationale. Ce sont des décisions que nous, Européens, souhaiterions prendre de façon plus indépendante. De même, il faut prendre garde aux partenariats que nous bâtissons avec des pays comme la Chine, l'Inde ou Israël dans le cadre du système de positionnement européen GALILEO. Je ne suis pas protectionniste mais nous livrons une technologie européenne. La démarche américaine de GEO a été une tentative heureusement avortée de phagocyter GMES dans un cadre global. Il faut conserver notre indépendance, rester maîtres de nos sources d'informations et de nos décisions car cela revêt un intérêt stratégique croissant. M. Hervé JEANJEAN : Les différents services météorologiques du monde coopèrent et échangent des données. Si l'un d'entre eux décidait de ne plus faire suivre ses informations, le système fonctionne de telle façon que nous garderions l'accès à un minimum de données, moins complètes mais suffisantes pour faire tourner nos modèles. C'est le principe de l'indépendance sur la sécurité environnementale. Le programme international GEO initié par les des Américains avait vocation à leur faire reprendre la main sur une initiative européenne. Nous commençons à connaître l'ampleur du changement climatique global et nous sommes suffisamment mûrs pour établir des scénarios crédibles. Nous savons qu'une partie du carbone émis reste dans l'atmosphère pour des centaines d'années et que nous avons perturbé le système non pas pour une ou deux générations mais pour des milliers d'années. M. Robert KANDEL : Nous passons à un système où les satellites météos ont des applications à la fois civiles et militaires. De toute façon, les données servant à la prévision sont mises à la disposition de prévisionnistes. Les informations climatologiques et météorologiques, en principe, devraient être échangées mais les organismes météorologiques européens, notamment français et britannique, ont adopté une politique de vente de produits et ont tendance à privatiser les services météos, à l'inverse, paradoxalement, des États-Unis, où beaucoup d'entre eux sont disponibles gratuitement. La vocation des agences spatiales est de développer l'outil spatial, celle des services météos est d'effectuer des prévisions, et la problématique du climat tombe un peu entre les deux. Or il n'existe pas d'agences responsables sur ce sujet, que ce soit au niveau national ou international. Il ne s'agit pas d'arrêter l'innovation dans l'instrumentation spatiale ni dans la modélisation des données mais un effort de structuration devrait être accompli pour assurer la continuité des données climatologiques. M. Michel PETIT : Si les émissions cessaient, quand le CO2 disparaîtrait-il de l'atmosphère ? M. François GROSDIDIER : Si tant est que l'accord de Kyoto soit appliqué, par quel coefficient faudrait-il multiplier l'effort pour stabiliser la situation ? M. Philippe CIAIS : Pour stabiliser le CO2 dans l'atmosphère, il faudra à terme réduire les émissions bien en dessous des valeurs actuelles à l'horizon 2100. Cela dit, l'impact des émissions sur les concentrations atmosphériques est en partie irréversible, si 45% des émissions annuelles sont absorbées par la végétation et l'océan en un an, les 55% restant ont une « durée de vie » beaucoup plus longue. Environ 20% du carbone fossile injecté dans l'air vont en fait rester dans l'atmosphère très longtemps pour le futur. Il faudra attendre des dizaines de millénaires pour que les processus géologiques (érosion.) « nettoient » tout l'excès de carbone anthropique, et que l'atmosphère retrouve les niveaux de CO2 de l'ère préindustrielle. M. le Président : Comment expliquez-vous ce phénomène ? M. Philippe CIAIS : Par la chimie du CO2 dans l'océan : le CO2 y sature chimiquement et 20 % du total demeure dans l'atmosphère, quelle que soit la façon dont le carbone a été brûlé. M. le Président : Des échanges se produiront toujours : ce stock correspondant à 20 % du CO2 émis va donc baisser progressivement. M. Philippe CIAIS : Compte tenu de la masse supplémentaire de carbone fossile émis dans l'atmosphère, un changement radical du climat est possible au cours des cent prochaines années. Si le CO2 atteint par exemple une valeur aussi élevée que 1 000 ppm, le climat va devenir très chaud, peut-être dangereusement chaud. Si, grâce aux efforts, le niveau est limité à 700 ppm, cela sera mieux pour l'humanité. L'enjeu du changement climatique concerne les cent ou deux cents prochaines années ; dans mille ans, il aura été vécu, les écosystèmes auront été affectés mais le climat se sera de nouveau stabilisé. Nous partons d'un climat froid ; dans mille ans, il sera tiède ; la grande incertitude consiste à savoir si au cours des deux ou trois prochaines générations d'humains, il sera chaud, très chaud ou très très chaud. Et le niveau de réchauffement que vivront nos descendants dépend bien sûr de notre capacité à limiter ou pas les rejets de CO2 et d'autres composés à effet de serre dans l'atmosphère. M. le Président : Est-il déjà arrivé, dans l'histoire de la terre, que 1 000 ppm soient atteints ? M. Philippe CIAIS : Oui : l'atmosphère de la terre primitive, il y a 4 milliards d'années, contenait 80 % de CO2, comme celle de Vénus ! Mais la teneur n'avait jamais été aussi élevée depuis au moins 20 millions d'années. Au temps des dinosaures, il y a 100 millions d'années, le CO2 était encore plus élevé qu'aujourd'hui, le climat était très chaud mais les continents avaient aussi une position différente .. et il n'y avait pas d'humains pour en expérimenter les conséquences. M. Hervé JEANJEAN : Kyoto revêt surtout une symbolique politique. La principale question de fond est de parvenir à tempérer l'utilisation des énergies fossiles. Serons-nous capables d'infléchir la boulimie énergétique de notre société d'ici à cinquante ou cent ans ? Comment relever ce défi et comment relayer le charbon et le pétrole par des énergies renouvelables ? M. Philippe CIAIS : Kyoto visait à réduire de 10 % les émissions de 1990 pour les pays industrialisés. M. Philippe MEUNIER : L'objectif de division par deux des émissions mondiales à l'échéance 2050 n'est tenable que si les pays signataires divisent les leurs par quatre. Entre l'objectif actuel de moins 5 % et l'objectif souhaitable de moins 75 %, le rapport est de un à quinze : il faudrait donc multiplier l'effort par quinze. L'objectif de Kyoto était très peu ambitieux. Tout le monde partage le souhait de relancer les négociations mais il est très difficile de les recommencer alors que nous vivons avec des incertitudes. Nous demandons la poursuite des travaux, notamment en termes de géographie des productions, afin de fixer une stratégie de négociation pays par pays. Pour la Chine ou d'autres États émergents, la problématique climatique est secondaire par rapport à la problématique pollution immédiate. Quel sera l'impact sur le Maghreb et le pourtour méditerranéen dans son ensemble ? C'est fondamental pour la politique européenne de la France. Tout le monde a besoin d'une feuille de route affinée, dans une logique coopérative. M. le Président : Messieurs, je vous remercie. Table ronde avec les organisations syndicales, réunissant : Présidence de M. Jean-Yves LE DÉAUT, Président M. le Président : Nous accueillons M. Bernard Saincy, de la CGT, M. Henri Catz, de la CFDT, M. Claude Courty, de la CFE-CGC, et Mme Marie-Suzie Pungier, de FO. Nous avons souhaité recueillir l'avis des organisations syndicales sur ce sujet majeur, qui constitue une des menaces majeures du XXIe siècle. La France a signé le protocole de Kyoto sur la stabilisation des effets de serre, voire leur baisse pour un certain nombre de pays, et nous nous acheminons vers un protocole post-Kyoto de réduction. Quelle est votre position à ce sujet ? Quelle énergie préconisez-vous pour demain ? Quelles sont les conséquences, de votre point de vue, pour les grands secteurs d'activité, notamment l'industrie, les transports et l'agriculture, mais aussi en matière d'habitat ? M. Bernard SAINCY : Le réchauffement climatique est effectivement l'un des grands défis du XXIe siècle. Une idée fait désormais consensus : les incertitudes demeurent mais ne font pas le poids devant les certitudes. Les scientifiques, de rapport en rapport, s'éloignent du catastrophisme mais se rapprochent de la réalité du réchauffement climatique, dont les conséquences doivent être évaluées. Beaucoup de retard a été pris, y compris du côté du monde syndical. Je crois néanmoins que nous avons dépassé ce stade, en France comme au niveau européen - la Confédération européenne des syndicats prend beaucoup d'initiatives - et international. Il s'agit d'estimer les impacts socioéconomiques et d'examiner les leviers susceptibles de jouer sur le réchauffement climatique. Nous ne disposons guère de données sur l'impact socioéconomique et en particulier sur la question de l'emploi. Les événements climatiques peuvent avoir des effets extrêmement importants sur l'emploi, avec des disparitions mais aussi des créations potentielles. En tout état de cause, la revendication syndicale est de prévoir des mesures de transition sociale, ce qui signifie des négociations sociales, des action de formation, d'éducation et de reconversion. Les pays pauvres n'ont pas la même responsabilité que les pays riches, ce qui justifie des contributions différenciées. La CGT demande la mise en œuvre de transferts technologiques pour assurer le développement de pays pauvres sans aggraver l'effet de serre. Les décisions doivent être prises dans le cadre d'un processus démocratique, avec des lieux de consultation et de négociation afin de déterminer les formes sociales permettant de combattre les conséquences des gaz à effet de serre. Un changement du système productif est requis. Le climat fait partie du bien public et nous sommes réservés sur tous les systèmes flexibles : il n'est pas vraiment certain que les permis de polluer génèrent des cycles vertueux. Finalement, plus les grandes entreprises énergétiques européennes ont pollué par le passé, plus elles seront autorisées à continuer à le faire et plus elles retireront des bénéfices dans la revente de leurs droits. En matière d'énergie, de transport et d'habitat, nous nous prononçons depuis longtemps en faveur des énergies renouvelables - en particulier de l'hydraulique, au fil de l'eau, avec l'amélioration des barrages existants -, des économies d'énergie et du lancement de l'EPR et du palier nucléaire N4. Le développement des transports intermodaux est en panne ; il nécessite une réflexion et de mesures. La recherche devrait être réorientée vers les systèmes présentant les meilleurs potentiels de réduction des gaz à effet de serre. La CGT est attachée à l'idée de responsabilité sociale des entreprises et préconise une amélioration du reporting social et environnemental des entreprises. Cela passe en particulier par l'amélioration de la loi sur les nouvelles régulations économiques et par une réorientation des services publics vers des stratégies intégrant bien mieux la dimension environnementale et la lutte contre le réchauffement climatique. Le mouvement syndical international propose la création d'une organisation mondiale de l'environnement et d'un comité économique et social environnemental mondial. Nous souhaitons que le protocole de Kyoto soit consolidé et que les efforts soient poursuivis, notamment pour que les États-Unis reviennent à la table de négociation. Au niveau européen, nous aurons déjà du mal à atteindre les objectifs de Kyoto 1 ; il convient de mettre sur pied une véritable politique européenne et d'en faire un véritable axe stratégique. En France, il faut favoriser les transitions énergétiques, poser la question de la mise en place des plans d'action à cinq ans, revoir le Plan Climat, redonner des moyens au ministère de l'écologie ainsi qu'à l'ensemble des associations - ils ont été réduits en 2005 -, créer une institution spécialisée pour recenser les avis des acteurs sociaux et mener à bien les négociations en matière d'emploi, de conditions de travail, de plan de formation et d'éducation. M. Claude COURTY : Une émission diffusée la semaine dernière à la télévision montrait l'état de la planète vue de satellite et distinguait les zones les plus productrices de CO2, avec des points rouges marqués sur les États-Unis, l'Inde, la Chine et une partie de l'Europe ne comprenant pas la France. Notre pays, grâce à sa politique énergétique, a échappé à certaines pollutions. Toutefois, la pollution par le CO2 est transnationale et les choix doivent par conséquent être pris au niveau européen. Je crains que nos décisions futures ne conduisent à un manque de compétitivité ou à un excès de charges pour les entreprises c'est-à-dire, à terme, à une chute de leur compétitivité et à des destructions d'emplois industriels. Le bilan carbone doit être obligatoire dans les entreprises pour qu'il soit possible de se faire une idée de la nocivité de leur production. La transparence permettra de lever les fantasmes et d'éviter les dérives. Les unités d'incinération, par exemple, sont aujourd'hui parfaitement au point et il ne faut pas créer des phobies. Il faut accompagner les industries françaises non seulement financièrement mais aussi en matière de formation des équipes. Les jeunes sont très conscients de l'importance du développement durable mais les entreprises restent sujettes à la routine et cette thématique n'est pas encore créatrice d'emploi. Les chefs d'entreprises manifestent une certaine prévention car ils craignent de voir augmenter les coûts et de perdre leur compétitivité par rapport à des pays ne respectant pas les mêmes contraintes. L'État doit accomplir un effort pour aider les industriels à investir dans cette démarche et se montrer sévère, au niveau européen, pour que tout le monde s'aligne sur la même idée. Les transports constituent l'activité la plus polluante en matière de CO2. La position géographique de la France et son équipement autoroutier en font un lieu de transit. Il faudrait réfléchir au développement des transports combinés. Nous disposons d'un excellent réseau routier mais aussi d'un très bon réseau ferroviaire et, plutôt que de créer de multiples plates-formes et voies ferrées supplémentaires, utilisons et valorisons les potentialités existantes : mettons les camions sur des plates-formes et instaurons une taxe de compensation pour pénaliser les pays qui transfèrent leur pollution à l'étranger (Voir exemple de l'Alsace avec les transporteurs allemands). Les contribuables, qui ont financé la construction du réseau autoroutier dont profitent les transporteurs hollandais, allemands, belges ou danois, doivent bénéficier d'un air plus pur. Le produit de cette taxe servirait à financer de nouveaux travaux dans ce but et créerait de l'emploi. Il n'est plus possible de reculer. Il convient d'aller beaucoup plus loin en ce qui concerne l'emballage et la traçabilité des produits, en faisant le bilan énergétique complet de la filière, c'est-à-dire en indiquant toute l'énergie qui a été nécessaire dans les process mis en œuvre et en calculant le coût final pour l'environnement. L'emballage, outre qu'il est particulièrement consommateur d'énergie et donc de CO2, crée un nouveau déchet. Il faut donc se doter d'outils permettant une meilleure traçabilité écologique et énergétique afin d'aller au-delà du bilan de fonctionnement de la machine en intégrant production et commercialisation. Faut-il développer les énergies renouvelables, le solaire, l'éolien, la biomasse, l'hydraulique ? S'agissant de l'hydraulique, beaucoup de sites sont déjà équipés mais une amélioration du fil de l'eau est possible. Là aussi, la traçabilité de chaque filière doit être complète en tonnes de CO2. L'énergie éolienne permettra certes de diminuer le bilan CO2, mais la fabrication de tous les engins nécessaires n'est-elle pas elle-même polluante ? Il en va de même pour les cultures susceptibles de créer de la biomasse : la forêt doit être stabilisée car, avec le développement des conifères, elle a perdu de sa performance. Comment faire évoluer notre filière énergétique actuelle ? Je suis bien entendu très favorable à la poursuite de l'industrie nucléaire dans les meilleures conditions de confort et de sécurité pour les entreprises du secteur et les populations. La France doit continuer à montrer l'exemple et à informer la population pour garantir la plus grande transparence possible, y compris sur la question du stockage des déchets. Par le passé, certaines informations ont provoqué des mouvements d'opposition dramatiques pour l'équilibre énergétique de certaines régions françaises - je pense en particulier à la Bretagne. Peut-être convient-il de réduire la part du nucléaire dans le bilan énergétique au profit des énergies renouvelables mais ne faisons pas passer pour miraculeux quelque chose qui risque de devenir diabolique. Les déchets à ciel ouvert produisent du méthane et contribuent par conséquent à l'effet de serre. Une loi prévoit la disparition des décharges à ciel ouvert à partir de 2005. Elle a certes pris du retard, comme toute loi, mais il est évidemment toujours plus agréable de stocker ses déchets dans le jardin du voisin et je suis résolument contre les référendums inutiles organisés ici ou là. Obtenir 90 % ou plus dans un scrutin qui mobilise 60 % de la population est une stupidité qui génère des dépenses négatives pour l'environnement. C'est contraire au service public, au courage politique et même à l'honnêteté. Il faudrait interdire ce genre de référendum, contraires à la démocratie et à la responsabilité locales. Les décharges à ciel ouvert sont néfastes pour l'environnement mais des réaménagements sont possibles, avec la création d'unités d'incinération exemplaires. La phobie de la dioxine est déplacée car la réglementation prévoit des équipements pour éviter la pollution. Il faut aussi obliger les élus politiques de tous bords à respecter un code de déontologie ou une certaine éthique au regard de l'environnement. La démagogie peut leur faire gagner quelques voix supplémentaires mais la solution de traitement des ordures aura été retardée d'autant. L'éducation doit commencer à l'école primaire mais il manque deux maillons dans la chaîne de l'information : le secondaire et les entreprises. Très peu d'entreprises mènent un dialogue avec leurs organisations syndicales pour écrire les bilans de développement durable qui fleurissent. Le bilan social de l'entreprise pourrait être accompagné d'un bilan environnemental. Il a été question, au sommet de Johannesburg, d'un institut du développement durable rassemblant régulièrement, autour d'un thème particulier, les organisations syndicales, les ONG, les élus et les chefs d'entreprise. M. Henri CATZ : Sur le fond, je rejoins mes collègues. La CFDT est très sensible à la question depuis les années soixante-dix ; cela sera d'ailleurs l'un des thèmes importants de notre prochain congrès confédéral, en juin, avec sans doute une traduction dans notre texte de résolution. Pendant longtemps, nous avons été les seuls à porter cette préoccupation, en partant des conditions de travail et des pollutions à l'intérieur de l'entreprise. Mais la pollution ne s'arrête pas aux grilles de l'entreprise et les salariés ont une famille, elle aussi touchée. La grosse difficulté consiste à faire intervenir dans l'entreprise des personnes extérieures qui ont des demandes à formuler. Nous avons longtemps été les seuls à porter cette idée, mais nous sommes maintenant épaulés par des associations écologistes. Notre préoccupation principale reste l'emploi et il faut instaurer le dialogue entre les partenaires politiques, associatifs et socioéconomiques pour qu'ils apprennent à comprendre les arguments des autres. Nous étions partie prenante de la Conférence de Rio de 1992, à travers la Confédération internationale des syndicats libres et la Confédération européenne des syndicats. Nous avons soutenu le protocole de Kyoto dès le début et toutes les propositions qui en ont été issues. Parallèlement, nous nous sommes prononcés pour l'introduction du principe de précaution dans la Constitution et nous participons au groupe « facteur 4 ». Le problème du gaz à effet de serre est mondial, global, et toute mesure risque d'avoir pour effet une distorsion de concurrence. Il importe donc de mettre en œuvre des mesures au niveau international ou européen ; voilà pourquoi nous avons soutenu le protocole de Kyoto. La cause principale de l'effet de serre est la production et l'utilisation d'énergie, avec le sous-problème des transports, tout le monde en est conscient. Nous préconisons d'abord la mise en place de politiques d'efficacité énergétique et d'économie d'énergie, qui ont montré leur efficacité après le choc pétrolier mais ont ensuite été laissées de côté. Ensuite, nous sommes évidemment favorables au développement des énergies renouvelables dans un cadre raisonnable, même si elles ne sont pas la panacée, dans la mesure où elles sont localisées, ne s'adressent qu'à des niches et posent un problème de coût : elles doivent être encouragées à condition de devenir compétitives économiquement. Dans ce cadre, l'énergie nucléaire sera indiscutablement fondamentale à l'avenir, notamment dans la perspective de l'épuisement des combustibles fossiles prévisible à l'horizon de trente ou quarante ans. L'industrie nucléaire devra être développée, surtout dans les pays où elle est actuellement insuffisante. En France, avec plus de 80 % de la production, il nous semble qu'elle occupe une place excessive car elle recèle des problèmes, notamment en ce qui concerne la gestion des déchets et le risque lié aux installations. Cela soulève la question des exportations : l'Italie, par exemple, contrairement à ce qu'elle prétend, consomme du nucléaire, même s'il est produit en France. Nous sommes par ailleurs partisans d'une politique énergétique européenne, ce qui signifie que toute la production d'énergie nucléaire ne doit pas être assumée par un seul pays ; l'effort doit être partagé par l'ensemble de l'Union européenne. Nous nous sommes prononcés en faveur des mesures instaurées par le protocole de Kyoto et l'Union européenne, notamment des instruments financiers, qui nous semblent les plus efficaces et les plus neutres pour inciter à une politique d'énergie qui induise le moins de distorsions de concurrence. Il peut s'agir de taxes sur le CO2 ou de quotas d'émissions négociables. Mais ces instruments ne sont pas parfaits ; des contrôles sont nécessaires pour vérifier que personne ne triche et cela suppose éventuellement de créer des structures compétentes. La lutte contre l'effet de serre est un problème de société qui implique des changements de comportement de la part de tous les acteurs sociaux. Les mesures autoritaires et les culpabilisations ne sont pas souhaitables. En revanche, il faut mettre en pratique une politique globale, ne jamais rien interdire sans proposer une solution de remplacement acceptable socialement et économiquement, que ce soit en matière de transport ou d'urbanisme. La question exige l'engagement de l'ensemble des forces sociales et, dans ce cadre, les organisations syndicales ont un rôle crucial à jouer ; elles sont prêtes à le faire. Mme Marie-Suzie PUNGIER : Je vous transmettrai l'étude sur le développement durable que nous venons de publier en partenariat avec l'Institut des relations économiques et sociales, qui ne fait pas le tour de la question mais aborde les problèmes de conditions de travail, d'énergie, de biodiversité, de biotechnologies et de recherche. Force Ouvrière a été proche de la théorie du développement démocratique et économique alimentant les politiques sociales et culturelles. Ce fut son engagement en faveur de la solidarité avec la Confédération internationale des syndicats libres, dont nous avons été l'une des organisations fondatrices, en 1948. Lorsque la notion de développement durable est apparue, nous nous sommes interrogés car sa définition n'est pas claire : s'agit-il d'un ancrage définitif dans les sociétés pour les protéger de risques ou d'une question de financement supportable ? Nous restons assez réservés car nous avons le sentiment d'une opposition d'intérêts entre croissance forte, créatrice d'emploi, et nécessité de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Nous ne restons cependant pas à l'écart des débats. À la fin des années quatre-vingt-dix, le Commissariat général du Plan organisait des confrontations d'idées et l'un de ces séminaires a abouti à la publication d'un rapport, en 2001. Aujourd'hui, il nous est beaucoup plus difficile de nous exprimer, si ce n'est au sein du Conseil national du développement durable. Dans ce cadre les débats ne sont pas faciles, que ce soit pour le projet de charte de l'environnement, le principe de précaution ou l'actualisation de la stratégie nationale de développement durable mais, au final, lorsque nous arrivons à nous entendre sur des points d'accroche, je constate que la puissance publique ne les prend pas en compte. Nous occupons notre place au sein du Conseil national mais il semble que ce soit un paravent du Gouvernement pour reconnaître la société civile : aucune des préoccupations fondamentales que nous avons exprimées n'a jamais été retenue, notamment concernant le dysfonctionnement climatique. Les scientifiques ont suffisamment alerté sur la nécessité d'analyser la question du climat au fond ; cela nous renvoie inévitablement au seul outil disponible, le protocole de Kyoto. A Force Ouvrière nous l'avons soutenu raisonnablement, mais le débat et les conclusions nous ont intéressés, même si ses ambitions n'étaient pas démesurées. Pourtant, la puissance principale, les États-Unis, qui produit à elle seule 25 % des gaz à effet de serre, refuse de parapher. Les locomotives économiques, comme la Chine ou l'Inde, qui se développent hors normes sociales et environnementales, ne sont pas concernées. Quant à l'Union européenne et la France, elles flottent par rapport à l'application des politiques sur lesquels elles s'étaient engagées. Pourtant le défi est redoutable ; il transcende les frontières. Nous demandons donc à tout le moins que le Protocole de Kyoto, seul instrument existant pour tempérer les gaz à effet de serre, soit universellement appliqué. Mais il n'existe aucun moyen de coercition vis-à-vis des États pour les forcer à respecter leurs engagements. Nous avons depuis toujours des compétences en matière de politique de l'emploi et d'amélioration des conditions de travail ; nous avons du mal à le faire entendre dans le cadre du développement durable mais c'est un fait. Imposer aux employeurs une diminution des nuisances et des risques nécessite qu'ils nous écoutent ; sur le dossier de l'amiante, nous avions tiré la sonnette d'alarme dès le début des années soixante et il a fallu attendre trente ou quarante ans pour faire prendre conscience de l'ampleur du risque. Nous sommes des initiés, mais l'ensemble de la société est très éloigné de la problématique du développement durable et ne participe pas au débat. Nous préconisons donc, dans le cadre de la formation initiale, à l'école, la création de modules pour éduquer les générations futures à la question du développement durable et leur inculquer une certaine culture. Et puis, nous constatons que la question de la protection de l'environnement passe totalement à la trappe dans la formation professionnelle continue des salariés. La résolution de la question des gaz à effet de serre passe par une interrogation sur la théorie économique qui nous gouverne. La timidité des politiques s'explique par leurs discours contradictoires, dès lors que la concurrence s'exerce tous azimuts. Ne faut-il pas la freiner en instaurant des règles et en s'interrogeant sur la rémunération du capital ? Pour atteindre l'objectif de la diminution des risques, en particulier climatiques, la question majeure est celle de la modification des modes de production, avec des incidences sur la recherche, le développement et l'innovation. Si le risque a atteint un tel niveau, c'est en raison de l'affaiblissement considérable, depuis trente ans, des politiques de recherche. Nous avons toujours été partisans du nucléaire et l'éternelle question est celle des déchets. Il convient de dégager des moyens et de mener une politique européenne. Mme Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET, rapporteure : Nous échangeons de plus en plus de produits sur lesquels l'Organisation mondiale du commerce nous interdit de porter un regard autre que technique et nous demande de ne pas prendre en compte les conditions sociales et environnementales de leur production dans le jeu de taxes que nous leur appliquons. Nous ne sommes pas non plus supposés prendre en compte le carbone employé au cours de son cycle de vie. Que préconisez-vous ? Une organisation mondiale de l'environnement ferait-elle contrepoids à l'Organisation mondiale du commerce ? M. Henri CATZ : Nous n'avons pas de solution définitive à avancer. Deux possibilités existent : créer une organisation mondiale de l'environnement ou étendre les prérogatives de l'OMC. Dans la première hypothèse, le risque serait que la nouvelle institution ne dispose pas de pouvoir d'arbitrage ni de sanction et ne puisse s'imposer politiquement vis-à-vis de l'OMC ; elle serait alors marginalisée. Dans la seconde hypothèse, le risque serait que l'OMC elle-même considère les problèmes environnementaux comme secondaires par rapport au libre-échange. Nous sommes donc plutôt favorables à la création d'une organisation mondiale de l'environnement dotée d'un véritable pouvoir de réglementation, de sanction et bénéficiant d'un engagement politique fort des opinions publiques et des nations. Mme Marie-Suzie PUNGIER : C'est une excellente question. Pour commencer, il est anormal que le mandat donné au commissaire européen chargé du dossier ne soit pas connu - les parlementaires sont peut-être plus au courant que nous, et encore. L'OMC ne semble pas avoir intérêt à jouer le jeu de la transparence. Je serai plutôt favorable à ce que le problème soit de la compétence d'un organisme dans lequel sont représentés les États, les entreprises et les syndicats, à savoir l'Organisation internationale du travail, car le même niveau d'exigence doit être posé en matière environnementale et sociale. Pendant un temps, nous avons plaidé pour une représentation de la Confédération internationale des syndicats libres, mais l'OIT serait plus adaptée pour défendre les règles de normalisation sociale et environnementale. M. Claude COURTY : Le combat mené par l'OIT en faveur du respect des normes sociales fondamentales au niveau mondial doit être résolument appuyé par tous les pays. Créer un organisme nouveau provoquerait encore des discussions interminables sur son rôle et son articulation avec les structures existantes. Lorsque nos propres entreprises internationales veulent se restructurer au niveau mondial, elles devraient prendre un engagement éthique en matière sociale et environnementale. Ce serait déjà un progrès, qui aurait aussi des conséquences indirectes au niveau de l'OMC puisqu'il serait intégré dans le marché global. M. Bernard SAINCY : Le débat est totalement théorique. Pour faire progresser les droits, nous ne voyons que des avantages à une organisation mondiale de l'environnement, ce qui n'empêcherait pas un rééquilibrage des pouvoirs entre les institutions onusiennes. Le problème de l'OIT, c'est que, contrairement à l'OMC, elle ne possède pas de structure de règlement des différents, ni d'un quelconque pouvoir de contrôle. Il faudrait commencer par réformer l'OIT afin de lui donner les moyens de faire appliquer les droits sociaux plutôt que de lui conférer de nouveaux pouvoirs théoriques. De toute façon, l'OMC sera toujours saisie du débat récurrent relatif aux clauses sociales et environnementales. M. le Président : Le marché des réductions d'émissions ne s'applique qu'à un secteur, l'industrie, et de manière différente selon la nature des entreprises. Que pensez-vous des pollutions de CO2 diffuses ? Doivent-elles être soumises à des taxes ? Par ailleurs, les normes présentent-elles un intérêt pour réduire les pollutions ? M. Henri CATZ : Les trois armes principales - la normalisation, les taxes et les autres produits financiers comme les permis négociables - se complètent car elles sont plus ou moins adaptées selon les secteurs. Il existe un risque sous-jacent : l'aggravation des inégalités sociales. Mais il est possible de lutter contre. Le choc pétrolier a démontré qu'une augmentation importante du coût de l'énergie induisait une politique forte d'économies d'énergie. Il existe un besoin vital minimum d'électricité pour tout le monde, qui peut être satisfait par une subvention ou une première tranche de quantité de consommation à très bas prix, quitte à ce que la progressivité, au-delà, soit très rapide : les ménages aux moyens limités peuvent satisfaire leurs besoins et les gros pollueurs payer plus cher. Dans certains secteurs, la réglementation s'impose, des produits dangereux (par exemple l'amiante) doivent être interdits, mais, pour qu'une telle mesure soit efficace, il faut proposer des biens de substitution, dotés de caractéristiques similaires et utilisables à un coût économiquement acceptable. Dans le domaine de l'énergie, ce n'est pas possible mais l'instrument économique est une contrainte forte : en France, le prix de l'essence est pour 90 % composé de taxe et la société ne le conteste guère. Aux États-Unis, l'essence étant bien moins chère qu'en France, le parc automobile consomme beaucoup, mais une augmentation forte serait socialement inacceptable, même si les pressions intérieures et internationales commencent à inciter les Américains à s'intéresser à la consommation de leurs véhicules. Accroître aveuglément le prix de l'essence sans rien proposer parallèlement n'est pas une solution. Les pouvoirs publics doivent également favoriser la recherche et instituer des incitations en faveur des véhicules économes en énergie, hybrides, électriques, utilisant une pile à combustible, ou pour perfectionner les moteurs diesels. Dans certains domaines industriels, je pense que les quotas d'émissions sont plus efficaces. Les différents outils sont complémentaires ; tout est question d'acceptabilité sociale et de dialogue. M. Claude COURTY : Nous sommes favorables à la plus grande transparence concernant le bilan CO2 des entreprises, ne serait-ce que pour favoriser une créativité susceptible d'améliorer les cycles. En 2005 et 2006, vingt-cinq à trente normes touchant ces sujets auront été déposées. Il arrive un moment où l'intéressé ne sait plus à quelle norme il doit se fier. Au demeurant, les industriels échappent souvent aux pénalités en jouant le chantage à l'emploi. Pour que les normes soient appliquées, il importe donc de simplifier la réglementation. S'il s'agit de faire comprendre au citoyen comme aux élus que quelque chose doit être fait, pourquoi ne pas pénaliser les productions diffuses ? Les pollueurs doivent être les payeurs, certes, mais avec une gradation. Les gros consommateurs d'électricité, par exemple, ne sont pas forcément ceux qui sont à l'origine de la plus grosse production de CO2, sauf s'ils tirent leur énergie aux heures de pointe, ce qui nécessite de faire tourner les turbines à gaz. Ne pointons pas du doigt des coupables qui ne le sont pas mais privilégions la responsabilité. M. Bernard SAINCY : Entre la normalisation, la fiscalité et la régulation de la concurrence, nous nous prononçons clairement pour la première option, avec l'approfondissement des décisions prises à Marrakech en 2002 : mise en place de systèmes de contrôle voire de sanction des émissions de gaz à effet de serre. Avant d'élaborer une fiscalité verte qui frapperait surtout les gros consommateurs, il conviendrait de remettre à plat toute la fiscalité. Les permis d'émissions négociables ne sont qu'un des trois moyens de Kyoto, avec les mises en œuvre conjointes et les mécanismes de développement propre, sur lesquels s'était portée notre attention. L'implication du marché des produits dans la crise électrique californienne n'a pas été suffisamment investiguée. Ce système peut en outre conduire à des aberrations, par exemple sur l'ordre de préférence des choix de production : un entrepreneur peut avoir intérêt à produire avec du charbon plutôt qu'avec du gaz, pourtant moins polluant. Peut-être ce modèle de régulations concurrentielles est-il tout bonnement inadapté à un bien public comme le climat. Enfin, certains pays remettent sur le marché des quantités de CO2 qu'ils n'auraient pas été en mesure de produire eux-mêmes. Finalement, le système favorise ceux qui ont le plus pollué par le passé, les industries charbonnières allemandes plutôt que le nucléaire français. M. Henri CATZ : La réglementation européenne sur les émissions des véhicules impose des limites sans rien interdire. Même si elle a un effet sur les prix, elle est progressive et tient compte des technologies existantes, ce qui la rend acceptable. Au demeurant, elle a été très positive pour la consommation des véhicules européens. M. Serge POIGNANT : Pouvez-vous nous donner des précisions sur le bilan en matière de création d'emplois ? M. Jacques BASCOU : Est-il souhaitable et envisageable d'intégrer le transport dans la traçabilité et la labellisation ? M. Claude COURTY : Dans l'entreprise, le développement durable n'a pas créé d'emplois, mais il a entraîné des transformations de postes dans les domaines de la sécurité et de l'environnement, désormais occupés par des spécialistes du développement durable. Ce nouveau concept intègre une dimension sociale que les ingénieurs n'avaient pas acquise auparavant : le bilan développement durable n'est pas un bilan social ou environnemental mais conjugue les trois grandes dimensions, voire une quatrième, le dialogue avec le monde extérieur. Le bilan formule des constats à partir desquels il est possible de trouver des idées sur tel ou tel principe d'évolution, ce qui évite une débauche de réglementation. Dans cette logique, je suis favorable à l'intégration du coût du transport pour l'atmosphère, de même que celui de l'emballage. Je crains que les contraintes, la sur-réglementation française, ne détruisent de l'emploi. Pourquoi vouloir devenir plus vertueux encore, alors que nous sommes déjà performants par rapport à nos voisins, sans aider correctement nos industriels à soutenir la compétitivité internationale et à sauver l'emploi ? Plutôt que la TVA sociale prônée par le Président de la République, nous sommes favorables à une cotisation sociale, qui permettrait de décharger les industriels français de certaines charges. M. Philippe TOURTELIER : Le fondement implicite de la théorie des avantages comparatifs, à la base de l'OMC, est remis en cause par la situation actuelle. Jusqu'à présent, les aspects sociaux et environnementaux ont toujours été externalisés, chaque pays se débrouillant avec. Pour la première fois, la globalisation du problème des gaz à effet de serre s'impose à tous et nous oblige à revoir nos pratiques. Une des solutions consiste à inclure le coût carbone dans les coûts, en incluant la localisation de la production et les composants agricoles. M. Catz m'a semblé méfiant vis-à-vis des énergies renouvelables parce qu'elles ne sont pas centralisées. J'en étais pourtant resté à la CFDT modèle « Vivre et travailler au pays » ! Je vous trouve aussi un peu optimiste s'agissant du nucléaire, qui ne sera jamais la solution au niveau mondial. La question des déchets est aussi évacuée un peu vite. Pourquoi faire implicitement confiance à la recherche pour régler cette question et pas pour débloquer les verrous technologiques sur les énergies renouvelables ? M. François DOSÉ : Que pensez-vous du principe de précaution ramené à l'entreprise et à la société ? M. Henri CATZ : Les économistes, ces dernières années, ont beaucoup travaillé et produit sur l'intégration des nuisances dans les théories économiques en usage, notamment sur les effets comparatifs des taxes et des quotas négociables sur le PIB. Dans le cadre de modèles sans viscosité, ils arrivent à des valeurs d'équilibre identiques. Il est extrêmement difficile de quantifier les nuisances. Quel est le coût de la nuisance bruit, par exemple ? Celui des murs antibruit, des doubles vitrages, la perte de valeur foncière d'un immeuble situé à proximité de la source sonore ? En tout cas, la protection de l'environnement ne pourra être introduite dans les théories économiques que si l'on affecte les nuisances d'un coût et les économistes font beaucoup de progrès sur ce sujet. M. Bernard SAINCY : La CGT, à l'instar de la Confédération européenne des syndicats, considère que des mesures de transition sociales équitables doivent accompagner la sortie d'un système économique gourmand en CO2. M. Philippe TOURTELIER : Le climat risque de créer les mêmes déséquilibres sociaux. M. Bernard SAINCY : C'est pourquoi la question de la transition sociale est centrale. M. le Président : J'ai relevé des nuances entre vous sur le nucléaire. Mais revenons aux énergies renouvelables. M. Henri CATZ : Les énergies renouvelables, hormis l'hydraulique, sont diffuses. Une maison peut être alimentée avec un chauffe-eau solaire ou une éolienne, mais une grande ville ou une grande industrie a besoin d'une énergie concentrée. La géothermie existe dans certaines régions ; elle présente des limites mais doit être développée. L'énergie hydraulique, en France et en Europe, est utilisée au maximum et même au-delà puisque les grands barrages existants ne pourraient plus être créés aujourd'hui. M. le Président : Pour m'être rendu sur place, je peux vous dire que le barrage des Trois-Gorges a été beaucoup mieux réalisé que ne le laissent à penser les images caricaturales diffusées à la télévision française. M. Bernard SAINCY : Aucun barrage nouveau n'est construit mais le renforcement au fil de l'eau, notamment la modernisation des turbines, a pratiquement doublé notre capacité. M. Henri CATZ : L'éolien, essentiellement offshore, est l'alternative la plus prometteuse, mais n'est pas non plus dépourvu d'inconvénients et ne produit de l'énergie que par intermittence, ce qui nécessite souvent un investissement parallèle. M. Philippe TOURTELIER : Pourquoi la recherche ne parviendrait-elle jamais à stocker l'électricité dans les piles ? Vous devriez être un peu plus cohérent dans vos raisonnements ! M. Henri CATZ : Il est indispensable de poursuivre la recherche, notamment pour stocker l'énergie, par exemple grâce à l'hydrogène. Le nucléaire représente 16 à 17 % de la production d'électricité mondiale et 6 % de la production d'énergie, avec une répartition très inégale entre les pays développés et les autres. Je ne dis pas que l'énergie nucléaire va devenir majoritaire - ce ne serait d'ailleurs pas souhaitable - mais la contribution du nucléaire peut être importante pour gagner les quelques points de CO2 nécessaires à la maîtrise de l'effet de serre. Cela ne dispense aucunement d'investir dans la recherche sur l'utilisation rationnelle des combustibles fossiles, dont l'horizon est limité, sur les énergies renouvelables, même si la rupture espérée peut très bien ne jamais se produire, et sur le nucléaire, avec la génération 4 et d'autres technologies que nous avons la responsabilité de développer pour les avoir sous le coude en cas de nécessité. Mme Marie-Suzie PUNGIER : Entre l'énergie fossile, sous embargo et en voie de pénurie, les énergies renouvelables, à commencer par l'éolien et le solaire, dont la puissance est difficile à évaluer mais qui ne pourront en tout état de cause pas se substituer aux énergies fossiles, et le nucléaire, qui fait plus peur que jamais, que proposez-vous ? M. Philippe TOURTELIER : Je cherchais seulement à souligner que la confiance envers la recherche est à géométrie variable : 90 % des crédits sont consacrés au nucléaire et moins de 10 % aux énergies renouvelables ; si la répartition, depuis vingt ans, avait été de 50-50, la situation et le raisonnement seraient différents. M. François DOSÉ : Le principe de précaution pose le problème de la hiérarchie des priorités. Toutes les familles politiques ont été secouées par ce débat, chacun voyant bien que la précaution est nécessaire pour nos enfants. Mais, si nous agissons les premiers en le déclinant dans notre réglementation, la générosité se transformera en handicap. Où se situe le point d'équilibre ? Si les autres pays ne sont pas prêts à faire l'effort, devons-nous y consentir tout de même ? M. le Président : Comment montrer l'exemple et provoquer un effet d'entraînement au niveau européen sans entrer dans le mur ? De l'effet de serre ou des déchets nucléaires, quel phénomène vous paraît le plus dangereux ? M. Philippe TOURTELIER : Ma question est légèrement reformulée ! M. le Président : Le problème est majeur ! M. François DOSÉ : Entre effet de serre partout et déchets nucléaires à un seul endroit, que choisissez-vous, en fonction du lieu où vous habitez ? Mme Marie-Suzie PUNGIER : Le principe de précaution pose des problèmes, d'autant que, au plan juridique, il reste incertain, indéfini et subjectif. Le débat a également traversé notre confédération car les branches industrielles étaient évidemment moins chaudes que celles des services. Nous avons donc adopté une position ménageant la chèvre et chou. Nous vivons une période de transfert de risque du consommateur vers le producteur, de la bourse vers le salarié, de l'État vers l'usager du service public, et le principe de précaution évite à la société dans son ensemble d'assumer un risque. Mais il crée une inégalité entre la France et les autres pays alors que la vraie solution passe par la réglementation. Le principe de précaution est une fausse solution car il peut aboutir à des fermetures d'entreprises et des destructions d'emplois ; il protège certes le pilier environnemental mais affecte le pilier social. Entre effet de serre et nucléaire, je me vois mal choisir ; les deux risques existent et, pour les limiter, il convient de réglementer. M. le Président : Vous vous êtes pourtant prononcée en faveur du nucléaire. Mme Marie-Suzie PUNGIER : Vous n'avez pas posé la question dans ces termes. La menace est réelle dans les deux cas, mais elle est sans doute plus lourde avec le nucléaire qu'avec l'effet de serre - encore que. M. Henri CATZ : Ceux qui se sont opposés à l'introduction du principe de précaution dans la Constitution avaient en tête l'utilisation que certains veulent en faire, relayée par les journalistes, et qui est complètement inexacte : il faut renoncer à faire tout ce qui est dangereux. Mais le principe de précaution n'a rien à voir avec cette logique : il s'applique en situation d'incertitude, d'ignorance sur un risque. Dans le cas de la tremblante du mouton, le danger était bien connu et des mesures de sécurité ont été prises. S'agissant des OGM, par contre, le risque de dissémination vers les plantes naturelles est incertain ; toutefois, le principe de précaution, principe d'action, ne doit surtout pas conduire à détruire les champs expérimentaux mais au contraire à poursuivre la recherche. Même si les autres pays ne suivent pas son exemple, la France et ses partenaires européens, en tant que nations occidentales, ont la responsabilité d'agir pour limiter les émissions de CO2. Nous pouvons ainsi jouer un rôle vis-à-vis des États-Unis, pour soutenir la frange de l'opinion publique américaine sensible à la question, mais aussi de pays en voie de développement comme l'Inde et la Chine, pour leur montrer que nous assumons nos responsabilités et les pousser à en faire autant. La sensibilité face à tel ou tel danger est une question individuelle et ne se tranche, au final, que par le vote démocratique et le choix politique. La seule réalité objective est que le risque lié à la gestion des déchets nucléaires est concentré tandis que celui relatif à l'effet de serre est global et concerne directement toute l'humanité. M. Claude COURTY : Sur le principe de précaution, nous avons été très mesurés car il ne faudrait pas qu'il se traduise par un bond en arrière ; une bonne pédagogie est nécessaire. Quand les partenaires parlent le même langage, bien des dialogues inutiles sont évités. Je suis malade de l'effet de serre mais pas des déchets nucléaires. Le nucléaire doit être appréhendé comme une chaîne qui évolue avec le progrès. Dans un demi-siècle, il sera plus fondamental encore car nous en serons à la fusion et une énergie devra être proposée à l'industrie et à la population. Il faut démythifier le nucléaire et inviter la population à parler. Le stockage des déchets doit-il être définitif ou réversible ? Le progrès, demain, nous permettra sans doute de les valoriser. Le nucléaire n'est pas la seule solution mais constituera un espoir jusqu'à ce que nous ayons atteint un palier d'effet de serre suffisant pour survivre. Le stockage de l'énergie produite par les éoliennes ne passe pas uniquement par les piles : de l'eau peut être accumulée dans un lac puis relâchée pour répondre à un besoin d'électricité, comme avec les barrages. Il faut se montrer imaginatif et tout faire pour que les entreprises, à travers le bilan carbone et la pédagogie, contribuent au repli de l'effet de serre tout en favorisant l'emploi et en faisant attention à la compétitivité. M. Bernard SAINCY : Les modèles scientifiques progressent à une telle vitesse que le débat n'aurait pas été le même il y a cinq ans : nous commençons à savoir avec certitude ce qui se passe. Il est donc temps de se doter d'outils sociaux et environnementaux adaptés, interdépendants, transparents et démocratiques. Des mesures de transition sociale et économique sont indispensables et votre Mission pourrait commencer à formuler des propositions concrètes concernant le cadre de négociation dans lequel elles seront élaborées. J'attire votre attention sur le fait que les gouvernements espagnol et allemand ont déjà mis en place des instances de concertation avec les organisations syndicales sur le thème de l'effet de serre ; il serait dommage que la France reste à la traîne. M. le Président : Madame, messieurs, je vous remercie. Table ronde sur « l'information et la sensibilisation du public », réunissant : Présidence de M. Jean-Yves LE DÉAUT, Président M. le Président : Notre mission d'information s'est récemment rendue aux États-Unis, à Washington et en Californie. Nous y avons constaté la différence d'approche du problème du réchauffement climatique entre le niveau fédéral et le niveau des États. Face à l'une des grandes menaces du XXIe siècle, l'information et la sensibilisation du public nous ont paru constituer un sujet majeur. Nous n'avons peut-être pas encore pris l'entière mesure de sa gravité. Même si les experts et certains politiques en sont bien conscients, nous n'avons pas encore une idée précise des mesures à prendre pour lutter contre le réchauffement climatique. Au-delà des propositions que nous ferons et qui viendront compléter les dispositifs déjà existants, nous devrons mener des actions de sensibilisation. Vous nous y aiderez, par votre participation à cette table ronde. M. Philippe Gillet est professeur des universités, directeur de l'École normale supérieure de Lyon et a travaillé particulièrement sur l'intégration des questions d'environnement dans l'enseignement. M. Patrice Joly est directeur de la communication, de la formation et du développement de l'ADEME et Mme Valérie Martin est le chef adjoint du service « communication institutionnelle et information du public » de cette même ADEME. Mme Marie-Jeanne Husset est directrice de la rédaction de « 60 millions de consommateurs ». Mme Catherine Laborde, de TF1, est bien connue des téléspectateurs pour la météo. Elle est très engagée sur le sujet du changement climatique et auteur d'un livre fantastique sur les relations de l'homme avec le climat, « Le mauvais temps n'existe pas ». Mme Geneviève Guicheney est directrice du projet développement durable du groupe France Télévisions. Mme Marie Jaudet est en charge de la communication à la MIES, mission interministérielle sur l'effet de serre Mme Odile Meuvret est journaliste. Elle a été pendant longtemps chargée de l'environnement à l'AFP. Je demande aux uns et aux autres de nous faire un court exposé, de façon qu'il nous reste le temps de dialoguer. Nos collègues parlementaires et les membres du comité de pilotage - Raymond Leban, Robert Kandel, Ghislain Gomart, Jean Jouzel, Jean-Marc Jancovici, Michel Petit et d'autres - pourront intervenir. Madame Marie Jaudet, vous allez nous parler de l'état de l'opinion sur les principaux enjeux de l'information et de la sensibilisation du public. Mme Marie JAUDET : Pour relever le défi climatique, une prise de conscience accrue de l'opinion est indispensable, que ce soit dans un avenir très proche, en 2008-2012, pour honorer les engagements de Kyoto, ou dans un avenir plus lointain, vers 2050, pour diviser par quatre nos émissions de gaz à effet de serre. Il conviendra de bien faire connaître et de comprendre la problématique, pour que les gens acceptent de changer leur comportement. La compréhension est une condition de l'acceptabilité sociale des mesures à prendre. Il conviendra également de guider les gestes et les choix des consommateurs. Le phénomène de l'effet de serre est complexe, il n'est pas imputable à un seul émetteur et il faut explorer des angles de communication très divers. Principes à respecter : Le cadre : on peut déplorer aujourd'hui la façon trop technique dont ce sujet est véhiculé. On parle d'énergie, de science, de comptabilisation de gaz à effet de serre, etc. Il faudrait le rendre plus proche de la vie des citoyens en mettant en avant les impacts du changement climatique sur leur quotidien plutôt que certains engagements internationaux. Le ton : faut-il adopter un ton dramatique ou essayer de valoriser ceux qui tentent de s'impliquer sur le sujet ? On peut s'interroger à propos de la crédibilité des émetteurs eux-mêmes. La crédibilité des émetteurs : les personnes les plus crédibles sont les scientifiques et les associations qui interviennent dans l'environnement, voire les associations de consommateurs. Les représentants de l'État se retrouvent en bas du classement. La cible est très diverse. Il ne faut donc oublier personne. La sémantique : il faut être prudent quant aux termes choisis et aux chiffres avancés. Faut-il, par exemple, parler de réchauffement, ou de changement climatique ? Est-ce que, lorsqu'on dit aux gens que la température s'élèvera entre 1,4 et 5 à 6 degrés, cela leur parle ? Faut-il utiliser un discours pédagogique ou un discours moralisateur ou accusateur. L'ADEME, dans sa campagne, a fait un choix qui semble porter ses fruits. On s'est demandé ce que l'opinion française connaissait du sujet. Des enquêtes et des sondages ont été faits. Je n'en citerai que deux, qui reviennent chaque année : l'étude des représentations sociales qui est faite à l'initiative de l'ADEME ; l'étude sur les Français et l'énergie qui est faite par le ministère délégué à l'industrie. Bonne nouvelle : l'effet de serre est une certitude de mieux en mieux partagée. Aujourd'hui 70 % des Français sont convaincus qu'il y a une certitude scientifique sur le changement climatique, du fait des activités humaines. Malheureusement, le sujet est encore très mal expliqué et très mal compris. Quand on interroge les gens sur les causes du réchauffement climatique, on trouve en tête de liste les bombes aérosol, les activités industrielles, les centrales nucléaires. Les transports sont toutefois souvent cités, ainsi que les activités industrielles et, depuis quelque temps, tout ce qui relève de la gestion des bâtiments. Autre bonne nouvelle : les Français sont conscients de la nécessité de modifier notre mode de vie pour limiter les émissions. 75 % disent que la solution passera par une évolution des comportements, contre 12 % qui disent que la technique résoudra les problèmes. Comment, concrètement, intensifier cette prise de conscience ? Nous pouvons identifier six grands domaines d'action : l'éducation, la sensibilisation, les médias, la publicité, la formation et la participation démocratique. M. Gillet traitera de l'éducation. Mais je peux déjà citer certains cours de science de la vie et de la terre (SVT) et, plus récemment, l'éducation à l'environnement pour un développement durable mis en place dans les établissements scolaires. L'intérêt de cette dernière réside dans le fait qu'on essaie d'aborder le sujet de façon transversale. L'ADEME a lancé une campagne de sensibilisation aux enjeux du changement climatique et, surtout, à sa maîtrise. Je précise qu'une campagne nationale doit être ancrée territorialement ou régionalement si on veut qu'elle soit vraiment pertinente. L'étiquette « énergie » se trouve sur de nombreux appareils électroménagers et maintenant sur des climatiseurs, voitures, produits du bâtiment. C'est un moyen d'action très fort. Il permet de guider le choix des acheteurs et d'inciter les producteurs à proposer des appareils performants. La publicité peut jouer un rôle crucial. Je ne pense pas seulement aux campagnes de sensibilisation, mais aux messages publicitaires. Il faut veiller à ne pas inciter à la surconsommation d'énergie. La fameuse loi « POPE » de juillet 2005 sur la politique énergétique de la France comporte un article à ce sujet ; le décret est en cours de rédaction. Mais il conviendrait d'aller au-delà de ce dispositif législatif pour sanctionner les annonceurs qui feraient croire que l'énergie, sous toutes ses formes, est un bien très commun dont on peut abuser. De leur côté, les annonceurs se sont fédérés autour de ce sujet, le Bureau de vérification de la publicité disposant d'un code de déontologie destiné à faire respecter certains de ces critères. Les médias sont les ambassadeurs du sujet climat. On note d'ailleurs une progression quantitative en ce domaine. Malheureusement, se pose un problème de qualité. Certaines études montrent en effet que les Français se sentent insuffisamment et mal informés. Le sujet est encore trop souvent couvert uniquement par des journalistes spécialisés dans l'environnement. On ne traite pas le sujet de manière transversale. Le Premier ministre, à l'occasion du rendez-vous climat, a prévu, dans le cahier des charges des chaînes publiques, d'inscrire certaines obligations en matière d'environnement. Nous verrons si cela aidera les journalistes à mieux couvrir le sujet climat. Les journalistes, présentateurs de la météo, se sont approprié le sujet et tentent de donner des conseils. Catherine Laborde en est un exemple. À quoi attribuer cette situation ? A la recherche du sensationnel ? A un manque de confiance dans les médias s'agissant d'un tel sujet ? A un manque de formation des journalistes, en général, sur le climat ? La formation sur le changement climatique est, en France, très pauvre. Tous ceux qui travaillent dans le secteur du bâtiment pourraient y contribuer. Or, par exemple, le sujet n'est même pas abordé au cours de la formation des architectes. Il faudrait davantage travailler sur la participation du public. Ce rôle d'animation est aujourd'hui tenu par les associations : associations de protection de l'environnement, associations d'usagers et de consommateurs - notamment « 60 millions de consommateurs ». Ces organismes jouissent d'un certain crédit en ce domaine. Le changement climatique peut impliquer les citoyens autrement que de façon unilatérale. De nouvelles pratiques de démocratie participative pourraient être mises en place, dans le cadre des processus de prise de décision et d'élaboration des politiques. Des tentatives ont eu lieu, mais de manière assez anecdotique. Je pense notamment à une conférence des citoyens en 2002 sur les attentes des Français et les politiques à mettre en place ; au débat national sur les énergies, qui a fait parler les Français. Mais cela n'a pas été suivi dans les faits car ces démarches sont trop déconnectées de l'élaboration de politiques publiques. Les Français, une fois informés, seraient prêts à accepter des mesures que certains décideurs, politiques notamment, jugent trop rapidement impopulaires et n'osent pas mettre en place : bridage des moteurs, taxation, achat obligatoire d'énergie verte, etc. En conclusion, même si les campagnes d'information et de sensibilisation ont connu un véritable développement en France, le sujet du climat est encore trop absent des débats publics et ne fait pas encore l'objet de vraie pratique démocrative. La question du climat ne pourra mobiliser des forces nouvelles, dans les sciences sociales par exemple mais surtout dans les opinions publiques, que si elle est cadrée de manière plus large qu'aujourd'hui : il faut commencer à construire une culture du climat afin qu'une représentation du thème de l'effet de serre soit présente dans la vie quotidienne et qu'une vraie mobilisation de l'ensemble du corps social s'organise sur le sujet. Il faudra enfin penser aux indicateurs qui permettent de mesurer la réussite des actions mises en place. Il n'en existe pas beaucoup, en dehors des sondages sur les perceptions sociales. M. le Président : Merci pour cet exposé introductif. M. Philippe GILLET : Je m'exprime ici à deux titres, car j'ai abordé les problématiques de l'effet de serre à deux occasions : Claude Allègre m'avait demandé de participer à la réécriture des programmes de lycée ; d'autre part, j'ai dirigé pendant trois ans l'Institut national des sciences de l'univers au CNRS, qui s'intéressait, entre autres, au changement climatique et à l'observation de la terre. Nous sommes face à des questions à enjeux multiples, qu'elles soient économiques, sociétales, de sciences dures ou de santé publique. Selon moi, pour les étudier, le meilleur vecteur reste l'école, lieu où l'on forme les citoyens, auxquels on peut faire passer certaines valeurs. Nous étions partis de l'idée que la formation scientifique était la base de la formation citoyenne. Il faut d'abord comprendre les enjeux. Si, dans dix ans, vous vous interrogez sur les alternatives énergétiques entre le nucléaire et les ressources fossiles et que les gens, qui ne comprennent pas, ne peuvent que suivre ceux qui crient le plus fort, nous aurons perdu notre citoyenneté. Le vrai débat démocratique doit reposer sur un fond, qui est transmis par l'école. À l'époque, nous avons lutté pour introduire dans les programmes de lycée, notamment en classe de seconde qui est la dernière classe où tous les enfants font des sciences, la définition claire et les enjeux qui sont liés à l'effet de serre. Ce fut difficile parce que notre système éducatif n'est pas adapté à de telles questions. De par sa structure, l'enseignement est cloisonné et nous avons du mal à aborder des sujets complexes, qui font intervenir plusieurs champs. Normalement, tous les enfants qui sortent de seconde doivent comprendre pourquoi le nuage de Tchernobyl ne s'est pas arrêté à nos frontières, savoir que les perturbations de la quantité des gaz à effet de serre produisent des modifications climatiques, connaître la différence entre la météorologie et la climatologie, etc. Toujours en seconde, en cours de SVT, il est possible de dégager trois semaines flottantes, moments où les élèves peuvent construire un travail à long terme au cours de l'année. Nous avions donné quelques pistes s'agissant du changement climatique : suivre un évènement, étudier les conséquences d'une canicule, suivre tout au long de l'année l'évolution d'une courbe de température française, européenne, etc. C'est donc dans le programme de l'État. Toujours en SVT, mais en terminale scientifique, nous avons insisté pour montrer que le message climatique s'était enregistré au travers de l'histoire de la planète, à des échelles de temps variables : l'année, le siècle, le million d'années, le milliard d'années, que la part de l'effet anthropique dans le changement climatique actuel était largement supérieur à la variabilité naturelle. Nous rencontrons quelques difficultés en raison du cloisonnement disciplinaire de notre système éducatif. Ces questions sont en effet interdisciplinaires et touchent tout autant le monde économique que le domaine social ou celui de la santé. Poser cette grande problématique du changement climatique devrait être pour nous l'occasion de réfléchir à nos pratiques d'enseignement. M. Patrice JOLY : L'une des mesures phares du Plan Climat a été le lancement d'une campagne de communication sur la maîtrise de l'énergie et l'effet de serre, intitulée : « Economies d'énergies : faisons vite, ça chauffe ! » Cette campagne s'inscrit dans la durée, ce qui nous donne aujourd'hui une lisibilité de trois ans, ce qui est exceptionnel. Elle a deux aspects indissociables : d'abord un aspect de publicité classique, avec des spots à la radio et à la télévision ; ensuite un aspect partenarial. On donne à des partenaires la possibilité d'utiliser un logo, le logo « Faisons vite, ça chauffe », dans la mesure où ils s'engagent dans des opérations et acceptent de démultiplier certains messages. Ils font ainsi de la communication autour des enjeux. Le budget total de cette opération tourne autour de 12 millions d'euros sur trois ans. Elle a été lancée en 2004. Pendant les deux premières années, on a plutôt fait la promotion des bons gestes par le biais de spots à la radio et à la télévision, en utilisant la chanson de Dalida : « Toujours des mots, encore des mots ». Maintenant, on s'oriente vers des actes plus engageants, en s'appuyant sur le dispositif du crédit d'impôt. Une nouvelle campagne démarre demain matin, avec la chanson « Formi-formidable », en mettant en scène des gens qui mettent en place des actions formidables, de façon à inciter les autres à agir. Nous avons fait des bilans d'impact, qui sont tout à fait satisfaisants. Nous constatons que la demande d'information est énorme. Mais il ne suffit pas de susciter des attentes, il faut être capable de répondre aux questions des gens. Or ces questions sont multiformes. Il peut s'agir d'un simple conseil, d'une demande d'adresse ou de savoir comment mener à bien un investissement, s'il faut changer la chaudière ou isoler la maison. Grâce au « Téléphone Azur », nous avons répondu à 100 000 appels cette année contre 30 000 il y a trois ans. Nous diffusons des brochures, dont il existe trente exemplaires différents. Nous avons un site Internet, avec 30 000 demandes par jour. Surtout, nous avons un réseau d'information qui couvre toute la France : 180 points d'information « Info énergie » qui emploient aujourd'hui 300 personnes et sont montés en partenariat avec les collectivités territoriales. Ils sont financés par l'ADEME et des financements locaux. Nous avons ainsi touché cette année 1 300 000 personnes, contre 800 000 l'année dernière et 400 000 l'année précédente. La duré moyenne de rendez-vous est d'une demi-heure. La demande est donc très forte et cela implique un investissement très important. Qui sont nos partenaires ? Les associations de consommateurs comme « Que choisir ? », EDF, les cinémas Pathé-Gaumont qui distribuent une petite plaquette qui indique aux spectateurs quel est l'impact de leurs comportements sur le climat. Elle a été diffusée à un million d'exemplaires à l'occasion de la sortie du film catastrophe Le Jour d'après. L'opération fut très appréciée. Une autre opération remarquable, « Le défi pour la terre », a été montée l'année dernière avec la Fondation Nicolas-Hulot. La communication était plus engageante, puisqu'on demandait aux gens de s'engager sur des sites Internet à faire certains gestes. Reste à savoir si les gens vont au-delà de leurs intentions. Il est très facile de le vérifier, par exemple en regardant combien on vend en France de chauffe-eau solaires - 14 000 cette année contre 8 000 l'année dernière - ou de chaudières à condensation - 10 % du marché contre 2 %. Le pourcentage de gens qui achètent des lampes à basse consommation est maintenant de 51 %, contre 48 % l'année dernière. On peut faire des constats équivalents pour les inserts ou les pompes à chaleur. En conclusion, nous avons noté une très forte attente d'information. Il nous faut être en capacité d'y répondre et nous espérons avoir les moyens de le faire. M. le Président : Nous n'avons installé cette année que 350 MGW d'éolien. M. Patrice JOLY : Nous allons atteindre cette année 1 000 MGW d'éolien installé. M. le Président : Il nous en faudrait au moins 10 000 pour satisfaire aux 21%. Mme Marie-Jeanne HUSSET : 60 millions de consommateurs n'est pas une association. C'est le magazine de service public - le seul d'ailleurs qui existe en France - de l'Institut national de la consommation (INC). Avant d'aborder ce que nous faisons à 60 millions de consommateurs et à l'INC, je dirai quelques mots de mon parcours personnel. Je suis journaliste scientifique depuis un peu plus de trente ans. Je m'intéresse aux questions climatiques depuis cette époque, bien avant l'existence de l'ADEME. J'ai assisté à la création de l'AFME, son ancêtre. J'ai participé à la création du magazine Ça m'intéresse, où je suis restée neuf ans. La première couverture du magazine, en mars 1981, montrait un ours polaire sur le pont Alexandre III, et j'avais alors écrit un grand papier sur les questions climatiques. Je ne suis pas d'accord avec Mme Jaudet qui disait tout à l'heure que les sujets sur le climat étaient réservés aux journalistes d'environnement. Je dirai qu'ils étaient réservés aux journalistes scientifiques. D'ailleurs, les questions climatiques sont le premier pont entre la science et l'environnement. J'ai été présidente de l'Association des journalistes scientifiques. Nous avions organisé, au moment des conférences internationales comme celle de La Haye, des réunions et des colloques sur les questions climatiques. J'ai également dirigé pendant quelques années le magazine Science et Avenir. Tout cela pour vous dire que je m'intéresse aux questions climatiques depuis pratiquement toujours. 60 millions de consommateurs, que je dirige depuis onze ans, a pour mission d'assurer l'information indépendante des consommateurs. Il doit donc informer et sensibiliser les consommateurs sur ces questions. Nous défendons en effet une vision globale du consommateur, qui ne se dissocie pas du contribuable, du citoyen, du salarié ou du téléspectateur. Il est important de sensibiliser les consommateurs à l'impact de leurs actes de consommation sur le climat. Ils peuvent d'ailleurs être les victimes, à tous les niveaux, des conséquences du réchauffement climatique. Je ne vous donnerai pas le détail de tout ce que nous avons publié, mais j'en citerai quelques exemples. Avec l'ADEME, en 1997, nous avions commencé à faire des petits suppléments détachables sur la maison économe. Tout ce qui concernait l'équipement de la maison était passé en revue pour montrer ce qu'on pouvait économiser en énergie. En mai 2001, avant la première campagne de l'ADEME, nous avons publié, dans nos hors série, le premier Guide vert du consommateur. Il s'agissait de faire prendre conscience au consommateur qu'il ne fallait pas attendre forcément les grandes décisions nationales ou internationales et que chacun d'entre nous pouvait, par ses actes quotidiens, contribuer à réduire les émissions de gaz à effet de serre et ce, dans tous les domaines. En 2004, la première partie du hors série Le Climat se dérègle était consacrée au changement climatique. Nous avions laissé la plume aux climatologues. Nous faisons régulièrement des articles sur les économies d'énergie, notamment sur les aides dont on peut bénéficier. La question est de savoir comment nous pouvons conserver notre mode de vie ou notre confort en protégeant la planète et en économisant l'énergie. Nous avons fait l'année dernière, avec l'ADEME, des tests sur les climatiseurs. Mais notre première action avait été de dissuader les consommateurs d'en acheter. Nous avons également mené une action avec la Ligue contre la violence routière, pour promouvoir le concept de « voiture citoyenne ». Elle consiste à noter les véhicules qui sont sur le marché en fonction de quatre critères relatifs à la sécurité, à l'économie et à la protection de l'environnement. Le deuxième palmarès sera publié très bientôt. Mme Catherine LABORDE : Du fait de ma position de présentatrice météo, on me parle très souvent du changement climatique. J'observe alors très souvent deux attitudes contradictoires : soit une dénégation totale - « ça n'existe pas », ou « l'homme a toujours su s'en tirer » -, soit la panique totale, les explications scientifiques devenant un maquillage destiné à couvrir une peur ancestrale. Je vois mal comment, à la météo, nous pourrions dans le temps qui nous est imparti présenter des arguments pour désamorcer la panique ou la peur. Ce qui est sûr, c'est que cette panique ou cette peur risquent de réduire à néant les moyens ou les efforts qu'on pourrait mettre en œuvre pour résister au changement climatique. Monsieur Gillet, vous pensez que l'école est la première chose. Je l'ai longtemps cru. Maintenant, je pense que c'est la télévision. M. Philippe GILLET : La télévision peut être un support de l'école ! Mme Catherine LABORDE : À TF1, nous avons essayé d'agir. Nous ne disposons que des deux minutes de séquence météo. Nous nous sommes beaucoup appuyés sur l'ADEME. Nous avons nous aussi participé au « Défi pour la terre ». Nous donnons des conseils : prenez des douches plutôt que des bains, le climatiseur n'est peut-être pas la meilleure solution, ce n'est pas bon de trop chauffer les appartements. Nous avons un slogan : « C'est bon pour la planète ». Certes, c'est assez limité. Mais il faut faire « tenir » tout en 2 minutes ! Plus on arrivera à faire des prévisions météorologiques, claires, précises et fiables sur du court, du moyen et du long terme, mieux on avertira les gens des crises consécutives au changement climatique. Il s'agit de faire en sorte qu'il n'y ait plus de victimes. C'est déjà le cas grâce à la vigilance mise en place par Météo France. Cela me paraît important si l'on veut lutter contre la panique devant le réchauffement climatique. Il faut également dire ce qu'il faut faire lorsque les prévisions font état d'une menace contre la vie ou les biens. Je voudrais terminer par quelques réflexions. Michael Crichton est un scénariste de grand talent. On lui doit le feuilleton Urgences, grâce auquel ma fille cadette veut devenir médecin. Je remercie Michael Crichton et j'espère que ma fille se maintiendra dans sa détermination. Si des gens comme Michael Crichton, qui connaissent l'audiovisuel, mettent leur talent au service du bouleversement climatique, la prise de conscience des gens en sera accrue. Je cite Michael Chrichton parce qu'il vient d'écrire un roman, qui marche très bien, et qui nie les conséquences du réchauffement climatique. Le héros moderne du XXIe siècle est le scientifique. Je suis toujours émerveillée d'entendre certains d'entre eux parler de ce qui nous attend. Ils sont eux-mêmes émerveillés par leur propre recherche et par la manière dont ils peuvent faire fonctionner leur cerveau. Je pense que la télévision, publique ou privée, devrait leur donner la parole. Mais cela implique de leur donner du temps. En effet, la question du changement climatique est compliquée, complexe et deux minutes de bulletin météo ne suffiront jamais. Enfin, il me semble que les journalistes de la télévision ne sont pas les premiers responsables, mais qu'ils ont un rôle primordial à jouer. M. le Président : Merci madame. Comment réagit France Télévisions ? Mme Geneviève GUICHENEY : Pour les uns il y a l'école qui joue un rôle de transmission de valeurs et un rôle symbolique, et la télévision qui joue un rôle d'information. Je ne pense pas qu'il faille uniquement agir sur les enfants. On ne doit pas attendre qu'ils soient grands. Il faut agir sur tout le monde. Comment travailler à la sensibilisation du public ? D'abord en arrêtant de dire seulement à nos concitoyens que le ciel va leur tomber sur la tête et de les prendre pour des crétins méchants et irresponsables. Tout le monde est concerné par le regard que l'on porte sur nos concitoyens, qui sont les mêmes que les téléspectateurs. On a toujours l'impression qu'il existe plusieurs populations de rechange. Ainsi l'on s'adresserait qui à des téléspectateurs, qui à des électeurs, qui à des consommateurs. Mais c'est toujours des mêmes que l'on parle. Quand ils ont le moral dans les baskets après avoir regardé le journal télévisé, s'ils vont voter tout de suite après, ils ont toujours le moral dans les baskets. La sensibilisation aux problèmes climatiques est une œuvre collective. Nous avancerons ensemble. Il ne s'agit pas de se demander, comme je l'ai entendu ce matin : comment se fait-il que les médias n'aient pas réagi plus vite à la canicule ? Comme si les politiques devaient attendre pour agir que les médias traitent d'un problème ! Il s'agit en l'espèce de savoir de quelles informations disposaient les uns et les autres pour faire leur métier et remplir leur mission. Voilà maintenant qu'on fait aux médias le reproche inverse : ils parleraient trop de la peste aviaire (improprement appelée « grippe » aviaire). Ce que chacun doit faire là où il est face à un problème comme celui du climat, où l'on attend des citoyens du monde entier qu'ils changent leur comportement, c'est donner aux gens les clés pour savoir, pour comprendre et pour agir. Il est désespérant d'assister à certains évènements, menaçants de surcroît, et d'attendre qui va bouger, qui va dire quoi, qui va faire quoi. Je prends un exemple. Celui de Belle-Ile-en-Mer, qui subit en plein hiver une sécheresse extravagante. De l'eau en bouteille a été distribuée à la population, qui a reçu par téléphone (un message enregistré du distributeur d'eau) la consigne de ne pas utiliser l'eau du robinet pour se laver les dents. Vous pouvez imaginer l'effet que cela fait de devoir aller sur un aérodrome où, sous un hangar, sont empilées des tonnes de bouteilles. C'est très spectaculaire et les télévisions ont accouru. Si ce n'est que les journalistes ont pris le bateau du matin et repris celui de la fin de l'après-midi ! L'été dernier déjà, on avait livré de l'eau par bateau-citerne, ce qui avait impressionné et fait causer. Trois mois plus tard, au cœur de l'hiver, voilà que l'eau manque toujours. Chacun peut avoir le sentiment, justifié ou non dans ce cas précis, de faire l'expérience du réchauffement climatique. Les questions ont fusé en pensant à l'été et à l'afflux des touristes. Faut-il ou non être inquiet ? Les solutions envisagées sont-elles pertinentes et à long terme ? Rien de tout cela, juste les images des piles de packs de bouteilles, trois personnes qui confirment que c'est préoccupant de ne plus avoir d'eau au robinet. En l'occurrence, les médias auraient dû, selon moi, faire un travail beaucoup plus fin. Tout cela n'est pas arrivé en un jour. Autrefois, la population permanente était beaucoup plus nombreuse. Il y avait des citernes, on captait l'eau dans les nombreux vallons de l'île, on la gaspillait sans doute moins, il n'y avait pas de maïs, etc... Il n'y avait pas non plus de distributeur d'eau. Parmi les solutions évoquées, la construction d'un pipe-line sous-marin de 17 km de long, ou le dessalement de l'eau de mer. Tandis que les politiques réfléchissent, la population passe son temps à aller fouiner sur l'Internet, sur les sites de l'ADEME ou d'autres, pour voir s'il n'existe pas des solutions, une addition de solutions. Ils ont anticipé le fait qu'il n'existe pas de solution simple à un problème complexe. Je conviens que ce ne soit pas facile pour les politiques. Le temps politique n'est ni le temps tellurique, ni même le temps économique. Vous êtes amenés aujourd'hui à prendre des décisions dont vous ne verrez pas l'application au cours d'un ou deux mandats. Il n'empêche qu'il faut les prendre. Cela suppose que tout le monde fasse un effort. Et que les consommateurs électeurs téléspectateurs admettent qu'à certaines questions, vous puissiez répondre dans un premier temps : « Je ne sais pas ; en attendant, je ne dois pas prendre de risques et je dois faire cela ». Les médias doivent faire une information précise et non pas catastrophiste, proposer des petits gestes et passer des documentaires qui expliquent, mettent en perspective, etc. Les scientifiques ont une expertise indispensable, mais ce n'est pas à eux de décider. Lorsque le Professeur Axel Kahn dit : « Ne nous demandez pas de prendre des décisions politiques », il a raison. Le développement durable suppose que l'on reconnaisse la compétence de chacun. Nos concitoyens ont sûrement des tas d'idées sur ce qu'ils pourraient faire. On ne doit pas désespérer d'eux. À la campagne, le tri sélectif est très compliqué, parce qu'il faut se déplacer. Et pourtant, ils le font, dans des proportions impressionnantes. La Gazette des communes a publié une enquête selon laquelle l'ensemble de la population dit qu'il n'était pas trop tard. Les gens pensent que l'échelon local est le plus approprié, que les dégâts auxquels on assiste aujourd'hui et que l'on prévoit pour demain sont réversibles, à condition que tous fassent un effort. La transversalité est en effet très importante. Face à un problème nouveau, enfin relativement, on n'a pas assez anticipé ; peut-être faut-il imaginer des modes d'approche différents. Le concours de tous est nécessaire. Dont celui des médias. Mais à la télévision aussi, c'est très difficile. Il faut commencer par sensibiliser, former les journalistes. C'est l'objet même de ma mission. Et il y a du travail. L'état des connaissances est très varié. Quelqu'un m'a dit : « Je sais ce qu'est le développement durable, c'est pour les pays sous-développés. En tant que pays développés, on n'est pas concernés, si ce n'est qu'on va devoir payer, comme d'habitude. » D'autres sont très au fait de toutes ces questions et regrettent que cela n'intéresse que peu leur hiérarchie, sauf catastrophe. Ils attendent beaucoup de l'adoption d'une politique de développement durable par notre groupe. Pour autant, les gens de France Télévisions sont prêts à démarrer et me demandent ce qu'ils peuvent faire et quand. Ils ajoutent que nous devons sans doute commencer par mettre en application ce que nous allons préconiser aux autres. Car disent-ils : « Serons-nous crédibles à l'antenne si, en tant qu'entreprise, nous ne faisons rien ? » Quoi faire ? Du plus petit au plus grand, je peux donner deux exemples de réalisations. Il y a maintenant du café équitable dans tous les distributeurs du siège. Cela fait poser des questions, échanger. D'autre part nous allons construire un nouveau bâtiment. En tant que directrice du développement durable, j'ai demandé qu'il soit aux normes Haute qualité environnement (HQE). C'est en route, mais cela n'a pas été simple. En effet, le choix de normes HQE induit des surcoûts à la construction mais des économies d'exploitation à terme et un mieux-être. Les réticences n'étaient pas celles des responsables de France Télévisions, mais celles que l'on prêtait par avance au grand argentier de Bercy. On a tendance à attendre qui va commencer à faire quoi. Or les signaux doivent partir de partout, de tous ceux qui, à un moment ou à un autre, ont quelque chose à faire, à dire, à expliquer, tout en indiquant comment on pourra s'en sortir et sans tomber dans le catastrophisme. J'ai entendu, il y a une quinzaine de jours à Rennes, lors des Carrefours de l'eau, que 85 % des personnes interrogées dans une enquête sur l'eau n'en connaissaient pas le prix, mais qu'une proportion importante déclarait être prête à payer plus cher pour que l'eau soit meilleure. Quand on leur demandait si 12 litres par minute au robinet étaient un débit indispensable, ils répondaient que non. Toujours dans le domaine de l'eau, les contrats entre les communes et les distributeurs d'eau sont interminables. Or tout le monde doit et devra faire des efforts. Les médias ont besoin, lorsqu'ils font passer des messages, de sentir que l'aventure est partagée. Ils ont à améliorer la qualité et la quantité d'information sur toutes ces questions, mais ne confondons pas les rôles. Le chemin doit être ouvert par ceux dont c'est la responsabilité, politiques à tous les échelons, industriels, décideurs. Si un grand programme d'HLM est décidé, il est bon que l'on apprenne qu'il est construit aux normes HQE et qu'on ne lance pas un programme dont on ne saura pas régler la facture énergétique dans dix ou quinze ans. Nous avons besoin d'une accumulation de gestes et de projets pour former un comportement global où chacun aura un rôle à jouer. À partir de là, je pense que l'on avancera. M. le Président : Merci. Madame Meuvret, quel est votre avis ? Mme Odile MEUVRET : Tout ayant été dit, je ne ferai que quelques remarques. Je ne suis pas sûre que, si on faisait un sondage auprès des journalistes de l'AFP, ou d'autres rédactions, sur ce qu'est le développement durable, on obtiendrait une réponse très différente de celle mentionnée par Mme Guicheney. Je veux souligner par là que la communication sur le changement climatique tout comme sur l'environnement en général est trop souvent entachée d'un jargon peu accessible au grand public. D'une manière générale, la couverture du changement climatique par la presse écrite manque encore de rigueur. Certes, comme l'a dit Mme Jaudet, elle a augmenté de façon considérable au plan quantitatif. Mais elle reste entachée d'erreurs et le bêtisier est innombrable. La presse écrite pourrait éviter de dire, par exemple, que les États-Unis n'ont pas signé Kyoto. Pourquoi y a-t-il de nombreuses erreurs dans les articles traitant de ces questions ? Il faut savoir que l'environnement est couvert au mieux à 50 % par les correspondants environnement basés à Paris. Quand un communicant envoie une information d'environnement, par exemple sur le changement climatique, il est bien plus probable que cette information soit traitée par quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de la question que par les correspondants environnement. De nombreux organes de presse, et non des moindres, comme les journaux gratuits par exemple, n'ont pas de correspondants environnement qui connaissent quoi que ce soit à l'effet de serre. J'ai cru comprendre que M. Jancovici était membre de votre comité de pilotage. Je signale qu'il est l'auteur, sur son site Internet, en 2004, d'un article sur la presse écrite et l'effet de serre, dont je vous recommande la lecture. Cela dit, la complexité du sujet explique beaucoup de problèmes. Ainsi, il ne suffit pas d'être un scientifique de haut niveau pour être un journaliste capable de couvrir l'effet de serre. Par exemple, savoir que les États-Unis ont bien signé Kyoto relève du droit international public. C'est toute la différence entre signature et ratification. On peut bien sortir de Polytechnique et ne pas la connaître. Traiter du changement climatique demande des connaissances dans une multitude de domaines. C'est sans doute le plus transversal de tous les sujets sur l'environnement. Vous pouvez suivre toutes les formations que vous voulez, vous n'aurez jamais une formation complète. Par ailleurs, un journaliste qui sort d'une grande école scientifique ne sera peut-être pas forcément capable de se mettre au niveau du grand public et de poser les bonnes questions. Ce qui est frappant, et qui a déjà été mentionné, c'est le cloisonnement existant non seulement à l'école, mais aussi dans la presse. Résultat : en page 2, il y a un article sur l'environnement qui met en garde contre la climatisation, et en page 7, un autre article fait l'éloge des dernières innovations dans les 4X4 en matière de climatisation automobile. Il n'y a aucune coordination dans les rédactions ; du moins dans les quotidiens ou les organes de presse écrite que je connaisse. C'est un vrai problème de formation et de sensibilisation qui concerne à la fois les journalistes qui ne sont pas des journalistes environnement, et leur hiérarchie qui a plutôt tendance, par manque de place, à arbitrer en faveur d'un article sur l'automobile qui lui apportera quelque bonne publicité sur les 4X4 plutôt qu'un article sur l'environnement qui ne lui rapportera pas la même bonne publicité. L'argent est également un très gros problème pour la presse écrite. Un dernier mot sur la communication gouvernementale. On jette beaucoup la pierre à la presse écrite. Mais la presse écrite est une presse d'« actu ». Or l'actualité n'est pas toujours, ni pour le journaliste de base ni pour sa hiérarchie, aisée à déceler. Et lorsqu'il y a une vraie actualité, l'expérience prouve que la communication en direction des médias, notamment au niveau gouvernemental, est souvent déficiente. Je citerai en exemple, la communication au moment de la présentation des Plans « climat ». Quand on prévoit, un certain 19 janvier 2000, une conférence de presse à 18 heures 30, heure à laquelle beaucoup de journaux ont bouclé ou sont en bouclage ; quand on organise une communication sur le Plan « climat » le 22 juillet 2004 ; quand, dans les deux cas, on met le dossier sous embargo sans doute parce qu'on s'imagine que les malheureux journalistes seront capables d'avaler 200 pages en une demi-heure et d'en sortir les mesures les plus importantes, le résultat est à la hauteur de ce qu'on pouvait attendre en pareille circonstance. M. le Président : Merci de vos remarques. Vous faites partie, pour nous, de ceux qui devraient concourir à la sensibilisation du public. Je remarque, de mon côté, que Jean-Marc Jancovici n'est pas le seul membre de notre comité de pilotage, qu'il comprend d'autres héros modernes, notamment des économistes. Si certains d'entre nous ont fait Polytechnique ou ont un doctorat, nous restons désarmés devant ces sujets complexes et nous nous heurtons, nous aussi, au cloisonnement que vous dénoncez. Il faut du temps pour traiter ces questions et il n'est pas question de répondre blanc ou noir. Certes, les États-Unis n'ont pas ratifié Kyoto. Mais la situation a évolué, comme nous l'avons constaté dernièrement avec certains maires ou certains gouverneurs d'États. Vous avez dit qu'ensemble on arriverait à de meilleurs résultats. Il me semble en effet que si la totalité des acteurs, depuis les scientifiques jusqu'aux politiques en passant par les journalistes, les associations, coordonnaient leurs efforts, on réussirait à sensibiliser le public sur ces questions. Un rapport comme celui que nous préparons doit être l'occasion de le faire. Je regrette que, du fait de la tenue de la commission d'enquête sur l'affaire d'Outreau, nous n'ayons plus à notre disposition la même salle, qui permet une meilleure médiatisation. Cela dit, notre Parlement a fait des progrès s'agissant des auditions publiques. La première réunion de ce type concernait d'ailleurs l'Antarctique, il y a quinze ans, avec le commandant Cousteau. Le premier comité de pilotage date, lui, d'une dizaine d'années. Nous devons, en l'occurrence, essayer de voir comment, dans le système éducatif, dans la fonction publique, via l'ADEME ou la MIES, dans les associations, dans la presse, on pourra faire progresser le sujet, comment on pourra organiser le débat entre l'expert, le citoyen et le politique. Il faut bien voir que certaines questions ne sont pas discutées. Lorsque nous nous présentons à une élection présidentielle ou à une élection législative, on ne parle pas de tous les sujets. Nous ne sommes pas élus suivant notre position sur ces sujets-là. Nous devons donc revenir devant les citoyens et réinventer des formes de démocratie participative. Vos propos ont permis de résumer les problématiques. Maintenant, comment aller plus loin ? Comment faire mieux ? Comment articuler cela avec le rôle du politique ? M. Alain GEST : Vous avez pointé des choses qui, de mon point de vue, sont très importantes et très utiles si l'on veut atteindre notre objectif. Mme Laborde a dit qu'il fallait donner la parole aux scientifiques à la télévision, en leur donnant du temps. Mais est-ce sérieusement compatible avec l'audimat ? Je pense aussi bien aux chaînes publiques qu'aux chaînes privées. Comment trouver le moyen de faire passer des scientifiques aux heures de grande écoute ? Mme Jaudet a dit qu'elle avait tout lieu de penser que nos concitoyens, qui sont en même temps électeurs, consommateurs, etc. étaient prêts à agir et à accepter certaines mesures : bridage des moteurs, taxations. Qu'est-ce qui permet de le dire ? M. Serge POIGNANT : Nous sommes en effet devant un problème complexe et il n'y a pas de réponse simple. Notre rapport devrait permettre de sensibiliser le public. Les auditions nous amèneront à faire des préconisations. Au-delà, une conscience globale devrait se dégager et nous disposerons d'une base d'informations qui sera utile à tous. Je ne suis pas persuadé que les citoyens soient prêts à accepter le bridage des moteurs. Mais vous qui êtes communicants, médias, si nous devions prendre demain des mesures de contrainte, de taxation qui, par nature, sont plus difficiles à faire passer que l'idée qu'il y a danger, comment réagiriez-vous ? Certains héros modernes comme Nicolas Hulot contribuent de façon extraordinaire à la communication et à la présentation de certains sujets dans les écoles. Tous les niveaux scolaires sont concernés, selon moi. Savez-vous si des solutions plus efficaces existent dans certains pays ? Si oui, quels conseils nous donneriez-vous ? Mme Geneviève GUICHENEY : Vous avez parlé d'audimat. Il se trouve que je suis sur une chaîne publique dont vous décidez de l'existence et dont vous votez le budget. M. Serge POIGNANT : Mais l'audimat est pour tout le monde. Mme Geneviève GUICHENEY : Un service public procède d'une volonté politique : qu'est-ce qu'on en attend, qu'est-ce qu'on veut en faire ? Je connais bien les téléspectateurs, pour avoir été médiatrice des programmes à France Télévisions pendant six ans. Dans mes rapports annuels, dont je vous recommande la lecture, on retrouve leurs paroles, on apprend ce qu'ils en attendent et ce qu'ils pensent, par exemple, de la redevance. Si on leur demande s'ils veulent garder ce qu'ils ont aujourd'hui sans rien payer, je pense qu'ils répondront « oui ». Mais si on leur dit le prix des choses, si on leur indique ce qu'on peut espérer en échange, ils sont capables de comprendre. Il faut leur faire confiance. Ce que j'aime dans le service public, c'est que je dois m'adresser à l'intelligence de chacun. J'ai l'ardente obligation de communiquer à chacun des informations qui pourront lui être utiles. Vous avez raison de penser que le service public n'échappe pas à la course à l'audience. Aucun artisan de la télévision ne peut souhaiter faire un programme que personne ne regarde. Des arbitrages ont lieu entre la quantité de publicité et la redevance. Mais je suis persuadée, et des exemples existent, que l'on peut faire de l'audience sans faire de la course à l'audimat. Des programmes ont été mis à l'antenne qui ont très bien marché, alors que le service public lui-même n'était pas certain que ce serait le cas. Je trouve fantastique qu'alors, des téléspectateurs prennent l'initiative de nous écrire pour nous remercier. Sans que nous ayons communiqué sur la fonction de la médiation, j'ai reçu la première année 2 400 courriers, la deuxième année 24 000, la troisième année 35 000 ! Sommes-nous capables de faire passer des messages ? Ce qui me plaît dans le service public, c'est que l'on y fait confiance aux téléspectateurs. Dans la mesure où on leur explique, où notre objectif est clair et ambitieux, qu'il sert l'intérêt général et qu'on n'a pas la trouille, je suis convaincue qu'on peut en effet faire passer des messages. M. le Président : Puisqu'on vote le budget, pourquoi ne pas l'inclure dans le cahier des charges ? Et qu'en pense TF1 ? Mme Catherine LABORDE : Il existe des émissions très intéressantes, dans le privé, où l'on donne la parole aux scientifiques. C'est le cas de Terre-Mère, qui passe sur le câble, sur LCI. Nicolas Hulot, qui n'est pas un scientifique, a réussi à imposer, dans le privé, avec des audiences remarquables, une émission sur la beauté de la terre. Ce n'est pas rien. C'est donc possible. Cela dépend plus des individus plus que de la bonne cause. Revenons à mes propos sur Michael Crichton. Je pense, sans cynisme, que scénariser le bouleversement climatique intéresserait les jeunes gens et les amènerait à se poser des questions et à se positionner. Ce fut le cas pour le film catastrophe Le Jour d'après, qui comportait beaucoup de bêtises mais aussi des choses intelligentes. Et puis, je crois malheureusement à la vertu pédagogique des catastrophes. Lorsque se produira une énorme catastrophe météorologique, les gens seront prêts à payer beaucoup plus cher, à ne plus se servir de leur voiture et à renoncer au climatiseur. Autant leur montrer cette catastrophe en fiction, avant qu'elle ne se produise. Mme Marie-Jeanne HUSSET : Souvenez-vous du succès qu'a eu l'histoire de l'homme par Yves Coppens, qui a fait des records d'audience. Il existerait l'équivalent sur l'histoire du climat, cela marcherait tout autant. Il y a vingt-cinq ans, on n'arrivait pas à sensibiliser beaucoup de lecteurs aux questions climatiques. Certaines personnes étaient passionnées. Le très grand public ne l'était pas. Il faut dire que les échéances étaient à cinquante ans, ou à la fin du siècle. Mais depuis, deux événements se sont produits : la tempête de 1999 et la canicule de 2003. Ces grandes questions touchent à la science, à la vie de tous les jours, aux questions économiques, aux questions de droit, au porte-monnaie, etc. Mais, en l'occurrence, ce ne sont pas les citoyens qui me semblent frileux : ce sont plutôt les hommes politiques qu'il faut convaincre et à qui il faut insuffler du courage pour qu'ils assument leurs choix. M. le Président : Vous avez sans doute raison. Sauf que les hommes politiques ne prennent des décisions que s'ils y sont globalement incités, voire poussés. Que voulons-nous faire ? S'agissant de l'état des lieux, nous sommes tous convaincus : la consommation énergétique ne fait qu'augmenter ; si les pays en voie de développement arrivent à un niveau équivalent au nôtre, il faudra, dans notre système actuel, davantage d'énergie. Comment leur opposer que ce n'est pas possible ? Quand on étudie les projections de Météo France relatives au réchauffement de la planète et qu'on sait qu'on n'a jamais vu de tels changements climatiques à des échelles aussi courtes, en tant que politiques, on est bien obligés de le dire. Puisque nous sommes tous d'accord sur cet état des lieux, il nous faut prendre des mesures. Si nous n'en proposions pas, nous ne jouerions plus notre rôle d'hommes politiques. Ce sera ensuite à vous de nous juger. Nous voulons donc faire des propositions, qui passeront ou qui ne passeront pas, en fonction des intérêts, des lobbies, de l'état de perception de la population. Mais nous voulons aussi sensibiliser. Et là, nous avons à jouer le même rôle que vous. Quand nous aurons entendu la totalité des personnes qui comptent sur le sujet au niveau national et en européen, et que nous serons allés à l'étranger, dans deux pays : l'Inde et les États-Unis, nous aurons joué notre rôle de parlementaires. Et nous pourrons essayer de dire quel type de mesures devrait s'imposer. Voilà où nous voulons aller. Mme Marie JAUDET : Est-ce qu'il y a vingt ou trente ans, on aurait cru que l'histoire pouvait passionner les Français à la télévision ? Je pense à l'émission Alain Decaux raconte. Pourquoi ne pas faire la même chose sur le sujet climatique ? Catherine Laborde a dit que les scientifiques étaient les héros du vingt et unième siècle et qu'il fallait les inviter pour en parler. Mais il faudrait aussi que les hommes politiques soient invités pour en parler et pour dire qu'il faut faire quelque chose. C'est aussi à l'État d'afficher l'importance du sujet, à porter la cause et à construire la culture du climat. Quelles sont mes sources par rapport aux attentes des citoyens ? Il existe des études et des sondages sur le sujet. Je n'ai cité que les études qui avaient le mérite d'être récurrentes, qui reviennent tous les ans depuis plusieurs années. L'étude « Les Français et l'énergie » est due à une institution reconnue, à savoir le ministère de l'économie ; elle constitue un baromètre d'opinion depuis dix ou vingt ans. On y apprend que maintenant, une majorité de Français, soit 55 %, sont prêts à accepter une augmentation de leur facture d'électricité à partir du moment où il s'agit d'électricité verte. Une étude est faite depuis 2002 pour savoir quelles sont les mesures que l'on pourrait adopter pour lutter contre l'effet de serre, et pour savoir si les Français seraient d'accord. Par exemple, on pourrait limiter la vitesse des voitures dès leur sortie d'usine. L'opinion des Français est en évolution constante et on apprend qu'en 2005, 80 % d'entre eux pensaient qu'une telle mesure était souhaitable. Il en est de même de la limitation de la vitesse sur autoroute à 110 km/heure, acceptée par 53 % des Français. Nous avons observé la même évolution s'agissant de certaines mesures fiscales. Mais nous pourrons vous transmettre les documents correspondants. M. Patrice JOLY : Certaines questions ont été posées aussi à des élus locaux. On s'est aperçu que leurs réponses étaient toujours très en deçà de celles du public. Mme Geneviève GUICHENEY : La Gazette des communes a réalisé un double entretien, avec les élus et le « grand public ». M. Philippe GILLET : Je suis persuadé que la télévision est un excellent véhicule de l'information et de la formation. Vous avez la chance de pouvoir porter certaines choses vers le Gouvernement. Pourquoi ne se repose-t-on pas la question de l'information scientifique à la télévision ? C'est une espèce d'Arlésienne qui dure depuis des décennies. On pourrait imaginer de monter une sorte de plan. Les Anglo-Saxons sont redoutablement forts en la matière. Les émissions de la BBC sur le changement climatique, que je vous invite à regarder, sont exceptionnelles. Ce sont des émissions nationales, qui passent dans les écoles. Cela n'existe pas en France, que je sache. Par ailleurs, la télévision sait se mobiliser sur des enjeux de société ou des causes importantes, comme les maladies orphelines, avec le Téléthon. Pourquoi pas sur le changement climatique ? Peut-on faire de la télévision à audimat sur de telles questions ? Mme Geneviève GUICHENEY : La réponse est : oui ! M. Philippe GILLET : Alors, faites-le ! Mme Geneviève GUICHENEY : C'est autre chose. M. Philippe GILLET : Les scientifiques sont prêts à vous aider. Jusqu'à présent, les scientifiques étaient payés à découvrir le monde qui nous entoure. Les climatologues étaient là pour comprendre le fonctionnement de notre planète. Aujourd'hui, on les met sous pression en leur demandant d'être des décideurs, de prendre position dans un jeu d'une complexité extrême. M. Christian DECOCQ : Alors que je milite et que je travaille sur le développement durable depuis une trentaine d'années, j'avoue qu'il n'y a que quatre ou cinq ans que j'ai pris conscience de l'effet de serre. J'ai même confondu couche d'ozone et effet de serre. Il se trouve que j'ai déjeuné, un peu par hasard, avec un de mes anciens patrons, un haut fonctionnaire, très compétent dans le domaine de l'environnement. Cet ingénieur, polytechnicien, m'a dit qu'il avait découvert l'effet de serre en 1988 ! Depuis les auditions de notre mission, notamment, j'ai pris conscience de l'urgence. On ne peut plus se contenter du message de développement durable, de protection des milieux, etc. qui était le mien. Sans dramatiser, il faut faire la part des choses. Notre mission est d'éclairer nos concitoyens sur la prégnance de ce qui se passe. Les scientifiques fournissent l'information. Nous fabriquons un peu d'émotion, afin de communiquer, de mettre les choses en perspective, de montrer la gravité de la situation et la nécessité de modifier nos comportements. Nous n'avons pas besoin de l'accord de nos concitoyens pour nous assurer une certaine sécurité politique. Mais nous savons que la modification durable des comportements passe par leur appropriation de ces phénomènes. À un certain moment, nous devrons nous poser la question du choix entre les mesures normatives et les mesures incitatives. Accepteriez-vous que nous prolongions un peu le débat pour parler de la dramatisation ? M. le Président : Malheureusement, nous avons des impératifs, et les participants à la seconde table ronde sont déjà là. Mme Marie-Jeanne HUSSET : Je ferai deux remarques. Premièrement, il y a longtemps que l'on parle de la science à la télévision. Je considère qu'il ne faut pas isoler la science du reste de la vie. Intégrez-la au quotidien et vous verrez qu'elle passera très bien à la télévision. Deuxièmement, le bridage des moteurs est une restriction de liberté. Mais si vous faites appel au bon sens des gens, si vous leur demandez s'ils sont contre les limitations de vitesse sur les routes, ils vous répondront que non. Demandez-leur pourquoi il faudrait fabriquer des voitures qui roulent à 200 km/heure. Vous verrez que tout le monde trouve cela débile. Mme Geneviève GUICHENEY : Mieux vaudrait parler de moteurs économes que de moteurs bridés. Je suis résolument hostile à la dramatisation, qui me semble contre-performante. Je me fonde, entre autres, sur ce que j'ai pu lire dans le courrier des téléspectateurs, qui avaient protesté contre certaines émissions et exprimé leur accord à propos d'autres. Les chiffres d'audience sont là pour le confirmer. Lorsqu'on vient à leur rencontre, les téléspectateurs répondent positivement. Fabriquer de l'émotion ? Je ne suis pas certaine. Entraîner, oui. C'est cela que nous avons tous à faire. L'été dernier, je regardais, au supermarché, un couple de gens très modestes, qui venaient d'acheter : du jambon sous plastique, des carottes râpées dans une petite barquette et du taboulé également dans une barquette. Je me suis demandé comment ces gens, qui avaient sans doute un jardin, pouvaient acheter ces choses infectes, enfin pas bonnes en tout cas. Et je voyais la quantité de déchets qu'il y aurait pour cette minuscule quantité de nourriture immangeable. Mais je ne pouvais pas leur faire observer que cela aurait des conséquences sur la couche d'air au-dessus de nos têtes. Après tout, ils avaient trouvé tout cela dans les rayons. Nous devons obtenir des distributeurs qu'ils cessent ce genre de conditionnements, auxquels les consommateurs ne peuvent rien. Je me suis sentie coupable de l'achat de ces gens. Il va falloir travailler sur ces questions, en s'adressant gentiment aux gens qui doivent pouvoir choisir de ne pas nuire à l'environnement tout en bénéficiant eux aussi d'un certain nombre d'éléments de confort. Il ne s'agit pas de vivre moins bien au contraire, il s'agit de vivre autrement. Il faut changer nos modèles. L'enjeu est considérable. Nous devons prendre le temps d'un diagnostic fin, qui laisse supposer qu'il existe de nombreuses solutions à tous les problèmes posés. Mme Catherine LABORDE : J'aime beaucoup ce mot de « dramatisation » parce que c'est un terme de théâtre. La mise en scénario me semble importante. Mais ce mot laisse aussi supposer que l'histoire finit mal. Or je ne pense qu'on puisse persuader les gens et les intéresser si cela doit mal finir. Nous sommes aujourd'hui pris d'une fièvre obsidionale : nous nous sentons assiégés par la grippe aviaire, le changement climatique. Tout devient menace. Je suis comme vous, monsieur : j'ai découvert l'effet de serre il n'y a pas si longtemps. Mais même à Météo France, on n'en parlait pas beaucoup. Reste que certaines catastrophes comme la tempête de 1999 ont permis une certaine prise de conscience. Je suis donc favorable à une dramatisation qui soit une scénarisation. Mais il faut qu'elle débouche sur une fin heureuse. Je ne sais pas comment cela pourrait finir bien. Grâce aux scientifiques peut-être .. Je l'ai dit, ce sont eux les héros modernes. M. Patrice JOLY : Le point-clé est d'offrir des solutions, en effet. Il ne s'agit pas de désespérer les gens par des discours de fin du monde. Il faut leur donner des explications pour leur permettre d'agir. Nous devons pouvoir mobiliser des conseillers sur le terrain pour expliquer aux gens ce qu'il faut faire et leur donner des perspectives. Mme Geneviève GUICHENEY : Et écouter leurs solutions : il en ont plein ! Mme Odile MEUVRET : Je pense vraiment que c'est la télévision qui aura le rôle clé. Je veux bien que l'on mette des scientifiques à la télévision, mais il faut qu'ils soient capables de communiquer. Or la démarche scientifique, toujours d'une extrême prudence, passe mal auprès du grand public. Vous devrez donc bien choisir vos interlocuteurs. Je suis d'accord pour la scénarisation. Mais le problème fondamental est tout de même d'expliquer et de faire le lien entre climat et vie courante. Et je pense que rien ne remplacera, à cet égard, deux minutes après la météo. M. le Président : Je vous remercie. Cela nous a changé des auditions des scientifiques et des économistes. Table ronde sur le bilan carbone des biocarburants, réunissant : Présidence de M. Jean-Yves LE DÉAUT, Président M. le Président : Nous avons déjà tenu une table ronde sur l'agriculture et le changement climatique, au cours de laquelle nous avons notamment évoqué les perspectives de développement des biocarburants. Les arguments échangés à cette occasion ont été pour le moins contradictoires. C'est pourquoi il s'agit principalement aujourd'hui de faire un point sur les résultats des études relatives au bilan carbone des biocarburants. Au-delà, nous aborderons les perspectives du développement de biocarburants, non seulement du point de vue de leur impact sur l'environnement mais aussi sur les plans technique, énergétique et économique. Après une introduction synthétique de M. Henri Prévot, un exposé de M. Thierry Raes sur les résultats de l'étude conduite pour l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, l'ADEME, et une intervention de M. Jean-François Larivé sur le bilan des biocarburants effectué par CONCAWE, notamment du point de vue énergétique et en ce qui concerne le bilan carbone, nous entamerons le débat. M. Henri PRÉVOT : Le contexte mondial n'est pas à la pénurie de carbone fossile, mais à la surabondance. Si nous émettons tout le carbone accessible, nous atteindrons des teneurs de l'ordre de 1 000 ppm, c'est-à-dire le pire scénario envisagé. Cela signifie que nous devons laisser ou réintroduire dans le sol la moitié environ du carbone. Du carbone fossile peut également être économisé par plusieurs moyens et les biocarburants en font partie. La première contrainte mondiale est le sol. La seconde concerne les moyens financiers. Cela nous donne deux critères : la quantité d'émission de gaz à effet de serre par hectare et le surcoût par tonne de carbone économisée - quant au rapport entre l'énergie délivrée par le biocarburant et le carbone consommé, il est peu intéressant en lui-même. Ces deux critères peuvent être calculés pour le méthanol et l'ester méthylique d'huile végétale, l'EMHV. Demain, ils pourront l'être pour de nouveaux procédés : la production d'éthanol par hydrolyse enzymatique ; la gazéification et recombinaison en vue de produire du carburant de synthèse. Ces deux procédés coûteront probablement aussi cher que ceux en vigueur aujourd'hui mais utiliseront l'intégralité de la matière et pourront intégrer les variétés poussant le mieux, ce qui optimisera la quantité de biomasse par hectare. Le surcoût de l'éthanol par tonne de carbone fossile qu'il permet de ne pas émettre est de 600 à 800 euros avec un pétrole à 50 euros par baril ; le surcoût de l'EMHV (ester méthylique d'huile végétale) est de l'ordre de 300 euros par tonne. A l'avenir, il faudra compter autour de 400 euros par tonne. A partir du résultat des études de Price Waterhouse Coopers et de Concawe, on calcule que les quantités de carbone fossile économisées à l'hectare sont les suivantes : 0,5 tonne par hectare et par an pour l'éthanol à partir de céréales, 1,5 pour l'éthanol à partir de betterave, 1,07 pour le biodiesel. A l'avenir, avec les procédés de fuel synthétique, nous pourrons atteindre, selon les techniques 1,5 voire 3 ou 4,5 tonnes. Je vous propose une piste pour obtenir davantage de carburant sans émettre de gaz à effet de serre et en améliorant l'utilisation du sol par rapport aux méthodes actuelles : brûler de la biomasse dans les réseaux de chaleur en lieu et place du fuel domestique, ce qui coûterait 200 euros par tonne de carbone et dégagerait de 4 à 5 tonnes de carbone par hectare. C'est maintenant aux décideurs de choisir où ils veulent mettre l'accent. M. Thierry RAES : Notre étude a été réalisée en 2002, pour le compte de l'ADEME et de la direction des ressources énergétiques et minières du ministère de l'économie et de finances, la DIREM. Le bilan des biocarburants en termes d'émission de carbone est 2,5 fois meilleur par rapport à la filière essence et 3,5 fois meilleur par rapport à la filière gazole. Les aspects économiques ne faisaient pas partie de la commande. Les produits étudiés étaient l'éthanol et l'ethyl tertio butyl ether - l'ETBE - de blé et de betterave en comparaison à l'essence, et l'huile végétale et l'EMHV de colza et de tournesol en comparaison au gazole. Ces bilans ont fait l'objet de deux scénarios, l'un immédiat, concernant 2002, l'autre prospectif, à l'horizon 2009. Notre méthode a reposé sur l'analyse des cycles de vie. Nous avons choisi comme unité de référence le mégajoule et non le kilomètre parcouru car il ne nous avait pas été demandé, à l'époque, d'incorporer l'aspect rendement des moteurs. Nous avons comparé les différentes étapes de production et de transport du brut ; nous avons considéré que la combustion était totale. Nous avons travaillé sur deux indicateurs du bilan énergétique intéressants du point de vue de l'accroissement de l'effet de serre d'ici à cent ans : la mobilisation d'énergie non renouvelable et la performance énergétique par unité de surface. Le facteur le plus important de réduction de l'effet de serre concernera, en 2009, la récupération du CO2 issu de l'étape industrielle de fermentation pour les filières éthanol de blé et de betterave. Le rendement énergétique, pour la filière comparée à l'essence, est de 2,05 contre 0,87 avec l'éthanol et de 1,02 contre 0,76 avec l'ETBE de blé et de betterave : le rendement énergétique des biocarburants est donc supérieur. Pour la filière comparée au diesel, il est encore meilleur : il atteint 4,68 avec l'huile de colza, 5,48 avec l'huile de tournesol, 2,99 avec l'EMHV de colza et 3,16 avec l'EMHV de tournesol contre 0,92 avec le diesel. S'agissant des émissions de gaz à effet de serre, les bilans des filières essence et diesel sont respectivement à peu près 2,5 fois et 3,5 fois supérieurs à celui des filières de biocarburants. D'après le scénario prospectif, la réduction des émissions de CO2, à l'horizon 2009, atteindrait 45 % pour l'éthanol de blé et 43 % pour l'éthanol de betterave ; elle serait plus faible pour les huiles de colza et de tournesol. Pour l'essence et le gazole, nous n'avons pas anticipé de variation significative. M. Jean-François LARIVÉ : Notre étude a été effectuée en partenariat avec la branche recherche de l'industrie automobile européenne, EUCAR, et le Joint Research Centre, le JRC, centre de recherche de la Commission européenne. De plus, les travaux sur la filière éthanol ont été revus par des universitaires et des industriels britanniques. Le bilan carbone des biocarburants dépend de nombreux facteurs et, selon les cas, peut être très bon comme très mauvais. Le bilan de la filière éthanol de betterave n'est pas très bon lorsque la pulpe est employée comme aliment pour bétail (cas habituel aujourd'hui). Il serait en principe bien meilleur si la pulpe était utilisée comme combustible. De même, une grande partie de l'énergie utilisée dans la filière de l'éthanol de blé étant consacrée au procédé de production, selon la manière dont cette énergie est produite, le bilan est relativement favorable ou défavorable. La paille n'est pas utilisée aujourd'hui parce que le procédé est complexe et cher ; la cogénération avec turbines à gaz est efficace énergétiquement et rentable économiquement. Le bilan de la filière canne à sucre (modèle brésilien) est extrêmement positif : près de 90 %. Sur la base des filières effectivement utilisées en Europe, le CO2 économisé atteint environ 40 % avec l'éthanol et environ 50 % avec l'ester méthylique mais, en particulier dans ce dernier cas, la marge d'erreur est élevée, à cause des émissions de protoxyde d'azote. Les biocarburants utilisent l'énergie de manière peu efficace : ils économisent de l'énergie fossile mais usent beaucoup d'énergie bio, ce qui donne un rendement énergétique faible. C'est ainsi que la gazéification du bois pour la production de chaleur, d'électricité ou de carburant de deuxième génération recèle un bien meilleur potentiel d'économie de CO2. Nous avons estimé les volumes qui pourraient être remplacés. En Europe, à production d'aliments et à surfaces cultivées constantes, jachères incluses, ils ne peuvent qu'être limités. Mais il serait possible d'aller plus loin avec les carburants de deuxième génération. Même à 50 euros le baril de pétrole, les biocarburants restent plus chers que les carburants conventionnels puisque le tonnage de CO2 évité équivaut à 120 à 150 euros tandis que le coût de substitution, par tonne de carburant substitué, atteint 200 à 500 euros. Je précise qu'aujourd'hui le prix de la tonne de CO2 sur le marché est de l'ordre de 20 à 25 euros. Enfin, les carburants de deuxième génération économiseront davantage de CO2 mais restent très chers et nécessitent des investissements relativement lourds. M. le Président : Si j'ai bien compris, quels que soient les types de cultures à partir desquelles les biocarburants sont produits, les coûts sont relativement faibles par rapport au gain obtenu. M. Henri PRÉVOT : Non ! Le coût des biocarburants par tonne de carbone évitée reste élevé, presque aussi élevé avec l'éthanol qu'avec les futurs biocarburants : 300 euros par tonne de carbone pour le gazole et 600 à 800 euros par tonne de carbone pour l'éthanol, sachant que les incitations sont presque aussi élevées - 300 euros de défiscalisation par mètre cube d'éthanol, c'est-à-dire 450 euros par mètre cube d'essence remplacée - soit 550 euros par tep, soit plus de 1000 euros par tonne de carbone fossile évitée. Aux Antilles et en Guyane, la bonne utilisation de la biomasse consiste à produire de l'électricité pour remplacer le charbon ou le fioul, y compris s'il est nécessaire de se lancer dans des cultures dédiées, une tonne équivalent pétrole - TEP - de biomasse remplaçant une TEP de fioul. En métropole, c'est le contraire car cela reviendrait à remplacer le nucléaire ; ce serait la pire des utilisations de la biomasse. En revanche, une fois saturées les capacités d'utilisation de la biomasse pour la chaleur, il sera possible de l'utiliser pour produire du biocarburant. M. Serge POIGNANT : Tenez-vous compte du processus de fabrication des biocarburants ? M. Jean-François LARIVÉ : Bien entendu : de tous les intrants chimiques et de la préparation des biocarburants. M. le Président : Comment expliquez-vous l'égalité entre la fixation de CO2 lors de la croissance des plantes et l'émission de CO2 lors de la combustion des biocarburants ? M. Jean-François LARIVÉ : C'est très simple. Lorsqu'une plante est brûlée, le carbone consumé correspond au CO2 qui a précédemment été pompé par la plante dans l'atmosphère. Mais quelle est, dans la préparation de biocarburant, la quantité d'énergie nécessaire et quelle est sa part fossile ? Le débat est là. Tout dépend du mode d'élaboration du biocarburant et certains pays européens s'intéressent à des systèmes de certification. Il faut distinguer biocarburant et biocarburant, éthanol et éthanol, et même éthanol de blé et éthanol de blé. M. le Président : Dans les conditions actuelles, substituer des biocarburants aux productions traditionnelles est-il rentable ou bien s'agit-il d'une aide à l'agriculture ou à l'environnement ? M. Henri PRÉVOT : Cela coûte cher au contribuable ou au consommateur et, pour que cela change, il faudrait économiser les mêmes quantités de carbone à moindre coût. Mais, d'après une étude de l'Institut national de recherche agronomique, il semble que cela ne profite qu'en petite partie à l'agriculture. M. Christian DECOCQ : Il importe d'aller au-delà de l'écobilan carbone. Projetons-nous dans le futur : une politique de biocarburants volontariste nécessiterait une agriculture extraordinairement intensive et il faudrait établir un écobilan général. Si les problèmes de l'eau ou de l'érosion des sols sont négligés, nous ne ferons qu'une politique de gribouille ; les bénéfices obtenus en matière d'effet de serre seront perdus d'un autre côté. M. Henri PRÉVOT : Le sol doit être utilisé de la meilleure façon possible et non pas au maximum. Peut-être la nation optera-t-elle par exemple pour le développement d'arbres à croissance rapide. Des recherches variétales correspondant aux circonstances météorologiques et climatiques locales paraissent prometteuses, en particulier en ce qui concerne l'hydrolyse enzymatique, même si cette technique capricieuse n'est pas encore maîtrisée. Mme Martine BILLARD : Il convient effectivement de ne pas se polariser sur l'effet de serre mais de comprendre l'écobilan général, sans quoi il faudra bientôt créer des missions d'information sur d'autres sujets ! Vu les urgences environnementales, il serait désastreux de réfléchir morceau par morceau. J'ai compris que vous n'étiez pas très convaincu de l'intérêt global des biocarburants pour remplacer les carburants automobiles et que vous préconisiez davantage l'usage de ces techniques pour produire de l'énergie dans des réseaux locaux. M. Henri PRÉVOT : Aujourd'hui, oui, mais la lutte contre l'effet de serre va progressivement s'intensifier et il faudra payer plus cher pour lutter contre l'effet de serre. Par ailleurs, une partie de la biomasse pourra être utilisée efficacement pour produire des biocarburants avec les procédés techniques qui seront mis au point dans le futur. Mme Martine BILLARD : Pour l'éthanol de blé, toute la plante est-elle utilisée ? Et que pensez-vous de l'utilisation directe des huiles végétales ? M. Jean-François LARIVÉ : Pour l'éthanol, seul le grain de blé est utilisé. La transformation des huiles végétales en ester est peu énergivore et indispensable pour obtenir un carburant automobile acceptable par les moteurs actuels. L'utilisation directe des huiles végétales n'a guère de sens : un moteur de tracteur tiendrait le coup mais un petit moteur Peugeot ne durerait pas longtemps. M. Serge POIGNANT : Si vous êtes tous d'accord sur les chiffres du bilan, cela nous éclairera. Mieux vaut brûler de la biomasse et réduire la consommation de gazole dans le transport, sans quoi les émissions seront stables. Mais quand parviendrons-nous à l'économie de carbone de 3 à 5 tonnes par hectare et par an dont il a été question ? Et quel sera le bilan général ? M. Henri PRÉVOT : Il manque en effet une vision globale dans les raisonnements. Une fois la molécule de gaz carbonique rejetée dans l'atmosphère, peu importe d'où elle est partie ; de même, peu importe l'endroit où se trouve celle qui n'est pas dégagée. Seul compte le résultat final du tableau des différentes origines et utilisations de l'énergie, en fonction des critères du sol et du coût : les bilans d'émissions sectoriels ne présentent aucun intérêt. M. le Président : Combien faudrait-il consacrer d'hectares aux biocarburants ? Et je vous invite à bien distinguer carbone et CO2, le rapport entre deux quantités étant de l'ordre de 3 ou 4. M. Joseph RACAPÉ : Il convient de se méfier des effets d'annonce et des propos à l'emporte-pièce sur tel ou tel aspect de l'écobilan. L'élément fort, en matière d'écobilan, est le statut conféré au coproduit. Il faut savoir de quoi l'on parle et sortir de l'obscurantisme, surtout avec l'opinion publique, mal initiée au sujet. L'écobilan doit tenir compte de la composante agri-environnementale. Les dégâts environnementaux occasionnés par le processus de production doivent être pris en compte pour déterminer si cette culture est plutôt positive ou négative. Le dispositif d'assolement et le suivi de la plante entière doivent être intégrés dans le raisonnement. Si la plante entière est employée, le bilan énergétique sera amélioré mais la ponction d'humus sera néfaste pour le sol agricole. D'autant que, dans le cadre du dispositif de Kyoto, certains pays ont pris l'option gestion des terres agricoles, avec un enregistrement du taux de carbone contenu dans les sols. M. le Président : Je regrette de ne pas comprendre. Le CO2 des sols est-il compris dans l'écobilan ? Les études actuelles intègrent-elles le coût du travail agricole et le coût de la restitution du CO2 ? Si, au bout du compte, le solde d'énergie consommée est positif, il faut renoncer ; si, au contraire, il est positif, il faut avancer. M. Alain GEST : Vos calculs semblent partir du principe d'un accroissement des surfaces exploitées alors que nous nous orientons plutôt vers une substitution, notamment en ce qui concerne la betterave. Pour nous faire une idée, nous avons besoin d'une conjugaison de toutes les données. M. Joseph RACAPÉ : La comparaison à la tonne de carbone évitée crée un effet d'optique : avec les biocarburants, un substitut liquide est créé pour les transports alors que, avec les carburants classiques, l'utilisation de l'énergie n'a pas la même fonction. Le coût à la tonne de carbone évitée, en bioénergie, constitue un gisement bon marché considérable - je pense en particulier au bois des forêts. M. Henri PRÉVOT : Si l'utilisation de biomasse me permet d'économiser un mètre cube de fioul domestique, je pourrai m'en servir pour faire tourner un moteur. L'enjeu consiste à utiliser la matière de la façon la plus commode. M. le Président : Si vous économisez une tonne de fioul, c'est positif. Mais si vous avez perdu une tonne de fioul en équivalent carbone dans le sol, cela ne présente aucun intérêt. Je m'étonne que la MIES soit moins optimiste que les agriculteurs ! Avant de sortir de cette salle, il faudra que nous ayons compris et que vous nous ayez donné des idées. Mme Isabelle SPIEGEL : Nous avons opéré une simulation : quand du carbone est stocké dans les sols, quel est l'impact sur les résultats ? Cependant, dans le scénario de référence, nous avons choisi de ne pas intégrer les variations de stockage dans les sols car des questions techniques se posent encore concernant la pérennisation de ce carbone. En simulation, nous sommes partis sur une hypothèse allant jusqu'à 200 kilos de carbone stocké par hectare et par an et nous arrivons à environ 10 et 30 % de gains sur le bilan carbone de l'éthanol et du l'EMHV. M. Henri PRÉVOT : Mais le stockage n'est pas indéfini. M. Christian DECOCQ : Personne ne peut prétendre qu'une étude complète du coût de l'agriculture intensive pour l'environnement a été accomplie. L'usage d'engrais azoté, par exemple, rend indisponible pour longtemps les nappes phréatiques, ce qui oblige l'agriculteur à fabriquer de l'eau potable au lieu de la prélever, avec parfois une multiplication du coût par dix, sans oublier la consommation d'énergie. Ce n'est pas gravissime si les biocarburants sont fabriqués à partir de ce qui est déjà cultivé aujourd'hui, d'autant que cela contribue à régler des problèmes géostratégiques et économiques. Mais si, à l'inverse, nous nous orientons vers de la culture de biomasse, nous tomberons forcément dans la vision intensive. M. Dominique PARET : Tous les bilans sont favorables aux biocarburants : le bilan CO2 est nettement positif tant pour le diester par rapport au gazole que pour l'éthanol par rapport à l'essence. Je rappelle que seul le diester dans le gazole conduit à une réduction de la dépendance énergétique de la France en matière d'approvisionnement, et que seul le diester ne pose aucun problème de logistique puisqu'il peut être acheminé, mélangé au gazole, par pipeline - contrairement à l'éthanol, qui se mélange mal à l'essence. Le Parlement a favorisé la fiscalité du gazole et ainsi 70 % des immatriculations concernent des voitures diesel. L'industrie pétrolière a donc le sentiment que, s'il faut développer les biocarburants, tout milite en faveur du diester incorporé au gazole, qui, contrairement à l'éthanol, pourra être incorporé dans les carburants à hauteur de 5, 10, 15 voire 30 %, sans difficultés techniques majeures. Nous avons farouchement défendu cet argumentaire mais les parlementaires ont malheureusement choisi de répondre à la demande de la filière éthanol en refusant la fusion des filières, au titre du calcul de la nouvelle Taxe Générale sur les Activités Polluantes (TGAP) relative à l'incorporation de biocarburants ; de ce fait, l'incorporation des biocarburants ne sera pas optimale. Le diester est le seul vecteur de développement majeur des biocarburants, le bilan de l'éthanol étant toujours inférieur, en termes d'émission de CO2 comme en matière logistique ou énergétique. Les biocarburants actuels constituent une solution transitoire ; dès que les résultats de la recherche le permettront, il faudra passer aux biocarburants de deuxième génération. Attention, par conséquent, aux investissements lourds à la durée de vie limitée. M. Alain GEST : Votre position est facilement compréhensible, l'écart de consommation entre véhicules fonctionnant au diesel et à l'essence ne nous avait pas échappé. Tout le monde est favorable à l'évolution vers la deuxième génération mais pourquoi certains pays ont-ils une autre approche que la vôtre concernant les produits actuels ? M. Dominique PARET : Les scénarios du Brésil et des États-Unis ne peuvent pas s'appliquer à la France. Il n'y a pas de diesel au Brésil ni de canne à sucre en France. L'éthanol est un carburant de niche, qui ne peut être transporté par pipeline, et les États-Unis réfléchissent aussi sur les biocarburants de deuxième génération. Tout litre d'éthanol incorporé conduira à un litre d'essence supplémentaire exporté en majeure partie aujourd'hui aux États-Unis, mais le cas d'école brésilien ou américain n'est pas transposable en France et nous sommes les premiers à le regretter. M. le Président : Les États-Unis travaillent sur la deuxième génération et même sur les voitures à hydrogène : le Gouverneur de l'Etat de Californie, M Schwartzenegger, sur les autoroutes californiennes, veut ouvrir des pompes à hydrogène tous les vingt miles et chaque marque automobile propose des véhicules en démonstration ; entre le centre fédéral américain et certains États, la différence est nette. Les moyens consacrés à la recherche publique et privée pour les biocarburants de deuxième génération sont-ils suffisants ? Il semblerait que les pôles de compétitivité concernés ne polarisent pas toutes leurs équipes sur cette question. M. Dominique PARET : Certaines compagnies pétrolières injectent des investissements dans cette direction mais nous en sommes toujours aux recherches. M. le Président : Dans quels laboratoires français ? M. Antoine PASQUIER : Dans des centres de recherche de l'industrie pétrolière ou papetière mais je ne sais pas trop où ; cela avance vite mais les problèmes logistiques sont énormes. M. Serge POIGNANT : Dans ces conditions, comment prévoir les coûts ? M. Jean-François LARIVÉ : Les usines pilotes et de démonstration de gazéification du bois ou de la biomasse destinées à fabriquer du diesel synthétique déjà en fonctionnement en Europe donnent une idée du coût du système. Le procédé aval est du reste identique à celui utilisé pour produire le diesel de synthèse à partir du gaz naturel et l'expérience sur la gazéification du charbon donne aussi une idée des montants d'investissement nécessaires. Mais la limite de la biomasse porte sur la taille des équipements : une usine, pour être rentable, doit être très grosse, ce qui, pour la biomasse, pose un problème de logistique. Faut-il atteindre des tailles suffisantes pour conforter la biomasse économiquement ou réduire se limiter à des tailles limites pour que les usines ne soient pas totalement inexploitables ? M. le Président : EDF avait étudié la possibilité de créer, dans les Vosges, une centrale combinée charbon et bois, mais l'approvisionnement en bois, même si les distances étaient réduites, coûtait déjà trop cher. M. Henri PRÉVOT : Au prix actuel du charbon, évidemment, mais la question du coût deviendra secondaire s'il est décidé de diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Actuellement, l'un des thèmes de recherche appliquée concerne la transformation partielle de la matière première pour extraire le jus avant de l'envoyer dans les raffineries. Quoi qu'il en soit, les industriels attendent d'être sûrs de l'existence de débouchés et ces derniers ne naîtront que de décisions politiques. J'ajoute que nous en avons encore pour plus de cent ans de charbon. Mme Martine BILLARD : Je suis de plus en plus sceptique vis-à-vis des biocarburants et de la biomasse, surtout si l'on considère le coût des transports : les recherches doivent continuer, mais il serait préférable de se battre pour restreindre la circulation et développer des types de véhicules alternatifs. M. Thierry RAES : Dans notre analyse comparée des filières fossiles et biocarburants, nous avons pris en compte les effets des transports sur l'environnement et la conclusion est claire : cette étude, réalisée il y a près de quatre ans, a prouvé que le bilan environnemental des biocarburants était sensiblement meilleur. Depuis lors, sans que nos études soient rendues publiques, nous avons travaillé pour les différentes filières agricoles et chacun a cherché à justifier d'un point de vue financier le bilan de l'apport de sa filière par rapport aux exonérations de TIPP qui subsistaient encore à l'époque. C'est la notion d'externalité : les coûts sont supportés non pas par le décideur économique mais par la société dans son ensemble. Nous avons pu démontrer que presque toutes les exonérations de TIPP étaient justifiées : quand l'État injectait 100 euros dans la filière, celle-ci en renvoyait 80 à 90, notamment sous la forme d'emploi. Il serait intéressant de poursuivre ces études relatives aux externalités, avec des parties prenantes indépendantes, à commencer éventuellement par la puissance publique. M. le Président : Globalement, par rapport à l'essence comme au gazole, les réductions sont significatives, surtout dans la filière diester, l'utilisation de l'éthanol étant difficile. S'agissant du diester, quelle surface faudrait-il cultiver pour passer de 5,75 à 9 ou 10 ? Ces terrains doivent-ils être cultivés sur des jachères ou en substitution de cultures actuelles ? M. Jean-François LARIVÉ : Deux champs ne sont pas identiques, les rendements varient en fonction de nombreux paramètres et il faut se méfier des moyennes. M. le Président : Le rendement du colza est relativement stable au niveau national. M. Jean-François LARIVÉ : Parce que les agriculteurs ne cultivent du colza que là où c'est raisonnable. M. le Président : Si vous ne vous jetez pas à l'eau, comment voulez-vous que nous prenions des décisions ? J'ai l'impression d'assister à un congrès de diplomates ! M. Henri PRÉVOT : Les besoins en biocarburants anticipés pour 2010 conduisent aux surfaces calculées à l'annexe V du rapport du Conseil général du GREF, de l'inspection générales des finances et du Conseil général des mines : 2 millions d'hectares, ce qui dépasse largement les surfaces en jachère. Les biocarburants entrent donc en concurrence avec la production alimentaire et les exportations. M. le Président : Les grandes cultures, actuellement, couvrent 13 à 14 millions d'hectares. Mais le bilan carbone ne serait plus le même. M. Jean-François LARIVÉ : Pour une TEP d'essence, près d'une tonne de carbone est émise et 1,5 tonne d'éthanol n'économise qu'environ 0,3 tonne de carbone. M. Jacques BASCOU : L'utilisation des produits viticoles a-t-elle fait l'objet d'une étude ? M. Thierry RAES : Non ; nous n'avons pas eu connaissance de demande de la part du syndicat professionnel. M. Jacques BASCOU : Nous avons reçu depuis peu des courriers de distilleries coopératives. M. Henri PRÉVOT : Il ne faut pas produire des tonnes de biocarburants pour le plaisir mais trouver un équilibre avec la liberté de consommer et de circuler, choisir les bonnes variétés et travailler de préférence sur la plante entière, ce qui offre beaucoup plus de choix sur les variétés agronomiques. En tout cas, dans l'avenir, un tiers des kilomètres parcourus seront dus à la propulsion électrique, un tiers aux biocarburants et un tiers aux carburants traditionnels. M. le Président : Mesdames, Messieurs, je vous remercie. Table ronde sur la nouvelle économie du changement climatique, réunissant : Présidence de M. Jean-Yves Le DÉAUT, Président M. le Président : Je vous souhaite la bienvenue à cette table ronde, dont l'objectif est d'examiner les implications économiques du changement climatique, notamment en ce qui concerne les coûts financiers, l'emploi, la croissance et le coût des dommages. Peut-être pourrez-vous nous aussi nous montrer ce qui pêche dans le raisonnement qui nous a été tenu lors de notre récent voyage aux États-Unis, selon lequel les changements économiques supposent un investissement important alors qu'on est pas sûr d'obtenir des résultats, et qu'il vaut donc mieux mettre tout de suite cet argent dans la recherche pour construire une nouvelle économie qui permettra de répondre au changement climatique. Dans cette logique, ceux qui réagiront vite seront pénalisés tandis que ceux qui réagiront avec décalage en se préparant à d'éventuels changements seront gagnants. Il serait donc bon d'entendre des arguments aptes à conforter la position française et européenne. De même, nous aimerions avoir une analyse coûts/avantages économiques des différentes options pour l'après 2012. Il serait également intéressant que vous nous disiez quels instruments vous paraissent pouvoir être les plus efficaces, entre mesures normatives et permis d'émission. Après un exposé liminaire de MM. Olivier Godard, professeur à l'Ecole Polytechnique et directeur de recherche au CNRS, Richard Baron, administrateur principal de l'Agence Internationale de l'Energie (AIE), qui suit en particulier l'analyse économique du changement climatique et qui apportera aussi le point de vue de l'OCDE, Jean-Charles Hourcade, directeur du CIRED, directeur de recherche au CNRS, qui a beaucoup étudié les questions liées à l'effet de serre, et Maximilien Rouer, président de BE-CITIZEN, nous avons également souhaité convier pour illustrer concrètement nos propos deux responsables d'entreprises dont l'activité est liée au changement climatique, dans le domaine de l'habitat : M. François Cann, directeur du développement de Liberty House - maisons économes en énergie - et M. Raphaël Lamé, responsable de l'entreprise « Le Prieuré - toits végétalisés » Sont également présents en tant qu'observateurs et peuvent évidemment participer au débat s'ils le souhaitent : M. Jean-Pierre Tabet, chef du service Économie de l'ADEME, et Mme Dominique Dron, professeur à l'École des Mines, ancienne présidente de la MIES. M. Olivier GODARD : Tout ce que je vais vous dire repose sur l'hypothèse de la prise au sérieux de la question de l'effet de serre et du message délivré par les climatologues en faveur d'un objectif de réduction des émissions par un facteur 4 à l'horizon 2050. Avec le changement climatique, c'est une situation économique fondamentalement différente qui se présente, avec la fin de la perspective de la croissance illimitée d'une demande qui ne serait freinée que par la solvabilité et les possibilités technologiques. Aujourd'hui, il y a une contrainte absolue, un plafond de gaz effet de serre qu'il faut tenir durablement dans le temps et à l'échelle de l'humanité. Il reste bien sûr toujours une place considérable pour l'innovation technique mais il faut réorienter les priorités. On ne peut plus raisonner simplement sur une offre qui s'adapterait toujours à une demande en croissance ; il faut engager une réflexion et des moyens en vue d'une maîtrise de la demande. Ainsi, un tourisme aérien de masse, en l'état actuel de fonctionnement des avions, n'est pas durable : il faut revenir sur cette orientation et non plus espérer la croissance illimitée du secteur. La contrainte de long terme ne s'impose pas par elle-même, elle nécessite un retour important de l'État qui doit fixer les orientations, organiser la coordination, mettre en place des cadres institutionnels adaptés, promouvoir des mécanismes économiques permettant de relayer l'ensemble de ces actions auprès des millions d'agents économiques. Rien de sérieux ne se fera à partir de la seule bonne volonté des acteurs économiques orientée par le système actuel des prix. Cela implique que la recherche et développement ne s'inscrive pas seulement, comme le proposent les Américains, dans une logique de big push sur financement public, mais qu'on crée des niches de marché pour accueillir l'innovation et rendre ainsi crédible cette nouvelle orientation. Là aussi, un nettoyage institutionnel s'impose car un grand nombre de règles et de normes vont à l'encontre de l'innovation. Je ne fais pas ici référence au principe de précaution, dont je suis un fervent défenseur, d'autant que je pense qu'il n'est pas un obstacle mais un fort stimulant de toute la politique de lutte contre l'effet de serre. On a besoin par ailleurs de diffuser partout des mécanismes de prix pour relayer les nouvelles contraintes. De ce point de vue, la directive sur les quotas de CO2 ne concerne qu'une part limitée des sources d'émissions, c'est-à-dire uniquement l'industrie, alors qu'il n'y a pour l'instant aucun effet prix pour les transports, l'habitat, le tertiaire et l'agriculture. On peut donc être sceptique quant aux effets des actions volontaires et des quelques mesures réglementaires sur lesquelles on mise dans ces secteurs. Il faut également de bonnes règles de marché et de taxation, le choix étant plus important pour l'impact économique que l'objectif lui-même. L'exemple de la directive sur les quotas de CO2 n'est pas très encourageant car en France, pour le secteur industriel, on a joué sur une forme de laxisme dans l'allocation initiale et on a ainsi offert une aide indirecte de plus à l'industrie au lieu d'instituer de bonnes règles pour l'avenir. L'Europe nous a imposé la règle de l'allocation gratuite pour 95 % du plafond, mais on aurait pu miser sur les 5 % de marge de manœuvre pour lancer un système de mise aux enchères, on ne l'a pas fait. Surtout, le montant des allocations au secteur industriel, au lieu de s'inscrire dans un mouvement de baisse, conformément au protocole de Kyoto, est en augmentation par rapport aux émissions de 2003. Au regard des objectifs que la France dit poursuivre, on a distribué 20 millions de tonnes de CO2 en trop. Compte tenu du prix actuel de 27 euros la tonne, cela représente une aide indirecte d'1,5 milliard d'euros sur trois ans. Si on continue de la sorte, il faudra soit acheter du CO2 à l'étranger, soit en trouver ailleurs, mais on voit mal comment. En fait, cela signifie qu'on va demander aux contribuables de payer des aides à des industriels qui n'en ont pas vraiment besoin. On peut toujours dire qu'il s'agissait dans un premier temps de faire accepter les règles du jeu, mais il est évident qu'il ne faut pas continuer de la sorte. Les économistes préconisent d'aller au plus simple : ces allocations de CO2 devraient être mises aux enchères, tout le monde serait ainsi dans les mêmes conditions et le lobbying ne jouerait plus. Bien sûr, on nous oppose que tout cela ruinerait la compétitivité de nos industries. Mais il suffirait de contrebalancer ce système par un ajustement des taxes aux frontières en fonction du CO2. Cela paraît incompatible avec les règles de l'OMC, mais nos collègues de Cambridge viennent d'expliquer qu'il faudrait mettre en place un système de détaxation en fonction de ce que donnerait la meilleure technique de production d'un produit donné pour que cette mesure, qui permettrait d'éliminer la partie la plus mauvaise et inciterait les industriels à se moderniser afin d'utiliser les meilleures technologies disponibles, ne puisse pas être jugée discriminatoire. Cela éviterait aussi d'avoir à analyser les procédés d'émission pays par pays, puisque c'est à partir de ces meilleures techniques disponibles, répertoriées par une autorité indépendante, qu'on déterminerait la taxation. Les pays en développement seraient soumis à la même exigence et donc contraints de se soucier des émissions s'ils veulent pouvoir exporter leurs produits. Je vous communiquerai bien évidemment les résultats complets de cette étude. À plus long terme, on doit s'attendre à une nouvelle économie territoriale au regard de la logique des transports et de ce qu'elle implique en termes de géographie des activités. Entre l'avion, le transport terrestre et le transport maritime il y a un rapport de 1 à 100 en termes d'émissions de CO2. Si on s'oriente vers un renchérissement important du coût des émissions de CO2, il va falloir stopper l'expansion du transport aérien et privilégier fortement le transport par mer ainsi que toutes les activités qui en dépendent et donc la zone littorale, le reste du territoire étant soumis à d'autres logiques économiques. Certains imaginent qu'on va ainsi revenir à la situation du Moyen Âge, quand le littoral espagnol avait plus de contacts avec les Pays-Bas qu'avec le centre de l'Espagne. Je ne pense pas qu'il suffise de s'en remettre à la hausse du pétrole pour arriver à l'adaptation nécessaire de nos économies. En effet, des effets de substitution seraient dangereux, si l'on se détournait d'un pétrole et d'un gaz devenus plus chers pour se reporter vers le charbon, qui émet deux fois plus de gaz à effet de serre. M. Jean-Charles HOURCADE : Je rappelle tout d'abord qu'on trouve dans les travaux du GIEC, qui recense toutes les publications en la matière, une bonne partie des réponses aux questions que vous nous avez posées. Vous nous avez interrogés sur les positions américaines. Mais je pense qu'il faut revenir à l'origine, c'est-à-dire à cette réunion du G7 en 1988 où l'affaire climatique a été mise par Bush Senior et Margaret Thatcher sur l'agenda international. Dès 1988, au G7, le changement climatique a été intimement lié aux questions de sécurité énergétique et il importe de bien noter que cela a encore été rappelé au G8 de juillet dernier. Mais il y a aussi d'autres enjeux sous-jacents. Selon un de nos collègues -Bill Nordhaus- qui ne passe pas pour un écologiste fou, le climat sera sauvé lorsque les travailleurs américains descendront dans la rue pour demander une augmentation du prix de l'essence afin de payer leurs retraites. J'aime bien cette façon de poser le problème parce qu'elle permet de bien inscrire la question du changement climatique dans un contexte réel où le monde est agité par bien d'autres tensions, tension énergétique bien sûr, mais aussi tension provoquée par l'inversion des pyramides d'âge dans divers continents, tension sur l'emploi. La position américaine sur la recherche et le développement n'est pas tenable. Elle suppose en effet que l'on fasse de la recherche développement sans jouer sur les signaux économiques qui permettent de lancer des mécanismes d'apprentissage et de diffusion dans toute l'économie. Un modèle presque parfait de ce type de fonctionnement est celui du CEA en France, c'est-à-dire d'une organisation très fortement liée à l'appareil d'Etat et je me fais toujours un plaisir de citer cette comparaison quand je parle avec mes collègues d'outre atlantique. D'autre part, les travaux sur le tempo de l'action montrent qu'il n'y a aucune chance pour que les technologies entrent assez vite dans le système pour le sauver. Par exemple dans le domaine des transports, alors que les pays émergents vont construire un grand nombre d'infrastructures dans les prochaines décennies, il est difficile d'imaginer un autre carburant à bas coût totalement compétitif avec des carburants issus du pétrole, carburants qui ont, il ne faut pas l'oublier, d'importantes réserves de compétitivité et de grande capacité, par des baisses brutales, à décourager tout effort de substitution trop agressif. Il faut donc bien sûr poser la question des prix et des systèmes incitatifs à mettre en place dès aujourd'hui et c'est ici qu'il faut revenir à la réalité d'un monde où il y a à la fois des tensions énergétiques, des risques climatiques, des problèmes de financement des retraites et de la protection sociale et des enjeux de compétition internationale. Permettez-moi d'être ici un peu brutal. Plus un syndicat ou un parti politique est convaincu de la nécessité de poser des limites à la possibilité pour un patron de licencier un travailleur, plus il devrait être favorable à un basculement des charges sociales vers autre chose que le travail. Aujourd'hui, nous avons un système où tout l'Etat providence est financé directement ou indirectement par le travail, ce qui décourage l'emploi en augmentant le risque pris par un entrepreneur lorsqu'il embauche quelqu'un et que le coût du licenciement n'est pas nul. L'exemple le plus typique du caractère contreproductif de ce système est que nous finançons le chômage par des prélèvements sur ceux qui travaillent, ce qui renchérit le coût du travail par rapport aux autres facteurs de production et par la même décourage un peu plus la création d'emplois. Si en revanche on lie financement des systèmes sociaux, compétitivité et basculement de la fiscalité, et des prélèvements obligatoires, je pense qu'on a la possibilité d'accompagner la transition vers des systèmes moins carbonés. Certes, on objecte très souvent le fait qu'une énergie plus chère toucherait les couches sociales les plus défavorisées. Or, il faut être conscient du caractère pervers de l'idée qu'une énergie peu chère est équitable. Ainsi, depuis quarante ans, alors que l'essence est restée à un prix bas, le prix du mètre carré du logement s'est envolé, ce qui a incité les gens à habiter plus loin des centres-villes. Le développement urbain s'est donc fait de façon perverse. On a envoyé des couches sociales moins favorisées dans des environnements urbains auxquels on ne pouvait assurer, très souvent, un seuil minimum de biens collectifs, sans parler des problèmes de ségrégation ethnique ou sociale. En fait, cet exemple montre bien qu'il ne faut pas se focaliser sur le seul prix de l'essence mais tenir compte d'un ensemble de paramètres parmi lesquels le prix de l'immobilier ensuite le logement populaire et les politiques d'infrastructure et d'urbanisme. A l'échelle internationale, nous avons été victimes d'une logique de négociations qui a empêché, jusqu'à Marrakech, de faire le lien entre OMC et climat. Olivier Godard a pourtant montré qu'il y avait des moyens de négocier sur ce point pour peu qu'on le veuille. L'enjeu est en effet que, dans un système économique ouvert, il n'y a pas d'autres moyens sérieux de forcer un pays à respecter une signature sur un traité global d'environnement ou, s'il n'y adhère pas, d'être pénalisé par des taxes aux frontières. Pour l'après Kyoto, l'enjeu est d'embarquer les États-Unis et les pays en développement. Mais on n'a fait à ces derniers, jusqu'ici, aucune offre crédible qui leur permettrait de ne pas se retrouver dans un système de contrainte obligatoire. Il faut donc trouver un système optionnel et discuter avec eux de l'ensemble des obstacles à long terme. L'Inde et la Chine commencent à comprendre que le mouvement actuel n'est pas viable, qu'ils vont eux aussi être confrontés aux problèmes des infrastructures et de la sécurité énergétique. Les Chinois savent ainsi qu'un des effets de la politique de l'enfant unique sera de ramener de 35 à 15 % leur capacité d'épargne d'ici 2030, puisque, à cet horizon, ils vont avoir une charge importante de personnes âgées à prendre en charge, avec un nombre réduit de population en âge de travailler. Il faut donc commencer par parler de développement, des obstacles qu'on va lever ensemble, et dire comment la politique climatique va permettre d'y contribuer. Par exemple, par une politique de maîtrise de la demande qui leur permettra de voir de moindres parts de leur capacité de financement, absorbées par les infrastructures d'offres d'énergie de transport. Les Américains refusent Kyoto en le caricaturant. Cette caricature profite de ce qui est parfois proposé comme interprétation de Kyoto, à savoir un système de permis d'échange généralisé à l'échelle mondiale et débouchant sur un prix unique du carbone. Mais les choses ne peuvent pas se passer comme cela, ne serait-ce que parce que 10 euros de prix du carbone n'ont pas du tout le même impact sur la population en Inde, en Chine, en France et aux États-Unis. De plus, il faut bien voir qu'un même prix sera sans effet sur la mobilité (par exemple parce qu'il ne représentera qu'une part infime des billets d'avion), alors que, il pourra mettre en danger des secteurs fortement intensifs en énergie et fortement exposés à la concurrence internationale comme l'acier voire, à un moindre titre, le ciment maintenant. Il faut donc être clair on ne pourra jamais faire passer un système avec un prix unique pour l'ensemble du monde. Cela signifie que les gouvernements devront conserver une marge de manœuvre afin de pouvoir en interne jouer sur autre chose que sur ce prix. En d'autres termes, il faut bien se rappeler que ce sont les gouvernements qui sont dépositaires des permis d'émissions et que ce sont eux qui doivent garder la marge de manœuvre nécessaire pour diffracter en interne le prix mondial du carbone selon les tarifs différenciés, de façon à tenir compte de leur situation concrète. Si on continue à concevoir Kyoto de façon un peu intégriste, ça ne marchera pas et ni les Américains, ni les Chinois, ni les Indiens, ni les Brésiliens n'entreront dans le système, et les principaux secteurs industriels feront tout pour le bloquer. En revanche, la structure de Kyoto peut être totalement utilisée pour réconcilier l'existence d'un système intégré à l'échelle internationale et la nécessité de tenir compte des aspérités du monde réel. M. Richard BARON : Les projections sur la demande mondiale d'énergie primaire montrent que, sans autre action significative que celles qui ont déjà été engagées et sans réalisation des objectifs de Kyoto, les énergies renouvelables apporteraient en 2030 une part importante mais encore minime, par rapport à la croissance attendue de la contribution des carburants fossiles, qui couvriraient 83 % des besoins supplémentaires en énergie. Cela poserait de très importantes questions de sécurité des approvisionnements énergétiques et entraînerait une augmentation de 50 % des émissions, alors qu'il faudrait, si on veut parvenir à maintenir l'augmentation de la température en dessous de 2 degrés, qu'elles culminent entre 2015 et 2030 et qu'elles diminuent ensuite. La politique du climat est une forte préoccupation pour les secteurs intensifs en énergie et soumis à la compétition internationale. En application de la directive européenne sur les quotas d'émissions échangeables, entrée en vigueur en 2005, 11 500 installations soumises à des quotas d'émissions et la moitié des émissions de CO2 de l'UE sont visées, dans les secteurs de la production d'électricité et de chaleur, de la sidérurgie, du ciment, du verre, du papier et du carton, du raffinage. On l'a dit, à l'option de la mise aux enchères, on a préféré celle des quotas distribués gratuitement. Les installations doivent mettre en œuvre des mesures de réduction des émissions et/ou, en cas de dépassement, acheter des quotas à d'autres sources dont les réductions sont accessibles à coûts plus faibles. On a ainsi désormais un marché du CO2 sur lequel un à deux millions de tonnes sont échangés chaque jour, principalement par les électriciens, à un prix de 20 à 25 euros la tonne. L'AIE a élaboré deux scénarii, dans lesquels l'allocation couvre respectivement 98 % et 90 %des émissions. Dans les deux cas, les augmentations des charges peuvent être considérées comme modestes, sauf pour le ciment qui connaît une hausse non négligeable de 7 % des charges d'exploitation. Même s'il est hors directive, l'aluminium serait aussi touché en raison du renchérissement du coût de l'énergie. Il s'agit d'estimations hautes, qui amèneraient les entreprises à se demander si elles ne devraient pas privilégier les réductions d'émissions en interne, qui seraient moins onéreuses. Si l'objectif initial des quotas échangeables était de minimiser les coûts des réductions d'émissions et les impacts sur la compétitivité, il apparaît qu'une allocation largement gratuite des quotas et une réserve pour les nouveaux entrants atténuent l'impact sur les coûts, mais peuvent aussi affaiblir l'incitation aux réductions. Il faut éviter la concurrence entre pays européens sur les conditions nationales d'accès aux quotas et harmoniser dès que possible les règles relatives à l'entrée de nouvelles installations et à la fermeture d'installations au sein de l'Union européenne. Il paraît également nécessaire de fixer des objectifs à long terme : 2050, c'est presque demain pour les producteurs d'électricité. Enfin, le tableau que j'ai dressé n'est pas complet car il y manque le bâtiment et les transports. Mais la politique climatique peut être une nouvelle source de valeur ajoutée pour l'activité industrielle qui aurait, dans un scénario de « facteur 4 », un rôle essentiel pour répondre aux besoins en infrastructures - on imagine l'impact économique du renouvellement de 400 000 logements par an qui serait nécessaire pour que la France atteigne le facteur 4 -, ainsi qu'à la nécessité de développer de nouveaux produits et de nouvelles technologies, ce cercle vertueux nécessitant une politique climatique cohérente couvrant l'ensemble des secteurs émetteurs. Maîtriser la demande d'énergie passera aussi par une demande de matériaux et services à forte valeur ajoutée. Ainsi, équiper tous les bâtiment en double vitrage supposerait une augmentation des émissions de CO2 pour produire le verre nécessaire, mais cela pourrait être justifié compte tenu des économies ainsi réalisées. À l'avenir, il conviendra de compléter la directive quotas avec des mesures incitant à économiser l'énergie dans le bâtiment et les transports, susciter un modèle de développement économique compatible avec une forte réduction des émissions et « exportable », si l'on veut réduire les émissions à l'échelle mondiale. À ce propos, des travaux récents de l'OCDE sur « aide publique au développement et changement climatique » montrent que l'aide officielle au développement implique des montants bien supérieurs aux financements mobilisés au titre de la politique climatique, comme le mécanisme de développement propre, qu'elle porte sur des activités et des projets qui pèsent sur les niveaux d'émissions de gaz à effet de serre et sur la vulnérabilité au changement climatique des pays receveurs. Ainsi, ajuster à la marge ces investissements peut avoir un effet beaucoup plus significatif sur ces deux dimensions que le financement « climat » stricto sensu. En général, le changement climatique n'est pas pris en compte dans les documents stratégiques d'aide au développement. Certes, des activités spécifiques sont en cours, mais loin des ministères-clefs ou des processus budgétaires nationaux. On observe ainsi un manque évident de cohérence entre les priorités de la lutte contre les changements climatiques et les politiques d'aide publique au développement. Les quotas échangeables sont un instrument efficace en vue de réductions à moindre coût dans l'industrie, mais ils doivent êtres complétés par des objectifs à long terme. Une harmonisation des règles est souhaitable. Les enjeux de compétitivité de la politique climat dépassent la question des coûts de la directive quotas. Des politiques ambitieuses sont nécessaires du côté de la demande d'énergie finale, en particulier dans les bâtiments et les transports. Il convient enfin de faire apparaître un modèle de développement économique compatible avec une forte réduction des émissions et adapté au changement climatique, qu'on doit retrouver dans les politiques d'aide au développement. M. Maximilien ROUER : J'interviens essentiellement auprès de mes clients chefs d'entreprises, mais aussi en tant qu'expert auprès de l'APM, Association pour le progrès du management. Ce que je vais vous dire a donc été testé depuis un an auprès d'un public de 4000 chefs d'entreprise français. Je suis aussi professeur de stratégie à HEC. Un journaliste m'a demandé, il y a quelque temps, quelle était pour moi la plus grande des pollutions. Eh bien, elle est mentale : nous sommes tellement défaitistes que nous ne nous autorisons pas à penser autrement qu'en termes de réduction, de limite et même de castration. A l'inverse, les Américains voient d'abord dans le climat une opportunité. Mais ensuite, ils nous enfument sur la recherche et développement, car on a intérêt à enfumer les autres quand on est leader. Mais je suis ici pour vous parler de l'habitat, dans le contexte du facteur 4, et plus précisément de ce qu'on appelle « maison positive », c'est-à-dire un logement qui produit en un an plus d'énergie qu'il n'en consomme. Cela passe par plusieurs étapes : réduire la consommation en diminuant les pertes thermiques ; réutiliser, par exemple les calories grâce à une VMC double flux à récupération de chaleur ; recycler ce qui peut l'être ; substituer, par exemple une maison en béton armé avec des fenêtres en aluminium, qui émet de 17 à 20 tonnes, par une maison en biomasse et en roche qui stocke 10 tonnes. Je ne suis évidemment pas dupe : je sais que la consommation énergétique d'un bâtiment réside à 80 % dans son usage. C'est pour cela qu'il faut avant tout gérer la demande énergétique du bâtiment. Si on pousse le raisonnement jusqu'au bout on peut imaginer que les 30 millions de logements français, dont 5 millions de résidences secondaires qui ne servent actuellement à rien d'un point de vue thermique, s'inscrivent dans une logique de production énergétique, c'est-à-dire qu'ils soient équipés de panneaux solaires permettant de redistribuer l'électricité au réseau, de petites éoliennes urbaines à axe vertical, qui ne demandent pas de permis de construire et qui produisent de l'électricité avec un vent inférieur à 2 m/s. On disposerait ainsi d'un parc de plusieurs millions de logements producteurs d'énergie. On peut aussi étendre ce concept à celui d'usine positive, les surfaces industrielles représentant un actif solaire qui n'est pour l'instant pas valorisé. Aux États-Unis, on a déjà installé des panneaux solaires sur plusieurs hectares et de la sorte une usine qui produit des pare-chocs produit aussi de l'électricité, y compris pendant le week-end et les vacances. On imagine par ailleurs la réaction d'un investisseur qui comprendrait que son investissement dans une usine est remis en question parce qu'on va passer d'un climat stable à un climat instable. Personne n'a encore pris la mesure de la variable climat, alors qu'on sait qu'on est déjà à près de 400 ppm. Or, de mémoire humaine, on n'a jamais eu à faire face à une telle instabilité, et on ne peut donc pas prévoir ce que cela va donner. Cela vaut aussi pour les assurances puisque les primes sont calculées en fonction de la probabilité d'un sinistre dans une série statistique. Dans ces conditions, il va falloir diversifier les sources d'approvisionnement et de production. De même que l'Internet a été créé, dans le contexte de la guerre froide, pour lutter contre une éventuelle attaque centralisée, il faut aujourd'hui aménager les territoires afin que le risque climatique soit réparti non plus dans des points centraux mais dans une logique de réseau. Tout cela est pour moi moteur de la croissance. J'ai publié un article sous le titre Demain la croissance stockera le carbone : si on peut considérer que la croissance sera, demain comme aujourd'hui, émettrice, on peut aussi se dire qu'elle permettra de stocker du carbone : imaginez les effets de l'extension d'un modèle de maison positive aux centaines de millions de logements en préparation en Chine. S'ils étaient construits en biomasse et stockaient le carbone, cela changerait radicalement la donne. Bien sûr, on nous oppose souvent l'argument du manque de sols, mais il est réfuté par les travaux des Canadiens et des Australiens sur la résilience, c'est-à-dire sur la capacité de récupérer un sol même lorsqu'il est totalement détruit. Un sol désertique peut ainsi devenir producteur de biomasse : les meilleurs sols agricoles ne sont-ils issus de la déforestation ? Comme toujours, l'entreprise a intérêt à faire du profit. En l'espèce, elle le tire de la diminution des coûts, de la réduction du capital investi et de son recyclage, surtout en dégageant de nouveaux marchés. On est ici très proche de la logique de l'économie positive. Quand ils nous parlent d'investissements dans la recherche et développement, j'ai l'impression que les Américains nous refont le coût de la couche d'ozone quand, il y a vingt ans, Ronald Reagan a affirmé qu'on n'avait aucune preuve de l'effet destructeur des CFC, jusqu'à ce que Du Pont de Nemours dépose le brevet des substituts au CFC et que la lutte contre la destruction de la couche d'ozone devienne une priorité américaine. L'impression de revivre la même chose est confortée par un certain nombre d'exemples. Depuis quelques mois a été lancé sur la côte est des États-Unis un marché de développement des énergies vertes, dans lequel une vingtaine de multinationales américaines s'organisent pour réduire les coûts. Une initiative climat a été prise sur la côte nord-est, dans laquelle sont impliquées d'autres multinationales qui se préparent au business context d'une économie sans carbone, afin d'en être les seules bénéficiaires. Un dirigeant de General Electric a déclaré récemment « Green is green », ce qui signifie qu'aujourd'hui, pour faire du profit, il faut être écologiste et participer à la construction de cette nouvelle économie afin de prendre des parts de marché. Un outil de management stratégique important est le total cost of ownership, qu'on peut traduire par coût global : tant qu'on ne sortira pas de la logique d'allocation des prêts et des crédits sur un simple coût d'investissement, sans prendre en compte ce coût global sur toute la durée de vie du produit, on n'y arrivera pas. Aujourd'hui, les grandes multinationales introduisent cet outil dans leurs prévisions de rentabilité. Au-delà des 50 % traités par le marché des émissions, la petite industrie européenne a besoin de signaux politiques et fiscaux forts, de mécanismes flexibles adaptés aux PME. Les projets domestiques peuvent répondre à cette attente. Même si on ne sait pas encore où on va pour l'après 2012, il faut montrer aux analystes financiers qu'on peut limiter de façon prévisionnelle le risque énergétique et climatique. Car ils veulent aujourd'hui savoir ce qu'une entreprise fait pour limiter la dépendance aux énergies fossiles ainsi que les émissions de gaz à effet de serre, afin de voir si elle a déjà commencé à entrer dans une économie de la biomasse. M. le Président : Merci beaucoup pour ces exposés introductifs passionnants. Il me semblerait utile que l'AIE normalise l'usage des termes « carbone » et « CO2 », car même les scientifiques font la confusion et il est bien difficile de comparer les tonnages qui nous sont donnés. Vous avez par ailleurs évoqué les pollutions diffuses, qui viennent d'autres secteurs que l'industrie visée par les quotas d'émissions. Comment est-il selon vous possible de traiter cette question ? Comment organiser un système de réduction des émissions ? J'ai bien entendu ce que vient de nous dire M. Rouer sur les maisons positives et il faut bien entendu s'engager dans cette voie, mais, je rappelle une fois encore que j'ai été à la fois coauteur d'un rapport sur les énergies renouvelables et président d'un office HLM qui a construit un grand nombre de logements qui, sans être « positifs », ont largement fait diminuer le nombre de kWh/m2/an. C'est intéressant à long terme et sans doute utile au développement de l'économie, mais cela entraîne des surcoûts de 20 à 25 % et il est difficile de trouver les financements nécessaires. Quels mécanismes pourrions-nous proposer en la matière ? Par ailleurs, s'il paraît nécessaire de favoriser le transport maritime, on voit mal, à moins de construire un grand nombre de canaux, comment les régions continentales accepteraient que l'activité soit concentrée sur les côtes. L'exemple de la sidérurgie lorraine me montre qu'il s'agirait d'une bataille politique difficile. J'aimerais également savoir comment vous vous situez par rapport au discours assez décapant mais séduisant de l'économiste David Victor, que nous avons rencontré à Stanford et qui est opposé au mécanisme des MDP. Enfin, que préconisez-vous pour essayer de tempérer le laxisme dans l'attribution des quotas ? M. Serge POIGNANT : J'ai bien entendu vos réserves sur la possibilité de faire entrer les États-Unis, la Chine, l'Inde et d'autres dans le mécanisme de Kyoto, mais alors comment voyez-vous l'après 2012 ? Il faut bien trouver une solution mondiale à un problème mondial. Doit-on prévoir une exception environnementale aux règles de l'OMC ? M. le Président : Pensez-vous qu'il conviendrait de créer une agence mondiale de l'environnement ou que l'OMC soit apte à traiter ces questions ? M. Maximilien ROUER : On ne peut plus raisonner sur le coût de construction d'il y a quelques années : si lors de la construction de BEDZED, il y a 5 ans, le surcoût a bien été de 25 %, aujourd'hui il ne dépasserait pas 1 %. M. Jean-Charles HOURCADE : Une période d'apprentissage est toujours nécessaire. Cela étant, s'il y a dans ces démarches un potentiel de croissance important, je crois qu'il faut arrêter de dire qu'on peut s'en tirer pour pas cher : à court terme, des ajustements seront effectivement nécessaires. Et il faudra donc bien que quelque chose change dans les modalités de financement. C'est pour cela que j'insiste sur le basculement global de la fiscalité : le corps social n'acceptera ces transitions positives que si on les accompagne. Or pour l'instant, en particulier en France, on ne voit cela que comme un problème environnemental sans faire le lien avec les aspects fiscaux. À propos de l'ozone, je rappelle que dès 1974 Du Pont de Nemours a réussi à faire une coalition avec ses principaux concurrents étrangers, ce qui montre que les entreprises sont plus ouvertes qu'on ne le croit. Il appartient donc aux politiques de définir les modalités d'accompagnement de leurs efforts, ce qui passe par la loi et par la fiscalité. M. François CANN : On est aujourd'hui à un surcoût bien inférieur à 25 %. Nous-mêmes construisons des maisons totalement autonomes en chauffage et en électricité, sur la base de l'énergie solaire et de la récupération d'eau, pour un surcoût de 4 à 5 %. S'il y avait une incitation fiscale forte, je suis persuadé que beaucoup y viendraient. Mme Dominique DRON : Je confirme que les coûts sont maintenant très inférieurs à ce qu'a dit M. le Président. M. le Président : C'est aussi ce que nous disait l'ADEME, mais je sais ce que nous avons payé. Mme Dominique DRON : Mais plus généralement, ce qui est en jeu c'est la survie de notre secteur du bâtiment. Voilà des années qu'en Allemagne, aux Pays-Bas, en Autriche, en Suisse, on construit des maisons, si ce n'est autonomes, du moins à 15 kWh/m2 pour le chauffage. Or l'an dernier encore, quand on demandait à une grande entreprise française de fournir une maison à 60 kWh/m2, elle en était incapable. Mettre l'ensemble du parc français à 50 kWh/m2 en moyenne, contre environ 20 aujourd'hui pour le chauffage et 300 toutes utilisations confondues, nécessiterait selon les experts consultés par la MIES en 2003 un investissement de 7 à 8 milliards d'euros par an pendant quarante-cinq ans, pour une création annuelle de 100 000 emplois et avec un coût global à la tonne de CO2 économisé inférieur à 8 euros. Et c'est bien à cela qu'il faut venir car, compte tenu de la durée de vie de la molécule de CO2 dans l'atmosphère, un à trois siècles, ce qu'on va faire ou pas dans les vingt ans qui viennent déterminera une bonne part de nos marges de manœuvre pour notre trajectoire climatique. Des gains considérables sont possibles dans l'organisation des transports. Je rappelle ainsi que selon les études de l'ADEME entre une organisation de type hypermarché et un commerce ou une supérette de proximité alimentés par camion, le rapport est de 1 à 60 en défaveur de l'hypermarché, et encore de 1 à 15 dans le même sens en comparant l'hypermarché au téléachat desservi par camionnette. Or cela pèse sur le budget carburant des ménages, qui représente déjà 30 % du budget global d'un grand nombre de ceux qui habitent dans les zones de foncier le moins cher, en couronne peu dense des agglomérations ou en zone rurale. On mesure le risque socio-économique et donc politique qu'il y a derrière cela, et pas seulement en région parisienne. Depuis 2004, les réassureurs, comme les assureurs en particulier britanniques, considèrent que, dans leurs discussions avec les gouvernements, ils vont être amenés à conditionner leur intervention à la mise en place de politiques de réduction non seulement des émissions de gaz à effet de serre, mais aussi des risques climatiques, en particulier à travers la politique d'aménagement du territoire. Pour les entreprises, le retour sur investissement sera calculé en tenant compte de la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Les Britanniques se sont en effet rendu compte que le coût des dommages et des adaptations aux modifications climatiques tendancielles était bien supérieur à celui de toute politique de réduction des émissions. Ainsi, atteindre l'objectif de 60 % de réduction en 2050 n'entraînerait au bout du compte qu'un retard de croissance de six mois pour la Grande-Bretagne, ce qui est sans commune mesure avec les 2 % de perte de PIB attendus quand les grandes marées passeront au-dessus du barrage sur la Tamise, ce qui ne devrait pas tarder tendanciellement. Il me paraît difficile de parler d'un « optimum économique » dans les scénarii climatiques tendanciels car les dégâts et l'instabilité deviennent tels qu'on ne pourra plus considérer des territoires, avec leur gestion et leur organisation actuelles, comme fiables. Les opérations de prévention et de réparation des dommages, essentielles pour préserver les fonctionnements et donc l'attractivité des territoires, devront prendre une place bien plu importante qu'aujourd'hui dans les budgets publics et privés, par exemple dans le cadre du basculement fiscal évoqué par Jean-Charles Hourcade. M. Jacques BASCOU : Vous nous avez expliqué, Monsieur Hourcade, que fixer un prix mondial du carbone était une hérésie, qu'il valait mieux mener des négociations bilatérales avec les pays en développement, qu'il fallait poser le problème des cotisations sociales alors que les Américains s'inscrivent dans une logique qui nous est étrangère de fonds de pension qui investissent d'ailleurs dans le domaine de l'environnement, et que les entreprises devaient prendre conscience de la nécessité de produire d'une manière écologiquement responsable. J'observe d'ailleurs que, quelles que soient les voies qui ont été suivies, on est arrivé à des résultats pour la protection de la couche d'ozone. Ce sont tous ces éléments que les Américains mettent en avant, au nom du pragmatisme écologique, pour ne pas adhérer au protocole de Kyoto. Aussi, dans la perspective de l'après 2012, j'aimerais que vous précisiez les divergences entre eux et ceux qui ont accepté le protocole. M. Jean-Pierre HOURCADE : C'est un peu le débat que nous avons avec David Victor. C'est en fait la façon dont les partisans du protocole de Kyoto l'ont défendu qui a ouvert la voie à cette argumentation, pour partie fondée, notamment ce qui concerne le prix du carbone et la flexibilité. Mais, si je suis persuadé qu'il convient que les États aient une certaine capacité à mener eux-mêmes des actions, comme l'a dit Richard Baron, les investisseurs ont besoin d'une vision à long terme et c'est pour cela qu'une coordination et un cadre mondial sont éminemment nécessaires. Je travaille avec un collègue indien qui participe aux négociations avec les Américains sur les accords bilatéraux et qui dit qu'il s'agit d'une coquille vide. Mme Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET, Rapporteure : Les Américains ne nous l'ont pas caché. M. Jean-Pierre HOURCADE : Par rapport à ce qu'a dit Dominique Dron, je rappelle que sur les dix personnes présentes à la réunion de la Banque mondiale le 9 novembre 2005, deux ont dit que les dommages n'étaient pas importants. Si nous étions dans un monde rêvé, où tout le monde anticiperait ce qui va se passer, où les pertes seraient compensées par les gains, alors le coût du changement climatique serait nul. Mais n'oublions pas qu'en données actualisées 1970, le coût de la première guerre mondiale a été pour la France de 0,8 point de PIB. Nous sommes dans un monde réel, avec des tensions et des risques de crise, et ceux qui nous disent qu'on peut se passer d'une coordination ne sont pas crédibles. Bien sûr, on peut accepter des modalités de négociations particulières pour les pays en développement, mais on a bien besoin d'un accord global. M. Richard BARON : Les Américains ont commis l'erreur de négocier sans disposer d'une base politique nationale leur permettant d'atteindre des objectifs, tout simplement parce qu'ils ont fait le calcul que les réductions qu'on pourrait se procurer sur le marché international seraient moins onéreuses que les réductions domestiques, et que le principe économique s'imposerait comme le principe de la politique climatique. Ce raisonnement s'est effondré immédiatement quand on s'est rendu compte qu'il faudrait payer chaque année, pour rien, 30 à 40 milliards à la Russie. On peut en tirer comme conclusion non pas que le prix unique du carbone ne sert à rien, mais que, dès lors qu'au moment où l'on signe on organise des transferts massifs d'une région vers l'autre, un tel accord ne peut tenir. C'est bien pour cela qu'il faut proposer aux pays en développement des accords non contraignants, en leur montrant qu'ils ont un scénario tendanciel, que s'ils arrivent à faire mieux que cela ils en tireront un bénéfice, mais sans qu'on commence par organiser, sur la base d'une allocation par tête, des transferts très importants. Sur l'après Kyoto, les discussions actuelles entre experts portent sur des objectifs sectoriels : faut-il négocier pour savoir si l'acier ou l'aluminium doivent avancer dans telle ou telle direction ? On a bien vu en Europe qu'il n'était pas possible de laisser de côté le transport et le résidentiel. Compte tenu de l'opposition considérable que cela entraînerait la part du secteur de l'électricité et des investissements en capital nécessaires, on ne peut pas faire croire que la récupération et le stockage du CO2, qui coûteraient actuellement entre 20 et 30 euros la tonne, pourraient être la panacée. Il convient donc de travailler sur la demande d'énergie et sur des solutions comme celle proposée par M. Rouer. Mme la Rapporteure : Nous en venons aux exemples concrets que vont nous présenter MM. Lamé et Cann. M. Raphaël LAMÉ : Notre société, Le Prieuré, dispose désormais d'une expérience de quinze ans dans la végétalisation des toitures puis des murs. C'est en 1989 que notre entreprise horticole a commencé à diversifier ses activités en produisant du gazon de placage. En 1996 a débuté la production de tapis de sedums et des premières toitures végétalisées. En 2000, nous avons déposé un brevet pour un nouveau système de végétalisation, les bacs Hydropack. À partir de 2003, nous avons développé des solutions de végétalisation à la verticale. La toiture végétalisée se caractérise par une faible surcharge, qui permet la pose sur tous les toits, par un entretien limité, par un coût réduit, de dix fois inférieur à celui d'un jardin classique. Elle fait appel à des plantes adaptées : les sedums, et à d'autres vivaces sélectionnées. Ses avantages tiennent à l'esthétique, car elle embellit les villes et permet l'intégration des bâtiments dans l'environnement des campagnes ; à l'impact écologique, car elle libère de l'oxygène, fixe le CO2 et retient les poussières contenues dans l'air ; à la gestion de l'eau, par la réduction des surfaces imperméables, la régulation des eaux de pluie par l'écrêtement des pointes de précipitations et l'absorption d'une partie de la pluviométrie annuelle ; à la protection phonique et thermique, qui permet de gagner de 5 à 10 degrés en été à l'intérieur du bâtiment. Notre marché est principalement constitué pour l'instant de bâtiments publics, même si les commandes privées commencent à se développer. Même s'il est un peu favorisé par l'impact de la haute qualité environnementale, le démarrage en France est lent, puisque nous en sommes à environ 150 000 m2 végétalisés chaque année, contre 15 millions de m2 en Allemagne. Nous développons aussi des murs végétalisés, en particulier antibruits, ainsi que des haies pré-cultivées. Des incitations, en particulier fiscales, paraissent nécessaires dans la mesure où le surcoût par rapport à une toiture nue est de l'ordre de 20 %. Certaines régions, comme le Nord-Pas-de-Calais sous la présidence de Marie-Christine Blandin, font preuve d'une véritable volonté politique. Dans le cadre du PLU 2006, il sera possible à Paris que les toitures végétalisées soient prises en compte au titre des espaces verts exigés des promoteurs de constructions neuves. Ce marché est en développement rapide aux Etats-Unis, et on sent qu'il est en train de bouger également en France. Nous avons besoin de recherche-développement pour valider nos procédés et l'aide des collectivités nous est précieuse car elle permet de réaliser des tests grandeur nature. Plus globalement, je crois que les grands groupes français du bâtiment vont être amenée à se préoccuper fortement de la haute qualité environnementale dans les années qui viennent s'ils ne veulent pas être complètement dépassés. M. François CANN : Liberty House construit des maisons dans un souci de protection de l'environnement mais aussi de l'être humain. Car on parle beaucoup d'économies et peu de l'homme alors qu'une éducation aux économies d'énergie paraît indispensable tant les gens consomment aujourd'hui sans en mesurer les conséquences. Nos maisons de 50 m2 sont construites uniquement en bois et dans des produits non allergisants. Elles peuvent être implantées en 48 heures et déplacées facilement, y compris par bateau. Notre société est la première à s'être engagée dans une fabrication de type industriel qui nous permet de produire 200 maisons par mois et de répondre ainsi à la demande, qui vient essentiellement des parcs de tourisme. Un de nos problèmes tient au fait que l'industrie française du bois, pourtant importante, est incapable de nous fournir les panneaux dont nous avons besoin, que nous sommes obligés d'acheter en Finlande. Il me semble que l'État devrait inciter à ce type de fabrication sur le territoire national. Afin de garantir une totale autonomie, nous ne misons pas uniquement sur des panneaux solaires mais aussi sur une nouvelle technologie allemande de capteurs sur le toit. Nous arrivons ainsi à 30 % d'économies, tous les équipements étant par ailleurs en basse tension. Nous n'économisons pas seulement l'électricité mais aussi l'eau qui est recyclée pour la boisson et tous les nettoyages. Il est possible d'ajouter 25 m2 à la structure de base, tout en répondant aux critères de la maison à moins de 100 000 euros voulue par Jean-Louis Borloo. Le coût est d'environ 1200 euros au mètre carré, contre 1000 euros habituellement. Ces maisons présentent aussi l'avantage d'être construites sur plots indéformables, ce qui leur aurait par exemple permis d'être emportées et non pas détruites par le tsunami. M. Jacques BASCOU : Une entreprise de mon département est confrontée aux mêmes problèmes : alors que l'Aude avait une filière bois importante, elle est aujourd'hui obligée de s'approvisionner à l'étranger. Or, dans ce cas, il faut aussi intégrer le coût des transports. M. Maximilien ROUER : Sur la question du coût, il me paraît essentiel de prendre en compte le fait que des maisons comme celles-ci stockent du carbone au lieu d'émettre du CO2. Si on prenait vraiment au sérieux la question du climat, on chercherait à mettre en valeur les démarches qui permettent de stocker de manière pérenne. La plus vieille maison tout en bois que je connais, en Suisse, date de 1137, elle est toujours habitée. Entre 30 et 60 % de l'habitat dans le monde serait composé de construction en bois. M. François CANN : Il n'y a pas, en France, de véritable politique de communication sur le bois en tant que matériau de construction. Alors que nos procédés protègent l'environnement, nous avons des difficultés à nous implanter tout simplement parce que les Français pensent que le bois n'est pas un matériau durable, ce qui est faux. Mme Dominique DRON : J'ai pu constater, dans la préparation du Plan Climat en 2003, que le ministère de l'équipement ne jouait absolument pas son rôle de recensement et de diffusion des possibilités de progrès des différentes filières, par rapport au climat, des bonnes pratiques et des innovations, venant de France ou de l'étranger. C'est un frein considérable à la progression du BTP et un handicap pour sa compétitivité prochaine. Par exemple, il a été impossible, pendant la préparation du plan en 2003, de faire se rencontrer le ministre de l'équipement et les entreprises de ce secteur qui étaient pourtant demandeuses, et ce malgré le souhait exprimé par le cabinet du Premier ministre. Le ministre actuel doit être sensible à cette question : en tant que maire de Chalon-sur-Saône, il a fixé à sa ville l'objectif de réussir Kyoto (-5,2% de GES) en trois ans ; en 2 ans les opérations ont déjà dépassé l'objectif, et la majeure partie d'entre elles touche au bâtiment et à sa gestion. M. Raphaël LAMÉ a confirmé ensuite ce diagnostic de fragilité du BTP avec une appréciation qui, venant d'un professionnel, me paraît importante à restituer : sans adaptation rapide le BTP français sera en crise « dans 4 ou 5 ans » par rapport à ses concurrents des pays voisins. Mme la Rapporteure : Nous recevons tout à l'heure M. Dominique Perben et nous pourrons donc lui poser des questions à ce propos. Je vous remercie tous d'avoir participé à cette table ronde. Table ronde sur « L'après 2012 » réunissant : Présidence de Mme Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET, Rapporteure Mme Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET, Rapporteure : Je vous souhaite la bienvenue. Plusieurs de nos interlocuteurs ont évoqué devant nous « l'après 2012 », et nous vous avons réunis pour traiter spécifiquement de ce thème. M. Paul Watkinson ouvrira le débat en rappelant les enjeux. M. Paul WATKINSON : Si l'on souhaite limiter le changement climatique, il faut au minimum stabiliser la concentration de CO2 dans l'atmosphère. On en est loin, puisqu'elle continue de progresser. Certes, la courbe des émissions dans les pays développés est plate, mais comme y sont inclus la Russie et autres pays à économie en transition, qui ont connu une phase de régression dans les années 1990, cet agrégat cache des augmentations d'émissions. Pour leur part, les pays en développement connaissent une croissance de leurs émissions de 45 à 50 % depuis 1990 dans certains pays, et la tendance est toujours haussière. Terre et forêt exceptées, la part de la France dans les émissions de gaz à effet de serre est de 1,5 %, celle de l'Union européenne à vingt-cinq de 14 %, celle des dix plus gros émetteurs de 72 % et celle des vingt plus gros émetteurs de quelque 84 %. Le défi, mondial, exige une coopération internationale, notamment Nord-Sud, pour limiter les émissions, dont le pic devrait se produire dans les vingt ans à venir, avant une réduction de moitié d'ici 2050. Mais, selon le scénario de référence de l'AIE, les émissions de CO2 augmenteront de 60 % à l'horizon 2030. Or, des investissements considérables sont prévus d'ici là dans les secteurs de l'énergie, de l'habitat, des transports et de l'urbanisme, et les choix d'aujourd'hui influent sur le futur. Une action est donc nécessaire dans les dix à vingt ans à venir pour permettre une transition vers une économie mondiale sobre en émissions de carbone. Comme le problème ne va pas se résoudre seul, une politique volontariste est nécessaire. Elle suppose un cadre international pour faciliter l'action concertée de tous les pays, qui ont une obligation de solidarité. Mais on met là le doigt sur une contradiction : comme il n'existe pas de gouvernance mondiale habilitée à imposer des contraintes, on est dans le cadre d'une négociation entre Etats souverains, qui peuvent les accepter, ou les refuser comme l'ont fait les Etats-Unis. Les actions possibles sont diverses. A la Convention climat, 189 Etats sont parties, mais le texte ne fixe pas d'engagements contraignants. C'est pourquoi le Protocole de Kyoto a été négocié mais, outre qu'il n'a pas de visibilité au-delà de 2012, les engagements qu'il a permis de créer ne concernent que 30% des émissions mondiales. Il y a aussi les partenariats sur les technologies, conçus comme des compléments au protocole de Kyoto, et encore les dialogues qui se déroulent hors du processus de négociations. Enfin, à la Conférence de Montréal, les parties ont décidé de poursuivre le Protocole de Kyoto et d'engager l'examen des engagements des pays industrialisés après 2012. Aucun calendrier n'a été fixé, mais les négociations doivent aboutir aussitôt que possible pour éviter toute interruption en 2012. Dans le même temps, un dialogue ouvert et non contraignant se poursuit, visant à renforcer la coopération entre tous les pays dans le cadre de la Convention climat. Une première réunion aura lieu en mai à Bonn, et le groupe ad hoc va également se réunir. Le processus démarre donc, mais à ce stade on ne sait pas ce que sera la forme finale d'un accord futur, ni le temps que prendra le rapprochement nécessaire. De nombreuses questions demeurent en suspens. Quel cadre définir pour créer les incitations ou les contraintes nécessaires à la transition vers une économie mondiale sobre en émissions de carbone ? Comment obtenir la participation pérenne de tous les pays à un système ambitieux qui suppose un grand respect des engagements souscrits ? Quel sera le rôle donné au Protocole de Kyoto après 2012 ? La France souhaite progresser dans ce domaine, le Président de la République l'a dit avec force, mais comment faire? L'instauration du prix de carbone et les mécanismes de flexibilité dépendent de l'existence d'une contrainte crédible. Dans ce contexte, quels acquis garder ? Comment assurer la continuité ? Comment permettre une plus grande visibilité à long terme ? D'autres problèmes se posent, dont le moindre n'est pas que les Etats-Unis refusent tout système contraignant. Que faire s'ils persistent dans leur opposition au protocole de Kyoto et restent en dehors du mécanisme futur ? Pourra-t-on imaginer une participation américaine fondée sur d'autres règles que celles qui vaudront pour les autres pays développés, et comment tenir compte des actions menées par les Etats-Unis sur le plan national ? Par ailleurs, les pays en développement refusent de modifier le clivage entre pays de l'annexe I et pays hors annexe I. Quelles options permettront alors d'élargir les instruments de Kyoto, et jusqu'à quel point peut-on envisager une contrainte pesant uniquement sur les pays de l'annexe I ? Que faire si la Chine et l'Inde demeurent elles aussi à l'écart du dispositif ? Comment avancer s'il n'y pas de régime global ? Quelles sont d'autre part les limites du financement carbone, et quels autres mécanismes sont pertinents ? Tels sont certains des multiples problèmes qui se posent au moment de lancer la nouvelle négociation, mais ce ne sont pas les seuls. Il reste aussi à définir comment intégrer pleinement les pays à économie en transition, qui n'ont pas de vrais objectifs pour l'instant, la Russie notamment, mais aussi les nouveaux pays membres de l'Union européenne, et déterminer si des approches alternatives ou complémentaires au Protocole de Kyoto doivent être explorées, et pour quels pays. Le dialogue est lancé dans le cadre de la Convention climat, mais comment passer du dialogue aux négociations ? Comment gérer la transition entre la phase actuelle et l'après- 2012 alors que des élections sont en vue aux Etats-Unis ? Cherchera-t-on à conditionner le renforcement des engagements déjà souscrits à l'engagement des pays qui, jusqu'à présent, se sont abstenus d'en prendre ? Comment éviter de stabiliser le marché de carbone, et comment prendre en compte les technologies futures ? Faudra-t-il, à l'avenir, privilégier la compensation ou la solidarité ? Comme on le voit, les questions ne manquent pas. M. Nicolas THÉRY : Je vous remercie de m'avoir invité à prendre la parole. Votre invitation montre bien que le changement climatique n'est pas seulement un problème scientifique et technique mais que c'est aussi un problème politique et social. Du point de vue de la Commission européenne, le traitement de la question relève de l'« Europe nécessaire », car elle est au point de convergence des politiques internes et externes. S'agissant de l'après- 2012, je soulignerai le danger du slogan « à problème global, réponse globale », qui pourrait donner le sentiment qu'une solution miracle, à base de poudre de perlimpinpin, est à portée de main. Les solutions sont multiples et doivent être articulées sans que l'on puisse faire l'impasse sur aucune, les difficultés résidant beaucoup plus dans la mise en œuvre que dans la décision. Pour agir avec succès après 2012, deux conditions sine qua non doivent être remplies. La première est que l'Europe balaye vigoureusement devant sa porte ; la seconde, que l'on sache élargir et approfondir le dispositif existant. Pour être crédible, l'Europe doit balayer devant sa porte. Nous avons un objectif, qui est de limiter le réchauffement à 2 degrés de plus qu'au niveau préindustriel, ce qui suppose que le pic des émissions de CO2 soit atteint en 2025. Pour cela, elles devraient être réduites de 15 à 30 % à 2020, puis de 60 à 80 % à 2050. Cet objectif est-il crédible ? Sur le plan technique, oui, comme l'indiquent les travaux faits à Princeton par le professeur Robert Socolow. Est-il financièrement acceptable ? Oui, puisque la réduction de 30 % des émissions de carbone coûterait à l'Europe un demi point de PIB en 2025, ce qui, en matière assurancielle, est un prix extrêmement raisonnable. Est-il économiquement fondé ? Oui, car la lutte contre le réchauffement climatique peut participer d'une stratégie de compétitivité et qu'elle permet la création d'emplois sur toute la chaîne de valeur, des moins qualifiés aux plus qualifiés, de surcroît difficilement délocalisables. Préparer l'après-2012, c'est donc d'abord réussir 2012, ce qui n'est pas gagné. Ainsi, si des mesures additionnelles ne sont pas prises, la France pourrait dépasser de 9 % son objectif en 2010. Après 2012, il faudra élargir et approfondir le dispositif en vigueur. L'élargissement signifie une coopération internationale renforcée pour faire face à une responsabilité commune. Les pays gros émetteurs rejettent à eux seuls 75 % des émissions. Les pays développés qui ont ratifié le Protocole devront poursuivre leurs efforts tendant à limiter les émissions sur la même base, en allongeant sa période d'application actuellement un peu courte pour les opérateurs privés et en faisant tout pour y faire adhérer les Etats-Unis. Pour les pays émergents, la question est de savoir comment les intégrer à cette dynamique sans brider leur développement. Cela peut se faire par la diffusion des technologies, et l'on se félicitera de l'accord que M. Andris Piebalgs, commissaire européen à l'énergie, vient de signer avec la Chine et qui tend à la construction d'une centrale à charbon à émissions "quasi nulles". Plus largement, l'AIE estimant à 16 000 milliards de dollars le montant des investissements énergétiques d'ici 2030, ils doivent être orientés dans la bonne direction. Cela peut se faire aussi par l'extension sectorielle du marché du carbone, et aussi par la création de partenariats énergétiques entre l'Union européenne et l'Inde d'une part, l'Union européenne et la Chine d'autre part. Mais c'est une exigence démocratique que de ne pas négliger les autres pays en développement, d'autant que la déforestation provoque 20 % des émissions de CO2. Il faut les convaincre d'y mettre un terme, et valoriser le maintien des forêts. On le voit, la clef de l'élargissement, c'est une grande solidarité des pays développés vers les pays en développement. Quant à l'approfondissement, il passe par un effort accru en matière de recherche. A ce sujet, on peut regretter que le septième programme-cadre, qui couvre la période 2007-2013, ne soit pas plus développé. Ainsi la Commission a t-elle proposé six projets d'initiatives technologiques communes dont trois étaient centrés sur le développement « propre » (avion vert, système d'observation spatiale pour l'environnement et la sécurité hydrogène et voiture propre). On déplorera également que la mutualisation du programme de capture du carbone se fasse mal. Dans le domaine énergétique, il faudra réduire les subventions aux énergies fossiles, qui s'élèvent actuellement à 24 milliards dans l'Europe des Quinze contre 5 milliards aux énergies renouvelables ; le Livre vert sur la politique énergétique qui sera publié le 8 mars prochain est appelé à jouer un rôle central dans la mise en œuvre d'une politique énergétique européenne cohérente. Enfin, il faudra étendre le marché du carbone au transport aérien et maritime. En conclusion, il faut éviter le jeu cynique du « Je te tiens, tu me tiens par la barbichette », notamment avec les Etats-Unis, car le seul espoir de s'en sortir, c'est de tirer toutes les barbichettes à la fois. M. Cédric PHILIBERT : Je partage le point de vue qui vient d'être exprimé, mais je pense aussi que le dispositif ne fonctionnera pas si l'on ne tient pas compte des incertitudes sur les coûts. On a besoin de toutes les technologies car, selon que l'on exclut ou non l'une des options, les coûts et les incertitudes seront plus ou moins élevés. L'efficacité énergétique doit être privilégiée car ses avantages sont indéniables ; elle consiste, par exemple, à investir 1 000 milliards de dollars en 25 ans dans l'achat de voitures plus efficaces pour en gagner 7 000 en économie de carburants et contribuer ainsi à la stabilisation des émissions. Pour y parvenir, on aura besoin de tous les pays. Le changement climatique est global, de long terme, et plein d'incertitudes sur les coûts des dommages et ceux des réductions d'émissions. En théorie, des taxes seraient préférables, car elles ajustent spontanément les réductions d'émissions ; mais le dispositif de « taxe carbone » ne fonctionne pas dans un monde inégal. Quant aux objectifs quantitatifs fixes, ils sont difficiles à accepter, comme on le voit avec les Etats-Unis et les pays en voie de développement, et ils sont par nature arbitraires. Les politiques de recherche et développement sont utiles mais insuffisantes, l'exemple schizophrénique des Etats-Unis le montre, puisque la capture et le stockage du CO2 ne pourront se diffuser si le carbone n'a pas de prix. Dans ce contexte, l'AIE suggère de maintenir le principe des échanges de permis, outils à la fois économiques et efficaces pour l'environnement, qui permettent une part d'allocation gratuite, qui permettent aussi aux pays riches d'aider les pays pauvres à faire face aux surcoûts ? et qui mobilisent l'argent du privé et pas uniquement les fonds publics. Il faut pour cela créer un MDP (mécanisme de Développement Propre) mondial large, éventuellement sectoriel ce qui a, en principe, été acquis à Montréal et, mieux encore, en venir à des engagements non contraignants. Mais il faut aussi réduire les incertitudes sur les coûts pour les pays industriels, soit en indexant les objectifs sur la croissance soit, ce qui serait mieux, en plafonnant les coûts. Le dilemme de l'objectif ultime, c'est que la Convention vise la stabilisation des gaz à effet de serre sans préciser aucun niveau ni calendrier. Quant aux coûts et aux bénéfices, ils sont incertains, mais ils comptent ! Les inerties contraignent l'action précoce, et aussi l'appellent. La solution possible consisterait donc à viser des concentrations faibles sous condition de coûts, en définissant un prix plafond. Il permettrait de fixer des objectifs plus ambitieux en réduisant les risques économiques, et il n'interviendrait que si les coûts sont plus élevés qu'attendu. Ainsi mettrait-on au point une politique efficace de lutte contre les changements climatiques et une politique efficace de l'énergie. Présidence de M. Jean-Yves LE DÉAUT M. Jonathan WIENER : Je vous remercie de m'avoir invité à cette table ronde. Quand on parle de « l'après 2012 », il ne reste que 6 ans, ce qui est beaucoup moins que les 15 ans prévus en 1997. Il faut également penser à 2020 et 2030. Et pour que le marché des permis d'émissions négociables, établi par le Protocole de Kyoto en 1997, puisse continuer après 2012, cela suppose de définir avant le commencement des transactions de ce marché en 2008, de nouveaux engagements pour l'après-2012. Ce sera difficile, parce que l'administration américaine actuelle ne veut pas d'objectifs quantitatifs et parce que l'élection d'un nouveau président n'arrivera qu'en novembre 2008. En plus, cette élection ne changerait pas la donne à elle seule. En effet, la ratification d'un traité suppose la majorité des deux tiers des voix du Sénat qui, en 1997, a repoussé le Protocole de Kyoto par 95 voix contre zéro. Certes, en 2003, le projet de loi « McCain-Lieberman » relatif à la création d'un système de permis négociables avec un plafond d'émissions a recueilli 44 voix, soit près de 50 %, mais on est encore loin des 67 voix nécessaires à la ratification d'un traité. La raison la plus importante est le manque d'engagement des grands pays en développement. Dans ce contexte, la seule solution, pour continuer le marché des permis après 2012, et pour y attirer les Etats-Unis, consiste à trouver un moyen d'inciter la Chine, l'Inde, le Brésil et les autres pays comparables à participer au dispositif, ce qui améliorerait l'efficacité environnementale, économique et politique de l'ensemble. Sur le plan de l'efficacité environnementale, l'augmentation rapide des émissions de gaz à effet de serre impose l'engagement de tous les pays gros émetteurs, car tout mécanisme international auquel ne participeraient que l'Europe, le Canada, la Russie et le Japon serait inutile, d'autant qu'on estime que les émissions des pays en développement dépasseront celles des pays développés en 2020 environ. Cette estimation atteste en elle-même de l'accélération du phénomène car, il y a peu encore, on estimait que ce dépassement ne se produirait qu'en 2030. Parce que le Protocole de Kyoto n'a pas été ratifié par l'ensemble des nations, des réglementations adoptées dans certains pays ne le sont pas ailleurs, si bien que des activités émettrices de gaz à effet de serre sont délocalisées. Que le régime prévu par le Protocole de Kyoto ne soit appliqué qu'aux pays riches a donc aussi pour effet que les émissions baisseront dans l'Union européenne, mais qu'elles augmenteront dans les pays en développement. Sur le plan de l'efficacité économique, si le marché des permis est limité à l'Europe, le coût du contrôle des émissions sera beaucoup plus élevé que si les pays en développement y participent également. Si, d'autre part, seuls la Russie et l'Ukraine sont vendeurs, on risque de voir s'instaurer un monopole. Les incidents récents relatifs à la distribution du gaz naturel russe montrent le risque que ce pouvoir de marché s'exerce dans ce secteur également, et l'Europe serait dans une position beaucoup plus forte si les vendeurs des permis d'émissions en concurrence étaient plus nombreux. Sur le plan politique, en l'absence de gouvernance mondiale, on est dans le cadre du droit international des accords, dans lequel chaque Etat décide souverainement de participer ou non au dispositif après en avoir évalué le rapport coût/bénéfice pour ce qui le concerne. C'est le cas, en particulier, pour les Etats-Unis. La réduction des coûts de participation par l'emploi d'outils de flexibilité pourrait donc inciter des pays qui refusaient jusqu'à présent de le faire à s'engager sur le marché ; pour autant, il ne faut pas, au risque de restreindre les possibilités de participation, opposer ce marché des permis et les crédits de puits. Même sous l'administration Clinton, l'opposition aux engagements contraignants existait ; de plus, des membres du Sénat craignent des pertes d'emplois et de la compétitivité au bénéfice d'autres Etats. Tous les pays grands émetteurs devraient participer au mécanisme, mais l'on ne peut les y contraindre, et il est difficile d'imaginer imposer des pénalités à la Chine ou aux Etats-Unis, parce qu'ils s'y refusent. Comment, alors, les y inciter ? En premier lieu, on ne peut pas exiger la participation des pays en développement au dispositif, mais par contre il faut s'assurer qu'ils y trouveront avantage. Certains pensent à des aides fiscales ou à des subventions, mais elles feraient courir un risque d'effet pervers, celui d'attirer des investissements dans ce secteur, ce qui pourrait augmenter les émissions au lieu de les réduire. Si le Mécanisme du Développement Propre (MDP) fonctionne comme une subvention, sans objectif quantitatif, il pourrait susciter l'inquiétude. On peut l'améliorer soit en créant des projets de MDP pour un pays entier, soit en instituant des paiements compensatoires visant à réduire la déforestation dans un pays entier (comme a proposé la Papouasie Nouvelle-Guinée en décembre 2005 à Montréal). Une autre solution consisterait à étendre à la Chine, à l'Inde, au Brésil et aux autres pays en développement gros émetteurs, le dispositif des permis négociables et des paiements compensatoires versés d'avance à travers le niveau des permis accordés, comme cela a été fait pour la Russie dans le cadre du Protocole de Kyoto. C'est pourquoi j'avais suggéré, dans un ouvrage publié en 2003, que le meilleur moyen serait d'engager l'Australie, le Brésil, la Chine, les Etats-Unis et l'Inde dans un régime de permis négociables parallèle au protocole de Kyoto, et sous la Convention Cadre de Rio, avec la possibilité de profiter de l'expérience, de modifier et éventuellement de fondre les deux régimes par la suite. M. Richard ARMAND : Les gros consommateurs d'énergie font partie d'un système d'échange de permis gratuits, malheureusement limité à l'Europe. Mais, à mesure que la « contrainte carbone » se renforcera, la compétitivité des entreprises soumises à la concurrence internationale diminuera. De plus, la pression de la concurrence étrangère les empêchera de répercuter le surcoût dû à cette contrainte dans leurs prix. La première nécessité est d'engager le plus grand nombre de pays possible dans ce combat, mais cela prendra du temps et, dans l'intervalle, si la contrainte devient trop forte, les entreprises iront produire ailleurs, non par chantage, mais pour ne pas laisser du champ à leurs concurrents. Le système en vigueur a des inconvénients, dont celui d'avoir un rythme quinquennal, très coûteux, incertain et qui peut avoir des effets pervers. Les investissements des secteurs concernés sont à la fois très lourds et porteurs d'innovation, et il est très coûteux d'en avancer la date, singulièrement lorsque les cycles de renouvellement sont de trente ans. En obligeant les entreprises à des segmentations quinquennales, on les soumet à des contraintes qu'elles ne peuvent satisfaire et que les allocations de quotas ne règleront pas davantage. Or, elles ne sont pas nécessaires. Par ailleurs, l'absence de visibilité sur la période suivante entretient l'incertitude. Enfin, le système pouvait avoir un effet pervers, auquel les pouvoirs publics ont trouvé une parade partielle : si l'allocation de quota avait été fonction de la situation au début de la période, il y aurait peut-être eu intérêt à ne pas trop réduire les émissions pour bénéficier de davantage de quotas au cours de la période suivante. Ce n'est pas le cas à titre individuel, mais si les entreprises « en avance » en viennent à envisager que cela pourrait être le cas collectivement, ce serait fâcheux. On pourrait améliorer le dispositif en allongeant le cycle à vingt ans sinon davantage. Je rappelle que le marché d'échange de droits d'émission du SO2 pris comme modèle pour la création du marché carbone est fondé sur un cycle de trente ans. Evidemment, ce n'est pas une panacée, et des difficultés apparaîtront, que nous étudierons, comme d'autres éléments qu'il faudra corriger ou assouplir. Enfin, il faudra coupler le dispositif ainsi amélioré à des accords sectoriels mondiaux qui auront l'avantage de mettre dans la course les concurrents mondiaux que sont la Chine et l'Inde. Mme la Rapporteure : On ne parvient pas au consensus, sinon sur le fait qu'il faut multiplier ou associer les différents systèmes en leur trouvant une convergence, la plus rapide possible selon les uns, impossible à obtenir pour d'autres. Mais, concrètement, si l'on souhaite s'engager dans une négociation qui permettrait que de nouveaux pays intègrent le dispositif pour la période 2012-2017, doit-on seulement se donner pour objectif de laisser vivre le Protocole de Kyoto ? Dans quel esprit aborde-t-on les négociations, à très court terme ? M. Paul WATKINSON : On peut soit essayer de s'accorder sur un texte qui poursuit le Protocole de Kyoto, soit reprendre le Protocole proprement dit. L'administration américaine donne peu à négocier. Quant à nos partenaires du Sud, s'ils ne veulent pas simplement intégrer le dispositif, ils veulent néanmoins agir sur les transports, sur l'énergie ou sur d'autres secteurs. A Montréal, ils se sont pourtant montrés réticents à entamer le débat sur la proposition d'engagements sectoriels, même s'ils ne sont pas contraignants mais seulement incitatifs. Il serait plus intéressant de commencer par définir l'effort attendu d'un pays puis de générer un crédit. Un dialogue informel nourri a lieu avec plusieurs pays émergents, dont Chine et Brésil, mais ces pays ne souhaitent pas négocier pour l'instant. Il faut donc poursuivre le dialogue en soulignant l'intérêt de l'approche, et œuvrer pour parvenir à quelque chose. L'une des difficultés est que de nombreux pays attendent de savoir ce que feront les Etats-Unis. La Commission européenne a évoqué des partenariats avec la Chine et avec l'Inde : ce sont des occasions à saisir, pour ne pas laisser la coopération technologique aux Etats-Unis, qui en parlent beaucoup mais qui font moins que ce qu'ils disent. La coopération technologique doit faire partie de l'enveloppe globale. M. Nicolas THÉRY : L'accord de Montréal de 2005 a montré un changement de perspective, en établissant que se poursuivraient en parallèle le Protocole de Kyoto, élargi à de nouveaux secteurs et de nouveaux pays, et le dialogue déjà engagé dans le cadre de la Convention climat. La Conférence a aussi montré une prise de conscience assez frappante à propos de la question énergétique. Elle figure désormais en troisième position dans les priorités du discours sur l'état de l'Union récemment prononcé par le président Bush, qui a annoncé, par exemple, un programme « voiture propre ». Il y a là une occasion à saisir. L'inflexion du discours de la Chine à propos du changement climatique est tout aussi marquante. C'est sur la base de l'accord de Montréal qu'il faut construire un mécanisme de convergence des politiques. M. Richard ARMAND : Ce que peuvent faire les industriels, c'est trouver les conditions d'accords sectoriels mondiaux, mais ils souhaitent un aménagement du Protocole de Kyoto tel que les entreprises européennes ne soient pas pénalisées avant que d'autres n'intègrent le dispositif. M. Jean-Pierre TABET : On a parlé du marché des permis et de paiements compensatoires mais aujourd'hui des centaines de projets sont enlisés par manque de moyens. De plus, le mécanisme s'étouffe car plus 2012 approche, moins les projets ont de temps pour produire leurs effets, sans visibilité ultérieure. Les choses seraient plus faciles s'il existait une assurance de rentabilisation à long terme. M. Jonathan WIENER : Le Protocole de Kyoto peut se poursuivre de 2012 à 2017 avec les mêmes pays membres qu'aujourd'hui. Je ne dis pas que c'est la meilleure solution, mais comme les négociations demandent beaucoup de temps, c'est probablement cet engagement intermédiaire ou rien. En même temps, les Etats-Unis et la Chine pourraient construire avec cinq ou six autres pays, par le dialogue, le mécanisme parallèle dont j'ai parlé, ce qui permettrait d'avancer plus vite. Ce régime commence déjà avec le Partenariat Asie-Pacifique sur le Développement Propre et le Climat. Le marché des permis est effectivement le meilleur moyen d'organiser les paiements compensatoires aux pays en développement. Je ne dis pas qu'il faut les rejeter le MDP, mais qu'il faut l'améliorer. Pour plus d'efficacité environnementale et économique, il faut attirer les pays à adhérer à un mécanisme formalisé de plafonds quantitatifs et de permis d'émissions. M. Cédric PHILIBERT : Puisque même la procédure de prolongation du Protocole de Kyoto est longue et compliquée, il faudrait en profiter pour améliorer et enrichir le texte, ce qui serait plus rassurant sur les coûts futurs. L'idée d'une période d'engagement longue se fait jour mais aller au-delà de quinze ans est problématique. C'est risquer que des gouvernements s'engagent avec une certaine désinvolture, sachant qu'ils ne seront plus aux affaires à si long terme. Il faut coller aux échéances démocratiques. Certes, la durée de l'accord pose problème, mais une période de quinze ans est un rythme assez lent pour une entreprise. De plus, en écoutant les gouvernements, on comprend que le carbone aura dans le futur un prix au moins égal à celui qu'il a aujourd'hui. M. le Président : J'observe que l'on ne traite que des entreprises qui, certes, peuvent encore faire des efforts mais qui en ont déjà fait, et des seules entreprises de certains pays volontaires. De plus, certains disent que l'on a attribué trop de quotas, ce qui a dispensé d'efforts obligatoires, et que l'on aurait même créé un effet d'aubaine en assimilant certains gaz tels que le peroxyde d'azote aux gaz à effet de serre. Autrement dit, alors qu'il y a urgence et que les négociations internationales piétinent faute d'accord, on ne traite pas la totalité du problème. M. Cédric PHILIBERT : C'est vrai et c'est faux. Vrai parce que les systèmes domestiques ne traitent que de la grande industrie et de la production d'électricité, faux car les échanges de permis selon Kyoto concernent toutes les émissions, sauf celles des transports maritimes et aériens internationaux. On a donc bien créé un mécanisme incitatif très puissant, sans mobiliser seulement les rares finances publiques mais bien l'ensemble des ressources des pays développés. Les systèmes domestiques sont effectivement limités à ce qui est le plus facile à atteindre. Ce marché représente 45 % des émissions de l'Union européenne et la réflexion doit se poursuivre sur les moyens de l'élargir. Mais, sachant que le Protocole de Kyoto ne couvre qu'un cinquième des émissions mondiales de gaz à effet de serre, il faut aussi convaincre les pays qui ne l'ont pas ratifié à le faire. M. le Président : Peut-on imaginer de régler la question par le seul biais de permis négociables ? M. Paul WATKINSON : Il faut distinguer les engagements des Etats des moyens choisis pour les respecter. La France a décliné des mesures dans le Plan Climat. Pour l'industrie, l'instrument principal est l'échange de quotas. On peut aussi explorer la voie des projets domestiques, mais ce ne sera qu'un outil. De même, le mécanisme pour un développement propre est le seul outil à la disposition des Etats permettant d'influer sur les investissements des pays du Sud, mais il n'est pas à la hauteur de l'enjeu. Il faut donc trouver de nouveaux instruments susceptibles d'inciter de nouveaux pays et de nouveaux secteurs à s'engager. M. Nicolas THÉRY : Certains Etats ont trouvé le premier plan d'allocation de quotas rigoureux, et le prochain sera plus contraignant. Ainsi, la tendance spontanée, en France, étant un dépassement de 9 % de l'objectif à l'horizon 2010, des mesures additionnelles devront être prises. Il est significatif que le Sommet de Hampton Court se soit conclu par l'affirmation de la nécessité d'une politique européenne de l'énergie car, dans la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre, les politiques de l'énergie, du bâtiment et des transports sont fondamentales. Il faudra donc revoir complètement ce qui touche à la voiture, à la construction et au transport, avec détermination et constance. Mme Martine BILLARD : Comment expliquer que la France ne parvienne pas à respecter ses objectifs ? Cela provient-il d'efforts insuffisants de l'industrie, ou les secteurs choisis ont-ils été mal ciblés ? Si c'est le cas, sur quels secteurs faut-il durcir la position en Europe, sachant que ceux du transport, de l'énergie et du bâtiment présentent l'avantage de ne pas être délocalisables ? D'autre part, on ne fait allusion qu'à la Chine, à l'Inde et au Brésil ; mais qu'en est-il de l'Afrique et des autres pays en développement ? On semble rejeter la faute sur eux et sur les Etats-Unis. M. Cédric PHILIBERT : Un des objets des discussions en cours est précisément de trouver les moyens d'inciter les pays en développement à participer au dispositif du Protocole de Kyoto. Leur situation est paradoxale car elle se caractérise par une forte intensité énergétique exprimée en énergie par points de PIB et par un très faible niveau de consommation énergétique par habitant - et cela vaut aussi pour la Chine. Cette forte intensité énergétique signifie en corollaire une forte possibilité de réduction des émissions à moindre coût quand on construit une centrale ou une usine neuve. Voilà pourquoi il est si important que les pays qui ont un grand potentiel d'augmentation d'émissions adhèrent au Protocole de Kyoto ou au texte qui lui succèdera ; mais il faut trouver pour cela des dispositions équitables, et l'échange de permis est un des moyens puissants de cette nécessaire équité. M. Paul WATKINSON : Je ne souhaite pas entrer dans la polémique relative aux émissions de la France, mais les projections montrent qu'elle respectera ses engagements. Un petit nombre de pays doivent impérativement se joindre au dispositif afin que l'on puisse influer sans tarder sur les cycles d'investissement, tout en facilitant leur développement. Il faut pour cela utiliser les instruments dont on dispose déjà, sans négliger l'impact de la déforestation. M. Jonathan WIENER : Il ne s'agit pas de blâmer les pays, mais de promouvoir leur engagement. La difficulté tient au cadre de la négociation, qui est celle d'un accord entre pays souverains, libres de participer ou de ne pas participer au dispositif. Il faut donc les y inciter, ce que devrait permettre, en dissociant coûts et lieux, un mécanisme de permis négociables associé à des paiements compensatoires. Un tel dispositif pourrait inclure tous les secteurs, y compris celui des transports, et tous les pays, y compris les pays africains. Pour inclure tous les secteurs, il y a des approches plus « upstream » (en amont), traitant les carburants et autres entrées aux sources des émissions, et plus downstream (aval), c'est-à-dire au niveau des consommateurs. M. le Président : Messieurs, je vous remercie. Audition de M. Dominique PERBEN, Présidence de M. Jean-Yves LE DÉAUT, Président M. le Président : Après quatre mois de travail intensif - une trentaine d'auditions collectives, cent cinquante personnes entendues, un voyage à Bruxelles, un autre en Grande-Bretagne, un autre aux États-Unis et un autre bientôt en Inde, sans oublier la mise en place d'un comité de pilotage -, nous entamons les auditions ministérielles : vous êtes, monsieur le ministre des transports, le premier que notre mission interroge sur la lutte contre le changement climatique. Quelle est votre position sur la politique de réduction des émissions, dans la perspective notamment de l'objectif dit « facteur 4 » ? Que pensez-vous de l'adaptation aux effets avérés ou probables du changement climatique - effets territoriaux, températures, régime des eaux, inondations, niveau des mers, enneigement, etc. ? M. Dominique PERBEN : Mon ministère est par essence celui de la mobilité : il est donc particulièrement concerné par la problématique de l'effet de serre et des changements climatiques. Les transports sont à l'origine d'un tiers des émissions. Mais si mon ministère est en première ligne, il n'est pas seul à détenir les responsabilités dans le domaine de la mobilité et des transports : les collectivités territoriales ont un rôle à jouer, de même évidemment que les acteurs économiques. L'important est d'adopter une approche la plus concrète possible, qui repose sur une réflexion de fond. Aussi ai-je confié au Conseil général des Ponts et Chaussées une mission de prospective sur les transports à l'horizon 2050, dont on peut déjà tirer quelques enseignements. Ainsi, quand bien même il existe de fortes potentialités de développement des transports alternatifs, le mode routier restera pendant longtemps prédominant ; pour autant, l'étude montre qu'il est possible d'envisager une division par 2,5 des émissions dues aux transports d'ici à 2050. Dès lors, la politique de mon ministère repose sur trois axes : que peuvent nous apporter les nouvelles technologies et comment les diffuser ? Comment agir sur les comportements individuels et collectifs ? Comment organiser les différents modes de transports ? S'agissant des technologies et de leur diffusion, la première priorité doit être l'amélioration de la motorisation des véhicules, notamment routiers. C'est là que le gisement d'économie est le plus important à court terme. Notre industrie automobile sait d'ores et déjà fabriquer des voitures émettant moins de 140 grammes de CO2 par kilomètre. Cela dit, avant de songer à aller plus loin dans la réglementation applicable aux véhicules neufs, on aurait tort d'oublier qu'il existe un stock considérable de véhicules anciens dont certains ont des caractéristiques véritablement calamiteuses sur le plan écologique : ainsi les anciennes R5 diffusent une quantité impressionnante de gaz à effet de serre. Avant de songer à progresser marginalement sur les véhicules neufs, réfléchissons bien au stock des véhicules existants, parfois très polluants, même si cette problématique n'a rien d'évident. Mon ministère soutient les motorisations propres de plusieurs façons, en mobilisant pour commencer le potentiel de recherche des laboratoires placés sous sa tutelle : ainsi en est-il de la participation de l'INRETS au pôle de compétitivité MOV'EO. L'étiquette énergie, qui renseigne sur les émissions de CO2 des véhicules neufs, est de nature à modifier le regard du consommateur sur le produit automobile. Rappelons également que 40 % des crédits de recherche en aéronautique sont dédiés aux performances environnementales des avions. Des améliorations notables ont déjà été obtenues ; les nouvelles améliorations et les caractéristiques aéronautiques des avions de demain devraient entraîner des progrès considérables. Enfin, certaines collectivités territoriales envisagent de financer des transformations sur les actuelles locomotives diesel de leurs transports ferroviaires. La seconde priorité porte évidemment sur le carburant, mais ce domaine ne relève pas à proprement parler du ministère des transports. Quoi qu'il en soit, le plan adopté par le Gouvernement en faveur des biocarburants va dans le bon sens ; une série de recherches portent sur l'hydrogène et la pile à combustible - j'inaugurerai dans quelques jours à Berlin une station Total de fourniture d'hydrogène - qui apparaît comme une solution intéressante à plus long terme. Les voitures hybrides constituent également des éléments d'amélioration importants : l'hybride diesel notamment semble offrir des perspectives tout à fait intéressantes en termes de lutte contre la profession. S'agissant du deuxième axe, les comportements individuels et collectifs, nous entendons en premier lieu renforcer l'éducation et la formation à l'« éco-conduite », autrement dit la conduite apaisée qui, en parallèle de la politique de sécurité routière, va dans le sens d'une moindre pollution et d'une économie d'énergie. L'offre de transports collectifs est évidemment un outil très important et bien connu des élus, pour peu que ceux-ci soient efficaces et fiables. Il faut également agir sur l'organisation collective. Les évolutions réglementaires des dernières années ont essayé de faire prévaloir une vision différente de la dynamique urbaine en inversant l'ordre des facteurs, c'est-à-dire en intégrant la dimension transports dès le stade de la conception au lieu d'attendre que la ville se soit étendue pour mettre en place les dessertes. Il s'agit là d'une véritable révolution culturelle qui a déjà bien avancé, au niveau des esprits en tout cas - la pratique est plus difficile. Au-delà même des problématiques écologiques, chacun prend progressivement conscience de la nécessité de construire désormais la ville autour de l'idée de mobilité. Le troisième axe de notre politique renvoie évidemment à l'intermodalité, qu'il faudrait plutôt appeler « co-modalité ». Deux idées fortes doivent rester à l'esprit : premièrement, la route a toutes chances, au moins jusqu'en 2050, de rester prédominante compte tenu de son caractère difficilement remplaçable sur les courtes et moyennes distances ; deuxièmement, le report modal, quoi qu'on en dise, ne dégage que des gains relativement modestes en termes d'effet de serre - ce qui ne veut pas dire qu'il n'a pas d'autres avantages par ailleurs. Toujours est-il que le « rendement » de l'opération n'a rien de comparable à celui d'une évolution des motorisations automobiles, par exemple. Dès lors, ma politique consiste à faire en sorte que chaque mode se développe dans son domaine de pertinence, c'est-à-dire là où il est économiquement viable et écologiquement efficace. Il faut agir là où l'espérance de gain est la plus forte, en favorisant le report vers les modes « massifiés » sur les axes à fort trafic. Encore faut-il, dans un premier temps, rendre ces modes massifiés attractifs. Cela suppose d'améliorer la compétitivité du mode ferroviaire ; le rail doit regagner des trafics sur les axes importants. Parmi les actions engagées, le plan Fret SNCF vise à sauver le transport ferroviaire de marchandises dont la situation il y a trois ou quatre ans était dramatique ; le plan est en passe de réussir, malgré l'extrême difficulté. Deuxième élément, l'ouverture du fret à la concurrence à partir du 31 mars prochain peut être de nature à modifier le comportement des chargeurs en leur offrant une certaine souplesse. Le métier de transporteur routier est en train d'évoluer vers celui de chargeur, qui fait appel à tous les modes de transports disponibles en fonction de la nature du chargement, de la destination, de la complémentarité des différents modes et surtout de leur fiabilité : la certitude de l'heure d'arrivée du produit chez le client est pour le transporteur un élément fondamental. L'inconvénient majeur est moins la lenteur que l'irrégularité ; or c'est souvent là que nos prestations ferroviaires ont péché par le passé. Troisième élément, l'amélioration des acheminements terminaux ferroviaires. J'ai confié à cet égard une mission à M. Jacques Chauvineau, qui l'a amené à rencontrer nombre d'élus, de responsables et de chambres de commerce, afin de réfléchir à la création d'opérateurs ferroviaires de proximité capable d'assurer et d'organiser cette capillarité indispensable si nous voulons augmenter significativement la part du fret ferroviaire. Quatrième élément enfin, les autoroutes ferroviaires que je tiens à expérimenter en vraie grandeur. Avec RFF et la SNCF, nous avons décidé de mettre en service une liaison Perpignan-Luxembourg afin de mesurer l'effet et les avantages d'une telle offre, à plus forte raison sur un axe réellement encombré par les poids lourds. Cette première autoroute ferroviaire devrait être ouverte au premier trimestre 2007, le temps de procéder aux indispensables aménagements techniques et mises au gabarit des tunnels et de fabriquer les wagons. L'objectif à court terme est de parvenir à 4 milliards de tonnes-kilomètres dès 2010, ce qui évitera la diffusion de quelque 160 000 tonnes de CO2. Le chiffre est relativement modeste, mais le plus difficile est d'inverser la tendance. La voie d'eau, fluviale et maritime, est un autre levier important. La France s'efforce de faire avancer la question des autoroutes de la mer. Nous espérons concrétiser le plus rapidement possible un projet qui permettrait de soulager le trafic transitant par le Sud-Ouest et l'Ouest français en reliant l'Ouest de l'Espagne et le Nord de l'Europe. Dans un second temps, il paraît nécessaire de renforcer l'attractivité des modes de transport alternatifs. Verra-t-on un jour des quotas de CO2 dans le transport comme il en existe dans l'industrie ? La question se pose, dans le domaine aéronautique notamment. Je reste pour ma part très ouvert. Cela a permis de faire bouger les choses dans d'autres secteurs ; pourquoi n'en irait-il pas de même dans celui des transports ? On a longtemps dit, et pas toujours à tort, que le ministère de l'équipement était d'abord le ministère des infrastructures, pour ne pas dire le ministère du béton, face aux représentants, beaucoup plus vertueux, de l'environnement et de l'écologie. Comme tous les ministres, je suis seulement de passage dans cette administration, mais je crois réellement que le ministère de l'équipement est en passe de devenir le ministère du développement durable. Il n'est qu'à discuter avec les membres du Conseil des Ponts et Chaussées pour se rendre compte de la façon dont les structures de cette grande maison ont su s'approprier la problématique du développement durable et de l'environnement, qui témoigne d'une évolution considérable de notre système de décision. Plutôt que de lutter contre cette technostructure, nous avons tout intérêt à nous appuyer sur elle pour faire bouger les choses et à nous servir de l'impressionnant potentiel technique du ministère de l'équipement, qui ne demande qu'à se mobiliser au bénéfice d'une vision « développement durable » des transports. M. le Président : La part des transports dans les émissions de gaz à effet de serre en 1990 était de 22 % ; elle atteint désormais 26 %. Pensez-vous que le Plan Climat du Gouvernement soit, dans votre domaine, à la hauteur des objectifs de réduction affichés ? Les questions de bonus-malus, de péage, de bilan carbone des véhicules, de réduction des vitesses sur autoroute ont-elles déjà été étudiées ? Ont-elles déjà reçu réponse, dans un sens ou un autre ? Êtes-vous disposé à aller plus loin pour que le ministère de l'équipement devienne réellement celui du développement durable ? M. Dominique PERBEN : Les chiffres sont un bon moyen d'apprécier l'efficacité des évolutions technologiques dans le domaine des motorisations : on s'aperçoit immédiatement que les courbes de l'augmentation du trafic et des émissions de CO2 ne sont pas parallèles. La consommation d'énergie s'est stabilisée et, sur le plan qualitatif, les émissions de gaz à effet de serre ont proportionnellement diminué. Entre 2002 et 2010, il est prévu que le trafic augmentera d'au moins 15 % et les émissions de CO2 de 8 % seulement. D'ici à 2025, on table sur une augmentation de 13 % des émissions de CO2 et de 41 % du trafic. Nos économies sont de plus en plus fondées sur la mobilité ; de ce fait, tous les trafics augmentent considérablement. Ainsi, le trafic maritime mondial est en train d'exploser. C'est une réalité, et il faut faire avec ; d'où les efforts à poursuivre sur les carburants et les moteurs non polluants pour maîtriser les effets négatifs de cette évolution par ailleurs porteuse de croissance et de bien-être. M. le Président : Mais si les émissions augmentent d'ici à 2025 dans votre secteur, on aura du mal à les réduire par ailleurs. M. Dominique PERBEN : Il n'y a pas que les transports. M. le Président : Mais si la part des autres baisse, la vôtre ne pourra qu'augmenter. Mme Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET, Rapporteure : Ma première question portera sur les infrastructures et les systèmes. Une personnalité auditionnée nous a présenté un graphe très intéressant comparant les durées de vie des différents équipements et l'inertie associée : les infrastructures de transports et les logements avaient la durée de vie la plus longue. J'entends bien que les carburants permettent de sensibles améliorations à court terme, mais ne doit-on pas mettre également l'accent sur la durée de vie des infrastructures et des systèmes ? Un de nos internautes affirmait ce matin que le tourisme aérien était probablement voué à disparaître d'ici à vingt ans : on ne prendra plus l'avion sans se poser de questions pour passer une semaine aux Antilles, par exemple. Ce genre de perspectives a-t-il été pris en compte dans nos choix d'infrastructures ? Deuxième question, sur les technologies. Un groupe de travail présidé par Christian de Boissieu se penche sur le « facteur 4 », autrement dit sur la perspective de diviser les émissions par quatre d'ici à 2050, ce qui équivaudrait à appliquer une réduction uniforme de 3 % par an à tous les systèmes. Cela ne sera possible que grâce à une percée technologique : nous avons pu nous apercevoir aux États-Unis que l'administration américaine avait déjà des plans là-dessus et à quel point l'État de Californie s'était déjà mobilisé avec notamment une autoroute à hydrogène. Vous avez parlé de l'inauguration d'une station Total. Pourrions-nous espérer voir un peu plus de push sur certaines technologies, à l'exemple de ce qui se fait en Californie ? M. Dominique PERBEN : Pour ce qui est des infrastructures, notre attitude en matière d'investissement est assez volontariste. Il n'est qu'à voir comment est réparti le budget de l'AFITF entre la route et les autres modes : La répartition des investissements est 50/50 alors que celle des parts de marché des modes est de 80/20. Cela témoigne d'une réelle volonté de correction alors même que nous sommes pris entre les pressions du court terme et du long terme, souvent contradictoires. Le secteur du logement aussi recèle des gains énergétiques considérables. La direction de l'urbanisme, mais également les élus locaux doivent désormais concevoir les extensions urbaines en fonction du transport, voire à partir du transport ; malheureusement, ce qui paraît une évidence dans ce cénacle est loin de se retrouver, admettons-le en toute objectivité, dans la pratique courante sur le terrain. À chaque fois que nous nous livrons à cet exercice dans le cadre d'un PLU ou d'un SCOT, nous sommes confrontés à une demande particulièrement vive d'extension des terrains constructibles tout en essayant autant que faire se peut de structurer l'espace. Or c'est précisément cette volonté de croissance de tout un chacun, au demeurant parfaitement compréhensible, qui amène à créer du besoin de mobilité, donc de transport, et de surcroît d'une façon extrêmement diffuse où la seule solution devient l'automobile. D'où les problèmes qui s'ensuivent, le rond-point, puis la déviation qu'il faut financer, et les élus qui viennent demander au ministère de l'équipement les subventions complémentaires pour réaliser les voiries routières capables de désengorger l'habitat qui s'est ainsi développé. Il est devenu indispensable d'intégrer désormais la dimension transports dans la problématique urbaine. Pour ce qui est des technologies, il faut avoir conscience que les émissions unitaires de CO2 des véhicules particuliers neufs ont baissé de 16 %, en passant de 183 grammes en 1993 à 154 grammes en 2004 ; la tendance est la même pour l'ensemble du parc en circulation, avec une baisse de 11 %. Le problème reste celui du stock de véhicules : la durée moyenne de vie d'une voiture étant de douze ou treize ans, l'effet d'une nouvelle réglementation mettra du temps à se manifester dans la mesure où celle-ci ne joue que sur les nouveaux véhicules. Mais d'autres pistes de réflexion méritent d'être développées : les biocarburants peuvent nous faire gagner pas mal de points en termes d'émissions, de même que les recherches sur les nouveaux types de moteurs. Sans même parler des piles à combustible, des progrès considérables ont été enregistrés dans le domaine notamment des moteurs électriques. L'hybride diesel n'émet plus que 90 grammes par kilomètres et l'hybride essence 109 grammes - la différence entre un hybride essence et un diesel classique très moderne est pratiquement négligeable. Dassault et Michelin travaillent sur le moteur électrique et des groupes automobiles s'y intéressent désormais. J'ai rencontré récemment tous ces industriels ; les choses devraient bouger. Votre remarque sur le tourisme aérien m'embarrasse d'autant plus que je suis allé aux Antilles il y a peu. Nous vivons dans un système de liberté où la régulation s'opère principalement par l'économie. Dans l'aéronautique également, d'immenses progrès sont à attendre des nouvelles motorisations, mais l'augmentation du trafic, tout aussi extraordinaire, ne permet pas d'espérer une réduction des émissions à brève échéance. Mme la Rapporteure : Contrairement à ce que l'on peut espérer pour les autres secteurs, on ne saura jamais fabriquer un avion électrique. Cette absence d'alternative technologique explique que l'avion ait été présenté à plusieurs reprises comme une des premières impasses auxquelles nous serons confrontés du fait de l'explosion du coût de l'énergie. M. Dominique PERBEN : Il y a de gros progrès à attendre des nouveaux moteurs, mais on ne voit effectivement pas d'alternative à court et moyen terme. M. le Président : C'est bien d'ouvrir une station d'hydrogène à Berlin, mais on ne voit guère chez nous d'expérimentations de nature à sensibiliser le public aux énergies renouvelables, qu'il s'agisse de l'éolien, du solaire photovoltaïque ou de la filière hydrogène, certes encore bien lointaine. Nous avons nous-mêmes conduit des voitures à hydrogène en Californie. Mme la Rapporteure : Qui valaient un million d'euros. M. le Président : Toutes les marques étaient là - Audi, Volkswagen, les italiennes, Ford, Honda, etc. -, sauf les françaises. Nous avons des régions très technologiques, mais nulle part nous n'avons d'exemples de technologies futuristes à montrer au grand public. Il faudrait faire davantage. M. Dominique PERBEN : Pour qu'un système fonctionne, encore faut-il qu'il soit économiquement viable. Il faut garder la faisabilité des projets à l'esprit. Ainsi, l'utilisation de l'hydrogène suppose de résoudre les problèmes d'approvisionnements par des réseaux spécifiquement dédiés alors que les biocarburants se contentent des stations services existantes. Dans un pays où l'électricité d'origine nucléaire est relativement abondante et à un prix abordable, faut-il se précipiter à toute force sur l'hydrogène, ou plutôt essayer de travailler comme Dassault sur le moteur électrique et les piles de nouvelle génération ? J'ai testé la voiture Dassault : avec une recharge classique, on dispose de 200 kilomètres d'autonomie, et jusqu'à 400 kilomètres avec un système de branchement particulier. On n'est plus dans le gadget. Si l'on veut obtenir au plus vite des résultats concrets en matière d'émission de gaz à effet de serre, mieux vaut privilégier les technologies les plus facilement applicables - ce qui n'exclut pas les expérimentations à long terme. Mme la Rapporteure : Les Américains eux-mêmes reconnaissaient qu'ils n'avaient pas encore résolu la question de l'approvisionnement en hydrogène. M. Dominique PERBEN : Ni tous les problèmes de sécurité. M. Serge POIGNANT : Le logement et les transports sont à l'évidence les deux grands gisements d'économies en termes d'énergie comme en termes de rejets de carbone pour l'avenir. Le choix d'implanter les activités près des ports ou, à l'inverse, des lieux de consommation a une importance déterminante. Il arrive de voir deux poids lourds faire des trajets exactement inverses en Europe au point de se croiser, pour aller tous deux livrer des tomates. Il y a certainement des progrès à faire de ce côté-là. On nous a dit hier à propos des biocarburants que les bilans énergétiques globaux restaient à apprécier. M. le Président : Pour le bioéthanol, pas pour le diester. M. Serge POIGNANT : .et nous avons besoin de connaître votre position au moment de faire les bilans et de préparer nos propositions. Par ailleurs, s'il faut agir pour atténuer le réchauffement climatique, il faudra inévitablement nous y adapter. Le ministère s'est-il penché sur ces questions pour ce qui touche au littoral, aux zones submersibles, au tourisme, à la montagne ? Une réflexion est-elle en cours sur ce sujet ? M. Dominique PERBEN : Les scientifiques sont plus compétents que moi sur ces questions. Plutôt que de parler de bilan énergétique ou écologique de tel ou tel produit, je préfère raisonner en termes de système économique global. Pour les biocarburants, la question est de savoir jusqu'où peut aller la culture de végétaux produisant des biocarburants sans aller à l'encontre des cultures alimentaires. Il est évident que jamais on n'ira chercher des biocarburants au Brésil. Non seulement le bilan serait ridicule, mais nous passerions d'une dépendance énergétique à une autre. Mon ministère travaille-t-il sur la question du réchauffement ? Oui, par le biais de Météo-France et de l'IGN, nous avons réellement progressé dans la connaissance et la prévision des phénomènes météorologiques, grâce notamment à un maillage de radars plus fin et plus efficace qui nous permettront bientôt de parvenir à une précision très intéressante. Nous en avons déjà fait l'expérience dans la région de Nîmes où deux événements climatiques identiques, à quelques années d'intervalle, ont eu des conséquences totalement différentes, grâce précisément à l'amélioration du taux de prévisibilité et aux mesures de correction prises sur le terrain. De la même façon, le travail de cartographie réalisé par l'IGN nous permet de disposer de données très intéressantes sur les évolutions à venir. M. Michel DESTOT : Je suis toujours frappé, lorsque l'on parle de l'effet de serre, d'entendre souvent proposer des solutions techniques avant même d'avoir posé les enjeux politiques du sujet. De l'avis de tous, la plus grande révolution que nous ayons connue depuis trente ans serait l'avènement de la société de l'information ; mais sait-on que ces trente dernières années ont vu le déplacement journalier moyen passer de six kilomètres à trente-cinq kilomètres ? C'est là qu'est la véritable révolution, au cœur du couple infernal climat-croissance ou énergie-développement durable. Le GART1, que je préside, a demandé à vingt automobilistes de circuler pendant un an dans certaines grandes villes françaises et de juger leurs politiques de déplacement. Ils sont venus rapporter devant notre congrès et nous en avons pris plein la figure. « Vous avez tout faux », nous ont-ils dit. « Vous vantez votre métro, votre tramway, votre bus, mais, premièrement, notre budget voiture reste extrêmement élevé et ne tient pas la route par rapport aux modes alternatifs, y compris en faisant appel à la location pour les cas où l'automobile est indispensable, et deuxièmement, vous ne nous parlez jamais de l'effet de serre et des risques sanitaires. » D'où ma première question : sommes-nous suffisamment responsables, au niveau tant de l'État que des collectivités, pour aborder enfin ces sujets avec nos concitoyens ? Deuxième question, sur le financement - des transports en commun en site propre notamment. Reconnaissons-le : nous avons jusqu'à présent travaillé à tramway, métro ou bus suiveurs, en reliant les zones les plus denses de nos agglomérations. Or c'est le contraire qu'il faudrait désormais exiger, en conditionnant le financement d'un axe de tramway - 20 millions d'euros le kilomètre, ce n'est pas rien - à la création d'habitats collectifs et de grands équipements le long dudit axe. L'État pourrait ainsi s'engager de façon conditionnelle dans l'aide qu'il devrait apporter aux transports en site propre : d'accord pour financer, mais seulement si vous modifiez votre urbanisme en fonction de ces nouvelles lignes. Cela aurait à coup sûr un effet décisif sur la dynamique urbanistique de nos agglomérations. M. Dominique PERBEN : Vous êtes décidément pour un encadrement de la liberté locale. Si le raisonnement est juste, le remède paraît très difficile. Il faudrait commencer par trouver des critères de densité et déterminer des seuils, ce qui n'a rien d'évident. Il faut bien sûr une transition et j'ai fait en sorte que l'État puisse de nouveau aider les transports en site propre, mais je suis persuadé que la politique de transports urbaine doit rester dans la même main que la responsabilité de l'urbanisme opérationnel. On y parvient à peu près dans les communautés urbaines et les communautés d'agglomération ; c'est beaucoup moins facile en région parisienne, où la région a la compétence transports cependant que les communes conservent la compétence en matière d'urbanisme. Reste qu'il faut poser le problème, bien qu'il n'y ait pas de réponse immédiate. Cela dit, la réglementation apporte déjà une réponse partielle : l'obligation du PDU et son intégration dans le SCOT en tant que référence pour les PLU ont fait avancer les choses, et il est intéressant pour nos assemblées territoriales de pouvoir mener une réflexion sur le plan de développement urbain avant de délibérer sur les documents d'urbanisme. Reste que certains PDU sont de véritables litanies de bonne volonté, dégoulinantes de générosité mais sans rien de concret dedans. Nous avons désormais une idée de l'exercice, mais il nous faut encore apprendre à mettre un réel contenu dans la démarche, encore un peu molle. M. François DOSÉ : Depuis trois ou quatre mois, nous entendons parler d'obligations, de défis pour nos petits-enfants, d'échéances 2030, 2040, mais j'aimerais bien savoir comment on pourrait régler cette affaire. S'il est vrai que notre rendez-vous « facteur 4 » est dans trois décennies, s'il est vrai que nous ne ferons qu'accélérer le mouvement en ne bougeant pas, s'il est vrai que la division sera possible, mais seulement par 2,5, croyez-vous vraiment que la régulation peut se faire par l'économie ? Je suis évidemment pour la liberté, mais à coté du saut technologique qu'il faut espérer à l'horizon 2030-2035, de l'évolution des comportements par l'appropriation citoyenne, on ne peut oublier qu'il existe la contrainte réglementaire. Croyez-vous que la seule incitation suffira pour relever le défi du facteur 4 ? On a vu les limites de l'expérience de Londres, mais aurons-nous le courage, en tant que démocrates, de dire la vérité à nos concitoyens et d'annoncer que de douloureuses réalités nous ont rattrapés et que le temps des obligations est arrivé ? Or l'obligation suppose l'exemplarité : j'entends le président Chirac appeler toutes les collectivités publiques à valoriser le déplacement propre, mais j'aimerais savoir où je vais ! Comme tout un chacun, je m'interroge. M. Dominique PERBEN : Nous sommes d'ores et déjà entrés dans la contrainte : les émissions de gaz sont soumises à une réglementation européenne, pour les automobiles comme pour les avions. À chaque étape, les contraintes se resserrent : ainsi, pour les poids lourds, j'avais décidé de revaloriser l'aide sur la taxe professionnelle, adoptée à la suite des hausses catastrophiques du prix du pétrole de septembre dernier, en fonction des normes environnementales euro 3 et euro 4. La Commission travaille sur une norme euro 5 encore plus contraignante. On ne peut se fier aux seuls équilibres économiques. J'en ai fait état à propos du choix entre les modes, qui sera toujours fonction de l'intérêt qu'y trouvera l'utilisateur. Mais il est toujours possible de jouer de la réglementation pour modifier la situation, au regard de la pollution, de tel ou tel engin ou mode de transport, et c'est ce qui se passe. Mme Martine BILLARD : La liberté des élus est déjà limitée par la réglementation dans bien des domaines : les élus locaux ont ainsi été obligés de mettre en place des politiques de tri sélectif afin que l'on puisse développer des filières de valorisation, et c'est heureux. Nous sommes tous convaincus ici qu'il y a urgence et que le problème n'est pas de brider les élus locaux, mais de travailler ensemble, élus et non élus, pour le bien commun. N'est-il pas temps de songer, comme M. Destot, à conditionner les aides au respect de certaines politiques environnementales, qu'il s'agisse de subventions aux transports ou au logement ? Le ministère semble bien timide sur ce point. La dimension environnementale est-elle désormais systématiquement intégrée dans le choix des équipements et, du coup, des investissements ? L'explosion des voyages aériens, dont parlait Mme la Rapporteure, pour des séjours de durée très limitée apparaît une absurdité en termes de lutte contre l'effet de serre : à défaut de les interdire, on devrait à tout le moins ne pas les favoriser et jouer sur le développement d'aéroports locaux ou sur le choix des compagnies. Le ministère des transports s'est-il posé la question des choix à terme des modes les moins polluants - transport par eau ou ferroviaires, par exemple - et de leurs incidences sur le type de tourisme ? Est-il bien raisonnable de financer le développement de stations de ski alors que la neige a toutes chances de se faire plus rare dans certaines zones ? Cet aspect est-il systématiquement intégré dans vos décisions ? M. Dominique PERBEN : Le rôle du ministère de l'équipement se limite à réaliser des infrastructures, à servir d'autorité de régulation pour certaines activités économiques et à cofinancer certaines réalisations avec les collectivités territoriales ; nous ne finançons jamais des activités à proprement parler. Au demeurant, nous essayons à chaque fois que possible de conditionner notre soutien au respect de certaines obligations, comme nous l'avons fait pour l'allègement de taxe professionnelle en faveur des routiers, qui devenait plus intéressant lorsque les véhicules répondaient à la norme euro 4 ; mais les occasions de pratiquer ces coups de pouces incitatifs sont devenues très rares. L'essentiel des possibilités se situe au niveau des choix d'infrastructures - j'y ai fait allusion en parlant du budget de l'AFITF. Nous avons là des stratégies à développer dans un environnement économique mondialisé. De ce point de vue, l'augmentation prodigieuse du trafic maritime est pour la France un motif d'interrogations, mais également l'occasion d'une réflexion stratégique. Aussi avons-nous décidé de concentrer des moyens importants sur deux grands ports - Le Havre sur l'Atlantique et Marseille sur la Méditerranée - pour ne pas rester à l'écart de l'extraordinaire développement du trafic maritime de conteneurs. Car s'il se faisait sans nous, cela signifierait que les flux économiques ne viennent plus chez nous. L'enjeu économique est donc considérable. À partir de là, la question se pose ensuite de savoir comment l'on fait pour traiter ces flux de la façon la plus écologique possible : d'où l'intérêt de développer à partir du Havre tout un tissu de voies d'eau et de dessertes ferroviaires. C'est précisément les sujets sur lesquels nous travaillons en ce moment même : Port 2000 est en passe de devenir une superbe réussite, mais que fait-on derrière et comment traiter ce qui entrera ou sortira par cette porte ? Le trafic maritime mondial s'accroît de 8 à 9 % par an. Si nous ne sommes pas capables de développer nos activités portuaires, nous passerons à côté d'un potentiel de croissance énorme, dont dépendra directement le bien-être de nos concitoyens ; et si nous mettons au point une stratégie un peu construite pour faire passer une part substantielle des conteneurs sur la voie d'eau ou sur la voie ferrée plutôt que par la route, nous nous inscrirons dans une vraie problématique écologique. D'où l'importance de mettre en place des systèmes cohérents les uns avec les autres, ce qui n'est pas toujours évident. M. le Président : Alain Godard disait ce matin que le transport maritime émettait cent fois moins de gaz à effet de serre que le transport routier ; il affirmait également que le développement se concentrerait, comme au Moyen Âge, dans les ports maritimes si nous ne traitions pas des problèmes de transports vers nos zones continentales - ce qui, à l'évidence, créerait de violentes tensions. Or force est de reconnaître que, pour ce qui est de la voie d'eau, nous n'avons pas su anticiper. Après avoir constaté que la liaison Rhin-Rhône ne pouvait pas, pour des raisons d'ordre écologique, passer sur les boucles du Doubs, il serait temps de nous battre sur la liaison Saône-Moselle. Si nous n'avons pas une liaison par voie d'eau vers le Sud, alors que les Allemands ont su développer les leurs, jamais nous ne pourrons réussir notre aménagement du territoire. Quand va-t-on enfin « booster » cette affaire ? Je ne sais si la Rapporteure et la mission la proposeront, mais on ne peut en rester à annoncer une politique : elle a été annoncée de tout temps, par tous les gouvernements, de gauche comme de droite. mais personne ne la fait. M. Dominique PERBEN : Le trafic fluvial connaît une véritable explosion : plus 30 % en trois ans. C'est un phénomène nouveau, sur lequel nous avons parfois été pris à contre-pied. Ancien maire de Châlon-sur-Saône, je n'étais pas partisan de l'arrêt de l'opération Rhin-Rhône ; mais si nous avions commencé par Saône-Moselle, ce serait chose faite aujourd'hui. Je reconnais que le franchissement des boucles du Doubs n'était pas des plus simples. Reste que la priorité est aujourd'hui clairement donnée à Seine-Nord, y compris par rapport au Havre ; ce qui ne veut pas dire qu'il ne faille pas se pencher rapidement sur Saône-Moselle. M. le Président : Saône-Moselle, c'est Marseille. M. Dominique PERBEN : À ceci près que le projet marseillais, tout à fait comparable à celui du Havre, peut se développer sans Saône-Moselle, tout au moins dans un premier temps, grâce à son arrière-pays, autrement dit PACA et Rhône-Alpes. À Anvers, plus de 50 % de l'activité du port est desservie par le fer et le fleuve, contre 20 % dans les ports français. La desserte de Port 2000 et le contournement Nord de Paris nous permettront d'utiliser la voie ferrée pour le transport des conteneurs et de supprimer une partie de la circulation des poids lourds qui descendent d'Anvers et de Rotterdam. Il y a là de réels enjeux en termes d'infrastructure, qui répondent à vos préoccupations. M. Alain GEST : Vous avez indiqué tout à l'heure que le plan Fret était en passe de réussir. J'avais cru comprendre il fut un temps que vous vous interrogiez plutôt ; c'est donc que des éléments nouveaux sont intervenus. Pouvez-vous nous en faire part ? L'ouverture du marché dans ce domaine se confirme-t-elle ? Même si je suis comme vous persuadé que l'économie régit beaucoup de chose, je m'interroge sur les marges de progrès possible, sachant l'incomparable souplesse du transport camion par comparaison à tous les autres modes. Nos voisins suisses ont su mettre en place un système d'obligation. Pensez-vous qu'un tel dispositif soit transposable à un pays comme la France, beaucoup plus vaste ? M. Dominique PERBEN : Pour ce qui est du plan Fret, après une année 2004 plutôt bonne, le début 2005 avait effectivement été préoccupant. Heureusement, le second semestre a été meilleur et les objectifs ont été tenus. Sur les axes massifiés, la part du fret ferroviaire augmente de nouveau. Il est encore trop tôt pour dire ce que donnera l'ouverture du marché à partir du 31 mars. Cinq entreprises ont d'ores et déjà demandé un certificat de sécurité ; c'est donc qu'il y a un intérêt. Quelle sera l'ampleur du processus ? Bien malin qui peut répondre. Cela devrait faire bouger les choses. Je vous ai fait part de ma volonté de réussir la mise en place d'une autoroute ferroviaire Perpignan-Luxembourg. Or nous avons, en autres, comme partenaire un syndicat de transporteurs routiers. Il ne faut pas voir une concurrence totale entre les différents modes. Si un transporteur routier peut faire l'économie d'un chauffeur sur un trajet donné, il n'hésitera pas à mettre la remorque sur la voie ferrée ; un chauffeur l'amène et, à l'autre bout, un autre vient la chercher ; durant le transfert, il n'y a pas de chauffeur. Autrement dit, le transporteur peut y trouver à intérêt économique, à condition d'être assuré de la fiabilité de l'opération. C'est le refrain de tous les chargeurs : trois heures de retard, c'est pour eux ingérable. Ils nous l'ont redit cet été lorsque nous avons voulu augmenter les cadences de l'autoroute ferroviaire du Mont-Cenis pour compenser la fermeture du tunnel du Fréjus. Les exemples suisse et autrichien sont très intéressants, moins en termes d'émission de gaz à effet de serre qu'en termes de pollution sonore et de nuisances esthétiques. Les Suisses se sont trouvés dans la situation qui devient de plus en plus celle des vallées de Maurienne et de Chamonix où les gens ne supportent plus la circulation routière et particulièrement des poids lourds. Force est de trouver d'autres dispositifs : ainsi l'idée d'une eurovignette, autrement dit d'un système de péage variable selon les pays, avancée par l'Europe. Il est à noter que la géographie influe sur la position des États : si les pays de transit comme la France sont évidemment favorables à l'eurovignette, les pays de la périphérie y sont hostiles. Les Portugais notamment ne veulent pas en entendre parler. Sur l'arc alpin en tout cas, j'ai la conviction que nous devrons progressivement évoluer vers des dispositifs analogues à ceux des Suisses et des Autrichiens. De ce point de vue, le projet Lyon-Turin auquel je suis particulièrement favorable est une réponse comparable à ce que les Suisses réalisent sur le Gothard et à ce que les Autrichiens et les Italiens vont faire sur le Brenner : des systèmes qui permettent d'écouler le trafic de fret et de faire passer les poids lourds par des tunnels ferroviaires plutôt que dans les vallées. Ce sera tôt ou tard une obligation ; faute de quoi, il faudra s'attendre à de véritables révoltes. J'ai rencontré cet été des associations de riverains du Mont-Blanc et je comprenais parfaitement ce qu'elles me disaient : il suffit d'avoir vu cette route à encorbellement épouvantable sur laquelle des milliers de poids lourd font la queue pour passer dans le tunnel. Des telles situations ne peuvent s'éterniser - sans même parler de l'aspect sécurité. M. Robert LECOU : Depuis quatre mois que nous sommes ensemble à écouter les climatologues et les scientifiques, nous avons compris que nous étions incontestablement face à un réel problème, alors que lorsque nous nous réunissons sur le thème des voies de communication et du développement économique, nous sommes unanimes à soutenir qu'il ne peut y avoir de partage sans bonne communication. C'est dire le dilemme ! Comment peut-on être le ministre de la mobilité et en même temps celui du développement durable ? De ce point de vue, le fluvial et le ferroviaire restent à l'évidence des voies - c'est le mot - à développer. L'urbanisme et le logement faisaient naguère partie des compétences de votre ministère. Avec les transports, c'est l'habitat qui fait partie de nos préoccupations les plus vives. Mais comment faire du logement sans urbanisme et vice-versa ? M. Dominique PERBEN : Rassurez-vous : à coté des responsabilités ministérielles, l'organisation fonctionnelle de l'administration demeure. La direction générale de l'urbanisme et du logement est unie et la répartition des compétences ministérielles, au demeurant variable selon les gouvernements, ne modifie pas pour autant la structure fonctionnelle des administrations. De quels moyens d'action disposons-nous en matière d'urbanisme et de logement pour limiter les émissions de gaz à effet de serre ? Pour ce qui est de l'urbanisme, moyennant un peu d'ambition dans l'élaboration de la législation et de la réglementation, et un certain sens des responsabilités du côté des élus locaux en charge de ces dossiers, il doit être possible d'éviter une urbanisation lâche, en tâche d'huile qui ne fait qu'aggraver les contraintes de mobilité. Pour ce qui est du logement, les normes de construction, d'isolation, de chauffage mises au point au fil des ans et sans cesse améliorées ont déjà permis d'énormes progrès et il reste encore des marges considérables, jusqu'à la perspective de réaliser des bâtiments dits à énergie positive. Mme Martine BILLARD : Cela a été refusé dans la loi sur l'engagement national pour le logement ! Il n'y a plus rien dedans ! M. Dominique PERBEN : Une étude est en cours de réalisation par le CSTB à Marne-la-Vallée. Peut-être est-il encore un peu tôt pour légiférer. Encore faut-il que la recherche soit suffisamment avancée pour savoir quoi mettre dans la loi, sous peine de figer des éléments encore insuffisamment inventoriés. Je ne connais pas très bien ces bâtiments à énergie positive, mais je sais que nous avons fait des progrès considérables sur le plan énergétique depuis vingt ans. M. Jacques BASCOU : La mise en place d'une liaison Perpignan-Luxembourg n'aura qu'un effet très marginal sur le trafic des camions par l'autoroute. Si l'on voulait parvenir à un résultat réellement significatif, il faudrait revoir tous les couloirs du bassin rhodanien, et tout porte à croire que c'est l'élargissement de l'autoroute qui prévaudra au moment de décider des financements. Il est exact que la technologie permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre ; mais pendant ce temps, les déplacements s'allongent et le parc automobile s'accroît. Le moment ne viendra-t-il pas où l'on devra faire jouer la contrainte ? Les limitations de vitesse ont fait grand bruit, mais elles ont produit un résultat. Ne devrait-on pas brider les moteurs et intégrer le covoiturage dans les publicités des constructeurs en insistant sur l'utilité sociale du véhicule plutôt que sur les performances du moteur et la consommation ? En Californie, certaines voies sont réservées aux véhicules transportant plusieurs personnes. M. Dominique PERBEN : L'imagination est libre, et j'ai moi-même vu comment la ville de Washington incitait au covoiturage qui permet effectivement une meilleure utilisation des équipements de voirie ; ils vont même jusqu'à changer le sens de circulation de certaines voies à un moment précis de la journée - je me demande toutefois ce que cela donnerait chez nous, et surtout ce qu'il arriverait au maire au premier accident mortel. L'idée en tout cas d'autoriser seulement les véhicules transportant plus de trois personnes à emprunter la voie la plus rapide pourrait fort bien être expérimentée : rien ne l'interdit. On est loin d'avoir tout inventorié en matière de transport urbain. M. Francis HILLMEYER : Vous avez parlé d'un bilan relativement modeste de l'intermodalité en termes d'émission de gaz à effet de serre. Qu'entendez-vous par là ? Il semblerait qu'une nouvelle étude sur le Rhin-Rhône ait été confiée au sénateur Grignon : il faut savoir que Ottmarsheim est le premier port fluvial de France pour le trafic de conteneurs. Enfin, ne serait-il pas judicieux d'interdire les dépassements des poids lourds sur les autoroutes à deux voies les plus surchargées ? M. Dominique PERBEN : Non seulement ces questions de sécurité routière sortent quelque peu du cadre de cette mission, mais tout est affaire de circonstances : une solution a priori parfaite peut, en fonction de la topographie de l'endroit et du profil de l'autoroute, aboutir à l'inverse du résultat escompté. Les gains d'un transfert de la route au rail sont évalués à 160 000 tonnes de CO2 d'ici à 2010 sur un total de 150 millions de tonnes, autrement dit à un millième. Cela ne veut pas dire qu'il ne faille pas le faire, mais gardons les ordres de grandeur en tête : les gains dégagés par l'amélioration des motorisations sont autrement considérables, ce qui ne signifie pas davantage que je veuille en rester au tout-voiture. Évitons les approches idéologiques et efforçons-nous à chaque fois de quantifier les bénéfices attendus. Si nous ne faisons que du transfert modal, sans aucun effort sur la motorisation, les biocarburants, la propulsion électrique, nous nous planterons totalement au regard de l'objectif de lutte contre le réchauffement. N'allons pas croire que nous serons au rendez-vous du « facteur 4 » en développant uniquement la voie d'eau et le fer, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faille pas faire du rail et du fluvial. Quant à Rhin-Rhône, soyons réalistes : c'est terminé, n'en parlons plus. En revanche, il y a un travail à faire sur Saône-Moselle, qui ne pose pas les mêmes problèmes écologiques. M. le Président : Monsieur le ministre, il ne nous reste plus qu'à vous remercier pour cette audition. Audition de Mme Nelly OLIN, Présidence de M. Jean-Yves LE DÉAUT, Président M. le Président : Après un large tour d'horizon de plus de trois mois, nous approchons du terme de nos auditions en entendant Mme la ministre de l'écologie et du développement durable pour un état des lieux - gravité du phénomène et ses conséquences, politiques mises en œuvre, voies d'un renforcement des actions engagées, etc. Nous avons déjà auditionné M. Perben ; nous entendrons bientôt M. Loos, M. Goulard et, si possible, M. Baroin. Nous tiendrons alors plusieurs réunions internes avec les membres de notre comité de pilotage, que je remercie de leur assiduité. Au fil de nous travaux - trente-cinq tables rondes, cent cinquante à deux cents auditions -, nous avons vu un groupe de parlementaires se souder petit à petit autour de ces questions. M. Michel DESTOT : Se rassembler ! M. le Président : Nous verrons si cela durera jusqu'au rapport. Quoi qu'il en soit, c'est tout l'intérêt de ce travail qui nous aura permis de nous rencontrer sur un sujet majeur, mais dont on ne parle pas encore assez. Mme Nelly OLIN : Je me félicite de ce que le Parlement ait décidé de se saisir d'un sujet à mes yeux primordial : la lutte contre le changement climatique est devenue une priorité qu'il nous faut prendre à bras-le-corps. Nous célébrons demain le premier anniversaire de la charte de l'environnement, sur laquelle plusieurs d'entre vous s'étaient mobilisés. Ce texte fondamental, voulu par le Président de la République, doit nous encourager à aller plus avant dans la lutte contre le changement climatique. J'organiserai mon propos autour de trois points : premièrement, la situation de la France en matière de lutte contre le changement climatique et de développement des énergies renouvelables ; deuxièmement, l'action du Gouvernement, les travaux en cours et l'état des négociations internationales ; troisièmement, mes pistes de réflexion et d'amélioration pour l'avenir. Le changement climatique est un sujet grave, mais il est heureusement quelques bonnes nouvelles dont nous pouvons nous réjouir. Pour commencer, la France est sur la bonne trajectoire par rapport à l'objectif de Kyoto : nos émissions de gaz à effet de serre se situent en 2004 à 562 millions de tonnes d'équivalent CO2, soit 0,8 % au-dessous du niveau de 1990 et même 6,1 % en tenant compte des puits de carbone dus à l'utilisation des terres forestières. Ensuite, la France est en valeur absolue le premier producteur d'énergies renouvelables en Europe. Celles-ci sont en pleine expansion, et particulièrement l'éolien : nous avons près de 120 parcs éoliens aujourd'hui et bientôt mille éoliennes en fonctionnement. Le rythme de notre équipement s'accélère : la capacité installée a été multipliée par cinq en trois ans, passant de 142 mégawatts en 2002 à 745 mégawatts en 2005. Ce développement soutenu doit, j'y insiste, se poursuivre de manière harmonieuse en respectant notamment la nature et les paysages. Le hasard du calendrier veut que j'organise demain matin au ministère une journée de consultation sur la circulaire qui sera adressée en mars aux préfets à propos des zones de développement éolien. La biomasse connaît également un développement soutenu en France. Le plan bois-énergie a permis de réaliser près de mille chaufferies collectives et industrielles en sept ans. Le plan biocarburants et la mise en route de six nouvelles unités de production dès 2007 permettront à la France de retrouver son rang de leader européen dans cette filière. Le développement des énergies renouvelables dans le bâtiment est également tout à fait significatif, grâce notamment au succès du crédit d'impôt pour les particuliers. Le marché du solaire en est le premier bénéficiaire avec 14 000 chauffe-eau individuels vendus - +70 % par rapport à 2004 - et un doublement de la surface totale de capteurs installée : plus de 100 000 mètres carrés. Plus généralement, on constate que les « bons gestes » écologiques font de plus en plus partie du comportement de nos concitoyens. Une enquête de l'ADEME montre que le nombre de Français possédant une ou plusieurs lampes basse consommation est passé de 44 % en 2002 à 51 % en 2004. Pour les appareils frigorifiques, la part des équipements de catégorie A et A + dans les ventes est passée de 43 % en 2003 à 70 % en 2005. Le crédit d'impôt a également encouragé les travaux d'économie d'énergie et les équipements en chaudières performantes : les ventes de chaudières à condensation ont doublé en 2005. Pour autant, ces bonnes nouvelles ne nous autorisent certainement pas à baisser la garde. La prise de conscience continuera d'être encouragée par la campagne de sensibilisation « Faisons vite, ça chauffe ! » menée dans le cadre du Plan Climat. J'ai déjà eu à plusieurs reprises l'occasion de constater les effets du changement climatique sur le terrain. En août dernier, avec mes collègues ministres de l'environnement au Groenland, nous avons pu constater sur place que la vitesse de la fonte de la glace était passée de cinq kilomètres en 1988 à quatorze kilomètres et le front du glacier Kangerdlugssaq a reculé de sept kilomètres. En Sibérie, où je suis allée à la rencontre de Nicolas Vannier, celui-ci a constaté un phénomène inquiétant de fonte du permafrost : on sait que le permafrost en fondant dégage du méthane qui lui-même accélère le réchauffement, et l'on peut craindre que cette marmite n'en vienne un jour à exploser. Si nous ne faisons rien, les émissions de gaz à effet de serre pourront augmenter de 10 % ou plus d'ici à 2010. Deux secteurs me préoccupent plus particulièrement en ce qu'ils sont particulièrement émetteurs de gaz à effet de serre et qu'il s'agit de secteurs diffus sur lesquels la réglementation a peut-être moins de prise que sur les secteurs dits concentrés comme l'industrie ou la production d'électricité. Le Plan Climat de juillet 2004 du Gouvernement a permis de mettre en place un cadre d'actions dont la majorité ont été appliquées, voire renforcées : ainsi l'étiquette-énergie pour les voitures particulières. Je dois reconnaître que nos constructeurs ont fait d'énormes efforts, particulièrement PSA et Renault chez qui tout est déjà mis en place ou pratiquement alors que la loi l'imposait pour fin mai. J'ai pu me rendre compte que cette mesure avait un effet tout à fait pédagogique et sensibilisateur sur les acheteurs. Un dispositif similaire sera mis en place pour les logements à compter de juillet prochain. Citons également le plan en faveur des biocarburants et les crédits d'impôt pour les voitures propres, les économies d'énergie et les énergies renouvelables. Précisons que le Plan Climat fait l'objet d'un tableau de suivi en toute transparence, que l'on peut consulter à tout moment sur le site Internet de mon ministère. Le plan a été renforcé par les mesures nouvelles annoncées l'automne dernier à l'occasion du Rendez-vous Climat par le Premier ministre : augmentation du crédit d'impôt pour les économies d'énergie et les énergies renouvelables, qui pourra aller jusqu'à 50 % ; augmentation du crédit d'impôt pour la voiture propre, qui passe de 1 725 euros à 2 000 euros ; revalorisation du tarif d'achat pour le photovoltaïque ; affectation d'un budget de 100 millions d'euros pour le développement d'un véhicule familial sobre en carbone - le groupe PSA a d'ores et déjà postulé en présentant son projet de voiture hybride diesel. Pour ce qui est de la réflexion à moyen et long terme, nous avons mis en place des groupes de travail de haut niveau et notamment le groupe « facteur 4 » que j'ai installé avec mon collègue François Loos, ministre de l'industrie. Dirigé par Christian de Boissieu, ce groupe de travail est chargé d'étudier les scénarios économiques propres à répondre à cet objectif drastique. Tout récemment nous avons mis en place avec Thierry Breton la commission sur les outils économiques au service du développement durable, dirigée par Jean-Pierre Landau. Un premier rapport d'étape nous sera remis en juillet afin que nous puissions présenter des propositions en matière de fiscalité environnementale dès le PLF 2007. Enfin, le Premier ministre a demandé l'avis du Conseil économique et social sur la politique à mener dans le domaine du logement et du bâtiment. Je reste persuadée que si nous ne saisissons pas dès aujourd'hui l'opportunité de mettre toutes les nouvelles constructions aux normes HPE ou HQE, nous perdrons la légère avance que nous avons prise sur les émissions et nous raterons un rendez-vous majeur pour l'avenir. Contrairement au transport, nous disposons d'ores et déjà pour le bâtiment des boîtes à outils nécessaires et la Caisse des dépôts et consignations est d'ores et déjà prête à accompagner les projets. Nous devrions donc être rapidement saisis de propositions intéressantes que nous intégrerons avant l'été dans le Plan Climat actualisé pour 2006. À cette fin, des groupes de travail sectoriels ont été constitués sous l'égide de la MIES, chargée d'évaluer et de proposer des mesures nouvelles dans chaque secteur pour sécuriser l'objectif et l'engagement pris par la France dans le cadre du protocole de Kyoto. Ces groupes de travail seront ouverts à la société civile. Le Plan Climat actualisé comprendra également un large volet territorial. Un guide pour l'élaboration des plans climat territoriaux a été publié afin d'aider les collectivités territoriales à engager leur propre démarche intégrée contre le changement climatique. Un autre grand volet du Plan Climat concerne évidemment l'international, où nous sommes à une période charnière. La conférence de Montréal n'a pas été des plus faciles ; nous avons durement bataillé pour en sortir avec quelques espoirs et les avancées n'ont été concédées qu'à la toute dernière heure. Elle a notamment décidé le lancement de quatre ateliers internationaux pour parler de l'après-2012, ce que plusieurs États avaient jusqu'à présent refusé. La France accueillera en janvier 2007 la réunion du GIEC, qui permettra de préparer le quatrième rapport et d'actualiser le constat des scientifiques sur le changement climatique au niveau mondial. Notre pays sera donc au premier plan. Ma première piste de réflexion pour l'avenir a trait aux moyens que l'État entend consacrer à la politique climatique : nous devons accroître encore notre « force de frappe » dans la lutte contre l'effet de serre. De nombreuses compétences se retrouvent autour de l'énergie et du changement climatique dans l'administration : MIES, l'ADEME, Délégation du développement durable, ministère de l'industrie. Nous aurions tout intérêt, me semble-t-il, à regrouper davantage d'experts au sein de la MIES afin de lui donner davantage de moyens sous forme de mise à disposition. Cela doit s'accompagner d'une amplification de nos efforts de communication et de pédagogie en direction du grand public. La campagne « Faisons vite, ça chauffe ! » doit être soutenue dans la durée pour avoir des effets concrets et positifs. Deuxièmement, nous devons sans attendre mettre un plan d'adaptation au changement climatique. L'adaptation est d'ores et déjà une nécessité que nous voyons surgir à chaque nouvelle crise : canicule, tempêtes, inondations, sauvegarde de certains littoraux, menaces sur la biodiversité, etc. L'ONERC a préparé une stratégie nationale d'adaptation au changement climatique qui a le mérite de rassembler des données scientifiques, mais également de tirer la sonnette d'alarme ; cette stratégie s'intégrera dans le Plan Climat actualisé 2006. Mais je souhaite que nous dépassions le stade du simple constat et que le Gouvernement pose d'ores et déjà les bases d'un plan d'actions coordonnées pour l'adaptation de notre pays au changement climatique. La France a un rôle leader à jour sur le plan international, grâce notamment à l'expérience acquise par ses régions, mais également ses départements d'outre-mer. Troisième piste de réflexion, déjà évoquée : la politique du logement avec les normes HPE ou HQE. Je veux y insister, car il y a là un gisement tout à fait intéressant de réduction des émissions de gaz à effet de serre, mais également un moyen pour des populations qui, dans les quartiers dits « ANRU » notamment, vivaient jusqu'à présent dans des habitats-passoires, de réaliser de notables économies sur leur facture d'énergie. La norme HQE recouvre, il est vrai, quatorze critères, mais on peut également exiger des objectifs de hautes performances énergétiques - HPE, soit 8 % de mieux que la réglementation en vigueur - ou de très hautes performances énergétiques - THPE, 15 %. Le jeu en vaut la chandelle. Un gros travail de normalisation s'impose pour faire entrer ces normes dans la classification AFNOR afin que les projets puissent faire l'objet d'une certification, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Nous nous appuierons également sur les diagnostics de performances énergétiques qui entreront en vigueur en juillet prochain et qui seront un outil très utile pour inciter les propriétaires à réaliser des travaux d'amélioration. Enfin, j'ai demandé à l'ADEME de lancer une action en direction des artisans installateurs : ils sont un relais essentiel de notre action auprès des particuliers. J'ai également appelé à la mise en place d'une formation : nous manquons de gens suffisamment formés et qualifiés pour vendre ces nouvelles technologies, voire pour les installer. Les fabricants ont appelé mon attention sur ce problème à l'occasion de ma toute récente visite au Salon de l'agriculture. Cela offrirait, du coup, un gisement d'emplois supplémentaires. Il en est de même dans le secteur des biocarburants et des énergies renouvelables, où la recherche d'économies va de pair avec la problématique de l'emploi, au cœur de nos préoccupations. M. le Président : Nous adhérons à tous ces propos, madame la ministre ; malheureusement, force est de constater que la situation de notre pays n'est pas encore optimale. Notre bonne position dans le domaine des énergies renouvelables tient pour beaucoup à la part - 14 % - de notre secteur hydraulique. La loi de 2002 a sans doute trop misé sur l'éolien qui n'est finalement pas à la hauteur de nos espérances alors que nous prévoyons d'atteindre 21 %. L'augmentation du prix de rachat du solaire photovoltaïque et le soutien au solaire thermique ont certes donné des résultats - 14 000 chauffe-eau et 100 000 mètres carrés de capteurs -, mais il va falloir continuer à avancer si nous voulons atteindre les objectifs de la loi d'orientation. Comment, sur le plan pratique, allons-nous pouvoir développer davantage les énergies renouvelables dans le Plan Climat ? Pensez-vous que la MIES a réellement un rôle interministériel aujourd'hui ? Comment pouvons-nous coordonner son action interministérielle afin qu'elle devienne une réelle priorité nationale aux yeux du Gouvernement ? À voir les arbitrages rendus dans d'autres textes de loi sur le logement et les transports, nous ne sommes pas persuadés que votre volonté dans ce domaine soit partagée. À titre d'exemple, l'office HLM que je préside s'était lancé dans le solaire thermique, au prix de surcoûts de l'ordre de 20 %. Mme Nelly OLIN : Ils ont baissé depuis. M. le Président : Il est vrai que le locataire paie moins cher ; reste que nous avons dû financer les surcoûts. Comment concilier dans la pratique ces deux exigences ? Je suis tout à fait d'accord sur la normalisation, mais peut-être n'est-ce pas totalement suffisant. Quels arbitrages espérez-vous obtenir en termes de fiscalité dans le Plan Climat 2006 ? Certaines mesures seraient bienvenues dans le domaine des transports. Nous avons sauvé l'ONERC dans les discussions budgétaires ; mais tout ce qui touche globalement à ces sujets est sujet à des attaques financières tous azimuts, qui montrent que nous n'avons pas encore atteint un seuil de crédibilité suffisant. Nous nous efforcerons évidemment de vous aider par nos recommandations, mais qu'envisagez-vous de votre côté ? Mme Nelly OLIN : L'épisode de l'ONERC était en fait plus lié à un mouvement d'humeur de certains parlementaires mécontents de n'avoir pas reçu les explications qu'ils demandaient, qu'à une volonté délibérée de lui couper les crédits. Les choses se sont réglées depuis, grâce à la bonne volonté des uns et des autres. S'agissant de la MIES, je souhaiterais moi aussi une meilleure coordination et une plus forte cohérence plutôt que de voir chacun travailler de son coin. La MIES a également besoin d'un renfort sous forme d'experts et de chercheurs mis à disposition, à un moment clé de notre analyse de la situation. M. le Président : Il paraît que les Anglais ont cinq à six fois plus d'experts que nous. Est-ce vrai ? Mme Nelly OLIN : Je n'ai pas eu l'occasion d'aller vérifier, mais je me garderai de mettre cette affirmation en doute. Il est clair que la MIES a besoin d'une meilleure synergie et de moyens d'expertise renforcés. D'après les dernières prévisions du ministère de l'industrie, nous atteindrons en 2012 l'objectif de 21 % d'énergies renouvelables grâce à l'éolien. Cela signifie que nous avons encore beaucoup d'efforts à faire. Le Plan Climat 2006 devra comporter des moyens complémentaires et des nouvelles mesures dont je ne saurais vous dévoiler la teneur aujourd'hui. Nous avons ensemble défendu le budget de la MIES ; je ne crois pas possible d'aller au-delà des 50 % de crédit d'impôt en 2007. Cela étant, nous avons jusqu'au Plan Climat révisé 2006 pour trouver de nouvelles idées et d'autres moyens d'action. S'agissant des bâtiments, les bailleurs impliqués dans la rénovation des quartiers ANRU doivent impérativement s'engager dans les normes HPE et HQE d'autant que la Caisse des dépôts et des consignations est prête à les accompagner avec des taux bonifiés. Peut-être aurons-nous plus de mal dans l'habitat privé, quoique les mesures mises en place en juillet devraient y faire avancer les choses, mais nous n'avons pas intérêt à rater ce rendez-vous dans des quartiers que nous nous apprêtons à reconstruire pour des années. C'est un peu comme la méthode Coué : plus on répétera qu'il faut le faire, plus on arrivera à des résultats. Rappelons que les quartiers ANRU bénéficient de subventions importantes et que le surcoût ne dépasse pas 8 %. Je viens d'inaugurer un collège construit dans le Val-d'Oise aux normes HQE et il m'a bien été confirmé que cela n'avait entraîné aucun surcoût par le fait que tout avait été calé dès le début, c'est-à-dire au moment du cahier des charges. Cela en vaut la peine au regard des économies qui en découleront par la suite. M. le Président : J'aimerais bien que vos services nous apportent la démonstration que le surcoût ne dépasse pas 8 %. Nous sommes très largement capables de construire des logements qui ne consomment pas plus de 50 kWh par mètre carré et par an, mais pas seulement 8 % plus cher. Dans les collèges, le surcoût peut être énorme. Je ne demande qu'à vous croire, mais j'aimerais bien voir les notes techniques qui le prouvent. Par ailleurs, si on veut y aider via l'ANRU, pourquoi ne pas l'avoir mis dans la loi ? Mme Nelly OLIN : Cela fait un moment que je sensibilise tout le monde à cela, et dans tous mes discours. M. Richard CAZENAVE : Non seulement nous n'avons pas une vision très claire des surcoûts, mais il est très dommageable de ne pas les mettre en relation avec les économies de fonctionnement. Il faut impérativement globaliser la problématique et s'attacher à la vulgariser d'une façon simple et claire. Qu'il soit public ou privé, le promoteur cherchera toujours le coût d'investissement le plus léger. Une communication plus claire et plus systématique, sinon obligatoire, permettrait au locataire de HLM comme à l'acquéreur potentiel de connaître exactement les charges de chauffage à prévoir en plus du loyer ou de la mensualité de prêt. C'est là que l'on pourrait découvrir que les surcoûts en question ne sont pas si élevés. Les consommateurs sont prêts à retenir des modes de consommation moins pénalisants pour l'environnement ; peut-être faudrait-il rendre obligatoire la communication sur ces sujets afin qu'ils aient toujours les yeux ouverts sur ces questions. Mme la Rapporteure : Ma première question portait sur ce sujet. Pourquoi n'irait-on pas plus loin dans la conditionnalité écologique en conditionnant l'octroi de certaines aides au respect de normes HPE ou HQE ? Une des premières personnalités auditionnées nous a montré à quel point l'étiquette énergie fonctionnait bien. M. le Président : C'était en Californie. On s'apercevait que, très rapidement, la dernière catégorie n'était plus construite. Mme la Rapporteure : Cela incitait effectivement le marché à rejeter les équipements les moins performants tout en stimulant la recherche sur les plus efficaces. L'extension de l'étiquette énergie aux voitures et aux logements est une excellente idée. N'y a-t-il pas moyen d'en faire autant pour d'autres produits en retenant au besoin d'autres critères écologiques que la consommation d'énergie ? Enfin, plusieurs participants à l'audition de Nicolas Hulot ont critiqué notre organisation institutionnelle et déploré la trop grande faiblesse du ministère de l'écologie et du développement durable. Ils appelaient à le faire monter en puissance en trouvant les moyens appropriés au niveau des services décentralisés comme de l'administration centrale afin de le rendre tout à la fois incontournable sur bon nombre de sujets et plus central. Quelles modifications pourriez-vous proposer à cet égard ? Mme Nelly OLIN : Le Premier ministre a alerté tous les ministères sur la nécessité d'une véritable transversalité. Un cadrage a été opéré, ministère par ministère, pour savoir ce que fait réellement chacun en matière de développement durable et de lutte contre le changement climatique. Je suis en train d'essayer - j'espère bien y arriver - de répertorier ce qui se fait déjà, en termes d'actions comme en matière financière, ce qui permettra du coup de voir ce qui n'est pas fait. On dit que le Gouvernement doit être exemplaire dans bien des domaines, y compris celui-là. Nous avons encore du chemin à faire pour conforter le pouvoir financier de mon ministère, qu'il s'agisse de son budget proprement dit ou à travers les actions menées par d'autres ministères. Sur l'étiquette énergie, vous avez tout à fait raison de ne pas vous arrêter aux voitures et au logement. Tout produit qui peut jouer un rôle dans la réduction du changement climatique et de l'effet de serre doit pouvoir être labellisé et bénéficier d'une décote sur le prix. Nous devrions être en mesure de vous apporter un début de réponse d'ici à six mois. Cela dit, votre idée est excellente et sera assurément reprise, tout comme d'autres. Mme Martine LIGNIÈRES-CASSOU : N'y voyez aucune mise en cause de votre travail ni de votre volonté, madame la ministre, mais le positionnement de la MIES auprès de votre ministère réduit de fait son poids dans notre organisation institutionnelle par rapport à un organisme qui serait placé auprès du Premier ministre - sans compter le problème des moyens, en termes d'effectifs comme en termes de pluralité des compétences. L'absence de l'agriculture, par exemple, dans un domaine par essence transversal, est à cet égard très révélatrice. Ma question porte sur le bâtiment, que l'on aurait tort de réduire au seul logement. Il faudrait considérer d'un peu plus près le tertiaire, qu'il soit public ou privé. Mme Nelly OLIN : Vous avez parfaitement raison. Mme Martine LIGNIÈRES-CASSOU : Quelles mesures incitatives ou obligatoires pourraient être envisagées pour ces constructions, y compris lorsqu'elles sont le fait de l'État ou des collectivités ? Mme Nelly OLIN : Nous avons effectivement tout intérêt à améliorer la coordination et à renforcer nos moyens, non par des recrutements supplémentaires, mais en développant la cohérence entre tous ces organismes afin que tout le monde travaille réellement ensemble au lieu de collationner des informations de-ci, de-là pour les analyser ensuite. S'agissant des bâtiments, la D4E a déjà produit des études sur les surcoûts qu'elle chiffre à 7 %. D'autres ont été effectuées sur les logements sociaux en Rhône-Alpes, que je verserai au dossier, et qui détaillent les économies ainsi générées. Ce qui répond à la question de M. Cazenave. M. Serge POIGNANT : Le Plan Climat prévoit de relever le prix d'achat du photovoltaïque et de porter à 50 % le crédit d'impôt pour l'ensemble des énergies renouvelables ; de son côté, le ministère de l'industrie soutient que nous atteindrons les 21 % de part des énergies renouvelables essentiellement grâce à l'éolien. Partagez-vous ce sentiment ? Pour ma part, je suis persuadé que nous n'y parviendrons pas si nous ne jouons pas simultanément sur la biomasse, le photovoltaïque, la géothermie, etc.,. Mme Nelly OLIN : Tout à fait. M. Serge POIGNANT : De ce fait, l'interministériel prend une dimension fondamentale. Se pose également le problème des pays en voie de développement dont les besoins ne s'accordent pas nécessairement avec le système de contraintes et de quotas d'émissions du protocole de Kyoto. La France doit, avec l'Europe, être un élément moteur, avez-vous dit. Mais comment pouvons-nous entraîner les autres pays ? Cela doit-il se discuter au niveau de l'OMC ou devons-nous mettre quelque chose d'autre en place ? La France a-t-elle déjà participé à une amorce de réflexion nationale sur cette question ? Mme Nelly OLIN : Nous pourrions atteindre les 21 % grâce au seul éolien, pour peu que le développement du parc continue au même rythme ; mais je n'en suis pas sûre. On aurait effectivement tort de se focaliser sur une seule énergie. Si nous nous sommes fixé pour objectif de diviser par quatre nos émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2050, les pays en voie de développement auront seulement à les diviser par deux - je reconnais que cela leur sera également très difficile. Nous avons réussi à leur faire accepter d'inscrire la lutte contre le changement climatique comme priorité ; on peut évidemment comprendre qu'ils aient d'autres problèmes, mais il ne faut pas qu'ils la perdent de vue. Au-delà des discussions, il faudra que nous soyons plus concrets sur les aides à leur apporter ; cela ne se fera pas que par des paroles. Même si nous avançons bien dans le domaine de la coopération, il nous faudra redoubler d'efforts ; faute de quoi, jamais ils ne parviendront à diviser leurs émissions par deux. M. Serge POIGNANT : La Chine et l'Inde ne sont pas à proprement parler des pays sous-développés. Mme Nelly OLIN : Notre discours sur la Chine a beaucoup évolué. Les Chinois ne veulent plus être montrés du doigt comme les vilains petits canards qui ne feraient jamais d'efforts. Ils ont réellement envie d'entrer dans une dynamique. Avec l'Inde en revanche, le dialogue reste extrêmement difficile, aussi difficile qu'avec les États-Unis. Il ne faudrait pas oublier un troisième pays, le Brésil, auteur d'une déclaration au forum ministériel sur l'environnement de Dubaï. Le programme des Nations unies pour l'environnement fait du bon travail, mais il reste trop méconnu. L'environnement est le seul à ne pas être reconnu aux Nations unies. Quatre-vingt-dix-neuf pays soutiennent l'ONU, mais ni le Brésil, ni l'Inde, ni les États-Unis ne veulent en entendre parler. Mais le fait de pouvoir travailler sur cette question à 99 est déjà une avancée remarquable. M. le Président : La mission d'information se rendra en Inde dans une dizaine de jours. Nous avons constaté aux États-Unis une différence très nette entre la position de l'autorité fédérale et celle de nombre d'États, d'élus et de la population. Mme Nelly OLIN : Tout à fait. M. le Président : Reste que la question des transferts de technologie sera un élément majeur dans notre dialogue avec les pays en voie de développement. Certains ont tout misé sur le développement technologique. Mais si le transfert de technologie est assorti de brevets qu'il faudra payer très cher, on peut assurément s'attendre une rébellion : on l'a déjà vu lors du protocole de Montréal de 1987 sur la couche d'ozone. Les Brésiliens et les Chinois n'ont pas manqué de réagir lorsque DuPont de Nemours, qui venait d'inventer les HCFC, s'était déclaré prêt à participer à la lutte contre le trou dans la couche d'ozone. Mme Nelly OLIN : Nous avons trouvé au sortir de Montréal un accord sur les mécanismes de développement propre, que la France était jusque-là la seule à financer. J'ai menacé de tout arrêter si d'autres ne mettaient pas la main au portefeuille. L'Italie est restée la seule à refuser, mais nous avons réussi à trouver un financement pour les MDP afin que les pays en voie de développement aient accès aux technologies. M. Robert LECOU : On peut s'étonner de voir l'énergie éolienne susciter parfois l'opposition résolue d'associations environnementales. Quelle est la solution ? Faut-il intensifier le travail de communication et de promotion ? Faut-il privilégier les fermes éoliennes plutôt que la dispersion ? Le sujet est très sensible dans certains territoires. Alors que sévit la crise viticole, de nombreux vignerons me demandent pourquoi le Gouvernement ne développe pas une filière biocarburants à partir de la vigne. Des réflexions sont-elles en cours sur ce sujet alors qu'un plan sera prochainement présenté par le Premier ministre ? Mme Nelly OLIN : Des réflexions sont effectivement menées sur la vigne au niveau du ministère de l'agriculture, mais je ne peux vous en dire davantage. S'agissant de l'éolien, je partage le jugement de M. Poignant : nous ne pouvons pas nous focaliser sur une seule énergie renouvelable et il n'est pas question de défigurer tous nos paysages. Il est heureux que la loi nous donne un certain contrôle sur l'implantation des éoliennes. Dans certaines contrées plates, il est possible d'en installer des champs entiers sans gêner personne. Mais dans des paysages plus variés, cela peut poser de sérieuses difficultés sur le plan des coûts comme de l'esthétique. Nous avons intérêt à nous servir de toute la panoplie des énergies renouvelables pour atteindre l'objectif des 21 %. M. Denis MERVILLE : Si l'on parvient à construire aux normes HQE sans surcoût, tant mieux, mais je n'en suis pas persuadé. Quoi qu'il en soit, vous avez raison de mener campagne en direction du grand public pour l'amener à changer de comportement : un degré de plus dans une pièce, c'est 7 % de dépenses supplémentaires. Cela dit, nous voyons souvent dans nos permanences des gens qui ont réalisé des opérations ouvrant droit à déduction fiscale et qui voient, trois ans plus tard, l'administration revenir sur la déduction et exiger d'eux 27 % d'intérêts de retard alors que le contribuable était totalement de bonne foi. Il serait bon d'appeler votre collègue des finances à un peu de tolérance. Il y a deux ans, le congrès des maires de France avait organisé un atelier sur l'effet de serre, malheureusement beaucoup moins suivi par nos collègues que l'atelier sur les déchets. Nous avons tout intérêt à leur montrer les économies qu'une collectivité peut attendre du développement du solaire et autres énergies renouvelables. Or bon nombre de nos administrés persistent à nous réclamer le développement de l'éclairage public à tous les carrefours et jusqu'aux plus petites routes communales. Non seulement cela coûte, mais cela ne joue pas en faveur de l'environnement. Pour ce qui est de la fiscalité environnementale, je souhaite que vous puissiez progresser en 2007. La DGE est répartie par le préfet entouré d'une commission d'élus. Pourquoi celui-ci ne pourrait-il pas accorder une bonification de dix points pour les bâtiments HQE ? Certaines régions comme la mienne connaissent un rapprochement de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement et de la direction régionale de l'environnement. Je crains que l'environnement ne fasse les frais d'une direction unique, particulièrement dans les régions industrielles. Au niveau européen enfin, je sais que la Commission et le Comité des régions sont très sensibles à ces questions. Mais vos collègues ministres partagent-ils notre volonté de progresser dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre ? Mme Nelly OLIN : Nous avons de fréquentes réunions ente ministres européens. Il y a de très bons élèves et de moins bons. Mais avec plusieurs ministres de l'environnement, assez nombreux, nous avançons très bien, notamment lors des séminaires informels, particulièrement utiles. Au demeurant, n'y viennent que ceux qui ont envie de travailler ; les absences, rares, montrent ceux qui ne se sentent pas concernés. Celui du Groenland a été un moment privilégié qui nous a permis de bien préparer Montréal ; jamais nous n'aurions pu « gagner » et faire céder les États-Unis sans cette préparation en amont. J'y ai senti une réelle synergie, une convergence d'idées et un lieu d'échange d'expériences et de retours d'expériences. Pour ce qui est du rapprochement DRIRE - DIREN, les cinq expérimentations fonctionnent bien, mais je vous avoue en toute honnêteté que je n'ai aucune envie de prendre de décision rapide en la matière. Peut-être la sensibilité environnementale n'était-elle pas aussi présente dans les esprits au moment où a été décidée cette affaire - cela ne remonte pourtant pas à bien loin. On ne pourra pas dépouiller le ministère de l'environnement au moment où il a besoin de toute son énergie pour développer et mettre en place, au-delà de la lutte contre le changement climatique, un tas de choses : les PPRI, les PPRT, les dossiers Natura 2000, etc. Nous avons besoin de ces hommes, de ces femmes et de ces outils sur le terrain. M. Christian DECOCQ : Le bâtiment et les transports sont à vos yeux des secteurs prioritaires dans la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre. Pour ce que est du bâtiment, vous nous avez donné des indications précises, notamment sur les projets ANRU ; pour ce qui est des transports, vous nous avez parlé, à juste titre, des nouvelles technologies et des recherches dans le domaine de la motorisation. Mais quelle appréciation portez-vous sur le « dur », c'est-à-dire le tout-autoroute qui reste la règle ? Cela fait déjà trente ans que nous nous posons la question des solutions alternatives et notamment de l'autoroute ferroviaire. Nous avons entendu là-dessus tout et son contraire : les éléments positifs, les impossibilités, des coûts pharaoniques, des chantiers lancés, comme le TGV Paris-Lille, en ignorant totalement le concept alors qu'il aurait été aisé de se ménager quelques emprises supplémentaires. On ne construira plus guère de grandes autoroutes désormais, mais nous nous retrouvons encore avec le projet A 24 dans le Nord. Déjà en 1992, à l'époque de Mme Blandin, nous étions quelques élus de droite au conseil régional à assortir notre accord sur l'A 24 à une réflexion sur les solutions alternatives. Aujourd'hui, on parle toujours de l'A 24, mais on n'a pas avancé d'un millimètre sur lesdites solutions. Quelle appréciation le ministère de l'environnement porte-t-il sur l'autoroute ferroviaire ? Je serais tout à fait favorable à l'idée que votre ministère mette au point des tableaux de bords simples, propres à sensibiliser nos concitoyens sur les progrès accomplis et, à l'inverse, les secteurs où nous patinons, à l'exemple de ce que Thierry Breton essaie de faire dans le domaine des finances publiques. Enfin, la transversalité à laquelle vous appelez ne pourrait-elle pas s'imaginer également au niveau du terrain ? Ce ne sera évidemment pas très aisé à mettre en œuvre : je sais par expérience qu'on ne décolonise pas facilement avec les colonisateurs. Mais ce serait aussi efficace, sinon plus, qu'au niveau central. Mme Nelly OLIN : Je suis clairement pour développer le plus rapidement possible le ferroutage et le transport fluvial. Nous y serons d'une façon ou d'une autre contraints par les problèmes de changement climatique et d'environnement, mais également par l'envolée inéluctable du prix du pétrole. Il n'est plus possible de raisonner exclusivement en termes de transport routier. Le Premier ministre a d'ores et déjà confirmé la réalisation de la liaison Lyon-Turin, prévue pour le ferroutage et qui devrait réduire considérablement les files de camions dans la vallée de Chamonix, ou encore du canal Seine-Nord. Un budget de 100 millions d'euros a été alloué à l'AFITT pour rechercher des infrastructures de transport propres ; nous devrions avoir d'ici peu un bilan des possibilités en matière de transports collectifs en site propre et de modes alternatifs maritimes, fluviaux ou ferroviaires, pour lesquels certains chantiers sont d'ores et déjà lancés et d'autres pourraient l'être à moyen terme. Faute de quoi, nous aurons de sérieuses difficultés à être aux rendez-vous de 2020 et de 2050. L'aboutissement de Lyon-Turin, dont on parle depuis des décennies, et du canal Seine-Nord sera un premier pas, mais il en faudra d'autres. S'agissant des rapprochements sur le terrain, des expériences sont en cours au niveau des DDA et des DDE. Il faut que les gens apprennent à mieux travailler ensemble en évitant que chacun ne s'approprie son carré réservé : ce n'est pas ainsi que l'on avance. Je suis sur ce point parfaitement d'accord avec la façon de voir de M. Decocq. M. le Président : N'oublions pas, après le Seine-Nord, le Saône-Moselle. M. le Président : Nous ne pouvons nous passer d'un axe Nord-Sud reliant le Rhin et la Méditerranée. Il ne nous reste plus, Madame la ministre, qu'à vous remercier pour cette audition. Audition de M. François GOULARD, Présidence de M. Jean-Yves LE DÉAUT, Président M. le Président : Monsieur le Ministre, je vous remercie de votre présence et vous souhaite la bienvenue. Nous avons déjà entendu vos collègues Nelly Olin et Dominique Perben, nous recevrons demain M. François Loos, et nous arrivons au terme d'un programme très serré d'auditions et de tables rondes qui nous ont permis, depuis le 15 novembre, d'entendre quelque 200 personnes. Au fil du temps s'est ainsi formée une conscience collective au sein de la Mission. Elle repose sur la conviction partagée que le problème du changement climatique est l'un des défis majeurs, peut-être même le plus grave que nous ayons à relever au cours de ce siècle, compte tenu de l'inertie des phénomènes. Notre conviction est aussi qu'il faut agir de façon très forte, et sans attendre, car l'inaction aurait des conséquences gravissimes. Dans ce contexte, la recherche et la formation sont au cœur des enjeux, alors même que le Parlement est en train de discuter de l'avenir de la recherche française. La question générale à l'ordre du jour de votre audition est donc la prise en compte par votre ministère des impératifs de la lutte contre le changement climatique, du point de vue de la réduction des émissions de gaz à effet de serre, comme de l'adaptation aux conséquences avérées ou probables du changement climatique et des politiques mises en œuvre dans ce domaine, en liaison avec les autres partenaires concernés. Il s'agit notamment de savoir quelle est la participation de la recherche française à l'étude du phénomène du changement climatique et de son évolution, et quelle place ce thème occupe dans les moyens de financement du CNRS et de l'ANR. La même question se pose pour l'étude des conséquences du changement climatique, que ce soit sur la faune, la flore, l'agriculture, le régime des eaux, les glaciers, le niveau des mers, la santé, les événements climatiques extrêmes, le coût des dommages, l'économie en général. Quels sont, d'autre part, les domaines-clés qui constituent les priorités de la recherche dans ce domaine ? Les transports, l'habitat, la production d'énergie, l'industrie ? Quelle est, plus généralement, la part du soutien à la technologie - dont les Etats-Unis pensent qu'elle est de nature à résoudre les problèmes - par rapport aux autres moyens d'action ? Pour nous, la recherche est une question majeure, et nous attendons de vous un message fort. M. François GOULARD : Je vous remercie de m'avoir invité. C'est un sujet dont l'ampleur est évidente, et qui concerne tous les départements ministériels, mais il faut avoir, tant sur l'analyse du phénomène lui-même que sur ses conséquences et sur les solutions techniques, un éclairage scientifique, et la recherche française est d'ailleurs forte dans ce domaine. Il n'est pas possible d'apporter au phénomène une réponse strictement française. C'est pourquoi nous insistons pour que le thème figure parmi les priorités de la recherche européenne, en mettant l'accent sur le caractère géostratégique de la connaissance, notamment avec le programme GMES de mobilisation des données d'origine spatiale. Celui qui détient la connaissance est plus fort dans la négociation internationale, notamment face aux Etats-Unis dans la perspective de l'après-Kyoto. S'agissant de la part de la recherche française consacrée à l'étude des phénomènes et de leur évolution, il n'est pas facile de donner des indications chiffrées, étant donné le grand nombre d'organismes concernés par des sujets qui, de surcroît, sont transversaux pour la plupart, et le récolement des données n'est pas fait de façon systématique. On estime néanmoins à un millier le nombre des chercheurs permanents qui s'occupent de ces sujets, et à 200 millions d'euros le budget correspondant. C'est loin d'être négligeable. Les équipes françaises sont très actives et performantes, notamment dans le domaine de l'observation et de la modélisation climatiques - le « thème 1 » de la MIES. Les glaciologues et les paléoclimatologues français sont également très reconnus. Le cycle du carbone, les puits de résorption, l'océanographie, la réactivité de l'atmosphère, sont autant de points forts de la recherche française. Le programme national de dynamique du climat de l'INSU, qui associe le CNRS, le CEA, Météo France, l'IFREMER, le CNES et de nombreuses universités, occupe une place centrale au niveau national. S'agissant de l'étude des conséquences, il existe un programme « Gestion et impact du changement climatique », sous la responsabilité du ministère de l'Ecologie et du développement durable, et qui comporte aussi des aspects liés aux sciences humaines et sociales. Il s'agit cependant de recherches plus dispersées, sur lesquelles nous devons davantage mobiliser nos équipes, et qu'on retrouve dans plusieurs programmes financés par l'ANR. C'est l'INSU qui porte la plupart des recherches au sein du CNRS, mais beaucoup d'équipes travaillent aussi au sein des départements de sciences de l'ingénieur ou de sciences du vivant sur d'importantes thématiques nouvelles, comme les écotechnologies, le génie civil et urbain, ou la nouvelle technologie des matériaux. L'effort accompli dans ces domaines est estimé à 40 millions d'euros, 200 millions en ajoutant les cofinancements. La coordination avec les autres partenaires concernés, c'est-à-dire le ministère de l'Ecologie, les ministères techniques ainsi que le secteur privé, se fait au sein du programme « Gestion et impact du changement climatique », qui associe la MIES et tous les ministères concernés. Les comités d'animation des programmes ANR sont toujours dans le programme de coordination. L'action dans le domaine des transports fait l'objet du programme PREDIT, dont la lutte contre le changement climatique n'est toutefois pas le seul objet - même si c'est l'un des principaux -, et des actions de l'ADEME. Dans le domaine de l'habitat, une thématique de l'ANR prolonge le programme PREBAT. C'est dans ce cadre que sont organisés les appels d'offres de l'Agence. L'ADEME, quant à elle, finance des actions et des recherches. Le CSTB a dans ses priorités la lutte contre l'effet de serre, mais il est difficile d'isoler, dans son action, ce qui relève strictement de cette thématique. Les mêmes remarques valent pour la production d'énergie : la plupart des thématiques sont liées, de près ou de loin, au sujet qui nous occupe. Dans le domaine agricole, les actions de l'INRA sont assez nombreuses sur ces thématiques, et liées aux pratiques agricoles, notamment dans le cadre du programme AGRIGES qui vient à terme. Il existe également le programme AGRICE, coordonné avec l'ADEME, et un programme de bioénergies de l'ANR, coordonné avec l'INRA. Dans l'industrie, enfin, il existe divers programmes de l'ANR. Au niveau européen, les propositions de la Commission pour le 7e PCRD rejoignent assez largement nos préoccupations. Il y aura un programme prioritaire « Climat et systèmes de la Terre » - cycle de l'eau et du gaz, composition des atmosphères et des océans, impact des océans sur les écosystèmes. Le « thème 3 », c'est-à-dire la limitation des effets des gaz à effet de serre, les propositions de la Commission sur le volet énergie prévoient d'exploiter ce thème, avec l'hydrogène et la production d'énergie à partir d'énergies renouvelables. Le champ couvert est très large. On peut lire dans le 6e PCRD le bilan des résultats obtenus par les équipes françaises dans les appels à projets. Notre pays est bien classé, voire très bien, pour le « thème 1 », où il est deuxième derrière l'Allemagne, ce qui est d'ailleurs son rang pour l'ensemble du PCRD. Mais, sur certains sous-thèmes, comme le cycle du carbone, ou « dynamique et réversibilité », ou les mécanismes de diversification, la France n'est que troisième, et quatrième sur les incidences écologiques du changement climatique ou les technologies d'atténuation, ce qui n'est pas satisfaisant. Il faut renforcer l'effort, comme je le disais tout à l'heure, sur ces thématiques. Politiquement, nous sommes convaincus que le sujet doit être l'une des grandes priorités de la recherche française. Notre appareil de recherche est largement mobilisé. Or son organisation n'est pas forcément adéquate, car il n'a pas été conçu en fonction de ces thématiques, et le nombre élevé d'organismes intervenants pose un problème de coordination. L'affirmation politique de la gravité du sujet est appelée à croître, et les moyens à suivre. Dans les prochains budgets, donc, les financements devraient être en hausse, et les priorités plus affirmées dans les budgets et les appels à projets. Nous sommes de ceux qui, en Europe, ont beaucoup milité pour que ce soit une priorité. Dans les activités spatiales, l'ESA a décidé d'augmenter au-delà de l'inflation le financement des programmes scientifiques ayant des répercussions sur les sujets dont nous traitons. Mais, quel que soit le domaine concerné, nous considérons que nous devons accentuer encore l'effort. M. le Président : Je vous remercie. Plusieurs de nos collègues voudraient vous poser des questions. M. François DOSÉ : Les 1 000 chercheurs et les 200 millions d'euros dont vous avez fait état incluent-ils les financements européens ? Si, comme j'ai cru le comprendre, ce n'est pas le cas, ces fonds européens sont-ils importants en comparaison ? M. François GOULARD : Il s'agit en effet des seuls fonds nationaux. M. François CLIN : Auxquels il faut ajouter les 60 millions d'euros de fonds européens dont ont bénéficié les équipes françaises sur les trois années du 6e PCRD. M. François GOULARD : Mais ces fonds ne sont pas acquis définitivement. M. François DOSÉ : Peut-on évaluer les dépenses de recherche des entreprises sur ces sujets ? Savoir si elles sont en augmentation ? M. François GOULARD : C'est beaucoup plus difficile, car il y a un problème de définition. Faut-il inclure, par exemple, les efforts accomplis par les constructeurs automobiles pour réduire la consommation des véhicules ? M. François CLIN : On estime à une centaine de millions d'euros la recherche privée partenariale. M. François GOULARD : Les programmes PREDIT et PREBAT associent largement le secteur privé, mais la majeure partie de la recherche privée n'est pas partenariale, et est donc beaucoup plus difficile à évaluer. M. le Président : Quelle est la stratégie globale du ministère en matière d'énergies renouvelables ? Inclut-elle toutes les formes d'énergies renouvelables, y compris les filières hydrogène ? Et quels moyens sont consacrés à la recherche sur les « ruptures technologiques » ? Le problème du stockage de l'électricité, par exemple, s'il était résolu, changerait énormément de choses, de même que l'hydrolyse enzymatique de la biomasse. Y a-t-il des programmes spécifiques sur ces sujets ? Comptez-vous en lancer via l'ANR ? Les crédits augmentent - moins, cependant, que nous ne l'avions demandé - mais la participation de l'Agence à la recherche sur le changement climatique - tous aspects confondus - va-t-elle s'accroître aussi ? M. François GOULARD : Il est difficile de répondre sur la question des énergies renouvelables, car les organismes de recherche concernés sont très nombreux. L'ANR a fait des appels à projets, et les crédits ont augmenté entre 2005 et 2006. M. François CLIN : L'ordre de grandeur est de 40 millions d'euros pour les nouvelles technologies de l'énergie en 2005, et ce montant devrait augmenter de 30 % en 2006. M. François GOULARD : Cela fera donc près de 60 millions d'euros. M. le Président : Sur un budget de 700 millions d'euros en 2006. M. François GOULARD : L'ANR s'occupe de recherche fondamentale et appliquée, et couvre tous les domaines de la recherche. Il y a aussi parmi les programmes « blancs » quelques thèmes concernant l'énergie. Il faudrait faire des comparaisons plus rigoureuses. M. Pierre TREFOURET : Les nouvelles technologies de l'énergie, hors ANR, représentent environ 20 % des moyens consacrés à la recherche sur l'énergie. M. le Président : Est-il possible d'avoir, avant que nous rédigions notre rapport, une estimation, même approximative, des financements ? M. François GOULARD : Nous pourrons vous adresser un tableau où figureraient, pour chaque grand thème, les organismes concernés et les financements estimés. M. François CLIN : Nous avons les chiffres, mais ils ne sont pas encore validés. M. le Président : Cela vaut mieux que pas de chiffres du tout ! M. François GOULARD : Nous vous les fournirons sous quinzaine. M. François CLIN : Hors énergie, le total peut être estimé, en France, à quelque 600 millions d'euros par an. M. François GOULARD : Nous vous fournirons donc un tableau des thèmes et des organismes concernés, avec une estimation de la part consacrée à ce thème dans le budget de leurs équipes. Nous ferons naturellement de notre mieux, mais lorsqu'on entend dire qu'il y a un manque d'explicitation des priorités de la recherche, ce n'est pas un vain mot. M. le Président : C'est bien pour vous faire progresser que nous vous demandons ces données. M. François GOULARD : Nous sommes en fait assez mal outillés, je m'en aperçois depuis quelques mois, pour répondre à des questions comme les vôtres, car nous n'avons pas de tels tableaux de bord, mais seulement des données par organisme. C'est regrettable, car cela nous permettrait de connaître, sur chaque thème défini comme prioritaire, l'ensemble des actions. M. le Président : Que pensez-vous des filières hydrogène ? On nous a tenu tous les discours possibles à ce sujet. Certains nous ont dit que les perspectives étaient trop lointaines, que c'était une perte de temps, que cela ne servait à rien. Mais, d'un autre côté, les Etats-Unis s'emploient à développer cette filière de façon importante, et M. Perben a inauguré récemment une station-service à hydrogène à Berlin. M. François GOULARD : Ce qui est clair, c'est que ce n'est pas encore applicable à grande échelle, et que l'hydrogène n'est pas un gaz d'un maniement très commode. Mais je me garderai de me prononcer sur le fait que les perspectives sont proches ou lointaines. Je n'ai pas d'opinion personnelle sur la question. M. Serge POIGNANT : Il est très intéressant que nous ayons cette vision transversale et thématique. Nous sommes allés aux Etats-Unis et en Espagne, et on nous a parlé de « vision thématique ». C'est un langage que l'on entend dans beaucoup de pays, notamment aux Etats-Unis. Y a-t-il en France des équipes qui travaillent sur le solaire ? Cela nous intéresserait de le savoir. Quant à l'adaptation, nous avons depuis un certain temps le sentiment que ce sont les gens qui travaillent dans la santé qui sont les moins convaincus. Or, ce secteur est très directement concerné par les stratégies d'adaptation. Je voudrais votre avis là-dessus. M. François GOULARD : Dans le domaine de l'énergie, la France a des priorités connues de longue date, comme le nucléaire, et ces priorités se lisent clairement dans les budgets. Cela ne veut pas dire que nous écartions les recherches sur les autres technologies : nous avons de nombreuses équipes qui travaillent sur le solaire, il y a même un pôle de compétitivité. Cela dit, les biocarburants sont un sujet sans doute prioritaire par rapport à d'autres, comme d'ailleurs dans de nombreux pays. S'agissant de la santé, le changement climatique a des effets à la fois déterminants et multiples, et pose des questions à la recherche pour l'avenir, car des pathologies qu'on croyait disparues renaissent. Les aspects sanitaires du changement climatique sont une préoccupation fondamentale. Mme Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET, Rapporteure : La semaine dernière, nous avons passé 48 heures en Espagne, où nous avons rencontré différents partenaires. J'ai eu l'impression que leur discours implicite était quelque chose comme : « Nous avons finalement un énorme avantage comparatif, qui est l'ensoleillement, et nous serons aux premières loges si, un jour, se développe une économie fondée sur le solaire ». Cela dit, ils semblent assez sous-équipés en solaire. M. François GOULARD : L'Espagne n'est pas un grand pays de recherche, et n'a pas les mêmes moyens que la France, dont les équipes sont plus largement présentes dans tous les domaines. Ce n'est pas parce que la France est le pays du nucléaire qu'elle va faire une croix sur les autres technologies, et il n'est effectivement pas certain que l'Espagne soit en avance sur nous dans le domaine du solaire. Nous avons toujours été très présents dans l'énergie, qu'il s'agisse du nucléaire ou du pétrole. Je crois que c'est un point fort industriel de la France, avec lequel notre recherche doit chercher à être en phase. Mme la Rapporteure : Pour le solaire, comme d'ailleurs pour la biomasse et la bioplastique, les incitations financières ne sont-elles pas trop faibles pour que se développe une vraie filière industrielle ? M. François GOULARD : L'émergence d'un marché dépend en grande partie de la vigueur des initiatives privées et des débouchés industriels potentiels. Nous avons, en Champagne-Ardenne et en Picardie, deux pôles de rayonnement mondial. Cela dit, la puissance publique peut avoir son rôle à jouer, et même un rôle important, pour doper à la fois le marché et la recherche. M. le Président : Ce que dit Mme la Rapporteure est juste : globalement, on n'a pas accordé à la technologie la même place qu'à la recherche proprement dite. Nous avons développé des éoliennes et des panneaux solaires, sans en construire chez nous. Quant à la biomasse, je n'offenserai personne en disant que c'est une divine surprise pour la Picardie et Champagne-Ardenne que d'avoir chacune un pôle à vocation mondiale. J'ai, pour ma part, une question plus pointue : comment faire pour développer la gazéification en filière sèche à partir de la biomasse ? J'ai aussi une question plus générale : comment faire le lien avec la recherche universitaire afin de ne pas nous laisser « décrocher » en cas de rupture technologique ? Ce serait tout de même un comble que les filières hydrogène se développent et que les Etats-Unis, après avoir été un frein, bénéficient seuls des retombées économiques de cette technologie. M. François GOULARD : Il y a sans doute, dans la stratégie américaine, un calcul, que l'on peut trouver cynique, et qui consiste à ne pas agir pour l'instant, mais à se préparer pour le jour où une solution technologique sera au point. S'agissant des biomatériaux et des biocarburants, nous avons un pôle de compétitivité, qui associe naturellement divers organismes de recherche, dont certains locaux. M. le Président : Y aura-t-il des incitations financières dans le programme ? C'est très important. M. François GOULARD : Ce n'est pas à l'Etat de dire aux uns et aux autres ce qu'ils doivent faire. Mais, d'une part, il fait confiance aux pôles pour s'adresser aux acteurs les plus concernés, et d'autre part, quand nous lançons des appels à projets dans le cadre de l'ANR, nous tenons compte de l'existence des pôles de compétitivité. Les équipes qui se sentent compétentes se portent candidates, et si quelqu'un répond à la fois à l'ANR et au pôle, on l'oriente plutôt vers le pôle. Cela dit, on ne gagne pas à tous les coups. Quand le marché est créé par la collectivité, le développement a une chance plus grande. Mais il n'y a pas de fatalité en la matière. L'approche par pôle est de nature à faciliter les relations entre les industries et les forces de recherche. On ne gagne pas à tous les coups, mais c'est assez bien adapté à ce type de problème. M. le Président : Parlons un peu de l'Europe. Nous avons eu le bilan du 6e PCRD, et nous voudrions quelle sera la place de la recherche sur le changement climatique dans le 7e PCRD, sachant qu'il reste une incertitude quant au niveau des financements. Question subsidiaire : puisque nous sommes mal placés sur l'atténuation et l'adaptation, que devons-nous faire pour être meilleurs ? M. François GOULARD : Sur le premier point, nous n'avons qu'une liste de thèmes, mais pas les montants que l'on propose de leur consacrer. Pour ce qui est des champs couverts, il semble que cela corresponde à nos attentes. Nous devrions être à 50 % de progression, soit 50 millions d'euros d'aujourd'hui sur la totalité du programme. M. le Président : La Grande-Bretagne a proposé 75 millions d'euros. M. François GOULARD : Les Britanniques ont un art consommé de faire des propositions qui ne les engagent pas. Nous attendons d'eux qu'ils nous soutiennent sur l'utilisation des fonds propres de la BEI. La décision n'est pas acquise, mais nous pouvons être raisonnablement optimistes. Je réponds maintenant à votre seconde question : comment faire pour être meilleurs sur l'adaptation et l'atténuation ? Il ne faut pas oublier le facteur habitude. Sur le « thème 2 », nous avons des équipes relativement récentes, qui devaient songer à s'installer avant même de répondre aux appels à projets. Nous devrions donc obtenir de meilleurs résultats dans le 7e que dans le 6e PCRD. Naturellement, c'est un effort de tous les organismes, de toutes les universités, que d'aider leurs équipes à répondre aux appels à projets. Mais, contrairement aux idées reçues, la France est bien placée, et il n'y a donc pas de raison qu'on ne progresse pas. Mme la Rapporteure : N'y a-t-il pas, en aval de la recherche, un problème de certification ? Notre rôle n'est pas d'évaluer le contenu des dossiers, mais dans le secteur du bâtiment, beaucoup de chercheurs se plaignent que leurs brevets ne soient pas homologués et que le CSTB ne soit pas très ouvert à l'innovation. M. François GOULARD : Je ne suis pas vraiment en mesure de répondre. Dans certaines industries, la certification est déterminante. Y a-t-il dans ce secteur une frilosité particulière ? Il est trop facile de jeter la pierre, car il y a, là comme ailleurs, un principe de précaution. Le sujet est sérieux. Mme la Rapporteure : Beaucoup se plaignent qu'il y ait un seul guichet, que celui-ci ne soit pas accueillant, et qu'il n'y ait pas de droit d'appel, l'ADEME ne remplissant pas sa fonction. Ne faudrait-il pas garantir une possibilité d'appel, une interface pour l'innovation ? M. François GOULARD : Je vais voir dans quelle mesure cela correspond à une réalité, car lorsqu'un organisme installé a tendance à privilégier ce à quoi il est habitué, cela peut constituer, en effet, un frein à l'innovation. M. François DOSÉ : Il y a aussi des blocages assurantiels. Ainsi, les recherches sur la chaux et sur le bois dans l'habitat étaient considérées, il y a vingt-cinq ans, avec une prudence de sioux ! La garantie décennale protège un certain nombre de personnes. M. François CLIN : Dans la plupart des programmes liés au développement durable, on conseille de prendre en considération ces problèmes de certification et de cahier des charges. M. François GOULARD : Le programme PREBAT intègre la question de l'accès de l'innovation à la certification. Cette préoccupation est également présente dans PREDIT ; M. le Président : Je voudrais évoquer, fût-ce rapidement, la séquestration du carbone, souvent présentée comme un remède miracle à la progression des émissions. Où en sont les recherches ? Qui en fait, hormis l'Institut français du pétrole ? Et qu'en pensez-vous ? M. François GOULARD : Le BRGM y travaille aussi. Je m'interdis d'avoir un avis personnel a priori, en l'absence de conférence de consensus. Tout ce que je puis dire, c'est que c'est une voie de recherche dont l'intérêt est reconnu. Mais l'apport sera-t-il significatif ? Je n'en sais rien. M. Serge POIGNANT : On nous a dit que des projets existaient dans différents pays, notamment au Danemark, au Canada et en Ecosse. Existe-t-il, en France, un projet in situ ? M. François GOULARD : Le BRGM a étudié différents sites, mais il n'y a pas de projet aussi avancé que celui de Bure pour le stockage des déchets. Nous avons une expertise reconnue en la matière. Mme la Rapporteure : Les Espagnols nous ont beaucoup parlé de la possibilité de diluer le CO2 dans les profondeurs de l'océan. C'est très séduisant sur le papier, mais. M. François CLIN : Il faut se garder de jouer les apprentis sorciers, en touchant sans précaution aux équilibres sous-marins. M. François GOULARD : Cela ne fait pas partie des solutions technologiques envisagées en France. M. Jean JOUZEL : L'incorporation naturelle du CO2 dans l'océan pose déjà un problème d'acidification. Si on en rajoute encore, cela va devenir problématique ! M. Pierre TREFOURET : Il y a des études théoriques sur tous ces projets, qui ont leurs inconvénients et leurs risques, le principal étant que l'océan devienne un milieu de stockage, alors que l'instabilité y est plus grande que dans les couches géologiques. M. le Président : On assiste au développement de projets à très long terme, comme ITER, où nous sommes présents, ou d'autres, dont nous sommes absents. Les Anglais, qui travaillent sur l'énergie des courants marins et des vagues, nous ont dit qu'ils souhaiteraient développer leur coopération avec la France sur certains sites propices, par exemple certaines « marmites » en Manche. Avons-nous des équipes qui travaillent sur ce sujet ? M. François GOULARD : A ma connaissance, nous ne sommes guère en avance dans les technologies d'utilisation de la houle et des courants. L'usine marémotrice de la Rance était très novatrice à l'époque de sa construction, mais cela commence à dater. Aujourd'hui, EDF manifeste un vague intérêt, qui ne se traduit pas par un effort très significatif. Peut-être est-ce dommage, car les marées sont à la fois prévisibles et décalées dans le temps le long du littoral, ce qui pourrait théoriquement permettre une production ininterrompue d'électricité. Mais ce n'est sûrement pas un axe fort de notre effort de recherche. M. le Président : Les Anglais nous ont dit qu'ils souhaitaient, grâce à cette méthode, arriver à 20 % d'énergie renouvelable ! M. François GOULARD : Cela me paraît vraiment considérable. Le principe est un peu le même que celui de l'énergie éolienne, la discrétion esthétique en plus. M. Christian DECOCQ : La France, comme la Grande-Bretagne, est réellement favorisée par la géographie, car l'énergie des marées qui déferlent sur ses côtes représente au total quelque 450 Térawatts, soit l'équivalent de la consommation énergétique de notre pays. Il y a à Nantes un laboratoire qui étudie un dispositif d' « hydroliennes ». M. François GOULARD : La houle a une plus grande régularité. Mme Geneviève COLOT : Je voudrais vous interroger sur la géothermie, qui me semble faire l'objet de peu de recherches. M. François GOULARD : Nous sommes considérés comme très bien placés pour la géothermie profonde, et notre expertise en la matière est reconnue. M. François CLIN : Le prototype de Soultz est quelque chose d'exceptionnel, mais qui n'a rien à voir avec la géothermie classique, car on utilise la roche comme radiateur : on recherche non des fluides, mais des failles, et ce à 5 000 mètres de profondeur. Mme Geneviève COLOT : Quel est le pourcentage de foyers chauffés par géothermie ? M. François CLIN : Environ 2 %. M. François GOULARD : C'est donc très minime. M. Michel DESTOT : Ma question s'adresse à l'ancien ministre des transports que vous êtes. Nous avons eu connaissance aujourd'hui du taux d'exécution des contrats de plan Etat-régions, et il en ressort que le routier est favorisé par rapport au ferroviaire. Quel est votre sentiment à ce propos ? M. François GOULARD : Il y a neuf mois que je ne suis plus en charge des transports. Cela dit, je puis tout de même vous répondre que, comme vous le savez d'ailleurs, la pression des élus en faveur de l'investissement routier est considérable. Mais les chiffres peuvent aussi être trompeurs, car le délai de réalisation des investissements ferroviaires est bien plus long. Je ne crois pas, au demeurant, que leur taux d'exécution soit ridicule. M. Michel DESTOT : Je n'ai pas dit qu'il l'était, mais qu'il était inférieur à celui des investissements routiers. M. François GOULARD : La France reste un pays qui investit beaucoup dans le ferroviaire, au point de faire figure d'exception, car la tendance, dans nombre de pays, est plutôt à la fermeture de lignes. Il y a en tout cas une bonne nouvelle : c'est la rallonge annoncée de 500 millions d'euros, dont 200 millions pour le non-routier, et la promesse d'un traitement particulier pour le ferroviaire dans les prochains CPER. M. le Président : Monsieur le ministre, nous vous remercions. Audition de M. Yves MARTIN Présidence de M. Serge POIGNANT, vice-président M. le Vice-Président : Nous avons le plaisir de recevoir M. Yves Martin, ingénieur général des mines honoraire, et ancien président de la MIES, que je remercie pour les nombreux documents qu'il nous a fait parvenir, et qui va nous faire une brève présentation, après quoi nous pourrons lui poser quelques questions. M. Yves MARTIN : Je suis admiratif devant toutes les auditions auxquelles vous avez procédé, et je pense que vous en savez maintenant beaucoup plus que moi sur la réalité du changement climatique, que je ne suis plus que par la grande presse. J'ai un motif d'optimisme, que je tiens des sondages réalisés par l'ADEME depuis quatre ou cinq ans, et qui montrent que nos concitoyens ne sont que 10 % à croire que le progrès technique fournira une solution, mais 75 % à considérer que nous devrons modifier de façon importante nos modes de vie. J'y vois la preuve qu'ils sont conscients qu'on leur demandera des choses désagréables. Je suis également optimiste quand je vois l'objectif que se sont fixés la plupart des pays européens : diviser par quatre, en cinquante ans, leurs émissions de gaz à effet de serre. Mais je veux souligner mon inquiétude devant les mesures concrètes qui figurent dans les programmes nationaux : elles me paraissent en effet dérisoires en regard de cet objectif ambitieux et courageux. De plus, la communication officielle ne peut que laisser entendre que ces mesures sont en phase avec l'objectif, ce qui n'est pas le cas. Il y a, à coté de cette communication, un effort de pédagogie très important à faire, que l'opinion publique est prête à accepter. J'ai proposé, il y a trois ans, de créer à cet effet une fondation, qui serait encouragée par l'Etat financée, le cas échéant modestement par lui, mais surtout par les entreprises, qui ont intérêt à ce que le problème soit pris au sérieux. Le défi est si grand que nous ne pouvons gagner qu'à condition d'optimiser parfaitement notre action, de rechercher inlassablement les options les moins coûteuses. Nous sommes tous concernés, que ce soit en tant que consommateurs ou en tant que producteurs, et ces derniers sont doublement concernés : en tant qu'émetteurs et en tant que porteurs potentiels d'innovations qui permettent de réduire les émissions des autres. Il n'est naturellement pas question de distribuer des tickets de rationnement : seul le jeu du marché peut éviter qu'un émetteur dépense cent fois plus qu'un autre pour le même résultat. On n'atteindra pas le « facteur 4 » si l'on ne taxe pas l'énergie de façon croissante. Il ne s'agit pas de savoir si on devra le faire, mais à quelle vitesse on devra le faire. Une telle évolution sera ruineuse si elle n'est pas progressive et programmée pour profiter de toutes les opportunités de progrès, notamment lors des investissements et pour garantir aux innovateurs l'existence d'un marché à l'horizon de dix ou vingt ans. Comparons les extraordinaires progrès que l'innovation nous a fait accomplir, depuis la dernière guerre, dans l'efficacité de l'utilisation de la main-d'œuvre, et notre performance plus que médiocre quant à l'efficacité de l'utilisation de l'énergie. La raison en est que, comme le savent tous les producteurs, le prix de la main-d'œuvre n'a fait qu'augmenter, tandis que les prix de l'énergie ont continuellement diminué entre 1945 et 1974. En 1974, nous sommes entrés, avec le premier choc pétrolier, dans une période où les prix de l'énergie sont chaotiques et imprévisibles ; or, rien ne dissuade plus d'innover que l'incertitude. D'où l'importance d'une taxe dont le poids réduit l'ampleur relative de cette évolution chaotique des prix. J'en viens à l'efficacité de l'outil fiscal. On dit souvent que ce n'est pas parce que l'on taxera plus l'énergie que l'on en consommera moins. C'est faux. Certes, l'élasticité immédiate des prix de l'énergie est faible : une augmentation de 10 % ne provoque qu'une baisse de 2 à 3 % de la consommation de carburant. Mais si la hausse se poursuit pendant trois ans, les consommateurs, au moment de changer de voiture, opteront pour des modèles plus économiques disponibles sur le marché, et les constructeurs s'efforceront de mettre l'accent sur cet aspect. C'est ce qu'ils ont fait, du reste, pendant les douze années qui ont suivi 1974, si bien que la consommation moyenne des véhicules a fortement baissé, mais l'effondrement des cours, en 1986-1987, a donné un coup d'arrêt à cette tendance. S'il y avait, donc, une hausse prévisible et programmée des prix, les constructeurs innoveraient bien davantage. Il n'est que de comparer l'évolution inégale de la consommation de carburant aux États-unis et en Europe pour mesurer l'enjeu que représente sur le long terme la taxation de l'énergie. En France, la TIPP n'a pas été conçue pour provoquer des économies d'énergie, mais elle a eu cet effet collatéral. Pour autant, elle n'a pas obéré notre développement économique, et je crois que si nos constructeurs sont aujourd'hui aussi compétitifs au plan industriel et ont des produits aussi performants, c'est parce qu'ils ont à faire face à un marché où les carburants sont chers et où la TIPP atténue les fluctuations des prix du pétrole. La même chose se vérifie quant à l'élasticité au prix de la quantité d'énergie utilisée pour le chauffage des logements. Pour s'en tenir aux logements construits après 1975, et à surface équivalente, la consommation avec un chauffage individuel au gaz est de 100, elle est de 133 avec un chauffage collectif au gaz sans compteur individuel, de 160 avec un chauffage collectif urbain dont le coût marginal est faible en raison de l'importance du terme fixe de l'abonnement dans son prix, et de 30 avec un chauffage électrique individuel marginalement le plus coûteux. Ce sont des ordres de grandeur qu'il faut avoir présents à l'esprit. Mais je ne parlerai pas davantage, faute de temps, de l'urbanisme, de la mobilité urbaine et des façons de la maîtriser, sinon pour dire que la seule arme efficace, selon moi, est le péage urbain. Je sais quelles peuvent être vos appréhensions devant cette approche fiscale. Un gros effort d'explication est nécessaire, qui commence par l'affirmation et la démonstration du fait qu'il ne s'agit pas de créer un impôt supplémentaire, mais de remplacer des impôts pervers par un impôt vertueux. L'objet premier de toute fiscalité est de couvrir les dépenses publiques votées par nos instances démocratiques, nationales ou locales. Mais elle a aussi deux autres effets : un effet redistributif - entre les ménages et les entreprises d'une part, entre ménages riches et pauvres d'autre part -, effet qui est rarement étudié dans l'administration, et un effet dissuasif ou incitatif, comme l'on voudra, qui conduit les contribuables à réduire l'assiette sur laquelle ils sont imposés. Les impôts vertueux sont ceux qui tendent à réduire les dépenses publiques futures. J'en citerai trois exemples : les taxes sur l'alcool, sur le tabac, et la TIPP. Or, ces impôts vertueux ne représentent même pas 5 % de l'ensemble des prélèvements obligatoires, alors que les impôts, fondamentalement pervers, qui sont assis sur les salaires, en représentent, sous leurs diverses formes, 38 %. En 1990, j'ai eu l'occasion de présenter pour la première fois, à une réunion au Commissariat général du Plan, l'« anatomie comparée » des deux facteurs de production majeurs que sont la main-d'œuvre et les énergies fossiles. La première est renouvelable, n'est importée que très marginalement, et sa taxation est un important facteur du chômage qui coûte 33 milliards par an au budget de l'État. La seconde n'est pas renouvelable, est importée en totalité, et son utilisation génère des coûts futurs, notamment liés au changement climatique. Par quelle aberration taxe-t-on la première à 38 % ? Notre objectif devrait être de rééquilibrer, en vingt ou trente ans, le niveau de taxation des deux facteurs, à hauteur de 21 % chacun. En 1975, quelques années seulement après la création du ministère de l'environnement, on a rendu obligatoire, pour tout investissement public ou privé d'une certaine importance, l'étude préalable de son impact sur l'environnement. Il faudrait que, de même, toute mesure fiscale soit assortie d'études sur son effet redistributif et sur son effet incitatif ou dissuasif ; nous aurions tout à y gagner, et je suis horrifié par la médiocrité actuelle du débat public sur la fiscalité. La Suède, avant d'entrer dans l'Union européenne, n'avait pas de TVA. Pendant une dizaine d'années, un débat a été mené au sein des universités, avec un fort encouragement du gouvernement suédois, sur le point de savoir quelles seraient les conséquences de son introduction. En 1991, il y a eu un changement de majorité, l'un des professeurs qui avaient participé activement au débat est devenu ministre de l'économie, et le 1er janvier 1993, la Suède a revu de fond en comble toute sa fiscalité, le changement portant sur l'équivalent de 7 % de son PIB. Il est navrant que nulle part en France il n'y ait une telle réflexion d'ensemble sur la fiscalité. Naturellement, la fiscalité a des inconvénients si elle crée des effets de distorsion qui handicaperaient une partie de nos entreprises sur le marché mondial. C'est pourquoi, dès le départ, c'est-à-dire à partir de 1989, le gouvernement français a considéré qu'il fallait traiter la question de la fiscalité énergétique au niveau de l'Europe, de façon à espérer entraîner les autres pays de l'OCDE. La France a envoyé à Bruxelles toute une série de mémorandums - le premier était en date d'octobre 1990 - pour proposer de taxer le CO2. L'accueil, contrairement à ce qu'on pouvait craindre, a été bon - à un détail près - nos partenaires nous ont dit qu'il fallait asseoir la taxe pour moitié sur le CO2 et pour moitié sur l'énergie, afin de ne pas favoriser indûment le nucléaire, alors que se dessinait l'ouverture des marchés de l'électricité. C'était déjà extrêmement avantageux pour la France, car cela ne pouvait qu'accroître la compétitivité du nucléaire, et pourtant qui a pris la tête de la lutte acharnée contre le projet ? Le lobby nucléaire français, qui a su, par une formule habile, convaincre un ministre de l'industrie - dont j'étais le collaborateur - de ce qu'« on ne lutte pas contre l'alcool en taxant les jus de fruits » ! Je dirai quelques mots, pour conclure, sur les « permis négociables » comme alternative à la taxe. Ma dernière intervention officielle remonte au premier trimestre 1999, quand, après Kyoto, le gouvernement français a demandé à la MIES de créer des groupes de travail pour préparer le programme français. J'ai accepté de présider le groupe de travail « Industrie », à la condition - qui fut satisfaite - que me soient adjoints un représentant de la direction de la législation fiscale et un représentant de la direction de la prévision. Les conclusions de ce groupe de travail ont été que la seule approche efficace, optimisante, était une taxe, à acquitter à la fois par le consommateur final et par toutes les entreprises, à l'exception de celles à forte intensité énergétique, lesquelles ne représentent que 16 % de la valeur ajoutée et 20 % des émissions. Ces industries étaient représentées au sein du groupe de travail, et ont fait valoir que la seule solution était que la taxe en question leur fût remboursée, et que fût instauré en contrepartie un dispositif de permis négociables. Jusque-là, l'accord était total. Mais les choses ont dérapé lorsque ces mêmes industries n'ont pas voulu du système que je proposais pour l'allocation des permis. Il s'agissait de fixer celui-ci à 90 % ou 95% (pour commencer) des émissions de la dernière année, de mettre en place un marché piloté au niveau européen pour que l'évolution du cours des permis ne diverge pas trop de celle programmée pour la taxe. Ainsi, elles auraient payé moins de 10 % du montant de la taxe dont elles seraient dispensées. Elles ne l'ont pas voulu, et se sont battues pour que les quotas soient alloués entreprise par entreprise, ou branche par branche, dans chaque pays, en quelque sorte à la tête du client. C'est sur ces bases que le système a démarré, avec tout de même un élément intéressant : le prix de la tonne de carbone, qui est de 80 euros. Et on ne sait pas s'il n'y a pas des professions qui sont systématiquement vendeuses, ou contraintes d'être systématiquement acheteuses de ces permis, compte tenu du flou artistique qui a présidé à leur création. Les Anglais ont eu, sur deux points, une attitude exemplaire, que nous n'avons pas été capables d'imiter. Tout d'abord, en 1992, notre TIPP était au même niveau que la leur ; ils ont décidé de l'augmenter de 3 % par an en monnaie constante, puis, deux ans plus tard, de 5 % par an. Le résultat est très parlant : elle était égale à 1,2 fois la nôtre en 1995 et à 2,1 fois en 1999. Elle a un peu baissé ensuite, pour deux raisons : la première est qu'ils ont eu des difficultés avec leurs transporteurs parce que l'Europe ne suivait pas ; la seconde est que la dévaluation de la livre sterling a changé les termes de la comparaison. Autre point sur lequel les Anglais ont été exemplaires : ils ont proposé en 1988 l'attribution de permis négociables à chaque constructeur, en fonction de sa proportion de véhicules neufs consommant moins d'un certain nombre de litres au cent, nombre appelé à baisser d'année en année. Or, quel pays a été - c'était avant la création de la MIES - le premier à torpiller le projet ? La France. Je n'en dis pas plus, et préfère rebondir sur vos questions. M. le Vice-président : Je vous remercie de ces rappels historiques. Mme Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET, Rapporteure : Il faut tout de même que nous cherchions des raisons d'espérer. Vous nous avez montré qu'à plusieurs reprises, la France a tué des propositions qui auraient pu être bénéfiques, notamment à ses entreprises. Y a-t-il un salut à attendre de l'Europe dans le contexte actuel, ou devons-nous en rester à des propositions françaises ? M. Yves MARTIN : Je n'ai pas d'opinion sur ce qui peut être fait aujourd'hui dans le cadre de l'Union européenne. Quand je présidais la MIES, j'accordais une priorité absolue à travailler avec la Commission et à faire ce que j'appelais de l'interministériel en bilatéral. Avec un groupe de fonctionnaires de la direction de la législation fiscale, de la direction de la prévision, de la direction générale de l'énergie et des matières premières et de la direction des transports terrestres, nous allions voir nos principaux partenaires pour discuter informellement avec un groupe de composition analogue. Lors de ma première visite à Bonn, mon homologue, qui était directrice des relations internationales au ministère de l'environnement, m'a dit en prenant congé : « Vous m'avez rendu un immense service, car c'est la première fois que je rencontrais la personne qui, à Bruxelles, parle de la taxation des carburants au nom de l'Allemagne, c'est-à-dire le directeur des douanes. » Une autre fois, à Madrid, j'ai eu la grande surprise d'être reçu non pas au ministère de l'environnement ni à celui de l'énergie, mais par le « numéro deux » du ministère de l'économie et des finances, car le gouvernement espagnol, apprenant le sujet dont j'étais venu discuter, avait décidé que le ministère compétent ne pouvait être que celui des finances. Aujourd'hui, hélas, la France ne donne plus le ton des réflexions sur la lutte contre l'effet de serre. La dernière fois que j'ai rencontré un responsable bruxellois, c'était en 2000, quand on m'a demandé de présenter les conclusions du groupe de travail « Industrie » que je présidais. A la pause-café, un de mes anciens interlocuteurs à la Commission, M. Jos Delbecke, aujourd'hui directeur en charge du changement climatique, qui avait suivi mon exposé au premier rang, m'a dit : « Vous avez exprimé de façon très claire ce à quoi nous pensons confusément à la Commission, en matière de taxe et de permis d'émission pour les industries à forte intensité énergétique. Pourquoi la France ne l'a-t-elle pas proposé ? » Je n'ai pu que lui répondre que ces choses ne dépendent plus de moi. M. Christian DECOCQ : Vous venez de nous démontrer qu'il y a un génie français et un mal français, mais vous donnez aussi l'impression - je vous le dis avec toute l'amitié que je vous porte - de tenir un double discours, en appelant à la vertu des peuples et des dirigeants tout en leur faisant valoir que cette vertu rejoint leur intérêt bien compris. S'il est difficile de convaincre des bienfaits de la fiscalité écologique, c'est sans doute, ainsi que vous l'avez vous-même dit au début de votre propos, parce que la vertu est immédiate, quand l'intérêt, lui, est à plus long terme. La seule façon de réduire ce décalage ne serait-elle pas de recourir à une communication plus émotionnelle que rationnelle ? Au fond, êtes-vous vraiment assez optimiste pour croire à la sincérité des sondés lorsqu'ils répondent, à 75 %, être prêts à changer de comportement ? M. Yves MARTIN : J'ai utilisé, en effet, le terme de communication, mais pour dire que celle-ci se limitait à affirmer que les mesures prises allaient dans le bon sens. Ce qui a préparé la révolution fiscale suédoise de 1993, ce n'est pas une campagne de communication gouvernementale, mais la pédagogie d'un débat intellectuel animé par des universitaires, ce que nous ne savons pas faire : nous avons même supprimé le Plan ! M. le Vice-président : Je voudrais me faire un peu l'avocat du diable. Un accord au sein de l'Union européenne est certes nécessaire, mais l'ascension de l'Inde et de la Chine change la problématique. Comment voyez-vous l'après-2012 au niveau planétaire ? M. Yves MARTIN : Le problème est bien planétaire, mais nous avons, en tant que pays industrialisé, une responsabilité écrasante, en regard de laquelle celle des autres est dérisoire. Il est normal, au demeurant, que ceux-ci connaissent à leur tour la croissance et que leurs émissions augmentent fortement. Il y a quinze ans, nous avions beaucoup insisté sur le fait qu'un des lieux principaux où devait s'organiser la lutte contre le changement climatique était l'OMC. Celle-ci arbitre les conflits entre protection de l'environnement local et liberté du commerce, en évitant que des mesures prises pour la protection de l'environnement local ne constituent une entrave technique à celle-ci. Mais le dossier de l'effet de serre est une affaire d'environnement mondial, et non local, et il faut que les pays qui font plus que d'autres pour lutter contre le changement climatique puissent se protéger, dans le cadre de l'OMC, contre des délocalisations d'activités qui seraient provoquées par leur propre effort ; d'où l'idée d'imposer des droits de douane compensateurs à due concurrence sur une toute petite partie du commerce. Je suis consterné de voir qu'il ne parait pas y avoir de réflexion de ce type au sein de l'administration française. M. le Vice-Président : Monsieur Martin, nous vous remercions. Table ronde sur le rôle des collectivités territoriales, réunissant : Présidence de M. Serge POIGNANT, Vice-Président, M. le Vice-Président : Je vous souhaite la bienvenue à cette table ronde qui vise à faire un point sur l'action des collectivités territoriales en matière de lutte contre le changement climatique, à la fois s'agissant de la réduction des émissions de gaz à effet de serre, et dans le domaine de l'adaptation aux effets avérés ou probables du changement climatique. Les collectivités territoriales sont en effet en première ligne du combat contre le changement climatique. D'abord en termes de responsabilités et de compétences, chacune à leur niveau territorial : leur rôle en matière d'habitat, de transports, de développement économique, leur confère une mission essentielle dans le contexte de la réduction des émissions. Comment peuvent-elles, de ce point de vue, mobiliser leurs efforts pour s'inscrire dans l'objectif d'une réduction drastique des émissions - le fameux « facteur quatre » ? Quelles sont les expériences qui fonctionnent, qui mériteraient de faire école, en France ou ailleurs en Europe, en matière d'habitat, de transports, d'énergie renouvelable ? Quels sont les éventuels obstacles à un approfondissement de l'action des collectivités dans ce domaine ? Que peut-on dire du développement des plans climat territoriaux ? Faut-il réfléchir à des quotas d'émission territoriaux ? Comment les contrats de plan peuvent constituer des outils d'action efficaces dans le cadre de la lutte contre le changement climatique ? L'habitat social peut-il s'insérer dans la démarche de la réduction des consommations d'énergie et des émissions ? S'agissant plus spécifiquement des transports, faut-il étendre les compétences des communes à l'organisation des transports en ville ? Tels sont les sujets que nous proposons d'aborder au cours de cette table ronde. M. Michel ALLEX : Je suis très heureux de l'occasion qui m'est donnée ce matin d'exposer devant vous l'action de la ville de Chalon-sur-Saône pour la maîtrise des émissions de gaz à effet de serre. Vous avez choisi d'évoquer le rôle des collectivités territoriales en matière de changement climatique. Cette approche rejoint tout à fait la nôtre. Si Chalon s'est engagée dans ce combat, c'est bien parce que nous pensons que la maîtrise de l'effet de serre, enjeu planétaire, commence d'abord par une action au niveau local : ce que les États ne parviennent pas à faire, nous pouvons commencer à le réussir par des gestes simples dans notre vie quotidienne. Cette prise de conscience n'est pas récente. Dès le tout début des années 1990, sous l'impulsion de mon prédécesseur Dominique Perben, dont je salue l'action, Chalon a innové, en particulier avec : la Création de la Cellule Énergie au sein du Service Architecture de la mairie ; la création de la Maison de l'Environnement, structure de conseil et d'animation auprès des entreprises, des collectivités, des publics scolaires et du grand public ; l'adoption du Plan Municipal de l'environnement la création d'un réseau de surveillance de la qualité de l'air. Ce bref rappel historique est destiné à montrer comment notre ville a été peu à peu amenée à s'organiser autour d'un objectif lié aux problématiques de l'environnement. Au cours de cette période pionnière, nous avons ainsi expérimenté une démarche de management environnemental avec trois services techniques municipaux, l'idée étant d'apprendre aux agents municipaux à travailler et à développer ensemble un savoir-faire. C'est cette approche transversale qui nous a conduit à une première décision importante en 2000, avec l'installation d'une turbine de cogénération au gaz pour alimenter le réseau de chaleur urbain. Forte de son expérience, Chalon s'est impliquée dans les travaux de préparation du Plan Climat ainsi que dans un groupe de réflexion sur le thème de la quantification territoriale des émissions de gaz à effet de serre, piloté par la MIES. Quand l'Union européenne a lancé le projet Life Environment dans le cadre des actions de lutte contre le changement climatique, c'est assez naturellement que nous avons été amenés à présenter la candidature de Chalon qui a été choisie, à notre grande satisfaction, parmi plus de 400 projets pour être ville pilote du Programme d'Initiative des villes pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre, PRIVILEGES. Coordonné avec WWF-France en partenariat avec la Ville de Chalon-sur-Saône, la Maison de l'Environnement et la délégation régionale de l'ADEME, ce programme visait à mobiliser tous les acteurs locaux du territoire autour d'un objectif ambitieux. II s'agissait en fait de montrer qu'il était possible, sur un territoire, de diminuer le niveau des émissions de gaz à effet de 5,2 % en trois ans au lieu de dix Les actions de ce programme sont dirigées vers trois cibles principales : les entreprises du bassin économique, les collectivités locales, les citoyens, mais je ne vais pas dresser ici la liste de toutes les actions engagées. Puisqu'il est question du rôle des collectivités territoriales, je veux insister sur le plan d'action municipal piloté par mon adjoint en charge de l'environnement, Gilles Manière. Ce plan se décline en matière d'efficacité énergétique et quantifie les effets induits au regard des émissions de gaz à effet de serre. Il mobilise sept services municipaux : service environnement propreté, cellule énergie du service architecture, service électricité urbaine, service urbanisme, garage, ateliers, voirie. Le plan couvre les 4 fonctions « énergie » d'une ville : la ville aménageuse, la ville productrice et distributrice, la ville consommatrice, la ville incitatrice. Il est coordonné par le service environnement propreté, qui assure : l'animation de la Commission municipale, qui regroupe les sept services impliqués dans cette dynamique ; le pilotage de l'étude de quantification des émissions de gaz à effet de serre associées au Plan municipal ; la mise à jour périodique du Plan et du tableau de bord de quantification, en étroite relation avec les autres services. Dans l'organigramme de la ville, tous les services municipaux impliqués dans la démarche sont rattachés à la Direction Générale des Services Techniques. La ville a missionné un bureau d'études, cofinancé avec l'ADEME, afin de réaliser un tableau de bord « effet de serre », en lien avec les services municipaux et à partir des données collectées dans chaque service autour de cinq grands postes consommateurs d'énergie : l'éclairage public, les bâtiments communaux, les véhicules municipaux, le réseau de chaleur urbain les réseaux d'eau, services publics délégués. A titre d'exemple, pour l'éclairage, la ville a fait procéder au remplacement de 70 sources ballons fluorescents par des sources sodium haute pression. L'économie d'électricité est de 40 679 kWh/an, soit une baisse de 20 % de la consommation, pour un gain de 59 % de luminosité, avec un surcoût d'investissement de 2550 euros amorti en 18 mois. Si je donne ces précisions, c'est pour répondre à ceux qui affirment que l'environnement coûte cher. La preuve est faite que si nous ne faisons rien aujourd'hui, cela coûtera encore plus cher demain. Au bout du compte, nous avons obtenu une diminution de 5,8 % sur le patrimoine municipal et de 11,1 % sur le réseau de chaleur et le réseau d'eau, soit une diminution de 10,9 % des émissions de gaz à effet de serre en deux ans. C'est un donc un résultat positif et encourageant. Parmi les réalisations concrètes qui ont intégré l'objectif de maîtrise des gaz à effet de serre, deux touchent particulièrement au logement et à l'habitat. Il s'agit tout d'abord de la réalisation d'un programme de 180 logements répondant au label HQE et d'un site de jardins familiaux, sur une surface de 5 hectares, avec une réserve de 20 hectares. La gestion des énergies est l'une des 6 thématiques prise en compte dans le cahier des charges. L'aménagement est conçu pour limiter l'usage de la voiture. Le quartier sera raccordé au réseau de chaleur urbain, dont l'extension introduit le bois énergie en remplacement du fioul et du charbon. La chaudière bois, d'une puissance de 4 MW, couvrira les besoins de 1000 équivalents-logements et permettra d'économiser 94 % de gaz à effet de serre par rapport à un chauffage individuel au gaz sur l'ensemble du quartier. Sur l'ensemble du réseau de chaleur urbain, cette opération permet de réduire d'environ 10 % les émissions de gaz à effet de serre liées à la production de chaleur, ce qui constitue un des objectifs marquants du programme Privilèges. Par ailleurs, la municipalité apporte une aide financière de 100 euros par m2 de capteur pour tout équipement solaire thermique individuel ou collectif installé dans l'habitat chalonnais - chauffe-eau et système combiné eau chaude et chauffage. Cette prime est destinée aux particuliers, aux maîtres d'ouvrage privés, publics et parapublics. Afin de promouvoir l'énergie solaire thermique, la ville organise, avec le soutien technique de l'ADEME Bourgogne, une information auprès des professionnels locaux du bâtiment et de la construction, des installateurs et des fabricants de matériels solaires, ainsi que des collectivités locales de l'agglomération. Ces exemples illustrent bien une de nos priorités : sensibiliser pour responsabiliser. L'autre aspect positif de notre bilan, c'est que l'on parle désormais de développement durable à Chalon. Pendant une semaine, nous avons organisé une campagne de sensibilisation aux économies d'électricité auprès des employés de la mairie pour les inciter à être vigilants. Une campagne de mesure des consommations électriques a été reconduite la semaine suivante. L'analyse des résultats a montré une économie d'électricité de l'ordre de 7 %. Forts de ce résultat, nous allons élargir cette démarche aux ménages et aux particuliers dont nous allons mesurer les consommations en électricité avec l'aide d'EDF à partir d'un quartier que nous avons choisi. Autres cibles de cet effort de sensibilisation : les administrations et les entreprises. A leur intention, nous avons réalisé un guide des bonnes pratiques qui donne toute une série d'informations sur les diagnostics énergétiques et leur permet d'optimiser leur consommation en énergie. Ce document a la particularité d'être actualisé en permanence grâce au réseau d'échanges d'expériences entre les techniciens de collectivités territoriales que nous avions réunis à Chalon en 2003 pour un colloque portant déjà sur le rôle des collectivités territoriales face au changement climatique. Enfin, nous avons donné la priorité à la sensibilisation des citoyens et surtout aux enfants qui sont de formidables avocats de la planète auprès de leurs parents. Pour eux, nous avons réalisé un « guide éco-citoyen » et diffusé dans les établissements scolaires une mallette pédagogique baptisée « 1 degré de plus », qui permet une approche ludique des enjeux de l'effet de serre. J'espère avoir apporté la démonstration qu'une ville de taille moyenne comme Chalon - 52 000 habitants - peut jouer un rôle, ne serait-ce que pour favoriser la prise de conscience de nos concitoyens et les inciter à changer de mentalité. Quand notre ville est choisie pour représenter la France à l'exposition universelle au Japon sur le développement durable, nous sommes fiers. C'est aussi le signe que les questions que nous nous posons sont partout les mêmes. Bien sûr, il y a encore beaucoup à faire pour vaincre le scepticisme car certains ont du mal à croire qu'ils ont une partie de la solution entre leurs mains. Voilà pourquoi, pour ce qui concerne Chalon, nous allons approfondir notre démarche en l'étendant à de nouveaux publics, en l'occurrence la consommation en énergie des ménages et des particuliers, et à un nouveau territoire, en l'occurrence celui de l'agglomération qui couvre 38 communes et 108 000 habitants. Je serais naturellement très heureux d'accueillir votre Mission d'information à Chalon. M. François-Michel GONNOT : Ce que nous venons d'entendre est un bon exemple de comportement responsable et de démarche totalement transversale. Malheureusement, cette attitude n'est pas vraiment majoritaire parmi les 36 000 communes de France. Le premier obstacle est sans doute que les maires ont le sentiment d'être d'abord responsables des services de proximité et de ne pas être là pour sauver la planète d'autant que l'action à leur niveau leur paraît inefficace. On peut néanmoins penser que la conjoncture et la sensibilisation des acteurs les convaincront de la nécessité de rendre vertueuses l'ensemble des collectivités. Face aux problèmes que nous rencontrons tous dans les centres urbains et face à l'augmentation de la consommation d'énergie et de ses coûts, les communes vont être amenées à s'engager résolument dans la lutte contre le changement climatique et pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre sur leur territoire, ce qui leur permettra de réaliser des économies substantielles, d'améliorer le cadre de vie de leurs habitants et de contribuer à la diffusion de pratiques éco-responsables. On estime aujourd'hui que les émissions provenant des collectivités locales représentent 12 % du total. Il y a donc là d'importants gisements d'économies en fonction des décisions d'aménagement de leur territoire, notamment sur les modes de transports et les types d'habitat. Les collectivités détiennent en outre directement le pouvoir d'agir sur les émissions résultant de la gestion de leur patrimoine - flottes de véhicules, bâtiments publics - et de l'exercice de leurs compétences - transports, déchets, chauffage urbain. La prise en compte de la dimension effet de serre au sein des politiques communales contribue à améliorer le cadre de vie par le développement des transports publics, la diminution du trafic automobile et des nuisances qui l'accompagnent, la sensibilisation et la responsabilisation des habitants à la problématique environnementale. L'engagement pris à Kyoto de diviser par quatre nos émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050 est un défi qui suppose des investissements permettant non seulement de promouvoir des pratiques vertueuses mais d'anticiper sur l'entrée en vigueur de règles de plus en plus coûteuses et contraignantes. Des collectivités locales ont déjà lancé des démarches pour agir sur l'énergie, l'habitat, les transports. Outre Chalon-sur-Saône, on peut citer Valenciennes, Rennes, la Communauté Urbaine de Nantes Métropole, les Communautés d'agglomération de Grenoble-Alpes Métropole et de Mulhouse Sud Alsace, le Conseil général des Hauts-de-Seine, la Région Poitou-Charentes et bien d'autres, qui ont adopté des Plans climat territoriaux, passé des contrats ATENEE - Actions Territoriales pour l'Environnement et l'Efficacité Énergétique -, mené des actions dans le cadre des Agendas 21 locaux, lancé des « Défis climat » ou d'autres démarches volontaires. L'Association des Maires de France et ses partenaires, soutiennent et encouragent les actions des collectivités locales de lutte contre les changements climatiques. A ce titre, l'AMF développe des méthodes et des outils pour répertorier les meilleures pratiques et les diffuser aux collectivités qui relèvent ce défi. J'en veux pour preuve notre collaboration avec l'association 4D pour la mise en place d'un Observatoire national des Agendas 21 locaux et des pratiques territoriales de développement durable, ou encore la parution, lors du dernier Congrès des Maires, du guide « un Plan climat à l'échelle de mon territoire » réalisé avec la participation d'Energie Cité, de la MIES de l'ADEME et de l'AMF. Je ne développerai pas l'ensemble des politiques que peuvent mener les municipalités, en particulier en réalisant des audits de la consommation énergétique des bâtiments et des équipements publics existants ; en agissant sur les transports par l'intermédiaire des flottes municipales et des politiques de transports publics ; en réduisant la pollution de l'air et le bruit ; en prenant des mesures urbanistiques adaptée grâce aux Projets d'aménagement et de développement durable, désormais parties intégrantes des PLU. Enfin, les actions de sensibilisation et de communication vis-à-vis de l'ensemble de la population, en particulier en milieu scolaire, sont particulièrement importantes. M. le Vice-Président : Il paraît fort utile que l'AMF répertorie et diffuse les expériences, en particulier pour faire le point sur les coûts et sur les retours sur investissement. Il est également nécessaire de montrer les difficultés rencontrées, nous y reviendrons dans la suite de la discussion. M. Philippe RICHERT : Au sein de l'ADF, la problématique du réchauffement est de plus en plus présente. Au-delà de la prise en compte de la nécessité de réduire les émissions de gaz à effet de serre, c'est surtout d'une démarche développement durable qu'il s'agit, plus de la moitié des départements ayant lancé une politique de développement durable et plus de vingt d'entre eux s'inscrivant dans une démarche d'Agenda 21. Une dizaine sont même engagés dans une démarche, plus en amont encore, de réflexion globale sur l'intégration dans leur politique et leurs engagements d'une démarche citoyenne qui permette d'associer les habitants à ce qui est décidé. Il est normal les conseils généraux s'intéressent au développement durable, d'abord parce que cela relève directement de leurs compétences sur les transports routiers interurbains, ensuite parce qu'ils s'occupent, notamment avec les collèges, d'un parc urbain important, enfin parce qu'ils seront demain responsables de l'aide à la pierre au logement social. Mais leur implication est aussi liée au fait qu'ils sont des interfaces avec les autres collectivités comme avec les citoyens. De ce point de vue, la démarche engagée auprès des collégiens me paraît éminemment citoyenne en ce qu'elle mise sur des répercussions ultérieures sur l'ensemble des familles. Cet engagement des départements peut aller très loin puisqu'ils sont concernés par l'environnement - la moitié d'entre eux disposant d'un schéma départemental des espaces naturels sensibles -, l'aménagement du territoire, le social et le développement économique. Ainsi, si nous sommes tous persuadés qu'il est nécessaire que les collèges soient plus beaux et plus fonctionnels qu'il y a vingt ans, cela nous amène à y consacrer dix fois plus d'argent que ne le faisait l'État et nous devons donc nous interroger sur le rapport qualité-prix. Dans l'attente de la nouvelle décentralisation, mon département a décidé de faire le bilan de la précédente et d'étudier les nouvelles attentes des citoyens. Nous nous sommes ainsi rendu compte qu'elles avaient beaucoup changé en quelques années et qu'au rêve d'habiter une petite maison entourée d'un jardin dans un lotissement, s'était substitué l'envie d'un appartement dans un petit immeuble. Alors qu'on privilégiait jadis la proximité du lieu de travail, désormais le mari et la femme travaillent tous deux à des endroits différents, la mobilité professionnelle s'est accrue et le besoin de planter une petite parcelle de terrain n'est plus aussi affirmé. L'espace de vie est devenu le plus important et la première demande aujourd'hui dans le Bas-Rhin est celle d'un appartement dans une petite copropriété avec des facilités d'accès aux transports en commun ou au moins au réseau routier. Il faut donc aller vers une nouvelle configuration de l'espace départemental en fonction de ces considérations. C'est dans un souci d'anticipation que nous développons par exemple des tramways ruraux jusqu'à 30 km de Strasbourg, afin que l'aménagement du territoire se fasse en fonction non pas de l'offre de terrain, mais d'une conception intelligente du développement durable. Tout ceci ne relève pas du seul conseil général mais aussi des communes et des groupements de communes et il convient donc de s'intéresser ensemble à ces attentes pour apporter collectivement des réponses. C'est pour cela que nous sommes engagés depuis trois ans dans une démarche humaine et territoriale, 2000 personnes ayant participé à une trentaine de réunions thématiques destinées à connaître les attentes des citoyens, et 10 000 à des réunions territoriales qui ont permis de faire un bilan et d'adopter des politiques partenariales. C'est ainsi que les politiques ne sont plus seulement celles du conseil général mais de l'ensemble de la collectivité, en relation étroite avec les citoyens. La nouvelle politique se traduit par une déterritorialisation des services, des contrats de développement des territoires et une action des élus de terrain. En interne aussi, le conseil général a engagé une démarche très poussée et très fine autour de l'Agenda 21, en impliquant l'ensemble des services, mais aussi les élus, en particulier parce que pour quantifier les efforts nous avons besoin de disposer d'un bilan carbone dans l'ensemble du département, non seulement pour le transport mais aussi pour les bâtiments. Quand on développe des transports interurbains, on accroît les rejets de CO2, il faut donc que le gain obtenu par rapport aux déplacements individuels soit plus important. En matière de développement, la problématique des transports doit être envisagée en amont afin d'éviter d'être toujours en train de chercher à rattraper un retard. S'agissant des bâtiments, la démarche HQE c'est les grands principes du développement durable. Dans les collèges, nous avons mis en place des Agendas 21 qui intègrent non seulement l'équipe pédagogique mais l'ensemble de la communauté éducative, y compris les parents. Pour améliorer le rendement énergétique des bâtiments, nous avons changé tous les éclairages intérieurs - et je vois dans cette salle que des progrès seraient possibles simplement en remplaçant les ampoules actuelles par des ampoules à basse tension. Pour éviter que les collaborateurs du conseil général n'empruntent leurs voitures individuelles, nous remboursons la moitié des titres de transport de ceux qui utilisent les transports en commun. Les véhicules du conseil général ont une motorisation hybride, y compris les voitures de fonction, ce qui peut poser quelques problèmes car il n'est pas toujours facile d'arriver à une inauguration dans une voiture japonaise. Il serait donc souhaitable que les constructeurs français produisent de tels véhicules. Nous avons aussi mis en place une politique de déplacement doux, avec 400 km de pistes cyclables financées par le seul conseil général. Nous disposons bien évidemment d'une flotte de vélos de fonction. M. le Vice-Président : Merci. J'observe simplement que les attentes de nos concitoyens ne sont pas les mêmes partout : chez moi ils aiment encore les petites maisons avec un jardin. M. Philippe RICHERT : Je vous assure que les choses ont bien changé en vingt ans : aujourd'hui, même dans des communes de 200 à 300 habitants, on trouve de petits immeubles collectifs. À 30 km de Strasbourg, en deuxième couronne, des villages sont sortis de terre pour des gens qui veulent être facilement desservis transports en commun ou au moins en routes. Dans la quasi-totalité du Bas-Rhin, à l'exception de certaines vallées des Vosges et de l'Alsace bossue, la pression foncière est très forte, ce en raison précisément de ce changement d'attente vis-à-vis de l'habitat. Le conseil général essaie d'intégrer ce changement dans sa démarche. M. Jean DEY : Je pense moi aussi que les gens aspirent encore à un petit pavillon entouré d'un jardin, c'est du moins ce qui ressort des entretiens spontanés. Mais, si on pousse un peu la discussion, on s'aperçoit que les gens cherchent surtout un endroit où il fait bon vivre. Il me semble donc on ne peut pas trop extrapoler à partir de telles enquêtes. La Seine-et-Marne, comme bien d'autres départements, s'est tournée davantage vers le développement durable que vers une vraie politique de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Mais ainsi, tel M. Jourdain et la prose, nous faisons de la prévention sans le savoir. Nous savons que nous devons nous attendre à des événements climatiques extrêmes et que nous allons subir les effets du réchauffement. Pour les illustrer, on prend souvent l'exemple du déplacement des vignobles ou des populations de poissons, mais ces effets sont déjà visibles : en Seine-et-Marne, la période de plantation et de récolte des salades s'est allongée de six semaines en quinze ans. De tels effets peuvent paraître bénéfiques, mais il faut bien sûr aller plus loin dans l'analyse du changement climatique. Département qui couvre la moitié de la surface de l'Île-de-France, la Seine-et-Marne souffre et profite à la fois de sa proximité avec la capitale. Nous sommes actuellement à un moment privilégié de réflexion, autour du SDRIF et du lancement de l'Agenda 21. La partie diagnostic est terminée et la phase d'élaboration des propositions pour l'avenir est en cours. Nous avons en particulier procédé à une analyse de notre vulnérabilité et de nos éléments de non durabilité. Elle montre un déséquilibre entre l'habitat et l'emploi, avec des cités dortoirs qui obligent à de nombreux déplacements essentiellement avec des véhicules privés, un puis deux, voire trois par foyer, que nous sommes au total à 7 millions de kilomètres par jour. L'étalement urbain est mal maîtrisé et il se fait en tache d'huile, sans qu'on tienne assez compte des milieux. On observe aussi une pollution des nappes phréatiques et des réserves en eau, des arrêtés relatifs à la sécheresse ayant déjà dû être pris. Dans le cadre du SDRIF, nous préconisons une maîtrise de l'étalement urbain et un développement durable de l'emploi local en limitant les déplacements par la réservation de surfaces suffisamment bien situées à proximité des grandes infrastructures. On peut aussi se demander quelles doivent être aujourd'hui les priorités, entre la mise à quatre voies de plus de routes ou l'isolation de l'habitat social. Nous allons aujourd'hui vers un plan climat départemental et nous souhaitons disposer des indicateurs propres à éclairer nos choix, dans un cadre budgétaire contraint. Il me paraîtrait également utile de constituer une importante réserve foncière afin de créer une francilienne des transports en commun car, je le rappelle, en Seine-et-Marne la francilienne routière a été saturée le jour même de son ouverture. Une autre mission du département est la couverture du territoire par l'ADSL puis par le très haut débit, par délégation de service public, afin de créer des conditions propices au télétravail. Nous souhaitons aussi proposer un covoiturage de qualité, avec un site Internet dédié, sur le modèle de ce que le département de l'Essonne est en train de faire sur son propre portail ou ce qui existe dans le Finistère. Bien évidemment, nous souhaitons nous inscrire dans une démarche d'exemplarité des collectivités territoriales, en exploitant en premier lieu cette niche d'efficacité énergétique que constitue le patrimoine bâti et en commençant pour cela par un audit de l'ensemble des bâtiments, notamment de nos 125 collèges. Toutes les nouvelles constructions respectent la haute qualité environnementale. Pour notre parc automobile, nous privilégions les véhicules propres et à basse consommation. Dans le cadre de notre politique contractuelle nous développons une politique d'incitation en direction des collectivités locales et nous favorisons toutes les démarches intégrant le développement durable. Pour les transports, dans le cadre du réseau « 77 express », nous expérimentons l'introduction de 30 % de diester dans les transports collectifs, ce qui ne sera peut-être pas spectaculaire en termes de réduction des émissions, mais aura valeur d'exemple et de sensibilisation. J'observe toutefois que si on parle beaucoup du développement des biocarburants, il n'est pas facile de s'engager dans cette voie, les fabricants refusant de garantir les véhicules que nous utilisons dans le cadre de cette politique. Dans le même esprit, les motoristes demandent des subventions pour transformer les moteurs et Total facture le gazole coupé de biocarburants au même prix que le gazole normal. Dans le cadre d'une grande étude ad hoc nous en sommes davantage au stade du diagnostic en ce qui concerne les transports fluviaux et de la réactivation de certaines lignes stratégiques de la SNCF. Avec l'introduction de produits « bio » dans la restauration scolaire, nous voulons développer une filière amont locale et structurer l'offre. Les enjeux en matière d'eau sont très importants en Seine-et-Marne. Avec la sécheresse que nous connaissons depuis plusieurs années, un problème de quantité s'est ajouté aux problèmes de qualité. Le schéma départemental vise à sécuriser et à pérenniser la ressource en eau. Contrairement à ce que déclare le Président du syndicat des eaux d'Île-de-France, les interconnexions ne sont pas réalisées dans toute la région. Faute d'une alimentation sécurisée dans de nombreuses communes, si les sécheresses se multiplient, comme c'est probable, le risque de manque d'eau va s'accroître. C'est pour cela que nous avons adopté ce schéma curatif. Il faut par ailleurs susciter une certaine solidarité intercommunale afin de mutualiser les moyens. Nous avons besoin pour cela de l'aide de l'Association des maires de Seine-et-Marne et des services de l'État. En Seine-et-Marne comme ailleurs, les villages de moins de 1500 habitants ne sont pas alimentés en électricité par EDF mais par des syndicats d'électrification rurale. La distribution est très mal structurée dans notre département où il existe encore des réseaux de fils nus qui ne seraient pas protégés en cas de nouvelle tempête. Il faut donc essayer d'aller vers un syndicat départemental. Une telle mutualisation des moyens permettrait en outre d'être plus performants dans la mise en place du courant porteur en ligne. Enfin, nous nous sommes lancés dans la réalisation d'un atlas départemental de la biodiversité, où les continuités biologiques seront répertoriées dans le but d'être sauvegardées - Peut-être constitueront-elles un jour une voie de repli vers le nord de la faune et de la flore ? C'est également dans l'esprit du développement durable que s'inscrit l'aide du Conseil général à la réserve de biosphère du pays de Fontainebleau, pour soutenir la mise en œuvre d'une filière bois. M. le Vice-Président : Je vous remercie. Nous recevons tout à l'heure les motoristes et nous leur poserons la question des biocarburants d'autant qu'un rapport complémentaire sur ce sujet sera préparé avant l'été. Mme Élisabeth DUPONT KERLAN : Les régions interviennent à divers titres dans la lutte contre le changement climatique, en particulier pour la réduction des gaz à effet de serre, se situant en fait sur les mêmes thèmes que les départements, mais avec des différences de compétences et de territoires. En tant que maîtres d'ouvrage et gestionnaires, leurs actions concernent : les lycées, au titre de la construction comme de la réhabilitation ; les bâtiments des services de la région ; la prise en compte des critères de qualité environnementale, notamment dans le domaine énergétique. Certaines élaborent aussi des Agendas 21, des plans de déplacement d'entreprises, des actions de sensibilisation du personnel. De façon plus générale, la démarche de développement durable est inscrite dans les orientations politiques. Elles interviennent également en tant que porteuses des politiques publiques. Dans le domaine des transports, les régions sont compétentes depuis 2002 en matière de trains express régionaux et mènent une politique dynamique pour favoriser l'usage de ces transports collectifs : augmentation de l'offre, horaires cadencés, investissements importants pour le renouvellement du matériel souvent bi-mode, diesel et électrique, pôles d'échange intermodaux en lien avec les autres collectivités. Leurs interventions de plus en plus fréquentes dans le transport ferroviaire sont cohérentes avec l'allongement des déplacements des habitants, qui résident désormais plus souvent à 25 qu'à 15 km du centre-ville. Elles développent aussi des politiques en faveur des modes doux, en particulier du vélo. Les régions sont également susceptibles d'acquérir de nouvelles compétences dans les domaines des ports et des aéroports, la loi d'août 2004 prévoyant la décentralisation de ces grands équipements. Il est un peu tôt pour savoir comment cette nouvelle vague de décentralisation jouera sur les schémas de déplacement. Un levier important pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre peut être aussi la préparation des futurs contrats de plan État-régions. Dans le domaine du développement économique et de l'aménagement, qui sont des compétences traditionnelles des régions, celles-ci prennent de plus en plus en compte les critères environnementaux dans l'attribution des aides. Certaines favorisent les éco-entreprises, aident au management environnemental dans les entreprises, soutiennent des actions de recherche ou d'innovation, s'impliquent dans les pôles de compétitivité sur ces sujets. Plusieurs commencent à élaborer un Plan Climat régional. Dans le domaine de la formation, de l'éducation et de la sensibilisation, diverses actions visent l'éducation à l'environnement, souvent en lien avec des associations ou des observatoires, et en particulier en direction des lycées dont les régions ont la responsabilité. Elles interviennent de manière complémentaire pour promouvoir une utilisation rationnelle de l'énergie et l'usage d'énergies renouvelables. Cela peut prendre la forme de conseils et d'aides aux particuliers notamment en faveur du bois et du solaire, mais aussi d'un soutien à des actions de recherche. Les régions sont initiatrices ou partenaires de politiques contractuelles. Elles développent pour cela depuis plusieurs années un partenariat avec l'ADEME. Au sein de l'ARF et de sa commission développement durable, nous essayons de favoriser les échanges d'expériences entre régions. M. le Président : Je vous prie d'excuser mon retard, mais j'étais retenu par une autre réunion. M. Ronan DANTEC : On a dit que les maires avaient le sentiment de ne pas pouvoir faire grand-chose à leur échelle, mais c'est bien au niveau local que les choses commencent. Faisons un petit calcul : Nantes Métropole représente 600 000 habitants, soit 0,05 % de l'ensemble des grands émetteurs individuels à l'échelle de la planète, qui sont 1,2 milliard. Ce n'est absolument pas négligeable. Animateurs d'un terrain urbain déjà important en termes quantitatifs, nous avons donc une véritable responsabilité d'autant que l'enjeu est connu : atteindre le « facteur 4 » d'ici 2050. Et c'est bien afin d'atteindre l'objectif de Kyoto que Nantes Métropole a engagé un Plan Climat territorial. Nous parvenons aujourd'hui à une véritable sensibilisation des élus, à tel point que l'Agenda 21 a été adopté à l'unanimité en février dernier. Notre Plan Climat territorial est déjà en partie engagé. Mais, de 1,7 million de tonnes d'équivalent CO2 hors industrie en 1990, nous sommes passés à 2,10 millions aujourd'hui. Si nous voulons atteindre nos objectifs du protocole de Kyoto, il va donc falloir descendre très rapidement et pour cela mettre en cohérence l'ensemble des politiques publiques afin de gagner 1,2 million de tonnes d'ici 2025. Une première étude a montré où devaient plus particulièrement porter les efforts. En matière de transport, l'objectif de ramener à 48 % la part de la voiture individuelle doit faire gagner 440 000 tonnes, soit un tiers de l'effort total. Cela suppose de faire passer, en vingt ans, de 100 à 200 millions le nombre de passagers des transports collectifs chaque année, soit un rythme de 4 à 5 % d'augmentation par an, que nous tenons depuis cinq ans. Il faut donc maintenir notre effort. Il convient aussi d'améliorer l'isolation des bâtiments anciens construits dans les années 1970-1980. Sur ces 5 millions de mètres carrés, le gain potentiel est de 200 à 250 000 tonnes. C'est particulièrement intéressant par rapport au solaire thermique pour lequel même un équipement important ne fait guère gagner que quelques dizaines de milliers de tonnes. L'échelle n'est donc pas la même et nous voyons clairement où est la priorité. Le développement du chauffage urbain et de la filière bois doit avoir un impact de 100 à 150 000 tonnes, en particulier grâce au déploiement des réseaux de chaleur. À cela s'ajoute un gain de 60 à 80 000 tonnes grâce aux biocarburants, avec une augmentation de l'incorporation conforme à ce que prévoit la loi. Au total, on arrive bien à 1,2 million de tonnes, ce qui signifie qu'atteindre l'objectif est possible à l'échelle d'un grand territoire comme le nôtre et donc que, grâce à un effort considérable et systématique, on peut agir sans se contenter de danser sur le pont du Titanic. Sur un certain nombre de sujets, nous en sommes encore au stade des études, mais nous devrions être capable de voter en février prochain le Plan Climat territorial qui précisera les engagements de la collectivité à courte et à moyenne échéance. Je souhaite pour finir prendre l'exemple, un peu emblématique de l'effort collectif, d'un territoire particulier, l'île de Nantes, avec le passage de 15 000 à 30 000 habitants. Nous avons cherché auprès de l'ADEME tout ce qu'il était possible de faire et nous l'avons mis en œuvre : espace info énergies, opération programmée d'amélioration thermique des bâtiments, action territoriale pour l'environnement et l'efficacité énergétique. Cette dernière nous a permis de lancer un certain nombre d'études et de nous positionner ainsi sur CONCERTO, programmes européens sur les énergies renouvelables, qui va nous offrir un levier de 10 millions d'euros. Nous nous sommes aussi intéressés au développement des réseaux de chaleur. Aujourd'hui, nous avons de la sorte une stratégie globale qui nous permet de répondre au doublement de la population et du nombre de bureaux sans augmentation de la consommation en énergies fossiles ni de l'électricité d'origine nucléaire. La dynamique d'ores et déjà engagée nous fait penser que nous allons tenir cet objectif. Grâce au réseau de chaleur, l'industrie devient plus durable puisqu'elle dispose d'une énergie garantie à moyen terme. Nous développons toute une filière de recherche avec une pépinière d'entreprises sur les questions de l'énergie et de l'efficacité énergétique, constituant ainsi un important gisement d'emplois. Nous créons la plus grosse centrale photovoltaïque de l'Ouest français sur le toit du centre commercial. Nous engageons des moyens importants d'information. Nous améliorons l'existant grâce à l'OPATB. L'ensemble de cette dynamique permet d'atteindre l'objectif quantitatif pour ce territoire. Mais il est sans doute intéressant, dans le cadre de ce débat, d'exposer nos difficultés. En dépit de la nouvelle loi d'orientation, il est essentiel d'éclaircir les compétences : comment peut-on assumer le rôle d'autorité organisatrice de l'énergie dans le maquis juridique actuel ? Nous avons impérativement besoin de savoir jusqu'où nous pouvons aller. Il me semble par ailleurs que le Plan Climat territorial devrait être un outil juridique qui, un peu comme les schémas d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE), s'impose aux autres documents d'urbanisme, SCOT, PADD et autres PLU. Car en termes de lutte contre l'effet de serre, la densification de l'habitat apparaît primordiale : il faut éviter cet étalement urbain culturel mais aussi contraint, en raison du prix du foncier, et « redensifier » la ville avec une vision novatrice de l'habitat, qui permette de conserver le confort et l'intimité auxquelles chacun est attaché, et d'être en lien avec les grandes infrastructures de transport. Par ailleurs, alors que gagner sur l'énergie représente des investissements, la récupération se fait à moyen terme sur du fonctionnement. Or nos enveloppes d'investissement sont extrêmement contraintes. Il faut chercher le moyen de basculer l'investissement énergétique vers le fonctionnement, faire preuve pour cela d'imagination en matière de fiscalité et de comptabilité publique, peut-être aussi faire intervenir les grands opérateurs qui pourraient vendre de l'isolation et récupérer sur une facture à moyen terme. Tout cela est assez compliqué mais très important. Enfin, on ne saurait oublier tout ce qui concerne l'adaptation des territoires aux changements climatiques, qui interviendront même si nous parvenons à limiter nos émissions de gaz à effet de serre. Chez nous, cela va se jouer dans le domaine de l'eau. Nos systèmes de gestion des niveaux d'eau sur l'Erdre sont déjà remis en cause par le changement climatique. Des conflits d'usage apparaissent déjà et il est donc évident qu'il faut immédiatement commencer à adapter les territoires aux changements climatiques, tout en essayant de le limiter ; c'est une des grandes responsabilités de la génération politique actuelle. M. le Président : Le chiffre de 5 millions de mètres carrés à isoler paraît bien faible. M. Ronan DANTEC : Il s'agissait des mètres carrés prioritaires. Au total, on va arriver à 20 millions de mètres carrés ciblés. M. Gérard MAGNIN : Énergie Cités est une association de municipalités européennes qui regroupent 500 collectivités locales de 25 pays. Elle a été créée il y a quinze ans et cela lui donne un point de vue privilégié sur ce qui se passe dans les collectivités en matière de politique énergétique locale durable. Il y a maintenant un certain temps que nous travaillons en France sur ces sujets et que nous sommes dans des actions menées avec la MIES et l'ADEME, en particulier dans des études et dans la rédaction récente du Guide du Plan Climat territorial. Nous consacrons beaucoup de temps à mettre en valeur les actions des autorités locales, y compris celles qui sortent de l'ordinaire, afin de montrer leur dynamisme. Mais peut-être sommes-nous ici avant tout pour développer un certain point de vue critique. En fait, je pense qu'on ne peut pas faire du « facteur 4 » sans le savoir, comme M. Jourdain faisait de la prose, tout simplement parce que cela impose des réductions drastiques de consommations, y compris aux collectivités qui sont déjà les plus engagés. Ainsi, les actions menées par exemple par la ville de Chalon-sur-Saône, qui sont exemplaires, et qui impliquent la population donnent au final des résultats, qui ne permettent pas d'atténuer sensiblement la tendance actuelle. Bien sûr, il est bon de le faire des efforts sur le patrimoine communal mais n'oublions pas qu'il ne représente que 3 % de la consommation en énergie de l'ensemble d'un territoire. Au bout du compte, nous ne sommes pas actuellement sur une tendance de « facteur 4 ». S'il existe, je l'ai dit, un guide du Plan Climat territorial, personne n'assure sa promotion. Par ailleurs, la ville de Rennes, que ces sujets motivent, a pris l'initiative d'organiser les 14 et 15 juin une première rencontre interrégionale Climat et Territoires, mais la MIES ne suit pas. Avant d'aborder la question des quotas territoriaux d'émissions, il conviendrait sans doute d'envisager que les plans climat territoriaux deviennent de véritables documents d'urbanisme contraignants. Lors de l'examen de la loi du 13 juillet, nous avions proposé en vain qu'on institue l'obligation pour les agglomérations de plus de 100 000 habitants de se doter d'un tel plan avant la fin 2008. On voit bien, une fois de plus, combien il est difficile de passer à l'acte politique. Car personne ne sait vraiment ce qu'on attend des plans climats territoriaux et il n'est prévu aucune promotion ni incitation à les mettre en œuvre. Nous aurions pourtant bien besoin que ce document s'impose aux autres et soit pris en compte par toutes les politiques sectorielles car si certains se préoccupent beaucoup du climat, d'autres continuent à ne pas s'en soucier. Ainsi, une assez grande agglomération littorale vient d'adopter un schéma de cohérence territoriale, un SCOT, où ne figure même pas l'expression « changement climatique ». On voit bien qu'il n'y a pas encore dans notre pays une véritable culture en la matière. Les futurs contrats de projets sont une véritable chance d'imprimer une orientation différente en y introduisant précisément la notion de Plan Climat territorial, non pas seulement pour afficher les objectifs, mais en y conditionnant le financement de certaines opérations. L'habitat social est une autre question très importante, en particulier en ce qui concerne les programmes de rénovation urbaine. On va construire 500 000 nouveaux logements sociaux, en rénover plusieurs centaines de milliers, mais sur la base d'une consommation de 120 kWh par mètre carré et par an, c'est-à-dire comme on construit actuellement et non en fonction de ce qu'ils devraient consommer en 2050 afin de mettre leurs habitants à l'abri de la précarité énergétique, c'est-à-dire 40 kWh/m2/an. Car il faut être bien conscient que même la haute qualité environnementale n'est pas aujourd'hui dans une logique de facteur 4. En revanche, quand le coût du chauffage pour un logement est de 10 euros par mois, comme à Fribourg, là les occupants sont protégés. Nous avons organisé le mois dernier, pour le compte de la communauté urbaine de Dunkerque, les septièmes assises nationales de l'énergie, qui portaient sur le bâtiment. Nous avions invité à cette occasion le directeur de l'ANRU. Celui-ci a envoyé une de ses collaboratrices se faire siffler pendant les 10 minutes de son intervention parce qu'elle n'a pas pu donner un seul exemple de prise en compte de cette question dans le programme de l'ANRU. Pour nécessaire qu'elle soit, l'initiative locale ne peut résoudre les problèmes à elle seule et nous avons donc besoin aujourd'hui de signaux politiques. Je suis pour ma part persuadé qu'il s'agit de questions culturelles plus que techniques. On doit apprendre à travailler autrement. Nous avons lancé la campagne Display : climat, énergie et bâtiment, qui consiste à afficher sur de grands posters la consommation énergétique des bâtiments municipaux. Ce mouvement se développe dans plusieurs centaines de villes d'Europe, des milliers de bâtiments sont impliqués, beaucoup de collectivités françaises se sont engagées spontanément, mais nous nous sentons une certaine réticence des institutions qui pourraient faire la promotion nationale de cette campagne. Cela montre bien qu'on a besoin de ces signaux plus clairs qui mettraient davantage en accord le préambule de la loi du 13 juillet et les mesures qui doivent concourir à son application. M. le Président : Nathalie Kosciusko-Morizet et moi-même avons écrit au directeur de l'ANRU qu'il y avait là un gisement et que si on ne montrait par l'exemple dans le logement social on n'y arriverait pas. Je le rappelle souvent, j'ai été à la fois l'auteur par rapport sur les énergies nouvelles et le Président d'un office HLM où j'ai appliqué entièrement la haute qualité environnementale et la haute préférence énergétique, ce qui m'a donné l'occasion de m'apercevoir que cela entraînait un surcoût bien supérieur à ce qu'on nous dit habituellement. Je suis néanmoins favorable à ce qu'on fixe un objectif de 50 kWh/m2/an, mais il faut vraiment trouver des solutions pour réduire ce surcoût car même si on obtient ainsi une diminution des charges hautement souhaitable, car on ne peut plus parler d'habitations à loyer modéré quand la part des charges est aléatoire, il faut bien que quelqu'un supporte l'investissement immédiat. Peut-être faudrait-il en faire une condition à l'occasion de toutes les mutations. Quoi qu'il en soit, exploiter toutes ces pistes me paraît essentiel dans le cadre du rapport de notre mission. Il me semble par ailleurs que l'idée que le plan territorial s'impose aux autres documents d'urbanisme est bonne. M. Serge POIGNANT : Tous les intervenants ont insisté sur le fait que le transport et le logement, neuf comme ancien, sont les véritables priorités. M. François Michel GONNOT : En effet, pour le logement social, le surcoût de l'investissement est un vrai problème. Il faut donc vraiment essayer de modifier la règle d'imputation sur les charges, en particulier pour le chauffage collectif : c'est le seul moyen d'être vraiment vertueux. La contrainte pesant sur leurs budgets amène les organismes HLM à faire en matière d'énergie des choix qui ne sont pas vraiment les plus économes. Mais les déclarations d'intentions ne suffisent pas. Dans la loi sur l'air de 1996, et avait adopté un amendement imposant qu'on prévoit un conduit les cheminées dans toute construction neuve afin de ne pas condamner les occupants à recourir à tout jamais à la mono énergie électrique dominante. Il est tout simplement ridicule que le décret d'application n'ait jamais été pris. M. le Président : C'est la même chose pour les détecteurs de monoxyde de carbone ! M. François Michel GONNOT : Pour l'éclairage public, quand on survole la nuit nos métropoles, il est effrayant de constater que les axes fréquentés ne sont pas éclairés alors que d'immenses zones industrielles le sont. S'agissant des gestes vertueux, le fait d'avoir exonéré récemment les collectivités locales du dispositif qui fait que les personnes morales paient aujourd'hui l'énergie 30 à 40 % plus cher, n'est guère de nature à inciter les élus à corriger leur politique énergétique. Il faudra bien, dans le cadre de l'ouverture totale le 1er juillet 2007, que l'on prenne les dispositions qui nous permettent d'être exemplaires. M. François DOSÉ : Le poids de l'énergie dans le budget des collectivités locales fait qu'on est de toute façon attentifs à ces questions. On a parlé de l'exemplarité des services territoriaux, maîtres d'ouvrage ou gestionnaires, et du rôle de leader que peuvent avoir les responsables de collectivités territoriales quand ils discutent avec des partenaires publics et privés. Mais imagine-t-on qu'une collectivité territoriale puisse imposer une condition de performance énergétique pour l'octroi d'un financement à une autre collectivité ? L'AMF a-t-elle connaissance de telles pratiques ? Par ailleurs, dans la commune, depuis six ou sept ans, tous les 15 jours, les restaurants scolaires servent un repas bio. Mais cela est plus cher de 30 %. Comme je suis lâche, c'est la ville qui paie, mais tous ceux qui viennent nous donner des leçons sont-ils concrètement prêts à payer plus cher les repas de leurs enfants parce que cela s'inscrit dans l'effort pour aller vers le « facteur 4 » ? M. Ronan DANTEC : Il nous est impossible d'imposer aux opérateurs privés qui construisent dans nos villes d'aller dans le sens de l'efficacité énergétique : comment leur demander, au bout du compte, de renoncer à un étage du bâtiment pour l'équiper en production d'énergie renouvelable ? A défaut de pouvoir, comme la ville de Barcelone, obliger les promoteurs à faire du solaire thermique, le nouveau PLU de Nantes prévoit que les installations d'énergie renouvelable ne seront pas comptabilisées dans le volume global du bâtiment. Il serait donc bon de faire évoluer la loi sur ce point, ainsi que sur le raccordement au réseau de chaleur hors ZAC car quand quelqu'un investit dans un tel réseau, il faut être sûr que les gens pourront s'y connecter. Aujourd'hui, tout le lait de la restauration scolaire nantaise est bio. Faute de disposer d'une filière adaptée, nous avons créé un réseau de toutes les collectivités à l'échelle du grand Ouest afin que nos appels d'offres permettent précisément de structurer cette filière. Il me semble par ailleurs qu'on peut contester l'argument du coût immédiat : la région de Munich a imposé du bio tout autour de la ville, parce que cela lui permet aussi d'avoir une eau de bonne qualité est donc de beaucoup moins investir pour la gestion de l'eau. À l'inverse, nous avons aujourd'hui de sérieux soucis en matière phytosanitaire. S'agissant du salaire thermique, l'article 13 de la loi de 2003 sur l'énergie prévoit l'installation d'un million de mètres carrés de capteurs chaque année jusqu'en 2010. Là non plus, le décret n'a pas été pris. Il conviendra donc que nous insistions sur ces aspects. M. Alain GEST : Si le seul frein tient au fait qu'un décret ne paraît pas, il paraît quand même facile de le lever. S'agissant des initiatives que prennent les collectivités locales elles-mêmes, les toitures terrasses des bâtiments scolaires paraissent bien adaptés à la pose de panneaux. Pourquoi en voit-on aussi peu ? M. Jean DEY : En Seine-et-Marne, dans le contrat départemental de développement durable, si on ne peut rien imposer, il est possible, notamment sous la forme de contrats bonifiés, d'encourager une collectivité qui s'engage dans une démarche HQE. Sur le bio, une intéressante étude autrichienne est disponible auprès de l'Agence française. M. Serge POIGNANT : Il me semble que pour le solaire thermique - chauffe-eau solaire-, il s'agit surtout d'un problème de communication et d'incitation des artisans car le dispositif des 50 % de crédits d'impôt doit fonctionner. Pour le photovoltaïque, il ne faut pas confondre les centrales thermiques solaires qui permettent de concentrer l'énergie, par exemple à l'échelle d'un supermarché, et le photovoltaïque individuel qui reste beaucoup trop onéreux. M. Gérard MAGNIN : Il est vrai qu'il peut y avoir un surcoût, mais il ne faut pas se laisser aveugler par cela car souvent on se contente de réaliser une opération pilote sans passer à la phase ultérieure qui seule permettrait des économies d'échelle. Qui plus est, cette opération pilote bénéficie de subventions ce qui incite tous les opérateurs à augmenter leurs tarifs et c'est sur cette base qu'on calcule le surcoût. Si on décidait de rénover des centaines de milliers de mètres carrés de logements, le coût de l'apprentissage serait bien mieux réparti. Les villes qui ont lancé ce mouvement il y a une quinzaine d'années arrivent aujourd'hui à un coût sensiblement équivalent à celui du marché. Il n'est pas toujours beaucoup plus cher de faire bien, pour peu qu'on s'y consacre vraiment. M. le Président : Nous avons beaucoup entendu que cela n'était pas « beaucoup plus cher », mais nous aimerions quand même qu'on nous fournisse des études comparatives sur les résultats en termes de consommation et sur les surcoûts. Si vous nous le prouvez, nous l'écrirons. M. Ronan DANTEC : La médiathèque nord de Nantes, qu'on vient d'inaugurer et qui est un bâtiment HQE, a été construite à un coût du mètre carré qui en fait un bâtiment pas très cher. Sur l'île de Nantes, où nous avons la volonté d'aller très loin dans la promotion des énergies renouvelables, les promoteurs devront les intégrer sans surcoût et je suis persuadé que la concurrence les y poussera. M. le Président : Je vous remercie d'avoir participé à cette audition. Table ronde sur le rôle des constructeurs automobiles dans la lutte contre le changement climatique, réunissant : Présidence de M. Jean-Yves LE DÉAUT, Président M. le Président - Je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation. Je vais tout d'abord vous donner la parole, avant d'entamer le débat, mais je vous serais reconnaissant de ne pas être trop longs dans vos interventions. Il s'agit de faire le point sur la prise en compte par les constructeurs automobiles des objectifs de la lutte contre le changement climatique, en particulier la réduction des émissions de gaz à effet de serre. On a le sentiment que les efforts accomplis sont récents. Vous nous direz ce qu'il en est. Par ailleurs, il semble que, si les sociétés font de la publicité autour de modèles qui consomment peu, elles en fabriquent aussi d'autres qui consomment beaucoup plus, d'où un bilan global pas si satisfaisant que cela. Dans quelles conditions peut-on atteindre l'objectif de 120 grammes d'émission de CO2 par kilomètre ? Quelles sont aujourd'hui les limites des moteurs ? Enfin, quelles sont vos stratégies, par rapport au diesel, à l'hybride, aux perspectives hydrogène, aux piles à combustible ? Mme Thérèse MARTINET : Incontestablement, la réduction de l'effet de serre est un enjeu essentiel pour l'industrie automobile, à côté de la sécurité routière et de la mobilité urbaine, non que l'automobile soit la cause principale de l'effet de serre, mais leurs émissions de CO2 ne se réduisent pas suffisamment malgré les progrès technologiques de ces dernières années. Cela étant, sur le plan mondial, c'est en France que les émissions moyennes de CO2 sont les plus basses. Pour ce qui est des voitures de PSA Peugeot-Citroën, leurs émissions de CO2 sont basses en moyenne, à tel point qu'en 2005, PSA Peugeot Citroën représentait 30 % de parts de marché des véhicules émettant moins de 120 grammes de CO2 par kilomètre en Europe, contre 15 % tous véhicules confondus. Quels sont les leviers sur lesquels on peut agir pour réduire les émissions de CO2 ? L'aérodynamique, le travail sur la résistance au roulement, la réduction de la masse globale - malgré les attentes des clients et la réglementation automobile qui conduisent plutôt à l'augmenter -, et enfin le groupe moto propulseur, qui est l'élément le plus porteur, et sur lequel nous travaillons tout particulièrement. Nous ne négligeons pas pour autant les autres éléments, mais ils nous permettent plutôt de compenser les augmentations d'émission de CO2 liées, par exemple, en aérodynamisme, au fait qu'on doit faire un design qui respecte les contraintes du choc piéton. Notre objectif est de trouver des solutions économiquement diffusables à grande échelle, afin qu'elles aient un effet sur l'environnement. Dans ce cadre, nous devons améliorer les chaînes de traction existantes, inclure les énergies alternatives, engager des travaux sur les hybrides et les piles à combustible. Le moteur Diesel reste la solution la plus efficace, dans l'immédiat, pour réduire les émissions de CO2. Plus de huit millions de moteurs « HDi » ont été vendus, depuis 1998, dont 1,5 million avec filtre à particules, système qui a permis de mettre fin aux derniers inconvénients du moteur diesel sur le plan environnemental. Le moteur HDi est un progrès par rapport à la génération précédente, en ce qu'il a permis de réduire de 15 à 20% les consommations et émissions de CO2, selon les applications, mais aussi de diminuer les émissions de polluants à la source, et d'améliorer les niveaux de bruit et de vibrations. Et l'on continue à travailler sur la combustion homogène, pour améliorer encore la motorisation Diesel. Les motorisations essence ont encore un potentiel important. En coopération avec BMW, nous déployons les meilleures technologies essence sur un grand nombre de véhicules - matériaux, process, injection directe, suralimentation, gestion électronique, contrôle moteur - afin de réduire la consommation de carburant, les émissions, et d'améliorer le contrôle pollution. Mais ce sont des technologies qui coûtent encore cher. Par ailleurs, on reste convaincus que l'on peut encore réduire les émissions de CO2 grâce aux boîtes de vitesse manuelles pilotées - SensoDrive et 2 Tronic pour les moteurs petits et moyens, et la nouvelle boîte compacte MCP pour la gamme moyenne et haute, que nous allons bientôt lancer sur Valenciennes. Ces boîtes permettent de réduire de 5 % les émissions de CO2, ce qui est important, compte tenu de tous les efforts que l'on doit déployer pour obtenir un gain ne serait-ce que de 1 %. Et leur coût est acceptable. Les biocarburants sont une autre solution immédiatement exploitable. On peut garantir les motorisations Diesel jusqu'à 30 % de diester, et s'agissant de l'éthanol, nous avons une expérience importante au Brésil, avec des motorisations à 25 % d'éthanol en moyenne, et le système Flex Fuel (jusqu'à 85 % d'éthanol). Le GNV, du point de vue de l'émission de CO2, est presque aussi intéressant que la motorisation Diesel. Il reste la question de la distribution. On travaille à l'optimisation d'un moteur cylindré 1,6 litre, et à l'optimisation du véhicule, avec en particulier le problème du stockage, pour réduire la masse du réservoir avec un matériau composite. On a bon espoir d'arriver à un véhicule qui ait une autonomie satisfaisante pour le client, même en tout GNV. Pour ce qui est du Stop and Start, on utilise un peu d'électricité, mais seulement au démarrage. On commence à travailler avec cette technologie un premier stade d'hybridation. La première génération de Stop and Start permet de gagner jusqu'à 6 % en circulation urbaine dense, et la deuxième génération aura de meilleurs résultats encore, avec une machine électrique un peu plus puissante, de 4kW, et l'ajout d'une fonction de récupération d'énergie au freinage. L'hybridation est aussi une solution, à condition d'utiliser la technologie thermique la plus performante, donc le diesel. L'enjeu est de réduire les surcoûts de cette technologie, qui reste chère, l'objectif étant de diviser par deux les surcoûts actuels, pour atteindre un niveau de surcoût entre l'hybride diesel et le diesel du même ordre de grandeur qu'entre le diesel aujourd'hui et l'essence. La pile à combustible nous entraîne vers un avenir beaucoup plus lointain, car l'utilisation d'hydrogène pose de nombreux problèmes techniques, économiques, et d'acceptabilité par les clients. Ces travaux sont en cours. Nous avons pu aboutir à une première étape, la pile GENEPAC, développée avec le CEA, pile compacte modulaire qui peut atteindre 80 KW. L'objectif est d'utiliser cette pile en range extender. Au total, pour les ruptures technologiques par rapport au moteur thermique, il s'agit de faire de l'hybride diesel une technologie au coût acceptable. M. Alain GEST : Qu'est-ce au juste qu'une boîte manuelle pilotée ? Mme Thérèse MARTINET : C'est une boîte manuelle dont les vitesses sont pré-réglées. Ce n'est pas le conducteur qui les passe. Mme Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET, Rapporteure : C'est donc de l'automatique ? Mme Thérèse MARTINET : Non, car il n'y a pas de convertisseur. M. Luc-Alexandre MENARD : Nous sommes sur la bonne voie. La moyenne de Renault, en France, est de 147 grammes, obtenus malgré l'aggravation des contraintes règlementaires depuis la date à laquelle nous nous étions engagés à aller vers 140 grammes. Quelques véhicules sont remarquables, la Clio 3 nouvelle, qui fait 118 grammes, ce qui est très faible, la Mégane, 120 grammes. Par ailleurs, cette progression n'est pas réservée à ces quelques véhicules emblématiques. Entre 2001 et 2004, en France, le nombre de véhicules émettant entre 101 et 120 grammes de CO2 a augmenté de 270 000, entre 120 et 140 grammes de 168 000, alors que ceux émettant entre 140 et 160 grammes sont 270 000 de moins, et ceux émettant entre 161 et 200 grammes, 272 000 de moins. Dans le cadre du plan Renault 2009, nous nous sommes engagés à vendre un million de voitures émettant moins de 140 grammes de CO2 par kilomètre, dont un tiers moins de 120 grammes, ce qui représente une véritable rupture. Pour atteindre cet objectif, nous agirons sur cinq leviers. Tout d'abord, avec Peugeot-Citroën, nous allons continuer à développer la diésélisation, car l'industrie française en général, et Renault en particulier, est bien placée sur les petits Diesel. C'est un grand avantage compétitif de la France, que nous souhaitons maintenir, ne serait-ce que pour l'emploi. Si aux seuls États-unis, 30 % du parc était diesel, les gains seraient de 125 millions de tonnes de CO2, soit l'équivalent des émissions de CO2 des transports routiers en France. Nous devons aussi travailler sur les biocarburants, et nous sommes favorables au développement de la première génération. On sait que la France a pris des options politiques fortes en ce domaine. Nous nous sommes engagés à ce que les moteurs Diesel puissent fonctionner avec un taux de 30 % de diester, et nous allons importer du Brésil la technologie FlexFuel. Une Clio FlexFuel était d'ailleurs présentée lors du dernier salon de l'agriculture. Mais le plus important est peut-être d'aller vers les carburants synthétiques. Nous avons créé hier à Bruxelles, avec nos collègues de Volkswagen, Daimler-Chrysler, Shell et Chevron, une association pour le développement de ces carburants synthétiques. Par ailleurs, nous gardons l'hybride en réserve. Nous disposons de la technologie avec Nissan aux États-unis -Nissan mettra d'ailleurs sur le marché américain des voitures hybrides dans les prochains mois - mais le surcoût actuel n'est pas acceptable pour les clients. Si le coût d'abattement d'une tonne de CO2 pour un véhicule Diesel est de 80 euros, il se situe entre 400 et 600 euros pour un véhicule hybride. Il faut aussi penser, de temps en temps, aux clients. Par ailleurs, Renault reviendra sur les véhicules électriques. Nous y travaillons et nous sommes en liaison avec les partenaires japonais pour développer des piles et des batteries. Il y a un marché pour le véhicule électrique, et nous y reviendrons dans le cadre du plan 2009. Enfin, avant la fin du plan, probablement en 2008, nous ferons rouler en France un démonstrateur avec piles à combustibles. Cela étant, il faut aller plus loin, et favoriser ce que la commission de Bruxelles appelle une « approche intégrée » ou « globale ». Nous devons tout d'abord orienter le client vers le véhicule qui émet le moins de CO2. Nous en sommes au début. Le CO2, vous et moi savons ce que c'est, mais les clients et les vendeurs, pas encore. Aussi l'étiquetage est-il une première mesure que nous avons adoptée avec nos collègues de PSA, et nous devons former les vendeurs pour orienter les clients. Par ailleurs, nous ne devons pas nous voiler la face, car le vrai problème, c'est le parc. 80 % du parc français aujourd'hui est en Euro II, et d'après nos prévisions de renouvellement, 50 % du parc sera encore en Euro II en 2010. Si nous voulons aller plus vite, nous devons nous attaquer à son renouvellement. La solution qui consiste à envoyer les véhicules d'occasion vers les nouveaux pays de l'Union européenne, comme la Pologne, ne permet évidemment pas de résoudre le problème. Nous devons encore parler, non plus au client, mais au consommateur, qu'il faut éduquer pour qu'il apprenne à conduire de manière à dégager le moins de CO2 possible. Tout ce qui a été fait en France en matière de circulation routière et de limitation de vitesse va dans le bon sens, et pratiquement toutes les Renault peuvent être aujourd'hui équipées, au choix du client, d'un régulateur-limitateur de vitesse. Enfin, les constructeurs, au niveau de l'Association européenne des constructeurs d'automobiles (ACEA), souhaiteraient taxer l'émission de CO2. J'en profite pour reprendre un message, déjà lancé à plusieurs reprises à Bruxelles. Aujourd'hui, en matière de taxation sur les véhicules, certaines initiatives sont prises, en particulier par la France, mais elles sont anarchiques et aboutissent à segmenter le marché. Le manque de coordination est un inconvénient. M. Daniel COPPENS : Depuis 1998-1999, les membres de l'ACEA ont pris un accord pour réduire les émissions moyennes de CO2 de la flotte automobile à 140 grammes par kilomètre. Cet accord sera mis à jour en septembre 2006. L'objectif est de réduire encore davantage les émissions de CO2. Il faut savoir qu'entre 1998 et 2003, les résultats sont en ligne avec le planning même si on tient compte des effets opposés dus à la nouvelle réglementation en matière de sécurité. L'objectif de l'ACEA est de prolonger l'accord en tant qu'accord négocié jusqu'en 2012, selon une approche intégrée, qui consisterait à faire travailler ensemble tous les acteurs concernés - constructeurs, sociétés pétrolières, organismes politiques, clients -, car il ne faut pas faire peser sur les seuls constructeurs le problème de l'émission de CO2. Le but est de réduire l'émission de CO2, mais dans un contexte économiquement acceptable pour la société, ce qui va dans le sens de la stratégie de Lisbonne. Cette approche intégrée a été présentée pour la première fois en novembre 2005. Si nous poursuivons notre travail sur les technologies « conventionnelles », nous pouvons espérer réduire encore les émissions de CO2 de 5 %. Grâce à la propulsion alternative et la technologie hybride, nous pouvons encore gagner 3 %. En revanche, d'ici 2012, les prescriptions légales pourraient inverser la tendance et conduire à une augmentation des émissions de CO2. Quant aux biocarburants, ils peuvent nous faire gagner 4 %, tandis que la gestion du trafic, ou le comportement des consommateurs, peuvent permettre un gain supérieur à 5 %. Comme l'a dit M. Ménard, un accord entre constructeurs et sociétés pétrolières a été conclu pour travailler dans cette direction. Pour ce qui est de l'aspect économique, on peut comparer le coût des diverses méthodes. L'amélioration de la technologie du véhicule s'avère ainsi bien plus onéreuse, par exemple, que le travail sur le comportement des conducteurs, le biocarburant ou la synchronisation des feux. Mais il faut déterminer quel système a le plus de potentiel, et de ce point de vue, l'eco-driving, c'est-à-dire la façon de se comporter au volant, présente le mérite de s'appliquer aussi au parc existant. M. Serge POIGNANT : Le fait de disposer d'une boîte manuelle ou automatique a-t-il une incidence ? M. Daniel COPPENS : Tout à fait, mais c'est tout de même le conducteur qui choisit de quelle manière il va consommer du fuel. Cette approche intégrée permet d'avancer plus vite, en jouant aussi sur le parc existant, sans attendre le renouvellement complet. L'ACEA demande la suppression des incitations fiscales spécifiques à une technologie. Le législateur doit fixer un certain résultat, mais sans déterminer les moyens d'y parvenir. C'est aux constructeurs de choisir leur méthode. Le législateur ne doit pas avantager l'une ou l'autre technologie. L'ACEA encourage donc l'harmonisation des systèmes de taxation des véhicules dans l'Union européenne, la neutralité lors de l'introduction de ces nouveaux produits, la neutralité en matière de technologie, une transition progressive afin de permettre aux constructeurs de mettre en place les mesures nécessaires, la suppression des taxations de voitures de luxe, la transparence des systèmes de taxation des véhicules sur la base de l'émission de CO2, sans application de paramètres techniques arbitraires tels que la masse, la cylindrée. M. Michel GARDEL : Je voudrais rappeler la problématique. Le développement de la mobilité devrait conduire à l'augmentation conséquente du nombre de véhicules - 1,2 milliard en 2020, soit 71 % de plus d'ici quinze ans. Il s'agit donc de gérer cette demande dans les pays développés et dans les pays émergents. Dans ce contexte de forte croissance prévisible du parc mondial, trois questions d'ordre environnemental se posent : la qualité de l'air, le changement climatique, la demande énergétique. S'agissant de la qualité de l'air, les constructeurs automobiles ont déjà accompli de gros efforts, et les normes européennes commencent à porter leurs fruits, mais il faut aller encore plus loin. Par ailleurs, les problèmes de disponibilité et de coût de l'énergie fossile imposent de diversifier nos sources d'énergie. Si l'automobile a permis un progrès économique indéniable, elle est aujourd'hui un facteur de nuisance environnementale. Une entreprise d'envergure mondiale comme Toyota doit s'en soucier et intervenir rapidement. Dans cet esprit, elle s'est attachée à réduire l'ensemble des impacts négatifs liés à l'automobile tout en maximisant la dimension de liberté, d'utilité et de plaisir, car il faut remettre le client au centre de nos préoccupations. Tout d'abord, nous avons mis en place une stratégie pour tendre vers la voiture écologique ultime. La technologie du Diesel propre Toyota - Clean Power - permet de concilier les performances CO2 de la technologie Diesel, et les exigences de qualité de l'air, en réduisant les matières particulaires, et les NOx. Trois modèles de notre gamme en sont déjà équipés aujourd'hui. L'hybridation est notre deuxième grande avancée, stratégie transversale qui permet d'envisager un Diesel hybride, voire des biocarburants hybrides ou une technologie pile à combustible ou toute autre forme de carburant. Cette technologie est aujourd'hui maîtrisée, y compris au niveau des véhicules utilitaires, et Toyota a vendu plus de 500 000 véhicules hybrides dans le monde. Je rappelle que Lexus est la deuxième marque du groupe. Prius a été élue voiture de l'année 2005. C'est une vraie berline familiale, avec une taille significative et qui permet d'embarquer cinq passagers dans les meilleures conditions de confort. On a amélioré les performances de la première génération de la Prius à tel point qu'elle se place aujourd'hui en tête du palmarès de l'ADEME dans la catégorie essence. - 104 grammes de CO2 par kilomètre. La Prius présente un écart de plus de 40 g/km en terme d'émission de CO2 par rapport aux berlines Diesel de sa catégorie. Si on s'attache à présent aux normes Euro IV 2005, les performances de la Prius sont indiscutables au regard de l'émission de CO2 et vont même largement au-delà de leurs exigences. Ses émissions d'oxyde d'azote (NOx) et d'hydrocarbure (HC) sont inférieures de 93% par rapport aux niveaux EURO IV concernant les diesels et de 64% en ce qui concerne le monoxyde de carbone (CO). Et bien évidemment, le moteur essence ne produit pas de PM. Il s'agit donc de la solution aujourd'hui la plus convaincante pour lutter à la fois contre l'effet de serre et la pollution urbaine. La technique de la pile à combustible est prometteuse, mais encore chère. Dans un autre domaine, on s'attache également à donner à l'utilisateur les moyens d'une conduite toujours plus respectueuse de l'environnement. L'indicateur de changement de vitesse permet d'optimiser les changements de vitesse, d'économiser ainsi de l'énergie, et de dégager moins de CO2. Sur le cycle d'homologation, on arrive à une réduction de la consommation d'énergie de 2,6 % et en situation réelle de 5 %. M. le Président : Nous en venons au débat proprement dit. Madame Martinet, vous avez décrit la situation actuelle, les perspectives d'amélioration économiquement envisageables, et vous avez livré une piste de réflexion, à moyen terme, avec l'hybride. Toyota vient de nous dire qu'ils sont déjà passés à l'hybride : est-ce compatible économiquement, ou le nombre de véhicules vendus est-il finalement trop faible pour être significatif ? Par ailleurs, et je m'adresse à vous tous, pensez-vous que les prochaines évolutions soient compatibles avec nos objectifs de réduction de l'émission de gaz à effet de serre ? Certains nous disent que dans l'industrie, on leur a imposé des contraintes plus fortes que dans le secteur de l'automobile. Faut-il réfléchir au problème des camions et des motos ? Enfin, pourquoi ne pas avoir davantage parlé de consommation au kilomètre ? Si je parle de grammes de CO2 au kilomètre dans ma circonscription, il n'y aura pas grand monde pour me comprendre. Cela étant, il y a l'étiquetage rouge et vert, c'est déjà une bonne chose. Mme Thérèse MARTINET : Si la France obtient de meilleurs résultats - 20 grammes de moins en moyenne -, c'est aussi qu'elle a su mener une politique de publicité vigilante sur les aspects de consommation. L'obligation d'étiquetage ne concernait jusqu'à présent que l'affichage des consommations de carburant, mais nous devons maintenant afficher également les émissions de CO2, et présenter cette échelle rouge-verte, beaucoup plus visuelle, et que le client comprend mieux. C'est comme sur les frigidaires ou les machines à laver. M. le Président : Mais vous ne nous avez pas indiqué les consommations. Mme Thérèse MARTINET : Elles figuraient sur le schéma. Les démonstrateurs hybrides Diesel, que l'on a présentés en début d'année, émettent 90 grammes de CO2 par kilomètre, ce qui équivaut en Diesel à 3,4 litres de gazole par 100 kilomètres. M. Serge POIGNANT : Quand le client achète, il voit écrit : 5 litres en campagne, 10 litres en urbain. En revanche, pour l'émission en grammes de CO2, on n'a qu'un seul chiffre. M. Luc-Alexandre MENARD : Les résultats qu'on obtient sont en moyenne de cycle. Prenez une grosse voiture, hybride, davantage adaptée à l'autoroute qu'à une conduite en ville. La moyenne de cycle est faite à partir de ses résultats sur autoroute, en ville, sur route. Naturellement, vous avez une baisse de la consommation de la voiture hybride, car quand elle n'est pas en ville, elle roule sur l'électrique. La moyenne de cycle ne veut pas dire grand-chose, il vaut mieux se fier au réel effectué. M. le Président : C'est compliqué. Mme Thérèse MARTINET : - En réalité, la consommation de carburant et les émissions de CO2 sont en corrélation. Pour passer de l'un à l'autre, il suffit de faire une règle de trois. Mais c'est vrai, le litre au cent, c'est quelque chose que tout le monde connaît. De toutes façons, quand on choisit un véhicule qui consomme peu, on est sûr de faire aussi le bon choix au niveau de l'émission de CO2. Cela étant, comme il faut aussi sensibiliser les clients à cette question, il est bon qu'ils aient aussi la valeur CO2. M. Alain GEST : Avec le recul, l'inscription de l'émission de CO2 influence-t-elle le client ? Mme Thérèse MARTINET : C'est une bonne chose ; même si l'on sait bien que la consommation de carburant n'est pas l'un des trois premiers critères d'achat d'une voiture. En réalité, on pense qu'en lui indiquant que la voiture est économe, le client va essayer de remonter ce critère sur son échelle. C'est cela l'objectif. M. Alain GEST : Et quels sont ses critères ? Mme Thérèse MARTINET : Cela dépend de la gamme, il y a le prix, le design, les prestations, le confort, la sécurité. M. le Président : Avec l'étiquetage, cela va changer, j'en suis convaincu. Mme Thérèse MARTINET : Je pense que cette mesure va dans le bon sens. M. Luc-Alexandre MENARD : On avait beaucoup travaillé avec l'administration sur l'étiquetage, et il y a bien eu un effet, au moins indirect. D'un seul coup, l'attention du client a été attirée, ce qui l'a obligé à un dialogue avec le vendeur, notamment sur le problème de la consommation. Comme au même moment, le prix de l'essence a augmenté, les voitures plus économes et plus petites se sont mieux vendues. C'est une très bonne chose de l'avoir fait, sans parler des actions menées par les autorités publiques en matière de communication sur l'effet de serre. M. Alain GEST : Dans ma circonscription, les électeurs risquent de ne pas comprendre non plus la signification de ces grammes de CO2. En revanche, 250 km/heure sur circuit, ils comprennent très bien, et ils sont nombreux à ne pas comprendre que l'on ne bride pas les moteurs puisque la vitesse est limitée à 130 km/heure sur autoroute. M. Michel GARDEL : C'est un problème de responsabilité. Sanctionner ou brider, ce n'est pas nécessairement la meilleure solution. Mieux vaut éduquer. Même si vous êtes bloqué à 130 km/heure, vous serez un danger public si vous roulez à 110 en ville. M. le Président : Vous faites de la communication sur des plans de développement durable, sur des moteurs propres, et dans le même temps, vous lancez un modèle haut de gamme très vorace en énergie : le message est brouillé. Et ça, on nous le dit dans nos circonscriptions ! A quoi sert de fabriquer des moteurs qui vont jusqu'à 160 km/heure, si on est limité à 130 ? C'est une réflexion basique. M. Alain GEST : Et c'est difficile à expliquer sur le plan de la sécurité. M. Michel GARDEL : Si l'on s'en tient au marché français, 40 000 véhicules haut de gamme, au maximum, ont une puissance et une sportivité supérieures à la moyenne. Ce n'est pas du tout significatif. On peut très bien nous demander pourquoi on continue à en construire s'il est interdit de rouler au-delà d'une certaine vitesse, mais il serait plus important d'insister sur le fait que ces véhicules, chez Toyota, correspondent aux normes de sécurité et sont équipés de dispositifs de nature à limiter les nuisances environnementales, comme l'hybride. De toutes façons, il y aura toujours des gens qui aimeront le haut de gamme, et je ne pense pas que l'interdire serait démocratique. Mme Thérèse MARTINET : Sur la première question, j'ai notamment indiqué pour ce qui est de l'hybride - je ne parle pas des piles à combustible, on n'y est pas encore - que nous voulions obtenir un surcoût d'hybride Diesel par rapport à un véhicule Diesel du même ordre de grandeur que celui qui existe aujourd'hui entre un véhicule Diesel et un véhicule essence. Entre le véhicule Diesel et le véhicule essence, il y a aujourd'hui un surcoût, compensé par l'intérêt de l'économie de carburant et de la protection de l'environnement. Il y a un marché, du moins en Europe, pour le Diesel. Pour qu'il y ait un marché pour l'hybride Diesel, il faut arriver à ce même ordre de grandeur, soit diviser le surcoût actuel par deux ou trois. M. Michel GARDEL : Toyota vend une Prius à 24 950 euros. Un Diesel classique coûte environ 23 900 euros dans la plupart des marques. Avec l'avantage fiscal et le crédit d'impôt de 2 000 euros, la Toyota Prius coûte même moins chère qu'une voiture du segment M2. C'est vrai que le surcoût en matière de Diesel hybride sera plus important, puisqu'un Diesel est déjà plus cher qu'un moteur essence. Quand on va sur une technologie hybride essence, on n'a pas ce surcoût lié au Diesel. Toyota a un marché mondial, ce qui a permis d'amortir les coûts, beaucoup plus que si l'on était basés uniquement en Europe. On ne vend ainsi que 18 000 Prius en Europe, contre 180 000 à travers le monde. Si vous êtes un acteur mondial, et que vous êtes présent sur le continent nord-américain, ou sur le marché asiatique, vos débouchés vous permettent de baisser les coûts. Par ailleurs, on a totalement intégré le processus industriel. M. le Président : Combien coûte une Prius normale en France, et une Prius hybride ? M. Michel GARDEL : La Prius n'existe qu'en hybride chez nous. M. le Président : Ou l'équivalent ? M. Michel GARDEL : Un modèle équivalent de la gamme Peugeot, même puissance, coûte 23 900 euros, alors que la Prius, est à 24 950 euros. Et si on déduit les 2000 euros de crédit d'impôt, elle est même moins chère. M. le Président : Vous parlez bien d'une voiture équivalente ? Mme Thérèse MARTINET : Là est toute la difficulté de l'exercice. Nous ne vendons pas d'hybride, nous n'avons donc pas de tarification. Cela étant, quand on regarde tout ce qu'il faut faire pour obtenir un véhicule hybride, diesel ou essence, les surcoûts sont tels que l'hybridation essence, en Europe, ne présente pas d'avantage par rapport au Diesel. Si on veut aller plus loin, l'hybridation Diesel est une bonne solution, mais on n'y est pas encore, il faut diviser par deux ou trois les surcoûts actuels. M. le Président : De quel ordre sont-ils ? Mme Thérèse MARTINET : Entre 4 000 et 5 000 euros par voiture. On ne peut pas vendre une telle voiture sur notre marché, ce n'est pas tenable. Ce marché n'existe pas aujourd'hui, sauf un marché élitiste qui n'aura aucun impact sur l'environnement. L'enjeu est de trouver des technologies qui réduisent ce surcoût. M. Alain GEST : Vous avez donné les chiffres de vente des Prius. Pouvez-vous nous donner les chiffres de vente de véhicules équivalents chez vous, et préciser à quoi correspondent les Prius dans les marques françaises ? M. Michel GARDEL : Sur les 180 000 Prius vendues l'an dernier dans le monde, 3 000 ont été vendues en France. La Prius est à peu près comparable à la Laguna. M. le Président : Et par rapport à la Scenic ? M. Michel GARDEL : La Scenic, c'est un monospace compact, c'est un peu différent. M. Luc-Alexandre MENARD : La Prius, ce n'est pas une grosse voiture. M. Michel GARDEL : Mais elle a quand même un gros coffre. La Scénic n'est pas plus longue. M. Luc-Alexandre MENARD : La longueur n'est pas le seul élément d'une voiture. M. Michel GARDEL : Mais en logeabilité, la Prius est une vraie cinq places. Mme Thérèse MARTINET : Comme une 307. Une 307 mesure 4,21 m de long et la Prius 4,45 m. M. Michel GARDEL : Tout à fait. M. Alain GEST : Et combien d'Avensis vendez-vous en France ? M. Michel GARDEL : Environ 8 000. M. Serge POIGNANT : Vous êtes tous favorables à la taxation de l'émission de CO2. S'agissant des biocarburants, vous savez que la France a pris des décisions en ce domaine, mais on nous dit que cela n'avance pas comme il faudrait. Certains prétendent qu'il vaudrait mieux attendre le carburant synthétique. Qu'en pensez-vous? Cela vaut-il le coup de travailler maintenant sur le biocarburant ? Faut-il fabriquer plus d'éthanol que de diester ? M. Alain GEST : Le discours que vous avez tous tenu sur les biocarburants peut rassurer un élu de la région picarde. Surtout, l'un d'entre vous a signalé qu'il fallait tenir compte aussi des pétroliers, dont le discours est malheureusement assez éloigné du vôtre. M. Luc-Alexandre MENARD : Il y a deux générations de biocarburants. La première est celle du diester, et c'est bon pour le CO2, mais il faut le fabriquer, ce qui représente un investissement important de la part de la puissance publique. Cela vaut tout de même le coup. Les pétroliers s'en trouvent un peu gênés car cela suppose qu'ils mettent en place un système de distribution - il y aura une pompe diester - sans parler d'une légère perte d'activité. Mais ce qui est vraiment important, et les experts sont unanimes, c'est la deuxième génération - les carburants de synthèse. Il y en a trois sortes. La première est le Coal to liquid - certains pays ont beaucoup de charbon, et auraient intérêt à l'utiliser pour faire du carburant, et remplacer le pétrole, de plus en plus rare et de plus en plus cher. La deuxième est le Gas to liquid - il y a beaucoup de gaz, notamment en Iran où ils devraient, comme à Dubaï, utiliser le gaz, qui est en très grande quantité, pour en faire du gas to liquid. L'avantage n'est pas très important en termes de réduction d'émission de CO2, mais cela permet en revanche de couvrir le déficit à venir du pétrole. Enfin, le biomass to liquid est l'élément le plus important, de l'avis unanime des experts français et de l'ADEME. Mme Thérèse MARTINET : S'agissant du BTL, je précise qu'on compte transformer le charbon, le gaz, ou la biomasse principalement en gazole, car c'est plus facile. M. Luc-Alexandre MENARD : C'est le procédé Fischer Tropsch. Mme Thérèse MARTINET : C'est ce qu'on faisait pendant la guerre. L'inconvénient majeur du procédé reste que la transformation du charbon ou du gaz en gazole produit du CO2. De nombreux laboratoires sont actuellement en train de rechercher les moyens de réduire ces émissions. M. le Président - Excusez-moi de vous interrompre, mais je suis obligé de quitter la séance. Cela étant ; j'aimerais que l'un d'entre vous explique en quoi des mesures règlementaires peuvent conduire à augmenter les émissions de CO2. Mme Thérèse MARTINET : Aujourd'hui, c'est clair, chaque fois que l'on décide d'exploiter un hectare en jachère pour fabriquer soit de l'éthanol, soit du diester, on est gagnant au niveau du CO2. Sur le bioéthanol, l'intérêt est le même que celui du diester en Europe, et on sait faire. C'est vrai qu'au Brésil, ils ont un tel rendement qu'en termes d'émission de CO2, ils nous dépassent largement. M. Alain GEST : Sauf que cela s'applique plus à l'essence. Mme Thérèse MARTINET : L'éthanol, c'est en effet pour l'essence. M. Luc-Alexandre MENARD : Pour avoir été patron chez Renault cinq ans au Brésil, je peux vous dire que lorsque vous arrivez à Rio ou São Paulo, ça ne sent pas pareil dehors. Tout d'abord, vous avez des pompes 100 % éthanol, ou bien vous pouvez mélanger essence-éthanol, comme vous voulez. C'est vrai aussi que leur production de canne à sucre est telle que pendant longtemps, l'utilisation de carburant a servi à écouler les excédents de production. Quand il n'y avait plus d'excédent, il n'y avait plus rien à la pompe, il fallait repasser à l'essence, d'où le FlexFuel. Mais aujourd'hui, compte tenu de leur productivité, et du coût du pétrole, c'est rentable. M. Daniel COPPENS : Il y a une corrélation entre la consommation de carburant et l'émission de CO2. Or, c'est le poids du véhicule qui détermine la consommation. Plus il est lourd, plus il consomme, sans parler des aspects aérodynamiques. Par exemple, suite à l'obligation de mettre sa ceinture de sécurité, il a fallu prévoir tout le dispositif nécessaire. Au total, entre 2003 et 2008, les mesures règlementaires ont conduit à une hausse de l'émission de CO2 de 5,7 grammes par kilomètre. M. Luc BASTARD : De mémoire, j'aurais plutôt dit entre 1998 et 2008, ce serait à vérifier. Mme Thérèse MARTINET : Le pire est devant nous. M. Alain GEST : Et il n'est jamais sûr. Mme Thérèse MARTINET : ...dans le secteur des règlementations à venir, y compris en matière environnementale sur les voitures, vous savez qu'il existe un projet Euro V sur les émissions, cette fois, de polluants règlementés et s'il y a des contraintes pour que les polluants règlementés diminuent, les émissions de CO2, forcément, vont augmenter, mécaniquement compte tenu des compromis thermodynamiques à réaliser et des éventuels dispositifs de postraitement. Par ailleurs, l'obligation de concevoir des véhicules émettant peu de NOx va conduire à des surcoûts pour les motorisations diesel tels que l'avantage compétitif pour le client pourrait disparaître, et qu'il pourrait se tourner vers le moteur essence, bien plus plus émetteur de CO2. M. François MOISAN, directeur scientifique à l'ADEME : Les constructeurs nous ont présenté les options technologiques futures potentielles par rapport à un véhicule standard, sans faire référence à l'utilisation différenciée du véhicule. On a bien vu, quand même, que la Prius hybride était plus adaptée à l'urbain. D'ici 2020-2030, existera-t-il un véhicule adapté à tous les usages, ou pourrait-il y avoir des véhicules différenciés en fonction de leur usage - urbain, interurbain. ? M. Daniel COPPENS : Les constructeurs souhaitent que le législateur détermine les objectifs mais laisse les constructeurs libres de choisir leur méthode. Si l'on va dans cette direction. M. Serge POIGNANT : La question était plutôt de savoir s'il faut construire ou non des véhicules adaptés à l'urbain. M. Daniel COPPENS : Je ne pense pas, personne ne roule uniquement en urbain. Mme Thérèse MARTINET : Je reprendrai simplement l'expérience que nous avons eue avec les véhicules électriques, qui étaient des véhicules urbains, et auxquels nous avons cru - 10 000 voitures. A l'expérience, le client considérait que l'autonomie n'était pas suffisante, et que c'était trop cher. Si on trouve des batteries qui améliorent significativement l'autonomie d'un véhicule, ce ne sera pas un véhicule strictement urbain, car il faudrait être assez riche pour avoir les moyens d'acheter plusieurs voitures. Le véhicule polyvalent a encore de beaux jours devant lui. M. Serge BLISKO : Pourquoi cette divergence ? Vous y croyez toujours alors que PSA a arrêté sa production . M. Luc-Alexandre MENARD : Nous aussi, nous avons arrêté la production, mais le progrès technique fait avancer le monde. Soyons honnêtes, il y aura toujours plusieurs gammes de véhicules, des petites, des grosses etc. Faire un véhicule uniquement urbain, pourquoi pas ? Un constructeur l'a fait, mais je ne pense pas que ce soit un modèle de réussite économique. Laissons les constructeurs définir leur gamme, et le client achètera en conséquence. En revanche, l'encombrement urbain, c'est une réalité. De plus en plus, le système sera règlementé. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais la zone bleue a fait hurler lors de sa mise en place, tout comme les parcmètres, alors qu'aujourd'hui il y en a partout.Il existe même des péages urbains - Stockholm ou Londres -, sans parler des interdictions règlementaires. Pour le véhicule électrique, si nous trouvons des batteries adéquates, il a ses chances, et si on arrive à réduire les coûts, ce sera une utilisation idéale pour la ville, avec des utilisateurs ciblés, comme des administrations ou de grandes entreprises qui ont besoin d'une autonomie de l'ordre de 200 kilomètres. C'est dans ce sens que nous travaillons. M. Michel GARDEL : C'est vrai qu'il faut distinguer suivant les cibles. Je pense que les flottes ou les administrations en ville devraient utiliser les véhicules électriques. Bien sûr, nous devons progresser sur les batteries. S'agissant de la petite voiture unique, urbaine, on voit que déjà, les compactes citadines ont grandi en taille, pour justement offrir plus de polyvalence au client. M. Christian NGÔ : Personne n'a parlé de l'hybride rechargeable, alors que beaucoup de personnes ne parcourent que 40 ou 50 kilomètres dans la journée, et pourraient très bien rouler à l'électricité en ayant un moteur essence ou Diesel comme secours. Par ailleurs, personne n'a évoqué les études qui montrent que le Diesel émet des particules. Les filtres arrêtent les grosses particules, mais pas les petites, et ce sont celles qui vont dans les poumons. Des produits cancérigènes se greffent sur ces particules Diesel. Pourquoi n'y a-t-il pas plus de Diesel au Japon ou aux États-unis ? Ne serait-ce pas pour des raisons de santé ? L'impact sur la santé, on s'en apercevra dans dix ou quinze ans. Mme Thérèse MARTINET : Le filtre que nous avons développé enlève les particules sur l'ensemble du spectre de la granulométrique des particules qui sortent de l'échappement. On travaille sur l'ensemble de ce spectre. M. Serge POIGNANT : Et par rapport à la santé ? Les États-unis nous demandent ce qu'on fait de ces particules. M. Christian NGÔ : Le problème est qu'on ne peut pas mesurer les particules les plus fines. Mme Thérèse MARTINET : En effet, mais c'est que ce ne sont plus des particules nocives, mais des poussières, comme on en trouve partout, et sur lesquelles peuvent s'agréger diverses choses. Ce ne sont pas des particules Diesel. M. Serge POIGNANT : Et l'hybride rechargeable ? M. Michel GARDEL : On travaille également sur ce sujet. Pour le moment, le fait que l'hybride ne soit pas rechargeable était justement un argument de vente, mais nos ingénieurs travaillent sur cette solution, notamment pour des flottes, ou des clients un peu particuliers qui y trouveraient leur intérêt. Mme Thérèse MARTINET : C'est tout de même un système qui coûte très cher. M. Luc-Alexandre MENARD : L'autre idée est de faire de l'anti-hybride actuel, c'est-à-dire que le principal, ce serait le moteur électrique, rechargeable. Le moteur thermique ne serait là que comme appoint - mais c'est cher. M. Serge POIGNANT : Et pour le diesel, les américains ont-ils d'autre raison que le coût ? Mme Thérèse MARTINET : Il y a une raison de coût de l'énergie, et de culture. M. Serge POIGNANT : Parce qu'ils nous ont posé la question, et on a senti une interrogation intéressée. M. Luc-Alexandre MENARD : Ils n'ont peut-être pas envie de permettre le Diesel pour des raisons de compétitivité, car ils savent très bien que l'industrie européenne, et en particulier l'industrie française, est compétitive dans ce domaine. M. Michel GARDEL : Au Japon, le diesel est généralement réservé aux utilitaires, et maintenant, même à Tokyo, ils prennent des mesures pour leur interdire de circuler, pour des raisons de pollution. Mme Thérèse MARTINET : Il y a peut-être un autre élément, l'outil de raffinage. Cela a pu jouer dans les équilibres mondiaux entre l'essence et le gazole de bonne qualité qu'il faut pour les moteurs diesel performants en terme d'environnement. Cet équilibre peut évoluer à terme, mais cela nécessite des investissements. M. Serge POIGNANT : Merci pour ces deux heures très intéressantes. Audition de M. François LOOS, Ministre délégué à l'Industrie Présidence de M. Jean-Yves LE DEAUT, Président M. le Président : Je remercie François Loos d'être avec nous ce soir, pour une audition qui avait précédemment dû être reportée en raison de l'ordre du jour du Sénat. Nous arrivons au terme des travaux de notre mission, au cours de laquelle nous avons organisé 44 rencontres, tables rondes et auditions, qui nous ont permis de rencontrer 200 personnes, sans compter les déplacements, en particulier aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Espagne et la semaine prochaine en Inde, ni les réunions internes à la mission. Nous avons également rencontré trois de vos collègues : les ministres chargés des transports, de l'environnement et de la recherche. L'industrie est au cœur des enjeux qui nous préoccupent. En termes d'émissions, beaucoup a été fait et nous avons rencontré à ce propos les entreprises et industriels, mais il reste beaucoup à faire sur le chemin du facteur 4. S'agissant plus spécifiquement de la production d'énergie, à propos de laquelle nous avons notamment tenu des réunions sur la production d'électricité et la production de chaleur, le sujet reste ouvert, qu'il s'agisse du développement et de l'avenir des énergies renouvelables ou de l'avenir du nucléaire, en France et dans le monde. Beaucoup de questions pourront être abordées au cours de cette rencontre : mise en oeuvre par l'industrie des engagements découlant du protocole de Kyoto ; bilan du Plan Climat dans le champ de l'industrie ; mise en œuvre du PNAQ dans le cadre de la directive droits d'émission ; mise en œuvre de la loi énergie de juillet 2005 et parution des décrets d'application, en particulier en ce qui concerne les certificats d'économie d'énergie, les objectifs en termes d'énergies renouvelables et de biocarburants. Au delà de ce qui est déjà réalisé, et des points forts ou faibles des actions engagées, la mission aimerait connaître le point de vue du ministre sur le renforcement du Plan Climat prévu pour cette année et sur l'évolution du système des quotas - quid des « projets domestiques » ? -, sur l'extension du champ couvert - installations, gaz concernés, instauration d'un prix plafond du quota CO2 préconisé par certains représentants de l'industrie. A plus long terme, pouvez-vous nous indiquer quelles voies sont envisagées pour aller vers l'objectif du facteur 4 ? Quelle est votre approche sur le « post 2012 », à la suite de la conférence de Montréal, compte tenu notamment de la nécessité exprimée par la plupart des acteurs économiques rencontrés par la mission d'une visibilité à plus long terme, pour pouvoir participer activement aux actions de réduction, et en particulier aux « flexibilités ». Faut il par exemple s'orienter vers des normes internationales par secteurs industriels, hypothèse évoquée par plusieurs des chefs d'entreprise que nous avons rencontrés ? M. François LOOS : Je vous remercie de me donner l'occasion de m'exprimer devant votre mission. L'énergie, pour les transports, le logement ou l'industrie, joue un rôle déterminant dans les émissions de gaz à effet de serre. L'industrie peut jouer aussi un rôle important en apportant, par la recherche et l'innovation, les technologies nécessaires pour concilier la protection de l'environnement et le développement économique et social. En tant que ministre chargé de l'énergie et de l'industrie, j'aborde donc cette audition avec un grand intérêt. L'Union européenne soutient l'objectif de stabilisation des concentrations de gaz carbonique pour limiter la hausse de la température du globe à 2 degrés d'ici 2100, soit à un niveau dont les effets sont jugés supportables. Cela suppose de diviser les émissions de gaz à effet de serre par quatre d'ici 2050 dans les pays industrialisés. La Communauté internationale s'est mobilisée en signant en 1997 le Protocole de Kyoto, entré en vigueur en 2005. Les pays industrialisés doivent réduire leurs émissions de 5 % entre 2008 et 2012 par rapport à 1990. Mais il ne s'agit que d'un premier pas. Je rappelle tout d'abord que la demande énergétique mondiale croît à un rythme annuel de 2 %, la consommation d'énergie totalisant 80 % des émissions de gaz à effet de serre ; La tension entre l'offre et la demande d'hydrocarbures pèse sur la croissance des pays de l'OCDE, dans un contexte de dépendance croissante d'ici 2030 vis-à-vis des sources extérieures d'approvisionnement en pétrole et en gaz ; L'Union européenne est un émetteur « historique » mais sa part diminue et ne représente aujourd'hui plus que 13 % des émissions, l'équivalent de la Chine dont l'importance croît, bien moins que les États-Unis, qui sont à 25 %. Pour les pays développés qui se sont engagés sur des objectifs quantitatifs dans le protocole de Kyoto, le prix du carbone, 20 euros par tonne de CO2 sur le marché des quotas européen, affecte immanquablement le coût de production des biens qu'ils produisent, notamment de l'électricité, et influe sur la compétitivité des entreprises ; je rappelle que sur la période 2008-2012, nous nous sommes engagés à n'émettre pas plus de 2,5 milliards de tonnes. Je vous laisse calculer ce que nous coûterait un écart, positif ou négatif, de 5 %. La réduction significative des émissions - de 80% d'ici 2050 - suppose des ruptures technologiques. La politique de recherche et développement dans le domaine des nouvelles technologies de l'énergie doit être soutenue. C'est dire l'ampleur des défis énergétique, économique, environnemental et technologique à relever. J'évoquerai successivement dans ce propos liminaire : l'apport des instruments de marché inspirés du Protocole de Kyoto ; l'impact de ces instruments sur l'industrie ; les voies d'amélioration de ces dispositifs ; l'impératif pour la France de mettre en œuvre d'autres mesures. S'agissant des instruments de marché, le Protocole de Kyoto inspire la politique communautaire de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Les pays développés se sont engagés en le signant à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre de 5 % à l'horizon 2010. L'Union européenne à quinze a accepté de réduire ses émissions de 8 %, l'effort étant différencié entre ses membres selon leurs niveaux historiques. Dans ce cadre, la France s'est engagée à maintenir en 2010 ses émissions à leur niveau de 1990, c'est-à-dire à effacer par ses efforts l'augmentation mécanique qu'auraient eue, sans cela, vingt ans de croissance économique. L'objectif de Kyoto reste particulièrement ambitieux. Les émissions de l'Union européenne à quinze sont inférieures en 2003 de 1,7 % à celles de 1990, pour un objectif de 8 %. La France est l'un des rares États membres, avec le Royaume-Uni, l'Allemagne et la Suède, à tenir son objectif : ses émissions ont diminué de 1,1 % entre 1990 et 2004. L'Union européenne, en instaurant un système d'échange de quotas d'émission de CO2, montre le chemin dans la lutte contre le changement climatique. Le Protocole de Kyoto repose sur des instruments de marché pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. La directive « quotas » s'en est inspirée pour instituer le 1er janvier 2005 un marché européen d'échange de quotas d'émissions. Le système européen ne vise dans un premier temps que les seules émissions de CO2 de certains secteurs industriels les plus émetteurs - sidérurgie, papier, verre, ciment, céramique, chaux, secteur énergétique et raffineries -, soit 45 à 50 % du total des émissions de CO2.de l'industrie. Le principe du marché est le suivant. Les États membres fixent, pour chaque période, des objectifs de réduction d'émission à chacune des installations concernées à travers un plan national d'affectation des quotas préalablement validé par la Commission européenne, sur la base des émissions récentes des activités concernées. Les exploitants doivent restituer chaque année de la période le nombre de quotas correspondant à leurs émissions réelles de CO2 sous peine d'une amende de 40 euros la tonne de CO2 pour la période 2005-2007, de 100 euros ensuite, l'exploitant devant acheter en plus sur le marché les quotas supplémentaires nécessaires car l'amende n'est pas libératoire. Il s'agit donc d'un mécanisme excessivement sévère. Le plan français fixe une enveloppe totale de quotas de 156,51 MtCO2 par an et concerne 1 100 installations. Le marché européen de quotas regroupe près de 11 500 installations, dont le quota est de 6,572 milliards de tonnes sur la période 2005-2007, soit 2,190 milliards de tonnes par an. La valeur de ces quotas est évaluée à ce jour à plus de 100 milliards d'euros. L'Union européenne s'affirme donc comme le leader en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Elle stimule l'essor des technologies environnementales et des places financières en créant un nouvel « actif financier ». Ainsi, rien qu'en 2005, près de 260 millions de tonnes de CO2 ont été échangées. C'est 12 % du total distribué, le prix de vente se situant aujourd'hui autour de 20 euros par tonne de CO2. Ces mécanismes innovants mais ils font porter l'essentiel du coût d'ajustement sur l'industrie. Au niveau européen, avec le marché de quotas CO2 on rend l'industrie comptable de l'engagement des États membres pris à Kyoto au risque de contraindre sa croissance. En effet, un plafond absolu d'émissions est imposé à l'industrie pour une période donnée, en proportion du plafond global d'émissions sur lequel l'État s'est engagé à Kyoto. Ainsi les États membres ont la garantie que les émissions du secteur industriel seront contenues. Mais ce plafond est déterminé à partir de projections de croissance sur la période. Ce mécanisme peut s'avérer pénalisant pour un industriel qui, en raison d'une croissance plus forte que prévue, dépasserait son quota et serait soumis à des pénalités. Cette contrainte est encore plus pénalisante à l'heure où d'autres facteurs se conjuguent pour renchérir, à moyen terme, les prix de l'électricité : renouvellement d'un nombre important d'installations de production, choix de certains États membres de sortir du nucléaire ce qui les conduit à privilégier des moyens de production fossiles dont les coûts seront renchéris par la prise en compte de l'impact CO2. Le risque de porter atteinte à la compétitivité des industries électro-intensives, donc à l'emploi, est d'autant plus fort en France que l'industrie soumise au marché de quotas ne représente qu'environ 25 % des émissions totales, avec des gisements de réduction des émissions plus limités qu'ailleurs dans l'Union européenne. En effet du fait de la structure particulière du secteur électrique français, peu émetteur de CO2, la France se situe parmi les pays de l'OCDE les moins émissifs de CO2 par unité de PIB ou par habitant. Nous émettons 6,3 tonnes par habitant et par an quand l'Allemagne en émet 10,3 et les États-Unis 19,6. En outre, si la France respecte son engagement de Kyoto à ce stade, elle le doit à l'industrie dont les émissions ont baissé de 20 % depuis 1990. Au contraire, la tendance est plus préoccupante dans les secteurs non soumis au marché de quotas CO2, comme ceux des transports - 26 % des émissions -, du bâtiment - 19 % -, de l'agriculture - 19 %. Une action vigoureuse doit être engagée dans ces secteurs sinon la France pourrait dépasser de 10 % en 2010 son engagement de Kyoto. L'amélioration des dispositifs international et communautaire est donc indispensable. Au niveau européen, la Commission européenne doit produire un rapport fin juin 2006 sur la révision éventuelle de la directive 2003/87 mais elle a déjà indiqué ne pas vouloir modifier en profondeur le dispositif, seulement alléger son volet administratif. Ces modifications à la marge sont insuffisantes pour recentrer le marché sur son objectif premier : faciliter la réduction des émissions au moindre coût. Il s'agit de préserver la compétitivité des opérateurs européens, les seuls aujourd'hui exposés à une contrainte carbone, et ne pas les inciter à se délocaliser dans des pays à norme environnementale moins stricte. A la lumière de l'expérience de la période 2005-2007, la France a fait des propositions d'amendement pour : élargir le marché à d'autres gaz pour lesquels des réductions d'émissions peuvent être faites à moindre coût ; exclure les installations faiblement émettrices, les coûts administratifs excédant les bénéfices de leur participation ; abaisser le montant de la pénalité et la rendre surtout libératoire. Une révision rapide pour être applicable sur la période 2008-2012 serait plus que souhaitable. Il faudrait également donner de la prévisibilité à moyen ternie aux opérateurs avec des engagements de plus long terme, plus en phase avec le cycle d'investissement dans le secteur énergétique, et favoriser les nouveaux investissements. Au lieu de cela certains imaginent de les pénaliser encore plus en introduisant par exemple des enchères pour les attributions de quotas. Au niveau international, l'inclusion de l'ensemble des principaux acteurs économiques mondiaux dans le futur régime après 2012 est indispensable. L'Union européenne ne peut plus être la seule à agir alors que sa part des émissions mondiales, 13 %, diminue. Il doit également être mis fin à la discrimination de l'énergie nucléaire par le Protocole de Kyoto, alors qu'elle fournit durablement une énergie bon marché et non émettrice de gaz à effet de serre et qu'elle peut constituer une réponse adaptée aux besoins en énergie de pays en forte croissance. Un meilleur équilibre entre environnement et compétitivité est indispensable au niveau européen. Je veux, en guise de conclusion, indiquer les actions à entreprendre à moyen et long terme pour lutter contre le changement climatique. L'industrie ne peut pas être le seul acteur de la réduction des émissions de gaz à effet de serre Une répartition plus équitable s'impose en particulier en France, où aucune contrainte sur l'industrie, aussi sévère soit-elle, ne suffira pour que la France respecte son engagement de Kyoto. L'industrie ne représente plus que 21 % des émissions en 2003 contre 25 % en 1990, tandis que, dans le même temps, celle des transports s'est élevée de 21 % à 28 %. Tous les secteurs doivent être mis à contribution, en particulier ceux des transports et du bâtiment. C'est tout l'enjeu de l'actualisation en 2006 du Plan Climat, qui recense nos actions de lutte contre le changement climatique, pour inscrire plus étroitement encore notre politique dans l'objectif d'une division par 4 de nos émissions d'ici 2050. C'est dans cet esprit qu'a été adoptée la loi française du 13 juillet 2005 qui fixe les objectifs de la politique énergétique et donne les outils pour les atteindre. Elle affirme notre choix d'un bouquet énergétique diversifié avec à la fois des fossiles, du nucléaire et du renouvelable, pas seulement pour l'électricité, où on ne gagne pas beaucoup de CO2, mais aussi pour les carburants et la chaleur. Elle affirme aussi notre engagement pour la maîtrise de la demande d'énergie dans tous les secteurs et pour la recherche et l'innovation sur les nouvelles technologies de l'énergie. Elles concernent la production - biocarburants de synthèse, solaire photovoltaïque, séquestration du CO2, photovoltaïque. - ou la consommation - véhicules et bâtiments économes. Cette approche transversale, intégrant les dimensions de sécurité énergétique, de compétitivité, de recherche et d'environnement, manque au niveau européen, alors qu'elle est demandée par le Conseil européen des 15 et 16 décembre 2005. C'est l'objectif du Mémorandum pour une relance de la politique énergétique européenne adressé par la France à ses partenaires. Sur la base de loi du 13 juillet 2005, il propose d'agir à la fois sur trois facteurs. Sur la demande d'énergie, d'abord, avec des pistes pour améliorer l'efficacité énergétique tel que le système d'obligation et de certificats d'économie d'énergie que nous mettons en place, qui induira un effort des énergéticiens de 180 millions d'euros par an. Sur l'offre d'énergie, ensuite : si l'essor des énergies renouvelables, en particulier thermiques, est souhaitable, le mémorandum souligne l'intérêt d'un bouquet énergétique équilibré, l'énergie nucléaire pouvant contribuer positivement à la lutte contre l'effet de serre. Sur la recherche-développement, enfin : pour accroître la part de l'énergie dans le programme de recherche européen afin de promouvoir des plates-formes communautaires dans les domaines de la pile à combustible ou des bioénergies par exemple. Je souhaite finir ce propos liminaire sur cette note européenne car c'est bien au niveau européen et même mondial que le problème doit être résolu. La France et l'Union européenne doivent être en pointe. Mais ces efforts ne serviraient à rien s'ils étaient isolés. C'est ensemble, par la recherche et l'innovation, que nous saurons résoudre le double défi, énergétique et écologique, du XXIe siècle, sans affecter le développement économique et social de nos pays et des pays émergents. M. le Président : Nous avons déjà cerné un certain nombre des points que vous venez d'évoquer. Je l'ai dit, nous aimerions savoir où en est la loi de 2005 en ce qui concerne les énergies durables, les biocarburants et les certificats d'économies d'énergie. S'agissant du marché des émissions, nous avons entendu dire que l'on avait accordé beaucoup trop de quotas et que certains, s'ils jouaient simultanément sur les mécanismes de développement propre, pouvaient profiter d'un véritable effet d'aubaine. Pensez-vous que c'est vraiment le cas ? S'oriente-t-on, lors de la deuxième phase, vers une diminution des quotas ? Si tel est le cas, sera-t-elle de 6 ou de 8 % ? M. François LOOS : Tous les décrets d'application de la loi de juillet 2005 relatifs aux certificats sont prêts, ils sont actuellement en cours d'examen devant le conseil d'État et ils devraient donc paraître prochainement. Nous avons donc fait notre travail. S'agissant du marché européen des quotas et de ce que l'Union envisage, nous avons donné notre point de vue qui est qu'il ne se faut pas faire peser les efforts nécessaires uniquement sur l'industrie, d'autant que, quels que soient les gains possibles, elle ne représente que 21 % du total de nos émissions. Si nous voulons vraiment respecter nos objectifs, il faut aussi mobiliser les transports, c'est-à-dire l'ensemble du parc des automobiles et des camions, et l'habitat, notamment ancien. Nous avons aussi expliqué à la Commission qu'il fallait bien mesurer les effets des quotas sur les prix de l'électricité, que subissent l'ensemble des industries comme les consommateurs. Nous demandons en particulier qu'on tienne compte de l'énergie nucléaire dans les mécanismes de développement propre. Afin que les plus vertueux ne soient pas ceux qui paient le plus, peut-être faudrait-il attribuer des quotas à ceux qui produisent de l'énergie nucléaire. En effet, ne pas en tenir compte nous obliger à faire des efforts important alors que, par habitant, la France émet beaucoup moins que l'Allemagne. Nous avons aussi demandé que les entreprises qui sont obligées d'acheter des quotas ne soient pas en plus soumises à une pénalité non libératoire car la perte de compétitivité est alors trop importante. S'agissant d'un éventuel effet d'aubaine, Rhodia et Lafarge ont bénéficié du dispositif des MDP de façon tout à fait normale puisqu'ils ont réalisé des économies de CO2 en procédant à des investissements au Brésil et au Maroc. Il n'y a rien de choquant à ce qu'ils bénéficient d'un système qui a été construit pour cela. Les éoliennes implantées par Lafarge au Maroc permettent d'économiser l'électricité produite à partir du gaz et de transporter ainsi les économies de CO2 en France, avec l'accord des Nations unies, grâce aux MDP. Si aubaine il y a, elle est d'abord pour le Maroc. M. Serge POIGNANT : Les Espagnols que nous avons rencontrés nous ont dit vouloir utiliser de plus en plus les MDP avec l'Amérique latine car ils y voient un moyen de faire avancer les pays en développement. M. François LOOS : En effet, tout le monde est gagnant. M. le Président : David Victor, économiste que nous avons rencontré à Stanford et qui s'oppose à la position américaine, nous a dit qu'il avait analysé 500 projets dans le cadre des MDP et qu'il avait constaté que la plupart ne visaient pas des réductions des émissions de CO2 mais d'autres gaz, avec des coefficient multiplicateur très fort, ce qui peut conduire à se placer dans une logique davantage financière qu'environnementale. M. Raymond LEBAN : C'est tout le débat sur la base line. Les MDP peuvent aussi être vus comme le seul moyen de faire entrer les pays en développement dans le processus, en espérant que cela les amènera ensuite à prendre des engagements et à réaliser les investissements nécessaires. Pour accélérer ce mouvement, il faudrait permettre que ces mécanismes puissent aussi concerner de gros projets, par exemple dans le charbon voire dans le nucléaire. M. François LOOS : Je suis tout à fait d'accord : plus la base des MDP sera large, mieux cela sera. Nous avons tout intérêt à ce que le plus de pays possible soient vertueux et à ce que le protocole de Kyoto concerne davantage de pays et de secteurs. Bien évidemment, il serait intéressant de promouvoir des projets plus importants. Ainsi, Lafarge, qui était prêt à faire bien plus et donc à permettre des économies de CO2 plus importantes, n'a été autorisé à construire que cinq éoliennes car les autorités marocaines craignaient de mettre en danger le monopole de l'électricité. On peut aussi regretter que celui qui construit une centrale nucléaire en Chine ne bénéficie pas pour l'instant de quotas. M. Serge POIGNANT : C'est une question fondamentale au niveau mondial : comment élargir le processus de Kyoto pour entraîner un maximum de pays ? Pensez-vous qu'il faille passer par l'OMC ? M. François LOOS : Ce qui est fondamental, c'est la position des États-Unis. Alors qu'ils refusent de participer au système de Kyoto, ils ont passé un accord avec l'Australie, la Chine, l'Inde et d'autres pays afin de mener ensemble des programmes de recherche. Bien sûr, la recherche est utile pour parvenir à des procédés moins consommateurs d'énergie et moins producteurs de CO2, mais en attendant qu'elle produise ses effets, la méthode du protocole de Kyoto et des MDP est beaucoup plus efficace. Aujourd'hui, c'est l'Union européenne qui fait le plus d'efforts. Et au sein de l'Union, la France est un bon élève, dont les efforts reposent essentiellement sur l'industrie. Or, je le rappelle, il faut travailler aussi sur les transports et sur l'habitat. M. le Président : Certains de ceux que nous avons rencontrés en Espagne et au Royaume-Uni doutent qu'un système fondé uniquement sur la régulation économique pour l'industrie puisse véritablement fonctionner. Il semble donc qu'on soit amené à s'orienter vers d'autres contraintes, sous la forme de normes ou d'une fiscalité internationales. Quel intérêt accordez-vous à des mesures complémentaires de ce type ? M. François LOOS : Dans le cadre du dispositif existant, faire porter les efforts sur l'industrie peut entraîner de temps à autre de réels problèmes. En effet, cette politique, globalement efficace, revient à taxer l'énergie, dans la mesure où on suppose que les investissements seront plus rentables parce qu'ils entraîneront des économies. Mais cela peut avoir pour effet paradoxal d'inciter à importer, au prix d'un acheminement coûteux en CO2, des produits de pays qui ne sont pas soumis aux quotas, qui sont donc beaucoup plus compétitifs, mais qui produisent en polluant beaucoup plus. Il ne faut pas que l'économie de CO2 dans nos pays se traduise par une réduction de l'activité, même si cela permettrait de diminuer encore plus les émissions. Ce que nous voulons, c'est que les entreprises continuent à se développer, tout en étant conscientes de leurs responsabilités. La question est aujourd'hui directement posée pour la production d'électricité : l'Allemagne constate que le système des quotas conduit à l'augmentation du prix de l'électricité marginale et donc de l'ensemble de l'énergie européenne, ce qui a des effets sur la compétitivité de toute l'économie. Bien sûr, il faut être vertueux, mais au-delà d'une certaine pression les produits ne sont plus compétitifs. C'est ce qui se produit actuellement pour le ciment et un certain nombre de projets d'importation sont engagés dans nos ports. Exercer une pression trop grande sur les industriels pourrait les entraîner à fermer des usines et les obliger à importer des produits fabriqués avec beaucoup plus d'émissions mais moins chers puisqu'ils n'ont pas supporté le coût du CO2. M. Jacques BASCOU : Vos arguments sont un peu ceux des États-Unis, qui refusent le mécanisme de Kyoto pour éviter une perte de compétitivité de leur industrie. Comment sortir du sentiment d'impuissance que donne cette position ? M. François LOOS : Le risque est que les pays qui s'engagent dans la bonne direction ne soient pas assez nombreux, en particulier si les pays émergents et les États-Unis n'appliquent pas le protocole de Kyoto. Pour le ciment par exemple, dont la tonne coûte 70 euros, si on doit acquitter 20 euros de plus, il va être difficile de résister aux importations et, du coup, d'atteindre les objectifs globaux de réduction du CO2. Produire ailleurs fait donc perdre économiquement et écologiquement. C'est pour cela que je pense qu'il faut poursuivre les discussions en espérant qu'un certain nombre de pays vont finir par se rallier à nous. M. le Président : La France a annoncé qu'elle produirait, en 2010, 21 % de son électricité à partir d'énergies renouvelables. Sachant qu'on est aujourd'hui à 14 % grâce à l'hydroélectricité, comment parviendra-t-on à 7 % de plus sans engager un effort considérable d'implantation d'éoliennes pour une production d'au moins 10 000 MgW ? M. François LOOS : Le rythme de l'installation des éoliennes s'est un peu accéléré l'an dernier. S'il reste ce qu'il est, les projections amènent à penser que l'objectif sera atteint en 2013 plutôt qu'en 2010. M. le Président : Peut-on s'attendre à un retard équivalent dans l'application de l'article 13 de la loi sur l'énergie, qui prévoit l'installation d'un million de mètres carrés de capteurs pour le solaire thermique. M. François LOOS : Toutes ces données et tous les scénarii possibles figureront dans la programmation pluriannuelle des investissements que je communiquerai prochainement au Parlement. Afin que vous en disposiez à temps pour la publication de votre rapport, nous pourrons néanmoins vous fournir très rapidement les informations relatives à l'énergie. M. François DOSÉ : Nous avons rencontré au Royaume-Uni des gens qui se sont spécialisés dans le marché du CO2 et qui ont fait fortune. Je connais par ailleurs très bien les responsables du groupe LHOIST, qui est un des premiers producteurs mondiaux de chaux, qui m'ont mis en garde contre le risque que le marché juteux les droits des missions ne prenne le pas sur l'activité industrielle. Ils ne souhaitent pas pour leur part entrer dans ce jeu et demandent simplement qu'on fixe une taxe et qu'on évite les dérapages. Par ailleurs, je ne suis pas un dogmatique, je souhaite simplement qu'on fasse un peu plus de place à la justice sociale et la solidarité. Or, quand je vous entends, j'ai le sentiment que vous défendez - et c'est après tout votre travail - uniquement l'industrie. Je crois quant à moi que s'il faut trouver un point d'équilibre dans le surcoût lié à l'énergie et au CO2 produit, c'est vis-à-vis non seulement de la concurrence mais surtout de la société. J'ai vécu dans une cité ouvrière où il y avait tellement de fumée qu'on l'a fermée et rasée. Du coup, tout le monde habite aujourd'hui à 20 kilomètres du lieu de production et vient travailler en voiture. Cet exemple montre que c'est bien d'une vision globale dont nous avons besoin. M. François LOOS : C'est vrai. Je ne défends pas l'industrie, je rends compte devant vous des effets sur elle du système qui a été mis en place pour réduire ses émissions de CO2 et je dis simplement que si on veut atteindre nos objectifs de diminution des émissions totales il ne faut pas s'intéresser qu'à elle. Quand on décide une politique des biocarburants c'est l'ensemble du parc automobile qui est concerné, et parvenir à incorporer 7 % de biocarburants amène directement à diminuer de 7 % les émissions de CO2. Mais quand on dit qu'il faut que les voitures consomment moins et qu'on applique les normes Euro 4 et Euro 5, on ne s'intéresse qu'aux véhicules neufs. J'ai un véhicule vieux de dix ans qui consomme de 10 à 12 litres aux 100 km. Si j'achète un véhicule neuf qui ne consomme plus que 5 litres, l'économie ainsi réalisée ne suffit pas à rentabiliser mon achat, même en prenant en compte le crédit d'impôt de 2 000 euros. Je veux simplement montrer que le système actuel conduit à augmenter le prix de l'énergie mais ne suffit pas à engager un vrai mouvement qui permettrait d'arriver au résultat attendu. M. le Président : Nous aurions aussi souhaité vous demander pourquoi la France s'est souvent contentée d'utiliser les nouvelles technologies sans développer les filières industrielles correspondantes. Malheureusement, nous devons interrompre cette discussion afin de rejoindre l'hémicycle pour participer au scrutin public sur le texte relatif à l'égalité des chances. Je vous prie de nous en excuser et je vous remercie sincèrement d'avoir participé à cette audition. --------
1 Groupement des Autorités Responsables du Transport - http://www.gart.org/ |