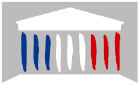N° 1686
______
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
TREIZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 19 mai 2009.
RAPPORT
FAIT
AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES, FAMILIALES ET SOCIALES SUR LA PROPOSITION DE LOI (n° 1621) de Mme Marie-George BUFFET, M. Daniel PAUL et plusieurs de leurs collègues visant à prendre des mesures urgentes de justice sociale en faveur de l’emploi, des salaires et du pouvoir d’achat,
PAR M. Daniel Paul,
Député.
——
A. UNE RÉCESSION SANS PRÉCÉDENT DEPUIS LES ANNÉES TRENTE 7
B. L’EXPLOSION DU CHÔMAGE 7
C. L’ACCÉLÉRATION DES DESTRUCTIONS D’EMPLOI 8
D. LA PROGRESSION DES LICENCIEMENTS POUR MOTIF ÉCONOMIQUE ET DU CHÔMAGE PARTIEL 8
II.- QUAND ACCROISSEMENT DES PROFITS RIME AVEC LICENCIEMENTS 9
A. DES CHIFFRES D’AFFAIRES ET DES BÉNÉFICES FABULEUX 9
B. DES DIVIDENDES DISTRIBUÉS PAR MILLIARDS 9
C. DES SUPPRESSIONS DE POSTES EN CASCADE 10
III.- UN GOUVERNEMENT EN CARENCE 11
A. UN PLAN DE RELANCE MANIFESTEMENT INSUFFISANT 11
B. LE REFUS D’AUGMENTER LES SALAIRES 12
C. LES DIFFICULTÉS DE FONCTIONNEMENT DE PÔLE EMPLOI 13
IV.- DES MESURES D’URGENCE SOCIALE À PRENDRE EN FAVEUR DE L’EMPLOI, DES SALAIRES ET DU POUVOIR D’ACHAT 15
A. DÉVELOPPER UNE ACTION GLOBALE ET DURABLE EN FAVEUR DE L’EMPLOI, DES SALAIRES ET DU POUVOIR D’ACHAT 15
B. VERSER UNE ALLOCATION COMPLÉMENTAIRE AUX BÉNÉFICIAIRES DES AIDES ÉTUDIANTES 17
C. ÉTENDRE LE REVENU DE SOLIDARITÉ ACTIVE (RSA) AUX JEUNES QUI TRAVAILLENT 20
D. SUPPRIMER LES FRANCHISES MÉDICALES 25
E. CRÉER UNE ALLOCATION DE SOLIDARITÉ EN FAVEUR DES DEMANDEURS D’EMPLOI NON INDEMNISÉS 27
TRAVAUX DE LA COMMISSION 37
I.- DISCUSSION GÉNÉRALE 37
II.- EXAMEN DES ARTICLES 53
TITRE IER . DE L’INTERDICTION, DE LA PRÉVENTION DES LICENCIEMENTS ÉCONOMIQUES ET DE LA SAUVEGARDE DE L’EMPLOI 53
Article 1er : Modification de la définition et des modalités de contrôle des licenciements pour motif économique 53
Article 2 : Renchérissement du coût du licenciement pour motif économique 58
Article 3 : Création d’un droit d’opposition aux licenciements pour motif économique 63
Article 4 : Suppression des exonérations fiscale et sociale sur les heures supplémentaires instaurées par la « loi TEPA » 67
TITRE II : DE L’AUGMENTATION DES SALAIRES ET DE LA PROTECTION DES DEMANDEURS D’EMPLOI 73
Article 5 : Instauration d’un seuil minimum de fixation du SMIC à hauteur de 1 600 euros 73
Article 6 : Suppression de la réduction générale de cotisations patronales en l’absence de conclusion d’accords collectifs annuels sur les salaires 79
Article 7 : Tenue d’une conférence nationale sur les salaires 86
Article 9 : Affectation prioritaire des bénéfices à l’indemnisation du chômage partiel 93
Article 10 : Exclusion des sociétés bénéficiaires de l’indemnisation du chômage partiel 97
TITRE III : DIVERSES MESURES D’ORDRE SOCIAL 98
Article 14 : Échelonnement du remboursement d’un crédit à la consommation en cas de résiliation du contrat 98
Article 15 : Gage 104
Face à l’ampleur et à la violence de la crise que traverse l’économie française, et dont les salariés sont les premières victimes comme l’indiquent la remontée spectaculaire du chômage et la diminution corrélative du pouvoir d’achat des Français, il est urgent de réagir.
Contre la carence du gouvernement, dont le plan de relance ne traite pas de la question de l’augmentation des revenus des travailleurs, et contre les comportements scandaleux de grandes entreprises qui versent des milliards d’euros de dividendes tout en annonçant des centaines voire des milliers de suppressions d’emploi, les députés communistes et républicains et du parti de gauche proposent l’adoption de mesures urgentes de justice sociale en faveur de l’emploi, des salaires et du pouvoir d’achat.
Accéder à un emploi, vivre dignement grâce aux revenus de son travail, se soigner, étudier dans de bonnes conditions : toutes ces possibilités, qui paraissent évidentes et surtout nécessaires au bon fonctionnement d’une société, sont en réalité fermées à des milliers de personnes aujourd’hui, contraintes à la précarité par les politiques de privilèges et de dérégulation des gouvernements successifs de droite.
Les dispositifs visés dans la présente proposition de loi ont un double objectif. Il s’agit tout d’abord, à court terme, de relancer l’économie en stimulant la consommation, un facteur central de la croissance, par une augmentation immédiate et conséquente des salaires. Il s’agit ensuite, à plus long terme, de bâtir une société juste et centrée sur l’homme, contre la dictature de l’argent roi et le développement des inégalités sociales. Véritable plan de relance face à une situation d’urgence manifeste, cette proposition de loi porte donc en elle les logiques permettant un véritable dépassement du capitalisme.
I.- UNE CRISE ÉCONOMIQUE BRUTALE
PAYÉE PAR LES SALARIÉS
Les conséquences brutales de la crise du système capitaliste qui frappe l’économie mondiale sont principalement assumées par les salariés, qui paient une lourde facture sociale.
Selon l’Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE) (1), la France s’apprête à connaître « deux années noires » avec une diminution de 2,3 % de son produit intérieur brut (PIB) en 2009, soit la plus forte récession enregistrée depuis les années trente, et de 0,2 % en 2010. Le gouvernement table même sur une diminution historique du PIB de 3% en 2009.
Au niveau de la zone euro, l’OFCE prévoit également une croissance négative à hauteur de - 3,3 % en 2009 et de - 0,3 % en 2010. La croissance mondiale reculerait enfin de 1,5 % en 2009.
Cette récession d’un caractère exceptionnel a déjà entraîné une remontée spectaculaire du chômage. Pour l’année 2008, ce sont 165 000 demandeurs d’emploi en plus inscrits à Pôle emploi (2).
Certaines catégories de population sont particulièrement touchées. Ainsi, de mars 2008 à mars 2009, le chômage des moins de 25 ans a progressé de 35,8 %, contre 20,1 % pour les personnes entre 25 et 49 ans et 16,7 % pour les plus de 50 ans. La situation des jeunes hommes de moins de 25 ans se révèle très préoccupante, avec une augmentation du chômage de 49,9 % sur la même période (3).
Au total, entre mars 2008 et mars 2009, le chômage a crû de 22,1 % pour la catégorie A des demandeurs d’emploi, et de 12,3 % pour toutes les catégories confondues. En mars 2009, le nombre de demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi s’élevait à 3 899 600, dont plus d’un million de personnes en chômage de longue durée.
Les intentions d’embauche sont en berne : elles baissent de 23,8 % en 2009 (4). Cette donnée concorde avec les prévisions alarmantes de l’Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE) qui table sur environ 800 000 chômeurs supplémentaires d’ici à la fin 2010 ; le taux de chômage s’établissant alors autour de 10,2 % de la population active fin 2010.
Au constat de l’explosion du chômage, il faut associer les statistiques relatives aux destructions d’emploi qui démontrent une forte accélération en la matière. L’emploi intérimaire a ainsi reculé de - 79 000 postes au quatrième trimestre de 2008, contre une baisse limitée à - 42 000 postes au trimestre précédent.
Pour l’année 2008, la Direction de l’animation de la recherche des études et des statistiques (DARES) a dénombré 117 000 destructions d’emplois. Selon l’OFCE, cette tendance devrait se poursuivre à la hausse : l’emploi diminuerait de - 646 000 postes en 2009 et de - 296 000 postes en 2010. Au seul premier trimestre 2009, 138 000 emplois ont été détruits.
Les licenciements pour motif économique explosent. Ainsi, en mars 2009, ce sont 22 500 personnes qui se sont inscrites à Pôle emploi suite à un licenciement pour motif économique, soit une augmentation de 11,9 % par rapport à au mois de février 2009, et de 46,1 % par rapport au mois de mars 2008 (5).
Les statistiques relatives au chômage partiel traduisent une évolution également à la hausse (6). En 2008, le nombre d’heures de chômage partiel autorisées s’est élevé à 22 millions. Au 10 février dernier, ce nombre atteignait déjà, pour l’année 2009, près de 12 millions d’heures. Le nombre potentiel de salariés concernés par le chômage partiel pour l’année 2009 devrait s’élever à 330 000.
II.- QUAND ACCROISSEMENT DES PROFITS
RIME AVEC LICENCIEMENTS
Les données du chômage, des destructions d’emploi, des licenciements pour motif économique et du chômage partiel, s’inscrivent dans une dynamique d’accroissement rapide et puissant ; elles démontrent la violence de la crise et le coût qui en résulte pour les salariés, qui se retrouvent sans emploi ou avec une rémunération largement amputée en cas de chômage partiel (7).
Malgré cette facture sociale, certaines grandes entreprises adoptent des comportements scandaleux : tout en affichant des chiffres d’affaires et des bénéfices record pour 2008, elles annoncent des plans de compressions d’effectif impliquant des centaines voire des milliers de suppressions d’emploi.
Si les effets de la crise se sont fait sentir dès 2008 chez les salariés, les entreprises du CAC 40 ont par contre publié des résultats exceptionnels pour cet exercice.
Ainsi, pour 2008, le chiffre d’affaires d’Air Liquide s’élève à 13,1 milliards d’euros, celui de Danone à 15,2 milliards d’euros, celui d’Alcatel - Lucent à 16,9 milliards d’euros, celui d’Air France – KLM à 24,1 milliards d’euros, celui de Renault à 37,7 milliards d’euros et celui d’Arcelor - Mittal à 84,8 milliards d’euros.
Quant aux bénéfices distribuables, celui de Total a atteint 14 milliards d’euros, celui de Sanofi – Aventis 8,5 milliards d’euros et celui du groupe PPR 924 millions d’euros.
Parmi les grands groupes étrangers, on peut citer les résultats de Caterpillar, dont le bénéfice net s’élève à 3,5 milliards d’euros, ou d’Ericsson, dont le bénéfice net atteint 1,093 milliard d’euros pour 2008.
En plus d’afficher des chiffres d’affaires et un bénéfice net fabuleux, les entreprises du CAC 40 et les grands groupes étrangers ont distribué ou prévu de distribuer des dividendes au titre de l’année 2008, qui se comptent en milliards d’euros.
Ainsi, les groupes Accor, PPR et Vivendi ont annoncé que les dividendes versés à leurs actionnaires, au titre de l’exercice 2008, seraient au moins égaux à 50 % de leurs bénéfices nets. Les dividendes octroyés aux actionnaires de Total ont augmenté de 10 % en 2008, ils s’élèvent au final à 2,28 milliards d’euros, et ceux de Caterpillar ont connu une hausse de 17 %.
Au total, sur les 75 milliards d’euros de profits réalisés par les entreprises du CAC 40 en 2008, ce sont 34,9 milliards qui ont été redistribués aux actionnaires sous la forme de dividendes.
Ces données actent la financiarisation de l’économie : la part des profits dans la valeur ajoutée s’accroît toujours davantage au détriment des salaires et de l’autofinancement des investissements (8).
Malgré le caractère exceptionnel de leurs résultats et du montant des dividendes qu’elles ont redistribués, ces grandes entreprises arguent de la crise pour mettre en œuvre des plans de suppressions d’emploi, qui affecteront à terme des milliers de salariés, sans compter leurs effets sur les sous-traitants, et fragiliseront encore un peu plus des dizaines de bassins d’emploi déjà sinistrés.
Les récentes annonces de plans de suppressions de postes en cascade dans des entreprises bénéficiaires démontrent que la jurisprudence Michelin (9) est toujours d’actualité et que les salariés constituent, plus que jamais, la première variable d’ajustement du capitalisme financier.
Ainsi le groupe Ericsson a présenté en janvier dernier un plan de suppression de quelque 5 000 emplois sur les 78 750 que compte l’entreprise. D’autres exemples peuvent être cités : Total a annoncé la suppression de 550 postes, Caterpillar de 733 postes, et PPR de 1900 postes.
Enfin que dire de Renault et de PSA, qui ont obtenu 6 milliards d’euros d’aide de l’État, et qui ont maintenu leurs projets respectifs de 4 450 et 3 350 suppressions d’emploi ?
Ces pratiques, qui visent à accroître encore les profits, au prix de milliers de vies brisées, sont injustifiables. Et ce d’autant plus que l’on sait que la plupart de leurs actionnaires sont des investisseurs étrangers, des fonds de pension, dont la rémunération ne participera pas à la croissance de l’économie française.
Ces mêmes entreprises, tout en multipliant les licenciements et les fermetures de sites, contraignent leurs salariés au chômage partiel et imposent donc aux plus modestes de réduire leurs dépenses quotidiennes. Par là même, elles renvoient la charge du coût social de la crise à l’État, principal financeur de l’indemnisation du chômage partiel, même lorsqu’elles réalisent des profits et distribuent des dividendes (10).
III.- UN GOUVERNEMENT EN CARENCE
Face à ces comportements scandaleux, le gouvernement a proposé des mesures bien limitées et s’est souvent contenté d’effets d’annonces. Mais pire encore, les moyens déployés pour sortir l’économie française de la crise, à travers le plan de relance, semblent à la fois insuffisants et inadaptés. De surcroît, alors même que le chômage explose, Pôle emploi connaît, de l’aveu de sa direction, des difficultés de fonctionnement importantes, qui nuisent au bon accompagnement des demandeurs d’emploi.
Selon l’Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE) (11), les plans de relance auront un impact proportionné à l’ampleur des fonds qui leur sont alloués. Or, si l’on mène une comparaison au niveau international, le plan de relance français apparaît très réduit. En effet, l’effort de relance atteint aux
États-Unis le taux de 5,6 % du produit intérieur brut (PIB), en Espagne de 3,5 %, en Allemagne de 3 %, au Japon de 2 % du PIB, au Royaume-Uni de 1,4 %.
En France, le plan de relance ne s’élève qu’à 0,6 % du PIB. Dû à sa faiblesse, selon l’OFCE, le plan de relance français n’aurait qu’un impact limité à 0,5 % point de croissance en 2009 et à 0,2 % point de croissance en 2010.
Invoquant notamment l’accroissement des déficits publics, le gouvernement refuse de consacrer plus de moyens au plan de relance. Pourtant il existe des sources de financement possibles pour combattre les effets économiques et sociaux de la crise. Ainsi la remise en cause des exonérations de cotisations sociales patronales constitue une solution logique et aisée à mettre en œuvre.
La seule réduction « Fillon » (12), le principal allègement général de cotisations patronales, a coûté en 2008 plus de 22,8 milliards d’euros. Or, si l’on se fonde sur l’analyse de la Cour des comptes, le montant exorbitant des exonérations générales n’est pas justifié par l’efficacité de la mesure.
Dans son rapport sur les comptes sociaux en 2007 (13), la Cour des comptes affirmait que « l’effet net des exonérations traduit plutôt un ralentissement des destructions d’emploi qu’une augmentation des créations ». Dans ses recommandations finales, la Cour préconisait « un meilleur ciblage des exonérations, d’une part en les limitant aux entreprises de moins de vingt salariés ou en resserrant la plage de 1,6 à 1,3 SMIC et, d’autre part, […] en fixant le point de sortie en euros ou en pourcentage du plafond de la sécurité sociale en lieu et place du SMIC ».
La manne financière que représentent les exonérations générales de charges sociales pourrait être utilement allouée aux dépenses sociales supplémentaires nécessaires en temps de crise et aux dépenses d’avenir comme l’école et la recherche. Mais telle n’est pas la philosophie ni l’idéologie du gouvernement, qui refuse toute remise en cause des cadeaux fiscaux et sociaux qu’il a généreusement accordés à une minorité de privilégiés.
Le deuxième défaut majeur du plan de relance provient de son absence de prise en compte de la question de l’augmentation du pouvoir d’achat. Or sa dégradation progressive depuis 2002 est aujourd’hui très préoccupante (14).
Les inégalités de revenus ont également progressé. Ainsi, une étude de l’École d’économie de Paris (15) a relevé « une augmentation très forte des revenus des foyers les plus riches depuis 1998, tandis que les revenus moyen et médian croissent très modestement sur la période. […] En particulier, les 0,01 % des foyers les plus riches ont vu leur revenu réel croître de 42,6 % sur la période, contre 4,6 % pour les 90 % des foyers les moins riches ». De surcroît, elle constate que « la très rapide augmentation des inégalités de salaires a également fortement participé à cette augmentation des inégalités de revenus. De ce point de vue, la France rompt avec vingt-cinq ans de grande stabilité de la hiérarchie des salaires ».
L’une des causes de l’accroissement des inégalités résiderait dans l’évolution de la répartition entre capital et travail dans les revenus des ménages, comme le souligne l’économiste Thomas Piketty : « Si l’on se place du point de vue des revenus effectivement perçus par les ménages, alors on constate que la part des revenus du capital (dividendes, intérêts, loyers) n’a cessé d’augmenter, alors que celle des salaires nets baissait inexorablement, renforçant d’autant la progression des inégalités » (16). Cette tendance n’est pas sans rappeler celle que connaît la valeur ajoutée, dans laquelle la part salariale recule constamment (17).
Plus précisément, si l’on analyse les données de l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), sur les salaires dans les entreprises en 2007 (18), on constate la persistance d’une forte disparité des salaires entre les différentes catégories socioprofessionnelles : un cadre à temps complet perçoit un salaire mensuel net moyen de 3 997 euros, contre 1 459 euros pour un ouvrier et 1 391 euros pour un employé.
Si le salaire mensuel net moyen se situe à 1 997 euros en 2007, le salaire médian, qui partage les salariés à temps complet en deux groupes d’effectifs égaux, est inférieur : il s’élève à 1 594 euros. En outre, en 2007, 10 % des salariés à temps complet ont gagné un salaire mensuel net inférieur à 1 083 euros.
L’INSEE parvient aux mêmes conclusions pour l’année 2007 que l’École d’économie de Paris pour la période 1995-2006 : « C’est tout en haut de l’échelle, parmi les 10 % de salariés à temps complet qui gagnent le plus, que les salaires ont le plus progressé ». De fait, alors que la moitié des salariés vivaient en 2007 avec moins de 1 594 euros nets par mois, soit à l’année 19 128 euros, la rémunération moyenne des grands patrons s’élevait à 4,7 millions d’euros par an.
Au-delà même de la montée des inégalités, le développement du phénomène des travailleurs pauvres, dont le nombre a crû de 21 % entre 2003 et 2005, démontre que la précarité s’étend désormais y compris aux personnes qui travaillent. L’emploi ne protège donc plus de la pauvreté et ce sont 8 millions de Français qui vivent sous le seuil de pauvreté selon l’INSEE.
Face au constat d’une dégradation du pouvoir d’achat des ménages et d’un accroissement tant des inégalités que des travailleurs pauvres, le gouvernement refuse toute augmentation globale des salaires en arguant notamment que cette mesure est inefficace. Or, si l’on se réfère à un exemple historique, lorsque le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) avait été augmenté de 35 % en 1968, l’économie française en avait profité dans son ensemble. De plus, la part des importations dans la consommation des ménages français demeure relativement faible : elle se situe à environ 14 % selon l’Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE). Augmenter les salaires ne jouerait donc pas contre la relance économique.
Dans une conjoncture aussi difficile, avec des chances de plus en plus minces de retrouver un emploi, les personnes au chômage se trouvent, de surcroît, confrontés à des problèmes importants dans leur accompagnement vers l’emploi.
La fusion du réseau des Assedic et de l’Agence nationale pour l’emploi (ANPE) qui a donné lieu à la création en décembre 2008 d’une nouvelle institution, Pôle emploi, chargée à la fois de l’indemnisation et du suivi des demandeurs d’emploi, devait conduire à une amélioration de la prise en charge des personnes au chômage.
Or, force est de constater, six mois plus tard, que Pôle emploi accumule les difficultés de fonctionnement. Alors que l’objectif fixé par le gouvernement était d’atteindre la moyenne de 60 demandeurs d’emploi par conseiller, de l’aveu même du directeur général de Pôle emploi, aujourd’hui « on compte 90 demandeurs d’emploi par conseiller » et « dans certaines agences, cela peut aller jusqu’à 120, 140 voire 180 » (19). Un suivi convenable est impossible dans ces conditions, d’autant que 50 000 dossiers demeurent toujours en attente de traitement. La question de l’insuffisance du nombre des personnels est donc posée.
Seule une centaine de sites mixtes sont à l’heure actuelle opérationnels, sur les 956 sites prévus, et moins de 5 000 personnes ont été formées, depuis six mois, à l’accueil dans un guichet unique, c’est-à-dire à être en mesure tant de renseigner le demandeur d’emploi sur ses allocations que d’assurer le suivi de sa recherche d’emploi. Dans leur activité quotidienne, les conseillers de Pôle emploi se heurtent, de plus, à d’importants problèmes de raccordements informatiques entre les anciens réseaux des Assedic et de l’ANPE, ce qui complique leur tâche.
Au-delà de ces difficultés de fonctionnement, la création de l’institution s’est accompagnée d’un immense gaspillage de l’argent public qui doit être dénoncé : le coût de l’invention du nom « Pôle emploi » et de l’implantation du nouveau logo afférent est estimé, au total, à plus de 7 millions d’euros. Une dépense d’une utilité et d’une nécessité flagrantes pour les demandeurs d’emploi…
Au final, le directeur général de Pôle emploi, juge que le chantier de la fusion sera achevé vers la mi-2010 (20), un délai beaucoup trop long pour les millions de demandeurs d’emploi actuels et à venir.
IV.- DES MESURES D’URGENCE SOCIALE À PRENDRE
EN FAVEUR DE L’EMPLOI, DES SALAIRES
ET DU POUVOIR D’ACHAT
Face à l’urgence sociale qui résulte des multiples constats dressés ci-dessus, la présente proposition de loi vise à prendre des mesures immédiates dans deux domaines fondamentaux pour l’ensemble des Français.
A. DÉVELOPPER UNE ACTION GLOBALE ET DURABLE EN FAVEUR DE L’EMPLOI, DES SALAIRES ET DU POUVOIR D’ACHAT
Il s’agit en premier lieu de favoriser l’emploi :
– par la limitation des conditions d’admission des licenciements pour motif économique, en restreignant la définition de ce type de licenciement et en excluant les entreprises bénéficiaires de son champ d’application (article 1er) ;
– par le renchérissement du coût des licenciements pour motif économique, en sanctionnant par la nullité les licenciements abusifs et en augmentant le montant de l’indemnité perçue par le salarié en cas de licenciement nul (article 2) ;
– par la création d’un droit d’opposition des salariés contre les licenciements pour motif économique, exercé devant le juge des référés par les représentants des salariés, avant même la fin de la procédure, lorsque le licenciement semble infondé (article 3) ;
– par la suppression du dispositif d’exonérations fiscale et sociale sur les heures supplémentaires instauré par la « loi TEPA », qui freine les créations d’emploi et génère un coût très élevé pour le budget de l’État (article 4).
Il s’agit en deuxième lieu d’accroître les salaires et le pouvoir d’achat :
– par l’augmentation du SMIC à 1 600 euros bruts par mois (article 5), par la suppression des réductions générales de cotisations sociales si l’employeur ne conclut pas un accord salarial tous les ans (article 6), par l’exigence de la tenue d’une conférence nationale sur les salaires afin de relever l’ensemble des grilles salariales de branche (article 7) ;
– par la garantie intégrale des salaires des salariés contraints au chômage partiel dans des entreprises bénéficiaires, en vertu d’un mécanisme d’affectation prioritaire des bénéfices distribuables au maintien total des rémunérations (articles 9 et 10) ;
– par l’octroi de réels moyens de rupture des contrats de crédit à la consommation, afin de permettre aux emprunteurs de sortir à temps de la spirale de l’endettement et de ne pas sombrer dans le surendettement (article 14).
La présente proposition de loi contient quatre mesures supplémentaires qui ont été jugées irrecevables au regard de l’article 40 de la Constitution. Cet article, en interdisant aux membres du Parlement d’adopter des propositions de loi ou des amendements qui auraient « pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l’aggravation d’une charge publique », confère en réalité une primauté au gouvernement pour l’essentiel des dispositifs sociaux.
Bien que la délégation du Bureau de l’Assemblée nationale chargée du contrôle de recevabilité financière a priori des propositions de loi en application de l’article 81 du Règlement en ait accepté le dépôt, la présente proposition de loi a été renvoyée par le Président de l’Assemblée nationale au bureau de la Commission des finances afin qu’il statue sur sa conformité à l’article 40 de la Constitution. Par décision en date du 12 avril 2009, il a déclaré contraires à l’article 40 : l’article 8 (extension du RSA aux jeunes qui travaillent), l’article 11 (création d’une allocation de solidarité en faveur des demandeurs d’emploi non indemnisés), l’article 12 (suppression des franchises médicales) et l’article 13 (versement d’une allocation complémentaire aux bénéficiaires des aides étudiantes) de la proposition de loi.
Cette décision, qui rompt avec la tradition qui permettait à la Commission des affaires culturelles, familiales et sociales de discuter sur le fond de l’ensemble des dispositifs proposés, avant que soit opposée le cas échéant l’irrecevabilité financière, et qui ne tient pas compte du gage financier prévu à l’article 15 destiné à compenser à due concurrence toutes les charges supplémentaires pour les budgets de l’État et de la sécurité sociale générées par la présente proposition de loi, s’apparente à un recul démocratique, comme l’ont souligné tant M. Alain Vidalies (SRC) (21), rapporteur de la proposition de loi n° 1541 pour l’augmentation des salaires et la protection des salariés et des chômeurs, que M. Jean-Frédéric Poisson (UMP) (22), rapporteur de la proposition de loi n° 1610 pour faciliter le maintien et la création d’emplois.
Cette procédure conduit à un appauvrissement du débat et de la capacité d’initiative du Parlement et rend très relative la prétendue extension des droits de l’opposition, pourtant présentée comme l’une des avancées de la réforme constitutionnelle de juillet 2008 par les défenseurs de cette réforme.
Afin que le débat puisse tout de même avoir lieu sur ces mesures de première importance, bien que jugées irrecevables au titre de l’article 40 de la Constitution, qui concernent les jeunes, les droits des malades et l’indemnisation des demandeurs d’emploi, le rapporteur a souhaité les présenter en détail dans les développements qui suivent.
L’article 13 de la proposition de loi, auquel a été opposée l’irrecevabilité financière de l’article 40 de la Constitution, a pour objet de verser aux bénéficiaires des aides étudiantes et des allocations pour la diversité de la fonction publique une allocation complémentaire s’élevant à 50 % des sommes qu’ils ont perçues au titre de ces différentes prestations (alinéa unique).
Ce complément d’aide ciblé doit apporter aux étudiants bénéficiaires une bouffée d’oxygène, indispensable à leur pouvoir d’achat. Mais cette mesure n’est pas que socialement nécessaire : elle se veut aussi un geste fort en direction de la jeunesse, susceptible d’apaiser ses inquiétudes.
La jeunesse de notre pays est en effet anxieuse. Selon les termes du document de cadrage de la Commission de concertation sur la politique de la jeunesse, elle est « désillusionnée de l’ascenseur social », « fragmentée » et elle manifeste « une très faible confiance dans l’avenir » (23). Une récente enquête reflète sans ambiguïté l’état de désillusion des jeunes Français : ainsi, 55 % des étudiants interrogés doute de leur capacité à réussir dans la vie et 66 % juge la société peu favorable à leur génération (24). Comment pourrait-il en être autrement quand le chômage de masse fait des jeunes une variable d’ajustement ?
Avec l’approfondissement de la révolution informationnelle, l’éducation s’affirme comme un enjeu de société de premier ordre. Il faut désormais se former tout au long de la vie. En mars 2001, le rapport « Jeunesse, le devoir d’avenir », de la commission du commissariat général au plan présidée par Dominique Charvet, avait déjà pointé la nécessité d’établir au profit des jeunes un « droit-créance » traduisant l’investissement éducatif collectif. La mise en place d’une allocation de formation devait permettre aux jeunes travailleurs en formation de s’insérer dans le droit commun du travail pour alterner études et expérience professionnelle. Au lieu de cela, le gouvernement a privilégié le statu quo, n’envisageant l’expérience professionnelle qu’au travers de stages dont les conditions d’encadrement et de rémunération sont déplorables, et de petits boulots non qualifiants. Ainsi, trop souvent, les étudiants sont obligés pour des raisons financières de choisir des filières courtes ou de se salarier dans de mauvaises conditions, au détriment de la qualité de leurs études.
Le phénomène du travail étudiant est difficile à mesurer, mais les données disponibles sont sans appel quant à l’ampleur du phénomène – et de ses effets potentiellement nocifs. Le Conseil économique, social et environnemental a notamment estimé que plus de 40 % des étudiants exerce une activité rémunérée pendant l’année universitaire (25). De son côté, l’Observatoire de la vie étudiante (OVE) indique qu’une « proportion non négligeable des étudiants exercent au cours de l’année universitaire un emploi en très forte concurrence avec leur scolarité. C’est notamment le cas de ceux (au moins 13 %) qui travaillent à côté des études au moins à mi-temps et au moins six mois par an dont la part augmente régulièrement avec l’âge » (26). Malheureusement, ce sont précisément ces activités exercées au moins à mi-temps et au moins six mois par an qui exposent le plus les étudiants au risque d’échec.
Cette inégalité devant la réussite qu’entraîne un travail contraint est d’autant moins acceptable que celui-ci pénalise, en tout premier lieu, les étudiants issus des milieux les plus modestes.
Ainsi, une enquête de l’OVE a mis en évidence le fait que « les étudiants dont les parents ont un diplôme d’études primaires, ceux dont le revenu des parents est compris entre 762 euros et 1 524 euros…sont plus souvent contraints » à exercer un travail rémunéré (27). La reproduction sociale est ainsi confortée au profit de la classe dominante.
Or force est de constater que les aides publiques actuelles sont nettement insuffisantes pour mettre les étudiants à l’abri de ce travail subi.
Elles ne leur permettent pas en effet de faire face à leurs besoins quotidiens, les jeunes devant, comme les autres adultes, se nourrir, se vêtir, se loger, se déplacer et se divertir.
Ainsi, bien que le dispositif ait été reformé en 2008, les bourses sont d’un niveau trop faible.
Chacun sait que celui-ci repose, pour l’essentiel, sur les bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux, le tableau ci-après retraçant les montants et le nombre de boursiers.
Attribuées pour neuf mois, elles varient en fonction des ressources et des charges des parents, appréciées par rapport à un barème national, et de deux critères d’attribution : l’éloignement entre le domicile et le lieu d’études et le nombre d’enfants à charge du foyer fiscal de référence.
Montant des bourses sur critères sociaux (BCS) et nombre de boursiers
Montant annuel de la bourse |
Nombre de boursiers | |
Échelon 0 |
Exonération des frais d’inscription et de cotisation à la sécurité sociale |
69 332 |
Échelon 1 |
Exonération + 1 424 € |
93 443 |
Échelon 2 |
Exonération + 2 145 € |
52 327 |
Échelon 3 |
Exonération + 2 749 € |
52 726 |
Échelon 4 |
Exonération + 3 351 € |
51 751 |
Échelon 5 |
Exonération + 3 847 € |
97 534 |
Échelon 6 |
Exonération + 4 019 € |
108 110 |
Total BCS |
525 223 |
Source : Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Ainsi, sauf en cas de cumul avec une aide d’urgence ponctuelle, les bourses sur critères sociaux peuvent atteindre, au maximum, pour des familles extrêmement modestes, 4 019 euros, soit 446 euros par mois pendant neuf mois… C’est peu, trop peu.
On pourrait nuancer ce jugement en faisant valoir que le gouvernement a revalorisé le taux de ces bourses. Cependant, les augmentations intervenues sont dérisoires : 2,5 % en 2007, et en 2008. Ce chiffre est à comparer avec la décision prise par l’Institut d’études politique de Paris de compléter, pour les étudiants du premier cycle et du master de l’année 2008-2009, la bourse délivrée sur critères sociaux d’un montant équivalent à 50 % du montant de ladite bourse, sous réserve que l’étudiant ne bénéficie pas de l’aide au mérite.
Complément financé par l’Institut d’études politiques de Paris
pour les boursiers sur critères sociaux
A |
B |
A + B | |
Échelon |
Montant bourse |
Montant du complément versé par Sciences Po |
Total reçu par l’étudiant |
1 |
1 424 |
712 |
2 136 |
2 |
2 145 |
1 073 |
3 218 |
3 |
2 749 |
1 375 |
4 124 |
4 |
3 351 |
1 676 |
5 027 |
5 |
3 847 |
1 924 |
5 771 |
6 |
4 019 |
2 010 |
6 029 |
Pour remédier à cette insuffisance de solidarité, l’article 13 propose d’agir sur deux leviers, en revalorisant, d’une part, les prestations étudiantes et, d’autre part, les allocations pour la diversité dans la fonction publique.
Dans les deux cas, les bénéficiaires de ces aides percevraient, au titre de l’année 2008-2009, une allocation complémentaire s’élevant à 50 % des sommes qu’ils ont reçues au titre de ces prestations.
Seraient ainsi visés :
– Les bénéficiaires des prestations prévues à l’article L. 821-1 du code de l’éducation aux termes duquel la collectivité nationale « accorde aux étudiants des prestations qui sont notamment dispensées par des organismes spécialisés où les étudiants élisent leurs représentants… Elle privilégie l’aide sous condition de ressources afin de réduire les inégalités sociales ». Il s’agissait donc des bénéficiaires de toutes les prestations (bourses sur critères sociaux, aide au mérite, aide à la mobilité et aides du Fonds national d’aide d’urgence) mises en place par le ministère de l’enseignement supérieur.
– Les bénéficiaires du dispositif « allocations pour la diversité dans la fonction publique ». Peu connues, ces aides ont été instituées par un arrêté en date du 5 juillet 2007. D’un montant de 2 000 euros seulement pour l’année 2008-2009 et n’ouvrant droit à aucune prestation connexe (exonération des droits de sécurité sociale par exemple), elles sont attribuées, par les préfets, dans le cadre d’un contingent régional modifié chaque année par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, aux étudiants (environ 800 aujourd’hui) préparant un ou plusieurs concours de la fonction publique sur la base de deux critères : les « ressources de leurs familles » et les « résultats de leurs études antérieures » (28). Elles sont également versées aux personnes sans emploi et titulaires d’un diplôme leur permettant de passer un concours de catégorie A ou B et préparant un ou plusieurs concours de la fonction publique.
Le débat autour de l’article 13 et son éventuelle adoption aurait envoyé, dans un contexte de mouvement étudiant massif, un signal positif à la jeunesse, tout en rappelant qu’une telle avancée n’aurait constitué qu’un premier pas en attendant la mise en place de l’allocation de formation précitée.
Le RSA, tel qu’il a été institué par la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion, est réservé aux personnes âgées de plus de 25 ans, sauf dans le cas où elles assument « la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître » ; en sont également écartés (même lorsqu’ils ont atteint l’âge de vingt-cinq ans), les élèves, étudiants et stagiaires.
L’article 8 de la proposition de loi, qui a été jugé irrecevable au titre de l’article 40 de la Constitution, propose de supprimer cette dernière restriction (c’est l’objet de son alinéa 3) et d’atténuer la condition d’âge de 25 ans : elle ne serait plus opposable aux jeunes majeurs qui travaillent (alinéa 2).
Le RSA est assurément un dispositif dangereux. Reposant sur le dogme libéral du mythique « chômeur fainéant », le RSA focalise la question du retour à l’emploi sur l’incitation économique, alors qu’une enquête de la Direction de la recherche des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES) d’avril 2007 (29) (Enquête auprès des bénéficiaires de minima sociaux 2006 Études et résultats – n°567) a mis en évidence son caractère très secondaire. Cette approche nie une réalité évidente, à savoir qu’en l’absence d’emplois disponibles décents, ceux-ci ne peuvent être pourvus : le problème vient donc principalement des stratégies de compression systématique de la masse salariale. La stigmatisation des personnes au chômage qui découle de cette approche constitue en outre un alibi certain pour mettre en œuvre une politique visant à offrir au patronat une main d’œuvre bon marché : découplant aux frais du contribuable le revenu et le salaire, le RSA met en danger l’existence même du SMIC et encourage la multiplication d’emplois précaires et peu rémunérés, créant de véritables « trappes à précarité ». Ces « trappes à insécurité sociale » ont d’autant plus vocation à être des « trappes à pauvreté » que le montant du RSA permet difficilement de dépasser le seuil de pauvreté.
Au lieu de découpler insertion sociale et insertion professionnelle comme le fait le gouvernement, une approche plus globale serait souhaitable, par la mise en œuvre d’un dispositif de sécurité emploi et formation. Un tel dispositif réduirait l’insécurité sociale et la pauvreté, tout en répondant aux exigences de notre temps en termes de formation tout au long de la vie et d’épanouissement des individus. L’urgence toutefois impose de répondre rapidement à la pauvreté croissante que la crise impose aux femmes et aux hommes de ce pays : aussi, l’extension provisoire du RSA aux jeunes travailleurs de moins de 25 ans semble-t-elle un moindre mal. Elle repose sur trois constats :
– Les jeunes étant les premiers touchés par le chômage, la pauvreté et la crise, leur appliquer le RSA relève de la justice sociale élémentaire. Quand bien même, d’ailleurs, les jeunes ne seraient pas dans une situation en général plus difficile que la moyenne de nos concitoyens, comment pourrait-on justifier que deux salariés occupant le même emploi dans une entreprise, pour le même salaire, aient en fin de parcours un revenu différent compte tenu du complément de revenu de RSA que touche l’un, mais pas l’autre, selon leurs âges respectifs ?
– La grande majorité des pays européens n’excluent pas les jeunes des mécanismes de solidarité de droit commun ; une telle exclusion ne saurait aller de soi.
– Le caractère discriminatoire de l’exclusion des jeunes du RSA a été démontré par la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité (HALDE) et notre pays, en la maintenant, ne respecte pas ses engagements internationaux.
1. Les jeunes sont les premiers touchés par le chômage, la pauvreté et la crise
Traditionnellement, les jeunes sont particulièrement concernés par le chômage et la pauvreté. De surcroît ils sont les premières victimes de la crise.
Le taux de chômage des moins de vingt-cinq ans est supérieur à 20 % et pratiquement trois fois plus élevé que la moyenne nationale, comme il ressort de la statistique ci-après, qui montre aussi la dégradation importante de la situation que l’on peut constater au cours de l’année 2008 : de fin 2007 à 2008, le taux de chômage des jeunes est passé de 19 % à plus de 21 %, ce qui traduit l’impact particulièrement dramatique de la crise économique sur l’emploi des jeunes.
Taux de chômage par tranches d’âge au sens du BIT
(DOM inclus)
(en %)
4e trimestre 2007 |
4e trimestre 2008 | |
Ensemble |
7,9 |
8,2 |
Moins de 25 ans |
19 |
21,2 |
25 à 49 ans |
7,3 |
7,4 |
50 ans et plus |
5,1 |
5,2 |
Source : INSEE.
En effet, en un an, de mars 2008 à mars 2009, le nombre de jeunes de moins de vingt-cinq ans demandeurs d’emploi dits de catégorie A (immédiatement disponibles et sans emploi au cours du dernier mois) a augmenté en France métropolitaine de 35,8 %, quand la hausse pour l’ensemble des classes d’âge a été de 22,1 % (30).
Les jeunes sont aussi les plus touchés par la pauvreté, ainsi que le montrent les dernières statistiques disponibles, portant sur 2006. Les 18-24 ans apparaissent, devant les enfants et les personnes âgées, comme la classe d’âge la plus fréquemment concernée par la pauvreté.
Taux de pauvreté monétaire des personnes selon leur âge en 2006
(revenu inférieur à 60 % du revenu médian, par unité de consommation)
(en %)
Femmes |
Hommes | |
Moins de 18 ans |
17,6 |
17,8 |
18 à 24 ans |
23,2 |
18,9 |
25 à 34 ans |
12 |
9,5 |
35 à 44 ans |
13,2 |
11,2 |
45 à 54 ans |
12,1 |
10,6 |
55 à 64 ans |
9,9 |
10 |
65 à 74 ans |
8,5 |
7,7 |
75 ans et plus |
13,6 |
9,3 |

Champ : personnes vivant en France métropolitaine dans un ménage dont le revenu déclaré est positif ou nul et dont la personne de référence n’est pas étudiante.
Source : INSEE-DGFIP-CNAF-CNAV-CCMSA, enquête Revenus fiscaux et sociaux 2006.
2. La grande majorité des pays européens n’écartent pas les jeunes des minima sociaux
Les services statistiques du ministère des affaires sociales ont publié en 2006 une enquête comparative baptisée « Un panorama des minima sociaux en Europe » (31) portant sur la quasi-totalité (14 sur 15) des États-membres de l’Union européenne avant son élargissement à l’est. Derrière la diversité des systèmes nationaux, cette étude notait que tous les États étudiés sauf un (l’Italie) ont mis en place un minimum social à vocation générale du type du revenu minimum d’insertion (RMI) français. Or, dans la grande majorité d’entre eux, il n’y a pas de condition d’âge pour en bénéficier ou bien elle est fixée entre seize et dix-huit ans ; seuls trois pays en écartaient, au moment de cette étude, les moins de vingt-cinq ans : la France (avec le RMI), l’Espagne et le Luxembourg.
La discrimination à l’égard des moins de vingt-cinq ans est donc bien, en l’espèce, une exception. La grande majorité de nos voisins considèrent, à la différence de la France, qu’il n’existe pas de raison valable d’exclure les jeunes des mécanismes de solidarité de droit commun.
3. Le caractère discriminatoire de l’exclusion des jeunes du RSA est établi
Saisie par le Groupe d’information et de soutien des immigrés (GISTI) sur la loi généralisant le RSA, la HALDE a établi, dans sa délibération n° 2008-228 du 20 octobre 2008, le caractère discriminatoire de l’exclusion des jeunes du RSA, qui apparaît contraire aux engagements internationaux de la France. En effet, la prohibition de la discrimination sur critères d’âge est prévue non seulement dans des textes législatifs nationaux (code pénal et code du travail), mais aussi par des textes européens.
L’un des principaux arguments invoqués pour justifier la condition d’âge de vingt-cinq ans posée pour le RSA est celui de la continuité avec le RMI, auquel le RSA succède. Mais s’il est vrai que le RMI comportait la même règle d’âge, sa conformité à nos engagements internationaux avait déjà été mise en cause, comme le rappelle la HALDE dans sa délibération susmentionnée : « s’agissant du RMI, le Comité européen des droits sociaux du Conseil de l’Europe a estimé, sur le fondement de l’article 13 (droit à l’assistance sociale et médicale) de la Charte sociale européenne révisée, que : " l’exclusion des personnes de moins de vingt-cinq ans du RMI et l’insuffisance des autres mesures d’assistance sociale prévues pour ces personnes en cas de besoin ne sont pas conformes à cette disposition de la Charte " (conclusions XV-1 - 01/01/2000) ».
Au regard des éléments susmentionnés, la HALDE conclut sa délibération en constatant « l’existence d’une différence de traitement fondée sur l’âge des personnes actives, (…) ; une telle différence de traitement n’est licite que si elle est justifiée de façon objective et raisonnable, c’est-à-dire si elle poursuit un but légitime et qu’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé ». Or, interrogé sur ce point, le gouvernement n’a adressé à la haute autorité aucune observation ; elle demande donc, dans sa délibération, que soit réalisée « une étude sur les conséquences de la condition d’âge fixée pour les bénéficiaires du RSA, au regard en particulier des difficultés d’insertion sociale et professionnelle des jeunes âgés de moins de vingt-cinq ans ».
Le rapporteur ne peut que relayer ces questionnements : l’étude demandée a-t-elle été réalisée ? Quel est le « but légitime » poursuivi par l’exclusion des jeunes du RSA et cette exclusion est-elle un moyen raisonnable et proportionné de l’atteindre ? À défaut de réponses à ces interrogations, le fait est qu’au-delà des considérations de justice sociale qui doivent conduire à étendre le RSA aux jeunes, au-delà des considérations d’égalité entre les salariés quel que soit leur âge, c’est le strict respect des engagements internationaux et de la parole de la France qui impose cette extension.
La majorité avait montré, lors du débat parlementaire sur le RSA, son malaise sur la question de l’exclusion des jeunes en votant des amendements cosmétiques : une demande de rapport du gouvernement sur la situation des jeunes à déposer avant le 1er juin 2010 et la création urgente d’un fonds d’appui aux expérimentations en leur faveur. L’aggravation dramatique de la situation des Français modestes depuis, et en particulier des jeunes, impose désormais de vraies mesures. Dans l’attente de la création d’une allocation de formation et de la mise en œuvre d’un dispositif de sécurité emploi-formation, il faut étendre le RSA aux jeunes qui travaillent.
L’article 12 de la proposition de loi, qui a été jugé irrecevable au titre de l’article 40 de la Constitution, a pour objet de supprimer les « franchises médicales » instituées par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2008.
1. Le régime des franchises médicales
L’article 52 de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008 a complété l’article L. 322-2 du code de la sécurité sociale afin d’instaurer une franchise – dite « franchise médicale » – laissée à la charge des assurés sociaux, sur certaines prestations et certains produits de santé pris en charge par l’assurance maladie.
Le décret n° 2007-1937 du 26 décembre 2007 a fixé le montant de cette franchise à :
– 0,50 euro par unité de conditionnement de médicaments, à l’exception de ceux délivrés au cours d’une hospitalisation ;
– 0,50 euro par acte effectué par un auxiliaire médical (c’est-à-dire un infirmier, un masseur-kinésithérapeute, un pédicure-podologue, un orthophoniste ou un orthoptiste), à l’exclusion des actes pratiqués au cours d’une hospitalisation ;
– 2 euros par trajet effectué en ambulance, en véhicule sanitaire léger ou en taxi, sauf pour les transports d’urgence.
L’article 52 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 prévoit que cette franchise est due dans la limite d’un double plafond :
– un plafond annuel, fixé à 50 euros par le décret précité ;
– un plafond journalier, fixé à 2 euros pour les actes des auxiliaires médicaux et à 4 euros pour les transports sanitaires.
Cette franchise est due par tous les assurés sociaux, y compris ceux qui relèvent des régimes d’accidents du travail et de maladies professionnelles (AT/MP). Seuls en sont exonérés les ayants droit mineurs, les bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C), les bénéficiaires de l’assurance maternité et certains pensionnés militaires d’invalidité.
Elle se cumule en effet avec le « ticket modérateur » et la participation forfaitaire d’un euro déjà à la charge des bénéficiaires de l’assurance maladie.
Selon un rapport d’évaluation de la mise en œuvre de cette franchise remis au Parlement par le gouvernement, le produit de la franchise s’élèverait à 800 millions d’euros en 2008 (32).
2. L’impact des franchises médicales sur l’accès aux soins
Selon l’exposé des motifs du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2008, l’instauration des « franchises médicales » avait deux objectifs.
D’une part, elle visait à financer des investissements concernant la maladie d’Alzheimer, les soins palliatifs et le cancer. Cela aurait supposé que la loi prévoit un « fléchage » des sommes économisées, mais comme le reconnaît le rapport précité, « il n’y a pas, d’un point de vue juridique et comptable, d’affectation d’une recette à une dépense en matière de sécurité sociale ».
D’autre part, la création de la franchise répondait également à un « souci de responsabilisation des assurés », visant à contrôler l’évolution des dépenses de santé dans des secteurs qui « correspondent aux champs de dépenses parmi les plus dynamiques ». Le principe même d’une telle responsabilisation est contestable, car l’assuré ne choisit pas d’être malade ou victime d’un accident du travail, et n’est pas responsable des choix de prescription que fait son médecin. On peut penser que c’est pour ces raisons que, comme l’indique le rapport précité, la franchise « n’a pas eu d’impact sensible sur l’évolution des volumes des prestations couvertes », le tassement observé en 2008 dans la consommation de médicaments s’expliquant essentiellement par des déremboursements.
On constate en revanche que la franchise a aggravé les difficultés financières d’accès aux soins rencontrés par les patients les plus démunis et par ceux qui ont le plus besoin de soins, les conduisant parfois à renoncer à des soins. Une récente étude de l’institut de recherche et de documentation en économie de la santé (IRDES) (33) montre d’ailleurs qu’avant l’instauration de cette franchise, 14 % de la population métropolitaine avait déjà dû renoncer à des soins pour des raisons financières.
Même plafonnée à 50 euros par an, la franchise aggrave d’autant plus ces difficultés que les organismes complémentaires d’assurance maladie sont incités à ne pas la prendre en charge : une telle garantie est en effet exclue par les règles définissant les contrats d’assurance dits « responsables », qui seuls ouvrent droit à certains avantages fiscaux.
Ainsi, la franchise a pour effet de fragiliser particulièrement les malades dont les revenus sont modestes, mais excèdent le plafond d’éligibilité à la CMU-C (environ 620 euros par mois pour une personne seule). C’est par exemple le cas d’un assuré qui aurait pour seule ressource l’allocation adulte handicapé (AAH), soit 666,96 euros par mois.
Pour toutes ces raisons, l’article 12 propose d’abroger l’article 52 de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008, qui a institué cette franchise (alinéa unique).
Face à la recrudescence du chômage et à la dégradation du marché de l’emploi, l’article 11 de la proposition de loi, qui a été jugé irrecevable au titre de l’article 40 de la Constitution, a pour objet de créer une allocation de solidarité de l’État en faveur des demandeurs d’emploi non indemnisés par le régime de l’assurance chômage.
Les conditions d’attribution, la durée de versement et le montant de l’allocation d’assurance chômage, dénommée « allocation d’aide au retour à l’emploi » (ARE), sont régis par le code du travail, la convention du 19 février 2009 relative à l’indemnisation du chômage et le règlement général qui lui est annexé, applicables depuis le 1er avril 2009.
● Les conditions d’attribution de l’allocation d’aide au retour à l’emploi
Pour bénéficier de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, tout demandeur d’emploi doit remplir sept conditions.
Le demandeur d’emploi doit, en premier lieu, justifier d’une période d’affiliation préalable de 4 mois minimum, c’est-à-dire qu’il doit avoir déjà exercé une activité professionnelle salariée dans une ou plusieurs entreprises pendant au moins 4 mois au cours des 28 derniers mois, lorsqu’il a moins de 50 ans à la date de fin de son contrat de travail, ou au cours des 36 derniers mois, lorsqu’il a plus de 50 ans à la date de fin de son contrat de travail (34).
Le salarié privé d’emploi doit, en deuxième lieu, ne pas avoir quitté volontairement son emploi aux termes de l’article L. 5422-1 du code du travail et des articles 2 et 4 du règlement général annexé à la convention du 19 février 2009. La cessation de son contrat de travail doit résulter soit d’un licenciement, soit d’une rupture conventionnelle, soit d’une fin de contrat de travail à durée déterminée, soit d’une démission considérée comme légitime dans les conditions fixées par l’accord d’application n° 14 de la convention relative à l’indemnisation du chômage du 19 février 2009, soit de l’une des causes économiques visées à l’article L. 1233-3 du code du travail.
Le demandeur d’emploi doit en troisième lieu être apte au travail, en vertu de l’article L. 5422-1 du code du travail, car l’indemnisation du chômage suppose que la personne est disponible et pourra reprendre une activité professionnelle dès qu’elle acceptera un emploi. Cette condition est présumée remplie dès lors que la personne est inscrite sur la liste des demandeurs d’emploi.
Le salarié privé d’emploi doit en quatrième lieu, être inscrit comme demandeur d’emploi selon les articles L. 5411-1 du code du travail et 4 du règlement général annexé à la convention du 19 février 2009.
Le salarié privé d’emploi doit, en cinquième lieu, accomplir une recherche effective et permanente d’emploi, sous peine de sanctions (voir infra). Il doit ainsi effectuer des actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, accepter les offres raisonnables d’emploi et mener les actions proposées par le service public de l’emploi comme l’actualisation du projet personnalisé d’accès à l’emploi, aux termes de l’article L. 5411-6 du code du travail.
Les conditions d’obtention de la dispense de recherche d’emploi ont été restreintes par la loi n° 2008-758 du 1er août 2008 relative aux droits et aux devoirs des demandeurs d’emploi. L’article L. 5421-3 du code du travail prévoit désormais que pour bénéficier de la dispense de recherche d’emploi en 2009, l’allocataire doit être âgé de cinquante-huit ans. En 2010, seules les personnes âgées de cinquante-neuf ans pourront y prétendre et à partir de 2011 uniquement celles âgées de soixante ans. Enfin le dispositif devrait a priori être supprimé en 2012.
Le demandeur d’emploi doit en principe, en sixième lieu, être âgé de moins de soixante ans. Toutefois, selon l’article 4 du règlement général annexé à la convention du 19 février 2009 relative à l’indemnisation du chômage « les personnes qui, lors de leur soixantième anniversaire, ne justifient pas du nombre de trimestres d’assurance requis au sens des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale (tous régimes confondus), pour percevoir une pension à taux plein, peuvent bénéficier des allocations jusqu’à justification de ce nombre de trimestres et, au plus tard, jusqu’à l’âge de soixante-cinq ans ». Une fois que le demandeur d’emploi a atteint la durée d’assurance requise pour l’ouverture du droit à une pension de vieillesse à taux plein ou l’âge de soixante-cinq ans, l’allocation cesse d’être versée, selon l’article L. 5421-4 du code du travail.
Le salarié privé d’emploi doit enfin résider sur le territoire relevant du champ d’application du régime de l’assurance chômage à savoir le territoire métropolitain, les départements d’outre-mer et les collectivités d’outre-mer de Saint-Pierre et Miquelon, Saint-Barthélemy et Saint-Martin, selon l’article 4 de la convention du 19 février 2009. Il est à noter que le régime d’assurance chômage s’applique également « aux salariés détachés ainsi qu’aux salariés expatriés, ressortissants d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) ou de la Confédération suisse, occupés par des entreprises entrant dans le champ d’application territorial de la convention », en vertu du même article.
● La durée de versement et le montant de l’allocation d’aide au retour à l’emploi
La durée de versement de l’allocation d’assurance chômage est égale à la durée d’affiliation de la personne. En effet, la convention du 19 février 2009 a mis en place une filière unique d’indemnisation régie par le principe « un jour travaillé égal un jour indemnisé ». Par exemple, une personne ayant travaillé six mois percevra l’allocation d’assurance chômage pendant six mois.
La durée maximum de versement de l’allocation d’assurance chômage est de vingt-quatre mois pour les personnes de moins de cinquante ans et de 36 mois pour les personnes de plus de cinquante ans, selon les articles R. 5422-1 du code du travail et 11 du règlement général annexé à la convention du 19 février 2009.
Le montant de l’allocation d’aide au retour à l’emploi est calculé à partir d’un salaire de référence qui est constitué des salaires ayant servi au calcul des cotisations de sécurité sociale pendant une période de référence, en principe les douze mois civils précédant le dernier jour de travail (35). Selon l’article 3 de la convention du 19 février 2009, le salaire de référence ne peut toutefois pas dépasser un montant limite fixé à quatre fois le plafond de la sécurité sociale, fixé à 2 859 euros pour 2009 (36), soit 11 436 euros.
Le « salaire journalier de référence » est égal au quotient du salaire de référence divisé par le nombre de jours de travail au titre desquels les rémunérations ont été perçues. Le montant de l’allocation journalière est égal à la valeur la plus élevée entre 40,4 % du salaire journalier de référence, auquel s’ajoute une partie fixe de 10,93 euros par jour depuis le 1er juillet 2008, ou 57,4 % du salaire journalier de référence. Le montant de l’allocation journalière ainsi déterminé ne peut être ni inférieur à un certain montant revalorisé chaque année au 1er juillet (26,66 euros par jour depuis le 1er juillet 2008), ni supérieur à 75 % du salaire journalier de référence (37).
● Les possibilités de réduction et de suppression de l’allocation d’aide au retour à l’emploi
Le préfet, sur le signalement des agents de Pôle emploi, peut décider de réduire voire de supprimer totalement l’allocation d’un demandeur d’emploi dont il a été constaté qu’il a manqué à ses obligations, selon les règles énoncées par les articles L. 5426-2 et suivants et R. 5426-3 et suivants du code du travail.
En termes de procédure, si le préfet envisage de réduire l’allocation, il est simplement tenu d’informer le demandeur d’emploi qui ne peut que présenter des observations écrites. Si la suppression de l’allocation est envisagée, le demandeur d’emploi peut saisir une commission composée de représentants de l’État et de Pôle emploi qui formule un avis sur le projet de décision du préfet. Mais ce dernier n’est pas lié par l’avis rendu.
En parallèle, le directeur général du pôle emploi peut prononcer la radiation de la personne de la liste des demandeurs d’emploi, conformément aux dispositions des articles L. 5412-1 et suivants et R. 5412-1 et suivants du code du travail. Comme le préfet, il n’est tenu que d’informer le demandeur d’emploi et de recueillir éventuellement ses observations.
En cas de manquement à son devoir d’accomplir des actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, ou de refus sans motif légitime de suivre une action s’inscrivant dans son projet personnalisé d’accès à l’emploi, ou de refus sans motif légitime d’une proposition de contrat de professionnalisation ou d’apprentissage, d’une action de formation ou d’insertion d’un contrat aidé, le demandeur d’emploi encourt une réduction de 20 % de son revenu de remplacement pendant une durée de deux à six mois et une radiation de la liste des demandeurs d’emploi de quinze jours.
En cas de manquements répétés, la réduction peut atteindre un taux de 50 % pendant une durée de deux à six mois et la suppression du revenu peut être prononcée. Le demandeur d’emploi peut se voir infligé alors une radiation d’une durée d’un à six mois.
En cas de refus sans motif légitime de deux offres raisonnables d’emploi, ou de refus sans motif légitime d’élaborer ou d’actualiser le projet personnalisé d’accès à l’emploi, de répondre aux convocations du service public de l’emploi ou de se soumettre à une visite médicale, le demandeur d’emploi peut être sanctionné par la suppression de l’allocation d’aide au retour à l’emploi et la radiation pendant deux mois.
En cas de manquements répétés, la suppression de l’allocation et la radiation peuvent être prononcées pour une durée de deux à six mois. La suppression de l’allocation peut même être définitive.
Enfin en cas d’absence de déclaration, de fausse déclaration ou de déclaration mensongère, le demandeur d’emploi encourt en principe la suppression définitive de son allocation et une radiation de six à douze mois.
Il est à noter qu’avant de pouvoir exercer un recours contre la décision du préfet de réduire ou de supprimer l’allocation devant la juridiction administrative, le demandeur d’emploi doit exercer un recours gracieux qui n’est pas suspensif.
● La situation des demandeurs d’emploi à l’expiration de leurs droits
À l’expiration de leurs droits, certains demandeurs d’emploi, lorsqu’ils justifient d’une importante activité salariée passée, peuvent être pris en charge par le régime de solidarité et continuer de percevoir des allocations.
Les chômeurs de longue durée ayant épuisé leurs droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi peuvent ainsi bénéficier de l’allocation de solidarité spécifique (ASS) (38) sous réserve de remplir les conditions énoncées aux articles L. 5423-1 et suivants et R. 5423-1 du code du travail :
– être à la fois à la recherche d’un emploi (sauf en cas d’obtention d’une dispense de recherche d’emploi) et physiquement apte à exercer un emploi ;
– ne pas dépasser un plafond de ressources mensuelles fixé à soixante-dix fois le montant journalier de l’allocation pour une personne seule et à cent dix fois le même montant pour un couple ;
– justifier de cinq ans d’activité salariée dans les dix ans précédant la fin du contrat de travail. En cas d’interruption d’activité pendant au moins un an pour élever un ou plusieurs enfants, cette durée peut être réduite d’un an par enfant élevé ou à charge dans la limite de trois ans.
L’allocation équivalent retraite (AER), qui était accordée aux demandeurs d’emploi (39), justifiant avant leurs soixante ans d’au moins 160 trimestres validés (ou périodes équivalentes) dans les régimes de base obligatoire de l’assurance vieillesse a été supprimée depuis le 1er janvier 2009.
L’allocation de fin de formation, qui avait été supprimée à compter du 1er janvier 2009 par la loi de finances initiale de 2009, a été rétablie temporairement, pour l’année 2009, par le décret n° 2009-458 du 22 avril 2009 instituant une allocation en faveur des demandeurs d’emploi en formation.
Elle permet le maintien des allocations de chômage jusqu’à la fin d’une formation entamée en 2009 par le demandeur d’emploi, sur prescription de Pôle emploi, avant l’expiration de ses droits à indemnisation mais s’étendant postérieurement à cette date.
2. Un régime laissant 40 % des demandeurs d’emploi sans indemnisation
À la lecture du dispositif permettant l’indemnisation du chômage, le constat du caractère restrictif des conditions d’accès à l’allocation d’aide au retour à l’emploi et au régime de la solidarité s’impose.
Le démontrent notamment la nécessité d’une période d’affiliation préalable d’une durée de quatre mois, le principe d’une durée d’indemnisation équivalente à la durée de cotisation et les possibilités de radiation des listes ou de réduction et de suppression des allocations de chômage ainsi que la suppression ou le caractère temporaire ou très limitatif des allocations du régime de solidarité en faveur des demandeurs d’emploi en fin de droits.
Les conditions restrictives régissant l’accès à l’indemnisation du chômage entraînent des conséquences sociales majeures.
En effet, en juin 2008, selon les statistiques publiées par l’Unédic, seuls 59,4 % des demandeurs d’emploi inscrits sur les listes étaient indemnisés soit au titre de l’assurance chômage pour 47,8 % d’entre eux, soit au titre de la solidarité pour 11,6 % d’entre eux.
Il est à noter, de plus, que depuis quinze ans, si le taux de demandeurs d’emploi couverts par le régime de la solidarité demeure stable, le taux de demandeurs d’emplois indemnisés par le régime de l’assurance chômage a fortement varié, comme le retrace le graphique ci-dessous.
Taux de demandeurs d’emploi qui bénéficient d’une indemnisation
(en juin des années considérées, en %)

Source : Unédic, revue Statis, n° 189, 2008.
Cette variation s’explique principalement par la conjoncture économique et l’état du marché du travail mais aussi par les évolutions du système d’indemnisation du chômage dont les conditions plus restrictives laissent sans indemnisation 40 % des personnes au chômage. Les radiations administratives représentaient ainsi en mars 2009 près de 40 000 sorties du dispositif d’assurance chômage (40).
L’absence d’indemnisation frappe en particulier les salariés précaires : 170 000 à 180 000 inscriptions mensuelles à Pôle emploi sont dues à des fins de contrat de travail à durée déterminée (CDD) ou de mission d’intérim, ce chiffre s’élevant à 172 700 pour mars 2009. Selon la Direction de l’animation de la recherche des études et des statistiques (DARES), la fin de CDD constituait ainsi le deuxième motif d’inscription à Pôle emploi, représentant 24,7 % des inscriptions (41), et la fin de mission d’intérim représentait 9,2 % des inscriptions, en mars 2009 (42).
Or ces salariés répondent plus difficilement aux conditions d’admission à l’allocation d’aide au retour à l’emploi et bénéficient d’une durée d’indemnisation moindre en raison du nouveau principe d’indemnisation « un jour travaillé égal un jour indemnisé ».
Parmi ces salariés précaires, la situation des jeunes est particulièrement préoccupante : en mars 2009 le nombre de demandeurs d’emploi de moins de vingt-cinq ans s’élève à 597 700 (43), soit une augmentation de 24,5 % par rapport aux chiffres de mars 2008 (44). Le taux de couverture des jeunes demandeurs d’emploi se situe à un niveau bien inférieur à celui d’autres tranches d’âge : fin 2007, si 80 % des demandeurs d’emploi de plus de cinquante ans bénéficiaient d’une allocation de chômage ou de solidarité, seuls 45 % des demandeurs d’emploi de moins de vingt-cinq ans étaient couverts.
3. Le dispositif proposé : une allocation de solidarité en faveur de tous les demandeurs d’emploi non indemnisés
Les demandeurs d’emploi non indemnisés au titre de l’assurance chômage ou au titre de la solidarité ne peuvent prétendre qu’au bénéfice des minima sociaux, s’ils en remplissent les conditions d’obtention, ou à la prime forfaitaire de l’État de 500 euros, créée par le décret n° 2009-339 du 27 mars 2009 instituant une prime exceptionnelle pour certains salariés privés d’emploi.
Cette prime forfaitaire est insuffisante dans son montant et les conditions de son obtention sont limitatives. Pour bénéficier de la prime, le demandeur d’emploi n’ayant pas droit à un revenu de remplacement doit avoir perdu involontairement son emploi entre le 1er avril 2009 et le 31 mars 2010 et doit justifier, au cours des 28 mois qui précèdent la date de sa perte involontaire d’emploi, d’une période d’activité salariée au moins égale à 305 heures mais sans atteindre la durée d’affiliation minimale requise par le régime d’assurance chômage pour l’octroi de l’allocation d’aide au retour à l’emploi. Cette prime forfaitaire n’est de surcroît accordée qu’une seule fois.
Face à l’urgence sociale et à l’importance du nombre des demandeurs d’emploi non indemnisés au titre de l’assurance chômage ou de la solidarité, l’article 11 de la présente proposition de loi vise à créer une allocation de solidarité de l’État, dont le bénéfice serait mensuel et ouvert à tous les demandeurs d’emploi involontairement privés d’emploi et inscrits sur les listes de Pôle emploi, qui ne remplissent pas les conditions d’obtention des revenus de remplacement de l’assurance chômage. L’article 11 renvoie à un décret la détermination du montant de cette nouvelle allocation ainsi que les modalités de son versement et de sa gestion (alinéa unique).
Il s’agit ainsi de permettre aux 40 % de demandeurs d’emploi aujourd’hui non indemnisés de percevoir au moins un revenu stable tous les mois, dans l’attente de retrouver un emploi, et non simplement une prime forfaitaire au montant faible et au versement unique qui n’offrent aux travailleurs privés d’emploi ni les ressources nécessaires pour faire face aux charges quotidiennes, ni les conditions pour effectuer la recherche d’un emploi de qualité.
L’indemnisation du chômage ne relevant en principe pas de l’État, cette prime forfaitaire est conçue pour être provisoire, dans l’attente d’une nouvelle négociation entre les syndicats et les organisations patronales concernant l’indemnisation des personnes sans emploi prenant acte de la crise.
La Commission des affaires culturelles, familiales et sociales examine, sur le rapport de M. Daniel Paul, la proposition de loi visant à prendre des mesures urgentes de justice sociale en faveur de l’emploi, des salaires et du pouvoir d’achat (n° 1621) au cours de sa séance du mardi 19 mai 2009.
Un débat suit l’exposé du rapporteur.
M. Jean-Pierre Door, président. Il convient, me semble-t-il, de veiller à distinguer le diagnostic de la crise, sur lequel tout le monde pourra sans doute tomber d’accord, et les remèdes, qui sont plus contestés avec, d’un côté, le plan de relance du Gouvernement, dont la pertinence ne vous semble pas établie, et, de l’autre, les mesures alternatives que vous proposez.
M. Dominique Dord. Je fais mien une bonne partie du constat dressé par notre rapporteur, qu’il s’agisse de la gravité de la crise ou de ses conséquences sociales. Certains licenciements peuvent en effet être choquants comparés aux chiffres d’affaires et aux bénéfices réalisés.
En revanche, je comprends moins bien les solutions que vous proposez, monsieur le rapporteur. Vous voudriez notamment rétablir une autorisation administrative des licenciements, ce qui me paraît difficile dans le contexte actuel d’ouverture des économies et de concurrence mondiale. Connaissez-vous un seul autre pays, y compris socialiste, qui aurait adopté une telle mesure de contrôle des licenciements face à la crise ?
M. Patrick Roy. En dépit d’une apparente unanimité, je ne suis pas certain que nous partagions réellement le même diagnostic. Certaines personnes, dont je fais partie, considèrent en effet que la crise actuelle s’explique par la folie du système libéral, qui s’est traduite par le versement de revenus totalement indécents et immoraux. Or cela ne semble pas être l’opinion de tout le monde, notamment à droite. Nous avons entendu quelques belles déclarations, mais la folie n’a pas cessé.
Certains voleurs – je n’hésite à employer ce terme – nous donnent même des leçons de morale. Le patron des Banques populaires, M. Philippe Dupont, vient ainsi d’augmenter sa rémunération de 100 % tout en expliquant aux syndicats qu’il ne saurait y avoir d’augmentation salariale dans le contexte actuel. Et ce n’est malheureusement pas un cas isolé. Dans ces conditions, il est difficile de ne pas songer à 1789 : certains continuent manifestement à s’accrocher à des privilèges dépourvus de sens.
Comme l’a rappelé notre collègue Daniel Paul, de nombreuses entreprises lancent également des plans de licenciement alors qu’elles réalisent des profits. Au risque de faire un mauvais jeu de mots, c’est un scandale « total » !
Face à cette situation, on ne peut que s’étonner de l’incompétence manifeste de certains dirigeants. La ministre de l’économie, Mme Lagarde, multiplie par exemple les contrevérités depuis deux ans. Cela pourrait être sans conséquence si tous nos concitoyens pouvaient vivre dans des conditions décentes. Or, pour des millions de Français, ce n’est malheureusement pas le cas. Quand ils se révolteront, il sera bien tard pour agir. Je vous mets donc en garde.
Enfin, je trouve particulièrement dommage que nous ne puissions pas examiner la proposition tendant à supprimer les franchises médicales, dispositif qui empêche de nombreux concitoyens d’accéder aux soins quand il en est encore temps. C’est à se demander si nos collègues côtoient vraiment les Français ! Il est temps d’ouvrir les yeux ou bien d’arrêter de mentir.
Mme Marie-George Buffet. La crise actuelle occasionne de graves souffrances sociales, mais elle engage aussi l’avenir économique de notre pays : quand on licencie des salariés qualifiés, comme cela arrive aujourd’hui, on perd du savoir-faire et les donneurs d’ordre risquent de se tourner vers l’étranger une fois la croissance revenue.
Par ailleurs, il ne suffit pas de s’apitoyer sur les conséquences de la crise ; il faudrait également s’interroger sur ses causes : on constate, par exemple, qu’une part croissante des richesses produites est aujourd’hui consacrée au versement des dividendes et à la spéculation financière au lieu d’aller à la recherche, à l’éducation, au développement de nouvelles formes de production et, surtout, à la rémunération des salariés – cela permettrait pourtant d’enclencher la relance par la consommation.
Alors même qu’elle dégage des marges considérables, la société Celanese, dont les employés manifestent aujourd’hui devant l’Assemblée nationale, va par exemple supprimer des emplois en France et contraindre plusieurs sous-traitants à la fermeture. Des productions innovantes et uniques en France vont ainsi disparaître de notre territoire.
Face à cette situation, le Gouvernement n’a proposé que des mesures inopérantes. Nous vous proposons donc d’autres solutions, qui consistent tout d’abord à renforcer la place des salariés dans la gestion des entreprises, en leur accordant notamment un droit d’opposition. Le licenciement ne doit plus être la variable d’ajustement. Les salariés de Celanese, par exemple, que nous avons rencontrés, ont des propositions alternatives concrètes. Vous pouvez bien sûr ironiser et parler de révolution mais nous, nous attendons que vous fassiez des propositions concrètes pour répondre aux salariés qui sont aujourd’hui menacés de licenciement !
De même, nous souhaitons faire en sorte que l’argent cesse d’aller à la spéculation ; il doit être utilisé de manière utile, c’est-à-dire en faveur de la consommation et donc de notre économie. Outre la revalorisation du SMIC, nous demandons une conférence nationale sur les salaires.
Nous avions également proposé d’augmenter les revenus des étudiants, mais notre dispositif a été déclaré irrecevable, ce qui peut sembler curieux au moment où la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche envisage publiquement de prolonger les bourses d’un mois supplémentaire dans l’espoir d’apaiser les colères.
M. Bernard Perrut. On ne peut que partager le constat dressé par Daniel Paul : de nombreux Français connaissent effectivement de graves problèmes, soit parce qu’ils sont touchés par le chômage, soit parce que leur activité professionnelle a été réduite, soit parce que les fins de mois sont tout simplement difficiles.
Tout cela est vrai, mais pourquoi faire comme si le Gouvernement et sa majorité n’avaient apporté aucune réponse à la crise ? Nous ne sommes pas sourds aux inquiétudes de nos concitoyens : au contraire, nous avons pris des décisions courageuses pour soutenir l’emploi et le pouvoir d’achat, mais aussi pour aider les entreprises. Pourquoi ne pas avoir dit un mot du plan de relance par l’investissement, des mesures d’aide au secteur automobile, du dispositif « zéro charge » pour les TPE, de la réforme de l’indemnisation du chômage partiel, de la prime exceptionnelle de 500 euros accordée aux chômeurs ayant travaillé entre deux et quatre mois à compter du 1er avril, ou encore de toutes les dispositions adoptées en faveur des Français les plus modestes, telles que la suppression des deux derniers tiers provisionnels de l’impôt sur le revenu et la prime de 150 euros versée aux familles bénéficiant de l’allocation de rentrée scolaire ?
À cela s’ajoutent d’autres mesures prises avant la crise, notamment la réforme des 35 heures, qui a levé un frein à l’activité, mais aussi l’instauration du revenue de solidarité active (RSA), dont l’objectif est d’inciter à la reprise de l’emploi en mettant un terme à l’assistanat. Une fois la crise survenue, nous avons également adopté les mesures nécessaires pour sauver le secteur bancaire, lequel doit continuer à consentir du crédit, et pour aider les entreprises. En effet, il ne faudrait pas oublier que ce sont elles qui créent de l’emploi.
De votre côté, vous en restez aux vieilles recettes : les 35 heures, l’interdiction des licenciements ou encore l’augmentation des impôts, toutes mesures qui ne soutiendront en rien l’emploi, contrairement aux dispositions que nous avons adoptées.
On constate d’ailleurs quelques signes d’amélioration : la consommation des ménages, qui a augmenté de 1,1 % en mars, résiste mieux dans notre pays que dans d’autres, et la création d’entreprises se poursuit, notamment grâce au statut d’auto-entrepreneur que nous avons créé. Au lieu de mettre en place des mesures restrictives, comme vous le proposez, il faut adapter notre législation aux changements économiques. C’est d’ailleurs pour cette raison que nous avons créé une mission d’information sur la flexisécurité à la française, placée sous la présidence de Pierre Morange.
En ce qui concerne les aides aux étudiants, je rappelle que le nombre de bourses a considérablement augmenté depuis la rentrée dernière, et que la ministre en charge a prévu de poursuivre leur versement pendant un mois supplémentaire afin que les jeunes puissent passer leurs examens dans de meilleures conditions.
En matière de santé, comment pouvez-vous faire l’impasse sur les comptes du régime général de sécurité sociale, en déficit de 10,2 milliards d’euros en 2008, soit 0,7 milliard de plus qu’en 2007 ? Reconnaissez également que nous faisons tout pour préserver et consolider l’atout que constitue notre modèle social à travers notre système de sécurité sociale, en matière de santé, de retraites ou encore d’indemnisation du chômage. C’est la clef de notre meilleure résistance à la crise.
Pour toutes ces raisons, vous comprendrez que nous ne puissions pas approuver les solutions que vous nous proposez d’adopter.
Christian Eckert. Je m’associe au regret de M. Daniel Paul s’agissant de l’application particulièrement restrictive de l’article 40 de la Constitution.
Par ailleurs, M. Dominique Dord devrait user modérément de l’argument de la concurrence internationale : devrions-nous, par exemple, nous aligner sur les pays qui autorisent le travail des enfants ou dont les patrons paient libéralement leurs salariés d’un bol de riz ? Je suis, quant à moi, fier de notre système de protection sociale !
Votre politique est entièrement fondée sur la déréglementation. Déjà, en 2007, Mme Christine Lagarde chantait les vertus du paradis financier britannique et s’était émue du sort des pauvres banquiers faisant la queue à la Gare du Nord afin de prendre l’Eurostar en première classe aux frais de leurs entreprises. Vous n’avez donc rien compris à la crise que nous connaissons ? Vous serez comptables, devant vos électeurs, des déréglementations successives du droit du travail que vous préconisez et que vous avez déjà mises en œuvre.
La proposition de loi de M. Daniel Paul, elle, va dans le bon sens, les articles 4 et 6 reprenant d’ailleurs des dispositions que nous avions évoquées le 30 avril dernier lors de l’examen de la proposition de loi défendue par M. Alain Vidalies, notamment le conditionnement des exonérations fiscales à un accord salarial d’entreprise. Je crois, en outre, que sur ce plan-là les positions du président Méhaignerie ne sont guère éloignées des nôtres.
Quant à la flexisécurité, allez en parler avec les salariés de Continental qui ont accepté de travailler plus pour gagner autant et conserver leur emploi ! Après, vous pourrez ricaner des propositions intelligentes de M. Daniel Paul que notre groupe, lui, ne manquera pas de soutenir !
M. le rapporteur. Que MM. Dord et Perrut reconnaissent partager le diagnostic que nous portons constitue, selon le point de vue où l’on se place, une énorme avancée ou un recul considérable. Il ne leur reste plus, maintenant, qu’à reconnaître que notre société ne sortira pas des difficultés qu’elle connaît sans la mise en place de mesures fortes et contraignantes, lesquelles n’ont rien à voir avec la flexisécurité. Qu’ils aillent voir quelle est la situation économique et sociale de l’autre côté de la Manche, où cette politique est appliquée depuis des années ! Prôner de telles méthodes, c’est défendre la liberté du renard de plumer le poulet libre dans le poulailler libre !
Par ailleurs, il ne s’agit pas de rétablir l’autorisation administrative de licenciement mais de restreindre les conditions d’admission de ce dernier. La proposition de loi ne confère en rien à l’inspecteur du travail le pouvoir de l’interdire : il pourra simplement procéder à des constatations que les salariés pourront éventuellement présenter au juge. Vous arguez qu’aucun autre pays ne fait de même, mais n’est-il pas temps de changer la donne et d’inventer un autre modèle ?
La mise en garde de M. Patrick Roy est quant à elle tout à fait justifiée. Je suis surpris de voir comment la majorité considère la colère et l’angoisse des salariés de nombreux bassins industriels. Non seulement l’entreprise Celanese, par exemple, menace de fermer ses portes malgré les bénéfices réalisés, mais ses dirigeants refusent tout repreneur ! S’il en allait ainsi, ce serait une catastrophe pour quantité d’entreprises sous-traitantes ! N’est-il donc pas temps de mettre fin à de telles situations ? Arrive un moment où il faut mettre un terme au droit sacré des patrons ! Je précise par ailleurs que ce ne sont pas les éléments les plus radicaux de la CGT qui, en l’occurrence, ont parlé d’un droit d’expropriation. J’avais en outre cru comprendre que le Président de la République lui-même avait mis en cause la financiarisation de l’économie, justement évoquée par Mme Buffet.
Les réponses du Gouvernement, quant à elles, ne correspondent pas aux attentes des salariés. Certes, le passage de la rémunération du chômage partiel à 75 % du salaire brut et 95 % du salaire net va dans le bon sens, mais, d’une part, pourquoi ne pas aller jusqu’à 100 % et, d’autre part, pour quelle raison l’argent public serait-il en la matière indifféremment dépensé pour les entreprises qui font des bénéfices et pour celles qui connaissent des difficultés ? Nous, nous proposons de faire jouer la solidarité au sein des entreprises en prélevant de l’argent sur les dividendes distribués.
Nombre d’entre nous, y compris dans la majorité, considèrent de surcroît que les contreparties des entreprises aux aides octroyées par l’État sont soit insuffisantes soit nulles – ainsi les banques ne sont-elles pas au rendez-vous du crédit. N’en aurait-il pas néanmoins été autrement si les représentants de l’État, au sein de leur conseil d’administration, avaient tapé du poing sur la table ?
S’agissant du maintien de la consommation, sans doute serait-il intéressant d’évaluer la part du surendettement des ménages : au mois de février dernier, ce dernier avait ainsi augmenté de 20 % par rapport à l’année précédente. Quoi qu’il en soit, je considère que la consommation est un élément crucial pour éviter une aggravation de la crise.
Le groupe GDR, par ailleurs, se félicite d’autant plus d’avoir voté contre le statut de l’auto-entrepreneur que les responsables des chambres patronales du bâtiment et de l’artisanat y sont eux-mêmes farouchement opposés !
Enfin, si vous voulez réduire le déficit de la sécurité sociale, cessez donc de voter des exonérations à tire-larigot !
M. Jacques Grosperrin. Lisant votre rapport, monsieur Paul, j’ai le sentiment – sur un plan formel – que vous nous resservez l’antienne idéologique du méchant patron et du bon travailleur en reprenant d’ailleurs des préconisations du parti communiste. Sur le fond, nous savons tous que le chômage a augmenté – plus 35 % dans ma région de Franche-Comté – mais, outre que ce ne sont pas de puissants patrons du CAC 40 qui sont en cause, je gage que l’on ne pourrait en dire autant des dégâts causés par les 35 heures dans les PME et les TPE – aussi bien d’ailleurs qu’en matière de pouvoir d’achat.
Enfin, si l’article 5 de la proposition de loi vise à porter le SMIC à 1 600 euros brut – s’élevant aujourd’hui à 1 321 euros, cela représenterait une augmentation de 27 % –, il conviendrait dès lors d’augmenter dans les mêmes proportions un grand nombre de salaires – dont celui des enseignants débutants par exemple. Je ne suis pas sûr que nous en ayons les moyens ou que ce soit là la meilleure façon de remettre notre économie en état de marche.
Bien entendu, je ne voterai pas ce texte.
M. Maxime Gremetz. Messieurs et mesdames de la droite, vous n’avez tiré aucun enseignement de la crise que nous traversons. Comment pouvez-vous considérer les propositions de M. Paul comme de vieilles recettes alors qu’à la différence de toutes les vôtres, elles n’ont jamais été mises en œuvre ? C’est à vous que l’on doit le chômage, la misère qui s’étend et la précarité ! Je vous rappelle tout de même que 7,5 millions de nos compatriotes vivent sous le seuil de pauvreté ! Où est l’idéologie là-dedans ?
Si nous sommes d’accord sur les conséquences de la crise, nous ne le sommes pas du tout sur ses causes parmi lesquelles compte, au premier chef, l’action des multinationales – que je me garderai bien de confondre avec les PME ou les TPE. La loi de modernisation sociale de 2002, que nous avons contribué à faire adopter, disposait que si l’entreprise pouvait décider des licenciements, les salariés avaient quant à eux la possibilité de faire des contre-propositions dans le cadre de leur droit d’opposition. Après que le dialogue social avait joué et faute d’accord, il était alors possible de faire appel à un juge. En quoi la proposition de loi de M. Paul est-elle sensiblement différente ? Outre que son adoption empêcherait que des situations comme celles de Continental, Valeo ou GoodYear se reproduisent, il n’est en rien question de rétablir l’autorisation administrative de licenciement, mais de savoir si les licenciements sont justifiés par la nécessité ou s’ils sont destinés à permettre de faire des profits ailleurs.
Les travailleurs n’auraient-ils donc pas le droit d’avancer des contre-propositions qui ne seraient pas motivées par la seule rentabilité financière immédiate ? Ce ne serait pourtant ni exagéré ni révolutionnaire.
Le dernier numéro de La Gazette de la Société et des Techniques, journal patronal, est éloquent. Je cite : « les salaires stagnent depuis trente ans » ; « de 1978 à 1995, le gain de pouvoir d’achat du salaire net est nul » ; « depuis 1995, on observe une stabilisation relative de la part des dépenses de protection sociale » ; « 40 % des salariés de plus de cinquante ans voient le pouvoir d’achat de leur salaire baisser entre 2000 et 2005 » ; « jeunes et précaires : les nouveaux perdants » ; « en trente ans, les salariés précaires sont passés de 17 à 31 % de la population » !
Comment, dans ces conditions, concevoir une relance économique et technologique, avec un potentiel industriel qui se dégrade ? Si, dans ma région, les PME et les TPE tirent le diable par la queue, on ne peut en dire autant des grands groupes internationaux dont M. Sarkozy appela certains de leurs dirigeants des « patrons voyous » – terme que j’avais moi-même utilisé pour Flodor. Il en avait même appelé à la loi mais rien, hélas, n’a été fait.
Le Premier président de la Cour des comptes, M. Séguin, considère lui-même que les exonérations de cotisations patronales non seulement ne sont pas opérationnelles, mais ne créent pas d’emplois. Pire : elles suscitent de véritables effets d’aubaine, y compris pour ceux qui délocalisent !
M. le rapporteur, par ailleurs, a mésestimé le taux de surendettement des ménages français : ce n’est pas de 20 %, mais de 33 % qu’il a augmenté ! Certains prétendent que la consommation se maintient, mais il faut bien nourrir les enfants !
Pour éviter les délocalisations et une aggravation de la situation économique et sociale, j’en appelle donc à la loi, et je soutiens donc le texte qui nous est proposé.
M. Jacques Domergue. Même si nous ne divergeons guère sur le constat, nous aurons du mal à trouver un consensus ! À vous entendre, en effet, les entreprises licencieraient par plaisir. S’il faut certes s’attaquer aux « patrons voyous », je note toutefois qu’une entreprise bénéficiaire doit parfois ajuster ses effectifs au prorata de sa productivité présente et à venir et que cela suppose de tenir compte de facteurs internationaux sur lesquels nous ne pouvons avoir de prises. Les mesures contraignantes en la matière ne servent à rien. Si tel n’était pas le cas, ne croyez-vous pas qu’elles seraient partout appliquées ?
Le Gouvernement, par ailleurs, a non seulement aidé les entreprises afin de soutenir l’activité économique, mais également les plus modestes, pour favoriser la consommation, ainsi que les collectivités locales qui sont autant de donneurs d’ordres.
Enfin, ce n’est pas en multipliant les carcans que, le moment venu, nous pourrons saisir la reprise au vol.
Vous l’avez compris : je ne peux soutenir le texte proposé.
Mme Jacqueline Fraysse. En dépit d’une déjà longue présence au sein de cette Commission, jamais je n’ai vu un texte traité avec pareille désinvolture. Faut-il rappeler à certains que nous traitons ici de questions particulièrement graves, qui touchent souvent au cœur de l’humanité de l’homme ? Pourquoi faire preuve d’une telle dérision à l’endroit des propositions de M. Paul ? La réaction amusée de certains collègues me choque : que leur salaire tombe, quoiqu’il arrive, à la fin du mois implique-t-il pour autant de rire lorsqu’il est question de licenciement ? Je rappelle que nous parlons d’hommes et de femmes qui, perdant leur emploi, perdent leur salaire et se demandent comment ils feront pour payer leur loyer.
Ce texte serait donc idéologique et directement issu du programme électoral du Parti communiste ? Mais quelles propositions alternatives avez-vous formulées, monsieur Perrut ? La récitation du catéchisme présidentiel ne suffit pas ! C’est parce que nous voulons éviter de toutes nos forces la suppression d’emplois et, donc, l’augmentation du nombre de chômeurs que nous soutenons ce texte. Qui, ici, peut justifier des suppressions d’emplois dans des entreprises qui font des bénéfices et distribuent des dividendes ? S’il faut être solidaires dans la crise, que les actionnaires participent donc à l’effort national en créant les conditions du maintien de l’emploi même si, pour ce faire, ils doivent un peu rogner leurs marges ! Cela n’a rien de provoquant et mérite d’être sérieusement examiné.
Vous parlez de vieilles recettes, mais vos préconisations sont depuis longtemps mises en œuvre, et l’on voit où nous en sommes. Faites donc preuve d’un peu plus d’humilité et réfléchissez à des propositions qui sortent des sentiers battus au lieu d’appauvrir les plus pauvres et d’enrichir les plus riches !
M. Jean-Pierre Door, président. Je ne partage pas votre sentiment, madame Fraysse, sur l’atmosphère de nos débats et je n’y retrouve pas, en particulier, la désinvolture dont vous faites état.
M. Roland Muzeau. Il est faux de prétendre que nous ferions tous le même constat, et les collègues de la majorité ne manquent vraiment pas de culot lorsque, sur le terrain, ils vont dire aux salariés de leur circonscription menacés de chômage qu’ils sont d’accord avec eux et qu’ils partagent leur souffrance. Ou vous acceptez le capitalisme, ou vous le combattez ! C’est lui qui est responsable de la crise que nous traversons !
Je rappelle, par ailleurs, que le Président de la République, dans son programme, faisait grand cas des subprimes et que la multiplication des crédits hypothécaires dans notre pays devait selon lui favoriser le développement économique. Où la dynamisation était en fait dynamitage… Bonjour les recettes éculées !
A cela s’ajoute que vous êtes aux affaires depuis 2002 et que, si l’on en croit les rapports de la Fondation Abbé Pierre, la pauvreté n’a fait que croître.
Vous pouvez également pleurer sur le sort des familles surendettées, mais pourquoi refusez-vous de légiférer sur les taux scandaleux du crédit à la consommation ? Avec 18 % ou 22 %, les emprunteurs ne remboursent jamais le capital, mais se « surendettent » sans fin pour financer les seuls intérêts !
Par ailleurs, selon M. Grosperrin, une augmentation du SMIC de 27 % serait néfaste à notre économie. Dois-je lui rappeler qu’en 1968 elle avait été de 35 % et qu’elle avait ainsi contribué à relancer considérablement l’emploi ?
Est-ce normal que sur 75 milliards de profits, 35 milliards de dividendes soient distribués ? Pourquoi ceux-ci n’iraient-ils pas, par exemple, au fonds d’investissement social ? Les actionnaires ne pourraient-ils pas, pour une fois, passer leur tour au profit des salariés qui souffrent et des entreprises qui ne peuvent pas boucler leur budget ? L’exigence d’un rendement à deux chiffres entraînera toujours la financiarisation de l’économie.
Je rappelle également que, sur le versant des recettes, cela fait la quatrième fois que vous votez un budget insincère et que depuis 2002 les comptes sociaux sont dans le rouge alors qu’ils étaient au vert lorsque vous êtes arrivés au pouvoir.
Par ailleurs, comment peut-on encore soutenir l’idée selon laquelle les licenciements d’aujourd’hui seraient les emplois de demain ? Arrêtez de prendre les salariés pour des imbéciles ! Vous êtes d’autant plus incorrigibles qu’entre 2009 et 2010, ce ne sont pas moins d’un million d’entre eux qui perdront leur emploi !
Enfin, à quoi bon s’indigner lorsqu’un salarié, voilà quelques jours, s’est vu proposer un reclassement professionnel en Inde pour 69 euros mensuels, si l’on n’interdit pas purement et simplement ces pratiques ?
Le moindre mérite de la proposition de M. Paul n’est pas de tenter d’inverser la donne en préconisant des mesures inédites. En tant que telle, nous ne pouvons qu’en être satisfaits.
Mme Catherine Lemorton. Tant que l’on ne fera pas le même constat, à savoir que c’est en augmentant le pouvoir d’achat que l’on favorisera la croissance, il sera difficile de tous nous retrouver. J’avais pourtant cru entendre lors de la campagne présidentielle le candidat devenu Président de la République, Nicolas Sarkozy, promettre aux personnes handicapées et aux bénéficiaires du minimum vieillesse – qui font partie des 7,5 millions de pauvres cités par M. Gremetz – une augmentation de 25 % de leur pouvoir d’achat. Nous en sommes très loin !
Dans le même ordre d’idée, la loi de 2008 portant modernisation du marché du travail a prévu la rupture conventionnelle de gré à gré, censée fluidifier les rapports entre employeur et salarié en cas de problème entre les deux, et non, m’avait-il semblé, en cas de licenciement économique. Or, si au 31 décembre 2008 ce dispositif avait été utilisé 1 700 fois, leur nombre était de 66 951 au 30 avril 2009. La rupture conventionnelle a bien été détournée de son objectif.
Par ailleurs pourquoi la prime de solidarité active de 200 euros versée aux allocataires du revenu minimum d’insertion (RMI) ou de l’allocation de parent isolé (API) n’a-t-elle pas été accordée aux bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique (ASS) qui touchent moins que le RMI ?
En outre, n’est-il pas indécent que, lors de l’examen du dernier projet de loi de financement de la sécurité sociale, on ait osé – avec quel courage ! – appliquer une taxe sociale sur les parachutes dorés à partir d’un million d’euros, soit soixante-dix années de SMIC net – presque deux carrières entières ?
Quant aux 35 heures, faut-il remuer le couteau dans la plaie et rappeler ce que subissent les salariés de Continental après avoir accepté de retravailler quarante heures, sans pour autant être payés en conséquence ?
Pour ce qui est des exonérations sociales sur les heures supplémentaires, dont tous les gens de bonne foi ont reconnu que cela avait empêché de créer 90 000 emplois, le fait que 80 000 personnes s’inscrivent maintenant tous les mois à l’ANPE ne doit-il pas faire réfléchir quant à la pérennité de cette mesure ? Sachant que pour payer les heures supplémentaires on a décomposé le salaire en deux parties, en diminuant la part fixe, le résultat est que non seulement le gain en pouvoir d’achat est égal à zéro, mais qu’en aval, la variable d’ajustement que sont les heures supplémentaires a des incidences sur les indemnités de licenciement, puisque le salarié aura moins gagné en part fixe, ainsi que sur les indemnités journalières si l’employé tombe malade. Le dispositif a été utilisé de manière très pernicieuse – je pourrais citer le nom d’entreprises.
Enfin, nous attendons toujours le rapport de Mme Bachelot après un an d’application des franchises médicales, afin de connaître le nombre de personnes qui, en conséquence, se sont privées de soins.
Saisi par la FNATH, association des accidentés de la vie, et par l’ANDEVA, association nationale de défense des victimes de l’amiante, le Conseil d’État a rendu, le 6 mai dernier, un arrêt annulant l’article 2 du décret n° 2007-1937 du 26 décembre 2007 instituant les franchises médicales, reconnaissant que leur montant peut être de nature à « compromettre le droit à la santé ». Voilà un an, en mai 2008, nos collègues du groupe Nouveau Centre ont déposé une proposition de loi tendant à la suppression des franchises pour les affections de longue durée. Je ne désespère donc pas de les voir nous rejoindre sur ce point.
M. Jean-Pierre Door, président. S’agissant du non-versement de la prime de solidarité active de 200 euros aux bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique (ASS), je vous suggère de vous adresser au ministre au cours du débat. Quant au rapport relatif aux franchises, je ferai en sorte qu’il vous soit fourni. Je m’étonne d’ailleurs que tel n’ait pas été le cas puisque j’ai déjà pu le lire.
M. Paul Jeanneteau. Je souhaite indiquer à Mme Fraysse que nul ici ne doute du sérieux de la proposition de loi de M. Daniel Paul et ne tourne celle-ci en dérision. À cet égard, nous n’avons pas de leçon d’humanisme à recevoir de nos collègues de l’opposition. Il n’y a pas dans leur circonscription des Français en grande difficulté et aucun dans les nôtres ! Nos circonscriptions sont toutes en quelque sorte des France en miniature avec leurs réussites et leurs difficultés et, surtout, ces hommes et ces femmes qui constituent leur plus grande des richesses.
Mme Fraysse souhaite éviter la suppression d’emplois et l’augmentation du nombre des chômeurs. C’est ce pourquoi nous travaillons toutes et tous ici au quotidien et que nous nous sommes, quelles que soient nos convictions, engagés en politique. Ne donnons donc de leçon ni d’un côté ni de l’autre.
M. Michel Liebgott. Pour en revenir à nos échanges démocratiques habituels au sein de l’institution parlementaire, je ferai d’abord remarquer à nos collègues de la majorité que si la France surnage un tant soit peu aujourd’hui, c’est bien parce que les transferts sociaux fonctionnent à plein. Ils l’ont d’ailleurs si bien reconnu que la majorité a anticipé le remboursement de TVA pour les collectivités locales qui le souhaitaient. Voilà confirmées
– malheureusement seulement pour la période de crise, peut-on craindre – les thèses que nous défendons depuis des années s’agissant de la place essentielle du secteur public dans la société française !
Dois-je en effet rappeler que les collectivités publiques contribuent aux dépenses d’investissement à hauteur de 75 % ? On peut se gausser des augmentations d’impôt dans les régions et les départements, mais c’est grâce aux investissements des collectivités qu’aujourd’hui la France s’en sort peut-être un peu mieux que cela n’aurait été le cas si le secteur public avait été beaucoup plus faible. Il en est d’ailleurs de même des prestations sociales en général que l’on a beau jeu de critiquer quand les choses vont bien, mais que l’on est bien content de rétablir quand les choses vont mal. J’en veux pour preuve les emplois aidés, supprimés à grand renfort d’idéologie, mais restaurés face au péril social et sécuritaire
– on peut en effet craindre le pire dans les quartiers les plus défavorisés, frappés de plein fouet par la crise.
Une fois de plus, deux conceptions non pas de la société, voire de l’homme, mais de la politique, au sens noble du terme, apparaissent. D’un côté, celle d’une opposition qui veut remettre l’égalité au cœur de la société, de l’autre celle d’une majorité qui veut faire de la liberté le vecteur économique essentiel permettant à chacun de s’enrichir – sachant toutefois qu’il est plus facile de devenir plus riche quand on est riche que quand on est pauvre ! Aussi comprendra-t-on que le groupe socialiste soutienne la proposition de loi en se fondant sur des thèmes qui lui tiennent à cœur – le partage, la solidarité, la redistribution – et concrets.
Comment la majorité peut-elle, par exemple, vouloir maintenir les franchises médicales – instaurées au faux prétexte d’un déséquilibre qui serait aggravé entre 1997 et 2002 – alors que la crise frappe, que le pouvoir d’achat est en chute libre, que les gens souffrent, que certains ne peuvent plus se soigner ? En tant qu’élu d’Alsace-Moselle, je suis bien placé pour savoir que le système le plus redistributif est celui où les gens cotisent dans l’intérêt de l’ensemble des citoyens – principe même de la solidarité inventé à l’époque par Bismarck.
Quant à l’éducation, qui est au cœur de l’ascenseur social, ce sont une fois de plus les plus défavorisés qui, en cette période de crise, n’y auront pas accès, car aujourd’hui il leur faut avoir un travail pour étudier. Voilà d’ailleurs pourquoi nous sommes favorables à une certaine forme de discrimination positive, faute de quoi les jeunes des zones urbaines sensibles ne s’en sortiront pas – je le dis d’autant plus que je suis maire d’une commune qui bénéficie d’un partenariat avec Sciences-Po Paris.
Concernant les mesures visant à prévenir les licenciements et à sauvegarder l’emploi, nous partageons l’essentiel des mesures du titre Ier tout simplement parce que l’histoire nous donne raison. À maintes reprises, la majorité a critiqué les 35 heures. Mais dans ma région, par exemple, où la sidérurgie est encore puissante, les 35 heures – dont la mise en place n’a d’ailleurs posé aucun problème aux grands groupes du secteur – sont un formidable amortisseur social !
Aujourd’hui, ceux qui souffrent ce sont les sous-traitants car les grandes entreprises estiment avec cynisme qu’elles n’ont pas à s’occuper de ceux qui ne sont pas suffisamment protégés par le droit du travail. À cet égard, nous nous opposerons à la proposition de loi tendant à faciliter le maintien et la création d’emploi, dont le rapporteur est notre collègue M. Jean-Frédéric Poisson – qui sera examinée dès lundi soir prochain puisque l’on a cru bon une fois de plus de bouleverser l’agenda parlementaire. Elle vise en effet à plus de flexibilité alors qu’au quotidien c’est souvent plus d’insécurité qui attend déjà les salariés. Mettre l’homme au cœur du système, c’est avant tout mettre en place des dispositifs qui le protègent.
M. Jean-Frédéric Poisson. Je rappellerai d’abord que, dans le passé récent, le gouvernement Raffarin, sous l’impulsion de Jean-Louis Borloo et de Gérard Larcher, avait procédé à des revalorisations importantes du SMIC avec l’alignement de ses différents régimes. Quant au crédit à la consommation, le Parlement devrait débattre dans un futur proche d’un projet de loi visant à améliorer l’encadrement du crédit aux ménages.
Mme Catherine Génisson. On aurait pu en débattre lors de l’examen de la loi de modernisation de l’économie !
M. Jean-Frédéric Poisson. Au-delà de la considération réelle que j’ai pour le travail de notre collègue Daniel Paul, je constate cependant une différence de philosophie sur deux points principaux. Nous faisons, nous, davantage confiance au contrat qu’à la réglementation …
M. le rapporteur. Aux patrons voulez-vous dire !
M. Jean-Frédéric Poisson. … et nous ne croyons pas que les dispositions proposées soient plus bénéfiques que néfastes pour l’économie.
M. Maxime Gremetz. Elles n’ont jamais été mises en œuvre !
M. Jean-Frédéric Poisson. L’économie administrée, monsieur Gremetz, on sait pourtant ce que c’est !
J’ai eu l’occasion, lors de l’examen voilà quinze jours de la proposition de loi de notre collègue Vidalies pour l’augmentation des salaires et la protection des salariés et des chômeurs, de souligner que je n’étais pas contre le fait de remettre à plat le système des exonérations de charges. Encore convient-il de rappeler si ces dernières existent, c’est soit pour faire en sorte que les entreprises appliquent des dispositifs qu’elles ne mettraient pas sinon en œuvre toutes seules – je pense là spécifiquement aux dispositions des lois Aubry I et II –, soit pour diminuer le coût du travail, lequel peut être un frein à l’emploi.
Par ailleurs, je souligne que les actionnaires ne sont pas que des grands capitalistes. Nombre de salariés sont eux-mêmes actionnaires de leur entreprise et nombre de nos concitoyens ont leurs économies placées en bourse.
Enfin, notre collègue M. Roland Muzeau a cité l’exemple de ce patron qui avait eu l’outrecuidance, pour ne pas dire la cruauté, de proposer des postes de reclassement en Inde. Faut-il rappeler que la loi oblige l’entrepreneur qui licencie à proposer des postes de reclassement dans tous les établissements dont il dispose en France ou à l’étranger ? Or l’entreprise en question n’avait d’autre établissement qu’en Roumanie et en Inde.
M. Roland Muzeau. La victime, c’est l’employeur !
M. Jean-Frédéric Poisson. La loi est ainsi faite que l’employeur était obligé de procéder de cette manière.
Il est normal qu’une entreprise qui recourt à des licenciements propose des emplois de reclassement dans le périmètre du groupe. Mais soit l’on maintient le dispositif en l’état, au risque de sombrer dans le ridicule, soit on l’aménage de manière à ne pas choquer les salariés concernés.
Mme Catherine Génisson. Je ne reviendrai pas pour ma part sur les différences idéologiques qui existent entre nous : nous les revendiquons les uns et les autres et c’est l’honneur du débat politique.
Je reviendrai en revanche sur trois dispositions particulièrement intéressantes de la proposition de loi.
La première concerne le « droit d’opposition à la rupture du ou des contrats de travail ». Pourquoi le salarié n’aurait-il pas toute légitimité à présenter des contre-propositions en cas de licenciements envisagés ? La mise en avant d’une telle mesure de responsabilité est une question de respect tant des travailleurs que de l’employeur. Outre qu’elle figurait dans la loi de modernisation sociale de 2002, je puis attester qu’elle pouvait donner des résultats positifs lorsqu’elle était appliquée.
La deuxième disposition traite des exonérations de cotisations sociales. Tous les rapports l’ont prouvé, y compris celui tout récent de la Cour des comptes, les exonérations de cotisations sociales sans contrepartie n’aboutissent qu’à des effets d’aubaine et ne facilitent ni la diminution du chômage ni la création d’emplois.
La troisième et dernière disposition que je soulignerai porte sur les franchises médicales que notre Assemblée s’honorerait à supprimer comme le propose notre rapporteur. Elles aboutissent en effet, ainsi que nous l’avons dénoncé, à ce que certains soit se privent de soins soit retardent ces derniers, ce qui est strictement inadmissible sur le plan humain. Il s’agit, en outre, d’une mesure extrêmement délétère, ne serait-ce que parce qu’elle éloigne du soin préventif.
Concernant les dégâts du crédit à la consommation et du crédit revolving en particulier, n’aurions-nous pas pu traiter du sujet – je m’adresse là à nos collègues de la majorité – lors de l’examen de la loi de modernisation de l’économie ?
S’agissant enfin du contrat de travail, si tout le monde peut se féliciter du contrat issu de la négociation collective, il n’en va pas de même du contrat de gré à gré qui se développe et qui devint quasiment la seule méthode de relation contractuelle entre l’employeur et le salarié. Un tel contrat, qui n’est absolument pas favorable au salarié qui se retrouve seul dans la négociation face à l’employeur, est lui aussi délétère.
M. le rapporteur. Qu’ont fait les grandes entreprises et les groupes depuis une vingtaine d’années, sinon se tourner pour leur financement non plus vers les banques, mais vers les marchés financiers – « les veuves écossaises » qui contrôlent les entreprises françaises ? C’est ainsi que par un phénomène de bascule, l’endettement des entreprises auprès des banques a été remplacé par la rémunération du capital. On a ainsi vu flamber les dividendes, le leitmotiv des grands patrons étant que la première tâche d’une entreprise, c’est de créer de la valeur pour l’actionnaire.
Le Président de la République l’a lui-même souligné, sauf qu’il n’en tire pas les mêmes conclusions. Alors qu’il prétend que l’on peut réguler le système, nous savons, nous, que ce dernier ne peut être régulé, mais qu’il s’autoalimente.
Le rapport de M. Jean-Philippe Cotis, directeur général de l’INSEE, fait apparaître qu’entre 1993 et 2007, les dividendes sont passés, en pourcentage, de 7 % de l’excédent brut d’exploitation à 16 %, et, ont, en valeur, été multipliés par cinq. Ne disions-nous pas que la part des dividendes était devenue prépondérante par rapport à celle des salaires ?
Il est facile par ailleurs de considérer tous les salariés de la même manière. Mais nous, lorsque nous disons que l’on peut prélever sur les dividendes pour faire en sorte que les salaires augmentent, ce n’est pas aux salariés du haut de l’échelle qui ont vu leurs rémunérations exploser auxquels l’on pense, mais à la masse des travailleurs dont les salaires ont été maintenus au niveau du SMIC. Du fait des exonérations patronales, il était en effet beaucoup plus intéressant pour les entreprises de garder les salaires à ce niveau plutôt que d’accorder des rémunérations plus importantes. Nos propositions visent à gripper ce système et à rien d’autre.
Celles-ci n’ont d’ailleurs jamais été mises en œuvre, que ce soit dans notre pays ou ailleurs. Dois-je rappeler que les huit grandes organisations syndicales sont unies concernant ces questions ? Vous ne trouverez pas depuis plus de soixante ans d’exemple d’unité qui ait duré aussi longtemps sur un sujet aussi sensible !
Dernièrement, 1 150 salariés de Sandouville ont quitté leur entreprise sans licenciement, dans le cadre de ce que l’on appelle les « départs volontaires ». Pourtant, ils ne voulaient pas partir car il n’existe rien d’autre dans la région – tous les secteurs suppriment des emplois. C’est la nouvelle donne : les salariés sont volontaires en période de crise pour quitter leur travail à dix ou quinze de l’âge de la retraite sans que des pressions, bien entendu, soient exercées à leur encontre !
Dans un autre groupe automobile, la direction surutilise le chômage partiel – auquel elle ne contribue pas puisque ce sont les fonds publics qui paient – pour se servir des heures supplémentaires exonérées lorsqu’il faut produire un peu plus. Et lorsque les organisations syndicales unanimes protestent et lui demandent d’embaucher, même à durée déterminée, pour faire face à un pic de production, elle se contente de leur opposer un refus. Il lui faut bien en effet trouver toutes les ficelles lui permettant de bénéficier des aides !
Nous sommes favorables, comme notre collègue M. Jean-Frédéric Poisson, à un réexamen de la question des exonérations de cotisations patronales. Nous ne nous satisfaisons ni du fait que le système actuel soit identique quel que soit le nombre de salariés dans une entreprise ni du fait qu’il constitue un effet d’aubaine pour cette dernière, surtout qu’il ouvre la porte à la mise en place inéluctable, si l’on continue sur la même voie, d’une individualisation de la protection sociale, en particulier du fait du vieillissement de la population et des problèmes de retraite.
La Commission examine les articles de la présente proposition de loi au cours de sa séance du mardi 19 mai 2009.
TITRE IER
DE L’INTERDICTION, DE LA PRÉVENTION DES LICENCIEMENTS ÉCONOMIQUES
ET DE LA SAUVEGARDE DE L’EMPLOI
Article 1er
Modification de la définition et des modalités de contrôle
des licenciements pour motif économique
L’article 1er de la présente proposition de loi tend à rendre plus sévères les conditions de validité et le contrôle des licenciements pour motif économique en proposant une nouvelle définition du licenciement pour motif économique et un renforcement du rôle de l’inspection du travail pendant la procédure.
1. Une définition plus stricte du licenciement pour motif économique
La définition actuelle du motif économique de licenciement comporte trois éléments complémentaires, selon l’article L. 1233-3 du code du travail. Le motif économique doit tout d’abord être extérieur à la personne du salarié, ce qui l’oppose au motif personnel de licenciement. Il doit s’agir ensuite soit d’une suppression de l’emploi, soit d’une transformation de l’emploi ou d’une modification d’un élément essentiel du contrat de travail refusée par le salarié. Ces dernières doivent enfin résulter notamment de difficultés économiques ou de mutations technologiques.
La liste des causes économiques, énoncée par l’article L. 1233-3 du code du travail, n’est donc pas limitative du fait de la présence de l’adverbe « notamment ». La jurisprudence a donc admis d’autres causes économiques ayant présidé à la suppression de l’emploi et pouvant justifier valablement un licenciement pour motif économique. Il s’agit tout d’abord de la cessation d’activités lorsqu’elle n’est pas due à une faute de l’employeur ou à sa légèreté blâmable (Cass. Soc. 16 janvier 2001 Morvant) et surtout de la réorganisation de l’entreprise pour sauvegarder la compétitivité de l’entreprise ou du secteur d’activité du groupe auquel elle appartient (Cass. Soc. 5 avril 1995 Vidéocolor, Ass. plén. 8 décembre 2000 SAT, Cass. Soc. 11 janvier 2006 Société Pages jaunes).
Or, comme le rappelle l’exposé des motifs de la présente proposition de loi, aujourd’hui « la définition du licenciement économique, complétée par une abondante jurisprudence, n’est protectrice pour le salarié qu’en apparence ». En particulier, « même si en théorie l’accroissement des profits ne peut juridiquement être un motif recevable pour le juge, la notion de "sauvegarde de la compétitivité" laisse la porte ouverte à tous les abus ». En effet, dans l’arrêt du 11 janvier 2006 société Pages jaunes, la chambre sociale de la Cour de cassation a déclaré valables les licenciements pour motif économique accomplis sur le fondement de la réorganisation de l’entreprise pour sauvegarder sa compétitivité sans qu’il soit nécessaire que l’entreprise connaisse des difficultés économiques au moment où elle envisage de licencier des salariés. Selon la Cour de cassation, la réorganisation de l’entreprise, cause économique du licenciement, n’a pas à être « subordonnée à l’existence de difficultés économiques à la date du licenciement » (45), elle doit être mise en œuvre pour prévenir des difficultés économiques à venir liées à des évolutions technologiques et leurs conséquences sur l’emploi.
L’arrêt SAT du 8 décembre 2000 de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation illustre de manière encore plus claire les possibilités de dérives que porte l’admission de la notion de réorganisation de l’entreprise pour sauvegarder sa compétitivité comme cause économique de licenciement valide. En effet, dans cet arrêt, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation a décidé que les juges du fond, dès lors qu’ils avaient constaté qu’une réorganisation de l’entreprise était nécessaire pour sauvegarder sa compétitivité, n’avaient pas le pouvoir de contrôler le choix effectué par l’employeur entre les différentes solutions de restructuration de l’entreprise. Ce qui signifie, et c’était le cas en l’espèce, que l’employeur peut choisir, sans que le juge puisse juger de la pertinence et remettre en cause ce choix au nom de la préservation de l’emploi, la solution qui entraîne le plus grand nombre de licenciements. L’employeur, en l’espèce, qui aurait pu choisir de limiter le nombre de licenciements à 86, a pu valablement licencier 318 salariés.
L’ouverture de la définition du licenciement pour motif économique, prévue à l’article L. 1233-3 du code du travail, semble donc insuffisamment protectrice de l’emploi et des salariés. Le licenciement pour motif économique doit demeurer le dernier recours après que d’autres solutions, recherchées avec les représentants des salariés, ont été explorées pour assurer la pérennité de l’entreprise.
C’est pourquoi, l’article 1er de la présente proposition de loi propose une nouvelle rédaction de l’article L. 1233-3 du code du travail (alinéa 1).
L’alinéa 2 de l’article 1er de la proposition de loi modifie donc la définition du licenciement pour motif économique en procédant à une nouvelle rédaction de l’alinéa 1er de l’article L. 1233-3 du code du travail qui révise la rédaction antérieure sur quatre points :
– il énonce tout d’abord que le licenciement doit avoir été « rendu inévitable » ; cette disposition vise à rappeler dans la loi que le recours au licenciement pour motif économique doit conserver un caractère exceptionnel et qu’il ne constitue pas un mode normal de gestion des ressources humaines ;
– il élargit le champ de l’un des trois motifs économiques, celui résidant actuellement dans « une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel de son contrat de travail » qui est étendu à tout type de modification du contrat de travail ;
– il supprime l’adverbe « notamment », ce qui confère à l’énumération des causes économiques justifiant un licenciement à l’article L. 1233-3 du code du travail le caractère d’une liste limitative et impérative, qui ne peut pas être étendue par la jurisprudence (46). Désormais seules les difficultés économiques et les mutations technologiques, sous certaines conditions, pourront valablement fonder un licenciement pour motif économique. Les deux autres causes économiques admises par la jurisprudence, la cessation d’activité et surtout la réorganisation de l’entreprise pour sauvegarder sa compétitivité, ne pourront plus légitimer les licenciements pour motif économique ;
– il précise les caractéristiques des deux causes économiques qui justifient un licenciement : les difficultés économiques ne doivent pas avoir « pu être surmontées par la réduction des coûts autres que salariaux » et les mutations technologiques doivent être « indispensables à la pérennité de l’entreprise » pour être recevables.
Poursuivant le même objectif de retenir une définition plus stricte du licenciement pour motif économique afin de protéger davantage les salariés et l’emploi et de prévenir les abus, l’alinéa 3 de l’article 1er propose une nouvelle rédaction du deuxième alinéa de l’article L. 1233-3 du code du travail. L’ancien alinéa 2 excluait la possibilité de requalifier une rupture conventionnelle en licenciement pour motif économique. Cette exclusion est supprimée et le nouvel alinéa 2 de l’article L. 1233-3 du code du travail prévoit désormais que sont dépourvus de cause réelle et sérieuse les licenciements pour motif économique accomplis dans les entreprises :
– soit ayant « réalisé des bénéfices, constitué des réserves ou distribué des dividendes au cours des deux derniers exercices » ; il s’agit d’affirmer clairement, dans une disposition législative du code du travail, le principe de l’interdiction des licenciements boursiers dont le but est d’accroître les profits des actionnaires au détriment des salariés et de s’assurer que l’entreprise qui licencie a recours à cette procédure en raison de réelles difficultés économiques ou de mutations technologiques qui mettent en péril sa survie ;
– soit ayant « procédé à un transfert d’activité, de production ou de services vers un pays étranger pour exécuter des travaux qui pourraient l’être par le ou les salariés dont le poste est supprimé » ; face au phénomène croissant des délocalisations, qui, selon l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) (47), engendre environ 15 000 destructions d’emplois par an dans le seul secteur industriel, les restrictions au droit du licenciement économique doivent constituer une protection efficace pour les salariés ;
– soit ayant « reçu des aides publiques de toute nature » ; une entreprise ayant bénéficié de la solidarité de la collectivité voit sa responsabilité sociale accrue et ne doit pas pouvoir licencier des salariés pour un motif économique.
Les licenciements pour motif économique effectués dans des entreprises qui ont dégagé des bénéfices, délocalisé ou reçu des aides publiques seront désormais dépourvus de cause réelle et sérieuse et donc nuls puisque l’article 2 de la proposition de loi propose que l’absence de cause réelle et sérieuse soit désormais sanctionnée par la nullité et les effets qui lui sont attachés.
2. Un renforcement du rôle de l’inspection du travail en matière de licenciement pour motif économique
L’inspection du travail joue aujourd’hui deux rôles en matière de licenciement pour motif économique.
Elle dispose tout d’abord du pouvoir d’autoriser les licenciements pour motif économique des salariés dits « protégés » (48) en vertu des articles L. 2411-1 et suivants du code du travail. Le licenciement pour motif économique d’un salarié protégé est subordonné à l’autorisation de l’inspection du travail sous peine de nullité du licenciement (49) (Cass. Soc. 3 juin 1948).
L’inspection du travail participe, de plus, dans le cadre de sa mission générale de contrôle de l’application du droit du travail et du respect des droits individuels et collectifs des salariés, au contrôle des procédures de licenciement.
Toutefois, le code du travail ne prévoit pas expressément l’intervention de l’inspection du travail dans les procédures de licenciement pour motif économique. C’est le directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle qui reçoit les informations relatives aux licenciements pour motif économique et qui est notamment chargé de contrôler et d’émettre un avis sur la procédure de licenciement et les plans de sauvegarde de l’emploi en cas de licenciement de plus de dix salariés dans une même période de trente jours dans les entreprises de plus de cinquante salariés.
D’une manière plus générale, sous réserve de la procédure d’autorisation de licenciement en faveur des salariés protégés, le pouvoir juridique de l’administration du travail dans les procédures de licenciement pour motif économique semble réduit. Le directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle est seulement « informé » a posteriori des licenciements économiques concernant moins de dix salariés (article L. 1233-19 du code du travail) et il n’exerce aucun contrôle sur le caractère réel et sérieux du motif économique invoqué par l’employeur. Si le directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle exerce un contrôle administratif des licenciements économiques concernant plus de dix salariés, la portée de ce contrôle est limitée à la régularité de la procédure de consultation des représentants du personnel et aux mesures prévues dans le plan de sauvegarde de l’emploi. Ce contrôle ne donne, de plus, lieu qu’à un avis auquel l’employeur est simplement tenu de répondre (article L. 1233-56 du code du travail).
Au vu de cette position en retrait de l’État face aux procédures de licenciement pour motif économique, il semble nécessaire de replacer l’inspection du travail au cœur de cette réglementation fondamentale pour la protection de l’emploi et des salariés. À cette fin, l’alinéa 4 de l’article 1er de la proposition de loi crée un troisième alinéa à l’article L. 1233-3 du code du travail aux termes duquel l’inspection du travail se voit confier la mission de « procéder aux vérifications nécessaires » pour l’application de l’article L. 1233-3 du code du travail dans sa nouvelle rédaction.
Le dispositif proposé n’a pas pour effet de restaurer l’autorisation administrative de licenciement (50) mais de réaffirmer le rôle de l’État dans la sphère sociale et face aux entreprises en chargeant l’inspection du travail de dresser un constat vérifiant que l’employeur qui licencie répond aux conditions exigées par la loi pour avoir valablement recours à une procédure de licenciement pour motif économique. Grâce à ses prérogatives importantes, comme son droit d’entrée et de visite, son droit d’enquête ou son droit de communication, l’inspecteur du travail constitue l’acteur le plus approprié et le mieux à même de procéder à ces vérifications. Il pourra ainsi, par exemple, vérifier que l’entreprise n’a pas distribué de dividendes au cours des deux derniers exercices ni délocalisé sa production vers des pays à bas salaires.
Le document établi par l’inspecteur du travail pourra utilement appuyer les recours judiciaires préventifs des salariés contre les licenciements dans le cadre de la nouvelle procédure devant le juge des référés que l’article 3 de la proposition de loi propose de créer.
*
La Commission rejette l’article 1er.
Article 2
Renchérissement du coût du licenciement pour motif économique
L’article 2 a pour objectif de renchérir le coût des licenciements pour motif économique, afin d’encourager le développement de solutions alternatives à cette procédure. Il vise à sanctionner par la nullité les licenciements pour motif économique dépourvus de cause réelle et sérieuse et à augmenter le montant de l’indemnité versée au salarié en cas de nullité du licenciement pour motif économique.
1. La sanction par la nullité des licenciements pour motif économique sans cause réelle et sérieuse
Tout licenciement pour motif économique doit comporter une cause réelle et sérieuse, sous peine d’être jugé abusif et sanctionné à ce titre. Les sanctions encourues en cas d’absence de cause réelle et sérieuse semblent cependant aujourd’hui insuffisantes, en particulier au regard de celles infligées en cas de nullité du licenciement. Le dispositif proposé tend par conséquent à aligner le régime des licenciements pour motif économique abusifs sur celui des licenciements pour motif économique nuls.
● La nécessité d’une cause réelle et sérieuse de licenciement
Aux termes de l’article L. 1233-2 du code du travail, pour être valable, tout licenciement pour motif économique doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, dont le contrôle sera opéré par le juge en cas de litige, en vertu de l’article L. 1235-1 du code du travail.
Le motif économique invoqué par l’employeur pour licencier le salarié, à savoir la suppression de l’emploi, la transformation de l’emploi ou la modification d’un élément essentiel du contrat de travail refusée par le salarié, doit ainsi être réel et sérieux c’est-à-dire existant et exact. Par exemple, la jurisprudence ne considère pas qu’il y a suppression d’emploi lorsqu’un salarié de la société mère d’une entreprise est affecté aux fonctions du salarié licencié dans une filiale (51).
De même la cause économique qui a présidé à la suppression, à la transformation de l’emploi ou à la modification refusée par le salarié, à savoir notamment soit des difficultés économiques soit des mutations technologiques, doit revêtir un caractère réel et sérieux que l’employeur a l’obligation de démontrer. Par exemple, selon la Cour de cassation, se limiter à alléguer une baisse du chiffre d’affaires ou une diminution des bénéfices n’établit pas en soi la réalité et le sérieux de difficultés économiques (52).
Enfin, dans le cadre du contrôle de la cause réelle et sérieuse d’un licenciement pour motif économique, le juge est tenu d’apprécier la réalité et le sérieux d’une part du lien de causalité reliant le motif économique à la cause économique (53) et d’autre part de la mise en œuvre de l’obligation de reclassement de l’employeur. En effet selon l’article L. 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque « le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient » et la Cour de cassation a affirmé que « le licenciement pour motif économique n’a une cause réelle et sérieuse que si l’employeur s’est trouvé dans l’impossibilité de reclasser le salarié ; qu’il appartient au juge saisi d’une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de rechercher si l’employeur a satisfait à son obligation de reclassement » (54).
● La sanction actuelle de l’absence de cause réelle et sérieuse de licenciement
Aujourd’hui un licenciement pour motif économique dépourvu de cause réelle et sérieuse est qualifié de licenciement abusif. L’irrégularité du licenciement, constatée par le juge, ouvre droit au prononcé de plusieurs sanctions contre l’employeur, prévues aux articles L. 1235-3 et L. 1235-4 du code du travail :
– le juge peut en premier lieu proposer la réintégration dans l’entreprise du salarié licencié abusivement, avec le maintien de ses avantages acquis ;
– si le juge choisit de ne pas proposer la réintégration ou si celle-ci est refusée par le salarié ou par l’employeur, le juge doit, en deuxième lieu, octroyer au salarié une indemnité ne pouvant être inférieure aux salaires des six derniers mois ; le versement de cette indemnité est de droit chaque fois que le licenciement se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, quelle qu’en soit la raison (55) ;
– le juge peut en dernier lieu condamner l’employeur à rembourser tout ou partie des allocations de chômage dans certains cas ; cette dernière sanction ne concerne qu’indirectement le salarié par son effet financier dissuasif pour les entreprises.
Ces sanctions ne sont toutefois pas applicables à tous les employeurs et les salariés, alors même qu’ils sont victimes d’un licenciement abusif d’une façon identique, ne sont pas habilités à invoquer les mêmes droits en justice. Ainsi, aux termes de l’article L. 1235-5 du code du travail, les salariés employés dans des entreprises de moins de onze salariés et ceux jouissant de moins de deux ans d’ancienneté dans toute entreprise, quelle que soit sa taille, ne bénéficient pas des dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-4 du code du travail.
Ces salariés, en cas de licenciement abusif, ne peuvent prétendre qu’à une indemnité correspondant au préjudice subi, selon le même article L. 1235-5 du code du travail. Le montant de cette indemnité est évalué par le juge en fonction de la réalité et de l’étendue du préjudice qu’a généré le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il n’existe dans ce cas aucune possibilité de voir prononcer la réintégration dans l’entreprise.
D’une manière plus générale, même lorsque l’article L. 1235-3 du code du travail s’applique, le juge n’est pas tenu de proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise selon une jurisprudence ancienne de la Cour de cassation (Cass. Soc. 18 décembre 1975 Polyclinique Ducuing). De surcroît, selon la lettre du texte, le seul refus de l’employeur suffit à empêcher la réintégration du salarié, celle-ci ne pouvant être imposée ni par les juges du fond ni par le juge des référés (Cass. Soc. 29 janvier 1981 et 1er avril 1981)
Au regard de la gravité que revêt l’absence de cause réelle et sérieuse d’un licenciement pour motif économique, qui peut signifier par exemple qu’un salarié a été licencié en raison de difficultés économiques qui n’ont pas été estimées a posteriori comme justifiant légitimement son licenciement, les sanctions énoncées actuellement par le code du travail semblent insuffisantes.
● La sanction actuelle de la nullité du licenciement
Ce caractère insuffisant apparaît d’autant plus clairement lorsque l’on compare ces sanctions avec celles qui sont infligées en cas de nullité du licenciement pour motif économique.
La nullité du licenciement pour motif économique est tout d’abord encourue en cas d’annulation de la procédure de licenciement en raison de l’absence ou de l’insuffisance du plan de sauvegarde de l’emploi (56), aux termes des articles L. 1235-10 et L. 1235-11 du code du travail.
Selon l’arrêt de principe de la chambre sociale de la Cour de cassation du 14 janvier 2003, la nullité du licenciement pour motif économique est également encourue en cas d’annulation de la procédure pour défaut de consultation du comité d’entreprise mais à condition que l’irrégularité affectant la saisine du comité d’entreprise ait été soulevée avant la fin de la procédure, à un moment où celle-ci pouvait encore être suspendue puis reprise, et que, malgré cette possibilité de régularisation, l’employeur ait notifié les licenciements.
La nullité du licenciement pour motif économique est enfin encourue lorsque l’employeur, en dépit de l’annulation d’une précédente procédure de licenciement pour motif économique, n’a pas repris entièrement la procédure de consultation des représentants du personnel mais s’est contenté de présenter un plan de sauvegarde de l’emploi au stade qui avait été atteint lors de la précédente procédure (57).
En cas de nullité du licenciement pour motif économique, la réintégration du salarié dans son emploi ou, à défaut, dans un emploi équivalent est de droit (58) car le licenciement est annulé et la rupture du contrat est supposée ne jamais avoir eu lieu. Tout acte juridique déclaré nul ne doit produire aucun effet : la relation de travail se poursuit comme si elle n’avait pas été interrompue.
Dans le cas précis de l’annulation de la procédure de licenciement pour motif économique par le juge pour absence ou insuffisance du plan de sauvegarde de l’emploi, le droit à réintégration du salarié est expressément prévu par le code du travail aux articles L. 1235-10 et L. 1235-11 du code du travail. Le juge a le pouvoir d’ordonner la réintégration, sauf si elle est devenue impossible, par exemple du fait de la fermeture du site.
Le salarié a, en outre, droit d’obtenir une indemnisation de la part de l’employeur car la réintégration seule n’offre pas une réparation complète du préjudice qu’il a subi du fait de son licenciement : le salarié a en effet en plus été privé de son salaire pendant une période plus ou moins longue. Comme l’a affirmé la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 3 juillet 2003 : « le salarié dont le licenciement est nul et qui demande sa réintégration a droit au paiement d’une somme correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s’est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé ».
En cas de nullité du licenciement pour motif économique, en raison de l’annulation de la procédure par le juge pour absence ou insuffisance du plan de sauvegarde de l’emploi, le salarié peut choisir de ne pas réintégrer l’entreprise : il a droit alors au versement d’une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des douze derniers mois en vertu de l’article L. 1235-11 du code du travail (59) ainsi qu’aux indemnités de rupture du contrat de travail (60).
● Le dispositif proposé : sanctionner par la nullité l’absence de cause réelle et sérieuse d’un licenciement pour motif économique
Face à la faiblesse évidente des sanctions prévues en cas de licenciement pour motif économique sans cause réelle et sérieuse, surtout comparées à celles qu’entraîne la nullité du licenciement, l’article 2 de la proposition de loi propose de déclarer « nul et nul d’effet » tout licenciement pour motif économique dépourvu de cause réelle et sérieuse (alinéa 2) en complétant par une phrase en ce sens le dernier alinéa de l’article L. 1233-2 du code du travail (alinéa 1er).
Désormais tout licenciement pour motif économique jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse sera considéré comme nul et les salariés bénéficieront ainsi des effets importants et protecteurs, décrits ci-dessus, qui sont attachés à la nullité. L’objectif est d’inciter les entreprises à privilégier des solutions alternatives au licenciement, comme les ajustements en capital, en renchérissant le coût des licenciements abusifs. En effet l’indemnité versée au salarié en cas de nullité du licenciement, que le présent article propose d’ailleurs de relever (voir infra), représente le double de celle octroyée en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse. De plus, le salarié se verrait affermi dans son droit à réintégration.
2. L’augmentation du montant de l’indemnité versée au salarié en cas de nullité du licenciement pour motif économique
Dans le but de rendre encore plus efficace et dissuasive la sanction par la nullité des licenciements pour motif économique dépourvus de cause réelle et sérieuse, l’alinéa 3 de l’article 2 de la proposition de loi vise à augmenter l’indemnité accordée au salarié en cas de licenciement nul en imposant un montant minimum qui correspond aux salaires des dix-huit derniers mois et non plus des douze derniers mois comme c’est le cas actuellement. À cette fin, le nombre « douze » est remplacé par le nombre « dix-huit » au dernier alinéa de l’article L. 1235-11 du code du travail.
Cette modification renforce le choix de sanctionner par la nullité les licenciements pour motif économique abusifs et améliore la situation des salariés victimes de licenciements injustifiés en leur permettant de percevoir une indemnité d’un montant plus élevé.
*
La Commission rejette l’article 2.
Article 3
Création d’un droit d’opposition aux licenciements pour motif économique
Face à l’urgence sociale que constitue la multiplication des licenciements économiques, qui sont parfois déclarés abusifs ou nuls après plusieurs années de procédure contentieuse, l’article 3 de la proposition de loi vise à créer une nouvelle voie de recours contre les licenciements pour motif économique : un droit d’opposition ouvert devant le juge des référés, le cas échéant avant même la fin de la procédure, portant sur la validité du motif invoqué par l’employeur et exercé par les représentants du personnel.
1. Les recours actuels contre un licenciement pour motif économique
Aujourd’hui, un licenciement pour motif économique peut être contesté par le salarié qui en est victime, mais aussi par les organisations syndicales et les représentants du personnel, à des titres néanmoins différents.
● Les recours ouverts aux salariés
En principe, le salarié peut contester, devant le conseil des prud’hommes, la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux du motif de son licenciement économique, dans un délai de douze mois à compter de la notification du licenciement, aux termes de l’article L. 1235-7 du code du travail (61).
Il bénéficie alors d’une procédure d’urgence spéciale devant le conseil des prud’hommes. L’article L. 1456-1 du code du travail énonce en effet qu’« en cas de litige portant sur les licenciements pour motif économique, la section ou la chambre statue alors en urgence » (62). La tentative de conciliation doit alors avoir lieu dans un délai d’un mois maximum. Le bureau de conciliation fixe ensuite la date d’audience du bureau de jugement, qui doit statuer dans un délai de six mois au plus (63).
Les salariés disposent, de surcroît, d’un droit individuel propre à faire valoir la nullité de leur licenciement pour motif économique en invoquant la nullité du plan de sauvegarde de l’emploi, selon l’arrêt du 28 mars 2000 de la chambre sociale de la Cour de cassation. Cette action doit être portée devant la juridiction prud’homale (64). Ils ne peuvent toutefois exercer ce droit de recours qu’une fois le licenciement prononcé, la Cour de cassation ayant jugé que « les salariés, qui n’ont pas fait l’objet d’une mesure de licenciement économique, sont sans intérêt à agir en nullité de la procédure de licenciement collectif pour motif économique en cours » (Cass. Soc. 15 janvier 2003).
● Les recours ouverts aux organisations syndicales
Dans le cadre du licenciement pour motif économique, outre l’action collective qui leur est ouverte (voir infra), les organisations syndicales peuvent agir en justice en faveur d’un salarié, en vertu de l’article L. 1235-8 du code du travail.
Elles sont autorisées à exercer l’ensemble des recours nés des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles régissant le licenciement pour motif économique en cause, sans avoir à justifier d’un mandat de la part du salarié.
Les organisations syndicales sont cependant tenues d’avertir le salarié concerné par une lettre recommandée avec accusé de réception, indiquant la nature et l’objet de l’action envisagée. Le salarié peut alors s’opposer à l’exercice du recours pendant un délai de quinze jours. D’une manière plus générale, il peut, à tout moment, intervenir à l’instance engagée par le syndicat ou mettre un terme à cette action.
● L’action collective des représentants des salariés
Le comité d’entreprise, ou les délégués du personnel à défaut, et les syndicats professionnels peuvent enfin contester la régularité ou la validité de la procédure de licenciement pour motif économique :
– soit sur le fondement de l’absence ou de l’insuffisance du plan de sauvegarde de l’emploi, qui doit être élaboré et présenté aux représentants du personnel dans les procédures de licenciement pour motif économique d’au moins dix salariés sur une même période de trente jours dans des entreprises de plus de cinquante salariés, selon l’article L. 1233-61 du code du travail ;
– soit sur le fondement du défaut de consultation et d’information des représentants du personnel sur les projets de licenciement, une procédure obligatoire en cas de licenciement collectif, qu’il vise dix salariés ou moins, aux termes des articles L. 1233-8 et suivants et L. 1233-28 et suivants du code du travail.
Ils doivent agir dans un délai de douze mois à compter de la date de la dernière réunion du comité d’entreprise, selon l’article L. 1235-7 du code du travail.
Les représentants des salariés peuvent également exercer une action devant le juge des référés du tribunal de grande instance, dans un délai de quinze jours suivant chacune des réunions du comité d’entreprise, en vertu de l’article L. 1235-7 du code du travail. Le juge des référés peut ordonner la suspension de la procédure et enjoindre à l’entreprise d’élaborer et de mettre un plan de sauvegarde de l’emploi.
En cas d’irrégularité, la procédure de licenciement est donc soit suspendue puis reprise correctement à partir de l’étape qui a connu l’irrégularité en cause, si celle-ci a été soulevée avant la notification des licenciements, soit, dans le cas contraire, elle donne lieu à une indemnisation des salariés réparant le préjudice subi du fait de l’irrégularité, sans que la validité des licenciements soit remise en cause (65).
La nullité de la procédure, et par conséquent celle des licenciements pour motif économique associés, peut également être parfois prononcée, mais dans des cas limitativement admis, comme par exemple en cas d’insuffisance du plan de sauvegarde de l’emploi (voir commentaire de l’article 2 pour les autres cas).
Si les représentants du personnel sont habilités à contester la régularité de la procédure de consultation et d’information suivie par l’employeur ainsi que le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi, ils ne peuvent pas aujourd’hui contester la validité du motif économique invoqué par l’employeur, comme cela a été jugé au sujet du comité d’entreprise par la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 9 juin 2004.
2. Le dispositif proposé : un nouveau droit d’opposition aux licenciements économiques
Afin de renforcer la capacité de négociation des salariés et d’inciter, de ce fait, les entreprises à promouvoir des mesures alternatives aux compressions d’effectifs, l’article 3 de la présente proposition de loi vise à créer un recours supplémentaire contre les licenciements pour motif économique en insérant un nouvel article L. 1233-10-1 du code du travail après l’article L. 1233-10 du même code (alinéa 1er).
Ce recours consisterait en un droit d’opposition à la rupture du ou des contrats de travail qui revêtirait les caractéristiques suivantes :
– il serait exercé par les délégués du personnel ou le comité d’entreprise, le cas échéant élargi (alinéa 2) ;
– le recours porterait sur la validité du motif économique invoqué par l’employeur, c’est-à-dire sur la conformité du motif économique à la définition qui en est donné à l’article L. 1233-3 du code du travail, tel que modifiée par l’article 1er de la présente proposition de loi, à savoir une définition plus restrictive (voir le commentaire de l’article 1er) (alinéa 2) ;
– la mise en œuvre du recours suspendrait la procédure de licenciement pour motif économique en cours (alinéa 4).
Le droit d’opposition obéirait à la procédure suivante : il serait porté devant le juge des référés qui devrait statuer dans un délai de quinze jours au plus (alinéa 3).
L’exercice du droit d’opposition aux licenciements pour motif économique aboutirait :
– soit à la reprise de la procédure de licenciement si le juge des référés juge infondée la demande, c’est-à-dire s’il estime que le motif de licenciement est valable au regard de la définition prévue par l’article L. 1233-3 du code du travail, et qu’il déboute par conséquent les représentants du personnel (alinéa 4) ;
– soit à l’annulation de la procédure, dans le cas contraire, ainsi qu’à celle des licenciements pour motif économique qui seraient déjà intervenus (alinéa 5) avec pour conséquence la réintégration immédiate des salariés, cette dernière constituant la sanction de la nullité d’un licenciement.
Il s’agit de permettre, par l’institution d’une nouvelle action en contestation des licenciements économiques, aux salariés de ne pas être simplement informés de la procédure en cours mais de pouvoir agir par l’intermédiaire de leurs représentants, plus efficacement et surtout d’une manière parfois préventive, ou tout du moins bien plus rapide, contre les licenciements injustifiés.
L’existence d’un droit de veto suspensif des salariés leur conférera d’une part un poids accru dans la négociation avec leur employeur, qui se trouvera davantage incité à déployer des solutions autres que la rupture des contrats de travail, et d’autre part un véritable droit de regard sur les choix de l’entreprise dont ils créent quotidiennement la richesse par leur force de travail. C’est un premier pas en vue de l’entrée de la démocratie dans l’entreprise.
*
La Commission examine l’amendement AC 1 du rapporteur.
M. le rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination qui étend le champ d’application du droit d’opposition des représentants du personnel à la rupture des contrats de travail aux procédures de licenciement pour motif économique de dix salariés ou plus sur une même période de trente jours.
M. Roland Muzeau. Il s’agit en effet de réparer un simple oubli.
La Commission rejette l’amendement.
Elle rejette ensuite l’article 3.
Article 4
Suppression des exonérations fiscale et sociale sur les heures
supplémentaires instaurées par la « loi TEPA »
Cet article a pour objet de supprimer le dispositif d’exonération de l’impôt sur le revenu et d’allègement de cotisations sociales, salariales et patronales, sur les rémunérations des heures supplémentaires, instauré par la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur, du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat (« loi TEPA »).
1. Le dispositif d’exonération mis en place par la loi TEPA
Le dispositif institué par la loi TEPA, applicable depuis le 1er octobre 2007, est prévu à l’article 81 quater du code général des impôts et aux articles L. 241-17 et L. 241-18 du code de la sécurité sociale. Il consiste à exonérer aux plans fiscal et social l’ensemble des temps supplémentaires travaillés. Sont en effet visés par ces articles et donc inclus dans le dispositif d’exonérations :
– les heures supplémentaires ;
– les heures complémentaires effectuées par les salariés à temps partiel ;
– les heures réalisées au cours d’une semaine en dépassement de la durée légale du travail, par les salariés bénéficiant d’un temps réduit pour les besoins de la vie familiale ;
– l’ensemble des temps excédentaires travaillés en cas d’application d’un régime de modulation du temps de travail ;
– les heures effectuées au-delà de 1607 heures pour les salariés au forfait annuel en heures ;
– les salaires versés au titre des jours supplémentaires travaillés au-delà de 218 jours, pour les salariés relevant d’une convention de forfait annuel en jours.
Aux termes de l’article 81 quater du code général des impôts et des articles L. 241-17 et L. 241-18 du code de la sécurité sociale, les rémunérations perçues et versées pour ces temps supplémentaires travaillés se voient appliquer trois types d’avantages fiscaux et sociaux. Il s’agit :
– d’une exonération d’impôt sur le revenu en faveur du salarié qui a perçu une rémunération pour l’un des temps supplémentaires travaillés compris dans le dispositif TEPA ;
– d’une réduction de cotisations salariales de sécurité sociale, proportionnelle à la rémunération brute du salarié, dans la limite des cotisations et contributions d’origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi, ce qui correspond à un taux plafond de 21,5 % ;
– d’une déduction forfaitaire de cotisations patronales de sécurité sociale pour les employeurs entrant dans le champ de la réduction générale de cotisations patronales dite « réduction Fillon », au titre des salariés ouvrant droit à cette réduction. Il faut noter que la déduction forfaitaire des cotisations patronales ne concerne que les heures supplémentaires, lorsqu’elles font l’objet d’une rémunération au moins égale à celle d’une heure normale (ne sont donc visées ni les heures complémentaires, ni les heures supplémentaires rémunérées en repos compensateurs de remplacement). Le montant de la déduction, fixé forfaitairement par heure supplémentaire effectuée, est égal à 0,50 euro par heure dans les entreprises de plus de vingt salariés et 1,50 euro par heure dans les entreprises employant de un à vingt salariés. Il s’impute sur les sommes dues par les employeurs aux unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et allocations familiales (URSSAF) au titre de l’ensemble de la rémunération versée à l’intéressé.
L’article 81 quater du code général des impôts et les articles L. 241-17 et L. 241-18 du code de la sécurité sociale imposent deux limites au dispositif d’exonérations fiscale et sociale.
Tout d’abord, les exonérations s’appliquent aux majorations salariales correspondant aux temps supplémentaires travaillés dans la limite des taux prévus par la convention collective ou par l’accord professionnel ou interprofessionnel applicable. À défaut d’un tel accord, le montant de la majoration retenu pour l’application des allégements est limité à 25 % pour les huit premières heures supplémentaires et 50 % pour les heures suivantes, à 25 % pour les heures complémentaires effectuées au-delà de 10 % de la durée contractuelle de travail, à 25 % de la rémunération horaire pour les heures réalisées au-delà de 1 607 heures et à 25 % de la rémunération journalière pour les heures effectuées au-delà de 218 jours.
Ensuite, sont expressément exclues du bénéfice de la réduction des cotisations salariales et de la déduction forfaitaire, les rémunérations versées au titre des heures supplémentaires et complémentaires ou de jours auxquels le salarié a renoncé, dès lors qu’elles se substituent à d’autres éléments de rémunération (par exemple des primes), à moins qu’un délai de douze mois se soit écoulé entre le versement du dernier élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier paiement des heures supplémentaires ou complémentaires qui le remplace.
Ce principe de non-substitution a pour but d’éviter les effets d’aubaine.
2. Un dispositif sans contrepartie, très coûteux et aux effets limités
Le dispositif prévu par la loi TEPA s’inscrit dans la philosophie nouvelle des mesures de réductions générales de cotisations patronales de sécurité sociale, initiée par loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l’emploi (dite « loi Fillon »).
En effet, la « loi Fillon » a mis en place un dispositif unique d’allègement qui, pour la première fois, n’a pas établi de mécanisme de conditionnalité de l’exonération à la protection ou à la création d’emplois (66).
Les exonérations instaurées par la loi TEPA reprennent le même schéma n’imposant aucune obligation relative au maintien et au développement de l’emploi pour profiter des réductions de charges, qu’elles appliquent aux rémunérations supplémentaires.
Or ce dispositif, qui n’exige pas de contrepartie pour l’emploi, est très onéreux pour le budget de l’État : son coût total s’élève à 4,4 milliards d’euros.
Ce coût, que décrit le tableau présenté ci-dessous, prend en compte les cinq dispositifs résultant de l’article 81 quater du code général des impôts et des articles L. 241-17 et L. 241-18 du code de la sécurité sociale, à savoir :
– l’exonération des cotisations salariales ;
– la réduction forfaitaire des cotisations patronales ;
– la neutralisation de la majoration des heures supplémentaires dans l’allégement général dit « Fillon » ;
– l’exonération de l’impôt sur le revenu ;
– l’effet d’assiette sur les cotisations salariales et patronales lié à l’augmentation de la majoration à 25 % de la rémunération des heures supplémentaires dans les entreprises de vingt salariés et moins.
Évaluation du coût net pour l’État des dispositifs d’exonération
sur les temps supplémentaires travaillés de la loi TEPA
(en milliards d’euros)
Mesures nouvelles |
Montants cumulés | ||||
2007 |
2008 |
2009 |
2007-2008 |
2007-2009 | |
Exonération (cotisations salariales, CSG, CRDS) Réduction forfaitaire de cotisations sociales employeur Coût des compensations des nouvelles exonérations de cotisations sociales |
- 0,4 - 0,2
|
- 2,1 - 0,5
|
0,0 0,0
|
- 2,5 - 0,7
|
- 2,5 - 0,7
|
Neutralisation de la majoration Coût des exonérations de charges sociales |
- 0,2
|
- 0,6
|
0,0
|
- 0,8
|
- 0,8
|
Impôt sur le revenu Coût total brut des heures supplémentaires TEPA |
0,0 - 0,8 |
- 0,2 - 3,5 |
- 0,7 - 0,7 |
- 0,2 - 4,3 |
- 0,9 - 5,0 |
Augmentation de la majoration Coût total net des heures supplémentaires TEPA |
0,1 - 0,6 |
0,4 - 3,0 |
0,0 - 0,7 |
0,6 - 3,7 |
0,6 - 4,4 |
Source : direction générale du trésor et de la politique économique (DGTPE) du ministère de l’économie et des finances.
Selon les termes mêmes du rapport annuel de la Cour des comptes publié en février 2009, « la loi TEPA du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi, et du pouvoir d’achat est venue rendre le système d’exonérations encore plus complexe et plus coûteux » (67).
De plus, si le dispositif d’exonération de la loi TEPA a bien engendré une augmentation du recours aux heures supplémentaires, ses effets économiques semblent très limités voire contreproductifs.
À volume horaire de travail déterminé en fonction des mécanismes de marché à un instant donné, permettre à ceux qui occupent un emploi d’allonger leur durée de travail a pour corollaire logique d’empêcher ceux qui n’occupent pas d’emploi d’en occuper un.
Cette analyse se trouve confortée par l’évolution des chiffres de l’emploi et du chômage, certes en partie due à la période difficile que traverse l’économie mondiale.
Selon les données statistiques de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS), le recours aux heures supplémentaires a fortement progressé depuis la mise en place du dispositif TEPA en octobre 2007, passant de 148,8 millions d’heures supplémentaires comptabilisées au quatrième trimestre de 2007 à 183,5 millions d’heures supplémentaires au troisième trimestre de 2008 comme le retrace le tableau ci-dessous.
Évolution du nombre d’heures supplémentaires
Heures supplémentaires |
T4 2007 |
T1 2008 |
T2 2008 |
T3 2008 |
Heures supplémentaires (en millions) |
148,8 |
173 |
183,5 |
183,5 |
Heures supplémentaires / effectif salarié |
8 |
9,2 |
9,7 |
9,6 |
Heures supplémentaires par effectif salarié des entreprises effectuant des heures supplémentaires |
13 |
14,2 |
14,6 |
14,2 |
Source : ACOSS.
Cependant les effets économiques du dispositif TEPA paraissent très limités au regard des évolutions récentes de l’emploi et du chômage en France. En effet, selon l’estimation de la Direction de l’animation de la recherche des études et des statistiques (DARES) (68), l’emploi dans l’ensemble de l’économie française a reculé de 102 000 postes au quatrième trimestre de 2008, après un recul de 22 000 au troisième trimestre de 2008. La DARES comptabilise au total 117 000 destructions de postes de fin décembre 2007 à fin décembre 2008, alors que le dispositif d’exonération de la loi TEPA était supposé développer tant l’emploi que le pouvoir d’achat.
Les chiffres du chômage interrogent également l’efficacité du dispositif TEPA sur l’emploi. Selon la DARES (69), le nombre de demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi en catégorie A, B et C, sur la France entière, a augmenté de 13 % de mars 2008 à mars 2009 et il s’élève, au total, en mars à 3 688 000 demandeurs d’emploi. Le tableau ci-après reproduit l’évolution du nombre de demandeurs d’emploi par catégorie de mars 2008 à mars 2009.
Demandeurs d’emploi inscrits en fin de mois à Pôle emploi
Unités : milliers et %
France métropolitaine |
Mars 2008 |
Mars 2009 |
Variation sur un an | |
Catégorie A |
Demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi, tenus de faire des actes positifs de recherche d’emploi, sans emploi |
2 004,3 |
2 448,2 |
22,1 |
Catégorie B |
Demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi, tenus de faire des actes positifs de recherche d’emploi, ayant exercé une activité réduite courte (i.e. de 78 heures ou moins au cours du mois) |
453,9 |
482,2 |
6,2 |
Catégorie C |
Demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi, tenus de faire des actes positifs de recherche d’emploi, ayant exercé une activité réduite longue (i.e. de plus de 78 heures au cours du mois) |
612,8 |
550,3 |
- 10,2 |
Catégories A, B, C |
Demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi, tenus de faire des actes positifs de recherche d’emploi |
3 071,0 |
3 480,7 |
13,3 |
Catégorie D |
Demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi, non tenus de faire des actes positifs de recherche d’emploi pour diverses raisons (stage, formation, maladie, etc.), sans emploi |
176,8 |
192,2 |
8,7 |
Catégorie E |
Demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi, non tenus de faire des actes positifs de recherche d’emploi, en emploi (par exemple : bénéficiaires de contrats aidés) |
224,8 |
226,7 |
0,8 |
Catégories A, B, C, D, E |
Demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi |
3 472,6 |
3 899,6 |
12,3 |
France entière, catégories A, B, C (actes positifs de recherche d’emploi) |
3 623,2 |
3 688,0 |
13,0 |
Source : Pôle emploi, DARES.
3. Le dispositif proposé : la suppression des exonérations fiscales et des allègements de cotisations sociales sur les heures supplémentaires
Le dispositif d’exonération instauré par la loi TEPA, et prévu à l’article 81 quater du code général des impôts et aux articles L. 241-17 et L. 241-18 du code de la sécurité sociale, est critiquable tout d’abord pour son défaut d’exigence d’une contrepartie pour l’emploi dans l’octroi des exonérations en vigueur, mais aussi pour son coût qui semble exorbitant en temps de crise et qui participe de la dérive des finances publiques.
Au lieu d’être alloués à un dispositif dont les effets sur l’économie sont très limités, au regard de l’évolution de l’emploi et des chiffres actuels du chômage, les 4,4 milliards d’euros que coûtent les exonérations TEPA pourraient être affectés à des dépenses sociales communes et financer des mesures d’urgence sociale, telles que celles prônées par la présente proposition de loi.
De surcroît, l’efficacité sur l’économie et sur l’emploi du dispositif d’exonération TEPA paraît plus que limitée. Il semble jouer contre l’emploi en freinant les embauches, le nombre de postes non créés ayant été estimé à 90 000 postes (70). Il acte, enfin, le choix politique et idéologique de ne pas augmenter le taux horaire des salaires, à l’encontre de ce qui est préconisé dans la présente proposition de loi.
C’est pourquoi, l’article 4 de la proposition de loi vise à supprimer le dispositif d’exonération aux plans fiscal et social des temps supplémentaires travaillés, instauré par la loi TEPA, en abrogeant l’article 81 quater du code général des impôts (alinéa 1er) et les articles L. 241-17 et L. 241-18 du code de la sécurité sociale (alinéa 2) qui le prévoient (71).
*
La Commission rejette l’article 4.
TITRE II
DE L’AUGMENTATION DES SALAIRES ET DE LA PROTECTION
DES DEMANDEURS D’EMPLOI
Article 5
Instauration d’un seuil minimum de fixation du SMIC à hauteur de 1 600 euros
Dans un contexte de dégradation du pouvoir d’achat des Français, l’article 5 de la proposition de loi vise à instaurer un seuil minimum de fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC), à hauteur de 1 600 euros bruts mensuels.
1. Le SMIC, une institution sociale et économique centrale
● Le SMIC, symbole du rôle de régulation des relations sociales de l’État
Selon l’analyse de Gérard Lyon-Caen, le droit du travail s’est « construit autour de la question du salaire » (72) qui constitue un nœud central des relations sociales dans une société qui peut aujourd’hui être qualifiée de « société salariale » (73).
L’abandon de la doctrine libérale, qui confiait à la loi de l’offre et de la demande et à la négociation de gré à gré la détermination du montant des salaires, pour un système dirigiste dans l’après-guerre puis au profit d’un principe de liberté des salaires encadré par un minimum fixé par l’État, reflète le caractère social central du salaire, source de subsistance principale de nombreux Français et dont le niveau général ne peut donc pas désintéresser l’État.
Depuis la loi n° 50-205 du 11 février 1950 relative aux conventions collectives et aux procédures de règlement des conflits collectifs de travail, la détermination du montant des salaires repose sur un mécanisme à deux étages : l’État fixe tout d’abord un salaire minimum puis les salaires réels sont déterminés par voie d’accords collectifs, dans le cadre d’une négociation de branche ou d’entreprise. Si la loi renvoie la fixation du montant des salaires à la liberté contractuelle, qui peut s’exercer à l’échelle des conventions collectives et du contrat de travail, c’est à la condition, d’ordre public, que soit respecté le salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Le SMIC, qui a succédé en 1970 au salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG), peut donc être défini comme le seuil minimal de rémunération que tous les salariés doivent percevoir. Il s’impose en effet non seulement à l’ensemble des salariés et des employeurs de droit privé, mais aussi au personnel des établissements publics à caractère industriel et commercial et au personnel de droit privé des établissements publics administratifs, aux termes de l’article L. 3231-1 du code du travail.
Une entreprise qui ne respecterait pas les règles de rémunération relatives au SMIC encourt une amende de 1 500 euros, applicable au titre de chacun des salariés rémunérés dans des conditions illégales, selon l’article R. 3233-1 du code du travail.
La fixation du SMIC par l’État symbolise ainsi son rôle de régulateur des relations sociales puisqu’il impose un montant de salaire minimum, s’appliquant aux échelles nationale et interprofessionnelle, dont la violation est passible de sanctions.
● La raison d’être principale du SMIC : la garantie du pouvoir d’achat
S’il constitue juridiquement en tant que salaire incompressible de base simplement la contrepartie minimum qu’est tenu de verser un employeur pour le travail du salarié, le SMIC joue en réalité un rôle social fondamental par son caractère de garantie pour tous les salariés d’un seuil minimum de revenus, assurant une vie décente.
Il doit permettre de répondre aux exigences de la Charte sociale européenne révisée qui affirme que « tous les travailleurs ont droit à une rémunération équitable leur assurant, ainsi qu’à leurs familles, un niveau de vie satisfaisant » (Partie I n° 4).
C’est pourquoi l’article L. 3231-2 du code du travail dispose que « le salaire minimum de croissance assure aux salariés dont les rémunérations sont les plus faibles : 1° La garantie de leur pouvoir d’achat ; 2° Une participation au développement économique de la nation ». Le SMIC assume en effet également, comme le précise cet article, une fonction économique, la consommation, dont le niveau dépend du niveau des salaires, constituant le moteur de l’économie française.
L’institution du SMIC a donc une double vocation : il s’agit non seulement de maintenir le pouvoir d’achat, quel que soit le niveau des prix, mais aussi de garantir un pouvoir d’achat progressant en même temps que l’essor économique de la nation pour éviter le développement d’inégalités salariales et par conséquent sociales, du fait de la place centrale du salaire dans notre société.
L’article L. 3231-9 du code du travail confirme cet objectif : « Les relèvements annuels successifs du salaire minimum de croissance doivent tendre à éliminer toute distorsion durable entre sa progression et l’évolution des conditions économiques générales et des revenus ».
● Le mécanisme actuel de fixation du SMIC et son montant
Le mécanisme de détermination du montant du SMIC se doit ainsi d’obéir à cet impératif de garantie du pouvoir d’achat et d’équilibre social. À cette fin, en vertu des articles L. 3231-4 et suivants du code du travail, la fixation du SMIC est régie par quatre règles :
– le niveau du SMIC est en premier lieu indexé « sur l’évolution de l’indice national des prix à la consommation », cet indice étant lui-même fixé par voie réglementaire, après un avis de la commission nationale de la négociation collective (CNNC) pris sur le fondement du rapport portant sur l’évolution du SMIC établi par un groupe d’expert (74) ;
– le montant du SMIC, en deuxième lieu, est révisé au 1er juillet de chaque année par décret : cette revalorisation est effectuée par une indexation automatique sur le coût de la vie et sur la moitié de la progression du pouvoir d’achat du salaire moyen ouvrier ; en application de la loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail, à compter 1er janvier 2010, la revalorisation annuelle du SMIC interviendra au 1er janvier ;
– en troisième lieu, lorsque l’indice des prix à la consommation, variable de référence de fixation du SMIC, connaît « une hausse d’au moins 2 % par rapport à l’indice constaté lors de l’établissement du salaire minimum de croissance immédiatement antérieur, le salaire minimum de croissance est relevé dans la même proportion à compter du premier jour du mois qui suit la publication de l’indice entraînant ce relèvement », cette revalorisation automatique étant accomplie par arrêté ;
– enfin, le gouvernement dispose de la faculté de décider de porter, par décret, en cours d’année le SMIC à un niveau supérieur à celui qui résulterait de la seule évolution des prix, lorsque la seule indexation se révèle insuffisante.
Depuis le 1er juillet 2008, le montant du SMIC horaire brut est fixé, à 8,71 euros, soit 1 321,02 euros bruts mensuels sur la base de la durée légale de 35 heures hebdomadaires.
2. La dégradation du pouvoir d’achat des Français
Malgré la multiplication de lois censées accroître le pouvoir d’achat des Français (75), en réalité vouées à l’échec en raison de leur absence de prise en compte de la question de l’augmentation des salaires, le constat de la dégradation du pouvoir d’achat des Français s’impose.
● La notion de pouvoir d’achat
Selon l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), la notion de pouvoir d’achat correspond au pouvoir d’achat du revenu disponible brut des ménages, également dénommé « revenu réel disponible » (76).
L’INSEE définit le revenu disponible brut comme « la part du revenu qui reste à la disposition des ménages pour la consommation et l’épargne une fois déduits les prélèvements sociaux et fiscaux » (77).
Le revenu disponible brut comprend les revenus suivants :
– les revenus d’activités (salaires et traitements bruts des ménages, augmentés des bénéfices des entrepreneurs individuels) ;
– les revenus du patrimoine hors plus-values latentes ou réalisées (dividendes, intérêts et loyers) ;
– les transferts en provenance d’autres ménages (notamment les indemnités d’assurance nettes des primes) ;
– les prestations sociales (allocations familiales, minima sociaux, pensions de retraite, indemnités de chômage, etc.).
Le montant du revenu disponible brut s’élève à la somme de ces revenus diminuée des cotisations sociales et des prélèvements fiscaux. Les quatre principaux impôts directs pris en compte sont : l’impôt sur le revenu, la taxe d’habitation, la contribution sociale généralisée (CSG) et la contribution à la réduction de la dette sociale (CRDS).
● Le recul du pouvoir d’achat des ménages
Depuis 2002, le pouvoir d’achat des ménages ne cesse de se dégrader, comme l’illustre le graphique présenté ci-après. En effet si en 2002, le pouvoir d’achat par ménage avait augmenté de 2,3 %, il a décru de - 0,4 % en 2003 puis presque stagné en 2005 (0,2 %). S’il a progressé de 1,7 % en 2007, ce chiffre est bien inférieur aux évolutions observées en 2001 et 2002.
![]()
![]()

Source : Comptes nationaux, INSEE.
Ces données expliquent le malaise et les difficultés sociales grandissantes, d’autant plus lorsqu’on les compare à l’évolution des prix à la consommation en France que retrace le graphique reproduit ci-dessous.
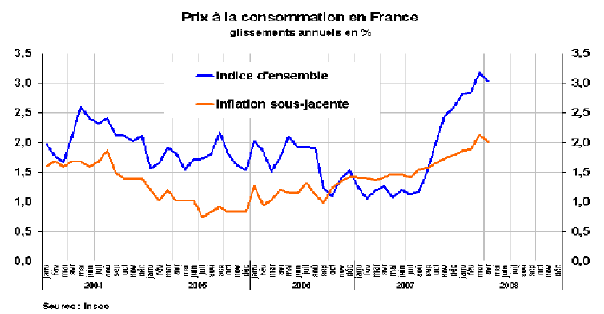
Les données trimestrielles de 2008 relatives à l’évolution du pouvoir d’achat du revenu brut disponible, exposée dans le graphique ci-après, montrent une stagnation du pouvoir d’achat aux premier et troisième trimestre (0,0 % et + 0,1 %), entrecoupé d’une régression au deuxième trimestre (- 0,3 %) puis d’un simple retour à la normale au quatrième trimestre (+ 0,9 %), avec en perspective un chiffre global annuel de l’évolution du pouvoir d’achat du revenu brut disponible pour 2008 nécessairement préoccupant.
Évolution du pouvoir d’achat du revenu disponible brut (RDB) trimestriel
(en %)

Source : Comptes nationaux trimestriels, INSEE.
Le constat du recul du pouvoir d’achat des Français constitue une source de préoccupation non seulement en soi mais aussi, d’une manière plus générale, pour l’économie entière car il pèse sur le niveau de la consommation, l’un des facteurs de croissance majeurs de notre économie, et dont la stimulation devrait se trouver au cœur du plan de relance, comme le souligne l’exposé général.
3. Le dispositif proposé : instituer un seuil minimum de fixation du SMIC
Le refus gouvernemental d’inclure la question de l’augmentation des salaires, contre toute notion de justice sociale, face à l’accroissement des inégalités constitue donc de surcroît un choix inefficace car il retarde d’autant la sortie de crise, et ce aux prix de milliers de suppressions de postes et d’emplois.
Les données chiffrées de l’évolution du pouvoir d’achat, présentées ci-dessus, démontrent incontestablement que le SMIC ne remplit plus aujourd’hui la fonction que la loi lui assigne envers les salariés les moins rémunérés, celle de « la garantie de leur pouvoir d’achat » (article L. 3231-2 du code du travail).
Mais comment pourrait-il en être autrement, au vu de la faiblesse des revalorisations du SMIC accordées par le gouvernement depuis 2005, comme l’indique le tableau présenté ci-dessous ?
Évolution du montant du SMIC depuis 2005
Année |
Smic horaire brut |
Smic mensuel brut |
Date de parution |
2008 |
8,71 |
1 321,02 |
28/06/2008 |
2008 |
8,63 |
1 308,88 |
29/04/2008 |
2007 |
8,44 |
1 280,07 |
29/06/2007 |
2006 |
8,27 |
1 254,28 |
30/06/2006 |
2005 |
8,03 |
1 217,88 |
30/06/2005 |
Source : INSEE.
C’est pourquoi, l’article 5 de la présente proposition de loi vise à instaurer un seuil minimum de fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) à hauteur de 1 600 euros bruts mensuels, applicable à compter du 1er juillet 2009 (alinéa 2). À cette fin, il insère un second alinéa à l’article L. 3231-4 du code du travail, qui renvoie au décret la détermination du montant du SMIC, énonçant qu’« à compter du 1er juillet 2009, le montant du salaire minimum de croissance servant de référence pour le calcul de l’indexation prévue au présent article ne peut être inférieur à 1 600 euros bruts mensuels » (alinéa 1er).
Si la fixation du SMIC demeure de la compétence réglementaire du gouvernement, ce dernier ne pourra plus, et ce dès la prochaine revalorisation du montant du SMIC en juillet 2009, le fixer au-dessous du seuil de 1 600 bruts mensuels. De fait, le SMIC serait augmenté de près de 300 euros dès l’été prochain, soit 21 % de hausse.
Il s’agit d’une mesure d’urgence sociale, au vu de la dégradation du pouvoir d’achat des Français, et économique, en raison de l’impact du niveau des salaires sur la consommation, composante essentielle de la croissance.
*
La Commission rejette l’article 5.
Article 6
Suppression de la réduction générale de cotisations patronales
en l’absence de conclusion d’accords collectifs annuels sur les salaires
L’article 6 de la proposition de loi a pour objet de sanctionner l’absence de conclusion d’accords collectifs annuels sur les salaires par la suppression des réductions de cotisations patronales de sécurité sociale prévues à l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, afin que la négociation annuelle obligatoire sur les salaires, levier fondamental de l’amélioration des rémunérations, assure l’augmentation effective des revenus dans une période de crise économique et de dégradation du pouvoir d’achat des Français.
1. L’obligation d’une négociation collective annuelle sur les salaires
Si le principe d’une fixation du niveau des salaires partagée entre l’État, qui arrête le salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC), et les partenaires sociaux qui négocient ensuite le montant des salaires réels, remonte à la loi n° 50-205 du 11 février 1950 relative aux conventions collectives et aux procédures de règlement des conflits collectifs de travail, l’obligation d’une négociation annuelle sur les salaires a été imposée par la loi n° 82-957 du 13 novembre 1982 relative à la négociation collective et au règlement des conflits collectifs du travail.
Le code du travail prescrit aujourd’hui une négociation salariale annuelle sur deux échelles :
– à l’échelle de la branche, l’article L. 2241-1 du code du travail énonçant que « les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels, se réunissent, au moins une fois par an, pour négocier sur les salaires » ;
– à l’échelle de l’entreprise, l’article L. 2242-8 du code du travail disposant que « chaque année, l’employeur engage une négociation annuelle obligatoire portant sur : 1° Les salaires effectifs ».
Au niveau de l’entreprise, les modalités de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires sont organisées par des règles détaillées quant à ses conditions d’engagement, son déroulement et son terme.
Ainsi, en vertu de l’article L. 2242-1 du code du travail, à défaut d’une initiative de l’employeur depuis plus de douze mois suivant la précédente négociation, celle-ci s’engage obligatoirement à la demande d’une organisation syndicale représentative. La demande de négociation formulée par l’organisation syndicale est transmise dans les huit jours par l’employeur aux autres organisations représentatives. Dans les quinze jours qui suivent la demande formulée par une organisation syndicale, l’employeur convoque les parties à la négociation annuelle. Il s’agit d’éviter que l’inertie de l’employeur empêche la tenue de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires.
Le déroulement de la négociation se trouve également encadré par la loi, du moins pour le contenu de la première réunion. En effet l’article L. 2242-2 du code du travail impose que lors de la première réunion soient précisés : le lieu et le calendrier des réunions ; les informations que l’employeur remettra aux délégués syndicaux et aux salariés composant la délégation ainsi que la date de cette remise. Selon ce même article, ces informations doivent permettre une analyse comparée de la situation des hommes et des femmes concernant les emplois et les qualifications, les salaires payés, les horaires effectués et l’organisation du temps de travail. Elles doivent aussi indiquer les raisons justifiant la situation constatée dans l’entreprise.
Le code du travail protège, de surcroît, le bon déroulement de la négociation en interdisant à l’employeur, « tant que la négociation est en cours », de prendre des « décisions unilatérales concernant la collectivité des salariés, sauf si l’urgence le justifie » (78) dans les matières faisant l’objet de la discussion.
Enfin, l’article L. 2242-4 du code du travail prévoit la procédure à suivre en cas d’absence d’accord à la fin de la négociation. Si, au terme de la négociation, aucun accord n’a été conclu, un procès-verbal de désaccord doit être établi. Doivent y figurer, en leur dernier état, les propositions respectives des parties et les mesures que l’employeur entend appliquer unilatéralement. Ce procès-verbal donne lieu à dépôt auprès des services du ministre en charge du travail, à l’initiative de la partie la plus diligente.
En cas de violation des règles relatives à la négociation annuelle obligatoire sur les salaires, des sanctions pénales sont encourues en vertu des articles L. 2243-1 et L. 2243-2 du code du travail :
– l’employeur qui se soustrait aux obligations relatives à la convocation des parties à la négociation annuelle et à l’obligation périodique de négocier, prévues à l’article L. 2242-1 du code du travail, est passible d’une peine d’emprisonnement d’un an et d’une amende de 3 750 euros ;
– les mêmes peines sont encourues en cas de contravention aux obligations relatives au contenu de la négociation.
2. Une obligation annuelle de négocier sur les salaires en réalité peu contraignante
Malgré l’aspect apparemment contraignant du dispositif de négociation annuelle sur les salaires, précisément décrit par le code du travail et pénalement sanctionné, cette obligation semble en réalité limitée, tant dans son champ d’application que dans son effectivité, et elle n’assure pas aujourd’hui le rôle moteur de levier du niveau des rémunérations qui lui est pourtant imparti.
– En premier lieu, le champ d’application de l’obligation annuelle de négocier sur les salaires ne concerne pas toutes les entreprises. En effet, l’obligation annuelle de négocier ne s’impose que dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d’organisation représentative, à savoir, en pratique, celles où il existe au moins un délégué syndical.
Or, aux termes de l’article L. 2143-3 du code du travail, la désignation de délégués syndicaux ne peut intervenir que dans les entreprises ou les établissements d’au moins cinquante salariés. Si la loi offre deux exceptions à cette règle, à savoir, d’une part, que dans les établissements de moins de cinquante salariés un délégué du personnel titulaire peut être désigné par un syndicat comme délégué syndical et, d’autre part, qu’un délégué syndical peut être désigné en dessous de ce seuil de cinquante salariés si une convention ou un accord collectif le prévoit, elles se rencontrent cependant rarement en pratique.
Comme l’atteste le tableau reproduit ci-dessous, en 2005, seul 23 % des établissements comprenant de 20 à 49 salariés étaient dotés d’un délégué syndical et moins de la moitié des établissements comprenant de cinquante à quatre vingt dix-neuf salariés en comportaient un.
Les institutions représentatives du personnel dans les établissements
du secteur marchand non agricole
en % d’établissements
France métropolitaine |
Année 2004-2005 | ||||||
Type de l’institution |
20 à 49 salariés |
50 à 99 salariés |
100 à 199 salariés |
200 à 499 salariés |
500 salariés ou plus |
Toutes tailles |
dont 50 salariés ou plus |
Présence d’un comité d’entreprise ou d’une délégation unique du personnel (DUP) |
26 |
72 |
90 |
95 |
96 |
46 |
81 |
Présence d’au moins un délégué du personnel ou d’une délégation unique du personnel |
63 |
83 |
92 |
93 |
96 |
72 |
87 |
Présence d’au moins un délégué syndical |
23 |
49 |
74 |
88 |
97 |
38 |
63 |
Présence d’un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail CHSCT |
17 |
59 |
84 |
93 |
96 |
37 |
72 |
Présence d’au moins une de ces institutions |
68 |
89 |
97 |
98 |
99 |
77 |
93 |
Source : INSEE, DARES, enquête Réponse 2004 - 2005.
Le champ d’application de l’obligation annuelle de négociation apparaît par conséquent plus limité que ce que les textes laissent à penser.
– En deuxième lieu, les statistiques relatives à la négociation collective en 2007 (79) démontrent que, dans le champ même des entreprises pourvues d’un délégué syndical et donc soumises légalement à l’obligation de négocier, aucune négociation n’a été menée dans 20 % des cas, toutes entreprises confondues, et que le taux d’absence de toute négociation collective est porté à 35 % pour les entreprises de dix à quarante-neuf salariés, comme le retrace le graphique ci-après. Quant aux entreprises dépourvues de délégués syndicaux, seules 5,9 % d’entre elles ont engagé une négociation collective en 2007.
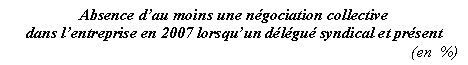
![]()
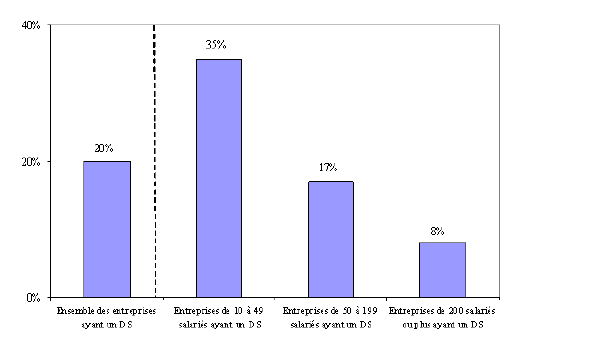
Selon la Direction de l’animation de la recherche des études et des statistiques (DARES), parmi les entreprises dotées d’un délégué syndical et ayant ouvert des négociations, 16,9 % d’entre elles n’ont pas abouti à la conclusion d’un accord, ce qui restreint davantage l’effectivité de l’obligation de négocier.
Plus précisément, selon la DARES, seul 69,4 % des entreprises de dix salariés ou plus du secteur marchand non agricole (80) ont signé en 2007 un accord d’entreprise relatif aux salaires et aux primes, ces accords ne concernant au total que 40,9 % de l’ensemble des salariés employés dans des entreprises de dix salariés ou plus (81). Or le champ des entreprises de dix salariés et plus du secteur marchand non agricole emploie près de 7,5 millions de salariés. Ce sont donc plusieurs millions de salariés qui n’ont pas bénéficié en 2007 d’un accord sur les salaires.
– Enfin, en troisième lieu, il faut observer que les sanctions pénales encourues en cas de violation des règles relatives à l’obligation de négociation annuelle sur les salaires, à savoir des peines d’emprisonnement et d’amende, se révèlent inadaptées en pratique et ne sont donc pas appliquées.
3. Le dispositif proposé : supprimer les réductions de charges sociales en l’absence de conclusion d’accords salariaux annuels
Face à l’ineffectivité de l’obligation de négocier annuellement sur les salaires, due en partie à la faiblesse des sanctions risquées en pratique, qui prive des millions de travailleurs du bénéfice d’accords salariaux, les allègements généraux de charges sociales offerts aux employeurs, sans l’exigence de réelles contreparties, paraissent disproportionnés et devraient être subordonnés à la conclusion d’accords salariaux annuels.
● Des allègements généraux de cotisations patronales coûteux et sans réelle contrepartie
La loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l’emploi (dite « loi Fillon ») a mis en place un dispositif unique d’allègement, prévu aux articles L. 241-13 et D. 241-7 et suivants du code de la sécurité sociale, qui, pour la première fois, n’a pas établi de mécanisme de conditionnalité de l’exonération à la protection ou à la création d’emplois (voir le commentaire de l’article 4).
L’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale énonce ainsi que « les cotisations à la charge de l’employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des maladies professionnelles et des allocations familiales […] font l’objet d’une réduction ».
Le dispositif d’exonération de la « loi Fillon », principal allègement général de charges sociales, s’applique à l’ensemble des entreprises du secteur privé soumises à l’obligation de cotisation au régime de l’assurance chômage (à l’exception des particuliers employant des salariés à domicile), selon le même article.
Il consiste en une réduction de la part patronale des cotisations sociales fixée par l’article D. 241-7 du code de la sécurité sociale, au niveau du SMIC, qui s’annule progressivement au fur et à mesure que le salaire parvient à un seuil de 1,6 SMIC (82). Au niveau du SMIC, le taux de la réduction est fixé soit à 26 points, soit à 28,1 points pour les rémunérations versées depuis le 1er juillet 2007 dans les entreprises de moins de vingt salariés (83).
Le coût du dispositif d’exonération institué par la « loi Fillon » est très élevé pour l’État et il n’a cessé de croître depuis sa mise en place en 2003, comme le rappelle le tableau ci-dessous. En effet, si en 2004 le coût total de cet allègement atteignait 15 milliards d’euros, il est estimé pour 2009, selon le rapport de septembre 2008 de la Commission des comptes de la sécurité sociale à plus de 22 milliards d’euros.
Évolution du coût de la réduction « Fillon »
en millions d’euros
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 | |
Réduction générale des cotisations patronales de sécurité sociale (réduction « Fillon ») |
7 230 |
15 033 |
17 147 |
19 422 |
21 433 |
22 820 |
23 376 |
23 678 |
23 980 |
Source : INSEE, données des régimes de sécurité sociale jusqu’en 2008, prévisions du gouvernement ensuite.
L’importance de ces sommes semble sans rapport avec leur effet économique réel, comme le souligne l’exposé général du présent rapport, et surtout socialement contestable au regard du peu de contreparties exigées des entreprises pour bénéficier de la réduction, qui prive des millions de salariés d’une augmentation annuelle de revenus.
Si la loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail a instauré un mécanisme de conditionnalité du bénéfice des exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale au respect de l’obligation de négociation annuelle sur les salaires, en vigueur depuis le 1er janvier 2009, cette mesure paraît insuffisante à deux titres.
Tout d’abord, la sanction prévue réside dans une diminution du montant de la réduction de seulement 10 % les deux premières années, la suppression de l’exonération n’intervenant que la troisième année consécutive de la violation de l’obligation de négociation salariale annuelle, aux termes de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale. L’employeur qui n’ouvre pas de négociations salariales pendant deux ans de suite ne perd donc que 10 % du montant total de l’allègement de charges sociales, cette sanction apparaissant dérisoire.
De surcroît, le mécanisme de conditionnalité repose sur une obligation de négociation, c’est-à-dire en pratique d’ouverture des négociations, et non sur une obligation de conclusion par les entreprises concernées d’un accord collectif salarial. Les employeurs sont donc légalement tenus de négocier mais pas de conclure, ce qui démontre toute la limite de ce dispositif. Les entreprises qui négocieront mais qui ne concluront pas d’accord pourront continuer de bénéficier des allègements généraux sans autre condition.
● La suppression de la réduction « Fillon » en l’absence de conclusion d’un accord salarial annuel
Pour remédier à cette situation et redonner à l’obligation de négociation annuelle des salaires son rôle de levier du niveau des rémunérations, l’article 6 de la présente proposition de loi vise à subordonner le bénéfice de l’allègement général issu de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l’emploi ou « loi Fillon », à la conclusion d’accords salariaux annuels dans le cadre de l’obligation annuelle de négociation sur les salaires et dans le respect de ses conditions (alinéa 2).
À cette fin, le présent article propose une nouvelle rédaction du dernier alinéa du II de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale prévoyant que « lorsque l’employeur, durant l’année civile, n’a pas conclu d’accord salarial dans le cadre de l’obligation définie au 1° de l’article L. 2242-8 du code du travail dans les conditions prévues aux articles L. 2242-1 à L. 2242-4 du même code, la réduction est supprimée » (alinéa 1er).
Les employeurs seront ainsi tenus de conclure, et non plus seulement de négocier, un accord collectif annuel sur les salaires pour bénéficier de l’allègement général institué par la « loi Fillon » sous peine de la suppression immédiate, dès la première année du constat de l’absence de conclusion d’un accord salarial, de la réduction de charges sociales patronales. Cette sanction financière des employeurs renforce le pouvoir de négociation des salariés, pour qu’enfin leur travail soit rémunéré à sa juste valeur, dans la perspective de l’établissement d’une gestion véritablement démocratique des entreprises.
*
La Commission rejette l’amendement rédactionnel AC 2 du rapporteur.
Elle rejette ensuite l’article 6.
Article 7
Tenue d’une conférence nationale sur les salaires
L’article 7 a pour objet d’imposer la tenue d’une conférence nationale sur les salaires, réunissant les partenaires sociaux, portant sur l’augmentation de la masse salariale dans la valeur ajoutée par le relèvement de l’ensemble des grilles salariales applicables dans les différentes branches professionnelles, dans un délai d’un mois à compter de l’adoption de la présente proposition de loi.
1. Le constat du recul de la part des salaires dans la valeur ajoutée
Selon la définition d’une étude de l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), la valeur ajoutée « représente la richesse engendrée au cours du processus de production par la mise en œuvre des facteurs de production, notamment le travail et le capital » (84). Or la répartition de cette richesse entre les salaires et la rémunération du capital a connu des variations très importantes depuis cinquante ans.
● La diminution de la part salariale
Selon le constat de M. Michel Husson, administrateur de l’INSEE et chercheur à l’Institut de recherches économiques et sociales (IRES)(85), « la caractéristique principale du capitalisme mondialisé depuis le début des années 1980 est la baisse de la part de la valeur créée par le travail qui revient aux salariés » et dont le pendant réside en un accroissement corrélatif de la part des profits dans le partage de la valeur ajoutée.
En France, la part des salaires dans la valeur ajoutée a connu une relative stabilité jusqu’à la récession, provoquée par les chocs pétroliers, du milieu des années 1970, après laquelle elle a fortement augmenté jusqu’au début des années 1980. Depuis lors, selon l’analyse de M. Michel Husson, elle baisse constamment, et ce dans l’ensemble des économies développées, comme l’atteste le tableau présenté ci-après.
La part salariale en France et en Europe
(ensemble de l’économie)
(en %)
Années 1960 |
1982 |
2006 |
Différence 2006-1983 |
Différence 2006 années 1960 | |
France |
62,4 |
66,5 |
57,2 |
- 9,3 |
- 4,1 |
Europe |
63,2 |
66,3 |
57,7 |
- 8,6 |
- 5,5 |
G7 |
66,0 |
67,3 |
61,5 |
- 5,8 |
- 4,5 |
Source : Michel Husson, « La baisse tendancielle de la part salariale », INSEE, Commission européenne, FMI.
La diminution de la part salariale dans la valeur ajoutée atteindrait donc - 9,3 % entre 1982 et 2006, la France se situant dans une évolution comparable à celle des autres pays européens.
M. Michel Husson explique ces fluctuations à partir du mode de formation des salaires en fonction de la productivité du travail. Selon lui, « durant la période “ fordiste” le salaire réel et la productivité du travail augmentent à peu près au même rythme, élevé (environ 5 % par an). La période intermédiaire 1974-1982 se caractérise par un ralentissement très marqué de la productivité du travail, alors que le salaire réel continue à progresser selon une trajectoire faiblement infléchie. Cette croissance du salaire réel plus rapide que celle de la productivité conduit à une augmentation de la part salariale. La baisse salariale à partir de 1982 est obtenue par un blocage de la progression du salaire réel, tandis que la productivité du travail continue à augmenter, même si c’est à un rythme désormais inférieur » (86).
● L’accroissement corrélatif de la part des profits
Parallèlement à la diminution de la part salariale, le taux de profit moyen a connu un redressement rapide et important, comme le retrace le graphique ci-dessous, alors que le taux d’accumulation s’est maintenu, ce qui signifie, d’après M. Michel Husson ; que « la ponction sur les salaires n’a pas été utilisée pour investir plus » (87)mais a été, au contraire, redistribuée aux actionnaires sous la forme des dividendes de plus en plus importants, ce qui a participé au mouvement de financiarisation de l’économie.
Taux de profit et taux d’accumulation dans l’Union européenne 1961-2007
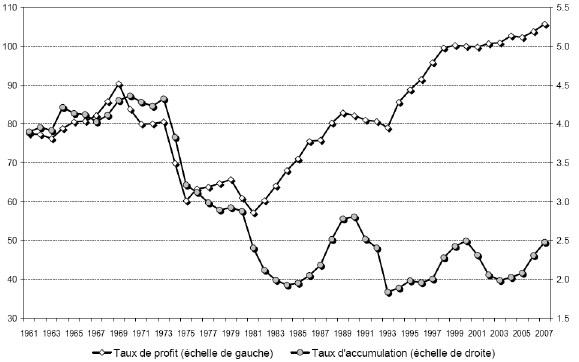
Source : « La baisse tendancielle de la part salariale », Michel Husson, septembre 2007
● Les enjeux du recul de la part salariale dans la valeur ajoutée
Or, selon M. Denis Clerc (88), un recul de la part salariale dans la valeur ajoutée recèle des enjeux majeurs à deux titres :
– tout d’abord « en termes de justice sociale : si le travail salarié, qui représente aujourd’hui les neuf-dixièmes des personnes en emploi dans la société française, voit sa part diminuer, cela signifie qu’une partie importante de la population ne bénéficie pas de la croissance autant qu’elle aurait pu l’espérer » ;
– ensuite « en termes d’efficacité macroéconomique : si la demande de biens et services de consommation issue du monde salarié est comprimée, c’est la dynamique du système économique elle-même qui est freinée ».
Au vu de ces données et de leurs possibles répercussions tant sociales qu’économiques, il semble impératif de rehausser la part de la masse salariale dans la valeur ajoutée. Cet objectif peut être rempli par le biais d’une augmentation des salaires négociée au niveau des branches.
2. Le bilan insatisfaisant de la négociation salariale annuelle de branche
Malgré l’obligation pour les branches de négocier chaque année sur les salaires, les statistiques disponibles démontrent une dynamique de conclusion insuffisante, de trop nombreuses grilles salariales de branche démarrant encore sous le salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC).
● L’obligation de négociation salariale annuelle de branche
La fixation du montant des salaires se trouve aujourd’hui répartie entre l’État, qui arrête le salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC), et les partenaires sociaux qui négocient ensuite le montant des salaires réels (voir le commentaire de l’article 6).
Aux termes de l’article L. 2241-1 du code du travail, « les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels, se réunissent, au moins une fois par an, pour négocier sur les salaires ». Cette obligation constitue le pendant, à l’échelle de la branche, de l’obligation annuelle de négociation salariale en entreprise (89)et se limite, comme elle, à une obligation d’ouvrir des négociations et non de conclure une convention.
La négociation salariale de branche remplit trois fonctions (90) :
– elle fixe l’ordre hiérarchique global des salaires dans la branche, c’est-à-dire l’écart entre le salaire minimum du plus haut coefficient d’une catégorie et le salaire minimum du coefficient le plus bas de la même catégorie, le taux des coefficients étant déterminé en fonction des qualifications professionnelles plus ou moins élevées des salariés ;
– elle établit une structure hiérarchique interne, définissant les écarts de salaires entre les coefficients successifs, qui correspond à la classification des qualifications professionnelles par catégorie ;
– elle donne enfin la valeur du salaire minimum affecté à chaque coefficient et par là même à chaque catégorie.
Il faut observer que le principe d’une liberté contractuelle complète prévaut pour fixer le montant des minima salariaux et les pourcentages d’augmentation entre les différents échelons de la grille salariale de branche : aucune obligation légale ne s’impose aux branches s’agissant du SMIC. L’obligation de fixer, et de payer, un salaire dont le montant est au moins égal au SMIC, ne s’applique qu’à l’employeur.
En vertu du principe de la liberté contractuelle, les minima des différentes branches n’ont pas non plus de base identique, puisqu’aucun cadre ni aucune assiette ne sont légalement prescrits pour la fixation du salaire conventionnel. Ainsi certaines branches négocient des salaires hiérarchiques (91)mensuels ou annuels et d’autres des rémunérations minimales garanties mensuelles ou annuelles (92), les minima entre les différentes branches ne pouvant être comparés en raison de leur hétérogénéité de niveaux et de contenus.
Quant à leur champ d’application, les accords de branche ne sont opposables, avant leur extension le cas échéant, qu’aux seules entreprises adhérentes à un syndicat professionnel signataire. Si le ministre en charge du travail choisit de les étendre par arrêté, ils deviennent obligatoires pour toutes les entreprises relevant de la branche.
● De trop nombreuses grilles salariales démarrant sous le SMIC
Au 31 décembre 2007, la Direction générale du travail (DGT) recensait environ 700 branches professionnelles dont :
– 160 branches relevant du secteur dit «général» ;
– 68 branches relevant du secteur de la métallurgie ;
– 48 branches relevant du secteur du bâtiment et des travaux publics (BTP).
Ces trois catégories qui regroupent 276 branches de plus de cinq mille salariés chacune, emploient près de douze millions de salariés sur les dix-sept millions de travailleurs du secteur privé. Les 400 autres branches, de moins de cinq mille salariés chacune, représentent des secteurs d’activité très spécialisés et localisés.
Or au 31 décembre 2007, selon les chiffres du ministère du travail (93), 25 % des branches du secteur général, couvrant au total près de deux millions et demi de salariés, disposaient encore d’une grille salariale démarrant sous le SMIC. Il en allait de même pour 29 % des branches de la métallurgie et 33 % des branches du BTP dont les conventions restent applicables à des dizaines de milliers de salariés.
Cette distorsion est permise par l’absence de toute obligation de négocier les minima salariaux conventionnels au niveau du SMIC et le dynamisme encore insuffisant des négociations (94). De ce fait, à chaque revalorisation du montant du SMIC, de nouvelles branches voient leur grille salariale démarrer sous le niveau du SMIC.
c) Une dynamique de conclusion encore insuffisante
Si le nombre d’accords (ou d’avenants) salariaux de branche semble en progression depuis 2004, passant de 40,5 % de l’ensemble des accords conclus à 49,2 % en 2007, le nombre réel de textes signés demeure limité : il s’élève à 496 en 2007 (95)et marque un recul par rapport aux deux années précédentes, où il atteignait environ 520 textes signés, comme le montre le graphique présenté ci-dessous.
Évolution du nombre d’avenants salariaux

Source : Ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville.
Cette même diminution du nombre d’avenants salariaux conclus par rapport aux données des années antérieures s’observe également dans le secteur de la métallurgie qui connaît une baisse importante entre 2006, où l’on comptait 68 textes signés, et 2007 où ce chiffre plafonne à 59 textes signés.
En outre, dans l’ensemble des branches, les pourcentages d’augmentations de salaires accordées marquent un fléchissement assez net par rapport aux montants des augmentations obtenues en 2006. Ainsi en 2007, 70 % des hausses des salaires hiérarchiques et 80 % des hausses des salaires garantis sont inférieures à 3 %, contre seulement 55 % et 65 % respectivement en 2006. Parmi les augmentations inférieures à 3 %, près de la moitié des hausses négociées sont, de surcroît, inférieures à 2 %.
Cette situation insatisfaisante peut s’expliquer en partie par les limites que comporte l’obligation annuelle de négocier au niveau de la branche sur les salaires, à savoir que (96) :
– l’article L. 2241-1 du code du travail ne définit pas le périmètre de la négociation et n’indique donc pas si celle-ci doit porter sur toute la grille obligatoirement ou si la discussion peut ne porter que sur certains échelons ;
– cette absence de cadre a pour conséquence qu’en pratique certaines branches n’actualisent que quelques niveaux et que d’autres se contentent même d’envoyer des recommandations patronales aux employeurs de la branche dont l’application peut n’être que facultative pour ces derniers ;
– enfin l’obligation légale de négocier, comme cela a été déjà souligné, ne consiste qu’en une obligation d’ouvrir des négociations et non pas de signer un accord ce qui a conduit certaines branches à conserver parfois pendant dix ans la même grille salariale.
3. Le dispositif proposé : augmenter la part de la masse salariale dans la valeur ajoutée par le relèvement des grilles salariales de branche
Face au recul de la part revenant aux salariés dans la répartition finale de la valeur ajoutée et au constat du nombre important encore de branches disposant de grilles salariales démarrant sous le SMIC, ce qui pénalise des millions de salariés, l’article 7 de la présente proposition de loi vise à imposer la tenue d’une conférence nationale sur les salaires, réunissant les partenaires sociaux sous l’égide du gouvernement, et dont l’objectif serait de trouver un accord portant sur l’augmentation de la masse salariale dans la valeur ajoutée par le relèvement de l’ensemble des grilles salariales applicables dans les différentes branches professionnelles, dans un délai d’un mois à compter de l’adoption de la proposition de loi (alinéa unique).
Il s’agit de contrer la tendance de l’accroissement de la part des profits dans la création de la richesse pour revenir à un équilibre plus raisonnable entre les revenus du travail et du capital et de mettre en conformité l’ensemble des premiers niveaux des grilles salariales de branche avec le SMIC.
*
La Commission rejette l’article 7.
M. Maxime Gremetz. L’article 8 a été déclaré irrecevable au titre de l’article 40 de la Constitution. Je proteste contre cette application de l’article 40, protestation qui vaudra pour les autres articles déclarés irrecevables !
Article 9
Affectation prioritaire des bénéfices à l’indemnisation du chômage partiel
Dans le contexte de la crise mondiale qui affecte l’économie française, les entreprises ont eu recours d’une manière plus massive, selon les termes mêmes de la Direction générale de l’emploi et de la formation professionnelle (DGEFP) (97), au dispositif de chômage partiel. Or cette mesure ne garantit pas aujourd’hui le maintien intégral des salaires.
L’article 9 de la proposition de loi a pour objet de permettre aux salariés, contraints au chômage partiel dans des sociétés qui ont réalisé des bénéfices, de continuer de percevoir leur rémunération complète en affectant prioritairement les sommes distribuables au maintien total des salaires.
1. La définition du chômage partiel
L’article L. 5122-1 du code du travail définit le chômage partiel comme la situation dans laquelle se trouvent des salariés « qui, tout en restant liés à leur employeur par un contrat de travail, subissent une perte de salaire imputable soit à la fermeture temporaire de l’établissement qui les emploie, soit à la réduction de l’horaire de travail habituellement pratiqué dans l’établissement en deçà de la durée légale de travail ».
Le code du travail donne la liste limitative des causes de réduction d’horaire ou de suspension d’activité caractérisant le chômage partiel. La réduction d’horaire ou la suspension d’activité doit être motivée soit par la conjoncture économique, soit par des difficultés d’approvisionnement en matières premières ou en énergie, soit par un sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnel, soit par la transformation, la restructuration ou la modernisation de l’entreprise, soit enfin par toute autre circonstance de caractère exceptionnel (art. R. 5122-1 du code du travail). La réduction d’horaire ou la suspension d’activité doit en outre être temporaire (art. R. 5122-1 du code du travail).
2. Le système actuel d’indemnisation du chômage partiel
Le système de l’indemnisation du chômage partiel s’organise autour de plusieurs allocations versées aux salariés par l’État et par l’employeur. Mais celles-ci ne garantissent pas le maintien intégral des salaires : les salariés ne reçoivent au mieux que 60 % de leur rémunération, sauf en cas de convention d’activité partielle de longue durée où ce taux s’élève à 75 %. Le mécanisme de la garantie de rémunération mensuelle minimale assure toutefois aux salariés un niveau minimal de rémunération équivalent au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) mensuel net.
● L’allocation légale spécifique de chômage partiel
Aux termes de l’article L. 5122-1 du code du travail, les salariés bénéficient tout d’abord de l’allocation spécifique de chômage partiel. En principe tous les salariés, sans condition d’ancienneté, peuvent y prétendre (98). Cette indemnité se trouve à la charge de l’État, même si le paiement en incombe en pratique à l’employeur, qui avance l’allocation puis en obtient le remboursement.
Les salariés perçoivent ainsi une indemnité horaire pour chaque heure chômée en deçà de la durée légale du travail ou de la durée conventionnelle applicable dans l’entreprise. Le montant horaire de l’allocation spécifique de chômage partiel varie en fonction de la taille de l’entreprise : il est plus élevé dans les entreprises de moins de deux cent cinquante salariés (3,84 euros) que dans celles de plus de deux cent cinquante salariés (3,33 euros) (99).
L’allocation spécifique de chômage partiel est cependant versée dans la limite d’un contingent annuel d’heures indemnisables fixé, depuis le 1er janvier 2009, à 800 heures pour l’ensemble des branches professionnelles. Par dérogation, ce contingent s’élève à 1 000 heures pour les industries du textile, de l’habillement et du cuir, pour l’industrie automobile et ses sous-traitants, mais uniquement ceux qui réalisent avec elle au moins 50 % de leur chiffre d’affaires, et pour le commerce de véhicules automobiles (100). Cette limite ne peut être dépassée que « dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l’entreprise », en vertu de l’article R. 5122-7 du code du travail.
De surcroît, en cas de suspension totale de l’activité, en raison de la fermeture temporaire de l’établissement, l’allocation spécifique de chômage partiel n’est octroyée que pendant une durée maximale de six semaines consécutives, selon l’article R. 5122-8 du code du travail. Les salariés dont la suspension d’activité se prolonge au-delà de six semaines se trouvent assimilés à des travailleurs privés d’emplois et bénéficient, à partir de ce moment, du régime d’allocation de chômage total de l’assurance-chômage, en vertu de l’article R. 5122-8 du code du travail, bien que leur contrat de travail ne soit pas rompu.
● L’allocation conventionnelle complémentaire de chômage partiel
La deuxième indemnité perçue par les salariés contraints au chômage partiel résulte d’un régime complémentaire d’indemnisation du chômage partiel, s’ajoutant à l’allocation versée par l’État, mis en place par l’accord national interprofessionnel du 21 février 1968 sur l’indemnisation du chômage partiel, modifié récemment par un avenant du 15 décembre 2008.
Au titre de ce régime, les employeurs sont tenus de payer aux salariés qui reçoivent déjà l’allocation spécifique de chômage partiel un complément à la charge de l’entreprise, qui permet aux salariés de percevoir 60 % de leur rémunération brute horaire (101). Le montant minimum de cette allocation conventionnelle complémentaire s’élève à 6,84 euros brut par heure, dont l’employeur déduit l’allocation spécifique de chômage partiel.
Il est à noter que ce régime complémentaire d’indemnisation ne concerne pas tous les employeurs, certaines branches professionnelles étant expressément exclues du champ d’application de l’accord 21 février 1968, comme par exemple celle de la maroquinerie.
● L’allocation de garantie d’une rémunération mensuelle minimale
En parallèle de ces allocations, les articles L. 3232-1 et suivants du code du travail garantissent aux salariés une rémunération mensuelle minimale équivalente au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) mensuel net, fixé à 1 037,53 euros depuis le 1er juillet 2008.
Ainsi, aux termes de l’article L. 3232-5 du code du travail, lorsqu’un salarié, du fait d’une réduction de son horaire de travail au-dessous de la durée légale, a perçu au cours d’un mois, au titre des allocations légales ou conventionnelles de chômage partiel, une somme totale inférieure à la rémunération minimale, l’employeur se trouve dans l’obligation de lui verser une allocation complémentaire permettant d’atteindre le niveau du SMIC mensuel net.
Si le droit à la rémunération mensuelle minimale est automatiquement ouvert, les salariés travaillant à temps partiel ou en intérim et les apprentis ne peuvent pas en bénéficier, selon l’article L. 3232-1 du code du travail.
● L’allocation d’activité partielle de longue durée
Depuis le 1er mai 2009, aux termes des articles D. 5122-43 et suivants du code du travail, sous réserve de la conclusion d’une convention d’activité partielle, les salariés subissant un chômage partiel de longue durée, c’est-à-dire de trois à douze mois, percevront une allocation complémentaire à l’allocation légale de chômage partiel à hauteur de 75 % de leur rémunération brute horaire, versée par l’État et par l’Unedic.
Cette indemnité ne peut être inférieure à la rémunération mensuelle minimale. En revanche, elle est attribuée dans la limite du contingent annuel d’heures indemnisables.
3. Le dispositif proposé : le maintien intégral des salaires par une réaffectation prioritaire des bénéfices
Le dispositif actuel de chômage partiel ne confère donc aux salariés qu’une indemnisation parcellaire et inappropriée, en particulier lorsque la société a dégagé des bénéfices dont une partie sera destinée aux associés. Le versement de dividendes aux actionnaires, alors même que les salariés en chômage partiel voient leur rémunération largement amputée, se traduit par un déséquilibre entre le travail et le capital, et au profit de ce dernier.
En outre, le système d’indemnisation du chômage partiel en vigueur renvoie principalement à l’État la charge de cette mesure. En effet, ce dernier accorde d’une part l’allocation spécifique de chômage partiel et, d’autre part, sous certaines conditions, il peut être amené à assumer une partie du coût des allocations complémentaires de chômage partiel octroyées par les employeurs. Ainsi par exemple, une prise en charge partielle par l’État de l’allocation conventionnelle complémentaire de chômage partiel est possible selon l’article D. 5122-32 du code du travail, dans le cas où la mise en œuvre du chômage partiel a pour but d’éviter de futurs licenciements pour motif économique.
Ce dispositif n’établit donc pas suffisamment la responsabilité sociale de l’entreprise et allie paradoxalement une architecture complexe et une protection imparfaite des salariés.
C’est pourquoi l’article 9 de la proposition de loi vise à imposer que les bénéfices distribuables soient préalablement au paiement des dividendes et prioritairement affectés à « la garantie de l’intégralité des salaires » des salariés se trouvant en situation de chômage partiel (alinéa 2). À cette fin, il complète l’article L. 232-12 du code de commerce par l’insertion d’un nouvel alinéa après l’alinéa 1er de cet article (alinéa 1er).
Désormais, après l’approbation des comptes annuels et la constatation de l’existence de sommes distribuables, l’assemblée générale d’une société devra en premier lieu, c’est-à-dire avant même la détermination du montant des dividendes des actionnaires, et de manière prioritaire allouer ces sommes distribuables à la garantie de l’intégralité de la rémunération des salariés au chômage partiel.
Si la société a effectué des bénéfices, les salariés au chômage partiel continueront donc de percevoir une indemnité d’un montant équivalant non plus à 60 ou 75 % de leur salaire mais à 100 %.
*
La Commission rejette l’article 9.
Article 10
Exclusion des sociétés bénéficiaires de l’indemnisation du chômage partiel
Dans une démarche complémentaire de celle proposée par l’article 9 de la proposition de loi, le présent article 10 a pour objet d’exclure les sociétés ayant réalisé des bénéfices distribuables du champ d’application de l’indemnisation du chômage partiel, dont le régime est prévu aux articles L. 5122-1 et suivants du code du travail. Ces deux articles offrent des dispositifs qui se renforcent mutuellement.
Face à un système d’indemnisation du chômage partiel complexe et insuffisamment protecteur des salariés (voir commentaire de l’article 9), l’article 9 vise, tout d’abord, à modifier l’article L. 232-12 du code de commerce afin d’imposer que les bénéfices distribuables soient préalablement à la détermination des dividendes des actionnaires et prioritairement, affectés à la garantie du maintien intégral de la rémunération des salariés subissant une période de chômage partiel.
Pour assurer la pleine effectivité de cette mesure, le présent article 10 tend ensuite à exclure du bénéfice du régime de l’indemnisation du chômage partiel, assumé principalement par l’État (voir commentaire de l’article 9), les employeurs dont les entreprises ont constitué des bénéfices distribuables : dans ce cas précis, les salariés contraints au chômage partiel jouiront du maintien intégral de leur salaire assuré par l’affectation préalable et prioritaire des sommes distribuables mentionnés aux articles L. 232-10 et suivants du code de commerce.
À cette fin, le présent article complète l’article L. 5122-1 du code du travail (alinéa 1er) qui prévoit les conditions de l’octroi de l’indemnisation des salariés au chômage partiel, de manière à en exclure expressément la situation « des salariés dont l’employeur a constitué un bénéfice distribuable visé par les articles L. 232-10 et suivants du code de commerce, pour lesquels la rémunération est intégralement garantie par les sommes distribuables ainsi prioritairement affectées » (alinéa 2).
En vertu des modifications produites par les dispositifs combinés des articles 9 et 10 de la proposition de loi, dès lors qu’il est établi qu’une société a effectué des bénéfices distribuables selon le code de commerce, celle-ci ne pourra plus profiter du régime d’indemnisation du chômage partiel énoncé par le code du travail. La société bénéficiaire devra garantir par elle-même, c’est-à-dire au moyen de ses bénéfices, et totalement les rémunérations des salariés victimes du chômage partiel.
Il s’agit de réaffirmer la responsabilité sociale de l’entreprise ainsi que d’inciter les employeurs à rechercher un équilibre plus raisonnable entre capital et travail. Le recours au chômage partiel ne doit pas avoir pour but de privilégier les ajustements relatifs aux salariés pour éviter les réductions des marges. Il doit poursuivre l’objectif contraire, ce que les mesures des articles 9 et 10 de la proposition de loi impliquent.
*
La Commission rejette l’article 10.
TITRE III
DIVERSES MESURES D’ORDRE SOCIAL
Article 14
Échelonnement du remboursement d’un crédit à la consommation
en cas de résiliation du contrat
Face à la montée de l’endettement des ménages et en particulier du recours aux crédits à la consommation, l’article 14 de la proposition de loi vise à donner aux particuliers une réelle possibilité de rompre les contrats de crédits à la consommation en imposant un échelonnement du remboursement du crédit à un taux d’intérêt limité, à la demande de l’emprunteur, lorsque ce dernier souhaite résilier le contrat.
1. Les crédits à la consommation, principale cause du surendettement
L’évolution croissante du recours aux crédits par les ménages révèle la gravité du problème actuel de la dégradation du pouvoir d’achat des Français, obligés de s’endetter pour subvenir à leurs besoins quotidiens. L’augmentation constante de l’utilisation de crédits à la consommation est particulièrement problématique car ces derniers constituent la principale cause du surendettement.
● L’évolution générale du recours aux crédits par les ménages
Le taux de diffusion des crédits aux ménages a progressé en 2008. Il s’établit à 52,6 % des ménages, l’un des taux les plus élevés depuis 1989, selon l’Observatoire des crédits aux ménages, comme le souligne le graphique reproduit ci-dessous.
Évolution du taux de détention des crédits par les ménages
(tous crédits confondus)
![]()
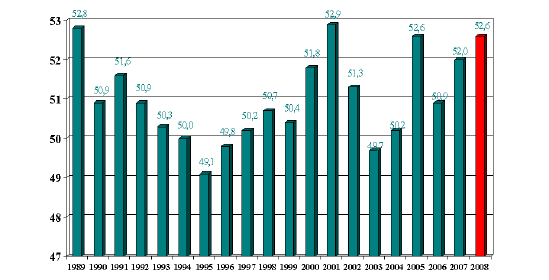
Source : Présentation du 21è rapport annuel par l’Observatoire des crédits aux ménages, M. Mouillard, 12 mars 2009
Parmi les ménages possédant un crédit en 2008, 21,3 % détiennent un crédit à la consommation, soit 5,7 millions de ménages, et près de 12,5 % cumulent un crédit immobilier et un crédit à la consommation, soit 3,35 millions de ménages, ces deux chiffres se situant à des niveaux particulièrement élevés au regard des données recueillies depuis 1989, comme l’atteste le graphique présenté ci-après. Quant à la fréquence d’utilisation du découvert bancaire par les ménages, elle a atteint en 2008 son taux record avec 24,6 % des ménages concernés.
![]()
Évolution du taux de détention des crédits par les ménages

Source : Observatoire des crédits aux ménages, 21e rapport annuel, mars 2009
● L’évolution spécifique du recours au crédit à la consommation
En 2008, c’est donc 33,8 % des ménages, soit 9,05 millions de ménages, qui détiennent un crédit à la consommation, en plus ou non d’un crédit immobilier, ce qui démontre l’ampleur du problème du pouvoir d’achat auquel sont confrontés les Français aujourd’hui.
En effet, pour la seule année 2008, ce sont 7,8 millions de nouveaux crédits à la consommation qui ont été conclus (102).
Les Français sont désormais plus nombreux à être endettés au titre d’un crédit à la consommation (33,8 % des ménages en 2008) qu’au titre d’un crédit immobilier (31,3 % des ménages en 2008).
L’évolution de l’encours des crédits à la consommation souscrits par les ménages illustre l’accélération du développement de ces crédits depuis dix ans.
Si de 1989 à 1999, l’encours a augmenté de 34,4 milliards d’euros, passant de 56,3 à 90,7 milliards, il s’est accru de 51,7 milliards entre 1999 et 2008, où il atteint 142,4 milliards d’euros.
L’utilisation des crédits à la consommation est inégalement répartie entre les différentes tranches d’âge. Ainsi 39,8 % des jeunes de moins de trente ans détiennent un crédit à la consommation contre seulement 29 % des personnes de cinquante-cinq à soixante-quatre ans.
Si la fréquence du recours au crédit à la consommation des personnes de 65 ans et plus semble faible en quantité par rapport aux autres tranches d’âge, elle a, en réalité, atteint un niveau record depuis 2007 en s’établissant à 20,7 % des ménages.
L’évolution de l’utilisation des crédits à la consommation par tranche d’âge, comme l’indique le graphique ci-dessous, prouve une tendance à un accroissement constant chez les personnes âgées de plus de trente ans.
En effet le taux de recours aux crédits à la consommation a doublé dans la catégorie des personnes plus de 65 ans et augmenté d’environ 50 % dans celle des personnes de cinquante-cinq à soixante-quatre ans.
Ce qui signifie que les revenus tirés d’une activité professionnelle ou les retraites ne permettent plus d’assumer les charges de la vie de tous les jours.
Évolution du taux de détention de crédits à la consommation par tranche d’âge
![]()

Source : Observatoire des crédits aux ménages
De plus, les crédits à la consommation touchent en particulier les ménages fragiles, qui sont principalement des jeunes ménages (16,8 %) et des ménages de plus de 65 ans (19,1 %). Selon l’Observatoire des crédits aux ménages, un ménage est réputé fragile s’il remplit au moins l’un des trois conditions suivantes (103) :
– avoir déposé un dossier devant la commission de surendettement ;
– considérer que les dettes sont nécessaires ;
– estimer que les charges de remboursement des crédits sont beaucoup trop élevées.
Or les ménages fragiles, qui représentent 6,6 % de l’ensemble des ménages détenant des crédits, font très largement appel aux crédits à la consommation : en 2008 69,2 % d’entre eux ont eu recours à ce type de prêt pour régler leurs dépenses courantes.
D’une manière plus générale, selon le rapport sur le surendettement des particuliers du Conseil économique, social et environnemental d’octobre 2007 (104), ce sont 26,1 % des ménages qui font appel aux prêts de consommation pour financer des dépenses de consommation courante ou des factures exceptionnelles.
● Une orientation massive des consommateurs vers les crédits permanents
L’enquête de l’association UFC-Que choisir sur l’offre de crédit de mars 2009 (105), distingue trois formes de prêts de consommation :
– le prêt personnel, qui est proposé pour financer tout type de projet et dont les taux d’intérêt oscillent entre 4,5 % et 9,5 % ;
– le crédit permanent (renouvelable, revolving ou réserve d’argent) qui correspond à une somme mise à la disposition du client, réutilisable au fur et à mesure des remboursements, et dont les taux se situent entre 13 % et 20 % ;
– le crédit affecté qui est accordé pour l’achat d’un bien déterminé.
Les résultats de l’enquête dévoilent que les consommateurs sont massivement orientés vers les crédits permanents, à hauteur de 72 % des demandes de financement, d’une manière parfois forcée, par la pratique de seuils, voire cachée à travers des cartes de fidélité équipées de crédits renouvelables.
Ce constat se double de celui que dans 82 % des cas, les distributeurs n’ont pas donné d’information claire et précise sur les caractéristiques principales de ce crédit, notamment sur le taux d’intérêt. Enfin dans 87 % des cas, aucune vérification de la solvabilité de l’emprunteur n’a été opérée.
Selon l’association UFC-Que choisir, en termes de nombre d’ouvertures de crédits, le crédit permanent occuperait la première place. Fin 2007, la France comptait 43,2 millions de crédits permanents ouverts dont 20 millions d’actifs.
● Crédit à la consommation et surendettement
Or la prépondérance du crédit renouvelable, selon l’enquête UFC-Que choisir, qui se substitue progressivement au crédit affecté, génère du « malendettement », le premier pas vers le surendettement, pour cinq raisons principales :
– le montant de la réserve d’argent mise à la disposition du client ne correspond pas, dans 40 % des cas, à celui dont a besoin l’emprunteur pour l’achat de son bien mais représente une somme bien supérieure parfois disproportionnée par rapport à sa capacité de remboursement ;
– le taux des crédits permanents est très élevé et s’applique en grande partie à des ménages modestes ;
– le remboursement du crédit permanent se présente sous la forme de petites mensualités qui masquent un crédit en réalité non amortissable ;
– l’emprunteur ne connaît pas à l’ouverture du crédit le goût global de ce dernier puisqu’il ne dispose pas d’un échéancier stable ;
– enfin le crédit permanent est octroyé sans un examen suffisant de la solvabilité, qui n’est jamais vérifiée par la suite.
Le « malendettement », défini comme l’accumulation de crédits non adaptés, affecterait aujourd’hui, selon le Médiateur de la République, de 15 à 20 % des Français. Il constitue la première étape vers le surendettement, une situation dans laquelle l’emprunteur se trouve dans l’impossibilité d’assumer ses dettes.
De fait, les statistiques de la Banque de France sont éloquentes : les crédits permanents sont présents dans 85 % des dossiers de surendettement, pour un montant moyen d’endettement de 19 900 euros, et les autres crédits à la consommation, assortis d’une échéance, dans 54 % des dossiers, pour un montant moyen d’endettement de 17 600 euros. Les prêts immobiliers ne figurent en revanche que dans 9 % des dossiers (106).
La Banque de France estime que, depuis le début de l’année 2009, le nombre de dossiers déposés auprès des commissions de surendettement est en hausse de 16 % par rapport à la période correspondante de l’exercice précédent.
Au vu des données collectées fin 2008 sur l’intention des ménages de souscrire un crédit à la consommation, cette tendance ne devrait pas se corriger. En effet, selon l’Observatoire national des crédits aux ménages, 4,6 % de l’ensemble des ménages envisageaient de recourir à un tel crédit dans les six mois dont 2,6 % des ménages ne détenant à ce moment aucun crédit(107).
2. Permettre aux particuliers de sortir de la spirale de l’endettement
Face aux effets néfastes des crédits à la consommation, qui constituent la principale source du surendettement, et à leur diffusion massive dans la société française par des pratiques parfois douteuses, il convient de réagir.
Le gouvernement a déposé un projet de loi portant réforme du crédit à la consommation, en avril 2009 au Sénat, afin d’encadrer ces prêts mais les mesures proposées sont insuffisantes. Il se contente de proposer des garde-fous, relatifs, comme la fourniture de certaines informations par le prêteur, lors de la conclusion du contrat mais il ne s’attaque pas aux modalités de remboursement et aux conditions de leur échelonnement.
Elles sont pourtant la clé du problème, en particulier des crédits permanents, que le consommateur ne parvient jamais à épurer, surtout s’il a des revenus modestes. Le projet de loi présenté ne traite des difficultés de remboursement qu’à partir du moment où l’emprunteur se trouve déjà quasiment en situation de surendettement.
À l’inverse la présente proposition de loi vise à prévenir les cas de « malendettement » et de surendettement en s’attaquant à la racine du problème : les modalités de remboursement des crédits à la consommation.
L’article 14 a ainsi pour objectif de renforcer le droit de résiliation des emprunteurs en prévoyant une nouvelle rédaction de la dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 311-9 du code de la consommation (alinéa 1er) qui disposerait désormais que lorsque l’emprunteur sollicite la résiliation du contrat « le prêteur est tenu de proposer à l’emprunteur qui en fait la demande un échelonnement du remboursement du montant de la réserve d’argent déjà utilisé à un taux effectif global qui ne peut excéder la moitié du taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent par les établissements de crédit pour des opérations de même nature comportant des risques analogues, telles que définies par l’autorité administrative après avis du Comité consultatif du secteur financier » (alinéa 2).
Il s’agit de limiter les taux d’intérêts pratiqués par les prêteurs de crédits à la consommation, qui peuvent atteindre 20 % dans le cas des crédits permanents, lorsque l’emprunteur souhaite rompre le contrat, afin qu’il jouisse réellement des moyens d’apurer sa dette et de lui éviter de sombrer dans le « malendettement » ou le surendettement.
Par répercussion, cette mesure dissuadera les établissements de prêts à la consommation de poursuivre leur politique de diffusion de « mauvais crédits », selon l’expression de l’association UFC-Que choisir, dans la société française, qui deviendront alors moins profitables.
*
La Commission rejette l’article 14.
Le présent article vise à compenser les charges résultant de la proposition de loi, tant pour le budget de l’État, par la remise en cause du « bouclier fiscal », que pour celui des organismes de sécurité sociale, par l’abaissement du seuil d’exonération de cotisations sociales patronales.
1. La compensation des charges pour le budget de l’État par la remise en cause du « bouclier fiscal »
L’article 15 tend à compenser les charges résultant de mesures d’urgence sociale contenues dans la proposition de loi par « le relèvement du taux mentionné à l’article 1er du code général des impôts » (alinéa 1er), c’est-à-dire par la remise en cause du « bouclier fiscal » (108), qui a été institué par l’article 74 de la loi de finances pour 2006 (109) et renforcé l’article 11 de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat (« loi TEPA ») (110).
En effet, l’article 1er du code général des impôts prévoit depuis lors que « les impôts directs payés par un contribuable ne peuvent être supérieurs à 50 % de ses revenus ». Ce dispositif, associé à un droit de restitution de la fraction des impositions perçues qui excèdent le seuil de 50 % (111), favorise essentiellement les contribuables très aisés.
Comme le démontre l’analyse de la mise en œuvre de cette mesure en 2007, les deux tiers des bénéficiaires des restitutions opérées au titre du bouclier fiscal concernent les ménages disposant d’un patrimoine de plus de quinze millions d’euros (112).
Il s’agit de permettre aux contribuables les plus aisés de participer à l’effort de solidarité nationale, nécessaire en temps de crise économique.
Il faut noter que les charges pour l’État résultant de la proposition de loi se trouvent également compensées par le dispositif proposé à l’article 4, à savoir la suppression de l’exonération fiscale des heures supplémentaires instaurée par la « loi TEPA », suppléée pour les particuliers par les augmentations de salaires préconisées par ce texte et qui profiteront à l’ensemble des ménages tout en stimulant l’économie française.
2. La compensation des charges pour le budget de la sécurité sociale par l’abaissement du seuil d’exonération des cotisations sociales patronales
Quant aux charges pour le budget de la sécurité sociale résultant de la proposition de loi, l’article 15 vise à les compenser par « un abaissement du seuil d’exonération de cotisations patronales d’assurance sociale mentionnées dans le code de la sécurité sociale » (alinéa 2).
Il s’agit, comme le souligne l’exposé général, d’appliquer les recommandations de la Cour des comptes, qui a dénoncé le coût engendré par le manque de ciblage des dispositifs d’allègements généraux et son caractère injustifié au regard des effets produits, tant en termes d’emploi que de croissance économique.
Il faut observer que les charges pour le budget de la sécurité sociale sont aussi compensées par le dispositif proposé à l’article 4 de la présente proposition de loi, à savoir la suppression de l’exonération sociale mise en place par la « loi TEPA » et qui devrait rapporter plusieurs milliards d’euros (voir commentaire de l’article 4).
*
La Commission rejette l’article 15.
*
La Commission rejette l’ensemble de la proposition de loi.
En conséquence, la Commission des affaires culturelles, familiales et sociales demande à l’Assemblée nationale de rejeter la proposition de loi visant à prendre des mesures urgentes de justice sociale en faveur de l’emploi, des salaires et du pouvoir d’achat (n° 1621).
___
Dispositions en vigueur ___ |
Texte de la proposition de loi ___ |
Proposition de loi visant à prendre des mesures urgentes de justice sociale en faveur de l’emploi, des salaires et du pouvoir d’achat | |
TITRE IER | |
De l’interdiction, de la prévention des licenciements économiques et de la sauvegarde de l’emploi | |
Code du travail |
Article 1er |
L’article L. 1233-3 du code du travail est ainsi rédigé : | |
Art. L. 1233-3. - |
« Art. L. 1233-3. - Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement rendu inévitable par un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié, résultant soit d'une suppression ou d'une transformation d'emploi ou d'une modification du contrat de travail dues à des difficultés économiques qui n'ont pu être surmontées par la réduction des coûts autres que salariaux, soit à des mutations technologiques indispensables à la pérennité de l'entreprise. |
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants, résultant de l'une des causes énoncées au premier alinéa.
|
« Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement économique effectué alors que l'entreprise ou sa filiale a réalisé des bénéfices, constitué des réserves ou distribué des dividendes au cours des deux derniers exercices, a procédé à un transfert d'activité, de production ou de services vers un pays étranger pour exécuter des travaux qui pourraient l'être par le ou les salariés dont le poste est supprimé, ou a reçu des aides publiques de toute nature. |
« L’inspection du travail procède aux vérifications nécessaires pour l'application du présent article. » | |
|
Article 2 |
Art. L. 1233-2. - Tout licenciement pour motif économique est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. |
I. - Le dernier alinéa de l’article L. 1233-2 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : |
Il est justifié par une cause réelle et sérieuse. |
|
« À défaut, le licenciement est nul et nul d’effet. » | |
Art. L. 1235-11. - Lorsque le juge constate que le licenciement est intervenu alors que la procédure de licenciement est nulle, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 1235-10, il peut ordonner la poursuite du contrat de travail ou prononcer la nullité du licenciement et ordonner la réintégration du salarié à la demande de ce dernier, sauf si cette réintégration est devenue impossible, notamment du fait de la fermeture de l’établissement ou du site ou de l'absence d'emploi disponible. |
|
Lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail ou lorsque la réintégration est impossible, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des douze derniers mois. |
II. - Dans la deuxième phrase du second alinéa de l’article L. 1235-11, le nombre « douze » est remplacé par le nombre « dix-huit ». |
Article 3 | |
|
Après l’article L. 1233-10 du code du travail, il est inséré un article L. 1233-10-1 ainsi rédigé : |
« Art. L. 1233-10-1. - Afin de promouvoir les projets alternatifs aux compressions d'effectifs, les délégués du personnel ou le Comité d’Entreprise, le cas échéant élargi, qui constatent que les licenciements économiques envisagés par l’employeur ne sont pas pourvus d'un motif conforme à l’arti | |
« Ils saisissent à cet effet le juge des référés qui statue dans les quinze jours sur la conformité du motif invoqué par l’employeur à l'article L. 1233-3. | |
« S’il juge que les licenciements visés par l’opposition sont pourvus d'un motif économique au sens de l’article sus-mentionné, le tribunal met fin à la suspension de la procédure, laquelle peut produire tous ses effets, sans préjudice des dispositions de l’article L. 1233-65 et suivants. | |
|
« S’il juge que le motif des licenciements visés par l’opposition n'est pas conforme à l’art. L. 1233-3, la procédure et rupture consécutive des contrats de travail sont nulles. » |
Code général des impôts |
Article 4 |
Art. 81 quater. - I.- Sont exonérés de l’impôt sur le revenu : 1° Les salaires versés aux salariés au titre des heures supplémentaires de travail définies à l'article L. 3121-11 du code du travail et, pour les salariés relevant de conventions de forfait annuel en heures prévues à l'article L. 3121-42 du même code, des heures effectuées au-delà de 1 607 heures, ainsi que des heures effectuées en application du troisième alinéa de l'article L. 3123-7 du même code. Sont exonérés les salaires versés au titre des heures supplémentaires mentionnées à l'article L. 3122-4 du même code, à l’exception des heures effectuées entre 1 607 heures et la durée annuelle fixée par l’accord lorsqu’elle lui est inférieure. L’exonération mentionnée au premier alinéa est également applicable à la majoration de salaire versée, dans le cadre des conventions de forfait annuel en jours, en contrepartie de la renonciation par les salariés, au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours mentionné à l'article L. 3121-44 du code du travail, à des jours de repos dans les conditions prévues à l’article L. 3121-45 du même code ; 2° Les salaires versés aux salariés à temps partiel au titre des heures complémentaires de travail définies au 4° de l'article L. 3123-14, aux articles L. 3123-17 et L. 3123-18 du code du travail ou définies au onzième alinéa de l’article L. 212-4-3 du même code applicable à la date de publication de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail ; 3° Les salaires versés aux salariés par les particuliers employeurs au titre des heures supplémentaires qu'ils réalisent ; 4° Les salaires versés aux assistants maternels régis par les articles L. 421-1 et suivants et L. 423-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles au titre des heures supplémentaires qu’ils accomplissent au-delà d'une durée hebdomadaire de quarante-cinq heures, ainsi que les salaires qui leur sont versés au titre des heures complémentaires accomplies au sens de la convention collective nationale qui leur est applicable ; 5° Les éléments de rémunération versés aux agents publics titulaires ou non titulaires au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires qu'ils réalisent ou du temps de travail additionnel effectif ; 6° Les salaires versés aux autres salariés dont la durée du travail ne relève pas des dispositions du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail ou du chapitre III du titre Ier du livre VII du code rural au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires ou complémentaires de travail qu’ils effectuent ou, dans le cadre de conventions de forfait en jours, les salaires versés en contrepartie des jours de repos auxquels les salariés auront renoncé au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours. II.- L’exonération prévue au premier alinéa du I s'applique : 1° Aux rémunérations mentionnées aux 1° à 4° et au 6° du I et, en ce qui concerne la majoration salariale correspondante, dans la limite : a) Des taux prévus par la convention collective ou l'accord professionnel ou interprofessionnel applicable ; b) À défaut d'une telle convention ou d'un tel accord : - pour les heures supplémentaires, des taux de 25 % ou 50 %, selon le cas, prévus au premier alinéa de l’article L. 3121-22 du code du travail et au I de l'article L. 713-6 du code rural ; - pour les heures complémentaires, du taux de 25 % ; - pour les heures effectuées au-delà de 1 607 heures dans le cadre de la convention de forfait prévue à l’article L. 3121-46 du code du travail, du taux de 25 % de la rémunération horaire déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre d’heures de travail prévu dans le forfait, les heures au-delà de la durée légale étant pondérées en fonction des taux de majoration applicables à leur rémunération ; 2° À la majoration de salaire versée dans le cadre des conventions de forfait mentionnées au second alinéa du 1° du I et au 6° du I, dans la limite de la rémunération journalière déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre de jours de travail prévu dans le forfait, majorée de 25 % ; 3° Aux éléments de rémunération mentionnés au 5° du I dans la limite des dispositions applicables aux agents concernés. III.- Les I et II sont applicables sous réserve du respect par l'employeur des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail. Les I et II ne sont pas applicables lorsque les salaires ou éléments de rémunération qui y sont mentionnés se substituent à d'autres éléments de rémunération au sens de l’article 79, à moins qu'un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l'élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement des salaires ou éléments de rémunération précités. De même, ils ne sont pas applicables : - à la rémunération des heures complémentaires lorsque ces heures sont accomplies de manière régulière au sens de l'article L. 3123-15 du code du travail, sauf si elles sont intégrées à l’horaire contractuel de travail pendant une durée minimale fixée par décret ; - à la rémunération d'heures qui n’auraient pas été des heures supplémentaires sans abaissement, après le 20 juin 2007, de la limite haute hebdomadaire mentionnée à l’article L. 3122-4 du code du travail. |
I. – L’article 81 quater du code général des impôts est abrogé. |
Code de la sécurité sociale |
|
Art. L. 241-17. – Le premier alinéa est applicable aux heures supplémentaires ou complémentaires effectuées par les salariés relevant des régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1 du présent code dans des conditions fixées par décret, compte tenu du niveau des cotisations dont sont redevables les personnes relevant de ces régimes et dans la limite mentionnée au premier alinéa. II.- La réduction de cotisations salariales de sécurité sociale prévue au I est imputée sur le montant des cotisations salariales de sécurité sociale dues pour chaque salarié concerné au titre de l’ensemble de sa rémunération versée au moment du paiement de cette durée de travail supplémentaire et ne peut dépasser ce montant. III.- Le cumul de la réduction prévue au I avec l’application d'une exonération totale ou partielle de cotisations salariales de sécurité sociale ou avec l’application de taux réduits, d'assiettes forfaitaires ou de montants forfaitaires de cotisations ne peut être autorisé, dans la limite mentionnée au premier alinéa du I, que dans des conditions fixées par décret, compte tenu du niveau des cotisations dont sont redevables les salariés concernés. IV.- Le bénéfice de la réduction prévue au I est subordonné à la mise à la disposition des agents du service des impôts compétent ou des agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 du présent code et à l'article L. 724-7 du code rural, par l'employeur, d'un document en vue du contrôle de l’application du présent article dans des conditions fixées par décret. Pour les salaires pour lesquels il est fait usage des dispositifs mentionnés aux articles L. 133-5-2, L. 133-8, L. 133-8-3 et L. 531-8 du présent code et à l’article L. 812-1 du code du travail, les obligations déclaratives complémentaires sont prévues par décret. |
II. - Les articles L. 241-17 et L. 241-18 du code de la sécurité sociale sont abrogés. |
Art. L. 241-18. - II.- Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié dans les conditions prévues par le second alinéa du 1° du I du même article 81 quater. III.- Les déductions mentionnées aux I et II sont imputées sur les sommes dues par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 du présent code et L. 725-3 du code rural pour chaque salarié concerné au titre de l'ensemble de sa rémunération versée au moment du paiement de cette durée de travail supplémentaire et ne peuvent dépasser ce montant. IV.- Les déductions mentionnées aux I et II sont cumulables avec des exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l'employeur au titre de l'ensemble de la rémunération du salarié concerné. Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II du présent article est subordonné au respect des conditions prévues au III de l'article 81 quater du code général des impôts. Le bénéfice de la majoration mentionnée au I du présent article est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. V.- Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné au respect des obligations déclaratives prévues par le IV de l’article L. 241-17. |
|
TITRE II | |
De l’augmentation des salaires et de la | |
Code du travail |
Article 5 |
Art. L. 3231-4. - |
L’article L. 3231-4 du code du travail est complété par un second alinéa ainsi rédigé : |
| |
Code de la sécurité sociale |
Article 6 |
Art. L. 241-13. – |
Le dernier alinéa du II de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé : |
II.-Cette réduction est appliquée aux gains et rémunérations versés aux salariés au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par l'article L. 351-4 du code du travail et aux salariés mentionnés au 3° de l'article L. 351-12 du même code, à l’exception des gains et rémunérations versés par les particuliers employeurs et, jusqu'au 31 décembre 2005, par l’organisme mentionné à l'article 2 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de La Poste et à France Télécom. |
|
Cette réduction n’est pas applicable aux gains et rémunérations versés par les employeurs relevant des dispositions du titre Ier du livre VII du présent code, à l'exception des employeurs relevant des régimes spéciaux de sécurité sociale des marins, des mines et des clercs et employés de notaires. |
« Lorsque l’employeur, durant l’année civile, n’a pas conclu d’accord salarial dans le cadre de l’obligation définie au 1° de l’article L. 2242-8 du code du travail dans les conditions prévues aux articles L. 2242-1 à L. 2242-4 du même code, la réduction est supprimée. » |
………………………………………………………... |
|
Article 7 | |
« Dans un délai d’un mois suivant l'adoption de la présente proposition de loi, le gouvernement réunit les partenaires sociaux dans le cadre d’une conférence sur les salaires se fixant pour objectif un accord sur l’augmentation de la masse salariale dans la valeur ajoutée par le relèvement de l'ensemble des grilles salariales applicables dans les différentes branches professionnelles. » | |
Article 8 | |
(Dispositions déclarées irrecevables au regard de l’article 40 de la Constitution) | |
Code de commerce |
Article 9 |
Art. L. 232-12. – |
Après le premier alinéa de l’article L. 232-12 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
« Les sommes distribuables sont au préalable, et prioritairement, affectées à la garantie de l’intégralité des salaires des salariés qui, tout en restant liés à leur employeur par un contrat de travail, subissent une perte de salaire imputable soit à la fermeture temporaire de la société qui les emploie, soit à la réduction de l’horaire de travail habituellement pratiqué. » | |
………………………………………………………... |
|
Code du travail |
Article 10 |
Art. L.5122-1. - |
L’article L. 5122-1 du code du travail est complété par les mots : |
« à l’exception des salariés dont l’employeur a constitué un bénéfice distribuable visé par les articles L. 232-10 et suivants du code de commerce, pour lesquels la rémunération est intégralement garantie par les sommes distribuables ainsi prioritairement affectées. » | |
Article 11 | |
(Dispositions déclarées irrecevables au regard de l’article 40 de la Constitution) | |
TITRE III | |
Diverses mesures d’ordre social | |
Article 12 | |
(Dispositions déclarées irrecevables au regard de l’article 40 de la Constitution) | |
Article 13 | |
(Dispositions déclarées irrecevables au regard de l’article 40 de la Constitution) | |
Code de la consommation |
Article 14 |
Art. L.311-9. – |
La dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 311-9 du code de la consommation est ainsi rédigée : |
L’emprunteur doit pouvoir s’opposer aux modifications proposées, lors de la reconduction du contrat, jusqu’au moins vingt jours avant la date où celles-ci deviennent effectives, en utilisant un bordereau-réponse annexé aux informations écrites communiquées par le prêteur. Un décret précisera les caractéristiques de ce bordereau ainsi que les mentions devant y figurer. L’emprunteur peut également demander à tout moment la réduction de sa réserve de crédit, la suspension de son droit à l’utiliser ou la résiliation de son contrat. Dans ce dernier cas, il est tenu de rembourser, aux conditions du contrat, le montant de la réserve d’argent déjà utilisé.
|
« Dans ce dernier cas, le prêteur est tenu de proposer à l’emprunteur qui en fait la demande un échelonnement du remboursement du montant de la réserve d’argent déjà utilisé à un taux effectif global qui ne peut excéder la moitié du taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent par les établissements de crédit pour des opérations de même nature comportant des risques analogues, telles que définies par l'autorité administrative après avis du Comité consultatif du secteur financier. » |
………………………………………………………... |
|
Article 15 | |
I - Les charges pour l’État engendrées par les articles de la présente proposition de loi sont compensées, par le relèvement du taux mentionné à l'article 1er du code général des impôts. | |
|
II - Les charges pour les organismes de sécurité sociale engendrées par les articles de la présente proposition de loi sont compensées, à due concurrence, par un abaissement du seuil d'exonération de cotisations patronales d’assurance sociale mentionnées dans le code de la sécurité sociale. |
AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION
Amendement n° AC 1 présenté par M. Daniel Paul, rapporteur :
Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :
« II. Après l’article L.1233-33 du code du travail, il est inséré un article L. 1233-33-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1233-33-1. – Afin de promouvoir les projets alternatifs aux compressions d’effectifs, les délégués du personnel ou le Comité d’Entreprise, le cas échéant élargi, qui constatent que les licenciements économiques envisagés par l’employeur ne sont pas pourvus d’un motif conforme à l’article L.1233-3, peuvent exercer un droit d’opposition à la rupture du ou des contrats de travail.
Ils saisissent à cet effet le juge des référés qui statue dans les quinze jours sur la conformité du motif invoqué par l’employeur à l'article L. 1233-3.
S’il juge que les licenciements visés par l’opposition sont pourvus d’un motif économique au sens de l’article sus-mentionné, le tribunal met fin à la suspension de la procédure, laquelle peut produire tous ses effets, sans préjudice des dispositions de l’article L. 1233-65 et suivants.
S’il juge que le motif des licenciements visés par l’opposition n’est pas conforme à l’art. L. 1233-3, la procédure et rupture consécutive des contrats de travail sont nulles. »
Amendement n° AC 2 présenté par M. Daniel Paul, rapporteur :
Au premier alinéa, substituer à la référence : « II », la référence : « III ».