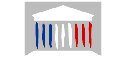______
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 5 juin 2014
RAPPORT
FAIT
AU NOM DE LA COMMISSION D’ENQUÊTE relative aux coûts passés, présents et futurs de la filière nucléaire, à la durée d’exploitation des réacteurs et à divers aspects économiques et financiers de la production et de la commercialisation de l’électricité nucléaire, dans le périmètre du mix électrique français et européen, ainsi qu’aux conséquences de la fermeture et du démantèlement de réacteurs nucléaires, notamment de la centrale de Fessenheim
TOME I
Président
M. François BROTTES
Rapporteur
M. Denis BAUPIN
Députés
——
Voir les numéros : 1507, 1595 et T.A. 256
La commission d’enquête relative aux coûts passés, présents et futurs de la filière nucléaire, à la durée d’exploitation des réacteurs et à divers aspects économiques et financiers de la production et de la commercialisation de l’électricité nucléaire, dans le périmètre du mix électrique français et européen, ainsi qu’aux conséquences de la fermeture et du démantèlement de réacteurs nucléaires, notamment de la centrale de Fessenheim est composée de : M. François Brottes, président ; M. Denis Baupin, rapporteur ; MM. Philippe Baumel, Mme Sabine Buis, MM. Franck Reynier et Michel Sordi, vice-présidents ; MM. Christian Bataille, Patrice Carvalho, Claude de Ganay et Jacques Krabal, secrétaires ; MM. Damien Abad, Bernard Accoyer, Julien Aubert, Mme Marie-Noëlle Battistel, MM. Yves Blein, Jean-Paul Chanteguet, Jean-Louis Costes, Mme Françoise Dubois, MM. Hervé Gaymard, Jean-Pierre Gorges, Marc Goua, Mme Geneviève Gosselin-Fleury, M. Francis Hillmeyer, Mme Sandrine Hurel, MM. Hervé Mariton, Mme Frédérique Massat, MM. Patrice Prat, Éric Straumann, Stéphane Travert et Mme Clotilde Valter.
SOMMAIRE
___
Pages
AVANT-PROPOS DU PRÉSIDENT FRANÇOIS BROTTES 13
INTRODUCTION 15
CHAPITRE LIMINAIRE 25
CHAPITRE 1 : LE NUCLÉAIRE DANS LE SYSTÈME ÉLECTRIQUE EUROPÉEN 27
I. LES ÉLÉMENTS DE CONTEXTE 27
A. LE NUCLÉAIRE DANS LE SYSTÈME ÉLECTRIQUE EUROPÉEN 27
1. Comment le prix de l’électricité est-il formé ? 27
2. L’interconnexion des réseaux des États membres : vers un prix de l’électricité européen 28
B. LE NUCLÉAIRE EN EUROPE : DES SITUATIONS SIMILAIRES DANS LES DIFFÉRENTS ÉTATS-MEMBRES, DES CHOIX DE POLITIQUE ÉNERGÉTIQUE DIFFÉRENTS 29
1. En Allemagne : la fin du parc nucléaire historique à la suite d’une décision politique consécutive à l’accident de Fukushima 29
2. En Belgique : la prolongation de la durée de vie d’un seul des trois réacteurs les plus anciens par accord entre le Gouvernement et les propriétaires de la centrale 30
3. Au Royaume-Uni : le lancement du renouvellement du parc nucléaire 33
II. LES APPORTS DE LA COMMISSION D’ENQUÊTE 34
A. LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE : UN CHOIX POLITIQUE… SOUS CONTRAINTES 34
1. Des choix divergents entre les États membres qui illustrent le caractère politique des choix de transition énergétique 34
2. Des contraintes techniques et financières 35
B. UN DIAGNOSTIC PARTAGÉ SUR LA SITUATION DU SYSTÈME ÉLECTRIQUE EUROPÉEN, DEUX PISTES DE SOLUTION 36
1. Le diagnostic : un accroissement de la variabilité du système et une pénétration croissante du charbon qui posent la question du modèle de rémunération des capacités de production 36
2. Deux pistes : introduire un véritable « signal carbone » ou rémunérer la capacité et la flexibilité 39
C. LE NUCLÉAIRE : UNE ÉCONOMIE « À PART » REQUÉRANT UNE FORTE IMPLICATION DE LA PUISSANCE PUBLIQUE 40
CHAPITRE 2 : L’AMONT DU CYCLE NUCLÉAIRE. ASSURER LA SÉCURITÉ DE L’APPROVISIONNEMENT DU PARC NUCLÉAIRE FRANÇAIS EN TOUTE TRANSPARENCE 43
I. LES ÉLÉMENTS DE CONTEXTE 43
A. DES RESSOURCES RELATIVEMENT DIVERSIFIÉES ET ABONDANTES EN URANIUM QUI ASSURENT UNE SÉCURITÉ DE L’APPROVISIONNEMENT ET ENTRETIENNENT DES PRIX ASSEZ BAS 43
1. Les ressources mondiales 43
2. L’équilibre offre-demande 45
B. UNE FAIBLE DÉPENDANCE DU PRIX DE L’ÉLECTRICITÉ NUCLÉAIRE AU PRIX DE L’URANIUM 48
1. Plusieurs étapes entre la mine et le combustible 49
2. Un contenu énergétique bien plus important que les ressources fossiles 50
II. LES APPORTS DE LA COMMISSION D’ENQUÊTE 50
A. AREVA : UN ACTEUR MONDIAL DE L’AMONT DU COMBUSTIBLE 51
1. Les activités minières : diversifier les sources d’approvisionnement en uranium 51
2. Les activités de transformation de l’uranium : gagner des clients grâce à des offres « packagées » 52
3. La position d’AREVA dans la controverse qui l’a opposé au gouvernement nigérien 53
B. EDF : UN CLIENT MAJEUR CHERCHANT À RÉDUIRE SA VULNÉRABILITÉ 54
1. Premier objectif : sécuriser l’approvisionnement en combustible nucléaire 55
2. Deuxième objectif : sécuriser les prix dans la durée 56
C. L’ÉTAT : LE RÉGULATEUR D’EDF, L’APPUI D’AREVA 57
CHAPITRE 3 : CHARGES DU PARC EN EXPLOITATION : MAINTENANCE ET SOUS-TRAITANCE 59
I. LES ÉLÉMENTS DE CONTEXTE 59
A. LA MAINTENANCE, UN ENJEU MAJEUR POUR LA MAÎTRISE DES COÛTS DU PARC NUCLÉAIRE 59
1. La qualité des opérations de maintenance, une condition de la sûreté et de la performance économique du parc 59
2. Après un sous-investissement au début des années 2000, des coûts de maintenance désormais en hausse durable 60
B. LE RECOURS À LA SOUS-TRAITANCE, UN CHOIX DE POLITIQUE INDUSTRIELLE 61
1. Les justifications du recours à la sous-traitance 61
2. La sous-traitance, un phénomène massif 62
II. LES APPORTS DE LA COMMISSION D’ENQUÊTE 64
A. EDF N’A PAS ENCORE RECONQUIS LA MAÎTRISE DE LA MAINTENANCE 64
1. Il n’est pas facile de sortir d’une période de sous-investissement dans l’outil de production 64
2. La maîtrise des compétences est un enjeu pour tous les acteurs de la filière 67
B. LA SOUS-TRAITANCE RESTE UN SUJET DE CONTROVERSES 68
1. Un débat toujours vif sur l’ampleur du recours à la sous-traitance 68
2. Un effort de remise en ordre nécessaire mais inabouti 70
3. Une différence de condition entre les travailleurs des prestataires et ceux des exploitants 73
CHAPITRE 4 : ÉVOLUTION DU PARC. EDF À UN TOURNANT 77
I. LES ÉLÉMENTS DE CONTEXTE 77
A. UN PARC NUCLÉAIRE QUI ENTRE PROGRESSIVEMENT DANS SA QUATRIÈME DÉCENNIE 77
1. Le parc nucléaire français : un ensemble construit rapidement et par paliers homogènes 77
2. EDF a fait le choix de prolonger la durée de vie de ses réacteurs significativement au-delà de 40 ans 79
B. UN PROJET DE PROLONGATION QUI DOIT S’INSCRIRE DANS UN PROCESSUS EXIGEANT D’AMÉLIORATION DE LA SÛRETÉ 82
1. Le réexamen périodique de sûreté des installations nucléaires 82
2. L’intégration du retour d’expérience de l’accident de Fukushima 83
II. LES APPORTS DE LA COMMISSION D’ENQUÊTE 84
A. LE « GRAND CARÉNAGE », UN PROJET INDUSTRIEL ENTOURÉ DE NOMBREUSES INCERTITUDES 85
1. Une éventuelle prolongation des réacteurs soumise à des contraintes techniques fortes 85
2. Un chiffrage du Grand carénage encore difficile à cerner 88
B. LA CONSTRUCTION D’UN NOUVEAU PARC NUCLÉAIRE, UN INVESTISSEMENT CONSIDÉRABLE 94
1. L’EPR de Flamanville : une « tête de série » construite dans la douleur, de laquelle il est encore délicat de tirer un retour d’expérience 94
a. Un chantier très difficile 94
b. Un coût de l’EPR « modèle Flamanville » peu évident à cerner 96
2. La palette des options est largement ouverte 99
a. La conception générale de l’EPR peut être optimisée 99
b. Les dispositifs de sûreté sont appelés à évoluer 100
c. Les réacteurs de 1 000 MW pourraient être de réels concurrents 101
3. Le coût du renouvellement du parc ne semble pas échapper à la « loi d’airain » du nucléaire 103
C. L’AVENIR DU PARC NUCLÉAIRE, UNE APPROCHE NÉCESSAIREMENT GLOBALE 105
1. Le débat sur la prolongation des réacteurs doit prendre en compte de nombreux paramètres 105
a. La pertinence économique de la prolongation est très sensible au chiffrage du Grand carénage 105
b. La grille d’analyse nécessite cependant d’être enrichie 106
2. L’État manque encore d’outils adaptés 108
D. L’ARRÊT DES CENTRALES NUCLÉAIRES, UN ACCOMPAGNEMENT INDISPENSABLE 111
1. Le démantèlement, une activité essentielle qui ne peut à elle seule compenser l’arrêt d’une installation nucléaire 112
2. Fessenheim, une reconversion que les pouvoirs publics doivent anticiper et soutenir 115
CHAPITRE 5 : CHARGES FUTURES. ÉVALUER CORRECTEMENT LEUR MONTANT ET SÉCURISER LEUR FINANCEMENT 119
I. LES ÉLÉMENTS DE CONTEXTE 119
A. DEUX CHARGES FUTURES MAJEURES : LE DÉMANTÈLEMENT DES INSTALLATIONS ET LE STOCKAGE DES DÉCHETS NUCLÉAIRES () 119
1. Le démantèlement 119
a. Un problème méthodologique : comment mesurer le coût du démantèlement des installations en exploitation ? 119
b. Les charges brutes de démantèlement 120
c. Les éléments de comparaison internationale : une première approche de l’évaluation de la crédibilité des estimations 120
2. La gestion des déchets radioactifs 121
a. Les différents types de déchets : des volumes différents, des solutions de gestion propres 121
b. Les charges brutes de gestion future des déchets radioactifs 122
3. Le cas particulier des déchets les plus nocifs (HA-MAVL) 122
a. Le stockage en couche géologique profonde : la solution de référence pour la gestion à long terme des déchets hautement radioactifs français 122
b. Cigéo : un projet de grande envergure dont les étapes sont fixées par la loi 123
c. Un devis qui a fait l’objet d’une vive controverse entre les exploitants et l’ANDRA 124
B. UN DISPOSITIF SPÉCIFIQUE DESTINÉ À GARANTIR LE FINANCEMENT DES CHARGES FUTURES SUR LE LONG TERME : LES ACTIFS DÉDIÉS 125
1. Des charges futures aux provisions : l’importance du taux d’actualisation 125
2. La couverture des provisions : les actifs dédiés 126
II. LES APPORTS DE LA COMMISSION D’ENQUÊTE 127
A. DES ESTIMATIONS DES CHARGES FUTURES ENTOURÉES D’UN ALÉA TRÈS IMPORTANT 128
1. Des interrogations majeures sur le coût du démantèlement 128
a. L’inflation du coût du démantèlement des installations à l’arrêt 128
b. Des facteurs de variabilité dont il est impossible de quantifier les effets sur le coût du démantèlement des installations en exploitation 129
2. Des angles morts inquiétants dans la gestion de certains déchets radioactifs : les déchets RCD et les résidus miniers 132
3. L’élaboration du devis de Cigéo paralysée par l’absence d’orientations politiques définitives 133
a. Deux paramètres fondamentaux aujourd’hui indéterminés 133
b. Un exercice de chiffrage périlleux, qui réclame la réalisation d’une phase pilote 135
c. Une évolution inéluctable de la législation 137
B. FAUT-IL TRANSFÉRER LA GESTION DES ACTIFS DÉDIÉS À UN ACTEUR INDÉPENDANT ? 139
1. Les arguments en faveur du transfert de la gestion des actifs dédiés à un acteur indépendant 139
a. Les risques de dépréciation du capital 139
b. Le report du risque sur la puissance publique 140
c. L’absence de liquidité 141
d. La tentation de la dérogation 142
2. Les arguments en faveur du maintien du système actuel 142
CHAPITRE 6 : RETRAITEMENT ET MOX – RÉACTEURS DE 4ÈME GÉNÉRATION 145
I. LES ÉLÉMENTS DE CONTEXTE 145
A. LA FRANCE A FAIT LE CHOIX DU RETRAITEMENT ET DU COMBUSTIBLE MOX 145
1. La gestion du combustible usé : un problème, deux solutions 145
2. Des acteurs français fortement engagés dans le retraitement et la filière Mox 146
B. DIFFÉRENTES PISTES DE RECHERCHE POUR UNE « 4ÈME GÉNÉRATION » DE RÉACTEURS 147
1. Un effort conduit dans une dynamique internationale 148
2. Les options privilégiées par la France 148
II. LES APPORTS DE LA COMMISSION D’ENQUÊTE 149
A. LE RETRAITEMENT ET LE MOX, SUJETS DE JUGEMENTS SOUVENT TRANCHÉS 150
1. Des appréciations sensiblement divergentes sur l’intérêt économique du retraitement et du Mox 150
2. Le retraitement et le Mox n’apportent qu’une réponse partielle au problème des déchets 152
3. L’avenir de la filière doit être apprécié à l’aune de nombreux paramètres 154
B. UNE FILIÈRE « 4ÈME GÉNÉRATION » QUI DEVRA FRANCHIR DES OBSTACLES IMPORTANTS AVANT DE VOIR LE JOUR 156
1. Le débat sur la validité des choix techniques français 156
2. Une divergence de vue sur les objectifs de sûreté 158
3. Une compétitivité qui restera à démontrer 160
CHAPITRE 7 : LE RISQUE NUCLÉAIRE : PASSER DE LA CONCEPTUALISATION À L’ACTION 163
I. LES ÉLÉMENTS DE CONTEXTE 163
A. DE NOUVEAUX OUTILS DE GESTION DE CRISE 163
1. Le cadre antérieur 163
2. Les innovations post-Fukushima 164
B. UN SYSTÈME D’INDEMNISATION QUI NE COUVRE QUE PARTIELLEMENT LES RISQUES 165
1. L’accident nucléaire grave et l’accident nucléaire majeur : des dommages potentiels colossaux 165
2. Un système d’indemnisation insuffisant pour couvrir les dommages provoqués par un accident nucléaire de grande ampleur 167
a. L’assurance du risque nucléaire : un système dérivé de la Convention de Paris du 29 juillet 1960 167
b. Le fonctionnement du système français d’assurance du risque nucléaire 168
c. Des plafonds d’indemnisation insuffisants qui posent la question de la garantie implicite de l’État 169
II. LES APPORTS DE LA COMMISSION D’ENQUÊTE 169
A. DISPOSER DES OUTILS DE GESTION DE CRISE ADÉQUATS : DE LA THÉORIE À LA PRATIQUE 169
1. Une territorialisation à peine débutée 170
2. Une information et une participation des riverains à travailler 170
3. Une harmonisation européenne nécessaire 171
4. Des interrogations persistantes 172
B. PRÉVOIR UNE JUSTE INDEMNISATION DES VICTIMES D’UN ACCIDENT NUCLÉAIRE 173
1. Des interrogations majeures sur le chiffrage des probabilités d’accident et des coûts d’une catastrophe nucléaire 173
a. Une probabilité d’un accident majeur sur la durée de vie restante du parc français « de l’ordre de 1 % » ? 173
b. Des travaux sur l’évaluation des coûts d’un accident à perfectionner 175
2. Le moins mauvais des systèmes d’assurance : une obligation de provisionnement annuel imposée à l’exploitant 177
a. Option n° 1 : le statu quo 177
b. Option n° 2 : mettre en place un mécanisme assuranciel de grande ampleur 178
c. Option n° 3 : imposer une obligation de provisionnement à l’exploitant 180
CHAPITRE 8 : LA PLACE DU NUCLÉAIRE DANS LE MIX ÉNERGÉTIQUE FRANÇAIS 185
I. LES ÉLÉMENTS DE CONTEXTE 185
A. LE DÉBAT NATIONAL SUR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE : COMMENT METTRE EN APPLICATION L’ENGAGEMENT PRÉSIDENTIEL DE RÉÉQUILIBRAGE DU MIX ÉLECTRIQUE ? 185
B. LES CARACTÉRISTIQUES DES PRINCIPAUX SCÉNARIOS 186
II. LES APPORTS DE LA COMMISSION D’ENQUÊTE 187
A. APPROCHE 1 : UNE FORTE HAUSSE DE LA DEMANDE EST INÉLUCTABLE, CE QUI REND NÉCESSAIRE LE PROLONGEMENT DU PARC NUCLÉAIRE 187
1. L’électricité au service d’un objectif prioritaire : la diminution des émissions de gaz à effet de serre 187
2. L’impossibilité de faire baisser fortement la demande d’énergie requerrait le maintien d’une capacité nucléaire importante 188
3. Un scénario compatible avec l’engagement présidentiel ? 190
B. APPROCHE 2 : UNE BAISSE DE LA DEMANDE ÉNERGÉTIQUE EST POSSIBLE, CE QUI REND INUTILE LA PROLONGATION DE L’ENSEMBLE DU PARC NUCLÉAIRE 191
1. La possibilité de faire baisser fortement la demande d’énergie ouvre la voie à une forte réduction de la part du nucléaire dans le mix électrique 191
2. Un tel scénario met en avant la création d’emplois locaux, la diminution de la facture énergétique et le renforcement de la résilience du système énergétique 192
3. Limiter l’utilisation de l’électricité à ses usages « nobles » ? 192
CHAPITRE 9 : COMMERCIALISATION DE L’ÉLECTRICITÉ NUCLÉAIRE 195
I. LES ÉLÉMENTS DE CONTEXTE 195
A. LE PRINCIPE DE LA LIBÉRALISATION DES MARCHÉS : LA SUBSTITUTION DES PRIX DE MARCHÉ AUX TARIFS RÉGLEMENTÉS 195
1. Le tarif : le fondement de l’histoire française de l’électricité. 195
2. L’extinction progressive des tarifs réglementés en application du droit européen 195
B. LES CONSÉQUENCES DE LA LIBÉRALISATION : LA MISE EN PLACE DE MÉCANISMES COMPLÉMENTAIRES AU MARCHÉ DE GROS 198
1. Exeltium : développer des instruments alternatifs au marché pour s’assurer d’une source d’approvisionnement pérenne et compétitive 198
2. L’ARENH : l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique 200
II. LES APPORTS DE LA COMMISSION D’ENQUÊTE 201
A. LE NUCLÉAIRE TOUCHÉ PAR LES DIFFICULTÉS LIÉES AU FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS SUR LA PLAQUE ÉLECTRIQUE EUROPÉENNE 201
1. Exeltium : un prix d’enlèvement supérieur au prix de l’ARENH et aux prix de marché 201
2. Selon EDF, un prix de l’ARENH insuffisant pour couvrir les coûts d’EDF 203
3. Selon les concurrents d’EDF, le financement des investissements actuels et futurs doit s’étaler sur l’ensemble de la durée de leur utilisation 205
B. DES ÉLECTRO-INTENSIFS EN DIFFICULTÉ MALGRÉ UN CONTEXTE DE BAISSE DES PRIX DE GROS 207
1. La France, historiquement bien placée, bientôt reléguée 207
2. Une augmentation de prix due à l’inflation de tous les postes de la facture 208
3. Un « bouquet » de solutions ? 209
RECOMMANDATIONS 213
Enjeux énergétiques et industriels globaux 213
Enjeux de l’industrie nucléaire 215
EXAMEN EN COMMISSION 219
CONTRIBUTIONS DE MEMBRES DE LA COMMISSION ET DE GROUPES POLITIQUES 237
ANNEXE 1 – LISTE DES PERSONNES ENTENDUES PAR LA COMMISSION D’ENQUÊTE 255
ANNEXE 2 – LISTE DES PERSONNES ENTENDUES PAR LE RAPPORTEUR 261
ANNEXE 3 – LISTE DES PERSONNES RENCONTRÉES AU COURS DES DÉPLACEMENTS EFFECTUÉS PAR LA COMMISSION D’ENQUÊTE 263
ANNEXE 4 – RAPPORT DE LA COUR DES COMPTES 267
AVANT-PROPOS DU PRÉSIDENT FRANÇOIS BROTTES
La commission d’enquête sur les coûts de la filière nucléaire a été constituée, le 11 décembre 2013, à la demande du groupe écologiste, dans le cadre du « droit de tirage » reconnu aux groupes minoritaires par le deuxième alinéa de l’article 141 du Règlement de l’Assemblée nationale. Tous les groupes politiques ont annoncé, au cours du débat en séance publique, qu’ils prendraient une part active à ses travaux.
La création de la commission d’enquête est, en effet, intervenue à un moment très particulier : entre la conclusion du Débat national sur la transition énergétique et la présentation du projet de loi sur la transition énergétique s’ouvrait un espace propice à un exercice de clarification.
Le contexte international est marqué par la diversité des choix de politique nucléaire, certains pays ayant décidé de « sortir du nucléaire », d’autres, au contraire, poursuivant ou engageant des programmes ambitieux de construction ; le contexte national est, pour sa part, marqué par l’engagement présidentiel de ramener la part de l’électricité d’origine nucléaire à 50 % de la production totale à l’horizon 2025. La commission d’enquête n’avait donc pas pour rôle de prendre position « pour » ou « contre » le nucléaire, mais d’apporter des éclairages argumentés sur l’ensemble des facteurs de coût de l’électricité nucléaire, afin de contribuer au débat politique à venir et d’aller au-delà des mythes – notamment celui des hypothétiques « coûts cachés » du nucléaire. C’est dans cette perspective que le rapporteur et moi-même avons veillé à orienter ses travaux.
Il fallait d’abord faire œuvre de transparence et de pédagogie. Cela nous a conduit à proposer à la commission une structuration thématique des auditions, par séquences successives qui, après avoir évoqué le contexte économique au sein duquel opère aujourd’hui l’industrie nucléaire – tant national qu’européen –, ont analysé tous les aspects de la filière, depuis le minerai d’uranium jusqu’à la gestion des déchets, depuis la situation du parc actuel jusqu’aux perspectives ouvertes par les réacteurs dits « de 4ème génération ».
Il fallait également veiller à faire œuvre objective. Sur le sujet de l’énergie nucléaire, ce n’est souvent pas une mince affaire. Conjuguant leurs efforts à ceux du rapporteur et aux miens propres, les membres de la commission se sont eux aussi emparés de cette exigence et se sont faits les gardiens vigilants d’un bien commun aux contours multiples. De fait, – et c’était un autre avantage du découpage thématique – les séquences d’auditions ont mis en balance de façon systématique les propos d’interlocuteurs – industriels, institutionnels, associatifs – dont les inclinations n’étaient pas forcément concordantes.
Avec un tel cahier des charges, le programme de travail promettait d’être dense. D’autant que la suspension de l’Assemblée nationale pendant plusieurs semaines, en raison des élections municipales, était un inconvénient certain. Mais il n’était pas envisageable que la commission d’enquête se mette totalement « entre parenthèses », son existence étant enserrée dans des délais contraints.
Soixante-cinq auditions – dont trois tables rondes – ont eu lieu, entre le 9 janvier et le 27 mai, et ont permis d’entendre 110 interlocuteurs environ. Trois déplacements ont permis d’approfondir, sur le terrain, certains enjeux spécifiques : dans le Nord-Cotentin – sur le chantier de l’EPR de Flamanville et à l’usine de retraitement de La Hague –, en vallée du Rhône – sur le centre CEA de Marcoule, à l’usine Melox, à la centrale nucléaire du Tricastin et à l’usine d’enrichissement Georges Besse 2 – et en Alsace – au conseil régional, au conseil général du Haut-Rhin, en mairie de Fessenheim et à la centrale nucléaire de Fessenheim. Le rapporteur a conduit en propre 25 entretiens informels ouverts à l’ensemble des membres de la commission. La commission a également demandé à la Cour des comptes, en application de l’article L.132-4 du code des juridictions financières, d’actualiser plusieurs éléments du rapport qu’elle avait publié en janvier 2012.
A l’issue de 6 mois d’intenses travaux, je peux dire que la commission d’enquête est allée aussi loin que possible, les enjeux techniques et financiers qui s’attachent au sujet traité n’ayant pas facilité l’émergence de certaines réponses aux questions qui étaient posées. En ce sens, je comprends que des frustrations puissent subsister. Je me réjouis cependant que l’on ait pu éviter la domination des postures caricaturales, ce dont témoigne l’ouvrage final adopté par la commission : celui-ci n’est dépourvu ni de la tonalité propre aux convictions du rapporteur, ni de l’« honnêteté » que chacun est en droit d’attendre d’une commission d’enquête.
Lorsque le groupe Écologiste a proposé à l’Assemblée Nationale la création d’une commission d’enquête concernant les coûts de la filière nucléaire, l’objectif était d’éclairer la représentation nationale au moment où celle-ci va être saisie par le Gouvernement d’un projet de loi concernant la transition énergétique. L’objet de ce travail n’était pas d’examiner l’ensemble des filières de production d’énergie, et encore moins de se prononcer sur la pertinence de telle ou telle, mais d’apporter l’information la plus complète possible sur celle qui occupe la place prépondérante dans le mix électrique national. Et pour cela, cette commission s’est penchée non seulement sur l’ensemble des étapes du processus de production (de l’extraction du combustible au traitement des déchets et au démantèlement), mais aussi sur le contexte international, et plus particulièrement européen, dans lequel se posent aujourd’hui les enjeux de politique énergétique, notamment électrique.
Je pense pouvoir dire que, ce faisant, la commission a fait œuvre utile, en apportant transparence et analyse dans un domaine où la complexité des processus, de légitimes soucis de confidentialité (pour des raisons de sécurité, comme de secret commercial et industriel), mais aussi une certaine tradition du secret, ne rendent pas toujours lisibles pour les décideurs politiques l’ensemble des enjeux et l’impact des décisions prises… voire, dans certains cas, de l’absence de décision.
Pour ce faire, la commission globalement, et le rapporteur en particulier, a auditionné de nombreux experts, chercheurs, économistes, représentants des organismes de sûreté nucléaire (ASN, IRSN), la ministre de l’Écologie et ses différents services de l’État, des syndicalistes, des ONG, une association de salariés de sous-traitants, des CLI et l’ANCCLI et, bien évidemment, les équipes des entreprises et établissements publics du nucléaire (EDF, AREVA, CEA, ANDRA, ainsi que leurs homologues britannique et belge) qui ont été amplement sollicitées, et dont la disponibilité a été mise à contribution tant pour la participation aux auditions et la fourniture de documents utiles à notre enquête (1), que pour l’organisation des déplacements sur sites (Flamanville, La Hague, Marcoule, Tricastin, Fessenheim), sans oublier l’apport essentiel de la Cour des comptes et de la Commission de régulation de l’énergie qui ont accepté à notre demande de prolonger et mettre à jour les rapports qu’elles avaient rédigés par le passé, assurant une bonne complémentarité avec nos travaux.
Du fait même du sujet concerné – l’énergie nucléaire – la commission a mené en parallèle travail d’investigation et débat politique inhérent aux convictions respectives de ses membres et de leurs familles politiques (2), sous le pilotage bienveillant de son Président François Brottes, qui a veillé au bon déroulement des travaux, malgré un calendrier contraint, et à l’expression de chaque sensibilité.
Intervenant ici es qualités en tant que rapporteur, et sans rien renier de mes convictions personnelles, il me paraît important de souligner les résultats les plus marquants de notre travail qui sont repris de façon plus détaillée tout au long du rapport.
Le premier de ces constats est que la filière nucléaire française fait face à des difficultés spécifiques. Elles sont de deux ordres :
– certaines sont exogènes : la surproduction électrique en base sur la plaque européenne ; un marché nucléaire atone au niveau planétaire et une érosion de la rentabilité économique des activités nucléaires, selon les termes mêmes du président d’AREVA, M. Luc Oursel ; un marché électrique européen inadapté qui handicape la construction de toute nouvelle installation de production électrique et favorise la production à base de charbon en substitution du gaz depuis la montée en puissance du gaz de schiste aux États-unis, à rebours d’un paquet climat-énergie européen défini pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, favoriser l’efficacité énergétique et les renouvelables…
– certaines sont intrinsèques : le sous-investissement important en maintenance du parc qui a provoqué des avaries génériques et implique un rattrapage d’investissement très important ; les contraintes de sûreté supplémentaires que l’accident nucléaire de Fukushima a rendu indispensables (notons que l’industrie nucléaire est probablement la seule où un accident à l’autre bout du monde peut avoir autant d’impact à des milliers de kilomètres, ce qui est indéniablement un facteur de vulnérabilité, d’ailleurs indiqué comme tel dans le document de référence déposé chaque année par EDF auprès de l’Autorité des marchés financiers) ; une très forte homogénéité du parc qui est un atout d’un point de vue économique, mais aussi une vulnérabilité à tout problème générique comme le rappelle régulièrement l’ASN, particulièrement dans un pays qui dépend à 78 % de cette technologie pour son alimentation électrique ; une pyramide des âges défavorable liée à l’effort très important consenti par la collectivité pour construire l’essentiel du parc en une dizaine d’années et qui se traduit par le départ à la retraite à court terme d’une partie importante des personnels compétents, et par l’arrivée prochaine de l’échéance des 40 ans sur une courte période pour une grande majorité du parc.
Cette échéance des 40 ans a été omniprésente dans le travail de la commission, car elle constitue la date butoir de durée de vie d’un certain nombre d’équipements essentiels des réacteurs dimensionnés pour une telle période. La tentation légitime de l’exploitant est de prolonger cette durée de vie, s’appuyant sur des décisions prises à l’étranger (États-Unis) mais dans un contexte juridique et de sûreté différent de celui en vigueur en France. La Cour des comptes elle-même, dans le rapport qu’elle nous a rendu, insiste fortement sur la préoccupation qu’elle avait déjà exprimée il y a 3 ans : l’absence de décision claire et rapide des pouvoirs publics reviendrait à une décision implicite de prolongation… Chacun peut s’accorder à estimer qu’il ne s’agirait pas de la forme la plus démocratique et la plus transparente de prendre une décision, surtout lorsque les enjeux sont si conséquents.
Et cela d’autant plus que l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN), dont la légitimité en la matière n’est remise en question par aucune des parties, indique que rien n’est aujourd’hui garanti en ce qui concerne cette prolongation. En effet, certaines parties sensibles des réacteurs (la cuve et l’enceinte de confinement notamment) ne sont pas remplaçables et leur vieillissement apparaîtra peut-être incompatible avec la préservation de la sûreté. Il n’y a par exemple aujourd’hui aucun retour d’expérience concernant la tenue d’une cuve de réacteur au-delà de 45 ans. Par ailleurs, seconde hypothèque, l’ASN estime qu’une telle prolongation devra s’accompagner d’un renforcement de la sûreté des réacteurs prolongés à un niveau équivalent à celui de la 3ème génération (EPR), ce qui pourrait conduire à des investissements significatifs (mais dont le périmètre ne pourra réellement être évalué que vers 2018-2019 quand l’ASN fera connaître exactement son référentiel de sûreté pour le post-40 ans).
L’ancien président de l’ASN, André-Claude Lacoste, disait déjà en 2009 « Il ne faut pas que la gestion d’EDF soit basée sur des paris concernant la durée d’exploitation ». L’actuel président, Pierre-Franck Chevet, le dit aussi à sa façon en estimant que la France doit se donner des marges de sécurité quant à son mix électrique pour être moins vulnérable à des problèmes génériques pouvant conduire à l’arrêt immédiat et simultané de nombre de réacteurs, et donc à un risque important sur l’alimentation électrique du pays (3). Parallèlement, chacun peut convenir que, si l’arrêt à 40 ans de tous les réacteurs induirait un « effet falaise » insoutenable, il en serait de même si tous les réacteurs étaient portés à 50, voire 60 ans. Une voie intermédiaire est donc à privilégier, basée sur des durées de vie différenciées en fonction des réacteurs (prenant évidemment en compte les impératifs de sûreté, une répartition pertinente des investissements et l’alimentation électrique des territoires), permettant à la fois de mettre en œuvre l’engagement présidentiel de ramener la part du nucléaire à 50 % du mix électrique en 2025 – ce qui réduirait indéniablement la vulnérabilité de notre système électrique – et, en réduisant la surcapacité actuelle, d’accroître la rentabilité des installations maintenues en activité.
Comme l’a rappelé la Cour des comptes, c’est dorénavant aux pouvoirs publics de prendre les décisions qui s’imposent, et la loi de programmation de la transition énergétique en est évidemment l’occasion. La non décision et l’absence de visibilité à moyen terme ont un coût économique, social, environnemental, industriel, en compétitivité… que notre pays ne peut pas se permettre. Cela implique non seulement de définir un scénario global d’évolution de la puissance installée, mais aussi des outils de pilotage par l’État en partenariat avec l’opérateur (dont l’État est l’actionnaire très majoritaire). Cette évolution doit s’inscrire bien évidemment dans une politique énergétique globale (efficacité énergétique, développement des énergies renouvelables, stockage, etc.) permettant, outre le respect des engagements internationaux de la France (particulièrement contre le dérèglement climatique), de réunir les conditions pour que cette transition énergétique soit une opportunité pour l’emploi, le pouvoir d’achat des ménages, la compétitivité économique, l’indépendance énergétique, la sécurité d’approvisionnement et des besoins en puissance, garantissant la robustesse économique et énergétique de la France. La transition doit également donner une impulsion nouvelle à la lutte contre la précarité énergétique, en agissant à la fois sur les leviers proprement financiers (modalités particulières de tarification, aide au paiement des factures) et sur celui d’une plus grande efficacité énergétique des logements.
Le travail de la commission a mis en évidence un certain nombre de conditions à la réussite d’une telle transition : que l’État se dote d’outils et d’instances d’expertise globale en continu tant sur la politique énergétique que sur les priorités d’investissement (et donc l’évaluation de leurs coûts) notamment sur le parc nucléaire ; que des business models robustes et durables soient mis en place pour la production énergétique, l’efficacité énergétique, le transport et la distribution de l’énergie ; que la France valorise pour cela ses champions industriels (dont nombre ont d’ores et déjà entamé une diversification et une évolution vers la transition énergétique qui ne demande qu’à être consolidée), particulièrement ceux dont l’État est actionnaire principal, en sortant d’une forme de schizophrénie tout particulièrement dans le cas d’EDF ; que les politiques nationales et européennes permettent la protection des entreprises électro-intensives en accompagnant leurs efforts d’efficacité énergétique ; et que les signaux prix donnés par un marché de l’électricité réformé découlent des orientations du paquet climat-énergie au lieu de les handicaper.
˜ ™
Parallèlement à ces constats globaux et au besoin d’un pilotage politique dorénavant urgent et indispensable, la commission d’enquête s’est penchée sur un certain nombre de spécificités de la filière nucléaire.
La première est évidemment l’évolution de ses coûts. Le rapport que la Cour des comptes a remis à la commission met en évidence une situation préoccupante : un accroissement de 21 % en 3 ans du coût courant économique, une tendance à la hausse qui va se poursuivre, et cela sans même prendre en compte le coût de l’EPR de Flamanville – le résultat du calcul est cependant très sensible au taux d’indisponibilité des réacteurs pour maintenance. Même si cette évolution s’explique par le contexte général rappelé plus haut, et notamment par l’âge des réacteurs, elle risque d’avoir des conséquences importantes sur le pouvoir d’achat des ménages et le prix de l’électricité pour les entreprises du pays, dans un contexte économique déjà difficile. La rapidité de ces évolutions, elle-même, fait problème (le dernier rapport de la Cour des comptes, ou le rapport Énergies 2050, déjà dépassés, ne datent que de 2012) : dans un domaine d’activité où l’échelle de temps est le temps long, voire très long, où les investissements engagent pour des décennies (voire bien plus longtemps encore), la prospective n’en est rendue que plus difficile.
Par ailleurs, la filière va devoir faire face à ce que nombre d’interlocuteurs ont qualifié de « mur d’investissement » dans les années à venir, à la fois pour compenser le sous-investissement passé, maintenir un niveau d’investissement correct sur l’ensemble du parc afin d’améliorer sa disponibilité, intégrer les travaux de sûreté issus des ECS (Évaluations Complémentaires de Sûreté suite à Fukushima) et ceux nécessaires pour renforcer la sécurité, ou encore pour résister aux événements climatiques extrêmes liés au dérèglement climatique, auxquels s’ajoutent les investissements qu’EDF programme pour préparer une éventuelle prolongation au-delà de 40 ans. La Cour des comptes a évalué l’impact de ces investissements d’ici 2033 à 110 milliards d’euros courants. Pourraient s’y ajouter des investissements supplémentaires de sûreté en cas de prolongation si le référentiel de sûreté de l’ASN l’imposait. Et auxquels s’ajouteront ensuite des investissements annuels d’environ 50 millions par an et par réacteur selon EDF, soit 3 milliards par an pendant 20 ans si, comme le souhaite l’entreprise, tous les réacteurs étaient prolongés à 60 ans.
EDF a déjà indiqué qu’elle n’engagerait une partie de ces investissements colossaux (hors ceux nécessaires à la sûreté) qu’une fois connues les décisions de l’État sur la stratégie énergétique. La pertinence de dépenses si considérables, qui pèseront in fine sur le consommateur, se pose en effet de façon globale. La capacité à investir parallèlement à la fois sur les réacteurs existants, sur des moyens de production alternatifs – qu’ils soient nucléaires ou renouvelables –, mais aussi sur l’efficacité énergétique et sur le développement et l’entretien des réseaux de transports et de distribution est forcément limitée.
En tout état de cause, ce programme d’investissement massif sur le parc existant a des conséquences potentielles importantes en termes de besoin de financement, d’organisation des travaux, de disponibilité des réacteurs du fait des arrêts de tranche, de capacité des entreprises sous-traitantes à faire face à ces nombreux chantiers menés en parallèle. Dans son rapport annuel, l’Inspecteur général pour la sûreté nucléaire et la radioprotection, interne à EDF, a mis en évidence les défis organisationnels à relever, au vu des difficultés déjà rencontrées depuis quelques années par l’entreprise lors de ses arrêts de tranche qui ont fortement impacté la durée de ces arrêts de tranche, auxquels s’ajoutent des arrêts fortuits de réacteurs en nombre croissant. Ses recommandations visent à mieux anticiper l’organisation des chantiers afin de réduire les incidents, les accidents du travail et les risques potentiels sur la sûreté.
À cette occasion, la commission d’enquête s’est penchée sur les conditions de travail des salariés du nucléaire, en particulier des sous-traitants, dont chacun s’accorde à considérer qu’ils reçoivent 80 % des doses sur les sites nucléaires. Si des progrès ont été effectués pour réduire les doses reçues, il nous est apparu qu’en la matière tout ce qui peut être fait pour continuer d’améliorer la protection des travailleurs et aller vers une harmonisation entre celle des salariés EDF et celle des sous-traitants devait être fait. D’où les recommandations portées par la commission d’enquête.
La réduction des niveaux de sous-traitance est d’ailleurs une demande constante de l’ASN afin d’améliorer la sûreté. Demande que l’on ne peut qu’appuyer et relayer dans le cadre de la prochaine loi de transition énergétique, de même que les demandes de moyens supplémentaires (juridiques, financiers, humains) pour l’ASN et l’IRSN afin que ces organismes puissent assurer au mieux leur mission alors que leur charge de travail va augmenter de façon très significative pour plusieurs années. S’il est indéniable que le système de sûreté français est reconnu comme unique au monde (par l’indépendance de l’ASN, les CLI, etc.), chacun convient que la sûreté reste une exigence absolue, et que l’on doit systématiquement viser les plus hauts standards en la matière. Le fait que l’ASN ait qualifié pour la seconde année consécutive la sûreté de « globalement assez satisfaisante », estimant devant la commission d’enquête que cela pourrait correspondre à une notre de 12 à 13 sur 20, montre qu’il reste des marges de progression.
La commission d’enquête a auditionné et rencontré sur le terrain les CLI (commissions locales d’information), lors de ses déplacements, et l’ANCCLI, leur structure de coordination nationale. Spécificité française, ces structures doivent être soutenues et avoir les moyens indispensables à leurs rôles de veille, de dialogue, d’interpellation.
De même, une participation du public renforcée, comme le propose l’ASN, au processus de décision relatif à la prolongation de durée de vie de réacteurs, ou pour tout ce qui concerne le projet d’enfouissement des déchets à Bure, apparaît comme un gage de transparence indispensable.
˜ ™
La commission d’enquête a, par ailleurs, permis de mettre en évidence un certain nombre d’incertitudes concernant une part des coûts de la filière, qui mériteront approfondissement.
La première porte sur les réacteurs de 3ème génération (dont l’EPR). La commission ne peut que constater, comme la Cour des comptes, l’incapacité à évaluer le coût du kWh qui sera produit à Flamanville. Les raisons de la dérive des budgets et des calendriers sont connus (effet tête de série, perte de savoir-faire dans la construction des réacteurs, etc.) même si on peut s’étonner que ces difficultés aient été à ce point sous-estimées lorsque les décideurs publics ont eu à se prononcer sur l’opportunité de construction car cela impactera la facture des consommateurs et dessert plutôt la crédibilité des industriels, de même que les difficultés de l’EPR d’Olkiluoto en Finlande qui pèsent lourdement sur les finances d’AREVA. En tout état de cause, comme le souligne la Cour des comptes, l’accord signé avec le gouvernement britannique pour la construction des deux EPR d’Hinkley Point C (avec garantie de l’État pour la construction, tarif d’achat garanti pendant 35 ans à 114 €/MWh, etc.), même si les conditions de construction y sont spécifiques, indique que les coûts de production de réacteurs de 3ème génération – certes construits pour une durée de fonctionnement de 60 ans – seront significativement supérieurs à ceux du parc actuel.
EDF a indiqué œuvrer à une optimisation de l’EPR, et d’autres concepts de réacteurs de 3ème génération de moindre puissance (ATMEA notamment) sont en projet, mais les coûts en restent inconnus. Les seuls éléments qu’a eus à connaître la commission d’enquête en la matière sont une courbe d’investissement élaborée par EDF qui permettait d’estimer le coût de construction d’un parc EPR d’une puissance équivalente à celui existant, à 250 milliards d’euros.
Autre incertitude récurrente : celle concernant les charges futures (4) du nucléaire, à savoir le coût du démantèlement et des déchets nucléaires. La loi prévoit leur juste provisionnement dès maintenant, et cela apparaît d’autant plus indispensable que le moment où il faudra dépenser ces sommes sera pour une part très lointain. Une provision sous-évaluée reviendrait à reporter ces charges sur les générations futures, alors qu’on ne peut présumer ce que seront alors devenues les entreprises productrices à cette échéance. Or, bien provisionner implique de bien évaluer les coûts.
En ce qui concerne le démantèlement, la tâche est rendue difficile par le faible retour d’expérience, bien que, sur 125 installations nucléaires de base en France, une trentaine soit en cours de démantèlement. Mais force est de constater que les cas existants montrent bien plus souvent une sous-évaluation des devis que l’inverse. Par ailleurs, la comparaison effectuée par la Cour des comptes entre les estimations réalisées en France et à l’étranger montre que la France se situe en bas de la fourchette. L’audit annoncé devant la commission d’enquête par la ministre de l’Écologie est donc bienvenu. Le travail de la commission d’enquête a, par ailleurs, confirmé l’intérêt industriel de mettre en place une filière du démantèlement d’installations nucléaires.
Pour ce qui est des déchets nucléaires, la principale hypothèque concerne le projet Cigéo d’enfouissement des déchets les plus radioactifs à Bure. Le projet a connu plusieurs étapes alors même que se tenait la commission d’enquête : le débat public et sa conférence de citoyens se sont achevés, l’ANDRA a indiqué les conclusions qu’elle comptait en tirer, de même que le Gouvernement par la voix de la ministre de l’Écologie devant la commission d’enquête. Une phase pilote préalable d’expérimentation est dorénavant prévue, qui devrait permettre de savoir si les incertitudes qui persistent sur l’inventaire à enfouir, la sûreté, les coûts, la récupérabilité des colis, les capacités de l’installation à évoluer pour répondre à la stratégie énergétique du pays peuvent être levées. En l’attente, il apparaîtrait raisonnable de préserver un plan B, en conduisant une recherche équivalente sur l’entreposage en subsurface. En tout état de cause, la décision finale devrait revenir au Parlement comme ce fut le cas à chaque étape dans cette recherche d’une solution au problème des déchets radioactifs. En ce qui concerne plus spécifiquement le coût du projet Cigéo, force est par ailleurs de constater que les divergences d’appréciation entre l’ANDRA d’un côté et les producteurs de déchets de l’autre persistent puisque ce coût varie du simple au double : entre 14 et 28 milliards d’euros. Il est donc probable que les provisions passées par les producteurs se révèlent significativement insuffisantes, comme le souligne la Cour des comptes.
Sécuriser le financement de ces charges futures passe aussi par une juste évaluation du taux d’actualisation pratiqué, ce qui a une importance considérable pour des dépenses dont certaines interviendront dans 150 ans ! La Cour des comptes demande qu’on mette fin aux dérogations en la matière et que la règle soit respectée. On ne peut que la rejoindre sur ce point, de même que sur ses recommandations relatives à la variété des actifs dédiés et à leur disponibilité.
Enfin, concernant ces charges futures, la commission d’enquête s’est interrogée sur la pertinence qu’il y aurait à créer un fonds dédié au sein de la Caisse des Dépôts et consignations, permettant de mieux les sécuriser, et à permettre que ce fonds abonde les fonds de garantie nécessaires à la transition énergétique. La commission souhaite que cette hypothèse fasse l’objet d’une étude de la part de l’État.
Une autre partie de la filière nucléaire a été examinée avec attention par la commission lors de plusieurs auditions et visites : ce qu’on appelle l’aval du cycle, c’est-à-dire le retraitement des combustibles usés à La Hague et la fabrication du Mox à Marcoule. Il nous est apparu dommageable que depuis 15 ans aucune évaluation globale n’ait été effectuée concernant les coûts et les bénéfices globaux de cette partie de la filière. Des études existent au niveau international mais pas en ce qui concerne la filière française. La Cour des comptes n’avait pas la capacité, dans le temps imparti de la commission d’enquête, de mener cette analyse. Cela reste donc à faire, y compris en prenant en compte d’un côté la réduction des volumes de déchets, et de l’autre les risques induits par l’aval de la filière, notamment ceux concernant le plutonium. Il est cependant un point qui fait consensus entre tous les acteurs : stocker directement les combustibles usés ne coûterait pas plus cher que de les retraiter, fabriquer le Mox et stocker les seuls autres déchets.
L’autre point qui semble faire consensus est que la pertinence du retraitement dépend largement de la capacité à mettre au point un jour une 4ème génération de réacteurs qui valoriseraient plus efficacement les matières énergétiques (uranium et plutonium) et réduiraient d’autant la dépendance à l’importation d’uranium. Nos auditions ont mis en évidence une diversité d’approche de cette question de la part des acteurs de la filière nucléaire, en ce qui concerne tant la capacité de la recherche à dépasser un certain nombre de verrous technologiques, que le renforcement de la sûreté par rapport à la 3ème génération, le calendrier potentiel de mise au point de réacteurs industriels et a fortiori leur rentabilité.
Le dernier point sur lequel la commission d’enquête a mis en évidence une incertitude importante est celui de l’assurance. Comme le dit la Cour des comptes, l’État assure gratuitement le risque d’accident nucléaire. A minima, cela constitue une forme de subvention qui mérite d’être intégrée dans le coût de l’énergie nucléaire si on veut le comparer à d’autres énergies (au même titre d’ailleurs que l’impact sur le dérèglement climatique devrait être internalisé au coût des énergies fossiles). Cet exercice se heurte cependant à des difficultés méthodologiques pour évaluer le coût de l’accident (l’IRSN y a apporté une première contribution), sa probabilité, et la prime d’assurance qui pourrait y être associée. Cette évaluation ne constitue d’ailleurs pas qu’un exercice intellectuel. La situation japonaise post-Fukushima montre à quel point l’indemnisation des victimes se révèle un casse-tête – et recèle potentiellement de très lourdes injustices et souffrances, indépendamment même des conséquences directes de la catastrophe – si elle n’a pas été pensée « à froid », et ce d’autant plus que dans les contrats d’assurance de nos concitoyens, les risques liés à un accident radiologique sont aujourd’hui exclus. En auditionnant des chercheurs et experts, notamment du Conseil d’analyse économique, qui ont exposé les avantages et inconvénients (y compris éthiques) de systèmes de provisionnement par avance ou de garantie par l’État, la commission d’enquête a permis de poser un certain nombre d’éléments d’un débat qui se doit d’être approfondi à partir du moment où l’ASN estime qu’un accident majeur ne peut être exclu en France, et que sa probabilité, ne serait-ce qu’au regard des accidents passés, ne peut être considérée comme négligeable.
La question de l’accident a naturellement amené la commission d’enquête à faire le point sur les capacités du pays en matière de gestion de crise, ainsi qu’à auditionner les services de l’État (pour une part à huis clos) sur les questions de sûreté et de sécurité des installations nucléaires. Le diagnostic fait par ces services eux-mêmes, ainsi que par l’Autorité de sûreté nucléaire, est que si ces questions sont mieux appréhendées depuis quelques années, il reste cependant du travail à accomplir pour en renforcer la robustesse. Pour ce qui est de la gestion de crise notamment, la bonne information du public, l’harmonisation des dispositifs avec nos voisins (notamment en cas de catastrophe sur une installation frontalière), l’adaptation des périmètres des plans d’intervention au regard des accidents déjà intervenus, etc. font partie des pistes de travail relevées par la commission.
Enfin, la commission d’enquête s’est inquiétée des inévitables impacts qu’aura – et ce quel que soit l’avis des uns et des autres sur l’échéance – un jour ou l’autre la fermeture des installations nucléaires. Elle s’est notamment rendue sur le site de Fessenheim et a rencontré les élus régionaux, départementaux et locaux, ainsi que les responsables et salariés de la centrale. Outre le constat d’un besoin impérieux de dialogue avec les principaux intéressés, ma conviction en a été renforcée que dédramatiser et réaliser dans de bonnes conditions la fermeture inéluctable de réacteurs implique de réunir un ensemble de conditions préalables : un cadre juridique adapté concernant la mise à l’arrêt définitif et le démantèlement ; une garantie d’alimentation électrique du territoire, par le renforcement de la production locale (notamment en favorisant l’implantation d’énergies nouvelles) et/ou le renforcement des réseaux ; un accompagnement économique des territoires tant pour ce qui concerne les emplois directs qu’indirects, l’impact sur les services publics et les collectivités ; et évidemment la sécurisation des parcours professionnels des personnels. Du traitement pertinent et humain des premières mises à l’arrêt dépendra largement la bonne mise en œuvre d’une transition énergétique qui, comme toutes les mutations industrielles de notre histoire, n’est pas exempte de difficultés, mais qui, justement au regard de ce que l’histoire nous a enseigné, se doit d’anticiper celles-ci.
˜ ™
En conclusion, j’ai le sentiment que la commission d’enquête a rempli le mandat pour lequel elle a été mise en place, à savoir identifier les éléments de coût qui étaient accessibles, mettre en évidence les incertitudes sur lesquelles il convient encore de progresser, mais aussi étudier les impacts des restructurations qu’impliquera la fermeture d’installations nucléaires. Ce faisant, j’estime qu’elle a donc joué un rôle utile pour préparer le futur débat sur la loi de programmation de la transition énergétique.
Saisie du sujet des « coûts passés, présents et futurs de la filière nucléaire, à la durée d’exploitation des réacteurs et à divers aspects économiques et financiers de la production et de la commercialisation de l’électricité nucléaire, dans le périmètre du mix électrique français et européen, ainsi qu’aux conséquences de la fermeture et du démantèlement de réacteurs nucléaires, notamment de la centrale de Fessenheim », la commission d’enquête a pris acte d’emblée qu’elle ne s’avançait pas en terrain inconnu et que d’autres publications, déjà disponibles, pouvaient utilement guider ses réflexions et orienter ses travaux.
Au demeurant, la difficulté historique à faire émerger dans l’espace public une vision claire des coûts du nucléaire incitait à s’approprier les démarches entreprises antérieurement par d’autres instances et à s’appuyer sur les résultats acquis dans ce cadre.
C’est pourquoi la commission a décidé de débuter ses investigations en auditionnant les auteurs de trois rapports considérés comme des références. L’objectif était de disposer d’une « toile de fond » de qualité, par rapport à laquelle seraient positionnés par la suite les éléments recueillis au fil du programme de travail.
Trois rapports pour trois approches a priori différentes, mais concordantes en vérité, comme l’ont montré les auditions correspondantes. Il revenait à la Commission de régulation de l’énergie d’exposer la vision d’une autorité administrative indépendante amenée à examiner les coûts du nucléaire pour répondre aux missions qui lui sont fixées par la loi – s’étant traduite, en l’espèce, par la publication du rapport portant Analyse des coûts de production et de commercialisation d’EDF dans le cadre des tarifs réglementés de vente d’électricité (juin 2013). La Cour des comptes avait l’occasion de présenter de vive voix le rapport public thématique publié en janvier 2012 sur Les coûts de la filière électronucléaire, avec toute la précision que l’on pouvait attendre de hauts magistrats rompus à l’évaluation des comptes et des politiques publiques. MM. Jean Desessard, sénateur de Paris, et Ladislas Poniatowski, sénateur de l’Eure, étaient invités à exposer le travail de la commission d’enquête que le Sénat avait constituée sur Le coût réel de l’électricité afin d’en déterminer l’imputation aux différents agents économiques (juillet 2012), son intérêt résidant tout autant dans les conclusions elles-mêmes que dans les conditions ayant conduit à leur adoption.
Ce n’est pas rendre justice à la qualité de ces travaux que les réduire ici à quelques mots, en une synthèse partielle et réductrice. Deux éléments particulièrement forts saillent cependant :
– la France est entrée dans une période d’augmentation durable des coûts de l’énergie en général, de l’électricité en particulier, à laquelle le nucléaire n’échappe pas nonobstant le discours souvent entendu selon lequel le nucléaire « amorti » ne coûte plus grand-chose ; les besoins d’investissements sont tels, pour entretenir ou renouveler le parc et le réseau, que le mythe d’une électricité éternellement bon marché s’estompe inexorablement ;
– le politique doit se saisir de la question des coûts et, plus largement, de la stratégie industrielle des grands acteurs de l’électricité, au moment où il va être amené à se prononcer sur des choix structurants à l’occasion de l’examen du prochain projet de loi sur la transition énergétique ; cette appropriation des sujets énergétiques doit s’inscrire dans la durée.
C’est munie de cet indispensable bagage que la commission a ensuite poursuivi ses travaux.
CHAPITRE 1 : LE NUCLÉAIRE DANS LE SYSTÈME
ÉLECTRIQUE EUROPÉEN
La commission d’enquête avait souhaité organiser le déroulement de ses travaux selon un découpage thématique, l’ensemble des thèmes abordés couvrant l’intégralité des problématiques relatives à la filière nucléaire « de l’amont à l’aval ».
Le présent rapport reflète le fonctionnement suivi au cours de ces six mois de travail. Chaque chapitre est consacré à l’un des thèmes de travail identifiés. Une première partie expose les éléments de contexte nécessaires à la compréhension des travaux de la commission. Une seconde partie fait état des questions qui ont été traitées au cours des auditions ; elle expose le point de vue des participants en extrayant les passages les plus importants de leurs interventions.
A. LE NUCLÉAIRE DANS LE SYSTÈME ÉLECTRIQUE EUROPÉEN
1. Comment le prix de l’électricité est-il formé ?
La formation du prix de l’électricité sur le marché de gros obéit à des règles spécifiques, en raison de deux caractéristiques techniques importantes : d’une part, l’offre et la demande sur le réseau électrique doivent être équilibrées à tout moment pour garantir la stabilité de celui-ci ; d’autre part, aucun mécanisme de stockage à grande ampleur n’est possible à ce jour.
Le prix de l’électricité varie donc à chaque instant, en fonction de l’évolution de la demande et des moyens de production disponibles. Ces derniers sont classés selon leur coût marginal de production, pour former une courbe de merit order. Ils sont appelés dans cet ordre, jusqu’à ce que l’offre égalise la demande. Le fait que les moyens de production ayant les coûts marginaux les plus faibles soient appelés en premier permet de minimiser le prix payé par le consommateur.
Selon une telle structure de marché, le mode de production d’électricité a peu d’importance : seul le coût marginal détermine le taux d’utilisation d’une centrale. Comme l’indique Thierry Morello, chief operating officer et membre du directoire d’EPEX Spot : « l’entreprise EDF traite elle-même ses productions en portefeuille. Au niveau de la commercialisation, donc, elle ne fait pas véritablement de distinction entre les différentes origines. Pour le négociant, l’important est de savoir quel est le coût marginal de production de ses centrales et quelles sont les centrales disponibles ». On distingue traditionnellement, en fonction de leur durée d’utilisation tout au long de l’année, les moyens de production « en base » (le nucléaire, le charbon et l’hydraulique au fil de l’eau) des moyens de production en semi-base (les centrales à cycle combiné gaz) et de pointe (hydraulique avec retenue, centrales au fioul, turbines à combustion, etc.). Signalons toutefois qu’EDF choisit de faire fonctionner le parc nucléaire en suivi de charge et non en base, ce qui constitue une exception notable.
Les énergies éolienne et photovoltaïque bouleversent cette classification : d’un côté, leur faible coût marginal de production les rapproche des moyens de production en base ; de l’autre, leur taux d’utilisation (entre 35 et 50 % pour l’éolien offshore, 22 % pour l’éolien terrestre (5) et 14 % pour le photovoltaïque (6), variable selon les régions) est davantage comparable aux moyens de production de pointe.
2. L’interconnexion des réseaux des États membres : vers un prix de l’électricité européen
Les pays européens unifient progressivement leurs réseaux nationaux, dans le but de former un continuum physique que certains surnomment la « plaque de cuivre européenne ». Par exemple, les capacités d’interconnexion entre la France et les pays avoisinants représentent environ 12 % des capacités de production installées en France à l’export et 11 % à l’import. En 2012, 73 TWh d’électricité ont été exportés et 29 TWh ont été importés, principalement en période de pointe. L’unification des réseaux nationaux est l’un des rares axes forts de la politique énergétique européenne : en application du règlement (CE) n° 347/2013 du 17 avril 2013, la Commission européenne a adopté, le 14 octobre dernier, la première liste européenne de projets d’intérêt commun, qui compte 132 projets électriques. Les projets sélectionnés bénéficieront d’une procédure simplifiée lors de l’attribution des autorisations administratives et d’un cadre de financement attractif.
Pourquoi la construction d’une infrastructure de taille européenne revêt-elle une telle importance ? Elle permet de résorber les situations d’ « îlots énergétiques », comme celle que subit l’Espagne, peu reliée aux autres pays européens. Mais surtout, elle constitue une base sur laquelle se construit le marché unique de l’énergie, fondé sur le couplage des marchés nationaux. À terme, lorsque les capacités de transport seront suffisantes pour qu’il n’y ait pas de congestion aux frontières, un seul prix de gros devrait s’imposer dans l’ensemble de la zone interconnectée. Ce prix de gros s’imposera à l’ensemble des producteurs et sera déterminé par la centrale européenne dont le coût marginal de production permettra d’égaliser l’offre et la demande appréciées au niveau de la zone interconnectée. Comme on le verra par la suite, ce raisonnement théorique souffre, au moins pour l’instant, de nombre d’imperfections.
L’interconnexion des réseaux et le couplage des marchés constituent des instruments d’optimisation des parcs électriques européens. D’une part, ils renforcent la sécurité du système en mutualisant les capacités de production disponibles : plus il y a de moyens de production disponibles, moins la probabilité de défaillance du réseau est élevée ; inversement, l’exploitation coordonnée de plusieurs parcs permet de faire un gain de puissance de réserve. D’autre part, ils génèrent, en moyenne (7), une diminution du prix payé par le consommateur car le système appelle les capacités de production les moins chères sur l’ensemble de la plaque européenne.
Une telle organisation nécessite toutefois une coordination poussée des politiques énergétiques nationales car les conséquences de chacune d’entre elles se répercutent sur les systèmes électriques des autres pays.
Ces éléments montrent que la question de l’évolution du parc nucléaire français ne peut s’abstraire d’éléments de cadrage globaux sur le contexte européen : le nucléaire n’est que l’un des éléments du système électrique interconnecté et doit prendre en compte un certain nombre de paramètres, au premier rang desquels le prix de gros sur les marchés européens.
B. LE NUCLÉAIRE EN EUROPE : DES SITUATIONS SIMILAIRES DANS LES DIFFÉRENTS ÉTATS-MEMBRES, DES CHOIX DE POLITIQUE ÉNERGÉTIQUE DIFFÉRENTS
Dans les trois pays étudiés, l’Allemagne, la Belgique et le Royaume-Uni, le nucléaire « historique » arrive à la fin de vie prévue initialement. Il est intéressant de constater que ces trois pays ont chacun choisi une option différente : l’arrêt définitif, la prolongation ou le renouvellement.
1. En Allemagne : la fin du parc nucléaire historique à la suite d’une décision politique consécutive à l’accident de Fukushima
En septembre 2010, le gouvernement allemand a rendu public un vaste plan d’action dénommé Energiekonzept, qui définit les orientations nationales en matière énergétique d’ici à 2050 ainsi que plus de 140 mesures :
– le développement des énergies renouvelables : elles devront représenter 18 % de l’énergie finale consommée en 2020 et 60 % en 2050 ; au sein des énergies renouvelables, l’électricité renouvelable prendra une part croissante, de 35 % en 2020 à 80 % en 2050 ;
– la baisse de la demande en énergie : par rapport à 2008, elle devra atteindre 20 % en 2020 (en énergie primaire) et 80 % en 2050 pour l’ensemble des secteurs, 10 % et 25 % pour la consommation d’électricité et 20 % et 80 % pour la demande de chaleur dans le bâtiment ;
– la diminution de l’intensité énergétique, au rythme de 2,1 % par an ;
– la réduction des émissions de gaz à effet de serre, par rapport au niveau de 1990, de 40 % d’ici à 2020, 55 % à 2030, et 80-95 % à 2050.
La transition énergétique – Energiewende – a été complétée par une décision, consécutive à l’accident de Fukushima, d’abandon complet du nucléaire avant 2022. La fermeture du parc nucléaire allemand entraînera la fermeture de 21,5 GW de capacités et la disparition de 150 TWh de production, soit respectivement 13 % et 24 % du total national. L’année 2011 était une étape importante avec l’arrêt des huit tranches alors en maintenance, soit une production réduite évaluée à 32 TWh environ.
Un premier bilan transitoire peut être tiré de ces trois années de réduction du parc nucléaire. En 2011, la réduction de production a été compensée grâce à :
– une augmentation considérable de la production d’électricité renouvelable (18 TWh) ;
– une baisse sensible du solde exportateur d’électricité au profit de la consommation intérieure (11 TWh) ;
– une baisse légère de la consommation domestique (3 TWh).
En 2012, les bilans électriques font apparaître :
– une baisse de la consommation d’électricité qui équilibre à elle seule la baisse de la production électronucléaire (9 TWh chacune) ;
– une nouvelle progression des énergies renouvelables (11,5 TWh) qui alimente la progression du solde exportateur (16,5 TWh) ;
– pour ce qui est de la production électrique d’origine fossile, un basculement du gaz (– 12,5 TWh) vers le charbon (+ 13,5 TWh).
2. En Belgique : la prolongation de la durée de vie d’un seul des trois réacteurs les plus anciens par accord entre le Gouvernement et les propriétaires de la centrale
La Belgique dispose de deux centrales nucléaires (Doel et Tihange) équipées de sept réacteurs REP et exploitées par Electrabel. Elles assuraient 54 % de la production d’électricité nationale en 2012.
En janvier 2003, le Parlement fédéral a adopté une loi qui proscrit la construction de nouvelles centrales nucléaires et qui impose la fermeture des centrales existantes après 40 ans d'exploitation, entre 2015 et 2025 ; la loi prévoit toutefois la possibilité de maintenir les centrales en opération sur recommandation de la CREG, le régulateur national, dans le cas où la fermeture des installations menacerait la sécurité des approvisionnements énergétiques du pays.
En octobre 2009, à la suite de la remise du rapport du groupe Gemix (Quel mix énergétique idéal pour la Belgique aux horizons 2020 et 2030 ?), un accord entre le Gouvernement et Electrabel prévoit de prolonger de dix ans la durée de vie des trois réacteurs les plus anciens (Doel 1 et 2, Tihange 1), moyennant une contribution annuelle au budget de l’État comprise entre 215 et 245 millions d’euros de 2010 à 2014, puis fixée chaque année par un comité spécial.
PRÉSENT ET FUTUR DU PARC NUCLÉAIRE HISTORIQUE BELGE
Date de connexion au réseau |
Date d’arrêt programmée | |
Doel 1 |
août 1974 (39 ans) |
2015 (41 ans) |
Tihange 1 |
mars 1975 (39 ans) |
2025 (50 ans) |
Doel 2 |
août 1975 (38 ans) |
2015 (40 ans) |
Doel 3 |
juin 1982 (31 ans) |
Octobre 2022 (40 ans) |
Tihange 2 |
octobre 1982 (31 ans) |
Février 2023 (40 ans) |
Doel 4 |
avril 1985 (29 ans) |
Juillet 2025 (40 ans) |
Tihange 3 |
juin 1985 (29 ans) |
Septembre 2025 (40 ans) |
Source : CEA, Les centrales nucléaires dans le monde, édition 2012
Le 3 juillet 2012, l’autorité de sûreté belge, l’AFCN (Agence fédérale de contrôle nucléaire), rend son avis sur les propositions de l’exploitant quant à la poursuite de l’exploitation de Doel 1 et 2 et de Tihange 1. Elle conclut que « l’approche présentée et le plan d’amélioration qui en découle sont adéquats » et que « les propositions faites par l’exploitant permettront une augmentation claire du niveau de sûreté des unités ». Elle identifie cependant « des points où des éclaircissements ou des investigations complémentaires étaient encore nécessaires ».
La Belgique décide toutefois de faire un pas vers l’arrêt du nucléaire sur son territoire. Au lieu de prolonger les trois réacteurs ayant reçu un avis favorable de l’AFCN, seul Tihange 1 devrait continuer à fonctionner au-delà de quarante ans : le 4 juillet 2012, les pouvoirs publics actent le prolongement de la durée de vie de Tihange 1 de dix ans jusqu’en 2025 parallèlement à la fermeture de Doel 1 et 2 en 2015, conformément au calendrier prévu par la loi de 2003. Le choix de Tihange 1 au détriment de Doel 1 et 2 s’explique par des considérations économiques : la prolongation des réacteurs de Doel aurait été plus coûteuse. Un accord est conclu entre le Gouvernement et les propriétaires de la centrale, EDF et Electrabel, pour prolonger Tihange 1 moyennant la réalisation d’ « investissements de jouvence » d’un montant de 600 millions d’euros, partagés à parts égales entre EDF et Electrabel. Cet accord prévoit que les pouvoirs publics prélèveront une redevance à hauteur de 70 % de la marge réalisée par les exploitants de la centrale – ce qui devrait dégager une somme comprise entre 1 et 1,2 milliard d’euros sur dix ans, destinée au soutien des énergies renouvelables –, tout en permettant la rémunération des investissements de jouvence à hauteur de 9,3 %. La fermeture des quatre autres réacteurs doit toujours suivre le calendrier initial.
Le calendrier de fermeture définitive des réacteurs belges pourrait toutefois être modifié, en raison de l’arrêt imprévu des réacteurs de Doel 3 et Tihange 2 pour des raisons de sûreté. À l’été 2012, l’exploitant avait découvert des défauts dans la cuve des réacteurs de Doel 3 et Tihange 2. L’AFCN avait autorisé la reprise de leur fonctionnement en mai 2013, à la condition qu’Electrabel satisfasse un certain nombre d’exigences, au nombre desquelles la réalisation d’études des propriétés mécaniques d’un matériau irradié présentant des indications de défauts. Les tests réalisés dans ce cadre, en mars 2014, ont révélé des résultats non conformes aux attentes des experts, ce qui a poussé Electrabel à arrêter les réacteurs de Doel 3 et Tihange 2 par mesure de précaution. Leur éventuel redémarrage ne pourra être envisagé que si d’autres tests permettent de montrer que l’effet de l’irradiation sur l’acier des cuves n’affecte pas ses propriétés.
Avant que les tests ne soient effectués, M. Jacques Repussard, directeur général de l’IRSN, avait pourtant déclaré devant la commission d’enquête, le 27 février 2014, que la poursuite de l’exploitation de ces réacteurs était une solution raisonnable :
« M. Jacques Repussard. L’examen en profondeur de la couche d’acier des cuves belges a révélé de très nombreuses microfissures. Notre expertise a été sollicitée pour déterminer si elles étaient dues à l’irradiation en service ou s’il s’agissait d’un défaut d’origine. L’enquête a été difficile car la société ayant fabriqué ces cuves n’existait plus, mais elle a conclu qu’il s’agissait bien d’un défaut d’origine. Si ces microfissures ne présentaient pas en elles-mêmes un grand caractère de nocivité, du fait de leur très grand nombre, les modèles mathématiques dont nous disposons n’ont pas permis de déterminer de manière probante leur impact sur la tenue du matériau. Les autorités belges ont jugé peu vraisemblable que survienne une rupture brutale et ont donc choisi de redémarrer les réacteurs en mettant en place un programme de surveillance […]
« M. le président François Brottes. Qu’auriez-vous conseillé si un tel incident s’était produit en France ?
« M. Jacques Repussard. Les microfissures concernaient deux cuves belges, soit un tiers de la capacité de production. Dans ces conditions, l’IRSN n’avait pas de raison d’insister sur la nécessité de maintenir les réacteurs à l’arrêt.
« M. le président François Brottes. Est-ce dangereux ou non ?
« M. Jacques Repussard. Ma conviction personnelle est que ce n’est pas vraiment dangereux et que la mise en place d’un programme de surveillance est une solution raisonnable ».
Cet exemple illustre, s’il en était encore besoin, que la connaissance sur l’évolution des cuves de réacteurs sous l’effet des radiations reste encore très partielle, ce qui conforte la position de l’ASN selon laquelle aucune garantie ne peut être donnée sur l’allongement de la durée de vie des réacteurs.
3. Au Royaume-Uni : le lancement du renouvellement du parc nucléaire
En raison de la forte composante carbone de son mix électrique – le gaz et le charbon y représentent respectivement 41 % et 29 % en 2011 –, le Royaume-Uni s’est engagé dans une stratégie de décarbonation reposant sur deux piliers :
– la mise en place d’un prix plancher du carbone, croissant de 16 ₤/tonne en 2013 à 30 ₤/tonne en 2020 et 70 ₤/tonne en 2030 ;
– une réforme du marché de l’électricité, prévoyant des tarifs d’achat pour l’ensemble des sources de production non carbonées, par le biais de « contracts for difference » (8).
Cette stratégie coïncide avec la nécessité de renouveler une part importante du parc électrique : 40 % des sites de production d’électricité doivent être démantelés au cours des quinze prochaines années. Le Gouvernement anticipe un besoin de capacités nouvelles de 60 GW d’ici à 2025, dont 35 GW à partir de renouvelables.
Pour les Britanniques, le nucléaire a vocation à prendre une place importante dans leur futur énergétique, à travers la fermeture du parc historique et la construction de nouveaux réacteurs. Le Royaume-Uni compte seize unités en exploitation, représentant une puissance électrique de 9,2 GW et une production de 64 TWh en 2013. Le prolongement de la durée de vie de ces unités au-delà de quarante ans est en débat. Néanmoins, les perspectives concernent surtout la construction de 16 GW de capacités nucléaires nouvelles d’ici à 2030, soit 12 réacteurs sur 5 sites. Pour atteindre cette cible, que le Gouvernement a fixée en collaboration avec l’industrie nucléaire, deux projets ont déjà été lancés :
– Hinkley Point C : ce projet porte sur la construction de deux réacteurs de type EPR, pour un montant de 16 milliards de livres, à travers un « contract for difference » de 92,5 ₤/MWh, qui serait ramené à 89,5 ₤/MWh si un second projet de construction de deux réacteurs de type EPR à Sizewell C aboutit ; le projet est mené par la filiale d’EDF au Royaume-Uni, EDF Energy, et financé par une structure partenariale au sein de laquelle le groupe EDF est actionnaire à 45-50 %, AREVA à 10 % et deux opérateurs nucléaires chinois à 30-40 % ; le contrat fait actuellement l’objet d’un examen par la Commission européenne afin de vérifier s’il respecte la réglementation européenne relative aux aides d’État.
– deux à quatre réacteurs ABWR pourraient être construits par Hitachi-General Electric sur les sites d’Oldbury et Wylfa.
Contrairement à la France, l’Allemagne, la Belgique et le Royaume-Uni ont d’ores et déjà fait des choix de transition énergétique clairs. Même si ces choix peuvent être remis en cause à l’occasion de changements de majorité ou d’évolutions imprévues du contexte, ils donnent aux acteurs de marché une visibilité importante qui leur permet d’adapter leur stratégie économique aux orientations nationales. La commission d’enquête a ainsi souhaité entendre des acteurs et des spécialistes de ces pays, de façon à en tirer des enseignements pour ses propres travaux sur le parc nucléaire français.
II. LES APPORTS DE LA COMMISSION D’ENQUÊTE
A. LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE : UN CHOIX POLITIQUE… SOUS CONTRAINTES
1. Des choix divergents entre les États membres qui illustrent le caractère politique des choix de transition énergétique
En sollicitant des personnalités et des acteurs ayant un regard sur les pays voisins de la France, la commission d’enquête a fait apparaître des choix de politique énergétique très différents entre les États membres de l’Union européenne.
L’Allemagne et le Royaume-Uni prennent ainsi des directions diamétralement opposées. D’un côté, le Royaume-Uni a fait le choix de se tourner vers le « nouveau nucléaire », en mettant en place un cadre favorable à la construction de deux EPR à Hinkley Point. La loi de 2013 prévoit une réforme du marché de l’électricité devant favoriser les infrastructures d’électricité sobre en carbone. Comme l’explique Humphrey Cadoux-Hudson, directeur exécutif « Nouvelles constructions nucléaires » d’EDF Energy : « le Gouvernement a obtenu l’appui des trois grandes formations politiques pour la réforme du marché de l’électricité et pour le redémarrage du nucléaire : la Déclaration de politique nationale pour la production d’énergie nucléaire a été adoptée par 267 voix contre 14 en juillet 2011 – un moment significatif – et l’amendement du parti écologiste, qui proposait de revenir sur la partie nucléaire de la loi sur l’énergie, a été rejeté par 502 voix contre 20 en juin 2013. Et l’on constate un soutien croissant de l’énergie nucléaire au sein de la population – 67 % des citoyens britanniques sont en effet favorables à ce que l’énergie nucléaire fasse partie de notre futur mix énergétique ».
De l’autre, l’Allemagne, après deux décisions contradictoires (9), fait le choix d’accélérer la sortie du nucléaire après la catastrophe de Fukushima. Selon Andreas Rüdinger, le paquet législatif, adopté en 2011, dans lequel était inscrite la décision de sortie du nucléaire, fait l’objet d’un quasi-consensus, puisque 83 % des députés ont voté en sa faveur et plus de 90 % des Allemands soutiennent la sortie du nucléaire.
Deux pays peuvent décider, grâce à une loi adoptée à la quasi-unanimité dans chacun des cas, de se lancer dans deux politiques opposées. Les élus allemands et britanniques ont reflété l’aspiration de leurs citoyens, les uns en considérant que le risque nucléaire était trop important, les autres en donnant au nucléaire une place importante au motif qu’il est une source de production d’électricité décarbonée compétitive. En cela, ils font la démonstration que la transition énergétique est un sujet politique.
La France doit à son tour se prononcer sur son avenir énergétique et rester maîtresse de ses choix quant à l’avenir de son parc nucléaire. Pierre Bornard, vice-président du directoire de RTE, le reconnaît : « Pour RTE, donc, le mix énergétique de demain relève de la décision politique. Quoi que l’on décide, nous saurons le faire techniquement ».
Des choix de transition énergétique assumés feront l’objet d’une appropriation citoyenne. En Allemagne, les grands énergéticiens sont longtemps restés très frileux en refusant d’investir dans les énergies renouvelables. « Jusqu’en 2006, ils ont soutenu des recours devant les instances européennes, arguant que le dispositif des tarifs d’achat violait les règles de marché. Ils se sont donc battus contre le développement des énergies renouvelables sans y prendre part » (Andreas Rüdinger). Ce sont les particuliers qui ont pris le relais et les petits producteurs, notamment les projets citoyens, ont connu un fort essor.
2. Des contraintes techniques et financières
Aucune des personnes auditionnées ne s’est opposée à la légitimité du pouvoir politique pour orienter les choix de transition énergétique. En revanche, comme le rappelle Pierre Bornard, « il y a néanmoins des précautions à prendre. Le choix d’un mix énergétique donné emporte des conditions précises […]. La seule cause d’échec, c’est le déni de réalité : il faut absolument envisager et traiter l’ensemble des conséquences de tel ou tel choix ».
En premier lieu, le système électrique est soumis à une série de contraintes techniques. L’électricité étant un produit qui, pour l’instant, ne se stocke pas ou très peu (10), la production et la consommation doivent s’équilibrer en permanence, faute de quoi des événements catastrophiques de type black-out risquent de survenir. Ces caractéristiques nécessitent, d’une part, d’intégrer au réseau les nouveaux moyens de production et de trouver des solutions à la variabilité de l’offre (foisonnement, stockage, auto-consommation, smart grids) et, d’autre part, de développer des moyens d’ajuster la demande (efficacité énergétique, effacement).
Autre contrainte technique, l’intégration au réseau de moyens de production décentralisés peut se faire rapidement – l’Italie a ainsi construit 9000 MW de capacités photovoltaïques dans la seule année 2012, soit l’équivalent en puissance installée de dix réacteurs comparables à Fessenheim –, mais requiert le déploiement, l’adaptation et le renforcement du réseau électrique. Or, la construction d’une ligne de grand transport prend huit à dix ans. Pierre Bornard en conclut qu’ « il est donc possible de gérer les problèmes, mais à condition de bien anticiper et de bien articuler les différentes temporalités. »
Les choix de politique énergétique sont dans le même temps soumis à des contraintes financières (par exemple le financement de la recherche), dans un contexte de rareté des ressources budgétaires, de contrainte sur les budgets des ménages et de déficit de compétitivité industrielle.
À l’aune des exemples étrangers, la France doit se doter des outils qui lui permettront, avec la participation de l’ensemble des acteurs du secteur, de se lancer définitivement dans la transition énergétique, sans en sous-estimer pour autant les difficultés techniques et les contraintes.
B. UN DIAGNOSTIC PARTAGÉ SUR LA SITUATION DU SYSTÈME ÉLECTRIQUE EUROPÉEN, DEUX PISTES DE SOLUTION
1. Le diagnostic : un accroissement de la variabilité du système et une pénétration croissante du charbon qui posent la question du modèle de rémunération des capacités de production
En l’espace de quelques années, le système électrique européen a été soumis à deux bouleversements majeurs qui n’avaient pas été anticipés.
Le premier changement est l’accroissement de la variabilité du système due à l’introduction massive des moyens de production éoliens et photovoltaïques. « L’importance que le solaire et l’éolien ont prise en Allemagne aboutit en effet à des phénomènes dits de ramping : la montée progressive – la « rampe » – de la production photovoltaïque au cours de la journée ne correspond pas forcément avec celle de la demande, qui commence un peu avant le jour » (Thierry Morello). La question de l’excès de vent a également soulevé des difficultés pour l’industrie éolienne. « En cas de tempête dans le Nord de l’Allemagne, la production éolienne atteint son maximum puis, quand le vent dépasse 90 km/h, les éoliennes s’arrêtent pour se mettre en sécurité. Le phénomène n’est pas absolument instantané mais les baisses de puissance peuvent atteindre 5000 à 6000 MW en l’espace de quinze ou vingt minutes » (Pierre Bornard). La hausse de la part des énergies renouvelables variables est incontestablement un défi technique, mais qui a toutes les chances d’être relevé comme le démontre leur montée en puissance impressionnante en Allemagne, Danemark, Espagne, Portugal, Italie… Au même titre que les gestionnaires de réseau se sont adaptés à l’intégration d’unités de production de grandes tailles – la mise en service de l’EPR a nécessité des investissements importants et pourrait poser de nouvelles questions –, ils parviendront à faire augmenter la part de capacités de production intermittentes dans le mix électrique pour repousser le seuil maximal de 30 % (en tout état de cause loin d’être atteint dans notre pays).
Le second bouleversement est l’écroulement de la rentabilité des moyens de production « traditionnels » hors charbon, en raison du regain de compétitivité de ce dernier. À un contexte de forte baisse du prix du carbone s’est ajouté l’effet de l’exploitation des gaz de schiste aux États-Unis induisant une offre surabondante de charbon, confirmé par l’ensemble des intervenants. Ce phénomène est tangible dans tous les pays européens. « Le prix du charbon étant inférieur à celui du gaz au Royaume-Uni, la part du charbon a augmenté récemment » (Humphrey Cadoux-Hudson). La substitution de centrales à charbon à des centrales à gaz se lit de façon très directe dans les évolutions statistiques de la production électrique entre 2011 et 2012.
ÉVOLUTION DE LA PRODUCTION D’ÉLECTRICITÉ
À PARTIR DE CHARBON ET DE GAZ ENTRE 2011 ET 2012
En TWh
Charbon |
Gaz | |
Royaume-Uni |
+32 |
-47 |
Allemagne |
+23,1 |
-23,3 |
Espagne |
+11,2 |
- 12 |
France |
+ 5 |
-7,3 |
Source : Andreas Rüdinger.
La conjonction de ces deux phénomènes conduit à réduire de façon significative la rentabilité des centrales thermiques à gaz, pour lesquelles le coût variable représente une part importante du coût total de production, mais sans doute aussi des centrales nucléaires. Les avis sont partagés quant à savoir si cette baisse de rémunération résulte de la situation de surproduction en base sur le marché européen – en d’autres termes, faut-il fermer des moyens de production existants, notamment nucléaires, pour rétablir des prix de marché suffisants ?
La réponse à cette question est loin d’être évidente : si, en moyenne, le système électrique est en situation de surproduction, il est important de conserver des moyens de production non intermittents, dits « programmables », pour faire face à des périodes de tension sur la demande.
Gwenaëlle Huet, directrice des affaires européennes de GDF Suez, affirme ainsi que « la crise nous a placés en situation de surcapacité, et nous constatons en Europe un phénomène rapide et massif de fermeture de centrales extrêmement flexibles ». Elle précise toutefois que : « nous sommes en moyenne en surcapacité, et en sous-capacité dans les périodes de pointe ».
Pour autant, plusieurs intervenants estiment que le problème ne se résume pas à une opposition base-pointe. Les problèmes de pointe électrique perdurent, notamment en France : « la puissance maximale appelée au cœur de l’hiver par des températures froides s’accroît en France deux fois plus vite que la consommation » (Pierre Bornard) et la thermo-sensibilité de la consommation électrique française est la plus importante de toute l’Europe : une baisse de 1° C en hiver requiert la mise en route de 2300 MW de capacités supplémentaires. Mais les moments de tension peuvent intervenir à tout moment, lorsque l’offre est supérieure à la demande, ou, au contraire, lorsque les moyens de production intermittents font défaut. « Quant à la surproduction, il peut arriver en effet que ce produit non stockable qu’est l’électricité soit en fort excédent. Pour autant, cela ne signifie pas que nous soyons en surcapacité structurelle : à d’autres moments, on manquera au contraire de capacités. Les prix bas peuvent donc caractériser des moments de surproduction, mais ce n’est pas contradictoire avec les périodes de forte tension » (Pierre Bornard). De plus, l’augmentation de la part du solaire et de l’éolien dans le système électrique diminue, en moyenne, le besoin en électricité de base, mais les moyens de production réguliers restent nécessaires pour faire face aux situations où vent et soleil font défaut.
À capacités de production égales, le remplacement de centrales thermiques, aux coûts variables importants, par des capacités de production renouvelables, au coût marginal très faible en raison de l’importance de l’investissement initial, modifie radicalement la courbe du merit order. C’est en réalité l’ensemble du modèle économique basé sur le coût marginal qui est remis en question.
« La production a plutôt tendance à être en excédent en période de faible consommation […]. Je ne crois pas qu’il y ait de surproduction. Le parc actuel fait face à la demande. Les prix bas s’expliquent moins par une hypothétique surproduction que par l’ordre de préséance économique » (Thierry Morello).
Ce constat recoupe le diagnostic du rapport du Commissariat général à la stratégie et à la prospective (CGSP) (11) : « le secteur de l’électricité européen est en train de passer d’un “monde d’OPEX” à un “monde de CAPEX”. Cette transition comporte des implications importantes pour l’évolution de l’architecture des marchés de l’électricité concurrentiels. Si, en théorie, la fixation du prix au coût marginal est compatible avec une partie du « mix de production » caractérisée par des coûts marginaux de court terme très faibles, voire nuls, en l’absence d’une demande qui pourrait répondre de façon plus élastique aux variations de l’offre, les prix risquent de devenir très volatils du fait de l’augmentation de la part des énergies renouvelables et de la marginalité de plus en plus fréquente des technologies dotées de coûts marginaux de court terme nuls. Ainsi, le risque est que les prix deviennent égaux à ou proches de zéro (et puissent même devenir négatifs) pendant de longues périodes et que les coûts fixes des centrales thermiques doivent alors être récupérés en quelques heures, générant ainsi des prix extrêmement élevés ».
Une telle situation pourrait poser des problèmes à moyen et long terme. Aucune capacité de production n’est désormais rentable sans aide, ce qui ne permet pas d’anticiper des besoins de renouvellement ou de transition importants : « Si le débat sur l’électricité est aussi passionné depuis quelques années, c’est que nous sommes à la fin d’un cycle d’investissements : les deux tiers du parc de production européen doivent être remplacés d’ici à 2025-2030 » (Claude Turmes, député européen).
Les auditions tenues par la commission d’enquête pointent les menaces qui pèsent sur la transition énergétique européenne, nécessaire tant d’un point de vue environnemental que géopolitique, dont la crise ukrainienne rappelle l’acuité – Claude Turmes rappelle ainsi que l’Europe importe pour près de 500 milliards d’euros par an d’énergies fossiles – : la mise en œuvre de la politique climatique européenne, basée sur l’efficacité énergétique, l’intégration croissante des énergies renouvelables et le passage à une économie bas-carbone ne seront possibles qu’en faisant évoluer les instruments de régulation économique.
2. Deux pistes : introduire un véritable « signal carbone » ou rémunérer la capacité et la flexibilité
L’ensemble des acteurs s’accordent sur la nécessité de « reconnecter » les politiques climatique et énergétique européennes. Alors que la politique européenne s’est construite essentiellement sur un marché energy only, c’est-à-dire rémunérant uniquement le kilowattheure, la politique climatique a montré les limites de ce fonctionnement en favorisant le développement des énergies renouvelables. Ces dernières, dont le coût marginal de production est très faible et qui bénéficient dans certains cas d’une priorité d’injection sur le réseau, sont très bien placées dans le merit order et diminuent de ce fait le taux d’utilisation des autres moyens de production. Pourtant, le maintien des capacités de production de back-up existantes est important pour préserver la sécurité d’approvisionnement du système électrique dans les années futures et assurer ainsi le succès de la transition énergétique.
Pour parvenir à résoudre cette contradiction, deux moyens sont envisagés.
La première solution vise à introduire une incitation économique à la production décarbonée à travers l’accroissement du prix du carbone. Une telle mesure aurait pour avantage d’accroître le prix de l’électricité produite à partir de charbon, ce qui laisserait un espace économique aux centrales à cycle combiné gaz. « Ne nous leurrons pas, si le charbon ne paie pas la pollution qu’il génère – et à 10 euros par tonne, il ne la paie pas –, l’éolien, le solaire et le nucléaire ne pourront jamais le concurrencer » (Claude Turmes). Une telle mesure aurait un second avantage : elle permettrait de diminuer le poids financier des aides accordées aux énergies renouvelables, qui sont calculées par différence.
Toutefois, les récentes décisions de la Commission européenne ne semblent pas assurer un relèvement rapide du prix du carbone : « après la décision prise [en janvier 2014] à Bruxelles de laisser 7 % des émissions dans le système, il est très probable que, d’ici à 2025, le prix du carbone restera extrêmement bas ».
La seconde solution consiste à modifier le market design européen en introduisant une nouvelle composante dans le prix de l’électricité. Rémunérer la capacité et la flexibilité permettrait de donner une valeur économique aux services rendus par les capacités de production, de stockage ou d’effacement qui s’adaptent à l’équilibre entre l’offre et la demande. La grande majorité des personnes auditionnées semblaient considérer cette évolution comme inéluctable : « Nous proposons d’engager une réflexion sur le nouveau modèle de marché « energy only » car s’il reflète la valeur de l’énergie sur le marché de gros, il n’attribue aucune valeur à la sécurité d’approvisionnement » (Gwenaëlle Huet) ; « dans le prix du kilowattheure acquitté par le consommateur final, le coût de la sécurité d’approvisionnement devrait être intégré » (Pierre Bornard) ; « il faut également que les marchés rémunèrent à sa juste mesure la flexibilité » (Manuel Baritaud, analyste senior « Électricité » de l’Agence internationale de l’énergie).
Toutefois, Claude Turmes attire l’attention sur les précautions à prendre en introduisant de nouveaux mécanismes de subvention dans un système électrique déjà très complexe à piloter : « Les marchés de capacité nationaux ont des effets pervers. GDF Suez ne saura pas si elle doit situer son nouvel outil à Strasbourg ou de l’autre côté de la frontière […] Je souligne à cet égard l’incohérence dont fait preuve GDF Suez en demandant la fin des subventions pour les énergies renouvelables tout en voulant les conserver pour les unités de production d’énergies fossiles ».
C. LE NUCLÉAIRE : UNE ÉCONOMIE « À PART » REQUÉRANT UNE FORTE IMPLICATION DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
Les séances de la commission d’enquête consacrées aux exemples britannique et belge reflétaient les débats principaux ayant cours dans ces deux pays, centrés autour de thématiques financières.
En Belgique, la principale question abordée concerne la captation de la « rente nucléaire » générée par le prolongement du parc nucléaire historique. L’existence d’une telle rente ne semble faire l’objet d’aucune contestation : avec la réalisation d’investissements de jouvence pour un montant de 600 millions d’euros – significativement moins élevé que les investissements prévus sur les réacteurs français –, le coût de production de Tihange 1 devrait se situer en deçà du prix de marché. Cette situation justifie l’instauration d’un prélèvement sur le chiffre d’affaires de l’opérateur du parc nucléaire : ce dernier ne doit pas tirer un avantage démesuré d’un parc nucléaire qui a été financé par les consommateurs belges. La mise en œuvre d’un tel prélèvement supposait de déterminer le coût de production du nucléaire historique. Alors qu’Electrabel souhaitait que le coût calculé assure une rémunération suffisante de son capital, de façon à permettre les investissements de jouvence, le Gouvernement avait intérêt à ce que ce coût soit le moins élevé possible. Les enjeux d’une telle discussion étaient d’autant plus importants que, contrairement à la France, Electrabel est un opérateur privé : l’appropriation de la rente par l’opérateur n’aurait donné lieu à aucune compensation pour le consommateur belge.
Au Royaume-Uni, le débat oppose les partisans du nucléaire, qui considèrent que cette technologie est la plus compétitive parmi les énergies décarbonées, à ceux qui la contestent, au motif que le coût de production du nucléaire est sous-estimé.
Défenseur de l’option « nouveau nucléaire » au Royaume-Uni, Humphrey Cadoux-Hudson estime que les estimations de coût de la construction des EPR d’Hinkley Point sont robustes. Contrairement à celles de l’EPR de Flamanville, elles n’ont que peu varié au cours du temps et ont fait l’objet de nombreux contrôles croisés entre le constructeur et le ministère de l’énergie britannique : « le gouvernement britannique a minutieusement étudié les coûts et la rentabilité du projet, en y associant des experts tiers, et a jugé qu’ils étaient raisonnables ». Les deux EPR fourniront ainsi de l’électricité à un prix stable de 92,5 £/MWh, à comparer avec le coût de production des autres moyens de production décarbonés : « 140 £/MWh pour l’éolien en mer, et 90 £/MWh pour l’éolien terrestre, montant auxquels il faut ajouter le coût systémique de l’intégration au réseau, ce qui est beaucoup plus cher que le projet de Hinkley Point ».
À l’inverse, Stephen Thomas, professeur en Études énergétiques à l’Université de Greenwich, dénonce les choix de politique énergétique du gouvernement britannique. Le prix garanti obtenu par EDF Energy est bien trop élevé : il équivaut à un coût de 9,6 milliards d’euros par réacteur, soit plus que le coût de construction de Flamanville et d’Olkiluoto, qui sont pourtant des têtes de série sur lesquelles « tout ce qui pouvait aller de travers est effectivement arrivé ». De plus, ce prix n’aurait pas pu être obtenu sans la garantie du Trésor britannique, qui fait in fine porter le risque industriel sur les contribuables. Le contrat conclu avec EDF court sur quarante-quatre ans de tarifs garantis, soit une durée très supérieure aux tarifs accordés aux moyens de production renouvelables. Il peut donc constituer une distorsion de concurrence majeure, ce qui fait l’objet d’un examen par la Commission européenne.
CHAPITRE 2 : L’AMONT DU CYCLE NUCLÉAIRE.
ASSURER LA SÉCURITÉ DE L’APPROVISIONNEMENT DU
PARC NUCLÉAIRE FRANÇAIS EN TOUTE TRANSPARENCE
A. DES RESSOURCES RELATIVEMENT DIVERSIFIÉES ET ABONDANTES EN URANIUM QUI ASSURENT UNE SÉCURITÉ DE L’APPROVISIONNEMENT ET ENTRETIENNENT DES PRIX ASSEZ BAS
L’uranium est une matière première sur laquelle les risques d’approvisionnement sont mesurés, et ce pour trois raisons.
En premier lieu, les ressources en uranium naturel, que ce soit les ressources connues avec un degré de certitude raisonnable (RAR) ou les ressources identifiées (12), sont relativement abondantes.
PERSPECTIVES DE CONSOMMATION D’URANIUM
Ressources (MtU) |
Nombre d’années de production (*) | |
Ressources RAR |
4,379 |
75 ans |
Ressources identifiées |
7,097 |
122 ans |
(*) Pour une production d’uranium de 58 000 tonnes en 2012
Source : Uranium 2011 : resources, production and demand, Nuclear Energy Agency, 2012
En deuxième lieu, ces ressources sont peu soumises au risque géopolitique : elles sont bien réparties sur l’ensemble de la planète et majoritairement situées dans des pays considérés comme stables.
RÉPARTITION DES RESSOURCES MONDIALES
(ressources identifiées, coût d’extraction < 130 $/kg)

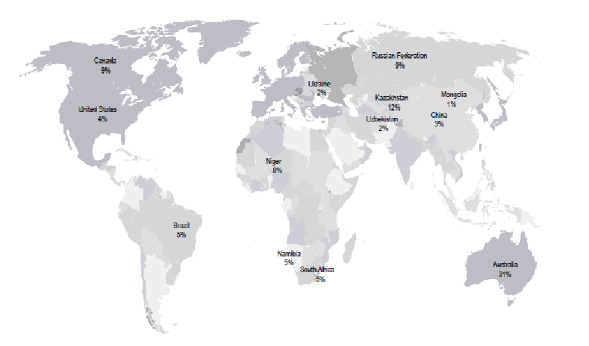
Les pays disposant des ressources identifiées les plus importantes sont l’Australie (31 %), suivie du Kazakhstan (12 %), de la Russie et du Canada (9 %). 44 % des ressources sont concentrées dans des pays de l’OCDE (Australie, Canada et États-Unis). De plus, ces pays disposent des gisements parmi les moins chers à exploiter : le Canada possède 52 % des ressources identifiées extractibles à un coût inférieur à 40 $/kg et l’Australie représente à elle seule 44 % des ressources extractibles à un coût inférieur à 80 $/kg.
RESSOURCES IDENTIFIÉES SELON LE COÛT DE PRODUCTION (EN TU)
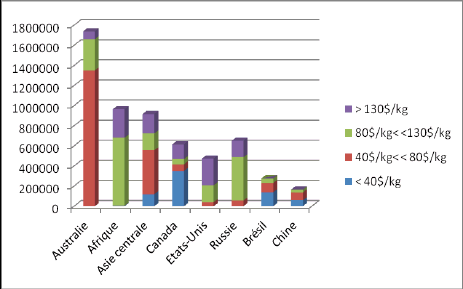
En dernier lieu, trois types de sources complémentaires s’ajoutent à la production minière d’uranium naturel :
– les stocks d’uranium anciens : jusque dans la deuxième moitié des années 1980, l’offre d’uranium était supérieure à la demande, alimentant la constitution de stocks importants, à hauteur de 150 000 tonnes au maximum, soit 5 fois le besoin annuel de l’époque ;
– les matières fissiles issues du retraitement : 200 tonnes de Mox réduisent d’environ 2 000 tonnes les besoins en uranium naturel (voir le chapitre 6) ;
– les stocks issus des arsenaux militaires : la fin de la guerre froide a réduit la demande d’uranium à des fins militaires mais a aussi permis la mise sur le marché de certains stocks d’uranium fortement enrichi ; les États-Unis et la Russie ont ainsi conclu un accord, en 1993, prévoyant l’appauvrissement et l’achat par les États-Unis de 500 tonnes d’uranium russe sur vingt ans ; 30 tonnes traitées chaque année réduisent d’environ 9 700 tonnes les besoins en uranium naturel (soit 15 %).
La demande globale d’uranium est assez aisément prévisible. Le parc nucléaire commercial mondial compte 435 réacteurs, d’une puissance totale de 370 GWe : cela représente un besoin annuel de 78 000 tonnes d’oxyde contenant 66 000 tonnes de métal uranium. Les facteurs susceptibles de faire évoluer cette demande n’interviennent qu’à la marge :
– la consommation d’uranium de chaque réacteur ne varie que très peu car, en général, les réacteurs nucléaires fonctionnent en base et non en suivi de charge ; de plus, les modifications relevant de la gestion des cœurs, comme la hausse du taux de combustion ou du taux d’enrichissement, n’ont quasiment pas d’impact ;
– les réacteurs utilisant la filière de Mox sont connus ;
– seules les évolutions liées au processus d’enrichissement sont susceptibles d’avoir un effet : une extraction plus efficace de l’U235 permet de réduire les besoins en uranium naturel.
Par conséquent, les projections de demande d’uranium reflètent essentiellement les projections de puissance installée. En période optimiste, ces projections se sont quasi-systématiquement révélées supérieures à ce qu’a montré la réalité.
COMPARAISONS DES BESOINS EN URANIUM PROJETÉS ET RÉELS ENTRE 1982 ET 2000
(En tonnes d’uranium)
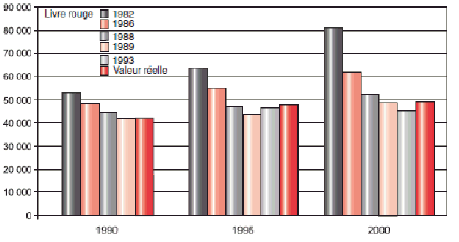
Le graphique compare les prévisions d’uranium contenues dans les éditions 1982 à 1993 des « livres rouges » de l’AEN pour les années 1990, 1995 et 2000 à la consommation constatée ces mêmes années.
Source : Ressources, production et demande de l’uranium : un bilan de quarante ans, Agence de l’OCDE pour l’énergie nucléaire.
Le renouvellement du parc nucléaire s’effectue, par ailleurs, à un rythme lent : indépendamment des incertitudes concernant le parc japonais, à l’arrêt depuis Fukushima, l’année 2012 a ainsi connu trois mises en service de réacteur (deux réacteurs en Corée du Sud et un en Russie) contre trois arrêts définitifs (deux réacteurs britanniques et un réacteur canadien).
S’agissant de l’offre, elle a fortement progressé entre 2005 et 2012, passant de 42 000 à 58 000 tonnes (+38 %). Cette hausse s’explique quasi-intégralement par la politique très ambitieuse du Kazakhstan, dont la production est passée de 4 400 à 21 000 tonnes sur la même période. Dans le même temps, les deux autres grands pays producteurs ont fortement diminué les tonnages extraits (-23 % pour le Canada et –27 % pour l’Australie).
Au total, le différentiel entre la demande et la production d’uranium se réduit : il était de 65 % en 2005, contre 86 % aujourd’hui.
Conséquence de ces tendances, les prix de l’uranium sont considérés comme relativement bas. Les prix spot et les prix de long terme sont de 35 et 50 dollars par livre d’U3O8 à la fin de l’année 2013, soit des niveaux très inférieurs à ceux atteints ces dernières années.
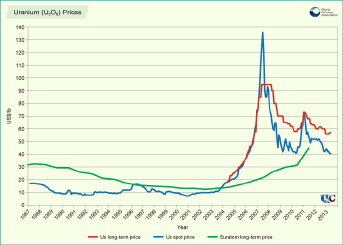
À la fin 2006, le « renouveau du nucléaire », ainsi que l’épuisement des stocks accumulés jusque dans les années 1980, font craindre une pénurie d’uranium. À cette date, la politique de développement du Kazakhstan n’a pas encore abouti et le différentiel entre la production et la consommation est alors de 65 %. Par conséquent, les prix spot passent de 40 à 137 dollars la livre, atteignant ainsi un record historique. Les prix de long terme, bien que moins spéculatifs, grimpent tout de même à près de 100 dollars la livre. C’est d’ailleurs dans ce contexte d’emballement des prix que se déroule l’acquisition très controversée d’UraMin par AREVA (13). Deux facteurs expliquent le retournement subit qui s’est produit : le réalignement de l’offre sur la demande, mais également la catastrophe de Fukushima, en mars 2011, qui a mis un frein très net à la perspective de renouveau du nucléaire.
S’il n’existe pas de facteurs de tension sur le court et le moyen terme, deux phénomènes pourraient cependant menacer la sécurité d’approvisionnement sur le long terme et contribuer à accroître les prix de l’uranium dans le futur :
– la politique chinoise de constitution de stocks stratégiques, accompagnant le développement de son programme nucléaire ;
– la hausse du coût d’extraction de l’uranium avec l’extinction progressive des gisements les plus rentables ; bien que les ressources identifiées aient globalement augmenté, les ressources « bon marché » ont enregistré un net recul depuis 2009, principalement en raison de la hausse des coûts d’extraction (baisses de 14 % pour la tranche de coûts < 40 $/kgU et de 18 % pour la tranche de coûts < 80 $/kgU).
RESSOURCES IDENTIFIÉES MONDIALES PAR COÛT D’EXTRACTION (en MtU)
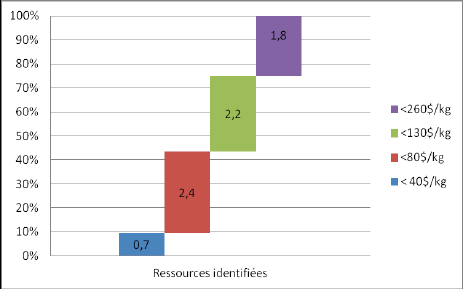
Cette tendance à la hausse des coûts de production est confirmée par Sylvain Granger, directeur de la division « combustible nucléaire » d’EDF : « de nombreuses mines d’uranium découvertes dans les années soixante et soixante-dix sont en déclin. Ce qui est arrivé en France, où on n’extrait plus d’uranium depuis 2001, va se répéter dans d’autres régions du monde. C’est pourquoi nous sommes entrés dans un cycle de réinvestissement minier. Alors que l’investissement réalisé dans ces anciennes mines était presque amorti, il est à nouveau nécessaire d’apporter du capital. Il en résulte une augmentation structurelle des prix.
« Pour savoir si cette évolution va perdurer et pour évaluer le niveau auquel le prix de l’uranium pourrait se stabiliser, il importe donc d’apprécier le coût complet de développement des nouvelles mines, qui varie d’une région à l’autre : alors qu’il est d’environ 30 dollars la livre au Kazakhstan, il peut atteindre ailleurs 60 à 70 dollars. Toutes ces mines ne seront pas exploitées : si de très grandes comme Cigar Lake et Olympic Dam peuvent être développées à un coût raisonnable, on peut envisager un équilibre entre l’offre et la demande rendant inutile l’ouverture des mines plus coûteuses.
« Selon nos propres estimations, toutefois, le prix de l’uranium pourrait monter jusqu’à 60 dollars la livre dans les dix prochaines années. Dans cette hypothèse, l’augmentation à venir serait plus modérée que celle que nous venons de connaître au cours des dix dernières années où, de 10 à 20 dollars, il est passé à 40 dollars. »
B. UNE FAIBLE DÉPENDANCE DU PRIX DE L’ÉLECTRICITÉ NUCLÉAIRE AU PRIX DE L’URANIUM
Contrairement à la fabrication d’électricité à partir de ressources fossiles, le prix de l’uranium ne joue que pour une faible part dans le prix final de l’électricité nucléaire, pour des raisons industrielles – la nécessité de fabriquer un combustible –, mais aussi du fait des propriétés physiques de l’uranium.
1. Plusieurs étapes entre la mine et le combustible
L’uranium extrait des mines, sous forme de yellow cake, n’est pas utilisable en l’état. Il subit donc une série de transformations, qui réduisent d’autant la part de la valeur du l’uranium naturel dans la valeur ajoutée totale du combustible nucléaire :
– l’uranium naturel subit d’abord une première étape de conversion : il est successivement raffiné, pour en garantir la pureté, transformé en tétrafluorure d’uranium puis en hexafluorure d’uranium et converti de l’état solide à l’état gazeux, pour rendre possible l’étape d’enrichissement ;
– l’enrichissement se justifie par les propriétés de l’uranium naturel. 1 kg d’uranium contient 993 grammes d’uranium 238 (U238), contre seulement 7 grammes d’uranium 235 (U235). Or, le fonctionnement des combustibles des réacteurs à eau sous pression (REP) demande une teneur en U235 comprise entre 3 % et 5 %, car seul cet isotope peut subir la fission nucléaire générant de l’énergie. L’opération consistant à augmenter la proportion d’U235 est fondée sur la différence de masse entre les deux isotopes et peut se réaliser selon deux méthodes différentes, la diffusion gazeuse et la centrifugation ;
– enfin, la fabrication des combustibles – l’assemblage – consiste à fabriquer des pastilles d’oxyde d’uranium puis à les enfiler dans de longs tubes métalliques, les gaines. Ces gaines sont scellées de façon à former des « crayons ». Le produit final, l’assemblage de combustibles, est composé de 264 crayons : il s’agit de l’élément qui sera chargé dans le cœur du réacteur nucléaire.
L’ensemble de ces étapes nécessitant des transformations industrielles lourdes, le coût de l’approvisionnement en uranium naturel ne représente donc qu’une faible part du coût total du combustible. Selon les estimations d’AREVA, les importations d’uranium naturel coûtent entre 500 et 600 millions d’euros par an à EDF, soit un tiers de ses dépenses annuelles de combustible, estimées par la Cour des comptes à 1 500 millions d’euros.
La France dispose, avec AREVA, d’un acteur présent sur l’ensemble de la chaîne du combustible :
– la conversion de l’uranium s’effectue dans les usines Comurhex de Malvési, à Narbonne, et de Pierrelatte (Drôme) ;
– l’enrichissement est réalisé dans l’usine Georges Besse 2, sur le site du Tricastin ; pendant plus de trente ans, AREVA a utilisé la technologie de l’enrichissement par diffusion gazeuse dans l’usine Georges Besse 1 ; toutefois, la centrifugation, bien moins consommatrice d’énergie, s’est imposée comme la technologie de référence en matière d’enrichissement ; AREVA a donc signé un accord avec la société Urenco pour y avoir accès et l’a mise en œuvre dans l’usine Georges Besse 2, entrée en production en avril 2011 ;
– enfin, AREVA procède à l’assemblage de combustibles d’oxyde d’uranium dans l’usine de Romans et de combustibles Mox dans celle de Marcoule (voir le chapitre 6).
L’amont du cycle nucléaire est donc une filière industrielle technologiquement maîtrisée sur le territoire français.
2. Un contenu énergétique bien plus important que les ressources fossiles
L’uranium est un combustible à haute densité énergétique. Selon Sylvain Granger, une tonne d’uranium naturel permet de produire la même quantité d’énergie thermique que 10 000 tonnes de pétrole, 10 000 tonnes de gaz naturel liquéfié ou 14 000 tonnes de charbon. Ainsi, le fonctionnement d’un réacteur nucléaire d’une puissance de 1 000 MW nécessite chaque année 150 tonnes d’uranium naturel alors qu’il faut 1,5 million de tonnes de charbon pour produire la même quantité d’électricité dans une centrale à charbon supercritique.
Ces propriétés physiques contribuent fortement à faire baisser la part du combustible dans le coût total de l’électricité produite. Selon la Cour des comptes, les dépenses de combustible nucléaire représentent 3,7 €/MWh en 2010 hors coût du portage des stocks.
II. LES APPORTS DE LA COMMISSION D’ENQUÊTE
Au cours d’auditions se tenant à huis clos, les deux acteurs majeurs de la filière nucléaire française, AREVA et EDF, ont exposé leur stratégie en matière de gestion de leur approvisionnement en uranium et leur positionnement dans la chaîne du combustible. Les représentants du Ministère des affaires étrangères et du Ministère de l’énergie ont également présenté le rôle joué par l’État.
La commission d’enquête a, par ailleurs, relevé l’importance des moyens déployés pour surveiller la gestion de matières nucléaires et prévenir les risques de prolifération, au cours des déplacements qu’elle a effectués dans les installations d’AREVA, à La Hague comme à l’usine d’enrichissement Georges Besse 2. Le rôle joué par l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) a pris un relief tout particulier, marqué par la présence de nombreuses caméras, les contraintes posées au fonctionnement des installations au quotidien et la possibilité d’effectuer à tout moment des inspections dédiées au contrôle des matières.
A. AREVA : UN ACTEUR MONDIAL DE L’AMONT DU COMBUSTIBLE
1. Les activités minières : diversifier les sources d’approvisionnement en uranium
Les activités minières représentent 15 % du chiffre d’affaires d’AREVA (1,4 milliard d’euros) et 10 milliards d’euros de carnet de commande. En 2012, l’entreprise a produit 8 641 tonnes d’uranium naturel et fait partie des quatre plus gros producteurs mondiaux.
Tonnages d’uranium (tU) |
Part de marché | |
KazAtomProm (Kazakhstan) |
8 900 |
15 % |
AREVA (France) |
8 600 |
15 % |
Cameco (Canada) |
8 400 |
14 % |
ARMZ – Uranium One (Russie) |
7 600 |
13 % |
Rio Tinto (Australie) |
5 400 |
9 % |
BHP Billiton (Australie) |
3 400 |
6 % |
Total |
58 400 |
100 % |
Source : World Nuclear Association
La particularité d’AREVA par rapport à ses concurrents est d’être implanté dans toutes les grandes zones de production hormis l’Australie : « notre entreprise bénéficie déjà d’une relative diversification géographique de sa production, avec un site au Kazakhstan, deux mines au Niger et un site au Canada. C’est là une spécificité par rapport à nos concurrents, qui sont généralement beaucoup plus concentrés géographiquement : KazAtomProm ne produit qu’au Kazakhstan et de grands concurrents comme Rio Tinto ne le font en général que dans deux pays » (Luc Oursel).
Site |
tonnes U |
% du total |
Somaïr (Niger) |
2.819 |
29,0 |
Cominak (Niger) |
709 |
7,3 |
Katco (Kazakhstan) |
3.661 |
37,7 |
usine McArthur (Canada) |
2.271 |
23,4 |
installation pilote de Trekkopje (Namibie) |
251 |
2,6 |
Total 2012 |
9.714 |
100,0 |
AREVA poursuit sa stratégie de diversification, de façon à répondre à l’objectif qu’elle se fixe : maintenir dans son portefeuille des réserves supérieures à vingt années de besoins – ces réserves atteignent aujourd’hui vingt-huit années.
Cette stratégie passe par le développement de projets miniers de grande ampleur. Il s’agit en premier lieu de la mine de Cigar Lake, dans laquelle AREVA détient 37 % des participations. En application de la loi canadienne, Cigar Lake est détenue en majorité par Cameco : « Au Canada, la loi qui interdisait à un opérateur étranger de posséder plus de 49 % d’un gisement minier et imposait donc systématiquement le recours à un opérateur canadien a été abrogée à la suite des négociations qui ont eu lieu avec l’Union européenne. Nous pourrons ainsi intensifier nos activités dans ce pays ». Cette mine se caractérise par des teneurs en uranium très élevées et par une exploitation entièrement automatisée. Quant à la mine d’Imouraren, au Niger, elle représente une capacité de 5 000 tonnes par an ; selon Luc Oursel, « afin d’éviter le risque de déséquilibre que pourrait avoir la mise immédiate sur le marché d’une telle quantité d’uranium, nous réfléchissons au moment qui serait le plus opportun pour le lancement de cette production ». D’autres projets de développement et d’exploration sont également menés, en Mongolie, au Gabon et au Canada. En revanche, le site de Trekkopje a été mis sous cocon.
AREVA achète également de l’uranium sur les marchés : « Nous avons ainsi acquis, à la suite de l’arrêt des centrales du pays, des stocks détenus par les consommateurs japonais et nous avons commercialisé, à des fins évidemment pacifiques, une partie de l’uranium hautement enrichi mis sur le marché au terme d’un programme de démantèlement des armes russes et américaines, soit 2 600 tonnes. »
Cette diversification, que ce soit par l’activité minière ou les achats sur le marché, est essentielle. Elle permet à AREVA de proposer des prix stables à ses clients sur le long terme : « notre diversification géographique assure notre crédibilité lorsque nous prenons à l’égard de nos clients des engagements de long terme. Nous pouvons ainsi signer des contrats comportant une forte composante de prix de long terme ou établissant un lien entre prix et coûts de production. Nous sommes ainsi moins sensibles que certains de nos concurrents aux variations du prix spot. »
2. Les activités de transformation de l’uranium : gagner des clients grâce à des offres « packagées »
L’activité amont représente 22 % du chiffre d’affaires d’AREVA (soit 2,1 milliards d’euros). On ignore souvent qu’avant même d’entrer dans le réacteur, l’uranium est transporté 6 fois et transformé 5 fois. La première préoccupation d’AREVA sur cette branche d’activité est de diversifier son portefeuille de clients, ce qui passe par la normalisation de ses relations avec son partenaire historique, EDF : « La relation avec EDF est bien évidemment essentielle mais, comme pour l’ensemble de nos activités, notre objectif est d’être présents dans le monde entier auprès des électriciens nucléaires. Avec 25 % du chiffre d’affaires d’AREVA, EDF en est aujourd’hui le premier client, mais non le seul, les 75 % restants étant réalisés sur le marché international. »
Le positionnement d’AREVA sur l’ensemble de l’amont du cycle nucléaire permet au groupe de gagner des clients, par capillarité, pour l’ensemble de ses activités : « Il n’est pas rare, par exemple, que nous nouions une relation commerciale en commençant par fournir un service de maintenance ou d’enrichissement, puis que nous étendions peu à peu notre présence en proposant l’ensemble de nos services, que ce soit au coup par coup ou dans le cadre d’offres « packagées » où nous vendons à la fois de l’uranium naturel et des activités de conversion et d’enrichissement, voire de fabrication de combustible. »
Par ailleurs, AREVA tire des bénéfices du « modèle intégré ». Comme le reconnaît Luc Oursel devant la commission d’enquête, le 20 mai 2014, « la rentabilité des activités nucléaires s’est lentement érodée entre 2006 et 2011, ainsi que le relève la Cour des comptes ». Les difficultés rencontrées par la division nucléaire du groupe ont pu être compensées par les résultats plus positifs rencontrés sur d’autres activités : « l’activité minière d’AREVA enregistrera en 2013 des résultats économiques remarquables et sera l’un des contributeurs majeurs au redressement de l’entreprise que nous avons engagé ».
3. La position d’AREVA dans la controverse qui l’a opposé au gouvernement nigérien
Le 5 février 2014, lors des questions au Gouvernement, Pascal Canfin, ministre délégué chargé du développement, était interpellé sur le sujet de l’activité d’AREVA au Niger (14). En réponse à une question de Noël Mamère, il déclarait que « [le gouvernement nigérien et AREVA] se sont mis également d’accord sur une date limite, la fin du mois de février, afin de parvenir à un accord compatible avec les conditions d’exploitation de l’uranium d’AREVA mais aussi, je vous le dis très clairement, afin de permettre au Niger d’augmenter les recettes fiscales auxquelles il a droit. Car les demandes du Niger sont considérées par le présent Gouvernement, ce n’était pas le cas du précédent, comme légitimes ». Devant la commission d’enquête, le lendemain, Luc Oursel a tenu à présenter la situation et préciser la position d’AREVA dans la controverse qui l’oppose au gouvernement nigérien au sujet des mines de la Somaïr et de la Cominak.
AREVA considère qu’elle ne peut plus répondre aux exigences fixées par la loi minière adoptée en 2006, en raison de la diminution de rentabilité de ces mines : « Les mines du Niger sont parmi les plus coûteuses de notre portefeuille de production. De fait, le coût des mines a tendance à augmenter avec le temps et l’exploitation des deux mines de la SOMAÏR et de la COMINAK est déjà ancienne – la fin des gisements devrait du reste survenir vers la fin de la décennie […]. En 2006, période de renaissance nucléaire qui ouvrait des perspectives d’augmentation beaucoup plus importante des prix de l’uranium naturel et où le prix spot était bien plus élevé qu’aujourd’hui, le Niger avait adopté une nouvelle loi minière qui, si elle était intégralement appliquée aujourd’hui, mettrait immédiatement les exploitations existantes en lourd déficit, les condamnant à court terme. »
Par ailleurs, l’entreprise considère que son apport économique et social est déjà largement positif au niveau local : « Pour la période récente, 70 à 80 % des bénéfices des mines ont été attribués au Niger, qui en est actionnaire, et cette part n’a cessé d’augmenter au cours des dernières années ». « Les achats nécessaires au fonctionnement des mines du Niger s’élèvent à environ 180 millions d’euros par année, dont plus de la moitié faits auprès d’entreprises locales. En outre, bien qu’en règle générale l’industrie minière soit très capitalistique et ne soit pas créatrice d’emplois au prorata de son chiffre d’affaires, nos activités génèrent dans le pays, comme je l’ai dit, 6 000 emplois directs et indirects ». « Nous avons construit des hôpitaux, que nous faisons fonctionner et dont l’accès est gratuit pour la population d’Arlit, les employés d’AREVA ne représentant que 30 % des consultants. »
Enfin, selon Luc Oursel, interrogé par le rapporteur, il n’existe aucune preuve de l’existence d’effets sanitaires de l’exploitation minière sur les travailleurs nigériens : « un observatoire est destiné à examiner l’état sanitaire des anciens travailleurs des mines et nous recherchons – ce qui n’est pas facile – les personnes ayant travaillé pour la COGEMA, puis pour AREVA, pour la COMINAK et pour la SOMAÏR. Sur près de 350 qui ont déjà été retrouvées, il n’a pas été mis en évidence de cas avérés où le travail dans le domaine minier aurait eu un impact sur la santé. » Cette évaluation fait cependant l’objet d’un désaccord avec les ONG Sherpa, Médecins du Monde et la CRIIRAD.
Les discussions entre AREVA et le gouvernement nigérien ont finalement abouti à la signature d’un accord, le 26 mai dernier, qui prévoit :
– des taux de redevance allant de 5,5 % à 12 % sur le chiffre d’affaires des mines de la Somaïr et de la Cominak, en contrepartie d’une exonération de TVA ;
– le report de l’ouverture de la mine d’Imouraren selon un calendrier déterminé par un comité stratégique paritaire en fonction de l'évolution du marché ;
– le financement par AREVA de deux projets de développement locaux, pour un investissement de 107 millions d’euros ;
– l’attribution des postes de directeur général de la Somaïr et de la Cominak à des ressortissants nigériens.
B. EDF : UN CLIENT MAJEUR CHERCHANT À RÉDUIRE SA VULNÉRABILITÉ
Leader mondial de la production nucléaire, avec cinquante-huit réacteurs, EDF cherche avant tout à réduire sa dépendance vis-à-vis de ses fournisseurs. La stratégie poursuivie par l’électricien français vise à réduire à sa plus petite part les risques pesant sur le cycle amont du nucléaire.
1. Premier objectif : sécuriser l’approvisionnement en combustible nucléaire
EDF assure la sécurité de l’approvisionnement en combustible de ses centrales par plusieurs moyens.
Tout d’abord, l’énergéticien cherche à diversifier la provenance de l’uranium naturel qu’il utilise : « Notre stratégie de portefeuille consiste à faire approximativement correspondre les zones de provenance de notre combustible à la part qu’elles représentent dans la production mondiale. Cela signifie que nous achetons principalement de l’uranium canadien, australien et kazakh même si, en réalité, toutes les zones de production mondiales sont sollicitées pour nous approvisionner, y compris l’Afrique – Niger et Namibie –, la Russie et l’Ouzbékistan. Et, par exemple, la part du Niger dans nos achats – 10 à 20 % comme je l’ai dit – reste supérieure à sa part dans la production mondiale, de l’ordre de 6 %. ». EDF intervient également à chaque maillon de la chaîne du combustible : par exemple, elle peut réaliser des arbitrages entre l’achat d’uranium naturel et celui d’uranium enrichi, en fonction du prix relatif de l’uranium naturel et de l’enrichissement : « Il n’est pas sans intérêt de noter qu’elle a une certaine latitude pour arbitrer entre investissement dans la matière première et investissement dans l’enrichissement : elle peut charger les réacteurs, soit avec une plus grande quantité d’uranium naturel moins enrichi, soit avec de l’uranium plus enrichi mais en moindre quantité. »
Dans le même temps, EDF élargit le panel de ses fournisseurs à l’ensemble des acteurs dominants du marché (Cameco, BHB Billiton, Rio Tinto). AREVA conserve toutefois une place importante, bien que décroissante, dans l’approvisionnement des centrales nucléaires françaises : « À cet égard, AREVA est notre partenaire principal : il nous fournit à peu près 40 % des services de conversion et d’enrichissement, une proportion significativement supérieure à celle de ses capacités de production rapportées aux capacités mondiales. »
Point le plus important, l’État impose à EDF des obligations réglementaires de détention de stocks stratégiques. L’article L.143-1 du code de l’énergie dispose que : « En vue de remédier à une pénurie énergétique y compris localisée ou à une menace sur l'équilibre des échanges extérieurs, le Gouvernement peut, par décret en conseil des ministres, et pour une période déterminée, soumettre à contrôle et répartition, en tout ou en partie, les ressources en énergie et en produits énergétiques de toute nature, ainsi que les produits pétroliers, même à usage non énergétique, et les produits dérivés ou substituables y compris les produits chimiques ». Le décret n° 2010-1466 du 1er décembre 2010 prévoit un tel contrôle pour une période expirant au 31 décembre 2017. En application de ce décret, la directive Besson du 22 décembre 2010 demande au président d’EDF la constitution d’un stock stratégique de combustibles jusqu'à cette date. Ces stocks représentent un peu plus de deux années de consommation. La Cour des comptes a chiffré leur valeur à 7,5 milliards d’euros (15) au 31 décembre 2010 et leur coût de portage à 600 millions d’euros par an.
2. Deuxième objectif : sécuriser les prix dans la durée
Plutôt que d’adopter une politique agressive d’optimisation, EDF privilégie la stabilité des coûts par le recours prioritaire aux contrats de long terme : « l’anticipation et la contractualisation à long terme sur chacun des segments de la chaîne d’approvisionnement […] permettent de limiter considérablement les effets d’une volatilité des prix et, dans le meilleur des cas, d’obtenir un avantage économique sur la durée. Ainsi, au cours des dix dernières années, alors que le prix spot de l’uranium naturel a un peu plus que triplé en raison de l’entrée dans un nouveau cycle d’investissement minier, le coût de l’approvisionnement en combustible pour EDF – achat d’uranium, conversion, enrichissement et fabrication – a augmenté de moins de 20 %. »
Le cas échéant, des clauses de renégociation permettraient à EDF de se dégager de ses obligations en cas de forte divergence entre les prix spot et les prix de long terme : « ces contrats comportent systématiquement des options et des clauses de flexibilité, nécessaires pour que nous puissions nous adapter à la demande. Dans le cas, exceptionnel, où une option se révèle plus chère que le prix du marché spot, il est possible de ne pas la lever et d’acheter de l’uranium sur ce marché. »
COÛT D’APPROVISIONNEMENT EN URANIUM
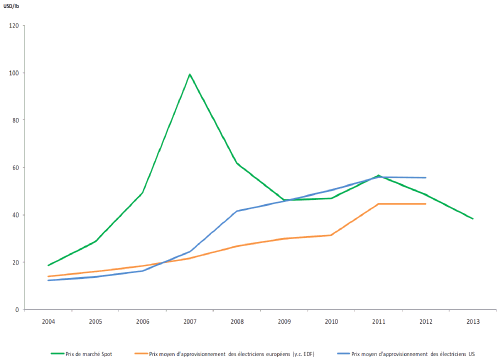
Source : Cour des comptes, Le coût de production de l’électricité nucléaire. Actualisation 2014, d’après EDF
Compte tenu de ces caractéristiques, EDF, au même titre que les autres énergéticiens européens, bénéficierait d’un approvisionnement meilleur marché que ses concurrents américains (cf. graphique supra).
Néanmoins, comme l’indique la Cour des comptes dans le rapport remis à la commission d’enquête, cet avantage pourrait ne pas perdurer en raison de l’expiration de contrats historiques qui permettaient à EDF de bénéficier de prix compétitifs. Cette tendance est confirmée par les déclarations de Philippe de Ladoucette, président de la Commission de régulation de l’énergie : « la période 2010-2012 a vu arriver à échéance un certain nombre de contrats d’approvisionnement à des prix inférieurs aux prix de marché, avec des conséquences à la hausse sur le coût amont du combustible. Cette tendance va vraisemblablement se poursuivre dans le futur étant donné la hausse des coûts d’approvisionnement d’uranium […] Au total, le coût du combustible, qui a été de l’ordre de 5 euros par MWh en 2013, devrait vraisemblablement avoisiner les 7 euros par MWh en 2015 » (audition du 9 janvier 2014).
C. L’ÉTAT : LE RÉGULATEUR D’EDF, L’APPUI D’AREVA
Le premier rôle de l’État est de contrôler le respect de l’obligation des stocks stratégiques. La dépendance française au nucléaire justifie que l’État contrôle la sécurité d’approvisionnement en uranium du parc des réacteurs. Il s’assure donc qu’EDF remplit ses obligations : « EDF fait une déclaration annuelle qui est vérifiée. La constitution d’un stock fait partie, à côté de la diversification des fournisseurs et des pays d’origine, de la panoplie de mesures que les entreprises peuvent prendre pour assurer la sécurité de leur approvisionnement. Mais pour EDF et pour elle seule, il s’agit d’une contrainte juridique » (Charles-Antoine Louët). Si EDF se fixe comme objectif de limiter la part d’AREVA à 40 % de son approvisionnement, c’est en accord avec l’État : « M. le président François Brottes. Cette contribution à hauteur de 40 % résulte-t-elle d’un choix d’EDF ? Ne subissez-vous pas, dans le cadre du conseil de politique nucléaire, des pressions pour la réduire ?
« M. Sylvain Granger. Ces questions sont en effet examinées régulièrement avec les services de l’État, lors des réunions du conseil de politique nucléaire ou dans d’autres cadres. »
L’État propose également un appui diplomatique à AREVA dans ses relations avec les pays producteurs et leur société civile : « je rappelle que le réseau diplomatique apporte un soutien aux entreprises dans leurs relations avec les pays qui détiennent des mines d’uranium ou qui envisagent d’en ouvrir. En effet, comme vous l’avez indiqué, monsieur le président, les interlocuteurs des entreprises françaises sont souvent des sociétés d’État et les questions d’exploitation minière sont traitées dans ces pays au plus haut niveau politique » (Yves Kaluzny). Le ministère des Affaires étrangères contribue à favoriser l’acceptation des implantations minières par les populations locales : « après la récente signature par AREVA et une société mongole d’un accord créant une société minière pour mettre en exploitation des gisements prometteurs, les premières actions consisteront à expliquer aux populations ce que sont réellement les implantations minières et à insérer cette activité dans le tissu économique local ». Il peut aussi intervenir en cas de difficulté : il a, par exemple, joué le rôle de facilitateur entre AREVA et l’État du Niger en proposant la désignation d’un médiateur, M. François Bujon de l’Estang. AREVA bénéficie par ailleurs d’une protection militaire dans les zones qui le demandent : « il existe des consignes et des coopérations avec les États pour assurer la sécurité des sites, notamment dans le Sahel ».
Enfin, l’État est le garant de la pérennité de la filière industrielle française. À ce titre, il s’assure qu’AREVA dispose de suffisamment de commandes pour maintenir ses capacités de production : « L’État, bien entendu, s’assure que les usines de cette entreprise trouvent des débouchés et observe le taux de diversification d’EDF. S’il considère que ce taux descend au point de mettre en péril les bases industrielles françaises, il peut demander un réexamen. L’enjeu n’est pas de contraindre l’électricien national à commander à AREVA, mais de disposer d’un outil industriel performant qui puisse vendre aussi bien à EDF qu’à d’autres électriciens. Lorsque des opérations importantes d’investissement et de rénovation sont nécessaires dans notre pays et que d’autres pays choisissent de ne pas réinvestir, nous devons alors pouvoir demander à EDF de participer à la couverture des surcoûts. »
L’implication de l’État est donc particulièrement forte sur les questions d’amont du cycle nucléaire. Les travaux de la commission d’enquête contribuent à faire le point sur les relations qui le lient avec les deux acteurs français, AREVA et EDF, et soulignent à quel point l’activité nucléaire est liée à des enjeux stratégiques internationaux.
CHAPITRE 3 : CHARGES DU PARC EN EXPLOITATION : MAINTENANCE ET SOUS-TRAITANCE
A. LA MAINTENANCE, UN ENJEU MAJEUR POUR LA MAÎTRISE DES COÛTS DU PARC NUCLÉAIRE
1. La qualité des opérations de maintenance, une condition de la sûreté et de la performance économique du parc
« Comme tout outil industriel, le parc nucléaire exige un entretien régulier pour fonctionner de manière pérenne, en toute sûreté, avec des performances attendues » (Henri Proglio, président-directeur général d’EDF). Pour les centrales nucléaires, les activités de maintenance, grâce auxquelles est assuré l’« entretien » évoqué par Henri Proglio, concernent les parties nucléaires ou les parties dites « conventionnelles » (salle des machines, etc.) ; dans l’un ou l’autre cas, ces activités peuvent avoir un impact sur la sûreté, les activités exercées en zone nucléaire étant naturellement plus sensibles à cet égard.
C’est pour cette raison que la maintenance des installations est soumise au regard de l’Autorité de sûreté nucléaire. Celle-ci considère que la maintenance constitue une ligne de défense essentielle pour prévenir l’apparition d’écarts et maintenir la conformité d’une installation à son référentiel de sûreté ; il faut cependant qu’elle soit correctement réalisée. Pierre-Franck Chevet, président de l’ASN, souligne ainsi que « la maintenance est facteur de sûreté, puisqu’elle vise à entretenir les matériels, notamment de manière préventive, en profitant des arrêts de tranche. On se souvient néanmoins de l’incident de niveau 3 survenu à Gravelines en 1989. Une équipe de la société qui avait travaillé sur l’ensemble des soupapes protégeant le circuit primaire principal avait utilisé de mauvaises vis, ce qui empêchait les soupapes de fonctionner pendant le cycle. De ce fait, le réacteur n’était pas protégé contre les surpressions. L’incident a montré que, faute d’être effectuée de manière rigoureuse, la maintenance peut devenir contre-productive. »
La qualité de la maintenance est donc tout à la fois une question de méthodes, d’organisation industrielle et de moyens financiers et humains. Ces moyens émargent à plusieurs catégories : les dépenses peuvent être constitutives d’immobilisations et être en conséquence comptabilisées au titre des investissements ; elles peuvent aussi relever des charges courantes d’exploitation, notamment les achats de prestations externes ; les moyens humains regroupent les personnels d’EDF et les personnels des entreprises prestataires. Le coût de la maintenance est donc une donnée financière peu accessible en soi.
2. Après un sous-investissement au début des années 2000, des coûts de maintenance désormais en hausse durable
L’effort financier consacré par EDF à l’entretien de son outil de production a été sensiblement réduit au tournant des années 2000, au moment où les centrales ont commencé à atteindre une durée de fonctionnement d’une quinzaine ou vingtaine d’années. Quelque temps après, le parc a été touché par un ensemble d’avaries génériques – sur la partie secondaire des installations – qui a grevé la disponibilité des centrales et dégradé les performances industrielles et la rentabilité du nucléaire. Le taux de disponibilité, qui était supérieur à 80 % jusqu’en 2007, est depuis passé au-dessous de ce pourcentage à l’exception de l’année 2011. Les indisponibilités fortuites ont connu une forte dérive jusqu’en 2010.
INDICATEURS DE PERFORMANCE DU PARC NUCLÉAIRE
(en %)
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 | |
Taux de disponibilité |
81,1 |
82,2 |
82,7 |
82,8 |
83,4 |
83,6 |
80,2 |
79,2 |
78,0 |
78,5 |
80,7 |
79,7 |
78,0 |
Indisponibilités fortuites |
n.c. |
2,5 |
3,0 |
3,5 |
3,2 |
3,3 |
3,7 |
4,4 |
4,6 |
5,2 |
2,2 |
2,8 |
2,6 |
Source : EDF – Inspecteur général pour la sûreté nucléaire et la radioprotection, rapports 2008 à 2013
Pour EDF, le coût direct de la maintenance doit donc être mis en regard du coût d’opportunité résultant de la mauvaise disponibilité des réacteurs. Un jour d’arrêt d’un réacteur représente un manque à gagner d’environ un million d’euros ; toute réduction de la puissance délivrée au réseau résultant d’une avarie sur une quelconque partie de la centrale peut aussi être traduite en manque à gagner.
Étienne Dutheil, directeur-adjoint de la production nucléaire à EDF, a bien précisé à la commission qu’EDF n’avait jamais transigé sur les investissements nécessaires à la sûreté : « les avaries techniques qui conduisent à incriminer d’éventuels défauts d’investissement concernaient des matériels du secondaire, c’est-à-dire de la partie non nucléaire de l’installation – alternateurs ou transformateurs. Dans le même temps, EDF consacrait à l’amélioration des éléments de sûreté l’essentiel des moyens alloués aux modifications. Ce sont là deux champs différents. »
Dans son rapport de janvier 2012, la Cour des comptes montrait qu’un redressement de l’effort financier était visible dès 2003, les dépenses passant de 584 millions d’euros (valeur 2010) à 1 748 millions d’euros (valeur 2010) à l’année 2010. Étienne Dutheil indique qu’« en 2012, les dépenses totales d’investissement de maintenance se sont élevées à 2,748 milliards d’euros et le montant des dépenses d’exploitation liées à la sous-traitance à 1,351 milliard d’euros, soit un total de 4,099 milliards d’euros. » Pour le seul montant des investissements, les dépenses de 2012 se rapprochent donc de la « cible » évoquée à plusieurs reprises devant la commission ou devant votre rapporteur : EDF estime qu’il lui faut réaliser environ 50 millions d’euros par an et par réacteur de dépenses récurrentes d’investissement pour assurer la maintenance ; cela représente, en ordre de grandeur, 3 milliards d’euros par an sur l’ensemble du parc.
Dans le rapport qu’elle a consacré, en juin 2013, à « l’analyse des coûts de production et de commercialisation d’EDF dans le cadre des tarifs réglementés de vente d’électricité », la Commission de régulation de l’énergie (CRE) offre quelques éclairages complémentaires. Elle montre, en premier lieu, que les coûts de production d’EDF relèvent, pour environ un quart, des coûts variables (essentiellement coûts de combustibles et achats d’énergies renouvelables sous obligation d’achat), pour environ un quart, des coûts du capital et pour environ la moitié, des charges fixes d’exploitation ; celles-ci correspondent, pour l’essentiel, à la masse salariale de l’entreprise et à des achats de prestations de maintenance.
La CRE a constaté une augmentation d’environ 5,1 % par an des charges fixes d’exploitation au cours des cinq dernières années, qui traduit la densification des opérations de maintenance. EDF a pu évaluer l’impact des différents paramètres sur la variation du poste des achats d’exploitation. Sans prise en compte de la requalification comptable en investissement d’une partie des charges d’exploitation, les chiffres communiqués par EDF à la CRE conduisent à estimer que 67 % de la hausse totale des achats d’exploitation – hors déconstruction – est due à l’augmentation du volume de la maintenance. L’augmentation du prix des achats d’exploitation représente pour sa part 30 % de la hausse totale, ce chiffre reflétant, en partie, l’augmentation du prix des prestations de maintenance.
Dans son rapport de mai 2014, la Cour des comptes précise que le montant des consommations externes (périmètre un peu différent de celui évoqué dans le présent chapitre car calqué sur une stricte nomenclature comptable) a progressé de 52 % entre 2008 et 2013, une fois les montants correspondants retraités des changements de méthodes comptables. Ces dépenses de consommations externes atteignent 2 892 millions d’euros en 2013, ce qui représente un impact sur le coût de production de l’électricité de 7,16 euros par MWh.
B. LE RECOURS À LA SOUS-TRAITANCE, UN CHOIX DE POLITIQUE INDUSTRIELLE
1. Les justifications du recours à la sous-traitance
Pour AREVA comme pour EDF, le recours à la sous-traitance relève d’une politique industrielle revendiquée et justifiée. Plusieurs objectifs sont mis en avant par les exploitants :
– bénéficier de compétences et de moyens spécialisés ou rares, par exemple les spécialistes des domaines de la ventilation nucléaire, de la détection automatique d’incendie, de la télémanipulation, du rinçage des canalisations ou de grattage des parois, etc. ;
– absorber des pics d’activité ou accroître la réactivité pendant les arrêts programmés d’équipements, d’ateliers, d’installations : certaines opérations de maintenance ont lieu sur une période courte (quelques semaines à quelques mois) et demandent un apport important de main-d’œuvre qualifiée, de plusieurs dizaines ou centaines d’intervenants, pour lesquels le « nomadisme » fait partie intégrante du métier ;
– disposer des meilleures pratiques sur des activités qui ne font pas partie du cœur de métier, notamment les auxiliaires industriels : production et distribution aux installations d’énergie (électrique, calorique, etc.), de fluides (eau industrielle, eau déminéralisée, eau de refroidissement, eau de lavage, etc.), de gaz (air respirable, air comprimé, vapeur haute et basse pression, argon, azote, hélium, etc.), ou encore ventilation des bâtiments ;
– bénéficier d’une compétitivité plus élevée sur des activités qui ne font pas partie du cœur de métier, par exemple les interventions courantes sur les bâtiments (plomberie, éclairage, chauffage, réfection des toitures, portes, fenêtres, revêtements, peintures) ou les services aux occupants (gestion du courrier et des salles de réunion, restauration collective, conciergerie, réseau de transport intrasite, crèche pour les enfants, etc.) ;
– produire des tierces expertises ou réaliser des contrôles indépendants.
AREVA avance également l’intérêt de recourir à des prestataires pour construire des offres plus larges, de produits ou de services, en agrégeant à ses métiers propres des entreprises spécialisées sur des corps de métiers particuliers comme les machines tournantes, la chaudronnerie et la tuyauterie, la robinetterie, les examens et contrôles non destructifs, le génie civil, la logistique nucléaire.
C’est donc autour des deux notions de « cœur de métier » et d’optimisation économique que se construit, pour l’exploitant, le choix entre faire soi-même et faire appel à des prestataires. Pour certains métiers, la dimension technique du choix est dominante ; pour d’autres métiers, l’objectif de baisse des coûts passe au premier plan.
2. La sous-traitance, un phénomène massif
En 2012, l’achat de prestations de services et de travaux par AREVA à des entreprises prestataires extérieures au groupe s’est élevé à 583 millions d’euros pour un montant total d’achats de 1 555 millions d’euros. Ce montant correspond à l’équivalent d’un effectif d’environ 6 000 salariés à temps plein. Cet effectif est une simple estimation car les contrats correspondants sont des contrats avec obligation de résultats, non des contrats de moyens. Le montant annoncé ne tient pas compte des achats effectués auprès des filiales du groupe, qui sont nombreuses et interviennent dans des domaines d’activité variés.
Plus de 95 % de ce montant donne lieu à une activité en France. 60 à 70 % de ces sommes est attribué à des entreprises prestataires localisées à proximité des sites AREVA, dans le département d’implantation ou dans les départements limitrophes.
Les prestations concernées sont principalement des prestations de maintenance, de modification ou de rénovation de systèmes ou équipements (contrôle-commande, moyens de levage, ventilation, électricité, automatismes…), de logistique, de services généraux, d’assainissement radioactif et de démantèlement d’installations nucléaires.
Sur la période 2010-2012, le volume de prestations de services et de travaux passés par AREVA à des entreprises prestataires est resté peu ou prou d’environ 550 millions d’euros. Les variations s’expliquent principalement par l’arrêt de production de l’usine d’enrichissement Georges Besse 1 sur le site du Tricastin, par l’accroissement de l’activité d’assainissement et de démantèlement sur l’usine UP2-400 à La Hague, et par les travaux résultant des évaluations complémentaires de sûreté (ECS) initiées à la suite de l’accident de Fukushima.
Pour sa part, depuis plus de 20 ans, EDF a choisi de confier la majorité des opérations de maintenance sur ses centrales nucléaires à des entreprises prestataires. Le volume de travail concerné s’est élevé à 32 millions d’heures travaillées en 2012, et les entreprises prestataires ont assuré à ce titre près de 80 % de la maintenance des centrales nucléaires, le chiffre d’affaires correspondant s’élevant à plus de 1,5 milliard d’euros. En 2012, quelque 22 000 salariés extérieurs ont ainsi été mobilisés pour ces travaux, dont plus de 19 500 sont intervenus en zone nucléaire.
Certaines entreprises prestataires sont présentes de façon permanente dans les centrales. ; d’autres n’interviennent qu’en arrêt de tranche. À Fessenheim, par exemple, Thierry Rosso, directeur de la centrale, a indiqué à la commission que 250 prestataires travaillent « à demeure » sur le site et qu’un millier d’autres environ les rejoignent pendant les arrêts. « Dans des domaines tels que la logistique ou le nettoyage, la présence permanente sur site de cette main-d’œuvre spécialisée est un gage d’efficacité dans les périodes d’arrêt de tranche » (Étienne Dutheil).
Les spécialités les plus représentées – en effectifs salariés – sont la logistique nucléaire (18 %), la mécanique-machines tournantes (18 %) et les automatismes-électricité (16 %). Viennent ensuite, à hauteur de 7 % chacune, les spécialités de contrôle non destructif, chaudronnerie-tuyauterie, calorifugeage-échafaudages et génie civil ; la robinetterie et le soudage représentent, chacune, 5 % des effectifs de prestataires.
II. LES APPORTS DE LA COMMISSION D’ENQUÊTE
A. EDF N’A PAS ENCORE RECONQUIS LA MAÎTRISE DE LA MAINTENANCE
EDF est dans une phase délicate : les dépenses consacrées à la maintenance sont en croissance depuis maintenant quelques années déjà mais cet effort n’a eu pour l’heure que des conséquences limitées sur la performance du parc. La remise à niveau de l’outil industriel est en tant que telle un processus difficile à piloter, surtout dans un contexte de fort renouvellement des effectifs.
1. Il n’est pas facile de sortir d’une période de sous-investissement dans l’outil de production
Tous les interlocuteurs de la commission d’enquête estiment qu’EDF tire les conséquences de la politique de sous-investissement physique qu’elle avait adoptée au tournant des années 2000. Tout d’abord, la question des moyens a été tranchée et la remise à niveau des centrales s’inscrit dans une perspective globale qui oriente les actions de l’entreprise, en rupture avec les choix précédents. Ainsi, « le sous-investissement dans l’outil de production s’explique par les choix de l’entreprise à l’époque. Aujourd’hui, elle développe un projet industriel qui ouvre des perspectives de fonctionnement dans la durée, ce qui change complètement la donne : elle a donc réinvesti dans ses moyens de production, à la fois pour les fiabiliser et pour s’inscrire dans une perspective de fonctionnement au-delà de quarante ans. Aujourd’hui, EDF consacre des moyens suffisants à la modernisation de ses installations et à leur maintenance, tant sur le plan humain que sur le plan financier » (Étienne Dutheil).
Pour l’ASN, EDF est effectivement entrée dans une démarche de « rattrapage » qui emporte des effets conséquents sur le volume des activités de sous-traitance : « En cinq ans, le volume de travaux réalisés pendant les arrêts de tranche, pour des raisons de disponibilité ou de sûreté, a plus que doublé. Il faut en effet rattraper un sous-investissement de cinq à dix ans en matière de maintenance. Le volume de la sous-traitance devrait encore augmenter de manière significative. »
Les résultats tardent à venir, pourtant, ce qui a amené Étienne Dutheil à vouloir réfuter l’idée selon laquelle les centrales nucléaires d’EDF seraient aujourd’hui moins fiables qu’auparavant. Il souligne qu’il faut distinguer entre la fiabilité des tranches rendues disponibles sur le réseau et les problèmes qui peuvent apparaître pendant les opérations conduites en arrêt : « La vie d’une tranche nucléaire se divise en deux parties : l’arrêt de tranche – assimilable à un arrêt technique –, pendant lequel on renouvelle une partie du combustible et on réalise des opérations de contrôle et de maintenance ; le cycle de production, qui se poursuit jusqu’à l’épuisement du combustible et un nouvel arrêt de tranche. En 2013, la disponibilité des centrales durant le cycle de production a été en moyenne de 97,4 %, et de 99 % pour plus de la moitié des tranches. C’est dire si la fiabilité de redémarrage après arrêt est élevée ; elle a progressé ces dernières années. Le niveau de disponibilité des tranches en marche est comparable à celui qu’on trouve chez les autres exploitants internationaux parmi les meilleurs. »
La précision est certes utile mais n’emporte pas totalement la conviction : si, en effet, le taux d’indisponibilité fortuite a été diminué de 3 points entre 2010 et 2011 et reste désormais inférieur à 3 %, une note communiquée à votre rapporteur par Bernard Laponche montre, sur la base des statistiques diffusées par RTE, que le nombre d’arrêts fortuits avec perte totale de la puissance délivrée au réseau a augmenté en 2013.
Quoi qu’il en soit, ce sont donc les arrêts de tranche qui sont la source des difficultés actuelles. Au cours d’un entretien avec votre rapporteur, Jean Tandonnet, Inspecteur général pour la sûreté nucléaire et la radioprotection d’EDF, a indiqué que la durée des arrêts de tranche en 2013 avait dépassé de 26 jours en moyenne la durée programmée. Il pointe le paradoxe d’une situation dans laquelle EDF démontre une maîtrise très insuffisante de ses arrêts de tranche alors que l’entreprise dispose de l’expérience d’exploitation la plus importante au monde et qu’elle bénéficie d’une ingénierie fortement couplée à l’exploitation. Au-delà des répercussions directes sur la disponibilité des tranches, Jean Tandonnet souligne que les décalages de planning créent un « manque de sérénité » pendant les arrêts et sont donc préjudiciables à la sûreté. Ce diagnostic est confirmé par Pierre-Franck Chevet, qui indique que « lors des inspections que nous effectuons pendant les arrêts de tranche, nous constatons que le temps qu’EDF consacre à la réalisation des travaux dépasse en moyenne de 50 % les prévisions. Or tout écart par rapport au planning compromet la qualité de la réalisation, sinon la sûreté de l’installation. Seul un tiers des dépassements tient à une bonne raison, par exemple au fait qu’une intervention a révélé un problème technique qui appelle une réparation. Dans les deux tiers des cas, la planification initiale a été mauvaise ou la maintenance insuffisante, ce qui implique une seconde intervention. »
Depuis plusieurs années, Jean Tandonnet relève dans ses rapports une baisse de la qualité de la maintenance, qui se traduit d’ailleurs par une augmentation sensible du nombre d’événements significatifs de sûreté (ESS) provenant d’activités de maintenance, tranche à l’arrêt ou en marche. Ces défaillances le conduisent à s’interroger de façon récurrente sur les organisations en place, les ressources disponibles ainsi que sur la rigueur et les moyens. On comprend pourquoi l’ASN souhaite que sa compétence soit étendue à l’inspection des activités des prestataires préalables à leur intervention sur une installation nucléaire, car la sûreté nucléaire ne dépend pas que de ce qui se passe sur l’installation elle-même : « Les textes nous chargent de réaliser des inspections sur les installations nucléaires, mais, lorsqu’un sous-traitant prépare une action de maintenance, il exécute les travaux de préfabrication ou de fabrication en dehors de ces installations. Dans le cadre du projet de loi sur la transition énergétique, voire dans un autre cadre législatif, nous souhaitons être autorisés à inspecter ce travail préalable, dont la qualité est déterminante » (Pierre-Franck Chevet).
EDF est comme prise dans un faisceau de contraintes multiples : d’une part le volume d’activité augmente (« on fait 60 % de choses en plus dans un arrêt de tranche ») et va continuer à augmenter ; d’autre part « il faut beaucoup plus de temps aujourd’hui qu’il y a vingt ans pour réaliser les mêmes opérations, compte tenu de l’évolution du cadre réglementaire et des progrès intervenus dans l’analyse de la sûreté » (Pierre Dambielle, directeur Activités nucléaires d’ORTEC) ; enfin, le temps programmé des arrêts de tranche s’est réduit au fil des années, avec la volonté de comprimer les coûts.
La capacité à planifier correctement les opérations a été identifiée comme un élément clef du problème, donc comme l’un des leviers sur lequel EDF se propose d’agir. L’électricien annonce une nouvelle organisation fondée sur une plus grande autonomie des sites. Étienne Dutheil indique que « traditionnellement, les programmes d’activité étaient définis de façon centralisée pour être ensuite intégrés par les sites pour les arrêts de tranche. […] Pour faire face à l’accroissement d’activité, il va falloir renverser la logique et permettre aux CNPE de définir eux-mêmes, dans une perspective pluriannuelle et, bien sûr, en lien avec le niveau national, la programmation de leurs activités afin de faciliter la maîtrise industrielle des arrêts de tranche. »
De nombreux interlocuteurs s’interrogent sur la solidité du modèle industriel de la maintenance à EDF, alors que l’entreprise s’engage dans le programme d’investissement connu sous le nom de « Grand carénage » et que Jacques Repussard estime que la « demande réglementaire » adressée à l’exploitant pourrait être excessive : « il existe des tensions dans certains sites, et la surcharge de travail pour l’exploitant, les équipes d’ingénierie, les commanditaires, les sous-traitants et les fournisseurs entraîne un allongement des délais de maintenance. Or les décisions de renouvellement des autorisations vont nécessiter beaucoup de travail supplémentaire dans les prochaines années. Il faut donc parvenir à un compromis qui permette de faire davantage en termes de sûreté, sans imposer à ceux qui font fonctionner le système nucléaire des demandes exorbitantes qui constitueraient un stress supplémentaire et pourraient, in fine, déboucher sur une diminution de la sûreté. » Il rejoint en cela certaines remarques dont Jean Tandonnet a fait part, directement à votre rapporteur ou dans son rapport 2013, qui l’ont conduit à souhaiter qu’un dialogue avec l’autorité de sûreté aboutisse à une meilleure priorisation des demandes et prescriptions que celle-ci adresse à l’exploitant.
Il reste que, comme l’indiquait l’ASN, EDF doit ajuster en permanence ses propres prévisions pour ne pas être débordée par les travaux qu’elle a elle-même décidés.
2. La maîtrise des compétences est un enjeu pour tous les acteurs de la filière
Le vieillissement des personnels a suivi celui du parc et EDF n’échappe pas aux effets de l’accélération des départs en retraite, qui l’obligent à se préoccuper du renouvellement des générations. L’ensemble des interlocuteurs de la commission d’enquête est convenu de la réalité de l’effort consenti, en ce domaine, par l’entreprise. En revanche, au cours de l’entretien qu’il a eu avec votre rapporteur, Jean Tandonnet a estimé que EDF a mal anticipé le besoin de préserver les compétences de son personnel et a tardé à engager les politiques correspondantes ; selon lui, on constate aujourd’hui « un retard difficile à rattraper » qui crée de l’inquiétude chez les syndicats et sur les sites.
Le processus est désormais enclenché. Marc-Jacques Kuntz (CFE-CGC) fait part de ce que « l’entreprise embauche beaucoup actuellement, au-delà du simple remplacement des personnes partant à la retraite. Au mois d’août dernier, un accord social a été signé à la division de la production nucléaire (DPN), qui prévoit l’embauche de 2 000 personnes supplémentaires, réparties dans différents secteurs de la direction dont l’effectif atteindra 22 000 personnes. »
La filière dans son ensemble est confrontée à la même nécessité : Damien Gouzy, vice-président du Groupement des Industriels Prestataires Nord Ouest, a présenté à la commission d’enquête l’activité de cette association loi de 1901 qui rassemble 80 entreprises adhérentes sur le territoire des centrales nucléaires de Penly, Paluel et Gravelines : « Pour le volet emplois et compétences, nous assurons la promotion des métiers du nucléaire en travaillant avec les acteurs locaux : maisons de l’emploi, Pôle emploi, conseils régionaux, chambres de commerce et d’industrie. Nous facilitons le lien entre donneurs d’ordre et fournisseurs de services, pour permettre l’embauche, à travers des forums de recrutement, et la formation professionnelle de personnels intervenant dans les sites nucléaires. »
Les prestataires font preuve de volontarisme dans le développement de formations adaptées à leurs besoins. Ainsi Jean-Claude Lenain, président-directeur général de Mistras Group SA, indique embaucher de jeunes personnels et les former en douze à vingt-quatre mois dans l’institut de formation de Chalon récemment créé par son entreprise.
Dans un contexte qui pourrait être marqué par une certaine concurrence des embauches entre EDF et ses partenaires, il semble que les acteurs aient un « réflexe de filière ». D’une part, Pierre Dambielle concède que « EDF a recruté beaucoup de personnel au sein de nos entreprises pour constituer l’effectif de ses sections d’intervention. Un grand groupe possède une aura. En outre, il offre des perspectives de carrière et des conditions de rémunération qui n’ont rien à voir avec celles d’une PME » ; mais il précise que « dans ce domaine, EDF n’intervient pas brutalement. On nous sollicite, sinon pour nous demander notre accord, du moins pour ne pas agir de manière trop brusque. Il nous serait difficile de débaucher quand nous travaillons en arrêt de tranche pendant cinq à six mois. Nous fixons avec EDF la date à laquelle les salariés sortiront de nos effectifs. » D’autre part, l’électricien et les industriels ont engagé des initiatives communes en direction de l’Éducation nationale et des collectivités territoriales en vue de développer l’apprentissage et des formations spécifiques au domaine nucléaire : « Des formations de type baccalauréat professionnel, BTS et Bac+3 ont ainsi été développées en logistique nucléaire – qui inclut la radioprotection – et en robinetterie. En général, les jeunes qui sortent de ces formations trouvent un emploi avant même d’obtenir leur diplôme » (Étienne Dutheil).
Deux questions restent ouvertes, qui pourraient ne pas être sans incidence sur la question des coûts. En premier lieu, la facilité des embauches dépendra de l’attractivité de la filière ; celle-ci ne semble pas menacée à ce jour, sans que l’on puisse dire si les éventuelles tensions de recrutement pourraient conduire prochainement à une « inflation » des salaires. En second lieu, une incertitude subsiste sur l’évolution future des effectifs d’EDF : si le but des embauches récentes est uniquement de préparer dans de bonnes conditions le renouvellement des générations, l’augmentation des effectifs pourrait relever d’un simple « tuilage » favorisant la transmission de l’expérience et des savoirs entre la génération « sortante » et la génération « entrante » ; dans ce cas, l’augmentation des coûts de personnel devrait n’être que transitoire – toutes choses égales par ailleurs. Si, au contraire, EDF considère que l’entreprise doit passer à un palier supérieur en matière d’effectifs, alors la hausse des coûts de personnel sera pérenne.
Les années présentes sont cruciales pour EDF : l’entreprise se propose d’accomplir un effort industriel majeur – le Grand carénage – alors même que ses ressources humaines les plus expérimentées se dérobent avec l’âge. Comme le dit Pierre-Franck Chevet, « l’entreprise est confrontée à un renouvellement massif de ses effectifs, qui concernera, en cinq ans, plus de la moitié du personnel. Les jeunes embauchés se forment tandis que des seniors se préparent à la retraite, ce qui explique peut-être certaines difficultés de planification ou d’organisation des travaux. La gestion prévisionnelle des emplois et des compétences est stratégique pour préparer le grand carénage. »
Une réduction progressive de la taille du parc permettrait d’absorber dans de meilleures conditions l’attrition des compétences due aux départs en retraite de cohortes importantes.
B. LA SOUS-TRAITANCE RESTE UN SUJET DE CONTROVERSES
1. Un débat toujours vif sur l’ampleur du recours à la sous-traitance
Le partage entre le « faire » et le « faire faire » est un point sensible du débat sur l’emploi entre les syndicats et l’entreprise. Dans ce débat, l’Autorité de sûreté nucléaire se veut neutre quant à l’opportunité du recours à la sous-traitance ; seule lui importe la capacité de l’exploitant à maîtriser la sûreté de son installation, ce qui passe notamment par le respect de l’obligation réglementaire de surveillance des activités réalisées par les prestataires, posée par l’« arrêté INB » du 7 février 2012 (16) : « Il faut non seulement qu’EDF conserve en propre la capacité d’exercer une surveillance, en allant contrôler le travail au bon endroit et au bon moment, mais que sa surveillance soit effective » (Pierre-Franck Chevet). L’enjeu n’est pas mince puisque, selon l’ASN, les défauts portant sur la qualité de la maintenance tiennent pour moitié à des problèmes d’organisation ou de planification imputables à EDF, et pour moitié à la qualité des gestes exécutés par les sous-traitants. Mais faut-il donc savoir faire pour « savoir faire faire » et savoir surveiller ?
Tous conviennent que le choix entre « faire » et « faire faire », la décision de sous-traiter telle ou telle activité, est du ressort de l’employeur. Et si Étienne Desdouits (CFE-CGC) estime sans ambages que « les conditions économiques et le besoin de compétences particulières expliquent le recours à la sous-traitance. La maintenance d’un groupe diesel ou frigorifique n’est pas une activité spécifique au nucléaire et l’on souhaite que l’entretien de nos matériels soit assuré par des spécialistes. La durée relativement brève de l’arrêt de tranche rend préférable l’intervention de prestataires », Philippe Page (FNME-CGT) dénonce le fait que « le collège “Exécution”, le premier collège d’EDF, qui regroupe les employés et les ouvriers, a vu ses effectifs divisés quasiment par dix en vingt ans : un site “deux tranches” qui employait entre 150 et 200 ouvriers de maintenance, n’en emploie plus que 25 à 30 aujourd’hui. Autant dire que la politique dite du “faire faire”, mise en œuvre par la direction, a parfois dérivé en “faire faire faire” ou en “voir faire faire”. »
Les syndicats défendent une vision selon laquelle l’entreprise doit garder en son sein un maximum de compétences : « la part de la sous-traitance dans la filière nucléaire doit être réduite ; c’est pourquoi nous n’avons eu de cesse de nous battre pour la réinternalisation d’un maximum d’activités » (Jacky Chorin, FNEM-FO). Cette revendication est quasi unanimement partagée parmi les organisations syndicales représentatives.
EDF a décidé de réinternaliser une partie des activités de maintenance en matière de robinetterie et a embauché à cette fin 200 à 250 robinetiers ; l’entreprise indique qu’elle poursuit un processus identique de réinternalisation de certaines activités de soudage, le but recherché étant notamment le maintien des compétences. Elle considère avoir ainsi « équilibré la politique de “faire” ou “faire faire” » et dit envisager d’étendre ce mouvement. « Il est important de disposer de capacités internes avec un haut niveau d’entraînement et susceptibles d’être rapidement déployées dans un CNPE. D’autres évolutions sont possibles, dans la mesure où la politique du “faire” ou “faire faire” n’est pas dogmatique et qu’elle est régulièrement révisée. Nous envisageons d’étendre le champ d’action des équipes chargées de la maintenance des groupes turbo-alternateurs et des motopompes primaires vers la maintenance de machines auxiliaires. Ainsi, si les grands équilibres restent stables – avec la proportion déjà évoquée de 80 % de sous-traitants –, la situation peut évoluer concernant des segments particuliers » (Étienne Dutheil).
Philippe Page concède que « quelques activités sont réinternalisées, mais cela ne diminue pas notre vigilance, car la direction pourrait décider d’en externaliser d’autres. Le « tertiaire diffus » s’est développé, par greffage de la sous-traitance sur les activités techniciennes ou par multiplication des emplois précaires. »
2. Un effort de remise en ordre nécessaire mais inabouti
Entreprise commerciale toujours imprégnée de l’esprit de service public, EDF a cherché depuis le début des années 1990 – peut-être poussée par la pression des organisations syndicales, des pouvoirs publics et de la société civile – à atténuer les effets délétères de la course à la compétitivité par le développement d’un « partenariat » avec les entreprises prestataires. L’un de ces effets est la multiplication des niveaux de sous-traitance pour les prestations réalisées sur les centrales nucléaires, multiplication qui n’est pas à l’initiative du donneur d’ordres mais qui réduit sa capacité à maîtriser la chaîne de qualité et de sûreté dont il est responsable in fine.
Une première « charte », signée en 1997 avec neuf organisations professionnelles, formalisait les engagements réciproques dans plusieurs domaines : transparence de l’appel aux entreprises prestataires, développement du professionnalisme des intervenants, prévision à long terme des charges d’activité́, amélioration de la radioprotection, de la sécurité et des conditions de travail. Une seconde charte, dite « de progrès et de développement durable », a été signée en 2004 avec treize autres organisations ; elle comporte quatre nouveaux engagements, dont la mise en place dans chaque centre de production nucléaire de Commissions inter-entreprises sur la sécurité et les Conditions de Travail (C.I.E.S.C.T), présentées comme un lieu de discussion spécialement dédié à la prévention des risques et aux conditions de travail et réunissant des représentants des directions d’EDF et des entreprises prestataires ainsi que des représentants du personnel des agents EDF et des employés prestataires. Les C.I.E.S.C.T. ne peuvent cependant être assimilées à de véritables « CHSCT de site », dotés de toutes les prérogatives attachées à ces instances centrales de la protection des travailleurs. Le caractère supplétif du décret n° 2008-467 du 19 mai 2008 relatif au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail d’un établissement à risques technologiques ou comprenant une installation nucléaire a permis à EDF – qui disposait déjà, à sa date de parution, des C.I.E.S.C.T. établies par voie conventionnelle – d’échapper à la mise en place des CHSCT de site créés par ce décret ; celui-ci prévoit d’élargir le CHSCT de l’établissement de l’entreprise utilisatrice aux représentants (patronaux et salariés) d’un panel d’entreprises prestataires intervenant habituellement sur le site. Il n’y a donc « pas de socle d’analyse et de critique des conditions de travail » partagé entre l’exploitant, ses salariés, les entreprises prestataires et leurs salariés pour les installations nucléaires de base, déplore le docteur Dominique Huez, médecin du travail retraité ayant passé la majeure partie de sa carrière à la centrale de Chinon.
Le processus de mise en ordre s’est poursuivi avec l’adoption, en 2012, du cahier des charges social du CSFN (Comité stratégique de la filière nucléaire), que tous les exploitants nucléaires doivent intégrer à leurs appels d’offres pour toutes les activités de service et de travaux sur les INB. « Ce document vise à mieux encadrer le recours à la sous-traitance sur les installations nucléaires, à garantir le savoir-faire, les compétences et l’expérience des intervenants sur site. Il prend comme critères incontournables la sûreté nucléaire, la radioprotection, la prévention des risques professionnels et la qualité de vie au travail. Il constitue désormais une pièce contractuelle intégrée aux appels d’offres et aux marchés, qui lie l’exploitant nucléaire et l’entreprise prestataire, ce qui lui confère un poids bien plus important que celui d’une charte signée avec des organisations professionnelles. Le cahier des charges social encadre notamment le recours à l’intérim et limite à trois les niveaux de sous-traitance. La qualification des entreprises inclut désormais l’existence d’une grille des salaires et la prise en compte de l’ancienneté et des qualifications ; des seuils qualitatifs sont aussi fixés pour l’indemnisation des grands déplacements, complétés par des critères de « mieux-disance » renforcés. Tous les exploitants nucléaires se sont engagés à mettre en œuvre ce cahier dès le début de 2013. EDF l’intègre dans ses appels d’offres depuis la fin janvier 2013 » (Étienne Dutheil).
Ces avancées, incontestables sur le papier, devront être rendues effectives, notamment par les services achats d’EDF, qui sont les interprètes au quotidien de la notion de « mieux-disance ». C’est pourquoi la plus grande vigilance doit demeurer de mise en ce qui concerne les facteurs sociaux, humains et organisationnels, aspects qui ont été, et sont encore pour partie, trop souvent négligés : de nombreux sujets n’ont pas été clos avec l’adoption du cahier des charges social.
L’ASN a justement mis en place, en juin 2012, un Comité d’orientation sur les facteurs sociaux, organisationnels et humains (COFSOH) ; elle n’emploie directement, il est vrai, qu’un seul spécialiste de ces questions. Le rapport rendu en juin 2013 constate une déstabilisation profonde, voire des ruptures dans les organisations, et note la complexification accrue résultant du recours à la sous-traitance, phénomène aggravé par la question de la formation des personnels.
Les répercussions sont potentiellement sérieuses. Au cours de l’élaboration du Livre blanc sur la sûreté des installations civiles nucléaire de la Manche, publié par les trois CLI concernées en décembre 2013 et présenté à la commission d’enquête lors de son déplacement dans le Nord-Cotentin, les CHSCT respectifs des groupes EDF et AREVA ont été conduits à répondre à la question suivante : « En quoi le recours à une entreprise sous-traitante participe-t-il au développement continu de la culture de sûreté ? » Leurs réponses sont éclairantes :
– CHSCT EDF : « La sous-traitance ne participe en rien au développement de la culture de sûreté. Au contraire elle peut être la source d’un risque de dilution de cette culture ; on peut parler d’une perte de compétence des gestes techniques en déléguant systématiquement comme aujourd’hui ces travaux à la sous-traitance. Lors des arrêts de tranche, le travail de près de 2 000 personnes de la sous-traitance est parfois contrôlé par une petite dizaine de salariés EDF seulement. »
– CHSCT AREVA élargi : « Le recours à la sous-traitance engendre à la fois une perte de compétence de l'exploitant et un risque sur la pérennité des compétences nécessaires aux tâches sous-traitées. En effet, la remise en cause au bout de quelques années de contrats attribués au moins-disant n'est pas de nature à stabiliser le personnel sous-traitant sur l'établissement, et par conséquent, ne peut pas être favorable au développement d'une expérience et d'une culture de sûreté. De plus, l'événement Fukushima a fait la preuve, si besoin était, que la maîtrise de fonctions considérées à tort comme mineures (électricité, refroidissement, décontamination,...) peut être cruciale pour la mise en sûreté-sécurité des installations. Ces tâches de mise en sécurité doivent être du domaine régalien de l'exploitant d'une INB. C'est pourquoi le CHSCT estime que garder en interne l'ensemble des compétences est préférable pour garantir un niveau de culture de sûreté satisfaisant. »
La sous-traitance est par elle-même source d’aggravation des risques organisationnels, dont les conséquences peuvent être notables sur la sûreté. Pour Gilles Reynaud et José Andrade, membres de l’association Ma Zone contrôlée, que la commission a rencontrés lors de son déplacement sur le site de Marcoule, près de 80 % des problèmes apparaissant au cours de la maintenance sont liés aux facteurs sociaux, organisationnels et humains : les cascades de sous-traitance entraînent le mal-être et aggravent les conditions de travail car plus il y a de sous-traitance, plus la pression économique se fait forte sur l’entreprise qui réalise la prestation et sur ses salariés ; le regard de l’ASN en inspection, trop réglementaire, ne serait pas assez porté sur ces problèmes. Il n’est pas anodin que ce soit sur l’intervention d’un syndicat que l’ASN a inclus dans le cahier des charges des Évaluations complémentaires de sûreté (ECS) le sujet des facteurs sociaux, organisationnels et humains.
Les travaux de la commission montrent que la sûreté nucléaire et la protection des travailleurs ne peuvent se confiner dans une dimension exclusivement technique et que des initiatives bienvenues ont été lancées pour remettre l’homme au centre des préoccupations. Comme ces initiatives ne pourront aboutir que d’ici à quelques années, il conviendra que le Parlement reste attentif à leurs développements.
Une telle évolution est heureuse, car elle permet de mieux comprendre combien la situation des travailleurs de prestataires est – nonobstant les discours des donneurs d’ordres – toujours très différente de celle des salariés des exploitants.
3. Une différence de condition entre les travailleurs des prestataires et ceux des exploitants
Réalisant 80 % des tâches de maintenance, les salariés des prestataires reçoivent 80 % de la dose de rayons ionisants ; ce fait n’est contesté par personne. Dans quelles conditions ces doses sont-elles reçues ? Les travailleurs de la sous-traitance bénéficient-ils des mêmes garanties que les employés d’EDF ? La maîtrise des doses délivrées est-elle suffisante pour garantir la protection de tous les travailleurs et, plus particulièrement, ceux de la sous-traitance ?
Force est de constater qu’à l’issue des travaux de la commission d’enquête, le tableau reste contrasté. D’une part, un certain consensus s’est dégagé chez la majorité des interlocuteurs pour convenir que des progrès très substantiels ont été obtenus par EDF dans les 15 dernières années. La dose collective a été significativement réduite, ainsi que le nombre de « fortes » expositions individuelles. En la matière, les voies du progrès sont parfois tortueuses et l’Inspecteur général pour la sûreté nucléaire et la radioprotection – bien que satisfait que les responsables aient « pris à cœur le sujet de la radioprotection » – n’a pas caché à votre rapporteur sa préoccupation pour les années à venir. Il relève que la dose collective a légèrement augmenté entre 2012 et 2013 et que beaucoup trop d’incidents sont encore constatés sur les opérations de contrôle des soudures par gammagraphie. Surtout, Jean Tandonnet rappelle que EDF est à la veille de s’engager dans un programme de rénovation « lourde » de ses centrales qui aura vraisemblablement pour conséquence d’augmenter l’exposition globale délivrée aux travailleurs ; il estime en conséquence qu’« on ne devra pas accepter que la dose collective augmente à due concurrence des opérations entreprises ».
D’autres phénomènes sont plus inquiétants. Certes, il semble que les comportements de « triche au dosimètre » qui avaient cours il y a seulement encore une dizaine d’années soient moins fréquents aujourd’hui : « En matière de suivi de dose, tout salarié, qu’il soit d’EDF ou d’une entreprise sous-traitante, doit passer par des contrôles d’accès. Il est difficile d’y échapper » (Vincent Rodet, FCE-CFDT). Pour Marc-Jacques Kuntz, « s’agissant du contrôle de la dose reçue par les intervenants, nos résultats sont parmi les meilleurs dans le monde, ce que confirme le rapport annuel de l’Inspecteur général pour la sûreté nucléaire et la radioprotection (IGSN). Des progrès sont accomplis chaque année et peu de déviances sont à déplorer sur le terrain, ce qui n’a pas toujours été le cas. » Mais Philippe Billard, fondateur de l’association Santé – Sous-traitance Nucléaire-Chimie, fait valoir que le système de dosimétrie peut être pris en défaut, notamment parce que le dosimètre de poitrine ne permet pas de mesurer la dose reçue dans une ambiance radiologique susceptible de délivrer des rayonnements concentrés sur certaines zones du corps ; suivant les gestes à accomplir, la dose reçue aux extrémités peut être sensiblement supérieure à la dose évaluée pour le corps entier et le risque sanitaire subi par le travailleur peut en être sous-estimé d’autant.
S’agissant du respect des limites de dose, Étienne Dutheil rappelle que « depuis 2005, la réglementation française fixe la limite de dose reçue par exposition aux rayonnements ionisants à 20 millisieverts [mSv] sur douze mois glissants pour les travailleurs du nucléaire. La même limite réglementaire a été retenue en Belgique ; elle est de 20 mSv par an en Allemagne et au Royaume-Uni et de 50 mSv par an aux États-Unis. EDF s’est fixé pour objectif qu’aucun intervenant ne dépasse 16 mSv par an, instituant un seuil d’alerte à 14 mSv. En 2013, le seuil de 16 mSv n’a pas été dépassé, et seulement huit intervenants ont atteint les 14 mSv à un moment de l’année, ce qui a déclenché une procédure de concertation avec l’employeur. » Par ailleurs, « EDF a pour politique d’offrir à tous les intervenants, salariés EDF comme salariés d’entreprises prestataires, les mêmes conditions de travail. Les différences d’exposition aux rayonnements ionisants sont liées aux métiers exercés, non au statut des salariés » (Étienne Dutheil).
Ces éléments sont exacts mais ne peuvent faire oublier le poids de certaines réalités. Comme l’affirme Philippe Billard, « il y a deux catégories de sous-traitants : ceux qui sont là parce qu’ils ont des compétences très spécialisées, et ceux qui sont là pour les tâches les plus dosantes ». Les travailleurs intervenant dans le domaine des « servitudes nucléaires » (logistique, décontamination, calorifugeage-décalorifugeage, etc.) sont particulièrement exposés, de même que des spécialités comme les robinetiers en raison de la présence de « points chauds » irradiants difficiles à éliminer avant l’intervention de maintenance, malgré les progrès réalisés dans le nettoyage des circuits. De même, les jumpers, ces travailleurs qui sont amenés à intervenir dans les boîtes à eau des générateurs de vapeur, font partie des personnels qui reçoivent des doses parmi les plus importantes : « on prend 4 à 7 mSv pour une intervention sur un générateur de vapeur », signale le docteur Dominique Huez. Les tâches correspondantes ne semblent pas susceptibles d’être robotisées à brève échéance. Il est donc tout à fait compréhensible que ce genre d’interventions soit préparé sur maquette à l’échelle 1, comme la commission a pu le constater dans les salles techniques jouxtant l’Académie des métiers à la centrale nucléaire du Tricastin. D’ailleurs, la robotisation ne résoudra pas tous les problèmes, même si elle devrait être développée avec plus de vigueur pour réduire les doses reçues au cours de certaines catégories d’intervention ; les organisations syndicales ont exprimé de vives attentes en ce sens.
Par ailleurs, l’attention de votre rapporteur a été attirée par une remarque du docteur Dominique Huez, qui relève que les rayonnements ionisants et l’amiante font partie des rares facteurs de risque où existent en France des normes opposables, mais que la norme d’exposition aux rayonnements ionisants est annuelle alors que toutes les autres sont journalières ; il estime que l’on pourrait au moins imposer une limitation au prorata temporis sachant que les travailleurs sont sur site entre 1 semaine et 2 mois (17). Il conviendrait de même de s’interroger sur les raisons qui font que les cancers reconnus comme maladies professionnelles (en tant que cancers radioinduits) par la Caisse nationale d’assurance maladie sont au nombre de 3 alors qu’aux États-Unis, ce sont 29 maladies du travail qui sont reconnues pour les travailleurs du nucléaire.
Sur un autre registre, les organisations conçues pour fonctionner dans le cadre d’une entreprise unique se voient prises en défaut lorsqu’il s’agit de protéger les travailleurs extérieurs intervenant sur le site d’une entreprise utilisatrice, en l’espèce nucléaire. Selon Philippe Billard, par exemple, la pression en arrêt de tranche – encore accrue dans le cas d’une sous-traitance en cascade – ne permet pas de mettre en place correctement les plans de prévention et de procéder systématiquement à la procédure de « levée des préalables » ; Gilles Reynaud et José Andrade confirment que, trop souvent, il n’est pas possible d’organiser les visites préalables qui devraient normalement avoir lieu avec l’ensemble des corps de métiers et des entreprises concernés par une intervention. Enfin, Mme Annie Thébaud-Mony, directrice de recherches à l’INSERM, estime que la connaissance des salariés suivis par l’IRSN dans le cadre du dispositif national de centralisation des données dosimétriques n’est pas parfaite et s’érode au fil du temps ; de ce fait, les études épidémiologiques sur les effets des faibles doses portant sur les travailleurs du nucléaire sont affectées d’un biais par exclusion d’une partie de leur population cible.
Il n’est donc pas vrai que la protection des travailleurs soit identique, que ceux-ci soient salariés de l’exploitant ou salariés de prestataires. Comme l’indique le docteur Dominique Huez, « il y a un avantage objectif à segmenter les doses sur des groupes définis de travailleurs. La sous-traitance a ruiné l’équité de traitement des travailleurs par rapport à l’exposition aux rayonnements ionisants. » Le discours tenu par les représentants des entreprises prestataires ne reflète pas ces inquiétudes et, à l’occasion de la table ronde organisée par la commission d’enquête, Pierre Dambielle a estimé que « l’industrie nucléaire est plutôt un secteur où l’on s’intéresse à l’homme et où l’on veille aux conditions de travail opérationnelles des différents acteurs ».
Comment dépasser cette situation où les salariés des prestataires – pas tous, certes, mais bon nombre d’entre eux – cumulent l’exposition à un risque sanitaire supérieur et une plus grande précarité sociale ? Des progrès sont possibles en matière d’institutions de protection sociale. Dans le champ de l’hygiène, de la sécurité et des conditions de travail, la revendication de création de CHSCT de site apparaît légitime. À cet égard, Philippe Page indique que « sur le site de l’EPR à Flamanville, la situation s’est améliorée, mais des salariés voulant représenter leurs collègues ont été licenciés ou mutés à l’autre bout du monde […]. Il ne doit pas exister de zone de non droit, même sur un chantier ».
Par ailleurs, le suivi médical des travailleurs extérieurs qui se déplacent de site en site dépend, sauf exception, du médecin du travail relevant de leur employeur, ce qui peut constituer un obstacle à un suivi efficace. Il serait utile de conforter l’action du médecin de l’employeur par le recours à un réseau de médecins du travail référents sur site nucléaire, chaque travailleur extérieur dépendant d’un médecin référent unique. Un tel réseau pourrait d’ailleurs apporter une réponse à la difficulté soulevée par M. Alain Bertaux, président de l’entreprise CICO Centre : « dans certaines régions, le déficit de médecins du travail compétents pour assurer le suivi médical renforcé applicable en matière de dosimétrie risque de bloquer certaines de nos interventions. »
Dans le champ de la protection du travail proprement dite, les organisations syndicales se sont fait l’écho, parfois avec des nuances mais dans une même perspective, d’une amélioration du statut des personnes prestataires. Cela passe au minimum par une clarification dans l’application du droit conventionnel. À chaque changement de titulaire d’un marché de prestations, les salariés de l’entreprise « sortante » – qui sont désormais repris par l’entreprise « entrante » – peuvent être soumis à une nouvelle convention collective. Dès lors, certains salariés considèrent qu’ils sont sans réel statut puisqu’ils « passent » d’une convention collective à une autre sans que le nouveau titulaire ait l’obligation de maintenir les avantages acquis sous le régime précédent. De ce fait, les conventions collectives de la métallurgie et du bâtiment sont progressivement remplacées par celle de Syntec, propre aux bureaux d’études, qui n’offre pas les mêmes garanties. Une réflexion pourrait être engagée sur la création d’une convention collective propre aux métiers du nucléaire.
CHAPITRE 4 : ÉVOLUTION DU PARC.
EDF À UN TOURNANT
A. UN PARC NUCLÉAIRE QUI ENTRE PROGRESSIVEMENT DANS SA QUATRIÈME DÉCENNIE
1. Le parc nucléaire français : un ensemble construit rapidement et par paliers homogènes
Les 58 réacteurs électronucléaires actuellement exploités en France sont globalement semblables. En premier lieu, ils sont tous des réacteurs à eau sous pression (REP) : après avoir construit 6 réacteurs de la filière « uranium naturel-graphite-gaz » entre 1963 (Chinon A1) (18) et 1972 (Bugey-1), après avoir mis en service en 1967 le réacteur à uranium naturel et eau lourde des Monts d’Arrée (centrale de Brennilis) et construit dans la caverne de Chooz une centrale REP de 305 MW, la France a opté pour cette dernière filière à la fin de l’année 1969. Ce choix a été confirmé par l’abandon, en août 1975, d’une commande de réacteurs à eau bouillante de technologie General Electric.
Les réacteurs français sont également très homogènes au regard des conditions industrielles de leur déploiement : ils reposent tous sur des fondements dérivés des technologies mises au point et licenciées par Westinghouse, progressivement « francisées » par Framatome (aujourd’hui AREVA) ; EDF a assuré, pour l’ensemble du parc, les fonctions d’architecte-ensemblier ; Framatome a fabriqué tous les composants principaux du circuit primaire.
Enfin, les réacteurs ont été commandés et réalisés par grands blocs, les paliers, dans le cadre d’une planification publique :
– le palier CP0 (pour « contrat-programme »), décidé en 1970, est constitué de 6 réacteurs (4 au Bugey et 2 à Fessenheim) d’une puissance unitaire de 900 MW environ ; leur âge à date de mai 2014 (19) s’échelonne de 34 ans et 10 mois à 37 ans et 1 mois ;
– le palier CP1, lancé en 1974, compte 18 réacteurs de 900 MW environ qui équipent 4 centrales (Le Blayais, Dampierre, Gravelines, Tricastin) ; leur âge s’échelonne de 29 ans et 9 mois à 34 ans et 2 mois ;
– le palier CP2, engagé en 1976, regroupe 10 réacteurs de 900 MW environ, sur les centrales de Chinon, Cruas et Saint-Laurent-des-Eaux ; leur âge s’échelonne de 26 ans et 6 mois à 33 ans et 4 mois ;
– le palier P4, décidé en 1977, marque le passage à des réacteurs de plus forte puissance ; il est constitué de 8 réacteurs de 1 300 MW environ installés sur les centrales de Flamanville, Paluel, et Saint-Alban ; leur âge s’échelonne de 27 ans et 10 mois à 29 ans et 11 mois ;
– le palier P’4, engagé en 1980, complète le précédent par 12 réacteurs de 1 300 MW environ, sur les centrales de Belleville, Cattenom, Golfech, Nogent et Penly ; leur âge s’échelonne de 20 ans et 11 mois à 27 ans et 6 mois ;
– le palier N4 marque l’achèvement de la « francisation » progressive du design des réacteurs ; leur puissance est portée à 1 450 MW et 2 centrales sont équipées chacune de 2 réacteurs : Chooz et Civaux ; l’âge des réacteurs s’échelonne de 14 ans et 5 mois à 17 ans et 9 mois.
Les différences matérielles entre les paliers sont sensibles :
– les paliers CP1 et CP2 se caractérisent par une configuration des bâtiments différente de celle du palier CP0, ainsi que par la présence d’un circuit intermédiaire entre celui permettant l’aspersion de l’enceinte en cas d’accident et celui contenant l’eau de la source froide ; leur mode d’exploitation est plus souple ;
– dans le palier P4, le circuit primaire des réacteurs comporte 4 boucles et 4 générateurs de vapeur, au lieu de 3 sur les paliers CP, en raison de l’augmentation de la puissance ; l’enceinte de confinement comporte une double paroi en béton au lieu d’une paroi simple doublée d’une « peau » en acier ; le bâtiment piscine du palier P’4 est légèrement différent de celui du palier P4 ;
– le palier N4 se caractérise essentiellement par une plus grande compacité des générateurs de vapeur et par l’informatisation de la salle de commande.
La standardisation du parc a permis de bénéficier d’effets d’apprentissage et de mutualisation, tant pour la construction qu’ultérieurement, en exploitation ; elle offre également des facilités pour intégrer sur le parc des modifications matérielles, notamment à travers le mécanisme d’allotissement des travaux, qui génère des économies d’échelle. Elle facilite aussi l’exercice du contrôle de la sûreté nucléaire, puisque l’analyse peut se déployer, dans un premier temps, au niveau d’un palier sous la forme d’évaluations et de décisions à caractère générique puis, dans un second temps, au niveau de chaque réacteur puisqu’il subsiste toujours des spécificités, notamment liées à l’implantation sur site ou à l’historique de construction et d’exploitation du réacteur.
La standardisation est aussi facteur de fragilité : des défauts peuvent affecter simultanément plusieurs réacteurs, donnant lieu à des incidents dits « génériques ». Lors de la présentation du rapport annuel de l’ASN devant l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, le 15 avril dernier, Pierre-Franck Chevet, président de l’ASN, a évoqué les conséquences potentielles de ces événements à caractère générique : « Une rigueur particulière est nécessaire en raison même de la standardisation du parc. Malgré cela, il est impossible d’exclure la détection tardive d’une anomalie qui pourrait, si la situation l’exige, conduire à arrêter simultanément cinq à dix tranches, comme cela a été le cas au début des années 1990, suite à la détection tardive de corrosions et de fuites sur des couvercles de cuves de réacteurs. Cette situation est susceptible de se reproduire, même avec un système de retour d’expérience très rigoureux ».
Pour ne parler que d’incidents génériques récents, on peut citer le refus de fermeture des disjoncteurs affectant l’ensemble des réacteurs de 1 300 MW, constaté en 2010 et toujours pas résolu ; la corrosion de l’alliage zircaloy des gaines de combustibles, induisant un risque de dislocation des assemblages lors du déchargement ; le problème des coussinets de têtes de bielles des moteurs diesel des alimentations de secours sur les réacteurs de 900 MW ; les bouchons d’eau claire créant un risque de dilution de l’eau borée dans la cuve et le circuit primaire, susceptible de provoquer un accident de criticité sur les réacteurs du palier 1 300 MW, ou encore l’incident portant sur les écarts de serrages de visserie de certaines vannes, qui affecte l’ensemble des réacteurs.
Si le lien entre l’âge des réacteurs et l’apparition d’incidents génériques n’est pas direct, on ne peut manquer de signaler que la vigilance en matière de détection des écarts doit se renforcer au fur et à mesure que le parc vieillit.
2. EDF a fait le choix de prolonger la durée de vie de ses réacteurs significativement au-delà de 40 ans
Le parc nucléaire ayant été construit sur un laps de temps assez court – 33 réacteurs de 1977 à 1984 pour une puissance de 30,7 GW ; 15 réacteurs de 1985 à 1989 pour une puissance de 18,6 GW et 10 réacteurs de 1990 à 2000 pour une puissance de 13,9 GW –, la pyramide des âges des réacteurs est assez concentrée. L’âge moyen du parc est aujourd’hui de 29 ans et 3 mois. Les trois quarts des réacteurs ont plus de 26 ans et 7 mois et la moitié des réacteurs a plus de 30 ans.
Or la durée de vie de conception des réacteurs français actuellement en fonctionnement est 40 ans : c’est sur cette base qu’ont été établis les dossiers de sûreté, fondement technique essentiel des décrets d’autorisation de création qui ont donné naissance, au plan juridique, aux « installations nucléaires de base » (INB) que constituent les réacteurs (20). Le passage éventuel des 40 ans marquerait donc une césure dans la vie d’un réacteur. De fait, dès la première moitié des années 2000, la question s’est posée aux pouvoirs publics comme à EDF de savoir comment aborder cette échéance (21).
HISTOGRAMME DE L’ÂGE DES RÉACTEURS EN EXPLOITATION
(date de référence : mai 2014)
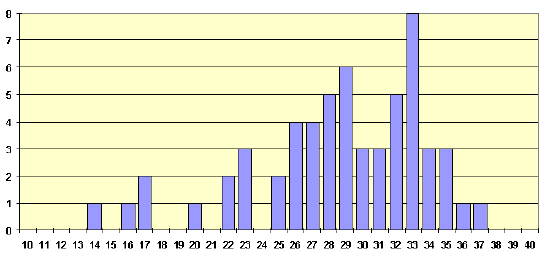
Données issues de : CEA, Elecnuc - Les centrales nucléaires dans le monde, édition 2013
Dans l’hypothèse où chaque réacteur serait arrêté à l’âge de 40 ans (compté à dater de sa connexion au réseau), la décroissance de la capacité installée commencerait en avril 2017 avec la fermeture de Fessenheim-1 ; en 10 ans seulement – et cela n’est que le miroir du déploiement nucléaire depuis les années 1970 – la capacité installée diminuerait de plus de 40 GW et reviendrait à 20 GW environ ; 5 ans plus tard, elle ne serait plus que légèrement supérieure à 7 GW.
ÉVOLUTION DE LA CAPACITÉ NUCLÉAIRE INSTALLÉE EN CAS D’ARRÊT
DES RÉACTEURS À 40 ANS
(en GW)
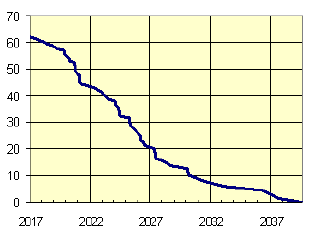
Données issues de : CEA, Elecnuc - Les centrales nucléaires dans le monde, édition 2013
Très vite, EDF a posé l’option de la prolongation de ses réacteurs. Dans son « document de référence 2004 », publié en juillet 2005, EDF affirme que la préparation de l’avenir du parc nucléaire s’appuie sur deux axes stratégiques, dont le premier est « l’allongement de la durée de vie des centrales nucléaires au-delà de 40 ans » et le second, la préparation de leur renouvellement avec le développement d’une tranche EPR de tête de série. Cette option est réaffirmée par la suite dans chaque document de référence annuel.
La démarche de prolongation des réacteurs existants n’est pas spécifique à la France.
Aux États-Unis, la Nuclear Regulatory Commission (NRC) – autorité de sûreté – délivre des autorisations initiales d’exploitation d’une durée pouvant aller jusqu’à 40 ans ; les autorisations sont renouvelables par durée de 20 ans, à condition que les exploitants soient en mesure de démontrer qu’ils peuvent continuer d’exploiter la centrale nucléaire en toute sûreté ; l’examen de la NRC est principalement axé sur l’effet du vieillissement des composants non remplaçables, les autres aspects de sûreté étant traités dans le cadre des contrôles classiques. En 2014, 73 réacteurs sur 100 ont obtenu un renouvellement de leur licence d’exploitation jusqu’à 60 ans – dont la centrale de Beaver Valley qui a servi de « modèle » aux réacteurs du palier 900 MW. Parmi eux, une vingtaine environ a dépassé les 40 années d’exploitation depuis leur connexion au réseau (le plus ancien étant Oyster Creek, connecté au réseau en septembre 1969). Une vingtaine de demandes de renouvellement de licence sont en cours d’instruction par la NRC – dont la centrale de South Texas, référence technique du palier français de 1 300 MW. Certains exploitants évoquent désormais l’idée de prolonger leurs installations de 20 années supplémentaires ; il s’agit là de projets d’autant plus hypothétiques que le retour d’expérience en matière d’exploitation à long terme de centrales nucléaires reste limité : la plus ancienne d’entre elles n’a « que » 45 ans de fonctionnement et la plupart de celles qui ont dépassé 40 ans ne l’ont fait que depuis peu.
La Suisse compte 5 réacteurs, dont trois ont plus de 40 ans (Beznau-1 et 2, connectées au réseau en juillet 1969 et octobre 1971, et Muehlberg, connectée au réseau en juillet 1971). L’autorité de sûreté suisse impose que l’exploitant fournisse des preuves sur la capacité des équipements importants à être exploités plus de 40 ans à partir de la 35ème année d’exploitation. L’électricien BKW, propriétaire et exploitant de la centrale de Muehlberg, a néanmoins annoncé en octobre dernier que celle-ci sera arrêtée en 2019, après 48 ans de service.
B. UN PROJET DE PROLONGATION QUI DOIT S’INSCRIRE DANS UN PROCESSUS EXIGEANT D’AMÉLIORATION DE LA SÛRETÉ
1. Le réexamen périodique de sûreté des installations nucléaires
Le régime juridique des INB ne fixe pas de limitation dans le temps à l’exploitation d’une telle installation. Il impose cependant des rendez-vous réguliers, qui visent à examiner et améliorer son niveau de sûreté :
– pour l’ensemble des INB, l’article L.593-18 du code de l’environnement dispose que l’exploitant procède à un réexamen de la sûreté de son installation tous les dix ans ;
– pour les seules centrales nucléaires, l’arrêté du 10 novembre 1999 relatif à la surveillance de l'exploitation du circuit primaire principal et des circuits secondaires principaux des réacteurs nucléaires à eau sous pression impose que les équipements soient soumis à une requalification tous les 10 ans. Cette requalification comprend une inspection approfondie des équipements, une épreuve hydraulique et un examen des dispositifs de sécurité.
L’arrêté du 10 novembre 1999 consolide plusieurs textes antérieurs qui, historiquement, ont imposé le rythme des visites décennales réalisées sur les réacteurs, rythme sur lequel s’est par la suite « greffé » avec une certaine souplesse le réexamen de sûreté récemment codifié dans le code de l’environnement.
Le réexamen de sûreté comporte deux volets :
– l’examen de conformité : il consiste à examiner en profondeur la situation de l’installation afin de vérifier qu’elle respecte bien l’ensemble des règles qui lui sont applicables ;
– la réévaluation de sûreté : elle consiste à améliorer le niveau de sûreté de l’installation en comparant notamment les exigences applicables à celles en vigueur pour des installations présentant des objectifs et des pratiques de sûreté plus récents et en prenant en compte l’évolution des connaissances ainsi que le retour d’expérience national et international.
L’exploitant étant responsable de la sûreté de son installation, c’est à lui qu’il revient de procéder au réexamen de sûreté. À l’issue de celui-ci, l’ASN analyse les conclusions de l’exploitant, se prononce sur l’aptitude de l’installation à fonctionner jusqu’au prochain réexamen de sûreté et peut fixer des prescriptions complémentaires. Cette phase propre à l’installation est cependant précédée d’un processus générique propre à chaque palier :
– très en amont des visites décennales, la phase « d’orientation du réexamen de sûreté » vise à définir, d’une part, les sujets sur lesquels l’examen de conformité devra être particulièrement approfondi et, d’autre part, les thèmes que l’exploitant devra traiter dans le cadre de la réévaluation de sûreté ; l’ASN s’est prononcée, en juin 2013, sur les orientations du programme d’études conduit par EDF en vue de prolonger la durée de fonctionnement du palier 900 MW au-delà de 40 ans et a demandé des compléments d’études ;
– à l’issue des études réalisées par l’exploitant sur chacun des thèmes retenus, des modifications permettant des améliorations de sûreté sont définies, qui devront être déployées pendant les visites décennales. Ce faisant, l’ASN prend position sur les aspects génériques de la poursuite du fonctionnement des installations concernées jusqu’au prochain réexamen de sûreté. De telles prises de position ont été annoncées en 2006 pour les deuxièmes visites décennales du palier 1 300 MW et en 2009 pour les troisièmes visites décennales du palier 900 MW.
2. L’intégration du retour d’expérience de l’accident de Fukushima
À la suite de l’accident de Fukushima, deux initiatives concomitantes ont conduit l’ASN à engager le processus des Évaluations complémentaires de sûreté (ECS). Les ECS se sont inscrites dans un double cadre : d’une part, la réalisation d’un audit de la sûreté nucléaire des installations nucléaires civiles françaises au regard des événements de Fukushima qui a fait l’objet d’une saisine de l’ASN le 23 mars 2011 par le Premier ministre en application de l’article 8 de la loi TSN et, d’autre part, l’organisation de « tests de résistance » demandée par le Conseil européen lors de sa réunion des 24 et 25 mars 2011.
Le détail du processus est présenté de façon détaillée dans le rapport de la Cour des comptes publié en mai dernier. Trois étapes sont particulièrement importantes.
En janvier 2012, l’ASN publie son rapport sur les ECS réalisées par les exploitants, dans lequel elle affirme que « les installations examinées présentent un niveau de sûreté suffisant pour qu’elle ne demande pas l’arrêt immédiat d’installations. Dans le même temps, l’ASN considère que la poursuite de l’exploitation des installations nécessite d’augmenter dans les meilleurs délais leur robustesse face à des situations extrêmes »
En juin 2012, l’ASN adopte 32 décisions fixant chacune une trentaine de prescriptions complémentaires relatives aux centrales nucléaires d’EDF, aux installations d’AREVA et à certains réacteurs du CEA au vu des conclusions des ECS. Pour EDF, les prescriptions concernent notamment :
– la mise en place d’un « noyau dur » d’équipements permettant d’assurer les fonctions vitales en cas d’agression ou d’aléas notablement supérieurs à ceux retenus pour le dimensionnement de l’installation ;
– la mise en place d’une « force d’action rapide du nucléaire » (FARN) proposée par EDF, dispositif national d’urgence permettant de déployer en moins de 24 heures des équipes spécialisées sur un site accidenté ;
– le renforcement des dispositions visant à réduire le risque de dénoyage des assemblages combustibles entreposés dans les piscines.
En janvier 2014, l’ASN adopte 19 décisions fixant des exigences complémentaires pour la mise en place du « noyau dur » post Fukushima sur les centrales nucléaires d’EDF. Les décisions relatives aux autres exploitants seront publiées ultérieurement (22).
Par ailleurs, dans le but identique de renforcer la résistance des installations nucléaires vis-à-vis des agressions externes (au sens de la sûreté nucléaire et non de la sécurité), l’ASN a demandé à EDF d’améliorer la tenue de ses installations aux événements climatiques extrêmes et de déployer sur ses réacteurs les modifications matérielles correspondantes. En particulier, l’ASN a validé en 2012 le référentiel « grands chauds » élaboré par EDF à destination des réacteurs du palier 900 MW et a demandé à EDF de prendre en compte les remarques formulées au cours de l’instruction de ce dossier dans l’élaboration des référentiels « grands chauds » qui seront arrêtés pour les autres paliers et instruits dans le cadre du réexamen de sûreté associé aux troisièmes visites décennales des réacteurs du palier 1 300 MW et des deuxièmes visites décennales des réacteurs du palier 1 450 MW.
L’ensemble de ces prescriptions représente des coûts substantiels, en investissement comme en fonctionnement, qui ont donc été intégrés dans la réflexion de la commission d’enquête.
II. LES APPORTS DE LA COMMISSION D’ENQUÊTE
La commission d’enquête a consacré plusieurs séquences d’auditions à l’évolution du parc nucléaire d’EDF. Elle a tout d’abord cherché à mieux comprendre le contenu et la portée du grand programme d’investissement présenté par EDF sous le nom de « Grand carénage » ; elle a ensuite cherché à cerner les conditions économiques du déploiement de réacteurs de 3ème génération ; elle a sollicité plusieurs intervenants susceptibles de lui présenter une vision globale des choix qui s’offrent en matière d’avenir du parc nucléaire ; elle a ensuite organisé une séquence d’auditions relatives à l’arrêt des centrales nucléaires, qui a été complétée par un déplacement en Alsace consacré à la perspective de fermeture de la centrale de Fessenheim.
A. LE « GRAND CARÉNAGE », UN PROJET INDUSTRIEL ENTOURÉ DE NOMBREUSES INCERTITUDES
Les travaux de la commission d’enquête sur le Grand carénage ont été structurés autour de deux questions : la prolongation des réacteurs au-delà de 40 ans est-elle possible et, dans l’affirmative, à quelles conditions ? Le chiffrage du Grand carénage avancé par EDF est-il crédible ?
1. Une éventuelle prolongation des réacteurs soumise à des contraintes techniques fortes
S’il est un point qui n’a donné lieu à aucune divergence de vue, c’est bien l’impérieuse obligation de garantir la sûreté du parc nucléaire en toutes circonstances. Mais il convient d’aller au-delà des affirmations de principe pour examiner ce que cela implique au regard du projet de prolongation au-delà de 40 ans car, comme l’indique Pierre-Franck Chevet, « des sujets de sûreté cruciaux doivent être traités » à partir du moment où on sort du dimensionnement initial.
Ces sujets concernent en premier lieu le vieillissement des composants non remplaçables d’un réacteur nucléaire que sont la cuve et l’enceinte de confinement. Pour la cuve, l’irradiation neutronique modifie la structure cristalline des aciers et provoque une fragilisation ; plus précisément, Raymond Sené, membre fondateur du Groupement des scientifiques pour l’information sur l’énergie nucléaire (GSIEN), rappelle que « un paramètre essentiel est l’évolution de la température de transition ductile-fragile qui évolue en raison de l’irradiation neutronique en provenance du cœur. […] Progressivement, la température de transition s’élève. » Or « il importe que l’acier des cuves n’atteigne jamais la température de transition ductile-fragile. Pour les matériaux utilisés, cette température se situe au départ autour de – 30 °C mais sous irradiation neutronique, elle ne cesse de s’élever. Pour certaines cuves, elle dépasse aujourd’hui les 60 °C, à tel point qu’il est hors de question de faire une injection de sécurité à basse température parce que la cuve serait susceptible de se casser. » La rupture de cuve n’étant pas prise en compte dans le dimensionnement des centrales nucléaires, il s’agit là d’un risque d’accident majeur.
Par ailleurs, « les enceintes doivent également faire face au vieillissement : ainsi, la centrale de Belleville a rencontré des problèmes de qualité de béton pour l’enceinte de confinement, qui devront être de plus en plus surveillés au fur et à mesure que les années passeront » (Pierre-Franck Chevet). Le vieillissement est particulièrement préoccupant lorsqu’il touche des composants « diffus » des installations nucléaires, ainsi que des composants difficilement accessibles comme les tuyauteries enterrées.
C’est notamment pour ces raisons que l’ASN affirme régulièrement, comme elle l’a fait devant la commission d’enquête par la voix de son président, que « la poursuite du fonctionnement des réacteurs au-delà de quarante ans n’est pas acquise. » et qu’il ne s’agit pas d’une formule rhétorique.
Dominique Minière, directeur délégué à la direction Production-Ingénierie d’EDF, a fait part à la commission de sa confiance quant à la capacité des réacteurs d’EDF à voir leur durée de vie prolongée au-delà de 40 ans. Il s’est tout d’abord appuyé sur la parenté entre les réacteurs français et les réacteurs REP américains pour mettre en perspective l’échéance technique des 40 ans : « Le cap des quarante années est important et la question se pose de la possibilité d’une prolongation au-delà. […] Nos centrales ont été conçues et construites pour une durée de vie technique de quarante ans. Les études de dimensionnement et la qualification des matériels ont bien été réalisées pour quarante ans. En même temps, elles ont été construites sur le modèle américain, celui de Westinghouse, avec des centrales de référence qui sont en voie d’obtenir une licence de soixante ans. »
Dominique Minière a également exprimé sa confiance dans la qualité des cuves françaises et leur tenue à l’irradiation : « Sur le plan purement technique, la capacité de nos cuves à résister aux accidents graves est nettement meilleure que celle des cuves américaines, tout simplement parce que les nôtres ont été fabriquées grâce au tissu industriel français très développé des années 1980, créé grâce à l’effet palier que nous avons collectivement constitué. On constate bien le paradoxe technique, injuste pour la réputation de notre industrie, selon lequel l’exploitation des cuves américaines est prolongée alors qu’elle ne pourrait excéder quarante ans chez nous. »
Quand bien même les phénomènes de vieillissement seraient parfaitement maîtrisés, à la fois dans leur connaissance et par la mise au point de « parades » acceptées par l’ASN, un autre obstacle se présente sur la voie de l’éventuelle prolongation des réacteurs : le réexamen de sûreté effectué à l’occasion des visites décennales et à l’occasion duquel la sûreté des installations doit être réévaluée et améliorée.
Or l’ASN a adopté une position de principe extrêmement rigoureuse, conforme à la doctrine française de sûreté, plus protectrice que celle en vigueur aux États-Unis : l’amélioration de la sûreté des centrales nucléaires en exploitation devra être examinée dans un contexte où, dans les années à venir, les réacteurs actuels cohabiteront avec des réacteurs de type EPR ou équivalents, dont la conception vise un niveau de sûreté significativement plus élevé. Comme l’indique le rapport annuel de l’ASN, celle-ci « considère donc que les améliorations de sûreté à apporter aux réacteurs existants (études de réévaluation de sûreté et objectifs radiologiques associés) doivent être définies au regard de ces nouvelles exigences de sûreté, de l’état de l’art en matière de technologies nucléaires et de la durée de fonctionnement visée par EDF. » (23).
L’exigence ainsi formulée n’est pas applicable uniquement à une éventuelle prolongation de réacteurs au-delà de 40 ans, mais concerne l’ensemble du parc, y compris les réacteurs du palier N4. Elle prend cependant un relief particulier au regard du projet de prolongation – qui concernera en premier les réacteurs du palier 900 MW.
L’ASN a donc identifié comme sujets majeurs la sûreté des piscines d’entreposage du combustible présentes auprès de chaque réacteur – dont Jacques Repussard, directeur général de l’IRSN, a dit lors d’un entretien avec votre rapporteur qu’elles ont toujours été « le parent pauvre de la sûreté » –, la capacité à refroidir l’enceinte en cas d’accident grave et la capacité à éviter le percement du radier par le corium fondu après que la cuve aurait été percée ; l’EPR dispose d’un récupérateur de corium mais pas les réacteurs actuellement en fonctionnement.
Tout en convenant que « cet objectif ambitieux n’a pas d’équivalent dans le monde et nous le comprenons », Dominique Minière souligne que l’écart n’est pas si grand entre les référentiels de sûreté des réacteurs actuels et celui des réacteurs de 3ème génération : « L’ASN ne nous a pas demandé de mettre le parc au niveau des réacteurs de la troisième génération, mais d’avoir des objectifs de sûreté identiques à ceux concernant les réacteurs de troisième génération. Nous n’avons pas laissé vieillir les réacteurs de deuxième génération sans leur apporter d’améliorations. Les objectifs de sûreté se sont ainsi rapprochés. Grâce aux visites décennales, la probabilité de fusion du cœur en cas d’événement interne sera quasi égale à celle de l’EPR. Il s’agit donc d’une transition douce. »
Le travail sur les aspects génériques de la prolongation des réacteurs a franchi une étape en juin 2013, lorsque l’ASN a rendu publique sa position sur le programme d’études proposé par EDF. En octobre 2013, l’électricien a transmis à l’ASN son dossier d’orientation du réexamen de sûreté associé aux quatrièmes visites décennales du palier 900 MW. Le dialogue technique se poursuit puisque Dominique Minière a indiqué à la commission avoir adressé un courrier à l’ASN dans lequel, « pour répondre aux demandes de compléments de l’ASN, nous formulons des propositions concrètes pour l’amélioration de la sûreté de l’entreposage des combustibles usés. » Un premier avis pourrait être émis par l’ASN en 2015 et l’avis final pourrait être rendu en 2018 ou 2019. Naturellement, l’ASN se prononcera ensuite sur chaque réacteur en fonction de ses spécificités. Son président, Pierre-Franck Chevet, a fait valoir que l’ASN n’était actuellement pas en mesure de déterminer combien de réacteurs pourraient ne pas « passer le cap » des 40 ans, même si certains font déjà apparaître des faiblesses particulières, comme Tricastin-1 (pour des défauts sous revêtement de cuve) (24) et les deux réacteurs de Belleville (pour des problèmes d’étanchéité de l’enceinte de confinement).
Les travaux de la commission d’enquête montrent donc que l’horizon technique n’est pas encore dégagé au regard du projet de prolongation, des sujets majeurs restant en discussion entre l’autorité de sûreté et l’exploitant. De ce fait, la faisabilité d’une prolongation n’est pas garantie et l’ASN a d’ores et déjà indiqué que la décision sera différente selon les réacteurs.
Le Grand carénage est donc une condition nécessaire, mais pas suffisante, pour prolonger les réacteurs actuels au-delà de 40 ans.
2. Un chiffrage du Grand carénage encore difficile à cerner
Pendant toute la durée de la commission d’enquête, EDF a maintenu que le coût du Grand carénage jusqu’en 2025 était stabilisé à 55 milliards d’euros. Henri Proglio, président-directeur général d’EDF, déclarait ainsi le 6 mai dernier : « Au-delà de la maintenance courante de l’outil industriel, qui représente 50 millions par réacteur et par an, le grand carénage est une opération de modernisation, de rénovation et d’amélioration de la sécurité, dont la terminologie rappelle celle de la navigation. Le coût de cette restructuration, qui permettra de prolonger la durée potentielle des réacteurs, a été estimé à 55 milliards. » Avec la publication, trois semaines plus tard, du rapport de la Cour des comptes, on sait désormais que le coût prévisionnel du projet industriel d’EDF sur 2011-2025 s’élève à 62,5 milliards d’euros (coût en valeur 2010, donc directement comparable à l’évaluation de 55 milliards évoquée jusqu’alors). Un subtil glissement temporel – peu clair, il est vrai – a en fait conduit EDF à annoncer à la commission d’enquête des coûts portant plutôt sur la période 2014-2025, comme le précisait d’ailleurs Pierre-Marie Abadie, directeur de l’Énergie au ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie : « Selon l’estimation d’EDF, ces investissements s’élèveraient à 55 milliards d’euros pour la période 2014-2025. Initialement, ils portaient sur la période 2012-2025. »
Quoi qu’il en soit, les montants concernés étaient suffisamment importants pour que la commission cherche à en éclaircir les contours. La question se posait, tout d’abord, de savoir si le coût annoncé du Grand carénage pouvait être sur-estimé ou sous-estimé.
Le fait est que toute possibilité de sur-estimation ne devait pas être écartée a priori. Comme l’indique Pierre-Marie Abadie, « il est dans l’intérêt d’EDF de gonfler ce chiffre [des investissements de maintenance] dans le cadre du calcul de l’ARENH » puisque cela permettrait d’augmenter le prix auquel EDF doit céder une partie de son électricité nucléaire à ses concurrents (voir le chapitre 9). Sans établir de lien avec les conditions de commercialisation de l’électricité d’origine nucléaire, Philippe Knoche souligne pour sa part que « cinquante-cinq milliards d’euros correspondraient quasiment à un milliard d’euros par réacteur ; jamais nous n’avons vu de programme d’investissement approchant de ce montant, même en ne prenant en compte que les autorités de sûreté dont le niveau d’exigence est proche de celui, très élevé, de l’ASN. »
Mais le risque principal était inverse. C’est pourquoi votre rapporteur a sollicité à maintes reprises EDF, au cours des auditions comme par courrier, pour obtenir des précisions sur le périmètre et le calendrier du Grand carénage. Il s’agissait de sortir du flou qui entourait ce programme et qui a conduit Pierre-Franck Chevet lui-même à concéder « Je ne connais pas le détail du programme du grand carénage. » Le panorama s’est progressivement affiné, y compris à la suite d’une réunion de travail organisée dans les locaux d’EDF le 23 mai dernier pour consulter les documents de l’entreprise.
Il est revenu à Dominique Minière d’apporter à la commission d’enquête la première vision un peu plus détaillée du contenu du Grand carénage, en décomposant ce qui n’était jusqu’alors qu’un grand « bloc » de 55 milliards d’euros en quatre éléments : « Les 55 milliards d’euros prévus pour le grand carénage se répartissent comme suit : 10 milliards d’euros pour le déploiement des modifications post-Fukushima ; 20 milliards d’euros pour les investissements réalisés lors des arrêts de tranche, notamment des visites décennales ; 15 milliards d’euros pour la maintenance lourde des gros composants ; 10 milliards d’euros au titre d’autres projets patrimoniaux, concernant l’environnement, le risque incendie ou le risque “grand chaud, grand froid” ». Des détails moins parcimonieux ont ensuite été donnés à votre rapporteur, celui-ci cherchant surtout à évaluer la crédibilité des montants annoncés et non à contrôler la cohérence industrielle du projet de Grand carénage (25).
Il apparaît également aujourd’hui qu’en termes de périmètre, une partie des travaux prévus dans le Grand carénage est très directement liée par EDF aux perspectives qui seront offertes en matière de prolongation de tout ou partie des réacteurs : « Notre projet industriel […] suppose la réalisation d’investissements à la fois de maintenance lourde et d’amélioration de la sûreté qui n’ont de sens que dans une perspective de prolongation du parc, compte tenu de l’ampleur et du calendrier de ces investissements. Une certaine visibilité est donc nécessaire dans la perspective de prolonger l’exploitation des réacteurs, même si les autorisations ne sont octroyées in fine que tranche par tranche tous les dix ans » (Dominique Minière). Cela concerne les travaux précisément associés aux quatrièmes visites décennales des paliers 900 MW et 1 300 MW, que EDF évalue à près de 6 milliards d’euros ; cela concerne également la « phase 3 » des améliorations de sûreté post-Fukushima, dont EDF voudrait voir le début décalé à 2019 et l’échéance décalée à 2025 afin de l’associer aux quatrièmes visites décennales. Ce projet n’est pas compatible avec le calendrier de déploiement des mesures post-Fukushima avancé par l’ASN – qui prévoit que l’ensemble des mesures doit être mis en place en 2019 au plus tard – et est donc soumis à un accord préalable de l’ASN.
Votre rapporteur précise, à ce stade, que la profonde refonte, entreprise ces dernières années, de la réglementation relative à la sécurité des installations nucléaires et à leur protection contre les actes de malveillance devrait occasionner des dépenses d’environ 750 millions d’euros pour EDF – inclus dans le chiffrage du Grand carénage – et 275 millions d’euros pour le CEA. S’agissant d’AREVA, Luc Oursel évoque, pour sa part, un montant de 120 à 150 millions d’euros pour les améliorations en cours de discussion avec les autorités. Les informations détaillées qui ont été portées à la connaissance de votre rapporteur et de la commission d’enquête (au cours d’une audition à huis clos) montrent qu’une prise de conscience a eu lieu, que des progrès substantiels ont déjà été enregistrés et que d’autres sont encore à venir.
Les travaux de la commission ont aussi permis de lever les zones d’ombre sur les besoins en matière d’investissement au-delà de 2025. Le Grand carénage met l’accent sur l’année 2025 et laisse en effet dans l’ombre les années ultérieures, donc minore le coût global de la rénovation du parc. « Que se passera-t-il après 2025 ? […] La plupart des remplacements auxquels nous devons procéder doivent intervenir au bout de vingt-cinq à trente ans. Notre parc a démarré, pour l’essentiel, entre 1980 et 1990, les dernières tranches en 1992. La plupart des grosses opérations auront été menées d’ici à 2025, et c’est pourquoi nous mettons l’accent sur cette année-là ; ce qui ne signifie pas pour autant que d’autres opérations ne seront pas à prévoir ensuite, notamment sur des réacteurs de 1 300 MW qui sont un peu plus jeunes » (Dominique Minière). L’horizon de 2033 étant en fait plus pertinent que celui de 2025, la Cour des comptes a évalué à 90 milliards d’euros 2010 et 110 milliards d’euros courants le montant total des investissements à consentir sur la période 2011-2033 en vue de réaliser les programmes de travaux prévus pour les quatrièmes visites décennales des paliers 900 MW et 1 300 MW. La « bosse d’investissements » à nombre de réacteurs constant souvent évoquée par EDF apparaît désormais bien plus large que ce qui était annoncé au début de la commission d’enquête.
Enfin, la commission s’est interrogée sur la faisabilité du Grand carénage, tant en termes industriels que financiers. Sur le second point, l’attention de votre rapporteur a été attirée par le fait que EDF a procédé en janvier 2013, à des émissions d’obligations dites « hybrides » à hauteur de 6 milliards d’euros, qui, au regard des normes comptables internationales, sont considérées comme des fonds propres et non comme des dettes . Cela a permis à EDF d’afficher une réduction de son endettement et d’améliorer le ratio entre son EBITDA (26) et son endettement, ratio particulièrement suivi par les agences de notation et les marchés financiers. Si aucun des interlocuteurs de votre rapporteur n’a exprimé d’inquiétude sur le niveau d’endettement d’EDF, il n’empêche que le montant des investissements qu’EDF envisage de consacrer au Grand carénage représente, par son ampleur, un « mur » dont le franchissement présente quelques difficultés.
S’agissant de la faisabilité industrielle, Pierre-Franck Chevet fait valoir que « le rendez-vous des quarante ans […] représente, par ailleurs, une charge de travail hors du commun pour EDF et pour l’ASN et son appui technique. EDF rencontre des difficultés pour gérer les arrêts de tranche et les opérations de maintenance qu’ils exigent, alors que le rendez-vous du grand carénage et, éventuellement, la mise en œuvre des recommandations émises après Fukushima et la prolongation au-delà de quarante ans sont devant nous. Cette situation pose la question de la capacité à faire face à ces défis. » D’ailleurs, l’électricien a cherché à améliorer la trajectoire de ses investissements résultant de cet « empilement » d’objectifs et de contraintes afin de retrouver des marges de manœuvre financières et de sécuriser la réalisation industrielle de son projet. Dominique Minière a indiqué à la commission avoir conduit une « mission d’évaluation » dont les résultats tels que détaillés désormais par la Cour des comptes sont les suivants :
– une capacité de réduction d’environ 8 milliards d’euros a été identifiée pour les investissements prévus sur la période 2013-2025 ;
– la trajectoire des investissements est fortement lissée : elle progresse plus régulièrement pour atteindre un sommet en 2017, inférieur de 20 % à celui du scénario précédent ; elle plonge en 2022 et repart à la hausse pour atteindre un nouveau pic en 2025 puis se stabiliser entre 2025 et 2030, à un niveau inférieur de 7 % à celui du scénario précédent.
Le lissage induirait une baisse de la charge industrielle et permettrait, selon EDF, de réduire la durée de certains arrêts de tranche. Le plan de charge des prestataires serait également affecté.
Loin d’être anecdotique, la mobilisation et l’organisation du tissu industriel sur de nombreux sites en parallèle constituent un réel enjeu. Les avatars connus à l’occasion des arrêts de tranche montrent le poids de l’héritage de la décennie de sous-investissement qui a désorganisé les interventions des entreprises prestataires des exploitants (voir le chapitre 3). Hervé Machenaud, directeur exécutif Production-Ingénierie d’EDF, attribue aux « faiblesses liées aux problèmes de mobilisation de l’industrie » une partie des retards observés dans le déroulement du chantier de l’EPR de Flamanville. Afin de prévenir la réédition de ce phénomène et les conséquences que cela pourrait entrainer sur les calendriers, les coûts, voire la sûreté, EDF s’attelle à organiser dans toute la France des rencontres avec les entreprises prestataires. Comme l’indique d’ailleurs Pierre-Marie Abadie, « sous l’appellation de “Grand carénage”, il y a une part de communication vis-à-vis du tissu de PME à mobiliser et des autres acteurs industriels. […] Ce programme constitue un véritable défi industriel : il s’agit de mobiliser et d’organiser tout le tissu industriel avec la visibilité nécessaire. »
La table ronde organisée avec des dirigeants d’entreprises prestataires d’EDF a permis de montrer que la mobilisation du tissu industriel, acquise dans son principe, se heurte à l’insuffisante visibilité offerte par EDF à ses partenaires. Ainsi, Alain Bertaux, président de CICO Centre, indique que « nous avons estimé que, par comparaison avec la charge nécessaire dans un contexte de maintenance normale des sites, le volume de travaux nécessaires dans les métiers de tuyauteurs-soudeurs et de chaudronniers allait être multiplié par 1,7 pour la décennie à venir. Le groupe de travail en a conclu que, dans ces métiers, l’industrie française avait des ressources suffisantes pour y faire face en favorisant les passerelles entre les industries et en proposant des formations au fil des ans. […] Cependant, nous ne serons en mesure de nous adapter que sous réserve de disposer d’une certaine visibilité. Car la formation aux métiers de tuyauteur-soudeur et de chaudronnier ne se prépare pas en un stage de trois à douze mois, mais peut durer jusqu’à dix ans ».
Jean-Claude Lenain, président-directeur général de Mistras Group SA, déplore pour sa part la différence de situation entre les PME et les grands groupes, alors que l’exigence de visibilité est peut-être plus forte encore pour les premières que pour les seconds : « Ascot poursuit un important programme de création d’emplois, mais, faute de trouver du personnel qualifié sur le marché, nous embauchons du personnel sans qualification, essentiellement des jeunes, que nous envoyons dans notre institut de formation de Chalon. […] Selon le niveau des acteurs, il faut douze à vingt-quatre mois pour les former au contrôle non destructif. C’est pourquoi il nous est indispensable d’avoir une certaine visibilité sur l’évolution du secteur. À cet égard, nous regrettons qu’une PME n’ait pas accès au même niveau d’information qu’un grand groupe. »
Il n’est donc pas certain que le tissu industriel soit en mesure de participer comme il le souhaiterait au projet d’EDF. Or, ne pas donner de visibilité suffisante aux acteurs fait courir les risques d’un accroissement des prix, par le biais de deux phénomènes : une hausse du prix des prestations en cas de tension sur l’outil industriel ou la main-d’œuvre ; éventuellement, un recours accru à des entreprises étrangères est à prévoir si le tissu industriel français ne suit pas ; un coût financier lié à l’allongement des délais.
Le coût du Grand carénage est donc entouré de multiples incertitudes : sur la tenue des équipements non remplaçables, sur les exigences d’amélioration de la sûreté qui seront in fine arrêtées par l’ASN, sur le périmètre exact des travaux qui y seront inclus, sur les coûts de réalisation ; il faut également y ajouter les incertitudes sur la rentabilité des travaux effectués, qui dépend largement du prix de vente de l’électricité (voir chapitre 9) et de la durée de fonctionnement qui sera accordée, au cas par cas, par l’ASN à chacun des réacteurs. Votre rapporteur ne peut manquer de rappeler, à ce stade, que André-Claude Lacoste, alors président de l’ASN, déclarait en 2009 : « il ne faut pas que la gestion d’EDF soit basée sur des paris concernant la durée d’exploitation » (27).
C’est dire si le rapport de la Cour des comptes, nonobstant sa précision et la justesse de ses analyses, ne clôt pas le sujet du Grand carénage. C’est dire si des études et des évaluations extérieures au giron d’EDF apparaissent aujourd’hui plus indispensables que jamais. À cet égard, le rapport réalisé par WISE-Paris pour le compte de Greenpeace et publié en février dernier apporte des éléments au débat.
Son auteur, Yves Marignac, en a présenté les grandes lignes et les principaux enseignements devant la commission, en soulignant d’emblée que « la plus grande incertitude règne sur les conditions dans lesquelles une telle prolongation est envisageable. » Yves Marignac fait également mention d’un point sur lequel bien peu de personnes se sont exprimées : « Deux visions s’opposent donc : pour les uns, on peut, par le renforcement, compenser le vieillissement et conserver une marge de sûreté suffisante par rapport à des exigences de sûreté même accrues ; pour les autres, inéluctablement, le vieillissement nous empêchera de respecter les exigences de sûreté. » L’articulation est souvent faite entre le vieillissement des installations et les parades que l’on peut y opposer ; la prise en compte des marges de sûreté doit aussi faire l’objet d’une attention constante. Or, justement, quelques débats ont été ouverts à ce sujet entre l’ASN et EDF, qui souhaiterait, par exemple, remplacer le critère de non amorçage par un critère de non-propagation, pour les défauts du métal de la cuve.
Le rapport adopte ensuite « une démarche prospective en déterminant cinq facteurs discriminants : référentiel de sûreté, maintenance pour assurer la conformité de l’installation, orientation technique, processus de décision, délais de réalisation. Il s’agit bien de prospective, c’est-à-dire que ces scénarios ne sont ni des prévisions ni des prescriptions, mais des visions cohérentes en fonction de différents niveaux d’exigence. Nous avons défini trois scénarios : sûreté « dégradée », sûreté « préservée » et sûreté « renforcée », ce troisième scénario correspondant à la recherche aussi systématique que possible de niveaux d’exigence de nouveaux réacteurs de type EPR. L’étude détaille, en neuf catégories, trente-six postes de renforcement avec, pour chaque scénario, une caractérisation technique des renforcements associés. » L’analyse de coûts associée à ces trois scénarios aboutit à « une estimation de 350 millions d’euros, plus ou moins 150 millions, pour le scénario de sûreté « dégradée » ; de 1,4 milliard, plus ou moins 600 millions, pour le scénario de sûreté « préservée » ; et enfin de 4 à 5 milliards pour un scénario de sûreté « renforcée » », ces montants s’entendant pour un seul réacteur.
Henri Proglio a contesté avec force et une dose de cynisme la validité des chiffrages présentés dans le rapport WISE : « Nous avons pris connaissance de cette évaluation. À titre de comparaison, j’ai consulté l’estimation du même cabinet pour les diesels d’ultime secours, en cours de construction. Il les valorise à 200 millions par tranche, alors que le programme porte sur 2 milliards pour l’ensemble des cinquante-huit tranches. On peut donc relativiser la pertinence de ce chiffrage, ce qui est une bonne nouvelle pour l’économie française. Mais tout le monde a le droit de se tromper ! Dans le domaine nucléaire, nous avons une certaine antériorité par rapport aux cabinets anglo-saxons, ce qui nous permet de connaître les coûts de revient de nos propres tranches. » Mais, inversement, la CFDT a estimé qu’« une réponse sérieuse et circonstanciée doit être apportée au récent rapport de l’agence WISE-Paris sur les coûts de l’éventuelle prolongation de la durée de vie des centrales nucléaires. Certes, ce rapport a été commandé par Greenpeace, ce qui suffit à le discréditer aux yeux de certains. Mais ce n’est pas notre cas : il est fondé sur des chiffres qui ne sont pas contestés » (Dominique Olivier, secrétaire confédéral chargé du développement durable). De son côté, l’ASN a estimé que la grille d’analyse et les questions posées par le rapport WISE étaient les bonnes, recoupant largement les siennes propres, mais que l’ASN ne se prononçait pas sur les coûts. Lors de la réunion de travail au siège d’EDF, Dominique Minière a lui aussi confirmé la pertinence du travail, la justesse de nombre d’évaluations, mais des écarts très importants sur 4 à 5 postes qui constituent l’essentiel de la différence de point de vue entre EDF et WISE.
La divergence de vue ainsi exprimée devant la commission montre que le rapport de WISE est devenu un élément du débat sur l’éventuelle prolongation des réacteurs. Ce rapport rappelle, notamment, qu’aucun exploitant n’a à ce jour d’expérience en matière d’exploitation à très long terme d’un réacteur puisqu’aucun d’entre eux n’a jamais atteint l’âge de 50 ans.
B. LA CONSTRUCTION D’UN NOUVEAU PARC NUCLÉAIRE, UN INVESTISSEMENT CONSIDÉRABLE
1. L’EPR de Flamanville : une « tête de série » construite dans la douleur, de laquelle il est encore délicat de tirer un retour d’expérience
Trois mots caractérisent le chantier de l’EPR de Flamanville : retards, surcoûts et malfaçons. L’EPR de Flamanville a reçu son décret d’autorisation de création en avril 2007, après que la loi d’orientation sur l’énergie du 13 juillet 2005 lui a fourni un cadre législatif adéquat et qu’un débat public a été organisé au plan national entre octobre 2005 et février 2006. Au début du chantier, la mise en service est prévue pour 2012. Cette date ne cessera d’être repoussée et la première production d’électricité en conditions commerciales est désormais prévue en 2016.
Lorsqu’en mai 2006, le conseil d’administration d’EDF valide le lancement du projet, le coût de l’EPR est estimé à 3,3 milliards d’euros, correspondant à un coût complet de production d’environ 46 euros par MWh (en valeur 2005). Les prévisions de coût sont par la suite relevées à plusieurs reprises et, pour la dernière fois, en décembre 2012, à 8,5 milliards d’euros. EDF ne fournit plus de prévision du coût complet de production du MWh depuis 2008, date du relèvement du devis global à 4 milliards d’euros ; le coût complet était estimé à cette date à environ 54 euros par MWh (en valeur 2008).
Le chantier a été marqué par de nombreuses difficultés, par exemple au regard de la qualité des opérations de bétonnage, qui ont parfois amené l’ASN à interrompre son déroulement et à soumettre sa reprise à autorisation : « Je citerai, à titre d’exemple, des problèmes de soudage du liner, le revêtement interne de l’enceinte de confinement, en 2008, 2009 et 2010, ou des problèmes de génie civil : positionnement des câbles de précontrainte, nids de cailloux dans certaines parois, problèmes de fabrication du couvercle de cuve – lequel comporte davantage de conduits que les couvercles actuels – ou encore montage à l’envers de certaines vannes. Dans ce dernier cas, l’ASN a exigé qu’AREVA donne des explications sur les causes de cette erreur et fasse le nécessaire pour empêcher qu’elle se reproduise ; elle n’a autorisé la reprise du chantier qu’à partir du moment où elle a considéré qu’elle avait obtenu des garanties suffisantes » (Philippe Jamet, commissaire de l’ASN). Et même si l’ASN « n’a aujourd’hui aucun doute sur la qualité de la réalisation de l’EPR », la remarque de Yannick Rousselet (Greenpeace) ne peut être totalement écartée : « bien qu’il n’y ait eu qu’un couvercle de cuve à construire, il a fallu refaire les soudures des traversées et des bossages. Résultat : on en est réduit à monter un couvercle bricolé sur une cuve censée être neuve ! »
La réédition, sur le chantier de l’EPR d’Olkiluoto, en Finlande, de délais et surcoûts similaires amène, selon les dernières estimations, le coût final du projet finlandais à environ 8,5 milliards d’euros. Il n’appartenait pas à la commission de se prononcer sur les responsabilités respectives du constructeur et du futur exploitant, ni sur les exigences de l’autorité de sûreté finlandaise.
La commission d’enquête a pris note de ce que les conditions dans lesquelles se déroule le chantier d’Olkiluoto ont amené AREVA à passer en provisions pour perte un montant total de 3,9 milliards d’euros, que le consortium AREVA-Siemens a déposé une demande de compensation pour 2,7 milliards d’euros – qui, indique Luc Oursel, président du directoire d’AREVA, « ira hélas en s’accroissant » –, qu’AREVA se refuse désormais à avancer une date de mise en service de la centrale et que le coût de production du MWh qui sera délivré aux bornes de la centrale n’est pas plus communiqué. Luc Oursel a, par ailleurs, contesté devant la commission qu’AREVA ait fait du « forcing » pour vendre la centrale, comme l’aurait indiqué la Cour des comptes dans un pré-rapport ayant filtré dans la presse, même s’il concède que « l’appel d’offres s’est déroulé, début 2000, dans un climat de forte compétition. C’était le premier projet européen de ce type, ce qui a suscité des rivalités avec les constructeurs américains et japonais. »
Les interrogations sur le bon achèvement du chantier de Flamanville restent de mise. Pour EDF, le projet est désormais revenu sous contrôle : « Le projet d’EPR à Flamanville fait aujourd’hui l’objet d’un pilotage très rigoureux, qui résulte d’un plan d’action prioritaire lancé en 2010 et qui a permis de mieux maîtriser le coût et les délais du chantier. L’avancement des travaux, en matière tant d’études que de réalisation, offre désormais une idée stabilisée du budget à terminaison. Bien entendu, compte tenu de l’ampleur du chantier, des risques et des incertitudes demeurent, mais ils sont clairement identifiés et font l’objet de plans d’action spécifiques permettant d’anticiper les difficultés et de regagner les marges […]. Nous disposons à ce jour d’une vision détaillée des risques et de ce qui reste à faire, y compris par nos prestataires. Le planning et les coûts n’ont pas évolué depuis deux ans » (Hervé Machenaud). Philippe Jamet rappelle cependant que des étapes essentielles sont encore à venir avant que la mise en service du réacteur puisse être autorisée : EDF doit établir et transmettre pour analyse plusieurs études (études d’accident, programme des essais de démarrage, plan d’urgence interne, règles générales d’exploitation) avant la fin de l’année 2014. Or, comme le souligne l’ASN, « la poursuite des études et les aléas du chantier ont conduit à des évolutions et à des modifications qu’il faudra prendre en compte pour l’autorisation de mise en service définitive. Ce sont des circonstances assez classiques pour un prototype, mais l’ampleur de la tâche est telle que, dans la perspective d’une autorisation de mise en service prévue pour 2016, le planning est plus que tendu » (Philippe Jamet). L’ASN attire, par ailleurs, l’attention sur la complexité de la validation des systèmes de contrôle-commande informatiques, qui avaient conduit aux retards de mise en service du palier N4.
Si l’EPR n’était pas mis en service en avril 2017, date du 10ème anniversaire de son décret d’autorisation de création fixant un délai de 10 ans pour sa mise en service, se poserait la question du statut juridique de l’installation. Selon l’ASN, le Gouvernement aurait la possibilité d’annuler le décret, obligeant ainsi EDF à reprendre l’ensemble de la procédure administrative.
b. Un coût de l’EPR « modèle Flamanville » peu évident à cerner
Pour savoir dans quelle mesure l’EPR de Flamanville peut préfigurer un modèle industriel de renouvellement du parc nucléaire dans des conditions de compétitivité suffisantes, il faut passer par plusieurs détours, puisque EDF ne souhaite plus donner de prévision du coût du MWh aux bornes de Flamanville-3.
La comparaison avec le projet de construction de deux EPR à Hinkley Point, au Royaume-Uni, est délicate, ne serait-ce que parce l’EPR y est encore un réacteur totalement « papier » dès lors que le projet n’a pas encore reçu toutes les autorisations nécessaires, ni le blanc-seing de la Commission européenne sur les aspects financiers. Certains paramètres sont cependant connus : d’une part « l’EPR de Hinkley Point bénéficie d’un effet d’apprentissage dont le prix tient compte » ; d’autre part, « il s’apparente en même temps à une tête de série. En effet, la réglementation anglaise diffère beaucoup de la nôtre pour des raisons historiques. Les règles relatives au risque d’incendie ou au contrôle commande ont conduit à redimensionner les bâtiments, ce qui n’est pas sans conséquences. En outre, le site très particulier de la centrale, au bord d’un estuaire où les marées sont très fortes, nécessite des travaux souterrains et maritimes lourds pour aller chercher l’eau et la rejeter très loin. De plus, si l’EPR de Flamanville bénéficie de toutes les installations du parc destinées notamment à la gestion des combustibles, il faut à Hinkley Point construire des piscines spécifiques. Bref, de nombreuses causes structurelles expliquent le surcoût » (Hervé Machenaud). Évoquant devant la commission d’enquête, le 6 mai dernier, la perspective de construire cinq réacteurs EPR au Royaume-Uni, Henri Proglio indique d’ailleurs que « Avec plus de 50 milliards d’euros au total, il s’agit de loin du plus gros investissement réalisé au Royaume-Uni depuis la fin de la deuxième guerre mondiale », ce qui place le coût d’un EPR britannique à environ 10 milliards d’euros.
À ce stade, le projet de construction des EPR britanniques bénéficierait d’un environnement économique spécifique. C’est celui qui fait d’ailleurs l’objet d’une enquête de la part des services de la Commission européenne : le tarif d’achat de l’électricité est garanti pendant 35 ans dans le cadre d’un « contract for difference » et la dette émise pour financer la centrale est couverte par une garantie du Trésor britannique (voir chapitre 1).
Pour approcher le coût que pourrait représenter un « programme » de construction d’EPR, évaluer l’effet des spécificités de Flamanville-3 et des difficultés rencontrées sur le chantier est une voie plus prometteuse. Hervé Machenaud présente les éléments qui expliquent que, à ses yeux, l’EPR de Flamanville « n’est dès lors pas représentatif d’une filière EPR industriellement mature qui pourrait être développée par la suite ». On peut notamment citer :
– le fait que « tous [les] pays et constructeurs traversent une phase de mise au point et d’apprentissage et connaissent des difficultés et des retards dans le développement de leurs réacteurs de troisième génération » ;
– le fait que le projet fait suite à une interruption de près de 15 ans de toute construction neuve, qui a entraîné une perte de savoir-faire ; Philippe Knoche, directeur général délégué d’AREVA, estime que l’expérience de la filière industrielle chinoise a un rôle déterminant dans le bon déroulement du chantier de construction de deux EPR sur le site de Taishan, en Chine ; « En matière industrielle, l’efficacité résulte essentiellement de la pratique. Si Taishan a été un tel succès, aussi rapide, cela résulte du retour d’expérience joint au fait que les entreprises chinoises construisent dix centrales nucléaires par an » (Hervé Machenaud) ;
– le fait que Flamanville-3 est une « première du genre », expression distinguée par Hervé Machenaud de celle de « tête de série », même s’il a également employé cette dernière ;
– le fait que certains choix de conception et de construction ont été malheureux : Hervé Machenaud évoque « des évolutions techniques auxquelles on a procédé de manière quelque peu théorique et insuffisamment adaptée à la réalité industrielle. En d’autres termes, nous nous sommes fixé à nous-mêmes des contraintes qui n’étaient ni constructives ni réalistes du point de vue industriel », notamment en matière de génie civil ;
– le fait que le travail d’ingénierie de détail n’était pas suffisamment avancé au moment où les travaux de Flamanville ont été lancés ;
– le fait que l’évaluation des coûts et des délais a été fondée sur les données issues des chantiers du palier N4 alors que, dans l’intervalle, « la réglementation et les contrôles ont été substantiellement modifiés » ; dès lors, « partir de Civaux pour construire un EPR n’était probablement pas la bonne référence… » (Hervé Machenaud).
En définitive, le coût d’un « EPR normalisé », c’est-à-dire débarrassé des surcoûts facilement évitables constatés à Flamanville et délesté des coûts d’ingénierie imputés à toute tête de série, serait, selon EDF, d’environ 6 à 6,5 milliards d’euros : « Le coût de construction de Flamanville 3 est aujourd’hui estimé à 8,5 milliards d’euros. C’est le budget que nous avons annoncé il y a près de deux ans. Sur ce total, 900 millions environ sont identifiés comme des coûts propres à la tête de série, liés essentiellement à de l’ingénierie, et amortissables sur la série. Il faut aussi tenir compte des difficultés, également propres à la tête de série, de mise en œuvre du génie civil […]. Nous évaluons à 1,5 milliard d’euros environ le coût de ces difficultés et des retards qui s’ensuivent. Ces deux calculs ramènent le coût de l’EPR à 6 ou 6,5 milliards d’euros. »
Dans son rapport de janvier 2012, la Cour des comptes avait estimé le coût de production de l’EPR dans une fourchette de 70 à 90 euros par MWh, sur la base du coût global alors retenu par EDF, à savoir 6 milliards d’euros, et pour la durée d’exploitation prévue de 60 ans. L’estimation du coût de l’« EPR normalisé » donnée devant la commission d’enquête correspond à cette estimation, ce qui amène Cyrille Cormier, chargé de campagne climat-énergie à Greenpeace France, à relever que « la production de l’EPR […] sera vendue sur un marché de gros européen où le mégawattheure se négocie entre quarante et soixante euros. Sa compétitivité est donc loin d’être garantie. » Et ce, d’autant que « sa capacité à fonctionner n’a pas été démontrée, et ses performances supposées, notamment s’agissant du taux de charge de 90 %, restent hypothétiques. Or cela aura une incidence sur le coût de production de l’électricité. » Sur ce dernier point, dont EDF rappelle qu’il constitue un objectif, Philippe Knoche fait valoir que l’évaluation du taux de disponibilité attendu de l’EPR s’appuie sur certains éléments objectifs et vérifiés : « En ce qui concerne la disponibilité, le taux de 90 % est dépassé dans les centrales qui sont à la base de la conception de l’EPR, à savoir les centrales Konvoi allemandes – et vous savez que le régulateur allemand n’est pas le plus porté à être favorable au nucléaire… Elles le doivent à une architecture qui a été reprise pour l’EPR, comportant l’existence de quatre « trains de sûreté », ce qui permet d’assurer la maintenance de l’un d’entre eux pendant que la centrale est en service. Ce taux de disponibilité est également dépassé aux États-Unis. » Ce n’est évidemment qu’à l’épreuve de l’exploitation future que ces appréciations pourront être confirmées ou infirmées, et ce d’autant plus qu’à l’heure actuelle, aucun des quatre EPR en cours de construction n’a été autorisé à être chargé en combustible, encore moins mis en service, et qu’il s’agit toujours d’une phase délicate, particulièrement pour une « tête de série ».
2. La palette des options est largement ouverte
Si la France décidait de se doter d’un parc de réacteurs de 3ème génération, il est très probable que ceux-ci seraient assez différents de l’EPR de Flamanville. Pour Jacques Repussard, directeur général de l’IRSN, « l’EPR n’est pas la fin de l’histoire des réacteurs à eau légère ; en d’autres termes, des améliorations sont encore possibles. Il correspond à un choix de filière et marque une étape et des progrès importants mais, si la France décidait de se doter d’un nouveau parc de réacteurs à eau légère, ce serait une erreur de se contenter de dupliquer l’EPR de Flamanville, dont la conception, je le rappelle, remonte à plus de vingt ans. »
Les conséquences de ces ajustements sur le coût de renouvellement du parc sont, à ce stade, difficiles à apprécier.
a. La conception générale de l’EPR peut être optimisée
Les réacteurs de puissance constituent l’un des segments du marché des nouveaux réacteurs nucléaires tel qu’identifié par AREVA : « 10 à 20 % du marché est « spécifique grande taille ». Par exemple, les pays scandinaves donnant des autorisations pour la construction d’un réacteur sur un site, mieux vaut maximiser la puissance de celui-ci. » La filière nucléaire française considère donc que des réacteurs de type EPR peuvent trouver leur place, en France ou à l’exportation, dès lors qu’un travail d’ingénierie substantiel permettrait d’abaisser leur coût. L’optimisation du produit industriel et la réduction de ses coûts peuvent prendre des formes plus ou moins exigeantes.
En premier lieu, EDF estime pouvoir tirer bénéfice d’un « effet d’apprentissage » en ne reproduisant pas, sur de nouveaux réacteurs, les mêmes erreurs que sur Flamanville. Il s’agit, pour l’essentiel, d’établir un mécanisme de retour d’expérience entre les différents chantiers EPR dans le monde (Chine, Finlande, France) : « il importe aussi de mieux exécuter à design identique – autrement dit, de ne pas refaire les mêmes erreurs que sur les premiers réacteurs. Nous pouvons d’ores et déjà observer des progrès quantitatifs entre Olkiluoto 3 et Taishan : le nombre d’heures d’ingénierie sur notre périmètre chaudière a baissé de 60 % ; nous avons gagné 50 % sur le temps de construction, 40 % sur les temps de fabrication et jusqu’à 65 % sur les délais d’approvisionnement, notamment grâce à l’effet de série constaté chez les fournisseurs et intégré par les autorités de sûreté » (Philippe Knoche).
Dans un second temps, l’optimisation passe par un travail de reprise du design, mais à certification constante, donc sans changement majeur ; c’est le sens du travail que EDF et AREVA conduisent actuellement en vue de répondre à un appel d’offres en Pologne : « le travail que nous menons avec AREVA sur la plateforme dite « Pologne » et notre réflexion en vue d’améliorer la sûreté et l’efficacité, sur la base de cet EPR et éventuellement de modèles évolutifs, nous permettent d’escompter une baisse notable de ce montant à assez long terme » (Hervé Machenaud). Il s’agit par exemple de revoir certains éléments de génie civil pour en simplifier la réalisation : Hervé Machenaud cite la réduction de la densité du ferraillage et le réalignement de certains voiles de béton de façon à éviter des reprises de charge.
Enfin, une optimisation plus approfondie passe par la mise au point d’un nouveau design, qui oblige à une nouvelle certification du modèle de réacteur et repousse le déploiement de celui-ci à un horizon plus lointain : « On peut par exemple se demander s’il est plus sûr d’avoir deux enceintes qu’une seule, cinq trains de sûreté plutôt que deux » ; « une conception de base (basic design) de ce nouveau réacteur pourrait débuter à l’été 2014, ce qui serait compatible avec les calendriers saoudiens » (Hervé Machenaud).
b. Les dispositifs de sûreté sont appelés à évoluer
Initié au début des années 1990, l’EPR fait partie de la première génération de réacteurs à prendre en compte les accidents graves, notamment de fusion du cœur, et la possibilité de rejets importants dans l’environnement. Il tire en cela le retour d’expérience des accidents de Three Mile Island et de Tchernobyl. Les objectifs de sûreté fixés à l’EPR ont été définis sur une base très rigoureuse, rappelée par Philippe Jamet : « Dès 1993, un certain nombre d’objectifs de sûreté ont été définis. Le premier d’entre eux consiste à réduire significativement le nombre des incidents par rapport au parc actuel, grâce, d’une part, à la fiabilisation des équipements et, d’autre part, à la prise en compte, dès la conception du projet, du facteur humain. Un deuxième objectif est de réduire très significativement, de l’ordre d’un facteur 10, la probabilité de fusion du cœur. Et l’EPR s’est également vu assigner des objectifs en termes de conséquences des accidents. […] Ces objectifs de 1993 ont été […] complétés par des objectifs supplémentaires en termes de résistance à la malveillance, de gestion des déchets, de radioprotection et de management de la sûreté. »
Pour autant, si l’ASN affirme que « le réacteur EPR marque, du point de vue de la sûreté, un progrès considérable par rapport au parc existant », cela ne signifie pas que de nouveaux progrès seraient inaccessibles. D’ailleurs, l’EPR a, comme les autres réacteurs du parc, fait l’objet de prescriptions à la suite des Évaluations complémentaires de sûreté ; compte tenu du niveau de sûreté initial du réacteur, en termes de conception, ces prescriptions ne concernent que le « noyau dur » et la FARN. Pour Philippe Jamet, d’ailleurs, « le « noyau dur » est naturellement plus facile à mettre en place sur l’EPR que sur les réacteurs du parc actuel. Sans doute certaines exigences sont-elles d’ailleurs déjà remplies. » Dans plusieurs domaines, des fragilités subsistent cependant sur l’EPR actuel et des pistes sont explorées dans le cadre d’autres projets de réacteurs.
En matière de résistance aux agressions externes, le sujet de la tenue de l’enceinte en cas de chute d’avion fait l’objet d’une approche prudente : « Je confirme que l’enceinte de l’EPR a été conçue pour résister à un crash d’avion. L’aéronautique évoluant, je ne sais néanmoins si cela sera encore le cas dans un siècle » (Philippe Jamet). Jacques Repussard ajoute que « l’EPR est conçu pour résister à l’impact mécanique d’un avion de grande capacité, mais les effets qu’aurait l’embrasement de plusieurs dizaines de tonnes de carburant restent difficiles à évaluer. »
Les piscines de l’EPR sont mieux protégées que celles du parc actuel contre les agressions externes mais « le système reste intrinsèquement vulnérable » ; en effet, « les piscines de l’EPR sont en hauteur. À la différence de celles du parc actuel, elles sont protégées des crashs d’avion. Mais d’autres scénarios sont possibles, comme une vidange accidentelle » (Jacques Repussard).
Au regard de la gestion des accidents graves, l’EPR est équipé d’un récupérateur de corium qui a une triple fonction : faire obstacle au corium et l’empêcher d’attaquer le béton du radier, étaler le corium de façon à faciliter son refroidissement et refroidir directement le corium grâce à des réserves d’eau spécifiques. Yannick Rousselet estime cependant que la robustesse technique de cette solution n’a jamais été validée. Par ailleurs, rappelle Jacques Repussard, « il existe d’autres solutions, et certains ingénieurs nucléaires travaillent à l’étranger sur le concept du maintien en cuve du combustible fondu, ce qui empêcherait des conséquences graves en cas d’accident sérieux puisque le combustible se refroidirait dans la cuve. »
La possibilité d’implanter des systèmes dits « passifs » sur un réacteur de 3ème génération a également été évoquée devant la commission d’enquête. Pour Jacques Repussard, l’usage éventuel de systèmes de sûreté passifs pourrait être un élément d’optimisation économique et industrielle d’un futur parc électronucléaire. L’intérêt des systèmes passifs est qu’ils permettent, au moins pour un temps, d’assurer la fonction de sûreté pour laquelle ils ont été conçus sans avoir besoin d’énergie extérieure : « contrairement à l’AP 1000 américain, l’EPR ne dispose pas de système de sûreté passif : il nécessite une source d’énergie externe, avec des lignes de raccordement et des générateurs de secours à moteur diesel pour que l’eau du circuit primaire puisse continuer à circuler et le système de refroidissement à fonctionner. C’est précisément un tel système qui avait fait défaut à Fukushima. L’AP 1000 américain, lui, n’a besoin d’aucune énergie extérieure : en cas d’accident, par simple échange thermique, le circuit d’eau chaude/eau froide continue à faire circuler l’eau dans le circuit primaire » (Yannick Rousselet).
La sûreté du réacteur dépend cependant de la robustesse de la démonstration effectuée par l’exploitant et, en l’espèce, l’ASN relève que les démonstrations de sûreté de réacteurs comme l’AP 1000 « ont un fort caractère probabiliste, peu conforme à notre conception de ce que doit être une démonstration de sûreté. »
c. Les réacteurs de 1 000 MW pourraient être de réels concurrents
Historiquement, la France a choisi de développer des réacteurs de taille toujours plus grande afin de bénéficier d’économies d’échelle et d’abaisser le coût de production de l’électricité. À l’issue des travaux de la commission d’enquête, il apparaît qu’il n’est pas exclu que ce choix fondateur soit amené à évoluer.
Cela répond d’abord à une préoccupation industrielle de diversification de l’outil de production. Henri Proglio affirme ainsi : « Quels sont les outils susceptibles d’assurer la permanence de la production électronucléaire française ? Aujourd’hui, l’EPR est l’outil de référence, car c’est le plus achevé des réacteurs de troisième génération existant en France. Il n’est pas exclu que nous développions des réacteurs de troisième génération de 1 000 mégawatts de différents types, mais aucun n’a été construit à ce jour, à la différence des réacteurs de 1 650 mégawatts de type EPR. […] Je suis toujours aussi partisan du développement d’un réacteur français de 1 000 mégawatts, qui permette d’engager des coopérations internationales, plutôt que d’attendre de nos partenariats une réponse pour la conception d’un futur « produit sur étagère » de 1 000 mégawatts. Nous nous sommes mis d’accord avec AREVA pour avancer sur un tel projet. »
Parallèlement, Areva et Mitsubishi développent le projet ATMEA, notamment pour une éventuelle implantation en Turquie. Selon Luc Oursel, le prix du kWh produit par les réacteurs ATMEA devrait se situer 5 à 10 % au-dessus de celui de l’EPR.
Mais l’évolution vers des réacteurs de plus petite taille pourrait aussi apparaître comme une réponse à la préoccupation exprimée par Jacques Repussard, qui conteste la pertinence de la logique d’économies d’échelle lorsqu’elle doit être rapportée au risque d’un accident majeur : « Le risque zéro n’existe pas. J’ai donc recommandé que l’on appréhende la course à la puissance en termes de précautions et non plus en termes de performances technologiques. Les Coréens et les Chinois imaginent des réacteurs passifs de 1 600 MW, ce que je juge très déraisonnable. Mes propos à la presse ne visaient pas particulièrement l’EPR, mais je m’interroge : l’industrie nucléaire ne se trompe-t-elle pas de combat quand elle tente de baisser le coût du KWh en augmentant la puissance de ses réacteurs plutôt qu’en vendant des réacteurs moins puissants mais générant des risques dont la probabilité de maîtrise est plus grande ? La probabilité que survienne un accident consécutif à une catastrophe à laquelle les ingénieurs n’auraient pas pu parer est supérieure pour l’EPR à 10-6, et ses conséquences sont proportionnelles à la puissance du réacteur. » Pour l’IRSN, donc, « la question de la puissance doit être réexaminée. »
Une interrogation demeure sur la vigueur du « moteur » économique qui pourrait alimenter la transition vers des réacteurs de 1 000 MW. Dès lors que, devant la commission d’enquête, personne n’a remis en cause la réalité des économies d’échelle résultant de l’accroissement de la puissance des réacteurs, la compétitivité comparée des réacteurs de 1 000 MW par rapport aux réacteurs de type EPR ne peut reposer – tous autres aspects techniques ou réglementaires égaux par ailleurs – que sur des effets de série, dont l’apparition est liée au volume du marché. Or, aux yeux de Philippe Knoche, le marché spécifique des réacteurs de 1 000 MW n’est pas si grand : « Nous avons entendu dire que la demande du marché porterait majoritairement sur des réacteurs de 1 000 MW, mais cette affirmation ne peut être vérifiée. La Chine développe aujourd’hui le CAP 1400, sur lequel elle fonde une partie de son avenir nucléaire, au-delà de l’EPR, et on estime à environ 15 % la part du marché qui est « spécifique 1 000 MW », c’est-à-dire les cas où les exploitants ont indiqué qu’ils n’accepteraient pas de puissance supérieure. Dans les projets en cours, que ce soit en Chine, pour les tranches suivantes de Taishan, en Inde, en Pologne, en Afrique du sud, en Arabie saoudite ou au Royaume-Uni, ce sont le coût du mégawattheure, le risque de construction et la qualité du financement qui sont en débat. Ce sont donc des facteurs de compétitivité économique, de qualité de design et des critères de sûreté qui sont privilégiés, la taille ne jouant que pour une faible part. »
Plusieurs intervenants ont cependant souligné l’inadaptation de réacteurs de forte puissance dans les pays ne disposant pas d’un réseau de transport électrique adapté. La concentration de la puissance installée sur un site accroît la vulnérabilité globale de l’approvisionnement par rapport à une plus grande « dispersion » sur des installations de production de puissance plus faible. La dimension et la structure du réseau de transport sont, pour beaucoup de pays, un facteur dimensionnant essentiel.
3. Le coût du renouvellement du parc ne semble pas échapper à la « loi d’airain » du nucléaire
Le rapport de la Cour des comptes avait déjà noté, en janvier 2012, que les coûts du MWh produit augmentent progressivement, même si ce n’est pas de manière régulière. Il notait aussi que les têtes de série d’une part, les premières tranches d’un site d’autre part, ont en général des coûts de construction plus importants que les tranches suivantes.
La réévaluation du devis de l’EPR, en décembre 2012, donne encore plus de relief à ce constat et Cyrille Cormier souligne que « la courbe d’apprentissage de l’ensemble des réacteurs, de 1978 à 2002, montre une pente positive : en d’autres termes, le coût de production des réacteurs a augmenté avec le temps – pour une augmentation totale de l’ordre de 50 % sur l’ensemble de la période. Si l’on considère l’évolution par paliers, en distinguant les différentes séries de réacteurs – 900 CP0, 900 CP1, 900 CP2, 1 300 P4, 1 300 P’4 et 1 450 N4 –, on note une augmentation du coût des têtes de série d’environ 10 % à chaque nouveau palier, à l’exception de la tête de série du 1 300 P4, dont le coût fut bien supérieur. […] Pour l’EPR, on pouvait donc s’attendre, pour la tête de série, à un coût d’environ 2 400 euros par kilowatt, soit un coût global de quelque 3,8 milliards, plus élevé que ce qui avait été annoncé au début du chantier ; ce coût est aujourd’hui estimé à 5 300 euros par kilowatt, soit un total de 8,5 milliards d’euros, c’est-à-dire un peu moins de deux fois plus ! La rupture de coût est donc très supérieure aux 10 % habituels. »
Il n’apparaît pas clairement à l’issue des travaux de la commission d’enquête que les effets d’apprentissage et un éventuel effet de série seraient susceptibles de contrecarrer totalement la très forte « rupture de coût » observable sur le montant du capital engagé, même si le devis d’un « EPR normalisé » était effectivement ramené à 6 ou 6,5 milliards d’euros. François Lévêque, professeur d'économie au CERNA-Mines ParisTech, souligne d’ailleurs : « les travaux que j’ai consacrés à l’évolution des coûts du nucléaire mettent en évidence une tendance relativement connue des spécialistes : le nucléaire est – historiquement du moins – une technologie à coûts croissants, pour laquelle les économies d’échelle et d’apprentissage sont assez difficiles à observer en France, où les conditions ont pourtant été les plus favorables en termes de standardisation et d’expérience de l’opérateur. »
Par ailleurs, l’importance du coût du capital a été rappelée par plusieurs interlocuteurs de la commission. Ce paramètre est essentiel dans une industrie aussi capitalistique que l’industrie nucléaire et, plus généralement, la production d’énergie. Le rapport de la Cour des comptes remis en mai dernier fait valoir, par exemple, que l’augmentation du taux de rémunération du capital utilisé a exercé un effet majorant de +4 % sur le calcul du loyer économique inclus dans le coût économique courant de l’électricité nucléaire.
Nicolas Boccard, professeur associé d’économie à l’Université de Girona (Espagne), souligne à ce propos que « les publications de l’OCDE et de l’Agence internationale de l’énergie tentent généralement de comparer les techniques de production d’électricité en les soumettant à un scénario de taux à 5 % et à un scénario à 10 %. La production au charbon, au gaz et à partir du renouvelable étant assurée par des investisseurs privés, il est d’usage de retenir le taux de 10 %. Si le nucléaire était logé à la même enseigne, il serait beaucoup plus cher. C’est le problème auquel est confrontée la Commission européenne : la garantie de l’État revient à prêter de l’argent à un taux qui n’est pas celui que paierait une entreprise privée. […] le financement du nucléaire français peut apparaître comme indu par comparaison avec le financement d’opérateurs privés. Dans la mesure où tout était financé par une seule entreprise, il n’y a pas eu de discrimination par rapport à l’hydraulique ou du charbon ; mais, dès lors que le marché est soumis à la concurrence, il convient d’examiner l’hypothèse du financement des techniques futures de production électrique avec des fonds privés levés sur les marchés. »
La fixation du taux de rentabilité interne est donc un élément déterminant de la compétitivité du nucléaire : « [le coût du mégawattheure], à EPR identique, n’est pas le même avec un financement finlandais à 5 %, un financement britannique à 10 % ou un financement à taux normal en France. C’est pourquoi EDF fait preuve de prudence en matière de chiffres. Il en va de même pour les énergies renouvelables, compte tenu du poids de l’investissement dans le coût du mégawattheure. Il faut donc toujours comparer à hypothèse de rentabilité identique » (Philippe Knoche).
Pour EDF, société cotée dont le principal actionnaire exige désormais un taux de rentabilité interne d’environ 10 %, l’équation n’est pas neutre : avec un tel taux de rentabilité exigé, l’horizon des recettes futures est singulièrement rétréci ; il l’est d’autant plus que la durée de construction de moyens nucléaires est très sensiblement plus longue que celle de moyens de production renouvelables. Dans un monde où les exigences de marché raccourcissent les horizons et où le renouvellement des capacités installées pourrait représenter une dépense de 240 à 260 milliards d’euros (28), il n’est pas certain qu’un parc d’EPR reflète un optimum économique.
C. L’AVENIR DU PARC NUCLÉAIRE, UNE APPROCHE NÉCESSAIREMENT GLOBALE
1. Le débat sur la prolongation des réacteurs doit prendre en compte de nombreux paramètres
a. La pertinence économique de la prolongation est très sensible au chiffrage du Grand carénage
Par essence, la décision relative à une éventuelle prolongation de tout ou partie du parc nucléaire suppose une comparaison entre les coûts estimés de l’ensemble des solutions susceptibles d’être retenues par l’électricien. Sur ce plan, les propos de bon nombre des interlocuteurs de la commission d’enquête ont été convergents : sur la base des estimations du Grand carénage fournies par EDF, et sous réserve des décisions de l’ASN quant à sa faisabilité et quant aux coûts induits par le nouveau référentiel de sûreté, la prolongation du parc existant est présentée comme la solution la plus économique.
C’est assez naturel, s’agissant des responsables d’EDF : « Nous garantissons dans la durée un coût de production de 55 euros valeur 2011, en euros constants, par mégawattheure, avec la réalisation du programme de grand carénage et une durée de fonctionnement de cinquante ans. Nous garantissons ainsi à nos clients et à la collectivité nationale que le parc nucléaire existant est compétitif par rapport à toutes les alternatives, puisque le coût de revient du MWh se situe entre 70 et 100 euros pour les centrales au charbon ou au gaz, aux alentours de 85 euros pour l’éolien terrestre – sans compter les surcoûts d’intermittence et de réseaux – et jusqu’à quatre fois plus pour l’éolien offshore. La compétitivité s’apprécie sur l’ensemble de la durée de fonctionnement du parc » (Henri Proglio).
La DGEC partage cette perspective, puisque Pierre-Marie Abadie indique que « s’il fallait doubler les investissements en faveur de la maintenance et de la prolongation des centrales, le prix actuel du mégawattheure de l’ARENH se verrait renchéri de 10 euros. Il resterait néanmoins dans une fourchette comprise entre 50 et 60 euros, bien au-dessous du prix d’un nouveau mix, qu’il soit nucléaire ou d’une autre nature, que l’on peut situer dans une fourchette de 80 à 100 euros par mégawattheure. »
La réévaluation par la Cour des comptes du coût complet économique de production de l’électricité – de 49,6 euros par MWh en 2010 à 59,8 euros par MWh en 2013, et à 62 euros par MWh pour le nucléaire prolongé à référentiel de sûreté équivalent – invitant à regarder les chiffres en tendance, ne remet pas en cause cette conclusion mais met en évidence que les écarts se resserrent significativement entre le coût potentiel du MWh prolongé et les alternatives.
C’est un jugement du même ordre que formule Benjamin Dessus, président de Global Chance. Examinant les coûts du mégawattheure pour un parc prolongé et non prolongé, et les comparant à ce qu’ils pourraient être avec l’EPR, Benjamin Dessus montre que « quelles que soient les hypothèses retenues pour le carénage, les coûts sont élevés : ils sont au minimum de 60 euros le mégawattheure et, très rapidement, dès qu’ils atteignent des valeurs de l’ordre de 70, 75, 80 ou 90 euros le mégawattheure, ils rattrapent le coût du mégawattheure produit par l’EPR […] Il apparaît donc que le grand carénage, qui induit sur dix ou vingt ans des coûts qui ne sont pas sensiblement inférieurs à ceux de l’EPR, induit aussi un risque important de pannes génériques, avec des réacteurs moins robustes que des réacteurs jeunes, et donc le risque de dépasser les coûts de l’EPR.
« M. le président François Brottes. Cela signifie-t-il qu’il vaut mieux faire des EPR ?
« M. Benjamin Dessus. Ma conclusion est plutôt que tout cela est très cher, que l’on construise des EPR ou que l’on rénove les réacteurs sur dix ans – même si le coût est un peu moindre pour une rénovation sur vingt ans. Les coûts sont sans commune mesure avec celui du parc amorti […] En l’état, les coûts ne sont pas assez différenciés pour recommander plutôt de prolonger la durée de vie des réacteurs ou de construire dès maintenant des EPR. »
Cette évaluation est encore renforcée par l’information fournie par EDF à la commission d’enquête, qu’il sera nécessaire d’investir environ 50 millions d’euros par an sur chacun des réacteurs prolongés, soit 1 milliard par réacteur prolongé de 20 ans.
b. La grille d’analyse nécessite cependant d’être enrichie
Comme l’affirme Pierre-Marie Abadie, « l’approche par les coûts et les investissements doit être replacée dans un contexte général, car elle est un peu réductrice. » La commission d’enquête a d’ailleurs été très directement confrontée à cette problématique puisque son mandat portait sur l’analyse des coûts de la filière nucléaire dans le cadre du mix énergétique français et européen. Il faut donc prendre en considération un tableau plus riche et plus complexe.
Jouent en faveur de la prolongation les contraintes inhérentes au déploiement de tout nouveau moyen de production – de quelque nature que ce soit, d’ailleurs. Elles sont de nature réglementaire ou physique : « les limites physiques, par exemple des gisements, sont d’autres paramètres qu’il ne faut pas négliger. Pour l’éolien terrestre, qui est la source d’électricité la plus mature et la moins chère, l’augmentation annuelle de capacité, tombée à 800 mégawatts, remonte, et l’on parviendra rapidement à 1 200 mégawatts grâce aux mesures de simplification et de clarification du cadre financier. Toutefois, on plafonnera assez vite autour de 1,5 gigawatt par an, faute de gisements, les meilleurs étant déjà exploités par les premiers parcs éoliens. Il faudra donc attendre l’obsolescence de ce dernier, vers 2025-2030, pour le remplacer par des machines nouvelles. Le rythme de construction de nouveaux EPR se heurtera de la même façon à des limites physiques » (Laurent Michel, directeur général de l’énergie et du climat).
En sens inverse, renforcer la sécurité d’approvisionnement du pays conduit à privilégier la mise en place de moyens de production plus diversifiés : « la marge de robustesse du système électrique entre également en ligne de compte. Devoir fermer une centrale au risque de déséquilibrer le système serait, en effet, une décision impossible pour l’ASN. Comme les centrales sont toutes très similaires, un défaut pourrait s’avérer systémique et affecter plusieurs centrales. Cette question de la marge de robustesse et de sécurité du système, soulevée par la Cour des comptes, est à ce jour insuffisamment documentée ». Il en est de même de la dynamique des énergies renouvelables, désormais bien affirmée : « La prolongation de toutes les centrales pose évidemment des questions de sûreté mais aussi d’adaptation aux besoins. Si les énergies renouvelables se développent au rythme de 1 gigawatt d’éolien et 1 gigawatt de photovoltaïque par an, à l’horizon 2030, certaines centrales nucléaires ne seront plus nécessaires pour couvrir les besoins. La réponse n’est pas dans le tout ou rien » (Pierre-Marie Abadie).
Les travaux de Benjamin Dessus, exposés devant la commission d’enquête, montrent également l’enjeu capital que représentent les économies d’électricité ; celles-ci ouvrent une autre voie et permettent, à ses yeux, de sortir de l’impasse qui résulte de la comparaison des coûts entre prolongation et déploiement d’un parc d’EPR. Benjamin Dessus a établi des scénarios de coûts fondés, d’une part, sur le maintien d’une production électrique de 400 TWh selon diverses options et, d’autre part, sur l’introduction d’énergies renouvelables assorties d’économies d’électricité. Sur la base de coûts du « mégawattheure évité » de 70 euros pour l’électricité thermique, de 50 euros pour l’électricité spécifique et de l’ordre de 40 euros pour l’industrie – « seuil au-dessous duquel les investissements, dont le temps de retour est de quatre à cinq ans, ne sont pas engagés », Benjamin Dessus observe que, « face aux investissements très importants nécessaires pour remettre le parc à niveau, tout effort d’économie d’électricité est très payant ».
Dans ce contexte multiforme – au sein duquel il faut aussi faire entrer les considérations relatives à la sûreté nucléaire, déjà évoquées dans le présent chapitre, et le prix de vente de l’électricité – la stratégie industrielle de l’électricien prend une dimension spécifique et entre en résonance avec le dialogue de sûreté conduit avec l’ASN. L’incertitude qui entoure les autorisations que pourrait accorder l’ASN, au cas par cas, a des répercussions majeures sur l’approche du Grand carénage que retiendra EDF. Votre rapporteur rappelle, à cet égard, quelques indications données par EDF : « j’y insiste, le grand carénage n’a pas vocation à naître d’un coup, mais c’est progressivement que nous rénovons notre parc et améliorons sa sûreté » (Dominique Minière) ; « M. Henri Proglio. […] La décision de lancer le grand carénage ne sera donc prise que si nous avons le sentiment que la durée de vie peut aller jusqu’à cinquante ans. […]
« M. le rapporteur. La décision de lancer le grand carénage n’est donc pas encore prise !
« M. Henri Proglio. Il ne s’agit pas d’une décision binaire : réaliser ou ne pas réaliser cet investissement. Le grand carénage est un programme industriel énorme, dont certaines actions ont déjà été engagées, mais dont l’essentiel reste à venir. »
La prolongation des réacteurs apparaît donc comme un projet global, dont la réalisation sera fractionnée en fonction de la vision que l’industriel se fera du faisceau de contraintes au sein duquel il opère. Mais l’horizon ne semble pas encore complètement dégagé : comme l’indique fort justement Pierre-Marie Abadie, « l’analyse fine des besoins d’investissement – ceux qui doivent être faits dans tous les cas et pour lesquels, dans une stratégie de parc, on peut se permettre d’accepter des coûts échoués, et ceux qui dépendent de la possibilité de prolonger la durée de vie, appréciée au niveau de chaque centrale – n’a pas été faite. Cette distinction entre les deux catégories d’investissements doit rester en arrière-plan de toutes les analyses relative au passage éventuel des centrales à une durée de vie de 50 ans : l’essentiel n’est pas dans le fait de savoir si toutes les centrales passent à 50 ans mais si, globalement, le parc peut avoir un horizon de durée de vie qui justifie que l’exploitant y fasse des investissements, quitte à ce que certaines centrales s’arrêtent à 40 ans, d’autres à 50 ans et d’autres à 60 ans. Il reviendra ensuite à l’exploitant d’assumer son risque industriel sur l’ensemble du parc et de définir en conséquence ce qu’il accepte d’investir sur l’intégralité de son outil de production et ce qu’il réserve aux seules centrales dont il aura la quasi-certitude qu’elles seront autorisées à être prolongées. EDF n’en est pas encore là. »
2. L’État manque encore d’outils adaptés
Le temps est une variable stratégique. Il permet la maturation des technologies, voire l’émergence de nouvelles technologies, ce qui est souvent mis en avant comme un facteur favorable au succès de la transition énergétique. Comme l’a indiqué Jean-Paul Bouttes, directeur de la prospective et de la stratégie à EDF, il y aurait, par exemple, des « courbes d’apprentissage » à descendre pour faire sauter certains obstacles et obtenir une vision plus claire des grands déterminants techniques et économiques, par filière. L’argument est recevable mais ne peut pas être prétexte à tergiversation.
Or, les pouvoirs publics et la société sont confrontés à un paradoxe : l’échéance des « 40 ans » est pour demain, compte tenu des délais nécessaires à l’instruction du dossier dans le cadre du contrôle de la sûreté et compte tenu des constantes de temps qui sont à l’œuvre dans l’industrie de l’énergie – il s’écoule de 6 à 8 ans entre le moment où la décision est prise de remplacer un générateur de vapeur et le moment où le chantier est achevé ; il en est de même pour tout moyen de production ou de transport lourd d’énergie. Pourtant, l’État ne dispose pas encore d’instruments lui permettant de fixer un cap et une ambition globale, donc, concrètement, de prendre position de façon réfléchie sur les projets d’EDF.
C’est pourquoi la DGEC propose un système à deux étages : « D’abord, la stratégie nationale bas carbone fixerait pour toutes les énergies et les émissions de gaz à effet de serre des objectifs sur quinze ans, révisés tous les cinq ans, et définirait des politiques publiques consacrées. Ensuite, une programmation pluriannuelle de l’énergie, sur une période de cinq ans, rassemblerait et compléterait les programmations existantes (électricité, gaz, chaleur) mais comporterait aussi des volets relatifs aux énergies renouvelables et à l’efficacité énergétique. Notre proposition a été soumise à la commission spécialisée du Conseil national de la transition écologique. Les deux outils envisagés, qui seraient présentés au Parlement et révisés périodiquement – c’est important –, seraient un gage de visibilité pour les pouvoirs publics et les investisseurs. »
Cette proposition – qui concerne directement le Parlement – n’épuise pas le champ des ajustements qui peuvent être apportés au dispositif de pilotage de la politique énergétique pour que l’État se dote des moyens d’organiser la transition énergétique, en partenariat avec des industriels qui ont vocation à être les champions nationaux et européens du nouveau paysage énergétique.
Par ailleurs, la place de la société civile, trop longtemps tenue éloignée du sujet nucléaire, s’est renforcée au fil du temps.
Les commissions locales d’information (CLI) ont trouvé leur place dans le paysage institutionnel propre aux activités nucléaires. Nées en 1981 d’une simple circulaire du Premier ministre, elles ont gagné une existence légale avec la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, dont les dispositions ont ensuite été introduites dans le code de l’environnement. Les CLI sont chargées d’une mission générale de suivi, d’information et de concertation en matière de sûreté nucléaire, de radioprotection et d’impact des activités nucléaires sur les personnes et sur l’environnement pour ce qui concerne les INB implantées sur le site concerné. Elles doivent aussi assurer une large diffusion des résultats de leurs travaux sous une forme accessible au plus grand nombre. L’Association nationale des comités et commissions locales d’information (ANCCLI) fédère les 38 CLI existantes.
La commission d’enquête a pu constater, tant lors de sa visite dans le Nord-Cotentin que lors de son déplacement en Alsace, que les CLI sont un élément essentiel de la participation citoyenne. Leur constitution autour de quatre collèges (élus, associations, organisations syndicales des salariés des exploitants et personnalités qualifiées) en fait une enceinte où la diversité des opinions peut s’exprimer. La qualité des travaux qui y sont effectués est également remarquable ; c’est ainsi que la commission a pris connaissance du Livre blanc sur sûreté des installations civiles nucléaire de la Manche établi par les trois CLI du département éponyme, paru en décembre 2013, et de l’étude réalisée sur L’industrie nucléaire et le risque de cancers dans le département de la Manche.
Mais l’attention de la commission d’enquête a également été attirée sur les conditions matérielles dans lesquelles les CLI doivent accomplir leur mission. Elles ne disposent pas de ressources stables et le montant de celles-ci reste modeste au regard de l’intérêt que représente cette institution. Jean-Claude Delalonde, président de l’ANCCLI, explique les difficultés auxquelles sont confrontées les CLI par l’absence de cadre clair pour leur financement, qui n’a pas incité les bailleurs de fonds potentiels à consentir tous les efforts nécessaires : « La circulaire Mauroy de 1981 prévoyait que l’exploitant accorde des moyens financiers aux CLI. Mais aucun cadre précis n’ayant été fixé, ces moyens ne sont pas venus. Nous avons milité, comme je l’ai dit, pour que le législateur fasse le nécessaire. Comme les centrales procuraient de substantielles recettes de taxe professionnelle aux communes, aux structures intercommunales et aux départements, et que le pouvoir de fixer la composition des CLI avait été confié aux présidents de conseils généraux, il a été jugé normal que les départements financent ces commissions. Alors même que la période était plus faste qu’aujourd’hui, il a été difficile d’obtenir à la hauteur souhaitée la contribution de toutes les collectivités concernées. Nous avons alors demandé que la loi permette d’affecter aux CLI et à l’ANCCLI une part du produit de la taxe sur les installations nucléaires de base (INB), dont l’exploitant s’acquitte auprès de l’État et qui représente près de 600 millions d’euros par an. Cette proposition a été reprise par le législateur, puis confirmée dans le décret. Mais, six ans plus tard, force est de constater que ce n’est toujours pas appliqué. »
De ce fait, les CLI et l’ANCCLI « émargent » désormais au budget de l’ASN, qui leur alloue au total 1 million d’euros, certaines CLI bénéficiant par ailleurs d’un soutien en nature du conseil général. On constate que les CLI qui fonctionnent bien sont celles qui disposent d’un permanent, mais ce n’est pas, loin de là, le cas de toutes. Cette situation n’est pas satisfaisante et la définition d’un cadre clair pour le financement et le soutien à l’activité des CLI mériterait d’être abordée dans le cadre du projet de loi sur la transition énergétique.
La participation directe du public au processus de décision s’est également accrue, comme en témoigne le recours, désormais courant, à une consultation formelle du public préalablement à certaines décisions de l’ASN ainsi que l’ouverture des « groupes permanents d’experts » à des personnes extérieures au secteur nucléaire. En la matière, Pierre-Franck Chevet estime que « le rendez-vous des quarante ans est primordial pour la sûreté et il doit donner lieu à une participation renforcée du public ». Deux options sont alors possibles :
– l’une, minimaliste, consisterait à considérer que la prolongation d’un réacteur au-delà de la durée de conception retenue dans son rapport de sûreté est une « modification notable » de l’installation au sens de l’article L.593-4 du code de l’environnement ; dans ce cas, cette modification notable fait l’objet d’une procédure similaire à celle d’une demande d’autorisation de création et suppose donc la tenue d’une enquête publique, avec toutes les limites que l’on connaît à cet exercice ;
– l’autre, plus ambitieuse, consisterait à considérer que, préalablement, le projet de prolongation des réacteurs est, en tant que tel, une opération entrant dans le champ de compétence de la Commission nationale du débat public et devrait donner lieu à un tel débat.
Dans un cas comme dans l’autre, le temps du débat doit être borné afin qu’il ne contribue pas à accentuer la « non décision ».
Le projet de l’EPR de Flamanville s’est inscrit dans cette dernière perspective et un débat public a eu lieu en 2005 et 2006. Le projet de loi de transition énergétique pourrait en décider de même pour la prolongation des réacteurs d’EDF.
Une fois qu’ils auront été adoptés, il restera à actionner réellement ces outils, peut-être en tout premier lieu sur la définition de l’avenir du parc nucléaire, afin que la décision sur la méthode ne tienne pas lieu de décision sur le fond. En matière d’énergie, le temps est nécessairement long et la capacité d’anticipation est essentielle ; pour autant, l’urgence d’une décision sur le projet de prolongation du parc est bien là, comme le rappelle avec force la Cour des comptes, soulignant que l’absence de décision constituerait une forme de décision implicite… dont la transparence et le caractère démocratique laisseraient pour le moins à désirer ; le Parlement devra veiller à se saisir de ces outils s’il ne veut pas que l’échéance des « 40 ans » soit une occasion ratée du débat politique sur les orientations énergétiques de la France.
D. L’ARRÊT DES CENTRALES NUCLÉAIRES, UN ACCOMPAGNEMENT INDISPENSABLE
Aucun réacteur n’est éternel et l’arrêt des installations actuellement en fonctionnement est inéluctable, quelle qu’en soit l’échéance. La commission d’enquête a cherché à savoir si la constitution et le déploiement d’une filière du démantèlement pouvaient constituer une réponse appropriée à la perte de substance économique qui résulte de la fermeture d’une installation de production électrique ; elle a pour cela auditionné des représentants du Comité stratégique de la filière nucléaire (CSFN). Afin d’appréhender au mieux la situation spécifique de la centrale de Fessenheim, elle a également auditionné Jean-Michel Malerba, délégué interministériel à la fermeture de la centrale nucléaire et à la reconversion du site de Fessenheim, et a effectué un déplacement en Alsace, notamment sur le site de Fessenheim.
1. Le démantèlement, une activité essentielle qui ne peut à elle seule compenser l’arrêt d’une installation nucléaire
Le démantèlement constitue la dernière étape du cycle de vie d’une installation nucléaire. Il consiste à assainir celle-ci en récupérant et en évacuant les matières accumulées durant la phase d’exploitation, à démonter et à évacuer les équipements contaminés, à éliminer la radioactivité des ouvrages de génie civil, puis, une fois leur déclassement obtenu, à démolir ces derniers selon des méthodes conventionnelles, enfin à éventuellement reconvertir tout ou partie de l’installation. Pour une centrale, l’ensemble du processus dure de huit à quinze ans.
En janvier 2013, le comité de pilotage du CSFN a décidé de créer un groupe de travail consacré aux sujets du démantèlement, de l’assainissement et de la reprise et du conditionnement des déchets. Ce groupe de travail réunit – comme le CSFN – des représentants des maîtres d’ouvrage, des industriels, des organisations syndicales, de l’État, des pôles de compétence et de l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA). Sa mission est d’essayer de dynamiser l’activité de démantèlement en France en identifiant les leviers susceptibles d’améliorer le fonctionnement de la filière et en analysant le potentiel du marché à l’exportation.
Il ressort de ces travaux que l’activité de démantèlement produit quelque 7 % de la valeur ajoutée de la filière nucléaire française, ce qui représente une activité annuelle d’environ 800 millions d’euros, dont une part importante est réalisée dans les installations du cycle du combustible.
Cependant, Arnaud Gay, président du groupe de travail et par ailleurs responsable de l’activité « Valorisation des sites » chez AREVA, souligne que « le marché du démantèlement [reste] un marché extrêmement difficile, en raison de son manque de visibilité. On met en avant des chiffres d’affaires potentiels extrêmement élevés, mais la réalité économique est tout autre, car ces chiffres couvrent l’intégralité de l’activité sur la totalité de sa durée, et non ce qui est réellement ouvert au marché. […] le marché du démantèlement représente quelque 800 millions d’euros, mais une partie importante des provisions sont consommées, d’une part par les installations elles-mêmes – en coûts de surveillance, de fourniture en électricité, de maintien en condition opérationnelle… –, d’autre part par le stockage des déchets ; la part restante sous-traitée aux industriels ne correspond en réalité qu’à 20 à 30 % du total. »
Le marché du démantèlement est, par ailleurs, confronté à deux autres difficultés, sources d’incertitudes pour les industriels :
– d’une part, « les opérations ont tendance à « glisser » dans le temps, en raison de procédures administratives souvent plus complexes et plus longues que prévu, et aussi parce que l’on travaille sur des installations contaminées et que la caractérisation nucléaire réserve parfois des surprises : il peut survenir en début de chantier des aléas qui obligent à interrompre les opérations pour faire de nouvelles études » ;
– d’autre part, « la rentabilité de l’activité est à renforcer : les industriels estiment que les marges sont trop faibles. Cela s’explique par le fait que les montants en jeu sont modestes et que l’activité est soumise à des aléas, alors qu’elle exige des niveaux de compétence élevés : les personnels doivent être dûment qualifiés et le maintien de cette qualification dans la durée a un certain coût. Il s’agit d’un marché restreint, très concurrentiel, avec des coûts élevés ».
Il en résulte que l’industrialisation du processus de démantèlement est encore balbutiante.
Au demeurant, les chantiers de démantèlement des INB font aujourd’hui l’objet d’une règlementation importante concernant la sûreté : de la même façon que pour une installation en fonctionnement, cette réglementation vise à maîtriser les risques susceptibles de provoquer une dissémination de matières radioactives dans l’environnement et en direction de la population et des travailleurs. Les entreprises ont fait part à la commission d’enquête de leur souhait de voir adapter cette réglementation aux spécificités des chantiers de déconstruction et à la diversité des types de sites. Une telle adaptation ne pourrait évidemment être envisageable qu’à « sûreté constante », dans des conditions dûment encadrées par l’ASN ; pourrait par exemple être étudiée l’adaptation du régime des autorisations internes prévu par l’article 27 du décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives, et par la décision n° 2008-DC-0106 de l’ASN du 11 juillet 2008 relative aux modalités de mise en œuvre de systèmes d’autorisations internes dans les installations nucléaires de base.
Des difficultés similaires sont observées sur le marché international. Celui-ci est pourtant souvent présenté comme très attractif, comme une source de développement pour les entreprises qui décideraient de se lancer dans le domaine. Arnaud Gay en dresse cependant un tableau moins porteur : « On évoque souvent dans la presse plusieurs dizaines de milliards d’euros pour le marché mondial du démantèlement, mais il faut là encore relativiser : cette somme correspond à une activité étalée sur plusieurs dizaines d’années. Par exemple, sur le site de Sellafield, au Royaume-Uni, le plan de démantèlement court jusqu’à 2100 – mais il est vrai que c’est un cas particulier. Le démantèlement des installations du cycle du combustible dure en général plus longtemps que celui des réacteurs. Si l’on transpose en flux annuels les dizaines de milliards des projets identifiés, le marché réel est bien plus réduit, d’autant que, comme je l’ai dit, 40 à 60 % des coûts provisionnés ne sont pas accessibles aux industriels, mais sont consommés par le site lui-même ou par la gestion des déchets. En outre, il est bien évident que l’on a tendance à s’adresser de façon privilégiée à la chaîne de sous-traitance locale, présente autour des sites, de manière à limiter l’impact social de l’arrêt de l’exploitation. Il est dès lors difficile pour une société étrangère de pénétrer ces marchés. Il s’agit donc d’un marché extrêmement restreint, qui nécessite un niveau de valeur ajoutée élevé. »
Il n’est donc pas étonnant qu’un acteur majeur du secteur comme AREVA ait décidé, à la fois, d’être présent sur ce segment des services nucléaires et de concentrer ses efforts sur les activités où il dispose d’un avantage comparatif. Luc Oursel indique ainsi : « Pour le groupe AREVA, [le démantèlement] représente un chiffre d’affaires d’environ 400 millions d’euros et 1 500 personnes y travaillent. Notre ambition est de nous positionner pour les activités où nous avons les compétences les plus grandes, notamment la cartographie initiale des situations et l’établissement d’un planning de démantèlement et d’un budget fiables. […] nous interviendrons uniquement là où nous avons une forte valeur ajoutée, c’est-à-dire notamment dans la gestion des zones les plus contaminées, et dans les interventions robotisées. […] Nous développons donc une forte spécialisation dans certains domaines précis, car nous ne pouvons pas prétendre, depuis la France ou depuis nos bases industrielles, démanteler une centrale entière. […] Il faut également être conscient que les compagnies d’électricité sont rarement pressées de procéder à ces opérations, et qu’elles songent d’abord à utiliser leur personnel. En Allemagne, par exemple, il est très clair que le démantèlement des centrales est une façon de régler les problèmes sociaux liés à l’arrêt de l’exploitation. C’est un marché dont nous estimons qu’il va se développer, mais plutôt lentement : le chiffre d’affaires pourrait doubler en dix ans. »
Concrètement, sur un site arrêté, l’activité liée au démantèlement ne représente qu’une faible fraction de l’activité sur le site en exploitation : « les besoins en effectifs varient selon les sites et selon les phases du projet ; il existe toutefois un consensus pour dire que, de ce point de vue, l’activité de démantèlement ne représente que 10 à 20 % de l’activité d’exploitation – le bas de la fourchette correspondant plutôt au démantèlement des réacteurs et le haut à celui des installations du cycle du combustible » (Arnaud Gay). De fait, lors de la visite de l’ancienne usine de retraitement UP1 à Marcoule, en cours de démantèlement, la commission a pu apprécier combien l’effectif que nécessitent les opérations de démantèlement diffère de celui qui était présent en exploitation.
Les actions tendant à bâtir une filière industrielle du démantèlement n’en sont pas moins légitimes, car personne ne conteste que les besoins vont s’accroître pour des raisons structurelles – « les installations de première génération ayant été construites dans les années 1950 et 1960, elles arrivent à des âges où il est raisonnable d’envisager de les démanteler » – que conjoncturelles, liées aux décisions politiques de sortie du nucléaire, pour certains pays, ou aux fermetures résultant d’une rentabilité insuffisante des centrales, comme aux États-Unis.
À l’issue de ses travaux, la commission doit cependant faire le constat que la fermeture des centrales nucléaires doit recevoir un accompagnement spécifique supplémentaire.
2. Fessenheim, une reconversion que les pouvoirs publics doivent anticiper et soutenir
La centrale de Fessenheim s’étend sur 106 hectares au bord du grand canal d’Alsace. Implantée au sein du bassin rhénan, elle est installée sur le territoire de la commune de Fessenheim, à l’est du département du Haut-Rhin, à 30 kilomètres de Mulhouse. Les deux réacteurs Fessenheim-1 et Fessenheim-2 ont été couplés au réseau électrique en 1977 ; ils constituent ensemble une seule installation nucléaire de base.
Actuellement 850 salariés EDF travaillent sur site, et environ 250 salariés permanents d’entreprises prestataires, tout au long de l’année. À cela, il convient d’ajouter les salariés d’entreprises prestataires lors des arrêts pour maintenance : de 600 à 2 000 selon le type d’arrêt. Les entreprises locales sollicitées sont nombreuses : les marchés passés avec les entreprises du Grand Est pour la maintenance représentent un tiers du volume d’activité du site. En 2013, la centrale a contribué à la fiscalité locale à hauteur de 48 millions d’euros, dont 1,8 million pour la seule taxe foncière.
Les réacteurs ont connu leur troisième visite décennale, respectivement, d’octobre 2009 à mars 2010 et d’avril 2011 à mars 2012. Au cours de ces visites décennales, EDF a effectué 80 millions d’euros d’investissement sur Fessenheim-1 et 200 millions d’euros sur Fessenheim-2, la différence résultant notamment du remplacement des 3 générateurs de vapeur sur Fessenheim-2, préalablement effectué sur Fessenheim-1. À l’issue des visites décennales, l’ASN a formulé pour chaque réacteur un avis positif de poursuite d’exploitation (4 juillet 2011 et 29 avril 2013) ; ces avis étaient assortis de prescriptions techniques, dont la totalité a été soldée pour Fessenheim-1 et quatre restent à solder pour Fessenheim-2 avec des échéances allant de 2014 à 2015. Sur place, la commission a pu visiter l’un des bâtiments d’appoint ultime en eau par pompage dans la nappe phréatique (29). Par ailleurs, EDF a lancé, sur l’ensemble de son parc, un programme d’investissement de 600 millions d’euros sur cinq ans dans des travaux de rénovations de peintures, de tuyauteries et de signalétique ; la centrale de Fessenheim a investi dans le cadre de ce programme environ 33 millions d’euros.
En 2013, 42 millions d’euros de travaux comprenant à la fois l’intégration des prescriptions demandées par l’ASN et la maintenance des installations ont été investis sur chaque unité de production.
Ainsi, malgré la perspective de devoir arrêter son installation au plus tard en 2016, EDF continue à investir dans sa centrale comme si elle devait ne pas être fermée. C’est évidemment incontournable pour la sûreté nucléaire et intéressant pour le tissu industriel local.
Malheureusement, le déplacement de la commission sur place a conduit à constater que les conditions ne sont pas réunies pour que le processus de mise à l’arrêt se déroule dans les meilleures conditions de dialogue et de prise en compte des attentes des salariés, des entreprises et des collectivités locales.
Les conséquences de la fermeture de Fessenheim commencent à être appréciées plus précisément, même si certains éléments importants pourraient ne pas être connus avant longtemps.
Comme l’indique Jean-Michel Malerba, « pour ce qui est des aspects sociaux, nous avons demandé à l’INSEE de mesurer l’impact de la centrale sur l’emploi en Alsace : selon les premiers résultats de cette étude, cette contribution serait comprise entre 1 580 et 1 700 emplois. Le président d’EDF nous a indiqué que les 850 agents de son entreprise seraient redéployés sur d’autres sites de production ou affectés dans d’autres services du groupe. Il n’y aurait donc pas de licenciement, EDF mettant en place des cellules de reconversion comme elle l’a fait lorsqu’elle a fermé des centrales thermiques. Environ 300 personnes travaillent pour les sous-traitants, dont certains seraient plus touchés que d’autres – pour une vingtaine d’entre eux, la fermeture de la centrale devrait se traduire par une réduction de plus de 5 % de leur chiffre d’affaires. […] Le solde des quelque 1 700 emplois correspond aux emplois induits, notamment dans les activités de commerce et de services des environs. »
L’impact sur les finances locales serait essentiellement concentré sur la commune de Fessenheim et la communauté de communes Essor du Rhin. Jean-Michel Malerba signale que « la commune verrait sa capacité d’autofinancement devenir fortement négative à partir de 2020, dans la mesure où elle continuera à être taxée au titre du Fonds national de garantie individuelle des ressources communales et intercommunales à hauteur de 2,8 millions, ce pour une période non limitée dans le temps. Une réflexion est en cours pour apporter une solution à cette situation inédite et absurde… » On ne peut en effet évidemment pas laisser les choses en l’état.
Au regard du développement économique, « le territoire de Fessenheim, dans le Haut-Rhin, est dans une position relativement inconfortable pour ce qui est des perspectives de développement. » Enfin, l’impact de la fermeture de la centrale sur le réseau électrique est bien cerné : « RTE considère que l’approvisionnement de l’Alsace sera assuré sans risque à compter de 2017 à condition d’augmenter d’ici là la capacité de transit de la ligne à 400 kilovolts et de veiller à la qualité de la tension en procédant à des travaux dans les postes. Dans cette optique, le gestionnaire du réseau a présenté en octobre 2013 un dossier qui a été validé par le directeur de l’énergie, celui-ci précisant toutefois que les mesures préconisées cesseraient d’être pleinement efficaces à partir du milieu des années 2020. […] La situation de la centrale sur les grandes artères de circulation de l’énergie constitue plutôt un élément favorable au projet de fermeture » (Jean-Michel Malerba).
L’éventuelle indemnisation d’EDF est un élément assez épineux du dossier. Henri Proglio en fait une conséquence inéluctable d’une décision de fermeture qui ne serait ni imposée par l’ASN, ni proposée par la direction d’EDF : « À tout moment, l’ASN peut décider, pour des raisons de sûreté, de fermer une exploitation nucléaire sans compensation. Le président d’EDF peut également le faire. En revanche, si la décision est prise par la voie législative, qui exige un vote du Parlement et un décret d’application, il est logique que l’entreprise sollicite une indemnisation. Une telle démarche est aussi naturelle que nécessaire, compte tenu des responsabilités de l’entreprise vis-à-vis de ses actionnaires. Le cas échéant, l’indemnisation devra être juste et précise. Elle fera l’objet d’une évaluation, qui n’a pas encore été arrêtée mais qui sera transmise, en temps voulu, pour analyse contradictoire, voire pour arbitrage. » De même, « le principe de l’indemnisation, qui a d’abord fait débat, est désormais admis par tous. » Pour autant, le président d’EDF n’avance aucun montant à ce stade. S’agissant des partenaires d’EDF liés par un contrat d’allocation de production – l’électricien allemand EnBW à hauteur de 17,5 % et un groupement d’électriciens suisses à hauteur de 15 % –, le principe et les modalités d’une éventuelle indemnisation ne sont pas particulièrement clairs.
L’aboutissement d’une solution négociée et contractuelle « sur la base d’un projet, entre l’État, EDF et les élus locaux », annoncée devant la commission d’enquête par Mme Ségolène Royal, ministre de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie, offrirait une issue plus constructive. Chacun doit œuvrer au succès du groupe de travail sur Fessenheim que la ministre a également annoncé lors de son audition.
Cette annonce est bienvenue : elle comblerait le « vide » de l’action étatique que la commission a pu constater lors de son déplacement en Alsace. Au-delà des prises de position de principe, les élus locaux ressentent mal l’absence de projet porté par l’État et se sentent quelque peu abandonnés, voire méprisés. Force est de constater que pour l’instant l’État n’a pas réussi à trouver le ton juste ni le bon rythme pour apporter des réponses fortes, dans une situation qui est exceptionnelle et qui aurait mérité une action exceptionnelle. Les indications portées dans le document stratégique préparatoire au futur contrat de plan État-région ne peuvent suffire à compenser l’absence de projet mobilisateur concret à l’heure actuelle. Peut-être trop isolés, les délégués interministériels successifs n’ont pas pu apparaître comme porteurs d’une parole reconnue ; il est significatif qu’ils n’aient pas réussi à engager le dialogue avec l’ensemble des acteurs concernés.
Alors que la décision de fermer la centrale de Fessenheim est avant tout une décision de politique énergétique à caractère national – par ailleurs étayée par des éléments objectifs (30) –, elle a manqué d’une impulsion venue d’en haut. Beaucoup de temps a été perdu, alors que des dispositifs européens de type Interreg particulièrement adaptés aux zones frontalières peuvent être sollicités, et des instances de coopération internationale, comme le Conseil rhénan, offrent des lieux où peuvent être discutés et mis au point des projets communs susceptibles de dynamiser le bassin du Rhin supérieur et dont Fessenheim pourra bénéficier.
Il n’est pas trop tard pour construire un projet de reconversion ambitieux et cohérent, qui traiterait de l’emploi, des ressources des collectivités locales, de la sécurité et de la qualité de l’approvisionnement électrique, du soutien au logement, etc. Il n’est pas trop tard pour convaincre que l’avenir de Fessenheim pourra se lire très bientôt au-delà de sa centrale. De la capacité de l’État à se mobiliser avec les acteurs locaux pour réussir cette mutation dépendra en grande partie sa crédibilité à faire de la transition énergétique un chantier tourné vers l’avenir. C’est pourquoi la commission d’enquête appelle à renforcer très significativement le dialogue et les moyens mis en œuvre sur le terrain.
CHAPITRE 5 : CHARGES FUTURES. ÉVALUER CORRECTEMENT LEUR MONTANT ET SÉCURISER LEUR FINANCEMENT
A. DEUX CHARGES FUTURES MAJEURES : LE DÉMANTÈLEMENT DES INSTALLATIONS ET LE STOCKAGE DES DÉCHETS NUCLÉAIRES (31)
La puissance publique est parfois confrontée à l’attitude irresponsable de certains industriels qui, à la suite de difficultés financières ou d’une délocalisation, laissent leur site orphelin et un passif environnemental important. Une telle situation serait d’autant plus problématique dans le cas de l’activité nucléaire, dont la dangerosité perdure longtemps après l’arrêt des installations en raison de la persistance de la radioactivité. Le législateur a souhaité prévenir de telles difficultés en imposant des obligations spécifiques aux exploitants nucléaires. Ils sont désormais contraints d’anticiper la complexité des opérations de démantèlement et la mise en place de solutions de gestion des déchets radioactifs, ainsi que de provisionner les sommes nécessaires au financement de ces charges futures, même si, en France, les opérateurs sont situés dans la sphère publique.
a. Un problème méthodologique : comment mesurer le coût du démantèlement des installations en exploitation ?
Le démantèlement n’est pas une activité du futur, mais bien du présent. Les trois exploitants français sont chacun engagés dans des opérations de démantèlement de plusieurs installations. Le CEA est aujourd’hui le plus concerné des trois exploitants par le démantèlement : 21 de ses installations sont arrêtées. EDF mène un programme de démantèlement dit « de première génération » qui comprend 12 installations nucléaires de base (INB) : neuf réacteurs composant le parc de 1ère génération (32) et trois installations annexes. Enfin, AREVA gère le démantèlement de l’usine UP2-400 à La Hague, ainsi que celui de l’usine Georges Besse 1, au Tricastin.
Disposer d’une expérience du démantèlement est un atout pour élaborer des évaluations fiables du devis des charges futures de démantèlement. La méthode dite « Dampierre », l’une des deux méthodes d’évaluation du coût du démantèlement du parc nucléaire historique, s’appuie sur les coûts constatés. Elle décompose le coût des opérations de démantèlement de la centrale éponyme, constituée de quatre réacteurs REP de 900 MW, pour en déduire un chiffrage global du démantèlement des autres centrales en fonctionnement.
La méthode « Dampierre » n’est cependant pas retenue par EDF, qui préfère la méthode du « coût de référence » au motif qu’une telle méthode serait plus prudente car elle aboutirait à des devis plus élevés. Le « coût de référence » consiste à déduire le coût du démantèlement à partir de la valeur des centrales, en appliquant un taux forfaitaire.
De manière générale, l’estimation des charges de démantèlement des INB en cours d’exploitation ne peut être déduite mécaniquement de l’expérience passée car les opérations en cours portent pour l’essentiel sur des installations non standardisées.
b. Les charges brutes de démantèlement
L’article L.594-1 du code de l’environnement, introduit par l’article 20 de la loi du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs, oblige les exploitants d’installations nucléaires de base à évaluer de manière prudente les charges de démantèlement de leurs installations. En application de ces dispositions, ils établissent, depuis 2007, un plan de démantèlement pour chacune d’entre elles.
CHARGES BRUTES DE DÉMANTÈLEMENT DES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES
EDF |
AREVA |
CEA |
Total | |
Installations en exploitation |
19 558 |
5 046 |
1 245 |
25 849 |
Installations arrêtées |
2 890 |
2 828 |
2 454 |
8 172 |
Total |
22 448 |
7 874 |
4 034 (*) |
34 356 |
(*) Ce chiffre inclut les charges transverses (40 millions d’euros) ainsi que les charges de démantèlement « hors loi » (142 millions d’euros).
Source : Cour des comptes, Le coût de production de l’électricité nucléaire. Actualisation 2014
c. Les éléments de comparaison internationale : une première approche de l’évaluation de la crédibilité des estimations
L’un des éléments permettant d’apprécier la robustesse des estimations fournies par les exploitants est de soumettre ces dernières à une comparaison internationale. Le rapport de la Cour des comptes datant de 2012 souligne à ce titre que « les 11 évaluations reconstituées sur la base des données étrangères et extrapolées au parc des 58 réacteurs REP d’EDF sont toutes supérieures à EDF ». Ce constat est néanmoins tempéré par l’existence d’une forte dispersion des résultats analysés, témoignant de l’insuffisante stabilisation des méthodes d’estimation.
ESTIMATION DU COÛT DU DÉMANTÈLEMENT DU PARC NUCLÉAIRE FRANÇAIS HISTORIQUE PAR EXTRAPOLATION DES MÉTHODES UTILISÉES DANS D’AUTRES PAYS
(en milliards d’euros)
Estimation EDF |
Suède |
Belgique |
Japon |
États-Unis (3 méthodes) |
Royaume-Uni |
Allemagne (4 méthodes) |
18,1 |
20 |
24,4 |
38,9 |
27,3 33,4 34,2 |
46 |
25,8 34,6 44 62 |
Source : Cour des comptes, Les coûts de la filière électronucléaire, janvier 2012
2. La gestion des déchets radioactifs
a. Les différents types de déchets : des volumes différents, des solutions de gestion propres
Les déchets radioactifs font l’objet d’une classification en fonction de leur niveau de radioactivité et de leur durée de vie. Ces caractéristiques déterminent les méthodes de gestion et les exutoires qui leurs sont applicables.
Les déchets de très faible activité (TFA), qui proviennent majoritairement de la déconstruction des installations nucléaires, disposent du centre de stockage de Morvilliers (Aube), ouvert depuis 2003 ; il existe un risque de saturation de ce dernier dans la mesure où sa capacité est de 650 000 m3 contre un stock de déchets TFA estimé à 1 300 000 m3 à l’horizon 2030 ; le taux de remplissage du centre de Morvilliers et d’ores et déjà de 39 %.
Les déchets de faible et moyenne activité à vie courte (FMAVC) sont issus des activités de maintenance des installations nucléaires : le centre de stockage de la Manche, fermé depuis 2003, a reçu 527 000 m3 de déchets depuis 1969 ; le site de Soulaines-Dhuys (Aube), conçu pour contenir 1 000 000 m3, est occupé à 24 % ; selon la Cour des comptes, dans l’hypothèse d’une prolongation de la durée de fonctionnement des centrales nucléaires jusqu’à 50 ans, la capacité du centre de Soulaines serait insuffisante de 50 000 m3.
Trois types de déchets ne disposent pas encore de solution de gestion adaptée : les déchets de faible activité à vie longue (FAVL), les déchets de moyenne activité à vie longue (MAVL) et les déchets de haute activité (HA). Les premiers sont entreposés en surface, le plus souvent sur les sites où ils sont produits, en attendant l’élaboration d’une solution de stockage adaptée. Les deux autres font l’objet de dispositions législatives particulières (cf. infra).
Sans même aborder la question du coût de la gestion des déchets, les éléments précédents font apparaître des tensions dans la capacité à gérer les stocks de déchets produits par l’activité nucléaire sur l’ensemble de son cycle. « Les centres de stockage sont des outils précieux qui ne doivent pas être utilisés pour des déchets inadaptés » (Jean-Christophe Niel, directeur général de l’ASN).
b. Les charges brutes de gestion future des déchets radioactifs
À l’image des dispositions régissant le démantèlement des INB, les exploitants sont contraints par l’article L. 594-1 du code de l’environnement d’évaluer les charges liées à la gestion des déchets radioactifs générés par le fonctionnement de leurs installations.
CHARGES BRUTES DE GESTION DES DÉCHETS RADIOACTIFS
Charges brutes au 31 décembre 2013 |
Pourcentage du total | |
EDF |
25 578 |
80,7 % |
AREVA |
3 468 |
11,0 % |
CEA civil |
2 623 |
8,3 % |
Total |
31 753 (*) |
100 % |
(*) Ce chiffre inclut les charges brutes liées à la gestion des déchets de l’ANDRA (84 millions d’euros)
Source : Cour des comptes, Le coût de production de l’électricité nucléaire. Actualisation 2014
3. Le cas particulier des déchets les plus nocifs (HA-MAVL)
a. Le stockage en couche géologique profonde : la solution de référence pour la gestion à long terme des déchets hautement radioactifs français
La gestion des déchets les plus nocifs, les déchets haute activité (HA) et moyenne activité vie longue (MAVL), recoupe des questions d’ordre technique, moral et politique.
INVENTAIRE DES DÉCHETS HA ET MAVL ENGAGÉS FIN 2013
Type de déchets |
Inventaire à la fin 2013 |
MAVL |
63 056 m3 |
HAVL |
5 173 m3 |
Combustibles usés |
2 728 t |
Source : Cour des comptes, Le coût de production de l’électricité nucléaire. Actualisation 2014
Trois grandes solutions étaient envisageables :
– le stockage des déchets en subsurface, à environ une vingtaine de mètres sous terre, était une première option très compétitive, mais présentait toutefois l’inconvénient majeur de ne pas garantir un niveau de sûreté suffisant au-delà de quelques générations. « L’Autorité de sûreté nucléaire l’a clairement dit dans un avis de 2005, et la loi l’a d’ailleurs confirmé : on ne peut pas stocker en surface et subsurface des déchets aussi dangereux et à durée de vie aussi longue que les déchets de haute activité et de moyenne activité à vie longue. Vu la nature des risques, il faut les placer à 500 mètres de profondeur. C’est d’ailleurs la solution retenue au niveau international, ainsi que par l’Union européenne dans une directive » (Marie-Claude Dupuis, directrice générale de l’ANDRA) ;
– la transmutation des déchets nucléaires aurait été à l’inverse la solution idéale, puisqu’elle aurait permis de réduire la toxicité des déchets et leur durée de vie en les transformant au sein de réacteurs ; l’IRSN a cependant rendu un avis négatif, en 2012, sur la faisabilité technique d’une telle solution ;
– le stockage géologique est la solution finalement retenue.
Après 15 ans de recherche, des évaluations nombreuses et la tenue d’un débat public, le principe du stockage en couche géologique profonde a été retenu par la loi du 28 juin 2006 comme la solution de référence pour gérer les déchets HA et MA-VL. Cette solution repose sur l’hypothèse qu’une couche de roche mère assurera une protection suffisante pour que la diffusion de radionucléides résultant de la dégradation des colis se rapproche du niveau naturel de radioactivité lorsqu’ils atteindront un environnement accessible à l’homme. Si sa création est autorisée, ce centre sera implanté dans un sous-sol argileux, dans l’Est de la France, à la limite de la Meuse et la Haute-Marne.
b. Cigéo : un projet de grande envergure dont les étapes sont fixées par la loi
Le projet Cigéo est mené par l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA). Cette dernière opère un laboratoire, situé à Bure, dans lequel elle réalise des travaux préparatoires destinés à démontrer la faisabilité technique des différentes options retenues pour le site de stockage définitif.
Ce dernier sera composé d’installations de surface, destinées à accueillir et préparer les colis de déchets et à réaliser les travaux de creusement et de construction des ouvrages souterrains. Les déchets seront stockés dans des installations souterraines, situées à environ 500 mètres de profondeur, dans une couche de roche argileuse imperméable choisie pour ses propriétés de confinement sur de très longues échelles de temps. La loi prévoit par ailleurs que le stockage en couche géologique profonde de déchets radioactifs soit mis en œuvre « dans le respect du principe de réversibilité ».
La loi du 28 juin 2006, codifiée à l’article L.542-10-1 du code de l’environnement, détermine précisément les étapes nécessaires à la création du centre de stockage :
– l’ANDRA doit présenter une demande d’autorisation de création de l’installation de stockage, après avoir procédé à l’organisation d’un débat public ; cette demande d’autorisation donne lieu à un avis de l’Autorité de sûreté nucléaire ; l’article 3 de la loi du 28 juin 2006 (non codifié) prévoit que la demande d’autorisation soit instruite en 2015 ;
– dans l’hypothèse où l’avis de l’ASN serait favorable, la demande de création est transmise à l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, qui l’évalue et rend compte de ses travaux aux commissions parlementaires compétentes ;
– le Parlement doit ensuite se prononcer sur les conditions de réversibilité du site ; ce n’est qu’après la promulgation de la loi portant sur la réversibilité que l’autorisation de création peut être délivrée, par voie de décret ;
– enfin, l’article 3 de la loi du 28 juin 2006 prévoit une mise en service de l’installation en 2025, pour une durée d’exploitation d’environ 100 ans.
Des étapes présentées, seule l’organisation du débat public préalable à la demande d’autorisation a été menée à son terme. La Commission nationale du débat public a été saisie par l’ANDRA, en octobre 2012 ; ce débat s’est déroulé au cours de l’année 2013 et ses conclusions ont été rendues publiques en février 2014.
c. Un devis qui a fait l’objet d’une vive controverse entre les exploitants et l’ANDRA
L’article L.542-12 du code de l’environnement précise le cadre selon lequel sont élaborées les estimations des coûts du projet Cigéo : l’ANDRA propose au ministre chargé de l’énergie une évaluation après avoir recueilli les observations des exploitants et l’avis de l’Autorité de sûreté nucléaire. Le ministre chargé de l’énergie arrête l’évaluation de ces coûts et la rend publique. Malgré un cadre juridique clair, plusieurs estimations ont tour à tour été versées sur la place publique, sans qu’il soit facile de déterminer s’il s’agissait de chiffres définitifs ou de travaux en cours. Cette situation a donné lieu à des oppositions entre l’ANDRA et les exploitants :
– la première estimation officielle (SI 2003) date de 2003 et retient une « fourchette raisonnable d’évaluation d’un coût de stockage » de 13,5 à 16,5 Md€2002. À l’intérieur de cette fourchette, les exploitants retiennent la valeur de 14,1 Md€2002. Ce chiffre sert aujourd’hui de base à l’évaluation des provisions à couvrir par les actifs dédiés (cf. infra), sur la base d’un taux d’inflation de 2 % pour EDF et du taux d’inflation constaté pour AREVA et le CEA ;
– en 2005, l’ANDRA propose un nouveau chiffrage, reposant sur les mêmes bases techniques que le précédent, mais prenant en compte un allongement de la durée de vie du site et retenant un taux d’inflation de 4 % ; le SI 2005 est évalué à 20,8 Md€2010, ce qui représente 4,3 Md€ de différence avec le chiffre retenu par les exploitants, de 16,5 Md€2010 ;
– en 2009, l’ANDRA produit une 3ème estimation, cette fois-ci en faisant évoluant les données techniques pour mieux prendre en compte les objectifs de sûreté et de réversibilité ; le SI 2009 aboutit au chiffre de 35,9 Md€2010 ; ce dernier chiffre n’a jamais fait l’objet d’une quelconque officialisation, mais a été rendu public par la Cour des comptes dans son rapport de 2012 ; cette dernière indique que les exploitants ont élaboré une contre-proposition, qui conclut à un coût de 14,4 Md€2010.
ÉVOLUTION DES ESTIMATIONS DU PROJET CIGÉO RETENUES PAR L’ANDRA
ET LES EXPLOITANTS
ANDRA |
Exploitants | |
2003 |
SI 2003 : 13,5 - 16,5 Md€2002 |
14,1 Md€2002 |
2005 |
SI 2005 : 20,8 Md€2010 |
16,5 Md€2010 |
2009 |
SI 2009 : 35,9 Md€2010 |
STI 2009 : 14,4 Md€2010 |
Ces épisodes posent la question du cadre juridique actuel, qui empêche l’ANDRA de rendre ses estimations publiques avant qu’elles ne soient arrêtées par le ministre chargé de l’énergie. Cette règle favorise une atmosphère de controverse, alors que la transparence qui résulterait d’une confrontation publique entre les points de vue de l’ANDRA et des exploitants est pourtant souhaitable.
B. UN DISPOSITIF SPÉCIFIQUE DESTINÉ À GARANTIR LE FINANCEMENT DES CHARGES FUTURES SUR LE LONG TERME : LES ACTIFS DÉDIÉS
Le démantèlement, comme le traitement des déchets nucléaires, constituent des défis technologiques majeurs, dont le coût doit reposer sur les générations actuelles. C’est pourquoi le législateur a imposé des contraintes spécifiques aux exploitants, les obligeant à provisionner les sommes nécessaires à la couverture des charges futures à mesure de l’exploitation de leurs installations.
1. Des charges futures aux provisions : l’importance du taux d’actualisation
Les charges brutes futures de la filière nucléaire, évaluées par la Cour des comptes à 87,2 milliards d’euros en 2013, ne sont pas inscrites telles quelles dans les comptes d’EDF, d’AREVA et du CEA, mais sous la forme de provisions, pour un montant de 43,7 milliards d’euros. La différence entre les deux montants s’explique par l’application d’un taux d’actualisation. Cette opération comptable est tout à fait classique : elle vise à traduire les effets financiers liés à l’échelonnement des dépenses futures dans le temps. Par exemple, le rapport entre les provisions et les charges brutes est plus élevé dans le cas du CEA, car les dépenses futures de l’établissement public seront réalisées plus tôt que celles d’EDF et d’AREVA.
CALCUL DES PROVISIONS PAR ACTUALISATION DES CHARGES BRUTES
(En millions d’euros)
Charges brutes |
Taux d’actualisation |
Provisions |
Provisions / charges brutes | |
EDF |
67 873 |
4,8 % |
32 658 |
48 % |
AREVA |
12 038 |
4,75 % |
6 258 |
52 % |
CEA |
7 165 |
4,75 % |
4 736 |
66 % |
Source : Cour des comptes, Le coût de production de l’électricité nucléaire. Actualisation 2014
Toutefois, l’actualisation donne une importance considérable au taux fixé. Ce dernier est choisi par l’exploitant selon des règles fixées par voie réglementaire. L’article 3 du décret n° 2007-243 du 23 février 2007 relatif à la sécurisation du financement des charges nucléaires dispose notamment que le taux d’actualisation utilisé pour le calcul du montant des provisions :
– « ne peut excéder le taux de rendement, tel qu'anticipé avec un haut degré de confiance, des actifs de couverture, gérés avec un degré de sécurité et de liquidité suffisant pour répondre à leur objet » ; cette exigence permet de s’assurer que la valeur du portefeuille des actifs dédiés se maintienne au cours du temps ;
– est plafonné à une valeur nominale égale à la moyenne sur les 48 derniers mois du taux d’obligations d’État à échéance constante à 30 ans (TEC 30), majorée de 1 point (33) ; cette marge de 1 point correspondait, en 2007, à la moyenne constatée des spreads pour les entreprises A-, AA ou BBB. Le plafond était de 4,57 % au 31 décembre 2013.
Les trois exploitants calculent un taux théorique selon leur propre méthode (34), reflétant leurs comportements d’investissement, et s’assurent que ce taux est compatible avec le taux réglementaire. Jusqu’en 2012, les trois exploitants retenaient un taux de 5 %, inférieur au taux réglementaire, et respectant donc les obligations réglementaires. Suite à la diminution progressive du taux plafond depuis 2012, les exploitants ont abaissé leur propre taux d’actualisation, mais de façon insuffisante : AREVA et le CEA retiennent aujourd’hui un taux de 4,75 % et EDF un taux de 4,8 %, supérieurs au taux réglementaire de 4,57 %.
2. La couverture des provisions : les actifs dédiés
L’article L.594-2 du code de l’environnement, issu de la loi du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs dispose que : « Les exploitants d’installations nucléaires de base constituent les provisions correspondant aux charges définies à l’article L.594-1 et affectent, à titre exclusif, à la couverture de ces provisions les actifs nécessaires. » Le décret n° 2007-243 du 23 février 2007 relatif à la sécurisation du financement des charges nucléaires, dont la dernière modification date du 24 juillet 2013, précise les règles applicables :
– le périmètre des provisions qui doivent être couvertes par les actifs dédiés comprend les dépenses qui ne sont pas liées au cycle d’exploitation, c’est-à-dire le démantèlement, la gestion des combustibles usés non recyclables et la gestion à long terme des déchets radioactifs. Les dépenses de retraitement sont donc exclues ;
– la loi de 2006 fait le choix de maintenir les actifs dédiés au bilan des entreprises, et non de les loger dans une structure séparée. En contrepartie, ils doivent être clairement identifiés et les exploitants sont tenus de mettre en place des dispositifs de contrôle interne ;
– les actifs de couverture peuvent prendre 4 formes, chaque catégorie ne devant pas dépasser une proportion fixée du portefeuille total : des obligations, des actions, des créances sur l’État et des actifs réels non cotés. Jusqu’en 2010, les textes réglementaires excluaient les titres d’une filiale d’un exploitant nucléaire.
TAUX DE COUVERTURE DES PROVISIONS PAR LES ACTIFS DÉDIÉS
(En millions d’euros)
Provisions |
Provisions devant être couvertes |
Valeur de réalisation des actifs dédiés |
Taux de couverture | |
EDF |
32 658 |
21 020 |
21 737 |
103,4 % |
AREVA |
6 258 |
5 957 |
6 097 |
102 % |
CEA |
4 736 |
4 736 |
4 725 |
99,8 % |
Source : Cour des comptes, Le coût de production de l’électricité nucléaire. Actualisation 2014
La loi de 2006 constitue une étape décisive. Désormais, les exploitants sont contraints d’évaluer les charges futures, faisant ainsi apparaître de façon transparente une part significative du coût du nucléaire. Ils doivent également présenter des garanties financières équivalentes au montant des charges estimées.
Le sujet du juste provisionnement est d’ailleurs d’une telle importance que les commissaires aux comptes ont tenu systématiquement à attirer l’attention des actionnaires sur sa sensibilité, depuis l’entrée en Bourse d’EDF, par une observation systématique dans leur rapport annuel. Une pratique inusuelle pour une entreprise du CAC 40, comme a tenu à le faire remarquer l’Autorité des Marchés Financiers au rapporteur en entretien avec celui-ci.
II. LES APPORTS DE LA COMMISSION D’ENQUÊTE
En matière de charges futures, l’impératif majeur est de s’assurer que les dispositifs légaux donnent toutes les garanties aux générations futures. L’objectif de la commission d’enquête était d’évaluer la pertinence du mécanisme de couverture de ces charges. Elle s’est notamment penchée sur deux questions : les estimations des charges futures sont-elles robustes ? Les sommes destinées à couvrir le montant des devis sont-elles suffisamment sécurisées et permettront-elles de couvrir les dépenses de démantèlement et de stockage en temps voulu ?
A. DES ESTIMATIONS DES CHARGES FUTURES ENTOURÉES D’UN ALÉA TRÈS IMPORTANT
1. Des interrogations majeures sur le coût du démantèlement
a. L’inflation du coût du démantèlement des installations à l’arrêt
L’historique du coût du démantèlement des installations nucléaires mène vers un constat sans appel : lorsque l’on confronte aux dépenses réellement exposées les devis initiaux, ces derniers sont systématiquement sous-évalués.
Pour EDF, la révision des devis de 2012 concernant les installations arrêtées a renchéri les coûts de 22,4 % en euros constants par rapport aux précédents devis de 2008 selon la Cour des comptes. Cette augmentation fait suite à une augmentation qui atteignait déjà 17,3 % entre 2006 et 2008. Par exemple, les coûts de démantèlement de la centrale de Brennilis ont connu une forte augmentation depuis 2001, comme le reconnaît Thomas Piquemal, directeur exécutif groupe chargé des finances d’EDF :
« M. le rapporteur. S’agissant de Brennilis, l’augmentation de la dépense que l’on m’avait indiquée [26 %] concernait la période allant de 2001 à 2008 : celle de 15 % que vous avez mentionnée pour les années 2008-2012 s’y ajouterait donc ?
« M. Thomas Piquemal. Je ne suis pas en mesure de commenter la hausse intervenue entre 2005 et 2008, mais je confirme que le chiffre que je vous ai fourni représente l’augmentation intervenue en 2012 par rapport au devis de 2008.
« M. le président François Brottes. Cela s’ajoute donc… »
Pour AREVA, le dérapage des coûts est également très important. Le devis de démantèlement d’UP2-400 est passé de 1 327 millions d’euros à 1 955 millions d’euros entre 2006 et 2013, soit une augmentation de 47 % en euros constants. Celui de Georges Besse 1 a plus que doublé, passant de 480 à 1 000 millions d’euros (+105 %).
Enfin, pour le CEA, la Cour des comptes considérait, dans son rapport de 2012, qu’ « à l’exception des devis du réacteur Siloette et du LAMA de Grenoble qui ont baissé, les autres ont augmenté, de 13 % pour celui de la station de traitement des effluents de Cadarache, de manière beaucoup plus significative pour les autres devis examinés (de 54 % à 108 %) ». L’actualisation 2014 du rapport de la Cour fait apparaître une diminution des charges brutes restantes de 135 millions d’euros (-5 %) entre 2010 et 2013, qui doit être mise en regard avec le montant des dépenses de démantèlement engagées, qui s’élèvent, selon Bernard Bigot, à 280 millions d’euros sur la seule année 2013.
L’expérience en matière de démantèlement incite donc à la plus grande prudence sur la fiabilité des estimations réalisées par les exploitants.
b. Des facteurs de variabilité dont il est impossible de quantifier les effets sur le coût du démantèlement des installations en exploitation
Les exploitants reconnaissent les difficultés inhérentes à l’exercice de prévision des coûts de démantèlement. Ils mettent en avant deux catégories de facteurs expliquant les dépassements des devis initiaux.
En premier lieu, un certain nombre d’installations étant uniques, des problèmes techniques non identifiés par le passé peuvent ralentir les opérations, engendrant ainsi des surcoûts, à l’image de la situation rencontrée par AREVA sur l’usine Georges Besse 1 : « Le devis de démantèlement de l’usine Georges-Besse 1, exploitée par Eurodif Production, a été sensiblement révisé à la fin de 2011, puisqu’il est passé de 660 millions à près d’1 milliard d’euros, cette augmentation résultant de la modification substantielle du scénario de démantèlement à la suite de la réalisation d’études avancées. Les causes principales de cette hausse résident dans l’accroissement de la durée des opérations – l’exiguïté des installations obligeant à échelonner soigneusement celles-ci – et dans l’augmentation des dépenses de surveillance qui en résultera, mais aussi, pour 100 millions d’euros, dans l’obligation de remplacer ou d’ajouter certains équipements comme des ponts de levage et, pour 130 millions, dans un besoin de main-d’œuvre supplémentaire » (Pierre Aubouin, directeur général adjoint chargé des finances d’AREVA). Selon Thomas Piquemal, la progression de 26 % des coûts de démantèlement de la centrale de Brennilis entre 2008 et 2012 s’explique pour 71 % par des raisons techniques.
En second lieu, l’augmentation des coûts de démantèlement peut être liée à des raisons administratives et réglementaires, au nombre desquelles des recours contentieux ou encore le rehaussement des exigences de sûreté imposées par l’ASN. « Nous restons dépendants de demandes externes – évolution des conditions de sûreté, des prix de l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA), des calendriers… Ainsi, [le CEA devait] démanteler le réacteur Phénix à Marcoule : pour des raisons électorales, l’enquête publique a été reportée d’un an ; il faudra donc payer les charges de fonctionnement de Phénix, soit plusieurs dizaines de millions d’euros, pendant une année supplémentaire » (Bernard Bigot, administrateur général du CEA). « Dans le cas de Grenoble, le CEA a déposé une demande d’autorisation de démantèlement prévoyant un niveau résiduel de contamination extrêmement bas, puisque cinquante fois inférieur à la dose considérée comme acceptable pour le public. De mon point de vue, nous nous sommes montrés trop ambitieux, ce qui explique le renchérissement des coûts de 50 millions d’euros – nous avions proposé que des servitudes nous soient imposées afin que l’enceinte du réacteur Siloé puisse être utilisée pour produire de la chaleur par biomasse, mais cela nous a été refusé, ce qui a entraîné ce surcoût, avec le transfert de milliers de mètres cubes de gravats jusqu’en Bourgogne » (Bernard Bigot).
Néanmoins, certains facteurs pourront jouer dans l’autre sens à l’avenir, permettant de modérer les dépassements de coût. Le démantèlement devrait susciter moins de difficultés imprévues dans les installations les plus récentes : « les scénarios de démantèlement sont plus favorables pour les installations de génération plus récente – usines UP2-800 et UP3 à La Hague, usine Georges-Besse 2 d’enrichissement de l’uranium –, grâce aux choix technologiques opérés et à la prise en compte des exigences du démantèlement dès le stade de la conception » (Pierre Aubouin). Par ailleurs, la filière du démantèlement bénéficiera à la fois du retour d’expérience des opérations menées sur des installations similaires et des travaux de recherche menés par les industriels « Dans le parc de première génération en cours de déconstruction, il existe à Chooz un réacteur à eau pressurisée (REP) dont la puissance est certes faible – 300 mégawatts contre 900 au minimum dans le parc actuellement exploité –, mais dont le démantèlement, en particulier celui de sa cuve, prévu à échéance de dix-huit mois à deux ans, nous procurera un retour d’expérience utile pour mettre à jour l’étude Dampierre en vue de nous en servir lorsqu’il s’agira de déconstruire les centrales aujourd’hui en fonctionnement » (Thomas Piquemal). « Lorsque nous établissons les devis, nous ne prenons en compte ni les gains de productivité, ni le progrès technologique, alors même que nous fournissons, sur fonds propres ou dans le cadre d’initiatives partagées avec le CEA et EDF, d’importants efforts de recherche et de développement (R&D) qui nous permettent d’envisager une plus grande efficacité dans les opérations d’assainissement préalables à la déconstruction des installations – nous travaillons ainsi actuellement sur des procédés innovants de scan en trois dimensions permettant de connaître très précisément la configuration d’une cellule avant son démantèlement et les sources de contamination ponctuelle qui peuvent s’y trouver » (Pierre Aubouin).
L’inflation constatée des coûts de démantèlement des installations arrêtées et les fortes incertitudes entourant les opérations sur les installations en fonctionnement conduisent à deux interrogations majeures. La première porte sur la prise en compte de l’incertitude dans la constitution des provisions par l’intégration d’un taux d’aléas et d’incertitudes venant majorer le coût des devis. Le taux retenu par les exploitants est-il suffisant ?
Les exploitants intègrent un taux d’aléas et d’incertitudes dans l’évaluation de leurs devis qu’ils considèrent proportionné. Dans le cas d’AREVA, par exemple, ce taux est de 20 % pour les installations anciennes (UP2-400) et de 10 % pour les installations récentes (usines UP2-800 et UP3 à La Hague, usine Georges-Besse 2 d’enrichissement de l’uranium) : « cela étant, nous estimons à 20 % le risque d’aléas, ce taux étant inclus dans le devis en sus des coûts bruts, de sorte que nous disposons d’une marge de sécurité satisfaisante » (Pierre Aubouin). Pour le CEA, ce taux est également de 20 % : « Nous intégrons continûment les retours d’expérience et lorsqu’il a été procédé, conformément à ce que j’avais demandé lors de ma nomination, à une nouvelle évaluation de l’ensemble de nos 44 installations nucléaires concernées par une phase d’assainissement ou de démantèlement, nous avons en outre requis l’aide de consultants extérieurs qui ont examiné les meilleures pratiques. En conséquence, notre estimation du coût total – constitué de la somme des différents devis majorée d’un taux d’aléa de 20 % (35) – apparaît robuste ». Enfin, d’après la Cour des comptes, le taux effectivement retenu par EDF pour le programme de démantèlement de première génération ne représente que 2,2 % des travaux restant à effectuer (71 millions d’euros sur un total de 5 017 millions d’euros) ; s’agissant des installations en exploitation, la méthode Dampierre – qui n’est pas celle retenue par EDF – intègre un taux d’aléas et d’incertitudes d’environ 20 %.
Le décret du 23 février 2007 pose comme seule obligation la « prise en compte des incertitudes techniques résiduelles et des aléas de réalisation », mais ne fixe pas de seuil. Force est de constater que les taux choisis par les exploitants, de 20 % au maximum, ne correspondent pas à la variabilité constatée. Ainsi que le relève la Cour des comptes, « la situation actuelle appelle à une grande vigilance, d’autant que des facteurs probables de surcoûts ont d’ores et déjà été identifiés, notamment la question de la dépollution des sols. Par ailleurs, les niveaux de marges pour aléas paraissent souvent insuffisants, sauf peut-être pour le CEA qui présente un taux moyen d’aléas et d’incertitudes de 30 % environ ».
La seconde interrogation est plus importante encore : peut-on laisser aux exploitants la responsabilité d’évaluer eux-mêmes les charges de démantèlement, lorsque l’on connaît l’effet financier d’une réévaluation des devis ? En l’absence d’éléments concrets, nul ne peut remettre en cause des chiffrages dont la comparaison internationale montre pourtant qu’ils sont particulièrement bas. En réalité, aucune institution n’est aujourd’hui capable de challenger les devis élaborés par les exploitants. Lors de son audition devant la commission d’enquête, Mme Ségolène Royal, ministre de l’Écologie, du développement durable et de l’énergie, a annoncé la réalisation d’un audit sur les provisions pour démantèlement du parc en exploitation, sous la responsabilité de la direction générale de l’énergie et du climat : « Le processus de sélection des entreprises est en cours : l’audit démarrera en juin prochain et se terminera en avril 2015. Il est important d’examiner les devis en détail pour se forger une opinion. Ces travaux seront évidemment communiqués à votre assemblée, sachant que le déroulement de l’audit tiendra compte de vos conclusions ». Cette évaluation à un instant t sera-t-elle suffisante pour s’assurer de la sincérité comptable des estimations des exploitants dans la durée ?
Peut-être pourrait-on réfléchir à l’opportunité de confier dans la durée à une commission ad hoc, indépendante des exploitants, la mission d’évaluer régulièrement les charges de démantèlement et de proposer au Gouvernement le montant des provisions à constituer.
2. Des angles morts inquiétants dans la gestion de certains déchets radioactifs : les déchets RCD et les résidus miniers
Deux types de déchets font l’objet de mesures de gestion totalement défaillantes, voire complètement absentes.
Les déchets dits « RCD » (reprise et conditionnement des déchets anciens), issus du retraitement avant les années quatre-vingt-dix, n’ont pas été conditionnés et sont contenus dans des silos à La Hague. Ils représentent un volume de 10 000 m3. Pour un certain nombre d’entre eux, l’ASN considère que les conditions de sûreté ne sont pas satisfaisantes et que leur reprise doit être résolument engagée par AREVA. Ces opérations en milieu très radioactif seront complexes et s’inscriront dans la durée.
« Le troisième enjeu concerne les déchets dits « RCD », qui feront l’objet de reprise et conditionnement. Il s’agit de déchets anciens qui n’ont pas subi un conditionnement définitif : certains sont conditionnés, mais selon des modalités incompatibles avec leur gestion ultérieure ; d’autres, sous forme liquide ou solide – parfois en vrac –, ne sont pas conditionnés et sont entreposés dans des conditions de sûreté que l’ASN considère comme non satisfaisantes […] Les modalités de conditionnement définitif de ces déchets sont difficiles à définir en raison de leurs caractéristiques physico-chimiques complexes ou hors du commun : ils sont très radioactifs et leur niveau de toxicité est très élevé. Le conditionnement reste à inventer, ce qui nécessite des ressources. La reprise, dans des silos ou des tranchées, ne sera donc pas facile au regard des incertitudes techniques, de l’enjeu de sûreté et de radioprotection ainsi que des incertitudes sur les charges financières associées […] L’ASN prépare actuellement une décision visant à renforcer les échéances de reprise de ces déchets. Ces prescriptions à destination d’AREVA fixeront les échéances bâtiment par bâtiment ; elles ont été transmises à l’ANDRA pour consultation, et devraient être publiées dans un ou deux mois » (Michel Bourguignon, commissaire de l’ASN).
Selon la Cour des comptes, les charges pour reprise et conditionnement des déchets anciens s’élèvent à 512 millions d’euros pour le CEA et 1 541 millions d’euros pour AREVA. Ces chiffres, pourtant conséquents, apparaissent sous-évalués au regard de l’ASN.
S’agissant des résidus miniers, ils représentent 50 millions de tonnes de déchets TFA, voire FAVL ou MAVL. Comptabilisés dans l’inventaire de l’ANDRA, ils sont pourtant éparpillés sur l’ensemble du territoire national, ainsi que l’a expliqué Roland Desbordes, président de la CRII-RAD, en entretien devant le rapporteur. Cette situation, mise sous les feux des projecteurs de façon éphémère à la suite de l’émission de télévision Pièce à conviction du 13 février 2009, n’a pas connu de progression significative depuis. Le PNGMDR prévoit la remise, en novembre 2014, d’un bilan des études permettant d’aboutir à des actions concrètes et un chiffrage plus précis de la gestion à long terme de ces résidus.
3. L’élaboration du devis de Cigéo paralysée par l’absence d’orientations politiques définitives
a. Deux paramètres fondamentaux aujourd’hui indéterminés
Le premier paramètre déterminant pour l’architecture de Cigéo est le choix que les parlementaires seront amenés à faire sur la réversibilité. Certaines personnes auditionnées ont souligné l’imprécision de ce concept ou en ont proposé une définition qui s’éloignait de l’intention du législateur.
« La notion de réversibilité introduite dans la loi est très floue, et sans doute mérite-elle de faire l’objet d’une réflexion plus approfondie. Selon nous, elle doit permettre d’arrêter un projet en cours si l’on se rend compte qu’il n’est pas faisable. Elle diffère de la notion de « récupérabilité », qui renvoie à la réextraction » (Michel Bourguignon).
« M. Jacques Percebois, président de la CNE2. […] La CNE2 a rédigé une note sur la réversibilité. Ce terme de « réversibilité » est un terme compliqué qui n’est pas compris de la même façon par tous. Pour certains, il signifie qu’on pourra aller rechercher ce qu’on voudra quand on voudra. Ce n’est pas très réaliste. Certes, on peut toujours aller rechercher, mais cela coûtera très cher. Ce qui est certain, c’est que le site de stockage devra être fermé un jour, au bout de cent ou cent vingt ans – c’est en tout cas la position de la CNE2. La réversibilité signifie que s’il y a un problème avec un colis de déchets, on doit pouvoir aller le rechercher. Il faut donc maintenir des options de flexibilité à cette fin, mais il faut aussi avoir conscience que plus le temps passe, plus ce sera difficile.
« M. le président François Brottes. Permettez-moi de vous arrêter : il y a une loi. Ce n’est pas à la CNE2 de dire ce que le législateur a dit. Or ce que dit la loi, c’est que le jour où on aura trouvé une solution pour retraiter les déchets qu’on ne savait pas traiter auparavant, il faut avoir la possibilité de les récupérer pour les traiter. Que je sache, la loi se fait au Parlement, et non dans les commissions, quelle que soit la qualité de leurs membres ».
Dans un but de clarification, le présent rapport se doit d’établir une distinction entre les termes de récupérabilité et de réversibilité, et préciser l’intention du législateur de 2006. La notion de récupérabilité a une dimension essentiellement technique : elle vise à garantir, lors de la construction et de l’exploitation du stockage, la possibilité de récupérer certains déchets, par exemple lorsqu’ils sont endommagés ou en cas de problèmes techniques. La notion de réversibilité a une dimension politique plus large : il s’agit de permettre aux générations futures, en l’espace de cent ans, de revenir sur le choix du stockage géologique profond, en particulier si une solution plus satisfaisante était trouvée. C’est cette acception qui prévalait lors des discussions de la loi de 2006.
Le choix de la réversibilité exige de mettre en place des solutions techniques qui la garantissent pendant cent ans : « pendant la phase industrielle pilote […], les alvéoles pour les déchets de moyenne activité à vie longue, qui prendront la forme de tunnels de 400 mètres de longueur et de 9 mètres de diamètre, seront closes par des portes blindées pouvant être rouvertes. Pour assurer la sûreté à long terme – un million d’années –, le scellement définitif sera obtenu par des ouvrages en béton de 30 à 40 mètres associés à de la bentonite » (Marie-Claude Dupuis). Elle accroît également les problèmes à résoudre pour garantir la sûreté du site : « Les évaluateurs – ASN, IRSN, CNE2 – préconisent d’effectuer le scellement le plus tôt possible, afin d’assurer la sûreté passive, tandis que la société civile tend à vouloir le plus possible retarder ce moment, afin de laisser les choix ouverts. Nous allons approfondir ces deux scénarios, ainsi qu’un troisième, intermédiaire, qui consisterait à fermer les alvéoles par quartiers compte tenu de la nécessité de les surveiller » (Marie-Claude Dupuis).
Le second paramètre majeur est l’inventaire des déchets. Trois choix peuvent influer sur la quantité et la nature des déchets stockés par Cigéo. Premièrement, l’accroissement de la durée de vie du parc nucléaire augmenterait mécaniquement le volume de stockage nécessaire. Deuxièmement, il existe une incertitude sur le statut des matières en attente de valorisation dans l’optique d’une hypothétique quatrième génération de réacteurs nucléaires (voir le chapitre 6).
« Les déchets de haute activité à vie longue (HA-VL) sont actuellement, en France, le produit du retraitement des combustibles usés. L’inventaire en est connu et peut être anticipé pour les quelques années à venir. Cependant, il conviendra d’y ajouter, à terme, les combustibles usés non retraités qui apparaîtront le jour où la France cessera d’exploiter les réacteurs à eau ou à neutrons rapides : le retraitement de ces combustibles n’ayant plus d’objet, ils devront être stockés tels quels. Leur quantité ne peut pas être déterminée à l’avance, et la question de l’inventaire des déchets demeure donc ouverte » (Jacques Repussard).
« L’établissement de l’inventaire précis des déchets destinés au stockage […] est encore incertain et dépend de choix industriels et de politique énergétique, en particulier au regard de la double notion de matières et de déchets. Ceux-ci peuvent conduire à la requalification en déchets de certaines matières radioactives, notamment des combustibles usés de CNPE ou de réacteurs de recherche. Il faut donc imaginer une flexibilité suffisante du stockage géologique profond pour préserver la capacité technique d’accueil de ces combustibles usés en stockage direct. Les coûts associés sont très importants, puisque les combustibles usés représentent des volumes considérables » (Michel Bourguignon).
Enfin, certains déchets posent des problèmes de sûreté, en particulier les bitumes : « Le risque d’incendie est celui sur lequel nous nous interrogeons le plus. De notre point de vue, pendant la phase pilote, il ne sera pas souhaitable de stocker des emballages contenant des éléments combustibles, en particulier du bitume » (Jacques Repussard). « Dans la mesure où les déchets bitumés sont sensibles au risque incendie, il nous semble prudent de stocker prioritairement des déchets aux caractéristiques plus stables, tels les coques et embouts cimentés » (Michel Bourguignon).
Le projet Cigéo comporte donc un certain nombre de points d’interrogations. Malgré le travail réalisé sous la direction de l’ANDRA, le projet industriel est encore très loin d’être abouti.
Il fait, par ailleurs, toujours l’objet de controverses à la fois sur sa pertinence, sa conception mais aussi son emplacement, notamment en ce qui concerne le potentiel géothermique du site, sur lequel Jacques Repussard a estimé qu’il était légitime que les collectifs locaux interrogent l’ANDRA. Même si le débat public n’a pu se tenir dans des conditions optimales, la CNDP (Commission nationale du débat public) a souligné, par la voix de son président Christian Leyrit, les nombreux apports de la concertation et de la Conférence de citoyens ainsi que la nécessité de poursuivre la concertation et de l’approfondir.
b. Un exercice de chiffrage périlleux, qui réclame la réalisation d’une phase pilote
Il convient de ne pas se fourvoyer sur la nature des estimations proposées par l’ANDRA. En raison de la persistance d’incertitudes, elles doivent être prises avec toutes les réserves nécessaires.
Signalons d’abord que le chiffrage de projets industriels qui ont vocation à s’étaler sur une durée de 100 ans est, par définition, un exercice particulièrement complexe. Il nécessite de « chiffrer un coût complet, comprenant non seulement l’investissement initial correspondant à la phase industrielle pilote, mais aussi le coût de l’exploitation de l’installation pendant plus de cent ans, de sa fermeture, du démantèlement des installations de surface, etc. » (Marie-Claude Dupuis). De nombreux paramètres ne peuvent pas être connus aujourd’hui, ce qui oblige à poser un certain nombre d’hypothèses : « Or non seulement une telle estimation dépend de toutes sortes de paramètres techniques, mais elle ne peut être réalisée qu’à partir d’hypothèses de travail. Quelle sera, par exemple, la fiscalité applicable à Cigéo en 2020, année où le projet pourrait être autorisé ? Que dire alors sur une période de cent ans ? Sur de telles questions, nous attendons les hypothèses de l’État ».
L’estimation des coûts de Cigéo comporte des éléments de difficulté supplémentaires, liés à l’absence de choix politiques clairs sur les questions de la réversibilité et de l’inventaire des déchets. Les solutions techniques retenues – et par conséquent les coûts – dépendront de la façon dont le législateur précisera l’orientation de la loi de 2006, qui considère que le stockage géologique doit assurer la réversibilité :
« Le CEA voudrait que la totalité des pistes d’optimisation technique soient prises en considération dans la phase d’avant-projet sommaire, de manière à pouvoir réduire les coûts tout en conservant le meilleur niveau de sûreté. Cela suppose que les conditions de réversibilité soient fixées rapidement, afin que l’on puisse définir le projet Cigéo du point de vue technique » (Hervé Bernard, administrateur général adjoint du CEA).
De même, l’inventaire des déchets a une influence significative sur la taille de l’installation. « Tous les chiffres qui ont pu être cités dans la presse doivent être mis en regard d’un certain type d’inventaire. Ainsi, le chiffre de 15 milliards avait été calculé en prenant pour hypothèse une durée de vie des réacteurs de quarante ans, et de cinquante ans pour l’estimation de 35 milliards effectuée en 2010. Notre chiffrage dépend donc de certaines hypothèses telles que le volume des déchets et la durée de vie des réacteurs. Il sera fondé sur l’inventaire conforme à la loi de 2006, et ne prendra donc en compte que les déchets vitrifiés et les déchets de moyenne activité à vie longue, pas les combustibles usés. Néanmoins, l’État nous a demandé de mettre à jour en 2015 notre rapport sur le stockage de ces derniers dans Cigéo, dans l’hypothèse où ils deviendraient des déchets. De même, les provisions constituées par EDF tiennent compte du coût du stockage des MOX usés dans le cas où ne seraient pas développés les réacteurs de quatrième génération. La Cour des comptes a d’ailleurs salué la prudence d’une telle démarche » (Marie-Claude Dupuis).
Enfin, les spécialistes conviennent qu’il est impossible d’avoir une appréciation exacte des techniques utilisées, et donc des coûts, sans la réalisation de tests « grandeur nature ». « S’agissant des coûts, il n’est pas raisonnable de vouloir connaître le montant de la facture tout de suite : il est nécessaire de passer au préalable par une phase pilote, qui permettra d’affiner les choix technologiques, lesquels auront une incidence sur ce montant » (Jacques Repussard). La décision de l’ANDRA de mener une « phase pilote » s’inscrit dans cette perspective : tant que cette phase ne sera pas réalisée, les estimations du projet Cigéo seront encore entourées d’un degré d’incertitude important. La ministre de l’Écologie a elle-même confirmé devant la commission d’enquête la nécessité d’une telle « phase préalable d’expérimentation ». De son côté, l’ASN a demandé à l’ensemble des exploitants de prévoir des capacités d’entreposage suffisamment important afin de ne prendre aucun risque de sûreté tant que le projet ne serait pas au point.
L’ensemble de ces réserves ainsi énoncées, l’ANDRA a élaboré un nouveau chiffrage du projet Cigéo, rendu public par la Cour des comptes dans son rapport de 2014 : « Pour avoir une idée des montants en jeu, le chiffrage de fin 2013, qui n’intègre pas encore toutes les optimisations possibles, se décompose en 19 Md€2013 d’investissements et 9 Md€2013 environ d’exploitation. Au sein des investissements, la première tranche (2012-2019) représenterait environ 6 Md€. En raisonnant en montants actualisés (hypothèse d’un taux d’actualisation de 3 % nets d’inflation), ces trois montants deviendraient : 6,5 Md€2013 pour l’ensemble des investissements dont 4,5 Md€2013 pour la première tranche et un peu moins de 2 Md€2013 pour les dépenses d’exploitation ».
S’il était officialisé, ce nouveau chiffrage, d’un total de 28 milliards d’euros, représenterait un saut significatif par rapport à la dernière estimation ayant fait l’objet d’un arrêté ministériel. Son ordre de grandeur est plus proche du SI 2009, scénario non endossé par l’ANDRA mais rendu public par la Cour des comptes dans son rapport de 2012, que du STI 2009, proposé par les exploitants. La Cour des comptes précise par ailleurs que la prise en compte du nouveau chiffrage « pourrait conduire à une hausse des provisions d’EDF de l’ordre de 2 à 3 milliards d’euros, avec une baisse du résultat du même montant ».
c. Une évolution inéluctable de la législation
Selon les personnes auditionnées, le projet Cigéo a connu des évolutions trop importantes depuis l’adoption de la loi de 2006 pour maintenir le calendrier initial.
D’une part, selon l’analyse concordante de l’ANDRA, de l’ASN et de l’IRSN, l’échéance de 2015 ne sera pas respectée : en raison du renforcement des exigences de sûreté de l’ASN, l’ANDRA ne sera pas en mesure de présenter à cette date une demande d’autorisation qui soit suffisamment solide pour être validée par l’Autorité de sûreté.
« En 2006 également, le Parlement a voté une loi relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, dont le décret d’application a été pris en 2007. Cette loi a fait évoluer la réglementation sur l’autorisation des installations nucléaires de base. Dorénavant, le niveau de détail exigé par l’ASN pour de telles demandes d’autorisation est beaucoup plus fin qu’il ne l’était avant 2006, si bien que la demande d’autorisation pour Cigéo ne pourra être finalisée par l’ANDRA qu’en 2017. Nous proposons donc de remettre, dès 2015, un dossier préliminaire comprenant les trois pièces essentielles de la demande : le projet de plan directeur d’exploitation, le dossier d’orientation de sûreté qui permettra à l’ASN de vérifier que nous sommes proches de la démonstration complète attendue, et un dossier d’options techniques de récupérabilité détaillant les moyens par lesquels l’Agence s’engage à assurer la possibilité de récupérer les colis de déchets pendant cent ans. Et ce n’est qu’en 2017, sur la base des avis et du résultat des études, que nous finaliserons la demande d’autorisation de création. » (Marie-Claude Dupuis). « En raison des incertitudes techniques, le dossier ne nous paraît pas suffisamment avancé pour que l’ANDRA puisse déposer une demande d’autorisation d’ici à 2015 » (Michel Bourguignon). « Compte tenu des difficultés rencontrées pour établir une démonstration de sûreté convaincante d’ici à 2015, il nous semblerait préférable qu’une loi soit adoptée plus tôt que prévu, c’est-à-dire entre maintenant et 2015, pour fixer les orientations politiques que devra respecter le projet Cigéo » (Jacques Repussard).
Il faut toutefois souligner que le décalage du calendrier fixé par la loi n’épuisera pas la question des démonstrations de sûreté. À ce titre, l’opinion de Jacques Repussard, selon laquelle une démonstration de sûreté fiable doit nécessairement s’appuyer sur la première phase « pilote » du projet Cigéo semble contradictoire avec la nécessité d’obtenir l’autorisation de l’ASN préalablement au lancement du projet. « L’IRSN a estimé à plusieurs reprises, notamment dans des avis officiels transmis à l’ASN en 2010 et en 2012, qu’il ne serait pas possible d’établir une démonstration de sûreté technologique sur laquelle elle puisse se prononcer de manière fondée sans que soient réalisées et testées au préalable des infrastructures grandeur nature. Or le dimensionnement du laboratoire de Bure ne permet pas d’y construire, à l’échelle 1/1, des exemplaires des futures galeries et alvéoles, ni d’expérimenter un début d’exploitation avec des colis chauffants, en utilisant les technologies qui seraient mises en œuvre par la suite » (Jacques Repussard).
D’autre part, certains des acteurs du projet Cigéo plaident pour que le choix politique sur la réversibilité intervienne préalablement au dépôt du dossier de demande d’autorisation de création, contrairement à ce qui est prévu par l’article L.542-10-1 du code de l’environnement. « Il nous est difficile de préciser techniquement ce que sera une opération aussi compliquée que le stockage en couche géologique profonde si nous ne connaissons pas, au départ, les principes sur lesquels se fonderont les conditions de réversibilité » (Hervé Bernard). « Il nous semblerait raisonnable que l’ANDRA puisse proposer un dossier sur la base d’une contrainte législative connue et non à venir. Il serait donc légitime que le Parlement revienne sur la loi de 2006, définisse ses attentes en matière de réversibilité et pose le principe d’un phasage du projet Cigéo, à charge pour l’ANDRA, l’IRSN et l’ASN de mettre en œuvre chacune des étapes ainsi définies » (Jacques Repussard).
L’ANDRA maintient toutefois ouverte la possibilité de conserver le calendrier actuel : « En ce qui concerne d’éventuelles modifications de la loi, la délibération du conseil d’administration ouvre la voie à plusieurs scénarios : dans le premier, le Gouvernement et le Parlement considèrent qu’ils disposent d’ores et déjà de toute la matière pour inscrire dans la loi les nouvelles modalités d’élaboration du projet, voire les conditions de réversibilité ; dans le deuxième, ils attendent la remise du premier dossier en 2015 ; dans le troisième, ils préfèrent attendre la demande finalisée d’autorisation de création, en 2017. Les trois options sont possibles. Ce qui est clair, c’est que l’autorisation de création ne peut être donnée avant le vote d’une loi sur les conditions de réversibilité. Par ailleurs, le démarrage en 2025 de l’installation industrielle pilote suppose que les conditions de réversibilité aient été définies avant 2017 ».
En tout état de cause, comme cela a été le cas depuis que s’élabore une politique en matière de gestion des déchets radioactifs, et au vu des enjeux de très long terme, il est légitime que la décision finale revienne en temps utile au Parlement. Par ailleurs, au vu des incertitudes qui continuent d’entourer la faisabilité du projet Cigeo, il serait prudent que des recherches complémentaires sur le stockage en subsurface soient menées en parallèle.
B. FAUT-IL TRANSFÉRER LA GESTION DES ACTIFS DÉDIÉS À UN ACTEUR INDÉPENDANT ?
Les auditions de la commission d’enquête ont permis d’expliciter les modalités pratiques de fonctionnement des actifs dédiés. Elles ont également apporté des éléments de réponse à une question décisive : les exploitants doivent-ils conserver la gestion des actifs dédiés ? L’OPECST, dans un rapport de 2005, proposait de transférer cette mission à un opérateur indépendant, sur l’exemple des solutions choisies aux États-Unis, en Finlande et en Suède. Philippe Germa, directeur général de WWF France a également présenté la position et les arguments de son organisation, favorable à la création d’un « fonds indépendant pour la transition énergétique et une sortie équitable du nucléaire ».
1. Les arguments en faveur du transfert de la gestion des actifs dédiés à un acteur indépendant
a. Les risques de dépréciation du capital
Le régime des actifs dédiés a pour but de préserver les provisions constituées par les exploitants pour faire face à leurs obligations de long terme. Or, dans le droit actuel, comme ces derniers sont maîtres de la constitution de leur portefeuille, aucune mesure ne vient encadrer les risques qu’ils prennent pour s’assurer du rendement élevé de leurs actifs.
L’historique de la performance des actifs dédiés montre que des dépréciations de capital importantes peuvent avoir lieu, ce qui va à l’encontre de l’objectif poursuivi par la loi. EDF et AREVA ont ainsi connu deux « années noires », en 2008 et 2011.
PERFORMANCE ANNUELLE DES ACTIFS DÉDIÉS
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 | |
EDF |
+ 3% |
-14,9% |
+13,1% |
+8,8% |
-0,5% |
+10,4% |
+9,4% |
AREVA |
+3,8 % |
-26,9 % |
+14,2 % |
+6,40 % |
-2,7 % |
+13,2 % |
+10,5 % |
Source : Cour des comptes, Le coût de production de l’électricité nucléaire. Actualisation 2014
Les dépréciations d’actif intervenues n’ont pas prêté à conséquence, dans la mesure où les exploitants n’avaient pas de charges importantes à financer ces années-là. Mais cette situation pourrait se révéler problématique dans le futur si elle intervenait durant les périodes de pics de dépenses. Signalons, par ailleurs, que de telles dépréciations pourraient avoir des conséquences en cascade, dans la mesure où les exploitants sont liés mutuellement, soit par des participations croisées soit par des coopérations commerciales renforcées. Par exemple, AREVA intègre dans ses actifs dédiés une créance CEA de 642 millions d’euros, tandis que les titres d’AREVA comptent pour 914 millions d’euros dans les actifs dédiés du CEA.
Ce constat pose la question de la stratégie de placement des exploitants. Afin de diminuer le risque de dépréciation de capital, il conviendrait que ces derniers visent une performance moins élevée en constituant un portefeuille d’actifs peu risqués. Toutefois, ils sont opposés à une telle solution pour des raisons financières. Comme le rendement doit être supérieur au taux d’actualisation, se donner pour cible un rendement moins élevé implique d’abaisser le taux d’actualisation de façon concomitante. Une telle opération augmenterait mécaniquement le montant des provisions à constituer et contraindrait les exploitants à redoter les actifs dédiés. Par exemple, abaisser le taux d’actualisation des trois exploitants à 4,0 % obligerait EDF, AREVA et le CEA à provisionner respectivement 5,2 milliards, 870 et 380 millions d’euros supplémentaires.
SENSIBILITÉ DES PROVISIONS AUX VARIATIONS DU TAUX D’ACTUALISATION
(En milliards d’euros, par rapport au montant des provisions 2012)
Taux d’actualisation | |||||
3,0 % |
4,0 % |
Taux de référence (*) |
5% |
5,5% | |
EDF |
+ 14,7 |
+5,2 |
0 |
-1,1 |
-3,0 |
AREVA |
+ 2,5 |
+ 0,87 |
0 |
- 0,25 |
- 0,68 |
CEA |
+ 1,1 |
+0,38 |
0 |
- 0,11 |
- 0,32 |
(*) 4,75 % pour AREVA et le CEA ; 4,80 % pour EDF
b. Le report du risque sur la puissance publique
L’objectif de la loi de 2006 est d’éviter que les exploitants ne mettent la puissance publique devant le fait accompli. Or, l’État a lui-même concédé à ces derniers deux entorses à l’esprit du dispositif.
En 2013, il reconnaît une créance de 4,9 milliards d’euros correspondant au déficit de CSPE pris en charge par EDF. Cette créance a été affectée intégralement aux actifs dédiés, conduisant le taux de couverture des engagements de l’entreprise à dépasser 100 %.
En raison des difficultés de trésorerie rencontrées par le CEA pour faire face aux dépenses de démantèlement, le conseil de politique nucléaire du 12 février 2010 décide que le financement des dépenses de long terme du CEA sera assuré par le budget de l’État. Le même conseil de politique nucléaire autorise par ailleurs l’accroissement de la part des titres AREVA dans le portefeuille des actifs dédiés du CEA de 15 à 30 %. Ce mécanisme oblige ainsi l’État à réévaluer le montant de sa créance en fonction de l’évolution de la valeur des titres AREVA. « Sur les 10 milliards d’actifs dédiés du CEA, 7 ou 8 sont garantis par l’État, les 2 milliards restant représentant la valeur de la participation d’AREVA. C’est dont bien le budget de l’État qui, in fine, est le garant du financement de démantèlement ultime des installations du CEA » (Jean-Luc Lépine, président de la CNEF). Comme le résume Philippe Germa, « qu’il s’agisse d’EDF ou du CEA, les actifs dédiés sont en fait des créances sur l’État ou s’y apparentent : directement ou indirectement, l’État apparaît, pour reprendre les termes de la Cour, comme le financeur en dernier ressort ».
La contribution au service public de l’électricité (CSPE)
La contribution au service public de l’électricité (CSPE) est une imposition assise sur la consommation d’électricité qui vise à compenser les surcoûts supportés par les opérateurs historiques (EDF et les entreprises locales de distribution) du fait de leurs obligations de service public :
– le financement des moyens de production d’électricité renouvelable, via le mécanisme des obligations d’achat attribuées à certaines installations (éoliennes, photovoltaïque, etc.) ; les charges à couvrir en 2014 pour le poste « énergies renouvelables » sont estimées par la CRE à 3 722 M€ (36) ;
– la péréquation tarifaire à destination des zones non interconnectées (la Corse et les outre-mer) : la CSPE supporte la différence de coût de production entre la France continentale et les ZNI, de façon à ce que chaque citoyen ait accès à l’électricité au même prix (1 651 M€ de charges à couvrir en 2014) ;
– la solidarité énergétique, à travers les aides attribuées aux ménages précaires, essentiellement sous la forme du tarif social dit « produit de première nécessité » (350 M€) ;
– le soutien aux installations de cogénération (462 M€) et à l’effacement (4 M€) ;
– le financement de la moitié du budget du médiateur national de l’énergie (6,5 M€).
L’implication de l’État est d’autant plus problématique que ses intérêts (au moins à court terme) concordent avec ceux de l’exploitant : « La tendance naturelle d’EDF est de privilégier les éléments de son propre développement, tandis que celle du Gouvernement est d’atténuer la charge à faire payer au consommateur. Au moment des arbitrages, la garantie du financement des opérations de fin de cycle n’est donc pas toujours considérée comme prioritaire » (Jean-Luc Lépine).
Le dispositif des actifs dédiés est conçu de façon à s’assurer que les sommes provisionnées pourront être décaissées en temps voulu. Or, la liquidité de certains actifs est très discutable.
EDF a obtenu une dérogation à l’interdiction de doter les actifs dédiés par des titres de filiales d’exploitants nucléaires : en application du décret du 29 décembre 2010, EDF a affecté à son portefeuille d’actifs dédiés 50 % de ses parts de RTE, pour un montant de 2,3 milliards d’euros (37). La liquidité des actions de RTE repose sur l’hypothèse d’une vente possible de RTE par EDF. Or, le droit constitutionnel français précise que l’acheteur ne peut être qu’une entité publique car le réseau de transport est un monopole de fait. En pratique, la dotation des titres de RTE au portefeuille d’actifs dédiés revient à une garantie d’État.
De même, les titres AREVA, qui comptent pour une grande part des actifs dédiés du CEA, ne peuvent pas être considérés comme des actifs liquides, dans la mesure où il s’agit de participations dans une entreprise stratégique. Si le CEA devait vendre ces actions, l’État serait sans doute contraint de se porter acquéreur.
Enfin, la commission d’enquête a pris connaissance avec attention des déclarations de Luc Oursel relatives à la possible intégration dans les actifs dédiés d’AREVA de la participation que l’entreprise envisage de prendre dans les réacteurs EPR de Hinkley Point. Encore plus que celle de RTE pour EDF, une telle intégration paraît s’écarter sensiblement des obligations de liquidité et de diversification qui s’imposent en matière d’actifs dédiés. Luc Oursel estime cependant que « nous montrerons notre engagement [dans le projet] en étant présents, sinon durant toute la vie de la centrale, du moins pendant sa construction. Quand elle aura redémarré, nous serons libres de rester pour des raisons financières ou de valoriser notre participation, ce qui ne devrait pas être difficile. Le fait que l’investissement soit pris, tout ou partie, dans le fonds dédié ne nous semble pas contradictoire avec l’obligation de fluidité des capitaux, puisque, lorsque la centrale redémarrera, après 2020, il sera aisé de retrouver des repreneurs intéressés par une fraction, voire la totalité de notre participation. La question, qui relève des règles de construction et de gestion des fonds dédiés, a été posée à la direction générale de l’énergie ou du climat (DGEC). »
d. La tentation de la dérogation
Les analyses de la Cour des comptes en 2014 confirment, après celles de 2012, que le maintien des actifs dédiés au sein du bilan des exploitants est un facteur propice à l’adoption de dispositions dérogatoires et d’autorisations au cas par cas. La Cour relève, par exemple, que l’affectation de la créance CSPE aux actifs dédiés a permis à EDF de vendre 2,4 milliards d’euros d’actifs financiers devenus « inutiles » et, de ce fait, de réduire le niveau de son endettement financier. La Cour estime que « les actifs dédiés ont ainsi été utilisés de manière conjoncturelle pour gérer un problème d’endettement, alors que la loi de 2006 prévoyait justement que ces actifs devaient être exclusivement dédiés au financement des opérations de fin de cycle. »
La rédaction du décret encadrant la constitution du portefeuille d’actifs dédiés apparaît offrir trop de souplesse pour répondre convenablement aux objectifs de la loi de 2006, qui ont portant été exprimés de façon très explicite par le législateur.
2. Les arguments en faveur du maintien du système actuel
Au cours des auditions, les trois exploitants se sont montrés farouchement opposés à toute gestion séparée des actifs dédiés.
Tout d’abord, ils considèrent qu’un tel fonctionnement irait à l’encontre de l’objectif recherché, qui est de faire reposer le risque sur l’exploitant : tout « accident » serait de la responsabilité du gestionnaire des actifs dédiés et n’aurait pas à être compensé par l’exploitant.
« M. Thomas Piquemal. […] Si vous me demandez un avis définitif, il me semble inefficient, voire dangereux, d’externaliser la gestion des fonds, car la couverture des charges auxquelles nous devrons faire face un jour repose sur le taux de retour de ce portefeuille. Si ce taux de retour n’est pas garanti, ce seront les clients qui devront payer.
« M. Bernard Bigot. J’irai dans le même sens que M. Piquemal. L’intérêt de placer les actifs sous la responsabilité de celui qui devra assumer la dépense est d’obliger ce dernier à compenser les variations de taux constatées dans le temps, en puisant dans ses ressources. Je ne vois pas en quoi l’État ou quelque fonds que ce soit serait mieux à même de le faire que les entreprises ».
Ensuite, même en ayant traversé une crise financière grave, le portefeuille des exploitants est encore tout à fait suffisant pour atteindre le taux de couverture requis, grâce à une performance moyenne de plus de 5 %.
« En 2013, la performance totale du portefeuille des actifs dédiés était de 9,4 % ; pour le portefeuille financier seul, c’est-à-dire hors créance de CSPE et trésorerie, elle était de 11,6 %. La performance de RTE était de 11,1 %. Sur les dix dernières années, le rendement moyen annualisé du portefeuille est de 5,8 %, ce qui est supérieur au taux d’actualisation. La performance sur les actifs dédiés est donc essentielle pour faire face aux coûts futurs du nucléaire » (Thomas Piquemal). Ces performances résultent de stratégies de placement adaptées à la nature des actifs dédiés, qui réclament des performances de long terme : « Nous avons donc aujourd’hui diversifié nos investissements, et créé notamment un compartiment « infrastructures » au sein du portefeuille d’actifs dédiés, dans lequel se trouvent 50 % des titres de RTE (Réseau de transport d’électricité) et 20 % de TIGF (Transport et Infrastructures Gaz France), le réseau que Total a vendu l’année dernière. EDF dispose ainsi d’un rendement régulier, à faible risque, et augmente donc la valeur de son portefeuille à très long terme » (Thomas Piquemal).
Comme le remarque la Cour des comptes, le rendement propre de la « créance CSPE » pèsera sur le rendement du portefeuille d’actifs pendant les 5 ans prévus pour le remboursement de ladite créance. Celle-ci ne porte intérêt qu’à hauteur de 1,72 % (taux fixe), « en lien avec le risque faible de cette créance » certes, mais très inférieur au taux d’actualisation retenu pour constituer les provisions. Il est vrai que cette situation a vocation à n’être que transitoire ; elle contrevient cependant aux principes élémentaires de bonne gestion des actifs dédiés.
Les exploitants plaident en revanche pour une révision de la formule du taux réglementaire, de façon à garantir une plus grande stabilité dans la fixation du taux d’actualisation.
« Le taux d’actualisation des passifs […] n’est pas pour nous une question de normes comptables, mais plutôt une frustration causée par les modalités de calcul imposées par l’arrêté ministériel qui définit le taux plafond utilisable. Ce calcul est fondé sur une moyenne mobile historique de taux d’intérêt observés sur les obligations d’État, ce qui pose problème dans un contexte de forte volatilité des marchés financiers. Nous dialoguons donc depuis plus d’un an avec l’autorité administrative, ainsi qu’avec les autres entreprises concernées, pour stabiliser dans le temps ce taux d’actualisation : cela permettrait une gestion sereine et durable du portefeuille d’actifs. Dans le cas contraire, la volatilité qui pourrait être introduite dans l’évaluation des passifs, du fait des variations du taux d’actualisation, pourrait provoquer des difficultés dans la gestion du portefeuille d’actifs » (Pierre Aubouin).
En outre, le maintien chez les exploitants de la gestion des actifs dédiés leur permet d’adapter la liquidité des actifs au calendrier des opérations industrielles, ce qui serait plus difficile dans le cas d’une gestion dissociée.
« Nous nous assurons que les dépenses les plus proches dans le temps, c’est-à-dire celles des cinq prochaines années, seront financées sans avoir à revendre des actifs volatils ou risqués. Pour AREVA, cela représente environ 200 millions d’euros par an : nous utilisons les revenus du portefeuille, sans toucher au principal, et complétons par des cessions de parts de fonds monétaires ou d’obligations d’État notées AAA […] On ne peut pas désolidariser la gestion du passif de celle de l’actif ; certains passifs de nature sociale – engagements de préretraite ou de retraite, couverture de frais médicaux par les entreprises – peuvent être pris en charge par des assureurs, mais les charges de démantèlement n’entrent pas dans cette catégorie pour des raisons de responsabilité et de spécificité technique. Nous devons dès lors conserver la haute main sur ces actifs, ne serait-ce que pour pouvoir adapter nos placements à l’échéancier des dépenses, qui peut connaître des variations de plusieurs années en fonction de l’évolution des scénarios de démantèlement » (Pierre Aubouin).
À la lumière de ces éléments, la Cour des comptes émet un jugement nuancé : elle considère « que le positionnement de ces fonds au sein des comptes des exploitants ne semble pas devoir être remis en cause », mais ajoute néanmoins que « les conditions devront être réunies pour que la DGEC puisse exercer un véritable contrôle efficient, en appui à des expertises extérieures ».
CHAPITRE 6 : RETRAITEMENT ET MOX – RÉACTEURS DE 4ÈME GÉNÉRATION
A. LA FRANCE A FAIT LE CHOIX DU RETRAITEMENT ET DU COMBUSTIBLE MOX
1. La gestion du combustible usé : un problème, deux solutions
Placé en réacteur, le combustible s’empoisonne progressivement du fait même des réactions nucléaires et, au-delà de 4 à 5 % de la transformation de la matière, ses qualités sont trop dégradées pour que son exploitation se poursuive dans des conditions acceptables. Il convient alors d’extraire du réacteur le combustible usé, composé pour quelque 95 % d’uranium, pour environ 1 % de plutonium, pour environ 4 %, de produits de fission et pour 0,1 % environ d’actinides mineurs formés par capture neutronique.
Certains éléments sont en tout état de cause des déchets : il s’agit des produits de fission contenus dans les pastilles de combustible et des structures métalliques constituant les assemblages eux-mêmes. D’autres ont un contenu énergétique qui les rend valorisables : l’uranium et le plutonium, ce dernier ayant été produit au cours du séjour du combustible dans le réacteur. Deux choix sont donc possibles :
– soit on décide de considérer les assemblages extraits du réacteur comme des déchets, et ils sont alors destinés à un stockage direct ou bien à un entreposage en attendant qu’une stratégie soit définie quant à leur avenir ;
– soit on décide de retraiter le combustible usé ; le retraitement est le processus physico-chimique qui consiste à séparer les différents constituants des combustibles usés et à les conditionner pour les diriger soit vers des filières de valorisation, soit vers des exutoires adaptés à chaque flux de déchets.
L’extraction du plutonium par retraitement vise deux objectifs : récupérer une matière au fort contenu énergétique et réduire la radiotoxicité et le volume des déchets ultimes. Quelques dizaines d’années après le déchargement du réacteur, cette radiotoxicité deviendrait en effet dominée par la contribution du plutonium.
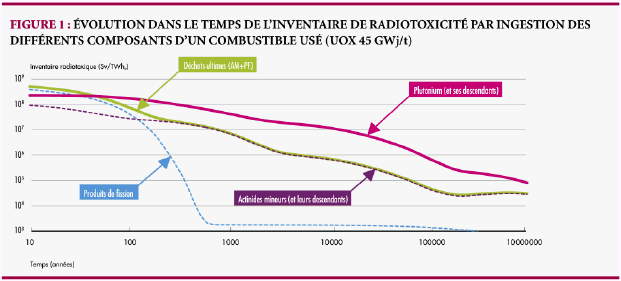
Source : CEA, Rapport sur la gestion durable des matières nucléaires, décembre 2012
Quasiment dépourvue de ressources énergétiques, la France a fait le choix du retraitement du combustible usé dans les années 1960 (l’usine de La Hague a commencé à retraiter les combustibles de la filière UNGG en 1966). Le but était de fournir le plutonium nécessaire au démarrage d’une filière ambitieuse de réacteurs à neutrons rapides, susceptibles de mieux valoriser les ressources en uranium et d’asseoir l’indépendance énergétique.
Certains pays ont fait le choix inverse. Après avoir envisagé la voie du retraitement, les États-Unis ont décidé son abandon en 1976, dans le but de limiter les risques de prolifération mais aussi parce que des espaces permettant la gestion des volumes nécessaires au stockage direct sont disponibles. La Suède a choisi de stocker directement son combustible nucléaire usé ; le concept retenu consiste à placer les combustibles usés dans des conteneurs en cuivre qui seront déposés dans une roche granitique à une profondeur de 400 à 500 mètres ; chaque conteneur sera isolé du granite par une enveloppe de bentonite. En Espagne, le combustible usé de la centrale de Vandellos (UNGG) a été retraité pendant plusieurs années à Marcoule ; le combustible usé des centrales de José Cabrera (réacteur à eau sous pression) et Santa Maria de Garona (réacteur à eau bouillante) ont été retraités au Royaume-Uni ; cependant le retraitement a été abandonné en 1983.
2. Des acteurs français fortement engagés dans le retraitement et la filière Mox
Le retraitement du combustible usé et la fabrication du MOX constituent un élément important du modèle industriel d’AREVA. Le combustible usé est retraité dans son établissement de La Hague (capacité autorisée : 1 700 tonnes par an (38)) et le combustible Mox est fabriqué dans l’usine Melox de Marcoule (capacité autorisée : 195 tonnes). En 2013, le chiffre d’affaires des activités de recyclage s’est élevé à un peu plus de 1 milliard d’euros, soit un peu plus de 11 % du chiffre d’affaires total d’AREVA. Plus de 4 000 salariés AREVA et 1 000 sous-traitants travaillent sur le site de La Hague.
Les relations entre EDF et AREVA relatives au transport, au traitement des combustibles usés et à leur recyclage sont formalisées pour la période 2008-2040 par un accord-cadre signé le 19 décembre 2008. Une première déclinaison contractuelle de cet accord-cadre s’est traduite par la signature le 12 juillet 2010 d’un accord traitement-recyclage et du protocole de reprise et conditionnement des déchets et de mise à l’arrêt définitif et démantèlement de l’usine de La Hague.
L’accord traitement-recyclage fixe, sur la période 2008-2012, les prix et les quantités des prestations mises à la charge d’AREVA par EDF. Les quantités annuelles de combustibles traités et de combustible Mox ont été portées à environ 1 050 tonnes et 120 tonnes, respectivement, entre 2010 et 2012. Une négociation est engagée avec AREVA pour définir les conditions du traitement-recyclage à partir de 2013. Luc Oursel, président du directoire d’AREVA, a indiqué à la commission que cette négociation est toujours en cours et qu’en l’attente de sa conclusion, EDF et AREVA ont conclu un accord transitoire qui permet de poursuivre les opérations industrielles.
LE CYCLE DES MATIÈRES DANS LE PARC NUCLÉAIRE FRANÇAIS
(flux annuels indicatifs pour une production de 400 TWh environ)
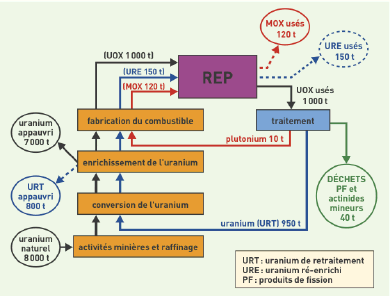
Source : CEA, Clefs CEA, n° 61, printemps 2013
B. DIFFÉRENTES PISTES DE RECHERCHE POUR UNE « 4ÈME GÉNÉRATION » DE RÉACTEURS
Si la notion de « génération » de réacteurs nucléaires a été conceptualisée et mise en avant en 2000 par le Department of Energy américain, la plupart des filières évoquées dans ce cadre ont fait l’objet de recherches, de tests, de prototypes, voire de réalisations semi-industrielles (réacteurs de sous-marins), dès la fin de la Seconde guerre mondiale. Les réacteurs Phénix et Superphénix, par exemple, relèvent de la filière des réacteurs à neutrons rapides, l’une des pistes technologiques labellisées « 4ème génération ». La « 4ème génération » est tout sauf neuve : elle a des racines historiques bien ancrées dans le foisonnement scientifique et technique qui a marqué les premiers temps du nucléaire ; elle ambitionne évidemment d’aller bien au-delà.
1. Un effort conduit dans une dynamique internationale
Le Forum International Génération IV est une instance établie au niveau intergouvernemental qui a pour objet de coordonner les recherches en matière de réacteurs de nouvelle génération, avec les objectifs suivants : améliorer la sûreté nucléaire, améliorer la résistance à la prolifération, minimiser les déchets, optimiser l’utilisation des ressources naturelles, et diminuer les coûts de construction et d’exploitation des réacteurs. La perspective concerne les réacteurs nucléaires qui pourraient être exploités industriellement à partir de 2040.
Fondé en 2000 à l’initiative du Department of Energy américain, le Forum compte actuellement douze États membres (l’Afrique du Sud, l’Argentine, le Brésil, le Canada, la Chine, les États-Unis, la France, le Japon, la République de Corée du Sud, le Royaume-Uni, la Russie et la Suisse) et Euratom.
Six technologies ont été retenues :
1 - VHTR (Very High Temperature Reactor) Réacteur à très haute température (1 000 °C / 1 200 °C), refroidi à l’hélium, dédié à la production d’hydrogène ou à la cogénération hydrogène/électricité ;
2 - GFR (Gas-cooled Fast Reactor) Réacteur rapide à caloporteur hélium ;
3 - SFR (Sodium-cooled Fast Reactor) Réacteur rapide à caloporteur sodium ;
4 - LFR (Lead-cooled Fast Reactor) Réacteur rapide à caloporteur alliage de plomb ;
5 - SCWR (Supercritical Water-cooled Reactor) Réacteur à eau supercritique ;
6 - MSR (Molten Salt Reactor) Réacteur à sels fondus.
2. Les options privilégiées par la France
Le CEA travaille en parallèle dans deux directions, qui reposent sur des réacteurs à neutrons rapides (RNR) avec cycle du combustible fermé.
Le projet ASTRID est un projet de démonstrateur industriel électrogène de 600 mégawatts électriques relevant de la technologie des réacteurs rapides refroidis au sodium. Moins puissant qu’une tête de série, mais suffisamment puissant pour permettre de valider les options de sûreté de cette filière, il a vocation à précéder la tête de série d’un futur réacteur commercial. Ses principaux objectifs sont de tester certaines options innovantes, notamment en termes de sûreté et d’opérabilité (39), et de démontrer la faisabilité, sur des quantités significatives, de la transmutation des actinides mineurs.
En 2010, ASTRID a été sélectionné au titre des projets éligibles aux « investissements d’avenir ». Il a reçu à ce titre une subvention, couvrant les seules « études de conception ». Sur la période 2010-2019, le budget d’ASTRID totalise 607 millions d’euros au titre des « investissements d’avenir », 378 millions d’euros à partir de la dotation annuelle du CEA, 97 millions d’euros au titre des recettes industrielles « en numéraire » pour la R&D et 150 millions d’euros d’apports extérieurs en nature ou en industrie ; l’apport des partenaires est de l’ordre de 100 millions d’euros pour EDF et de 110 millions d’euros pour AREVA (source : CEA).
Le calendrier du projet a été allongé en raison des contraintes budgétaires du CEA : initialement l’avant-projet sommaire devait être achevé en 2014 et l’avant-projet détaillé en 2017 ; ces deux dates ont été respectivement repoussées à 2015 et 2019.
Le projet ALLEGRO est un projet de réacteur expérimental utilisant l’hélium comme fluide caloporteur. L’hélium élimine les difficultés liées à l’emploi d’un caloporteur sous forme de métal liquide, tel que le sodium ou le plomb. Les efforts portent essentiellement sur le combustible et la sûreté en collaboration avec la Hongrie, la République tchèque et la Slovaquie afin de construire dans l’un de ces trois pays un réacteur expérimental.
Le projet ALLEGRO est encore dans une phase conceptuelle, du fait de son caractère très innovant. Sa faisabilité ne peut pas être confirmée tant que l’ensemble des questions de sûreté n’aura pas trouvé une réponse satisfaisante, de même que le verrou technologique lié au développement du combustible tout céramique. Le CEA considère qu’un effort de R&D substantiel doit encore être mené au niveau européen avant de pouvoir être prêt à choisir les options techniques du réacteur et à lancer les études d’ingénierie détaillées en support au développement du réacteur ALLEGRO.
II. LES APPORTS DE LA COMMISSION D’ENQUÊTE
Le retraitement, le combustible Mox et les perspectives de conception et de déploiement des réacteurs de « 4ème génération » ont fait l’objet d’une séquence spécifique d’auditions qui ont permis à la commission d’enquête de confronter les points de vue des représentants du secteur nucléaire à celui de Mycle Schneider, consultant en politique énergétique et nucléaire, membre d’un groupe d’experts soutenu par l’Université de Princeton, l’International Panel on Fissile Materials. Ces questions ont également été abordées au cours de diverses autres auditions et lors des déplacements à La Hague et Marcoule, offrant ainsi à la commission d’enquête d’utiles éclairages complémentaires.
A. LE RETRAITEMENT ET LE MOX, SUJETS DE JUGEMENTS SOUVENT TRANCHÉS
1. Des appréciations sensiblement divergentes sur l’intérêt économique du retraitement et du Mox
Conformément à son mandat, la commission a cherché à obtenir une vision claire des coûts de la filière « retraitement et Mox », notamment par comparaison avec ceux de l’approvisionnement des réacteurs par du combustible à uranium naturel enrichi. Ce n’est manifestement pas une question nouvelle, puisque Mycle Schneider rappelle qu’elle est posée depuis le début des années 1980. Le document distribué au cours de son audition montre ainsi que, « en 1982, quand il est apparu que le développement de ces réacteurs [à neutrons rapides] serait différé et pour longtemps, EDF a dû réexaminer la situation pour voir si le recyclage du plutonium dans les réacteurs à eau sous pression présenterait un intérêt suffisant pour légitimer la poursuite du programme de retraitement. » Mycle Schneider souligne que le choix fait alors, confirmé par la suite, échappe dans une certaine mesure à la pure rationalité économique au profit de considérations de stratégie industrielle et de stabilité juridique : « il a tout de même été décidé de poursuivre le programme de retraitement et de l’option Mox. Il ne s’agissait pas d’une décision sur le fond, les conditions économiques de séparation et d’utilisation du plutonium s’étant très sensiblement dégradées, mais d’une décision destinée à honorer des engagements. On craignait, par surcroît, que l’arrêt de la construction de l’usine UP2-800, donc l’arrêt du retraitement français, n’eût un grave impact sur l’activité du nucléaire dans le reste du monde. »
Le caractère structurant des choix faits en matière énergétique et l’« inertie » du système industriel qui en découle ont été clairement confirmés par Sylvain Granger, directeur de la division « Combustible » d’EDF : « D’un point de vue pratique et industriel, j’insiste, la France a fait un choix : les investissements ont été faits, les installations de traitement existent et sont récentes. Dès lors qu’une politique industrielle a été décidée, en changer est extrêmement coûteux : non seulement on détruit de la valeur en ne laissant pas aux investissements le temps d’être rentabilisés, mais il faut en consentir de nouveaux. »
S’agissant de coûts constatés dans le cadre de relations commerciales concurrentielles, le « juge de paix » est, in fine, le client électricien. Le fait est que la base de clientèle pour les services de retraitement proposés par AREVA s’est progressivement réduite et qu’EDF est aujourd’hui la principale, sinon l’unique, source récurrente d’activité de l’usine de La Hague. Au 31 décembre 2012, 9 790 tonnes de métal lourd (40) étaient présentes sur le site de La Hague, provenant en quasi-totalité d’EDF (plus de 99 % du total) ; l’usine accueillera ces prochaines années quelques dizaines de tonnes de combustibles néerlandais, italiens et belges. Même si Philippe Knoche, directeur général délégué d’AREVA, précise à juste titre que « depuis l’origine, AREVA a traité 29 000 tonnes de combustible, dont 10 000 pour des clients étrangers », la France apparaît aujourd’hui « parfaitement isolée » (Mycle Schneider). L’usine britannique Thorp de Sellafield devrait fermer ses ateliers de réception de combustible vers 2018, les derniers contrats en cours ne prévoyant plus de livraison au-delà de cette date. En revanche, comme l’indique Philippe Knoche, la Chine a prévu de construire une installation de retraitement de taille industrielle dans les prochaines années, pour laquelle elle a d’ailleurs sollicité AREVA.
Il en est de même pour la fabrication de combustible Mox. Si l’on met à part quelques installations de capacité modeste (l’usine de Tokai au Japon et l’usine de Mayak en Russie) ou en voie de fermeture (l’usine de Sellafield), Melox représente près de 80 % de la capacité mondiale en attendant l’éventuel démarrage – plusieurs fois repoussé et actuellement envisagé pour mars 2016 – de l’usine japonaise de Rokkasho, dont la capacité serait de 130 tonnes par an. Par ailleurs, sur l’année 2012, les fabrications pour EDF ont représenté plus de 80 % de la production de Melox.
Sollicités expressément par votre rapporteur sur la comparaison des coûts entre le combustible uranium et le Mox, les représentants d’EDF et d’AREVA et Mycle Schneider ont exprimé des appréciations radicalement opposées. Pour ce dernier, « depuis une trentaine d’années, de nombreuses études ont démontré que, quelles que soient les hypothèses émises, le retraitement se révèle plus coûteux que le stockage direct. » Philippe Knoche affirme, au contraire, que « toutes les études réalisées montrent que le coût du recyclage des combustibles usés et celui du cycle ouvert sont équivalents, à supposer que le pays considéré ne dispose pas déjà d’installations de retraitement » ; il s’appuie sur une étude de l’Agence pour l’énergie nucléaire de l’OCDE (AEN-OCDE) (41) pour préciser que « les coûts de production de l’électricité se situent entre 6 et 8 dollars par mégawattheure (42), que l’on aille de la mine au réacteur, pour le cycle ouvert, ou du combustible usé au réacteur, pour le cycle fermé. Si l’on décompose les coûts, ceux de l’extraction et de l’enrichissement de l’uranium naturel sont nettement plus élevés dans le cas du cycle ouvert et, inversement, ceux du recyclage et de la fabrication du Mox sont sensiblement supérieurs dans le cas du cycle fermé. […] L’étude de l’AEN indique également que, toutes choses étant égales par ailleurs, les coûts de stockage sont plus élevés pour le cycle ouvert que pour le cycle fermé. »
Sylvain Granger précise que cette équivalence, estimée globalement sur l’ensemble des opérations du cycle, se retrouve si l’on s’intéresse au coût complet des deux types de combustible : « le coût du combustible à l’uranium enrichi ne se résume pas au coût de fabrication. Alors que le combustible Mox permet d’utiliser directement du plutonium sans devoir l’acheter, le convertir ou l’enrichir, dans le cas du combustible à l’uranium enrichi, il faut acheter l’uranium naturel, le convertir et l’enrichir. La somme des coûts – approvisionnement, conversion, enrichissement et fabrication – pour l’uranium enrichi est équivalente au coût de fabrication du Mox, qui est la seule composante du coût final. Même si le coût de fabrication du Mox est supérieur, les coûts complets des deux combustibles sont comparables. » Cette approche, dans laquelle le plutonium est « gratuit » et le coût du retraitement n’est imputé ni au combustible uranium, ni au Mox, suppose d’imputer entièrement ce coût à la gestion des déchets.
Il ressort donc des travaux de la commission que, a minima, l’ensemble des intervenants s’accordent pour dire qu’il ne revient pas plus cher de stocker directement le combustible usé que de le retraiter. Pour apprécier l’intérêt du retraitement et du Mox, pour les industriels comme pour la société, il convient donc d’examiner plus avant leur finalité, les avantages recherchés, et de les mettre en balance avec leurs inconvénients.
2. Le retraitement et le Mox n’apportent qu’une réponse partielle au problème des déchets
La gestion des matières par retraitement des combustibles usés poursuit deux objectifs : récupérer les matières valorisables au plan énergétique et améliorer la gestion des déchets de haute activité en réduisant leur toxicité et en les conditionnant de façon adéquate. Comme l’indique Jacques Repussard, directeur général de l’IRSN, la gestion des matières doit être considérée comme un tout : « [le retraitement] n’aurait pas d’intérêt s’il s’agissait simplement de stocker les déchets. Et il ne serait pas rentable si nous n’avions pas l’ambition de développer une autre filière nucléaire. […] Le retraitement des combustibles usés n’a de sens économique que si l’on réutilise les matières qui en sont issues. […] Il s’agit en effet d’une technique très coûteuse de séparation des déchets, qui n’a de sens que si elle est utilisée dans le cadre d’une politique énergétique telle que celle qui a été mise en place en France. »
Sylvain Granger n’en disconvient pas, qui indique que « pour EDF, le traitement-recyclage du combustible usé est avant tout un mode de gestion des déchets de haute activité et de moyenne activité à vie longue, qui permet d’en diviser le volume par dix, d’adapter le conditionnement à leur durée de vie et de garantir un entreposage sûr dans un espace limité. Le recyclage permet également de réduire les besoins du parc nucléaire en uranium naturel. Il contribue ainsi à la sécurité de notre approvisionnement. » La valorisation des matières ayant un potentiel énergétique justifie donc toujours, mais seulement à titre accessoire, le recours au retraitement.
Celui-ci permet effectivement de faire en sorte que « le volume total de déchets ainsi vitrifiés et compactés s’élève à environ 300 mètres cubes par an pour l’ensemble du parc d’EDF » (Philippe Knoche), auxquels il faut ajouter les déchets de procédé (de moyenne activité à vie longue) qui relèvent des mêmes modes de stockage et représentent un volume près de 7 fois supérieur, comme l’indique le bilan-matières de l’un des scénarios retracés dans l’Inventaire national des matières et déchets radioactifs, présenté par Sylvain Granger devant la commission. Ces volumes ne constituent d’ailleurs qu’une partie de ceux de l’ensemble de la filière nucléaire, qui sont bien supérieurs.
Ces éléments s’entendent de la gestion des combustibles usés UO2 : ils peuvent être retraités à une échelle industrielle et les matières issues du retraitement peuvent être réutilisées au sein du parc actuel grâce au combustible Mox. L’affaire est tout autre pour la gestion du combustible Mox une fois qu’il a été irradié en réacteur : aucun intervenant n’a contesté le fait que les combustibles Mox usés n’ont pas vocation à être retraités en vue d’être recyclés dans les réacteurs actuels ou l’EPR.
Le recyclage du Mox usé est en effet possible, sur un plan technique, mais il présente des écueils dirimants qui interdisent d’envisager une mise en œuvre industrielle : « Nous sommes capables aujourd’hui de recycler plusieurs fois du combustible Mox usé : nous l’avons fait pour certains clients étrangers. Cependant, ce n’est possible que pour des quantités limitées, le Mox réutilisé devant être mélangé à plusieurs reprises avec d’autres combustibles usés. Cela ne correspond donc pas à un optimum technique avec les réacteurs à eau légère dont nous disposons actuellement » (Philippe Knoche).
Ainsi, le « cycle du combustible », qui était « fermé » au stade de l’utilisation du combustible uranium, devient « ouvert » à l’étape suivante, au stade du combustible Mox.
« Que faire, alors, du combustible Mox usé ? S’il est stocké en l’état, il faut prévoir le coût de son confinement pendant un temps très long et de la prévention de tout risque de criticité » en raison du plutonium qu’il contient (Bernard Bigot, Administrateur général du CEA). Le risque de criticité (« déclenchement spontané d’une réaction nucléaire en chaîne si une certaine quantité de cette matière est réunie dans un volume limité ») vient du fait que le plutonium est une matière fissile ; l’obligation de mettre en œuvre un confinement robuste vient de la très forte radiotoxicité du plutonium.
Pour Bernard Bigot, « le premier problème à traiter […] est celui du plutonium : s’il n’est pas multi-recyclé, le problème demeure irrésolu ». La filière actuelle de retraitement et de recyclage du plutonium dans le parc actuel, via le combustible Mox, ne permet pas de maîtriser, sur le long terme, les risques dus au plutonium puisqu’elle ne peut intégrer son multirecyclage, que le CEA estime indispensable.
3. L’avenir de la filière doit être apprécié à l’aune de nombreux paramètres
Quelle que soit l’opinion de chacun sur l’opportunité d’avoir choisi le retraitement et le Mox plutôt que des solutions alternatives, il faut convenir que la filière industrielle qui s’est organisée autour de ce choix a su organiser sa pertinence économique. Le retraitement-recyclage « permet une économie en matières premières, telle que la plupart des industries cherchent à en réaliser actuellement, et contribue à limiter les importations d’EDF à hauteur de 150 millions d’euros par an ». Symétriquement, « sur les cinq à sept dernières années, nos prestations de recyclage nous ont rapporté environ 600 millions d’euros par an à l’exportation. […] l’effet net sur la balance commerciale de la France est positif à hauteur de 750 millions. Cela fait du retraitement une filière d’excellence française ». « La filière emploie aujourd’hui 12 500 personnes, principalement sur le site de La Hague, dans l’usine Melox et pour le transport. Ce chiffre n’inclut pas les effectifs de tous les prestataires. » Pour l’ensemble du secteur, « d’une manière générale, la prévisibilité des coûts est plus grande pour le cycle fermé, en raison du meilleur conditionnement des déchets » (Philippe Knoche) et c’est sur le savoir-faire d’AREVA que la Chine va s’appuyer pour concevoir et construire une usine de retraitement de grande capacité.
Il reste que d’autres éléments doivent également être pris en considération afin que chacun se forge un jugement éclairé. Tout d’abord – et même si l’usage du Mox dans les réacteurs du parc actuel a reçu les autorisations nécessaires de l’ASN – la gestion d’un réacteur chargé en Mox est plus complexe que celle d’un réacteur chargé uniquement en combustible uranium et des modifications matérielles doivent être effectuées : « Pour charger en Mox un réacteur qui n’a pas été conçu initialement pour cette utilisation, il est nécessaire d’en modifier un certain nombre de paramétrages et d’éléments matériels, par exemple en ajoutant des grappes de commande. Il faut également déterminer le pourcentage de Mox qui peut être introduit dans le réacteur de sorte que le combustible d’ensemble soit sûr, acceptable et adapté. Ces contraintes expliquent que tous les réacteurs ne sont pas autorisés à charger du Mox. Pour obtenir les autorisations, il nous a fallu constituer un dossier de sûreté démontrant que toutes les conditions posées par la loi en matière de sûreté nucléaire étaient remplies » (Sylvain Granger). Seul l’EPR est conçu dès l’origine pour être chargé en Mox, mais cela ne signifie pas que la gestion du réacteur en soit simplifiée : « s’agissant du Mox et de l’EPR, nous essayons de progresser par étape, et d’abord de démarrer des EPR. Dans un premier temps, nous avons demandé des autorisations pour l’utilisation de combustible à l’uranium enrichi, avec l’idée de les obtenir ensuite pour le Mox » (Sylvain Granger).
Mycle Schneider relève, par ailleurs, que le stock de plutonium séparé n’a cessé de croître au fil du développement de l’usage du Mox alors même que celui-ci est censé contribuer à la limitation de l’inventaire et que EDF met en œuvre une politique industrielle qui « a pour objet de ne rendre disponible du plutonium par traitement du combustible usé que dès lors que nous sommes capables de le recycler à court terme dans nos réacteurs » (Sylvain Granger). Au demeurant, « le schéma opérationnel de retraitement pour la conversion et l’enrichissement de l’uranium [issu du retraitement] est apparemment au point mort : on ne fabrique pas actuellement de combustible sur la base de l’uranium retraité, ce qui pose la question de son avenir » (Mycle Schneider). Enfin, « si le retraitement conduit à une réduction du volume des déchets de haute activité, il entraîne une augmentation du volume de tout autre déchet, comme les effluents radioactifs, qui sont rejetés dans la nature sous forme gazeuse ou liquide, ou les déchets de démantèlement ». Il faut également tenir compte des risques résultant des transports routiers d’oxyde de plutonium (une centaine par an).
Au-delà de ces éléments « structurels », le contexte du retraitement et du Mox est affecté par des évolutions récentes du panorama de la politique énergétique. La commission d’enquête doit à Mycle Schneider de l’avoir exposé en des termes particulièrement clairs : « Trois facteurs contribuent à créer une perspective qui n’a pas été anticipée ; ils plaident tous pour la nécessité d’une nouvelle stratégie. Le premier facteur est la décision du président Hollande de réduire la part de l’énergie nucléaire à 50 % à l’horizon 2025 ; le deuxième est la perspective d’un « non-besoin » d’une vingtaine de réacteurs, ainsi que l’a évoqué devant cette commission le directeur général de l’énergie et du climat (43) ; le troisième est l’échéance des quarante ans pour les réacteurs de 900 mégawatts, notamment ceux qui sont moxés : que fera-t-on si ces derniers ne reçoivent pas leur autorisation de fonctionnement jusqu’à quarante ans, sachant que, en début d’année, seule l’unité n° 1 de Tricastin avait reçu un avis favorable ? » Il ne s’agit pas là d’une vision exagérément pessimiste, voire « orientée », puisque Luc Oursel a fait part à la commission de réflexions similaires lors de son audition du 7 mai dernier : « ce sont les réacteurs les plus anciens, ceux de 900 mégawatts, qui utilisent aujourd’hui du Mox. Chaque fermeture de l’un de ces vingt réacteurs fait donc diminuer d’à peu près 5 % l’utilisation de Mox. Cela entraîne une diminution de l’activité à Marcoule et à La Hague – à moins que vous ne décidiez, ce qui est un choix politique, de remplacer ces vieux réacteurs par de nouveaux réacteurs capables d’utiliser du Mox. […] Si l’on ne recrée pas de débouchés pour le Mox, les conséquences sont donc importantes ».
Constatant que « la stratégie actuelle conduit à une impasse : l’augmentation de tous les stocks […] accroît les risques induits et les coûts, complexifie le système pour EDF et a d’importantes implications géopolitiques », Mycle Schneider appelle à « revoir le système » et à « bâtir une nouvelle stratégie vraiment cohérente ». Comme l’indique le document remis aux membres de la commission lors de son audition, « cette situation est une occasion unique d’abandonner le schéma de l’action en fonction “des engagements déjà pris” et de rouvrir de véritables choix politiques. […] Finalement, c’est aussi une occasion pour l’Assemblée nationale de statuer enfin sur un sujet sur lequel elle ne s’est jamais explicitement exprimée. »
B. UNE FILIÈRE « 4ÈME GÉNÉRATION » QUI DEVRA FRANCHIR DES OBSTACLES IMPORTANTS AVANT DE VOIR LE JOUR
« Nul ne doute plus de la nécessité de développer une quatrième génération, comme le prouvent les projets lancés aux États-Unis, en Chine, en Russie, en Inde ou au Japon » (Luc Oursel). Ce n’est que « pure spéculation », répond Mycle Schneider.
L’enjeu de la « 4ème génération » est l’exploitation optimale du potentiel énergétique contenu dans l’uranium, dont seule une petite partie (0,6 à 0,7 % de la masse totale du métal extrait du minerai) est exploitable dans les réacteurs actuels ou ceux de 3ème génération. Comme l’indique Bernard Bigot, « la donne est alors complètement changée. On estime que les réserves mondiales d’uranium naturel qui peuvent être extraites du sous-sol permettent de couvrir les besoins pendant deux cents ans dans les conditions d’exploitation actuelles. En utilisant l’uranium au centuple de ce à quoi l’on parvient en ce moment, on modifie radicalement les perspectives, le matériau naturel permettant alors de couvrir l’exploitation pendant vingt mille ans. »
Chacun s’accorde cependant à reconnaître que le début du déploiement d’une telle filière ne pourrait intervenir qu’à partir du milieu du siècle, la constitution d’un parc de taille respectable n’étant envisagée que vers la fin du siècle. Ces horizons très lointains ont un avantage : ils offrent aux ingénieurs le temps nécessaire pour concevoir et valider les solutions techniques sur lesquelles seraient mis au point les nouveaux réacteurs ; ils ont aussi un inconvénient : ils brouillent certaines perspectives, notamment économiques, laissant le décideur dans l’embarras lorsqu’il s’agit d’apprécier s’il est pertinent de s’engager dans des efforts au résultat si incertain.
1. Le débat sur la validité des choix techniques français
Six catégories de réacteurs ont été identifiées par le Forum Génération IV comme présentant un potentiel intéressant pour fonder une filière de nouvelle génération. Quatre d’entre elles sont fondées sur des réacteurs à spectre rapide, seuls à même d’extraire de la ressource en uranium l’essentiel de son contenu énergétique. Parmi elles figure la filière des réacteurs à neutrons rapides refroidis au sodium (RNR-Na), qui a donné le jour, en France, aux réacteurs Phénix et Superphénix. Le CEA disposant d’une expérience importante en matière de RNR-Na, il privilégie cette voie dans l’allocation de ses ressources : « Je ne dis pas que les autres technologies – réacteurs à caloporteur plomb ou hélium, filière à sels fondus – ne pourraient faire l’objet d’une démonstration au cours de ce siècle, mais je ne pense pas leur développement industriel possible au XXIe siècle. […] La Russie utilise des réacteurs à caloporteur sodium depuis quarante ans et le réacteur Phénix a fonctionné pendant trente ans ; nous disposons donc d’un retour d’expérience considérable sur lequel nous pouvons nous appuyer. J’observe que les réacteurs qui n’ont jamais fonctionné sont toujours dits plus sûrs, moins chers et meilleurs. Je doute des vertus dont ils sont ainsi parés » (Bernard Bigot).
Cette orientation est d’ailleurs assez largement partagée au plan international, où les principaux acteurs cherchent à valoriser leur patrimoine scientifique et technique : « Dans les grands pays nucléaires qui sont avancés dans leurs politiques de recyclage et de recherche sur les réacteurs de quatrième génération – Inde, Chine, Russie et États-Unis, où le modèle est néanmoins différent –, la filière privilégiée est celle des réacteurs au sodium » (Philippe Knoche).
Votre rapporteur a déjà indiqué qu’une partie des crédits consacrés à ASTRID est imputée sur la dotation annuelle du CEA, à hauteur d’environ 300 millions d’euros. Cependant, la majeure partie du budget d’ASTRID est financée sur les crédits publics dégagés au titre des « investissements d’avenir ». C’est cette partie qui concourt – avec le financement du réacteur Jules Horowitz – à l’augmentation du montant des dépenses financées sur crédits publics qui a été relevée par la Cour des comptes dans son rapport de mai 2014 : + 18 % entre 2010 et 2013.
Désormais, comme le souligne la Cour, le montant des dépenses de recherche financées sur crédits publics est sensiblement supérieur à celui de la taxe sur les installations nucléaires de base – ce rapprochement permettant d’apprécier dans quelle mesure le coût du financement public de la recherche nucléaire est « internalisé » dans les comptes des exploitants par l’intermédiaire de la fiscalité. Il est peu probable que cette situation évolue dans les prochaines années, Mme Ségolène Royal, ministre de l’Écologie, du développement durable et de l’énergie faisant part de sa volonté de stabiliser l’effort de recherche dans la durée : « Le maintien d’une capacité de recherche de pointe au sein de l’État est essentiel pour la préservation de sa capacité de décision en vue de préparer l’avenir, garantir l’avance technologique française et conserver un haut niveau de sûreté. Je veillerai à ce que ces efforts soient maintenus. »
Mais d’autres voix ont fait valoir devant la commission la nécessité que les options ne soient pas fermées dès à présent. Pierre-Franck Chevet, président de l’Autorité de sûreté nucléaire, a ainsi affirmé : « Le CEA préfère que les réacteurs de la quatrième génération soient au sodium. Mais d’autres types de réacteurs de quatrième génération sont conçus dans le monde et certains d’entre eux disposent de caractéristiques de sûreté plus prometteuses. Nous souhaitons donc que des études reposant sur ces comparaisons soient effectuées et nous avons mis en place un groupe permanent sur ce sujet, qui rendra ses conclusions à la fin du premier semestre de 2014. Il est logique que nous pensions à continuer de fabriquer des réacteurs à neutrons rapides, mais il ne faut pas refuser d’examiner d’autres types de réacteurs. »
En effet, l’utilisation du sodium dans les réacteurs nucléaires présente des avantages réels (par exemple le circuit primaire n’est pas sous pression), mais aussi des inconvénients importants ; Philippe Knoche précise par exemple que « il s’agit en particulier d’éviter tout risque d’interaction entre le sodium et l’eau, point qui a posé problème dans le projet Superphénix, notamment pour ce qui est des dispositifs techniques de manipulation du combustible ». Le CEA rappelle cependant qu’il est de la vocation des organismes de recherche et des industriels qui collaborent avec eux de trouver des solutions aux sujets soulevés par les autorités de sûreté. Sur le sujet de l’inspection en service, évoqué par Pierre-Franck Chevet, Bernard Bigot précise : « Il est vrai que, le sodium n’étant pas transparent à la lumière visible, la question se pose de l’inspection dans le réacteur en service. Pour cette raison, nous développons avec nos partenaires industriels une technique d’observation du bain de sodium chaud utilisant des ultrasons et d’autres moyens – comme, en médecine, le progrès scientifique a permis la conception de techniques non invasives, telle que l’utilisation de la fibre optique, pour parcourir le corps humain. C’est le genre de progrès technique majeur sur lequel nous sommes mobilisés. »
Il reste que, aux yeux de l’ASN, « le choix d’une technologie de quatrième génération doit être le résultat d’une analyse ouverte, qui compare non seulement les différentes technologies disponibles, mais également leurs implications en termes de sûreté : des réacteurs de 300, 1 000 ou 1 500 MW ne sont pas équivalents en termes de risques et de sûreté. » Pour des raisons tenant certainement plus à la stratégie industrielle qu’à la sûreté nucléaire, AREVA semble aussi envisager d’explorer des voies diversifiées : « ASTRID est porteur d’avancées technologiques intéressantes, mais il n’est pas le seul projet de réacteur de quatrième génération. Comme souvent en matière de recherche, nous nous interrogeons sur l’opportunité de développer un concept distinct ou au contraire cohérent avec ceux de nos partenaires étrangers » (Philippe Knoche).
En tout état de cause, quelle que soit la filière, de nombreux verrous techniques devront être levés en matière de sûreté pour atteindre les objectifs généraux que s’est fixé WENRA, l’association des autorités de sûreté nucléaire d’Europe occidentale, a tenu à souligner Jacques Repussard : « Sur les six filières de quatrième génération identifiées par la communauté internationale, certaines n’ont pas encore dépassé le stade du bureau d’études. L’IRSN a produit, il y a deux ans, un rapport que nous vous remettrons et qui compare les avantages et les inconvénients des différents concepts en termes de sûreté. Il en ressort que certains de ces concepts posent plus de questions qu’ils n’apportent de réponses. »
2. Une divergence de vue sur les objectifs de sûreté
Si l’ASN insiste pour que certaines options restent ouvertes, c’est parce qu’elle n’est pas prête à accepter que les réacteurs de 4ème génération ne marquent pas de progrès en matière de sûreté. Comme l’a clairement exposé Pierre-Franck Chevet devant la commission, « l’expression “quatrième génération” est source de confusion. Elle représente en réalité une avancée en termes de gestion et de recyclage des déchets, et non en matière de sûreté. C’est la troisième génération qui avait marqué un progrès dans ce domaine. Cependant, pour l’ASN, il faut faire en sorte que la quatrième génération – notamment le prototype ASTRID – permette également une amélioration de la sûreté par rapport aux générations précédentes. »
Par la voix de son Administrateur général, le CEA a exprimé une position sensiblement différente, voire diamétralement opposée : « Venons-en à la sûreté. Il est toujours très facile de prétendre que le réacteur qui vient doit avoir un niveau de sûreté supérieur à celui de la génération précédente. Selon moi, nous avons atteint, avec les réacteurs de troisième génération, un niveau de sûreté très élevé. Néanmoins, même s’il est extrêmement peu probable, un accident est toujours possible, et il aurait des conséquences dommageables. Le seul objectif qui vaille en matière de sûreté, la condition absolue, c’est qu’il ne doit pas y avoir de relâchement de radionucléides à l’extérieur du site nucléaire, même dans le cas du pire accident nucléaire. Autrement dit, il faut éviter ce qui s’est passé à Fukushima, où un relâchement de radionucléides a neutralisé pour quelques décennies un territoire de quelque 400 kilomètres carrés. C’est, pour nous comme pour nos concitoyens, l’exigence absolue, et c’est l’objectif que doivent atteindre les réacteurs de troisième génération, ce qui a impliqué des renforcements considérables en matière de conception et d’organisation. Les réacteurs de quatrième génération doivent avoir le même niveau de sûreté.
« M. le rapporteur. Vous considérez que l’on en fait assez en matière de sûreté avec les réacteurs de troisième génération et que l’on n’est pas obligé de faire plus. Vous êtes donc en désaccord avec l’ASN, pour laquelle le réacteur de quatrième génération doit apporter un gain de sûreté significatif par rapport aux réacteurs de troisième génération ?
« M. Bernard Bigot. Si, après un retour d’expérience de plusieurs décennies, nous avons atteint un niveau de sûreté satisfaisant, celui des critères les plus exigeants pour l’ensemble des acteurs et pour la population, pourquoi me donnerai-je pour objectif d’aller encore plus loin, handicapant ainsi le développement en question ? Si déjà la démonstration claire est faite que le premier réacteur de quatrième génération a le même niveau de sûreté que celui que j’évoque et qu’il est capable de satisfaire les exigences de sûreté les plus élevées, je ne sais pas ce que signifie « plus de sûreté » que cela. »
Les conséquences de cette divergence pour le projet ASTRID pourraient être majeures. Philippe Jamet, commissaire de l’ASN, estimait ainsi : « il est clair pour l’ASN que les réacteurs de quatrième génération doivent impérativement se caractériser par un progrès en termes de sûreté par rapport à la troisième génération. S’agissant d’une filière dont la durée de vie est d’un siècle ou d’un siècle et demi, il n’est pas imaginable que la technologie et le niveau de sûreté soient figés. […] Pour les raisons que je viens d’indiquer, l’ASN considère que ce projet [ASTRID], dont le niveau de sûreté n’excède pas celui des réacteurs de troisième génération, ne peut constituer un prototype. […] La condition pour qu’un prototype de quatrième génération puisse être construit, c’est qu’il permette d’expérimenter des solutions qui garantiront un niveau de sûreté significativement augmenté par rapport aux réacteurs de troisième génération. »
3. Une compétitivité qui restera à démontrer
À supposer que les exigences de l’Autorité de sûreté nucléaire soient satisfaites, aujourd’hui et dans la durée (puisque le contrôle de la sûreté nucléaire repose, en France, sur la réévaluation périodique du niveau de sûreté au regard des meilleures technologies et pratiques disponibles), à supposer que les « verrous technologiques » évoqués par Jacques Repussard aient été levés, à supposer que l’ensemble des éléments nécessaires au déploiement à grande échelle d’un parc de réacteurs de 4ème génération aient été réunis (44), il resterait encore à maîtriser les coûts d’une telle filière. Les réacteurs de 4ème génération n’ont pas pour vocation exclusive de multirecycler le plutonium existant et de maîtriser la production de déchets ultimes : s’ils sont censés permettre à l’humanité de disposer d’une énergie quasi illimitée, c’est parce qu’ils ont une vocation électrogène, indépendamment des qualités qu’on leur prête au regard de la gestion des matières.
Ces réacteurs de 4ème génération seront donc en concurrence avec les moyens de production électrique disponibles à la fin du siècle. Personne ne peut évidemment, à cet horizon, connaître les déterminants de coûts au sein du mix correspondant. Pour autant, le CEA indique que « dans le rapport que nous avons remis au Gouvernement en décembre 2012, nous estimons le coût du kilowattheure produit dans le cas du multi-recyclage du plutonium – technologie qui dispense de l’obligation d’enrichir l’uranium – de 15 % supérieur à celui de la production d’électricité par les réacteurs de troisième génération. »
Reconnaissant que « ce réacteur, plus complexe que les précédents et associé à un cycle de production également plus complexe, ne peut entrer en compétition stricte avec ses prédécesseurs », Bernard Bigot précise qu’il peut trouver son intérêt dans un parc mixte, composé de réacteurs à eau sous pression et de réacteurs de 4ème génération, les surcoûts des seconds étant à la fois atténués dans les coûts d’ensemble du parc et justifiés par leur contribution à la maîtrise des déchets ultimes.
Deux éléments importants ont été exposés à la commission à propos de la compétitivité des réacteurs de 4ème génération. Tout d’abord, Philippe Knoche a appelé de ses vœux une harmonisation internationale des exigences en matière de sûreté, la concurrence entre les industriels de pays différents, sur la base de choix technologiques éventuellement différents, ne pouvant se développer de façon saine si certains sont soumis à des exigences moins strictes que d’autres.
Ensuite, l’attention a été attirée sur un paramètre majeur de l’équilibre économique comparé entre les réacteurs actuels ou de 3ème génération et les réacteurs de 4ème génération : le prix de l’uranium naturel. De même que l’envolée des prix au début des années 1970, puis leur effondrement une décennie après, avaient suscité l’essor du retraitement civil et le lancement rapide de projets de surgénérateurs, puis conduit la plupart des électriciens à s’éloigner de cette voie, de même l’abondance actuelle de la ressource en uranium réduit l’intérêt que peuvent porter les industriels au développement de moyens de production annoncés dès aujourd’hui comme plus coûteux que ceux du « nouveau nucléaire ».
À cet égard, les propos tenus par AREVA sont particulièrement clairs : « le moment choisi pour déployer tels ou tels réacteurs est aussi une question d’optimum technico-économique : il serait plus urgent de passer à la quatrième génération si l’uranium se raréfiait et que son prix était de 75 dollars par livre, et non inférieur à 50 dollars comme aujourd’hui » (Philippe Knoche). Pour EDF, « l’intérêt principal de la quatrième génération pour un énergéticien réside dans sa capacité à repousser les limites en termes de ressources en matières premières. […] Pour la production d’électricité d’origine nucléaire, les ressources sont importantes et il n’y a pas d’urgence à se doter de réacteurs de quatrième génération avant 2050. Néanmoins, il faut pouvoir les développer dans le marché global de la production d’énergie sur lequel ils seront en compétition avec des réacteurs de troisième génération et de nombreuses autres sources de production d’électricité » (Sylvain Granger).
De fait, plutôt que la complémentarité souhaitée par le CEA, c’est une concurrence entre 3ème et 4ème génération qui pourrait marquer l’éventuelle introduction de la nouvelle filière. Dès aujourd’hui, d’ailleurs, AREVA peut dire que « la construction de réacteurs de génération III+ retarde le déploiement de la quatrième génération. Il y a donc différents horizons possibles » (Philippe Knoche).
S’il ne se révèle pas être finalement une impasse, le chemin sera encore long entre le prototype, le démonstrateur et la tête de série.
Le maintien d’une recherche active sur les réacteurs de 4ème génération reste cependant utile pour les grands acteurs du nucléaire. Tant qu’est préservée la perspective qu’un jour, un débouché soit donné aux quelque 290 000 tonnes d’uranium appauvri entreposées sur les sites de Bessines et du Tricastin, aux quelque 27 000 tonnes d’uranium de retraitement entreposées sur le site du Tricastin et au gros millier de tonnes de combustibles Mox d’EDF entreposés dans les piscines de La Hague, ceux-ci n’auront pas à être requalifiés en déchets, avec les conséquences techniques et financières qui résulteraient d’une telle requalification.
Au regard de l’ensemble de ces enjeux, il serait légitime que la représentation nationale soit associée régulièrement au choix des orientations prises par le pays.
CHAPITRE 7 : LE RISQUE NUCLÉAIRE : PASSER DE LA CONCEPTUALISATION À L’ACTION
La catastrophe de Fukushima a illustré une nouvelle fois à quel point les conséquences d’un accident touchant une centrale nucléaire étaient sans commune mesure avec d’autres types d’accident. Mais cet épisode dramatique a également fait resurgir la question de la vulnérabilité de la France au risque nucléaire, qui avait été placée au second plan pendant des années.
Les données fondamentales sont inchangées : le risque nucléaire a toujours pesé sur la France, pays fortement nucléarisé, à la densité de population importante et au territoire peu étendu. André-Claude Lacoste, alors président de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN), déclarait ainsi devant l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, le 30 mars 2011, que « la position constante de l’ASN a toujours été la suivante : personne ne peut garantir qu’il n’y aura jamais en France un accident nucléaire. Je dis ce que je dis, et je répète une position constante de l’ASN française ».
La catastrophe subie par le Japon a agi comme un électrochoc sur les décideurs politiques et l’opinion publique : elle oblige à sortir du non-dit qui avait régné sur ce sujet, entretenu par d’hypothétiques perspectives de « renaissance du nucléaire » et de succès commerciaux. « Penser » l’accident nucléaire conduit à se pencher sur deux sujets d’importance majeure : le système de gestion de crise et l’indemnisation des victimes et des dommages.
A. DE NOUVEAUX OUTILS DE GESTION DE CRISE
La gestion des crises nucléaires est encadrée par deux types de dispositifs : un dispositif spécifique à l’exploitant nucléaire, le plan d’urgence interne, et des dispositifs de protection des populations en cas de crise, communs aux installations présentant des risques technologiques.
L’exploitant est tenu d’élaborer un plan d’urgence interne (PUI). Défini par l’article L.1333-6 du code de la santé publique, il concerne exclusivement les activités susceptibles de porter atteinte à la santé des personnes par l’exposition aux rayonnements ionisants. Sous la responsabilité du directeur du site, ce plan définit les moyens mis en œuvre par l’opérateur pour ramener une installation accidentée dans un état sûr et éviter que les conséquences ne s’étendent en dehors du site. Les PUI sont contrôlés par l’ASN, en application de l’article L.592-21 du code de l’environnement.
D’autre part, dans le cadre du plan Orsec (Organisation de la réponse de sécurité civile), le préfet élabore un plan particulier d’intervention (PPI) pour chaque site nucléaire, au même titre que pour les autres sites présentant des risques industriels (article L.741-6 du code de la sécurité intérieure). Le PPI prévoit les principales mesures de protection de la population en cas de menace ou de rejet radioactif hors du site, dans un rayon de dix kilomètres autour de celui-ci. Il comprend des mesures d’alerte, de mise à l’abri des personnes, de prise de comprimés d’iode, d’éloignement ou d’évacuation des personnes menacées. Le PPI impose aux communes la réalisation d’un plan communal de sauvegarde (PCS) afin de préparer le soutien aux services de secours, l’alerte, l’information et l’accompagnement de la population (article L.731-3 du code de la sécurité intérieure).
2. Les innovations post-Fukushima
Une révision du dispositif de gestion de crise a été lancée suite à la catastrophe de Fukushima. Sur la base du retour d’expérience japonais, cette révision s’oriente autour de deux axes.
Le premier axe a consisté à formaliser les procédures à suivre en cas d’accident, en couvrant les différentes éventualités de la façon la plus exhaustive possible. Les analyses de l’accident nucléaire de mars 2011 ont souligné la nécessité d’élargir le champ couvert par le dispositif alors en vigueur afin de couvrir toutes les conséquences d’un accident majeur. Ce constat a conduit le Premier ministre à demander l’élaboration d’un Plan national de réponse à un accident nucléaire ou radiologique majeur, sous le pilotage du Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale (SGDSN) (45). Les travaux ont associé un large cercle de participants : outre les différents ministères concernés, l’ASN et l’ASND (Autorité de sûreté nucléaire de la défense), l’IRSN et les trois exploitants nucléaires majeurs ont été mobilisés. Le plan gouvernemental issu de ce travail a été approuvé par le Premier ministre en avril 2013, testé en juin 2013 lors d’un exercice, et rendu public en février 2014.
Le Plan national de réponse à un accident nucléaire ou radiologique majeur couvre huit situations types :
– une situation dite « d’incertitude », correspondant à la phase initiale de toute situation d’urgence, quand on ignore encore la nature précise de l’événement mais que la sécurité de la population peut exiger de prendre sans délais des mesures conservatoires ;
– trois situations d’accident d’installation nucléaire avec rejets radioactifs ;
– une situation d’accident de transport de matière radioactive ;
– deux situations d’accident à l’étranger : la première, de type « Tchernobyl », couvrant les cas pouvant avoir des conséquences sanitaires sur le territoire français, la seconde, de type « Fukushima », correspondant à des accidents plus lointains ;
– une situation d’accident en mer, mettant en jeu un navire à propulsion nucléaire ou transportant des matières radioactives ou nucléaires.
Pour chacune de ces situations, le Plan national décrit l’organisation de la réponse et les stratégies de gestion de crise. Il précise les responsabilités de chacun, de façon à permettre une action coordonnée et efficace face à un événement.
Le second axe est l’établissement d’une doctrine de gestion de la phase post-accidentelle d’un accident nucléaire. Fukushima montre la complexité de la phase post-accidentelle : touchant de nombreux domaines (usage des terres, ressource en eau, etc.), elle nécessite un travail très minutieux d’identification des dommages potentiels et d’élaboration de réponses adaptées.
L’ASN est chargée, depuis 2005 (46), de préparer et de mettre en œuvre les dispositions nécessaires pour répondre aux situations post-accidentelles. Elle a mis en place un Comité directeur pour la gestion de la phase post-accidentelle d’un accident nucléaire ou d’une situation d’urgence radiologique (CODIRPA) dont le rôle est d'élaborer les éléments de doctrine correspondants. Pour mener ses travaux, le CODIRPA a mis en place différents groupes de travail thématiques, réunissant des experts provenant d’horizons différents (commissions locales d’information, associations, élus, agences sanitaires, organismes d’expertise, autorités, etc.). Les éléments de doctrine du CODIRPA ont été publiés en octobre 2012. Ils présentent de façon détaillée les différentes actions à engager suite à un accident nucléaire, en distinguant trois périodes : la sortie de la phase d’urgence, la période de transition et la période de long terme.
B. UN SYSTÈME D’INDEMNISATION QUI NE COUVRE QUE PARTIELLEMENT LES RISQUES
1. L’accident nucléaire grave et l’accident nucléaire majeur : des dommages potentiels colossaux
Dans une série de publications très commentées, l’IRSN a fourni des estimations du coût d’un accident nucléaire grave ou majeur. Le coût d’un accident grave médian (47) est évalué à 120 milliards d’euros, soit 6 % du PIB annuel.
COÛT D’UN ACCIDENT GRAVE MÉDIAN EN FRANCE
Milliards d’euros |
% | |
Coûts sur site |
10 |
8 % |
Coûts radiologiques hors-site |
9 |
7 % |
Territoires contaminés |
11 |
9 % |
Effets sur le parc de production d’électricité |
44 |
35 % |
Coûts d’image |
50 |
40 % |
Total (arrondi) |
120 |
100 % |
Source : Méthodologie appliquée par l’IRSN pour l’estimation des coûts d’accidents nucléaires en France, IRSN, avril 2014.
Dans le cas d’un accident grave, les principaux dommages sont les coûts liés à la production d’énergie et à la dégradation de l’image nationale, notamment pour l’activité touristique. Les coûts liés à la contamination ne représentent que 16 % du total.
COÛT D’UN ACCIDENT MAJEUR MÉDIAN EN FRANCE
Milliards d’euros |
% | |
Coûts sur site |
15 |
3 % |
Coûts radiologiques hors-site |
54 |
12 % |
Territoires contaminés |
110 |
25 % |
Coûts liés à la production d’énergie |
88 |
20 % |
Coûts d’image |
180 |
40 % |
Total (arrondi) |
450 |
100 % |
Source : Méthodologie appliquée par l’IRSN pour l’estimation des coûts d’accidents nucléaires en France, IRSN, avril 2014.
Dans le cas de l’accident majeur, les dommages sont évalués à 450 milliards d’euros, soit dix années de croissance économique. L’accident majeur étant défini par l’existence de rejets à l’extérieur de l’enceinte du réacteur, les dommages liés à la contamination sont nécessairement bien plus importants que dans le cas de l’accident grave. Ils comptent pour 37 % du coût total de l’accident. L’IRSN indique que ces estimations sont susceptibles de varier très significativement car l’étendue des dommages dépend de la météo et qu’ils pourraient être très significativement accrus si une grande agglomération était touchée.
2. Un système d’indemnisation insuffisant pour couvrir les dommages provoqués par un accident nucléaire de grande ampleur
a. L’assurance du risque nucléaire : un système dérivé de la Convention de Paris du 29 juillet 1960
Le système d’assurance du risque nucléaire s’est mis en place en application de la Convention de Paris sur la responsabilité civile dans le domaine de l’énergie nucléaire du 29 juillet 1960. Cette convention, négociée dans le cadre de l’OCDE au sein de l’Agence de l’énergie nucléaire (AEN), visait à protéger les victimes potentielles d’un accident nucléaire tout en permettant le développement d’une filière naissante. Elle a été amendée à trois reprises (1964, 1982 et 2004) et est en vigueur dans 15 pays.
Le régime de responsabilité civile nucléaire issu de la Convention de Paris a été bâti sur deux principes majeurs visant un certain équilibre. D’un côté, la responsabilité objective sans faute est favorable aux victimes : elle leur garantit d’être indemnisées rapidement en leur épargnant la longue voie des recours juridiques. De l’autre, la responsabilité limitée de l’exploitant est favorable à ces derniers : la réparation ne s’effectue que dans la limite d’un certain plafond. Dans le cadre d’une responsabilité illimitée, il est probable que le développement de la technologie nucléaire n’aurait pas été possible car aucun dispositif n’aurait été suffisant pour assurer des installations nucléaires.
Le dispositif d’indemnisation compte 3 tranches cumulatives : la première tranche est couverte par l’exploitant ; les deux autres interviennent en complément de la première, et reposent sur l’État où se situe l’installation concernée, puis sur l’ensemble des États partis à la Convention de Paris.
PLAFONDS D'INDEMNISATION FIXÉS PAR LES CONVENTIONS INTERNATIONALES
Loi du 30 octobre 1968 |
Protocoles de 2004 | |
Exploitant |
91,5 M€ |
700 M€ |
État où se situe l’exploitation |
+109,8 M€ = 201,3 M€ |
+500 M€ = 1 200 M€ |
États parties à la Convention de Paris |
+ 143,7 M€ = 345 M€ |
+ 300 M€ = 1 500 M€ |
Les plafonds applicables aux exploitants nucléaires, initialement fixés par la loi du 30 octobre 1968 relative à la responsabilité civile dans le domaine de l’énergie nucléaire (48), sont désormais codifiés aux articles L.597-26 à 597-46 du code de l’environnement. Un protocole d’amendement à la Convention de Paris, signé le 12 février 2004, accroît significativement les plafonds de responsabilité mais n’est toujours pas entré en vigueur (49) en raison du retard de certains États membres de l’Union européenne. Le projet de loi sur la transition énergétique devrait prévoir l’entrée en vigueur du nouveau plafond par anticipation (50).
b. Le fonctionnement du système français d’assurance du risque nucléaire
Le droit français impose aux exploitants de se couvrir par garanties bancaires ou par assurance, à concurrence des montants stipulés dans les conventions internationales (article L.597-31 du code de l’environnement). Par exemple, EDF a conclu une police d’assurance auprès d’Allianz.
Toutefois, les montants en jeu, d’une ampleur considérable, ont conduit à la création de pools nationaux de réassurance, fonctionnant en réseau. En France, c’est le GIE Assuratome qui joue ce rôle. Assuratome est un GIE comprenant 36 compagnies d’assurance adhérentes qui gère les conventions de réassurance sur les dommages matériels et la responsabilité civile et produit des études de risque.
CAPACITÉS DE RÉASSURANCE D'ASSURATOME AU 1er JANVIER 2014
(en millions d’euros)
Dommages matériels : Réassurance des installations de l’exploitant |
Responsabilité civile : Indemnisation des victimes | |
“Affaires directes” : Réassurance des exploitants en France |
376 |
200 |
“Acceptations” : Réassurance des autres pools nationaux |
156 |
77 |
Les exploitants ont également développé des systèmes alternatifs pour briser le monopole des pools nationaux. Ils peuvent souscrire des contrats avec des mutuelles telles que Emani (European mutual Association for Nuclear insurance) ou Elini (European Liability Insurance for the Nuclear Industry) en Europe et Neil aux États-Unis. EDF et AREVA se reposent ainsi sur Elini pour leur assurance responsabilité civile. Les exploitants peuvent également monter des « captives », c’est-à-dire des sociétés d’auto-assurance. Par exemple, la société Océane Re, propriété d’EDF, réassure les contrats signés auprès d’Allianz et Elini.
c. Des plafonds d’indemnisation insuffisants qui posent la question de la garantie implicite de l’État
Ainsi que le montrent les chiffres précédemment cités, le système d’assurance français est totalement déséquilibré. D’un côté, les plafonds d’indemnisation sont limités à 345 millions d’euros dans le droit actuel, et seront portés à 1,5 milliard d’euros après l’entrée en vigueur dans le droit français du protocole de 2004. Ces plafonds sont encore inférieurs pour l’exploitant, dont la responsabilité n’est engagée qu’à hauteur de 91,5 millions d’euros aujourd’hui et 700 millions d’euros demain. De l’autre, le montant des dommages peut atteindre plusieurs centaines de milliards d’euros. Le rapport entre les deux est de 1 à 1 000.
En réalité, c’est l’État qui supporte la quasi-intégralité du risque financier lié à l’accident nucléaire. Ainsi que le signale le rapport de la Cour des comptes, il intervient déjà à tous les niveaux de l’indemnisation des victimes d’un accident nucléaire :
– en tant qu’actionnaire majoritaire d’EDF et d’AREVA, en contribuant au financement de la première tranche d’indemnisation ;
– en couvrant la deuxième tranche d’indemnisation ;
– en participant au financement de la troisième tranche : chaque État contribuant à proportion de sa puissance nucléaire installée, la part de la France est de 34 %, soit 49 millions d’euros dans le droit actuel et 120 millions d’euros après l’entrée en vigueur de la révision de 2004 ;
– dans l’hypothèse d’une défaillance des assureurs (hypothèse peu probable avec un plafond à 91,5 millions d’euros mais possible avec un plafond à 700 millions d’euros) ;
– surtout, dans l’hypothèse où les trois tranches d’indemnisation ne couvriraient pas les dommages, l’État serait contraint d’assurer l’indemnisation complémentaire des victimes par des dotations budgétaires.
La Cour des comptes mentionne donc la possibilité de réinternaliser le risque nucléaire en obligeant l’exploitant à constituer un fonds à hauteur de 70 milliards d’euros sur 40 ans, soit un impact sur le coût de l’électricité produite de 1,41 €/MWh.
II. LES APPORTS DE LA COMMISSION D’ENQUÊTE
A. DISPOSER DES OUTILS DE GESTION DE CRISE ADÉQUATS : DE LA THÉORIE À LA PRATIQUE
Les auditions sur le thème de la gestion de crise en cas d’accident nucléaire ont souligné l’importance du travail qui avait été effectué pour mettre en place des outils nationaux. Mais elles ont aussi montré que beaucoup de progrès restent à faire pour garantir que ces outils soient opérationnels dans l’éventualité d’un accident.
1. Une territorialisation à peine débutée
S’agissant des dispositifs de crise « classiques », les représentants de l’ANCCLI ont souligné qu’ils étaient parfois mal adaptés aux réalités de terrain.
D’une part, les communes manquent de moyen pour élaborer des PCS : « Sur le terrain cependant, on constate que ces législations peinent à être appliquées. Actuellement, à peine 50 % des 11 000 communes où la mise en œuvre d’un PCS est obligatoire l’ont effectivement mis en place, en dépit du guide de deux cents pages diffusé à l’époque par le ministère de l’intérieur à destination des élus et des techniciens des collectivités concernées » (Michel Demet, conseiller du président de l’ANCCLI). D’autre part, le périmètre de dix kilomètres prévu par les PPI actuels paraît inadapté : « S’il peut être suffisant en cas d’incident ou d’accident mineur, il ne correspond pas à la réalité d’un accident d’importance moyenne » (Jean-Pierre Charre, vice-président de l’ANCCLI).
S’agissant des dispositifs spécifiques aux accidents nucléaires, l’ensemble des personnes auditionnées ont salué la mise en œuvre d’outils nationaux, et notamment des éléments de doctrine du CODIRPA, mais ils ont souligné qu’un important travail restait à faire pour territorialiser ces outils : « La France peut s’enorgueillir des travaux du Comité directeur pour la gestion de la phase post-accidentelle d’un accident nucléaire, qui manifestent l’excellence de la France dans ce domaine au niveau européen, voire mondial, mais le plus difficile sera d’assurer l’application de la doctrine du CODIRPA » (Michel Demet).
Cette démarche est en cours. L’ASN prévoit de décliner les éléments de doctrine pour la gestion de la phase post-accidentelle au niveau local : « Les mesures à prendre ne seront pas les mêmes selon les territoires : elles dépendront notamment des possibilités d’approvisionnement en eau et plus généralement de l’environnement économique » (Pierre-Franck Chevet, président de l’Autorité de sûreté nucléaire). Parallèlement, le Secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale, Francis Delon, a indiqué que le Plan national de réponse à un accident nucléaire ou radiologique majeur ferait l’objet d’un guide de déclinaison territoriale, disponible à la fin du semestre. Il sera destiné à orienter l’élaboration des futurs plans zonaux et départementaux de gestion d’une crise nucléaire majeure. « Il ne s’agit donc pas de dupliquer [le plan national], encore moins de le refaire, mais de planifier les actions complémentaires spécifiques au niveau zonal » (Francis Delon).
2. Une information et une participation des riverains à travailler
Seconde faiblesse des outils français de gestion de crise, les élus locaux et les citoyens ne sont pour l’instant pas assez associés et informés.
L’ANCCLI considère que les échanges avec EDF sont satisfaisants, mais déplore au contraire le manque d’informations délivrées par les préfectures. Cette lacune peut s’expliquer par le devoir de réserve qui s’impose aux préfets, mais participe à l’affolement des riverains en situation d’incertitude : « Je pense en particulier à ce qui s’est passé en 2011 sur le site de Marcoule, et qui a été abondamment médiatisé. Il faudrait que les services préfectoraux, voire l’Autorité de Sûreté nucléaire, l’ASN, et le ministère de l’intérieur communiquent davantage quand il y a un tel emballement médiatique. La préfecture devrait au moins confirmer les informations communiquées par l’exploitant, les élus communaux étant tenus d’attendre les consignes de la préfecture avant de déclencher un PCS ou de prévenir les populations » (Jean-Pierre Charre).
La robustesse du dispositif de crise repose également sur la réalisation d’exercices fréquents : seuls des tests grandeur nature permettent d’évaluer que les mesures prévues dans les plans sont adaptées aux réalités de terrain. « Il y a quelques années, dans les communes situées dans un périmètre de deux kilomètres autour de la centrale de Golfech, périmètre à protéger rapidement, la sirène, théoriquement destinée à signaler aux habitants la nécessité de se mettre à l’abri, s’était déclenchée, provoquant un attroupement de cinquante personnes devant la mairie […] Il s’agissait heureusement d’un dysfonctionnement de l’alarme, mais il a montré que les mesures prévues par le PPI – plan particulier d’intervention – auraient sur la population des effets contraires à ceux attendus en cas d’accident réel. C’est la raison pour laquelle je déplore que la périodicité des exercices de crise ait été ramenée de trois à cinq ans. Ces exercices constituent pourtant la meilleure pédagogie qui soit. En cinq ans on perd les réflexes acquis, d’autant que la population a eu le temps de changer » (Alexis Calafat, secrétaire du bureau de l’ANCCLI).
Pierre-Franck Chevet souligne que de tels exercice doivent impliquer jusqu’aux plus hautes sphères de l’État, car la gestion d’une crise nucléaire entraînerait vraisemblablement la mobilisation très rapide du Premier ministre, voire du Président de la République, et pourrait nécessiter de devoir traiter en urgence de nombreux problèmes en chaîne, pour lesquels le retour d’expérience de Fukushima peut se révéler extrêmement instructif.
3. Une harmonisation européenne nécessaire
S’il survenait en Europe un accident de type Fukushima, dont le rayon d’impact était de 80 kilomètres, plusieurs pays pourraient être simultanément touchés. La gestion d’une crise nucléaire doit donc comprendre une dimension européenne, qui passe par l’harmonisation des mesures de gestion de crise et de l’information diffusée aux populations.
La catastrophe de Tchernobyl avait montré que les critères de gestion de crise étaient différents de chaque côté du Rhin. Les ordres donnés à quelques kilomètres de distance n’étaient pas cohérents, ce qui avait nui à la crédibilité de l’action publique. Depuis 1986, la situation a progressé mais l’harmonisation des règles est encore loin d’être réalisée, selon le constat de l’ANCCLI : « le retour d’expérience des deux représentants de l’ANCCLI qui ont pu participer à l’exercice national de crise de Cattenom, à titre d’observateur, a mis en évidence la différence entre les dispositifs français et allemand de gestion de crise post-accidentelle, notamment en ce qui concerne les règles de confinement » (Michel Demet).
L’ASN confirme la persistance de différences importantes : « les critères de déclenchement des actions de protection des populations – confinement, distribution de pastilles d’iode, évacuation – ne sont pas identiques en Europe » (Pierre-Franck Chevet). Elle mène une initiative au plan européen en vue d’accélérer les efforts d’harmonisation. Les discussions qu’ont eu les membres de la commission avec les acteurs locaux lors du déplacement à Fessenheim ont par ailleurs mis en évidence la nécessité d’organiser des exercices conjoints transfrontaliers pour anticiper les besoins de coordination en cas de crise.
4. Des interrogations persistantes
Malgré le travail considérable qui a été réalisé, des incertitudes demeurent sur le caractère réaliste de certains paramètres pris en compte dans les plans nationaux.
Deux exemples tirés du retour d’expérience de Fukushima permettent de l’illustrer. Durant la crise japonaise, les agents de l’ASN ont été tellement mobilisés qu’ils étaient au bout de leurs forces après deux mois de travail intensif : « Imaginez la charge de la gestion d’un accident nucléaire qui se serait produit en France : elle serait encore plus lourde. L’ASN doit pouvoir disposer de renforts rapides, notamment en provenance des pays riverains » (Pierre-Franck Chevet). Force est de reconnaître que cette difficulté, et les solutions pour y remédier, n’avaient pas été anticipées auparavant.
De même, l’accident de Fukushima a tragiquement mis en lumière le rôle des « liquidateurs ». Quels salariés seraient prêts à risquer leur vie pour décontaminer le site touché et les zones environnantes ? Pierre-Franck Chevet confirme ainsi que « s’agissant des sous-traitants, nous n’avons pas pour l’heure la garantie juridique qu’en cas de crise les personnels voudront intervenir et nous ignorons dans quelles conditions ils le feraient ». Le même type de difficulté pourrait être rencontré pour mobiliser les professionnels indispensables pour organiser une éventuelle évacuation, etc.
Aussi important que soit le travail de conceptualisation de la crise et d’élaboration de plans d’intervention, l’expérience passée montre à quel point la réalité peut être profondément différente des schémas préétablis. Au traumatisme de l’accident s’ajoute alors celui de l’incapacité à agir efficacement.
B. PRÉVOIR UNE JUSTE INDEMNISATION DES VICTIMES D’UN ACCIDENT NUCLÉAIRE
1. Des interrogations majeures sur le chiffrage des probabilités d’accident et des coûts d’une catastrophe nucléaire
Si la réflexion sur les outils de gestion de crise a connu des avancées intéressantes, en revanche, les auditions de la commission d’enquête font apparaître une réelle insuffisance en matière de mesure des probabilités d’accident et des coûts d’une catastrophe nucléaire.
a. Une probabilité d’un accident majeur sur la durée de vie restante du parc français « de l’ordre de 1 % » ?
La question de la probabilité d’un accident majeur sur le territoire français a une dimension politique majeure : la décision sur la prolongation de la durée de vie du parc nucléaire historique ne sera pas la même si cette probabilité est considérée comme négligeable ou bien, au contraire, si elle est significative. Or, la commission d’enquête a pu constater l’absence de réponse claire sur le sujet.
Les exploitants nucléaires ont construit des évaluations probabilistes de sûreté (EPS), qui donnent une première approximation des probabilités d’accident. Elles sont de :
– 10-5 par année-réacteur pour un accident nucléaire grave (EPS de niveau 1) conduisant à une fusion du cœur, soit un accident en moyenne tous les 100 000 ans ;
– 10-6 par année-réacteur pour un accident nucléaire majeur (EPS de niveau 2) entraînant des rejets radioactifs, soit un accident en moyenne tous les 1 000 000 ans.
L’âge moyen du parc nucléaire français étant de 29 ans, la prolongation de la durée de vie de l’intégralité des 58 réacteurs jusqu’à 40 ans représente une durée d’exploitation totale d’environ 650 années-réacteur. Le prolongement de la durée de vie du parc jusqu’à 60 ans ajouterait 1160 années-réacteur supplémentaires. À partir des EPS, les probabilités d’un accident nucléaire sur le parc, à date actuelle, sont :
– pour un accident grave : de 0,7 % en cas d’arrêt du parc à 40 ans et de 1,8 % en cas de prolongement de la durée de vie du parc jusqu’à 60 ans ;
– pour un accident majeur : de 0,07 % en cas d’arrêt du parc à 40 ans et de 0,18 % en cas de prolongement de la durée de vie du parc jusqu’à 60 ans.
Toutefois, ces chiffres ne sont pas parfaitement significatifs, pour quatre raisons.
Premièrement, les EPS ont été inventées par les exploitants non pas pour calculer une probabilité agrégée d’accident, mais pour comparer des designs de réacteurs différents. Les EPS consistent à attribuer une probabilité à tout événement (défaillance de composants, mauvaise action des opérateurs, etc.) qui, replacé dans une chaîne de causalité, peut conduire à un accident de fusion du cœur et à des rejets radioactifs dans l’environnement. Or, la valeur des probabilités accordées aux différents événements est parfois contestable. Comment mesurer, par exemple, la probabilité d’une erreur humaine ? Le calcul de la valeur absolue de la probabilité agrégée d’accident n’est donc pas rigoureusement exact, mais cela n’invalide pas pour autant l’exercice de comparaison entre les différents designs de réacteur si les valeurs choisies sont les mêmes entre les réacteurs. Comme l’indique Jacques Repussard dans une note transmise au rapporteur, « [les évaluations probabilistes] sont surtout utilisées pour hiérarchiser en fonction de leur fréquence relative les différentes arborescences d’incidents, de manière à faire porter l’effort de prévention sur celles qui pèsent le plus dans l’échelle des probabilités ». Même si elles ont une dimension probabiliste, les EPS sont en réalité l’un des éléments de l’approche déterministe suivie par le système nucléaire français. Ce sont des instruments qui permettent de se prémunir contre les événements qui semblent réalistes et, une fois construite une défense à toute épreuve pour l’ensemble de ces catégories d’événements, d’exclure du paysage les événements résiduels.
Deuxièmement, les EPS ne prennent en compte que les défaillances internes à la centrale. En excluant de nombreuses chaînes de causalité conduisant à un accident, elles aboutissent à un chiffrage très partiel. « Plusieurs catégories d’événements défavorables peuvent conduire à des scénarios accidentels : les défaillances internes, c’est-à-dire propres aux équipements, systèmes et composants de la centrale ; les agressions internes, comme un incendie, une inondation à l’intérieur de la centrale ; et surtout les agressions externes : un séisme, une inondation, un acte terroriste […] En regardant dans les autres pays, on sait que ces catégories d’événements exclues contribuent pour environ 90 % du risque. Un calcul de coin de table – toutes sortes d’événements prises en compte –, nous donne alors des probabilités dix fois plus élevées : 10-4 pour la fusion ; 10-5 pour les rejets » (Reza Lahidji, directeur de recherche à l’Institut de droit international). La prise en compte de ces facteurs d’accident conduit donc à réévaluer la probabilité d’accident issue des EPS d’un facteur 10. S’ajoutent de potentielles erreurs dans l’estimation des probabilités de ces événements extérieurs, comme cela s’est produit à Fukushima : « Une partie de la communauté des sismologues avait indiqué que les hypothèses sismiques sur lesquelles était fondée l’évaluation du risque n’étaient pas les bonnes, en particulier en matière de tsunami, et que la récurrence d’un méga tsunami était à peu près de mille ans dans la région de Sendai. Bien avant la catastrophe, des travaux universitaires et des publications avaient tenté d’alerter sur ce problème. On se retrouve donc avec une probabilité d’un événement face auquel la centrale était totalement démunie, car la probabilité d’une catastrophe conditionnée à la survenue d’un méga tsunami est de l’ordre de 1 et que la probabilité d’occurrence du méga tsunami était de l’ordre de 10-3 » (Reza Lahidji).
Troisièmement, il existe beaucoup d’incertitudes liées à l’« effet site », qui pourrait faire évoluer les probabilités de rejet massif à la hausse. En effet, les EPS raisonnent par réacteur. La probabilité qu’un accident se produise simultanément dans plusieurs réacteurs n’est donc pas prise en compte, alors que les événements pouvant conduire à des fusions de cœur ont en réalité une forte chance de toucher l’ensemble des réacteurs d’un même site, notamment en cas d’agression externe. « Avant l’accident de Fukushima, les probabilités communiquées par les autorités japonaises étaient de 10-6 pour un accident avec des rejets importants, soit un ordre de grandeur inférieur à ce qu’il est en France. Les réacteurs japonais sont en effet extrêmement solides, et ces chiffrages ne faisaient pas l’objet de contestations. Sur la base de ces probabilités, l’événement fusion du cœur avec rejets importants dans trois réacteurs donne une probabilité de 10-18 ». Dans le cas d’événements qui ne sont pas indépendants, la multiplication des probabilités n’est pas une opération mathématique valide. Cela signifie que la probabilité d’un accident sur plusieurs réacteurs simultanément, entraînant des dégâts matériels et humains potentiellement beaucoup plus larges, est très largement sous-estimée si l’on se fie aux EPS.
Quatrièmement, l’évolution de la sûreté n’est pas prise en compte alors qu’elle a beaucoup progressé depuis 1979, date de l’accident de Three Mile Island, premier accident grave au niveau mondial. Cette variable pourrait, à l’inverse des deux citées précédemment (prise en compte des événements extérieurs et effet de site), diminuer la valeur des probabilités d’accident.
En conclusion, le chiffrage de la probabilité d’un accident est entouré de beaucoup d’incertitudes. Néanmoins, il ne peut être considéré comme négligeable. Les chiffres issus des EPS donnent déjà des chances d’un accident majeur sur la durée de vie restante des réacteurs français qui doivent être prises en compte (0,18 % en cas de prolongement de la durée de vie jusqu’à 60 ans), et sont très certainement sous-estimés en raison de l’exclusion des agressions externes. Au regard de ces éléments, M. Lahidji estime ainsi qu’« il n’est pas aberrant de dire que sur la durée de vie restante, la probabilité d’un accident majeur, c’est-à-dire avec des rejets en dehors de la centrale, est de l’ordre de 1 % en France ».
b. Des travaux sur l’évaluation des coûts d’un accident à perfectionner
Les études de l’IRSN constituent, pour l’heure, la seule référence sur l’évaluation des coûts d’un accident nucléaire. S’ils ont confirmé le sérieux de ces études, les spécialistes auditionnés par la commission d’enquête en ont toutefois signalé les limites.
« Nous souffrons d’une insuffisance de travaux. La Cour des comptes a salué le travail de l’équipe de l’IRSN – à laquelle nous sommes tous redevables de deux estimations, en 2007 et 2013 –, mais tout en soulignant qu’il s’agit d’une très petite équipe. Comme vous l’a expliqué M. Lahidji, la publication tardive de ces travaux nous a choqués – ceux de 2007 l’ont été en 2013, à la suite d’une fuite dans la presse. Nous ne connaissons toujours pas la méthodologie détaillée de ces estimations, qui nous intéresse en tant qu’économistes.
« L’estimation de 2 000 milliards d’euros ne nous semble pas fondée. Nous connaissons celle de 430 milliards d’euros, dernière estimation autorisée de l’IRSN pour l’accident le plus gravissime, et celle de 120 milliards d’euros qui correspond à un niveau de gravité considérable. Nous connaissons par ailleurs un majorant stupéfiant, celui de 5 737 milliards d’euros, qui a circulé en 2007, mais à propos duquel nous pouvons rassurer cette commission. En effet, grâce au document de l’IRSN datant de 2007 et finalement publié, nous pouvons dire que ce dernier calcul est aberrant, il a d’ailleurs été désavoué par son auteur » (Philippe Mongin, directeur de recherche au CNRS).
L’IRSN doit donc mettre ces travaux à disposition de l’ensemble de la communauté scientifique, de façon à les approfondir : « Ces limites n’invalident pas l’exercice. Néanmoins, il conviendrait de les dépasser dans des exercices futurs, notamment en mettant à la disposition des universitaires les travaux de l’IRSN qui pourront alors être approfondis et élargis » (Reza Lahidji). Jacques Repussard souligne lui-même les limites de l’exercice auquel les équipes de l’IRSN se sont livré : « Nos travaux, toutefois, n’avaient pas pour objectif de fixer des coûts, par définition très aléatoires, mais d’expertiser les approches ayant cours, dans le monde, sur le paramètre coût-bénéfice […] Le sens de notre rapport n’est évidemment pas de procéder à un chiffrage au centime près, mais de mettre en évidence des paramètres sur lesquels il est possible d’agir, notamment dans le cadre des politiques de prévention ». La nécessité d’approfondir l’expertise sur le coût de l’accident nucléaire a d’ailleurs conduit l’IRSN à se doter de compétences spécifiques par la création d’un laboratoire de recherche sur le sujet.
Là encore, s’agissant d’évaluations dont les conséquences politiques pourraient être considérables, la commission d’enquête n’a pu que constater à quel point les travaux académiques étaient encore en nombre insuffisant.
Les travaux sur la gestion de crise ont fait des progrès importants, qui s’expliquent par l’existence d’organismes pilotes : ils relèvent en partie des compétences de l’ASN et s’insèrent dans des dispositifs gouvernementaux existants (plan Orsec). En revanche, aucune institution n’est chargée par la loi de travailler sur les questions de la probabilité d’accident et du coût des accidents, ce qui peut expliquer l’absence d’évaluations exhaustives avant que l’IRSN ne se saisisse de cette question. De plus, ces thématiques sont pour l’instant dépourvues de conséquences pratiques, tant les réflexions sur la mise en place de systèmes d’assurance adaptés à l’ampleur du risque nucléaire sont pour l’instant verrouillées.
2. Le moins mauvais des systèmes d’assurance : une obligation de provisionnement annuel imposée à l’exploitant
L’analyse des travaux de la commission d’enquête fait apparaître trois options possibles.
La première option serait le statu quo. En intégrant les modifications annoncées par le Ministère de l’écologie, la responsabilité de l’exploitant serait portée à 700 millions d’euros et l’indemnisation totale apportée par le système en trois tranches à 1,5 milliard d’euros.
À titre de comparaison, Tepco a annoncé que le coût du traitement de l’accident nucléaire de Fukushima, intégrant la décontamination et les dédommagements des victimes, pourrait atteindre 10 000 milliards de yens, soit 100 milliards d'euros, sans même prendre en compte le coût du démantèlement des réacteurs, ni évidemment l’ensemble des impacts économiques, énergétiques, touristiques qui ne sont pas indemnisés.
On note donc un décalage évident entre les montants pris en compte par le système d’assurance actuel et les estimations du coût réel d’un accident nucléaire, qu’elles résultent des travaux de l’IRSN ou de la réalité de Fukushima.
Il est donc tout à fait clair que le poids de l’indemnisation résiduelle – qui n’a rien de résiduel dans ses montants – repose sur la garantie implicite de l’État. Rien ne semble prévu pour parer à cette éventualité. À cet égard, la réponse de Maurice Corrihons, directeur des spécialités de la Caisse centrale de réassurance (CCR), est éloquente :
« M. le rapporteur. Ma question était de savoir comment financer les 450 milliards d’euros de dommages évalués par l’IRSN.
« M. Maurice Corrihons. Je ne saurais vous répondre. Quant au niveau des transferts de risques, il sera déterminé par le marché et non par la CCR : les marchés privés de l’assurance, de la réassurance et de la rétrocession doivent déterminer les capacités qui peuvent être transférées sur les marchés financiers. Il revient ensuite aux pouvoirs publics d’évaluer les compléments à apporter, le cas échéant. »
Cette solution présente un avantage indéniable, qui est de ne pas reporter le coût d’un mécanisme d’assurance bien dimensionné sur le coût de l’électricité produite. En revanche, elle fait peser un risque financier considérable sur l’État. En cas d’accident nucléaire majeur, ce dernier serait contraint de s’endetter massivement sur les marchés. En définitive, une telle solution revient à faire supporter le risque financier de l’activité nucléaire sur les générations futures, qui rembourseront la dette. Comme l’explique Pierre Picard, professeur au département d’économie de l’école Polytechnique, « on peut très bien ne rien faire et considérer que l’on se procurera les ressources nécessaires si jamais un accident se produit. L’État pourra ainsi emprunter sur le marché national ou les marchés internationaux. Mais les générations futures sont alors victimes de ce choix puisqu’il faut des dizaines d’années pour rembourser les emprunts de reconstruction ».
La solution du statu quo présente un second inconvénient, découlant du principe de responsabilité limitée : elle externalise le risque nucléaire et n’incite donc pas l’exploitant à prendre toutes les mesures nécessaires à la préservation de la sûreté. Cet effet doit tout de même être nuancé. En effet, c’est l’ASN, et non l’exploitant, qui établit le niveau de sûreté d’une centrale ; de ce point de vue, la responsabilité limitée ne pose de problème que si l’on considère que l’autorité de sûreté est en situation d’asymétrie d’information vis-à-vis des exploitants nucléaires français. On peut par ailleurs penser que l’effet que produirait un accident nucléaire sur l’image d’EDF ou d’AREVA serait suffisant pour inciter ces derniers à prendre toutes les précautions nécessaires.
b. Option n° 2 : mettre en place un mécanisme assuranciel de grande ampleur
La deuxième solution consisterait à abandonner le principe de responsabilité limitée de l’exploitant, en évoluant vers une responsabilité illimitée, à l’image de ce que prévoit la législation allemande. Pour constituer un réel progrès, elle devrait s’accompagner de la mise en place d’un système d’assurance à la hauteur des montants en jeu – à défaut, l’application de la responsabilité illimitée aboutirait à l’insolvabilité de l’exploitant, ce qui équivaudrait à l’option n° 1 de garantie implicite de l’État.
Or, bâtir un système d’assurance, sur le modèle de l’assurance des risques technologiques, qui soit capable de supporter des dommages de l’ampleur de ceux d’une catastrophe nucléaire semble très difficile : « D’un point de vue normatif, cette solution de la responsabilité illimitée de l’exploitant nous semble préférable. Néanmoins, et malgré la modalité d’application permettant d’améliorer la couverture des victimes contre l’insolvabilité de l’exploitant, elle reste peu crédible » (Céline Grislain-Letrémy, économiste de l’assurance et de l’environnement à l’INSEE). Le système, en vigueur pour les catastrophes technologiques, ne fonctionne que dans le cas d’une responsabilité avec faute et avec des obligations de couverture qui ne concernent pas les dommages aux tiers : « Par conséquent, aucun système ne garantit la solvabilité de l’exploitant industriel pour ce qui est de l’indemnisation aux victimes à l’extérieur de l’usine. Le système d’assurance des catastrophes technologiques est donc une couverture très partielle, en permettant simplement aux riverains d’être couverts pour les dommages au bâti de leur résidence principale – les dommages corporels sont exclus.
« Pour le nucléaire, les montants seraient probablement beaucoup plus importants et il s’agit d’une responsabilité sans faute. Si l’on passait à un régime de responsabilité sans faute illimitée, se poserait à nouveau ce problème de l’incitation à la couverture des exploitants, lequel ne semble pas pouvoir être résolu aisément » (Céline Grislain-Letrémy).
Les problèmes posés par le relèvement de la première tranche d’indemnisation à hauteur de 700 millions d’euros illustrent parfaitement les difficultés inhérentes à l’organisation d’un système d’assurance privé portant sur des sommes de plusieurs centaines de millions à plusieurs milliards d’euros. « Le relèvement légal du plafond d’assurance de 91,5 à 700 millions d’euros représente effectivement un saut très important pour les assureurs. Il nous faudra donc déterminer avec nos autorités de tutelle, le ministère des finances, comment parvenir à nous y conformer, les dispositions législatives et réglementaires actuelles ne nous le permettant pas, sauf à des conditions de prix exorbitantes » (Gilles Trembley, directeur d’Assuratome).
Le document de référence 2013 d’EDF fait état des difficultés que pourraient rencontrer les assureurs du groupe pour s’adapter à l’élévation du plafond de responsabilité et signale qu’une telle réforme pourrait engendrer un surcoût pour EDF : « Le Groupe [EDF] ne peut pas garantir que, dans les pays où il est exploitant nucléaire, les plafonds de responsabilité fixés par la loi ne seront pas augmentés ou supprimés. Ainsi, les protocoles portant modification de la convention de Paris et de la convention de Bruxelles, actuellement en cours de ratification, prévoient un relèvement de ces plafonds. L’entrée en vigueur de ces protocoles modificatifs, ou toute autre réforme visant à relever les plafonds de responsabilité des exploitants nucléaires, pourrait avoir un impact significatif sur le coût de l’assurance, et le Groupe ne peut pas garantir que les assurances couvrant cette responsabilité seront toujours disponibles ou qu’il arrivera toujours à maintenir ces assurances ».
Notamment, dans le cas où un accident toucherait un site industriel sous la responsabilité de plusieurs exploitants – Tricastin et Marcoule en sont deux exemples –, le plafond d’indemnisation supporté par le système privé serait multiplié par le nombre d’exploitants. Pour les cas où les montants à couvrir dépasseraient 700 millions d’euros, les ministères de l’énergie et de l’économie ont engagé un travail portant sur l’articulation des modalités d’assurance du risque de responsabilité civile nucléaire par le marché avec une garantie publique complémentaire. Autrement dit, la garantie de l’État serait de nouveau sollicitée.
Le système mis en place par les États-Unis constitue une alternative intéressante : « la présence de plusieurs opérateurs nucléaires a permis l’instauration d’un mécanisme tout à fait spécifique, défini par le Price-Anderson Act, de responsabilité conjointe obligatoire entre tous les opérateurs en cas d’accident, si jamais la première tranche – celle de l’opérateur directement impliqué – est dépassée. Ce système permet ainsi aux Américains de disposer d’une capacité de plus de 10 milliards d’euros, soit une somme bien supérieure à celle que l’on pourrait mobiliser en France » (Pierre Picard). Pour atteindre des montants d’indemnisation comparables à ceux en vigueur aux États-Unis, un tel système ne pourrait en réalité s’envisager qu’au niveau européen et nécessiterait donc de convaincre l’ensemble des États membres nucléaires de l’opportunité d’un tel mécanisme.
c. Option n° 3 : imposer une obligation de provisionnement à l’exploitant
La troisième option consiste à provisionner une somme d’argent qui permettrait de faire face au risque financier d’un accident nucléaire, en imposant à l’exploitant le paiement d’une prime annuelle. Cette solution a la préférence des spécialistes entendus par la commission d’enquête. Selon Pierre Picard, « l’imputation du risque [à l’exploitant] par le provisionnement importe donc autant si ce n’est davantage que l’extension des mécanismes de marché, cette dernière étant inévitablement et rapidement vouée à trouver ses limites ».
Une telle option a l’avantage de répondre, par définition, à l’objectif poursuivi, mais pose toutefois la question de la méthode de calcul de la prime annuelle et de son impact sur le coût de production de l’électricité.
Au préalable, il convient de rejeter deux idées préconçues, dont on peut considérer qu’elles sont en partie responsables aujourd’hui de l’absence de système d’assurance du risque nucléaire à la hauteur des enjeux financiers que ce dernier représente.
La première idée préconçue consiste à dire que la multiplication du zéro (la probabilité supposée d’un accident nucléaire) par l’infini (le coût de l’accident) donnerait un résultat indéterminé. Comme l’explique Philippe Mongin, « en cherchant comme Pascal à multiplier l’infini par zéro, on risque de mystifier la question nucléaire, c’est-à-dire d’aller à l’encontre de l’objectif de vérité de cette commission. Dans notre effort d’objectivation, nous voudrions avoir des montants de coût élevés, des probabilités petites, mais ne pas jouer sur des infinitésimaux. Je suis partisan de calculs qui évitent une dramatisation des choses ».
La seconde est l’affirmation selon laquelle la prime annuelle d’assurance payée par l’exploitant serait égale à l’espérance mathématique du coût du risque nucléaire. En application d’une telle formule, cette prime serait faible, de l’ordre de 1,2 million d’euros par réacteur et par an pour l’assurance d’un accident grave (51) et 450 000 euros pour l’assurance d’un risque majeur (52) – avec toutes les réserves émises précédemment sur la valeur des probabilités issues des EPS. Le coût de l’assurance d’un risque majeur serait donc très faible pour l’exploitant. Sur la base des évaluations de coûts de l’IRSN, on remarque aussi que, paradoxalement, l’assurance contre le risque d’accident majeur serait moins coûteuse que celle contre le risque d’accident grave.
En réalité, un tel mode de calcul n’est valable que dans le cadre traditionnel de l’assurance. Selon Pierre Picard : « les grandes catastrophes nucléaires constituant des événements rares, on n’a pas affaire à une multitude de petits accidents pouvant se compenser mutuellement et pour lesquels chaque individu pourrait avoir une petite somme à payer tous les ans. De plus, ces grands accidents ont des effets macroéconomiques et sociétaux. Enfin, ils ont des conséquences intergénérationnelles. Pour toutes ces raisons, tout calcul consistant à diviser l’espérance mathématique du coût d’un risque nucléaire par la valeur de l’électricité produite tous les ans n’a pas le moindre fondement méthodologique sérieux. Il n’en aurait que s’il reflétait le comportement des compagnies d’assurance – ce qui n’est pas le cas – ou le calcul économique public d’un État parfaitement capable de mutualiser les risques – ce qui n’est pas possible non plus ».
Ces réserves étant posées, quelle est la bonne méthode pour déterminer la prime annuelle versée par l’exploitant ? Cette dernière dépend de trois paramètres.
Le premier paramètre est le montant des dommages à indemniser. Il convient de distinguer les dommages susceptibles d’être directement imputables à l’exploitant de ceux qui pourraient devoir être supportés par d’autres acteurs (y compris les victimes) ou par la puissance publique ; par exemple, selon les calculs de l’IRSN, sur les 120 milliards d’euros de dommages causés par un accident grave, les 50 milliards d’euros de dommages liés à la perte d’image ne donneraient vraisemblablement lieu à aucune indemnisation.
Le deuxième paramètre est la probabilité annuelle d’occurrence d’un accident sur l’ensemble du parc. La valeur de cette probabilité devrait être déterminée sur la base de travaux scientifiques appropriés : à partir des EPS, mais en intégrant la possibilité d’événements extérieurs, l’amélioration de la sûreté, etc. (cf. supra).
Enfin, les travaux empiriques en économie indiquent qu’il est raisonnable, dans le cas d’un risque catastrophique, de pondérer la valeur des pertes en cas d’accident par un coefficient multiplicatif, afin de tenir compte de l’aversion de la population pour le risque. Dans le cas du nucléaire, ce coefficient serait, en ordre de grandeur, de 10 (53). La nécessité d’intégrer une prime de risque dans le calcul de la prime annuelle a été confirmée à la fois par Pierre Picard et par les auteurs du rapport du Conseil d’analyse économique sur les risques majeurs et l’action publique. « Sur le plan méthodologique, l’évaluation du coût du risque nucléaire mérite donc une réflexion approfondie et suppose la prise en compte des dimensions spécifiques de ce risque aux effets à la fois macroéconomiques et de très long terme. De telles dimensions justifient l’ajout d’une prime de risque à cette espérance mathématique, sans doute négligeable en soi » (Pierre Picard). « Quand on fait des comparaisons, il faut tenir compte de l’ampleur du risque et d’un trait du comportement humain que les économistes appellent l’aversion pour le risque. Plus un risque est important, plus vous êtes prêt à payer pour vous couvrir contre celui-ci. Autrement dit, si un risque de 5 millions de morts avec une probabilité de 10-6 est équivalent, en termes d’espérance, à cinq morts par an, vous allez payer beaucoup plus pour le risque de catastrophe. Ainsi, il y a une justification à se prémunir contre le risque de catastrophe. C’est bien ce terme-là que nous faisons intervenir pour multiplier la prime annuelle et parvenir à ce que la collectivité serait prête à mettre de côté, chaque année, pour se couvrir contre le risque de catastrophe » (Reza Lahidji).
À partir de ces trois paramètres, Céline Grislain-Letrémy, Reza Lahidji et Philippe Mongin aboutissent à une prime annuelle de 700 millions d’euros, dont la somme actualisée sur quarante années permet de constituer des provisions à hauteur de 78 milliards d’euros.
En conclusion, les éléments précédents montrent qu’il est possible de calculer un montant de provisionnement annuel à partir d’une méthode scientifique rigoureuse et dont le montant correspond aux ordres de grandeur du risque financier associé à un accident nucléaire. La fixation des paramètres de calcul – montant des dommages couverts, probabilité de l’accident et valeur de la prime de risque – répond toutefois à des principes complexes, qui nécessitent la mobilisation de spécialistes.
En tout état de cause, quelle que soit la solution retenue par les pouvoirs publics, les éléments qui précèdent concernant tant le coût potentiel d’un accident, sa probabilité, que l’assurance garantie aujourd’hui par l’État, conduisent à estimer qu’une juste comparaison des coûts respectifs des différentes énergies implique d’évaluer la valeur correspondant à cette subvention implicite. Par ailleurs, l’inscription au hors bilan de l’État des conséquences de cette garantie – en tout cas en l’état actuel du droit – permettrait, comme l’estime la Cour des comptes (54), une transparence accrue sur ces engagements, notamment par une information plus complète du Parlement.
Enfin, signalons que la question essentielle du dimensionnement du système d’assurance du risque nucléaire se double d’une question accessoire : celle des modalités pratiques du fonctionnement de ce système en cas de catastrophe. À ce titre, la prise en compte du risque nucléaire dans les contrats d’assurance des particuliers sur le modèle de l’assurance du risque naturel devrait faire l’objet d’une étude plus approfondie. Il pourrait ainsi être envisagé un mécanisme à deux étages, faisant intervenir dans un premier temps les assureurs des particuliers puis un mécanisme de réassurance appuyé, selon les scénarios envisagés précédemment, sur l’assureur de l’exploitant, sur un fonds dédié constitué par les provisions de celui-ci, ou encore sur la CCR et l’État.
L’assurance des risques de catastrophes naturelles en droit français
Toute personne juridique – particulier, entreprise ou collectivité territoriale – qui souscrit un contrat d’assurance garantissant les dommages d'incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur (contrat multirisque habitation ou multirisque entreprise) est aussi couverte contre les catastrophes naturelles, en application de l’article L.125-1 du code des assurances (55).
Le supplément de couverture est une obligation légale s’imposant à la fois à l’assureur et à l’assuré. Le premier a l’obligation d’insérer dans ses contrats une clause étendant leur garantie aux effets des catastrophes naturelles (1er alinéa de l’article L.125-2), tandis que le second doit payer une prime complémentaire fixée par arrêté (12 % pour un contrat multirisque habitation ou entreprise et 6 % pour un contrat véhicule terrestre à moteur) et s’ajoutant au contrat de base.
De telles dispositions n’ont pas pour objet de reporter le risque sur les assurances privées : elles fonctionnent au contraire sur le principe de solidarité nationale, selon deux niveaux. La Caisse centrale de réassurance (CCR), dont l’État est actionnaire à 100 %, soutient les assureurs privés qui proposent la garantie catastrophe naturelle en les faisant profiter de contrats de réassurance avantageux. Lorsque les montants en jeu dépassent 90 % des provisions d’égalisation et réserves spéciales constituées par la CCR, celle-ci peut solliciter directement l’intervention financière de l’État.
En réalité, le principal avantage d’un tel fonctionnement est de permettre une indemnisation rapide des assurés par le biais de leur assureur traditionnel, dès lors que l’état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté ministériel.
CHAPITRE 8 : LA PLACE DU NUCLÉAIRE DANS LE MIX ÉNERGÉTIQUE FRANÇAIS
A. LE DÉBAT NATIONAL SUR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE : COMMENT METTRE EN APPLICATION L’ENGAGEMENT PRÉSIDENTIEL DE RÉÉQUILIBRAGE DU MIX ÉLECTRIQUE ?
« Je préserverai l’indépendance de la France tout en diversifiant nos sources d’énergie. J’engagerai la réduction de la part du nucléaire dans la production d’électricité de 75 % à 50 % à l’horizon 2025, en garantissant la sûreté maximale des installations et en poursuivant la modernisation de notre industrie nucléaire. Je favoriserai la montée en puissance des énergies renouvelables en soutenant la création et le développement de filières industrielles dans ce secteur. La France respectera ses engagements internationaux pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Dans ce contexte, je fermerai la centrale de Fessenheim et je poursuivrai l’achèvement du chantier de Flamanville (EPR) ». Tel était libellé l’engagement n° 41 du candidat François Hollande à la Présidence de la République. Cette promesse majeure était justifiée par les dangers d’une trop grande dépendance à une technologie unique : l’engagement de campagne ne prônait pas une sortie du nucléaire, mais un rééquilibrage du mix électrique, au profit des énergies renouvelables. Ce cap, dont la validité n’a été que peu contestée par les personnes auditionnées, notamment parce qu’un équilibre entre énergies apparaît comme un facteur de robustesse, a constitué l’un des éléments du « décor » de la commission d’enquête.
Dès 2012, la question s’est posée du chemin par lequel la France parviendrait à atteindre l’objectif présidentiel. La France a souhaité mettre en œuvre une démarche innovante pour associer les citoyens à l’élaboration de la politique énergétique. Elle a ainsi lancé le « débat national sur la transition énergétique » (DNTE). Reprenant les acquis méthodologiques du Grenelle de l’environnement, ce lieu de dialogue a fonctionné sur le modèle d’une gouvernance pluraliste : y ont participé les syndicats, les employeurs, les associations environnementales et de consommateurs, les élus locaux et nationaux et l’État. Le DNTE a également bénéficié de l’appui d’un collège d’experts.
Parmi les thématiques abordées (efficacité énergétique, mix énergétique, énergies renouvelables, financement, gouvernance, transition professionnelle, compétitivité, transition sociale, réseaux de distribution), confiées à des groupes de travail, la question de l’évolution du mix énergétique a fait l’objet de travaux particulièrement nourris. Le « GT2 » a pu s’appuyer sur des travaux de modélisation nombreux, tels que ceux de négaWatt, Greenpeace, WWF, Global Chance, l’ADEME, GrDF, l’ANCRE, RTE, DGEC, Négatep, l’UFE, etc.
La synthèse des travaux du débat sur le sujet de l’évolution du mix énergétique, et plus particulièrement de la place du nucléaire dans le mix électrique français, fait apparaître trois impératifs faisant consensus :
– atteindre le « facteur 4 », soit une division par quatre des émissions de tous les gaz à effet de serre par rapport à 1990, à l’horizon 2050 ;
– définir une stratégie d’évolution claire pour anticiper les décisions à prendre, quels que soient les choix effectués (renouvellement, maintien, réduction ou sortie) ; le lissage dans le temps, sous réserve de l’avis de l’ASN, de l’évolution du parc est la meilleure façon de concilier les impératifs techniques, industriels, financiers et de sûreté ;
– disposer de marges suffisantes dans le système électrique pour faire face à l’éventualité d’une fermeture simultanée de plusieurs réacteurs qui présenteraient un défaut générique grave, point sur lequel insiste fortement l’Autorité de sûreté nucléaire ; à ce titre, la recherche d’alternatives au nucléaire, par le développement de nouvelles capacités de production ou les énergies renouvelables, prend une importance décisive.
Toutefois, le débat ne s’est pas prononcé sur une trajectoire particulière d’évolution du mix, en raison des différences de point de vue importantes entre les différents participants.
B. LES CARACTÉRISTIQUES DES PRINCIPAUX SCÉNARIOS
Les divergences de position entre les participants au débat sur la transition énergétique s’appuient sur des travaux de modélisation différents. Pour parvenir à un même résultat, le « facteur 4 » à l’horizon 2050, quatre types de scénarios ont été présentés :
– les scénarios de type SOB : s’appuyant sur des efforts d’efficacité énergétique importants, mais également sur la prise en compte des évolutions de comportement et de mode de vie, ces scénarios représentent une véritable transition écologique ; sur la base d’une réduction forte de la consommation d’énergie (division par 2 de la consommation en 2050), ils ambitionnent une sortie définitive du nucléaire dès 2040 et un développement concomitant des énergies renouvelables ;
– les scénarios de type EFF : suivant des principes similaires aux scénarios de type SOB mais avec des objectifs de rénovation thermique moins ambitieux, ils aboutissent à des évolutions moins rapides du mix énergétique (respect de l’objectif de 50 % de nucléaire dans le mix électrique, maintien d’une composante nucléaire de long terme à hauteur d’environ 25 %) ;
– les scénarios de type DIV : ils s’appuient en priorité sur le foisonnement des énergies renouvelables, avec un accent porté sur les énergies renouvelables thermiques qui permet de diminuer la part du nucléaire à 50 % à partir de 2030 ;
– les scénarios de type DEC : plaçant au premier rang de leurs priorités la diminution des émissions de gaz à effet de serre, ils privilégient la réduction de la consommation des énergies fossiles par le transfert d’usage vers l’électricité (transport électrique, etc.) ; ces scénarios s’appuient assez fortement sur le nucléaire, y compris sur le long terme.
Les divergences de résultat entre les scénarios ne résultent pas d’erreurs de raisonnement mais d’hypothèses de calcul et de choix politiques en amont différents. La commission d’enquête s’est attachée à comprendre quelles étaient les hypothèses sous-jacentes à chaque groupe de scénario, afin de faire apparaître les conditions sous lesquelles la diminution de la part du nucléaire dans le mix électrique était raisonnablement possible.
L’ensemble de la réflexion sur le mix énergétique est donc largement conditionné par la vision qu’on a des potentialités d’efficacité énergétique. Il n’est pas inutile de rappeler que des orientations ont déjà été adoptées par le passé, et des engagements pris au niveau international. La loi POPE (loi de Programmation fixant les Orientations de la Politique Énergétique, du 13 juillet 2005) prévoyait ainsi d’atteindre en 2015 une réduction annuelle de l’intensité énergétique finale de 2 %, et de 2,5 % en 2030. Par ailleurs, le scénario énergétique présenté par le gouvernement français à l’Union européenne le 16 décembre 2011, en application du paquet climat-énergie se donnait pour objectif en 2020 une consommation énergétique finale de 128 à 131 Mtep, inférieure de 17 % à 19 % à celle de 2009 (158 Mtep).
II. LES APPORTS DE LA COMMISSION D’ENQUÊTE
Les travaux de la commission d’enquête ont fait apparaître une opposition entre deux visions.
A. APPROCHE 1 : UNE FORTE HAUSSE DE LA DEMANDE EST INÉLUCTABLE, CE QUI REND NÉCESSAIRE LE PROLONGEMENT DU PARC NUCLÉAIRE
1. L’électricité au service d’un objectif prioritaire : la diminution des émissions de gaz à effet de serre
Les partisans du prolongement du parc nucléaire mettent l’accent sur ce qui doit demeurer l’unique objectif prioritaire de la transition énergétique : la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre.
« En matière de transition énergétique, l’objectif majeur est la lutte contre le changement climatique et la réduction des émissions de gaz à effet de serre […] Nous devons néanmoins améliorer notre performance en matière de CO2. Cela suppose une stratégie bas carbone ambitieuse qui cible en priorité la consommation de pétrole – le pétrole représente 60 % des émissions de CO2 en France tandis que le fuel est la troisième source de chauffage – sur laquelle on a moins travaillé » (Robert Durdilly, président de l’Union française de l’électricité).
À ce titre, la France est déjà relativement bien placée du fait de la composition de son mix électrique actuel, laissant une part importante aux moyens de production décarbonés. Il faut donc s’appuyer sur cet atout en développant les nouveaux usages de l’électricité.
Favoriser le développement de l’électricité présente également un atout industriel car la France compte des acteurs très bien placés dans ce domaine : « Nous relevons avec satisfaction que, parmi les 34 plans de reconquête industrielle, 27 intéressent directement l’électricité, qu’il s’agisse de transfert d’usage, de gestion de la demande ou de stockage » (Robert Durdilly).
À terme, l’objectif poursuivi est d’évoluer vers un mix électrique intégralement décarboné, à l’image de la Suède : « la Suède offre un bon exemple : grâce à une stratégie bas carbone inscrite dans la durée, le mix électrique, composé de 58 % d’énergies renouvelables, 40 % de nucléaire et 2 % d’énergie fossile, est presque totalement décarboné. La compétitivité reste remarquable puisque le prix du mégawattheure est de l’ordre de 30 à 35 euros » (Robert Durdilly).
2. L’impossibilité de faire baisser fortement la demande d’énergie requerrait le maintien d’une capacité nucléaire importante
Les partisans du prolongement de la durée de vie du parc nucléaire s’appuient sur le constat selon lequel les objectifs d’efficacité énergétique ambitieux sont irréalisables.
D’une part, réaliser des économies importantes consisterait à s’inscrire dans une trajectoire de décroissance économique : « L’essentiel – au-delà du fait de choisir, ou non, du nucléaire – porte sur la capacité de notre pays à réduire la demande et la consommation d’électricité. négaWatt part du postulat que nous pourrons procéder à cette réduction de manière drastique sans pénaliser la croissance économique. Or cela n’est pas démontré. Nous trouvons donc très dangereux de construire un scénario ou de piloter une évolution en imaginant maintenir un certain niveau de croissance, d’autant que celle-ci est « boostée » par la démographie, beaucoup plus importante en France qu’en Allemagne. Construire un tel scénario, même s’il est cohérent en lui-même, sur des hypothèses aussi lourdes, peut se révéler risqué pour l’ensemble du système électrique » (Robert Durdilly).
D’autre part, il est important que les business models nécessaires au développement à grande échelle de l’efficacité énergétique et notamment des travaux de rénovation thermique soient consolidés, en prenant exemple sur les actions menées par les pays voisins. Les scénarios misant sur une baisse de la consommation énergétique – et ce quels que soient les transferts entre vecteurs – doivent encore faire la démonstration de la faisabilité des modalités selon lesquelles cette baisse pourrait être réalisée. Comme l’indique l’ADEME, ces outils restent à mettre en place en France. Pour ce qui est du bâtiment par exemple : « nous n’avons pas détaillé les mécanismes qui devront être mis en place pour déclencher les investissements. Cela ne relève pas de la compétence de l’ADEME. Nous savons que la rénovation représente un coût de 20 000 à 30 000 euros par maison, qui est très important pour les ménages non solvables, alors que les dispositifs actuels s’adressent à des ménages avec un certain niveau de revenu » (François Moisans, directeur exécutif scientifique Recherche et international de l’ADEME).
La croissance inéluctable – voire souhaitable selon certains intervenants – de la demande rendrait le prolongement du parc nucléaire indispensable. Si l’on prend pour hypothèse un accroissement du niveau de la demande d’électricité, cela suppose de conserver la capacité de production nucléaire française, ou bien d’investir dans de nouvelles capacités de production. Or, toutes les autres capacités décabornées présenteraient un coût de production plus important que le nucléaire historique. Par conséquent, diminuer la part du nucléaire en l’absence de baisse de la demande aurait nécessairement pour effet de faire augmenter les prix de l’électricité supportés par les ménages et les entreprises. « Nous considérons donc qu’en l’état actuel des technologies, nous avons intérêt à prolonger le nucléaire existant, tout en renforçant par ailleurs et de façon significative la sûreté nucléaire – ce qui a été intégré dans les coûts » (Robert Durdilly).
Dans la même logique, le développement des énergies renouvelables risquerait par ailleurs d’accroître la surproduction, ce qui se révèlerait un mauvais choix économique : « il faut s’interdire de développer des moyens de production en l’absence de besoins, au risque de créer des surcapacités coûteuses pour la collectivité. Plusieurs pays européens sont en train d’en payer le prix […] il convient d’agir en bon gestionnaire, d’une part, en privilégiant les solutions à bonne rentabilité, y compris dans les énergies renouvelables, par le choix de filières à maturité qui ne demandent pas de subventions ; d’autre part, en tirant parti des synergies européennes, sans toutefois se départir du souci de la sûreté du système électrique européen. »
À l’inverse, le scénario de maintien du nucléaire présenterait plusieurs avantages. D’une part, le nucléaire peut servir d’appui aux énergies renouvelables venant en substitution des moyens de production fossiles : « si la demande électrique est soutenue pour les raisons que j’ai indiquées, même si nous devons faire d’énormes efforts en matière d’efficacité énergétique, même si l’intensité énergétique doit s’améliorer dans les prochaines années, il nous faut un socle solide en matière de production électrique » (Robert Durdilly). D’autre part, l’exportation d’électricité dans les conditions actuelles génèrerait environ deux milliards d’euros de chiffre d’affaires par an.
3. Un scénario compatible avec l’engagement présidentiel ?
Selon Henri Proglio, président-directeur général d’EDF, cette question ne fait pas de doute. Il est possible de porter la part du nucléaire à 50 % du mix électrique sans fermer de centrales : « Compte tenu de ces paramètres, en supposant que nous atteignions un taux de croissance de 2 % par an – ce qui n’est pas impossible au regard des performances actuelles de pays comparables à la France et correspond au minimum requis pour maintenir le taux d’emploi – et que nous réalisions 20 % d’économies d’énergie sur la période – un grand plan qui se fixe un tel objectif me paraît prioritaire dans un souci de bonne gestion des ressources énergétiques –, les besoins en énergie de la France continueront à augmenter à l’horizon 2025. Selon nos estimations – qui peuvent bien sûr être discutées et comparées à celles de nos voisins –, le parc nucléaire existant suffira à peine à fournir 50 % des besoins électriques de la France en 2025 ou en 2030 ».
La réponse apportée par Jacques Percebois est plus nuancée : « Dans le scénario tendanciel, le nucléaire, légèrement réduit, restait autour de 70 %, car l’arrêt de réacteurs qui fonctionnent lorsque la demande continue à croître revient à une destruction de valeur économique » (Jacques Percebois). Autrement dit, le prolongement de l’intégralité du parc actuel ne conduit pas mécaniquement vers l’objectif du Président de la République.
Quant aux scénarios sur lesquels s’appuie le Ministère de l’écologie, ils montrent que la baisse de la part du nucléaire pour atteindre 50 % du mix énergétique passe par la fermeture de 20 réacteurs.
« Selon une étude de RTE, avec une croissance de 1,8 % par an d’ici à 2030, la croissance de la consommation électrique pourrait être de 0,4 % en raison des transferts d’usage. En 2011, la consommation, hors auto-consommation du secteur de l’énergie, était de 422 térawattheures. On peut envisager de passer à 440 ou 465 en tenant compte d’importantes économies d’énergie, de l’ordre de 120 térawattheures, dans le secteur tertiaire et l’industrie, mais aussi d’une augmentation de la consommation du fait des technologies de l’information et de la communication et des transferts d’usage. Nous travaillons surtout sur des scénarios d’évolution modérée de la demande électrique, y compris après transferts d’usage […] Quant au nombre de réacteurs à prolonger ou à fermer, on peut l’estimer en fonction d’hypothèses de développement et de demande de nouveaux moyens de production. Actuellement, la capacité des installations nucléaires est de 63 gigawatts. Dans l’hypothèse d’une part du nucléaire de 50 % en 2025, les besoins seraient de 36 à 43 gigawatts, ce qui correspond, indépendamment des problèmes de sûreté, à un « non besoin » d’une vingtaine de réacteurs » (Laurent Michel, directeur général de l’énergie et du climat).
B. APPROCHE 2 : UNE BAISSE DE LA DEMANDE ÉNERGÉTIQUE EST POSSIBLE, CE QUI REND INUTILE LA PROLONGATION DE L’ENSEMBLE DU PARC NUCLÉAIRE
1. La possibilité de faire baisser fortement la demande d’énergie ouvre la voie à une forte réduction de la part du nucléaire dans le mix électrique
Pour les partisans de cette seconde approche, les trajectoires de diminution de la capacité nucléaire installée reposent sur une forte baisse de la demande d’énergie. Une telle baisse est tout à fait possible et doit constituer l’objectif premier de la transition énergétique. « L’analyse de la chaîne énergétique réserve de belles surprises : on constate ainsi que l’usage peut permettre des gains énergétiques importants dès lors que le service attendu et les besoins sont déterminés afin d’éviter les consommations superfétatoires ou le gaspillage » (Thierry Salomon, président de négaWatt). Bernard Laponche, ancien directeur général de l’AFME – aujourd'hui ADEME –, considère ainsi que le sujet de l’efficacité énergétique n’a pas encore été suffisamment creusé. « Tandis que l’on consacre des rapports de 400 pages au nucléaire, on évacue en trois pages la question de l’efficacité énergétique. Celle-ci est pourtant fondamentale pour toute la transition énergétique. Si en effet la consommation d’énergie diminue de moitié [d’ici 2050], conformément à l’objectif fixé par le Président de la République, tous les problèmes liés au climat et à la sécurité énergétique, ainsi que tous les risques, diminuent de façon pratiquement proportionnelle ».
L’exemple allemand montre qu’une forte diminution de la consommation est possible si l’on met en place les instruments adéquats. Une étude comparative des systèmes énergétiques français et allemand publiée en 2011 par l’IDDRI et l’association Global Chance a montré que la consommation d’électricité « spécifique » – incluant les appareils électriques et l’éclairage, mais excluant le chauffage et le chauffe-eau – par habitant était au même niveau dans les deux pays en 1998. À cette date est instaurée une taxe écologique sur l’électricité dont les recettes sont affectées à l’abaissement des charges sociales sur le travail. L’Allemagne a ensuite connu une augmentation régulière des tarifs de l’électricité, liée à plusieurs effets, aboutissant à un prix du kilowattheure de 27 centimes. « À partir de 2000, l’Allemagne commence à stabiliser sa consommation d’électricité spécifique par habitant dans le logement, tandis que la courbe de la consommation française continue d’évoluer de façon quasi linéaire. En 2010, la différence de la consommation par habitant est de 15 % et de 27 % par ménage […] Fixer un objectif raisonnable d’économie de l’ordre de 15 % n’a donc rien de scandaleux » (Bernard Laponche). À l’arrivée, le ménage allemand paie son kWh électrique plus cher que le ménage français, mais en consomme moins, ce qui conduit à des factures du même niveau de part et d’autre du Rhin. À l’occasion du débat sur la transition énergétique (DNTE) le rapport adopté par le groupe de travail « compétitivité » avait d’ailleurs montré que la part des revenus consacrés par les ménages français et allemands à leur éclairage et à leur chauffage était exactement la même : 4,8 %.
Dans l’hypothèse d’une forte baisse de la demande, le maintien des capacités de production nucléaire au niveau actuel n’est plus nécessaire : « il est très grave de ne pas prendre en compte la demande car, selon que cette dernière sera de 350 ou de 600 milliards de kilowatt-heure, la réflexion sur l’industrie nucléaire sera très différente : la différence est un facteur 2, même si la part du nucléaire reste de 50 % » (Bernard Laponche).
2. Un tel scénario met en avant la création d’emplois locaux, la diminution de la facture énergétique et le renforcement de la résilience du système énergétique
Une trajectoire de baisse de la demande d’énergie repose à la fois sur des appareils plus sobres (électro-ménagers, informatique, mais aussi véhicules) et sur des investissements très importants dans l’efficacité énergétique. Or, ces investissements ont la caractéristique d’être très intenses en travail : « Une rénovation poussée peut permettre une baisse significative de la consommation d’énergie – par exemple de 300 kWh par m2 à 75 ou 85 kWh par m2, comme on sait le faire actuellement en énergie primaire. Cela signifie, pour l’usager, une baisse du niveau de l’énergie à acquérir pour satisfaire à ses besoins. Cela signifie, sur le plan économique, des travaux réalisés par des artisans et des PME, et de nouveaux services énergétiques – par le biais de la garantie de performance, par exemple. D’où un transfert de la production vers des services. C’est cela qui fait la croissance et l’emploi, et qui permet la réalisation de nouveaux équipements en matière de renouvelables » (Thierry Salomon).
Les effets bénéfiques de ce type de scénarios sont désormais démontrés. Par exemple, l’ADEME a soumis ses travaux à une analyse macro-économique, en lien avec l’Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE) et un laboratoire de Sciences-Po qui a développé un modèle d’équilibre général : « L’évaluation macroéconomique montre, par rapport au scénario de référence, une croissance du PIB légèrement supérieure, à l’horizon 2030, de l’ordre de 1,7, soit une année de croissance supplémentaire, et à l’horizon 2050, de 2,5. On est loin de la décroissance…
« En outre, des emplois supplémentaires sont créés, environ 300 000 en 2030 et entre 650 000 et 850 000 en 2050, qui proviennent du secteur du bâtiment et de la production d’énergies renouvelables.
« Enfin, le budget des ménages croît de manière importante puisqu’il est multiplié par 1,5 d’ici à 2050. Malgré la facture énergétique et la dette contractée pour financer la rénovation du logement, le revenu disponible progresse » (François Moisans).
3. Limiter l’utilisation de l’électricité à ses usages « nobles » ?
Les progrès de l’efficacité énergétique permettent de diminuer la consommation électrique et ouvrent ainsi une voie vers la réduction de la dimension du parc nucléaire français. Ils permettent également de corriger les défauts du système électrique français actuel, marqué par gaspillages significatifs.
D’une part, le rendement thermique des centrales nucléaire, d’environ un tiers, est très bas en comparaison des autres moyens de production. « Dans la production nucléaire actuelle, le volume d’énergie lié au rendement des centrales, sous forme de chaleur, est perdu. Il représente 830 milliards de kilowattheures, soit plus que le chauffage de tous les logements et les bâtiments tertiaires de France » (Thierry Salomon).
D’autre part, l’utilisation massive des chauffages électriques explique que la pointe électrique française soit sans commune mesure avec celle des autres pays européens, la Norvège exceptée. « Notre scénario prévoit, par ailleurs, un glissement vers beaucoup moins de chauffage à effet Joule, qui est le problème du réseau actuel. RTE, qui vient de refaire ses calculs, a évalué la sensibilité électrotechnique à 2 400 MW par degré : autrement dit, à chaque fois qu’en hiver la température baisse d’un degré en France, il nous faut mettre en marche deux réacteurs et demi de 900 MW. Vous savez que cette sensibilité électrotechnique est une malheureuse caractéristique française : nous avons la moitié de la sensibilité électrotechnique de l’Europe. Si on baisse cette valeur-là par une politique d’efficacité énergétique, de transfert vers des usages beaucoup nobles de l’électricité et vers d’autres énergies, on retrouvera une marge de manœuvre. Dans notre scénario, nous redescendons cette consommation maximale sur l’ensemble du réseau aux alentours de 60/70 GW, donc bien en dessous des records que vous connaissez, qui sont à 110 GW » (Thierry Salomon).
Les caractéristiques françaises du mix électrique ne sont donc pas si favorables qu’annoncées, dans la mesure où l’importance de la pointe électrique requiert la mise en marche de moyens de production thermiques fortement émetteurs de gaz à effet de serre.
˜ ™
Les travaux de la commission d’enquête font apparaître l’importance de la variable « demande ». Dans le cas d’une progression forte de la consommation d’électricité, le maintien d'une capacité nucléaire importante serait nécessaire pour éviter la dérive des prix de l’électricité. En revanche, en cas de maîtrise de la consommation, la prolongation de la durée de vie de tout le parc nucléaire est inutile.
Or, force est de constater que, d’ores et déjà, la consommation électrique est stable depuis 6 ans, et que RTE, estimant la tendance durable, revoit à la baisse ses propres simulations d’évolution sur les années à venir, jugeant que les efforts de maîtrise de consommation déjà engagés équilibreront globalement les nouveaux usages.
La mise au point de business models pour l’efficacité énergétique, en s’inspirant par exemple des dispositifs existant chez nos voisins, constitue néanmoins aujourd’hui une priorité pour la réalisation d’objectifs volontaristes. La réflexion devra aboutir rapidement afin d’accélérer la maîtrise de la consommation énergétique et notamment un rythme de rénovations thermiques encore loin d’être suffisant. À défaut, il pourrait être tentant de présenter la prolongation de tout le parc nucléaire comme une option qui s’imposerait. Ce serait toutefois une solution de facilité qui priverait la France d’une véritable transition énergétique. Le jeu en vaut pourtant la chandelle tant les scénarios produisent des effets très positifs sur l’emploi.
CHAPITRE 9 : COMMERCIALISATION
DE L’ÉLECTRICITÉ NUCLÉAIRE
A. LE PRINCIPE DE LA LIBÉRALISATION DES MARCHÉS : LA SUBSTITUTION DES PRIX DE MARCHÉ AUX TARIFS RÉGLEMENTÉS
1. Le tarif : le fondement de l’histoire française de l’électricité.
Depuis la loi du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz, la production et la commercialisation de l’électricité étaient gérées dans le cadre d’un monopole régulé attribué à EDF et, sur leur zone de desserte, aux entreprises locales de distribution. L’électricité faisait l’objet d’une tarification dite « intégrée », couvrant l’ensemble des composantes de coûts du système électrique :
– la part acheminement, couvrant les coûts liés à la gestion du réseau de transport et des réseaux de distribution ;
– la part fourniture, couvrant les coûts de production et de commercialisation de l’électricité ;
– les taxes : la contribution au service public de l’électricité (CSPE), la TVA, les taxes sur la consommation finale d’électricité (TCFE, ex-taxes locales sur l’électricité) et la contribution tarifaire d’acheminement (TCA, qui permet de financer les droits spécifiques relatifs à l’assurance vieillesse des personnels relevant du régime des industries électriques et gazières).
Divers tarifs étaient proposés aux particuliers, selon leur puissance souscrite : tarifs bleus pour les particuliers et les petits professionnels (puissance souscrite inférieure à 36 kVA), tarifs jaunes pour les sites de taille moyenne (puissance souscrite comprise entre 36 et 250 kVA) et tarifs verts pour les gros consommateurs (puissance supérieure à 250 kVA).
2. L’extinction progressive des tarifs réglementés en application du droit européen
À partir de la seconde moitié des années 1990, la Commission européenne décide d’ouvrir à la concurrence les segments des marchés de l’électricité et du gaz qui n’étaient pas en situation de monopole naturel. Il s’agit du segment amont, la production, et du segment aval, la commercialisation. Deux motifs sont invoqués à l’appui de cette libéralisation : la concurrence provoque en théorie une baisse des coûts et engendre des innovations qui profitent au consommateur ; l’intégration des marchés gaziers et électriques des pays européens doit renforcer la solidarité énergétique et réduire le risque de rupture d’approvisionnement pour le gaz et de coupure pour l’électricité.
Des directives européennes successives, surnommées 1er, 2ème et 3ème « paquets énergie », fixent le cadre juridique imposé aux États membres. D’une part, les fournisseurs historiques sont contraints de séparer leurs activités de production et de commercialisation, soumises à la concurrence, de leurs activités de gestion du réseau, demeurant en situation de monopole. Ces dispositions entraînent la création de RTE et d’ERDF, filiales d’EDF respectivement chargées de la gestion du réseau de transport et des réseaux de distribution d’électricité. D’autre part, un marché européen de gros de l’électricité et du gaz est mis en place, sur lequel les fournisseurs alternatifs peuvent désormais s’approvisionner pour fournir des clients domestiques ou professionnels.
Dans le but de développer la concurrence, le droit européen s’oppose aux instruments qui rendent les consommateurs captifs. La Commission européenne a ainsi fait pression pour que la France supprime les tarifs réglementés de vente à destination des professionnels, considérant que ces derniers constituaient une forme d’aide d’État. Le 13 juin 2007, elle a ouvert une procédure d’examen au titre des aides d’État, considérant que les tarifs réglementés pourraient constituer des subventions publiques aux grandes et moyennes entreprises, susceptibles d’entraîner des distorsions des échanges et de la concurrence sur le marché unique de l’Union européenne.
La France a obtenu le maintien sine die des tarifs bleus ; ces derniers ne seront toutefois plus calculés selon une logique intégrée, mais par addition des coûts, aux termes de l’article L.337-6 du code de l’énergie : « Dans un délai s'achevant au plus tard le 31 décembre 2015, les tarifs réglementés de vente d'électricité sont progressivement établis en tenant compte de l'addition du prix d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique, du coût du complément à la fourniture d'électricité qui inclut la garantie de capacité, des coûts d'acheminement de l'électricité et des coûts de commercialisation ainsi que d'une rémunération normale ».
S’agissant des tarifs jaune et vert, les dispositions de l’article L.337-9 du code de l’énergie prévoient leur suppression pure et simple, au plus tard le 31 décembre 2015.
La suppression des tarifs verts, en particulier, est source d’inquiétude. Les tarifs verts concernent certes un nombre moins important de sites que les tarifs jaunes, mais les clients au tarif vert ont une consommation unitaire bien plus élevée (740 MWh de moyenne, contre 118 MWh pour les clients au tarif jaune). Les entreprises concernées, pour lesquelles le coût de l’énergie représente une part importante du coût de production, sont aujourd’hui dans une phase transitoire d’incertitude : elles ne savent pas quel prix de l’électricité elles paieront demain.
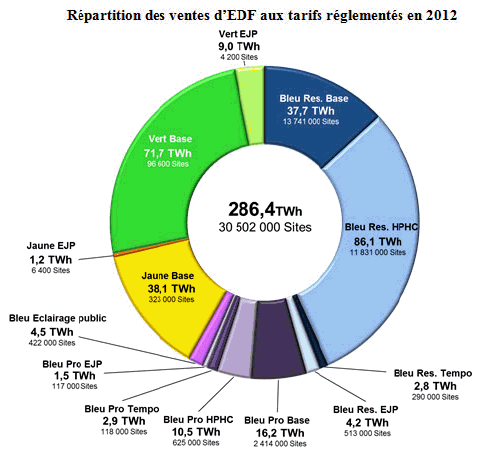
Source : CRE
S’ajoutent à la suppression des tarifs verts les coups portés à deux dispositifs importants pour les gros consommateurs : les contrats de long terme et l’accès réservé à une partie de la production hydroélectrique. D’une part, à la suite d’une enquête de la Commission européenne pour abus de position dominante, EDF s’est engagée à ce que les contrats de long terme conclus avec ses consommateurs de grande puissance respectent un certain nombre de critères :
– 65 % en moyenne (et 60 % au minimum) de l’électricité pour laquelle elle a passé des contrats avec des grands clients doivent être remis sur le marché chaque année, soit du fait de l’expiration de contrats, soit en permettant aux clients de résilier leur contrat sans frais ;
– la durée des contrats ne peut excéder cinq ans, à moins que les clients concernés puissent résilier leur contrat sans frais tous les cinq ans au moins ;
– ces contrats ne doivent pas comprendre de clauses d’exclusivité ni interdire la revente de l’électricité fournie.
Ces engagements ont mis fin à l’enquête de la Commission, mais lient EDF jusqu’au 1er janvier 2020.
D’autre part, le mécanisme issu de l’article 8 de la loi de nationalisation de 1946, attribuant une compensation en nature aux entreprises électro-intensives expropriées de leurs moyens de production hydrauliques, s’éteint progressivement. Par exemple, FerroPem, Alteo et Rio Tinto France bénéficient encore des droits attribués à Pechiney, pour 2,4 TWh par an. La contribution qui leur est versée vient en déduction de leur facture d’électricité, à hauteur de 20,9 €/MWh (56) . Sous la pression de la Commission européenne, le volume d’énergie entrant dans le cadre des dispositions de l’article 8 de la loi de 1946 doit décroître de 1/13ème par an depuis 2011 pour s’annuler en 2023.
Ainsi, non seulement les gros consommateurs d’électricité vont perdre prochainement le bénéfice du tarif vert, mais l’accès aux instruments permettant de bénéficier de prix garantis sur une période donnée est également de plus en plus difficile.
B. LES CONSÉQUENCES DE LA LIBÉRALISATION : LA MISE EN PLACE DE MÉCANISMES COMPLÉMENTAIRES AU MARCHÉ DE GROS
1. Exeltium : développer des instruments alternatifs au marché pour s’assurer d’une source d’approvisionnement pérenne et compétitive
En prévision de l’extinction des tarifs réglementés, les industriels ont cherché des sources d’approvisionnement en électricité à un prix stable et compétitif sur le long terme. Exeltium, consortium d’entreprises grosses consommatrices d’électricité ayant conclu un partenariat industriel de long terme avec EDF, est l’une des réponses trouvées à cette problématique.
La création d’Exeltium tire parti de l’ouverture du secteur de la production d’électricité à la concurrence. Le principe en est simple : les consommateurs électro-intensifs peuvent s’assurer d’un approvisionnement stable en énergie en rémunération d’un co-investissement dans des moyens de production d’électricité (57) . Il s’agit donc d’une forme inventive de collaboration industrielle, dont les deux parties tirent un avantage.
D’un côté, les 26 sociétés électro-intensives, actionnaires de la société Exeltium, disposent d’un approvisionnement présentant trois qualités essentielles, la sécurité, la visibilité et la compétitivité :
– les actionnaires ont droit, depuis le 1er mai 2010, à un « ruban » d’électricité c’est-à-dire à une fourniture électrique constante tout au long de l’année. Entre le 1er mai 2010 et décembre 2013, Exeltium a livré au total 25 TWh à une centaine de sites, soit 7,4 TWh en rythme annuel. Ce volume représente entre le tiers et la moitié des besoins des sites concernés.
– la phase 1 du projet porte sur la livraison de 148 TWh sur une période de 24 ans.
– le prix de l’électricité livrée par Exeltium revient à environ 50 €/MWh. Il intègre deux composantes : une part correspondant au coût d’exploitation d’EDF et une part destinée à couvrir les coûts d’investissements engagés par Exeltium au début du contrat. En effet, Exeltium a versé à EDF une « avance de tête » de 1,75 milliard d’euros au début de l’exécution du contrat, financée à 10 % par des fonds propres et à 90 % par de l’emprunt. Cette structure de financement est la clé de la compétitivité car elle permet de tirer parti d’un effet de levier : si les partenaires s’approvisionnaient de façon traditionnelle, ils devraient rémunérer le producteur d’électricité à son coût moyen pondéré du capital, soit approximativement 10 % ; les frais financiers d’Exeltium sont, eux, essentiellement constitués du coût de sa dette et sont donc bien moins élevés.
De l’autre, EDF bénéficie d’un partenaire financier, dont la participation est calée sur le coût complet économique du « nouveau » nucléaire. Les avances de tête versées par Exeltium sont destinées à rémunérer le coût d’investissement, qui représente une part très majoritaire du coût total. Elles s’élèvent à 1,75 milliard d’euros pour la phase 1 du projet et 4 milliards d’euros au total, si la phase 2 venait à se réaliser.
La mise en place d’Exeltium a demandé un délai d’environ cinq ans entre le début du projet et la livraison des premiers mégawattheures, notamment pour s’assurer de la compatibilité de l’accord avec le droit européen de la concurrence. EDF a été retenue par appel d’offres en 2007 car elle présentait une offre à la fois compétitive et décarbonée. Le partenariat a fait l’objet d’un examen approfondi de la part de la Commission européenne ; cette dernière a imposé une clause préservant un droit de sortie au bout de dix, quinze et vingt ans pour les consommateurs bénéficiant d’Exeltium. Ces obligations visent à préserver la liquidité du marché de l’électricité en évitant qu’une partie des gros consommateurs soient captifs d’un marché parallèle au marché de gros. Mais elles ont fait peser un risque sur le devenir du projet, que les banques n’ont accepté de financer que jusqu’à la première des échéances, rendant ainsi nécessaire un refinancement d’ici la fin de l’année 2014.
L’exemple d’Exeltium illustre très bien les contradictions constantes entre le droit européen de la concurrence et la mise en place de politiques industrielles de long terme. Exeltium constitue un signal très fort donné par les consommateurs électro-intensifs qui en sont partenaires : s’engager sur des longues durées par des contrats « take or pay » donne de fortes garanties en matière de préservation de l’emploi sur les sites concernés. En exigeant le raccourcissement de la durée des contrats concernés et l’introduction de toujours plus de flexibilité, la Commission européenne s’inscrit à rebours de cette logique industrielle.
2. L’ARENH : l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique
A compter de l’entrée en vigueur des directives sur le marché intérieur de l’électricité, la Commission européenne a veillé à ce que la libéralisation « en droit » du marché de l’électricité se concrétise par une libéralisation de fait. À ce titre, l’attribution d’un monopole à EDF pour la production nucléaire constituait une entrave à l’émergence d’une « vraie » concurrence.
En effet, le parc nucléaire, parce qu’il est déjà construit, représente un moyen de production plus compétitif que les autres moyens de production d’électricité neufs, empêchant les fournisseurs d’énergie alternatifs de concurrencer les offres d’EDF (58) . Dans un contexte de prix de marché de l’électricité élevés, ces derniers faisaient ainsi face à un « ciseau tarifaire » : ne pouvant se fournir que sur le marché de gros, à des prix supérieurs au coût de production du parc nucléaire, ils étaient dans l’incapacité de concurrencer les tarifs de détail d’EDF.
Suivant les injonctions de la Commission européenne (59) , le législateur français a mis en place un dispositif spécifique : l’ARENH (accès régulé à l’électricité nucléaire historique). Créé par la loi du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l’électricité, dite loi « NOME », il impose à EDF, seul exploitant de centrales nucléaires en France, de vendre à ses concurrents une partie de l’électricité produite à partir du parc nucléaire historique, dans la limite de 100 TWh. Le prix de cette électricité est régulé et doit refléter « les conditions économiques de production d’électricité par les centrales nucléaires d’Électricité de France situées sur le territoire national et mises en service avant le 8 décembre 2010 ». Une telle solution permet de développer une concurrence en aval, tout en garantissant au consommateur français, grand financeur du parc nucléaire historique, le contrôle d’un investissement qu’il a financé et qui lui revient de droit.
La création de l’ARENH en 2010 a donné lieu à des controverses sur la question du calcul du « prix de l’ARENH » qui se prolongent encore aujourd’hui. Elles concernent plus particulièrement la rémunération des investissements passés et à venir (60). La référence aux « conditions économiques de production » inscrite à l’article L.336-1 du code de l’énergie ne donnant qu’une orientation, la Commission de régulation de l’énergie a été amenée à présenter sa « doctrine » dans sa décision du 5 mai 2011 (61). Deux types d’investissements doivent être distingués.
S’agissant des investissements passés, engagés au moment de la construction du parc, ils sont égaux à la valeur nette comptable du parc figurant dans les comptes d’EDF à la date du 31 décembre 2010 ; ces investissements sont intégrés à une base d’actifs amortie sur la durée de vie du dispositif de l’ARENH (soit jusqu’en 2025) et rémunérée à un taux représentatif de la nature de l’activité.
S’agissant des investissements futurs, c’est-à-dire des coûts des investissements de maintenance ou nécessaires à l’extension de la durée de l’autorisation d’exploitation prévus par l’article L.337-14, la CRE considère au contraire qu’ils doivent être assimilés à des charges d’exploitation. Selon cette méthode de comptabilisation, EDF dispose des liquidités correspondant au montant de ses investissements sans recours à l’endettement. De plus, l’arrêt d’un réacteur, pour des raisons indépendantes de la volonté d’EDF, avant la fin de la période de régulation, ne pourrait donner lieu à aucune réclamation.
II. LES APPORTS DE LA COMMISSION D’ENQUÊTE
A. LE NUCLÉAIRE TOUCHÉ PAR LES DIFFICULTÉS LIÉES AU FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS SUR LA PLAQUE ÉLECTRIQUE EUROPÉENNE
1. Exeltium : un prix d’enlèvement supérieur au prix de l’ARENH et aux prix de marché
Datant de huit ans seulement, le partenariat industriel Exeltium semble déjà inadapté au contexte énergétique actuel, obligeant ses partenaires à des renégociations d’ampleur.
Une partie des difficultés rencontrées résulte des conditions initiales. Négocié au plus fort de la crise économique, le montage financier s’est retrouvé fragilisé par les exigences de la Commission européenne : les banques n’ont accepté de financer la société que jusqu’à la première échéance, au terme de laquelle les partenaires d’Exeltium pouvaient se retirer.
Mais Exeltium a surtout pâti de la mise en place du dispositif de l’ARENH. Non seulement le prix offert dans ce cadre est inférieur à celui proposé par Exeltium, mais il est sans risque car il ne requiert aucune participation préalable en capital :
« Depuis le démarrage d’Exeltium en 2010, le contexte énergétique a considérablement évolué, tant en France qu’à l’échelle européenne et mondiale. En France, l’ARENH a été mis en place en juillet 2011, avec un prix de 40 euros par mégawattheure (MWh), puis de 42 euros dès janvier 2012, reflétant en principe le coût de la production du parc nucléaire historique. Le coût total d’Exeltium pour ses actionnaires-clients revient, quant à lui, à environ 50 euros par MWh en 2014 […] Or le recours à l’ARENH est moins risqué et ne nécessite aucun apport en capital. En outre, la loi NOME limite l’accès à ce dispositif pour les actionnaires d’Exeltium : elle les oblige à consommer toute l’électricité achetée auprès d’Exeltium avant d’acquérir des quantités dans le cadre de l’ARENH, ce qui crée une réelle distorsion de traitement » (Jean-Pierre Roncato). Les actionnaires d’Exeltium sont d’autant plus défavorisés que les volumes dont ils bénéficient dans le cadre de ce projet sont décomptés de leur droit à l’ARENH, en application de l’article L.336-4 du code de l’énergie.
L’équation économique d’Exeltium n’est donc plus aussi favorable qu’au moment de sa création et subit même un effet ciseau. D’un côté, contrairement à ce qui était prévu, les prix de marché ont suivi une tendance à la baisse (voir le chapitre 1). De l’autre, les prix offerts par Exeltium, calés sur le coût de construction de l’EPR, ont subi directement l’explosion du devis du chantier. Les difficultés financières rencontrées par Exeltium traduisent donc rigoureusement le manque d’espace économique pour le « nouveau nucléaire ». Le contrat prévoyant par ailleurs une hausse du prix du mégawattheure en cas de diminution de la capacité du parc nucléaire historique, Exeltium sera donc doublement perdant dans la perspective de la fermeture de certaines centrales.
Dans de telles conditions, la phase 2 du dispositif, qui prévoyait la livraison complémentaire de 163 TWh sur la même période (2010-2034) est en suspens et les actionnaires d’Exeltium ont souhaité entrer en négociation avec EDF pour rééquilibrer le contrat.
« Dans ces conditions, refonder la compétitivité à court-moyen terme du dispositif Exeltium est devenu une urgence industrielle, en particulier pour certains sites directement menacés à brève échéance. Nous menons, depuis quelques mois, des discussions avec EDF sur un certain nombre d’améliorations. L’objectif est d’adapter ce contrat privé, qui offre certes une compétitivité et une prévisibilité à long terme, aux évolutions violentes du contexte immédiat : compte tenu de la situation économique des industries électro-intensives en France, le long terme apparaît bien lointain, alors que la question posée à court terme peut être celle de la survie !
« La solution en négociation consiste à sécuriser une baisse du prix pour les prochaines années et à introduire dans le contrat une souplesse qui permette de l’adapter aux aléas futurs de l’environnement économique. Pour simplifier, il s’agit de créer un « tunnel » autour du prix actuel, avec une modulation à la baisse, dans une certaine limite, lorsque le contexte est déprimé, et une modulation à la hausse, également dans une certaine limite, lorsque la situation économique est plus favorable et que les prix de l’électricité sont revenus à la « normale ». Les discussions avec EDF portent également sur une limitation plus stricte de l’impact pour Exeltium de la matérialisation des risques partagés avec EDF dans le cadre du contrat de partenariat » (Jean-Pierre Roncato).
2. Selon EDF, un prix de l’ARENH insuffisant pour couvrir les coûts d’EDF
La libéralisation du marché de l’électricité et la mise en place de l’ARENH ont conduit EDF à réviser sa stratégie tarifaire. Pour être concurrentielle, l’entreprise construit ses offres par référence à celles de ses concurrents, c’est-à-dire par addition du prix de l’ARENH, d’un complément au prix de marché et du coût de commercialisation. Cela signifie qu’une très large part de la production nucléaire d’EDF est commercialisée au coût de l’ARENH.
« Le champ d’application de ce dispositif est très large. Aujourd’hui, EDF commercialise la plus grande partie de son électricité – 304 térawattheures (TWh) – via le tarif réglementé de vente, les entreprises locales de distribution d’électricité (ELD) disposant d’un contrat aux tarifs de cession pour un volume de 18 TWh. En 2013, la répartition de ce volume de 304 TWh était le suivant : 183 TWh destinés aux clients résidentiels et aux petits professionnels facturés au tarif bleu, 41 TWh pour les PME-PMI facturées au tarif jaune, et 80 TWh pour les gros industriels facturés au tarif vert. EDF réalise également des ventes sur offre de marché pour un volume de 55 TWh, ainsi que des ventes d’ARENH à ses concurrents pour 64 TWh.
« Pour que la concurrence ne soit pas biaisée, EDF s’impose de construire ses offres d’électricité sur le marché en utilisant les mêmes règles d’attribution et de prix d’ARENH que celles appliquées aux autres fournisseurs, et en complétant, comme ses concurrents, les droits au nucléaire par l’achat de compléments aux prix de marché en vigueur. Nous faisons donc comme les fournisseurs alternatifs : il s’agit d’une obligation à la fois économique et réglementaire » (Raymond Leban, directeur « Économie, tarifs, achats » d’EDF).
La fixation du prix de l’ARENH revêt donc une importance majeure : une surestimation des coûts d’EDF conduirait à une rémunération trop importante de l’opérateur historique et menacerait le développement de la concurrence. A l’inverse, comme l’explique Raymond Leban, une sous-estimation de ces coûts mettrait en péril le financement des investissements nécessaires dans le parc nucléaire historique. « Quel est le bon prix pour l’ARENH ? Nous sommes convaincus qu’il convient de rester fidèle aux principes qui ont prévalu à l’élaboration des tarifs historiques de l’électricité en France, sous l’instigation de Marcel Boiteux. Il s’agit, non pas de se fonder sur ce que coûterait aujourd’hui le parc, comme je l’ai entendu dire, mais de récupérer les investissements consentis. On a mis un terme à cette logique à la fin des années 90. Or, si le phénomène reste dissimulé durant les périodes où les investissements – qui fonctionnent par cycles – ne sont pas importants, dès que ceux-ci redémarrent, des problèmes de cash-flow se posent. En conséquence, nous pensons que le coût économique complet est la valeur à retenir pour fixer le prix de l’ARENH » (Raymond Leban).
En pratique, EDF considère que les risques liés au financement du parc nucléaire historique sont avérés, pour deux raisons. La première raison réside dans la sous-estimation systématique des coûts d’EDF par la puissance publique pour le calcul des tarifs réglementés de vente, de façon à limiter la hausse de la facture d’électricité des Français. « Dans les faits, le prix de commercialisation de l’électricité nucléaire française, tel qu’il apparaît au travers des tarifs réglementés de vente, est toutefois inférieur au coût économique complet depuis le milieu des années 90 – époque à laquelle ont été pratiquées des baisses de prix assez brutales. Il est clair que cela participe largement à la situation de free cash flow (flux de trésorerie disponible) négatif que connaît le groupe EDF depuis que les investissements ont repris – ceux-ci ayant beaucoup augmenté entre 2011 et 2013 » (Raymond Leban).
La seconde raison tient au contexte actuel de baisse des prix de marché, qui n’avait pas été anticipé au moment de la conception du dispositif de l’ARENH. En 2010, selon les prévisions, le prix de l’ARENH ne pouvait constituer qu’une limite inférieure : les fournisseurs d’électricité s’approvisionneraient prioritairement auprès d’EDF et utiliserait le marché comme un complément, une fois atteint le plafond de 100 TWh. La réalité est tout autre dans un contexte de baisse des prix de marché et de faiblesse de la demande. Même avec un prix de l’ARENH fixé à un niveau suffisant pour couvrir les coûts engagés par EDF, l’entreprise est contrainte de vendre une partie de sa production au prix de marché à ses concurrents, qui peuvent décider de faire jouer ou non leur option gratuite sur des volumes d’électricité nucléaire au prix de l’ARENH.
« Ce prix constituera toutefois un maximum pour EDF, car acheter du nucléaire historique est pour les fournisseurs, non pas une obligation, mais une option, intéressante seulement si le prix de l’ARENH est inférieur à celui du marché. Quand la loi a été conçue, on ne pensait pas que la situation contraire pourrait arriver – et pourtant ! […] En conséquence, fixer le prix de l’ARENH au niveau du coût du nucléaire historique ne suffira pas à assurer qu’EDF pourra couvrir ce coût sur la durée de la période de régulation. En effet, dans les périodes où le prix de marché sera inférieur à celui de l’ARENH, EDF vendra sa production au prix du marché, alors que lorsque le prix de marché sera supérieur à celui de l’ARENH, EDF vendra sa production au prix de l’ARENH » (Raymond Leban).
EDF démontre ainsi clairement que le nucléaire est touché, au même titre que les autres actifs de production, par le contexte énergétique européen.
« Monsieur le rapporteur, le prix de marché est aujourd’hui à un niveau déraisonnable, au point qu’aucune technologie de production d’électricité, quelle qu’elle soit, ne peut trouver de rentabilité […] Même pour les installations existantes, on n’arrive plus à couvrir les coûts variables ! La situation est devenue tellement critique que certaines centrales à cycle combiné gaz qui viennent d’être construites ont été mises sous cocon, parce qu’on ne pouvait pas faire face aux charges d’exploitation ! […] La situation actuelle est totalement atypique : les prix de marché étaient à 50-55 euros il n’y a pas si longtemps. Il faut revenir à la raison et que le marché émette à nouveau des signaux cohérents et favorables aux investissements » (Raymon Leban).
Avec un tel niveau de prix, les centrales nucléaires françaises ne dégagent pas un niveau de rentabilité suffisant pour rémunérer leurs coûts fixes, ce qui laisse présager des difficultés de financement très fortes pour le « grand carénage ».
Le cas de l’EPR est également complexe. Ce dernier ne fait pas partie du dispositif de l’ARENH, qui concerne exclusivement le nucléaire historique. EDF valorisera une partie de la production issue du nouveau réacteur de Flamanville dans le cadre du tarif réglementé de vente, dont l’article L.337-6 prévoit qu’il doit compenser les coûts de production d’EDF qui ne sont pas couverts par l’ARENH : « Dans un délai s’achevant au plus tard le 31 décembre 2015, les tarifs réglementés de vente d’électricité sont progressivement établis en tenant compte de l’addition du prix d’accès régulé à l’électricité nucléaire historique, du coût du complément à la fourniture d’électricité qui inclut la garantie de capacité, des coûts d’acheminement de l’électricité et des coûts de commercialisation ainsi que d’une rémunération normale ». En revanche, le reste de la production sera valorisé au prix de marché, soit très en deçà du coût complet du nucléaire. D’un point de vue économique, la question est de savoir si la rente infra-marginale associée à l’EPR sera suffisante – et à quelle échéance – pour couvrir les coûts fixes de cet investissement colossal.
Signalons enfin que si l’EPR avait été mis en service avant que n’entre en vigueur le nouveau mode de calcul des tarifs réglementés de vente, ces derniers auraient dû être relevés de plusieurs pourcents par le seul effet de l’EPR. En effet, la couverture des investissements d’EDF dans le cadre des tarifs réglementés s’effectue à partir du moment où ces derniers commencent à être amortis, c’est-à-dire à la date de début de fonctionnement. L’année de démarrage de l’EPR aurait donc été marquée par une hausse brutale des amortissements à couvrir se répercutant immédiatement par une hausse des tarifs réglementés de vente pour les particuliers.
3. Selon les concurrents d’EDF, le financement des investissements actuels et futurs doit s’étaler sur l’ensemble de la durée de leur utilisation
Les concurrents d’EDF, par la voie de l’ANODE, n’ont pas la même analyse : ils considèrent d’une manière générale que le marché souffre d’un déficit de concurrence, très directement lié au poids du nucléaire : « Malgré le processus de libéralisation, nous faisons le triste constat que la spécificité nucléaire française a été la cause d’une fermeture du marché aval de la fourniture, et donc d’un faible développement des nouveaux services en matière de MDE – maîtrise de la demande en énergie – et d’efficacité énergétique » (Fabien Choné, président de l’ANODE).
Ils estiment en particulier que le niveau de l’ARENH est suffisant pour assurer le financement des investissements dans le parc nucléaire historique. D’une part, la méthode, dérogatoire du droit commun, consistant à rémunérer des investissements comme des charges d’exploitation, donne un avantage certain à EDF. « Le fait de considérer, pour l’établissement du prix de l’ARENH, les investissements visant à prolonger la durée de vie du parc nucléaire comme des OPEX, c’est-à-dire des charges opérationnelles, constitue déjà une forme d’inventivité économique et financière ouvrant la voie à de nombreuses hypothèses. Le problème réside dans la faisabilité financière : l’opérateur historique de production nucléaire a-t-il la capacité financière de réaliser tous ces investissements, sachant que sa dette est supposée ne pas augmenter ? Nous n’avons pas fait le calcul, mais tout laisse penser que c’est envisageable » (Fabien Choné). L’ARENH rémunère EDF en une fois, à hauteur de l’investissement réalisé, alors que ce dernier n’entre dans les comptes d’EDF que progressivement, à hauteur de l’amortissement associé. Il s’agit donc d’une forme d’avance.
D’autre part, l’ANODE est défavorable aux dispositions de la loi NOME selon lesquelles la période couverte par l’ARENH cessera en 2025. En application de telles dispositions, EDF bénéficierait d’un remboursement de ses investissements selon un calendrier anticipé : l’ensemble des investissements liés au « grand carénage » sont pris en compte sur la période allant jusqu’en 2025, alors que la plupart des équipements financés a une durée de vie technique supérieure. « S’agissant du grand carénage, une proportion non négligeable du coût total – lequel atteint 45 milliards d’euros – doit permettre la réalisation d’investissements qui serviront au-delà de la période de régulation. Ne disposant d’aucun chiffre permettant de justifier cette répartition, nous avons pris pour hypothèse de travail que ces investissements, qui devraient être payés après 2025, représentent 15 milliards d’euros » (Fabien Choné). Cela revient à faire supporter aux consommateurs actuels l’ensemble de l’effort, tandis que l’exploitant en tirera un avantage indu à partir de 2025 : « Il ne paraît pas raisonnable de se montrer aussi prudent pendant la période de régulation, au risque de faire subir au consommateur une augmentation significative du tarif réglementé de vente. Une telle vision revient à faire payer tout de suite – et au plus mauvais moment, de surcroît – le coût d’investissements qui porteront leurs fruits au-delà de 2025 » (Fabien Choné). A l’inverse, allonger la période de régulation permettrait de lisser le prix de l’ARENH, qui pourrait être ramené de cette façon à 37,9 €/MWh.
Ce raisonnement se fonde toutefois sur l’hypothèse que la prolongation de la durée de vie du parc au-delà de quarante ans est la plus probable. Or, il n’existe aucune garantie en ce sens car l’ASN peut décider l’arrêt du fonctionnement d’une centrale à tout instant. Par conséquent, étaler l’amortissement des investissements accroît le risque de reporter une partie de la dépense sur une période durant laquelle les recettes mises en regard seraient moindres, en raison de la fermeture d’une partie des capacités de production.
B. DES ÉLECTRO-INTENSIFS EN DIFFICULTÉ MALGRÉ UN CONTEXTE DE BAISSE DES PRIX DE GROS
1. La France, historiquement bien placée, bientôt reléguée
Le témoignage des électro-intensifs, par la voie de Jean-Philippe Bucher, président-directeur général de FerroPem, ou de Jean-Pierre Roncato, président d’Exeltium, est sans équivoque : la situation des électro-intensifs est menacée à très court terme par les hausses prochaines du coût de l’électricité en France.
« Pour ces industries soumises à la concurrence internationale, l’approvisionnement en électricité est un enjeu de compétitivité majeur : il représente 15 à 50 % de leurs coûts de production. Compte tenu de la durée du cycle d’investissement dans les lignes de production de ces sites industriels – dix ans au minimum –, toute incertitude sur l’évolution du prix de l’électricité obère leur pérennité » (Jean-Pierre Roncato). « Aujourd’hui, nous ne sommes plus en mesure d’investir pour nous développer en France, par manque de visibilité sur le prix de l’énergie ; si nous passons des tarifs verts à l’ARENH au 31 décembre 2015, les simulations que nous avons faites avec EDF nous font passer, en termes de compétitivité, du premier tiers aux tout derniers rangs. Nous serons dès lors les premiers à disparaître en période de crise. C’est aussi simple que cela ! » (Jean-Philippe Bucher).
Alors que le tarif de l’électricité constituait un atout français, la perte de compétitivité est constatée de façon unanime, y compris vis-à-vis de l’Allemagne : « Nous assistons ainsi à une inversion complète du rapport entre la France et l’Allemagne en matière de compétitivité des prix de l’électricité : alors que, en 2009, les prix de marché en Allemagne étaient supérieurs au TaRTAM de 30 euros par MWh, ils seront de 35 euros par MWh environ en 2015, à comparer aux 42 euros de l’ARENH et aux 50 euros d’Exeltium » (Jean-Pierre Roncato).
La France subit directement la concurrence de pays qui pratiquent des offres très avantageuses en garantissant des prix bas pendant de longues périodes. Les pays les mieux placés sont ceux qui disposent d’abondantes ressources hydrauliques, comme le Canada ou la Norvège. Le Moyen-Orient, zone productrice de gaz, et les États-Unis, bénéficiant de l’effet du gaz de schiste, sont également compétitifs en raison des coûts de revient très faibles de leurs centrales à gaz. Enfin, avec une production d’électricité très majoritairement à base de charbon, la Chine développe une industrie électro-intensive très carbonée, mais qui, profitant de l’absence de régulation internationale du prix du carbone, se retrouve très favorisée en termes de compétitivité :
« Aujourd’hui, alors que la possession de centrales par les industriels électro-intensifs eux-mêmes est révolue en France, les pays qui disposent d’une production électrique compétitive, souvent issue de ressources locales, s’appuient sur ces spécificités pour développer des dispositifs favorables aux industries électro-intensives – l’hydroélectricité au Québec, aux États-Unis, au Brésil, en Norvège et en Russie ; le gaz dans les pays du Golfe ; le charbon en Chine » (Jean-Pierre Roncato).
« Nous sommes conduits à nous intéresser aux prix de l’électricité à l’échelle mondiale pour mener à bien notre développement stratégique et nous avons établi une short list de pays et de régions où nous pourrions obtenir de l’électricité à bon marché. Y figurent l’Islande, le Canada et les États-Unis, le Moyen-Orient, la Russie dans sa partie sibérienne, la Malaisie. La plupart ont en effet fortement investi dans la production hydraulique – c’est le cas en Sibérie, au Québec et en Malaisie – ou thermique – ainsi les États-Unis, avec le gaz de schiste, et le Moyen-Orient.
« Je ne peux pas donner trop de détails car nos contrats comportent des clauses de confidentialité, mais on peut trouver, même dans certains pays européens, des prix inférieurs à 30 dollars par mégawattheure et, dans le Golfe persique, des tarifs de 15 euros ! En tout état de cause, aucun des pays que j’ai cités ne pratique des prix supérieurs à 40 dollars et, la plupart du temps, il s’agit de tarifs publics, non négociés donc, accordés aux industriels grands consommateurs d’électricité pour les alimenter en tension de l’ordre de 200 kiloVolts. Je précise qu’il s’agit à chaque fois de prix aux bornes de l’usine, donc transport compris.
« Nous arrivons également à négocier des clauses d’indexation sur vingt ans, avec des plafonds d’augmentation de 2,5 % par an. C’est pour nous la garantie d’un prix compétitif sur toute la durée d’un investissement. On peut certes s’interroger sur la stabilité des prix que peut garantir un pays comme les États-Unis, où la pérennité de l’exploitation des gaz de schiste fait question, mais aucune volatilité de ce genre n’est à redouter lorsqu’il s’agit d’énergie hydraulique.
« Les pays que j’ai cités offrent donc des tarifs, et souvent, je le redis, des tarifs publics, bien plus faibles que l’ARENH » (Jean-Philippe Bucher).
2. Une augmentation de prix due à l’inflation de tous les postes de la facture
La perte de compétitivité du « site France » en matière de prix de l’électricité est l’addition de plusieurs facteurs. En premier lieu, les règles européennes imposent à tout consommateur la participation au financement du réseau. Ces règles ont une explication technique : aucun moyen de production n’est affecté à une usine en particulier, chaque site industriel bénéficie de l’effet de mutualisation induit par le réseau européen. Des pays non-européens adoptent toutefois une approche différente, justifiée d’un point de vue historique : « notre industrie est née en même temps que l’hydroélectricité et nos usines, installées dans les vallées des Alpes principalement mais aussi des Pyrénées, se sont développées il y a une centaine d’années en même temps que la houille blanche, de manière à pouvoir consommer l’électricité à l’endroit même où elle produite… Notre proximité avec les sources d’énergie fait que nous n’avons pas de coûts de transport, techniquement parlant, et indépendamment de la politique tarifaire – quelques centrales d’EDF sont même intégrées à nos sites » (Jean-Philippe Bucher).
En deuxième lieu, la part « fourniture » de la facture d’électricité des électro-intensifs subit la hausse des coûts de production du parc français, et notamment de sa composante nucléaire, comme en témoignent l’augmentation du prix de l’ARENH destinée à couvrir les investissements du « grand carénage » ainsi que les difficultés liées à Exeltium.
Enfin, les taxes destinées à participer au financement des énergies renouvelables, à la péréquation avec les territoires non connectés au réseau et aux tarifs sociaux sont un élément nouveau, dont l’impact est toutefois plafonné pour les électro-intensifs (62) à hauteur de 0,5 % de leur valeur ajoutée, en application de l’article L.121-21 du code de l’énergie.
Jusqu’à il y a récemment, la logique des tarifs réglementés de vente permettait non seulement d’amortir les hausses dans le temps, mais aussi de favoriser certaines catégories de consommateurs au détriment d’autres. Désormais, de telles latitudes ne sont plus possibles : les règles européennes interdisent de vendre à perte et les éléments régulés (le tarif d’accès au réseau et les taxes) doivent refléter l’intégralité des coûts. « Il n’y a certainement aucune recette magique, ne serait-ce qu’en raison de la surveillance exercée par l’Union européenne – surveillance qui n’existe pas sur les autres continents, où je négocie avec des gens qui cherchent plutôt à proposer des prix situés en deçà des tarifs publics » (Jean-Philippe Bucher).
3. Un « bouquet » de solutions ?
La France est mise au pied du mur et se doit de trouver des solutions pour conserver sur son sol les emplois des secteurs de l’aluminium, de la sidérurgie, du verre ou encore de la chimie.
L’amélioration de l’efficacité énergétique des procédés industriels constitue la première des pistes à creuser, même s’il semblerait que les électro-intensifs aient déjà fait une partie des améliorations nécessaires.
« Depuis des dizaines d’années, nous avons travaillé avec EDF, puis par nos propres moyens, à améliorer le profil de notre consommation. Ressemblant en cela aux industriels de l’aluminium, nous avons un facteur de charge très important : quand nos usines tournent, c’est en moyenne à 85 % de la puissance maximale, mais dans des conditions de stabilité qui facilitent l’exploitation des réseaux et des centrales, notamment nucléaires. Nous avons également investi dans des technologies qui nous permettent, à l’inverse, d’être extrêmement flexibles et de disparaître du réseau en quelques secondes si on nous le demande […] Nous continuons à bénéficier des tarifs EJP (effacement des jours de pointe). Nous pratiquons également la saisonnalisation, c’est-à-dire l’arrêt de nos activités l’hiver – avec les contraintes que cela emporte pour nous – afin de permettre un effacement complet de longue durée » (Jean-Philippe Bucher).
« Au vu de mon expérience, les industries fortement consommatrices d’énergie, que ce soit le gaz ou l’électricité, ont déjà envisagé toutes les solutions possibles en la matière et ont effectué, depuis de nombreuses années, les efforts nécessaires pour s’adapter. Pour elles, c’était une question vitale, l’énergie constituant une composante essentielle de leurs coûts de production. Paradoxalement, les gisements d’économie se trouvent plutôt chez les entreprises faiblement consommatrices ou pour qui l’énergie ne représente pas une part importante du prix de revient » (Jean-Pierre Roncato).
Il est toutefois possible de développer de nouveaux gisements en améliorant la rentabilité de l’interruptibilité et de l’effacement.
Le développement des capacités d’effacement dans le secteur de l’industrie a été freiné par l’écrasement du différentiel entre les prix de la base et de la pointe. L’espace économique est aujourd’hui très faible pour développer des systèmes d’effacement valorisés uniquement sur la vente d’énergie. En revanche, ces systèmes d’effacement pourront bientôt disposer de rémunérations complémentaires. L’article L.271-1 du code de l’énergie, introduit à la faveur de la loi du 15 avril 2013 dont l’auteur est le président de la commission d’enquête, donne la possibilité aux opérateurs d’effacement de bénéficier d’une prime dont le calcul tient compte des avantages que procure l’effacement pour la collectivité. Les capacités d’effacement ont également vocation à être rémunérées dans le cadre du marché de capacité et servir ainsi d’appui au développement des énergies renouvelables (voir le chapitre 1).
La deuxième piste de solution consiste à développer des montages du type Exeltium, dans lesquels les électro-intensifs agissent en tant que co-investisseur, mais selon des conditions de prix plus avantageuses. Deux actifs de production peuvent disposer de ces caractéristiques : l’hydroélectricité et le nucléaire historique. L’arrivée à échéance échelonnée des concessions hydrauliques peut permettre d’instaurer un nouveau cadre dans lequel une part de l’hydroélectricité produite serait mise à disposition des électro-intensifs au coût de production.
S’agissant du nucléaire, l’article L.336-8 prévoit que, suite à une évaluation du dispositif de l’ARENH avant le 31 décembre 2015, les ministres chargés de l’énergie et de l’économie proposent, le cas échéant, « des modalités permettant d'associer les acteurs intéressés, en particulier les fournisseurs d'électricité et les consommateurs électro-intensifs, aux investissements de prolongation de la durée d'exploitation des centrales nucléaires ». Pour autant que cette prolongation soit autorisée et économiquement attractive, cet article permettrait de dupliquer l’effet de levier utilisé par Exeltium pour permettre à ces entreprises de bénéficier d’un prix de l’électricité moins élevé que celui de l’ARENH – rappelons que le prix de l’ARENH intègre une rémunération des capitaux d’EDF au coût moyen pondéré du capital de l’entreprise.
Enfin, la troisième piste de solution a été soumise à la commission d’enquête par le président de la Commission de régulation de l’énergie, Philippe de Ladoucette : « Pour faire bénéficier les industriels allemands d’avantages spécifiques, l’autorité de régulation allemande peut s’appuyer sur un support législatif, lequel fait aujourd’hui défaut en France. Pour autant, comme nous ne sommes pas du tout insensibles à la situation de nos entreprises électro-intensives, nous avons décidé hier, je vous l’indique ici en avant-première, d’abaisser pour elles d’environ 50 % le TURPE (tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité) pour l’année à venir, sous certaines conditions de volume de consommation. […] Toutefois, il s’agit d’une mesure « à un coup ». Pour la suite, si le Gouvernement ou le législateur estime nécessaire de soutenir la compétitivité des entreprises électro-intensives en France, une loi sera nécessaire, précisant les niveaux de consommation à partir desquels telle ou telle réduction pourra être accordée sur le TURPE. »
Plus précisément, la CRE a tiré parti d’un « trop plein » exceptionnel de recettes de transport de 178 millions d’euros (63) par rapport aux estimations. Par définition, une telle situation n’est pas vouée à se reproduire. En revanche, le régulateur estime possible la mise en œuvre d’un mécanisme pérenne, inspiré de la législation allemande. Les industriels allemands bénéficient en effet d’exonérations partielles ou totales du tarif d’accès au réseau : les consommateurs intensifs ayant un profil de consommation régulier, dont la durée d’utilisation est supérieure à 7 000 heures, peuvent être exonérés et les consommateurs « anticycliques », qui consomment peu aux heures de pointe et beaucoup aux heures creuses, disposent de réductions pouvant atteindre 80 % du tarif de base (64). De tels mécanismes n’ont pas été contestés par la Commission européenne, et peuvent donc être retranscrits tels quels dans la législation française.
Au cours des 6 mois de son mandat, la commission d’enquête a entendu en audition l’ensemble des acteurs, s’est rendue sur plusieurs sites industriels nucléaires, a pris connaissance de nombreux documents et notamment du récent rapport de la Cour des comptes réalisé à sa demande. Elle est consciente des enjeux auxquels font face les entreprises de ce secteur : EDF est une société cotée en Bourse, AREVA est engagée dans une procédure d’arbitrage international, les deux sociétés mènent des négociations à forts enjeux commerciaux. Par ailleurs, le secteur nucléaire justifie de précautions spécifiques, notamment en matière de sécurité intérieure.
Dans cet esprit de responsabilité, au regard de la confidentialité d’un certain nombre d’informations,
Enjeux énergétiques et industriels globaux
LA COMMISSION
1. Exprime sa préoccupation concernant l’évolution des coûts de la filière nucléaire (coûts d’exploitation, mur d’investissement, améliorations de la sûreté et de la sécurité, érosion de la rentabilité des activités de la filière, coût croissant de l’EPR tête de série). Elle s’interroge sur les impacts potentiels de cette augmentation, si elle se poursuivait en série, sur le pouvoir d’achat des ménages, le prix de l’électricité pour les entreprises et l’avenir des entreprises de la filière, ainsi que sur la façon de mieux maîtriser ces coûts. Les incertitudes qu’entraîne l’arrivée prochaine des 40 ans de durée de vie des réacteurs et l’absence de connaissance précise des contraintes de sûreté qui conditionneraient une éventuelle prolongation et son coût rendent la perspective complexe. La commission a pris acte des informations qui lui ont été transmises et de l’attente, de la part des entreprises, d’orientations politiques claires avant d’engager certains investissements. La commission estime en conséquence qu’il revient aux pouvoirs publics de définir le cadre stratégique énergétique permettant de réduire les incertitudes pesant sur la filière, notamment à l’occasion de la loi de programmation sur la transition énergétique, afin d’optimiser les orientations industrielles et anticiper les mutations nécessaires, en prenant en compte le temps long, dimension temporelle incontournable des politiques énergétiques et notamment du nucléaire.
2. Estime nécessaire de renforcer la robustesse du système électrique national en réduisant sa vulnérabilité aux aléas techniques (avaries génériques, etc.) liées à la prépondérance d’une même technologie et d’un parc de production très homogène, en s’orientant vers un mix électrique équilibré. Estime que l’engagement présidentiel de ramener la part du nucléaire dans ce mix à 50 % en 2025 contribue à ce rééquilibrage. Considère nécessaire que des scénarios d’évolution du parc soient concertés de façon pluraliste afin d’atteindre ces objectifs, notamment au regard des perspectives d’évolution de la consommation d’électricité sur lesquelles elle a pris note des différents avis. Elle note que les acteurs industriels eux-mêmes ont engagé une politique de diversification dans le domaine de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables. Elle souhaite que la loi à venir permette à l’État stratège d’organiser cette évolution du mix en partenariat avec les acteurs industriels.
3. Estime indispensable que l’État se dote d’outils et d’instances d’expertise globale de la politique énergétique, organisant de façon pérenne et pluraliste l’évaluation, la comparaison technico-socio-économique des orientations et scénarios énergétiques, la comparaison des différentes filières en prenant en compte l’ensemble de leurs apports et de leurs coûts globaux, y compris les externalités induites. Considère que les orientations retenues doivent permettre que la transition énergétique soit une opportunité pour l’emploi, le pouvoir d’achat des ménages, la compétitivité économique, la sécurité en approvisionnement et en puissance, l’indépendance énergétique et la robustesse économique et énergétique de la France. Elle estime que le Débat sur la Transition Energétique, les différents rapports sur le coûts de la filière nucléaire, ceux de l’Autorité de sûreté nucléaire et de l’IRSN, ont significativement permis d’améliorer la connaissance et la transparence en matière énergétique. Pour autant, il manque encore de lieux permettant de confronter les approches respectives des différents organismes afin de permettre aux décideurs de faire les choix les plus pertinents. Elle estime notamment indispensable que l’État se dote d’une capacité d’expertise indépendante permettant, au vu des enjeux de sûreté et de leurs impacts en matière d’investissement, de contribuer au mieux à la planification des choix d’investissement et de leurs impacts sur les coûts globaux de la filière, notamment pour tout ce qui touche à la prolongation de la durée de vie des réacteurs.
4. Estime que la transition énergétique implique la mise en place de business models robustes et durables tant pour la production énergétique, l’efficacité énergétique, que le transport et la distribution de l’énergie. Estime que cette stratégie doit s’appuyer sur des champions industriels, au niveau national et européen, en favorisant l’organisation en filière ainsi que la diversification déjà entamée des principaux acteurs industriels du secteur afin qu’ils soient pleinement acteurs de la transition énergétique. Estime que l’État doit exercer sa pleine responsabilité en ce sens, particulièrement au sein des entreprises dont il est partie prenante, en commençant par sortir d’une forme de schizophrénie en ce qui concerne EDF. Estime par ailleurs indispensable une réforme du marché européen de l’électricité (qui, au même titre que les directives sectorielles en contradiction avec le paquet climat-énergie, ne permet pas d’adresser aux industriels les bons signaux économiques correspondant aux intérêts stratégiques, économiques et environnementaux, de l’Union), la mise en place d’un véritable prix du carbone, de mécanismes favorisant l’effacement, d’un marché de capacité ouest-européen et d’une organisation des réseaux et des interconnections favorisant les complémentarités et les économies d’investissement
5. Attire particulièrement l’attention sur la situation des entreprises électro-intensives particulièrement vulnérables aux prix de l’énergie, et sur la nécessité de leur assurer une protection juridiquement robuste, tout en les accompagnant dans leurs efforts d’efficacité énergétique. Se félicite de la décision de la CRE d’accorder une réduction de 50 % du TURPE pour ces entreprises et souhaite que cette décision soit pérennisée par la loi.
Enjeux de l’industrie nucléaire
6. Réaffirme l’impératif absolu de la sûreté comme élément incontournable des politiques en matière nucléaire et la volonté de viser les plus hauts standards en la matière. Estime que l’indépendance de l’Autorité de sûreté nucléaire en constitue un élément clé. Prend acte du programme d’investissement important prévu par les opérateurs pour mettre en œuvre les préconisations issues des ECS (Évaluations complémentaires de sûreté) post-Fukushima et partiellement réalisé. Soutient la volonté des organismes (ASN, IRSN) qui exercent le contrôle de la sûreté de voir confortée la doctrine de sûreté française et les moyens (humains, financiers, juridiques) leur permettant d’exercer toujours au mieux leur mission. Note avec intérêt la proposition de l’ASN d’informer plus régulièrement encore le Parlement. Soutient la volonté de l’ASN de réduire les niveaux de sous-traitance afin d’améliorer la sûreté. Estime qu’au vu de l’importance accordée par l’ASN à la vulnérabilité de l’approvisionnement électrique aux défauts génériques, une échelle de graduation de l’importance de ceux-ci contribuerait à la lisibilité des enjeux.
7. Attire l’attention sur l’importance des facteurs organisationnels et humains en matière de sûreté, au vu des difficultés rencontrées par EDF dans la gestion des arrêts de tranche et notamment la reprise d’activité, sur lesquels tant l’ASN que l’Inspecteur général pour la sûreté nucléaire et la radioprotection d’EDF, dans son dernier rapport, ont tiré la sonnette d’alarme. Soutient les propositions de ce dernier visant à une meilleure anticipation et organisation des chantiers, afin de réduire les incidents, les accidents du travail et les risques potentiels sur la sûreté. Prend acte des réorganisations en cours en ce sens au sein d’EDF et du programme de recrutement engagé afin de faire face à la fois à la pyramide des âges des personnels (départs à la retraite) et au surcroît de travaux importants. Souligne l’importance stratégique de ces préconisations au moment où EDF s’apprête à mettre en œuvre des chantiers de grande envergure : grand carénage, post-Fukushima, visites décennales, etc.
8. Souligne la réduction, que font apparaître les statistiques, des doses individuelles reçues par les travailleurs du nucléaire depuis 10 ans et l’importance du contrôle permanent des doses existant dans les installations nucléaires. Soutient tout ce qui peut être fait pour poursuivre cette nécessaire amélioration de la protection face aux risques des personnels, notamment en favorisant une harmonisation de la protection des sous-traitants et des salariés EDF : diminution des doses globales et individuelles, diminution des doses journalières, mise en place de CHSCT de sites, suivi médical épidémiologique et individuel, rattachement de chaque travailleur sous-traitant à un médecin du travail référent unique sur site nucléaire, robotisation des tâches les plus dosantes, prise en compte de la pénibilité.
9. Souligne l’importance de sécuriser le financement des charges futures du nucléaire (démantèlement, déchets) afin que celles-ci ne soient pas à la charge des générations futures. Note que la loi organise dorénavant de façon plus rigoureuse le provisionnement et que les entreprises en rendent compte régulièrement à leur tutelle. Note cependant que les modalités d’application font régulièrement l’objet de controverses. Soutient en conséquence la demande de la Cour des comptes de mettre fin aux dérogations successives au droit en ce qui concerne les actifs dédiés, qu’il s’agisse du taux d’actualisation et de la disponibilité des provisions en cas de besoin. Considère que la constitution d’un fonds dédié au sein de la Caisse des Dépôts et consignations, alimenté par les provisions des entreprises nucléaires, pourrait permettre une meilleure sécurisation de ces financements, éventuellement en venant renforcer les fonds de garantie nécessaire à la transition énergétique, et demande au Gouvernement un rapport permettant d’en mesurer l’ensemble des impacts.
10. Regrette de n’avoir pu, dans le calendrier qui était le sien, avoir connaissance des coûts potentiels d’un site d’enfouissement de déchets à Bure. Elle s’interroge sur la persistance d’écarts importants entre les évaluations respectives des différents acteurs et souligne, comme la Cour des comptes, la nécessité d’aboutir rapidement à un coût entériné par les pouvoirs publics. Prend acte de la volonté de l’ANDRA et du Gouvernement, suite au débat public, de conduire une phase pilote préalable d’expérimentation avant toute décision. Rappelle la demande de l’ASN de clarification de l’inventaire et de la nécessité d’évaluation des coûts selon les différents scénarios possibles. Insiste sur le rôle du Parlement dans la définition préalable des conditions de récupérabilité, dans le respect des principes fixés par la loi. Estime que la recherche sur l’entreposage en subsurface de longue durée devrait être conduite en parallèle. Estime que, comme cela a toujours été le cas concernant les déchets nucléaires, la décision finale devrait revenir au Parlement. Souligne, par ailleurs, l’importance de veiller dans la durée au traitement le plus sécurisé de l’ensemble des matières radioactives présentes sur le territoire, et de leur conditionnement dans le respect des règles fixées par l’ASN.
11. Note que la France ne dispose aujourd’hui d’aucune étude globale approfondie coûts / bénéfices de l’aval de la filière nucléaire (retraitement, fabrication du Mox). Estime qu’un rapport de la Cour des comptes sur la question permettrait d’éclairer les pouvoirs publics sur la pertinence des stratégies possibles, sur les potentiels économiques réels des matières valorisables (ou les conséquences de leur classement potentiel en déchets) ainsi que sur les options ouvertes par la mise au point éventuelle d’une « 4ème génération » de réacteurs. Approuve sur ce point les remarques émises par l’ASN et l’IRSN de laisser plusieurs voies ouvertes, et que la recherche en la matière s’inscrive dans la doctrine d’amélioration systématique de la sûreté et de réduction des déchets radioactifs.
12. Souligne les incertitudes persistantes sur l’évaluation des coûts de démantèlement des installations nucléaires. Se félicite du lancement par la ministre de l’Écologie d’un audit permettant d’en avoir une plus juste évaluation, notamment au regard des chantiers déjà entamés et réalisés ainsi que des expériences à l’étranger. Estime cette évaluation indispensable pour vérifier que les provisions passées par les industries nucléaires sont suffisantes pour faire face aux coûts. Estime, par ailleurs, que la filière du démantèlement constitue une opportunité industrielle majeure pour les acteurs nationaux du nucléaire. Préconise en conséquence que la réglementation soit adaptée, sous supervision de l’ASN, aux spécificités de ces chantiers de déconstruction et que les opérations de démantèlement sur notre territoire soient une opportunité de mise en évidence du savoir-faire des acteurs nationaux en la matière.
13. Souligne l’importance de l’implication citoyenne et associative pour la transparence et la sûreté nucléaire. Soutient en conséquence la demande des CLI et de l’ANCCLI de bénéficier de moyens supplémentaires, au travers de la taxe sur les INB, leur permettant d’assurer au mieux leur mission, et de renforcer par la loi leur association aux différentes étapes de la vie d’une installation nucléaire. Partage l’avis de l’ASN que des décisions aussi importantes que la création d’un site d’enfouissement de déchets ou la prolongation de la durée de vie d’un réacteur doivent faire l’objet d’une consultation du public renforcée.
14. Au regard des attentes entendues lors de ses rencontres avec les travailleurs et les élus lors de sa visite à Fessenheim, et des rendez-vous avec les élus régionaux et départementaux, estime indispensable la mise en place au plus vite de dispositifs spécifiques d’accompagnement lors de la fermeture d’installations nucléaires, notamment de réacteurs : encadrement juridique pour garantir la sûreté et le démantèlement ; garantie d’alimentation électrique du territoire par des moyens de production complémentaires et/ou renforcement des réseaux ; accompagnement économique des territoires concernant tant les emplois directs qu’indirects que l’impact sur les services publics et les collectivités locales ; sécurisation des parcours professionnels des personnels. Estime en conséquence nécessaire de renforcer le dialogue et la mission interministérielle compétente pour le site de Fessenheim et la mise en place d’un volet spécifique du CPER Alsace.
15. S’interroge sur les impacts potentiels d’un accident nucléaire, sur ses coûts et leur indemnisation, et constate le besoin d’expertiser ces questions de façon beaucoup plus importante. Estime nécessaire d’approfondir la recherche sur l’évaluation du coût potentiel d’un accident nucléaire, sur la base du travail mené par l’IRSN, et en le confrontant, comme celui-ci l’a souhaité, à des contre-expertises. Ces estimations doivent laisser un maximum de place à une analyse rationnelle des risques et des impacts. Considère que parallèlement doit être approfondie la recherche sur l’assurance et la prise en charge des coûts dans le cas d’un tel sinistre. Estime nécessaire d’explorer les différentes voies possibles de provisionnement, de mutualisation avec l’ensemble des acteurs nucléaires au niveau international, de couverture des risques des particuliers, etc. afin d’éclairer les pouvoirs publics sur les dispositifs les plus adaptés. Estime que cette évaluation complèterait l’évaluation globale des coûts du nucléaire, au même titre que les risques induits par le dérèglement climatique devraient être inclus dans le coût global des énergies fossiles. Estime que la garantie de fait apportée par l’État pour ces risques globaux devrait être inscrite au hors bilan des comptes de la France.
16. Constate les progrès effectués dans l’anticipation d’une éventuelle gestion de crise, notamment dans le cadre du CODIRPA. Attire cependant l’attention sur la nécessité de rendre plus opérationnels et lisibles de nos concitoyens les plans et procédures qui seraient mis en place, d’adapter les périmètres auxquels ils s’appliquent au retour d’expérience d’accidents majeurs à l’étranger, et d’harmoniser les dispositifs avec les pays voisins, particulièrement pour les installations nucléaires situées en zone frontalière.
Au cours de sa réunion du jeudi 5 juin 2014, la commission d’enquête a procédé à l’examen du rapport.
M. le président François Brottes. Notre réunion se déroule à huis clos, mais fera l’objet d’un compte rendu qui sera joint au rapport que M. Baupin va nous présenter.
Sur quelques points, j’ai souhaité des aménagements que j’ai discutés avec lui et dont je vous préciserai tout à l’heure la teneur. Vous pourrez ensuite formuler vos remarques, après quoi les groupes politiques auront jusqu’à vendredi, 17 heures, pour fournir une contribution s’ils le souhaitent. À l’issue de la réunion, nous voterons en vue d’autoriser la publication du rapport, amendé le cas échéant.
M. Denis Baupin, rapporteur. Ce rapport témoigne du travail important que nous avons fourni et je remercie tous ceux qui y ont pris part. Notre objectif était d’éclairer autant que possible le choix des décideurs, en particulier des parlementaires, dans la perspective de l’examen prochain du projet de loi sur la transition énergétique. De l’avis général et abstraction faite des positions de chacun sur le fond, cette commission d’enquête a contribué à éclaircir plusieurs questions.
Nous avons utilisé les chiffres présentés par la Cour des comptes dans le rapport qu’elle a établi à notre demande et que nous avons annexé au nôtre. Grâce à ce travail, certains coûts sont désormais bien établis, mais d’autres restent incertains, ce qui, de l’avis même de la Cour, nécessite de poursuivre l’analyse. D’autre part, certaines données évoquées au cours d’auditions à huis clos doivent demeurer confidentielles, soit pour des raisons de sécurité, soit en raison de leur enjeu commercial ; elles ne sont donc pas reprises dans le rapport, car il n’était évidemment pas question de mettre en danger les installations ni les entreprises de la filière, cotées en Bourse et engagées dans des négociations internationales.
Nous avons travaillé dans un délai d’autant plus contraint que les six mois dont dispose toute commission d’enquête pour mener à bien ses travaux ont été amputés dans notre cas de la période correspondant à la campagne des municipales. Nous avons néanmoins auditionné 75 personnes ou organisations et effectué trois déplacements sur le terrain – à Flamanville et La Hague, à Marcoule et Tricastin, enfin à Fessenheim – qui ont été fort utiles : il est bien plus éclairant d’observer soi-même les installations et de rencontrer les personnes concernées sur place que d’en discuter depuis Paris.
Je l’ai dit aux dirigeants d’EDF et d’AREVA : leurs équipes respectives ont apporté à nos travaux une contribution précieuse en nous fournissant les chiffres – même s’il n’a pas toujours été facile de tous les obtenir – et les informations nécessaires à une vision claire de la situation. Il convient de saluer cette coopération, même si elle est obligatoire dans le cadre d’une commission d’enquête.
J’en viens aux recommandations qui concluent le rapport.
Nous constatons en premier lieu que les coûts de la filière nucléaire augmentent, pour plusieurs raisons : l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) a demandé que la sûreté soit renforcée à la suite de l’accident de Fukushima et à ces coûts et à ceux de la maintenance s’ajoutent ceux des nouvelles installations, à Flamanville comme à l’étranger. En effet, si l’on ne peut évaluer aujourd’hui le prix du mégawattheure qui sera produit à Flamanville, la Cour des comptes juge que le coût d’un EPR sera plus élevé que celui d’un réacteur de deuxième génération, même en tenant compte d’une durée d’exploitation de soixante ans.
Deuxièmement, nous soulignons la nécessité, souvent rappelée par l’ASN, de renforcer la robustesse de notre système électrique afin d’éviter des incidents génériques qui nous obligeraient un jour à choisir entre la sûreté nucléaire et l’approvisionnement électrique de notre pays. Le fait que 78 % de notre alimentation électrique provienne d’une même technologie et d’un parc très homogène nous rend vulnérables. Il convient par conséquent que soit respecté l’engagement de rééquilibrer notre mix électrique.
Troisièmement, nous constatons qu’il a fallu une commission d’enquête parlementaire pour que l’on s’attache enfin à déterminer clairement les coûts potentiels de la filière, les contraintes de sûreté et leurs conséquences sur les investissements à consentir, alors que ce travail devrait être mené sous l’égide de l’État. Nous souhaitons donc que celui-ci se dote d’outils de pilotage à cette fin. Pour autant que nous puissions le savoir, il semble que le projet de loi sur la transition énergétique aille dans ce sens en prévoyant l’installation de comités d’experts chargés de collecter les données utiles. Nous avons néanmoins tenu à souligner que, lorsqu’il s’agit d’évaluer le coût des investissements résultant des contraintes de sûreté définies par l’ASN, il faut non seulement donner la parole à l’exploitant, mais accorder un droit de regard aux services de l’État.
Quatrièmement, la transition énergétique suppose l’élaboration de modèles économiques (business models) robustes, à l’intention des entreprises concernées. Y concourt la diversification de la production entamée par les entreprises de la filière nucléaire, que ce soit EDF avec EDF Énergies nouvelles ou AREVA avec les appels d’offres concernant l’éolien offshore. L’État en tant qu’actionnaire ou stratège peut contribuer à ce que la transition énergétique s’appuie sur des acteurs industriels reconnus au niveau national ou européen, voire au niveau mondial, en particulier en envoyant les bons signaux-prix. Or la commission d’enquête constate avec bien d’autres observateurs que, de ce point de vue, le marché européen de l’électricité ne fonctionne pas de façon satisfaisante. Nous avons besoin d’un véritable prix du carbone, d’un marché de l’effacement, de capacités de stockage, etc.
La cinquième de nos recommandations est en faveur des électro-intensifs, sur le cas desquels nous avons été alertés à plusieurs reprises. Il y a un consensus entre nous sur la nécessité de les protéger, afin d’éviter que la hausse du prix de l’électricité ne les incite à s’expatrier. C’est d’ailleurs devant la commission d’enquête que la Commission de régulation de l’énergie (CRE) a proposé de leur accorder une réduction de moitié du tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité (TURPE). Pour être pérennisée, cette mesure nécessite une disposition législative que nous appelons de nos vœux.
Notre sixième recommandation porte sur les questions de sûreté. Nous avons en France, en particulier grâce à l’indépendance de l’ASN et à l’existence des commissions locales d’information (CLI), un système de sûreté unique et reconnu même par les acteurs les moins favorables au nucléaire. Nous devons être d’autant plus à l’écoute de l’ASN lorsqu’elle demande des moyens supplémentaires – humains, financiers, juridiques – pour mener à bien un travail accru du fait du grand carénage et de la construction de l’EPR, et pour faire respecter ses recommandations par les exploitants.
En septième lieu, nous recommandons de « muscler » la maintenance, qui pose au sein des centrales des difficultés sur lesquelles EDF elle-même a alerté par la voix de son inspecteur général pour la sûreté nucléaire. Les savoir-faire se perdent, notamment à cause des départs à la retraite. Cette recommandation est d’autant plus importante à l’heure où de nombreux chantiers sont en préparation.
Notre huitième recommandation concerne la protection des travailleurs du nucléaire. En la matière, des progrès ont déjà été accomplis : les doses qu’ils reçoivent ont globalement baissé depuis une dizaine d’années. Nous soutenons toutes les mesures susceptibles d’améliorer encore la situation et d’harmoniser la protection des travailleurs quels que soient leur statut – salarié d’EDF ou sous-traitant – et le lieu où ils interviennent.
La neuvième recommandation porte sur les charges futures. Par cette expression que le président Brottes n’aime guère, car il estime qu’elles ont pour partie déjà donné lieu à des engagements, il faut en réalité entendre les charges qui incomberont à la filière y compris dans l’hypothèse d’une cessation de son activité : celles du démantèlement des installations et de la gestion des déchets radioactifs. Chacun en conviendra, c’est dès aujourd’hui qu’il faut sécuriser ces financements. Nous soutenons donc les recommandations de la Cour des comptes en ce sens, qu’elles concernent le taux d’actualisation ou la fin du système de dérogations. Nous recommandons, en outre, d’étudier une suggestion que plusieurs groupes politiques de notre Assemblée ont formulée dans des propositions de loi : le placement des provisions destinées à couvrir ces charges dans un fonds dédié auprès de la Caisse des dépôts. Cette proposition est donc versée au débat, notamment dans le cadre de la discussion sur le projet de loi de transition énergétique.
La dixième recommandation concerne le projet de centre industriel de stockage géologique, Cigéo. C’est finalement la Cour des comptes qui nous a renseignés sur son coût, dont nous n’avions pu obtenir aucune estimation de la part des représentants de l’ANDRA, malgré notre insistance. Entre les exploitants et l’ANDRA, l’évaluation varie du simple au double : de 14 à 28 milliards d’euros. Il y a donc là un élément d’incertitude alors que le Gouvernement doit annoncer un chiffre cet été. Actuellement, les entreprises se fondent sur l’estimation la plus basse pour constituer leurs provisions ; dès lors, on peut craindre un surcoût. Même si, comme la Cour des comptes l’a souligné, l’effet sur le prix du kilowattheure ne doit pas être massif, il convient de provisionner au bon niveau.
Nous nous sommes également intéressés à l’aval de la filière, en particulier dans le cadre de nos déplacements à La Hague et à Marcoule : retraitement, fabrication du MOX, quatrième génération de réacteurs. Sur ce dernier sujet, les positions diffèrent au sein de la filière elle-même quant à la sécurité et aux pistes à privilégier. C’est assez logique dans la mesure où on en est encore au stade de la recherche, mais le débat sur les coûts et bénéfices doit être le plus ouvert possible pour éclairer les Pouvoirs publics. Tôt ou tard, il nous faudra en demander une évaluation globale et impartiale, sans doute à la Cour des comptes, qui nous a dit ne pas pouvoir le faire dans le temps qui nous séparait de la fin de nos travaux.
En matière de démantèlement, objet de notre douzième recommandation, plusieurs opérations sont en cours, mais trop peu sont achevées pour que nous puissions évaluer correctement les coûts – le seul constat étant celui d’un dépassement général des devis. L’audit annoncé par le Gouvernement pourrait favoriser une juste estimation qui ne soit pas tributaire du seul point de vue des exploitants, en vue d’un provisionnement adéquat. Par ailleurs, les industriels nous l’ont clairement indiqué, le démantèlement est une source d’activité économique et d’emplois, en France et à l’étranger.
Au nom de la transparence et de la nécessité d’impliquer le public, notre treizième recommandation tend à assurer aux comités et commissions locales d’information ainsi qu’à leur association nationale les moyens prévus par les textes mais qui ne leur ont jamais été alloués, afin qu’ils puissent faire correctement leur travail dont tous reconnaissent l’utilité. Je le répète, nous sommes le seul pays au monde à posséder en matière d’activité nucléaire un tel dispositif de contrôle citoyen associant toutes les parties prenantes.
Dans notre quatorzième recommandation, nous soulignons qu’il est de la responsabilité des Pouvoirs publics d’accompagner la fermeture des installations nucléaires, quel que soit le moment où celle-ci aura lieu, en veillant à la sécurité de l’approvisionnement électrique, grâce au développement de la production locale ou au renforcement des réseaux, mais aussi à la reconversion industrielle et au maintien de l’activité et des services publics dans les territoires concernés.
La quinzième recommandation a trait aux questions d’assurance. Si un accident nucléaire majeur devrait se produire, les textes sont clairs : c’est l’État qui serait mis à contribution – en tout cas à titre principal, car bien que la Cour des comptes écrive que l’État assure gratuitement contre ce risque, une partie demeure tout de même à la charge des exploitants. Il faut pouvoir chiffrer le coût qui en résulte, en équivalent assurance, afin de pouvoir comparer les différentes filières sous ce rapport. Ce qui soulève un problème très concret, que formulait déjà la Cour des comptes dans sa première étude : doit-on provisionner par avance la somme nécessaire pour faire face à un accident, ou est-ce à ceux qui le subiront de payer ? La pollution due aux pétroliers est indemnisée par les Fonds internationaux d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures (FIPOL). Le fait qu’il n’en existe pas d’équivalent dans le domaine du nucléaire pose un problème éthique dans la mesure où ce sont les victimes futures qui paieront, plutôt que ceux dont la consommation d’électricité aura conduit à l’accident. Cette question de l’internalisation des coûts externes se pose d’ailleurs également à propos des dégâts du réchauffement climatique.
La seizième et dernière recommandation concerne la gestion de crise en cas d’accident nucléaire. En la matière, nos capacités d’anticipation se sont améliorées, notamment grâce aux travaux du Comité directeur pour la gestion de la phase post-accidentelle d’un accident nucléaire ou d’une situation d’urgence radiologique (CODIRPA). Ces avancées résultent notamment de la réaction de l’ASN à l’accident de Fukushima, ainsi que de celle de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN), mobilisé du fait de la présence de citoyens français au Japon ou de l’importation de produits en provenance de ce pays. Toutefois, des progrès restent à faire : nous l’avons constaté à Fessenheim, les consignes à suivre en cas d’accident – faut-il se calfeutrer ou au contraire s’éloigner ? – ne sont pas harmonisées de part et d’autre de la frontière.
M. le président François Brottes. Merci, monsieur le rapporteur.
Précisons que, si vous avez employé la première personne du pluriel, c’est bien parce que les recommandations formulées dans le rapport le sont au nom du rapporteur et du président de la commission d’enquête : j’en assume le contenu jusque dans le détail.
Je me félicite du travail utile, et même nécessaire, que nous avons accompli. Le rapport distingue, chapitre après chapitre, le certain de l’incertain en présentant les différents points de vue de la manière la plus objective possible. Il ne prend pas parti pour ou contre l’énergie nucléaire, mais pose les questions qui doivent l’être. Certes, le rapporteur en termine systématiquement par la thèse dont il se sent le plus proche, mais cela relève de sa marge de manœuvre légitime ; l’important est qu’il fasse état des positions en présence et des échanges que nous avons eus ou entendus, ce qui est le cas.
Je reste simplement quelque peu sur ma faim pour ce qui est de la partie consacrée au risque : nous n’en sommes pas encore arrivés à une approche totalement rationnelle, à mon avis. Cela étant, nous avons identifié les problèmes et les questions majeures sur un sujet qui mériterait qu’on lui consacre une étude entière.
J’ai demandé au rapporteur de procéder à quelques modifications, ce qu’il a accepté. Elles seront donc intégrées au rapport, à la différence des amendements que les membres de la commission d’enquête pourraient proposer et qui relèveront de contributions spécifiques. Outre quelques corrections de forme, j’ai ainsi souhaité que nous soyons plus pédagogues, en ajoutant au chapitre 5 une description de la contribution au service public de l’électricité (CSPE) et en expliquant, au chapitre 9, la manière dont sont constitués les tarifs. J’ai également demandé que soit mentionnée la précarité énergétique à la page 14 de l’introduction, qui souligne l’importance de la politique énergétique pour la compétitivité des entreprises, mais ne parlait jusqu’à présent pas des ménages. J’ai aussi souhaité un complément sur l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), qui accomplit un travail remarquable de lutte contre la prolifération et déploie dans toutes nos installations un dispositif de contrôle très performant.
Enfin, j’ai demandé que soit réécrit, page 91, le paragraphe relatif au chantier finlandais d’Olkiluoto, dont la version initiale tendait à remettre en cause la filière en tant que telle. Le rapporteur et moi-même nous sommes mis d’accord sur la rédaction suivante : « La réédition, sur le chantier de l’EPR d’Olkiluoto, en Finlande, de délais et surcoûts similaires amène, selon les dernières estimations, le coût final du projet finlandais à environ 8,5 milliards d’euros. Il n’appartient pas à la commission de se prononcer sur les responsabilités respectives du constructeur et du futur exploitant, ni sur les exigences de l’autorité de sûreté finlandaise. » Cette version est plus sobre.
M. le rapporteur. Moins maladroite.
M. le président François Brottes. Dans un contexte de contentieux lourd, elle pose une question, prend acte d’un état de fait, mais évite de tirer des conclusions à la place des juges.
M. Jean-Pierre Gorges. Le titre du rapport est conforme à l’objet qui était assigné à la commission d’enquête, mais je trouve étonnant que, quitte à le modifier, il ne fasse pas de place à une préoccupation vers laquelle nous avons dérivé tout au long de nos travaux, à savoir la transition énergétique.
Nous avons bien senti que notre rapporteur abordait ce travail avec un a priori, comme en a témoigné le choix de certaines des personnes auditionnées, dont on se demande ce qu’elles ont apporté au débat sinon quelques moments épiques. D’autre part, alors que nous étions au milieu d’une campagne électorale, certaines réunions ont été organisées à des moments qui ne facilitaient pas notre participation, ce qui n’a pas été le cas pour la mission d’information sur l’écotaxe, présidée par Jean-Paul Chanteguet et dont j’étais également membre, de sorte que je puis faire la comparaison. Même ayant remporté mon élection au premier tour, je n’ai pu visiter les sites nucléaires comme cela aurait été mon souhait !
Cependant, à mesure que nous avancions dans nos auditions, j’ai noté que l’attitude de notre rapporteur évoluait, peut-être sous l’influence de ce qu’il entendait. Il reste que, ayant participé par goût à plusieurs commissions d’enquête ou missions d’évaluation et de contrôle, je n’en ai jamais vu conduites de cette façon : en général, on y commence par s’efforcer à une objectivité maximale, quitte à laisser percer sa subjectivité par la suite. Je me souviens par exemple de la commission d’enquête sur les emprunts toxiques, que présidait Claude Bartolone et dont j’étais rapporteur : nous n’étions pas du même avis au début, il n’empêche que nous avons fini par voter le rapport à l’unanimité.
Dans ce rapport, la sécurité l’emporte sur toute autre considération et, par exemple, les coûts futurs du nucléaire, mentionnés pourtant dans l’intitulé de la commission, ont été négligés – hormis ceux de la quatrième génération, dont vous venez de dire qu’elle serait plus chère que les précédentes alors que tout a démontré le contraire.
Je ne retrouve pas dans ce rapport bien des points essentiels, dont un dont la démonstration, elle, a été faite, à savoir que l’électricité d’origine nucléaire est la moins chère, même si son prix doit continuer d’augmenter et même si tous les coûts n’ont pas été pris en compte. D’où l’intérêt de l’étude à venir, qui fera la comparaison avec les autres sources d’énergie.
Non seulement le nucléaire est l’énergie la moins chère, mais c’est aussi la plus propre. L’intermittence des énergies alternatives est en effet génératrice d’émissions de CO2. Les Allemands, j’ai pu le constater ce week-end, doivent payer de plus en plus cher leur électricité tout en étant soumis à une pollution accrue. Il convient donc de souligner que la France est le pays où le taux de rejet de CO2 est le plus faible, rapporté à sa production d’électricité.
Avec nos centrales de troisième génération, le combustible ne pèse que pour 10 % dans le prix de revient du kilowattheure mais, comme l’explique bien le rapport, il nous suffit d’adopter une nouvelle technologie – que nous avions d’ailleurs sous la main au moment où nous avons arrêté Superphénix, en 1998 – pour que, avec la quatrième génération, la ressource en uranium connue passe de 130 ans – disons de 70 à 80 ans au pire – à 5 000 ou 7 000 ans : autrement dit, ce sera une ressource illimitée ! Il faudrait le faire savoir à tous nos concitoyens, au lieu de tenir cette information confidentielle, de propos délibéré de la part de ceux qui y ont intérêt. Et que sera-ce avec les générations de réacteurs suivantes ? Le progrès sera sans doute le même qu’en informatique ! Ayons donc confiance en la science et en la technologie ! Le crédit d’impôt recherche n’a pas été créé pour rien. Nous traitons ici de domaines que nous commençons seulement d’explorer et nous faisons comme si le mouvement devait s’arrêter ! Sur tout ce pan prospectif de la question qui nous était posée, je trouve donc le rapport très faible, alors que beaucoup d’auditions nous ont fourni des données objectives que nous aurions pu exploiter. À l’étranger, la quatrième génération est déjà à l’ordre du jour et, comme souvent, nous nous laisserons devancer…
Il en est d’ailleurs un peu de même en ce qui concerne la troisième génération : nous nous apprêtons à arrêter Fessenheim alors qu’aux États-Unis, on va exploiter le réacteur jumeau pendant soixante ans, voire quatre-vingts. Nous prenons des décisions fondées sur des considérations politiques, subjectives ou purement conjoncturelles.
Pour ce qui est de la sécurité, je suis entièrement d’accord avec le rapporteur. Il serait stupide de contester ses recommandations en la matière, notamment celle qui tend à intégrer dès à présent le traitement des déchets aux coûts de la filière. En revanche, il n’est aucune technologie, aucun dispositif qui permette de prendre en compte l’accident ultime – le faire ne peut revenir qu’à condamner la production nucléaire, comme cela conduirait à ne plus mettre une voiture sur les routes ou à ne plus construire d’usines chimiques, sachant que Seveso a fait plus de morts que tous les accidents nucléaires à ce jour. C’est d’ailleurs une loi qui vaut dans bien des domaines : c’est à l’État d’assumer la charge dans de telles circonstances extrêmes. Et, comme pour les retraites, la question est en effet de savoir s’il faut ou non anticiper, en économisant. Il en va ici comme pour l’achat d’une maison : le choix est entre épargner pour la payer comptant et souscrire un crédit, avec tous les aléas que cela comporte. Il n’y a pas lieu de faire d’une loi générale un argument contre le nucléaire, qui repose peut-être lui aussi sur une forme de crédit. Je m’étonne d’ailleurs que le rapporteur, bien au fait des réalités technologiques, oublie ce que peut apporter la recherche : il y a des solutions qu’on trouve en marchant ! Et c’est parce qu’on le savait qu’on a pu découvrir l’Amérique ou aller sur la Lune ! Le principe de précaution – je fais partie des cinq qui ont voté contre – est fait pour les animaux, pas pour l’homme ! L’homme teste, prend des risques à tout bout de champ et avance grâce à ses erreurs quand un animal ira toujours paître au même endroit.
C’est cet esprit que je ne retrouve pas dans le rapport : on n’a pas essayé de déterminer le coût à consacrer à la quatrième génération, en prévoyant bien sûr toutes les mesures de sécurité nécessaires mais en sachant que plus une technologie progresse, plus il y a convergence des solutions aux problèmes qui se présentaient initialement divers : tout s’améliore en même temps. Il en a été ainsi en informatique, hormis pour ce qui est de la dissipation de chaleur, et il en ira de même dans le nucléaire. Déjà, la quatrième génération présente, surtout par rapport à la deuxième, une valeur ajoutée en matière de sécurité et permet la transformation des déchets ultimes. On ne peut pas ne pas en tenir compte…
M. le président François Brottes. Le rapport en fait état.
M. Jean-Pierre Gorges. Le problème est ce qu’en retiendront les journalistes dans un document qui insiste avant tout sur ce qui peut faire peur. Les recommandations en faveur d’une amélioration de la sécurité, par exemple par la généralisation des redondances, sont incontestables, mais on ne peut faire abstraction du fait qu’il n’existe pas d’alternatives au nucléaire : ce ne peut être ni le photovoltaïque, ni l’hydraulique, ni, après l’arrêt du Conseil d’État, l’éolien, qui est en dernière analyse financé par l’État. Partout où on recourt à ces énergies nouvelles, il faut rallumer les chaudières au fioul ou au gaz ! Si ce rapport doit faire peur, ce devrait plutôt être pour convaincre d’investir dans la maintenance des réacteurs de deuxième et troisième générations, afin de les sécuriser et de prolonger leur vie, ce qui en abaisserait mécaniquement le coût comme l’a indiqué la Cour des comptes et nous donnerait du temps pour travailler aux technologies de l’avenir.
Pour résumer, la transition énergétique passera certainement par plusieurs voies mais, pour ce qui est du nucléaire, elle doit se faire vers une quatrième génération dans laquelle le combustible acquiert une durée de vie illimitée. Il faut donc investir dans la recherche tout en confortant la troisième génération afin de nous ménager les vingt années nécessaires pour ce saut technologique. Le pire qui puisse nous arriver, c’est que ce soient la Chine, les États-Unis ou le Royaume-Uni qui fassent ce saut – ou encore le Japon, qui s’est remis au nucléaire, ou l’Allemagne, qui pourrait s’y remettre. En effet, le constat est là pour tous : personne n’est mort du fait du nucléaire, pas même à Fukushima où c’est le tsunami qui a tué. Mais, dans ce rapport, on a opté pour faire peur avec ce qui fait notre force ! Pour moi, libéral-social, qui ne suis gaulliste que par admiration pour l’auteur d’une décision qui a assuré à la France trente années de tranquillité, je dois avouer que ce qui m’inquiète, c’est la suite !
M. Michel Sordi. Nous avons besoin, en effet, d’un vrai débat sur l’énergie, en partenariat avec nos voisins proches, en particulier allemands et suisses.
Je regrette comme M. Gorges l’arrêt de Superphénix, décidé en 1997 par Mme Voynet : c’était un outil de recherche et développement dont nous avons toujours besoin pour mettre en service les réacteurs de quatrième génération grâce auxquels nos réserves connues d’uranium passeront de 130 ans à plus de 6 000 ans.
Je me suis bien sûr intéressé avant tout à la partie du rapport consacré à Fessenheim. Alors que la ministre décrit le démantèlement de cette centrale comme une expérimentation en grandeur nature, le rapport rappelle très honnêtement qu’EDF dispose d’une certaine expérience en la matière pour avoir déjà procédé au démantèlement de centrales graphite-gaz et d’autres installations nucléaires de base : elle n’a donc pas besoin de la fermeture de Fessenheim pour apprendre à faire !
D’autre part, contrairement à ce qu’on annonce, le démantèlement ne créera pas beaucoup d’emplois, dans la mesure où il s’étalera dans le temps. On semble nous promettre des miracles…
M. le président François Brottes. Ce n’est pas le cas de ce rapport !
M. Michel Sordi. …mais rappelons que ce sont 2 200 emplois, directs ou indirects, qui sont menacés de disparaître dans vingt-quatre mois, c’est-à-dire demain, sans qu’aucune solution concrète soit offerte à ces salariés. Le rapport le reconnaît : « Malheureusement, le déplacement de la commission sur place a conduit à constater que les conditions ne sont pas réunies pour que le processus de mise à l’arrêt se déroule dans les meilleures conditions de dialogue et de prise en compte des attentes des salariés, des entreprises et des collectivités locales. » De fait, lors de la réunion à la préfecture de région, on nous a prodigué beaucoup de bonnes paroles, on a évoqué quantité de procédures, mais, à la question que je posais : « Est-il prévu un seul projet concret pour compenser la suppression de 2 200 emplois dans vingt-quatre mois ? », la réponse a été négative.
Toute l’économie locale sera affectée par la fermeture de la centrale. Avec le départ des agents, ce sont 300 à 400 maisons qui seront à vendre dans les villages alentour, des classes et des commerces qui disparaîtront. Pour les collectivités, ce sera la perte de 50 millions d’euros de taxes et autres recettes, de sorte, précise le rapport, que la commune verra « sa capacité d’autofinancement devenir fortement négative à partir de 2020, (…) à hauteur de 2,8 millions », alors que « le territoire de Fessenheim (…) est dans une position relativement inconfortable pour ce qui est des perspectives de développement ». L’adverbe « relativement » est certainement de trop…
Mais je ne puis suivre le rapporteur sur d’autres points, par exemple lorsqu’il affirme que « l’impact de la fermeture de la centrale sur le réseau électrique est bien cerné ». Et si, aujourd’hui, RTE « considère que l’approvisionnement de l’Alsace sera assuré sans risque à compter de 2017 », il faut croire qu’il a modifié sa position si l’on se réfère à l’étude diligentée par le conseil général, dont vous avez été destinataire, monsieur le président…
M. le président François Brottes. Nous ne l’avons pas reçue.
M. Michel Sordi. Comment est-ce possible ? Lorsque j’ai relancé les services qui tardaient à me l’envoyer, ils m’ont assuré qu’elle vous serait adressée en même temps qu’à moi.
M. le président François Brottes. C’est un élément que nous aurions volontiers intégré au rapport et que j’avais donc demandé ; nous avons reçu la présentation PowerPoint mais pas l’étude elle-même.
M. Michel Sordi. Il ressort de cette étude qu’une fois la centrale à l’arrêt, et sachant que tirer une ligne à haute tension prendra dix ans compte tenu des procédures nécessaires et des recours inévitables, on en sera réduit à « bricoler » sur les transformateurs sans parvenir à faire face aux pointes de consommation. En effet, le potentiel éolien est relativement limité dans la plaine d’Alsace et, sauf peut-être sur les crêtes, bien inférieur à ce qu’il est de l’autre côté de la frontière. Il est certes possible de développer géothermie et méthanisation, ainsi que d’aménager des champs de panneaux photovoltaïques mais, en 2013, la CRE n’a retenu que des dossiers concernant le sud de la France, aucun pour l’Est : on veut fermer notre centrale, mais on ignore nos réponses aux appels d’offres ! En tout état de cause, le potentiel des énergies thermiques ne dépasse pas 150 mégawatts, auxquels peuvent s’ajouter 350 mégawatts grâce à l’hydraulique, c’est-à-dire au Rhin – mais celui-ci est à l’étiage l’hiver. Il va donc nous manquer de l’énergie pour assurer une qualité d’approvisionnement constante et, pour écrêter les pointes, nous ne pourrons compter sur les Allemands que lorsqu’ils auront un surplus d’électricité d’origine éolienne et nous ne pourrons nous adresser aux Suisses, qui importent de l’électricité de France.
Il est donc certain que nous aurons des problèmes, que nous ne pouvons espérer régler dans les vingt-quatre mois qui viennent. Le risque est grand, par exemple, que les industries électro-intensives qui se sont installées dans la plaine d’Alsace en comptant sur la centrale et sur les ressources hydrauliques ne se relocalisent.
Cette décision de fermeture est avant tout politique, comme il est dit dans le rapport…
M. le président François Brottes. En définitive, vous êtes d’accord avec ce qui y est dit du sujet !
M. Michel Sordi. On fait valoir que Fessenheim est la plus ancienne de nos centrales et qu’elle est construite sur la plus grande nappe phréatique d’Europe. Mais, lors de la visite, vous avez pu constater qu’un récupérateur de corium avait été installé sur chacun des deux réacteurs et, comme les représentants de l’ASN nous l’ont expliqué, il est exclu que la nappe soit polluée en cas d’accident.
Selon Mme Royal, les normes actuelles de sécurité interdiraient de construire aujourd’hui la même centrale. Certainement, mais cela vaut pour toutes les autres. Ne chargeons donc pas Fessenheim : cette centrale est en parfait état de fonctionnement ; 200 millions d’euros ont été investis pour changer les générateurs de vapeur et 50 autres ont été consacrés à des travaux de sécurité « post-Fukushima ». Je voudrais donc que vous alliez au bout de vos conclusions, monsieur le rapporteur : puisque vous constatez à juste titre que « les conditions ne sont pas réunies pour que le processus de mise à l’arrêt se déroule dans les meilleures conditions », dites clairement que la centrale ne doit pas fermer dans deux ans, mais doit continuer d’être exploitée pendant les dix années autorisées par l’ASN pour chaque réacteur, afin de mettre à profit les 500 millions qu’elle rapporte annuellement pour développer les énergies renouvelables ou la recherche sur la quatrième génération.
M. Christian Bataille. Le ton de ce rapport est plus mesuré que ce que l’on pouvait craindre : M. Baupin a retenu sa plume, et sans doute le président a-t-il lui-même joué un rôle modérateur.
Des questions restent néanmoins posées, ne serait-ce que parce que tout coûte. Même si le rapport a le mérite de faire litière de la fable des coûts cachés, propagée par certains amis de M. Baupin, il reste que les montants en jeu sont considérables : 200 milliards d’euros déjà dépensés et 80 milliards de dépenses prévisibles, dont environ 30 milliards pour le projet Cigéo de Bure. Le coût du démantèlement, que le rapporteur n’a pas chiffré, se monte à lui seul à 30 milliards également ; et EDF consent chaque année environ 9 milliards de dépenses. Les Anglais, sans doute éclairés par les exemples de Flamanville et de l’EPR finlandais, viennent de réévaluer à quelque 9,5 milliards d’euros le coût de chacun des deux réacteurs qu’ils construisent.
Ces chiffres doivent néanmoins être comparés avec d’autres. Les techniciens estiment le coût de la rénovation énergétique à 300 euros par mètre carré, si bien que la facture de la rénovation de 500 000 logements par an, selon l’objectif fixé par le Président de la République, atteindrait 15 milliards, et ce pour une économie de 7,5 térawattheures. Un EPR, rappelons-le, coûte de 6 à 8 milliards et produit 10 térawattheures. L’énergie la moins chère est celle que l’on économise, a-t-on coutume de dire : nous voyons qu’il n’en est rien. Tout a un coût, je le répète, y compris les économies !
L’arrêt de la production d’électricité nucléaire serait compensé par des importations d’hydrocarbures ou, à l’exemple des Allemands, de charbon. Or, s’agissant du pétrole et du gaz, le déficit de notre balance commerciale atteint 68 milliards d’euros par an, soit 80 % du déficit global du commerce extérieur. On pourrait multiplier les chiffres ; tous infirmeraient le préjugé selon lequel le nucléaire est une énergie très coûteuse, comparée à d’autres qui le seraient peu. J’ajoute qu’il faut aussi tenir compte du critère de la durée. Pour le nucléaire, l’unité de temps est de cinquante à soixante ans, alors que nos décisions politiques s’inscrivent dans le cadre d’un mandat de cinq ans.
L’effort en faveur du nucléaire, cher collègue gaulliste, a commencé bien avant le général de Gaulle : il remonte à la IVe République, les gouvernements de Pierre Mendès France et de Guy Mollet ayant précédé en ce domaine le général de Gaulle. Celui-ci a recueilli les fruits de cette politique, qu’on lui a ensuite attribuée grâce à un certain art de la propagande. François Mitterrand lui-même a poursuivi cet effort, tout comme Lionel Jospin.
M. Bernard Accoyer. Non : lui a fermé Superphénix !
M. Christian Bataille. Pour en revenir au rapport, j’en salue donc la retenue, en particulier en ce qui concerne les recommandations, à l’exception d’une seule : celle qui a trait à la fermeture de Fessenheim. Je désapprouve cette décision, quoi qu’ait déclaré le Président de la République à ce sujet. Fessenheim est la plus vieille centrale française, entend-on souvent dire. Or elle n’a que trente-sept ans, et fait l’objet d’une autorisation décennale : au regard de l’âge moyen des centrales américaines, il est très abusif de la dire « vieille ». Qui plus est, les « vieilles » centrales sont en réalité devenues plus modernes qu’elles n’étaient à l’époque de leur construction, puisqu’elles sont entièrement rénovées tous les dix ans, à l’exception de la coque en béton et de la cuve, et bénéficient des progrès technologiques intervenus entre-temps. Certaines centrales américaines, rappelons-le, ont déjà plus de cinquante ans d’existence.
M. le rapporteur. Non, la plus âgée a quarante-cinq ans.
M. Christian Bataille. Il me semble qu’elle est plus proche de cinquante ans ; mais on n’est pas à quelques années près. En tout cas, cet âge dépasse largement les quarante ans.
Ce n’est d’ailleurs pas au Parlement, mais à l’ASN, dont on connaît l’indépendance, qu’il appartient de se prononcer sur la durée de vie des centrales. La fermeture de Fessenheim serait une perte, mais je m’inclinerais bien entendu si l’ASN jugeait qu’elle s’impose – ce qui, pour l’instant, ne semble pas être la perspective.
Les autres recommandations me semblent indiscutables. Dans le cadre de la loi de 2006, j’avais moi-même préconisé, par exemple, la constitution de fonds dédiés, placés sous la responsabilité de la Caisse des dépôts.
Pour le reste, il est bien légitime que le rapport reflète les convictions et les engagements du rapporteur ; mais les membres de notre commission d’enquête ne sont pas obligés de le suivre.
On peut d’ores et déjà parier que ce rapport sera diversement interprété dans la presse. Le journal Le Monde, devenu le porte-parole des anti-nucléaires, ne manquera pas d’en exciper pour publier une diatribe contre cette source d’énergie. J’avais personnellement rédigé, sur le gaz de schiste, un rapport dont un journaliste avait tiré, sans l’avoir lu, un article caricatural et à charge… Bref, même si le jugement peut être plus nuancé dans d’autres journaux, comme Les Échos, on sait d’avance que, malgré son caractère équilibré, le rapport générera une litanie de discours hostiles au nucléaire.
D’autre part, certains aspects y sont un peu passés sous silence : la question des externalités, par exemple, devrait aussi être posée pour d’autres sources d’énergie, responsables d’émissions de gaz à effet de serre, de rejets dans l’eau et dans l’air, de la dégradation de paysages, d’occupation des sols, pour ne pas parler des conditions de travail dans les mines de charbon, en Chine ou en Turquie. La production d’énergie nucléaire, c’est vrai, est exposée à des accidents de la nature, on l’a vu à Fukushima, mais elle n’est pas plus risquée que d’autres. N’oublions pas non plus, car on ne le répète pas assez, que le nucléaire n’émet pas de CO2 ; grâce à lui, la France est le pays d’Europe, après la Norvège, qui émet le moins de gaz à effet de serre.
Autre question : quand se penchera-t-on sur le renouvellement des centrales ? Entre la réflexion, l’élaboration et la construction, le processus prend plusieurs décennies : il faudrait y réfléchir assez tôt pour permettre à la nouvelle génération de centrales de prendre progressivement le relais – puisqu’il faudra bien fermer un jour celles qui fonctionnent aujourd’hui : après tout, nous ne sommes en désaccord que sur les dates…
M. le président François Brottes. Je vous invite, monsieur Bataille, à lire attentivement la recommandation 14, qui, sur Fessenheim, ne dit pas exactement ce que vous lui avez fait dire. Le passage relatif à la quatrième génération est, lui aussi, assez dense.
M. Hervé Mariton. Notre commission d’enquête a notamment abordé la question des « coûts futurs » de la filière nucléaire. Il est dommage, de ce point de vue, que le rapport ne propose aucun chiffrage de la stratégie annoncée dans le cadre du projet de loi relatif à la transition énergétique, en particulier sur l’évolution de la filière nucléaire. Je pense tout d’abord, bien entendu, à l’impact économique de la fermeture de Fessenheim, question à laquelle les personnes auditionnées ont refusé de répondre. Les travaux de la mission que je mène avec Marc Goua n’ont guère progressé à cet égard, mais le présent rapport, au fond, ne fait que souligner l’intérêt de les poursuivre.
Reste que la commission d’enquête aurait pu, avec la force qui lui est propre, tenter d’en savoir plus. Cette lacune est frustrante et même grave, car c’est toute la question des fermetures anticipées dans le cadre de la stratégie énergétique qui est posée ; de ce point de vue, ce n’est pas tant l’objectif de porter la part du nucléaire à 50 % que la date de 2025 qui pose problème : si l’on se fie à certains scénarios d’évolution de la demande, l’échéance de 2050 peut paraître moins absurde. Bref, il n’aurait pas été insensé que notre commission d’enquête se penchât, au-delà du seul cas de Fessenheim, sur cette question également, d’autant que nous n’aurons sans doute pas d’autres moyens de le faire lors du débat parlementaire.
Hier, Marc Goua et moi avons auditionné, comme l’avait fait la commission d’enquête, le délégué interministériel et le directeur général de l’énergie au ministère ; le moins que l’on puisse dire est qu’ils n’ont guère été bavards. Faut-il considérer que le Gouvernement s’engage dans une stratégie aussi lourde sans estimations chiffrées ? Je n’ose le croire ; mais la commission d’enquête avait peut-être les moyens d’être plus pressante…
Son travail est par ailleurs estimable, et le rapport soulève des questions intéressantes en témoignant d’un certain doigté. Le problème, comme l’a dit Christian Bataille, est que cette mesure ne résistera sans doute pas à l’épreuve de la communication.
M. le président François Brottes. On peut donner un autre nom à ce « doigté » : l’honnêteté, tout simplement…
M. Bernard Accoyer. Je ne répéterai pas ce qui a été fort bien dit par les orateurs précédents.
Je déplore que cette commission d’enquête ait été conduite de façon militante et partisane par son rapporteur, alors que l’objectivité et l’impartialité doivent être la règle dans une telle instance, vouée à éclairer les choix du pays. Je regrette également les errances du calendrier, régulièrement bouleversé pendant la suspension des travaux de l’Assemblée, et l’audition de certaines personnalités qui, dénuées d’expertise scientifique, n’étaient que des militants, de surcroît délinquants, qui s’étaient livrés, avec leurs associations, à des actes violents mettant en danger, non la sûreté, mais la sécurité de nos installations, en particulier au regard du risque terroriste. Sur ce point, monsieur le rapporteur, vous portez une responsabilité considérable.
Je regrette aussi que la question de la fermeture de Fessenheim, qui aurait pu faire l’objet d’une commission d’enquête à elle seule, n’ait été incluse dans le champ de la nôtre qu’à la faveur d’un amendement, si bien que son impact n’est abordé que très succinctement, insuffisance irresponsable au regard des conséquences énumérées par Michel Sordi. De nos auditions, il ressort que le coût de cette fermeture se monte à 8 milliards d’euros : est-il sérieux de maintenir une telle décision, purement politique, au moment où le Gouvernement demande aux Français un effort de 50 milliards d’euros ?
En matière énergétique, les choix ne peuvent laisser place au parti pris et au dogmatisme, car ils sont essentiels pour notre pays ; aussi je me réjouis d’avoir entendu Christian Bataille dire qu’ils dépassent les clivages politiques, et que des hommes de gauche les avaient anticipés, précédant le général de Gaulle et Georges Pompidou.
L’erreur colossale qu’a été, en 1997, la décision de Lionel Jospin de fermer Superphénix, générateur de quatrième génération qui donnait vingt ans d’avance à la France, est en train de se reproduire, et pour les mêmes raisons, celles d’un compromis politique avec les Verts.
Ce qui m’a le plus choqué, dans les quelques pages que j’ai pu lire – les conditions d’examen du rapport interdisant d’en prendre connaissance de façon approfondie –, c’est la distance qui sépare les recommandations, fruits d’un compromis politique – quoique en la matière les compromis politiques mènent souvent à des catastrophes –, et le contenu du rapport lui-même, qui est une « bombe ». C’est précisément ce que voulait notre rapporteur, M. Baupin. Ce qu’il souhaite, avec la banque de données qu’il s’est constituée et les pages explosives dont seront extraites des citations tronquées, c’est que prospèrent les peurs, le renoncement et le passéisme, sur quoi il a bâti son action politique. Détail révélateur, le mot « recherche » n’apparaît qu’une seule fois dans le rapport, au sujet des techniques de démantèlement. Tout cela, monsieur le rapporteur, n’est conforme ni au génie de la France, ni à son histoire, ni à l’intérêt de sa jeunesse ; et ce n’est certes pas ainsi que vous sortirez notre pays de la situation où il se trouve. Votre rapport, irresponsable, cherche à vendre une utopie, une idéologie, en utilisant à cette fin des méthodes peu recommandables.
M. le président François Brottes. Sur Fessenheim, M. Sordi a plutôt insisté sur d’autres éléments…
M. Bernard Accoyer. Le rapport est muet sur le coût de la fermeture de cette centrale !
M. le président François Brottes. Parce que nous ne le connaissons pas ; mais, en tout cas, il n’est pas de 8 milliards.
M. Bernard Accoyer. Vous vous apprêtez donc à soutenir une décision sans en connaître les implications financières, monsieur le président ?
M. le président François Brottes. Ne concluez pas à ma place…
M. Bernard Accoyer. J’en prends acte.
M. Jean-Louis Costes. L’intitulé de notre commission d’enquête mentionne les « coûts passés, présents et futurs de la filière nucléaire » ; or le rapport évoque beaucoup le passé et le présent, mais peu le futur et on y regarde le verre à moitié vide plutôt que le verre à moitié plein. En bref, il révèle une orientation partisane.
Nous sommes tous d’accord sur l’amélioration de la sécurité et sur les aspects financiers. Je ferai néanmoins une brève comparaison. Page 187, on peut lire ce gros titre – qui à n’en pas douter sera repris dans la presse –, en lettres capitales et en caractères gras : « Une baisse de la demande énergétique est possible, ce qui rend inutile la prolongation de l’ensemble du parc nucléaire. » L’étude de l’association Global Chance, citée à l’appui de la démonstration, exclut le chauffage et les chauffe-eau ! Elle ne me semble pas mériter d’être mise sur le même plan que l’analyse de M. Proglio, président-directeur général d’EDF, qui, page 186, déclare que « les besoins en énergie de la France continueront à augmenter à l’horizon 2025 ». Or cette phrase, elle, ne donne pas lieu à un titre.
M. le président François Brottes. Le titre que vous avez cité correspond seulement à l’une des deux approches dont le rapport constate qu’elles sont en opposition, et l’autre, celle de M. Proglio, fait l’objet d’un titre de même niveau page 183.
M. Patrice Prat. Je craignais le pire, et constate avec satisfaction que beaucoup ont mis de l’eau dans leur vin, en sorte que le rapport offre un bon éclairage sur les coûts de la filière nucléaire à l’orée des débats sur la transition énergétique. Il est cependant regrettable que nous n’ayons pas eu le temps de l’examiner en profondeur, même si je comprends que les délais soient contraints.
Je m’interroge moi aussi sur la qualification de certaines personnes auditionnées, et donc sur l’expertise qu’elles pouvaient nous apporter. Cela étant, comme vous l’avez écrit dans votre introduction, monsieur le rapporteur, votre rapport ne prend pas position sur l’énergie nucléaire et ne préconise pas d’en sortir : une certaine objectivité y prévaut donc.
Je souscris aux remarques de Christian Bataille sur les coûts, insuffisamment explorés ; il eût été utile, sur ce point, d’avoir des éléments de comparaison avec les autres sources d’énergie. En 1997, j’ai quitté le parti socialiste après qu’eut été prise la décision d’arrêter Superphénix ; et l’on s’apprête à nouveau, à propos de Fessenheim, à faire des choix peu constructifs pour la filière nucléaire, et ce sans connaître les coûts d’une fermeture. À cet égard, il est tout à l’honneur du rapporteur d’avoir relevé l’absence de vision et d’éléments de reconversion, de la part de l’État, pour le site de Fessenheim : si la décision de le fermer devait être scellée, il faudrait apporter des réponses concrètes au territoire concerné, qui est très vulnérable.
Le nucléaire demeure une filière d’avenir, notamment avec la quatrième génération, que le rapport met en valeur. Ayant une foi inébranlable dans le progrès scientifique et technologique, je déplore néanmoins qu’il soit accordé trop peu de place au volet recherche et développement.
M. le président François Brottes. Sur la méthode, je n’ai pu obtenir une prolongation du délai réglementaire de six mois. Quant à l’examen du rapport, monsieur Prat, nous sommes contraints par le délai de remise de deux jours.
M. Yves Blein. Je salue la méthode et la rigueur de M. Baupin, qui, contrairement à ce que disait M. Accoyer, a su éviter toute approche militante. Je pense notamment à la nécessité, plusieurs fois soulignée dans les recommandations, d’un partenariat avec les industriels et à la place accordée à la transition énergétique – dont ce rapport, sans préjuger de rien, a vocation à éclairer les réflexions préparatoires – ainsi qu’aux questions d’emploi.
Le débat sur la transition énergétique s’inscrit dans le temps long : il faudra tenir compte, par exemple, de la nouvelle donne que représente, pour le secteur de l’énergie, l’exploitation des gaz de schiste dans le monde. Le fait que les États-Unis exportent vers l’Europe du charbon et du gazole, alors qu’ils en importaient naguère, n’est pas sans soulever un certain nombre de questions. Les assurances dont nous disposons sur les ressources identifiées nous permettent d’inscrire notre réflexion dans la durée. Du rapport, je retiendrai donc l’impérieuse nécessité d’intégrer la question du nucléaire dans une réflexion de long terme sur l’économie globale de l’énergie, compte tenu des évolutions macroéconomiques en cours.
M. le rapporteur. Je remercie les intervenants qui ont bien voulu souligner l’objectivité du rapport. De fait, j’ai beaucoup appris en travaillant avec les différents acteurs concernés, et ce dans le cadre d’un dialogue permanent avec le président Brottes.
Tout a en effet un coût, monsieur Bataille, y compris la transition énergétique : on ne me fera jamais dire le contraire. L’objectif du rapport est de donner des éléments de comparaison, aussi objectifs que possible.
Je me suis également efforcé d’être le plus clair possible sur la gestion des installations, notamment sur la fermeture de Fessenheim. À cet égard, si nous n’avons pas eu de réponse à nos interrogations sur l’indemnisation, monsieur Mariton, ce n’est pas faute d’avoir posé la question, ni d’avoir tenté d’obtenir les contrats passés avec les pays voisins, en vue de dissiper les incertitudes sur les conséquences de cette fermeture. Mais, en tout état de cause, la question qui se pose est celle de la capacité de l’installation à durer. Le premier réacteur, je le rappelle sans esprit polémique, vient de redémarrer après sept semaines d’arrêt. Il est donc difficile de faire des anticipations sur plusieurs années.
On ne peut traiter de délinquants des gens qui n’ont pas été condamnés, monsieur Accoyer. Vos propos me paraissent donc déplacés : les personnes auxquelles vous avez fait allusion défendent des convictions, certes, mais leur travail est reconnu, y compris par l’ASN, qui intègre certaines d’entre elles dans ses comités.
S’agissant des coûts potentiels, le rapport donne plusieurs éléments, citant par exemple M. Bigot, administrateur général du CEA, pour qui l’électricité produite avec les réacteurs de quatrième génération serait de 10 à 15 % plus chère que l’électricité produite aujourd’hui par les réacteurs de troisième génération.
M. le président François Brottes. Je propose une brève suspension avant le vote.
M. Bernard Accoyer. L’OPECST, l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, se réunit en ce moment même pour une séance très importante consacrée au principe d’innovation. Il faut donc passer au vote, monsieur le président. Il y a des règles : y déroger ne serait pas acceptable, d’autant que nous avons dû nous plier déjà à suffisamment de contraintes pour participer à toutes les réunions de cette commission d’enquête.
M. le président François Brottes. Nous n’avons à nous prononcer, je le rappelle, que sur la publication du rapport, non sur son contenu – ce qui au demeurant revient à peu près au même.
M. Christian Bataille. Si le vote ne portait que sur les recommandations, j’approuverais cette publication ; mais je ne puis le faire au vu de certains passages. C’est pourquoi, à titre personnel, je m’abstiendrai.
M. Patrice Prat. J’en ferai de même.
La commission d’enquête adopte le rapport.
CONTRIBUTIONS DE MEMBRES DE LA COMMISSION
ET DE GROUPES POLITIQUES
Commission d’enquête sur le coût du nucléaire
Contribution de Patrice Carvalho
au nom du groupe GDR
Une réalité s’impose d’abord à notre réflexion : la France offre à ses entreprises et à ses ménages le prix de l’électricité le moins élevé d’Europe.
Le tarif du kwh est à 0,15€, quand il est en moyenne à 0,20€ dans la zone euro, à 0,19€ à l’échelle des 28 pays de l’Union européenne et à 0,27€ en Allemagne, qui se trouve tout en haut du tableau.
Cette situation résulte du choix historique fait par la France de développer l’énergie nucléaire au début des années 70 après la flambée des prix du pétrole et de garantir son indépendance énergétique.
Cette option, qui conduit nos centrales nucléaires à fournir aujourd’hui 75% de notre production électrique, s’est mise en place et déployée sur la base d’un service public, en conséquence non assujetti aux appétits financiers qui, ailleurs, ont pu amener à en rabattre sur l’exigence de garantir la sécurité des installations.
Nous sommes entrés, à présent, dans une autre période. Cette commission d’enquête et le rapport de la Cour des comptes, qui aura utilement contribué à ses travaux, auront mis en évidence les défis qui sont devant nous.
Le Cour des comptes relève que le coût de l’énergie nucléaire a augmenté de 20,6% en euros courants entre 2010 et 2013. Le coût moyen du mégawattheure (mwh) de nos 19 centrales nucléaire s’évalue à 59,8€ contre 49,6€ en 2010.
Les Français s’en sont récemment aperçus puisque les tarifs réglementés ont augmenté de 5% au 1er août 2013 et augmenteront à nouveau le 1er août prochain de 5%, soit une hausse de 10% en un an. C’est la plus forte hausse depuis 10 ans. Encore le gouvernement n’a-t-il pas suivi les demandes d’EDF et les recommandations de la Commission de régulation de l’énergie (CRE), qui préconisaient une flambée de 7,6% en 2013 et une autre, dans la foulée, de 6,8% à 9,6% avec l’objectif d’une augmentation de 30% entre 2013 et 2017.
La progression du coût du nucléaire s’explique par une forte croissance des dépenses d’exploitation d’EDF (+11%) : achats de combustible nucléaire, impôts, logistique et par les investissements nécessaires pour permettre le prolongement de la durée d’exploitation des réacteurs existants.
Les charges futures et les dépenses de maintenance devraient atteindre 3,7 milliards € par an en moyenne d’ici à 2025.
Ces évolutions sont-elles de nature à remettre en cause le choix de la France en faveur du nucléaire, comme certains le préconisent ? Ma conviction est que non. Et encore faudrait-il nous dire d’ailleurs par quoi nous le remplacerions, à la lumière de quelques expériences malheureuses, en particulier Outre-Rhin ?
Lorsque nous évoquons le renchérissement du coût du nucléaire, n’oublions pas que les coûts de production et de maintenance ne sont pas les seuls en cause.
L’Union européenne, dans sa logique libérale, nous a imposé l’ouverture du marché au nom de la concurrence « libre et non faussée ». Cela devait profiter aux consommateurs, nous disait-on. C’est le contraire qui s’est produit.
De multiples lois et taxes ont vu le jour : loi NOME, CSPE, TURPE, ARENTH… Elles ont toutes contribué à l’augmentation des tarifs au détriment du pouvoir d’achat des usagers.
L’évolution des statuts d’EDF a conduit l’opérateur historique à n’être plus l’entreprise publique que nous avions connue et les critères du privé guident aujourd’hui sa gouvernance. Les usagers en font les frais.
Penchons-nous à présent un instant sur le choix de nos voisins allemands, que j’ai déjà évoqués et qui nous sont souvent vantés.
En 2000, l’Allemagne lançait le « tournant énergétique ». Les énergies renouvelables représentaient alors 7% de la production électrique nationale. Aujourd’hui, les énergies vertes représentent 23% de la consommation électrique et l’objectif pour 2020 est d’atteindre les 35%.
De fait, l’Allemagne est parvenue à développer le solaire, l’éolien et la biomasse. Le mouvement devrait d’autant plus s’accélérer que nos voisins ont décidé de « sortir du nucléaire ».
Mais cette transition énergétique rapide a un coût particulièrement élevé. La principale dépense est la subvention des tarifs de rachat de l’électricité produite sur la base d’énergie renouvelables. Le montant de ces subventions est estimé à 680 milliards € d’ici 2022. Ce sont, bien sûr, les usagers qui paient et le kwh allemand est déjà l’un des plus chers d’Europe.
A cela s’ajoute d’autres difficultés en forme de paradoxes ; la sortie du nucléaire conduit à réactiver les centrales à charbon, les plus émettrices de CO2.
De la même manière, les intermittences du vent rendent précaire la production électrique par l’éolien, ce qui conduit, là encore, à doubler le dispositif de centrales à charbon, ce qui renchérit les coûts de production.
La France a donc besoin de bien réfléchir à ses choix. Le nucléaire n’est pas un horizon indépassable.
Il nous faut, sans aucun doute, concevoir un mix énergétique, qui permettra une montée en puissance d’énergies alternatives à mesure de l’élévation de leur efficacité. Mais le nucléaire demeure indispensable pour notre indépendance énergétique. La poursuite de son exploitation, sa modernisation avec des équipements de nouvelle génération, à côté d’autres énergies, doivent s’effectuer dans un retour à une logique de service public, qui garantisse toujours plus la sécurité et des tarifs au juste prix pour les usagers.
Commission d’enquête relative aux coûts de la filière nucléaire
Contribution des Députés UMP
La commission d’enquête « relative aux coûts passés, présents et futurs de la filière nucléaire, à la durée d’exploitation des réacteurs et à divers aspects économiques et financiers de la production et de la commercialisation de l’électricité nucléaire, dans le périmètre du mix électrique français et européen, ainsi qu’aux conséquences de la fermeture et du démantèlement de réacteurs nucléaires, notamment de la centrale de Fessenheim » a été créée le 11 décembre dernier à la demande du groupe Ecologiste.
Lors de l’examen de la proposition de résolution tendant à la création de cette commission d’enquête, les députés UMP avaient décidé de ne pas prendre part au vote craignant que cette commission ne soit détournée de son objectif, à savoir une analyse impartiale et ouverte des coûts de la filière nucléaire. Nous craignions que les auditions menées et les orientations du rapport ne soient qu’à charge.
A l’issue de six mois de travaux, nous sommes au regret de constater que nos craintes étaient fondées.
Observations sur les conditions de travail de la commission d’enquête : Le rythme et l’agenda des travaux de la commission n’ont pas été à l’image de ce que doit être une commission d’enquête, dans un Parlement respecté et responsable, au service de l’intérêt général. Les premières auditions ont débuté le 9 janvier et se sont poursuivies sans interruption, alors même que l’Assemblée nationale a suspendu ses travaux entre le 28 février et le 8 avril, comme il est d’usage, pour les élections municipales. On ne compte plus les convocations envoyées seulement deux jours avant l’audition prévue, ni celles qui ont ensuite été rectifiées, parfois la veille de l’audition (en dehors des jours où siège l’Assemblée nationale). Outre les auditions plénières de la commission d’enquête, le Rapporteur a décidé de conduire des « entretiens ». Ces entretiens se sont multipliés pendant l’interruption parlementaire et se sont tenus bien souvent les lundis et vendredis. Par ailleurs, deux déplacements sur site ont été organisés les lundi 31 mars et mardi 1er avril (dans la Manche) et le jeudi 3 avril (dans la vallée du Rhône). Or, cette semaine était la semaine de l’entre-deux-tours des élections municipales et pour de nombreux élus dès le premier tour, elle devait être consacrée à l’organisation des conseils municipaux. Sans aucun doute que la majorité, comme l’a fait le rapporteur, nous objectera que c’est « la faute au cumul des mandats ! ». Remarque facile pour ne pas dire simpliste. Nous pensons que le cumul des mandats n’a rien à voir dans cette affaire. Il s’agit ni plus ni moins du respect à la fois de la qualité du travail parlementaire et de la prise en compte des impératifs des députés, qui ne sont pas tous des élus parisiens et doivent donc s’organiser pour venir à l’Assemblée nationale. Etant prévenus seulement quelques jours à l’avance, il leur est souvent difficile d’être présents lors de ces réunions, laissant ainsi toute latitude au Rapporteur pour mener les travaux comme il l’entend et sans collégialité. Enfin - et il s’agit sans doute du plus problématique - les auditions ont fait une large place à des associations militantes, certaines ayant même été auditionnées à deux reprises. Nous nous étonnons de ce choix et de la légitimité ainsi conférée à des acteurs de la société civile qui ont pourtant souvent fait preuve de comportements délictueux ou violents lors d’intrusion dans les centrales ou à l’intérieur même de notre Assemblée. |
Un rapport instrumentalisé pour justifier une idéologie partisane
La commission d’enquête devait permettre de donner à la représentation nationale « l’ensemble des documents juridiques et financiers lui permettant d’évaluer l’ampleur des engagements de l’État liés à la production d’électricité nucléaire sur le territoire » afin d’engager le débat parlementaire sur la loi de programmation sur la transition énergétique en toute transparence65.
Les députés UMP craignaient que cette commission ne soit instrumentalisée pour justifier un parti-pris contre le nucléaire, qui a d’ailleurs été celui martelé pendant la campagne présidentielle de 2012.
En effet, le candidat François HOLLANDE avait affiché sa volonté de baisser la part du nucléaire dans la production d’électricité de 75% à 50% :
« Je préserverai l’indépendance de la France tout en diversifiant nos sources d’énergie. J’engagerai la réduction de la part du nucléaire dans la production d’électricité de 75% à 50% à l’horizon 2025, en garantissant la sûreté maximale des installations et en poursuivant la modernisation de notre industrie nucléaire. Je favoriserai la montée en puissance des énergies renouvelables en soutenant la création et le développement de filières industrielles dans ce secteur. La France respectera ses engagements internationaux pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Dans ce contexte, je fermerai la centrale de Fessenheim et je poursuivrai l’achèvement du chantier de Flamanville (EPR). » (Engagement n° 41)
En outre, l’accord électoral de novembre 2011 entre le PS et les Verts prévoyait de fermer 24 réacteurs nucléaires.
Ces promesses faisaient fi de toute expertise objective sur les conséquences pour notre pays. La commission d’enquête devait donc pallier cette absence d’analyse, et comme nous le craignions les conclusions visent à justifier a posteriori ces promesses électorales.
En effet, le rapport ne présente pas un état des lieux objectif des coûts de la filière nucléaire mais est un manifeste anti-nucléaire qui s’apparente sans conteste à un document militant. Le choix des mots, sciemment pesés, a pour objectif d’alimenter la peur de nos concitoyens et de justifier le démantèlement pur et simple de toute la filière électro-nucléaire. Il n’est guidé que par l’idéologie de l’abandon du nucléaire au profit des seules énergies renouvelables.
Les députés du groupe UMP ne peuvent pas cautionner ces travaux et affirment leur désaccord avec les conclusions du Rapporteur.
La filière nucléaire est un atout pour notre pays
A l’UMP, nous avons toujours été transparents sur nos positions et nous souhaitons exprimer clairement notre point de vue.
Sous l’impulsion du Général de Gaulle, la France a fait le choix du nucléaire comme ressource de base pour sa production d’électricité et pour assurer son indépendance énergétique. Ce choix a été assumé et poursuivi par l’ensemble des Gouvernements qui se sont succédé depuis. Dès 1974, le premier choc pétrolier a montré l’importance de ce choix. C’est encore plus vrai aujourd’hui où l’épuisement des ressources fait de l’énergie une arme économique voire plus, comme le prouve le dossier du gaz russe livré à l’Ukraine ou à certains pays de l’Union Européenne. Alors que les réserves de gaz comme celles de pétrole s’amenuisent, l’électricité nucléaire reste l’énergie de base la plus sûre et la plus pérenne.
A plusieurs égards, le nucléaire et notre indépendance énergétique sont par conséquent un atout pour l’économie de notre pays.
• Atout du nucléaire au regard de notre balance commerciale
Notre pays compte 58 réacteurs nucléaires, répartis en 19 centrales, pour une puissance installée de 63 200 MWh, ce qui permet de subvenir à 78% de notre consommation d’électricité.
Alors qu’en 1973, notre taux d’indépendance énergétique était de seulement 24 %, il dépasse aujourd’hui les 50 %. Cette indépendance énergétique, unique en Europe, a un impact positif sur notre balance commerciale.
En effet, dans le monde, les réserves de pétrole et de gaz se réduisent, leurs coûts d’exploitation vont donc sensiblement augmenter dans les prochaines années car il deviendra plus difficile d’atteindre certaines réserves. Les derniers sites pétrolifères en France ont été fermés au cours des dernières années par manque de rentabilité ou pour cause d’assèchement. Les réserves de pétrole en France sont de 30 jours, pour le gaz elles s’élèvent à 3 mois. Pour satisfaire nos besoins en pétrole et en gaz, notre pays doit par conséquent importer massivement.
Si la France ne disposait pas d’un programme nucléaire et si elle devait, en conséquence, acheter à l’étranger les combustibles – en l’occurrence le gaz – nécessaire à la production des trois-quarts de son électricité, il lui en coûterait dans les conditions économiques actuelles autour de 20 milliards d’euros chaque année. Cette somme viendrait s’ajouter aux 69 milliards d’euros de facture énergétique de la France en 2012. Actuellement, seul la production d’électricité d’origine nucléaire permet de réduire ce déficit avec un excédent commercial de près de 2 milliards d’euros.
Ainsi, le recours à l’énergie nucléaire permet à la France de réduire fortement sa facture énergétique, ainsi qu’à garantir notre indépendance énergétique : sans lui, nous serions dépendants d’accords avec d’autres Etats souverains tels que la Russie, l’Iran ou le Qatar.
• Atout du nucléaire au regard de son coût
1. L’énergie d’origine nucléaire est la moins chère à produire
Selon le rapport présenté par la Cour des comptes à la commission d’enquête, le coût de production d’électricité nucléaire est de 59,6 euros/MWh en 2013.
La Cour des comptes estime que le coût de production a augmenté de 20,6% entre 2010 et 2013, en raison de la croissance des dépenses d’exploitation qui représentent plus de 40% du coût de production (+ 11%), des investissements de maintenance (+118%), des charges futures à travers les provisions de démantèlement, de gestion des combustibles usés et des déchets (+14%), ainsi que de la hausse du loyer économique (+8%).
Plus concrètement, la hausse des coûts de production du nucléaire ces dernières années correspond aux impératifs suivants66 :
- renforcement des règles de sécurité (1,1 milliard d’euros en 2013 pour l’ensemble du parc)
- remplacement des gros composants obsolètes : générateurs de vapeur (2/3 des dépenses totales de 1,2 milliard d’euros en 2013 ; 22/58 tranches ont été traitées à ce jour), alternateurs, transformateurs…
- prescriptions post-Fukushima de l’ASN : 10 milliards sur 10 ans, dont 650 millions en 2013.
Sur la période 2007-2012, les investissements ont augmenté de +16% par an, alors qu’ils avaient baissé au cours des années 1990 et 2000.
Le coût de production de l’électricité d’origine nucléaire doit cependant être apprécié en comparaison des autres énergies :
- Le tarif d’achat de l’éolien terrestre est de 80€ par MWh
- Pour l’éolien en mer : 200€ par MWh
- Photovoltaïques au sol avec suivi de la courbe du soleil : 95€ par MWh
- Petites installations résidentielles : 150€ par MWh
- Installation intégrée au bâti : 300€ par MWh
- Biomasse : entre 130 et 180€ par MWh selon la technologie
- La cogénération : tarif de 130€ par MWh (fonctionnement en chaleur fatale)
- 60€ par MWh pour les petits ouvrages hydrauliques
- Centrales thermiques : entre 70 et 100€ MWh selon la source (charbon ou gaz)
2. L’énergie nucléaire permet aux consommateurs de payer leur électricité à un coût abordable
Notre indépendance énergétique a permis à nos ménages français en 2013 de payer leur électricité environ 40 % de moins que la moyenne européenne. Alors que le prix TTC d’1 MWh est de 147 euros en France, il est de 300 euros au Danemark ou de 292 euros en Allemagne. Certes les français trouvent leur facture d’électricité bien souvent « trop salée » mais qu’en serait-il si nous devions importer de l’électricité pour pallier notre production insuffisante ?
• Atout du nucléaire pour la situation économique et sociale de notre pays.
Avec 2.500 entreprises, la filière nucléaire est la 3ème filière industrielle en France. A ce titre, elle participe activement à la situation économique et sociale de notre pays.
Selon les derniers chiffres publiés par le Comité stratégique de la filière nucléaire en juin 2012, elle concerne 150 000 emplois directs et 220 000 indirects, soit 4 % de l’emploi industriel.
En 2013, alors que le chômage a augmenté en France, EDF embauchait 6.000 personnes. Le temps de formation d’un ingénieur nucléaire chez EDF est de 5 années, pendant lesquelles les nouveaux entrants sont accompagnés par des ingénieurs confirmés qui leur transmettent leur savoir-faire. C’est grâce à ce « passage de témoin » que la filière nucléaire demeure l’un de nos fleurons industriels.
Il faut également rappeler que le programme de grand carénage, c’est-à-dire la mise à niveau de tous les réacteurs pour aller au-delà des 30 ans d’exploitation, est estimé à 55 milliards d’euros. Ces travaux étalés sur la période 2011-2025 représenteront 110.000 emplois.
• Atout du nucléaire en matière de lutte contre le réchauffement climatique
Le nucléaire permet à la France de respecter le protocole de Kyoto et ses engagements internationaux en matière de lutte contre le réchauffement climatique
Quoiqu’on en dise, l’énergie d’origine nucléaire doit en effet être qualifiée d’énergie « propre » dès lors que le fonctionnement d’une centrale ne produit pas d’émission de CO2. Nos émissions de gaz à effet de serre sont donc limitées.
Grâce à son mix électrique décarbonné, l’intensité carbone du mix électrique français en 2010 est de 79gCO2/kWh, soit 7 fois moins que la moyenne mondiale, 5,4 fois moins que la moyenne européenne et près de 6 fois moins que l’Allemagne. Il faut noter que l’Allemagne importe massivement du charbon, suite à sa décision de réduire drastiquement la part du nucléaire dans sa production d’électricité. Le résultat environnemental est sans appel : cette décision a contribué à augmenter ses émissions de CO2.
En France, la production d'électricité n'est en effet à l'origine que de 10 % des émissions françaises de gaz à effet de serre, contre 40 % au niveau mondial. Le parc nucléaire français permet ainsi d’éviter chaque année le rejet de 400 millions de tonnes de dioxyde de carbone.
Les parlementaires que nous sommes doivent avoir pour objectif de préparer l’avenir de notre pays.
Le rapport se base sur une vision erronée de l’avenir en pariant sur une baisse de la consommation d’énergie. Les auditions ont démontré que réduire la part du nucléaire à 50% dans la production d’électricité à l’horizon 2025 ne permettra pas d’assurer un approvisionnement énergétique suffisant, sécurisé et pour un coût abordable.
Il est donc indispensable de développer de nouvelles installations.
Les énergies renouvelables évidemment, mais celles-ci étant intermittentes, elles ne peuvent intervenir qu’en complément du nucléaire.
La question de la prolongation de la durée d’exploitation des centrales est cruciale. Prolonger de 40 à 60 ans abaisserait mécaniquement les coûts. Dans son rapport la Cour des comptes affirme que « le seul élément qui pourrait avoir un effet à la baisse sur le coût de production est l’allongement de la durée d’exploitation des réacteurs de 40 à 50 ans ». Selon la méthode de calcul de la Cour des comptes, le coût moyen de production, lissé sur 50 ans, atteindrait 61,6 euros/MWh ; selon la méthode de calcul d’EDF, il atteindrait 56,4 euros/MWh.
Dans son rapport, la Cour des comptes « insiste, en renforçant une de ses recommandations précédentes, sur la nécessité de prendre position, dans le cadre de la fixation des orientations de la politique énergétique à moyen terme, sur le prolongement de la durée d’exploitation des réacteurs au-delà de 40 ans, sous réserve bien sûr d’un accord de l’ASN, afin de permettre aux acteurs, notamment à EDF, de planifier les actions et les investissements qui en résulteront ».
Un délai supplémentaire de 10 ou 20 ans permettrait la mise au point de centrales de quatrième génération qui sont de nature à résoudre la question de nos besoins d’énergie en tenant compte des réserves mondiales de combustible.
En effet, ces réserves seraient suffisantes pour faire fonctionner les centrales classiques pendant une période comprise entre 50 et 100 ans. Elles seraient suffisantes pour assurer le fonctionnement des centrales de troisième génération pendant 130 ans. Et surtout, elles deviendraient suffisantes pour assurer le fonctionnement des centrales de quatrième génération et suivantes entre 5 000 à 7 000 ans ! C’est dire le saut technologique que représentent ces futures centrales et leur intérêt stratégique. Il est donc indispensable que notre pays puisse développer cette nouvelle génération de centrales. D’ailleurs, lors de son audition par la commission d’enquête, en réponse à une question de Jean-Louis COSTES, député UMP, Madame Ségolène Royal, Ministre de l’environnement, du développement durable et de l’énergie, n’a pas dit autre chose : « Comme elle s’est positionnée dans le passé sur son savoir-faire nucléaire, la France peut aujourd’hui se positionner sur le savoir-faire de la gestion de la durée de vie des centrales et l’émergence des centrales de nouvelle génération. Au vu de la demande mondiale, celle-ci correspond à des centrales de plus petite taille, plus proches et s’inscrivant dans le cadre d’un mix énergétique ».
Pour construire une nouvelle génération de centrales, la recherche doit donc être notre priorité. Or, le terme même de « recherche » est totalement absent des conclusions du Rapporteur. La fermeture du prototype Superphénix décidée en 1997 par le Gouvernement de Lionel JOSPIN, pour des raisons politiques et électorales (qui sont d’ailleurs identiques à celles données pour justifier la fermeture de Fessenheim) a fait perdre à notre pays une avance technologique que nous n’avons jamais pu retrouver. Aucune leçon n’a pourtant été tirée de cette décision, ce qui est regrettable.
Observations sur la sureté des centrales nucléaires Les détracteurs de l’industrie nucléaire agitent le chiffon rouge de la sécurité et rappellent sans cesse les dramatiques catastrophes de Tchernobyl et de Fukushima. Il faut rappeler que nous sommes dotés en France de l’Autorité de Sûreté nucléaire (ASN), autorité administrative indépendante, véritable gendarme du nucléaire. Elle contrôle la sûreté nucléaire et la radioprotection, met en place des inspections régulières et inopinées, et rend ses travaux publics. Suite à l’accident de Fukushima, le Gouvernement a demandé qu’un audit de nos installations nucléaires soit réalisé. L’ASN a ainsi lancé des évaluations complémentaires de la sûreté (ECS) afin de tester la robustesse des installations face à des situations extrêmes. L’ASN a conclu que les installations examinées présentent un niveau de sûreté suffisant et ne nécessitent donc pas d’être arrêtées. La poursuite de leur exploitation nécessite cependant d’augmenter dans les meilleurs délais, au-delà des marges de sûreté dont elles disposent déjà, leur robustesse face à des situations extrêmes. Nous pensons qu’il est indispensable de respecter l’expertise, les conclusions et les recommandations de l’ASN. En tant qu’Autorité indépendante, elle est au-dessus des démarches politiciennes ou électoralistes. Elle doit être la seule apte à décider si une centrale doit être arrêtée ou bien continuer à fonctionner sur des critères de sureté. Les députés UMP regrettent que, alors même qu’elle a validé la sûreté des installations, la commission d’enquête ait mis à mal leur sécurité en rendant publique des informations qui auraient dû rester confidentielles. |
OBSERVATIONS PARTICULIERES SUR LA CENTRALE DE FESSENHEIM
De Michel SORDI et des députés du Groupe UMP
L’annonce par le chef de l’Etat de la fermeture de la centrale de Fessenheim fin 2016 ne manque pas d’interroger. En outre, pareille fermeture aurait un impact considérable tant au niveau du bassin de vie que du signal négatif envoyé par l’Etat (actionnaire d’EDF) auprès des clients étrangers de la filière.
A.- Les équipements et la sureté :
1.- Le mythe de la « plus vieille centrale » :
L’argument principal pour en demander la fermeture est son âge et sa prétendue vétusté. Dans la pratique, il n’en est rien. Premier site à avoir passer avec succès les 3èmes visites décennales pour ces deux réacteurs, la centrale de Fessenheim est tout sauf une « usine rouillée ». Les installations ont été modernisées au fur et à mesure, ainsi le radier a été renforcé en 2013 avec une zone de rétention pour le corium. EDF a investi plusieurs centaines de millions d’euros pour remplacer les deux générateurs de vapeur ces dernières années.
2.- La sureté du site :
La centrale nucléaire de Fessenheim est un des premiers sites à disposer des mesures prévues dans l’audit post-Fukushima, notamment un système d’approvisionnement ultime en eau. Dans son dernier rapport l’ASN conclut que Fessenheim se situe dans la moyenne des centrales en matière de sureté. La « mise à niveau » du site, selon les prescriptions post-Fukushima est en voie d’achèvement pour un coût de 50 millions d’euros.
B.- L’impact économique et social :
1.- Un site rentable :
Le site ayant plus de 30 ans, il sera bientôt amorti (amortissement calculé sur 40 ans pour l’heure), par conséquent les marges financières augmenteront d’autant. Ces marges permettent de financer des projets en matière d’énergies renouvelables.
2.- Les aspects sociaux :
La centrale de Fessenheim représente 2.200 emplois directs et indirects. Fermer la centrale revient à désertifier tout un territoire. Le départ du personnel de la centrale entraînerait une vente du parc de logement détenus et occupés par les agents (nous en avons l’expérience avec les fermetures de casernes à travers le pays), des fermetures de classes (enfants scolarisés). Le démantèlement n’occupe que 50 à 100 salariés comme on a pu le constater sur d’autres sites (Cf. Tricastin). Par ailleurs ce démantèlement n’interviendra que 3 à 5 ans après l’arrêt des réacteurs.
C.- Le temps de la reconversion ?
1.- La fermeture :
Oui, un jour il faudra bien fermer les centrales de 2ème génération en France, tôt ou tard, mais la question se pose, est-ce après 40, 50 ou 60 ans d’exploitation ? Selon la durée retenue, le tableau d’amortissement des investissements change, les travaux d’entretien évoluent et enfin le prix global de l’électricité est impacté. Ce n’est donc pas neutre. Et dans tous les cas de figure, ce n’est pas dans la précipitation que cela doit se faire. L’ASN a donné en 2011 et 2012 deux autorisations de poursuite de l’activité respectivement pour les réacteurs 1 et 2 de Fessenheim. Pourquoi ne pas mettre ce temps à profit (d’ici 2021 et 2022) pour envisager une reconversion du site, sereinement, avec un maintien de l’emploi sur le bassin de vie et des solutions de rechange pérennes en matière d’approvisionnement pour la région et les entreprises électro-intensives du secteur ? En effet la particularité de la région c’est que 47% de l’électricité produite sert aux entreprises donc à l’économie du territoire (contre 10 à 25% dans d’autres régions). De plus la production hydraulique est certes forte en été (lors des crues du Rhin) mais elle est faible en hiver (phénomène de l’étiage). L’énergie hydraulique représente alors 350MW alors que la demande en région Alsace est de 2.900MW.
2.- Les conséquences économiques et écologiques :
Ce délai supplémentaire permettra de trouver des solutions pour les énergies de substitutions, et permettra d’attirer des acteurs économiques nouveaux sur le territoire, car à ce jour, dans le cadre du futur contrat de plan Etat-Région il y a beaucoup d’idées sur le papier mais absolument rien de concret comme nous avons pu le constater le 5 mai dernier lors de la rencontre en Préfecture de Région avec les acteurs étatiques locaux du dossier.
Se pose également la question de l’indemnisation d’EDF par rapport au manque à gagner (fermeture d’une centrale en parfait état de marche) ainsi que l’indemnisation des partenaires allemands et suisses d’EDF sur la centrale de Fessenheim pour respectivement 17,5% et 15% de la production annuelle.
Le coût global de la fermeture et du démantèlement peut être ainsi apprécié à plusieurs milliards d’euros. Au moment où le Gouvernement cherche 50 milliards d’économie, une telle dépense, un tel gaspillage est évidemment inadmissible et scandaleux.
Enfin l’impact écologique : il faudra bien remplacer les deux réacteurs nucléaires par d’autres sources de production d’électricité. Les énergies renouvelables ont leurs limites, ainsi :
- Faiblesse du potentiel éolien dans la région ;
- Les champs photovoltaïques : la CRE n’a retenu en 2013 que des dossiers dans le sud de la France (pourtant deux dossiers alsaciens avaient été présentés) ;
- La géothermie et la méthanisation sont des filières pouvant être performantes en Alsace ;
- Pour autant l’ensemble du potentiel des énergies thermiques se limite à 150MW, auxquels on peut rajouter 350MW grâce à l’hydraulique (en hiver) ;
Nous sommes cependant loin des 2.900MW demandés en période de pic de consommation.
Nos voisins allemands ne pourront pas nous alimenter, eux-mêmes ferment leurs centrales nucléaires, l’Allemagne ne vend son électricité que lorsqu’elle est en trop plein, mais les éoliennes du nord du pays ne fonctionnent pas en continue. Quant à nos voisins suisses, ils importent de l’énergie de France.
Récupérer l’électricité d’une autre centrale nucléaire suppose des trajets très long (300km pour la centrale de Cattenom qui est la plus proche) et donc des pertes en ligne et un réseau qui n’est plus stable en Alsace. Par conséquent, l’installation d’une centrale de remplacement s’impose, avec une capacité de 800 à 900MW. Que ce soit au gaz ou au charbon, dans les deux cas le site sera source de pollution pour les populations environnantes et une catastrophe en matière de rejet de gaz à effet de serre dans l’atmosphère. En l’absence de centrale de rechange c’est tout le réseau électrique alsacien qui est menacé. Les entreprises présentes dans la région, à fort capitaux étrangers, auront tôt fait, face à cette menace de quitter la région.
Conclusion :
Le mix énergétique à l’horizon 2025 est difficilement quantifiable aujourd’hui quand on ne sait pas quels seront les besoins. Car malgré une politique volontariste en matière de maîtrise des énergies et de développement des énergies renouvelables, force est de constater que les modes de vie changent et que le recours à l’électricité se fera de plus en plus : domotique, tablettes électroniques, voitures électriques, etc…. Nous pouvons également noter la courbe démographique française qui est à la hausse. Donc les besoins en électricité seront très vraisemblablement en hausse. Dans ces conditions, fermer un outil industriel qui fonctionne et qui est quasiment amorti relève de la gageure et du non-sens économique.
Cependant nous avons pris acte de la proposition de Madame Ségolène ROYAL, Ministre de l’Ecologie, de l’Energie et du Développement Durable, visant à la création d’un groupe de travail, dans lequel la ministre s’impliquerait personnellement aux côtés du Préfet, d’EDF, des représentants des salariés de la centrale, des élus parlementaires et locaux, et des collectivités territoriales en vue de contractualiser un projet sur le devenir du site. Ce dialogue est essentiel et doit déboucher sur un nouveau calendrier car il est impossible qu’une solution pour l’emploi soit trouvée dans seulement 24 mois. Par conséquent, et en l’état, nous nous opposons fermement et catégoriquement à la fermeture du CNPE de Fessenheim au 31 décembre 2016.
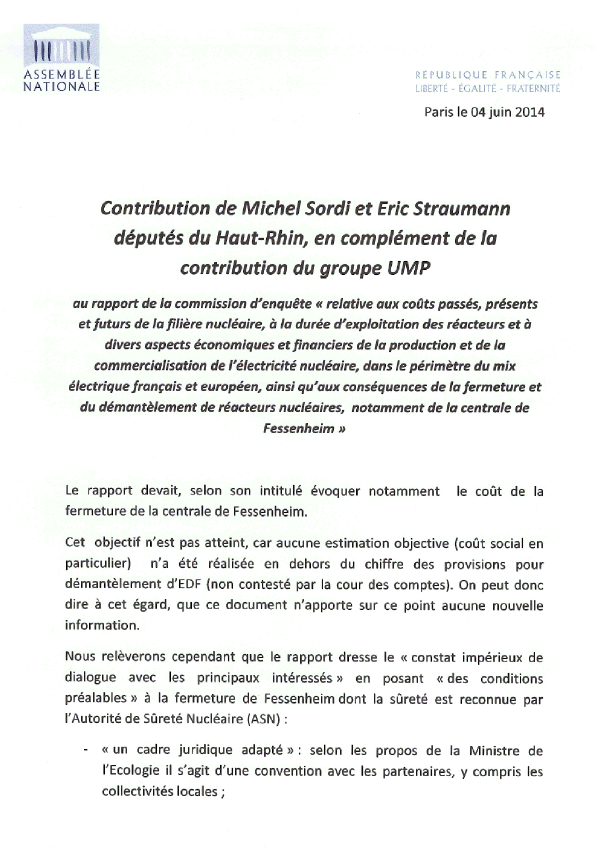
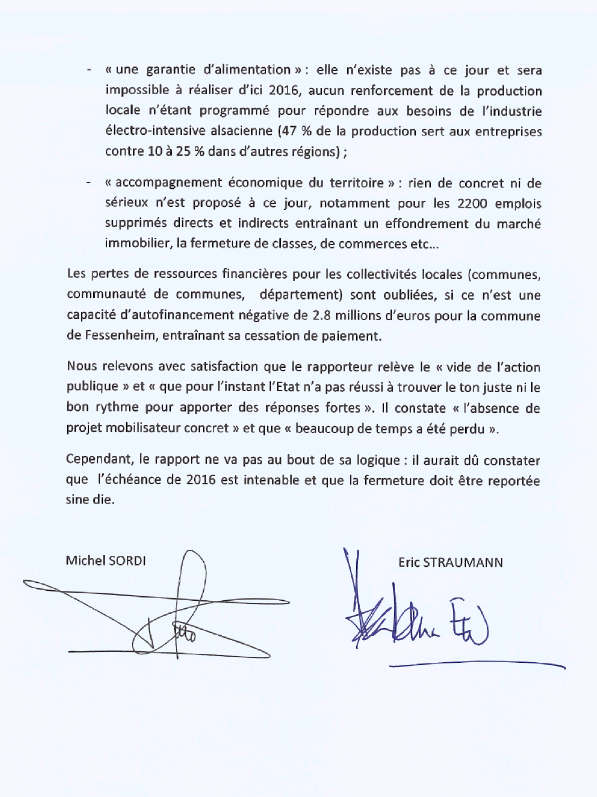
Commission d'enquête relative aux coûts passés, présents et futurs de la filière nucléaire, à la durée d'exploitation des réacteurs et à divers aspects économiques et financiers de la production et de la commercialisation de l'électricité nucléaire
Contribution de Christian Bataille
Coût du nucléaire : relativiser la dépense.
L’approvisionnement de la France en énergie représente, dans tous les cas de figure, un coût. Nos achats de gaz et de pétrole représentent plus de 80% de notre déficit commercial qui atteint, avec 68 milliards d’euros en 2012, un niveau insupportable pour notre économie. Les énergies renouvelables représentent aussi une dépense pour une énergie souvent intermittente. C’est dans ce contexte que l’énergie nucléaire, en intégrant les charges présentes et futures, a contribué à une hausse du coût de production de l’électricité de 20% en passant de 50 à 60 euros par MWh au cours des 3 dernières années.
Les coûts de la filière nucléaire sont l’objet de commentaires multiples et contradictoires. Alors que les opposants à cette énergie essaient de démontrer qu’il y a des « coûts cachés », la Cour des Comptes en 2009 puis, plus récemment, en janvier 2012 a apporté des commentaires décisifs. Leur sérieux n’est pas discutable.
Du point de vue des chiffres et constats, la dépense à retenir est de plus de 200 milliards d’euros déjà engagés, les charges futures s’élèvent à 80 milliards et les coûts annuels d’exploitation représentent 9 milliards. Ces chiffres considérables doivent être étalés dans le temps et sont relatifs si l’on considère que c’est sur une période de près de 60 ans que s’étale cette dépense.
Les dépenses futures principales concernent les charges de démantèlement pour 30 milliards et les charges de gestion des déchets radioactifs pour une somme presque équivalente. Ces dépenses auront finalement un impact inférieur à 10 % sur le coût de production de l’électricité.
Des questions restent en suspens. En premier lieu, les provisions pour les charges de long terme. EDF et les autres producteurs de déchets ont constitué un portefeuille d’actifs qui correspond à 85 % des provisions nécessaires. En second lieu les facteurs externes (accidents imprévisibles) ou les externalités (impacts sur l’environnement et sur la santé humaine) sont mesurables, pour une part, mais sont aussi d’ordre politique et diplomatique mondial (sécurité d’approvisionnement, balance commerciale, emploi).
Une des décisions majeures d’avenir concerne la prolongation des centrales et le remplacement du parc. La prolongation des centrales c’est l’allongement de la durée de vie au delà de 40 ans ou de 50 ans. Les coûts de rénovation sont élevés mais restent faibles au regard des bénéfices potentiels.
Le remplacement du parc est une dépense à l’échelle du siècle. Il apparaîtra modéré aux générations futures qui le paieront en partie.
La Cour des Comptes a livré une estimation indiscutable. Les chiffres cités apparaissent très importants mais il faut les moduler sur la durée pour ce qui concerne la rénovation et le renouvellement. En comparaison, la rénovation totale des bâtiments existants, qui représente l’essentiel des économies d’énergie, correspondrait à une dépense supérieure à 1 000 milliards d’euros étalée sur 80 ans.
Il ne faut donc pas s’incliner devant l’énormité des chiffres mais continuer à débattre sur un choix essentiel : économiser ou produire, il faudra bien choisir.
ANNEXE 1 – LISTE DES PERSONNES ENTENDUES
PAR LA COMMISSION D’ENQUÊTE
9 janvier M. Philippe de Ladoucette, président de la CRE (Commission de régulation de l’énergie)
9 janvier M. Gilles-Pierre Levy, président de chambre à la Cour des comptes, et Mme Michèle Pappalardo, conseiller-maître
9 janvier M. Jean Desessard, sénateur de Paris, et M. Ladislas Poniatowski, sénateur de l’Eure
16 janvier M. Thierry Morello, chief operating officer et membre du directoire d'EPEX Spot
16 janvier M. Pierre Bornard, vice-président du directoire de RTE, directeur général délégué chargé de l'économie, des marchés et de l'innovation
16 janvier M. Jean-Philippe Bucher, président-directeur général de FerroPem
23 janvier M. Andreas Rüdinger, chercheur « Politiques climatiques et énergétiques » à l’IDDRI (Institut du développement durable et des relations internationales)
23 janvier Pr. Stephen Thomas, professeur en études énergétiques à l’Université de Greenwich, et M. Humphrey Cadoux-Hudson, directeur exécutif « Nouvelles constructions nucléaires », EDF Energy
30 janvier M. Manuel Baritaud, analyste senior « Électricité » de l’Agence internationale de l’énergie
30 janvier Mme Gwenaëlle Huet, directrice des affaires européennes de GDF-Suez, et M. Claude Turmes, député européen
30 janvier M. Philippe Van Troye, directeur général d’Electrabel, et M. Eric De Keuleneer, professeur à l’Université libre de Bruxelles
6 février M. Luc Oursel, président du directoire d’AREVA (huis clos)
6 février M. Sylvain Granger, directeur de la division « Combustible nucléaire » d’EDF (huis clos)
6 février M. Yves Kaluzny, conseiller auprès de la Mission de soutien aux secteurs stratégiques, Direction générale de la mondialisation, du développement et des partenariats (Ministère des Affaires étrangères) et M. Charles-Antoine Louët, sous-directeur « Industrie nucléaire » à la Direction générale de l’Énergie et du climat (Ministère de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie) (huis clos)
13 février M. Pierre-Franck Chevet, président de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN)
13 février M. Étienne Dutheil, directeur-adjoint de la Production nucléaire (EDF)
13 février Table ronde avec les syndicats représentés au comité central d'entreprise d’EDF :
– CFDT – Fédération Chimie-Énergie : M. Vincent Rodet
– CFE-CGC – Énergies : MM. Marc-Jacques Kuntz et Étienne Desdouits
– CGT – Fédération nationale Mines-Énergie : MM. Serge VIDAL et Philippe Page
– FO – Fédération nationale Énergie-Mines : MM. Jacky Chorin et Denis Cattiaux
20 février M. Pierre-Franck Chevet, président de l’ASN, et M. Jacques Repussard, directeur général de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN)
20 février M. Dominique Minière, directeur délégué à la direction Production-Ingénierie (EDF)
20 février Table ronde d'entreprises prestataires d'EDF :
– M. Pierre Dambielle, directeur Activités nucléaires de ORTEC
– M. Damien Gousy, vice-président du GIP Nord-Ouest
– M. Alain Bertaux, président de CICO Centre
– M. Michel Dupiech, directeur général adjoint d’ONET Technologies
– M. Jean-Claude Lenain, président-directeur général de Mistras Group SA
27 février M. Philippe Jamet, commissaire de l’ASN, et M. Jacques Repussard, directeur général de l'IRSN
27 février MM. Yannick Rousselet, responsable du dossier nucléaire, et Cyrille Cormier, chargé de campagne climat-énergie de Greenpeace France
27 février M. Hervé Machenaud, directeur exécutif groupe Production et Ingénierie d’EDF
27 février M. Philippe Knoche, directeur général délégué d’AREVA
26 mars M. Yves Marignac, directeur de WISE-Paris, et M. Sébastien Blavier, chargé de campagne nucléaire à Greenpeace
26 mars M. Laurent Michel, directeur général de l'Énergie et du climat, et M. Pierre-Marie Abadie, directeur de l’Énergie (ministère de l’Écologie, du développement durable et de l’énergie)
26 mars M. Benjamin Dessus, président de Global Chance, et M. François Lévêque, professeur d'économie au CERNA-Mines ParisTech
26 mars M. Arnaud Gay, président, et M. Philippe Bernet, vice-président du groupe de travail "Démantèlement" du Comité stratégique de la filière nucléaire
26 mars M. Jean-Claude Delalonde, président de l’ANCCLI (Association nationale des comités et commissions locales d’information), M. Jean-Paul Lacote, vice-président de l’ANCCLI et membre de la CLI de Fessenheim, et M. Florion Guillaud, trésorier de l’ANCCLI et membre de la CLI du Blayais
26 mars M. Jean-Michel Malerba, délégué interministériel à la fermeture de la centrale nucléaire et à la reconversion du site de Fessenheim
2 avril M. Jean-Luc Lépine, président de la CNEF (Commission nationale d'évaluation du financement des charges de démantèlement des INB et de gestion des combustibles usés et des déchets radioactifs)
2 avril M. Thomas Piquemal, directeur exécutif groupe chargé des finances d’EDF, M. Bernard Bigot, administrateur général du CEA, M. Christophe Gégout, directeur financier du CEA, et M. Pierre Aubouin, directeur général adjoint chargé des finances d’AREVA
2 avril M. Philippe Germa, directeur général du WWF France
2 avril M. Jacques Repussard, directeur général de l’IRSN
2 avril M. Michel Bourguignon, commissaire de l’ASN, et M. Jean-Christophe Niel, directeur général de l’ASN
2 avril M. Sylvain Granger, directeur de la division Combustible d'EDF, M. Hervé Bernard, administrateur général adjoint du CEA, et M. Dominique Mockly, directeur du Business Group Aval d’AREVA
2 avril M. Jacques Percebois, membre de la Commission nationale d'évaluation (CNE2)
10 avril M. Sylvain Granger, directeur de la division du Combustible (EDF)
10 avril M. Philippe Knoche, directeur général délégué d’AREVA
10 avril M. Mycle Schneider, consultant
10 avril M. Bernard Bigot, administrateur général du CEA
10 avril M. Raymond Sené et Mme Monique Sené, Groupement des scientifiques pour l’information sur l’énergie nucléaire (GSIEN)
10 avril M. Jacques Repussard, directeur général de l’IRSN
10 avril M. Gilles Trembley, directeur du GIE Assuratome, M. Maurice Corrihons, directeur des Spécialités de la Caisse centrale de réassurance, et M. Pierre Picard, professeur au département d'économie de l’École Polytechnique
17 avril Mme Céline Grislain-Letrémy, M. Reza Lahidji et M. Philippe Mongin, auteurs du rapport « Les risques majeurs et l’action publique » (Conseil d'analyse économique, décembre 2012)
17 avril M. Francis Delon, secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale, et M. Pierre-Franck Chevet, président de l’ASN
17 avril M. Jean-Pierre Charre, vice-président, M. Michel Demet, conseiller du président, et M. Alexis Calafat, secrétaire, du bureau de l’ANCCLI
17 avril M. François Moisan, directeur exécutif scientifique Recherche et International de l'ADEME, et M. Jacques Bittoun, président de l'ANCRE (Alliance nationale de coordination pour la recherche sur l'énergie)
17 avril M. Robert Durdilly, président de l’UFE (Union française de l'électricité), et M. Thierry Salomon, président de l'association négaWatt
17 avril M. Jacques Percebois, président de la commission « Énergies 2050 », et M. Bernard Laponche, polytechnicien, docteur ès sciences, docteur en économie de l’énergie, ancien directeur général de l'AFME (aujourd'hui ADEME)
30 avril M. Christophe Quintin, chef du Service de défense, de sécurité et d’intelligence économique (SDSIE), Haut fonctionnaire de défense adjoint au ministère de l’Écologie, du développement durable et de l’énergie, M. le colonel Pascal Segura, adjoint au chef du SDSIE, M. le général Christian Riac, chef du Département de la sécurité nucléaire et M. Benoît Piguet, conseiller auprès du Secrétaire général du ministère (huis clos)
30 avril M. Nicolas Boccard, professeur associé d’économie, Université de Girona (Espagne)
30 avril Table ronde avec les confédérations syndicales représentatives au plan national :
– CFDT : M. Dominique Olivier, secrétaire confédéral chargé du développement durable
– CFE-CGC : M. Alexandre Grillat, Secrétaire national « développement durable-énergie-logement-RSE »
– CFTC : MM. Francis Orosco, président de la fédération Chimie-Mines-Textile-Énergie, et Henri Richard, conseiller technique
– CGT : Mme Marie-Claire Cailletaud, membre de la Commission confédérale « Politique industrielle », et M. Bernard Devert
– FO : MM. Jacky Chorin, secrétaire fédéral Énergie et mines, et Éric Devy, délégué syndical central
30 avril M. Jean-Pierre Roncato, président d’Exeltium
30 avril M. Fabien Choné, président de l'ANODE (Association nationale des opérateurs détaillants en énergie)
30 avril M. Raymond Leban, directeur « Économie, tarifs, achats » d'EDF
30 avril M. Philippe de Ladoucette, président de la CRE (Commission de régulation de l'énergie)
6 mai M. Henri Proglio, président-directeur général d’EDF
7 mai M. Christian Leyrit, président de la Commission nationale du débat public, et M. Claude Bernet, président de la Commission particulière du débat public Cigéo
7 mai Mme Marie-Claude Dupuis, directrice générale, et M. Thibaud Labalette, directeur des programmes (ANDRA)
7 mai MM. Jacques-François Lethu (KPMG), Alain Pons et Patrick Suissa (Deloitte), commissaires aux comptes d’EDF (huis clos)
7 et 20 mai M. Luc Oursel, président du directoire d’AREVA
21 mai Mme Ségolène Royal, ministre de l’Écologie, du développement durable et de l’énergie
21 mai M. Gilles-Pierre Levy, président de chambre, Mme Michèle Pappalardo, conseiller-maître, et Mme Anne-Sophie Dessillons, rapporteur à la Cour des comptes.
ANNEXE 2 – LISTE DES PERSONNES ENTENDUES
PAR LE RAPPORTEUR
20 février M. Jean-Paul Bouttes, directeur de la Prospective et de la Stratégie (EDF)
3 mars M. David Azéma, directeur général de l’Agence des participations de l’État
6 mars M. Jacques Repussard, directeur général de l’IRSN
6 mars M. Jean Tandonnet, Inspecteur général pour la sûreté nucléaire et la radioprotection, et M. Jean-Paul Combemorel, membre de l’Inspection générale pour la sûreté nucléaire et la radioprotection (EDF)
7 mars M. Dominique Huez, ancien médecin du travail de la centrale nucléaire de Chinon
7 mars M. Gilles Hengoat, président du département Marchés financiers de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes
11 mars M. Thomas Béhar, président, et M. Régis de la Roullière, directeur de l’Institut des actuaires
17 mars M. Benoît de Juvigny, secrétaire général de l’Autorité des marchés financiers, Mme Florence Priouret, directrice de division, Direction des émetteurs, et Mme Laure Tertrais, conseillère parlementaire et juridique (AMF)
17 mars M. Philippe Huet, directeur des risques et de l’audit (EDF)
20 mars M. Fabien Choné, président de l’A.N.O.D.E.
20 mars M. Patrick Lagadec, consultant, ancien directeur de recherche à l’École polytechnique sur les risques majeurs et les crises
21 mars M. Nicolas Rivière, analyste « EDF » à Standard & Poor’s
25 mars MM. Michel Llory et Jacki Guérinot, consultants en sûreté, sécurité et risque technologique
27 mars M. Didier Anger, président du CRILAN
27 mars M. Jean-Louis Basdevant, ancien directeur du département de physique de l’École polytechnique
28 mars M. Bernard Laponche, ancien directeur général de l’AFME (aujourd'hui ADEME)
28 mars Mme Maryse Arditi, pilote du réseau “Énergie” à France Nature Environnement
28 mars M. Vincent Mazauric, Secrétaire général et Haut fonctionnaire de défense du ministère de l’Écologie, du développement durable et de l’Énergie, M. Christophe Quintin, chef du Service de défense, de sécurité et d’intelligence économique (SDSIE), Haut fonctionnaire de défense adjoint, M. le colonel Pascal Segura, adjoint au chef du SDSIE, M. le général Christian Riac, chef du Département de la sécurité nucléaire, et M. Benoît Piguet, conseiller auprès du Secrétaire général du ministère
11 avril M. Guillaume Blavette, militant du collectif « Stop-EPR ni à Penly ni ailleurs »
11 avril Mme Laura Hameaux, chargée de communication du Réseau Sortir du nucléaire
16 avril M. Roland Desbordes, président de la CRII-RAD
18 avril Mme Annie Thébaud-Mony, sociologue, directrice de recherches à l’INSERM, et M. Philippe Billard, fondateur de l’association Santé - Sous-traitance Nucléaire-Chimie
28 avril Mme Patricia Blanc, directrice générale de la prévention des risques, déléguée aux risques majeurs, et M. Benoît Bettinelli, chef de la mission « Sûreté nucléaire et radioprotection » (ministère de l’Écologie, du développement durable et de l’énergie)
20 mai M. Christophe Leininger, directeur adjoint du développement des marchés (Commission de régulation de l’énergie)
22 mai M. Goulven Graillat, directeur-adjoint de la Prospective et de la Stratégie (EDF)
23 mai M. Dominique Minière, directeur délégué à la direction Production-Ingénierie, et M. Yves Giraud, directeur « Économie de la production et stratégie industrielle » à la direction Production-Ingénierie (EDF)
ANNEXE 3 – LISTE DES PERSONNES RENCONTRÉES
AU COURS DES DÉPLACEMENTS EFFECTUÉS
PAR LA COMMISSION D’ENQUÊTE
M. Antoine Ménager, directeur du chantier EPR
M. Michel Laurent, président des trois CLI de la Manche (AREVA-La Hague, ANDRA-Centre de stockage de la Manche, EDF-Flamanville)
M. Yves Baron, membre des trois CLI de la Manche
Mme Anne-Marie Duchemin, membre de la CLI AREVA-La Hague
Mme Caroline Guillaume, DREAL de Basse-Normandie, déléguée territoriale de l’ASN
M. Guillaume Bouyt, chef de la division de Caen, ASN
M. Éric Zelnio, adjoint au chef de division et chef du pôle LUDD (contrôle des laboratoires, des usines du cycle du combustible, des déchets et des opérations de démantèlement)
M. Philippe Knoche, directeur général délégué d’AREVA
M. Pascal Aubret, directeur de l’établissement AREVA La Hague
M. Frédéric Martinet, directeur-adjoint de l’établissement AREVA La Hague
M. François Dutertre, directeur Démantèlement fin de cycle, AREVA La Hague
M. Sébastien Delamarche, directeur Exploitation traitement recyclage, AREVA La Hague
M. Jacques Gérault, directeur des affaires publiques d’AREVA
M. Guillaume Renaud, responsable des relations institutionnelles, direction des affaires publiques d’AREVA
M. Philippe Guiberteau, directeur du centre de Marcoule (CEA-DEN)
Mme Laurence Piketty, directrice de l’Assainissement et du démantèlement nucléaires (CEA-DEN)
M. Christophe Poinssot, chef du département Radiochimie et Procédés (CEA-DEN)
M. Bernard Vignau, chef du département des Projets d’Assainissement et Démantèlement (CEA-DEN)
M. Jean-Pierre Vigouroux, chef du service des Affaires publiques, chargé des relations avec le Parlement
M. Jean-Marc Ligney, directeur de l’établissement AREVA Melox
M. Régis Faure, direction de la communication, AREVA Melox
M. Gilles Reynaud, secrétaire de l’association
M. José Andrade, membre de l’association
Mme Sylvie Richard, directrice du CNPE du Tricastin
M. André Abad, directeur technique
Mme Stéphanie Hugues, chef de l’équipe commune DIN-DPN
M. Pierre Bras, chef de mission Prévention des risques
M. Bruno Poulmarc’h, référent chantier école
M. Jean-Marie Bros, mission Finance et Relations industrielles
M. Yves Giraud, directeur « Économie de la production et stratégie industrielle », Direction Production – Ingénierie (DPI)
M. Éric Jouen, directeur adjoint, DPI-DIN
M. Bertrand Le Thiec, directeur adjoint des Affaires publiques, Direction des relations institutionnelles
M. Frédéric De Agostini, directeur de l’établissement AREVA Tricastin
M. Pascal Turbiault, directeur Exploitation Georges Besse 2
M. Philippe Richert, président du conseil régional
M. François Bouchard, directeur général des services
M. Christophe Kieffer, directeur de cabinet du président
M. Stéphane Bouillon, préfet de la région Alsace, préfet du Bas-Rhin
M. Jacques Garau, secrétaire général pour les affaires régionales et européennes (SGARE)
M. Philippe Roesch, adjoint au SGARE
M. Marc Hoeltzel, directeur de la DREAL Alsace
M. Daniel Gallissaires, chef du Pôle « Entreprises, Emploi, Économie » de la DIRECCTE Alsace
M. Dominique Blais, administrateur civil chargé du volet « Fessenheim » du contrat de plan État-région
M. Charles Buttner, président du conseil général
M. Christophe Marx, secrétaire général de la préfecture
M. Michel Habig, conseiller général, maire d’Ensisheim
M. Georges Walter, directeur général adjoint du conseil général
M. Claude Brender, maire de Fessenheim
Mme Fabienne Stich, ancien maire de Fessenheim
M. Jean-Paul Lacote, membre de la commission locale d’information et de surveillance de Fessenheim
M. Florien Kraft, chef de la division de Strasbourg, ASN
M. Claude Brender, maire
Mme Lilly Ancel, adjointe au maire
Mme Ghislaine Beringer, adjointe au maire
M. Yannick Meal, conseiller municipal
M. Éric Schwein, conseiller municipal, président du syndicat des eaux
M. François Beringer, président de la communauté de communes Essor du Rhin, maire de Blodelsheim
M. Sylvain Waltisperger, vice-président de la communauté de communes
M. Cédric Lepaul, vice-président de la communauté de communes
M. Thierry Rosso, directeur du CNPE
Mme Christine Tousch, responsable de la communication
Mme Delphine Rorive, attachée de communication
M. Yves Giraud, directeur « Économie de la production et stratégie industrielle », direction Production-Ingénierie
Représentants des organisations syndicales :
CGT : M. Laurent Raynaud et M. Philippe Huck
FO Énergies et Mines : Mme Martine Herod et M. François Toubin
CFDT : M. Pascal Bakchich et M. Pascal Meyer
CFE-CGC : M. Rodolphe Percet et M. Laurent Buhler
ANNEXE 4 – RAPPORT DE LA COUR DES COMPTES
Le document est consultable sur la version pdf.
1 () L’article 6 de l’ordonnance du 17 novembre 1958 précise : « Les rapporteurs des commissions d’enquête exercent leur mission sur pièces et sur place. Tous les renseignements de nature à faciliter cette mission doivent leur être fournis. Ils sont habilités à se faire communiquer tous documents de service, à l’exception de ceux revêtant un caractère secret et concernant la défense nationale, les affaires étrangères, la sécurité intérieure ou extérieure de l’État, et sous réserve du respect du principe de la séparation de l’autorité judiciaire et des autres pouvoirs ».
2 () Diversité qui s’exprime dans les contributions des différents groupes politiques intégrées à ce rapport.
3 () Lors du débat sur la sûreté nucléaire organisé en séance publique, le 30 mai 2013, Pierre-Franck Chevet déclarait « La deuxième observation de l’Autorité de sûreté nucléaire, relative à la prise en compte d’un incident générique nécessitant l’arrêt de plusieurs réacteurs simultanément, plaide en faveur de la diversification du mix énergétique mais aussi du maintien de marges de sécurité en matière d’approvisionnement énergétique de la France. » cf. http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/cri/2012-2013/20130255.pdf (page 5910).
4 () Dont certaines sont déjà en cours.
5 () Moyenne sur les cinq dernières années. Source : RTE, Actualisation du bilan prévisionnel de l’équilibre offre-demande d’électricité en France, édition 2013.
6 () Moyenne 2010-2011. Source : RTE, Actualisation du bilan prévisionnel de l’équilibre offre-demande d’électricité en France, édition 2013.
7 () Le couplage des marchés bénéficie ainsi aux consommateurs des pays dont les coûts de production sont les plus élevés.
8 () Si le prix de marché est inférieur au prix du contrat, les exploitants ont le droit à une compensation égale à la différence entre les deux prix ; dans le cas inverse, ils reversent la différence ; le dispositif sera géré par le gestionnaire de réseau de transport.
9 () La coalition SPD-Verts de 1998 adopte un premier texte qui pose le principe d’une sortie définitive du nucléaire vers 2024 ; la coalition CDU-FDP, formée en 2009, décide de retarder de douze années en moyenne cette sortie.
10 () Les seuls moyens actuels de stockage d’électricité qui soient compétitifs et d’une capacité importante sont la retenue d’eau dans les barrages et le pompage-turbinage dans les STEP (station de transfert d’énergie par pompage).
11 () CGSP, La crise du système électrique européen. Diagnostic et solutions, janvier 2014.
12 () Les ressources connues avec un degré de certitude raisonnable (reasonnably assured resources, RAR) sont celles dont la qualité et le tonnage sont connus avec suffisamment de certitudes pour décider une exploitation industrielle. Les ressources déduites (infered resources) sont celles qui sont définies avec suffisamment de mesures directes pour conduire des études de pré-faisabilité, voire de faisabilité, mais qui nécessitent des mesures complémentaires préalablement à la mise en exploitation. Les ressources identifiées (identified resources) sont la somme des ressources RAR et des ressources déduites.
13 () Pour plus de précisions sur l’acquisition d’UraMin, se reporter au rapport d’information relatif à la situation financière et aux perspectives d’Électricité de France et d’AREVA, de MM. Marc Goua et Camille de Rocca Serra, 7 mars 2012, http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i4463.asp#P1555_191957.
14 () http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2013-2014/20140155.asp#P183052.
15 () Le périmètre des stocks pris en compte par la Cour des comptes n’est pas défini, mais est sans doute plus large que celui des stocks stratégiques car il comprend également le combustible en réacteur.
16 () Arrêté du 7 février 2012 fixant les règles générales relatives aux installations nucléaires de base, Journal officiel du 8 février 2012.
17 () Le système de l’exposition au prorata temporis n’est appliqué qu’aux formes précaires de travail : intérim et CDD.
18 () Les dates sont celles de la connexion au réseau.
19 () L’âge d’un réacteur est déterminé ici par l’écart entre sa date de connexion au réseau et mai 2014.
20 () Ou des groupes de 2 réacteurs, selon les centrales.
21 () L’annexe à la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique indique, par exemple : « Si, pour les centrales nucléaires actuelles, une durée de vie de quarante ans semble plausible, cette durée de vie n'est pas garantie et son prolongement éventuel l'est encore moins. Les premières mises à l'arrêt définitif des centrales nucléaires actuelles pourraient donc se produire vers 2020. »
22 () AREVA estime pour sa part les investissements nécessaires sur ses sites suite aux ECS à 200 à 300 millions d’euros, auxquels s’ajoutent 120 à 150 millions d’euros destinés à renforcer la sécurité des sites.
23 () ASN, Rapport sur l’état de la sûreté nucléaire et de la radioprotection en France en 2013, avril 2014 (p. 380).
24 () D’autres cuves présentent des défauts, mais Tricastin-1 est revenu à plusieurs reprises dans les auditions de la commission et les entretiens du rapporteur.
25 () Pour des raisons légitimes de confidentialité commerciale – des appels d’offres étant en cours ou à venir – la commission s’est évidemment engagée à ne pas diffuser les chiffres détaillés.
26 () L’EBITDA est un indicateur d’origine anglo-saxonne qui met en évidence le profit généré par l’activité indépendamment des conditions de son financement (les charges financières), des contraintes fiscales (impôts et taxes), et du renouvellement de l’outil d’exploitation (amortissements). Il est proche de l’EBE (excédent brut d'exploitation) utilisé en France.
27 () « Nucléaire – Faut-il reculer l’âge de la retraite des centrales ? », Environnement Magazine, n° 1681, octobre 2009.
28 () Une quarantaine d’EPR de 1600 MW pour reconstituer une capacité de 63 GW, à un coût unitaire de 6 ou 6,5 milliards d’euros.
29 () Cette prescription est une exigence pour l’ensemble du parc français au titre du retour d’expérience post-Fukushima. Elle est mise en œuvre à Fessenheim dans le cadre de la poursuite d’exploitation au-delà de 30 ans depuis fin 2012 pour l’unité n° 1 et depuis fin 2013 pour l’unité n° 2.
30 () En particulier le fait qu’il s’agit de la centrale en exploitation la plus ancienne et que les réacteurs sont situés sur la nappe phréatique la plus importante en Europe. Mme Ségolène Royal souligne d’ailleurs que « avec les normes nouvelles de sécurité, cette centrale ne serait pas construite ».
31 () Les « charges futures » comprennent également un troisième poste : la gestion des combustibles usés. Cette thématique est abordée plus spécifiquement dans le chapitre consacré au retraitement des combustibles et à la filière Mox.
32 () Ce parc est composé des réacteurs graphite-gaz de Chinon (2 réacteurs), Saint Laurent (2 réacteurs) et Bugey (1 réacteur) ainsi que du réacteur à eau lourde de Brennilis, du REP de Chooz et de Super-Phénix
33 () Les règles de calcul du plafond sont déterminées par arrêté du 21 mars 2007 relatif à la sécurisation du financement des charges nucléaires.
34 () Le décret du 23 février 2007 précise que cette méthode doit être « précise et pérenne » et respecter les normes comptables applicables.
35 () Selon la Cour des comptes, le taux moyen d’aléas et d’incertitudes retenu par le CEA est supérieur au taux mentionné par Bernard Bigot : il serait d’environ 30 %.
36 () Délibération de la Commission de régulation de l’énergie du 9 octobre 2013 portant proposition relative aux charges de service public de l’électricité et à la contribution unitaire pour 2014
37 () Le décret modificatif du 24 juillet 2013 a depuis abaissé le plafond d’admissibilité des titres RTE à 15 % de l’ensemble des actifs dédiés.
38 () La capacité technique actuelle, sans investissements de capacités complémentaires, est de l’ordre de 1 250 tonnes.
39 () ASTRID devra démontrer au bout de quelques années d'exploitation un taux de disponibilité comparable à celui du parc actuel de réacteurs en exploitation, soit autour de 80%.
40 () La notion de « masse de métal lourd » recouvre uniquement les masses de l’uranium et du plutonium présents dans les combustibles usés en attente de retraitement, à l’exclusion de la masse de l’oxygène présent dans les oxydes UO2 et PuO2 et de la masse des structures métalliques composant les assemblages.
41 () AEN-OCDE, The Economics of the Back End of the Nuclear Fuel Cycle, octobre 2013.
42 () Il s’agit naturellement des seuls coûts liés au combustible et non des coûts totaux de production.
43 () Voir le chapitre 8.
44 () Jacques Repussard rappelle, par exemple, qu’« un changement de filière implique par ailleurs un autre cycle du combustible. Il ne suffit pas de construire des réacteurs, il faut fabriquer de nouveaux combustibles, qui apportent des bénéfices en termes de sûreté, mais au prix de profonds bouleversements industriels, en amont comme en aval. »
45 () Service du Premier ministre, assistant celui-ci dans l’exercice de ses responsabilités en matière de défense et de sécurité nationale.
46 () Cette compétence lui est confiée par la directive interministérielle du 7 avril 2005 sur l’action des pouvoirs publics en cas d’événement entraînant une situation d’urgence radiologique.
47 () L’IRSN n’estime pas directement le coût médian d’un accident pour chaque catégorie (accident grave et accident majeur) mais détermine dans un premier temps un scénario de rejet médian, dont elle estime le coût médian.
48 () En application de la convention complémentaire de Bruxelles de 1963.
49 () L’UE exige que les instruments de ratification soient déposés simultanément par tous les États membres, et trois d’entre eux (Belgique, Grande-Bretagne et Italie) n’ont pas encore adopté les dispositions internes nécessaires.
50 () La teneur du protocole de 2004 est déjà transcrite aux articles L.597-1 à 25 du code de l’environnement, mais ceux-ci ne seront applicables qu’à compter de l’entrée en vigueur du protocole de 2004.
51 () 120 milliards d’euros multipliés par une probabilité égale à 10-5.
52 () 450 milliards d’euros multipliés par une probabilité égale à 10-6.
53 () Ce chiffre est celui proposé par les auteurs du rapport du CAE sur les risques majeurs et l’action publique lors de leur audition devant la commission d’enquête. Des travaux académiques font état d’un chiffre plus élevé. Par exemple, L. Eeckhoudt, C. Schieber et T. Schneider proposent une méthode de calcul en application de laquelle le coefficient multiplicatif tenant compte de l’aversion de la population pour le risque est de 20 (« Risk aversion and the external cost of a nuclear accident », Journal of Environmental Management (2000) 58, 109–117).
54 () Cour des comptes, Le recensement et la comptabilisation des engagements hors bilan de l’État, mai 2013.
55 () « Les contrats d’assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l’État et garantissant les dommages d’incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l’objet de tels contrats ».
56 () Rapport d’information sur l’hydroélectricité (n° 1404), Mme Marie-Noëlle Battistel et M. Éric Straumann, députés, 7 octobre 2013.
57 () Le cadre juridique du montage Exeltium a été fixé par la loi de finances rectificative pour 2005 et codifié aux articles 238 bis HV à 238 bis HZ bis du code général des impôts. Ces articles définissent notamment les sociétés éligibles à la participation aux « sociétés d’approvisionnement à long terme d’électricité ». Seuls les consommateurs finals peuvent y participer, ce qui exclut une association avec des fournisseurs ou producteurs d’électricité. Ces consommateurs doivent présenter une intensité énergétique supérieure à un certain seuil, fixé à 2,5 kWh par euro de valeur ajoutée.
58 () Selon la théorie économique, l’existence de rentes infra-marginales est justifiée car ces rentes couvrent exactement les frais fixes engagés pour la construction des capacités correspondantes. Toutefois, dans le cas du parc nucléaire français, les frais fixes ont déjà fait l’objet d’un amortissement en début de vie, et les rentes infra-marginales sont donc de véritables rentes, au sens où elles dépassent le paiement minimum nécessaire pour conserver le facteur de production dans son emploi présent.
59 () La Commission européenne a engagé deux procédures, l’une pour transposition incorrecte des directives du « 2ème paquet », la seconde au titre des aides d’État.
60 () La couverture des charges d’exploitation ne pose pas de problème méthodologique particulier : ces dernières sont remboursées à mesure qu’elles sont constatées, sur la base d’une prévision et de la correction ex post de cette prévision.
61 () Délibération de la Commission de régulation de l’énergie du 5 mai 2011 portant avis sur le projet d’arrêté fixant le prix de l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique à 42 €/MWh à compter du 1er janvier 2012.
62 () Sont concernés les sites industriels consommant plus de 7 GWh d’électricité par an.
63 () Délibération de la Commission de régulation de l’énergie du 7 mai 2014 portant décision sur l’évolution au 1er août 2014 des tarifs d’utilisation d’un réseau public d’électricité dans le domaine de tension HTB.
64 () Commission de régulation de l’énergie, Analyse de la compétitivité des entreprises intensives en énergie : comparaison France-Allemagne, juin 2013.
65 Rapport n° 1595 sur la proposition de résolution tendant à la création de cette commission d’enquête
66 Cf audition de M. Philippe de Ladoucette, Président de la Commission de régulation de l’énergie, le 9 janvier 2010
© Assemblée nationale