

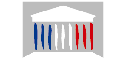
N° 3922
______
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 5 juillet 2016
RAPPORT
FAIT
AU NOM DE LA COMMISSION D’ENQUÊTE (1)
relative aux moyens mis en œuvre par l’État pour lutter
contre le terrorisme depuis le 7 janvier 2015
M. Georges FENECH
Président
M. SÉBASTIEN PIETRASANTA
Rapporteur
Députés
——
TOME 2 :
COMPTES RENDUS DES AUDITIONS
(1) La composition de cette commission d’enquête figure au verso de la présente page.
La commission d’enquête relative aux moyens mis en œuvre par l’État pour lutter contre le terrorisme est composée de : M. Georges Fenech, président ; M. Sébastien Pietrasanta, rapporteur ; MM. Jacques Cresta, Meyer Habib, Guillaume Larrivé, Mme Anne-Yvonne Le Dain, vice-présidents ; M. Christophe Cavard, Mme Françoise Dumas, MM. Olivier Falorni, Serge Grouard, secrétaires ; MM. Pierre Aylagas, David Comet, Jean-Jacques Cottel, Marc Dolez, Mme Marianne Dubois, MM. Philippe Goujon, Henri Guaino, François Lamy, Jean-Luc Laurent, Michel Lefait, Pierre Lellouche, Mme Lucette Lousteau, MM. Olivier Marleix, Jean-René Marsac, Alain Marsaud, Pascal Popelin, Mmes Maina Sage, Julie Sommaruga, MM. Patrice Verchère, Jean-Michel Villaumé.
COMPTES RENDUS DES AUDITIONS
Table ronde, ouverte à la presse, de victimes et de proches de victimes des attentats du 13 novembre 2015 : Association 13 novembre : fraternité et vérité : M. Georges Salines, président, M. Mohammed Zenak, trésorier, Mme Sophie Dias, membre de l’association, Mme Aurélia Gilbert, membre de l’association ; Association Life for Paris – 13 novembre 2015 : Mme Caroline Langlade, vice-présidente, Mme Lydia Berkennou, membre de l’association, M. Alexis Lebrun, membre de l’association ; M. Grégory Reibenberg, dirigeant du restaurant La Belle Équipe (lundi 15 février 2016) 9
Audition, ouverte à la presse, de Mme Françoise Rudetzki, fondatrice de SOS Attentats (lundi 15 février 2016) 28
Table ronde, ouverte à la presse, d'avocats de victimes d'attentats terroristes : Me Patrick Klugman, avocat au barreau de Paris, accompagné de M. Samuel Sandler, père et grand-père de victimes de Mohamed Merah ; Me Samia Maktouf, avocate aux barreaux de Paris et Tunis, accompagnée de M. Omar Dmougui, victime des attentats du 13 novembre 2015 ; Me Olivier Morice, avocat au barreau de Paris, accompagné de M. René Guyomard et Mme Emmanuelle Guyomard, père et soeur d'une victime de l'attentat du Bataclan (mercredi 17 février 2016) 46
Table ronde, ouverte à la presse, d'associations de victimes d'attentats terroristes : Association française des victimes du terrorisme (AVFT) : M. Guillaume Denoix de Saint-Marc, directeur général, M. Stéphane Lacombe, directeur adjoint, Mme Aline Le Bail-Kremer, responsable communication et gestion ; Fédération nationale des victimes d'attentats et d'accidents collectifs (FENVAC) : M. Olivier Dargouge, vice-président, Mme Marie-Claude Desjeux, vice-présidente, M. Stéphane Gicquel, sécrétaire général ; Institut national d'aide aux victimes et de médiation (INAVEM) : Mme Michèle de Kerckhove, présidente, Mme Sabrina Bellucci, directrice générale (mercredi 17 février 2016) 63
Audition, ouverte à la presse, de M. Daniel Pszenny, journaliste au Monde, victime des attentats du 13 novembre 2015 (mercredi 17 février 2016) 77
Table ronde, ouverte à la presse, consacrée à la prise en charge hospitalière des victimes des attentats de l'année 2015 : M. le médecin général des armées Jean-Marc Debonne, directeur central du service de santé des armées (SSA), M. le médecin général inspecteur Dominique Vallet, adjoint « offre de soins et expertise », M. le médecin en chef Jean-Christophe Bel ; M. Martin Hirsch, directeur général de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), docteur Christophe Leroy, chef du service « gestion des crises sanitaires » à l’AP-HP (lundi 29 février 2016) 82
Audition, ouverte à la presse, de M. Patrice Paoli, directeur de la cellule interministérielle d'aide aux victimes (lundi 7 mars 2016) 109
Audition, ouverte à la presse, de M. Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur (lundi 7 mars 2016) 120
Audition, à huis clos, de M. Jean-Michel Fauvergue, chef du RAID (Recherche Assistance Intervention Dissuasion), et de M. Éric Heip, son adjoint (mercredi 9 mars 2016) 152
Audition, à huis clos, du général Denis Favier, directeur général de la gendarmerie nationale, du colonel Hubert Bonneau, commandant le groupe d'intervention de la gendarmerie nationale (GIGN), et du colonel Armando de Oliveira, commandant la région de gendarmerie de Picardie et le groupement de gendarmerie départementale de la Somme (mercredi 9 mars 2016) 174
Audition, à huis clos, de M. Philippe Chadrys, sous-directeur chargé de l'antiterrorisme à la direction centrale de la police judiciaire (DCPJ), de M. Franck Douchy, directeur régional de la police judiciaire de Versailles, et de M. Frédéric Doidy, chef de l'Office central de lutte contre le crime organisé (OCLCO) et chef des brigades de recherche et d'intervention nationales (BRI) (mercredi 9 mars 2016) 191
Audition, à huis clos, de M. Christophe Molmy, chef de la brigade de recherche et d'intervention (BRI) de la préfecture de police de Paris, et de M. Marc Thoraval, chef de la brigade criminelle de la direction régionale de la police judiciaire (DRPJ) de Paris (jeudi 10 mars 2016) 212
Audition, à huis clos, de M. Patrick Pelloux, médecin urgentiste (lundi 14 mars 2016) 236
Audition, à huis clos, de militaires mobilisés dans le cadre de l’opération Sentinelle le 13 novembre 2015 : lieutenant-colonel D. D., chef de l’état-major tactique de Paris, capitaine P-M. A., commandant d’unité, maréchal des logis chef G. A., chef de la section déployée rue de Charonne et maréchal des logis R. D., chef du groupe intervenu au Bataclan (lundi 14 mars 2016) 246
Audition, à huis clos, de policiers intervenus lors des attentats des 7, 8 et 9 janvier 2015 : M. B. B., commissaire de police, M. M. J., commandant de police, M. J-S. B., chef de bord BAC 11 (lundi 14 mars 2016) 258
Audition, à huis clos, de policiers intervenus lors des attentats du 13 novembre 2015 : M. B. B., commissaire de police, Mme C. P., commissaire de police, M. G. P., commissaire de police, M. G. B., capitaine de police, M. Z. I., commissaire de police, M. D. K., commissaire divisionnaire, M. S. Q., commissaire divisionnaire, M. J. M., commissaire de police, M. F. C., commissaire divisionnaire, Mme V. G., commissaire divisionnaire, M. T. D., commissaire de police (lundi 14 mars 2016) 273
Table ronde, ouverte à la presse, consacrée à la prise en charge des victimes des attentats de l'année 2015 par la brigade de sapeurs-pompiers de Paris (BSPP) et le service d'aide médicale urgente (SAMU) : général Philippe Boutinaud, commandant la BSPP, professeur Jean-Pierre Tourtier, médecin-chef de la BSPP, médecin chef Michel Bignand, colonel Jean-Claude Gallet, adjoint au général commandant la BSPP, colonel Gérard Boutolleau, chef de corps du 2e groupemement d'incendie et de secours et commandant des opérations de secours au Bataclan, ; professeur Pierre Carli, directeur médical du SAMU de Paris, chef de service au département d'anesthésie-réanimation de l'hôpital Necker-Enfants-Malades, professeur Frédéric Adnet, directeur du SAMU 93, responsable du pôle accueil-urgences-imagerie de l'hôpital Avicenne, docteur François Braun, président du SAMU Urgences de France, chef de service médecine d'urgence, docteur Yves Lambert, chef du pôle de l'urgence, directeur du SAMU 78, docteur Valérie-Charlotte Chollet-Xémard, praticien hospitalier du SAMU 94 à l'hôpital Henri-Mondor (mercredi 16 mars 2016) 289
Audition, ouverte à la presse, de M. Jean Benet, directeur des transports et de la protection du public de la préfecture de police de Paris, et du professeur Bertrand Ludes, directeur de l’Institut médico-légal de Paris (mercredi 16 mars 2016) 318
Table ronde, ouverte à la presse, consacrée à la sécurité au Stade de France le 13 novembre 2015 : pour le Consortium Stade de France : M. Christophe Bionne, directeur de la sécurité et de la sûreté, M. Jean-Philippe Dos Santos, directeur-adjoint de la sûreté, Mme Florence Gaillot, assistante de direction, en charge de la saisie de la main courante de l’événement, M. Pascal Begain, chargé de sécurité incendie, M. Damien Chemla, préventeur, chargé des moyens humains et techniques, Mme Suzanne Delourme, chargée de sûreté ; pour la Fédération française de football : M. Victoriano Melero, directeur de cabinet du président et directeur général adjoint, Mme Cécile Grandsimon, responsable réglementation et gestion de la sécurité des rencontres, M. Didier Pinteaux, responsable sécurité et sûreté ; pour les sociétés privées de sécurité : M. Jean-Marc Peninou (Stand up), M. Mustapha Abba Sany (Gest n’sport), M. Bastien Rousseau (SGPS), M. Fabrice Laborie (ACA), M. Olivier Bruel (Alès Event’s), M. Olivier Ploix (ISMA), M. Christian Glaz (MCS), M. Ludovic Foret (JM Sécurité), M. Olivier Roussel (Europa Secure Dog), M. Bruno Lafond et M. Franck Chaboud (Main Sécurité) (mercredi 16 mars 2016) 326
Audition, à huis clos, du commissaire divisionnaire X et du brigadier Z, son chauffeur (jeudi 17 mars 2016) 339
Audition, à huis clos, de fonctionnaires de la BAC de nuit du Val-de-Marne intervenus le 13 novembre 2015 : M. T.P., brigadier-chef, M. L. S., brigadier-chef, M. O. B., brigadier, M. N. B., gardien de la paix, M. A. D., gardien de la paix, et M. P. T., gardien de la paix (lundi 21 mars 2016) 355
Audition, à huis clos, de M. Jean-Marc Falcone, directeur général de la police nationale, et de M. Marc Baudet, conseiller stratégie et prospective (lundi 21 mars 2016) 369
Audition, à huis clos, du général Denis Favier, directeur général de la gendarmerie nationale, et du colonel Samuel Dubuis, membre de son cabinet (lundi 21 mars 2016) 386
Audition, à huis clos, du général Bruno Le Ray, gouverneur militaire de Paris, et du colonel Marc Boileau, chef de cabinet (lundi 21 mars 2016) 402
Audition, à huis clos, de M. Michel Cadot, préfet de police de Paris, M. Christian Sainte, directeur de la police judiciaire à Paris, M. Jacques Méric, directeur de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne, et du général Philippe Boutinaud, commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris (BSPP) (mercredi 23 mars 2016) 417
Table ronde, ouverte à la presse, de syndicats de la police nationale : Mme Céline Berthon, secrétaire générale du Syndicat des commissaires de la police nationale (SCPN), M. Jean-Luc Taltavull, secrétaire général adjoint ; M. Thierry Clair, délégué pôle province d'UNSA Police (mercredi 23 mars 2016) 443
Table ronde, ouverte à la presse, des syndicats de magistrats : M. Olivier Janson, secrétaire général adjoint de l’Union syndicale des magistrats, M. Benjamin Blanchet, chargé de mission ; Mme Clarisse Taron, présidente du Syndicat de la magistrature, Mme Laurence Blisson, secrétaire générale ; Mme Béatrice Brugère, secrétaire générale de FO-Magistrats, M. Jean de Maillard, membre associé (mercredi 23 mars 2016) 457
Audition, à huis clos, de M. François Molins, procureur de la République près le tribunal de grande instance (TGI) de Paris, Mme Véronique Degermann, procureure de la République adjointe près le même TGI, et Mme Camille Hennetier, vice-procureure de la République près ledit TGI (mercredi 30 mars 2016) 472
Audition, à huis clos, de Mme Laurence Le Vert, première vice-présidente chargée de l'instruction au pôle antiterroriste du TGI de Paris, et de M. David Benichou, vice-président chargé de l'instruction au pôle antiterroriste du même TGI (mercredi 30 mars 2016) 486
Audition, à huis clos, de M. Denis Couhé, premier vice-président adjoint du TGI de Paris, M. Laurent Raviot, vice-président du même TGI, présidents de la 16e chambre correctionnelle, et M. Régis de Jorna, président de chambre à la cour d'appel de Paris (mercredi 30 mars 2016) 497
Audition, à huis clos, de Mme Isabelle Gorce, directrice de l'administration pénitentiaire, et de Mme Fabienne Viton, cheffe du bureau du renseignement pénitentiaire (lundi 4 avril 2016) 509
Audition, à huis clos, de M. Marc Trévidic, premier vice-président du TGI de Lille (mercredi 6 avril 2016) 528
Audition, à huis clos, de M. Vincent Le Gaudu, vice-président chargé de l’application des peines au TGI de Paris (mercredi 6 avril 2016) 542
Table ronde, ouverte à la presse, de syndicats de la presse : M. Jean Viansson- Ponté, président du Syndicat de la presse quotidienne régionale (SPQR), Mme Haude d’Harcourt, conseillère chargée des relations avec les pouvoirs publics, et M. Jacques Lallain, secrétaire général de la rédaction du Parisien ; M. Denis Bouchez, directeur du Syndicat de la presse quotidienne nationale (SPQN) ; M. Jean-Christophe Boulanger, président du Syndicat de la presse indépendante d’information en ligne (SPIIL) (lundi 25 avril 2016) 553
Table ronde, ouverte à la presse, de représentants de médias audiovisuels : Groupe TF1 : M. Antoine Guélaud, directeur de la rédaction de TF1, M. Nicolas Charbonneau, directeur général de LCI, M. Philippe Moncorps, directeur juridique de l’information, Mme Nathalie Lasnon, directrice des affaires réglementaires et concurrence ; Groupe France Télévisions : M. Michel Field, directeur exécutif chargé de l’information, M. Alexandre Kara, directeur de la rédaction, Mme Audrey Goutard, adjointe au chef de service enquêtes et reportages ; BFM TV : M. Hervé Béroud, directeur de l’information, Mme Cécile Ollivier, reporter police ; iTélé : M. Guillaume Zeller, directeur de la rédaction, M. Alexandre Ifi, directeur adjoint de la rédaction ; Groupe Radio France : M. Olivier Zegna Rata, directeur des relations institutionnelles et internationales de Radio France ; M. Grégory Philipps, directeur adjoint de la rédaction de France Info, Mme Angélique Bouin, directrice adjointe de la rédaction de France Inter ; RMC : M. Hervé Béroud, directeur de l’information (lundi 25 avril 2016) 565
Audition, ouverte à la presse, de M. Guillaume Blanchot, directeur général du Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA), et de M. Thomas Dautieu, adjoint à la directrice des programmes (mercredi 27 avril 2016) 586
Audition, à huis clos, de M. Jérôme Bonnafont, directeur d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient à l’administration centrale du ministère des Affaires étrangères et du Développement international, M. Didier Chabert, sous-directeur du Moyen-Orient, M. Philippe Errera, directeur général des relations internationales et de la stratégie du ministère de la Défense, et M. Fouad El Khatib, chef du département Afrique du Nord et Moyen-Orient (mercredi 27 avril 2016). 597
Audition, à huis clos, du colonel Bruno Arviset, secrétaire général du Conseil de la fonction militaire de la gendarmerie nationale, du chef d’escadron Philippe-Alexandre Assou, du chef d’escadron Y, du major Emmanuel Franchet, de l’adjudant-chef Frédéric Guaignier, de l’adjudant Raoul Burdet, de l’adjudant Vincent Delaval, de l’adjudant Sébastien Perrier et de la gendarme Annaïk Kerneis (lundi 9 mai 2016) 612
Audition, à huis clos, de M. Jean-Jacques Colombi, chef de la division des relations internationales à la direction centrale de la police judiciaire (DCPJ), et de M. Alexandre Pichon, son adjoint (lundi 9 mai 2016) 628
Audition, à huis clos, du général Pierre de Villiers, chef d’état-major des armées (lundi 9 mai 2016). 643
Audition, à huis clos, de M. Grégoire Doré, chef-adjoint de l'unité de coordination des forces d'intervention (UCOFI) (mercredi 11 mai 2016) 666
Table ronde, ouverte à la presse, de spécialistes du Moyen-Orient : M. Pierre-Jean Luizard, historien, directeur de recherche au Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ; M. Béligh Nabli, directeur de recherche à l’Institut de relations internationales et stratégiques (IRIS) ; M. Wassim Nasr, journaliste à France 24 ; M. Pierre Razoux, directeur de recherche à l’Institut de recherche stratégique de l’École militaire (IRSEM) (mercredi 11 mai 2016) 680
Audition, à huis clos, de M. David Skuli, directeur central de la police aux frontières (PAF), M. Fernand Gontier, directeur central adjoint, et M. Bernard Siffert, sous-directeur des affaires internationales, transfrontières et de la sûreté (jeudi 12 mai 2016) 698
Audition, à huis clos, de Mme Hélène Crocquevieille, directrice générale des douanes et des droits indirects, M. Jean-Paul Balzamo, sous-directeur des affaires juridiques et contentieuses, des contrôles et de la lutte contre la fraude, et M. Jean-Paul Garcia, directeur national du renseignement et des enquêtes douanières (jeudi 12 mai 2016) 714
Audition, à huis clos, de M. Didier Le Bret, coordonnateur national du renseignement (CNR) (mercredi 18 mai 2016) 727
Audition, à huis clos, de M. Francis Delon, président de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR), accompagné de M. Marc Antoine, conseiller auprès du président (mercredi 18 mai 2016) 746
Table ronde, ouverte à la presse, de spécialistes du renseignement : M. Jean-François Clair, ancien directeur-adjoint de la direction de la surveillance du territoire (DST) ; M. Philippe Hayez, responsable de la spécialité « renseignement » de l'École des affaires internationales de l'Institut d'études politiques de Paris ; M. François Heisbourg, conseiller spécial du président de la Fondation pour la recherche stratégique ; M. Sébastien-Yves Laurent, professeur à la faculté de droit et de science politique à l'Université de Bordeaux ; M. Damien Martinez, secrétaire général du Centre d'analyse du terrorisme (CAT) (jeudi 19 mai 2016) 759
Audition, à huis clos, de M. Jérôme Léonnet, chef du service central du renseignement territorial (SCRT) (jeudi 19 mai 2016) 771
Audition, à huis clos, du général Pierre Sauvegrain, sous-directeur de l’anticipation opérationnelle de la gendarmerie nationale (SDAO), et de M. Olivier Métivet, son adjoint (lundi 23 mai 2016). 783
Audition, à huis clos, de M. Olivier de Mazières, chargé de l’état-major opérationnel de prévention du terrorisme (EMOPT) (lundi 23 mai 2016) 798
Audition, à huis clos, de M. Patrick Calvar, directeur général de la sécurité intérieure (DGSI), accompagné de Mme Marie Deniau, cheffe de cabinet (mardi 24 mai 2016). 813
Audition, à huis clos, de M. Louis Gautier, secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale (SGDSN) (mercredi 25 mai 2016). 839
Audition, à huis clos, de M. Bernard Bajolet, directeur général de la sécurité extérieure (DGSE) (mercredi 25 mai 2016) 856
Audition, à huis clos, de M. René Bailly, directeur du renseignement à la préfecture de police de Paris (DRPP) (jeudi 26 mai 2016) 871
Audition, à huis clos, du général Christophe Gomart, directeur du renseignement militaire (DRM), Mme Lorraine Tournyol du Clos, adjointe au directeur, chargée de la stratégie, et du colonel N, assistant militaire (jeudi 26 mai 2016) 889
Audition, ouverte à la presse, de M. Jean-Jacques Urvoas, garde des Sceaux, ministre de la Justice (mercredi 1er juin 2016) 902
Audition, ouverte à la presse, de M. Jean-Yves Le Drian, ministre de la Défense (mercredi 1er juin 2016) 920
Audition, ouverte à la presse, de M. Bernard Cazeneuve, ministre de l’Intérieur (jeudi 2 juin 2016) 938
Audition, ouverte à la presse de Mme Juliette Méadel, secrétaire d’État chargée de l'aide aux victimes (jeudi 16 juin 2016) 969
Table ronde, ouverte à la presse, de victimes et de proches de victimes des attentats du 13 novembre 2015 : Association 13 novembre : fraternité et vérité : M. Georges Salines, président, M. Mohammed Zenak, trésorier, Mme Sophie Dias, membre de l’association, Mme Aurélia Gilbert, membre de l’association ; Association Life for Paris – 13 novembre 2015 : Mme Caroline Langlade, vice-présidente, Mme Lydia Berkennou, membre de l’association, M. Alexis Lebrun, membre de l’association ; M. Grégory Reibenberg, dirigeant du restaurant « La Belle Équipe »
Compte rendu de la table ronde, ouverte à la presse, du lundi 15 février 2016
M. le président Georges Fenech. Mesdames et messieurs, nous vous remercions d’avoir répondu à l’invitation de la commission d’enquête relative aux moyens mis en œuvre par l’État pour lutter contre le terrorisme depuis le 7 janvier 2015.
Cette commission d’enquête s’est constituée le 9 février dernier ; elle comporte trente membres issus de toutes les formations politiques représentées dans notre assemblée. Le rapporteur Sébastien Pietrasanta et moi-même sommes assistés de quatre vice-présidents et quatre secrétaires. Sauf empêchement, nous nous réunirons les lundis et mercredis après-midi ainsi que les jeudis matins.
Nous ne sommes ni des procureurs ni des juges, nous n’accusons ni ne jugeons ; nous sommes des commissaires d’enquête, dont l’objectif est d’établir la vérité et d’en tirer des propositions pour que le Gouvernement prenne les dispositions qui s’imposent pour remédier à ce qui ne va pas.
J’indique à l’intention de la presse que, conformément aux dispositions de l’article 6 de l’ordonnance du 17 novembre 1958 et dans un souci de transparence, la règle est celle de la publicité de nos travaux. La presse écrite est donc autorisée à assister aux auditions. Une retransmission audiovisuelle sera assurée par le canal interne de l’Assemblée et diffusée en direct sur son site internet, les vidéos demeurant disponibles pendant quelques mois.
Toutefois des exceptions à la règle de la publicité seront appliquées lorsqu’il s’agira de préserver les secrets professionnels – secret-défense, secret de l’instruction – de certaines personnalités que nous serons amenés à auditionner. De même, les auditions pourront se tenir à huis clos, à la demande des personnes auditionnées, même si elles ne sont pas soumises au secret. En ce cas, un compte rendu, total ou partiel, sera publié a posteriori.
Les séances d’aujourd’hui et de mercredi seront exclusivement consacrées à l’audition des victimes des attentats commis le 13 novembre 2015, à celle de leurs associations et de leurs avocats. Le 29 février, une séance sera consacrée aux attentats du mois de janvier 2015.
Si nous avons décidé de commencer par entendre les victimes, c’est avant tout pour leur manifester notre solidarité mais également pour entendre tout ce qu’elles ont à nous dire, tant sur ce qui concerne la manière dont elles ont été prises en charge que sur les difficultés qu’elles ont eu à affronter.
Mesdames et messieurs, votre liberté de parole est totale pour nous faire part de votre sentiment sur les moyens dont dispose l’État face à des événements dont on sait qu’ils risquent de se reproduire.
Le vendredi 13 novembre 2015, les attentats djihadistes perpétrés à Paris ont fait 130 morts et des centaines de blessés. Au total, ce sont 4 000 personnes qui sont considérées comme victimes directes ou indirectes par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI).
L’association « 13 novembre : fraternité et vérité » a été constituée le 9 janvier 2016 par des victimes et proches de victimes de l’ensemble des sites touchés. Elle a pour objet de permettre aux victimes et à leurs proches de se rencontrer. Elle veut également les accompagner dans la défense de leurs droits et agir pour la manifestation de la vérité. Elle est représentée ici par son président, M. Georges Salines, 58 ans, dont la fille a été tuée au Bataclan. M. Mohammed Zenak, 58 ans, trésorier de l’association ; Mme Sophie Dias, 34 ans, qui a perdu son père au Stade de France ; Mme Aurélia Gilbert, 43 ans.
L’association « Life for Paris » est quant à elle représentée par sa vice-présidente, Mme Caroline Langlade, 29 ans, rescapée du Bataclan ; Mme Lydia Berkennou, 27 ans, rescapée du Bataclan ; M. Alexis Lebrun, rescapé du Bataclan.
Nous accueillons également M. Grégory Reibenberg, patron du restaurant La Belle Équipe, 46 ans, rescapé de la fusillade de son restaurant, dans laquelle il a perdu la mère de sa fille.
M. Sébastien Pietrasanta, rapporteur. Les travaux de notre commission d’enquête obéiront à une double exigence, celle de la vérité et celle de l’efficacité. La vérité, nous la devons aux Français et avant tout à vous, les victimes. Nous entendons enquêter pour connaître la vérité des faits, sans parti pris, dans le respect de nos institutions judiciaires.
Quant à l’efficacité, nous entendons faire œuvre utile pour notre pays, et je veillerai personnellement à ce que le rapport comporte des propositions très concrètes.
Si nous avons souhaité débuter nos travaux par l’audition des victimes, c’est afin de leur exprimer notre solidarité et de montrer que nous travaillons d’abord pour elles, pour vous qui êtes là. Nous attendons que vous vous exprimiez librement, dans le but de nous aider à apporter des réponses aux questions légitimes que vous vous posez.
M. le président Georges Fenech. Mesdames et messieurs, avant de vous donner la parole, je dois, conformément à l’article 6 de l’ordonnance du 17 novembre 1958 relative aux commissions d’enquête, vous demander de prêter serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité.
M. Georges Salines, M. Mohammed Zenak, Mme Sophie Dias, Mme Aurélia Gilbert, Mme Caroline Langlade, Mme Lydia Berkennou, M. Alexis Lebrun et M. Grégory Reibenberg prêtent serment.
M. Georges Salines, président de l’association « 13 novembre : fraternité et vérité ». L’un des objets de notre association est d’agir pour la manifestation de la vérité, ce qui rejoint les objectifs de votre commission, chargée de faire la lumière sur la manière dont notre pays fait face au terrorisme. Nous espérons donc que nos témoignages vous y aideront.
Nous avons parmi nos adhérents des témoins directs de ce qui s’est passé le 13 novembre, qui peuvent témoigner de ce qu’ils ont pu constater sur les lieux des attentats tant en matière de sécurité qu’en ce qui concerne l’intervention des forces de l’ordre ou l’assistance portée aux blessés et aux victimes.
Quant aux personnes dans ma situation, proches de victimes, elles ont aussi des choses à dire, si tant est que les moyens de lutte contre le terrorisme vous paraissent devoir également inclure les moyens d’en atténuer les effets les plus douloureux : il y a en effet des choses à améliorer dans les dispositifs d’information des personnes qui recherchent des disparus, dans le processus d’identification des morts et dans la manière dont sont annoncées les nouvelles, surtout quand elles sont mauvaises, aux parents des victimes. De même, nous pouvons témoigner que des progrès restent à faire dans l’organisation des dispositifs d’aide – financière, juridique ou sanitaire – déclenchés en aval des attentats. En effet, si notre pays dispose en la matière d’outils assez remarquables que beaucoup peuvent nous envier, tout est loin malgré tout d’être parfait, notamment sur le plan de la coordination et de l’unité de doctrine.
Il est difficile notamment, lorsque l’on a souffert d’un traumatisme psychologique, de trouver le bon interlocuteur au sein d’un système psychiatrique français, très fragmenté par les querelles d’école et composé de professionnels plus ou moins compétents dans le domaine du psychotrauma. De même, tous les avocats ne sont pas spécialistes des affaires de terrorisme. Quant aux procédures administratives, leur complexité conduit parfois à des aberrations – certaines des victimes du Bataclan ou des terrasses ne figurent toujours pas, par exemple, sur la liste des personnes à indemniser – qui sont autant de tracasseries difficiles à tolérer pour des victimes en état de grande fragilité psychologique. La nomination d’une secrétaire d’État chargée de l’aide aux victimes au sein du Gouvernement suffira-t-elle à résoudre ces problèmes de coordination ? La réponse dépend en partie de l’administration sur laquelle elle pourra s’appuyer pour apporter les solutions appropriées.
Agir pour la manifestation de la vérité, c’est aussi vous interpeller pour obtenir des réponses aux mille questions que nous nous posons. Vous enquêtez sur les moyens mis en œuvre par l’État pour lutter contre le terrorisme depuis le 7 janvier 2015, mais ce qui s’est passé le 13 novembre ne doit-il pas d’emblée nous conduire à dresser un premier constat d’échec ? Ces attentats pouvaient-ils être évités ? Qu’en est-il de la manière dont ont été mobilisés les moyens policiers et les forces de renseignement pour surveiller les apprentis terroristes et les filières djihadistes ? Ne doit-on pas s’interroger sur le déploiement massif des forces de sécurité sur le territoire ? De nombreux militaires patrouillent dans Paris en tenue léopard, ce qui est sans doute très adapté pour se camoufler dans la jungle mais ce qui peut apparaître d’une efficacité contestable si, par ailleurs, les lieux de spectacle et de rassemblement sont insuffisamment protégés.
Selon nous, les moyens de lutter contre le terrorisme ne peuvent se résumer aux moyens policiers et sécuritaires, en excluant la prévention. À titre personnel, je m’inquiète d’entendre dire au plus haut niveau de l’État qu’expliquer le djihadisme, c’est déjà l’excuser. Je suis le dernier qui penserais à excuser les personnes qui ont tué ma fille ou celles qui les ont manipulées, mais il me semble absolument essentiel, si l’on veut lutter, d’expliquer les mécanismes qui conduisent de jeunes Français à prendre les armes contre des jeunes de leur âge.
Il faut saluer ici le travail de fourmi accompli par Mme Latifa Ibn Ziaten, que j’ai rencontrée, ou par Dounia Bouzar, qui interviennent auprès de jeunes en danger d’être recrutés par des mouvements radicaux islamistes de type sectaire. Malheureusement, en l’état actuel des moyens mobilisés, leur tâche s’apparente surtout à vouloir vider la mer à la petite cuillère et, si l’on veut être efficace, il faudra sans doute changer d’échelle.
Pour en être arrivée là, notre société doit être bien malade, et nous devons nous interroger sur les moyens de la soigner, ce qui n’est nullement une manière de renverser la culpabilité. La France n’est pas plus coupable de ce qui lui est arrivé le 13 novembre que les États-Unis ne le sont des attentats du 11 septembre ou Londres des attentats de 2005. Les coupables restent les coupables et rien ne justifiera les crimes odieux qu’ils ont commis.
D’autres commissions d’enquête parlementaires se sont déjà penchées sur le terrorisme, notamment celle présidée par M. Éric Ciotti sur la surveillance des filières et des individus djihadistes. Quelles ont été les préconisations de ces commissions ? Ont-elles été mises en œuvre ?
M. le président Georges Fenech. Je précise à ce stade que notre commission d’enquête a délibérément choisi de concentrer ses travaux sur les moyens mis en œuvre pour lutter contre le terrorisme et non sur les phénomènes de radicalisation qui ont déjà fait l’objet de plusieurs commissions d’enquête.
J’aimerais par ailleurs que vous nous précisiez quelles sont vos marges de manœuvre au plan judiciaire, puisque votre association est nouvellement créée.
M. Georges Salines. Dans la mesure où notre association n’a pas cinq ans d’existence, elle ne peut, en application de l’article 2-5 du code de procédure pénale, se constituer partie civile, ce qui est pour le moins paradoxal, dans la mesure où nous représentons les victimes directes d’actes qui feront l’objet d’une procédure judiciaire.
Quelques jours avant de quitter le Gouvernement, Christiane Taubira m’avait indiqué être favorable à l’alignement de notre régime sur celui des victimes de catastrophes, pour lesquelles est prévue une dérogation qui permet aux associations, sous réserve d’un agrément du ministère de la justice, de se constituer parties civiles. J’ai soumis la même requête à M. Jean-Jacques Urvoas, dont nous attendons qu’il s’engage à son tour sur ce point.
M. le président Georges Fenech. La Commission des lois se penche dès mercredi sur un projet de loi de réforme de la procédure pénale qui pourrait être l’occasion de faire évoluer le droit sur cette question.
Vous vous êtes également plaints de ne pas avoir eu accès aux rapports d’autopsie et de ne pas avoir été reçus par les juges.
M. Georges Salines. La plupart des familles endeuillées souhaitent savoir ce qui est arrivé à la personne qu’elles ont perdue. Cela est possible par l’intermédiaire d’un avocat, ce qui implique de prendre un avocat et de le payer. C’est entre autres la raison pour laquelle nous demandons que les frais d’avocat soient pris en charge par le FGTI. Cela étant, à ma connaissance, les rapports médicaux n’ont pas encore été versés au dossier. Nous souhaitons plus généralement être tenus informés du déroulement de la procédure d’instruction et demandons aux juges, en particulier au juge Teissier, de réunir le plus rapidement possible à cet effet l’ensemble des parties civiles.
M. François Lamy. Disposez-vous d’un canal officiel d’accès à l’information au sein des services de l’État ?
Pensez-vous que le nouveau secrétariat d’État à l’aide aux victimes puisse remplir cette fonction ?
M. Georges Salines. Nous ne disposons d’aucune source d’information régulière. Bénéficier d’un retour d’expérience, auquel nous participerions, fait partie de nos demandes. La seule action à laquelle nous avons été associés – et encore était-ce à notre demande – est une journée de réflexion organisée par le ministère de la santé, au cours de laquelle nous avons pu nous exprimer sur l’absence de prise en charge sur les lieux des attentats des personnes qui n’étaient pas blessées et qui ont, le plus souvent, été renvoyées chez elles alors qu’elles avaient perdu leurs vêtements, leur téléphone, leur argent ou leurs papiers.
J’ai également beaucoup insisté sur l’atroce insuffisance du dispositif d’information des personnes recherchant des disparus : un numéro de téléphone qui s’est révélé injoignable des heures durant, des plateformes téléphoniques multiples correspondant aux différents hôpitaux et à l’Institut médico-légal et, au final, des ratages au-delà de l’imaginable, pour ce qui est de l’annonce des décès.
Pour le reste nous ne disposons d’aucune information ni régulière ni ponctuelle. Suggérer à la nouvelle secrétaire d’État de remplir ce rôle peut en effet être une bonne idée…
M. Serge Grouard. Vous insistez sur la situation terrible dans laquelle se sont trouvés les parents de victimes qui cherchaient à obtenir des nouvelles de leurs proches lors de la nuit où ont eu lieu les attentats, mais dressez-vous le même constat pour les jours qui ont suivi ? Avez-vous eu, ou non, le sentiment que les dispositifs s’organisaient ?
M. Georges Salines. Dans la nuit du 13 au 14 novembre, le dispositif d’information des victimes et des personnes impliquées s’est avéré déficient, probablement parce qu’il n’avait pas été correctement dimensionné et que l’on n’avait guère anticipé qu’un attentat pourrait provoquer autant de victimes. C’était pourtant prévisible au regard de ce qui s’est déjà produit dans d’autres capitales et dans la mesure où Paris se savait menacée. Par ailleurs, tous les instruments nécessaires n’ont pas été mis en place. Il n’existe notamment pas de système d’information commun à l’ensemble des établissements de santé de la région parisienne. C’est donc aux proches des victimes de les contacter les uns après les autres, car aucun dispositif d’assistance de recherche n’a été prévu.
Pour les jours qui ont suivi, je dresserai un tableau moins noir de la situation, car certains dispositifs existent, notamment les associations d’aide aux victimes réunies au sein de l’Institut national d’aide aux victimes et de médiation (INAVEM). Cela est vrai en tout cas à Paris, car il semble que les choses soient plus difficiles en province.
Une association comme Paris Aide aux Victimes est un bon portail d’entrée mais ne supprime pas la totalité des obstacles. La prise en charge à 100 % par la sécurité sociale dépend de l’inscription sur la liste des victimes ; or, dans certains cas, on vous suggère pour figurer sur cette liste de vous constituer partie civile, alors qu’il s’agit de deux démarches sans rapport et que se constituer partie civile n’a rien d’obligatoire. Par ailleurs, cette prise en charge court non à partir du 13 novembre mais à partir de la date de demande de prise en charge, ce qui est encore une aberration.
M. Mohammed Zenak, trésorier de l’association « 13 novembre : vérité et fraternité ». Je suis le père de Sonia, 22 ans, blessée au Comptoir Voltaire. Nous avons la chance qu’elle ait toujours été consciente et qu’elle ait donc pu nous prévenir qu’elle était en vie. À trois heures du matin, elle a ainsi pu nous indiquer qu’elle était dirigée vers la Pitié-Salpêtrière, où elle a été prise en charge, comme tous les blessés, sous un numéro. À ce sujet, si l’on peut admettre qu’il y ait eu, cette première nuit, un certain nombre de cafouillages, que dire du fait que, le lendemain et le surlendemain, certains blessés, ceux dans le coma notamment, n’avaient pas encore de nom ?
Je voudrais par ailleurs insister sur le manque de suivi après l’hospitalisation. Opérée à cinq reprises, ma fille a quitté l’hôpital au bout de trois semaines, sans que rien n’ait été prévu pour sa sortie, ni médicalement ni psychologiquement, et il a été très compliqué de trouver une cellule d’aide psychologique qui accepte de se déplacer à domicile pour l’aider, sachant qu’elle était dans un état de fragilité psychique qui l’empêchait de sortir.
Mme Françoise Dumas. Je ne peux que rendre hommage au courage et à la résilience dont vous faites tous preuve ici pour surmonter vos souffrances. Il me semble que le fait de vous regrouper en associations est une manière de vous reconstruire en dépassant l’addition de vos solitudes face à un événement traumatique imprévisible, dont les services publics requis n’avaient pas anticipé l’ampleur, ce qui explique sans doute les manquements dont vous avez tous été témoins ou victimes.
Pensez-vous qu’il faille, pour pallier ces manquements, installer au sein de chaque ministère une personne et une cellule référente ? Pensez-vous qu’il soit préférable et plus efficace d’organiser ces relais d’information au niveau territorial ? Doit-on imaginer une forme de guichet unique ?
M. Mohammed Zenak. Certains de nos adhérents en Province se plaignent de ne pas avoir accès à l’information ; l’auront-ils davantage avec un guichet unique ? Un guichet unique est-il d’ailleurs envisageable lorsque sont impliqués des services aussi différents que les pompiers, la police, l’armée, les services sanitaires ?
M. Georges Salines. Vous expliquez l’impréparation des services par l’ampleur inédite des événements et le nombre de victimes. Sans doute mais, sans refaire l’histoire a posteriori, des attaques comme celles-ci se sont déjà produites – je pense en particulier aux attentats de Bombay qui ont touché simultanément plusieurs points de la ville. Je ne peux donc m’empêcher de penser que l’on a préparé la guerre de 14-18 en 1939.
Concernant les interlocuteurs vers lesquels peuvent se tourner les victimes pour demander de l’aide et résoudre leurs difficultés, on les trouve dans les quelque cent cinquante associations d’aide aux victimes, et notamment à Paris, au sein de Paris Aide aux victimes. Ces associations gèrent en réalité un service public : est-ce pertinent ? Je ne me prononcerais pas mais la question mérite d’être posée.
Reste ensuite le problème de l’interlocuteur vers lequel peuvent se tourner ces associations. Il est en effet très compliqué, lorsqu’on est bénévole au sein d’une association, de gérer la multiplicité des interlocuteurs impliqués. J’ai pour ma part un travail par ailleurs, et n’ai pas l’intention de devenir une victime professionnelle ; il est probable qu’avoir un référent unique me simplifierait la tâche.
Mme Sophie Dias, membre de l’association « 13 novembre : fraternité et vérité ». Je suis la fille de Manuel Dias, chauffeur de car, tué, à 63 ans, devant la porte D du Stade de France.
La mise en place d’un guichet unique me paraît en effet indispensable, en particulier pour les personnes habitant la Province, ce qui est le cas de maman. Il m’a fallu proprement implorer un rendez-vous auprès de l’association d’aide aux victimes locale, qui était débordée. Nous n’avons bénéficié d’aucun traitement prioritaire et le psychologue qui nous a reçues nous a expliqué ne pas pouvoir faire grand-chose pour nous, ce qui montre à quel point les moyens de ces associations sont limités.
Quant à l’ampleur imprévisible des attentats, j’aimerais être rassurée sur la protection de nos stades, à l’approche des événements sportifs que notre pays se prépare à accueillir. Les nombreuses victimes du Bataclan ont sans doute détourné l’attention de la seule victime qu’il y a eu au Stade de France, mais cette victime était mon père.
En ce qui concerne le numéro vert à contacter pour obtenir des informations sur les personnes disparues, je signale qu’il était inaccessible depuis l’étranger. Les personnes que ma mère y a eu en ligne n’ont cessé de lui répéter que le fait qu’elle n’ait pas de nouvelles était plutôt bon signe…
Il nous a fallu contacter par nous-mêmes tous les hôpitaux proches du stade de France, en vain, car papa n’était sur aucune des listes. Ce n’est qu’en passant par le consulat du Portugal – puisque papa était portugais – que j’ai pu avoir confirmation de son décès, le samedi à quatorze heures, le Quai d’Orsay ayant attendu quarante-huit heures pour me contacter. C’est inadmissible et c’est grave. On ne peut envisager que de telles erreurs se reproduisent, et il ne me paraît pas si compliqué de gérer informatiquement une liste d’une centaine de noms, sans céder au fatalisme de ceux qui pensent que si les attaques avaient massivement touché le Stade on en serait encore, aujourd’hui, à compter nos morts…
En ce qui concerne le rapport d’autopsie, nous n’y avons toujours pas eu accès, pas plus que nous ne disposons des informations qui pourraient nous aider à faire notre deuil. Il est indispensable que les victimes puissent se tourner vers quelqu’un qui les écoute et les renseigne. C’est l’un des buts de notre association.
M. Grégory Reibenberg, patron du restaurant La Belle Équipe. J’ai perdu le soir du 13 novembre, la mère de ma fille et douze proches dont certains travaillaient avec moi. Je m’étonne qu’il faille mettre en place une commission d’enquête pour en arriver à la conclusion que les victimes doivent pouvoir trouver en face d’elles des interlocuteurs compétents, mais cela s’explique sans doute par l’archaïsme de notre système administratif.
Pour le reste, j’ai un point de vue qui diffère de celui de Sophie Dias et ne pense pas qu’il faille installer des militaires dans chaque stade. Depuis le 13 novembre, j’essaie d’échapper au discours ambiant sur la peur en n’allumant plus la télévision.
Ce soir-là, j’ai eu affaire à des policiers qui m’ont demandé huit fois mes papiers sans me proposer un verre d’eau, j’ai attendu quarante minutes les pompiers, mais nous ne sommes ni à Tel-Aviv ni à Beyrouth, et je n’ai pas envie que nous investissions tout notre argent et toute notre énergie pour nous spécialiser dans ce genre de traumatismes. Tous ces morts, ces blessés, ces victimes indirectes, ces morts vivants à cause de sept individus, ce n’est pas censé se reproduire tous les jours. Et j’espère que cela sera très rare. La résilience, c’est personnel. Certes, on peut être aidé mais vous seul pouvez faire quelque chose pour vous. Je dois à la vérité de dire que les personnes de Paris Aide aux victimes que j’ai contactées fin décembre se sont montrées parfaitement prévenantes, disponibles et compétentes.
On n’empêchera jamais un assassin d’être un assassin, et l’on pourra déployer tous les policiers et tous les militaires que l’on veut, cela n’y changera rien. Il est très facile de tuer, et ce qui doit nous inquiéter, c’est le nombre d’individus lâchés dans la nature qui peuvent passer à l’acte demain. C’est contre cela que nous devons lutter. Or qu’a-t-on fait depuis le 7 janvier, à part mettre sur la table l’idée de la déchéance de nationalité, mesure symbolique à mon sens complètement inutile ? Est-il sérieux, quand on a un problème de moteur de se préoccuper de la couleur des sièges ? Je ne comprends pas.
M. le président Georges Fenech. Notre commission d’enquête a d’autres ambitions que de résoudre les questions administratives liées à la prise en charge des victimes. Mais améliorer l’organisation de nos services est néanmoins nécessaire et cela fait partie des questions que nous nous devons d’aborder.
Mme Aurélia Gilbert, membre de l’association « 13 novembre : fraternité et vérité ». Je suis rescapée du Bataclan, où je suis restée cachée pendant plus de deux heures avant d’être libérée par les équipes de la brigade de recherche et d’intervention (BRI) juste avant l’assaut de minuit dix, alors que les preneurs d’otages étaient encore dans les lieux. Comme beaucoup, il m’a fallu traverser cette fosse épouvantable où, deux heures auparavant, nous étions réunis pour assister à un concert de rock.
Notre association a pour but d’aider toutes les personnes concernées – proches de victimes et rescapées de l’ensemble des sites – à se repérer face à une multiplicité d’interlocuteurs, sachant que tous ne sont pas dans une situation sociale, psychologique ou physique leur permettant d’avoir accès à la bonne information et à une prise en charge médico-psychologique appropriée.
Pour ma part, je suis la preuve que les choses peuvent bien se passer : je figure sur les listes, je me suis rendue à l’École militaire au bon moment, j’ai été prise en charge correctement et contactée par le FGTI. Mais les choses ne sont pas aussi simples pour tout le monde.
Nous recevons notamment encore à l’association des primodemandeurs, c’est-à-dire des personnes ayant développé un complexe du survivant et que le fait de s’en être sorti indemne a incité à penser que tout allait bien et qu’elles n’étaient pas légitimes à demander de l’aide. Or les troubles peuvent apparaître avec retard, et c’est la raison pour laquelle nous demandons la pérennisation des cellules d’urgence. Il faut également songer au cas des étrangers, qui n’ont pas accès aux mêmes dispositifs dans leur pays de résidence et ne savent pas forcément qu’ils ont le droit à l’aide du Fonds de garantie.
C’est donc pour aider tous ces gens, ceux qui sont blessés à vie et ne pourront pas retrouver une vie normale, que je me suis engagée au sein de l’association, sachant qu’aider les autres fait également partie du processus de reconstruction des rescapés.
Une remarque enfin sur la façon dont vous avez éludé un peu rapidement, monsieur le président, les travaux de la commission d’enquête sur les filières djihadistes. J’ai lu son rapport, qui comportait un certain nombre de préconisations, notamment concernant la mise en place du PNR – Passenger Name Record – ou la collaboration entre services de renseignement et services de police. Savoir lesquelles de ces propositions ont été implémentées depuis le mois de juin et quel est l’état des lieux que l’on peut dresser aujourd’hui sont des questions sur lesquelles nous ne pouvons passer aussi rapidement.
M. le président Georges Fenech. Votre requête est légitime, et notre commission d’enquête s’est aussi créée pour obtenir des réponses à ces questions et déterminer dans quelle mesure les dispositifs ont évolué par rapport aux constats faits par la précédente commission d’enquête, à laquelle le rapporteur et moi-même participions. Où en sont les discussions européennes sur le PNR ? Qu’a changé la nouvelle législation sur le renseignement ? Les responsables politiques que nous auditionnerons auront le devoir de nous éclairer sur ces questions.
M. Alain Marsaud. Madame Gilbert, vos remarques signifient-elles que vous estimez les hommes politiques incapables de transformer le système ? Il est vrai que rien de ce qu’a recommandé la commission sur les filières djihadistes n’a été mis en œuvre et que, depuis cinq ans que l’on en parle, le PNR, ce fichier qui recenserait les données concernant les voyageurs empruntant l’espace aérien européen, est bloqué au motif qu’il constituerait une atteinte aux libertés individuelles – ce qui n’est pas totalement inexact. En tant que citoyenne, comment l’expliquez-vous et comment jugez-vous l’action des politiques que nous sommes ?
Mme Aurélia Gilbert. Ce n’est pas à nous de juger l’action des politiques, et il est d’ailleurs trop tôt pour le faire. Nous sommes attentifs à la protection des libertés individuelles, et toute la difficulté, telle qu’elle était déjà pointée dans le rapport de la commission sur les filières djihadistes, va être de trouver le juste équilibre entre les moyens donnés aux services de renseignement et de police pour prévenir les attaques terroristes et la préservation des libertés individuelles.
Nous devons, très en amont, nous préoccuper de la prévention, pour empêcher ces jeunes Français, que j’ai regardé dans les yeux et qui ont voulu me tuer, de tuer d’autres Français. Demandons-nous à quel moment nous les avons perdus. Ce sont des assassins, mais ils restent des êtres humains, qui ont grandi et été éduqués dans notre société. La menace qui nous guette ne vient plus aujourd’hui du GIA mais des enfants de la République.
M. Georges Salines. Il nous est d’autant plus difficile de juger l’action des politiques que nous avons des opinions diverses, notamment sur la déchéance de nationalité. Le fait d’être des victimes ne fait pas pour autant de nous des experts.
À titre personnel néanmoins, je peux témoigner qu’un certain nombre de binationaux nés en France de parents musulmans ont perçu dans le brouhaha actuel un message qui leur été adressé selon lequel ils n’étaient pas tout à fait des Français comme les autres – certainement à tort. Pourtant, nombre de ces binationaux font partie des victimes du 13 novembre, et la réprobation universelle face aux attentats aurait dû nous donner l’occasion de recréer entre les Français de différentes origines un lien bien plus fort que le 7 janvier, où s’opposaient ceux qui étaient Charlie et ceux qui ne l’étaient pas. Or la manière dont s’est construit le débat politique laisse un sentiment de désordre et de cacophonie qui sont venus perturber la solennité du moment. Nous pouvons tous le regretter.
Mme Caroline Langlade, vice-présidente de l’association « Life for Paris – 13 novembre 2015 ». Il y a trois mois, nous avons subi le terrorisme, la barbarie et la violence aveugle. Une fois l'état de sidération passé, il a fallu nous relever et agir. Nous nous sommes alors fédérés autour de l'appel lancé par Maureen Roussel sur Facebook et avons créé l'association Life for Paris, qui regroupe des blessés, des parents de disparus, des victimes psychologiques et des aidants. Cet appel, vu deux millions de fois, a permis le regroupement de plus d'un demi-millier de personnes impliquées directement qui, par-delà le réseau social, se structurent depuis le 13 janvier dernier pour mener une action de long terme. En effet, la prise en charge et l'accompagnement des victimes exigent un travail de longue haleine. Au-delà de l'aide directe au quotidien, du soutien entre victimes et de la volonté de commémorer les disparus, notre voix, représentative et fondée sur notre expérience, doit permettre de contribuer à améliorer l'organisation et la prise en charge des victimes en cas de survenue d'un événement comparable.
En France, lorsque l'on est victime d'un accident ou d'une agression, il existe un certain nombre de dispositifs de prise en charge physique et morale, ce dont nous nous félicitons. Malheureusement, le 13 novembre 2015, ceux-ci n'ont pas suffi pour faire face au nombre considérable de victimes de ces actes de guerre. En outre, les prises en charge des victimes se sont avérées particulièrement kafkaïennes. De leur expérience, les membres de l'association Life for Paris ont constaté certains manquements.
La prise en charge des personnes non blessées physiquement a été unanimement considérée comme très insuffisante, certains individus ayant été renvoyés chez eux sans être vus ni entendus et sans conseils pour mettre en place un accompagnement. D'autres ont dû décliner leur identité à plusieurs reprises sans jamais être recontactés par la suite. Ce soir-là, aucun dispositif de soutien psychologique n'a pu être proposé massivement. Des agents de la protection civile ont été obligés d'écouter des victimes, ce qui a probablement traumatisé davantage de personnes. La grande majorité des gens emmenés en cellule de crise ont été relâchés entre quatre et six heures du matin sans consignes sur les démarches à entreprendre.
Le respect des victimes passe également par la protection de la diffusion de leur image dans les médias. Plusieurs membres de notre association se sont ainsi plaints que leur visage n'ait pas été flouté à la télévision, ce qui a ajouté à leur traumatisme.
De nombreux blessés ne furent soignés qu’après une longue attente dans certains sites. Les examens effectués par des soignants dans l'urgence ont pu donner lieu à des erreurs dommageables ; ainsi une personne a reçu une balle qui n'a pas été vue lors du premier examen.
La prise en charge des personnes décédées s'est avérée très néfaste pour les familles. En effet, l'Institut médico-légal étant débordé, des familles sont restées sans information pendant trois jours. Pourquoi ne pas imaginer le déploiement d'un mécanisme de reconnaissance par prise d'empreintes digitales au scanner ?
L'administration s'est montrée pesante, procédurière et n’a parfois pas fait preuve de la moindre empathie pour les victimes ou leurs familles. Il convient donc de replacer l'humain au cœur des dispositifs de prise en charge.
Nous souhaitons saluer le travail extraordinaire accompli ce jour-là par les forces de police, les pompiers, les personnels soignants des hôpitaux, les associations d'aide aux victimes, qui ont su écouter, aider et prendre en charge les victimes au-delà de leur propre peur et de leur propre cadre de travail, en faisant preuve d'une immense empathie pour répondre au mieux aux besoins de chacun. Il serait d'ailleurs urgent de considérer et de traiter le traumatisme chez les aidants.
Lorsque l'on est victime d'un attentat, on perd ses repères, et la moindre démarche administrative apparaît insurmontable. On est incapable de se prendre en charge, tant on a besoin de soutien, d'aide et de simplicité. La prise en charge constitue-t-elle uniquement un droit ? Ne devrait-elle pas être une obligation légale, afin que personne n’entame seul son processus de reconstruction ? Pourquoi les cellules ministérielles ne cherchent-elles pas à simplifier les démarches, en proposant un parcours de prise en charge allégé reposant sur un référencement commun à toutes les antennes pour la reconnaissance du statut de victime ? Est-ce réellement aux victimes ou à leur famille d'accomplir le travail de l'État dans l’accomplissement de ces procédures ? Est-ce aux associations de victimes et d'aide aux victimes de pallier les manques d'information, d'organisation et de suivi de la prise en charge des personnes ?
Des individus ne bénéficiant d'aucune prise en charge depuis le 13 novembre dernier rejoignent quotidiennement notre association. Ils n'ont aucune information et s'avouent découragés devant le nombre considérable de démarches à accomplir. Les membres étrangers de notre association sont abandonnés par le manque de coordination des services français entre eux et de notre administration avec celle de leur pays. Personne ne leur a dit qu'ils bénéficiaient des mêmes droits que les citoyens français victimes d'actes de terrorisme.
Communiquer dès le jour même semble impératif, car nombre d'individus ont coupé les médias après les attentats et n'ont donc pas reçu d'informations. De même, il convient de prendre en charge les victimes dès le début, afin qu'elles ne s'épuisent pas. Ainsi, la convocation à la consultation de suivi psychologique à l'Hôtel-Dieu aurait dû être donnée dès les premiers jours, alors que ce protocole n'a été mis en place qu'au bout de trois ou quatre semaines. Les victimes ayant déjà porté plainte ont donc été contraintes de refaire leur déposition.
Le 13 novembre dernier, la France n'a pas été en mesure de protéger ses citoyens et a failli à ses obligations. Pouvons-nous espérer un jour qu'elle puisse les protéger après un drame ? Pouvons-nous, en tant qu'association et usagers de ces structures publiques, avoir l'espoir d'être entendus et consultés sur le perfectionnement de la prise en charge des victimes ? Nous avons des droits, mais nous sommes conscients d'avoir aussi un devoir envers les prochaines victimes potentielles. Notre association travaille main dans la main avec d'autres organisations d'aide aux victimes afin de pallier le manque d'information sur les dispositifs mis en place et sur la prise en charge des victimes françaises, étrangères et des familles de personnes décédées.
M. Alexis Lebrun, membre de l’association « Life for Paris – 13 novembre 2015 ». Je me trouvais dans la fosse du Bataclan le 13 novembre dernier, où j'ai attendu la mort pendant une heure et demie avant que l'intervention miraculeuse d'un commissaire ne vienne me sauver et me permette de vous parler aujourd'hui.
Le 18 septembre 2015, le quotidien Le Figaro révélait, via une information de BFM TV, qu'un djihadiste français de retour de Syrie pour commettre un attentat dans une salle de concert a été arrêté mi-août 2015 par la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI). Au lendemain des attentats du 13 novembre, Marc Trévidic, ancien juge antiterroriste, a affirmé qu'il avait auditionné ce terroriste présumé qui aurait évoqué l'idée d'un attentat dans une salle de concert. À la fin du mois d'août 2015, M. Trévidic est invité à quitter ses fonctions malgré cette menace. Ce mouvement était-il opportun ?
Ce même 18 septembre, un journaliste de RFI spécialiste du djihadisme, M. David Thomson, évoquait l'arrestation de cet homme et une affiche de propagande djihadiste incitant à faire exploser des grenades dans des salles de concert.
Le 7 janvier 2016, le quotidien Le Monde a publié une enquête sur le parcours de cet homme ; celui-ci y explique avoir reçu, de la part de l’un des coordinateurs des attentats du 13 novembre, la mission de commettre une attaque en France lors d'un concert de rock. L'homme arrêté avait affirmé aux enquêteurs que cela allait se produire très bientôt. Le mode opératoire décrit lors de ces auditions correspond exactement à celui utilisé par les auteurs des attentats du 13 novembre 2015. Quelles mesures ont été prises dans l'intervalle pour assurer la sécurité des salles de concert ? Trois mois après cette arrestation et deux mois après ces révélations, la menace est mise à exécution au Bataclan, dans des terrasses parisiennes et au Stade de France. Le 13 novembre 2015, le Bataclan affichait complet et accueillait plus de 1 500 personnes, mais aucune mesure de sécurité n'a été déployée pour ce concert : il n'y avait aucune présence policière ou militaire devant la salle et aucune fouille n'a été effectuée. Au regard de la menace sérieuse, avérée, répétée et connue des services de renseignement, comment est-il possible que l'une des plus grandes salles de concert de Paris n'ait pas bénéficié des mêmes mesures de protection que celles déployées autour de certains lieux dits sensibles après les attentats de janvier 2015 ? Comment le plan Vigipirate, alors à son niveau le plus élevé, ne pouvait-il pas prévoir de mobiliser quelques hommes devant des salles accueillant des centaines ou des milliers de personnes ? Qui a décidé des endroits devant être protégés dans le cadre de Vigipirate ? Comment étaient déployées les forces du plan Vigipirate le 13 novembre 2015 ? Pourquoi certains lieux sont-ils protégés 24 heures sur 24 même lorsqu'ils sont vides, alors que d'autres sont délaissés quand ils sont remplis ? A-t-on sous-estimé cette menace ? On connaît le résultat : 130 personnes ont été assassinées le 13 novembre 2015 et des milliers d'autres ont été blessées physiquement ou psychologiquement. Malgré le maintien du plan Vigipirate à son niveau le plus élevé et la mise en place de l'état d'urgence, nous constatons que les lieux recevant du public ne semblent pas bénéficier aujourd'hui d'une protection renforcée. Peut-on dans ces conditions considérer que toutes les actions et décisions adaptées ont été mises en œuvre en 2015 ?
M. le président Georges Fenech. Je vous remercie, monsieur Lebrun, d’avoir soulevé des questions claires et légitimes que notre commission d’enquête posera aux personnes auditionnées. Nous avons besoin de réponses, que les responsables de la sécurité nous apporterons.
M. Grégory Reibenberg. J’apparais distinctement, malgré le floutage de mon visage, dans une émission de télévision, diffusée deux jours après les événements. En effet, le caméraman d’une chaîne était embarqué dans une brigade de pompiers qui est intervenue à La Belle équipe. Je suis choqué qu’un tel moment ait pu être mis à l’antenne : j’avais du sang sur mes vêtements et je portais la mère de ma fille qui n’était pas encore décédée ! J’espère que ma fille ne verra jamais ces images. Comment une personne a-t-elle pu accepter de les diffuser, alors même que le Gouvernement avait demandé aux médias la plus grande retenue ?
M. le président Georges Fenech. Monsieur Reibenberg, dans notre pays, les citoyens disposent de protections quant à l’utilisation de leur image. Je comprends votre émotion et nous discuterons avec M. le rapporteur de l’opportunité d’entendre des journalistes et un représentant du Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA).
Des chaînes audiovisuelles ont reconnu leurs torts dans le traitement médiatique des attentats de janvier 2015 au cours duquel elles ont pu mettre en danger la vie des personnes prises en otage dans le magasin Hypercacher. Notre commission d’enquête se saisira de ce sujet.
M. Grégory Reibenberg. Ces images existent, et je ne souhaite pas que ma fille tombe un jour dessus.
Mme Caroline Langlade. Lorsque l’on tape « Bataclan » dans le moteur Google, la photographie de l’intérieur de la salle le soir du drame apparaît en premier. Les membres de notre association saisissent régulièrement Google pour que cette image disparaisse, mais il s’avère difficile de la supprimer puisqu’elle a déjà été reprise et relayée à de nombreuses reprises.
Mme Lydia Berkennou, membre de l’association « Life for Paris – 13 novembre 2015 ». J’étais présente au Bataclan le soir du 13 novembre 2015. Les forces de l’ordre ont accompli un travail remarquable, même si l’on peut déplorer le délai d’intervention pour donner l’assaut et évacuer la salle. Je tiens à féliciter les secours, qui ont montré leurs capacités à prendre en charge les victimes. Malheureusement, certains secouristes n’avaient pas reçu l’entraînement adéquat, et certaines erreurs auraient pu causer davantage de décès. Mon amie, évacuée de la salle à minuit et demi, a d’abord été placée au milieu des blessés légers car un secouriste pensait qu’elle n’avait qu’une éraflure. À trois heures du matin, à force de se plaindre de douleurs, elle a été transportée dans l’hôpital de campagne où un médecin a constaté qu’une balle était logée dans son poumon. Le manque de coordination entre les différents intervenants a entraîné la diffusion de consignes contradictoires et déstabilisantes pour les victimes. Il faudrait mettre en place un protocole de procédures à suivre pour chaque acteur. Il conviendrait également de réduire le plus possible le temps d’intervention, afin de sauver davantage de vies.
Une formation et un entraînement prévoyant des exercices de mise en situation réguliers apparaissent nécessaires. Il y a également lieu d’améliorer la communication entre les différents dispositifs déployés, afin de mieux orienter l’ensemble des victimes, y compris les blessés psychiques. On ne doit pas leur demander de rentrer chez eux parce que l’on ne peut rien pour leur cas. Il convient de prévoir les lieux d’accueil et de prise en charge pour gagner du temps. L’État doit élaborer un document unique consignant l’ensemble des démarches à effectuer après un attentat et le diffuser à grande échelle.
Les obstacles administratifs s’avèrent bien trop nombreux, alors que les victimes se trouvent en état de choc. Je me réjouis qu’un secrétariat d’État à l’aide aux victimes ait été instauré. J’espère que cette commission d’enquête répondra aux questions que nous nous posons : la sécurité est notre priorité, elle ne doit pas connaître de faille et traitée sérieusement. L’interrogation ne porte plus sur l’hypothèse d’une attaque, mais sur le moment et le lieu où elle aura lieu. L’organisation et la communication se révèlent essentielles au bon déroulement des interventions. Les débats sur les prises en charge des victimes permettront, en s’appuyant sur le vécu des sujets, de les améliorer. En cas de nouvelles attaques, nos compatriotes pourront cette fois-ci compter sur un service d’excellence. Les discussions de votre commission doivent aboutir à la simplification des démarches administratives et à la facilitation de l’accès aux soins à long terme. Trop d’obstacles nous ralentissent voire nous découragent aujourd’hui, ce qui est inadmissible après un tel drame. N’oublions pas que nous sommes des êtres humains : nous n’avons pas à nous adapter à la société, c’est à elle de le faire et de nous aider.
M. le rapporteur. Vous avez pointé la nécessité d’améliorer les dispositifs d’information des personnes recherchant des disparus. Monsieur Salines, j’ai consulté votre compte Twitter où j’ai constaté votre détresse dans le processus de recherche de votre fille. Avez-vous des propositions concrètes pour corriger le système existant ?
Vous avez été nombreux à considérer que le processus d’identification des victimes était trop long. Là aussi, votre expérience vous a-t-elle conduit à songer à des pistes de perfectionnement ?
Monsieur Salines, vous avez dit que les personnes chargées d’annoncer le décès des proches n’étaient pas formées pour cette tâche. Que conviendrait-il de changer ?
Trois ou quatre d’entre vous se trouvaient au Bataclan le soir du drame : comment avez-vous perçu l’intervention des forces de police ?
M. Georges Salines. Il convient tout d’abord d’instaurer un système d’information unique identifiant les blessés et les morts et interrogeable par les personnes recherchant des disparus. De nombreuses familles ont dû faire le tour des services d’urgence dans l’espoir de retrouver un de leur proche ; on parle là de gens qui vivent des heures épouvantables et qui en viennent à espérer que leur enfant se trouve dans le coma.
Monsieur le rapporteur, la lecture des tweets accompagnés du hashtag « Recherche Paris » le 14 novembre dernier constituait l’activité la plus triste qui soit.
Il ne suffit pas de mettre en œuvre une base de données unique consultable par téléphone – qui constituerait néanmoins un progrès –, car un accompagnement humain s’avère indispensable dans ces moments. Il convient de s’appuyer sur le dispositif mis en place à l’École militaire, et des pays étrangers ont prévu l’envoi de travailleurs sociaux ou de psychologues au domicile des personnes recherchant un disparu afin de les accompagner dans cette épreuve.
Ce système d’information doit contribuer à identifier les victimes. M. Mohammed Zenak nous a fait part des difficultés qu’il avait rencontrées pour l’identification de sa fille, et la plateforme de l’assistance publique des hôpitaux de Paris (APHP) ne pouvait pas intégrer des renseignements sur les personnes recherchées en dehors de leur nom, de leur prénom et de leur date de naissance. Il faut améliorer ce système, notamment en y incorporant l’Institut médico-légal, afin d’engager des recherches plus précises au sujet des blessés non identifiés.
Alors que je me trouvais à l’hôpital européen Georges-Pompidou, l’un de mes amis est parvenu à joindre un agent à la cellule interministérielle de crise qui lui a annoncé le décès de ma fille. La cellule a diffusé un tweet indiquant un numéro permettant d’obtenir des nouvelles de Lola. De nombreuses personnes ont appelé ce numéro, si bien que des messages de condoléances ont été publiés sur les réseaux sociaux ; fort heureusement, je n’en ai pas eu connaissance. Il s’agissait d’une erreur majeure de confier cette mission à quelqu’un, en l’occurrence, M. Stéphane Gicquel secrétaire général de la Fédération nationale des victimes d’accidents collectifs (FENVAC), qui n’était pas le mieux placé pour la mener, comme il l’a d’ailleurs reconnu. Une fois à la maison, j’ai rappelé ce numéro et M. Gicquel, qui m’a annoncé la mort de ma fille ; j’ai demandé à ce qu’un fonctionnaire me confirme la nouvelle, ce qu’un membre du cabinet de la ministre de la Justice, a fait avec beaucoup d’humanité et de compétence. Cinq minutes après, la cellule d’identification de l’Institut médico-légal nous a fait remplir par téléphone un questionnaire portant sur la taille, la couleur des cheveux et les signes particuliers de notre fille, alors que l’identification était déjà accomplie puisque l’on venait de nous prévenir de son décès. Enfin, la police judiciaire (PJ) nous a également joints pour nous apprendre la mort de notre fille. Il s’agit bien d’un ratage, car l’on ne devrait pas apprendre une telle nouvelle par téléphone et dans ces conditions. Et encore, je me considère comme chanceux, parce que des familles ont attendu trois jours et certaines ont veillé le corps d’un enfant qui n’était pas le leur. Il reste donc des marges de progrès considérables à accomplir.
Mme Caroline Langlade. Un membre de notre association insiste sur la nécessité d’améliorer le contact humain ; en effet, quelqu’un lui a demandé d’identifier le numéro B8768, qui était son frère. Il est important que ces personnes ne se retrouvent pas en contact avec des professionnels faisant aussi peu preuve d’empathie.
Mme Sophie Dias. La solidarité humaine est importante dans ces moments et nous n'en avons pas rencontré à l'Institut médico-légal. Nous avons dû faire face au détachement de personnes qui nous ont expliqué que si l'on ne pouvait pas voir le visage de mon père, on nous présenterait un pied ou une main. On a dû gentiment insister pour que l'identification s'opère à partir du passeport, et la seule préoccupation de ces gens était que l'on vienne chercher le corps rapidement, alors que celui de kamikazes s'y trouve encore aujourd'hui. On subit totalement la situation, et il faudrait que le personnel de l'Institut médico-légal se montre bien plus humain, car on y a été traité de manière honteuse.
M. le président Georges Fenech. Le consulat du Portugal à Paris a été informé par le quai d'Orsay du décès de votre père un jour avant vous ?
Mme Sophie Dias. Oui. Le consulat m'a contacté le samedi vers 14 heures, mais le ministère des affaires étrangères ne m'a appelée que le dimanche soir.
M. le président Georges Fenech. Vous étiez-vous manifestée auprès du Quai d’Orsay ?
Mme Sophie Dias. Non, car je ne savais pas quelle démarche effectuer. J'ai surtout contacté les hôpitaux de Paris, mais il faut les contacter un par un car aucune centralisation de l'information n'est assurée. Le nom de mon père ne figurant ni sur les listes de la PJ ni sur celles des hôpitaux, j'étais plutôt rassurée alors qu'il était déjà à l'Institut médico-légal.
Mme Caroline Langlade. Des membres de Life for Paris travaillent à l'Institut médico-légal et sont choqués car rien ne leur a été proposé en termes de soutien psychologique. Aucun métier n'oblige à devoir faire face à autant d'horreurs, et il importe de mettre en place un accompagnement professionnel pour tous ceux qui ont eu à intervenir ce soir-là.
M. Alexis Lebrun. À titre personnel, je ne peux émettre de remarques négatives sur l'intervention policière, puisque c'est elle qui me permet de vous parler aujourd'hui. Je suis sorti du Bataclan par la fosse vers 23 heures 30, à un moment où l'assaut n'avait pas encore été donné. J'ai réussi à sortir miraculeusement, grâce à l'initiative d'un commissaire de police qui, de son propre chef, est entré dans le Bataclan avec son chauffeur et a abattu le terroriste présent sur la scène. Cet homme a changé le cours de la soirée, car son intervention héroïque a sauvé de nombreuses personnes présentes autour de moi au rez-de-chaussée du Bataclan.
Les forces de police ont accompli un exploit en réussissant l'évacuation de tous les otages retenus par les terroristes et qui s'en sont sortis indemnes. Toutes les forces d'intervention d'autres pays ne seraient pas forcément capables d'accomplir une telle opération.
M. le président Georges Fenech. Vous dites être resté une heure et demie dans la fosse : vous avez dû vous interroger sur le délai d'intervention de la police, non ?
M. Alexis Lebrun. Au cours de cette heure et demie, j'étais caché sous des gens et ignorais donc ce qui se passait, mais, même si le temps paraît extrêmement long, les tirs se sont arrêtés au bout d'une demi-heure et j'ai attendu dans le silence. Lorsque les forces d'intervention sont entrées au rez-de-chaussée, nous ne nous sommes pas levés car nous ignorions s'il s'agissait de la police ou de terroristes. L'intervention du commissaire s'est produite au bout de vingt à trente minutes : cela paraît long lorsque l'on attend la mort, mais l'opération n'a pas échoué puisque je suis là aujourd'hui. Évidemment, tout le monde n'a pas eu cette chance.
M. Alain Marsaud. Monsieur Lebrun, les terroristes ont tiré pendant une demi-heure, puis il ne s’est plus rien passé : le commissaire de police est-il intervenu à la fin de ce moment ou au cours de celui-ci ?
M. Alexis Lebrun. Il est intervenu de son propre chef en entrant en premier dans la salle.
M. Alain Marsaud. Très tôt donc, n’est-ce pas ?
M. Alexis Lebrun. Il fut le premier à entrer et a tiré sur le terroriste situé sur la scène. Les deux autres assaillants l'ont pris pour cible depuis l'étage, et il a dû se replier avec son chauffeur puisqu'il n'était pas du tout équipé pour faire face à l'armement des deux terroristes. Les forces d'intervention de la police ont pris le relais plus tardivement.
M. Alain Marsaud. Combien de temps s'est-il écoulé entre la fin de l'échange de tirs entre les terroristes et le commissaire et l'arrivée des forces d'assaut de la police ?
Mme Caroline Langlade. L'assaut final de la brigade de recherche et d’intervention (BRI) a été donné après un peu plus de trois heures.
M. le président Georges Fenech. Je repose la question de M. Alain Marsaud : combien de temps s'est-il écoulé entre le repli du commissaire et l'intervention des forces de police ?
Mme Caroline Langlade. Environ deux heures et demie.
M. Georges Salines. Je suis médecin et ai lu un article intitulé Retour d'expérience des attentats du 13 novembre 2015 et publié dans les Annales françaises de médecine d'urgence par le service médical du service de Recherche, Assistance, Intervention, Dissuasion (RAID). Cet article fournit la chronologie suivante : l'attaque débute à 21 heures 49, le commissaire intervient à 22 heures 10 et provoque l'explosion de la ceinture de l'un des terroristes et le repli de ses deux complices dans les étages du Bataclan, et les colonnes de la BRI et du RAID donnent l'assaut à partir de 22 heures 35.
M. le rapporteur. La commission auditionnera des membres des forces d'intervention et le commissaire de police afin de connaître le déroulement précis des événements.
M. le président Georges Fenech. La commission envisage également de se rendre au Bataclan.
M. Alain Marsaud. Cela est nécessaire, car Mme Langlade évoque une attente de trois heures, alors que M. Salines relate un article faisant état d'un délai de vingt-cinq minutes entre le repli du commissaire et l'arrivée des forces de sécurité !
Mme Caroline Langlade. J'ai envoyé un message sur Facebook pour prévenir mes proches au moment où nous avons été évacués du Bataclan, c'est-à-dire entre minuit quarante-cinq et minuit cinquante. La BRI venait alors de donner l'assaut final. Je me trouvais dans la loge qui donne sur le passage Amelot et devant laquelle les deux terroristes ont explosé suite à l'échange de coups de feu avec la BRI. Nous étions quarante dans cette salle de neuf mètres carrés où nous avons attendu pendant trois heures. J'ai communiqué plusieurs fois avec la police pour leur fournir l'ensemble des éléments dont j'avais connaissance – présence de plusieurs terroristes, nombre de personnes présentes dans la salle, propos échangés entre les terroristes – et pour obtenir des informations. En effet, lorsque l'on attend trois heures dans une salle sans pouvoir agir sur son propre sort, on se trouve dans une situation terrible.
Le réseau étant saturé, j'ai appelé ma mère à Nancy pour qu'elle contacte la police de la ville afin de transmettre des informations à la police de Paris. J'ai rappelé la police et ai fini par parler à un agent au bout de quinze minutes d'attente. Mon interlocuteur, un brigadier très humain, a pris le temps de me parler et m'a indiqué que les forces de police allaient bientôt intervenir. Nous étions enfermés dans cette loge depuis une demi-heure et dans laquelle l'un des terroristes tentait de pénétrer. J'ai fourni des informations au policier en chuchotant – j'avais déjà fait éteindre la lampe et fermer les fenêtres afin que le terroriste ne nous voie pas et ne tire pas dans l'interstice de la porte qui se formait après chaque à-coup qu'il donnait dans la porte – et l'ai supplié de ne pas raccrocher alors qu'il souhaitait répondre à d'autres appels pour conserver cette attache avec l'extérieur. Il m'a rassurée pendant cinq minutes supplémentaires, ce qui m'a permis d'apaiser à mon tour les personnes qui se trouvaient avec moi dans la loge en leur disant que les forces de l'ordre arrivaient.
Au bout d'une heure, j'ai rappelé la police en chuchotant puisque le terroriste était toujours derrière la porte, et mon interlocutrice m'a demandé de parler plus fort. Je lui ai expliqué ma situation, ce à quoi la policière a répondu que je bloquais la ligne pour une réelle urgence. Je ne vois pas ce qu'il peut y avoir de plus urgent que quarante personnes menacées d'une mort imminente. J'ai parlé un peu plus fort et tout le monde m'a demandé de me taire car je mettais la vie de tout le monde en danger. La policière s'est énervée et m'a raccroché au nez en me disant « Tant pis pour vous » ! L'idée n'est pas de pointer du doigt des institutions, mais il faut prendre en compte le fait que les gens gèrent plus ou moins bien l'urgence. Dans la loge, certaines personnes ont failli mener des actions individuelles qui auraient coûté la vie à tout le monde, mais on ne peut pas juger car personne, y compris parmi les professionnels, ne peut connaître son comportement dans de telles circonstances avant de les avoir vécues. Il convient néanmoins d’identifier ceux qui peuvent faire face à de tels événements, afin que les dysfonctionnements de ce soir-là ne se reproduisent pas.
M. Alain Marsaud. Pourquoi le terroriste n'est-il pas entré dans la loge alors qu'il sait que plusieurs personnes s'y sont réfugiées ?
Mme Caroline Langlade. Il a tenté de pénétrer dans notre pièce, notamment en prétendant appartenir au groupe d'intervention de la gendarmerie nationale (GIGN) ; j'ai initié un vote à main levée pour ne pas lui ouvrir la porte, et la majorité de mes compagnons m'ont suivie. La porte était fermée, car lorsque nous avons investi cette loge, des garçons ont mis le canapé et le frigidaire devant la porte pour en empêcher l'ouverture. À chaque coup donné par le terroriste, nous tenions tous ensemble le canapé et le frigidaire pour que la porte reste fermée. Une solidarité extraordinaire s'est créée ce soir-là, et nous avons vocation à la faire perdurer parce que si nous avons vu le pire de l'être humain, nous en avons également vu le meilleur.
M. le rapporteur. Lorsque les forces de l'ordre sont arrivées, avez-vous voté à nouveau pour leur ouvrir ? Avez-vous tout de suite su qu'il s'agissait bien de la police ?
Mme Caroline Langlade. J'avais parlé à un haut responsable de la BRI à qui j'avais transmis des informations, mais je n'ai jamais été tenue au courant des modalités de l'intervention des forces de police. Le meilleur ami de l'une des personnes présente dans la loge a donné son téléphone au commissaire de la BRI, ce qui a permis d'établir une communication avec l'extérieur et d'aborder la question de l'ouverture de la porte. En effet, nous avons discuté pendant quinze minutes avec la BRI car nous refusions de l'ouvrir ; nous avons demandé un mot de passe pour pouvoir identifier les policiers de la BRI, mais devant le chaos qui s'était emparé de la loge, l'un de nos compagnons a pris un risque inconsidéré en ouvrant la fenêtre pour demander en hurlant si l'on pouvait sortir. Il aurait pu se faire tirer dessus, et l'entrée de la BRI dans la loge fut d'ailleurs le seul moment où j'ai cru mourir.
Cela a toujours été à nous de chercher l'information, si bien que nous, victimes rescapées, n'avons plus envie de le faire et sommes épuisées de devoir quotidiennement quémander de l'information. Nous ne devrions pas avoir à nous battre pour obtenir de l'information, celle-ci devrait venir à nous !
Mme Lydia Berkennou. Les terroristes ont pénétré à 21 heures 47 – et non 21 heures 49 – dans le Bataclan. Le commissaire a abattu le terroriste qui se trouvait sur la scène à 22 heures 15, et l'assaut final a été donné à minuit dix-huit.
M. Georges Salines. Cette chronologie est parfaitement compatible avec les éléments fournis par l'article que je citais, car l'assaut final n'a pas été donné à 22 heures 35, cette heure correspondant au moment où le RAID a pénétré dans le Bataclan. Les forces de sécurité ont procédé à l'évacuation de l'ensemble des personnes vivantes se trouvant dans la fosse.
Mme Lydia Berkennou. Mon amie n’est sortie de la fosse qu’à minuit et demi.
M. Georges Salines. L'intervention des médecins et des policiers a été remarquable puisque les personnes vivantes au moment de l'intervention s'en sont sorties indemnes, à une exception près. L'article indique par ailleurs qu'«en raison du délai incompressible entre la survenue de l'attaque et l'arrivée des médecins d'intervention, il n'y avait plus de patient vivant nécessitant une prise en charge médicale immédiate et lourde ».
M. le rapporteur. Entre le moment où le commissaire intervient et l’assaut final de la BRI, y a-t-il eu des coups de feu à l’intérieur du Bataclan ?
Mme Caroline Langlade. Oui, mais j’ignore s’ils ont fait des victimes.
M. Alexis Lebrun. Comme Mme Langlade, je ne sais pas si ces tirs ont fait des victimes. Je suppose que les terroristes visaient les forces de l’ordre depuis les fenêtres d’une salle à l’étage, cette version étant confirmée par certains témoignages.
Il me semble que les forces de police n’avaient pas le plan de la salle lors de leur intervention. Cela est d’autant plus étonnant que l’intensité de la menace était élevée. Au vu du contexte, la police devrait posséder des plans très détaillés des endroits accueillant du public à Paris et dans le reste du pays. Ce manque d’information a sans aucun doute constitué une difficulté supplémentaire pour les forces d’intervention.
M. Serge Grouard. Tous vos propos confirment que l’assaut de la BRI n’a pas eu lieu avant minuit ; plus de deux heures – entre 21 heures 47 ou 21 heures 49 et 0 heure 18 ou 0 heure 45 – s’écoulent donc entre le début de l’action terroriste et l’intervention des forces de sécurité.
Mme Aurélia Gilbert. La BRI était présente sur les lieux bien avant l’assaut de 0 heure 18 et a procédé à l’évacuation de plusieurs personnes, dont moi-même. La neutralisation des auteurs des faits a, elle, bien eu lieu à partir de 0 heure 18.
M. le président Georges Fenech. Nous établirons, lors d'une prochaine séance, la chronologie précise des événements survenus au Bataclan.
M. Serge Grouard. Le commissaire se trouvait-il au Bataclan ou est-il venu de l'extérieur ? Si je comprends bien, la BRI est intervenue avant l'assaut donné après minuit : c’est bien cela ?
Mme Caroline Langlade. Le commissaire de la brigade anti-criminalité (BAC) se trouvait à proximité du Bataclan peu après le déclenchement de l'attaque terroriste et a décidé, avec l'un de ses collègues, d'intervenir. Ils se sont placés dans l'entrée, et le commissaire a tiré sur le terroriste resté sur la scène. Les portes d'entrée étant vitrées, le commissaire était exposé, mais il a réussi à toucher le terroriste qui a explosé.
La BRI a d'abord procédé à l'évacuation des victimes situées dans la fosse, puis a répondu à une demande de négociation des terroristes. Enfin, les forces de sécurité se sont déployées pour neutraliser les terroristes et sécuriser la salle.
M. François Lamy. Il serait utile que l'on nous distribue la chronologie des événements et que l'on se concentre sur les vraies questions, posées par M. Alexis Lebrun.
M. le président Georges Fenech. Tout à fait, monsieur Lamy.
M. le rapporteur. Combien de temps les forces de l'ordre ont-elles mis pour arriver dans les cafés et les restaurants touchés par les attaques ?
M. Grégory Reibenberg. Le premier pompier est arrivé à La Belle équipe vingt minutes après les tirs, le voisin du dessus ayant lui compté trente-cinq minutes. Il s'agissait de la dernière terrasse attaquée, d'où le délai important avant l'arrivée des secours, mais le bar est quand même situé à un carrefour et près d'une caserne de pompiers. Attendre aussi longtemps est quand même inquiétant quant aux moyens octroyés aux secours à Paris. Ceux-ci ont transformé le café d'à côté en hôpital de campagne ; certains pompiers n'étaient pas préparés à voir une telle scène, et j'ai dû soutenir l'un d'entre eux. Il s'agissait de gamins apeurés qui ne pouvaient pas nous rassurer. Le service d'aide médicale urgente (SAMU) est arrivé au bout de trente-cinq à quarante minutes avec du matériel médical, les pompiers n'ayant rien d'autre que leurs mains et leur bonne volonté puisqu'ils n'avaient même pas d'oxygène.
Mme Aurélia Gilbert. Imaginez un instant que de telles attaques se produisent en province ! Les personnels de santé et de secours redoutent ce scénario, car les hôpitaux et les services de secours seraient débordés, ce qui causerait des morts.
M. le président Georges Fenech. En tant qu'élu, je suis membre d'un service départemental d'incendie et de secours (SDIS) qui mène une réflexion sur les modalités d'intervention en cas d'attentat de masse. Il y a beaucoup à faire, mais ces menaces sont prises en compte.
M. Mohammed Zenak. Ma fille a vu le terroriste qui a attaqué le Comptoir Voltaire, situé à proximité de La Belle équipe. Il souriait et, après avoir demandé un café, il s'est fait exploser. La police et les pompiers sont rapidement arrivés sur les lieux. Elle a dit aux policiers qu'il s'agissait d'un acte terroriste, mais ceux-ci le niaient. Le terroriste était toujours vivant, car il n'a heureusement pas réussi à déclencher l'ensemble de ses explosifs. Comprenant que l'attaque était bien de nature terroriste, la police a procédé à l'évacuation des clients dans le calme.
Ma fille m'a plusieurs fois posé cette question : « comment en est-on arrivé là ? ». Les terroristes étaient fichés et interdits de territoire européen : comment ont-ils pu se rendre à Paris pour y diriger une attaque de cette ampleur ?
M. le président Georges Fenech. Notre commission d'enquête se penchera sur ces questions qui se trouvent au cœur de sa mission. Nous tâcherons notamment d'identifier ce qui a pu dysfonctionner dans le renseignement. Votre interrogation est légitime, monsieur Zenak, mais il est trop tôt pour y répondre.
Nous vous remercions de la dignité et de la qualité de vos interventions, qui nous permettront de concentrer nos travaux sur les sujets les plus importants.
Audition, ouverte à la presse, de Mme Françoise Rudetzki, fondatrice
de SOS Attentats
Compte rendu de l’audition, ouverte à la presse, du lundi 15 février 2016
M. le président Georges Fenech. Nous sommes très heureux d’accueillir Mme Françoise Rudetski qui, nous nous en souvenons tous, a été grièvement blessée en 1983 lors d’un attentat à Paris.
Madame, face à la carence des pouvoirs publics et à l’absence de prise en considération des victimes, vous avez fondé en 1986 l’association SOS Attentats, que vous présiderez jusqu’en 1998 avant d’en devenir déléguée générale. Parallèlement, vous avez activement soutenu la création du Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme. Vous êtes également membre du Conseil économique, social et environnemental, que vous représentez par ailleurs à la Commission nationale consultative des Droits de l’homme.
Nous vous remercions d’avoir répondu à la demande d’audition de la Commission d’enquête relative aux moyens mis en œuvre par l’État pour lutter contre le terrorisme depuis le 7 janvier 2015. Nous avons en effet souhaité commencer nos travaux par les témoignages des victimes, des associations et des avocats des victimes, qui ont droit à toute l’attention de la représentation nationale. Votre expérience, dans le contexte particulier que nous vivons, et après les attentats commis en 2015, nous sera particulièrement précieuse.
Cette audition, madame, est ouverte à la presse. Elle fait l’objet d’une retransmission en directe sur le site internet de l’Assemblée nationale, et son enregistrement sera également disponible pendant quelques mois sur le portail vidéo de l’Assemblée nationale. Je vous signale également que notre commission pourra décider de citer dans son rapport tout ou partie du compte rendu qui sera fait de votre audition. Nous avons décidé d’ailleurs que les auditions seraient ouvertes à la presse, dans un souci de transparence – exception faite, évidemment, des auditions relevant du secret professionnel.
Conformément aux dispositions de l’article 6 de l’ordonnance du 17 novembre 1958 relative aux commissions d’enquête, je vous demande, madame, de prêter le serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité.
Mme Françoise Rudetzki prête serment.
Mme Françoise Rudetzki. Merci, monsieur le président, monsieur le rapporteur, merci aux membres de cette commission de me faire l’honneur de m’entendre dans le cadre de vos auditions.
Je commencerai par l’historique de la création de l’association SOS Attentats. Celle-ci s’est d’abord battue pour parer au plus pressé. À travers ma propre expérience et de par ma formation de juriste, j’ai vite découvert en effet que les victimes du terrorisme étaient à l’abandon. En 1985, le mot « terrorisme » n’existait pas dans le droit français. Or ce que l’on ne nomme pas, on ne le reconnaît pas et on ne le prend pas en considération. Ainsi, ces victimes n'étaient pas reconnues, elles n’étaient même pas identifiées en tant que telles et se trouvaient noyées dans la masse des victimes d’infractions pénales.
J’ai utilisé les médias pour retrouver la trace des victimes d’attentats, dont le premier, après la guerre d’Algérie, est celui qui a été commis le 15 septembre 1974 au Drugstore Saint-Germain, un dimanche à Paris, et qui a été revendiqué par Ilitch Ramirez Sanchez, dit Carlos. J’ai retrouvé ainsi une vingtaine de victimes encore vivantes. Nous avons alors fondé SOS Attentats, avec mon mari, qui était présent sur les lieux le 23 décembre 1983, et un ami qui avait été victime, à l’étranger, d’une violence que l’on pouvait qualifier de terrorisme.
Cette aventure de SOS Attentats s’est traduite par l’adoption, au bout d’un laps de temps assez bref, de huit lois qui ont permis de faire avancer le droit de toutes les victimes en France. L’urgence était de les prendre en charge, d’où la création du Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme.
Deux solutions étaient possibles : la première, présentée par l’Assemblée nationale, passait par une indemnisation des assurances ; la seconde qui avait la faveur du Sénat, par une indemnisation de l’État. Le Premier ministre de l’époque, Jacques Chirac, m’avait expliqué que l’État n’indemniserait ni vite ni bien. À l’époque, je craignais déjà qu’un jour, les finances de l’État soient dans un état tel que les victimes risquent d’en pâtir. D’où l’idée de cette contribution de solidarité nationale, que nous versons tous à travers nos contrats d’assurance de biens – multirisque habitation, moto, bateau, maison, entreprise. Il y a aujourd’hui 80 millions de contrats d’assurance de biens en France.
Je passe sur l’historique de cette contribution qui a varié dans le temps. La dernière augmentation, après dix ans d’immobilisme, date du 1er novembre dernier, soit treize jours avant les attentats de novembre. Cela faisait deux ans que je demandais une nette augmentation de la contribution, car un rapport demandé par le ministère des finances montrait que nous étions en train de piocher dans nos réserves. Redoutant en outre un attentat d’ampleur majeure, je souhaitais que le Fonds de garantie soit prêt à affronter des décaissements immédiats pour venir très rapidement en aide aux victimes. Il a fallu les attentats de janvier et l’unanimité du conseil d’administration du Fonds de garantie pour que nous obtenions un euro supplémentaire. Ainsi, la contribution qui est versée sur chacun de nos contrats d’assurance de biens est aujourd’hui de 4,30 euros.
La loi du 9 septembre 1986, qui a donc été adoptée avant les attentats de la rue de Rennes, est unique au monde : elle prévoit une indemnisation intégrale de tous les préjudices. Elle est en outre d’une simplicité remarquable – puissions-nous avoir toujours en France des lois aussi simples et faciles d’application.
Nous avons donc la meilleure loi au monde. Nous avons aussi le meilleur financement, dans la mesure où cette contribution prouve que chacun de nous participe à l’effort de solidarité qui est dû, au bout de la chaîne des actes de terrorisme, aux victimes. Malgré les difficultés financières d’un certain nombre de pays dont la France, nous pourrions être dans une situation idyllique. Malheureusement, il faut distinguer la législation de la pratique.
J’évoquerai donc certains des dysfonctionnements existant en matière d’indemnisation des victimes. Cette indemnisation fait partie de la lutte contre le terrorisme. C’est notre façon de prouver que nous sommes solidaires des victimes, que nous ne renonçons pas à nos valeurs, c’est reconnaître que nous pouvons tous être, du jour au lendemain, victimes d’un acte de terrorisme. Il est important de montrer qu’en France, la population civile bénéficie de la plus grande des solidarités. C’est la meilleure réponse – avec l’arsenal judiciaire, le renseignement et la coopération européenne – que nous puissions apporter face à cette menace. La France n’est pas en guerre : on mène la guerre contre elle.
Fin 2014, le Fonds de garantie avait instruit 4 200 dossiers de victimes d’actes de terrorisme, qui ont été prises en charge à partir du 1er janvier 1985, en raison de la rétroactivité de la loi. Après janvier 2015, un peu plus de 200 dossiers ont été ouverts à la suite des 17 morts et des blessés, en comptant les proches des décédés et ceux que l’on appelle aujourd’hui les impliqués.
Dès 1986-1987, nous avons considéré, à l’association SOS Attentats, que le terrorisme était une nouvelle forme de guerre, une guerre en temps de paix touchant les populations civiles, et nous souhaitions le faire reconnaître symboliquement. Il a fallu quatre ans de combat pour que la loi du 23 janvier 1990 soit adoptée, avec l’implication personnelle de François Mitterrand. Au-delà du symbole, cette loi – d’ailleurs rétroactive au 1er janvier 1982 pour englober toute une série d’attentats attribués soit à Action directe, soit au groupe Carlos, soit aux activistes Basques ou Corses – apporte, par rapport au Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme, un complément au plan social.
Cette loi institue un carnet de soins gratuits à vie, qui permet le remboursement et la prise en charge de la totalité des soins, bien mieux que la récente loi adoptée le 3 janvier. Elle prend en charge de très nombreux aménagements qui ne figurent pas dans la nomenclature de la sécurité sociale – aménagement de domicile, appareillages, accès aux hôpitaux militaires. Enfin, elle confère le statut de pupille de la Nation aux enfants, soit parce qu’ils sont orphelins, soit parce qu’ils ont été eux-mêmes blessés, soit parce qu’ils ont un parent grièvement blessé, à la suite d’un attentat. On peut en faire la demande jusqu’à la majorité, qui est à 21 ans au ministère de la défense. Ce statut de pupille de la Nation est accordé à vie ; l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre, l’ONAC, peut verser des aides sociales pour des frais relatifs à la scolarité, aux loisirs, à des voyages, des équipements informatiques ou d’aménagement d’appartements.
Enfin, les victimes peuvent bénéficier des dispositions d’une troisième loi, celle relative aux accidents de travail et de trajet, dans le cadre du droit commun des accidents du travail.
Ces lois sont utiles et se complètent même si cela pose parfois des problèmes d’articulation.
Je me suis longtemps battue pour que le Fonds de garantie soit, pour les victimes, un guichet unique où elles pourraient déposer leur dossier, ensuite dispatché entre les différents organismes. En 1995, à la suite des attentats dans le métro de Paris, j’ai été entendue par M. Alain Juppé, et ces dispositions ont été mises en place. Aujourd’hui, on me dit que cette procédure unique est tombée en désuétude. J’en appelle à votre commission : on ne peut pas imaginer que l’on aille vers plus de complexité, plus de démarches par rapport à ce qui s’est fait il y a vingt ans ! Mais comme il ne s’agit pas de l’inscrire dans la loi, je vais aussi m’adresser aux plus hautes autorités de l’État, qui sont parfaitement au courant de cette situation, pour faire graver dans le marbre, grâce à un décret, cette possibilité.
Il faut savoir que le Conseil d’administration du Fonds de garantie est composé : d’un président, qui est actuellement M. Delmas-Goyon, membre de la Cour de cassation ; de quatre représentants des ministres des finances, des affaires sociales, de la justice et de l’intérieur ; d’un représentant du monde de l’assurance ; et de trois personnes ayant œuvré et manifesté un intérêt pour les victimes.
Je siège au CA depuis l’origine, en 1986, ce qui fait que je passe pour la « mémoire » de ce Fonds. Les deux autres membres changent assez régulièrement : il y a un siège pour l’INAVEM et un siège pour le Conseil national des barreaux – qui a désigné dernièrement un avocat de Marseille spécialisé dans le dommage corporel.
Après les paroles officielles que nous avons entendues, et notamment celles du Président de la République qui a déclaré qu’après avoir enterré les morts, nous allions réparer les vivants, je pensais pouvoir m’appuyer sur les quatre représentants des ministres pour réparer les vivants, améliorer les pratiques d’indemnisations, et au moins retrouver celles d’il y a vingt ans. Mais je peux le dire ici : je n’ai pas le soutien que j’escomptais. J’espère que les travaux de votre commission vont m’aider à obtenir un tel soutien. Peut-être la nomination d’un nouveau secrétaire d’État aux victimes, Mme Juliette Méadel, y contribuera. En tout état de cause, j’ai bien l’intention de solliciter un rendez-vous avec M. Urvoas, votre ancien président de la commission des lois qui, je le pense, sera attentif à mes demandes.
Parmi les dysfonctionnements que je peux pointer, il y a la mauvaise utilisation des logiciels informatiques. Il faut le savoir : les listes de victimes qui sont établies, par le Parquet, le SAMU, les hôpitaux et les différents services de l’État, ne fonctionnent pas avec le même logiciel. Nous perdons donc énormément d’informations et notre liste est totalement disparate. Il faut convaincre l’État d’utiliser le même logiciel pour permettre à chaque organisme de rajouter à la liste des éléments susceptibles de nous servir à gérer la prise en charge des victimes et à assurer leur traçabilité. Il faut pouvoir en effet donner le plus rapidement possible des informations aux familles qui sont à la recherche de parents décédés ou blessés. Il est tout de même regrettable que les médias et les réseaux sociaux aient apporté plus rapidement des informations que les pouvoirs publics eux-mêmes.
Je dénoncerai un autre dysfonctionnement, d’ordre médical celui-ci. En 1986-1987 et en 1997, j’avais fait mener deux enquêtes épidémiologiques sur l’état de santé des victimes du terrorisme, avec l’aide de l’INSERM et d’un comité international, qui avaient abouti à la publication, par la direction générale de la santé, d’un guide pratique à l’usage des professionnels de santé en cas d’accidents collectifs, d’attentats et de catastrophes naturelles. Ce guide comprend, entre autres, un certain nombre d’informations sur la rédaction des certificats médicaux, très importants pour la traçabilité des soins, et sur la réparation et l’indemnisation, avec quelques mises en garde à propos des blessures invisibles – ORL et pulmonaires.
Toutes les victimes qui sont à proximité d’une explosion, qu’il s’agisse d’un accident dû au gaz, ou d’un attentat, comme dans le métro ou au Bataclan, souffrent en effet de troubles auditifs, d’acouphènes. Si ceux-ci sont traités dans les trois jours qui suivent l’explosion, par un traitement de cortisone, ils peuvent être guéris à 80% environ. Il est d’autant plus important d’intervenir rapidement que ces troubles coûtent très cher à la société : ils peuvent « désociabiliser » complètement les victimes, provoquer des troubles du comportement ou psychologiques graves et empêcher une activité professionnelle. Or, lors de la journée du 20 janvier organisée au ministère de la santé dans le cadre de l’opération « Retex », tous les professionnels de santé ont exprimé leur regret d’avoir complètement oublié ces problèmes d’oreilles. De la même façon, on peut passer à côté de pathologies pulmonaires, consécutives par exemple à l’émanation de sièges en plastique brûlés dans le métro.
Par ailleurs, les expertises médicales ne se passent pas toujours très bien. Personne ne le conteste aujourd’hui, ces blessures, qu’elles soient physiques ou psychologiques, s’apparentent à des blessures de guerre, que les militaires savent parfaitement traiter – tirs à la kalachnikov, dégâts dus aux ceintures d’explosifs, troubles psychologiques graves. En revanche, les experts du Fonds de garantie ne sont pas formés à cette traumatologie.
J’ai donc alerté le Conseil d’administration du Fonds sur ce point en lui demandant d’élargir son panel d’experts : ils ne sont que cinq ou six alors que nous allons devoir traiter 3 000 dossiers d’indemnisation, et surtout, ils n’ont pas la formation nécessaire que pourraient leur prodiguer les médecins militaires.
J’avais obtenu que les trois organismes – sécurité sociale, anciens combattants, ministère de la défense – et le Fonds de garantie organisent une expertise unique où, dans chaque spécialité, la victime ne serait vue qu’une seule fois, les trois rapports étant ensuite envoyés à chacun d’entre eux. Là encore, la pratique s’était un peu perdue. Mais Mme Touraine l’a inscrite dans la loi – celle du 3 janvier 2016. Je suis donc un peu rassurée.
Dysfonctionnement également s’agissant des séquelles présentées par les otages. Les otages ont des troubles particuliers qui ne sont pas les mêmes que ceux des victimes du RER, ou de ceux qui se trouvaient au Bataclan. De nouveaux postes de préjudice ont été créés, dans le cadre des catastrophes collectives, par les tribunaux de droit commun. Je veux parler du préjudice d’angoisse et du préjudice d’anxiété – attente de la mort, angoisse de la mort, angoisse de ceux qui ne savent pas si leurs proches sont vivants ou blessés. Or ces nouveaux postes de préjudice ne sont pas reconnus par le Fonds de garantie.
J’ai en revanche obtenu une avancée : la prise en compte de la durée de la détention. Comme les victimes d’attentats qui, depuis 1986, bénéficient d’une prise en charge particulière au plan psychologique, les otages se sont vus reconnaître un préjudice spécifique de détention, leurs proches étant également aidés pendant la durée de celle-ci. Mais là encore, on bute sur la reconnaissance des troubles : les experts ont tendance à minimiser ce que représentent trois ans de détention, dans des conditions qui ont été largement évoquées par la presse et sur lesquelles je ne reviendrai pas.
Les « oubliés » des attentats du 13 novembre sont un autre exemple de dysfonctionnement. Il s’agit plus précisément de victimes du Stade de France. On a parlé d’un mort, mais trente personnes étaient présentes, dont huit ont été grièvement blessées. Elles ont été oubliées pendant plusieurs semaines. Avec l’aide de journalistes, de la population qui s’était mobilisée, et des militaires, nous avons retrouvé la trace de ces victimes défavorisées, des Roms ou des SDF, qui n'avaient pas été enregistrées tout de suite.
Il y a par ailleurs les personnes qui se trouvaient dans l’immeuble squatté de Saint-Denis et qui sont selon moi, elles aussi des victimes du terrorisme. Là encore, il s’agit d’une population un peu défavorisée. Au moment de l’assaut des services de police, il y a eu des blessés physiques et psychologiques. On m’a dit qu’ils n’entraient pas dans la catégorie des victimes du terrorisme pouvant être indemnisées par le Fonds de garantie, mais que, comme victimes de l’intervention de la police, ils relèveraient éventuellement d’une indemnisation du ministère de la justice. La même question s’était posée en 2012, avec l’affaire Merah, lors de l’assaut donné par la police.
Les règles sont alors celles d’avant 1986 : les indemnisations ne sont pas intégrales, comme le prévoit la loi du 9 septembre, mais forfaitaires, donc payées sur le budget de l’État, selon les règles de la comptabilité publique. Trois mois après, ce sont ainsi les seules victimes qui n’ont pas reçu, par exemple, de provisions alors qu’elles sont dans le besoin, qu’elles doivent se reloger et se soigner, et qu’elles ne peuvent pas le faire, n’ayant reçu aucune aide.
Par ailleurs, une victime du Bataclan, qui s’en est sortie indemne et qui a été témoin des difficultés d’identification des personnes décédées et blessées, m’a demandé de vous faire une suggestion : il existe pour les délinquants un fichier des empreintes génétiques, ne pourrait-on pas disposer d’un tel fichier pour assurer la traçabilité des victimes, et permettre de les retrouver dans les hôpitaux ou ailleurs ? Les victimes seraient ainsi mieux prises en charge, ce qui favoriserait leur reconstruction.
Me sont également remontés les problèmes posés par les images prises par les médias – images de victimes en sang, dans les journaux et à la télévision.
J’avais été consultée par Mme Guigou, dans le cadre de sa loi en 2002 sur l’aggravation des amendes encourues par les médias qui publiaient des images indécentes. Je me souviens de l’affaire Érignac et du préfet dans une flaque de sang, mais aussi de cette femme victime de 1995 à la robe relevée, qui avait essayé de mener une action dans le cadre du droit à l’image. À l’époque, toutes les victimes qui avaient intenté un procès dans ce cadre l’avaient perdu puisque l’on avait donné la primauté au droit à l’information. J’avais fait observer à Mme Guigou que l’intention était bonne mais qu’il importerait peu aux médias de payer des amendes car plus les photos sont sanguinolentes et indécentes, plus les ventes augmentent. Les médias ne sont donc pas les seuls à mettre en cause : au bout de la chaîne, il y a ceux qui achètent les magazines. J’avais plutôt suggéré l’adoption d’une charte ou d’un code de déontologie, un peu à l’instar de ce qu’a fait la BBC en Angleterre. Mais tout a volé en éclats avec les appareils portables : ainsi à Londres, le 7 juillet 2005, malgré le respect des médias, des images prises par les passagers ont circulé dans les minutes qui ont suivi les explosions dans le métro ; elles ont été soit vendues, soit mises sur internet.
Je n’ai pas la réponse à ce problème. Tout ce que je sais, c’est que ces images font mal aux victimes, d’autant qu’elles sont systématiquement ressorties aux dates anniversaires des attentats. Même si elles sont parvenues à se reconstruire, elles se revoient dans l’état où elles étaient alors.
J’aimerais vous faire une autre suggestion qui relève, quant à elle, de la loi. Vous venez de recevoir l’Association 13 novembre : fraternité et vérité. Cette association a une très forte légitimité. Je peux vous le dire alors que j’ai rencontré de nombreuses victimes et les plus grands blessés. En effet, tous les jours ou tous les deux jours, je me rends dans les hôpitaux civils et militaires – à l’Institution nationale des Invalides et à Percy – pour former, à la demande des autorités militaires, le personnel et des assistantes sociales – sur l’articulation des différentes lois et sur leurs avantages respectifs.
Malheureusement, l’Association 13 novembre ne peut pas encore se constituer partie civile. En effet l’article 2-9 du code de procédure pénale ne permet aux associations qui s’occupent des victimes du terrorisme de se constituer partie civile qu’après cinq ans d’existence. Or, en raison même de la légitimité de cette association, il ne paraît pas envisageable qu’elle ne puisse ester en justice. Pourriez-vous travailler à la modification de l’article 2-9, moyennant tout de même une homologation par le ministère de la justice ou de l’intérieur ? Il convient en effet d’éviter que des associations à but commercial ou des associations d’avocats ne se créent pour faire du commerce ou démarcher des clients. Il faut faire preuve de prudence et contrôler la légitimité des associations – a fortiori lorsqu’elles sollicitent des subventions.
M. le président Georges Fenech. Merci, madame Rudetzki, d’avoir retracé l’historique du combat que vous avez mené pour la reconnaissance des victimes du terrorisme, et de leurs droits.
Vous avez d’ailleurs soulevé des problèmes qui ont été évoqués devant nous tout à l’heure par les différentes associations de victimes : le guichet unique, qui est tombé en désuétude, la mauvaise utilisation des logiciels, les difficultés d’identification ; les expertises – M. Salines a fait allusion à l’insuffisante compétence et formation des experts ; la question des images ; enfin, la capacité juridique des associations.
Sur ce dernier point, nous verrons comment, dans le cadre de la réforme de la procédure pénale dont l’examen est prévu prochainement en séance, aligner les dispositions de l’article 2-9 du code de procédure pénale sur celles de l’article 2-15 relatif aux associations s’occupant de victimes de catastrophes. Cela permettrait à l’Association 13 novembre d’ester en justice et faciliterait l’action de ses membres.
Enfin, je ne comprends pas bien comment pourrait être créé le fichier des empreintes génétiques auquel vous avez fait allusion.
Mme Françoise Rudetzki. L’idée ne vient pas de moi, je me suis contentée de vous la transmettre. Mais je vous laisserai la note qui m’a été adressée, et qui renvoie au vécu de plusieurs personnes qui se sont retrouvées au Bataclan le soir du 13 novembre. Sans doute faudrait-il que nous ayons tous nos empreintes génétiques dans une puce, dans notre carte Vitale ? Je n’ai pas eu le temps de réfléchir précisément. Tout ce que je sais, c’est que des informations ont été perdues, que des victimes ont parfois été mal orientées, dans des hôpitaux pas toujours adaptés à leurs blessures, et que des familles ont eu des difficultés pour retrouver leurs proches. Il faut donc creuser un peu la question.
M. le président Georges Fenech. Vous avez regretté que le statut de victimes du terrorisme n’ait été reconnu, ni aux victimes « collatérales » de Saint-Denis, ni à ceux que vous qualifiez d’« oubliés ». Cela relève-t-il de l’appréciation du Fonds de garantie ? Qui est à l’origine de cette classification ?
Mme Françoise Rudetzki. Le Fonds de garantie est lié par la liste du Parquet, qui fait foi. Dès lors que le procureur de la République lui transmet la liste, le Fonds de garantie est en mesure d’envoyer, dans les quinze jours ou trois semaines, une provision qui est modulée en fonction de la gravité des lésions. On distingue seulement entre les victimes hospitalisées qui subissent des interventions, et celles que l’on appelle aujourd’hui les « impliquées ». Après, on affine en fonction de la durée d’hospitalisation.
Le Fonds verse également une provision aux proches des personnes décédées. Il faut le reconnaître, depuis 1995, sa gestion de la prise en charge des familles des personnes décédées est assez remarquable. En l’occurrence, la liste des 130 morts ne faisait pas l’objet de contestations, et a été transmise assez rapidement. Les frais d’obsèques ont alors été pris en charge sans qu’il soit nécessaire d’avancer l’argent. Si quelques familles l’ont fait, c’est que l’information n’a pas toujours bien circulé. De fait, on reproche souvent au Fonds de garantie son manque de transparence, ce qui est sans doute justifié. Reste que, dans la plupart des cas, les services funéraires étaient au courant. Les familles se rendaient dans le service qu’elles voulaient et choisissaient un mode d’obsèques. L’entreprise établissait ensuite un devis et l’envoyait au Fonds de garantie qui réglait directement les factures, que les obsèques se déroulent en France ou à l’étranger, avec la prise en charge et le déplacement des familles pour se rendre aux obsèques. Le Fonds va même jusqu’à payer les fleurs sur le convoi. Le système fonctionne donc bien.
Nous avions la liste des 130 personnes décédées et des 350 blessés graves hospitalisés, et de pratiquement toutes les victimes du Bataclan puisque l’on disposait de la liste de la billetterie. Cela représentait 1 500 personnes, moins les 90 morts.
Si l’identification des victimes du Bataclan n’a pas fait l’objet de trop de difficultés, il en a été différemment en revanche pour les victimes qui se trouvaient aux terrasses des cafés. Certaines avaient été transportées dans les hôpitaux, mais d’autres, en effet, avaient fui les lieux. Elles y avaient d’ailleurs été incitées par les forces de police et de sécurité – SAMU et autres – parce qu’il fallait rapidement évacuer le site : on ne savait pas si une autre équipe de terroristes n’allait pas se manifester, et il ne fallait pas gêner les secours. En tout état de cause, ces victimes-là n’étaient pas sur les premières listes du Parquet.
J’ai tout de suite demandé au Fonds de garantie de lister les modes de preuve qu’elles pouvaient utiliser pour le saisir. Pour être enregistrées, elles avaient intérêt à déposer plainte et à être entendues par la police. En revanche, on a parfois fait inutilement déposer plainte à des victimes qui étaient déjà sur les listes du Parquet. Cela n’a fait que surcharger les emplois du temps des familles de décédés ou de blessés.
Elles pouvaient également solliciter le témoignage des serveurs dans les cafés – mais ceux-ci ont souvent fermé après les attentats. Elles pouvaient avoir recours au témoignage de personnes qui se trouvaient avec elles ce soir-là. Mais certaines parfois étaient attablées seules dans ces cafés. On a alors utilisé des certificats médicaux, rédigés soit par les médecins de famille, soit par les différents hôpitaux.
Aujourd’hui, la liste des victimes prises en charge par le Fonds est de 1 200 dossiers ouverts. Mais on s’attend à devoir en gérer 3 000.
M. le président Georges Fenech. J’ai cru comprendre qu’une personne, victime du tir non pas d’un terroriste, mais d’une force d’intervention, ne relèverait pas du Fonds de garantie.
Mme Françoise Rudetzki. Ce n’est pas nous qui en avons décidé ainsi. Cela vient du Parquet.
Sitôt après le 13 novembre, j’avais demandé au président de convoquer le conseil d’administration, car c’est là que sont fixées les règles générales de notre politique d’indemnisation. Mais il a nous a fallu attendre jusqu’au 1er février – alors que la loi nous impose une réunion une fois par trimestre. Ainsi, pour la première fois depuis trente ans d’existence du Fonds, nous sommes restés quatre mois sans réunir le CA, ce que je déplore.
Quoi qu’il en soit, le 1er février, nous nous sommes réunis et j’ai évoqué le point que vous venez de soulever. J’ai demandé pourquoi il y avait des exclus, s’agissant notamment des victimes de Saint-Denis. Le représentant du ministre de la justice m’a répondu que ce n’étaient pas des victimes du terrorisme et qu’il appartiendrait à son ministère de les prendre en charge. J’ai mis l’affaire au vote mais je n’ai malheureusement pas été suivie. Nous devons donc nous en tenir à cette position que je regrette profondément.
M. le président Georges Fenech. La commission d’enquête engagera une réflexion sur cette question.
M. Jean-Michel Villaumé. Madame, les critères d’indemnisation sont-ils adaptés ? Comment souhaiteriez-vous qu’ils évoluent ?
Par ailleurs, vous avez évoqué assez positivement la création du secrétariat d’État d’aide aux victimes. Concrètement, qu’en attendez-vous ?
Et encore une fois, merci pour tout ce que vous faites.
Mme Françoise Rudetzki. En matière de modes de préjudice, il existe la nomenclature Dintilhac, qui porte le nom d’un membre de la Cour de cassation aujourd’hui décédé. Celui-ci avait constitué une commission, aux travaux de laquelle j’avais participé, pour faire un état des lieux des différents postes de préjudice d’indemnisation. On avait retracé l’évolution de la jurisprudence – par exemple, en matière d’accidents de la route ou d’agressions – avec les décisions des cours d’appel, et repris les travaux de la doctrine.
En cas de terrorisme, la loi parle de l’indemnisation intégrale de tous les préjudices. Cela suppose la prise en compte du taux d’invalidité, que ce soit au plan physique ou psychologique. Il y a aussi des postes de préjudice que l’on appelle « personnels », c’est-à-dire : les souffrances endurées en fonction des sévices subis par les otages, le nombre d’interventions chirurgicales, les brûlures qui sont très douloureuses, les douleurs neurologiques également très pénibles ; le préjudice d’agrément, qui fait que l’on ne peut plus exercer un loisir ou un sport ; le préjudice sexuel ; le préjudice esthétique que l’on prouve avec des photos ; et enfin un poste qui pose des difficultés d’évaluation, bien qu’il soit d’accès très facile, le préjudice économique, à propos duquel le Fonds de garantie se montre particulièrement redoutable.
Il est vrai qu’au titre du préjudice économique, des sommes très importantes peuvent être en jeu : disparition d’un chef d’entreprise, qui subvient au besoin de toute sa famille ; perte d’un ou de deux salaires ; enfants à élever, etc. Chaque situation s’examine in concreto. On ne peut pas édicter de règles ni fixer un barème, dont personne d’ailleurs ne voudrait. Il faut procéder à une évaluation avec les services fiscaux, à partir des déclarations d’impôt, des fiches de salaire. Mais pour les professions libérales, les artisans, c’est plus compliqué ; et pour les gens au chômage, davantage encore. Et comment faire, pour les femmes au foyer ? Les situations sont toutes différentes. L’évaluation variera également en fonction de la composition de la famille – et aujourd’hui, il y a beaucoup de familles recomposées, avec des enfants de lits différents.
Certes, ce sont des calculs compliqués, mais le Fonds doit se doter de davantage de moyens humains pour traiter plus rapidement les dossiers – d’autant qu’il n’a pas de problème financier pour embaucher. Je ne citerai qu’un exemple, que vous allez trouver très choquant. À ce jour, presque quatre ans après l’attentat du 19 mars 2012 devant l’école juive de Toulouse où elle a perdu son mari et deux de ses enfants, Mme Sandler n’a touché que certaines provisions et certains postes de préjudice mais rien au titre de son préjudice économique. Il y a des batailles d’évaluation, dans lesquelles je n’entrerai pas. En tout état de cause, cette situation n’est pas admissible quatre ans après les faits : cette femme a besoin d’argent pour élever son troisième enfant, qui avait dix-huit mois à l’époque ; elle doit savoir de combien elle peut disposer, où habiter et comment gérer sa vie.
Si la théorie est très bonne, on constate donc dans la pratique certains dysfonctionnements que l’on ne peut pas accepter. Je prévois les mêmes problèmes pour les victimes de Charlie, davantage encore que pour celles de l’Hypercacher. En effet, les indemnisations vont mettre en jeu les droits d’auteurs qu’auraient pu toucher les différents dessinateurs. Nous sommes partis pour une longue bataille d’évaluation, dans la mesure où les victimes étaient des travailleurs indépendants. Je pense notamment à l’évaluation du préjudice économique de Mme Maryse Wolinski, la femme de Georges Wolinski.
M. le président Georges Fenech. Vous n’avez pas évoqué le pretium doloris ?
Mme Françoise Rudetzki. En français, ce sont les « souffrances endurées », qui sont évaluées sur une échelle de 1 à 7. À ce propos, j’observe qu’une telle échelle n’est pas adaptée à trois ans de détention d’un otage, car la situation relève de l’exceptionnel. Il en sera de même de certains postes de préjudice lorsqu’il s’agira d’indemniser les victimes du Bataclan.
Cela m’amène à vous faire part d’une décision très importante, qui a été rendue par le tribunal de Thonon-les-Bains dans une affaire liée à un grave accident au passage à niveau d’Allinges, où plusieurs collégiens avaient perdu la vie. À l’occasion de cette affaire, le président Deparis a créé et fait accepter par le tribunal correctionnel deux postes de préjudice que la doctrine avait déjà un peu développés, à savoir le préjudice d’angoisse – certains enfants ont vu arriver la mort – et le préjudice d’anxiété – les parents ont attendu des heures pour connaître le sort de leurs enfants.
Quand on imagine les trois heures qu’ont passées la plupart des victimes dans l’enceinte du Bataclan, avec quatre-vingt-dix morts, certaines victimes ayant été protégées par les corps des personnes décédées… Il va falloir que l’on innove. Heureusement, il n’y a pas de règles précises pour procéder à cette indemnisation intégrale. Nous pourrons, en fonction de situations exceptionnelles, répondre de façon exceptionnelle à de tels préjudices. Les experts vont nous aider à mettre en évidence ces séquelles particulières, que nous tâcherons ensuite, au conseil d’administration, de traduire en monnaie.
Mme Marianne Dubois. Merci, madame, d’être parmi nous ce soir.
Dans ma circonscription, une famille a été endeuillée et une autre a été très touchée au moment de l’attentat qui a eu lieu au musée du Bardo. Or elles ont l’impression de ne pas être reconnues comme des victimes parce que cela ne s’est pas passé en France. Ainsi, le Président de la République a rencontré à plusieurs reprises des victimes d’attentats qui ont eu lieu en France, mais pas en Tunisie.
Je voudrais par ailleurs vous interroger sur la reconnaissance du préjudice affectif. Comment peut-on évaluer la perte d’un père, d’une mère, d’un proche ?
Mme Françoise Rudetzki. Je n’oublie aucune victime : j’ai notamment organisé aux Invalides une réunion d’information à l’intention des victimes des attentats du Bardo, afin qu’elles prennent connaissance de leurs droits, et je défends leurs dossiers au Fonds de garantie.
Bien sûr, il faut d’abord que les avocats, qui ne sont pas toujours au fait des droits des victimes, s’informent. C’est ce qu’ont fait un certain nombre d’entre eux en s’adressant à moi. Je mène en effet tout un travail au Barreau pour transmettre mon savoir – à titre bénévole, je tiens à le préciser. Je leur indique les législations qui existent. Ces professionnels du droit connaissent bien la législation sur les accidents du travail, mais pas le fonctionnement du Fonds et le statut de victime civile de guerre.
Je suis également à la disposition de ces victimes, qui ont toutes mes coordonnées. Elles savent qu’elles peuvent me joindre. Je ne mets jamais plus d’une demi-journée pour rappeler. Je reçois à peu près 150 mails par jour, en dehors des appels téléphoniques. Donc, pour moi, elles ne sont pas oubliées. Maintenant, je ne saurais répondre à la place du Président, dont je ne tiens pas l’agenda. Leur avocat a-t-il fait une demande en bonne et due forme ? Aux dernières nouvelles, ce n’était pas le cas. Mais je n’en dirai pas plus.
Quant à savoir ce que vaut la vie humaine, la question est vaste. Les Américains évaluent la vie en millions de dollars. Les Allemands, quant à eux, considèrent que la vie est inestimable, au point que la reconnaissance de ce préjudice moral ou d’affection, comme on dit maintenant en France, était, avant le passage à l’euro, d’un DM. Cela était compensé par d'autres postes de préjudice, notamment économique, pour aider les familles à vivre et à revivre.
La France a adopté une position intermédiaire – à partir de la loi Badinter, qui prévoit un droit à indemnisation pour les accidentés de la route. Au fil des années, entre 1985, année où j’ai commencé mon combat, et aujourd’hui, les montants ont évolué : ils sont passés de 20 000 euros à environ 45 000 euros pour la perte d’un compagnon, d’une épouse ou d’un enfant. J’observe d’ailleurs que la perte d’un enfant est moins bien « rémunérée» que celle d’un compagnon ou d’une épouse. Je trouve cela curieux, dans la mesure où un enfant ne se remplace pas alors que le conjoint survivant peut refaire sa vie. C’est pourtant ce qui ressort de la jurisprudence. Cela étant, que vaut la vie d’un enfant ? Si je perdais ma fille, je ne pourrais pas vous donner un chiffre…
Il m’arrive de demander aux familles qui contestent la proposition du Fonds de garantie à combien elles évaluent la perte de leur proche, et en dessous de quelle somme elles vont décider d’aller devant les tribunaux – ce qu’elles ne font d’ailleurs jamais. Je vous pose la même question : à combien évaluez-vous la vie humaine ? Pour ma part, je ne suis pas capable d’apporter une réponse. Mais je me bats comme une tigresse pour l’évaluation des préjudices physiques, psychologiques et économiques, et tout ce qui va avec : réadaptation des logements, des voitures, réinsertion et formation professionnelles qui sont également prises en charge par le Fonds de garantie.
M. Serge Grouard. Madame, je voudrais saluer à mon tour votre combat.
Vous avez évoqué la procédure devant le Parquet, qui permet l’élaborer la liste de celles et ceux qui vont être considérés comme victimes. Cette liste est ensuite transmise au Fonds de garantie, et ouvre droit à indemnisation et à prise en charge. Eu égard au nombre important de victimes des attentats de novembre dernier, quels sont les délais du Parquet ? Certaines victimes attendent-elle de pouvoir être inscrites sur cette liste pour bénéficier d’une prise en charge ? Le Parquet est-il outillé pour gérer une telle situation, différente de celles que l’on a connues auparavant ?
Par ailleurs, j’ai noté qu’en presque trente ans, le Fonds de garantie avait traité 4 200 dossiers, et que vous vous attendiez à en recevoir 3 000 autres. Le Fonds de garantie dispose-t-il de moyens suffisants pour prendre en charge ces victimes ?
Mme Françoise Rudetzki. Premièrement, cette liste du Parquet a été établie assez rapidement, dans les jours qui ont suivi les attentats. Ce fut notamment le cas de celle des 130 personnes décédées, grâce au travail remarquable d’identification de l’Institut médico-légal – hormis un problème d’inversion.
Au passage, je voudrais saluer nos services de santé. Le soir du 14 novembre, nous avions une liste de 128 personnes décédées. Le bilan s’est finalement établi à 130, grâce à la qualité des soins, de la chirurgie et de la médecine française qui, en dépit des difficultés financières, a su sauver beaucoup de vies, notamment celle d’un nombre impressionnant de jeunes, qui étaient grièvement blessés.
Les hôpitaux ont également transmis des listes au Parquet, mais cela a pris un peu de retard du fait des problèmes de logiciels que j’évoquais précédemment. Si l’on veut être en mesure d’affronter d’autres attentats de grande ampleur, il est urgent de mettre au point un logiciel commun à tous les intervenants. Cela permettra de disposer, sur un même listing, de toutes les informations : profil de chaque victime, structure et situation sociale de chaque famille… Nous saurons ainsi, par exemple, si des enfants sont restés seuls au domicile.
Il faut également savoir que l’on prend en charge, en France – et c’est très positif – toutes les victimes, quelle que soit leur nationalité ou leur situation au regard de la régularité de leur séjour dans notre pays. J’avais formulé cette demande début 1986 lorsque j’ai commencé à négocier la loi du 9 septembre 1986 : au Fonds de garantie, nous n’avons pas à nous interroger sur la légalité de la présence d’une personne sur notre territoire. Au pays des Droits de l’homme, nous devons à tous la sécurité, car ce sont des êtres humains.
De la même façon, nous prenons en charge toute victime française d’attentats à l’étranger : que ce soit au Musée du Bardo, à Sousse, au Caire, à New-York, à Londres, à Madrid, en Israël, partout dans le monde où il y a des familles, des victimes qui ont la nationalité française ou qui sont binationales. Après nous être renseignés, nous prenons en charge les binationaux, en complément de ce qui peut être fait par la législation de leur pays d’origine. On sait bien que de nombreux pays, et je pense à l’attentat de Ouagadougou, n’ont rien prévu pour les victimes. Mais si ces dernières ont des liens avec la France, elles sont prises en charge.
Une fois la liste du Parquet établie, plusieurs semaines s’écoulent. Comme je l’ai indiqué, des victimes peuvent également être amenées à apporter les preuves que j’ai énumérées plus haut, et le Fonds les examine. Cela peut prendre deux ou trois semaines, mais pas des mois. Si, au vu des éléments, le Fonds accepte la victime sur cette nouvelle liste, il peut lui verser immédiatement une provision.
Si les preuves sont considérées comme insuffisantes, la demande peut être rejetée. J’ai demandé que tout rejet soit soumis au conseil d’administration du Fonds, qui devra en examiner la validité. Certes, nous ne gérons pas les dossiers, mais je tiens à connaître les motivations en cas de refus. Et si une personne n’est pas acceptée sur les listes, elle peut toujours former un recours devant le tribunal de grande instance de Créteil, qui est le tribunal dont relève le Fonds de garantie – domicilié à Vincennes – pour se voir attribuer la qualité de victime.
M. Jean-Luc Laurent. Merci pour votre exposé qui retrace l’évolution positive de la reconnaissance du terrorisme à la création du Fonds de garantie, mais qui montre aussi qu’il reste du chemin à parcourir.
Vous insistez particulièrement sur la liste unique comme élément déclenchant, pour le Fonds de garantie, des indemnisations qui seront attribuées aux victimes ou à leurs familles. Les associations que l’on a auditionnées ont pointé dès le début la diversité des listes et la difficulté d’accès à l’information. D’où ces quelques questions.
Sur la base de votre expérience, ne pensez-vous pas qu’il serait bon d’avoir une liste unique dès le début de la procédure, afin de pouvoir informer puis d’ouvrir des droits au Fonds de garantie ? Une seule autorité ne devrait-elle pas concentrer l’élaboration de cette liste, à partir d’un même logiciel ? Comment procéder, concrètement, pour aller vers cette procédure unique et, éventuellement, vers une autorité unique ? Cela doit-il relever de la loi, d’autres mesures, ou simplement de dispositions internes au Fonds de garantie ?
Mme Françoise Dumas. Merci, Madame, pour la clarté de votre propos. Vous avez malheureusement une connaissance aiguë des besoins des victimes et de leurs proches ainsi que des différents dysfonctionnements. Comment expliquez-vous le recul de la procédure du guichet unique ? Est-ce dû au fait que plusieurs ministères sont concernés ? À la complexité des dispositifs ? Auriez-vous des propositions concrètes à faire en la matière ?
Mme Françoise Rudetzki. Sur la liste unique, la pratique actuelle, qui passe par un contrôle du Parquet, me semble être la meilleure. Le Parquet est une autorité incontestable, incontestée, et c’est à lui de réunir toutes les informations qu’il reçoit des hôpitaux, des services de secours, des services de police qui ont pu recueillir des témoignages, et de tous ceux qui ont été en contact avec les victimes et ont pu relever leur identité. Encore une fois, le problème vient de la différence de logiciels, qui entraîne une déperdition de données. M. François Molins, vous expliquera dans les détails les difficultés rencontrées par le parquet pour recueillir les éléments d’identification de toutes les victimes.
À ce jour, 1 200 dossiers ont été ouverts au Fonds de garantie, à partir de tous les éléments qui lui sont parvenus. À mon sens, le Fonds de garantie n’a pas la légitimité de tenir la liste unique : il doit la recevoir et enclencher la procédure.
Restent tous ceux qui n’ont pas été identifiés. La loi prévoit que toute personne qui s’estime victime peut saisir directement le Fonds de garantie. Elle peut aussi se constituer partie civile et apporter des éléments de preuve pour prouver qu’elle était bien sur les lieux. Je le répète, je souhaite que le conseil d’administration ait connaissance des dossiers rejetés par le Fonds de garantie, quitte à ce que le refus soit validé et que la personne aille devant le tribunal de grande instance de Créteil.
Je ne crois pas que, dans ce domaine, l’intervention d’une loi soit nécessaire. Mais c’est vous qui êtes les professionnels de l’élaboration des lois… Un décret pourrait peut-être suffire pour compléter la loi du 9 septembre 1986. En tout cas, hormis ce problème de logiciel et de gestion d’un grand nombre de victimes, le parquet me semble être l’autorité la plus légitime pour élaborer cette liste.
Comment expliquer le recul des acquis de 1995 ? Par le fait que les intervenants changent au fil du temps. Je vous l’ai dit, je suis « la mémoire » du Fonds, une « rescapée » de 1986 ; aucun membre autre que moi n’était présent à l’époque. Ainsi, le président a été nommé il y a un an. Les ministres sont représentés par différentes instances. Par exemple, le ministre de la justice est représenté par le chef du bureau des victimes. Or ce service est en déshérence, et je pèse mes mots ! Les chefs de bureau n’y restent pas. La dernière en date avait quitté ses fonctions peu avant le 13 novembre. Elle a fini par rester jusqu’au 30 janvier 2016, et n’était donc même pas présente au CA du 1er février. À l’heure actuelle, il n’y a pas de chef de bureau des victimes. C’est pourtant le cœur, au ministère de la justice, de l’organisme qui gère les droits des victimes ! Ce département est délaissé depuis des années – cela n’a pas commencé avec Mme Taubira. À tel point que M. Sarkozy, alors ministre de l’intérieur, avait créé une Délégation aux droits des victimes au sein du ministère de l’intérieur, précisément pour venir en aide aux victimes du terrorisme. Cela montre, et j’en suis désolée, le peu d’intérêt de l’État vis-à-vis des victimes.
Mme Nicole Guedj, secrétaire d’État aux droits des victimes auprès de M. Perben, a fait des choses intéressantes et concrètes. Puis le secrétariat d’État a disparu. Aujourd’hui, il est réapparu, à la différence que la nouvelle secrétaire d’État dépend du Premier ministre. Aura-t-elle à sa disposition outre un cabinet, une structure administrative qui lui permettra de fonctionner ? Je fonde tous mes espoirs dans cette création. En effet, au conseil d’administration, les représentants des quatre ministres votent toujours dans le même sens pour permettre à la solidarité gouvernementale de s’exercer. Encore faut-il qu’ils aient défini une position commune au cours d’une réunion interministérielle. S’ils répercutent la voix du Premier ministre et celle du Président de la République qui demande que l’on répare les vivants, nous serions cinq sur neuf à souhaiter faire avancer les droits des victimes et éviter la déperdition que vous évoquiez.
Du fait de la mobilité dans la fonction publique, les fonctionnaires qui siègent au conseil d’administration sont sans cesse remplacés – parfois même avant deux ou trois ans. Il en est de même à la direction du Fonds de garantie : le directeur général, M. François Werner, et la directrice, Mme Nathalie Faussat, ne sont là que depuis quelques années. La phase de 1995 s’est perdue dans la nuit des temps. Et en 1986, les dossiers n’étaient pas informatisés. D’où une certaine déperdition du savoir, que l’on observe d’ailleurs dans toutes les administrations françaises.
Je peux reprendre, à cet égard, l’exemple du guide que nous avions édité en 2003, et dont j’avais évoqué l’existence avec le cabinet de Mme Touraine, juste avant Noël. Ce fascicule contient en effet beaucoup de choses intéressantes sur la prise en charge des victimes. Cela m’amène à faire un petit retour dans le passé.
Il y a dix-huit mois, s’est tenue une réunion sur les cellules d’urgences médico-psychologiques. – CUMP – qui ont été créées en 1995 par M. Xavier Emmanuelli, alors secrétaire d'État à l’action humanitaire d’urgence.
M. Xavier Emmanuelli, que j’avais rencontré en juin 1995, et auquel j’avais présenté les résultats de l’étude épidémiologique sur l’état de santé des victimes des attentats de 1986, envisageait de créer un nouveau dispositif et m’avait proposé d’en discuter à la rentrée suivante. L’attentat du RER B à la station Saint-Michel se produisit le 25 juillet 1986. M. Emmanuelli avait son projet de CUMP en tête. Il a emmené le Président de la République dans les hôpitaux, à la rencontre des personnes qui avaient fui le métro et l’horreur, à qui on avait dit de partir et qui ont erré, hagards, dans Paris. Ces personnes avaient parfois marché dans les rues pendant plusieurs jours et avaient été récupérées par des passants, des policiers ou des médecins. C’est là que sont nées les CUMP qui prennent en charge sur les lieux même des attentats ou des accidents les victimes impliquées – je ne parle pas de celles dont il faut sauver la vie et qui sont envoyées immédiatement vers les hôpitaux. Ces cellules sont animées par des volontaires qui viennent des hôpitaux : des psychiatres, des psychologues ou même des infirmiers-psychiatres. Ils interviennent dans l’urgence, puis réintègrent leur service d’origine.
Il y a dix-huit mois, donc, nous avons célébré le vingtième anniversaire de ces cellules d’urgence. À cette occasion, j’avais fait observer au représentant de la Direction générale de la santé qu’alors qu’on risquait d’être victime d’un attentat d’ampleur majeur, notre petit guide n’était plus à jour. Il m’avait répondu qu’on allait le remettre en chantier. Je n’en ai plus jamais entendu parler. Alors que ce fascicule figure sur le site du ministère de la santé, plus personne au cabinet de Mme Touraine n’en avait le souvenir. Encore une fois, il y a en France une déperdition du savoir qui me paraît tout à fait préoccupante, surtout dans des situations extrêmes.
S’agissant des finances du fonds, pour l’année 2016, sauf événement majeur, grâce à cet euro supplémentaire qui a porté la contribution de solidarité nationale à 4,30 euros depuis le 1er janvier, nous disposons de la trésorerie nécessaire. Si d’autres attentats venaient à se produire, ce serait autre chose. Cela étant, le montant de la contribution est fixé par un simple arrêté, pris chaque année au mois d’octobre par le ministère, afin d’être pris en compte par les compagnies d’assurance l’année suivante.
Après la catastrophe du DC10, en 1989, qui avaient fait 170 morts, on avait eu peur de manquer de trésorerie et d’avoir à piocher dans nos réserves. Le ministère des finances de l’époque avait alors, en cours d’année, augmenté d’un franc, la contribution pour nous permettre de faire face à cette catastrophe. Le 1er février 2016, j’ai donc demandé au Fonds de garantie de ressortir cet arrêté – qui est également dans les archives du ministère des finances –, pour prouver, le cas échéant, qu’il est tout à fait possible d’augmenter la contribution en cours d’année.
Enfin, mesdames et messieurs les parlementaires, en 2008, à l’unanimité, vous avez mis à la charge du Fonds de garantie l’indemnisation des propriétaires des voitures et des motos brûlées au 14 juillet et au 31 décembre – avec 40 % d’abus. En quoi cela concerne-t-il le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et autres infractions pénales ? C’est inadmissible ! Certes, cela ne représente pas des sommes énormes, mais c’est symbolique : cette indemnisation devrait relever du Fonds de garantie automobile. Pourquoi la solidarité nationale devrait-elle fonctionner alors qu’il y a des gens qui n’ont ni voiture ni moto ?
Dès 2008, alors que j’avais été reçue ici même par le président de la commission des lois, M. Warsmann, ainsi qu’au Sénat, j’avais exprimé mon opposition devant un tel dévoiement. Mais ce fut en vain. Depuis, j’ai repris mon bâton de pèlerin et je me bats pour que l’on revienne sur cette disposition. À chaque fois, on m’explique que l’on n’a pas le véhicule législatif nécessaire, qu’on ne peut pas faire de cavalier budgétaire, etc.
En novembre dernier, Mme Taubira a présenté son projet de loi sur la justice du XXIème siècle : j’ai pensé que ce texte un peu fourre-tout pouvait être le bon support. Une sénatrice m’ayant demandé si j’avais un amendement à lui proposer, je lui ai suggéré la suppression de cette charge indue et le transfert de l’indemnisation correspondante vers le Fonds automobile. Elle a déposé l’amendement, à l’occasion de la première lecture au Sénat. Mais l’attaché parlementaire ou l’administrateur ayant oublié l’article 40 de la Constitution, cet amendement n’est même pas passé en discussion. J’ai donc saisi M. Bruno Le Roux, le président du groupe parlementaire socialiste, et lui ai préparé un autre amendement en prévision de la prochaine lecture. Mais après les événements du 13 novembre, l’ordre du jour des travaux du Parlement a peut-être été modifié. En tout cas, il me paraîtrait être de bonne administration financière de décharger le Fonds de garantie de cette charge indue.
M. le président Georges Fenech. Pouvez-vous nous donner le montant des ressources du Fonds ?
Mme Françoise Rudetzki. En plus de la contribution de solidarité nationale, qui est de 4,30 euros pour chacun des 80 millions de contrats d’assurance, nous avons placé beaucoup d’argent.
Au 29 janvier, nous avions ouvert 1 137 dossiers d’indemnisation, et versé 17 millions d’euros de provisions. Et selon mes documents, nous avons une trésorerie d’une valeur comptable de 1, 331 milliard d’euros.
En fait, le Fonds « terrorisme et infractions » est géré par le Fonds de garantie automobile, qui se trouve à Vincennes, et emploie 120 personnes. Un département financier gère à la fois le Fonds de garantie automobile et le Fonds « terrorisme et infractions ». Nous payons au Fonds automobile un pourcentage de frais de gestion au prorata du temps passé par la cellule en charge des victimes du terrorisme – le Fonds de garantie vous donnera les chiffres. Ainsi, nous n’avons pas besoin d’avoir un local, ce qui limite les frais. Je pense que c’est de bonne administration.
Donc, nous n’avons pas de problème d’argent. Nous avons même de quoi embaucher, notamment des rédacteurs ayant bac+5 en droit, sous réserve de leur assurer une formation complémentaire, du fait de la spécificité de nos règles.
M. le président Georges Fenech. Pouvez-vous nous donner votre sentiment sur les attentats du mois de janvier, et sur l’objet de notre mission ? J’ai beaucoup apprécié votre propos lorsque vous avez dit que l’indemnisation des victimes faisait partie de la lutte antiterrorisme et qu’elle était la preuve de notre solidarité face au terrorisme. Avez-vous des observations à faire sur la question des moyens et la prévention ?
Mme Françoise Rudetzki. On parle beaucoup de la radicalisation et de la « déradicalisation ». Mais j’avoue ne pas très bien savoir comment on peut « déradicaliser ».
Ce n’est pas en allant porter la parole des victimes à ceux qui sont en prison que l’on pourra leur faire un lavage de cerveau à l’envers. D’ailleurs, faire de la manipulation mentale irait à l’encontre de nos valeurs. Il faut donc trouver d’autres voies.
J’ai entendu l’ancien Premier ministre, M. Alain Juppé, parler d’une police pénitentiaire. Ce serait peut-être un bon moyen d’avoir des informations. Les affaires Merah, Beghal, Coulibaly ou Kouachi, nous ramènent toujours à la prison. On sait que Djamel Beghal a formé, en quelque sorte, les frères Kouachi et Coulibaly. Peut-être est-ce une erreur de les avoir mis dans la même prison.
On parle de regroupement, d’un camp d’internement – je n’aime pas trop ce type de dispositif – pour les personnes fichées au fichier S. Mais cela me paraît difficile si elles ne sont pas passées à l’acte. En tout état de cause, on ne peut pas agir sur les cerveaux de ceux qui sont déjà en prison…
Par contre, nous pouvons agir au niveau de l’éducation nationale. Certes, je ne suis pas une spécialiste, mais nos valeurs démocratiques, nos valeurs de laïcité, doivent pouvoir être transmises dès le plus jeune âge. Notre erreur a été de considérer que la radicalisation ou le non-respect des valeurs républicaines étaient liés au problème des banlieues. Aujourd’hui, tout le monde s’accorde à dire que l’on s’est trompé. Bien sûr qu’un travail a été fait dans les banlieues, et qu’on y a mis beaucoup d’argent, mais le résultat n’est pas à la hauteur. En dépit des progrès, – étudiante, j’ai travaillé sur la rénovation urbaine –, le problème de l’urbanisme n’est pas réglé.
En tout état de cause, et on le note aussi en Belgique, à part peut-être Merah, toutes les personnes impliquées ne se sont pas forcément radicalisées dans les banlieues. Le phénomène est constaté dans tous les milieux. Je rappelle que 220 Françaises sont parties en Syrie et que leurs familles n’avaient rien vu venir.
Pour avoir des contacts avec les autorités musulmanes, avec l’imam Chalghoumi, avec le recteur de la mosquée de Paris, M. Boubakeur, je pense qu’une des solutions ne peut venir que de la communauté musulmane. Celle-ci doit faire le ménage au sein des mosquées où des prêches salafistes sont prononcés chaque semaine.
Doit-on arrêter ceux qui prêchent contre nos valeurs, qui appellent à la violence ? Cette question relève du ministère de l’intérieur, ministère des cultes. Mais aussi du monde musulman. On le voit bien, et certains le disent, ils sont d’abord français, républicains, démocrates, puis musulmans. Il ne faut donc pas rentrer dans le système du communautarisme : ce serait la pire des choses. Ce serait la perte de nos valeurs, et de la laïcité.
Les intellectuels, travailleurs sociaux qui fréquentent les milieux musulmans devraient peut-être aussi donner les moyens de détecter la radicalisation, ce que ne peuvent pas toujours faire les familles, parfois divisées, parfois recomposées. Il faut donner à toutes les personnes qui sont impliquées auprès de ces Français qui pratiquent, ou non d’ailleurs, la religion musulmane mais qui ont des attaches avec des musulmans, les moyens de détecter, d’être à l’écoute dans le milieu associatif. Elles constitueraient une sorte d’équipe de vigilance qui conduirait un travail complémentaire de celui de la police pénitentiaire.
Il faut utiliser les mêmes modes de communication que les djihadistes, qui mènent des campagnes énormes, avec des vidéos. Il faut quasiment faire du matraquage : toutes les chaînes de télévision, les radios, les réseaux sociaux doivent être utilisés aujourd’hui pour mener le combat.
Il y a aussi le problème de la formation des imams et de son financement. Qui dit qu’un imam est imam ? C’est un vaste débat et cela relève du ministère de l’intérieur.
En tout cas, il y a une prise de conscience de la société civile. Le 11 janvier en a magnifiquement témoigné même si, après, le soufflé est un peu retombé. Cette journée de mobilisation exceptionnelle marquera l’histoire du pays, et d’ailleurs celle du monde entier. Il faut prendre en compte également les cercles de réflexion : l’Institut Montaigne, Diderot, les Francs-Maçons, les associations qui travaillent sur la résilience – car je n’en ai pas parlé, mais on ne doit pas maintenir une victime dans son statut de victime, il faut l’aider sur le chemin de la résilience.
On note chez certains intellectuels français, des « droits de l’hommistes » que je fréquente à la CNCDH (Commission nationale consultative des Droits de l’homme), une confusion entre terrorisme et résistance. Ce n’est pas du tout la même chose. Quand les Résistants français menaient des actions pendant la Seconde Guerre mondiale contre des Allemands, il s’agissait de cibles très particulières. Les Allemands, en revanche, prenaient des otages ou tuaient des civils. Ne confondons pas ! Action Directe qui posait des bombes et causait de graves dommages collatéraux, ce n’était pas acceptable dans un pays où l’on a le droit de voter, de militer, de s’exprimer. De même, il n’était pas admissible d’offrir l’hospitalité aux brigadistes rouges, de donner l’asile politique à des réfugiés prétendument italiens, réclamés par la justice italienne pour des crimes commis en Italie. Le cas de Battisti est inadmissible : on l’a libéré et il s’est enfui. Il fallait le remettre à la justice italienne. L’Italie fait partie de l’Europe.
Cela m’amène à mon combat en faveur de l’Europe judiciaire. Pour moi, les seules frontières qui existent aujourd’hui sont des frontières judiciaires. Prenons l’exemple de Carlos, qui a été arrêté par les services français et ramené en France en 1994. Il a été condamné pour les attentats de 1982-83 : le TGV, le Capitole, la gare saint-Charles, la rue Marbeuf – pour lui aussi, les victimes étaient des dommages collatéraux. Weinrich, qui était son bras droit, a été arrêté, quant à lui, en Allemagne et l’on n’a jamais pu organiser de confrontation entre les deux – les Allemands considéraient que le déplacement dans un avion de l’un ou l’autre aurait été trop dangereux – alors pourtant qu’ils avaient participé aux mêmes actions. Il y a eu deux procédures judiciaires, une à Berlin et une à Paris, parce que ni les Allemands ni les Français n’extradent leurs propres nationaux.
Donc l’Europe judiciaire dysfonctionne complètement. J’avais organisé en 1996 un colloque au Sénat, à la suite de l’appel de Genève lancé par les magistrats antiterroristes. Mais il a fallu attendre les événements de 2001 pour que le mandat d’arrêt européen soit créé. Il n’y a pas de liste commune d’infractions, sur laquelle on puisse travailler, avec une extradition automatique. On n’extrade pas entre Paris et Lyon : pourquoi une procédure d’extradition entre Bruxelles et Paris ? Il ne devrait plus y avoir de frontières judiciaires. On alors on ferme complètement chaque pays, et on dit au revoir à l’Europe. C’est un autre débat.
Si l’on reste dans cette Europe qu’à mon avis on doit sauver, il faut construire l’Europe judiciaire, et créer un Parquet européen afin que, si un État s’abstient de poursuivre, s’il y a des problèmes de coopération entre les différentes justices, on puisse avoir une autorité suprême, en Europe, qui permette de juger, d’arrêter et de lutter avec nos armes contre le terrorisme. Je le dis toujours, les armes d’une démocratie, c’est le droit.
Voilà mon projet. Il est peut-être un peu fou, mais je souhaite vraiment que l’on travaille à la création de cet espace judiciaire européen, pour commencer au sein d’un petit noyau : Bruxelles, bien évidemment ; l’Espagne qui, elle aussi, a été touchée par les attentats.
M. le président Georges Fenech. Madame Rudetzki, au nom de tous mes collègues de la commission d’enquête, je salue le combat que vous menez depuis tant d’années, avec toujours la même flamme et le même dynamisme. Nous vous remercions pour votre importante contribution, qui va nourrir nos travaux. C’est avec beaucoup de respect que nous vous avons reçue.
Table ronde, ouverte à la presse, d'avocats de victimes d'attentats terroristes : Me Patrick Klugman, avocat au barreau de Paris, accompagné de M. Samuel Sandler, père et grand-père de victimes de Mohamed Merah ; Me Samia Maktouf, avocate aux barreaux de Paris et Tunis, accompagnée de M. Omar Dmougui, victime des attentats du 13 novembre 2015 ; Me Olivier Morice, avocat au barreau de Paris, accompagné de M. René Guyomard et Mme Emmanuelle Guyomard, père et sœur d'une victime de l'attentat du Bataclan
Compte rendu de la table ronde, ouverte à la presse, du mercredi 17 février 2016
M. le président Georges Fenech. Mesdames, messieurs, nous vous remercions d’avoir répondu à la demande d’audition de notre commission d’enquête. Comme je l’ai indiqué lors de la première réunion de notre commission, nous avons souhaité commencer par entendre les victimes qui ont droit à toute l’attention de la représentation nationale. Nous poursuivons notre série d’auditions avec plusieurs avocats, accompagnés de victimes ou de parents de victimes.
Me Samia Maktouf, avocate aux barreaux de Paris et Tunis, est accompagnée de M. Omar Dmougui, victime des attentats du 13 novembre 2015, vigile en faction au Stade de France le 13 novembre. Monsieur Dmougui, vous avez, en cette qualité, réussi à empêcher l’un des kamikazes de pénétrer dans l’enceinte du stade. Vous souffrez aujourd’hui d’un traumatisme profond. Nous vous entendrons en premier.
Me Olivier Morice, avocat au barreau de Paris, est accompagné de M. René Guyomard et Mme Emmanuelle Guyomard, père et sœur d’une victime du Bataclan, M. Pierre-Yves Guyomard, qui était âgé de quarante-trois ans.
Me Patrick Klugman, avocat au barreau de Paris, est accompagné de M. Samuel Sandler, père et grand-père de victimes de Mohamed Merah. Monsieur Sandler, même si, a priori, votre audition peut paraître hors du champ de nos investigations, votre expérience, ainsi que celle de votre avocat, est utile pour que la commission mette en perspective le traitement des victimes de 2015 avec ce qui a été fait précédemment.
Je rappelle que cette table ronde est ouverte à la presse et qu’elle fait l’objet d’une retransmission en direct sur le site internet de l’Assemblée nationale. Son enregistrement sera disponible pendant quelques mois sur le portail vidéo de l’Assemblée. La commission pourra décider de citer dans son rapport tout ou partie du compte rendu qui sera fait de cette audition. Nous avons décidé, d’une manière générale, que nos auditions seraient ouvertes à la presse, car nous devons mener cette enquête en toute transparence.
Conformément aux dispositions de l’article 6 de l’ordonnance du 17 novembre 1958 relative aux commissions d’enquête, je vais demander aux uns et aux autres de prêter le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité.
Me Patrick Klugman, Me Samia Maktouf, M. Omar Dmougui, M. Samuel Sandler, Me Olivier Morice, M. René Guyomard et Mme Emmanuelle Guyomard prêtent successivement serment.
M. Omar Dmougui, victime des attentats du 13 novembre 2015. Bonjour à tous et merci d’avoir demandé à m’entendre.
Je m’appelle Omar Dmougui. Je suis né le 7 septembre 1983 à Guelmim, au Maroc. Je suis en France depuis le 18 janvier 2003, depuis treize ans. Je suis le père d’une petite fille française, Dikra Dmougui. Je travaille au Stade de France où je suis vigile, à la porte G.
Le 13 novembre, je suis venu au Stade de France pour faire mon travail. C’était un jour comme tous les autres. J’ai pris mon badge. J’étais très content, car la France jouait contre l’Allemagne. Il y avait toutes les couleurs de la France. Il y avait aussi des Allemands. C’était bien.
Je fais des rondes entre la porte G et la porte H. Devant moi, il y a un jeune, âgé au maximum de vingt-trois, vingt-quatre ans, qui est habillé en civil. Je le regarde et il me regarde dans les yeux. Je croyais que c’était un policier en civil.
J’ai fait entrer les gens dans le Stade. Il y avait des jeunes, des hommes, des femmes, des couples, des personnes âgées. Avant la fermeture des portes, il y a eu des retardataires ; je les ai fait entrer. Ensuite, il y a eu une première explosion, à ma droite. Je n’ai rien vu, sauf un camion, à côté du café, qui a bougé à cause de la puissance de l’explosion. Après, je suis sorti pour évacuer du monde. Un policier s’est dirigé vers l’endroit où a eu lieu la première explosion. J’ai entendu des policiers dire que c’était un attentat. Après, j’ai évacué tout le monde vers le boulevard parallèle. Il y avait des jeunes, des très jeunes, des femmes. J’ai dit : « Éloignez-vous, reculez, s’il vous plaît, reculez, reculez ! ». J’ai vu le jeune homme qui me fixait dans les yeux. Il déclenche sa ceinture. Il y a une explosion et je tombe par terre à cause du souffle. Là, j’ai vu un monsieur, de type européen, âgé de cinquante-deux ans, qui me dit : « Aidez-moi, s’il vous plaît ! ». Je ne peux rien faire, car je n’arrive plus à bouger mes jambes. J’étais au milieu, à côté du kamikaze et du monsieur qui est blessé et qui perdra la vie cinq minutes plus tard.
Ensuite, les secours m’ont évacué et mis à côté de tout ce que je ne veux pas vous décrire. Un médecin a dit : « Non, sa place n’est pas ici ». Ils m’ont ramené au McDonald’s où ils m’ont donné les premiers soins. Après, j’ai été évacué à l’hôpital.
M. le président Georges Fenech. Vous avez empêché ce jeune homme que vous évoquez d’entrer dans le stade ?
M. Omar Dmougui. Oui.
M. le président Georges Fenech. Comment ?
M. Omar Dmougui. Tous les policiers sont partis vers l’endroit où a eu lieu la première explosion. C’était le chaos, la porte G était ouverte, et le kamikaze a voulu entrer dans le stade.
M. le président Georges Fenech. C’est à ce moment que vous vous êtes interposé.
M. Omar Dmougui. Oui.
M. le président Georges Fenech. Comment ?
M. Omar Dmougui. Je lui ai dit : « Où allez-vous ? Poussez-vous, monsieur ! ». Il m’a regardé dans les yeux, a fait deux pas en arrière et a fait exploser sa ceinture. Il y avait un papa de cinquante-deux ans, de type européen, derrière lui, qui m’a demandé de l’aide. Mais il est décédé. Cet homme, je le vois tout le temps ; quand je dors et même ici, je le vois devant moi.
M. le président Georges Fenech. On comprend que vous soyez toujours extrêmement traumatisé par ce que vous avez vécu. Grâce à votre intervention extrêmement courageuse, vous avez empêché que ne se produise quelque chose de plus grave encore.
Notre commission aimerait savoir ce que vous pensez des mesures de sécurité autour du stade. Selon vous, étaient-elles suffisantes ce soir-là ?
M. Omar Dmougui. Pour moi, ce sont les vigiles qui ont fait le travail, un travail extraordinaire. Ce sont eux qui ont sauvé la France avec toutes ses couleurs, toutes ses cultures, toutes ses religions.
M. le président Georges Fenech. Souhaitez-vous ajouter quelque chose ?
M. Omar Dmougui. Mon titre de séjour expire le 29 février 2016. Je suis le papa d’un enfant français et je ne sais pas ce qui va se passer.
J’ai été victime d’un attentat. Je ne comprends pas pourquoi je n’ai pas été bien pris en charge. Ce sont mon avocate et le psychiatre qui m’a soigné, le Dr Mezouane Belkacem, qui m’ont aidé à être transféré à l’hôpital militaire de Percy.
M. Sébastien Pietrasanta, rapporteur. Je vous remercie pour ce témoignage.
On s’interroge sur le fait que ces individus n’avaient pas de billet d’entrée. Votre expérience nous éclairerait utilement sur ce point. Avez-vous le sentiment que la première explosion était destinée à faire diversion pour que le kamikaze qui était en face de vous puisse profiter de la panique pour entrer dans le stade ? Pensez-vous que c’est ainsi que les choses avaient été organisées, et que, du coup, votre intervention a permis d’éviter un massacre beaucoup plus important ?
Que pensez-vous de la prise en charge par les secours, à la fois le soir du 13 novembre et les jours suivants, notamment de l’accompagnement psychologique et psychiatrique ?
M. Omar Dmougui. Pourriez-vous poser une seule question à la fois, s’il vous plaît ?
M. le rapporteur. Comme le kamikaze n’avait pas de billet pour entrer dans le stade, pensez-vous que la première explosion avait pour but de lui permettre d’entrer dans le stade pour faire plus de dégâts ?
M. Omar Dmougui. Oui, c’était une stratégie. Tous les policiers sont partis vers le lieu de la première explosion, vers le café. Du coup, je me suis retrouvé tout seul. Et lui, il a cherché à entrer dans le stade ; je l’ai stoppé, j’ai empêché le carnage.
M. le rapporteur. Après la première explosion, avez-vous eu des consignes particulières pour rester sur place ou bien chacun gérait-il la situation à sa façon ?
M. Omar Dmougui. Je n’ai pas eu de consignes. Ma seule consigne, c’était de contrôler les billets. Point final.
M. le rapporteur. Qu’avez-vous pensé de l’accompagnement des secours le soir du 13 novembre et les jours suivants ?
M. Omar Dmougui. Le soir du 13 novembre, les secours ont mis beaucoup de temps à arriver. Cela m’a énervé. Les soignants n’étaient pas bien formés pour les attentats.
M. le président Georges Fenech. Selon vous, combien de temps ont mis les secours pour arriver ?
M. Omar Dmougui. Vingt ou trente minutes. Pour moi, c’était long.
M. Olivier Falorni. Monsieur, je veux vous remercier de votre présence et saluer votre courage.
Combien étiez-vous à cette porte d’accès ? Combien de temps s’est écoulé entre la première explosion et la tentative d’entrer dans le stade de la personne que vous avez arrêtée ? Vous avez évoqué un déplacement des forces de l’ordre vers le lieu de la première explosion ; à ce moment-là, étiez-vous seul ou accompagné de collègues ?
M. Omar Dmougui. Pourriez-vous poser une seule question à la fois ?
M. Olivier Falorni. Combien étiez-vous à l’entrée de la porte d’accès avant les attentats ?
M. Omar Dmougui. Nous étions quatre.
M. Olivier Falorni. Quand la première explosion s’est produite, étiez-vous encore quatre ou vous êtes-vous retrouvé seul ?
M. Omar Dmougui. Tout le monde s’est sauvé. Derrière moi, les employés de la société Stand’Up, qui s’occupaient des fouilles, sont partis. Je me suis retrouvé tout seul.
Olivier Falorni. Combien de temps s’est écoulé entre la première explosion et la tentative d’entrer du terroriste ?
M. Omar Dmougui. Quinze à seize minutes.
Olivier Falorni. Si vous n’aviez pas été là, est-ce que d’autres sas, après vous, auraient pu empêcher le terroriste d’entrer directement dans une tribune ?
M. Omar Dmougui. Je ne pense pas. Les femmes et les hommes employés par la société Stand’Up pour faire les palpations se sont tous sauvés après la première explosion. J’ai tourné la tête : il n’y avait plus personne. Ceux qui étaient là-bas pourront vous dire qu’il n’y avait personne.
Olivier Falorni. Lorsque vous avez repoussé le terroriste, vous avez indiqué qu’il s’était fait exploser. C’était une démarche volontaire de sa part parce qu’il n’avait pas pu pénétrer dans le stade. Tout de suite, il a fait quelques pas en arrière et a déclenché sa ceinture.
M. Omar Dmougui. Tout à fait.
M. Meyer Habib. Vous nous avez parlé de ce monsieur de cinquante-deux ans qui a agonisé devant vous. Cet attentat aurait pu être encore beaucoup plus meurtrier.
La police était-elle présente à l’entrée du stade avant les attentats ? Les fouilles ont eu lieu après votre barrage, n’est-ce pas ?
M. Omar Dmougui. La police n’était pas loin.
M. Meyer Habib. Vous avez échangé des regards avec la personne qui s’est révélée être un terroriste, et que vous aviez prise, dans un premier temps, pour un policier.
M. Omar Dmougui. Oui.
M. Meyer Habib. Cela veut dire que cette personne est restée pendant longtemps devant vous.
M. Omar Dmougui. Elle faisait des allers-retours.
M. Meyer Habib. J’imagine qu’au début, beaucoup de gens entraient dans le stade. Si l’homme avait pu y pénétrer avec toute cette masse, il y aurait eu un vrai carnage. Vous l’avez donc vu avant le début du match.
M. Omar Dmougui. Oui.
M. Meyer Habib. Et vous pensiez que c’était un policier.
M. Omar Dmougui. Oui. Cela faisait deux heures que je le voyais, que je fixais ses yeux.
M. Meyer Habib. Il était habillé normalement ?
M. Omar Dmougui. Il portait une doudoune noire et un jeans. Et il avait une petite queue-de-cheval.
M. Meyer Habib. Vous l’avez arrêté avec vos mains.
M. Omar Dmougui. Non, de loin, parce que derrière lui il y avait beaucoup de monde.
M. Meyer Habib. Les gens qui regardaient la télévision ont entendu une explosion. À ceux qui étaient à l’intérieur du stade, on a dit qu’il y avait eu un attentat ?
M. Omar Dmougui. Oui.
M. Meyer Habib. Comment cela s’est-il passé ?
M. Omar Dmougui. Pendant que je faisais évacuer le monde par le boulevard parallèle, il est venu. Je lui ai dit : « Reculez, reculez ! ». Et il a déclenché sa ceinture.
M. Meyer Habib. Vous avez été blessé. Comment s’est passée la prise en charge immédiate ? Quelques mois après l’attentat, comment ressentez-vous, en tant que victime, cette prise en charge ?
M. Omar Dmougui. Le premier jour, les secours m’ont emmené à l’hôpital. Après, on m’a dit que je pouvais partir ; j’avais un certificat pour pouvoir revenir dans sept jours si je n’allais pas bien. Depuis ce jour-là, je ne dors pas. Tous les soirs, j’allais aux urgences. Un professeur de l’Hôtel-Dieu m’a donné une liste de psychiatres pour me faire suivre. Et c’est le psychiatre qui a demandé mon hospitalisation.
M. Meyer Habib. Dans un hôpital psychiatrique ?
M. Omar Dmougui. Oui, un hôpital civil à Crosne. Comme je suis trop stressé, je serre les dents et je saigne. Le dentiste m’a prescrit une gouttière à mettre le soir.
M. le président Georges Fenech. Monsieur Dmougui, je vous remercie pour votre déposition qui était très attendue.
Me Samia Maktouf, avocate aux barreaux de Paris et Tunis. Il est très difficile de prendre la parole après le témoignage très touchant de M. Dmougui, qui nous rappelle la situation des victimes.
J’interviens aujourd’hui devant votre commission en tant qu’avocate de partie civile de différentes affaires que la France a connues depuis 2012 : l’affaire Merah, les attentats de Charlie Hebdo, de l’Hypercacher, du Bataclan et du Stade de France.
Plusieurs de mes clients, victimes, pensent que c’est une commission de plus. Mais je ne céderai pas au scepticisme. Je suis les travaux de votre commission, j’ai entendu les témoignages bouleversants des victimes, et je suis persuadée qu’il est très important de parler. Votre rapport permettra de comprendre, mais aussi de prévenir d’autres attentats. Il ne restera pas lettre morte et n’ira pas juste grossir les archives de l’Assemblée nationale.
J’ai suivi avec beaucoup d’intérêt les auditions que vous avez effectuées lundi dernier, et je voudrais revenir sur la prise en charge des victimes. Ces victimes ne comprennent pas qu’on puisse dire aujourd’hui que leur prise en charge est totale et complète. Ce n’est pas le cas.
Sachez qu’Omar Dmougui et plusieurs autres victimes ne sont pas considérés comme des victimes civiles de guerre. Le texte de 2015, qui n’est toujours pas entré en vigueur, ne prévoit une assimilation que pour le règlement d’une pension. Les victimes veulent être reconnues comme telles même si elles ne présentent pas de blessures corporelles. Omar Dmougui n’a aucune blessure sur son corps, mais il souffre d’une profonde blessure psychiatrique. Lui aussi doit être considéré comme une victime civile de guerre.
Les victimes attendent davantage que l’hospitalisation et la prise en charge psychiatrique et psychologique. On leur doit une réponse. Cela fait partie de leur thérapie.
Leur prise en charge passe également par l’accompagnement par les associations d’aide aux victimes, qui effectuent un travail extraordinaire, et par les professionnels du droit. Aujourd’hui, plus de 500 victimes n’ont pas d’avocat. C’est pourquoi j’ai pris sur moi d’interpeller notre ordre – et je suis certaine que mes confrères ont fait la même chose. Il faut interpeller les barreaux de toute la France. Il n’est pas acceptable que des familles, des parents, des mamans doivent écrire au juge pour lui demander comment faire pour prendre un avocat. Faut-il rajouter ce traumatisme à leur douleur ? La France connaît des attaques depuis 2012 ; il faut qu’on se structure, que les professionnels du droit fassent acte de civisme en s’organisant pour s’occuper de nos concitoyens que ces atrocités ont rendus malades.
Il me vient à l’esprit, en présence de M. Samuel Sandler, dont le fils et les deux petits-fils ont été tués, la formule d’Alain Badiou qui qualifie ces actes de meurtres de masse. En 2012, dans l’affaire Merah, les victimes étaient ciblées : des militaires, trois enfants et un rabbin qui ont été tués parce qu’ils étaient juifs. Aujourd’hui, pour reprendre une expression de Gilles Kepel, on est passé à un terrorisme de troisième génération, voire de quatrième génération, car nous sommes tous devenus des cibles. Depuis 2012, les terroristes ne cessent de prendre de l’avance sur nous, sur nos services de police, sur nos services de renseignement. Ils ont une capacité extraordinaire à se dissimuler, il n’y a plus de signes pour les reconnaître. Le terroriste, aujourd’hui, ne porte plus de qamis, ne se laisse plus pousser la barbe ; on le croise peut-être dans le métro – on sait qu’Abaaoud le prenait –, c’est peut-être un voisin de palier, quelqu’un avec qui on partage un espace professionnel. Les terroristes sont semés dans notre société comme une gangrène.
M. le président Georges Fenech. Vous avez été saisie d’un certain nombre de dossiers depuis 2012. Depuis cette époque, et plus particulièrement depuis le mois de janvier 2015, avez-vous le sentiment qu’il y a eu une évolution dans les moyens de lutte contre le terrorisme ?
Me Samia Maktouf. La réponse est clairement non, parce que nous n’avons pas pu éviter et arrêter d’autres attentats.
Les personnes fichées « S » sont supposées être suivies mais ne sont pas judiciarisées – il faudrait un cours de droit pour expliquer pourquoi. On essaie certes de faire face, mais au coup par coup ; pardon de le dire, c’est du bricolage. Faut-il rappeler que Fabien Clain, qui n’est autre que le mentor de Mohamed Merah et la voix des attentats du 13 novembre, a envoyé deux personnes à Sid Ahmed Ghlam ? Il est dans la filière belge, il est partout ; c’est le fil conducteur de toutes les affaires terroristes que nous avons connues à ce jour. Il est en fuite. Il est apparu dans la première affaire, dont l’instruction a été bâclée. Elle n’a pas permis d’arrêter des terroristes en puissance alors qu’un œil novice aurait pu conclure de l’examen de leur situation qu’ils allaient fatalement passer à une action armée. Les personnes impliquées dans les attentats du 13 novembre sont les mêmes protagonistes que ceux de l’affaire Merah – Sabri Essid, Corel, Fabien Clain, Megherbi, la liste est trop longue pour les citer tous. J’en veux pour preuve qu’après l’affaire Artigat 1, il y a maintenant une affaire Artigat 2.
Vous l’avez dit, monsieur le président, nous ne sommes pas ici pour pointer la responsabilité des uns et des autres mais pour tenter de savoir ce qui n’a pas marché, et pour essayer de prévenir.
M. le président Georges Fenech. Vous dites que l’instruction a été bâclée. C’est une accusation lourde. Pourquoi dites-vous cela ?
Me Samia Maktouf. Parce qu’elle n’a pas permis de neutraliser des terroristes identifiés en passe de commettre des actes terroristes et de tuer des citoyens français.
Artigat est la genèse du terrorisme ; c’est là qu’apparaît la tête pensante du terrorisme en France, qui est toujours active. Avec mes confrères, nous avons demandé que l’affaire Artigat 1 soit versée au dossier Merah, ce qui a été fait. Nous avons pu évaluer les dégâts. À ce jour, les protagonistes de l’affaire Merah sont les mêmes que dans toutes les autres affaires arrêtées ou avortées. Ce qui est grave, c’est qu’il y a eu beaucoup d’actions.
Je veux enfin faire part du manque de moyens du pôle antiterroriste. Aujourd’hui, il n’y a pas suffisamment d’experts auprès des magistrats chargés des instructions terroristes. On manque notamment d’experts arabophones. Dans l’affaire Merah, par exemple, le magistrat instructeur a cru qu’Abdelkader Merah avait modifié sa signature lors d’une audition ; en fait, il écrivait en langue arabe. Et ce qu’il a écrit est extrêmement grave : sur dix-huit pages de procès-verbal, il demande au juge de se convertir à l’islam, dit ne pas reconnaître la justice des hommes et ne reconnaître que la justice de Dieu. Il cite même certaines sourates du Coran. Ces éléments n’ont pas été traduits. J’ai dû demander une traduction assermentée parce que, avec mes confrères, nous avions besoin de démontrer la montée en puissance de l’endoctrinement d’Abdelkader Merah.
Me Olivier Morice, avocat au barreau de Paris. Notre démarche comme avocats est résolument indépendante. Nous sommes indépendants à tout moment, quel que soit le pouvoir politique en place. Nous avons dénoncé des dysfonctionnements dans l’affaire Merah ; nous dénonçons aujourd’hui un certain nombre de dysfonctionnements, avec un objectif bien précis : aider la représentation nationale à faire en sorte que la lutte contre le terrorisme soit beaucoup plus efficace. J’aurai des propositions concrètes à faire.
Si je m’exprime ainsi préalablement, c’est pour vous dire que, en tant qu’auxiliaires de justice, mes collaborateurs et moi nous étonnons que la représentation nationale ait consacré si peu d’espace et ait eu si peu de considération pour l’autorité judiciaire dans le cadre des différentes lois qui ont été votées ou qui sont en cours d’examen. L’autorité judiciaire est, de manière totalement incompréhensible en démocratie, la grande absente. Nous avons le sentiment que, pour des raisons plus ou moins claires, il y a une absence de volonté de conférer à l’autorité judiciaire le rôle qui est le sien. C’est si vrai que le premier président de la Cour de cassation et le procureur général près la Cour de cassation ont alerté le pouvoir exécutif sur ce point au mois de janvier.
Il y a eu des dysfonctionnements graves, mais il ne faut pas céder à l’approximation ni lancer des condamnations trop rapides. Dire, par exemple, que les juges d’instruction qui ont eu en charge le projet d’attentat du Bataclan ont bâclé l’information judiciaire ou qu’ils n’ont pas cherché à arrêter ceux qui ont pu projeter un tel attentat, serait erroné. Ce sont des juges d’instruction expérimentés et courageux, mais ils se sont heurtés à l’absence totale de coopération judiciaire des autorités égyptiennes qui les ont empêchés d’approfondir leur travail.
Soyons néanmoins lucides. Nous savions dès 2009 qu’un projet d’attentat au Bataclan avait été envisagé de manière suffisamment précise – une enquête préliminaire et une information judiciaire avaient été ouvertes, deux juges d’instruction étant chargés du dossier. Or les propriétaires du Bataclan n’ont jamais été prévenus de cette information judiciaire. Je rappelle que, dans l’affaire des événements du 13 novembre, 2 000 avis à victime ont été adressés. Aucune mesure particulière n’a été prise sur la salle de spectacle du Bataclan alors que l’on savait, grâce à plusieurs auditions faites, soit par les services secrets, soit dans le cadre d’informations en cours, qu’avant l’été une salle ou des salles de spectacle seraient visées. Et les personnes auditionnées ont même dit qu’un attentat aurait lieu très prochainement.
Et que s’est-il passé ? Les nouveaux propriétaires de l’établissement n’ont pas été prévenus, et, comme vous le savez, aucune mesure de sécurité particulière n’a été prise à l’entrée de la salle de spectacle, les personnes présentes à l’entrée vérifiant seulement les billets. De surcroît, et c’est surréaliste – nous n’avons pas de réponse aujourd’hui à cette question –, les plans des salles de spectacle les plus concernées par un risque potentiel d’attentat n’auraient même pas été transmis aux autorités susceptibles d’intervenir. La Brigade de recherche et d’intervention (BRI) qui est intervenue – et non le RAID, comme j’ai pu l’entendre parfois – n’avait pas, en effet, le plan de l’établissement alors qu’on l’a retrouvé dans le téléphone portable d’un terroriste.
Il est évident que tous ceux qui œuvrent dans la lutte contre le terrorisme font tout pour essayer d’apporter des améliorations. Malheureusement, les avocats spécialisés dans l’accueil des victimes et les auxiliaires de justice ne peuvent que constater que les choses ne se sont pas grandement améliorées depuis l’affaire Merah, qui a été marquée par des dysfonctionnements – le défaut de judiciarisation des informations dans un certain nombre de dossiers, par exemple. Qu’est-ce qu’un défaut de judiciarisation ? Le fait qu’on n’ait pas porté en temps utile à la connaissance de l’autorité judiciaire des informations dont l’exploitation est susceptible de permettre, soit de prévenir des actes terroristes, soit d’intercepter les auteurs d’infractions. Nous sommes convaincus qu’il faut modifier un certain nombre de réflexes et de textes. Aussi, ai-je apporté avec moi des propositions de loi en guise de suggestions. Je précise que cette réflexion a été menée avec le professeur Didier Rebut, spécialiste en droit pénal et en procédure pénale.
M. le président Georges Fenech. Pouvez-vous être plus concret sur l’absence de judiciarisation ?
Me Olivier Morice. Peut-être savez-vous que l’article 40 du code de procédure pénale ne prévoit aucune sanction à l’encontre des autorités administratives qui ne révèleraient pas les infractions dont elles pourraient avoir eu connaissance. Nous proposons que soit ajoutée, dans le code de la sécurité intérieure, une disposition prévoyant une sanction en cas de non-transmission à l’autorité judiciaire d’informations liées à la connaissance de délits ou de crimes et susceptibles d’aider à la poursuite d’actes de terrorisme. Aujourd’hui, une personne, dans quelque service qu’elle travaille, qui a en sa possession de telles informations et qui retarde leur transmission à l’autorité judiciaire, n’est pas sanctionnée. Rendez-vous compte qu’à la suite des attentats commis par Mohamed Merah, les services de la Direction centrale du renseignement intérieur (DCRI) se sont précipités chez le procureur de la République de Paris pour porter à la connaissance de l’autorité judiciaire vingt procédures afin de savoir s’il était nécessaire de les judiciariser.
En ce qui concerne les informations judiciaires en cours, les magistrats instructeurs travaillent, fort logiquement, sous forme de commissions rogatoires, qui sont souvent très longues. Pour des motifs parfois incompréhensibles, les investigations effectuées ne sont portées à la connaissance des parties civiles que deux, trois ou quatre ans plus tard, ce qui a des conséquences sur la gestion même de l’information judiciaire, car les juges ne sont pas toujours informés des résultats. Dans l’affaire Mohamed Merah, qui dure depuis plusieurs années, les enquêteurs chargés des commissions rogatoires ont envoyé, juste avant la clôture de l’information, un nombre considérable de dépositions au magistrat instructeur qui les réclamait depuis plusieurs années. Des procès-verbaux qui avaient été établis, par exemple dès 2013, n’ont été transmis qu’en 2015, sans la moindre sanction.
Nous avons réfléchi à une solution qui permette de respecter de manière équitable et les droits des parties civiles et ceux des personnes susceptibles d’être poursuivies. Si le défaut ou les délais de transmission insuffisamment motivés des commissions rogatoires à l’autorité judiciaire étaient sanctionnés par le régime des nullités, je peux vous assurer que la remontée des informations serait beaucoup plus efficace.
M. le président Georges Fenech. Vous êtes affirmatif sur le fait que, plusieurs années avant l’attentat du Bataclan, figurait sur un procès-verbal la dénonciation d’un projet d’attentat visant expressément le Bataclan.
Me Olivier Morice. Bien sûr !
M. le président Georges Fenech. Ne s’agissait-il pas simplement de viser un établissement ouvert au public ou une salle de spectacle ? Je vous demande d’être le plus précis possible.
Me Olivier Morice. Je suis précis. Et je vais même violer le secret de l’instruction ou le secret professionnel…
M. le président Georges Fenech. Nous ne vous le demandons pas.
Me Olivier Morice. Je vais le violer parce que, conformément aux décisions récemment rendues par la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l’Homme –qui ont d’ailleurs condamné la France –, je suis en droit, en ma qualité d’avocat, de révéler à l’opinion publique, et en particulier à la représentation nationale, des dysfonctionnements majeurs dans un certain nombre d’informations. Et j’affirme que la salle de spectacle du Bataclan était visée par un projet d’attentat parce que son propriétaire appartenait à la communauté juive. Cela dit, on ne peut pas jeter l’anathème ainsi sur une information judiciaire. L’objectivité commande de reconnaître que les magistrats instructeurs, dont la qualité n’est pas en cause, ont essayé à ce moment-là de cerner les responsabilités, mais ils n’ont pas pu le faire du fait d’un défaut de coopération des autorités égyptiennes. C’est si vrai que, dans le dossier du projet d’attentat du Bataclan, qui concerne M. Ben Abbes, les deux frères Clain, dont je n’ai pas besoin de vous expliquer qui ils sont, ont été entendus. J’ai avec moi un schéma, que nous tenons à la disposition de la représentation nationale, montrant tous les liens entre un certain nombre de personnes, que nous avons pu expliquer grâce à ce que nous avons demandé, dès le mois d’octobre 2014, à un magistrat instructeur, dans le cadre de la gestion de l’attentat du Caire.
Chacun à sa place doit être conscient de ses limites mais aussi de ses responsabilités. Dans le cadre de l’état d’urgence et de la législation, la représentation nationale a donné des pouvoirs tout à fait exorbitants au pouvoir exécutif. Il faut les contrebalancer, sinon nous ne sommes plus en démocratie. Si l’autorité judiciaire n’est pas mise à sa véritable place, nous allons droit dans le mur. Rendez-vous compte que tous les premiers présidents de cour d’appel de France se sont manifestés pour dire que la manière dont les choses étaient envisagées était totalement en décalage par rapport à la mission de l’autorité judiciaire !
M. le président Georges Fenech. Selon vous, qu’est-ce qui a constitué un obstacle avec les autorités égyptiennes pour avoir plus d’informations ?
Me Olivier Morice. Plusieurs demandes d’entraide pénale internationale ont été formulées. Mais les autorités égyptiennes ont fait preuve d’une absence délibérée de coopération, qui d’ailleurs existe toujours.
M. Meyer Habib. Il y a eu un changement de pouvoir en Égypte.
Me Olivier Morice. Cela n’a rien changé. Les obstacles sont tels que les magistrats instructeurs n’y arrivent pas. Ce n’est pas trahir la confidence que de dire que ces magistrats, qui travaillent d’arrache-pied à lutter contre le terrorisme, vivent très difficilement de retrouver dans d’autres affaires les mêmes personnes qu’ils n’ont pas réussi à arrêter à certains moments. Vous pensez bien que, si jamais ils avaient pu le faire, ils l’auraient fait.
Le texte que nous tenons à la disposition de la représentation nationale est surtout très juridique parce qu’il a été élaboré par un professeur de droit.
Me Patrick Klugman, avocat au barreau de Paris. J’ai tenu à venir aujourd’hui devant vous avec M. Samuel Sandler parce que, bien qu’elle ne fasse pas l’objet de votre commission d’enquête, vous avez compris des propos non concertés de mes confrères Samia Maktouf et Olivier Morice que l’affaire Merah a été matrice des actes de terrorisme qui ont visé notre pays. Les racines de cette matrice remontaient d’ailleurs à l’affaire d’Artigat, citée par Me Maktouf, la première à avoir conduit devant un tribunal les filières de l’Ariège, dites du Sud-Ouest. Sont déjà présents tous les protagonistes que l’on retrouve directement à l’œuvre dans les attentats des 12, 15 et 19 mars 2012 à Toulouse et Montauban, et dans la préparation, perpétration ou revendication des attentats du 13 novembre à Paris. Tout nous ramène à l’affaire Merah.
Alors que nous réagissons parfois dans des séquences très scindées, séparées, les djihadistes, eux, ont le sens du message, du temps long : Fabien Clain, qui a revendiqué l’attentat du Bataclan, est lié organiquement à Mohamed Merah ; son beau-frère, Sabri Essid, est apparu dans des vidéos diffusées en France, assistant à une décapitation commise par un enfant qui semble être son fils. Visiblement, quelque chose n’a pas été compris.
Acquérir la compréhension de ces différentes affaires est, pour le moment, impossible, quand bien même les magistrats instructeurs saisis des différents dossiers sont les mêmes – ce sont les quelques magistrats de la galerie Saint-Éloi que certains d’entre vous connaissent bien. Dans une affaire, ce que veut le magistrat, c’est la résolution, c’est-à-dire amener devant une juridiction un ou des auteurs, à défaut, un ou des complices. C’est le cas de l’affaire Merah, qui est maintenant au règlement. Le magistrat instructeur n’a pas le devoir de tirer tous les enseignements de cette affaire ni des indices ou des autres affaires qui sont suivies par le renseignement. Où est le centre de commandement ? Où est le centre d’analyse ? Est-ce seulement l’affaire des services de renseignement ou peut-il être ailleurs, au niveau du parquet ? S’il y existe déjà une direction du terrorisme, elle n’est pas, selon moi, parfaite. À aucun moment, les affaires n’ont été interconnectées, ni dans leurs faiblesses ni dans leurs manquements. C’est particulièrement criant après l’affaire Merah.
Les pouvoirs publics ont porté beaucoup d’attention aux dispositifs de prise en charge des victimes, à tous les niveaux. Cela a été particulièrement vrai lors des attentats du mois de janvier dernier. Bien évidemment, l’ampleur des attentats du 13 novembre a créé une situation inédite et fait exploser tous ces dispositifs, et nous nous retrouvons avec des gens qui sont désorientés. Il est inacceptable que le Fonds d’indemnisation des victimes du terrorisme, dans le souci certes normal de protéger ses deniers, « envoie sur les roses » des gens qui demandent un accompagnement, des soins, un suivi.
Le statut de victime civile de guerre n’est pas adapté, a dit Me Samia Maktouf. Des dispositifs existent mais il manque un statut pour ces personnes qui ont été victimes de crimes qui ont touché la nation dans ce qu’elle a de plus profond.
De nombreux problèmes ont été pointés à propos du traitement de l’information, surtout lors de la prise d’otage de l’Hypercacher. Je tiens d’ailleurs à saluer ici la réaction de BFM TV, qui a fait preuve de beaucoup d’intelligence en acceptant l’accord qui a permis le dénouement du drame. Les scènes auxquelles nous sommes confrontés font très souvent l’objet d’un traitement médiatique immédiat ; les journalistes n’ont pas de cadre juridique leur permettant de savoir quoi diffuser, où s’arrête le devoir d’information et où commence celui de la protection des personnes, à quel moment il y a mise en danger d’autrui. La représentation nationale doit se pencher sur cette question, car il y a une volonté évidente de manipulation de la part des djihadistes. Souvenez-vous que Mohamed Merah a attaqué ses victimes avec une GoPro et cherché à transmettre ses vidéos, et que, lors de la prise d’otages de l’Hypercacher les terroristes n’ont eu de cesse de joindre les médias. Tout le monde, y compris les médias, a besoin d’un cadre juridique clarifié.
Enfin, il est important de savoir ce qu’est le salafisme. Mais pour comprendre le phénomène, encore faut-il pouvoir l’appréhender. À cet égard, je défends la diffusion du film Salafistes, qui n’a rien à voir avec une œuvre de propagande – je précise qu’en la matière j’ai un conflit d’intérêts. Je suis atterré de voir que, un an après l’attentat de Charlie Hebdo, on censure une œuvre qui entend montrer au public la réalité du salafisme et de ces criminels.
M. Christophe Cavard. À la suite de l’affaire Merah, j’ai présidé, en 2013, la commission d’enquête sur le fonctionnement des services de renseignement français dans le suivi et la surveillance des mouvements radicaux armés. J’ai également été membre de la commission d’enquête sur la surveillance des filières et des individus djihadistes, dont Éric Ciotti était le président et Patrick Mennucci, le rapporteur. Le témoignage des victimes, en même temps qu’il permet de les reconnaître en tant que telles, donne toute sa force et sa réalité au choc des attaques que nous avons subies. Je remercie le président et le rapporteur de la présente commission d’enquête de l’avoir permis, car les semaines passant et pris dans le travail parlementaire, on a tendance à oublier ce qui s’est produit.
Beaucoup de choses ont été dites lors des deux précédentes commissions d’enquête, que je voudrais confronter aux interrogations dont ont fait état les orateurs sur les développements intervenus depuis l’affaire Merah. À l’époque, le manque de coopération entre les services de renseignement avait été pointé. À vous écouter, peu de choses ont changé en la matière, or ce n’est pas ce qui ressort de nos discussions avec les services. Me Morice vient de parler du lien entre les services de renseignement et la justice, et de la judiciarisation des dossiers. C’est une difficulté qui a justifié la loi relative au renseignement, que j’ai votée. La collecte de renseignements par certaines techniques posait des problèmes de légalité et ne permettait pas au juge d’inscrire les renseignements ainsi obtenus dans la procédure. Le problème, c’est que les lois n’entrent pas toujours en vigueur immédiatement.
Actuellement est en discussion à l’Assemblée nationale le projet de loi renforçant la lutte contre le crime organisé, qui donnerait au pouvoir administratif – préfet, parquet, ministère de l’intérieur – la capacité de prendre des décisions administratives préventives en l’absence de preuve. Or, dans une logique judiciaire, on ne peut pas prendre de sanctions si l’on n’a pas de preuve. Ce pouvoir administratif est toutefois donné de manière encadrée, et le texte fondamental demeure : on ne peut pas priver quelqu’un de liberté simplement sur la base de la prévention d’un acte. Il s’agit de laisser du temps à la judiciarisation de se mettre en place.
Selon vous, les lois que nous avons votées et le texte qui est en cours d’examen vont-ils dans le bon sens ?
Me Olivier Morice. Il y a sûrement eu des améliorations en matière de coopération entre les services de renseignement, sinon ce serait vraiment pitoyable. Mais cette coopération est encore insuffisante. L’appréhension des informations sur le terrain, notamment, a été négligée depuis la restructuration intervenue au niveau de la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI). Certes, une réforme a permis que les techniques utilisées pour le recueil d’informations rentrent dans les clous de la législation. Pour autant, cela n’a pas amélioré la judiciarisation. À cet égard, votre responsabilité est lourde, car vous vous passez tout de même énormément de l’autorité judiciaire. Peut-être me trouvez-vous agressif, et je vous prie de m’en excuser.
Pourquoi avoir occulté la place de l’autorité judiciaire dans le texte relatif à la lutte contre le crime organisé ? Cela devrait être inconcevable pour des juristes – et parmi vous, il y a des magistrats. C’est d’autant plus inconcevable dans une démocratie comme la nôtre, qui se veut le pays des droits de l’Homme. Ce n’est pas seulement une question d’équilibre dans la séparation des pouvoirs ; concrètement, il y a un déficit de réflexes, notamment de l’autorité administrative dont vous augmentez les pouvoirs. En tant qu’auxiliaire de justice, je trouve que les pouvoirs des préfets sont exorbitants. Vous vous êtes passés de l’autorité judiciaire, et je ne sais toujours pas pourquoi. Cela a des conséquences en matière de lutte contre le terrorisme.
M. le président Georges Fenech. Maître Morice, nous ne ressentons aucune agression à notre égard. Vous avez une totale liberté de parole et de critique.
Me Patrick Klugman. Entre le barreau et la représentation parlementaire, il y a apparemment des croisements intéressants. Mais chacun a sa place.
Dans le dossier Merah, la fuite de Souad Merah à l’étranger avait été mal ressentie ; le changement de cadre législatif permettrait aujourd’hui de poursuivre ou d’empêcher un tel acte. Il faut avoir l’honnêteté de dire qu’un certain nombre de choses ont changé depuis l’affaire Merah, même si nous avons parfois le sentiment d’une procédure martyre. Aujourd’hui, par exemple, l’incrimination peut viser une entreprise terroriste individuelle. Le cadre juridique a changé, et c’est heureux. Pour autant y a-t-il un centre de pilotage et d’intelligence ? Je ne le pense pas.
Enfin, je crois que l’autorité administrative doit avoir un rôle, mais que l’autorité judiciaire, à sa place, doit pouvoir appréhender le terrorisme.
Me Samia Maktouf. S’il y a eu une légère amélioration en matière d’entraide entre les services internes en France, il n’y a malheureusement aucune coopération entre les services de renseignement. C’est ce qui a décidé la maman de notre jeune confrère à porter plainte devant la justice européenne : si la Belgique, qui n’a pas cru bon de le faire, avait transmis les informations qu’elle avait concernant Abaaoud et la filière de Verviers en janvier 2015, cela aurait certainement permis d’éviter la mort de personnes innocentes.
M. le président Georges Fenech. Nous nous rendrons en Belgique pour répondre à ces questions.
M. Serge Grouard. Remontant dans le temps, vous faites l’articulation entre les différentes affaires, en parlant d’intelligence entre elles. Le fait que l’on retrouve les mêmes acteurs à chaque fois signifie-t-il, pour vous, que l’on a affaire à une logique de réseau limité, de groupuscule ? Il me paraît important de bien identifier la menace. Tant de choses sont dites sur ce point, parfois très différentes, qu’il est difficile de s’en faire une idée précise. Vous soulevez des pistes que je trouve très intéressantes.
Maître Klugman, pouvez-vous préciser ce que vous entendez par « centre de commandement et d’analyse » ?
M. François Lamy. Maître Morice, vous avez évoqué les problèmes liés à l’article 40 du code de procédure pénale – un point que nous pouvons partager aussi pour d’autres questions que celle du terrorisme. Vous avez également fait état de retards dans la transmission, par les services de police, de procès-verbaux à des magistrats instructeurs antiterroristes ainsi que de l’information judiciaire ouverte concernant la possibilité d’un attentat au Bataclan. Quel lien voyez-vous entre ces trois éléments ? Pensez-vous qu’il y aurait eu d’autres freins que ceux des autorités égyptiennes ? Avez-vous des informations plus précises, par exemple sur des procès-verbaux qui n’auraient pas été transmis par les policiers ? L’affaire, qui est sortie dans la presse, est suffisamment grave pour que l’on ait des informations très précises.
En quoi, selon vous, des pouvoirs accrus à l’institution judiciaire auraient pu empêcher les attentats du 13 novembre, en tout cas permettre d’éclairer les services de police ?
Enfin, pourriez-vous nous transmettre une copie du schéma que vous avez évoqué tout à l’heure ? Ce matin, le journal Libération en a publié un également, mais assez succinct.
Me Patrick Klugman. Nous partageons tous le même souci. Ce que nous avons à faire ici, plutôt que de rechercher les fautes, c’est un travail de construction à partir de beaucoup de doutes.
Rien, dans le travail judiciaire qui a été accompli dans les différentes affaires que nous avons eu à connaître, ne permet de dire que nous sommes face à une filière. En revanche, il est clair qu’il s’agit d’un projet politique dans le cadre duquel certaines personnalités émergent et des moyens se structurent. Une des filières les plus identifiées est celle du Sud-Ouest qui est apparue avant l’affaire Merah, et qui, à l’extérieur du territoire français, a continué à porter le même message, à revendiquer ou à aider la commission d’autres actes – ce qui fut le cas dans l’attentat du 13 novembre. Voilà ce que l’on peut dire de manière sérieuse pour l’heure. Penser qu’il n’y a qu’une seule filière avec un seul centre de commandement serait passer à côté du sujet.
Ce qui est insupportable, c’est de voir que des personnes que nous connaissons de près ou de loin n’ont pas été incriminées, ni empêchées d’agir ou de quitter le territoire alors que leur nom était déjà cité depuis plusieurs années.
M. le président Georges Fenech. Lesquelles ?
Me Patrick Klugman. Fabien Clain et Sabri Essid, entre autres. Ce sont des personnalités connues, identifiées et qui nous ont donné l’impression, depuis le départ, qu’il n’y a jamais eu de loup solitaire. Il y avait, autour de Mohamed Merah, un clan qui était connu sur le plan judiciaire, avant qu’il ne commette des attentats. Mais aucune conséquence n’en a été tirée.
Me Samia Maktouf. Non seulement ces personnes étaient connues, mais tous les avocats ici présents ont exercé leur droit de demande d’acte, demandant expressément qu’elles soient auditionnées et empêchées de quitter le territoire. Or Souad Merah, Sabri Essid et Fabien Clain sont partis. Ma demande date de 2012. J’ai demandé également qu’Olivier Corel soit auditionné. Rien n’a été fait. Bien entendu, nous avons une entière confiance dans le travail des magistrats chargés de ces dossiers. Nous ne sommes pas là pour incriminer ou pointer des responsabilités…
M. le président Georges Fenech. Vous êtes en train de le faire.
Me Samia Maktouf. Vous nous demandez de mentionner des dysfonctionnements. En voilà ! Pour autant, nous avons une entière confiance dans le travail que font les magistrats.
M. le président Georges Fenech. Vous dénoncez un dysfonctionnement à ce niveau-là tout en conservant votre entière confiance dans le travail des magistrats. C’est tout à votre honneur. Vous avez le droit de pointer du doigt quelque responsable que vous souhaitez.
M. François Lamy. Vous avez aussi le droit de nous transmettre des documents, car c’est le cœur même de notre commission d’enquête. Vous ne pouvez pas lancer des accusations en l’air sans nous fournir des documents précis, concrets.
Me Patrick Klugman. Les raisons pour lesquelles les magistrats instructeurs ne donnent pas suite sont compréhensibles : leur propos à eux, c’est de boucler leur information sur les actes de Toulouse et Montauban. Je comprends qu’un magistrat instructeur refuse d’élargir sa saisine pour ne pas s’engluer dans une procédure sans fin. Le problème, c’est qu’il n’existe pas un ailleurs où cela pourrait être fait. Il manque des procédures adéquates pour pouvoir judiciariser, même en dehors de l’information précise qui vise un acte précis. Je ne mets pas en cause le travail des magistrats instructeurs. Leur action est compréhensible et elle n’est pas sujette à caution ni à reproche.
M. Olivier Falorni. Maître Morice, vous avez dit que le Bataclan avait été une cible déterminée de façon très précise. Puisque vous étiez l’avocat de la famille Vannier, après l’attentat du Caire, pouvez-vous confirmer que M. Farouk Ben Abbes, qui avait été soupçonné de fomenter un attentat contre le Bataclan, avait des liens avec Fabien Clain ? Est-il exact que, le 13 octobre 2014, vous avez fait une demande d’acte au pôle antiterroriste pour avoir des informations sur le dossier Farouk Ben Abbes et ce projet d’attentat contre le Bataclan ?
L’information judiciaire, qui a été lancée en 2010, a été classée, je crois, en 2012. Qui en a été informé ? Pour quelles raisons personne n’était visiblement au courant des menaces sérieuses qui pesaient sur le Bataclan, qui par ailleurs était identifié comme un établissement dirigé par un juif où se déroulaient des soirées au profit de Tsahal, ce qui en faisait une menace encore plus sensible ?
Me Olivier Morice. Avant de répondre à vos questions, je vous rappelle qu’est assis à côté de moi M. Guyomard. Je suis gêné d’avoir pris aussi longtemps la parole et qu’il n’ait pas encore pu s’exprimer.
M. le président Georges Fenech. Je lui donnerai la parole tout à l’heure.
Me Olivier Morice. Les avocats ont l’habitude de ne pas se faire que des amis, et ce que je vais vous dire ne fera peut-être pas plaisir aux magistrats instructeurs ni au parquet.
Dans le projet d’attentat contre le Bataclan, Farouk Ben Abbes avait non seulement été entendu mais mis en cause. Les Clain ont, eux aussi, été entendus. Ce que je ne m’explique pas, c’est qu’aucun avis à victime n’a été adressé au propriétaire du Bataclan. Je n’ai pas de réponse sur ce point. Lorsque j’ai posé la question aux magistrats instructeurs qui, soit dit en passant, ne sont pas toujours les mêmes à suivre un dossier, ils m’ont répondu que, compte tenu de la menace terroriste qui pesait, notamment sur les salles de spectacle, le procureur de la République aurait pu avertir, à tout le moins, que des menaces pesaient sur cette salle. À moins que nos informations soient erronées sur ce point, ni l’ancien ni le nouveau propriétaire n’ont affirmé avoir été prévenus.
Dans le dossier de l’attentat du Caire, dans lequel Cécile Vannier a été assassinée, en 2009, dans des conditions absolument abjectes, les informations collectées ont été transmises aux services français. Elles ont ensuite donné lieu à l’ouverture d’une information judiciaire en France. Une judiciarisation plus rapide aurait-elle pu permettre d’éviter certains attentats ? Ce que je ne sais pas mais que j’aimerais bien connaître, monsieur Lamy, c’est ce qui figure dans les notes d’information des services secrets français. Je sais que, lors des précédentes commissions d’enquête, des demandes ont pu être formulées. En France, notre système de déclassification est obsolète par rapport à celui d’autres démocraties : ou c’est une autorité administrative qui déclassifie ou c’est l’autorité judiciaire qui organise la déclassification.
Dans les jours qui ont suivi les attentats du 13 novembre, un certain nombre d’informations ont été transmises à l’autorité judiciaire aux fins de judiciarisation, exactement comme cela s’est passé dans l’affaire Merah. Dès que les attentats ont eu lieu, on a porté à la connaissance de l’autorité judiciaire des informations. C’est pourquoi je suggère, avec le professeur Didier Rebut, de modifier l’article 40 du code de procédure pénale et de sanctionner le défaut de transmission à l’autorité judiciaire.
M. le président Georges Fenech. Madame, messieurs les avocats, merci pour vos réponses extrêmement précises. Nous attendons de votre part tout document qui pourrait être utile à notre commission d’enquête.
Me Olivier Morice. Je vais vous transmettre les propositions de modifications législatives que nous avons préparées.
M. le président Georges Fenech. Je vais maintenant donner la parole à M. René Guyomard, père de M. Pierre-Yves Guyomard, décédé lors de l’attentat du Bataclan à l’âge de quarante-trois ans.
M. René Guyomard. Mon fils était marié et son épouse est également décédée, le même soir, au Bataclan.
Lorsque je discute avec Me Morice, il me parle de colère – de la colère, oui, je ne peux pas vous dire autre chose ; le mot est même trop faible. Lorsque l’on découvre dans la presse que le Bataclan faisait l’objet de menaces depuis quelques années, on ne peut pas s’empêcher de se dire que si elles avaient été transmises à qui de droit, prises au sérieux, mon fils et ma belle-fille seraient peut-être encore en vie.
Votre commission d’enquête s’intéresse aux moyens mis en œuvre par l’État pour lutter contre le terrorisme depuis le 7 janvier 2015. Pour moi, les moyens mis en œuvre du 7 janvier au 13 novembre, c’est zéro ! Puisque mon fils n’a pas été protégé, c’est zéro ! Depuis le 13 novembre, je ne sais pas. Quelqu’un parmi vous pourrait peut-être me dire quelles mesures précises ont été prises pour que d’autres pères de famille ne connaissent pas ma situation. Je ne suis pas du tout optimiste, et je crains de devoir vous dire qu’il y aura d’autres Bataclan.
Mesdames, messieurs les parlementaires, rien n’a été fait pour protéger le Bataclan alors que l’on avait l’information, que l’on avait les moyens. Pourquoi les choses changeraient-elles aujourd’hui ? Le risque était précis, ciblé : il ne s’agissait pas de n’importe quel bistrot, mais du Bataclan, d’une adresse précise. On connaissait les raisons. Rien n’a été fait : les plans de la salle n’ont pas été communiqués aux forces de police, les propriétaires du Bataclan n’ont pas été prévenus du risque. On me parle maintenant de politique étrangère, des réticences des Égyptiens. Mais cela n’a rien à voir. Je me fiche du détail ! On savait qu’une menace pesait sur le Bataclan, et rien n’a été fait.
Comme par miracle, dans les semaines qui ont suivi, des décisions très énergiques ont été prises : on a lancé 700, 800 perquisitions, on a trouvé des Kalachnikov, des lance-roquettes, des armes en tout genre. Mais si on a pu faire ces perquisitions, c’est bien parce qu’on avait des adresses et des noms, c’est bien parce que des gens étaient fichés S, Y ou Z. Pourquoi ces perquisitions n’ont-elles pas été faites au moins après l’attentat de Charlie Hebdo ? Pourquoi les fait-on tout à coup après le 13 novembre ? Parce qu’il faut montrer au petit peuple qu’on se remue ! Mais cela ne me rend pas mon fils ni ma belle-fille que nous adorions. Ils sont morts.
Et puis, une fois le drame passé, il y a l’après. Cet après, je ne souhaite à aucun d’entre vous de le connaître. C’est un cauchemar : ne pas savoir, pendant des heures, des jours, si vos enfants sont « sur la liste » ; pire, quand ils n’y sont pas, on téléphone de numéro en numéro, on a au bout du fil des gens incompétents ou pas du tout informés, certains même raccrochent. Personne ne peut imaginer une telle impréparation, une telle improvisation, un tel mépris pour les citoyens que nous sommes dans des situations pareilles. Au moins sur cet aspect des choses, qu’avez-vous fait, quelles décisions ont été prises ?
Ne vous faites pas d’illusion, demain il y aura un autre Bataclan et peut-être pire ! Si jamais cela se passe dans une ville de province qui ne bénéficie pas de l’Institut médico-légal de Paris, censément le plus performant, ce sera épouvantable.
Je voulais juste vous dire qu’il n’y a que de la colère. Quand on me parle d’oubli, c’est comme si on ne me parlait pas. J’espère que ce que je viens de vous dire servira à quelque chose, mais je ne me fais pas beaucoup d’illusion. Je vous remercie de m’avoir écouté.
M. le président Georges Fenech. Monsieur Guyomard, soyez certain que tous les parlementaires ici présents sont touchés par les mots d’un père qui demande justice et se soucie que d’autres ne connaissent pas le même sort que ses enfants. C’est bien l’objectif de cette commission d’enquête. Aujourd’hui, nous ne pouvons vous apporter aucune réponse ; nous espérons vous en donner à la fin de nos travaux. Nous sommes là pour cela, nous sommes là pour vous, pour tous ceux qui ont vécu ces drames.
Je souhaite que M. Samuel Sandler puisse s’exprimer également.
M. Samuel Sandler. J’ai été très touché par le témoignage que je viens d’entendre puisque je suis un peu dans le même cas. Je m’appelle Samuel Sandler. Mon fils a été tué à Toulouse, ainsi que mes deux petits-fils. J’en profite pour dire que je souffre de voir avec quelle approximation la presse a rendu compte du décès d’un professeur et de trois élèves. Lorsque l’on est à l’extérieur de l’école, que l’on est en train d’attendre une navette et que l’on tient par la main un enfant de trois ans et un autre de cinq ans, il ne peut s’agir d’élèves d’un lycée. C’est bien un père que l’on a visé. Et l’assassin a bien vu qu’il y avait ses deux enfants à côté de lui.
Vous aurez remarqué que je ne prononce jamais le nom de l’assassin. Il ne faut pas y voir de la superstition. Si je prononçais son prénom et son nom, cela reviendrait à lui donner une certaine étincelle d’humanité, ce que je me refuse de faire. C’est pourquoi je parle toujours de « l’assassin de mes enfants » – les avocats ont très bien répondu sur l’aspect du loup solitaire.
Chaque attentat efface le précédent. Pourtant, la douleur est toujours là.
M. le président Georges Fenech. Avez-vous quelque chose à dire sur le temps qui est passé depuis les attentats de Toulouse et Montauban, jusqu’au 13 novembre dernier ? Avez-vous le sentiment que notre pays a tiré les conséquences de ces événements ?
M. Samuel Sandler. Je me souviens surtout de la manifestation du 11 janvier, qui donnait l’impression que, comme pour la guerre de 14-18, c’était la « der des ders ». Mais à chaque fois que l’on m’interrogeait, je répondais que non, ce ne serait pas la « der des ders ».
M. le président Georges Fenech. Mesdames, messieurs, je vous remercie très sincèrement.
Table ronde, ouverte à la presse, d'associations de victimes d'attentats terroristes : Association française des victimes du terrorisme (AVFT) : M. Guillaume Denoix de Saint-Marc, directeur général, M. Stéphane Lacombe, directeur adjoint, Mme Aline Le Bail-Kremer, responsable communication et gestion ; Fédération nationale des victimes d'attentats et d'accidents collectifs (FENVAC) : M. Olivier Dargouge, vice-président, Mme Marie-Claude Desjeux, vice-présidente, M. Stéphane Gicquel, sécrétaire général ; Institut national d'aide aux victimes et de médiation (INAVEM) : Mme Michèle de Kerckhove, présidente, Mme Sabrina Bellucci, directrice générale
Compte rendu de la table ronde, ouverte à la presse, du mercredi 17 février 2016
M. le président Georges Fenech. Nous accueillons, pour une deuxième table ronde, des représentants de trois associations de victimes d’attentats terroristes, que nous remercions d’avoir répondu à la demande de notre commission d’enquête. Nous avons souhaité commencer par entendre les victimes, qui ont droit à toute l’attention de la représentation nationale.
L’Association française des victimes du terrorisme (AFVT) a été créée en février 2009 pour aider les victimes d’attentats dans l’ensemble de leurs démarches, qu’elles soient judiciaires, administratives ou concernant la santé. Elle apporte une assistance psychologique aux victimes, ainsi qu’un soutien juridique et administratif.
Elle est ici représentée par son fondateur, M. Guillaume Denoix de Saint Marc, qui en est le directeur général, et lui-même fils d’une victime du terrorisme, en l’espèce l’attentat contre le vol d’UTA reliant Brazzaville à Paris via N’Djamena en 1989. Sont également présents M. Stéphane Lacombe, directeur adjoint, et Mme Aline Le Bail-Kremer, responsable communication et gestion.
La Fédération nationale des victimes d’attentats et d’accidents collectifs (FENVAC) a été créée en avril 1994 par huit associations de victimes de catastrophes survenues entre 1982 et 1993. Elle n’a donc pas pour seule vocation le soutien aux victimes d’attentats et à leurs proches. Elle intervient également dans le cadre plus général de catastrophes. Elle est devenue experte pour porter la parole des victimes et de leurs familles et pour améliorer les dispositifs publics d’accueil, d’aide et de soutien.
Elle est représentée par M. Olivier Dargouge, vice-président, Mme Marie-Claude Desjeux, vice-présidente, et M. Stéphane Gicquel, secrétaire général.
L’Institut national d’aide aux victimes et de médiation (INAVEM), créé en 1986, a pour mission d’animer, de coordonner et de promouvoir le réseau d’aide aux victimes, ainsi que d’engager des partenariats et des conventions pour faciliter l’accès des personnes victimes aux associations locales. L’INAVEM fédère 150 associations.
Il est représenté par Mme Michèle de Kerckhove, présidente, et Mme Sabrina Bellucci, directrice générale.
Nous avons décidé que nos auditions seraient ouvertes à la presse, car nous devons mener cette enquête dans la transparence.
Conformément aux dispositions de l’article 6 de l’ordonnance du 17 novembre 1958 relative aux commissions d’enquête, je vous demande de prêter le serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité.
M. Guillaume Denoix de Saint Marc, M. Stéphane Lacombe, Mme Aline Le Bail-Kremer, M. Olivier Dargouge, Mme Marie-Claude Desjeux, M. Stéphane Gicquel, Mme Michèle de Kerckhove et Mme Sabrina Bellucci prêtent serment.
M. Guillaume Denoix de Saint Marc, directeur général de l’AVFT. L’AFVT intervient dans deux domaines. Je m’exprimerai d’abord sur la question du soutien aux victimes et laisserai Stéphane Lacombe développer le second volet, qui concerne les actions de prévention que nous menons, avec, entre autres, la voix des victimes.
M. Mohamed Sifaoui, consultant, n’a pas pu venir, pour des raisons de santé. Il pourrait éventuellement intervenir sur la question de la prévention, sur laquelle il a beaucoup plus de choses à dire.
Les très importants témoignages que votre commission d’enquête a entendus lundi dernier et tout à l’heure reflètent parfaitement ceux qui nous parviennent depuis les attentats. Nous n’en avons guère parlé, car il nous paraissait important de ne pas trop dévoiler la faiblesse de notre dispositif, qui souffre effectivement de nombreux dysfonctionnements. Il est nécessaire de le restructurer, en améliorant la collaboration entre l’État et la société civile et en y intégrant toutes les associations qui peuvent apporter leur concours.
Bien que nous ayons été exclus du dispositif d’accompagnement depuis plus d’un an, les victimes se sont spontanément adressées à nous. Elles savent que notre association existe, mais ne comprennent pas ce qui la distingue de telle ou telle autre structure, en quoi elle est différente ou complémentaire. Elles ont du mal à avoir une vision d’ensemble du dispositif, de savoir qui collabore avec qui et quel est le rôle de chacun. Nous avons, de ce point de vue, un énorme travail à faire, car la situation est vraiment cacophonique.
Je voudrais évoquer un événement qui a provoqué de nombreux traumatismes : en décernant la Légion d’honneur à certaines victimes, on a ouvert la boîte de Pandore. Il sera très difficile de refuser que les 130 victimes du 13 novembre soient elles aussi faites chevaliers. Les victimes d’autres attentats, antérieurs ou postérieurs à ceux du mois de janvier, ont ressenti ce geste comme une violence extrême et se sont demandé : « Pourquoi pas nous ? » Sans doute a-t-on voulu, dans un élan de générosité, apporter précipitamment une réponse, mais on a créé un précédent qui sera très difficile à gérer. C’est un exemple, parmi d’autres, de tout ce qu’il faudrait faire pour la reconnaissance des victimes du terrorisme.
M. Stéphane Lacombe, directeur adjoint de l’AFVT. Au moment où les pouvoirs publics semblent préparer l’opinion à de futurs attentats de grande ampleur, nous devons nous interroger sur la stratégie mise en place par l’État pour prévenir la radicalisation. J’insiste sur la nécessité d’articuler un partenariat entre les pouvoirs publics et la société civile à travers différents acteurs, dont notre association, pour lutter contre l’idéologie qui nourrit le terrorisme. Nous partons du principe que le terrorisme n’est pas le fruit d’une génération spontanée. Dans ce cadre, nous travaillons avec de nombreux intervenants, y compris au sein de l’Union européenne, sur la voix des victimes, en tant que contenu et vecteur de promotion d’une citoyenneté positive. La voix des victimes peut être un très bel outil de prévention dès lors que les victimes sont elles-mêmes dans une perspective de reconstruction et qu’elles se sentent la force de faire la promotion des valeurs qui nous unissent tous.
La thématique de la radicalisation est très médiatique, si bien que certains effets de communication peuvent cacher les vrais enjeux, face auxquels il ne peut y avoir d’approche exclusive. C’est, au contraire, une approche pluridisciplinaire qui doit prévaloir. Nous menons donc nos actions de prévention en collaboration avec l’association « Onze janvier », fondée et présidée par Mohamed Sifaoui, et l’association « Entr’Autres », qui regroupe un collectif de psychiatres, de psychanalystes, de praticiens de terrain, qui suivent des profils djihadistes depuis une dizaine d’années.
Il nous paraît important de décomplexer le débat autour de ces questions, en nommant notre ennemi idéologique, l’islamisme, qui nourrit le corpus idéologique des terroristes et qui est l’une des conditions du passage à l’acte.
Lorsque nous organisons des rencontres auprès des citoyens, en milieu carcéral ou ailleurs, dans le cadre de nos modules de sensibilisation, nous constatons avec inquiétude que les agents de l’État éprouvent des doutes sur leurs missions et des fragilités idéologiques : cela peut créer des brèches que ne manquent pas d’exploiter les extrémistes ou ceux qui relaient leur discours.
Le 5 janvier dernier, dans un communiqué de presse, nous avons interpellé l’État sur sa stratégie en la matière, qui ne nous paraît pas très claire. Acteurs de la société civile, nous souhaitons être associés, avec les ressources que nous pouvons proposer, à ce travail d’élaboration sur le long terme, qui dépasse de loin les enjeux de la communication politique.
Mme Aline Le Bail-Kremer, responsable communication et gestion de l’AFVT. Les choses ont commencé à changer depuis 2012, mais il va falloir s’occuper sérieusement et de façon plus coercitive de la question de la diffusion de contenus haineux sur internet. Il est très surprenant que, en plein état d’urgence, certains sites — la liste serait longue — n’aient pas été fermés. Les familles et les proches de victimes, dont je fais partie, ne comprennent pas cette situation et s’interrogent. Certes, on constate une prise de conscience, notamment de la part des réseaux sociaux — je crois que Twitter a enfin décidé de fermer certains comptes —, mais il se passe encore des choses sidérantes, puisqu’on peut diffuser sur internet des contenus violents, manifestement hors-la-loi, et attiser les haines, au moment même où tout le monde travaille à reconstruire un « vivre ensemble ».
M. Stéphane Gicquel, secrétaire général de la Fédération nationale des victimes d’attentats et d’accidents collectifs (FENVAC). Nous vous remercions de votre invitation : c’est un honneur de nous exprimer devant vous.
La FENVAC est une association de victimes : tous ses adhérents, tous les membres de son conseil d’administration, sont des victimes. Elle a pour mission de défendre les droits des victimes et de les accompagner dans la durée.
Nous intervenons dans le cadre d’une convention signée avec le ministère de la justice. C’est ainsi que nous avons fait partie du dispositif de cellule interministérielle d’aide aux victimes (CIAV), dont il a beaucoup été question lundi dernier. Cet engagement très fort de notre association dans l’aide aux victimes et dans la gestion de crise dès les premières heures qui suivent un attentat ou une catastrophe s’explique par notre désir de faire de la résistance, de lutter contre le terrorisme.
Nous siégeons au conseil d’administration du Fonds de garantie d’indemnisation des victimes, et nous avons été récemment nommés au conseil d’administration de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Enfin, notre association est partie civile dans une trentaine de procédures concernant des dossiers liés au terrorisme. Nous comprenons le besoin de vérité et de justice, le besoin de décrypter et de comprendre, qu’a exprimé notamment l’association « 13 novembre 2015 : Fraternité et Vérité », dont nous avons accompagné la création et dont nous soutenons la demande de réforme de l’article 2-9 du code de procédure pénale visant à permettre à toutes les associations de victimes d’un attentat de se porter partie civile. Il est très important, dans le processus complexe de réparation, que les victimes ne subissent pas les suites des attentats, mais qu’elles soient actrices.
Avant d’aborder les questions concernant la lutte contre le terrorisme, je voudrais revenir sur les dispositifs d’aide aux victimes. Différentes critiques et incompréhensions se sont exprimées lundi dernier. Du point de vue de la FENVAC, la récente instruction interministérielle concernant la prise en charge des victimes d’actes de terrorisme constitue malgré tout un progrès. En disant cela, je ne suis pas en opposition avec les victimes qui se sont exprimées lundi et qui ne peuvent avoir la vision d’ensemble dont dispose notre fédération. Mais ces améliorations n’impliquent pas que le système soit parfait.
Un retour d’expérience est en cours. Nous avons été présents pendant trois semaines, de huit heures à minuit, au sein de la cellule interministérielle du Quai d’Orsay et, pendant quinze jours, nous avons assuré la présence quotidienne de trois membres au sein du centre d’accueil des familles de l’École militaire. En ce qui concerne la liste des victimes et le délai pour prévenir leurs familles, nous partions d’une page blanche. Nous avons eu le nom des personnes décédées, mais il faut s’interroger sur le temps qu’a pris leur identification. Pourquoi n’a-t-on pas fait appel à l’Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale (IRCGN), qui dispose d’une réelle compétence en matière d’identification et d’accompagnement des familles, dans l’attente de l’identification ? Cet institut intervient en effet pour identifier les victimes de grandes catastrophes, comme l’accident de Puisseguin ou le crash de la Germanwings.
D’autre part, la cellule interministérielle a perdu du temps. Alors que nous étions mobilisés dès le vendredi soir au Quai d’Orsay, les premiers appels téléphoniques n’ont été basculés que le samedi, vers dix-sept ou dix-huit heures. On peut se demander pourquoi. C’est à la préfecture de police de répondre à cette question. C’est moi qui ai dû annoncer à M. Salines, au téléphone, le décès de sa fille. Il a été profondément heurté. Nous nous en sommes expliqués, mais il faut savoir que l’annonce des décès s’est faite dans le plus grand désordre. Le samedi, à dix-huit heures, nous recevions les premiers appels et nous trouvions devant l’alternative suivante : soit nous mentions en demandant à nos interlocuteurs de se présenter le lendemain à l’École militaire, soit nous annoncions le décès au téléphone. C’était le choix du diable : cela doit être pris en compte dans le retour d’expérience.
En ce qui concerne le dispositif d’aide aux victimes, il faut plus d’État. Ces victimes sont en effet très particulières : à travers elles, c’est notre État, notre système démocratique, nos valeurs qui ont été visées. Il faut donc une réponse directe, forte, durable, de l’État. Les victimes ne comprennent pas pourquoi elles n’ont pas été reçues par une autorité, que ce soit le Président de la République ou le Premier ministre. Moi-même, je m’interroge quand je compare avec ce qui s’est fait lors de précédentes catastrophes. Ainsi, dans le cas du crash d’Air Algérie, en 2013, les familles ont été réunies quarante-huit heures après au Quai d’Orsay, en présence de cinq ou six ministres, du Premier ministre et du Président de la République, lequel reçut à nouveau les familles en septembre. La même question de lisibilité se pose à propos de certains gestes qui ne sont pas systématiques : M. Denoix de Saint Marc évoquait avec raison l’attribution de la Légion d’honneur.
Le 23 janvier, nous avons organisé une réunion d’information à la Maison du Barreau, avec 300 victimes. C’était une démarche associative. Les victimes nous ont dit que cette réunion était une bonne chose, mais elles se demandaient pourquoi ce n’était pas l’État qui l’avait organisée.
Il faut aussi « mieux d’État », c’est-à-dire une meilleure intervention de l’État. Le grand progrès de l’instruction ministérielle est d’organiser l’interministérialité. Les représentants des ministères ne travaillent plus côte à côte, mais ensemble, dans la cellule interministérielle. Cependant, il reste des mystères à éclaircir, même aux yeux des représentants associatifs qui faisaient partie du dispositif.
Pourquoi l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) a-t-elle mis autant de temps pour transmettre la liste des personnes hospitalisées ? Nous partions à nouveau d’une page blanche. Le mardi ou le mercredi suivant les attentats, nous avions les coordonnées de 1,5 % des personnes hospitalisées. Grâce à une action vigoureuse du cabinet du ministère de la santé, nous sommes passés, en quarante-huit heures, de 1,5 à 3 %. Ce manque de collaboration, ces blocages institutionnels sont inacceptables et incompréhensibles. Il faut, mesdames et messieurs les députés, que vous en soyez le relais pour faire avancer les choses.
J’en viens aux incongruités. Chaque victime reçoit un dossier pour constituer une demande de pension militaire ou de veuve de guerre. Ce sont sans doute les premiers éléments que reçoivent les victimes, les services des pensions du ministère de la défense étant extrêmement diligents pour envoyer ces documents. Ce sont des droits théoriques : personne ne percevra de pension militaire ou de pension de veuve de guerre, parce que le système d’indemnisation des victimes est en fait assuré par le Fonds de garantie. Imaginez cependant ce que peut ressentir une personne qui reçoit de tels documents, surtout lorsqu’elle a vingt-cinq ou trente-cinq ans…
On nous avait dit, par ailleurs, que le Parlement avait voté une mesure assurant la gratuité des soins. Mais le système est tellement complexe que nous-mêmes, acteurs associatifs, avons mis plusieurs jours à comprendre qu’il ne s’agissait pas de soins gratuits, mais de soins remboursés à 100 % du tarif de la sécurité sociale. La fille de M. Zenak — que vous avez auditionné lundi — a été touchée à l’œil et doit changer de lunettes tous les deux mois. Avec ces soins « gratuits », on ne lui rembourse que 35 ou 40 euros sur les 250 ou 300 euros que coûte chaque fois la paire de lunettes. Cela peut paraître un détail, mais c’est une bonne illustration de ce qu’ont exprimé les familles et les victimes.
« Mieux d’État », c’est aussi assurer l’équité entre toutes les victimes. Les attentats du 7 janvier et du 13 novembre sont dans toutes les mémoires, mais n’oublions pas tous les Français qui ont été frappés à l’étranger, par exemple à Tunis, au musée du Bardo, ou à In Amenas — Mme Desjeux pourra en parler. L’action de l’État doit être la même pour les victimes frappées à l’étranger.
En ce qui concerne les voies d’action pour lutter contre le terrorisme, je n’apporterai rien de nouveau par rapport à ce qu’ont déjà dit différents rapports, notamment celui de la commission d’enquête sur la surveillance des filières et des individus djihadistes, présidée par M. Ciotti, et celui de M. Pietrasanta concernant la radicalisation. Tout y est : le manque de moyens de la justice, le manque de coopération judiciaire, les frontières qui existent pour les juges mais pas pour les terroristes, la déconnexion du renseignement avec le judiciaire, l’impossibilité de mener des enquêtes de fond sur le financement des réseaux terroristes, le problème de coordination des services, la nécessité de détecter la radicalisation et les signaux faibles, le cryptage des données et l’impossibilité de le faire sauter, la question des réseaux sociaux.
Je signalerai cependant deux pistes nouvelles : nous devons, d’une part, cultiver la résistance citoyenne au terrorisme et, d’autre part, réfléchir à la responsabilisation des entreprises qui envoient des Français travailler sur des sites sensibles à l’étranger.
Tous ces constats ont été dressés dans les précédents rapports, car les interrogations et les doutes des victimes préexistaient au 7 janvier 2015. Ces questions étaient déjà d’actualité quand nous avons connu la vague d’attentats de 2012. Votre commission éveille un nouvel espoir, et il faudra que vous vous assuriez de l’effectivité et du suivi des recommandations que vous pourrez être amenés à formuler. Il faut un plan d’action sérieux, un vrai pilotage, peut-être organiser un nouveau système de suivi, avec un panel citoyen dont nos associations pourraient faire partie. On ne peut pas, au plus haut niveau de l’État, annoncer que nous sommes en guerre et que d’autres attentats auront lieu, sans que s’engage un débat sur la lutte contre le terrorisme, pour que chacun soit véritablement sensibilisé et conscient des arbitrages à faire entre libertés publiques et sécurité.
Aujourd’hui, cet espace de débat est complètement phagocyté par la question de la déchéance de nationalité. Je ne me prononce pas sur l’utilité ou sur la légitimité de cette mesure, mais le débat sur la lutte contre le terrorisme ne doit pas se résumer à la polémique sur la déchéance de nationalité. Il est important, pour notre sécurité collective, que le débat ait lieu, car il ressort d’innombrables entretiens avec les victimes qu’elles veulent attaquer l’État, dont elles considèrent qu’il a une responsabilité dans ce qui est arrivé. Cela trahit l’insuffisance de la pédagogie et de l’information à l’égard des victimes, auxquelles on doit rendre des comptes en toute transparence.
M. le président Georges Fenech. Qu’entendez-vous par « cultiver la résistance citoyenne » ?
M. Stéphane Gicquel. Chaque citoyen doit être acteur de sa sécurité et faire preuve de résilience, c’est-à-dire de la capacité à résister à une menace. La campagne d’affichage du Gouvernement sur les bons gestes à avoir va dans ce sens. Il faut avoir une vraie culture de la sécurité. Que signifie « être en guerre » ?
Mme Marie-Claude Desjeux, vice-présidente de la FENVAC. C’est pour moi un honneur d’autant plus grand d’être ici que je n’ai rejoint la FENVAC que récemment. Ma famille et moi-même avons été victimes, il y a trois ans, de la prise d’otage d’In Amenas, en Algérie, au cours de laquelle mon frère Yann a été tué.
J’appelle votre attention sur le fait que les événements de janvier et novembre 2015 ont contribué à une prise de conscience globale en France, mais beaucoup de familles françaises sont victimes du terrorisme à l’étranger et ne reçoivent pas le soutien dont bénéficient celles qui en sont victimes en France. Au cours des réflexions sur les solutions à apporter, je vous supplie de ne pas oublier ces familles qui ont perdu l’un des leurs à l’étranger, qui se trouvent très souvent abandonnés et n’ont pas de moyens pour se regrouper.
M. le président Georges Fenech. Nous prenons acte de ce que vous venez de nous dire sur les Français victimes du terrorisme à l’étranger.
Mme Marie-Claude Desjeux. Nous sommes conscients que les relations entre certains pays sont souvent très compliquées, notamment entre la France et l’Algérie, mais il faudrait mener un travail de fond sur les relations entre les pays dans l’optique spécifique des attentats.
Mme Michèle de Kerckhove, présidente de l’Institut national d’aide aux victimes et de médiation (INAVEM). Fondée et animée par des professionnels, psychologues et juristes, présente sur tout le territoire français, l’INAVEM se différencie des autres associations en cela qu’elle ne regroupe pas des victimes, mais qu’elle leur vient en aide. Elle rassemble 150 associations et 1 200 professionnels habilités à intervenir dès qu’ils sont mandatés par le procureur de la République, le préfet ou les autorités judiciaires, à la suite d’un accident grave ou d’un acte terroriste.
M. le président Georges Fenech. Quel est votre ministère de tutelle ?
Mme Michèle de Kerckhove. Pour le moment, c’est le ministère de la justice.
M. le président Georges Fenech. Allez-vous travailler avec la secrétaire d’État auprès du Premier ministre, chargée de l’aide aux victimes ?
Mme Michèle de Kerckhove. Nous allons commencer à le faire, mais il me semble que la justice et le secrétariat d’État chargé de l’aide aux victimes — qui n’est pas le secrétariat d’État chargé des victimes — ont des rôles un peu différents. Comme le disait tout à l’heure M. Gicquel, l’interministérialité est nécessaire, parce que tous les ministères peuvent être concernés lorsqu’il y a un accident collectif grave, un risque sériel ou un attentat. Il faut coordonner les actions de tous ces ministères, et la justice n’avait sans doute pas l’autorité suffisante pour le faire, que ce soit au niveau de la santé, du transport ou de l’intérieur. Ce secrétariat d’État étant placé sous l’autorité du Premier ministre, il permettra peut-être de coordonner plus facilement l’action des différents ministères.
Notre présence sur le terrain et notre réactivité sont notre particularité. Dès qu’il se passe quelque chose dans un département — il y a eu beaucoup d’attentats à Paris, mais il y en a eu aussi ailleurs, comme à Toulouse —, nous intervenons et mobilisons les acteurs pour qu’ils se portent le plus rapidement possible au côté des victimes.
Depuis le mois de janvier, nous avons œuvré à la Chancellerie, avec la FENVAC, à la création du dispositif qui a donné naissance à la cellule interministérielle d’aide aux victimes. Cette cellule, qui a été mise en œuvre pour la première fois, est certes perfectible à bien des égards, mais elle est un premier pas qui nous permettra d’être plus opérationnels, plus réactifs, et de répondre beaucoup mieux aux demandes des victimes.
Il a été question tout à l’heure des victimes du terrorisme à l’étranger. L’INAVEM est membre d’un réseau européen. Dès que nous avons connu la nationalité des victimes européennes, nous nous sommes mis en relation avec nos homologues européens pour qu’ils les prennent également en charge.
Le modèle français de l’aide aux victimes est envié à l’étranger, et nous tâchons de l’exporter. Une directive européenne d’octobre 2012 sur l’aide aux victimes s’en est inspirée et des visiteurs du monde entier viennent régulièrement étudier notre modèle : les liens que nous nouons ainsi nous permettent de créer des réseaux facilitant la prise en charge des victimes.
Bien entendu, nous participons au dispositif d’urgence d’aide aux victimes en France, mais nous intervenons dans la proximité et surtout dans la durée, avec des professionnels qui sont présents tant que les victimes en ont besoin.
Mme Sabrina Bellucci, directrice générale de l’INAVEM. L’aide aux victimes est un métier, que nous avons choisi, et qui perdure puisqu’il existe depuis trente ans. En tant que professionnels, nous sommes à l’écoute des victimes et de leurs besoins. Notre souci quotidien est d’adapter notre prise en charge à ce qu’elles nous disent. Tout processus peut être pérennisé si les victimes nous le demandent.
L’INAVEM intervient dans les dispositifs concernant les actes de terrorisme depuis 1985. Le premier colloque qu’il a organisé s’est tenu en 1987. Depuis, nous développons des dispositifs d’accompagnement et de suivi.
En novembre, les 92 associations mobilisées ont envoyé plus de 988 courriers et reçu 733 appels sur notre plateforme téléphonique. Les 1 800 personnes prises en charge nous ont toutes dit la même chose : elles étaient en quête d’écoute, de lisibilité, de traçabilité, elles avaient besoin de référents, de facilitateurs. M. Gicquel et d’autres, notamment l’AFVT, réclament plus et mieux d’État : la responsabilité de l’État est en effet de coordonner et d’identifier les acteurs qui interviennent auprès des victimes, de savoir qui fait quoi et à quel moment, et si l’action engagée est efficace. Il n’y a rien de pire, quand on est en plein chaos, que d’y ajouter du désordre. Quand on répond au chaos par le chaos, l’action menée en faveur des victimes n’est ni lisible ni efficace.
Quoique je sois un acteur associatif issu de la société civile, je partage avec l’État la responsabilité de mener cette réflexion, qui, au-delà de l’instruction ministérielle et du secrétariat d’État — dont le périmètre semble concerner à la fois les victimes du terrorisme et celles des accidents collectifs —, doit se pencher sur le pilotage des dispositifs existants. Car, si les bons dispositifs de droit commun dont nous disposons peuvent être améliorés, ils ont avant tout besoin d’être pilotés.
Nous devons aux victimes la lisibilité et surtout la traçabilité de nos actions. Elles nous ont dit, par exemple, ne pas avoir eu connaissance du numéro de téléphone de la cellule interministérielle d’aide aux victimes, alors qu’il s’agit d’un numéro de première écoute qui doit être diffusé immédiatement après l’attentat. C’est scandaleux. Il n’est pourtant pas difficile de trouver des dispositifs simples mais efficaces, tel « alerte enlèvement », mis en place par Nicole Guedj, qui permet de contraindre l’ensemble des chaînes de télévision, des médias, des transporteurs et des autoroutiers, à diffuser des annonces. Il suffirait de s’inspirer de telles actions pour informer les victimes du terrorisme des dispositifs qui sont mis à leur disposition.
M. le président Georges Fenech. Sébastien Pietrasanta, Philippe Goujon et moi-même avons soutenu ce matin un amendement au projet de loi renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale, qui visait à supprimer la condition des cinq années d’existence prévue par le code de procédure pénale pour permettre à une fédération d’associations de victimes d’attentats de se porter partie civile. L’amendement a été finalement retiré pour être réécrit, mais le rapporteur Pascal Popelin s’est engagé à y revenir en séance dans quinze jours et je crois savoir que le garde des sceaux est particulièrement attentif à la question. Cette disposition aidera beaucoup les associations et les victimes.
M. Sébastien Pietrasanta, rapporteur. Il s’agissait là d’une première proposition concrète issue des premières auditions de notre commission d’enquête.
Monsieur Gicquel, quel a été votre rôle durant les heures qui ont suivi les attentats du 13 novembre ? Comment avez-vous été mobilisé ? Quelles difficultés avez-vous rencontrées ?
Vous avez dit que nous partions d’une page blanche, mais que nous avions progressé. Au regard des événements du 13 novembre, quelles sont les pistes qui s’offrent à nous pour améliorer la prise en charge des victimes ?
J’aimerais aussi que vous consacriez quelques instants à la gestion de la crise du 13 novembre et au rôle qui a été le vôtre, et que vous fassiez quelques propositions concrètes.
Les questions suivantes s’adressent plutôt à l’AFVT, que j’ai eu l’occasion de rencontrer à l’occasion de mon rapport sur la déradicalisation. Un an après vos premières interventions — à la prison d’Osny, notamment — auprès de détenus radicalisés, considérez-vous que la première expérience de déradicalisation a été concluante ? Vous intervenez, après avoir répondu à un appel d’offres du ministère de la justice, avec un programme de six semaines en milieu carcéral. Cela n’est-il pas un peu court pour être efficace, même si un suivi est prévu ? Le Gouvernement, lui, met en place un programme de dix mois dans des centres de déradicalisation, hors milieu carcéral.
Enfin, même si la question pénitentiaire n’est pas au cœur de notre réflexion, notre commission d’enquête doit s’y intéresser et je voudrais connaître votre sentiment sur la création, dans certaines prisons, de quartiers réservés aux personnes radicalisées.
M. Stéphane Gicquel. L’instruction interministérielle créant la cellule interministérielle d’aide aux victimes a été signée le 12 novembre et a dû être appliquée dès le 13 au soir. Comme l’INAVEM, la FENVAC intervient dans cette cellule, composée de représentants de différents ministères. Pour notre part, nous n’intervenons pas directement, mais à la demande du ministère de la justice et dans le cadre de nos conventionnements. Nous avons été mobilisés très rapidement, dès le vendredi soir, et nous étions opérationnels dès le samedi matin.
M. le rapporteur. Vous êtes-vous « autosaisis » dès le 13 au soir ou avez-vous été appelés ?
M. Stéphane Gicquel. Personnellement, j’ai été appelé par le centre de crise du ministère des affaires étrangères, qui gère ce dispositif, ce qui peut poser question. Je ne dis pas cela pour remettre en cause ces professionnels, qui sont les meilleurs pour gérer la crise. Toutefois, si nous faisons l’objet de menaces réelles, faut-il un dispositif et une salle spécifiques ? Nous avons été confrontés, pendant la gestion de cette crise, à des problèmes pratiques. Par exemple, nous n’avions pas de logiciel de saisie. Nous travaillions sur des fichiers Excel qui prirent très vite des dimensions considérables et étaient complètement illisibles. À un moment donné, les boîtes mail cessèrent de fonctionner. Nous appelions les familles pour leur demander d’envoyer des documents par mail, mais nous nous rendions compte ensuite que la boîte mail ne marchait pas. Il fallait rappeler les familles pour donner une autre adresse mail.
Nous connaissons bien le centre de crise du ministère des affaires étrangères, où opèrent de vrais professionnels, mais nous avons été jusqu’à 120 personnes de différents ministères à y travailler, et les locaux ne sont pas adaptés. Nous avons même rencontré des problèmes de communication interne. Il faut que nous nous dotions des moyens de réaliser ce suivi : il y va de notre crédibilité.
Lorsque nous étions en contact avec les familles, nous ne nous exprimions pas en tant qu’association, mais en tant que membres de la cellule interministérielle d’aide aux victimes. Avec sa sensibilité d’association de victimes, la FENVA peut jouer le rôle de conseiller, orienter ou faire des propositions aux ministères. Étant nous-mêmes des victimes, nous avons une expérience et un regard différents sur ce qu’il faut faire ou ne pas faire. C’est la plus-value associative que nous avons apportée à ce qui reste un dispositif d’État.
Mais, comme l’a dit Sabrina Bellucci, nous nous interrogeons quand nous recevons des victimes qui nous disent ne pas avoir eu connaissance du numéro de téléphone de la cellule interministérielle.
L’instruction interministérielle prévoit formation et moyens. Il faut que ce soit effectif. Le dispositif est bon, mais il faut l’améliorer et s’entraîner. L’affaire des fichiers Excel n’est pas une simple anecdote : lorsque vous êtes en contact avec une famille, que vous êtes obligé de faire défiler sur votre écran un fichier Excel que vous ne pouvez pas modifier parce que vous êtes en réseau, la situation est extrêmement compliquée. Quand l’intendance ne suit pas, les familles et les victimes le ressentent. Il existe une solution pratique pour chacun de ces problèmes.
M. Guillaume Denoix de Saint Marc. L’appel d’offres que nous avons remporté au mois de janvier de l’année dernière a été émis avant les attentats de janvier. Le budget était limité, s’agissant d’un petit reliquat dont disposait l’administration pénitentiaire. Le délai était assez court puisque, en un an, il fallait atteindre trois objectifs : revoir l’outil de détection — ce qui n’était pas une mince affaire —, organiser deux sessions de prise en charge d’une quinzaine de détenus dans deux centres pénitentiaires différents, et transmettre l’intégralité de notre processus à l’administration pénitentiaire.
Notre objectif n’était pas de déradicaliser, mais d’amener certains individus à changer de comportement. Nous avons conduit un travail pluridisciplinaire avec les services pénitentiaires d’insertion et de probation (SPIP), la direction, la surveillance, les renseignements, le scolaire, le médical, etc. Nous avons proposé à plusieurs détenus, choisis par l’ensemble des personnes intervenant auprès d’eux, de suivre notre programme. En général, ces personnes n’ont pas de démarche de réinsertion et n’ont pas recours aux outils qu’on met à leur disposition pour préparer leur sortie de prison. Nous devions, en six semaines, les amener à se fixer un objectif personnel, c’est-à-dire à travailler à leur réinsertion future. La portée de l’expérience était donc très limitée. Nous n’avons noté aucun désistement, alors que, l’expérience étant menée sur la base du volontariat, ils pouvaient arrêter à tout moment. Réunis en groupe sous la conduite de travailleurs sociaux, ils ont écouté divers intervenants extérieurs, dont, en fonction de la dynamique du groupe, des victimes du terrorisme, des juges, d’anciens détenus : il s’agissait d’amener les détenus à se poser des questions, de déconstruire leur vision du monde, puis de les faire partir sur un projet personnel. En définitive, la plupart d’entre eux ont changé de comportement, même si certains se sont sans doute engagés dans un processus de dissimulation : si l’on veut donner dans la caricature, on dira que, pour les SPIP, ils sont tous « super bien », alors que, pour le renseignement, aucun d’eux n’a changé… La vérité se situe sans doute entre les deux.
Toujours est-il que nous avons l’amorce d’un processus : à travers tous les outils de réinsertion qui existent en prison et s’il n’y a pas de dysfonctionnement, on peut amener ces personnes à être moins dangereuses lorsqu’elles sortiront qu’elles ne l’étaient au moment où nous les avons rencontrées. Je reste très prudent quant aux résultats du dispositif, mais avons-nous d’autres solutions ? On ne peut pas amener quelqu’un à changer d’idéologie par la force. Cela ne peut se faire que par le biais d’un travail personnel. Nous avons essayé d’amorcer la prise en compte d’une autre réalité pour les amener à voir le monde différemment.
Les quartiers spécialisés sont un vrai sujet de débat en Europe. Je fais partie du Radicalisation Awareness Network, au sein duquel un groupe travaille sur les prisons et la probation. Il y a des avantages et des inconvénients, tant à regrouper les détenus qu’à les séparer. Les isoler empêche le prosélytisme envers les détenus qui n’ont pas envie d’être harcelés par des recruteurs. Cependant, si les individus isolés dans ces quartiers spécialisés ne sont pas pris en charge, cela n’a aucun intérêt.
Notre méthodologie de recherche-action sur un temps court a beaucoup inspiré la façon dont ces personnes vont être prises en charge dans un temps beaucoup plus long. D’après les discussions que nous avons eues avec l’administration pénitentiaire, il semble en effet que notre action, avec ses témoignages de victimes et ses échanges avec les détenus, va se poursuivre. Là encore, nous partions d’une page blanche. Nous avons essayé d’y inscrire quelque chose qui semble prometteur.
M. Serge Grouard. Monsieur Lacombe, vous avez parlé de fragilité chez les agents de l’État en milieu carcéral. Pourriez-vous préciser ce que vous entendez par là ?
Compte tenu de ce que vous avez dit, monsieur Gicquel, sur la gestion de l’immédiat au moment de la crise, et des témoignages poignants que nous avons entendus lundi, on a le sentiment d’une défaillance du système. Plusieurs personnes ont évoqué la nécessité qu’une administration quelconque gère et coordonne le dispositif, avec le soutien de vos associations. J’aimerais connaître votre sentiment sur la gestion de la crise. Vous avez dit que 120 personnes étaient venues apporter leur aide. Comment, concrètement, ont-elles été prises en charge ? Sont-elles venues en un lieu unique ? On parle du Quai d’Orsay et de la CIAV. Est-ce là que les choses se sont organisées ? Comment cela s’articulait-il avec les services de santé, les hôpitaux ? Y avait-il une coordination ? Les hôpitaux, qui prenaient en charge des blessés, avaient-ils eux-mêmes un numéro à appeler ? J’ai le sentiment qu’il n’y avait pas d’articulation entre les acteurs. J’aimerais que notre commission d’enquête approfondisse le sujet, car nous devons faire des propositions précises en la matière.
Si nous pouvons disposer d’éléments précis, nous aurons plus de chances d’être écoutés. Tous ceux qui ont entendu les témoignages recueillis par notre commission d’enquête sont convaincus qu’il est impératif que nous assumions cette responsabilité. C’est pourquoi j’aimerais, mesdames, messieurs, vous entendre parler de choses très concrètes, très précises. J’ai le sentiment, en l’occurrence, qu’il n’y a pas de gestion de crise. J’espère que vous pourrez me démentir sur ce point, mais je crains que ce ne soit pas le cas.
Mme Aline Le Bail-Kremer. On pourrait déjà réfléchir à la mise en place d’un numéro « 08 », avec des gens qui répondent vraiment, car les familles sont restées trois jours sans informations. Nous avons entendu des témoignages très forts en la matière, mais, pour l’avoir vécu personnellement, ce numéro « 08 » qui ne répondait pas était très perturbant. Il y a eu là un raté abyssal. Certes, soyons justes, ce moment ne pouvait pas bien se passer : il ne faut pas se tromper de colère. Mais se rend-on bien compte de la violence produite par cette défaillance, des blessures supplémentaires qu’elle a occasionnées, sans parler de la perte de temps et d’énergie, et du malheur ajouté par ce numéro qui ne répondait pas, par le numéro de l’AP-HP qui ne répondait pas non plus et qu’il fallait appeler cinquante fois pour obtenir une information partielle ?
Cela dit, pouvait-on se préparer à un événement d’une telle ampleur ? Il est peut-être plus sain de ne pas avoir été préparé à cette horreur. Mais ce n’est pas réécrire l’histoire de dire qu’il y a eu des ratés sidérants et vertigineusement douloureux pour de nombreuses familles.
Il ne s’agit pas de montrer du doigt tel ou tel individu croisé dans le dispositif : tous étaient prévenants. Mais il y a des défaillances dans leur formation. Le samedi, vers dix-sept heures, on nous a dit « de ne pas nous inquiéter ». La phrase était très perturbante, et pour le moins maladroite, mais je n’en veux pas à la personne qui a dit cela. Comme bien d’autres familles, nous avons compris que ces gens n’étaient absolument pas formés. On m’a dit aussi, de façon légère : « Bonne soirée ! » C’est peut-être un détail anodin, mais l’addition de détails anodins finit par montrer qu’il y a quelque chose qui n’a pas fonctionné, que les gens n’étaient pas formés, en tout cas que ceux auxquels nous avons eu affaire ne l’étaient pas.
Il faut reconnaître l’authenticité de la douleur qui s’est exprimée, aujourd’hui ou avant-hier. Si elle se donne libre cours lors des travaux de cette commission d’enquête, c’est, je pense, en réaction à ce qui s’est passé ces trois derniers mois. Nous nous sommes adressés à différents responsables pour obtenir des réponses, mais nos questions ont été comme balayées d’un revers de manche. Nous avons même ressenti une certaine forme de mépris, ce qui a été très difficile à vivre pour des gens effondrés, en souffrance. Peut-être ce mépris et cette non-empathie ont-ils contribué à faire ressortir la douleur, qui a explosé ces derniers temps.
Voilà ce que je voulais dire sur ce dispositif, sachant que j’ai vécu la situation de l’intérieur.
J’ajoute qu’il faut absolument mettre des sièges à l’Institut médico-légal…
M. Stéphane Gicquel. En ce qui concerne ce dispositif de crise, nous progressons, même si nous avons eu des difficultés. Cela étant, il faut tenir compte du grand nombre de victimes. Les avis sont divers ; certaines personnes ont apprécié le dispositif.
Concrètement, il faut savoir que les appels au numéro qui avait été communiqué aboutissaient à la préfecture de police, laquelle ne connaissait pas le dispositif de la cellule interministérielle d’aide aux victimes, bien que le ministère de l’intérieur y ait été associé.
Le samedi matin, on a réuni toute une équipe au Quai d’Orsay. Nous avions même, grâce au système d’information numérique standardisé (SINUS), la liste de la répartition des personnes par hôpital. Mais le téléphone ne sonnait pas. Il a fallu qu’on s’énerve beaucoup, au plus haut niveau de l’État, pour que les appels soient retransmis automatiquement de la préfecture de police à la cellule interministérielle, et non plus vers un service de la Mairie de Paris. En même temps, nous entendions dire que la Mairie de Paris avait ouvert, sans concertation, un dispositif d’accueil aux victimes. De la même façon, quand le centre d’accueil de l’École militaire a été ouvert, nous l’avons appris en voyant un bandeau défiler sur BFMTV.
Je ne veux pas accabler le dispositif, qui est bon. Cependant, il n’y avait ni formation ni préparation, mais une part d’improvisation, avec des fonctionnaires qui arrivaient d’horizons très divers. Je crois qu’un appel sur dix seulement aboutissait à la préfecture de police. Une fois transmis au ministère des affaires étrangères, tous les appels étaient pris en compte.
Les relations avec les hôpitaux n’ont pas non plus été satisfaisantes. L’AP-HP ne voulait pas transmettre des données qu’elle considérait comme confidentielles. Il faut savoir que les ministères ont chacun une appréciation différente de ce qu’est une victime. Dans les premières heures et les premiers jours, la priorité de la cellule interministérielle était les familles endeuillées. Mais, je le répète, nous partions d’une page blanche. Nous avions la liste des personnes décédées, mais pas la composition de la famille de Monsieur X ni ses coordonnées. Nous devions donc attendre que la famille se manifeste. C’est une vraie difficulté opérationnelle, qui n’est pas incontournable, mais qui existe.
M. le rapporteur. Pourquoi l’AP-HP n’a-t-elle pas voulu transmettre ces données ? Est-ce en raison du secret médical ?
M. Stéphane Gicquel. Le secret médical a pu être invoqué, en effet. Des personnels de l’établissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires (EPRUS), qui est en quelque sorte la force de frappe du ministère de la santé, étaient présents au sein de la cellule interministérielle, mais on ne leur donnait pas l’information.
Il y a aussi le secret professionnel, s’agissant des victimes qui ont été accueillies par les cellules d’urgence médico-psychologique (CUMP). C’est là aussi une réelle difficulté en ce qui concerne le recensement des victimes. À l’École militaire, une personne de la Croix-Rouge relevait les coordonnées de chaque personne qui se présentait, mais elle les gardait pour la Croix-Rouge. De toute façon, à l’École militaire, il n’y avait pas de liaison internet pour communiquer avec la CIAV. Tous ces petits dérèglements se sont accumulés et ont compliqué la gestion opérationnelle.
Mme Sabrina Bellucci. J’entends bien que nous partons d’une page blanche à chaque événement, mais c’était notre deuxième expérience. La cellule interministérielle d’aide aux victimes a travaillé par deux fois, au mois de janvier et au mois de novembre. Ce qui veut dire que l’on a tiré les leçons du mois de janvier, qui ont mis beaucoup de temps à être entendues et appliquées. Autrement dit, rien n’a été fait, que ce soit en matière de formation ou d’exercices pratiques, pour que nous soyons capables de bien travailler ensemble.
Je le dis d’autant plus sereinement que nous avons fait remonter cette remarque à notre ministère de tutelle. Nous avons dit clairement qu’il semblait important que les professionnels volontaires mobilisés de tous les ministères soient formés à l’écoute. Nous ne donnons pas que des éléments de langage, nous ne sommes pas des singes savants qui se contentent de donner des informations. Nous avons en ligne des gens qui recherchent leurs proches, qui sont en état de stress et d’angoisse. On ne dit pas « Bonne soirée » à une personne en quête d’un proche. Il faut que les gens soient formés à répondre à de tels appels. C’est un métier.
En 2015, la CIAV a malheureusement travaillé par deux fois. On aurait pu organiser des formations interministérielles pour tous les volontaires, afin qu’ils œuvrent dans la même direction. Je l’ai dit par deux fois, la première juste après des attentats de janvier, la seconde au mois de novembre. Quand allons-nous nous former tous ensemble et faire des exercices ? Une crise, cela s’anticipe et on s’y prépare. Les militaires le savent bien ; les plans blancs, les plans rouges, cela existe. Pourquoi pas des exercices en matière de prise en charge des victimes ? Nous le devons aux victimes. Nous qui avons été dans l’action, tous autant que nous sommes, nous nous devons de rectifier le tir et d’améliorer notre action tous ensemble.
Enfin, il faut le dire, tout professionnels de l’aide aux victimes que nous soyons, mobilisés de façon volontaire, nous avons tous été aussi un peu perdus. Notre façon de faire, chacun avec sa propre organisation, a fait qu’il n’existait pas un cadre d’intervention homogène nous regroupant tous sous l’égide d’un même pilote.
M. le rapporteur. Avez-vous fait, depuis le 13 novembre, un retour d’expérience ?
Mme Sabrina Bellucci. Nous en avons fait un au mois de janvier, et nous sommes en train d’élaborer celui du mois de novembre. Ces retours d’expérience ont été envoyés à nos ministères respectifs. L’instruction interministérielle y a pris quelques idées.
M. le rapporteur. Le retour d’expérience du mois de janvier a-t-il permis d’améliorer le dispositif du 13 novembre ?
Mme Sabrina Bellucci. Bien sûr, mais pas suffisamment, et l’échelle était différente. La gestion de crise est un vrai métier. Il faut former les gens qui y travaillent.
M. le président Georges Fenech. En tout cas, on ne peut qu’espérer que vous soyez très rapidement entendue.
M. Stéphane Lacombe. Quand j’évoquais des fragilités, je visais surtout certains agents de la fonction publique, pas les personnels en milieu carcéral. J’ai beaucoup échangé avec les personnels des établissements d’Osny et de Fleury-Mérogis. J’en profite pour louer ici leur professionnalisme et leur complet dévouement. J’ai appris énormément de choses avec eux. Toutefois, nous avons constaté des fragilités lors de rencontres avec des cadres municipaux et des éducateurs. Il ne faut pas généraliser, mais elles existent. Nous sommes attentifs à l’expression de ces fragilités, par exemple, autour de la devise « Je suis Charlie », qui est, pour nous, une devise républicaine. Mais cela ne va pas de soi pour tous. De nombreux éducateurs et certains enseignants m’ont confié leur désarroi. Ils estiment ne pas être outillés pour expliquer le sens des devises républicaines auprès des jeunes et déplorent le fait, parfois, de ne pas se sentir assez soutenus sur ce sujet.
M. le président Georges Fenech. Je vous remercie beaucoup. Vos interventions seront très utiles pour les travaux de notre commission d’enquête.
Audition, ouverte à la presse, de M. Daniel Pszenny, journaliste au Monde, victime des attentats du 13 novembre 2015
Compte rendu de l’audition, ouverte à la presse, du mercredi 17 février 2016
M. le président Georges Fenech. Nous terminons notre après-midi d’auditions en entendant M. Daniel Pszenny, journaliste au Monde. Vous avez été victime des attentats du 13 novembre 2015 au Bataclan : vous avez filmé la fuite des spectateurs et vous avez reçu une balle dans le bras en secourant l’un d’eux. C’est à votre demande que nous vous recevons : vous avez souhaité nous faire part de votre témoignage et c’est bien volontiers que nous allons vous écouter.
Conformément à l’ordonnance du 17 novembre 1958, je vous demande de prêter le serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité.
M. Daniel Pszenny prête serment.
M. Daniel Pszenny, journaliste au Monde, victime des attentats du 13 novembre 2015. Je souhaitais apporter mon témoignage sur la soirée du 13 novembre, notamment sur l’intervention policière : je ne remets pas en cause son déroulement, auquel je n’ai d’ailleurs pas assisté, mais elle a eu des conséquences pour nous — c’est-à-dire pour moi-même et pour le blessé américain que j’ai secouru.
Nous étions au tout début de l’attentat, il était vingt-deux heures : nous nous étions réfugiés tous les deux dans le hall de mon immeuble, nous étions dans l’incertitude ; je pensais que la police allait arriver et que le blessé serait évacué par une ambulance. Après que j’ai été blessé par balle, nous avons eu un moment de panique, nous ne savions pas quoi faire : un voisin pensait que le terroriste était dans la rue et qu’il allait venir dans le hall pour nous achever. C’est alors que j’ai décidé d’appeler un voisin qui, courageusement, est venu nous chercher pour nous mettre à l’abri. Nous sommes montés chez lui, au quatrième étage. C’est là que les choses se sont compliquées. Nous avons dû faire nous-mêmes des garrots : j’avais une balle dans le bras et le sang coulait beaucoup ; l’Américain, qui avait une balle dans le mollet, était dans un état très critique — il était tout blanc, il vomissait ; nous étions très inquiets.
J’ai téléphoné au journal Le Monde, qui a appelé la police et les secours, expliquant que nous étions au quatrième étage, isolés de fait ; nous étions au cœur de l’action, mais il y avait un tel chaos dans la rue que la police avait sécurisé l’endroit et que personne ne pouvait plus passer. Mon intention n’est pas de critiquer le protocole policier : il est plutôt efficace, on l’a vu au Bataclan. Mais je constate que les deux blessés que nous étions n’ont pas pu être évacués, malgré l’intervention de hautes autorités — y compris le chef des pompiers du 17e arrondissement qui m’a dit au téléphone qu’il était informé de notre situation, mais ne pouvait pas venir nous chercher. Nous sommes donc restés trois heures dans l’appartement en attendant qu’on nous autorise à l’évacuer. Trois heures, c’est très long quand on perd son sang. Nous nous demandions combien de litres de sang contient un corps humain et nous craignions de finir par tout perdre. Nous nous disions : « Nous allons mourir alors que les secours sont à cinquante mètres ! Malgré la police, les ambulances, la sécurité civile, personne ne peut venir nous chercher ! »
C’est ce stress et cette angoisse que nous avons ressentis. Les services de secours savaient que nous étions là, mais, malgré toutes les bonnes volontés, personne ne pouvait venir nous chercher. Aussi, je me demande s’il ne faudrait pas réaménager le protocole. Je ne connais pas exactement les dispositifs policiers dans les situations extrêmes comme celle-ci, et il paraît normal qu’on sécurise la zone, mais il y a la règle et il y a l’esprit de la règle : ne peut-on tout de même organiser l’évacuation des blessés, dès lors qu’on est averti de leur situation ? On ne peut pas mettre en jeu aussi longtemps la vie de deux personnes. Nous nous en sommes sortis miraculeusement, et je m’en réjouis. Mais il faudrait que l’Assemblée nationale se penche sur cette question, pour éviter que ce cas de figure ne se répète. Bien sûr, on le voit dans la vidéo que j’ai tournée, le chaos était général : personne ne savait ce qui se passait, il y avait des morts et des blessés dans la rue, nous-mêmes étions blessés, et tout cela était sans doute très compliqué à analyser au premier coup d’œil pour la police.
Durant ces trois heures d’attente, l’autre blessé, Matthew, a connu des moments où il était très mal. Nous ne pouvions rien faire. Puis nous avons appris, sur une chaîne d’information, que l’assaut avait été donné. Les premiers secours se sont portés auprès des corps qui gisaient dans la rue — de nombreux blessés et des dizaines de morts devant et à l’intérieur du Bataclan. Je ne dirai pas qu’on nous avait abandonnés, mais ce qui devait arriver arriva : on nous oubliait, il y avait tant à faire que personne n’avait le temps de monter au quatrième étage d’un immeuble pour venir nous chercher.
Mon voisin s’est donc manifesté à la fenêtre pour rappeler que nous étions là : aussitôt, dix rayons laser se sont braqués sur lui. Les forces de l’ordre présentes en bas nous ont autorisés à descendre. J’avais la chance de pouvoir marcher, j’ai prévenu que je descendais à pied pour éviter toute confusion — j’avais perdu ma chemise, j’étais dans un état assez lamentable. Dans l’escalier, j’ai croisé un policier qui montait, très armé : suivant le protocole, il me pointe son pistolet sur la tempe et se met à me palper. Je me suis dit : s’il pense que je suis un sniper qui cherche à fuir, il va m’abattre. Je me trouvai dans cette situation paradoxale : nous avions attendu des heures au risque de mourir faute de soins, et nous risquions à présent de nous faire tuer parce que le protocole exigeait que la police nous fouille. Ce policier était suivi d’un officier qui lui a dit de me laisser passer et nous avons pu finir de descendre. Mais je vous assure que ça fait bizarre, quand on sort de trois heures d’angoisse et de stress, de se faire pointer un pistolet sur la tempe ! Cela fait partie du protocole, m’a-t-on expliqué. Je ne conteste pas qu’il faille l’appliquer. Mais certains points concernant l’évacuation des blessés sont peut-être à revoir. Et s’il y avait eu une bavure ? Si le policier m’avait pris pour un terroriste, il n’aurait pas hésité à tirer. Il y a quand même là quelque chose qui ne marche pas.
Après cet incident fâcheux, le policier qui était devant la porte de l’immeuble ne m’a pas laissé passer, parce que, disait-il, la zone n’était pas encore sécurisée. Après nous être vidés de notre sang pendant trois heures dans l’appartement, nous avons donc dû attendre une heure de plus dans le hall. Sans doute la zone n’était-elle pas sécurisée, mais les forces de l’ordre n’étaient-elles pas assez nombreuses pour pouvoir nous évacuer ? Ces précautions, qui ont montré leur efficacité, sont sans doute justifiées, mais elles sont à double tranchant. On ne peut pas dire à deux blessés qu’ils ne doivent pas sortir parce que la zone n’est pas sécurisée, mais on pourrait leur dire qu’on a pris leur demande en compte et qu’on va tout faire pour qu’ils soient secourus. Mais peut-être le policier en bas de l’immeuble ne savait-il pas que nous avions déjà attendu trois heures.
C’est à cette question qu’il faut réfléchir : si, lors d’un assaut, certaines règles sont impératives, ne peut-on conserver une marge d’appréciation, une capacité à juger de la situation, ou doit-on se contenter d’appliquer le protocole ?
Après que j’ai été autorisé à sortir, il m’a fallu encore une heure pour aller à pied — et pieds nus ! –, jusqu’au Cirque d’hiver, situé au moins à 500 mètres, où l’on m’a pris en charge. Il était une heure trente du matin : j’attendais depuis la veille, vingt-deux heures, qu’on me pose une perfusion et qu’on me fasse un pansement. Pour Matthew, que les pompiers ont descendu sur un brancard, je pense que ça a été plus rapide.
Certes, il s’agissait d’une situation vraiment exceptionnelle. Mais il faut sans doute, à la lueur de cette expérience, réfléchir à des améliorations. Il aurait pu y avoir beaucoup plus de blessés à l’intérieur de l’immeuble. Qu’aurait-on fait ? Il faut prendre en compte ce cas de figure, qui, malheureusement, pourrait se reproduire.
M. Sébastien Pietrasanta, rapporteur. Je vous remercie pour votre témoignage. Dans le laps de temps durant lequel vous étiez retranché chez votre voisin, avez-vous été en contact direct avec les forces de l’ordre ? Avez-vous été tenu informé régulièrement ?
M. Daniel Pszenny. Nous avions des informations, soit par mes interlocuteurs au Monde, soit par d’autres personnes. Mes souvenirs sont assez flous. Je crois que c’est le commandant des pompiers du 17e arrondissement qui était au courant que nous étions là et qui me disait qu’il ne pouvait pas venir vous chercher. J’ai pourtant proposé une solution : il aurait été possible de nous évacuer par les toits avec la coopération de la police en bas.
M. le président Georges Fenech. Si vos blessures avaient été plus graves, compte tenu du délai qui s’est écoulé avant que vous ne puissiez bénéficier des secours médicaux, vous auriez pu ne pas être là aujourd’hui pour nous en parler.
M. Daniel Pszenny. C’est l’absurdité de la situation. Les forces de l’ordre et les secours étaient à cinquante mètres au bout de la rue, mais nous ne pouvions pas y avoir accès !
Mme Lucette Lousteau. Le commandant des sapeurs-pompiers du 17e arrondissement vous a-t-il interrogé sur l’état de vos blessures et de celles de l’autre blessé pour évaluer leur gravité ?
M. Daniel Pszenny. J’ai expliqué à tous mes interlocuteurs l’état de nos blessures — en l’occurrence des blessures par balle. Si j’étais lucide, l’autre blessé était dans un état critique. Malgré les explications et l’urgence de la situation, la réponse fut toujours : « Malheureusement, on ne peut rien faire. »
M. Serge Grouard. La situation est absurde. Vous avez un contact direct avec les pompiers : les forces de police sont donc forcément au courant que deux blessés sont là. Comment se fait-il que l’information ne remonte pas dans la chaîne de commandement, qu’elle ne parvienne pas à une autorité de police qui aurait pu décider de lever l’interdiction ?
M. Daniel Pszenny. Il n’y a pas de coordination entre les différents interlocuteurs — police, pompiers, secours, mairie de Paris. Le commandement sait que nous sommes au quatrième étage, il nous appelle, ne nous laisse pas tomber. Dans le chaos de l’assaut et de ses suites, il y a des urgences dans et devant le Bataclan. Tout le monde savait que nous étions au quatrième étage, mais il fallait que les forces de l’ordre sécurisent l’immeuble, étage par étage. Toutefois, si la chaîne de commandement savait qu’il y avait deux blessés assez graves dans l’immeuble, l’information n’a pas dû être répercutée aux policiers de base, sur le terrain. Si le policier que je croise pointe son arme sur moi, c’est parce qu’il n’a pas eu l’information. S’il avait été au courant, il ne nous aurait pas pris pour des terroristes. Je ne mets pas en cause la chaîne de commandement. C’est un immense chaos qui régnait sur place, toute la chaîne devait être très compliquée à gérer.
M. Serge Grouard. Mais vous avez été blessé à vingt-deux heures : or l’assaut n’a été donné que bien plus tard, au-delà de minuit. Ce n’était donc pas encore le chaos de l’assaut.
M. Daniel Pszenny. Toute la question est là. Entre vingt-deux heures et minuit et demi, nous avons eu de nombreux contacts avec les secours, qui n’ont pas voulu prendre la décision de venir. Je suppose que, tant que le RAID ou le GIGN sécurisaient la zone, les pompiers n’y avaient pas accès. Quand je suis sorti à une heure du matin, il n’y avait plus ni ambulances ni sécurité civile. J’ai dû remonter à pied, sans avoir encore été pansé, jusqu’à cet hôpital de campagne installé dans un restaurant. Là, nous étions sauvés, et on nous a pris en charge. Il existe des priorités dans l’évacuation ou dans le sauvetage, et la sortie des otages était sans doute au premier rang de celles-ci. Ce n’est pas à moi d’évaluer la hiérarchie des blessures.
M. le président Georges Fenech. Avez-vous, depuis, rencontré des responsables pour faire état de vos interrogations ? Vous a-t-on fourni des explications, vous a-t-on présenté des excuses ?
M. Daniel Pszenny. Je ne réclame pas d’excuses. L’important, c’est que nous nous en soyons sortis. Il s’en est fallu de peu, mais nous nous en sommes sortis. Au cours des trois mois qui ont suivi, j’ai dû recevoir des soins et faire face aux complications, avant de rechercher des explications que votre commission d’enquête ou que diverses rencontres pourraient m’apporter. Ce qui est sûr, c’est qu’il faut tâcher de trouver des solutions pour améliorer la gestion de telles situations. Je souhaite comprendre pourquoi cela ne s’est pas fait plus vite.
M. le président Georges Fenech. C’est la première fois que vous posez ces questions. L’article publié le 19 novembre dans Le Monde est très factuel : vous racontez ce que vous venez de nous dire, mais sans émettre la moindre interrogation, comme si tout s’était bien fini. Vous parlez des heures d’attente, mais vous ne posez pas de questions.
M. Daniel Pszenny. Dans un premier temps, après un tel fracas personnel et collectif, on pense à se soigner et à rassembler les pièces du puzzle. C’est une bonne chose que votre commission d’enquête se penche aujourd’hui sur ce qui s’est passé. Nos témoignages divers et variés permettront sans doute de construire et d’avancer.
C’est en effet la première fois que je pose publiquement ces questions. Dans le journal, les faits parlaient d’eux-mêmes. Il ne s’agit pas pour moi de mettre la police en cause : elle a fait son travail et tout s’est déroulé assez vite. Mais il faut revoir l’application stricte du protocole et l’information dans la chaîne de commandement. Dans d’autres situations moins dramatiques, la question peut se poser aussi. Une centralisation de l’information entre les différents intervenants est nécessaire, pour savoir exactement quelles informations sont communiquées.
Mme Anne-Yvonne Le Dain. Je vous remercie pour votre témoignage concis et précis. Vous posez la question de la chaîne de commandement. Le sujet est complexe, car les intervenants sont nombreux. Vous demandez pourquoi une information importante qui arrive au commandement lui-même peut ne pas être répercutée aux opérationnels. Cela peut se comprendre dans le contexte qui était celui de ce soir-là : l’assaut, l’inquiétude, le périmètre à sécuriser, l’incertitude — on ne sait pas s’il n’y a pas des snipers tout autour. Sur le fond, la sécurisation du périmètre ne me choque pas. Mais, une fois que c’est fini, comment se fait-il que la première personne que vous rencontriez soit un policier seul, qui par ailleurs fait son travail ? L’information ne lui est pas parvenue, et c’est cela qui m’interpelle. Au bout du compte, sur le terrain, les gens ont fait leur travail, pas seulement en suivant le protocole, mais en se mettant en danger.
Enfin, je trouve sidérant que vous ayez dû parcourir 500 mètres à pied.
M. Daniel Pszenny. J’ignore comment était organisée la chaîne de commandement. Un poste de commandement de la police devait être installé au Bataclan. Pourquoi n’a-t-il pas retransmis aux officiers l’information que nous avions communiquée — nous avons ensuite été accompagnés par des officiers en civil ? Sans doute, sur le moment, tout se passe très vite et tout le monde a peur, y compris les policiers, ce que je peux comprendre. Il y a tout de même quelque chose qui n’a pas fonctionné, et il faut s’interroger sur le dispositif que les forces de l’ordre ont mis en place devant le Bataclan. Apparemment, l’information s’est perdue d’un téléphone portable à l’autre. Si nous ne nous étions pas manifestés à la fenêtre, nous aurions pu attendre encore longtemps. C’est cela qui est dramatique. Il faut que l’information, quelle qu’elle soit, soit répercutée. Visiblement, celle nous concernant ne l’avait pas été.
Mme Anne-Yvonne Le Dain. Et les 500 mètres à pied ?
M. Daniel Pszenny. Il y avait des ambulances sur le boulevard, mais, je ne sais pas pourquoi — sans doute pour des raisons de sécurité —, elles ne pouvaient pas venir dans le passage où se trouve mon immeuble. Certaines victimes en avaient pourtant bénéficié avant. J’ai pu marcher, mais ce n’est pas ce qu’il y a de mieux quand on est dans cet état.
M. le président Georges Fenech. Je vous remercie, monsieur Pszenny. Sachez que la commission d’enquête va se déplacer sur les lieux de situation de crise et de commandement. Votre témoignage est important pour nous, car il nous permettra de poser des questions fondées sur ce que vous avez vécu. J’espère que nous pourrons apporter des réponses et des améliorations.
Table ronde, ouverte à la presse, consacrée à la prise en charge hospitalière des victimes des attentats de l'année 2015 : M. le médecin général des armées Jean-Marc Debonne, directeur central du service de santé des armées (SSA), M. le médecin général inspecteur Dominique Vallet, adjoint « offre de soins et expertise », M. le médecin en chef Jean-Christophe Bel ; M. Martin Hirsch, directeur général de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), docteur Christophe Leroy, chef du service « gestion des crises sanitaires » à l’AP-HP
Compte rendu de la table ronde, ouverte à la presse, du lundi 29 février 2016
M. le président Georges Fenech. Nous avons souhaité commencer nos travaux par l’audition des victimes, qui ont droit à toute l’attention de la représentation nationale. Nous les poursuivons en nous intéressant à leur prise en charge hospitalière.
Je suis heureux d’accueillir à cette fin M. le médecin général des armées Jean-Marc Debonne, directeur central du service de santé des armées (SSA), accompagné du médecin général inspecteur Dominique Vallet, adjoint « offre de soins et expertise » au directeur central, et du médecin en chef Jean-Christophe Bel.
Le service de santé des armées est un service interarmées dont la mission première est d’être au plus près des combats, mais il participe aussi à la gestion des risques dans le domaine de la santé et aux secours en cas de catastrophe naturelle.
J’ai le plaisir d’accueillir également M. Martin Hirsch, directeur général de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), accompagné du docteur Christophe Leroy, chef du service « gestion des crises sanitaires » à l’AP-HP.
L’AP-HP est un établissement public de santé et le centre hospitalier universitaire (CHU) de la région Île-de-France. Elle regroupe trente-neuf hôpitaux, qui accueillent 7 millions de personnes malades chaque année.
Nous avons décidé que nos auditions seraient ouvertes à la presse, car nous devons mener cette enquête dans la plus grande transparence. Tel est donc le cas de cette table ronde, qui est en outre retransmise en direct sur le portail vidéo internet de l’Assemblée nationale. Son enregistrement y restera disponible pendant quelques mois.
Notre commission pourra décider de citer dans son rapport tout ou partie du compte rendu de cette audition.
Conformément aux dispositions de l’article 6 de l’ordonnance du 17 novembre 1958, je vous demande de prêter le serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité.
M. Martin Hirsch, M. Christophe Leroy, M. Jean-Marc Debonne, M. Dominique Vallet et M. Jean-Christophe Bel prêtent successivement serment.
Je vous laisse la parole pour un exposé liminaire, afin que vous puissiez notamment répondre aux questions que nous vous avons adressées préalablement par écrit. Ensuite, le rapporteur, les membres de la commission et moi-même serons amenés à vous demander des précisions ou à vous poser d’autres questions.
M. le médecin général des armées Jean-Marc Debonne, directeur central du service de santé des armées. C’est un honneur de m’exprimer devant vous dans le cadre de cette commission d’enquête.
En 2015, le SSA, parce qu’il est au croisement des mondes de la défense et de la santé, a été en effet tout particulièrement impliqué dans la lutte contre le terrorisme sur le territoire national. La part la plus visible de son action, mais non la seule, reste la participation des hôpitaux d’instruction des armées (HIA) Bégin et Percy à la prise en charge des blessés des attentats du 13 novembre. Ce soir-là et dans les jours qui ont suivi, le SSA s’est fortement mobilisé aux côtés des autres acteurs de la santé, au premier rang desquels figure, bien évidemment, l’AP-HP. Le fait que vous ayez souhaité m’entendre conjointement avec son directeur général est révélateur de la complémentarité de nos services.
Avant de vous présenter le rôle qu’a joué le SSA dans l’action des pouvoirs publics en réponse aux attentats, permettez-moi d’insister brièvement sur son positionnement actuel dans la gestion des crises sanitaires sur le territoire national.
Fort d’une longue expérience de la gestion des crises sanitaires sur les théâtres d’opérations extérieures (OPEX), le SSA a développé un certain nombre d’aptitudes spécifiques, qui peuvent être mises au service de la Nation. Le SSA pourrait être amené à considérer la gestion des crises sur le territoire national comme une nouvelle dimension de son action, et non plus seulement comme une contribution optionnelle visant à épauler les structures civiles de santé.
Il ne s’agit pas pour le SSA de suppléer, et évidemment encore moins de supplanter les acteurs institutionnels civils de la réponse aux crises sur le territoire national. Nos organisations ne doivent être ni redondantes ni concurrentes, mais, bien au contraire, complémentaires. Il s’agit donc de partager nos compétences et nos aptitudes avec l’ensemble de la communauté de santé. Pour reprendre les propos tenus en novembre dernier par le chef d’état-major des armées au sujet de l’action des armées sur le territoire national, je pense aussi qu’ « il faut une valorisation, et non pas une banalisation » de l’action du SSA.
C’est dans cet état d’esprit que les ministères de la santé et de la défense opèrent actuellement un rapprochement sans précédent. Cela devrait prendre la forme, au printemps, d’un protocole d’accord visant à identifier nos complémentarités pour faire face aux menaces impliquant le domaine de la santé lors des crises intérieures. Sans attendre cette échéance, à titre d’exemple, nous travaillons de concert avec la direction générale de la santé (DGS), la direction générale de l’offre de soins (DGOS) et le Conseil national de l’urgence hospitalière (CNUH) pour mettre en place très rapidement des formations au profit des professionnels de santé civils en vue de la prise en charge des blessés lors d’attentats utilisant des armes de guerre. Les premières versions des modules de formation sont en cours de finalisation, et les formations débuteront très prochainement.
Voici pour le contexte et l’actualité de notre action depuis la survenue des attentats de janvier et de novembre 2015. Cependant, n’oublions pas que, à côté de cette contribution grandissante à la résilience de la Nation, le SSA doit avoir en permanence la capacité de remplir sa mission première : appuyer l’action militaire, où qu’elle se situe et quelles qu’en soient les modalités. De facto, par le soutien médical qu’il prodigue aux forces armées, le SSA participe activement à la lutte contre le terrorisme, tant par le renforcement de la posture de protection du territoire national que par l’intervention de nos forces à l’étranger.
J’en viens maintenant concrètement aux faits : quelle a été la participation du SSA à l’action des pouvoirs publics dans les suites immédiates des attentats ? Sans en détailler la chronologie précise – qui est l’objet du document que nous vous avons communiqué ce jour même –, je m’attacherai à en dégager les grandes lignes. Ainsi que vous me l’avez demandé, mon intervention ne concernera que les personnels « placés sous mon autorité ». Je n’évoquerai donc pas l’action du service médical de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris (BSPP), qui compte quarante-cinq praticiens du SSA dans ses rangs, puisqu’il est placé sous les ordres du général commandant la BSPP.
Je vous propose d’articuler mon propos de manière chronologique en évoquant dans un premier temps les attentats de janvier, avant d’aborder plus longuement, dans un second temps, ceux de novembre 2015, qui ont largement mobilisé les moyens du SSA.
L’action du SSA lors des attentats de janvier est dans la ligne de son action habituelle. Si les attentats du 7 au 9 janvier 2016 ont été un événement « inhabituel », ils n’en ont pas pour autant provoqué une situation inhabituelle dans les hôpitaux militaires : nous n’avons pas assisté à un afflux massif de blessés. Il semble que la proximité géographique ait joué un rôle dans l’orientation des blessés. La participation de l’HIA Bégin de Saint-Mandé, situé quasiment sur la même avenue que l’Hypercacher de Vincennes, n’est donc pas surprenante. Cet hôpital a d’ailleurs reçu un policier du RAID blessé par balle lors de l’assaut.
L’HIA Percy de Clamart a également apporté sa contribution en prenant en charge le joggeur blessé peu avant l’attaque, un dessinateur de Charlie Hebdo, ainsi que la policière municipale blessée à Montrouge, malheureusement arrivée en état de mort apparente et déclarée décédée peu après.
L’action du SSA a également concerné les centres médicaux des armées (CMA), qui assurent le premier recours. Ils ont été mobilisés pour soutenir l’opération Sentinelle déclenchée en janvier. Dans un premier temps, le SSA a pu s’appuyer sur son maillage territorial pour assurer un soutien de proximité. Dans un second temps, une organisation spécifique a été mise en place, avec notamment la désignation d’un directeur médical de l’opération Sentinelle, à l’instar de ce qui se pratique en OPEX. Les CMA parisiens ont alors été renforcés par des équipes venues des autres régions. Enfin, l’ensemble des militaires déployés a été doté d’une trousse individuelle comportant un pansement compressif et un garrot tourniquet.
L’action du SSA lors des attentats de novembre a été, quant à elle, plus inhabituelle par son ampleur. Je souhaiterais insister sur les quatre points les plus marquants de l’engagement du SSA à l’occasion de ces événements dramatiques.
Le premier point porte sur la prise en charge des blessés physiques. Placés en alerte dans les minutes qui ont suivi les premiers événements, les hôpitaux de la plateforme hospitalière militaire d’Île-de-France se sont mis en capacité, en moins de quatre-vingt-dix minutes, d’assurer une prise en charge simultanée d’un nombre maximal de blessés, conformément au plan Mascal – mass casualties –, qui est la procédure mise en œuvre en OPEX en cas d’afflux massif de blessés. Peu avant minuit, les blessés sont arrivés par vagues successives de sept à huit ambulances, régulées efficacement pour limiter la saturation des capacités hospitalières. Ces blessés ont bénéficié de stratégies et de techniques de prise en charge largement utilisées et éprouvées en OPEX, tel le damage control, mais aussi, lorsque cela était nécessaire, d’une transfusion de plasma lyophilisé (PLYO), qui est systématiquement utilisée en première intention en cas de traumatismes hémorragiques, dans les HIA comme en OPEX.
Au total, ce sont cinquante-deux blessés qui ont été pris en charge dans la nuit, dont dix-huit urgences absolues sur les quatre-vingt-dix-huit qui ont été dénombrées dans les hôpitaux franciliens. Cinquante interventions chirurgicales ont été réalisées en quarante-huit heures au profit de ces blessés, treize d’entre eux étant admis en réanimation. En parallèle, ces hôpitaux ont contribué au réapprovisionnement de certaines ambulances de la BSPP et du service d’aide médicale urgente (SAMU) pour leur permettre de poursuivre leur mission. Dès le lendemain après-midi, les HIA se sont réorganisés pour intégrer la prise en charge des blessés dans leurs activités habituelles, programmées et d’urgence.
Dans le même temps, le centre de transfusion sanguine des armées (CTSA) a mis en œuvre sa procédure de montée en puissance en cas d’urgence, ce qui a permis d’assurer sans discontinuer le soutien transfusionnel des deux HIA. Le samedi, dès 7 h 30, l’ensemble du personnel militaire et civil du CTSA a répondu présent pour accueillir 500 volontaires des communes environnantes venus spontanément donner leur sang. Il a fallu en effet identifier les 164 donneurs du groupe O – les plus immédiatement utiles, comme vous le savez –, puis prélever les 132 personnes qui ne présentaient pas de contre-indication au don du sang. La préparation des produits ainsi collectés et leur qualification ont pu démarrer immédiatement, le CTSA étant en mesure de qualifier les produits sanguins même le week-end.
L’établissement de ravitaillement sanitaire (ERSA) de Vitry-le-François a également été mobilisé en soutien des HIA. Il a permis leur fonctionnement continu ainsi que la régénération de leurs moyens dans un délai extrêmement bref. Devant la forte consommation de produits antihémorragiques, il a constitué des « stocks tampons » pour pouvoir répondre aux éventuels besoins de nos structures chirurgicales actuellement déployées en OPEX. Dès le dimanche midi, anticipant la venue des renforts militaires de l’opération Sentinelle en région parisienne, il a livré 2 000 garrots et 2 000 pansements compressifs pour en doter nos soldats. Il a également livré sans préavis des trousses de secours individuelles du combattant aux deux unités parachutistes arrivées à Paris en urgence, ainsi qu’à la BSPP.
Le deuxième point marquant concerne la prise en charge des blessés psychiques, qui a eu deux volets : l’un dans les HIA, l’autre au sein d’une cellule dédiée située à l’École militaire.
Dans les HIA, nos psychiatres et nos psychologues ont été présents dès l’arrivée de la première vague de victimes. Ils ont pris en charge à la fois les blessés conscients ne relevant pas de l’urgence vitale et les patients impliqués sans blessure physique, lesquels ont pu bénéficier d’échanges individuels dans un espace dédié, avec un souci permanent de traçabilité. Au cours de la nuit, les équipes ont progressivement été renforcées afin de prendre en charge les personnes venant retrouver un blessé, mais également de soutenir les personnes profondément angoissées après la recherche infructueuse d’un proche dans d’autres hôpitaux parisiens.
Passées ces premières heures de mobilisation immédiate, la cellule d’urgence médico-psychologique s’est réorganisée pour prendre en charge au plus tôt les blessés hospitalisés – c’est-à-dire dès que leur état clinique l’a permis –, ainsi que leur entourage familial. Au total, plus de 100 consultations ont été réalisées en moins de quarante-huit heures dans les deux HIA. Les assistantes du service social ont renforcé sous vingt-quatre heures ce dispositif de crise par la prise en compte globale des besoins des victimes et de leurs proches. Dans le même temps, les équipes de soins ont fait l’objet d’une attention particulière. Des débriefings médico-psychologiques ont d’emblée été programmés. Ils ont ensuite été réalisés progressivement, pour permettre aux soignants d’aborder autrement l’expérience qu’ils venaient de traverser.
En parallèle, à la demande de la DGS, une cellule d’aide médico-psychologique a été mise en place sur le site de l’École militaire pour armer un dispositif d’aide aux familles et aux personnes impliquées. Des psychiatres et des psychologues des HIA Percy, Bégin et du Val-de-Grâce, ainsi que du service médico-psychologique des armées et du service de psychologie de la marine, ont apporté leurs compétences dans l’organisation du soutien psychologique aux familles et aux victimes. Ils ont mis en place une zone d’accueil et de priorisation des personnes en difficulté, comportant un premier niveau d’accompagnement médico-psychologique qui pouvait se prolonger dans des entretiens individuels. Nos personnels ont mené au total plus de quatre-vingts entretiens individuels, sans compter les nombreuses autres rencontres informelles. À chaque fois, ils ont proposé un rendez-vous de suivi pour assurer la continuité de la prise en charge. C’est un principe fondamental que nous appliquons à chaque déploiement d’une cellule de soutien médico-psychologique.
Ainsi, le SSA a été pleinement associé au soutien médico-psychologique qu’il a assumé sans discontinuer durant près de vingt-quatre heures, en étroite collaboration avec les personnels de santé civils, avant d’être relevé par d’autres équipes civiles mobilisées par le ministère de la santé.
Le troisième aspect que je voudrais brièvement évoquer est l’accompagnement de la montée en puissance de la force Sentinelle. Tout le personnel des CMA de la région Île-de-France est passé en alerte, et les personnels soignants ont été rappelés, voire sont revenus spontanément. Dès le samedi matin, les antennes médicales concernées par l’arrivée de renforts militaires ont anticipé le soutien médical du premier renfort de 1 000 soldats et ont mis en place un accueil médico-psychologique spécifique aux armées.
Enfin, il est essentiel de rappeler le quatrième aspect de notre engagement : durant tout ce temps, le SSA a continué à garantir la permanence du soutien des forces projetées en OPEX, où sept équipes chirurgicales sont actuellement déployées, deux d’entre elles provenant d’ailleurs des HIA d’Île-de-France. L’alerte Medevac – medical evacuation – a été assurée, une évacuation médicale aérienne étant réalisée le jour même des attentats entre la Côte d’Ivoire et l’HIA Percy. L’approvisionnement de nos unités médicales opérationnelles déployées sur les théâtres d’opérations a été assuré en permanence durant cette période de forte tension sur le territoire national et pendant son décours.
Mesdames, messieurs les députés, je voudrais profiter de la tribune qui m’est accordée aujourd’hui pour saluer devant vous l’engagement, le dévouement et la compétence des personnels du SSA. Ils ont fait preuve d’une exceptionnelle réactivité et d’une efficacité difficilement égalable dans un tel contexte. Ils ont tout mis en œuvre pour apporter aux victimes de ces terribles attentats une prise en charge visant à préserver leurs chances de survie et, le cas échéant, de moindres séquelles physiques et psychiques. Pour cela, le SSA a plus particulièrement mobilisé cinq aptitudes fondamentales nécessaires à sa mission première qui est, je le rappelle, le soutien médical des forces armées en opérations.
En premier lieu, le SSA dispose d’un savoir-faire non seulement technique, mais aussi organisationnel en matière de traitement des blessés de guerre. La prise en charge des victimes, parfois « sous le feu », leur catégorisation, leur mise en condition à l’avant, en prenant toujours en compte les facteurs temps et sécurité, est l’aboutissement d’une expérience fortement éprouvée et mise en œuvre encore aujourd’hui sur de nombreux théâtres d’opérations.
Au-delà des procédures et du sang-froid qu’elle suppose, cette prise en charge est basée sur des techniques médico-chirurgicales spécifiques et parfois novatrices. Prenons l’exemple du damage control, que j’ai évoqué : ce concept, complémentaire de celui de sauvetage au combat, donne la priorité à la correction des désordres physiologiques, et non à la réparation chirurgicale complète immédiate. Son intérêt est de réduire le temps opératoire initial en ne réalisant que les gestes vitaux strictement nécessaires. Cette technique permet une prise en charge rapide de réanimation, centrée sur la maîtrise du choc hémorragique grâce à l’emploi précoce des dérivés du sang et de médicaments favorisant la coagulation. Elle autorise une reprise chirurgicale éventuelle dans les vingt-quatre heures chez un blessé stabilisé, donc dans de bien meilleures conditions.
La notion de chirurgie de guerre dépasse très largement, vous l’aurez compris, la simple prise en charge d’une blessure par balle. Elle est une stratégie globale visant à adapter l’acte chirurgical aux conditions dans lesquelles il est exercé. La nature des soins prodigués dépendra ainsi, par exemple, des moyens et des délais d’évacuation et du caractère éventuellement hostile, voire agressif de l’environnement.
En deuxième lieu, le SSA dispose d’équipes hospitalières particulièrement réactives. En novembre dernier, les médecins-chefs des HIA ont déclenché le plan blanc dans les trente minutes qui ont suivi le début de la fusillade. Ils se sont immédiatement organisés pour préparer les équipes et les locaux. Ils ont été tout aussi réactifs dans le reconditionnement de leur établissement : le dimanche 15 novembre dans l’après-midi, ils avaient restauré toutes leurs capacités et étaient en mesure de faire à nouveau face, le cas échéant, à un afflux massif de blessés, cela sans jamais avoir compromis la capacité du SSA à assurer le soutien médical des forces en OPEX.
La troisième aptitude porte sur le soutien logistique santé intégré. En temps de paix, il appartient au SSA de constituer et d’entretenir des stocks préconditionnés afin qu’ils soient immédiatement transportables et utilisables sur le terrain. Cet objectif implique d’entretenir et de renouveler un stock « plancher » constitué de tous les produits pharmaceutiques, équipements médico-chirurgicaux et produits sanguins labiles nécessaires au soutien des forces. Il implique également de disposer d’équipes prêtes à conditionner et distribuer ces produits à tout moment. Cela nous permet d’être autosuffisants en contexte opérationnel afin de ne pas freiner l’action médicale.
La quatrième aptitude concerne la capacité d’organisation dans la conduite des opérations. À la chaîne organique du service se superpose en permanence une chaîne fonctionnelle dédiée à l’engagement opérationnel. Cette chaîne de commandement est en mesure d’assurer une couverture globale des risques. Son pivot est l’état-major opérationnel santé (EMO-santé). Intégré au pôle opérationnel de l’état-major des armées à Balard, l’EMO-santé dirige en permanence l’échelon opératif du SSA placé en OPEX, outre-mer ou en métropole. Il coordonne la projection des équipes et des structures, leur ravitaillement et, surtout, l’évacuation et le rapatriement des soldats malades ou blessés. Il permet de commander et de contrôler la manœuvre santé dans tout son spectre et de conserver ainsi une autonomie de décision. Ce savoir-faire permet d’activer instantanément et simultanément un ensemble de compétences pour répondre à une problématique donnée dans sa globalité. C’est ce que nous avons fait durant tout ce terrible week-end. C’est également ce que nous avions fait lors de la crise de fièvre ebola.
Enfin, la dernière des cinq aptitudes que je tenais à signaler concerne la doctrine d’emploi, qui est in fine la clé de voûte de toutes nos aptitudes. Cette doctrine régit l’ensemble de nos activités opérationnelles. Elle est continuellement révisée grâce aux enseignements tirés en permanence des retours d’expériences. Elle conduit le SSA à bâtir et planifier des scénarios de réponse aux crises. Elle est le fondement de notre auto-résilience, car elle garantit le recours à des moyens adaptés à la situation, par des équipes médicales correctement formées et présentes au bon endroit et au bon moment.
En conclusion, au-delà de son expertise, le SSA se singularise par une capacité d’action permanente et réactive, adaptable à son environnement, structurée par sa chaîne de commandement et sa doctrine d’emploi, qui intègre un soutien logistique autonome. Tout cela est rendu possible par les fortes valeurs d’engagement et de cohésion que partagent les personnels de notre service, comme ceux des armées en général.
Les savoir-faire des personnels du SSA, ainsi que les moyens dont il dispose, ont été utilisés lors des attentats qui ont frappé Paris en 2015. Pour être véritablement efficace dans de telles circonstances, l’expérience opérationnelle du SSA doit s’intégrer dans une réponse plus globale associant de nombreux autres acteurs. C’est bien ce que vise le SSA à travers la démarche d’ouverture, vers le service public de santé notamment, qui caractérise son nouveau modèle « SSA 2020 ».
M. le président Georges Fenech. Merci, monsieur le directeur central. Vous nous avez dit que le plan blanc avait été déclenché environ trente minutes après le début de la fusillade, lequel est intervenu vers 21 h 20. Vous avez également indiqué que les premiers blessés étaient arrivés quelques minutes avant minuit. Il s’est donc passé environ deux heures entre ces deux événements. Comment expliquez-vous ce temps de latence ?
M. le médecin général des armées Jean-Marc Debonne. Nos médecins chefs ont été prévenus immédiatement que des attentats avaient lieu à Paris. Cette simple pré-alerte est intervenue trente minutes après le début des attentats. Il ne leur était pas encore demandé de prendre en charge des blessés, mais de se mettre en capacité de prendre en charge le plus rapidement possible dans leurs hôpitaux un nombre de blessés qu’il nous fallait indiquer. Il s’est effectivement écoulé environ deux heures entre la première mise en alerte des hôpitaux militaires et l’arrivée des blessés. Selon l’interprétation que je peux en faire, ce délai tient au fait qu’il a fallu mettre les blessés en condition d’évacuation et les transporter.
M. le président Georges Fenech. À moins que l’évacuation n’ait commencé que tardivement ? Avez-vous le cas échéant une autre explication que celle que vous avez donnée ?
M. le médecin général des armées Jean-Marc Debonne. Non, je n’ai pas d’autre explication. Il est tout à fait logique que nous ayons été pré-alertés et qu’on nous ait demandé de nous mettre en capacité d’accueillir des blessés. Sur cette simple pré-alerte, nous avons activé le plan blanc. Nos hôpitaux ont été sollicités – ils n’ont pas été les seuls à l’être – au moment où la régulation l’a estimé nécessaire.
M. le président Georges Fenech. Quelle distance sépare le Bataclan et l’hôpital Bégin de Saint-Mandé ?
M. le médecin général des armées Jean-Marc Debonne. La question est plutôt celle du temps qui était nécessaire pour parcourir cette distance. À mon avis, la circulation devait être très perturbée. Je ne peux pas me prononcer sur le temps qui était nécessaire dans le contexte de cette nuit-là pour acheminer des blessés entre le lieu des attentats et l’hôpital Bégin.
M. Sébastien Pietrasanta, rapporteur. Je salue le travail remarquable accompli par les personnels du SSA et de l’AP-HP.
Je complète la question posée par le président sur la prise en charge des blessés : pouvez-vous nous expliquer de manière très pédagogique comment ils ont été répartis entre les hôpitaux militaires et ceux de l’AP-HP ? La question du délai est évidemment importante, et les victimes ont un certain nombre d’interrogations à propos de la pré-hospitalisation. Le fait de déterminer s’il y a des places disponibles dans tel ou tel hôpital rallonge-t-il les délais ?
Considérez-vous que les choses se sont passées comme elles le devaient le 13 novembre – certes, les circonstances étaient exceptionnelles – ou bien avez-vous des critiques à formuler à cet égard ? Au regard de votre expérience, quelles sont, le cas échéant, les pistes d’amélioration ? J’aimerais avoir votre sentiment personnel à ce sujet.
M. le médecin général des armées Jean-Marc Debonne. Je regrette de ne pas pouvoir répondre à votre première question : la régulation des blessés n’entre pas du tout dans le champ du SSA. Ainsi que je vous l’ai indiqué, une quarantaine de praticiens du SSA travaillent au sein de la BSPP, mais celle-ci n’est pas placée sous mon autorité. Je ne peux absolument pas éclairer cette commission sur ce qui a prévalu en matière d’orientation des blessés vers telle ou telle structure, ni vous donner un avis pertinent à ce sujet. Je n’ai d’ailleurs pas connaissance de ce qui s’est passé en la matière.
En revanche, pour ce qui est de votre seconde question, je peux vous dire exactement la façon dont nous avons vécu l’arrivée des blessés dans nos hôpitaux : premièrement, en aucun cas, nous n’avons été saturés malgré l’afflux important de blessés ; deuxièmement, en aucun cas, les blessés n’ont été mal orientés – si tel avait été le cas, cela aurait pu être dramatique pour certains d’entre eux. Tous les blessés qui ont été orientés vers les hôpitaux militaires parisiens ont pu être pris en charge par ces hôpitaux sans transfert secondaire. La première mise en alerte des hôpitaux visait à identifier et à vérifier au préalable leurs capacités d’accueil et leurs compétences, de manière à s’assurer de l’adéquation de ces compétences aux éventuels blessés à orienter. Cela a parfaitement fonctionné : à aucun moment, les HIA Bégin et Percy n’ont été saturés par un afflux non régulé d’ambulances. Les blessés sont arrivés en nombre important, mais la situation était parfaitement gérable et a d’ailleurs été parfaitement gérée, grâce aux techniques de catégorisation initiale que nous avons mise en œuvre. Voilà ce que je peux dire sur la question du pré-hospitalier.
M. le rapporteur. La question de la répartition ne relève pas de votre responsabilité, mais elle est posée. D’autre part, à vous écouter, j’ai le sentiment que vous auriez pu prendre en charge beaucoup plus de blessés dans les HIA Bégin et Percy. D’après les chiffres dont nous disposons – M. Hirsch pourra y revenir –, les hôpitaux Georges-Pompidou, Henri-Mondor et La Pitié-Salpêtrière, ainsi que Saint-Louis et Saint-Antoine en raison de leur proximité, ont accueilli à eux seuls 80 % des victimes. Comment se fait-il qu’il n’y ait pas eu de montée en charge des hôpitaux militaires et que d’autres hôpitaux civils qui avaient offert leurs services – de l’AP-HP ou hors AP-HP – n’aient pas été sollicités ?
M. le médecin général des armées Jean-Marc Debonne. Dans un contexte opérationnel de guerre, sur les théâtres d’opération, nous sommes contraints de prendre en charge tous les blessés, quel que soit leur nombre. C’est aussi le cas pour un certain nombre d’opérations. Le 13 novembre au soir, les hôpitaux militaires parisiens n’ont pas été saturés au sens strict du terme, en tout cas pas au point d’être déstructurés, mais leur taux d’occupation a été largement suffisant. Certes, nous n’avons pas rappelé tous les personnels, ni ouvert en permanence tous les blocs opératoires. Mais, si nous avions dû le faire, ces hôpitaux auraient clairement été placés en mode de fonctionnement « anormal ». Nous avons eu à gérer une situation inhabituelle, mais cela n’a pas entraîné de dysfonctionnement. Les capacités des hôpitaux militaires parisiens, augmentées compte tenu du contexte, ont été utilisées de manière optimale. Je ne peux pas dire qu’il y avait une réserve d’accueil importante dans ces hôpitaux.
M. le médecin général inspecteur Dominique Vallet, adjoint « offre de soins et expertise » au directeur central du service de santé des armées. Ainsi que vient de l’évoquer le directeur central, les HIA Bégin et Percy n’ont pas été saturés, mais ils ont été largement utilisés, bien au-delà de leurs capacités habituelles de fonctionnement. Je dirais qu’ils ont été utilisés à 100 % de leurs capacités et des moyens humains disponibles, lesquels se sont d’ailleurs mobilisés spontanément. Il faut bien mesurer que trente-cinq blessés sont arrivés à l’HIA Bégin en l’espace d’une heure et demie – en trois vagues avec un intervalle d’une demi-heure – et que, de ce fait, les blocs opératoires ont fonctionné sans discontinuer pendant près de trente-six heures, compte tenu du temps nécessaire pour assurer un triage secondaire des patients, procéder à leur évaluation au service des urgences et les transférer vers les blocs.
À un moment donné, il peut y avoir encore des capacités d’accueil et de médicalisation des patients en urgence, mais les capacités des blocs opératoires rencontrent, elles, une limite, dans la mesure où l’accomplissement des gestes chirurgicaux demande un certain temps, même s’il ne s’agit que de gestes de première intention ou de sauvetage. Il faut aussi tenir compte des temps de récupération des équipes chirurgicales, qui sont nécessaires. Nous avions d’ailleurs pré-alerté des équipes militaires de province afin qu’elles rejoignent éventuellement les hôpitaux parisiens, tout en sachant cependant qu’il fallait aussi conserver des réserves là où elles se trouvaient, au cas où d’autres attentats seraient survenus sur le territoire.
M. le président Georges Fenech. Qui procède à l’identification préalable des capacités hospitalières en vue de l’orientation des blessés ?
M. le médecin général des armées Jean-Marc Debonne. Ce sont les SAMU et la BSPP qui sont chargés de la régulation, et nous répondons à leurs sollicitations. M. Hisrsch est sans doute mieux placé que moi pour répondre.
M. Jean-Michel Villaumé. Le matin même du jour où les attentats se sont produits, un exercice de réponse à une attaque terroriste multisite a été organisé. Il a mobilisé de nombreux services hospitaliers, notamment les SAMU de Paris et de la région parisienne. Son objectif correspondait malheureusement à ce qui s’est passé le soir même. Avez-vous, le SSA et vous-même, monsieur le directeur central, été sollicités dans le cadre de cette répétition générale ?
M. le médecin général des armées Jean-Marc Debonne. J’ai appris a posteriori que cet exercice avait eu lieu et que des agents du SSA y avaient été associés. À ma connaissance, qui n’est peut-être pas exhaustive, cela a été l’occasion pour eux de s’assurer de leur capacité de réponse au cas où de tels attentats se produiraient, notamment de leur capacité à activer le plan blanc et à rappeler les personnels. Mais cela n’a pas été au-delà : il n’y a pas eu de simulation grandeur nature d’un afflux massif de blessés dans les hôpitaux militaires parisiens.
M. le président Georges Fenech. Pour la clarté de cette audition, avant de passer aux autres questions, je donne la parole à M. Hirsch pour son exposé liminaire.
M. Martin Hirsch, directeur général de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris. J’essaierai, dans mon exposé, d’apporter des éclaircissements sur certaines questions que vous avez commencé à aborder.
En droite ligne avec les propos de M. Debonne, j’indique que nous avons beaucoup travaillé, notamment au deuxième semestre 2014, sur les relations entre l’AP-HP et le SSA, d’une part, et entre l’AP-HP et la BSPP, d’autre part. Dans les deux cas, cela s’est traduit par la signature d’une convention – celle qui a été passée entre l’AP-HP et la BSPP a été préparée à la fin de l’année 2014 et officialisée au début de l’année 2015. Nous avons ainsi organisé nos relations quotidiennes et nos actions communes en matière de formation, d’exercices, de communication et de répartition de nos forces. Nous avons souhaité faire en sorte que nos trois organisations jouent un rôle complémentaire dans la prise en charge des blessés, à la fois en temps normal et en cas d’événements dramatiques. Ces conventions ont joué un rôle très important dans la coordination des secours et des moyens mis en place lors des moments tragiques que nous avons connus.
Au moins de janvier, plusieurs épisodes se sont produits en quatre jours. Nous avons pris en charge des victimes dans un état grave, en nombre bien évidemment beaucoup plus réduit qu’au mois de novembre. Cela a néanmoins été l’occasion d’examiner les conditions et les temps d’accès et de prise en charge. Nous avons également été confrontés à la prise en charge des victimes psychologiques, des proches et des témoins, tant de l’attentat contre Charlie Hebdo que de la prise d’otages à l’Hypercacher de Vincennes. Pour la première fois, nous avons organisé cette prise en charge dans un lieu unique, à l’Hôtel-Dieu, où des équipes de professionnels étaient disponibles, avec des psychiatres, des psychologues, des médecins somatiques et un certain nombre de volontaires. Nous avons ouvert cette structure d’accueil à l’Hôtel-Dieu dans l’après-midi du 7 janvier, l’avons maintenue en activité intense pendant plusieurs jours et l’avons laissé fonctionner encore plusieurs semaines. Nous avons constaté l’utilité de ce type de prise en charge et réfléchi à sa pérennisation, de manière à pouvoir l’activer dans d’autres situations exceptionnelles.
D’autre part, ainsi que vous l’avez souligné, monsieur Villaumé, l’année 2015 a été consacrée à plusieurs exercices réguliers sur différents scénarios, certains étant malheureusement proches des événements que nous avons vécus. L’exercice le plus récent s’est tenu le matin même du 13 novembre, ce qui est bien évidemment le fruit d’un triste hasard. En revanche, le fait que ces exercices aient été organisés régulièrement n’était pas, lui, le fruit du hasard. Ce travail conduit par les services médicaux de l’AP-HP et les autres services de l’État visait à nous préparer à différentes éventualités. Il se poursuit bien sûr aujourd’hui. Ces exercices sont fondamentaux.
Ainsi que vous l’avez rappelé, monsieur le président, l’AP-HP regroupe trente-neuf hôpitaux, mais elle exerce aussi une responsabilité dans le pré-hospitalier, puisqu’elle compte en son sein quatre SAMU, ceux de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne. Le SAMU de Paris joue le rôle particulier de SAMU de zone : lorsque des moyens sont déployés au-delà de son propre ressort, sa responsabilité opérationnelle s’étend à tous les autres SAMU de la zone de défense et de sécurité.
Le 13 novembre, les premiers événements s’étant produits à proximité du Stade de France, le premier SAMU activé a été celui de la Seine-Saint-Denis ; il est arrivé quelques minutes après sur les lieux. Ensuite, lorsqu’a été connue l’information selon laquelle des fusillades se déroulaient dans Paris intra-muros, les autres SAMU, notamment celui de Paris, et la BSPP ont eux aussi été activés et sont arrivés sur les lieux. Le SAMU de Paris et la BSPP disposent chacun d’un système de régulation central. Il y a des relations, d’une part, entre ces deux systèmes centraux et, d’autre part, entre les acteurs sur le terrain.
Cette nuit-là, le contexte pré-hospitalier a été marqué par des éléments particuliers par rapport aux planifications que nous pouvons faire. Première caractéristique : certaines fusillades s’étant produites à proximité immédiate d’hôpitaux, des victimes ont pu se rendre spontanément dans ces établissements, soit par leurs propres moyens, soit portés par d’autres blessés, soit avec l’assistance d’équipes médicales qui sont sorties des hôpitaux pour aller les chercher. L’AP-HP a donc connu une situation symétrique à celle qu’a évoquée M. Debonne : les premiers blessés sont arrivés dans nos hôpitaux très rapidement, avant le déclenchement du plan blanc. Tel a été le cas à Saint-Louis et à Saint-Antoine, qui ne sont pas particulièrement destinés à la prise en charge de victimes souffrant de traumatismes lourds, mais se sont organisés en quelques minutes pour faire face à la situation.
Dans le même temps, les SAMU et les pompiers ont mis en place conjointement le mécanisme de régulation pour transporter les blessés graves vers d’autres établissements. Environ 130 véhicules de l’AP-HP ont été mobilisés à cette fin. Il existe certaines règles : Paris et la petite couronne sont divisés en quartiers, afin que l’on puisse trouver les chemins les plus courts vers les hôpitaux les plus appropriés. Un recensement des moyens disponibles et des équipes prêtes est effectué soit par le centre de régulation du SAMU de Paris, soit par le centre de crise de l’AP-HP. Les médecins chargés de la régulation ont dont connaissance de la réalité des disponibilités par rapport au schéma théorique du nombre de places en bloc opératoire ou en réanimation.
Deuxième caractéristique du contexte : il était très évolutif. Au moment où les fusillades ont commencé dans Paris, personne ne savait ce qui pouvait se produire, notamment à la suite des premières explosions au Stade de France. Quant à la situation au Bataclan, elle ne s’est révélée qu’un peu plus tard. Le nombre des terroristes et leurs déplacements n’étaient pas connus. Dans ces conditions, les équipes de régulation – les professionnels que vous avez prévu d’auditionner vous le diront avec plus de précision et de compétence que moi – ont fait le choix de concilier deux objectifs : d’une part, faire en sorte que les victimes, notamment celles qui relevaient de l’ « urgence absolue », arrivent dans des établissements complètement prêts à les prendre en charge pour des traumatismes complexes ; d’autre part, conserver des établissements disponibles pour accueillir des blessés supplémentaires au cas où le bilan s’alourdirait au-delà des premières dizaines ou centaines de victimes recensées, par suite des attaques en cours ou d’éventuelles autres attaques.
La prise en charge des blessés a été organisée au sein de l’AP-HP en utilisant au mieux des établissements très équipés, notamment les hôpitaux Georges-Pompidou et de La Pitié-Salpêtrière. Quant à Saint-Louis et Saint-Antoine, qui n’ont pas vocation à être mobilisés lors d’une attaque de cette nature, ils ont reçu des renforts en personnel, venus en partie d’autres établissements. Enfin, nous avons mis d’autres hôpitaux en alerte pour qu’ils accueillent un petit nombre de blessés envoyés par la régulation ou se présentant spontanément.
Lorsque des voies d’accès étaient fermées pour des raisons de sécurité, il a pu arriver que les véhicules de secours soient déroutés : partis vers un hôpital, ils ont été réorientés vers un autre établissement. À cet égard, le fait que plusieurs hôpitaux aient été mobilisés représentait un avantage : cela a permis au système de s’adapter au fur et à mesure des contraintes de terrain liées aux événements dramatiques en cours.
Ainsi que j’ai pu en juger par moi-même tout au long de la nuit, nous avons vérifié en permanence la capacité de prise en charge de blessés, notamment de blessés graves, par les différents hôpitaux, d’abord par ceux de l’AP-HP, puis par ceux de la région Île-de-France – hôpitaux militaires, hôpitaux généraux hors AP-HP ou établissements de santé privés d’intérêt collectif (ESPIC) – qui ont été mobilisés par l’Agence régionale de santé (ARS), en étroite relation avec nous. Assez rapidement, des établissements situés hors de l’Île-de-France ont également été mis en alerte, notamment des CHU disposant de moyens de transport héliportés avancés, afin qu’il n’y ait pas de perte de chance pour les patients au cas où le nombre de blessés graves aurait dépassé les quelques centaines.
Ce qu’a indiqué M. Debonne à propos des hôpitaux placés sous sa responsabilité vaut aussi pour ceux qui sont placés sous la mienne : la répartition des blessés a été faite de telle sorte que certains établissements spécialisés prennent en charge le plus grand nombre possible de patients sans atteindre leurs limites. Je peux vous en donner une illustration très claire : l’hôpital de La Pitié-Salpêtrière, qui a pris en charge de nombreux blessés graves dans les toutes premières heures, avant que l’hôpital européen Georges-Pompidou ne prenne le relais, a pu continuer dans le même temps à sauver des vies en procédant à des interventions très lourdes, notamment à une greffe de cœur et à une greffe de rein. Cela vous montre la force de ces établissements et leur capacité de mobilisation : en quelques minutes, une dizaine de blocs opératoires ont été ouverts en parallèle. Or ouvrir un bloc opératoire, ce n’est pas seulement en ouvrir la porte : c’est faire en sorte que l’ensemble des équipes – chirurgicale, médicale, d’anesthésie, paramédicale – soient disponibles, ce qui a été le cas. Dans aucun de nos établissements, nous n’avons déploré de manque de personnel ou de matériel.
Et je parle de l’ensemble des personnels : non seulement de ceux auxquels on pense immédiatement et que je viens d’évoquer, mais aussi de ceux qui assurent des fonctions support, par exemple la stérilisation des instruments ou la fourniture de médicaments et de matériel. À aucun moment, je le répète, il n’y a eu de manque de personnel, malgré les petites incertitudes que nous avons eues concernant l’accès aux établissements : cette nuit-là, plusieurs périmètres ont été bouclés, et les membres du personnel n’avaient pas nécessairement sur eux leur carte professionnelle ou un document prouvant leur appartenance à une équipe hospitalière. Cela n’a pas eu de conséquences, car nous avons eu de nombreux contacts avec les services de police pour faciliter leur accès aux hôpitaux. De même, en janvier 2015, la circulation avait été coupée ou perturbée sur certaines voies de communication pour des raisons de sécurité, ce qui avait compliqué le trajet de certains de nos agents jusqu’à leur établissement, notamment lorsqu’ils habitaient – c’est souvent le cas – relativement loin de celui-ci. C’est un point important sur lequel nous travaillons aujourd’hui.
En résumé, la prise en charge des blessés s’est faite selon un schéma pensé et organisé pour maintenir des capacités techniques disponibles en cas d’évolution ultérieure, mais, comme toute action planifiée, elle a aussi dû s’adapter à la réalité, c’est-à-dire aux conditions d’accès à tel ou tel établissement. Certains patients qui étaient en route vers un hôpital ont donc probablement été réorientés vers un autre, sans que cela soit le résultat d’une improvisation, car, à tout moment, les régulateurs avaient connaissance des disponibilités dans les différents établissements. J’insiste sur ce point : la capacité de prévision, qui implique un recensement des besoins et des moyens, ainsi que des exercices préalables, doit aller de pair avec une capacité d’adaptation des acteurs sur le terrain.
À l’AP-HP, nous avons notifié le déclenchement du plan blanc à nos hôpitaux à 22 h 34. Pourquoi ai-je pris la décision à ce moment-là ? Dans la demi-heure qui a précédé, nous nous sommes interrogés sur l’opportunité de mobiliser tous les établissements à l’échelle de l’AP-HP, ce qui, à ma connaissance, ne s’était jamais fait. Cela présentait un avantage : déployer l’ensemble de nos capacités. Mais cela présentait aussi un risque : mobiliser sur une nuit des hôpitaux qui pourraient, de ce fait, ne pas « tenir » dans la durée. Cependant, nous avons considéré que le caractère évolutif de la crise, le nombre de lieux touchés dans Paris et à Saint-Denis, ainsi que les fortes incertitudes concernant le nombre de victimes possibles au Bataclan – à 22 h 34, nous ignorions ce qui s’y passait ; nous savions seulement qu’un grand nombre de personnes y étaient enfermées avec des terroristes – justifiaient la mise en alerte de l’ensemble de nos hôpitaux. Ils ont donc tous rappelé du personnel, sachant qu’il est difficile de faire la part entre ceux qui ont répondu à ce rappel et ceux qui sont revenus spontanément. Encore une fois, il n’y a eu de manque de personnel dans aucun établissement, ni dans les heures immédiatement après les attentats, ni dans les jours qui ont suivi.
Comme vous le savez, parmi plusieurs centaines de blessés, au moins une centaine d’ « urgences absolues » ont été prises en charge dans nos hôpitaux. Il y a eu quelques transferts secondaires, mais pour des raisons tout à fait justifiées. Ce que tous nos chirurgiens et nos médecins nous ont dit, c’est qu’ils ont pu intervenir, certes dans des circonstances exceptionnelles, mais dans les mêmes conditions de sécurité et de qualité que la semaine précédente ou la semaine suivante, c’est-à-dire dans les conditions de prise en charge sanitaire qui sont prévues dans ces établissements de très grande technicité. En d’autres termes, nous ne nous sommes pas mis en situation de devoir transiger sur la qualité et la sécurité des soins ; aucun professionnel n’a eu l’impression de pratiquer une chirurgie ou une médecine dégradée. C’est pourquoi la plupart des patients, y compris ceux qui souffraient de blessures extrêmement graves, ont été sauvés. Sur les centaines de victimes qui sont parvenues jusque dans les hôpitaux, quelques-unes seulement sont décédées : deux à leur arrivée, une le 14 novembre au matin, une autre quelques jours plus tard. Ces données n’ont pas de valeur scientifique, mais des études plus poussées permettraient probablement de les confirmer.
La question de l’information s’est rapidement posée : nous avons aussitôt reçu des appels, ce qui nous a conduits à activer notre système de réponse téléphonique en mettant en place un numéro dédié, celui que nous utilisons en général en journée lorsque des personnes ont perdu de vue un de leurs proches et veulent savoir s’il est hospitalisé. À cette fin, les établissements ont communiqué à la cellule de crise l’ensemble des données concernant l’identité des victimes. Le numéro a été opérationnel vers 1 heure du matin dans la nuit du 13 au 14 novembre. Nous avons reçu environ un millier d’appels à ce numéro dans les vingt-quatre premières heures, puis environ 4 000 dans les jours qui ont suivi.
J’insiste sur le fait que nous pouvions répondre à une seule question : lorsque l’on nous donnait un nom, dire si cette personne était ou non hospitalisée dans un établissement de l’AP-HP. Nous avons été en mesure de fournir cette information très rapidement au cours de la nuit et, avec une certitude quasi complète, au début de la matinée du samedi 14 novembre. Notre système étant centralisé, les proches n’avaient pas à faire le tour des différents hôpitaux de l’AP-HP. Mais, bien évidemment, nous ne pouvions pas indiquer si une personne qui ne figurait pas sur notre liste était hospitalisée dans un établissement hors AP-HP, ni dire ce qu’elle était devenue. Telles sont les questions extrêmement douloureuses qu’un certain nombre de proches ont pu se poser pendant plusieurs heures, voire plusieurs jours. Certaines familles ont connu un parcours atroce, se rendant d’un hôpital à un autre. Les personnes qu’elles cherchaient pouvaient être, entre autres, décédées ou réfugiées ailleurs. Nous avons donc mis en place, dans chacun de nos hôpitaux, des équipes chargées de leur répondre.
En outre, à la lumière de notre expérience du mois de janvier, nous avons mis en place à l’Hôtel-Dieu, un peu avant minuit, un lieu pouvant recevoir des proches ou des personnes s’étant trouvées sur les lieux des attentats mais ne souffrant pas de blessures graves. Ainsi que j’ai pu le constater en me rendant sur place, un grand nombre de psychiatres et de psychologues étaient disponibles dans la nuit à l’Hôtel-Dieu. Ils ont reçu relativement peu de patients dans les premières heures, notamment parce que d’autres centres étaient ouverts.
Le samedi matin, nous avons constaté qu’un certain nombre de numéros étaient saturés, que les sources d’information étaient cloisonnées et qu’il y avait une limite aux informations que nous pouvions fournir – comme vous le savez, les hôpitaux ne donnent pas d’information concernant les décès lorsqu’une enquête est ouverte. On a alors ressenti le besoin de prévoir un lieu où seraient centralisées et mises à jour l’ensemble des informations à destination des familles et des proches, et où seraient présentes les autorités habilitées à délivrer ces informations, ainsi que des soutiens psychiatriques et psychologiques. En fin de matinée, les autorités gouvernementales ont décidé que ce lieu serait l’École militaire. Celle-ci a pu recevoir les familles à partir de 15 heures.
Bien évidemment, l’AP-HP a elle aussi assuré un soutien psychologique et pris en charge des victimes du stress gravissime consécutif aux attentats. Ainsi, plus de 1 000 personnes sont venues en consultation soit pour recevoir un appui et des soins, soit pour obtenir un certificat de la part d’un médecin. Le flux de patients a été très important pendant au moins une dizaine de semaines – la deuxième quinzaine de novembre, le mois de décembre et l’ensemble du mois de janvier. Les équipes de l’Hôtel-Dieu, les cellules d’urgence médico-psychologique (CUMP) qui avaient été déployées au cours de la nuit du 13 au 14 novembre et les équipes qui ont pris leur relais ont donc vu un grand nombre de patients.
Les agents de l’AP-HP, quels que soient leur métier et leur grade, ont fait preuve d’une conscience professionnelle – je dirais même d’une « conscience vocationnelle » – tout à fait remarquable. Mais il faut aussi rappeler le choc que cela a été pour ces professionnels : ils ont été confrontés à une situation d’une rare violence, au fait que beaucoup de victimes étaient jeunes, à des blessures gravissimes, à des chocs psychologiques et somatiques, à la douleur des proches et des victimes. Nous avons donc mis en place des mécanismes de soutien psychologique à la fois collectifs et individuels. Ils ont été beaucoup utilisés et le seront encore dans les mois qui viennent. Cette dimension doit être prise au sérieux pendant une longue période.
Je confirme ce que M. Debonne vous a indiqué pendant la première partie de l’audition : nos moyens n’ont pas été saturés, et ils ont été mobilisés pour faire face à une éventuelle dégradation de la situation. Au nom des équipes que je représente, je dois dire que, lors des nombreux retours d’expérience que nous avons organisés, personne n’a évoqué de désorganisation des secours, de quelque point de vue que ce soit – administratif, technique, logistique, chirurgical ou médical –, y compris dans les heures qui ont immédiatement suivi les attentats. Je ne parle pas là des difficultés de terrain rencontrées lors de la phase pré-hospitalière compte tenu des conditions extrêmement difficiles, mais de l’intervention une fois que l’accès aux victimes a été possible. C’est à mettre au crédit du très grand professionnalisme des équipes qui ont été mobilisées. Et je mets sur un même plan celles et ceux qui ont dû faire face à un afflux de blessés extrêmement important et celles et ceux qui étaient en réserve avec peu ou pas de blessés à prendre en charge, mais dont le rôle est tout aussi important dans des circonstances de cette nature. C’est pourquoi nous faisons en sorte que les exercices concernent non seulement celles et ceux qui risquent de se retrouver en première ligne, mais aussi celles et ceux qui seront en seconde ligne.
Nos institutions tiennent un double rôle : le premier, visible et tout à fait fondamental, est d’apporter une réponse sanitaire ; le second est d’être un facteur de stabilité face à la menace. Si je peux m’exprimer au nom de mes équipes, tout le monde sent, au-delà de l’effet des bombes et des balles de kalachnikov, une tentative de déstabilisation psychologique. Et nous voyons dans les exercices que nous organisons et dans la discipline dont font preuve les différentes équipes une réponse à cette deuxième menace, qui tue certes moins directement que la première, mais s’avère tout aussi redoutable. Même si chacun est touché dans sa chair, ainsi que vous avez pu le constater en entendant de nombreux témoignages, les équipes ont montré un grand sang-froid.
Nous avons tenu à ce que nos établissements rendent des comptes dans les heures, les jours et les semaines qui ont suivi les attentats, tout en restreignant fortement l’accès des médias à nos établissements, car il fallait à la fois permettre aux équipes de travailler et préserver le secret professionnel et médical. C’est un élément important pour la stabilité d’un dispositif sanitaire dans des conditions aussi dramatiques que celles que nous avons vécues.
M. le président Georges Fenech. Merci beaucoup, monsieur le directeur général, pour cet exposé très complet.
M. le rapporteur. Vous avez expliqué que la prise en charge avait été concentrée principalement sur trois établissements ainsi que sur deux hôpitaux de proximité tout simplement parce que l’on ne savait ce qui pouvait arriver. Cependant, pourquoi les hôpitaux qui ne dépendent pas de l’AP-HP n’ont-ils pas été mobilisés davantage ?
Ainsi que certains responsables politiques l’ont dit, nous faisons face à une situation de guerre avec l’emploi d’armes de guerre. Les hôpitaux ont dû traiter des blessures de guerre reçues en plein cœur de Paris. Vous avez indiqué que la prise en charge médicale et chirurgicale n’avait en rien été dégradée. Pour sa part, M. Debonne a évoqué le damage control. La doctrine de l’AP-HP sur ce type d’intervention et de prise en charge a-t-elle évolué au regard de l’expérience qui a été la sienne le 13 novembre ?
Les associations de victimes, que nous avons reçues il y a quelques semaines, nous ont beaucoup fait part de leurs difficultés à obtenir des informations sur l’identité des victimes, notamment de la part de l’AP-HP. Ainsi que vous l’avez rappelé, cela a été un parcours du combattant pour certaines personnes. Compte tenu des retours d’expérience, comment envisagez-vous d’améliorer le dispositif d’information, en particulier à destination des familles ?
M. Martin Hirsch. Dans de telles circonstances, la préoccupation est non pas d’assurer une répartition harmonieuse des victimes entre les différents établissements, mais de faire en sorte – cela a bien été le cas – qu’aucun patient n’arrive dans un endroit où l’on soit débordé.
En tant que directeur général de l’AP-HP, je ne me suis pas occupé de la régulation, et c’est très bien ainsi : les décisions de régulation ne sont pas politiques ou administratives, elles doivent être purement médicales et opérationnelles. Je les constate a posteriori. Et je peux dire a posteriori que, si j’avais eu la légitimité pour le faire, je n’aurais pas donné d’instructions différentes de celles qui ont été données.
Si l’on examine les lieux des attentats, la répartition géographique des victimes s’explique aisément.
Le premier attentat s’est produit à côté du Stade de France. L’AP-HP dispose de deux établissements relativement proches : au nord de Paris, les hôpitaux Beaujon et Bichat, qui font partie du même groupe hospitalier et, à Bobigny, l’hôpital universitaire Avicenne. Ces deux établissements ont été préservés.
À proximité du Bataclan et des lieux des autres fusillades se trouvent les hôpitaux Lariboisière, Saint-Louis, Saint-Antoine et de La Pitié-Salpêtrière. Logiquement, c’est cet ensemble d’établissements qui a été sollicité.
Le seul établissement qui a été sollicité à quelque distance de ce périmètre est l’hôpital européen Georges-Pompidou. Il l’a été pour une raison assez simple : c’est l’un des rares hôpitaux qui dispose de toutes les spécialités nécessaires – chirurgie orthopédique, chirurgie du rachis, réanimation, chirurgie cardiaque et vasculaire, etc. Certains établissements m’ont dit qu’ils auraient pu faire venir d’autres équipes en renfort de leurs spécialités, mais il valait mieux faire appel à des établissements parfaitement adaptés et complètement armés.
J’ajoute que, à Paris, les hôpitaux et les services d’urgences ne chôment pas, même en période normale. Il est donc assez logique de garder des établissements pour faire face aux urgences quotidiennes, par exemple aux infarctus.
La règle veut que l’on « croise » la disponibilité des établissements et leur labellisation. L’hôpital de La Pitié-Salpêtrière est labellisé pour l’accueil des polytraumatisés. L’hôpital Bichat-Beaujon l’est aussi, mais il a été mis en réserve précisément pour cette raison. Encore une fois, lorsqu’on l’examine a posteriori, la répartition des victimes me paraît avoir répondu à l’objectif d’intérêt général qu’est la protection des patients.
Les professionnels que vous auditionnerez ultérieurement seront plus légitimes et plus compétents que moi – qui ne suis pas médecin – pour répondre à votre question sur les évolutions de la prise en charge. En tout cas, celles-ci n’ont pas été décidées dans la nuit du 13 au 14 novembre. Les armes très meurtrières qui ont été utilisées provoquent en effet beaucoup de blessures et de traumatismes. Ces derniers temps, nos équipes, surtout les équipes pré-hospitalières, ont eu des échanges nourris avec leurs collègues français, mais aussi britanniques, espagnols et américains, afin d’adapter leur prise en charge. Les conditions balistiques dictent les conditions de prise en charge.
Nous travaillons beaucoup sur les questions d’identification des victimes et d’information. Il y a plusieurs aspects. D’abord, il faut établir plus rapidement et mieux une liste consolidée des victimes prises en charge dans les différents établissements, non seulement dans les trente-neuf hôpitaux de l’AP-HP, mais aussi dans les autres hôpitaux, où les blessés ont pu arriver par leurs propres moyens. Cela a été fait sous l’égide de l’ARS non pas dans les premières heures, mais dans les jours qui ont suivi.
Ensuite, il existe un délai incompressible – que je ne suis pas en mesure d’évaluer – pour l’identification des victimes décédées, compte tenu du temps nécessaire à l’enquête et aux opérations d’identification parfois extrêmement délicates qu’il faut réaliser. Cette attente restera douloureuse pour les proches et les familles.
Enfin, selon moi, c’est une bonne chose de consacrer un lieu central et accessible à l’accueil des familles et des proches. Nous avions suggéré que ce lieu soit l’Hôtel-Dieu, que nous venions d’ouvrir. Ce n’est pas le choix qui a été retenu, pour des raisons de sécurité que je comprends très bien. Nous sommes prêts à organiser, pour l’avenir, un lieu analogue à l’Hôtel-Dieu, offrant des conditions d’accueil adéquates, doté du personnel et des moyens informatiques requis, qui soit considéré par les différents acteurs comme un lieu naturel pour recevoir les familles et les proches.
M. Philippe Goujon. J’exprime toute ma reconnaissance et mon admiration aux équipes qui sont intervenues à Paris dans des conditions aussi particulières et difficiles.
En temps normal, les hôpitaux de l’AP-HP font face à un afflux considérable de patients, notamment dans leurs services d’urgences. Ceux-ci sont saturés de manière quasi permanente. Même si chacun fait ce qu’il peut, il n’est pas rare que l’on attende jusqu’à six ou sept heures aux urgences dans les hôpitaux parisiens, par exemple à l’hôpital Georges-Pompidou, qui est situé dans l’arrondissement dont je suis maire. Comment peut-on concilier l’arrivée de blessés de guerre en grand nombre, comme cela a été le cas, avec l’afflux régulier de personnes qui réclament des soins aux urgences ? Dans un tel cas de figure, que deviennent les personnes qui ne sont pas prises en charge aux urgences ?
Les établissements hospitaliers qui ne relèvent ni de l’AP-HP ni du SSA n’ont presque pas été sollicités pendant cette crise. À ma connaissance, très peu de blessés – il serait d’ailleurs intéressant d’en connaître le nombre exact – ont été orientés vers ces établissements, alors qu’ils auraient pu les prendre en charge dans les mêmes conditions, sans bouleverser l’organisation générale des urgences. Pourquoi en a-t-il été ainsi ? Je soulève à nouveau cette question, car de nombreux médecins et responsables d’établissements hospitaliers parisiens se la posent. Ils ont attendu « l’arme au pied » – passez-moi l’expression – que des blessés arrivent, mais cela ne s’est pas produit, alors que certains hôpitaux de l’AP-HP étaient saturés.
Les chirurgiens des hôpitaux civils ne sont pas accoutumés à traiter des blessés souffrant de blessures de guerre. Existe-t-il une formation ou une préparation à la médecine de guerre pour le personnel hospitalier civil ? Si tel n’est pas le cas, a-t-il été décidé d’en mettre une en place, notamment depuis les attentats ? Le SSA, l’AP-HP et, le cas échéant, d’autres organismes coopèrent-ils en la matière ?
Les hôpitaux de l’AP-HP sont-ils eux-mêmes suffisamment protégés contre les risques d’attentat ? J’imagine que ceux du SSA le sont. Si un attentat se produisait dans un hôpital, la crise pourrait être encore beaucoup plus grave que celle que nous avons connue.
M. Serge Grouard. Je voudrais revenir sur ce qui s’est passé au cours de la nuit à proximité des lieux des attentats. Vous avez évoqué, monsieur le directeur général, des « difficultés de terrain », expression qui m’a alerté. De quelle nature étaient-elles ? On comprend très bien que des membres du personnel médical aient pu rencontrer des difficultés pour rejoindre leurs hôpitaux respectifs, ainsi que vous l’avez expliqué. Mais, qu’en est-il des professionnels de santé relevant des SAMU ou des sapeurs-pompiers – nous aurons l’occasion de les entendre ? Ont-ils eu des difficultés pour accéder aux blessés qui se trouvaient sur les lieux des attentats ou à proximité ? Comment le premier secours s’est-il passé très concrètement ? Je fais référence aux témoignages des victimes que nous avons reçues il y a quelques semaines. Plusieurs nous ont dit avoir été prises en charge après un certain délai, qu’elles ont parfois quantifié. L’une d’entre elles a relaté les faits suivants : elle a appelé de son téléphone portable pour signifier qu’elle était à tel endroit, qu’elle était blessée et qu’elle perdait beaucoup de sang ; les personnels de santé ont été mis au courant très vite, mais ils n’ont pas pu accéder à elle alors qu’elle ne se trouvait pas à proximité immédiate du Bataclan. Il semble donc que des professionnels de santé n’aient pas pu franchir certains périmètres de sécurité. Comment la coordination avec les forces de police s’est-elle passée ?
M. le président Georges Fenech. Nous auditionnerons les SAMU et les sapeurs-pompiers le 16 mars. Ils pourront apporter des éléments de réponse à votre question.
M. Martin Hirsch. On attend en effet trop longtemps aux urgences. Ce n’est pas normal, et je suis le premier à le reconnaître. Nous avons pris l’engagement de diviser par deux le délai moyen de prise en charge dans les services des urgences – qui est actuellement un peu inférieur à quatre heures – sur la durée de notre plan stratégique. Nous travaillons beaucoup sur ce point.
Cependant, cela n’a aucun impact sur les conditions de prise en charge dans des circonstances telles que celles du 13 novembre, pour plusieurs raisons. Premièrement, les blessés suivent alors un circuit préparé. Ils sont souvent pris en charge directement en salle de réveil sans passer par l’infirmière d’orientation, notamment. C’est l’une des forces de cette prise en charge. Deuxièmement, outre le rappel du personnel, le plan blanc a pour objet de « faire de la place », non pas au sens physique du terme, mais en accélérant le circuit des patients déjà présents dans l’hôpital. Par exemple, un patient se trouvant en salle de réveil va passer plus rapidement à l’étape suivante. Il n’y a eu aucune difficulté de ce point de vue le 13 novembre. Ainsi que me l’ont rappelé certaines équipes le lendemain, elles s’y étaient préparées le matin même, lors de l’exercice mentionné précédemment.
D’autre part, j’y insiste, en raisonnant en professionnels, les agents des hôpitaux de l’AP-HP ou hors AP-HP qui n’ont pas pris en charge de victimes ne devraient pas exprimer de frustration. Ils pourraient le faire si les hôpitaux qui ont été en première ligne avaient été débordés et avaient mal pris en charge les victimes. Or tel n’a pas été le cas. Partager le flux de patients entre l’hôpital Saint-Joseph et l’hôpital européen Georges-Pompidou plutôt que de les orienter tous vers ce dernier aurait été une mauvaise décision médicale, car les équipes de Georges-Pompidou avaient préparé tous les aspects de la prise en charge – matériel, stérilisation, etc. Imaginez l’inverse : que l’on ait réparti les victimes entre les hôpitaux dans un souci d’équité et que l’une d’entre elles ait été mal prise en charge…
En tant que directeur de l’AP-HP, responsable à la fois d’une partie du pré-hospitalier – les quatre SAMU que j’ai cités – et de l’hospitalier, j’estime qu’il faut assumer complètement la répartition qui a été faite. Elle était rationnelle du point de vue de la qualité de la prise en charge. Elle a d’ailleurs permis à certains établissements, qui n’étaient pas nécessairement labellisés pour l’accueil des polytraumatisés, de faire face à un plus grand nombre de « petites » urgences. Les gens qui regardaient les actualités en continu savaient que, s’ils se faisaient une entorse, ce n’était guère le moment d’aller à Georges-Pompidou, et qu’il y avait d’autres hôpitaux qui n’étaient pas, eux, en première ligne.
Concernant la prise en charge sur les lieux des attentats, il y a eu des difficultés de deux ordres. D’une part, ainsi que les acteurs de terrain pourront en témoigner, certains endroits étaient sécurisés, notamment le Bataclan et ses abords, parce que les rafales de tirs continuaient et qu’il s’agissait d’éviter des victimes supplémentaires. De ce fait, les secours n’ont pas pu accéder immédiatement à certains blessés – dont, probablement, le journaliste du Monde que vous avez reçu. Les forces de police dissuadaient les médecins secouristes d’emprunter telle ou telle rue, les instructions étant alors de se mettre à l’abri sous les porches ou dans les rues avoisinantes. Telle a été la logique. J’ignore s’il y a des choses à revoir en la matière. Rappelons que la situation était inédite : nous étions en plein Paris, le nombre de terroristes était indéterminé, de même que la quantité d’armes dont ils disposaient.
D’autre part, de manière moins dramatique, nous avons été alertés sur le cas d’infirmières bloquées à des barrages alors qu’elles rejoignaient, par exemple, l’hôpital Saint-Louis. J’ai appelé le préfet de police de Paris et ses collaborateurs, et nous nous sommes mis d’accord sur le fait que, compte tenu des circonstances, tout moyen d’identification pouvait convenir. Nous nous sommes aussi entendus sur un numéro d’appel permettant de vérifier l’identité des personnes en cas de doute. Actuellement, nous travaillons à la mise au point d’une carte d’identification identique au badge d’accès qui serait mise à jour plus régulièrement et que chaque membre du personnel conserverait sur lui en permanence. Tout le monde ne disposait pas d’un tel document le 13 novembre.
M. le médecin général des armées Jean-Marc Debonne. Je souhaite revenir sur la question posée par M. Goujon à propos des urgences et apporter l’éclairage du SSA en la matière, en complément de la réponse de M. Hirsch. Je rappelle que je suis médecin de formation.
Dans une situation telle que celle que nous avons vécue le 13 novembre, il y a deux mots-clés à retenir : « circuit séparé » et « catégorisation ». En cas d’afflux massif de blessés, ce n’est pas le même circuit qui est emprunté, et ce n’est pas non plus le personnel du service d’accueil des urgences (SAU) qui est sollicité pour les prendre en charge. La catégorisation des blessés – on parle aussi parfois de « tri » – est une méthode que nous avons apprise sur les théâtres d’opérations et que nous avons implantée dans nos hôpitaux sur le territoire national. Elle est tout à fait adaptée en cas d’afflux de blessés en grand nombre, ou en nombre moins important mais dans un état grave, ce qui peut avoir un effet très déstructurant sur l’activité. Il s’agit de faire en sorte que le plus grand nombre de blessés aient le maximum de chances de survie et de moindres séquelles.
D’une part, il est important de dédier un circuit particulier à la catégorisation : elle ne peut pas se faire dans les locaux d’un SAU, quel qu’il soit. Dans la nuit du 13 au 14 novembre, nous avons mis en place de tels circuits dédiés dans les HIA Bégin et Percy. D’autre part, les personnels qui vont devoir accomplir cet acte médical majeur, qui consiste à déterminer qui relève de l’urgence absolue et qui relève de l’urgence relative, doivent être pré-identifiés. Il doit s’agir de professionnels particulièrement avertis : on affecte toujours à cette tâche les professionnels les plus expérimentés.
En tout cas, il faut se préparer en amont à la catégorisation. Car, si l’on découvre cette méthode au moment où l’on est confronté aux événements, c’est plus compliqué. D’après notre expérience, la prise en charge d’un afflux massif de blessés n’entre pas en concurrence avec le fonctionnement quotidien d’un SAU, car les personnels les plus concernés ne sont pas les médecins urgentistes du SAU : on mobilise d’autres compétences, celles d’anesthésistes-réanimateurs et de chirurgiens, j’y insiste, particulièrement expérimentés.
Nous avons été confrontés, nous aussi, à une certaine frustration des personnels, soit parce qu’ils étaient dans des structures hospitalières qui n’ont pas eu de blessés à prendre en charge, soit parce que nous n’avons pas fait appel à eux alors qu’ils auraient souhaité venir – nous avons voulu les garder en réserve, car nous ne savions pas, nous non plus, ce qui pouvait se passer. Ce sentiment de frustration est parfaitement compréhensible, d’autant que nous n’avions peut-être pas assez préparé les personnels à une telle situation, plus coutumière sur les théâtres d’opérations extérieures. Nous en avons tiré la leçon qu’il fallait désormais mettre les cartes sur la table en amont vis-à-vis d’eux, en leur disant clairement que, si un événement se produit, ils doivent attendre qu’on les appelle. C’est sans doute préférable à un afflux massif de personnel, qui peut être déstabilisant.
J’en viens à la question de la formation.
D’abord, il faut bien comprendre que la chirurgie de guerre est non pas une série d’actes techniques ou une méthode qu’il s’agit d’appliquer, mais la prise en charge globale de blessés graves dans un contexte de guerre. Cela revient à se poser la question de ce qu’est un contexte de guerre. Or – c’est un point majeur – il n’y a pas de contexte de guerre univoque, ce qui signifie qu’il n’y a pas de recette. En d’autres termes, sur un théâtre d’opérations extérieures ou en plein cœur de Paris, ce n’est pas la même chose.
Certes, il existe des techniques, notamment le damage control, dont nous avons parlé. C’est une technique qui vise à préserver toutes les chances du patient mais en tenant compte des conditions d’exercice, la première d’entre elles étant l’afflux massif de blessés. Passer plusieurs heures à opérer un seul patient lorsqu’il y a d’autres urgences absolues à côté, cela soulève de nombreuses questions du point de vue éthique. Le damage control permet précisément de donner le plus grand nombre de chances au plus grand nombre de blessés, ce qui est parfaitement recevable tant du point de vue technique que du point de vue éthique.
La chirurgie de guerre, ce sont donc des gestes techniques, le cas échéant sur des plaies particulières, mais dans le cadre d’une prise en charge beaucoup plus globale qui tient compte du contexte, lequel peut être agressif. À Paris, dans la nuit du 13 au 14 novembre, d’après les retours que nous avons eus, il y avait de l’agressivité au moment où les soignants sont intervenus. C’est une situation que nous vivons quotidiennement sur les théâtres d’opération et qui impose des techniques particulières. Quant aux plaies par balle, elles ne sont pas propres à la chirurgie de guerre : on en soigne couramment à l’AP-HP et dans d’autres hôpitaux français.
En revanche, à Paris, on n’est pas confronté à la problématique de l’ « élongation » que nous, militaires, rencontrons sur les théâtres d’opérations extérieures, par exemple en Afghanistan ou au Mali : presque chaque semaine, nous réalisons l’évacuation d’un blessé grave par voie aérienne sur 4 000 ou 5 000 kilomètres, ce qui influe sur le geste que doit accomplir le chirurgien.
Le SSA existant depuis trois siècles, les militaires ont, malheureusement ou heureusement, une certaine expérience en matière de chirurgie de guerre. Nous avons été sollicités très rapidement pour des formations dans ce domaine. Il y a d’abord eu des échanges entre confrères civils et militaires – chirurgiens et réanimateurs, notamment – et entre institutions. Puis, au début de cette année, la DGS et la DGOS nous ont adressé une demande officielle, au professeur Pierre Carli, président du CNUH, et à moi-même.
Ainsi que je l’ai indiqué dans mon exposé liminaire, nous sommes en train de répondre à cette demande : nous mettons actuellement en place une formation de formateurs destinée à être relayée sur tout le territoire, afin de préparer les équipes civiles – pas seulement des chirurgiens, mais des équipes complètes – à prendre en charge un afflux massif de blessés. Chaque fois que cela sera possible, des équipes militaires seront associées, sachant que nous avons des hôpitaux implantés à Paris, à Lyon, à Marseille, à Toulon, à Bordeaux, à Brest et à Metz. La nuit du 13 au 14 novembre, ainsi que l’a indiqué le médecin général inspecteur Vallet, nous n’avons pas fait venir de chirurgiens militaires de Lyon ou d’ailleurs. Nous avons préféré coopérer là où nous nous trouvions, car aucun d’entre nous ne savait ce qui pouvait se passer.
L’une de nos formations, le cours avancé de chirurgie en mission extérieure (CACHIRMEX), est déjà ouverte à des chirurgiens civils qui en font la demande, notamment à ceux qui s’engagent dans la réserve opérationnelle du SSA et qui partent sur les théâtres d’opérations extérieures. Certains praticiens de l’AP-HP donnent d’ailleurs des cours dans le cadre du CACHIRMEX aux côtés de leurs collèges militaires. Nous sommes très satisfaits que la coopération fonctionne ainsi dans les deux sens, le SSA ayant besoin de réservistes. Donc, les relations entre professionnels de santé militaires et civils existent, et elles se sont un peu plus institutionnalisées sous l’impulsion des demandes récentes du ministère de la santé.
M. Martin Hirsch. J’aimerais souligner un point. Tous les professionnels vous diront qu’ils ont été frappés par l’altruisme des blessés, qui leur ont souvent dit d’aller s’occuper des autres plutôt que d’eux-mêmes. J’en ai moi-même été témoin. Il y a donc, dans de telles circonstances, un phénomène de résilience – je ne sais pas si c’est le terme approprié – tout à fait remarquable au sein de la population, que les pouvoirs publics doivent prendre en compte.
Cela m’amène à pousser la réflexion un cran au-delà : outre la question de la préparation des pouvoirs publics eux-mêmes, il faut aller plus loin en matière de formation de la population aux premiers secours et de diffusion des connaissances sur la protection civile. Lorsque j’étais président de l’Agence du service civique, nous avons fait en sorte que tous les voltaires du service civique aient obligatoirement une formation au brevet de premiers secours. Dans notre pays, la proportion de la population qui a suivi une telle formation est trop faible, et les connaissances relatives à la protection civile sont peu enseignées. Or cette sensibilisation est fondamentale pour la population elle-même, notamment pour qu’elle acquière des réflexes qui peuvent sauver des vies. En outre, ce sont autant d’occasions d’échanges entre la population, les professionnels de santé, les militaires, les pompiers, etc.
La protection des hôpitaux est pour nous une source de préoccupation majeure, d’autant que ce sont des lieux facilement accessibles. Nous avons pris nous-mêmes des mesures visant à renforcer leur sécurité, en liaison avec la préfecture de police de Paris. Au-delà, il y a un travail très lourd à réaliser, notamment du point de vue budgétaire. Il est un cours. Selon moi, nous devons modifier dans une certaine mesure la doctrine traditionnelle des hôpitaux en matière de sécurité.
M. Jean-Michel Villaumé. Combien de victimes des attentats du 13 novembre sont encore hospitalisées aujourd’hui ?
D’après les associations d’aide aux victimes, vous n’avez transmis certaines informations à la cellule interministérielle d’aide aux victimes (CIAV) qu’au bout de quelques jours, après intervention ministérielle. Pourquoi ?
M. Martin Hirsch. Il y a encore huit victimes hospitalisées.
Il n’y a eu strictement aucune rétention d’information de notre part. Nous avons transmis les listes des victimes en temps réel à la fois aux autorités sanitaires – à charge pour l’ARS de les diffuser à ceux qui en avaient besoin – et à l’autorité judiciaire – dont un représentant est venu en cellule de crise. Sur ces listes figuraient le nom, le prénom et la date de naissance. Dans les trente-six heures après les attentats, la quasi-totalité des victimes avait été identifiées, et leur liste était parfaitement connue.
Le lundi à la mi-journée, la CIAV nous a demandé les coordonnées des victimes – adresse postale, adresse électronique, numéros de téléphone fixe et portable –, informations que nous n’avions pas demandées dans les premières heures. Nous sommes retournés vers les patients ou leurs proches pour les obtenir.
Je comprends que ce problème ait pu être ressenti comme extrêmement douloureux par les familles, mais, selon moi, il n’y a pas eu de dysfonctionnement.
M. Jean-Michel Villaumé. En effet, cela a été ressenti de manière très douloureuse par les familles. On a même évoqué des problèmes de logiciel et de mise en forme des documents entre les différents services concernés.
M. Martin Hirsch. Les coordonnées ne font pas partie des informations que l’on recueille dans les premières heures.
Mme Anne-Yvonne Le Dain. Au cours des auditions précédentes, une victime nous a indiqué qu’un certain nombre d’informations, notamment son nom et son prénom, avaient été recueillies par les personnels de santé lors d’un premier entretien, mais que ces informations n’avaient pas été transmises lorsqu’elle avait été prise en charge par une autre structure. Tout le monde a été impressionné par l’accueil médical, mais il y a eu, semble-t-il, une grande désorganisation du point de vue administratif. Selon vous, certains aspects pourraient-ils être améliorés ?
M. Martin Hirsch. À ma connaissance, il est possible qu’on ait demandé deux fois leur identité aux victimes : une première fois sur site, avant de les placer sur un brancard et de les emmener en véhicule, et, une seconde fois, à l’entrée de l’hôpital. Il y a peut-être eu des cas où l’information n’a pas complètement suivi entre ces deux moments. C’est le seul hiatus qui a pu se produire. Mais, à partir du moment où les victimes ont été enregistrées à l’entrée de l’hôpital, il n’y a eu aucune perte d’information, en tout cas dans les établissements de l’AP-HP.
M. Christophe Leroy, chef du service « gestion des crises sanitaires » à l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris. L’identité des victimes a en effet probablement été demandée une première fois sur site – je n’étais pas sur site, mais à la cellule de crise – par les intervenants pré-hospitaliers et, une seconde fois, à l’arrivée à l’hôpital.
L’identitovigilance est une question très complexe à l’hôpital. Au quotidien, il arrive souvent que l’identité recueillie lors de la prise en charge pré-hospitalière par les SAMU ne soit pas vraiment consolidée, notamment lorsque le patient est inconscient. Or une erreur sur un prénom peut entraîner des conséquences très graves, en ce qui concerne la carte de groupe sanguin, les résultats d’analyses biologiques ou les antécédents figurant dans le dossier médical. C’est pourquoi nous faisons une première vérification en demandant une nouvelle fois leur identité aux patients communicants lorsqu’ils arrivent à l’hôpital. S’agissant des patients non communicants, nous sommes obligés de conserver une identité provisoire, qui est consolidée par la suite. Ainsi, après les attentats, un certain nombre d’identités sont restées provisoires dans notre application VICTIMES, qui concentre l’ensemble des informations relatives aux personnes prises en charge. Ces identités ont été consolidées au fil du temps, ce qui a parfois permis d’affiner la réponse que nous avons apportée aux familles.
Au téléphone, il est extrêmement délicat de communiquer des informations concernant un patient si nous ne sommes pas sûrs de l’orthographe de son nom, notamment s’il y a un risque d’homonymie. Car il est tout aussi dramatique de donner une mauvaise réponse que de dire que nous n’avons pas la réponse. Il y a donc un temps incompressible nécessaire à l’identitovigilance, ce qui a entraîné de l’attente pour les familles.
Grâce à l’application VICTIMES, conçue en 2007, nous avons pu récupérer auprès de nos établissements l’ensemble des données qui nous ont permis d’établir les listes de victimes très tôt dans la nuit. Au petit matin, la grande majorité des fiches d’identité étaient consolidées.
Il a été très compliqué pour nous de faire le travail supplémentaire demandé par la CIAV le lundi matin, car il a fallu que nous retournions dans les dossiers des victimes. Les blessés les plus légers étaient déjà sortis. Nous n’avions pas pour habitude de communiquer à des personnes tierces les numéros de téléphone des personnes de confiance et des personnes à contacter. Cela a été un gros travail pour les hôpitaux de les récupérer et de les envoyer à l’ARS à l’attention de la CIAV. Comme il n’existait pas d’autre système, les tableaux ont été réalisés au format Excel. Les intervenants successifs possédant des versions différentes de ce tableur, cela a été source de difficultés techniques pour la CIAV. Pour sa part, l’AP-HP a été en mesure de fournir en paquet l’ensemble des coordonnées et références des victimes prises en charge dans ses établissements.
M. Jean-Luc Laurent. Pouvez-vous expliquer ce qu’est concrètement un plan blanc ? Combien de lits et de véhicules sont mobilisables ? Quelles sont les modalités d’activation ? En tant que président de la commission de surveillance des hôpitaux universitaires Paris-Sud, je ne l’ignore pas, mais il serait utile que vous apportiez des éléments d’information à l’attention du public qui regarde cette audition. Les plans blancs concernent d’ailleurs tous les hôpitaux. Vous en avez rappelé l’esprit, monsieur le directeur général : il s’agit de secourir les victimes d’un événement dramatique et de leur prodiguer des soins, mais aussi de garder des disponibilités pour répondre, le cas échéant, à des besoins ultérieurs.
Combien de personnes blessées se sont présentées de façon spontanée dans les SAU ou les autres services des différents hôpitaux, qu’ils relèvent ou non de l’AP-HP ? On nous a indiqué que des victimes avaient quitté elles-mêmes les lieux des attentats et qu’elles avaient même parfois été encouragées à le faire, pour des raisons de sécurité, lorsqu’elles étaient en mesure de se déplacer.
S’agissant de la prise en charge du traumatisme psychologique, je comprends de vos interventions qu’il n’y a pas de plan d’ensemble, mais que chaque institution – l’AP-HP, le SSA et, éventuellement, d’autres hôpitaux – a pris ses propres dispositions. D’après les échos que j’ai eus, les familles, les victimes et les aidants, mais aussi les personnels de santé, ont besoin d’un soutien et d’un accompagnement en la matière. Quelles sont concrètement les prises en charge mises en place ? Quelles en sont les modalités et la durée ?
Monsieur le directeur central du SSA, une fois que vous avez accompli les actes de médecine ou de chirurgie requis, assurez-vous le suivi des victimes que vous avez prises en charge, ou bien les réorientez-vous vers d’autres hôpitaux ? Dans la seconde hypothèse, combien de personnes ont été réorientées ?
Il est prévu que l’organisation du SSA évolue, et un nouveau plan stratégique de l’AP-HP vient d’être adopté. De votre point de vue, au regard de l’expérience que vous venez de vivre, y a-t-il des réorientations qui s’imposent dans vos institutions dans les semaines ou les mois à venir – à moyens constants, je suppose ?
M. Martin Hirsch. Le plan blanc, c’est un mode opératoire, un ensemble de procédures organisées, qui concerne plusieurs aspects.
Premièrement, il s’agit de pourvoir les besoins en personnel, soit en maintenant sur place les agents présents, soit en en rappelant d’autres. Dans une institution telle que l’AP-HP, il y a d’abord une décision de principe qui est prise pour l’ensemble des établissements ; ensuite, chaque établissement, en fonction de ses spécialités notamment, « décachette » une liste de membres du personnel à rappeler, avec leur qualification et leurs coordonnées. Cela implique une connaissance des spécialités et des métiers de chacun.
Deuxièmement, ainsi que je l’ai évoqué précédemment, il s’agit d’accélérer le circuit des malades déjà pris en charge, par exemple en faisant passer en phase d’hospitalisation ceux qui sont en salle de réveil, ou en faisant sortir plus rapidement ceux dont le départ n’était prévu que pour le lendemain.
Troisièmement, il y a un volet relatif aux questions logistiques, notamment à la fourniture et à la stérilisation du matériel.
Précisons que le « mode d’emploi » est spécifique au contexte : le plan blanc ne sera pas actionné de la même manière selon qu’il s’agit d’un accident ou d’un attentat de tel ou tel type, touchant telle ou telle catégorie de la population.
La prise en charge du traumatisme psychologique est organisée. Depuis environ vingt ans existent les CUMP, dont j’ai parlé, qui sont chacune rattachée à un SAMU. La CUMP du SAMU de Paris a une responsabilité zonale et peut être amenée à coordonner les autres. Dans la nuit du 13 au 14 novembre, le directeur général de la santé a jugé nécessaire de faire appel à des CUMP de province en renfort. Cela a permis d’avoir davantage d’équipes présentes sur place, mais nous avons vu lors des retours d’expérience qu’elles n’avaient pas nécessairement les mêmes modes d’intervention ni les mêmes habitudes de travail. Nous devons donc nous poser la question de l’évolution du dispositif. L’ARS travaille actuellement avec nous et avec les autres acteurs concernés à la réactualisation d’une forme de « plan blanc médico-psychologique ». Car tout n’a pas fonctionné de manière optimale dans cette mobilisation et cette prise en charge : pour le dire de manière caricaturale, à certains endroits, il y avait des professionnels présents mais peu de patients ont été orientés vers eux, tandis que, à d’autres endroits, il y avait des proches des victimes mais pas nécessairement les professionnels nécessaires.
Nous avons eu une discussion à ce sujet avec les élus de la ville de Paris. Ils estiment qu’il vaut mieux installer les lieux d’accueil à proximité immédiate du traumatisme. Cela peut se justifier, mais impose un certain type d’organisation. À l’inverse, on peut considérer qu’il vaut mieux prévoir des lieux disposant de l’ensemble des moyens utiles. Pour notre part, le 13 novembre, nous étions partis sur cette deuxième option, et nous avons dû nous adapter, tant bien que mal, à la première option. Ces options méritent d’être étudiées à nouveau – il était très difficile de le faire pendant la période de crise –, au regard d’impératifs qui ne sont pas nécessairement tous faciles à prendre en compte.
M. le médecin général des armées Jean-Marc Debonne. Je ne peux pas vous dire exactement combien des cinquante-deux patients que nous avons pris en charge sont encore suivis dans les hôpitaux du SSA. Lorsque nous prenons en charge des victimes dans un tel contexte – ce soir-là, elles ont évidemment été amenées dans nos hôpitaux indépendamment de leur volonté –, nous les suivons au moins un certain temps avant de les réorienter vers un circuit plus habituel. Certains des patients que nous avons pris en charge résidaient en province ou, pour trois d’entre eux, à l’étranger. Nous les avons parfois réorientés vers d’autres hôpitaux, quelques-uns étant d’ailleurs dans un état grave. Nous continuons à suivre dans nos hôpitaux ceux qui résident en région parisienne et ceux qui l’ont souhaité.
Je n’ai pas d’éléments complémentaires à apporter concernant le plan blanc.
Une dizaine de blessés sont arrivés par leurs propres moyens dans les hôpitaux militaires. Il s’agissait de blessés légers ou de blessés psychiques.
Je laisse le soin au médecin général inspecteur Vallet, qui est psychiatre et responsable des hôpitaux auprès de moi, de vous exposer la façon dont le SSA s’est organisé, de manière très structurée et depuis un certain temps déjà, pour prendre en charge le traumatisme psychique. On parle beaucoup de chirurgie de guerre et de plaies par balle, mais la dimension psychique de ces blessures est tout à fait essentielle. La prise en charge ne peut être que globale. Le SSA a totalement intégré cette exigence, qui est devenue pour lui une évidence depuis longtemps.
M. le médecin général inspecteur Dominique Vallet. La confrontation à des événements d’une telle ampleur a évidemment des conséquences psychologiques importantes, tant sur les victimes directes que sur les autres personnes impliquées, notamment les sauveteurs. Il faut bien reconnaître qu’il est parfois difficile d’agir sur ces conséquences, les victimes civiles étant par définition très dispersées et constituant une population moins « captive » ou « cernable » que les unités militaires ou le personnel d’un hôpital.
Environ 180 personnes bénéficient actuellement d’un suivi psychologique dans nos trois hôpitaux parisiens. Elles ont pris contact avec nous soit directement dans les hôpitaux le 13 novembre et dans les jours qui ont suivi, soit à travers la cellule d’accueil des familles qui avait été mise en place à l’École militaire, au sein de laquelle nous sommes intervenus pendant trente-six heures.
S’agissant des sauveteurs, le SSA est concerné au premier chef par le personnel de la BSPP, qui a un statut militaire. L’impact des événements sur ces femmes et ces hommes ayant été rapidement perceptible, un plan d’action de grande ampleur a été décidé : les 840 pompiers concernés ont été reçus en entretien individuel par un psychiatre ou un psychologue dans les jours suivants, et 24 % d’entre eux ont souhaité avoir un deuxième entretien. Un plan d’action spécifique a été mis en place à la BSPP : le commandement est formé à la détection d’un certain nombre de signes indirects qui peuvent traduire une souffrance des personnels à distance des événements. En outre, dans le cadre de la médecine du personnel dont disposent ces unités, une procédure particulière de dépistage du traumatisme psychique et de l’état de stress post-traumatique a été mise en place lors des visites médicales périodiques. Elles concernent soit l’ensemble de l’unité, soit des personnels spécifiquement ciblés.
Ces mesures s’inscrivent plus largement dans le cadre d’un plan d’action mis en place depuis trois ans par le SSA en matière de prise en charge des troubles psychotraumatiques. Ce plan prévoit notamment un dépistage systématique lors du débriefing ou du sas de décompression qui suit immédiatement certaines interventions, ainsi que lors des visites médicales annuelles ou bisannuelles que passent les militaires.
Il est essentiel de conserver un regard très attentif sur ces personnels dans la durée, au-delà des événements et au-delà de l’émotion et de l’attention collective qu’ils ont suscitées. La souffrance de ces personnels peut s’exprimer parfois de manière très indirecte, soit au travers de troubles du comportement, qui, en milieu militaire, peuvent éventuellement avoir une traduction disciplinaire, soit au travers d’incidents dans l’exercice technique des fonctions, voire de fautes professionnelles. Ces faits qui, à distance, paraissent se réduire à de simples défaillances du personnel, peuvent être le reflet de sa souffrance psychique. Il est donc très important que les institutions mettent en place des dispositifs qui permettent de suivre ces personnels dans la durée, sans les forcer et en respectant leur intimité. Il faut continuer à offrir une prise en charge, dont les intéressés peuvent se saisir ou non.
En ce qui concerne les victimes civiles, la tâche est plus difficile, je l’ai dit, en raison de leur dispersion et de l’absence de structures « de cohésion » qui permettent d’exercer un regard collectif attentif. Cela rend encore plus nécessaire l’attention de la part de l’ensemble des acteurs de la communauté nationale, notamment dans les secteurs médical et médico-social. Il ne faut pas oublier ce que les gens ont traversé et s’efforcer de ne manquer aucune des occasions dans lesquelles on peut leur apporter une aide, qu’elle soit médicale, médico-sociale ou de l’ordre de la réparation. Outre le suivi de 180 victimes civiles au sein de nos HIA, que j’ai mentionné, nous avons réalisé plus de 60 expertises initiales à distance des événements pour des victimes qui demandent un certificat médical, lequel constitue une reconnaissance de leur souffrance et une première étape vers une réparation de la part de la communauté nationale. En effet, ces victimes peuvent éventuellement solliciter une réparation au titre des pensions militaires d’invalidité ou des pensions civiles, les deux dispositifs étant ouverts à l’ensemble des victimes, civiles comme militaires.
M. le président Georges Fenech. Souhaitez-vous ajouter quelque chose sur l’un ou l’autre des sujets qui ont été abordés, monsieur le médecin en chef Jean-Christophe Bel ?
M. le médecin en chef Jean-Christophe Bel. Non, je n’ai pas d’éléments supplémentaires à apporter.
M. Martin Hirsch. S’agissant des éventuelles réorientations concernant l’organisation de l’AP-HP, le premier enseignement, c’est qu’il faut préserver notre potentiel. Il a été extrêmement sollicité, mais n’a été ni saturé ni désorganisé. Au cours des dernières semaines, j’ai participé à un retour d’expérience devant les ambassadeurs des vingt-sept autres pays de l’Union européenne, et j’ai discuté avec les Américains. Tous les observateurs, qui se sont informés en suivant les actualités ou en consultant les articles scientifiques que nous avons fait paraître, considèrent que nous disposons d’un système de haut niveau, à la fois en termes de capacités, de moyens techniques et de compétences professionnelles. C’est de nature à rassurer les Parisiens et les Franciliens.
M. Jean-Luc Laurent. Nous parlons là de l’Île-de-France…
M. Martin Hirsch. En effet. D’ailleurs, toutes les capitales ne disposent pas d’un service public civil et militaire capable d’apporter une telle réponse sanitaire. Il me semble important de le souligner devant les représentants de la Nation.
Notre défi en matière d’organisation et d’utilisation des moyens, c’est de tenir compte en permanence du fait que des circonstances exceptionnelles peuvent survenir. Cependant, nos réorganisations sont moins dictées par cette exigence que par la nécessité de faire face à la demande de soins au jour le jour. L’un de nos objectifs est de réduire l’attente des patients aux urgences, ainsi que nous l’avons évoqué. Selon moi, il n’y a pas besoin de davantage de services de réanimation ou de centres pour les polytraumatisés en Île-de-France. Encore une fois, nous disposons de capacités fortes, que d’autres métropoles de la même taille peuvent nous envier.
D’autre part, notre préoccupation, c’est que notre « force de frappe » – en personnel, en véhicules, etc. – puisse être mobilisée au cas où d’autres points du territoire seraient touchés. Certes, la probabilité de catastrophes de cette nature est plus élevée en Île-de-France, mais il peut y avoir, un jour, autant de victimes ailleurs en France. Il y a, je le souligne, une solidarité très forte entre les institutions et les professionnels de région parisienne et de province. Elle peut jouer dans les deux sens : de la même manière que des collègues provinciaux nous ont dit qu’ils étaient à notre disposition le 13 novembre, la région Île-de-France sera à leur disposition si nécessaire, non seulement pour les soutenir psychologiquement, mais aussi pour leur apporter une aide organisationnelle et concrète.
M. le médecin général des armées Jean-Marc Debonne. Depuis trois ans, le SSA a engagé une profonde réforme : il met en œuvre son nouveau modèle, baptisé « SSA 2020 ». Celui-ci est caractérisé par deux mots-clés : « concentration » et « ouverture ».
La « concentration » n’est pas un processus inhabituel : toute institution doit s’interroger périodiquement sur l’adéquation de ses ressources à ses missions. Dès 2012, le SSA avait anticipé la nécessité de mettre fin à une certaine dispersion de ses activités, qui était le fruit de l’histoire : le service avait été amené à répondre aux besoins d’une communauté très étendue et à certaines demandes spécifiques, par exemple en matière de médecine tropicale. Aujourd’hui, le SSA recentre ses activités sur les besoins actuels des armées, c’est-à-dire ceux des militaires projetés sur les théâtres d’opérations, qui correspondent aussi à ceux auxquels il faut répondre en situation de crise. Il s’agit en particulier de la traumatologie et de la défense médicale face aux risques nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques (NRBC). Le SSA a une très grande expertise dans ces domaines, en termes non seulement de soins, mais aussi de formation et de recherche.
Corollaire de la concentration, l’ « ouverture » est un principe plus nouveau pour nous. Le SSA a décidé de ne plus assumer seul le soutien médical des forces armées – en tant que directeur central, j’ai estimé qu’il était de ma responsabilité de dire qu’il lui serait de plus en plus difficile de le faire – et a donc proposé de devenir un acteur à part entière des territoires de santé, qui sont actuellement en pleine réorganisation. Il faut que le SSA trouve une juste place au sein de ces territoires de santé. L’article 222 de la loi de modernisation de notre système de santé, qui vient d’être votée, habilite le Gouvernement à prendre des ordonnances à cette fin. Cette loi nous permettra d’aller plus loin. Ainsi que je l’ai indiqué dans mon propos liminaire, conformément à la demande des ministres de la défense et de la santé, un protocole d’accord sera signé très prochainement. L’accord-cadre qui en découlera aura pour objet de bien positionner le SSA en fonction de la contribution qu’il peut apporter sur le territoire national.
Derrière cela, il y a un autre mot-clé, que j’emprunte à l’armée de l’air : « unis pour faire face ». En situation de crise, nous considérons que nous devons travailler ensemble, de manière complémentaire : si la crise a lieu à l’extérieur, le SSA peut avoir besoin, parfois, d’un soutien ; si la crise a lieu sur le territoire national, le SSA peut soutenir les institutions qui ont la responsabilité première d’y répondre. Dans les deux cas, cela fonctionne parfaitement.
Le SSA avait anticipé ces évolutions. Les événements qui se sont produits en 2015 nous ont conduits à accélérer la mise en œuvre de notre nouveau modèle, pour toutes les composantes du service : non seulement l’hôpital, mais aussi la médecine de premier recours militaire, la formation, la recherche et le ravitaillement sanitaire.
M. le président Georges Fenech. Je vous remercie vivement, messieurs, pour votre importante contribution. Elle nourrira notre réflexion, nos travaux et, sans aucun doute, des propositions de notre part, qui iront, je le pense, dans le sens que vous souhaitez.
Audition, ouverte à la presse, de M. Patrice Paoli, directeur de la cellule interministérielle d'aide aux victimes
Compte rendu de l’audition, ouverte à la presse, du lundi 7 mars 2016
M. le président Georges Fenech. Nous recevons aujourd’hui M. Patrice Paoli, directeur de la cellule interministérielle d’aide aux victimes (CIAV). Monsieur le directeur, nous vous remercions d'avoir répondu à la demande d'audition de notre commission d'enquête relative aux moyens mis en œuvre par l'État pour lutter contre le terrorisme depuis le 7 janvier 2015.
Vous savez que nous avons souhaité commencer par entendre les victimes qui ont droit à toute l'attention de la représentation nationale. Nous poursuivons notre série d'auditions avec vous qui dirigez la CIAV. Établie au Quai d'Orsay, dans les locaux du centre de crise et de soutien (CDCS) du ministère des affaires étrangères et du développement international, la CIAV a été mise en place le 12 novembre 2015, conformément à l'instruction interministérielle du même jour, relative à la prise en charge des victimes d'actes de terrorisme. La mission de vos équipes est de constituer, pour les victimes et leurs familles, un interlocuteur exclusif capable de communiquer des réponses à leurs questions ou de les orienter vers les bons experts.
La CIAV se compose de plus de 110 personnes. Ce sont des agents des ministères de la justice, de l'intérieur, de la santé et des affaires étrangères, des professionnels de santé issus notamment de la Croix-Rouge, l'établissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires, de la cellule d'urgence médico-psychologique et de membres d’associations d'aide aux victimes telles que l'Institut national d'aide aux victimes et de médiation (INAVEM) et la Fédération nationale des victimes d'attentats et d'accidents collectifs (FENVAC).
Je rappelle que cette table ronde est ouverte à la presse et fait l'objet d'une retransmission en direct sur le site internet de l'Assemblée nationale ; son enregistrement sera également disponible pendant quelques mois sur le portail vidéo de l'Assemblée nationale, et je vous signale que la commission pourra décider de citer dans son rapport tout ou partie du compte rendu qui sera fait de cette audition.
Je vous laisse la parole pour un exposé liminaire qui sera suivi d’un échange de questions et réponses. Mais, au préalable, conformément aux dispositions de l’article 6 de l’ordonnance du 17 novembre 1958, je dois vous demander de prêter le serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité.
M. Patrice Paoli prête serment.
M. Patrice Paoli, directeur de la cellule interministérielle d’aide aux victimes (CIAV). Je précise que je suis un directeur intermittent puisque la CIAV ne fonctionne pas en permanence ; elle est convoquée par le Premier ministre dans des circonstances particulières.
J’ai suivi avec une grande attention, sur le site internet de l’Assemblée nationale, les débats que vous avez menés jusqu’à présent, en particulier la table ronde consacrée aux victimes et aux associations qui les accompagnent. La douleur indicible des personnes et de leur famille nous incite à la plus grande modestie quand nous faisons face à des situations telles que celle que la France a connue ce 13 novembre 2015 et les jours suivants. Dans mon intervention, je vais évoquer ce que nous avons essayé de faire et les imperfections qui sont apparues lors de la mise en place du système.
Certains de mes collaborateurs m’accompagnent, signe de l’esprit d’équipe qui nous a animés. J’insiste sur ce mot d’équipe et sur cette notion de travail collectif au service de nos concitoyens. Je vous remercie de nous avoir conviés à cette réunion qui nous offre l’occasion de mieux nous connaître.
La CIAV était un objet inconnu ; elle ne s’était jamais réunie. Comme vous l’avez rappelé, monsieur le président, elle a été créée par une instruction interministérielle signée le 12 novembre dernier. Elle a été activée pour la première fois le lendemain, à la demande du conseil des ministres, à la suite des attentats, c’est-à-dire le 13 novembre 2016. Cette cellule interministérielle, inventée dans l’urgence, rassemble des personnels de quatre ministères – justice, intérieur, santé et affaires étrangères –, les associations FENVAC et INAVEM, et aussi le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) qui en est un acteur indispensable.
La CIAV est issue des réflexions menées au niveau interministériel après les attentats de janvier 2015, qui ont abouti à la signature de cette instruction, le 12 novembre 2015. J’imagine que vous allez m’interroger sur les difficultés de sa mise en place, un thème abordé par toutes les personnes auditionnées. Au fil des heures, nous avons réussi à créer une équipe véritablement solidaire. C’est un organisme ad hoc qui dépersonnalise ceux qui y viennent : nous représentons la CIAV, quels que soient nos ministères ou organismes d’origine. La CIAV est l’objet que nous devions créer et je pense que nous avons réussi à lui donner vie.
À partir du moment où la réponse téléphonique a été localisée chez elle, la CIAV a reçu 11 300 appels – je ne compte pas les communications sortantes. Quelque 120 agents ont été mobilisés en permanence pendant environ quinze jours, et ce nombre a atteint 160 durant les derniers jours, lorsque nous avons été chargés de préparer la cérémonie d’hommage national qui a exprimé la solidarité de la nation avec les victimes et leurs familles.
La CIAV a fini par fonctionner, j’y insiste. Elle a trouvé peu à peu son rythme, car il y avait des précédents sur lesquels nous pouvions nous appuyer : d’une part, les retours d’expérience des heures douloureuses que nous avons connues lors des attentats du mois de janvier ; d’autre part, les habitudes de travail acquises, souvent dans un cadre interministériel, lors des crises internationales dans lesquelles nous assurons précisément le soutien aux victimes. En cas d’attentats, nous sommes exclusivement chargés de l’assistance aux victimes, et nous n’intervenons pas dans les enquêtes ou le travail technique qui a été décrit par plusieurs des personnes que vous avez déjà auditionnées.
L’un des principes à établir rapidement – qui a été conforté dès la visite du Premier ministre au CDCS – est celui des trois unités : de lieu, de direction et d’équipe. Cependant, nous avons été confrontés d’emblée à la nécessité de rompre avec ce principe prévu par la circulaire interministérielle, pour nous adapter aux circonstances, aux besoins du moment, en ouvrant un centre d’accueil physique à l’École militaire et un dispositif d’accueil et d’accompagnement des familles à l’institut médico-légal de Paris. La CIAV a coordonné ces dispositifs qui n’étaient pas prévus au départ. Les premières heures ont été occupées par la mise en place du dispositif, par la constitution d’équipes capables de le faire fonctionner, afin de répondre à l’attente des familles. Dès le samedi 14 novembre, nous avons pu essayer d’accomplir au mieux les missions qui nous étaient dévolues : centralisation des informations concernant l’état des victimes ; information et accompagnement des proches ; coordination de l’action des ministères intervenant en relation avec les associations et avec le parquet ; préparation de la cérémonie d’hommage.
En ce qui concerne l’accompagnement, j’ai pu constater que les victimes et leurs proches demandent du soutien psychologique et une assistance pour accéder à leurs droits, notamment en matière d’indemnisations. Ils demandent aussi à être épaulés dans les démarches administratives, notamment celles qui sont liées à un décès.
Pour fonctionner, la CIAV a besoin d’un carburant : les coordonnées des victimes et de leurs proches. C’est précisément ce qui a été un angle mort pendant les premières heures. La contribution des hôpitaux est décisive. Il a fallu créer une culture commune avec des agents de l’État, des personnels hospitaliers de toutes provenances, qui n’avaient pas l’habitude de ce travail en commun ni des procédures nouvelles qui ont été adaptées dans l’urgence.
Après la cérémonie d’hommage aux Invalides, nous avons passé le relais au comité de suivi des victimes, qui a été mis en place dès le 27 novembre. Installé au ministère de la justice, ce comité est placé sous l’autorité de Mme Juliette Méadel, secrétaire d’État chargée de l’aide aux victimes.
J’en viens à quelques éléments de bilan pour introduire notre débat. L’unité de direction, d’équipe et de lieu a été consacrée au cours des réunions organisées sous l’autorité du Premier ministre. Le 11 décembre, nous avons procédé à un premier retour d’expérience pour confirmer que la CIAV devait bien être hébergée et pilotée par l’équipe en place au CDCS.
Deuxième enseignement : le recueil des informations nécessaires doit être centralisé. Selon l’instruction qui est en cours de révision et qui devrait être prochainement signée, la réponse téléphonique, qui a été un peu hoquetante au départ, doit être localisée directement à la CIAV. Si, par malheur, des nouveaux actes terroristes devaient survenir sur notre territoire, la réponse téléphonique serait immédiatement confiée à la CIAV.
Un autre problème a été soulevé, à juste titre, par les victimes : le choix d’un numéro en 800 ne permettait pas l’accès des appelants de l’étranger. Nous avons donc mis en place, aussi vite que possible, un numéro dédié qui permettra de recevoir les appels de l’étranger à l’avenir. Nous ne souhaitons pas avoir à l’utiliser mais, si de telles occurrences devaient se reproduire, un numéro ordinaire permettrait à tout le monde d’avoir directement accès à la cellule.
La prochaine instruction va consacrer l’École militaire comme lieu d’accueil pour les victimes à Paris, placé sous l’autorité de la CIAV et coordonné par elle. Le dispositif de l’École militaire, créé dès le samedi 14 novembre, avait été annoncé avant sa mise en place. Des familles ont alors afflué vers un centre qui n’était pas encore opérationnel, ce qui a causé des difficultés. De même, la CIAV structurera l’accueil des familles à l’Institut médico-légal de Paris ou des autres instituts médicaux qui seraient chargés de l’identification afin de gagner du temps.
Une autre question se pose, même si elle ne relève pas de la CIAV : les moyens du FGTI à terme. Si le FGTI est appelé à indemniser un nombre de croissant de personnes, il faudra qu’il puisse faire face à ces exigences.
Les réflexions sur l’adaptation du dispositif ont aussi conduit à envisager l’hypothèse où des attentats surviendraient à la fois dans Paris et hors de Paris. L’idée, qui est arrivée à un stade de maturation avancé, est de désigner dans chaque préfecture une personne qui serait au fait des procédures. Ce correspondant pourrait prendre les premières dispositions, concernant les lieux d’accueil des familles et les instituts médico-légaux notamment, en attendant qu’une équipe de la CIAV arrive sur place dans un délai qui ne devrait pas excéder quelques heures.
L’hypothèse d’attentats concernant à la fois la France et des ressortissants Français à l’étranger a aussi été examinée. En fait, elle est concrète puisque, le 20 novembre dernier, un attentat a eu lieu dans un hôtel de Bamako où se trouvait de nombreux Français. Nous avons installé une cellule de crise dans nos salles pour traiter concomitamment cette attaque et les attentats du 13 novembre. Nous avons pu la désactiver rapidement car, chance inouïe, aucun Français n’a été victime de cette attaque. Nous devons néanmoins envisager le cas où des événements nécessiteraient une mobilisation importante dans différents théâtres d’intervention.
Les attaques qui ont conduit à l’activation de la CIAV sont d’une portée d’une ampleur nouvelle, inédite. Nous avons donc dû nous adapter. Personnellement, je trouve que la mobilisation – des hommes et des pouvoirs publics – a été exemplaire, même si elle n'a pas été parfaite, loin de là. Il n’était pas évident de réunir d’emblée toutes les compétences de l’État dans un organisme dont le fonctionnement est unique.
En guise de conclusion à ce propos liminaire, je vais un peu résumer notre travail post-attentat. Tout d’abord, nous tendons à adapter l’instruction interministérielle pour la rendre opérationnelle et corriger les imperfections décelées. Des retours d’expérience ont eu lieu dans les divers ministères. Pour notre part, nous avons participé à un retour d’expérience au ministère de la santé où j’ai rencontré M. Georges Salines, un président d’association avec lequel j’ai établi un contact. Dans les jours qui viennent, je vais présenter nos réflexions pour l’avenir à M. Salines et aux autres représentants d’association.
J’ai déjà dit un mot de la réflexion que nous conduisons sur le lien entre Paris et les autres villes. Nous voulons aussi qu’à l’intérieur de la CIAV, chacun connaisse mieux les cultures et les procédures des autres. Nous avons donc entamé un travail de connaissance systématique et pointilleux avec la police technique et scientifique de Lyon, avec la préfecture de police qui nous a rendu visite récemment et avec qui nous avons partagé nos expériences, avec les associations. L’objectif est de limiter les incertitudes. Pour cela, outre le travail de conceptualisation et d’adaptation de l’outil, nous devons faire des exercices sur le plan interministériel. Avant que ne soit consacrée totalement la nouvelle instruction interministérielle, nous devons avoir testé et vérifié le bon fonctionnement de la CIAV.
M. le président Georges Fenech. Je note, mais c’est le hasard tragique du calendrier, que la CIAV a été créée le 12 novembre 2015, c’est-à-dire à la veille des attentats. Il est assez troublant de constater cette concomitance.
S’agissant du lieu de prise en charge des victimes, il a été décidé dans l’urgence que ce serait l’École militaire. Lors de son audition, M. Martin Hirsch, le directeur de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), a suggéré de configurer l’Hôtel-Dieu pour en faire ce lieu unique de prise en charge. Quel est votre avis ?
M. Patrice Paoli. À ce stade, je n’ai plus d’avis puisque cette question a été tranchée : dans l’instruction interministérielle, qui est en voie de finalisation avec la contribution de tous les services impliqués, l’École militaire a été retenue comme lieu de prise en charge à Paris. Avec les équipes de M. Le Drian et de Mme Méadel, nous sommes allés voir la semaine dernière comment il était possible d’améliorer l’aménagement et l’organisation de ce lieu.
M. le président Georges Fenech. Pourriez-vous nous donner un peu plus de précisions sur les méthodes et les moyens qui sont à votre disposition pour identifier les victimes ?
M. Patrice Paoli. L’identification des victimes n’est pas du ressort de la CIAV. Dans un premier temps, la cellule doit recenser tous les appels qu’elle reçoit. Tous les appels sont considérés comme pertinents et sont enregistrés sur un logiciel où nous devons veiller à inscrire les coordonnées des gens, ce qui nous permettra de les rappeler et d’échanger des informations avec les familles. Ce recueil d’informations ne sert pas à l’enquête qui est centralisée au ministère de l’intérieur. Dans un deuxième temps, les cas sont ventilés en trois catégories : les décédés, les blessés, les autres personnes impliquées et éventuellement éligibles à une indemnité après examen de leur situation par le parquet.
Le lieu d’accueil des victimes, établi à l’École militaire, dispose d’une cellule ante morten. Elle sera désormais organisée d’emblée de manière cohérente et solidaire, et elle recueillera toutes les données que les familles pourront avoir à porter à la connaissance des autorités : signes distinctifs, tatouages, etc. Aucune méthode ne sera exclue pour identifier les victimes. Le travail d’identification proprement dit s’effectuera dans les instituts médico-légaux requis. La collecte de tous ces éléments permet de resserrer petit à petit le cercle des investigations.
M. le président Georges Fenech. Lors des premières auditions, une personne nous a raconté la manière dont on lui a annoncé la mort d’un proche dans les attentats. Elle nous a fait part du choc et de l’émotion ressentis lorsque la personne, au bout du fil, lui a annoncé le décès de ce parent avant de lui souhaiter une bonne soirée. Il s’agit là sans doute d’un manque de formation, d’expérience. Votre organisation actuelle permet-elle de corriger ce genre de choses ?
M. Patrice Paoli. La communication de ce genre d’information aux proches ne se fait pas par téléphone et respecte des règles extrêmement précises. C’est un officier de police judiciaire (OPJ) qui doit annoncer la nouvelle, sauf exceptions prévues par les textes et motivées par des raisons humaines et non pas administratives. Dans ces derniers cas, il s’agit de protéger les familles de la diffusion de nouvelles par les médias ou les réseaux sociaux, dont vous avez eu des témoignages, me semble-t-il. On ne peut faire entorse à la règle que pour des raisons humaines, psychologiques.
Nous savons la douleur indicible des proches, mais ce système est mis en place par des hommes et des femmes. Tout ne fonctionne pas toujours parfaitement. Dans l’urgence, face à l’ampleur et au caractère inédit de ces événements en France, il y a certainement eu des couacs.
Si nous avons insisté pour que l’information soit centralisée, ce n’était pas par souci de défendre un territoire : la CIAV respecte des procédures qui offrent des garanties, mais elles peuvent prendre du temps et donc être contestées par les familles. Une information ne peut pas être donnée tant qu’elle n’a pas été vérifiée. Nous avons le même problème avec les procédures d’identification. Pour répondre vite, il a été décidé d’accélérer les procédures autant que possible. Il est difficile de concilier deux exigences en partie contradictoires : informer au plus vite par humanité ; prendre le temps de respecter les procédures pour être sûr de donner la bonne information.
M. Sébastien Pietrasanta, rapporteur. À plusieurs reprises, vous avez évoqué l’unité de lieu, de direction et d’équipe, et vous avez fait référence au fait que, durant les vingt-quatre premières heures au moins, la gestion des appels téléphoniques était assurée par la préfecture de police et non pas par la CIAV. Je peux imaginer que cette dissociation – accueil téléphonique à la préfecture de police et la gestion du suivi des appels au ministère des affaires étrangères – ait pu causer des difficultés d’organisation. Qui a pris cette décision de dissocier les lieux ? Est-ce que cela a été un véritable handicap ?
Il a été dit que le standard téléphonique de la préfecture de police a sauté à quatre reprises entre le 13 et le 14 novembre. La CIAV était-elle suffisamment équipée pour gérer le flux téléphonique ? Les 11 300 appels reçus dont vous avez parlé comprennent-ils aussi ceux qui ont été gérés par la préfecture de police ? La CIAV était-elle suffisamment dotée pour gérer les appels ? Si oui, pour quelle raison et par qui a été prise la décision d’envoyer les appels vers la préfecture de police ?
À partir de quelle heure et par quelle autorité la CIAV a-t-elle été mobilisée ? En combien de temps avez-vous pu mobiliser le personnel ? Comme vous l’avez rappelé dans votre propos liminaire, plus d’une centaine de fonctionnaires – notamment du ministère des affaires étrangères – et de bénévoles ont été sollicités.
À partir de quelle heure la CIAV a-t-elle commencé à récupérer en direct les appels téléphoniques ?
Lors de l’audition de Martin Hirsch, le directeur de l’AP-HP, il a été dit que vous aviez demandé les numéros de portables des victimes hospitalisées le lundi matin. Pour quelle raison et dans quel but ?
Lors du retour d’expérience, forcément utile puisque vous continuez à évoluer, avez-vous pointé d’autres véritables difficultés que celles concernant l’accueil téléphonique ?
M. Patrice Paoli. En ce qui concerne l’activation de la CIAV, en fait, nous sommes tous allés au centre de crise dès que nous avons été informés des attentats. Nous y sommes allés parce que les circonstances l’exigeaient, sans nous préoccuper de lire l’instruction sur la CIAV qui n’avait été signée que la veille et que nous n’avions pas encore. La cellule interministérielle a été ensuite activée dans la soirée, à l’issue d’un conseil des ministres extraordinaire et donc par une décision du Premier ministre. Je n’ai pas l’heure exacte. Nous étions déjà sur place et nous avions déjà commencé à faire appel aux personnels volontaires que nous mobilisons régulièrement, en particulier les personnels de la Croix-Rouge. La CIAV s’est constituée progressivement. Il a dû s’écouler une heure et demie entre l’annonce des attentats et la mise en place d’une structure qui commençait à être opérationnelle, constituée des premiers volontaires et des équipes du centre de crise avant que les personnels des autres ministères ne commencent à arriver.
L’instruction interministérielle du 12 novembre prévoyait que les appels téléphoniques arrivent à la préfecture de police. Le texte a donc été appliqué tel qu’il était prévu. Je n’étais pas moi-même à la préfecture de police et je ne sais pas quels moyens y ont été déployés mais il y a effectivement eu une saturation des lignes. Nous sommes restés en contact avec la préfecture tout au long des premières heures pour voir comment nous pouvions régler les problèmes d’accès.
À cet égard, je reviens sur cette question de culture commune et sur le fait que nous avons demandé le numéro de téléphone des victimes des attentats. Il ne s’agit pas seulement de répondre à tous appels ; nous devons aussi le faire de manière à pouvoir assurer un suivi des victimes. Comment pouvons-nous les joindre ? Telle est la première question à laquelle nous devons répondre. Pour traiter les appels, nous utilisons le logiciel Crisenet qui n’est pas à la disposition de tous les ministères et qui n’était pas en place à la préfecture de police. Ce logiciel permet d’enregistrer les demandes et les coordonnées des personnes. Ce premier appel que nous recevons n’a de valeur que si nous pouvons le suivre car la relation avec les victimes et leurs proches est interactive.
Dans la matinée du samedi 14 novembre, il devait être à peu près neuf heures, il a été décidé de basculer les appels vers la CIAV, comme je l’avais demandé. J’étais en communication avec notre directeur de cabinet qui nous représentait au centre interministériel de crise à la place Beauvau. L’opération a pris quelques heures, et la réponse téléphonique nous a été définitivement attribuée à dix-neuf heures le samedi 14 novembre. Nous avons alors pu commencer à fonctionner. En creux, on peut deviner la saturation mentale ou morale de personnes en détresse qui, n’ayant pas pu avoir accès à cette réponse téléphonique dans des conditions souhaitables, ont peut-être été découragées. Mais la cellule téléphonique a opéré dès que nous avons pu prendre le relais.
Je reviens sur la question suscitée par l’audition de Martin Hirsch et à laquelle j’ai déjà partiellement répondu. Effectivement, il n’est pas dans les habitudes d’un établissement hospitalier de communiquer les coordonnées téléphoniques de ses patients mais, pour notre part, nous ne pouvons pas travailler si nous n’avons pas ces numéros. Ils nous sont nécessaires pour informer les gens de leurs droits, pour assurer le suivi des dossiers et, tout bêtement, pour que personne ne soit laissé de côté lors de la cérémonie d’hommage. Ces numéros sont le carburant du centre de crise et du CIAV.
M. le rapporteur. L’instruction du 12 novembre prévoyait que l’accueil téléphonique se fasse à la préfecture de police. Qu’est-ce qui a motivé cette dissociation physique entre le centre d’appel et la CIAV ? Ensuite, l’accueil téléphonique a été transféré à la CIAV. Mais il s’est écoulé un laps de temps important entre le moment où la cellule a été active, c'est-à-dire partir de vingt-trois heures ou vingt-trois heures trente le vendredi soir, et la récupération de l’accueil téléphonique à dix-neuf heures le lendemain. Dans cet intervalle, il y a forcément eu un afflux d’appels. Étiez-vous suffisamment dotés ? Quelles difficultés avez-vous rencontrées ?
Pourriez-vous nous en dire un peu plus sur le logiciel Crisenet que vous venez d’évoquer ? Lors des auditions, les uns et les autres nous ont parlé de tableaux en format Excel qui avaient du mal à transiter. L’AP-HP nous a ainsi expliqué que leurs tableaux arrivaient déformés à la CIAV, que les lignes ne correspondaient plus forcément au modèle de départ, etc. Est-ce lié à l’utilisation de ce logiciel ? La question peut paraître anecdotique mais elle a été soulevée à de nombreuses reprises, notamment par les victimes et des associations qui les représentent.
M. Patrice Paoli. Au contraire, c’est une excellente question. Nous nous posons en permanence la question de la compatibilité des outils. Nous avons découvert des choses que nous ne connaissions pas, auxquelles nous n’avions pas pensé. Je le répète, il faut créer une culture commune.
La réponse téléphonique avait été conçue ainsi parce que l’événement était survenu en France, à Paris en l’occurrence. Il y avait des raisons de faire comme ça. Pour ma part, je suis arrivé en cours de négociation, quand j’ai pris mes fonctions au centre de crise, à un moment où un certain nombre de choses étaient déjà écrites. Personne n’a pensé que ça pourrait poser un problème. Il se trouve qu’il y en a eu un, sous l’effet de l’afflux. Je ne suis pas là pour juger et pour compter les points. Nous travaillons tous ensemble. Pendant toute la journée du samedi, nous avons été en relation avec le préfet de police et ses équipes pour régler ce problème technique.
Pour le reste, il y a des méthodes de recueil d’information. Le logiciel Crisenet a été créé pour traiter des événements survenant à l’étranger et gérés par le CDCS. Il s’agissait de recueillir la matière première indispensable, c'est-à-dire les bonnes données pour pouvoir fonctionner. La réflexion interministérielle en cours va permettre d’améliorer le système. Qui dit nouvelle mission, dit aussi nouveaux moyens : le CIAV va faire appel à des programmistes pour adapter les outils et faire en sorte qu’ils soient parfaitement compatibles entre eux, car nous avons en effet rencontré des problèmes de compatibilité ou simplement de transfert de données. À certains moments, c’était difficile. Nous avons réussi à surmonter ces difficultés. C’est cela aussi une cellule de crise : vous ne savez pas comment les choses vont se présenter ; vous devez vous adapter en permanence pour répondre à des questions qui n’avaient été ni posées ni même imaginées. À l’avenir, les logiciels devraient donc être interopérables et nous devrions ne plus rencontrer ce genre de problèmes.
L’un des points identifié est en lien direct avec votre question : la remontée des informations des établissements hospitaliers. Un établissement hospitalier n’a pas nécessairement pour principe de communiquer tel ou tel type de donnée. Pour fournir certaines informations, il utilise des procédures qui le contraignent à passer par l’Agence régionale de santé (ARS) dont il dépend, etc. Or nous avons eu besoin de récupérer des données directement et les systèmes de transmission n’étaient pas nécessairement adaptés.
Je n’ai pas à me prononcer sur la façon dont les blessés ont été accueillis dans les hôpitaux. Je pense qu’ils l’ont été dans des conditions extrêmement rudes et difficiles. Les bons réflexes n’étaient pas forcément acquis et partagés. Mais cette culture commune est en train de se créer. C’est ce qui me frappe dans les retours d’expériences et les réunions interministérielles que nous avons eus depuis le 27 novembre. Dans les réunions, tout le monde sait maintenant quel est notre travail, quels sont nos objectifs et les moyens de les atteindre. Nous sommes donc en train de corriger tous ces problèmes potentiels.
M. le président Georges Fenech. La Commission d’enquête peut-elle considérer que vous êtes au fond le guichet unique réclamé par les victimes afin de faciliter toutes leurs formalités sanitaires, administratives et juridiques ? Êtes-vous ce guichet unique en cours de constitution ?
M. Patrice Paoli. C’était l’objectif visé lors de la création de la CIAV. L’instruction du 12 novembre visait à créer un guichet unique, rassemblant des intervenants en quelque sorte dépersonnalisés sur le plan administratif : les agents réfèrent au directeur de la CIAV et non pas à leur ministère. La CIAV est donc pleinement en charge. Depuis l’hommage national, nous avons cédé la place au comité de suivi, mais pendant toute la durée de cette expérience douloureuse, entre le 13 et le 27 novembre, nous avons constaté que les victimes et les associations réclamaient ce guichet unique. Nous sommes en parfaite harmonie sur ce point et notre objectif était effectivement d’être pour elles ce guichet unique.
À l’avenir, à Dieu ne plaise, ce guichet unique devra permettre de recueillir tous les appels téléphoniques dès la première heure mais également d’encadrer et d’organiser l’accueil des familles à l’École militaire et dans les instituts médico-légaux qui seraient mobilisés. En novembre, nous étions un peu dans une course contre la montre pour adapter des choses qui n’étaient pas encore complètement conceptualisées.
M. Jean-Luc Laurent. La vocation de la CIAV était de devenir un guichet unique mais pendant quelle durée, jusqu’à quel stade ? Comment s’effectue le passage de relais avec le comité de suivi dont vous avez parlé ?
La CIAV s’occupe de la prise en charge et de l’assistance des victimes. Concrètement, que faites-vous après le travail d’identification et d’accompagnement vers les instituts médico-légaux ou les différents instituts ? Au cours des travaux de notre commission d’enquête, il est apparu qu’il existait une forte demande d’accompagnement dans la durée, au-delà de l’hommage national, pour tout ce qui concerne notamment les démarches d’indemnisation et l’aide psychologique. Le guichet unique est-il organisé pour répondre à ces demandes dans la durée ou pour assurer une mission de coordination avec le comité de suivi et les structures médicales ?
L’identification a été effectuée par l’Institut médico-légal de Paris. Pourquoi ne pas avoir fait appel à d’autres instituts afin d’accélérer l’identification ?
M. Patrice Paoli. Tout d’abord, je vais revenir un peu en arrière parce que j’ai omis de mentionner un élément concernant les numéros de téléphone des blessés, que nous demandions. Ces numéros vont alimenter la liste unique de victimes (LUV), établie sous l’égide du procureur de la République, qui servira notamment de base aux travaux du FGTI.
Jusqu’où va la CIAV ? Dans les textes et dans la pratique, il y a très clairement deux temps : le travail dans l’urgence qui est celui de la CIAV ; le travail dans la durée qui est celui du comité de suivi. La CIAV a cessé de fonctionner de manière opérationnelle après la cérémonie d’hommage. Dès l’après-midi du vendredi 27 novembre, une réunion s’est tenue sous l’égide de Mme Taubira, garde des sceaux à l’époque, afin de créer le comité de suivi. En tant que directeur de la CIAV, je n’en suis pas responsable. Ce comité est localisé au ministère de la justice et placé sous la présidence de la secrétaire d’État chargée de l’aide aux victimes. La CIAV alimente le comité de suivi de toute l’information qu’elle a recueillie. Le service de l'accès au droit et à la justice et de l'aide aux victimes (SADJAV) quitte la CIAV pour le comité de suivi avec toutes ces données, afin d’assurer la continuité. Nous communiquons tout ce dont nous disposons.
Vous avez raison de le souligner, le grand enjeu pour les pouvoirs publics est maintenant de réussir à créer cette structure capable d’assurer le suivi avec empathie et humanité. Au centre de crise du ministère des affaires étrangères, nous avons une expérience, à petite échelle, de ce genre de situation. Nous y suivons dans la durée les ex-otages, par exemple, que nous recevons et que nous assistons notamment dans leur relation avec le FGTI. Les témoignages ont montré que les victimes de tels événements sont durablement choquées et ont besoin d’assistance.
Nous cédons toutes les informations que nous avons au comité de suivi. J’en reviens, encore et toujours, à ce qui est essentiel : les coordonnées, la capacité de joindre les victimes à toute heure, afin d’assurer ce suivi et de répondre à leurs questions. Il faut aussi être capable d’informer sur les procédures. Nous avons mis au point des documents qui n’existaient pas sous cette forme auparavant : des fiches récapitulant les procédures à suivre ; les coordonnées des établissements de santé, des structures de soutien psychologique, du FGTI, etc. Ce compendium de données a été créé dans l’urgence. Restons modestes, mais il y a maintenant un outil, un fond de documentation et de pratiques. Il faut maintenant donner toute sa pertinence au comité de suivi, dont la tâche est d’accompagner toutes ces personnes avec empathie.
Venons-en aux instituts médico-légaux. Le choix de l’établissement chargé de l’identification des victimes relève du procureur de la République. Dans le cas d’espèce, l’Institut médico-légal de Paris a été retenu comme le lieu de centralisation des victimes en vue de leur identification. À l’avenir, l’une des questions posées est de savoir comment l’on pourrait accélérer les procédures en répartissant la tâche entre diverses structures, qu’il s’agisse d’instituts médico-légaux ou d’autres établissements qui peuvent exister au sein de la gendarmerie nationale ou d’autres services.
M. le président Georges Fenech. Nous aurons d’ailleurs l’occasion, chers collègues, d’auditionner les responsables de l’institut médico-légal.
M. Michel Lefait. Monsieur le directeur, en préambule de votre intervention, vous avez fait état des tâtonnements bien compréhensibles de cette nouvelle instance qu’est la CIAV. Vous avez également esquissé quelques pistes d’amélioration très intéressantes. Avez-vous d’autres suggestions ou souhaits à émettre pour perfectionner encore la structure que vous dirigez ?
M. Patrice Paoli. Merci de votre question. Il est toujours possible d’améliorer les choses même si toute institution humaine conserve un degré d’incertitude. La perfection n’est pas humaine. Je voudrais d’ailleurs profiter de l’occasion pour saluer le travail fantastique qui a été effectué par tous les volontaires, tous les personnels des divers instituts, confrontés à la douleur des familles et aux difficultés.
Que demander ? En premier lieu, j’insisterais sur cette culture commune créée avec tous les ministères qui ne connaissaient rien de la CIAV avant qu’elle ne commence à fonctionner, aux premières heures qui ont suivi les attentats. C’est maintenant un réflexe pour eux de s’articuler avec la CIAV, le lieu unique de traitement qui fédère toutes les énergies et les compétences.
Il faut consolider ce travail et, dès à présent, faire des exercices. Une mise à l’épreuve pratique permet de s’assurer que le dispositif est fonctionnel, que les uns et les autres ont bien compris les changements de base et les adaptations culturelles qu’implique la CIAV dans les mentalités et dans les procédures. De tels exercices permettent, par exemple, d’identifier avec précision toutes les mesures à prendre pour bien canaliser les personnes vers l’École militaire, telle préfecture ou tel autre lieu déterminé.
En deuxième lieu, il y a la question des moyens. Nous avons obtenu l’augmentation de nos moyens, notamment en matière de capacité téléphonique. Nous pouvons mobiliser immédiatement soixante-cinq téléphones, à condition de disposer aussi des personnels capables de les utiliser, qui mettraient sans doute environ deux heures à arriver. Au plus fort de l’urgence, nous avions jusqu'à 120 téléphones en fonctionnement. Il ne s’agit pas de créer partout des salles téléphoniques. Ce sont plutôt des bureaux avec des postes débrayables, comme il en existe au centre de crise.
D’autres moyens ne nous ont pas encore été affectés en totalité pour armer, pardonnez-moi l’expression, les comités de suivi et notamment le nôtre. Il existe des besoins en personnels : magistrats au fait des procédures ; personnels médicaux capables de définir les moyens psychologiques, même si nous nous appuyons sur les cellules d'urgence médico-psychologique (CUMP) et d’autres organismes ; spécialistes des services de gestion d’urgence auxquels appartiennent les trois collègues qui m’accompagnent, afin de pouvoir envoyer des gens expérimentés vers les préfectures. Nous avons aussi besoin d’argent pour financer nos outils techniques tels que ces nouveaux logiciels qui doivent être compatibles avec ceux de nos partenaires.
M. le président Georges Fenech. Vous avez parlé de 110 personnes à la CIAV. Est-ce que ce sont des personnels permanents, détachés de leur ministère ?
M. Patrice Paoli. En moyenne, nous étions entre 110 et 120 présents au CIAV. Pour être honnête, au début, nous ne savions pas combien nous étions. Dans l’urgence, nous n’avons pas commencé par établir une comptabilité. Nous avons créé un outil et mis au point, petit à petit, un système d’enregistrement avec des badges. Il y avait donc en permanence quelque 120 personnels présents, jamais les mêmes évidemment, puisqu’il y avait une rotation. Au moment de la préparation de la cérémonie d’hommage, nous sommes montés jusqu’à 160. Lors des retours d’expérience, nous avons partagé les organigrammes de la CIAV avec tous les ministères. Nous leur avons surtout fourni une feuille où sont récapitulés nos besoins en personnels pour armer chaque cellule, sachant que l’une est chargée du suivi des décédés, l’autre des blessés, l’autre du soutien psychologique, etc.
Pour qu’il y ait des personnels suffisants pour alimenter cette rotation – la tâche est très éprouvante – nous avons des correspondants dans chaque entité qui participe à la CIAV, chargés de constituer un vivier. Le chiffre de 120 correspond à des événements d’une ampleur comparable à ceux du 13 novembre, ce n’est pas une donnée absolue. Selon l’instruction interministérielle, j’établis les besoins avec mon équipe, et les personnels sont envoyés par les ministères.
M. le rapporteur. Lors des attentats du 13 novembre, les réseaux sociaux ont joué un rôle particulier en ce qui concerne la recherche d’identification. Un hashtag #RechercheParis a été créé. Avez-vous abordé ce phénomène dans vos réflexions et lors des retours d’expérience ? Selon vous, les réseaux sociaux ont-ils constitué un handicap ou une aide ?
Dans le cadre de cette commission d’enquête, nous allons nous intéresser au risque d’attentat en province. Vous nous avez indiqué que vous allez travailler avec les préfectures et voir comment la CIAV pouvait se projeter en province. Où en est votre réflexion en la matière ? Dans cette hypothèse, la CIAV resterait-elle physiquement au sein du ministère des affaires étrangères ou serait-elle partiellement détachée dans la préfecture concernée ? Pourriez-vous nous en dire un peu plus sur la manière dont un attentat pourrait être géré en province ?
M. Patrice Paoli. Les réseaux sociaux sont un fait ; ce sont des médias qui existent et dont nous devons tenir compte. Nous avons réfléchi à la manière dont nous pourrions les utiliser pour recueillir des informations, et avoir une adresse internet en plus du numéro de téléphone. Les réseaux sociaux sont aussi un moyen de diffuser de l’information. C’est une hypothèse qui est bien entendu présente à notre esprit et envisagée.
Quant à l’idée de cellules projetées dans les préfectures en cas d’attentats en province, elle est très avancée. À Paris, les cellules projetées sont l’École militaire et l’Institut médico-légal – et éventuellement d’autres instituts mobilisés. Pour la province, nous sommes en train de finaliser un modus operandi : la préfecture identifie la nature des besoins et les tâches à accomplir ; nous envoyons une équipe de deux personnes, un encadrant et un opérationnel, afin d’aider et de permettre une bonne liaison avec le centre qui resterait à Paris. C’est ce qui est envisagé pour le moment.
M. le président Georges Fenech. Il me reste à vous remercier, monsieur le directeur, pour votre importante contribution à nos travaux.
Audition, ouverte à la presse, de M. Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur
Compte rendu de l’audition, ouverte à la presse, du lundi 7 mars 2016
M. le président Georges Fenech. Monsieur le ministre de l’intérieur, nous vous remercions d'avoir répondu à la demande d'audition de notre commission d'enquête relative aux moyens mis en œuvre par l’État pour lutter contre le terrorisme depuis le 7 janvier 2015.
Nous avons commencé nos travaux depuis un mois environ et nous avons déjà procédé à plusieurs auditions, consacrées à entendre les victimes, leurs conseils ou les responsables des services qui sont appelés à les prendre en charge : le directeur général de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, le directeur central du service de santé des armées, ou, à l'instant, le directeur de la cellule interministérielle d'aide aux victimes (CIAV). Nous entendrons prochainement le général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et le directeur médical du SAMU.
À cette étape de nos travaux, nous avons pensé utile de vous entendre, monsieur le ministre, essentiellement sur les questions relatives à la conduite des opérations, à l'intervention des forces de l'ordre et aux moyens mis à leur disposition. Les questions relatives au renseignement seront traitées plus tard, au mois de mai, et nous vous demanderons de revenir à ce sujet devant la commission d'enquête, conformément à ce dont nous étions convenus.
Cette audition est ouverte à la presse et fait l'objet d'une retransmission en direct sur le site internet de l'Assemblée nationale ; son enregistrement sera également disponible pendant quelques mois sur le portail vidéo de l'Assemblée nationale et la Commission pourra décider de citer dans son rapport tout ou partie du compte rendu qui sera fait de cette audition. Nous avons en effet décidé que, d'une manière générale, quand cela ne soulèvera pas de difficulté, pour les personnes entendues ou au regard de la confidentialité des informations recueillies, nos auditions seraient ouvertes à la presse car nous devons mener cette enquête en toute transparence.
Conformément aux dispositions de l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958, relatif aux commissions d'enquête, je vous demande de prêter le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité.
M. Bernard Cazeneuve prête serment.
M. le président Georges Fenech. Je vous laisse la parole pour un exposé liminaire qui sera suivi par un large échange de questions et réponses.
M. Bernard Cazeneuve, ministre de l’intérieur. Merci beaucoup, monsieur le président, mesdames et messieurs les députés, de me donner l’occasion de m’exprimer devant votre commission d’enquête. Je suis moi-même très désireux, sur ce sujet et sur l’ensemble de ceux qui relèvent de la compétence de mon ministère, de pouvoir à tout moment répondre devant les parlementaires de l’action que je conduis, a fortiori sur une question aussi tragique que celle qui est l’objet de votre commission d’enquête. Je me trouve cependant contraint par un certain nombre de principes de droit, qui m’empêchent de révéler ici des éléments qui seraient couverts par le secret de l’instruction, par nature, puisque je n’en ai pas connaissance, ou qui seraient couverts par le secret de la défense nationale, mais votre commission a la possibilité de demander l’ensemble des documents nécessaires à son travail d’investigation. Pour ma part, j’ai toujours été très favorable à ce que l’on donne au Parlement, sur ces sujets, la totalité des éléments dont il souhaite disposer. Ayant, en d’autres temps, été moi-même rapporteur de missions d’information pour lesquelles il était fort difficile d’obtenir les éléments demandés, je garde un tel souvenir de ces périodes compliquées que je me fais un devoir de vous communiquer tout ce dont vous aurez besoin.
Notre pays est aujourd’hui confronté à une menace terroriste d’une gravité extrême, sans précédent. Au mois de janvier 2015 et au mois de novembre dernier, nous avons dû faire face à deux campagnes d’attentats perpétrés en plein cœur de Paris et dans sa proche banlieue. Entre ces deux événements et depuis lors, d’autres attaques à caractère terroriste ont été commises en différents points du territoire national, et d’autres attentats ont été déjoués par nos services. Jusqu’alors, jamais nous n’avions connu une menace d’une telle nature ni d’une telle ampleur en France.
Au cours de l’année passée, 149 victimes innocentes, frappées par la barbarie djihadiste, ont perdu la vie, tandis que des centaines d’autres resteront encore longtemps marquées dans leur chair, parfois même pour le restant de leurs jours, et que des familles entières ont été brisées à jamais. En janvier comme en novembre, je me suis moi-même rendu sur les lieux des attentats, et, chaque fois, j’ai vu une horreur sans nom et une désolation que je n’oublierai jamais.
Je sais que plusieurs victimes, ainsi que certains de leurs proches, ont d’ores et déjà apporté leur témoignage auprès de votre commission d’enquête. Malgré le traumatisme que ces personnes ont subi, malgré le chagrin et la douleur du deuil qui les habite, elles ont pris la parole avec dignité, et il est important que vous ayez commencé par les écouter. Je souhaite tout d’abord leur exprimer, ainsi qu’à leurs familles, ma profonde compassion, comme je pense également avec une très forte émotion à toutes celles et ceux à qui les terroristes ont brutalement pris la vie.
Je sais aussi qu’après moi, dans les jours et les semaines qui viennent, vous allez également, comme il est normal, auditionner plusieurs responsables des forces de sécurité. Dès à présent, je veux souligner le sang-froid et la très grande réactivité dont ils ont fait preuve dans les épreuves exceptionnelles que nous avons traversées. Au cœur de la tragédie, ils ont accompli leur mission avec un professionnalisme et un admirable sens du devoir qu’ils partagent avec les femmes et les hommes qui sont alors intervenus sous leur autorité, dans des circonstances que nul d’entre nous ne peut vraiment imaginer. Il convient de ne pas oublier ce qu’a été à ce moment-là leur investissement.
Depuis les crimes commis par Mohamed Merah à Toulouse et à Montauban au mois de mars 2012, qui étaient des crimes à caractère terroriste, nous sommes confrontés sur notre sol à la menace djihadiste, qui avait auparavant frappé les États-Unis, l’Espagne, puis le Royaume-Uni, et qui a par ailleurs muté au cours de ces dix dernières années. En effet, nos adversaires recrutent désormais une partie de leurs activistes au sein même des sociétés occidentales qu’ils prennent pour cible et les terroristes utilisent internet et les réseaux sociaux pour diffuser leur propagande mortifère.
Ce terrorisme de proximité, à la fois endogène et exogène, nous commande donc de prendre les précautions qui s’imposent sur l’ensemble du territoire national. Chacun doit avoir conscience que, pour des organisations telles que Daech ou bien AQMI, la France constitue aujourd’hui comme hier une cible prioritaire.
Face à l’existence d’une telle menace et après les traumatismes collectifs que nous avons vécus l’année dernière, je crois qu’il était à la fois normal, sain et nécessaire que le Parlement pût examiner dans le détail l’action des pouvoirs publics lors des événements de 2015 et dans le temps long de la lutte antiterroriste. Aussi, je veux remercier les membres de la commission d’enquête, tout particulièrement son président, Georges Fenech, et son rapporteur, Sébastien Pietrasanta, pour les travaux importants qu’ils conduisent.
Je rappelle en effet qu’en matière de lutte antiterroriste, le Gouvernement s’est toujours efforcé de faire preuve de la plus grande transparence possible. Pour ma part, je n’ai jamais refusé de répondre à aucune sollicitation ni aux interrogations des parlementaires ; c’est bien normal, c’est même un devoir dans la fonction qui est la mienne. Par trois fois depuis que je suis à la tête du ministère de l’Intérieur, j’ai été auditionné par des commissions d’enquête portant sur la lutte que nous menons contre les réseaux djihadistes en France et en Europe. Par ailleurs, de nombreux débats ont eu lieu en séance et en commission des lois à l’occasion de l’examen des différentes lois proposées par le Gouvernement. Je pense tout particulièrement au grand débat qui a précédé l’adoption de la loi du 24 juillet 2015 relative à notre politique publique du renseignement, rompant ainsi avec ce qu’il faut bien appeler la « culture du secret » qui, sur ce sujet, avait longtemps prévalu en France.
Enfin, après les attentats du 13 novembre dernier, nous n’avons pas hésité à mettre en place des procédures de contrôle inédites des mesures que nous prenons dans le cadre de l’état d’urgence, notamment des procédures de contrôle parlementaire. À mes yeux, l’exercice qui nous réunit aujourd’hui s’inscrit donc dans cette même logique vertueuse. Je suis moi-même convaincu que la démocratie ne peut que sortir renforcée d’une telle démarche, dès lors que celle-ci est conduite avec toute la rigueur nécessaire.
Je l’ai dit : jamais la menace n’a été aussi élevée qu’aujourd’hui. Mais, dans le même temps, jamais la réponse de l’État n’a été aussi forte. Tel est le sens du message que je veux délivrer aujourd’hui devant vous, sans pour autant ignorer que le risque zéro n’existe pas. Je commencerai par évoquer la réponse opérationnelle que nous avons opposée aux attentats de 2015, avant d’en venir à notre politique de lutte antiterroriste et aux moyens que nous mettons en œuvre sur le long terme pour empêcher la commission de nouvelles attaques.
Parce que le risque zéro, je le redis, n’existe pas face à la menace terroriste, les pouvoirs publics ont l’obligation de se préparer au pire, de prévoir à l’avance les moyens de réagir face à une séquence d’attentats de haute intensité.
C’est dans cet esprit d’anticipation que les services du ministère de l’intérieur ont travaillé au cours des dernières années. Et c’est pourquoi la qualité du retour d’expérience auquel nous avons procédé présente une grande importance. Comment les services du ministère de l’intérieur, et plus largement l’appareil d’État, ont-ils réagi face aux deux vagues d’attentats de janvier et novembre 2015 ? Étaient-ils convenablement organisés et suffisamment préparés à cette mission ? Et quelles leçons doivent être tirées pour l’avenir de ces événements tragiques ?
Ces questions sont extraordinairement complexes, en raison du très grand nombre de services et de personnels qui ont été mobilisés dans les heures qui ont suivi les attentats, et de la multitude des tâches qu’il leur aura fallu accomplir dans l’urgence. Pour la clarté de l’exposé, je me propose donc de distinguer quatre sujets de réflexion principaux, tout en sachant que nous aurons l’occasion d’y revenir aussi longuement que vous le souhaiterez dans le cadre des questions qui suivront cet exposé liminaire : la coordination générale des moyens engagés ; la mobilisation des forces d’intervention ; les procédures d’enquête ; les opérations de secours aux victimes.
Voyons, tout d’abord, la coordination générale des moyens engagés.
Face à des événements exceptionnels, qui amènent à prendre des décisions dans l’urgence et à mobiliser des effectifs considérables, la question de la coordination générale des moyens de l’État est bien entendu cruciale. Toutefois, elle me semble s’être posée de façon différente en janvier et en novembre.
En janvier en effet, l’action des forces de sécurité s’est d’abord concentrée sur la traque des frères Kouachi, après que ceux-ci ont réussi à quitter la capitale. Tous les services et toutes les forces de sécurité se sont donc trouvés mobilisés : préfecture de police, direction générale de la sécurité intérieure (DGSI), direction générale de la police nationale (DGPN), direction générale de la gendarmerie nationale (DGGN). Il est très vite apparu qu’il fallait renforcer leur coordination et assurer entre eux un partage plus fluide de l’information. C’est la raison pour laquelle j’ai tenu à ce que les responsables de ces grandes directions se réunissent en permanence dans le salon du ministère de l’intérieur dit « le fumoir ». Cet outil de pilotage opérationnel a fait la preuve de son efficacité toute au long de la gestion de la crise des 7 et 9 janvier 2015, puisqu’il a permis un pilotage totalement intégré jusqu’à la neutralisation des terroristes.
La situation a été très différente le 13 novembre dernier. En effet, la préfecture de police avait cette fois naturellement vocation à assurer le pilotage opérationnel du dispositif, à Paris comme à Saint-Denis, mais il lui fallait coordonner des moyens bien plus nombreux pour répondre aux circonstances inédites de cet attentat : pluralité des sites, usage de ceintures d’explosifs par les terroristes, absence de ciblage et nombre élevé des victimes. En l’espace de quelques heures, nos services ont d’abord dû intervenir, à la fois, pour mettre hors d’état de nuire les terroristes demeurés sur place, notamment au Bataclan, pour sécuriser les sites et prévenir le risque de surattentat, secourir les victimes et procéder au recueil des données utiles aux enquêtes. Dans un deuxième temps, il leur aura fallu réaliser l’enquête judiciaire et assurer le suivi des victimes, des familles et de leurs proches, tout cela sans oublier, ni les échanges d’information et la coordination avec les services étrangers, ni l’action de cyberdéfense, ni l’information du grand public.
Globalement, le pilotage opérationnel par la préfecture de police de ces moyens et missions complexes peut être jugé comme ayant été, dans un contexte extrêmement difficile, optimal. La réactivité des forces de sécurité a permis de mobiliser les personnels nécessaires à la sécurisation des sites, à la conduite des enquêtes et au secours des victimes dans les délais les plus brefs possibles. Sur le plan opérationnel, nous devons cependant tirer certains enseignements concernant l’organisation du commandement, la répartition des personnels sur les différents sites et l’intégration dans notre dispositif des personnes qui offrent spontanément leurs concours – je pense aux militaires de la force Sentinelle, aux médecins civils et aux riverains.
Enfin je rappelle qu’au-delà de la coordination opérationnelle, il existe un dispositif de coordination interministérielle, la cellule interministérielle de crise (CIC), qui a été activée par le Premier ministre en janvier comme en novembre 2015 et qui a été placée sous ma responsabilité. La CIC a notamment joué un rôle très utile pour partager en continu les informations entre administrations, pour mobiliser, au profit du préfet de police, des renforts nationaux et, en novembre, pour assurer la mise en œuvre rapide des mesures prises au titre de l’état d’urgence et du rétablissement des contrôles aux frontières.
La mobilisation des forces d’intervention – GIGN, RAID et BRI – constitue un deuxième aspect fondamental de notre dispositif en cas d’attaque terroriste, en particulier dès lors que nous sommes confrontés, comme c’est le cas avec les terroristes de Daech, à un ennemi résolu à frapper au hasard et parfois à mourir pour faire le plus grand nombre possible de victimes.
Après les crimes de Mohamed Merah, le RAID et le GIGN ont ainsi dû faire évoluer leurs doctrines d’emploi, ainsi que leurs schémas tactiques et opérationnels d’intervention. Leurs hommes doivent être préparés à agir vite pour sauver des victimes, empêcher les agresseurs d’initier des charges explosives et ne pas leur laisser l’opportunité de communiquer sur les médias d’information continue et les réseaux sociaux.
En juillet 2014, le RAID a ainsi présenté sa nouvelle stratégie d’intervention sur les individus radicalisés ayant déjà tué, basée sur l’abandon dans ce cas précis de la négociation pour privilégier, si possible, un contact maîtrisé par les forces de l’ordre. Elle est complétée par une tactique dite de « non-réversibilité » c'est-à-dire un assaut rapide et continu, quelquefois doublé d’une technique consistant à offrir l’opérateur du RAID, protégé par un gilet lourd et un bouclier balistique, aux tirs ennemis, afin de détourner l’attention du tueur potentiel d’otages. Ces techniques ont été utilisées à Vincennes.
De son côté, le GIGN a mis en place une cellule de veille du phénomène terroriste et sur les modes opératoires des tueries planifiées. Quatre exercices spécifiques ont été programmés en 2015 dans le cadre de la préparation opérationnelle de l'unité.
Parallèlement, un travail de collaboration entre les chefs du RAID et du GIGN a abouti le 24 juillet 2014 à la rédaction d’une note commune organisant la coopération des deux unités en cas de crise grave. Ce dispositif a été mis en place en janvier 2015. De même, une collaboration étroite a été engagée entre le RAID et la BRI dans le cadre de la Force d’intervention de la police nationale (FIPN). Le 9 janvier 2015, pour la première fois depuis sa création, j’ai décidé de déclencher la FIPN, donnant ainsi le commandement du dispositif composé des deux forces au chef du RAID.
À la suite d’une autre de mes décisions, dans le courant de l’année 2015, le RAID a été doté de nouveaux équipements acquis sur financement antiterroriste, dont des blindés urbains permettant de s’approcher des zones de feu y compris dans les centres commerciaux. Ces véhicules ont été engagés pour évacuer en toute sécurité des blessés et des otages du Bataclan.
Une autre question essentielle, face à une menace terroriste qui n’est pas concentrée sur la région parisienne, porte sur les capacités de projection des forces d’intervention spécialisées. C’est pour répondre à ce défi que la décision a été prise en avril 2015 de faire des sept groupes d’intervention de la police nationale situés à Lille, Strasbourg, Lyon, Nice, Marseille, Bordeaux et Rennes des antennes du RAID, mises en capacité d’effectuer les mêmes interventions que l’échelon central. Ces antennes permettent ainsi au RAID de se projeter plus rapidement sur tout point du territoire national. Face à la même nécessité opérationnelle, le GIGN a mis au point un « plan d'assaut immédiat » reposant sur un départ immédiat du premier échelon – au moins quatre équipes de cinq pour le GIGN –, capable de quitter Satory en quinze à trente minutes, vingt-quatre heures sur vingt-quatre et trois cent soixante-cinq jours par an.
Enfin, j’ai moi-même demandé aux directions générales de la police et de la gendarmerie nationales, ainsi qu’au préfet de police d’actualiser le schéma national d’intervention spécialisée afin d’adapter les conditions d’interventions d’urgence de ces unités en cas d’attentat sur le territoire de la nation tout entière. Ce schéma est en cours de finalisation, il sera présenté dans les prochains jours.
J’en viens, troisième point, à la conduite des enquêtes.
Je ne m’étendrai pas, vous le comprendrez, sur un sujet qui relève d’abord de l’autorité judiciaire, mais je voudrais souligner l’importance du travail d’enquête effectué par les services du ministère de l’intérieur tout au long de ces crises.
En janvier 2015 et plus encore au mois de novembre, les services d’enquête ont dû faire face à un double défi, puisqu’il leur fallait à la fois procéder de manière coordonnée aux actes d’investigation sur plusieurs scènes d’attentats ayant fait un très grand nombre de victimes, et identifier les auteurs survivants et leurs complices éventuels afin de prévenir absolument la commission de nouveaux actes terroristes.
Dès le 13 novembre à 23 heures, le parquet de Paris a saisi conjointement la DGSI, la direction régionale de la police judiciaire (DRPJ) de Paris et la direction centrale de la police judiciaire (DCPJ) et a confié à la sous-direction antiterroriste (SDAT) de cette dernière la coordination, la centralisation et la direction de l’enquête. À 23 h 45 la SDAT déclenchait le « plan attentat », comme en janvier, permettant notamment la mise en place d’un PC de crise, l’activation du numéro d’urgence « 197 » et du site internet dédié pour recueillir les témoignages de la population, l’activation de la « main courante attentats » et la mobilisation de renforts des services territoriaux de la DCPJ (Versailles, Lille, Orléans, Rennes, Bordeaux et Ajaccio). Ce sont ces renforts qui ont rapidement permis de répartir entre le travail entre ces enquêteurs et ceux de la DRPJ de Paris les six scènes de crimes en vue d’établir les actes de constatation.
Entre le 13 et le 24 novembre, les enquêteurs ont établi 5 300 procès-verbaux et confectionné plus de 4 000 scellés. Ce travail a notamment permis de réaliser les constations sur les six scènes de crimes, d’identifier les neuf terroristes abattus ou s’étant suicidés, de localiser deux lieux conspiratifs en banlieue parisienne et trois en Belgique, de procéder à 26 interpellations en France. L’activation du numéro d’appel à témoins « alerte attentat 107 » a notamment permis de recueillir trois informations décisives, dont celle qui a permis de localiser trois terroristes dans un appartement de Saint-Denis avant qu’ils ne puissent commettre de nouveaux attentats.
Enfin, je tiens à souligner l’importance de la coopération franco-belge, qui s’est notamment matérialisée par la mise en place d’une équipe commune d’enquêteurs, ainsi que l’apport de la police technique et scientifique, à la fois pour l’identité judiciaire, pour la documentation criminelle et pour l’exploitation des traces informatiques et technologiques. Les supports exploités par la sous-direction de la police technique et scientifique (SDPTS) à Écully ont ainsi permis de démontrer la préparation préalable des attentats et de retracer une partie des déplacements effectués par les terroristes dans les jours précédant le 13 novembre.
J’en viens, quatrième point, à ce qui concerne les secours aux victimes.
La prise en charge des victimes et de leurs proches a été pour l’État une préoccupation majeure, tout particulièrement en nombre compte tenu du nombre très élevé des victimes. Je rappelle qu’au matin du 14 novembre, le bilan provisoire était de 124 morts, 100 victimes en situation d’urgence absolue et 157 victimes en situation d’urgence relative.
Dans les heures et les jours qui ont suivi cet attentat, il a donc fallu à la fois porter le plus rapidement possible secours aux victimes et procéder à leur évacuation vers les structures hospitalières adaptées, mais aussi donner aux familles des éléments d’information fiables sur la situation de leurs proches. Et il a fallu ensuite accompagner dans la durée les victimes au plan médical, psychologique, juridique et financier.
Le soir du 13 novembre, les secours ont dû intervenir simultanément sur six sites, à Saint-Denis et à Paris. Ils l’ont fait avec une extrême réactivité, notamment grâce au maillage des centres de secours parisiens, en arrivant sur les lieux très rapidement. Pour la seule brigade des sapeurs-pompiers de Paris (BSPP), ce sont 125 engins d’incendie et de secours, 450 sapeurs-pompiers, 200 secouristes des associations agréées de sécurité civile, 21 équipes médicales, qui se sont portés au secours des victimes sur les différents sites.
Ce très haut niveau de réponse est le fruit d’un long travail de préparation interservices. Je m’étais rendu le 4 décembre 2014 à la caserne Champerret où m’avaient été présentées les modalités de réponse de la BSPP à un attentat multisites. Et un exercice conjoint entre la BSPP et le SAMU avait été organisé le matin même des attentats du 13 novembre.
Depuis novembre, j’ai donc souhaité que ce travail d’anticipation et d’entraînement se poursuive à l’échelle nationale, afin notamment de nous préparer aux enjeux de sécurité liés à l’Euro 2016. Le 16 mars, je réunirai les responsables de la sécurité et des secours de 16 grandes agglomérations et de villes accueillant l’Euro 2016, pour évoquer les enjeux post-attentats et l’adaptation des modes opératoires. Je me rendrai également à Nîmes le 17 mars pour un exercice simulant un attentat dans une « fan zone ».
Si personne ne conteste la réactivité, le professionnalisme et le dévouement dont ont fait preuve les services de secours, je sais que l’accompagnement par l’État des familles a suscité davantage d’interrogations. Les attentats de 2015 ont suscité de ce point de vue une évolution importante de la réponse de l’État.
Lors des attentats de janvier, le Premier ministre a en effet décidé de créer une structure ad hoc, placée directement sous sa responsabilité, pour assurer l’information et l’accompagnement des familles de victimes, abritée et armée par le centre de crise et de soutien du Quai d’Orsay, avec le concours, bien entendu, des différents ministères. Cette cellule interministérielle d’aide aux victimes a évidemment été fortement mobilisée en novembre. Je veux souligner l’apport majeur qui est le sien en situation de crise : elle offre un accompagnement permanent, assuré par des professionnels formés pour ce faire et expérimentés, qui sont dans la durée de véritables référents pour les familles de victimes.
Il reste que deux points ont concentré, à juste titre, les critiques. D’abord, de nombreuses familles ont indiqué avoir été dans l’incapacité de joindre le numéro vert mis en place par la préfecture de police, lequel a été destinataire de 93 000 appels en quelques heures, ce qui a entraîné sa saturation. Pareille situation ne doit plus se reproduire. Désormais, une nouvelle organisation sera mise en œuvre en cas de nouvel attentat, en lien avec la CIAV, pour s’assurer que les appels des familles et des proches seront traités avec la plus grande célérité.
Ensuite, le nombre élevé de victimes décédées a très fortement mobilisé les équipes de la police judiciaire et de l’Institut médico-légal de Paris, en charge de leur identification. Celle-ci ne peut être faite que par une commission d’identification présidée par un magistrat, au terme d’une procédure rigoureuse cadrée par des protocoles Interpol. Cette procédure a entraîné des délais très longs, souvent même insupportables, avant que les familles plongées dans l’angoisse soient formellement informées. Le samedi 14 novembre au matin, plus de 1 700 personnes étaient ainsi restées sans réponse après s’être manifestées comme étant à la recherche d’un proche à travers la plateforme téléphonique de la CIAV.
À cet égard, je dois souligner que les services du ministère de l’intérieur ont accompli, en novembre comme en janvier, un travail éprouvant afin de procéder à l’identification des victimes, avec un très haut niveau d’engagement des services. La DCPJ a utilement pu bénéficier à cette occasion de renforts de l’institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale (IRCGN). Leur professionnalisme ne saurait être mis en cause mais il reste que des mesures devront être prises pour accélérer ce processus d’identification afin d’éviter aux familles de demeurer longtemps dans l’incertitude, ce naturellement sans remettre en cause l’exigence de rigueur, toute erreur pouvant entraîner des conséquences dramatiques.
Enfin, l’État doit bien évidemment accompagner dans la durée les victimes et leurs proches, aux plans médical, psychologique, juridique et financier. Lorsque la CIAV, structure de l’urgence, a fini son œuvre, le relais est pris par un comité interministériel de suivi des victimes. La création du secrétariat d’État aux victimes devra permettre de s’assurer de la cohérence et de l’efficacité de ce suivi, mais je laisserai bien entendu ma collègue Juliette Méadel vous apporter de plus amples précisions sur ce sujet.
J’en viens à présent aux dispositions que nous avons prises sur le long terme pour empêcher la commission de nouveaux attentats. J’en viens donc à la question que vous avez posée, de façon réitérée, sur les décisions, les dispositions qui ont été prises depuis 2012 et, plus particulièrement, depuis le mois de janvier.
À cet égard, je souhaite faire une précision liminaire sur un point qui revêt à mes yeux une grande importance et auquel nul ne semble pourtant prêter attention : aujourd’hui, nous ne parlons pas des attentats qui n’ont pas eu lieu. Par définition, personne n’en parle jamais. Et par définition, on ne pose aucune question sur la façon dont nous les avons empêchés, alors que, bien sûr, de nombreuses interrogations seraient sur le métier aujourd’hui si ces attentats étaient survenus. En fait, souvent personne ne sait même que ces attentats ont été évités, et personne n’est informé de l’exacte activité des services.
Ainsi, depuis 2013, grâce au travail minutieux de nos services, pas moins de onze projets d’attentats ont été déjoués – dont six depuis le mois de janvier 2015.
J’ajoute qu’à ce jour, 325 individus impliqués d’une façon ou d’une autre dans des filières djihadistes ont été interpellés par la DGSI. Parmi eux, 201 ont été mis en examen, 155 ont été écroués et 46 ont été placés sous contrôle judiciaire. D’une manière générale, je rappelle que la DGSI est saisie, en propre ou avec la police judiciaire, du suivi de 236 dossiers judiciaires, concernant 1 088 individus pour leur implication dans des activités liées au terrorisme djihadiste.
Ces chiffres vous donnent ainsi une idée du nombre potentiel d’attaques ou d’attentats dont nous sommes jusqu’à présent parvenus à entraver la commission sur notre sol. Par là même, ils vous montrent à quel point l’action quotidienne des services, sous l’autorité de la justice, porte ses fruits. Et s’il est bien légitime que vous m’interrogiez sur les attentats de 2015, je considère qu’il serait regrettable que nous passions sous silence les résultats importants qui sont le fruit du travail sans discontinuité des services de renseignement ou des services de sécurité intérieure.
Le Gouvernement a très tôt pris la mesure du caractère inédit et protéiforme de la menace. Depuis 2012 et l’adoption de la loi relative à la sécurité et à la lutte contre le terrorisme, dite « loi Valls », nous n’avons cessé de renforcer notre dispositif antiterroriste et d’adapter notre arsenal juridique aux évolutions de la situation. Dès le mois d’avril 2014, nous avons ainsi mis en place un plan de lutte contre la radicalisation violente et les filières djihadistes, lequel a constitué la matrice de notre stratégie globale de prévention, de sécurisation et de répression du terrorisme. Depuis lors, cette action n’a cessé de monter en puissance pour nous donner les moyens d’agir sur les différentes composantes de la menace.
Car, s’il est avéré que les attentats du 13 novembre ont été planifiés depuis la Syrie et coordonnés en dehors de nos frontières – j’insiste sur ce point –, d’autres attaques ont, elles, été le fait de personnes radicalisées sur notre sol – parfois dans un délai extrêmement court et au contact d’un milieu propice à une telle dérive. Le plus souvent, ces individus ou ces petits groupes ont bénéficié d’une formation accélérée au maniement des armes en Syrie ou en Irak, avant de revenir sur notre sol pour se fondre dans notre tissu social et, le cas échéant, passer à l’acte très rapidement. D’autres, enfin, entendent répondre à un appel général au djihad lancé par Daech ou par toute autre organisation terroriste d’inspiration djihadiste, sans que l’on puisse parler, pour ce qui les concerne, d’une mission précise à remplir. Dans le même temps, les modes opératoires ont évolué : les exécutions isolées par arme de poing ou arme blanche se sont muées en attentats commis à l’arme de guerre et, pour la première fois le 13 novembre, au moyen de ceintures explosives. J’ajoute enfin que les cibles elles-mêmes des terroristes ont évolué. Si elles avaient été choisies, en janvier 2015, en raison de leur évidente portée symbolique – communauté juive, journalistes, policiers –, tel n’était plus le cas le 13 novembre : les assassins ont cette fois délibérément frappé au hasard. À travers ces meurtres de masse indiscriminés, c’était donc une cible plus globale qui était visée : notre mode de vie, les solidarités qui nous unissent, bref le moral et l’unité de notre nation.
À l’heure actuelle, nous savons qu’un peu plus de 1 850 Français ou résidents habituels sont impliqués, d’une façon ou d’une autre, dans les filières de recrutement djihadiste : 600 d’entre eux sont présents en Syrie et en Irak, ce n’est pas un chiffre faible, et 236 sont d’ores et déjà revenus sur le territoire national – nous faisons preuve à leur endroit de la plus grande vigilance. Parmi eux, 143 font l’objet d’un suivi judiciaire : 74 ont été incarcérés après avoir été placés en garde à vue, 13 sont sous contrôle judiciaire. Par ailleurs, 100 Français de retour de Syrie ou d’Irak sont actuellement surveillés par nos services de renseignement ; 67 d’entre eux ont d’ores et déjà fait l’objet d’entretiens administratifs avec la DGSI.
Notre premier objectif porte sur le renforcement des services de renseignement.
En raison du caractère diffus de la menace, le principal objectif que nous nous sommes fixé, dès 2012, a été de renforcer l’organisation, le cadre d’action et les moyens dont disposent nos services de renseignement, qu’ils soient chargés de la surveillance du haut du spectre, c’est le cas de la DGSI, ou bien de la détection des signaux faibles de radicalisation, c’est le cas du renseignement territorial. C’était là une nécessité absolue pour tirer les leçons des tueries de Toulouse et de Montauban et éviter que notre pays ne se retrouve dans une situation d’extrême vulnérabilité.
Dès 2013, nous avons commencé à réformer en profondeur les services de renseignement intérieur. C’est la raison pour laquelle nous avons transformé la direction centrale du renseignement intérieur (DCRI) en direction générale de la sécurité intérieure, créée par le décret du 30 avril 2014 et directement placée sous l’autorité du ministre de l’intérieur. Par ailleurs, dès 2013, nous avons programmé la création de 432 postes supplémentaires sur cinq ans pour renforcer les compétences de la DGSI et diversifier son recrutement. Ces recrutements nouveaux ont été accompagnés d’un effort en crédits hors titre 2 de 12 millions d’euros par an.
Après les attentats de janvier 2015, nous avons continué de faire monter notre dispositif en puissance. Des moyens humains supplémentaires ont tout d’abord été alloués aux services dans le cadre de la lutte antiterroriste. Dans le cadre du plan antiterroriste de janvier, il a ainsi été décidé que 500 agents viendraient renforcer progressivement la DGSI, en plus des 432 déjà prévus, et ce jusqu’en 2017. Des analystes techniques, des informaticiens, des linguistes sont notamment recrutés pour renforcer ses capacités d’analyse, de détection et de prévention des risques terroristes. Et 500 effectifs supplémentaires – 350 policiers et 150 gendarmes – sont venus renforcer le service central du renseignement territorial (SCRT), tandis que 100 effectifs nouveaux ont été alloués à la direction du renseignement de la préfecture de police. Enfin, les autres services contribuant d’une façon ou d’une autre à la lutte antiterroriste et appuyant l’action des services de renseignement ont quant à eux été renforcés par l’arrivée de plus de 300 agents. Un tel effort vient bien sûr s’ajouter à la mobilisation des forces de police, de gendarmerie et des militaires dans le cadre du plan Vigipirate.
Pour autant, s’il est indispensable d’accorder davantage de moyens à nos services, un tel effort resterait insuffisant si nous ne réformions pas en parallèle la façon dont ils coordonnent leur action. Pour mieux prendre en compte le caractère diffus de la menace, ainsi que les phénomènes de porosité entre délinquance et terrorisme, priorité a été donnée à la coopération et au partage de l’information entre les différents services concernés. Nous avons consolidé l’articulation entre le « premier cercle » du renseignement, c’est-à-dire la DGSI et ses partenaires de la communauté du renseignement, et le « deuxième cercle », c’est-à-dire le SCRT et les services d’investigation. À cet égard, l’unité de coordination de la lutte antiterroriste (UCLAT) joue bien sûr un rôle décisif. Des « cellules de coordination » ont été mises en place, qui rassemblent l’ensemble des services de renseignement dans une organisation réactive et fluide. Enfin, nous renforçons les liens entre les renseignements intérieur et extérieur, et une équipe de la DGSE est désormais présente dans les locaux de la DGSI. Nous progressons donc, et je dois à la vérité de dire que ces rapprochements n’ont suscité aucune réserve, tant la menace est globale et que la réponse, pour être efficace, se doit d’être collective.
Pour mieux détecter en amont les signaux faibles de radicalisation, nous avons également réformé et renforcé le positionnement du SCRT. Ses attributions ont ainsi été clairement élargies pour lui permettre de contribuer à la prévention du terrorisme, notamment par la détection des signaux faibles de radicalisation. C’est la raison pour laquelle son maillage, en métropole comme outre-mer, a été renforcé pour mieux territorialiser son action et densifier le réseau de ses capteurs. De même, nous avons décidé de développer des relais du renseignement territorial dans les compagnies ou les brigades de gendarmerie, ainsi que dans les commissariats de police, à chaque fois que cela s’est révélé nécessaire. Une telle proximité est absolument indispensable. À Lunel, par exemple, dans l’Hérault – où nous avons, le 27 janvier 2015, procédé à plusieurs interpellations et perquisitions dans les milieux islamistes locaux –, l’implantation de la gendarmerie au plus près de la population a permis de recueillir les renseignements qui ont contribué au démantèlement d’une filière de recrutement djihadiste.
Enfin, avec la loi du 24 juillet 2015 relative au renseignement, nous avons élaboré un cadre légal moderne et cohérent pour l’activité de nos services, adapté aux nouvelles menaces, aux mutations technologiques les plus récentes et à l’évolution du droit national et international. Ce cadre fixe des règles d’emploi claires des techniques de renseignement afin de protéger les agents qui y ont recours tout en garantissant le respect des libertés individuelles. La loi renforce ainsi les indispensables dispositifs d’évaluation de l’action des services. Un triple niveau de contrôle a été instauré – administratif, juridictionnel et parlementaire – et la loi du mois de juillet en a résulté.
Nous avons souhaité aussi des effectifs et des moyens renforcés pour les forces de l’ordre. La volonté de renforcer les effectifs et les moyens dont disposent les forces de sécurité n’a pas seulement concerné les services de renseignement. En raison de l’ampleur de la menace, il était en effet absolument indispensable qu’un tel mouvement affecte l’ensemble des forces de sécurité intérieure.
Je vous rappelle que, d’une manière générale, le Gouvernement a consenti, depuis 2012, un effort national important sur le plan des recrutements au sein de la police et de la gendarmerie nationales. Nous avons ainsi mis un terme aux coupes claires qui avaient considérablement réduit les effectifs des forces de sécurité dans une période antérieure. Nous avons remplacé tous les départs à la retraite, et nous avons créé près de 500 emplois nouveaux par an dans les deux forces. Cet effort a bien évidemment un impact positif sur notre dispositif antiterroriste : nous avons notamment pu le constater quand, après les attentats de janvier 2015, il a fallu déployer dans l’urgence 120 000 femmes et hommes, toutes unités et tous services confondus, pour assurer la protection de nos concitoyens et garantir l’efficacité du plan Vigipirate.
À cette politique de fond, nous avons ajouté, après les attentats de 2015, deux plans pluriannuels d’une ampleur sans précédent : plus de 1 400 créations nettes d’emplois au titre du plan antiterroriste (PLAT) décidé par le Premier ministre en janvier 2015 ; 5 000 emplois au titre du Pacte de sécurité annoncé par le Président de la République devant le Congrès le 16 novembre dernier, au lendemain des attentats de Paris et de Saint-Denis. Il faut y ajouter les 900 postes supplémentaires dans le cadre de la loi de finances pour 2016 pour lutter contre l’immigration irrégulière. D’ici à la fin de quinquennat, ce sont donc 9 000 emplois en tout qui auront été créés dans la police et la gendarmerie.
Je précise qu’actuellement, aux côtés de nos forces armées de l’opération Sentinelle, de nombreux effectifs des forces de l’ordre sont mobilisés pour la surveillance et la protection de 5 700 lieux jugés sensibles, répartis sur l’ensemble du territoire national. Parmi eux, 882 font l’objet d’une garde statique, tandis que des dispositifs dynamiques sont mis en œuvre pour les 4 818 restants. Les sites surveillés sont principalement des sites religieux : 3 713 sur 5 700, parmi lesquels 51 % de sites chrétiens, 27 % de sites musulmans et 21 % de sites juifs. Un tel dispositif de sécurisation implique lui aussi que nous disposions de forces de l’ordre en nombre suffisant.
Par ailleurs, les créations de postes que je viens d’évoquer se sont accompagnées au cours des derniers mois d’un renforcement sans précédent des moyens d’équipement, d’investissement et de fonctionnement du ministère de l’intérieur, à hauteur de 233 millions d’euros sur cinq ans. L’année dernière, 98 millions d’euros ont d’ores et déjà été progressivement alloués aux services concernés pour qu’ils puissent accomplir leurs missions de la façon la plus efficace possible. Un plan de modernisation des systèmes d’information et de communication au bénéfice des forces antiterroristes a également été lancé, à hauteur de 89 millions d’euros sur trois ans. Grâce à ces financements, nous modernisons le système CHEOPS pour la circulation des enregistrements de la police, ainsi que la plateforme PHAROS d’analyse, de recoupement et d’orientation des signalements.
L’accent a également été mis sur la protection et sur les nouveaux équipements – je pense aux véhicules et aux armements – des effectifs de police et de gendarmerie. En 2015, nous avons tenu nos engagements et, en 2016, cet effort sera massivement poursuivi. D'ores et déjà, le service de l’achat, des équipements et de la logistique de la sécurité intérieure (SAELSI) a commandé des matériels pour un montant de 55 millions d'euros.
C’est dans le même esprit que j’ai annoncé, le 29 octobre dernier, la mise en œuvre, dès l’année 2016, d’un plan ambitieux et inédit de renforcement, sur l’ensemble du territoire national, des équipements des BAC de la police nationale et des pelotons de surveillance et d’intervention de la gendarmerie (PSIG). Ces unités jouent en effet un rôle indispensable pour protéger nos concitoyens, notamment en cas de tueries de masse. L’objectif du plan BAC-PSIG 2016 est donc d’apporter des moyens supplémentaires à des personnels mieux formés, dans le cadre d’une doctrine d’intervention adaptée à la réalité des menaces auxquelles nous sommes aujourd’hui confrontés, notamment à l’usage de plus en plus fréquent dans les milieux terroristes et délinquants d’armes de guerre. Qu’il s’agisse des armements, des moyens de protection ou des véhicules, sachez qu’une partie des équipements prévus dans le cadre du plan BAC-PSIG 2016 a d’ores et déjà été livrée ; d’ici à la fin du mois de juin, le reste arrivera progressivement dans les unités concernées.
Nous avons également souhaité doter nos forces d’un arsenal juridique renforcé.
Depuis 2012, nous avons fait en sorte de renforcer et d’adapter notre arsenal juridique à la réalité de la menace terroriste.
Tel fut d’abord l’enjeu de la loi du 21 décembre 2012 : grâce à elle, nous pouvons désormais poursuivre des Français ou des personnes résidant habituellement en France qui ont participé à des activités liées au terrorisme à l’extérieur de nos frontières, et non plus seulement sur notre sol.
La loi du 13 novembre 2014 nous a ensuite permis de nous doter de moyens de police administrative nouveaux pour prévenir et empêcher la commission d’actes terroristes. Au cours de ces derniers mois, après l’adoption de l’ensemble des décrets d’application, les innovations introduites dans notre législation ont été, comme vous le savez, appliquées avec la plus grande détermination. Je vous donne quelques chiffres. À ce jour, 294 interdictions de sortie du territoire, visant des ressortissants français soupçonnés de vouloir rejoindre les organisations actives au Moyen-Orient, ont été prononcées – et près de 80 sont en cours d’instruction –, 97 interdictions d’entrée et de séjour ont été prononcées contre des ressortissants étrangers soupçonnés d’être liés aux réseaux djihadistes, 54 prêcheurs de haine ont été expulsés du territoire français, car de tels individus – je le dis avec force – n’ont pas leur place dans notre pays. Depuis 2014, six individus qui s’étaient rendus coupables d’actes de nature terroriste ont également été déchus de la nationalité française. D’autre part, 83 adresses internet ont fait l’objet d’une mesure de blocage administratif et 355 adresses ont été déréférencées pour avoir diffusé de la propagande terroriste.
Enfin, j’ajoute que les autres dispositions prévues ou renforcées par la loi du 13 novembre 2014 sont tout aussi résolument appliquées, qu’il s’agisse du gel des avoirs terroristes ou des mesures spécifiques de sûreté imposées aux entreprises de transport aérien desservant le territoire national. Je pense également à l’extension de l’enquête sous pseudonyme ou à l’adaptation des modalités de perquisition informatique.
Enfin, quatrième objectif : consolider une politique offensive de prévention et de suivi de la radicalisation…
M. le président Georges Fenech. Permettez-moi de vous interrompre. Comme je l’ai indiqué, nous n’abordons pas le problème du renseignement, auquel sera consacrée l’intégralité d’une deuxième audition. Je demande d’ailleurs à mes collègues de bien vouloir réserver leurs questions sur ce sujet à cette deuxième audition.
D’autre part, nous avons décidé de ne pas revenir sur la prévention de la radicalisation. Cela a déjà été largement traité par de précédentes commissions d’enquête. Je dis cela pour la commodité et l’organisation de nos travaux, mais si vous souhaitez en dire un mot…
M. le ministre. Monsieur le président, j’ai conçu mon propos à partir des questionnaires qui m’ont été adressés par votre commission. Comme ils comportaient des questions relatives à ces sujets, je ne voulais pas quitter cette salle avec le reproche de ne pas avoir traité tous les points que vous aviez évoqués. Si tel est votre souhait, néanmoins, je m’en tiendrai là. Je suis à votre entière disposition – je pourrai, malgré tout, vous faire parvenir des réponses écrites.
Par souci de précision et de méticulosité, j’ai considéré préférable que me soient adressées les questions que vous souhaitiez absolument que je traite, en plus de celles que vous allez poser. C’est ce que je fais…
M. le président Georges Fenech. Nous avons souhaité ne pas revenir sur ce qui a été très largement étudié par de précédentes commissions d’enquête, auxquelles le rapporteur et d’autres membres de celle-ci ont d’ailleurs participé. Nous nous concentrons vraiment sur les moyens de lutte contre le terrorisme, les moyens de prévention de la radicalisation ayant déjà été traités.
M. le ministre. Je ne souhaite occulter aucun sujet, monsieur le président, mais je ne veux pas non plus vous assommer avec des réponses à des questions que vous m’avez posées. Je mets donc cela de côté, et, si vous en êtes d’accord, je terminerai par le sujet de l’action européenne. Celle-ci entre dans le cadre de l’action contre le terrorisme. C’est un sujet sur lequel nous nous sommes beaucoup mobilisés et je vous propose de conclure par ce point. Ensuite, je répondrai à toutes les questions que vous souhaiterez me poser.
La dimension européenne de la lutte contre le terrorisme est centrale. Souvent, lorsque nous sommes confrontés à des actes de nature terroriste en France, nous oublions de faire l’inventaire des terroristes qui nous ont frappés, de s’interroger sur les conditions dans lesquelles ils nous ont frappés et sur les lieux à partir desquels ils nous ont frappés.
Nous sommes confrontés aujourd’hui à une forme de terrorisme d’un type tout à fait nouveau. Il y a bien entendu les actes perpétrés par des individus qui se sont auto-radicalisés sur internet et qui veulent nous frapper. L’agression, à Marseille, d’un professeur d’une école juive par un élève d’un lycée professionnel témoigne de cette capacité qu’ont les informations diffusées sur internet ou les réseaux sociaux à déclencher des actes d’une extrême violence. Il y a les actes commis par ceux qui frappent après être allés sur le théâtre des opérations terroristes et participé à toutes les exactions. Il y a aussi les actions, de plus en plus nombreuses, organisées depuis la Syrie par des individus qui ne sont pas ressortissants français. Ils préparent la commission des attentats à partir de l’étranger et nous frappent alors qu’ils ne sont pas dans le radar de nos services de renseignement puisqu’ils sont dans celui d’autres pays, qui ne les signalent pas tous nécessairement – il faut le dire – au système d’information Schengen. Ces individus arrivent sur le territoire de l’Union européenne après avoir bénéficié de faux documents. Daech a en effet récupéré énormément de passeports vierges sur le théâtre des opérations terroristes en Irak, en Syrie et en Libye et s’est doté d’une véritable usine de faux documents. La dimension européenne et internationale de l’action est donc centrale – j’évacue les sujets diplomatiques, mais ils pourront être évoqués si vous le souhaitez.
Quel est l’agenda ? Il est extrêmement précis. Il s’agit de faire en sorte que les contrôles aux frontières extérieures de l’Union européenne soient considérablement renforcés, parce que si nous ne le faisons pas, la capacité d’entrer dans l’Union européenne d’individus susceptibles de nous frapper s’en trouve décuplée. Deuxièmement, il s’agit de faire en sorte qu’au moment de l’entrée de l’Union européenne, le système d’information Schengen soit systématiquement interrogé. C’est la raison pour laquelle nous avons demandé et obtenu la modification de l’article 7-2 du code frontières Schengen pour que les contrôles de nos ressortissants au moment du franchissement des frontières extérieures de l’Union européenne soient systématiques et coordonnés. Troisièmement, nous souhaitons voir l’ensemble des services de renseignement de l’Union européenne alimenter de façon systématique et homogène le système d’information Schengen car les fiches ne peuvent sonner opportunément que dès lors que le système d’information Schengen a été documenté par les pays. Quatrièmement, il s’agit de faire en sorte qu’il y ait une connexion des fichiers du système d’information Schengen avec l’ensemble des fichiers criminels, et que nous puissions aussi utiliser la base Eurodac à des fins de sécurité, ce qui n’est pas possible aujourd’hui compte tenu de ce qu’est le règlement européen. Il faudrait le modifier pour pouvoir utiliser le fichier à des fins de sécurité. Enfin, il s’agit de mettre en place une véritable task force européenne dans les aéroports et les hot spots, notamment pour identifier les faux documents de ceux qui entrent sous de fausses identités avec l’intention de commettre des attentats terroristes. Deux des kamikazes qui ont frappé le 13 novembre étaient dotés de passeports qui n’étaient pas à leur véritable identité ; ils avaient été enregistrés au moment du franchissement des frontières extérieures de l’Union européenne à Leros.
La dimension européenne est donc un point très important, sur lequel nous avons beaucoup agi. Nous nous sommes beaucoup mobilisés et avons obtenu de premiers résultats, mais ceux-ci méritent d’être renforcés. Sur ces sujets, en effet, l’Union européenne a pour caractéristique de mettre beaucoup de temps à prendre de bonnes décisions, puis beaucoup de temps à les appliquer – parfois plus qu’elle n’en a mis à les prendre.
C’est la raison pour laquelle l’Europe est un combat. La présence au sein des instances européennes doit permettre, grâce à notre action, de renforcer considérablement la gestion du temps, car la lutte contre le terrorisme est une course contre la montre.
M. le président Georges Fenech. Beaucoup de députés souhaitent intervenir à la suite de votre exposé, extrêmement complet.
Vous vous êtes réjoui, Monsieur le ministre, du contrôle parlementaire démocratique, précisément celui que nous exerçons aujourd’hui. Vous avez émis le vœu que ce contrôle soit fait avec la rigueur qui s’impose. Nous allons tâcher d’y répondre, étant précisé que nous ne disposons pas encore de tous les éléments pour poser toutes les questions sur la chronologie des faits. À cet égard, notre commission d’enquête a prévu de se transporter au Bataclan le 17 mars prochain, pour essayer de mieux en comprendre le déroulement.
Beaucoup, parmi nous et parmi nos concitoyens, se demandent pourquoi les moyens que vous avez évoqués, auquel il faut ajouter l’état d’urgence, n’ont pas été mis en œuvre dès le lendemain des attentats du mois de janvier 2015. Pourquoi avoir attendu ceux du 13 novembre pour réagir avec cette force ? Vous-même avez déclaré, lors d’une interview le 8 janvier 2016 : « On prend la décision de l’état d’urgence quand les conditions de droit définies par le texte de 1955 sont réunies, on ne déclenche pas parce que cela offre un confort politique mais parce que la situation le justifie et qu’il peut avoir une efficacité. » Vous concluiez par cette phrase : « Il faut pour cela qu’il y ait un péril imminent et que ceux qui ont frappé soient susceptibles de frapper encore. »
Bien entendu, il est toujours facile de refaire l’histoire mais, avec le recul, on sait aujourd’hui que ce péril était imminent, on sait que les terroristes ont frappé de nouveau, parce qu’il y a eu 130 morts le 13 novembre de la même année. Ma question est très claire, très simple : n’avez-vous pas le sentiment que le risque d’une nouvelle vague d’attentats a pu être sous-estimé après ceux du mois de janvier alors même que tous les spécialistes disaient leur crainte devant la précédente commission d’enquête, présidée par M. Ciotti, dont le rapporteur était M. Mennucci et à laquelle notre rapporteur et moi-même avons participé ? Selon eux, la question était non pas de savoir si une nouvelle vague d’attentats se produirait, mais où et quand. N’avez-vous donc pas le sentiment d’avoir un peu trop attendu pour mettre en œuvre tous ces moyens ?
M. le ministre. Je vous remercie, monsieur le président, de poser cette question de façon aussi directe, car je l’ai vue affleurer à plusieurs reprises dans le débat public, ainsi, parfois, que dans les journaux qui en relataient les termes ; elle appelle la réponse la plus précise.
Avons-nous attendu les attentats du mois de novembre, ou même ceux du mois de janvier 2015, pour prendre la mesure du risque terroriste ? Je viens par mon exposé de reconstituer la totalité de la chronologie des décisions que nous avons prises. Nous avons décidé de réarmer les services de renseignement et les services de sécurité intérieure dès 2012, pour des raisons qui tenaient à la conscience que nous avions, à l’époque, de l’état de faiblesse dans lequel ces services se trouvaient, à la suite de la réforme des renseignements généraux, qui avait ébranlé l’organisation du renseignement dans les territoires, de la diminution de 13 000 des effectifs de la police et de la gendarmerie, qui n’avait pas été sans impact quant à la capacité du pays de réagir au risque terroriste et quant à l’évolution des moyens des services de renseignement, et d’une diminution d’environ 17 % des crédits hors titre 2 de la police, la privant de matériels significatifs. Nous avons pris des dispositions législatives, notamment avec la loi de décembre 2012, destinée à renforcer les moyens de lutte antiterroriste, et la loi du 13 novembre 2014, qui offre un ensemble de moyens que j’ai rappelés : interdiction de sortie du territoire, interdiction d’entrée sur le territoire, blocage administratif des sites, blocage des adresses internet, possibilité pour les services de renseignement d’intervenir sous pseudonyme dans les réseaux sociaux, mise en place de l’incrimination pénale individuelle terroriste, mise en place du statut de repenti, possibilité d’utiliser les fonds de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) en vue du financement de ce statut. Je pourrais dresser la liste de l’ensemble des mesures qui ont été prises avant les attentats de janvier.
Après les attentats de janvier, nous avons décidé de renforcer davantage encore les moyens des services de renseignement : 1 500 emplois créés, 233 millions d’euros débloqués, dont 98 millions dépensés pour des sujets absolument stratégiques dès l’année 2015, mise en place de la loi sur le renseignement, absolument essentielle à la lutte antiterroriste, avec l’instauration du suivi en continu des terroristes et de la détection sur données anonymes – les risques que ces dispositions législatives pouvaient représenter pour les libertés publiques ont suscité d’énormes débats au cours desquels nous avons apporté toutes explications. Nous avons également commencé à préparer les dispositifs de renforcement des primo-intervenants, et le plan du 29 octobre, que j’ai présenté avant les attentats du 13 novembre, était le résultat d’un travail important de confortement des forces d’intervention.
Reste la question de l’état d’urgence, dont je comprends qu’elle se pose quand on connaît la fin du film, mais, monsieur le président, mesdames et messieurs les députés, combien de parlementaires, de responsables politiques ont demandé l’instauration de l’état d’urgence au mois de janvier 2015 ?... Je n’en tiens rigueur à personne, la raison est très simple : l’état d’urgence n’est pas un dispositif à convenance, les conditions doivent être réunies sur le plan juridique pour le déclarer.
Je reprends très précisément ce que vous avez dit. Votre raisonnement est le suivant : le fait que d’autres attentats aient été commis après ceux du mois de janvier prouve que le risque était imminent. Je rappellerai car il faut être extrêmement précis sur ces sujets qu’en janvier, à l’issue de l’assaut à l’Hypercacher, nous savions que ceux qui étaient à l’origine des tueries avaient été neutralisés : les deux frères Kouachi à Dammartin-en-Goële et Amedy Coulibaly à l’Hypercacher. Le risque d’une réplique dans les heures suivantes était donc relativement faible.
Tel n’est pas du tout le cas le 13 novembre. Ce qui a conduit au déclenchement de l’état d’urgence, c’est cette tuerie de masse dont les acteurs, à l’heure où je vous parle, n’ont pas encore été tous récupérés par les services sous l’autorité de la justice. Je pense notamment à l’un des frères Abdeslam et à certains de ses complices. Nous sommes donc dans une configuration très différente.
Si personne au mois de janvier 2015 n’a proposé qu’on déclenche l’état d’urgence, c’est que chacun, suivant cette approche rigoureuse, voyait bien que les conditions juridiques n’étaient pas réunies. J’ajoute un point : il n’a échappé à la sagacité d'aucun d’entre vous que trois jours après son déclenchement en novembre, le débat a émergé – parce que la démocratie est ainsi faite et il est bien qu’elle soit ainsi – sur la procédure elle-même, comme si le problème était non pas l’attaque terroriste mais l’état d’urgence.
En outre, comme l’état d’urgence ne peut pas se prolonger indéfiniment, je vous pose la question : si l’état d’urgence avait été déclenché après les attentats de janvier alors que les conditions juridiques n’étaient pas réunies, son re-déclenchement aurait-il été accepté après le 13 novembre, alors qu’il aurait déjà été en vigueur plusieurs mois après le 13 janvier ? Toute une série d’acteurs se seraient d’ailleurs demandé pourquoi il n’avait pas permis d’éviter de nouveaux attentats.
L’argument que vous développez est tout à fait réversible, monsieur le président. Vous dites que le péril était imminent, la preuve en étant qu’il y a eu des attentats ensuite, mais les conditions juridiques n’étaient pas réunies pour les raisons que je viens d’indiquer, et s’il avait été déclenché et qu’il y avait eu des attentats ensuite, on aurait dit : « Mais alors, vous avez pris des mesures qui ne servent à rien ! »
Les conclusions que je tire de tout cela sont très simples. La première, c’est que l’état d’urgence ne peut être déclenché que dès lors que les conditions juridiques sont strictement réunies pour qu’il le soit. La deuxième, c’est que l’état d’urgence ne peut durer indéfiniment. Par conséquent, il est indispensable que soient prises en droit des dispositions qui permettent de faire suite à l’état d’urgence après qu’il a cessé de faire connaître ses effets. C’est ce que nous avons fait avant que l’état d’urgence ne soit déclenché, avant même les attentats du mois de janvier 2015. La loi du 13 novembre 2014 prévoit ainsi un certain nombre de mesures de police administrative susceptibles de prendre le relais de l’état d’urgence – je pense, par exemple, aux interdictions de sortie du territoire, dès lors que les conditions juridiques sont réunies pour les appliquer à ceux qui font l'objet d’assignations à résidence. D’autre part, j’insiste aussi beaucoup sur le fait que l’état d’urgence n’est pas le seul instrument de la lutte antiterroriste : il y a toutes les dispositions que je viens de rappeler, sur le plan budgétaire, sur le plan de la création des emplois, sur le plan des moyens juridiques donnés aux services. De ce point de vue, l’agenda qui a été le nôtre, et qui s’est traduit par une mobilisation parlementaire très forte, a été extrêmement chargé.
M. le président Georges Fenech. Je vous remercie de votre réponse, monsieur le ministre.
Je veux également vous interroger sur un point de détail, mais peut-être ne pourrez-vous pas répondre, car il fait sans doute l’objet d’informations judiciaires.
Lors des premières tables rondes que nous avons organisées, nous avons entendu des victimes. Le père de l’une d’entre elles et son avocat ont posé une question très précise : pourquoi ne pas avoir sécurisé le Bataclan alors que le nom de cette salle de spectacle figurait sur un procès-verbal de la DCRI daté du 6 mai 2009, et qu’elle était visée par un projet d’attentat ? Cela semble avoir été confirmé par l’audition d’un certain Farouk Ben Abbes, lui-même lié à l’attentat commis au Caire en 2009, dans lequel une jeune française, Cécile Vannier, avait trouvé la mort. Selon les dires des témoins auditionnés par notre commission d’enquête, les propriétaires du Bataclan n’avaient pas été informés de ces menaces et les forces de l’ordre ne disposaient pas de plan des lieux au moment de l’intervention. Disposez-vous d’informations permettant de répondre à la légitime et douloureuse interrogation de ces victimes ?
M. le ministre. Bien entendu, j’ai suivi très attentivement ces auditions. Cette question est extrêmement importante mais je ne peux pas aller au-delà du secret de l’instruction. Je vous dirai absolument tout ce que je sais, mais ce n’est pas exhaustif, ce n’est peut-être pas tout ce qu’il faut savoir – et je l’ignore puisque je n’ai pas accès au contenu du dossier. Comment se fait-il qu’aucune protection du Bataclan n’ait été mise en place, alors que l’enquête sur l’attentat du Caire montrait que des menaces auraient pesé sur cette salle, en lien avec le personnage que vous avez cité, Farouk Ben Abbes – un proche des frères Clain, eux-mêmes suivis de près par nos services et impliqués dans les attentats du 13 novembre –, et qu’un individu interpellé en août faisait part de menaces sur cette salle de spectacles ? Telle est, si j’ai bien compris, la question.
Tout d’abord, l’enquête judiciaire sur l’attentat du Caire en 2009 est toujours en cours : je ne peux donc la commenter, pour des raisons de droit que chacun comprend. J’observe cependant que le dénommé Farouk Ben Abbes n’a pas fait, à ma connaissance, l’objet de poursuites dans cette affaire, pas plus, d’ailleurs, que les frères Clain. Je rappelle ensuite que Farouk Ben Abbes a été interpellé et mis en examen dans le cadre d’une seconde affaire, indépendante de la première, puis a bénéficié d’un non-lieu – en 2012. Il faut donc se garder d’établir hâtivement, en mettant bout à bout, rétrospectivement, des fragments d’enquête, des liens que seule l’enquête pourra, le cas échéant, établir. Moi, je ne suis pas, aujourd’hui, en situation de les établir. Je rappelle surtout que les menaces proférées par le djihadiste de retour de Syrie interpellé au mois d’août dernier de commettre des attentats dans des salles de spectacle étaient génériques. Il n’a cité aucune salle en particulier et en aucun cas le Bataclan. De la même manière, aucun suspect n’avait fait état, lors d’interpellations préalables, de projets visant spécifiquement des brasseries, le restaurant Le Petit Cambodge ou le Stade de France. De même, les églises de Villejuif, le Thalys d’Amsterdam et l’arsenal militaire de Toulon, cibles d’attentats que nous avons déjoués ou évités, n’ont, à aucun moment, été préalablement évoqués par les terroristes dans les affaires précédentes. Je confirme par ailleurs à la commission que je n’ai vu aucune note témoignant d’une menace particulière sur le Bataclan ou sur telle ou telle salle de spectacle. Les seules que j’ai vues concernaient des menaces générales sur des salles de spectacle – au terme des enquêtes réalisées aux mois de mai et juin.
Il faut donc que chacun comprenne que la menace terroriste peut frapper des lieux, des cibles très diverses – nous l’avons malheureusement constaté. Or il est impossible, je dis avec beaucoup de solennité et de sincérité, de placer en permanence un peloton d’une force d’intervention rapide ou des militaires relevant de l’opération Sentinelle devant chaque lieu accueillant du public. C’est matériellement impossible. Et laisser croire que les terroristes sèmeraient de petits cailloux, à la manière du petit Poucet, à l’intention des services de police et de renseignement pour les informer de leurs futures cibles, serait une erreur.
Telles sont les réponses que je peux apporter le plus précisément possible en fonction des informations dont je dispose, un certain nombre des points auxquels vous faites référence pouvant être confirmés ou approfondis, à l’occasion des enquêtes en cours, qui ne sont pas conduites par moi et qui doivent l’être dans le respect rigoureux des prérogatives du juge.
M. le président Georges Fenech. Je vous remercie de votre réponse, monsieur le ministre.
Ma dernière question relève directement de votre ministère et porte sur l’intervention le soir du 13 novembre. Notre commission d’enquête doit vraiment comprendre ce qui s’est passé – et nous comprendrons mieux lorsque nous irons sur les lieux.
Il s’est écoulé un certain temps, entre le début des attaques au Bataclan et l’intervention des forces de police. La première explosion d’un kamikaze, rue Jules Rimet à Saint-Denis, a lieu à 21 h 20. À 21 h 25, donc cinq minutes plus tard, c’est la première attaque à la kalachnikov, devant Le Petit Cambodge et Le Carillon, rue Alibert et rue Bichat, dans le 10e arrondissement de Paris. À 21 h 40, c’est le début du massacre au Bataclan. L’assaut final a été donné à 0 h 18 dans la nuit du vendredi 13 au samedi 14 novembre, étant précisé que la BRI se trouvait déjà au rez-de-chaussée du Bataclan à 22 heures 20, pour faire évacuer de premiers blessés et des survivants. Il s’est donc écoulé deux heures quarante entre le début de la fusillade au Bataclan et l’assaut final. Il s’est écoulé environ une heure entre l’attaque du Bataclan et l’arrivée de la BRI dans la salle, où il a fallu, alors, gérer la prise d’otages. D’où une question simple : pourquoi a-t-il fallu une heure à la BRI pour arriver et pénétrer dans les lieux ? Cette question en amène naturellement une autre : quelle autorité a donné le feu vert à l’assaut final, deux heures quarante après le début de l’attaque ?
M. le ministre. Pardonnez-moi, Monsieur le président, mais on ne peut pas présenter les choses tout à fait de cette manière. Je vais reconstituer de façon extrêmement précise le minutage de cette opération, car, à ce propos aussi, j’ai lu des choses étonnantes. Or je dois au courage des policiers de la BRI de rétablir la vérité sur ces sujets.
Des attaques se déroulent pratiquement dans la même demi-heure sur huit sites distincts, dont trois autour du Stade de France. À 21 h 17 précisément, la première explosion a eu lieu au Stade de France. À 21 h 24 a lieu la première fusillade des terrasses à l’angle de la rue Alibert et de la rue Bichat. À 21 h 26, c’est la fusillade de la rue de La-Fontaine-au-Roi. À 21 h 36, c’est la fusillade rue de Charonne. À 21 h 40, c’est la prise d’otages au Bataclan et l’explosion boulevard Voltaire. C’est un quart d’heure après le début de la prise d’otages au Bataclan que la BAC de nuit est présente sur les lieux et abat déjà un terroriste. La BAC de nuit prévient immédiatement la BRI. À 22 heures, la BRI quitte sa base, c’est-à-dire cinq minutes après l’arrivée de la BAC. Et à 22 heures 20, c’est-à-dire vingt minutes après avoir quitté sa base, la BRI est sur les lieux. Le PC est installé et il y a les premières progressions au rez-de-chaussée de la salle de spectacle. La question qui se pose, je m’en souviens très bien puisque je suis alors en ligne avec le préfet de police de Paris, est de savoir si ces individus, qui ont tué, n'ont pas piégé la salle. On n’intervient pas n’importe comment dans une salle pour procéder à la neutralisation de terroristes : il faut s’assurer qu’il n’y aura pas de victimes supplémentaires. Une analyse très précise des lieux et des conditions est nécessaire avant toute intervention.
Donc, vingt minutes après son départ, la BRI est sur les lieux, son PC est installé, et une première progression est possible au rez-de-chaussée de la salle de spectacle. Le GIGN, quant à lui, est mis en alerte à 22 h 26 pour le cas où nous aurions besoin de son concours. Il reçoit son ordre de départ à 22 h 45 pour se rendre disponible à la caserne des Célestins. La BRI appuyée par le RAID avance progressivement dans l’établissement. L’ordre de l’assaut n’est donné que lorsque les services opérationnels, c’est-à-dire la BRI, estiment être en situation de le faire, parce qu’ils maîtrisent totalement les lieux, et sont en mesure de procéder au sauvetage des derniers otages sans risque supplémentaire pour eux. Dès lors que l’information est transmise que les conditions sont réunies, l’ordre de l’assaut est donné par le préfet de police, après que j’ai donné moi-même l’ordre d’y procéder puisque la sécurisation des lieux est intervenue et qu’il est possible de le faire.
Il y a des ceintures d’explosifs, le terrain est peut-être miné, nous ne connaissons pas le nombre de terroristes, nous ne savons pas où ils se trouvent : dans un tel contexte, une intervention pour sauver des vies n’est possible que dès lors qu’il y a une maîtrise totale du lieu et des conditions de l’intervention. Voilà donc, très rigoureusement, ce qui s’est passé. Et bien entendu, pour une intervention de ce type, l’appréciation par les services opérationnels des conditions de l’intervention est un élément pris en compte pour décider de l’assaut. C’est lorsque les conditions sont réunies que la décision est prise. Si nous n’agissions pas ainsi et si après une décision hasardeuse, il devait y avoir des explosions et des morts, une autre question me serait posée aujourd’hui. Donc, ce n’est qu’une fois que les conditions opérationnelles sont réunies que l’assaut peut être donné : c’est une modalité classique d’intervention.
M. le président Georges Fenech. Je vous remercie de votre réponse, monsieur le président, et je cède la parole à M. le rapporteur.
M. Sébastien Pietrasanta, rapporteur. Votre déroulé des faits montre bien, Monsieur le ministre, l’importance de ce qu’on appelle les primo-intervenants, déjà soulignée lors de précédentes auditions. Au sein du Bataclan, il y a eu un avant et un après : d’après ce qui a été dit, les tirs ont cessé après l’intervention salutaire du commissaire de la BAC, qui a permis d’éliminer un des kamikazes et de sauver des vies. La formation initiale ou continue des fonctionnaires de police ou de gendarmerie a-t-elle été révisée après les attentats de janvier 2015, notamment pour permettre à ces primo-intervenants d’agir le plus rapidement et le plus efficacement possible ?
Quant à la BRI, au RAID et au GIGN, dont vous avez souligné à plusieurs reprises quels furent leur rôle et leur importance lors des attentats de janvier et de novembre, leur doctrine d’emploi a-t-elle évolué, notamment au regard de ce qui s’est passé au Bataclan mais pas seulement ? Pour la première fois, nous étions confrontés à des kamikazes, avec des ceintures d’explosifs. Le mode opératoire, le mode d’intervention a-t-il évolué ? Des conclusions ont-elles été tirées après les événements du 13 au soir ?
M. le ministre. Tout d’abord, les attentats de 2015 ont conduit la police et la gendarmerie à réagir immédiatement pour adapter le contenu et les modalités de formation dans le domaine des techniques et de la sécurité en intervention, tant pour la formation initiale que pour la formation continue. Un arrêté interministériel a été pris le 27 juillet 2015, relatif à la formation continue aux techniques et à la sécurité en intervention des personnels actifs de la police nationale et des adjoints de sécurité. Il renforce le caractère obligatoire de cette formation, qui recouvre le tir, l’emploi des armes, les pratiques professionnelles en intervention, les techniques d’intervention, les techniques de défense et d’interpellation, les premiers secours en intervention. Il consolide les principes d’un temps minimum annuel de douze heures d’entraînement et de complémentarité des formations au tir et aux pratiques professionnelles en intervention. Dans le cadre de ces séances de formation continue, les formateurs bénéficient de nouveaux supports pédagogiques et de dispositifs de formation renforcée. Le programme de formation aux techniques et à la sécurité en intervention de la scolarité des gardiens de la paix a été renforcé dans la formation au tir, aux premiers secours en intervention. Et afin de travailler avec le discernement en action, des exercices sur le facteur de prise de décision en situation complexe ont été conçus à partir de cas réels rencontrés sur le terrain.
J’ai défini de nouvelles doctrines d’intervention des PSIG et des BAC dans le cadre du plan du 29 octobre dernier, que j’ai présenté rapidement dans mon exposé, et de nouvelles armes seront utilisées. J’ai souhaité que les stages de formation à l’utilisation de ces dernières, qui permettent aux policiers des BAC, qui sont parfois primo-intervenants, de faire face à des tueries de masse, soient prévus en amont de la livraison des armes, de manière que ces armes puissent être utilisées dès leur livraison par le SAELSI aux différents services de police et de gendarmerie. Ce n’est pas évident, les dispositions d’entraînement au tir étant assez contraintes. J’ai donc demandé que l’on regarde, par-delà les stands d’entraînement de la police et de la gendarmerie, quelles autres structures pourraient éventuellement être utilisées avec l’accord d’utilisateurs privés afin de faciliter ces entraînements.
S’agissant de la doctrine d’intervention des forces, je vous l’ai indiqué tout à l’heure, il faut distinguer, sur l’ensemble du territoire national, car il peut y avoir des attentats et des risques de surattentats partout, les primo-arrivants, qui n’interviennent pas à proprement parler contre les terroristes, mais qui mettent en condition le site avant l’arrivée des primo-intervenants. Avec le plan BAC-PSIG et le déploiement des forces d’intervention rapide de la police et de la gendarmerie sur l’ensemble du territoire national, l’objectif est que des primo-intervenants puissent être sur les lieux de la tuerie dans un délai de vingt à trente minutes. C’est la raison pour laquelle j’ai demandé aux directeurs généraux respectifs de la police nationale et de la gendarmerie nationale de bien vouloir profiter des efforts que nous faisons en termes d’augmentation des effectifs pour répartir les forces d’intervention rapide dépendant de leurs directions respectives sur l’ensemble du territoire national, avec le souci qu’il soit totalement couvert. Je rendrai publique la répartition de ces forces dans les tout prochains jours puisque la copie doit m’être rendue sans tarder par ces deux directeurs généraux.
M. Pascal Popelin. Dès l’examen en commission des lois, le 20 janvier dernier, de la résolution tendant à la création de cette commission d’enquête sur les moyens mis en œuvre par l’État pour lutter contre le terrorisme depuis le 7 janvier 2015, j’avais exprimé mes réserves sur ce bornage dans le temps. Comme beaucoup d’autres, notre pays n’est pas confronté à la menace terroriste que depuis le 7 janvier 2015 ; même si ses formes ont évolué au fil du temps, le terrorisme se manifeste en France depuis plusieurs décennies, et les moyens opérationnels mis en œuvre par l’État pour y faire face s’inscrivent dans cette longue histoire. Or, pour savoir où l’on va, il est toujours bon de savoir où l’on est, et d’où l’on part.
Vous avez détaillé, monsieur le ministre, l’action du Gouvernement depuis que qu’il est aux responsabilités, et ce n’était pas inutile.
J’ai compris que nous reviendrons lors d’une prochaine audition sur la question du renseignement, estimez-vous néanmoins que les conséquences de la décision de suppression des renseignements généraux, fusionnés avec l’ex-direction de la surveillance du territoire, pour créer la DCRI à compter du 1er juillet 2008, sont désormais derrière nous ? Considérez-vous que les mesures prises depuis 2012 ont permis de restituer au ministère de l’intérieur sa capacité en matière de renseignement de proximité ? Vous avez détaillé également l’augmentation des effectifs, par paliers, mais de manière constante depuis 2012. Avez-vous le sentiment que du point de vue de la lutte contre le terrorisme, ces moyens nouveaux compensent les 13 700 suppressions de postes de policiers et de gendarmes décidées entre 2007 et 2012 ? Vous avez évoqué aussi la baisse de 17 % des crédits hors titre 2 durant le quinquennat précédent – il s’agit des moyens techniques mis à disposition de nos services. Comment les choses ont-elles évolué depuis lors ?
M. le président Georges Fenech. Je le rappelle encore une fois : la question du renseignement doit faire l’objet d’une deuxième audition. C’est une question de respect vis-à-vis du ministre que de respecter nous-mêmes nos engagements.
M. Guillaume Larrivé. Je ne reviendrai pas sur la question du renseignement et des effectifs. Il y aurait en effet beaucoup à dire, cher collègue Popelin. Si nous voulions évoquer la question dans la durée, nous pourrions ainsi parler de la période 1997-2002 et de l’impact d’un certain nombre de réorganisations relatives au temps de travail sur la mobilisation des forces de la police nationale.
J’ai pour ma part cinq questions.
La première, j’en suis bien conscient, est peut-être à la lisière de l’enquête judiciaire, contrairement aux quatre autres. La revendication des attentats du 13 novembre mentionne expressément huit individus impliqués. Or il n’y en a que sept qui aient fait l’objet d’une mention publique. Ce point peut-il être expliqué ? De même, la revendication affirme qu’ont été attaqués le Stade de France, le 10e, le 11e et le 18e arrondissement de Paris, mais, si une voiture a bien été retrouvée dans ce dernier arrondissement, il ne s’y est heureusement rien passé. Ce point aussi peut-il être expliqué à ce stade ?
Deuxièmement, le plan Vigipirate et l’opération Sentinelle, qui impliquent des militaires de l’armée de terre, vous paraissent-ils atteindre leurs objectifs en termes de lutte antiterroriste ? Vous paraissent-ils efficaces également au regard des moyens mobilisés, qui, affectés à ces missions, ne peuvent l’être à d’autres ?
Troisièmement, le Gouvernement estime-t-il que la fermeture de l’hôpital du Val-de-Grâce peut être pérennisée compte tenu de la persistance d’une menace terroriste extrêmement élevée à Paris et en Île-de-France ?
Quatrièmement, devant le Parlement réuni en Congrès le 16 novembre dernier, le Président de la République a évoqué la perspective de la création, à partir des réserves de la défense, d’une « garde nationale encadrée et disponible ». Quelles suites l’intention exprimée a-t-elle aujourd’hui, notamment au sein de la gendarmerie nationale ?
Cinquième et dernière question, vous avez vous-même conclu votre intervention en évoquant à juste titre la dimension européenne de ces questions. Or, lors de la dernière conférence des présidents du Parlement européen, jeudi dernier, une coalition hétéroclite, allant du Parti socialiste au Front national, en passant par les Verts et le Modem, a refusé l’inscription du vote sur le texte relatif au PNR (Passenger Name Record) à l’ordre du jour de cette semaine, semaine de session plénière. Seuls le groupe du Parti Populaire Européen et celui des Conservateurs et Réformistes Européens ont voté pour. Comment expliquer cette attitude des députés européens socialistes, qui paraît directement contraire aux intentions, affichées et réelles, de votre gouvernement ? Vous êtes effectivement attaché, comme nous, à ce que ce dossier du PNR avance enfin au service de la sécurité dans les transports aériens.
M. François Lamy. Vous avez expliqué, monsieur le ministre, que le GIGN était en position à la caserne des Célestins à 22 h 45, donc après l’arrivée de la BRI au Bataclan. Pourquoi le GIGN n’est-il finalement pas intervenu ? Est-ce parce que la BRI et le RAID estimaient être en nombre suffisant ? La rumeur, à laquelle il faut tordre le cou, d’une « bataille » entre les forces d’intervention circule.
Mes autres questions sont plus générales et recoupent en partie celles de mes collègues.
Estimez-vous qu’un service de renseignement du type du service central de renseignement territorial créé assez récemment, au mois de mai 2014, doit disposer de capteurs humains et de capteurs techniques ? Je pourrai expliquer un jour ce qui s’est passé dans mon propre département lorsque les renseignements généraux ont été supprimés : d’un coup, tout le renseignement territorial a disparu. Selon vous, quand le SCRT sera-t-il suffisamment remonté en puissance pour être efficace dans la détection des signaux faibles, qui, par principe, doit venir après celle des signaux plus importants ?
Vous avez à juste titre expliqué qu’il était impossible de protéger l’ensemble des sites. Des mesures ont néanmoins été prises depuis le 7 janvier 2015 : avec les 7 000 militaires de l’opération Sentinelle et les 11 000 policiers et gendarmes affectés à la protection des sites stratégiques, près de 19 000 fonctionnaires attachés à la sécurité et à la défense du pays sont actuellement affectés à des tâches qui ne correspondent pas tout à fait à leur formation. Où en est la réflexion sur la possibilité de créer une force dédiée à la protection de sites, une force qui n’aurait pas la même formation que nos militaires et policiers ? On a parlé de garde nationale, de sociétés privées…
Ma dernière question, générale, rejoint celle du président, mais je la poserai de manière inverse. Vous avez expliqué l’efficacité des services de police le soir du 13 novembre, vous avez évoqué un certain nombre de dysfonctionnements, notamment dans l’identification des victimes. De votre point de vue de ministre de l’intérieur, quelles ont pu être les manques – il ne s’agit pas de savoir s’il y a eu des erreurs – au niveau de l’organisation des services de sécurité, entre le 7 janvier 2015 et le 13 novembre dernier ? Bref, sur quels points, aimeriez-vous peut-être encore renforcer notre dispositif de sécurité au cours des prochains mois ? Les services étaient-ils totalement au point ? Y a-t-il eu des améliorations entre le 7 janvier 2015 et le 13 novembre ? On parle encore de guerre des services, entre les services de la préfecture de police de Paris et les autres services de la police nationale.
M. le ministre. Je suis désolé, monsieur le président, mais je dois répondre aux questions relatives aux services de renseignement, par respect pour ceux qui m’ont interrogé.
Je suis trop conscient de la difficulté de la lutte antiterroriste pour l’aborder avec des arrière-pensées polémiques. Il serait extrêmement facile pour moi de dire qu’il y a deux périodes : l’une au cours de laquelle on a supprimé 13 000 emplois, l’autre où l’on en recrée ; l’une où l’on a démantelé le renseignement, l’autre où on le conforte. Ma conviction profonde est que, tous les gouvernements, de droite ou de gauche, qui ont été confrontés à la menace terroriste – et ils l’ont tous été – ont essayé de faire au mieux dans l’organisation des services qui étaient sous leur responsabilité pour assurer la protection des Français. Je ne suis pas sûr que ma volonté de tenir en la matière le propos le plus rigoureux et le plus juste possible conduira l’ensemble des acteurs à avoir la même précaution à mon égard mais je pense que la question du terrorisme mérite cette approche. Sinon, on crée les conditions d’un climat extrêmement malsain. La force d’un pays face au terrorisme, ce n’est pas simplement la capacité d’une administration à s’organiser, même si c’est bien entendu essentiel, c’est aussi la capacité des forces qui sont ou ont été en situation de responsabilité d’assurer aux Français que le mieux est fait. Ne pas les convaincre de cela alors que telle est la réalité, c’est diminuer considérablement la capacité de résilience du pays. La capacité de résilience d’un pays dépend pour partie de la conviction qu’ont les citoyens que le maximum est fait pour les protéger : moi, je n’ai pas de doutes sur le fait que le maximum a été fait pour protéger les Français dans une période antérieure. Et, compte tenu du temps que j’y passe aujourd’hui, je n’ai pas de doutes non plus sur le fait que nous essayons de faire au mieux.
La réforme des renseignements généraux a reposé sur l’idée qu’il y avait un changement d’époque, que nous pouvions « technologiser » le renseignement et que le renseignement territorial, tel qu’il avait pu exister par le passé, devait évoluer compte tenu des nouveaux enjeux technologiques auxquels le pays était confronté. Était-ce une erreur ? Ce n’est jamais une erreur, de considérer que des services ont besoin de la technologie. Était-ce suffisant ? Non. Depuis que nous sommes confrontés au risque terroriste, de nombreuses analyses d’experts ou de journalistes développent l’idée qu’on aurait fait le choix, en France, de la technologie contre les hommes. Mais que vaut la technologie dans les services de renseignement s’il n’y a pas des hommes pour analyser l’ensemble des éléments collectés par la technologie ? Cela ne sert à rien. La technologie permettra-t-elle de tout faire, y compris ce qu’étaient capables de faire les policiers sur le terrain, lorsqu’ils étaient immergés dans des quartiers dont ils connaissaient tous les acteurs ? Non. Mais ne pas armer les policiers de moyens numériques et technologiques qui permettent notamment d’entrer dans les dispositifs extrêmement sophistiqués qu’utilisent les terroristes en vue de la commission d’actes terroristes serait stupide. Cette opposition, cette espèce d’antienne constamment réitérée sur le thème du choix de la technologie contre les hommes est donc absurde. Il faut des hommes compétents et de la technologie.
Dans le cadre de la lutte antiterroriste, nous essayons précisément aujourd’hui de moderniser considérablement les moyens technologiques des services. C’est ce que nous avons fait avec la loi sur le renseignement, c’est ce que nous faisons en consacrant dès 2015 98 millions d’euros de crédits hors titre 2 à cette modernisation, au sein des 233 millions d'euros de crédits hors titre 2 alloués dans le cadre du plan de lutte antiterroriste.
Vous avez évoqué, Monsieur Larrivé, la revendication des attentats, mais je ne peux pas communiquer d’informations sur ce sujet, pour la bonne et simple raison que, si je le faisais, je diffuserais devant votre commission des informations couvertes par le secret de la défense nationale ou le secret de l’instruction. D’ailleurs, pour des raisons qui tiennent à la manière dont les enquêtes sont conduites et au respect des principes de droit, le ministre de l’intérieur n’est pas au courant du détail de toutes les procédures judiciaires conduites par les juges antiterroristes, même si un certain nombre d’éléments de l’enquête peuvent être portés à sa connaissance afin que ses services s’organisent pour éviter la commission d’autres actes. Je ne peux donc pas répondre à cette question.
Le plan Vigipirate est-il efficace ? Il n’est pas dirigé par le ministère de l’intérieur, qui n’en est qu’un contributeur. J’ai sur la question des modalités d’intervention des militaires et des forces de l’ordre sur le territoire national une réflexion, qui résulte des événements qui se sont produits en Europe, dans le monde et en France au mois de janvier 2015 et au mois de novembre dernier et qui m’incite à faire au Président de la République et au Premier ministre des propositions de modification de la doctrine. Je ne souhaite pas les livrer ici car elles n’ont pas encore été arbitrées. Peut-être serai-je en situation, lorsque vous me réauditionnerez d’expliquer les raisons pour lesquelles j’ai fait ces propositions, mais sans les dévoiler toutes. À mon sens, dès lors que nous avons affaire à des terroristes, qui peuvent frapper en tout lieu et à tout instant, et commettre des tueries de masse, la meilleure manière d’assurer la protection optimale, c’est de prévoir des dispositifs de patrouille aléatoires et imprévisibles qu’ils sont susceptibles de croiser à tout instant. Les moyens ne seront jamais suffisants pour protéger par des gardes statiques tous les lieux susceptibles d’être frappés. Si nous laissons accroire cela, chaque fois que des personnes seront touchées dans un lieu, on se demandera pourquoi il n’était pas protégé. La question, au demeurant très légitime, qui m’a été posée sur le Bataclan en témoigne.
Il y a par exemple, tout confondu, 77 000 établissements scolaires en France. Pour assurer une garde statique permanente devant ces établissements scolaires, il faudrait que je mobilise 220 000 policiers et gendarmes, c’est-à-dire la quasi-totalité de mes effectifs. Ce serait très compliqué. Il n’est d’ailleurs pas sûr, les premières actions de sensibilisation que nous avons conduites en témoignent, qu’une garde statique devant chaque établissement garantirait la sécurité optimale des enfants sans sécurisation des locaux. La meilleure manière d’assurer cette protection, c’est de faire tourner en permanence des forces, pour que le dynamisme de la garde nous permette d’aboutir à des solutions plus efficaces. En tant que ministre de l’intérieur, je constate cependant qu’il est très difficile d’arriver à faire partager ce point de vue, même si cela relève pour nous d’une démarche de bon sens, à ceux qui sont dans l’anxiété et qui peuvent légitimement penser qu’une garde statique est plus efficace qu’une garde dynamique. Ainsi, Charlie Hebdo faisait l’objet d’une garde dynamique. Dans les semaines qui ont précédé les événements, il avait été considéré en effet que chaque garde fixe constituait une cible pour les terroristes et que la meilleure manière d’assurer la sécurité des lieux sans présenter des cibles était de dynamiser les gardes. Cette théorie a été beaucoup développée, nous l’avons mise en œuvre.
Je suis favorable à une évolution et je fais des propositions dans l’esprit que je viens de vous indiquer. Cela fait également l’objet de réflexion avec les militaires, l’objectif étant que le dispositif de garde soit suffisamment dynamique pour que Vigipirate présente suffisamment d’imprévisibilité pour ceux à qui nous devons faire face.
Le sujet de l’hôpital du Val-de-Grâce ne relève pas directement des compétences du ministère de l’intérieur, mais peut-être pouvons-nous revenir sur ce qui s’est passé le soir des attentats du 13 novembre. Les sapeurs-pompiers, renforcés par les 21 équipes médicales, ont veillé à apporter des premiers secours et de premiers soins. L’objectif était d’évacuer les blessés vers les hôpitaux afin qu’ils bénéficient de la prise en charge la plus adaptée. C’est d’ailleurs ce qui a été fait, avec une capacité de résilience de notre dispositif de secours et de soins qui a été saluée. Paris dispose de nombreux établissements hospitaliers, et deux hôpitaux militaires ont également été mobilisés ; à aucun moment le dispositif auquel nous avons fait appel ne s’est trouvé saturé. Le ministre de la santé et le ministre de la défense veillent ensemble, dans le cadre des exercices auxquels nous procédons, à ce qu’il n’y ait pas de saturation de nos moyens d’intervention.
Le Président de la République a effectivement évoqué l’intérêt de la garde nationale devant le Congrès. Le ministère réfléchit à la création d’une garde nationale gendarmerie nationale, et fera, à la mi-mars, des propositions en ce sens au Premier ministre et au Président de la République. Nous réfléchissons concrètement à une force rapidement mobilisable, placée sous l’autorité des préfets, formée pour accomplir des missions de type sécurisation ou appui des policiers et gendarmes. Le modèle des réserves de la gendarmerie, avec ses 28 000 réservistes – 40 000 demains –, nous inspire, parce qu’il fonctionne bien depuis vingt-cinq ans, pour un coût relativement modéré. Si nous reprenons cette idée, je souhaite néanmoins que nous puissions créer une garde nationale qui n’écrase pas la réserve actuelle, qui est employée tous les jours dans les brigades. Je crois beaucoup à ce concept nouveau qui nous permettra de renforcer nos moyens lors d’événements extraordinaires. Je vous confirme donc que c’est une idée sur laquelle nous travaillons et à propos de laquelle nous formulerons très prochainement des propositions ; les choses avancent.
Votre cinquième question, sur le PNR, est dépourvue de toute arrière-pensée politique. (Sourires.) J’y vois là l’expression de votre malice et de votre très bonne connaissance des sujets, et je vais par conséquent vous répondre sans précautions. Je considère qu’il n’est absolument pas responsable, mais alors pas du tout, de différer aujourd’hui l’examen par le Parlement européen du PNR. Lorsque je suis allé devant la commission LIBE du Parlement européen en février 2015, ce sujet était hors de portée. Et l’accueil qui m’a été réservé était absolument glacial, pour ne pas dire frondeur. (Sourires.) Il était par conséquent extrêmement difficile de convaincre, mais nous avons convaincu. Et nous sommes parvenus, dans le cadre du trilogue, à une discussion de très bonne qualité qui a abouti à un accord. Voici maintenant que l’on veut différer l’examen du texte par le Parlement européen et le lier à des éléments à venir sur la protection des données ! Soyons très clairs : le seul instrument fiable dont nous disposons pour assurer la traçabilité du retour des terroristes sur le territoire de notre pays, c’est le PNR – pour ceux qui reviennent par avion en tout cas. Ne pas se doter de cet outil, alors que nous sommes allés au bout de la discussion dans le trilogue et que toute garantie est donnée sur la protection des données – elle pourra toujours être renforcée par les textes à venir – nous expose. Or nous exposer face au risque terroriste n’est pas du tout responsable. J’ai donc sur ce sujet, compte tenu du combat que j’ai mené au sein des instances européennes et de l’intérêt qu’il présente, une vision extrêmement claire, et je ne peux que me retrouver dans votre préoccupation et redire ce que j’ai déjà eu l’occasion de dire à plusieurs reprises.
En ce qui concerne le GIGN et le RAID, monsieur Lamy, j’ai vu qu’il y avait des polémiques, mais j’ai donné tout à l’heure la chronologie précise des modalités d’intervention du RAID : le GIGN est mis en alerte à 22 h 26 et reçoit son ordre de départ à 22 h 45 pour se rendre disponible à la caserne des Célestins au cas où il devrait être engagé sur d’autres sites. C’est le principe de précaution qui nous conduit à mobiliser le GIGN. Dans une situation comme celle du 13 novembre, on ne sait pas si d’autres attentats n’interviendront pas après ceux qui viennent d’avoir lieu. La responsabilité qui est la mienne, et je l’ai dit à plusieurs reprises aux deux directeurs généraux, qui en conviennent, est alors non pas d’organiser la guerre des services mais de faire en sorte que tous les services fassent la guerre au terrorisme. Le temps de la guerre des services est dépassé ; aujourd’hui, c’est le temps de la guerre de tous les services contre le terrorisme. C’est la raison pour laquelle nous avions mobilisé le GIGN, pour le cas où…
De même, le patron de la gendarmerie nationale et le patron de la police nationale travaillent dans un excellent esprit, et j’aurai l’occasion de l’exposer dans quelques jours. Avec le patron de la DGSI, ils ont fait un travail très important au mois de janvier 2015, dans le « fumoir », où nous sommes restés ensemble pendant quarante-huit heures jusqu’à la neutralisation des terroristes. Ils ont parfaitement conscience qu’en cas de tuerie de masse, il n’y a pas de place pour la stratégie normande « au plus fort la pouque » : c’est au contraire tous ensemble pour faire face à l’adversité et à la nécessité de neutraliser les terroristes. D’ailleurs, la carte que nous présenterons montrera que nous couvrons la totalité du territoire.
Sur le SCRT, j’ai répondu. Il est déjà opérationnel, et nous lui donnons des moyens supplémentaires, y compris sur le plan technologique ; il pourra mobiliser des techniques de renseignement. D’ores et déjà, dans la lutte antiterroriste, il est tout à fait à pied d’œuvre.
Sur la protection des sites, nous pouvons trouver aujourd’hui une excellente articulation avec les militaires dans le cadre d’un processus dynamique et imprévisible pour les terroristes. Les gardes statiques posent un problème opérationnel face à des individus qui peuvent frapper à tout moment et partout. Il faut donc faire mouvement.
Quant aux manques dans l’organisation des services, lorsqu’on exerce mes responsabilités et qu’on affronte ce qui s’est passé en 2015, on n’est pas du tout dans l’état d’esprit de quelqu’un qui considère que tout s’est passé comme cela devait se passer. D’ailleurs, si je raisonnais ainsi, je commettrais une faute à l’égard de mes services. Je n’ai pas de suspicion à l’égard des services, mais des événements comme ceux que nous avons vécus justifient un retour d’expérience agrégé, et pas simplement par direction, un retour d’expérience global qui permette d’identifier les difficultés.
Celles-ci résultent d’abord de trous dans le dispositif européen de coopération entre les services de renseignement – sujet considérable, le 13 novembre l’a montré. Le dispositif de contrôle des frontières extérieures est également déficient, s’agissant de la lutte contre les faux documents. Une plus grande fluidité est en outre nécessaire dans les échanges entre les services, notamment en ce qui concerne le suivi individuel des cas. C’est la raison pour laquelle j’ai mis en place l’état-major opérationnel de prévention du terrorisme (EMOPT) – complémentaire de l’UCLAT –, pour s’assurer que chaque individu figurant au FSPRT fait l’objet d’un suivi extrêmement méticuleux et attentif. Cela suppose aussi, et c’est fondamental, un croisement dans l’analyse des services, ce que nous organisons. Cela suppose également que nous ouvrions davantage le ministère de l’intérieur au monde de la recherche et de l’université sur ces questions. J’y tiens beaucoup car, quelle que soit l’excellence de nos services, auxquels je veux encore une fois exprimer ma gratitude, quelle que soit la haute compétence de ceux qui les servent, nous ne pouvons pas, dans la période que nous traversons, ne pas nous ouvrir à la réflexion intellectuelle et universitaire sur ces sujets.
Je veux le dire à la commission d’enquête : j’aborde ces questions avec beaucoup d’humilité et une volonté de faire monter en gamme notre dispositif, dans l’esprit que je viens d’indiquer.
M. le président Georges Fenech. Chers collègues, vous êtes encore huit à vouloir intervenir, et notre réunion doit se terminer dans trente minutes. Je vous demande donc de ramasser vos interventions, et prie M. le ministre de faire des réponses synthétiques. Entendons d’abord quatre interventions.
M. Meyer Habib. Monsieur le ministre, merci pour votre clarté et toutes ces précisions. La polémique n’a pas sa place dans nos discussions, il n’y a ici ni droite ni gauche : il n’y a que le souci partagé de la sécurité des Français.
Notre système de dé-radicalisation ne semble pas forcément tout à fait adapté. Ainsi la petite Israé, âgée de quinze ans, qui est finalement rentrée chez elle, était-elle en cours de dé-radicalisation, placée en foyer et interdite de sortie de territoire – elle avait été retrouvée par sa mère à la gare, deux ans plus tôt alors qu’elle voulait rejoindre la Syrie. Dans les lycées, 617 cas de radicalisation supposée ont été signalés, concernant des élèves de plus en plus jeunes. Comment améliorer notre système de dé-radicalisation ?
M. Georges Fenech. J’ai déjà dit que ce n’était pas l’objet de cette audition.
M. Meyer Habib. Je laisse donc cette question de côté.
J’en viens à la vidéosurveillance. Ne pensez-vous pas, Monsieur le ministre, particulièrement après l’attentat contre Charlie Hebdo, qu’il y a beaucoup à faire en la matière ? Les terroristes ont quand même pu circuler dans Paris, en sortir et disparaître des écrans pendant près de quarante heures. Ne faudrait-il pas, comme en Angleterre et dans d’autres pays, revoir en profondeur le maillage de notre système de vidéosurveillance, en utilisant les nouvelles technologies ?
Sur le Bataclan, vous avez déjà répondu à propos du témoignage des avocats des victimes, qui rappelaient que cette salle, appartenant à des membres de la communauté juive et ayant accueilli certaines soirées pour Israël, était particulièrement visée. Nous avons été interpellés à deux reprises sur ce point.
J’en viens à la doctrine d’intervention. Il est tout à votre honneur, monsieur le ministre, de défendre vos hommes, d’assumer vos responsabilités et de vous tenir comme un bouclier devant vos services, vos policiers, qui font un travail remarquable, mais, si tout était parfait dans le meilleur des mondes, cette commission d’enquête n’existerait pas et nous n’aurions pas de questions à vous poser. La doctrine et les procédures ont été respectées, notamment au Bataclan, avez-vous rappelé. Cependant, le nombre de victimes ne cessait d’augmenter à mesure que les minutes passaient. Ne faudrait-il donc pas revoir la doctrine et les procédures ? Selon certaines doctrines, il faut aller au contact directement ; plus on va vite au contact, moins le nombre de victimes est élevé. Cela vaut non pas dans le cas d’une prise d’otage mais dans celui d’un massacre. Or, manifestement, au Bataclan, c’était un massacre, pas une prise d’otages : il n’y avait pas de revendication, ils tuaient.
M. Olivier Falorni. Toutes les questions que je souhaitais aborder ayant été posées, je vous ferai simplement part de l’indignation que m’inspire un fait d’actualité en lien direct avec les attentats du 13 novembre, une indignation d’autant plus forte que nous avons entendu les familles des victimes. J’ai été indigné ce matin en lisant dans Le Parisien des extraits d’une interview donnée par M. Jean-Marc Rouillan, cofondateur du groupe terroriste Action directe, à une radio marseillaise le 23 février dernier. Lutter contre le terrorisme, c’est également lutter contre l’apologie du terrorisme. Or, interrogé sur les attentats du 13 novembre, M. Rouillan a déclaré : « Ils se sont battus courageusement, dans les rues de Paris, en sachant qu’il y avait près de 3 000 flics autour d’eux. On peut dire plein de choses sur eux, qu’on est absolument contre les idées réactionnaires, que c’était idiot de faire ça, mais pas que ce sont des gamins lâches. »
Jean-Marc Rouillan a été condamné en 1987 à la réclusion criminelle à perpétuité, notamment pour les assassinats de Georges Besse et de René Audran. Il bénéficie d’un régime de semi-liberté depuis 2011, mais tel avait déjà été le cas en 2007. À l’époque, il avait violé l’obligation de s’abstenir de toute prise de parole qui pesait sur lui en s’exprimant dans L’Express et était retourné en prison en 2008.
Compte tenu des circonstances, Monsieur le ministre, de tout ce que nous avons vécu et entendu, de la gravité de nos échanges, alors que tant de familles sont meurtries, on ne peut accepter de tels propos !
En tout cas, tout cela montre que, quelles que soient les pseudo-idéologies qui animent toutes ces personnes, les criminels terroristes se retrouvent toujours dans leur haine, qu’ils soient anarchistes, fascistes ou islamistes. Je voulais vous faire part de cette indignation, et vous demander votre réaction. Que pensez-vous de ces déclarations ? Estimez-vous qu’elles soient aujourd’hui tolérables ?
M. Serge Grouard. Monsieur le ministre, je souhaite revenir sur la doctrine d’emploi, déjà évoquée à plusieurs reprises. Si je résume et simplifie – peut-être trop –, la question est de savoir s’il faut intervenir plus rapidement et, effectivement, en moindre sécurité que ne le permet la doctrine actuelle. Vous avez répondu qu’il fallait avoir la maîtrise totale de la situation avant d’intervenir. On le comprend parfaitement. En même temps, j’ai cru comprendre que vous réfléchissiez à une telle évolution de la doctrine d’emploi.
Dans cette logique, qu’en est-il de nos capacités d’intervention ? Est-il envisagé de rapprocher, voire de réunir le GIGN et le RAID pour avoir une même capacité opérationnelle ou l’idée vous paraît-elle absurde ? Dès lors que la doctrine connaîtrait une telle évolution, faut-il que les forces de sécurité plus classiques puissent elles aussi mener ce type d’intervention ? Vous l’avez dit : on était à Paris, avec des moyens importants. Si de tels événements se produisaient en province, il faudrait plus de temps pour intervenir. Ne faudrait-il pas que les forces plus classiques puissent procéder aux premières interventions ?
Ma deuxième question est plus simple. Quelle a été, sur le terrain, la coordination entre les forces de sécurité et les services de premier secours ? Quelle autorité coordonnait les interventions des uns et des autres, notamment vers le Bataclan et vers les terrasses de café qui ont fait l’objet de ces attentats ?
M. Pierre Lellouche. À écouter ce débat, je ne suis pas sûr, monsieur le président, que la formule de la transparence totale, s’agissant du ministre de l’intérieur et de certains hauts responsables des services d’intervention et de renseignement, permettra d’avancer. Il y a nécessairement une part de posture et de non-dit, tout simplement parce qu’il y a, en ces matières, des choses qu’on ne peut pas dire. Je le sais pour travailler beaucoup sur ces questions.
Monsieur le ministre, certains propos m’ont dérangé dans votre présentation, au demeurant très bonne, très solide, en défense de nos policiers et de nos forces – et je m’associe à vous pour leur exprimer notre gratitude. Il y a en effet des choses qui n’ont pas fonctionné, qui ne fonctionnent pas et qui continuent à poser problème dans une guerre qui sera longue et difficile. Nous devons donc être capables de nous remettre en cause.
Vous avez par exemple répondu au président que vous n’avez pas entendu dire, au mois de janvier 2015, qu’il fallait instaurer l’état d’urgence, mais nous sommes des parlementaires ! La responsabilité de l’état d’urgence, vous le savez mieux que personne, relève du gouvernement, et si vous l’aviez instauré au mois de janvier 2015, vous auriez peut-être donné un coup de pied dans la fourmilière et permis de déclencher des actions utiles pour le renseignement au cours d’une année où nous avons été attaqués une bonne quinzaine de fois. Certains ont eu de la chance, dans le Thalys ou à Villejuif, mais pas d’autres – je songe au malheureux qui a été décapité dans l’Isère.
Vous dites que vous avez déjoué beaucoup d’attentats, mais si l’on considère le ratio entre, d’une part, ce qui a été déjoué et les cas où nous avons eu de la chance et, d’autre part, le nombre d’attentats, honnêtement, je suis inquiet. Je vous le dis parce qu’il se trouve que j’ai passé plusieurs jours en Israël récemment et, là-bas, le taux de prévention des attentats est très, très élevé – parce qu’ils ont des attentats tous les jours... Et je crains qu’à mesure que nous remporterons des victoires sur Daech, nous n’ayons malheureusement beaucoup de candidats à l’attaque chez nous. Il faut donc augmenter le taux de prévention.
Une fois que l’attentat a eu lieu, c’est trop tard, même si on peut s’interroger sur le modus operandi et la gestion de l’attentat lui-même. Sans déflorer le sujet de nos travaux du mois de mai, le cœur, c’est la prévention, et donc la coordination du renseignement, l’endroit où l’information se partage, et la manière dont cela se répercute sur les forces opérationnelles. S’y ajoute la dimension européenne, sur laquelle vous avez très justement insisté.
Puisqu’on ne parle pas de renseignement aujourd’hui, je voudrais insister sur deux points en matière d’intervention. Tout d’abord, la question du Bataclan a été posée avec pertinence. Un théâtre a été attaqué à Moscou, en 2002, une école a été attaquée ensuite à Beslan, dans les deux cas ce fut épouvantable. Je comprends ce que vous nous dites sur la doctrine d’emploi, le souci de sécuriser les lieux, mais enfin, quand les victimes doivent attendre trois heures par terre après avoir été blessées à l’arme de guerre, cela fait beaucoup de morts à l’arrivée ! Cela me paraît justifier, au niveau opérationnel, un entraînement dédié et, peut-être, une réflexion sur un changement de doctrine, qui permette une action immédiate. Ce n’est pas une critique : une démocratie qui bascule brutalement de la paix à la guerre tâtonne. Il faut donc s’interroger sur le mode opératoire, et c’est aussi l’un des objectifs de cette commission.
J’en viens à l’intervention à Saint-Denis. Le procureur évoque 5 000 cartouches. Il y avait trois personnes, avec une arme automatique. Fallait-il agir ainsi ? Encore une fois, ce n’est pas une critique : l’immeuble aurait pu être piégé, et nous sortions d’une période de dramatisation intense, mais cela mériterait un retour d’expérience et une discussion – peut-être pas en public.
Quant à l’identification des personnes impliquées, les Kouachi et Coulibaly ont été repérés par la police, parfois interceptés. Comment se fait-il que les mesures de contrôle aient été suspendues ? Comment se fait-il que l’un d’entre eux ait pu accompagner sa compagne jusqu’en Espagne, pour qu’elle y prenne un avion pour la Syrie, et qu’on le retrouve ensuite impliqué dans un attentat ? Ces constats m’ont d’ailleurs conduit à ne pas voter votre loi sur le renseignement : il ne sert à rien d’augmenter la pile d’informations si on ne sait pas utiliser celles qu’on a. Or vous aviez tout un tas d’indications, sur Verviers, sur les Buttes-Chaumont, sur Molenbeek, sur des gens qui ont ensuite participé à des attentats. Sommes-nous sûrs que nous savons exploiter les renseignements ? Cela me préoccupe, comme beaucoup de gens.
Enfin, je n’ai pas le temps d’évoquer les limites de votre loi antiterroriste, débattue en séance la semaine dernière, mais que fait-on de ceux qui reviennent de Syrie ? Les laisse-t-on retourner chez eux avec plus ou moins de contrôles ?
J’en viens à une double question parisienne. Je suis le député des zones les plus attrayantes pour les terroristes : tout ce qu’il y a de plus touristique à Paris est dans ma circonscription, des Champs-Élysées au Palais Garnier, en passant par les Grands Boulevards, la gare Saint-Lazare, etc. Tous les jours, cette géographie parisienne m’angoisse. Quand les BAC et les commissariats auront-ils des moyens suffisants pour faire face à une frappe forte ou pour un combat rapproché ? Ensuite, et je vous prie de croire que ma question n’a aucun caractère polémique, comment fera-t-on pour acheminer 125 véhicules de secours ou d’intervention, comme ce fut le cas le 13 novembre dernier, si la circulation automobile est supprimée sur la voie express, sur les quais bas ? La maire de Paris envisage effectivement de les rendre aux piétons et aux cyclistes. C’est très sympathique, mais comment traverser Paris s’il n’est possible de circuler que sur les quais hauts de la Seine ? Ils seront absolument saturés. À partir du mois de septembre prochain, ce sera Paris Plages toute l’année ! Comment concilier ce projet avec une menace terroriste « extrêmement grave », comme vous l’avez vous-même souligné ?
Monsieur le ministre, je vous remercie pour le travail que vous faites, avec beaucoup de sérieux et de rigueur, mais en tant que citoyen, et pas seulement en tant qu’élu de l’opposition, je me pose des questions sur la préparation de notre pays à ce qui s’annonce comme une guerre longue et cruelle.
Mme Françoise Dumas. Votre responsabilité, Monsieur le ministre, était tout d’abord de remédier aux conséquences des réductions budgétaires et d’effectifs intervenues bien avant 2012, et de réarmer vos services. Si nous avons vécu le pire dans Paris, ville des symboles universels, notre responsabilité de protection et d’anticipation doit s’exercer sur tout le territoire. Nous devons donc poursuivre nos efforts et parvenir à la plus efficace répartition des forces d’intervention sur tout le territoire. Ne sombrons ni dans la démagogie ni dans la psychose mais nos concitoyens veulent légitimement être protégés partout. Pouvez-vous, dès lors, préciser quel est le déploiement des forces d’intervention, notamment des premiers secours ? Je songe en particulier aux sapeurs-pompiers. Au-delà du renforcement des moyens, c’est la question de la mutualisation toujours perfectible des services qui se pose. Nous pouvons nous inspirer des dispositifs déjà prévus pour d’autres crises majeures, qui ont donné lieu à des exercices de simulation.
Bien sûr, les préfets ont la responsabilité d’organiser ces simulations qui permettent sur le terrain de préparer et former les personnels de sécurité en lien avec ceux des collectivités territoriales concernées, et même des centres hospitaliers. Quelles sont les modalités de cette politique d’exercices sur tous les territoires ? Vous viendrez d’ailleurs très bientôt dans le Gard pour vous rendre compte de sa mise en œuvre. Il s’agit de pouvoir faire face, le cas échéant – espérons que cela ne se produira pas – à la prochaine crise majeure.
M. Michel Lefait. Onze projets d’attentat ont été déjoués, nous avez-vous dit, Monsieur le ministre, par les services de l’État, dont six depuis le mois de janvier 2015, mais le risque zéro n'existe pas et tous les moyens du monde ne parviendront jamais à empêcher la réplique de semblables abominations. Cependant, avec le recul et l’analyse des faits, des enseignements utiles pour la sécurité des Français, voire de précieuses préconisations, ont-ils pu être tirés ?
M. Jean-Luc Laurent. Monsieur le ministre, est-il envisageable de verser à l’instruction, comme le demandent des avocats des familles de victimes, certaines pièces d’affaires et de dossiers antérieurs ? Je pense aux dossiers de l’attentat du Caire, en 2009, des Buttes-Chaumont ou d’Artigat.
Ensuite, puisqu’une réflexion sur le dispositif Sentinelle est en cours, ne pensez-vous pas que le fichier S, qui rassemble des individus pour des motifs que je qualifierai de très larges, mérite lui aussi une réflexion, et doit peut-être évoluer ?
M. le président Georges Fenech. Le fichier S, cela concerne le renseignement, cher collègue.
M. Jean-Michel Villaumé. Lors de la prise d’otages au Bataclan, les forces d’intervention et les terroristes ont-ils communiqué ? Autrement dit, y a-t-il eu négociation ?
M. le ministre. Monsieur Meyer Habib, je propose que nous parlions de la dé-radicalisation une autre fois. Quant à la vidéosurveillance, comme vous le savez, nous avons mobilisé 20 millions d’euros de plus par an sur le fonds interministériel de prévention de la délinquance à des fins d’accompagnement de l’équipement par les collectivités locales des bâtiments ou des axes sur lesquels pourrait être apposée de la vidéosurveillance. Ces 20 millions d’euros sont à la disposition des collectivités locales qui présentent des projets. Nous avons déjà financé dans ce cadre un très grand nombre de projets destinés à améliorer significativement l’équipement en vidéosurveillance et vidéoprotection d’un certain nombre de sites.
En ce qui concerne la doctrine et le protocole d’intervention, soyons, encore une fois, extrêmement précis. Lorsque je parle de la sécurisation des lieux avant engagement de l’assaut, il s’agit de nous assurer qu’au moment de l’intervention nous ne ferons pas de victimes supplémentaires. Par exemple, je me souviens très bien qu’avant que l’ordre d’assaut ne soit donné à l’Hypercacher, il y a eu de nombreuses discussions sur la configuration des lieux, sur les conditions dans lesquelles nous pouvions intervenir, sur les issues qui pouvaient être empruntées. Selon nos informations, il y avait déjà au moins trois morts : il fallait s’assurer qu’il n’y en aurait pas davantage encore. Lorsqu’il y a des victimes sur un théâtre d’opérations des forces d’intervention rapide, notre doctrine, simple et logique, consiste pour l’instant à créer les conditions qui permettront d’éviter d’accroître le nombre des victimes au moment de l’assaut.
Cela ne signifie pas qu’il ne faut pas mener de réflexion sur la doctrine d’intervention de ces forces. Je partage le sentiment exprimé par Serge Grouard, par Meyer Habib et par Pierre Lellouche : il est nécessaire de réfléchir en continu sur les modalités d’intervention. Les compétences des forces sont différentes – nous avons pu le constater en novembre dernier. J’ai donc demandé une analyse segmentaire des compétences des forces dans le cadre du retour d’expérience (RETEX). Il s’agit de pouvoir faire intervenir telle force plutôt que telle autre, en fonction de la situation et des compétences, ou plusieurs forces en même temps pour être plus efficaces. Chaque événement doit faire l’objet d’un retour d’expérience afin d’adapter, voire de changer notre doctrine. Je suis, sur ce sujet, extrêmement pragmatique : chaque intervention doit permettre de sauver la vie de ceux qui ont été blessés, il faut toujours faire en sorte qu’il n’y ait pas plus de blessés, plus de morts. Chaque événement fait donc l’objet d’un RETEX qui peut conduire à des modifications de doctrine et à une évolution des modalités d’intervention.
C’est le cas aussi pour des interventions du type de celle de Saint-Denis. À cet égard, monsieur Lellouche, le RAID a tiré 1 300 cartouches ; 5 000, c’est le nombre de munitions dont il disposait. J’ai eu l’occasion de réagir sur l’assaut de Saint-Denis, en défense, effectivement, de mes troupes. Quelque appréciation que l’on porte sur cette intervention, conduite sous le contrôle du juge dans le cadre d’une opération judiciaire, je peux vous dire en effet, pour avoir été toute la nuit en contact avec le directeur général de la police nationale et la directrice centrale de la police judiciaire, qu’il fallait beaucoup de cran de la part des policiers du RAID pour intervenir : nul ne savait comment était le bâtiment, s’il était piégé, etc. J’entends les commentaires formulés ici et là et, dans un pays comme le nôtre, tous les commentaires sont recevables, mais j’estime de mon rôle, compte tenu de la part de risque que comportent ces interventions et du courage dont font preuve mes troupes, de souligner d’abord ce courage. Cela n’empêche pas les légitimes retours d’expérience. Et défendre ses troupes ne revient pas à s’interdire de réfléchir à la manière d’optimiser le fonctionnement des dispositifs.
Monsieur Falorni, en ce qui concerne Jean-Marc Rouillan, j’ai demandé à mes services d’examiner la possibilité juridique d’adresser au procureur de la République un signalement au titre de l’article 40 du code de procédure pénale, afin, si c’est possible, que les procédures adéquates soient déclenchées. D’autre part, il appartient au ministère public de requérir la révocation de la libération conditionnelle de cet individu – c’est l’État de droit. Pour ma part, je n’ai aucune mansuétude à l’égard de ce type de propos. Je considère qu’ils sont une offense à la mémoire des victimes et une blessure supplémentaire pour des familles qui ont déjà beaucoup enduré. La réponse doit être claire, et j’espère, monsieur le député, que vous considérerez que celle que je viens de vous faire l’est effectivement
Sur l’état d’urgence, nous avons régulièrement un débat sur ce sujet, monsieur Lellouche, et c’est très sain. Je considère que la lutte contre le terrorisme appelle la plus grande rigueur juridique dans la mobilisation des moyens pour y faire face. J’ai déjà eu l’occasion de développer publiquement l’analyse que j’ai livrée tout à l’heure concernant les conditions juridiques de déclenchement de l’état d’urgence. J’ai toujours souhaité que la plus grande rigueur soit de mise au sein de mes services, notamment la direction des libertés publiques, quand il s’agit de recourir aux mesures de police administrative de l’état d’urgence. En dépit de toutes les précautions prises, le juge administratif casse néanmoins certaines décisions, parce que le droit n’est pas une science exacte, et le ministère de l’intérieur ou le ministre lui-même sont parfois mis en cause. C’est dans l’ordre des choses, mais ma doctrine est de faire en sorte que le ministère de l’intérieur respecte toujours scrupuleusement le droit, même si ce souci peut entraver un certain nombre d’actions dont nous considérons qu’elles sont utiles.
Bien entendu, monsieur Grouard, le 13 novembre dernier, une coordination était assurée pour les forces d’intervention rapides, comme pour les forces de sécurité civile, soit par la cellule de crise soit par le préfet de police lui-même – selon la décision à prendre. Vous avez pu constater que l’articulation de l’intervention de la BSPP, des forces de protection civile, des forces de sécurité civile mobilisées dans les services départementaux d’incendie et de secours de la couronne parisienne et de la région Île-de-France a été bonne ; il faut nous assurer qu’il en serait de même des territoires plus lointains, ce qui est votre préoccupation d’Orléanais. J’ai donc donné des instructions aux préfets pour déclencher des exercices sur la base d’une méthode extrêmement précise qui permette cette coordination et cette articulation dans chaque territoire. Je me rendrai à Nîmes le 17 mars prochain pour la mise en œuvre de cette coordination sur le terrain, dans le cadre d’un exercice concret et réel. C’est la même philosophie qui présidera au RETEX et à ce que nous ferons le 17 mars à Nîmes.
Avons-nous tiré des renseignements utiles des attentats déjoués ? Bien entendu. Dans le cadre des entretiens administratifs ou judiciaires qui ont suivi, nous avons récupéré beaucoup de renseignements. Il en ira de même avec les 1 038 individus qui ont été ou seront auditionnés dans le cadre des 236 procédures judiciaires. Ces éléments sont autant de préconisations qui, chaque jour, nous conduisent à adapter l’intervention de nos services face au risque. Face au terrorisme, face à des gens qui font mouvement, nous devons nous aussi faire mouvement chaque jour en fonction des éléments d’information que nous récupérons.
Peut-on, monsieur Laurent, verser des éléments d’affaires antérieures dans les dossiers actuels ? Je n’ai pas à me prononcer sur ce sujet, c’est une affaire de juges d’instruction. Ceux-ci peuvent souhaiter, dans le cadre de réquisitoires supplétifs, obtenir des éléments complémentaires ou, éventuellement, verser dans leurs dossiers des éléments résultant d’enquêtes antérieures susceptibles d’alimenter la suite de la leur. Les avocats sont d’ailleurs là pour faire en sorte que cela soit possible. J’ai compris, de l’audition des victimes et de leurs avocats, que certains souhaitaient qu’il en soit fait ainsi à propos du Bataclan. Très bien. Ayant été engagé sur d’autres dossiers – je pense à celui de l’attentat de Karachi –, je vous le répète très solennellement : je ferai tout pour que le maximum – pour ne pas dire la totalité – d’informations soient communiquées. Les juges et les avocats auditionnés, dont je connais certains, ont une très bonne maîtrise de ces techniques. Ils savent comment il faut procéder pour obtenir ces éléments d’information nécessaires à l’avènement de la vérité.
Quant aux fiches S, il est important qu’elles soient actualisées en permanence. Dans le cadre du travail que nous conduisons avec l’EMOPT et de l’état d’urgence, nous avons dû procéder à plusieurs milliers d’actualisations – je n’ai pas le chiffre exact à l’esprit, je vous transmettrai les éléments par écrit. Il faut donc nous donner les moyens de faire preuve d’une vigilance constante, notamment par des mesures de police, à l’égard de ceux qui sont fichés S et peuvent présenter un danger. La retenue de quatre heures envisagée dans le cadre du projet de loi défendu par Jean-Jacques Urvoas répond tout à fait à cet objectif.
Compte tenu de la rapidité de l’intervention, je ne crois pas que l’on puisse parler de négociation entre la BRI et les terroristes le 13 novembre. Très vite, un terroriste a été neutralisé par les BAC. D’ailleurs, j’en profite pour dire à Serge Grouard, que le schéma sur lequel nous travaillons pour une couverture optimale du territoire, c’est l’articulation entre, d’une part, primo-arrivants – sécurité publique – et primo-intervenants – BAC, PSIG – et, d’autre part, dans un deuxième temps, l’intervention, le plus vite possible, des forces d’intervention rapide.
Le négociateur de la BRI est entré en contact avec les terroristes à 23 h 27, à 23 h 29, à 23 h 48, à 0 h 05 et 0 h 18, mais ces appels permettaient de dénombrer les terroristes et de mesurer leur détermination à mourir en martyrs. Il n’y a pas eu de négociation à proprement parler, c’était plutôt une tentative d’évaluation et de contact. Le dernier appel passé, à 0 h 18, visait à capter leur attention de manière à faciliter l'assaut. Il ne s’agissait pas d’une négociation au sens classique du terme. Je pense vous avoir répondu précisément, mais nous sommes évidemment à la disposition de la commission. Au-delà des auditions, nous pourrons répondre par écrit à vos questions afin que vous disposiez de la totalité des informations souhaitées.
Enfin, monsieur Lellouche, nous sommes tombés d’accord avec la maire de Paris sur le fait que les conditions de sécurité et d’intervention des forces – sécurité civile ou sécurité intérieure – doivent être évaluées en très étroite discussion avec la Ville de Paris, chaque fois qu’un aménagement de voirie est envisagé. Il s’agit simplement de pouvoir faire face à des risques élevés dans les meilleures conditions. Nous aurons cette discussion à propos des voies sur berge.
M. Pierre Lellouche. Vous allez donc étudier cette question avec Mme Hidalgo ? Normalement, c’est prévu pour le mois de septembre…
M. le ministre. Tel est effectivement le souhait légitimement exprimé par la maire de Paris. Chaque fois qu’il y a des sujets de ce type, soucieux d’accompagner la Ville de Paris, nous étudions les conditions dans lesquelles nous pouvons assurer une intervention efficace des forces de sécurité intérieure et des forces de sécurité civile – pas seulement en cas d’attentat.
M. Georges Fenech. Merci, monsieur le ministre, pour vos réponses et votre disponibilité. Nous nous retrouverons au mois de mai pour parler du renseignement.
Audition, à huis clos, de M. Jean-Michel Fauvergue, chef du RAID (Recherche Assistance Intervention Dissuasion), et de M. Éric Heip, son adjoint
Compte rendu de l’audition, à huis clos, du mercredi 9 mars 2016
M. le président Georges Fenech. Je vous remercie, messieurs, d’avoir répondu à la demande d’audition de notre commission d’enquête. Avec le ministre de l’intérieur, que nous avons reçu lundi, nous avons commencé à aborder les questions relatives à la conduite des opérations, l’intervention des forces de l’ordre et les moyens mis à leur disposition. Nous poursuivons nos investigations avec vous, monsieur le contrôleur général Fauvergue. Vous êtes le chef du RAID et vous êtes accompagné de votre adjoint, le commissaire divisionnaire Éric Heip.
Je rappelle que le RAID (Recherche Assistance Intervention Dissuasion) est une unité spécialisée en gestion des crises, qui a été créée en 1985. Elle est en mesure d’apporter son assistance aux directions de la police nationale, à la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) et aux unités de la gendarmerie qui la sollicitent pour répondre, notamment, aux missions de contre-terrorisme.
En raison de la confidentialité des informations que vous êtes susceptibles de nous délivrer, cette audition se déroule à huis clos. Elle n’est donc pas diffusée sur le site internet de l’Assemblée. Néanmoins, et conformément à l’article 6 de l’ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, son contenu pourra être publié en tout ou partie si nous en décidons ainsi à l’issue de nos travaux. Je précise que les comptes rendus des auditions tenues à huis clos seront au préalable transmis aux personnes entendues afin de recueillir leurs observations, dont la commission pourra décider de faire état dans son rapport.
Ce même article dispose que sera punie des peines prévues à l’article 226-13 du code pénal, soit un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, toute personne qui, dans un délai de vingt-cinq ans, divulguera et publiera une information relative aux travaux non publics d’une commission d’enquête, sauf si le rapport publié à la fin des travaux de la Commission a fait état de cette information. Les collaborateurs ne sont pas autorisés à assister aux auditions se déroulant à huis clos.
Conformément aux dispositions de l’article 6 précité, je vais maintenant vous demander de prêter le serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, de lever la main droite et de dire : « Je le jure ».
M. Jean-Michel Fauvergue et M. Éric Heip prêtent successivement serment.
M. le président Georges Fenech. Nous entrons dans le vif du sujet : le déroulement des attentats et l’intervention des forces. Compte tenu de la multiplicité des faits et de leur complexité, nous nous attacherons, pour la clarté de l’audition, à bien distinguer les événements du mois de janvier de ceux du mois de novembre. Vous voudrez donc bien, monsieur le contrôleur général, scinder votre exposé liminaire en deux parties, l’une portant uniquement sur les attentats du mois de janvier, l’autre, sur ceux du mois de novembre, chacune d’entre elles étant suivie de questions des commissaires d’enquête.
M. Jean-Michel Fauvergue, contrôleur général, chef du RAID. Monsieur le président, je ne saurais exposer correctement les faits du mois de janvier sans me référer à la préparation que le RAID a élaborée pour des faits de même nature depuis l’affaire Merah. Celle-ci est considérée par le RAID comme l’an zéro d’un type de terrorisme nouveau que l’on a retrouvé au cours de l’année 2015.
Il s’agit d’abord d’un terrorisme low cost, qui ne demande pas beaucoup d’organisation et utilise des armes automatiques et des gilets explosifs. Ensuite, il se caractérise par une nouvelle manière d’agir. Dans un premier temps, Mohamed Merah s’en est pris à des cibles à haute visibilité et à haut potentiel émotionnel : les militaires qu’il a tués, l’école juive et les petits enfants juifs qu’il a tués et achevés sur le trottoir. Dans un deuxième temps, une fois qu’il été retrouvé par les services d’enquête, il n’a pas essayé de fuir, il s’est retranché. Troisième temps, le terroriste radicalisé, qui veut mourir en combattant, en moudjahid, attend l’arrivée des forces d’intervention puis les charge pour essayer de faire le plus de dégâts possible, à la fois dans leurs rangs et sur les entourages.
Nous avons travaillé en partant de ce que nous avions constaté dans l’affaire Merah, mais aussi des événements intervenus dans le monde entier. Nous avons été particulièrement marqués par l’affaire du centre commercial du Westgate au Kenya, qui s’est déroulée de manière assez semblable, mais d’autres se sont également produites dans d’autres pays.
Fort de ces constatations, le RAID s’est préparé ; à raison, puisque les frères Kouachi, d’un côté, et Amedy Coulibaly, de l’autre, ont agi exactement ainsi. Nous nous y attendions tant que, le 13 juillet 2014, lors de la visite au RAID du tout nouveau ministre de l’intérieur Bernard Cazeneuve, je lui ai fait ce même exposé. Nous lui avons fait la démonstration des nouvelles techniques d’intervention que nous utiliserions si ou plutôt quand ce type d’événement se reproduirait.
Il est ressorti de nos analyses, que lorsque ce type d’individu prenait des otages ou se retranchait, jamais il ne se rendait. Il n’y a pas eu un seul exemple, ni en France ni dans le monde, où cela a été le cas. Cela signifie que la négociation que nous engageons toujours avec les forcenés familiaux ou les preneurs d’otages mentalement dérangés, et qui aboutit favorablement dans 80 % des cas, n’a pas d’autre utilité pour les terroristes radicalisés que de préparer leurs engins explosifs, utiliser les réseaux sociaux, notamment pour y mettre les films montrant le massacre de leurs victimes, et se reposer. C’est ce qu’avait fait Mohamed Merah.
La nouvelle technique d’intervention du RAID, que le GIGN utilise aussi, consiste à faire en sorte que la négociation ne puisse pas servir aux radicalisés. Elle est transformée en contact : en même temps qu’elle servira aux forces de l’ordre pour préparer éventuellement l’assaut final, elle laisse une chance de dialogue à l’individu qui, au dernier moment, voudrait se rendre.
Cette préparation, nous l’avons donc présentée au ministre le 13 juillet 2014, mais je l’avais exposée dans une note confidentielle dès le mois de février de la même année – cela figure dans le dossier que nous vous avons envoyé. L’important, à l’époque, c’était l’abandon de la négociation, qui était une tradition pour nous, mais aussi pour l’opinion publique et peut-être aussi les responsables politiques. Or on savait dorénavant que la négociation jouait en défaveur à la fois des otages et du dénouement de l’affaire.
L’affaire de la porte de Vincennes a été retracée sur un chronogramme que nous vous avons transmis. Le matin, j’étais avec mes effectifs sur Dammartin-en-Goële, qui n’est pas dans mon secteur de compétence mais dans celui de la gendarmerie. Nous y étions pour prêter main forte au GIGN, s’il le désirait, au titre de la théorie du « menant-concourant », élaborée par les chefs du RAID et du GIGN. Celle-ci a donné lieu à la signature d’un texte par le directeur général de la gendarmerie nationale, le directeur général de la police nationale et le préfet de police. Le principe est que, en cas de crise grave ou multiple, une unité peut prêter main forte à l’autre, même si elle n’est pas dans son secteur de compétence. L’unité qui est dans son secteur de compétence est dite « menante » ; elle donne les missions à l’autre, qui est « concourante ». En l’occurrence, j’étais concourant sur Dammartin.
Quand a éclaté l’affaire de l’Hypercacher, j’étais pré-positionné sur Dammartin avec deux colonnes d’assaut, plus une colonne de la BRI, donc beaucoup d’effectifs. Visiblement, sur cette crise-là, le GIGN n’avait pas besoin de nous. Il était en effectifs suffisants, il gérait l’affaire sans aucun problème. Lorsqu’à 13 heures 20, j’ai eu connaissance de la fusillade de l’Hypercacher, j’ai ordonné à mon premier adjoint ici présent, le commissaire divisionnaire Éric Heip – pour plus de commodité, je le désignerai sous son indicatif radio, Laser 2, étant entendu que je suis Laser 1 et que Laser 3 est mon deuxième adjoint –, de partir immédiatement avec une colonne d’assaut sur Vincennes. Je suis resté sur Dammartin pendant quelque temps. Quand on a eu confirmation qu’il s’agissait d’une prise d’otages, je me suis rendu moi-même à Vincennes, en faisant partir un peu avant moi une deuxième colonne d’assaut.
En cours de route, la Force d’intervention de la police nationale (FIPN) a été déclenchée, à la demande du directeur général de la police nationale, par le ministre de l’intérieur. La FIPN est une bannière sous laquelle se regroupent, en cas de crise majeure et grave, tous les effectifs du RAID – à l’époque, sept groupes d’intervention de la police nationale, devenus des antennes du RAID depuis avril 2015 – et la BRI-PP. Pour être plus précis, la BRI est en fait la BAC, non pas au sens de la brigade anti-criminalité, mais de la brigade anti-commando. La BAC-PP, donc, est composée de la BRI et d’une autre structure qui est la brigade d’intervention de Paris. Le tout est placé sous le commandement du chef du RAID, donc de moi-même. Ce dispositif a été déclenché à la porte de Vincennes. Il l’avait également été une journée auparavant, quand nous avions fait le ratissage du secteur de Villers-Cotterêts, en zone de gendarmerie, pour prêter main-forte au GIGN.
À l’Hypercacher, les choses se mettent en ordre. Je reprends rapidement le chronogramme : 13 heures 20, je prends connaissance de la fusillade de l’Hypercacher; 13 heures 21, j’envoie la colonne numéro 1 du RAID avec Laser 2 en direction de la porte de Vincennes ; 13 heures 25, je demande la constitution d’une troisième colonne du RAID.
M. le président Georges Fenech. La FIPN est déclenchée le 8 ou le 9 janvier ?
M. Jean-Michel Fauvergue. Le 8 janvier, pour faire le ratissage.
M. le président Georges Fenech. Vous en êtes certain ?
M. Jean-Michel Fauvergue. Le 8 janvier, j’avais sous mes ordres à la fois les colonnes du RAID, une colonne du GIPN de Lille et une colonne de la BAC-PP.
M. le président Georges Fenech. D’après les éléments que j’ai, en l’espèce votre rapport, la FIPN a été déclenchée le 9 janvier à 13 heures 40.
M. Jean-Michel Fauvergue. Oui, elle a été déclenchée le 9 janvier à 13 heures 40. Mais la veille, j’avais aussi tous ces gens sous mes ordres.
M. le président Georges Fenech. La FIPN a été effectivement, et légalement, déclenchée le 8 ? En êtes-vous certain ?
M. Jean-Michel Fauvergue. Elle a été déclenchée de facto. Certes, je n’ai pas reçu d’ordre particulier, mais j’ai pris le commandement de tous ces gens.
M. le président Georges Fenech. C’est tout de même le ministre, sur saisine du DGPN ou autre, qui peut déclencher la FIPN. Vous-même pouvez la demander, mais vous ne pouvez pas la déclencher.
M. Jean-Michel Fauvergue. Non.
M. le président Georges Fenech. Nous sommes bien d’accord. Est-ce que le 8 janvier, la FIPN a été ordonnée ?
M. Jean-Michel Fauvergue. Il ne me semble pas me rappeler qu’elle ait été déclenchée officiellement. Mais la seule possibilité que j’ai de prendre le commandement de tout le monde, c’est en configuration FIPN. Comme ce jour-là, j’avais le commandement de tout le monde, j’estime – mais peut-être ai-je tort – que j’étais en configuration FIPN.
M. le président Georges Fenech. Pourquoi n’a-t-elle pas été déclenchée le 8 janvier ?
M. Jean-Michel Fauvergue. Je ne sais pas pourquoi elle n’a pas été officiellement déclenchée le 8 janvier, comme je ne sais pas pourquoi elle n’a pas été déclenchée au Bataclan.
M. le président Georges Fenech. On y reviendra. Je vous laisse poursuivre.
M. Jean-Michel Fauvergue. À 13 heures 40, le DGPN m’avise du déclenchement de la FIPN. Je pars vers l’Hypercacher. Une fois arrivé, je prends le commandement de l’ensemble du dispositif.
Sans entrer dans le détail du dispositif, il s’agit de placer des tireurs, des équipes d’assaut d’urgence, des équipes qui vont exfiltrer les gens se trouvant dans le bâtiment à côté de l’Hypercacher et ceux qui étaient dans la pâtisserie Lenôtre, juste en face. L’ensemble des lieux ainsi sécurisé, on commence à travailler : on installe nos deux PC, autorité et opérationnel, et on commence à chercher du renseignement. Ce qui nous importe plus particulièrement, c’est de récupérer les plans, de savoir où sont les entrées et les sorties, et comment sont constitués les murs pour savoir si l’on peut entrer à l’explosif – ce n’est pas possible s’ils sont porteurs. Nous cherchons à savoir comment ouvrir les portes et, dans la mesure du possible, le nombre d’otages – nous pensions qu’ils étaient dix-neuf, en réalité ils étaient vingt-six – et de preneurs d’otages. Depuis le début, nous savions que Coulibaly était preneur d’otages mais, jusqu’à la fin, nous avons pensé qu’il y en avait peut-être un second.
À 15 heures 55, selon mon chronogramme – mais c’est à vérifier –, le ministre de l’intérieur arrive sur les lieux et je lui rends compte de la situation : nous sommes face à un individu radicalisé, au moins dix-neuf à vingt otages se trouvent à l’intérieur, il y a peut-être deux preneurs d’otages. Un premier contact-négociation, que l’on sait très bien ne pas en être une, a eu lieu juste avant. Pendant ce contact assez rapide, Amedy Coulibaly s’est présenté en tant que tel, et a dit un certain nombre de choses traditionnelles.
Lors d’un deuxième contact-négociation, à 16 heures 15, Amedy Coulibaly se revendiquera de son djihad, demandera que la France sorte ses soldats du Mali et que des bandeaux passent sur les chaînes de télévision. Je rendais compte au ministre jusqu’à son départ, puis, comme il me l’avait demandé, j’en référais au directeur régional de la police judiciaire Bernard Petit, qui lui-même rendait compte au ministre et me rapportait en feed-back les informations du ministre.
À 17 heures 15, on préparait l’assaut. Dès le départ, me référant à la démonstration qui lui avait été faite le 13 juillet de l’année précédente, j’avais dit au ministre que l’assaut serait la seule solution si on voulait sauver le maximum d’otages, mais je ne garantissais pas de sauver tous les otages ni de ne pas avoir de pertes dans nos rangs, même si la FIPN ferait tout pour sauver les uns et préserver les autres.
M. le président Georges Fenech. À ce stade, notre commission d’enquête cherche à savoir comment les services sont coordonnés. Donc, à partir du 9 janvier à 13 heures 40, la FIPN est déclenchée. À ce moment-là, il y a donc le RAID et la BRI.
M. Jean-Michel Fauvergue. Oui.
M. le président Georges Fenech. Comment se fait-il que la présence de la BRI sur les lieux de l’Hypercacher n’est pas mentionnée dans votre rapport, alors qu’elle y est arrivée entre 12 heures 30 et 13 heures, et alors même, si j’ai bien compris, que vous êtes unité menante et la BRI concourante ?
M. Jean-Michel Fauvergue. Le cadre du menant-concourant ne concerne que les deux unités nationales RAID et GIGN. Avec la BRI, on est dans le cadre de la FIPN, qui est une force intégrée. Quand je mentionne le RAID ou la FIPN indifféremment, je vise l’ensemble.
M. le président Georges Fenech. Vous ne mentionnez pas la présence de la BRI dans votre rapport alors qu’elle était présente sur les lieux. Pour quelle raison ?
M. Jean-Michel Fauvergue. Il n’y a aucune raison particulière. Puisqu’on est dans la cadre de la FIPN, mon rapport vise globalement l’ensemble des effectifs. Toutefois, je peux développer la manière dont nous sommes intervenus, à la fois avec la BRI et le RAID.
Nous travaillons avec deux négociateurs, dits N1 et N2 : le premier, qui appartient à la BRI, prend les appels téléphoniques ; le second fait partie du RAID et il analyse ce qui se dit. On est donc bien dans la formation FIPN.
La BRI se voit confier la mission de faire diversion sur l’arrière du bâtiment en faisant sauter la porte arrière à l’explosif et, si possible, d’y entrer. Or il s’agit d’une porte tirante, c’est-à-dire une porte de secours avec une barre que l’on pousse de l’intérieur du magasin pour évacuer les gens en cas d’incendie. Cette barre poussoir n’est pas accessible. La difficulté est donc d’arriver, à partir d’explosifs dont la première qualité est de pousser, à tirer une porte. Assez rapidement, le chef de la BRI me dit qu’il n’a pas la ressource à l’explosif pour y parvenir. Nos artificiers travaillent avec plusieurs unités sœurs, spécialisées dans ce domaine. Deux artificiers du RAID se chargent donc de mener à bien la mission, et la porte est ouverte.
L’ouverture de la porte donne le signal de l’assaut, à la fois devant et derrière. À l’arrière, l’unité de la BRI monte au contact avec nos deux artificiers. On savait déjà, et cela se confirme, que des palettes chargées de sucre, de farine, et autres denrées empêcheraient les effectifs de passer par cette entrée arrière. Néanmoins, il y a eu des échanges de coups de feu à travers ces palettes, ce qui a permis de fixer Coulibaly.
Nous avons pu le surprendre, car, juste avant l’assaut, nous avions eu un dernier contact téléphonique avec lui ; nous le savions pris au téléphone, et cela a constitué un premier abcès de fixation pour Coulibaly. Puis il a été sidéré par l’explosion de la porte – car l’explosif a un effet sidérant –, suivie des échanges de coups de feu avec la BRI à l’extérieur. En même temps que se produisait l’explosion de la porte arrière, les deux colonnes du RAID se mettaient en marche à l’avant, protégées par le camion blindé de la BRI – les nôtres n’avaient pas pu être acheminés, parce qu’ils étaient pris dans le trafic sur le périphérique. La FIPN supposant coordination, coopération, prêt d’instruments et modularité, nous avons pu utiliser les moyens de la BRI. Nos deux colonnes d’assaut du RAID sont arrivées jusqu’au contact de la porte du devant. Elles ont pu l’ouvrir avec les clés que nous avions récupérées – nous avions, sinon, prévu un système d’explosion. Elles ont alors pénétré à l’intérieur, de la façon que vous savez, puisqu’on l’a vu sur toutes les télévisions.
Voilà comment s’est déroulé cet assaut.
M. le président Georges Fenech. Comment se fait-il, alors que les frères Kouachi étaient encore dans la nature et que le périmètre était parfaitement circonscrit, que vous ayez, le 8 janvier à 22 heures 30, levé les troupes et renvoyé la BRI à Paris ?
M. Jean-Michel Fauvergue. Parce que ce sont les ordres que j’ai reçus.
Le 8 janvier, nous avons ratissé l’ensemble du dispositif, où j’étais concourant de la gendarmerie nationale : les ordres reçus par la police nationale étaient donnés par la gendarmerie nationale, et les ordres reçus par le RAID étaient donnés par mon collègue du GIGN. Pendant la journée, nous avons ratissé un certain nombre de secteurs boisés et travaillé sur plusieurs cibles, en particulier des maisons qu’on nous a signalées comme suspectes, dans lesquelles nous sommes entrés pour les fouiller. Nous avons aussi contrôlé de très nombreux journalistes qui s’étaient introduits sur le secteur. Le GIPN de Lille, avec lequel je me trouvais, a notamment arrêté deux jeunes journalistes locaux qui avaient la même voiture que les Kouachi. Ils se baladaient en secteur forestier, à l’intérieur d’un dispositif qui aurait dû être étanche.
M. le président Georges Fenech. À ce propos, nous avons été étonnés par la présence des chaînes de télévision, le 8 janvier, à Reims, alors que c’est votre service qui détenait cette information.
M. Jean-Michel Fauvergue. Quelle information ?
M. le président Georges Fenech. Celle selon laquelle les auteurs étaient éventuellement localisables à Reims. Comment se fait-il que la télévision était déjà présente ? D’où viennent les fuites ?
M. Jean-Michel Fauvergue. C’est une question que je suis toujours en train de me poser, monsieur le président.
Le RAID est une unité de service, c’est-à-dire qu’il se met au service des unités d’enquêteurs pour interpeller les individus dangereux, en général en milieu clos. Il est le bras armé de la SDAT (Sous-direction anti-terroriste) en matière de terrorisme, de la DCPJ (Direction centrale de la police judiciaire) et de la DGSI (Direction générale de la sécurité intérieure). Cette dernière abrite aussi un petit groupe d’intervention, mais lorsqu’il est occupé, c’est le RAID qui intervient. À ce titre, nous avons arrêté l’année dernière un certain nombre de terroristes, qui revenaient ou voulaient partir en Syrie. Quand il agit, le RAID ne connaît pas ses objectifs. Je suis parti sur Reims avec deux colonnes d’assaut du RAID, et j’ai été rejoint par une colonne d’assaut du GIPN de Strasbourg. Mon adjoint Laser 2 est parti sur Charleville-Mézières, et il a été rejoint par le GIPN de Lille. Nous avons « tapé » plusieurs objectifs, que je ne connaissais pas avant de partir.
Déjà, sur l’autoroute, j’ai été rattrapé par des motos de journalistes. Si je me souviens bien, il y en avait deux, qui m’ont suivi jusqu’à Reims. Mais à Reims, il y avait déjà TF1 et d’autres.
M. le président Georges Fenech. Vous ne savez pas d’où viennent les fuites ?
M. Jean-Michel Fauvergue. Je ne sais pas d’où viennent les fuites.
M. Sébastien Pietrasanta, rapporteur. À l’Hypercacher, on sait qu’il y a des otages. Coulibaly appelle BFM pour dire que si l’assaut est donné contre les frères Kouachi, il en exécutera. Donc, les deux opérations de Dammartin et de la porte de Vincennes étaient fortement liées. D’après mes souvenirs, vous deviez d’abord intervenir pour libérer les otages, avant que l’assaut ne soit donné contre les frères Kouachi. Seulement, ils sont sortis à ce moment-là, surprenant le GIGN, ce qui a bouleversé les plans. Il me semble que la scène était filmée en direct par BFM. Coulibaly avait donc certainement connaissance de l’assaut. Or, selon les déroulés qui nous ont été donnés par les uns et les autres, il y a un écart d’à peu près un quart d’heure entre l’assaut à Dammartin et l’assaut à l’Hypercacher.
Durant ce quart d’heure, étiez-vous déjà en place ? Aviez-vous prévu d’intervenir, et à quel moment ? Comment le lien se faisait-il avec le GIGN ? Qu’est-ce qui vous a décidé à intervenir ? N’y avait-il pas un grand risque à le faire ? Et pourquoi avoir attendu un quart d’heure ?
Vous avez dit, dans votre propos introductif, que vous aviez revu votre doctrine d’intervention en fonction de l’affaire Merah. Au regard de ce qui s’est passé en janvier, puis en novembre, l’avez-vous réévaluée à nouveau ou est-elle restée calquée sur les événements de 2012 ?
M. Jean-Michel Fauvergue. Dans l’affaire de l’Hypercacher, après discussion avec le ministre qui s’était rendu sur place, la priorité d’intervention m’avait été donnée. Je l’avais réclamée parce qu’il y avait une vingtaine d’otages, vingt-six, en réalité, alors que les Kouachi n’en détenaient pas – la personne qui s’était cachée n’a jamais été prise en otage. Cela avait été décidé en concertation avec mon collègue chef du GIGN, avec qui j’ai des rapports étroits et excellents. Un premier go between entre le GIGN et le RAID était assuré par la présence à Dammartin d’une équipe de négociation du RAID qui, disposant d’éléments intéressants susceptibles de servir à la négociation, était venue renforcer celle du GIGN.
M. le rapporteur. Mais vous nous avez dit qu’il n’y avait plus de négociation ?
M. Jean-Michel Fauvergue. Il s’agissait d’éléments de contexte sur la famille des Kouachi, sur leur passé. Nous ne nous interdisons pas d’avoir de tels éléments, ni de nous en servir le cas échéant, même lorsque des personnes radicalisées sont en cause. Il était intéressant, pour les gendarmes qui ne les avaient pas, de les connaître. J’ai donc laissé, en toute connaissance de cause et en pleine collaboration avec le GIGN, deux de mes négociateurs pour travailler éventuellement à partir de ces éléments. Mais, là non plus, la négociation n’a pas servi ; on était bien dans la situation que j’ai décrite au début.
Un deuxième go between avec le GIGN avait été mis en place. Deux autres de mes officiers faisaient la liaison entre eux et moi, et deux officiers du GIGN sont restés avec moi sur Vincennes tout le temps. Nous avions avec eux une relation directe et étroite, ce qui m’a d’ailleurs permis de savoir que le GIGN était en train de donner l’assaut.
Sans problème donc, la priorité de l’intervention m’avait été donnée, sauf que les frères Kouachi sont sortis. Je ne suis pas sûr que les gendarmes aient été surpris, comme vous l’avez dit. À mon avis, c’est une hypothèse qui avait été étudiée par le GIGN.
M. le rapporteur. Ce sont eux qui sont sortis, ce n’est pas le GIGN qui est entré.
M. Jean-Michel Fauvergue. Ce genre de comportement n’est plus surprenant, dans la mesure où l’on sait maintenant que ces individus sortent, chargent, foncent sur les policiers ou les gendarmes, et qu’ils veulent mourir en chahîd, en martyrs. On le sait grâce à l’expérience que l’on a acquise, notamment au RAID.
M. le rapporteur. Je voulais dire que la temporalité n’était pas forcément la vôtre.
M. Jean-Michel Fauvergue. J’allais y venir : ce n’était pas exactement ce que nous avions prévu. Lorsque les Kouachi sortent, ils sont engagés par le GIGN, c’est-à-dire qu’on leur tire dessus. De mon côté, je sais qu’ils sont engagés. On craint qu’il y ait une liaison entre eux et Coulibaly et que ce soit fatal aux otages. Mais dans le même temps, Coulibaly est occupé au téléphone, puisque l’on a un dernier contact avec lui.
M. le rapporteur. L’intervention à Dammartin intervient à 16 heures 55, le contact téléphonique à 17 heures 05, donc dix minutes plus tard, et votre assaut à 17 heures 10. Après la sortie des frères Kouachi, il y a un laps de temps, d’au moins dix minutes, pendant lequel Coulibaly n’est pas occupé. Or, encore une fois, la sortie des frères Kouachi était retransmise en direct sur les chaînes d’info en continu.
M. Jean-Michel Fauvergue. Tout à fait : 16 heures 55, les frères Kouachi sortent de l’imprimerie ; 17 heures 05, contact-négociation au téléphone. Si Coulibaly avait été au téléphone avec les frères Kouachi, nous n’aurions pas pu l’avoir au téléphone. Donc, je pense que, de manière générale, il n’a pas eu de contact avec les frères Kouachi.
Le temps de latence entre notre assaut et celui qui a été forcément donné par surprise à Dammartin est, en termes d’intervention, très bref. Nous n’avions pas pu préparer physiquement notre positionnement. Il était impossible de mettre plus tôt les explosifs sur la porte, parce que nous étions filmés en direct. Si Coulibaly nous avait vu le faire, il aurait su que nous allions donner l’assaut. Jamais une affaire n’a été résolue aussi rapidement, nulle part au monde – dans les pays démocratiques s’entend, là où l’on doit travailler avec des instruments particuliers.
Reste que nous avons été desservis dans la préparation de cet assaut. Nous n’avons pas pu cheminer pour aller nous placer à côté des portes parce que nous étions filmés en direct. Le faire, c’était condamner les otages. Or les vingt-six otages ont tous été sauvés par le RAID.
M. le rapporteur. Dernière question sur la chronologie : à 13 heures 20, vous prenez connaissance de la fusillade de l’Hypercacher. Le premier contact-négociation qui figure dans votre chronologie a lieu à 15 heures 38. Cela représente à peu près deux heures, ce qui est relativement long. Avez-vous une explication là-dessus ? Faut-il forcément être sur place pour commencer à négocier ?
M. Jean-Michel Fauvergue. Nous avons une explication.
Ce n’est pas moi qui fais la négociation, c’est un négociateur de la BRI qui était sur place dès le départ, bien avant moi. Ce négociateur a essayé d’avoir un contact avec Coulibaly. On ne connaissait pas son numéro de portable, et le seul contact possible passait par le numéro de fixe du magasin. Or la ligne était occupée par BFM, iTélé et tous ceux qui voulaient des interviews en direct de Coulibaly en train de prendre des gens en otage.
M. le rapporteur. Les premiers essais de contact interviennent très rapidement ?
M. Jean-Michel Fauvergue. Les premiers essais de contact interviennent dès le départ, mais la ligne ne s’est libérée que très tardivement. On a bien pensé appeler sur les téléphones des otages, que l’on connaissait, mais j’ai fait abandonner cette idée, pensant que cela pourrait mettre en péril la vie des otages. Ce n’est que lorsque BFM a libéré la ligne que nous avons joint Coulibaly. Voilà pourquoi le contact n’a pu être pris qu’à cette heure-là.
Les médias ont eu un rôle très pénalisant pour nous, non seulement des points de vue opérationnel et stratégique, puisque nos modes opératoires sont décelés assez rapidement, mais aussi et surtout du point de vue personnel, pour moi et mon équipe. Lorsque les chaînes filment en direct les policiers blessés, les familles y assistent devant leur poste de télévision. Sans doute à cause de cela, j’ai eu dix départs du RAID.
M. le président Georges Fenech. BFM a aussi annoncé la présence d’un otage dans l’imprimerie. C’est tout de même assez stupéfiant !
M. Jean-Michel Fauvergue. Oui. C’est énorme.
M. le président Georges Fenech. Nous sommes bien d’accord qu’il y a là une mise en danger évidente.
M. François Lamy. Pourquoi les forces d’intervention, que ce soit le RAID, la BRI ou le GIGN, n’utilisent pas d’armes non létales ? Je pense notamment aux gaz lacrymogènes. À Dammartin, à la différence de l’Hypercacher, il n’y avait pas d’otage. Les interventions étaient de nature différente. Donc, pourquoi ce choix ?
Vous dites ne pas connaître vos objectifs lorsque vous partez en intervention, mais vous aviez tout de même des éléments sur Coulibaly, ses antécédents. Comment les avez-vous eus ? Comment s’organise votre mode d’information ? Qui vous les donne, ou ne vous les donne pas, suivant les interventions ?
Plus généralement, selon vous, le fait de ne pas être avertis en amont, notamment par les services de renseignement, de l’état de la menace réelle à laquelle vous pourriez être confrontés, ne constitue-t-il pas une difficulté ?
Par ailleurs, n’est-ce pas un problème de ne pas disposer, dans ce pays, d’une base de données recensant les plans de tous les équipements recevant du public, centres commerciaux compris ? Lors d’une précédente rencontre, vous nous aviez fait part de votre inquiétude s’agissant de ce qui s’était passé à Nairobi et de la nécessité pour vous d’avoir ces plans. Ne faudrait-il pas aller jusqu’à rendre obligatoire, pour chaque établissement recevant du public, de communiquer ses plans à une base de données, et à les actualiser régulièrement ?
M. Serge Grouard. Si je comprends bien, les télévisions vous ont empêché d’intervenir en monopolisant le téléphone fixe du magasin et en filmant. Confirmez-vous que les préparatifs sur la porte arrière, visant à la faire sauter avec des explosifs, étaient filmés ?
Seriez-vous intervenus plus tôt à Vincennes s’il n’y avait pas eu ce problème avec les télévisions ou d’autres paramètres sont-ils entrés en ligne de compte ?
M. Jean-Michel Villaumé. Lundi, le ministre nous a dit avoir demandé une analyse très fine des compétences en fonction des forces et des territoires, afin de les faire évoluer le plus efficacement possible. J’aimerais avoir votre sentiment sur cette évolution.
La compétence territoriale est-elle vraiment un bon critère pour désigner qui doit intervenir ? N’est-ce pas plutôt la nature de l’événement qui devrait être déterminante ? Quelle est la plus-value d’intervention entre le GIGN, le RAID et la BRI ? Comment vous coordonnez-vous ? Comment vous formez-vous ? Ce sont des questions basiques, mais j’ai le sentiment que l’objectif devrait maintenant être d’avoir une force d’intervention unique sur le territoire. L’état de la menace réclame une évolution dans la coordination de nos différentes unités spécialisées, sans que cela constitue une remise en cause de leurs compétences et de la qualité du travail qu’elles accomplissent, dont nous vous félicitons.
M. Pierre Lellouche. Nous sommes là pour essayer d’améliorer le système, aussi ne voyez pas dans mes questions une critique du courage physique et du dévouement des forces.
D’abord, il me semblerait utile d’avoir une cartographie de toutes ces forces dont, pour certaines, bien qu’étant parisien, je n’apprends l’existence qu’aujourd’hui : la FIPN, une autre BAC que la brigade anti-criminalité.
M. le président Georges Fenech. On la dressera.
M. Pierre Lellouche. C’est un vrai sujet que M. Villaumé a soulevé avant moi. J’entends dire qu’il y a deux négociateurs différents, formés différemment, l’un ayant des informations que l’autre n’a pas ; il y a deux types de véhicules, les uns bloqués, les autres pas… Ne serait-il pas plus raisonnable de réunir l’ensemble de ces dispositifs ?
La connexion entre le renseignement, collecté et analysé, et le système opérationnel me semble être un vrai problème de fond. Cela fait un moment que les Kouachi et Coulibaly tournent dans la nature. Ils ont été photographiés à Murat, dans le Cantal, quand ils sont allés voir Mohamed Beghal, qui avait déjà été condamné et qu’on avait essayé d’expulser. Donc, on les connaît ; ils ont été arrêtés mais pas contrôlés. On sait maintenant qu’ils étaient en contact entre eux, mais les professionnels du renseignement devaient déjà le savoir – ou alors, le système ne fonctionne pas. Et si eux le savaient, pourquoi ne le saviez-vous pas, vous, dès le début ? On voit bien qu’il y a eu un temps de latence.
M. le président Georges Fenech. Ce sont des questions qui seront posées aux chefs des services de renseignement. Pour l’heure, nous entendons les chefs des forces d’intervention.
M. Pierre Lellouche. Il n’en reste pas moins que le problème clé est la connexion entre le renseignement et l’opérationnel. Voilà pourquoi j’essaie de savoir ce que ces messieurs ont comme renseignements avant de mener l’opération.
S’agissant de l’opération elle-même, les fameuses dix minutes dont a parlé le rapporteur tout à l’heure sont absolument cruciales. Car enfin, on a eu beaucoup de chance : si, pendant ces dix minutes, Coulibaly avait décidé de tirer, il faisait un massacre. On en revient au renseignement et à la doctrine d’emploi. Vous dites que c’est la faute du téléphone qui était bloqué, mais la doctrine d’emploi était que vous attendiez pour coordonner l’ensemble des opérations. Vous avez certes libéré tout le monde et êtes intervenus plus rapidement qu’on ne l’avait jamais fait, mais il reste ce détail des dix minutes : avons-nous eu de la chance ? Si Coulibaly avait été plus réactif, aurait-il tiré sur les otages pour les tuer ?
Pour ce qui est de la presse, je suggère que nous lui envoyions un message fort, parce que ce que l’on vient d’entendre fait froid dans le dos !
Je termine sur un problème sur lequel j’ai déjà interrogé le ministre de l’intérieur et auquel se sont heurtés vos véhicules, bloqués sur périphérique. Peut-on espérer réussir à organiser la circulation dans la capitale de la France, en bloquant des axes, pour être capable de régler un problème en plein jour ?
M. Jean-Michel Fauvergue. On s’est interrogé sur le fait que nous n’avions pas utilisé de gaz lors de l’assaut contre Merah, ce que les Russes avait fait dans l’affaire du théâtre de Moscou, qui impliquait 800 otages et qui s’est soldée par 117 morts. Des études ont été faites, que nous avons abandonnées. D’une part, la police n’a pas le droit d’utiliser de gaz anesthésiants ; d’autre part, les gaz lacrymogènes n’ont aucun effet sur un forcené ou un terroriste.
M. François Lamy. Pour en avoir fait l’expérience dans ma jeunesse, je peux vous dire que lorsque l’on est pris dans un nuage de gaz lacrymogène, même en extérieur, on ne peut pas faire grand-chose.
M. Jean-Michel Fauvergue. Monsieur le député, vous n’étiez pas un forcené. La charge d’adrénaline que reçoit un forcené lui permet de déployer une énergie vitale sans commune mesure avec celle que l’on mobilise lors d’une manifestation. Moi-même, j’ai subi des gaz lacrymogènes ; ils n’arrêtent pas un instinct meurtrier.
L’utilisation de gaz anesthésiants dans une salle comme un théâtre nécessite de les doser sur l’individu le plus résistant – par principe, le terroriste –, ce qui risque d’occasionner aux moins résistants des problèmes majeurs. Ces gaz seront diffusés à haute intensité en un endroit, deux au maximum : ceux qui se trouveront à côté auront également des problèmes majeurs. On estime le nombre de victimes collatérales entre 17 et 20 %. Tout cela pour s’apercevoir, une fois dans la pièce, que les preneurs d’otages ont acheté un masque à gaz à 40 euros au surplus d’à côté !
Pour ce qui est de la menace, le RAID est au courant. Ce qui l’intéresse, c’est le changement d’état de la menace, lorsqu’elle se transforme en opérationnel. Vis-à-vis du renseignement, le RAID, unité d’intervention, n’a pas besoin de savoir comment s’est déroulée l’enquête ; il est là pour interpeller et arrêter. Les renseignements qui lui sont nécessaires sont très précis et très opérationnels : la distribution des lieux, le nombre d’ouvertures sont le type de renseignements qui nous permettent d’intervenir assez rapidement. Ce sont ceux qui nous ont servi à Vincennes.
Si Coulibaly n’a pas tué les otages pendant les dix minutes de battement, ce n’est pas de la chance, c’est parce que nous avons déployé un plan, que j’ai validé et sur lequel le RAID s’entraîne et travaille tout le temps. L’action est menée en connaissance de cause, et je suis peiné quand j’entends dire que nous avons eu beaucoup de chance, surtout pour mes gars qui se sont offerts de cette manière.
S’agissant des plans, le RAID dispose, comme le GIGN, d’une unité chargée de constituer des dossiers d’aide à l’intervention (DAI). Nous sommes en contact avec tous les grands centres et nous essayons de disposer de DAI pour chacun d’entre eux. Notre implantation territoriale est une aide précieuse puisqu’en plus de notre centre de Bièvres, nous avons sept autres antennes – les anciens GIPN – qui nous aident à recueillir ces plans, pour intervenir le plus rapidement possible et le mieux possible.
M. le président Georges Fenech. Aviez-vous les plans du Bataclan ?
M. Jean-Michel Fauvergue. Non, car il se trouve en secteur PP, donc celui de la BRI.
M. le président Georges Fenech. Et la BRI les avait-elle ?
M. Jean-Michel Fauvergue. Je ne sais pas, je ne peux pas vous répondre.
M. François Lamy. Une base de données nationale, dans laquelle chacun pourrait puiser, serait-elle utile ?
M. Jean-Michel Fauvergue. Ce serait un bel instrument.
Serions-nous intervenus plus tôt s’il n’y avait pas eu les chaînes de télévision ? En termes de temps, pour des groupes aussi lourds que le RAID, le GIGN et la BRI, l’opération que nous avons menée a été très rapide. Reste que, effectivement, nous avons été gênés par les caméras, sans lesquelles nous aurions déjà pré-positionné nos colonnes d’assaut, ce qui nous aurait fait gagner quelques minutes sur l’intervention.
M. le président Georges Fenech. Ce que vous dites est très grave !
M. Jean-Michel Fauvergue. Il me reste à répondre à la question la plus importante : RAID, BRI, GIGN, plus personne ne s’y retrouve. Il m’arrive de ne pas m’y retrouver non plus. À l’heure actuelle, on fait avec ce que l’on a, compte tenu de l’historique de chacune des unités. Ainsi, dans la police nationale, une unité locale, la BRI ou BAC, et une unité nationale, le RAID, se répartissent les secteurs de compétence entre Paris intramuros pour la BRI et Paris à l’extérieur pour le RAID – ce qui ne nous a pas empêchés de venir donner un coup de main à la porte de Vincennes et au Bataclan.
Le déclenchement systématique de la FIPN – qui n’a pas eu lieu au Bataclan – n’aurait-il pas l’avantage d’assurer une unicité d’intervention ? À mon avis, c’est peut-être une solution. À moins que l’on ne s’attaque directement à la base du problème, c’est-à-dire qu’on s’interroge sur la pertinence de maintenir en France une force de sécurité dans chacun des corps de la gendarmerie et de la police nationale. Cela, messieurs, n’est pas de mon ressort. Je suis persuadé, mais cela n’engage que moi, que dans les cinq à dix ans qui viennent, une autre vision prévaudra et qu’une fusion des deux corps apparaîtra souhaitable.
Sans doute peut-on passer par des étapes intermédiaires avant d’y arriver. L’armée en a peut-être franchie une lorsqu’elle a créé, pour les forces spéciales, un commandement des opérations spéciales (COS) directement placé auprès de l’état-major. Pourquoi ne pas, avant de fusionner les deux unités nationales du RAID et du GIGN, les faire chapeauter par un commandement dirigé par des gens qui s’y connaissent en intervention, et situé au-dessus des directions générales ? Une telle formule pourrait également être généralisé dans des directions métiers : dans la police judiciaire, dans la sécurité publique, dans la PAF, on mettrait des gendarmes et des policiers. Mais là, on est sur un autre paramètre.
M. le président Georges Fenech. Je vous propose maintenant de nous parler des attentats du mois de novembre.
M. Jean-Michel Fauvergue. Lors de la soirée en question, deux officiers du RAID étaient au Stade de France pour voir, dans le cadre de la préparation de l’Euro 2016, quelles améliorations pouvaient être apportées. Et le hasard a voulu que nous soyons, avec mes trois adjoints et leurs épouses respectives, tous ensemble au même endroit pour dîner. Cela nous a servi lorsqu’il s’est agi de rassembler les forces.
Très rapidement, mes effectifs qui sont sur le Stade de France nous avertissent de ce qui se passe. Je reçois l’appel de mon officier à 21 heures 43, alors que, selon le chronogramme, le premier kamikaze s’est fait sauter à 21 heures 17. Pourquoi ce laps de temps ? Au départ, personne ne croyait à une explosion, mais mon officier y a pensé. Il est sorti du stade, a fait le tour, a vu le cadavre puis a entendu la deuxième explosion. Une fois qu’il a vérifié tout cela, il m’a appelé.
À 21 heures 48, d’initiative, je mets en pré-alerte tout le RAID. Je ne suis alors avisé par personne hormis mon officier. À 21 heures 49, la tuerie au Bataclan débute, et nous voyons l’information sur BFM – comme quoi, cela sert aussi… À 21 heures 52, je rends compte à mon directeur général, qui n’est pas compétent sur Paris, que j’ai mis tout le monde en pré-alerte. À 22 heures 04, je passe de la pré-alerte à l’alerte ; j’envoie, en accord avec mon directeur, Laser 2 se pré-positionner à Beauvau pour y attendre les premiers effectifs, les effectifs rapides du RAID. À 22 heures 07, me rendant bien compte que la situation est extraordinaire, je déclenche l’alerte générale, c’est-à-dire le rappel de tous les effectifs du RAID. Toutes nos antennes de Lille, Strasbourg, Lyon, Nice, Marseille, Bordeaux et Rennes sont mises en pré-alerte. À 22 heures 25, j’arrive au RAID avec Laser 3 et Laser 4. Une minute plus tard, je demande par téléphone à mon premier adjoint de se détourner de Beauvau pour aller directement sur le Bataclan et d’y attendre les premiers effectifs rapides du RAID. À 22 heures 28, Laser 2 est au Bataclan. Il prend contact avec le chef de la BRI, qui est sur place et a déjà avec lui une équipe rapide.
M. le président Georges Fenech. Combien d’hommes dans cette équipe ?
M. Jean-Michel Fauvergue. Sept ou huit.
M. le président Georges Fenech. On entend parler de sept ou de quinze, sans savoir exactement ce qu’il en est.
M. Éric Heip, commissaire divisionnaire, adjoint au chef du RAID. Je suis assez affirmatif sur la taille du groupe BRI présent sur place. Mon homologue de la BRI, avec qui je prends contact dès mon arrivée sur le site, me demande, dans un premier temps, de positionner des « appuis feu », c’est-à-dire un soutien avec des armes longues pour faciliter la progression des groupes. Très rapidement, il me demande de compléter sa colonne, parce qu’elle n’est pas complète. Ce sont donc les effectifs du RAID sous mon autorité qui vont compléter cette colonne, dont l’effectif, à ce moment-là, n’était pas de quinze.
M. le président Georges Fenech. Nous poserons la question à M. Molmy demain.
À ce stade, comment se fait-il que ni vous, monsieur le contrôleur général, ni le patron de la BRI Paris n’ait demandé le déclenchement de la FIPN, censée rassembler toutes les forces de police ?
M. Jean-Michel Fauvergue. Pour vous répondre franchement, la FIPN a été déclenchée en janvier, ce qui m’a semblé la meilleure des choses. Or, lors d’une réunion de débriefing organisée avec le DGPN et le préfet de police quelques jours plus tard, ce dernier a déclaré n’avoir pas compris pourquoi le RAID était venu sur l’Hypercacher, le besoin ne s’en étant pas fait ressentir.
M. Pascal Popelin. Il s’agit du préfet Boucault…
M. Jean-Michel Fauvergue. Cela m’a beaucoup vexé, mais il était préfet, et je n’ai rien dit.
Partant de là, c’est d’initiative que je me mets en pré-alerte puis en alerte, que j’envoie mon adjoint sur place puis que je m’y rends, sans jamais être saisi de rien. Je rends compte à mon directeur général qui, le sachant, me donne l’autorisation d’y aller. Après, ce sont des affaires qui ne peuvent pas se régler au niveau du chef du RAID.
M. le président Georges Fenech. Par qui, alors ?
M. Jean-Michel Fauvergue. Par l’autorité préfectorale, qui va demander le déclenchement de la FIPN au ministre.
M. le président Georges Fenech. Donc, c’est l’autorité politique.
Ce qui nous interpelle, ce sont les temps d’intervention : vous avez été informé du début de la tuerie du Bataclan à 21 heures 49, mais votre prise de contact avec la BRI Paris a lieu à 22 heures 28, soit trente-neuf minutes plus tard.
M. Jean-Michel Fauvergue. À 21 heures 49, je ne suis pas informé.
M. le président Georges Fenech. Quand donc l’avez-vous été ?
M. Jean-Michel Fauvergue. Je le vois sur un bandeau télé à 21 heures 49. Mais l’information est télévisuelle, pas administrative.
M. le président Georges Fenech. Comment se fait-il qu’il faudra attendre trente-neuf minutes.
M. Jean-Michel Fauvergue. Je vais d’initiative sur place, alors que je ne suis pas mandaté et pas officiellement au courant.
M. le président Georges Fenech. C’est donc qu’il y a eu un manque d’information de la part de la BRI, qui était déjà sur place, vis-à-vis de l’autorité préfectorale et de vous-même. Comment se fait-il que l’information ne remonte pas ?
M. le rapporteur. Si vous n’aviez pas pris vous-même l’initiative d’y aller, les effectifs de la BRI seraient restés incomplets, ce qui aurait sans doute posé des difficultés pour l’intervention.
M. Éric Heip. L’écart qu’il peut y avoir dans la comptabilisation des effectifs tient à la manière de les prendre en compte. La colonne d’assaut de la BRI comptait sept fonctionnaires, mais il y avait aussi sur place des effectifs de la brigade anti-criminalité et de la section de sécurisation, qui sont intégrés dans la brigade anti-commando sans pour autant constituer des colonnes d’assaut. C’est comme si, lors d’un déplacement, le RAID prenait sous son étiquette les effectifs de la BAC.
M. Pierre Lellouche. Combien d’hommes forment une colonne d’assaut ?
M. Jean-Michel Fauvergue. Une colonne d’assaut de la BRI et du RAID, en principe, compte une quinzaine d’effectifs.
M. Pascal Popelin. Pour que l’on comprenne bien, Paris et la petite couronne sont du ressort de la préfecture de police. La personne compétente pour référer au Gouvernement et demander un certain nombre de choses est donc le préfet de police. La BRI dont on parle, c’est la BRI-PP, un service qui dépend de la préfecture de police et dont la mission est d’intervenir, au premier chef, sur ce type d’affaires. Celui qui est comptable du dispositif, qui peut dire s’il a les moyens d’agir, c’est le préfet de police. S’il ne les a pas, on appelle le RAID ou, en zone gendarmerie, le GIGN, voire, le cas échéant, les deux.
Corrigez-moi si je me trompe, il n’est donc pas illégitime que, dans un premier temps, le RAID ne soit pas sollicité.
M. François Lamy. Le patron du RAID est tout de même celui de la FIPN.
M. Pascal Popelin. À ce moment-là, la FIPN n’est pas déclenchée.
M. le président Georges Fenech. Selon votre rapport, à 22 heures 50, vous constatez qu’il y a sept policiers intervenants de la BRI, si l’on exclut les autres personnels. Compte tenu du très faible nombre de forces d’intervention, pourquoi, alors que vous-même avez la possibilité de demander le déclenchement de la FIPN, ne le faites-vous pas ?
M. Jean-Michel Fauvergue. Je ne le demande pas parce que j’ai donné beaucoup d’informations à mon directeur général, qui les a transmises lui-même à l’autorité, et sans doute aussi à son collègue préfet. J’ai envoyé beaucoup de messages disant que j’ai mis mes effectifs en alerte, que je suis présent, que je saurai faire le travail.
Cela dit, si c’est le fond de la question, mon intervention n’aurait pas évité les massacres puisqu’ils ont été commis dès le départ. Néanmoins, la brigade anti-criminalité de Paris, qui est primo-intervenant, a eu une belle réaction. Elle est intervenue rapidement, et une fois qu’elle a ouvert le feu, l’affaire a été figée.
M. le rapporteur. La note que vous nous avez fait passer, datée du 31 juillet 2009 et relative à l’organisation de la FIPN et aux compétences territoriales des unités de la police, indique que « le RAID intervient sur décision du directeur général de la police nationale sur demande des préfets de département. Pour les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, la demande doit émaner du préfet de police. » Sur Paris, votre autorité est donc, en quelque sorte, le préfet de police, pas le directeur général de la police nationale.
Je comprends que c’est de votre propre initiative que vous vous êtes rendu au Bataclan. À aucun moment, le préfet de police n’a fait le choix de mobiliser le RAID.
M. Jean-Michel Fauvergue. Le préfet de police a fait le choix de mobiliser la BRI.
M. Olivier Marleix. Quand vous appelez le directeur général de la police nationale, est-il informé ? A-t-il eu, lui-même, le préfet de police au téléphone ? À quel niveau l’information est-elle échangée ?
Savez-vous ce qu’il en est du GIGN, lui-même informé de manière assez fortuite, à 21 heures 15, des événements qui sont en train de se dérouler ? Selon la presse, les hommes sont stationnés devant la caserne des Célestins, prêts à intervenir, dès 22 heures. Visiblement, ils n’auront aucune instruction et resteront sur place.
Que vous dit, très précisément, le directeur général de la police nationale sur le dispositif qui est envisagé ? Vous dit-il que le préfet de police s’en occupe ?
M. Jean-Michel Fauvergue. Pour nous, c’est à 0 heure 10 que le GIGN était à la caserne des Célestins. Sur ce point, il y a une polémique, d’ailleurs entretenue. Mais la vérité ne devrait pas tarder à jaillir puisque des caméras ont filmé. Pour ma part, je ne la connais pas. Ce que je sais, c’est que je suis arrivé au Bataclan relativement rapidement, avec l’unité complète du RAID.
M. le président Georges Fenech. Donc, vous étiez dans le périmètre ?
M. Jean-Michel Fauvergue. J’étais dans le Bataclan, et je n’ai pas vu un képi de gendarme.
Les rapports que j’ai avec mon directeur général se font par texto et par téléphone. Lui est fort occupé avec les PC opérationnels et le ministre, et mon rôle à moi, c’est de lui rendre compte. À un moment, il me dit de nous rapprocher et de nous positionner au ministère de l’Intérieur, place Beauvau, sans doute parce qu’il ne veut pas empiéter sur les prérogatives de son collègue préfet de police, qui plus est nouvel arrivant. Je pense que c’est sur ce modus vivendi que les choses fonctionnent.
Ce que je dis, c’est que je suis une unité nationale spécialisée dans l’intervention et que la BRI est une unité de police judiciaire qui fait de l’intervention. Il y a une nuance et une différence. Nous avons arrêté de faire de la police judiciaire depuis quatre ans parce que nous savons l’importance de la spécialisation. Le GIGN est, comme nous, une unité nationale spécialisée dans l’intervention. Nous sommes entraînés pour cela. Nous aurions pu être déclenchés, de même que la FIPN. Mais cela n’a pas été le cas.
M. le président Georges Fenech. Le dérouleur des horaires que vous nous avez fourni indique que les premiers coups de feu retentissent au Petit Cambodge et au Carillon à 21 heures 25. Vous ne vous déplacez qu’à 23 heures 15, soit environ deux heures plus tard, alors que vous êtes dans le périmètre depuis une heure. Comment expliquer cela ?
M. Jean-Michel Fauvergue. Selon le chronogramme, j’arrive avec ma colonne d’assaut à 23 heures 09 pour renforcer l’équipe rapide qui se trouve déjà au Bataclan où mon numéro deux est également présent. Une autre colonne d’alerte, rassemblée au RAID, part travailler dans un immeuble de la rue de la Fontaine-au-Roi où l’on signale le retranchement de terroristes. Ils fouilleront le bâtiment jusqu’à 2 heures 10 du matin. Deux colonnes d’assaut sont donc engagées très rapidement : l’une, rue de la Fontaine-au-Roi, l’autre, avec moi, au Bataclan, où une troisième colonne nous rejoint par la suite. Une fois le dispositif en place, tous les effectifs du RAID de Bièvres se trouvent donc à Paris, à l’exception des blessés.
M. le président Georges Fenech. À quelle heure ?
M. Jean-Michel Fauvergue. La première colonne arrive sur place à 23 heures 09. Il faut tenir compte du délai de projection.
M. le président Georges Fenech. Vous venez de Bièvres ! Deux heures, cela semble long !
M. Jean-Michel Fauvergue. Les policiers ne sont pas logés sur leur lieu de travail. Le temps de faire revenir au RAID les personnels d’alerte et qu’ils s’équipent pour partir, il faut compter trois quarts d’heure. Nous sommes bien dans ces délais.
M. le rapporteur. Comme vous vous êtes rendu d’initiative au Bataclan, est-ce également de votre propre initiative que vous complétez les effectifs de la BRI, puis que vous entrez dans les lieux ? Avez-vous reçu une instruction ou avez-vous agi seul ?
De même, est-ce à votre initiative que la colonne du RAID est allée fouiller un immeuble rue de la Fontaine-au-Roi ou un ordre vous a-t-il été donné en ce sens ?
J’ajoute une question directe qui n’est pas sans lien avec les précédentes : quelles sont vos relations avec la BRI ?
M. le président Georges Fenech. La question est excellente : vos relations avec la BRI sont-elles aussi « excellentes » que celles que vous entretenez avec le GIGN ?
M. Jean-Michel Fauvergue. J’ai dit que j’avais des relations excellentes avec le chef du GIGN.
Sur place, mon numéro deux a déjà pris contact avec le chef de la BRI. Ils se sont partagé la tâche dans l’urgence avec les équipes dont ils disposaient : les sept hommes de la BRI, plus quelques autres, et neuf membres de l’équipe rapide du RAID, soit vingt personnes au total. Ma colonne d’assaut arrive concomitamment avec celle de la BRI – je ne saurais dire si c’est avant ou après, je ne me souviens plus. Quoi qu’il en soit, dès que j’arrive, je prends immédiatement contact avec mon collègue chef de la BRI, qui est compétent puisque la FIPN n’est pas déclenchée. Nous nous répartissons les missions de façon simple : je prends le bas, il prend le haut.
M. le rapporteur. Vous décidez seuls, sans autorisation ? C’est l’initiative des deux patrons de la BRI et du RAID ?
M. Jean-Michel Fauvergue. Oui.
M. le président Georges Fenech. Qui a le commandement ?
M. Jean-Michel Fauvergue. Normalement, le chef de la BRI est compétent territorialement. À ce stade, il n’importe pas tant de savoir qui a le commandement des opérations : il travaille en haut avec ses hommes, plus un de mes tireurs de précision (sniper) puisqu’il n’en a pas ; je travaille en bas avec les miens. Nous sécurisons le lieu, évacuons les victimes valides, et sommes au contact des deux terroristes restants. C’est à partir de là qu’il est important de savoir qui donnera ensuite le top départ action ; ce sera le chef de la BRI.
M. le président Georges Fenech. La BRI n’avait pas, sur place, de tireur de précision : le seul présent était le vôtre ?
M. Jean-Michel Fauvergue. Je dis seulement que j’ai renforcé leur équipe avec l’un de mes tireurs.
M. le président Georges Fenech. Combien de tireurs opérationnels de la BRI étaient présents ?
M. Jean-Michel Fauvergue. Je ne sais pas.
Alors, oui, nous avons agi d’initiative. Mais, en trente-sept ans de police, j’ai pris beaucoup d’initiatives.
M. le rapporteur. Je reviens à ma question sur vos relations avec la BRI.
M. Jean-Michel Fauvergue. La BRI est une unité de police judiciaire qui fait de l’intervention. Elle est composée de valeureux et courageux combattants qui sont allés au feu. À titre personnel, je ne suis pas persuadé qu’aujourd’hui on puisse pratiquer les deux métiers.
Les relations avec la BRI sont bonnes. Quelques jours avant les événements, nous avons même signé un protocole d’accord pour travailler avec elle sur un ensemble de formations afin de développer des complémentarités. Dans le cadre de ce protocole, la BRI sera amenée à spécialiser des personnels dans l’intervention, ce qui n’est peut-être pas son dogme aujourd’hui, sachant qu’elle souhaite continuer à faire à la fois du judiciaire et de l’intervention. Le problème n’est donc pas d’ordre relationnel. Ce qu’il faut, c’est que nous puissions nous rencontrer sur des terrains identiques dans le domaine professionnel. Aujourd’hui, nous rencontrons plus facilement le GIGN que la BRI parce nous parlons de la même chose, nous sommes deux unités nationales qui ne font que de l’intervention, et nous nous retrouvons aussi dans les forums internationaux.
M. François Lamy. Si la FIPN avait été déclenchée, vous auriez été le patron de l’opération au Bataclan ?
M. Jean-Michel Fauvergue. Oui.
M. le président Georges Fenech. Regrettez-vous que cela n’ait pas été le cas ?
M. Jean-Michel Fauvergue. Ce n’est pas par ego démesuré que je souhaite avoir le commandement, c’est parce que cela me permet d’organiser mes postes de commandement opérationnels (PCO), de me reposer sur des personnels du RAID que je connais et qui travaillent sur ces PCO, d’organiser la noria des services de santé – nous travaillons avec des médecins, comme la BRI. Bref, cela me permet d’avoir une visibilité sur l’ensemble de l’opération.
Je le répète, lorsque nous sommes arrivés, le massacre était perpétré. Les otages que nous avons sauvés n’étaient plus sous la menace directe des terroristes, sauf ceux de l’étage que la BRI a délivrés. J’ai néanmoins eu le sentiment de subir cette opération bien qu’il n’y ait pas eu de dégâts collatéraux. De fait, quelque chose ne va pas lorsqu’un groupe spécialisé de compétence nationale se met à la disposition d’un groupe non spécialisé de compétence locale.
M. le président Georges Fenech. Merci pour ces propos extrêmement clairs et sincères.
Il n’y avait donc pas de PCO à l’extérieur du Bataclan ?
M. Jean-Michel Fauvergue. Pas de PCO de la FIPN en tout cas. Peut-être la BRI en avait-elle installé un, mais nous n’y avons pas eu accès. Il n’y avait pas de PCO commun.
M. le président Georges Fenech. Lorsque vous intervenez, vous mettez en place un PCO, et vous en prenez la direction. Là, vous avez été tenu à l’écart par la BRI.
M. Jean-Michel Fauvergue. Je n’ai pas été tenu à l’écart puisque j’étais à l’intérieur…
M. le président Georges Fenech. Je veux dire que vous avez été tenu à l’écart de la direction des opérations.
M. Jean-Michel Fauvergue. Je n’étais pas à la tête des opérations.
M. François Lamy. Je reviens aux questions de chronologie. Combien de temps s’écoule entre la pré-alerte et le moment où les fonctionnaires du RAID sont en mesure d’être projetés depuis Bièvres ? Que se passe-t-il le week-end, les jours fériés et durant les vacances ? Combien de fonctionnaires pouvez-vous mobiliser, et dans quel laps de temps ?
M. Jean-Michel Fauvergue. Entre le mois de janvier et le mois de novembre 2015, le RAID a créé une équipe rapide d’intervention (ERI). Composée à l’origine de huit à dix personnes, elle en compte aujourd’hui seize. L’ERI est en mesure de partir en dix minutes durant les horaires de travail ; la nuit, elle arrive beaucoup plus rapidement que le reste du convoi parce que les hommes sont prééquipés et partent plus rapidement, soit après une vingtaine de minutes environ. Sachant que, dans la police, aucun personnel n’habite sur place, l’alerte du RAID aux heures non ouvrables, les jours fériés et les weekends est prête à quitter le service en quarante minutes.
M. Olivier Marleix. Au Bataclan, il n’y a pas de PCO. Comment et où se gère la réponse aux autres attentats qui se déroulent dans Paris ? De quelles informations disposez-vous sur tout cela, et comment pouvez-vous y faire face en tant que patron du RAID ?
M. Pierre Lellouche. Si j’ai bien compris, ce soir-là, il n’y a pas de centre de commandement où se concentrent les informations relatives aux opérations et au renseignement. Durant toute la soirée, il n’y a pas non plus de commandement.
M. François Lamy. Il y a un préfet de police !
M. Pierre Lellouche. S’il y a un préfet, il n’a pas assumé le commandement. Car, enfin, comment se fait-il que l’unité spécialisée de lutte antiterroriste ne soit pas prévenue ? Si vous apprenez la nouvelle à la télévision, c’est qu’il n’y a pas de centre de commandement qui alerte les unités compétentes. Comment se fait-il que personne ne vous demande de vous rendre à Paris, et que vous décidiez d’y aller de votre propre initiative ? Qu’une fois sur place, ce soit à vous de coordonner, au mieux, les opérations avec votre homologue ? C’est bien qu’il n’y a pas de centre de commandement et que personne n’assume le commandement.
Comprenez-moi bien, je ne formule ni accusation ni mise en cause ; je me demande comment éviter que ne se reproduise la même chose la prochaine fois. Je constate que les terroristes qui ont mitraillé dans le quartier ont pu partir. Vous n’y êtes pour rien, mais où étaient les unités de police ? Il n’y a pas d’intégration de la riposte dans une ville comme Paris, où entrent trois groupes armés et d’où certains terroristes repartent ensuite.
M. Jean-Michel Fauvergue. Je ne vous ai parlé depuis le début que de ce qui me concerne : l’intervention sur les crises en milieu clos. Sur celle du Bataclan, j’ai dit m’être rendu sur place d’initiative, où nous avons travaillé « au mieux » avec mon collège de la BRI – je préfère retenir cette expression plutôt que d’entendre parler d’improvisation. Cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas de commandement, surtout à la préfecture de police (PP), qui est la deuxième force de police en France, en plus de la DGPN. La PP a une salle de commandement où se retrouvent les primo-intervenants, les acteurs du périmètre de sécurité. On ne peut pas prétendre que cela n’existe pas en se fondant sur ce que je viens de vous dire. Il y a un commandement au niveau des interventions et un commandement général sur l’ensemble de la situation.
Ce jour-là, je ne suis pas actionné, car l’état-major de la PP fait appel, par réflexe, à la BRI ; elle ne pense pas au RAID. Croyez bien cependant que l’initiative que j’ai prise de me rendre sur place n’est pas fortuite : chaque chef du RAID, dès lors qu’il se passe quelque chose en France a ce réflexe de mettre son unité en alerte.
M. Pierre Lellouche. C’est bien pour cela que vous n’êtes pas en cause ! Nous nous interrogeons sur le système.
M. Serge Grouard. Mettons les pieds dans le plat : êtes-vous tenu volontairement à l’écart ? Car, enfin, les deux unités d’élite française ne sont pas sollicitées sur des agressions majeures !
M. Jean-Michel Fauvergue. Non, je ne suis pas tenu à l’écart, et je n’ai pas le sentiment d’être tenu à l’écart.
L’actuel préfet de police de Paris, M. Michel Cadot, est en train de revoir les règles d’intervention des diverses forces concernées. Il propose que la BRI intervienne dans Paris intra-muros et que le RAID intervienne en petite couronne.
M. président Georges Fenech. Est-ce satisfaisant ?
M. Jean-Michel Fauvergue. Il fait au mieux compte tenu des pressions qu’exercent ses services. Si le préfet de police n’avait pas la BRI à sa disposition, il serait plus enclin à saisir le RAID, qui est compétent sur l’ensemble du territoire, a plus de moyens et est mieux formé pour l’intervention pure.
M. le président Georges Fenech. On peut donc améliorer cette organisation. Faut-il l’améliorer ?
M. Jean-Michel Fauvergue. Si l’on veut garder cette spécificité parisienne d’une BRI à disposition du préfet de police dans Paris intra-muros, il faudrait, selon moi, qu’elle dispose d’un groupe d’une trentaine de personnes spécialisées dans l’intervention.
M. le président Georges Fenech. Ces personnels ne doivent plus faire de police judiciaire.
M. Jean-Michel Fauvergue. Oui. Ils doivent être sélectionnés et recrutés sur le modèle des groupes d’intervention.
M. le rapporteur. C’est ce qui est prévu dans le protocole que vous évoquiez.
M. Jean-Michel Fauvergue. C’est vrai, mais cela ne se fera pas au même rythme que ce que nous avons connu avec les groupes d’intervention de la police nationale (GIPN).
M. le rapporteur. Il existe déjà des formations communes ?
M. Jean-Michel Fauvergue. Elles existent dans le cadre de la FIPN, mais chacune ne concerne que trois ou quatre personnes de la BRI. Ce n’est pas suffisant.
M. Serge Grouard. Pensez-vous que si vous aviez eu le commandement de l’opération, vous seriez intervenu plus rapidement ? Vous avez évoqué l’équipe rapide d’intervention, qui prend sans doute des risques beaucoup plus grands. Aujourd’hui, au vu de ce qui s’est produit, privilégieriez-vous la rapidité par rapport à la mise en place complète d’un dispositif sécurisé ? Quel est votre retour d’expérience en la matière ?
M. Jean-Luc Laurent. L’intervention des équipes de secours, l’assistance aux victimes, leur évacuation et leur prise en charge ont-elles gêné la conduite de votre opération ?
Dans l’incertitude quant à de possibles autres risques, à votre connaissance, d’autres forces étaient-elles en réserve ce soir-là ?
M. Jean-Michel Fauvergue. Je ne comprends pas très bien la question sur la gêne que pourraient occasionner les équipes de secours. Fait-elle référence à l’affirmation par Mediapart d’un problème entre le SAMU et les pompiers ? En tant qu’unité nationale, nous avons l’avantage de disposer d’une unité médicalisée permanente. Elle compte cinq médecins qui sont physiquement capables d’absorber les chocs et qui interviennent avec nous. Quatre d’entre eux étaient présents cette nuit-là. Sur un théâtre d’intervention, nous mettons en place une zone rouge dans laquelle aucun secours ne rentre autre que nos propres médecins. Leur rôle est de suivre la colonne d’intervention pour apporter des soins d’abord aux policiers intervenants, ensuite aux otages blessés.
Au Bataclan, nous avons commencé par sécuriser le bas en maintenant les deux derniers terroristes au niveau de l’arrière-scène afin d’évacuer progressivement les dizaines et les dizaines de blessés que nous avons trouvés en arrivant sur place, avec les morts. Nous parvenions à peine à nous faufiler en traînant les pieds entre les cadavres. Les blessés au sol nous tiraient par le pantalon. C’était une vision d’horreur. Mes quatre médecins et ceux de la BRI voulaient absolument intervenir. Nous avons d’abord sécurisé les lieux. Ils ont ensuite commencé à faire évacuer, aidés par les primo-intervenants présents sur place, avec les moyens du bord. Cela a sans doute sauvé la vie à des dizaines de personnes. Nous étions en zone de guerre, l’évacuation se faisait au moyen de barrières métalliques, à dos d’homme. On a vu de très belles réactions de la part des fonctionnaires de police.
Nous gérons de cette manière nos équipes de secours. Personne ne rentre dans la « zone feu ». On y récupère les blessés qu’on amène vers un nid de victimes, où ils sont pris en charge par les structures d’urgence des pompiers, du SAMU et autres. Nous n’avons donc pas été gênés. Disons seulement que si nos PC avaient été installés, cette noria aurait pu être mise en place en gagnant deux, trois ou quatre minutes, suffisamment peut-être pour sauver une vie.
Concernant les forces de réserve, pour le RAID, j’avais engagé trois alertes et j’avais en réserve toutes les antennes du reste de la France, qui étaient mobilisées. Celle de Lille peut venir assez rapidement sur Paris et nous avons la possibilité d’utiliser des moyens héliportés pour acheminer des équipes restreintes. Par ailleurs, le GIGN était présent dans la capitale, et nous n’aurions pas hésité à l’engager.
M. Olivier Marleix. Je ne sais toujours pas quelles informations vous aviez sur ce qui se passait sur les autres sites ni, en conséquence, quelle était votre capacité de coordination.
M. Jean-Michel Fauvergue. Lorsque nous intervenons, nous montons une salle de crise, à Bièvres, qui distribue l’information au chef du RAID et à ses adjoints. Elle gère aussi les fonctionnaires de réserve. C’est un instrument autonome qui me permet d’être informé 24 heures sur 24.
M. Pierre Lellouche. De combien de fonctionnaires spécialisés disposez-vous en permanence ?
M. Jean-Michel Fauvergue. Le RAID compte 300 opérateurs de terrain. En tenant compte des congés, on peut considérer que 200 à 250 fonctionnaires sont mobilisables à tout moment.
M. le rapporteur. S’agissant de l’assaut de Saint-Denis, selon ce que le ministre de l’intérieur nous a dit lundi, le RAID aurait utilisé 1 500 munitions. Confirmez-vous ce chiffre ? La presse l’évalue à plus de 5 000.
De quelles armes les terroristes disposaient-ils, selon vous ? Seul un pistolet semi-automatique aurait été retrouvé.
Dans une situation où il n’y avait pas d’otage, l’utilisation d’armes non létales, comme des grenades assourdissantes ou lacrymogènes, n’aurait-elle pas été possible ? Pouvez-vous nous dire quelques mots des autres modes opératoires auxquels vous réfléchissez ?
M. Jean-Michel Fauvergue. Je confirme que nous avons tiré environ 1 200 cartouches.
M. le président Georges Fenech. Pourquoi avoir parlé de 5 000 ?
M. Jean-Michel Fauvergue. C’est le procureur de la République qui a transmis ce chiffre, mais il y a eu une confusion. Il nous avait demandé combien de cartouches étaient engagées dans le dispositif, pour savoir si nous avions des munitions en réserve. Il lui a été répondu 5 000.
Nous savons, à coup sûr, que les terroristes avaient un pistolet 9 millimètres, car ils nous ont tiré dessus avec, ainsi que sur le chien qu’ils ont tué.
M. le président Georges Fenech. Vous avez la certitude que le chien a été tué par les terroristes ?
M. Jean-Michel Fauvergue. Nous en avons la certitude. Il est enterré à Bièvres, et nous sommes prêts à le déterrer quand on nous le demandera – ce serait dommage pour les maîtres-chiens qui ont quasiment construit un mausolée. Ce que les journalistes ont raconté à ce sujet était aberrant, et énervant.
Les terroristes avaient aussi des grenades qui ont fait cinq blessés dans nos rangs. Il s’agissait de grenades artisanales ou offensives yougoslaves chemisées – mes blessés ont été touchés par de la limaille.
Surtout, ils disposaient de gilets explosifs, ce qui détermine tout pour un chef d’unité, car ces gilets peuvent faire cinq ou dix morts parmi vos hommes. Dans ces conditions, vous ne prenez aucun risque. Moi, je n’en ai pris aucun. C’est pourquoi 1 300 ou 1 500 cartouches ont été tirées, pour maintenir les terroristes à distance.
Lorsqu’on interpelle un terroriste à domicile, il est inutile de chercher à l’endormir : il est sur ses gardes, et il faut intervenir rapidement. Nous avons utilisé les grenades offensives et assourdissantes dont les gendarmes mobiles ne se servent plus en maintien de l’ordre, et que nous avons récupérées. Elles font 72 grammes et elles ont un fort pouvoir explosif.
Aujourd’hui, le gilet explosif est la préoccupation constante en matière d’interpellation. Tous les policiers et gendarmes de France vont sans doute être confrontés à des individus porteurs d’un gilet explosif ou susceptibles d’en être porteurs. Dans ce cas, il faut décider rapidement si on les laisse progresser ou si on leur tire dessus. Le problème –grave –, c’est que selon qu’il y a explosifs ou pas, il y aura ou non légitime défense. Pour ma part, il était hors de question que mes gars aillent au contact à Saint-Denis. Tant que je serai chef du RAID, il sera hors de question que je perde sciemment des policiers. C’est ce que j’ai fait ce jour-là, et je ne regrette rien.
M. le président Georges Fenech. Vous ne mentionnez pas, dans votre rapport, la présence de la BRI-Paris à Saint-Denis. Pourquoi ? En l’espèce, je ne crois pas que la FIPN ait été déclenchée.
M. Jean-Michel Fauvergue. La BRI est venue à la fin de l’opération.
M. le président Georges Fenech. À votre demande ?
M. Jean-Michel Fauvergue. Non !
M. le président Georges Fenech. Sur la demande de qui ?
M. Jean-Michel Fauvergue. Je ne sais pas.
M. le président Georges Fenech. Elle ne passait pas par-là par hasard. Vous ne savez ni pourquoi elle était présente ni qui lui a demandé d’intervenir ?
M. Jean-Michel Fauvergue. L’intervention de Saint-Denis est une opération d’assistance de la SDAT et de la DGSI, qui ont récupéré les adresses et effectué le travail en amont, sous l’autorité du procureur de la République. Comme à l’accoutumée, nous avons prêté main-forte à la SDAT. Jamais la présence de la BRI n’avait été prévue dans cette opération : elle n’est pas le bras armé de la section antiterroriste.
M. le président Georges Fenech. Pourquoi est-elle là ?
M. Jean-Michel Fauvergue. Je vous le répète, je ne le sais pas ! Elle est là vers onze heures du matin.
M. le président Georges Fenech. C’est tout de même assez stupéfiant ! Et là encore, toujours pas de FIPN ?
M. Jean-Michel Fauvergue. Non, mais là, cela s’explique.
M. le président Georges Fenech. Messieurs, nous vous remercions.
Audition, à huis clos, du général Denis Favier, directeur général de la gendarmerie nationale, du colonel Hubert Bonneau, commandant le groupe d'intervention de la gendarmerie nationale (GIGN), et du colonel Armando de Oliveira, commandant la région de gendarmerie de Picardie et le groupement de gendarmerie départementale de la Somme
Compte rendu de l’audition, à huis clos, du mercredi 9 mars 2016
M. le président Georges Fenech. Messieurs, nous vous remercions d’avoir répondu à la demande d’audition de notre commission d’enquête. Avec le ministre de l’intérieur, que nous avons reçu lundi, et avec les chefs du RAID, il y a un instant, nous avons commencé à aborder les questions relatives à la conduite des opérations, à l’intervention des forces de l’ordre et aux moyens mis à leur disposition. Nous poursuivons nos investigations avec vous. Nous sommes entrés dans l’opérationnel, et nous sommes désireux de vous interroger aussi bien sur la participation aux opérations des forces de gendarmerie classiques que sur l’intervention du GIGN, unité d’élite spécialisée notamment dans le contre-terroriste.
En raison de la confidentialité des informations que vous êtes susceptibles de nous délivrer, cette audition se déroule à huis clos. Elle n’est donc pas diffusée sur le site internet de l’Assemblée. Néanmoins, et conformément à l’article 6 de l’ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, son compte rendu pourra être publié en tout ou partie, si nous en décidons ainsi à l’issue de nos travaux. Je précise que les comptes rendus des auditions conduites à huis clos sont transmis aux personnes entendues afin de recueillir leurs observations, dont la commission d’enquête peut décider de faire état dans son rapport. Je rappelle que, selon ce même article 6, encourt les peines prévues à l’article 226-13 du code pénal, soit un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, toute personne qui, dans un délai de vingt-cinq ans, divulguera ou publiera une information relative aux travaux non publics d’une commission d’enquête, sauf si le rapport publié à la fin des travaux de la commission a fait état de cette information.
Conformément aux dispositions de l’article 6 précité, je vous demande de prêter le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité.
Le général Denis Favier, le colonel Hubert Bonneau et le colonel Armando De Oliveira prêtent successivement serment.
Je vous laisse la parole en vous priant, pour la clarté de nos débats, de bien vouloir évoquer dans un premier temps les attentats du mois de janvier 2015. Nous aborderons dans un second temps ceux du mois de novembre.
Général d’armée Denis Favier, directeur général de la gendarmerie nationale. La gendarmerie a joué un rôle clé dans la recherche opérationnelle engagée à l’occasion des attentats de janvier 2015. Je distingue trois aspects opérationnels bien distincts s’agissant de ces événements.
Une première phase concerne l’attaque de Charlie Hebdo qui se déroule dans la matinée du 7 janvier, à partir de 11 heures 20, dans Paris intra-muros. Du fait de cette localisation, le préfet de police de Paris est incontestablement à la manœuvre en termes de responsabilité opérationnelle. Très rapidement, compte tenu des indications données sur la fuite des terroristes en direction du Nord, la gendarmerie déclenche, dans la région Île-de-France et en grande périphérie parisienne, une manœuvre de contrôle des flux et des axes dont la pertinence sera par la suite démontrée : nous savons aujourd’hui que les terroristes sont venus buter sur un dispositif de gendarmerie installé sur l’autoroute A4.
Dans un délai très bref après la commission des faits, une structure de crise est installée à l’hôtel de Beauvau, à laquelle je suis associé bien que n’étant pas concerné au premier chef. Pour avoir connu d’autres crises dans le passé, je considère que cette organisation inédite au sein du salon « Fumoir » constitue une plus-value notable, car tous les acteurs de sécurité se trouvent associés, autour du ministre, dans la gestion de la crise et partagent l’appréciation de la situation. Dans cette salle de crise, nous avons pris des mesures de renforcement du dispositif de contrôle général des flux, des palais nationaux et des centrales nucléaires – à ce stade, nous estimions qu’il existait peut-être des risques d’attaque terroriste sur différents sites sensibles.
Dès le début de l’après-midi du 7 janvier, la gendarmerie engage un volume très important d’unités. En moins de deux heures, huit escadrons de gendarmerie mobile sont mobilisés, ce qui représente un effort considérable. Au total, environ 520 hommes sont à la disposition du préfet de police. À quinze heures, le Président de la République réunit pour la première fois, autour des ministres, l’ensemble des décideurs en matière de sécurité. En tant que directeur général de la gendarmerie, je suis présent à cette réunion, ce qui me permet d’appréhender parfaitement la situation et d’adapter mon dispositif avec anticipation.
Durant toute cette phase de police judiciaire, nous sommes « force concourante » et nous apportons à ce titre notre appui et le soutien de nos moyens à la police nationale, « force menante ».
Dans l’après-midi, nous apprenons que le RAID va intervenir à Reims pour contrôler les logements de proches des frères Kouachi. L’opération de police judiciaire prend donc une dimension extraterritoriale, sortant du ressort de la préfecture de police de Paris pour se dérouler dans une zone qui relève davantage de la compétence de la gendarmerie nationale. On voit bien alors que la manœuvre qui se dessine sera globale et qu’elle nécessitera un engagement fort de tous les acteurs. Dans un esprit de participation et de collaboration active avec la police, nous mettons des moyens à sa disposition, en particulier pour assurer le bouclage du site sensible sur lequel le RAID va travailler. Nous engageons également des hélicoptères pour assurer la surveillance des lieux.
Dans cette phase initiale, il est déterminant que soient réunis dans une même salle, autour de l’autorité ministérielle, tous les décideurs des forces de sécurité : en de telles circonstances, le partage de l’information en temps réel se révèle essentiel. Ce point constitue une préoccupation majeure du ministre de l’Intérieur et garantit la cohérence du dispositif global mis en œuvre.
Une deuxième phase commence le matin du 8 janvier. Les choses basculent à 8 heures 53 avec l’assassinat, par Coulibaly, de la policière municipale de Montrouge Clarissa Jean-Philippe, puis, à 9 heures 20, avec le braquage d’une station-service à proximité de Villers-Cotterêts, sur la route nationale 2, par deux individus qui sont très rapidement identifiés comme étant les frères Kouachi. Cette station-service se trouve en zone de gendarmerie. On sort alors d’une phase exclusivement judiciaire pour entrer dans une phase de recherches opérationnelles. Comme je suis associé à la conduite globale des opérations, je propose au ministre de suivre cette logique.
Notre solide implantation territoriale nous permet de tenir le terrain : nous mettons en place un plan Épervier dans un rayon de quarante kilomètres autour de Villers-Cotterêts, en contrôlant une vaste zone qui comprend la forêt de Retz ; nous engageons le GIGN afin qu’il apporte son soutien aux unités territoriales déjà présentes sur le site ; nous installons à Villers-Cotterêts un poste de commandement opérationnel (PCO), placé sous le commandement du colonel Armando De Oliveira. Dans sa zone de compétence, la gendarmerie nationale n’est plus alors force concourante, mais devient la force menante dans une opération, non plus seulement de police judiciaire, mais de recherches opérationnelles. C’est un autre élément clé qui me semble également déterminant.
Cette opération de recherche opérationnelle s’est révélée payante. Nous avons su tenir le terrain en mobilisant l’ensemble de nos forces et capacités : gendarmerie mobile, gendarmerie départementale, garde républicaine, hélicoptères. Tous les renseignements recueillis auprès des habitants dans le cadre du dispositif dynamique de contrôle de zone ont été vérifiés afin de nous assurer de la présence ou de l’absence des frères Kouachi. Les conditions de recherche de la journée du 8 janvier sont particulièrement difficiles : la météo est défavorable et la nuit tombe tôt. Nous travaillons en complémentarité totale avec la police nationale. J’ai moi-même défini le secteur de recherches du GIGN, à l’est de la zone de Villers-Cotterêts, et celui du RAID, qui se trouve un peu au Sud ; il n’y a pas de chevauchement de compétences. Chaque force agit dans le souci de l’intérêt général dans un excellent esprit de coordination.
Lorsque la nuit tombe, nous disposons de renseignements fragmentaires qui m’incitent à proposer au ministre de maintenir le dispositif. Nous tenons, en particulier, les carrefours et les hameaux, nous patrouillons et vérifions chaque fois que nécessaire les renseignements collectés. Cette option démontre toute sa pertinence car, le matin du 9 janvier, les frères Kouachi, qui avaient été « fixés » dans la zone que nous tenions, sortent du bois, au sens propre comme au sens figuré. Ils viennent buter sur notre rideau d’interception alors qu’ils quittent le secteur vers la Seine-et-Marne. À 8 heures 30, alors que je me trouve en réunion à l’Élysée, l’information me parvient qu’à 8 heures 20, ils se sont emparés d’une voiture, après en avoir expulsé la conductrice. Je m’isole alors pour travailler avec mes cartes et donner des directives. Le GIGN, qui se trouve à quelques kilomètres, se déploie immédiatement par hélicoptère sur le site de Dammartin-en-Goële ; les effectifs de gendarmerie départementale, en alerte et sur place depuis la veille, contrôlent les axes. Les frères Kouachi se retrouvent pris dans une nasse ; ils sont détectés par une patrouille qui riposte avec une formidable lucidité aux tirs de kalachnikovs. Cette opposition forte les contraint à se retrancher dans les locaux d’une imprimerie. Je fais part de cette manœuvre au Président de la République et aux ministres présents, qui me demandent de me rendre sur les lieux pour coordonner l’ensemble des opérations.
Lorsque j’arrive sur place, vers 11 heures 40, le PC opérationnel est déjà activé : le colonel Bonneau, commandant le GIGN, est présent ainsi que le procureur de la République de Paris, M. François Molins, et le préfet de Seine-et-Marne. Le GIGN encercle l’imprimerie dans laquelle se sont réfugiés les frères Kouachi. Le RAID et la BRI sont présents et se mettent à notre disposition mais, à ce stade, il n’est pas nécessaire de faire appel à leurs capacités, car nous sommes assez nombreux et en mesure de gérer la situation. Nous travaillons sur le site dans une logique de sécurisation globale : la situation de l’otage caché dans l’imprimerie est prise en compte ; les établissements scolaires à proximité sont évacués. Nous entrons alors dans une phase de neutralisation des terroristes.
À ce stade, la prise de l’épicerie cachère à Paris n’est pas encore survenue. Nous prenons connaissance de qui se produit à la porte de Vincennes à 13 heures 30. Le RAID et la BRI quittent alors Dammartin-en-Goële pour Paris afin de prendre en compte cette nouvelle situation. À partir de ce moment, deux opérations lourdes se déroulent donc simultanément, avec une priorité opérationnelle très clairement donnée à l’épicerie cachère où un nombre important d’otages est retenu par Coulibaly. Le scénario prévu à Dammartin est donc modifié : l’assaut est désormais subordonné au dénouement de la situation de la porte de Vincennes. Cependant, les choses ne se déroulent pas comme prévu, car les frères Kouachi sortent de l’imprimerie à 16 heures 54. J’en informe le ministre et je lui dis que nous allons les neutraliser, ce qui suppose qu’une opération offensive soit organisée dans le même temps à Paris pour libérer les otages et neutraliser Coulibaly. La coordination est parfaite entre nous, le RAID et la BRI ; des officiers de liaison du RAID et du GIGN, respectivement à Dammartin et à Paris, assurent des échanges opérationnels par téléphone, qui confirment les informations que nous partageons au plus haut niveau politique. C’est dans ce contexte, immédiatement après que l’assaut a été déclenché à Dammartin, que l’opération s’est engagée à la porte de Vincennes.
M. le président Georges Fenech. Parmi vos réponses écrites au questionnaire que nous vous avons adressé, vous faites état, lors de la réunion qui s’est tenue à l’hôtel de Beauvau, à dix-neuf heures, le 7 janvier, d’une demande du ministre exigeant un partage complet de l’information. Existait-il un problème à ce niveau pour que vous ayez ressenti le besoin d’écrire ce fait noir sur blanc ?
Général d’armée Denis Favier. Dans un premier temps, alors que nous nous trouvons dans une phase de police judiciaire, le partage du renseignement revêt une dimension primordiale. C’est bien pour cette raison que le ministre de l’Intérieur a décidé d’activer le salon « Fumoir » à Beauvau, non seulement pour fluidifier l’échange d’informations entre l’ensemble des acteurs mais aussi pour optimiser la coordination des recherches opérationnelles.
Je reconnais que le fait de se réunir autour de la table et de tout mettre en commun a constitué un élément déterminant qui m’a permis d’appréhender très précisément la complexité de la situation dans ma zone de compétence et de prendre les mesures qui s’imposaient. Sans information sur la complexité de l’environnement ni données exactes sur la situation, je risquais de ne pas réagir en apprenant qu’une station-service Avia était braquée à Villers-Cotterêts. Si nous parvenons à être aussi réactifs, c’est parce que nous sommes autour de la table et que le partage de l’information est total.
M. le président Georges Fenech. Lors des attentats du 7 janvier, à quatorze heures, vous envoyez au centre interministériel de crise de l’hôtel de Beauvau, votre rapport sur le plan Épervier qui concerne sept départements. Comment se fait-il que la réunion de crise, qui réunit le ministre, le directeur général de la gendarmerie nationale (DGGN) et le directeur général de la police nationale (DGPN), n’intervienne que cinq heures plus tard ?
Général d’armée Denis Favier. Le 7 janvier, la première réunion au ministère de l’intérieur a eu lieu aux environs de treize heures. Vous faites référence à un horaire qui concerne un compte rendu relatif à l’installation du plan Épervier.
Nous avons été très rapidement réunis autour du directeur de cabinet du ministre. Dès quinze heures, je participe à la réunion qui se tient à l’Élysée. Trois réunions se sont tenues à l’Élysée : l’une le jeudi à quinze heures, la suivante, le 8 janvier en début de matinée, et la dernière le 9 janvier à huit heures.
M. le président Georges Fenech. C’est à l’occasion de cette dernière réunion que vous est attribué le commandement des opérations à Dammartin-en-Goële ?
Général d’armée Denis Favier. Lorsque le Président de la République et les ministres ont eu terminé la réunion que j’avais moi-même quittée pour travailler dans un bureau attenant en apprenant que les frères Kouachi avaient été localisés, ils sont venus me rejoindre afin que je présente la manœuvre que nous élaborions avec le GIGN et la région de gendarmerie de Picardie. J’ai présenté les options, le Président les a écoutées et il m’a demandé de me rendre sur place pour diriger l’ensemble des opérations.
M. le président Georges Fenech. Pourquoi votre rapport ne mentionne-t-il pas la présence du RAID et d’un peloton de la BRI à vos côtés, aux abords de l’imprimerie, juste avant l’assaut ?
Général d’armée Denis Favier. Au moment de l’assaut, le RAID et la BRI ne se trouvent plus à Dammartin-en-Goële. Ils ont déjà basculé vers Paris depuis treize heures, lorsque les événements de la porte de Vincennes ont été connus.
Nous avions associé le RAID aux opérations de recherche dans un souci d’ouverture, d’efficacité et d’intérêt général, alors que nous étions force menante et que nous n’avions pas de besoin particulier. Les zones de travail avaient été réparties sur cartes, dans un climat très apaisé entre les patrons du RAID et du GIGN. Très sincèrement, la préparation et la conduite de ce dispositif coordonné se sont déroulées dans des conditions très satisfaisantes.
Policiers et gendarmes sont restés sur le terrain durant toute la nuit du 8 au 9 janvier. Le 9 au matin, lorsque les événements se précipitent, je fais faire mouvement au GIGN, de Villers-Cotterêts vers Dammartin, en hélicoptère, et le RAID, qui se trouve à proximité, se déplace en voiture. Se retrouve alors à Dammartin un volume important de forces – GIGN, RAID et BRI –, chacun sachant sans ambiguïté à ce stade que le GIGN est la force principale et menante.
M. Sébastien Pietrasanta, rapporteur. Le RAID, que nous avons entendu avant vous, a modifié ses modes opératoires après l’affaire Merah, en 2012. L’avez-vous fait aussi ? Ont-ils été réévalués depuis les attentats de l’année dernière ? Continuez-vous à négocier avec les personnes radicalisées ? À Dammartin-en-Goële, y a-t-il eu des prises de contact téléphoniques avec les frères Kouachi ? Le cas échéant, à quoi ont-elles servi ?
Comment s’est faite la coordination, le 9 janvier, entre Dammartin et la porte de Vincennes ? Quand les forces de sécurité présentes devant l’Hypercacher ont-elles été prévenues de l’assaut à Dammartin-en-Goële ?
Les frères Kouachi sortent de l’imprimerie à 16 heures 55 et l’intervention du RAID à l’Hypercacher commence à 17 heures 10. Sans chercher à mettre en cause qui que ce soit, je souhaite savoir si, dans votre pratique, ce quart d’heure paraît long ou pas ?
Général d’armée Denis Favier. Les doctrines d’emploi des unités spéciales n’ont cessé d’évoluer depuis la prise d’otage des Jeux olympiques de Munich, en 1972. J’ai, commandé le GIGN à deux reprises. La première fois, entre 1992 et 1997, alors que nous connaissions un terrorisme extrêmement violent, mais d’une autre nature. Il était alors encore possible de négocier. Puis, la menace évoluant, nous avons été amenés à évoluer nous-mêmes de façon significative. Au début des années 2000, nous avons dû intégrer des éléments qui découlaient des prises d’otages du théâtre moscovite de la Doubrovka, en octobre 2002, et de l’école de Beslan, en Ossétie du Nord, en septembre 2004. Le terrorisme de masse nous a contraints à modifier totalement nos structures et nos préceptes d’intervention.
En 2007, nous avons restructuré profondément le GIGN et j’ai pris à nouveau son commandement à cette occasion, jusqu’en 2011. Durant cette période, la négociation restait possible, mais les modes d’action avaient considérablement durci : il fallait désormais avoir la capacité de travailler en milieu piégé ou pollué par des produits nucléaires, radiologiques, biologiques, chimiques (NRBC) et celle d’utiliser les explosifs de manière très intensive pour pouvoir libérer les otages. Les attaques de Bombay, en 2008, ont conduit à adapter nos modes opératoires pour pouvoir répondre aux attentats ou aux prises d’otages multiples. Au fil du temps, nous n’avons cessé de nous adapter à la menace.
Aujourd’hui, les situations que nous rencontrons demandent que nous soyons en mesure d’engager très rapidement le feu lorsque nous arrivons sur la zone d’opération. Un plan d’assaut immédiat nous permet, lorsque nous quittons notre base par véhicules ou hélicoptères, de « briefer » en mouvement et d’engager très vite une opération offensive visant à neutraliser les terroristes. Car, depuis trois ou quatre ans, on retrouve comme constante qu’il n’y a plus de négociation possible avec les terroristes qui affrontent les forces de l’ordre. Depuis les événements du mois de novembre, le GIGN a considérablement fait évoluer la doctrine d’emploi.
Pour aller plus loin dans le raisonnement, je considère que l’engagement contre les terroristes ne concerne pas seulement les unités spéciales. Nous n’aurons pas forcément, demain, le temps d’attendre l’arrivée du RAID ou du GIGN. Dans la profondeur du territoire, il faudra être capable d’engager le feu avec des unités plus conventionnelles, pour pouvoir mettre un coup d’arrêt à des terroristes qui veulent tuer jusqu’à ce que l’on vienne à leur contact dans une logique de martyre. Entre janvier et novembre, nous avons en conséquence « dopé » nos unités élémentaires d’intervention : dans le cadre d’un plan BAC (brigades anti-criminalité) pour la police et PSIG (pelotons de surveillance et d’intervention de la gendarmerie) pour la gendarmerie, qui comprend de l’armement de qualité, de la protection balistique, des aides à la visée, des gendarmes et des policiers spécifiquement formés sont en mesure d’engager le feu assez rapidement. Lorsque le ministre parle d’un plan d’action à vingt minutes, il fait référence à cette capacité que nous aurons de prendre en main les situations d’urgence en différents points du territoire, sans attendre les unités nationales. La doctrine a donc évolué et les capacités se sont considérablement renforcées, notamment pour les unités du haut du spectre comme le GIGN pour ce qui concerne la gendarmerie.
M. le président Georges Fenech. Vous nous confirmez donc ce que nous a expliqué le ministre de l’intérieur sur le nouvel armement lourd des BAC et des PSIG.
Général d’armée Denis Favier. L’armement sera livré dès le mois de juin prochain. J’ai constitué 150 PSIG durcis, dits PSIG « SABRE ». Il y en aura dans tous les départements. Je les mets en place par tranche de cinquante par an sur trois ans, car les coûts budgétaires engagés sont importants.
Ces personnels seront équipés du fusil HK G36, qui est une arme performante, d’une protection balistique individuelle et de boucliers balistiques qui permettront aux gendarmes d’aller au contact sous le feu. Nous aurons ainsi une solide capacité de primo-intervenant, qu’il faut distinguer du primo-engagé qui est la patrouille « classique » qui arrive sur le site, est prise à partie, se poste, observe, riposte si elle le peut et rend compte. Dans la foulée, le primo-intervenant est envoyé sur place, dans les délais les plus brefs possible.
Monsieur le rapporteur, la communication entre Dammartin-en-Goële et la porte de Vincennes se passe par liaison téléphonique, d’une part, celle que j’ai avec le ministre, d’autre part, celle des opérateurs du RAID et du GIGN présents sur les deux sites. Quelques minutes avant leur sortie de l’imprimerie, les frères Kouachi en ont entrouvert la porte. Le colonel Bonneau m’a transmis l’information et j’en ai avisé le ministre auquel j’ai dit qu’il faudrait les neutraliser s’ils sortaient. La priorité opérationnelle, qui allait à l’épicerie cachère, est alors inversée, car on ne peut pas accepter l’idée que les frères Kouachi sortent sans être neutralisés. À 16 heures 54, lorsqu’ils sortent, tout le monde sait que nous allons devoir engager le feu.
M. le rapporteur. À quelle heure précise entrouvrent-ils la porte ?
Général d’armée Denis Favier. Vers 16 heures 40.
M. le rapporteur. Dès lors, l’information est-elle donnée au RAID qu’il doit se préparer à l’inversion de la priorité ?
Général d’armée Denis Favier. C’est ce qu’il fait depuis le départ. La situation à l’Hypercacher est très complexe.
M. le rapporteur. Je pensais au quart d’heure qui s’est écoulé entre la sortie des frères Kouachi et l’assaut sur l’Hypercacher. On peut penser que le moment où les frères Kouachi entrouvrent la porte, en même temps qu’il permet au RAID d’anticiper davantage, augmente encore ce laps de temps d’un quart d’heure. Celui-ci vous paraît-il long ?
Général d’armée Denis Favier. Très sincèrement, et pour avoir géré moi-même ce type de situation, la réponse est non. Il a fallu au RAID le temps de se rendre sur place, de la prise en compte opérationnelle de la situation et de la perception exacte de l’environnement complexe. Les choses sont plus délicates à Paris qu’à Dammartin où elles sont contenues – globalement, les frères Kouachi ne peuvent pas sortir de l’imprimerie. À la porte de Vincennes, l’affaire est beaucoup plus volatile et l’on n’entreprend pas une libération d’otages sans travail préparatoire. On ne peut vraiment pas trouver que le délai pour passer à l’action a été trop long ; la situation était vraiment complexe.
M. François Lamy. À Dammartin-en-Goële, contrairement à ce qui se passe à la porte de Vincennes, il n’y a pas d’otage. Dans ces conditions, pourquoi ne pas utiliser d’armes non létales, comme le gaz, même si vous savez avoir affaire à des gens qui souhaitent mourir ?
Colonel Hubert Bonneau, commandant le groupe d’intervention de la gendarmerie nationale (GIGN). Depuis plusieurs années, nous travaillons en profondeur sur l’évolution des modes opératoires de l’adversaire. Au sein du GIGN, nous avons un bureau Suivi Anticipation, où des officiers, anciens opérationnels, consacrent leur temps à observer ce qui se passe dans le monde entier. Par ailleurs, nous sommes engagés dans des pays en crise – nous sommes présents à Bagdad depuis douze ans –, et nous comprenons comment l’adversaire évolue. Les capacités déployées au mois de janvier n’ont pas constitué, pour nous, une surprise. Nous savons que nous avons en face de nous des gens qui agissent sans préavis, qui tuent et avec qui il n’y a pas de négociation possible. La tuerie s’arrête lorsqu’elle rencontre l’opposition des forces de l’ordre. S’ensuit alors une phase de retranchement qui doit durer le plus longtemps possible pour avoir une bonne couverture médiatique. Pour Merah, il s’agissait de montrer l’échec de l’État face à une personne seule qui reste enfermée pendant trente-six heures. Mais l’issue est toujours la même : c’est la mort, non pas en chahîd, mais en inghimasi, soldat suprême, dont le but, tant chez Daech que chez al-Qaïda, est de sacrifier sa vie en emportant avec soi le plus grand nombre possible de soldats du tâghût, c’est-à-dire des catégories suprêmes que sont le RAID ou le GIGN. Ces modes opératoires nous les avons étudiés, et nous les connaissons parfaitement au mois de janvier. Et que ce soit Merah, les frères Kouachi, Coulibaly, les terroristes du Bataclan, du Mali ou du Burkina Faso, ce sont eux qui décident du moment de leur mort et qui se jettent sur les forces de l’ordre. Ces modes opératoires, que nous avons vu apparaître à l’étranger, sont le fait d’individus totalement déterminés, potentiellement porteurs de ceintures d’explosifs.
C’est ce que nous avons face à nous lorsque les frères Kouachi sortent à Dammartin. Les ordres donnés ne sont pas de les tuer, mais d’essayer de les prendre vivants en les neutralisant. Les tirs sont effectués à environ cent mètres par des tireurs d’élites et des hommes en poste de part et d’autre de l’imprimerie. Ils visent les épaules, les mains et les cuisses. Mais nous avons affaire à des combattants qui veulent aller jusqu’au bout. Je vois Saïd Kouachi tomber une première fois : touché au bras, il perd son arme, mais la récupère de l’autre main et continue de tirer. Alors que notre but était de maintenir les frères Kouachi sur le parking afin d’éviter qu’ils ne parviennent sur la route au contact des groupes du GIGN, nous n’avons pas pu faire autrement que de les neutraliser complètement.
Face à des gens aussi déterminés, il est illusoire de vouloir utiliser des armements comme le taser ou des armes non létales. Nous avons aussi l’obligation de protéger nos propres hommes.
M. Jean-Michel Villaumé. Outre les aspects opérationnels des services, ne faudrait-il pas faire évoluer leurs critères d’emploi, en particulier du point de vue territorial ? Ne ressentez-vous pas la nécessité d’établir un véritable commandement commun des forces d’intervention rapide du GIGN, du RAID et de la BRI, et, pourquoi pas, d’en arriver à regrouper ces forces ?
Mme Françoise Dumas. La présence de la presse ou les informations qu’elle a pu divulguer durant les opérations ont-elles constitué une gêne pour vos actions ? Quel type de comportement devrait-elle adopter dans le cadre de telles opérations ? Jusqu’où peut-on aller en matière de tolérance de la liberté de la presse ?
M. Pierre Lellouche. Général, à vous écouter, je comprends qu’il n’y aurait pas eu de coordination entre les services si elle n’avait pas été mise en œuvre au niveau du ministre lui-même, voire celui du Président de la République. Il n’y a pas de pilote dans l’avion. Malgré l’affaire Merah, qui remonte à 2012, nous n’avons pas de centre de pilotage du contre-terrorisme pour partager le renseignement et gérer le commandement d’une crise.
Quelque chose m’aurait-il échappé ? Ai-je bien compris que, si les forces de sécurité n’avaient pas été réunies, le 8 janvier, afin de partager l’information, vous n’auriez pas pu faire le lien avec les frères Kouachi en apprenant le braquage d’une station-service en grande couronne et réagir en conséquence ? Que le RAID s’était déplacé de son côté, sans vous prévenir, dans l’est de la France, alors que c’est théoriquement votre zone ? En trois ans entre 2012 et début 2015, on n’a pas pris le temps, en France, de mettre en place les moyens de gérer et de coordonner ce genre de situation.
M. le rapporteur. J’ai été étonné de lire, dans les documents que vous nous avez transmis, que les applications Coyote signalent les barrages routiers mis en place par la gendarmerie. Cela pose-t-il une vraie difficulté opérationnelle ? Est-ce fréquent ?
Général d’armée Denis Favier. Le problème avec l’application Coyote, c’est que les automobilistes pensent avertir d’un banal contrôle de vitesse alors qu’ils signalent la présence de gendarmes opérant dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. C’est, en effet, pénalisant. Je ne saurais en estimer la fréquence, mais le phénomène n’est pas factuel, il mérite d’être analysé et pris en compte.
Pour ce qui est de la presse, il me semble nécessaire de conduire une réflexion conjointe avec les forces de sécurité. Alors que je suis en mouvement entre Paris et Dammartin-en-Goële, un journaliste spécialiste des questions de sécurité intérieure m’appelle pour m’annoncer qu’il vient d’avoir Kouachi au téléphone et qu’il va le passer à l’antenne. Je lui demande de ne pas le faire, en raison de la présence d’un otage. Dans la forêt de Retz, la BRI ou le RAID effectuent leurs recherches sous l’œil des caméras. Ce constat n’est pas satisfaisant.
J’appelle de mes vœux la conduite d’une réflexion, une sorte de forum qui réunirait les acteurs de la presse et ceux de la sécurité afin de rappeler les règles et les limites de l’engagement de chacun. Cette démarche doit être initiée rapidement.
À Dammartin-en-Goële, nous sommes parvenus à mettre en place un périmètre large autour de la zone opérationnelle. Très peu d’images sont sorties, et celles qui existent sont lointaines et floues. En plein Paris, en revanche, il semble totalement impossible d’isoler un périmètre quand les journalistes peuvent accéder aux appartements des immeubles voisins.
Il y a également un problème avec les réseaux sociaux. Les tweets sur les évolutions en situation opérationnelle nous mettent franchement en difficulté. C’est là un sujet majeur qu’il faut traiter.
La coordination constitue bien un enjeu clé mais, en la matière, j’ai une appréciation positive des événements du mois de janvier. S’agissant d’une crise de sécurité intérieure de cette nature, une implication politique majeure est nécessaire, et il n’y a que le ministre de l’intérieur qui puisse rassembler dans une même salle tous les directeurs généraux pour leur dire qu’il veut tout savoir et que toutes les informations doivent être échangées. À partir de ce moment, on comprend bien qu’il faut fédérer les énergies, se rassembler et mettre tout à plat. La structure existe : une salle interministérielle permet les échanges. Mais, de mon point de vue, c’est un engagement ministériel extrêmement fort qui fait basculer les choses.
Dans la préparation des opérations, l’implication du politique est essentielle. Il doit être présent pour prendre des décisions, et à nos côtés parce que les ordres se donnent à partir de cartes et de données très précises techniques et tactiques. À nous, ensuite, de traduire en actions l’intention claire du politique.
En plus de la présence de ce dernier, une unité de lieu est nécessaire, où doivent se rassembler tous les patrons impliqués : renseignement, police judiciaire, gendarmerie, police, services de santé. Il faut que les « sachants » échangent, et ils doivent parler au nom de leur autorité ministérielle respective. Nous en avons ressenti encore davantage la nécessité en novembre.
Monsieur Lellouche, l’activation du salon « Fumoir » a démontré toute son utilité au moment du braquage de la station-service Avia : elle permet en effet de ne pas rester cantonné dans un traitement judiciaire et de partir immédiatement sur une phase coordonnée de recherches opérationnelles de grande ampleur. Ainsi, nous reprenons l’initiative et l’ascendant sur les terroristes.
Ce qui distingue les unités spéciales les unes des autres, ce sont les capacités. Le contre-terrorisme, c’est l’action une fois que le fait terroriste s’est produit. Il nécessite des capacités rares détenues par peu d’unités. Aujourd’hui, plus personne ne passe par les portes dans ces groupes ; il faut être capable de passer par les murs, de franchir une dalle par le sol ou le plafond sans provoquer de dommages collatéraux. Dans un mouvement offensif extrêmement rapide, il faut pouvoir « dépiéger », c’est-à-dire détecter les pièges installés par les terroristes et les neutraliser, travailler en milieu vicié avec des appareils respiratoires individuels ou des scaphandres, travailler également en milieu non éclairé avec des appareils de visée nocturne.
Dans le cadre du schéma national d’intervention qui se met sur pied, je propose que ces capacités rares que nous détenons soient mises au service de l’ensemble des forces de sécurité quelle que soit la zone de compétence. C’est dans cet esprit que nous avons apporté notre concours aux forces spéciales belges en janvier 2015 pour neutraliser un redoutable groupe de salafistes. Ils se sont tournés vers nous, car le GIGN est sans doute le seul en Europe à détenir la capacité d’ouvrir une brèche dans des endroits particuliers.
L’idée qui se dessine dans le schéma national d’intervention, c’est de partager les capacités rares afin qu’elles soient mises à disposition de la force qui ne les maîtriserait pas. Ces capacités ne se réduisent pas à un moyen technique, c’est un concept d’emploi porté par des hommes, dont le fonctionnement repose sur le principe de modularité – par exemple, un module de spécialistes des explosifs qui travaille au profit d’une autre force. Je pense que le schéma national d’intervention débouchera rapidement sur ce point. Un échange de capacités sera possible au niveau central ; en province, les échanges se feront entre les groupes spécialisés de gendarmerie et de police, antennes du RAID et du GIGN.
L’inventaire des capacités des uns et des autres doit être dressé mais pas seulement sur un mode déclaratif ; chaque capacité doit être testée. En matière de contre-terrorisme, sur le haut du spectre, la maîtrise des capacités doit être évaluée de manière objective.
M. Pierre Lellouche. Le Yamam israélien travaille avec les forces spéciales des commandos dans un certain nombre d’opérations lourdes. Faut-il commencer à préparer dès aujourd’hui une coopération entre vos forces et les forces spéciales de l’armée ?
Général d’armée Denis Favier. Une coopération forte existe déjà ainsi que des échanges très réguliers, notamment pour ce qui concerne le contre-terrorisme maritime. En 2008, le GIGN est intervenu dans l’affaire du Ponant, menée par les commandos de marine.
Des protocoles existent également s’agissant de l’engagement en dehors du territoire. Le GIGN, unité militaire, capable de s’intégrer en interopérabilité parfaite avec les forces spéciales, est déployé dès lors qu’il y a une prise d’otages à l’étranger. Nous sommes allés au Mali, en novembre dernier, lors de la prise d’otage de l’hôtel Radisson Blu de Bamako. Nous étions en pré-alerte s’agissant du Burkina Faso, il y a quelques semaines.
Sur le territoire national, on pourrait imaginer une telle coopération dans une situation extrême. Je considère toutefois qu’entre les moyens de la police et de la gendarmerie, nous disposons déjà de capacités solides. L’hypothèse peut néanmoins concerner la question du soutien en matière de santé en cas de prise d’otages massive : le service de santé des armées constituerait un outil particulièrement adapté pour apporter des soins d’urgence. Il ne faut fermer la porte à rien, mais, sur le territoire national, il faut commencer par optimiser ce qui existe.
M. le président Georges Fenech. Pourriez-vous maintenant nous dire quelques mots du rôle du GIGN au moment des attentats du 13 novembre ?
Général d’armée Denis Favier. Les choses se sont essentiellement déroulées à Paris, nous étions en conséquence moins directement concernés qu’au mois de janvier. Nous avons toutefois mené une action importante dans la soirée du 13 novembre afin de contrôler les axes extérieurs à la capitale. Notre action sur les flux a d’ailleurs porté ses fruits puisque, le 14 novembre au matin, nous avons contrôlé, à Cambrai, Salah Abdeslam qui s’est présenté sur un dispositif de gendarmerie mis en place au titre de la manœuvre de contrôle des flux.
Le GIGN a été mis en alerte le 13 novembre, à 22 heures 26. Il a été déployé à Paris, à la caserne des Célestins, qui se trouve à proximité de la place de la Bastille.
M. le président Georges Fenech. À quelle heure ?
Général d’armée Denis Favier. Entre 22 heures 40 et 22 heures 45. Le commandant du GIGN est arrivé à 23 heures 15. L’ensemble des unités, composé de quarante-cinq équipiers opérationnels, ce qui constitue un engagement lourd, est présent et prêt à agir à 23 heures 45. À ce stade, la mission qui est assignée au GIGN consiste à armer une réserve d’intervention, car on ne sait pas si d’autres attentats peuvent avoir lieu. Nous sommes donc engagés.
M. le président Georges Fenech. Qui a demandé cet engagement ?
Général d’armée Denis Favier. Comme au mois de janvier, une réunion se tient en salle de crise ministère de l’intérieur. Le directeur du cabinet me dit qu’il faut engager très vite le GIGN.
M. le président Georges Fenech. Les instructions viennent de Beauvau et pas de la préfecture de police de Paris ?
Général d’armée Denis Favier. Dans une affaire comme celle-là, le préfet de police dépêché sur le terrain est difficilement joignable. De nombreuses incertitudes pèsent de surcroît sur la nature et les lieux de commission des actes terroristes perpétrés.
M. le rapporteur. C’est donc le directeur de cabinet du ministre de l’intérieur qui vous demande de mobiliser le GIGN ?
Général d’armée Denis Favier. Oui. Nous sommes ensemble en salle de crise et nous voyons bien que l’affaire est sérieuse. Tous les moyens sont engagés, et nous avons besoin de tout ce qui peut apporter une aide significative à la conduite opérationnelle. L’ordre d’engagement est donné au commandant du GIGN à 22 heures 26. Ce dernier quitte la base de Satory avant vingt-trois heures, il arrive à Paris à 23 heures 15. L’ensemble des quarante-cinq équipiers armés du GIGN est constitué à la caserne des Célestins vers 23 heures 45. Les vidéosurveillances de la ville de Paris peuvent attester de cette chronologie.
M. le président Georges Fenech. Après avoir entendu le RAID et vous-mêmes, nous constatons que les deux forces d’élites d’intervention ne disposaient pas de la maîtrise des opérations, le 13 novembre. Il semble, général, que vous-même avez tenté d’entrer en contact avec le chef de la BRI à 22 heures 15. Vous a-t-il rappelé ?
Général d’armée Denis Favier. C’est le commandant du GIGN qui a tenté de joindre le chef de la BRI.
Colonel Hubert Bonneau. Le soir du 13 novembre, des informations nous remontent rapidement, car nous avons des personnels engagés dans la protection de l’équipe d’Allemagne de football au Stade de France. Puisque les événements ont lieu dans Paris, je tente alors de joindre, le patron de la BAC-BRI.
Je suis mis en alerte à 22 heures 26 et je reçois, de la direction des opérations et de d’emploi de la gendarmerie, l’ordre d’engagement à 22 heures 40. Je suis présent à Paris à 23 heures 10, et une première vague du GIGN arrive à 23 heures 20, puis une seconde à 23 heures 40 – quarante personnels. Dès que je quitte Satory, à 22 heures 40, j’ai le réflexe d’appeler le patron du RAID, pensant que nous sommes, comme au mois de janvier, en configuration FIPN. Jean-Michel Fauvergue m’indique qu’il se rend à Paris, mais n’est pas en mesure de me faire un état de la situation. Je l’informe que je me rends à la caserne des Célestins.
M. le président Georges Fenech. Vous avez essayé de joindre ce dernier, mais en vain, et il ne vous a jamais rappelé ?
Colonel Hubert Bonneau. Non, mais sans doute était-ce dû à la configuration de cette soirée. Le chef de la BRI devait être pris par son travail de compréhension de la situation et de mise en place de ses propres troupes, d’où l’impossibilité de le joindre.
M. le président Georges Fenech. À 0 heure 18, vous prenez connaissance d’un message d’une victime sur FaceBook qui écrit : « Je suis au premier étage au Bataclan. Blessés graves. » Pourquoi ne demandez-vous pas au DGGN l’autorisation d’intervenir en appui de la BRI ? Pourquoi n’intervenez-vous pas alors que vous êtes présents, prêts et équipés ?
Colonel Hubert Bonneau. J’ai reçu l’ordre de me rendre à la caserne des Célestins. Dans une configuration aussi confuse, une discipline collective s’impose. Aussi, j’attends des ordres précis sur mon engagement. Lorsque j’arrive à la caserne des Célestins, je ne dispose d’aucune information.
M. le président Georges Fenech. Cela vous paraît normal ?
Colonel Hubert Bonneau. Je cherche à en avoir !
M. le président Georges Fenech. Donc cela ne vous paraît pas normal !
Colonel Hubert Bonneau. Nous avons l’habitude de gérer des crises ; je sais ce qu’est une situation confuse. Dans de telles circonstances, il est très difficile d’avoir une photographie exacte de la situation. Je ne m’engage pas directement sur le Bataclan parce que je n’ai pas reçu l’ordre de mon chef de le faire : je ne veux pas rajouter à la confusion qui peut exister sur zone.
M. le président Georges Fenech. Vous restez impuissant !
Colonel Hubert Bonneau. Je suis prêt à intervenir ailleurs en cas de besoin. On nous dit, à ce moment, que des tirs peuvent survenir dans d’autres lieux parisiens, notamment aux Halles. J’attends un ordre. D’initiative, je ne me déplace pas au Bataclan, car je n’ai pas d’information sur la situation précise sur place.
Général d’armée Denis Favier. En salle de crise, où je me trouve, nous mesurons la gravité des faits, et nous avons beaucoup de difficultés à avoir une vision claire des choses. La réunion s’est formée autour des attentats du Stade de France, mais à mesure qu’elle se déroule, nous comprenons que les événements se sont déplacés au centre de Paris. Nous avons donc du mal à apprécier nettement ce qui se passe, et passons par une phase d’incertitude, incontournable dans une telle situation.
Dans ce contexte, essayer d’obtenir des autorisations d’engagement qui viendraient de l’autorité en charge des questions d’ordre public dans la capitale est complexe. Le préfet de police est injoignable, de même d’ailleurs que le patron de la BRI ou du RAID : ils sont en opération.
Dans le cadre du schéma national d’intervention, nous travaillons à la construction d’une sorte de fiche réflexe pour gagner en efficacité. Il s’agirait de faire en sorte que le GIGN, qui est stationné aujourd’hui à Satory, près de Versailles, à moins de vingt minutes du centre de Paris, puisse se rendre à la porte Maillot, sans autre ordre qu’un engagement donné par le ministre. Une telle fiche réflexe reste à valider.
Nous avons laissé le GIGN aux Célestins afin qu’il puisse être engagé parce que nous ne savons pas où un autre drame peut se dérouler. D’ailleurs, qu’aurait-il fait au Bataclan ? Aurait-il pu éviter que l’on dénombre 130 morts ?
M. le président Georges Fenech. Plus à ce moment !
Général d’armée Denis Favier. Aurait-il pu aider, grâce à ses compétences en matière de soins de proximité ? Peut-être, du fait que, ayant travaillé pendant des années aux côtés des forces spéciales en Afghanistan, nous avons des gendarmes qui sont équipiers mais peuvent aussi poser un garrot. Quoi qu’il en soit, nous n’étions pas au Bataclan, et nous ne sommes pas à même de mesurer quel aurait été l’impact de notre présence.
En revanche, nous devons tirer les conséquences des événements : dans le cadre du schéma national d’intervention, les unités qui détiennent les capacités doivent pouvoir s’engager très rapidement à partir de leur base pour apporter une aide significative où elle est nécessaire. Nous avons débriefé ces points avec le ministre, les directeurs de la police et le préfet de police. À partir du 23 novembre, durant toutes les fêtes de fin d’année, une équipe du GIGN maîtrisant des capacités rares, notamment en matière d’explosifs, a été installée en permanence dans la caserne des Célestins, pour être en mesure de s’engager en tout point de Paris avec la BRI. Il nous a également été demandé de constituer des équipes souples et mobiles, qui puissent se rendre très rapidement dans la capitale avec des véhicules puissants. Nous sommes aujourd’hui en mesure d’engager ces petites structures.
M. le rapporteur. Le 13 novembre, vous vous trouvez vous-même au centre interministériel de crise à Beauvau. Les événements se déroulant à Paris, l’autorité compétente est le préfet de police ; il engage la BRI mais pas le RAID. Le directeur de cabinet du ministre de l’intérieur vous demande de positionner le GIGN à la caserne des Célestins au cas où d’autres attentats seraient perpétrés. Le fait que nous nous trouvions à Paris, avec plusieurs autorités, le ministre et le préfet de police, représente-t-il une difficulté particulière ?
Vous évoquiez le contrôle de Salah Abdeslam par un dispositif de gendarmerie le 14 novembre, à 9 heures 10. Le bureau SIRENE France, chargé de la gestion opérationnelle de la partie nationale du système d’information Schengen, interrogé, demande alors aux gendarmes uniquement de récupérer des informations parce que Salah Abdeslam fait l’objet d’une fiche S. Ce n’est que deux heures plus tard qu’il rappelle pour demander une interpellation. Quelles informations le bureau SIRENE donne-t-il lors du premier appel ? Salah Abdeslam est-il déjà recherché comme auteur des attentats à ce moment-là ? Travaillez-vous sur l’itinéraire de l’automobile, une fois l’arrestation demandée ?
Général d’armée Denis Favier. Votre première question pose le problème des zones de compétence. La répartition en zones de compétence de police et de gendarmerie a du sens pour 97 % de l’activité. En situation de crise, cette approche me semble décalée par rapport à l’action à mener. Un travail indispensable doit être conduit pour parvenir, sans déposséder quiconque, à amener une capacité donnée dans n’importe quelle zone. Je pense que, dans le courant du mois de mars ou au plus tard en avril, nous aurons bien avancé sur ce dossier. Il s’agit de confirmer le rôle de telle ou telle force menante tout en l’amenant à accepter le concours d’une autre force. Telle est la réponse que nous préparons.
S’agissant de Salah Abdeslam, nous le contrôlons le 14 novembre, à 9 heures 10, au péage de Thun-Lêvèque sur l’autoroute A2. Trois personnes sont à bord d’un véhicule : Salah Abdeslam et deux de ses camarades venus de Belgique pour le récupérer. Les gendarmes de la barrière de péage de Cambrai, que je suis allé rencontrer, disent avoir détecté un comportement anormal et arrêté la voiture pour contrôler ses occupants. Il ressort de la vérification informatique que Salah Abdeslam fait l’objet d’une fiche, non pas S, mais Schengen, une fiche judiciaire qui indique seulement qu’il est connu en Belgique pour avoir été à l’origine d’un trafic de stupéfiants avec les Pays-Bas. La conduite à tenir consiste à rendre compte, à renseigner et à laisser passer. Au regard du comportement suspect des individus et de ce qui s’est produit la veille à Paris, les gendarmes sont intrigués : ils retiennent le véhicule durant trente minutes, soit au-delà du temps réglementaire prévu pour ce type de contrôle. Ils téléphonent au bureau SIRENE France, ce qui n’est pas prévu dans le protocole, pour qu’on leur confirme la conduite à tenir. Après trente minutes, ils sont dans l’obligation de relâcher les trois hommes. Ils sont rappelés non pas deux heures après, mais quarante-cinq minutes plus tard.
M. le rapporteur. Cette durée de deux heures provient des documents que vous nous avez fournis.
Général d’armée Denis Favier. Je vous confirme que nous avons été recontactés par Sirène quarante-cinq minutes après la remise en circulation du véhicule. Pour autant, aucune information relative à l’implication de Salah Abdeslam dans les attentats de la veille n’est fournie aux gendarmes lors de cet échange téléphonique.
M. le rapporteur. La réforme de la procédure pénale, qui prévoit quatre heures de retenue, constitue une réponse adéquate ?
Général d’armée Denis Favier. Certainement.
M. Pierre Lellouche. La fouille du véhicule n’était pas possible ?
Général d’armée Denis Favier. Non.
M. François Lamy. Dans le cadre du commandement des opérations spéciales, différentes unités spécialisées de l’armée, comme le 13e régiment de dragons parachutistes (RDP), le 1er régiment de parachutistes d’infanterie de marine (RPIMA) ou les commandos de l’air, sont sous les ordres du général chef du commandement des opérations spéciales, et il n’y a qu’un seul décideur : le chef d’état-major des armées. De la même façon, tout en conservant leur histoire et leur spécificité, toutes les unités d’intervention ne pourraient-elles pas être placées sous un commandement unique permanent ? N’est-il pas temps de construire, en la matière, un système organique permanent ? En bref, les gendarmes et les policiers peuvent-ils travailler ensemble ?
Général d’armée Denis Favier. Le commandement des opérations spéciales rassemble des unités de nature différente de l’armée de terre, de la marine et de l’armée de l’air. Le 13e RDP est une formation interarmes spécialisée dans la recherche du renseignement ; le 1er RPIMA se consacre plutôt à la protection ; les aviateurs gèrent la protection des bases. Si les capacités des militaires sont rassemblées, les métiers qu’ils exercent sont différents alors que les unités d’intervention GIGN, RAID et BRI exercent le même métier. Le sujet n’est donc pas de la même nature.
À première vue, l’idée de la création d’un commandement unique paraît séduisante ; dans la réalité, les choses sont plus contrastées. Nous avons néanmoins avancé. En 2008, nous avons créé une unité de coordination des forces d’intervention, l’UCOFI, qui vise à coordonner l’action du GIGN et du RAID dans la phase de préparation opérationnelle. Avec la prochaine parution du SNI, cette unité a vocation à étoffer son champ missionnel, je pense notamment au travail relatif aux vérifications capacitaires des forces. Elle n’est en revanche pas destinée à prendre le commandement des opérations.
M. François Lamy. Les difficultés pour mettre en place le commandement unique en conservant les spécificités de chacun ne sont tout de même pas insurmontables.
Général d’armée Denis Favier. Nous pouvons nous en sortir, dans le respect de chacune des deux maisons, en respectant les équilibres et en préservant l’efficacité, si nous affirmons très clairement et consolidons les notions « menant » et « concourant ». Elles existent et elles fonctionnent bien dans les armées : une force mène et d’autres apportent le concours de leurs capacités. On peut construire quelque chose de solide pourvu que l’on pousse au plus loin l’idée d’accepter les capacités des autres : il ne faut pas avoir peur de les requérir. Votre commission d’enquête doit permettre de promouvoir cette notion aujourd’hui essentielle. Il faut évidemment vérifier la nature exacte des capacités déclarées détenues : ce point est pour moi primordial.
M. le président Georges Fenech. Vous n’êtes pas favorable à la « fusion-acquisition » que préconisent certains ?
Général d’armée Denis Favier. Nous n’évoquons actuellement que 3 % du travail des unités en question. Pour les 97 % qui restent, le travail s’effectue dans la zone de compétence avec l’arrestation d’individus recherchés dans le cadre d’enquêtes judiciaires, la neutralisation de forcenés…
Pour le haut du spectre, les choses sont évidemment extrêmement complexes. Prenons l’exemple de l’avion : depuis 1994, on ne passe plus par la porte pour entrer dans un avion, il faut être capable d’y pénétrer autrement. Le GIGN dispose de cette expertise – ce qui signifie qu’il peut aussi pénétrer dans un bateau, un train, un métro, un tramway ou des bâtiments de grande hauteur. S’il y a une situation de prise d’otages à La Défense, il faut être en mesure de prendre pied sur le sommet d’une tour et de descendre étage par étage, en faisant des trous à l’explosif dans les plafonds sans dommages collatéraux. Ce sont ces capacités que la gendarmerie apporte dans le pot commun. Il ne s’agit pas de partager les capacités, mais de les mettre à disposition.
M. Olivier Marleix. Vous avez décrit une excellente coordination des forces le 7 janvier. Les choses paraissent moins claires s’agissant du 13 novembre : une salle de commandement à la préfecture de police aurait pris la décision d’engager le BRI au Bataclan ; la cellule de crise de Beauvau fonctionnait également ; on sait qu’au Stade de France, un PC sécurité a accueilli un moment le Président de la République et le ministre de l’intérieur. Où était le commandement ce soir-là ?
Général d’armée Denis Favier. Nous parlons de crises différentes, à la fois en termes d’espace géographique et en termes de temporalité. La crise du 13 novembre est subite et violente. Elle produit un effet de sidération et se déroule dans un temps bref. La crise du mois de janvier a duré plusieurs jours. Autant nous parvenons à structurer très fortement notre action sur la durée en janvier afin de bâtir une véritable manœuvre avec des recherches opérationnelles, autant, au mois de novembre, il nous faut instantanément construire une manœuvre de circonstance pour reprendre l’ascendant. C’est beaucoup plus difficile. Tout se passe en trois heures, ce qui exige une réaction immédiate. Dans cette cinétique, la planification des opérations est très difficile. Cette réflexion est bien évidemment intégrée dans les travaux en cours relatifs au schéma national d’intervention.
M. Pierre Lellouche. Sauf que les terroristes parviennent à sortir de la ville et à se cacher – c’est invraisemblable ! – dans des fourrés à Aubervilliers. Cette période où les choses traînent en longueur me soucie, car même une équipe de deuxième sinon de troisième division, qui n’a pas prévu son repli, réussit à quitter le pays, et nous ne sommes pas parvenus à trouver les têtes de réseaux. La dernière partie des opérations n’est pas brillante !
Général d’armée Denis Favier. Le retour d’expérience montre très nettement qu’il nous faut bâtir, pour des circonstances similaires, un plan Épervier national afin de tenir les axes et les points de passage obligé. Nous travaillons à l’élaboration de ce plan d’urgence de contrôle des flux dont les premières composantes seront opérationnelles pour l’Euro 2016.
M. Pierre Lellouche. Il est aberrant que l’on puisse sortir de Paris comme cela ! Ce serait impensable à Boston, à Washington, à Tel Aviv ou à Londres ! Il y a la vidéo et de nombreux autres outils.
Général d’armée Denis Favier. Nous devons renforcer notre manœuvre de contrôle des flux d’entrée et de sortie du pays. Le terrorisme vient de Belgique vers Paris : il nous faut tenir les barrières de péage, les gares, les aérogares. J’estime qu’à partir du moment où il n’y a plus vraiment de contrôles des phénomènes migratoires aux frontières nationales, il faut que nous soyons davantage actifs en matière de contrôle des flux.
Dans une logique d’engagement des armées sur le territoire national, on ne peut pas raisonner seulement en termes d’effectifs – ceux de Sentinelle venant renforcer le dispositif Vigipirate. Il faut raisonner en termes de missions nouvelles au regard du contexte. Une mission de contrôle des flux entrants et sortants, menée conjointement entre la police, la gendarmerie et l’armée, aurait vraiment du sens. Elle rassurerait nos concitoyens et elle serait efficace. C’est dans cet esprit que nous conduisons une expérimentation dans le département de l’Isère au cours de la deuxième quinzaine d’avril.
M. le président Georges Fenech. Les familles des victimes et les blessés survivants s’interrogent sur le délai qui s’est écoulé entre les premiers coups de feu au Bataclan, à 21 heures 48, et l’assaut de la BRI à 0 heure 18. Quel est votre sentiment à ce sujet ?
Général d’armée Denis Favier. Il est difficile pour moi de prendre position, car je n’étais pas sur place ; je ne suis donc pas en mesure de porter une appréciation sur ce sujet. L’engagement courageux du commissaire de la BAC a constitué, à mon avis, l’élément déterminant pour mettre un premier coup d’arrêt à la tuerie.
M. Pierre Lellouche. Vous avez suffisamment d’expérience pour savoir que des blessés par kalachnikov qui restent une heure sans être secourus sont condamnés.
M. le rapporteur. Il y a eu des évacuations pendant les opérations.
Général d’armée Denis Favier. Certains blessés ont pu être évacués, mais pas tous. Pour être constructif, les unités qui s’engagent doivent être en mesure de travailler très rapidement en contre-terrorisme mais également en secours au combat. Il faut notamment qu’elles puissent poser des garrots.
M. François Lamy. Le GIGN aurait-il agi de manière différente au Bataclan ? Des précautions ont manifestement été prises avant l’intervention – le ministre nous disait hier que l’on s’était demandé si la salle était minée –, ce qui a fait perdre beaucoup de temps. Le GIGN aurait-il pris les mêmes précautions ou serait-il intervenu d’entrée de jeu ?
Général d’armée Denis Favier. Pendant des années, nous avons travaillé au GIGN sur l’idée qu’une fois sur les lieux, il nous fallait d’abord observer, négocier, prendre un contact. Des générations de personnels ont été formées sur ce modèle, mais, aujourd’hui, nous en changeons. Le schéma d’intervention est de nature totalement différent : nous devons désormais être capables d’engager le feu très vite et puissamment. C’est sur ce modèle que nous travaillons.
M. le président Georges Fenech. S’il y avait un nouveau Bataclan, ferait-on la même chose ?
Général d’armée Denis Favier. Depuis le 14 novembre, nous avons constitué des équipes capables d’apporter une aide significative en tout point de Paris. On engagerait des équipes au fur et à mesure de la montée en puissance de l’alerte. Les gendarmes sont logés, par nécessité absolue de service, à proximité de la caserne de Satory. Ils sont donc prêts à faire mouvement, équipés, armés et briefés, dans des délais très rapides. Vingt minutes plus tard, ils peuvent se trouver sur n’importe quel site parisien. Ces équipes sont aujourd’hui très mobiles : elles se déplacent en structure légère avec un seul véhicule. Elles disposent de l’armement nécessaire, et elles sont composées d’individus maîtrisant les capacités rares que j’évoquais.
M. le président Georges Fenech. Elles entrent dans n’importe quel lieu sans procéder à une sécurisation préalable ? Vous appliquez un protocole différent.
Colonel Hubert Bonneau. Je ne sais pas si nous aurions fait mieux que la BAC-BRI, nous n’étions pas sur place. Il est difficile pour un opérationnel qui n’était pas engagé de poser un diagnostic. Ce que je peux dire, c’est que, aujourd’hui, le GIGN s’engage sur des modes d’opération dits plans d’assaut immédiat. Nous quittons notre base au maximum trente minutes après l’alerte en force constituée du GIGN, avec cinq équipes autonomes de cinq. L’alerte du GIGN, c’est donc vingt-cinq hommes capables de s’engager au complet en moins de trente minutes au départ de Satory.
Les cinq équipes autonomes maîtrisent des capacités rares en termes de contre-terrorisme. D’abord, elles arrivent en véhicules blindés et équipées de protections robustes. Ces trois dernières années, nous avons totalement revu les équipements pour assurer la protection balistique des hommes. Ensuite, les équipes disposent d’une puissance de feu qui leur donne la capacité d’entrer partout, de s’affranchir de tout obstacle, notamment grâce à la maîtrise des explosifs, pour créer de la fulgurance.
Ces capacités sont autonomisées autour d’une équipe à cinq qui peut être projetée partout dans Paris. Si le besoin s’en fait sentir, un dispositif à cinq équipes peut être éclaté puis complété immédiatement par une deuxième alerte à moins de deux heures.
M. le président Georges Fenech. La commission d’enquête serait intéressée de voir la démonstration de ce que vous décrivez.
Vous êtes les seuls à pouvoir agir ainsi. Si un nouveau Bataclan se produisait demain, vous laisserait-on à nouveau dans une caserne ou vous donnerait-on l’ordre de prendre la direction des opérations ? Laissera-t-on la BRI traiter un nouveau Bataclan ou fera-t-on appel à des unités d’élite comme la vôtre ?
Général d’armée Denis Favier. Ce serait mon rôle, en tant que directeur général, de faire valoir, en cellule de crise, nos capacités, qui sont connues de l’autorité ministérielle, et d’expliquer la plus-value que le GIGN pourrait apporter. Au regard des enseignements que nous tirons tous des événements du mois de novembre, cette posture s’avère nécessaire. Nous en avons beaucoup parlé avec le ministre. Il nous a demandé de nous mettre en place dans Paris durant les fêtes de fin d’année parce qu’il avait bien compris la nécessité de faire appel à nos capacités.
C’est dans cet esprit qu’est conçu le schéma national d’intervention qui sera très prochainement présenté par le ministre de l’Intérieur.
M. Georges Fenech. Ces dernières paroles nous rassurent. Messieurs, nous vous remercions pour l’ensemble de vos propos.
Audition, à huis clos, de M. Philippe Chadrys, sous-directeur chargé de l'antiterrorisme à la direction centrale de la police judiciaire (DCPJ), de M. Franck Douchy, directeur régional de la police judiciaire de Versailles, et de M. Frédéric Doidy, chef de l'Office central de lutte contre le crime organisé (OCLCO) et chef des brigades de recherche et d'intervention nationales (BRI)
Compte rendu de l’audition, à huis clos, du mercredi 9 mars 2016
M. le président Georges Fenech. Nous vous remercions, messieurs, d’avoir répondu à la demande d’audition de notre commission, dont les travaux consistent à enquêter sur les moyens mis en œuvre par l’État pour lutter contre le terrorisme depuis le 7 janvier 2015. Avec le ministre de l’intérieur, que nous avons entendu lundi, puis les responsables du RAID et de la Gendarmerie, que vous venons d’auditionner, nous avons commencé d’aborder les questions relatives à la conduite des opérations, à l’intervention des forces de l’ordre et aux moyens qui sont mis à leur disposition. Nous poursuivons nos travaux avec vous, qui dirigez les services de police sollicités lors des attentats de janvier et de novembre 2015.
Vous dirigez, monsieur Chadrys, le service dédié aux saisines du Parquet et des magistrats instructeurs en matière de terrorisme. Votre service, monsieur Douchy, a directement participé aux constatations et aux enquêtes conduites lors des deux séries d’attentats en complément de la direction régionale de la police judiciaire de Paris et de la SDAT, en particulier à la traque des frères Kouachi. Enfin, monsieur Doidy, vous avez piloté l’action de la BRI nationale et de différentes BRI territoriales suite aux deux séries d’attentats, notamment – là encore – lors de la traque des frères Kouachi.
Compte tenu de la confidentialité des informations que vous êtes susceptibles de nous fournir, cette audition se déroule à huis clos et n’est donc pas diffusée sur le site internet de l’Assemblée nationale. Néanmoins, conformément à l’article 6 de l’ordonnance du 14 novembre 1958, son compte rendu pourra être publié en tout ou partie si nous en décidons ainsi à l’issue de nos travaux. Je précise que le compte rendu de l’audition vous sera préalablement transmis afin de recueillir vos observations, lesquelles seront soumises à la Commission qui pourra décider d’en faire état dans son rapport. Je rappelle que, conformément aux dispositions du même article, sera punie des peines prévues à l’article 226-13 du code pénale – un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende – toute personne qui, dans un délai de vingt-cinq ans, divulguera ou publiera une information relative aux travaux non publics d’une commission d’enquête, sauf si le rapport publié à la fin des travaux de la commission fait état de l’information en question.
Conformément aux dispositions de l’article 6 de l’ordonnance précitée, je vous demande de jurer de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, en levant la main droite.
MM. Philippe Chadrys, Franck Douchy et Frédéric Doidy prêtent successivement serment.
M. le président Georges Fenech. Je vous donne maintenant la parole pour nous exposer votre rôle à l’occasion des attentats de janvier, puis nous reviendrons sur ceux de novembre.
M. Philippe Chadrys, sous-directeur, sous-direction antiterroriste (SDAT). La sous-direction antiterroriste, que je dirige, est un service à compétence nationale et constitue l’une des cinq sous-directions de la direction centrale de la police judiciaire (DCPJ), chargée d’enquêter sur les affaires de terrorisme. Compte tenu de l’affaiblissement des organisations de terroristes séparatistes basques et corses, il va de soi que, depuis quelques années, notamment depuis l’affaire Merah en 2012, nous nous sommes réorganisés de manière à adopter une configuration nous permettant de lutter contre le terrorisme d’inspiration djihadiste. Au 1er janvier 2015, l’effectif de la SDAT comptait 121 personnes, dont 97 agents actifs ; deux plans de renfort porteront son effectif théorique à plus de 220 agents d’ici la fin de l’année civile, et à 240 en 2017. Autrement dit, nos moyens, renforcés dès 2015, ont connu une nette montée en puissance.
En dehors des enquêtes qu’elle diligente seule ou en co-saisine avec d’autres services comme la direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) et la section antiterroriste (SAT) de la préfecture de police de Paris, la SDAT s’appuie également sur le maillage territorial de la DCPJ via les directions régionales de la police judiciaire (DRPJ) et les services régionaux de police judiciaire (SRPJ), de sorte qu’elle bénéficie de relais sur tout le territoire national pour traiter les affaires dont elle est saisie, qu’il s’agisse d’affaires qu’elle traite sous l’égide de magistrats antiterroristes ou d’affaires dites périphériques – qui ne sont pas forcément de nature terroriste, mais qui nous donnent en amont un aperçu de ce qui est fait sur l’ensemble du territoire avant une éventuelle saisine de la section antiterroriste du parquet de Paris. Au quotidien comme en cas de crise, nous nous appuyons également sur les autres sous-directions de la police judiciaire : la sous-direction de la police technique et scientifique, bien entendu, mais aussi la sous-direction de la lutte contre la criminalité organisée et la délinquance financière – en particulier l’Office central pour la répression de la grande délinquance financière (OCRGDF) pour tout ce qui concerne le financement du terrorisme et l’OCLCO et les BRI nationales – ainsi que sur la sous-direction de la lutte contre la cybercriminalité, nouvellement créée.
La SDAT est saisie d’un certain nombre d’affaires de terrorisme d’inspiration djihadiste de plus en plus importantes. Outre les enquêtes qu’elle diligente au quotidien, elle est impliquée en cas d’attentat majeur, 2015 ayant hélas été une année noire pour nous puisque nous avons dû traverser deux crises importantes, en janvier et en novembre.
Surtout, la SDAT est chargée de déployer le dispositif « Attentat » à l’échelle nationale. Créé en 2005 après les attentats de Londres et Madrid, ce dispositif est destiné à faire face à un événement majeur ou à des attentats commis sur plusieurs sites, comme ce fut le cas en janvier puis en novembre. Il a évolué depuis sa création et a été peaufiné chaque année, au fil d’exercices réguliers. Il a été déployé pour la première fois en conditions réelles lors des attentats de janvier 2015. Il permet de coordonner et de piloter l’ensemble des forces de la DCPJ qui sont impliquées lors d’un attentat majeur. Il se décline à plusieurs niveaux : au niveau central, un poste de commandement (PC) national de crise est mis en place dans les locaux de la SDAT et comprend plusieurs pôles visant à restructurer les effectifs pour faire face à la crise. Le pôle « Enquêtes » se charge de toutes les investigations relatives à l’attentat commis. Le pôle « Renseignement » est chargé de recueillir l’intégralité des renseignements qui parviennent aux services de police. Enfin, un pôle « Relations internationales » est créé car, comme l’ont montré les attentats de novembre, cette dimension prend une importance croissante.
Ce PC de crise national se décline dans chaque service territorial de la police judiciaire, puisque les sous-directions de la DCPJ ainsi que ses directions interrégionales et régionales se dotent de PC similaires comprenant les mêmes pôles – hormis le pôle « Relations internationales », qui relève du seul échelon central.
Enfin, des PC sont créés sur les scènes de crime pour gérer les constatations, les témoignages et les enquêtes de voisinage.
Le dispositif « Attentat » s’appuie principalement sur deux outils dédiés : une ligne verte, tout d’abord, permet de recueillir les innombrables appels parvenant aux centres de crise. Entre janvier et novembre, un numéro court – le 197 – a été adopté et diffusé par voie de presse ; il a permis de recevoir de nombreux appels. D’autre part, lorsque le dispositif « Attentat » est activé, nous armons une salle de crise dans les locaux de la sous-direction de lutte contre la criminalité organisée et la délinquance financière, à Nanterre, ainsi qu’une salle de crise à la préfecture de police de Paris en cas d’attentat commis à Paris, comme ce fut le cas en janvier et en novembre. Des opérateurs sont chargés vingt-quatre heures sur vingt-quatre de réceptionner les appels, qui sont basculés vers le PC de crise de la SDAT afin d’être traité par un outil appelé AMCA, c’est-à-dire « application main courante attentat », qui permet de traiter l’information et de la ventiler dans l’ensemble des services de police judiciaire saisis. Ainsi, lorsque des informations nécessitent des investigations en tous points du territoire, des agents de la SDAT sont spécialement chargés de les analyser, puis remplissent une fiche et la transmettent au service concerné pour qu’elle soit traitée. C’est un mécanisme important, car le volume d’appels est considérable. Pour information, entre le 7 et le 16 janvier 2015, la ligne verte a reçu 5 911 appels, qui ont donné lieu à la création de 1 600 fiches – et à autant de vérifications. Les attentats du 13 novembre 2015, quant à eux, ont suscité 17 497 appels et 8 000 fiches ont été constituées, les services centraux et territoriaux devant conduire les vérifications correspondantes.
Les investigations commencent dès l’activation du dispositif « Attentat ». Lors des attentats de janvier 2015, trois services ont été saisis : la sous-direction antiterroriste de la DCPJ, la préfecture de police de Paris et la DGSI. La direction de l’enquête a été confiée à la préfecture de police par le procureur de Paris. Précisons qu’en cas d’attentat majeur la saisine de la DCPJ est demandée – et naturellement obtenue – afin que l’ensemble de ses services territoriaux, qu’ils se trouvent à Lille, Bordeaux ou Marseille, puissent agir dans ce cadre. En janvier, les trois services saisis se sont donc répartis les investigations à diligenter : la préfecture de police de Paris a effectué les constatations sur la scène de crime dans les locaux de Charlie Hebdo, ainsi que tous les actes découlant de la commission d’un attentat – exploitation des vidéos et recueil de témoignages. La SDAT a été plus spécialement chargée des investigations relatives aux frères Kouachi, dont la fuite a très vite débordé les limites de la région parisienne. Il a fallu agir dans les départements de l’Oise et de l’Aisne, la SDAT s’appuyant pour ce faire sur les services régionaux, en particulier la direction interrégionale de police judiciaire (DIPJ) de Lille. Lorsque les frères Kouachi ont été identifiés, l’enquête sur leurs proches a été répartie entre la préfecture de police et la DCPJ, laquelle a conduit les investigations et perquisitions à Reims et à Charleville-Mézières : très vite, huit interpellations ont eu lieu, et autant de perquisitions. Les constatations effectuées à la station-service de Villers-Cotterêts, qui avait été attaquée par les frères Kouachi, ont été traitées de la même manière, ainsi que celles qui ont été faites dans l’Oise, à l’endroit où ils ont abandonné leur véhicule et en ont braqué un autre avant de se réfugier dans l’imprimerie de Dammartin-en-Goële. Lorsque les frères Kouachi ont été neutralisés, les constatations ont été faites par la police judiciaire de Versailles avec l’appui de la sous-direction de la police technique et scientifique. En revanche, c’est la préfecture de police de Paris qui s’est chargée des constatations faisant suite à l’assaut donné au magasin Hypercacher. La DGSI, enfin, a été chargée du volet concernant les relations internationales et du récolement des informations, et a également traité le départ d’Hayat Boumeddiene via l’Espagne.
Les frères Kouachi et Amedy Coulibaly étaient connus des services antiterroristes, notamment de la SDAT, puisque Chérif Kouachi et Coulibaly avaient été interpellés en 2010 dans le cadre d’un projet d’évasion de Smaïn Aït Ali Belkacem. Nous avons également été chargés de dresser les procès-verbaux d’environnement de chacun de ces individus. Au cours de la période de flagrance, quatre cents témoins ont été entendus par les différents services intervenants, 81 écoutes téléphoniques ont été mises en place et 31 personnes placées en garde à vue.
En clair, nous avons traité une énorme quantité d’appels et de renseignements, la ligne verte nous ayant permis – comme lors des attentats du 13 novembre – de localiser l’appartement conspiratif, en l’occurrence celui d’Amedy Coulibaly à Gentilly. Au terme de la période de flagrant délit, 3 500 procès-verbaux ont été rédigés – soit un volume considérable – et plus de 2 000 scellés ont été constitués ; cela représente une masse de travail phénoménale. Cette période de flagrance s’est achevée par le démantèlement de la cellule de soutien logistique à Coulibaly et des arrestations dans l’Essonne, avec l’appui du RAID ainsi que de la BRI nationale et des autres BRI impliquées sur le terrain dans la gestion de ces objectifs. Tel est le tableau rapide de l’organisation mise en place pour faire face à ces attentats majeurs.
M. Frédéric Doidy, chef de l’Office central de lutte contre le crime organisé (OCLCO) et des brigades de recherche et d’intervention (BRI) nationales. L’OCLCO a pour mission de lutter contre les formes d’actions criminelles les plus violentes qui sont commises au préjudice des personnes et des biens, de réprimer certains trafics qui concourent au développement du crime organisé, notamment les trafics d’armes et de véhicules volés, et de rechercher et arrêter certains malfaiteurs en fuite ou évadés. Pour ce faire, l’OCLCO et, le cas échéant, d’autres services centraux ou territoriaux de la DCPJ s’appuient sur un dispositif unique en France : les brigades de recherche et d’intervention de la DCPJ, qui constituent autant d’antennes de l’Office.
Les BRI agissent le plus souvent de leur propre initiative dans le cadre des missions prioritaires de la DCPJ, en particulier la lutte contre toutes les formes de criminalité organisée. Ces compétences leur permettent de faire preuve d’une grande efficacité lors des surveillances, des filatures et des interpellations, sur la voie publique ou en milieu clos, de malfaiteurs présentant une certaine dangerosité. Ce dispositif national se compose de 331 fonctionnaires de police recrutés au terme d’épreuves de sélection drastiques portant sur leurs aptitudes physiques, psychologiques et professionnelles – le taux de réussite à ces épreuves de sélection, organisées une à deux fois par an, ne dépasse pas 30 %. Les policiers des BRI suivent un entraînement soutenu et adapté aux situations les plus délicates, après avoir accompli un stage d’intégration d’une durée de deux semaines qui vaut socle commun de formation à toutes les techniques d’interpellation sur la voie publique, de filature et de maniement des armes.
Placées sous un commandement unique, les BRI peuvent être mobilisées très rapidement en cas d’événement majeur comme une tuerie de masse ou une prise d’otages multiple. Aujourd’hui, treize brigades de recherche et d’intervention sont réparties sur l’ensemble du territoire national : à Lille, Strasbourg, Lyon, Nice, Marseille, Montpellier, Toulouse, Nantes, Rouen, Versailles, Orléans, ainsi qu’à Bordeaux et Ajaccio, ces deux dernières BRI disposant respectivement d’une antenne à Bayonne et à Bastia.
Ces BRI sont placées pour emploi auprès des directeurs régionaux ou interrégionaux de la police judiciaire et sous l’autorité fonctionnelle du chef de l’OCLCO. À Nanterre, le chef de la brigade de recherche et d’intervention nationale, qui est placée sous mon autorité directe, est chargé de diriger l’action des différentes BRI lors du déploiement de dispositifs opérationnels d’envergure comme en cas d’opérations de type go fast ou d’attaques de centres-forts. Ce maillage territorial propre à la DCPJ date de la création, dès 1976, de la première BRI à Lyon, cette structure ayant été depuis reproduite sur l’ensemble du territoire. Les BRI sont composées d’effectifs et dotées de matériels qui leur permettent de lutter au quotidien contre toutes les formes de délinquance organisée, en particulier le trafic de stupéfiants, les extorsions de fonds, les vols à main armée, les séquestrations ou encore les enlèvements avec demande de rançon. Elles procèdent chaque année à l’interpellation de plusieurs centaines d’individus, que ce soit de leur propre initiative ou en soutien des services centraux ou territoriaux de la police judiciaire. En 2015, 688 malfaiteurs ont été interpellés par les différentes BRI de la DCPJ, dont 51 étaient impliqués à divers titres dans des affaires d’association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste – qu’il s’agisse de terrorisme séparatiste basque ou corse ou de terrorisme international en lien, notamment, avec l’islam radical.
Les BRI font désormais partie intégrante du dispositif national de lutte contre le terrorisme et possèdent une compétence avérée et reconnue de longue date en la matière, en particulier grâce à la participation des BRI de Bayonne et de Toulouse à la lutte contre l’ETA, et de celles d’Ajaccio, de Bastia, de Nice et de Marseille à la lutte contre les groupes nationalistes corses. En 2014, un dialogue engagé en collaboration étroite avec le RAID a abouti à la création du protocole FELIN, qui permet de mobiliser les BRI en cas d’attentat ou de prise d’otages multiple dans le cadre d’une bulle tactique d’intervention associant le RAID, les brigades de recherche et d’intervention de la DCPJ et la direction centrale des CRS. Les BRI sont alors chargées de la sécurisation rapprochée du site d’intervention du RAID, de l’exfiltration des suspects après leur neutralisation par le RAID, de l’évacuation des blessés et de la mise en sécurité des otages et des victimes ; les CRS se chargent de l’étanchéité extérieure de l’ensemble du dispositif. Les compétences des uns et des autres sont clairement définies et réparties en trois zones concentriques attribuées aux trois services impliqués. C’est dans le cadre de ce protocole que, lors des attentats de janvier et de novembre 2015, plusieurs unités placées sous mon autorité, j’étais alors chef de la BRI nationale, ont été intégrées aux nombreux dispositifs de surveillance et d’interpellation en soutien de la SDAT et du RAID. Ce fut le cas le 9 janvier 2015, lors de la neutralisation d’Amedy Coulibaly à la Porte de Vincennes, à Paris, le 16 janvier lors de l’arrestation de son complice à Fleury-Mérogis, ou encore le 18 novembre à Saint-Denis.
J’en viens aux circonstances précises de l’intervention des BRI de la DCPJ suite aux attentats contre Charlie Hebdo. Le jour même de l’attentat, alors que les premières pistes étaient révélées concernant les frères Kouachi et que des opérations devaient être envisagées à Reims, les différentes BRI de la DCPJ mobilisées – en particulier la BRI nationale, composée d’une trentaine d’agents basés à Nanterre, et la BRI de Versailles, la plus proche du lieu de l’attentat, composée d’un nombre équivalent d’agents – ont été mises en alerte dès midi. Le RAID ayant eu pour mission de se transporter vers Reims et Charleville-Mézières, le directeur central de la police judiciaire (DCPJ) a activé le protocole FELIN en attribuant clairement aux différentes BRI la mission d’agir en soutien des opérations d’interpellation que le RAID aurait à conduire concernant les frères Kouachi ou au domicile de certains de leurs proches dans les deux villes précitées. Pour ce faire, j’ai très vite décidé de solliciter l’appui complémentaire des BRI de Lille et de Strasbourg, les plus proches du lieu d’opération. Le soir même, pas moins d’une centaine d’enquêteurs de ces BRI ont été mobilisés en appui à Reims pour veiller à l’étanchéité du dispositif et récupérer les victimes le cas échéant, voire les malfaiteurs en cas d’interpellation – ce qui ne fut pas le cas.
Suite à ces opérations conduites le soir même de l’attentat contre Charlie Hebdo, plusieurs groupes opérationnels des différentes BRI mobilisées ont été laissés sur place à Reims et Charleville-Mézières, car certains membres de l’entourage des frères Kouachi, ciblés mais absents de leur domicile, n’avaient pas été interpellés. Les groupes restés sur place pouvaient ainsi apporter leur soutien aux autres opérations du RAID qui auraient éventuellement à être planifiées en urgence, en exerçant les mêmes missions d’étanchéisation du dispositif et, le cas échéant, de récupération des victimes ou des blessés. Je rappelle que la mission première des BRI de la DCPJ est une mission de filature et de surveillance en tenue civile de malfaiteurs aguerris qu’il faut souvent interpeller sur la voie publique. En janvier, néanmoins, alors que des opérations étaient encore en cours à Reims et à Charleville-Mézières, une réserve de fonctionnaires de BRI a été laissée sur place en appui à la SDAT pour surveiller les domiciles susceptibles d’être utilisés ou fréquentés par des membres de la famille Kouachi, voire par les fugitifs eux-mêmes.
La SDAT a alors identifié à Villers-Cotterêts une autre piste qui méritait d’être exploitée. Dès le lendemain, des agents de la BRI nationale qui n’avaient pas été déployés à Reims et Charleville-Mézières ont commencé à assurer la surveillance permanente de différentes adresses dans la commune de Villers-Cotterêts, avec l’appui d’agents des BRI de Versailles et de Lille. Les BRI de la DCPJ n’avaient pas participé aux opérations de ratissage conduites par le RAID, la BRI de la préfecture de police et le GIGN dans le secteur de Villers-Cotterêts ; elles n’accomplissaient que des missions très discrètes de surveillance, de filature et d’observation en civil afin d’interpeller les fuyards et d’éviter un surattentat ou la commission d’autres actes criminels. La présence des frères Kouachi était peu à peu ciblée à Dammartin, puis la prise d’otages fut avérée dans l’imprimerie ; j’ai donc modifié le dispositif relevant de ma compétence en demandant à l’intégralité des fonctionnaires de BRI déployés à Villers-Cotterêts d’abandonner leurs postes de surveillance pour gagner Dammartin, et j’ai pris la direction des effectifs de la BRI nationale et de la BRI de Versailles pour me mettre sur place à la disposition du chef du RAID dans le cadre du protocole FELIN déclenché par le DCPJ, alors que le GIGN exerçait le contrôle des opérations à ce stade de la crise.
En début d’après-midi, nous avons été avisés de la prise d’otages qui s’était produite dans le magasin Hypercacher de la Porte de Vincennes. En accord avec ma direction, j’ai alors décidé de maintenir une partie du dispositif à Dammartin-en-Goële en appui aux unités du RAID présentes sur place – et dans l’éventualité de l’assaut qu’elles auraient pu avoir à donner elles-mêmes ou lors duquel elles auraient eu à soutenir le GIGN. J’ai ensuite rassemblée environ 25 fonctionnaires de police et nous nous sommes transportés rapidement vers la Porte de Vincennes, où nous avons dressé un PC à proximité immédiate du magasin. Il va de soi que, dans ce type d’opérations, les enquêteurs de la BRI sont équipés d’une protection balistique maximale et d’un armement ad hoc tout en conservant la souplesse nécessaire pour pouvoir se projeter rapidement. Je me suis alors placé à la disposition du chef du RAID. Les missions de chacun étaient clairement définies en vue de l’assaut qui serait donné sur le magasin dans les heures suivantes. Lors de l’assaut, nous nous sommes placés en soutien des colonnes du RAID. La mission qui nous avait été confiée – et que nous avons exécutée – consistait à récupérer les otages et à veiller dans la mesure du possible à ce qu’aucun terroriste ou complice ne se soit dissimulé parmi eux. Une fois l’assaut terminé et les premiers otages libérés, nous les avons récupérés puis accompagnés, en sécurité et sous protection balistique majeure, à une centaine de mètres de l’établissement, au poste médical avancé, ou un premier tri devait être effectué entre ceux qui, blessés, devaient être conduits en urgence dans le secteur hospitalier, et ceux qui, choqués, devaient être examinés sur place par les médecins et services de secours tels que le SAMU et la Croix-Rouge. Nous avions également pour mission de récupérer certains fonctionnaires de police du RAID blessés lors de l’assaut et, toujours sous protection balistique, de les mener au poste médical avancé.
C’est là que s’est arrêtée ma mission concernant la prise d’otages au magasin Hypercacher. Dès le lundi 12 janvier, néanmoins, la SDAT a confié aux BRI une mission concernant le soutien logistique apporté à Coulibaly dans l’Essonne, notamment à Fleury-Mérogis. Ce jour-là, outre les unités mobilisées les jours précédents – la BRI nationale et la BRI de Versailles – avaient été mises sous alerte les BRI les plus proches, c’est-à-dire celles de Rouen et d’Orléans ; nous avons été chargés d’effectuer vingt-quatre heures sur vingt-quatre la surveillance de tout ou partie des soutiens logistiques de Coulibaly jusqu’à leur interpellation par le RAID dans la nuit du jeudi 15 au vendredi 16 janvier. À cette occasion et toujours dans le cadre du dispositif FELIN, nous avons conduit les colonnes d’assaut du RAID au plus près du lieu d’interpellation et nous sommes mis à disposition pour récupérer d’éventuels blessés et otages et assurer la sécurité arrière des opérations du RAID.
Telles furent les missions confiées aux différentes BRI de la DCPJ et la chronologie des opérations qu’elles ont conduites lors des attentats de janvier. Une centaine d’agents ont été mobilisés du 7 au 16 janvier, dès le début des événements et sur plusieurs sites : à Reims, à Charleville-Mézières, à Villers-Cotterêts, à Dammartin-en-Goële puis à la Porte de Vincennes et, enfin, dans l’Essonne.
M. Franck Douchy, directeur régional de la police judiciaire de Versailles. La direction régionale que je dirige participe du maillage territorial de la DCPJ. Comme mes homologues basés à Marseille, Lyon, Bordeaux, Rennes, Lille, Strasbourg ou Dijon, je suis chargé d’un territoire particulier – même si cette notion peut sembler paradoxale face à une criminalité organisée dont les auteurs sont des malfaiteurs qui se déplacent sur l’ensemble du territoire national. Il nous est en effet nécessaire de sectoriser notre action. Dans le secteur placé sous mon autorité, je dirige un service comprenant environ 420 personnes, qui sont à la fois des enquêteurs traditionnels mais aussi des spécialistes financiers ou criminels capables de réaliser des opérations de constatation très précises sur des scènes particulières. Je dirige également une BRI dans le cadre du dispositif que vous a présenté M. Doidy. En clair, ma direction est autonome et en mesure de traiter tous types d’affaires.
Pour chacun des champs thématiques dans lesquels nous intervenons, nous dépendons naturellement de nos responsables nationaux représentés dans les offices ou, en matière de terrorisme, de la SDAT. Autrement dit, nous représentons dans chacun de ces domaines une antenne de la direction centrale. Pour information, j’occupais moi-même les fonctions de M. Doidy à la DCPJ avant d’aller à Versailles. De fait, nous nous connaissons tous, travaillons ensemble depuis de nombreuses années et, surtout, dépendons du même chef. C’est important car, en matière de terrorisme plus encore qu’ailleurs, les logiques d’action sont nationales, voire transnationales, et la complexité de l’organisation policière – qu’illustre l’abondance des acronymes que nous utilisons – s’oppose à l’extrême mobilité des malfaiteurs que nous devons neutraliser. C’est ainsi, toutefois, et nous devons nous y adapter ; c’est d’autant plus aisé lorsque les responsables en poste se connaissent bien.
Nous avons été très rapidement alertés des attentats du mois de janvier, même s’ils se sont pour l’essentiel déroulés à Paris. D’un point de vue strictement judiciaire, nous n’avons donc pas été sollicités immédiatement ni au cours des deux premiers jours. En revanche, la DCPJ a d’emblée sensibilisé ses effectifs, en particulier ceux de la DRPJ de Versailles, assez particulière puisqu’elle est compétente dans les quatre départements de la grande couronne francilienne – Val-d’Oise, Yvelines, Essonne et Seine-et-Marne. Autrement dit, elle a été plus que les autres directions territoriales concernée par les deux séquences d’attentats sur lesquelles votre commission enquête. Cependant, au milieu de ce dispositif se trouve la préfecture de police de Paris. Sur cette plaque francilienne, qui constitue une sorte de continuum criminel, se superposent donc deux directions territoriales qui n’ont ni le même directeur général – sauf à remonter jusqu’au ministre de l’intérieur – ni les mêmes modes de fonctionnement. Il faut là aussi articuler ces différents services entre eux. Quant à moi, je place le cas échéant les effectifs de la BRI de Versailles à la disposition de la SDAT afin que son chef puisse en coordonner l’utilisation avec les autres effectifs de BRI qu’il juge utile de mobiliser.
Les frères Kouachi et Coulibaly ont été rapidement identifiés et ont pris la fuite. Les zones du Grand Est parisien, jusqu’à Reims, ont été désignées comme possibles zones d’accueil ; tout un ensemble de forces y a donc été déployé. Ajoutons à la complexité du dispositif le fait que certaines de ces zones sont du ressort géographique et juridique de la gendarmerie, ce qui explique la participation de gendarmes dans la conduite des enquêtes. En réalité, la piste ouverte à Reims et à Charleville-Mézières n’a donné lieu à aucune interpellation et, à mesure que les malfaiteurs étaient ciblés avec plus de précision, le dispositif a été réorienté vers la région parisienne, plus précisément en Seine-et-Marne – laquelle relève de ma juridiction. La présence des frères Kouachi fut confirmée à Dammartin-en-Goële, qui se trouve au nord du département. Il va de soi que les chefs des différentes DRPJ avaient été avisés du développement de l’enquête par le système d’information de la direction centrale – dans ce type d’affaires, en effet, il est essentiel de disposer de forces à la fois réactives et proactives qui soient capables d’anticiper la mise en place de dispositifs de surveillance et de filature, mais aussi des axes d’enquête. Dès le début de l’affaire, l’application main courante attentat (AMCA) fut déclenchée afin d’exploiter tous les éléments transmis par les citoyens concernés de près ou de loin via la ligne téléphonique dédiée en vue des auditions, déplacements et vérifications à effectuer dans le cadre de l’investigation. Or, ces éléments relèvent aussi des services territoriaux en fonction du lieu de domiciliation des victimes et témoins.
J’ai donc été alerté par ma direction, dès le matin du vendredi 9 janvier, du déplacement de l’affaire vers la Seine-et-Marne, et j’ai immédiatement anticipé en me rendant dans la zone. Outre son siège à Versailles, notre DRPJ dispose de quatre antennes couvrant l’anneau territorial sur laquelle elle est compétente, à Cergy-Pontoise, Meaux, Melun et Évry. Tôt le matin, j’ai naturellement alerté le chef de l’antenne de Meaux en lui demandant de rassembler tous ses effectifs dans les meilleurs délais, et de se rendre sur-le-champ à Dammartin-en-Goële. Il était important de repérer les lieux dans cette zone très particulière où la route nationale 2 relie Villers-Cotterêts à la région parisienne – une zone industrielle où les opérations de surveillance ne sont pas toujours aisées – et, surtout, de préparer l’accueil de la force de projection du siège, que j’organisais au même moment. C’est en effet au siège que se trouve la brigade criminelle, dont les enquêteurs spécialisés auraient à intervenir en cas d’assaut. Les effectifs locaux se sont donc très rapidement déplacés pour étudier le terrain et trouver une zone permettant de nous accueillir, cependant que les effectifs du siège étaient en route avec la brigade criminelle et le soutien de la police technique et scientifique pour répondre au plus vite aux exigences d’un assaut et de l’enquête subséquente, ainsi qu’à tout autre acte éventuel. Lorsque nous sommes arrivés sur place, en effet, un contact s’était déjà produit entre les malfaiteurs et des forces locales de gendarmerie ; le Parquet nous a immédiatement désignés comme investigateurs pour traiter ces premiers éléments, entendre les militaires impliqués, comprendre ce qui s’était passé et mettre la procédure en musique – tous ces actes aboutissant en effet en cour d’assises où la précision est indispensable.
Les autorités décisionnelles se sont regroupées à Dammartin-en-Goële, dans des locaux municipaux, où je me trouvais en présence du général Favier, du procureur de Paris et de plusieurs de ses substituts, et du directeur de la préfecture de police de Paris. Les instructions pouvaient ainsi être données en parfaite synergie, et j’ai pu au fil de la journée cerner davantage les liens réels qui existaient entre les frères Kouachi et Coulibaly, dont nous n’avions pas a priori compris qu’ils agissaient de manière coordonnée. Nous avons assisté à l’arrivée du GIGN puis du RAID en appui : un assaut se préparait sur place.
Avant même l’assaut dans l’imprimerie, une nouvelle scène de prise d’otages est survenue. Une partie des agents présents à Dammartin ont donc rejoint Paris, les autres demeurant sur place. Il est toujours difficile d’anticiper un « sur-attentat » ou un nouvel acte, et nous avons notamment beaucoup appris en matière de déplacement des effectifs, ce qui nous a permis d’être plus rapides lors des attentats de novembre.
Le GIGN a donné l’assaut dans les locaux de l’imprimerie lorsque les malfaiteurs en sont sortis ; ils ont été rapidement neutralisés. Entre temps, les effectifs de la police technique et scientifique, basés à Lyon, nous avaient rejoints ; notre force d’appoint technique était donc largement suffisante pour effectuer les constatations à l’intérieur et à l’extérieur des locaux de l’imprimerie et pour traiter les corps des deux malfaiteurs. Ces constatations longues et minutieuses nous ont occupés presque toute la nuit, après quoi nous avons rédigé les procès-verbaux. C’est en fin de soirée le dimanche que nous avons remis les résultats complets, propres et définitifs de nos travaux à l’autorité judiciaire. Près de quatre-vingts enquêteurs y ont participé, notamment l’ensemble de la brigade criminelle – soit une trentaine d’enquêteurs. Dans ces enquêtes extrêmement sensibles et complexes, chacun veut s’assurer de n’omettre aucun détail, de ne commettre aucune erreur qui pourrait être fatale à l’enquête. Nous effectuons donc un travail supplémentaire par rapport aux enquêtes du quotidien, ce qui nécessite non seulement d’y consacrer plus de temps, mais de prendre davantage de décisions.
Le dimanche soir à peine passé, commençait dès le lundi la poursuite des complices des trois malfaiteurs neutralisés dans l’Essonne – qui relève de la DRPJ de Versailles – et plus précisément à Fleury-Mérogis, zone ardue que l’on connaît pour son établissement pénitentiaire, mais à proximité de laquelle se trouve également une cité difficile, la Grande-Borne, à Grigny. J’ai naturellement mis la BRI de Versailles à la disposition des effectifs de la SDAT et de la BRI nationale déployés sur place, ce qui était d’autant plus opportun que nous avions précisément été saisis un an auparavant d’une affaire de malfaiteurs dans ce même périmètre. Connaissant bien les lieux, nous avons pu ouvrir la voie et préparer l’accueil de nos collègues de la direction centrale en leur expliquant le contexte. Les opérations de surveillance ont duré plusieurs jours, jusqu’à l’interpellation et l’arrestation de l’ensemble des malfaiteurs suspectés d’avoir apporté leur concours aux actes terroristes de la semaine précédente.
M. Philippe Chadrys. En complément, je précise que les attentats de janvier ont, pendant la période de flagrance, mobilisé environ 550 agents de la DCPJ, des services de police territoriaux, des BRI, de la sous-direction de la police technique et scientifique et, bien entendu, de la SDAT.
M. le président Georges Fenech. Les BRI de Versailles et de Lille ainsi que la BRI nationale ont effectué des opérations de surveillance à Villers-Cotterêts dès la nuit du 7 au 8 janvier. Comment expliquer que les frères Kouachi, qui ont commis un vol à main armée dans cette commune le 8 janvier à 9 heures 20, aient pu échapper vingt-quatre heures supplémentaires à votre surveillance ?
M. Philippe Chadrys. Lorsque les frères Kouachi ont pris la fuite, nous les avons identifiés assez rapidement puisque l’un d’entre eux a laissé sa pièce d’identité dans un véhicule. Nous connaissions l’immatriculation de leur véhicule et, dès leur identification, les dispositifs de surveillance ont été mis en place aux points de chute potentiels, les premiers étant les domiciles de leurs proches à Charleville-Mézières, à Reims et en région parisienne, où des interventions ont eu lieu pour vérifier qu’ils ne s’y étaient pas réfugiés. Les caractéristiques du véhicule ont immédiatement été diffusées sur les ondes radio de tous les véhicules de police et de gendarmerie du pays. Les informations relatives aux frères Kouachi ont fait l’objet d’une diffusion nationale urgente, dite « Sarbacane ». Cela étant, il était extrêmement difficile de les retrouver : les frères Kouachi ont dormi dehors et n’ont pas rejoint l’un des points de chute potentiels que nous pouvions leur connaître. D’autre part, ils ont changé de véhicule après avoir braqué un automobiliste. Autrement dit, ils n’avaient pas selon moi de point de repli préétabli et ont avancé au gré de leur fuite ; peut-être pensaient-ils être neutralisés avant d’atteindre le nord de Paris et, en l’occurrence, Dammartin-en-Goële. Cependant, les données relatives au véhicule et aux individus ont circulé, y compris leurs photographies, qui ont également été diffusées dans la presse.
Dans ce type de situations, comme l’ont de nouveau montré les attentats du 13 novembre, la difficulté tient au volume des renseignements qui nous sont transmis. Chaque information parvenant via la ligne verte est exploitée et vérifiée et, le cas échéant, d’éventuels points de chute sont placés sous surveillance. Hélas, les frères Kouachi ont pu quitter Paris, mais, heureusement, sans faire d’autres victimes dans leur fuite.
M. le président Georges Fenech. Dans quel délai la BRI de Versailles et la BRI nationale ont-elles été informées de l’attentat commis à Charlie Hebdo et de la traque des frères Kouachi ?
M. Frédéric Doidy. Immédiatement, par notre direction et par les médias.
M. le président Georges Fenech. Par les médias ?
M. Frédéric Doidy. La DCPJ a été avisée immédiatement et, comme toute direction centrale hiérarchisée, a informé sur-le-champ ses sous-directions.
M. Philippe Chadrys. Lorsque l’attentat de Charlie Hebdo est survenu, j’ai été avisé sans délai et je me suis rendu sur place immédiatement. Sachant qu’il s’agissait vraisemblablement d’un attentat majeur, la machine s’est tout de suite mise en marche. Lorsque le dispositif « Attentat » est sur le point d’être déclenché, consigne est donnée à tous les effectifs de la DCPJ – y compris dans tous les services territoriaux, et pas seulement parisiens – de rejoindre leurs bases toutes affaires cessantes et d’y attendre les instructions, la direction centrale se chargeant ensuite de répercuter les informations. Celles-ci nous sont donc parvenues très vite : je suis arrivé sur le site de l’attentat à Charlie Hebdo vers midi et le procureur de la République, qui s’y trouvait également, nous a confirmé la saisine de la DCPJ aux côtés de la préfecture de police de Paris. J’en ai immédiatement référé à ma direction, l’information étant répercutée sur-le-champ dans les différents services de police judiciaire. Lorsque le dispositif « Attentat » a été déclenché à 14 heures 35 sur décision du ministre de l’intérieur ou du DGPN, les services étaient donc déjà avisés. S’y ajoute le fait que les informations circulent parfois plus vite encore dans les médias et sur les réseaux sociaux que via les téléphones de notre direction ; quoi qu’il en soit, nous avons été prévenus en temps réel, car il allait de soi que nous faisions face à un attentat majeur.
M. le président Georges Fenech. Avez-vous été en contact avec la BRI de Paris afin de vous tenir informés de leur action au sein de la force d’intervention de la police nationale (FIPN), mise en place dès le 8 janvier ?
M. Frédéric Doidy. La BRI de la préfecture de police ne fait pas partie du dispositif des BRI de la DCPJ. Cette dichotomie se retrouve également entre les unités d’intervention de la préfecture de police de Paris et celles de la DCPJ, qui n’ont pas les mêmes missions. La préfecture de police possède ses propres directions – police judiciaire, renseignement, ordre public, circulation, etc. – et la DCPJ, quant à elle, possède ses propres BRI. Certains domaines de notre action, comme la lutte contre le crime organisé sous toutes ses formes, se rejoignent, notamment les missions de surveillance, de filature, d’interpellation des malfaiteurs en flagrant délit, avant qu’ils commettent une infraction grave ou peu après ; à la différence de la préfecture de police, néanmoins, la DCPJ n’est pas compétente en matière d’action anti-commando et en cas de retranchement à domicile d’un forcené ou de menace de suicide, par exemple.
M. le président Georges Fenech. Vous faut-il alors activer le protocole FELIN ?
M. Frédéric Doidy. En matière de terrorisme, dans le cadre d’interventions en lieux clos, nous n’intervenons que lors de prises d’otages massives ou multiples à caractère terroriste. De ce point de vue, notre mission n’est pas identique à celles de la BRI de la préfecture de police et du RAID. Par ailleurs, ces unités sont chargées d’intervenir en cas de retranchement de personnes à leur domicile ou de prises d’otages. Notre cœur de métier consiste en opérations de surveillance, de filature et d’interpellation dynamique sur la voie publique, pour l’essentiel en civil.
M. le président Georges Fenech. La BRI de Paris a donc une formation complémentaire particulière que ne suivent pas vos services.
M. Frédéric Doidy. Tout à fait. Cette mission d’intervention relève de la BRI de Paris, la première à avoir été créée en France. Ses effectifs suivent une formation particulière et possèdent certains matériels dont nous ne disposons pas. Comme le RAID et le GIGN, ils maîtrisent par exemple les techniques de pénétration en lieu clos par utilisation d’explosifs, techniques que nous n’utilisons pas puisque les BRI n’effectuent des interpellations en milieu clos – en tenue avec casques et boucliers, contrairement à celles qui ont lieu sur la voie publique – que s’il s’agit de malfaiteurs – braqueurs, assassins, trafiquants de stupéfiants – poursuivis dans le cadre d’opérations de police judiciaire. La BRI nationale et celle de Versailles ne sont pas sollicitées en région parisienne – pas plus que les autres BRI ailleurs en France – pour participer à des opérations concernant des individus retranchés à domicile qui menaceraient de provoquer une explosion au gaz, par exemple. Cette mission d’ordre public est exclusivement confiée aux forces d’intervention que sont le RAID, le GIGN et la BRI de la préfecture de police.
Cela étant, dès la fin 2013 et en 2014, le protocole FELIN nous a permis d’intégrer pleinement les affaires de terrorisme à notre action. En cas d’attentats terroristes, nous disposons tout de même de 330 agents qui, par leur recrutement, leur sélection, leur armement et leur professionnalisme reconnu, peuvent participer à telle ou telle opération en appui du RAID – lequel relève de la direction générale de la police nationale, comme les BRI de la DCPJ.
M. le président Georges Fenech. Envisagez-vous une évolution semblable à celle que le RAID a suivie depuis l’époque des groupes d’intervention de la police nationale (GIPN) ?
M. Frédéric Doidy. De même que le RAID dispose d’antennes en province, l’OCLCO dispose des antennes que sont les BRI, créées en 2006 par décret. Son siège se trouve à Nanterre, où sont basées trois brigades opérationnelles : la brigade nationale de répression du banditisme et des trafics, qui est chargée de conduire des enquêtes d’un certain niveau concernant des malfaiteurs d’envergure impliqués dans des attaques à main armée de centres-forts ou dans des affaires d’extorsion de fonds ; la brigade nationale de recherche des fugitifs, qui est chargée, à la demande des autorités judiciaires françaises, de la traque et de la recherche des malfaiteurs en fuite impliqués dans les événements les plus graves et qui fait aussi office de point de contact des autorités étrangères demandant une arrestation provisoire ; et enfin la brigade de recherche et d’intervention, qui est le bras armé de l’OCLCO. En province, aux treize BRI existantes vont s’en ajouter deux nouvelles, toujours dans le même but : accroître notre réactivité – par exemple face au phénomène des go fast, les BRI étant les seules unités à pouvoir suivre ces convois composés d’un véhicule d’ouverture chargé de vérifier qu’il n’y a aucune présence policière aux péages et d’un véhicule transportant plusieurs centaines de kilogrammes de résine de cannabis. En effet, elles sont en mesure de mailler le territoire pour poursuivre des objectifs liés au crime organisé dès Perpignan par exemple, après le passage de la frontière espagnole, et d’exercer une surveillance policière jusqu’à Strasbourg ou à Lille au cas où, en l’absence de flagrant délit, leur interpellation ne serait pas décidée.
Développé dès 1976, ce maillage a évolué depuis : compte tenu de l’évolution de la délinquance, nous tâchons de dupliquer le dispositif de telle sorte que toutes les directions régionales ou interrégionales de la police judiciaire disposent, comme celle de Versailles, d’unités de type BRI dont la mission première consiste à effectuer des opérations de surveillance, de filature, d’interpellation sur la voie publique ainsi qu’un travail d’initiative concernant des malfaiteurs que nous essayons d’interpeller au plus près de l’action, en réunissant un maximum de preuves en vue de les présenter à la justice.
À mesure que la menace terroriste s’est faite plus grave, nous nous sommes rapprochés du RAID dès la fin de 2013 et en 2014 – bien avant les attentats de janvier, donc – pour élaborer avec lui des stratégies conjointes, non seulement en matière terroriste mais aussi en cas d’actes commis par des criminels de droit commun qu’il serait nécessaire d’interpeller à leur domicile au moyen de techniques que le RAID est seul à maîtriser, en particulier l’utilisation d’explosifs pour pénétrer dans un lieu clos. Une telle affaire s’est justement produite à la fin de décembre 2013 dans la banlieue de Strasbourg, où une équipe de malfaiteurs belges avait fomenté le projet d’attaquer des centres-forts en France et sans doute en Allemagne : nous avions convenu avec le RAID qu’il s’occuperait des opérations d’interpellation en lieu clos, les plus dangereuses car les malfaiteurs détenaient probablement des kalachnikovs et autres armes de guerre, des explosifs et des véhicules puissants, et que les BRI se chargeraient le cas échéant des interpellations sur la voie publique et de veiller à la progression du RAID.
C’est ce même protocole qui s’est naturellement déployé lors des attentats contre Charlie Hebdo : à Reims, nous avons assuré dès le soir même la sécurité des opérations du RAID puis, surtout, nous avons exécuté la mission préalablement convenue de récupérer les otages retenus au magasin Hypercacher et de les mettre en sécurité.
M. le président Georges Fenech. Le ministre de l’intérieur a récemment annoncé la livraison de nouveaux équipements – fusils G36 et autres armes lourdes – aux brigades anti-criminalité (BAC) et aux pelotons de surveillance et d’intervention de la gendarmerie (PSIG). Êtes-vous concernés ?
M. Frédéric Doidy. Nous en disposons déjà. Dans le cadre du plan de renforcement antiterroriste décidé par le ministre de l’intérieur, la DCPJ a renforcé ses moyens humains et matériels avant même les attentats. Nous utilisons donc les G36 et la nouvelle protection balistique lors de nos opérations quotidiennes. Nous allons recevoir des armements sans doute plus sophistiqués et des protections balistiques différentes et plus aisées à utiliser – rappelons en effet que les agents des BRI travaillent sur la voie publique ou dans leur véhicule, qui fait office de bureau et où doit se trouver tout équipement leur permettant d’intervenir au plus vite en cas d’événement majeur tel qu’une tuerie de masse ou une prise d’otages, sachant qu’ils doivent utiliser un armement et une protection balistique susceptibles d’y mettre un terme tout en protégeant leur vie, faute de quoi leur mission ne pourrait être accomplie.
Autrement dit, nous avons intégré la problématique terroriste dès avant les attentats de janvier – et plus encore après – en étoffant notre dispositif territorial. Dans le cadre du schéma national décidé par le ministre de l’intérieur, deux nouvelles BRI seront créées, l’une à Metz et l’autre à Dijon, afin d’être au plus près du terrain pour remplir nos missions quotidiennes de police judiciaire, mais aussi pour être très réactifs en cas d’acte terroriste. À ce stade, les attentats se sont déroulés à Paris, mais d’autres pourraient survenir demain à Toulouse, Marseille ou Limoges. Encore une fois, notre objectif est donc de mailler le territoire.
M. le président Georges Fenech. Venons-en aux événements du mois de novembre.
M. Philippe Chadrys. Lors des attentats du vendredi 13 novembre, nous avons là aussi été avisés très vite par notre direction de la commission des premiers faits, vers 21 heures 20. Dans un premier temps, tous les fonctionnaires de la SDAT ont été rappelés, puisqu’il a immédiatement été question d’un acte terroriste. Les informations nous sont ensuite arrivées peu à peu, à mesure que les fonctionnaires se rassemblaient ; la direction centrale, cependant, avisait l’ensemble des services centraux et territoriaux de son ressort.
À 23 heures, j’ai reçu un appel de la section antiterroriste du parquet de Paris m’avisant de sa saisine et de celle de la DGSI, de la préfecture de police de Paris et de la DCPJ, la coordination des opérations étant cette fois confiée à la SDAT et non plus à la préfecture de police. C’est important, car nous nous sommes très vite rendu compte que les attentats se sont produits sur plusieurs sites – lors de notre saisine, nous ne savions pas encore précisément combien, certains sites nous étant désignés alors qu’il s’agissait en fait de lieux où les services de secours avaient rassemblé les blessés. Pendant quelques heures, il a régné une certaine confusion quant au nombre de scènes de crime et au fait qu’une prise d’otages était encore en cours – en réalité, elle a duré bien au-delà de 23 heures.
Nos effectifs ont été très rapidement placés « en configuration ». Dans une attaque terroriste de cette ampleur sans précédent, la coordination qui nous a été confiée consistait à orienter et diriger les investigations conduites par l’ensemble des services saisis, à répartir les missions qui leur incombent, à assurer la remontée rapide d’informations consolidées à l’autorité hiérarchique et à l’autorité judiciaire, à ventiler ces informations aux services co-saisis et aux enquêteurs et, enfin, à centraliser les actes établis par l’ensemble des services impliqués et à établir un plan de procédure. Ce qui peut sembler simple est très compliqué, car notre objectif visait à transmettre une procédure unique à l’autorité judiciaire. Au terme de l’enquête de flagrance, il nous fallut recueillir l’ensemble des procès-verbaux dressés à Paris et en province – jusqu’en Corse – suite à l’exploitation de certains renseignements, et les transmettre à l’autorité judiciaire selon un plan de procédure précis.
Lorsque s’est achevée l’enquête de flagrance, le 24 novembre, nous avions transmis 5 338 procès-verbaux – un nombre considérable.
M. le président Georges Fenech. La période de flagrance a donc duré douze jours ?
M. Philippe Chadrys. Oui, jusqu’au défèrement du « propriétaire » de l’appartement de Saint-Denis. À ces procès-verbaux s’ajoutaient les 4 000 scellés qui ont été constitués et que le service coordonnateur a dû hiérarchiser afin de prioriser les investigations techniques à effectuer, en distinguant les investigations les plus urgentes de celles qui pouvaient être différées. En outre, il fallait gérer l’« atelier victimes » : très vite, nous avons pris conscience qu’il y avait plus d’une centaine de morts. Le bilan final est le suivant : 130 morts et près de mille personnes touchées, dont 653 ont été hospitalisées dans les différents établissements parisiens. Aucun service de police n’avait eu à gérer pareille situation jusqu’alors.
Très rapidement, la DCPJ et la préfecture de police ont convenu de se répartir les six scènes de crime, étant entendu que nous ignorions encore si d’autres actes allaient être commis à Paris, en région parisienne voire en province, ce qui nous obligeait à conserver certaines unités d’intervention et de police judiciaire en réserve en cas de nouvelle attaque. Il a donc été décidé que la préfecture de police traiterait quatre scènes de crime, les deux autres étant confiées à la DCPJ. C’est ainsi que le site de La Belle Équipe, rue de Charonne, a été traité par la police judiciaire de Versailles, ainsi que celui du Comptoir Voltaire où, heureusement, personne n’est décédé hormis le terroriste.
M. le président Georges Fenech. Par quelle autorité cette répartition a-t-elle été décidée ?
M. Philippe Chadrys. Cette décision était le résultat d’une discussion entre chefs de service. Rappelons que nous nous connaissons tous, notamment parmi les services de lutte antiterroriste, la SDAT travaillant régulièrement avec la préfecture de police ; à cela s’ajoute l’expérience des attentats de janvier. Concrètement, j’ai convenu avec Philippe Bugeaud, directeur adjoint de la DRPJ de Paris, qu’il était opportun de nous répartir les scènes de crime, ce que le directeur central a naturellement validé. En tant que chef du service coordonnateur, je l’ai proposé au Parquet, à qui le dispositif a parfaitement convenu. L’objectif était en effet de mobiliser des spécialistes de la scène de crime, car il va de soi que de telles scènes, d’une ampleur inconnue jusqu’alors, ne pouvaient pas être confiées à des services ne possédant pas l’expérience adéquate. C’est donc la brigade criminelle de la DRPJ de Versailles qui a traité la scène de crime de la rue de Charonne, celle du Comptoir Voltaire étant confiée à la DRPJ de Lille – qui, étant l’une des plus proches de la région parisienne, avait été mobilisée sans délai, de même que la police technique et scientifique basée à Écully. L’ensemble de ce dispositif s’est mis en place de manière extrêmement souple et rapide.
Dès le 14 novembre, un premier terroriste, Omar Mostefai, a été identifié sur le site du Bataclan. Les constatations se sont poursuivies et l’enquête d’environnement a été entamée afin de détecter d’éventuels complices – en effet, nous ignorions à ce stade si d’autres terroristes étaient en fuite ou s’ils avaient tous été neutralisés, ce qui n’était pas le cas.
M. Sébastien Pietrasanta, rapporteur. Le samedi 14 novembre à 9 heures 10, Salah Abdeslam a fait l’objet d’un contrôle routier par la gendarmerie, laquelle a été appelée entre cinquante minutes et deux heures plus tard par le bureau SIRENE lui demandant d’appréhender le suspect ; dans l’intervalle, elle l’avait naturellement relâché au terme de la demi-heure de contrôle autorisée. À quel moment précis Salah Abdeslam a-t-il été identifié comme l’un des terroristes présumés ?
M. Philippe Chadrys. Je ne saurais vous le dire.
M. Sébastien Pietrasanta, rapporteur. Dans la matinée du samedi 14, vraisemblablement ?
M. Philippe Chadrys. Le premier terroriste identifié a été Mostefai. Les autres l’ont été au fil des investigations, au moyen de méthodes différentes, en particulier des prélèvements d’ADN et des recherches d’empreintes.
M. Sébastien Pietrasanta, rapporteur. Salah Abdeslam aurait donc été identifié entre le moment où il a été arrêté pour un contrôle routier et celui où le bureau SIRENE a appelé la gendarmerie afin qu’il soit appréhendé ?
M. Philippe Chadrys. Il a été identifié le 14 novembre à 15h30 à partir de la fouille du véhicule Polo découvert devant le Bataclan (contrat de location à son nom mis à jour).
M. le président Georges Fenech. À quelle heure son profil a-t-il été diffusé ?
M. Philippe Chadrys. Après son identification (au FPR).
M. Sébastien Pietrasanta, rapporteur. Pouvez-vous nous confirmer que l’appartement conspiratif de Saint-Denis a bien été identifié grâce à un appel téléphonique reçu sur la ligne verte ?
M. Philippe Chadrys. Oui. Les 17 897 appels reçus ont donné lieu à la rédaction de 8 000 fiches, lesquelles ont produit trois informations déterminantes pour la poursuite des investigations : la première a permis d’identifier un appartement conspiratif à Bobigny, la deuxième nous a mis sur la piste d’Abdelhamid Abaaoud et nous a permis d’identifier l’appartement conspiratif de la rue du Corbillon à Saint-Denis, et la troisième nous a permis de repérer trois des terroristes dans une station-service en Belgique.
M. le président Georges Fenech. Ces informations provenaient-elles du Maroc ?
M. Philippe Chadrys. Le renseignement nous ayant permis d’identifier l’appartement conspiratif de Saint-Denis nous est parvenu via la ligne verte.
M. Sébastien Pietrasanta, rapporteur. Provenait-il de l’amie de la cousine d’Abaaoud ?
M. Philippe Chadrys. Oui. Précisons que, lorsqu’il a été recueilli, ce témoignage nous est parvenu parmi des milliers d’autres.
M. Sébastien Pietrasanta, rapporteur. Comment avez-vous effectué le tri ?
M. Philippe Chadrys. Toute la difficulté a précisément consisté à hiérarchiser les appels en fonction de leur degré de priorité. C’est pourquoi le dispositif « Attentat » est centralisé : seul le service coordonnateur a connaissance de l’ensemble des investigations et est en mesure de les prioriser. Lorsqu’un appel est reçu via la ligne verte, il donne lieu à la rédaction d’une fiche qui est analysée par le pôle « Renseignement » de la SDAT, lequel se compose d’une équipe d’enquêteurs dirigée par un commissaire de police. La difficulté de notre tâche tient précisément à l’analyse et à la hiérarchisation des informations qui nous parviennent, puis au suivi de leur traitement par les services que nous désignons à ces fins. Le témoignage en question a donc été recueilli entre des milliers d’autres. Je rappelle que conformément à la répartition des tâches dont nous avions convenu, la préfecture de police était chargée des scènes de crime et la SDAT des individus impliqués et de leur entourage.
M. Sébastien Pietrasanta, rapporteur. Je peine à comprendre comment, dans ces moments, votre travail s’articulait avec les informations qu’était susceptible de détenir la DGSI et qui pouvaient lui permettre d’établir des ramifications. Comment vous êtes-vous coordonnés ?
M. le président Georges Fenech. Rappelons que ces services sont co-saisis de l’affaire.
M. Philippe Chadrys. Dans ce type d’affaire, les services procèdent à l’échange de fonctionnaires au sein des postes de commandement. Ainsi, certains fonctionnaires de la SDAT ont été dépêchés au PC de la préfecture de police et certains fonctionnaires de la DGSI – dont nous partageons par ailleurs les locaux à Levallois-Perret – ont intégré notre PC. Pour mémoire, nous travaillons avec la DGSI au quotidien et, en l’occurrence, nous étions conjointement saisis de l’affaire. Il va donc de soi qu’en cas d’attentat, la DGSI ne revendique pas le pilotage des investigations puisque l’attentat ayant été commis, les faits relevaient d’un travail de police judiciaire. Cela étant, elle a naturellement activé son service judiciaire et son service de renseignement ; de même, les services étrangers ont été mobilisés.
Les investigations se sont vite orientées vers la Belgique et nous avons constitué une équipe commune d’enquête avec les collègues de ce pays. Les informations qui nous sont parvenues ont été partagées entre les services saisis puis analysées afin de déterminer qui aurait à les exploiter. Le vendredi 13 novembre, par exemple, nous avons traité les informations relatives à l’environnement de Mostefai, la DGSI a traité celui de Samy Amimour. C’est ainsi que nous nous sommes réparti le travail.
M. Sébastien Pietrasanta, rapporteur. Cette répartition des tâches avec la DGSI se passe-t-elle bien ?
M. Philippe Chadrys. De mieux en mieux. Encore une fois, nous partageons les mêmes locaux et sommes co-saisis de la plupart des affaires ; nous nous côtoyons au quotidien.
M. Sébastien Pietrasanta, rapporteur. Il n’y a donc aucune rétention d’information de la part de la DGSI ?
M. Philippe Chadrys. Par définition, je ne saurais vous le dire ; quoi qu’il en soit, les informations de nature judiciaire sont partagées. En matière de renseignement, il faudra interroger mes collègues de la DGSI, car c’est à eux qu’il appartient de décider s’il convient de partager les informations qu’ils détiennent.
M. le président Georges Fenech. Vous n’appartenez pas à la communauté du renseignement.
M. Philippe Chadrys. En effet, mais la DGSI nous communique un certain nombre de renseignements qui pourraient être utiles à la conduite des enquêtes que je diligente. Ce partage se fait de manière assez souple, même si je ne peux évidemment pas affirmer que la DGSI me fournit l’intégralité des renseignements dont elle dispose, notamment ceux qui proviennent de ses partenaires à l’étranger. En cas d’attentat, cependant, le partage d’informations d’ordre judiciaire est total, et j’ai également reçu des informations provenant de services extérieurs.
M. Sébastien Pietrasanta, rapporteur. Le concours d’Europol a-t-il été déterminant pour l’identification et le suivi de certains migrants passés par la Grèce ?
M. Philippe Chadrys. Une équipe mobile d’Europol a été sollicitée dès le lendemain des attentats et s’est présentée dans nos locaux de Levallois-Perret afin que nous l’intégrions au dispositif. Nous avons très vite compris que l’enquête dépasserait largement le cadre du territoire national, à la différence de celle qui a suivi les attentats de janvier. Nos collègues belges ont immédiatement ouvert une enquête et une équipe commune d’enquête a été constituée dès le 15 ou le 16 novembre.
L’équipe de quatre fonctionnaires d’Europol qui s’est déplacée dans nos locaux devait pour l’essentiel traiter certains éléments liés à l’analyse criminelle. Les investigations concernant les migrants, en revanche, ont été conduites dans le cadre des relations bilatérales et des échanges de renseignements auxquels nous procédons avec certains pays, en particulier la Grèce. Les renseignements ainsi obtenus nous ont permis d’établir que deux des individus qui se sont fait exploser au Stade de France étaient entrés dans l’Union européenne par l’île de Leros dans un groupe de 199 migrants, sur lesquels nous continuons d’enquêter.
M. Sébastien Pietrasanta, rapporteur. L’agence Europol a-t-elle joué un rôle particulier ?
M. Philippe Chadrys. Elle a pris connaissance des éléments que nous avons mis à sa disposition, avec l’accord du parquet de Paris, afin de les analyser, comme dans d’autres investigations. Cependant, les enquêtes se sont essentiellement déroulées dans le cadre de relations bilatérales avec la Belgique en premier lieu, mais aussi la Grèce, l’Allemagne, l’Autriche et les États-Unis, qui nous ont fourni un certain nombre de renseignements.
M. le président Georges Fenech. La BRI de Paris, qui était compétente sur le site du Bataclan, aurait-elle pu demander le renfort d’une BRI proche comme celle de Versailles ?
M. Frédéric Doidy. Dès que nous avons été avisés des événements du vendredi 13 novembre, toutes les BRI de France ont été mises en alerte. La BRI nationale et la BRI de Versailles ont été rappelées et se sont équipées de manière à être prêtes à répondre à n’importe quelle sollicitation. Cependant, nous n’avons pas été sollicités pour intervenir au Bataclan.
M. le président Georges Fenech. Pourquoi ?
M. Frédéric Doidy. Je ne saurais vous répondre.
M. le président Georges Fenech. On nous dit que seuls sept des quarante fonctionnaires de la BRI de Paris étaient présents sur place. Était-il possible de faire appel à vous en renfort ?
M. Sébastien Pietrasanta, rapporteur. Une telle demande s’est-elle déjà produite ?
M. Frédéric Doidy. Non, jamais pour un événement de ce type. Nous travaillons très rarement de concert avec la BRI de Paris ; de mémoire, nous l’avons fait à l’occasion de certaines affaires de délinquance organisée ou de droit commun. Lors des attentats, nous n’avons pas été sollicités, même si rien ne l’empêchait. Le chef de la BRI de Paris pourra vous donner davantage d’informations sur les effectifs présents et les délais d’intervention.
M. le président Georges Fenech. Vous étiez donc disponibles et prêts à intervenir, mais personne n’a fait appel à vous.
M. Frédéric Doidy. Ce type de mission ne relève pas du tout de notre cœur de métier. Des fonctionnaires de police de mon service présents sur place pour d’autres raisons auraient pu agir en qualité de primo-intervenants, car c’est la mission normale de tout policier, qu’il soit membre d’une BAC ou de Police-secours, par exemple, confronté à un événement de cette nature, de tenter de le faire cesser. Ainsi, nous aurions naturellement agi si nous avions été présents sur place. En revanche, une telle intervention ne relève pas du cœur de métier de notre unité en tant que telle. Nous aurions éventuellement pu être sollicités dans le cadre du protocole FELIN aux côtés du RAID, mais de nombreuses forces se trouvaient déjà sur place. Dès la commission des faits, nous avons activé un plan de rappel, mais vous comprendrez qu’il faut du temps pour rassembler et équiper les fonctionnaires à Nanterre.
M. Jean-Luc Laurent. Combien de temps ?
M. Frédéric Doidy. Notre délai de rappel et de départ en intervention est d’au moins une heure, sachant que nos agents habitent dans toute la grande région francilienne.
M. Jean-Luc Laurent. Combien de temps la préparation des agents dure-t-elle ?
M. Frédéric Doidy. Une heure environ, entre le moment où ils sont rappelés – compte tenu du fait que la circulation était assez fluide à cette heure de la soirée – et celui où ils sont prêts à partir en mission.
M. le président Georges Fenech. Si vous aviez été sollicités, vous vous seriez déployés en soutien du RAID ; or, c’est l’inverse qui s’est produit, puisque le RAID est arrivé en soutien de la BRI de Paris.
M. Frédéric Doidy. En effet, mais tout dépend de la proximité des différentes forces par rapport aux sites d’intervention – le Bataclan étant au cœur de Paris, la BRI de Paris en était plus proche que le RAID, basé à Bièvres. Là encore, il appartiendra aux forces de police impliquées de vous donner davantage d’informations.
M. le président Georges Fenech. Êtes-vous saisis d’une commission rogatoire par le juge d’instruction afin que l’enquête se poursuive ?
M. Philippe Chadrys. Absolument.
M. le président Georges Fenech. L’enquête a dû vous conduire à vous rendre au Bataclan ; la visite du site serait-elle pertinente dans le cadre de nos travaux ?
M. Philippe Chadrys. Des fonctionnaires de la SDAT se sont naturellement rendus sur toutes les scènes de crime avec un commissaire de police, même si je ne m’y suis pas rendu personnellement car j’ai eu la responsabilité d’un important travail de coordination des tâches attribuées à plusieurs milliers d’agents. Le rôle du coordonnateur, en effet, est de rendre compte non seulement à l’autorité administrative, mais aussi à l’autorité judiciaire et de lui présenter des informations consolidées. Cela paraît simple mais, en réalité, c’est extrêmement difficile dans le cas d’une crise majeure comme celle de novembre.
M. le président Georges Fenech. La SDAT agit-elle toujours dans le cadre d’une co-saisine par le juge d’instruction ?
M. Philippe Chadrys. Six juges d’instruction ont été désignés, et la coordination de l’enquête a été confiée à la SDAT dans le cadre d’une commission rogatoire. La DGSI et la DRPJ Paris sont également co-saisies.
M. Franck Douchy. De même, les services territoriaux demeurent impliqués dans le traitement de certains aspects de l’enquête concernant des mineurs, par exemple, car les investigations ne se limitent hélas pas à la seule enquête de flagrance.
M. Olivier Marleix. Le dispositif « Attentat » a été remanié en 2005 ; quelle forme prend-il aujourd’hui, et qui décide de sa mise en œuvre ? Quand a-t-il été activé le 13 novembre ?
M. Philippe Chadrys. Le ministre de l’intérieur ou le directeur général de la police nationale décident de son activation, en accord avec l’autorité judiciaire. Le 13 novembre, lorsque nous avons décidé dès 23 heures 45 d’activer ce dispositif, j’en ai immédiatement avisé l’autorité judiciaire, qui ne s’y est bien entendu pas opposée.
Ce dispositif permet de coordonner l’ensemble des forces de police et d’enquête qui interviennent, en l’occurrence sous la direction de la SDAT. L’essentiel est d’activer les salles d’appel – celle de la SDAT à Nanterre et celle de la préfecture de police. En cas d’attentat majeur en province qui ne se traduirait pas par la saisine de la préfecture de police de Paris, nous disposons en effet d’une salle nous permettant de déclencher tout de même le dispositif « Attentat ».
Depuis 2005, ce dispositif n’a été déclenché que deux fois : en janvier et en novembre 2015. En mars 2012, lors de l’affaire Merah, j’étais chef adjoint de la SDAT : nous avons hésité à l’activer, le caractère terroriste des actes commis n’ayant été pleinement avéré que lors de l’attaque perpétrée à l’école juive de Toulouse. Il va de soi que ce dispositif ne doit pas être déclenché au moindre attentat commis. Ainsi, la SDAT a été co-saisie à l’occasion d’autres faits de terrorisme, qu’il s’agisse de l’attentat de Saint-Quentin-Fallavier, de l’affaire Sid Ahmed Ghlam ou de celle du Thalys : dans chacun de ces cas, il n’a pas été nécessaire de déclencher le dispositif « Attentat » car il est très chronophage et consommateur d’effectifs. Il faut en effet affecter un certain nombre d’agents à des tâches de réception d’appels et de traitement de l’information. Or, les événements du 13 novembre ont montré que la publication d’une information ou d’une photographie génère d’importants pics d’appels, qu’il nous faut traiter à bon escient. Sur les quelque 17 500 appels que nous avons reçus à cette occasion, trois ont été déterminants, l’un d’entre eux nous permettant notamment, au terme d’un travail de surveillance, de neutraliser Abaaoud à Saint-Denis. Un appel décisif sur 17 000 suffit à justifier la mobilisation d’importants effectifs. Cela étant, ce dispositif n’est prévu que pour les cas d’attentats majeurs ou commis sur plusieurs sites.
M. Olivier Marleix. J’ai lu dans la presse qu’un état-major opérationnel de prévention du terrorisme a été créé en juin et rattaché directement au cabinet du ministre de l’intérieur. Comment se coordonne-t-il avec l’Unité de coordination de la lutte antiterroriste (UCLAT), qui se réunit chaque semaine et à qui il me semblait que cette mission incombait ?
M. Philippe Chadrys. Je connais le fonctionnement de ce mécanisme, mais je ne peux pas répondre en lieu et place des responsables concernés.
M. Olivier Marleix. Quel est le rôle de l’EMOPT ?
M. Philippe Chadrys. L’état-major opérationnel de prévention du terrorisme (EMOPT), créé à la demande du ministre de l’intérieur, a permis de recenser l’intégralité des individus traités par les services de police compétents en matière de terrorisme et de radicalisation, en particulier le service central du renseignement territorial, qui ne possède certes pas de compétence judiciaire dans la lutte antiterroriste, mais qui a à connaître de faits de radicalisme. De ce point de vue, l’EMOPT a été le précurseur du fichier de traitement automatisé de données à caractère personnel (FSPRT), dans lequel les services concourant à la lutte antiterroriste ou ayant à connaître d’individus radicalisés peuvent inscrire leurs objectifs, ce qui permet aux services de vérifier si tel ou tel individu est déjà connu d’un service de renseignement territorial, de la DGSI ou de la préfecture de police, par exemple. J’ignore combien d’entrées il contient, mais son volume commence à être assez substantiel.
M. Sébastien Pietrasanta, rapporteur. Ma dernière question porte sur l’appel téléphonique qui vous a mis sur la piste de l’appartement conspiratif de Saint-Denis où se trouvait Abaaoud. Lors de l’intervention du RAID sur ce site, étiez-vous certain qu’Abaaoud s’y trouvait ?
M. Philippe Chadrys. La SDAT, chargée de poursuivre les « objectifs » en fuite, a reçu cet appel le 16 novembre à 18 heures 25 ; ce témoignage nous a d’emblée paru exceptionnel. En tant que service antiterroriste, nous connaissions en effet Abaaoud, mais nous ne disposions pas d’un dossier judiciaire le concernant, ce qui signifie que nous n’avions pas d’enquête judiciaire le concernant. Toutefois, cet individu faisait partie des objectifs les plus recherchés par les services de renseignement occidentaux, et il apparaissait sur une fameuse vidéo diffusée à la télévision. À ce stade des opérations, nous pensions qu’il se trouvait en Syrie, selon la DGSI notamment. Pourtant, le témoignage qui nous est parvenu nous a semblé crédible.
L’appel en question a été reçu à 18 heures 25 ; la convocation de son auteur, le recueil de sa déposition sur procès-verbal et la vérification de ses indications ont pris du temps. En effet, il ne suffisait pas de disposer de l’information ; encore fallait-il savoir comment l’exploiter. Nous devions pour ce faire installer un certain nombre de dispositifs techniques, notamment des écoutes téléphoniques, des mécanismes de géolocalisation en temps réel et une surveillance physique sur le terrain, ce que nous avons fait dans une zone d’Aubervilliers que nous a désignée le témoin. À ce stade, toutefois, nous ignorions si ce qui nous était rapporté était exact et si Abaaoud se trouvait sur place.
M. Sébastien Pietrasanta, rapporteur. Ce témoin a donc été reçu par vos services le soir même ?
M. Philippe Chadrys. Oui.
M. Sébastien Pietrasanta, rapporteur. Je suppose qu’il a crédibilisé ses propos. Pourtant, l’intervention n’a eu lieu que dans la nuit du 17 au 18 ; que s’est-il passé pendant la journée du 17 ?
M. Philippe Chadrys. Nous avons déployé des dispositifs d’écoutes téléphoniques, de géolocalisation et de surveillance physique.
M. Sébastien Pietrasanta, rapporteur. Était-il possible d’intervenir plus tôt ? On sait en effet qu’un projet d’attentat imminent à La Défense avait été formé et qu’il aurait pu se produire le 17 ou le 18 novembre. Avez-vous des informations à ce sujet ? Un tel projet a forcément posé la question de la rapidité de l’intervention qui permettrait de neutraliser Abaaoud. Aviez-vous connaissance de ce projet d’attentat à La Défense lorsque vous avez recueilli la déposition du témoin ?
M. Philippe Chadrys. À ce stade, nous ignorions où se trouvait Abaaoud, et le témoin l’ignorait également ; il nous a simplement communiqué un possible point de rendez-vous où nous avons déployé un dispositif de surveillance physique. Nous avons mobilisé pour ce faire une unité de la SDAT qui est spécialement consacrée à la surveillance et à la filature, et nous avons fait appel aux BRI pour localiser Abaaoud. Nous ne pouvions donc intervenir plus tôt, puisqu’il n’était pas localisé.
M. Sébastien Pietrasanta, rapporteur. L’éventualité d’un nouvel attentat à La Défense était-elle connue dès le 16 novembre au soir et, le cas échéant, avez-vous déployé un dispositif particulier sur place ?
M. Philippe Chadrys. Il faudrait examiner l’intégralité des auditions du témoin, qui a été entendu à plusieurs reprises, notamment durant sa garde à vue. De mémoire, il me semble que nous n’en avions pas encore connaissance. Cet élément est apparu lors d’une audition du témoin le 19 novembre, alors qu’il se trouvait en garde à vue.
M. Sébastien Pietrasanta, rapporteur. Quand en avez-vous eu connaissance ? Lorsque le procureur de la République a fait état, en conférence de presse, de ce projet d’attentat déjoué, Abaaoud et sa cousine étaient morts. Est-ce la déposition du témoin qui a apporté ces informations, ou bien les dispositifs de surveillance et d’écoute, voire la saisie de documents ? En clair, un attentat aurait-il pu se produire le 17 novembre à La Défense ?
M. Philippe Chadrys. Lors de la déposition du témoin, Abaaoud n’était pas encore neutralisé. C’est par d’autres moyens, en particulier l’exploitation de données techniques provenant de systèmes GPS analysés dans les jours suivants, que nous avons su qu’il s’était produit des étapes à La Défense. Placé en garde à vue à la demande du Parquet, le témoin en question nous a donné de nombreux éléments, y compris concernant la présence d’environ 90 terroristes. Je n’ai pas souvenir de tous les détails de ses auditions, mais les informations livrées ont pu être explicitées lors de la garde à vue. Nous n’avions pas encore connaissance d’un projet d’attentat à La Défense, car les choses se sont enchaînées très rapidement : le témoignage a été recueilli le 16 au soir et l’appartement localisé dans la nuit du 17 au 18 novembre – sans qu’Abaaoud, lui, le soit. La filature nous a en effet conduits à l’appartement de la rue du Corbillon, à Saint-Denis, que nous ne connaissions pas ; nous n’avions pas non plus la certitude qu’Abaaoud s’y trouvait. Nous savions cependant grâce aux filatures que Hasna Aït Boulahcen y avait conduit deux personnes depuis Aubervilliers, ce qu’ont confirmé des écoutes téléphoniques vers 22 heures 30 le 17 novembre. Nous avons alors fait appel au RAID, dont le chef s’est rendu à Levallois pour prendre connaissance des éléments dont nous disposions.
M. le président Georges Fenech. À quel moment précis avez-vous eu connaissance de la présence d’Abaaoud dans cet appartement ? Après sa mort ?
M. Philippe Chadrys. Son identification formelle a été effectuée grâce à ses empreintes. Il va de soi que nous n’avions pas la certitude absolue qu’il était la personne repérée lors des opérations de surveillance, même si nous pouvions le soupçonner. Une photographie extraite d’une caméra de surveillance nous paraissait ressemblante, mais nous n’avions aucune certitude quant à l’identité de cette personne – même si nous savions qu’Hasna est la cousine d’Abaaoud.
M. Sébastien Pietrasanta, rapporteur. La troisième personne a-t-elle été identifiée ?
M. Philippe Chadrys. Elle vient de l’être. Lorsque nous avons entamé les constatations dans l’appartement de Saint-Denis, où un étage était tombé, les corps n’étaient absolument pas identifiables, puisqu’une ceinture explosive avait été actionnée ; ils ont donc été identifiés par d’autres procédés. Celui d’Abaaoud, méconnaissable, l’a finalement été par dactyloscopie.
M. le président Georges Fenech. Nous vous remercions.
Audition, à huis clos, de M. Christophe Molmy, chef de la brigade de recherche et d'intervention de la préfecture de police de Paris, et de M. Marc Thoraval, chef de la brigade criminelle de la direction régionale de la police judiciaire (DRPJ) de Paris
Compte rendu de l’audition, à huis clos, du jeudi 10 mars 2016
M. le président Georges Fenech. Nous poursuivons nos investigations avec M. Christophe Molmy, chef de la Brigade de recherche et d’intervention de Paris, la BRIP, et M. Marc Thoraval, chef de la brigade criminelle de la Direction régionale de la police judiciaire de Paris, qui vont pouvoir utilement compléter les informations que nous avons recueillies hier, tout particulièrement sur le rôle respectif et l’articulation entre elles des différentes unités.
Nous vous remercions, messieurs, d’avoir répondu à la demande d’audition de notre commission d’enquête relative aux moyens mis en œuvre par l’État pour lutter contre le terrorisme depuis le 7 janvier 2015. Avec le ministre de l’intérieur, que nous avons reçu lundi, et avec les responsables de la gendarmerie et de la police, que nous avons entendus hier, nous avons commencé à aborder les questions relatives à la conduite des opérations, à l’intervention des forces de l’ordre, et aux moyens mis à leur disposition.
La présente audition, en raison de la confidentialité des informations que vous êtes susceptibles de nous délivrer, se déroule à huis clos. Elle n’est donc pas diffusée sur le site internet de l’Assemblée. Néanmoins, et conformément à l’article 6 de l’ordonnance du 14 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, son compte rendu pourra être publié en tout ou partie si nous en décidons ainsi à l’issue de nos travaux. Je précise que les comptes rendus des auditions qui auront eu lieu à huis clos vous seront au préalable transmis afin de recueillir vos observations. Celles-ci seront soumises à la commission, qui pourra décider d’en faire état dans son rapport. Je rappelle que, conformément aux dispositions du même article, « sera punie des peines prévues à l’article 226-13 du code pénal » — un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende — « toute personne qui, dans un délai de vingt-cinq ans […], divulguera ou publiera une information relative aux travaux non publics d’une commission d’enquête, sauf si le rapport publié à la fin des travaux de la commission a fait état de cette information ».
Conformément aux dispositions de l’article 6 précité, je vous demande de prêter le serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité.
M. Christophe Molmy et M. Marc Thoraval prêtent serment.
Pouvez-vous tout d’abord, l’un et l’autre, nous présenter votre parcours professionnel ?
M. Christophe Molmy, commissaire divisionnaire, chef de la Brigade de recherche et d’intervention (BRI) de Paris. Après un passage de deux ans en commissariat, après ma sortie de l’école, j’ai travaillé à la BRI de Marseille comme adjoint, puis à l’Office central pour la répression du banditisme (OCRB) pendant de nombreuses années. J’ai ensuite été responsable de deux antennes de la police judiciaire de Versailles, celle de Meaux pour la Seine-et-Marne, puis celle de Cergy pour le Val-d’Oise. Puis j’ai participé, avec le général Cormier, à la création de l’Unité de coordination des forces d’intervention (UCOFI) — Groupe d’intervention de la gendarmerie nationale (GIGN), RAID (Recherche, assistance, intervention, dissuasion) et BRI de Paris. Je suis retourné à l’Office central de la police judiciaire — à l’Office central pour la répression des violences aux personnes (OCRVP). Enfin, il y a un peu plus de deux ans, on m’a offert la possibilité de prendre la tête de la BRI de Paris. Ma carrière s’est donc surtout déroulée au sein de la police judiciaire.
M. le président Georges Fenech. Vous n’avez pas de formation de policier de force d’intervention ?
M. Christophe Molmy. De fait, si — et tout dépend de l’acception qu’on donne au mot « intervention ». Ainsi, dans le cadre de la police judiciaire, pendant plusieurs années, j’ai participé non seulement à des interventions en milieu ouvert — autrement dit, à des interpellations sur la voie publique —, mais aussi à ce que l’on appelle des « assistances domiciliaires ». Pour ces opérations, nous sommes équipés comme peuvent l’être les unités d’intervention — gilets pare-balles lourds, protections balistiques, armes. Il s’agit, par exemple, de casser une porte à six heures du matin et d’appréhender des malfaiteurs, voire des terroristes, pour le compte de services enquêteurs.
Pendant trois ans, je me suis ensuite penché sur les techniques d’intervention et sur la problématique de la coordination des forces, avant d’intégrer la BRI et de passer une partie de mon temps en intervention. La BRI de Paris est en effet un service très atypique : elle passe autant de temps à traiter d’affaires judiciaires, à procéder à des filatures-surveillance, qu’à intervenir. Cette spécificité tient à son histoire. Elle a été le premier groupe d’intervention en France, pourvu d’une compétence à l’échelle nationale, voire internationale puisqu’elle est intervenue à La Haye dans les années 1970. Par la suite, avec la création du RAID, du GIGN et d’autres antennes, les compétences se sont sectorisées et l’action de la BRI s’est concentrée sur Paris. Pour ce qui concerne l’aspect judiciaire, la technique de travail, en amont, de filatures-surveillance, déjà mentionnée et destinée à pratiquer les flagrants délits, a essaimé, notamment à Marseille où j’ai travaillé. Nous travaillons au quotidien pour remplir ces deux missions.
M. Marc Thoraval, commissaire divisionnaire, chef de la brigade criminelle de la Direction régionale de la police judiciaire de Paris. Pour ma part, j’ai commencé ma carrière à la direction centrale de la police judiciaire, à Versailles, où je suis resté quatre ans. J’ai ensuite rejoint la préfecture de police, la direction régionale de la police judiciaire, et j’ai occupé successivement les fonctions de chef de section au service départemental de la police judiciaire des Hauts-de-Seine, d’adjoint à la BRI, d’adjoint à la Brigade de répression du banditisme (BRP), de chef d’état-major de la police judiciaire, de chef de la Brigade des stupéfiants et, depuis cinq ans, je suis à la tête de la Brigade criminelle de la direction régionale de la police judiciaire de Paris.
M. le président Georges Fenech. Venons-en aux faits survenus à Paris au mois de novembre dernier au Bataclan, sur plusieurs terrasses et à proximité du Stade de France. La commission a reçu vos éléments de réponses aux questions qui vous ont été posées. Nous disposons ainsi d’un rapport détaillé de vos interventions lors de ces attentats.
À 21 h 19, puis à 21 h 21, le 13 novembre, monsieur Molmy, vous avez été informé de l’explosion de deux kamikazes au Stade de France.
M. Christophe Molmy. J’ai en effet été informé par mes collaborateurs. La préfecture de police de Paris est un service très « tissé » : dans le cadre de la BRI au sens large, c’est-à-dire anti-commando, nous intégrons des effectifs de la Brigade d’intervention (BI) de la direction de l’ordre public et de la circulation (DOPC), de la direction de la sécurité de proximité de l’agglomération parisienne (DSPAP) et de ses six brigades anti-criminalité (BAC). Les fonctionnaires qui travaillent au sein de ces services se connaissent, se parlent et, bien évidemment, dès les premières explosions au Stade de France, ils se sont appelés, si bien que, par ricochet, après quelques minutes, j’ai été avisé de la première explosion. Comme tout le monde, j’ai espéré qu’il ne s’agissait que d’un accident — de l’explosion d’une baraque à frites par exemple — ; mais, dès la seconde explosion, les premiers éléments laissant penser que des kamikazes étaient impliqués, nous avons pris conscience qu’il s’agissait d’attentats.
M. le président Georges Fenech. Que faites-vous à ce moment-là ?
M. Christophe Molmy. Je suis en rapport avec mon état-major, mais, comme vous ne l’ignorez pas, les unités sont réparties en fonction de zones de compétences territoriales, ce qui participe à leur bonne coordination, et la BRI n’est pas compétente dans la petite couronne. D’une part, je me pose la question de savoir s’il est utile de partir immédiatement, sachant que ces explosions pouvaient ne pas impliquer de prises d’otages nécessitant notre intervention — ce qui s’est avéré — et, d’autre part, comme il s’agissait du secteur du RAID, il me semblait plus avisé d’attendre à Paris et de rester en alerte dans l’hypothèse, malheureuse, où des attentats s’y produiraient — ce qui est advenu.
M. le président Georges Fenech. Prévenez-vous dès lors le directeur général de la police nationale (DGPN) ?
M. Christophe Molmy. Il n’entre pas dans mes attributions de prévenir le directeur général de la police nationale ni même le préfet de police. Je ne suis que chef de la BRI : j’ai des contacts avec mon directeur — lequel est, du reste, déjà au courant — et avec l’état-major qui me confirme les explosions près du Stade de France ; j’en prends acte et demande à mes collaborateurs de rester dans les starting-blocks.
M. le président Georges Fenech. À 21 h 25 commence la tuerie des terrasses, d’abord au Petit Cambodge et au Carillon, puis, à 21 h 49, au Bataclan avec trois terroristes. Par qui êtes-vous prévenu et quelles mesures prenez-vous, puisque nous sommes là sur votre ressort territorial ?
M. Christophe Molmy. Je ne suis pas prévenu des fusillades sur les terrasses de café dans des délais très courts. Je ne suis au courant, jusqu’à 21 h 47, que des attentats au Stade de France. Dès que j’apprends, par ricochet là aussi, que des tirs se sont produits dans Paris, j’active la Force d’intervention rapide (FIR) de la BRI, la première, la plus rapide. Les membres de la FIR ont leur matériel chez eux afin de pouvoir se projeter immédiatement.
M. le président Georges Fenech. La FIR est composée de sept fonctionnaires, c’est bien cela ?
M. Christophe Molmy. Pas du tout, nous étions quinze, précisément.
M. le président Georges Fenech. Quinze fonctionnaires composent la FIR que vous activez ?
M. Christophe Molmy. En effet, il s’agit de la première lame que j’ai activée. Puis j’ai lancé la seconde alerte, dite « H+30 » : nous devons alors être en mesure de quitter le service en colonne constituée, équipés avec du matériel lourd, une demi-heure après l’appel.
À la fin de 2014, alors que nous étions déjà dans un contexte de risque d’attentats, nous avons été confrontés à un événement qui n’avait rien à voir avec le contre-terrorisme : l’attaque d’une bijouterie Cartier sur les Champs-Élysées, qui s’est terminée par une prise d’otage dans le 15e arrondissement. À cette occasion, nous avons constaté que l’alerte H+30 fonctionnait très bien : les fonctionnaires appelés se sont mobilisés immédiatement et sont revenus s’équiper à la brigade, alors que nous étions en fin de journée et qu’ils étaient en train de rentrer chez eux. Mais la circulation, à Paris, est tellement dense que la colonne d’assaut a ensuite mis beaucoup de temps à arriver sur place : un peu plus d’une demi-heure, ce qui est très long dans un contexte de contre-terrorisme. Nous avons donc décidé de créer une autre alerte, avec des fonctionnaires qui, la journée, sont, au service ou à l’entraînement, déjà équipés et à même de partir immédiatement par moto, par bateau, selon la configuration de la crise, avec pour objectif d’arriver sur les lieux moins d’un quart d’heure après l’alerte. Le soir, pour éviter qu’ils ne repassent par le service et ne perdent du temps, ces fonctionnaires rentrent chez eux avec leur armement.
J’ai activé cette FIR, le 13 novembre au soir, dès que j’ai pris connaissance de tirs dans Paris. Nous sommes partis immédiatement et, sur le chemin, j’ai confirmé à mon état-major que nous étions en route ; ainsi nous sommes-nous projetés immédiatement, en lançant par ailleurs, par téléphone, l’alerte H+30.
M. le président Georges Fenech. Si je comprends bien, parmi vos équipes, vous disposez d’une FIR qui intervient H+10 ou H+15 maximum.
M. Christophe Molmy. C’est plus que cela : H+30 ne signifie pas que mes collaborateurs doivent se trouver sur les lieux une demi-heure après avoir été alertés, mais qu’ils doivent partir du 36 quai des Orfèvres une demi-heure après avoir été alertés.
M. le président Georges Fenech. Pour s’équiper.
M. Christophe Molmy. Tout à fait. La FIR, quant à elle, n’obéit pas à une logique de « H+ » : elle se projette immédiatement. Certes, il faut aux fonctionnaires le temps d’enfiler un gilet pare-balles et de descendre les escaliers, mais ils n’ont pas l’obligation, la nuit, de revenir au service pour s’équiper, et ils partent directement de chez eux. C’est ainsi que nous sommes allés renforcer le RAID, à sa demande, le 18 novembre : nous sommes arrivés un quart d’heure après. C’est un choix tactique : il faut savoir que la vélocité nuit à la balistique ; pour être rapides, notre équipement est moins lourd. Un équipement lourd, c’est un casque de plusieurs kilos, un gilet pare-balles de vingt-cinq kilos, une arme longue, des grenades... Or la FIR a non seulement vocation à se déplacer très rapidement, mais à faire des « bonds » dans Paris si nécessaire — à l’entraînement, nous avons anticipé une menace qui se déplace —, ce qui est beaucoup plus difficile avec une colonne lourdement équipée, avec un blindé, des artificiers et toute une caravane qui suit.
M. le président Georges Fenech. À quelle heure estimez-vous l’arrivée de la FIR au Bataclan ?
M. Christophe Molmy. D’abord — et j’en prends la responsabilité —, nonobstant le fait que la FIR offre la possibilité de se projeter immédiatement, nous nous sommes réunis au 36 dans la mesure où je ne disposais pas d’informations précises de la part de mon état-major sur l’endroit où nous devions intervenir : on a fait état de tirs à plusieurs endroits, de la rue de Charonne... tout cela me paraissait un peu confus. Par ailleurs, on évoquait la présence de terroristes munis de ceintures d’explosifs ; or, dans la configuration que je viens d’exposer, nous n’évoluons pas avec des boucliers, qui sont volumineux. Aussi m’a-t-il semblé que, pour la sécurité des fonctionnaires, il faudrait récupérer quelques boucliers. Nous sommes partis de chez nous environ à 21 h 50 pour nous retrouver au 36 ; quelques-uns sont allés chercher des boucliers et nous sommes repartis du 36 à vingt-deux heures.
M. le président Georges Fenech. Combien étiez-vous ?
M. Christophe Molmy. Quinze en comptant le médecin.
M. le président Georges Fenech. N’êtes-vous donc pas sept normalement ?
M. Christophe Molmy. Non, nous devons être douze au minimum et nous sommes quinze en comptant le médecin, le dépiégeur d’assaut et le chef de service.
M. le président Georges Fenech. Nous avons auditionné hier le commandant du RAID qui a déclaré que, lorsqu’il est arrivé en renfort, il a trouvé sept fonctionnaires de votre service ; c’est dans son rapport.
M. Christophe Molmy. Je lui laisse la liberté de ce comptage et de ses propos. Nous étions quinze : je peux vous communiquer la liste des fonctionnaires en question et vous pourrez les auditionner. Peut-être le commandant du RAID n’a-t-il compté que ceux d’entre nous qui se trouvaient dehors, mais je vous assure que nous étions quinze.
M. le président Georges Fenech. Donc, vous étiez quinze ?
M. Christophe Molmy. Nous étions quinze.
M. le président Georges Fenech. Vous êtes arrivés à 22 h 30, c’est cela ?
M. Christophe Molmy. Non, vers 22 h 15, le temps de sortir des voitures, de faire le point avec les effectifs sur place. Il faut savoir que, dans ce genre de situation, l’interopérabilité des forces est très compliquée. Il faut relever les fonctionnaires qui se trouvent sur place et qui nous font le point sur ce qu’ils ont vu, vécu, sur la manière dont ils envisagent la crise. J’ai pour ma part demandé si les tirs avaient cessé ; on m’a répondu qu’ils avaient cessé depuis quelques minutes et nous n’en avons plus entendu, en effet, jusqu’à l’assaut. Je leur ai demandé ensuite si les terroristes étaient encore présents ; ils n’ont pas su me répondre, ce qui est naturel.
M. Sébastien Pietrasanta, rapporteur. Qui avez-vous interrogé ?
M. Christophe Molmy. Un officier qui se trouvait dans le hall du Bataclan.
M. le rapporteur. Un officier qui intervenait ?
M. Christophe Molmy. Non. Je vous avoue que je n’ai pas relevé son identité à ce moment-là. Plusieurs fonctionnaires de la DSPAP se trouvaient à l’entrée du Bataclan et qui ont fait ce qu’on leur apprend — la BRI forme les effectifs de la BAC nuit et de la Compagnie de sécurisation et d’intervention (CSI), lesquelles font partie de son dispositif — : ils avaient cessé leur intervention puisque les tirs avaient cessé. Leur travail, dans l’hypothèse où les tirs cessent, n’est pas, en effet, d’entrer et de progresser — les risques de la présence d’explosifs ou de terroristes embusqués et le risque de sur-attentat sont importants —, mais de figer la situation, ce qu’ils ont d’ailleurs très bien fait. Nous leur avons demandé de nous faire le point et ils nous ont indiqué, je le répète, que les tirs, a priori, avaient cessé ; ils se demandaient s’il y avait encore des terroristes et si certains n’avaient pas pu s’échapper en même temps que des otages qui étaient sortis par les issues de secours ou par l’entrée. Un silence complet régnait dans la salle. Nous avons pris cette situation en compte et nous sommes rentrés dans le Bataclan avec la première FIR à 22 h 20 environ.
M. le président Georges Fenech. À combien entrez-vous ?
M. Christophe Molmy. Toujours à quinze. Lorsque nous partons, on nous indique la rue de Charonne et, en chemin, mon directeur m’appelle pour m’indiquer qu’il faut plutôt aller au Bataclan, où nous nous rendons donc. Alors que nous partions, une seconde équipe arrivait au 36 pour finir de s’équiper. J’ai donné à cette seconde équipe, qui avait une petite dizaine de minutes de retard sur nous, la consigne d’aller malgré tout rue de Charonne pour lever tout doute. Sur place, cette seconde lame de la FIR a constaté que, malheureusement, elle ne pouvait plus aider, et elle nous a rejoints au Bataclan.
M. le président Georges Fenech. Vous êtes dès lors une trentaine ?
M. Christophe Molmy. Nous nous retrouvons en effet à une trentaine vers 22 h 30, 22 h 35.
M. le président Georges Fenech. Nous poserons de nouveau la question au commandant du RAID puisque, quand il arrive vers 22 h 50, il déclare trouver sur place sept fonctionnaires de la BRI.
M. Christophe Molmy. Sur ce point je serai très péremptoire. Je trouve même aberrant qu’un commandant du RAID vous explique combien nous étions. Je suis chef de service, j’étais sur place à 22 h 15 avec quinze fonctionnaires et, à 22 h 20, nous avons commencé nos investigations ; nous avons été rapidement rejoints par une autre lame et l’ensemble de la BRI nous a rejoints aux environs de 22 h 40, 22 h 45.
M. le président Georges Fenech. Quelle décision prenez-vous à ce moment précis ? En effet, étant donné l’ampleur de l’attentat, vous avez une possibilité : celle de demander qu’on déclenche la Force d’intervention de la police nationale (FIPN) qui regroupe les forces du RAID et de la BRI, sous le commandement unique du RAID.
M. Christophe Molmy. En effet, dans cette configuration le chef du RAID change de casquette et son adjoint est le chef de la BRI.
M. le président Georges Fenech. Avez-vous alors la possibilité ou bien la contrainte, en tant que demandeur, de faire déclencher la FIPN par l’autorité de tutelle ?
M. Christophe Molmy. Sur la forme, je ne suis que chef de brigade et n’ai pas compétence pour déclencher la FIPN. Cette décision revient au ministre de l’intérieur — il l’a d’ailleurs prise en janvier — sur proposition du préfet de police, lui-même informé par le directeur général de la police nationale. Sur le fond, je comprends volontiers, dans le cas de crises majeures, qu’on essaie de se rassurer en se disant qu’il faut engager l’intégralité des forces d’intervention qu’on a sous la main et tout de suite. Or il ne s’agit pas forcément de la meilleure solution dans la mesure où il faut « dimensionner » les crises. Ce qui importe, c’est d’apporter une réponse à la hauteur de la crise, de se projeter dans la durée, d’envisager la possibilité que soient commis d’autres attentats et surtout d’assurer une bonne coordination des forces. En l’occurrence, un protocole de coordination entre le RAID et la BRI, signé par les deux chefs d’unité et par les autorités, prévoit une articulation de ces deux forces, en particulier sur la place parisienne, afin d’apporter une réponse à la hauteur de la crise.
Lorsque nous arrivons au Bataclan, nous sommes, dans un premier temps, une quinzaine puis une trentaine, enfin toute la BRI. Nous devons d’abord apprécier la situation : nous ignorons si des terroristes sont encore sur place — ils auraient très bien pu être déjà partis — et, dans l’affirmative, déterminer leur nombre et savoir si nous sommes capables de résoudre seuls la crise. La question n’est pas de savoir si nous voulons y faire face seuls, mais elle de savoir si nous avons la compétence pour le faire — ce qui me semble alors être le cas — et si nous avons les capacités numériques, voire techniques, de le faire. En ce qui concerne le Bataclan, nous étions assez nombreux pour déminer le bas afin que les services de secours puissent prendre les blessés en charge. On n’aurait pas pu engager rapidement des forces d’intervention à l’intérieur du Bataclan : on ne sait pas, à ce moment précis, si des otages sont piégés, si des engins explosifs sont cachés, si des terroristes sont embusqués. La meilleure solution ne consiste donc pas à se ruer à l’intérieur. Il faut procéder par étapes, avec précaution. C’était pour nous-mêmes difficile, car, alors que nous voyions des blessés au sol, j’ai pris la responsabilité de ne pas faire entrer tout de suite les services de secours — il a fallu le faire dans de bonnes conditions, après que nous nous étions assurés que le bas présentait des conditions de sécurité adaptées.
La question ne s’est donc pas posée de déclencher la FIPN, car, à ce moment-là, je n’ai pas ressenti le besoin d’être renforcé.
M. le rapporteur. Sauf que les représentants du RAID nous ont expliqué hier que leurs éléments sont venus sur place de leur propre initiative pour compléter vos effectifs…
M. Christophe Molmy. Je pense qu’ils ont voulu bien faire, que cette décision participait d’une bonne intention, mais, encore une fois, je n’ai pas jugé utile de demander du renfort : il fallait d’abord apprécier la situation. Reste que, malgré ce qu’on peut imaginer, nous travaillons en bonne intelligence. J’ai constaté qu’un petit nombre de collègues du RAID étaient arrivés sur place ; aussi les avons-nous intégrés dans notre dispositif et les choses se sont bien passées.
M. le président Georges Fenech. Nous souhaitons bien comprendre la coordination de vos services avec le RAID et le GIGN. Vous avez donc estimé que vous étiez en nombre et en force suffisants pour gérer cette catastrophe — puisqu’il y avait 1 500 personnes au Bataclan et nous connaissons le résultat : 90 morts et des centaines de blessés — ; vous avez estimé de votre propre chef que vous n’aviez pas à suggérer le déclenchement de la FIPN et que vous n’aviez besoin ni du RAID ni du GIGN. Avez-vous eu des contacts avec le RAID et le GIGN ?
M. Christophe Molmy. De fait, nous avons eu des contacts avec le RAID puisque le chef du RAID s’est adressé à moi…
M. le président Georges Fenech. Spontanément ?
M. Christophe Molmy. Oui, spontanément.
Je reviens, si vous le permettez, sur le protocole. Nous obéissons à des règles de compétence territoriale : la préfecture de police est compétente à Paris, la BRI à Paris intra-muros, le RAID autour de Paris et le GIGN et le RAID se partagent la province.
À Paris, hors FIPN – dont le déclenchement ne m’appartient pas et ne me pose aucune difficulté : je crois que la FIPN a bien fonctionné à Vincennes –, la BRI est « menante », c’est-à-dire qu’elle est l’unité d’intervention naturelle, alors que le RAID est « concourant » et vient donc renforcer la BRI, à sa demande, en tant que de besoin, par des effectifs, des moyens techniques ou autres.
M. le rapporteur. Ce qui n’était pas le cas le 13 novembre : vous n’étiez pas demandeurs de l’aide du RAID ?
M. Christophe Molmy. Les choses sont allées beaucoup plus vite que cela, mais je vais y revenir.
Il y a quelques semaines, le RAID a dû s’occuper de deux crises dans la petite et dans la grande couronne ; il lui manquait deux tireurs d’élite : ils m’ont appelé, je leur ai envoyé deux tireurs d’élite et tout s’est très bien passé — c’est ce qu’on appelle la modularité.
Pensez-vous que, le 13 novembre, quand j’entre au Bataclan, à 22 h 20, je me pose la question de savoir si je dois gérer cette crise tout seul ou s’il faut que je demande l’aide du RAID, que je fasse demander celle de la FIPN, si j’ai des susceptibilités à cet égard ? Pas du tout ! Ma première préoccupation est de déminer le bas du Bataclan et de prendre la mesure de ce qui se passe à l’intérieur. Si nous avions disposé de cent fonctionnaires de plus, lourdement équipés, ils seraient restés dehors. Du reste, une colonne de vingt fonctionnaires est restée sur le trottoir : tout le monde n’est pas entré. Nous avons affronté les terroristes dans un couloir : les dix premiers sont montés à l’assaut tandis que les autres étaient en réserve.
Le dimensionnement de la crise que j’ai évoqué est important. Il n’est pas forcément nécessaire d’ajouter des unités d’intervention sur place afin de se rassurer et de se dire, plus tard, qu’on se sera donné tous les moyens. Ce n’est pas judicieux, parce qu’il faut réfléchir à une crise dans la durée : il faut prévoir l’éventualité de relèves, celle de multiples crises. Quand Jean-Michel Fauvergue est arrivé, il m’a demandé ce qu’il pourrait faire. Nous avions déjà réglé le problème du bas du Bataclan et nous apprêtions à monter dans les étages. Je lui ai donc dit de rester en bas pour nous protéger, mais, surtout, je lui ai demandé, si une autre crise survenait à Paris, de la prendre en compte. Il a pris acte et c’était, je pense, la meilleure solution. Je n’ai perçu aucune difficulté : les opérations se sont bien passées, bien articulées, de même qu’en janvier 2015, les trois groupes d’intervention ont travaillé de conserve.
M. le président Georges Fenech. Bref, tout s’est bien passé !
M. Christophe Molmy. Et je dis cela sans faire preuve d’ironie ou de naïveté. Seulement, je n’ai pas été embarrassé par le RAID, je n’ai pas eu le sentiment que nous nous étions mal entendus ; en somme, je n’ai pas connu de difficultés opérationnelles — mais peut-être d’autres considérations me dépassent-elles…
M. le président Georges Fenech. Où se situe le poste de commandement (PC) ?
M. Christophe Molmy. Un PC avancé, réunissant les commissaires de la BRI et du RAID est installé in situ, c’est-à-dire à l’intérieur du Bataclan. Un autre PC de la BRI a été mis en place, lui, à l’extérieur, dans un café, un peu plus loin.
M. le président Georges Fenech. Il y a donc deux PC.
M. Christophe Molmy. Dans le PC avancé, nous ne sommes pas assis, mais debout et nous nous parlons.
M. le président Georges Fenech. Celui-ci est donc à l’intérieur ?
M. Christophe Molmy. Oui.
M. le président Georges Fenech. Au milieu des blessés, donc ?
M. Christophe Molmy. Ce PC bouge en fonction de l’endroit où je me trouve, où se trouve mon adjoint et où se trouve le chef du RAID. Nous avons par ailleurs monté un PC-BRI, à quelques dizaines de mètres de là, dans un café.
M. le président Georges Fenech. Et où vous trouvez-vous, à ce moment précis ? Au rez-de-chaussée ?
M. Christophe Molmy. Au rez-de-chaussée, à l’étage… Je me déplace avec mes fonctionnaires.
M. le président Georges Fenech. Vous êtes donc au rez-de-chaussée, mais où se trouve le RAID ?
M. Christophe Molmy. Je n’ai pas passé mon temps à regarder ma montre pour savoir à quelle heure arrivaient les uns et les autres, mais c’est vers 22 h 40 ou 22 h 45 que le gros de la troupe de la BRI arrive, à laquelle se sont greffés quelques précurseurs du RAID dont une équipe arrive à peu près en même temps. Nous leur demandons de prendre en compte le bas déjà sécurisé afin de nous assurer une couverture lorsque nous nous trouvons à l’étage. Le RAID se trouve donc en bas, dans la fosse, pendant que nous sommes à l’étage à partir de vingt-trois heures.
M. le président Georges Fenech. À vingt-trois heures ?
M. Christophe Molmy. C’est l’heure à laquelle nous commençons à progresser dans les étages.
M. le président Georges Fenech. Vous commencez donc à progresser dans les étages à vingt-trois heures.
M. Christophe Molmy. Environ, oui.
M. le président Georges Fenech. Vous êtes sur les lieux depuis quelle heure ?
M. Christophe Molmy. Je vous l’ai dit : depuis 22 h 20.
M. le président Georges Fenech. Vous allez donc mettre à peu près quarante minutes pour progresser dans les étages ?
M. Christophe Molmy. Oui et cela s’explique, monsieur le président. Dans ce type de situation, vous avez deux catégories d’otages : ceux qui sont pressés de sortir et ceux qui se trouvent dans un état catatonique. Lorsqu’un otage se précipite vers nous, nous devons l’arrêter et prendre la précaution de lui demander de soulever son tee-shirt, de nous montrer ses mains, car nous ne savons pas de qui il s’agit, nous ne savons pas s’il est piégé — les militaires nous ont en effet avisés que parfois, en Syrie, les terroristes piégeaient les otages. Nous avons donc pris de multiples précautions pour faire sortir les otages valides, fouillés à plusieurs reprises.
M. le rapporteur. À partir de quelle heure commencez-vous à les évacuer ? Dès 22 h 20 ?
M. Christophe Molmy. Dès que nous commençons à progresser dans la fosse, nous nous dispersons par secteurs…
M. le rapporteur. Excusez-moi de vous couper : le chef du RAID nous a décrit des scènes, au rez-de-chaussée, pendant lesquelles des blessés tiraient sur le pantalon des forces en leur disant : « Secourez-moi, secourez-moi ! »
M. Christophe Molmy. Au rez-de-chaussée ? Je n’ai pas ce souvenir. Peut-être tous n’avaient-ils pas été évacués… La première image que j’ai en arrivant au Bataclan, ce ne sont pas seulement 90 morts et des dizaines de blessés, mais 300 à 400 personnes couchées à terre et qui ne bougent plus, pour beaucoup tétanisées par la peur — avant que nous n’arrivions, dès que l’une d’elles bougeait ou dès que son téléphone sonnait, on lui tirait dessus. Aussi, certaines ne voulaient plus bouger et d’autres n’osaient pas, même lorsqu’elles ont vu surgir des fonctionnaires de police avec des fusils d’assaut, car elles étaient encore sous le choc. Nous avons donc mis un peu de temps pour en rassurer certaines, les faire se lever, les évacuer — il est ici question des personnes valides.
M. le rapporteur. Ceci se passe-t-il vraiment dès vingt-deux heures ?
M. Christophe Molmy. Oui.
M. le rapporteur. Quand nous avons auditionné des victimes, nous les avons interrogées sur le délai non pas de votre intervention — ce que vous expliquez en la matière est tout à fait justifiable —, mais sur celui de leur prise en charge. Pouvez-vous nous expliquer comment les opérations se sont déroulées ? Comment avez-vous sécurisé les lieux et comment avez-vous progressé jusqu’aux étages, jusqu’au couloir où se trouvaient les derniers otages et où étaient retranchés des kamikazes, et, d’autre part, comment, pendant ce temps, étaient prises en charge les victimes ? Pouvez-vous nous donner des précisions sur le moment où les secours sont intervenus ?
M. Christophe Molmy. Comme je vous l’ai indiqué, lorsque nous entrons, vers 22 h 20, au Bataclan, nous avons sous les yeux cette image de centaines de personnes au sol. Il nous faut quelques secondes — une ou deux minutes, peut-être — pour prendre la mesure de la situation et commencer à nous « étaler » avec précaution — vous pouvez imaginer qu’on n’entre pas en courant dans une salle où l’on voit des centaines de personnes par terre, où vient de se perpétrer un massacre, où l’on voit des morts, où l’on piétine…
M. le rapporteur. L’obscurité est-elle totale ?
M. Christophe Molmy. Non : malgré la pénombre, on peut distinguer ce qu’on a devant soi ; et on le distingue d’autant mieux que, je le répète, on voit des corps déchiquetés, on marche dans le sang… On sait donc très bien où l’on est. Il faut un peu de temps pour prendre la mesure des choses, pour commencer à avancer en sécurisant les lieux, c’est-à-dire en faisant glisser des fonctionnaires sur la droite, sur la gauche, tout en essayant de voir les points hauts, car il est difficile de travailler dans une fosse ceinturée d’étages d’où peuvent provenir des tirs. Techniquement, il n’est pas très judicieux de chercher à investiguer à la fois le bas et le haut : il faut malheureusement procéder par étapes.
Nous avons commencé à progresser lentement — avec le discernement indispensable —, car, je le répète, nous devions faire attention à ne pas tomber sur des engins piégés. On nous avait en effet prévenus, quelques mois auparavant, qu’on avait en Syrie de plus en plus recours aux gilets explosifs, ce qui n’a pas manqué. Nous sommes formés pour y faire face : nous disposons dans nos colonnes de dépiégeurs d’assaut pour nous conseiller. Progressant ainsi, avec précaution, nous avons fait sortir les otages valides, jusqu’à ce que nous ayons achevé de ceinturer la salle, de la sécuriser, moment où nous avons fait sortir en nombre les derniers otages valides restés au sol.
M. le rapporteur. Vers quelle heure ?
M. Christophe Molmy. Vers 22 h 30, 22 h 35.
M. le rapporteur. Donc, quasiment un quart d’heure après, vous faites sortir le gros des effectifs.
M. Christophe Molmy. Un peu moins : peut-être dix minutes après. Quand nous avons commencé à être renforcés par la deuxième équipe, nous sommes allés beaucoup plus vite, puisque nous avions déjà commencé à travailler. Nous nous sommes alors réparti la salle, et j’ai d’ailleurs donné la consigne à ceux qui étaient valides de se lever et de partir sous notre protection.
M. le rapporteur. Le gros des otages est-il évacué assez rapidement ?
M. Christophe Molmy. Oui, je dirais : cinq à dix minutes après que nous sommes entrés — je parle bien de la fosse.
M. le rapporteur. Vous entrez à 22 h 20 dans les locaux du Bataclan et, à 22 h 30, 22 h 35 ou 22 h 40…
M. Christophe Molmy. À 22 h 35, car je sais que mon adjoint arrive aux environs de 22 h 40, moment où il me dit voir les derniers otages sortir. Les otages sont alors passés au crible par les fonctionnaires de la CSI et de la BAC nuit qui se trouvent à l’extérieur et qui ont essayé de créer une sorte de goulot d’étranglement pour continuer à les appréhender, à les fouiller, de façon à s’assurer qu’il n’y ait pas de terroriste ou de personne piégée parmi eux.
M. le rapporteur. Une des otages dont la commission a recueilli le témoignage nous a assuré que, lorsque vous êtes arrivés, vous avez demandé aux personnes valides de se lever.
M. Christophe Molmy. C’est moi-même qui le leur ai demandé, mais pas tout de suite : au bout, je vous l’ai dit, de cinq ou dix minutes, puisqu’il a fallu sécuriser la salle. Après qu’ils sont sortis, nous nous retrouvons avec les blessés. Les pompiers et les personnels du SAMU ne seraient de toute façon pas entrés tant que les lieux n’étaient pas sécurisés, notamment le haut. Ce sont des fonctionnaires de police qui ont commencé à sortir les blessés, sous notre protection, en les portant aux services de secours sur des barrières Vauban. Le RAID est arrivé, la salle a fini d’être vidée des blessés que nous voulions sortir et nous avons commencé à progresser dans les étages.
M. le rapporteur. À partir de vingt-trois heures ?
M. Christophe Molmy. À peu près, oui.
M. le président Georges Fenech. Avant d’en venir à la progression dans les étages, sans doute des députés souhaitent-ils vous interroger. C’est vous qui dirigez les opérations et la FIPN n’est pas déclenchée ?
M. Christophe Molmy. La FIPN n’a pas été déclenchée.
M. Alain Marsaud. Vous faites donc en sorte que les valides puissent sortir afin d’être contrôlés, mais je suppose que des blessés restent au sol…
M. Christophe Molmy. Blessés ou catatoniques — certains n’osaient plus bouger.
M. Alain Marsaud. En effet, et tous méritent des soins. Vous êtes à ce moment-là sur le point de continuer à progresser, mais vous ne pouvez plus rien pour eux. Les services de secours comme le SAMU ne peuvent-ils pas intervenir à chaud pour s’occuper de ces blessés ?
M. Christophe Molmy. Non : à ce moment précis, nous faisons entrer des volontaires des services de police — CSI, DSPAP… — qui font sortir les blessés, parfois allongés sur des barrières Vauban pour être ensuite pris en charge par les services de secours. Reste qu’ils sont assez vite évacués.
M. Alain Marsaud. Vous continuez votre progression alors qu’il reste des blessés au sol…
M. Christophe Molmy. Certains le sont encore, je pense.
M. Alain Marsaud. Et êtes-vous certains qu’il y a des malfaiteurs à l’étage ?
M. Christophe Molmy. Non. Quand nous arrivons, nous faisons le point avec les services qui se trouvent dans le hall : ils nous disent que, de leur point de vue, il n’y a plus de terroristes à l’intérieur. Bien sûr nous nous méfions — et les faits nous donneront raison —, mais, jusqu’à 23 h 15 environ, moment où nous butons contre cette porte derrière laquelle nous entendons des otages nous hurler de ne pas approcher, nous n’avons aucune raison objective de penser qu’il reste des terroristes puisqu’il n’y a plus de tirs. Car il faut bien comprendre que soit les tirs cessent et nous progressons comme nous l’avons fait, soit les tirs continuent et, dans cette hypothèse, nous affrontons les terroristes immédiatement en entrant.
M. Alain Marsaud. Il y a le terroriste qui a été tué sur la scène en se faisant exploser.
M. Christophe Molmy. Lui est tué quelques minutes avant notre arrivée.
M. Alain Marsaud. Il est donc toujours sur la scène, quand vous arrivez.
M. Christophe Molmy. En effet, il est mort…
M. Alain Marsaud. Et, dans votre progression, alors que vous avancez avec les précautions nécessaires, vous ne savez pas s’il y a des gens en haut et vous pensez même qu’il n’y a plus personne ?
M. Christophe Molmy. Pour être tout à fait honnête, passé vingt-trois heures, tout en progressant dans les étages et avant d’arriver à cette fameuse porte, j’avais le sentiment qu’il n’y avait plus personne et que les terroristes étaient bien partis.
M. Olivier Falorni. On a évoqué le premier terroriste abattu, apparemment tué par un commissaire de la BAC de nuit de Paris.
M. Christophe Molmy. Absolument.
M. Olivier Falorni. Comment se fait-il que ce commissaire ait été en situation ? A-t-il agi de sa propre initiative ? Était-il vraiment en mesure d’intervenir ? Son geste a-t-il eu des conséquences sur votre analyse des interventions rapides dans ce type de situation où il n’y a pas vraiment de prise d’otages, mais où un massacre est presque immédiatement perpétré ? J’ai en effet du mal à comprendre : un mode opératoire prévoit qu’on attende l’entrée en action des groupes d’intervention spécialisés, ce qui est légitime ; or on a ici un commissaire de la BAC qui intervient, efficacement, avec un armement que j’imagine léger comparé à des kalachnikovs… Pourquoi est-il là, comment ressort-il et que fait-il ensuite ?
M. Christophe Molmy. Votre excellente question va me permettre d’apporter quelques explications. La BRI, dans sa formation anti-commando, est une structure fonctionnelle : dès lors que le préfet l’active, il place de facto sous mon autorité des fonctionnaires qui ne le sont pas usuellement, de manière organique ; il s’agit de fonctionnaires que nous formons, que nous équipons et que nous intégrons à notre dispositif. On parle alors de premier, de deuxième et de troisième périmètre.
Le premier périmètre se compose de ceux qui sont recrutés et formés pour passer à l’assaut, qui sont le plus lourdement équipés et qui s’entraînent le plus souvent. C’est la BRI qui, pour l’instant, intègre la BI de la DOPC, et qui, la restructuration en cours une fois achevée, sera, d’un point de vue numérique, complètement autonome.
Le second périmètre, quant à lui, a une utilité vitale, car il regroupe les fonctionnaires primo-engagés qui arrivent toujours avant nous. Je me permets de souligner, au passage, que la BRI est intervenue en douze minutes à Vincennes et en un peu plus de vingt minutes au Bataclan, ce qui, pour un groupe d’intervention, est très court : j’ai pris la liberté d’examiner ce type d’opérations un peu partout dans le monde où les délais d’intervention sont souvent beaucoup plus longs. Une intervention nécessite beaucoup de matériel, implique toute une logistique et va donc forcément moins vite que deux ou trois fonctionnaires d’une BAC qui tournent dans Paris à bord d’un véhicule civil.
Les BAC nuit et la CSI Paris comprennent donc des fonctionnaires que nous formons, à qui nous confions la mission d’arriver avant nous — sous notre contrôle opérationnel, en quelque sorte. Nous avons ainsi, il y a une quinzaine de jours, réalisé un exercice de nuit au Bon Marché, exercice au cours duquel la BAC nuit était censée arriver avant nous qui, ensuite, mettions en œuvre l’interopérabilité.
M. Olivier Falorni. Tous les policiers de la BAC nuit sont-ils susceptibles d’intervenir ou bien seulement des volontaires ?
M. Christophe Molmy. Tous les fonctionnaires de la BAC nuit et de la CSI sont formés et de façon continue, plusieurs fois par an — c’était d’ailleurs le cas du commissaire dont il a été question. Ce sont des formateurs de la BRI qui vont, la nuit, former les fonctionnaires de la BAC nuit.
Leur première mission consiste à se rendre immédiatement sur le lieu de crise et soit, en présence de tirs, ils pénètrent dans les locaux et, grâce aux techniques que nous leur enseignons, ils font cesser la crise en tuant le terroriste, soit les tirs ont cessé et ils figent la situation en attendant que nous arrivions et que nous passions devant. Leur deuxième mission, lorsque nous travaillons, ensuite, à la résolution de la crise, consiste à assurer notre protection. Il est arrivé, en Syrie, que des soldats soient attaqués par-derrière alors qu’ils étaient en train de traiter une crise — ce qu’on peut imaginer dans le contexte du Bataclan : nous sommes en train de travailler à l’intérieur alors que deux personnes entrent pour nous tirer dans le dos. Leur troisième mission est de prendre en compte les otages quand ils sortent — ce qui a été fait au Bataclan. Enfin, dernière mission, ils assurent avec nous ce que nous appelons la reprise : quand la crise est terminée, que les terroristes sont neutralisés, il faut s’assurer que l’un d’eux n’est pas caché dans un recoin. Cette dernière opération va très vite à l’Hypercacher de Vincennes qui est petit et n’a qu’un petit sous-sol ; elle est plus longue au Bataclan puisqu’elle a pris une heure — et imaginez une crise au quinzième étage de la tour Montparnasse : la reprise nous obligerait à vérifier tous les étages. Pour cela, nous avons besoin de fonctionnaires qui intègrent nos colonnes et avec lesquels nous nous entraînons, fonctionnaires qui font intégralement partie du dispositif prévu pour ce second périmètre.
Le troisième périmètre de la BRI est composé des services concourant à l’action et qui sont moins impliqués dans la partie opérationnelle : il s’agit des pilotes d’hélicoptères, de bateaux, de la direction opérationnelle des services techniques et logistiques (DOSTL) qui nous fournit les moyens de mettre en place la bulle tactique – échanges data, vidéo, radio.
La BRI, dans ces conditions, compte théoriquement un peu plus de 300 fonctionnaires — pour mémoire, à la porte de Vincennes, nous étions 148 et un peu moins d’une centaine au Bataclan.
M. Olivier Falorni. Qui donne à ce commissaire l’ordre d’intervenir ? Et de quel armement disposait-il ?
M. Christophe Molmy. Peut-être n’ai-je pas été assez précis. Nous les formons pour cela : ils ont une mission continuelle qui consiste à se porter en premier sur les lieux d’une crise afin, si possible, de la circonscrire immédiatement en affrontant le terroriste — ce qu’a fait ce commissaire, puisque je crois avoir compris qu’il y avait des tirs lorsqu’il est arrivé ; il a donc fait son travail en faisant cesser la crise et je pense que c’est lui qui a fait cesser les tirs et le massacre ; ensuite, il s’arrête et il ne progresse pas dans les étages, car, j’y insiste, il est formé pour cela. Quant à l’équipement de ces fonctionnaires, je crois qu’ils disposent de fusils à pompe, d’armes de poing et je crois savoir qu’ils vont recevoir davantage de matériel, ce qui est plutôt une bonne chose. Ils ont, je le répète, une mission permanente.
Mme Françoise Dumas. Je poserai également cette question à chacun de vos collègues que nous auditionnerons : lorsque vous arrivez sur place, avez-vous déjà eu des contacts avec la presse ? La presse vous a-t-elle, d’une certaine manière, empêchés dans vos missions ? Avez-vous eu cet élément à « gérer » en plus de toutes les autres tâches que vous avez assumées avec beaucoup de courage et de sang-froid ?
M. Christophe Molmy. Non. Nous n’allons pas nous mentir : nous avons tous des contacts avec des journalistes ; après plus de vingt ans de police, certains ont mon numéro de téléphone, bien sûr. Mais, dans un cas comme celui-ci, je n’ai pas touché mon téléphone à partir du moment où j’ai mis le pied au Bataclan. En sortant, je devais avoir reçu quelque quatre-vingts textos et une centaine d’appels en absence. Les journalistes ne nous ont pas du tout embarrassés. Cela dit, la communication de crise est un sujet en soi, un peu lourd et que nous ne traiterons pas aujourd’hui.
Mme Françoise Dumas. Quand je disais « vous », ce n’était pas vous personnellement ; mais des journalistes étaient-ils déjà présents sur les lieux et, si oui, avez-vous été entravés par eux ?
M. Christophe Molmy. Non.
M. Olivier Marleix. Les patrons du RAID et du GIGN, hier, nous ont longuement entretenus des nouveaux schémas d’intervention liés à l’évolution des phénomènes terroristes auxquels vous êtes confrontés, notamment le djihadisme. Si je résume : on engage les forces au fur et à mesure, sans attendre la mise en place d’un dispositif complet, on ne négocie pas…
M. Christophe Molmy. Permettez-moi de vous interrompre sur ce point important : il est faux qu’il n’y ait pas de négociations. On ne peut pas, dans le cas d’une crise majeure, obérer l’hypothèse d’un contact avec le terroriste afin qu’il libère les otages avant de passer à l’assaut. Ce serait une faute.
M. Olivier Marleix. Je schématisais évidemment leurs propos.
M. le rapporteur. Olivier Marleix n’est pas si schématique : et les représentants du GIGN et ceux du RAID nous ont expliqué que, depuis l’affaire Merah, il n’était plus question de négociation, mais de prises de contact pour obtenir des informations afin de mesurer la détermination du terroriste. Et, en dernier ressort, on tâche de contacter le terroriste pour le fixer avant d’intervenir. Quoi qu’il en soit, selon les personnes auditionnées, il n’était plus question de négociations en vue de la libération des otages.
M. le président Georges Fenech. Dans votre rapport, vous indiquez qu’à 23 h 27, 23 h 29, 23 h 48, 0 h 5 et 0 h 18, le négociateur de la BRI entrait en contact avec eux. Donc il y a eu des négociations…
M. Christophe Molmy. C’est bien ce que je dis, oui.
M. le président Georges Fenech. … entre un négociateur de la BRI et les terroristes.
M. Christophe Molmy. Comme à la porte de Vincennes.
M. le président Georges Fenech. Pour compléter l’information : dans les rapports, notamment du RAID, à aucun moment il n’est fait état de négociations.
M. Christophe Molmy. Il n’y a pas de dissonance. Je rappelle que l’Hypercacher, à la porte de Vincennes, comme le Bataclan, relève de la compétence de la BRI. Il est donc tout à fait naturel que, la BRI étant force menante, ce soit son négociateur qui entre en contact avec les terroristes, ce qui fut donc le cas à la porte de Vincennes et au Bataclan.
M. le président Georges Fenech. Il y a donc eu des négociations ?
M. Christophe Molmy. Bien sûr. Après, on joue sur les mots : quand je considère que c’est une faute de ne pas engager de négociation, vous me répondez qu’il ne s’agit pas tout à fait d’une négociation, mais d’une prise de contact. Certes. Dans les faits, ce qui n’est pas envisageable, c’est de ne pas faire l’effort d’entrer en contact avec des terroristes, c’est de refuser de leur parler en se disant que cela ne servira à rien et qu’il vaut donc mieux passer tout de suite à l’assaut. Voilà qui serait une faute.
Nous sommes face à des gens radicalisés et nous savons avoir une infime chance d’obtenir d’eux la libération d’otages et encore moins leur reddition. Malgré tout, ce serait une erreur de ne pas essayer ; en effet, nous avons obtenu des informations d’Israéliens et de militaires qui revenaient de Syrie nous indiquant que, même si cela était rare, certains terroristes se ravisaient. Ainsi, je ne prendrais pas la responsabilité de passer à l’assaut sans me donner cette chance. D’ailleurs, fin 2014, avant les attentats de janvier 2015, nous avions fait former le négociateur de la BRI spécifiquement sur la question de l’islam radical par des intervenants extérieurs à la police et par des membres des services de renseignement, voire par des personnes versées dans la religion, de manière à essayer de comprendre quel pouvait être l’état d’esprit des terroristes, à maîtriser un certain vocabulaire pour pouvoir discuter avec eux.
Parlons clairement, et sous le sceau de la confidentialité : au Bataclan, après le deuxième coup de téléphone, mon négociateur me rend compte du fait qu’il n’arrivera à rien, qu’il n’y aura pas de négociation dans le sens où il n’y aura pas de libération d’otages ni de reddition, et les trois derniers appels…
M. le rapporteur. Le négociateur se trouve au PC ?
M. Christophe Molmy. Il est au PC, oui. Les trois derniers appels ne sont pas destinés à faire libérer les otages, mais à nous faire gagner du temps, à prendre la mesure de la situation. Nous sommes parfois déstabilisés : le négociateur est à l’initiative du premier coup de téléphone alors que les autres viennent des terroristes.
M. le rapporteur. Pour quelle raison ?
M. Christophe Molmy. Je pense qu’ils veulent entrer en contact avec le négociateur. Après les événements, celui-ci m’a dit que, autant Amedy Coulibaly était très froid, très posé, très construit dans ses propos — il était résolu à mourir et tenait un discours sur le califat —, autant, au Bataclan, il lui paraissait que nous avions affaire à des gens plus jeunes, beaucoup plus instables, incontrôlables. Du reste, dès le deuxième coup de téléphone, il m’a confié que nous n’arriverions pas à les tenir et qu’il nous fallait être sur nos gardes, car la situation pourrait déraper. Je suis donc sorti de la colonne pour me rapprocher du préfet de police et de mon directeur afin de leur en rendre compte et de requérir l’autorisation de passer à l’assaut, autorisation qui m’a été donnée.
M. le rapporteur. Vous ressortez du Bataclan ?
M. Christophe Molmy. Oui, je l’assume, car je considère que certaines décisions doivent être prises de visu : il est nécessaire de se parler et j’ai besoin de rendre compte physiquement. Comme nous n’étions pas loin les uns des autres, j’ai trouvé que c’était la meilleure solution.
M. Alain Marsaud. Comment obtenez-vous le numéro de téléphone des terroristes, et comment ont-ils eu le vôtre ?
M. Christophe Molmy. En l’occurrence, les premiers contacts avec les terroristes se font par le truchement d’un otage qui est assis derrière la porte et à qui ils demandent de nous dire de nous en aller. Leur revendication est en effet que nous partions. Nous leur expliquons évidemment que nous ne pouvons pas. En outre, à plusieurs reprises, ils s’enquièrent de savoir si les chaînes d’information continue sont présentes, sans toutefois demander à leur parler. J’ai considéré qu’il y avait un risque qu’ils attendent d’être en direct à la télévision pour se faire sauter.
M. le rapporteur. Ils ont voulu durer un peu !
M. Christophe Molmy. Je ne sais pas s’ils ont voulu « durer », mais j’ai craint qu’ils ne cherchent à avoir une tribune médiatique pour se faire sauter afin que les images fassent le tour du monde. Manifestement, ils ne cherchaient pas à nous affronter : ils savaient que nous étions là et sont demeurés cachés à l’étage pendant une heure, alors qu’ils auraient pu rester dans le hall du Bataclan et nous faire face. Je ne sais pas dans quelles conditions nous aurions eu le dessus ; nous l’aurions eu, mais nous aurions pu déplorer des morts de notre côté. Ils sont donc montés à l’étage et se sont cachés pendant une heure, sans un bruit, demandant aux otages de se taire et, ensuite, ils nous ont demandé de partir. Lorsque nous avons lancé l’assaut, ils ont reculé.
M. Alain Marsaud. Je reviens à ma question : comment peuvent-ils vous téléphoner ?
M. Christophe Molmy. Ils demandent à un otage de communiquer. Comme nous n’entendons pas bien, nous demandons un numéro de téléphone, et ce sont plusieurs otages qui hurlent un numéro que nous communiquons au négociateur. C’est le coup de téléphone du négociateur à ce numéro qui est le premier contact avec les terroristes, lesquels l’ont rappelé ensuite à plusieurs reprises.
M. Olivier Marleix. Le patron du GIGN et le patron du RAID nous ont décrit une inflexion forte dans leurs schémas d’intervention. La BRI a-t-elle connu les mêmes évolutions et comment estimez-vous les avoir appliquées au cours du drame du Bataclan ? Êtes-vous allés plus vite, moins vite que vous ne seriez allés autrefois — sans sous-estimer la difficulté de votre mission ?
M. Christophe Molmy. Comme je vous l’indiquais tout à l’heure, il y a eu plusieurs étapes : à la fin de 2014, malgré la réactivité commune à tous les groupes d’intervention, nous avons pris la mesure du fait qu’il nous fallait une demi-heure, quelle que soit l’heure, pour partir en colonnes : c’était peu, mais encore trop long. C’est pourquoi nous avons doublé l’astreinte, puis, au début de 2015, créé cette Force d’intervention rapide qui, au fil des mois, s’est affinée et a disposé de davantage de moyens. Je note que, à la porte de Vincennes, Coulibaly entre à treize heures dans l’Hypercacher et que les premières colonnes de la BRI sont présentes à 13 h 20. Nous allons donc plus vite qu’auparavant.
Après l’épisode de la porte de Vincennes, nous avons considéré qu’il fallait encore renforcer le dispositif. Nous l’avons fait et c’est pourquoi nous sommes arrivés en un peu plus de vingt minutes au Bataclan, ce qui, pour un groupe d’intervention, me semble très rapide.
Nous avons mené une réflexion plus large sur le contre-terrorisme et en particulier, donc, sur la rapidité d’intervention, mais aussi sur la formation et la spécialisation des négociateurs, sur la communication de crise – sujet très vaste et loin d’être épuisé – et, question importante, sur la spécialisation technique, la bulle tactique, c’est-à-dire les moyens dont nous disposons pour échanger des données data, vidéo, radio, dans un environnement Wi-Fi et 4G sur place, quand nous montons un PC — étant entendu qu’un PC efficient, en la matière, implique une crise qui dure un peu, car les moyens mobilisés sont très lourds : on ne les monte pas en dix minutes.
Nous avons poursuivi nos réflexions après les événements du Bataclan. Pour ce qui concerne la coordination, un schéma national d’intervention, sur lequel nous avons tous travaillé, va être signé par le ministre, ce qui me semble une bonne chose. Cela ne signifie pas qu’il n’y avait aucune coordination auparavant, mais que nous nous adaptons aux événements. Je crois utile de rappeler, en effet, que, depuis le milieu des années 1990, la France n’avait pas été frappée de cette manière par des attentats. Nous étions évidemment en mesure d’intervenir et les services étaient déjà coordonnés, mais il était peut-être nécessaire d’aller plus loin dans l’articulation entre eux, tout au moins pour la plaque parisienne.
M. Olivier Marleix. Ma question portait sur la scène de crime elle-même. Un de nos interlocuteurs, que je résume, a déclaré que l’on n’attendait pas forcément que tout soit bien sécurisé, mais qu’il fallait avancer au plus vite. Sur le site lui-même, d’un point de vue technique, allez-vous plus vite ?
M. Christophe Molmy. Comme je vous l’ai dit peut-être maladroitement, la Force d’intervention rapide se compose de fonctionnaires plus légèrement équipés. Les gilets qu’ils portent sont lourds, mais pas autant que ceux prévus pour le passage à l’assaut ; leurs casques sont blindés, mais ne comportent pas de visière afin de pouvoir courir. Ces fonctionnaires sont géolocalisés pour que nous puissions leur demander de se déplacer dans Paris — de former une nasse si des tireurs circulent à scooter, par exemple. Plus rapides, ils sont moins protégés ; plus vous êtes véloces, plus vous êtes vulnérables. Ainsi, si vous voulez aller très vite, il faut poser les boucliers — c’est donc une affaire de choix. Ensuite, il ne faut pas confondre vitesse et précipitation.
Il existe deux situations différentes, techniquement, pour les trois groupes d’intervention. On déclenche soit un plan d’action d’urgence (PAU) si des tirs sont en cours, des vies en jeu, des personnes abattues ; dans ce cas de figure, nous entrons et faisons ce que nous pouvons ; nous affrontons immédiatement les terroristes avec les moyens et les hommes dont nous disposons. Soit, dans l’hypothèse d’une absence de tirs, on applique un plan d’action élaboré (PAE) qui consiste à définir une tactique d’intervention et à la soumettre à l’autorité politique ou, à tout le moins, au préfet de police de Paris qui la valide — ce qui a été le cas pour le Bataclan puisqu’il m’a donné l’autorisation de passer à l’assaut. Reste que, si nous sommes bien entrés au Bataclan, si nous n’avons pas marqué le pas, nous ne sommes pas pour autant entrés en courant et à 150, ce qui aurait été une faute, en termes de sécurité, tant pour les gens à l’intérieur que pour les services de sécurité, voire pour mes collaborateurs. Il faut donc apprécier la situation qui est toujours singulière : entrer au Bataclan, ce n’est pas entrer dans l’Hypercacher, ni au Bon Marché où nous avons réalisé un exercice il y a quelques semaines.
M. le président Georges Fenech. Aviez-vous les plans du Bataclan ?
M. Christophe Molmy. Nous n’avions pas les plans du Bataclan sur nous. Nous n’avons pas tous les plans avec nous quand nous nous déplaçons. Sur place, nous avons immédiatement récupéré les plans établis pour les pompiers par la commission de sécurité et qui étaient accrochés aux murs et d’où nous les avons arrachés. Nous disposions donc d’un plan de masse. Lorsque mon adjoint est arrivé avec l’ensemble de la BRI, il a récupéré l’ensemble des plans du Bataclan qui étaient à disposition au PC. Je vous avoue que, à ce moment, nous avions déjà beaucoup progressé et que ces plans de masse nous permettaient au moins de nous orienter — et puis, malgré quelques recoins, ce n’était pas si grand… Nous avons donc su nous organiser avec ces plans.
M. le président Georges Fenech. Vous avez donc eu les plans par le PC ?
M. Christophe Molmy. Non, j’ai dû mal formuler ma réponse : je vous ai dit que, à l’intérieur du Bataclan, nous avions arraché les plans de masse…
M. le président Georges Fenech. Mais ensuite vous avez eu les plans dont disposait le PC ?
M. Christophe Molmy. Un des responsables du Bataclan s’est rendu au PC pour donner à mes collaborateurs l’ensemble des plans de masse, mais ceux-ci n’ont pas été utilisés, puisque nous nous trouvions déjà devant la porte dont nous savions qu’elle donnait sur un couloir — celui-là même dans lequel nous avons affronté les terroristes.
Pour répondre plus précisément à votre question, il faut apprécier le volume, le nombre de fonctionnaires, la situation… Je pense humblement que vingt minutes pour faire sortir l’ensemble des personnes qui étaient allongées au sol au Bataclan et pour s’assurer qu’il n’y avait pas de terroristes ou d’explosifs, c’est assez rapide. Je me souviens d’avoir vu des otages sortir des faux-plafonds, d’avoir ouvert des toilettes classiques où dix personnes étaient entassées. Dans une telle situation, on ne peut pas leur demander de se précipiter dehors : il faut leur parler calmement, les faire sortir un par un, soulever le tee-shirt de chacun, les accompagner en leur demandant de ne pas regarder par terre — parce qu’il y a des corps partout. Cela prend beaucoup de temps, plus peut-être que l’on ne peut imaginer.
M. Alain Marsaud. Visiblement, un des terroristes a essayé de se faire passer pour un membre des forces de l’ordre. Tous vos hommes, y compris les premiers intervenants parmi les quinze, sont-ils déjà en uniforme au moment d’intervenir ou bien sont-ils en civil et enfilent-ils alors un gilet pare-balles ?
M. Christophe Molmy. Non. Comme je vous l’indiquais tout à l’heure, les hommes de la FIR partent en tenue noire avec un gilet tactique et la mention « BRI anti-commando » inscrite en gros dans le dos.
M. Alain Marsaud. Le commissaire de la BAC qui est intervenu était-il lui aussi en uniforme ?
M. Christophe Molmy. Non, je ne crois pas, ou peut-être en tenue de la BAC…
M. Alain Marsaud. Avez-vous un seul négociateur ou un négociateur par contexte ? Est-ce un policier ? Quelle est sa formation ?
M. Christophe Molmy. Nous avons sept négociateurs au sein du service. Ils reçoivent une formation spécifique, commune avec le RAID, et, auprès d’eux, se trouve une psychologue. Un des sept est de permanence chaque semaine, sans compter la permanence H+30…
M. Alain Marsaud. Le négociateur n’est pas un homme d’action ?
M. Christophe Molmy. Si. Le négociateur, au Bataclan, était à la fois chef d’état-major et chef des négociateurs. C’est un ancien chef de groupe qui a servi au sein des colonnes. À la BRI, nous avons fait le choix de la transversalité : de nombreux fonctionnaires ont plusieurs casquettes : ils peuvent être tireurs d’élite et membres des colonnes, négociateurs et spécialistes en varappe… Changer de casquette n’est pas inutile puisqu’ils ont ainsi plus de latitude sur leur intervention.
M. Philippe Goujon. Si nous faisons un peu de prospective, nous pouvons redouter des attentats multisites beaucoup plus nombreux dans Paris. En effet, vous êtes intervenus sur un site unique, le Bataclan. Mais imaginons une quinzaine d’attentats simultanés dans différents endroits de Paris. Vous vous heurterez à un premier obstacle : vous avez en effet évoqué votre difficulté à vous rendre sur les lieux en véhicule. Et je rappelle au passage que, à partir du mois d’août, la voie express de la rive droite sera définitivement fermée à la circulation automobile — nous avons d’ailleurs interrogé à ce sujet le ministre de l’intérieur, hier, lors de la séance des questions au Gouvernement, ainsi que le préfet de police qui nous a reçus. Qu’en est-il donc de la perspective d’attentats multisites dans Paris ?
Ensuite, vous nous dites que, arrivés au Bataclan, vous avez été amenés à arracher les plans des murs pour savoir comment progresser. N’y a-t-il pas d’autres méthodes ? La Brigade des sapeurs-pompiers possède les plans de multiples établissements, certains services de la préfecture de police également, la Ville de Paris dispose de ceux des établissements scolaires. Tout cela n’est-il pas informatisé et susceptible d’être mis à votre disposition ?
Quid, pour finir, d’un éventuel entraînement commun entre les forces de police et la brigade des sapeurs-pompiers ou avec les militaires de l’opération Sentinelle ? Ces derniers sont tout de même plusieurs milliers dans la région parisienne et, si leur métier est certes différent du vôtre, en cas de crise de cette nature, avez-vous des exercices communs ou une possibilité d’action commune ?
M. Christophe Molmy. Nous nous préparons, bien sûr, à l’éventualité d’attentats multisites ; nous nous préparons au plus grand nombre de scénarios possibles.
Comme je vous le disais, il me semble que les choses sont bien organisées. La coordination des forces comprend plusieurs échelons. En premier lieu, la BRI est compétente à Paris intra-muros avec un effectif de 300 personnes, dont 80 pour l’assaut — nous disposons donc de moyens. Nous nous projetons et voyons si nous sommes en mesure de traiter une ou deux crises ; nous menons à cet effet des exercices afin de déterminer un seuil de saturation. Si nous étions confrontés à deux crises similaires à celle du Bataclan, dans l’urgence, si nous n’avions pas le choix, nous pourrions essayer de nous scinder en deux et de traiter les deux. Nous étions environ 70 prêts à donner l’assaut au Bataclan. Or une dizaine seulement ont été mobilisés. Nous pouvons donc faire face à deux crises, mais la sagesse, bien sûr, consisterait d’abord à demander leur renfort au RAID puis au GIGN qui prendraient en charge d’autres sites. Nous devons néanmoins rester une garde prétorienne et être capables de traiter plusieurs sites, puisque le RAID et le GIGN peuvent être engagés ailleurs sur le territoire national.
Naturellement, nous n’avons aucune susceptibilité à demander du renfort — ce qui est prévu dans le protocole RAID-BRI. Plusieurs scénarios sont prévus : soit celui de la modularité — nous ne demandons que des moyens, s’il me manque des artificiers ou une colonne d’assaut ; j’ai ainsi demandé, il y a deux semaines, deux tireurs d’élite au RAID — ; soit celui de la complémentarité — modalité que nous avons appliquée au Bataclan puisque, comme nos collègues se sont portés en renfort, nous les avons intégrés au dispositif, ce qui a très bien fonctionné — ; soit celui de la subsidiarité — aux termes duquel nous confions au RAID ou au GIGN une crise à traiter seuls.
Au sein de la police, la FIPN peut être activée par les autorités et par le ministre. Dès lors, comme à la porte de Vincennes, nous sommes tous sous l’égide du même étendard et, comme nous savons travailler ensemble, le système fonctionne. Le GIGN peut, de son côté, être amené à nous renforcer, ce qui est précisé dans le schéma national d’intervention.
Je ne voudrais pas que vous craigniez qu’il n’y ait pas d’interopérabilité, en particulier avec le RAID. Je crois utile de rappeler que l’intégralité des intervenants du RAID et de la BRI participent à une même formation initiale de quatre mois dispensée par la FIPN. Ensuite, nous organisons des rencontres et, sous l’égide de l’UCOFI, des exercices communs, certes pas toutes les semaines, car ils sont très lourds à monter, soit avec le GIGN et le RAID, soit avec l’ensemble des forces.
Nous pouvons toujours être débordés et il est difficile de ne pas surréagir. Je reviens à l’attentat au Stade de France : ma responsabilité est également de ne pas partir trop vite — nos déplacements doivent être efficients — et il faut éviter de faire partir les collègues sans arrêt. Depuis novembre, si je les avais projetés chaque fois qu’on craignait quelque chose, nous n’aurions pas cessé. Nous nous sommes déplacés deux ou trois fois dans le quartier de la Goutte d’Or ; à la suite d’une explosion dans une école du 16e arrondissement, par précaution, nous avons envoyé les hommes de la FIR — et nous sommes arrivés en douze minutes —, mais on ne peut pas les envoyer chaque fois. Il faut prendre un peu de distance et se demander s’il s’agit d’un attentat ou d’une crise avec prise d’otages justifiant l’emploi d’une force d’intervention.
En ce qui concerne les sapeurs-pompiers, nous sommes étroitement liés à eux. Les médecins qui se trouvent avec nous dans les colonnes sont des médecins des sapeurs-pompiers. Nous avons chaque semaine un de ces médecins en permanence avec nous et deux lors des crises : le premier part avec la FIR et le second nous rejoint. Nous organisons des exercices avec eux. Dernièrement, nous nous sommes penchés sur l’hypothèse d’une intervention en « milieu feu », c’est-à-dire dans un immeuble en flammes dans lequel se trouveraient des terroristes détenant des otages. Il s’agissait de savoir si les pompiers devaient éteindre le feu pendant notre intervention ou si nous disposions du matériel nécessaire pour le faire nous-mêmes, pour peu que nous soyons formés. C’est ce dernier choix que nous avons fait avec la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris (BSPP), laquelle va nous familiariser avec le matériel et nous former. Le GIGN a la même approche.
Pour ce qui est des plans, nous n’avions pas ceux du Bataclan, n’ayant pas travaillé en amont sur ce site. Bien que la BRI dispose de très nombreux plans, elle n’a pas l’intégralité de ceux des salles de spectacle. Nous avons des dossiers d’objectifs, constitués au cours des années passées : ils n’ont pas tous été informatisés et nous sommes en train de les actualiser. Nous nous sommes récemment dotés d’un logiciel nous permettant non seulement de récupérer les plans de sites, mais d’y réaliser des repérages vidéo et photo qui nous seront très utiles si une prise d’otages s’y déroule. Nous procédons ainsi pour des sites majeurs, touristiques, étatiques, administratifs, mais aussi pour les grands bâtiments et les grandes entreprises. Reste que nous ne pouvons le faire pour l’intégralité de Paris.
Nous nous sommes rapprochés de la BSPP pour pouvoir récupérer les plans dont elle dispose. Nous cherchons à faire en sorte que la bulle tactique, in situ, lorsque nous montons un PC, nous donne accès à toutes ces données, tout en tenant compte des exigences de sécurité que nous imposent les administrations — nous avons trouvé un système qui nous le permet. Enfin, l’utilité d’un plan est à la mesure des lieux : plus un site est petit, moins son plan est susceptible de servir, alors que, si nous devions intervenir à Beaugrenelle, le site est si gigantesque que nous en aurions besoin. Quant au Bataclan, le site est grand, mais nous avons vite pris la mesure des lieux.
Je réponds, pour finir, à la question relative à nos éventuelles relations avec les soldats de l’opération Sentinelle. Nous les connaissons bien ; nous avons de nombreux contacts avec les militaires. Nous sommes allés la semaine dernière dans leur centre d’entraînement aux actions en zone urbaine (CENZUB), dans l’Aisne. Nous nous rapprochons par ailleurs du commandement des opérations spéciales (COS). Mais nous n’avons pas évoqué cette approche d’interopérabilité avec les militaires qui peuvent se trouver sur place. S’ils étaient amenés à intervenir, ils passeraient derrière nous une fois que nous serions arrivés.
M. Serge Grouard. Nous allons revenir ensuite, j’imagine, sur l’assaut final…
M. le président Georges Fenech. Non, nous n’aurons pas le temps, même s’il est bien légitime que nous ayons de nombreuses questions à poser.
Nous avons décidé avec le rapporteur de vous demander de bien vouloir vous présenter le 17 mars à 9 h 30 au Bataclan, où nous serons nous-mêmes. Sur place, nous pourrons avoir une meilleure idée de votre intervention et de sa chronologie.
M. Christophe Molmy. Très bien.
M. le président Georges Fenech. Nous pourrons ainsi aborder la question que voulait poser M. Grouard. En êtes-vous d’accord, monsieur le commissaire divisionnaire ?
M. Christophe Molmy. Je suis à votre service.
M. Serge Grouard. On voit bien la très grande difficulté de l’intervention au Bataclan ; on imagine bien les effets psychologiques y compris sur les fonctionnaires de police — or on n’en parle pas et je souhaite que nous l’évoquions un peu, que vous nous disiez très franchement, très simplement si, parmi les fonctionnaires placés sous votre responsabilité, certains sont marqués par ce qu’ils ont vu, par ce qui s’est passé à l’intérieur du Bataclan. L’armée, on le sait, rencontre ce genre de problème psychologique : est-ce le cas pour vos hommes ?
Ensuite, vous avez évoqué des scénarios de crises futures. Avez-vous des équipements NRBC (Nucléaire, radiologique, biologique et chimique) pour intervenir ?
M. Christophe Molmy. Oui, nous avons été marqués par l’intervention. J’ai peine à croire qu’on puisse vivre une situation pareille sans en garder de traces. Je n’avais jamais vu un charnier de 90 personnes et mes collègues non plus. Cela a été difficile, mais pas tant dans le traitement de la crise, car nous agissons en fonction de mécanismes automatiques et, tout à la résolution de celle-ci, mobilisés par notre action, nous parvenons à occulter autant que possible ce que nous avons sous les yeux. Le plus dur est évidemment après. La BRI a des contacts avec les militaires, que nous avons rencontrés par le biais du gouverneur militaire de Paris qui nous a aidés en la matière. Nous avons fait du defusing au cours de séances avec des psychologues. Jusqu’à présent, je n’ai enregistré aucune défection et je pense qu’il n’y a pas un seul de mes collaborateurs qui ne serait plus capable d’intervenir. Les semaines qui ont suivi ont été un peu difficiles, certes. Mais ils ne sont pas non plus dans un esprit de revanche. Ils restent professionnels et ont repris leurs marques. Reste que nous avons tous été bouleversés, bien sûr.
En ce qui concerne l’équipement NRBC, le risque d’être confronté à une attaque nucléaire ou radioactive dans Paris intra-muros est plus qu’infinitésimal et, le matériel qu’elle impliquerait étant très onéreux, la coordination s’imposerait et je n’aurais aucune susceptibilité à faire intervenir le RAID ou le GIGN — ce dernier disposant de scaphandres qui lui permettent d’intervenir dans les centrales nucléaires. En ce qui concerne une attaque biologique ou chimique, nous possédons du matériel — notamment des appareils respiratoires isolants (ARI) que nous prévoyons de renouveler en achetant une nouvelle génération. Nous avons réalisé un exercice dans le métro suivant un scénario d’attaque chimique. Nous serions en tout cas capables d’intervenir — c’est un sujet sur lequel nous travaillons.
La moitié de mes effectifs est mobilisée par l’intervention et l’autre moitié par l’activité judiciaire. Ils tournent par semaine de façon à rester polyvalents. Chaque semaine, mes collègues s’entraînent et nous essayons de multiplier les scénarios, que ce soit sur les bateaux-mouches, dans le métro, dans des centres commerciaux, dans des gares, dans la rue. Nous tâchons d’envisager un maximum de projections et le NRBC en fait partie.
M. le rapporteur. Dans le document portant sur le déroulement des événements, communiqué lors de l’audition, hier, par le directeur du GIGN, il est précisé qu’à 23 h 08, une information est envoyée au centre opérationnel du groupement 86 par le père d’une victime avisé par texto qu’un des terroristes se trouvait dans les loges du Bataclan et voulait négocier avec la police. À 0 h 18, un autre message précise : « Je suis au premier étage au Bataclan, blessés graves, etc. ». Ces informations et d’autres sont arrivées par divers canaux aux brigades de gendarmerie. Il en est allé de même, je suppose, avec la police par le biais du 17. Ces informations, susceptibles de vous être utiles, vous étaient-elles communiquées en temps réel ? Vous indiquiez que, à vingt-trois heures, quand vous commenciez à progresser, vous ne saviez pas s’il y avait encore des terroristes au Bataclan, et que vous en doutiez même. Aviez-vous des contacts avec l’extérieur à même de vous communiquer ces informations ?
M. Christophe Molmy. Je ne sais pas trop quelles informations les gendarmes ont obtenues ; en tout cas, nombreuses sont celles arrivées à la préfecture de police, soit directement par les fonctionnaires de police ou via les états-majors. La majeure partie d’entre elles ont été dirigées vers l’état-major, notamment, ensuite, vers le PC-BRI. Il leur revient de faire le tri et de ne me communiquer que les informations utiles, opérationnelles — à savoir celles qui peuvent influer sur l’opération elle-même.
M. le rapporteur. L’information selon laquelle un terroriste se trouve dans les loges, en haut, est forcément utile…
M. Christophe Molmy. Je ne me souviens pas que celle-ci me soit parvenue. En revanche, je sais que, juste avant l’assaut, on m’avise qu’un otage serait en train de tweeter qu’il y a des échanges de coups de feu et que des otages sont en train d’être abattus ; or nous sommes derrière la porte et nous n’entendons pas de coups de feu. De nombreuses informations sont arrivées, ont été triées par le PC et certaines me sont parvenues, sans doute pas toutes.
M. le rapporteur. Vous sont-elles envoyées par le PC opérationnel que vous avez mis en place ou par une salle de crise à la préfecture de police ?
M. Christophe Molmy. Je ne peux pas vous parler de la salle de crise de la préfecture de police : je n’y étais pas et elle ne relève pas de ma responsabilité…
M. le rapporteur. J’imagine qu’un certain nombre d’otages encore présents au Bataclan appelaient automatiquement le 17 — nous avons eu à ce sujet le témoignage de plusieurs victimes.
M. Christophe Molmy. Je pense au 17 mais aussi à des fonctionnaires de police de leur connaissance. Les informations parvenaient de partout et par tous les moyens.
M. le rapporteur. Les informations traitées que vous jugez utiles, opérationnelles, provenaient, dites-vous, de la police ; vous n’avez pas forcément obtenu d’informations de la part de la gendarmerie ou bien…
M. Christophe Molmy. Je n’ai pas dit cela !
M. le rapporteur. …vous ne savez pas comment a été opéré le tri.
M. Christophe Molmy. Je ne sais pas du tout de quelle manière le tri s’est opéré à l’état-major de la préfecture de police de Paris. Je peux vous parler de mon PC : lorsque les informations y arrivaient, elles étaient triées et certaines me sont arrivées.
M. le président Georges Fenech. Je reviens sur une contradiction qu’il faut résoudre : pouvez-vous nous faire parvenir, d’ici au 17 mars prochain, la liste des fonctionnaires de la BRI de Paris présents au début de l’intervention au Bataclan ?
M. Christophe Molmy. Je vous enverrai la liste des quinze, bien sûr.
M. le président Georges Fenech. Ainsi nous lèverons toute ambiguïté.
M. Christophe Molmy. Pour moi, il n’y en a pas, mais je n’ai aucune difficulté à vous communiquer la liste.
M. le président Georges Fenech. Pour nous, il y a ambiguïté, puisque nous avons deux positions différentes exprimées sous serment.
Je relève, dans votre rapport, que vous faites état à deux reprises du PC avancé : à un endroit, vous écrivez que le PC avancé de la BRI est implanté au rez-de-chaussée, sommes-nous bien d’accord ?
M. Christophe Molmy. Le PC avancé, oui.
M. le président Georges Fenech. Et vous écrivez également que tous les numéros de contact de ces personnes étaient retransmis au PC-BRI sur le site du Bataclan.
M. Christophe Molmy. S’agit-il bien de mon rapport ?
M. le président Georges Fenech. Oui.
M. Christophe Molmy. Je crois qu’il s’agit plutôt du document final de la direction régionale de la police judiciaire (DRPJ).
M. le président Georges Fenech. Ce sont les éléments de réponse de la DRPJ.
M. Christophe Molmy. Peut-être y a-t-il une litote.
M. le président Georges Fenech. Je souhaite que vous soyez bien clair sur ce point.
M. Christophe Molmy. Le PC avancé, c’est mon adjoint et moi-même et les officiers chefs de colonne ; nous sommes les uns auprès des autres, les pieds dans le Bataclan. Le PC avancé est plus qu’opérationnel : c’est là où nous prenons les décisions.
M. le président Georges Fenech. Je me suis renseigné sur ce qu’était un PC avancé : il s’agit d’un poste de commandement, une structure sous tonnelle…
M. Christophe Molmy. Non. Il s’agit peut-être d’un abus de langage de notre part, monsieur le président, mais, pour nous, un PC avancé, ce sont les autorités, ceux qui prennent les décisions et qui sont les uns auprès des autres, ce qui est le cas lorsque…
M. le président Georges Fenech. On a du mal à imaginer un PC avancé avec les autorités qui le constituent au milieu des cadavres et des blessés.
M. Christophe Molmy. C’est peut-être un abus de langage de notre part. Considérons dès lors qu’il s’agit de fréquentes réunions informelles des décideurs sur place : nous nous voyons et nous nous parlons.
M. le président Georges Fenech. Où se trouve exactement le PC avancé ?
M. Christophe Molmy. Dans le Bataclan.
M. le président Georges Fenech. Vous faites la distinction entre le PC-BRI et le PC avancé qui, lui, est dans le Bataclan.
M. Christophe Molmy. Oui, je fais aussi la distinction avec le PC de négociation et le PC de coordination avec les autres unités.
M. le président Georges Fenech. En fait, le PC avancé est un PC informel.
M. Christophe Molmy. Oui, bien sûr. Le PC avancé se compose des autorités qui sont à l’intérieur et qui prennent les décisions. Et, comme me le dit à l’instant mon collègue, M. Thoraval, tout est fonction de la configuration des lieux : on peut parfois s’isoler dans une salle et se poser. Au Bataclan, nous étions dans la fosse, puis nous sommes montés dans les escaliers. Avant l’assaut, le PC avancé était sur le premier palier avant l’escalier qui mène à la porte — nous aurons donc l’occasion de le constater sur place ensemble. Nous nous sommes mis là où nous pouvions nous parler en sécurité et prendre des décisions.
M. le président Georges Fenech. Lors des attentats du mois de janvier, la FIPN a-t-elle bien été déclenchée ?
M. Christophe Molmy. Oui, elle a été déclenchée la veille, dans l’après-midi, et associée au GIGN pour la battue menée autour de Longpont où tout a été, semble-t-il, très bien organisé : nous nous sommes partagé le travail entre le GIGN et la FIPN et, au sein de la FIPN, entre le RAID et la BRI par secteurs. La BRI, sous la protection du RAID, a investi, le soir, une maison qui s’est révélée vide. Le lendemain, nous avons laissé une colonne de chaque unité sur place pour finalement les démobiliser quand nous avons su que les frères Kouachi étaient en Seine-et-Marne. Le RAID et le GIGN se sont retrouvés à Dammartin où je me suis également rendu et, estimant que nous étions en surnombre, j’ai demandé l’autorisation, qui m’a été accordée, de me replier sur Paris. Ensuite, étant déjà à Paris, la BRI est intervenue seule et, une petite heure plus tard, le RAID nous a rejoints, nous l’avons intégré dans la configuration FIPN et nous sommes intervenus de conserve.
M. le président Georges Fenech. Contrairement à ce qui s’est passé au Bataclan.
M. Christophe Molmy. Est-ce si important que cela de déclencher la FIPN ?
M. le président Georges Fenech. Il faut la supprimer alors !
M. Christophe Molmy. Ce n’est pas de ma responsabilité, mais je constate que le RAID et la BRI, à Vincennes, ont bien travaillé sous cette égide, mais ont également très bien travaillé au Bataclan. La différence, peut-être, est que, à la porte de Vincennes, le RAID était en unité constituée, avec toutes ses troupes, alors que, au Bataclan, seul un petit détachement est venu nous renforcer. Dans les deux cas, la coordination a été convenable.
M. le président Georges Fenech. Je vous remercie. Je dois mettre un terme à cette audition, car le rapporteur et moi-même avons un rendez-vous avec le préfet de police et tout son état-major à seize heures. M. Thoraval n’a malheureusement pas pu être interrogé, mais il serait intéressant que, lui qui a dirigé les constatations après l’intervention au Bataclan, se joigne à nous le 17 mars prochain lorsque nous nous rendrons sur les lieux.
Audition, à huis clos, de M. Patrick Pelloux, médecin urgentiste
Audition, à huis clos, du lundi 14 mars 2016
M. le président Georges Fenech. Nous vous remercions, monsieur Pelloux, d’avoir répondu à la demande d’audition de notre commission d’enquête relative aux moyens mis en œuvre par l’État pour lutter contre le terrorisme depuis le 7 janvier 2015. Nous vous entendons à plusieurs titres : médecin urgentiste, vous êtes aussi ancien membre de la rédaction de Charlie Hebdo et vous vous êtes rapidement rendu sur les lieux de l’attentat de janvier 2015. Le 13 novembre dernier, vous avez passé la nuit au SAMU de l’hôpital Necker, à Paris. Les leçons que vous tirez de votre expérience sont donc précieuses pour notre commission, tout particulièrement en ce qui concerne l’organisation des secours et la prise en charge des victimes.
Comme vous l’avez souhaité, l’audition se déroule à huis clos. Elle n’est donc pas diffusée sur le site internet de l’Assemblée. Néanmoins, conformément à l’article 6 de l’ordonnance 58-1100 du 14 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, son compte rendu pourra être publié, en tout ou partie, si nous en décidons ainsi à l’issue de nos travaux. Les comptes rendus des auditions qui auront eu lieu à huis clos seront au préalable transmis aux personnes entendues afin de recueillir leurs observations ; ce sera donc le cas pour vous. Ces observations seront soumises à la commission, qui pourra décider d'en faire état dans son rapport.
Je rappelle que, conformément aux dispositions du même article, « sera punie des peines prévues à l’article 226-13 du code pénal – un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende – toute personne qui, dans un délai de vingt-cinq ans, divulguera ou publiera une information relative aux travaux non publics d’une commission d’enquête, sauf si le rapport publié à la fin des travaux de la commission a fait état de cette information ». Il résulte aussi de ces dispositions que les questions que nous pouvons être amenés à poser aux personnes que nous entendons ne doivent pas faire état d’éléments couverts par le huis clos lors de précédentes auditions.
Conformément aux dispositions de l’article 6 de l’ordonnance précitée, je vous demande de prêter le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité.
M. Patrick Pelloux prête serment.
M. Patrick Pelloux, médecin urgentiste. Je vous suis reconnaissant d’avoir créé cette commission d’enquête, qui m’importe au plus haut point. En m’exprimant devant vous, je pense à mes amis de Charlie Hebdo sauvagement assassinés, pour lesquels on a fait tout ce qu’il était possible de faire pour les sauver. Plusieurs d’entre vous ont été caricaturés par ceux qui sont morts, et qui étaient si fortement attachés aux valeurs de la République et de la laïcité. Les victimes de l’attentat contre Charlie Hebdo sont indissociables de celles de l’Hyper Casher de Vincennes, du chef d’entreprise assassiné à Grenoble et des victimes des tueries du 13 novembre dernier.
Chacun, à Charlie Hebdo, était conscient de la menace depuis que les locaux du journal avaient fait l’objet d’un incendie criminel en novembre 2011. C’était la première fois depuis la fin de la Deuxième guerre mondiale que les locaux d’un journal étaient incendiés en France et, à partir de cette date, Charlie Hebdo a été placé sous protection. La forme de cette protection a évolué avec le temps, et je suis d’accord avec ce qu’a expliqué le ministre de l’intérieur : il est préférable de passer de gardes statiques à des gardes dynamiques, avec des rondes régulières, comme c’était le cas, plutôt que de faire des policiers des cibles potentielles. La garde était moins visible, mais elle était bien là.
L’avant-veille de l’attentat, j’avais déjeuné avec Charb, le seul de l’équipe de Charlie Hebdo ayant encore une garde rapprochée. Bien que sa photo ait été publiée par Al Qaïda dans la péninsule arabique en regard de celle de Salman Rushdie dans une liste de personnes à abattre, il était plutôt confiant en l’avenir et m’avait dit vouloir faire cesser cette garde rapprochée, la menace lui semblant moindre. J’avais répondu que cela me semblait une très mauvaise idée.
Je préside l’Association des médecins urgentistes de France, qui souhaite la modernisation de la structuration des secours d’urgence. Pour donner suite aux travaux engagés par Mme Michèle Alliot-Marie, alors ministre de l’intérieur, en 2008, nous avons fait des propositions tendant à réviser les décrets organisant les relations entre les pompiers et les services d’aide médicale urgente (SAMU). Il ne s’agissait pas de mettre fin à une guerre inventée par la rumeur médiatique mais de moderniser l’organisation de l’accueil des urgences, qui passe par la coopération des systèmes et non par leur concurrence.
Le hasard a voulu que, le 7 janvier 2015, une réunion ait été prévue à la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, au cours de laquelle le médecin-chef de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris (BSPP), Jean-Pierre Tourtier, et moi-même devions présenter la rénovation des plans de secours. Il se trouve que le siège de la Fédération est situé rue Bréguet, tout près des locaux de Charlie Hebdo. Lorsque le graphiste du journal m’a téléphoné pour me dire ce qui était en cours, nous y sommes immédiatement allés, tous les deux. Ayant traversé sans le savoir la ligne de feu des deux terroristes qui étaient en train d’assassiner lâchement le policier Ahmed Merabet, nous sommes arrivés sur une scène de carnage. Tentez d’imaginer une salle trois fois plus petite que celle dans laquelle nous sommes, où toute la rédaction est réunie, que des terroristes prennent en tenaille en tirant avec des armes de guerre… En bref, entré dans cette pièce avec un ami et confrère, le commandant Tourtier, j’en suis sorti avec un frère.
Nous avons pénétré dans la salle de rédaction dix minutes avant tous les autres secours. Un véhicule de secours et d’assistance aux victimes (VSAV) des pompiers étaient déjà en bas ; nous n’avons pas vu les forces de police, qui étaient en train de poursuivre les terroristes. En ce 7 janvier, nous avons fait preuve de la même vaillance et du même courage que ceux de l’ensemble des secouristes et des policiers, le 13 novembre. Pour dire les choses autrement, on peut toujours préparer des protocoles et des scénarios, comptent aussi la volonté et le courage des hommes, qui s’exerceront quoi qu’il en soit.
Nous faisons partie d’un système héroïque, celui de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris, dans lequel, comme l’a souligné son directeur général, Martin Hirsch, des gens sont capables de se lever et d’être là, en une période abjecte où, pour la première fois depuis la fin de la Deuxième guerre mondiale, on commet une telle tuerie dans Paris.
Avons-nous bien fait d’y aller ? Mais en de tels cas, on ne réfléchit pas ! Aussi le ministre de l’intérieur a-t-il eu raison de vous dire qu’il fallait revoir la réponse opérationnelle pour améliorer l’efficacité des secours. Nous devons nous adapter pour que la volonté d’aller secourir les personnes victimes d’un attentat se manifeste dans la lumière d’un système de sécurité imparfait à ce jour. Il n’est pratiquement pas possible au préfet de police de décider qu’il y aura une zone d’exclusion, car secouristes et médecins veulent aller porter secours.
C’est ce que j’ai éprouvé, le 13 novembre, lorsqu’un collègue du SAMU m’a alerté, par un appel sur mon téléphone portable, que des explosions et des fusillades étaient en cours. Depuis les attentats de janvier 2015, sous l’égide du professeur Pierre Carli, médecin chef du SAMU de Paris, – moi-même y tenant beaucoup – nous avions mis au point des protocoles dits de damage control, qui consistent à protéger le plus vite possible les gens victimes d’un attentat. Le 13 novembre au matin, nous avions fait, comme souvent, un exercice de simulation avec nos collègues sapeurs-pompiers. Une fois alerté, j’ai décidé de rester à la régulation. Ayant souffert, en janvier, d’un psycho-traumatisme grave, je n’étais pas certain d’être vraiment efficace si je me rendais sur place. J’ai donc aidé à diriger les secours du SAMU. Il fallait porter l’alerte, mais nous ne savions pas vers quoi nous nous dirigions ; le général commandant le service de santé des armées l’a également souligné.
Il est très important de mettre au point des protocoles rénovés incluant le hasard –pour dire les choses autrement, de « se préparer à être surpris » –, même si l’on sait l’essentiel, qui est que ces terroristes veulent en découdre avec les représentants de l’État, les secouristes, les policiers, comme on l’a vu après l’attentat commis contre l’école Ozar Hatorah à Toulouse. Rien ne sert de vouloir prendre ces gens vivants car ils font tout pour tuer et se faire tuer, afin de sidérer le pays ; on ne pouvait donc faire autrement que les neutraliser.
Arrivé à la régulation du SAMU, j’ai constaté que les personnels qui n’étaient pas en service ou qui venaient de le quitter sont revenus spontanément dans les hôpitaux. Cela démontre un très haut niveau de citoyenneté, un engagement très fort, une vaillance qui donne une belle image de la République, une impérieuse volonté d’agir. Après les premiers appels, nous avons envoyé des moyens de secours, qu’il fallait bien répartir. Au Stade de France, il était inutile de dépêcher des équipes supplémentaires – les terroristes s’étaient fait exploser et les moyens présents sur place suffisaient – mais ailleurs, quels moyens envoyer, et quand ? La « ligne de front » se déplaçait mais si, sur le terrain, les liaisons se faisaient bien entre le Pr Carli et le commandant Tourtier, les informations passaient très mal, au niveau des commandements, entre les services de police d’une part, le SAMU et les pompiers d’autre part. Il y a là une source de progrès possible ; pour l’instant, il est extrêmement difficile de comprendre comment les forces de l’ordre sont organisées.
De même, une marge d’amélioration est possible au sein des commandements des services de santé, car des cellules de crises se sont créées à l’AP-HP, à l’Agence régionale de santé (ARS), au ministère de la santé, au SAMU de Paris, au SAMU de Seine-Saint-Denis… Il faudra revoir ces plans de commandement avec un souci de coopération renforcée, pour gagner du temps, puisque l’objectif impératif, pour les services publics, est de répondre efficacement à l’attaque. Les terroristes profitent de la sidération qu’ils provoquent pour faire le plus de morts possible. Que sont ces tueries de masse, comme celle qui a, hélas, été commise hier encore en Côte-d’Ivoire, sinon une stratégie de guerre ? À quoi se livre-t-on sinon à une guerre en massacrant des civils à l’arme lourde en plein Paris ?
Les personnels de secours sont allés sur le terrain très motivés et, bien que sidérés, ils ont très vite su s’adapter aux circonstances. Étant donné l’encombrement du système de communication entre la cellule de crise et les médecins sur le terrain, nous nous sommes constamment appelés avec nos téléphones portables personnels, pour réguler, c’est-à-dire pour adapter nos moyens aux besoins des victimes afin de les emmener là où elles pouvaient être soignées le mieux et le plus vite possible. Nous avons parfois installé plusieurs victimes dans les VSAV des pompiers et parfois scindé les équipes, faisant partir une ambulance avec un médecin et une autre avec une infirmière. Depuis l’attentat commis en janvier à l’Hyper Cacher de Vincennes, nous avons modifié notre pratique. De : « On prend et on part », nous sommes passés à : « On prend, on trie et on part vers le lieu le plus approprié ».
Dans cette optique, nous avons dirigé de nombreuses victimes vers le groupe hospitalier de La Pitié-Salpêtrière dont nous savions qu’il disposait des capacités d’accueil nécessaires en chirurgie digestive, vasculaire et cardiaque pour traiter des plaies par balle – cela est si vrai qu’une greffe cardiaque en cours a continué pendant ce temps. Il faut saluer les chirurgiens venus spontanément proposer leur aide dans d’autres établissements. Ce fut notamment le cas des chirurgiens cardiaques du centre chirurgical Marie-Lannelongue qui se sont rendus à l’hôpital du Kremlin-Bicêtre. Mais, parce que nous n’avons pas l’habitude d’une chirurgie cardiaque d’un tel niveau au Kremlin-Bicêtre, y transférer une victime aurait été prendre le risque de devoir la transférer ailleurs ensuite. Je signale qu’une seule victime est morte après son transfert à l’hôpital ; les 129 autres sont mortes sur les lieux des attentats.
Concernant l’aide à apporter aux victimes, je tiens à vous parler de l’Institut médico-légal de Paris (IML) car ce qui s’y est passé me pèse. Lorsque nous sommes allés à la levée du corps de Charb, il nous a été dit qu’il reposait au côté de ceux de ses assassins. J’ai fait part de cet épisode au procureur François Molins. Certes, les lieux sont exigus, mais était-il judicieux de nous faire savoir cela ? Surtout, pour dire les choses poliment, une réforme de l’IML de Paris est nécessaire. Comment comprendre que l’IML ait refusé, le 13 novembre, d’envoyer des corps à autopsier à l’Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale (IRCGN) de Pontoise ? Dans cette structure ultra-moderne, où l’on a su identifier en quelques semaines à peine les 4 000 morceaux de corps qui lui ont été remis après qu’un avion de la Germanwings a été précipité dans les Alpes, chacun était pourtant prêt dès minuit à recevoir des dépouilles. De plus, j’ai appris que l’IML a profité des attentats pour réclamer à Mme Christiane Taubira, alors garde des sceaux, un scanner de thanatologie, bien que l’IRCGN en ait un – qui n’a pas servi lors des attentats, je me demande bien pourquoi ! C’est celui de l’hôpital Sainte-Anne qui a été utilisé, et il en est résulté de graves problèmes pour son personnel. Je ne comprends pas pourquoi la coopération n’est pas meilleure entre l’IML de Paris et l’IRCGN.
Une autre remarque portera sur les cellules d’urgence médico-psychologique (CUMP). Elles sont essentielles. Tant de gens devaient consulter après les attentats du 13 novembre qu’il a fallu ouvrir les mairies pour y organiser les consultations. Mais ces soins d’une importance capitale doivent être plus professionnalisés, je l’ai constaté à titre personnel. Après l’attentat commis contre Charlie-Hebdo, nous avons été regroupés dans un théâtre, en état de sidération. Là, on m’a demandé un nombre de fois incalculable qui j’étais et si j’étais impliqué dans les événements qui venaient de se produire. Je me rappelle aussi ces psychologues qui voulaient absolument me faire avaler du sucre… Quand on est perdu comme je l’étais, on a besoin d’être pris en charge par un psychologue ou par un psychiatre et un seul, de dire une fois les choses, et qu’ensuite il y ait un suivi. Je pense donc, comme Martin Hirsch, qu’il n’est pas judicieux de créer une nouvelle structure à l’École militaire et qu’il est préférable de regrouper les victimes à l’Hôtel-Dieu de Paris, comme cela a été fait après les attentats de janvier – parce que s’y trouvent un service de psychiatrie, des médecins et des somaticiens. Les victimes ont besoin d’une écoute, elles ont besoin de voir des blouses blanches. La suite aussi est difficile, et j’espère que la cellule interministérielle d’aide aux victimes permettra d’améliorer la coordination.
Enfin, alors que les journalistes n’ont pas le droit de montrer des photos des assassins et à peine de donner leur nom ou d’enquêter sur eux, ils peuvent s’en donner à cœur joie avec les victimes. Certaines épouses de mes amis morts dans les locaux de Charlie-Hebdo ont été poursuivies par des paparazzi ; quant à moi, j’ai été accusé d’avoir gagné 1,5 million d’euros, et je vais porter plainte contre ce mauvais journaliste du magazine Le Point. Les victimes des attentats ne sont pas protégées du tout ; elles doivent l’être.
M. le président Georges Fenech. Je vous remercie pour cette intervention qui laisse de nombreuses questions ouvertes. Je puis vous indiquer que le choix du lieu d’accueil des victimes à Paris a été tranché : ce sera l’École militaire, et non l’Hôtel-Dieu comme le préconisait M. Martin Hirsch ; mais cela peut encore évoluer.
Il est en effet nécessaire de protéger de la presse les victimes d’attentat. Cela vaut aussi pour les otages, dont certains ont été mis en péril par un manque de déontologie ou par des erreurs professionnelles de journalistes. Nous auditionnerons vraisemblablement des représentants des organes de presse et le Conseil supérieur de l’audiovisuel pour réfléchir à un protocole garantissant cette sécurité.
Vous avez évoqué l’évolution de la garde des locaux de Charlie Hebdo, qui de statique est devenue dynamique. Vous savez certainement que Mme Ingrid Brinsolaro, veuve du policier chargé de la protection de Charb, a porté plainte contre X pour « homicide involontaire». Quel est votre avis à ce sujet ? Charb bénéficiait d’une garde unique le jour de l’attentat, non d’une garde rapprochée.
M. Patrick Pelloux. Si, il bénéficiait d’une garde rapprochée par le service de protection des personnalités.
M. le président Georges Fenech. Cela, c’était auparavant.
M. Patrick Pelloux. Non. Le jour de l’attentat encore, ils étaient deux policiers, dont l’un était à ses côtés ; l’autre était allé s’occuper de la voiture ou de tâches administratives, comme cela se peut se produire. Comme vous le savez, quand une personne à protéger se trouve dans un endroit clos, le garde reste avec lui mais il ne revient pas à l’État de sécuriser les locaux. Charlie Hebdo était un lieu privé, qui n’était pas sécurisé faute d’argent ; il y avait seulement une porte à code. À l’intérieur des locaux, le bureau du garde se trouvait derrière une porte. Il est très difficile de retracer avec exactitude ce qui s’est passé mais, vraisemblablement, quand une des « ordures » a commencé à tirer, le policier a sorti son arme, mis l’homme en joue et essayé d’armer, mais Cabu, Wolinski et Elsa Cayat, qui s’étaient levés, ont fait écran, et le deuxième terroriste, arrivant par derrière, a tué le policier à revers. Charb avait effectivement une garde rapprochée, et quand le commissariat de police du 11e arrondissement a fait valoir qu’une voiture stationnée devant les locaux du journal ne servait pas à grand-chose et risquait d’être prise pour cible, il n’en a pas été choqué, non plus que nous. Nous avons même pensé que les locaux en seraient ainsi rendus moins visibles – d’ailleurs, c’est sans doute pourquoi les terroristes, qui devaient s’attendre à trouver une voiture de police en faction, ont commencé par se tromper d’adresse. Mais les policiers continuaient d’aller le chercher et de l’amener où il devait aller ; il avait une protection.
Je comprends ce que dit Mme Brinsolaro mais ces événements atroces font maintenant partie des risques du métier. Peut-être cela doit-il entraîner une réflexion chez ces formidables et compétents policiers de protection qui banalisent leur activité professionnelle alors qu’elle ne peut l’être – le drame étant que l’on ne sait jamais quand le coup partira.
M. le président Georges Fenech. Vous avez évoqué la nécessité de revoir les plans de commandement, notamment pour mieux articuler les services de police d’une part, le SAMU et les sapeurs-pompiers d’autre part. J’ai encore du mal à cerner qui, dans les services de police, prend la décision d’autoriser les secours hospitaliers à entrer dans la zone sécurisée. Il m’a semblé comprendre qu’au Bataclan, c’est le médecin-chef de la brigade de recherche et d’intervention (BRI) qui aurait donné le feu vert à ce que les services de sécurité finissent par laisser entrer les secours ; savez-vous ce qu’il en a été ? D’autre part, nous avons tous été frappés par le temps qu’il a fallu pour secourir certains blessés ; ainsi, un journaliste du journal Le Monde a indiqué au cours de son audition avoir attendu plusieurs heures d’être secouru, alors qu’il souffrait d’une hémorragie. Pourriez-vous préciser ce que vous entendez par une meilleure articulation des commandements ?
M. Patrick Pelloux. Je comprends ce que les victimes ressentent puisque le 13 novembre, vers 22 heures 45, au moment de l’attaque du Bataclan, Mme Hidalgo, maire de Paris, m’a téléphoné, me demandant : « Où sont les secours ? ». Je rappelle que le Bataclan a été le théâtre d’une attaque éclair, qui a duré de 12 à 15 minutes. Pendant ce petit quart d’heure, une des « ordures » est passée à droite de la salle et deux autres à gauche, tous trois tirant avec des kalachnikovs dont chaque chargeur contient trente cartouches. Si je connais ces détails, c’est qu’il y a une dizaine de jours, à la demande du directeur du Bataclan, la salle a été rouverte, avec l’aide de la CUMP, pour une discrète cérémonie de recueillement, qui a aussi été l’occasion d’un debriefing. Le soir du 13 novembre 2015, à cet endroit, deux personnes ont été héroïques : les policiers de la BAC qui, transgressant leur règlement d’intervention, sont entrés à l’intérieur du Bataclan au lieu de se figer en attendant la BRI comme ils y étaient théoriquement tenus. N’auraient-ils pas fait cela que quatre chargeurs supplémentaires au moins auraient été tirés sur la foule, avec d’autres morts en nombre proportionnel. Les deux autres terroristes étaient montés au balcon, retenant des otages.
Ensuite, la BRI arrive, et ce qui se passe alors est assez mystérieux pour moi aussi. La BRI, comme le RAID – service de recherche, assistance, intervention et dissuasion – et comme le groupement d’intervention de la gendarmerie nationale (GIGN), a des médecins « de colonne » qui accompagnent les interventions pour prendre en charge les policiers ou les gendarmes éventuellement blessés. C’est à ce titre qu’était là M. Denis Safran, professeur d’université retraité de l’AP-HP mais travaillant à la BRI, et c’est lui qui a décidé. Mais je ne sais qui fait quoi dans la police, et le rôle de cet éminent professeur reste pour moi énigmatique.
Comme vous, j’ai entendu des témoignages de gens qui attendaient. À la régulation du SAMU, scindée en deux unités, et qui avait installé le poste de regroupement de victimes boulevard des Filles-du-Calvaire, je m’occupais du « tout-venant ». Mais je répondais aussi à des gens cachés dans les faux-plafonds du Bataclan, qui appelaient le 15 et à qui je disais de mettre un garrot, de ne pas parler, de faire tel ou tel acte… Nous avons également reçu des appels depuis des « nids » de victimes réfugiées dans des halls d’immeubles ou dans des appartements, que nous conseillions aussi par téléphone. La cellule de crise devait gérer tout cela, mais parfois les communications téléphoniques ne passaient pas, ce qui compliquait encore la situation, et les services de police interdisaient le passage des secours. Il n’empêche que des sapeurs-pompiers y sont allés, vaillamment ; c’est alors qu’ils ont fait le décompte des victimes en urgence absolue.
M. Sébastien Pietrasanta, rapporteur. Vous dites que des sapeurs-pompiers sont entrés à l’intérieur du Bataclan ; à quel moment ?
M. Patrick Pelloux. Je pense qu’ils sont entrés une heure un quart après le début de l’attaque.
M. le rapporteur. Autrement dit, avant l’assaut final qui a eu lieu à zéro heure dix-huit ?
M. Patrick Pelloux. C’est ce que je pense, mais il faut le leur redemander.
M. le rapporteur. Nous le ferons, car le président Fenech et moi-même avions cru comprendre qu’aucun service de secours n’était entré dans le Bataclan avant l’assaut final.
M. Patrick Pelloux. C’est une zone de temps que je ne parviens pas à comprendre car les témoignages se coupent ou se contredisent ; il en était de même lors de la reconstitution de l’attentat contre Charlie Hebdo. Quoi qu’il en soit, j’ai compris que des médecins ont pu entrer au Bataclan avant que l’assaut soit terminé ; c’est alors que nous avons su que la scène était celle d’une boucherie et qu’il y avait là 80 victimes en urgence absolue.
M. le rapporteur. Il nous faudra éclaircir ce point. Les informations peuvent en effet se contredire, parce que chacun n’avait pas nécessairement l’œil rivé sur sa montre et parce que les perceptions peuvent différer selon l’endroit où l’on se tenait. N’est-ce pas le Pr Safran qui vous a donné ces éléments, puisqu’il était à l’intérieur du Bataclan, accompagnant la colonne de la BRI ? Que voulez-vous dire précisément quand vous faites état d’un problème de communication entre la police, les pompiers et le SAMU ?
M. Patrick Pelloux. En effet, le Pr Safran, qui est également commandant en retraite de la BSPP, a sans doute prévenu les pompiers mais, que je sache, il n’a jamais contacté le SAMU.
M. le rapporteur. Quelles sont les procédures suivies pendant les crises ? Les informations transitent-elles toutes par la BSPP ? En soulignant que chacun a sa cellule de crise, vous avez semblé sous-entendre qu’il faudrait unifier cet ensemble. Comment les échanges se font-ils entre la BSPP et le SAMU ?
M. Patrick Pelloux. Le commandant des opérations de secours – à Paris, c’est un commandant de pompiers – est chargé de toute la logistique et des secours, ces derniers étant organisés par un directeur des secours médicaux, qui est généralement un médecin. Ce médecin gère le commandement des secouristes, des pompiers et des médecins. À Paris, le médecin-chef du SAMU est complémentaire du directeur des secours médicaux. Or, l’information ne passe pas : il n’y a pas de ligne directe entre le SAMU et la police, non plus qu’entre les pompiers et le SAMU, ce que nous réclamons pourtant. On passe toujours par des lignes normales si bien que, le 13 novembre, l’accroissement continu des appels, dont le nombre a augmenté de 400 %, a provoqué l’encombrement des standards, les conversations elles-mêmes se déroulant avec en arrière-plan des cris, des appels au secours et des tirs de kalachnikov. C’était extrêmement difficile pour nous qui avions besoin de motards pour sécuriser des rames, c’est-à-dire des convois de véhicules partant vers les hôpitaux, car des rumeurs faisaient état d’autres attentats, comme cela avait été le cas après les attentats contre Charlie Hebdo et l’Hyper Cacher de Vincennes. Il y a eu un défaut de coordination, de communication et de transmission des informations. Le regroupement physique permet de mieux se parler : on le voit sur le terrain, et cela doit valoir aussi pour la régulation.
M. le président Georges Fenech. Vous êtes médecin. Pensez-vous que ce manque de coordination et l’intervention quelque peu retardée des secours médicaux ont causé des morts qui auraient pu être évités ?
M. Patrick Pelloux. On peut toujours se poser la question. Bien sûr, on aurait pu faire mieux… si l’on avait connu d’emblée le scénario final. Mais, en réalité, il n’y a pas eu de retard. Comme on l’a constaté lors des attentats de Londres et de Madrid, il est très, très long d’intervenir sur le site d’un attentat. Et puis on a toujours à l’esprit, sans que cela doive conditionner l’action des secours, le risque de « sur-attentat », et l’idée qu’il ne faut pas mettre tous les œufs dans le même panier, c’est-à-dire qu’il faut économiser les ressources. Je dois avouer avoir fait partir des colonnes de secours en plus au Bataclan – plusieurs véhicules de la Protection civile – sans en référer à la cellule de coordination et de régulation, parce que j’estimais qu’il fallait le faire. Je ne pense pas que nous aurions pu sauver plus de blessés. Il est impossible de le dire, mais nous avons fait le maximum et nous avons même réussi à sauver une femme qui avait reçu neuf balles de kalachnikov. Mais je suis convaincu de la nécessité d’une colonne de secours « de l’avant », collant à l’intervention de la BRI, du RAID ou du GIGN. Je ne suis pas certain qu’elle doive être composée de médecins ; mieux vaudrait des secouristes, car il s’agit d’extraire au plus vite les gens encore en vie. En cas de catastrophe, le protocole classique est, une fois entré en un lieu, de déterminer qui est dans un état grave ; ce faisant, on perd un quart d’heure. Sur des terrains de tuerie de masse, il faut extraire les blessés vivants de la zone dangereuse, les regrouper à l’extérieur et les convoyer vers l’hôpital le plus vite possible. Incidemment, j’ai demandé que cette audition ait lieu à huis clos car je suis convaincu que Daech et Al Qaïda observent la manière dont nous nous organisons.
J’ai eu vent de rumeurs délirantes après l’attentat dans les locaux de Charlie Hebdo, quand il s’est dit par exemple que Georges Wolinski aurait eu un infarctus. Cela étant, nous ne devons pas rester sur un système figé, en arguant que tout se serait passé de manière formidable. Il faut revoir les chaînes de commandement et, puisqu’il est à craindre que des attentats se produisent à nouveau, nous devons passer du XXe au XXIe siècle en mettant au point de nouveaux systèmes de prompt secours très dynamiques, engageant des personnels entraînés à ramper sur 50 mètres avec une victime pour l’extraire.
M. le rapporteur. Selon vous, le service de santé des armées a-t-il ce savoir-faire ? Pouvez-vous nous dire si le SAMU a disposé à sa suffisance de véhicules et de morphine ? Si l’attaque avait eu lieu dans une école, les services de médecine pédiatrique auraient-ils pu faire face ?
M. Patrick Pelloux. Pour dire les choses crûment, une balle de kalachnikov dans un corps d’enfant faisant un carnage, il y aurait eu énormément de morts et très peu d’enfants auraient pu être sauvés. Cela étant, nous réfléchissons à ces questions avec les hôpitaux pédiatriques, et nous avons de quoi faire. La meilleure stratégie consiste à prendre des mesures d’anticipation et de sécurité innovantes et rapides. Elles ont été expérimentées au moment de l’attaque récemment menée contre le commissariat du 18e arrondissement de Paris : le confinement des enfants dans les écoles a été immédiat. Tout scénario étant possible, y compris l’attaque d’une école ou d’un hôpital, nous devons être prêts à tout et nous y travaillons constamment.
Que le SAMU ait manqué de morphine est une légende, mais nous en avons peu utilisé. Il y a eu deux raisons à cela. La première est que l’on a vu des blessés courir avec des balles dans le ventre ou dans les jambes, dans un état de sidération tel qu’ils nous disaient, comme l’a mentionné Martin Hirsch : « Occupez-vous des autres » ! La peur faisait qu’ils n’avaient pas mal. D’autre part, contrairement à ce qu’a dit un médecin qui ne travaille pas au SAMU de Paris, injecter trop de morphine à des gens en état de choc hémorragique, c’est les tuer. Ce n’est donc pas recommandable, et il ne l’est pas davantage d’intuber sur place les blessés par balle : il faut faire faire cesser l’hémorragie en utilisant les fameux pansements hémostatiques dit « israéliens » dont nous nous sommes dotés. Il faut accélérer l’arrivée dans nos services de ces matériels nouveaux qui permettent de faire des garrots tactiques.
Pour ce qui est des véhicules d’intervention, l’organisation, dans le cadre du plan de circulation « rouge alpha » de la préfecture de police, n’a pas trop mal fonctionné, si ce n’est que nous avons éprouvé des difficultés à manœuvrer en certains lieux.
Enfin, il est heureux que nos collègues du service de santé des armées aient été là, car ils ont la culture militaire de la prise en charge des blessures par armes de guerre, et c’est essentiel. Je considère la fermeture de l’hôpital militaire du Val-de-Grâce comme une erreur, mais c’est fait, et les hôpitaux d’instruction des armées Percy et Begin sont formidables.
M. Christophe Cavard. Les attaquants ont visé plusieurs lieux en même temps. Quelle analyse faites-vous de la répartition des prises en charge aux terrasses des cafés ? Les personnels civils sont-ils formés à la prise en charge de blessures de guerre ? Si ce n’est pas le cas, une évolution est-elle envisageable, puisque l’on redoute d’autres actes meurtriers de ce type ? Enfin, traite-t-on leurs propres lésions psychologiques post-traumatiques ?
M. Serge Grouard. Les forces de police ont établi un cordon de sécurité autour du Bataclan. À votre connaissance, les services de secours ont-ils éprouvé des difficultés à le franchir ? Des secours ont-ils été retardés parce qu’ils ne pouvaient approcher le Bataclan ou certaines terrasses de café touchées par les tirs ? Confirmez-vous que des pompiers sont arrivés jusqu’au Bataclan avant l’assaut final ? Savez-vous s’ils se trouvaient à l’intérieur ou à ses abords immédiats ?
M. Patrick Pelloux. Il vous faudra établir la chronologie de la présence des pompiers au Bataclan avec le général commandant des sapeurs-pompiers. C’est probablement en raison de la présence du Pr Safran, à la fois médecin de la BRI et ancien membre de la BSPP qu’a été soulevée la problématique de la présence des pompiers sur place. Ce qui est sûr, c’est que dès l’assaut donné, les premiers médecins entrés ont été les médecins des sapeurs-pompiers ; M. Jean-Pierre Tourtier, médecin-chef de la BSPP, peut vous en parler. Dès que l’information a été diffusée, les secours ont pu arriver, avec les véhicules, devant le Bataclan. Le problème n’était pas que les cordons de police ont empêché le passage mais que nous ne savions pas ce qui nous attendait. La difficulté tient à ce qu’il faut protéger les personnels et l’action des secours ; à cela s’ajoute la notion latente de « sur-attentat ». La difficulté est inhérente à cet exercice de guerre. Je reprends un instant ma casquette de défense sociale pour souligner que ce type d’intervention fait désormais partie, hélas, des risques professionnels. Ma génération pensait ne pas connaître la guerre, et nous y sommes.
Mais, j’y insiste à nouveau, la coordination entre les commandements doit s’améliorer considérablement pour que l’on sache exactement qui fait quoi dans les services de police. J’ai assisté à un colloque au cours duquel un représentant de la BRI affirmait que « c’est la BRI qui décide ». Or, quand nous arrivons, la BRI est certes sur le terrain, mais nous ne pouvons en voir les membres. Et quand j’ai demandé quel était le rôle des militaires, il m’a été répondu : « La circulation »… ce qui est faux : ils n’ont jamais fait la circulation ! Il est très difficile de savoir qui fait quoi dans la Police nationale et cela pose un problème réel. De même, les cellules de crise qui se sont créées dans le domaine de la santé ne coopèrent pas : elles sont redondantes. Malgré cela, nous parvenons à être efficaces. Les sapeurs-pompiers de Paris travaillent désormais avec la Police nationale, avec une régulation commune, ce qui leur donne accès à ce que les 3 000 caméras installées à Paris donnent à voir. Il faudra obliger les équipes à une meilleure collaboration physique ; nous y gagnerons en efficience.
Vous m’avez interrogé sur l’analyse de la répartition des secours. Nous sommes allés à l’aveugle mais, en gros, partout où des secours étaient nécessaires, il y a eu des médecins. Pour être entré dans les locaux de Charlie Hebdo et y avoir vu mes amis massacrés, je puis témoigner que dans une situation de ce genre, chaque minute semble une éternité. J’ai immédiatement appelé le SAMU, et le commandant Tourtier les pompiers. Je suis resté en tout dix minutes dans cette pièce, et j’ai vieilli de cent ans. Au Bataclan, parmi les gens restés en vie sous des cadavres, certains ont effectivement attendu une heure ou une heure et demie, d’autres une dizaine de minutes, et ceux-ci ont également eu l’impression que l’attente a été interminable. Il faut comprendre l’état de sidération et l’anéantissement dans lequel chacun se trouvait et ne pas remettre en cause leur témoignage.
S’agissant de la formation des personnels, soyez assurés que depuis les attentats de janvier 2015, nous avons tous relu les ouvrages relatifs aux prises en charge de plaies par armes de guerre. Un colloque été organisé au cours duquel ont pris la parole des médecins intervenus en Afghanistan. Au SAMU de Paris, le Pr Carli fait venir régulièrement des médecins militaires, notamment ceux qui sont affectés à la protection de la présidence et du Premier ministre. Nous avons donc beaucoup progressé sur le plan technique ; nous savons qu’en cas de blessure thoracique ou abdominale par arme de guerre, il faut perfuser un coagulant, saturer la plaie d’hémostatiques, maintenir le blessé en position semi-assise et le transférer au plus vite au bloc opératoire.
Nous essayons de former le personnel le plus vite possible. Urgentiste, je suis impatient, et j’aimerais que cela aille beaucoup plus vite, mais chacun ici connaît les travers français : le millefeuille administratif complique les choses. Malgré cela, nous avons rattrapé notre retard de formation. Maintenant, il est fondamental de mettre au point un schéma de secours réactif fort, avec des secouristes surentraînés capables d’aller chercher les victimes en zone de danger pour les emmener au plus vite vers l’hôpital pour les sauver.
Enfin, je n’ai jamais eu d’explication sur un fait que je juge troublant. Lors des attentats du 7 janvier, le prédicateur dont les frères Kouachi suivaient les prêches était exactement là où il fallait : au service des urgences de l’hôpital La Pitié-Salpêtrière. En dépit de ses condamnations, cet homme a pu suivre un de ces cursus très « droit-de-l’hommiste » grâce auxquels des individus ayant purgé une peine de prison peuvent faire des études de santé, ce qui était interdit auparavant. Il l’a fait, a validé ce cursus et, le jour des attentats, il se trouvait au-dessus de la salle de réveil, là où ont été regroupés le plus grand nombre des blessés. Je n’ai jamais obtenu d’explications à ce sujet, non plus que Martin Hirsch. La possibilité qu’il exerce est maintenant soumise à la décision du directeur de l’ARS. Il ne faut pas être dupe : on ne sait combien d’individus signalés par une fiche S travaillent dans les hôpitaux publics mais il y en a beaucoup et, contrairement à ce que laisse entendre le satisfecit de l’Observatoire de la laïcité, nous avons un réel problème avec l’exercice de la laïcité à l’hôpital public, notamment avec ceux qui prônent un islamisme radical.
M. le président Georges Fenech. Je vous remercie.
Audition, à huis clos, de militaires mobilisés dans le cadre de l’opération Sentinelle le 13 novembre 2015 : lieutenant-colonel D. D., chef de l’état-major tactique de Paris, capitaine P-M. A., commandant d’unité, maréchal des logis chef G. A., chef de la section déployée rue de Charonne et maréchal des logis R. D., chef du groupe intervenu au Bataclan
Audition, à huis clos, du lundi 14 mars 2016
M. le président Georges Fenech. Messieurs, nous vous remercions d’avoir répondu à la demande d’audition de notre commission d’enquête relative aux moyens mis en œuvre par l’État pour lutter contre le terrorisme depuis le 7 janvier 2015.
Nous avons commencé à aborder la semaine dernière les questions relatives à la conduite des opérations, l’intervention des forces de l’ordre, et les moyens mis à leur disposition. Nous poursuivons nos investigations avec des militaires déployés le 13 novembre dernier dans le cadre de l’opération Sentinelle dans le 11e arrondissement de Paris.
Je rappelle qu’en Île-de-France, l’opération Sentinelle est placée sous la responsabilité opérationnelle du gouverneur militaire de Paris, qui est l’officier général de la zone de défense et de sécurité (ZDS) et dispose pour cela d’un centre opérations interarmées. Le centre opérations a sous sa responsabilité trois groupements, qui correspondent à trois zones géographiques : Paris, banlieue ouest et banlieue est. Ces groupements sont dirigés par des états-majors tactiques : le lieutenant-colonel D. D. était le chef de l’état-major tactique de Paris le soir du 13 novembre. Le groupement de Paris est ensuite divisé en une vingtaine d’unités élémentaires, qui correspondent également à des zones géographiques. Le capitaine P-M. A. était le commandant de l’unité qui comprend le 11e arrondissement. Les unités élémentaires sont ensuite divisées en sections de trente soldats, elles-mêmes divisées en groupes de dix soldats. Le maréchal des logis-chef G. A. était chef de la section déployée rue de Charonne. Le maréchal des logis R. D. était le chef du groupe qui est intervenu au Bataclan.
En raison de la confidentialité des informations que vous êtes susceptibles de nous délivrer, cette audition se déroule à huis clos. Elle n’est donc pas diffusée sur le site internet de l’Assemblée. Néanmoins, et conformément à l’article 6 de l’ordonnance 58-1100 du 14 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, son compte rendu pourra être publié en tout ou partie, si nous en décidons ainsi à l’issue de nos travaux. Je précise que les comptes rendus des auditions qui auront eu lieu à huis clos seront au préalable transmis aux personnes entendues afin de recueillir leurs observations. Ces observations seront soumises à la commission, qui pourra décider d’en faire état dans son rapport.
Je rappelle que, conformément aux dispositions du même article, « sera punie des peines prévues à l’article 226-13 du code pénal – un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende – toute personne qui, dans un délai de vingt-cinq ans divulguera ou publiera une information relative aux travaux non publics d’une commission d’enquête, sauf si le rapport publié à la fin des travaux de la commission a fait état de cette information ».
Conformément aux dispositions de l’article 6 de l’ordonnance précitée, je vais maintenant vous demander de prêter le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité.
Le lieutenant-colonel D. D., le capitaine P-M. A., le maréchal des logis-chef G. A. et le maréchal des logis R. D. prêtent serment.
Messieurs, je vous invite à faire un bref exposé liminaire qui sera suivi par un échange de questions et réponses.
Lieutenant-colonel D. D. Je vous remercie de l’intérêt que vous nous témoignez en nous demandant d’être présents aujourd’hui : compte tenu de notre niveau tactique, il est rare que nous soyons amenés à rencontrer des parlementaires. Nous sommes très honorés de nous exprimer devant votre commission d’enquête afin d’expliquer ce que nous avons fait le soir du 13 novembre 2015.
Je commencerai par exposer notre organisation à la date des faits, avant de faire un récit chronologique de la nuit du 13 au 14 novembre telle que l’a vécue le groupement de Paris, étant précisé que je laisserai le soin au capitaine P-M. A. d’une part, au maréchal des logis-chef G.A. et au maréchal des logis R.D. d’autre part, de raconter dans le détail ce qui s’est passé rue de Charonne et au Bataclan. Je dirai un mot sur le renforcement de l’opération Sentinelle que nous avons dû gérer à la suite des événements, et je conclurai en évoquant les points qui me sont apparus positifs, ou au contraire perfectibles.
Fin octobre 2015 a eu lieu une réorganisation des militaires de l’opération Sentinelle en Île-de-France : les trois états-majors de circonstance ont fusionné pour aboutir à la mise en place d’une organisation identique à celle qui est la nôtre en opérations extérieures – un chef de corps, l’état-major du régiment et les unités élémentaires –, ce qui nous a permis de bénéficier d’une chaîne de commandement d’une grande fluidité, car les chefs ont l’habitude de commander, les adjoints et subordonnés connaissent parfaitement leur rôle au sein de l’état-major, et les unités rattachées ont une vision très claire du fonctionnement de l’ensemble.
J’ai été désigné pour prendre mon tour de chef du groupement de Paris fin octobre 2015. Chef de corps du 54e régiment d’artillerie de Hyères, je suis venu avec l’état-major de ce régiment : un chef des opérations, un chef du renseignement, un chef de planification et de conduite – exactement les mêmes composantes qu’en opérations extérieures. Je disposais à mon arrivée de dix-neuf unités élémentaires – dix-neuf compagnies –, toutes de dimensions différentes : il y a des compagnies à deux, trois, et quatre sections.
La zone d’intervention du groupement est Paris intra muros. Nous avons trois missions principales. La première est liée à la réquisition BAT 13-04, consistant en la surveillance des sites confessionnels ; en superposition, nous avons les anciennes missions du plan Vigipirate, à savoir la surveillance des lieux touristiques, ainsi que les missions d’observation des stations du réseau ferré en Île-de-France intra muros. Enfin, l’unité mobile d’intervention de police (UMIP) constitue une unité particulière, chargée notamment de la surveillance des ambassades. L’une de mes préoccupations initiales a consisté à attribuer à chaque zone géographique la mission la plus appropriée à son unité, en cherchant à parvenir à la plus grande homogénéité possible sur l’ensemble de la zone.
Le soir du 13 novembre, l’état-major a perçu une activité inhabituelle des vingt et une heures vingt, avec le compte rendu d’une détonation anormale, fait par une unité présente au nord de Paris. Nous avons demandé des précisions à ce sujet et, à vingt et une heures quarante, le capitaine P-M.A. m’a rendu compte d’une fusillade rue de Charonne, en m’indiquant qu’il était en mesure de faire intervenir son unité en appui des forces de sécurité intérieures. J’ai communiqué ces informations à mon état-major, à savoir l’état-major interarmées basé à Saint-Germain, avec une proposition de mission. Une fois cette proposition validée, j’ai pu donner le feu vert au capitaine pour qu’il fasse entrer son unité en action. Le contexte de crise étant identifié, nous avons opéré une réorganisation interne au niveau de l’état-major, essentiellement destinée à faire l’état des lieux de nos forces et à définir qui communique avec qui. Pour cela, j’ai demandé à l’ensemble de mes capitaines de me faire un point précis de la situation de leurs unités respectives afin de savoir lesquelles étaient en mission et lesquelles étaient en mesure de se régénérer rapidement – pour cela, il a été ordonné aux personnels se trouvant en repos physiologique de rejoindre dans les meilleurs délais leurs unités d’appartenance.
Je précise que chaque unité a un taux d’activité de 75 % sur ses missions : sur quatre journées, il y en a toujours une consacrée à la remise en condition par le sport, la préparation opérationnelle et le repos – les personnels sont en quartier libre dans une zone située à moins d’une heure de leur unité. En même temps que je faisais le point sur les unités pouvant être mobilisées, je mettais en alerte mes éléments d’intervention, appelés quick response forces (QRF) : sur les 1 500 personnels composant la force que je commande à Paris, je disposais de trois groupes de huit personnes présentes dans leurs quartiers, et pouvant intervenir dans un délai de trente minutes. La situation paraissant susceptible de prendre de l’ampleur, l’idée était alors de régénérer les unités qui pouvaient l’être : à chaque fois qu’une compagnie disposait de deux sections prêtes à être engagées, j’en étais avisé par son capitaine.
Ayant reçu un compte rendu me signalant qu’un nouveau point chaud était identifié rue Bichat, j’ai envoyé le premier QRF sur la zone concernée, afin de poser un dispositif de bouclage ou, à défaut, d’appui aux forces de sécurité. Presque simultanément, on m’a signalé un autre point chaud au Bataclan, où j’ai envoyé une unité comprenant deux sections. J’ai également pris la décision de me rendre moi-même sur place, comme nous avons l’habitude de le faire en opération extérieure : il est en effet plus facile de faire manœuvrer ses unités lorsqu’on se trouve à proximité de celles-ci. Après validation de cette proposition par ma hiérarchie, je suis parti de Vincennes avec un PC tactique, c’est-à-dire une équipe resserrée, à destination de la place de la Bastille. Géographiquement, ce lieu me paraissait être celui offrant les meilleures caractéristiques pour me permettre de m’adapter aux évolutions de la menace.
Je disposais au départ de trois unités du groupement de Paris, et j’ai appris pouvoir compter sur deux unités supplémentaires, l’une du groupement de la banlieue ouest, l’autre du groupement de la banlieue est. Avant de partir, j’ai envoyé place de la Bastille les deux QRF qui me restaient afin de préparer la zone. Une fois sur place, j’ai reçu l’ordre, entre minuit et une heure du matin, de défendre quatre sites, dont trois institutionnels – à savoir l’Assemblée nationale, le Sénat, Matignon et l’hôpital Necker. J’ai envoyé une unité sur chacun de ces sites, et maintenu en réserve la cinquième unité, en attendant de disposer de renseignements supplémentaires. Lorsque nous avons observé que les forces de sécurité intérieures étaient présentes en nombre, nous avons pu procéder au désengagement progressif de nos propres unités en fin de nuit, les dernières étant cependant restées en place jusqu’à dix-huit heures le lendemain – étant précisé que cette opération exceptionnelle ne remettait pas en cause la continuité de l’opération Sentinelle, qui devait reprendre le lendemain dès sept heures du matin.
Le lendemain, le groupement de Paris a dû revoir l’ensemble de son organisation afin de tenir compte de l’arrivée de 300 hommes supplémentaires, à savoir deux compagnies Guépard TAP du 3e régiment de parachutistes d’infanterie de marine (RPIMa) venant de Toulouse ; 300 hommes de plus sont arrivés le 15, et 400 le 16. En tout, nous avons donc reçu 1 000 hommes de plus en quatre jours, et avons dû, lors de chaque nouvelle arrivée, réorganiser l’ensemble du dispositif afin d’optimiser sa cohérence et son efficacité.
Pour ce qui est des points positifs que j’ai relevés, je soulignerai d’abord que les attaques sont survenues à un moment favorable à nos forces en termes d’horaires : vers vingt et une heures trente, la plupart des unités se sont désengagées des sites sur lesquels elles ont été présentes dans la journée – par exemple, leur présence n’est plus justifiée devant les écoles, qui ferment à partir de dix-sept heures –, mais l’heure n’est pas suffisamment tardive pour qu’elles soient complètement déconditionnées : elles peuvent donc facilement se réengager. De ce point de vue, l’horaire a joué en notre faveur, dans la mesure où il a permis une réactivité optimale de notre part.
Par ailleurs, les événements ont montré la pertinence de disposer d’unités dans Paris intra muros. En tant que chef du groupement de Paris, j’avais des unités stationnées dans Paris, mais aussi au fort de l’Est – à Saint-Denis – et à Villacoublay. Ce maillage efficace a permis aux unités parisiennes d’être mobilisées très rapidement : même celles qui étaient en repos ont été en mesure de gagner leur lieu d’hébergement et de s’équiper avant de partir sur le théâtre des événements en un temps très court.
La structure de commandement, constituée d’un chef de corps avec son état-major et des unités élémentaires, a fait la preuve qu’elle était aussi efficace qu’en opération extérieure. J’ai moi-même eu le réflexe de me transporter au plus près de l’action avec mon PC tactique, et les groupes de combat ont eu des comportements similaires, par exemple en prenant l’initiative de mettre en place des chicanes improvisées dans certaines rues pour ralentir et filtrer la circulation – quitte à la bloquer provisoirement –, afin de nous permettre de mieux différencier un Parisien affolé de ce qui aurait pu être un terroriste au volant d’une voiture-bélier.
Enfin, en arrivant sur zone, nous avons vu que notre présence avait pour effet de rassurer la population : la masse de personnels déployés, et notre capacité à sécuriser rapidement les périmètres où nous étions présents – grâce à un dialogue instauré de façon simple et efficace avec les policiers sur place – a convaincu les Parisiens que nous avions la situation en main.
J’ai également relevé quelques points qui m’ont paru perfectibles. Les contacts entre l’armée et la police sont bien structurés : ainsi, le centre opérationnel (CO) de niveau interarmées de Saint-Germain a un détachement de liaison (DL) auprès de la préfecture, et le capitaine Audibert a pu communiquer sur le terrain avec un interlocuteur des forces de sécurité intérieures, et mettre au point avec lui un dispositif d’intervention. En revanche, lorsque je suis arrivé sur le terrain avec mon PC tactique, je n’ai pas trouvé d’interlocuteur à mon niveau : aucun des nombreux policiers présents sur la place de la Bastille n’a été en mesure de me communiquer une cartographie des événements. L’une des améliorations envisageables pourrait donc consister à mettre en place un contact de niveau intermédiaire qui semble aujourd’hui faire défaut.
En ce qui concerne les communications, c’est une bonne chose que nous ayons accès au réseau ACROPOL – le système de communications radio de la Police nationale –, car cela nous permet d’obtenir un grand nombre d’informations. En revanche, le fait que notre propre système de commandement repose sur l’utilisation de téléphones portables est source de faiblesses. En période de crise, le réseau sature très vite et en tout état de cause, quand dix-neuf unités élémentaires m’appellent en même temps, je ne peux prendre qu’un appel à la fois – ce qui explique que le capitaine ait eu des difficultés à me joindre le soir même. Nous devons également faire face à des problèmes d’autonomie.
M. le président Georges Fenech. À quel système de communications avez-vous recours en opérations extérieures, et pourquoi ne les utilisez-vous pas lors des opérations intérieures ?
Lieutenant-colonel D. D. En OPEX, nous travaillons avec des moyens de transmissions dédiés – des terminaux basés sur la technologie 4G – et c’est sans doute pour des raisons techniques, liées à la puissance des émetteurs ou à la réception en milieu urbain, que nous devons y renoncer en OPINT. Quoi qu’il en soit, je fais simplement le constat selon lequel communiquer sur le terrain au moyen de téléphones portables présente des inconvénients.
Par ailleurs, je pense que la rentabilité des missions qui nous sont confiées pourrait être améliorée. Ainsi, si les personnels affectés à la protection des lieux confessionnels étaient motorisés, et pouvaient effectuer des patrouilles d’observation plutôt que de rester statiques, nous disposerions d’une plus grande capacité d’action ; le jour des événements, nous aurions sans doute été en mesure de mobiliser un plus grand nombre de personnels, ou d’accélérer leur venue. Il me semble que nous aurions, là encore, intérêt à rapprocher notre mode d’action de celui auquel nous avons recours en opérations extérieures. Le fait d’être motorisés, par exemple, permet de passer plus facilement d’une mission à une autre.
Capitaine P-M. A. Je suis arrivé à Paris le 28 octobre, à la tête d’une unité composée de soixante soldats. Notre mission, essentiellement statique, consiste à assurer la protection de deux écoles et de cinq lieux de cultes – étant précisé que si un événement survient, ce sont les forces de sécurité intérieure qui doivent intervenir pour nous aider. Le soir du 13 novembre, mes unités avaient commencé à regagner leurs logements et une relève était en cours. Du point de vue de l’hébergement, mon unité présente la particularité d’être dispersée dans le sud du 11e arrondissement et ses abords ; quant à mon poste de commandement, il est situé, dans des conditions assez spartiates, dans les combles de la mairie du 11e arrondissement.
Cette répartition m’a permis de disposer rapidement d’un premier point de situation : vers vingt et une heures trente, mon chef de section – le maréchal des logis-chef G. A. –, alors en quartier libre, s’est trouvé par hasard rue de Charonne alors que la fusillade venait de se produire. Il m’a appelé pour me prévenir et m’a demandé l’autorisation de faire intervenir un groupe alors situé boulevard Voltaire. J’ai immédiatement donné mon accord – au vu de la situation, il ne fallait pas se poser trop de questions – et, dès l’arrivée des hommes sur place, le chef G.A. les a disposés de façon à former un cordon de sécurité autour du bar La Belle Équipe et du nid de blessés installés dans le restaurant Le Petit Baïona. Ce groupe de huit soldats arrivés au pas de course, munis de gilets pare-balles, de casques et d’armes longues, a eu pour effet immédiat de rassurer les personnes présentes, y compris les policiers, peu équipés pour faire face à une situation de ce genre. Dans la mesure où il n’était pas exclu que la voiture des terroristes fasse un deuxième passage, il fallait rapidement sécuriser tout le monde, y compris les sauveteurs, afin de leur permettre de porter secours aux blessés sans craindre de constituer eux-mêmes des cibles.
Le chef, jusqu’alors en vêtements civils, est remonté à pied à la mairie du 11e, où il m’a fait un point de la situation. Celle-ci, dont je suivais également l’évolution grâce au système radio ACROPOL, paraissait très confuse, mais j’étais certain d’un point : nous serions forcément utiles rue de Charonne. Après avoir rendu compte au colonel, j’ai donc fait converger tous mes effectifs disponibles vers cette zone afin de procéder à l’installation d’un dispositif de bouclage, avec le double objectif de protéger et de rassurer. À un moment donné, j’ai appris que l’un des groupes envoyés en renfort – celui du maréchal des logis R.D. – se trouvait tout près du 52, boulevard Voltaire, où une nouvelle attaque venait de survenir : il se tenait à une cinquantaine de mètres des assaillants ! Dans la mesure où il ne se passait plus rien rue de Charonne, j’ai décidé de laisser ce groupe sur place : ayant pu juger à l’entraînement de l’efficacité du maréchal des logis, je lui faisais pleinement confiance pour se sortir seul de cette situation – parallèlement, je poursuivais la montée en puissance du dispositif de la rue de Charonne.
Vers vingt-trois heures, après m’être assuré que mon dispositif était stabilisé, j’ai pris la décision de laisser la rue de Charonne entre les mains du chef G.A., et d’aller voir ce qui se passait boulevard Voltaire. J’ai trouvé mon groupe à une vingtaine de mètres de la façade du Bataclan, dans l’enfilade du passage Saint-Pierre-Amelot, derrière les véhicules d’intervention. La BRI et le RAID étaient en train de se déployer, et le chef d’opérations du RAID nous a donné l’ordre de couvrir la mise en place de ses groupes d’assaut, ce que nous avons fait, tout en sécurisant l’extraction des blessés dans le passage Saint-Pierre-Amelot grâce au véhicule blindé du RAID. Je laisse le soin au maréchal des logis R.D. de vous faire le récit de ce qui s’est passé à proximité du Bataclan, car il s’est trouvé directement au contact avec la BAC 94, sous les tirs de Kalachnikov.
Une fois la situation réglée au Bataclan, je suis retourné rue de Charonne, où une autre unité était arrivée en renfort entre-temps. Nous avons continué à assurer le bouclage des lieux jusqu’à cinq heures du matin, heure à laquelle nos personnels se sont retirés, laissant les équipes de la police judiciaire procéder à leurs relevés. Notre objectif au cours de cette nuit a consisté à nous rendre utiles avec les moyens dont nous disposions, sur les points que nous avions pu identifier, en appliquant les techniques apprises à l’entraînement et en opérations. Notre plus-value a consisté à être équipés d’un armement bien plus puissant que celui des policiers, d’un gilet pare-balles par personne, et à disposer de la maîtrise de procédés tactiques nous permettant de mettre en place, en coordination avec la police, des dispositifs solides, de nature à rassurer. Je précise que les contacts avec la police se sont faits plus facilement rue de Charonne qu’aux abords du Bataclan, où ils n’ont pu s’établir qu’au hasard des rencontres.
Maréchal des logis-chef G. A. Étant de repos le soir du 13 novembre, j’étais parti boire un verre avec des collègues rue de Charonne, lorsque j’ai été alerté par un attroupement et des cris, parmi lesquels revenait le mot « attentat ». J’ai appelé mon capitaine commandant l’unité sur mon téléphone portable et, après lui avoir fait part de ce que j’avais vu et entendu, je suis arrivé à hauteur du bar La Belle Équipe, qui offrait un spectacle atroce après la fusillade qui venait d’y avoir lieu. Je suis allé voir le responsable des forces de police sur place, un major, à qui j’ai proposé de faire intervenir les groupes de militaires que je savais se trouver à proximité. Après avoir recueilli son accord, j’ai rendu compte à mon capitaine, qui m’a donné le feu vert.
J’étais encore en civil quand j’ai accueilli mon premier groupe boulevard Voltaire, et l’ai conduit auprès du nid de blessés en lui donnant pour mission d’établir un premier périmètre de sécurité afin de sécuriser la zone et de permettre un accès plus facile des secours et des forces, grâce à l’établissement d’un axe logistique sûr et ouvert, dédié à la circulation des véhicules d’urgence – c’est ce que nous faisons en OPEX. J’ai ensuite rendu compte aux forces de police et ai regagné en courant la mairie du 11e, où j’ai rendu compte à mon capitaine avant de revêtir ma tenue de combat et de repartir sur les lieux, afin d’y accueillir les différents groupes composant ma section et d’en assurer le commandement. Au fur et à mesure que ces groupes arrivaient, je les disposais dans les rues adjacentes afin d’élargir le dispositif. J’ai également pris l’initiative de constituer, au moyen de poubelles et de matelas trouvés dans la rue, des chicanes destinées à ralentir la circulation – car les comptes rendus de la police faisaient état du risque de voir surgir des tireurs embusqués et des voitures-béliers.
Notre mission s’est poursuivie toute la nuit, jusqu’à l’arrivée des services de police judiciaire. Nos soldats devant reprendre, dès le jour suivant, leurs activités dans le cadre de l’opération Sentinelle, nous avons quitté la rue de Charonne vers six heures du matin.
Maréchal des logis R. D. J’étais chef de groupe boulevard Voltaire le soir du 13 novembre. À l’issue des vingt-quatre heures de repos de mon groupe, je partais avec celui-ci à bord d’un véhicule afin de rejoindre le site que nous devions surveiller durant trois jours, lorsque nous sommes arrivés à la hauteur d’un attroupement, plus exactement de personnes qui couraient. Nous avons continué à avancer, jusqu’à parvenir à un civil posté au milieu du boulevard, qui déviait la circulation. Constatant que nous étions militaires, il nous a laissés passer ; une vingtaine de mètres plus loin, nous avons découvert des blessés auxquels les pompiers donnaient les premiers secours. À proximité, des policiers de la BAC 94, en colonne et arme de poing à la main – le policier placé en tête étant équipé d’un fusil à pompe – se tenaient le long d’un bâtiment.
Je suis descendu de mon véhicule afin d’entrer en contact avec les policiers – je ne disposais pas de mes moyens de communication ACROPOL, ceux-ci restant toujours sur le site dont nous assurons la surveillance. Alors que j’étais au centre du boulevard, j’ai entendu une première rafale de tirs, dont je n’ai pu identifier la provenance. Je suis donc retourné m’abriter derrière mon véhicule, en ai fait descendre mon groupe de combat et ai effectué une sûreté 360°. Sur ma droite, j’avais le square du Bataclan, et sur ma gauche, la façade de la salle de spectacle. J’ai demandé à mon adjoint d’appeler notre chef de section, afin de lui rendre compte que nous assistions à une prise à partie au 52, boulevard Voltaire. Une deuxième rafale est partie, d’une origine tout aussi indéterminée que la première. Un policier de la BAC est alors venu me dire que ses collègues étaient au contact avec le ou les tireurs à l’angle de la rue, et m’a demandé un soutien. J’ai envoyé quatre personnels de mon groupe dans cette direction, et confié à quatre autres la mission de sécuriser le square et d’évacuer les civils, notamment des journalistes, qui s’y trouvaient.
Les policiers se sont ensuite positionnés face au passage Saint-Pierre-Amelot, juste avant que les premiers éléments de la brigade de recherche et d’intervention (BRI) et du RAID n’arrivent, et que nous ne sécurisions leur mise en place avant l’assaut qui devait être donné puis, une fois l’assaut effectué, que nous ne couvrions leurs arrières afin d’éviter un sur-attentat par un individu embusqué. Nous sommes ensuite restés sur place le temps de l’évacuation des blessés, et n’avons quitté les lieux que vers cinq heures, afin de nous rendre sur les emplacements dont nous devions assurer la surveillance le lendemain.
M. le président Georges Fenech. Puisque vous avez assisté à l’arrivée des personnels de la BRI, pouvez-vous nous dire combien ils étaient ?
Maréchal des logis R. D. Ils sont arrivés à bord de plusieurs véhicules, dans les deux sens du boulevard. Six personnels sont descendus des deux véhicules qui se sont garés derrière le mien.
M. le président Georges Fenech. Vous avez entendu plusieurs rafales ?
Maréchal des logis R. D. Oui, des rafales manifestement tirées à l’extérieur, bien que l’on ne puisse en déterminer la provenance exacte. Je suis arrivé peu après vingt-deux heures devant le Bataclan, et n’ai pas entendu de tirs effectués à l’intérieur du bâtiment avant que l’assaut ne soit donné.
M. le président Georges Fenech. À bord de quels véhicules les personnels de la BRI sont-ils arrivés ?
Maréchal des logis R. D. Les deux véhicules qui sont arrivés par la même route que nous et sont garés derrière notre propre véhicule étaient des Passat. D’autres sont allés se garer plus loin, que je n’ai pu identifier.
M. le président Georges Fenech. En tout, combien de véhicules avez-vous vus arriver ?
Maréchal des logis R. D. Je ne sais pas combien de véhicules sont arrivés en plus des deux premiers.
M. le président Georges Fenech. Combien de personnels de la BRI avez-vous vus descendre des deux premiers véhicules ?
Maréchal des logis R. D. Ils étaient six.
M. le président Georges Fenech. En êtes-vous sûr ? Les avez-vous comptés ?
Maréchal des logis R. D. Je les ai vus passer.
M. le président Georges Fenech. Quelle était leur tenue ?
Maréchal des logis R. D. Ils étaient vêtus de noir, ils portaient des gilets tactiques et des armes.
M. le président Georges Fenech. Êtes-vous sûr d’avoir vu arriver d’autres personnels de la BRI ?
Maréchal des logis R. D. Oui, d’autres véhicules sont arrivés quelques minutes plus tard, mais ils venaient dans l’autre sens du boulevard, et des bus en stationnement m’ont empêché de voir les personnels qui en sont descendus.
M. Sébastien Pietrasanta, rapporteur. Quand vous avez constaté que les assaillants tiraient des rafales et que la BAC 94 ouvrait le feu en riposte, auriez-vous pu, vous et vos hommes, procéder également à des tirs ? Comment la coordination avec la BAC 94 s’est-elle faite avant l’arrivée de la BRI et du RAID, qui vous ont demandé de les sécuriser ?
Maréchal des logis R. D. Le premier policier est venu nous voir et, sur sa demande, quatre de nos personnels sont allés rejoindre ceux de la BAC. Tous les déplacements se sont faits sur des informations et des ordres donnés à la voix : le personnel de la BAC nous ayant indiqué que le terroriste tirait à partir d’une issue de secours, mes hommes se sont positionnés de manière à disposer d’une vue sur cet accès. Ils n’ont cependant pu ouvrir le feu, ne disposant pas de visuel sur le terroriste lui-même.
M. le rapporteur. Si vous aviez eu un visuel, auriez-vous ouvert le feu ?
Maréchal des logis R. D. Nous aurions évidemment fait en sorte de neutraliser le terroriste. Quand il a ouvert le feu pour la troisième fois, il l’a fait en entrouvrant la porte et en tirant au jugé, en ne laissant dépasser que son arme avant de refermer la porte.
M. le rapporteur. Ce tir a eu lieu vers vingt-deux heures quinze, et la BRI est arrivée cinq minutes plus tard. Une fois la BRI sur place, avez-vous conservé votre position ?
Maréchal des logis R. D. Oui, nous sommes restés en place jusqu’au déclenchement de l’assaut.
M. le rapporteur. Ce sont donc d’autres personnels du dispositif Sentinelle qui ont sécurisé la mise en place de la BRI et du RAID ?
Maréchal des logis R. D. Non, ce sont bien mes effectifs qui ont accompli cette mission. Leur rôle consistait justement à surveiller l’issue de secours située dans une ruelle, afin d’éviter que les terroristes ne sortent par là pour prendre à revers les personnels de la BRI et du RAID.
M. le rapporteur. Cette porte de secours était bien située au rez-de-chaussée ?
Maréchal des logis R. D. Effectivement.
M. le président Georges Fenech. Pouvez-vous nous décrire l’arrivée du RAID ?
Maréchal des logis R. D. Les hommes du RAID sont arrivés à bord d’un véhicule blindé, afin d’extraire deux blessés qui se trouvaient dans le passage Saint-Pierre-Amelot. Ils venaient de la partie du boulevard dissimulée à ma vue à cause des bus.
M. le président Georges Fenech. Comment les avez-vous identifiés comme des hommes du RAID ?
Maréchal des logis R. D. Je les ai reconnus à leur uniforme, et à l’inscription qu’ils portaient dans le dos.
M. Serge Grouard. Messieurs, je voudrais commencer par saluer votre engagement et vous en remercier, en notre nom et au nom de nos concitoyens.
J’aimerais savoir si, au cours d’une opération comme celle du 13 novembre, vous êtes placés sous un commandement opérationnel, ou si vous restez sous commandement militaire, comme je le suppose. Par ailleurs, comment la gestion de l’ouverture du feu s’effectue-t-elle ? Est-ce en réaction instantanée aux tirs ennemis, en protection, ou sur un ordre donné par votre commandant d’unité ?
J’ai le sentiment que tout au long de la soirée, vous n’avez disposé que de renseignements épars que vous aviez vous-mêmes réussi à recueillir, mais que le commandement opérationnel de la police ne vous a jamais exposé la situation de façon détaillée, ce qui vous aurait permis d’organiser vos effectifs de façon optimale – vous obligeant de ce fait à réagir en fonction des différents événements auxquels vous étiez confrontés. Mon colonel, confirmez-vous qu’il y ait eu sur le terrain un dysfonctionnement dans le partage des informations opérationnelles ? Pouvez-vous nous indiquer de façon détaillée qui vous dit quoi au cours d’une opération comme celle du 13 novembre ?
Lieutenant-colonel D. D. J’ai un échange très régulier avec le CO supérieur, qui m’informe que telle ou telle zone est identifiée comme un point chaud – c’est ainsi que j’ai été informé de ce qui se passait rue Bichat, par exemple, et non par le réseau ACROPOL. À l’inverse, quand le capitaine me rend compte des événements survenus rue de Charonne, je fais remonter cette information à mes chefs. Il est évident que lorsque nous sommes plongés en direct au cœur des événements, nous ne disposons pas d’une vision des faits aussi claire que la personne qui regarde BFMTV le lendemain matin : pour notre part, nous avons constaté qu’après l’attaque de la rue Bichat, les événements semblaient former une vague se déplaçant vers l’est, et c’est cette analyse des faits que nous avons partagée avec nos supérieurs et nos subordonnés.
M. Pascal Popelin. Parmi les missions qui vous étaient assignées préalablement aux événements, vous avez évoqué la surveillance de certains lieux de culte et des stations du réseau ferré. Vous avait-on également confié la mission de surveiller les salles de spectacle et de concert ?
Lieutenant-colonel D. D. Non, il ne nous avait pas été donné pour mission de surveiller les salles de spectacle ni les stades.
M. Philippe Goujon. Mon colonel, je vous exprime toute notre admiration devant le courage de vos hommes.
J’aimerais savoir si vous considérez que la chaîne hiérarchique de commandement pourrait faire l’objet de certaines améliorations. Par ailleurs, pouvez-vous nous expliquer comment vous suivez l’évolution d’un événement auquel vos hommes prennent part, dans quelles circonstances vous pouvez être amené à demander des renforts, et quelles sont les difficultés de transmission auxquelles vous estimez avoir été confronté ?
Enfin, l’armement et les munitions dont vous êtes dotés vous paraissent-ils adéquats pour mener à bien une mission comme celle du 13 novembre ?
Lieutenant-colonel D. D. Je pense que la chaîne de commandement telle qu’elle a été réorganisée fin octobre était pertinente d’un point de vue organique, dans la mesure où elle permettait une grande fluidité de l’engagement à tous les niveaux. Pour ce qui est des informations arrivant au niveau du commandement, sans doute les choses sont-elles perfectibles, comme elles le sont partout : il est évident que mieux un chef est renseigné, plus il dispose d’une vision claire de la situation. Pour ce qui est des liaisons avec les forces de sécurité intérieure, elles pourraient être renforcées, comme je l’ai déjà souligné en regrettant que le chef tactique d’état-major que je suis n’ait pu communiquer avec son homologue des forces de sécurité intérieure afin de faire un point de la situation : cette possibilité existe aux niveaux supérieur et inférieur, mais pas à mon niveau intermédiaire.
En ce qui concerne les moyens de liaison, je répète que si nous utilisons des téléphones portables dans le cadre de l’opération Sentinelle, c’est parce qu’il s’agit du moyen le mieux adapté à notre mission sur le plan technique : cela nous permet de disposer de comptes rendus réguliers des événements constatés sur les différents sites – par exemple, la découverte d’un colis suspect –, alors que les matériels utilisés en opérations extérieures ne nous permettraient sans doute pas de communiquer à partir d’une gare située en sous-sol. Cela dit, en période de crise, force est de constater que nous parvenons rapidement à saturation quand dix-neuf unités élémentaires tentent de me joindre simultanément. Le soir du 13 novembre, j’ai également craint que ne soit activée une « bulle de silence » entraînant la désactivation des portables dans un rayon donné, ce qui n’a heureusement pas été le cas. Si cela s’était produit, j’avais prévu de me rendre dans un café afin que mon PC établisse une communication avec le CO supérieur au moyen d’une ligne fixe.
Enfin, l’armement dont nous disposons, à savoir le fusil d’assaut FAMAS, nous donne toute satisfaction dans la mesure où il nous permet de tirer avec une grande précision à une distance variant de 25 mètres à 400 mètres – en binôme avec des jumelles dans ce dernier cas.
M. François Lamy. En ce qui concerne les transmissions, vous avez déploré de ne pouvoir communiquer à l’échelon tactique avec les forces de sécurité intérieure. Comment expliquez-vous que le contact avec les forces de police ne soit pas prévu à votre niveau, alors qu’il l’est au niveau supérieur, celui de la préfecture de police ? Par ailleurs, les informations que vous souhaitiez obtenir ne pouvaient-elles vous être communiquées par votre hiérarchie ?
Lieutenant-colonel D. D. J’obtenais effectivement des informations de la part du centre opérationnel interarmées (COIA), dont certaines lui avaient été communiquées par la préfecture de police. Cela dit, j’aurais apprécié de pouvoir comparer ces informations avec celles que mon homologue des forces de sécurité intérieure aurait pu me communiquer sur le terrain.
M. David Comet. Au fur et à mesure que la pression militaire s’accroît en Syrie, le risque est de plus en plus grand de voir revenir sur le territoire national des djihadistes bien formés militairement et équipés d’armes de guerre. Pour votre part, vous disposez de l’expérience nécessaire pour faire face à cette menace, compte tenu de vos engagements au cours d’opérations extérieures. Comment se fait-il que Sentinelle soit considérée le plus souvent comme une force supplétive des forces de sécurité, alors qu’elle possède un grand savoir-faire en matière d’observation et a l’habitude de mettre en œuvre du matériel militaire en faisant preuve de qualités de dynamisme et de furtivité qui seraient tout aussi utiles sur le territoire national qu’elles le sont en dehors de nos frontières ?
Tant que vous êtes sollicités pour intervenir comme une force supplétive, la question ne se pose pas, mais si nous devions faire face à des attaques d’une intensité encore supérieure à celle que nous avons connue le 13 novembre, ne serait-il pas opportun de mettre davantage à contribution les savoir-faire particuliers que je viens d’évoquer ?
M. le président Georges Fenech. Je rappelle que nous allons procéder prochainement à l’audition du gouverneur militaire, à qui cette question pourra également être posée.
M. Jean-Luc Laurent. En tant que député du Val-de-Marne, je salue l’intérêt de la mission Sentinelle du point de vue de la sécurisation des lieux de culte.
Pouvez-vous nous préciser dans quelles conditions vous pouvez faire usage de vos armes en appui ? Un protocole a-t-il été établi, des consignes ont-elles été données à l’ensemble des personnels intervenant dans le cadre de Sentinelle ?
Par ailleurs, votre mode opératoire, qui a été modifié en octobre dernier, a-t-il évolué de la même manière à Paris intra muros et en dehors de la capitale ?
Capitaine P-M. A. La seule consigne d’ouverture du feu sur le territoire métropolitain est, pour Sentinelle, la même que celle qui s’appliquait pour Vigipirate, à savoir la légitime défense pour soi-même et pour autrui. Dans le contexte du Bataclan, le maréchal des logis R.D. a dû faire face avec son groupe à un individu qui, tirant au hasard à la Kalachnikov, mettait en péril de mort les personnes se trouvant sur place – ce qui est considéré comme une situation de guerre. S’il avait été matériellement en mesure de le faire, le maréchal des logis aurait donc été tout à fait fondé à neutraliser cet individu sur le fondement de la légitime défense. L’ordre qu’il a pris l’initiative de donner à ses hommes – prendre les dispositions de combat, en l’occurrence mettre les cartouches en chambre – était parfaitement justifié.
Lieutenant-colonel D. D. Dans le cadre du dispositif Sentinelle, nos fusils sont équipés d’un témoin d’obturation de chambre (TOC) mis en place à la suite des premiers attentats de janvier 2015, et qui constitue une sécurité supplémentaire dans le cadre d’une utilisation de l’arme au quotidien. Le fait d’ôter ce dispositif permet à la cartouche d’accéder à la chambre, ce qui rend l’arme pleinement opérationnelle.
Maréchal des logis R. D. Le TOC est introduit dans la chambre à la place d’une munition réelle. Quand le chargeur est accroché sur l’arme, un simple mouvement de chargement a pour effet d’éjecter le TOC et faire entrer la munition en chambre : l’arme est alors approvisionnée et armée.
M. le rapporteur. Vous êtes-vous demandé si vous deviez aller au-delà de la légitime défense et pénétrer à l’intérieur du Bataclan ? Avec le recul, considérez-vous qu’il faille envisager d’évoluer sur cette question ?
Maréchal des logis R. D. Je me suis effectivement posé cette question mais je ne disposais d’aucun visuel sur l’entrée du Bataclan et donnais donc plutôt la priorité à la surveillance de l’issue de secours, à partir de laquelle le terroriste tirait en direction de la rue. Or, il nous aurait été impossible d’ouvrir cette porte de l’extérieur.
M. le rapporteur. Une entrée en force dans le bâtiment, effectuée avec la BAC 94, était-elle envisageable ?
Maréchal des logis R. D. Avec la BAC, nous aurions sans doute pu entrer. En revanche, je n’aurais pu me lancer dans une telle entreprise avec la seule participation du groupe de huit hommes dont je disposais, dans la mesure où je ne connaissais ni la disposition des lieux, ni le nombre d’assaillants et leur niveau d’armement : n’étant pas équipé de mon ACROPOL, ce n’est qu’au fil de la soirée que j’ai pu recueillir auprès de la BAC des renseignements sur ce point – en l’occurrence la présence de quatre assaillants munis d’armes de guerre et d’une ceinture d’explosifs.
Lieutenant-colonel D. D. Je souligne également le fait que, s’il était entré dans le bâtiment, le maréchal des logis aurait dû faire face à la difficulté consistant à distinguer les ennemis des civils à protéger. Nous ne sommes pas entraînés à discriminer dans les conditions d’une attaque terroriste effectuée en milieu urbain.
M. le rapporteur. Cette question est-elle susceptible d’évoluer ?
Lieutenant-colonel D. D. Nous n’avons pas reçu de directives en ce sens. En l’état actuel des choses, notre entraînement consiste simplement à améliorer notre temps de réaction face à un individu considéré d’emblée comme un ennemi.
M. le président Georges Fenech. Comme l’a dit le capitaine, vous êtes une force de protection et de sécurisation, mais pas une force d’intervention.
Lieutenant-colonel D. D. En tout état de cause, chaque force est spécialisée et, pour notre part, nous ne possédons pas le savoir-faire consistant à discriminer l’ennemi dans une situation correspondant à l’attaque du Bataclan.
M. le président Georges Fenech. Pour reprendre la question posée par David Comet, considérez-vous qu’une attaque terroriste d’une intensité supérieure à celles que nous avons connues l’année dernière pourrait justifier que vous soyez sollicités pour intervenir prioritairement, en mettant à profit votre expérience militaire, et non comme force d’appui ?
Lieutenant-colonel D. D. Le scénario que vous évoquez mérite que l’on y réfléchisse, mais il ne m’appartient pas de répondre à une question de cet ordre, dans la mesure où je suis ici en tant que chef d’état-major tactique : ce qui m’intéresse avant tout, c’est de savoir comment je vais répartir mes unités en fonction de la situation à laquelle je dois faire face.
M. le président Georges Fenech. Messieurs, je vous remercie pour vos interventions qui ont été riches d’enseignements.
Audition, à huis clos, de policiers intervenus lors des attentats des 7, 8 et 9 janvier 2015 : M. B. B., commissaire de police, M. M. J., commandant de police, M. J-S. B., chef de bord BAC 11
Compte rendu de l’audition, à huis clos, du lundi 14 mars 2016
M. le président Georges Fenech. Messieurs, nous vous remercions d’avoir répondu à la demande d’audition de notre commission d’enquête relative aux moyens mis en œuvre par l’État pour lutter contre le terrorisme depuis le 7 janvier 2015.
La semaine dernière, nous avons commencé à aborder les questions relatives à la conduite des opérations, à l’intervention des forces de l’ordre, et aux moyens mis à leur disposition. Nous poursuivons nos investigations avec des fonctionnaires de police de la direction de la sécurité de proximité de l’agglomération parisienne (DSPAP) intervenus lors des attentats de janvier 2015. Nous procéderons ensuite à l’audition de policiers intervenus en novembre dernier.
Je rappelle que la DSPAP est compétente à Paris et dans les départements de la petite couronne ; elle a pour mission de lutter contre la petite et la moyenne délinquance, et plus particulièrement celle commise sur la voie publique, comme les vols avec violence. Par ailleurs, la DSPAP reçoit et traite les appels d’urgence au numéro 17.
Lors des attentats commis en janvier 2015, des unités de la DSPAP sont intervenues. Nous recevons M. B. B., commissaire de police, chef adjoint du service des compagnies de sécurisation et d’intervention (CSI) et chef de la CSI de Paris, M. M. J., commandant de police, chef de la CSI du Val-de-Marne (CSI 94), et M. J-S. B., chef de bord à la brigade anticriminalité du onzième arrondissement de Paris (BAC 11). Nous devions aussi accueillir Mme Catherine Morelle, commissaire de police, chef de l’Unité mobile d’intervention et de protection (UMIP), chargée notamment de la protection de Charlie Hebdo, mais elle n’a pu nous rejoindre ce soir.
En raison de la confidentialité des informations que vous pourriez nous délivrer, cette audition se déroule à huis clos. Elle n’est donc pas diffusée sur le site internet de l’Assemblée nationale. Néanmoins, et conformément à l’article 6 de l’ordonnance du 14 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, son compte rendu pourra être publié en tout ou partie, si nous en décidons ainsi à l’issue de nos travaux. Je précise que les personnes entendues à huis clos recevront les comptes rendus de leur audition et qu’elles pourront faire des observations. Celles-ci seront soumises à la Commission qui pourra décider d’en faire état dans son rapport.
Je rappelle que, conformément aux dispositions de l’article 6 précité, « sera punie des peines prévues à l’article 226-13 du code pénal — un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende — toute personne qui, dans un délai de vingt-cinq ans, divulguera ou publiera une information relative aux travaux non publics d’une commission d’enquête, sauf si le rapport publié à la fin des travaux de la commission a fait état de cette information ».
Je vais vous laisser la parole, en vous demandant de présenter rapidement le rôle que vous avez été amené à tenir personnellement ou avec votre unité, avec toute la précision géographique et horaire possible.
Mais, au préalable, conformément aux dispositions de l’article 6 précité, je dois vous demander de prêter le serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité.
MM. B. B., J-S. B. et M. J. prêtent serment.
M. J-S. B., chef de bord à la brigade anticriminalité du 11e arrondissement de Paris (BAC 11). Le 7 janvier 2015, j’étais chef de bord d’un véhicule de la BAC 11. Alors que nous étions en patrouille, nous avons reçu un appel nous informant d’éventuels coups de feu au numéro 10 de la rue Nicolas-Appert. On ne nous a pas précisé si c’était sur la voie publique ou à l’intérieur d’un bâtiment. Nous nous sommes rapprochés. J’ai demandé à mon chauffeur de nous déposer sur le boulevard Richard-Lenoir.
Je suis descendu avec deux collègues et nous nous sommes dirigés à pied vers la rue Nicolas-Appert. C’est une sorte de cul-de-sac et elle n’est pas connue comme une rue à problèmes. En arrivant dans la rue, nous n’avons rien remarqué de particulier ; il y avait même un camion qui livrait des colis. Devant la porte du numéro 10, un employé de maintenance nous a expliqué qu’il avait un collègue à l’intérieur, blessé par balles. Nous ne savions toujours rien sur l’immeuble et nous lui avons demandé quelle était la nature de l’établissement. Il n’a pas su nous répondre.
Dans l’immeuble d’en face, il y avait des gens à une fenêtre. Ils nous ont appelés, nous ont dit qu’ils avaient vu trois personnes armées entrer dans l’immeuble et qu’ils avaient entendu des coups de feu. L’un d’eux nous a indiqué que cet immeuble hébergeait les locaux de Charlie Hebdo. C’est alors que nous avons entendu des rafales à l’intérieur. Quelques secondes plus tard — nous avions eu à peine le temps de nous écarter légèrement de l’entrée —, les portes se sont ouvertes et les deux frères Kouachi sont sortis. Ils ont fait feu dans notre direction. Mes deux coéquipiers et moi avons réussi à nous dissimuler derrière des murs.
À ce moment, des collègues en vélo tout-terrain (VTT) sont arrivés. Les frères Kouachi se sont focalisés sur ces collègues en tenue, en tirant dans leur direction. Nous avons riposté, sans effet. Ensuite, j’ai essayé de transmettre des messages pour indiquer ce qui se passait. Les frères Kouachi sont montés dans leur voiture ; ils sont partis ; ils ont croisé une voiture de police et de nouveaux échanges de tirs ont eu lieu. Ils sont repartis.
La station directrice nous a demandé de retourner au numéro 10 de la rue Nicolas-Appert pour savoir ce qui s’était passé à l’origine. Nous sommes revenus sur les lieux. En arrivant, nous avons trouvé les sapeurs-pompiers qui nous ont informés du décès de l’agent de maintenance qui était à l’intérieur. M. Pelloux est venu nous chercher et nous a demandé de monter au deuxième étage où il y avait de nombreuses victimes. Nous sommes montés ; nous avons sécurisé les lieux ; nous avons découvert le carnage dans les bureaux. Nous avons transmis les premières informations et avons ensuite été relevés par les autres services qui sont arrivés sur place.
M. B. B., commissaire de police, chef adjoint du service des compagnies de sécurisation et d’intervention (CSI) et chef de la CSI de Paris. Pour ma part, je suis le chef adjoint du service qui regroupe les quatre CSI du ressort de la DSPAP — il y en a une par département en comptant Paris. J’ai une double casquette, puisque je suis aussi le chef de la CSI de Paris.
Pour que vous puissiez comprendre leur rôle dans ce dispositif, je vais vous expliquer brièvement ce que sont les CSI. Unités d’intervention polyvalentes, elles sont compétentes en matière d’anticriminalité comme les BAC, mais aussi en matière de maintien de l’ordre et de violences urbaines, et elles jouent un rôle de primo intervenant en cas de crise, c’est-à-dire face à des preneurs d’otage, des terroristes ou des forcenés. Les CSI interviennent alors avant l’arrivée des corps spécialisés de troisième rang que sont le service Recherche assistance intervention et dissuasion (RAID) et la Brigade de recherche et d’intervention (BRI). Les CSI ont des unités en tenue, en civil, à moto. Elles ont aussi de petits groupes d’intervention appelés les groupes de soutien opérationnel (GSO). La CSI 75 envoie tous les jours environ vingt voitures et une dizaine de motos dans Paris. Le service des CSI est intervenu lors de tous les attentats qui ont eu lieu en Île-de-France en 2015 : Charlie Hebdo, Montrouge, la Porte de Vincennes, tous les lieux du 13 novembre, le commissariat du 18e arrondissement.
Le 7 janvier 2015, j’étais dans mon bureau. Sur les ondes radio, j’ai entendu qu’un appel à police secours venait d’être reçu, annonçant que deux individus encagoulés et munis d’armes d’épaule venaient d’entrer dans un immeuble situé rue Nicolas-Appert, sans plus de précision. J’ai pensé à un règlement de comptes ou à un vol à main armée. J’ai saisi mon GSO et j’ai demandé à mes hommes de commencer à s’équiper, leur expliquant que nous allions probablement intervenir pour poursuivre des braqueurs ou des auteurs de règlement de comptes. Le temps que je m’équipe et que je monte les rejoindre, les appels radio se sont multipliés. Nous avons compris qu’une fusillade était en cours dans le 11e arrondissement.
Il faut savoir que la DSPAP dispose de sept conférences — autrement dit de canaux – radio. Compte tenu du flux très important, une seule conférence ne permettrait pas d’assurer toutes les missions. Le problème est que l’on peut ne pas savoir exactement tout ce qui se passe en temps réel : au moment où la BAC du 11e arrondissement (BAC 11) intervenait sur la conférence 44, j’étais sur la 137. Il peut y avoir un petit délai dans les remontées d’information, mais nous n’avons pas trouvé de meilleur système : avec moins de conférences, nous ne pourrions pas travailler du tout.
Nous sommes alors partis vers la Porte de Pantin, la dernière direction annoncée sur les ondes radio comme étant celle des fuyards en Clio blanche. Nous pensions que, s’ils provoquaient un accident en conduisant trop vite, nous aurions une chance de les localiser. En ayant encore un peu plus de chance, nous pourrions même tomber sur eux et provoquer un accident pour les fixer à un endroit. Pendant une petite heure, nous avons tourné entre le nord de Paris et les villes limitrophes — Aubervilliers, Saint-Denis, Saint-Ouen. Malheureusement, nous n’avons jamais réussi à mettre la main sur ces individus. Nous sommes alors revenus dans le onzième arrondissement où nous avons sécurisé le périmètre de Charlie Hebdo pour éviter les risques de surattentat liés à l’arrivée sur place du Président de la République et des diverses autorités gouvernementales. Nous avons aussi activé le poste de commandement mobile de la DSPAP, un camion dont la CSI a la charge.
Le 8 janvier au matin, j’ai appris par France Info qu’une fusillade venait de se produire à Montrouge. Il se trouve que j’habite à Clamart, juste à côté de Montrouge. France Info n’avait rien de plus précis. J’ai allumé la radio de la police et me suis dirigé vers Montrouge. J’ai eu des difficultés à me faire communiquer la bonne adresse par la salle de commandement : c’est dire à quel point la fusillade était récente. Quand je suis arrivé sur place, il y avait déjà des policiers, et les premiers soins étaient donnés à la policière municipale, Clarissa Jean-Philippe, qui était en état de mort apparente. Dans cette optique de surattentat, j’ai pris le commandement des unités de la CSI des Hauts-de-Seine (CSI 92). Nous avons organisé un périmètre assez large, craignant d’être attaqués dans notre dos. À la fin de cette intervention, je suis reparti pour Paris.
Dans la matinée, nous avons été informés que les frères Kouachi étaient à bord d’une Clio grise, qu’ils avaient commis une grivèlerie d’essence vers Villers-Cotterêts et qu’ils roulaient sur une nationale en direction de Paris. La DSPAP a décidé de sécuriser les portes de Paris en organisant des postes de contrôle avec des fonctionnaires munis d’une protection balistique et d’un armement lourds, pour être en mesure d’intercepter le véhicule. Nous avons tenu cette position de 10 h 30 à vingt-trois heures, après quoi nous avons été relevés par la BAC de nuit de Paris. Ce sont les compagnies en tenue de la CSI qui ont assuré cette sécurisation des portes de Paris. Nos personnels en civil, nos motards et notre GSO étaient en patrouille dynamique dans Paris, afin de détecter d’éventuels actes de terrorisme et d’avoir une capacité de projection rapide.
Le vendredi matin, nous avons appris que les frères Kouachi étaient figés à Dammartin-en-Goële, ce qui nous permettait de relâcher un peu l’attention les concernant dans Paris, mais nous ne savions pas s’il y avait d’autres menaces. Vers treize heures, nous avons capté un message radio indiquant qu’un individu tirait à l’arme d’épaule sur la devanture du magasin Hypercacher de la Porte de Vincennes. Je m’y suis rendu assez rapidement, en venant de Paris. J’ai garé mon véhicule sur le grand rond-point de la Porte de Vincennes et j’ai pris le commandement des opérations à cet endroit puisqu’il y avait déjà beaucoup de policiers de différents commissariats. J’ai été rejoint par des véhicules de la CSI 75, avec des hommes mieux équipés que les policiers de commissariat.
Le magasin Hypercacher ouvre sur deux rues à angle droit, la façade principale étant située sur l’avenue de la Porte de Vincennes, et une porte de service donnant sur l’autre côté. L’auteur de la fusillade était retranché à l’intérieur. Dans ce genre de situation, la tactique vise à « limiter les dégâts » : il s’agit d’essayer de confiner l’individu apparemment lourdement armé à l’intérieur, pour éviter qu’il ne fasse un nombre encore plus grand de victimes en ressortant. On ne choisit pas délibérément de sacrifier ceux qui sont à l’intérieur, mais on essaie d’éviter que la situation n’empire. On s’efforce de l’empêcher de sortir en présentant une opposition armée aux diverses sorties qu’il pourrait utiliser, et on temporise en s’abstenant de toute action superflue dans l’attente des services spécialisés, le RAID ou la BRI.
Pour ma part, j’ai travaillé sur les côtés ouest et sud, et j’ai réorganisé le positionnement des fonctionnaires, faisant reculer ceux qui étaient inutilement exposés. J’ai ensuite été rejoint par d’autres effectifs. À un moment donné, en faisant le tour du dispositif, j’ai réussi à rejoindre le commandant M.J. qui était déjà là lui aussi, mais plutôt sur les flancs nord et est. Avec nos unités, nous avons extrait des riverains qui étaient réfugiés dans des boutiques, par exemple, et qui auraient pu se trouver dans l’axe de tir de Coulibaly. L’exercice demande une certaine technicité : il faut créer des colonnes d’intervention avec des hommes munis de boucliers, afin d’entourer les gens et les évacuer dans les conditions les plus sûres possible.
Ensuite, le RAID et la BRI ont donné l’assaut. Lorsqu’elle intervient dans ce genre de crise à Paris, la BRI constitue une brigade anti-commando : les équipes de la BRI sont au centre et, dans un deuxième cercle, on trouve celles des CSI ou des BAC de nuit en cas d’intervention nocturne. Notre but est alors d’appuyer les colonnes de la BRI pour récupérer leurs blessés ou les otages qu’ils extraient. Quand le RAID et la BRI ont donné l’assaut, nous avons récupéré quatre otages et un policier du RAID qui était blessé, et nous avons mis en place le poste de commandement de la DSPAP. Voilà pour l’aspect purement factuel des événements.
M. M. J., commandant de police, chef de la compagnie de sécurisation et d’intervention du Val-de-Marne (CSI 94). Personnellement, je n’ai pas été concerné par les événements du 7 janvier. En revanche, l’unité que j’ai l’honneur de commander a été appelée le 8 janvier en début d’après-midi pour interpeller un individu réfugié dans une agence bancaire à Gentilly et pouvant correspondre au signalement d’Amedy Coulibaly. Nous avions déjà reçu une information selon laquelle Amedy Coulibaly pouvait revenir dans ce secteur, soit à bord d’une Clio blanche plus ou moins repérée au moment de la fusillade de Montrouge, soit par les transports en commun. Nous avons alors monté une colonne d’intervention et nous avons interpellé l’individu à l’intérieur de l’agence bancaire. La police judiciaire a pris le relais et les soupçons ont été levés au bout de vingt-quatre heures de garde à vue.
Le 8 janvier, en plus de cette intervention, nous avons envoyé des effectifs dans le nord-est du département et aux abords des nationales arrivant dans la capitale, notamment les nationales 2 et 4, suite à l’information selon laquelle les frères Kouachi se trouvaient dans le nord-est parisien. Nos effectifs étaient dotés de moyens lourds, c’est-à-dire de gilets pare-balles lourds et d’armes longues, de manière à pouvoir intercepter les individus s’ils revenaient vers Paris. Ce dispositif a été repris par les effectifs de la BAC de nuit du Val-de-Marne (BAC 94 N), et maintenu jusqu’au vendredi matin.
Le vendredi 9 janvier, je me trouvais à la préfecture de police pour une réunion des chefs des CSI quand, vers treize heures, nous avons été informés que des coups de feu avaient été tirés au niveau du magasin Hypercacher qui a la particularité de se trouver à la limite des départements de Paris et du Val-de-Marne. Il donne sur l’avenue Gallieni, petite contre-allée de Saint-Mandé, et à l’angle de la rue du Commandant-L’Herminier. Suite à cet appel, mes effectifs de la CSI 94 se sont rendus d’eux-mêmes sur place où je les ai rejoints en arrivant par le bois de Vincennes et Saint-Mandé.
Arrivé sur place, j’ai pris la mesure de l’affaire. Les effectifs de police, répartis tout au long de l’avenue Gallieni et de la rue du Commandant-L’Herminier, se trouvaient extrêmement dispersés, munis d’armes diverses, dont des fusils à pompe, et provenant d’unités différentes : direction de l’ordre public de la circulation (DOPC), police de Paris intra-muros, direction territoriale de la sécurité publique du Val-de-Marne. J’ai commencé à regrouper des effectifs, quitte à faire deux ou trois petites entorses, à savoir intégrer dans les colonnes des collègues d’autres unités, équipés de gilets lourds et de boucliers balistiques, afin d’avoir un appui feu. Celui-ci a été apporté principalement par les effectifs DOPC de la compagnie des transferts, escortes et protections (COTEP), qui étaient armés de fusils d’assaut de type M4 de calibre 5,56 millimètres, et par des collègues dotés de fusils à pompe.
Nous avons positionné les effectifs à l’angle du boulevard Gallieni et de la rue du Commandant-L’Herminier, mais également à l’arrière du bâtiment de l’Hypercacher. Il faut savoir que ce bâtiment donne sur un petit immeuble qui est intégré dans une cité. Nous avons positionné des colonnes d’intervention, équipées de moyens lourds et de protections, de manière à éviter toute sortie de ce bâtiment, principalement sur les façades est et nord-est des lieux. Dans l’attente de l’intervention des unités spécialisées, nous avons aussi rétracté le périmètre, c’est-à-dire que nous avons fait reculer les collègues qui étaient trop proches de l’Hypercacher et de l’entrée principale qui donne sur le boulevard Gallieni, de manière à protéger tout le monde. J’ai aussi procédé à la fermeture des vannes d’une station-service toute proche qui aurait pu faire l’objet d’un incendie volontaire par des tirs.
La mise en place de ce dispositif a pris un certain temps. J’ai été en contact avec le commissaire B.B. ici présent, qui m’a donné pour mission de continuer à gérer ce périmètre dans l’attente des unités d’intervention de niveau 3, c’est-à-dire le RAID et la BRI. Une fois que nous avons été relevés par des colonnes de la BRI, nous nous sommes mis à leur disposition en tant qu’éléments d’appui. La BRI m’a demandé de procéder à l’évacuation d’un magasin situé à l’angle du boulevard Gallieni et de la rue du Commandant-L’Herminier, dans lequel se trouvaient encore des personnes. Nous savions également qu’il y avait des gens dans un autre magasin, Charles Traiteur, contigu à l’Hypercacher, mais ignorions si les deux commerces communiquaient entre eux. Ces personnes ont été forcées de rester à l’intérieur du magasin, pour qu’elles soient protégées et aussi pour empêcher toute sortie inopinée du preneur d’otages. Plus tard, le RAID est allé les chercher et les a mises en sécurité après les avoir palpées.
Ensuite, nous sommes restés en position, en appui de l’unité du RAID qui était de ce côté-là du dispositif. Vers dix-sept heures, nous avons reçu des messages disant que l’assaut avait été donné à Dammartin-en-Goële. Parallèlement, un officier du RAID est venu nous indiquer qu’il allait donner l’assaut et que nous allions devoir prendre sa place, c’est-à-dire le positionnement du RAID juste avant l’assaut. Nous avons monté une colonne de la CSI 94 au niveau du boulevard Gallieni et de la rue du Commandant-L’Herminier, sur le trottoir droit, afin d’appuyer l’unité du RAID qui donnait l’assaut.
Nous avons recueilli et mis en sécurité plusieurs otages — trois femmes et un homme — et un collègue du RAID qui avait été blessé. Nous avons palpé les otages, ce qui a été rendu possible par le fait qu’il y avait des femmes dans les unités présentes, afin de nous assurer qu’ils ne portaient pas d’arme. Nous voulions nous assurer que ces personnes ne portaient pas d’arme et qu’il n’y avait pas de complice de Coulibaly parmi elles : à ce stade, nous pensions qu’il avait une femme avec lui. Nous avons pu lever les doutes grâce aux informations recueillies auprès des familles des otages, qui se trouvaient dans le périmètre extérieur. En termes de périmètre, il faut savoir que la CSI 94 a été engagée sur une zone d’abord très restreinte qui a ensuite été élargie quand nous sommes intervenus en appui des effectifs du RAID.
À l’issue de tout cela, nous sommes rentrés chez nous avec le sentiment du devoir accompli.
M. le président Georges Fenech. Et soyez bien conscients que c’est aussi notre sentiment.
M. Sébastien Pietrasanta, rapporteur. Merci pour vos interventions respectives. Ma première question s’adresse plutôt à M. J-S.B. qui est arrivé parmi les premiers intervenants. Au moment où vous arrivez sur les lieux, savez-vous que le siège de Charlie Hebdo se trouve rue Nicolas-Appert ?
M. J-S. B. Non, pas du tout. Personnellement, je savais que Charlie Hebdo avait dû quitter le 20e arrondissement, mais j’ignorais qu’il avait emménagé dans cette rue.
M. le rapporteur. À quel moment vous en êtes-vous rendu compte ? Quand vous avez pénétré dans l’immeuble ? Quand vous avez eu affaire à M. Pelloux ? Est-ce que vous en avez été informé par radio ?
M. J-S. B. Quand nous sommes arrivés, trois personnes à une fenêtre du bâtiment d’en face nous ont indiqué que des individus lourdement armés étaient entrés dans l’immeuble où se situaient les locaux de Charlie Hebdo.
M. le rapporteur. Que pouvez-vous nous dire de la liaison radio entre vous qui étiez sur le terrain et la salle de commandement ? Vous avez évoqué le sujet et la presse a fait état de difficultés dans ce domaine. Il semblerait que la salle de commandement occupait les ondes. Depuis, l’organisation aurait été modifiée pour laisser la priorité aux policiers de terrain. Avez-vous eu des difficultés pour joindre la salle de commandement ? La pratique a-t-elle réellement évolué ? Avez-vous vraiment la priorité quand vous intervenez ?
M. J-S. B. Je confirme. Le 7 janvier, quand les frères Kouachi sont sortis, nous sommes devenus la cible de leurs tirs. J’ai réussi à me dissimuler derrière un mur qui, malheureusement pour moi, était juste à côté de leur véhicule en stationnement. Mais nous étions en civil et ils se sont focalisés sur les policiers en tenue qui sont arrivés en VTT. Du coup, je les avais sur ma droite. Je savais qu’ils allaient entrer dans leur véhicule dont j’avais l’immatriculation, puisque j’étais à une quinzaine de mètres. Je voulais transmettre toutes ces informations, mais je n’ai jamais pu prendre la parole à cause de tous les appels police secours qui confirmaient les tirs dans la rue.
M. le rapporteur. Ces informations venaient de la salle de commandement ou d’autres unités ?
M. B. B. Les gens appellent le 17, le numéro de police secours. Les informations remontent à la salle de commandement qui les répercute vers la radio.
M. le rapporteur. N’y a-t-il pas un filtre au niveau de la salle de commandement ?
M. J-S. B. Nous transmettons à notre station directrice qui est soit celle du 11e arrondissement, soit celle qui chapeaute le district, c’est-à-dire les 11e, 12e et 20e arrondissements. Au-dessus, il y a encore un niveau.
M. B. B. Quand vous composez le 17 pour joindre la police, l’appel arrive à un standard. S’il s’agit d’une mission non urgente, le standardiste remplit une fiche qui est envoyée par courriel ou par un système électronique à la salle de commandement. Il y a une salle de commandement pour toute la DSPAP, puis une salle par district, puis une autre par arrondissement.
Il arrive que le standard récupère des informations très précieuses qui doivent être envoyées en urgence. Dans ces cas-là, la voie électronique n’est pas forcément la plus opportune. Le standardiste peut alors contacter la salle de commandement par radio, et tout le monde entend l’information. La salle de commandement peut ensuite donner des ordres en fonction de l’information reçue. Elle dispose techniquement d’une priorité sur les ondes radio. Cela est justifié. Si par exemple un policier se fait voler sa radio lors d’une intervention houleuse, le système des priorités fait que le voleur de radio mal intentionné ne pourra pas perturber les messages de la salle de commandement puisque cette dernière aura une priorité systématique sur les messages émis depuis la radio volée. Mais l’effet pervers de cette priorité radio est que personne ne peut interrompre la salle de commandement, y compris en cas de nécessité.
Les collègues arrivés en premier ce jour-là voulaient prévenir qu’ils se faisaient tirer dessus ; ils pouvaient donner la position des individus, leur description, l’immatriculation du véhicule, etc. Ces informations étaient très importantes, ne serait-ce que pour le deuxième véhicule d’intervention : les policiers ne s’approchent pas de la même manière s’il y a des tirs au coin de la rue ou si les tireurs sont déjà partis.
Mais la salle a parfois utilisé de façon inopportune les ondes radio, empêchant les intervenants de transmettre. Quand le même message doit passer sur toutes les conférences, on utilise une procédure relativement lourde, l’appel général : après un jingle, une petite musique introductive, le message est diffusé dans un format très précis, puis répété. Pendant la durée de l’appel, qui peut durer une minute ou une minute trente, personne ne peut parler. En l’espèce, des appels généraux informant de la situation rue Nicolas Appert ont été diffusés sans pour autant apporter d’éléments opérationnels pertinents. Cela a perturbé les primo-intervenants qui voulaient communiquer. Cependant, si cela a insécurisé les intervenants, je ne crois pas que le résultat de la mission en ait été particulièrement impacté.
M. le rapporteur. C’est ce qui s’est passé le 7 janvier ?
M. J-S. B. Je confirme, c’est bien ce qui s’est passé. La salle de commandement a la priorité sur les ondes : elle peut nous couper, mais pas l’inverse. Pendant que j’essayais de transmettre mes messages, j’entendais les appels généraux.
M. le rapporteur. Ils ont duré une minute ou une minute trente, mais, j’imagine, cela vous a semblé une éternité.
M. J-S. B. En effet.
M. le rapporteur. Les procédures ont-elles évolué depuis le 7 janvier pour tenir compte des observations remontées du terrain, ou sont-elles toujours calées de la même manière avec le jingle ?
M. J-S. B. Il y a toujours ce fameux jingle, mais les choses ont évolué. Quand une opération sensible est en cours, les stations directrices émettent le message suivant : « silence radio, nous laissons la priorité aux effectifs intervenants ». Tous les collègues doivent attendre pour passer des messages concernant d’autres affaires. La première étape est respectée. Cela étant, les appels généraux sont toujours prioritaires et ils peuvent tomber à tout moment.
M. le rapporteur. Mais vous avez noté une évolution positive. Ma dernière question concerne les tirs. Vous vous êtes retrouvés face aux frères Kouachi à deux reprises, si j’ai bien compris ?
M. J-S. B. Nous nous sommes retrouvés face à eux à trois reprises. Quand ils sont sortis de l’immeuble, nous sommes devenus une cible pour eux. Nous avons cherché à nous dissimuler et nous avons riposté. Quand ils ont croisé le véhicule arrivant en face, j’ai fait feu sur leur voiture. Ensuite, ils sont partis sur le boulevard Richard-Lenoir. Nous avons entendu des coups de feu parce qu’ils tiraient sur d’autres collègues, mais nous ne savions pas exactement où ils se trouvaient. C’était délicat. En fait, ils ont fait demi-tour, ils ont contourné le boulevard Richard-Lenoir pour revenir dans notre direction, mais de l’autre côté du terre-plein.
M. le rapporteur. D’après ce que vous décrivez, nous comprenons que vous vous êtes retrouvé avec plusieurs de vos collègues face au feu nourri des frères Kouachi. L’un de vos collègues est malheureusement décédé. Vous dites que vous avez riposté et il y a d’ailleurs eu pas mal d’échanges de coups de feu. Pour autant, jamais vous n’avez réussi à atteindre les frères Kouachi. Pour vous, est-ce lié à votre armement ? Il a été dit et redit qu’il y avait une disproportion entre l’armement des terroristes et le vôtre. Est-ce une question de formation ? Est-ce que vous arrivez à l’expliquer autrement que par la difficulté de l’intervention, dans le feu de l’action ? Il ne s’agit pas de vous brusquer, mais certains de vos représentants syndicaux disent que les policiers ne savent plus tirer. Depuis janvier, les choses se sont-elles améliorées ? Avez-vous reçu une formation supplémentaire ? Avez-vous eu un changement d’armement ?
M. J-S. B. Pour notre part, lorsque nous avons tiré sur les frères Kouachi, ils étaient à une certaine distance et largement protégés par des gilets lourds puis par leur véhicule. Nous ne savons même pas si nous les avons touchés, car nous n’avons pas eu de retour. D’autres collègues les ont croisés en voiture, donc en déplacement.
Nous sommes essentiellement formés pour utiliser les armes en riposte, c’est-à-dire pour nous défendre, à une courte distance, de façon très rapide. Nous ne sommes pas entraînés au tir de précision. Je ne pense pas que la formation soit à remettre en cause. Nous n’avions pas du tout le même armement que les individus en question et nous étions en mouvement. Il est possible que nous les ayons touchés dans leur gilet, et nous avons atteint leur véhicule — il y a des impacts et des pare-brise sont tombés —, mais cela n’a pas changé la donne.
On nous a promis des armes plus lourdes. Nous avons reçu des moyens de protection – casques balistiques, gilets souples – dont nous n’étions pas dotés jusqu’alors. On attend l’arrivée d’armes longues, le Heckler & Koch G36 (HK G36) qui permet d’être plus à même de riposter face à ce type d’individus.
M. le rapporteur. Ces armes devraient arriver dans les prochaines semaines. En ce qui concerne la formation, on m’a expliqué qu’elle variait d’un commissariat à l’autre, d’une brigade à l’autre, en fonction des formateurs. Les tirs se font souvent sur cibles statiques, mais certains formateurs utilisent des cibles mouvantes. Les effectifs de la CSI, qui sont des primo intervenants, bénéficient-ils d’une formation supplémentaire ou sont-ils soumis au même régime que les policiers de base qui tirent quatre-vingt-dix cartouches par an ?
M. J-S. B. Pour ma part, je suis en BAC locale. Nous avons un minimum de quatre-vingt-dix cartouches par an, mais nous pouvons en utiliser beaucoup plus en allant tirer plus régulièrement. Nous y allons plusieurs fois par mois.
M. le rapporteur. Combien de cartouches tirez-vous chaque année ?
M. J-S. B. C’est variable. Chaque fois que nous y allons, nous tirons trente cartouches, et nous pouvons le faire deux fois par mois.
M. Christophe Cavard. Je comprends que le rapporteur insiste pour connaître les détails de votre expérience, car vous êtes les premiers à être intervenus en janvier. Notre commission s’intéresse à ces faits pour étudier les moyens de lutter contre le terrorisme. Or un virage a été pris à ce moment-là et nous sommes en train de changer certains cadres législatifs concernant les armes et les droits accordés aux forces de l’ordre. Votre point de vue sur l’efficacité de nos propositions nous intéresse donc grandement.
Comment les policiers peuvent-ils se protéger eux-mêmes, face à ce qu’ils découvrent, puis dans un contexte où les terroristes ont disparu ? Si j’ai bien compris, Monsieur J-S.B., on vous a déposé sur place, vous êtes parti à pied et vous étiez sans véhicule. Comment se refait le contact pour savoir si vous devez rester sur les lieux ou poursuivre les auteurs des faits ?
En 2015, nous avons vécu des opérations de commando, menées par plusieurs personnes armées agissant de conserve. Comment les professionnels que vous êtes appréhendent-ils ce genre de situation ? Que pensez-vous du débat qui se développe sur les capacités d’action directe, voire immédiate, dans ce genre de situation, même s’il y a des spécialistes plus aptes que d’autres à intervenir ?
M. B. B. En principe, le policier essaie de se débrouiller pour être toujours avec un équipier qui va assurer sa couverture. Dans la pratique, du fait de la topographie, il peut se retrouver seul. Dans ce cas, il doit localiser son équipage à la voix s’il n’est pas loin, par radio ou par téléphone portable.
Pendant longtemps, dans la police, on nous a appris à aborder toute intervention avec une grande prudence : il fallait d’abord analyser la situation, observer la topographie, le nombre d’individus, leur mode opératoire et leur armement, etc. On nous a enseigné qu’une intervention devait aboutir à une interpellation et être conduite de manière à protéger les policiers et les personnes interpellées. Toute la pédagogie en matière de formation policière est fondée sur la légitime défense, avec des rappels systématiques que d’aucuns jugent trop inhibiteurs.
La formation est assurée par des policiers diplômés, les formateurs en techniques de sécurité en intervention (FTSI), qui étaient auparavant appelés moniteurs en activités physiques et professionnelles (APP). Il y a quelques années, les formateurs se sont intéressés aux tueries qui se sont déroulées dans les universités nord-américaines, en se demandant ce que devaient faire des policiers dans ce genre de situation. Ils ont développé une formation de quatre jours baptisée stage de lutte contre les tueurs en chaîne, ou stage « Amok », du mot malais qui veut dire « forcené » ou « fou furieux », une description qui correspond bien aux auteurs de ces tueries.
Cette notion de tueur en chaîne me semble pertinente pour un policier. Sur le plan tactique, peu importe finalement que la personne soit qualifiée de cas psychiatrique ou de terroriste, puisque l’intervention sera à peu près la même, à ceci près que les risques de piégeage seront plus élevés pour le policier s’il a affaire à un terroriste. Au cours de ce stage, l’approche pédagogique était radicalement nouvelle. Dans une formation classique, on nous enseigne que, quand un voleur est par exemple en train de « faire les fils d’une voiture », il faut s’approcher tout près, essayer de bien voir la personne, lui demander de lever les mains, etc. Au cours du stage Amok, on nous a fait comprendre l’urgence d’établir un contact physique ou balistique avec les auteurs de tueries. On se rend compte que, dès qu’on les accule, dès qu’on renverse la pression du feu, on les oblige à se retrancher, à se figer, ce qui permet de faire cesser leur entreprise criminelle.
C’était un stage passionnant. Malheureusement, loin d’être généralisé, il a même été suspendu en 2013 ou 2014. Comme j’avais eu la chance de faire partie des stagiaires, je m’en suis ému. Pourquoi ce stage formidable, où était enseignée de manière globale une approche tactique et technique permettant de faire face à un phénomène que nous n’étions a priori pas formés à affronter, était-il suspendu ? Tout d’abord, on m’a dit que l’Inspection générale de la police nationale (IGPN) avait décidé de suspendre la formation après avoir constaté que les notions de légitime défense n’y étaient pas enseignées correctement. Ayant fait le stage moi-même, j’ai été très surpris : les règles de légitime défense étaient celles que l’on m’avait toujours enseignées, celles qui s’appliquent face à un individu menaçant, armé, et préparé à nous tuer ou à tuer autrui ; nous n’en étions toujours pas à discuter de la neutralisation d’un individu qui nous oppose son dos, par exemple. J’ai interrogé l’IGPN. On m’a répondu que la décision venait du RAID. J’ai interrogé le RAID. On m’a dit que la décision venait de l’IGPN.
Tout récemment, j’ai finalement su ce qui s’était passé. Je suis membre du groupe de travail de la direction générale de la police nationale (DGPN) qui, depuis les attentats de novembre dernier, cherche à élaborer une nouvelle doctrine d’intervention. Nous reprenons à peu près tout ce qui a été fait lors de ce stage Amok, ce qui veut dire que nous avons perdu deux ou trois ans. Comme la direction de la formation participe à ce groupe de travail, j’ai finalement réussi à savoir pourquoi le stage avait été suspendu.
Direction de soutien, la direction de la formation a décidé de ne plus assurer ce stage après s’être rendu compte qu’elle allait très loin d’un point de vue prospectif : elle était, de fait, en train d’élaborer une nouvelle doctrine d’intervention, ce qui relève normalement de la compétence de directions actives comme la DGPN ou la préfecture de police. Jugeant qu’elle outrepassait son rôle, la direction de la formation a décidé d’annuler ce stage. Voilà pourquoi on a cessé de former les fonctionnaires pendant deux ans, ce qui est dommage.
M. le président Georges Fenech. Qui a donné les instructions pour que la formation soit reprise ?
M. B. B. La DGPN élabore une nouvelle doctrine, très intéressante d’un point de vue stratégique et tactique, qui va sortir très prochainement. La stratégie consiste à entrer en contact. Partout dans le monde, après analyse de ces situations, on s’est rendu compte que, dès que la police a un contact avec eux, les auteurs de tels faits s’arrêtent, soit parce qu’on leur tire dessus, soit parce qu’ils se retranchent. On peut alors temporiser en attendant l’intervention du RAID et de la BRI. Une fois que la DGPN aura formalisé cette nouvelle doctrine, la direction de la formation se sentira autorisée à l’enseigner.
Pour en revenir à votre question sur le tir, monsieur le rapporteur, je peux comprendre l’étonnement des non-professionnels de l’armement. Il peut sembler incroyable qu’autant de balles aient été tirées rue Nicolas-Appert sans que les fugitifs aient été touchés. En fait, la vision des gens est déformée par les films où l’on voit des policiers qui tirent dans les mains des malfaiteurs. En cas de « bavures » — qui n’ont d’ailleurs souvent rien de bavures — on entend des quidams demander : « Pourquoi n’ont-ils pas tiré dans la main ? » On ne le fait pas parce que c’est que c’est impossible avec un pistolet. Un très bon tireur sera toujours moins performant avec un pistolet que le plus mauvais des tireurs avec un fusil, en raison de la longueur du canon. Car, on peut le regretter, c’est avec des armes de poing que nous ripostons aux kalachnikovs.
Vous allez auditionner le commissaire qui est intervenu au Bataclan. Ce qu’il a fait, à une distance de vingt ou vingt-cinq mètres, est exceptionnel. Je ne veux pas parler de chance pour ne pas dénigrer la qualité de son tir, mais, en termes de probabilités et de statistiques, c’était de l’ordre de l’impossible. Je suis allé au Bataclan et j’ai vu la distance de tir. Il ne faut pas penser qu’à peu près n’importe qui est capable de réussir un tel tir. À plus de sept ou dix mètres, il est quasiment impossible de toucher avec un pistolet quelqu’un qui est en action.
Avant même le mois de janvier 2015, nous avions demandé que les CSI soient renforcés en armement. Nous nous sommes ensuite appuyés sur les événements du mois de janvier pour argumenter nos demandes d’armes supplémentaires, notamment de fusils. En fait, nous n’avons jamais eu de réponse. Nous avions pourtant produit des rapports circonstanciés en nous inspirant notamment des événements qui s’étaient déroulés en Tunisie, au musée du Bardo et sur les plages de Sousse. Nous avions pourtant expliqué que de tels faits pouvaient se produire à Paris.
Certes, il y a des contraintes budgétaires. À l’impossible nul n’est tenu : si l’on n’a pas l’argent, on n’a pas de fusils. Mais nous avons appris par la bande que des armes étaient disponibles dans certaines armureries et qu’il suffisait d’une autorisation. Cette autorisation impossible à obtenir est arrivée le 14 novembre. C’est regrettable. On ne peut pas refaire l’histoire, et la journée du 13 novembre a été très bien gérée. Il est néanmoins regrettable que notre demande de janvier n’ait été acceptée — et encore, partiellement, à la marge — que le 14 novembre.
En octobre dernier, il y a eu un drame au commissariat de Saint-Denis : un policier de la BAC locale a pris une balle dans la tête, lors d’une intervention contre des braqueurs. Le ministre de l’intérieur s’est évidemment rendu sur place pour se rendre compte de la situation et témoigner sa solidarité aux policiers de terrain. Comme ceux-ci lui ont fait part de leur problème d’armement et d’équipement, le ministre a décidé de créer un plan BAC pour les doter. Malheureusement, la CSI ne s’appelle pas BAC et elle a été exclue de ce plan. À mon avis, cela résulte d’une carence dans la chaîne de décision et non pas d’une volonté ministérielle : personne n’a dû signaler à M. Cazeneuve que les CSI faisaient exactement le même travail que les BAC. Nous ne sommes pas très nombreux en France, c’est ce qui nous dessert. Alors que la CSI 75 est le seul service de la police nationale à être intervenu sur tous les attentats franciliens en 2015, elle sera prochainement moins armée que la BAC de Charenton-le-Pont. J’étais autrefois en poste dans le Val-de-Marne et je ne dénigre pas la BAC de Charenton-le-Pont, mais elle doit compter quatre fonctionnaires.
M. le président Georges Fenech. Vous avez été entendu, rassurez-vous.
M. Serge Grouard. Ce que vous dites, commissaire, nous éclaire sur les dysfonctionnements dont notre administration a le secret, et cela depuis trop longtemps.
Je voudrais revenir sur les questions de doctrine. À vous entendre, et en caricaturant un peu, il faudrait quasiment appliquer la doctrine du verre d’eau des pompiers plutôt que d’attendre le fourgon pompe-tonne. Pouvez-vous réagir sur ce point ?
En ce qui concerne Vincennes, où vous étiez présents tous les deux, Monsieur B.B. et monsieur M.J., comment cela s’est-il passé avec les médias ? Vous avez parlé de sécurisation du site afin d’éviter le surattentat et d’évacuer des personnes qui pouvaient se trouver dans l’axe de tir. Pourtant, d’après les images diffusées à la télévision, on avait l’impression que les médias étaient très proches des opérations, mais peut-être les cadreurs et les photographes étaient-ils plus loin et utilisaient-ils des zooms. On peut également s’interroger sur la saturation des télécommunications. Comment avez-vous fait ? Avez-vous pris en compte la présence des médias ? Comment avez-vous pu la gérer ? À l’avenir, comment pourriez-vous faire ? Visiblement, vous avez rencontré de nombreux soucis de ce côté-là.
M. M. J. Le périmètre restreint le plus proche de l’endroit où se déroulait la crise était doublé d’un périmètre extérieur. À notre niveau, nous avons été peu concernés par la gestion des médias. Toutefois, nous avons eu des retours sur le fait que les médias étaient arrivés rapidement et avaient réussi à pénétrer dans des appartements privés qui se trouvaient juste en face de l’Hypercacher, dans des emplacements qui ont d’ailleurs été pris en compte par les tireurs de précision des unités d’intervention. On peut le déduire en analysant les images.
En règle générale, les unités CSI et les unités primo intervenantes agissent dans un périmètre restreint et n’ont aucun contact avec les médias. Comment pourrait-on traiter le problème des médias à l’avenir ? À mon avis, la stratégie de l’écran noir, qui consiste à ne rien montrer, est la meilleure manière d’éviter que des informations n’arrivent jusqu’au preneur d’otage ou au terroriste.
Je voudrais revenir sur les tirs. Il faut savoir que n’importe quel policier placé dans une situation de stress perd entre 70 % et 80 % de la précision qu’il a dans un stand de tir. Ce phénomène extrêmement important a été étudié par les Américains. Il faut savoir aussi que l’enseignement se réfère aux distances habituelles de tir des policiers, inférieures ou égales à sept ou huit mètres dans 80 % à 90 % des cas. Jusqu’à présent, l’enseignement du tir à l’arme de poing était adapté à ces situations. Actuellement, des moniteurs s’intéressent à la question et proposent de nouvelles méthodes, un peu comme le ciné-tir que connaissent ceux qui ont fait leur service militaire il y a fort longtemps : les tirs sont effectués à balles réelles sur des cibles placées devant des images. Ces entraînements sont très appréciés des collègues.
Les effectifs des CSI ont des entraînements de tir particuliers — derrière des boucliers balistiques, en colonne, en déplacement — qui leur donnent une toute petite plus-value par rapport aux unités traditionnelles. Depuis le 7 janvier, nous avons systématiquement embarqué dans les véhicules des armes longues dont nous sommes dotés : le fusil à pompe calibre 12, qui est une excellente arme, car elle a une grande puissance d’arrêt ; le pistolet-mitrailleur. Depuis le 14 novembre, nous avons touché quelques armes de 5,56 millimètres qui sont assez efficaces bien que de conception ancienne.
M. Olivier Falorni. Monsieur B.B., nous ne pouvons qu’être intéressés par ce que vous nous avez dit des stages et des tueurs en chaîne — nous avons pu en voir à l’œuvre au mois de novembre dernier.
Revenons à votre intervention à l’Hypercacher et à la stratégie du confinement que vous avez adoptée. Quand vous êtes arrivé sur les lieux, que saviez-vous ? Pensiez-vous avoir affaire à un preneur d’otage ou à un tueur en chaîne ? Il y a eu des victimes très rapidement au cours de ces faits dont vous nous direz s’il faut les qualifier ou non de prise d’otages. Quand vous êtes arrivé, aviez-vous connaissance que Coulibaly avait déjà exécuté des personnes ? Pensiez-vous qu’une intervention était nécessaire dans l’urgence ? Vous évoquez la nécessité de l’empêcher de sortir pour tuer. Estimiez-vous être dans une logique de négociation avec un preneur d’otages ?
Vous nous avez décrit le processus inhibiteur de la prudence et de l’analyse. Pensez-vous que ce processus est pénalisant par rapport à cette nouvelle doctrine de la réaction rapide ?
En janvier, il fallait faire face à deux situations simultanées puisque, au moment où vous interveniez à la porte de Vincennes, les frères Kouachi étaient retranchés à Dammartin-en-Goële. Cette concomitance vous a-t-elle empêché de mener certaines actions ? Il semble en effet que l’intervention à l’Hypercacher ait été précipitée par la sortie des frères Kouachi de l’entreprise où ils étaient retranchés.
M. B. B. Nous avons rapidement compris qu’il s’agissait plutôt d’une prise d’otages. Certes, il avait déjà tué — on voyait les jambes d’un corps à l’entrée du magasin, car le rideau n’avait été abaissé qu’aux deux tiers —, mais, s’il avait voulu continuer à tuer, il était libre de le faire. Puisqu’il ne tuait plus, cela se transformait en prise d’otages. Les choses étaient plutôt figées.
C’est précisément le genre d’état que nous cherchons à obtenir en tant que primo intervenants lors d’une crise : nous devons figer la situation pour l’offrir au RAID ou à la BRI ; nous ne devons surtout pas provoquer un enchaînement catastrophique. Si les choses sont figées en une prise d’otages, cela nous arrange. Nous temporisons ; nous essayons de ne surtout pas exciter le preneur d’otages ; nous attendons les gens dont c’est vraiment le métier de gérer ce genre de crise, c’est-à-dire le RAID ou la BRI, car nous atteignons rapidement les limites de nos compétences.
En revanche, s’il avait commencé à exécuter des otages, nous n’aurions pas eu d’autre choix que d’intervenir. Nous sommes le service public de la police. Nous ne pouvons pas regarder les choses se faire sous prétexte que nous n’avons pas été formés. Dans ce cas-là, on lance un assaut d’urgence, mais sans la technicité du RAID ou de la BRI. Au moment de lancer un assaut d’urgence, on sait qu’il va y avoir des pertes considérables tant pour nous que pour les otages. On fait tout pour que cela n’arrive pas. Le critère est celui-là : les choses sont-elles figées ou le preneur d’otages est-il en action ? S’il se promène dans la boutique avec son fusil, pour nous, la situation est figée. S’il commence à tirer sur les gens, il est en action.
M. Olivier Falorni. Auriez-vous pu lancer un assaut d’urgence compte tenu de la simultanéité des deux scènes ?
M. B. B. En fait, au début, nous n’avions même pas en tête ce qui se déroulait à Dammartin-en-Goële. Nous ne savions pas encore que les deux événements étaient liés. Le lien n’est apparu que plus tard, après l’arrivée du RAID et de la BRI, lors des premiers contacts des négociateurs avec Amedy Coulibaly. Il leur a annoncé : si vous procédez à l’assaut à Dammartin-en-Goële, je tue les otages. À ce moment-là, nous avions reculé d’un cran et nous n’étions plus qu’en appui de la BRI. Ce genre de décisions relevait alors du RAID et de la BRI.
M. François Lamy. Ma première question s’adresse à M. J-S.B. et concerne les tirs devant Charlie Hebdo. À quelle distance étiez-vous des frères Kouachi quand vous avez riposté ? On peut penser, en effet, que l’exercice est difficile même pour un bon tireur.
Ma deuxième question s’adresse au commissaire B.B. Vous avez expliqué que les CSI faisaient le même travail que les BAC. Ne considérez-vous pas qu’il y a un double emploi ? Depuis le début des travaux de cette commission d’enquête, nous sommes confrontés à beaucoup de sigles et de services. D’une manière générale, ne pensez-vous pas qu’il y a un peu trop de services ? C’est toujours difficile pour un professionnel d’expliquer que son service ne sert à rien ou fait le même travail qu’un autre. Ce n’est pas ce que je vous demande. Mais, honnêtement, on se dit qu’un peu de simplification ne serait peut-être pas inutile.
M. J-S. B. Avant que les frères Kouachi ne sortent de l’immeuble, nous étions à deux mètres de la porte. Ils ont tiré avant de sortir, ce qui nous a permis de nous écarter de dix ou quinze mètres. Nous étions en fuite ; ils étaient dans notre dos et nous n’avons pas cherché à riposter tout de suite. Une fois protégés, nous étions à quinze ou vingt mètres d’eux. Quant à nos collègues qui les ont croisés en véhicule, ils étaient plus près, peut-être à huit ou dix mètres, mais en mouvement rapide.
M. B. B. La dualité police-gendarmerie ne pose pas de problème. En plus, les partages géographiques sont assez clairs.
M. François Lamy. C’est pour cela que je ne vous ai pas interrogé sur ce point.
M. B. B. Pour le reste, je comprends que l’on puisse s’étonner de l’existence d’une sphère DGPN et d’une sphère préfecture de police de Paris. Il y a beaucoup de services, mais je vois rarement des policiers en trop sur une intervention. Il y a aussi beaucoup de victimes qui se plaignent de ne pas voir de policiers du tout.
M. François Lamy. Réduire le nombre de services ne signifie pas que le nombre de policiers va diminuer. L’idée est plutôt d’optimiser leur travail. C’est dans cette perspective que vos points de vue de praticiens m’intéressent.
M. B. B. Le métier de policier est très technique, beaucoup plus que ne le pensent les citoyens. Comme la police est un outil très démocratique, tous les citoyens ont un avis à donner sur son fonctionnement, sur les conditions de telle ou telle intervention, alors qu’il ne leur viendrait pas à l’idée de commenter une opération chirurgicale, en se demandant s’il n’aurait pas mieux valu passer par tel ou tel endroit, utiliser tel ou tel bistouri. Cela laisse à penser que tout le monde pourrait être policier et que ce métier est simple. En fait, ce n’est pas le cas. C’est un vrai métier, très technique, d’où cet enchevêtrement de services. Chacun a sa petite technicité supplémentaire, son petit truc en plus.
C’est d’ailleurs ce qui a conduit à créer les CSI alors qu’il existait déjà des BAC. On a voulu créer un outil plus polyvalent. Les effectifs des BAC locales de commissariats sont quasiment toujours en civil : il leur manque donc souvent la compétence de policiers en tenue en matière de maintien de l’ordre ou de violences urbaines. Les BAC de nuit de l’agglomération parisienne sont en tenue, mais elles n’ont développé que récemment et marginalement la compétence de policiers en civil. Dans les CSI, il existe une coordination entre des unités en tenue et des unités en civils. Nos motos ne ressemblent pas à celles qui sont utilisées pour les escortes du service d’aide médicale urgente (SAMU) ou les contrôles routiers ; ce sont des motos tout-terrain qui doivent pouvoir monter sur les trottoirs dans les cités sensibles où il y a énormément de zones piétonnes. Ce sont des produits qui manquaient et qui ont été développés.
La BRI et le RAID sont intervenus ensemble lors de l’intervention à l’Hypercacher. Cela relevait peut-être davantage d’un choix politique. L’un ou l’autre service aurait peut-être pu gérer seul l’intervention. J’ai du mal à vous répondre mieux.
M. le président Georges Fenech. Comment expliquez-vous cette difficulté, que l’on peut qualifier de fonctionnelle, entre la DGPN et la préfecture de police de Paris ?
M. B. B. C’est difficile. Je pourrais l’illustrer par d’innombrables exemples qui, chaque jour, nous rappellent qu’on n’est pas dans le même monde qu’à la préfecture de police de Paris. Honnêtement…
M. le président Georges Fenech. Vous vous exprimez sous serment.
M. B. B. Je le sais bien, mais c’est très compliqué.
M. le président Georges Fenech. Monsieur M.J., vous avez une réponse ?
M. M. J. Je pense que c’est juste une question de pouvoir, de protection de zones de compétence qui se touchent et se complètent sur la totalité du territoire.
M. le président Georges Fenech. Que pensez-vous de l’idée même de l’existence de la préfecture de police de Paris ? Je m’empresse de préciser que je n’ai rien contre la préfecture de police de Paris !
M. B. B. La DGPN est une très belle direction, la préfecture de police aussi. (sourires) Il n’est pas aisé de s’expliquer, car nous connaissons les avantages et les inconvénients de chacun des deux systèmes, et nous pouvons les comparer… À la DGPN, il y a plus de problèmes d’effectifs qu’à la préfecture de police de Paris. Comme elle a plus d’effectifs, la préfecture de police de Paris a réussi à s’inventer des missions et des servitudes qui sont totalement injustifiées. De fait, alors qu’il y a plus d’effectifs théoriques, on se retrouve avec les mêmes sous-effectifs sur la voie publique.
La création de la DSPAP dans le cadre du Grand Paris de la sécurité est l’une des conséquences du problème DGPN-préfecture de police de Paris. Si tout avait été placé sous l’égide de la DGPN, on n’aurait pas eu besoin, pour sécuriser un peu mieux la banlieue, de créer la DSPAP. Tout aurait été regroupé sous la même direction centrale de la sécurité publique (DCSP) et les banlieusards auraient eu les renforts d’effectifs dont ils avaient besoin.
M. le président Georges Fenech. C’est très clair : merci beaucoup.
M. Christophe Cavard. Pour en revenir aux interventions de janvier 2015, j’aimerais avoir quelques précisions sur l’identification des gens concernés. À quel moment avez-vous su à qui vous aviez affaire ? Qui vous l’a appris ?
M. M. J. En règle générale, quand on est appelé pour une mission, nos informations viennent des salles de commandement auxquelles on est rattaché par les moyens radio. À la salle de commandement, ils récupèrent les informations à droite et à gauche, par le 17, par des instructions particulières.
Dans le cas spécifique de l’Hypercacher, les informations nous sont arrivées de nos chaînes hiérarchiques. Comme nous étions à la limite de Paris et du Val-de-Marne, les informations m’arrivaient aussi bien de la SIC 750, qui est la salle de commandement de la DSPAP, que de la SIC du Val-de-Marne. Les informations qui m’arrivaient par ces deux canaux étaient en général identiques, mais elles pouvaient aussi être complémentaires. En revanche, quand l’assaut a été donné à Dammartin-en-Goële, nous l’avons appris par les alertes de la presse sur nos téléphones portables. Deux ou trois minutes plus tard, l’assaut était donné par les gens du RAID qui nous ont prévenus afin que nous prenions nos dispositions pour les remplacer.
Il peut aussi arriver que des collègues nous préviennent de tel ou tel événement par téléphone. Cette information a pu leur parvenir de différentes manières, y compris par une chaîne hiérarchique qui, à un moment, a préféré prendre un autre biais.
M. Christophe Cavard. Et les frères Kouachi ?
M. M. J. Nous n’avons pas eu à traiter cette affaire.
M. Christophe Cavard. Mais, si vous les aviez croisés, il aurait mieux valu que vous les reconnaissiez !
M. M. J. Effectivement. La photo de la carte d’identité trouvée dans le véhicule a circulé sur les téléphones portables des fonctionnaires de police.
M. B. B. On connaissait aussi la plaque d’immatriculation de la Clio. L’information passait sur les ondes radio de la police, par ces fameux appels généraux qui empêchent parfois les policiers d’intervenir.
M. le président Georges Fenech. Messieurs, il me reste à vous remercier pour toutes ces explications et pour votre disponibilité.
Audition, à huis clos, de policiers intervenus lors des attentats du 13 novembre 2015 : M. B. B., commissaire de police, Mme C. P., commissaire de police, M. G. P., commissaire de police, M. G. B., capitaine de police, M. Z. I., commissaire de police, M. D. K., commissaire divisionnaire, M. S. Q., commissaire divisionnaire, M. J. M., commissaire de police, M. F. C., commissaire divisionnaire, Mme V. G., commissaire divisionnaire, M. T. D., commissaire de police
Audition, à huis clos, du lundi 14 mars 2016
M. le président Georges Fenech. Mesdames et messieurs, nous vous remercions d’avoir répondu à la demande d’audition de notre commission d’enquête relative aux moyens mis en œuvre par l’État pour lutter contre le terrorisme depuis le 7 janvier 2015.
Nous avons commencé à aborder la semaine dernière les questions relatives à la conduite des opérations, l’intervention des forces de l’ordre, et les moyens mis à leur disposition. Nous poursuivons nos investigations avec des fonctionnaires de police de la Direction de la sécurité de proximité de l’agglomération parisienne (DSPAP) intervenus lors des attentats. Nous venons d’entendre des policiers intervenus en janvier 2015, nous accueillons maintenant des fonctionnaires intervenus en novembre dernier.
Cette audition, en raison de la confidentialité des informations que vous êtes susceptibles de nous délivrer, se déroule à huis clos. Elle n’est donc pas diffusée sur le site internet de l’Assemblée. Néanmoins, et conformément à l’article 6 de l’ordonnance du 14 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, son compte rendu pourra être publié en tout ou partie, si nous en décidons ainsi à l’issue de nos travaux. Je précise que les comptes rendus des auditions qui auront eu lieu à huis clos seront au préalable transmis aux personnes entendues afin de recueillir leurs observations. Ces observations seront soumises à la commission, qui pourra décider d’en faire état dans son rapport.
Je rappelle que, conformément aux dispositions du même article, « sera punie des peines prévues à l’article 226-13 du code pénal – un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende – toute personne qui, dans un délai de vingt-cinq ans, divulguera ou publiera une information relative aux travaux non publics d’une commission d’enquête, sauf si le rapport publié à la fin des travaux de la commission a fait état de cette information ».
Conformément aux dispositions de l’article 6 précité, je vous demande maintenant de prêter le serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité.
M. B. B., Mme C. P., MM. G. P., G. B., Z. I., D. K., S. Q., J. M., F. C., Mme V. G. et M. T. D. prêtent serment.
M. le président Georges Fenech. La première des nombreuses questions que nous souhaitons vous poser concerne l’heure précise à laquelle vous avez reçu l’alerte et le délai dans lequel vous vous êtes rendus sur place.
M. S. Q., commissaire divisionnaire. Au moment des faits, j’étais le chef du 2e district, qui comprend les 10e, 11e, 12e, 18e, 19e et 20e arrondissements. À ce titre, le vendredi 13 novembre au soir, alors que j’étais en famille, j’ai été avisé par ma salle d’information et de commandement (SIC), vers 21 h 21 ou 21 h 22, de coups de feu ayant éclaté dans le 10e arrondissement et ayant potentiellement provoqué des blessés, voire des morts.
J’ai immédiatement demandé aux fonctionnaires de la salle de commandement de dépêcher sur place le plus de monde possible, afin que nous puissions être éclairés sur les faits, sachant que, à cet instant, les informations dont disposait la SIC étaient très parcellaires.
Trois ou quatre minutes plus tard – à 21 h 24 ou 21 h 25 –, la SIC m’a rappelé pour me confirmer la gravité de la situation et m’indiquer que les coups de feu avaient été tirés en différents endroits du 10e et du 11e arrondissement.
J’ai donc décidé de rejoindre immédiatement ma salle de commandement, afin de faire le point sur la situation pour pouvoir en rendre compte à mes supérieurs. Dans le même temps, j’ai réitéré ma demande d’envoyer sur place le plus grand nombre possible de fonctionnaires, en spécifiant que les consignes de sécurité devaient être rappelées aux intervenants.
J’ai traversé Paris en sept à huit minutes et suis parvenu place de la République, à 21 h 42 ou 21 h 43, mon idée initiale étant de gagner d’abord mon service, de manière à m’équiper de mon arme de service et de mon gilet pare-balles, pour me rendre ensuite sur les sites touchés. Constatant que de la rubalise avait été installée, j’ai interrogé une gardienne de la paix, qui m’a indiqué que l’attaque se déroulait au Bataclan. Je me suis dirigé vers la salle – il était environ 21 h 48 – à contre-courant de piétons qui fuyaient, affolés. Cela m’a confirmé la gravité de la situation. J’ai entendu les coups de feu et, sans plus d’information, ai d’abord pensé qu’ils étaient tirés à l’extérieur.
Ayant reçu confirmation de ma salle de commandement que les événements se déroulaient devant le Bataclan, je suis reparti m’équiper, faire le point depuis la SIC avec mes supérieurs et répartir sur les différents sites les équipages disponibles, sachant que nous étions proches de l’heure de relève des brigades de jour, qui terminent leur service à 22 h 30. Ces dernières ont naturellement toutes été maintenues en place, et les équipes de nuit ont été réparties là où elles pouvaient être utiles, notamment pour établir des périmètres de sécurité et prêter assistance aux blessés.
Une fois mes instructions relayées par mes opérateurs radio, j’ai rejoint, accompagné de deux fonctionnaires – un transmetteur et un conducteur – mon directeur, Pascal Le Borgne, à côté du Bataclan. Il devait être entre 22 h 30 et 22 h 35. Avec les commissaires et les équipages qui nous ont rejoints au fur et à mesure, j’ai fait en sorte d’organiser le périmètre de sécurité et les secours à l’intérieur du Bataclan. Je précise que je ne me suis pas rendu sur les autres sites touchés – désignés comme les « terrasses ».
M. le président Georges Fenech. Vous êtes arrivé pour la première fois devant le Bataclan vers 21 h 48 : combien y avait-il de policiers déjà sur place, avant l’arrivée de la Brigade de recherche et d’intervention (BRI) ?
M. S. Q. C’est difficile à dire, car, chronologiquement, le Bataclan est le dernier site attaqué, après les terrasses. Les patrouilles sont arrivées sur les lieux des attaques au fur et à mesure, ainsi que les commissaires, qui se sont transportés sur place de leur propre initiative, y compris ceux qui ne travaillaient pas.
En ce qui concerne le Bataclan, je ne saurais vous donner de réponse précise, car, lors de mon premier passage, la situation était trop confuse pour être jaugée de manière précise. J’ai donc pris l’initiative de gagner mon service, tentant de m’informer par radio.
M. le président Georges Fenech. Qui a vu la BRI arriver sur les lieux ? Quels étaient ses effectifs ?
M. B. B. commissaire de police. La BRI a créé il y a quelques mois une force d’intervention rapide (FIR). C’est elle qui a d’abord été dépêchée sur les lieux, soit une dizaine ou une quinzaine de fonctionnaires. Il est difficile d’être plus précis compte tenu du chaos qui régnait sur les lieux.
M. le président Georges Fenech. Ils étaient donc plus de six ?
Mme C. P., commissaire de police, service de nuit de Paris (SN 75). La BRI est arrivée en deux temps. Je ne saurais dire précisément quand est arrivé le gros de la troupe, mais les premiers éléments sont arrivés aux alentours de 22 h 25, leur mission étant de se rendre immédiatement au contact de la crise pour prendre le relais des équipages primo-intervenants. À cet instant, je vois cinq effectifs de la FIR.
M. le président Georges Fenech. Il s’agit d’un point que nous n’arrivons pas à éclaircir.
M. B. B. Selon moi, ce n’est pas essentiel. Ce qu’il faut surtout retenir de cette intervention policière, c’est que, après l’intervention du commissaire de la BAC 75N qui a pénétré dans le Bataclan et abattu l’un des assaillants, les tirs ont cessé. Quel qu’ait été le nombre des membres de la BRI, entre le tir du commissaire et l’assaut de la BRI, il n’y a plus eu de victime abattue.
M. le président Georges Fenech. Il est néanmoins important que nous puissions savoir dans quelles conditions est arrivée la BRI. La FIR se compose d’une quinzaine de fonctionnaires. Or le commissaire C. P. nous parle de cinq ou six hommes.
Mme C. P. Lorsque la FIR arrive, entre 22 h 25 et 22 h 30, nous sommes nous-mêmes dans une situation trouble et confuse, y compris émotionnellement, si bien qu’il est difficile de décrire avec précision ce que nous avons vu. Je sais seulement que la FIR a pris place très rapidement, ainsi que le prévoit le protocole.
M. le président Georges Fenech. Faisiez-vous partie, les uns et les autres, du poste de commandement avancé établi au rez-de-chaussée du Bataclan ?
M. B. B. Vous faites sans doute référence au poste de commandement de la BRI qui se trouvait en bas de l’escalier. Seuls s’y trouvaient les techniciens de la BRI pour y décider des modalités de l’assaut.
M. Sébastien Pietrasanta, rapporteur. Monsieur le commissaire divisionnaire S.Q., lorsque vous êtes arrivé la première fois devant le Bataclan vers 21 h 48, avez-vous eu affaire à la BAC 94 ?
M. S. Q. À ce moment-là, je n’ai pas prévu d’intervenir, mais de gagner au plus tôt mon service. C’est parce que j’ai entendu des coups de feu que je me suis approché du Bataclan. Mais, dans ce genre de situation, si l’on est seul est sans arme, on fait demi-tour. Je ne vois donc personne. Je sais en revanche que les messages d’alerte sont passés sur les ondes et que des équipages de la DSPAP ont été dépêchés sur les lieux.
M. le rapporteur. Y a-t-il parmi vous d’autres personnes qui se trouvaient sur les lieux avant 22 heures et qui ont été en contact avec la BAC 94, qui est la première à être arrivée sur place avec le commissaire qui a abattu l’un des terroristes ?
Pourriez-vous, par ailleurs, nous relater les faits entre votre arrivée aux uns et aux autres et celle de la BRI, entre 22 h 20 et 22 h 25 ? Quel a été le rôle de ceux d’entre vous qui étaient présents ?
M. B. B. Les premiers policiers sur place appartenaient à la DSPAP, qu’il s’agisse du commissaire qui a pénétré dans le Bataclan ou d’équipages de la BAC 94N. D’autres cadres sont rapidement arrivés, notamment les commissaires C.P. et D.K., ainsi que moi-même. Je le répète, après l’intervention du commissaire à l’intérieur, les tirs ont cessé.
M. le rapporteur. C’est en effet ce que tout le monde nous a dit, mais le commissaire en question, qui retrace les événements dans la revue du Syndicat des commissaires de la police nationale, La Tribune du Commissaire, déclare que, malgré son intervention, « les tirs ont continué mais plus sur nous. Nous pensions qu’ils étaient en train d’achever les gens, mais nous ne pouvions malheureusement rien faire. »
M. B. B. Vous lui poserez la question lorsque vous l’auditionnerez. Pour ma part, je sais qu’il annonce sur les ondes qu’il va entrer dans le Bataclan. Il tire, puis ressort. C’est ensuite que nous sommes entrés à notre tour avec lui à l’intérieur.
M. le rapporteur. Tout ceci se déroule donc bien avant l’arrivée de la BRI ? À quel moment précisément ?
M. B. B. Je n’ai pas d’horodatage exact, mais je peux essayer de retracer l’enchaînement des événements. Je suis, en ce qui me concerne, avec mon adjoint. C’est seulement à partir des tirs qui ont lieu rue de la Fontaine-au-Roi que nous comprenons que nous avons affaire à un attentat multisites. Avant cela, la concomitance entre ce qui s’est produit au Stade de France et rue Bichat peut encore n’être qu’une coïncidence.
Nous partons donc vers la rue de la Fontaine-au-Roi. En chemin, nous entendons sur les ondes que des tirs ont lieu au Bataclan. Nous nous détournons alors vers le Bataclan, nous garant à bonne distance pour éviter les tirs. En progressant précautionneusement le long du trottoir, nous tombons sur une victime très grièvement blessée. Nous la gérons, ce qui nous prend du temps – trop de temps, dirais-je avec le recul.
Nous sommes alors boulevard Voltaire, à une trentaine de mètres de l’entrée du Bataclan, mais il fait nuit et les terrasses de café qui se trouvent dans l’intervalle nous empêchent de voir l’entrée. C’est alors que j’entends le message radio du commissaire annonçant son entrée dans la salle : je m’en souviens avec précision, car je n’ai pu m’empêcher de penser qu’il était insensé.
Après avoir confié notre victime aux secours, nous avons repris notre progression. J’ai ensuite aperçu le commissaire C. P., qui avait dû arriver sur les lieux tandis que je gérais ma victime ; je pense donc qu’elle a été au contact du commissaire de la BAC avant moi.
À ce moment-là régnait un silence absolu. Nous sommes entrés dans le Bataclan et nous avons commencé à évacuer les premières victimes auxquelles nous pouvions accéder. Si nous savions que l’un des terroristes avait été neutralisé, nous ignorions où se trouvaient les autres et nous redoutions qu’ils soient en embuscade, attendant notre approche pour nous tirer dessus. C’est alors que la FIR est arrivée et que, progressivement, le dispositif s’est étoffé.
M. le rapporteur. Pouvez-vous préciser à quelle heure vous êtes entrés dans le Bataclan ?
Les victimes que vous avez évacuées avant l’arrivée de la BRI se trouvaient-elles dans la salle, où vous risquiez d’essuyer les tirs des terroristes ?
M. B. B. Lorsque nous pénétrons dans le Bataclan, la salle est silencieuse. Tous, nous restons sidérés quelques dixièmes de seconde devant l’amoncellement de corps ensanglantés parmi lesquelles s’enchevêtrent par dizaines les morts, les blessés et ceux qui font semblant d’être morts. Ignorant où se trouvent les terroristes survivants, nous tentons de nous protéger et d’analyser la situation, mais prenons vite conscience que, parmi la masse de corps se trouvent des vivants, qui bougent ou gémissent. Nous nous organisons donc avec les quelques policiers équipés de boucliers.
M. le rapporteur. Combien étiez-vous ?
M. B. B. Pas très nombreux. Peut-être une dizaine à pénétrer d’abord dans la salle. Je sais que nous étions cinq membres de la CSI 75, auxquels il faut ajouter les sept membres de la BAC N ainsi que trois ou quatre gardiens de la paix d’arrondissement, soit au total entre quinze et vingt.
Nous avons tiré les premiers blessés que nous avons vus vers notre zone abritée, puis nous les avons évacués jusqu’à l’angle Voltaire-Oberkampf, car les secours n’étaient pas admis dans le périmètre immédiat jugé trop dangereux. Comme nous ne disposions d’aucun moyen d’évacuation, nous avons utilisé les barrières Vauban en guise de brancards.
Mme C. P. J’estime mon heure d’arrivée au Bataclan aux alentours de 22 heures. Vers 21 h 45, j’ai été en contact téléphonique avec mon chef – le fameux commissaire qui a pénétré dans le Bataclan – et je progresse donc très rapidement, sachant qu’il est à l’intérieur du bâtiment et a besoin de renforts. Nous arrivons à cinq : trois fonctionnaires civils de la BAC 75N, mon chauffeur et moi-même. Nous arrêtons le véhicule en amont d’Oberkampf et progressons à pied le long des bâtiments. Nous croisons des blessés, des piétons qui n’ont pas encore compris ce qui se passait et à qui l’on demande de s’extraire rapidement. Nous tombons également sur des employés du Bataclan qui vont nous faire un schéma des sorties de secours et du site, car, à ce moment-là, nous ne disposons pas encore du plan de l’établissement.
Je retrouve mon chef et son équipier devant le sas d’entrée où se trouvent plusieurs cadavres. Nous tâchons de comprendre où sont passés les hostiles, ce dont nous n’avons aucune idée. C’est alors que nous allons avoir un premier visuel de ce que nous pensons être l’un des terroristes, aperçu au niveau de l’une des fenêtres centrales du premier étage. Nous apprendrons par la suite que certains otages avaient été positionnés au niveau des fenêtres, et nous ne saurons finalement jamais s’il s’agissait bien d’un terroriste.
M. le rapporteur. Lorsque vous arrivez au Bataclan vers 22 heures, vous vous employez à évacuer les victimes en attendant l’arrivée de la BRI. Lorsque celle-ci parvient sur les lieux, l’un d’entre vous lui rend-il compte de la situation ? Lui signalez-vous que vous avez repéré des terroristes à l’étage ?
Mme C. P. Nous n’avons aucune certitude que l’homme aperçu au premier étage est bien un hostile.
Au moment où nous sommes en contact avec les autorités de la Force d’intervention de la police nationale (FIPN) – puisqu’étaient également présentes les autorités du RAID –, nous leur donnons les informations dont nous disposons. Nous sommes formés pour cela et savons gérer ce type de situation sans difficulté.
M. le président Georges Fenech. Vous récupérez donc les premières victimes pour les mettre à l’abri bien avant l’assaut, qui a lieu à 0 h 18. Êtes-vous assistés par d’autres services de secours ?
M. T. D., commissaire de police. J’ai pour ma part passé la soirée dans le passage Saint-Pierre-Amelot, sur lequel donne la porte arrière du Bataclan. Lorsque j’arrive sur le site du Bataclan, vers 22 h 10, après être passé au Comptoir Voltaire où l’un des terroristes vient de se faire exploser, la présence policière devant l’entrée principale est très importante. Je décide donc de faire le tour jusqu’au passage Saint-Pierre-Amelot, où je retrouve plusieurs unités de police qui se mettent spontanément à ma disposition puisque je porte mon grade sur mon gilet tactique. À partir de là, nous effectuons une reconnaissance pédestre du passage jusqu’à la porte arrière du Bataclan, où nous allons être requis par des passants, pour nous rendre dans une résidence où se sont réfugiés, dans les parties communes, dans les étages, cinquante-deux spectateurs non blessés et vingt-six blessés par balles.
Nous allons faire appel aux sapeurs-pompiers. Ils ne viennent pas jusqu’à nous parce que le secteur n’est pas sécurisé, et il me faut donc repartir à pied jusqu’au PC sécurité, où je demande à un capitaine des pompiers de me libérer quelques-uns de ses effectifs en réserve d’intervention pour entrer dans le Bataclan au moment de l’assaut. Une vingtaine de pompiers vont ainsi m’être dépêchés : ils vont pouvoir, sous l’appui feu des effectifs que j’ai placés à une vingtaine de mètres de la sortie arrière du Bataclan, récupérer les vingt-six blessés, qui seront tous sauvés.
Quelques minutes après cette intervention, je demande à la colonne que je commande de m’accompagner pour une reconnaissance, jusqu’à la porte arrière du Bataclan. C’est à ce moment-là que nous verrons, à l’intérieur du bâtiment, un otage, les mains en l’air – les terroristes étant probablement dans son dos. Nous communiquons avec ce bouclier humain par des regards, ce dont nous rendons compte à la BRI.
M. le rapporteur. La quinzaine d’effectifs qui sont sur place avant l’arrivée de la BRI a-t-elle reçu consigne de ne pas intervenir dans les étages à la recherche de terroristes ?
Quel a été votre rôle une fois que la BRI est arrivée ? Vous a-t-on demandé de ressortir du Bataclan ?
M. B. B. Lorsque la BRI est arrivée, elle a progressé vers la mezzanine. Dès lors, nous n’avions aucune raison de gagner à notre tour le premier étage. Le RAID, arrivé un peu plus tard, s’est quant à lui déployé vers le fond de la salle, tandis que la BAC 75N envoyait une colonne d’intervention vers une zone qui n’était fouillée ni par le RAID ni par la BRI. Toutes ces manœuvres s’organisent en réalité en temps réel.
M. le rapporteur. Pendant la vingtaine de minutes qui ont précédé l’arrivée de la BRI, agissez-vous sur consigne ou de votre propre initiative, et, dans ce cas, l’un d’entre vous prend-il le leadership du groupe ?
M. B. B. Avant son arrivée, la BRI ne nous communique aucune consigne. Il faut du temps pour que nous puissions nous retrouver et communiquer les uns avec les autres. Chacun gère donc la situation à l’instinct. Les tirs ayant cessé, nous n’avions pas intérêt à investir les lieux avec le risque de les relancer. Avec le renfort des collègues territoriaux qui nous ont rejoints, nous avons donc procédé à l’évacuation des blessés, tandis que la BRI, arrivée entre-temps, entreprenait d’isoler l’accès aux endroits où se trouvaient les terroristes.
M. Serge Grouard. Au-delà des premiers moments de doute sur la nature de ce qui est en train de se produire et passé le premier effet de sidération – qui m’amène d’ailleurs à saluer l’action et les différentes initiatives des uns et des autres dans cette opération –, comment les choses s’organisent-elles au fil des minutes ? Comment sont-elles coordonnées ? Qui prend le pilotage des opérations ? En principe, c’est au commandant de la BRI, lorsqu’il se présente sur place, de prendre le commandement des opérations : comment lui rend-on compte de la situation ?
Je comprends qu’il vous ait fallu, en situation de crise, agir et réagir, mais comment s’est précisément articulé le dispositif ? Quels ordres avez-vous reçus les uns et les autres, et à partir de quel moment ?
Il est par ailleurs extrêmement difficile de bien réagir dans ces situations si l’on n’a pas été préparé à la gestion de crise. Avez-vous, après les attentats de janvier, effectué des exercices-cadres ou in situ pour vous préparer à divers types de scénarios ? Ce qui s’est produit le 13 novembre faisait-il partie des scénarios envisagés ou s’agissait-il pour vous d’une situation inédite ?
M. S. Q. Il était difficile de prévoir un attentat multisites comme celui du 13 novembre, mais les commissaires, officiers et chefs d’équipe de la DSPAP qui ont participé, comme cela a été mon cas, à la gestion des attentats de janvier 2015 ont échangé des retours d’expérience accompagnés de débriefings sur le rôle de chacun et les difficultés rencontrées. Cela a été grandement utile.
Pour ce qui concerne l’organisation des opérations au Bataclan, le dispositif a progressivement monté en puissance avec l’arrivée des effectifs locaux venus en soutien des équipages du commissaire B.B et du commissaire de la BAC 75 présent sur les lieux.
Pour ma part, j’ai dit que, après avoir donné mes instructions de dépêcher sur place chaque équipage disponible, j’ai rejoint le Bataclan vers 22 h 35. J’y retrouve d’autres commissaires, dont D. K. et Cyril Lacombe, du 3e arrondissement. Notre mission va être d’organiser un périmètre de sécurité parfaitement étanche, afin d’éviter les risques de surattentat ou l’intrusion de personnes indésirables – journalistes ou photographes. Nous organisons également les secours.
La coordination se fait au fur et à mesure, avec l’arrivée sur place des autorités – le préfet de police, le directeur de la DSPAP, le directeur de la PJ. Deux points de commandement se mettent en place, l’un à l’angle Oberkampf-Voltaire, où se trouvent les personnes précitées, l’autre à l’intérieur du Bataclan, où opèrent la BRI et les policiers de la SDSS de notre direction. Des liaisons radio sont établies avec le QG de la BRI installé dans un café voisin, Le Baromètre.
La chaîne de commandement se met donc en place progressivement et fonctionne parfaitement à 22 h 30, sachant que nous avons compris qu’il s’agissait d’un attentat terroriste vers 21 h 40 et que, un vendredi soir, les personnels ne sont pas tous à leur poste.
M. B. B. Lorsque l’on relate a posteriori la succession des événements minute par minute sur les cinq ou six scènes d’attentat, on a tendance à éluder tout ce qui a parasité la transmission de l’information au moment des faits. En effet, des dizaines de blessés par balles se sont enfuis et effondrés quelques centaines de mètres plus loin, où des gens ont appelé la police, ce qui a entretenu la confusion sur le nombre de lieux touchés, qui auraient aussi bien pu être une trentaine. Dans ces conditions, organiser la chaîne de commandement était extrêmement complexe.
En ce qui concerne les exercices, le 4 novembre, la SDSS, qui rassemble les CSI et les BAC N, avait organisé un exercice dont le scénario était le suivant : trois individus se rendent gare de Lyon à bord d’un véhicule, en descendent, tirent à la kalachnikov sur les voyageurs, avant de prendre la fuite en direction de Créteil. En route, ils s’arrêtent devant un collège, y rentrent, tirent sur tous les jeunes qu’ils trouvent, puis se retranchent dans une salle avec une quinzaine d’élèves otages en demandant que la France se retire de ses opérations extérieures. L’exercice s’est déroulé en conditions réelles, les fonctionnaires intervenants étant en patrouille sur la voie publique sans connaître à l’avance le scénario.
On peut évidemment regretter que cet exercice ait dû être organisé de notre propre initiative et que nous ayons donc eu du mal à le monter, mais il témoigne d’une prise de conscience par les services des problématiques prioritaires.
M. le président Georges Fenech. Le rapporteur et moi-même sommes extrêmement surpris par vos témoignages, car, avant votre audition, ni la BRI ni personne n’a mentionné votre présence. Nous pensions que, après l’intervention du commissaire de la BAC qui a tiré sur l’un des terroristes, les tirs avaient cessé et qu’il ne s’était plus rien passé jusqu’à l’arrivée de la BRI. Nous souhaitons donc, pour y voir plus clair, que vous accompagniez la commission qui doit se rendre jeudi matin au Bataclan.
M. B. B. En effet, en regardant la retransmission de l’audition des victimes, il m’a semblé qu’elles avaient le sentiment que rien n’avait été fait avant l’arrivée de la BRI, ce qui peut s’expliquer par l’état post-traumatique dans lequel elles se trouvaient.
Nous autres, commissaires, sommes formés, en tant que cadres, pour faire de « belles choses » et agir comme nous l’avons fait. Mais je pense à ces jeunes gardiens de la paix de la direction territoriale de Paris ou de la SDSS, âgés d’une vingtaine d’années, que j’aurais moi-même du mal à identifier aujourd’hui. Ils ont porté jusqu’aux pompiers des mourants ou des agonisants. Des dizaines de personnes ont été sauvées grâce à ces petites mains, et je tenais à ce qu’on le rappelle.
M. Christophe Cavard. Confirmez-vous que les premiers d’entre vous à avoir pénétré dans le Bataclan avant l’arrivée de la BRI l’ont fait de leur propre initiative ?
De quelles informations disposez-vous alors sur les terroristes qui se trouvent à l’intérieur ? Connaissez-vous leur nombre, savez-vous de quelles armes ils disposent et s’ils sont équipés d’explosifs ?
Il ressort de nos auditions que, le 13 novembre, les forces de sécurité ont privilégié l’action sur la réflexion. Nous ne pouvons que vous en remercier, mais notre rôle est également de nous interroger sur les protocoles applicables dans ce genre de situation.
Il a par ailleurs beaucoup été dit que certains des otages avaient pu communiquer avec l’extérieur, notamment avec les forces de l’ordre, grâce à leurs téléphones portables. Faisiez-vous partie de ces personnes qui ont été en contact avec eux et, si oui, que vous ont-ils dit ?
Mme C. P. Il faut d’abord que vous sachiez que, au moment d’entrer dans le Bataclan, nous avons tous eu le même réflexe opérationnel consistant à couper nos radios pour ne pas nous faire repérer. Nous n’avions donc plus de contact avec l’extérieur.
D’autre part, nous entrons en contact dans le sas d’entrée avec l’une des victimes, parvenue à s’extraire dans les premières minutes en rampant à l’extérieur. C’est un commissaire de police, qui nous informe immédiatement que les terroristes sont trois ou quatre et qu’ils sont armés de kalachnikovs. Les autres victimes, quant à elles, sont en état de choc et incapables de nous apprendre quoi que ce soit.
En ce qui concerne notre organisation, nous travaillons depuis plusieurs années à la SDSS en protocole BRI-BAC, ainsi qu’avec le RAID sur les autres départements de la DSPAP. Cela signifie que nous avons l’habitude de l’interopérabilité, que nous savons quand la BRI va arriver, de quoi elle aura besoin et comment s’effectuera le relais. Certains fonctionnaires de la BAC 75N sont formés par la BRI, et nous disposons d’un matériel plus adapté à ce type de situation, c’est-à-dire des protections balistiques et de l’armement de niveau supérieur. Pour ce qui est de mon cas personnel, mon chef est sur place ce soir-là : je n’ai donc qu’à le suivre.
M. B. B. D’une certaine manière, c’est en effet le commissaire de la BAC 75 qui nous a ouvert la voie. Je n’oublierai jamais ce qu’il m’a raconté en ressortant du Bataclan : le terroriste sur la scène, en train de mettre en joue quelqu’un, lui-même et son équipier qui prennent leur arme, le visent et tirent ; le terroriste qui tombe à terre, pousse un râle et se fait exploser provoquant une nuée de « confettis »… C’est ainsi que j’ai compris que les terroristes portaient des ceintures d’explosifs.
Ensuite, joue la puissance du collectif, qui fait que l’on se sent plus fort. Il est probable que, seul, aucun d’entre nous n’aurait osé y aller. Mais, compte tenu de l’urgence, chacun doit prendre ses responsabilités et agir sans avoir le temps d’en demander l’autorisation. C’est une décision individuelle.
M. Christophe Cavard. Pensez-vous que c’est désormais ainsi qu’il faut envisager la riposte : sans s’attacher au protocole et sans attendre les unités spécialisées, mais en tentant des actions immédiates ? Qu’en serait-il avec des unités moins bien formées que les vôtres ?
M. S. Q. Nous n’avons pas le choix. Nous sommes policiers, et nous nous devons d’intervenir. C’est une obligation normale et naturelle, à condition qu’elle soit encadrée par des règles d’intervention, en particulier en ce qui concerne la sécurité. Il fallait pénétrer dans le Bataclan. C’est ce qu’a fait le commissaire de la BAC 75N, à sa façon, et nous devions, quoi qu’il en soit, porter assistance aux victimes.
Les protocoles sont ce qu’ils sont. La SDSS dispose de matériels plus perfectionnés, ce qui est normal puisque ses membres sont davantage exposés que les policiers du service général, encore que ces derniers, les policiers de police secours, soient parfois les plus exposés, car ils se portent sur des situations dont ils ignorent tout. Il se trouve qu’en l’occurrence c’est la SDSS qui a été primo-intervenante. Mais, à mon avis, le problème que vous soulevez ne se pose pas. Quelle image aurait dans la population une police qui n’intervient pas ?
Mme Anne-Yvonne Le Dain. En premier lieu, j’aimerais savoir comment vous allez, vous et vos troupes ? Comment avez-vous géré la situation dans les jours qui ont immédiatement suivi les attentats ? Comment se sont effectués les débriefings ? N’ont-ils concerné que les officiers ou l’ensemble des troupes ? En quoi ont consisté vos échanges avec votre hiérarchie ?
Comment, ensuite, vous préparez-vous à d’autres attaques ?
Enfin, je tiens à vous remercier, vous et les personnels que vous encadrez ; ceux qui sont allés au combat, ont porté les blessés, ont fait face au feu. Je mesure l’épreuve que cela a pu être.
M. D. K., commissaire divisionnaire. Il se trouve que les primo-intervenants ce soir-là ont été les membres d’un équipage du 3e arrondissement qui effectuait une intervention sur un accident matériel de la circulation dans le secteur des Filles-du-Calvaire, c’est-à-dire juste à côté du Bataclan. Hélés par un agent de sécurité de la salle qui les a avertis que des tirs avaient lieu, ces trois jeunes gardiens de la paix, parmi lesquels se trouvait une stagiaire avec six mois d’ancienneté, se sont précipités vers le Bataclan, dont ils ont dû chercher l’adresse sur leurs téléphones personnels, car ils ne connaissaient pas cette salle qui ne se trouve pas dans le 3e arrondissement. Arrivés pendant la fusillade, impuissants, ils ont dû attendre l’arrivée des renforts. J’y insiste, parce qu’il est important de souligner que se trouvaient aussi devant le Bataclan ce soir-là des policiers largement démunis devant ce qui était en train de se produire.
Pour ma part, j’ai été prévenu à 21 h 50 et suis arrivé sur place à 22 h 30, en compagnie de mon adjoint, Cyril Lacombe. Nous nous sommes réparti les rôles de manière assez naturelle : lui s’est occupé de la circulation, car les pompiers bloquaient la rue Oberkampf et qu’il était nécessaire de libérer l’accès pour l’intervention d’autres véhicules de secours ; je me suis d’abord préoccupé de savoir si mes gars – sept au total – n’étaient pas blessés. Mes gardiens de la paix se sont occupés de faire des massages cardiaques, des garrots sur des personnes en train de mourir, lesquelles sont d’ailleurs toutes décédées dans les minutes qui ont suivi. Ils ont ensuite transporté les victimes encore vivantes à l’angle du boulevard Voltaire et de la rue Oberkampf où se trouvaient les pompiers. Je leur ai prêté assistance, puis nous sommes entrés dans la salle, sans trop nous poser de question ni solliciter l’autorisation de la hiérarchie, afin de récupérer d’autres blessés.
M. S. Q. Nous sommes entrés dans la salle après qu’on nous a informés que la BRI avait sécurisé le rez-de-chaussée.
M. D. K. Reste que, par une sorte d’effet « tunnel », on ne s’est pas posé énormément de questions et que nous avons évacué les victimes que nous trouvions, les unes après les autres, pour les conduire auprès des pompiers.
Lorsque les opérations ont été terminées, j’ai réuni mes équipes dans mon bureau, vers cinq ou six heures du matin, et nous avons fait un premier débriefing à chaud, au cours duquel chacun a pu partager ses émotions et ce qu’il avait vécu. Mes gars étaient très marqués, couverts de sang et de débris humains. Ils avaient de l’événement des perceptions – sonores, visuelles, olfactives – assez différentes, mais apocalyptiques.
J’ai ensuite organisé, le lundi à dix heures, avec deux spécialistes du Service de soutien psychologique opérationnel (SSPO), une séance davantage axée sur le contrecoup émotionnel. Nous avons beaucoup appris sur les différentes phases de stress, d’angoisse ou de cauchemars par lesquelles nous étions censés passer.
Il y a eu également d’autres débriefings opérationnels, au cours desquels nous avons réécouté les bandes radio, pour analyser le déroulement des opérations et améliorer ce qui pouvait l’être.
Nous procédons aussi à des exercices et sommes en train de réfléchir à un exercice-attentat qui nous permette de travailler notre réactivité et nos réflexes.
M. S. Q. J’ajoute que nous organisons dans de nombreux arrondissements des simulations sur cartes, de manière à éviter les mouvements de panique dans la population. Ces simulations se déroulent sans engagement de fonctionnaires, mais en coordination avec les pompiers afin de se préparer à des opérations communes.
Je précise également que tous les commissaires présents au Bataclan ont réuni leurs équipes à l’aube. Nous sommes tous revenus travailler le samedi 14 novembre, toute la journée, de manière à parler et à échanger les uns avec les autres.
La préfecture de police a enfin mobilisé des psychologues d’horizons divers afin qu’ils soient présents à nos côtés toute la semaine qui a suivi. Cette écoute a fait beaucoup de bien, en particulier dans mon district où beaucoup de fonctionnaires ont vécu successivement les attentats contre Charlie Hebdo, contre l’Hypercacher, puis les attentats du 13 novembre – 2015 a été pour eux une année difficile.
M. Olivier Falorni. On mesure en vous entendant ce qu’ont été l’abnégation et le courage des forces de police. Je tiens ici à les saluer. Votre audition est d’autant plus importante qu’elle nous permet de mesurer le travail que vous avez accompli entre l’intervention du commissaire de la BAC et l’arrivée de la BRI.
Vous nous avez parlé d’une quinzaine d’intervenants qui ont pénétré assez rapidement dans le Bataclan : s’agissait-il d’un « amalgame » entre fonctionnaires appartenant à différentes unités et comment cet amalgame s’est-il fait ? A-t-il été spontané ?
Aviez-vous tous le même niveau de formation et de quel équipement disposiez-vous ? La BRI vous forme-t-elle à intervenir dans ce type de situation ?
M. le président Georges Fenech. Si j’ai bien compris vos propos, vous n’êtes pas intervenus pour aller au contact des terroristes, mais pour sécuriser les lieux et sauver des vies. C’est à la BRI qu’il incombe de neutraliser les terroristes.
M. B. B. L’amalgame s’est fait assez naturellement, car nous avons une culture professionnelle commune. Les unités de la SDSS, qui sont des unités de renfort et de soutien, travaillent quotidiennement avec les unités de la DTSP. Nous nous identifions aisément sur le terrain grâce à nos uniformes, nos écussons ou nos véhicules. Qu’il s’agisse d’un délit, d’un crime de droit commun ou d’attentats, nous avons le réflexe de travailler ensemble.
Pour ce qui concerne nos équipements, ils sont un peu différents. Les unités de la SDSS disposaient ce soir-là de gilets pare-balles lourds, comme certains des fonctionnaires de la DTSP.
Quant aux formations, la BRI en assure en effet quelques-unes, mais la technicité de la SDSS ne repose pas sur ces quelques formations.
M. Olivier Falorni. Et de quel armement disposiez-vous ?
M. B. B. La CSI 75 est basée boulevard Bessières, porte de Saint-Ouen. En quittant le boulevard Bessières pour me rendre rue de la Fontaine-au-Roi – le Bataclan n’avait pas encore été attaqué –, je suis passé à l’armurerie récupérer mon arme. J’y ai croisé des fonctionnaires civils de la BAC 75N à qui j’ai appris ce qui était en train de se passer. Ils se sont donc équipés en conséquence, notamment d’un fusil à pompe.
Mme C. P. Notre priorité a été d’équiper la colonne de la BAC 75N qui avait besoin d’armes longues. Le premier équipage était composé de trois civils, qui se sont munis de gilets pare-balles classiques ainsi que d’un fusil à pompe ; mon chauffeur et moi-même, ainsi que le chef et son équipier, disposions également de l’équipement classique – gilet pare-balles et arme de poing.
Nous avions également deux gilets lourds dans le véhicule, ce qui n’est pas suffisant pour sept, sachant que ces gilets peuvent avoir un effet psychologique rassurant, mais qu’ils ne protègent pas des balles de calibre 7,62 tirées par la kalachnikov. Jusqu’à présent, ce type d’équipements de protection balistique était réservé aux unités d’intervention, mais c’est en train de changer.
Soucieux d’arriver le plus vite possible au Bataclan où se trouvait déjà l’un de nos équipages, nous avons sans doute commis l’erreur de ne pas compléter le matériel se trouvant dans les véhicules. Nous disposons notamment de casques que nous n’avons pas pris ce soir-là.
M. B. B. Je précise que, si certains casques arrêtent l’impact de la balle, la cinétique est telle qu’elle peut provoquer une rupture des cervicales mortelle.
J’ajoute aussi à ce que vient de dire le commissaire C. P. que l’un des trinômes de la CSI était par ailleurs équipé d’un bouclier balistique et de casques, mais sans visières pare-balles. Je portais pour ma part un gilet lourd, ce qui n’était pas le cas de mon adjoint, car, entre janvier et novembre, notre service s’est vu retirer une trentaine de gilets lourds réformés pour défaut, mais qui n’ont jamais été remplacés. Il a donc dû emprunter le sien à un gardien de la paix à qui il a demandé en conséquence de quitter l’intérieur du Bataclan.
M. Christophe Cavard. Je fais partie de ceux qui pensent, au vu de ce qui s’est passé le 13 novembre, qu’il va falloir faire évoluer nos procédures d’intervention, et il me semble que je peux déduire de vos propos que les protocoles qui incluent des phases de sécurisation et de négociation sont dépassés.
M. le rapporteur. Votre audition est importante, car elle nous permet de combler des trous dans le déroulé des opérations et d’avoir un aperçu de votre travail, que je tiens à saluer ici.
J’aimerais savoir si vous vous êtes coordonnés avec les militaires de l’opération Sentinelle, dont certains se trouvaient à l’arrière du bâtiment.
Comment ensuite – et je m’excuse d’y revenir – s’est fait le lien avec la BRI ? Lequel d’entre vous s’est entretenu personnellement avec l’un de ses membres ? Leur avez-vous transmis des informations ?
À partir de 22 h 20 enfin, heure à laquelle la BRI pénètre dans le Bataclan, cessez-vous d’évacuer les blessés ? Dans le cas contraire, comment s’est fait le lien avec le professeur Safran, le médecin de la BRI, à qui revenait la tâche de coordonner l’évacuation des blessés ?
M. le président Georges Fenech. Avez-vous eu un contact direct avec le commissaire Molmy ?
M. S. Q. Le lien avec les commissaires de la BRI s’est fait naturellement puisque nous étions à leur contact devant, puis à l’intérieur du Bataclan.
Nous dispositions d’indications techniques sur leur mode opératoire ainsi que d’informations sur les obstacles que pouvaient rencontrer les forces de police, mais cela ne nous a pas empêchés de poursuivre l’évacuation des blessés, dans la mesure du possible, jusqu’à 0 h 15, où l’on nous a demandé de quitter le Bataclan, car l’assaut allait être donné.
M. B. B. Je n’ai personnellement pas parlé à Christophe Molmy, parce que j’ai vu le commissaire de la BAC 75N lui parler.
M. le rapporteur. Vous confirmez que le commissaire qui est intervenu en premier au Bataclan a eu un échange vers 22 h 20 avec le chef de la BRI ?
M. B. B. C’est ce dont je me souvenais, mais le commissaire C. P. semble penser qu’il s’agissait plutôt du capitaine qui dirigeait la FIR. C’est possible. Quoi qu’il en soit, en tant que témoin privilégié de l’intervention de la BRI, j’ai sincèrement trouvé cette intervention particulièrement aboutie. Lorsque la FIR est arrivée, elle n’a pas tergiversé, sans se retrancher derrière tel ou tel prétexte pour ne pas intervenir avant l’arrivée des renforts. C’est à mettre à son actif.
M. S. Q. Pour ma part, j’estime que la coordination entre les différentes unités s’est faite progressivement de manière tout à fait naturelle et efficace, compte tenu des difficultés liées au contexte et du nombre effarant de blessés.
Avec la présence sur place du préfet de police, du directeur de la PJ, en contact avec la BRI, du directeur de la DSPAP, du directeur de la DTSP et de moi-même, la chaîne hiérarchique était en place.
Vous nous interrogez beaucoup sur l’état de cette coordination dans les premiers moments de l’intervention, mais la question ne me semble pas si fondamentale. L’essentiel est que la CSI et la BRI soient intervenues, la CSI en primo-intervenante, la BRI en soutien, et je crois que nous ne pouvons que nous féliciter des résultats obtenus.
M. le rapporteur. Notre intention n’est nullement de prendre en défaut qui que ce soit. Nous cherchons simplement à retracer la chronologie des faits, et il est important de notre point de vue de savoir s’il y a eu un contact entre la BRI à son arrivée et vous, qui vous trouviez sur place depuis une vingtaine de minutes. Sur ce point, les informations que nous avons eues ne sont pas celles que vous nous donnez. Je voudrais donc que vous nous confirmiez que le commissaire de la BAC 75N qui a abattu l’un des terroristes a eu un contact, vers 22 h 20 ou 22 h 25, avec l’un des responsables de la BRI.
M. B. B. Oui. Il s’agissait selon moi soit du capitaine de la FIR, soit du commissaire Molmy.
M. le rapporteur. Après 22 h 20, au moment où la BRI entre dans la salle pour progresser vers les étages à partir de 23 heures, continuez-vous à évacuer les blessés ? On nous a indiqué qu’une première vague d’otages avait été évacuée vers 22 h 35 ou 22 h 40 sur instruction de la BRI, mais que le gros des blessés avaient été évacués après l’assaut final, c’est-à-dire après 0 h 18. Vous dites, vous, que, jusqu’à 0 h 15, vous avez poursuivi l’évacuation.
M. B. B. C’est exact.
M. le rapporteur. N’y avait-il pas un risque que l’on vous tire dessus depuis les balcons ? Comment avez-vous évalué ce risque ?
Mme C. P. Il y a eu deux contacts entre la DSPAP et la BRI, je l’affirme avec certitude. Mon chef, le commissaire qui a abattu l’un des terroristes, a été en contact avec le chef de la FIR – j’ignore s’il avait le grade de capitaine ou de commandant –, qui s’est immédiatement porté à son niveau pour se positionner à l’intérieur du Bataclan.
J’ai pour ma part eu un contact avec le chef de la BRI, au niveau de la rue Oberkampf. J’ai mis à sa disposition la colonne de la BAC N qui venait d’arriver. Par la suite nous nous sommes engagés derrière la BRI, en restant au rez-de-chaussée du Bataclan.
Quant à la gestion des blessés, il y a eu un bref moment de flottement avec l’équipe médicale de la FIPN…
M. le président Georges Fenech. Mais la FIPN n’a pas été déclenchée ! Ce n’est d’ailleurs pas un détail mineur.
Mme C. P. Il y avait sur place le médecin de la BRI et le médecin du RAID – c’est en ce sens que j’emploie le terme.
M. D. K. Le RAID et la BRI-BAC sont des unités qui constituent la FIPN, même si celle-ci n’était pas déclenchée.
L’évacuation des victimes a commencé peu après 22 heures et s’est poursuivie jusqu’à minuit passé. Nous étions d’autant plus conscients que la zone n’était pas sécurisée que l’un des membres de la BRI m’a averti, à un moment donné, que nous nous trouvions dans l’axe de tir des terroristes.
Mme C. P. Dans mes souvenirs, le professeur Safran, que nous avons vu au tout début, était, me semble-t-il, plus en avant dans la salle. J’avais pour ma part à mes côtés un médecin – probablement du RAID – qui nous a aidés à organiser l’extraction des blessés. Nos collègues équipés en lourd allaient chercher les blessés dans la fosse ou dans les coursives pour les amener au sas d’entrée, où nous nous efforcions, tant bien que mal, d’organiser un flux qui ne gêne pas les colonnes d’assaut en train de se mettre en place.
M. le président Georges Fenech. Vous avez en quelque sorte fait fonction de service de secours, mais qui a donné l’autorisation aux services de secours de pénétrer dans cette zone ?
M. B. B. Après l’assaut, il y a eu une sorte de consensus.
Pouvant capter sur ma radio les ondes de la BRI, j’ai eu connaissance de la fin de l’assaut, dont j’ai averti un officier des sapeurs-pompiers qui se trouvait à mes côtés, pour qu’il puisse se porter auprès des blessés.
Après avoir utilisé les barrières Vauban pour transporter ces derniers, nous avions fini par obtenir des brancards, qui étaient entreposés dans le sas d’entrée du Bataclan, où deux ou trois médecins du RAID ou de la BRI, et probablement le docteur Safran, effectuaient un pré-tri, après quoi nous portions les brancards jusqu’à la rue Oberkampf, où un premier poste médical avancé (PMA) avait été installé dans une cour d’immeuble, qui est malheureusement rapidement devenue trop exiguë.
Nous avons ainsi pu sauver des dizaines de gens, mais il serait intéressant, d’un point de vue médico-légal, de connaître le nombre de décès survenus entre la quinzième minute – avant lesquelles les décès qui surviennent sont malheureusement quasiment inévitables – et la soixantième minute qui ont suivi l’attaque. Cela aiderait sans doute à progresser en matière de secourisme opérationnel, en améliorant les premiers soins prodigués.
M. le président Georges Fenech. Vous parlez de consensus, mais ne peut-on pas imaginer un dispositif doté d’un commandement unique ? Il y va de toutes les vies qui sont en jeu dans ce type de situation.
M. B. B. On est certainement perfectibles, mais je constate que le 13 novembre, face à une situation beaucoup plus dégradée qu’en janvier, la police nationale s’est montrée plus performante. Nous avons progressé, et nous serons encore meilleurs les prochaines fois. Lors de nos débriefings avec la BRI, nous nous sommes notamment engagés à établir un contact rapide, dès les premiers instants.
En ce qui concerne les soldats de l’opération Sentinelle, à un moment donné, un policier a demandé sur les ondes radio l’autorisation de recourir aux services d’un militaire qui se trouvait avec lui face à l’un des terroristes qui lui tirait dessus, autorisation qui lui a été refusée par l’état-major. Il s’agit d’une mauvaise question qui appelait une mauvaise réponse. L’état-major n’aurait pas dû refuser, mais, lorsque l’on se fait tirer dessus, on ne demande pas l’autorisation de riposter. Cela fait partie du genre d’inhibitions que génère le système.
M. S. Q. Je précise qu’à partir du moment où la BRI nous informe par radio que le commando terroriste a été neutralisé – je me trouve alors à côté du préfet –, il ne s’écoule que quelques secondes avant que les pompiers interviennent au secours des blessés, avec l’autorisation de leur hiérarchie, et prennent alors le relais des policiers. Tout s’enchaîne avec fluidité.
M. G. P., commissaire de police, BAC de nuit des Hauts-de-Seine. L’unité de la BAC 92N a été engagée sur ordre. Vers 22 heures, j’ai reçu instruction de ma salle de commandement de me rendre à Bastille. À Bastille, j’ai reçu de la salle de commandement parisienne instruction de me diriger vers République, où je ne me rendrai jamais, arrêté par la circulation et les véhicules de secours. C’est ainsi que je me suis retrouvé avec le commissaire Didier à l’arrière du Bataclan, d’où nous avons pu intervenir pour porter assistance aux pompiers et récupérer les blessés.
M. J. M., commissaire de police, commissaire central du 10e arrondissement. Je me suis trouvé dans le 10e arrondissement sur le site du premier attentat parisien, qui a eu lieu à l’angle de la rue Bichat et de la rue Alibert, où les terroristes ont tiré sur les terrasses du Carillon et du Petit Cambodge, faisant de nombreux morts et de nombreux blessés. J’y suis resté de 21 h 45 à 4 h 40, en quelque sorte coupé du monde, me concentrant sur la protection des traces et indices – de nombreuses douilles de 7,62 ainsi que des chargeurs de kalachnikov étaient éparpillés à terre. Il s’agissait d’un endroit très difficilement défendable, car le carrefour a la forme d’une étoile à cinq branches, et le préfet de police, déjà sur les lieux à mon arrivée, m’a demandé de sécuriser les lieux en priorité. Ma tâche principale a donc été d’éviter un surattentat et de faciliter le travail des sapeurs-pompiers et du SAMU. Si, avec le recul, cette mission paraît assez simple par rapport à ce qu’ont affronté nos collègues du Bataclan, elle a néanmoins nécessité une coordination entre différents types d’unités, notamment des unités de la CSI.
Merci, madame Le Dain, de vous inquiéter du moral des troupes. Elles vont beaucoup mieux, grâce à l’aide très précieuse que nous a apportée le SSPO dans les jours qui ont suivi. Les psychologues se sont montrés très disponibles, intervenant la nuit pour les équipes de nuit. Le travail qu’ils ont effectué a été essentiel pour permettre à nos collègues d’intégrer les événements extraordinaires – au sens propre du terme – qu’ils avaient vécus et dont ils parlent encore aujourd’hui avec une émotion non feinte.
Les effectifs du 10e arrondissement ont évidemment ressenti les choses de manière tout à fait particulière, dans la mesure où ils travaillent parfois dans cet arrondissement depuis des années – vingt-cinq ans pour certains. Devant une telle boucherie, ils ont été atteints d’autant plus profondément qu’ils ont cet arrondissement dans la peau. Ils en connaissent les commerçants et les riverains, le tissu associatif et socioculturel.
Notre intervention s’est faite sans la BRI ni le RAID, car la situation ne le nécessitait pas, notre « scène de crime » étant figée. Nos effectifs ont travaillé avec la plus grande sérénité possible et ils ont évité des drames – je pense entre autres aux idiots ou aux déséquilibrés qui se présentaient à eux en laissant supposer qu’ils étaient munis d’armes ou d’explosifs. Le stress qu’avaient subi les fonctionnaires aurait pu les conduire à des bavures, qui ne se sont pas produites grâce au sang-froid de tous ces collègues à qui je veux rendre hommage.
M. F. C., commissaire divisionnaire. Pour ma part, j’avais la charge du périmètre de sécurité sur le site de La Belle Équipe, rue du Charonne. Des militaires de l’opération Sentinelle se sont mis à ma disposition dès mon arrivée sur les lieux et ont contribué à rendre étanche le périmètre de sécurité. Leurs structures et leurs modes d’intervention sont différents des nôtres, mais ils ont su s’adapter. J’avais fait en sorte de placer des militaires quasiment sur chaque point de circulation autour du périmètre, et leur présence a été assez dissuasive, notamment à l’endroit des journalistes.
M. J. M. J’ai également eu recours aux militaires sur les points de sécurisation et je les en remercie.
Mme V. G., commissaire divisionnaire. Quarante-trois de mes fonctionnaires, rattachés au commissariat du 18e arrondissement sont intervenus sur les événements du 13 novembre, disséminés partout, sauf autour du Stade de France. Je suis moi-même intervenue de 21 h 30 à 4 heures du matin rue de la Fontaine-au-Roi, qui n’était pas du tout l’endroit où j’aurais dû arriver, puisque je devais me rendre rue Bichat. C’est par hasard que je me suis trouvée à cet endroit, où quelques effectifs intervenaient déjà avec les pompiers qui prodiguaient les premiers secours aux victimes du bar La Bonne Bière, tandis qu’il fallait s’assurer de la sécurisation du restaurant Casa Nostra, dans lequel de nombreux témoins disaient qu’un terroriste s’était retranché.
C’est une opération qui a pris du temps et, avant de pouvoir faire intervenir le Groupe de soutien opérationnel (GSO) et le RAID, il a fallu que les pompiers puissent évacuer toutes les victimes. J’ai été frappé par le fait que le capitaine des pompiers n’avait aucun médecin à ses côtés. Il n’a donc pu faire aucune stabilisation comme on a l’habitude de les pratiquer sur place, évacuant directement les blessés vers les hôpitaux.
Le dispositif était très vulnérable, et les collègues intervenants, dont beaucoup de jeunes qui n’avaient jamais vu un seul cadavre de leur vie, se sont montrés très courageux. Je me suis donc immédiatement préoccupée de protéger les bases arrière, les informations diffusées sur les ondes laissaient penser qu’il pouvait y avoir des terroristes dans le métro et qu’une autre attaque était possible.
J’ai agi sans hiérarchie intermédiaire, à l’exception d’un commandant qui est arrivé plus tard dans la nuit ; cela a compliqué les procédures de commandement sur un site en définitive assez étendu.
À un moment donné, j’ai été avertie par la Croix-Rouge qu’une quarantaine de personnes traumatisées s’étaient réfugiées au Palais des Glaces, à une centaine de mètres. Il m’a donc fallu courir à droite et à gauche, contrôler un véhicule suspect ainsi qu’un colis suspect dans le panier d’un Vélib’.
Nous n’avons pas vu de journalistes, et personne n’a parlé de nous le lendemain dans les médias, ce qui a étonné la plupart de mes effectifs.
Comme tous nos collègues, nous avons procédé à des débriefings et monté des cellules de soutien psychologique. J’ai mené des entretiens individuels avec une vingtaine de fonctionnaires parmi les plus choqués. Le traumatisme met souvent plusieurs jours à remonter à la surface, et j’ai pensé que le nombre d’arrêts maladie risquait d’être important : personne ne s’est arrêté et, s’il avait fallu recommencer les jours suivants, ils y retournaient.
Nous avons obtenu ces temps derniers un surcroît de matériel. Nous ont également été distribuées des fiches « Réflexes attentats ». Des retours d’expérience ont été organisés, notamment une réunion au cours de laquelle l’ensemble des commissaires de la DSPAP ont été débriefés par le RAID et la BRI pendant deux heures. Nous avons beaucoup appris, et cela nous a permis de transmettre à nos troupes des conseils utiles.
En ce qui concerne la prise de risque, on ne pourra jamais empêcher un gardien de la paix, un officier ou un commissaire de foncer s’il y a des blessés. Le risque fait partie de notre travail. Compte tenu néanmoins des risques qui ont été pris le 13 novembre, je considère que c’est un miracle qu’aucun policier n’ait été ni blessé ni tué.
Dans le cas d’une attaque nucléaire, radiologique, biologique et chimique (NRBC), nous risquons en revanche d’être en mauvaise posture, car nous ne disposons pas encore de protocole établi. Cela n’empêche pas les troupes de se déclarer prêtes à y aller, étant entendu que, lorsqu’on part en opération, on ne sait pas toujours à quel type de situation on va être confronté.
M. S. Q. Vous avez beaucoup insisté sur la question du commandement. J’ai omis de vous préciser le rôle de la salle de commandement de la DSPAP, la SIC 750, dans le déroulement des faits. Elle a joué un rôle majeur tout au long des opérations puisque les commissaires présents sur place lui ont rendu compte en continu et de manière systématique de tous les événements. Cela a contribué à la diffusion des informations auprès des policiers engagés, mais cela a également permis de répercuter les ordres. La SIC 750 parle au nom du directeur et, toute la soirée, la chaîne de commandement a ainsi pu fonctionner, malgré, parfois, les difficultés inhérentes au manque d’informations.
M. T. D. Je voudrais pour conclure saluer le courage et le dévouement des effectifs qui se sont mis spontanément à ma disposition sans que je les connaisse, de 22 h au petit matin. Ils venaient du 95, du 92, du 93 et de Paris, notamment la colonne civile de la BAC 75N. Ils se sont comportés avec exemplarité à un moment où nous devions agir dans la plus grande incertitude. En effet, lorsque nous nous engageons dans le passage Saint-Pierre-Amelot, les effectifs de police qui m’accompagnent ne savent pas où se trouvent les tireurs. Il fallait donc avoir un certain courage pour y entrer. Et je tiens à les saluer pour cela.
M. le président Georges Fenech. Mesdames et messieurs, il me reste à vous remercier pour les éclairages que vous nous avez apportés.
Table ronde, ouverte à la presse, consacrée à la prise en charge des victimes des attentats de l'année 2015 par la brigade de sapeurs-pompiers de Paris (BSPP) et le service d'aide médicale urgente (SAMU) : général Philippe Boutinaud, commandant la BSPP, professeur Jean-Pierre Tourtier, médecin-chef de la BSPP, médecin chef Michel Bignand, colonel Jean-Claude Gallet, adjoint au général commandant la BSPP, colonel Gérard Boutolleau, chef de corps du 2e groupemement d'incendie et de secours et commandant des opérations de secours au Bataclan, ; professeur Pierre Carli, directeur médical du SAMU de Paris, chef de service au département d'anesthésie-réanimation de l'hôpital Necker-Enfants-Malades, professeur Frédéric Adnet, directeur du SAMU 93, responsable du pôle accueil-urgences-imagerie de l'hôpital Avicenne, docteur François Braun, président du SAMU Urgences de France, chef de service médecine d'urgence, docteur Yves Lambert, chef du pôle de l'urgence, directeur du SAMU 78, docteur Valérie-Charlotte Chollet-Xémard, praticien hospitalier du SAMU 94 à l'hôpital Henri-Mondor
Compte rendu de la table ronde, ouverte à la presse, du mercredi 16 mars 2016
M. le président Georges Fenech. Messieurs, madame, nous vous remercions d’avoir répondu à la demande d’audition de la présente commission d’enquête relative aux moyens mis en œuvre par l’État pour lutter contre le terrorisme depuis le 7 janvier 2015.
Nous avons souhaité commencer par entendre les victimes qui ont bien évidemment droit à toute l’attention de la représentation nationale. Nous poursuivons notre série d’auditions avec vous en nous intéressant aujourd’hui à leur prise en charge, comme nous l’avons fait le 29 février en recevant le directeur général du service de santé des armées et le directeur général de l’Assistance publique de Paris.
Je suis heureux d’accueillir aujourd’hui les responsables de la Brigade de sapeurs-pompiers de Paris (BSPP) : le général Philippe Boutinaud, commandant la BSPP, accompagné du professeur Jean-Pierre Tourtier, médecin-chef de la BSPP, du médecin-chef Michel Bignand, du colonel Jean-Claude Gallet, adjoint au général commandant la BSPP et du colonel Gérald Boutolleau, chef de corps du 2e Groupement d’incendie et de secours et commandant des opérations de secours au Bataclan. Je précise que la BSPP, forte de 8 500 officiers, sous-officiers, gradés et sapeurs est placée pour emploi sous l’autorité du préfet de police de Paris, et qu’elle est compétente, outre Paris, dans les 124 communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.
Nous recevons également les responsables du Service d’aide médicale urgente (SAMU) : le professeur Pierre Carli, directeur médical du SAMU de Paris, chef de service au département d’anesthésie-réanimation de l’hôpital universitaire Necker-Enfants-Malades, président du Conseil national de l’urgence hospitalière, accompagné du professeur Frédéric Adnet, directeur du SAMU 93, responsable pôle accueil-urgences-imagerie de l’hôpital universitaire Paris Seine-Saint-Denis Avicenne à Bobigny, du docteur François Braun, président du SAMU Urgences de France, chef de service médecine d’urgence, du docteur Yves Lambert, chef du pôle de l’urgence, directeur du SAMU des Yvelines et du docteur Valérie-Charlotte Chollet-Xémard, praticien hospitalier du SAMU 94 à l’hôpital Henri-Mondor. Je précise que le SAMU, service public chargé de traiter les urgences à l’extérieur de l’hôpital, est en mesure de prendre en charge les patients dans les situations les plus graves.
La présente table ronde est ouverte à la presse et fait l’objet d’une retransmission en direct sur le site internet de l’Assemblée ; son enregistrement sera disponible pendant quelques mois sur ledit site. Je vous signale que la commission pourra citer dans son rapport tout ou partie du compte rendu de cette table ronde. Nous avons décidé que, d’une manière générale, nos auditions seraient ouvertes à la presse car nous devons mener cette enquête en toute transparence.
Conformément aux dispositions de l’article 6 de l’ordonnance du 17 novembre 1958, relative aux commissions d’enquêtes, je vais vous demander de prêter le serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité.
MM. Philippe Boutinaud, Jean-Pierre Tourtier, Michel Bignand, Jean-Claude Gallet, Gérald Boutolleau, Pierre Carli, Frédéric Adnet, François Braun, Yves Lambert et Mme Valérie-Charlotte Chollet-Xémard prêtent successivement serment.
Général Philippe Boutinaud, commandant la Brigade de sapeurs-pompiers de Paris. C’est un honneur pour moi et pour les officiers qui m’accompagnent d’être devant vous. C’est pour ma part la quatrième fois, depuis trois mois, que j’ai l’occasion d’échanger avec des parlementaires, et je trouve cela tout à fait salutaire.
Je suis ici parce que, le 13 novembre dernier, j’étais le commandant des opérations de secours de la plaque parisienne et de Saint-Denis. Il s’est agi d’une opération de secours très complexe mais qui est considérée par les professionnels de l’urgence français et étrangers comme une réussite malgré l’immensité des difficultés. Quand on compte 130 morts, il convient toutefois de rester modeste, et c’est bien dans cet esprit que j’aborde cet échange avec vous. Mes premières pensées vont naturellement aux victimes et à leurs proches, auxquels nous pensons énormément parce que nous les avons vus de nos propres yeux ce soir-là.
Je présenterai le cadre général de l’opération, les difficultés que nous avons rencontrées, ce que j’identifie comme des facteurs de succès, ce qui constitue également des forces de frottement, enfin la coopération avec les autres acteurs.
D’abord les faits : c’est la plus grosse opération de secours dans la capitale française – du moins par le nombre des victimes – depuis les bombardements de la Seconde Guerre mondiale. La dernière fois que Paris a été frappé par des attentats, c’était il y a environ vingt ans, à la station RER de Port-Royal. Le 13 novembre, les sapeurs-pompiers sont intervenus simultanément sur sept sites différents, ce qui ne s’était jamais produit – il faut le garder à l’esprit. Nous étions « fixés » sur deux sites : le Stade de France et les 10e et 11e arrondissements. Bien sûr, rien ne nous indiquait à vingt-deux heures que nous allions nous limiter à sept sites, ce qui nous a conduits à prendre un certain nombre de mesures conservatoires pour éviter de nous faire déborder.
Quarante minutes se sont écoulées entre la première explosion, à 21 heures 19, et la fixation des terroristes dans le Bataclan à 22 heures. Dans la partie parisienne, les événements se sont déroulées au sein d’un carré très limité puisque de moins de quatre kilomètres carrés. Les actes terroristes du Bataclan ont été le dernier point mais nous avions en permanence en tête que d’autres frappes risquaient de survenir.
La totalité de l’action des secours s’est établie dans un délai d’un peu moins de huit heures puisque nous avons commencé à 21 heures 20 et que les opérations actives se sont terminées à 5 heures 30, étant entendu que toutes les évacuations ont été réalisées bien avant 5 heures 30.
On peut diviser notre action en quatre phases successives. La première est une phase de réaction, chaotique et qui l’est toujours dans ce type de circonstances ; la meilleure façon de la « récupérer » est d’avoir des actes réflexes et des mesures planifiées. En clair : les gens téléphonent aux pompiers et, systématiquement, on envoie des moyens aux adresses indiquées. Cette phase dure, j’y ai fait allusion, une quarantaine de minutes, depuis la première frappe au Stade de France et le début des opérations actives au Bataclan.
La deuxième phase consiste à reprendre l’initiative et s’étend entre 22 heures et l’assaut final au Bataclan entre minuit et minuit et demie environ.
La troisième phase est celle de la concentration des efforts, car il ne faut pas oublier que, pendant que les choses continuent dans Paris, j’ai un souci permanent : celui des 72 000 spectateurs qui se trouvent au Stade de France.
La quatrième et dernière phase est celle du retour à la normale puisque, à partir de cinq heures du matin, j’ai donné des ordres pour qu’à huit heures du matin l’ensemble des moyens de secours soient ramenés à 100 %.
Au total, le 14 novembre, à 4 heures 21, le bilan que j’ai donné au préfet de police s’établissait à 381 victimes traitées par les sapeurs-pompiers de Paris, se répartissant en 124 personnes décédées, 100 urgences absolues et 157 urgences relatives. D’autres victimes se sont présentées spontanément dans les hôpitaux.
Le potentiel, je viens de le mentionner, a été ramené à 100 % à 8 heures le samedi matin, ce qui signifie que tous les vecteurs avaient été complétés à nouveau en oxygène, en tout ce que vous pouvez imaginer comme produits pharmaceutiques pour les ambulances de réanimation et pour les véhicules de secours et d’assistance aux victimes (VSAV).
Environ 500 pompiers de Paris sont intervenus auxquels il faut ajouter les 200 qui se trouvaient dans la chaîne de commandement et de soutien. Ont été déployés 125 engins dont deux ont été touchés par balles, juste en face du Bataclan, l’un étant rendu complètement inutilisable. Les premiers intervenants sont arrivés, suivant les sites, entre trois et douze minutes après le premier appel – douze minutes pour le Comptoir Voltaire puisqu’il s’agit du cinquième site frappé et qu’il a fallu chercher des secours dans des casernes un peu plus éloignées, les casernes environnantes étant déjà mobilisées. Je rappelle qu’en France les secours sont censés arriver dans les trente minutes. Nous pouvions donc difficilement faire mieux. Ce délai concerne les premiers intervenants qui ont demandé des renforts.
La difficulté initiale est, vous l’imaginez, de savoir ce qui se passe, où, et qui est contre qui… Nous avons reçu, entre 21 heures 30 et 22 heures, 700 appels. De 21 heures 20 à 22 heures, nous avons décroché 584 appels, pour des conversations d’une durée moyenne d’une minute et vingt secondes. Le temps d’attente était de six à quarante-neuf secondes, compte non tenu du disque qui vous indique que votre conversation va être enregistrée, qui dure vingt secondes et qu’aux termes de la loi nous sommes tenus de passer. Une seule personne a attendu deux minutes et cinquante-cinq secondes avant que nous ne décrochions. Je me suis entretenu avec un cadre d’une importante société française de téléphonie : il m’a indiqué qu’aucune autre plateforme que la nôtre, en France, n’était capable de répondre à un tel flot d’appels. Il faut ajouter à cette difficulté le grand nombre d’adresses différentes qui nous a été donné : quand les choses se passent à l’angle de plusieurs rues, on vous donne plusieurs adresses ; en outre, il arrive que certaines personnes soient si paniquées qu’elles vous donnent l’adresse de leur domicile.
Pour ce qui est du Stade de France, je me suis immédiatement posé la question de savoir s’il fallait arrêter le match et faire évacuer le stade. Il se trouve que j’étais déjà sur place. J’ai rejoint l’état-major et l’officier commandant les opérations de secours (COS) – présent, tout comme le directeur des secours médicaux (DSM), dès qu’est organisée une manifestation réunissant plus de 30 000 personnes – nous a demandé nos instructions. Nous lui avons demandé de dire aux autorités se trouvant sur place de ne pas faire évacuer le stade, puisque nous avions à ce moment précis la certitude qu’aucune explosion n’avait eu lieu à l’intérieur. Nous avons également demandé qu’on joue le match jusqu’au bout afin d’éviter tout flux de personnes sortant avant la fin. Le préfet de Seine-Saint-Denis était sur place avec le Président de la République et c’est à niveau-là que la décision a été prise, décision qui, il faut le souligner, a considérablement servi les secours.
Nous avions de multiples raisons de départ, les uns nous appelant pour signaler une explosion, d’autres une fusillade, d’autres encore une prise d’otages.
Malgré toutes les difficultés auxquelles nous avons été confrontés, j’estime qu’il s’est agi d’une opération de secours réussie, étant donné qu’il était vraiment difficile de faire mieux et, cela étant dit, une fois encore, je m’incline avec un profond respect devant la peine des familles endeuillées.
Je discerne quatre facteurs de succès. Le premier a été l’anticipation. Voilà dix ans, en effet, que nous échangeons avec nos collègues des autres villes européennes, en particulier ceux exerçant dans des capitales. Nous avons tiré les enseignements de ce qui s’était passé à Madrid, à Londres, à Bombay. Les pompiers de Paris avaient créé le plan « Rouge », par la suite généralisé à la France entière : conçu en 1978, il visait à faire face à un grand nombre de victimes mais en un point unique. À l’issue du retour d’expérience avec nos collègues espagnols et britanniques, nous nous sommes aperçus que si nous étions confrontés à plusieurs frappes simultanées, ce qui ne s’était jamais produit et qui a eu lieu pour la première fois le 13 novembre dernier, le plan « Rouge » ne serait pas la bonne réponse.
Aussi, en 2005, avons-nous conçu le plan « Rouge Alpha ». Il n’existe qu’à Paris et la plupart de nos collègues des grandes villes françaises sont en train de l’adopter. Il permet de faire face à plusieurs frappes simultanées en divers lieux et d’accélérer le traitement des victimes.
Nous nous sommes donc adaptés à la menace, nous suivons ce qui se passe ailleurs et observons de quelle manière nos collègues étrangers réagissent. Or, depuis quelques mois, il était évident que se multipliaient les fusillades mortifères. Nous y avons travaillé bien avant l’été 2015. Le 8 octobre dernier, avec l’accord du préfet de police, le professeur Tourtier et moi-même sommes allés voir le professeur Carli. Nos réflexions ont abouti à l’organisation d’un exercice le 13 novembre au matin avec l’ensemble des SAMU.
Le deuxième facteur de succès a été l’organisation. À la BSPP, nous avons colocalisé le centre de traitement de l’alerte, qui reçoit les appels des requérants, l’état-major opérationnel, qui est notre salle de gestion de crise, et la coordination médicale qui est ma partie puisque je dispose de plus de soixante médecins à la BSPP. Cette configuration a été définie en 2011 et fonctionne très bien puisque, quand vous devez donner un ordre ou faire circuler une consigne, il suffit d’ouvrir une porte…
Le commandement est très centralisé. C’est le commandant des opérations de secours, le chef, c’est-à-dire moi, qui donne les ordres. Leur exécution, la conduite sur le terrain n’en est pas moins totalement décentralisée. Dès lors que les priorités ont été affichées, chaque centre qui reçoit un départ de secours sait où ses effectifs doivent aller et pour quel motif, l’exécution de l’opération étant confiée au cadre le premier arrivé sur place, qui a toute autorité pour prendre sa radio et demander des moyens en renforcement. C’est le centre opérationnel qui, ensuite, lui envoie les moyens dont il a besoin. Ce système est parfaitement rodé, puisque la BSPP effectue près de 1 250 interventions par jour.
Nous avons par ailleurs un état-major opérationnel à deux niveaux. En posture immédiate, la salle de crise de la BSPP est activée environ 280 fois par an, soit très régulièrement – elle l’a été, le 13 novembre, à 21 heures 25. Mais la salle de crise peut également être activée en posture renforcée avec un certain nombre de personnes logées sur place ou à proximité et qui sont d’astreinte et, alors qu’ils disposent d’une heure et demie, toutes sont arrivées en quarante minutes. On peut donc considérer qu’à 22 heures 10 la totalité de la salle de crise de la BSPP était opérationnelle.
Le troisième facteur de succès a été la préparation opérationnelle. Nos procédures sont rodées du fait d’exercices que nous réalisons tous les samedis matins sur des thèmes portant sur les attentats. Nous nous exerçons également, je l’ai dit, avec les SAMU et avec celui de Paris en particulier. Il ne faut pas oublier que la BSPP est une unité militaire : quarante-cinq de nos soixante médecins ont des opérations extérieures (OPEX) à leur actif, et la plupart des officiers de la Brigade ont également participé à des OPEX. Par conséquence, prendre en compte des blessés et agir sous les tirs, cela nous est arrivé à tous et ne risque pas de déstabiliser mes cadres.
Les décisions prises ont constitué le quatrième facteur de succès. Certaines sont planifiées. Les demandes de renforcement, par exemple, visaient à anticiper une montée en puissance, le risque que de multiples sites allaient être frappés. Les messages correspondants sont préformatés et il suffit de les expurger de ce dont nous n’avons pas besoin, messages qui vont beaucoup plus vite à envoyer que s’il nous fallait spécifier à chaque fois ce qu’il nous faudrait. Nous avons donc demandé immédiatement deux colonnes de renfort-attentat au centre opérationnel de la zone de défense et de sécurité de Paris, mais aussi le concours d’hélicoptères dans le cas où il faudrait évacuer des blessés, en évacuation secondaire, en dehors de la région parisienne – nous n’en avons pas eu besoin, tant mieux. En outre, le concours des associations de sécurité civile est planifié. Entre les attentats du mois de janvier et ceux du mois de novembre, nous avons en effet mis au point, avec la Croix-Rouge, l’Ordre de Malte et la Protection civile de Paris un accord aux termes duquel ces organisations nous envoient immédiatement, en cas de besoin, un officier de liaison au centre opérationnel. Vers 22 heures 15, j’ai eu un représentant de chacune de ces associations, ce qui nous a permis, par leur intermédiaire, d’envoyer des vecteurs d’évacuation sur les points où c’était nécessaire. Une autre mesure d’anticipation consiste à pouvoir s’appuyer sur les hôpitaux des armées Bégin et Percy.
À côté des décisions planifiées, il y a les décisions de conduite. Parmi ces dernières, nous sommes passés en une heure de sept à vingt et une ambulances de réanimation. Une ambulance de réanimation est un petit hôpital sur quatre roues, avec un médecin, un infirmier et un conducteur. La BSPP doit en avoir six en ligne tous les jours. Il se trouve que, le 13 novembre, nous en avions sept car, occasionnellement, nous pouvons avoir besoin de procéder à des évacuations sanitaires – c’est nous qui, par exemple, prenons en compte, à Villacoublay, les soldats rapatriés d’une mission extérieure. Le docteur Bignand, ici présent, m’a proposé de rappeler les médecins et d’armer des véhicules de secours et d’assistance aux victimes pour les transformer en ambulances de réanimation. Ainsi, au bout d’une heure, je disposais de vingt et un vecteurs médicalisés avec chacun un médecin, un infirmier et un conducteur.
Une deuxième décision a beaucoup joué en faveur de la réussite de cette opération : le baptême du terrain. Je vous l’ai dit, nous avons reçu un grand nombre d’adresses différentes et l’idée a été de donner un mot-clef pour chaque site afin que nous parlions tous le même langage. Vers 22 heures, 22 heures 10, j’appelle le centre opérationnel de zone, m’entretiens avec le chef d’état-major auquel je propose de donner un nom aux différents sites : « République », « Bataclan » etc. Voilà pour la BSPP et la préfecture de police ; je ne sais pas si cette idée a été reprise au-dessus.
Sur chaque site, j’ai demandé qu’on identifie un commandant des opérations de secours et qu’on s’assure de la présence d’un directeur des secours médicaux – ce qui a été fait.
Deux décisions nous ont par ailleurs permis de reprendre l’initiative concernant les appels : nous avons changé le message d’accueil du 18 et du 112, pour informer qu’en raison des événements graves qui se déroulaient dans la région parisienne, si l’appel n’était pas urgent, il était recommandé de le différer. Cette seule mesure a permis l’effondrement du nombre d’appels. Un peu plus tard, vers 23 heures, 23 heures 15, nous avons commencé à communiquer sur Twitter et sur Facebook et notre message, du même type, a été relayé 29 000 fois par tweet et 39 000 fois via Facebook – d’après les spécialistes, il s’agit de bons chiffres, attestant d’un taux de pénétration important.
Tout, bien sûr, ne s’est pas bien passé dans le meilleur des mondes : vous devez savoir, les familles des victimes doivent savoir, qu’il y a eu des forces de frottement concernant certes les victimes, mais aussi les secours.
La sécurité des sites a posé problème. Il est impératif de protéger les secours. Or nous ne savons pas, quand nous arrivons, si les terroristes sont toujours dans les parages. Mes hommes n’ont pas hésité une seule seconde à s’engager, mais ils l’ont fait parfois au péril de leur vie. La police a fait tout ce qu’elle pouvait mais, là encore, les premiers sites étant couverts, quand vous arrivez au troisième ou quatrième, cela devient difficile. Reste que tout s’est bien terminé puisqu’il n’y a pas eu de frappe supplémentaire – mais cela, on ne le sait qu’à la fin de l’histoire.
La deuxième difficulté est l’identification du commandant des opérations de police (COP), qui s’ajoute au COS et au DSM. Le COP est pour nous important car c’est lui qui met en place le plan « Rouge Alpha Circulation » (PRAC) qui permet de libérer des axes routiers pour faire arriver les secours et, surtout, pour libérer les axes d’évacuation des blessés. Il est donc nécessaire de pouvoir identifier immédiatement le policier responsable. La préfecture de police en a bien conscience et je puis vous garantir que des décisions ont été prises puisque, depuis le 13 novembre, au cours de plusieurs opérations, j’ai vu arriver le COP portant une chasuble jaune aisément identifiable.
Ensuite, les demandes extérieures de renseignements sont chronophages. J’ai reçu un tas de coups de téléphone de gens cherchant à savoir ce qui se passait ; or, quand on commande, on n’a pas le temps de répondre à tout le monde. Je suis poli, dès lors j’ai répondu à tout le monde ; mais cela est susceptible de vous démobiliser au moment où il faut prendre une décision.
Une dernière force de frottement est ce que j’appelle les fausses alertes par le haut. N’y voyez pas de ma part une critique des médias mais, souvent, ces derniers rapportent en direct des informations qui aboutissent à un « haut niveau », à la suite de quoi on nous appelle pour nous demander si nous sommes au courant, par exemple, d’une attaque à la gare du Nord. Nous vérifions : il n’y a pas d’attaque à la gare du Nord. Dix minutes plus tard : « Mon général, on nous dit qu’il y a cent morts à la gare du Nord. » Or je suis sûr que personne n’est mort à la gare du Nord, puisque nous avons envoyé des pompiers pour le vérifier. D’où l’intérêt de colocaliser le centre de traitement de l’alerte avec la salle de crise : nous demandons aux opérateurs d’interroger les personnes qui éventuellement appellent à ce sujet pour savoir où ils se trouvent exactement et s’ils voient ou non des blessés, s’ils voient ou non des gens armés. Au bout de cinq minutes, personne n’avait rien vu : tout n’était donc que rumeurs et ces rumeurs étaient arrivées par le haut. Lors de la prise d’otages de l’Hypercacher, j’étais alors commandant en second de la Brigade et présent au centre opérationnel : on m’a demandé cinq fois dans l’après-midi des secours pour des prises d’otages qui n’en étaient pas. Or nous ne pouvons pas faire partir les secours sur le fondement d’une rumeur.
Après avoir mentionné les forces de frottement, j’en viens à la coopération avec les autres acteurs que je qualifie d’excellente malgré les difficultés rencontrées.
D’abord avec le SAMU, avec lequel nous parlons régulièrement et que par conséquent nous connaissons. Il y a toujours des difficultés initiales d’appréhension mais je puis vous assurer que la coordination, ce soir-là, a fonctionné et pour une bonne et simple raison : nous avions réfléchi ensemble, nous nous étions exercés ensemble le matin même et la nuit, au Bataclan, le professeur Carli, le professeur Tourtier – mon directeur des secours médicaux – et moi-même avons tous les trois pris la décision d’évacuer les blessés qui sortaient et de les médicaliser à environ 500 mètres de là. Tous les accès au site étaient bouclés par la police et seule la rue Oberkampf était utilisable.
M. le président Georges Fenech. Vous avez pris cette décision tous les trois ?
Général Philippe Boutinaud. Tout à fait. Nous étions tous les trois devant le poste médical avancé. Nous avons donc décidé d’évacuer les blessés vers l’arrière car les faire partir vers l’avant eût été les faire passer dans l’axe de tir des terroristes.
Nous utilisons le système d’information numérique standardisé (SINUS), qui consiste en un code-barres imprimé sur un bracelet qu’on met autour du poignet des victimes pour les identifier et pour assurer leur suivi tout au long de la chaîne de prise en charge. Tous les services de l’État n’utilisent pas encore ce système mais une réflexion est actuellement conduite au ministère de l’intérieur pour sa généralisation au plan national. Si je puis assurer au préfet de police, à 4 heures 30, que j’ai 381 victimes, c’est parce que chacune a un bracelet SINUS. Ceux qui sont allés spontanément dans les hôpitaux sans passer par les mains des pompiers sont aussi des victimes, mais je n’ai pas à les comptabiliser. Les améliorations à apporter en la matière ne sont pas de mon ressort.
Ensuite, j’y ai fait allusion, nous avons renforcé la coordination avec les associations agréées de sécurité civile. Reste, et je le leur ai dit, à juguler l’enthousiasme : il faut envoyer ce qui est nécessaire là où c’est nécessaire, afin de garder de la réserve. Nous continuerons à organiser des exercices en ce sens.
Pour ce qui est de nos rapports avec la police, sur la liste de garde, tous les jours, des éléments de liaison sont identifiables et partent dès qu’on les sonne pour aller à la direction de la sécurité de proximité de l’agglomération parisienne (DSPAP), à la direction de l’ordre public et de la circulation (DOPC), au centre opérationnel de zone etc. Autrement dit, ces directions de la préfecture de police reçoivent un pompier qui est le correspondant du centre opérationnel – il est important pour la police de savoir ce que font les pompiers.
Je reviens sur le cas d’un journaliste du Monde qui s’est réfugié dans une cage d’escalier, puis dans un appartement au quatrième étage qui se situait précisément dans l’axe de tir de la sortie de secours du Bataclan. Nous l’avons eu sept fois au téléphone, et sept fois nous lui avons expliqué – et à la dame qui se trouvait avec lui – que nous ne pouvions pas l’atteindre parce qu’il se trouvait dans la zone d’exclusion. Nous n’avons pas tout dit à ce journaliste parce qu’il était blessé par balle, ce qui est certes douloureux, mais dès lors que quelqu’un tient deux heures avec un pansement compressif, nous considérons qu’il s’agit d’une urgence relative ; sa peine ni son angoisse ne s’en trouvent diminuées et cela ne minimise pas le respect que je lui dois. Mais, je le répète, il était dans la zone d’exclusion et il était très difficile d’aller le chercher. J’ai été mis personnellement au courant de la présence de ce journaliste à cet endroit car le préfet de police lui-même me l’a signalée – nous pensions d’ailleurs au départ, comme il y avait deux personnes, qu’il s’agissait de deux journalistes du Monde. J’ai essayé, personnellement, de m’engager dans le passage, mais les forces de l’ordre m’ont signifié que ce n’était pas possible. Je pense qu’il y a moins de vingt mètres entre la sortie de secours du Bataclan et le porche d’entrée de l’immeuble où se trouvait ce monsieur. Je reconnais que ce cas fait partie de ceux qui sont difficiles à traiter, mais il y en aura toujours de ce type. J’ignore si cet exemple est bien choisi, mais il ressemble à celui d’un soldat blessé entre deux tranchées en 1916 : vous savez qu’il est là, qu’il a de la peine, qu’il va mal, mais, pour autant – je reviens au cas du journaliste –, peut-on se permettre le luxe de risquer la vie de deux ou trois personnes pour essayer d’entrer dans le hall ? C’est compliqué. Et, de toute façon, la police est intransigeante sur le non-franchissement de la zone d’exclusion. On peut en discuter mais je pense que la décision prise ce soir-là était la bonne.
J’ai évoqué la difficulté de protéger les pompiers et que reconnaissent les policiers, et je ne leur en fais pas du tout grief ; mais nous avons eu la chance de disposer de plusieurs soldats du dispositif « Sentinelle », notamment sur le site de Charonne et sur celui du Bataclan, soldats qui se sont révélés assez utiles.
Qu’avons-nous fait depuis ? Nous avons procédé à la prise en charge médico-psychologique de tous les pompiers de Paris qui sont intervenus ce soir-là. Il y a les victimes, bien sûr, mais il y a aussi les hommes et les femmes que je commande et tous – moi y compris – sont passés entre les mains d’un psychologue ou d’un psychiatre et tous seront suivis sur le long terme. À ma connaissance, une telle prise en charge n’a jamais été organisée à cette échelle.
Par ailleurs, vous savez peut-être que nous avons manqué de brancards. Un véhicule de secours et d’assistance aux victimes est équipé d’un brancard car il est censé ne transporter qu’une seule personne. Or il convient avant tout de transporter les victimes à l’horizontale. Nous les avons donc mises sur ce que nous avions sous la main, c’est-à-dire des barrières de foule. À première vue, cela peut choquer et laisser croire qu’il n’y a pas assez de moyens. Non : il est difficile de concentrer autant de moyens nécessaires en un seul instant. Pour l’heure, ce qui comptait, j’y insiste, c’était que les blessés soient transportés à l’horizontale. Nous avons distribué des trousses de damage control dans lesquelles on trouve des garrots tourniquets, des pansements hémostatiques, trousses qui se trouvaient déjà dans toutes les ambulances de réanimation. Désormais, tous les engins de la BSPP en sont pourvus.
Nous avons par ailleurs procédé, au niveau national, au regroupement du centre d’appel de la police et de celui des pompiers en un lieu unique. Aussi, pour l’Euro 2016, une plateforme d’appel unique sera opérationnelle.
Il convient d’y ajouter, avec le soutien de la mairie de Paris, de Mme Hidalgo, la création d’un module de formation au secourisme pour les Parisiens. Dans ce genre de circonstances, en effet, l’appui des personnes qui se trouvent sur les lieux est fondamental, ne serait-ce que pour accomplir les premiers gestes qui sauvent. Ainsi, depuis la mi-janvier, dans douze casernes de la BSPP, les Franciliens sont invités à se présenter et à apprendre pendant deux heures comment on fait pour sauver quelqu’un entre le moment où l’on a appelé les secours et celui où ils arrivent.
J’ai invité personnellement, la semaine dernière, mes homologues de Londres, Madrid, Berlin et Bruxelles, avec lesquels nous avons commencé à réaliser un retour d’expérience.
Je vais m’arrêter là. Je dirai simplement, en mon âme et conscience, que j’estime qu’il était difficile de faire mieux. Il ne faudrait pas croire que les pompiers ne sont que des acteurs indifférents. Un sapeur-pompier de Paris était spectateur au Bataclan : il a été victime de deux arrêts cardiaques et a dû être amputé d’une jambe. Nous le maintiendrons dans nos rangs car nous sommes solidaires : nous relevons nos blessés et nous les gardons. J’ai personnellement écrit onze lettres de soutien ou de condoléances à des sapeurs-pompiers de Paris qui ont perdu quelqu’un au cours de ces tragiques événements. Cela pour vous dire que ce qui est arrivé à ces gens nous a touchés profondément. Le professeur Tourtier et moi-même étions dans le Bataclan : nous n’oublierons jamais tous les téléphones qui vibraient sur les victimes laissant apparaître des messages commençant par : « Papa, maman… ». Je conclus sur ce point pour vous dire que c’est la plus grosse opération que j’ai commandée de ma vie – et j’ai participé à de nombreuses opérations dans mon existence ; j’ai trente-trois ans à mon actif au sein de l’armée française ; je suis très fier des hommes et des femmes que je commande et je vous le redis très sincèrement, dans les yeux : il était difficile de faire mieux.
M. le président Georges Fenech. Je vous remercie, mon général. Nous comprenons parfaitement votre émotion et croyez bien que la représentation nationale salue le courage, la bravoure et le dévouement de tous les hommes que vous avez commandés ce soir-là. Vous avez toute la sympathie et la reconnaissance de notre commission.
Vous avez été long mais c’était utile. Je donne immédiatement la parole au professeur Carli qui dirige le SAMU. Pourriez-vous faire un exposé plus court dans la mesure où nous sommes ensemble jusqu’à 17 heures 45 seulement et où de nombreuses questions vous seront posées ?
Professeur Pierre Carli, directeur médical du SAMU de Paris, chef de service au département d’anesthésie-réanimation de l’hôpital universitaire Necker-Enfants-Malades, président du Conseil national de l’urgence hospitalière. Je ferai mon possible, monsieur le président, mais je pense que je traiterai de nombreuses questions. Mon exposé sera complémentaire de celui du général Boutinaud et, comme lui, je pense que, le vendredi 13 novembre 2015, s’est produit le plus grave attentat, en France, depuis la seconde guerre mondiale. Le bilan humain est horrible : 130 morts, 350 blessés. Il est évident que les victimes, leurs familles et de nombreuses personnes se posent des questions. Nous allons tâcher de leur expliquer notre action, de répondre à leurs attentes, et nous vous remercions de nous donner l’occasion de le faire dans un cadre solennel.
Notre mission de médecins est simple : nous sommes au service des victimes. Au quotidien, à Paris et dans la région Ile-de-France, on compte huit SAMU ; chacun d’eux a une régulation médicale, c’est la loi, et chacun déploie soixante équipes de réanimation médicale. Le SAMU de Paris, ou SAMU 75, reçoit environ 800 000 appels au 15, dispose de neuf équipes médicales et procède à quelque 13 000 interventions médicalisées par an. De garde, à savoir le soir, comme le vendredi 13 novembre dernier, nous avons six équipes de service mobile d’urgence et de réanimation (SMUR), deux équipes pédiatriques, deux médecins régulateurs et quatre assistants de régulation médicale qui répondent au téléphone. En cas de catastrophe, le SAMU de Paris est chargé de coordonner l’action des sept autres SAMU de l’Ile-de-France.
Comme l’a rappelé le général Boutinaud, le précédent attentat remonte à il y a vingt ans. Il y était et moi aussi. La bombe qui a explosé à la station RER de Port-Royal a fait ce soir-là soixante-dix victimes dont douze urgences graves. Sur place, nous étions plus de 300 et, en moins de deux heures, dix-sept hôpitaux recevaient l’ensemble des victimes. Il y avait pour une victime trois ou quatre personnels de santé et de secours.
En vingt ans, les choses ont bien changé avec l’apparition de l’hyper-terrorisme. Je tiens à rappeler trois points marquants que le général a mentionnés : à Madrid, en 2004, survient un attentat multisites à la bombe ; à Londres, en 2005, un attentat multisites également et là aussi dans les transports ; à Bombay, en 2008, un attentat multisites encore, utilisant tous les moyens possibles pour causer le maximum de victimes. L’analyse de ces attentats, de leur déroulement, les multiples contacts que nous avons eus avec nos collègues des autres pays nous ont conduits à élaborer de nombreux plans : le plan matriciel de prise en charge des attentats multi-sites dans les transports – c’est le plan de la préfecture de police qui prévoit deux instructions, celle des pompiers, le plan rouge alpha, et le plan zonal des SAMU, surnommé « plan camembert », appellation que le préfet de police de l’époque n’avait pas beaucoup appréciée…
Ce plan coordonne les huit SAMU, divise la région Ile-de-France en secteurs et nous permet donc d’éviter l’accumulation des moyens médicaux sur un seul site, d’avoir un engagement raisonné et de sectoriser nos forces - pour les équipes SMUR, la petite couronne vient immédiatement renforcer Paris et la grande couronne renforce, pour sa part, la petite couronne -, mais aussi de sectoriser les hôpitaux. Cela est très important pour comprendre comment nous avons organisé l’évacuation vers l’hôpital. Dans chaque secteur, des hôpitaux sont en effet présélectionnés, ce qui évite, au cours d’un événement évolutif comme un attentat, que n’apparaissent des zones blanches, c’est-à-dire sans secours médicaux ou sans hôpitaux disponibles.
M. le président Georges Fenech. Par qui sont présélectionnés ces hôpitaux ?
Professeur Pierre Carli. Par nous-mêmes, mais, si vous le permettez, monsieur le président, je développerai ce point plus tard.
La simplification des procédures de régulation nous permet d’aller beaucoup plus vite qu’au quotidien où nous pouvons traiter les sujets dans le détail, et nous gardons des moyens en réserve pour pouvoir faire face au potentiel évolutif. Face à une attaque organisée, à un véritable acte de guerre, il ne faut pas seulement opposer des moyens, il faut aussi avoir une stratégie pour contrecarrer l’objectif de l’ennemi, qui est de faire le maximum de victimes, mais aussi de désorganiser notre prise en charge. Sur ce point, la coopération internationale s’est révélée importante pour nous.
Au début des années 2010, le général l’a souligné, la nature des attentats change : l’attentat à la bombe est remplacé par des attentats beaucoup plus meurtriers, utilisant notamment des fusils d’assaut. À Utøya, en Norvège, 69 personnes sont assassinées par un tireur : c’est l’une des premières tueries de masse. Les armes à feu seront utilisées à Toulouse en 2012, puis à Bruxelles et ailleurs. Dès cette époque, nous avons mis en place deux axes de travail importants : d’abord en ce qui concerne le soin aux blessés par des armes de guerre, notamment des fusils d’assaut, ensuite, pour ce qui est de l’adaptation de notre stratégie quotidienne à la prise en charge de ces sites multiples, en dehors des transports.
Dans ce cadre, nous avons de nombreux contacts avec le professeur Tourtier. Or comme l’a rappelé le général Boutinaud, les sapeurs-pompiers sont des militaires et, ayant été sur le terrain, ils connaissent les armes de guerre. Nous allons donc travailler avec eux pour convertir leurs techniques sur des théâtres d’opérations militaires en des prises en charge de victimes civiles non protégées par des équipes médicales civiles, les SAMU et les SMUR. Nous élaborons et publions des protocoles, les soumettons à nos collègues. Nous avons ainsi réalisé deux exercices de simulation, notamment de fusillades, en 2013 et en 2014. Nous avons pris ces initiatives en tant que chefs de service et elles ont été bien entendu approuvées et confortées par nos tutelles : la direction générale de l’assistance publique, l’agence régionale de santé (ARS) et les ministères concernés.
Au mois de janvier 2015, l’attentat contre la rédaction de Charlie Hebdo va malheureusement confirmer la justesse de notre anticipation : de nombreuses personnes sont tuées très rapidement avec un AK47. On compte en outre des blessés graves et on constate l’implication de nombreux individus. Nous en tirons deux enseignements. D’abord, nous comprenons alors que le danger est important : un policier qui se trouve sur le chemin des terroristes est assassiné ; or nous savons très bien que nos ambulances sont à proximité immédiate et que nous pouvons donc nous retrouver à tout moment face à des gens qui nous exécuteront parce que nous portons un uniforme. Le second enseignement concerne l’urgence médico-psychologique qui, si elle est importante en cas de catastrophe, se révèle essentielle dans celui d’un attentat. Or, à l’occasion de l’attentat de Charlie Hebdo, cette demande explose. Nous prenons donc, sur le terrain, des décisions opérationnelles. Ainsi, avec le prédécesseur du général Boutinaud et avec le professeur Tourtier, dans la rue, devant les locaux de Charlie Hebdo, nous décidons que les victimes médico-psychologiques doivent être amenées à l’Hôtel-Dieu dans une structure « dure », en sécurité, où elles pourront être prises en charge dans l’environnement le plus rassurant possible.
La prise d’otages à Dammartin-en-Goële et celle de l’Hypercacher constituent une nouvelle expérience. En effet, nous sommes là au contact de la police et de ses unités spéciales. Contrairement au contexte d’une fusillade, nous disposons de temps pour nous organiser : une négociation est engagée. Nous pouvons prévoir des voies d’évacuation très rapides, demander à la police de les sécuriser. Il s’agit donc d’un dispositif très différent où, clairement, les forces de police nous disent : « Vous, médecins civils du SAMU et du SMUR, vous ne devez pas pénétrer dans la zone dangereuse car vous n’êtes ni préparés ni entraînés pour cela ; vous êtes tout proches de nous et nous établissons un rapport entre nous pour prendre en charge les victimes. »
De janvier à novembre, nous n’allons pas perdre notre temps : nous acquérons du matériel, des garrots, des médicaments ; nous réalisons des formations pratiques, des exercices de fusillade, encore une fois – et cette fois-ci nous décidons de l’effectuer dans un TGV, dans la nuit du 17 au 18 juin, à la gare Montparnasse et, vous le savez, ce scénario d’attentat sera le même que l’attentat manqué du mois d’août – ; nous discutons des plans, occasion pour moi de rencontrer pour la première fois le général Boutinaud dont le premier mot, lorsqu’il me voit, est : « Bombay ». La direction générale de l’ARS change et, exactement de la même manière, nous travaillons sur l’attentat multisites qui paraît se rapprocher.
Le 13 novembre, à 9 heures, alors que nous avons déjà réalisé, pendant l’année, de nombreux exercices, nous menons celui de régulation zonale, préparé avec la BSPP, les huit SAMU et les hôpitaux qui doivent recevoir en première intention les blessés graves. Cet exercice dure trois heures et implique l’utilisation de téléphones, de tableaux, de cartes. Il porte sur treize sites et l’hypothèse retenue est de 66 morts et une centaine de blessés. De nombreux participants jugent qu’il s’agit d’un scénario exagéré et que ce n’est pas celui qui se produira. La suite, vous la connaissez. Nous avions prévu, la même semaine, d’autres formations dont une s’appelait « Sécurité lorsqu’on est sur les sites de fusillade », exercice que nous n’avions pas pu mener à bien et qui nous aurait été très utile le vendredi 13, mais que nous avons, depuis, bien sûr, réalisé.
Ce vendredi 13, un élément nous a beaucoup frappés. Entre le SAMU et les pompiers de Paris, depuis plusieurs années, il n’y a ni concurrence ni conflit : nous sommes complémentaires au quotidien ; nous avons créé une feuille de route ; une convention, signée par les ministères compétents, a été approuvée par nos tutelles ; nos exercices et nos formations sont communs ; nous échangeons nos médecins. Or, ce soir-là, l’action des médecins sur le terrain est partagée par la BSPP et par les médecins des SAMU. Ont été évoquées des insuffisances de communication. Eh bien, la deuxième personne qui appelle le professeur Tourtier, c’est moi. Toute la soirée, nous allons être côte à côte sur deux sites : rue Bichat et au Bataclan, avec nos moyens de communication respectifs qui nous permettent de rendre compte à nos équipes. Nous nous répartissons les rôles : au départ de la rue Bichat, Jean-Pierre Tourtier me dit : « Je vais au Bataclan, tu prends Charonne. » Et je vais rue de Charonne. Il me dit : « Renforçons les équipes ! » Je double la mienne avec un médecin et un infirmier des sapeurs-pompiers qui montent dans les véhicules du SAMU. Nous travaillons donc ensemble. Nous nous retrouvons tous les trois, dans la soirée, comme vous l’a indiqué le général, dans la rue, à côté du Bataclan, rue Oberkampf, pour prendre des décisions.
Ce qui nous inquiétait, dans l’hypothèse d’un attentat multi-sites, monsieur le président, c’était l’alerte, en tout cas au SAMU. À Londres, nos collègues, pendant très longtemps, n’ont pas su ce qui se passait, ce qui les a considérablement gênés dans leur action. Là, heureusement, l’alerte a été rapide. La situation au Stade de France devient rapidement évidente, les SAMU vont échanger très vite des informations. Nous pouvons donc commencer le recensement des lits disponibles, à rappeler les personnels, ouvrir la salle zonale – qui n’avait pas été débarrassée de l’exercice du matin : il a suffit d’effacer les tableaux et de recommencer. La stratégie que nous mettons en place – la « stratégie du camembert » – consiste immédiatement à prendre une décision importante et que j’assume : je dis à Jean-Pierre Tourtier, au téléphone, qu’aucune équipe du SAMU de Paris ne se rendra au Stade de France – qui est pourtant très près. Nous devons défendre le territoire et, en conséquence, nos équipes vont avoir à se déployer dans la capitale – elles partent d’ailleurs immédiatement – car nous savons qu’il s’agit d’un attentat multi-sites.
Paris est divisé en trois grands secteurs – les portions du camembert. Celui du Nord est pris en charge par le SAMU 93, représenté ici par le professeur Adnet ; à nous de lui trouver des moyens pour le renforcer ; des hôpitaux sont affectés à ce secteur : l’hôpital Avicenne, l’hôpital Beaujon, l’hôpital Bichat, l’hôpital Lariboisière et l’hôpital européen Georges-Pompidou (HEGP) ; des renforts de la petite couronne – avec le SAMU 92 – et de la grande couronne – avec le SAMU 95 – vont venir l’appuyer. Le secteur Est se situe pour l’essentiel dans Paris et sera donc surtout pris en charge par le SAMU 75, immédiatement renforcé par le SAMU 94, représenté ici par Mme Chollet-Xémard, qui est celui de la petite couronne le plus proche ; quant aux hôpitaux affectés à ce secteur, il s’agit, comme prévu, de la Pitié-Salpêtrière, de l’hôpital Henri-Mondor, de l’hôpital Saint-Antoine et de l’hôpital Bégin. En ce qui concerne le secteur Ouest, il n’y a pas d’attentat pour l’instant. Le SAMU 92 vient donc rapidement renforcer les SAMU 93 et 75 et le SAMU 78, représenté par le docteur Lambert, se rapproche du SAMU 92 pour savoir à quel moment il va être déployé dans la capitale, ce qui adviendra un tout petit peu plus tard sur le site du Bataclan.
Je vous l’ai dit : il n’y a pas de problème de communication entre nous, mais les outils de communication sont soumis à une très forte tension. Le général Boutinaud vous a donné ses chiffres. Le standard téléphonique du SAMU, quant à lui, subit une augmentation des appels de 420 % dans la demi-heure qui suit les attentats. Entre 22 heures et 23 heures, nous aurons jusqu’à 200 % d’augmentation en permanence. L’un des critères de qualité du centre 15 est le fait de décrocher dans les soixante secondes. Pendant un certain temps, ce critère va s’effondrer à 20 %, ce qui ne signifie pas que nous ne répondons pas mais que, au bout de vingt minutes, 20 % des appels sont décrochés dans les soixante secondes. Dans l’heure qui vient, nous parvenons à faire remonter ce taux à 50 % grâce aux personnels rappelés et qui prennent immédiatement le téléphone et qui ouvrent des lignes sans même prendre le temps de poser leurs affaires. Les lignes de la salle de crise sont libres, le système de radio ANTARES – Adaptation nationale des transmissions aux risques et aux secours- pose quelques problèmes pendant la soirée, mais sans que nous en soyons surpris – vous connaissez sans doute par cœur le rapport du sénateur Vogel ; et vous savez aussi que, pragmatiquement, nous allons utiliser nos téléphones portables de service parce que la couverture est très bonne, les relais fonctionnent très bien, et parce que ces téléphones nous permettent d’avoir des contacts personnalisés – nous « sautons » ainsi par-dessus les standards qui sont réservés à l’accueil du public.
À propos de l’organisation du commandement, ce que vous a indiqué le général Boutinaud est parfaitement vrai : il n’y a pas de discussion en la matière. Il y a un commandant des opérations de secours, un directeur des secours médicaux qui, à l’intérieur de Paris, est toujours un pompier et, à ses côtés, un médecin régulateur du SAMU. Ce dernier est un médecin senior qui connaît les procédures de régulation, connaît les hôpitaux et est chargé d’organiser les groupes de patients qui vont être évacués.
Comment les hôpitaux sont-ils choisis, m’avez-vous demandé, monsieur le président ? Cette question a fait couler beaucoup d’encre. Ils sont déterminés en fonction de la géographie. La régulation médicale est déportée sur le site – la régulation médicale, c’est ce que nous faisons tous les soirs pour tous les patients graves – ; elle reçoit des informations opérationnelles du SAMU qui indique quels sont les hôpitaux disponibles et s’ils n’ont pas trop reçu de victimes. Ainsi, nous n’enverrons pas de blessés thoraciques à l’hôpital Saint-Antoine, pourtant à proximité des sites, puisqu’il est spécialisé dans l’orthopédie et la chirurgie digestive, spécialités pour lesquelles, en revanche, nous utiliserons cet établissement. L’hôpital Saint-Louis, lui, mitoyen du site Bichat, reçoit des arrivées spontanées de blessés et des brancardages de proximité sont organisés ; aussi la régulation médicale nous demande-t-elle de ne pas y envoyer de patients graves puisqu’il en a reçus de manière inopinée.
Ce concept de régulation n’est pas rigide, mais dynamique. La chirurgie cardio-thoracique, la neurochirurgie font appel à des centres limités dans Paris. Nous ne sommes donc pas « coincés » dans le « camembert », si j’ose dire, mais nous l’utilisons au maximum. Cette organisation pré-hospitalière est un critère de qualité qu’il vous faut connaître : après cette régulation, il n’y a pas eu de transferts inter-hospitaliers – les patients ont été soignés dans les hôpitaux où ils sont arrivés. Si tout se passe bien à l’arrivée à l’hôpital, et ce fut le cas ici, c’est parce que l’hôpital dispose du temps et des informations nécessaires pour s’organiser et parce qu’il reçoit les bons patients et dans un nombre adapté. Un transport très rapide, évoqué par certains, consistant à se rendre dans l’hôpital le plus proche sans soins ni régulation, ce qu’est, d’une certaine manière, le scoop and run des Américains, si tant est du reste qu’une telle stratégie soit applicable en cas d’attentats multisites – je vous montrerai tout à l’heure qu’elle ne l’a jamais été –, aurait provoqué un afflux massif de blessés vers certains hôpitaux, avec un accueil chaotique et une baisse immédiate de la qualité et de la sécurité des soins. Le scoop and run ne fait que déplacer un problème de la rue à l’entrée de l’hôpital. La régulation médicale, le plan « camembert » que nous avons mis en place, a au contraire permis une répartition homogène des victimes, et en ce sens nous avons fait mieux que Madrid et Londres, sans compter le fait que nous n’avons pas dispersé dans toute la région nos ressources médicales.
Pour les hôpitaux qui reçoivent les victimes, ce soir-là, il n’y a pas d’afflux saturant mais un flux continu parce qu’ils reçoivent des groupes de patients, ce qui permet d’adapter le travail. La Pitié-Salpêtrière, hôpital qui n’a reçu que cinquante blessés, soit 15 % du total, alors qu’il s’agit du site le plus important, reprend son activité, comme vous l’a indiqué Martin Hirsch, dès 6 heures le lendemain matin, en effectuant des greffes qui étaient en attente de quelques heures.
La régulation médicale présente de nombreux avantages par rapport aux expériences hospitalières étrangères n’intégrant pas ce dispositif. À Madrid, seuls deux hôpitaux de proximité ont reçu 50 % des victimes – les hôpitaux militaires n’ont pas été utilisés alors que nous les avons pour notre part employés. À Londres, cinq hôpitaux étaient proches des sites : le Royal London Hospital a reçu à lui seul un tiers des blessés, soit plus de 200 et, en l’absence de régulation, un hôpital pédiatrique, à proximité, a reçu lui vingt blessés adultes alors qu’il ne s’agissait pas du tout de son type de patients habituels.
La faible mortalité hospitalière de la soirée du 13 novembre – 1,4 % – s’explique en particulier par la qualité des soins, l’absence de saturation et l’organisation pré-hospitalière et hospitalière.
La médicalisation pré-hospitalière, qui a été discutée, est très importante. Le taux de médicalisation, le nombre d’équipes médicales sur le terrain a été supérieur à ce qu’il fut lors des attentats de Londres et même de Madrid. L’arrivée des équipes médicalisées au contact des victimes a été plus rapide à Paris qu’à Londres : deux sites sur quatre, dans la capitale britannique, n’ont eu un médecin qu’une heure ou une heure et quart après le déclenchement des opérations. Or tous les rapports de tous les collègues confrontés, à Paris, à cette situation affirment que la médicalisation permet le triage médicalisé, de détecter le patient dont le cas s’aggrave, d’appliquer la technique du damage control aux blessés, de gérer le temps, de favoriser la prise en charge. Nous avons essayé d’employer le maximum de médecins sur le terrain. Ainsi, ici, certains véhicules partent du SAMU en renfort avec deux équipes médicales pour le site de Charonne ; là, deux infirmiers partent avec du matériel supplémentaire. Nous agissons comme la BSPP : avec des véhicules, nous créons des ambulances de réanimation complémentaires. Le résultat médical ainsi obtenu est supérieur à celui observé dans d’autres circonstances d’attentats. Voilà qui montre en tout cas que le scoop and run n’est probablement pas la panacée.
L’analyse scientifique précise de ce que je suis en train de vous dire est en cours : les données de chaque victime, tous les temps d’attente, les scores de gravité des lésions, les examens, sont intégrés dans une banque de données. Ce travail prendra beaucoup de temps – plusieurs mois – mais sera mené à terme et nous obtiendrons ainsi un résultat par patient et qui montrera l’importance de la médicalisation.
Cela vous paraît sophistiqué mais, dans le plan « Rouge Alpha », avec le général Boutinaud et ses prédécesseurs, nous avons prévu des verrous de sécurité. L’un d’eux est intéressant. Dans le plan « Rouge Alpha », pour quelque raison que ce soit, s’il n’y a pas assez vite de médecins sur place, le COS, officier des sapeurs-pompiers, peut décider une évacuation de proximité sans attente.
J’en viens à la sécurité des sites, évoquée par le général. Vous avez vu les vidéos et pu constater que sur tous les sites de fusillade, notamment au Bataclan, il y avait un vrai danger pour nous. Une voiture est entrée dans le périmètre où nous avions installé le poste médical avancé ; nos premières équipes se sont réfugiées sous un porche. Les policiers ont été extraordinaires avec nous : tous ont essayé de nous protéger pour nous permettre d’assurer le maximum de soins aux victimes. Il en est allé exactement de même avec les militaires du dispositif « Sentinelle ».
La sécurité des évacuations est un sujet différent. Il est en effet beaucoup plus difficile, dans ce quartier, de sécuriser nos évacuations. Il y a de nombreuses petites rues, bloquées, au bout desquelles nous ne savons pas ce qui se passe – un autre attentat est toujours possible. Des sites proches, des véhicules dans tous les sens forment un problème très complexe à résoudre pour la police, à laquelle il est difficile de nous dire que nous pouvons partir avec une escorte. Ceci a provoqué ce qui a pu être considéré par certains comme des temps d’évacuation longs. Or ils n’ont pas été si longs que cela : le fait que des victimes arrivent à l’hôpital en deux heures dans le cas d’une urgence relative – leur vie n’étant pas en danger – et alors que l’attaque s’est produite aux endroits et dans les circonstances évoqués, a été constaté à l’occasion de tous les autres attentats. Certes, les variations individuelles sont très importantes, et si des victimes atteignent l’hôpital en quelques minutes, le dernier arrivé y parviendra bien sûr beaucoup plus tard.
À Londres, par exemple, alors que nous sommes en milieu urbain, il faudra plus de deux heures à certains patients pour arriver à l’hôpital. À Madrid, la majorité des patients vont arriver à un hôpital aussi important que La Pitié-Salpêtrière et qui se trouve à proximité, entre deux ou trois heures après l’attentat. Le plus terrible est l’exemple d’Utøya : la fusillade a eu lieu à un endroit où existe un risque pour les secours dès leur arrivée. Des victimes s'enfuient et seront vite évacuées quand d’autres sont coincées sur place et seront évacuées jusqu’à cinq heures après l’attaque. C’est pour cette raison que nous ne mettons pas toute notre énergie dans le scoop and run des Anglo-Saxons, car ce dispositif joue la seule carte de la rapidité sans prise en charge médicale. C’est prendre le pari de pouvoir évacuer rapidement les victimes ; or, dans le cadre d’un attentat multisites, la faisabilité d’une évacuation immédiate n’est jamais certaine. Notre organisation – SAMU, BSPP – a l’avantage de s’adapter à la réalité du terrain, c’est-à-dire d’utiliser le meilleur compromis entre l’évacuation rapide et la médicalisation.
À Paris, ce soir-là, le temps d’évacuation n’était pas dû à un problème de régulation médicale ni à un problème de moyens, de soins médicaux ou de communication. Il fallait constituer les groupes de patients pour pouvoir organiser ces petits convois vers les hôpitaux, les faire protéger par la police et pouvoir partir avec l’escorte. La médicalisation nous a permis de « prioriser » l’évacuation des patients les plus graves, de les placer en tête et de les faire partir au plus vite. Le problème de l’accessibilité des victimes, dont on a beaucoup discuté, n’a en fait joué que pour le Bataclan puisque, vous le savez, l’extraction de victimes en grand nombre est très difficile lorsqu’une opération de police est en cours et cette situation, inédite, n’était pas similaire à celle de l’Hypercacher. Aussi la réflexion que nous menons sur ces points avec la police connaît-elle une évolution très importante afin que nous puissions aller encore plus loin.
Je me permets d’y insister : a posteriori, les temps d’évacuation sont comparables à ceux constatés pour les autres attentats, voire plus courts. La mortalité hospitalière des victimes a été faible – 1,4 %, je le répète –, et même l’une des plus faibles. Nous avons exploité au mieux les avantages du système mis en œuvre.
Je dirai un mot sur notre salle de régulation dont nous sommes très satisfaits : nous avons pu en disposer au mois de décembre 2014, quelques jours avant l’attentat contre la rédaction de Charlie Hebdo. Auparavant, nous n’en avions pas. Les moyens en sont rustiques : nous utilisons des tableaux, des cartes sur lesquelles nous n’hésitons pas à dessiner. Nous avons eu de nombreux contacts avec des collègues étrangers : ils procèdent exactement de la même manière que nous. En effet, l’informatique, c’est très beau, mais c’est long à mettre en œuvre et il faut un personnel nombreux pour entrer les données. La régulation que nous avons appliquée a coordonné les autres régulations, a fourni des informations à ceux qui se trouvaient sur le terrain. Son rôle, vis-à-vis du médecin régulateur, est simple : celui-ci reçoit les informations, demande des renforts et les équipes du SMUR, une fois déployées, peuvent être « réinjectées » dans la régulation. En moyenne, toutes les équipes ont travaillé deux fois sur deux sites différents. Ainsi, le SAMU 93, depuis le Stade de France, a été redéployé vers Paris. Là encore nous avons prévu un verrou de sécurité : si, dans ce plan de régulation, les communications sont interrompues, chaque médecin régulateur, sur chaque site, qu’il soit du SAMU ou de la BSPP, continue à travailler, à faire évacuer les victimes, sans partir de la zone qui lui a été impartie.
Je tiens à présent, tout en ayant conscience que le temps passe, à communiquer à la commission quelques points qui me semblent importants.
Le fait que nous ayons gardé des ressources pré-hospitalières et hospitalières en réserve a résulté d’un choix stratégique et c’est même un critère de qualité : la situation était évolutive et, au début, nous ne savions pas quels seraient la nature, les lieux, l’ampleur de la poursuite de l’attaque. Nous n’avions qu’une idée en tête : le but des terroristes est de nuire et donc de nous désorganiser. L’attentat multi-sites n’est pas une catastrophe naturelle ou technologique : c’est un acte de guerre. Or il faut opposer à un acte de guerre une stratégie à même de contrecarrer les plans de ceux qui nous attaquent.
Deuxième point : cette nuit a été longue et nous aurions pu tenir trente heures – c’était l’objectif –, durée des combats à Bombay. Nous avions soixante équipes et en avons utilisé quarante-cinq ; quinze ont servi en renfort. Au Bataclan, le potentiel d’aggravation était majeur. Nous avons pris un certain nombre de décisions dont le maintien de l’activité quotidienne – le service à la population a été maintenu. Enfin, la réserve, pour les moyens pré-hospitaliers, a permis de relever les équipes en fin de nuit car je puis vous dire qu’à quatre heures du matin, nous étions vraiment sur les genoux. Pour l’hôpital, c’est plus terrible encore : quand il reçoit des victimes, même en petit nombre, il va brûler ses ressources, toutes ses équipes étant mobilisées, et si nous « consommons » ainsi tous les hôpitaux, il n’y a plus rien. Tous les hôpitaux ont été alertés et ont communiqué leurs disponibilités prévisionnelles, immédiates aux régulations de SAMU. Mais une partie seulement de ces hôpitaux ont reçu effectivement des victimes : 60 % pour l’assistance publique, 30 % pour la région. Le secteur Ouest a constitué la majeure réserve pour les hôpitaux. C’est dur pour ces équipes parce qu’elles sont mobilisées comme les autres, parce que leurs équipes SMUR sont déjà parties sur le terrain mais, dans ce secteur, nous avons des centres hospitaliers de grande qualité et très motivés. Reste que le dispositif n’est pas fait pour les médecins mais pour les victimes. Or, pour les victimes, il était important, j’y insiste, de garder des moyens en réserve et de proposer des soins de bonne qualité, ce qui a été fait.
130 morts et 350 blessés, c’est un bilan horrible. J’ai trente-cinq ans de SAMU, comme le général Boutinaud a trente-trois ans à son actif dans l’armée, et moi non plus je n’avais jamais été confronté à cette violence extrême. Violence extrême à laquelle ont été confrontés de jeunes médecins qui ont pris en charge, dans la rue, des victimes qui avaient leur âge. Les plus anciens avaient l’âge de nos enfants. Les enfants de plusieurs médecins – que vous avez reçus – ont été tués ce soir-là. Une femme médecin du centre d’appel du SAMU, à Paris, se trouvait malheureusement parmi les victimes : le docteur Verry était au mauvais endroit au mauvais moment…
Face à un drame comme celui-là, donner entière satisfaction est impossible.
Mais, et ce sera ma conclusion, je tiens à insister sur le fait que nous nous étions préparés, que nous avons essayé d’anticiper, que nous avons une stratégie que nous avons répétée. Or il y a toujours un fossé entre la stratégie, l’anticipation et ce qui se réalise. Reste que ce qui n’était qu’une hypothèse, avant le vendredi 13, est devenu la base de travail sur laquelle nous construisons la suite qui peut être beaucoup plus grave, beaucoup plus compliquée. Je tiens à dire aux victimes et à leurs familles que, vraiment, les personnels de santé se sont mobilisés : 70 % de ceux du SAMU. Et nos équipes n’ont pas hésité à s’engager physiquement alors que le contexte était dangereux. Nous avons fait du mieux que nous pouvions avec les moyens dont nous disposions. Notre but était que les blessés soient pris en charge de la meilleure façon possible. Nous, médecins civils, notre façon de lutter contre le terrorisme était d’être là ce soir-là et de faire le maximum.
M. le président Georges Fenech. Au nom de la commission, je vous adresse – et, à travers vous, à l’ensemble des personnels du SAMU – les mêmes hommages que ceux que j’ai adressés à la BSPP. Je vous remercie pour votre exposé, si complet qu’il nous laisse peu de temps pour la discussion, mais il était important que vous apportiez toutes ces précisions.
M. Sébastien Pietrasanta, rapporteur. À mon tour je salue le travail exemplaire de la BSPP et du SAMU.
Je reviendrai sur votre intervention au Bataclan. À quel moment commencez-vous à prendre en charge les blessés ? À quel moment pénétrez-vous à l’intérieur du Bataclan et qui vous en donne l’ordre ? Est-ce après l’assaut final ? Enfin, comment avez-vous coordonné votre action avec celle du médecin de la colonne de la brigade de recherche et d’intervention (BRI) qui a joué un rôle important, qui était à l’intérieur du Bataclan et, a priori, en lien avec vous ? Pouvons-nous avoir des précisions d’ordre chronologique ?
Général Philippe Boutinaud. L’action commence au Bataclan aux alentours de 22 heures. De mémoire, le premier appel a été reçu par les pompiers de Paris à 21 heures 49. Nous avons dès lors envoyé une première équipe et qui, arrivée sur place, a été prise immédiatement sous le feu des terroristes, tirant depuis l’intérieur du Bataclan. L’engin des pompiers a été atteint par plusieurs balles. Pendant tout le temps qui a précédé, vers 0 heure 20, l’assaut final mené par la BRI avec l’appui du RAID – Recherche, assistance, intervention, dissuasion –, nous avons reçu des victimes qui parvenaient à sortir d’eux-mêmes pendant le moment où les terroristes changeaient le chargeur de leur kalachnikov – ces victimes-là étaient valides bien que blessées, parfois d’une balle dans le bras, la jambe ou ailleurs. Nous les avons donc prises en charge au fur et à mesure qu’elles sortaient par groupes. Il a fallu également prendre en compte les blessés qui se trouvaient sur le trottoir – car on évoque toujours l’intérieur du Bataclan, mais les terroristes ont commencé à tirer sur ceux qui étaient à l’extérieur en train de fumer leur cigarette. Toutes les personnes que nous avons pu récupérer, nous les avons emmenées sur le côté, dans la rue Oberkampf où nous avons ouvert successivement trois postes médicaux avancés.
Il faut bien comprendre que, lorsque les policiers sont arrivés, ils sont parvenus à pénétrer au rez-de-chaussée après qu’un des leurs – je l’ai appris plus tard – a abattu un terroriste. Ensuite, et le commissaire qui commande la BRI a dû vous l’expliquer dans le détail, la montée dans les étages est ce qui a pris du temps : de très nombreuses personnes sortaient, il fallait les fouiller, s’assurer qu’elles ne portaient pas de gilet d’explosifs. Donc, tout au long de la soirée, nous avons pris en compte des victimes et, évidemment, dès que l’assaut final a été donné, il a fallu aller chercher celles qui ne parvenaient pas à se déplacer, et nous sommes entrés quand la BRI a donné le feu vert. Juste à côté des forces d’intervention, j’étais en contact continuel avec elles.
Le professeur qui était dans la colonne, que je connais très bien – je travaille avec lui au quotidien –, venait me voir directement au coin de la rue pour me parler et pour, notamment, me demander des brancards supplémentaires. Nous avons continuellement coordonné notre action tous les deux et c’est de visu que nous avons établi la procédure d’évacuation des victimes.
Une fois que la BRI nous a donné le feu vert pour entrer dans la salle du Bataclan, notre première action a consisté à vérifier que, sous les corps, il ne restait pas des personnes blessées, encore vivantes.
M. Philippe Goujon. En tant qu’élu parisien, ma reconnaissance va à l’action des hommes de la BSPP et du SAMU.
Les missions de la BSPP vont croissant, auxquelles il faudra éventuellement ajouter celles liées à la survenance d’autres attentats multisites – qui sait, plus difficiles encore à traiter que celui-ci –, à la construction prochaine du Grand Paris Express, au risque d’une crue centennale et donc à l’application des plans de prévention des risques d’inondation (PPRI), à la tenue, au mois de juin prochain, de l’Euro 2016, à l’organisation possible de prochains Jeux olympiques, d’une prochaine Exposition universelle…
Or on constate que le budget spécial de la préfecture de police dédié aux sapeurs-pompiers de Paris est en baisse. Et si nous avons pu le stabiliser pour cette année, il n’en reste pas moins en forte diminution par rapport à 2014, si bien que vous perdez des effectifs – perte que j’évalue à 250 personnes, ce qui est loin d’être négligeable – et si bien que vous devez fermer plusieurs sites, abandonner un certain nombre de véhicules, non seulement des grandes échelles, mais certainement d’autres aussi. Du coup, les investissements sont en baisse… Bref, on note une distorsion entre l’augmentation des besoins de la Brigade – et Dieu sait si vous avez dû intervenir massivement lors de cet attentat – et la baisse des moyens, même si cette dernière, j’y insiste, aurait pu être plus grave encore – la mise en œuvre du plan de modernisation a été quasiment interrompue.
Vous avez évoqué le PRAC et la rapidité avec laquelle vous arrivez sur les lieux ; mais, là aussi, la politique d’urbanisme de la Ville de Paris, je le dis de façon objective, consiste à restreindre de plus en plus la circulation : les projets d’aménagement d’une demi-douzaine de places parisiennes prévoient une quasi-suppression de la circulation ; la voie express de la rive droite va être définitivement fermée à partir du mois de juillet – je m’exprime en présence du député de la circonscription concernée, Pierre Lellouche, qui a d’ailleurs récemment posé une question au Gouvernement sur le sujet. Un certain nombre d’unités de police nous ont fait part de leur difficulté, déjà dans les circonstances actuelles, à se rendre sur les lieux où ont été commis des attentats. Qu’en est-il dès lors de la capacité d’intervention de la BSPP, de sa capacité, en particulier, à parvenir aussi rapidement sur les lieux que cela a été le cas au Bataclan ?
J’ai ensuite une question à poser au professeur Carli : les blessés ont certes été traités mais, nous a indiqué le directeur général de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris (APHP), la durée moyenne d’attente aux urgences, à Paris, est de quatre heures – durée qui va bien souvent jusqu’à sept à huit heures dans certains hôpitaux parmi ceux que vous avez cités et que je connais bien. Aussi, que se passe-t-il pour les patients qui se trouvent déjà aux urgences et qui attendent, donc, de quatre à huit heures, et pas forcément pour de simples entorses, alors que les hôpitaux où ils se trouvent accueillent des centaines de personnes blessées par les attentats ? Pourquoi n’a-t-on pas transféré également ces blessés vers les hôpitaux privés, que vous n’avez pas mentionnés ?
Général Philippe Boutinaud. La partie budgétaire relève directement de ma responsabilité. Je confirme que la discussion budgétaire a été quelque peu compliquée. Pour l’année 2016, j’ai fait valoir des arguments auprès du préfet de police qui, intimement convaincu qu’il fallait préserver les moyens opérationnels de la BSPP, les a relayés auprès de la municipalité de Paris puis au Conseil de Paris. Fort heureusement, le budget de la BSPP pour 2016 lui permet de remplir sa mission. Les éventuels problèmes budgétaires ont-ils eu un impact sur ce qui s’est passé le 13 novembre ? Très franchement, non. Toute la rationalisation de la BSPP à laquelle il a été procédé touche le soutien logistique mais n’a absolument pas affecté la partie opérationnelle.
En outre, nous avons en effet fermé des sites au cours des deux années précédentes mais, grâce au budget que j’ai pu obtenir pour 2016, il n’y en aura pas d’autres. Et si le budget avait diminué, les sites concernés par une fermeture auraient été des centres de secours. Aussi la couverture opérationnelle de la BSPP n’est-elle en rien touchée.
En ce qui concerne le PRAC et la difficulté de circulation, la vérité statistique m’oblige à vous dire que, si les critères d’analyse restaient constants, la fermeture de voies entraînerait bien évidemment une augmentation des embouteillages. Il se trouve qu’au cours des années précédentes on n’est jamais parvenu à établir, statistiquement, que la fermeture d’un certain nombre d’axes à la circulation ralentissait les secours. Je vous le dis en toute sincérité. En effet, les gens s’y adaptent et la circulation diminue. En revanche, et je suis très attentif à ce point, les aménagements tout au long des axes, comme les bordures de trottoir qui délimitent les pistes cyclables, constituent un obstacle à la mise en station des échelles en cas d’incendie. Mais pour ce qui est de la limitation des itinéraires dans Paris, je ne suis pas en mesure, statistiquement, de vous prouver, j’y insiste, qu’elle ralentit les secours. Enfin, je n’entends pas entrer dans le débat politique.
Professeur Pierre Carli. Monsieur le député, de quoi parlons-nous ? Nous parlons d’urgences graves, de victimes qui sont prises en charge parce qu’elles souffrent d’une plaie par balle, tirée par un fusil d’assaut militaire, ou d’une lésion liée à une explosion. Ce type de victime bénéficie d’un circuit d’urgence qui est celui des polytraumatisés et des blessés les plus graves. Ce circuit est balisé par l’ARS pour un certain nombre d’hôpitaux publics. Or, dans ces hôpitaux il y a des chirurgiens formés pour les prendre en charge et il y a un dispositif très particulier qui est l’utilisation du circuit à rebours, c’est-à-dire l’utilisation de la salle de surveillance post-interventionnelle comme salle d’entrée dans le bloc opératoire, procédure qui fait l’objet d’exercices que les centres de traumatologie sont capables de réaliser.
Comme je vous l’ai indiqué, et c’est probablement le sens de votre question, il n’y a pas beaucoup, ici, de blessés légers. Ceux que nous appelons des urgences relatives sont des blessés graves qui sont stables, mais il n’y a pas, j’y insiste, de petits blessés, et il est donc difficile de les envoyer dans d’autres établissements. Car on ne fait bien que ce qu’on fait souvent.
Je vais vous raconter une anecdote pour vous montrer que les propos d’aujourd’hui sont les mêmes que ceux d’hier. Un des graves attentats de 1995 a été commis à proximité de l’Hôtel-Dieu, où l’on ne pratique plus que de la chirurgie digestive. Dans cet hôpital se trouve également un grand service d’obstétrique, dont le chef est un ancien militaire qui connaît parfaitement la chirurgie de guerre. Il a envoyé des lettres de protestation à tout le monde, au maire, au député… pour dénoncer le scandale de n’avoir pas reçu, le jour de l’attentat, des victimes qui pourtant étaient très proches de son lieu d’exercice. Nous ne mettons pas en doute la compétence de nos collègues du privé – ce sont des gens extraordinaires – mais les circuits, on ne peut pas les inventer au dernier moment. Voilà la réponse à votre question.
M. Christophe Cavard. J’éviterai les effets de tribune et en viens donc directement à mes questions. Je souhaite obtenir des précisions sur la notion de protection des secours. Qu’attendez-vous, mon général, en la matière ? Est-il question que la formation des secouristes intègre la notion de risque ? C’est sûrement déjà le cas pour les militaires que vous êtes, mais c’est une notion nouvelle pour des secouristes du secteur civil. Cette question de la formation tient au fait que nous sommes un certain nombre de députés provinciaux inquiets que d’autres villes que Paris soient touchées et qui ne disposent pas de l’organisation que vous nous décrivez.
Ensuite, on a cru comprendre que des victimes non accessibles avaient téléphoné à un centre d’appel. Comment le standard établit-il le lien direct avec un médecin afin que celui-ci puisse donner des indications de comportement ?
M. Pierre Lellouche. Je ne ferai pas non plus d’effet de tribune, mais une question me taraude depuis le 13 novembre : combien de temps faut-il, messieurs les médecins militaires, à un blessé par balle d’un fusil d’assaut, pour mourir de ses blessures ? Vous allez me répondre, sans doute, que cela dépend des blessures, mais, selon leur typologie, j’y insiste, combien de temps faut-il pour mourir à quelqu’un qui « pisse le sang » ?
Professeur Jean-Pierre Tourtier, médecin-chef de la BSPP. S’il est une population soumise au risque de blessure par armes de guerre, ce sont bien les militaires. Quand on examine les statistiques du moment du décès par rapport au moment de la blessure, quasiment une mort sur deux survient au cours des cinq premières minutes ; les trois quarts des morts surviennent au cours des trente premières minutes, c’est-à-dire pendant la phase de médicalisation et éventuellement pré-hospitalière. Il existe un concept fort, en médecine militaire, qui est celui de mort évitable. C’est sur ce point que nous avons été très attentifs avec le professeur Carli et le général Boutinaud : quelles sont ces morts que l’on peut encore éviter relativement facilement ? L’armée française a montré que, d’une part, en arrêtant les hémorragies, 90 % des morts étaient évitables ; d’autre part, en drainant les pneumothorax et en maîtrisant les voies aériennes supérieures, on peut permettre à davantage de combattants blessés, à davantage, en l’occurrence, de Parisiens blessés, d’arriver vivants à l’hôpital. Nous avons modélisé ces efforts de la médecine d’urgence, en accord avec le SAMU de Paris, il y a trois ans, par le biais d’une publication qui fait passer la médecine militaire vers la médecine traumatologique civile.
M. Pierre Lellouche. Vous avez souligné la faible mortalité hospitalière – 1,4 % – et tout le monde vous est reconnaissant du travail que vous avez accompli, que vous soyez civils ou militaires. Reste que la question qui m’intéresse, et c’est pourquoi je siège au sein de la présente commission, est de savoir comment, sur le plan opérationnel, faire en sorte que le minimum de gens meurent dans une affaire de ce genre – parce que nous en connaîtrons d’autres. Quand j’ai entendu que deux heures quarante s’étaient écoulées entre le début de l’attaque et l’intervention des forces de sécurité, je me suis demandé combien de gens étaient morts. Voilà la question qui me taraude et sur laquelle je souhaite que nous travaillions. J’ai donc bien noté la très faible mortalité une fois que vous prenez les victimes en charge et la très forte mortalité pendant les trente premières minutes. Nous aurons, j’imagine, des données plus précises à mesure que nos travaux avanceront ; sans doute nous donnerez-vous le résultat des autopsies et saurons-nous ainsi les conséquences à en tirer quant au mode opératoire de nos forces de sécurité – car c’est bien là le sujet.
M. le président Georges Fenech. Vous nous avez indiqué que, aux termes du protocole, vous ne pouviez pas entrer dans la zone d’exclusion. En revanche, nous apprenons qu’une réflexion est en cours sur la question et qui annonce peut-être une évolution. Est-il envisageable, je parle en Béotien, d’imaginer une unité d’élite de médecins dûment équipés à même de pénétrer dans la zone d’exclusion pour aller porter secours à ceux qui sont en train de mourir ? Nous avons en effet vu que vous ne pouviez pas porter secours à des victimes gravement blessées.
Général Philippe Boutinaud. Je répondrai en partie à votre question, monsieur le président, mais hors enregistrement afin que des oreilles indiscrètes et mal intentionnées n’utilisent pas ma réponse contre nous.
Pour le reste, la question est de savoir si l’on peut inventer des forces de sécurité, GIGN, BRI ou RAID, qui soient un peu pompiers, ou bien si l’on doit faire des pompiers de Paris des agents de sécurité de ces unités d’élite. Cette question complexe n’est pas tranchée et nous y réfléchissons. C’est compliqué, parce qu’il faut absolument que vous soyez protégé au moment où vous agissez. Même à la guerre, quand un médecin pose une perfusion, il ne tient pas un pistolet – c’est toute l’ambiguïté de la question. Et le pompier, si vous l’équipez avec un gilet pare-balles et un casque en kevlar, il ne faut pas qu’il se fasse tirer dessus comme un lapin. Il y a un juste équilibre à trouver, et je ne suis pas persuadé qu’il y ait de solution. Nous avons commencé d’examiner les pratiques étrangères et, pour l’instant, à ma connaissance, aucune décision politique ne demande aux secouristes, qu’ils soient militaires ou non, de s’équiper comme des forces spéciales.
Ensuite, peut-être serions-nous capables d’établir un tel dispositif à Paris, mais je suis incapable de vous dire s’il est envisageable dans d’autres villes de France, en métropole ou outre-mer. Il faut donc bien réfléchir à la portée de ce genre de proposition. Si, aujourd’hui, les Parisiens sont peut-être plus exposés que les autres, et si ce dispositif permet de mieux les protéger, les terroristes risquent de frapper dans les villes qui en seraient dépourvues.
Je suis donc prêt, je le répète, à vous répondre hors micro sur l’aspect technique de la question ; quant à l’aspect politique, il revient bien évidemment à la représentation nationale d’y réfléchir.
M. le président Georges Fenech. Je vous confirme qu’une réflexion est en cours sur le sujet.
Professeur Pierre Carli. Il y a deux points dans votre question importante, monsieur Cavard. Vous aurez compris qu’il n’y a pas seulement les équipes de secouristes, mais également des équipes médicales composées de médecins, d’infirmières, personnels dont la vocation n’est pas d’être blessés sur le terrain mais de soigner les autres le plus efficacement possible.
D’abord, toutes les équipes d’urgence doivent apprendre à se protéger lorsque, de manière inopinée, elles se trouvent confrontées à un risque. Il faut savoir faire machine arrière, savoir se mettre à l’abri très efficacement, savoir aussi alerter les autres équipes, la sécurité s’organisant pour que vous ne deveniez pas à votre tour une victime.
Ensuite, plus importante encore est la formation. Il faut former les personnels à se protéger, donc, mais aussi les former à prendre en charge des victimes d’armes de guerre, avec, souvent, des protocoles de soin à la fois rapides et précis. La direction générale de la santé (DGS), la direction générale de l’organisation des soins (DGOS), le service de santé des armées (SSA) nous ont demandé, depuis le 13 novembre, de développer un programme national en ce sens afin que l’ensemble des centres hospitaliers, dans les régions, surtout ceux qui se trouvent dans des villes où il sera difficile d’apporter rapidement du renfort à partir des grands centres, puissent prendre efficacement les premières mesures aussi bien sur le terrain, avec des équipes limitées, que dans un hôpital général qui ne dispose pas forcément des mêmes ressources qu’un centre hospitalo-universitaire. Ainsi du temps sera gagné, des vies seront préservées et sera développé un réseau de soins qui viendra en renfort. Comme vous voyez, monsieur le député, votre question a été anticipée.
M. Jean-Michel Villaumé. Ma question, professeur Carli, porte sur votre coopération effective sur le terrain avec le service de santé des armées. Travaillez-vous habituellement avec les hôpitaux de Paris et, dans l’affirmative, comment ? Ont-ils été associés à l’exercice du 13 novembre au matin ? Le SSA a tout de même une compétence militaire, issue de l’expérience du terrain, en particulier des opérations extérieures ; or ne peut-on pas l’utiliser davantage ? J’ai en effet l’impression, à la lumière d’une précédente audition, que ces services ont été sous-employés.
Mme Françoise Dumas. Vous avez évoqué la saturation des moyens de communication. Comment pensez-vous améliorer les relations avec les médias, radios, réseaux sociaux ou autres, à l’occasion d’autres types de catastrophe telles que, par exemple, des inondations, survenant dans d’autres départements ? Avez-vous senti le besoin d’améliorer votre dispositif en la matière et n’y a-t-il pas eu, à certains moments, redondance ou empêchement dans la communication ?
Professeur Pierre Carli. Je commencerai par nos rapports avec les hôpitaux militaires, question qui concerne les civils étant donné que le professeur Tourtier exerce au Val-de-Grâce. La réponse à votre question, monsieur Villaumé, est très simple : les hôpitaux militaires et les médecins militaires, nous travaillons au quotidien avec eux. Dans mon service, il y a des médecins militaires de garde. J’étais moi-même officier de réserve. Nous avons tous une culture militaire mais nous n’avons pas tous l’expérience du terrain de ceux qui se sont battus. C’est pourquoi notre coopération est des plus efficaces. Le SSA, représenté ici par Jean-Pierre Tourtier, nous a apporté son appui pour mettre au point les protocoles de soin que nous avons appliqués aux civils. Je rappelle qu’il convient de modifier ces protocoles dans la mesure où les civils ne sont pas protégés comme les militaires : ils ne portent pas de gilets pare-balles, de casques permettant d’éviter les balles – aussi les blessures par armes de guerres sont-elles pour les civils le plus souvent mortelles.
Les hôpitaux militaires travaillent-ils avec nous ? L’hôpital Percy fait partie du groupe des hôpitaux qui reçoivent les blessés graves au quotidien. D’ailleurs, les résultats concernant les blessés graves pris en charge par l’hôpital Percy – navire amiral dans cette affaire – et par l’hôpital Bégin sont totalement intégrés aux résultats globaux en la matière. Il n’est pas possible que nous oubliions les militaires puisqu’ils sont en permanence à nos côtés.
Je suis moi-même assez proche du service de santé des armées et je travaille avec le médecin-général Debonne que vous avez reçu. Nous travaillons, avec Jean-Pierre Tourtier, sur l’avenir de la médecine d’urgence de façon à créer des ponts entre la médecine d’urgence militaire et la médecine d’urgence civile. Dans ces professions, nous sommes engagés sur le terrain et il faut savoir agir vite, avec les mêmes critères de qualité, les médecines civile et militaire poursuivant le même objectif d’excellence.
Professeur Jean-Pierre Tourtier. Pour vous rassurer complètement, monsieur le député, la prise en charge de victimes balistiques est un pôle d’excellence du service de santé des armées. Or nous avons à cœur, depuis de nombreuses années, de partager nos connaissances avec les centres de traumatologie civils. De nombreux travaux scientifiques ont été réalisés à cette fin par le professeur Carli et moi-même.
Le soir du 13 novembre, les hôpitaux militaires ont été très utiles. Sur les 98 urgences absolues – blessés les plus graves, pour lesquels il fallait rapidement un chirurgien et un réanimateur –, dix-huit, soit 20 %, ont été prises en charge par un hôpital militaire, qu’il s’agisse de Bégin ou de Percy.
Général Philippe Boutinaud. Je réponds à la question de Mme Dumas. Il est nécessaire de tirer les enseignements de la saturation des centres d’appel. Je sais que vous avez reçu des personnes qui ont téléphoné à la police, laquelle, selon elles, leur aurait raccroché au nez. Il faut savoir qu’il est parfois très difficile d’entendre ce que disent les gens.
Pour ce qui nous concerne, je vous l’ai dit, le nombre d’appel s’est effondré dès lors que nous avons changé le message d’accueil. Nous avons assez rapidement pensé à utiliser Twitter et Facebook et, depuis le 13 novembre, nous continuons dans cette voie, mais quant à utiliser l’appel au secours par le biais de tweets, solution apparemment très alléchante, il ne faut pas oublier qu’il faut ensuite exploiter le message, et qu’il faut des hommes pour cela. En outre, au cours d’une conversation téléphonique, vous pouvez commencer à accompagner la victime : quand nous recevons un appel pour un arrêt cardiaque, nous donnons des instructions à notre interlocuteur pour qu’il commence le massage cardiaque. Et nous essayons de rattraper un maximum de gens de cette manière. Aussi, en l’état actuel de la technologie, la conversation téléphonique reste-t-elle très importante.
En ce qui concerne les gens qui se trouvaient dans le Bataclan, nous n’avons raccroché au nez de personne. Reste qu’il faut bien comprendre que cette espèce de soutien psychologique mobilise une ligne. Par conséquent, depuis, nous avons créé une sorte de salle de débordement. Il faut savoir que l’accompagnement psychologique d’une victime, en effet très important, peut mobiliser une ligne et un opérateur pendant une demi-heure ou trois quarts d’heure.
J’apporterai pour finir un complément de réponse à M. Lellouche. Dans la colonne de la BRI, le professeur Safran était là pour assurer la sécurité et le soutien médical des hommes de la BRI. Néanmoins, il a passé son temps à sortir des victimes et c’est ainsi que nous avons pu faire sortir un maximum de blessés bien avant l’assaut final de 0 heure 20. Les gens, les familles doivent savoir que tous ceux que nous pouvions aller chercher, nous sommes allés les chercher. Reste que le professeur Safran, lui, était équipé d’un gilet pare-balles, d’un casque en kevlar, et avait donc plus de facilité pour le faire. Très honnêtement, il faut dire la vérité : la BRI n’avait plus de soutien santé parce que les médecins de la BRI ne s’occupaient que des victimes.
M. Serge Grouard. Ma première question prolonge vos considérations, mon général, sur les victimes psychologiques. Quand on se trouve dans des situations d’extrême urgence telles que celles que vous avez décrites, on se doute bien qu’il y a des priorités, mais, vous l’avez certainement vu, nous avons auditionné des victimes qui ont évoqué cette question de la prise en charge dans la durée. Pouvez-vous nous en dire un mot ?
Ne voyez pas dans ma seconde question la moindre critique, mais la présente commission a pour objet de comprendre ce qui s’est passé et, si possible, de proposer des pistes d’amélioration. Encore une fois, il ne s’agit en rien d’une critique, au vu du dévouement des personnels qui se trouvaient sur place. Des attentats de masse, il y en a eu d’autres, et en Europe, vous les avez rappelés. Avez-vous imaginé, avant novembre et peut-être même avant les attentats de janvier 2015, ce type de scénario et réalisé des exercices permettant de tester vos capacités de réaction, d’adaptation comme d’ailleurs les militaires le font régulièrement ? J’ai participé à plusieurs livres blancs de la défense nationale dans lesquels on peut trouver des scénarios, des sous-scénarios, la description de situations de crises. On ne peut bien sûr pas tout prévoir, mais je souhaite savoir si des scénarios envisageant des attentats de masse tels que ceux que nous avons subis avaient été prévus, qui auraient permis d’appréhender la réalité.
M. Pierre Lellouche. L’attentat du théâtre de Moscou et la prise d’otages de Beslan constituent deux précédents au Bataclan.
M. le président Georges Fenech. Il me semble que des débuts de réponses ont déjà été apportés aux questions de M. Grouard.
Général Philippe Boutinaud. Les pompiers s’exercent très régulièrement, tous les samedis matins. Une fois par mois, les groupements d’incendie sont associés à l’exercice. Nous définissons des thèmes compagnie par compagnie. Il serait laborieux de détailler la quantité astronomique de nos exercices. Et ce n’est pas d’aujourd’hui. Il y a huit ans, je commandais un groupement d’incendie et nos exercices étaient inopinés – celui qui part ne sait pas si c’est pour un exercice ou pour une intervention réelle – puis, sans doute pour moins gêner la population, ils ont été planifiés. J’ai demandé au préfet de police la possibilité de reprendre les exercices inopinés et il m’y a récemment autorisé. La coordination avec les autres services est une autre affaire et qui se décide au-dessus de moi. Nous nous exerçons en tout cas presque systématiquement avec la police, tandis que c’est un peu plus compliqué avec les autres services. Il ne faut par ailleurs pas perdre de vue que, lorsque vous procédez à un exercice, vous êtes quelque peu démuni s’il se passe quelque chose pendant ce temps-là.
Professeur Pierre Carli. Contrairement aux militaires, pour les civils le temps d’exercice n’existe pas, donc nous le prenons. Chaque année, le SAMU de Paris, dans un cadre universitaire, celui de la capacité de médecine de catastrophe, c’est-à-dire dans le cadre de la formation des médecins – qui à cette occasion proviennent de toute la France –, nous organisons un exercice. Des exercices d’envergure ont été réalisés au cours de la période 2005-2010 portant sur des attentats multi-sites dans les transports. À cette époque, le scénario retenu était celui d’explosion de bombes ainsi que cela s’était passé à Madrid et à Londres. Est venue s’y ajouter la notion de fusillade, qui ne faisait pas partie du scénario, et qui changeait la prise en charge des victimes, nous obligeant à prévoir des parcours différents. C’est pourquoi nous nous y sommes attelés dès 2013. Nous avons donc effectué trois exercices de fusillade monosite qui nous ont permis d’avoir une certaine connaissance – certes théorique – du sujet.
M. le président Georges Fenech. La BSPP et le SAMU font-ils des exercices contre les attaques de type nucléaire, radiologique, biologique et chimique (NRBC) ?
Professeur Jean-Pierre Tourtier. Jeudi prochain a lieu une formation commune BSPP-SAMU sur le risque NRBC. Par ailleurs, je ne souhaite pas donner d’éléments d’information à des oreilles qui ne nous seraient pas bienveillantes. Nous adaptons nos plans de secours à l’évolution que nous percevons de la menace.
M. le président Georges Fenech. Parmi les personnes présentes qui n’ont pas encore pris la parole, quelqu’un souhaite-t-il s’exprimer ?
Docteur François Braun, président du SAMU Urgences de France, chef de service de médecine d’urgence. Je reviendrai sur la province. Les principes mis en place par nos collègues du SAMU de Paris et de la BSPP sont depuis plusieurs années déclinés dans toutes les régions de France. Nous appliquons exactement les mêmes principes de sectorisation, de « filiérisation » des victimes qu’à Paris, à une échelle qui va néanmoins nous imposer un plus en matière de capacité de réponse. En région Lorraine, par exemple, on compte 24 équipes SMUR de garde, ce qui ne représente pas du tout le même volume qu’à Paris. Aussi appliquons-nous des principes d’obligation de renforts très rapides, de devoir d’ingérence, si l’on peut le résumer ainsi. Autrement dit, les SAMU de proximité, dans le cadre des plans ORSAN – acronyme d’« organisation de la réponse du système de santé en situations sanitaires exceptionnelles » – définis par le ministère de la santé, vont envoyer immédiatement des moyens supplémentaires. En outre, et c’est une chose que l’on n’a pas vue, l’ensemble des zones de défense ont envoyé par anticipation des moyens vers Paris sans même que nos collègues parisiens nous les aient demandés. En particulier, des moyens héliportés étaient en route avant même l’assaut du Bataclan. Et, constatant que, malheureusement, les victimes potentielles étaient décédées, ils ont fait demi-tour. L’idée est bien que chacun envoie un peu de renforts afin de ne pas se démunir, mais ce qui représentera au total beaucoup pour ceux qui les reçoivent. Voilà, grosso modo, quelle est l’architecture de tous les plans désormais mis en place en province, fondés sur des concepts de prise en charge, d’équipes d’intervention en kit damage control, établis à la suite des expériences parisiennes.
M. le président Georges Fenech. N’est-il pas envisageable de procéder à des évacuations par voie aérienne dans Paris ?
Professeur Pierre Carli. Ce sujet est très important. Non seulement il n’est pas simple de se poser de nuit en hélicoptère dans Paris, mais nous disposions d’hôpitaux à proximité. Les hélicoptères de la sécurité civile et du SAMU étaient bien là pourtant, et ils étaient au nombre de huit, pourvus d’équipes médicales qui sont allées pour certaines jusqu’à l’héliport d’Issy-les-Moulineaux. Ces hélicoptères constituaient la troisième ligne de défense. Une zone de posée était prévue à côté du Bataclan qui devait permettre l’emploi d’hélicoptères pour transporter des victimes vers les hôpitaux de la petite et de la grande couronne.
M. le président Georges Fenech. Où se trouvait la zone de posée, exactement ?
Professeur Pierre Carli. Un peu derrière, vers le cours de Vincennes.
Général Philippe Boutinaud. Les zones de posée sont identifiées et nous savons lesquelles utiliser de jour, lesquelles de nuit. L’autorisation du survol de Paris appartient à la préfecture de police. Il n’est pas rare, dans la petite couronne, que nous utilisions un hélicoptère qui, en général, sert précisément à s’affranchir des difficultés de la circulation pour sauver un patient atteint d’une pathologie particulière. Le cas qui nous occupe était quelque peu différent. Nous avons demandé des hélicoptères pour anticiper les évacuations secondaires dans l’hypothèse d’un scénario « à la Bombay » avec beaucoup plus de victimes – même si, bien sûr, le nombre de victimes a été déjà beaucoup trop élevé. Connaissant les capacités de l’AP-HP pour en avoir discuté avec Pierre Carli bien avant l’attentat, il fallait, en cas de victimes bien plus nombreuses, être capable d’envoyer les urgences relatives vers les hôpitaux de province. En effet, un blessé en urgence absolue doit être traité immédiatement, sous peine de mourir dans l’heure. Les urgences relatives peuvent, pour leur part, attendre cinq ou six heures.
Il s’agit donc bien des victimes en urgence relative qui étaient éventuellement destinées à être évacuées par hélicoptère. Nous serions allés les chercher dans les hôpitaux où elles ne pouvaient être traitées et nous les aurions emmenés à l’aide de nos VSAV vers une zone où auraient pu se poser des hélicoptères lourds, à savoir des NH90, capables de transporter de dix à quinze personnes. Des places nous avaient déjà été attribuées à Lille, Nancy et Metz. Nous n’avons finalement pas eu besoin de ce dispositif, qu’il est de toute façon nécessaire de prévoir à l’avance plutôt que de monter au dernier moment.
M. le président Georges Fenech. Pourquoi ne pas avoir utilisé ces hélicoptères pour transporter les blessés du Bataclan vers les hôpitaux parisiens ?
Général Philippe Boutinaud. Parce que la distance était presque supérieure à la distance terrestre entre le Bataclan et l’hôpital. Le transport par hélicoptère n’aurait apporté aucune plus-value.
Colonel Jean-Claude Gallet, adjoint au général commandant la BSPP. Il y avait même un risque à faire voler un hélicoptère de nuit. La manœuvre aéromobile a été lancée à 22 heures 30.
Docteur Yves Lambert, chef du pôle de l’urgence, directeur du SAMU des Yvelines. Pour reprendre une précédente question, il n’y a pas que Paris. Les blessés, dans cet horrible attentat, étaient à proximité des hôpitaux – c’est ce qu’on vient de montrer en précisant que l’hélicoptère n’apportait pas, ici, de valeur ajoutée. Or, ne serait-ce que dans la grande couronne, nous voyons bien que nous serions amenés à utiliser des moyens quelque peu différents, a fortiori, donc, dans le reste de la France.
D’une manière générale, nous sommes en train de parler de plans, de préparation, de différentes activités. Reste qu’il faut souligner l’importance de la cellule d’urgence médico-psychologique qui a été très sollicitée. Les rapports des départements concernés ont montré que l’implication de ces cellules a duré plus d’un mois après les attentats.
Quand surviennent des événements qui ne correspondent pas tout à fait au plan, l’objectif n’est pas d’appliquer ce dernier mais bien de sauver le maximum de patients. Il faut pour cela un raisonnement d’état-major. En l’occurrence, l’involution par rapport au plan a été dans le bon sens. Ainsi, dans le cadre du damage control, nous avons dû prendre en charge un nombre de patients qui n’était pas prévu par ce système. Le damage control, qui est une prise en charge réfléchie, qui n’est pas le scoop and run des Anglo-Saxons, est une méthode qui doit être comprise par l’ensemble des services, y compris par la police. Le « tuilage » dont il a été fait état à plusieurs reprises est très important. Nous aussi, de notre côté, en tant que SAMU, nous devons comprendre comment fonctionnent les services de police afin de pouvoir intervenir. Nous avons eu de la « chance », si je puis dire, que les services de police, pour courageux qu’ils aient été ainsi que tout le monde l’a souligné, aient été peu impliqués. Mais comme il n’en ira sans doute pas toujours ainsi, nous avons besoin de comprendre les stratégies de tous.
En bref, il ne s’agit pas d’appliquer un plan parce que c’est le plan, mais le plan demeure fondamental pour aider à structurer l’action, mue par une réflexion d’état-major commune impliquant donc l’ensemble des services.
Professeur Frédéric Adnet, directeur du SAMU 93, responsable du pôle accueil-urgences-imagerie à l’hôpital universitaire Paris Seine-Saint-Denis Avicenne, Bobigny. J’étais responsable du service qui a pris en charge les premiers attentats, conformément au plan « camembert ». La spécificité de l’attentat perpétré au Stade de France, c’est que nous étions sur place avant. À l’intérieur du stade, se trouve un poste de commandement où sont représentés le service médical des sapeurs-pompiers, le SAMU, les forces de police, la RATP… Ce dispositif prudentiel nous a énormément aidés à assurer l’interface entre les différents services pour prendre en charge les victimes et pour savoir immédiatement ce qui se passait. Il me paraît important de le souligner car ces dispositifs prudentiels doivent à mon sens être développés dans les futurs rassemblements de masses qui vont avoir lieu en 2016 et par la suite. Il faut bien intégrer le fait que les personnels médicaux et ceux de la BSPP doivent être très présents au sein de tels dispositifs. Nous connaissons en effet les lieux et les hommes.
Ensuite, on a beaucoup évoqué la sécurité des personnels engagés ; mais je vous signale que le « sur-attentat », nous l’avons vécu. La deuxième explosion, au Stade de France, se produit lorsqu’une équipe du SAMU est présente et que les premiers secours de la BSPP sont présents. La troisième explosion, celle qui provoque le plus grand nombre de cas d’urgence absolue, survient longtemps après et toutes les équipes médicales sont présentes, de même que toutes les équipes des pompiers. Heureusement pour les équipes intervenantes, cette explosion a eu lieu au niveau d’une file d’attente du Mc Donald’s qui était un peu éloignée des secours. J’entends par là vous faire mesurer que le risque de sur-attentat n’est pas que théorique. Si l’explosion s’était produite au milieu des secours, non seulement le bilan aurait été plus grave mais les secours auraient été vraiment désorganisés. Aussi, j’y insiste, le point d’équilibre entre la sécurisation des personnels engagés et la prise en charge des victimes n’est-il pas que théorique.
Colonel Jean-Claude Gallet. Je suggère une piste d’amélioration facile à appliquer. Elle relève d’une volonté politique et relève du niveau interministériel. Elle concerne le partage de l’information.
Celui-ci doit s’effectuer en amont, de façon à connaître les modes opératoires que décrit très bien le professeur Carli : élaboration d’une stratégie, préparation d’exercices, cela par rapport au mode opératoire des terroristes. Il s’agit également pour les agences de se connaître mutuellement – la chaîne de l’urgence se compose d’un ensemble d’acteurs hétérogènes. Il nous faut mener un combat, élaborer une doctrine interarmées. Or, pour l’heure, nous n’avons pas de doctrine, nous sommes des acteurs différents, donc nous avons besoin de nous connaître, nous avons besoin de connaître nos facteurs dimensionnants, nos capacités critiques – car la décision se prend dans les deux à trois minutes.
Le partage de l’information doit aussi s’effectuer pendant les opérations. Le général vous a expliqué qu’il s’agissait d’une séquence de quarante minutes. Nous avons affaire à une vague, à une autre, nous sommes confrontés à une attaque NRBC… Ces informations sont nécessaires au politique de façon qu’il dispose d’un cadre temporel de communication. Car ensuite il y a la résilience, la résilience de la nation.
Enfin, le partage de l’information doit s’effectuer dans la phase qui suit : c’est ce que nous sommes en train de faire avec vous en ce moment. C’est la phase « retour d’expérience ».
M. Pierre Lellouche. Je vous ai entendus dire que vous vous étiez entraînés en vue d’opérations dans les trains, que vous vous étiez entraînés pour faire face à des mitraillages ; mais je reviens à la question de M. Grouard. Il y a eu un attentat dans un théâtre à Moscou en 2002, puis l’attaque de Beslan et, en 2009, un attentat en Égypte où il a été question d’attaquer le Bataclan. Une enquête a en effet révélé que le Bataclan était cité. À aucun moment, naturellement, vous n’avez été mis au courant de cela ? Et à aucun moment vous ne vous êtes entraînés sur des salles de spectacle ? Question annexe : comptez-vous le faire ?
M. le président Georges Fenech. La question est précise : avez-vous en effet été amenés à disposer de plans de salles de spectacle ? Saviez-vous que le Bataclan était une cible possible ?
Général Philippe Boutinaud. La difficulté pour les pompiers est qu’ils ne sont pas identifiés comme un service public ayant besoin de recevoir des informations sensibles. La police dispose de son système de remontée d’informations, l’armée du sien, et les pompiers, à la croisée des chemins, sont appelés quand quelque chose est arrivé. Or, pour pouvoir anticiper, il faut savoir exactement quels sont les modes d’action. C’était le sens de l’intervention tout à fait pertinente de mon adjoint.
Personnellement, je n’ai jamais su que le Bataclan était menacé. Quelqu’un, dans le pays, l’a-t-il vraiment su ? Ce que je puis vous dire, c’est que le colonel Gallet et moi passons notre temps à éplucher les modes d’action des autres. Vous avez cité Beslan ; la veille, à Beyrouth, il y a eu un attentat au cours duquel les secours ont été frappés. Nous discutons avec un certain nombre de nos homologues exerçant dans des zones très exposées. Je connais nombre de mes collègues, au Liban et ailleurs, et nous croisons nos informations. Mais cette pratique n’est pas institutionnalisée.
M. Pierre Lellouche. C’était le sens de ma question.
Général Philippe Boutinaud. Il faudrait progresser en la matière. J’en ai discuté personnellement avec le préfet de police et il en est tout à fait conscient.
Pour ce qui concerne les plans, les pompiers ont les plans de partout depuis longtemps. D’ailleurs, quand vous entrez dans n’importe quelle salle de spectacle, si vous tournez la tête à droite ou à gauche, vous tomberez sur le plan des lieux, dont l’affichage est obligatoire. Ces plans sont faits pour les pompiers et représentent le niveau où vous vous trouvez. Comme, dans la fumée, vous n’y voyez rien, vous arrachez le plan du mur pour vous en servir. Ainsi, en France, vous devez trouver dans tous les établissements recevant du public, le plan du niveau où vous êtes, c’est la loi.
De là à disposer des plans du sous-sol, du plan d’ensemble d’un immeuble, c’est une autre question. Les policiers, par exemple, peuvent prendre notre plan mais, n’ayant que celui du niveau où ils se trouvent, ils ne sauront pas tout à fait ce qu’il y aura à l’étage au-dessus. Constituer une base de données dans laquelle on trouverait tous les plans n’est pas impossible à imaginer, mais son usage serait compliqué ne serait-ce que pour la mettre à jour : le bureau de prévention de la BSPP traite 700 dépôts de permis de construire ou de demandes d’aménagements nouveaux par semaine !
M. Meyer Habib. Je souhaite revenir aux deux heures quarante minutes qui ont précédé l’assaut final au Bataclan. La semaine dernière, dans le cadre de la présente commission, j’ai interrogé le ministre de l’intérieur sur la possibilité d’un changement de doctrine, qui consisterait, quand il ne s’agit pas d’une prise d’otages mais d’un massacre, à entrer au contact le plus vite possible. Tout à l’heure, l’un des officiers a déclaré que l’un des médecins, équipé d’un gilet pare-balles et d’un casque, avait pu sortir des victimes. Je souhaite avoir votre sentiment sur ce changement de doctrine, en particulier sur la doctrine israélienne suivant laquelle il convient d’aller au plus vite au contact lorsqu’on n’est pas confronté, je le répète, à une prise d’otages. Peut-on ainsi imaginer que plusieurs médecins soient placés derrière les unités…
M. le président Georges Fenech. La question a été posée avant que vous ne nous rejoigniez, mon cher collègue.
Général Philippe Boutinaud. Je me permettrai toutefois de rappeler un point : le médecin qui suit la colonne de la BRI ou du RAID est là pour assurer le soutien médical des policiers. Or il se trouve que le professeur Safran, en l’occurrence, je l’ai mentionné, a passé son temps à sortir des victimes afin que nous les prenions en compte. Pour ce qui est du changement de doctrine, je n’ai pas souhaité vous donner tous les détails de la réflexion en cours sur le sujet, en tout cas publiquement.
M. le président Georges Fenech. Nous vous auditionnerons éventuellement à huis clos.
Il me reste, madame, messieurs, à vous remercier infiniment pour nous avoir apporté ces explications très précieuses pour notre commission d’enquête.
Audition, ouverte à la presse, de M. Jean Benet, directeur des transports et de la protection du public de la préfecture de police de Paris, et du professeur Bertrand Ludes, directeur de l’Institut médico-légal de Paris
Audition, ouverte à la presse, du mercredi 16 mars 2016
M. le président Georges Fenech. Merci, messieurs, d’avoir répondu à l’invitation de notre commission d’enquête. L’Institut médico-légal de Paris est rattaché à la direction des transports et de la protection du public de la préfecture de police de Paris. Il reçoit les corps en cas de décès, accidentel ou non, sur la voie publique, de décès d’origine criminelle ou considéré comme suspect, de demande de la famille, par mesure d’hygiène publique ou bien encore lorsque le corps n’est pas identifié.
J’indique que cette audition est ouverte à la presse et fait l’objet d’une retransmission en direct sur le portail vidéo du site internet de l’Assemblée nationale. Son enregistrement y sera disponible pendant quelques mois.
Je vous signale également que la Commission pourra citer dans son rapport tout ou partie du compte rendu qui sera fait de cette audition. Nous avons décidé que nombre de nos auditions seraient ouvertes à la presse afin d’assurer la nécessaire transparence vis-à-vis du public.
Conformément aux dispositions de l’article 6 de l’ordonnance du 17 novembre 1958, je vous demande de prêter le serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité.
M. Jean Benet et le professeur Bertrand Ludes prêtent successivement serment.
Je vous laisse la parole pour un exposé liminaire. Ensuite, le rapporteur, les membres de la Commission et moi-même serons amenés à vous demander des précisions ou à vous poser d’autres questions.
M. Jean Benet, directeur des transports et de la protection du public de la préfecture de police de Paris. Je compléterai vos propos, monsieur le président, en précisant que la direction des transports et de la protection du public de la préfecture de police de Paris (DTPP) participe de l’action sanitaire qui relève du préfet de police. La préfecture de police exerce, en lieu et place du maire de Paris, le suivi de l’Institut médico-légal en matière administrative et financière, mais n’interfère pas dans ses missions de nature médico-judiciaire dont les prescripteurs sont les autorités de police judiciaire. Cela signifie en particulier que, à l’occasion de crises, la DTPP peut venir apporter son soutien au directeur de l’Institut médico-légal, le professeur Ludes, sans pour autant qu’il y ait de relations hiérarchiques. L’Institut médico-légal est rattaché, pas intégré, à la DTPP.
Du point de vue de la chronologie des événements, Bertrand Ludes interviendra pour les attentats du mois de janvier 2015, car je n’étais pas encore en poste à cette époque. S’agissant des attentats du mois de novembre 2015, nous avons été alertés immédiatement par les services de permanence du cabinet du préfet des événements dramatiques de la soirée du 13 novembre. Nous nous sommes placés en situation d’alerte et j’ai contacté très rapidement le professeur Ludes ainsi que les responsables de tous les services susceptibles d’être mobilisés. C’est officiellement à 4 heures du matin qu’il m’a été très clairement demandé quelle était la capacité d’accueil de l’Institut médico-légal et c’est à ce moment-là que nous avons eu des informations très précises sur l’étendue du drame. Nous savions déjà que l’Institut allait devoir recevoir très rapidement de nombreux corps.
Professeur Bertrand Ludes, directeur de l’Institut médico-légal de Paris. Nous avons réceptionné les corps des victimes le lendemain, samedi 14 novembre, à partir de 6 heures du matin. Les opérations d’imagerie post-mortem ont débuté dans l’après-midi. Les opérations médico-légales proprement dites ont été effectuées à partir du dimanche 15 novembre et se sont achevées, pour les victimes, le jeudi 19 novembre. Au total, nous avons eu à traiter pendant ce laps de temps 123 corps, dont 17 corps mutilés, sous réquisition judiciaire de M. le procureur de la République.
S’agissant des attentats du mois de janvier, nous avons réceptionné un premier corps le 7 janvier dans l’après-midi puis les autres corps dans la soirée après 23 heures. Le lendemain matin, nous avons procédé aux opérations d’imagerie post-mortem et l’après-midi aux autopsies médico-légales. Le vendredi, nous avons poursuivi les opérations médico-légales et reçu les corps d’autres victimes, dont celles de l’attentat de l’Hypercacher. Ces opérations ont été achevées, pour les victimes, le samedi 10 janvier tard dans la soirée. En ce qui concerne les auteurs, les autopsies ont été faites le lundi 12 janvier.
M. Sébastien Pietrasanta, rapporteur. J’aimerais savoir si les opérations médico-légales concernant les victimes des attentats du 13 novembre ont toutes été achevées à ce jour.
Professeur Bertrand Ludes. Nous avons terminé les opérations thanatologiques sur l’ensemble des victimes.
M. le président Georges Fenech. Pouvez-vous nous préciser ce que recouvre ce terme ?
Professeur Bertrand Ludes. Il s’agit des autopsies médico-légales et des examens de corps approfondis.
M. le rapporteur. Les responsables de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris (BSPP) et du SAMU, que nous avons auditionnés juste avant vous, nous ont expliqué qu’un décès sur deux survenait dans les cinq minutes suivant les blessures par balles infligées par des kalachnikovs, et trois décès sur quatre dans les trente minutes. Cela implique de se concentrer sur les morts évitables pendant les opérations de premier secours.
Les autopsies que vous avez réalisées vous permettent-elles d’établir des éléments chiffrés de décès qui auraient pu être évités ?
Professeur Bertrand Ludes. La question pour nous est difficile dans la mesure où cette notion de mort évitable est portée par les médecins urgentistes qui traitent les personnes lorsqu’elles sont encore vivantes. Pour notre part, c’est en fonction des lésions que nous constatons lors des autopsies que nous pouvons émettre, avec une prudence extrême, un avis sur les possibilités de survie de la victime. L’expérience en la matière est détenue par les médecins militaires qui prennent en charge les blessés.
M. le rapporteur. Il nous a encore été précisé que 90 % de ces morts évitables sont liées à des hémorragies des membres et 10 % à l’obstruction des voies aériennes supérieures. J’ai bien compris la difficulté qui était la vôtre mais, compte tenu des lésions que vous avez constatées, êtes-vous en mesure de nous indiquer dans quelles proportions les morts sont dues à des hémorragies ou à l’obstruction des voies aériennes supérieures ?
Professeur Bertrand Ludes. Je ne peux pas répondre à votre interrogation portant sur la liberté des voies aériennes. Nous effectuons nos observations lorsque l’ensemble des appareillages a été retiré : nous ne pouvons que constater des plaies ou des lésions des voies aériennes supérieures. La liberté des voies aériennes ne peut être observée que de manière dynamique, lorsque la réanimation est en cours et que des sondes d’intubation sont posées.
Ensuite, nos opérations ne sont pas achevées. Nous n’avons pas remis l’ensemble de nos rapports d’autopsie. Nous sommes encore en train de travailler sur ces questions. En tout état de cause, nous avons souvent eu à constater des lésions multiples sur les victimes, qui laissent penser qu’il n’y avait pas simplement un membre qui était touché. Les victimes ont souvent été touchées par plusieurs projectiles.
M. le rapporteur. C’est un élément important pour notre commission d’enquête : vous semblez nous indiquer que, d’après vos premières observations, il y a eu peu de morts évitables, en raison des lésions multiples.
Professeur Bertrand Ludes. Ce n’est pas tout à fait ce que j’ai dit. Le travail est en cours. La vue d’ensemble que je peux retirer est qu’il y a eu des lésions multiples par balle chez les victimes.
M. le rapporteur. Les décès ne sont donc pas seulement dus au fait qu’un membre a été touché.
Professeur Bertrand Ludes. Ils ne sont pas forcément liés au fait qu’un seul membre a été touché. Nous pourrons réaliser d’autres travaux, une fois que l’ensemble des rapports auront été rédigés, à la demande de M. le procureur.
M. le rapporteur. J’en viens à des questions sur l’organisation qui a été la vôtre.
Dans les réponses que vous avez faites au questionnaire que nous vous avons transmis, vous mentionnez le fait que le procureur, me semble-t-il, a fait le choix de ne pas mobiliser l’institut médico-légal de la gendarmerie et de concentrer les équipes sur un lieu unique, l’Institut médico-légal de Paris. Je vous pose la question de manière un peu abrupte : vous êtes-vous senti dépassé par le nombre de victimes ? J’ai cru comprendre que certains gendarmes ont été dépêchés à l’Institut médico-légal de Paris. Néanmoins, vous aurait-il paru pertinent d’ouvrir le deuxième institut médico-légal ? La Commission a besoin d’avoir des explications sur le choix qui a été fait de n’ouvrir qu’un seul centre.
Par ailleurs, vous dites avoir été prévenu à 4 heures du matin dans la nuit du 13 au 14 novembre. Par qui vous ont été communiquées ces informations ? Pourquoi vous avoir prévenu si tard dans la nuit ?
Nous aurions besoin que vous nous apportiez des précisions sur certains éléments factuels. Le président et moi-même avons reçu le témoignage écrit d’une famille de victime, qui fait part des difficultés qu’elle a rencontrées à l’Institut médico-légal. Elle rapporte que le standard téléphonique n’était pas en adéquation avec l’ampleur des demandes et dit avoir eu l’impression d’être « face à une administration ordinaire dans son fonctionnement ordinaire ». « Le lundi, à 9 heures, nous avons appelé pour prévenir que nous serions sur place à 10 heures 30. Surpris et visiblement pas disposé à nous recevoir, notre interlocuteur nous a indiqué qu’il fallait attendre, qu’on allait nous rappeler très vite. À 10 heures 30, sans nouvelles, nouvel appel de notre part, nouvel interlocuteur et confirmation que nous ne serions pas en mesure de voir le corps le lundi. On nous demande même si nous aurions d’autres créneaux dans la semaine ». Attitude qui a choqué les parents de la victime, car le corps de leur fils n’avait toujours pas été identifié et une incertitude planait encore sur son décès. En outre, ils soulignent qu’il aurait été impossible, pendant un moment, de savoir où le corps se trouvait entre le départ de l’hôpital Percy et l’arrivée à l’Institut médico-légal. Ils disent aussi s’être heurtés à de nouvelles difficultés lors de la levée du corps : horaires inadaptés, mauvaises indications pour entrer dans l’Institut.
Je ne veux pas vous accabler, car vous avez fait, avec votre personnel, un travail exemplaire et je me dois de vous préciser que cette famille indique dans son témoignage avoir pu compter sur un interlocuteur extrêmement disponible, qui lui a donné son numéro de téléphone et a apporté des réponses efficaces. L’organisation de crise de l’Institut, avec notamment des personnels venus en renfort, vous a-t-elle paru assez solide ?
M. Jean Benet. Nous étions informés dès le début de ce qui se tramait. À 4 heures du matin, nous avons eu connaissance de manière très précise du nombre de corps que nous étions susceptibles d’accueillir. Mais nous étions d’ores et déjà organisés, y compris pour apporter notre appui à d’autres titres. L’Institut médico-légal s’est mis tout de suite en ordre de marche et il a pu recevoir les corps dès 6 heures du matin.
Professeur Bertrand Ludes. Je confirme ce que vient de dire M. le directeur. Nous étions en alerte dès la veille et avions déjà contacté nos collègues pour qu’ils soient présents dès l’arrivée des premiers corps.
Le procureur de la République a décidé de concentrer les moyens sur un seul centre. L’IML comporte une salle dite de catastrophe, qui permet d’accueillir 200 corps. Et l’autorité judiciaire peut décider de la mobiliser.
Par ailleurs, nous avons reçu l’appui de nos collègues de l’Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale (IRCGN) : le général Yves Schuliar s’est rendu sur place dès le samedi, et trois médecins sont venus nous épauler dès le début des opérations thanatologiques, le dimanche matin, ainsi qu’une équipe de balisticiens, qui nous a apporté une aide indispensable.
En ce qui concerne l’accueil, nous avons mobilisé nos agents et la psychologue de l’Institut. Nous avons accueilli quatre familles le samedi après-midi et procédé à deux présentations de corps. Le dimanche 15 novembre, vingt-six présentations ont eu lieu ; le lundi 16 novembre, quarante-trois ; le mardi, trente-sept ; le mercredi, vingt-huit ; le jeudi, dix-huit ; le vendredi, dix-sept ; le samedi, huit. Puis ces présentations ont suivi un rythme moins soutenu dans la mesure où les familles avaient déjà pu voir le corps de leur défunt.
Nous avons étendu les horaires d’ouverture autant que faire se peut : l’Institut permettait les départs de corps à partir de 7 heures 30 du matin jusqu’au soir, vers 18 heures ou 18 heures 30 pendant la semaine qui a suivi nos opérations. Les départs pour inhumation ont commencé à partir du jeudi.
S’agissant des interlocuteurs, les familles ont certainement eu affaire à diverses personnes. Le problème des créneaux se posait, compte tenu du nombre très important de demandes. Il fallait que nous puissions répondre à chacune des familles. Nous avons fait en sorte que toutes les familles puissent voir une fois le corps avant d’autoriser des deuxièmes ou des troisièmes présentations.
On ne peut donc pas parler de fonctionnement ordinaire. Nous nous sommes organisés en fonction de l’ampleur des événements. Nous avons même reçu des familles la nuit pour certaines présentations difficiles.
Vous avez cité le cas de ces parents qui ne trouvaient plus trace du corps de leur fils. Nous ignorons quand les corps partent des hôpitaux, nous les enregistrons à leur arrivée à l’Institut. Je ne peux donc pas me prononcer sur ce qui se passe auparavant.
M. le rapporteur. L’ouverture de l’IRCGN aurait-elle pu vous aider à mieux gérer l’accueil des familles ou la charge de travail ?
Professeur Bertrand Ludes. Il m’est difficile de répondre. Avoir reçu le soutien de l’IRCGN nous a indéniablement aidés. L’échange avec les balisticiens a été capital dans notre travail judiciaire.
Autre élément extrêmement important : nous avons également reçu le soutien de la Cellule interministérielle d’aide aux victimes (CIAV), qui apaise aussi bien les familles que les intervenants.
M. Jean Benet. L’Institut médico-légal procède chaque année à 2 000 autopsies et 8 000 examens externes, le plus souvent à caractère sensible. Il totalise le quart des autopsies médico-légales effectuées en France. Il offre, à Paris et petite couronne, une grande capacité pour les catastrophes de cette nature. Je ne sais pas quelle est la capacité de l’IRCGN.
M. Pierre Lellouche. Je voudrais revenir sur une question que j’ai déjà posée aux représentants des sapeurs-pompiers de Paris et du SAMU. Avez-vous établi une typologie des blessures ? Quand aurez-vous achevé le travail d’autopsie ? Autrement dit, êtes-vous en mesure de savoir combien de personnes auraient pu être sauvées si les secours étaient arrivés plus tôt ? C’est la question de fond qui se pose, pas seulement pour la soirée du 13 novembre, mais aussi pour la gestion d’autres attentats de ce type.
Professeur Bertrand Ludes. La typologie est faite, elle est incluse dans nos rapports d’autopsie. D’ici à la fin du mois d’avril, ce travail sera complété.
M. Pierre Lellouche. Monsieur le président, je souhaiterais que les membres de la Commission puissent en avoir connaissance afin de mieux comprendre ce qui pourra être fait à l’avenir.
M. le président Georges Fenech. Ce sont des éléments que vous devez d’abord fournir à la justice, n’est-ce pas ?
Professeur Bertrand Ludes. En effet. Ces travaux sont effectués à la demande du procureur de la République, et maintenant des magistrats instructeurs.
M. le président Georges Fenech. Nous solliciterons le parquet pour savoir s’il est possible de nous communiquer ces informations.
Pourriez-vous nous en dire plus sur vos méthodes d’identification et évoquer les difficultés que vous avez pu rencontrer ?
Professeur Bertrand Ludes. L’identification est de la responsabilité de l’unité de police d’identification des victimes de catastrophes (UPIVC), qui se divise en une cellule ante-mortem et une cellule post-mortem. En ce qui nous concerne, nous concourons aux données post-mortem. Les enquêteurs, de leur côté, relèvent l’ensemble des signes primaires et secondaires – cicatrices, tatouages, empreintes digitales, empreintes génétiques, odontogrammes. Ce sont ces équipes qui présentent ensuite au magistrat les identifications, auxquelles nous adjoignons des constatations médicales pour que ce dernier puisse signer le permis d’inhumer. Il s’agit donc d’un travail d’équipe.
Les difficultés sont toujours liées au nombre de personnes, à l’altération éventuelle des corps et à la connaissance des éléments ante-mortem. Des équipes de l’UPIVC relèvent auprès des familles des éléments pour établir une fiche ante-mortem. Concomitamment, nous réalisons des fiches post-mortem avec les enquêteurs. Et c’est la comparaison des deux fiches qui permet d’établir l’identification.
M. le président Georges Fenech. Vous avez indiqué que le premier corps était arrivé à 6 heures du matin, le samedi 14 novembre, et le dernier à 10 heures 50, le jeudi 19 novembre. Comment expliquez-vous ce laps de temps ?
Professeur Bertrand Ludes. Nous avons reçu après le 14 novembre les corps des victimes décédées dans les hôpitaux. Et ensuite ceux des auteurs des attentats.
M. Christophe Cavard. J’aimerais avoir des précisions sur les étapes qui séparent les constats de décès sur place et le transport à l’Institut médico-légal. Qui prend la décision de transport des corps : le médecin qui constate le décès ou une autre personne ? Cette précision a son importance lorsque les décès sont aussi nombreux.
Comment les visites des proches se sont-elles concrètement déroulées ? Le nombre limité de places pour l’accueil des familles a-t-il posé des problèmes ?
Quelles demandes vous ont été faites s’agissant des corps des terroristes et quels travaux médicaux avez-vous eu à effectuer ?
M. le président Georges Fenech. Je rappelle que le professeur Ludes est tenu au secret de l’instruction. Il me paraît difficile pour lui de répondre à cette dernière question.
Professeur Bertrand Ludes. S’agissant du circuit, c’est l’officier de police judiciaire, placé auprès des médecins du SAMU et de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, qui décide du transport du corps et du lieu où il va être acheminé par des services de pompes-funèbres, avec des véhicules autorisés, une fois tous les indices nécessaires recueillis. La constatation de décès sur place est établie par les médecins-urgentistes et les réanimateurs. Je n’interviens qu’à la réception du corps à l’institut. Il n’y avait pas de membre de mon équipe sur place. Nous étions rassemblés à l’IML pour traiter au mieux la situation.
S’agissant de la visite du public, il faut préciser que le défunt peut être vu lorsqu’il a été identifié ou lorsque nous avons suffisamment de critères, au vu des éléments fournis par les officiers de police judiciaire, pour pouvoir présenter le corps. Il y a eu des personnes qui ont pris rendez-vous par l’intermédiaire de la CIAV, d’autres qui se sont rendues directement à l’Institut. Nous avons pris en charge les familles dans leur ordre d’arrivée. Elles ont d’abord été accueillies par les cellules d’urgence médico-psychologique (CUMP) installées sous des tentes à l’entrée de l’Institut. Puis, nous les avons fait patienter dans une des deux salles d’attente où elles étaient accompagnées par une psychologue-clinicienne qui leur a apporté son soutien et leur a expliqué comment les choses allaient se dérouler. Enfin, nous avons présenté chaque corps individuellement dans une vaste salle de présentation où la famille pouvait se recueillir. Autrement dit, les familles ont été prises en charge par étapes avec plusieurs sas de décompression pour essayer d’introduire autant de sérénité que possible.
Nous avons connu des pics de présentation, avec, par exemple, le lundi 16 novembre, quarante-trois corps.
Pour les terroristes eux-mêmes, je peux vous dire, tout en respectant le secret auquel je suis tenu, que le traitement médico-légal est le même. Les questions posées par le magistrat valent pour les victimes comme pour les auteurs. Nous devons déterminer un certain nombre d’éléments fixés dans la mission, donc, nous le faisons : ils figureront dans le rapport. Certaines familles des auteurs ont souhaité qu’il y ait présentation. Les opérations funéraires ont ensuite suivi leur cours en respectant la volonté des proches et la réglementation, mais de manière différée par rapport aux victimes des attentats, à quoi peut s’ajouter une complexité du travail plus importante.
M. le président Georges Fenech. Tous les corps ont-ils été identifiés ?
Professeur Bertrand Ludes. Pour les victimes, oui, monsieur le président.
M. Jean-Michel Villaumé. J’aimerais revenir sur l’accueil des familles. Nous avons auditionné des victimes et avons entendu des témoignages poignants. Je pense à celui de Sophie Dias, dont le père est mort au Stade de France. Votre personnel est-il formé pour accueillir les familles et annoncer les décès ?
Professeur Bertrand Ludes. Le personnel est formé pour l’accueil. Nous devrons certainement revoir ce qui touche à l’annonce de décès en grand nombre. Je ne pense pas pouvoir être autorisé à parler du cas que vous avez cité. Je ne souhaite pas m’exprimer en citant des noms propres.
M. le président Georges Fenech. Vous avez raison.
Mme Françoise Dumas. Pensez-vous que d’autres instituts médico-légaux auraient pu être mobilisés pour vous permettre de faire votre travail dans des conditions plus sereines ?
Professeur Bertrand Ludes. J’ai mobilisé d’autres instituts. Le samedi, dans l’après-midi, nous avons eu le renfort d’un collègue de Strasbourg et d’un collègue de Lille. Nous avons un réseau et pouvons l’activer.
Mme Françoise Dumas. Qu’en serait-il si des attentats analogues se produisaient en province ? Les mêmes prestations pourraient-elles être assurées ?
Professeur Bertrand Ludes. C’est un plan d’ensemble qu’il faudra étudier avec la communauté médico-légale. La Société française de médecine légale mène une réflexion en ce sens.
M. le rapporteur. En cas d’attaques en province, l’Institut de Paris serait-il en mesure de dépêcher des personnels ? Où en êtes-vous de vos réflexions ? Un protocole ou un plan est-il à l’étude ?
Professeur Bertrand Ludes. Un plan est en cours d’élaboration. Nous avons rendu notre copie et le ministère de la santé est en train de traiter les données.
La Société française de médecine légale a recensé les capacités des différents instituts médico-légaux de France et réfléchi aux possibilités de projeter des personnels, qu’il s’agisse de techniciens, de secrétaires, de médecins, et d’envoyer des matériels – cases réfrigérées et tables d’autopsie. Même si n’avons pas encore fait d’exercice, nous avons d’ores et déjà élaboré une vision d’ensemble.
M. le rapporteur. Dans les jours qui ont suivi l’attentat, avez-vous été perturbés par des tiers, à proximité des locaux ou par téléphone ? Comment avez-vous géré vos relations avec la presse ?
Professeur Bertrand Ludes. Très clairement, nous n’avons pas été gênés par des tiers. Notre autorité de soutien étant la préfecture de police de Paris, nous avons été immédiatement protégés : l’Institut peut être isolé en moins de dix minutes, comme nous avions déjà pu le constater après les attentats de janvier 2015. Les deux accès de l’IML étaient gardés par des fonctionnaires de police.
Quant aux relations avec la presse, nous n’avons pas eu à nous en soucier. C’est le service de communication de la préfecture de police qui s’en est occupé.
M. Jean Benet. S’agissant de la presse, lorsque les questions relevaient de l’autorité judiciaire, l’autorisation était demandée au procureur de la République. Il y a eu une prise en charge différenciée des réponses, selon qu’elles étaient techniques ou qu’elles mettaient en jeu la procédure judiciaire.
M. Georges Fenech. Monsieur le directeur, professeur, merci d’avoir contribué à nos travaux avec autant de précision.
Table ronde, ouverte à la presse, consacrée à la sécurité au Stade de France le 13 novembre 2015 : pour le Consortium Stade de France : M. Christophe Bionne, directeur de la sécurité et de la sûreté, M. Jean-Philippe Dos Santos, directeur-adjoint de la sûreté, Mme Florence Gaillot, assistante de direction, en charge de la saisie de la main courante de l’événement, M. Pascal Begain, chargé de sécurité incendie, M. Damien Chemla, préventeur, chargé des moyens humains et techniques, Mme Suzanne Delourme, chargée de sûreté ; pour la Fédération française de football : M. Victoriano Melero, directeur de cabinet du président et directeur général adjoint, Mme Cécile Grandsimon, responsable réglementation et gestion de la sécurité des rencontres, M. Didier Pinteaux, responsable sécurité et sûreté ; pour les sociétés privées de sécurité : M. Jean-Marc Peninou (Stand up), M. Mustapha Abba Sany (Gest n’sport), M. Bastien Rousseau (SGPS), M. Fabrice Laborie (ACA), M. Olivier Bruel (Alès Event’s), M. Olivier Ploix (ISMA), M. Christian Glaz (MCS), M. Ludovic Foret (JM Sécurité), M. Olivier Roussel (Europa Secure Dog), M. Bruno Lafond et M. Franck Chaboud (Main Sécurité)
Compte rendu de la table ronde, ouverte à la presse, du mercredi 16 mars 2016
M. le président Georges Fenech. Notre dernière table ronde de la journée porte sur les événements survenus au Stade de France le 13 novembre 2015 et l’action des différents intervenants chargés de la sécurité. Sont ainsi présents les responsables de la sécurité du Consortium Stade de France, de la Fédération française de football, ainsi que les personnels des sociétés privées, notamment de sécurité. Tous ont participé à la sécurisation du public le 13 novembre dernier.
Cette table ronde est ouverte à la presse. Elle fait l’objet d’une retransmission en direct sur le site internet de l’Assemblée nationale. Son enregistrement sera également disponible pendant quelques mois sur le portail vidéo de l’Assemblée nationale, et la Commission pourra décider de citer dans son rapport tout ou partie du compte rendu qui sera fait de cette audition.
Nous avons décidé que, d’une manière générale, nos auditions seraient ouvertes à la presse, car nous devons mener cette enquête en toute transparence.
Conformément aux dispositions de l’article 6 de l’ordonnance du 17 novembre 1958 relative aux commissions d’enquête, je vous demande de prêter le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité.
M. Christophe Bionne, M. Jean-Philippe Dos Santos, Mme Florence Gaillot, M. Pascal Begain, M. Damien Chemla, Mme Suzanne Delourme, MM. Jean-Marc Peninou, Mustapha Abba Sany, Bastien Rousseau, Fabrice Laborie, Olivier Bruel, Olivier Ploix, Christian Glaz, Ludovic Foret, Olivier Roussel, Bruno Lafond et Franck Chaboud, et M. Victoriano Melero, Mme Cécile Grandsimon et M. Didier Pinteaux prêtent serment.
M. le président Georges Fenech. Je vais donner la parole à M. Christophe Bionne et à M. Victoriano Melero pour un propos liminaire, puis un débat s’engagera, au cours duquel les membres de la Commission vous poseront, mesdames, messieurs, des questions.
M. Christophe Bionne, directeur de la sécurité et de la sûreté du Consortium Stade de France. La sécurité et la sûreté au Stade de France reposent sur des dispositifs créés en commun par l’organisateur – le 13 novembre, c’était la Fédération française de football – et l’exploitant, le Consortium Stade de France. Ces dispositifs, préparés en partenariat complet, sont ensuite présentés en préfecture de la Seine-Saint-Denis, puisque le poste de commandement opérationnel (PCO) lors des événements est placé sous l’autorité du préfet.
Nous sommes nombreux autour de cette table – merci de nous avoir invités – pour la simple et bonne raison que nous employons environ 1 200 agents de sûreté par événement au Stade de France, qui peut accueillir plus de 80 000 personnes. Pour réunir autant d’agents, nous recourons à plusieurs sociétés référencées par le Stade de France.
Comment le dispositif fonctionne-t-il le soir du 13 novembre ? C’est un peu flou, en ce sens où nous avons travaillé toute la nuit par réflexe et en complète coordination avec les services de l’État – police, brigade des sapeurs-pompiers de Paris (BSPP), services de secours –, sans oublier la société ISMA, qui prépare les dispositifs médicaux pour l’organisateur. Tout cela est le résultat d’un partenariat total : tous les dispositifs sont préparés, les acteurs se connaissent depuis maintenant plusieurs années et ont l’habitude de travailler ensemble. Nous avons également eu la chance d’avoir de grands professionnels avec nous, ce qui a concouru à la sécurisation de toutes les personnes dans le stade et surtout permis d’éviter des mouvements de foule dont les conséquences auraient pu être plus dramatiques que l’action des kamikazes à l’extérieur du Stade de France.
M. Victoriano Melero, directeur de cabinet et directeur général adjoint de la Fédération française de football. Je confirme tout à fait ce qu’a dit M. Bionne. La responsabilité de la sécurité de l’événement dans l’enceinte sportive relève de la Fédération en sa qualité d’organisateur, conformément au code du sport et aux dispositions législatives en vigueur. En pratique, il y a une véritable cogestion de la sécurité entre les équipes du Consortium et celles de la Fédération. La parfaite connaissance des hommes et des lieux a permis une parfaite coopération, une très grande réactivité, sans moment de flottement lorsqu’il s’est agi de prendre des décisions en fonction du déroulement des événements. Il y avait un peu plus de 1 000 agents de sécurité pour cet événement, soit le dispositif de sécurité classique mis en place pour chaque match important de l’équipe de France au Stade de France. Je rappelle que la coopération implique autant les équipes de sécurité du Consortium que les sociétés de sécurité, la Fédération et les autorités de l’État, sans oublier les services de secours. Si nous avons pu sécuriser l’enceinte sportive et procéder à l’évacuation des spectateurs sans heurt majeur, cela résulte vraiment du fait que les équipes se connaissent et que les décisions ont été prises en temps utile sans atermoiement.
M. le président Georges Fenech. Immédiatement après que les explosions ont retenti, à 21 h 19 puis à 21 h 22, aux portes D et H, quelles sont les premières mesures prises par les responsable de la sécurité, du Consortium Stade de France ou de la Fédération française de football, ou encore par les agents des sociétés de sécurité privée ?
M. Didier Pinteaux, responsable du pôle sûreté et sécurité de la Fédération française de football. En tant que responsable du pôle sûreté et sécurité de la Fédération française de football, j’étais coordinateur principal au PCO, auprès du préfet. Dès la deuxième explosion, M. le préfet a pris la main sur la manifestation. Il nous a demandé de sécuriser le secteur Est dans sa totalité et d’éviter tout départ de spectateur par ce même secteur. Avec le Consortium, nous avons pris des dispositions pour fermer des accès de sorte qu’aucun spectateur ne parte vers ce secteur. Toutes ces opérations ont été menées et, à la mi-temps, les spectateurs ont été sortis sur les secteurs Sud et Nord ; aucun n’a été autorisé à accéder au secteur Est. Pendant que les secours s’organisaient sous l’autorité du préfet, nous avons laissé la manifestation se poursuivre jusqu’ à son terme.
À la fin de la rencontre, nous devions faciliter le départ des spectateurs, toujours sans les laisser sortir par le secteur Est, pour éviter de les exposer à d’éventuels nouveaux attentats. Tout s’est bien passé, mais, deux minutes plus tard, un groupe de spectateurs est revenu dans le stade, par le secteur Sud, à la suite de l’explosion de pétards près de l’autoroute A86, en allant vers le RER D. Entre 2 000 et 5 000 spectateurs se sont ainsi réfugiés sur la pelouse. Vingt à vingt-cinq minutes plus tard, le commissaire principal présent au PCO ayant trouvé la cause des explosions, nous avons laissé ressortir les gens. Tous sont partis sans problème.
M. Sébastien Pietrasanta, rapporteur. On n’a pas très bien compris la manière dont les choses se sont passées au Stade de France, ni comment les terroristes, qui n’ont pas réussi à entrer, étaient organisés, structurés. On connaît le rôle joué par la sécurité privée, en particulier par le vigile qui a repoussé, dans une action héroïque et exemplaire, l’un des kamikazes, mais pas le scénario exact des événements. Quelle certitude aviez-vous qu’il n’y avait pas de risque de sur-attentat au moment de la sortie du public ? La question se pose d’autant plus que l’équipe allemande a refusé de quitter les lieux et dormi sur place. Quel était le niveau d’information, à ce moment-là ? Et comment la décision de laisser sortir les spectateurs a-t-elle été prise ?
M. Didier Pinteaux. Toutes les décisions ont été prises par M. le préfet. Pour toute décision que j’avais à prendre, je devais demander son autorisation. Lui seul pourra donc vous répondre sur ce point. Comme il travaillait avec les forces de l’ordre, sur place et à proximité des attentats, il est le seul à savoir.
M. le rapporteur. À 21 h 44, le préfet avait pris la décision d’interdire aux spectateurs de sortir du stade.
M. Didier Pinteaux. Il prend cette décision à la deuxième explosion.
M. le rapporteur. Selon le déroulé qui nous a été transmis, c’est à 21 h 44.
M. Didier Pinteaux. Non, c’est à la deuxième explosion.
M. le rapporteur. Selon la main courante qui nous a été transmise par certains d’entre vous : 21 h 44, ordre du préfet : « personne ne sort du stade ». Des spectateurs sont-ils sortis malgré cet ordre ? Les zones étaient-elles sécurisées ?
M. Didier Pinteaux. Ils essayaient de sortir, mais le préfet avait refusé toute sortie de spectateur du stade.
M. le rapporteur. Vers 21 h 45, j’imagine que des informations ont circulé, par SMS, par les réseaux sociaux, et que des spectateurs étaient au courant. Y a-t-il eu des mouvements de foule aux portes, des demandes de sortie ? Comment la foule a-t-elle été gérée à l’intérieur du Stade de France ? Pendant la deuxième mi-temps, on a vu que les tribunes ne se vidaient pas.
M. Didier Pinteaux. À notre grande surprise, justement, rien n’a circulé dans le stade, il n’y avait pas vraiment de communication. Les spectateurs ne bougeaient pas. Quelques-uns voulaient sortir, mais vraiment peu – entre 50 et 100.
M. le rapporteur. Vous dites que, étonnamment, ils n’avaient pas l’information ?
M. Didier Pinteaux. Je le pense.
M. Christophe Bionne. Moi, je pense que les gens qui avaient des informations n’y ont pas cru.
Pour en revenir au risque de sur-attentat, il y a eu trois explosions : les deux premières à trois minutes d’intervalle, la troisième environ vingt minutes plus tard. Après la troisième, nous savions qu’il y avait très peu de risques que les terroristes soient entrés dans le stade. Il a donc été décidé que les gens y seraient plus en sécurité. Nous avons attendu que la police ait bien vérifié la zone et tous les parcours vers les RER B et D, et la ligne 13 du métro, pour laisser partir les gens.
M. le rapporteur. Le match s’est terminé entre 22 h 45 et 22 h 50. La grande majorité des Français était au courant de ce qui se passait au Stade de France, tout au moins qu’il y avait des suppositions d’explosion. Ils pouvaient faire le rapprochement avec les attentats qui s’étaient produits dans cinq autres zones de Paris ; l’information s’est diffusée. Jusqu’à la fin du match, il n’y a eu aucun mouvement d’inquiétude ou de panique, aucune tentative de sortie ? Je serais étonné qu’aucun des 65 000 spectateurs n’ait eu d’information.
M. Christophe Bionne. Les informations ont circulé : le stade est connecté, les notifications push passent, et avec BFM TV et les différents réseaux, l’information circule très vite.
Après la deuxième explosion, j’ai quitté le secteur Ouest pour aller à l’Est. Dans un premier temps, le PCO a donné l’ordre de fermer toutes les portes. Nous avons tiré une ligne de barrières Vauban sur le parvis du Stade de France. Puis, voyant que les gens ne bougeaient pas, nous nous sommes rapprochés du bâtiment pour fermer les portes basculantes et les escaliers monumentaux. À la mi-temps, j’étais encore sur place. Les gens venaient regarder, mais ils ne voyaient rien parce que, même si les explosions ont vidé la rue, il n’y a eu ni départ de feu, ni véhicule retourné, ni fumée. Les gens n’ont pas réellement vu qu’il se passait quelque chose.
M. le rapporteur. J’entends bien. Ils ne voient rien et ils doutent, tant une explosion au Stade de France paraît surréaliste. Mais dans les minutes qui suivent…
M. Christophe Bionne. Aucun mouvement, monsieur le rapporteur.
M. le rapporteur. Mais entre ce moment, à 21 heures 20, et la fin du match, à 22 h 50, presque une heure et demie se passe pendant laquelle l’information circule. Les chaînes d’information continue, les réseaux sociaux, les proches informent, confirment qu’il y a eu des explosions au Stade de France. Ce qui se passe à Paris, notamment au Bataclan, est également connu. J’ai bien compris que, dans les minutes qui ont suivi les premières explosions et pendant la mi-temps, il n’y a rien eu de spécial. Mais plus la soirée avançait, plus les spectateurs étaient au courant. Comment expliquez-vous que la gestion de la foule n’ait posé aucune difficulté au sein du Stade de France ? Les gens se sentaient-ils en sécurité parce que confinés ?
M. Christophe Bionne. Notre plus grande crainte était les mouvements de foule. Aussi avons-nous demandé à tous les coordinateurs ou patrons de société ici présents de ne mentionner qu’un problème technique. À aucun moment, ils ne devaient parler d’attentats ou de kamikazes.
M. le rapporteur. Cette explication est-elle encore crédible à 22 h 30, alors que la terre entière est au courant ?
M. Christophe Bionne. Je n’ai pas d’autre explication à vous donner. Je ne peux vous dire que ce que nous avons fait : nous avons dit de ne jamais évoquer autre chose qu’un problème technique et d’être rassurant avec le public. C’est ce qui a été fait.
M. le rapporteur. Au risque de sur-attentat s’ajoutait, pour vous, les difficultés liées à la gestion de la foule. Un dispositif particulier a-t-il été mis en œuvre par le personnel, en lien avec la police ? Je crois savoir que l’entrée des « renforts pelouse », à 21 h 42, est habituelle pour éviter les intrusions sur la pelouse pendant la mi-temps. Cela n’avait rien à voir avec les attentats.
M. Christophe Bionne. Tout à fait.
M. le rapporteur. Quelles dispositions supplémentaires, liées aux attentats, ont été prises pour éviter les mouvements de foule, pendant le match et au moment où le préfet autorise la sortie des spectateurs ?
M. Christophe Bionne. Des agents ont été déplacés de leurs postes pour se rapprocher au plus près du public, le rassurer et bloquer les accès vers le secteur Est et la moitié du secteur Nord, où étaient initialement déployés les véhicules de la BSPP. En fin de compte, nous avons évacué le Stade de France par deux secteurs et demi au lieu de quatre, en positionnant des agents qui ont très bien fait leur travail. Je n’ai pas d’autre explication à vous donner.
Quant à l’équipe allemande, je pense qu’elle a reçu des consignes pour rester au Stade de France. Elle avait déjà subi, semble-t-il, une alerte à la bombe à l’hôtel, dans l’après-midi.
M. le président Georges Fenech. Pouvez-vous répéter cela ?
M. Christophe Bionne. Il nous a été dit qu’il y avait eu une alerte à la bombe à leur hôtel au cours de l’après-midi.
M. Victoriano Melero. Il y a eu une alerte à la bombe à leur hôtel. Avec, en plus, les événements autour du Stade de France, ils ont décidé de rester jusqu’à leur départ pour l’aéroport, à sept heures du matin.
M. le président Georges Fenech. À quel hôtel étaient-ils descendus ?
M. Victoriano Melero. Au Molitor, porte d’Auteuil.
M. le rapporteur. À la mi-temps, vers 21 h 45, personne ne sort du stade. Outre la consigne que vous aviez donnée au personnel de communiquer sur des problèmes techniques, des messages ont-ils été diffusés à la mi-temps ? Je sais qu’il y en a eu à l’issue du match.
M. Christophe Bionne. Pour égayer la soirée, des animations au cours de la mi-temps sont prévues par l’organisateur. Nous avons suivi le programme normal ; toutes les animations se sont déroulées, et il n’y a pas eu de message pour dire autre chose. Nous avons été aussi surpris que vous l’êtes ce soir de voir que le public ne réagissait pas.
M. Didier Pinteaux. L’objectif principal que nous avait donné le préfet était clair : personne ne devait aller dans le secteur Est. Compte tenu de la deuxième explosion, il voulait le sécuriser en totalité, en prenant le temps qu’il faudrait pour lever le doute. Le deuxième point, c’était de rassurer les spectateurs présents dans le stade. Pour ce faire, nous avons donné l’instruction à l’ensemble des personnels d’invoquer un incident technique pour expliquer la fermeture des grilles. En voyant cela, un habitué comprend vite qu’il y a un problème, car ce n’est pas un dispositif habituel en cours de manifestation. Le message a été parfaitement passé par le personnel de sûreté, et aucun mouvement de foule n’a été observé pendant toute cette période.
M. Meyer Habib. La Fédération a-t-elle envisagé, à un moment donné, d’interrompre le match ? Je comprends que l’on craigne des mouvements de foule, mais il y a quand même des terroristes qui se font exploser au sein du Stade de France !
M. Christophe Bionne. À l’extérieur du Stade de France, monsieur le député !
M. Meyer Habib. Oui, à l’extérieur. Cette question s’est-elle néanmoins posée ?
Nous avons longuement auditionné le vigile, psychologiquement extrêmement marqué, qui a vu le kamikaze. Il l’a remarqué longtemps avant qu’il ne se fasse exploser, et il pensait qu’il s’agissait d’un policier. Que se serait-il passé si, au lieu d’attendre à l’extérieur du stade, le kamikaze était entré une demi-heure, un quart d’heure avant le match, lorsque les gens font la queue pour passer les contrôles de sécurité ? Notre chance est qu’il se soit fait exploser après le début du match, et à l’extérieur. Depuis, votre protocole de fouille a-t-il changé ? Je sais qu’il y a une palpation physique de tous les spectateurs.
M. Christophe Bionne. Je laisserai la FFF s’exprimer sur l’éventualité d’un arrêt du match. Je demanderai aussi à M. Dos Santos et à M. Pinteaux d’évoquer les dispositifs mis en place depuis les attentats, en partenariat avec la direction de l’ordre public et de la circulation (DOPC) et la préfecture de Seine-Saint-Denis.
M. Victoriano Melero. La décision de continuer le match a été prise par les autorités de l’État présentes sur le site ce soir-là. Après concertation avec le préfet, les forces de police et les autorités politiques présentes, il a été décidé, assez rapidement, par tout le monde, que l’endroit le plus sécurisé était l’enceinte du stade. Si la question d’un arrêt s’est posée, très vite, les autorités de l’État ont pris la décision que le match continuerait comme si de rien n’était. Peut-être M. Pinteaux pourra-t-il répondre aux autres questions.
M. Didier Pinteaux. Je laisserai la parole à M. Dos Santos, qui a œuvré lors des matchs de rugby joués au Stade de France depuis les attentats. Le même dispositif exactement sera déployé lors du prochain match de l’équipe de France – France-Russie, le 29 mars prochain.
M. Jean-Philippe Dos Santos, directeur adjoint de la sûreté du consortium Stade de France. Le dispositif de sécurité à l’extérieur du stade a été beaucoup modifié, au niveau des entrées des parkings publics et des parkings à l’intérieur du stade, notamment pour les VIP qui stationnent au P0. Tous les passagers descendent des véhicules pour une fouille complète. En plus du contrôle de l’habitacle et du coffre, qui était déjà pratiqué, des équipes cynophiles spécialisées dans la détection d’explosifs ont été déployées sur les parkings. Ce système convenait à l’ensemble des parties prenantes, mais nous nous sommes vite aperçus que les explosifs pouvaient être remontés à l’intérieur du parking, sous forme de très petites pièces. Nous avons donc décidé de contrôler une deuxième fois les personnes qui sortent des parkings. Une fois qu’elles ont emprunté les escaliers qui les ramènent au niveau des portes d’entrée du stade, la même fouille est donc refaite par des stadiers – ouverture des blousons, contrôle des sacs, palpation rapide uniquement sur la partie haute du corps. Une fois passés les parkings, un pré-filtrage a lieu au niveau des portes pour vérifier que les personnes qui se présentent détiennent bien un billet. Ensuite, elles passent leur billet au niveau des tripodes, derrière lesquels une palpation complète est refaite.
Le stade étant ouvert également sur l’avenue Jules Rimet, où se trouvent des commerces dont il n’est pas question d’interdire l’accès, nous ne contrôlons pas les billets. En revanche, deux heures avant le coup d’envoi – donc à 17 heures pour un match à 19 heures –, tout un dispositif est mis en place sur sept points de contrôle, avec des stadiers et des forces de l’ordre. La procédure est la même : ouverture des blousons, contrôle des sacs, palpation du haut du corps avant d’accéder au périmètre. Puis les gens suivent le même cheminement que les personnes arrivées par les parkings : contrôle du billet au niveau du barriérage, passage aux tripodes et palpation complète. Tous ces points sont requadrillés par les forces de l’ordre. Les stadiers sont en premier rideau ; derrière, nous avons toujours des forces de police armées, prêtes à intervenir, sur tous les points de filtrage, mais également aux parkings.
Depuis les trois derniers matchs, la direction de l’ordre public et de la circulation met également, sur les accès aux parkings, trois véhicules équipées du système de lecture automatisée de plaques d’immatriculation (LAPI) qui permet de savoir tout de suite si un véhicule est recherché pour un motif quelconque. La veille des événements nous faisons également les mêmes fouilles.
Nous ne pouvons pas contrôler tous les semi-remorques qui viennent pour des livraisons à l’intérieur du stade, mais les identités de toutes les personnes qui accèdent au stade sont récupérées. Des véhicules sont choisis aléatoirement pour être complètement déchargés : les stadiers les accompagnent jusqu’au point de déchargement où les caisses et les cartons sont ouverts. Malheureusement, on ne peut pas le faire pour tous les véhicules, cela représenterait un travail immense, et, surtout, un gros retard pour toutes les préparations. La majorité des véhicules n’en est pas moins vérifiée.
M. le président Georges Fenech. Vous n’êtes pas obligés de donner tous les détails.
M. le rapporteur. Aux abords du stade, comment sont répartis les périmètres de compétence entre stadiers, vigiles et forces de police ?
Selon quel processus les sociétés de sécurité sont-elles choisies ? Comment sont recrutés les vigiles et les stadiers, et sur quelle qualification ?
M. Jean-Philippe Dos Santos. Les sociétés répondent à un appel d’offres. Aujourd’hui, nous en avons référencé treize. Selon le type d’événement, elles sont huit ou neuf à intervenir au stade. Le recrutement est géré directement par les entreprises. Nous avons choisi chacune des sociétés par rapport à un type d’activité. Certaines sont plus spécialisées sur les palpations, d’autres sur le contrôle d’accès.
Sur le mail extérieur, une coordination est faite avec les forces de l’ordre. Nous n’intervenons que sur les pré-fouilles, les forces de l’ordre vont intervenir sur tous les problèmes qu’il pourrait y avoir sur le mail – mouvements de foule, etc.
M. le rapporteur. Plus précisément, y a-t-il, à votre niveau ou à celui des sociétés de sécurité, un travail de criblage effectué avec les services de renseignement ? De tels dispositifs sont prévus, et renforcés, à la RATP et à la SNCF, notamment à la suite de l’adoption récente d’une proposition de loi.
M. Christophe Bionne. Les 5 000 personnes qui travaillent sur un événement au Stade de France, des vendeurs d’écharpes aux buffetiers, sont accréditées. La seule autre manière d’entrer au Stade de France un jour d’événement est d’avoir un billet pour assister audit événement. La FFF nous délègue la mission d’édition des accréditations. Toutes les sociétés qui doivent ou veulent travailler au Stade de France reçoivent un fichier qui est ensuite transmis à différents services pour criblage. Les agents de sécurité ont obligatoirement la carte professionnelle délivrée par le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS). Depuis maintenant deux ans, le numéro de la carte professionnelle doit être inscrit à l’accréditation, pour une vérification directe, avec les services de l’État, de la conformité de la carte professionnelle.
M. le président Georges Fenech. Le criblage a-t-il donné des résultats ?
M. Christophe Bionne. Je ne suis pas au courant de cela.
M. Christophe Cavard. Le soir du 13 novembre, il se passe des choses à l’extérieur puisque la personne qui n’a pas pu entrer choisit de se faire exploser à côté d’un bar. Votre personnel est-il vraiment confiné à l’intérieur ou bien, compte tenu de la situation, une partie se retrouve-t-elle à l’extérieur ?
Des consignes sont données pour éviter les mouvements de foule et le public n’est pas informé. Mais qu’en est-il de l’information délivrée à votre personnel ? À quel niveau hiérarchique est-il mis au courant de la réalité de l’attentat ?
En tant que député de province, j’aimerais savoir si le Stade de France possède des spécificités en matière de sécurité que ne présenteraient pas des stades importants de province ? La FFF travaille-t-elle sur de possibles évolutions des dispositifs dans ces stades ?
Des évolutions législatives sont actuellement à l’étude s’agissant de droits administratifs nouveaux conférés aux personnels de sécurité privée intervenant lors des grands événements. L’avis administratif rendu sur les personnels en voie de recrutement s’en trouverait renforcé mais n’aurait toujours qu’une valeur d’avis. Quelle serait l’attitude des chefs d’entreprise de sécurité vis-à-vis de cet avis ?
M. Christophe Bionne. Le périmètre d’action d’un agent de sûreté sur la voie publique est soumis à l’autorisation du préfet. Les différents périmètres tracés entre les organisateurs, l’exploitant et la police sont donc présentés pour autorisation préfectorale. On demande aux sociétés de sécurité qui auront à placer des agents sur les extérieurs d’en donner les noms et numéros de carte professionnelle ; on les transmet à la préfecture, et le préfet prend un arrêté qui autorise ces sociétés à travailler sur la voie publique.
Le Stade de France comporte dix-huit portes. Pour pouvoir réguler au mieux les flux du public, un barriérage avec pré-filtrage est installé. Deux agents de sécurité vérifient que vous êtes bien porteur d’un billet. Le stade est sectorisé : si vous êtes muni d’un billet pour le secteur Est, vous ne pourrez pas entrer à l’Ouest. Pour éviter aux gens de faire la queue et les diriger au mieux, les agents de sûreté sont chargés d’une mission d’accueil et les invitent à se diriger vers la bonne porte. Cela permet aussi de réguler au mieux les palpations de sécurité.
Qui était au courant de quoi ? Il est impossible de communiquer par texto ou par téléphone avec toutes les personnes avec qui nous travaillons. Nous utilisons des talkies-walkies, entre 600 et 800 par événement, avec cinquante et un groupes de parole, dont l’un est réservé aux coordinateurs et aux dirigeants, en plus de ce qu’a la FFF. Nous communiquons sur ce canal.
M. Christophe Cavard. Jusqu’à quel niveau les personnes présentes sont-elles au courant qu’il y a une attaque terroriste ?
M. Christophe Bionne. Personnellement, je suis arrivé cinq minutes après la deuxième explosion ; j’ai donc pu apprécier par moi-même. Puis je suis revenu au poste de commandement opérationnel relever Jean-Philippe Dos Santos, qui est parti sur le site. Le PCO du Stade de France est une ligne droite le long de laquelle se succèdent la police, la sécurité de l’organisateur, l’exploitant, la RATP, la SNCF, la BSPP et le SAMU. Nous sommes tous là et c’est pourquoi nous avons eu de bons résultats : nous nous connaissons tous, nous travaillons ensemble à chaque événement, nous participons à toutes les réunions de sécurité en préfecture. Nous travaillons également sur tous les dossiers d’animation avec la BSPP. C’est vraiment un travail collégial, et c’est pourquoi ça marche aussi bien.
M. le rapporteur. Dites-vous à votre personnel qu’il y a eu des attentats ? Si oui, à quel moment ? Ou bien ne parlez-vous que d’un problème technique ?
M. Didier Pinteaux. Nous ne parlons que d’un problème technique. Et cela a été transmis aux coordinateurs et responsables par moi-même.
M. le rapporteur. Jamais des responsables intermédiaires ne vous ont interrogé ? Personne ne vous a dit « vous vous fichez un peu de moi alors que j’ai reçu telle ou telle alerte » ?
M. Christophe Bionne. Absolument pas.
M. le rapporteur. Je vous crois, mais j’ai du mal à me dire que, jusqu’à la fin du match, personne, ni dans le personnel ni dans le public, n’ait douté de vos problèmes techniques alors que des alertes parlant d’explosions de kamikazes au Stade de France et d’attentats en plein Paris étaient envoyées de partout.
M. Christophe Bionne. Personne. Les seules personnes qui voulaient bouger, c’étaient les journalistes.
M. le rapporteur. Je veux bien vous croire mais c’est extraordinaire !
M. Christophe Bionne. Nous avons prêté le serment de dire la vérité. De plus, nous avons une machine qui nous permet d’enregistrer les talkies-walkies.
M. Victoriano Melero. Ce qui a été fait porte la marque d’un très grand professionnalisme de l’ensemble du personnel.
M. le rapporteur. C’est vrai. Nous avons d’ailleurs auditionné, au début de nos travaux, l’un de vos collègues vigiles dont l’action fut héroïque. Reste que c’est étonnant.
M. Victoriano Melero. En ce qui concerne la province, tout déplacement de l’équipe de France donne lieu à des repérages sur le site où elle jouera et à des réunions, notamment en préfecture, pour définir le dispositif de sécurité. Bien entendu, compte tenu des événements, des dispositifs de sécurité renforcés seront mis en place pour les matchs qui auront lieu en province au cours des prochains mois. De toute façon, par principe, il y a toujours une organisation, des réunions de sécurité, une forte collaboration avec l’exploitant du stade. En raison du contexte particulier, les dispositifs seront renforcés, en concertation avec les autorités locales.
M. Christophe Cavard. Existe-t-il un « protocole attentat » qui anticipe jusqu’à des événements tels que ceux de la soirée du 13 novembre ? Ces derniers ont-ils révélés la nécessité d’apporter des évolutions ?
M. Didier Pinteaux. Il n’y a pas de protocole dédié prêt, mais tous, en particulier M. le préfet, nous avons en tête tout ce qui peut se passer lors d’une grande manifestation sportive rassemblant un grand nombre de spectateurs.
M. le rapporteur. Combien y a-t-il de vigiles par porte ?
M. Jean-Philippe Dos Santos. Cela varie en fonction du type d’événement et du public attendu. Le Stade de France est équipé de 141 tripodes et, ce soir-là, je crois qu’il y avait au total 170 agents. Il y avait donc une dizaine d’agents par porte.
M. le rapporteur. Une fois le match commencé, les vigiles restent-ils à une dizaine par porte ou bien sont-ils déplacés ailleurs ? Les explosions ont eu lieu à proximité des portes D et H, alors que le public était déjà rentré. Combien de vigiles étaient alors présents ?
M. Didier Pinteaux. Il faudrait voir cela avec la société Main Sécurité.
Lorsque nous fermons les portes du stade, nous en laissons une d’ouverte par secteur. Ce soir-là, nous voulions tester un déploiement des stadiers sur une autre mission, et nous nous sommes retrouvés avec beaucoup moins d’agents que prévu aux portes, étant donné qu’elles étaient fermées. Ne restaient donc que les agents qui devaient retirer le barriérage devant les portes pour préparer l’évacuation. Ils étaient très peu. Il faudrait demander à M. Bruno Lafond.
M. le rapporteur. Je complète mon propos avant que nous ne lui laissions la parole. J’imagine qu’au moment des explosions, des vigiles, des personnels équipés d’une radio étaient présents. Jamais les autres vigiles n’ont été au courant de ce qui s’est passé ? Ceux qui ont vu les explosions n’ont pas communiqué ? Ensuite, des ambulances, des pompiers sont arrivés… Tout cela n’a suscité aucune interrogation ni fait l’objet de transmissions entre collègues, de porte à porte ? L’information ne s’est pas répandue ?
M. Didier Pinteaux. Au PCO, l’ordre que j’avais donné à tous les responsables de société et coordinateurs de secteur était clair : on ne voulait entendre aucune communication parlant de l’attentat.
M. le rapporteur. Monsieur Lafond, pouvez-vous nous dire ce qu’il en était de vos vigiles ?
M. Bruno Lafond, représentant la société Main Sécurité. Les seuls stadiers qui ont pu voir les explosions sont ceux qui se trouvaient aux portes où elles se sont produites. Seuls les chefs d’équipe sont munis de talkies-walkies et ceux qui se trouvaient là ont peut-être communiqué entre eux. Mais pour ce qui est des stadiers, seuls ceux qui étaient à ces portes ont pu voir ce qui s’était passé. Il n’y a pas eu d’autre mouvement, même sur les autres portes.
M. Jean-Jacques Cottel. Nous sommes effectivement étonnés du calme qui a régné dans ce stade, et nous ne pouvons que nous satisfaire que vous n’ayez pas communiqué et que la foule n’ait pas réagi.
D’ordinaire, combien de temps faut-il pour évacuer les lieux lors d’une manifestation où il ne se passe rien d’exceptionnel ?
Dans la perspective de l’Euro de football prochain, des stadiers sont recrutés, qui ne sont pas des professionnels. La FFF peut-elle indiquer quels critères de recrutement sont retenus pour avoir le plus de garanties possible ?
M. Victoriano Melero. La sécurité est assurée par des professionnels. Des volontaires et des bénévoles participent effectivement à l’organisation d’événements internationaux, mais en aucun cas ne leur sont confiées des missions de sécurité.
Les sociétés de sécurité ont été sélectionnées à la suite d’un appel d’offres de la société Euro 2016 SAS. Bien entendu, bon nombre des sociétés qui assurent aujourd’hui la sécurité autour du Stade de France seront de la partie pour l’Euro 2016.
M. Christophe Bionne. Le Stade de France, qui peut contenir environ 80 000 personnes, se vide, si tout se passe bien, en huit minutes. Ensuite, les spectateurs cheminent vers les différentes gares. Pour assurer une meilleure régulation, les services de police et de gendarmerie, parfois accompagnés de gardes républicains à cheval, procèdent à une sorte de filtrage et de régulation du flux. Il y a aussi toute une coordination avec les points de vente que l’on gère à l’extérieur, pour faire des points d’accroche et éviter que tout le monde arrive à la gare en même temps – une rame de métro ou de train, c’est 2 500 personnes. C’est pour assurer cette régulation que des responsables de la SNCF et de la RATP sont présents au PCO. Une convention RATP-police nous permet aussi d’avoir un retour des images des différents quais des RER B et D et de la ligne 13 du métro.
M. le rapporteur. Le même vigile que nous avons auditionné a dit que lors de la première explosion, à la porte D, des vigiles qui se trouvaient avec lui à la porte H se déportent vers la porte D. Du coup, il se retrouve assez seul à sa porte où a lieu la deuxième explosion. Ce déport de vigiles correspond-il à un protocole en cas d’incident qui surviendrait à une porte ? Dès lors, n’y a-t-il pas de risque d’affaiblir la protection des autres ?
M. Didier Pinteaux. La première chose que l’on demande, c’est de fermer la porte pour éviter que les spectateurs entrent. La deuxième, c’est de faire un périmètre de sécurité pour écarter l’ensemble des personnels. C’est pourquoi ils partent vers des portes qui se trouvent à proximité.
M. le rapporteur. En l’occurrence, les portes ont-elles été fermées lors de la première explosion ?
M. Didier Pinteaux. Nous étions en train de les fermer, comme on le fait normalement une fois que les spectateurs sont entrés dans le stade. On le sécurise en limitant le nombre de portes ouvertes à quatre sur dix-huit – une par secteur.
M. le rapporteur. Quelle a été la consigne au moment de la première explosion ? A priori, vous ne savez pas alors qu’il y a un attentat.
M. Didier Pinteaux. Nous avons simplement sécurisé la zone proche. Nous pensions qu’une bouteille de gaz avait explosé à proximité. La vidéosurveillance montrait que les barres étaient retournées, mais pas de victime au sol. Nous pensions à un simple acte de malveillance. C’est à la deuxième explosion que nous avons su que c’était un attentat.
M. le président. Et c’est à 21 h 09 que les portes avaient été fermées, à l’exception de quatre pour les retardataires.
M. le rapporteur. Sans forcément tout dévoiler, avez-vous eu un retour d’expérience suggérant que tel ou tel dispositif devrait être amélioré ? Pouvez-vous dire lesquels ?
M. Victoriano Melero. Une réunion s’est tenue en préfecture avec l’ensemble des personnes et services concernés ce jour-là, pour faire un état des lieux de ce qui avait bien marché et ce qui avait moins bien marché. Des préconisations en sont ressorties, dont certaines seront mises en œuvre, et même renforcées, pour l’Euro 2016. Donc, oui, il y a bien eu des retours d’expérience, au niveau de l’ensemble des acteurs et du ministère de l’intérieur, notamment dans la perspective de l’Euro 2016.
M. le président. Vous parlez de moyens et de dispositifs nouveaux par rapport à ce qui existait jusqu’à maintenant ?
M. Victoriano Melero. Des dispositifs renforcés.
M. le président. On peut le dire, nous avons frôlé une terrible catastrophe. Qu’il n’y ait pas eu d’autre victime que M. Dias relève du miracle. Le risque zéro n’existe pas, mais pensez-vous véritablement que tous les dispositifs nouveaux permettront d’être plus efficace encore pour se prémunir de ce genre d’agression ?
M. Christophe Bionne. Il est difficile de répondre à cette question. Nous faisons tout pour assurer la sécurité du public, c’est un fait. Pour ma part, je me suis refait plusieurs fois le film de cette soirée : je n’aurais pas voulu faire différemment. Heureusement, nous avons eu beaucoup de chance, mais notre chance aussi, c’est de travailler avec de grands professionnels, en toute confiance et transparence. C’est une des clés de notre réussite, à mettre au crédit des acteurs tant de la sécurité privée que de la sécurité publique, même si on peut se féliciter d’avoir aussi un petit peu d’amateurisme de l’autre côté.
M. Christophe Cavard. Il y a une vie au Stade de France, et pas seulement les soirs de match. Même s’il y a des gardiens, comment vérifie-t-on, après un match ou à la fin d’une journée ordinaire, que le stade est vide au moment de tout fermer ?
M. Christophe Bionne. Nous avons différents systèmes de contrôle. Le plus simple consiste, comme à l’entrée de l’Assemblée nationale, à remettre un badge en échange d’une pièce d’identité, cela pour tout le monde. D’autres processus dont, si vous me le permettez, je ne donnerai pas le détail, impliquent des points de filtration, des agents de sûreté, un système de vidéosurveillance…
M. le président Georges Fenech. Quelqu’un parmi les personnes présentes souhaite-t-il apporter un complément ?
M. Olivier Ploix, représentant la société ISMA. La société ISMA, dont je suis le directeur des opérations, a un profil particulier en ce qu’elle assure, pour l’organisateur, la coordination du service médical et des secours. À ce titre, elle se réfère, pour son dispositif prévisionnel de secours, aux recommandations en termes de médicalisation, d’organisation de matériels et de compétences, émises au mois de juillet 2014 par SAMU-Urgences de France à destination des organisateurs.
Nous sommes présents au Stade de France et nous sommes également présents en province, où nous couvrons, à l’année, neuf sites accueillant de grands événements. Y sont pré-positionnés à la fois des médecins, des infirmiers, une coordination médicale, une interface avec les services publics et du matériel de réanimation. Le soir du 13 novembre, nous avons géré jusqu’à deux heures du matin 200 personnes impliquées dans ce qui s’est passé et en avons évacué trente-quatre sans saturer les hôpitaux de périphérie ou à proximité immédiate, ni affecter notablement leur activité. Nous avons pris le relais, à l’intérieur du stade, et géré toutes les personnes impliquées dans la première vague liée directement aux attentats, puis dans le mouvement de foule de la fin de l’événement. Nous avons pu traiter les urgences, retarder ce qui était moins urgent et orienter en coordination avec la BSPP, en bref, nous avons pu gérer le dispositif.
Nous faisons partie intégrante du service de sécurité, et sommes soumis aux mêmes règles et aux mêmes contrôles. Notre personnel était totalement informé, puisqu’au contact des victimes, mais suffisamment occupé pour ne pas pouvoir échanger. Les communications avec l’extérieur étaient très compliquées du fait de la saturation des réseaux – data, téléphoniques et SMS – qui se produit dès lors que le Stade de France est plein. La capacité d’information des personnes présentes était donc limitée.
Je voulais juste souligner qu’outre la sécurité et les questions de contrôle, il faut gérer à la fois le quotidien, les pathologies qui se rencontrent habituellement dans une population de 80 000 personnes, mais aussi anticiper le risque, l’enjeu étant la capacité de réaction immédiate en attendant le déploiement des secours. En l’espèce, la situation était d’autant plus compliquée qu’il s’agissait d’attentats multi-sites, et que nous avons dû gérer avec le dispositif intérieur ce qui se passait non seulement à l’intérieur, mais aussi à l’extérieur, certaines personnes ayant dû être rapatriées à l’intérieur, car les moyens de secours publics étaient dépassés en périphérie et au centre de Paris.
M. le président Georges Fenech. Vous avez indiqué qu’un poste médical avancé avait été déployé place du Cornillon. Qui l’a mis en place ?
M. Olivier Ploix. Il y en a eu deux : l’un, mis en place par la BSPP, pour gérer ce qui était extérieur, et le nôtre, à l’intérieur du stade, dans les sous-sols, au niveau du centre médical principal. Le commandant des opérations des sapeurs-pompiers de Paris était présent à l’intérieur du site, pré-positionné au niveau de la régulation, pour gérer en interne tout ce qui était gérable avec le matériel et le personnel sur place.
M. le président Georges Fenech. Quelqu’un d’autre veut-il ajouter quelque chose ?
M. Christophe Bionne. Juste une petite réflexion concernant les aptitudes qui seront requises à l’avenir pour les agents de sécurité. Ayant, dans une autre vie, été dans la situation des prestataires actuels du Stade de France, il me paraîtrait utile et nécessaire de s’appuyer davantage sur la formation des agents de sécurité. De ce point de vue, il faut les aider. Aujourd’hui, on leur demande de faire de plus en plus de choses, mais il faudrait un peu plus les accompagner au niveau des formations. Ce n’est pas parce qu’on a obtenu son permis de conduire lors du passage devant un examinateur qu’on sait conduire. Dans cet esprit, comme pour toute mission, une formation continue ou des rappels seraient les bienvenus.
M. le président Georges Fenech. La Commission vous a entendu et en tiendra compte.
Mesdames, messieurs, je vous remercie beaucoup de votre disponibilité et de vos réponses, qui nous seront extrêmement utiles.
Audition, à huis clos, du commissaire divisionnaire X et du brigadier Z, son chauffeur
Compte rendu de l’audition, à huis clos, du jeudi 17 mars 2016
M. le président Georges Fenech. Nous avons le plaisir et l’honneur d’accueillir deux fonctionnaires de police d’exception, dont nous saluons l’action menée le 13 novembre 2015, au péril de leur vie. Il s’agit du commissaire divisionnaire X et du brigadier Z, son chauffeur, primo-intervenants au Bataclan, où nous nous sommes rendus ce matin.
Nous y avons eu le récit chronologique de l’intervention des trois services : la Direction de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne (DSPAP), le RAID et la Brigade de recherche et d’intervention (BRI). Cela nous a permis, messieurs, de nous rendre compte de la difficulté de votre intervention, et du sang-froid dont vous avez fait preuve pour mettre un terme à l’action de l’un des terroristes.
Je vous remercie d'avoir répondu à la demande d'audition de notre commission d'enquête relative aux moyens mis en œuvre par l'État pour lutter contre le terrorisme depuis le 7 janvier 2015.
Au nom de l'ensemble des membres de la commission d'enquête, je salue votre courage et votre exceptionnel sang-froid. Vous êtes donc intervenus les premiers sur les lieux de l'attentat au Bataclan, et votre témoignage sera particulièrement précieux pour permettre à la Commission de comprendre comment neutraliser les terroristes dans ce genre de circonstances.
Cette audition, en raison de la confidentialité des informations que vous êtes susceptibles de nous délivrer, se déroule à huis clos et n'est donc pas diffusée sur le site internet de l'Assemblée. Au demeurant, je précise que pour des raisons de sécurité, vous vous exprimez sous couvert de l'anonymat.
Néanmoins, et conformément à l'article 6 de l'ordonnance 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, le compte rendu de cette audition – toujours sous couvert de l’anonymat– pourra être publié en tout ou partie, si nous en décidons ainsi à l'issue de nos travaux. Je précise que les comptes rendus des auditions qui auront eu lieu à huis clos seront au préalable transmis aux personnes entendues afin de recueillir leurs observations. Ces observations seront soumises à la commission, qui pourra décider d'en faire état dans son rapport.
Je rappelle que, conformément aux dispositions du même article, « sera punie des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal – un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende – toute personne qui, dans un délai de vingt-cinq ans divulguera ou publiera une information relative aux travaux non publics d'une commission d'enquête, sauf si le rapport publié à la fin des travaux de la commission a fait état de cette information ».
Conformément aux dispositions de l'article 6 précité, je vais maintenant vous demander de prêter le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité.
Le commissaire divisionnaire X et le brigadier Z, son chauffeur, prêtent successivement serment.
Monsieur le commissaire divisionnaire X , je vous laisse la parole afin que vous nous relatiez les circonstances de votre intervention. Nous vous poserons ensuite des questions, ainsi qu’à votre chauffeur.
Commissaire divisionnaire X. Avant tout, je tiens à vous informer des difficultés que nous allons certainement avoir à donner une vue d’ensemble de la situation cette nuit-là. Pendant ce que nous appelons en termes policiers « l’effet tunnel », nous avons eu, en effet, une vision assez parcellaire de ce qui s’est passé. Mon chauffeur et moi-même, n’avons d’ailleurs pas eu la même vision des faits alors que nous n’étions qu’à quelques mètres l’un de l’autre. De même, d’un point de vue chronologique, il a été assez difficile pour nous de répertorier dans le temps l’ensemble des éléments que nous avons eu à vivre.
Le début de soirée s’est déroulé de manière tout à fait banale. Nous prenons notre service vers 18 heures. Nous nous sommes rendus à la préfecture de police pour y prendre nos instructions comme à l’accoutumée, en ayant équipé notre véhicule avec le matériel nécessaire à notre mission. Il s’agit essentiellement de matériel de maintien de l’ordre, puisque notre action porte principalement sur l’anticriminalité et le maintien de l’ordre. De retour au service, je me suis attelé à mes tâches administratives habituelles. Vers 21 h 20 ou 21 h 25, j’ai été avisé par la salle d’information et de commandement avec laquelle je suis en lien permanent, téléphoniquement et par l’écoute des ondes radiophoniques, qu’une explosion avait eu lieu au Stade de France.
Je n’avais pas en charge ce service, qui était sous la compétence de la Direction de l'ordre public et de la circulation (DOPC). J’ai donc contacté mon collègue de la BAC 93 – qui dépend de la DSPAP – et qui se trouvait sur place. Dans un premier temps, il n’avait pas d’information précise à me communiquer. Il m’a dit qu’il s’agissait peut-être d’un mortier. Dans l’attente d’informations supplémentaires, je suis resté au service. Ensuite, mon directeur m’a contacté téléphoniquement pour me demander des précisions. J’ai alors décidé de me rendre sur place. Avant de monter à bord de notre véhicule, j’ai croisé C. P., ma collègue de la BAC 75 que vous avez vue ce matin, alors qu’elle arrivait au service. Je lui ai fait un point rapide de la situation et lui ai demandé de s’équiper en urgence, en lui disant que nous partions sur le Stade de France.
Nos effectifs ne prennent leur service qu’à 22 heures 20. À cette heure, nous n’avions donc encore aucun effectif de la BAC 75 à notre disposition. Nous sommes montés rapidement dans le véhicule, et c’est à ce moment qu’ont eu lieu les appels pour la première fusillade, au niveau de la rue Bichat. Je précise que nous basés boulevard Bessières, entre la porte de Clichy et celle de Saint-Ouen. En tant que chef de service, j’ai alors hésité sur l’option à prendre : je ne savais pas s’il fallait que je reste sur Paris ou que je parte sur le Stade de France. Ce sont des options opérationnelles sur lesquelles nous devons faire des choix en permanence. J’ai finalement décidé de m’en tenir à ma destination initiale du Stade de France. Nous devions alors nous trouver au niveau de la porte de Clignancourt.
Il y a ensuite eu un second appel confirmant la fusillade. J’ai alors considéré que la situation était plus grave sur Paris, et j’ai donné pour instruction à mon équipier de se dérouter et de repartir sur Paris. J’ai avisé mon directeur téléphoniquement, lui disant que les informations concernant la situation au Stade de France lui seraient communiquées par mon collègue. Il a confirmé mon choix.
Nous nous sommes dirigés vers le centre de Paris en empruntant le boulevard Ornano et le boulevard Barbès. Au gré des fusillades annoncées sur les ondes, nous nous déroutions pour aller à chaque fois sur les lieux des dernières en cours. En entrant sur le boulevard Magenta, nous avons entendu l’appel informant des tirs rue de la Fontaine-au-Roi, et une fois au bas du boulevard Magenta, nous avons entendu l’appel concernant les tirs au Bataclan. Nous étions à environ 500 mètres, avec le gyrophare et la sirène deux tons. Nous sommes allés le plus rapidement possible au niveau du Bataclan. Nous avons supprimé nos signaux lumineux 200 mètres avant, mesure de précaution habituelle à l’approche d’un lieu d’intervention. Nous sommes arrivés tellement vite que nous avons stoppé précipitamment devant le Bataclan : nous pensions qu’il était plus loin et nous ne nous sommes rendu compte que nous y étions qu’une dizaine de mètres avant. J’ai signalé à mon équipier que le Bataclan était là, et nous nous sommes arrêtés juste derrière le bus des artistes, qui était stationné devant la salle.
Nous sommes tout de suite descendus du véhicule, et nous avons chacun fait le tour du bus. Une personne était au téléphone, certainement avec les services de police. Elle nous a requis en disant qu’il y avait une attaque à l’intérieur. Nous avons contourné le bus, et tout de suite, sur ma gauche, au niveau du passage Saint-Pierre-Amelot, j’ai vu quelques effectifs de police. Je n’y ai pas été très attentif, car mon attention s’est immédiatement portée sur les personnes décédées, au sol, devant nous. Je me rappelle en avoir vu deux : un homme devant le « Bataclan Café » et une femme devant l’entrée. Nous avons été marqués parce qu’une personne filmait avec un téléphone portable. Nous lui avons dit de dégager.
Nous entendions des tirs en rafales. Nous nous sommes avancés vers la porte vitrée, qui n’était déjà plus là : elle était tombée. Dès que nous avons commencé à progresser, les portes battantes en bois du Bataclan se sont ouvertes vers nous, et entre quinze et trente personnes ont fui en courant dans notre direction et en hurlant. Je me souviens d’un monsieur qui m’a dit : « Vite, vite, entrez, il y a ma femme à l’intérieur ! » Nous avons revu ce monsieur plus tard dans les locaux de la BRI, et il nous a avisés que sa femme était décédée.
Nous avons dit aux gens de s’enfuir en longeant les bâtiments sur le boulevard Voltaire, vers la rue Oberkampf, ce qu’ils ont fait. Dans le même temps, par l’une des portes qui s’était ouverte et qui était en train de se refermer, j’ai pu apercevoir un des terroristes. Il avait une Kalachnikov à la main, il était de côté et ne regardait pas dans notre direction. Nous étions à 35 ou 40 mètres, la vision a été très furtive et les portes se sont refermées. J’ai juste eu le temps de le voir deux ou trois secondes. Les gens se sont enfuis et nous avons progressé. J’ai passé un message radio annonçant mon arrivée sur place ; d'après les informations que j’ai ensuite reçues de la salle, il devait être 21 h 54, assez peu de temps après le premier appel à Police-secours.
Nous avons progressé dans le couloir et nous sommes arrivés au niveau des portes battantes, que nous avons ouvertes. Nous avons été frappés par la lumière extrêmement forte, puisque les spots avaient été allumés, certainement dès le début de l’attaque, par la régie. Des projecteurs très puissants éclairaient donc dans notre direction. À partir du moment où nous avons commencé à progresser dans le couloir, les tirs ont cessé, et quand nous sommes rentrés, il n’y en avait plus aucun, c’était le silence.
Là, la vision était indescriptible – vous pouvez l’imaginer. Des centaines de corps – pour nous, tout le monde était mort – étaient enchevêtrés les uns sur les autres : devant le bar, dans la fosse, parfois même entassés sur plus d’un mètre de hauteur. On se rendait vraiment compte que les gens s’étaient jetés les uns sur les autres. Pour nous, il n’y avait aucun survivant : personne ne bougeait, il n’y avait pas de gémissements, pas de bruit, il régnait un silence glacial.
Notre première réaction a été de se demander comment ils avaient fait pour tuer autant de gens en aussi peu de temps. Très rapidement, nous nous sommes reconcentrés. J’ai éteint ma radio parce que nous voulions être le plus discret possible, et avec la succession des messages radios, ce ne pouvait pas être le cas. À partir de cet instant, nous étions complètement coupés de l’extérieur. Nous avons commencé à progresser très doucement à l’intérieur de la salle.
L’un des terroristes, que nous avons identifié ultérieurement comme Samy Amimour – c’était le seul qui avait le crâne rasé – est apparu sur la scène. Il marchait à reculons, en venant de la gauche. Il était face à nous et tenait à la main son fusil d’assaut en menaçant un jeune homme à quelques mètres de lui. Il lui donnait l’ordre de se coucher au sol. Nous avons retrouvé cette personne plus tard ; elle nous a expliqué que ces ordres étaient en fait destinés à une personne située dans la fosse. Avec l’effet d’optique, nous avons eu l’impression que c’était à lui qu’il s’adressait. Ce jeune homme, initialement dans la fosse, avait profité d’un moment d’accalmie pour tenter d’accéder à la sortie de secours. Mais en fait, il était tombé nez à nez avec le terroriste, qui lui avait demandé de revenir vers lui.
Pour nous, il le menaçait clairement. Même si les ordres ne lui étaient pas destinés, ce jeune homme s’est quand même mis au sol les mains sur la tête. Je l’ai désigné à mon chauffeur, qui ne l’avait pas immédiatement vu. Nous avons avancé encore de quelques mètres. J’avais repéré une colonne, que vous avez dû voir ce matin, avec une rambarde. Je souhaitais prendre appui dessus avec mon arme pour stabiliser mon tir. Assez rapidement, nous avons pris position et nous avons engagé le tir sur le terroriste.
J’ai tiré quatre fois, et mon équipier deux fois. Je pense qu’il a tiré à partir de mon deuxième ou troisième tir, puisque j’ai entendu son dernier coup de feu. L’individu a poussé un râle, s’est affaissé et est tombé au sol. Je pense qu’il est tombé sur le dos.
Nous étions environ à 25 mètres, et avec la distance, nous n’avons pas vraiment distingué ce qu’il faisait. Dans les quelques secondes qui ont suivi, une explosion s’est produite, mais elle était très en hauteur, à environ trois ou quatre mètres du sol et au-dessus de la fosse, c’est-à-dire bien avancée par rapport à la scène. Nous n’avons donc pas compris immédiatement que c’était lui qui avait explosé, nous pensions que ses collègues avaient lancé une grenade sur nous depuis l’étage.
Dans la foulée de l’explosion, il y a eu une succession de tirs. Nous nous sommes abrités en nous mettant près du sol. D’après la chronologie que j’ai eue a posteriori, nous l’aurions abattu à 21 h 57. Il s’est donc écoulé très peu de temps entre le moment où nous sommes descendus du véhicule et celui où nous l’avons abattu, car nous n’avons jamais cessé notre progression. Il y a donc eu des tirs, et nous nous sommes protégés. Notre sentiment était que nous allions y rester : nous étions certains de ne pas ressortir vivants de cet enfer-là. Cela a duré un certain temps.
Après, il y a eu une accalmie. En tant que chef de service, je me suis rendu compte que notre action était un peu limitée. Nous n’étions que tous les deux, nous n’avions pas d’armes longues, nous ne savions pas où étaient les terroristes. J’ai donc décidé de ressortir pour voir si des renforts étaient arrivés. Je suis tombé sur des fonctionnaires de mon service qui nous avaient déjà rejoints. Il y avait trois fonctionnaires civils de la BAC 75, dont l’un était muni d’un fusil à pompe, trois fonctionnaires de la BAC 94, dont l’un avait aussi un fusil à pompe, et deux ou trois autres fonctionnaires d’une autre BAC. Ils étaient en position au niveau du couloir d’accès. Je les ai rejoints, et nous avons fait le point de situation.
Puis les coups de feu ont repris à l’intérieur. J’ai eu un doute sur mon action : je ne savais pas trop s’il fallait que j’attende à l’extérieur. Mais humainement, compte tenu de ce qui se passait – on sentait bien qu’ils étaient en train d’achever les otages –, on ne pouvait pas rester à l’extérieur.
Un des fonctionnaires a proposé d’attendre la BRI. J’ai répondu non. Nous sommes donc tous retournés à l’intérieur. J’ai repositionné mes appuis feu sur les extrémités, puisqu’on avait des fusils à pompe. Il y a encore eu des tirs dans notre direction, sans que l’on puisse réellement savoir d’où ils provenaient. J’ai riposté deux fois. Nous avons repris position et nous avons essayé de sanctuariser le rez-de-chaussée en interdisant le retour des terroristes, mais nous ne savions toujours pas où ils étaient : dans les loges au-dessus, ou sur le côté, car au même moment, les effectifs de la BAC 94 étaient également pris sous le feu d’un tireur – cela a d’ailleurs été filmé, nous avons pu le visionner sur internet – et avaient riposté avec leurs fusils à pompe. Il se pouvait donc que l’un des terroristes soit à l'extérieur ou au niveau de la sortie de secours. J’ai stabilisé mes effectifs.
J’ai oublié de préciser quelque chose : avant de rentrer avec ces effectifs-là, alors que nous étions en attente à l’extérieur, une ombre est apparue sous la porte. En fait, c’était un des terroristes qui s'était rapproché de la porte d’entrée. Mais nous ne le savions pas ; il pouvait aussi s’agir d’une victime, et nous ne pouvions pas faire feu à travers la porte sans identification. Cette ombre est passée, puis s'est écartée, et nous avons distinctement entendu le rechargement d’une Kalachnikov : le bruit du chargeur qui tombe au sol, et la culasse qui est tirée en arrière.
Quelques secondes après, nous avons vu une autre ombre rasante passer, et la porte s’ouvrir légèrement. Nous avons pensé que c’était lui, qu’il allait faire une sortie sur nous, et on s’est préparé à le recevoir. En fait, c’était l’une des victimes, un commissaire de police qui était là à titre personnel et qui s’efforçait de ramper jusqu’à la porte. Il a juste sorti la main : nous avons couru pour aller le chercher, toujours sans savoir où se trouvaient les terroristes. Nous l’avons tiré jusque sur le trottoir. Il nous a expliqué qu’il ne pouvait plus marcher, qu’il avait été touché au dos et qu’il y avait trois terroristes armés de Kalachnikovs à l’intérieur. Il a été extrait par les fonctionnaires vers le poste médical avancé. Nous sommes quant à nous restés sur place.
Quelques secondes plus tard, cette fois sur la droite, une autre ombre est apparue et une main est sortie. Cette fois-ci c’était une femme. Nous l’avons extraite jusqu’au trottoir, – je ne me suis pas personnellement occupé d’elle. Puis nous avons décidé d’entrer à nouveau avec les effectifs présents.
Nous avons repris position à l’intérieur. J’ai fait feu à nouveau deux fois. Nous avons également subi des tirs. Puis les tirs ont cessé, ça s’est calmé. Nous avons maintenu la position un certain temps – je ne peux pas être plus précis. Les gens ne bougeaient toujours pas devant nous ; on sentait bien que même les vivants faisaient semblant d’être morts pour ne pas attirer l’attention. Constatant que notre action était encore assez limitée, j’ai laissé mes fonctionnaires sur place et je suis ressorti. J’attendais les effectifs de la BAC 75 qui avaient pris leur service entre-temps et qui devaient arriver avec de l’équipement lourd, c’est-à-dire casque de protection balistique et bouclier balistique lourd. Mais quand je suis ressorti, il n’y avait personne. J’ai attendu encore un peu ; puis j’ai fait des allers-retours entre l’intérieur et l’extérieur pendant un certain temps.
Après, j’ai réussi à faire la jonction avec la force d’intervention rapide (FIR) de la BRI, qui était arrivée. Je ne peux pas vous dire combien ils étaient exactement ; ils étaient positionnés en colonne et longeaient les bâtiments, en provenance de la rue Oberkampf. Ils étaient peut-être six ou sept.
Entre-temps, il y a eu des tirs en rafale sur la rue en direction des camions de pompiers stationnés à quelques mètres du Bataclan. J’ai fait la jonction avec l’officier de la FIR. Je lui ai dit de progresser rapidement jusqu’à l’entrée du Bataclan, car cette zone était plus ou moins sécurisée.
J’ai progressé avec lui et je lui ai fait un point de situation assez réduit car je n’avais pas beaucoup d’informations. Je lui ai dit qu’il y avait peut-être deux ou trois terroristes à l’intérieur, avec des Kalachnikovs, que nous n’étions pas sûrs qu’ils soient encore dans les lieux car il n’y avait plus de tirs – nous ne connaissions pas la configuration des lieux, nous ne savions pas s’il y avait des sorties sur les toits. En même temps, il y avait beaucoup d’appels concernant des tirs, dans de nombreux endroits de la capitale. Nous ne savions plus vraiment ce qui se passait : des gens parlaient de tirs au niveau de la Place de la République, d’autres faisaient état de blessés un peu partout. Nous avions une vision assez limitée de la situation globale.
La FIR est intervenue. Ils ont constaté la situation et considéré rapidement qu’au vu de leur nombre, ils ne pouvaient pas faire grand-chose. Puis, le reste de la BRI est arrivé, suivi de nos propres forces de la BAC 75, sans que je puisse déterminer le temps qui s’était écoulé. La BRI a commencé à progresser dans les étages, tandis que j’ai positionné les effectifs de la BAC 75 que j’avais récupérés le long de la fosse, en attente. Là encore, cela a duré un certain temps. Je n’avais pas de vision sur ce que faisait la BRI, ma vision périphérique était assez réduite.
Au bout d’un moment, il n’y a plus eu de mouvements ni de tirs. J’ai décidé d’aller chercher les victimes qui étaient dans la fosse à quelques mètres de nous. Les gens ont commencé à bouger et à se manifester. Nous avons commencé à les rassurer par la voix, en leur disant que nous allions intervenir dès que ce serait possible pour nous.
J’ai omis de dire qu’alors que nous étions en position, l’un des otages nous a parlé depuis les loges. Il nous a communiqué un numéro de téléphone de la part des terroristes, à l’intention des forces d’intervention. Nous lui avons fait répéter deux ou trois fois, le temps de le noter, et l’avons transmis à notre station directrice. Puis, il est reparti. Au vu de ce que j’ai lu dans la presse, l’un de ses proches devait être retenu à l’intérieur. Les terroristes l’avait donc envoyé passer ce message avec la certitude qu’il reviendrait auprès d’eux.
Pour en revenir à la situation, nous avons commencé à aller chercher les victimes sans savoir où se trouvaient les terroristes. Nous sommes donc intervenus sans être protégés –s’ils étaient positionnés au-dessus, ils pouvaient tirer sur nous.
Nous avons commencé à mettre en place une noria d’évacuation, avec toutes les difficultés présentes : le sol était extrêmement glissant car il y avait du sang et des douilles partout, ainsi que des chargeurs de Kalachnikovs. Nous étions obligés d’enjamber ou de déplacer des personnes décédées. Il y avait également des personnes dont nous savions très bien qu’elles étaient blessées sérieusement, mais qu’il fallait que l’on extraie quand même, sans pouvoir utiliser les gestes de secours habituels pour le transport des victimes. Nous les avons tirées comme on pouvait. Nous commencions à être épuisés. Entre-temps, en effet, nous nous étions équipés de gilets pare-balles lourds et nous avions en plus de l’armement collectif, des fusils à pompe ou des pistolets mitrailleurs, ce qui augmentait notre poids Les gens étaient eux aussi très lourds : ils étaient complètement habillés, et en sang, pour la plupart.
Nous avons donc commencé à sortir les gens. Comme vous l’avez vu, il y a deux ou trois marches entre la fosse, la sortie et le bar. Elles étaient extrêmement difficiles à monter car, à cet endroit aussi, il y avait des corps. Nous avons mis en place une noria entre le centre de la fosse et la sortie, où des personnels de secours prenaient en charge les victimes. Nous avons fait cela pendant des dizaines de minutes. D’autres forces d’intervention sont arrivées ensuite, certainement le RAID, mais je ne saurais vous dire à quelle heure. On nous a annoncé alors que les tireurs s’étaient enfuis et se trouvaient rue Amelot. Il s’est avéré a posteriori qu’il s’agissait en fait de victimes qui s’étaient enfuies et qui étaient allées se réfugier là-bas, mais nous ne le savions pas. J’ai donc récupéré tous mes effectifs de la BAC 75, et nous sommes repartis par le boulevard Voltaire et la rue Oberkampf, en remontant toute la rue Amelot jusqu’à l’arrière du bâtiment. Nous avons fait une progression dans les bâtiments pour sécuriser les lieux. C’est là que nous sommes tombés sur des victimes qui s’étaient cachées chez des gens et dans des caves.
Une fois la zone sécurisée, nous sommes revenus à l’entrée du Bataclan où nous avons continué à participer à l’évacuation entre l’entrée du Bataclan et le poste médical avancé, soit en transportant les gens à mains nues, soit avec des barrières de chantier et des barrières Vauban qui se trouvaient à disposition. Nous avons aidé comme nous pouvions et procédé aux palpations de sécurité de toutes les victimes et les otages, qui sortaient par dizaines voire par centaines. Tout le monde devait être palpé avant de quitter les lieux. Nous avons procédé à ces opérations dans l’entrée du Bataclan, et cela a duré un certain temps. Je me souviens seulement de l’heure à laquelle j’ai pu regrouper mes effectifs à la fin : il était 3 h 30. Nous avons soufflé un peu, puis regagné le service pour le débriefing opérationnel entre nous.
Brigadier Z. Je ne vais pas pouvoir vous en dire beaucoup plus que le commissaire. La seule différence entre nos deux vécus – nous nous en sommes rendu compte trois semaines après les événements – est que lorsqu’il est parti avec la colonne rue Amelot, parce que l’on pensait que les terroristes y étaient en fuite, je suis resté à l’intérieur du Bataclan, en protection des collègues de la BRI qui faisaient une progression pour sécuriser les alentours de la scène, sans savoir qu’il avait quitté les lieux. Comme le commissaire vous l’a expliqué, nous avons connu l’effet tunnel. C’est grâce aux radios et au récit de chaque collègue que j’ai pu reconstituer la chronologie des événements. Aujourd’hui encore, je suis quasiment incapable de vous donner l’enchaînement exact des faits. Ce n’est pas compliqué : je suis resté quatre heures dans le Bataclan, à manipuler notamment des corps, mais il me reste une dizaine de minutes de souvenirs de toute cette période. Le cerveau a complètement « zappé » tout ce qui s’est passé.
Notre intervention de départ, au cours de laquelle on abat le terroriste, se déroule sur très peu de temps, trois minutes à peine : le temps d’arriver, de l’abattre et de ressortir. Je me rappelle très bien des allers-retours que nous avons faits ensuite. S’agissant de l’évacuation des corps, j’ai quelques souvenirs. Après, il y a tout le laps de temps de la progression, et de l’attente de l’arrivée de certains collègues. Nous étions toujours aux aguets. Je me suis retrouvé, par un moyen qui m’étonne encore, avec un fusil à pompe dans les mains qui n’appartenait pas à mon service. Un collègue qui en avait un en plus me l’avait donné pour faire une progression. J’ai dû rester une heure avec le fusil à l’épaule à surveiller les points hauts : il fallait être en mesure de tirer tout de suite si un terroriste arrivait pour arroser la fosse.
Ensuite, je ne dirai pas que c’est le trou noir… Ce sont les allers-retours, l’évacuation des victimes…
M. le président. À l’écoute de vos récits, on peut considérer que votre intervention – dans un premier temps avec une arme de poing, puis avec une arme longue – a sans doute eu pour effet de faire se replier les deux terroristes qui restaient à l’étage. On peut imaginer que si vous n’aviez pas assuré cette sorte de sécurisation par vous-mêmes, ils auraient pu faire beaucoup plus de victimes dans la fosse.
Brigadier Z. C’est une évidence. Même s’il est impossible de savoir ce qui se serait passé si nous n’avions pas abattu un terroriste d’entrée de jeu, et si nous n’étions pas restés présents – car nous avons reçu des tirs, et le commissaire a fait deux tirs de riposte, ils sentaient donc une présence policière sur place qui les a empêchés de redescendre.
Commissaire divisionnaire X. Je crois qu’ils ont été surpris par la rapidité et l’attaque « périmétrique » : nous étions sur l’axe principal, et dans le même temps, les collègues du 94 ont fait feu à quatre reprises. D’ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu la sortie de secours : il y a un impact en plein milieu de la porte, le collègue pensait d’ailleurs avoir touché un des terroristes. Ils ont dû se dire que les forces d’intervention étaient arrivées très rapidement, et qu’elles étaient en train d’encercler le site. C’est à ce moment-là sans doute qu’ils sont remontés.
D’après le témoin que nous avons rencontré, les deux terroristes qui étaient toujours sur place ont eu conscience que le troisième avait été abattu, puisqu’ils en parlaient entre eux. L’un a demandé : « Il est où Samy ? », et l’autre lui a répondu qu’il était mort, qu’il avait explosé. Ils savaient donc bien ce qui s’était passé au rez-de-chaussée.
M. Sébastien Pietrasanta, rapporteur. On m’a dit que vous étiez, l’un et l’autre, très modestes, mais je tiens à saluer votre courage. Vous êtes vraiment des héros. Certes, il y en a d’autres, mais vous l’êtes particulièrement et je voulais vous le dire personnellement. Votre action a été exemplaire et a permis de mettre un terme au massacre qui était en cours. Toute la représentation nationale vous est reconnaissante pour la manière dont vous avez agi.
Je voudrais tout d’abord vous poser une question d’ordre général. Il y a les protocoles, et la vraie vie : j’imagine que les protocoles ne vous autorisaient pas à pénétrer dans le Bataclan de votre propre initiative, sans renforts. Y avez-vous réfléchi, ou êtes-vous entré instinctivement ? Avez-vous pris votre décision à la vue des victimes ?
S’agissant ensuite du déroulé des événements, vous avez prévenu par radio que vous étiez sur place à 21 h 54, et vous tuez le terroriste à 21 h 57. Je n’ai pas bien saisi la situation : était-il sur la scène ? J’avais compris qu’il mettait en joue un jeune homme. Dans le témoignage paru dans La tribune du commissaire, vous écrivez que si le tir avait échoué, vous étiez finis. Lorsque vous êtes entrés, y avait-il des exécutions en cours, ou avaient-elles déjà eu lieu ? Ce matin, il nous a été dit que les terroristes économisaient leurs munitions. Ils tiraient dans la tête en pas en rafale. Lorsque vous êtes intervenus, la plupart des victimes avaient-elles déjà été tuées ?
Par ailleurs, les autres terroristes semblaient être à l’étage lorsque vous avez tiré. Vous dites les avoir vus recharger lorsque vous êtes ressortis, pensez-vous qu’ils soient redescendus ?
Il nous a été dit qu’après votre intervention, les tirs à l’intérieur du Bataclan avaient cessé – les échanges avaient lieu à l’extérieur avec la BAC 94. Or vous nous apprenez que lorsque vous êtes entrés pour la deuxième fois, vous avez à nouveau échangé des tirs avec les terroristes. Ces tirs vous visaient-ils, ou bien y avait-il d’autres exécutions d’otages en cours ?
Commissaire divisionnaire X. Une tuerie de masse de ce type était une première en France. Les protocoles existent pour les prises d’otages classiques, dans un établissement bancaire ou n’importe quel autre lieu. Le mode d’intervention consiste alors à rester à l’extérieur et à envoyer des effectifs en civil faire une observation discrète. On coupe la circulation, on interdit la fuite des preneurs d’otages et l’on établit un périmètre de sécurité. On fige la situation et on attend les forces d’intervention, seules habilitées à intervenir. C’est ce que l’on fait en présence de forcenés, avec des armes supposées ou réelles : on fige, et on attend les services d’intervention.
En cas d’attaque de moindre importance, ou à l’arme blanche, les services généralistes peuvent intervenir. C’est le protocole habituel.
Pour les tueries de masse, il n’y avait pas encore de protocole. Mais nous avons l’habitude de travailler avec la BRI dans Paris, et avec le RAID en banlieue. Généralement, on fige, on fait un périmètre d’exclusion dans lequel nous sommes les seuls présents parce que nous sommes équipés en matériel lourd, celui de la Force d’intervention de la police nationale (FIPN) – dont nous faisons partie. Ensuite, à l’arrivée des effectifs spécialisés, nous faisons des relèves de colonne, c’est-à-dire qu’ils nous relèvent point par point. Puis eux progressent, éventuellement avec un soutien arrière de notre part : on suit la colonne de la BRI ou du RAID pour procéder aux extractions d’otages qui sont faites par eux. Nous constituons donc leur base arrière sur ce type d’interventions.
Depuis, des notes ont été rédigées, modifiant les schémas d’intervention afin que les primo-arrivants soient les primo-intervenants, dans la mesure de leurs possibilités et de la protection matérielle dont ils disposent. Je pense notamment à la note EVENGRAVE, qui a été rédigée par la zone de défense, dont vous avez dû avoir connaissance et qui décrit tout ce schéma d’intervention : la notion de périmètre d’exclusion, de zone contrôlée, de zone de soutien, en détaillant le rôle de chacun.
Concernant notre intervention au Bataclan, il est vrai que d’après le protocole, nous aurions peut-être dû rester à l’extérieur. À titre personnel, deux éléments m’ont poussé à entrer.
Tout d’abord, je considère qu’en tant qu’homme, on ne peut pas rester dehors pendant que des gens se font massacrer. En outre, on ne choisit pas notre métier par hasard. Si on devient policier, c’est que l’on a un sens du devoir et du service public qui font qu’au quotidien, nous sommes prêts à prendre des risques physiques pour nos concitoyens. C’est le cœur de notre métier, l’une des raisons pour lesquelles nous entrons dans la police. Même dans des fonctions qui comportent plus de tâches administratives, comme celles de commissaire.
Je ne l’ai pas précisé, mais, avec mon équipier, nous avons eu très peu d’échanges verbaux au moment où nous sommes entrés. Nous nous sommes regardés, je crois avoir dit : « Il faut qu’on y aille. » Je ne suis même pas certain qu’il m’ait répondu : il m’a regardé et cela m’a suffi pour comprendre que nous étions sur la même longueur d’onde et que dès lors, nous ne faisions plus qu’un. Je crois que nous avons la même perception de notre intervention sur ce point.
Peut-être que le grade de commissaire fait peser un poids supplémentaire sur mes épaules. Cela me donne une responsabilité et un devoir d’exemplarité. Si je n’entre pas, personne ne le fera. Je ne peux pas demander à mes effectifs d’entrer si moi-même je ne suis pas devant. C’est ma place en tant que chef de service.
Il n’y a donc pas eu de doutes sur la nécessité d’intervenir ; nous n’avons pas réfléchi. Je pense d’ailleurs qu’il n’y a pas eu de peur à ce moment-là. Peut-être y en a-t-il eu après, quand on a commencé à se faire tirer dessus. Nous avons alors pris conscience du risque.
Notre intervention ne relevait pas non plus de la bravoure déplacée, nous nous sentions prêts à intervenir. Mon équipier est à la BAC depuis longtemps et j’ai fait moi aussi de nombreux postes de terrain. Nous avons l’habitude en outre de travailler ensemble puisque nous le faisons depuis plus de quatre ans. Nous n’avions donc aucune appréhension au niveau technique.
S’agissant de la situation avant notre tir, pour nous, le terroriste menaçait le jeune homme. Il apparaît en reculant, arrivant de la gauche de la scène, derrière les rideaux, vers le centre de la scène. Il tenait sa Kalachnikov à hauteur d’homme et la pointait vers ce jeune homme, qui avait les mains sur la tête. Pour nous, il lui dit : « Couche-toi au sol », et le jeune homme commence à se baisser. L’arme est pointée dans sa direction et il y a eu un carnage auparavant : pour nous, il n’y a pas de doute sur le fait qu’il va l’exécuter. À ce moment-là, quand bien même il aurait pointé sa Kalachnikov vers le plafond, nous aurions fait feu, même si juridiquement, la légitime défense n’était pas constituée. Souvent, dans les actions de police, les policiers hésitent à faire usage de leur arme car ils se demandent s’ils sont en légitime défense. Dans cette situation, à aucun moment nous ne nous sommes posé la question.
M. le rapporteur. Y a-t-il des tirs lorsque vous entrez ?
Commissaire divisionnaire X. Non. Lorsque nous arrivons devant le Bataclan, que nous sortons de la voiture, il y a de nombreux tirs en rafale. En fait, ce n’était pas des rafales, c’étaient des coups très rapprochés. Je pense qu’ils n’ont tiré en rafale que lorsqu’ils ont tiré du premier étage vers l’extérieur, sur le trottoir et les camions de pompiers.
M. le rapporteur. Lorsque vous arrivez, à 21 h 53 ou 21 h 54, vous entendez des tirs dans le Bataclan. A priori, c'était pour exécuter. Votre entrée dans la salle permet donc stopper ces exécutions.
Commissaire divisionnaire X. À notre arrivée, il y avait quelques tirs. Lorsque les portes se sont ouvertes et que les gens ont couru vers nous, nous avons précisément entendu les coups de feu. Ce n'était sans doute pas des tirs en rafale, car lorsque l'on tire en rafale, le tir n’est pas précis et a tendance à monter. C’était des tirs successifs, très rapprochés, en continue. Les terroristes n’étaient donc pas en train d'exécuter des personnes au sol ; ils devaient tirer dans la foule.
Quand nous sommes entrés, les coups de feu avaient cessé depuis environ une minute. C'est d'ailleurs aussi pour cela que nous avons pénétré dans la salle : s'ils avaient tiré en continu, je ne sais pas si nous serions entrés. C'est lorsque nous sommes ressortis, après avoir fait feu sur le terroriste, que nous avons subi des tirs. Je pense qu'il y avait un terroriste en haut, et un autre au niveau de la sortie de secours. Chronologiquement, c'est à ce moment que les effectifs de la BAC 94 ont fait feu. D'ailleurs, on entend une explosion sur la vidéo lorsque l'un des collègues de la BAC 94 après avoir reculé sous le feu, reprend position. C'est assez bref, mais on perçoit l’explosion. Je pense que c'est à ce moment-là que notre terroriste s'est fait exploser.
Lorsqu’il a rechargé sa Kalachnikov, le deuxième terroriste devait donc revenir de la sortie de secours. Certes, c'est une hypothèse – peut-être qu'il était en haut et qu'il est redescendu… Mais je pense que si nous n'étions pas ressortis à ce moment-là, soit nous l’aurions vu sur notre gauche, et nous faisions feu, soit nous étions toujours dans notre « effet tunnel, » et c'est lui qui nous abattait. Cela s'est joué à quelques secondes car lorsque nous avons fait feu, notre vision périphérique était occultée. En période de stress, la vision périphérique se réduit, en effet. Étant vraiment concentrés sur la salle, nous ne pouvions plus voir ce qui se passait sur les côtés.
Nous sommes donc ressortis faire le point parce qu'il n'y avait plus de tirs, et c'est à ce moment-là que le terroriste est venu recharger sa Kalachnikov derrière la porte.
M. le rapporteur. On ne sait pas si c'était le terroriste qui était en haut.
Commissaire divisionnaire X. Pour moi, c'était le terroriste qui était en train de faire feu au niveau de la sortie Saint-Pierre-Amelot. Cela me paraît plus logique. Je ne vois pas pourquoi celui qui était en haut serait redescendu.
À cet instant, il n'y a plus de tirs. C’est lorsque j’ai repris contact avec mes premiers fonctionnaires - mes fonctionnaires en civil et ceux du 94, nous devions être neuf en tout - que les tirs ont recommencé. Et cette fois, c'était vraiment du coup par coup. Nous comprenons donc qu'ils sont en train d'exécuter des gens. Ce sont des tirs uniques, espacés de quelques secondes. Je suis incapable de vous dire combien il y en a eu, peut-être une dizaine.
Il y a une zone d'ombre pour nous – j'ai entendu des victimes se poser des questions ce matin à la radio – : nous ne savons pas du tout comment les victimes sont décédées. Nous ne savons pas si elles sont décédées des suites de leurs blessures, si elles ont été exécutées tout de suite ou plus tard. Nous ne savons pas non plus comment les quatre-vingt-dix morts sont répartis entre le rez-de-chaussée et le premier étage. Nous aimerions d’ailleurs avoir des explications, parce qu'il y a un impact post-traumatique assez important, et nous nous posons beaucoup de questions.
M. le rapporteur. Quelques exécutions auraient donc encore eu lieu à l'intérieur du Bataclan, après votre sortie. C'est après votre retour et à la suite de l'échange de tirs, qu’il n’y a plus rien ?
Commissaire divisionnaire X. Lorsque nous ressortons, il y a effectivement encore des tirs. Je pense qu'ils proviennent du premier étage, car ils semblent assez éloignés. J'ai la certitude à 99,99 % qu'il n'y a plus d'exécutions au rez-de-chaussée. Selon moi, plus personne n'a été abattu au rez-de-chaussée, après que nous avons abattu le terroriste.
Lorsque nous sommes entrés à nouveau et que nous avons repris position, il y a quelques tirs sur nous. Nous pouvions distinctement les voir : il y avait de la fumée et des impacts au-dessus de nos têtes. Mais nous ne savions pas d’où ils provenaient. Je n’ai pas le souvenir d’autres tirs après.
M. Serge Grouard. Je me joins bien sûr aux hommages qui vous ont été adressés il y a un instant. Vous avez vécu une situation de guerre, comment allez-vous aujourd'hui ? Arrivez-vous à prendre de la distance ?
Par ailleurs, tirez-vous des enseignements de cette expérience, notamment en matière de doctrine d'emploi des forces ? La doctrine générale, notamment lorsqu'il y a prise d'otages, consiste à figer la situation, à sécuriser, à chercher à prendre contact avec les preneurs d'otages – c'est un temps long – dans l'espoir de calmer les choses, de limiter les dommages collatéraux et de mettre fin à la situation de la manière la « moins risquée possible ».
Vous, vous n’avez pas fait cela : vous êtes intervenu en premier, directement, et, grâce à cette intervention, vous avez évité une tuerie plus grande encore. En tirez-vous l'enseignement que dans ce type de situation, face à des gens qui ne sont plus dans les ressorts psychologiques que l'on connaît, il faut y aller tout de suite, avec tous les risques que cela comporte ?
Commissaire divisionnaire X. Pour répondre à votre première question, je vais bien. Il est clair que nous avons été proches de la mort, donc beaucoup de choses changent, surtout vis-à-vis des familles. Il n’est pas facile d'expliquer à sa femme et à ses enfants que l'on est prêt à donner sa vie pour des personnes que l'on ne connaît pas. « C'est très bien, mais si tu meurs, que devenons-nous ? » : m’ont-ils demandé. Cela a été difficile à gérer, mais il n'y a pas eu trop de réactions de nervosité au sein de la cellule familiale.
Ensuite, j'ai évalué le temps pendant lequel j'ai rêvé du Bataclan : cela a duré pratiquement trois mois et toutes les nuits. Je ne faisais pas de cauchemars, parce que j'étais serein, mais je revoyais la scène, je pensais à ce que nous aurions pu faire autrement : si nous étions montés à l'étage peut-être aurions-nous pu mettre fin à cette attaque. Nous nous posons beaucoup de questions sur ce point.
Ce qui nous a fait du bien, par ailleurs, c'est d’avoir reçu des courriers de victimes – en préservant toujours notre anonymat. J'ai répondu à chacune en ne mentionnant que mon grade. Certaines ont envoyé des photos les montrant parfois sur un lit d'hôpital. Elles nous remercient, et nous disent que si elles sont encore vivantes aujourd’hui, c’est grâce à nous. Pouvoir mettre des visages ou des noms sur toutes ces personnes, nous a fait du bien.
Nous avons aussi fait connaissance du jeune homme, que nous avons retrouvé. Il y a enfin ce petit comité de victimes, très restreint, qui a déjà été filtré par notre syndicat, que nous allons rencontrer chez un particulier.
M. le président. Pourquoi tenez-vous absolument à garder l'anonymat ?
Commissaire divisionnaire X. Pour des questions de sécurité, surtout à l'égard de nos familles.
M. le président. Vous craignez d'éventuelles représailles ?
Commissaire divisionnaire X. Tout à fait. Nous sommes face à des fanatiques. En temps normal, déjà, nous craignons d'éventuelles représailles, parce que nous interpellons des voyous.
M. le président. Les trois terroristes en question sont morts.
Commissaire divisionnaire X. Mais il y a des ramifications, et tout un tas de fanatiques qui gravitent autour de ces gens-là, leurs proches. Ce n'est pas tant pour nous que pour nos familles. Nous faisons donc très attention.
Personnellement, je suis armé en permanence, même hors service, ce que je ne faisais pas avant. Je suis ainsi prêt à riposter lorsque je conduis mes enfants à l’école parce que je me dis que l’un de ces fanatiques va peut-être débarquer et attaquer l'école. Je leur ai expliqué que si ça commençait à tirer, ils devaient s’enfuir par les sorties de secours. Ce sont tout un tas de choses qui changent au quotidien pour nous.
Brigadier Z. Je vais bien, moi aussi. Comme je l’ai expliqué, la majorité des souvenirs a été occultée par le cerveau. Ce qui reste, je vis avec. Cela étant, et comme l’a dit le commissaire, nous refaisons l'histoire. Ce ne sont pas des cauchemars, ce sont des rêves d’autant que les premières semaines, nous avions de nouveaux éléments presque tous les jours, ce qui modifiait la perception de ce que nous avions fait, et de ce que nous aurions pu faire. Je revivais notre entrée au Bataclan. J'imaginais ce qui serait arrivé si nous ne nous étions pas focalisés sur un seul d'entre eux.
Quant à la doctrine d'emploi, ce n'est pas à moi de le dire, mais je pense qu'il a été essentiel de couper leur schéma d'intervention. Ces terroristes ont un projet bien défini, en l'occurrence, pour le Bataclan, procéder à une tuerie de masse. Le fait d'en éliminer un tout de suite les a perturbés. Ils attendent les unités d'élite pour se confronter à elles. L’arrivée de « flics lambda » a bouleversé leur schéma.
Dans le futur et dans des situations comparables, les primo-arrivants seront amenés à être les primo-intervenants, pour casser ce schéma.
Commissaire divisionnaire X. Nous avons élaboré une théorie à partir des événements de l'Hypercacher et du Bataclan : à partir du moment où la police intervient, les terroristes arrêtent de s'intéresser aux victimes, se retranchent, et attendent la confrontation avec les forces d'intervention. Mais ces deux cas ne sont pas suffisants et nous n'avons pas le recul nécessaire pour élaborer une doctrine. Je ne sais pas ce qui se passe à l'étranger, peut-être que le RAID ou la BRI ont d'autres expériences.
On part désormais du principe que les primo-arrivants seront les primo-intervenants, et qu’à la suite de cette intervention, les terroristes vont cesser d'abattre leurs otages. Mais ces fanatiques-là n'ont pas trop de logique. De tout cela je tire donc l'enseignement qu'il faut effectivement intervenir rapidement, parce que l'on peut difficilement faire autrement. Mais j’en déduis aussi qu'on ne peut pas établir une doctrine qui sera appliquée en permanence par les effectifs : c’est dans les tripes que ça se passe. Nous sommes entrés le 13 novembre au Bataclan mais si un tel événement se reproduisait demain sur un autre site, peut-être aurions-nous peur de le faire. On ne peut pas demander à tous les effectifs d’entrer, certains vont avoir peur, d’autres ne seront pas prêts techniquement, d’autres encore seront entrés dans la police depuis seulement un mois ou deux, il s’agira parfois d’adjoints de sécurité… On se rassure en se disant que nous allons établir une doctrine, fixer un schéma d'intervention, et que les choses se dérouleront désormais ainsi, mais dans les faits, les choses seront différentes.
M. Pascal Popelin. Je m'associe aux mots de remerciements qui vous ont été adressés. Nous nous félicitons que vous soyez bons tireurs, c'est ce qui vous permet de nous parler aujourd'hui.
Nous étions sur site ce matin. Où étiez-vous exactement par rapport à la porte d’entrée quand vous avez pris la décision d'engager un tir ?
S'agissant du déroulement des faits, vous avez indiqué que lorsque vous êtes ressortis, il y a eu un certain nombre de tirs. Combien de temps cela a-t-il duré ? Ces tirs ont cessé lorsque vous êtes rentrés. Comment cela s'est-il articulé avec l'arrivée de la BRI ?
Abattre le terroriste qui était sur la scène a considérablement perturbé leur stratégie, mais tout ne s'arrête pas tout de suite. Il y a donc un deuxième événement qui les a fait entrer dans une logique de retranchement et de prise d'otages. Est-ce votre retour ? L'arrivée de la BRI ?
Commissaire divisionnaire X. S'agissant de la topographie, nous ne sommes jamais retournés dans les lieux, donc je n'ai pas pu refaire le schéma. Dans mon souvenir, le bar est un peu surélevé, il y a une colonne à sa gauche, et une main courante. J'ai pris appui sur cette main courante, tandis que mon équipier, qui n'avait pas d'appui, était à environ un mètre sur ma droite. Nous étions à quelque 25 mètres de la scène – les tirs en stand nous permettent d’évaluer assez précisément les distances. Le terroriste était en mouvement, mais ne bougeait pas trop. En outre, il était sous les projecteurs et habillé en noir.
On peut se demander, à cet égard, s’il faut ou non rallumer les lumières dans pareille situation. C'est aux techniciens de le dire.
Concernant votre deuxième question sur le moment clé où cessent les tirs : nous sommes entrés une première fois, nous avons abattu le terroriste, et il n'y avait plus de tirs lorsque nous sommes ressortis. Un deuxième terroriste a alors rechargé sa Kalachnikov. C’est lorsque nous faisions la jonction avec les premiers effectifs que nous avons entendu cette dizaine de tirs au coup par coup. Lorsque nous avons à nouveau pénétré à l'intérieur du Bataclan, il y a eu quatre ou cinq tirs dans notre direction, et après, de mémoire, il n'y en a plus eu.
M. Pascal Popelin. Les forces d'intervention étaient-elles là ?
Commissaire divisionnaire X. Non, elles n'étaient pas encore arrivées.
M. Pascal Popelin. C’est donc vous qui avez figé la situation.
Commissaire divisionnaire X. C'est ma perception. Mais elle est peut-être faussée. Après notre première entrée, il n'y a plus eu de tirs en bas ; en haut, les tirs se sont arrêtés après notre deuxième progression dans la salle.
M. Pascal Popelin. Quand la BRI arrive, il n'y a plus de tirs. Les tirs avaient-ils cessé avant ?
Commissaire divisionnaire X. Oui puisque j'ai dit au précurseur de la force d'intervention rapide de la BRI que je ne savais pas si les terroristes étaient encore à l'intérieur. La jonction avec la BRI se fait donc avec la FIR – la force d'intervention rapide, les précurseurs de la BRI – le long des bâtiments, à peu près au niveau de la laverie. Je suis allé vers eux – ils ne m'ont d’ailleurs pas identifié tout de suite et m'ont demandé de me pousser. Je leur ai expliqué qui j'étais, et je les ai raccompagnés à l'intérieur du Bataclan, où ils sont restés en attente du soutien de la BRI. Nous ne pouvions pas franchir, notamment, la porte à gauche qui donne sur l'escalier. À cet égard, et j’ai omis d’évoquer cet élément, dans la décision d’intervenir, il y a certes l'objectif, mais il y a aussi la pondération et les limites. Ainsi, je n’ai pensé à aucun moment que l'on pouvait monter. Je ne connaissais pas la configuration des lieux, je n’avais pas de protections lourdes. Quand bien même les aurais-je eues, je ne pense pas que je serais monté car il aurait suffi d'un seul tireur au-dessus avec une Kalachnikov pour anéantir toute l'équipe.
Je n'ai pas de remords sur ce point ; je connais très bien les limites de notre intervention.
M. Olivier Falorni. Messieurs, je veux à mon tour vous faire part de toute notre reconnaissance et de notre admiration. Je voulais vous poser deux questions, l’une sur la visibilité et l’autre sur la distance de vos tirs. Le concert se déroule dans la pénombre. Lorsque vous entrez, la scène est éclairée. Les lumières avaient-elles été rallumées dans la salle ? Cela aurait-il pu vous mettre en danger ?
Par ailleurs, la distance à laquelle vous avez tiré semble exceptionnelle. À quelle distance pouvez-vous raisonnablement abattre quelqu'un avec votre armement ? J'ai été sidéré de votre capacité à abattre un terroriste à une telle distance, plus encore compte tenu du stress auquel vous étiez soumis.
Commissaire divisionnaire X. S'agissant de la visibilité, tout était éclairé. J’ai été ébloui même depuis l'extérieur, lorsque les portes se sont ouvertes pour la première fois et que les gens ont couru vers nous. Nous étions pourtant sur le trottoir, à la limite des portes vitrées. Ce sont des spots de concert. Vaut-il mieux les éteindre ou les allumer ? S’ils sont éteints, les gens pourront peut-être s'enfuir plus rapidement mais ils ne verront pas forcément les sorties de secours… Pour une intervention dans la pénombre, il faudrait être équipés de dispositifs de vision nocturne, dont nous ne disposons pas.
M. Olivier Falorni. Il semble qu'après, les lumières aient été éteintes, puisque la BRI nous a dit avoir progressé dans la pénombre.
Commissaire divisionnaire X. Peut-être y avait-il un éclairage différent au premier étage ?
M. Olivier Falorni. Vous distinguiez la fosse ?
Commissaire divisionnaire X. Nous distinguions tout. Le bar était un peu moins éclairé.
S'agissant de la distance de tir, en tir police, on fait généralement beaucoup de tirs réflexes, mais cela va devoir évoluer. Les actions de tir sur la voie publique, en légitime défense, se font entre 5 et 7 mètres. Nous nous entraînons donc beaucoup sur ces tirs de riposte. Comme nous aimons pour notre part faire des tirs de précision, nous nous entraînons donc, de temps à autre, à 25 ou 30 mètres, ce qui n'est pas forcément le cas de tous les effectifs de police. De plus, les stands de tir sont limités en distance.
M. Olivier Falorni. Quelle est la fréquence de vos entraînements ?
Commissaire divisionnaire X. Réglementairement, il faut faire trois séances de tir par an, au cours desquelles nous tirons deux chargeurs, donc trente cartouches. Mais nous, nous tirons plus souvent. Nous avons des créneaux de tir réservés la nuit. Nous avons ainsi peut-être fait une dizaine de séances dans l'année. Si nous voulions tirer tous les jours, nous pourrions le faire… Sans nous jeter de fleurs, nous sommes tous les deux bons tireurs.
S'agissant de la distance de tir et de la précision de l'arme – une arme que j'apprécie – elle est de 25 à 30 mètres en stand de tir. Nous étions donc pratiquement au maximum, mais j'avais un appui, ce qui permet de gagner encore quelques mètres, les appareils de visée ne bougeant pas. Mon équipier tire encore mieux que moi, puisque même sans appui, il a réussi à toucher.
S'agissant du choix du tir, j’ai considéré que nous étions trop loin pour faire un tir à la tête : j’ai donc visé son buste. Je ne savais pas s'il portait un gilet pare-balles en dessous, mais comme il se tenait un peu de profil, ses flancs n’étaient pas protégés. En visant le tronc, j'étais persuadé de le toucher à 99 %.
M. Pascal Popelin. Vous a-t-il vus ?
Commissaire divisionnaire X. Non, c'est ce qui nous a permis de prendre notre temps, malgré l'urgence. Nous n'étions pas nous-mêmes sous le feu. S'il nous avait tiré dessus, les conditions auraient été totalement différentes. Techniquement, nous n'avons pas été stressés du tout : nous connaissons bien notre arme, nous la sortons régulièrement en intervention sans nécessairement faire feu, donc une mécanique se créé.
M. Olivier Falorni. Mais il y a le contexte, des cadavres partout…
Commissaire divisionnaire X. Notre cerveau a dû se bloquer pour faire abstraction de l'environnement. Je n'ai aucun souvenir de cadavres – j'ai essayé de ne pas trop les regarder. Nous nous sommes concentrés sur les aspects opérationnels.
M. Jean-Michel Villaumé. Je ne reviendrai ni sur la chronologie ni sur votre action, que nous qualifions tous d'héroïque et qui a permis de mettre un coup d'arrêt au massacre. J'aimerais vous interroger sur vos conditions d'intervention, de fonctionnement, sur vos moyens matériels. Comment pouvons-nous les améliorer ? Vous disiez qu'il fallait intervenir rapidement. Concrètement, qu'est-ce que cela implique ? Au niveau matériel, qu'attendez-vous de nous, qui votons des budgets, des programmes ? Quels sont vos besoins ?
Commissaire divisionnaire X. Comme vous le savez, nous n'avions pas d'équipement de protection. Mais je ne suis pas certain que cela nous ait porté préjudice. Nous avons eu l'avantage de la rapidité et de la discrétion. Un casque balistique peut en effet provoquer des reflets et attirer l’œil. Avec un gilet pare-balles et un bouclier lourds, vous faites forcément plus de bruits. En outre, vous ne pouvez tirer que d’une main. Je ne regrette donc pas d'avoir eu l'équipement habituel pour intervenir.
En ce qui concerne les moyens de protection et balistiques, nous allons recevoir du matériel avec le plan BAC : soit des gilets pare-balles lourds type BRI, soit des portes plaques. La plupart des fonctionnaires vont maintenant être équipés de moyens de protection. Il faut en effet que chaque agent possède individuellement un gilet pare-balles lourd ou un porte plaques, à même d’arrêter des munitions de type Kalachnikov, ainsi qu'une protection balistique au niveau du casque. Ensuite, avoir un bouclier lourd ou un bouclier balistique souple avec double porte plaque par équipage serait une bonne chose, avec une arme longue.
Il y a eu une polémique sur le choix de l'arme. Le G36 est une bonne arme. Le tir au coup par coup ou par deux coups est suffisant, car le tir en rafale ne peut pas être maîtrisé. Le calibre 9 millimètres, du type PM ou Heckler & Koch, n'est pas assez perforant si les individus portent des gilets pare-balles : donc du point de vue de la munition, le G36 est adapté.
En revanche, nous sommes dépourvus de moyens de protection auditifs et de moyens de communication, qui sont pourtant essentiels pour nous. On nous a livré des casques de protection balistique et c’est bien. Mais vous êtes sourd après avoir tiré une fois ou deux avec un fusil G36. Il faut donc aussi penser à ce qui n'est pas visible du public, comme les protections auditives.
M. Serge Grouard. En aviez-vous ?
Commissaire divisionnaire X. Non, mais sur du 9 millimètres, c'est moins gênant. En plus dans une salle de concert, la configuration atténue peut-être les bruits. Nous n'avons donc pas subi de traumatismes sonores, alors que nous avons tiré à un mètre l'un de l'autre.
Cette protection auditive doit être associée à des moyens de communication. Lorsque nous progressons en milieu clos, en colonne d'intervention, nous devons pouvoir communiquer, savoir où chacun se trouve et se parler. C'est essentiel en termes de sécurité. Il faut donc que les fonctionnaires portant un casque balistique soient aussi équipés de moyens de communication qui servent aussi de protection auditive.
M. le président. Cette audition est bientôt terminée, et je ne voudrais pas que vous ayez commis d'erreur dans votre déclaration, c'est pourquoi je voudrais que vous nous répétiez un élément précis. Vous étiez boulevard Voltaire, à l'entrée du Bataclan, après être ressortis après avoir neutralisé le terroriste lorsque la FIR est arrivée. Combien d’hommes y avait-il dans la première colonne ?
Commissaire divisionnaire X. Je n'ai pas pu déterminer leur nombre exact. Visuellement, je dirais qu'ils étaient peut-être six ou sept.
M. le président. Êtes-vous sûr qu'ils n'étaient pas quinze ?
Commissaire divisionnaire X. Je vois ce que représente une quinzaine de fonctionnaires quand j'aligne les miens : j’ai l'impression qu'ils étaient un peu moins, mais je ne peux pas être formel.
Brigadier Z. Je confirme les chiffres du commissaire. Mais il faut savoir que nous étions dans l'entrée du Bataclan. La première partie de la FIR était là, nous l’estimons à six ou sept personnes, mais l'entrée ne pouvait pas accueillir plus de monde que cela. Je ne les ai pas vus, mais il est possible, et même fortement probable, que les collègues aient été juste derrière, en attente de l'avancée des premiers.
M. le président. C'est pour cela que je vous demande de préciser ce point : vous avez dit que la FIR était arrivée à six personnes, sans émettre de doutes. Vous avez même dit qu'ils étaient en attente de leur soutien. Qu'est-ce que cela signifie ?
Commissaire divisionnaire X. Je crois avoir dit que je n'étais pas sûr de leur nombre. Leur soutien, c'est en référence au mode d'intervention de la BRI : il y a la FIR, et ensuite le H+30. Ce que j’appelle leur soutien, c’est le gros de la troupe. Moi, je n'ai eu de visuel que sur le chef de colonne, l'officier. Les hommes étaient le long du mur, et j'étais face à leur officier. J'ai pu penser qu'ils étaient six ou sept, mais ils étaient peut-être le double, peut-être que la seconde partie de la FIR était plus éloignée dans la rue. J'ai pris contact avec le précurseur, et j'ai progressé ensuite avec lui à l'intérieur du Bataclan, puis je n'ai plus du tout regardé ce qu'il faisait.
M. le président. Vous ne pouvez pas exclure la présence de la deuxième partie de la FIR derrière, arrivée en même temps que la première colonne ?
Commissaire divisionnaire X. Je n'ai pas de précision sur leur nombre exact, sur le fait de savoir s'ils étaient scindés en deux ou trois colonnes. Je ne saurais le dire.
M. le président. Messieurs, il nous reste à vous remercier d’être venus devant notre commission. Il est très important pour nous de disposer de tous ces éléments. Je vous exprime à nouveau toute notre reconnaissance.
udition, à huis clos, de fonctionnaires de la BAC de nuit du Val-de-Marne intervenus le 13 novembre 2015 : M. T.P., brigadier-chef, M. L. S., brigadier-chef, M. O. B., brigadier, M. N. B., gardien de la paix, M. A. D., gardien de la paix, et M. P. T., gardien de la paix
Audition, à huis clos, du lundi 21 mars 2016
M. le président Georges Fenech. Messieurs, nous achevons avec votre audition l'étude de la chronologie des événements de 2015. Votre témoignage viendra utilement compléter celui de vos collègues de la direction de la sécurité de proximité de l’agglomération parisienne (DSPAP) que nous avons reçus la semaine dernière.
Vous appartenez à la brigade anticriminalité (BAC) de nuit 94, et vous êtes intervenus, le 13 novembre dernier, lors de l'attentat commis au Bataclan, à l'angle du passage Saint-Pierre-Amelot et du boulevard Voltaire, où vous avez échangé des coups de feu avec les terroristes.
Cette audition se déroule à huis clos, en raison de la confidentialité des informations que vous êtes susceptibles de nous délivrer. Elle n'est donc pas diffusée sur le site internet de l'Assemblée. Néanmoins, et conformément à l'article 6 de l'ordonnance 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, son compte rendu pourra être publié en tout ou partie, si nous en décidons ainsi à l'issue de nos travaux.
Je précise que les comptes rendus des auditions qui auront eu lieu à huis clos seront au préalable transmis aux personnes entendues afin de recueillir leurs observations. Ces observations seront soumises à la Commission d’enquête, qui pourra décider d'en faire état dans son rapport. Je rappelle que, conformément aux dispositions du même article, « sera punie des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal, soit un an d’emprisonnement et 15 000 euros d'amende, toute personne qui, dans un délai de vingt-cinq ans, divulguera ou publiera une information relative aux travaux non publics d’une commission d’enquête, sauf si le rapport publié à la fin des travaux de la commission a fait état de cette information ».
Conformément aux dispositions de l'article 6 précité, je vais maintenant vous demander de prêter le serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité.
MM. T. P., brigadier-chef, L. S., brigadier-chef, O. B., brigadier, N. B., gardien de la paix, A. D., gardien de la paix, et P.T., gardien de la paix, prêtent successivement serment.
Je vous laisse la parole, en vous demandant de présenter rapidement le rôle que vous avez été amené à tenir, personnellement ou avec votre unité, avec toute la précision géographique et horaire possible.
M. T.P., brigadier-chef. Le soir du 13 novembre, j’étais chef de bord du véhicule indicatif BAC 952-11, affecté en priorité sur le Val-de-Marne, dans lequel avaient pris place le brigadier N. B. et M. N. B.. Nous nous trouvions vers Ivry et Charenton lorsque nous avons entendu le premier message sur les ondes parisiennes de la conférence régionale 137, concernant une explosion au Stade de France. Notre unité a intégré la sous-direction des services spécialisés, qui a vocation à intervenir sur toute la zone de compétence de la DSPAP en cas d’événement particulier. J’ai donc décidé de rentrer à Vincennes : nous voulions dîner rapidement afin d’être disponibles par la suite pour nous rendre dans le 93.
Nous avons eu l’information relative à la deuxième explosion en chemin, ce qui nous a poussés à accélérer le mouvement. Puis, au moment où nous nous installions à Vincennes, nous avons appris, par les ondes de la conférence 137, que des attaques avaient lieu sur des terrasses parisiennes. D’initiative, nous avons repris notre véhicule et notre matériel. En entendant où se déroulait la deuxième attaque de terrasses, nous avons décidé de nous rendre place de la Nation, où le parcours des terroristes semblait les mener. Nous nous y sommes mis en position, en attente.
Nous nous y trouvions, à l’angle du boulevard Voltaire, quand nous avons entendu que des attaques visaient d’autres terrasses et qu’une Polo noire immatriculée en Belgique avait pris la fuite en direction du boulevard Voltaire. Nous nous sommes alors engagés sur le boulevard pour essayer d’intercepter le véhicule. À l’instant même, nous avons entendu une explosion, une détonation. En poursuivant notre chemin, à 300 mètres environ, nous sommes parvenus à l’angle de la rue de Montreuil, au Comptoir Voltaire, dans lequel un kamikaze venait de se faire sauter et devant lequel déambulaient des victimes.
Après avoir diffusé l’information sur les conférences parisiennes, j’ai placé M. N. B. en position de protection sur le boulevard Voltaire avec le fusil à pompe au niveau du véhicule, et M. N. B. a pris l’angle de la rue de Montreuil et du boulevard, arme de poing à la main – nous ne savions pas à ce moment si les terroristes étaient encore sur place. De mon côté, j’ai dressé un bilan des victimes à l’intérieur et à l’extérieur du bar afin de pouvoir demander des secours. J’ai dénombré deux blessés légers au niveau du bar, à l’avant, et deux autres, plus grièvement blessés, sur le côté. À l’extérieur, deux femmes enceintes étaient touchées par des éclats. Dans le bar, sous la terrasse couverte, une serveuse se trouvait au sol, très grièvement blessée, ainsi qu’un monsieur de type africain. Au fond de la terrasse, quelqu’un dispensait un massage cardiaque à une personne de sexe masculin de type européen ou nord-africain.
Lorsque je suis sorti du bar pour demander des secours, j’ai appris par les ondes que des tirs avaient lieu au Bataclan. L. S., signalait sa présence sur place avec la BAC 952-12. On entendait les tirs à la radio lorsqu’il annonçait qu’il y avait énormément de victimes qu’ils commençaient à évacuer. Nous nous sommes sentis impuissants parce que nous ne pouvions pas quitter le Comptoir Voltaire où il fallait gérer les victimes.
Un véhicule de secours de la Croix-Rouge qui passait par là nous a porté assistance ainsi qu’une femme médecin et une infirmière. Nous avons continué d’assurer la protection du lieu. Deux véhicules de pompiers sont ensuite arrivés : un véhicule incendie et la grande échelle. Un pompier m’a répondu, lorsque je l’ai interrogé sur la présence de la grande échelle, que cela permettait d’avoir des effectifs sur place. Les pompiers ont alors pris en charge les blessés les plus graves.
Un véhicule de police parisien s’est présenté. Vu l’âge de la voiture, nous avons eu des doutes sur son appartenance au parc automobile de la police. Le commissaire de la police judiciaire du 15e arrondissement de Paris se trouvait à son bord. Après avoir entendu les messages radio, il avait embarqué deux collègues avec des gilets lourds pour venir en renfort sur le terrain depuis le 15e. Je lui ai décrit la situation, et, étant donné que nous disposions d’un équipement plus lourd que le sien, il a décidé de rester sur place et de nous envoyer au Bataclan aider nos collègues.
M. Sébastien Pietrasanta, rapporteur. Quelle heure était-il ?
M. A. D., gardien de la paix. Je suis le chauffeur de la BAC 952-12. Nous partons de Créteil à 21 heures 42 et nous arrivons au Bataclan à 21 heures 51.
M. T. P. Entre le moment où nous sommes au Comptoir Voltaire et notre arrivée au Bataclan, il doit s’écouler au maximum une dizaine de minutes.
Au Comptoir Voltaire, nous croyions avoir affaire à une fusillade comme sur d’autres terrasses. C’est une victime qui m’a expliqué qu’un homme était entré dans le bar et qu’il y avait eu une explosion, sans me préciser que nous nous trouvions en présence de l’acte d’un kamikaze. Je suis retourné sur la terrasse pour constater qu’il n’y avait pas de douilles au sol. Il ne s’agissait donc pas d’un tireur. La présence d’énormément de boulons indiquait qu’une bombe avait explosé, ce que j’ai immédiatement indiqué à TN 750.
En arrivant au Bataclan, entre un camion de pompiers et un car de police, nous avons vu la Polo des terroristes, garée régulièrement à l’angle du passage Saint-Pierre-Amelot et du boulevard Voltaire. Après nous être équipés d’un casque balistique avec visière non balistique et d’un fusil à pompe, O. B., N. B. et moi-même nous sommes placés en colonne pour prendre l’angle gauche du passage Saint-Pierre-Amelot afin d’éviter toute retraite des individus. S’ils sortaient de la salle pour rejoindre leur véhicule, il fallait que nous puissions nous engager afin de les neutraliser.
L. S. se trouvait à l’autre angle, côté Bataclan, et A. D. arrêtait des véhicules de particuliers et des taxis, dans lesquels il faisait évacuer des blessés avec l’aide d’une serveuse. Je voyais également P. T. qui aidait les victimes à sortir du Bataclan.
Les effectifs parisiens du car de police qui se trouvait sur place, le TC 82G, ne disposaient d’aucun équipement hormis leur gilet individuel et leur arme. Ils avaient cassé une porte qui se trouvait derrière notre position. Elle donne accès aux locaux administratifs du Bataclan, où ils avaient installé avec les pompiers un poste avancé médicalisé afin de porter les premiers soins aux victimes. A. D. et la serveuse dont je vous parlais faisaient la navette pour emmener les victimes.
La BAC 915 en civil de Saint-Maur-des-Fossés, qui nous a rejoints, s’est placée dernière nous, et le collègue stagiaire du TC s’est positionné avec nous dans la colonne. Nous avons entendu trois ou quatre tirs à l’intérieur du Bataclan et une explosion, puis la porte s’est ouverte et nous avons essuyé une première rafale de Kalachnikov.
M. Pierre Lellouche. De quelle porte s’agissait-il précisément ?
M. T. P. De la première porte de secours de la salle en venant du boulevard Voltaire. Elle donne sur le passage Saint-Pierre-Amelot.
Je n’ai pas pu riposter avec mon arme longue car un civil, hors de vue du terroriste, se trouvait debout à hauteur de la porte et tentait de transporter une femme blessée ou décédée. Les vitrines du magasin derrière lequel nous étions tous abrités me permettaient de voir l’individu armé, mais il nous voyait aussi. J’ai dit à mes collègues qui n’étaient pas protégés de dégager. L’individu a refermé la porte. N. B. s’est installé en appui feu derrière moi.
Lorsque nous avons pris une autre rafale, j’ai pu riposter par deux tirs car, cette fois, le civil était couché. Pendant le rechargement tactique de mon arme, j’ai expliqué à Nicolas que nous avions deux solutions : « Le top serait d’essayer de rentrer, mais l’un de nous ou même nous deux allons y rester, parce que nous n’avons aucune protection ; l’autre solution, sachant que nous avons face à nous une puissance de feu largement supérieure, c'est de jouer l’effet de surprise et de changer de place pour que je puisse avoir une meilleure position de tir. » Nicolas m’a dit : « Faisons ça ! »
Nous avons alors bougé. Les collègues se sont installés derrière le camion de pompiers, et je me suis positionné en appui feu au niveau du bloc moteur essieux du car de police – la seule zone qui assure une protection. J’avais un bon appui pour le fusil à pompe. Nous avons alors essuyé une troisième salve de tirs. L’individu a tiré sur l’angle du boulevard Voltaire puis, constatant que nous n’y étions plus, il a visé le camion de police et le camion de pompier. Une balle a traversé le véhicule de pompier de part en part pour ressortir pas loin de la tête d’A. D.. J’étais à nouveau dans l’incapacité de riposter, car le civil s’était relevé.
Les militaires de Vigipirate nous ont alors rejoints. Ils étaient équipés d’armes de guerre, donc plus à même que nous de riposter aux tirs. J’ai sollicité sur les ondes l’autorisation de les engager, mais on m’a répondu : « Négatif, vous n’engagez pas les militaires, on n’est pas en zone de guerre. » J’ai annoncé à un soldat que si nous étions sous le feu et qu’il ne pouvait pas utiliser son arme, je m’en servirais moi-même si je n’avais plus de munitions.
M. Pierre Lellouche. Qui vous a fait la réponse dont vous nous parlez ?
M. T. P. C’est la salle de commandement de la préfecture, par les ondes ! Nous communiquons grâce à une conférence radio : TN 750, la plus haute autorité parisienne au niveau radio.
Mme Françoise Dumas. Comment cela se passe-t-il, en temps normal et en situation exceptionnelle ?
M. T. P. En temps normal, nous écoutons les conférences du Val-de-Marne. En cas de besoin, nous sommes également toujours à l’écoute de la conférence 137 qui donne les informations régionales depuis la salle de commandement de la DSPAP qui a autorité sur Paris et sur toute la petite couronne et la grande couronne.
M. Pierre Lellouche. Relève-t-elle directement du préfet de police ? Un officier dirige-t-il la salle de commandement ?
M. le rapporteur. Je crois que le directeur de cabinet était en salle de commandement. Nous aurons l’occasion d’éclaircir ces points.
M. O. B., brigadier. De leur côté, les militaires ne sont pas gérés par la salle de commandement de la DSPAP. Ils dépendent d’un autre PC radio.
M. T. P. Le militaire m’explique qu’il n’a pas d’ordres et qu’il ne pourra pas engager le feu, même quand je lui dis que nous nous faisons tirer comme des lapins et qu’il faudra bien neutraliser ceux qui sortiront.
M. le rapporteur. Combien y avait-il de militaires ?
M. T. P. Ils étaient huit : quatre auprès de nous et quatre derrière.
M. Pierre Lellouche. De combien de munitions disposez-vous pour votre fusil à pompe en dotation normale ?
M. T. P. Dix. J’en avais six dans le fusil, et quatre dans ma poche.
M. Pierre Lellouche. Est-ce que ce sont des Brenneke ? Avez-vous d’autres armes ?
M. T. P. Ce sont des Brenneke. Ce fusil est la seule arme dont nous disposions. L. S. a la même arme, mais il ne pouvait pas engager le feu en raison de son angle de tir.
Dans le passage Saint-Pierre-Amelot, le civil, auquel nous avions demandé à plusieurs reprises de ne pas rester sur place, a tiré la personne au sol à l’arrière des portes de secours et s’est couché sur elle. Le terroriste, constatant qu’il n’avait plus l’avantage en termes de position de tir, a ouvert en grand les deux portes de secours. En face de moi, à trente mètres, l’individu s’est retrouvé derrière la porte gauche ouverte pour tirer une salve de kalachnikov. On voyait seulement dépasser son bras. J’ai visé par deux fois au travers de la porte. Après avoir rectifié mon premier tir qui était trop haut, j’ai tiré au niveau du torse. La kalachnikov s’est affaissée d’un coup sec au sol. Les portes se sont refermées tout doucement. Le civil qui était au sol m’a fait un signe, que je n’ai pas compris, en levant les deux mains. Nous avons gardé la position en attendant les renforts.
L’ensemble de notre unité est arrivé ensuite, c'est-à-dire le reste de la BAC de nuit 94 en tenue avec un équipement lourd : casque lourd, bouclier balistique, gilet lourd, armement plus adéquat. Nous sommes allés chercher de l’équipement dans notre car d’intervention, puis nous sommes revenus prendre notre position. Dans l’intervalle, d’autres effectifs étaient intervenus en renfort dont la brigade spécialisée de terrain (BST) et la BAC de Champigny-sur-Marne. La force d’intervention rapide (FIR) de la BRI est arrivée à ce moment-là.
M. le président Georges Fenech. Pouvez-vous estimer le temps qui s’est écoulé entre votre arrivée, les premiers échanges de tirs, et l’arrivée de la BRI ? Quinze minutes ?
M. T. P. Entre le premier échange de tirs et le dernier, il y a quasiment dix minutes. Nous sommes approximativement entre 22 heures et 22 heures 15. La BRI arrive à peu près vers 22 heures 45.
M. le président Georges Fenech. Vers 22 heures 50 ?
M. T. P. À peu près : je ne regardais pas ma montre.
Ils nous ont demandé de les épauler car ils n’étaient pas assez nombreux.
M. le président Georges Fenech. Combien y avait-il de membres de la FIR ?
M. T. P. Dans un premier temps, ils devaient être une douzaine.
Ils ont emprunté le bouclier balistique qu’utilisait O. B., un deuxième à la BST de Champigny et, je crois, un troisième à un autre service. Ils ne disposaient pas de protection balistique autre que leurs gilets. Leur tireur d’élite m’a demandé un appui feu et balistique pour traverser le boulevard Voltaire afin de disposer d’un angle de tir sur la façade du Bataclan. Nous nous sommes équipés en lourd avec deux boucliers et deux fusils à pompe, et nous l’avons accompagné à trois.
Le reste de la BRI est arrivé ainsi que le RAID. Ils se sont mis en position. Grâce à leur véhicule blindé, ils ont pu pénétrer dans le passage Saint-Pierre-Amelot pour secourir le civil qui s’y trouvait avec la dame au sol. Je ne sais pas combien de temps après ils ont donné l’assaut.
M. Pierre Lellouche. Est-il normal que les forces de la BRI n’aient pas de boucliers balistiques ?
M. T. P. Je ne sais pas quel était le moyen de transport des hommes de la BRI. Ils sont peut-être venus en moto. Les boucliers souples ou lourds, c'est-à-dire rigides, sont encombrants, et les véhicules administratifs dont nous disposons ne sont pas adaptés à nos missions actuelles. On ne met pas un bouclier balistique dans une Peugeot 308. Je ne vous parle même pas des collègues de commissariat avec leur Peugeot Partner.
L. S. avait un bouclier balistique parce qu’il roulait en Mondéo. Il faut aussi savoir que les boucliers balistiques souples n’arrêtent pas les munitions de kalachnikov – il faut les équiper d’une plaque spéciale qui pèse plus de vingt kilos. Les boucliers rigides arrêtent les tirs de kalachnikov, mais ils ne rentrent pas dans nos véhicules.
M. le président Georges Fenech. Monsieur L. S., je crois que la BAC 952-12 est arrivée en premier au Bataclan, n’est-ce pas ?
M. L. S., brigadier-chef. Je suis le chef de groupe de M. A. D. et de M. P. T.. Nous nous trouvions dans le secteur de Créteil lorsque nous avons entendu que des explosions avaient lieu au Stade de France. Nous nous sommes d’abord dirigés vers Saint-Denis, puis nous avons changé d’itinéraire pour rejoindre Paris et le Bataclan lorsque nous avons appris ce qui s’y passait. J’avoue que je suis un peu fâché avec les horaires : le gardien de la paix A. D sera plus précis que moi à ce sujet.
M. A. D. Je suis le chauffeur du chef L. S. et du gardien de la paix P.T. Nous sommes partis de Créteil à 21 heures 42, et nous sommes arrivés à 21 heures 51 au Bataclan. J’ai l’heure sur le tableau de bord du véhicule, et j’ai téléphoné à ma femme pour la prévenir au moment où nous sommes partis
M. le rapporteur. Vous arrivez avant le commissaire N, intervenu en premier sur les lieux ?
M. L. S. Nous arrivons juste un petit peu avant le commissaire et son équipier.
Notre intervention s’est déroulée en trois phases. Dans un premier temps, M. A. D prépare le matériel de sécurité, c'est-à-dire les casques lourds et le bouclier balistique – nous n’avons pas de gilet lourd. Pendant ce temps, M. P.T. et moi-même nous engageons dans le passage Saint-Pierre-Amelot. Nous rendons compte à notre station directrice de ce que nous voyons : c’est une scène de guerre, des personnes sont au sol, blessées ou mortes. Je crois, pour avoir débriefé avec lui par la suite, qu’à ce moment le commissaire N et son chauffeur pénètrent dans le Bataclan par l’entrée principale et neutralisent l’un des terroristes. Deux cents à trois cents personnes sortent du Bataclan par le passage. Nous scannons la foule du regard à la recherche d’éventuels terroristes. Nous assistons à un mouvement de panique, mais nous demandons aux personnes valides d’aider celles qui le sont moins. Certaines font demi-tour pour aider les blessés. Nous décidons d’escorter les personnes en question jusqu’à un lieu sécurisé pour qu’elles soient prises en charge par un service d’urgence. Je crois que nous prenons une salve de kalachnikov : nous voyons tomber des personnes autour de nous, mais nous ne parvenons pas à déterminer l’origine des tirs – c’est assez frustrant. M. A. D est ensuite venu nous rejoindre.
Dans une deuxième phase, après nous être mieux équipés, nous avons rejoint le commissaire N à la porte principale. Dans l’intervalle, la BAC 952-11 nous a rejoints ; nous étions heureux de les voir arriver. Nous avons ensuite attendu les services spécialisés, BRI et RAID.
Dans une troisième phase, une fois tous les renforts présents, nous avons sécurisé les lieux et participé à l’évacuation des personnes blessées.
M. le rapporteur. Vous êtes les tout premiers à arriver au Bataclan !
M. L. S. Tout à fait. Nous sommes les trois premiers policiers sur place. Le commissaire N et son chauffeur arrivent rapidement.
M. le rapporteur. À 21 heures 54 !
M. L. S. Quelques policiers du 20e arrivent ensuite.
M. A. D. Certains viennent aussi du commissariat central du 3 !
M. L. S. Quelques minutes après, nous sommes une dizaine de fonctionnaires.
M. le rapporteur. Lorsque vous arrivez, vous assistez, selon vos propres mots, à une « scène de guerre ». Pour quelles raisons vous fixez-vous sur le passage Saint-Pierre-Amelot ? Pourquoi ne décidez-vous pas d’entrer dans le Bataclan ? Vous manquiez d’effectifs, d’équipements ?
M. L. S. Lorsque nous arrivons, des personnes sortent par le passage Saint-Pierre-Amelot, ce qui attire notre attention. Nous pensons que les individus armés vont peut-être tenter de s’enfuir par ce passage dans lequel nous progressons. Nous entendons des coups de feu et des explosions tellement fortes qu’elles résonnent dans nos corps.
M. le rapporteur. De quelles explosions s’agit-il ? Des kamikazes qui se font exploser ?
M. L. S. Nous entendons, à l’intérieur du Bataclan, un bruit qui ressemble à celui de grenades qui explosent. Nous reconnaissons aussi le bruit caractéristique de tirs nourris de kalachnikov. Les explosions sont si puissantes que nous les entendons de l’extérieur, malgré l’épaisseur des murs d’une construction haussmannienne.
Nous avons estimé ce que nous étions en mesure de faire. Nous ne disposions ni des effectifs ni des moyens matériels pour intervenir correctement. La plupart des fonctionnaires étaient engagés sur le site du Stade de France.
M. le président Georges Fenech. Si vous aviez disposé des moyens et de l’équipement nécessaires, seriez-vous rentrés dans le Bataclan ?
M. L. S. On aurait peut-être pu figer un peu la situation. Ce qui est frustrant, c’est de voir des gens tomber. Nous aurions voulu faire plus, mais nous n’avons pas pu le faire par manque de moyens matériels.
La BRI avec laquelle nous avons débriefé nous a dit que nous avions eu le bon réflexe : il fallait cerner le Bataclan afin de fixer les terroristes et de leur montrer que nous étions là. Dès lors qu’une présence policière attire leur attention, il y a des chances qu’ils s’intéressent moins aux otages.
M. le rapporteur. Après que le commissaire N a tué le kamikaze, deux à trois cents personnes sortent du Bataclan, nous dites-vous. Est-ce à ce moment que plusieurs rafales sont tirées ? Y a-t-il eu des victimes de ces tirs parmi les spectateurs du Bataclan ?
M. L. S. Des personnes s’écroulent à la sortie, mais nous ne savons pas si elles ont été blessées à l’intérieur. Comme je vous le disais, nous ne savons pas d’où viennent les tirs, même si nous voyons des impacts. Dans un instant pareil, tous nos sens sont à la fois en éveil et perturbés. Nous essayons d’être le plus réactifs et d’analyser la situation, mais le stress amoindrit une partie des réflexes professionnels. Nous essayons de travailler correctement. Le but était de sauver un maximum de gens.
M. le rapporteur. Après l’intervention du commissaire N, lorsque les spectateurs sortent en masse, tire-t-on sur eux ?
M. T. P. Lorsque nous essuyons des rafales dans le passage Saint-Pierre-Amelot, il ne s’y trouve plus que le monsieur dont je vous ai parlé, qui déplace une femme.
M. L. S. M. P. T. intervient juste après nous. À notre arrivée, il y avait du monde qui courait en tous sens en sortant du Bataclan par le passage Saint-Pierre-Amelot.
M. A. D. Lorsque les spectateurs sortent du Bataclan, l’individu ou les individus tirent depuis l’intérieur sur les spectateurs qui se trouvent quasiment à la porte. Une balle de kalachnikov traverse tout : L. S. et P. T. sont témoins de ces tirs.
M. le rapporteur. Cela se déroule avant 21 heures 57 et l’intervention du commissaire N.
M. T. P. Oui.
M. le rapporteur. Après 21 heures 57 et la mort du kamikaze, il n’y a plus de tirs, mis à part les rafales qui visent directement la BAC dans le passage Saint-Pierre-Amelot ?
M. T. P. Le commissaire N est entré avec son chauffeur. On entend alors ses tirs et une explosion. Une fois que l’individu visé est neutralisé, nous essuyons les premières rafales côté passage Saint-Pierre-Amelot. Pendant les dix minutes durant lesquelles le terroriste nous tire dessus, nous n’entendons plus d’autres tirs à l’intérieur.
M. le président Georges Fenech. Parce que l’autre est mort.
M. T. P. L’un d’entre eux a été neutralisé. L’autre est là-haut en train de… J’ai tendance à me dire que, tant qu’on tire sur moi, on ne tue personne d’autre.
M. Pierre Lellouche. Que voulez-vous dire par « en train de… » ?
M. le président Georges Fenech. Je crois que certaines choses n’ont jamais été dites. Je pense que l’on pourrait peut-être, à ce stade, éclaircir les choses.
M. T. P. Des corps n’ont pas été présentés aux familles parce qu’il y a eu des gens décapités, des gens égorgés, des gens qui ont été éviscérés. Il y a des femmes qui ont pris des coups de couteau au niveau des appareils génitaux.
M. le président Georges Fenech. Tout cela aurait été filmé en vidéo pour DAECH !
M. T. P. Il me semble. Les victimes en ont parlé.
M. le rapporteur. Ces actes ont été commis par les deux survivants. Savez-vous si vous avez blessé celui sur lequel vous avez tiré dans le passage Saint-Pierre-Amelot ?
M. T. P. Je pense, mais je n’ai aucune certitude. Comme ils se sont fait sauter, on ne peut pas savoir s’il était blessé au tronc. Je pense l’avoir touché car les tirs ont cessé, et la porte s’est refermée. Le fait que la kalachnikov s’affaisse et que les portes se referment me semble significatif. Plus tard, nous avons parlé avec le civil qui nous faisait des signes dans le passage Saint-Pierre-Amelot : il nous a dit que nous avions touché le tireur et que c’est pour cela qu’il avait cessé de tirer.
Après ce moment, les tirs que nous avons entendus à l’intérieur n’étaient que très sporadiques. Il n’y a plus eu de rafales. Selon toute vraisemblance, un des terroristes ou plusieurs achevaient les gens. Ensuite, j’avoue que je n’ai fait que quinze mètres à l’intérieur du Bataclan derrière la BRI. Ma présence n’était pas nécessaire, je suis donc ressorti. Ce que j’avais vu m’avait suffi.
M. Pierre Lellouche. Les exactions sur les gens se sont déroulées à quel endroit ?
M. T. P. À l’étage.
M. Pierre Lellouche. Cela se passe après que l’individu que vous avez blessé est remonté ?
M. T. P. Je pense même que ça s’est produit avant, mais ce n’est que mon avis personnel. Pendant que nous fixions un terroriste à la porte de secours, un autre faisait toutes ces choses ignobles à l’étage.
M. Pierre Lellouche. La vidéo est partie ?
M. le président Georges Fenech. Je crois savoir que des vidéos sont parties.
M. Pierre Lellouche. On peut le savoir si l’on a récupéré les portables des victimes. On les a ?
M. T. P. Ils se sont fait exploser. Il y a eu des personnes décapitées, égorgées, éviscérées. Il y a eu des mimiques d’actes sexuels sur des femmes et des coups de couteau au niveau des appareils génitaux. Si je ne me trompe pas, les yeux de certaines personnes ont été arrachés.
M. A. D. Je voudrais apporter une précision pour répondre à la question de M. le rapporteur qui se demandait pourquoi mes collègues avaient immédiatement pris la direction du passage Saint-Pierre-Amelot. Ils l’ont dit : c’est parce que l’on voyait des victimes sortir par les portes de secours, mais c’est aussi parce que, quelque temps après que nous sommes descendus de voiture, un véhicule de police est arrivé et s’est garé devant l’entrée principale du Bataclan, en direction de la rue Oberkampf, en attendant sans doute d’autres collègues. C’est donc naturellement, puisque nous nous trouvions du côté du boulevard Richard-Lenoir, que mes collègues ont pris la direction du passage Saint-Pierre-Amelot où l’on voyait des victimes, alors que ceux qui arrivaient du côté du boulevard Voltaire s’occupaient de l’entrée principale du Bataclan.
M. Pierre Lellouche. Le commissaire N arrive trois minutes après vous et il rentre directement dans le Bataclan. Vous vous êtes parlé ?
M. L. S. Non.
M. Pierre Lellouche. En fait, vous ne savez même pas qu’il est rentré dans la salle ?
M. L. S. Nous n’en savions rien, et il ne savait pas que nous étions du côté des sorties de secours. Dans un second temps, nous nous sommes retirés pour protéger un peu les victimes, et nous avons eu un contact visuel avec le commissaire N. Notre équipage s’est ensuite dissocié en deux groupes : A. D. a rejoint la BAC 952-11 de M. T. P, tandis que M. P.T. et moi-même rejoignions le commissaire N à l’entrée de la salle.
Ce dernier souhaitait pénétrer à nouveau dans le Bataclan, mais une lumière nous éblouissait, nous ne connaissions pas la topographie exacte, et nous étions encore sous-armés. Nous n’avions donc ni les moyens matériels ni la connaissance des lieux qui nous auraient permis de progresser dans le Bataclan. Si les terroristes étaient sortis, nous aurions tout fait pour les neutraliser, mais nous savions que nous n’avions pas les moyens matériels pour intervenir dans la salle en toute sécurité.
M. Pierre Lellouche. C’est pendant ce temps que vos collègues sortent les blessés du Bataclan ?
M. L. S. Deux ou trois personnes ont réussi à sortir, nous les avons accompagnées. Lorsque les services spécialisés sont arrivés, ils ont pris le relais. Nous avons élargi le périmètre puis nous l’avons sécurisé en travaillant, lorsque c’était nécessaire, en équipes mixées avec la BRI. Je me suis trouvé pendant un moment avec un collègue de la BRI qui avait ses ondes opérationnelles. J’avais conservé la fréquence de la BAC 75 N. Nous échangions nos informations. Nous avons eu beaucoup de difficultés pour communiquer sur cette intervention. C’était un gros problème. Nous avions du mal à obtenir la fréquence d’urgence…
M. Pierre Lellouche. Plusieurs fréquences émettaient en même temps ?
M. L. S. En temps normal, si vous demandez la priorité sur cette onde, on vous l’accorde, mais, ce soir-là, la demande venait de partout en même temps, ce qui a saturé le système.
M. Jean-Michel Villaumé. À ce moment, les militaires sont-ils présents ?
M. L. S. Ils sont présents dans une deuxième phase, mais pas au début de notre intervention.
M. T. P. Nous sommes arrivés sur place dix minutes après Laurent. Nous avons essuyé des tirs passage Saint-Pierre-Amelot pendant dix minutes, et les militaires sont arrivés dans cet intervalle puisqu’ils étaient avec nous lors des deux dernières salves. Ils devaient être sur place un quart d’heure après l’intervention de l’équipe de L. S..
S’agissant de la coordination et de la communication, les terroristes ont réussi à faire ce qu’ils voulaient : saturer les ondes. Ils ont utilisé un procédé militaire qui consiste à multiplier les points d’impact pour saturer les services de secours et d’intervention.
Ils ont été surpris parce qu’ils ne s’attendaient sans doute pas à une réaction aussi rapide de notre part, mais ils ont, en un sens, réussi. Laurent et moi-même nous sommes rendus sur place d’initiative. À aucun moment nous n’avons demandé l’autorisation d’aller au Bataclan. Les BAC 75, 92 et 93 ont été rassemblées pour former la BAC d’agglomération de nuit. Nous avons en conséquence la possibilité de prendre des initiatives.
M. le président Georges Fenech. Les premiers intervenants sont tous venus d’initiative. C’est le cas de la DSPAP, du commissaire N, de la BAC. Ceux qui réagissent sur commandement arrivent dans un deuxième temps, vers vingt-deux heures cinquante.
M. T. P. Il faut aussi savoir que, pour la couverture radio, Paris est divisé par arrondissement. Les ondes étaient donc déjà monopolisées parce que, dans la même zone, il y a eu multiplication des attaques puis des appels pour secourir les nombreuses victimes. Devant cet embouteillage, ni Laurent ni moi n’avons pris les ondes pour annoncer nos déplacements. Nous ne l’avons fait qu’une fois à destination : moi au Comptoir Voltaire, Laurent au Bataclan.
M. Pierre Lellouche. Lorsque nous nous sommes rendus sur place, jeudi dernier, M. B.B et Mme C.P, deux membres de la CSI-75, la compagnie de sécurisation et d’intervention compétente pour l’agglomération parisienne, nous ont raconté qu’ils avaient évacué des victimes durant toute la soirée. Ils étaient sur place lorsque vous êtes arrivés : vous avez dû les voir ?
M. T. P. La CSI n’était pas au Bataclan, mais sur les terrasses. Ils n’y sont arrivés que bien après nous.
M. le président Georges Fenech. M. B.B est allé directement au Bataclan.
M. T. P. Nous étions sur la conférence régionale 137 ; nous n’avions pas les ondes parisiennes.
M. Pierre Lellouche. Il y a quelque chose qui ne colle pas bien : je vois le commissaire arriver, s’appuyer sur le bar et descendre un terroriste. Mais il y avait ces deux policiers…
M. le président Georges Fenech. Il y avait le commissaire B.B et C.P qui est son adjointe.
M. P. T. J’ai participé à l’évacuation avec le commissaire B.B. La BRI qui est venue nous relever, a installé un bouclier Ramsès devant la porte du Bataclan avant de pénétrer à l’intérieur de l’établissement qu’ils ont sécurisé comme ils pouvaient. La colonne de la BAC 75 N les a suivis avec l’armement d’assaut. Sur ordre de BRI, nous avons commencé à évacuer tous les blessés valides qui pouvaient se déplacer par eux-mêmes. Ils sont venus vers nous et, après une palpation sommaire, nous les avons dirigés vers le PC sécurité. Nous avons ensuite commencé à évacuer les blessés qui se trouvaient au sol grâce à des barrières de sécurité. Le commissaire B.B nous a aidés avec d’autres collègues.
M. Pierre Lellouche. En gros, il s’est passé une heure entre le moment où le commissaire tue le terroriste et l’assaut.
M. le président Georges Fenech. L’assaut a lieu à minuit vingt.
M. L. S. Grosso modo, oui.
Les horaires des événements correspondaient globalement à ceux de la relève entre la CSI, qui travaille de jour, et la BAC 75 N. Pendant la relève, nous avons parfois un problème de moyens, puisque certains matériels sont mutualisés entre les équipes du jour et de la nuit.
M. Pierre Lellouche. Vous étiez sur place en permanence : vous n’avez plus entendu de coup de feu entre le moment où le commissaire a tiré et l’assaut ?
M. L. S. Seulement de manière très sporadique.
M. T. P. Au coup par coup.
M. L. S. Nous n’entendons plus de rafales.
M. Pierre Lellouche. Il y a combien de tireurs ?
M. L. S. Nous ne les voyons pas. Nous entendons des tirs de temps en temps. J’extrapole, mais on peut imaginer qu’ils faisaient le tour et que, de temps en temps, ils mettaient une cartouche ou deux dans certaines victimes.
M. T. P. Ce qui est sûr, c’est que, à partir de l’arrivée des effectifs de la BRI, il n’y a plus eu de tir du tout. Vous voudrez bien excuser l’expression, mais il régnait un silence de mort. Il n’y avait plus aucun bruit.
M. Pierre Lellouche. À ce moment, ils n’étaient plus que deux avec les vingt personnes coincées en haut.
M. T. P. Oui, je pense. Je pense qu’ils s’étaient isolés à ce moment dans la pièce dans laquelle ils se sont fait sauter.
M. Pierre Lellouche. Si vous aviez eu le matériel nécessaire, vous y seriez allés ?
M. L. S. Si nous avons les moyens de nous protéger de manière sérieuse, et du matériel en rapport avec l’agression, cela rééquilibre les forces, et nous devenons opérationnels. Ce soir-là, je vous le dis franchement, j’ai emmené mes gars en enfer. Ils sont allés au-delà de leurs capacités physiques et matérielles. Heureusement, j’ai avec moi de bons sportifs, des gars qui ont à la fois une tête et des jambes, qui s’exercent avec sérieux et qui sont capables de réagir correctement au stress. Vous ne pouvez pas faire ça avec n’importe qui. Si nous avions eu plus de matériels de protection et des armes plus efficaces, nous aurions peut-être pu être plus réactifs ou opérationnels.
M. le président Georges Fenech. Quel est votre ressenti personnel s’agissant de l’intervention du commissaire N qui est entré dans le Bataclan avec une arme de poing sans aucune protection ?
M. L. S. Des moniteurs de tir m’ont dit que le commissaire N était sportif et s’entraînait au tir régulièrement. C’est un homme de terrain polyvalent, tant physiquement qu’opérationnellement. Il est très à l’aise avec son arme. Lui et son équipier ont fait preuve de sang-froid et de courage. Ils sont vraiment allés au-delà de leurs capacités, et je suis admiratif à leur égard. Par rapport aux moyens dont ils disposaient, ils ont vraiment été « culottés ».
M. T. P. Ce qu’ont fait le commissaire N et son collègue, au moment où ils ont agi, avec un matériel qui était le même que le nôtre – je crois qu’ils n’avaient même pas de casque qui, de toute façon, ne sert à rien face à une kalachnikov –, c’est techniquement, sur le plan policier, le maximum que l’on puisse faire. Le tir a été effectué au niveau de la porte d’accès à la salle. Ils étaient dissimulés mais pas protégés. Ils ont pu neutraliser le terroriste par surprise.
Dans le passage Saint-Pierre-Amelot, ni Laurent et son équipage ni moi et le mien ne pouvions progresser : nous y serions restés, c’est sûr.
Du côté de l’entrée principale, ce qu’ils ont fait était « nickel », si je peux me permettre. C’était ce qu’il fallait faire : tenter de neutraliser l’individu sans trop progresser. C’est pour cela qu’ils n’ont pas trop progressé dans la salle.
M. le président Georges Fenech. Ils y sont tout de même retournés une deuxième fois !
M. L. S. Au risque de vous choquer, le but – ce que nous avons fait d’initiative, de façon presque inconsciente – était de juguler les terroristes et de les laisser, malheureusement, dans le Bataclan pour éviter qu’ils ne fassent d’autres victimes dans un nouveau lieu. En attendant les forces spéciales, il fallait essayer de les contenir sur le lieu où ils se trouvaient.
M. le rapporteur. Le ministre de l’intérieur a annoncé que des équipements supplémentaires seraient livrés, notamment aux BAC. Savez-vous quand ils vous parviendront ?
M. L. S. Deux jours après les événements, nous avons rencontré M. Bernard Cazeneuve, le ministre de l’intérieur, qui nous a annoncé que nous serions dotés de véhicules et de moyens matériels supplémentaires. Ils nous arrivent petit à petit. Il est question que nous récupérions des berlines dont le coffre soit plus adapté au matériel dont nous avons besoin. Nous avons reçu des boucliers balistiques avec des plaques de renfort qui protègent des tirs de kalachnikov, et des armes intermédiaires : lanceurs de projectile de calibre de 40 millimètres, Taser, grenades.
M. Pierre Lellouche. Je m’entraîne régulièrement au tir dans les locaux de la police. Je sais ce que c’est de tirer à quarante-cinq mètres dans la pénombre : ce n’est pas évident, sauf si l’on est très bien entraîné. Combien de fois un policier de terrain tire-t-il par an ?
M. L. S. En BAC, nous avons des « open tirs » une fois par semaine. Nous arrivons à tirer une fois par semaine, ou une fois tous les quinze jours. Nous avons un entraînement sportif une fois ou deux par semaine. Il faut savoir que nous sommes des privilégiés. Il y a aussi eu des périodes de carence de munitions pendant lesquelles nous ne tirions que deux fois huit cartouches. Nous nous retrouvions alors dans la situation du service général qui doit effectuer un minimum de trois tirs annuels.
M. T. P. Nous sommes privilégiés parce que, grâce aux séances de tir spéciales de la BAC, nous pouvons tirer beaucoup plus que les autres. Nous tirons en général au moins dix fois par an.
M. Pierre Lellouche. En gros, donc, vous tirez une fois par mois. Combien de cartouches ? Une cinquantaine ?
M. T. P. et M. L. S. Non ! Une trentaine.
M. L. S. Nous avons deux chargeurs de quinze cartouches.
M. T. P. Fort heureusement, nos moniteurs de tir savent s’adapter. Ils proposent des tirs de situation qui optimisent les munitions dont nous disposons. Je répète que nous sommes des privilégiés : les collègues de commissariat tirent trois fois par an, c'est-à-dire quatre-vingt-dix cartouches… lorsqu’il y a des cartouches.
M. L. S. Nous allons être dotés du fusil HK G36 : nous essayons de trouver des stands de tir adaptés aux cartouches de cette arme.
M. le président Georges Fenech. Peut-être M. N. B., qui n’a pas encore pris la parole, souhaite-t-il ajouter quelque chose ?
M. N. B., gardien de la paix. Je suis l’équipier de la BAC 952-11. Ce soir-là, mon chef de bord était M. T.P., et mon chauffeur le brigadier N. B.
Le 13 novembre, nous nous sommes d’abord arrêtés au Comptoir Voltaire. Ma mission a consisté à sécuriser l’angle du café vers la rue de Montreuil. Le brigadier-chef T.P. me donnait des instructions et m’informait. Dans le café, il a constaté qu’il y avait eu une explosion et non des tirs.
Nous étions à la recherche de la Polo en fuite. Je prenais le temps de regarder les plaques d’immatriculation – la Polo était immatriculée en Belgique – et les passagers de chaque véhicule qui passait.
Nous sommes ensuite partis au Bataclan.
M. O. B. Lorsque nous étions à l’angle du passage Saint-Pierre-Amelot, alors que des personnes dans le Bataclan subissaient des choses atroces, nous avons eu beaucoup de chance. Nous sommes retournés sur place, et le propriétaire du magasin de carrelage derrière lequel nous nous étions abrités nous a expliqué que sa boutique était une ancienne banque dont les vitres étaient blindées. Cela nous a protégés – je n’avais qu’un bouclier balistique sans plaques additionnelles.
À l’angle, nous entendions des gens gémir, mais nous ne pouvions pas aller les aider parce que nous ne disposions pas du matériel adéquat.
M. le président Georges Fenech. Pour l’information de la commission d’enquête, monsieur P. T., pouvez-vous nous dire comment vous avez appris qu’il y avait eu des actes de barbarie à l’intérieur du Bataclan : décapitations, éviscérations, énucléations… ?
M. T. P. Après l’assaut, nous étions avec des collègues au niveau du passage Saint-Pierre-Amelot lorsque j’ai vu sortir un enquêteur en pleurs qui est allé vomir. Il nous a dit ce qu’il avait vu. Je ne connaissais pas ce collègue, mais il avait été tellement choqué que c’est sorti naturellement.
M. Alain Marsaud. Les actes de tortures se sont passés au deuxième étage ?
M. T. P. Je pense, car je suis entré au niveau du rez-de-chaussée où il n’y avait rien de tel, seulement des personnes touchées par des balles.
M. Alain Marsaud. À votre connaissance, ils étaient trois sans aucun doute ? Il n’y a aucune chance qu’un quatrième se soit enfui ?
M. T. P. On est certains qu’ils étaient au moins trois, mais ils étaient peut-être quatre. Les ondes retransmettaient les appels au numéro d’urgence de la police, le 17 : on entendait parler de trois individus, voire quatre.
M. Alain Marsaud. Est-il exclu qu’une quatrième personne ait pu s’enfuir en se faisant évacuer parmi les blessés ?
M. T. P. Ce n’est pas exclu. C’est la raison pour laquelle mes collègues ont procédé à des palpations sommaires de toutes les victimes, même blessées, qui sortaient par l’entrée principale.
M. L. S. Nous effectuions systématiquement une palpation sommaire, au moins au niveau du plexus, de la base du torse, et des jambes.
M. Alain Marsaud. Un quatrième terroriste aurait pu être blessé lui-même ou s’enfuir parmi les blessés ?
M. T. P. Parmi les blessés, je ne pense pas.
M. Alain Marsaud. On ne retrouve que trois armes de guerre.
M. L. S. Cela relève des investigations. Pour notre part, nous n’en savons rien.
M. le président Georges Fenech. Messieurs, nous vous remercions vivement d’avoir livré ce très important témoignage. La commission d’enquête salue votre courage et l’intervention qui a été la vôtre.
Audition, à huis clos, de M. Jean-Marc Falcone, directeur général de la police nationale, et de M. Marc Baudet, conseiller stratégie et prospective
Compte rendu de l’audition, à huis clos, du lundi 21 mars 2016
M. le président Georges Fenech. Nous vous remercions d'avoir répondu à la demande d'audition de notre commission d'enquête relative aux moyens mis en œuvre par l'État pour lutter contre le terrorisme depuis le 7 janvier 2015.
Vous savez que nous avons déjà tenu de nombreuses auditions, consacrées aux victimes et à leur prise en charge par les secours, puis à la chronologie des événements de janvier et de novembre 2015.
Nous commençons avec vous une nouvelle phase de nos travaux tendant, à la lumière de l'expérience des attentats de janvier et novembre 2015, à nous interroger sur les moyens et les missions des forces de police.
Cette audition, en raison de la confidentialité des informations que vous êtes susceptibles de nous délivrer, se déroule à huis clos. Elle n'est donc pas diffusée sur le site internet de l'Assemblée. Néanmoins, et conformément à l'article 6 de l'ordonnance 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, son compte rendu pourra être publié en tout ou partie, si nous en décidons ainsi à l'issue de nos travaux. Je précise que les comptes rendus des auditions qui auront eu lieu à huis clos seront au préalable transmis aux personnes entendues afin de recueillir leurs observations. Ces observations seront soumises à la Commission, qui pourra décider d'en faire état dans son rapport.
Je rappelle que, conformément aux dispositions du même article, « sera punie des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal – un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende – toute personne qui, dans un délai de vingt-cinq ans, divulguera ou publiera une information relative aux travaux non publics d'une commission d'enquête, sauf si le rapport publié à la fin des travaux de la commission a fait état de cette information ».
Conformément aux dispositions de l'article 6 précité, je vais maintenant vous demander de prêter le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité.
M. Jean-Marc Falcone et M. Marc Baudet prêtent serment.
Je vous laisse la parole pour un exposé liminaire qui sera suivi par un échange de questions et réponses.
M. Jean-Marc Falcone, directeur général de la police nationale. Mesdames et messieurs les députés, je serai très bref. Je souhaite simplement, par courtoisie pour la Commission, repositionner la Direction générale de la police nationale (DGPN) parmi l’ensemble des forces de sécurité intérieure, puis vous exposer très rapidement l’action de cette direction en réponse aux attentats que nous avons connus en janvier et en novembre. Ensuite, je présenterai de manière schématique les dispositions que j’ai pu prendre à mon niveau, en qualité de directeur général, après les retours d’expérience effectués avec mes services à la suite des attentats.
La Direction générale de la police nationale est composée de 145 000 agents, et s’appuie sur des directions de police active.
Parmi elles, la Direction centrale de la sécurité publique (DCSP) est une direction généraliste. Elle comprend le Service central du renseignement territorial (SCRT).
Nous avons également des directions dites spécialisées, à compétence nationale, telles que la Direction centrale de la police judiciaire (DCPJ) ; la Direction centrale de la police aux frontières ; la Direction centrale des compagnies républicaines de sécurité, qui ont aussi compétence nationale ; le Service de recherche, assistance, intervention, dissuasion – le RAID – qui est directement rattaché au directeur général de la police nationale ; et le service de la protection qui est chargé de protéger les personnalités susceptibles d’être menacées.
L’engagement de cette direction générale a été réel, bien que les attentats ne se soient pas déroulés dans sa zone de compétence, le préfet de police de Paris ayant une compétence spécifique. Nous parlons de compétence de plein exercice. Néanmoins, les directions que je viens de citer ont apporté leur contribution aux opérations menées lors des attentats. Ainsi, le 7 janvier, les services de police situés dans les départements du Val-d’Oise, de l’Oise, de la Seine-et-Marne et de la Marne ont été mobilisés pour la recherche des frères Kouachi : près de 700 agents ont apporté leur assistance à la recherche.
Le 13 novembre, vers 22 h 40, j’ai fait converger sur Paris 215 policiers des départements de la grande couronne – Seine-et-Marne, Yvelines, Essonne et Val-d’Oise – pour prêter renfort au préfet de police, et en particulier à la Direction de la sécurité de proximité de l’agglomération parisienne (DSPAP).
La Direction centrale de la police judiciaire a aussi été très largement mobilisée, avec le « dispositif attentat », sur lequel je pourrai revenir si vous le souhaitez. Au plus fort des attentats du 13 novembre, ce ne sont pas moins de 750 enquêteurs issus de cette direction qui ont participé aux recherches, aux constatations et aux opérations de police technique et scientifique sur Paris.
La Direction centrale de la police aux frontières a également été mise à contribution ; près de 5 000 fonctionnaires de cette direction ont été déployées sur les frontières lorsque l’état d’urgence a été décrété.
Et bien évidemment, le personnel du RAID a contribué, par son action dans le cadre de ses missions, aux interventions faisant suite aux attentats de janvier et de novembre, en collaboration notamment avec la Brigade de recherche et d'intervention de la préfecture de police de Paris (BRI-PP). Ces fonctionnaires du RAID participent plusieurs fois par semaine aux opérations de la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) ou de la sous-direction antiterroriste (SDAT) lorsque ces services interpellent des personnes radicalisées ou susceptibles de passer à l’acte dans un cadre terroriste.
Depuis les attentats de janvier, j’ai repositionné le service central du renseignement territorial sur la prévention du terrorisme, en faisant suivre un certain nombre de personnes dites radicalisées. Actuellement, près de 3 000 sont suivies par ce service.
J’ai également créé un état-major auprès de moi, car nous nous sommes aperçus que la Direction générale de la police nationale n’était plus dans la même position qu’au cours des décennies passées. Elle doit maintenant jouer un rôle beaucoup plus opérationnel pour gérer au quotidien les états-majors des différentes directions que je viens de citer. J'ai donc créé un état-major qui intègre un centre d'information de la police nationale qui regroupera, dans les prochaines semaines, les dispositifs d'information de toutes les directions, qui étaient jusqu’à présent éclatés. J'aurai donc auprès de moi un état-major pour commander l'ensemble des directions centrales de la police, et un centre d'information qui va regrouper les centres d'information des services et des directions que je viens de citer.
Au sein de la Direction centrale de la police judiciaire, nous avons fait monter en puissance la sous-direction de la lutte contre la cybercriminalité avec le programme PHAROS (plateforme d'harmonisation, d'analyse, de recoupement et d'orientation des signalements) et les enquêtes liées à la cybercriminalité. Le dispositif attentat a été mis en œuvre au mois de novembre ; et les effectifs de la sous-direction anti-terroriste (SDAT) ont sensiblement augmenté, ce qui était nécessaire au vu du nombre d'enquêtes qu'elle doit suivre.
Les sept GIPN métropolitains ont été transformés en antennes RAID, sous le commandement unique et centralisé du RAID central à Bièvres, ce qui permet de donner des instructions et d'avoir à disposition les 270 opérateurs qui composent les antennes et le service central.
Enfin, j'ai fait monter en puissance l’unité de coordination de la lutte antiterroriste (UCLAT) avec la cellule d'appel radicalisation et le fichier FSPRT, qui répertorie l'ensemble des personnes signalées comme pouvant être radicalisées.
Au plan tactique, nous avons décidé d'adapter les dispositifs de formation initiale et continue des policiers, puisque nous nous sommes aperçus que la menace avait changé de nature, y compris dans ses formes, de plus en plus violentes et rédhibitoires. Nous avons fait en sorte de former l'ensemble des brigades et des fonctionnaires.
Nous sommes en train de mettre la dernière main au schéma national d'intervention, que le ministre de l’Intérieur pourra arrêter d'ici une semaine ou deux. Il en avait fait la demande après les attentats de novembre, afin de pouvoir concentrer et articuler l'ensemble des services d'intervention.
Nous avons également diffusé une doctrine à destination des primo-intervenants, car ce seront, par définition, les premiers à être exposés à des actes de terrorisme, et à un terrorisme de plus en plus violent et tueur. J'ai donc reconstruit une doctrine avec des « fiches réflexes » que j'ai fait distribuer avant Noël.
Il a aussi fallu organiser la police judiciaire pour prendre en compte la décision du parquet antiterroriste de saisir systématiquement la DCPJ-SDAT pour qu'elle coordonne les enquêtes en cas d'attentats sur le territoire.
Nous continuons de procéder aux différents recrutements décidés par le Gouvernement, pour la plupart dans le cadre de plans pluriannuels : le plan antiterroriste, le plan immigration et le pacte de sécurité du Président de la République. Nous prévoyons aussi l'organisation exceptionnelle de concours de recrutement de gardiens de la paix, puisque nous faisons entrer cette année 4 600 gardiens de la paix dans les écoles, tandis qu'autant en sortiront en fin d'année ainsi que l'an prochain. Il a donc fallu que mon administration réponde le plus vite possible, avec des moyens adaptés, à ces demandes tout en garantissant une formation initiale soutenue et la plus complète possible, afin de bénéficier de ces renforts dont nous avons bien besoin.
S'agissant des moyens, le plan BAC entre en vigueur. Les brigades anti-criminalité, composées de gens formés dont l'expertise est plus affirmée que celle des premiers intervenants ont en effet une capacité d’intervention. Elles peuvent, sur des tueries de masse ou des actes terroristes, stabiliser et fixer les terroristes. Nous l'avons vu à Paris lors de l'intervention d'un commissaire de la BAC.
Voilà, de manière schématique, la façon dont les différents services ont pu intervenir, et ce que j'ai pu développer.
M. le président. Deux questions liminaires, tout d’abord, pour bien clarifier les choses.
En tant que DGPN, c'est vous qui avez l'autorité pour, le cas échéant, déclencher la Force d'intervention de la police nationale (FIPN) ?
M. Jean-Marc Falcone. Tout dépend où. Sur Paris, c'est le préfet de police qui me sollicite lorsqu’il souhaite mettre en œuvre la FIPN.
M. le président. C'est donc sur la demande du préfet de police de Paris que le DGPN déclenche la FIPN. Pourriez-vous le faire d'autorité ?
M. Jean-Marc Falcone. Après un échange, je pourrais lui proposer de mettre en œuvre la FIPN, mais sur la plaque parisienne, c'est lui qui me le demande, par exemple en cas d'attentats multiples, ou parce que la BRI peut ne pas suffire à l'exécution de la tâche.
M. le président. Confirmez-vous que lorsque la FIPN se déclenche dans Paris intra-muros, le chef du RAID en prend le commandement sous votre autorité, malgré la compétence territoriale BRI-BAC ?
M. Jean-Marc Falcone. Si la FIPN est déclenchée dans Paris, c'est le patron du RAID qui en prend la direction, et qui se place sous les ordres du préfet de police.
M. le président. Le 13 novembre 2015, vous ne déclenchez pas la FIPN, alors que cela a été fait au mois de janvier. Pourquoi l’utiliser en janvier et pas en novembre, alors que les attentats étaient beaucoup plus importants ? On aurait pu imaginer que le RAID prenne la direction des opérations, mais vous avez laissé la BRI agir en tant que force menante.
M. Jean-Marc Falcone. C’est qu’au mois de janvier, le préfet de police en avait fait la demande ; tel n’a pas été le cas au mois de novembre. Le RAID a quand même été envoyé sur Paris, comme vous le savez ; il a agi en concourant du menant, qui a été la BRI.
M. le président. Cette réponse ne peut pas me satisfaire. Je veux connaître la motivation de cette décision. Je comprends que c’est votre décision mais je ne peux pas me satisfaire d’une réponse consistant à dire que c’est le préfet qui a estimé ne pas devoir demander de mettre en œuvre la FIPN, alors que c’est vous qui avez l’autorité sur cette force. Quels critères objectifs ont conduit à faire ce choix alors que nous sommes confrontés à une série d’attentats de grande ampleur à Paris ?
M. Jean-Marc Falcone. Les situations de janvier et de novembre sont différentes. En janvier, lorsque Amedy Coulibaly est entré dans l’Hypercacher, une autre action était en cours à Dammartin-en-Goële. Il fallait conjuguer les deux interventions de manière cohérente. La mise en œuvre de la FIPN a donc été demandée par le préfet de police de l’époque.
Au mois de novembre, les premières réactions ont consisté à envoyer le RAID sur Paris, en colonne.
M. le président. Qui a pris cette décision ?
M. Jean-Marc Falcone. Il y a eu un échange entre Jean-Michel Fauvergue – le chef du RAID – et moi. Le préfet de police a également demandé l’assistance du RAID.
M. le président. Il me semblait que le RAID s’était déplacé de sa propre initiative.
M. Jean-Marc Falcone. Non, pas du tout. J’ai parlé avec le chef du RAID à 22 h 05, pour l’informer qu’il y avait des attentats. Il le savait déjà : mon état-major avait eu le RAID à 21 h 45, et celui-ci avait procédé à son regroupement. Il est parti de Bièvres à 22 h 10.
M. le président. Nous n’avions pas eu ces détails de la part du RAID.
M. Jean-Marc Falcone. J’ai une main courante du SVOPN (service de veille opérationnelle de la Police nationale), mon état-major, qui recense la liste des personnes que j’ai informées en temps et en heure à partir de 21 h 55. Je vous en ferai parvenir un exemplaire.
M. Pierre Lellouche. À quelle heure dites-vous avoir donné l’ordre au RAID de se préparer ?
M. Jean-Marc Falcone. J’ai eu Jean-Michel Fauvergue au téléphone à 22 h 05 pour lui dire qu’il y avait eu des attentats à Paris, et mon état-major avait appelé le RAID à 21 h 45. Le RAID était alors en train de procéder à son regroupement.
M. Pascal Popelin. Le RAID avait-il anticipé votre ordre ?
M. Jean-Marc Falcone. Oui, parce qu’il avait eu des informations. D’autant que, dans le cadre de la préparation de l’Euro 2016, un officier du RAID et un officier du GIGN étaient présents au Stade de France. Ils ont donc vécu les premières explosions en direct et ont fait remonter l'information à leurs patrons.
M. le président. Vous avez expliqué qu’au mois de janvier, le préfet de police avait estimé devoir vous demander de mettre en œuvre la FIPN parce que plusieurs sites étaient concernés. Sur quels critères objectifs, selon vous, s’est-il fondé pour ne pas vous solliciter en novembre ? Ne lui avez-vous pas suggéré de le faire ?
M. Jean-Marc Falcone. Non. Nous étions dans le feu de l’action. Les informations qui parvenaient à Beauvau faisaient état d’attentats multiples : explosions au Stade de France, fusillades devant des établissements recevant du public, puis prise d’otages dans le Bataclan. Le premier réflexe de tous a été d’envoyer le maximum de forces spécialisées pour pouvoir intervenir dans les différents sites.
M. le président. J’essaie de comprendre la doctrine que vous suivez. La note du DGPN du 17 janvier 2014 rationalisant les modalités de saisine et d’emploi de la FIPN comprend une section I, relative aux interventions relevant de la compétence exclusive de la FIPN. Il y est prévu que l’engagement d’une unité d’intervention doit être systématique dans les situations de prises d’otages. Or nous sommes déjà dans ce cas de figure au Bataclan.
Si l'on se réfère à cette note, il devrait donc y avoir quasi-automaticité au recours à cette unité d’intervention dès lors qu’il y a prise d’otages.
M. Jean-Marc Falcone. La FIPN ?
M. le président. C’est ce qu'il me semble.
La section I, paragraphe a) du règlement de la FIPN prévoit : « Le responsable de la sécurité publique territorialement compétent présent sur les lieux (…) apprécie la gravité de la situation (…) S’il estime devoir faire appel à une unité d’intervention, il doit prendre attache sans délai avec l’état-major de la FIPN (…) »
Nous étions bien dans cette situation. Or il n’y a pas de saisine de l’état-major de la FIPN, ni de recours à la FIPN. Je ne dis pas que c’est une mauvaise chose, j’essaie de comprendre la raison de cette décision. Il faut que nous clarifiions ce point.
En cas de déclenchement de la FIPN, c’est le RAID qui aurait été menant, et la BRI concourant.
M. Jean-Marc Falcone. Ces unités auraient constitué une seule et même force, sous l’autorité du patron du RAID.
M. le président. Pour une telle tuerie de masse – il y avait 1 500 personnes dans le Bataclan – avez-vous estimé que la BRI était mieux à même d’agir ?
M. Jean-Marc Falcone. Non. La BRI et le RAID, comme le GIGN, sont des unités composées de personnels compétents qui disposent de l’expertise nécessaire. Je ne dis pas que la BRI était mieux à même d'investir les lieux au vu de son armement, de son expertise et de sa compétence. Ils étaient sur place, le préfet de police également, il avait déjà engagé sa BRI, et moi j’avais envoyé le RAID. Il a considéré que les deux forces devaient se répartir les différents lieux du Bataclan pour investir les lieux et procéder à l’assaut final. Je précise que, rue de la Fontaine-au-Roi, une colonne du RAID assurait également la sécurisation des lieux où il semblait que des terroristes avaient tiré.
M. le président. Après le retour d’expérience qui n’a pas manqué d’avoir lieu, pensez-vous que vous prendriez à nouveau la même décision, ou une réflexion est-elle en cours pour revoir ce qu’est la FIPN, et comment elle doit être déclenchée ?
M. Jean-Marc Falcone. Vous l’avez bien compris : la FIPN n’est pas une structure pérenne : c’est une structure ad hoc, qui répond à un besoin.
Lorsqu’elle a été créée, il y avait le RAID, sept GIPN (groupes d'intervention de la police nationale) et la BRI de Paris. Le ministre de l’Intérieur de l’époque avait considéré que cette multitude de forces d’intervention indépendantes les unes des autres devait, en cas de tueries de masse ou de problèmes particuliers, pouvoir être mise à disposition des préfets – le préfet de police de Paris, mais aussi les autres préfets territorialement compétents.
C’est à cela que le document que vous avez mentionné fait référence : il fallait pouvoir créer une structure sous l’autorité du patron du RAID, qui est normalement le plus âgé dans le grade le plus élevé. C’est un contrôleur général de la police nationale qui a l’expertise lui permettant de prendre le commandement.
Dans le schéma d’intervention sur lequel nous sommes en train de mettre la dernière main, la question du mode de déclenchement de la FIPN est posée, au moins pour Paris intra-muros. Doit-il être automatique lorsque le RAID intervient sur Paris ? Doit-il toujours dépendre de la demande exprimée par le préfet de police ? Ou bien le DGPN doit-il prendre la décision ?
M. le président. Il n’est pas question ici de critiquer la BRI, dont il convient au contraire de saluer le travail, mais cette brigade concerne essentiellement le judiciaire, l’interpellation de gangsters, de forcenés. Le RAID et le GIGN ont une autre vocation. Pourquoi avez-vous envoyé au Bataclan, en menant, des fonctionnaires méritants mais dont la mission exclusive n’est pas d’aller déloger des terroristes ? C’était la mission du RAID.
M. Jean-Marc Falcone. Je comprends tout à fait votre interrogation. Mais la BRI-PP peut intervenir en formation BRI-BAC, qui est un peu plus formée à ce type d’intervention que les BRI des directions centrales de la police judiciaire, que vous connaissez par ailleurs, et qui assurent des interpellations, des filatures, etc. C’est aussi la mission première de la BRI-PP.
Incontestablement, le GIGN et le RAID sont composés de personnels qui s’entraînent toute la journée, acquièrent une expertise et développent des doctrines pour intervenir. Néanmoins, tout cela se fait en liaison avec la BRI-PP, qui travaille de plus en plus avec le RAID. Ces deux unités ont des formations et des équipements communs. S’il fallait faire une gradation, je place la BRI-BAC au-dessus des BRI de la direction centrale de la police judiciaire en termes d’intervention.
M. le président. Mais en deçà du RAID.
M. Jean-Marc Falcone. En deçà du RAID s’agissant des prises d’otages de masse.
M. le président. Ce qui était le cas au mois de novembre.
Vous placez la BRI-PP au-delà des BRI situées hors du ressort de la préfecture de police de Paris, grâce à son entraînement spécifique, mais elle ne peut pas être considérée au même niveau que le RAID. Nous sommes bien d’accord ?
M. Jean-Marc Falcone. Elle s’en rapproche de plus en plus…
M. le président. Mais elle n’est pas au même niveau. Et c’est bien pour cela que nous nous demandons pourquoi vous n’avez pas confié cette opération au RAID, d’autant que vous lui aviez donné l’ordre d’intervenir.
M. Jean-Marc Falcone. Je lui avais donné l’ordre de se diriger sur Paris pour se mettre à disposition du préfet de police afin de renforcer les unités d’intervention, puisque l’on nous rapportait une multitude d’attentats. Je n’avais pas à donner au RAID l’ordre d’intervenir.
M. Sébastien Pietrasanta, rapporteur. Au regard de ce qui s’est passé le 13 novembre, on mesure bien l’importance des primo-intervenants. Hors de Paris, ce sont essentiellement les hommes et les femmes qui composent la DGPN et la Gendarmerie nationale.
Depuis les attentats, quels moyens ont été donnés à vos effectifs en matière d’équipement ? Le ministre a annoncé un certain nombre de mesures, notamment pour les brigades anti-criminalité et les compagnies de sécurisation et d’intervention. Pouvez-vous nous en dire plus sur le plan d’équipement prévu ?
La question de la formation au tir a souvent été évoquée, surtout après les attentats de janvier, alors que plusieurs fonctionnaires de police, confrontés aux frères Kouachi, avaient tiré à plusieurs reprises sans atteindre leur cible. Cette formation a-t-elle été renforcée ? Ou bien du fait de l’augmentation des effectifs a-t-il été nécessaire de réduire la formation initiale au tir ?
En matière de formation continue, un policier de voie publique tire réglementairement quatre-vingt-dix cartouches par an – ce nombre est plus élevé pour les membres des services spécialisés, tels que la BAC. Or il semble que la qualité des formations dépende beaucoup des formateurs. Dans certains centres, par exemple, il est possible de s’entraîner sur des cibles mouvantes, tandis que dans d’autres il n’y a que des cibles fixes. Prévoyez-vous de faire évoluer cette formation ?
Par ailleurs, les stages « Amok », destinés aux primo-intervenants, semblent avoir été suspendus. Pouvez-vous nous en dire un mot ?
S’agissant de la doctrine d’emploi, des consignes sont-elles passées sur la manière dont les primo-intervenants pourraient intervenir dans les situations de tueries de masse ?
Enfin, quel est votre point de vue sur la manière dont les forces d’intervention sont réparties sur le territoire ? Le critère territorial semble parfois un peu dépassé au regard de l’actualité et de la menace. Où en est cette réflexion, et de quelle manière envisagez-vous les choses à titre personnel ?
M. Jean-Marc Falcone. Après les attentats de janvier, nous avions considéré en effet qu’une nouvelle forme de terrorisme se développait sur le territoire national, celle des tueries de masse menées par des gens qui refusent de négocier et qui veulent aller jusqu’au bout de leur « mission ». Nous avons donc estimé qu’il fallait revoir le dispositif des primo-intervenants.
Nous avons distingué trois niveaux. Le service général, c’est-à-dire police-secours, arrivera le premier sur les tueries de masse, car les gens appelleront le 17. Ces agents ont pour consigne de stabiliser la situation, de rendre compte et de faire intervenir d’autres unités. C’est la doctrine à laquelle j’ai fait référence dans mon propos introductif et qui est expliquée dans la fiche - réflexe de décembre 2015.
Une deuxième catégorie de personnel, plus rompu, est constituée par les unités d’intervention en province, qui sont les BRI de la DCPJ et les BAC. Ces dernières représentent 3 200 personnes réparties sur l’ensemble du territoire.
Les BRI-PJ sont déjà équipées de protections individuelles et collectives et d’armes lourdes performantes. Tel n’était pas le cas des BAC. À la demande du ministre de l’Intérieur, un plan BAC a donc été développé – mon homologue de la Gendarmerie en bénéficiera pour ses pelotons de surveillance et d'intervention de la Gendarmerie (PSIG) – afin de doter ces unités de protections individuelles : caques balistiques et gilets capables d’arrêter des cartouches de Kalachnikov. Surtout, il a été décidé de les doter d’armes longues nouvellement acquises – le Heckler & Koch G36 – capables de tirer des munitions de calibre 5,56 mm, équivalentes à celles des Kalachnikov.
Les livraisons prévues par ce plan ont d’ores et déjà commencé, et s’accompagnent de formations, notamment au maniement de cette nouvelle arme. Tout cela fera partie du schéma national d’intervention.
La doctrine d’emploi est prévue dans les fiches auxquelles j’ai fait allusion. L’une porte sur les ceintures d’explosifs – phénomène hélas nouveau sur le territoire français Une autre est consacrée aux surattentats, pour faire en sorte, autant que faire se peut, de les éviter. Enfin, une fiche expose la doctrine d’intervention pour les primo-intervenants en cas de tueries de masse : quels sont les réflexes qu’il convient d’avoir.
Concernant les stages « Amok », au vu des événements, nous utilisons désormais, dans le cadre des nouvelles doctrines d’intervention, les fiches - réflexes, et le RAID assure dans toutes les directions départementales de la sécurité publique des formations pour faire face aux tueries de masse de ce genre.
M. le rapporteur. S’agissant de la formation au tir, nos policiers s’entraînent-ils mieux aujourd’hui ?
M. Jean-Marc Falcone. Tous les policiers sont dotés de pistolets automatiques Sig-Sauer de calibre 9 mm. À l’école de police, ils tirent 390 cartouches en 44 heures de formation.
M. Pierre Lellouche. Ça ne fait pas beaucoup de cartouches par heure.
M. Jean-Marc Falcone. La formation comprend également des mises en situation.
M. le rapporteur. Ce volume a-t-il diminué récemment ?
M. Jean-Marc Falcone. Non, il est resté identique.
Le recyclage consiste en trois tirs par an au minimum, soit 90 cartouches, et concerne tous les personnels qui doivent être formés.
S’agissant du pistolet-mitrailleur – c’est aujourd’hui le Beretta, mais la situation sera identique avec le nouveau modèle – l’habilitation en école est de six heures et 60 cartouches, et la réhabilitation se fait tous les ans, avec 30 cartouches, afin d’assurer un maintien en condition.
Ce volume de formation n’a pas baissé, et ne baissera pas dans le cadre de la nouvelle scolarité.
J’en viens à la répartition territoriale. Les forces d’intervention comprennent le RAID central, basé à Bièvres, et une antenne RAID dans chacune des six zones de défense – les GIPN ont été transformés en antennes RAID pour répondre au besoin d’un état-major commun. Par ailleurs, 336 fonctionnaires composent la BRI nationale de la police judiciaire auxquels s’ajoutent les BRI réparties sur l’ensemble des directions interrégionales de police judiciaire. Nous disposons aussi des 3 200 fonctionnaires des brigades anti-criminalité, qui sont réparties sur les 330 circonscriptions de sécurité publique et qui assurent le maillage de l’ensemble du territoire métropolitain et de l’outre-mer.
M. le rapporteur. Le GIGN est intervenu en zone police, vos forces sont intervenues en zone gendarmerie, nous avons évoqué la difficile relation parfois entre la BRI et le RAID dans Paris intra-muros : cette répartition territoriale et administrative a-t-elle encore un sens ? Une réflexion est-elle en cours pour spécialiser ces forces ? On le sait, le GIGN est plus spécialisé, par exemple, sur les risques nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques.
M. Jean-Marc Falcone. Pour moi, la répartition administrative a toujours un sens pour les missions courantes, qui sont nombreuses : forcenés, prises d’otages de basse intensité, interpellations effectuées presque tous les matins en assistance de la DGSI ou de la SDAT.
Pour les tueries de masse, le ministre nous a demandé de ne plus tenir compte de la répartition administrative – et nous avons travaillé en ce sens avec le préfet de police et mon homologue, le DGGN. En cas de tueries de masse, il n’y aura plus de zone police et de zone gendarmerie : ce sera la force la plus proche et la plus disponible qui interviendra et qui sera menante tant que les autres forces territorialement compétentes ne seront pas arrivées sur le site. Et si l’intervention est très engagée, la première force intervenante gardera la main pour des raisons évidentes.
M. le président. Il semblerait que les BAC, primo-intervenantes au Bataclan, se soient trouvées démunies face aux terroristes, du fait de la faiblesse de leur équipement et de leur armement. Les militaires de la force Sentinelle, présents sur les lieux, avaient quant à eux des armes longues. Les policiers ont donc demandé à ces militaires d’intervenir, pour arrêter l’avancée des Kalachnikovs. Mais ordre aurait été donné de ne pas faire intervenir l’armée, ni même d’utiliser leurs armes.
M. Jean-Marc Falcone. Je ne suis pas informé de cela.
M. Pierre Lellouche. J’ai également été frappé par ce témoignage d'un policier, auquel le militaire disposant d’une arme longue qu’il avait sollicité avait répondu qu’il n’avait pas d’ordre. L’ordre devait venir, m’a-t-on dit, de la salle de commandement. De quoi s’agit-il ?
M. Jean-Marc Falcone. C’est la préfecture de police.
M. Pierre Lellouche. Cela dépend-il de vous ?
M. Jean-Marc Falcone. Non, il s’agit des salles de commandement de la préfecture de police.
M. Pierre Lellouche. Donc l’emploi éventuel de forces militaires à côté des vôtres dépend de la préfecture de police ?
M. Jean-Marc Falcone. Sur Paris. J’ignorais les instructions auxquelles vous faites allusion.
M. Pierre Lellouche. Comment est-ce possible ?
M. Jean-Marc Falcone. Parce que je ne suis pas compétent sur Paris. C’est le préfet de police qui a l’entière compétence sur l’ensemble du territoire de la capitale, tout comme pour le déclenchement de la FIPN. Je n’ai donc pas eu connaissance de cette instruction, et je n’avais pas à en connaître.
M. Pierre Lellouche. Vous avez 145 000 agents sous vos ordres, dont le RAID et l’ensemble des BAC !
M. Jean-Marc Falcone. À l’exception des fonctionnaires de police de la préfecture de police de Paris.
Mme Françoise Dumas. Cela vous semble-t-il pertinent dans la situation ?
M. Pierre Lellouche. Je trouve cela aberrant !
M. Pascal Popelin. Ce n’est pas une découverte.
M. le président. Le directeur a clairement répondu que cela ne relevait pas de sa compétence territoriale.
M. Christophe Cavard. C’est la troisième commission d’enquête à laquelle je participe, et j’ai déjà eu l’occasion de vous entendre depuis 2012. Aujourd’hui, la presse, et en particulier L’Obs, revient sur la guerre des polices. Est-ce un fantasme, ou existe-t-il des problèmes de coordination ? Imaginez la surprise que peut provoquer la lecture de certaines déclarations, dont celle d'un général que nous allons auditionner après vous !
Par ailleurs, il existe un débat concernant le rôle et les fonctions des renseignements territoriaux, qui dépendent de la direction centrale de la sécurité publique. Les choses se sont largement améliorées depuis 2012, mais de votre point de vue, d’autres évolutions de ce service particulier sont-elles souhaitables ? Pourrait-il contribuer à fournir des renforts afin de pallier les problèmes d’effectifs ?
Enfin, s’agissant de l’utilisation des deux forces que sont la police et la gendarmerie, j’ai cru comprendre à la lecture de la presse que le ministre avait donné des consignes, au moins pour les unités d’élite. Comment cela va-t-il être mis en œuvre ?
M. Jean-Marc Falcone. S’agissant de la supposée guerre des polices, ce n’est pas un phénomène nouveau dans l’histoire de la police et de la gendarmerie de notre pays. La Gendarmerie nationale et la Police nationale disposent, incontestablement, de compétences et d’expertise, celle-ci étant d’ailleurs identique dans de très nombreux domaines.
J’ai également lu cet article de L’Obs, et je ne m’y suis pas reconnu. Avec le général Favier, nous avons fait d’énormes progrès. Tout d’abord, nous nous entendons bien, ce qui compte car les institutions sont aussi faites d’hommes, et de chefs. En outre, le ministre de l’Intérieur apprécierait peu que des guerres des polices puissent à nouveau voir le jour, au vu des événements dramatiques que nous vivons. Nous et nos hommes savons très bien que nous ne pouvons pas jouer à cela.
M. Christophe Cavard. Je fais référence aux propos des chefs du RAID et de la BRI.
M. Jean-Marc Falcone. Ces gens ont notre respect, parce qu’ils montent au feu ; leur position n’est pas celle des deux chefs de la police et de la gendarmerie, je peux vous l’assurer.
En ce qui concerne le Service central du renseignement territorial (SCRT), la Direction centrale des renseignements généraux a été supprimée. Une partie de ses effectifs a rejoint la Direction centrale du renseignement intérieur (DCRI) de l’époque, et l’autre, 700 ou 800 personnes, est partie dans les SDIG – services départementaux d’information générale – dont le nom même ne mentionnait plus le renseignement, ce qui montre bien que toute la doctrine du renseignement avait disparu du dispositif. Au bout de deux ou trois ans, il est clairement apparu que les effectifs et l‘expertise de ces services étaient insuffisants. Ainsi, le SDIG du département dont j’étais préfet comprenait une dizaine de personnes alors que quelques années auparavant, la direction départementale des renseignements généraux en comptait vingt-cinq ou trente !
La création de la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) par le ministre de l’Intérieur de l’époque a coïncidé à la création du Service central du renseignement territorial – le mot « renseignement » est réapparu, et ce n’est pas qu’une question de sémantique. Actuellement, il regroupe 2 200 à 2 300 équivalents temps plein. Il est réparti sur l’ensemble du territoire : un important service central à Paris assure les synthèses, les analyses et les expertises, et une division nationale du renseignement permet de se pencher sur des événements majeurs pour assurer l’aide et l’assistance au personnel territorialement compétent.
M. François Lamy. Monsieur le directeur général, quel était votre niveau d’information sur l’état de la menace terroriste entre le 7 janvier et le 13 novembre ? On entendait notamment beaucoup parler du risque d’attaques simultanées.
Avez-vous fait des propositions au ministre de l’Intérieur entre ces deux dates en matière d’organisation des services de police ? L’existence d’une note que le Premier ministre aurait eue en main au soir du 13 novembre, recommandant entre autres la déclaration de l’état d’urgence, a souvent été évoquée. Des mesures avaient-elles été envisagées ?
Ma troisième question peut appeler une simple réponse par oui ou non, mais c’est la plus difficile. Je connais l’histoire de la préfecture de police de Paris, et les raisons de son existence. Pensez-vous qu’il soit toujours d’actualité d’avoir, au sein de la Police nationale, un État dans l’État qui dispose notamment de ses propres services de renseignement ? Est-ce encore utile ?
M. Jean-Marc Falcone. Les services de renseignement, l’UCLAT et le secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale (SGDSN) produisent de manière hebdomadaire des notes sur l’état de la menace. Le Président de la République, le Premier ministre et le ministre de l’Intérieur n’ont cessé de répéter que le niveau de la menace n’avait jamais été aussi élevé.
Nous avions connu les prémices en octobre 2015 à Joué-lès-Tours, lorsqu’une personne radicalisée est entrée dans le commissariat avec un couteau pour tuer les policiers avant de se faire neutraliser. Nous avions donc des informations, le directeur général que je suis avait des informations, peut-être pas aussi poussées que la DGSI dont c’est le métier, mais au vu des échanges de renseignements qui existent entre les directions générales, je savais que le niveau de menace était élevé.
S’agissant des propositions que j’ai pu faire au ministre de l’Intérieur, nous avons notamment revu les plans de formation et d’équipement des fonctionnaires. Lorsque nous avons travaillé sur la COP 21, nous avions proposé le rétablissement temporaire des frontières, et le dispositif a été mis en place dès le 13 novembre au soir pour assurer la protection nécessaire à la suite des attentats. Nous avions également mis en œuvre la collaboration entre le GIGN et le RAID pour coordonner ces deux forces.
Donc j’étais bien informé, et nous avons travaillé individuellement et collectivement au sein de réunions d’état-major hebdomadaires sur le terrorisme et l’ordre public, autour du ministre de l’Intérieur. Nous avons tous participé à l’élaboration de différentes stratégies et de différents plans.
S’agissant de la préfecture de police, j’estime qu’à Paris, il doit y avoir un préfet de police et une préfecture de police, parce que les problèmes y sont spécifiques. Il faut donc un patron pour diriger l’ensemble des forces de police de la capitale, qui doit ainsi disposer d’une autorité organique et fonctionnelle sur ses effectifs.
M. François Lamy. Il y a un préfet de police qui a autorité sur les policiers à Marseille. Or vous êtes également compétent sur cette ville.
M. Jean-Marc Falcone. Pas tout à fait.
M. François Lamy. Le préfet de Marseille est en effet directement rattaché au ministre de l’Intérieur, si je me souviens bien.
M. Jean-Marc Falcone. Mais à Lyon, par exemple, je peux diriger les forces de l’ordre.
M. Pierre Lellouche. À Lyon, vous connaissez le mode d’emploi des militaires, mais pas à Paris.
M. Jean-Marc Falcone. À Lyon, le jour où il faudra faire intervenir les militaires, cela se fera avec le préfet de Lyon.
M. Pierre Lellouche. Mais vous avez une doctrine sur l’utilisation des militaires en cas de tuerie de masse ?
M. Jean-Marc Falcone. Non, elle n’existe pas.
M. Pierre Lellouche. Comptez-vous en élaborer une ?
M. Jean-Marc Falcone. Le travail est en cours avec le ministère de la Défense.
M. le président. La question de M. Lamy était très précise. L’existence de la préfecture de police de Paris, survivance du passé, se justifie-t-elle encore compte tenu des menaces qui pèsent aujourd’hui sur notre pays ? Encore une fois, c’est un problème institutionnel et non pas de personne.
M. Jean-Marc Falcone. Si les choses se passent bien entre le préfet de police et les directeurs généraux, au vu de la spécificité de Paris, avoir un préfet de police de plein exercice se justifie, à condition de ne pas faire de la PP une forteresse.
M. le président. Dans un de ses livres, le nouveau garde des sceaux avait proposé la suppression de la préfecture de police de Paris…
M. Meyer Habib. Le facteur temps est essentiel. Le 13 novembre, il y a eu l’attaque au Stade de France puis cinq événements en parallèle. Les terroristes ont tué près de cent personnes au Bataclan avant l’arrivée d’un commissaire de la BAC, qui en neutralisant l’un d’entre eux a mis, semble-t-il, un terme au massacre.
À la limite, peu importe le déclenchement ou non de la FIPN, car le temps qu’elle se prépare et qu’elle arrive, il est déjà presque trop tard. Comment faire en sorte d’avoir, en permanence, dans les grandes villes, des forces équipées et prêtes à partir dans la minute, comme cela se passe dans certains pays ? Il faut des gens formés capables d’arriver en un temps minimum. Pour mener une opération comme celle de Saint-Denis, les forces d’intervention sont maîtresses du temps. Dans le cas de tueries de masse, en revanche, le temps ne nous appartient pas, et les terroristes tuent. Seul un élément qui perturbe leur stratégie peut les arrêter.
Comment faire pour disposer dans le futur de forces prêtes à intervenir de façon immédiate ? Certes, c’est très difficile sur un territoire de 550 000 kilomètres carrés, mais au moins dans les grandes villes.
M. Pierre Lellouche. Ma question porte sur le commandement, et elle rejoint celle de François Lamy. Je trouve invraisemblable que le commandement à Paris relève du préfet, invraisemblable que vous soyez compétent à Lyon mais pas à Paris. Ce point devra effectivement être abordé dans les conclusions de notre rapport.
Je voulais revenir sur la chronologie : vous avez dit avoir fait converger sur Paris 215 policiers de la grande couronne vers 21 h 40. Par contre, vous faites intervenir le RAID bien après. Votre réflexe est donc de mobiliser les BAC des départements plutôt que le RAID ?
M. Jean-Marc Falcone. Pas du tout monsieur le député. C’est à 22 h 40 que j’ai donné l’ordre aux policiers de converger vers Paris.
M. Pierre Lellouche. Sauf que les policiers de la BAC de Créteil étaient à 21 h 42 au Bataclan.
M. Jean-Marc Falcone. L’ordre que j’ai donné à 22 h 40 s’adressait aux équipages de la grande couronne, afin qu’ils aillent prêter main-forte au préfet de police. Nous avons donné les instructions à partir du centre interministériel de crise (CIC) de la place Beauvau.
M. Pierre Lellouche. Mais le personnel de la BAC était déjà au Bataclan depuis une heure, à 21 h 40.
Ce qui m’interpelle, c’est que lorsque le policier de la BAC demande les conditions d’emploi du militaire, on ne sait pas lui répondre. Et vous faites, quant à vous, intervenir les forces spécialisées une heure après l’arrivée des policiers de terrain sur place. Il y a certainement de bonnes raisons à cela, mais j’aimerais les connaître.
Enfin, vous dites avoir créé autour de vous un état-major opérationnel et de renseignement...
M. Jean-Marc Falcone. Non, c'est mon service central du renseignement qui me nourrit en renseignement.
M. Pierre Lellouche. Y a-t-il près de vous un endroit où tout le renseignement converge ? Le service de renseignement qui rend compte à votre état-major, c’est celui de la police, qui n’est pas branché sur les autres ?
M. Jean-Marc Falcone. Monsieur Habib, les instructions données par le ministre de l’Intérieur, qui vont être déclinées dans le schéma d’intervention, répondent à votre préoccupation. Ce schéma conjugue en effet l’intervention, avant l’arrivée des forces spécialisées, des primo-arrivants et surtout des BAC et des BRI que nous équipons pour leur permettre d’intervenir dans les meilleures conditions de sécurité et avec les moyens d’attaque ou de défense les plus performants – j’y ai fait référence tout à l’heure. D’ici à la fin du mois de mai, la formation, l’équipement et le parc automobile seront donc adaptés pour pourvoir procéder à des interventions en cas de tueries de masse, dans l’objectif de stabiliser et de neutraliser la situation, à l’instar de ce qui s’est passé au Bataclan.
On ne peut évidemment pas créer des unités d’intervention sur l’ensemble du pays. Elles sont situées le plus harmonieusement possible sur le territoire. Et en cas de tueries de masse, il n’y aura plus de secteur police et de secteur gendarmerie : c’est la force d’intervention la plus proche des lieux du drame qui interviendra.
Monsieur Lellouche, mon état-major a contacté le chef du RAID à 21 h 45, pour mobiliser la force d’intervention. Je l’ai moi-même appelé quelques minutes plus tard, avant de rejoindre le CIC place Beauvau. Ensuite, quand je suis arrivé au ministère de l’Intérieur, j’étais accompagné de mes directeurs centraux, dont le directeur central de la sécurité publique, avec lequel nous avons échangé. Nous avons considéré que si cela continuait à frapper sur Paris, il faudrait apporter du renfort à la préfecture de police, pas des forces d’intervention, mais du service général. Nous avons donc envoyé les patrouilles disponibles, sans réduire à néant la présence policière dans les quatre départements de la grande couronne.
À 22 h 40, nous avons requis des unités pour assurer des points de barrage, de l’assistance, des patrouilles. Le préfet de police aurait ainsi pu les envoyer dans les gares – on ne savait pas si tous les auteurs de ces massacres étaient fixés. Les forces d’intervention ont constitué la priorité, même si la FIPN n’a pas été mise en œuvre : le but était d’envoyer le plus grand nombre d’unités formées et armées pour mettre fin à ces événements. C’est dans un deuxième temps, que nous avons décidé de mettre des unités du service général à disposition de la direction de la sécurité de proximité de l’agglomération parisienne (DSPAP) du préfet de police.
M. Serge Grouard. Monsieur le directeur général, j’ai le sentiment que nous n’étions pas du tout préparés à ces attentats, que c’est la sidération qui l’a emporté. Comment vous, ainsi que l’ensemble des policiers et des intervenants, l’avez-vous ressenti ?
Vous avez mentionné toutes les évolutions en cours à la suite des attentats du 13 novembre – schéma national d’intervention, doctrine d’emploi pour les primo-intervenants, enquêtes de la police judiciaire, plan BAC, etc. Mais pourquoi ne pas avoir pris ces mesures plus tôt ? Certes, il est toujours facile de soulever ces questions a posteriori –nous sommes à huis clos et cela n’a pas vocation à être porté sur la place publique. Pourquoi ne pas avoir agi après les attentats de janvier, d’autant qu’avant cela, il y avait eu des attentats de masse partout dans le monde, en Espagne, en Grande-Bretagne…. Peut-être avons-nous pensé – et nous aussi, chers collègues – que la France était sanctuarisée et que cela n’arriverait pas chez nous. Pourquoi a-t-il fallu attendre le carnage du 13 novembre pour commencer à prendre les choses en compte ?
M. Pascal Popelin. Sur la FIPN, j’ai bien noté dans vos explications qu’elle avait été créée dans un contexte d’organisation des forces d’intervention différent de celui qui existe aujourd’hui, s’agissant en particulier de l’articulation du RAID et des GIPN, qui forment maintenant une structure intégrée. Nous avons également observé que sur le terrain, au Bataclan, l’articulation opérationnelle entre BRI et RAID semble avoir été convenable.
Considérez-vous que si nous avions formellement été dans le dispositif FIPN, cela aurait amélioré l’efficience de l’organisation des interventions au cours de la soirée ? Ou cela n’aurait-il rien changé ?
M. Jean-Michel Villaumé. Je voudrais revenir sur les conditions d’emploi des forces armées. Il y a 10 000 hommes mobilisés sur le territoire, plusieurs milliers à Paris. Quel regard portez-vous sur le rôle des militaires ? Pourriez-vous mieux travailler ensemble, ou les militaires de l’opération « Sentinelle » doivent-ils rester une force de dissuasion ?
M. Jean-Marc Falcone. Monsieur Grouard, même lorsqu’on est directeur général de la police nationale, directeur de cabinet du ministre, préfet de police ou directeur général de la gendarmerie nationale, on a forcément un moment d’interrogation quand on vous annonce des dizaines de morts et des attaques multiples. Mais nous n’étions pas dans la sidération et nous comprenions très bien ce qui se passait. Certes, nous ignorions comment les choses se déroulaient exactement et combien de temps cela durerait, mais nous savions très bien, à entendre les témoignages qui nous arrivaient, que ces événements correspondaient hélas à un scénario que d’autres pays avaient d’ores et déjà connu.
Mon propos introductif a été volontairement rapide et schématique, mais nous avions mis en place un certain nombre de dispositifs dès les attentats du mois de janvier dernier. Nous avions ainsi travaillé sur les doctrines d’emploi, préparé des commandes d’armement et de protection pour nos fonctionnaires. J’avais réuni les organisations syndicales avant la fin du mois de janvier pour envisager un déploiement de matériel. S’agissant de la coordination entre le GIGN et le RAID, il existe des notes antérieures au 13 novembre.
Non, tout n’a pas été fait après le 13 novembre : l’état-major auquel je faisais allusion est antérieur, la salle d’information également, ainsi que les recrutements. Le plan BAC a été décidé par le ministre lorsqu’un fonctionnaire de la BAC du 93 a pris une balle dans la tête sur un braquage – et c’était avant les attentats de novembre.
Bien évidemment, après le 13 novembre, il a fallu confirmer la cohérence de ces dispositifs doctrinaux, organisationnels, d’équipement, de ressources humaines, mais nous avions travaillé dès les 9 et 10 janvier, pour développer au sein de la police nationale – préfecture de police comprise – un dispositif de déploiement et d’acquisition de nouveau matériel car nous avions alors considéré que l’on risquait d’avoir besoin de ce dispositif au vu de la menace.
Dès la fin 2014, le Service central du renseignement territorial s’est réorienté, comme je l’ai dit précédemment, sur la radicalisation et le terrorisme afin de suivre un certain nombre d’objectifs pouvant être considérés comme dangereux, avec un spectre de gravité différent selon les individus. Nous n’avons pas fait monter le renseignement territorial dans sa compétence radicalisation et terrorisme après le 13 novembre. Cela s’est fait avant, avec notamment le développement de la plateforme d’appels sur la radicalisation de l’UCLAT. Et après l’attentat dans l’usine de Saint-Quentin-Fallavier, il a été décidé de créer l’EMOPT – l’état-major opérationnel de prévention du terrorisme. De nombreux dispositifs ont donc été mis en place avant le 13 novembre.
S’agissant de l’opération au Bataclan, la FIPN est une procédure qui met un homme à la disposition du préfet de police – puisqu’elle ne peut pas être mise en œuvre sur le territoire métropolitain, où seul le RAID est compétent.
M. le président. La décision de ne pas mettre en œuvre la FIPN a été prise en plein accord avec le ministre de l’Intérieur ?
M. Jean-Marc Falcone. Oui, le préfet de police n’a pas exprimé le souhait de voir mettre en place la FIPN.
M. le président. Donc le ministre de l’Intérieur était parfaitement informé ?
M. Jean-Marc Falcone. Oui, nous étions tous dans la même salle.
M. Pascal Popelin. Cela n’a même pas été abordé ?
M. le président. Monsieur le directeur général, où étiez-vous physiquement, avec le préfet, lorsque la décision de laisser intervenir la BRI en force menante a été prise ?
M. Jean-Marc Falcone. J’ai appelé le RAID lorsque je me dirigeais vers le CIC, qui se trouve dans les sous-sols du ministère de l’Intérieur.
M. le président. Qui était présent à ce moment-là ?
M. Jean-Marc Falcone. Il y avait mon homologue de la gendarmerie…
M. le président. C’est-à-dire le général Favier ?
M. Jean-Marc Falcone. Oui. Il y avait également les directeurs centraux, des représentants des autres ministères, puisque c’est une salle interministérielle.
M. le président. Il n’y avait pas le ministre ?
M. Jean-Marc Falcone. Le ministre est arrivé après, avec le Président de la République et le Premier ministre. Ils sont venus faire un point.
À aucun moment, dans cette salle, nous n’avons parlé de la mise en œuvre de la FIPN.
M. le président. Cela n’a été évoquée à aucun moment, ni par vous, ni par le préfet de police, ni par le ministre ?
M. Jean-Marc Falcone. Le préfet de police était absent, par définition, puisqu’il était sur le terrain.
M. le président. La question ne s’est même pas posée ?
M. Jean-Marc Falcone. L’objectif, cette nuit-là, était de mettre à disposition du préfet de police le maximum de forces d’intervention compétentes pour mettre un terme à ces tueries.
M. le président. Nous sommes bien d’accord. Mais dans le cadre de cette réflexion, personne n’a suggéré, à aucun moment, de mettre en œuvre la FIPN ?
M. Jean-Marc Falcone. Non.
M. François Lamy. Le préfet de police était sur le terrain ?
M. Jean-Marc Falcone. Oui.
M. François Lamy. Dans la défense, il y a un état-major et un commandement tactique, qui est sur le terrain. Le 13 novembre, le principal décideur n'était pas dans la salle de commandement, mais sur le terrain. Et donc, difficilement joignable.
M. Jean-Marc Falcone. Je n’ai pas essayé d’entrer en contact avec le préfet, je le laisse travailler.
M. le président. Le préfet de police n’était donc pas au CIC à ce moment. C’est pourtant lui qui aurait compétence pour demander la mise en œuvre de la FIPN.
M. Jean-Marc Falcone. Il était sur le terrain, entouré de ses directeurs, du chef de la BRI et de Jean-Michel Fauvergue, chef du RAID. Il a considéré, au vu des événements et d’une situation qu’il vivait et en tant que responsable, qu’il n’avait pas à demander la FIPN.
M. le président. L’autorité politique aurait-elle pu se dispenser de l’avis du préfet de police, et prendre l’initiative de mettre en œuvre la FIPN sans que le préfet de police ne la demande ?
M. Jean-Marc Falcone. Le ministre commande le préfet de police, le GIPN, et tout le monde. Il aurait pu le faire à condition que nous en ayons débattu, ce qui n’a pas été le cas. Notre seul souci était d’envoyer des forces. Et celui qui était responsable de ces forces pour mettre un terme à cette tuerie était le préfet de police.
Le préfet de police était sur place, les forces d’intervention lui ont dit comment elles comptaient intervenir, et il a pris sa décision en tant que directeur des opérations.
M. Pierre Lellouche. À Lyon, il en aurait été autrement.
M. Jean-Marc Falcone. Cela aurait été exactement la même chose.
M. le président. Pas tout à fait, il n’y a pas de compétence exclusive.
M. Jean-Marc Falcone. À Lyon, c’est le RAID qui est compétent. Or la FIPN ne peut pas être mise en œuvre que lorsqu’il y a deux forces.
M. le président. Le RAID est compétent à Paris à partir du moment où l’on déclenche la FIPN. Si on ne le fait pas, le RAID n’est pas compétent.
M. Jean-Marc Falcone. Le RAID peut intervenir à Paris sans déclenchement de la FIPN, en tant que force concourante. Si l’on déclenche la FIPN, il devient menant, sous les ordres directs du préfet de police.
M. le président. Voilà, et ce n’est pas le cas hors de Paris.
M. Pascal Popelin. Les choses sont bien claires : le seul changement qu’aurait entraîné le déclenchement de la FIPN – qui n’a été ni évoqué ni demandé – eût été que le patron du RAID serait mécaniquement devenu le patron d’une opération qui, en l’occurrence, a été menée par le préfet de police et la BRI, avec l’appui du RAID qui était présent et qui s’est coordonné avec les autres unités.
M. le rapporteur. Le RAID aurait donc été menant sous l’autorité du préfet de police.
M. Jean-Marc Falcone. Le responsable, à Paris comme dans tous les départements, c’est le représentant de l’État et du Gouvernement, soit comme le prévoit la Constitution, le préfet.
M. Pierre Lellouche. Convenez qu’il n’est pas neutre de donner, ou non, le commandement opérationnel, sous l’autorité du préfet, à l’organisme le plus expérimenté parmi vos forces pour les tueries de masse et le terrorisme.
La question est bien celle-ci : quelle est la doctrine d’emploi des forces spécialisées sur la lutte antiterroriste un soir comme celui-là ? Il n’est pas neutre que ces forces ne soient pas employées comme forces menantes. Il est de notre devoir d’essayer de comprendre.
M. Jean-Marc Falcone. J’essaie de vous apporter les réponses les plus objectives possibles.
M. Pierre Lellouche. Si la raison, c’est que le préfet est souverain, elle n’est pas satisfaisante. Le Gouvernement est souverain, et en l’occurrence le ministre de l’Intérieur, qui a l’autorité hiérarchique sur tous les préfets, y compris le préfet de police de Paris.
M. le président. Au final, la BRI était menante, et s’agissant de nos deux forces d’élite nationales, qui nous sont enviées par le monde entier, l’une était concourante et est restée au rez-de-chaussée, tandis que l’autre était sur le pied de guerre à la caserne des Célestins. En fait, nos deux forces d’élite étaient en retrait.
M. Pascal Popelin. Eu égard à l’audition des différents intervenants précédents, et à la suite du déplacement fort utile sur site jeudi dernier, je ne pense pas que l’on puisse dire que le RAID ait été simplement concourant. Il était effectivement sous l’autorité du préfet de police, comme cela aurait de toute façon été le cas, mais bel et bien coacteur de l’opération.
Il est toujours facile de refaire le film après coup, mais je considère à titre personnel qu’avoir cantonné le GIGN à la caserne des Célestins au cas où d’autres événements encore se seraient produits ailleurs avait du sens.
M. Alain Marsaud. C’est une évidence !
M. le président. La réflexion que nous menons porte sur l’avenir. En tout état de cause, nous n’inventons rien puisque des réflexions en cours sur la territorialité, sur les doctrines d’emploi. Il est donc normal que nous posions ces questions.
Messieurs, il me reste à vous remercier de votre disponibilité.
Audition, à huis clos, du général Denis Favier, directeur général de la gendarmerie nationale, et du colonel Samuel Dubuis, membre de son cabinet
Audition, à huis clos, du lundi 21 mars 2016
M. le président Georges Fenech. Mon général, mon colonel, nous vous remercions d'avoir répondu à la demande d'audition de notre commission d'enquête relative aux moyens mis en œuvre par l'État pour lutter contre le terrorisme depuis le 7 janvier 2015.
Vous savez que nous avons déjà tenu de nombreuses auditions consacrées tout d'abord aux victimes et à leur prise en charge par les secours, puis à la chronologie des événements de janvier et de novembre 2015 sur lesquels nous avons d'ailleurs eu l'occasion de vous entendre.
Nous poursuivons avec vous une nouvelle phase de nos travaux, commencée aujourd'hui avec le directeur général de la police nationale, et qui tend, à la lumière de l'expérience des attentats de janvier et novembre 2015, à nous interroger sur les moyens et les missions des forces de sécurité intérieure, et donc maintenant sur ceux de la gendarmerie.
Cette audition, en raison de la confidentialité des informations que vous êtes susceptible de nous délivrer, se déroule à huis clos. Elle n'est donc pas diffusée sur le site internet de l'Assemblée. Néanmoins, et conformément à l'article 6 de l'ordonnance 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, son compte rendu pourra être publié en tout ou partie, si nous en décidons ainsi à l'issue de nos travaux. Je précise que les comptes rendus des auditions qui se déroulent à huis clos sont au préalable transmis aux personnes entendues afin de recueillir leurs observations. Ces observations sont soumises à la commission, qui peut décider d'en faire état dans son rapport.
Je rappelle que, conformément aux dispositions du même article, « sera punie des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende – toute personne qui, dans un délai de vingt-cinq ans divulguera ou publiera une information relative aux travaux non publics d'une commission d'enquête, sauf si le rapport publié à la fin des travaux de la commission a fait état de cette information ».
Conformément aux dispositions de l'article 6 précité, je vais maintenant vous demander de prêter le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité.
Le général Denis Favier et le colonel Samuel Dubuis prêtent successivement serment.
Je vous laisse la parole pour un exposé liminaire qui sera suivi par un échange de questions et réponses.
Général d’armée Denis Favier, directeur général de la gendarmerie nationale. Monsieur le président, mesdames et messieurs les députés, merci de m’accueillir à nouveau. Je suis très heureux de pouvoir m’exprimer devant vous sur les adaptations que la gendarmerie a dû réaliser dans les mois qui viennent de s’écouler pour faire face à la menace terroriste.
Mes propos liminaires se limiteront à dresser quelques constats sur l’état actuel d’une menace que vous connaissez, qui a été définie ici à plusieurs reprises. Mon analyse vise surtout à vous exposer les conséquences que j’en tire en termes d’adaptation de mon dispositif.
Premier constat : nous sommes confrontés à une menace terroriste qui s’inscrit dans la durée. Notre adaptation ne peut donc pas être ponctuelle mais elle implique – il faut vraiment le souligner – une rénovation profonde de notre action.
Deuxième constat : cette menace terroriste latente, diffuse, est caractérisée par un faible coût des armes utilisées qui favorise le passage à l’acte, mais aussi par son lien avec la grande délinquance de droit commun. Cette caractéristique nous contraint à mieux combiner les opérations de police administrative et de police judiciaire. Il s’agit d’une priorité et des directives ont d’ores et déjà été données aux unités pour optimiser ce volet essentiel.
Troisième et dernier constat : aucun point du territoire national n’est préservé, ce qui nous oblige à avoir une approche globale pour l’ensemble du pays. La compétence de la gendarmerie s’étend sur 95 % du territoire national, une zone où réside une partie importante de la population mais où se trouvent aussi de nombreux sites sensibles : des centrales nucléaires, des usines de type Seveso, de grands centres commerciaux construits à la périphérie des villes, et la plupart des sites militaires sensibles, pour ne citer que quelques exemples emblématiques.
Une fois ces constats dressés, j’ai défini quatre domaines dans lesquels notre action devait être améliorée : le renseignement ; le contrôle des flux et en particulier des entrées sur le territoire national ; le maillage territorial des unités d’intervention, sujet au cœur de l’actualité et de vos préoccupations, qui fait l’objet d’une réflexion très avancée au ministère de l’Intérieur ; notre capacité de résilience, à développer en lien avec la réserve opérationnelle de la gendarmerie et une future garde nationale française.
Dans le domaine du renseignement, nous devons poursuivre le travail collectif déjà engagé et identifier les marges de progrès. La gendarmerie ne fait pas partie des six entités du premier cercle du renseignement et elle ne revendique pas d’en devenir membre. Les unités du premier cercle font leur travail et connaissent ce que j’appellerais du renseignement fermé. La gendarmerie nationale intervient dans le deuxième cercle, avec les unités de compétence générale de la police nationale, pour collecter et analyser le renseignement territorial.
Compte tenu de l’étendue de sa zone d’intervention, de ses 3 000 brigades, de ses 60 000 militaires de la gendarmerie départementale et de ses outils informatiques, la gendarmerie a les moyens de capter les signaux faibles dans le territoire, de les analyser et de les faire remonter. Mieux prise en compte que par le passé, et s’appuyant sur un système de traitement des données très performant (la BDSP : base départementale de sécurité publique), cette capacité se révèle aujourd’hui essentielle, au regard notamment du nombre d’individus présentant des signes de radicalisation.
Dans cet esprit, nous avons décidé de créer 75 antennes de renseignement territorial (ART) dans des villes dans lesquelles nous sommes en zone de pleine compétence. Ce dispositif innovant produit d’ores et déjà des résultats probants. À titre d’exemple, je citerais Lunel, une ville qui a connu de nombreux départs pour le djihad, et d’où nous remontent des renseignements de toute première qualité depuis dix mois, ce qui nous permet de conduire une action particulièrement positive.
Notre positionnement en la matière pourrait se résumer ainsi : ancrage dans le renseignement territorial et valorisation de cette chaîne ; présence dans l’état-major opérationnel de prévention du terrorisme (EMOPT) qui a été constitué au sein du ministère de l’Intérieur après l’attentat de Saint-Quentin-Fallavier, à un moment où nous avons réalisé que certaines informations s’avéraient insuffisamment partagées. Cette structure, de taille réduite et où chacun des services est représenté, permet de fluidifier le partage des renseignements et de vérifier la réalité du suivi des personnes signalées et répertoriées au sein du fichier de traitement des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste (FSPRT). Pour ma part, je considère qu’il s’agit d’une avancée très positive qu’il faut entretenir au cours des années à venir.
Deux pistes d’amélioration pourraient être explorées. D’une part, et à l’instar de notre présence au sein de la Direction du renseignement militaire (DRM), de la Direction de la protection et de la sécurité de la défense (DPSD) et de la Direction générale de la sécurité extérieure (DGSE), entités du premier cercle, je suis favorable au détachement de gendarmes au sein de la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI). Il serait intéressant d’explorer cette piste au cours des prochains mois.
D’autre part, et afin de conforter le haut niveau de coopération entre le renseignement territorial et la gendarmerie, il me paraîtrait opportun de réfléchir au positionnement du Service central de renseignement territorial (SCRT).
Deuxième domaine d’améliorations possibles et qui, à mes yeux, est très important : le contrôle des flux. Depuis les attentats de janvier 2015, je considère que les points vulnérables de notre dispositif sont incontestablement les nœuds autoroutiers, les gares ferroviaires et les aéroports. Nous devons mieux contrôler, dans la profondeur du territoire, tous les axes qui convergent vers les villes et qui servent de vecteurs aux terroristes, qu’il s’agisse d’infrastructures routières, ferroviaires, portuaires ou aéroportuaires.
C’est la raison pour laquelle il faut notamment développer le système de lecture automatisée de plaques d’immatriculation (LAPI), qui serait encore plus performant si les données étaient collectées au plan national. Le système de traitement central de lecture LAPI (STCL) que je défends permettrait de détecter des mouvements de véhicules sur l’ensemble de nos axes routiers, mais il faudrait aussi faire évoluer les textes pour que nous puissions vraiment exploiter ces données. Quoi qu’il en soit, nous avons là un moyen de développer une action attendue de sécurisation du territoire national.
Dans ce domaine, nous pouvons également bâtir un engagement avec les armées, notamment dans le cadre du dispositif Sentinelle. À chaque fois que nous avons tenu des barrières de péages, ce que nous avons fait après le 13 novembre pendant plusieurs semaines, nous avons obtenu des résultats importants. De tels dispositifs contribuent à valoriser le sentiment de sécurité et sont de nature à dissuader les actions terroristes.
Dépassons le cadre du territoire national et élargissons un peu le périmètre d’observation. Je pense qu’il faut, d’une manière plus large, dans la même optique de contrôle des flux, avoir une réelle action aux frontières extérieures de l’Union européenne. C’est le sens du dispositif que nous sommes en train de mettre en œuvre. Si l’on va au-delà, je pense que nous devons aussi porter un regard affûté sur les zones de départ des terroristes : l’Afrique, la Libye, les pays du pourtour Est de la Méditerranée. Nous avons là une action déterminante à conduire. C’est une action de police générale qui doit impliquer les unités de l’intérieur et sans doute aussi les armées. Ce faisant, nous pourrions développer une politique cohérente de contrôle des flux.
Troisième domaine : la doctrine et les schémas d’intervention. Les attentats de janvier et de novembre ont mis en évidence la nécessité de faire évoluer nos schémas et de rénover nos doctrines nationales, en distinguant différents niveaux d’intervention. Je prolonge aujourd’hui une analyse que j’avais déjà esquissée devant vous. Mettons à part l’intervention élémentaire, celles des primo-engagés qui arrivent sur un fait de nature gravissime et qui doivent le gérer comme on l’a toujours fait dans notre pays : en se positionnant, en observant, en ripostant, le cas échéant.
Nous devons travailler l’intervention intermédiaire, celle où nous avons une fragilité, selon le plan engagé par le ministre, qui implique les brigades anti-criminalité (BAC) et les pelotons de surveillance et d'intervention de la gendarmerie (PSIG). Avant l’intervention des unités du haut du spectre que sont les service de Recherche, assistance, intervention, dissuasion (RAID) et le Groupe d'intervention de la gendarmerie nationale (GIGN), certaines unités doivent être capables d’engager le feu dans les quelques minutes qui suivent un début de tuerie planifiée. Nous devons développer de telles unités, en province notamment, en les dotant d’une puissance de feu renforcée, d’équipements de protection adaptés, et d’aides à la visée. Nous sommes en phase de montée en puissance dans ce registre et la gendarmerie aura atteint sa première cible au cours de l’été prochain : 50 PSIG « SABRE », répartis sur le territoire national, nous permettront ainsi de disposer d’une telle capacité intermédiaire.
Le GIGN et le RAID, les unités centrales spécialisées, doivent avoir des bras armés en province. La gendarmerie a trois antennes en province – à Toulouse, Orange et Dijon – auxquelles vont s’ajouter celles de Nantes, Tours et Reims dans le courant de l’année 2016. Ces unités sont en cours de formation et nous aurons à terme un dispositif assez solide, y compris outre-mer, puisque tous les départements et collectivités territoriales sont concernés. Nous allons notamment créer une antenne du GIGN à Mayotte, territoire sur lequel j’ai souhaité renforcer le dispositif d’intervention existant.
Voilà pour la théorie en matière d’intervention, mais nous devons également faire aboutir le schéma national d’intervention, qui fait l’objet d’importants débats. Nous devons notamment redéfinir ce que sont les unités du haut du spectre et ce qu’elles savent faire. Dans le cadre du schéma national d’intervention, nous avons listé des capacités qui font la différence en termes de contre-terrorisme. Nous avons également recensé les capacités des unités sur la base de déclarations ; il nous appartient à présent de vérifier leur existence réelle afin d’affiner le schéma national d’intervention.
Ce schéma, en cours de finalisation, rappelle les principes : l’unité concernée au premier chef est celle qui relève de la zone de compétence de la force considérée. Mais si cette dernière rencontre un problème technique ou si elle ne maîtrise pas une capacité nécessaire, une unité extérieure peut venir en force concourante. Ce schéma d’intervention me semble constituer une avancée considérable.
En matière d’intervention, la gendarmerie consent un effort important envers des groupes étrangers amis, notamment dans la bande sahélienne où nous devons nous déployer. Pour y être allé régulièrement, je considère qu’il y a là des menaces considérables, un besoin d’aide. Je préconise de reprendre la formation dans les cinq pays de l’arc sud sahélien – (la Mauritanie, le Mali, le Burkina Faso, le Niger et le Tchad) – et le Sénégal ainsi que la Côte d’Ivoire, afin de les aider à faire face aux menaces auxquelles ils sont aujourd’hui confrontés et que nous pourrons avoir à affronter demain.
Quatrième domaine : la résilience et le rôle de la réserve de la gendarmerie. La réserve est un outil exceptionnel, constitué de 25 000 hommes et femmes, dont 70 % de personnes âgées de vingt-cinq à quarante ans et qui, en complément de leur activité professionnelle, viennent travailler en gendarmerie pour contribuer à leur propre sécurité, là où ils vivent. Ce concept, qui fonctionne vraiment très bien, me permet de faire travailler 1 500 réservistes chaque jour, de renforcer la couverture du territoire, de collecter du renseignement, d’affirmer une présence de l’État, et de rassurer nos concitoyens. Il est possible d’aller encore plus loin en sollicitant notamment les réservistes pour la sécurité quotidienne, je pense aux écoles et aux hôpitaux. Cette piste de réflexion mériterait d’être creusée. Le succès de la réserve s’explique par son ancrage dans les territoires qui nous permet de faire travailler les gens pendant des périodes très courtes, parfois de vingt-quatre heures seulement.
Voici en quelques mots, Monsieur le président, ce que je voulais dire pour lancer les débats. Je suis bien sûr à votre disposition si vous souhaitez approfondir certains sujets notamment en ce qui concerne les équipements utilisés dans le cadre du plan de lutte antiterroriste du début de l’année ou du pacte de sécurité de fin d’année.
M. le président Georges Fenech. Merci, mon général, pour ces explications liminaires qui sont très riches et novatrices, qui témoignent d’une vraie réflexion que vous devrez soumettre aux autorités politiques, en collaboration avec la police nationale. Vous proposez que le service du renseignement territorial (SRT) soit codirigé par la police et la gendarmerie, ce qui implique des évolutions structurelles considérables. Vous parlez de refonte totale, d’évolutions fondamentales.
Je vais rebondir sur vos derniers propos car les commissaires d’enquête ont besoin de comprendre, sur un plan technique, ce que vous savez faire et que d’autres ne savent pas faire. Vous dites par exemple que vous pouvez réaliser des brèches par effractions chaudes. Pouvez-vous nous décrire cette technique ? D’autres services, tels que la brigade de recherche et d'intervention (BRI), peuvent-ils le faire ? Quelle est la valeur ajoutée du GIGN en matière d’intervention ?
Général d’armée Denis Favier. Monsieur le président, je vais vous parler de mon métier, de ce que je sais faire.
Compte tenu de sa nature, le GIGN a développé son concept d’intervention contre-terroriste à partir de capacités militaires qu’il a adaptées aux missions de police. Voilà le cheminement suivi : nous partons de nos capacités militaires et nous en atténuons les effets secondaires pour diminuer les dommages collatéraux, par exemple, pour intervenir sur le segment de missions de police. Il est plus difficile d’effectuer le cheminement inverse, c’est-à-dire de partir de missions de police pour aller vers des opérations de contre-terrorisme qui supposent l’emploi de moyens lourds. C’est une démarche différente sur les plans intellectuel et technique.
Notre longue pratique des engagements opérationnels nous a conduits à évoluer, notamment à utiliser les explosifs depuis vingt ans. Pour maîtriser cette technique, qui suppose un dosage particulièrement fin, nous avons, au départ, procédé de manière empirique.
Nous avons notamment engagé cette réflexion en 1994, après l’opération de Marignane où nous sommes entrés par la porte d’un avion pour libérer des otages. Une fois éventé, un mode d’action est perdu, on ne peut plus le développer, il faut en trouver un autre. Avec la délégation générale de l’armement (DGA), nous avons alors développé de nouveaux procédés.
Nous savons aussi travailler en ambiance polluée par une substance nucléaire, radiologique, biologique ou chimique (NRBC), équipés de tenues légères ou de scaphandres.
M. le président Georges Fenech. Nous sommes au cœur du sujet. Y a-t-il des questions sur ces points-là ?
M. Sébastien Pietrasanta, rapporteur. Comment auriez-vous agi à Saint-Denis sur la porte qui a explosé sans tomber ? Avez-vous des techniques différentes de celles du RAID ?
Général d’armée Denis Favier. Pas plus qu’il y a deux semaines, je ne peux vous répondre sur ce dossier-là puisque je n’étais pas sur place.
M. Pierre Lellouche. Le RAID et la BRI savent-ils intervenir face aux produits NRBC ?
Général d’armée Denis Favier. Je ne peux vous répondre que pour le GIGN. Les équipements de protection font l’objet d’une dotation individuelle et sont rigoureusement contrôlés.
M. Pierre Lellouche. Imaginons qu’il y ait une attaque chimique dans Paris, dans le métro ou dans un grand magasin. Qui saura gérer la situation ?
Général d’armée Denis Favier. Ces capacités sont listées dans le schéma d’intervention et elles vont faire l’objet d’une vérification. Je peux vous parler de ce que j’ai.
M. Pierre Lellouche. Vous être trop poli pour parler des autres, mon général ?
Général d’armée Denis Favier. Je reviens sur la finalité du schéma d’intervention, parce que c’est un point clef. Dans ce débat, on ne peut pas s’en tenir aux déclarations. Le ministre veut qu’on aille vérifier, capacité par capacité, qui est capable de faire telle ou telle chose. C’est déterminant. Et au bout de la vérification capacitaire, on saura répondre à votre question : qui est capable d’engager des explosifs, de faire face à des risques NRBC ? C’est un point très important et attendu.
M. le rapporteur. Au Maroc, il y aurait eu des éléments d’une bombe sale. Le schéma, que vous êtes en train d’élaborer, prend évidemment en compte ce type de menace particulière. Avez-vous dès à présent augmenté les capacités d’entraînement ou les équipements pour y faire face ?
Général d’armée Denis Favier. Oui, très clairement.
M. le rapporteur. C’est une préoccupation très importante ?
Général d’armée Denis Favier. Les unités du haut du spectre s’en préoccupent depuis plusieurs années. Elles sont capables de traiter le problème de l’amont – travail sous scaphandre, détection de substances NRBC et d’explosifs – à l’aval, c’est-à-dire jusqu’à l’intervention proprement dite. Ce dossier, complexe et ancien, est largement soutenu par le SGDSN, notamment sur le plan financier. Nous ne sommes pas en retard.
M. Serge Grouard. Allez-vous jusqu’à la décontamination ?
Général d’armée Denis Favier. Nous intervenons en effet à tous les stades : détection, intervention, décontamination.
M. François Lamy. Confirmez-vous que, le 13 novembre, le GIGN était positionné à la caserne des Célestins pour réagir au cas où il y aurait eu d’autres attaques dans Paris ? Était-ce bien sa mission ?
Général d’armée Denis Favier. Je vous le confirme, comme il y a quinze jours, quand je vous avais donné des précisions sur les horaires d’arrivée et les unités engagées.
M. François Lamy. Parmi les mesures prises depuis le 7 janvier, nous avons l’opération Sentinelle qui a mobilisé jusqu’à près de 10 000 soldats et qui a connu les difficultés inhérentes à la mise en place d’un nouveau dispositif. Des gardes statiques se sont transformées petit à petit en gardes dynamiques. Les soldats, qui travaillent sous l’ordre du préfet – ce qui n’est pas dans leurs habitudes –, ont vu leur temps de formation se réduire de manière considérable : près des deux tiers des sessions de formation ont été annulés l’année dernière et le seront encore cette année, dans l’attente des recrutements. Certains soldats cumulent six à sept missions Sentinelle dans l’année, alors qu’ils font aussi des opérations extérieures (OPEX) et que leur métier est, après tout, de faire la guerre et non de garder des lieux de culte, pour faire simple.
Nous réfléchissons, les uns et les autres, sur la manière de réduire petit à petit l’importance du dispositif Sentinelle. On se pose des questions, y compris sur l’emploi des soldats, le soir des attentats. Qui donne l’ordre de tirer ? Comment ? Pourquoi ?
Or nous avons une force militaire qui peut aussi faire des opérations de police et de la garde statique ou dynamique de sites tels que les centrales nucléaires. Si une force a toute l’expérience pour accomplir les tâches de la mission Sentinelle, c’est la gendarmerie nationale. On va me répondre que c’est une question d’effectifs. Si on trouvait la solution en matière d’effectifs, la Gendarmerie nationale n’aurait-elle pas toutes les capacités pour remplir la mission Sentinelle, ce qui permettrait à nos soldats d’aller faire la guerre, ou de s’y préparer en tout cas, ce qui est leur mission première ?
Général d’armée Denis Favier. Je me suis exprimé à plusieurs reprises sur ce sujet très sensible. En tant que patron de la gendarmerie, je pense que nous faisons face de manière satisfaisante aux problématiques générales d’insécurité : les cambriolages ont régressé en 2015 ; notre engagement est fort ; nous faisons également face à de lourdes séquences de maintien de l’ordre.
Cependant, la nature de la menace que nous rencontrons nous conduit à optimiser les moyens nationaux et, dans ce contexte, le recours aux moyens militaires est intéressant. Toutefois, je ne défends pas l’idée qu’il existerait une rupture stratégique. Afficher ce constat reviendrait en effet à admettre que Daech est parvenu à conquérir une partie du territoire national. Ce n’est pas le cas.
Je reconnais volontiers un durcissement de la menace, mais je pense que nous pouvons gérer la situation avec les moyens conventionnels et juridiques dont nous disposons. L’état d’urgence nous permet de faire face à la plupart des situations. De mon point de vue, l’emploi des forces armées sur le territoire national doit être guidé par le principe de subsidiarité, ce qui n’est pas un terme péjoratif dans ma bouche, et reposer sur une étroite collaboration avec les forces de sécurité du ministère de l’Intérieur dans une logique de « menant-concourant ».
Je reste aujourd’hui persuadé que le ministère de l’Intérieur possède l’ensemble des expertises techniques pour faire face aux nouvelles menaces. En outre, les gendarmes et policiers sont capables de passer très rapidement d’une posture de sécurité publique à une posture d’intervention, avec le souci constant de la proportionnalité des moyens et de la force engagés. Ce principe de réversibilité fait partie de nos fondamentaux et constitue l’un des piliers de la formation dispensée dans l’ensemble de nos écoles.
Il faut à mon sens développer l’emploi des forces armées dans une logique de contrôle des flux, comme nous le faisons en Guyane pour lutter contre l’orpaillage illégal, dans le cadre de l’opération Harpie. Les armées et la gendarmerie sont engagées dans une même mission, avec un groupe de combat d’infanterie et deux officiers de police judiciaires (OPJ). Cet alliage de compétences a du sens. Les règles de l’état de droit sont respectées : le gendarme fait son travail de contrôle, de police administrative et de police judiciaire, mais en ayant le soutien et, si nécessaire, l’appui feu d’un groupe de combat. Ce dispositif Harpie a fait ses preuves sur le terrain et mériterait d’être transposé sur le territoire national, dans une logique de contrôle des flux qui permette d’entraver la liberté de circulation des terroristes et des délinquants tout en rassurant nos concitoyens.
Pour être complet dans ma réponse, monsieur le député, j’indique que, dans le courant du mois d’avril, à l’initiative de l’armée de terre et de la gendarmerie, nous allons engager une expérimentation de deux semaines dans le département de l’Isère. Nous allons tester cet engagement conjoint des deux institutions, dans une logique de contrôle des flux dans un département exposé à une délinquance très active, et en tirer ensuite des conséquences.
M. François Lamy. Vous n’avez pas totalement répondu à ma question. Si vous aviez les effectifs, est-ce que vous ne seriez pas plus efficaces et plus adaptés que les militaires pour remplir les missions de l’opération Sentinelle ? Vous avez toute la panoplie pour agir dans un tel contexte, y compris parce que vos gendarmes font aussi du renseignement quand ils surveillent un lieu de culte. C’est un peu dans leurs gènes, si j’ose dire.
Général d’armée Denis Favier. Si la gendarmerie avait bénéficié des renforts d’effectifs que vous évoquez, elle aurait produit un « effet terrain » significatif.
M. le rapporteur. Le 13 novembre, des informations utiles à l’intervention au Bataclan étaient parvenues par divers biais à certaines brigades de gendarmeries. Ces informations étaient-elles répercutées à la police et aux forces qui intervenaient sur le terrain ? Si oui, dans ces moments de crise, comment se fait la communication ? A contrario, quand le GIGN dirige les opérations, des informations vous parviennent-elles de la Police nationale, notamment à travers le 17 ?
Nous voyons tous l’importance des primo-intervenants et, comme le ministre de l’Intérieur, vous avez indiqué que tous les PSIG allaient être équipés avant le 1er juillet. Quel est le niveau de formation et d’entraînement au tir de vos gendarmes ? Combien de cartouches tirent-ils par an ?
Enfin, combien la gendarmerie surveille-t-elle de lieux, sous forme de gardes statiques ou mobiles ?
Général d’armée Denis Favier. La gestion de l’information diffère selon la nature de la crise, et celle du 13 novembre est ce qu’on appelle une crise à cinétique rapide, durant laquelle tout le monde recueille de l’information, les unités de gendarmerie comme les commissariats. Dans une crise aussi rapide, on n’a pas le temps de mettre en place un poste de commandement pour travailler le renseignement et recueillir toutes les données, notamment celles qui transitent par les réseaux sociaux. Entre le premier coup de feu au Bataclan et la résolution de la crise, il s’est écoulé deux heures ou deux heures trente. Ce laps de temps est trop court pour pouvoir exploiter l’ensemble des renseignements recueillis par nos brigades sur le territoire national.
On peut le faire lors d’une crise plus longue, s’il s’agit par exemple d’une prise d’otage au cours de laquelle on peut dérouler les artifices normaux, notamment la prise de contact par la négociation. On peut alors utiliser les outils qui permettent de travailler l’information : observation des réseaux sociaux, à titre d’exemple On ne peut pas mettre cela en place lors d’une crise qui nécessite un assaut d’urgence.
S’agissant des primo-intervenants et des primo-engagés, il a fallu bouleverser la doctrine. Jusqu’alors, en gendarmerie comme en police, quand nous étions confrontés à une tuerie subite et planifiée, la mission donnée aux premiers engagés était d’observer, de se poster et d’attendre le renfort des unités spécialisées, le haut du spectre. Ce n’est plus possible : on ne peut plus attendre parce que les terroristes tuent et qu’il n’y a pas de négociation possible ; nous devons intervenir très vite pour donner un coup d’arrêt, signifier qu'on est présent et qu’on ne laissera pas faire.
M. le rapporteur. Ce changement de doctrine est intervenu avant ou après le 13 novembre ?
Général d’armée Denis Favier. La réflexion a débuté après les attentats de janvier, elle a mûri dans le courant du printemps, nous avons bâti une doctrine conjointe avec la police en juin dernier, et nous en sommes à la mise en œuvre.
M. Meyer Habib. Elle n’a pas été employée le 13 novembre ?
Général d’armée Denis Favier. Le ministre a présenté ce plan le 23 octobre 2015 à Rouen et son application représente un travail considérable. Il faut faire évoluer les esprits et les procédés opérationnels. Pendant des années, les primo-engagés ont eu pour consigne de se poster, d’observer, de rendre compte et d’attendre, alors qu’on leur demande maintenant d’aller au contact. Il faut changer les doctrines d’emploi, les matériels et les concepts tactiques. C’est très compliqué. Nous avons franchi ce pas. Nous allons à Reims le vendredi 1er avril pour assister à l’entraînement des premières unités. Il a fallu acquérir l’armement. C’est fait.
Nous adaptons donc l’armement, les équipements balistiques, les concepts d’emploi. Nous achetons des boucliers balistiques. Il faut voir ce qu’est un bouclier balistique : c’est très lourd, et il faut l’intégrer dans une manœuvre de cellule. Dans certaines unités, il y avait beaucoup de gendarmes adjoints volontaires, c'est-à-dire des jeunes qui ne sont pas des militaires d’active. C’est pourquoi j’ai décidé que chaque PSIG SABRE serait composé de 2/3 de sous-officiers de gendarmerie. La direction générale suit avec la plus grande attention la montée en puissance de ce dispositif, y compris la formation aux outils et aux armes. S’agissant du volume de munitions tirées chaque année par nos gendarmes, il s’établit à environ 60 cartouches de 9 mm, ce qui a doublé par rapport au niveau d’entraînement antérieur aux attentats. Je vous transmettrai une note détaillant avec précision la formation au tir mise en œuvre depuis les attentats.
En ce qui concerne Sentinelle, je ne suis pas très favorable à ce que des gendarmes mobiles soient engagés dans des dispositifs statiques qui, à mon sens, ne sont pas suffisamment efficients. Ce concept doit évoluer. La gendarmerie garde actuellement cinq sites dans Paris. Des moyens passifs, électroniques, pourraient être utilisés. Il faut optimiser nos capacités en moyens techniques pour dégager de la ressource vive qui peut alors être employée à d’autres missions.
M. le rapporteur. Vous êtes spécialisés sur les explosifs et les risques NRBC. La territorialisation des forces d’intervention a-t-elle encore un sens ? La pratique évolue en cas de tuerie de masse, mais ne faut-il pas aller plus loin ? Lors des attentats du mois de janvier 2015, le GIGN, le RAID et la BRI sont intervenus dans des zones ne relevant pas de leurs compétences. À votre avis, les choses doivent-elles évoluer sur ce point ? Si oui, de quelle manière ?
Général d’armée Denis Favier. Elles vont évoluer avec le schéma national d’intervention.
M. le rapporteur. Il faudrait aller encore plus loin.
Général d’armée Denis Favier. Dans 95 % des cas, le métier des unités spéciales consiste à maîtriser un forcené, à résoudre une prise d’otage à mobile crapuleux ou une situation de rétention familiale, à arrêter des individus dangereux à leur domicile. Dans ces cas, la question de la compétence territoriale a du sens. Ce dont nous parlons aujourd’hui représente les 5 % du métier qui nécessitent que l’on revisite les process. Le schéma d’intervention va nous y aider. Il faudra alors que nous sachions engager, quelle que soit la zone de compétence, tous les moyens disponibles. Ce schéma va nous permettre, en fonction des problèmes rencontrés, d’engager des moyens détenus au titre des capacités particulières par telle ou telle unité, dans une logique de « menant » et « concourant ». Nous allons déboucher à court terme sur cette évolution qui me semble notable. Pour les 5 % que j’évoque, nous allons évoluer dans ce sens.
M. Christophe Cavard. Mon général, vous avez donné une information qui m’intéresse particulièrement : vous regrettez que la gendarmerie ne soit pas associée au plus haut niveau à la DGSI. Avec les militaires de la DGSE et de la DRM, vous êtes entre vous, même si c’est déjà une évolution. Que pourrait vous apporter une présence au sein de la DGSI ?
La question de la codirection du renseignement territorial se pose, à un moment où une vraie réflexion est menée sur le renfort qu’ils peuvent apporter. Vous avez cité l’exemple de Lunel pour valoriser le rôle des brigades, là où elles sont, et prôner une fluidification de l’information. À une époque, l’information se faisait dans un sens mais il n’y avait pas beaucoup de va-et-vient. Comment ces évolutions se passent-elles concrètement ?
Les assignations à résidence et autres décisions administratives, qui se multiplient, ne concernent pas seulement les villes. En tant que gendarmes, comment êtes-vous préparés à y faire face ?
M. le président Georges Fenech. Je vous rappelle, chers collègues, que nous avons prévu tout un bloc pour le renseignement, donc nous aurons l’occasion d’auditionner la sous-direction de l'anticipation opérationnelle (SDAO) qui dépend du général Favier.
Général d’armée Denis Favier. La DGGN entretient des rapports très constructifs avec la DGSI et le niveau de coordination a évolué de manière positive depuis quelques années. Nous avons clairement décloisonné le suivi des personnes signalées et assignées à résidence, notamment grâce à la création auprès du ministre de l’Intérieur de l’état-major opérationnel de prévention du terrorisme (EMOPT) consécutivement à l’attentat de Saint-Quentin Fallavier du juin 2015. Je suis favorable au détachement d’un officier de liaison au sein de la DGSI.
S’agissant du renseignement territorial, et comme je l’indiquais au début de mon intervention, il me semble opportun de conduire une réflexion sur le positionnement du Service central de renseignement territorial.
M. Christophe Cavard. Il y a un souci ?
Général d’armée Denis Favier. Dans les départements, le détachement de gendarmes au sein des SDRT, la réunion hebdomadaire du bureau de liaison ont permis de rehausser le niveau de coordination de façon intéressante. Il faut poursuivre dans cette voie, notamment dans le domaine du suivi des individus radicalisés.
Quant aux assignations à résidence, nous en avons pris notre part : nous avons conduit 1 200 perquisitions administratives, et nous avons eu jusqu’à soixante-dix assignés à résidence entre le 13 novembre et la fin février – il doit en rester une dizaine. La DGSI nous avise systématiquement dès lors qu’un individu est assigné à résidence dans notre zone de compétence.
M. Philippe Goujon. Sur le renseignement, j’aimerais approfondir la question précédente. D’après votre réponse, la solution optimale ne serait-elle pas que vous soyez intégré dans le premier cercle de la communauté du renseignement, puisque vous regrettez de ne pas avoir de correspondant à la DGSI et la codirection du SCRT ?
Le GIGN était à la caserne des Célestins, à proximité du Bataclan, prêt à intervenir. Tant mieux, mais cela n’a pas été possible à cause de la territorialisation. On nous dit que vous étiez placés là en réserve, pour éventuellement intervenir dans d’autres secteurs. N'est-ce pas un handicap ? Vous étiez peut-être le service le plus près du Bataclan, et celui qui serait intervenu le plus rapidement. Ne faudrait-il pas envisager une sorte de fusion des forces d’intervention ou au moins une interopérabilité ? La question se pose d’autant plus que la BRI nous a indiqué qu’elle avait eu du mal à accéder au site, en raison de la circulation parisienne.
Vous parlez d’une garde nationale qui pourrait occuper une partie des missions dévolues à l’armée dans le cadre de l’opération Sentinelle. La réserve opérationnelle, transformée en garde nationale, serait sous l’autorité de la gendarmerie. Quel rôle pourrait-elle précisément avoir dans ce type de mission ?
Ma dernière question porte sur les effectifs dont vous disposez. Vous n’êtes pas convaincu par les gardes statiques, ce que je peux comprendre. Nombre d’escadrons sont mobilisés pour la garde de palais nationaux, l’Assemblée nationale, le palais de justice, etc. Dans ces conditions, n’est-il pas opportun de diminuer ces forces ? Nous sommes certes en situation de crise, mais il serait peut-être possible d’employer d’autres moyens ou d’autres effectifs, de façon que vous récupériez des personnels.
Général d’armée Denis Favier. Monsieur le député, je ne revendique pas le rattachement au premier cercle : c’est un renseignement particulier qui relève de la sécurité intérieure, alors que je me situe plutôt sur l’information générale. La place de la gendarmerie dans le deuxième cercle est satisfaisante. Si je pense que nous devons être présents à la DGSI, c’est pour mieux travailler la zone frontière entre le premier et le deuxième cercles.
Le GIGN était en effet présent à la caserne des Célestins avec quarante-cinq hommes. Aurait-il pu changer la donne ? Franchement, je n’en suis pas convaincu. Au moment où il est arrivé, beaucoup de choses avaient déjà été faites. Je ne peux pas répondre dans ce sens-là. Je n’en suis pas certain. Je n’ai de surcroît pas une connaissance exacte de ce qui s’est passé à l’intérieur du Bataclan.
Faut-il fusionner les unités d’intervention ? Il s’agit des fleurons des deux maisons. Il nous faut être responsable pour avoir un outil performant. À mon avis, en cas de tuerie planifiée et face à des situations d’urgence qui se déroulent toujours au moment le plus défavorable, nous devons collectivement accepter – et c’est le schéma d’intervention qui va nous y conduire – l’engagement immédiat de toutes les capacités disponibles.
Dans un tel contexte, il ne faut plus se poser la question de savoir qui fait quoi ; il faudra que nous allions tous très vite mettre un terme à la situation de crise. C’est une question de responsabilité. Il faudra que l’on prenne les moyens disponibles à l’instant considéré. Le schéma prévoit cette situation d’action placée sous le signe de l’urgence absolue. Je pense qu’on devra y faire face. Le GIGN se tient d’ores et déjà en mesure de se déployer plus rapidement, en particulier sous la forme de petites équipes « toutes capacités » dont la mission sera de donner un coup d’arrêt aux auteurs des faits. Nous avons bien vu comment se comportent les terroristes : au premier coup d’arrêt, la donne change. Nous devons nous placer dans cette logique. Si nous allons au bout du schéma d’intervention, nous allons y parvenir à très court terme.
La gendarmerie possède une expertise unanimement reconnue en matière de gestion et d’emploi des réservistes opérationnels. Notre réserve opérationnelle tire son efficacité de sa « territorialité ». Si on veut la gérer sur le plan national, faire travailler dans le nord de la France pendant un mois un individu qui habite dans la région Centre, cela n’ira pas. Nous devons pouvoir faire travailler les individus là où ils vivent et pendant des durées extrêmement courtes. Tout autre schéma, qui n’irait pas dans ce sens, rencontrera de mon point de vue de sérieuses difficultés de mise en oeuvre. Les préfets sont les mieux armés, le cas échéant avec l’appui de la gendarmerie, pour piloter cette forme de réserve « garde nationale » qui me semble être un concept intéressant.
Votre dernière question concernait les gardes statiques. J’en assure cinq et j’ai quatre escadrons mobilisés dans ce cadre.
M. Philippe Goujon. Ces gardes concernent surtout les palais nationaux et le palais de justice.
Général d’armée Denis Favier. Nous allons bientôt récupérer une partie des escadrons mobilisés au palais de justice : c’est la préfecture de police de Paris qui assurera la garde des nouveaux locaux, dont les travaux avancent très rapidement, aux Batignolles. Il faudra néanmoins conserver un certain nombre de postes car la cour d’appel et la Cour de cassation demeureront sur l’île de la Cité.
M. Pierre Lellouche. Votre exemple sur la Guyane m’a un peu étonné. Pour y avoir passé un peu de temps avec la gendarmerie, j’ai pu observer que le système de coopération avec l’armée se passait bien, en effet, mais que notre politique de lutte contre les orpailleurs était un échec retentissant. Avec tout le respect que je vous dois, je n’utiliserais pas cet exemple, même si je vois bien que vous faites allusion au fonctionnement opérationnel.
M. le président Georges Fenech. Nous ne sommes pas saisis du problème des orpailleurs.
M. Pierre Lellouche. D’accord, mais le général parlait de la coordination entre les militaires et la gendarmerie dans le cadre de la lutte antiterroriste, en donnant l’exemple de la Guyane où, malheureusement, les résultats ne sont pas au rendez-vous.
J’avais une question précise sur ce qui s’est passé à Cambrai, quand Salah Abdeslam était en vadrouille. D’après la presse, la voiture où il se trouvait aurait été contrôlée à trois reprises. Elle l’a été à coup sûr à Cambrai, par la gendarmerie. Pourquoi les gendarmes n’avaient-ils aucun renseignement ? Pourquoi le système de renseignement n’a-t-il pas fonctionné entre Paris et vos hommes sur le terrain ? En plus, nous avons appris ensuite que les informations ne circulaient pas entre les Belges et nous : la totale ! Comment peut-on régler ce problème ?
Sur le renseignement, votre idée de rattacher le SCRT au directeur général de la gendarmerie et au directeur général de la police devrait être l’une des conclusions de notre commission, tant elle paraît évidente : il n’y a aucune raison pour que le renseignement territorial dépende de la police et non de la gendarmerie alors que vous y contribuez.
S’agissant du fonctionnement en premier et deuxième cercles, permettez-moi de vous dire que, par opposition au renseignement classique interétatique, le renseignement antiterroriste nécessite de regrouper l’ensemble de l’information dans un lieu unique et dans un délai très rapproché entre la collecte et l’utilisation opérationnelle. Autrement dit, le fait que la gendarmerie ne soit pas dans le premier cercle, alors que vous avez des capteurs sur tout le territoire, me paraît un non-sens. Vous faites preuve d’une grande diplomatie en vous déclarant très bien dans le deuxième cercle mais, en vérité, il faut un aquarium où toutes les informations arrivent, soient traitées et transmises le plus vite possible sur le terrain.
Ma dernière question porte sur un point très important : le renseignement humain. Avez-vous des informations sur ce que font ces groupes à Lunel, Molenbeek ou ailleurs ? Pour notre part, nous n’en avons pas. En revanche, nous voyons que M. Salah Abdeslam peut survivre quatre mois sans téléphone dans un quartier où il est nourri et logé. Il n’est finalement repéré que sur dénonciation, ce qui veut dire que les services de renseignement sont absolument sourds et aveugles. C’est très inquiétant. Quelle est votre capacité de pénétrer ces milieux ?
Général d’armée Denis Favier. Monsieur le député, en prenant l’exemple de la Guyane, je faisais référence aux structures. En termes de structures, nous avons mené une réflexion et la coordination fonctionne bien désormais entre l’armée de terre et la gendarmerie pour accomplir cette mission difficile dans un environnement inhospitalier. L’expérience me semble intéressante et peut être dupliquée.
À Cambrai, nous avons mis un dispositif de contrôle dans la nuit du 13 au 14 novembre. Le matin du 14 novembre, cette voiture s’est présentée sur le point de contrôle au péage de Thun-Lêvèque sur l’autoroute A2. Il y avait trois hommes à bord, dont Salah Abdeslam. Les gendarmes les ont interceptés et ils ont interrogé les fichiers. Une fiche est sortie, effectivement, mais c’était une fiche police judiciaire Schengen et non pas une fiche S française : l’individu était connu pour un trafic de stupéfiants entre la Belgique et les Pays-Bas. À ce moment précis, personne ne savait que c’était l’homme que nous recherchions. La conduire à tenir était de le relâcher et de signaler son passage.
M. Pierre Lellouche. N’avez-vous pas dit vous-même qu’il existe un lien entre la criminalité organisée et le terrorisme ? Ce n’était pas dans les tuyaux à ce moment-là ?
Général d’armée Denis Favier. Le lien a été établi depuis plusieurs mois. Le gendarme, qui connaissait l’existence d’un tel lien, a retenu l’individu contre toute règle de droit, et a téléphoné au bureau SIRENE France, chargé de la gestion opérationnelle de la partie nationale du système d’information Schengen. Il sentait qu’il y avait peut-être quelque chose. Vérification faite, le bureau SIRENE a dit au gendarme de laisser passer. Le travail a été fait. Le gendarme a été prudent : outrepassant son rôle, il a pris des photographies du passeport qui ont été utilisées par la suite pour rechercher des renseignements. L’enquête établit par la suite l’implication directe des individus dans les attentats du 13 novembre. Je rappelle que la fiche qu’avaient les gendarmes n’était pas une fiche S.
J’en viens à votre question sur le rattachement du SCRT au directeur général de la gendarmerie et au directeur général de la police. Tous les services lourds et conjoints entre police et gendarmerie qui fonctionnent bien – qu’il s’agisse de coopération internationale, de télécommunications, de systèmes d’information ou d’achats d’équipements – sont copilotés par les deux directeurs généraux. Dans cet esprit, il pourrait être envisage de repositionner le SCRT.
Vous revenez sur la question du premier et du deuxième cercles du renseignement. Le gendarme agit de manière ouverte. Il est connu de la population. Dans le deuxième cercle, je peux rassembler de l’information générale, la transmettre en vue d’alimenter une base de données. Je peux rester dans le deuxième cercle et être associé au renseignement de nature terroriste. Comme je vous l’expliquais il y a quelques instants, il nous faut collectivement amplifier la fluidité des échanges de renseignement, dans le sens montant et descendant. L’EMOPT incarne ce nouveau souffle dans le domaine essentiel du suivi effectif et adapté des individus radicalisés.
M. Pierre Lellouche. La solution, c’est qu’il n’y ait qu’un seul cercle.
Général d’armée Denis Favier. En ce qui concerne le renseignement humain, il faut être prudent. Il n’est pas évident de rentrer dans certains secteurs. La création des antennes de renseignement territorial (ART) s’est accompagnée de pédagogie pour expliquer tout l’intérêt d’avoir des gendarmes insérés au cœur des populations. Si on le fait, on recueille vraiment des renseignements qu’on n’avait pas avant. À Lunel, les gendarmes vivent dans la cité, ils sont dans le club de sport avec les jeunes de la ville. Il en résulte un échange d’informations extrêmement fluide, vraiment bénéfique et qui va dans le sens d’un retour d’informations particulières que vous évoquez. Nous avons progressé dans ce domaine et nous poursuivons notre montée en puissance.
M. Guillaume Larrivé. Mon général, vous avez évoqué l’opportunité qu’il y aurait à disposer de nouveaux moyens juridiques pour mieux contrôler les flux d’entrées sur le territoire national. Sur quels points les législateurs que nous sommes pourraient-ils faire évoluer le droit ?
Général d’armée Denis Favier. Une mesure importante consisterait à optimiser le système LAPI, qui enregistre les vues des voitures et lit leurs plaques d’immatriculation. Nous ne disposons que d’applications locales qui ne permettent pas d’exploiter les données sur le plan national. Dans une optique post 13 novembre, il serait pertinent de connecter l’ensemble des capteurs de la DGG N, de la DGPN et des douanes à un système centralisé pour que l’exploitation de l’information soit instantanée.
Je vous transmettrai dans les tout prochains jours les propositions que je formule destinées à accroître l’efficacité des opérations de contrôle des flux.
M. Guillaume Larrivé. Si le président et le rapporteur en sont d’accord, je pense qu’une note écrite de la direction générale de la gendarmerie nationale sur ces points juridiques serait effectivement utile.
M. Meyer Habib. Mon général, vous avez parlé de l’importance des 1 500 réservistes que vous employez tous les jours. J’ai la conviction qu’à moyen, court ou long terme, nous devrons responsabiliser tous les citoyens, c'est-à-dire que nous devrons revenir à une forme de service militaire. Je crains que nous ne soyons obligés de responsabiliser et de former, au moins à un niveau minimum, la population, comme cela se passe hélas dans certains pays qui vivent avec ce genre de menace.
Venons-en à la doctrine. Comme dans toutes les armées du monde, il existe une compétition saine entre les différents corps d’armée et de police, qui doit s’effacer dans les situations d’urgence absolue. Nous vivons aussi à une époque « d’ubérisation » : le client veut le taxi qui va arriver le plus tôt parce qu’il est le plus près ; il préfère une 4L qui vient le chercher dans la minute à une Rolls Royce qui est à une heure et demie de lui. L’objectif est d’avoir, dans toutes les grandes villes, des forces adaptées capables d’intervenir le plus rapidement possible. Le fait qu’un commissaire de la BAC ait réussi à tuer l’un des trois assaillants du Bataclan, changeant ainsi le cours des événements, montre bien l’importance d’aller au contact le plus vite possible. Que pensez-vous de l’idée d’avoir le maximum de fonctionnaires de police, voire de militaires, armés, répartis dans la population ?
Général d’armée Denis Favier. La réserve est un outil formidable qui permet de faire le lien avec la société. Durant l’été, au mois de juillet, nous formons des jeunes qui sont ensuite reconnus aptes au service dans la réserve, et qui font un travail de gendarme pendant une vingtaine de jours par an. Ce sont des jeunes de la société civile qui rendent un service. C’est responsabilisant pour eux et c’est bon pour notre société. Ce système fonctionne vraiment bien. Je préside chaque année une cérémonie de fin de formation et c’est très impressionnant : en un mois, ces lycéens changent ; ils ont une autre vision de la société et ils s’inscrivent vraiment dans une logique d’intérêt général. Je suis un fervent défenseur de la réserve. Pour la gendarmerie, la cible idéale serait de 40 000 réservistes opérationnels.
Après le 13 novembre, nous avons vu arriver dans les brigades, des personnes qui demandaient ce qu’ils pouvaient faire pour aider. Ils peuvent sécuriser des écoles en faisant traverser les enfants à la sortie des classes, intervenir dans les hôpitaux, etc. Les gens veulent apporter leur contribution à l’intérêt général. On peut étendre le concept, même si je ne suis pas convaincu qu’il faille aller vers le modèle de la garde nationale américaine. Il n’est pas question de cela. Mais nous avons quelque chose à bâtir sur le territoire national. En tout cas, dans mon domaine, je vais vraiment loin en ce qui concerne la réserve.
La doctrine doit en effet évoluer, et les travaux que nous avons engagés tendent à doper les capacités des primo-intervenants. Le port de l’armement « hors service » est autorisé au sein de la gendarmerie durant la période couverte par l’état d’urgence. Cette disposition est rigoureusement encadrée, elle permet aux militaires volontaires et évoluant dans des territoires sensibles d’en bénéficier.
M. le président Georges Fenech. Général, ne pensez-vous pas qu’il manque, à côté de la cellule interministérielle de crise (CIC), un état-major opérationnel qui institutionnaliserait le salon fumoir ?
Général d’armée Denis Favier. Cela fait partie des retours d’expérience auquel le ministre nous a demandé de réfléchir. Il pourrait y avoir une structure permanente. Au-delà de la permanence classique, qui fait remonter les informations de portée générale, nous devons avoir une structure plus opérationnelle, qui s’emboite plus harmonieusement avec les postes de commandement des directions générales.
M. le rapporteur. Au mois de janvier, vous étiez au fumoir puis sur les lieux, à Dammartin-en-Goële. Quand vous allez sur le terrain, ne faites-vous pas défaut au ministre ?
Général d’armée Denis Favier. Je suis allé à Dammartin-en-Goële au moment où la crise allait s’y terminer.
M. le rapporteur. Elle était à Dammartin-en-Goële et à l’Hypercacher ensuite, dans une zone qui, certes, ne relevait pas vraiment dans votre compétence territoriale. Nous devons redouter des crises multiples, se déroulant dans divers endroits comme le 13 novembre. Le patron de la gendarmerie, le préfet de police et tous les chefs doivent-ils être nécessairement sur le terrain ? Il nous a été dit qu’il valait mieux être sur le terrain pour passer les ordres et avoir les informations le plus rapidement possible. Ce qui se passe au fumoir, place Beauvau, est-il moins important ?
Général d’armée Denis Favier. En janvier, nous avons respecté les différentes phases. La phase fumoir était nécessaire pour bâtir l’opération à forte connotation judiciaire et gérer la crise dans sa globalité nationale. J’étais à ma place au fumoir pour diriger l’opération dans ma zone de compétence et faire des propositions d’engagement au ministre. Cette période a duré deux jours. La manœuvre de contrôle de zone autour de la station-service était pilotée depuis Paris, par des ordres allant dans le détail jusqu’à la répartition des zones d’engagement de la police et de la gendarmerie. Nous avons procédé ainsi durant toute la nuit du 8 au 9 janvier. Le matin du 9 janvier, nous avions le résultat de notre opération : les frères Kouachi ont tenté de sortir du dispositif. Ils ont été décelés et se sont réfugiés dans l’imprimerie et nous savions qu’ils ne pourraient plus en bouger. Il s’agissait de contribuer à la résolution de la crise qui allait s’achever là.
M. le rapporteur. Pardonnez-moi d’insister, mon général, mais nous sommes très préoccupés par le risque de multi-attentats qui peuvent se dérouler aussi dans votre zone de compétence. Que se passe-t-il si une deuxième crise survient alors que vous êtes allé sur le terrain pour résoudre la première ? Au fumoir, qui vous accompagne ?
Général d’armée Denis Favier. La direction active à chaque crise son centre des opérations qui a la capacité de piloter les opérations sur l’ensemble du territoire, de recueillir le renseignement en temps réel, de me renseigner en permanence et de relayer mes directives à l’ensemble des chefs territoriaux. La continuité du commandement est ainsi garantie, quel que soit l’endroit où je me trouve.
M. le rapporteur. J’imagine mais n’y a-t-il pas une perte d’information ?
Général d’armée Denis Favier. Très sincèrement, je ne le pense pas. Je suis allé à Dammartin-en-Goële, imprégné de l’esprit de l’opération à mettre en œuvre. La place de la gendarmerie a été tenue au « fumoir » : des collaborateurs, comme le colonel Dubuis, ici présent, ont suivi toute l’opération depuis le CIC et le « fumoir ». Nous ne perdons pas le fil. À un moment, il faut que le patron aille sur le terrain.
M. le rapporteur. La place d’un patron est vraiment au cœur de l’opération ?
Général d’armée Denis Favier. C’est ainsi que je conçois l’exercice du commandement, surtout au moment crucial.
M. Christophe Cavard. J’ai une dernière question concernant les PSIG qui peuvent devenir des primo-intervenants en zone gendarmerie, si j’ai bien compris.
Général d’armée Denis Favier. Cette capacité de primo-intervention sera détenue par les 150 PSIG « SABRE » dont le déploiement est programmé selon un plan triennal à raison de 50 unités par an. Les premiers seront opérationnels au cours de l’été 2016.
M. Christophe Cavard. D’aucuns ont « glorifié » la réaction spontanée d’un officier qui entre, qui tue, qui ressort, en prenant la décision tout seul. Mais dans ce cas-là, il n’y a plus de protocole, plus rien. Comment préparez-vous les personnels, qui pourraient être des primo-intervenants, au changement de protocole d’intervention ?
Général d’armée Denis Favier. Le changement de notre doctrine d’intervention nécessite bien évidemment un effort de pédagogie et de formation vis-à-vis de nos personnels, notamment vis-à-vis des militaires affectés au sein des PSIG « SABRE ». Ce travail est en cours. C’est la raison pour laquelle je mets moins de volontaires et plus de professionnels. Ces PSIG vont, à 98 %, faire le travail de surveillance générale normale. Un jour peut-être, ils vont être confrontés à une situation où ils devront agir en primo-intervenants. Cette réversibilité ne saurait s’improviser.
M. le président Georges Fenech. Nous avons terminé cette audition très riche. Il me reste à vous remercier d’avoir répondu à nos nombreuses questions.
Audition, à huis clos, du général Bruno Le Ray, gouverneur militaire de Paris,
et du colonel Marc Boileau, chef de cabinet
Compte rendu de l’audition, à huis clos, du lundi 21 mars 2016
M. le président Georges Fenech. Mon général, mon colonel, nous vous remercions d’avoir répondu à la demande d’audition de notre Commission d’enquête relative aux moyens mis en œuvre par l’État pour lutter contre le terrorisme depuis le 7 janvier 2015.
Vous savez que nous avons déjà tenu de nombreuses auditions consacrées tout d’abord aux victimes et à leur prise en charge par les secours, puis à la chronologie des événements de janvier et de novembre 2015 – à ce titre, nous avons d’ailleurs reçu des militaires de l’opération Sentinelle déployés dans le 11e arrondissement le soir du 13 novembre.
Mon général, en qualité de gouverneur militaire de Paris, vous êtes l’officier général de la zone de défense et de sécurité en Île-de-France (OGZDS) et commandez les unités déployées en Île-de-France dans le cadre de l’opération Sentinelle. Vous êtes également chargé de planifier les opérations en cas de troubles à l’ordre public, sur réquisition du préfet de police. Nous sommes donc désireux de vous entendre, tant sur l’action des forces armées sur les différents sites d’attentat et la coordination des forces de sécurité, que sur le dispositif Sentinelle en Île-de-France et ses éventuelles perspectives d’évolution.
En raison de la confidentialité des informations que vous êtes susceptible de nous délivrer, cette audition se déroule à huis clos, et n’est donc pas diffusée sur le site internet de l’Assemblée. Néanmoins, et conformément à l’article 6 de l’ordonnance 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, son compte rendu pourra être publié en tout ou partie, si nous en décidons ainsi à l’issue de nos travaux. Je précise que les comptes rendus des auditions qui auront eu lieu à huis clos seront au préalable transmis aux personnes entendues afin de recueillir leurs observations. Ces observations seront soumises à la commission, qui pourra décider d’en faire état dans son rapport.
Je rappelle que, conformément aux dispositions du même article, « sera punie des peines prévues à l’article 226-13 du code pénal (un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende) toute personne qui, dans un délai de vingt-cinq ans divulguera ou publiera une information relative aux travaux non publics d’une commission d’enquête, sauf si le rapport publié à la fin des travaux de la commission a fait état de cette information ».
Conformément aux dispositions de l’article 6 précité, je vais maintenant vous demander de prêter le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité.
Le général Bruno Le Ray et le colonel Marc Boileau prêtent serment.
Je vais vous laisser la parole pour un exposé liminaire qui sera suivi par un échange de questions et réponses.
Général Bruno Le Ray. Monsieur le président, madame, messieurs, je suis très heureux de m’exprimer devant vous aujourd’hui en tant que gouverneur militaire de Paris. En poste depuis l’été 2015, j’exerce le contrôle opérationnel de l’ensemble des forces placées sous le commandement du chef d’état-major des armées. Au cours de ce propos liminaire, je vais vous rappeler les conditions d’engagement de nos forces, en particulier telles qu’elles ont été appliquées les 13 et 14 novembre derniers.
Les attentats de janvier avaient déjà créé un contexte exceptionnel, notamment sur le plan militaire, avec le déploiement d’un nombre important de militaires sur le territoire national, en particulier en Île-de-France. Les attentats de novembre ont eu pour effet de nous faire franchir un palier supplémentaire : à deux reprises, des unités de la force Sentinelle se sont en effet retrouvées au plus près de la zone de combat – une expression inhabituelle pour un événement survenu à l’intérieur de nos frontières, mais correspondant à la réalité des faits –, en situation d’appui direct des forces de sécurité intérieure.
Vendredi 13 novembre, avant que ne surviennent les attentats, près de 4 000 militaires étaient déployés sur l’Île-de-France, répartis en 49 unités élémentaires – ce chiffre a son importance pour ce qui est de certains aspects relatifs au commandement – engagées dans des missions de protection de 325 sites sensibles : 20 sites dits « Vigipirate historique » – principalement les lieux touristiques et les gares – et 305 sites confessionnels – presque exclusivement des lieux de culte israélites.
Notre dispositif en Île-de-France avait été réorganisé courant 2015, passant de quinze à huit états-majors tactiques ; à la mi-octobre, une deuxième évolution nous avait fait passer à trois états-majors tactiques. Toute l’Île-de-France était donc – comme elle l’est encore à ce jour – répartie en trois zones : Paris intra muros, avec un PC établi à Vincennes, Paris Est, avec un PC au fort de l’Est, et Paris Ouest, avec un PC à Satory. Ces trois groupements sont sous les ordres de chefs de corps en titre, commandant des régiments en s’appuyant sur un état-major de régiment – étant précisé que, depuis l’année dernière, nous faisons en sorte que le déploiement des unités corresponde au découpage territorial, afin de faciliter les mesures de coordination avec les échelons administratifs locaux, les arrondissements, les districts et les départements.
Le 13 novembre en fin de soirée, nous disposions encore d’environ 1 000 militaires déployés sur le terrain, puisque la garde ne prend fin qu’entre vingt et une heures trente et vingt-deux heures trente, selon l’activité des sites concernés. En l’absence d’informations précises nous permettant de disposer d’une vision exhaustive de ce qui se passait au cours des premières heures de la soirée, l’idée maîtresse des décisions que j’ai prises a consisté à m’assurer que tous les moyens militaires se trouvant au contact, c’est-à-dire engagés sur l’un ou l’autre des événements, se trouvaient en capacité effective de coordonner leur action avec celle des forces de sécurité intérieure, et que les renforts pouvant se révéler nécessaires étaient disponibles au bon moment et au bon endroit. À cet effet, une réflexion a été menée en deux temps, d’abord avec les personnels se trouvant au contact, puis avec ceux susceptibles d’être appelés en renfort.
Il se trouve que le soir du 13 novembre, je me trouvais au Stade de France, assis une rangée derrière le Président de la République. J’ai entendu les deux premières explosions ayant retenti à proximité du stade et assez rapidement, juste avant vingt et une heures trente, j’ai été informé par mon état-major stationné à Saint-Germain-en-Laye – depuis les attentats de janvier 2015, il fonctionne 24 heures sur 24, 365 jours par an, afin de coordonner l’ensemble des soldats déployés à Paris…
M. Sébastien Pietrasanta, rapporteur. Par qui votre état-major avait-il lui-même été informé ?
Général Bruno Le Ray. Il est alimenté par deux canaux : d’une part, celui des forces elles-mêmes – ainsi le 54e régiment d’artillerie, basé au PC de Vincennes, recueillait-il les renseignements transmis par les soldats sur le terrain –, d’autre part, celui constitué par les officiers de liaison répartis dans les différents centres opérationnels (CO) de la préfecture de police. Par ailleurs, mon état-major est également en contact avec le secrétariat général de la zone de défense (SGZD), qui est son interlocuteur naturel en temps ordinaire. Il se trouve qu’à l’heure des faits, le SGZD n’était pas totalement opérationnel, ce qui fait que les renseignements sont arrivés par tous les canaux. C’est ainsi que j’ai été personnellement informé peu avant vingt et une heures trente que plusieurs attentats avaient été commis dans Paris.
J’ai quitté le Stade de France à la mi-temps – le Président de la République avait lui-même quitté la tribune officielle quelque temps auparavant pour gagner le poste de sécurité du stade – afin de rejoindre mon lieu de travail situé aux Invalides, à partir duquel j’ai continué à assurer le suivi de l’opération et son commandement tout au long de la nuit. Dès le départ, j’ai donné des ordres afin de mettre en alerte, au sein de chacun des trois groupements, l’élément de réaction rapide prévu pour faire face à ce type de situation – il s’agit d’une compagnie dans chaque groupement. J’ai demandé que soient sécurisés tous les sites sur lesquels des militaires étaient encore déployés, et j’ai fait rappeler tous les militaires qui se trouvaient en repos – certains, qui se trouvaient au Stade France, ont ainsi dû regagner leur unité à Vincennes en petites foulées.
Dès que j’ai obtenu de mon CO – qui tenait lui-même le renseignement de la préfecture de police – la confirmation du fait que nous étions confrontés à une attaque coordonnée multisite, j’ai fait renforcer la sécurité de tous les sites sur lesquels des militaires se trouvaient déployés, et j’ai engagé un élément de réserve du groupement Paris centre, afin de renforcer l’unité déjà au contact rue de Charonne et au Bataclan. La compagnie de réserve du groupement de Vincennes est partie renforcer les unités du 11e arrondissement, tandis que je dirigeais les deux autres – celle du groupement Est celle du groupement Ouest – vers Bastille, où se trouvaient regroupées des forces de sécurité, afin qu’elles puissent intervenir rapidement en cas de nécessité. Dans le même temps, j’ai fait placer l’ensemble du dispositif sous les ordres du chef de corps du groupement, qui est parti sur le terrain avec un PC tactique afin de coordonner l’action des militaires et pallier toute difficulté de liaison avec les FSI : de cette manière, il pouvait en effet « commander directement à la voix ».
La présence militaire, sous la forme de l’arrivée de soldats lourdement protégés et armés, a rapidement eu pour effet de rassurer la population, les pompiers et les policiers. Appuyant les forces de sécurité intérieure suivant les consignes qui leur étaient données sur place, nos hommes ont bouclé des secteurs, ils ont couvert certaines directions et en ont interdit d’autres – afin d’éviter la fuite ou l’arrivée de terroristes. J’ai fait sécuriser l’aéroport du Bourget, tenant compte de la présence sur ce site d’éléments détachés dans le cadre de la préparation de la COP21 et non armés. Enfin, sur réquisition de la préfecture de police, nous avons pris en charge le remplacement des forces de sécurité intérieure qui assuraient la protection de Matignon, de l’Assemblée nationale, du Sénat et de l’hôpital Necker ; pour ce qui est de ce dernier site, nous avions reçu des informations provenant du secrétariat général de la zone de défense, selon lesquelles ce lieu accueillant des blessés risquait de faire l’objet d’une attaque.
Dans le même temps, pour préparer le futur, c’est-à-dire pour anticiper l’arrivée probable de renforts dans les heures et les jours suivants, j’ai fait mettre en alerte la zone de transit de Brétigny, qui est l’endroit par lequel arrivent et repartent toutes les unités militaires de Paris : elles y perçoivent leurs équipements – bombes lacrymogènes, matraques télescopiques, gilets pare-balles et casques lourds – avant de partir sur site, et les y restituent au retour de mission. Au total, nous disposions au milieu de la nuit d’environ 500 militaires engagés sur ou à proximité des lieux d’attentat du 11e arrondissement – j’englobe les unités se trouvant en renfort éventuel à Bastille – et de 500 militaires engagés sur la sécurisation des quatre sites que j’ai évoqués précédemment.
Dès le lendemain matin à six heures trente, nous avons repris la mission Sentinelle habituelle, consistant à sécuriser les 325 sites que j’ai mentionnés – j’avais doublé l’effectif sur tous les sites « Vigipirate historique », en particulier les gares. Le soir du 14 novembre, nous avons accueilli les premiers renforts sous la forme de deux compagnies Guépard TAP du 3e régiment de parachutistes d’infanterie de marine (RPIMa). Au total, dans les quarante-huit heures ayant suivi les attentats, nous avons reçu le renfort de 2 500 soldats. Durant toute la durée des opérations, je suis resté en contact avec le cabinet du ministère de la défense et le chef d’état-major des armées.
M. le président Georges Fenech. Vous nous avez expliqué que le rôle des forces militaires avait d’abord consisté à rassurer la population, les pompiers et la police, par la présence de personnels en armes, ainsi qu’à appuyer les forces de sécurité intérieure en bouclant les secteurs et en organisant la circulation. Le soir du 13 novembre, les premières forces à intervenir ont été celles des BAC . Alors que les forces militaires étaient également présentes, elles ne disposaient pas du cadre juridique qui leur aurait permis d’intervenir – je veux dire, de participer à un assaut contre les terroristes.
Alors que l’on se trouvait dans une situation de guerre, avec des assaillants munis d’armes lourdes, les militaires se tenaient donc en arrière, se contentant de sécuriser le quartier, tandis que les forces de police – qui, elles, n’étaient équipées que d’armes légères – étaient au plus près de l’action et tentaient même de neutraliser l’un des terroristes à l’angle du boulevard Voltaire et du passage Saint-Pierre-Amelot. À un moment donné, les fonctionnaires de police ont demandé aux personnels de l’opération Sentinelle s’ils pouvaient leur prêter leurs armes, mais se sont heurtés à un refus.
Si vous aviez été les premiers à intervenir au Bataclan, aurait-il été concevable qu’en entendant les coups de feu tirés à l’intérieur, vous décidiez de pénétrer dans le bâtiment dans le but de neutraliser les terroristes ?
M. le rapporteur. Par ailleurs, y a-t-il eu une évolution dans votre doctrine d’intervention, faisant que vous interviendriez si une situation semblable se présentait demain ?
Général Bruno Le Ray. Si je vous ai laissé penser que la mission première des personnels de l’opération Sentinelle était de rassurer, je me suis mal exprimé. En réalité, la mission première des militaires est d’appuyer, de soutenir les forces de sécurité intérieure. J’ai été informé, dans le courant de la soirée, que les militaires avaient retiré les dispositifs de sécurité de leurs armes – les TOC –, afin de rendre celles-ci immédiatement opérationnelles : en clair, les militaires qui se trouvaient aux côtés de la police et des pompiers auraient été en mesure d’ouvrir le feu immédiatement si des terroristes étaient sortis du Bataclan.
M. le rapporteur. En réplique ?
Général Bruno Le Ray. En réplique, effectivement : comme toutes les forces de sécurité, nous appliquons les règles de la légitime défense.
M. le président Georges Fenech. Mais vous n’auriez pas cherché à entrer dans le bâtiment pour aller abattre les terroristes ?
Général Bruno Le Ray. Les seuls moments où des coups de feu ont été échangés, c’est lorsqu’un terroriste a entrouvert une issue de secours pour lâcher des rafales à l’aveuglette – des impacts ont été relevés sur certains véhicules, notamment ceux des pompiers –, ce qui ne permettait pas à nos hommes de riposter efficacement. Si les terroristes étaient vraiment sortis du bâtiment en ouvrant le feu dans la rue, les militaires auraient tiré à leur tour dans le cadre de la légitime défense, sans que j’aie besoin de les y autoriser.
M. le président Georges Fenech. Vous n’avez pas répondu à ma question.
Général Bruno Le Ray. J’y réponds en vous disant qu’à l’instar des forces de sécurité intérieure, nous aurions ouvert le feu si les conditions de la légitime défense avaient été réunies, comme des soldats l’ont fait à Valence en janvier dernier. Les militaires ne sont pas inhibés dans l’usage de leur arme : ils connaissent parfaitement les règles de la légitime défense et les appliquent de manière rigoureuse.
Pour ce qui est d’entrer dans le Bataclan, nous avons agi conformément à notre mode d’action habituel – applicable en opération extérieure comme sur le territoire national –, qui veut que l’on n’entre pas dans une bouteille d’encre, c’est-à-dire sans savoir où l’on va, ce que l’on va faire et contre qui ! En mon âme et conscience, je n’aurais donc pas donné l’ordre à mes soldats de pénétrer dans le bâtiment sans un plan d’action prédéfini. Je peux concevoir que l’on intervienne en appui des forces de sécurité intérieure, qui décident de donner l’assaut parce qu’elles connaissent les lieux et savent ce qu’elles vont y trouver, mais pas que l’on se lance dans l’inconnu.
M. le président Georges Fenech. Vous entendiez tout de même des tirs en provenance de l’intérieur !
Général Bruno Le Ray. Certes, mais des bruits de tirs ne fournissent que fort peu d’informations sur ce qui se passe à l’intérieur.
M. le rapporteur. Vous saviez cependant que l’attaque des terroristes avait fait des morts et des blessés, puisque certains se trouvaient à l’extérieur. Un commissaire de la BAC et l’un de ses collègues policiers ont pris l’initiative d’entrer dans le bâtiment, alors qu’ils ne savaient pas plus que vos hommes ce qui s’y passait ; armés et protégés beaucoup moins efficacement que les militaires, ils sont parvenus à tuer l’un des terroristes avant de ressortir. Étant précisé que cette question ne constitue en rien un jugement de valeur – nous cherchons simplement à comprendre –, comment se fait-il que vous n’ayez pas pris la décision d’en faire autant, ni donné l’autorisation de le faire ?
Général Bruno Le Ray. Aucune demande d’entrer dans le Bataclan ne m’a été adressée, et je n’ai donné aucune autorisation en ce sens. Je ne connais pas les circonstances exactes de l’intervention du policier de la BAC et, si j’admire son courage, je vous répète qu’il était exclu que je fasse intervenir mes soldats sans savoir ce qui se passait à l’intérieur du bâtiment.
M. le président Georges Fenech. Il y avait des morts sur le trottoir !
Général Bruno Le Ray. Comme il y en a sur tous les théâtres d’opérations. Il est impensable de mettre des soldats en danger dans l’espoir hypothétique de sauver d’autres personnes. L’intervention en zone d’exclusion est un sujet très délicat. Pour moi, la première question à se poser consiste à savoir si l’on est en mesure d’assurer la protection des personnels allant au contact. Si les soldats que j’envoie dans le bâtiment se font eux-mêmes tuer, parce qu’ils ne sont pas en capacité de répondre aux tirs dont ils sont la cible, nous n’aurons guère progressé dans la résolution de la situation.
M. le président Georges Fenech. N’est-ce pas la vocation des soldats que de protéger les populations civiles ?
Général Bruno Le Ray. Si, bien sûr, et c’est ce qu’ils font. En revanche, ils n’ont pas vocation à se jeter dans la gueule du loup s’ils ne sont pas assurés de disposer de chances raisonnables d’accomplir leur mission.
M. le rapporteur. Si le commissaire entré dans le Bataclan avait demandé à des militaires de fournir un appui à son intervention, ceux-ci vous auraient-ils demandé l’autorisation de le faire, auraient-ils pu prendre d’eux-mêmes l’initiative d’entrer dans le bâtiment avec la police, ou cela leur aurait-il été purement et simplement interdit ?
Par ailleurs, quel lien aviez-vous avec le préfet de police au cours des différentes phases de l’opération ?
Général Bruno Le Ray. Les soldats ont des conduites à tenir en fonction des situations auxquelles ils sont confrontés, mais nous ne pouvons prévoir tous les cas de figure…
M. le rapporteur. Depuis les faits, avez-vous intégré la situation du 13 novembre à vos scénarios d’intervention ?
Général Bruno Le Ray. Comme la Police nationale, les forces armées terrestres travaillent à l’élaboration de conduites à tenir dans différentes situations, notamment celle d’un terroriste sortant du Bataclan qui, sans menacer les soldats, cherche à s’enfuir – dans l’intention éventuelle d’aller commettre d’autres actes de violence ailleurs. Si le policier de la BAC avait souhaité faire une seconde incursion dans le bâtiment en se faisant cette fois accompagner de soldats, je ne peux dire avec certitude quelle réponse il aurait reçu, mais j’ai tendance à penser qu’ils seraient entrés avec lui.
M. le président Georges Fenech. Ce qui est sûr, c’est qu’ils ont refusé de donner leurs armes !
M. le rapporteur. Plus exactement, quand la BAC leur a demandé s’ils accepteraient de prêter leurs armes à la police dans l’éventualité d’une nouvelle intervention, ils ont répondu que non.
Général Bruno Le Ray. Cela n’a rien d’étonnant : les militaires ne confient jamais leurs armes à quelqu’un d’autre.
En revanche, un policier de la BAC a demandé aux soldats de couvrir la sortie du bâtiment et de faire feu si les terroristes se montraient – il leur a même précisé de viser de préférence la tête, ou en tout état de cause en dehors des zones du corps susceptibles d’être entourées d’une ceinture d’explosifs –, et mes hommes l’auraient fait si la situation s’était présentée.
La question de l’entrée dans le bâtiment s’apparente à celle d’une prise d’otages de masse : en pareil cas, on fait systématiquement appel à des unités spécialisées, qui n’interviennent qu’à l’issue d’un minimum de préparation. Je me mets à la place d’un soldat entrant dans une pièce où il risque de tomber à la fois sur les terroristes et leurs victimes, dans une configuration inconnue, avec une luminosité peut-être insuffisante et des gens qui hurlent de tous côtés : comment faire, dans ces conditions, pour discriminer instantanément les agresseurs des victimes ? Ma propre expérience opérationnelle me porte à penser qu’une telle chose est quasiment impossible.
M. le président Georges Fenech. Je ne pense pas que les termes d’« agresseurs » et de « victimes », qui évoquent une situation de criminalité ordinaire, soient adéquats : en réalité, nous avions affaire à des terroristes kamikazes en train de perpétrer un massacre.
Imaginons que des soldats de Sentinelle se trouvent aux abords de Saint-Lazare, et que des terroristes ouvrent le feu à l’intérieur de la gare avec des Kalachnikov. Quelle serait la réaction de vos soldats ?
Général Bruno Le Ray. Ils ouvriraient le feu à leur tour, sans l’ombre d’un doute.
M. le président Georges Fenech. Dans ce cas, pourquoi n’en ont-ils pas fait de même au Bataclan ?
Général Bruno Le Ray. La situation n’était pas la même. Au Bataclan, les terroristes étaient retranchés dans un lieu fermé, tandis qu’une gare est un lieu ouvert.
M. le président Georges Fenech. Selon vous, donner l’assaut à un bâtiment fermé suppose l’intervention d’unités spécialisées, dont Sentinelle ne fait pas partie ?
Général Bruno Le Ray. Les soldats de Sentinelle sont formés pour intervenir dans le cadre d’opérations extérieures, mais pas dans celui d’une prise d’otages de masse dans un lieu fermé.
M. le président Georges Fenech. Une réflexion a-t-elle été engagée sur ce point ?
Général Bruno Le Ray. Nos forces spéciales travaillent sur cette question, car elles sont amenées à intervenir, à Bamako ou ailleurs, sur des situations très semblables. Sur le territoire national, nos soldats « de base », qui représentent 99 % des effectifs, ne sont pas formés à ce type d’opérations. Mais je vous confirme que si une attaque devait survenir à la gare Saint-Lazare, les soldats de Sentinelle n’hésiteraient pas une seconde à ouvrir le feu – comme ils l’ont fait dernièrement à Valence.
M. le président Georges Fenech. Je n’ai malheureusement pas pu écouter l’intervention faite par le ministre de la défense devant l’Assemblée nationale, puisque les travaux de la Commission d’enquête étaient en cours au même moment, mais nous l’auditionnerons prochainement. Il serait bon de savoir si une réflexion va être menée en vue de mieux associer la force militaire aux forces de sécurité intérieure quand surviennent des situations similaires à celles que nous évoquons.
Général Bruno Le Ray. Des réflexions sont en cours, mais je pense que le policier et le militaire de base ne sont pas préparés à faire face à de telles situations : cela relève de compétences et d’une formation bien particulières. Le policier de la BAC qui est entré dans le Bataclan s’est placé peut-être au-delà de ce qu’il était raisonnablement censé faire, et mes soldats ne sont pas formés pour aller déloger des terroristes retranchés dans une salle de spectacle.
M. Olivier Falorni. Si je comprends bien, les militaires de Sentinelle ne peuvent pas intervenir dans un lieu clos où se produit un massacre. Je rappelle qu’au Bataclan, après l’intervention isolée de deux policiers de la BAC, une quinzaine de fonctionnaires de police sont entrés une deuxième fois dans le bâtiment, de façon organisée : il ne s’agit dont pas d’une initiative individuelle et incontrôlée, comme vous le laissez entendre.
Pour ce qui est d’une intervention des militaires, vous dites qu’elle ne ferait aucun doute dans une gare, mais qu’il en est tout autrement dans le cadre d’une attaque comme celle du Bataclan. Imaginons que la police n’ait pas été en mesure d’arriver aussi vite qu’elle l’a fait, et que vos hommes se soient trouvés seuls boulevard Voltaire : dans ce cas, ils seraient restés à l’extérieur sans intervenir, alors même qu’ils auraient entendu des tirs et des cris à l’intérieur ? Alors qu’ils sont habitués au combat, ils se seraient refusés à entrer au seul motif qu’ils ne savaient pas ce qu’ils allaient trouver derrière la porte ? Ne prenez pas cela pour une mise en accusation, mais je vous avoue que cette idée me sidère.
Général Bruno Le Ray. Loin de moi l’idée de dénigrer en quelque façon que ce soit l’intervention des forces de sécurité intérieure, avec lesquelles nous travaillons au quotidien : je vous ai simplement dit ce que m’inspirait, à la lumière de ce que j’ai pu en lire, les conditions de leur intervention.
Dans un espace ouvert, on voit ce qui se passe et on n’a aucune difficulté à faire la différence entre les terroristes et les victimes potentielles. En revanche, les soldats de Sentinelle ne sont pas formés à intervenir dans un contexte proche d’une prise d’otages en milieu fermé. Il existe, parmi les unités militaires, des forces spéciales compétentes pour intervenir en pareil cas. C’est la même chose au sein de la police et, de ce point de vue, les unités de la BAC sont déjà des unités particulières.
Au demeurant, je ne dis pas que nous serions absolument incapables d’intervenir, mais simplement que ce n’est pas une mission à laquelle nos hommes sont préparés. Les services du chef d’état-major de l’armée de terre réfléchissent aux moyens de faire mieux dans l’hypothèse où surviendrait à nouveau une telle situation sur le territoire national, étant précisé qu’en pareil cas, nous ne serions pas en état de guerre au sens juridique – c’est le droit commun, et non le droit militaire, qui aurait vocation à s’appliquer. À certains égards, intervenir au cœur de Paris est bien plus compliqué que de livrer combat au fin fond du Mali ou de la Côte d’Ivoire, car on ne dispose évidemment pas de la même liberté d’action, et il est bon d’en avoir conscience.
M. le président Georges Fenech. Depuis janvier 2015, des exercices militaires ont-ils été effectués en coopération avec les forces de sécurité intérieure ?
Général Bruno Le Ray. Je suis simplement utilisateur des forces de l’armée de terre, la préparation opérationnelle des unités ne se faisant pas à mon niveau. Si des exercices sont effectivement menés, je ne pense pas qu’ils aient pour objet de nous préparer à intervenir dans le cadre d’une situation de type Bataclan – en tout cas, pas avec les soldats de l’opération Sentinelle. Le recours aux forces spéciales en pareil cas a été récemment évoqué, mais cela ne pourrait se faire que dans des conditions d’encadrement très strictes, en complément des forces de sécurité intérieure et des unités particulières.
Mme Françoise Dumas. Pour ma part, je souhaite évoquer la situation de la province, étant précisé que je suis élue d’un territoire présentant un haut risque, dans la mesure où l’on y trouve un grand nombre de mosquées, de synagogues et d’églises. Vous avez évoqué tout à l’heure le déploiement de vos personnels sur les lieux confessionnels. Dans la mesure où vos hommes ne fouillent pas les personnes qui pénètrent dans les lieux de culte, quelle serait votre réaction si une attaque survenait à l’intérieur d’un tel lieu, qui est par définition un lieu clos ?
Général Bruno Le Ray. Il n’existe pas de réponse simple à une telle question. Ce que je peux vous dire, c’est que des soldats montant la garde devant un site y entreraient s’ils voyaient des terroristes s’apprêter à y commettre des violences.
Au Bataclan, les militaires n’ont pas vu entrer les terroristes, et ne savaient donc pas ce qui se passait à l’intérieur. À l’inverse, ils connaissent très bien les synagogues qu’ils ont pour mission de surveiller – il leur arrive même de se reposer à l’intérieur – ainsi que les personnes censées s’y trouver, qu’ils voient entrer et sortir. J’imagine donc qu’en pareil cas, ils interviendraient systématiquement s’ils se trouvaient en situation de le faire.
M. le président Georges Fenech. Vous « imaginez » qu’ils interviendraient ? Vous n’en êtes pas sûr, alors même que vous entendriez des tirs de kalachnikovs en provenance d’une synagogue bondée ?
Général Bruno Le Ray. Peut-être me suis-je mal exprimé, monsieur le député. Ce que je veux dire, c’est que des soldats en faction devant l’unique entrée d’une synagogue ne pourraient manquer de remarquer l’arrivée de terroristes.
M. le président Georges Fenech. On ne peut exclure que les terroristes s’introduisent dans les lieux en empruntant un passage souterrain, comme cela se fait dans la bande de Gaza !
Général Bruno Le Ray. Il n’y a pas de réponse toute faite à cette question, mais je pense qu’ils interviendraient…
M. le président Georges Fenech. Vous « pensez » ? Comment peut-on seulement imaginer que des militaires armés restent au seuil d’une synagogue où des victimes innocentes se font massacrer ! Ce n’est pas possible !
Général Bruno Le Ray. Je ne me place pas sur le plan des principes…
M. le président Georges Fenech. Le simple risque de se voir reprocher une non-assistance à personne en danger devrait leur commander d’intervenir !
Général Bruno Le Ray. Vous mettez en parallèle deux situations radicalement différentes : d’une part, celle du Bataclan, où aucun soldat ne savait ce qui se passait à l’intérieur, ni même combien de terroristes et combien de victimes potentielles s’y trouvaient, d’autre part, celle d’une synagogue, qui n’est jamais bondée, contrairement à ce que vous dites, et que les soldats de Sentinelle connaissent bien – c’est pourquoi il y a 99,9 % de chances pour qu’ils y soient entrés en cas d’attaque, car cela correspond à leurs compétences en termes de lieu, de nombre de personnes sur place, et de capacité à gérer la situation de chaos régnant à l’intérieur.
Mme Françoise Dumas. L’attaque d’une synagogue ne constitue sans doute pas le meilleur exemple, car ce lieu de culte est généralement très contrôlé à l’entrée…
M. le président Georges Fenech. Alors, que se passerait-il en cas d’attaque d’une école ?
Général Bruno Le Ray. Nous sommes devant les écoles à longueur de journée, et filtrons très soigneusement leurs accès. Certes, on ne peut exclure que quelqu’un passe par les toits ou par des souterrains, et dans ce cas nous interviendrions, car nous connaissons très bien tous ces lieux que nous protégeons depuis plus d’un an, qu’il s’agisse des écoles, des synagogues, de l’espace Rachi – le Centre d’art et de culture juive du 5e arrondissement – ou de la Grande mosquée de Paris.
Mme Françoise Dumas. Mais que se passerait-il dans une cathédrale ou une église où serait célébré un mariage, c’est-à-dire un lieu où les allées et venues ne font pas l’objet du même contrôle ?
Général Bruno Le Ray. J’ai été réquisitionné pour protéger certains lieux de culte catholique durant la période des fêtes de Pâques. Je précise que les accès de ces lieux sont généralement filtrés par les fidèles eux-mêmes – c’est en tout cas la consigne donnée par le préfet de police à la communauté religieuse. À cette protection de base viendra s’ajouter la sécurisation effectuée par mes hommes à l’extérieur des sites concernés.
M. le président Georges Fenech. Ne pourrait-on imaginer une coordination des forces de sécurité intérieure et des militaires, comme c’est déjà le cas dans certaines situations particulières – je pense en particulier à l’opération Harpie mise en place en Guyane, dans le cadre de laquelle la gendarmerie travaille en collaboration avec les militaires ? Un centre opérationnel pourrait être mis en place, qui coordonnerait l’action des forces de sécurité intérieure et des militaires.
Général Bruno Le Ray. Je connais bien l’opération Harpie, qui ne consiste pas à faire travailler ensemble les policiers et les militaires, mais à intégrer les gendarmes à une chaîne de commandement militaire. À l’échelle de Paris, des dizaines de milliers de policiers sont déployés dans le cadre d’une forte activité de sécurité générale. Il me paraît difficilement concevable de mettre en place un centre de coordination permanent, qui n’aurait vocation à coordonner l’action des policiers et des militaires que dans les cas très exceptionnels où l’on sort du cadre de l’activité de sécurité générale pour entrer dans celui de la gestion d’une situation de crise.
M. le président Georges Fenech. Nous sommes en état d’urgence : n’est-ce pas une situation exceptionnelle qui justifierait la mise en place d’une coordination des interventions en période de crise ?
Général Bruno Le Ray. L’une de nos pistes de réflexion consiste à trouver les moyens d’être en mesure de basculer très rapidement d’un mode de fonctionnement normal à celui d’une période de crise, nécessitant la mise en place d’un système de coordination.
Aujourd’hui, des officiers de liaisons sont présents au sein des différents centres opérationnels de la préfecture de police, et nous avons décidé qu’en cas de crise, un officier de liaison serait envoyé dans le CO de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris (BSPP) – le général Boutinaud, qui commande cette brigade, a dû vous en parler –, ce CO étant particulièrement bien informé de la nature et de la localisation des incidents qui surviennent, et ayant la capacité particulière à discriminer rapidement les vraies alertes des fausses.
Si j’ai très souvent le préfet de police au téléphone, cela n’a pas été le cas dans la nuit du 13 au 14 novembre, car il était injoignable du fait de la situation. En revanche, tous ses services étaient en relation permanente avec les miens, et nous avons répondu à toutes les sollicitations qui nous ont été adressées. Quand on nous a demandé de remplacer les forces de sécurité intérieures présentes à Matignon, à l’Assemblée nationale, au Sénat et à l’hôpital Necker, cela s’est fait sur réquisition de la préfecture de police.
M. le rapporteur. Quel jugement portez-vous sur l’efficacité de l’opération Sentinelle ? Si la protection de 325 sites sensibles constitue une mission importante, un débat s’est ouvert sur l’efficacité des gardes statiques qui sont actuellement effectuées, par rapport à ce que pourrait être celle de gardes dynamiques. Votre doctrine a-t-elle évolué sur ce point au cours des derniers mois ?
Général Bruno Le Ray. La doctrine a effectivement beaucoup évolué. Si nous assurions la protection de 325 sites début novembre 2015, nous en protégeons désormais un peu plus de 1 800 sur l’ensemble de l’Île-de-France, selon différentes modalités. Ainsi, un grand nombre de sites sont désormais sécurisés par des patrouilles, ce qui nous permet de pallier le fait que le dispositif statique consomme une partie importante des forces armées : une patrouille couvre en effet plusieurs sites, contrairement à une garde statique – que certaines personnes continuent de préférer, car elles attachent de l’importance au fait qu’un site soit protégé en permanence, et à ce que cela se voie. Comme les forces de sécurité intérieure, nous tendons toujours plus vers des dispositifs dynamiques, qui présentent également l’avantage d’être plus aléatoires, donc moins prédictibles pour nos adversaires potentiels.
M. le rapporteur. Élu francilien – je suis maire d’Asnières-sur-Seine –, je discutais dernièrement avec le commissaire de ma circonscription au sujet de la garde dynamique qui y a été mise en place et couvre à la fois les lycées, la gare et certaines stations de métro. Pouvez-vous nous préciser si vous êtes en contact avec les commissaires afin de coordonner vos actions de protection avec celles de la police, et si le choix des lieux et des heures où vous intervenez relève de votre initiative, ou est défini en accord avec le préfet de police ?
Général Bruno Le Ray. Cette question est très intéressante. La moitié des 1 800 sites dont nous assurons actuellement la protection figure dans les réquisitions que m’adresse le préfet de police, tandis que l’autre moitié est définie par contact direct avec les préfets et les commissaires de district ou d’arrondissement, ainsi que les directions départementales de la sécurité publique (DDSP). Cela donne lieu à une coordination très étroite : ainsi, chaque capitaine a en charge un arrondissement parisien et se coordonne avec le commissaire territorialement compétent pour effectuer la répartition des effectifs en fonction des sites et des horaires, afin d’optimiser l’emploi des forces de sécurité intérieure et des forces armées. De la même manière, les chefs de corps, les commandants d’unité et les chefs de section se coordonnent chacun à leur niveau avec leurs interlocuteurs des forces de sécurité locales, afin d’éviter que certains sites soient doublement protégés ou ne le soient pas du tout.
Un officier de liaison assure la coordination avec la direction de la police territorialement compétente – il peut s’agit d’une DDSP ou d’une direction territoriale de la sécurité de proximité (DTSP), cela dépend du lieu concerné. Hormis les sites pour lesquels le préfet de police effectue des réquisitions, le préfet lui-même peut demander aux chefs de corps d’assurer la protection d’un site lui paraissant exposé à une menace particulière.
M. le rapporteur. Considérez-vous devoir protéger un trop grand nombre de sites ?
Général Bruno Le Ray. Non, je considère que nous faisons beaucoup mieux que ce que nous faisions précédemment, et que nous pouvons faire encore mieux si on nous laisse libres de définir les modes d’action que nous estimons être les plus adaptés à notre mission. Notre référence est l’instruction ministérielle n° 10100, qui fixe les relations « contractuelles » entre le donneur d’ordre, à savoir le préfet, et les forces armées. Ce texte pose le principe selon lequel une mission est confiée aux forces armées, qui déterminent elles-mêmes les modes d’action et les volumes d’effectifs nécessaires pour la remplir. C’est en faisant application de ce principe que nous serons à même d’assurer la sécurité sur le plus grand nombre possible de sites.
M. Christophe Cavard. Ayant fait partie de l’un des derniers contingents d’appelés, je suis en mesure de distinguer les différents uniformes des personnels de l’opération Sentinelle, et j’ai donc conscience de la très grande variété des régiments intervenant dans le cadre de cette opération. La question d’une sur-sollicitation de certaines unités a été évoquée, ainsi que celle de la fatigue des personnels. Pouvez-vous nous préciser selon quels critères on décide de faire intervenir tel ou tel régiment, et pour quelle durée ?
Par ailleurs, au cours d’une audition, des militaires nous ont indiqué être logés dans les combles de la mairie du 11e arrondissement dans des conditions « assez spartiates » – ce qui était sans doute un euphémisme. Pour que des personnels soient en mesure d’intervenir rapidement et efficacement en situation de crise, il faut qu’ils soient en situation physique et morale de le faire – et de manière durable, car il est à craindre que la situation actuelle ne se prolonge. Considérez-vous que les conditions de vie, notamment d’hébergement, de vos hommes, soient satisfaisantes ?
M. David Comet. Mon général, je vous remercie pour l’action de l’armée durant la période difficile que nous vivons actuellement.
On assiste actuellement à une interpénétration grandissante entre la sécurité intérieure et la sécurité extérieure. Nous sommes en état de guerre, même s’il s’agit d’une guerre diffuse, et ce sont les mêmes soldats qui interviennent en opérations extérieures ou sur le territoire national : ils ont les mêmes compétences. Le mois dernier, j’ai rencontré les forces françaises en Côte d’Ivoire – en l’occurrence, les Marsouins du 1er régiment d’infanterie de marine (RIMa) d’Angoulême – et je sais que ces soldats, qui luttent contre le terrorisme en Afrique, peuvent être amenés à le faire également à Paris dans le cadre de Sentinelle.
Une nouvelle doctrine d’emploi est récemment entrée en application en matière de sécurité intérieure, mettant en avant le rôle stratégique des primo-intervenants : on reconnaît désormais l’importance d’intervenir avec efficacité dès les premiers temps, afin de figer la situation. Dans ce cadre, on pourrait concevoir qu’un groupe de huit militaires, par exemple, se tienne à disposition des forces de police, qui feraient éventuellement appel à eux pour concourir à leur action. Ne pensez-vous pas qu’un tel dispositif aurait pu être mis en application au Bataclan et, plus largement, qu’il ait vocation à être adopté afin de faire face aux situations de crise qui se présenteront à l’avenir ?
Le principe d’une coopération entre forces de sécurité intérieure et militaires est très important sur le plan stratégique. À l’inverse, le fait de ne pas l’appliquer nous fait courir le risque d’aboutir à des situations de non-assistance à personne en danger : des personnes pourraient être torturées et tuées dans un bâtiment alors que des personnels ayant vocation à assurer la sécurité de la population se trouvent à proximité, mais n’interviennent pas.
Général Bruno Le Ray. La question de la sollicitation des personnels de l’armée de terre ne relève pas de ma responsabilité, puisque je ne suis qu’un employeur des moyens que l’on met à ma disposition. Cela dit, c’est un sujet particulièrement sensible. En début d’après-midi, j’ai effectué une présentation pour le ministre de la défense, ce qui m’a amené à me rendre sur les sites de l’îlot Saint-Germain et du fort de l’Est. Cela a été pour moi l’occasion de rappeler que 43 régiments différents – sur les 80 régiments environ que compte l’armée de terre – sont présents en ce moment à Paris pour une rotation de six semaines, étant précisé que certaines unités interviennent pour la septième fois. La sollicitation des personnels de l’armée de terre est donc effectivement très forte, ce qui justifie la campagne de recrutement actuellement mise en œuvre. Si cette campagne donne d’excellents résultats, nous n’en profiterons pas immédiatement, car la formation nécessaire pour qu’une nouvelle recrue puisse intervenir sur le terrain dure un certain temps.
Me faisant ici le porte-parole du chef d’état-major de l’armée de terre, qui est aussi mon chef sur une autre partie de mes responsabilités, je pense pouvoir affirmer que des unités supplémentaires vont être constituées au sein des régiments à partir de la fin de l’année, ce qui nous autorisera à revenir à un taux de rotation plus satisfaisant, permettant aux personnels d’être engagés sur les opérations, de se préparer correctement à l’éventualité de devoir livrer des combats de haute intensité au Mali ou en République centrafricaine, et de prendre un peu de repos entre-temps. En l’état actuel des choses, la sollicitation intense des régiments nous impose de déterminer au plus juste le volume des effectifs à déployer pour répondre aux besoins.
Pour ce qui est des conditions d’hébergement, celles de l’îlot Saint-Germain m’ont semblé tout à fait satisfaisantes, tandis que le fort de l’Est est plus spartiate. Quant à la mairie du 11e arrondissement, si elle offre un hébergement effectivement peu confortable – on ne peut y installer que des lits Picot –, elle présente l’avantage d’être située en plein cœur du 11e arrondissement, ce qui permet aux unités qui y sont basées de rejoindre leur lieu de mission en dix minutes à pied, au lieu d’avoir à effectuer un trajet d’une heure et demie en camion pour venir de Brétigny-sur-Orge, par exemple – sans compter que les personnels concernés apprécient, quand ils sont en repos, de pouvoir aller boire une bière en ville très facilement : c’est pourquoi, si vous faisiez un sondage parmi les personnels des unités logées dans la mairie du 11e arrondissement, vous n’auriez sans doute pas que des avis négatifs.
En tout état de cause, les conditions d’hébergement constituent un sujet de préoccupation permanent, et d’importants investissements sont effectués afin d’améliorer la situation – ainsi certains bâtiments du fort de l’Est sont-ils rénovés de fond en comble. Nous avions déserté – quand elles n’avaient pas été vendues – les enceintes militaires situées à l’intérieur de Paris, et nous sommes en train de les réinvestir afin de remonter durablement nos capacités, ce qui prendra un an ou deux. Les travaux effectués à l’Îlot Saint-Germain – où des bureaux doivent être transformés en lieux de vie – et au Val-de-Grâce vont nous permettre d’héberger environ 1 000 hommes en plein Paris dans des conditions satisfaisantes.
Sur le fait que les mêmes soldats soient amenés à intervenir en opérations extérieures et sur le territoire national, je veux souligner que les soldats présents le soir du 13 novembre ont mis en œuvre ce que leur expérience du combat sur le terrain leur avait appris : ils sont allés au contact des forces de sécurité intérieure afin de proposer leurs services, et se sont ensuite répartis pour assurer des missions d’appui ou de sécurisation des accès – par exemple en installant des chicanes improvisées –, qui ont aidé à circonscrire et à maîtriser la situation.
Pour moi, la notion de primo-intervenant implique celle de la responsabilité : or, de mon point de vue, la responsabilité d’assurer la sécurité sur le territoire national doit rester aux forces de sécurité intérieure. Si les militaires interviennent, c’est donc toujours sous le contrôle de l’autorité civile, et ils ne réclament pas d’être plus autonomes pour aller faire la guerre dans un quartier de Paris ou de Marseille. Les forces de sécurité intérieure et les militaires doivent se coordonner sur place comme ils l’ont fait le 13 novembre. Tous les jours, mes soldats sont sollicités pour accomplir des missions relevant de leurs compétences. Il peut s’agir, par exemple, de mettre en place un périmètre de sécurité dans un aéroport lorsqu’un bagage abandonné y est découvert, de sécuriser des zones où interviennent des chiens détecteurs de drogue, ou encore de mettre en place une bulle de protection aérienne pour couvrir certains grands événements.
Quand les militaires se trouvent confrontés seuls à une situation nécessitant d’intervenir, ils figent la situation comme le feraient les policiers, et entrent en contact avec les forces de sécurité intérieure au moyen d’ACROPOL pour leur demander d’intervenir. Fort heureusement, ils interviennent le plus souvent pour d’autres situations que des attaques terroristes : en dehors du prêt de main-forte, il peut s’agir de flagrants délits – qu’ils soient en présence d’individus brisant des vitres devant la gare Montparnasse, ou d’autres prenant des photos sur l’esplanade de la Défense –, en présence desquels ils font ce qu’est censé faire tout citoyen, à savoir geler la situation en attendant l’arrivée des personnels compétents.
M. Christophe Cavard. Si les militaires sont sollicités par les forces de sécurité intérieure, à quel niveau de hiérarchie la décision est-elle prise d’intervenir ou non ?
Général Bruno Le Ray. La cellule de base sur le terrain est constituée de trois soldats, dont un caporal-chef, à qui revient la responsabilité de cette décision. C’est le cadre d’emploi extrêmement précis de nos soldats qui leur permet de réagir à 99,9 % des situations sans requérir l’autorisation d’un supérieur hiérarchique – étant précisé qu’ils doivent rendre compte a posteriori, évidemment.
M. Christophe Cavard. La décision de tirer est-elle soumise aux mêmes conditions ?
Général Bruno Le Ray. Absolument. Dès lors que les conditions de la légitime défense sont réunies, les soldats peuvent tirer sans en demander l’autorisation, comme ils l’ont fait à Valence et comme ils étaient sur le point de le faire sur l’esplanade des Invalides – même si, dans ce dernier cas, c’est un gendarme qui a ouvert le feu.
M. Jean-Luc Laurent. La sollicitation intensive de nombreuses unités de l’armée de terre dans le cadre des opérations de Sentinelle, visant à appuyer les forces de sécurité intérieure et à rassurer la population, a des conséquences sur le moral des troupes – même si des efforts sont faits afin d’améliorer la coordination entre les effectifs militaires et ceux des forces de sécurité intérieure. Un dispositif interministériel a-t-il été mis en place afin d’assurer une coordination des unités présentes sur le terrain, mais aussi des autorités civiles et militaires ?
En termes de communication, existe-t-il, en plus du contact physique sur le terrain, des réseaux d’information communs destinés à faire remonter ou redescendre l’information ?
En ce qui concerne le retour d’expérience, pouvez-vous nous préciser quel a été le niveau d’activité de Sentinelle depuis sa mise en place, c’est-à-dire le nombre de fois où des militaires ont dû intervenir, et quel est le coût du dispositif – qui, sur le plan budgétaire, représente une ligne particulière ?
Enfin, j’ai tendance à considérer que l’armée a plutôt vocation à intervenir en dehors de nos frontières. Que pensez-vous de l’idée consistant à soulager les 7 000 personnels de l’armée des missions qu’ils accomplissent sur le territoire national, en faisant davantage appel à la réserve ?
Je pourrais vous parler du fort de Bicêtre, situé sur ma circonscription et abritant des unités qui contribuent largement au dispositif Sentinelle, mais je ne voudrais pas monopoliser la parole trop longtemps, aussi me contenterai-je d’évoquer ce sujet avec le général, directeur central, présent sur le site.
Général Bruno Le Ray. Vous avez été plusieurs à évoquer la mission de Sentinelle consistant à rassurer la population. Si cette mission existe, elle n’arrive qu’en troisième position après celles consistant à protéger et à dissuader, dont elle est surtout un effet induit. Ce n’est pas qu’une question de sémantique : cette hiérarchie des priorités reflète bien notre façon de concevoir la mission qui nous est confiée, et ce serait faire injure aux soldats que de leur dire qu’ils sont là uniquement pour rassurer.
Pour ce qui est de la coordination, une cellule interministérielle de crise (CIC) est actionnée en temps de crise – cela a été le cas à partir du 13 novembre, pour quelques jours durant lesquels elle a fonctionné 24 heures sur 24. En temps normal, des réunions interministérielles sont régulièrement organisées par le ministère de l’intérieur, auxquelles participent l’état-major des armées et, en tant que de besoin, les forces parisiennes.
Une coordination est donc mise en œuvre en amont – dans la programmation des activités par les cabinets ministériels – comme sur le terrain – par contact physique ou par radio, puisque toutes nos patrouilles sont équipées de moyens radio leur permettant de communiquer avec les forces de sécurité à l’intérieur du périmètre où elles se trouvent.
Nous répertorions tous les incidents, ce qui me permet de vous dire que l’an dernier, nous avons identifié 1 600 incidents de toute nature, parmi lesquels on compte essentiellement des incivilités, des insultes ou des tentatives de photographier un dispositif sensible, mais très peu d’agressions ou de tentatives d’agression sur la personne des soldats – la plupart du temps, les incidents sont d’ailleurs le fait de personnes sous l’emprise de l’alcool, qui ne se rendent pas compte de ce qu’elles font. Nous prêtons souvent main-forte aux forces de sécurité intérieure pour établir des périmètres de sécurité, et nous décelons des actions de surveillance de nos sites ou des sites que nous protégeons – nos soldats sont entraînés à identifier les allées et venues suspectes. Chaque incident fait systématiquement l’objet d’un rapport transmis par radio aux forces de sécurité avec lesquelles nous nous coordonnons.
Pour ce qui est du coût de l’opération Sentinelle, même si cela ne relève pas de mes attributions en tant que gouverneur militaire de Paris, je vous dirai de mémoire qu’il s’est élevé à 170 millions d’euros pour 2015.
Il se trouve déjà un certain nombre de réservistes parmi les personnels dont je dispose. En moyenne, depuis janvier 2015, ce sont un peu moins de 200 réservistes qui sont déployés en permanence au sein du dispositif Sentinelle – ce chiffre s’est élevé à 400 durant les fêtes de fin d’année, ce qui s’explique par le fait que les réservistes se libèrent plus facilement durant les périodes de congé.
Enfin, pour ce qui est de l’emploi des forces armées, que M. Laurent préférerait voir affectées aux missions situées en dehors de nos frontières, mon point de vue de militaire me porte à penser qu’il faut faire face à la menace où qu’elle soit : j’aurais du mal à considérer que mes hommes sont capables d’aller combattre au Mali, mais que nous n’avons pas de rôle à jouer dans la défense de nos compatriotes, de nos familles, sur le territoire national. Cela ne doit cependant pas aller jusqu’à transformer les militaires en forces de sécurité intérieure, car si des soldats préparés aux missions extérieures sont capables d’intervenir sur le territoire national, l’inverse n’est pas vrai. En disant cela, je pense exprimer un point de vue qui est également celui des chefs militaires et du ministre de la défense.
M. le président Georges Fenech. Mon général, nous vous remercions pour votre intervention devant notre Commission.
Audition, à huis clos, de M. Michel Cadot, préfet de police de Paris, M. Christian Sainte, directeur de la police judiciaire à Paris, M. Jacques Méric, directeur de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne, et du général Philippe Boutinaud, commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris (BSPP)
Compte rendu de l’audition, à huis clos, du mercredi 23 mars 2016
M. le président Georges Fenech. Nous allons procéder à l’audition de M. Michel Cadot, préfet de police de Paris, accompagné de M. Christian Sainte, directeur de la police judiciaire, de M. Jacques Méric, directeur de la sécurité de la police d’agglomération, et du général Philippe Boutinaud, commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris (BSPP).
Nous avons déjà tenu de nombreuses auditions, consacrées tout d’abord aux victimes et à leur prise en charge par les secours, puis à la chronologie des événements de janvier et de novembre 2015, et enfin, à la lumière de l’expérience de ces événements, aux moyens et aux missions des forces de sécurité. Nous avons ainsi reçu, lundi, le directeur général de la police nationale (DGPN), le directeur général de la gendarmerie nationale (DGGN) et le gouverneur militaire de Paris.
Monsieur le préfet de police, nous sommes particulièrement impatients de vous entendre et de pouvoir vous questionner sur le rôle de la préfecture de police, sur l’organisation et la coordination des forces.
Cette audition, en raison de la confidentialité des informations que vous êtes susceptibles de nous délivrer, se déroule à huis clos. Elle n’est donc pas diffusée sur le site internet de l’Assemblée. Néanmoins, et conformément à l’article 6 de l’ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, son compte rendu pourra être publié en tout ou partie, si nous en décidons ainsi à l’issue de nos travaux. Je précise que les comptes rendus des auditions qui auront eu lieu à huis clos seront au préalable transmis aux personnes entendues afin de recueillir leurs observations. Ces dernières seront soumises à la commission, qui pourra décider d’en faire état dans son rapport. Je rappelle que, conformément aux dispositions du même article, « sera punie des peines prévues à l’article 226-13 du code pénal » – un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende – « toute personne qui, dans un délai de vingt-cinq ans […], divulguera ou publiera une information relative aux travaux non publics d’une commission d’enquête, sauf si le rapport publié à la fin des travaux de la commission a fait état de cette information ».
Conformément aux dispositions de l’article 6 précité, je vais maintenant vous demander de prêter le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité.
Veuillez lever la main droite et dire : « Je le jure. »
MM. Michel Cadot, Christian Sainte, Jacques Méric et le général Philippe Boutinaud prêtent successivement serment.
Le rapporteur et moi-même vous avons déjà rencontré, monsieur le préfet, lorsque nous nous sommes rendus à la préfecture de police où nous avons eu déjà un large échange sur plusieurs points qui font l’objet de la présente commission.
M. Michel Cadot, préfet de police de Paris. J’ai pris mes fonctions de préfet de police de Paris le 20 juillet 2015 dans un contexte de menace terroriste élevée. La première préoccupation d’un préfet de police venant de prendre ses fonctions est de porter au meilleur niveau la préparation de la préfecture de police face à cette menace, ainsi que les réponses susceptibles d’être apportées à d’éventuelles attaques.
Depuis le 13 novembre, je garde en permanence le souvenir de l’intensité de la violence et de l’horreur de ce que nous avons vu sur place. Je pense évidemment aux familles des victimes, et considère qu’elles ont droit à toute la vérité. L’État et ses représentants doivent tirer tous les enseignements de cette attaque quelque peu inédite. Après ces quelques mois, je retiens de l’organisation des secours le courage, le professionnalisme des équipes et des personnes, qui me confortent dans cette ambition de porter la réponse au meilleur niveau. J’ai la conviction que la préfecture de police de Paris a été au rendez-vous et qu’elle a bien rempli sa tâche dans les diverses missions qui lui sont dévolues.
Je rappellerai en quelques mots le rôle de la préfecture de police dans la lutte contre le terrorisme et les moyens dont elle dispose, et reviendrai sur les enseignements que nous pouvons tirer des événements du 13 novembre.
Le modèle de la préfecture de police de Paris est original : organisation intégrée, ce qui permet que l’ensemble des missions de police, y compris, d’ailleurs, celles de secours, soient placées sous un commandement unique : celui du préfet de police et de son cabinet. Ce dispositif permet un partage optimal de l’information et une coordination territoriale organisée pour répondre, ici, à la menace terroriste.
La compétence de la préfecture de police se décline de manière diverse selon les territoires : à Paris ; dans l’agglomération parisienne – c’est-à-dire Paris et les trois départements de la petite couronne – ; et dans la région Ile-de-France – à savoir les huit départements de la région, avec une coordination zonale relevant du préfet de zone, qui est le préfet de police de Paris.
En matière de lutte contre le terrorisme, deux directions sont principalement impliquées : la direction du renseignement de la préfecture de police (DRPP), qui compte un effectif total de 870 agents, et dont dépend une sous-direction plus directement chargée de la lutte contre le terrorisme et les extrémismes à potentialité violente – qui, pour sa part, compte 245 fonctionnaires. L’organisation de cette sous-direction est classifiée, les fonctionnaires qui y travaillent n’ont pas de compétence judiciaire et leur activité est exclusivement consacrée à la recherche du renseignement – à la différence de la direction générale de la sécurité intérieure (DGSI), qui a une compétence judiciaire et une compétence de renseignement.
La DRPP a une mission de coordination et de rassemblement du renseignement dans la lutte contre le terrorisme, qui s’effectue à plusieurs niveaux. S’agissant de la ville de Paris, un rythme de réunions plus fréquentes a été mis en place depuis le mois de septembre dernier. Chaque semaine, je préside une réunion consacrée au terrorisme, avec tous les services de la préfecture auxquels s’associent la DGSI et le service central du renseignement territorial (SCRT), pour suivre directement les menaces terroristes, en analysant les situations individuelles et les dossiers signalés. Tous les quinze jours se réunit un groupe d’évaluation, comme dans chaque département, à cette différence près que ce groupe, à la préfecture de police, est doublonné, compte tenu de l’importance du territoire ; il évalue les signalements de radicalisation. Enfin, deux réunions mensuelles portent plus directement sur la prévention de la radicalisation, donc sur les cas qui nous sont signalés par la plateforme d’appel ou par les renseignements que nous collectons auprès des différents services.
Je préside par ailleurs une réunion zonale mensuelle avec les préfets des départements de la région et les représentants des services concernés, pour piloter le suivi du renseignement et la coordination zonale. Au niveau zonal toujours, une réunion est présidée par le DRPP.
Depuis le début de l’année 2015, les liens avec les services centraux ont été sensiblement renforcés. Un officier de liaison de la DGSI, ayant le grade de commandant, est depuis deux ans affecté, au sein de la DRPP, auprès du sous-directeur chargé du terrorisme. Deux officiers de la DRPP sont affectés au SCRT qui, vous le savez, dépend du directeur général de la police nationale (DGPN). La DRPP participe évidemment à la cellule nationale de coordination du renseignement, installée dans les locaux de la DGSI et mise en place en mai 2015 à la suite des attentats du mois de janvier, et qui permet de coordonner l’échange des renseignements ainsi que l’action non judiciaire des services. Enfin, des réunions bilatérales sont organisées très fréquemment, entre M. Calvar et moi-même ou, plus largement, entre la DGSI et mes services. Toutes les notes de la DRPP sont communiquées à la DGSI, et inversement.
Nous sommes en train de renforcer notre dispositif sur les plateformes aéroportuaires du Bourget et de Roissy, où le renseignement est assuré par la direction centrale de la police aux frontières (DCPAF). J’ai en effet proposé il y a plusieurs mois au ministre une meilleure coordination et une meilleure prise en compte de ce renseignement, et le dispositif de cette mission qui sera confiée à la DRPP est en cours de mise en œuvre.
Quant à la direction régionale de la police judiciaire (DRPJ), elle a une section antiterroriste (SAT) et une brigade de recherche et d’intervention (BRI). Sur un effectif de 2 222 agents, la SAT compte 59 fonctionnaires et la BRI, l’une des sept brigades de la police judiciaire, en compte 48 – effectif qui peut être porté à 110 fonctionnaires avec l’appui d’autres unités de la préfecture de police, telles que les brigades d’intervention. La BRI va faire l’objet d’un renfort de 45 fonctionnaires qui sont en cours de recrutement.
M. le président Georges Fenech. Le ministre de l’intérieur a annoncé le doublement des effectifs de la BRI, c’est bien cela ?
M. Michel Cadot. C’est à peu près cela : aux 48 fonctionnaires actuels vont s’ajouter 45 nouveaux, soit un doublement, à trois personnes près.
Enfin, la concertation entre les deux directions régionales de la police judiciaire (DRPJ) de Paris et de Versailles est désormais institutionnalisée, avec l’accord des deux parquets généraux.
Voilà pour les moyens et le rôle de la préfecture de police.
En ce qui concerne la soirée du 13 novembre, le rôle du préfet de police de Paris est double. Il est d’abord d’assurer la remontée d’informations rigoureuses et précises aux autorités gouvernementales, notamment par l’activation du centre opérationnel de la préfecture de police (COPP) – en fait une cellule de crise, dotée d’une permanence que nous avons renforcée dès 21 h 25. Le COPP est chargé d’assurer l’information continue de la cellule interministérielle de crise (CIC) placée sous l’autorité du ministre de l’intérieur et, bien entendu, de coordonner les renforts de moyens et la liaison entre les services. De même, nous avons immédiatement renforcé le centre opérationnel zonal (COZ) qui assure la liaison avec les autorités militaires et qui fonctionne, lui, en permanence. Je précise que ces deux cellules travaillent sur « Cris-ORSEC », logiciel commun qui permet de disposer de bases de données identiques.
L’un des enseignements de la nuit du 13 novembre, compte tenu du nombre de victimes, est la nécessité d’aller plus loin dans la définition d’une cartographie commune entre les services. J’ai mis par ailleurs en place un véhicule de commandement unique qui permettra de rassembler plus facilement sur le terrain, dans ce type de situations, les informations venant des différents services de secours et de police.
Les événements de Saint-Denis et de Paris se sont déroulés de manière très rapprochée puisque les fusillades ont eu lieu entre 21 heures 20 et 22 heures. J’ai moi-même informé le ministre, au moyen d’une vingtaine d’appels téléphoniques. J’ai renoncé à aller au Stade de France, où je me dirigeais, pour me rendre immédiatement sur le lieu de la première fusillade, où je suis arrivé entre dix minutes et un quart d’heure après le passage des assassins. La police et les pompiers venaient tout juste d’arriver. Je suis resté une vingtaine de minutes et je suis arrivé vers 22 heures 15 ou 22 heures 20 au Bataclan. Le rôle du préfet de police, dans ce genre de situation, est d’informer, puis de prendre la direction des opérations et de s’assurer du bon déroulement des actions de police et de secours, en s’appuyant sur le commandant des opérations de police, en l’occurrence Jacques Méric, directeur de la sécurité de proximité de l’agglomération parisienne (DSPAP) ici présent à mes côtés, sur le commandant des opérations de secours, le général Boutinaud, commandant la brigade des sapeurs-pompiers de Paris (BSPP), enfin sur le commandant des opérations de police judiciaire pour établir la liaison avec l’autorité judiciaire.
Au Stade de France, nous avons immédiatement, à 21 heures 40, partagé les responsabilités avec le préfet Galli, qui a pris la direction de l’opération dans un dispositif préparatoire planifié compte tenu de la venue du Président de la République et de plusieurs ministres, à l’occasion d’un match très important. Comme à chaque fois que se déroule un match important, que ce soit au Stade de France ou au Parc des Princes, le dispositif de sécurité est très organisé et le directeur de l’ordre public et de la circulation (DOPC), qui était sur place, a pris le commandement des opérations de police.
À Paris même, des fusillades ont éclaté sur cinq sites. Ma responsabilité consistait à vérifier la mise en place par les commandants des opérations de police et de secours des mesures adaptées et notamment l’établissement de périmètres de sécurité autour de chacun des sites, permettant ainsi le déroulement satisfaisant des opérations de secours ; il n’est pas question ici du Bataclan mais bien des cinq terrasses. Sur le site Alibert-Bichat, la première équipe de secours est arrivée à 21 heures 35. À 21 heures 48, le commandant des opérations de secours a pris le commandement, la police étant arrivée avant les secours – j’étais moi-même sur place et m’en suis assuré. Sur les autres sites, les opérations ont été menées de la même manière, au fur et à mesure de la progression des véhicules des assaillants. Le seul site à propos duquel nous avons eu un doute sur la persistance éventuelle d’une menace, donc d’un retranchement de terroristes, était le site de la pizzeria Casa Nostra, au coin de la rue de la Fontaine-au-Roi. J’en ai été le témoin puisque, quand je suis arrivé, le responsable policier m’a indiqué qu’il semblait que des terroristes s’étaient retranchés dans l’immeuble d’angle, autour duquel nous avons donc installé un périmètre de sécurité. Nous avons demandé à la BRI puis au groupe Recherche, assistance, intervention, dissuasion (RAID), lequel a pris la mission en charge, de lever le doute, étant donné qu’il n’y avait plus aucun tir et plus aucune action.
Au total, sur les cinq sites, les délais de prise en charge par les secours et de mise en place des périmètres de sécurité ont été assez rapides, étant donné la succession des opérations.
C’est au Bataclan, site concerné par une prise d’otages à partir de 21 heures 40 environ, que je me suis positionné en tant que directeur des opérations. En effet, une action s’y prolongeait alors que ce n’était pas le cas pour les autres sites. J’y ai regroupé les responsables des opérations de sécurité et de secours. Nous avons installé les différents périmètres prévus par la directive « EVENGRAVE » de la préfecture de police, définissant une zone contrôlée, une zone d’exclusion et un périmètre de sécurité. Ce dernier a été installé dans le haut de la rue Oberkampf, à l’angle du boulevard Voltaire – lequel était sous le tir potentiel des preneurs d’otages. Nous nous sommes répartis les espaces entre les différentes missions. À cause des voitures stationnées sur le côté, les secours disposaient de peu de place pour accéder au site – ce qui s’est révélé une vraie difficulté. Le commandant des opérations de police (COP), M. Méric, est arrivé très vite et a facilité l’évacuation de quelques voitures. Nous avons essayé d’améliorer la tenue d’un périmètre de commandement. Le commandant des opérations de police judiciaire (COPJ) est arrivé par la suite, avant le général Boutinaud, le professeur Tourtier étant là dès le départ. Ce lieu unique a permis de partager les informations, de prendre des décisions, d’apporter des réponses rapides et coordonnées. Se trouvaient également à mes côtés le procureur de la République, M. François Molins, et la maire de Paris, Mme Hidalgo, arrivée assez vite par la rue des Filles-du-Calvaire puisqu’elle ne pouvait traverser le boulevard Voltaire.
La sécurisation, tant des cinq sites où ont eu lieu des fusillades que du Bataclan, a mobilisé 1 100 policiers. Les militaires de la force Sentinelle se sont rapprochés en « deuxième rideau », si je puis dire, et se sont positionnés – je l’ai constaté à mon arrivée – de l’autre côté du boulevard Richard-Lenoir pour assurer une protection périmétrique du site.
Pour ce qui est de l’intervention elle-même, je soulignerai trois points.
D’abord, les forces d’intervention spécialisées sont arrivées rapidement. Les primo-intervenants, c’est-à-dire la brigade anti-criminalité (BAC) de nuit, sont arrivés à 21 heures 54 au Bataclan et le tir du commissaire intervenu sur les lieux de sa propre initiative, s’est produit à 21 heures 57, au moment où la BAC 94 est arrivée à son tour et s’est positionnée dans le passage Saint-Pierre-Amelot. Les forces d’intervention territorialement compétentes spécialisées (la BRI), sont alertées à la permanence à 21 heures 30. Le premier groupe, de quinze fonctionnaires, part de la préfecture de police du 36 quai des Orfèvres à 22 heures. Il est arrivé à 22 heures 20 au Bataclan et la seconde formation l’a rejoint à 22 heures 40. Il s’agit donc, j’y insiste, d’une intervention assez rapide, et l’on peut porter la même appréciation sur l’arrivée en renfort du RAID.
Ensuite, la coordination entre les services a été bonne. Je reviendrai sur ce point.
Enfin, la décision d’intervenir pour donner l’assaut a été très rapide et même quasi immédiate. J’étais à côté de M. Sainte quand M. Molmy est venu nous informer de l’échec des contacts téléphoniques avec les terroristes et demander l’autorisation de mener l’assaut. L’autorisation lui a immédiatement été donnée après que j’ai appelé le ministre.
Pour conclure, je rappellerai que, dans le cadre du pacte de sécurité et du plan BAC, des renforcements très importants ont été réalisés depuis novembre 2013, qui ont permis de doter les équipes de primo-intervenants – les BAC et les compagnies de sécurité et d’intervention (CSI), qui sont les BAC de jour à Paris et dans l’agglomération – en équipements de tir et en équipements de protection. Les services spécialisés de la BRI ont également été renforcés.
M. le président Georges Fenech. J’ai quatre séries de questions à vous poser, monsieur le préfet : la première série concerne l’absence de déclenchement de la Force d’intervention de la police nationale (FIPN) ; la seconde porte sur l’opération au Bataclan proprement dite ; la troisième est liée à l’éventuel manque de coopération entre les services – ou à leur parfaite coopération si j’en juge par votre satisfaction en la matière – ; enfin, je vous interrogerai sur l’Euro 2016 qui se tiendra du 10 juin au 10 juillet 2016.
Vous nous avez confirmé que la BRI de Paris était compétente à Paris intra muros ainsi que dans les trois départements de la petite couronne. Vous avez rappelé qu’au moment des faits, la BRI de Paris était composée de 48 hommes, ces effectifs étant amenés à augmenter, ainsi que l’a annoncé le ministre de l’intérieur. Quel était l’effectif de la BRI de Paris le 13 novembre dernier ?
M. Michel Cadot. La BRI n’est compétente qu’à Paris en qualité de service directeur – on dit alors qu’elle est « menante ». Elle n’est pas menante, en revanche, donc pas compétente en premier rang dans les trois départements de la petite couronne, où c’est le RAID qui l’est, ni dans les quatre autres départements de la région Ile-de-France, où c’est le GIGN dans les zones de gendarmerie et le RAID dans les zones de police qui le sont. Le Bataclan étant dans Paris, le schéma d’intervention prévoit que le service appelé soit la BRI.
La BRI a projeté quinze personnes qui sont arrivées à 22 heures 20. Une deuxième équipe de la BRI, composée de 25 fonctionnaires, est arrivée à 22 heures 40.
M. le président Georges Fenech. Nous avions donc 40 fonctionnaires de la BRI, auxquels s’ajoutent ceux des BAC.
M. Michel Cadot. Bien sûr, mais qui ont agi en primo intervenants et qui ne sont pas des services spécialisés.
M. le président Georges Fenech. Non, en effet, ils sont venus en renfort.
M. Michel Cadot. Tous les primo-intervenants faisaient partie des renforts, lesquels doivent garantir le périmètre de sécurité et préserver la zone d’exclusion et la zone de sécurité – le deuxième périmètre. Puis il y a des forces spécialisées pour intervenir dans un contexte aussi complexe que celui dont il est question avec, notamment, une prise d’otage.
M. le président Georges Fenech. Nous avons donc 40 fonctionnaires de la BRI à 22 heures 40.
M. Michel Cadot. Ensuite, nous avons la brigade d’intervention (BI), intégrée structurellement à la BRI quand une action est déclenchée.
M. Christian Sainte, directeur de la police judiciaire. Il y a eu trois vagues. La Force d’intervention rapide (FIR) est arrivée dans un premier temps.
M. le président Georges Fenech. À savoir les quinze premiers.
M. Christian Sainte. Ce sont en effet les quinze premiers. Les 25 suivants sont arrivés vingt minutes plus tard. Arrivent parallèlement des fonctionnaires de la BI qui s’agrègent à ceux de la BRI. Si bien qu’au total, nous comptons quelque 70 hommes.
M. le président Georges Fenech. Nous essayons de comprendre les choix qui ont été faits. Le RAID, dont je rappelle qu’il est situé à Bièvres, dispose d’un effectif opérationnel de 148 officiers d’intervention directe, sur un total de 300 personnes. D’un côté, nous avons 40 primo-intervenants et, de l’autre, 148 officiers d’intervention directe. La proportion est donc très différente. Nous essayons de comprendre, j’y insiste, pourquoi on fait appel à telle force et pas à telle autre.
Ceci étant rappelé, j’en viens à l’annexe 5 que le RAID nous a fournie et qui organise le déclenchement de la FIPN. Nous confirmez-vous, monsieur le préfet, que lorsque cette dernière est déclenchée, la BRI de Paris, qui est l’une des composantes de la FIPN, est placée sous commandement du RAID ?
M. Michel Cadot. La FIPN est un dispositif activé dans un certain nombre de situations…
M. le président Georges Fenech. Nous allons y venir, la question est précise, monsieur le préfet : si l’on en croit l’annexe 5…
M. Michel Cadot. À quelle annexe faites-vous référence ?
M. le président Georges Fenech. À l’annexe 5 du RAID.
M. Michel Cadot. C’est-à-dire ?
M. le président Georges Fenech. Il s’agit des annexes fournies par le RAID à la commission d’enquête.
M. Michel Cadot. La FIPN, ce n’est pas le RAID…
M. le président Georges Fenech. Il s’agit, plus exactement, de la note que nous a fournie le DGPN et dont l’annexe 5 concerne le RAID.
M. Michel Cadot. La FIPN ne relève pas d’une note du DGPN uniquement…
M. le président Georges Fenech. Cette annexe n° 5 reprend la note du 17 janvier 2014 qui rationalise les modalités de saisine et d’emploi de la Force d’intervention de la police nationale, adressée par le directeur général de la police nationale à M. le préfet de police, vous-même, à Paris.
M. Michel Cadot. C’est la circulaire, pour être précis, du ministre de l’intérieur, datée de janvier 2014 et qui fixe les conditions de déclenchement de la FIPN.
M. le président Georges Fenech. Je me réfère à cette note, ou à cette circulaire, comme vous voudrez, pour vous poser cette question : est-il exact que, lorsque la FIPN est déclenchée à Paris intra muros, la BRI de Paris, qui est l’une des composantes de la FIPN, est automatiquement placée sous le commandement du RAID ?
M. Michel Cadot. Bien sûr, puisque c’est précisé dans la circulaire que vous venez de citer.
M. le président Georges Fenech. L’annexe 6 des documents du RAID, note commune, cette fois, du DGPN, du DGGN et du préfet de police, dispose que lors d’événements d’envergure, à savoir des actes terroristes nécessitant une intervention armée, ou une prise d’otages, la FIPN est déclenchée et, selon l’annexe 5 que je viens de citer, le responsable de la sécurité publique territorialement compétent, c’est-à-dire vous-même, monsieur le préfet, ou bien le chef de la BRI de Paris, présent sur les lieux, apprécie la gravité de la situation et estime s’il doit faire appel à une unité d’intervention. Vous m’arrêterez si je commets une erreur. À ce moment-là, vous devez prendre l’attache, sans délai, suivant votre appréciation de la situation, de l’état-major de la FIPN.
Le chef de la BRI de Paris, M. Molmy, que nous avons auditionné, a-t-il lui-même informé au préalable, et ce sans délai, l’état-major de la FIPN pour évaluer la situation et déclencher l’action de la FIPN ? Ma question est précise. Quelle a été votre appréciation, puisque vous êtes présent sur les lieux, puisque le commissaire divisionnaire Molmy est présent sur les lieux et que les notes, les circulaires ministérielles que j’ai citées prévoient que vous devez apprécier la situation pour déclencher ou non la FIPN ?
Ce qui nous importe ici est de savoir quelle a été votre appréciation, étant rappelés les éléments que je viens de citer, à savoir l’effectif à la disposition de la BRI de Paris et l’effectif à la disposition du RAID, étant précisé également, il est important de le rappeler pour les commissaires d’enquête, monsieur le préfet, que la BRI-BAC, qui compte soix72 policiers, traite en règle générale de la petite et moyenne délinquance – vols, émeutes, extorsions, violences, drogue, prostitution… Elle n’est donc pas apte à intervenir dans le cas de crises majeures telles que les actes terroristes avec prise d’otages.
M. Michel Cadot. Le texte que vous lisez, monsieur le président, correspond-il à une circulaire, à un commentaire… ?
M. le président Georges Fenech. C’est une question que je pose. Je peux me tromper, monsieur le préfet, mais j'essaie d’éclairer toute la commission d’enquête.
Il existe plusieurs unités, dont l’une a pour objet exclusif ces situations de terrorisme ou de prise d’otages, et dont l’autre a également vocation à faire du judiciaire et à intervenir pour des interpellations. Donc, quand vous êtes sur les lieux, monsieur le préfet, avec le commissaire commandant la BRI de Paris, vous analysez la gravité de la situation, vous décidez de réserver l’intervention à la BRI de Paris et vous ne déclenchez pas la FIPN. Pourquoi ?
M. Michel Cadot. Je vais vous répondre très clairement, monsieur le président, et je vais vous répondre en tant que préfet de police ayant une longue carrière de préfet derrière lui et ayant eu à traiter de nombreuses crises, des situations particulièrement difficiles et de nature très diverse – je pense en particulier à l’opération qui a suivi le crash de l’avion de la Germanwings : j’étais responsable en tant que préfet de zone et je puis vous assurer que les décisions n’étaient pas faciles à prendre. Or je les assume toujours.
Ce que j’ai affirmé tout à l’heure à propos de l’affaire qui nous occupe ici n’était pas un effet rhétorique : je pense constamment à ces familles qui ont perdu des leurs, aux visages de ces otages que nous avons sauvés, qui, au moment de la libération par la BRI, sont sortis du Bataclan dans des conditions terribles, hébétés, par centaines. Je suis convaincu d’avoir pris la bonne décision. Je l’assume et je vais vous expliquer pourquoi.
M. le président Georges Fenech. Monsieur le préfet, personne ne vous met en cause ici. Nous vous posons des questions.
M. Michel Cadot. Je n’ai pas « réservé » l’intervention à la BRI. Je rappellerai la règle : le déclenchement de la FIPN ne relève pas du préfet de police tout seul ! Cette décision est prise au niveau ministériel. Il faut déclencher la FIPN si, en effet, le dispositif territorial de droit commun, qui prévoit ici l’intervention de la BRI, n’apparaît pas adapté à la nature des risques ou à la nature de l’attaque qu’il faut contenir et réduire.
N’étant pas un spécialiste moi-même de ce type d’intervention, j’écoute, en tant que préfet, mes services spécialisés. Je savais ce qu’était le Bataclan et mesurais bien la complexité d’une progression des forces alors qu’il y avait un très grand nombre d’otages – c’est l’information que nous avions à ce moment-là – et deux ou trois assaillants qui s’étaient réfugiés à l’étage. La BRI est arrivée avec 30 personnes. J’ai tiré de l’analyse de ce qui s’était passé à l’Hypercacher qu’il n’était pas nécessaire d’être quatre fois plus nombreux. Au contraire, le nombre n’est pas nécessairement une garantie d’efficacité. Ce qui en est une, c’est le professionnalisme, la méthode et le choix du moment de l’intervention.
Or l’intervention au Bataclan s’est réalisée sans provoquer aucune victime ; elle a été judicieusement menée et j’en conclus que le choix n’a pas été mauvais et qu’il était même justifié.
À quel moment aurait-il fallu proposer le déclenchement de la FIPN ? Évidemment, s’il y avait eu une deuxième prise d’otages, comme le laissaient craindre des rumeurs qui ont circulé pendant des heures et selon lesquelles il y avait des attaques au Châtelet, à la gare Saint-Lazare, il aurait fallu envoyer le RAID. Et c’est à ce moment que je l’aurais proposé au ministre, pendant que nous continuions à traiter le Bataclan. Voilà quelle était ma conviction. Je n’ai pas ressenti, ensuite, le moindre besoin d’obtenir des moyens supplémentaires sur le site du Bataclan.
C’est pourquoi je suis navré de ces difficultés, que les médias, je pense, ont accentuées. En effet, un accord a été trouvé avec le RAID, arrivé vers 23 heures 10 – après s’être annoncé sur les ondes à 23 heures 03 –, alors que la BRI avait déjà engagé la progression à l’étage. La BRI et le RAID se sont partagé les tâches, la première poursuivant la mission qu’elle avait engagée – elle avait les équipes pour le faire et elle l’a fait très bien – et le second s’occupant du rez-de-chaussée et du sous-sol.
Enfin, les deux forces ne sont pas opposées : elles ont des formations communes ; un médecin du RAID se trouvait dans la colonne et s’est efforcé, avec le médecin de la BRI, de faire sortir un maximum de blessés.
Voici quelle est ma conviction, monsieur le président.
M. le président Georges Fenech. Monsieur le préfet, nous essayons simplement de comprendre. Donc, vous êtes sur place, vous êtes informé des attentats, de ce qui se passe dans les 10e et 11 arrondissements ; des échanges de tirs se sont produits à l’angle du passage Saint-Pierre-Amelot, boulevard Voltaire ; les fonctionnaires que nous avons entendus ont parlé de scènes de guerre sans précédent ; nous savons que 1 500 personnes se trouvent au Bataclan ; nous savons que plusieurs individus armés de kalachnikovs se trouvent à l’intérieur. Ni vous ni le chef de la BRI de Paris n’avez sollicité l’aide d’autres forces spéciales – comme le RAID qui viendrait en concours, comme vous l’avez expliqué –,vous l’assumez et nous dites avoir pris la décision de réserver l’intervention à la BRI de Paris et non pas au RAID. « C’était ma décision, nous déclarez-vous, c’était en mon pouvoir, donc je l’assume et j’estime que c’était la bonne décision. » C’est bien ce que vous nous dites ?
M. Michel Cadot. Non, ce n’est pas ce que je vous ai dit, monsieur le président. Je n’ai jamais dit que j’avais « réservé » l’intervention à la BRI, mais j’ai indiqué qu’il ne m’avait pas semblé nécessaire d’activer la FIPN pour l’opération du Bataclan. Je vous répète que le RAID a été missionné, dans un premier temps, pour lever le doute quant à l’éventuelle présence de terroristes dans l’immeuble de la rue de la Fontaine-au-Roi, à côté de la pizzeria Casa Nostra. C’est donc le RAID qui aurait pris l’opération en charge si la rumeur s’était avérée correspondre à un retranchement effectif des terroristes. S’il y avait eu une autre prise d’otages importante dans un autre lieu, il aurait sans doute fallu confier l’opération au RAID. Aussi, j’y insiste, je n’ai pas « réservé » l’opération du Bataclan à la BRI, j’ai appliqué la procédure…
M. le président Georges Fenech. Selon votre appréciation.
M. Michel Cadot. Bien entendu : une appréciation que j’assume pleinement et que les résultats me semblent confirmer. Reste que ce n’est pas une décision personnelle, individuelle…
M. le président Georges Fenech. Mais vous en avez la responsabilité.
M. Michel Cadot. Je l’assume et j’en suis fier. Mais j’avais autour de moi des personnes habilitées à me conseiller et j’ai entendu leurs avis. Personne ne m’a demandé d’engager le RAID : cela n’aurait pas eu de sens, puisque la BRI connaissait davantage les lieux et était donc mieux à même d’agir, et qu’elle était entraînée pour cela.
M. le président Georges Fenech. Vous assumez donc cette décision, monsieur le préfet, estimant qu’il s’est agi de la bonne décision. Si un nouvel attentat de cette ampleur devait se produire à Paris, vous reprendriez donc la même ?
M. Michel Cadot. Chaque cas est un cas différent, monsieur le président. Je répète que la décision de déclencher la FIPN, ce n’est pas le préfet qui la prend seul : il la propose au ministre...
M. le président Georges Fenech. À qui l’avez-vous proposée ? Au ministre ?
M. Michel Cadot. La question ne s’est pas posée en ces termes au moment de l’intervention puisque la BRI assumait la mission et était en situation de la conduire. Vous me posez la question d’une manière biaisée, parce que…
M. le président Georges Fenech. Je ne vous pose pas de questions biaisées, mais au contraire des questions très simples, très claires.
M. Michel Cadot. Alors j’y réponds très simplement.
M. le président Georges Fenech. Pourquoi parlez-vous de questions biaisées ? Ce n’est pas le cas, j’y insiste, il s’agit de questions claires.
M. Christian Sainte. Il me semble important de revenir sur la nature des faits. Ceux concernant les terrasses sont caractérisés par une succession d’épisodes. Au moment où nous savons qu’un fait s’est produit, il est déjà terminé alors même que nous envisageons de projeter des forces. Dans le seul cas, évoqué par le préfet, de la pizzeria Casa Nostra, le bruit a couru qu’il pourrait s’y trouver un homme avec une kalachnikov. Nous n’y avons pas cru parce qu’il n’y avait pas de raison qu’un individu reste là, d’autant que le mode opératoire choisi était, je le répète, que deux ou trois individus, à bord d’un véhicule, en descendent, « rafalent », pour parler crûment, et remontent dans le véhicule pour passer à l’étape suivante. Le mode opératoire est donc très dynamique.
L’endroit où nous avons un point de fixation, c’est le Bataclan. Il s’agit, au fond, de la seule scène de crise à gérer. Cela étant, on semble sous-entendre que la BRI n’aurait pas les compétences requises pour intervenir, en tout cas des compétences équivalentes à celles du RAID, comme cela a été indiqué tout à l’heure...
M. le président Georges Fenech. Monsieur le directeur, sur ce point, lorsque, la semaine dernière, j’ai posé la question, et sans biaiser, au directeur général de la police nationale, il nous a très clairement présenté la hiérarchie des forces d’intervention : à la base il y a les BAC, puis les BRI et, pour le type d’intervention qui nous intéresse ici, il y a le RAID, parce que le RAID est formé pour cela et uniquement pour cela. Je ne dis donc pas que la BRI n’est pas formée, puisque vous avez rappelé, monsieur le préfet, qu’il y avait des formations communes aux deux unités – j’aimerais, au passage, savoir quand la dernière a eu lieu –, mais vous serez sans doute d’accord avec le DGPN pour considérer que le RAID est la formation qui, face à ce type d’événement, a quand même le plus grand savoir-faire !
M. Christian Sainte. À quel niveau le DGPN a-t-il placé la BRI de Paris dans la hiérarchie ?
M. le président Georges Fenech. En dessous ! Je parle sous le contrôle de mes collègues.
M. Pascal Popelin. Il n’y a pas de hiérarchie !
M. le président Georges Fenech. Il ne s’agit pas d’une hiérarchie fonctionnelle, mais d’une hiérarchie dans la compétence.
M. Christian Sainte. D’abord, en effet, les opérateurs qui intègrent la BRI de la préfecture de police ont une formation commune avec le RAID pendant quatre mois. Puis des stages, des échanges, des exercices communs sont prévus. Un protocole d’intervention a été mis au point avant les événements dont il est ici question – portant sur la coordination en matière de transmissions, sur les problématiques liées aux bulles tactiques, sur la mise en place de postes de commandement (PC).
Ensuite, quand le RAID est arrivé au Bataclan, je confirme que tout s’est passé très naturellement – j’y étais – et, d’ailleurs, Christophe Molmy vous l’a rappelé jeudi dernier alors que nous étions sur les lieux. Deux opérateurs du RAID sont bien montés dans les escaliers pour rejoindre la colonne d’assaut de la BRI.
M. le président Georges Fenech. C’est en effet ce qui nous a été dit.
M. Christian Sainte. En parallèle, la BRI de la préfecture de police pratique des surveillances judiciaires. Cela implique-t-il pour autant, en ce qui concerne l’opération…
M. le président Georges Fenech. Monsieur le directeur, je prends note de votre position. Vous mettez sur un pied d’égalité la BRI de Paris et le RAID. Point final.
M. Christian Sainte. Je constate que, lors de l’intervention à l’Hypercacher, les hommes de la BRI ont tenu leur place aux côtés de leurs collègues du RAID, et je constate qu’au cours de l’intervention au Bataclan aucune personne n’a été blessée par les forces d’intervention.
M. le président Georges Fenech. Parfait. Venons-en aux forces de gendarmerie. Le chef du GIGN a essayé d’entrer en contact avec le chef de la BRI de Paris à 22 heures 15 sans être rappelé par lui. Sur ordre du DGGN, ce même chef du GIGN a posté ses troupes à la caserne des Célestins dès 22 heures 45. Pourquoi, face à la situation catastrophique du Bataclan, ne pas les avoir sollicitées ? Je crois connaître votre réponse, mais je pense utile que vous la réitériez.
M. Michel Cadot. Cela a déjà été précisé, il me semble : le GIGN a été mis en alerte à 22 heures 26. Ordonner au GIGN, à 22 heures 45, de se prépositionner à la caserne des Célestins a été une très bonne décision : en cas d’autres attentats dans Paris, il valait en effet mieux que le GIGN se trouve à la caserne des Célestins plutôt qu’à Satory. À 23 heures 15 arrivent à la caserne des Célestins le commandant du GIGN et le commandant de la force d’intervention. Les groupes d’alerte, c’est-à-dire les effectifs, arrivent pour leur part aux alentours de 23 heures 30, à savoir à un moment où les interventions étaient déjà engagées, et depuis longtemps, dans les étages du Bataclan. Le prépositionnement du GIGN est certainement une bonne décision, puisque nous avons intérêt à être capables de faire face à de nouvelles menaces. Je rappelle que toute la soirée a été émaillée de rumeurs d’attaques dans d’autres lieux, et que c’est dans l’hypothèse où ces attaques se seraient avérées qu’il aurait fallu déclencher la FIPN, et qu’une coordination unique aurait été nécessaire : les uns s’occupant du Bataclan, les autres de la gare Saint-Lazare ou d’autres encore des Halles, par exemple. C’est cela, la FIPN : le partage des tâches, sous commandement unique, pour projeter les seuls services à même d’intervenir. Il s’agit de services spécialisés – et la BRI fait partie de ces trois groupes qui, au plan national, ont chacun sa spécialité : ainsi, dans un aéroport, le GIGN est le seul compétent
M. le président Georges Fenech. Nous avons auditionné M. Psenny, journaliste du Monde, qui s’est réfugié, blessé, au quatrième étage d’un immeuble. Il nous a fait état d’un manque de communication entre les officiers présents à l’extérieur, qui avaient pour mission de sécuriser la zone, et le commandement à l’intérieur. Comment peut-on, selon vous, monsieur le préfet, améliorer l’échange d’informations entre les forces qui se situent à l’intérieur et celles qui sont à l’extérieur pour évacuer les blessés ?
M. Michel Cadot. C’est en effet un des défis posés par cette intervention. Cette personne, blessée au bras et à la jambe, qui a appelé à l’aide, était dans un immeuble du passage Saint-Pierre-Amelot. Elle a fait passer le message, qui nous a été transmis – je ne savais pas de qui il s’agissait à ce moment précis –, et j’ai demandé au commandant des opérations de secours (COS) s’il était possible de la faire descendre et de la faire sortir de l’immeuble où elle s’était réfugiée, et depuis lequel elle passait ses appels téléphoniques. Les pompiers sont revenus me dire, au bout de quelque temps, qu’il n’était pas possible d’accéder en toute sécurité au passage, qui faisait partie de la zone d’exclusion dans laquelle, normalement, on ne doit intervenir en secours que dans des conditions de sécurité suffisamment garanties. Or, je le répète, il m’a été assuré qu’il n’était pas possible d’intervenir à ce moment-là.
Comment faciliter ce type de secours à l’avenir ? Une meilleure liaison entre les forces de secours et les forces d’intervention est-elle possible ? Les deux protocoles d’intervention du RAID et de la BRI privilégient la neutralisation des assaillants – et plus que jamais dès lors qu’ils sont prêts à se faire exploser, dès lors que leur démarche est celle de kamikazes. C’est donc prendre un risque très grand que de procéder à des interventions à portée immédiate de tir des preneurs d’otages. Il faut préalablement neutraliser les terroristes. Il était donc très difficile d’envisager une intervention, et l’image du soldat blessé immobilisé entre les tranchées, employée par le général Boutinaud lors de l’audition du 16 mars dernier, correspond assez à la réalité.
Par ailleurs, les précisions données téléphoniquement à la BSPP par ce journaliste sur ses blessures, le fait qu’il pouvait s’exprimer sans difficulté au téléphone, permettaient sans doute aux services de secours de considérer que le délai d’intervention était gérable.
M. le président Georges Fenech. Le général Boutinaud nous a en effet expliqué cette situation.
M. Pierre Lellouche. On peut cependant imaginer qu’il y ait davantage de médecins habitués à une ambiance de guerre, comme ceux de la BRI ou du RAID, donc à même d’aller tout de suite au contact des victimes dans les cas d’urgence. Nous comprenons tous vos impératifs : je parle moi-même avec les pompiers de la rue Blanche, dans ma circonscription. Il ne s’agit pas de transformer les pompiers en cibles, mais le fait de devoir les garer à 300 mètres et d’être incapable, sauf dans des conditions très compliquées, de leur amener les blessés, exige peut-être que l’on revoie le modus operandi, en prévoyant notamment davantage de médecins équipés et protégés, capables d’aller au contact des blessés. C’est peut-être une des leçons que nous pouvons tirer de ces discussions.
M. Michel Cadot. C’est une piste sur laquelle nous travaillons et qui nous semble souhaitable : celle de la professionnalisation des pompiers, pour leur faire partager le risque de l’intervention de manière beaucoup plus étroite. Mais cela suppose des changements fondamentaux : ces pompiers devraient être plus étroitement intégrés aux unités d’intervention et travailler régulièrement avec elles, ce qui n’est pas simple et ne correspondait pas aux protocoles actuels d’intervention.
M. Pierre Lellouche. L’avantage est que les pompiers de Paris sont des militaires.
M. Michel Cadot. Exactement, et cette solution, précisément, serait sans doute plus adaptée à Paris et à la petite couronne. Elle serait beaucoup plus difficile à mettre en œuvre dans les départements de la grande couronne ou du reste de la France, où les services départementaux d’incendie et de secours (SDIS) ne sauraient se conformer à un tel dispositif. Une fois de plus, le dispositif intégré de la préfecture de police de Paris est adapté aux particularités d’une « plaque » parisienne où se concentrent tout de même davantage de risques qu’ailleurs.
M. le président Georges Fenech. Hier, s’est réuni en présence du ministre de l’intérieur un comité de pilotage – auquel, monsieur le préfet, vous avez sans doute participé – à la suite des tragiques événements de Bruxelles, sur la sécurité de l’Euro 2016. Pouvez-vous faire part à la commission d’enquête des stratégies que vous avez pu mettre en place ?
M. Michel Cadot. Pour ce qui est de l’Euro 2016, le premier point concerne la sécurité dans les stades et le dispositif de pré-contrôle et de pré-filtrage. Nous avons adopté ce dispositif dès le lendemain du 13 novembre dans la mesure où il est apparu que, au Stade de France, le schéma de renforcement des précautions et des contrôles avait, dans une large mesure, empêché que les terroristes ne pénètrent dans le stade comme c’était leur projet, même s’il y a eu sans doute des dysfonctionnements dans l’organisation de leur attaque. Depuis, nous avons mis en place, et nous allons l’appliquer au Parc des Princes et au Stade de France pour les matchs de l’Euro 2016, un système de pré-filtrage évitant que ne puissent accéder au contrôle des billets, aux différentes portes d’entrée du stade – où, précisément, les assaillants avaient prévu de venir se faire exploser –, des personnes qui n’auraient pas été fouillées préalablement. Ce système fonctionne bien, mais demande des moyens supplémentaires puisque nous sommes obligés de mobiliser les forces mobiles en plus grand nombre, ce qui sera particulièrement difficile à l’occasion de l’Euro 2016. C’est en tout cas la solution que nous avons retenue, et qui a convaincu le ministre : elle est sûre en ce qui concerne le pré-filtrage et le contrôle dans les stades, pour peu que le nombre d’agents de sécurité et de palpations réalisées soit adapté et dimensionné.
Le second point concerne les fan zones, ces lieux où se rassemblent des dizaines de milliers de personnes pour voir la retransmission des matchs ou pour participer à d’autres événements festifs. Les deux sites envisagés à cette fin dans la région parisienne sont, à Saint-Denis, le parc voisin de la Maison de la Légion d’honneur et de la basilique, lieu assez fermé et relativement facile à sécuriser, et, à Paris, le Champ de Mars, qui requiert, lui, un dispositif très complexe. La mairie a passé une convention avec une société du groupe Lagardère et nous avons une discussion exigeante avec les services et le cabinet de la maire de Paris concernant les effectifs non seulement d’agents de sécurité, mais surtout de personnes chargées d’effectuer des palpations : le but n’est pas, en effet, de disposer simplement d’un nombre défini d’agents de sécurité, mais de pouvoir contrôler les personnes en amont, c’est-à-dire avant qu’elles ne viennent se présenter au contrôle d’entrée dans la zone fermée par des barrières. Le dispositif de palpation devrait être suffisamment fluide pour éviter l’accumulation d’un grand nombre de personnes non contrôlées qui constitueraient évidemment des cibles majeures. A raison de quatre palpations environ par minute, si 92 000 personnes se pressent au Champ de Mars, les effectifs chargés de la palpation devront être importants. Toutes les discussions ne sont pas encore abouties.
Enfin, toujours à propos de l’Euro 2016, il faudra sans doute restreindre le nombre d’événements festifs autour des matchs. Or, on compte énormément de demandes à Paris. Nous allons devoir limiter les possibilités de sécurisation de ces rassemblements, sur un nombre plus restreint d’évènements. Nous avons d’ores et déjà informé les organisateurs de spectacles et les élus que nous ne serons pas en mesure d’en sécuriser un très grand nombre.
M. le rapporteur. Vous avez rappelé, monsieur le préfet, votre expérience en matière de traitement des crises. La BRI a été créée, je crois, avant le RAID et le GIGN. Quant à vous, monsieur le directeur, vous êtes revenu sur l’existence d’une formation commune au RAID et à la BRI. J’ai même cru comprendre que des anciens du RAID étaient membres de la BRI. Pouvez-vous nous apporter des précisions sur ce dernier point ?
À l’Hypercacher, le RAID et la BRI sont intervenus à raison d’un effectif d’une centaine de personnes. Combien, parmi cette centaine de personnes, sont effectivement entrés dans l’Hypercacher ? De même, au Bataclan, j’ai cru comprendre que l’ensemble de la BRI n’avait pas été forcément mobilisé, une partie des hommes restant sur le trottoir ; ces derniers ont-ils eu une mission de sécurisation ? Plus important encore : quand nous nous sommes rendus sur les lieux, le commissaire Molmy nous a indiqué qu’il avait été décidé, à la suite de l’intervention à l’Hypercacher, que les colonnes seraient plus courtes. Son explication nous a fait froid dans le dos : si les kamikazes se faisaient exploser, nous a-t-il dit, les ravages seraient moindres sur la première colonne et, du coup, une deuxième colonne pourrait arriver plus rapidement. Si j’ai bien compris vos réponses, le retour d’expérience conduit à constater qu’il n’est pas nécessaire d’engager énormément de monde, car les hommes risqueraient de se gêner les uns les autres. En attendant que nous interrogions le RAID sur l’opération de Saint-Denis, pouvez-vous nous éclairer sur ce point ?
Comme vous, mon général, j’ai lu la presse, en particulier Mediapart et l’article du Monde d’hier, et je m’en voudrais de ne pas vous interroger sur les critiques concernant l’absence ou le retard des secours à La bonne bière et à la belle équipe. Certaines victimes ont critiqué l’absence de secours à La bonne bière et leur retard à La belle équipe. Le patron de ce dernier établissement a, de fait, déclaré devant nous qu’il s’était écoulé une certaine durée entre les rafales et l’arrivée des secours. Pouvez-vous nous donner les horaires précis, soit maintenant, soit dans un document que vous nous transmettrez ? Pouvez-vous nous apporter des informations sur les éventuels problèmes de connexion radio entre les pompiers et le service d’aide médicale urgente (SAMU) ?
Par ailleurs, la préfecture de police a pris en charge les appels téléphoniques jusqu’au samedi après-midi et le standard, m’a-t-on dit, a « explosé » à quatre reprises au moins. De combien d’opérateurs disposiez-vous, monsieur le préfet, et le plan du 12 novembre instituant la cellule interministérielle d’aide aux victimes (CIAV) prévoyait-il que c’était bien à la préfecture de police de prendre en charge les appels téléphoniques avant que le ministère des affaires étrangères ne prenne le relais ? Avez-vous tiré les conclusions de cette expérience ? Reprendriez-vous à votre charge les appels téléphoniques lors d’une crise similaire ?
Enfin, pouvez-vous nous dire un mot du plan d’équipement des BAC en armements ? Le DGPN nous a indiqué que l’ensemble des BAC allaient être équipées d’ici au mois de juillet. Qu’en est-il à Paris, et plus particulièrement pour les policiers sous votre responsabilité ? La formation au tir a-t-elle été renforcée, notamment depuis les attentats de janvier ?
M. Michel Cadot. Pour ce qui est des appels, en effet, la cellule d’information du public a été activée à partir de minuit-minuit et demie. Cette cellule a immédiatement été équipée par une dizaine de personnes qui ont été rappelées. Vers sept ou huit heures du matin, les effectifs ont été portés à vingt opérateurs, grâce au renfort de bénévoles des associations de protection civile. Il y avait également des représentants du ministère des affaires étrangères, puisque la CIAV relèvera de ce département ministériel. Cette équipe était assez bien dimensionnée pour une crise normale, et la préfecture de police a une grande habitude pour mobiliser rapidement, à savoir en quelques heures, une cellule dédiée exclusivement à la prise des appels. Toutefois, comme vous le savez, nous avons reçu 93 000 appels et seuls 10 000 ont pu être traités. Il y a donc eu un vrai engorgement, comme d’ailleurs, me dit-on, cela s’est produit à Bruxelles dans les toutes premières heures qui ont suivi les attentats. Par la suite, pour en revenir à Paris, le nombre d’appel est retombé à 3 000 ou 4 000, ce qui est très facile à traiter. Les autorités gouvernementales et notamment Mme Méadel annonceront les leçons à tirer de ce dispositif de gestion des appels. Je puis néanmoins d’ores et déjà vous indiquer qu’il est prévu un numéro d’entrée unique, qui sera celui de la CIAV et qui renverra immédiatement vers des cellules spécialisées. Pour ce qui concerne l’information des victimes, c’est la CIAV qui opérera (avec la possibilité de cellules ante mortem, post mortem…). En revanche, les demandes de renseignements ou la communication d’informations d’ordre général, sur l’existence de menaces dans d’autres parties de la ville, par exemple, qui ont été très nombreux et ont noyé le dispositif, seront renvoyés immédiatement vers la cellule d’information du public de la préfecture de police, dont c’est le rôle.
M. le rapporteur. Ces appels seront-ils transférés automatiquement, ou bien les appelants devront-ils composer un autre numéro ?
M. Michel Cadot. Leur appel sera immédiatement basculé sans qu’il leur soit demandé de s’expliquer, ce qui prend du temps et encombre les lignes. Le dispositif est au point et est installé dans les locaux du ministère des affaires étrangères. Le basculement, prévu par la circulaire du 12 novembre, arrivée au petit matin du 14 novembre, n’a pu être appliqué ce même jour avant 19 heures. Le dispositif, interministériel, relève du Premier ministre. J’observe en outre que, à la différence d’autres situations, les téléphones portables ont fonctionné, les réseaux n’ayant pas été saturés. Enfin, en lien avec le cabinet de Mme Méadel, nous creusons l’idée de diffuser des messages sur les réseaux sociaux afin d’éviter les appels inutiles, en indiquant, par exemple, quel comportement adopter. Le 13 novembre, nous avons envoyé seize messages comportementaux sur les réseaux sociaux : « évitez de vous rendre dans tel quartier », « ne téléphonez pas inutilement si vous n’avez pas de raison précise de le faire », etc. Il faut développer cette pratique de manière plus systématique.
J’en viens à la BRI. Elle vient en effet de fêter ses cinquante ans, et si l’âge n’est pas une garantie d’efficacité, il apparaît que cette brigade s’est constamment adaptée ; le renfort de 45 hommes, évoqué précédemment, correspond à cette adaptation constante de progresser et rechercher pour répondre à la difficulté des situations. L’enjeu des rapports entre la BRI, le RAID et le GIGN est de mieux identifier leurs spécialités respectives. Aussi le ministre a-t-il demandé aux deux directeurs généraux et au préfet de police de lui proposer un schéma national d’intervention précisant les conditions de fonctionnement de la FIPN et d’identifier en conditions réelles, c’est-à-dire à partir d’exercices, les moyens que chaque unité est capable de mobiliser. Il ne suffit pas d’annoncer qu’ils sont 80 ou 500 ; il faut savoir quand ils pourront être projetés à Clermont-Ferrand, Paris, Boulogne, Versailles.
Je n’étais pas encore en poste au moment de l’opération menée à l’Hypercacher, et je me garderai donc de tout commentaire. J’ai cependant l’impression, en voyant les photos, qu’il y avait beaucoup de monde, et j’ai la conviction absolue, depuis que j’ai assisté sur place, à 4 heures 30, à l’assaut mené à Saint-Denis, que, pour ce type d’opération, il faut être très rigoureux quant au respect des zones. À Paris, nous disposons, entre le recours au RAID et au GIGN, les moyens de primo-intervention que sont la BAC ou la CSI, de beaucoup de possibilités. Les effectifs mis en place doivent donc être proportionnés à chaque cas : c’est la leçon qu’on peut tirer de ces expériences. S’agissant du Bataclan, je suis profondément convaincu que l’effectif spécialisé pour l’assaut était adapté à une intervention rapide permettant de neutraliser les preneurs d’otages sans mettre ces derniers en danger, et ce dans une configuration du bâtiment rendant compliquée la progression des colonnes.
M. Christian Sainte. Nous avons vécu deux drames, deux assauts l’année dernière : celui de l’Hypercacher en janvier et celui du Bataclan en novembre. Nous pouvons en tirer deux enseignements.
En ce qui concerne l’Hypercacher, on voit sur le film des événements les deux colonnes intervenir : d’un côté le RAID, de l’autre la BRI. Il n’y a pas besoin d’être un grand spécialiste pour constater qu’il y a beaucoup d’intervenants, qu’il y a un embouteillage. Le nombre n’est donc pas forcément un gage d’efficacité ni de succès.
Pour ce qui est de l’intervention de novembre au Bataclan, c’est le besoin de réactivité, de rapidité, qui est l’enseignement à retenir. On peut en effet intervenir avec une quinzaine d’opérateurs, ainsi qu’il vous a été indiqué. Une vingtaine, c’est mieux, mais avec une quinzaine on peut déjà agir.
Il faut par ailleurs avoir à l’esprit que nous raisonnons-là à partir de deux opérations qui n’ont duré que quelques heures. Mais, dans le cas d’une prise d’otages plus longue– je pense à ce qu’il s’est passé à Moscou il y a plusieurs années –, il faut être capable de régénérer les effectifs. C’est un troisième enseignement.
Il n’est donc pas nécessaire, j’y reviens, d’engager de nombreux fonctionnaires qui vont se précipiter, au risque que des coups de feu partent de manière accidentelle.
M. le président Georges Fenech. Mon général, pouvez-vous répondre à la question posée sur le retard des secours à La belle équipe, dont fait état le journal Le Monde ?
Général Philippe Boutinaud. Je sais que Mediapart avait expliqué que les pompiers n’avaient pas été assez rapides. Je vous ai expliqué, lors d’une précédente audition, que les secours sont arrivés sur tous les sites dans un délai compris entre trois et douze minutes. Les interventions ont eu lieu au sein d’un périmètre dont la surface était de moins de quatre kilomètres carrés, les secours venant des casernes situées à proximité. Or, en moins d’une demi-heure, cinq sites ont été frappés, et les adresses qui nous sont données étaient très imprécises.
Il est vrai qu’il y a eu un problème à La bonne bière. La distance entre cet établissement et Le petit Cambodge est d’environ 500 mètres. Nous avons manqué d’unités mobiles hospitalières (UMH), c’est-à-dire de véhicules avec des médecins. En effet, nous avions ce soir-là sept ambulances de réanimation et, en une heure, nous sommes passés à 21. En attendant, nous avons immédiatement envoyé quatre de ces ambulances au Stade de France – la BSPP est compétente pour les trois départements de la petite couronne – et les trois autres sont parties pour Le petit Cambodge. Quand survient l’attentat à La bonne bière, les pompiers ne disposent déjà plus de moyens médicalisés, c’est donc le SAMU qui prend le relais. Le patron de La bonne bière a été choqué que le premier pompier qu’il a vu arriver n’ait aucun équipement avec lui : c’était normal, puisqu’il s’agissait de mon adjoint, qui était de sortie à Paris et qui, en arrivant, lui a dit qu’il était pompier. Il n’en a pas moins déclenché le plan « Rouge Alpha ». La petite bière est l’endroit, je le rappelle, où il y a eu le moins de morts. De plus, les cinq personnes décédées étaient hélas dans un état trop grave pour être sauvées. J’ai lu Mediapart et d’autres journaux, et je pense que certains, y compris ici, ont été influencés par les déclarations péremptoires des médias ; c’est donc à vous que je rends des comptes.
M. le rapporteur. Mon général, pouvez-vous nous envoyer des éléments précis sur La bonne bière et sur La belle équipe ? Nous ferons, bien sûr, la même demande aux responsables du SAMU. Il est important que la commission d’enquête puisse répondre, dans son rapport, à ces critiques.
M. François Lamy. Mes questions seront très pratiques.
Monsieur le préfet, vous estimez-vous suffisamment informé sur la réalité des menaces, en particulier concernant des salles de spectacle parisiennes ? Est-il possible de concevoir un plan de « verrouillage » de la ville de Paris ?
D’autre part, quand vous êtes sur le terrain, vous ne vous trouvez, par définition, ni dans la salle de commandement ni, a fortiori, avec le ministre de l’intérieur, le Premier ministre ou le Président de la République. Ne considérez-vous pas que c’est un problème ? Les militaires que nous avons auditionnés nous ont indiqué que le chef d’état-major restait avec son état-major et que c’était un colonel qui allait sur le terrain.
Enfin, ne serait-il pas plus efficace de fusionner, à terme, une partie de la DRPP, en tout cas celle qui s’occupe du terrorisme, avec la DGSI ?
M. le président Georges Fenech. Si vous me permettez, monsieur le préfet, je souhaite compléter la première question de M. Lamy. J’ai sous les yeux un procès-verbal daté du 6 mai 2009, rédigé par ce qui était alors la direction centrale du renseignement intérieur (DCRI), délivré par le vice-procureur de la République de Paris : « Des informations parvenues au service, il appert que la cible du projet d’attentat fomentée par Farouk Ben Abbes, interpellé le 3 avril 2009 par les autorités égyptiennes pourrait s’identifier à un bâtiment de la communauté israélite de la ville de Saint-Denis. Toutefois, au cours de ses différentes auditions, Farouk Ben Abbes aurait proposé la salle de spectacle du Bataclan, située dans le 11e arrondissement de Paris. Selon l’intéressé, le choix s’est porté sur ce lieu en raison de manifestations de soutien et de collectes de fonds réalisées au profit de la communauté juive. » En outre, lors de son audition, Me Olivier Morice, qui s’étonnait de tout cela, a fait état de l’arrestation, à la mi-août 2015, d’un djihadiste français de retour de Syrie qui avait pour projet de commettre un attentat contre une salle de spectacle à Paris. On peut faire le lien entre les deux.
La question que se posent les victimes, et qu’évidemment nous nous posons, est de savoir quelle exploitation a été faite de cette information. En avez-vous tenu compte ? Pourquoi, nous demande-t-on, n’avoir pas informé les propriétaires du Bataclan de ces menaces précises, qui ont fait l’objet, il y a un certain nombre d’années, d’un procès-verbal ?
M. Michel Cadot. Avons-nous, à la préfecture de police, une bonne information sur la réalité des menaces ? Les services de renseignement, qu’il s’agisse de la DGSI ou de la DRPP, nous donnent-ils suffisamment d’éléments ?
Tous les éléments d’information, à commencer par ce que nous appelons les signaux faibles – c’est-à-dire des messages remontant des différents acteurs et notamment des commissariats –, sont systématiquement suivis d’effets. Chaque semaine, nous recevons des dizaines de signalements qui font l’objet de vérifications – plaques minéralogiques, domicile, identité… – pour creuser toute information sur des risques potentiels. Ensuite, en fonction des informations provenant de la direction générale de la sécurité extérieure (DGSE), notamment des éléments provenant des stratégies, des discours, des publications de DAECH, des mesures sont prises concernant les cibles potentielles.
Entre mon arrivée à la préfecture de police, le 20 juillet 2015, et le 13 novembre, je n’ai eu connaissance d’aucune menace précise concernant des salles de spectacle – nous les avons en revanche, par la suite, sécurisées de façon beaucoup plus large – ni visant en particulier le Bataclan. Je ne sais pas à quel moment ni dans quelles conditions, entre 2009 et 2015, il a été jugé que les mesures de protection qui ont dû être prises à l’époque étaient moins pertinentes. La menace n’était d’ailleurs pas la même…
M. Pierre Lellouche. Le renseignement ne vous a-t-il pas été transmis ?
M. Michel Cadot. Il a dû être transmis en 2009.
M. Pierre Lellouche. Il existe tout de même des banques de données !
M. Michel Cadot. Nous allons vérifier, mais je suis convaincu qu’en 2009 il était partagé par la communauté du renseignement, cela me paraît évident.
M. le président Georges Fenech. C’est un point à vérifier.
M. Michel Cadot. L’enquête judiciaire pourra le confirmer.
M. Pierre Lellouche. Le service de renseignement conserve la trace des menaces contre différentes cibles et des attaques, et ce pendant des années, sans quoi il ne pourrait pas travailler. Ce n’est pas une question d’ordre seulement judiciaire, mais une question qui touche vraiment au renseignement et concerne donc la commission d’enquête. La question est de savoir si cette information a bien été transmise à vos services – et j’en reviens à la question de M. Lamy : ne serait-il pas astucieux de regrouper certains services pour en améliorer le fonctionnement ?
M. Michel Cadot. Je ne dis pas qu’elle n’a pas été transmise, mais que, pour ma part, je n’en ai pas eu connaissance entre juillet et novembre 2015. Cette information remontait à 2009. La menace est multiforme : des équipes sont diligentées par DAECH depuis la Syrie et font l’objet de circuits d’information et de surveillance spécifiques ; d’autres agissent de façon plus individuelle, comme ce fut le cas dans le Thalys. Le niveau de menace n’est pas exclusivement centré sur une forme d’attaque. À moins que vous ne posiez la question au directeur du renseignement de la Préfecture de police, je l’interrogerai moi-même et nous vous communiquerons une note précisant dans quelles conditions l’information du 6 mai 2009 a été connue de la préfecture de police.
M. le président Georges Fenech. Son audition est prévue.
M. Michel Cadot. J’en viens à la présence du préfet de police sur le lieu des opérations. Le préfet de police a le privilège d’avoir auprès de lui, sous son autorité directe, trois préfets : le préfet secrétaire général de zone, le préfet directeur de cabinet et le préfet secrétaire général de la préfecture. Bien évidemment, quand le préfet de police est sur le terrain, il est prévu que le directeur de cabinet dirige le COPP. Il se trouve que, cette nuit-là, le préfet directeur de cabinet était en train de faire un stage à Saint-Astier auprès de la Gendarmerie nationale. Il est immédiatement revenu et est arrivé à Paris à cinq heures du matin. Le préfet SGZDS, le directeur-adjoint du cabinet et le chef de cabinet étaient bien sûr sur place. Donc, en situation de crise, la présence du préfet de police sur le terrain ne gêne en rien le fonctionnement du centre de commandement.
S’agissant de la relation du préfet de police avec le ministre de l’intérieur, ce dernier a besoin d’être très vite informé, car ce sont les premières minutes qui comptent. Or, en la matière, la présence du préfet de police sur le terrain est très souhaitable. Si nous faisons face à une crise à cinétique courte, comme cela a été le cas au Bataclan, cette présence est maintenue jusqu’au bout. Lorsqu’une opération dure plusieurs journées, comme en janvier 2015, la situation est différente. Le préfet de police est alors conduit à participer à des réunions avec le ministre de l’Intérieur, et c’est le directeur de cabinet qui, pendant ce temps, assure à la préfecture la mise en œuvre des instructions prises.
Au Bataclan, l’enjeu était que l’opération de prise d’otages se termine au plus vite et dans les meilleures conditions, ce qui a nécessité deux heures, deux heures et demie environ ; il était par conséquent préférable, j’y insiste, que je sois sur place pour informer le ministre et faciliter les prises de décisions. En outre, nous n’avions pas à coordonner plusieurs lieux, à la différence des opérations du mois de janvier 2015 où, pour préserver la vie des otages, il a fallu coordonner l’opération de Dammartin-en-Goële et celle de Vincennes.
De ce point de vue, je pense que l’organisation actuelle est parfaitement armée pour faire face à la fois à une présence du préfet auprès du ministre si celui-ci souhaite réunir autour de lui ses directeurs et le préfet compétent, et à une présence du préfet sur le terrain quand elle est nécessaire. Bien entendu, le procureur était sur place à mes côtés et n’était pas au « fumoir », comme il peut l’être à d’autres occasions, lorsque les opérations durent longtemps et nécessitent qu’on réfléchisse à une stratégie d’action sous l’autorité du ministre.
Enfin, vous m’autoriserez à considérer que l’idée d’une fusion entre la DRPP et la DGSI dépasse mon niveau de compétence... J’observe cependant que plusieurs gouvernements successifs se sont posé la question et qu’aucun n’a retenu cette solution, sans doute parce que, dans la région parisienne, le territorial a du sens, et que confier des responsabilités territoriales à des directions centrales, fût-ce la DGPN ou la DGSI et malgré leur grande qualité, n’est sans doute pas toujours une bonne chose. Les directions centrales doivent fixer des orientations, vérifier que celles-ci sont bien mises en œuvre, évaluer la réussite des actions de terrain, mais il faut que les décisions se prennent au niveau territorial afin de faciliter la coordination.
M. Philippe Goujon. Je retiens la formule du préfet de police : à Paris, le territorial a du sens. Ma petite expérience de douze années en tant qu’adjoint au maire de Paris chargé de la sécurité m’amène à penser qu’il est indispensable que l’ensemble des forces de sécurité soient, à Paris, et désormais dans la zone de la police d’agglomération, commandées – hormis, peut-être, pour ce qui est du renseignement, sujet que nous étudierons ultérieurement – par un seul chef, ce qui permet de mesurer l’engagement des moyens et d’éviter la concurrence des forces, ce qui serait la pire des choses. Aussi, pour ce qui est de la cohésion, de la coordination, du commandement, de l’efficacité, de l’optimisation des forces, l’institution et l’organisation de la préfecture de police avec à sa tête un seul chef, me paraît-elle un marqueur, depuis deux siècles, de notre histoire, et en particulier de celle de la République.
Vous avez évoqué, monsieur le préfet de police, comme l’ont fait la DGGN avec les pelotons de surveillance et d’intervention de la gendarmerie (PSIG) ou la DGPN avec les BAC, l’équipement, l’entraînement, le renforcement des conditions de riposte des unités. Je souhaite savoir ce que vous prévoyez pour les commissariats d’arrondissement. Ces derniers peuvent également, en effet, se trouver confrontés à des situations de ce type et être les primo-intervenants. Il est donc prévu que leur soient attribués les moyens dont ils manquent pour ce faire : armements, équipements lourds… On a bien vu en effet, à l’occasion de l’attentat contre la rédaction de Charlie Hebdo, que les policiers ne disposaient pas des équipements nécessaires, ni dans leur véhicule, ni sur eux.
Vous avez mentionné les fan zones et je ferai part d’une inquiétude à ce sujet. Nous sommes en guerre, pour reprendre les termes mêmes du Premier ministre, et je pense que nous prenons un risque peut-être excessif à maintenir un rassemblement de 100 000 personnes tous les jours, toute la journée, de dix heures à minuit, pendant un mois, sous la Tour Eiffel, en plein cœur de Paris, même si sont mises en place des conditions de sécurité que nous avons d’ailleurs évoquées. Ne prend-on pas le risque, en maintenant les fan zones, que la fête se transforme en cauchemar ? À l’intérieur ne se trouveront pas, en effet, des policiers, mais des stadiers, des animateurs. La police, qui se trouvera autour de la zone, devra mobiliser un personnel nombreux ; elle a peut-être autre chose à faire que de déployer des effectifs pour les fan zones.
M. Pierre Lellouche. Je suis totalement d’accord.
M. Michel Cadot. Le ministre a de nouveau demandé aux préfets de vérifier dans chaque département, avec les élus, les conditions de sécurisation qui permettent d’envisager l’autorisation des fans zones. Les discussions n’ont pas encore abouti sur ce point à Paris.
En ce qui concerne les commissariats, le choix qui a été fait est très clair : les primo-arrivants sont en principe les patrouilles du « 17 police secours » ; il s’agit d’unités d’interventions élémentaires et, en cas d’une attaque, leur rôle est de fixer la situation et d’alerter ; normalement, ils ne doivent pas intervenir et ne peuvent qu’exceptionnellement se trouver en situation de primo-intervenants. Les primo-intervenants sont plus normalement les BAC ou les CSI, unités d’intervention intermédiaire ; viennent ensuite les services d’intervention spécialisée, c’est-à-dire la BRI à Paris, le RAID dans les départements de la petite couronne, la FIPN dans le cas d’une multiplication du nombre de sites touchés par des attentats. Ce sont plutôt des équipements de protection qui sont prévus pour les commissariats et non des armements.
M. Jacques Méric, directeur de la sécurité de la police d’agglomération. Vous avez tout à fait raison, monsieur le député, de poser la question des commissariats de Paris, auxquels on pourrait d’ailleurs ajouter ceux de banlieue. Le préfet vient de préciser qu’ils sont les primo-intervenants. Cela a été le cas non seulement pour l’attentat contre la rédaction de Charlie Hebdo, mais également le 13 novembre. On a, à juste titre, beaucoup parlé des BAC, mais le premier véhicule à intervenir, au Bataclan, a été un véhicule du commissariat du 3 arrondissement, qui était en train de traiter un accident de la circulation non loin de là et qui s’est dérouté vers le Bataclan alors que la prise d’otages venait de commencer.
M. Meyer Habib. À quelle heure exactement l’action des terroristes a-t-elle commencé au Bataclan ?
M. Jacques Méric. Sauf erreur, nous avons reçu les premiers appels à 21 heures 43.
Ces personnels de commissariat, dotés d’équipements que je qualifierai de classiques – gilets pare-balles discrets, pistolets SIG-Sauer… –, ne sont pas outillés pour faire face à des attaques terroristes menées par des personnes lourdement armées. Nous avons donc décidé de les doter d’équipements de protection de trois types : casque balistique avec visière, afin d’être protégé de tirs d’armes à feu, gilet porte-plaque, dans lequel on insère des plaques de céramique permettant de protéger des balles d’un fusil d’assaut, enfin bouclier balistique souple qui, déployé, permet également d’être protégé contre des tirs d’armes telles qu’une kalachnikov. Il s’agit d’un investissement lourd, compte tenu du nombre de policiers concernés.
M. Philippe Goujon. Les dotations se feront-elles par commissariats ?
M. Jacques Méric. Nous sommes allés plus loin et avons envisagé des dotations quasi-individuelles.
Il faut savoir que seule la partie doublée de céramique du bouclier balistique arrête les balles d’une kalachnikov. Cela signifie qu’il faudra prévoir des formations pour les personnels, afin qu’ils prennent conscience que leurs équipements ne les protégeront pas de tout. Un casque balistique lourd avec visière balistique, par exemple, ne protège pas d’une balle de kalachnikov ; aucun type de casque, du reste, n’arrête les balles de kalachnikov.
M. Pierre Lellouche. Je reviens sur l’information selon laquelle le Bataclan était une cible dès 2009. Il me semble très important que nous ayons un éclairage sur ce point, car cela en dira long sur l’état de nos services de renseignement, d’autant que, je le rappelle, des salles de spectacle avaient déjà été visées dans d’autres pays.
Au fil des auditions, monsieur le préfet, j’ai été frappé par le fait qu’un certain nombre d’intervenants nous ont dit avoir appris les choses par BFM TV. J’ai failli tomber de ma chaise en entendant cela. Si des forces d’intervention, professionnelles, ont BFM TV pour moyen d’information, c’est que, d’une certaine façon, il n’y a pas de centre de commandement ! Or, si nous nous trouvons, comme je le crois et comme le dit le Premier ministre avec raison, dans un contexte de guerre longue contre le terrorisme, avec différentes formes d’attaques, vous avez fortement intérêt à vous doter d’un commandement des opérations spéciales (COS), à l’instar de celui dont disposent les militaires, opérationnel vingt-quatre heures sur vingt-quatre et sept jours sur sept, où arrive le renseignement et où quelqu’un soit en mesure de transférer des ordres d’alerte afin qu’une riposte soit immédiatement préparée sans attendre qu’on apprenne les choses par la télévision ou la radio. Le tâtonnement est certes compréhensible : on ne passe pas de l’état de paix à l’état de guerre du jour au lendemain. Avez-vous néanmoins prévu de constituer un centre de commandement qui permette de mettre immédiatement les forces en branle ?
À propos des secours, une autre question me taraude : celle des armes chimiques. Hier, à Bruxelles, à l’occasion d’une perquisition, on a trouvé des armes chimiques. Comme on sait que ce type d’armes est couramment utilisé par DAECH…
M. le rapporteur. Il s’agissait de produits chimiques.
M. Pierre Lellouche. En effet, il s’agissait de produits chimiques, mais qui suffisent pour fabriquer une bombe « sale » dans la perspective d’un attentat terroriste. Il n’était pas question de miniaturiser une tête chimique pour un missile.
M. le rapporteur. Il s’agissait de produits permettant la confection d’explosifs et non destinés à la fabrication d’une bombe « sale ».
M. Michel Cadot. Pour ce qui est du centre de commandement, l’endroit où l’information remonte le plus vite est le PC de la DSPAP qui reçoit et traite les appels « 17 police secours ». Nous avons décidé, dans une telle situation, de faire venir immédiatement sur place un représentant du RAID et un représentant de la BRI comme officiers de liaison au sein de ce centre de commandement. Par ailleurs, nous avons activé le dispositif de montée en charge du COPP, ce qui se fait en quelques minutes puisque chacun des centres de commandement envoie un responsable auprès du centre de commandement du préfet de police, qui est dirigé, si celui-ci se trouve sur le terrain, par son directeur de cabinet.
M. Pierre Lellouche. Ce centre se trouve-t-il à la préfecture de police ?
M. Michel Cadot. Il se trouve à la préfecture de police. Nous pourrons vous faire visiter, si vous le souhaitez, les salles de commandement.
Pour ce qui est de la réception des appels, les policiers de la DSPAP sont regroupés avec les pompiers de la BSPP, puisque nous avons établi une plateforme unique d’appel qui permet de faire remonter dans la même salle les informations du « 17 » et du « 18 ». C’est donc là, je le répète, que l’information arrivera le plus vite. L’exploitation des très nombreux appels, d’origine très diverse, reçus au cours du premier quart d’heure, n’est pas toujours simple. Nous nous sommes ainsi mis d’accord pour que les trois forces – BRI, RAID et GIGN – aient l’information en direct.
M. Pierre Lellouche. Quand ce dispositif a-t-il été mis en place ?
M. Pierre Cadot. Dès après le 13 novembre. Auparavant, le circuit était celui prévu par la circulaire de 2014.
M. Serge Grouard. Monsieur le préfet, comment allez-vous gérer durablement le déploiement de dispositifs tels que celui de l’Euro 2016 ? Les effectifs mobilisés vont bien devoir se reposer. Face à une menace diffuse, comment l’ensemble des forces de sécurité pourront-elles assurer une mobilisation aussi durable ? Je crains qu’il ne faille déshabiller Pierre pour habiller Paul.
M. Meyer Habib. Nous saluons tous le courage et le professionnalisme des forces. La perfection, en revanche, est hors d’atteinte : plus de cent personnes ont perdu la vie, et notre commission vise précisément à explorer des pistes d’amélioration.
Le moment-clé du 13 novembre me semble s’être produit à 21 heures 57, lorsqu’un fonctionnaire de la BAC a abattu l’un des terroristes à l’intérieur du Bataclan. C’est entre 21 heures 43, moment de leur entrée dans le Bataclan, et 21 heures 57 – soit quatorze minutes plus tard – que les terroristes ont abattu près de cent personnes et fait beaucoup de blessés. Après 21 heures 57, en revanche, plus un seul coup de feu n’a été tiré. Autrement dit, le tir du policier de la BAC a interrompu un massacre qui aurait pu être bien plus grave encore.
Le RAID est préparé à agir en cas de prise d’otages, lorsqu’une négociation est envisageable ; en l’occurrence, ces terroristes ne font que tuer et tuer encore. La seule solution, comme me l’ont confirmé des Israéliens, qui en savent quelque chose, semble donc d’aller au contact le plus vite possible. Le 13 novembre, le coup de feu du policier – qui, s’il ne l’avait pas tiré, aurait été tué sur-le-champ – a tout changé.
Autre question : à combien d’événements simultanés sommes-nous capables de faire face ? Je crois, hélas, que nous ne sommes qu’au début d’une série d’attaques qui, à l’avenir, pourraient se produire simultanément par dix, quinze ou davantage. Songez qu’environ 15 000 messages libellés « Je suis Kouachi » ou « Je suis Coulibaly » ont été diffusés sur Twitter après les attentats de janvier. À supposer que quelques centaines de terroristes se coordonnent, à combien d’attentats pourrions-nous faire face ?
Certains policiers nous ont dit savoir que les assaillants se trouvaient à l’étage du Bataclan ; d’autres nous ont dit le contraire. Il va de soi que les pompiers ne doivent pas s’exposer aux tirs, mais n’aurait-il pas été possible d’agir plus vite – l’assaut s’est produit deux heures après le tir du policier de la BAC – pour éviter que des personnes blessées ne meurent ? Saviez-vous où les terroristes se trouvaient, et leur localisation aurait-elle permis de faire entrer les secours plus rapidement pour sauver certains des très nombreux blessés ?
M. Michel Cadot. Concernant notre capacité à répondre durablement à des sollicitations multiples et sans doute de plus en plus lourdes, reconnaissons d’emblée, comme l’a souvent répété le ministre, que le risque zéro et la garantie d’une sécurisation absolue n’existent pas. Notre exigence est de donner un maximum d’efficacité aux dispositifs de prévention et de renseignement et aux mesures d’action immédiate en cas d’attaque. Pour ce faire, il nous faut nous interroger sur certains dispositifs statiques qui sont très consommateurs d’effectifs sans pour autant répondre pleinement à la mobilité de l’adversaire et à l’effet de surprise qu’ils recherchent ; au contraire, ils peuvent constituer des cibles faciles et, de ce point de vue, l’utilité d’une garde statique privée devant le Bataclan, si elle avait existé, n’est pas évidente.
Surtout, nous devons envisager un dispositif comprenant des mesures de protection périmétrique et situationnelle dans certains lieux recevant du public, avec des procédures de filtrage et de contrôle, voire la présence d’un personnel de sécurisation armé, orientation nouvelle dans notre pays, qui a déjà été expérimentée une ou deux fois, qui est explorée actuellement par d’autres grands groupes gérant des lieux recevant un public nombreux. Pour accroître notre réactivité, il faut aussi développer la vidéoprotection à l’échelle zonale. Sur la plaque parisienne, c’est la région Île-de-France qui constitue l’échelle pertinente. Lorsque les terroristes interviennent sur Paris ou quittent la capitale, nous devions être en mesure de croiser et d’exploiter les données recueillies par les services de renseignement, ceux qui sont chargés de la circulation et de l’ordre public, les commissariats et la police judiciaire. Nous avons donc élaboré un plan zonal de vidéoprotection, pour lequel le ministre a mobilisé un budget de 15 millions d’euros. À Paris, nous allons ainsi quadrupler la surface d’espace public surveillé, en ciblant notamment les grands axes de circulation, les réseaux de transports, y compris de surface, et en intégrant au plan de vidéoprotection pour Paris (PVPP) les réseaux des centres commerciaux et des collectivités qui en disposent. Nous allons également améliorer l’exploitabilité des données en affinant les techniques de détection des comportements anormaux et fébriles, ainsi que de reconnaissance faciale.
En clair, nous devons nous placer dans une situation de guerre longue et adapter nos moyens en conséquence, en réfléchissant notamment, avec les militaires, au renforcement des patrouilles dynamiques au détriment des gardes statiques, tout en préservant le même niveau de sécurité dans les îlots de proximité les plus concernés par la menace.
M. Christian Sainte. S’agissant de notre capacité à faire face à plusieurs événements simultanés, nous partageons évidemment votre inquiétude. Au Bataclan, les terroristes étaient armés de plusieurs centaines de munitions. Or, lorsque le commissaire Molmy et sa colonne sont arrivés, nous ignorions combien de terroristes se trouvaient sur les lieux et leur positionnement exact. Ce n’est que vers 23 heures 10 qu’ils ont pu être situés par des gens qui les désignaient. Si la colonne a progressé à petits pas, c’est parce qu’elle a dû prendre toutes les mesures nécessaires de protection des policiers et des victimes. Dans de telles circonstances, il était difficile d’aller plus vite.
M. Michel Cadot. Le poste de commandement, où je me trouvais, a même reçu des messages selon lesquels les terroristes progressaient sur les toits.
M. Christian Sainte. En effet, alors qu’ils n’y sont jamais montés.
La BRI pourrait intervenir sur trois sites simultanés. En cas de prises d’otages ou de sites d’attaques supplémentaires, elle devrait demander le renfort d’autres forces.
M. Michel Cadot. Dans un tel cas de figure, l’agglomération parisienne est le seul territoire du pays qui dispose d’une capacité de moyens spécialisés d’importance en s’appuyant sur la BRI, le RAID et le GIGN. Le pays doit aussi renforcer sa capacité de projection rapide sur les grandes et moyennes villes de province, dans lesquelles les questions de coordination entre forces ne se poseraient pas dans les mêmes termes en cas d’attaques multiples, bien au contraire : le RAID ou le GIGN seraient en effet contraints d’y projeter leurs moyens, tandis qu’il appartiendrait à la BRI de sécuriser la capitale.
M. Meyer Habib. Face à de tels massacres, n’est-il pas préférable de sauter l’étape de la sécurisation pour aller immédiatement au contact afin de limiter le nombre de victimes ?
M. Michel Cadot. La doctrine prévoit en effet d’aller directement au contact et de neutraliser au plus vite les assaillants. Pour ce faire, il faut qu’une colonne organisée soit en place, ce qui fut le cas au Bataclan vers 23 heures. Lorsque cette colonne, au fil de sa progression, s’est retrouvée devant la porte fermée de la pièce dans laquelle des otages étaient retenus, un début de négociation s’est engagé. En effet, les tirs s’étaient interrompus ; il n’était donc pas indispensable d’agir immédiatement, avant même d’avoir mis à l’abri les victimes qui se trouvaient encore au rez-de-chaussée. Des centaines de personnes ont ainsi pu être évacuées pendant que les terroristes étaient fixés à l’étage. S’il faut en effet intervenir au plus vite, il faut également permettre l’évacuation des blessés quand c’est possible.
M. Christian Sainte. Pour intervenir plus rapidement et dans les meilleures conditions de sécurité, il n’est pas nécessaire que la force d’intervention rapide (FIR) se compose de trente ou quarante agents ; un effectif nominal de quinze personnes suffit.
M. Olivier Marleix. Après votre arrivée au Bataclan à 22 heures 15, monsieur le préfet, avez-vous eu des échanges téléphoniques avec le ministre de l’intérieur pour l’informer du dispositif opérationnel dans lequel la BRI agissait en force menante et le RAID en force d’appui ?
D’autre part, je peine à comprendre le pilotage de la coordination du renseignement. En juin, le Premier ministre aurait, selon la presse, chargé le ministre de l’intérieur de coordonner lui-même le renseignement dans le cadre d’un « état-major opérationnel », dont je suppose qu’il se réunit au « fumoir ». Autrefois, c’est à l’UCLAT qu’incombait cette mission, sous l’autorité du directeur général de la police nationale, ce qui permettait notamment les échanges avec la DGSE ; vous avez également évoqué une structure relevant de la DGSI. Comment cette coordination fonctionne-t-elle, et à quelles instances participez-vous en tant que préfet de police ?
M. Michel Cadot. Il va de soi que j’ai eu plusieurs échanges téléphoniques avec le ministre après 22 heures 15, afin de l’informer de la situation telle que nous la percevions de l’extérieur du bâtiment et de celle qui prévalait sur les autres sites de fusillade. Je l’ai informé de l’arrivée de la BRI environ une demi-heure plus tard, et du fait qu’elle se préparait à progresser pour mener l’assaut contre les assaillants. Sans développer le détail des moyens engagés et de la répartition des actions de la BRI et du RAID, je l’ai informé dès que la phase d’assaut était engagée.
La réunion « fumoir » que nous évoquions a rassemblé autour du ministre les directeurs compétents des zones relevant respectivement de la gendarmerie, de la DGPN et de la préfecture de police, afin de piloter le suivi des renseignements obtenus. Elle s’est reproduite au même format après le 13 novembre, sur l’échange de renseignements, le ministre étant tenu informé par les services des actions engagées à la suite des attentats.
L’état-major opérationnel de protection du territoire (EMOPT) est une structure opérationnelle tout à fait distincte. Elle est composée d’une dizaine d’agents qui recensent et traitent les dossiers des personnes inscrites au fichier FSPRT, que les préfets de zone alimentent chaque semaine par des tableaux recensant les signalements recueillis dans chaque département. Nous travaillons en lien avec elle lors de réunions régulières autour du ministre.
Mme Marianne Dubois. Peut-on déjà tirer quelques enseignements complémentaires des attentats qui viennent de se produire à Bruxelles, qu’il s’agisse du mode opératoire des terroristes ou de la réaction des forces de sécurité, afin de nourrir notre propre réflexion ?
M. Michel Cadot. J’observe d’emblée un élément nouveau : pour la première fois, les terroristes ont utilisé des explosifs, en grande quantité, placés dans des valises, contrairement à ce qui s’est produit à Paris. Il va de soi que cela pose des questions relatives aux mesures de contrôle à l’entrée des gares, des aéroports et des stations de métro.
M. Christian Sainte. Les équipements utilisés à Bruxelles étaient les mêmes qu’en novembre : des armes à feu de type kalachnikov et de l’explosif artisanal de type TATP, fabriqué avec des produits chimiques assez aisément accessibles. J’observe, quant à moi, la quantité importante de produit utilisé et la parfaite maîtrise qu’ont les terroristes de sa conception, alors qu’il s’agit d’un explosif instable. Le recours à des valises, et non à des gilets, leur a permis d’en utiliser davantage, d’où les dégâts matériels dans l’aérogare et dans le métro, qui est éventré. En outre, des clous et des boulons auraient également été employés.
M. Patrice Verchère. Chacun constate que vous tâchez de tirer tous les enseignements du 13 novembre et que l’intervention a été correcte, compte tenu de l’ampleur des attentats et de la multiplicité des sites. Toutefois, nous savions depuis plusieurs années déjà que le risque terroriste était très élevé et, au cours des mois qui ont précédé le mois de janvier 2015, tout indiquait que des attentats se produiraient prochainement. Surtout, nous savons qu’il y aura d’autres attentats de grande ampleur. Comment vos services se sont-ils préparés depuis le 7 janvier dernier à répondre à de tels attentats de grande ampleur, hélas prévisibles ?
M. Michel Cadot. Tout d’abord, les moyens humains et matériels du renseignement et de la police judiciaire – les deux directions de lutte antiterroriste – ont été renforcés grâce à un réel effort budgétaire consenti à l’initiative du ministre, effort qui porte déjà ses premiers fruits. Ensuite, la procédure dite EVENGRAVE, applicable en cas d’événement grave, a contribué à l’efficacité de l’intervention le 13 novembre puisqu’elle a été élaborée conjointement avec toutes les directions de la préfecture de police, qui ont ainsi pu se l’approprier et préparer sa mise en œuvre avant même sa publication – laquelle n’a d’ailleurs eu lieu que quelques jours après le 13 novembre. Nous l’avons actualisé avec les enseignements tirés des attentats du 13 novembre.
M. le rapporteur. Les terroristes du Bataclan ont-ils commis des décapitations ou des mutilations ? Des décès se sont-ils produits autrement que par fusillade ou explosion ? Nous sommes saisis d’informations contradictoires – dont certaines nous ont été communiquées lors de nos auditions – qu’il faut éclaircir.
M. le président Georges Fenech. En effet, la commission est troublée par ces informations, qui n’ont filtré nulle part. Ainsi, le père de l’une des victimes m’a adressé la copie d’une lettre qu’il a transmise au juge d’instruction, que je cite en résumant : « Sur les causes de la mort de mon fils A., à l’institut médico-légal de Paris, on m’a dit, et ce avec des réserves compte tenu du choc que cela représentait pour moi à cet instant-là, qu’on lui avait coupé les testicules, qu’on les lui avait mis dans la bouche, et qu’il avait été éventré. Lorsque je l’ai vu derrière une vitre, allongé sur une table, un linceul blanc le recouvrant jusqu’au cou, une psychologue m’accompagnait. Cette dernière m’a dit : ‟La seule partie montrable de votre fils est son profil gauche.” J’ai constaté qu’il n’avait plus d’œil droit. J’en ai fait la remarque ; il m’a été répondu qu’ils lui avaient crevé l’œil et enfoncé la face droite de son visage, d’où des hématomes très importants que nous avons pu tous constater lors de sa mise en bière. »
Ce témoignage précis pourrait corroborer les propos que nous a tenus l’un des fonctionnaires de la BAC, selon lequel l’un des enquêteurs a vomi immédiatement en sortant du Bataclan après avoir constaté une décapitation et des éviscérations. Avez-vous connaissance de tels faits ?
M. Michel Cadot. Je n’ai eu aucune connaissance de ces faits, ni par l’Institut médico-légal ni par les fonctionnaires en question. Il appartient de toute évidence à l’enquête judiciaire d’en apprécier la véracité. J’ai néanmoins compris qu’il n’a été retrouvé sur le site de l’attaque aucun couteau ni aucun autre engin tranchant qui aurait permis ce type de mutilations. Il sera aisé de le vérifier dans le cadre de l’enquête. En ce qui me concerne, encore une fois, je n'ai reçu aucun message de la sorte provenant de l’Institut médico-légal ou de la direction de tutelle de la BAC concernée.
M. Christian Sainte. Je ne peux guère m’avancer sur ce point, compte tenu de l’état de l’enquête, mais rien, en l’état actuel de mes connaissances, ne me permet de penser que ce qui vient d’être lu est juste. Je précise, pour que les choses soient claires, que certains des corps retrouvés au Bataclan étaient extrêmement mutilés par les explosions et par les armes, à tel point qu’il fut parfois difficile de reconstituer les corps démembrés. Autrement dit, les blessures que décrit ce père peuvent aussi avoir été causées par des armes automatiques, par les explosions ou par les projections de clous et de boulons qui en ont résulté.
M. le président Georges Fenech. On lui aurait mis ses testicules dans la bouche…
M. Christian Sainte. Je ne dispose pas de cette information et, si ces faits avaient été établis, je pense qu’une telle information ne m’aurait pas échappé.
M. François Lamy. Le verrouillage de Paris est-il envisageable ?
M. Jacques Méric. Compte tenu de la densité de la voirie, il est extrêmement difficile de verrouiller complètement la capitale. La question s’est posée le 7 janvier, lorsque les deux frères Kouachi ont pris la fuite en voiture pour entamer un périple dans Paris. Dans des cas de ce type, la salle de commandement ordonne le positionnement de véhicules d’interception aux principales portes de Paris, qui sont les axes de fuite supposés. C’est tout à fait réalisable, mais cela ne garantit pas le bouclage complet de Paris. De surcroît, la naissance de la police d’agglomération a mis fin à une longue période de coupure entre la police parisienne et la banlieue : depuis 2009, il est possible d’intervenir à Paris et en banlieue en utilisant le même système radio et, ainsi, d’intercepter des véhicules dans les trois départements de la petite couronne. Rappelons par exemple que le magasin Hypercacher est situé presque à cheval sur la commune de Paris et celle de Vincennes, dans le Val-de-Marne.
M. François Lamy. Le verrouillage total de Paris n’est donc pas possible ?
M. Jacques Méric. Non.
Mme Françoise Dumas. Le week-end du 13 novembre, un restaurateur m’a refusé l’accès à son établissement au motif que le préfet de police de Paris avait donné l’ordre d’évacuer les restaurants et cafés et interdit de s’y abriter. Nombreux sont ceux qui ont opté pour le métro – ce qui, de mon point de vue, est une très mauvaise idée, surtout lorsque l’on constate les stratégies d’attaques multisites des terroristes. Ne vaudrait-il pas mieux, dans de telles circonstances, que les gens soient enfermés dans des restaurants et des cafés plutôt que d’errer dans les rues ou dans le métro ?
M. Michel Cadot. Dans un premier temps, plusieurs cafés situés à proximité des lieux des attentats ont été utilisés comme postes de commandement. En outre, la préfecture de police a publié sur Twitter treize messages en urgence dans la soirée du 13 novembre, dont celui-ci, en plusieurs volets : « Suite à plusieurs événements graves, la préfecture de police recommande dans les prochaines heures aux établissements recevant du public de renforcer la surveillance des entrées et d’accueillir ceux qui en auraient besoin », soit le contraire de ce qui vous a été dit. De même, nous avons recommandé « à ceux qui se trouvent à domicile, chez des proches ou dans des locaux professionnels en Île-de-France d’éviter de sortir sauf nécessité absolue », et aux organisateurs de spectacles « d’interrompre les manifestations ou événements en cours en extérieur ». Il s’agissait de consignes de bon sens ; peut-être le restaurateur que vous évoquez, n’ayant pas lu nos messages, a-t-il préféré s’enfermer dans son établissement. De même, la fermeture, à l’initiative de son propriétaire, d’un grand hôtel près du Champ de Mars dans les jours qui ont suivi a suscité un mouvement de panique, étant assimilée à une prise d’otages. J’ajoute que nous avons également publié des messages d’information sur l’arrêt des lignes de Noctilien et de métro ; je tiens naturellement tous ces messages à votre disposition. Le nombre d’abonnés au compte Twitter de la préfecture de police a décuplé au cours de la soirée du 13 novembre.
M. le président Georges Fenech. Je vous remercie pour votre participation à cette longue audition.
Table ronde, ouverte à la presse, de syndicats de la police nationale : Mme Céline Berthon, secrétaire générale du Syndicat des commissaires de la police nationale (SCPN), M. Jean-Luc Taltavull, secrétaire général adjoint ; M. Thierry Clair, délégué pôle province d'UNSA Police
Compte rendu de la table ronde, ouverte à la presse, du mercredi 23 mars 2016
M. le président Georges Fenech. Avant, madame et messieurs, de vous passer la parole pour un exposé liminaire, je vous informe que cette audition, ouverte à la presse, est également retransmise sur le portail vidéo de l’Assemblée nationale, où elle pourra être consultée pendant plusieurs mois. La Commission pourra décider de citer dans son rapport tout ou partie du compte rendu de cette audition.
Conformément aux dispositions de l’article 6 de l’ordonnance du 17 novembre 1958, relatif aux commissions d’enquête, je vous demande de jurer de dire toute la vérité, rien que la vérité.
Mme Berthon, M. Tartavull et M. Clair prêtent successivement serment.
Mme Céline Berthon, secrétaire générale du SCPN. Votre commission d’enquête, devant laquelle nous vous remercions de nous permettre d’intervenir, poursuit un but noble et sain : informer et faire le point sur ce qui s’est passé – ou qui ne s’est pas passé. Comme lors des autres commissions d’enquête auxquelles nous avons participé, nous sommes très attentifs, en tant que représentants des chefs de police, à ce qu’elles ne se transforment pas en recherche de telle ou telle responsabilité, voire en accusation ou en procès. Les attentats dramatiques qui ont suscité la création de cette commission ont touché des femmes et des hommes, à qui nous pensons avant tout ; de même, les services de renseignement, d’intervention et d’investigation et même de la police du quotidien se composent de femmes et d’hommes, qui ont fait le choix de servir la sécurité de la France et qui éprouvent la douleur, la peine et l’impuissance de n’avoir pu faire mieux.
Le SCPN est le syndicat majoritaire des commissaires de police. À ce titre, la menace du terrorisme et de la radicalisation islamistes nous a frappés de plein fouet en janvier 2015, mais nous y avions déjà été abondamment sensibilisés dans tous les services de police, et nous avons eu l’occasion d’alerter sur son ampleur en France, en lien avec le contexte international. Au lendemain des attentats de janvier, la Fédération autonome des syndicats du ministère de l’intérieur (FASMI) à laquelle nous appartenons – comme l’UNSA-Police – et qui représente tous les métiers et tous les personnels – gardiens de la paix, gradés, officiers, commissaires, personnels administratifs et scientifiques de la police nationale – a adressé par écrit à notre administration et au ministre des propositions d’amélioration concernant l’évolution indispensable de notre organisation, de nos schémas tactiques d’intervention, de nos moyens de protection et d’équipement et de nos moyens juridiques d’intervention.
Si cette menace a été entendue, elle n’a pris corps pour le plus grand nombre que lorsque notre pays a hélas été frappé de nouveau, plus massivement encore, dans la nuit du 13 novembre. Nous avons alors rappelé à nos autorités de tutelle et à l’ensemble des directeurs de services quelles sont les attentes des policiers de terrain, de tous corps et de tous grades : disposer des moyens d’action nécessaires en matière de renseignement, d’intervention mais aussi de police du quotidien pour faire face à cette menace dont nous sommes convaincus qu’elle peut se concrétiser en tous points du territoire. C’est pourquoi il est essentiel de donner à la police et aux services de renseignement les moyens de ne pas être impuissants. Ces moyens sont juridiques – l’utilisation de l’arme à feu, par exemple, fait actuellement l’objet d’un projet de loi au sujet duquel le SCPN a présenté plusieurs propositions – mais portent aussi sur l’équipement en armement et en protection, ou encore sur les méthodes de travail. Il est vrai que plusieurs mesures législatives prises au cours de l’année passée ont permis de renforcer les capacités des services de renseignement, et qu’un projet visant à renforcer celles des services d’investigation est en cours d’examen.
Nous avons formulé toutes ces propositions de manière constructive, convaincus que la question de la coordination et de la collaboration entre les services est au cœur de la problématique. Nous savons depuis bien longtemps que tout ce qui nous désunit fait le jeu des malfrats et de l’adversaire, lequel est aujourd’hui si puissant qu’il est hors de question de se perdre en guerres fratricides. Nous avons toujours défendu tous les vecteurs d’une meilleure coordination entre services, qu’ils relèvent de la police nationale, de la direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) ou encore de la gendarmerie nationale.
M. Thierry Clair, secrétaire national de l’UNSA-Police. L’UNSA-Police représente des gradés et gardiens – autrement dit, le corps d’encadrement et d’application – de la police nationale. La question des moyens mis en œuvre par l’État pour lutter contre le terrorisme est plus que jamais d’actualité. L’implication de tous les acteurs de l’État est nécessaire et celle des policiers, que nous représentons, est particulièrement importante. Depuis les événements du 7 janvier 2015, l’État a pu compter sur l’engagement sans faille des policiers, gardiens de la paix publique et des libertés – engagement qu’une grande partie de la foule manifestant le 11 janvier 2015 a d’ailleurs salué. Nous gardons tous en mémoire les vigoureux applaudissements qui ont accueilli le passage des forces de police à cette occasion, et les accolades nombreuses que les citoyens ont données aux policiers. Ces symboles forts participent d’un élan spontané de solidarité nationale. Nous avons en effet assisté à un réel rapprochement entre la police et la population. Si, par leurs actes ignobles et abjects, les terroristes ont cherché à diviser entre elles les différentes composantes de notre société, ils ont en fait rapproché la population de sa police, de son armée et de ses institutions.
Au cours des semaines qui ont suivi les attentats de janvier, l’engagement des policiers a été total. Une prise de conscience générale a gagné nos rangs ; certains de nos collègues ont interrompu leurs congés sans même avoir été contactés par l’administration. Chacun a fait preuve d’une vigilance accrue. Deux éléments nouveaux sont apparus, en effet : tout d’abord, les policiers intervenant dans de telles situations se trouvent en face d’individus déterminés qui ne cherchent pas la fuite, comme c’est le cas dans des affaires de droit commun, mais dont l’objectif est de tuer un maximum de personnes jusqu’à se transformer parfois eux-mêmes en kamikazes. D’autre part, les policiers constituent des cibles car ils représentent l’État : nos collègues Ahmed Merabet et Clarissa Jean-Philippe ont été assassinés au seul motif qu’ils portaient un uniforme et une inscription.
Pour tenir compte de cette situation nouvelle, notre organisation syndicale a revendiqué des moyens de protection individuelle et collective supplémentaires – tout un équipement de gilets pare-balles lourds, de casques et visières pare-balles, de boucliers pare-balles – ainsi que des moyens d’intervention renforcés – notamment des armes collectives – et la possibilité pour les policiers qui le souhaitent de rester armés en dehors de leurs heures de service. Certains de nos collègues, en effet, ont manifesté quelque crainte de rentrer chez eux, compte tenu de leur lieu d’habitation. Enfin, nous avons revendiqué l’adaptation des règles d’utilisation des armes afin que leur cadre juridique soit non contestable.
Dès janvier 2015, il s’est produit dans les services une intensification des habilitations à utiliser des armes collectives, en particulier des armes d’épaule. Les stages de tir et de maniement de ces armes ont d’ailleurs suppléé la plupart des autres stages, devenant la priorité de la formation continue entre janvier et mars 2015. Le plan BAC-PSIG, actuellement en cours de déploiement, consiste notamment à doter les services de fusils d’assaut HK G36 et de casques et boucliers pare-balles ; nous attendons l’annonce de véhicules supplémentaires. Quoi qu’il en soit, notre organisation syndicale sera vigilante quant au respect du calendrier de livraison.
L’UNSA-Police approuve toutes ces dispositions mais estime qu’elles doivent s’étendre à d’autres services. Certes, il n’est pas nécessaire qu’un policier soit équipé comme un fantassin pour exercer des missions de police générale et quotidienne – et par exemple intervenir en cas de différend familial, de vol à l’étalage ou encore d’accident de la circulation. Il doit cependant avoir à sa disposition les outils lui permettant de riposter à toute éventualité. Toutes les circonscriptions de police ne sont pas dotées d’une brigade anti-criminalité (BAC) et, là où ces brigades existent, elles ne couvrent pas toujours tous les créneaux horaires. Les équipements de la BAC doivent donc être étendus à l’ensemble des services d’intervention – au moins dans le cadre des stages de formation, qui viennent de débuter. Les efforts légitimement consentis au bénéfice des services prioritaires ou spécialisés ne doivent pas faire oublier la police du quotidien, qui peut être confrontée à tout moment à des actions terroristes isolées ou concertées.
M. le président Georges Fenech. Le 22 décembre 2014, le Premier président de la Cour des comptes a adressé au ministre de l’intérieur, M. Cazeneuve, et à la garde des sceaux de l’époque, Mme Taubira, un référé selon lequel la répartition territoriale des effectifs de police et de gendarmerie serait déséquilibrée par rapport au nombre et à la gravité des faits à traiter. Je cite : « il n’est pas rare que les deux forces » de police et de gendarmerie « se disputent l’attribution des affaires complexes », notamment en matière judiciaire. Les principales directions de la police sont « organisées de façon distincte et cloisonnée ». « Nombreuses sont les occasions pour les services de police et les unités de gendarmerie d’enquêter d’initiative sur les mêmes « cibles ». Or, « bien que le principe en soit posé par le code de procédure pénale, le partage du renseignement, clé de voûte du métier des enquêteurs judiciaires, reste rare et alimente les rivalités. (…) Les relations concurrentielles entre les deux forces ont suscité le projet, annoncé au début de 2014 par le ministre de l’intérieur avant d’être retiré, de créer une « structure commune » à la police et à la gendarmerie, destinée à lutter contre la criminalité organisée et le terrorisme en Corse. (…) Un protocole cadre de répartition des compétences judiciaires, commun aux deux forces de sécurité, pourrait être conclu avec le ministère de la justice puis décliné à travers des protocoles locaux conclus avec les parquets ».
Autrement dit, cette question n’est pas nouvelle ; elle remonte à l’existence même des deux forces. Le point de vue de la Cour des comptes concernant la rivalité et l’insuffisance du partage d’informations est-il fondé ? Peut-on améliorer l’organisation actuelle, voire aboutir à l’unité des deux corps ?
Mme Céline Berthon. C’est un vaste sujet qui, selon moi, est sans rapport avec la question des attaques terroristes. La Cour des comptes fonde son point de vue sur des enquêtes criminelles, évoque un projet d’organisation des services de police et de gendarmerie en Corse et fait référence à la répartition territoriale des compétences. Or, rien de tout cela n’a dysfonctionné lors des attaques terroristes de 2015.
M. le président Georges Fenech. Le 7 juillet 2015, M. Jean-Michel Fauvergue, chef du RAID, déclarait à la presse que l’on « ne peut plus se permettre une guerre des services » entre police et gendarmerie. Compte tenu de « l’évolution de la menace, on a besoin de tous les opérateurs ». De fait, la question du partage de l’information a été souvent posée, au point que M. Cazeneuve lui-même a dû taper du poing sur la table pour que les informations circulent davantage. Il ne s’agit donc pas uniquement de criminalité de droit commun, mais aussi de terrorisme.
M. Jean-Luc Taltavull, secrétaire général adjoint du SCPN. Dans la majorité des cas, le partage d’informations, sous l’autorité du parquet, fonctionne. À Creil, où j’étais en poste auparavant, les services de police et la gendarmerie tenaient tous les deux mois une réunion de coordination sur les problématiques liées à la zone de sécurité prioritaire (ZSP), étant entendu que la règle d’intervention était la suivante : le service le mieux placé pour intervenir sur une affaire s’en charge. La coordination et le partage de l’information ne signifient pas qu’il faut nécessairement fusionner. Les guerres fratricides existent également au sein d’un même service ; elles sont inhérentes à la nature humaine. Il est aussi arrivé – même si ce n’est pas le cas aujourd’hui – que les responsables administratifs et politiques dépassent le cadre d’une saine émulation pour entrer en concurrence, ce qui ne saurait tenir lieu de pratique de management.
Toutefois, il n’est pas selon nous prioritaire de réorganiser les services. La détection des doublons se fait de manière construite et apaisée lors du pré-positionnement des forces d’intervention. Il est évidemment hors de question pour un service de police prêt à intervenir en cas d’attaque de faire attendre les victimes au motif que le site relève de la compétence ratione materiae d’une unité de gendarmerie, et inversement. C’est au service le mieux placé géographiquement d’intervenir ; reste à déterminer à qui, de la police ou de la gendarmerie, incombe la direction de l’opération en fonction de la zone d’action. Il peut certes se produire des tensions lorsque le nombre insuffisant d’affaires à traiter pousse les différents services à entrer en concurrence pour être saisis, mais nous constatons plutôt le contraire : les magistrats peinent souvent à trouver un service qui accepte une saisine, notamment en matière de délinquance économique et financière.
Autrement dit, il convient de ne pas généraliser le constat formulé dans le référé de la Cour des comptes, auquel le ministre a d’ailleurs répondu de manière assez construite en précisant que la pluralité des acteurs ne se traduit pas forcément par un doublonnage toxique ou une course à l’échalote.
Mme Céline Berthon. J’ajoute qu’en matière de renseignement, d’immenses progrès ont été accomplis ces dernières années afin d’intégrer les forces au sein du service central du renseignement territorial, la logique de concurrence ayant du même coup disparu ou presque. S’il demeure sans doute çà et là des problèmes d’ordre humain, les oppositions systémiques entre institutions n’existent plus car, outre le fait qu’il y a suffisamment de travail pour l’ensemble des services, c’est l’intérêt général qui prime.
M. le président Georges Fenech. Avez-vous été consultés au sujet du nouveau schéma national d’intervention des forces de sécurité intérieure, qui est en cours d’élaboration sous l’autorité du ministre de l’intérieur ?
Mme Céline Berthon. Pas encore. Il n’a été présenté que très récemment aux directions générales de la police et de la gendarmerie qui, l’une et l’autre, semble exprimer leur satisfaction. Il semble que l’on a donc réussi à trouver un équilibre intelligent de partage des compétences sur l’ensemble du territoire national en vue d’intervenir le plus rapidement possible et dans les meilleures conditions.
M. Sébastien Pietrasanta, rapporteur. Quel jugement les commissaires portent-ils sur la coordination au quotidien des services de police avec les militaires mobilisés dans le cadre de la force Sentinelle ?
Ma deuxième question porte sur la remontée des informations en matière de lutte contre le terrorisme. Comment les choses se passent-elles concrètement en cas de dépôt d’une main courante en commissariat ? Y a-t-il des pistes d’amélioration ?
Ensuite, plusieurs exemples récents ont montré que le respect du contrôle judiciaire est plutôt aléatoire, pour dire le moins. Il semble qu’en cas de carence, lorsque le contrôle n’est pas effectué en commissariat ou à la gendarmerie, l’information met parfois jusqu’à plusieurs semaines avant de remonter aux services de renseignement. Des mesures et circulaires ont-elles été prises pour renforcer le contrôle judiciaire, en particulier lorsqu’il concerne des personnes liées à l’islam radical et au terrorisme ?
Enfin, l’équipement des BAC et des PSIG – les pelotons de surveillance et d’intervention de la gendarmerie – est en cours, et nous sommes autant que vous soucieux du respect du calendrier fixé : il devrait être achevé à la fin juin, soit peu avant la remise de notre rapport. À ce stade, ce plan suit-il normalement son cours ? Estimez-vous que cet équipement, tant en termes d’armement que de protection, correspond aux attentes des personnels ?
M. Jean-Luc Taltavull. Les centaines de commissaires avec lesquels nous sommes en lien nous ont transmis de leur propre initiative ou sur demande des informations concernant la coordination avec la force Sentinelle qui ont évolué au fil du temps. La première phase s’est caractérisée par une certaine instabilité, voire des difficultés, et pour cause : les services de police n’ont pas, en temps normal, de contacts à cette échelle avec les forces armées. En janvier et plus encore en novembre, les patrouilles ont été déployées dans un contexte où il fallait déterminer si d’autres commandos s’apprêtaient à commettre des tueries çà et là. En pratique, certaines patrouilles militaires dynamiques ont été déployées sans que les commissaires et les préfets compétents dans la zone concernée en aient été avisés. À cette phase initiale, au cours de laquelle certains de nos adhérents ont eu le sentiment que l’on mettait la charrue avant les bœufs en dispersant des patrouilles sans leur donner de but précis ni les coordonner avec les forces de police, a succédé une deuxième phase où, hormis quelques cas particuliers où les chefs de patrouille négligent d’informer l’ensemble des forces de police et de gendarmerie compétentes d’une relève, les informations qui nous remontent sont très élogieuses, au point d’être parfois préoccupantes : en province, certains collègues nous indiquent qu’ils ne pourraient pas fonctionner sans l’appoint de la force Sentinelle, laquelle exerce des gardes statiques qui relevaient auparavant des forces de police – et qui leur reviendront peut-être un jour, à moins qu’elles ne soient confiées à des sociétés de sécurité privées. Dans ce domaine, en effet, aucune piste n’est à exclure car, selon l’ensemble des experts compétents, la problématique du terrorisme devrait durer vingt-cinq à trente ans ; il nous faut donc bâtir des réponses pérennes.
En clair, le degré de coordination est satisfaisant à ce stade. Des interrogations persistent quant à ce que les militaires prévoient désormais en termes d’articulation de leurs interventions. Le 13 novembre, des soldats de la force Sentinelle se trouvaient à proximité du Bataclan : un gradé de la BAC, parvenu à l’issue de secours, leur a demandé d’intervenir, ce à quoi ils ont répondu qu’ils n’avaient pas reçu d’ordres en ce sens ; il va de soi qu’ils n’ont pas non plus prêté leur arme, un Famas, aux policiers. Sans doute y a-t-il là une marge d’amélioration des modes d’intervention. Nombreux sont nos collègues qui, le soir même du 13 novembre, se sont présentés spontanément à leur commissariat alors qu’ils étaient en congé ou en récupération – comme l’ont également fait les secouristes – pour se mettre à disposition du plus gradé. L’un de nos commissaires a ainsi pu cheminer dans le passage Saint-Pierre Amelot avec une unité de marche composée d’éléments hybrides. À l’époque, l’articulation avec les militaires était impossible, car elle n’avait pas été pensée en amont. Des travaux en ce sens ont été entrepris, et nous espérons qu’ils se traduiront par l’adoption de mécanismes de mise à disposition et d’identification du commandant opérationnel.
Le mécanisme de remontée des informations provenant du dépôt de mains courantes a été affiné dès avant les attentats à mesure que montait en puissance le dispositif de suivi de la radicalisation. L’objectif est d’encadrer la multitude de constats locaux provenant de responsables d’établissements scolaires ou de travailleurs sociaux selon lesquels une personne en voie de rescolarisation, par exemple, aurait soudain interrompu tout contact. Avec la création de la plateforme nationale d’appels de l’unité de coordination de la lutte antiterroriste (UCLAT), le processus a été formalisé. Quant aux mains courantes, elles donnent lieu à un compte rendu écrit lorsque la personne s’est déplacée en personne ou, s’il s’agit d’un appel téléphonique à la plateforme de l’UCLAT, à un message transmis au service de renseignement territorial local à qui il appartiendra de contacter la personne en question afin de prévoir un entretien. Dans un deuxième temps, des mesures plus ou moins discrètes et poussées pourront être prises : nous disposons désormais d’un fichier digne de ce nom et d’outils de travail plus adaptés.
M. le président Georges Fenech. N’y a-t-il aucune déperdition d’informations ?
M. Jean-Luc Taltavull. Non, plus maintenant. Au contraire : nous recevons trop d’informations, ce qui rend leur discrimination difficile. Le problème se pose notamment de la sortie de la liste des suspects : une personne qui y aurait été inscrite suite à un signalement et sur lesquelles des vérifications auraient été effectuées sans résultat doit-elle vraiment y demeurer ? Faut-il par exemple en déduire son incapacité à travailler sur une plateforme aéroportuaire où dans d’autres métiers ? Tout est question de proportion : il s’agit d’un processus vivant dans lequel nous tâchons de nous faire l’idée la plus précise de telle ou telle personne, étant entendu que l’erreur est possible dans un système qui, en tout état de cause, demeure démocratique – les suspects n’étant pas soumis à des questionnements trop vigoureux, nous sommes pour partie prisonniers des apparences, en particulier pour ce qui concerne les suspects les plus habiles. De ce point de vue, se pose la question de l’accès aux données chiffrées des téléphones portables. Le moindre petit caïd local, en effet, sait très bien qu’il doit crypter son téléphone.
Mme Céline Berthon. Nous nous posons en effet la question de la sortie des tableaux de suivi de la radicalisation, car le danger pour les services est de disposer d’une liste sans fin qu’ils n’auraient pas les moyens de traiter. D’autre part, les signalements qui parviennent aux services de police doivent être articulés avec les informations que reçoivent les autres services de l’État chargés de contribuer à la déradicalisation et à l’accompagnement de personnes qui, sans être forcément dangereuses, méritent d’être suivies.
M. Sébastien Pietrasanta, rapporteur. Selon l’état-major opérationnel de prévention du terrorisme (EMOPT) et l’UCLAT, que nous avons interrogés en janvier, la sortie du fichier de suivi se fait déjà. En êtes-vous informés ?
M. Jean-Luc Taltavull. J’ignore le détail du fonctionnement de ce fichier. En revanche, lors de sa création, l’EMOPT, dont le périmètre de compétence chevauche quelque peu celui de l’UCLAT, a repris un certain nombre de fichiers d’individus répertoriés çà et là pour les insérer dans le fichier dit FSPRT. De ce fait, certaines antennes du renseignement territorial ont eu à démontrer une nouvelle fois l’inanité de l’inscription de tel ou tel individu sur la liste des personnes radicalisées, alors que cette démonstration avait déjà été faite. Or, refaire une démonstration déjà faite plusieurs mois auparavant entraîne une charge de travail supplémentaire dans une période où les services n’en manquaient pourtant pas, puisque nous étions entrés dans une phase d’attaques. Cela étant, cette difficulté devrait être résolue dès lors que les tâches accompagnant la mise en place du FSPRT auront été purgées.
En matière de contrôle judiciaire, nous ignorons si de nouvelles consignes ont été données. La difficulté tient non seulement au traitement ciblé des intéressés, mais aussi à l’absence de partage de l’information entre la justice et les services répressifs – qu’il ne faut pas attribuer à une quelconque intention malicieuse, mais plutôt à la différence des processus bureaucratiques. Un service de police typique gère quelques dizaines de contrôles judiciaires par semaine, et les carences donnent la plupart du temps lieu à la rédaction de rapports qui ne se traduisent jamais par un sursis ou par la révocation de la mesure de contrôle. Il se peut que se glisse parfois dans le lot des contrôlés un individu éventuellement radicalisé, mais surtout connu pour des faits de vol à main armée ou de trafic de stupéfiants. J’ose espérer que de tels cas donnent lieu à un coup de fil particulier : s’il est saisi de la spécificité d’un cas, un service de police en tient compte. C’est ce qui se produit pour les délinquants sexuels inscrits au fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes, le FIJAISV : sans doute faudrait-il reproduire le système d’alertes automatiques dont ce fichier est assorti pour affiner le suivi de certains individus radicalisés.
M. Sébastien Pietrasanta, rapporteur. Il est pourtant arrivé qu’il faille plus d’un mois avant que le commissariat signale le non-respect d’un contrôle judiciaire : c’est problématique.
Mme Céline Berthon. Le contrôle judiciaire est une mesure s’appliquant dans le cadre d’une ouverture d’information à une personne mise en examen mais qui n’est pas placée en détention provisoire. Les fiches de contrôle judiciaire dont sont saisis la plupart des commissariats portent sur des affaires de toute nature qui n’ont pas forcément de lien avec le terrorisme. Cependant, la réalité est la suivante : les services compétents établissent des dizaines de rapports de violation du contrôle judiciaire, que les violations en question portent sur l’interdiction de se trouver en présence de telle autre personne ou sur tel territoire. C’est tout particulièrement vrai dans des quartiers touchés par une délinquance chronique. Or, les services de police ont constaté l’inanité, en quelque sorte, de ces rapports de violation, puisqu’il est parfois nécessaire d’en rédiger plusieurs dizaines avant de susciter l’attention du juge d’instruction – lequel fait face à une forte masse de travail et n’est pas toujours en mesure de révoquer le contrôle judiciaire pour prononcer la détention provisoire.
Sommes-nous parvenus à mettre en place un dispositif d’alerte permettant de ne pas laisser passer la moindre violation du contrôle judiciaire dans certains cas particuliers ? Sur ce sujet comme sur d’autres, nous voulons veiller à éviter tout glissement de responsabilité. Les services des commissariats, qui sont chargés du suivi du contrôle judiciaire, exercent aussi un très grand nombre d’autres missions, et il ne faudrait pas que la responsabilité de la perte de tel signalement soit attribuée au seul policier en poste au moment concerné. De ce point de vue, il serait sans doute opportun, en effet, d’envisager un système de signalement sur le modèle de celui qui accompagne le FIJAISV.
M. Jean-Luc Taltavull. Ajoutons qu’il est impossible, dans les entrées du fichier de la DGSI, de mentionner des antécédents judiciaires. On ne peut donc pas y recenser les infractions reprochées à tel ou tel individu. Cette approche cloisonnée, qui offre certes des garanties, pose question.
Quoi qu’il en soit, les commissariats redoublent de vigilance. Ils se heurtent toutefois à deux difficultés que nous avons toujours déplorées : d’une part, les modalités du contrôle judiciaire ne sont pas précisées, ce qui permet aux individus concernés de pointer au moment de leur choix – au milieu de la nuit, par exemple, ce qui oblige une patrouille à rentrer. D’autre part, les individus en questions déclarent des adresses qui ne font l’objet d’aucune vérification poussée. Or, il s’agit parfois d’adresses fictives – adresse inexistante ou adresse d’une « copine » résidant dans un territoire où l’intéressé n’est pas connu des services de police locaux. Tout cela ne facilite pas la capacité des services à détecter les manquements au contrôle judiciaire.
M. Christophe Cavard. Quel est votre point de vue de représentants des commissaires sur les primo-intervenants – sachant que la situation diffère naturellement selon que l’on se trouve en région parisienne ou en province ? Jusqu’à quel point pouvez-vous envisager d’intervenir, et qui décide en la matière ?
D’autre part, quel lien entretenez-vous avec le service central du renseignement territorial, en particulier suite aux événements de 2015 ?
Enfin, comment travaillez-vous avec les gendarmes et avec certaines unités spécialisées, sachant que des changements sont à attendre de ce point de vue ?
M. Patrice Verchère. Plusieurs articles de presse sont récemment parus sur la progression du fondamentalisme religieux dans les commissariats. Êtes-vous alertés par certains de vos collègues qui s’en inquièteraient ? Le risque pourrait en effet exister, comme on l’a vu aux États-Unis et en Afghanistan, que des policiers radicalisés se retournent contre leurs collègues.
M. Thierry Clair. À ce jour, monsieur le rapporteur, nous n’avons reçu aucune remontée défavorable concernant le déploiement du plan d’équipement BAC-PSIG, qui vient d’être lancé. Les attentes étaient fortes, en effet, non seulement parmi les fonctionnaires des BAC, mais aussi parmi tous les autres primo-intervenants – police-secours, services généraux, compagnies d’intervention. Le fusil HK G36 a suscité une polémique qui ne nous concerne guère, tant les conditions d’utilisation sont différentes ; un certain nombre de services en sont déjà équipés, qu’il s’agisse des brigades de recherche et d’intervention (BRI), des compagnies républicaines de sécurité (CRS) ou du RAID, par exemple. Ce matériel donne entière satisfaction par sa facilité d’emploi et de transport. Quant à l’équipement de protection, il consiste en gilets pare-balles particuliers et accessibles qui permettent de se mouvoir aisément, en casques balistiques à visière et en toute une palette d’équipements qui répondent aux attentes de nos collègues, qui s’en disent satisfaits.
Cela étant, ce plan d’équipement ne concerne que les BAC ; nous souhaiterions qu’il soit largement étendu à d’autres services. Encore une fois, il n’est pas question d’équiper les fonctionnaires de police-secours comme des fantassins, mais au moins de mettre à leur disposition l’équipement leur permettant d’intervenir – ne serait-ce que dans les circonscriptions sans BAC.
Mme Céline Berthon. En tant que chefs de service, nous nous sommes opposés à l’emploi du terme « primo-intervenant », qui laisse entendre qu’un équipage part toujours en mission en connaissant son objectif d’intervention ; c’est artificiel. En zone urbaine comme en zone rurale, l’hypothèse qu’un équipage de police ou de gendarmerie intervienne sans le savoir dans une tuerie terroriste est envisageable – connaissant l’ampleur du risque de passage à l’acte, nous en sommes convaincus. Notre priorité, qui rejoint celle des services de terrain, a donc été de niveler les équipements en fonction de la vocation des unités, les unes étant destinées à intervenir jusqu’au bout – dans un lieu fermé lors d’une prise d’otages, par exemple – tandis que d’autres, intermédiaires – les BAC et les PSIG notamment – sont formées à des types d’interventions qui peuvent là aussi justifier un niveau d’équipement supérieur, sans pour autant négliger les policiers primo-arrivants qui effectuent leurs missions quotidiennes sur la voie publique, et qui peuvent se trouver confrontés à une tuerie. Nous exigeons qu’ils aient le droit de vendre chèrement leur peau, si j’ose dire, en étant protégés comme les autres policiers, mais aussi qu’ils ne soient pas condamnés à l’impuissance. Il est très difficile pour un policier confronté à une attaque de se savoir identifié comme représentant de la puissance publique et de ne pouvoir rien faire pour que cesse la tuerie.
En clair, s’il n’est pas question de faire des policiers généralistes des Robocop et s’ils doivent se concentrer sur leurs missions prioritaires du quotidien, il faut toutefois leur donner les moyens de se défendre et de défendre les citoyens grâce à des équipements embarqués de manière protégée dans les véhicules. Aujourd’hui, les équipages les plus formés sont habilités à porter l’arme ; les autres équipages – c’est particulièrement important dans les circonscriptions qui ne bénéficient pas de la présence permanente d’une BAC – doivent pouvoir transporter de manière sécurisée des équipements dont ils peuvent s’armer en quelques minutes pour protéger la population, car c’est leur devoir.
M. le président Georges Fenech. Ne faut-il pas pour cela disposer de véhicules adaptés ?
M. Jean-Luc Taltavull. La voiture de police-secours conviendrait telle quelle si elle était plus grande, car ces équipements prennent de la place, en effet. J’ai été choqué, à Creil, que deux de nos véhicules soient « pliés » par de grosses berlines volées ou achetées avec l’argent de la drogue, nos voitures étant mises hors d’usage tandis que les berlines en question roulaient toujours. Face à une menace en constante évolution, il faut renforcer les moyens en conséquence. Certes, cela a un coût. Il faut par exemple prévoir un support pour sécuriser les armes, car certains n’hésitent pas à se servir dans les véhicules de police. Sinon, les patrouilles devraient se composer de quatre agents car, dans certains quartiers, les interventions à trois agents peuvent mal tourner, ou bien les agents devraient transporter sur eux l’ensemble de leur équipement, depuis le lance-grenades et le pistolet à impulsion électrique jusqu’au fusil d’assaut, alors qu’ils n’interviennent que sur un différend conjugal, par exemple. Ce n’est pas cette police que nous voulons. Il faut simplement permettre l’accès rapide et sécurisé à bord des véhicules à un équipement permettant de répondre à une attaque terroriste. Les terroristes choisissent leurs cibles : on peut envisager qu’ils attaquent simultanément dix patrouilles de police et de gendarmerie en dix endroits différents. Il faut alors que les agents puissent disposer d’au moins une arme collective pré-positionnée pour réagir.
Cela va de pair avec une adaptation du cadre juridique permettant d’utiliser ces armes en s’affranchissant de l’extrême subtilité des règles de la légitime défense – auxquelles nous sommes par ailleurs très attachés, car elles contribuent à une culture de la force maîtrisée dont nous sommes fiers – en cas de situation exceptionnelle ou d’attaque terroriste, à supposer que les fonctionnaires concernés en aient conscience, notre collègue Ahmed Merabet étant sans doute mort sans même savoir qu’une attaque avait eu lieu dans les locaux de Charlie Hebdo. Tout en restant raisonnable, il faut donc tenir compte du fait que nous avons changé d’ère. Nous ne l’avons pas souhaité et le regrettons, comme tout le monde. Puisque les attaques terroristes se produisent, nous devons en prendre acte et permettre à la police de paix publique de se muer rapidement en police plus affermie qui n’aura pas à subir une quelconque impuissance.
Mme Céline Berthon. L’année 2015, monsieur Cavard, a été une année de consolidation du renseignement territorial qui, par la force des choses, a bénéficié d’une mise à niveau de ses moyens à la hauteur de sa mission. Les fonctionnaires du renseignement territorial ont, au lendemain des attentats de janvier et de ceux de novembre, fait la démonstration remarquable de leur réactivité et de leur mobilisation. Des efforts restent à accomplir, mais les responsables des services départementaux du renseignement territorial sont pleinement mobilisés pour que l’information circule et que les synergies se développent. Le lien entre le renseignement territorial et les services de la sécurité intérieure ne pose désormais plus aucun problème. L’enjeu reste donc de donner au service du renseignement territorial les moyens de son bon fonctionnement, car il est en première ligne en matière de radicalisation.
De même, s’agissant du lien avec la gendarmerie, il est vrai que certaines concurrences se sont développées car rien n’a été fait – y compris en termes de décisions politiques – pour les enrayer, mais ce débat relève davantage des administrations centrales. Dans les territoires, cependant, les fonctionnaires sont avant tout soucieux de travailler main dans la main. Mieux vaut consolider les capacités à travailler ensemble plutôt que déstabiliser le système tel qu’il existe, car le moment paraît peu adapté.
Enfin, comme toute institution, la police nationale présente des points de vulnérabilité, mais les cas de radicalisation qui ont été signalés sont extrêmement peu nombreux. On constate plutôt des problèmes liés au respect de la laïcité et à la pratique religieuse dans les services, qu’il s’agisse de l’exigence d’un temps de culte pendant le service ou de l’expression d’une pratique religieuse un peu radicale.
M. le président Georges Fenech. Radicale ou fondamentaliste ?
M. Jean-Luc Taltavull. Là est toute la difficulté. L’article de presse que vous avez cité, monsieur Verchère, faisait suite à une note confidentielle de vigilance qui, en réalité, ne faisait que mettre noir sur blanc ce qui est une pratique habituelle de vigilance entre collègues – qu’il s’agisse de radicalisation, de consommation de drogue ou d’autres problèmes. Selon les informations dont nous disposons, le phénomène de radicalisation dans la police demeure très marginal et se cantonne à des unités qui emploient des agents de surveillance sur la voie publique, qui sont davantage des collaborateurs du service public que des policiers à part entière. Il faut donc trouver un juste équilibre en n’empêchant pas ceux de nos collègues qui le souhaitent de s’épanouir spirituellement tout en demeurant assez vigilants pour qu’ils ne franchissent jamais la ligne rouge.
M. Olivier Marleix. Quels sont les moyens juridiques dont vous disposez pour traiter le cas des personnes revenues du djihad ? Le Premier ministre nous dit qu’un millier de personnes seraient parties et plus de 250 revenues. L’ancienne garde des sceaux avait pris une circulaire afin que ces personnes ne puissent être poursuivies qu’au titre de deux qualifications pénales seulement : l’association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste et l’entreprise terroriste individuelle. N’ayant aucun lien avec les services syriens, nous ne disposons que d’informations parcellaires et fortuites. Or, les autorités judiciaires se sont régulièrement prononcées contre la détention provisoire des personnes concernées, ce qui suscite une menace diffuse. Pensez-vous que l’on pourrait recourir à d’autres incriminations prévues dans le code pénal, comme l’intelligence avec une puissance étrangère, qui est passible d’une peine de trente ans de réclusion, ou d’autres qualifications plus précises ? L’initiative qu’a prise le Gouvernement de compléter, dans le projet de loi renforçant la lutte contre le crime organisé, le dispositif applicable aux personnes sur lesquelles nous manquons d’informations, montre que le dispositif actuel est lacunaire.
Ma deuxième question porte sur les effectifs. J’examine chaque projet de loi de règlement avec la plus grande attention, et je constate d’après le dernier d’entre eux, qui porte sur 2014, que le nombre de postes pourvus dans la police et la gendarmerie n’a pas été augmenté de cinq mille emplois pour la période 2011-2014, bien au contraire : il a diminué de deux mille dans la police, comme s’en est fait l’écho Le Monde. À chaque fois que je l’interroge sur ce point, le ministre de l’intérieur me fait une réponse hors sujet sur les plafonds d’emplois qui, eux, augmentent de manière incontestable, quoique virtuelle. J’espère que cette tendance changera en 2015 : certains services spécialisés, dans le renseignement notamment, semblent bénéficier de renforts. Plus globalement, le nombre élevé de recrutements est lié à l’évolution de la pyramide des âges. Quelle analyse faites-vous du volume actuel des effectifs ?
M. Jean-Luc Taltavull. S’agissant de la judiciarisation des personnes revenant d’un théâtre d’opérations terroristes, la première des difficultés consiste à fournir la preuve des actes commis. Certaines personnes se rendent dans les pays en question en tant qu’authentiques travailleurs humanitaires ou journalistes, voire parlementaires : il n’est donc pas aisé de définir l’infraction pour discriminer entre tous ces cas. Selon nos collègues, une infraction manque néanmoins à notre dispositif juridique : il serait opportun d’adapter à la détention d’un important volume d’images d’actes faisant l’apologie de la violence le même régime qui fonctionne très bien en matière de pédophilie. En effet, la détention d’images pédophiles constitue une infraction, mais pas celle de plusieurs dizaines de giga-octets d’images d’égorgements que l’on montre à tous les copains de l’immeuble. Cette demande nous est transmise de manière régulière, et je vous la livre telle quelle, en attendant que nous la formalisions.
L’ouverture d’une instruction judiciaire pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste ou pour entreprise individuelle de terrorisme repose la question de la judiciarisation du renseignement. Certes, nos liens officiels avec les services de renseignement syriens sont quasi inexistants, mais nous recueillons tout de même des éléments via d’autres capteurs. Tous ces éléments sont couverts par le secret défense et le code de procédure pénale ne prévoit pas de les exploiter dans le cadre d’une procédure judiciaire. Le mode de transformation de ces éléments d’information en preuves judiciaires reste donc à bâtir. En effet, il arrive souvent que des renseignements recueillis au moyen d’interceptions téléphoniques couvertes par le secret défense ne puissent être versés au dossier d’un procès contradictoire. De ce point de vue, la perquisition administrative, souvent décriée et qui a fait l’objet de tant de fantasmes, a au moins eu le mérite de lever des doutes sur des individus signalés via la plateforme de signalement, en contact avec des milieux salafistes et ayant par exemple mentionné leurs caches d’armes lors de conversations téléphoniques. En l’état actuel du droit, aucune procédure judiciaire ne permet d’aller vérifier ces éléments au domicile des intéressés, sauf à trouver un prétexte ou à ce qu’ils soient interpellés en compagnie de trafiquants de stupéfiants, par exemple. De même, les quelque 80 assignations à résidence encore en cours ont bien des défauts et ne concernent pas le haut du spectre des suspects, mais elles ont au moins le mérite de permettre la géolocalisation – une géolocalisation du pauvre, en quelque sorte – d’individus qui, en dépit de leurs protestations outrées dans les médias, ont passé la nuit du 13 au 14 novembre à se féliciter des attentats par téléphone. Ces personnes sont tenues de pointer trois fois par jour, et tout manquement déclenche immédiatement un mécanisme d’alerte. Peut-être pourrait-on s’en inspirer en fixant la date et l’heure des contrôles judiciaires, afin de tenir compte de la charge de travail des services.
M. Thierry Clair. S’agissant des effectifs, disons d’emblée ceci : la police nationale n’a pas été épargnée par la réduction générale des politiques publiques. Depuis 2008, les pertes d’effectifs ont été considérables. À titre de comparaison, la police nationale comptait vingt-cinq structures de formation en 2000 ; en 2015, elle n’en avait plus que dix. Avec moins de la moitié des structures de formation, nous devons pourtant former un nombre équivalent de fonctionnaires – recrutés ou intégrant les écoles. Dans les années 2000, 5 617 élèves gardiens de la paix étaient formés chaque année ; aux 2 917 fonctionnaires formés en 2015 dans les dix structures restantes, il faut ajouter un nombre substantiel d’adjoints de sécurité et de cadets de la République qui portent le nombre total de personnes formées à plus de cinq mille. Les écoles se trouvent en surchauffe car, si le besoin de recrutement est réel dans le services, les moyens de formation peine à y répondre. Pour y remédier, l’administration a suggéré de diminuer de plus de 40 % la formation des gardiens de la paix qui étaient auparavant adjoints de sécurité ; de notre point de vue, une telle réduction n’est pas satisfaisante car il n’est pas question de dispenser des formations moins bonnes, même si les intéressés ont déjà acquis des compétences dans le cadre de leurs missions antérieures. Le métier de policier se complique du fait, entre autres, de l’emploi des nouvelles technologies et de l’évolution du cadre juridique. Cette question de la formation constitue donc un réel problème.
M. Serge Grouard. Depuis les attentats de 2015, le dispositif de sécurité dans son ensemble – renseignement, intervention ou encore surveillance – monte en puissance. Combien de temps allez-vous tenir ainsi ? Nous saluons le professionnalisme, l’état d’esprit et la disponibilité de nos forces de police, mais les temps de récupération sont tout de même nécessaires. Or, de grandes manifestations – sportives, par exemple – se profilent à l’horizon, qui susciteront la mise en place de dispositifs importants. Comment envisagez-vous la question des congés, du temps de travail, des heures supplémentaires, de la récupération ?
Ensuite, vous avez beaucoup évoqué les moyens en armement et en protection, mais qu’en est-il des moyens technologiques dont disposent les équipages en matière de géolocalisation, de numérisation, de cartographie, d’utilisation des fichiers en temps réel, de partage de l’information ?
Enfin, s’agissant des doctrines d’emploi – une question qui dépend pour partie de celle des moyens –, la logique de police-secours est-elle toujours adaptée à la situation actuelle ? Ne devrait-on pas privilégier le maillage permanent du territoire en temps réel ? En situation d’attentat, il faut certes que les délais d’intervention soient très rapides, comme ce fut le cas en 2015, mais que répondrez-vous si l’on vous impose une nouvelle doctrine consistant à accélérer les délais de neutralisation dans la foulée d’une intervention ?
M. Thierry Clair. Dès le 7 janvier 2015, notre fédération syndicale a alerté le ministre sur le fait que la mobilisation des fonctionnaires de l’ensemble des services du corps d’encadrement et d’application s’inscrirait hélas dans la durée, et qu’il faudrait donc, en quelque sorte, ménager les troupes. Il ne sert à rien de mobiliser la totalité des agents à 100 % dans les jours et les semaines qui suivent un attentat ; mieux vaut conserver des ressources. Cette demande a été en partie entendue et chacun a eu la possibilité de fixer des périodes de congé et de récupération. En effet, il arrive souvent que les missions de police consistent aujourd’hui en décalages ou en rappels dans de petites unités, et pour cause : nombreux sont les services de police qui connaissent des problèmes d’effectifs. Nos collègues en poste dans les aéroports, par exemple, sont en nette surchauffe car ils doivent contrôler tous les vols, y compris ceux qui proviennent de l’espace Schengen. Au-delà d’une certaine limite, ce rythme ne pourra plus être tenu et il faudra bien trouver un créneau permettant à chacun de récupérer ou répartir autrement les missions.
M. Jean-Luc Taltavull. La question de la récupération va de pair avec celle de la réorganisation permettant de conduire toutes nos missions de façon durable. La direction générale de la police nationale conduit déjà des réflexions à ces fins. Ce souci de réorganisation s’articule avec la nécessité de ne pas déstabiliser l’architecture générale du dispositif : encore une fois, mieux vaut consolider que révolutionner.
Peut-être payons-nous aujourd’hui les effets collatéraux de telle ou telle réforme de services, celui du renseignement par exemple. Ainsi, l’information générale telle qu’elle a été restructurée lors de la création de la DCRI se compose d’un tiers des effectifs des anciens renseignements généraux pour un spectre de missions inchangé. Comment cela pouvait-il ne pas se traduire par un amoindrissement du maillage ? En théorie, l’idée était excellente : il s’agissait d’allier la rigueur quasi militaire de la direction de la surveillance du territoire (DST), qui avait fait la preuve de son efficacité dans la lutte contre les espions soviétiques, avec le sens de l’initiative et le maillage territorial des renseignements généraux, pour obtenir une sorte de FBI à la française. Malgré les alertes lancées dès cette époque, nous en constatons aujourd’hui pour partie les résultats.
L’équipement des forces de police en nouvelles technologies progresse – je pense au projet de police 3.0 ou encore à la tablette NéOGEND. Le déploiement de ces équipements est en phase expérimentale, non seulement parce que les moyens disponibles ne permettent pas encore d’en généraliser l’emploi, mais aussi parce que les policiers et les gendarmes ont besoin d’un temps d’acculturation, car ils sont loin d’être tous des geeks.
De plus, la priorité actuelle consiste à former les agents aux techniques de tir et de maniement de nouvelles armes – ce qui m’amène à aborder la question de la doctrine d’intervention. Elle est la suivante : le premier arrivé sur place n’est pas forcément le premier à intervenir, sachant qu’il faut distinguer entre les zones de gendarmerie, où la densité est souvent moindre, et les zones de police, où les patrouilles peuvent à tout moment être confrontées à des actes de violence, comme l’illustre le cas récent d’un braquage dans Paris qui s’est transformé en fusillade. Il va de soi qu’il ne revient pas au centre de commandement et d’information de la police de déterminer si, en cas d’attaque terroriste, il convient d’envoyer la BAC plutôt que la patrouille de police-secours ; c’est l’inverse qui se produit. Une patrouille de police, quelle qu’elle soit, qui passerait dans une rue adjacente au site d’une tuerie, n’attendra évidemment pas l’arrivée des « primo-intervenants » pour agir. C’est pourquoi nous réclamons le pré-positionnement dans tous les véhicules de police, a fortiori lorsqu’ils ne sont pas banalisés, de moyens plus puissants tels que des pistolets-mitrailleurs, comme l’ont fait depuis dix ans les Allemands, qui ont connu des massacres dans des écoles.
Mme Céline Berthon. La mission de police-secours, au fond, a trait aux missions régaliennes de l’État en matière de sécurité. Nous devons toiletter la répartition des compétences avec d’autres acteurs de la sécurité, ce dont il faudra reparler en vue des grandes manifestations qui se profilent et que nous évoquions déjà avant les attentats de l’an dernier. La mobilisation pour faire face aux attentats ne doit pas faire oublier la pression migratoire et les effectifs qu’elle consomme dans le secteur de Calais et Dunkerque, par exemple, ou encore dans les Alpes-Maritimes ; or, cette situation n’est pas non plus vouée à s’améliorer rapidement.
Se pose donc la question de la contribution des forces de sécurité privées et de celle des autres forces de sécurité publiques, y compris municipales et locales. Certes, nous sommes très attentifs à ce que certaines missions continuent de relever du rôle régalien de l’État, car il y va de l’égalité de traitement et de l’égalité des territoires. La question doit néanmoins être posée, car nous sommes convaincus que la menace actuelle perdurera pendant des années, voire des décennies.
M. Jean-Luc Taltavull. J’ajoute que l’état de la police et de la gendarmerie du quotidien est directement lié à la qualité de la lutte antiterroriste, car les détecteurs de proximité des signaux faibles sont les patrouilles qui connaissent la réalité de la radicalisation et savent remonter les informations. Or, la police du quotidien est aujourd’hui empêtrée dans des gardes statiques, à commencer par celles des commissariats eux-mêmes. Sans doute faut-il envisager d’investir aujourd’hui des moyens dans la sécurisation passive, qu’il s’agisse de bâtiments cultuels ou d’installations sensibles, afin d’économiser demain sur les coûts de fonctionnement des forces militaires mobiles comme Sentinelle.
D’autre part, il faut rétablir les patrouilles de police sur la voie publique, ce qui suppose que les policiers ne soient pas accaparés par des travaux de saisie informatique visant à recueillir des plaintes. Une patrouille de trois agents qui constate une infraction et interpelle son auteur est, à son retour au commissariat, neutralisée pendant trois heures, car l’un des trois agents dresse le procès-verbal et les deux autres ne ressortent pas sans lui tant, dans bien des quartiers, patrouiller à deux est une forme de provocation et supposerait en outre une intervention seul pendant que l’un des deux agents en question garde le véhicule. En tout état de cause, les travaux en cours sur la réforme de la procédure pénale sont primordiaux pour redonner des marges de manœuvre et de l’efficacité à l’action des services de police.
M. le président Georges Fenech. Je vous remercie pour la qualité de vos réponses complètes et riches, qui nous permettront de formuler des propositions dans le sens que vous avez exprimé.
Table ronde, ouverte à la presse, des syndicats de magistrats : M. Olivier Janson, secrétaire général adjoint de l’Union syndicale des magistrats, M. Benjamin Blanchet, chargé de mission ; Mme Clarisse Taron, présidente du Syndicat de la magistrature, Mme Laurence Blisson, secrétaire générale ; Mme Béatrice Brugère, secrétaire générale de FO-Magistrats, M. Jean de Maillard, membre associé
Compte rendu de la table ronde, ouverte à la presse, du mercredi 23 mars 2016
M. le président Georges Fenech. Nous achevons nos travaux de ce jour en recevant des représentants syndicaux de la magistrature, dont l’éclairage nous sera très utile : M. Olivier Janson, secrétaire général adjoint de l’Union syndicale des magistrats (USM), et M. Benjamin Blanchet, chargé de mission ; Mme Clarisse Taron, présidente du Syndicat de la magistrature, et Mme Laurence Blisson, secrétaire générale ; Mme Béatrice Brugère, secrétaire générale de FO Magistrats, et M. Jean de Maillard, membre associé.
Mesdames, messieurs, je vous rappelle que cette table ronde est ouverte à la presse ; elle fait donc l’objet d’une retransmission en direct sur le site internet de l’Assemblée nationale et son enregistrement sera disponible pendant quelques mois sur le portail vidéo de l’Assemblée. Je vous signale, par ailleurs, que la Commission pourra décider de citer dans son rapport tout ou partie du compte rendu qui sera fait de cette audition.
Conformément aux dispositions de l’article 6 de l’ordonnance du 17 novembre 1958 relatif aux commissions d’enquête, je vous demande de prêter le serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité.
M. Olivier Janson, M. Benjamin Blanchet, Mme Clarisse Taron, Mme Laurence Blisson, Mme Béatrice Brugère et M. Jean de Maillard prêtent serment.
M. Olivier Janson, secrétaire général adjoint de l’Union syndicale des magistrats. Nous vous remercions pour votre invitation. Nous sommes sensibles au fait qu’il vous ait paru important d’entendre la parole des magistrats dans son expression syndicale. Nous sommes également sensibles à la manière dont vous avez conduit vos travaux jusqu’ici. En effet, lorsqu’une commission d’enquête parlementaire est créée pour enquêter sur des faits relevant d’une information judiciaire, on est à la limite des compétences respectives de l’autorité judiciaire et du Parlement. Or vous avez su faire en sorte que vos travaux portent sur l’avenir et sur l’état du dispositif législatif plutôt que sur les faits eux-mêmes.
M. le président Georges Fenech. Je profite de cette occasion pour dire publiquement à ceux qui l’auraient mal compris que, contrairement à ce qu’a prétendu la presse, notre commission d’enquête n’a effectué aucune reconstitution au Bataclan. Il s’agissait uniquement pour nous d’analyser les moyens d’intervention des forces et des unités d’élite – on ne parle pas des enquêteurs – afin de comprendre la manière dont ils sont parvenus à neutraliser les terroristes et comment les services de secours ont pris en charge les victimes. Je précise que cette salle de spectacles est actuellement en travaux, qu’aucun scellé n’y avait été posé et que nous n’avons pas empiété sur le domaine judiciaire. Je tenais à faire ce rappel, car j’ai cru comprendre que certains avaient exprimé des états d’âme. Êtes-vous d’accord avec moi, monsieur le rapporteur ?
M. Sébastien Pietrasanta, rapporteur. Tout à fait.
M. le président Georges Fenech. Pardonnez-moi de vous avoir interrompu, monsieur Janson. Veuillez poursuivre.
M. Olivier Janson. L’Union syndicale des magistrats souhaite exprimer un triple message.
Premièrement, bien que l’autorité judiciaire ait une compétence reconnue en matière de lutte contre le terrorisme, qu’il s’agisse du passé ou des faits les plus récents, elle est dotée de moyens absolument insuffisants. Ce manque de moyens est un problème récurrent qui affecte autant les services de renseignement que les services d’enquête et l’autorité judiciaire. Deuxièmement, les instruments juridiques, qui ont évolué au fil du temps, répondent à des besoins, qu’ils soient exprimés par les services de renseignement, par les enquêteurs qui agissent sous la direction du procureur de la République ou par le juge d’instruction. Mais, et c’est le troisième point – sans doute le plus intéressant pour les travaux de votre commission d’enquête –, cette évolution n’a été accompagnée d’aucune réflexion d’ensemble sur la mise en cohérence des interventions respectives des services de renseignement, des services d’enquête et de l’autorité judiciaire. C’est cette absence de réflexion d’ensemble qui suscite le plus d’inquiétudes pour l’avenir : qui décide que telle intervention relève du renseignement et telle autre du judiciaire ? Qui décide de la mise en cohérence des informations ?
Je commencerai donc par évoquer le manque de moyens. Il se trouve que les services placés sous l’autorité du procureur de la République ont été, hélas, mis en lumière par les attentats de janvier et de novembre 2015. J’insiste sur ce point, car, pour l’opinion publique, celui qui symbolise, de fait, la lutte contre le terrorisme, c’est, qu’il le veuille ou non, le procureur de la République de Paris. Celui-ci a en effet démontré, par ses interventions et son mode de communication, la réactivité de l’autorité judiciaire et sa capacité non seulement à remplir sa mission immédiate, mais aussi à prévenir les troubles à l’ordre public. Il ne s’agit pas, ici, de faire son panégyrique : c’est ainsi. Et la magistrature se félicite, de manière sans doute assez unanime, de l’image qui a été donnée de son travail et de celui de l’ensemble des fonctionnaires placés sous l’autorité du procureur de la République de Paris. Pourtant, les moyens dont dispose ce dernier sont dérisoires. Qu’on en juge. La section antiterroriste du parquet de Paris, dite « C1 », qui est compétente pour l’ensemble du territoire français, comprend actuellement, après une évolution intervenue dans le courant de l’année 2015, douze magistrats ! Quant à ceux de la 16e chambre, chargés de juger les infractions terroristes, ils sont au nombre de neuf. Enfin, le pôle antiterroriste, surnommé « la galerie saint-Éloi », compte désormais dix magistrats.
M. le président Georges Fenech. M. Molins, le procureur de la République de Paris, nous a indiqué que des renforts étaient prévus au parquet et à l’instruction.
M. Olivier Janson. Les chiffres que j’ai cités incluent les renforts prévus dans le Plan antiterroriste « PLAT 1 », qui date du début de l’année. Le PLAT 2 prévoit en effet d’autres renforts, mais ils ne sont toujours pas arrivés à l’heure où je vous parle. Du reste, pendant l’année 2015, la communication du ministère a eu tendance à exagérer les renforts apportés notamment à la section antiterroriste. Des appels à candidature ont été lancés, mais la réalité est celle que je viens de vous décrire. Certes, des magistrats ont intégré le parquet de Paris, mais ils sont appelés à renforcer la section antiterroriste de manière tout à fait subsidiaire, en cas d’événements graves ; ils ne sont pas membres de cette section. J’ajoute qu’un seul juge de l’application des peines est spécialisé dans l’antiterrorisme – un second poste devrait être créé au cours de l’année 2016.
Par ailleurs, la cour d’assises spéciale, dont je rappelle qu’elle est entièrement composée de magistrats, requiert sept juges en première instance – neuf en appel –, pour un dossier, sachant que ces affaires sont d’une durée extraordinaire. Des effectifs extrêmement importants sont donc mobilisés, alors que nous ne disposons pas des moyens nécessaires par ailleurs. Je n’évoque pas la situation des juges civils, bien que de très nombreux contentieux soient attendus, notamment en matière de préjudices corporels.
M. le président Georges Fenech. Les représentants des autres syndicats partagent-ils l’avis de l’USM sur l’insuffisance des effectifs, malgré l’annonce de renforts ? Vous auriez pu évoquer également la situation des greffes, monsieur Janson.
M. Olivier Janson. En effet. La chambre correctionnelle chargée de juger les délits terroristes compte sept agents des greffes. Les effectifs sont – le terme n’est peut-être pas adapté compte tenu de la gravité du sujet – ridicules.
Mme Clarisse Taron, présidente du Syndicat de la magistrature. Nous établissons une distinction entre les moyens spécialisés – qui ont été renforcés dans les proportions indiquées et qui, même s’ils sont insuffisants, ont bénéficié d’un réel effort – et les moyens locaux. Une circulaire de décembre 2015 prévoit que, en cas d’attentats multiples, les juridictions et les parquets locaux devront être activés. Des magistrats référents en matière antiterroriste ont donc été désignés au sein de ces juridictions, mais il ne s’agit pas de postes supplémentaires : ces magistrats se voient confier cette tâche en sus de leur service. J’ajoute que nous avons de réelles inquiétudes quant à l’articulation de ces services et à la mobilisation des parquets locaux en cas de besoin. En effet, dans ce domaine, rien n’est fait et, pour ce qui est des moyens techniques, ils sont ce qu’ils sont aujourd’hui dans les juridictions, c’est-à-dire globalement lamentables – je pense notamment à l’informatique et à la téléphonie.
Mme Béatrice Brugère, secrétaire générale de FO Magistrats. Nous abordons ce sujet extrêmement important de façon un peu différente. Pour FO Magistrats, en effet, la question des moyens doit s’analyser en fonction des objectifs visés. Tout d’abord, on a annoncé, après chaque attentat, un renfort substantiel de moyens qui n’est pas arrivé. Mais la désignation de 178 référents locaux pouvait laisser penser que nous allions sortir du dogme jacobin de la centralisation du parquet de Paris. Je m’explique.
La centralisation à Paris de la lutte contre le terrorisme est un choix, qui avait sa raison d’être : le terrorisme a toujours eu un aspect politique, les services de renseignement compétents se trouvent à Paris et les menaces étaient, du point de vue quantitatif, relativement restreintes par rapport à ce qu’elles sont aujourd’hui. Or, comme nous avons désormais affaire à ce que nous appelons des nouvelles menaces extrêmement nombreuses, il nous semble intéressant de lier la question des moyens à une réflexion portant sur une nouvelle organisation de la lutte contre le terrorisme. Celle-ci pourrait ainsi, dès lors que le terrorisme est désormais susceptible de se développer sur l’ensemble du territoire, reposer sur un maillage territorial semblable à celui qui existe en Italie. Certes, les parquets italien et français ne sont pas tout à fait comparables puisque le juge d’instruction n’existe pas en Italie, mais, dans ce pays, plus de 150 magistrats connaissent des affaires de terrorisme, contre une dizaine au parquet antiterroriste français.
Notre vision du terrorisme est séparée de la lutte contre la criminalité organisée alors que la frontière entre ces deux types de criminalité est poreuse. Maintenir la centralisation de la lutte antiterroriste à Paris avec aussi peu d’effectifs traduit surtout, selon nous, un défaut de vision : on n’a pas anticipé la réalité de la menace à venir. En décembre dernier, 178 parquetiers de province ont été désignés référents antiterroristes. Ainsi le ministère a annoncé que les effectifs avaient augmenté alors qu’en réalité, ces magistrats n’ont qu’un pin’s « Antiterrorisme » : cette mission s’ajoute à toutes leurs autres tâches.
M. le président Georges Fenech. Pouvez-vous nous dire précisément ce qu’est un référent antiterroriste dans une juridiction de province ? A-t-il des pouvoirs d’enquête ?
Mme Béatrice Brugère. Ils aimeraient le savoir eux-mêmes… Lors du séminaire auxquels ils ont été invités à participer à Paris, lundi dernier, « C1 », c’est-à-dire le parquet antiterroriste, leur a rappelé que le code de procédure pénale prévoit, en matière de lutte contre le terrorisme, une compétence parisienne, que Paris interprète comme une compétence exclusive – et, de fait, c’est la réalité. Dès lors, pour le parquet antiterroriste de Paris, ces magistrats référents ne doivent surtout rien faire : leur rôle est de fluidifier l’information et de la lui faire remonter. S’il estime – et cela pose un problème de procédure et, éventuellement, d’efficacité – que le début de la procédure relève du terrorisme, il prendra les choses en main et des magistrats parisiens se rendront sur place. S’il estime qu’il ne s’agit pas de terrorisme, les parquetiers doivent traiter l’affaire comme une affaire de droit commun, à l’exception des affaires d’apologie du terrorisme, qui seront traitées en régions, car elles sont considérées comme relativement mineures.
La question des moyens se pose, certes, mais il faut savoir de quoi nous parlons. Actuellement, pour « C1 », la lutte contre le terrorisme doit être centralisée à Paris. C’est un point important, car si, demain, des attaques terroristes sont disséminées sur l’ensemble du territoire, je ne sais pas comment, compte tenu des moyens dont il dispose, « C1 » pourra absorber ces multiples attaques, qui nécessiteront notamment des déplacements et une prise de procédures immédiate afin d’éviter que celles-ci ne soient attaquées par les avocats des terroristes – car ces derniers font du droit et ils choisissent de bons avocats. Une telle organisation poserait donc un problème de fluidité et de garantie des procédures.
M. le rapporteur. N’est-il pas utile que l’information soit centralisée pour éviter qu’elle ne se perde ? Certes, trop d’information tue l’information, mais il est logique que les référents locaux la fassent remonter au parquet antiterroriste afin que celui-ci puisse opérer un tri et repérer les informations pertinentes. C’est d’autant plus important que, même au sein de « C1 », il arrive que des informations se perdent.
M. le président Georges Fenech. Madame Brugère, déduisez-vous du constat que vous avez dressé qu’il faut supprimer la section antiterroriste de Paris et redonner des compétences aux juridictions de province ou bien qu’il faut conserver cette centralisation en augmentant très sensiblement les effectifs ?
Mme Béatrice Brugère. Je décris l’existant. Je ne remets pas en cause le modèle jacobin parisien, qui a eu sa légitimité et sa raison d’être. Je dis simplement que, si l’on conserve ce schéma, on se prive, compte tenu des nouvelles menaces, de renseignements, de la possibilité d’agir avec efficacité et d’une capacité de réaction sur l’ensemble du territoire. Je précise, monsieur le rapporteur, que le renseignement ne remonte pas à Paris, car tel n’est pas le rôle confié aux magistrats dits référents : si un délit est commis, ils doivent interroger « C1 » pour savoir si celui-ci est compétent ou s’ils peuvent eux-mêmes traiter l’affaire.
M. le président Georges Fenech. Je crois que vous avez été vous-même juge antiterroriste, n’est-ce pas ?
Mme Béatrice Brugère. Il se trouve en effet que j’ai été juge antiterroriste – à la 14e chambre, à l’époque. J’ai donc, dans ce domaine, une expérience qui explique peut-être la passion avec laquelle je m’exprime. Quoi qu’il en soit – et c’est un choix politique crucial pour l’avenir de la justice –, si l’on continue à séparer, d’un côté, le terrorisme et, de l’autre, la criminalité organisée – et on peut penser que c’est nécessaire – en estimant que les deux types de criminalité ne se rencontrent jamais, on empêchera que des enquêtes conduites par des juridictions interrégionales spécialisées (JIRS) ou portant sur la criminalité organisée permettent d’anticiper ou, en tout cas, de démanteler des affaires de terrorisme. Mais, encore une fois, ce choix peut se comprendre.
M. le président Georges Fenech. Vous ne nous avez pas dit quel était, selon vous, le schéma idéal. Manifestement, vous n’avez pas la solution.
Mme Béatrice Brugère. Si, mais nous vous l’exposerons plus tard.
M. Olivier Janson. L’USM est d’un avis différent : on ne peut pas avoir 178 pôles antiterroristes particulièrement compétents et réactifs, agissant en parfaite cohérence sur l’ensemble du territoire. Il y a une certaine confusion entre deux notions, qui m’amène au deuxième point que je souhaitais évoquer : l’absence de cohérence et de réflexion structurée sur le rôle et la place de chacun.
Nous sommes confrontés à une évolution radicale du mode terroriste : aux filières se sont ajoutées des entreprises terroristes individuelles – la législation a été modifiée pour tenir compte de cette évolution – ; les attentats, qui étaient centralisés et s’attaquaient à des symboles, ont lieu maintenant – et peut-être, hélas, à l’avenir – en province… Le renseignement doit donc reposer sur un maillage complet du territoire. En revanche, le travail qui consiste à remonter les filières, assurer la cohérence de différentes enquêtes et repérer des liens entre les informations doit évidemment être centralisé. C’est une question, non pas de jacobinisme, mais d’efficacité. Le législateur a créé, dans des domaines tout autres, des pôles de compétence ; il serait tout de même curieux que l’on suive, en matière de terrorisme, une logique inverse qui consisterait à décentraliser.
M. le président Georges Fenech. Personne n’a dit cela !
Mme Clarisse Taron. Le Syndicat de la magistrature est depuis longtemps favorable à ce que l’antiterrorisme soit traité au niveau des juridictions interrégionales spécialisées. Celles-ci, qui sont au nombre de sept, ont des compétences particulières et la possibilité de mobiliser des moyens un peu plus importants que ceux des juridictions de province, avec lesquelles elles ont, en outre, des contacts fréquents. L’échelon des JIRS, dont je rappelle qu’elles sont spécialisées dans la lutte contre la criminalité organisée, nous semble le plus efficace, car il permettrait de prendre en compte les convergences entre terrorisme et criminalité organisée, dont on sait qu’elles existent, notamment en matière de financement.
M. le président Georges Fenech. Vous seriez donc, quant à vous, plutôt favorables à la fin de la centralisation en tant que telle. Vous ai-je bien compris ?
Mme Clarisse Taron. Tout à fait, sous réserve cependant que des formations ciblées soient dispensées aux magistrats concernés. Il ne s’agit pas de réunir une centaine de magistrats pour un séminaire d’une journée. Actuellement, les compétences des référents antiterroristes se résument à la consultation de l’annuaire du « C1 » et aux affaires d’apologie. La circulaire du 18 décembre évoque une compétence, théoriquement en concurrence, mais de fait exclusive. Il nous semble nécessaire de sortir de cette réalité et de privilégier l’échelon des JIRS.
Mme Laurence Blisson, secrétaire générale du Syndicat de la magistrature. Notre revendication est motivée par un souci d’efficacité. Je rappelle que certaines des personnes mises en examen sont mineures. Or ce statut implique une logique particulière et un suivi qui se fera mieux dans un cadre qui n’est pas celui de la centralisation.
Au-delà de la question de l’efficacité, la centralisation, qui a été un mouvement continu jusqu’à la création du juge d’application des peines antiterroriste en 2006, a une dimension politique. Non seulement elle n’est pas un gage d’efficacité, mais elle comporte un risque d’affaiblissement du contrôle par l’autorité judiciaire de l’activité des enquêteurs et des services de renseignement. Concrètement – cela a été étudié par des chercheurs –, elle risque de produire, au sein de la galerie saint-Éloi, des formes d’évidence commune et des méthodes de travail qui ne permettent pas à l’autorité judiciaire de jouer son rôle de contrôle, rôle qui suppose qu’elle soit extérieure aux services d’enquête et de renseignement. La remise en cause de la centralisation présenterait donc un intérêt en termes d’efficacité et sur le plan des principes. Sous ces deux aspects, les JIRS permettraient d’améliorer le fonctionnement de la lutte antiterroriste. Il ne s’agit pas de nier les qualités des magistrats chargés de ces contentieux, mais de rappeler qu’il est important pour l’institution de fonctionner dans un cadre qui lui permet d’agir efficacement dans le respect des prérogatives de chacun.
M. le président Georges Fenech. Ce que vous préconisez supposerait de nombreuses modifications. Vous dites que les magistrats du parquet ou ceux de la galerie saint-Éloi doivent exercer un contrôle. Mais ils sont également là pour enquêter eux-mêmes. Le parquetier et le juge d’instruction dirigent l’enquête, jusqu’à preuve du contraire.
Mme Laurence Blisson. Sur ce point, je vous renvoie au projet de loi « Urvoas », et plus précisément à son article 22, qui précise le rôle du magistrat du ministère public – dont la définition a fait l’objet de nombreuses missions de réflexion, notamment la mission Nadal et la mission Beaume. Outre la direction d’enquête, le magistrat du parquet, en tant que membre de l’autorité judiciaire, exerce une mission de contrôle de la proportionnalité des actes d’enquête et de la légalité.
M. Jean de Maillard, membre associé de FO Magistrats. La position exprimée par le Syndicat de la magistrature n’est pas une synthèse de deux conceptions extrêmes, mais la reprise, sous une autre forme, de ce que nous avons dit. Il est évident, pour nous, que ce n’est pas dans 178 TGI que doit être traitée la question du terrorisme ou de la criminalité organisée. Une « filiarisation » est nécessaire, mais nous estimons qu’il faut aller beaucoup plus loin. En effet, le terrorisme lui-même doit être compris comme une menace parmi d’autres, articulée avec d’autres menaces et indissociable d’elles, même si chacune d’entre elles a ses spécificités. Lorsque Daech vend du pétrole, des objets archéologiques ou alimente des réseaux de traite des êtres humains, qu’il y a des trafics d’armes, de drogue ou de contrefaçons et que tout cela alimente, à différents niveaux, le terrorisme, il est contre-productif et inefficace de dissocier la lutte contre le terrorisme de la lutte contre les autres menaces.
Or la question des moyens fait ressurgir la totalité de la problématique de la lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée, qui n’est pas prise au sérieux, en dépit de toute l’agitation produite. Même si l’on a mis, paraît-il, 800 millions d’euros sur la table et que l’on a promis des centaines, voire des milliers de créations d’emplois, on s’aperçoit, en réalité, qu’il n’y a ni doctrine ni méthodologie, et que les services sont défaillants. Même si nous pensons, bien entendu, que le rôle de la magistrature consiste également à produire des procédures de qualité qui respectent les droits fondamentaux des personnes, nous estimons – et c’est peut-être sur ce point que nous nous séparons du Syndicat de la magistrature – que le problème ne réside pas tant dans le contrôle de ces procédures que dans le fait que la justice ait été mise hors-jeu dans la lutte contre ces nouvelles menaces. Cette mise hors-jeu, qui a débuté il y a longtemps, a été consacrée par la loi sur le renseignement et sera définitivement acquise avec la loi sur le terrorisme, qui élimine le juge d’instruction, confie au parquet des pouvoirs qu’il n’est pas en mesure d’exercer et soulève, du reste, la question de la conformité du ministère public aux critères de la Cour européenne des droits de l’homme.
Il ne s’agit donc pas uniquement d’une question de moyens. La centralisation souligne le problème de l’absence de méthodologie. Je terminerai par une comparaison des situations française et italienne. Les Italiens, qui ont été confrontés dans les années 1980 et 1990 à des phénomènes d’une extrême violence, qu’il s’agisse du terrorisme rouge ou du terrorisme noir, sont familiers de la lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée. Or, aujourd’hui, ils n’ont pas affaire au terrorisme auquel nous devons faire face. Je ne sais pas dans quelle mesure cette situation est due à la qualité de leur justice et de leur police, mais on peut penser que l’existence de directions antimafia dans les tribunaux de district et d’un parquet national antimafia – chargé de réaliser la coordination qui vous préoccupe à juste titre, monsieur le rapporteur – a contribué à créer une culture du renseignement qui permet aux magistrats d’agir de façon stratégique et proactive. Voilà ce qui manque au système français !
M. Olivier Marleix. Je suis convaincu, comme vous, que nous devons être beaucoup plus attentifs au continuum entre criminalité et terrorisme. Pourquoi ne pas imaginer un système qui reposerait sur les JIRS, tout en maintenant un parquet antiterroriste à compétence nationale qui connaîtrait, à l’instar du parquet financier, des affaires les plus importantes ?
M. Jean de Maillard. Nous sommes d’accord. Nous pensons en effet qu’un parquet national est nécessaire, pour traiter des attentats ou des affaires relevant du niveau national ou international et pour assurer une coordination.
M. le rapporteur. Je souhaiterais connaître votre sentiment sur le quantum des peines applicables en matière de terrorisme. Cette question fait l’objet d’une réflexion du parquet antiterroriste, qui considère que la peine sanctionnant l’association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste (AMT) délictuelle n’est pas suffisante.
M. le président Georges Fenech. Je compléterai la question du rapporteur en vous interrogeant sur un sujet qui a été abordé, hier, lors des questions au Gouvernement : la création, pour les crimes de terrorisme, d’une forme de perpétuité réelle, sans aménagement de peine, à laquelle le Premier ministre semble ouvert.
M. Olivier Janson. Les peines prononcées en matière d’AMT sont en effet souvent à la limite du maximum prévu dans la loi…
M. le rapporteur. Et encore : pour cette infraction, je crois qu’elles sont en moyenne de six à sept ans d’emprisonnement, la peine maximale étant de dix ans.
M. Olivier Janson. Dans de nombreux dossiers, les peines prononcées sont de huit, neuf ou dix ans d’emprisonnement. Or, le fait est qu’il est relativement rare qu’une infraction soit sanctionnée, la première fois, de peines aussi lourdes. Cela peut indiquer, en théorie, que la peine n’est pas adaptée. Mais, en pratique, n’oublions pas que seuls les crimes sont punis d’une peine d’emprisonnement supérieure à dix ans. Or, crime égale cour d’assises – cour d’assises spéciale, en l’espèce. Si le législateur, qui vote également notre budget, nous donne les moyens de juger les crimes d’association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, pourquoi pas ? Mais s’il s’agit uniquement de décider que cette infraction constitue désormais un crime, nous ne serons pas en mesure d’en juger les auteurs.
Mme Laurence Blisson. L’échelle des peines fait en effet l’objet d’un débat, notamment depuis qu’un juge d’instruction antiterroriste a pris position en faveur d’un relèvement à quinze ans d’emprisonnement de la peine maximale encourue en matière d’association de malfaiteurs délictuelle. Mais avant d’évoquer l’échelle des peines, il convient de rappeler que l’incrimination d’association de malfaiteurs criminelle existe et peut être retenue lorsqu’il est établi que le projet en germe est de nature criminelle.
M. le rapporteur. Permettez-moi de préciser ma pensée. La réflexion porte, en fait, sur le cas des personnes qui reviennent de Syrie après y avoir participé à un certain nombre d’exactions relevant, par exemple, de la police de la charia ou de crimes de guerre. Faut-il, en ce qui les concerne, rester dans le domaine délictuel, comme c’est le cas aujourd’hui ?
Mme Laurence Blisson. Je rappelle tout d’abord, s’agissant des cas que vous évoquez, que la compétence des juridictions françaises est étendue aux crimes – voire, depuis la loi du 21 décembre 2012, aux délits – commis sur un territoire étranger. Ensuite, le Syndicat de la magistrature attache beaucoup d’importance au fait que, dans le cas de l’association de malfaiteurs, un rapport de proportionnalité doit exister entre les éléments de preuve et la sanction prononcée. Il s’agit en effet d’une infraction très particulière, car il suffit de réunir les preuves d’actes préparatoires qui, en eux-mêmes, n’ont pas nécessairement de caractère illicite et de l’associer à une intention qui doit être caractérisée, sans l’être forcément de manière précise, pour aboutir à une condamnation. Partant de ce constat, il ne nous paraît pas légitime d’augmenter l’échelle des peines sanctionnant cette infraction, car on aboutirait à une déconnexion, préoccupante au regard du droit pénal, entre ce qui est concrètement reproché à une personne et la sanction qui lui est infligée. Nous sommes donc résolument hostiles à une augmentation des peines sanctionnant l’association de malfaiteurs. Et nous ne pouvons pas accepter que l’on justifie la nécessité de relever la peine maximale par le fait que les peines prononcées s’en rapprochent.
S’agissant de la perpétuité réelle, je rappelle que la Cour européenne des droits de l’homme a condamné la Grande-Bretagne pour avoir créé une perpétuité « réelle » – les termes sont souvent impropres – sans possibilité de réexamen. La CEDH estime en effet qu’une personne peut être incarcérée à vie – et c’est le cas de nombreux détenus condamnés à perpétuité en France –, mais que la loi doit prévoir la possibilité d’un réexamen. En l’espèce, le projet de loi « Urvoas » vise à étendre la perpétuité incompressible, c’est-à-dire assortie d’une période de sûreté de trente ans au terme de laquelle un éventuel aménagement peut être examiné. Nous y sommes hostiles.
Il convient de rappeler, à cet égard, un élément fondamental. Il est évident que la perpétuité dite « incompressible » concerne des crimes d’une extrême gravité, qui suscitent une émotion très forte et ont de lourdes conséquences sur la société. Pour autant, il nous semble que la loi ne doit pas perdre de vue les principes d’un droit pénal humaniste, qui ne peut pas s’envisager comme un droit de l’élimination sociale totale. Concrètement, il existe aujourd’hui, pour les personnes condamnées à la réclusion criminelle à perpétuité, un délai – de dix-huit à vingt-deux ans – au terme duquel elles peuvent solliciter un aménagement de peine. Elles doivent, pour cela, se soumettre à de multiples expertises, passer devant le Conseil national de l’évaluation et la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, qui émettra un avis, et faire l’objet d’un examen de dangerosité très minutieux. Et, en définitive, il est difficile de leur proposer un aménagement de peine.
Toute la philosophie pénale française est fondée sur l’idée que la peine sert, certes, dans un premier temps, à punir et à mettre la société hors de danger, mais aussi à prévoir le retour des personnes condamnées dans la société, car elle se refuse à présupposer que celles-ci, quelles que soient la nature et la gravité de leur crime, puissent être irrécupérables par principe. Il est important que l’on ne perde pas de vue, sous le coup d’une émotion légitime, ces principes, que nous jugeons fondamentaux, du droit pénal.
M. le président Georges Fenech. Votre raisonnement vaut également pour celui qui, dans l’hypothèse où il aurait été capturé vivant, a tué, avec sa kalachnikov, quatre-vingt-dix personnes au Bataclan. Pardonnez-moi la brutalité de ma question, mais pensez-vous que ce type d’individu peut, un jour, retrouver le chemin de la société ?
Mme Laurence Blisson. Je refuse absolument de présupposer le contraire. La juridiction saisie décidera de prononcer, ou non, une peine de réclusion criminelle à perpétuité, puis la juridiction de l’application des peines examinera la situation, après un parcours de plusieurs dizaines d’années. L’incarcération doit avoir, nous semble-t-il, pour objectif de tenter, par tous les moyens, de faire évoluer les personnes.
M. Benjamin Blanchet, chargé de mission à l’Union syndicale des magistrats. J’ajouterai que le Conseil constitutionnel a indiqué, dans une décision du 20 janvier 1994, que toute sanction pénale devait avoir pour objectif l’amendement et la resocialisation du condamné. Si la perpétuité réelle, lorsqu’elle a été introduite dans notre droit pour les meurtres d’enfants accompagnés de viol ou d’actes de torture et de barbarie, a pu passer avec succès l’épreuve du contrôle de constitutionnalité, c’est parce que la possibilité a été prévue, au-delà d’un délai de trente ans, de réexaminer la situation de la personne condamnée et, le cas échéant, d’envisager une mesure de libération. En l’état actuel de notre droit constitutionnel, il n’est donc pas possible, à mon avis, de prévoir une perpétuité réelle, c’est-à-dire une peine de privation de liberté définitive, qui ne connaîtrait aucun aménagement possible.
M. Jean de Maillard. Le problème, pour FO Magistrats, n’est pas tant celui de la peine extrême – qui, comme la déchéance de nationalité, aurait sans doute très peu d’occasions de s’appliquer – que celui des peines de durée moyenne. Vous rappeliez, monsieur le rapporteur, que les peines prononcées pour association de malfaiteurs étaient en moyenne de six ou sept ans d’emprisonnement. Or il faut savoir que, dans notre système, l’érosion des peines est telle qu’une personne condamnée à six ans d’emprisonnement est, dès l’entrée en détention, « conditionnable » à partir d’environ deux ans, compte tenu des réductions de peines automatiques qui lui seront accordées.
Nous pensons, de manière générale, que l’échelle des peines telle qu’elle a été fixée lors de la réforme du code pénal est insuffisante, en particulier en matière de criminalité organisée et de terrorisme. De fait, en matière correctionnelle, le plafond est de dix ans, c’est-à-dire qu’en pratique une personne condamnée à cette peine maximale n’effectuera, pour les raisons que je viens d’indiquer, qu’une peine d’emprisonnement d’environ cinq ans, ce qui nous paraît extrêmement insuffisant pour des faits relevant de la criminalité organisée notamment.
Les plafonds devraient donc être rehaussés, d’autant plus que, dans ces domaines-là, la correctionnalisation est importante, et ce pour deux raisons. Tout d’abord, beaucoup de dossiers terroristes sont traités en association de malfaiteurs. En effet, la plupart du temps, les terroristes ne sont plus présents pour assister à leur procès, qui n’a donc pas lieu. En revanche, ils peuvent être arrêtés, jugés et condamnés lorsqu’on a agi préventivement ; c’est pourquoi la majeure partie des affaires de terrorisme sont des affaires correctionnelles. Ensuite, la correctionnalisation peut intervenir – même si c’est sans doute moins le cas en matière de terrorisme – pour des raisons qui tiennent à la gestion des flux. En effet, la justice n’étant pas en mesure, comme l’a indiqué mon collègue de l’USM, de tout assumer, elle préférera correctionnaliser certaines affaires, y compris peut-être des affaires de terrorisme.
Mais notre préoccupation est ailleurs. Vous avez évoqué, Monsieur le président, la question de savoir ce que l’on fait des personnes qui sortent de prison après avoir purgé leur peine. La dangerosité de certaines d’entre elles n’est pas forcément moindre, quels que soient les efforts qui ont pu être été faits, car notre système pénitentiaire n’est certainement pas en mesure aujourd’hui de garantir la réinsertion des anciens détenus. Il s’agit donc d’une réelle préoccupation, et nous pensons que ce débat devrait être ouvert sans exclusive, ni crainte, ni honte. Les nombreuses discussions suscitées par les infractions de violences sexuelles commises par des personnes ayant des caractères psychiatriques prononcés ont abouti à des mesures telles que la rétention de sûreté. Nous nous demandons s’il n’est pas nécessaire que des mesures graduées puissent être envisagées une fois que la personne a purgé sa peine. Lorsque des détenus comme auraient pu l’être les frères Kouachi, par exemple, sortent de prison après avoir été placés en détention pendant X années, ils sont toujours les frères Kouachi : que fait-on ?
Bien entendu, se pose le problème de la prédictibilité, nous en avons bien conscience ; c’est pourquoi nous n’apportons pas de réponse. Mais nous pensons qu’il ne faut pas refuser ce débat.
M. Olivier Marleix. Je souhaiterais prolonger la question de notre rapporteur sur les djihadistes de retour de Syrie, qui font peser une menace terrible sur la sécurité de nos concitoyens. L’opinion ne manquerait pas d’être interpellée si, par malheur, une personne qui avait été poursuivie, voire condamnée, repassait à l’acte. La difficulté à laquelle nous sommes confrontés tient à la nécessité de réunir des éléments de preuve suffisants, d’autant qu’une des personnes que nous avons auditionnées nous a indiqué que certains renseignements, couverts par le secret-défense, ne pourraient pas forcément, aussi graves soient-ils, constituer des éléments de preuve. Nous nous retrouvons donc dans une situation où des djihadistes ou des personnes participant à une entreprise djihadiste sont condamnés « par défaut » pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, cette qualification étant un peu, si l’on reprend les circulaires de Mme Taubira, l’alpha et l’oméga de la politique pénale sur ce sujet.
Je me demande donc pourquoi on n’utilise pas d’autres incriminations qui figurent dans le code pénal. Je pense notamment à l’intelligence avec une puissance étrangère, prévue à l’article 411-4, qui est punie de trente ans de réclusion. Bien entendu, cet article n’a pas été appliqué depuis 1944, ce qui peut soulever des questions, mais cette incrimination figure dans notre droit positif, et l’objet de notre commission d’enquête est de savoir si l’on applique bien la loi dans notre pays. On trouve également, dans les livres II et IV bis, la complicité de génocide ou la complicité de crime de guerre. Je suis bien conscient que, là encore, la preuve de tels actes est difficile à établir, mais la complicité est une notion que les juges ont l’habitude de manier. En tout état de cause, ces incriminations pourraient au moins justifier, dans un certain nombre de cas, un placement en détention préventive qui laisserait davantage de temps que les poursuites pour association de malfaiteurs pour examiner la situation de certaines personnes.
M. le président Georges Fenech. Certains proposent même l’application du livre IV, qui a trait aux infractions militaires.
M. Olivier Janson. Votre question est paradoxale à divers titres. Tout d’abord, il me semble que, pour ses dirigeants, le fait que l’on qualifie Daech de puissance étrangère serait sans doute une forme de victoire – nous nous souvenons des débats qu’a suscités l’utilisation de l’expression « État islamique ».
Ensuite, la situation que vous évoquez est au cœur des difficultés rencontrées tant par les services de renseignement que par l’autorité judiciaire. Je veux parler de ces centaines de personnes qui se sont rendues sur des théâtres d’opérations terroristes, qui en sont revenues ou vont en revenir et dont on ne sait pas grand-chose de plus, ce qui est en soi particulièrement inquiétant. Or, bien que le Parlement ait très récemment légiféré sur ce sujet dans le cadre de la loi sur la criminalité organisée, ce comportement ne correspond actuellement à aucune incrimination, quelle qu’elle soit. Ainsi, les services de renseignement se plaignent de ne pouvoir judiciariser ce type de comportements parce qu’il leur manque souvent un des éléments constitutifs des infractions pénales existantes. Pour que l’infraction d’entreprise individuelle terroriste soit retenue, par exemple, il faudrait prouver, en outre, que la personne a acquis ou tenté d’acquérir des armes ou des substances explosives. Or le législateur a estimé que la réponse – il en a décidé ainsi dans l’article 20 du projet de loi sur la criminalité organisée – ne doit pas être pénale, mais administrative !
Le Sénat avait pourtant suggéré, dans le cadre d’une proposition de loi qu’il a adoptée en décembre dernier, que cette réponse soit pénale, donc judiciaire, en créant un délit nouveau qui correspond point par point à la définition du comportement qui relèverait, aux termes du projet de loi, d’un arrêté administratif, à savoir le fait de s’être rendu ou d’avoir tenté de se rendre, sans motifs légitimes – cette précision permet d’éviter que le personnel humanitaire ou les journalistes n’entrent dans le champ de cette nouvelle incrimination – sur un théâtre d’opérations terroristes. La création d’un tel délit constituerait une réponse autrement plus efficace à ce type de comportements qu’une assignation à résidence d’un mois, éventuellement renouvelable une fois, ne serait-ce que parce qu’elle permettrait de décider un contrôle judiciaire ou de prendre une mesure de détention provisoire. J’indique au passage que le projet de loi renforçant la lutte contre le crime organisé est en cours d’examen au Sénat. S’il fait l’objet d’une commission mixte paritaire, peut-être le législateur devrait-il envisager de ne pas se soumettre à une vision qui est celle des services de renseignement.
Mme Clarisse Taron. Je souhaiterais revenir sur le fantasme de la correctionnalisation : je ne crois pas que beaucoup de magistrats envisagent de correctionnaliser des infractions terroristes. La correctionnalisation est, certes, parfois utilisée pour des raisons qui tiennent à la gestion des flux devant la cour d’assises, mais, entre la correctionnalisation d’un vol à main armée avec une arme factice et celle d’une affaire de terrorisme, la marge est tout de même importante.
En ce qui concerne la rétention de sûreté, le Syndicat de la magistrature est très clairement opposé à l’extension de cette mesure, dont on se doutait bien qu’elle risquait de revenir par la fenêtre dans le cadre de la lutte antiterroriste. Il semblerait, du reste, que Jean-Jacques Urvoas partage cet avis puisqu’il a indiqué qu’elle ne devait pas être envisagée pour ce type d’infractions.
Enfin, il convient de rappeler qu’existe l’imputation d’association de malfaiteurs en vue de commettre un crime, qui permet de punir les actes préparatoires – dont on disait pourtant, il n’y a pas si longtemps, qu’ils n’étaient pas plus punissables que la seule intention délictuelle. L’association de malfaiteurs délictuelle s’applique donc à des comportements qui, objectivement, n’ont pas à recevoir de qualification criminelle et pour lesquels la peine actuellement encourue est suffisante.
Mme Laurence Blisson. Il est évident, pour le Syndicat de la magistrature, que les personnes qui reviennent de théâtres d’opérations doivent faire l’objet d’une attention toute particulière des services de renseignement et des services d’enquête dans le cadre d’enquêtes judiciaires. Toutefois, les deux réponses proposées – d’une part, l’assignation administrative à résidence prévue à l’article 20 du projet de loi renforçant la lutte contre la criminalité organisée et, d’autre part, la création d’une infraction pénale spécifique pour ainsi dire purement matérielle qui serait constituée dès lors que l’on s’est rendu ou que l’on a tenté de se rendre sur un théâtre d’opérations terroristes –, ces deux solutions ne sont pas satisfaisantes. Lorsqu’une personne est de retour en France et que les éléments permettant de caractériser l’association de malfaiteurs ou l’entreprise individuelle – infraction qui est fort peu utilisée, si bien que l’on peut se demander si elle était vraiment nécessaire –, il est possible de la mettre en examen et de la placer en détention provisoire. Ainsi, soixante-treize des personnes revenues de ces théâtres d’opérations sont placées en détention provisoire et d’autres ont été placées sous contrôle judiciaire.
Dans un système démocratique, il n’est pas acceptable que l’on envisage de créer une mesure administrative afin de combler le vide créé par l’absence des indices graves et concordants que requiert la loi pour mettre une personne en examen puis, le cas échéant, prendre une mesure de sûreté. Dans un tel cas, l’enquête – accompagnée, éventuellement, de mesures de surveillance – doit se poursuivre afin de réunir les preuves suffisantes. Il a été dit que l’on était souvent confronté à une difficulté probatoire. Je rappelle à cet égard que les membres des services de renseignement sont soumis, au même titre que tout autre fonctionnaire, à l’article 40 du code de procédure pénale, qui leur impose de signaler au procureur de la République toute infraction qui serait portée à leur connaissance.
Quant à la création d’une infraction pénale autonome, elle nous paraît extrêmement problématique, car, cette fois-ci, on déconnecterait l’infraction de tout contenu concret. De fait, l’action pourra être caractérisée – « Il y est allé » –, mais on ne cherchera pas à savoir ce qui s’est passé ni, par conséquent, quel est le préjudice pour la société. Je ne dis pas que les personnes qui reviennent de ces théâtres d’opérations n’ont pas commis ou ne préparent pas des infractions ; je dis simplement que, dans un système pénal démocratique, il est nécessaire, lorsqu’on définit une infraction pénale, qu’elle soit constituée par des éléments matériels qui portent préjudice à un intérêt protégé par la loi et par un élément intentionnel. Or tel ne serait pas le cas de cette infraction.
Le droit pénal et la pratique antiterroriste utilisent très largement les infractions existantes. Il ne serait pas de bonne législation de les étendre sur le versant administratif ou sur le versant pénal.
M. Jean de Maillard. Juste un mot sur la question de la correctionnalisation des affaires de terrorisme. Il ne s’agit évidemment pas de correctionnaliser les attentats du 13 novembre, par exemple. Mais, entre une association de malfaiteurs correctionnelle et une association de malfaiteurs criminelle, on choisira la première, car on ne peut pas saisir la cour d’assises sur de tels motifs.
Les incriminations évoquées par M. Marleix pourraient en effet être utilisées, mais il faudrait étendre leur qualification, car les textes ne sont pas adaptés. On retomberait néanmoins sur le problème du basculement du correctionnel vers le criminel, qui n’est pas la démarche privilégiée. En effet, on ne conçoit pas que l’action du juge puisse être un moyen de lutter contre le terrorisme : tout est axé sur le renseignement et l’aspect judiciaire est sacrifié. Nous estimons – et nous nous différencions sur ce point du Syndicat de la magistrature – que le fait de se rendre sur un théâtre d’opérations sans motifs légitimes doit devenir une infraction objective, car, dès lors que cette qualification existera, ce sera à la personne qui revient de ce théâtre d’opérations de se justifier en donnant les raisons pour lesquelles elle s’y est rendue, et, si elle n’en a aucune, tant pis : au moins, la société pourra se protéger.
M. Christophe Cavard. Je précise que le quantum des peines fait encore débat au sein de l’Assemblée. Nous sommes en effet un certain nombre à penser que ce n’est pas en se livrant à une surenchère dans ce domaine que nous nous protégerons mieux des actes terroristes. Nous non plus, nous ne sommes pas d’accord sur tout. Par ailleurs, on a évoqué le rôle de l’incarcération et la question de la sortie de prison, qui m’intéresse tout particulièrement. Il est évidemment impossible, dans le contexte actuel, de débattre de ce que deviendra Salah Abdeslam après sa détention : l’émotion est trop forte. En revanche, on peut s’interroger sur l’accompagnement, au moment de sa sortie de prison, d’un jeune qui revient d’un théâtre d’opérations et dont il est prouvé qu’il a participé à un certain nombre de faits. Je souhaiterais donc avoir votre avis sur les mesures qui permettraient de favoriser la réinsertion d’anciens détenus potentiellement dangereux tout en garantissant la protection de la société.
M. le président Georges Fenech. C’est une très vaste question…
M. Christophe Cavard. C’est vrai, mais on peut me répondre par écrit.
Par ailleurs, je fais partie de ceux qui pensent qu’il n’est pas forcément nécessaire de créer de nouvelles infractions. Or une mesure administrative permet de neutraliser une personne le temps que dure l’enquête. Certes, le délai n’est peut-être pas suffisamment long pour que cette enquête puisse être menée à son terme. Mais c’est une des raisons pour lesquelles un certain nombre d’entre nous ont défendu cette mesure.
M. Benjamin Blanchet. Je vais essayer de vous répondre brièvement. L’article 66 de la Constitution fait de l’autorité judiciaire la gardienne des libertés individuelles. Or, du fait de l’accroissement du rôle de l’administration en matière de rétention et de contrôle administratif des personnes revenant de théâtres d’opérations, le juge judiciaire est de plus en plus écarté, voire disparaît du traitement de ces questions et d’une partie importante de la lutte contre le terrorisme. C’est un véritable problème. Les parlementaires manifestent-ils une défiance vis-à-vis des juges et, si tel est le cas, quelle est la cause de cette défiance ?
M. Olivier Marleix. Le juge ne peut pas aller enquêter en Syrie actuellement et il ne peut donc pas réunir de preuves !
M. Olivier Janson. Le fameux article 20 du projet de loi renforçant la lutte contre la criminalité vise à sanctionner un comportement, le fait de s’être rendu sur un théâtre d’opérations terroristes, par une décision administrative. Le caractère probant ou non des éléments n’est finalement pas si important, semble-t-on penser, puisque l’intéressé pourrait éventuellement saisir le juge administratif a posteriori. Mais comme, de surcroît, vous avez écarté le principe d’un référé, le droit commun s’appliquerait, de sorte que le juge pourrait statuer dans un délai de quatre mois, alors que la durée de la mesure est de un mois... On comprend bien que, dans une telle procédure, la liberté serait garantie d’une manière qui n’est peut-être pas tout à fait conforme à l’esprit du constituant de 1958…
Mme Laurence Blisson. Cette question est lancinante, puisqu’elle s’était déjà posée à propos de l’interdiction administrative du territoire. Il ne s’agit pas d’une querelle de chapelles entre le juge judiciaire et le juge administratif, comme ont voulu le faire croire ceux qui ont caricaturé notre critique de l’état d’urgence. Dans une démocratie, la privation de liberté doit reposer sur un fondement clair, c’est-à-dire une infraction clairement définie à la loi pénale, et non une dangerosité potentielle. Elle doit être précédée d’un débat contradictoire et la décision doit être prise a priori par une autorité juridictionnelle indépendante. Elle ne saurait faire uniquement l’objet d’un contrôle juridictionnel a posteriori, celui du juge administratif, qui est, au demeurant, comme on l’a vu pendant l’état d’urgence, limité par les termes mêmes de la loi. On ne peut pas, dans une démocratie, prendre une mesure privative de liberté si la base juridique sur laquelle elle repose est vague, comme c’est le cas dans ces dispositifs.
M. le président Georges Fenech. Je précise que la dernière réforme que nous avons adoptée confie au juge de la liberté et de la détention (JLD) un rôle important, puisque le parquet travaille de plus en plus avec lui.
Mme Laurence Blisson. Le problème que pose cette évolution de la procédure pénale – qui est ancienne, puisqu’elle a débuté avec les lois Perben –, c’est qu’elle marginalise et retarde l’intervention du juge judiciaire, alors même que le statut du parquet ne sera modifié, s’il l’est, qu’à la marge – puisque cette modification, nous annonce-t-on, serait limitée à l’avis conforme du CSM – et que celui du JLD est encore fragile puisqu’il n’est toujours pas nommé par décret et peut donc être muté par décision du président. En outre, le JLD intervient de manière sporadique dans un dossier ; il n’en a pas la connaissance qu’en a un juge d’instruction. Concrètement, il est sollicité dans l’urgence par un magistrat du parquet dans un dossier sur lequel il n’est pas en mesure d’exercer un contrôle suffisant pour que ce décalage de la procédure soit acceptable. Nous ne sommes donc pas favorables à ces mesures.
En ce qui concerne les peines, il y aurait beaucoup à dire sur un système dans lequel des personnes seraient par principe, à raison de l’incrimination terroriste, exclues de la logique qui préside à l’exécution et à l’application des peines en matière de réinsertion. Peut-être les sciences sociales, qui se focalisent actuellement sur la question de la détection a priori, se trompent-elles d’objet. On nous dit en effet qu’il n’est pas possible de détecter le passage à l’acte violent. En revanche, on peut mener une réflexion approfondie sur la manière dont on peut tenter de faire sortir les gens d’un tel parcours. D’autant que l’on sait que les profils des personnes revenues d’Irak ou de Syrie et les conditions dans lesquelles elles reviennent sont très différents.
M. le président Georges Fenech. Notre commission d’enquête doit bientôt se rendre à La Haye pour visiter Eurojust. Je souhaiterais donc avoir votre sentiment sur le niveau de la coopération judiciaire dans le domaine de la lutte antiterroriste.
M. Olivier Janson. Il est difficile de vous répondre de manière synthétique. Les instruments existent ; la difficulté est liée à la marginalisation de l’autorité judiciaire qui vient d’être rappelée. Certes, le terrorisme n’est pas le même aujourd’hui qu’il y a dix ans, mais, à cette époque, la justice antiterroriste était représentée par le juge d’instruction antiterroriste. La coopération internationale fonctionnait bien parce que ces juges étaient clairement repérés, qu’ils occupaient leurs fonctions pendant une durée significative et qu’ils avaient des contacts réguliers avec leurs homologues étrangers. Aujourd’hui, les juges d’instruction sont marginalisés par les textes et par la pratique ; ils ne sont plus les interlocuteurs classiques des référents antiterroristes européens. Mais le parquet n’est pas pour autant en mesure de répondre à toutes les attentes légitimes en la matière.
Je souhaiterais, à ce propos, évoquer certains points qui n’ont été qu’effleurés alors qu’ils sont, selon nous, au cœur des difficultés liées à la lutte antiterroriste. Comment fait-on pour gérer une masse considérable d’informations – les moyens techniques que vous avez donnés aux services de renseignements produisent une telle quantité d’informations qu’ils reconnaissent eux-mêmes être dépassés – et, dans le même temps, remonter des filières ? Ces deux problématiques ne se traitent pas de la même manière. Où placer le curseur pour distinguer ce qui relève de l’administratif, c’est-à-dire du renseignement, et ce qui relève des enquêtes judiciaires ? Dans les lois qui ont été adoptées depuis juillet dernier, le législateur a confié de fait aux services de renseignement le soin de répondre à cette question. Les textes ne prévoient en effet ni contrôle ni coopération : ce sont les services de renseignement qui décident du moment où ils vont judiciariser, de ce qu’ils vont faire connaître et de ce qu’ils gardent pour eux. C’est un problème particulièrement important au regard de l’efficacité de la réponse antiterroriste en général.
J’ai bien conscience de m’être écarté de votre question, monsieur le président, mais quelle est notre légitimité vis-à-vis de nos interlocuteurs européens lorsque nous nous présentons en ordre dispersé, comme c’est le cas actuellement ? Il faudrait peut-être que le législateur redonne une certaine cohérence au dispositif en confiant aux services de renseignement le soin de traiter la masse des informations qu’ils collectent, en prévoyant que l’autorité judiciaire doit intervenir dès qu’est repéré le début de quelque chose qui relève d’une infraction, et en décidant que les dossiers au long cours seront traités par des juges antiterroristes. Il faut revenir aux fondamentaux !
M. le président Georges Fenech. Je retiens de tout ce que vous avez dit au moins un point d’accord entre les trois syndicats que vous représentez : les moyens dont bénéficie la section C1 sont dérisoires, ridicules, avez-vous dit – dix juges d’instruction et douze parquetiers pour l’ensemble du pays –, alors que les affaires sont d’une extrême complexité et sans doute loin de se terminer.
M. Olivier Janson. Et alors même que la compétence de ces magistrats est reconnue !
Mme Laurence Blisson. Il me semble que nous nous accordons également sur un autre point, celui de la compétence du juge judiciaire.
M. le président Georges Fenech. J’ai bien compris.
M. Jean de Maillard. Pour nous, la question des moyens révèle – et c’est le point essentiel – une absence de doctrine, de méthode et de cohérence de l’action. Nous souffrons, dans notre pays, de carences considérables dans la compréhension de ce phénomène, voire dans la volonté de le comprendre, et c’est grave.
Audition, à huis clos, de M. François Molins, procureur de la République près le tribunal de grande instance (TGI) de Paris, Mme Véronique Degermann, procureure de la République adjointe près le même TGI, et Mme Camille Hennetier, vice-procureure de la République près ledit TGI
Compte rendu de l’audition, à huis clos, du mercredi 30 mars 2016
M. Georges Fenech, président. Monsieur le procureur de la République, mesdames les procureurs, nous vous remercions d’avoir répondu à la demande d’audition de notre Commission d’enquête relative aux moyens mis en œuvre par l’État pour lutter contre le terrorisme depuis le 7 janvier 2015.
Nous avons déjà tenu de nombreuses auditions, consacrées tout d’abord aux victimes et à leur prise en charge par les secours, ensuite à la chronologie des événements de janvier et de novembre 2015, puis, à la lumière de l’expérience des attentats de janvier et novembre, aux moyens et aux missions des forces de sécurité. Enfin, nous avons reçu mercredi dernier les syndicats de magistrats.
Monsieur le procureur, nous sommes particulièrement impatients de vous entendre et de pouvoir vous questionner, dans le respect de la séparation des pouvoirs, sur le rôle du parquet, les procédures judiciaires et les moyens de lutter contre le terrorisme. Vous êtes accompagné des responsables du parquet anti-terroriste, Mme Véronique Degermann, procureur de la République adjoint, et Mme Camille Hennetier, vice-procureur de la République.
Cette audition, en raison de la confidentialité des informations que vous êtes susceptibles de nous délivrer, se déroule à huis clos. Elle n’est donc pas diffusée sur le site internet de l’Assemblée. Néanmoins, conformément à l’article 6 de l’ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, son compte rendu pourra être publié en tout ou partie, si nous en décidons ainsi à l’issue de nos travaux. Je précise que les comptes rendus des auditions qui auront eu lieu à huis clos seront au préalable transmis aux personnes entendues afin de recueillir leurs observations. Ces observations seront soumises à la Commission, qui pourra décider d’en faire état dans son rapport. Je rappelle que, conformément aux dispositions du même article, « sera punie des peines prévues à l’article 226-13 du code pénal toute personne qui, dans un délai de vingt-cinq ans divulguera ou publiera une information relative aux travaux non publics d’une commission d’enquête, sauf si le rapport publié à la fin des travaux de la commission a fait état de cette information ».
Conformément aux dispositions de l’article 6 précité, je vais maintenant vous demander de prêter le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité.
M. François Molins, Mme Camille Hennetier et Mme Véronique Degermann prêtent serment.
Monsieur le procureur, je vous laisse la parole pour un exposé liminaire qui sera suivi par un échange de questions et réponses.
M. François Molins, procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris. Je veux souligner, tout d’abord, qu’après chaque vague d’attentats terroristes, en janvier comme en novembre 2015, le parquet de Paris a procédé à des retours d’expérience qui ont consisté à évaluer les dispositifs et modes de fonctionnement mis en œuvre afin d’identifier ce qui pouvait être corrigé ou amélioré.
La section antiterroriste du parquet de Paris est compétente pour traiter toutes les infractions terroristes commises sur le territoire national ainsi que, dans certains cas, à l’étranger. Elle désigne les services de police chargés de l’enquête et assume ensuite un rôle de direction de l’enquête.
Ses effectifs étaient de sept magistrats du parquet en 2014. Ce nombre a été porté à huit début janvier 2015, puis à neuf en février 2015 et enfin à onze en janvier 2016. Il s’agit là des effectifs permanents, mais les moyens consacrés aux affaires terroristes peuvent être considérablement augmentés de façon ponctuelle dans le cadre de la cellule de crise puisque nous avons la possibilité de mobiliser de façon immédiate de nombreux magistrats : les effectifs localisés à Paris sont de 134 magistrats du parquet.
La cellule de crise est une unité dédiée, intégrée au parquet, dirigée par le procureur de la République et mise en œuvre par la section anti-terroriste avec le concours de l’ensemble des magistrats du parquet. Elle a vocation à être activée en cas d’événement terroriste majeur nécessitant la mobilisation, en continu et sur une longue période, d’un grand nombre de magistrats.
Sa mission est d’assurer la conduite de l’action publique mais aussi la direction des enquêtes, en assurant au sein du palais de justice de Paris une permanence de magistrats du parquet et de greffiers vingt-quatre heures sur vingt-quatre sept jours sur sept, en offrant un point d’entrée aisément identifiable à tous nos partenaires, qu’il s’agisse des services de police, des états-majors, des experts de l’Institut de médecine légale (IML), de la cellule interministérielle d’aide aux victimes (CIAV) ou des parquets extérieurs, et en assurant la centralisation et la synthèse de l’information recueillie.
La cellule de crise est activée sur décision du procureur de la République à la suite de la saisine de la section anti-terroriste et elle a vocation à fonctionner pendant toute la durée de l’enquête, jusqu’à la saisine d’un juge d’instruction.
Elle s’appuie sur une liste de magistrats mobilisables à tout moment, qui était composée de trente-neuf magistrats jusqu’en novembre 2015. Afin de pouvoir faire face à des attaques simultanées sur l’ensemble du territoire national, ces effectifs viennent d’être portés à soixante-deux magistrats, et nous avons donc ainsi la possibilité de mobiliser en permanence un total de soixante-treize magistrats du parquet.
En font partie le procureur de la République, la procureure adjointe en charge de la division dans laquelle se trouve la cellule anti-terroriste, la chef de la section anti-terroriste, le magistrat chargé de la communication du parquet de Paris, ainsi qu’un représentant du parquet général dont la présence est destinée à faciliter la remontée d’informations vers la direction des affaires criminelles et des grâces.
La cellule de crise a été activée à quatre reprises dans son histoire : à l’occasion de l’affaire Merah en 2012, à l’occasion de l’affaire Sarcelles-Torcy en 2013, à la suite des attentats de janvier et enfin à la suite des attentats de novembre. Dès que la cellule est activée, les collègues inscrits sur la liste savent qu’ils doivent se rendre disponibles.
La cellule de crise est responsable de la saisine des services d’enquête. Nous saisissons principalement trois services : la section anti-terroriste de la brigade criminelle de la police judiciaire de Paris, pour les infractions commises à Paris et dans les départements de la petite couronne, la sous-direction anti-terroriste (SDAT) de la Direction centrale de la police judiciaire, et enfin la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI), pour les infractions commises à l’étranger ou par des individus ayant des liens avec l’étranger. En cas d’attentats d’ampleur, la règle est de saisir systématiquement ces trois services en même temps, l’un d’eux étant désigné par le parquet en qualité de coordonnateur.
La cellule de crise doit ensuite recevoir et traiter l’ensemble des comptes rendus intéressant les événements terroristes. Elle va devoir diriger les investigations, assurer une présence au sein des structures d’accueil et d’aide aux victimes, l’IML, la CIAV, l’École militaire, ainsi qu’au sein des états-majors et PC de crise au ministère de l’intérieur, de la Direction centrale de la police judiciaire (DCPJ), de la DGSI, et ordonner les autopsies et expertises de médecine légale nécessaires.
S’agissant des attentats des 7, 8 et 9 janvier 2015, la cellule de crise a été activée le 7 janvier au pied de l’immeuble de Charlie Hebdo et a fonctionné en continu pendant quatorze jours, jusqu’à ce que nous saisissions un juge d’instruction. Elle a délivré pendant ce laps de temps 109 réquisitions en matière médico-légale, dix-huit requêtes en autorisation de perquisition de nuit, soixante-dix autorisations de géolocalisation, quatre-vingt-une requêtes en interceptions judiciaires, quatre demandes d’entraide pénale internationale et neuf mandats de recherche, en gérant de surcroît trente et une mesures de garde à vue.
S’agissant des attentats du 13 novembre 2015, la cellule de crise a été activée dès la saisine de la section anti-terroriste, le 13 novembre vers 22 h 30 ou 22 h 45, et a fonctionné en continu jusqu’au mardi 24 novembre, date de l’ouverture de l’information judiciaire et du défèrement de la personne gardée à vue. Elle a fonctionné de manière continue pendant onze jours, mobilisant trente-neuf magistrats du parquet, dont les neuf magistrats de la section, et onze greffiers.
Les magistrats de la section anti-terroriste ont été spécifiquement affectés aux transports sur les lieux et au suivi de l’enquête, selon une répartition par thématique, tandis que les magistrats en renfort ont été principalement affectés à l’atelier victimes-témoins. Compte tenu du nombre très élevé de victimes, c’est en effet sur cette thématique que ce sont concentrés la plus grande partie des renforts : l’établissement de la liste unique des victimes (LUV) a nécessité de synthétiser plus d’un millier d’auditions de police. De même, la présence d’un magistrat a dû être assurée à l’IML durant toute l’enquête.
Durant les onze jours de l’enquête de flagrance sur les attentats de novembre, nous avons délivré 325 réquisitions en matière médico-légale, cinq requêtes en autorisation de perquisition de nuit, quarante et une autorisations de géolocalisation, quarante-sept requêtes en interceptions judiciaires, six demandes d’entraide pénale internationale, avec la Belgique et l’Allemagne, une équipe commune d’enquête, avec la Belgique, signée le lundi 16 novembre, et trois mandats de recherche.
Pour les attentats de novembre, en présence de scènes d’attentats multiples et simultanés, il a été décidé d’assurer un suivi de chaque événement au moyen d’une articulation entre les différents magistrats présents sur place et le chef de salle présent dans les locaux de la cellule de crise. Ainsi, plusieurs magistrats ont été projetés simultanément sur les lieux à partir de 22 heures. Je me suis moi-même rendu sur la scène du crime à La Bonne Bière et au Carillon, avant de rejoindre le Bataclan. Nous avons projeté un magistrat sur les scènes de crime du Stade de France. Nous sommes restés sur le site du Bataclan jusqu’à la fin de l’assaut donné par les unités d’intervention spécialisée.
Compte tenu de la fluidité dans la circulation de l’information dans les différents services, nous n’avons pas été obligés d’envoyer des magistrats dans les différents états-majors, contrairement à ce qui avait été le cas au mois de janvier, et nous sommes concentrés sur la prise en charge des victimes et de leurs proches.
Outre le volet « victimes », les investigations se sont articulées autour de deux axes principaux : la reconstitution du déroulement des faits et l’identification des auteurs.
Je voudrais tout d’abord rappeler nos compétences dans la problématique des victimes. Dans le cadre de l’enquête de flagrance – c’est le volet « médecine légale » –, le parquet détermine les examens qui doivent être effectués sur les victimes décédées et blessées pour parvenir à la manifestation de la vérité. Il a le libre choix des experts.
En ce qui concerne la prise en charge des victimes, nous avons une double compétence. La première est de signaler au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) les victimes qui devront être indemnisées, conformément au code des assurances. Cela nécessite d’identifier le plus rapidement possible les victimes, ou leurs ayants droit en cas de décès, d’obtenir des services enquêteurs leurs coordonnées, et si possible de faire évaluer les préjudices physique et psychologique, puis de transmettre sans délai ces éléments au FGTI.
Nous intervenons dans le dispositif interministériel mis en place en cas d’événement majeur, avec trois compétences particulières : nous établissons la liste unique des victimes, acte fondateur du déclenchement du droit à indemnisation, et qui sert aussi à déterminer le moment de l’annonce des décès aux familles, nous restons en lien étroit avec la cellule de crise du ministère des affaires étrangères et la CIAV, interministérielle et constituée d’équipes pluridisciplinaires, et nous fournissons aux familles des victimes une information sur le dispositif mis en place et l’état d’avancement des investigations. Pour mieux assurer ces missions, nous disposons au sein de la section antiterroriste d’un référent victimes.
Les attentats de janvier ont fait 17 morts, 20 blessés et plusieurs dizaines de victimes choquées. Ceux de novembre ont fait 130 morts, et la LUV toujours en cours d’élaboration répertorie plus de 1 600 personnes : 486 personnes blessées, 1 032 victimes choquées.
Une instruction interministérielle relative à la prise en charge des victimes d’actes de terrorisme avait été signée le 12 novembre au soir, la veille des attentats.
Pour les attentats de janvier, la problématique des victimes a été prise en charge par un pôle « victimes », avec un référent au sein de la section. Pour les attentats de novembre, compte tenu du nombre très important de victimes, nous avons densifié notre dispositif. Un pôle victimes a été mis en place, mobilisé et joignable vingt-quatre heures sur vingt-quatre, comprenant le magistrat référent de la section anti-terroriste, destinataire de toutes les remontées d’informations concernant les victimes, interface privilégiée avec les partenaires extérieurs, et une équipe tournante de magistrats présents : un magistrat présent à l’IML pour valider les identifications, signer les permis d’inhumer et relayer au référent victimes toutes les difficultés relatives à la signature des permis d’inhumer, deux magistrats présents à la CIAV et à l’École militaire, notamment chargés de l’annonce des décès. Ce pôle a aussi accueilli un atelier chargé de synthétiser les auditions de témoins-victimes, permettant d’affiner le statut des victimes en temps réel.
Pour assumer nos missions, il fallait être en possession des informations relatives aux victimes et nous avions heureusement tiré les conséquences de ce qui s’était passé en janvier. Nous avions mis en évidence un point faible dans l’articulation des moyens de justice et de police : il n’y avait pas, au niveau des services de police, un référent victimes, commissaire ou OPJ, qui soit débarrassé de toutes les missions relatives à l’avancement de l’investigation, ce qui avait conduit à attendre quasiment quarante-huit heures les éléments nécessaires pour établir la LUV. Nous avons tiré les leçons de cette expérience et obtenu la désignation par la DGPJ d’un commissaire de police au niveau de la SDAT dégagé de tout souci d’investigation et dont le rôle était exclusivement consacré au recueil d’informations pour lister les victimes. Ce référent victimes a été secondé par une équipe complète d’enquêteurs au sein de la SDAT et de la brigade criminelle.
En ce qui concerne la coordination des acteurs, dans le cadre de notre retour d’expérience sur les attentats de janvier, nous avons constaté que le guichet unique destiné aux victimes, sous l’impulsion du préfet et la coordination du service des anciens combattants, n’était pas adapté, et nous avons donc émis l’idée d’une structure permanente disposant de moyens ad hoc, en l’occurrence le centre de crise du ministère des affaires étrangères.
La veille des attentats, l’instruction interministérielle de prise en charge des victimes de terrorisme a entériné le principe de la CIAV, hébergée dans les locaux du centre de crise et de soutien du ministère des affaires étrangères. Elle rassemble des membres de différents ministères. Son rôle est de centraliser en temps réel l’ensemble des informations concernant l’état des victimes, d’informer et d’accompagner leurs proches et de coordonner l’action de tous les ministères intervenants.
La nécessité de prévoir un lieu d’accueil, d’information et d’orientation des familles s’est rapidement imposée, compte tenu de l’ampleur des attentats, et l’École militaire a été désignée. Il a alors fallu rapidement mettre en place un numéro unique pour la prise en charge des victimes et de leurs proches et prévoir des équipes pluridisciplinaires pour annoncer les décès aux familles.
Nous avons été confrontés à un certain nombre de problèmes dans la prise en charge des victimes décédées et de l’hospitalisation des blessés, qui sont gérées dans le cadre du logiciel SINUS. Ce logiciel est une application qui permet l’identification, le dénombrement et le suivi des victimes et doit fiabiliser la remontée et le traitement des informations indispensables au suivi des victimes. Il s’agit d’un outil nécessaire pour établir un bilan et savoir où se trouvent les victimes hospitalisées.
Chaque victime est dotée d’un identifiant matérialisé par un bracelet à code barre, muni de stickers supplémentaires permettant l’identification de documents ou d’effets attachés à la victime, et d’une fiche médicale de l’avant (FMA) : associée au numéro d’identifiant SINUS, contenant des données personnelles et d’ordre médical, elle est mise en place uniquement sur des victimes lors de la prise en charge pré-hospitalière au sein du poste médical avancé.
Nous avons constaté qu’un certain nombre de points méritaient d’être améliorés. Il nous est ainsi apparu pertinent d’enrichir SINUS en y ajoutant des données personnelles, numéro de téléphone et adresse des victimes, pour accélérer la prise en charge. Parmi les difficultés constatées, on peut citer des doublons, des bracelets souillés par le sang et devenus illisibles, des bracelets ne comportant pas le lieu d’origine et de prise en charge... Nous estimons que les enquêteurs devraient se charger de désigner la scène et de poser eux-mêmes les bracelets sur les corps, en multipliant la pose de stickers sur les linceuls, les sacs mortuaires afin d’éviter les pertes d’informations. Chaque corps doit être enregistré sous X ab initio pour sécuriser le processus d’identification et seuls les ensembles tête-buste doivent être enregistrés sur la base du logiciel SINUS, à l’exclusion des fragments de corps. Le besoin d’harmonisation de l’utilisation du logiciel SINUS en région parisienne, au-delà du ministère de la santé, et plus largement au niveau national s’est immédiatement fait ressentir.
En janvier comme en novembre, le choix a été de saisir l’IML de Paris, qui s’est renforcé. L’Institut dispose de quatre tables de médecine légale dont, pour des raisons d’organisation interne, trois fonctionnent. L’IML s’est adjoint trois médecins légistes de la Gendarmerie nationale, ce qui porte les effectifs à quinze, ainsi que de balisticiens de l’Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale (IRCGN). La capacité de stockage des corps de l’IML s’élève à 400 cases frigorifiques.
L’IML a enregistré 168 entrées, correspondant à des corps ou fragments de corps. L’absence de scanner au sein de l’IML a été palliée par le recours aux scanners des hôpitaux environnants, l’Hôtel-Dieu et la Salpêtrière.
Nous avons été très rapidement confrontés à la nécessité de faire un choix. Les causes de la mort étaient connues. Si une autopsie était systématiquement réalisée, cela aurait nécessité au minimum deux, voire trois, semaines et aurait retardé d’autant les présentations et restitutions de corps aux familles des victimes, dont la demande à cet égard était extrêmement forte. Le choix d’un second site pour effectuer les autopsies aurait par ailleurs complexifié le processus d’identification des corps et multiplié les équipes référentes de chaque service engagé ; enfin, et surtout, cela aurait beaucoup compliqué le parcours des victimes, que nous nous sommes efforcés de simplifier le plus possible.
Nous avons donc décidé de discriminer entre les autopsies indispensables et les examens de corps approfondis. Il a ainsi été décidé que seraient soumis à autopsie complète les corps des terroristes, les débris de corps, les corps de victimes non identifiables, et les corps des victimes décédées après hospitalisation, ainsi que tous les corps avec projectiles incorporés, c’est-à-dire avec des orifices d’entrée mais pas d’orifices de sortie. Pour les autres corps, il a été décidé de les soumettre à des examens de corps approfondis avec imagerie médicale, c’est-à-dire radios puis scanner, et recours aux services d’un balisticien de l’IRCGN. Il a été demandé au directeur de l’IML d’être le plus précis possible dans ses rapports sur les causes et les circonstances de la mort.
Ce choix a permis de réaliser l’ensemble des actes de médecine légale en moins d’une semaine, entre le dimanche 15 et le jeudi 19 novembre, et de restituer les corps aux familles dans un délai raisonnable, qui ne devait pas excéder une semaine à compter des attentats. Sur les 130 victimes, nous avons réalisé quatre-vingt-deux examens externes approfondis et quarante-huit autopsies complètes. Nous sommes toutefois conscients des limites du système et savons que, dans l’hypothèse d’attentats de plus grande ampleur, il sera nécessaire de doubler, voire tripler, le nombre de sites d’examen.
L’identification des victimes constitue un enjeu majeur mais de façon nuancée selon les types d’attentat. Un attentat à l’explosif, comme à Bruxelles la semaine dernière, se traduit par des problèmes majeurs d’identification des corps. Pour un mode opératoire à l’arme de guerre, nous n’avons pas les mêmes difficultés.
Pour les attentats du 13 novembre, l’Unité nationale d’identification des victimes de catastrophes (UNIVC) a, pour la première fois, été activée par la DCPJ dans ce type de contexte. L’identification des corps a été effectuée par cette unité selon le protocole Interpol. La commission UNIVC s’est réunie toute la journée du 16 novembre 2015 pour procéder à la corrélation des éléments ante-mortem et post-mortem. Le processus d’identification s’est achevé le 19 novembre avec la dernière présentation aux familles.
Il est toutefois apparu assez rapidement que le protocole UNIVC classique, prévoyant la réunion d’une commission a posteriori et le recueil systématique de l’empreinte génétique, pertinent dans l’hypothèse d’accidents collectifs ou d’un attentat à l’explosif où les corps sont fortement dégradés, n’était pas adapté aux attentats du 13 novembre, où les corps des victimes étaient le plus souvent identifiables sur photographies ou par les familles avec des signes distinctifs tels que des tatouages. L’allégement de cette procédure en simplifiant le processus a permis d’accélérer l’identification des corps, préalable indispensable à la restitution aux familles.
À la suite du retour d’expérience que nous avons effectué, nous pensons également que l’intervention précoce de la cellule post-mortem, le cas échéant directement sur les scènes d’attentat, peut être de nature à accélérer le processus d’identification. Le recueil à titre conservatoire des éléments primaires d’identification auprès des familles dès la phase d’accueil par la cellule ante-mortem accélère également ce processus. Enfin, nous tiendrons à l’avenir une réunion de la commission ante-mortem post-mortem au moins une fois par jour, pour travailler au fil de l’eau.
M. le président. La question des moyens est très importante et notre Commission d’enquête sera sans doute amenée à formuler des propositions à cet égard. En dehors de la cellule de crise, soixante-deux magistrats peuvent être mobilisés très rapidement. Les effectifs permanents de la section anti-terroriste du parquet de Paris, qui a une compétence nationale, sont de onze. Est-ce que ce sont des moyens suffisants compte tenu de la menace existante ?
M. François Molins. Ces effectifs correspondent aux nécessités de l’activité de la section aujourd’hui mais ce ne sera plus le cas dans quelques mois. Les chiffres qui nous ont été communiqués hier font état de 250 enquêtes ou informations en cours sur le djihad irako-syrien et de 782 personnes mises en cause, qu’elles soient déjà mises en examen ou encore recherchées. Ces chiffres sont en augmentation.
Le nombre de personnes suivies par les services de renseignement est globalement constant depuis plusieurs mois, entre 1 850 et 1 900. En revanche, le nombre d’individus judiciariés ne cesse d’augmenter, conséquence de l’augmentation très importante des effectifs du département judiciaire de la DGSI et de la SDAT. Le nombre de personnes mises en cause a donc vocation à doubler ou tripler.
Les effectifs de la section devront par conséquent augmenter dans les mois et années à venir. Dans le cadre du nouveau palais de justice des Batignolles, la direction judiciaire a acté le fait que les locaux de la section anti-terroriste seront configurés à partir de novembre 2017 pour accueillir un effectif de dix-huit à vingt magistrats.
M. le président. À la suite des attentats de novembre, il a été évoqué la commission d’actes de barbarie.
M. François Molins. C’est une rumeur. Les médecins légistes ont été formels : il n’y a pas eu d’acte de barbarie, pas d’utilisation, notamment, d’armes blanches. Selon un témoignage, les testicules d’une personne auraient été coupés, mais aucune constatation n’a permis de le corroborer.
M. Sébastien Pietrasanta, rapporteur. Je salue, monsieur le procureur, votre travail. Votre parole est entendue et respectée par tous.
Quelle est votre appréciation du quantum des peines ? La réflexion est en cours sur l’association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste (AMT) criminelle. Ce n’est pas un sujet simple. Vous êtes en outre confrontés à des mères, des jeunes filles, des mineurs. Pouvez-vous nous donner des éléments chiffrés sur les condamnations prononcées ces deux dernières années ?
Comment travaillez-vous, concrètement, avec les services de renseignement ? Considérez-vous que cette coopération soit bonne ou faut-il encore améliorer la fluidité des informations ? Même question au sujet de vos relations avec Eurojust et vos partenaires européens.
La presse a fait état d’un rapport de la DCRI de 2009 rapportant une menace sur le Bataclan. De même, des menaces sur un « concert de rock » ont été rapportées en août 2015. Lors de notre audition des victimes, le point de vue a souvent été exprimé que, le Bataclan ayant été menacé, les mesures de précaution qu’une telle situation appelait n’ont pas été prises. Quel est votre sentiment ?
Enfin, y a-t-il selon vous des points d’amélioration possibles au niveau du parquet ?
M. François Molins. Nous avons des rapports de très grande qualité avec la DGSI, qui a l’initiative de soumettre au parquet les éléments qui lui semblent devoir être judiciarisés.
La politique pénale a considérablement évolué vis-à-vis du djihad franco-syrien. Dans le premier dossier, on nous objectait que la France soutenait l’opposition au régime de Bachar el-Assad ; vous voyez le chemin qui a été parcouru depuis lors. Une prise de conscience a eu lieu. La politique pénale est allée dans le sens de la densification et d’une plus grande répression.
La configuration de l’AMT correctionnelle ne permet pas de faire une différence entre ceux qui ont commis des actes de moindre gravité – logistique d’organisation d’une filière – et ceux qui ont participé aux menées terroristes de Daech en tant que combattants. Nous avons donc annoncé il y a deux semaines au sein de notre hiérarchie que nous partions désormais sur une criminalisation. Quand nous ouvrons aujourd’hui une enquête ou information contre des gens ayant rejoint Daech, nous ne le faisons plus pour AMT correctionnelle mais pour AMT criminelle. Les affaires iront devant la cour d’assises spéciale, ce qui n’est pas non plus sans poser la question des moyens.
Mme Camille Hennetier, vice-procureure de la République au pôle anti-terroriste du tribunal de grande instance de Paris. Sur 261 personnes mises en examen dans le conflit irako-syrien, vingt-neuf sont des mineurs, dont un fait l’objet d’un mandat d’arrêt, huit sont détenus et trois sont mis en examen pour des faits de nature criminelle. Sur ces vingt-neuf, il y a sept jeunes filles, dont deux sont détenues. Huit de ces vingt-neuf mineurs avaient moins de seize ans au moment de la commission des faits.
Cinquante-quatre femmes sont actuellement mises en examen, neuf d’entre elles sont détenues. On ne peut pas dire que nous avons une politique de non-poursuite à l’égard des femmes, mais nous avons considéré qu’elles méritaient sans doute un traitement différencié, dans la mesure où elles ne participent pas aux combats sur zone. Nous mettons en examen des femmes qui participent au soutien logistique des filières, financent des combattants de Daech, ou bien ont pour projet de passer à l’acte sur le territoire national ou de recruter d’autres femmes pour partir épouser des combattants sur zone.
La réflexion sur l’AMT criminelle n’est pas récente. Il ne convient pas de plafonner les peines à dix ans pour des individus combattant au sein de Daech quand le fait même de rejoindre cette organisation terroriste implique de facto l’intention de commettre des crimes d’atteinte aux personnes. Mais nous nous autocensurions car, si nous criminalisons les personnes partant sur zone, il faut que la cour d’assises spéciale puisse suivre. On ne peut plus raisonner de cette manière : il ne faut plus adapter notre politique pénale aux moyens dont nous disposons mais adapter les moyens eux-mêmes. Une révolution est à mener du côté de la cour d’assises, qui doit juger dans des délais plus brefs des individus ne comparaissant pas, sur la base de dossiers dans lesquels il y aura peu de preuves.
Nous avons des rapports de confiance avec la DGSI. La phase en amont de la judiciarisation comporte un procès-verbal qui blanchit le renseignement et pose les bases de l’ouverture d’une enquête. Un dialogue s’instaure entre la DGSI et le parquet sur les éléments de renseignement communiqués et les raisons pour lesquelles la DGSI sollicite la judiciarisation d’un individu. Il nous est arrivé, la semaine dernière, de refuser une judiciarisation – ce n’était pas, je vous rassure, un combattant sur zone –, estimant que les éléments étaient trop ténus.
Mme Véronique Degermann, procureure de la République adjointe au tribunal de grande instance de Paris. Je précise que nous travaillons avec le département judiciaire de la DGSI. Cette dernière nous fournit également des PV de contexte dans les procédures, ce qui est très utile pour situer des individus, permettre des rapprochements ; nous en sommes très demandeurs.
M. le rapporteur. Nous avons le sentiment que les protagonistes du terrorisme sont des gens connus des services de renseignement. Il s’agit de réseaux anciens qui se défont et se refont. Comment se font les échanges d’informations entre les services de renseignement et le parquet au quotidien ? Quelle est la méthode de travail ?
M. François Molins. Celui qui peut appuyer sur le bouton, c’est celui qui détient l’information, c’est-à-dire la DGSI. Nous sommes donc tributaires du moment où elle viendra nous voir pour nous parler d’un cas. Cela se fait pratiquement tous les jours. Chaque fois, un dialogue s’instaure afin de rechercher si le dossier tel qu’on nous le présente permet d’ouvrir une procédure judiciaire. Dans la grande majorité des cas, c’est ce qui se passera, mais il peut aussi arriver que nous demandions à la DGSI d’approfondir tel ou tel point. Nous n’avons pas encore assez de recul sur l’application de la loi du 25 juillet pour savoir si elle a enrichi ou modifié le processus de judiciarisation.
La coopération internationale se passe bien. Eurojust a joué un rôle important de facilitateur et de rassembleur sur des enquêtes impliquant plusieurs pays. En matière pénale, la coopération sur les attentats de janvier et novembre a été positive avec un certain nombre de pays. Le travail avec l’Espagne est toujours de très grande qualité. La coopération a également très bien fonctionné avec les Américains. Dans le cadre d’une demande d’entraide pénale internationale, nous avons obtenu des éléments en une nuit – quand ils veulent aller vite, ils y arrivent ! La Belgique est un cas plus complexe. Les relations entre les deux parquets sont excellentes mais nos deux systèmes sont très différents. L’évolution législative en France a renforcé les pouvoirs du parquet, permet des gardes à vue jusqu’à six jours, des enquêtes téléphoniques… En Belgique, la garde à vue est de vingt-quatre heures, le parquet fédéral est obligé d’ouvrir une information très rapidement, les écoutes téléphoniques doivent être entièrement retranscrites, même ce qui ne présente aucun intérêt. L’équipe commune d’enquête, signée immédiatement après les attentats, a cependant bien fonctionné. La Belgique est le pays avec lequel nous avons le plus d’équipes communes en cours.
En ce qui concerne les améliorations législatives, on ne peut jamais dire « fontaine je ne boirai pas de ton eau » ; la problématique évolue sans cesse. Nous avons le sentiment que le projet de loi actuellement au Sénat va dans le bon sens, notamment sur l’extension des possibilités d’action la nuit. Nous souhaitions durcir un peu le régime d’exécution des peines, notamment en prévoyant des modes plus offensifs pour la frange de cinq à dix ans, avec le suivi socio-judiciaire et la surveillance judiciaire, pour éviter les sorties sèches.
Au sujet du Bataclan, il serait hasardeux de laisser croire que les attentats auraient pu être évités sur la seule base de renseignements reçus des autorités égyptiennes en 2009, qui n’ont jamais pu être étayés en procédure et ont au contraire été mis à mal par l’attitude des Égyptiens, lesquels ont remis en liberté les principaux acteurs soupçonnés d’être en relation avec M. Ben Abbes, tout cela ayant abouti à une décision de non-lieu par un juge d’instruction. On ne peut nier que le problème s’est posé à un moment donné mais, dès lors qu’un juge d’instruction a conclu, après enquête, que la menace n’était pas avérée, il était difficile d’engager une protection, qui aurait dû s’étendre sur plusieurs années.
M. le président. Le dossier n’était pas étayé en 2009 et a fait l’objet d’une ordonnance de non-lieu. Il y a eu ensuite, en 2015, l’information d’une menace sur une salle de spectacle. Mais la question du rapporteur n’est pas celle de la judiciarisation ; il s’agit de savoir s’il n’aurait pas fallu informer les propriétaires du Bataclan de la menace. Nous avons posé la question à M. Cazeneuve, qui a répondu qu’il n’avait pas d’information particulière en raison du secret de l’instruction.
M. François Molins. Je ne suis pas le mieux placé pour vous répondre car la justice n’est pas en charge de la protection des personnes et de l’ordre public, mais si nous avions apporté l’information d’une menace en 2009, nous aurions aussi apporté en 2011 celle d’un non-lieu en raison du fait que rien n’avait pu être vérifié.
Mme Camille Hennetier. Selon les PV de garde à vue, Reda Hame parle d’un concert de rock dans un pays européen. Il dit qu’Abaaoud lui a demandé de choisir « une cible facile, un concert, par exemple, là où il y a du monde ». Cela reste assez vague et le Bataclan n’est pas ciblé. Énormément de cibles sont aujourd’hui susceptibles de faire l’objet d’attentats. La présence de deux policiers ou militaires à l’entrée du Bataclan aurait-elle dissuadé trois individus armés de kalachnikovs et de gilets d’explosifs d’entrer dans les lieux ?
Mme Françoise Dumas. Au nom de l’ensemble du groupe socialiste, je vous remercie, monsieur le procureur, pour la sérénité et la précision de votre communication au moment des attentats. Comment arrivez-vous à gérer la presse ? Comment, tout d’abord, avez-vous appréhendé cette question lors des attentats et comment, ensuite, pourrait-on améliorer le dispositif dans le sens à la fois de la prévention, d’une information utile et protectrice, et de la lutte contre les rumeurs et les informations irresponsables ?
M. François Lamy. Je rejoins la question de Françoise Dumas sur la gestion de la presse. Comment avez-vous abordé le problème entre janvier et novembre, et depuis novembre ? Dans un environnement d’information permanente, de réseaux sociaux et autres, de nouvelles procédures ne doivent-elles pas être envisagées ?
Quel est par ailleurs votre sentiment sur le rôle et l’utilité de l’état d’urgence ?
M. François Molins. Selon les époques et les problèmes, les approches concernant la presse peuvent être extrêmement permissives ou au contraire extrêmement répressives. Quand on ouvre aujourd’hui une enquête pour violation du secret de l’instruction et recel de violation du secret de l’instruction, la législation est telle que l’on ne peut quasiment rien faire à l’égard d’un journaliste qui refuse d’indiquer comment il a obtenu une information. D’un autre côté, le besoin d’information dans les affaires terroristes est immense et je pense qu’il est du devoir de l’institution de communiquer un minimum d’informations objectives au public ; c’est la responsabilité du procureur, aux termes de l’article 11, alinéa 3, du code de procédure pénale. Nous l’avons intégré dans notre fonctionnement, mais nous sommes tenus au respect de certains principes : objectivité, respect des victimes, présomption d’innocence… Ainsi, on peut difficilement s’exprimer au cours d’une garde à vue ; le bon moment est plutôt le défèrement des personnes mises en examen, et après.
Il y a des fuites. Nous essayons d’appeler les journalistes à la responsabilité mais nous n’avons pas rencontré beaucoup de succès jusqu’à présent et nous sommes parfois très choqués de voir que certains journaux sont en possession d’informations qu’ils ne devraient pas avoir car elles concernent des investigations en cours et sont protégées. Certains jouent le jeu et retiennent ce genre d’informations, d’autres les divulguent. Quant aux réseaux sociaux, il est absolument impossible de les contrôler. J’ai aussi appris qu’une agence de presse avait perdu un gros marché parce que l’un des actionnaires avait eu vent du fait que l’agence n’avait pas communiqué une information en sa possession…
M. le président. Pourquoi ne faites-vous pas un flagrant délit en recel de violation du secret de l’instruction, ne serait-ce que pour marquer les esprits ?
M. François Molins. Quand nous ouvrons des enquêtes, quatre-vingt-dix-neuf fois sur cent elles n’aboutissent à rien. Elles aboutissent seulement quand des photos sont partagées sur les réseaux sociaux, par des journalistes à la lisière, des apprentis policiers ou pompiers qui ont pris des photos sur les scènes de crime…
M. le rapporteur. Au mois de janvier, M. Jean-Paul Ney, sur les réseaux sociaux, est le premier à diffuser l’identité des frères Kouachi. J’imagine que cela pouvait nuire grandement à l’enquête. L’avez-vous poursuivi ?
M. François Molins. Oui. Je ne pense pas que sa révélation ait freiné les investigations mais il est certain qu’elle aurait pu avoir cet effet.
Il faut tenir compte également de la Cour européenne des droits de l’homme, dont l’attitude est extrêmement permissive à l’égard du droit à l’information. Elle a ainsi rétréci comme une peau de chagrin la jurisprudence des tribunaux français, puisqu’elle reconnaît un droit à informer dès lors que cela correspond à un besoin légitime de l’information du public. Il y a des faits pour lesquels nous pouvions condamner une personne il y a vingt ans et nous ne le pouvons plus aujourd’hui.
M. François Lamy. Le secret de l’instruction n’existe plus. Nous avons vu la semaine dernière encore que les procès-verbaux de police se retrouvent dans la presse. N’avons-nous pas intérêt à passer à un autre système, à une communication de crise par l’information en temps réel des Français ?
M. François Molins. La communication judiciaire doit être maîtrisée et s’appuyer sur la certitude de la véracité et de la réalité de ce qui sera porté à la connaissance du public. Ce n’est pas un hasard si le parquet communique très peu dans les deux ou trois heures qui suivent ce genre d’événements, car nous serions conduits à dire des choses qui seraient contredites par la suite. Je ne veux pas non plus polluer la communication du politique, et notre communication sera de toute façon toujours limitée par le fait que nous ne pouvons dire des choses qui pourraient nuire au déroulement des enquêtes.
M. le président. Il semblerait tout de même que vous avez été un moment induit en erreur sur le nombre de balles tirées à Saint-Denis. N’est-ce pas l’exemple d’une communication trop rapide ?
M. François Molins. Tout à fait, c’est un bon exemple.
M. Jean-Michel Villaumé. L’avocat de Salah Abdeslam a menacé de porter plainte contre vous pour violation du secret de l’instruction.
M. François Molins. C’est plus qu’une menace, il l’a fait, mais, comme je l’ai dit publiquement, je suis très serein. Les dossiers français et belges sont reliés par un dispositif particulier qui est une équipe commune d’enquête, laquelle alimente les deux de la même façon. Français et Belges travaillent donc sur un dossier identique, mais nous communiquons chacun selon nos règles propres. Je communique en respectant l’article 11, alinéa 3, du code de procédure pénale français et non le code belge. Il n’y a donc pas de problème.
L’état d’urgence, monsieur Lamy, permet de procéder sur un mode administratif à des perquisitions pour lesquelles il n’y aurait pas d’éléments suffisants permettant de les conduire dans un cadre judiciaire. L’autorité judiciaire reste donc en dehors. J’ai le sentiment que l’état d’urgence a donné lieu à de nombreux résultats en matière de crime organisé mais à des résultats plus modestes sur le terrorisme : cinq perquisitions ont permis l’ouverture de procédures judiciaires.
M. le président. Dont quatre relèvent de l’apologie, n’est-ce pas ?
M. François Molins. Non, nous sommes sur de l’AMT. Pour être précis, une de ces cinq perquisitions a permis d’enrichir un processus de judiciarisation déjà en cours.
M. Alain Marsaud. Si j’avais un doute, je viens de prendre conscience, en vous écoutant, que le monde a véritablement changé depuis l’époque où j’ai quitté votre maison. Nous étions, au sein de la section anti-terroriste, des amateurs ; nous n’avions pas en charge des opérations telles que celles que vous avez menées, et je suis admiratif du professionnalisme de cette section aujourd’hui. Je suis rassuré, alors que j’avais eu des doutes en entendant certains autres acteurs auditionnés par cette Commission d’enquête.
J’ai écrit au président de notre Commission il y a quelques temps au sujet d’un enregistrement audio effectué au sein du Bataclan et permettant de connaître l’exact déroulement des faits. Le président vous a saisi et m’a laissé entendre que, ce document étant couvert par le secret de l’instruction, vous ne pouviez en révéler la teneur à notre Commission. Cela aurait pourtant été bien utile.
Avez-vous des rapports avec la DGSE, même informels, en vue d’obtenir des informations concernant les zones au Moyen-Orient, notamment sur les retours en France, sans passer par la DGSI ? Notre crainte à tous, ce sont les retours de Syrie lorsque l’État islamique sera réduit. Vous avez indiqué que vous souhaitiez mettre en place des procédures d’AMT criminelle. Si l’on en croit nos autorités politiques, cela concernerait entre 500 et 700 Français. Avez-vous réfléchi à la mise en place d’une procédure criminelle spécifique, épurée ? Il faudrait nettement raccourcir les délais.
M. François Molins. La bande sonore est en effet sous scellé. Je l’ai écoutée et elle montre qu’il y a bien eu deux temps ce soir-là : l’avant et l’après l’entrée du commissaire de la BAC. Les exécutions de victimes ont lieu avant l’intervention de ce commissaire et de son chauffeur.
Nous n’avons pas de relations institutionnelles avec la DGSE, même si j’ai personnellement les meilleures relations du monde avec M. Bajolet. Notre interface est la DGSI. C’est elle qui fait l’interface avec toute la communauté du renseignement, à l’exception de Tracfin.
S’agissant des retours de Syrie, je vous rejoins. Il est certain que le changement de politique pénale posera une question de moyens. Il faut, comme le disait ma collègue, que ce soient les moyens qui suivent.
Il n’est pas interdit de réfléchir à la manière d’assouplir la procédure criminelle. Un questionnaire est actuellement diffusé par la direction des affaires criminelles et des grâces pour consulter la totalité des parquets français sur leur sentiment à ce sujet. Des évolutions procédurales seront indispensables pour juger tous ces gens dans des délais compatibles avec le respect des délais de détention et les exigences du délai raisonnable de la Convention européenne.
M. Meyer Habib. Selon l’avocat de certaines victimes, l’information aurait dû être transmise aux propriétaires du Bataclan qu’il y avait eu une menace sur cette salle en raison du fait qu’elle avait organisé des soirées pour la communauté juive ou pour Israël.
Ce que vous avez dit au sujet d’internet est inquiétant. Je me souviens des 20 000 tweets « je suis Kouachi » ou « je suis Coulibaly », et c’est sans doute de facto impossible d’identifier ces 20 000 personnes. Les menaces de mort sur internet ne sont pas rares non plus. N’y a-t-il rien à faire ? Ne faudrait-il pas prévoir des sanctions très lourdes pour dissuader de profiter de l’immensité et de l’anonymat de la Toile ?
Au cours de l’attentat de l’Hypercacher, BFMTV révélait que des otages se trouvaient dans la chambre froide, alors que l’on essayait de bloquer l’information. Ne conviendrait-il pas de légiférer pour établir un black-out absolu, comme cela existe dans certains pays : une interdiction totale de communiquer assortie de sanctions très lourdes ?
M. François Molins. Je n’ai rien à ajouter à ce que j’ai dit sur le Bataclan. Si l’information avait été donnée à l’époque, le non-lieu serait venu signifier que la menace n’a pu être accréditée.
Internet est tout de même surveillé. Je ne me fais pas d’illusion, compte tenu de l’immensité du problème, mais il existe à la DCPJ une plateforme PHAROS spécialisée dans la surveillance, qui reçoit de nombreux signalements et permet d’initier des enquêtes lorsque sont découverts des contenus illicites, notamment des délits d’apologie.
L’embargo que vous évoquez me semble une bonne idée. La Belgique a un système connu dans notre jargon sous le nom de « système des petits chats ». En mettant des « petits chats » sur internet, ils parviennent à faire comprendre aux journalistes et à la population que tout le monde doit se taire sur ce qui est en train de se passer. Et cela marche : nous l’avons constaté il y a quelques semaines quand une gigantesque opération a été diligentée et personne n’en a parlé, ce qui a conduit la police belge à mettre sur internet un énorme plat de croquettes pour récompenser les petits chats.
De même, la procédure espagnole permet au juge de prendre une décision d’embargo interdisant à qui que ce soit de publier des informations sur le dossier concerné. Cela fonctionne aussi.
M. le président. C’est ce que font les Anglo-Saxons.
M. Meyer Habib. Israël également.
Mme Camille Hennetier. Une plainte a été déposée contre BFMTV par une des femmes présentes dans la chambre froide. Nous nous sommes demandé quel fondement juridique il convenait de donner à cette plainte, car il nous paraissait important, au moins symboliquement, de mettre BFMTV et les journalistes qui avaient relayé l’information face à leurs responsabilités. Nous n’en avons pas trouvé et nous avons donc dû recourir à l’infraction générique de mise en danger de la vie d’autrui, mais nous savions dès le départ que c’était voué à l’échec parce qu’il fallait prouver la violation délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité. Cela a tout de même permis de procéder à des auditions. Une transaction a eu lieu avec les victimes et la procédure s’est arrêtée. Les fuites peuvent mettre en danger la vie des personnes ou bien contraindre les services à précipiter des opérations d’interpellation, comme c’est arrivé dans le cas de l’interpellation de Salah Abdeslam, alors que cette opération extrêmement dangereuse devait se passer dans un quartier avec des écoles. Les opérations sont conduites à s’adapter au timing de la presse. Il conviendrait donc de réfléchir à une infraction permettant de réprimer des comportements qui mettent en danger les fonctionnaires de police et les victimes.
M. le président. La Commission d’enquête va y réfléchir.
M. Olivier Marleix. Je me réjouis de l’inflexion de la politique pénale. Y a-t-il déjà eu des mises en examen sur le fondement de l’article 421-6 du code pénal ? Quel est le délai prévisible du jugement sur la première mise en examen sur ce fondement ? Par ailleurs, l’article 411-4 sur l’intelligence avec une puissance ou organisation étrangère pourrait-il servir de fondement à l’accusation contre les terroristes de Daech, ou bien est-ce un article désuet ? Ces personnes ne pourront-elles pas être protégées par le principe du non bis in idem faute d’avoir été poursuivies sur une qualification suffisamment lourde ?
M. Serge Grouard. Ne faudrait-il pas aller vers un maillage territorial de l’organisation, en utilisant les parquets de province ?
M. François Molins. Il faut un maillage territorial dans une approche pragmatique qui permette au parquet anti-terroriste d’utiliser les ressources des parquets locaux pour faire face aux attentats d’ampleur. Si des attentats multiples se produisent demain dans l’agglomération lyonnaise, ou niçoise, il faudra, lorsque nous ouvrirons une cellule de crise à Paris, nous appuyer – une circulaire a été publiée en ce sens le 18 décembre dernier – sur les ressources humaines du parquet local, car nous en aurons besoin pour l’aide aux victimes ou la gestion de la médecine légale en lien avec l’IML. Mais cela ne saurait se traduire par une dévolution des compétences à des parquets autres que le parquet de Paris. Si une justice spécialisée en matière anti-terroriste a été créée en 1986, c’est justement pour lutter contre la déperdition qui résultait de l’absence d’unité d’action et de cohérence dans le traitement de ces dossiers.
Sur l’article 411-4, quand on évoque une puissance étrangère, on pense à un État. Ce serait donner à Daech des titres de noblesse qu’il ne mérite pas.
Des AMT criminelles ont déjà été notifiées pour des gens rentrés de Syrie, où ils avaient participé à des exactions, mais on peut avoir affaire à des dossiers tentaculaires renvoyant à l’organisation de filières comme à des dossiers beaucoup plus simples dont le traitement ne présente pas la même difficulté.
Mme Camille Hennetier. Les dossiers sont ouverts au criminel dès lors qu’un individu est sur zone, et nous reconsidérons d’anciennes mises en examen sous un visa correctionnel en sollicitant du magistrat instructeur une saisine supplétive sur l’AMT criminelle. Le calendrier, en termes de comparution devant la juridiction de jugement, ne devrait pas être très long. Outre les individus dont il est établi qu’ils ont commis des exactions sur zone, l’AMT criminelle est également visée sur les enquêtes concernant les attentats. Par exemple, quand Salah Abdeslam sera de retour en France, il sera mis en examen pour assassinat, tentative d’assassinat et AMT criminelle.
Mme Véronique Degermann. La centralisation de l’information fait notre force. La remontée vers cette cellule de crise unique, seul lieu de décision, est absolument essentielle. À titre de comparaison, il est très compliqué de travailler avec l’Allemagne, dont les structures sont éclatées dans les différents Länder.
M. le président. Merci. Nous vous adressons la reconnaissance de la représentation nationale pour le travail que vous accomplissez.
Audition, à huis clos, de Mme Laurence Le Vert, première vice-présidente chargée de l'instruction au pôle antiterroriste du TGI de Paris, et de M. David Benichou, vice-président chargé de l'instruction au pôle antiterroriste du même TGI
Compte rendu de l’audition, à huis clos, du mercredi 30 mars 2016
M. le président Georges Fenech. Nous accueillons Mme Laurence Le Vert, première vice-présidente chargée de l’instruction au pôle antiterroriste du tribunal de grande instance de Paris et M. David Benichou, vice-président chargé de l’instruction dans ce même pôle. Nous vous remercions, madame la première vice-présidente et monsieur le vice-président, d’avoir répondu à l’invitation de notre commission d’enquête relative aux moyens mis en œuvre par l’État pour lutter contre le terrorisme depuis le 7 janvier 2015. Nous venons d’entendre le procureur de la République de Paris et les responsables du parquet antiterroriste et avons commencé d’aborder l’ensemble des questions judiciaires ; nous poursuivons avec vous, dans le respect de la séparation des pouvoirs, nos investigations sur les moyens de lutter contre le terrorisme. Nous allons nous intéresser au pôle antiterroriste et à la pertinence des dispositions législatives que vous mettez en œuvre.
En raison de la confidentialité des informations que vous êtes susceptibles de nous délivrer, cette audition se déroule à huis clos et n’est donc pas diffusée sur le site internet de l’Assemblée. Néanmoins, et conformément à l’article 6 de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, son compte rendu pourra être publié en tout ou partie, si nous en décidons ainsi à l’issue de nos travaux. Les comptes rendus des auditions à huis clos seront au préalable transmis aux personnes entendues afin de recueillir leurs observations. Ces dernières seront soumises à la commission, qui pourra décider d’en faire état dans son rapport. Conformément aux dispositions du même article, « sera punie des peines prévues à l’article 226-13 du code pénal toute personne qui, dans un délai de vingt-cinq ans, divulguera ou publiera une information relative aux travaux non publics d’une commission d’enquête, sauf si le rapport publié à la fin des travaux de la commission a fait état de cette information ».
Conformément aux dispositions de l’article 6 précité, je vais maintenant vous demander de prêter le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité.
Mme Laurence Le Vert et M. David Benichou prêtent serment.
Mme Laurence Le Vert, première vice-présidente chargée de l’instruction au pôle antiterroriste de tribunal de grande instance de Paris. La section antiterroriste de l’instruction comporte actuellement un premier vice-président et chef de section, ainsi que huit vice-présidents, le dernier poste ayant été créé en 2015 à la suite des attentats de janvier et pourvu en septembre dernier. Nous sommes tous chargés de l’instruction et comptons chacun un greffier dans notre cabinet ; deux agents administratifs scannent les dossiers d’information, et quatre autres agents – deux à temps plein et deux à temps partiel – mettent en forme les dossiers, en établissent la cotation, les photocopient et délivrent les permis de visite, ces tâches administratives s’avérant très lourdes.
Depuis les attentats du 13 novembre dernier, un nouveau greffier a rejoint notre équipe ; placé auprès du vice-président, magistrat premier saisi du dossier des attentats de novembre, il reçoit les constitutions de partie civile, dont le nombre dépasse, à l’heure actuelle, les six cents. Il s’agit donc d’une tâche à temps plein pour une personne, voire deux, d’autant que nous avions déjà reçu beaucoup de constitutions de partie civile après les attentats de janvier et constaté que cela engorgeait le cabinet et empêchait le magistrat instructeur de procéder à des interrogatoires, la présence d’un greffier étant indispensable. Outre le greffier compétent que nous avons reçu, un autre agent administratif à temps plein remplacera bientôt l’une de nos agentes à mi-temps, qui va partir en congé maternité.
À la suite des attentats de janvier 2015, nous avions exposé à la garde des sceaux et à notre hiérarchie le problème du traitement des données informatiques. Un assistant spécialisé en informatique, en provenance des Douanes, nous a enfin rejoints cette semaine et aidera à plein-temps la section à exploiter tous les supports informatiques saisis, qui fournissent les données principales des dossiers d’information.
Nous avons également été équipés de nouveaux matériels, notamment de tablettes qui nous évitent de transporter nos ordinateurs et offrent davantage de sécurité puisque les données se trouvent uniquement sur une clef USB. Nous avons été dotés d’un double écran informatique qui nous fait gagner un temps considérable puisque cela permet de copier des paragraphes des dossiers scannés. Nous disposons de téléphones portables cryptés, sur lesquels nous pouvons recevoir nos mails professionnels, alors que cela n’est pas autorisé sur nos téléphones et nos ordinateurs personnels pour des raisons de sécurité. Enfin, nous avons été le dernier service du ministère de la justice à recevoir la version NPP4 du système de scanner : plus efficace et plus rapide, elle nous aide surtout à effectuer des inventaires de dossiers.
Nous sommes six magistrats à instruire les attentats du 13 novembre 2015, et ces renforts humains et techniques s’avèrent des plus nécessaires !
M. le président Georges Fenech. Voilà pour les moyens. Et pour la législation ?
Mme Laurence Le Vert. Nous attendons le vote du projet de loi renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale, encore en cours d’examen au Parlement.
Nous rencontrons des problèmes en matière informatique, la législation se révélant insuffisante pour nous permettre d’accéder aux données, alors que les systèmes employés par les membres de l’État islamique (EI) sont très perfectionnés. Ils cryptent leurs documents, avec des containers notamment, et se dotent des derniers iPhone qui leur permettent de sécuriser leurs données. Le volume de ces dernières est considérable, et nous avions souhaité que la loi nous autorise à capter, dans le cadre d’une commission rogatoire technique, les données stockées et non pas seulement celles à venir, comme actuellement. Notre requête n’attente pas aux libertés, et sa satisfaction nous éviterait de perdre des mines de renseignement sur l’activité de ces gens, sur la manière dont ils sont partis en Syrie, sur ce qu’ils y ont fait et sur les personnes avec lesquelles ils correspondent.
Nous aimerions que le délai de prolongation des détentions correctionnelles, actuellement fixées à quatre mois, soit porté à six mois. En effet, la norme actuelle nous contraint à établir une ordonnance au bout de deux mois et demi pour saisir le procureur de la République afin d’obtenir des réquisitions et une transmission au juge des libertés et de la détention (JLD). Entre deux prolongations, les détenus peuvent former jusqu’à deux demandes de remise en liberté par jour, ce qui représente une importante perte de temps pour le cabinet, et même un risque si l’on ne statue pas en temps voulu sur une demande de saisine de la chambre de l’instruction. Les détenus peuvent faire appel de chaque décision.
Il faut dorénavant intégrer les supports de données dans le fonctionnement de la justice, leur volume pouvant être considérable ; on ne peut plus commettre d’experts pour qu’ils impriment tout ce qui pourrait intéresser l’enquête. Les experts rapportent leurs opérations, décrivent les scellés et les techniques utilisées, et placent les données auxquelles ils ont accédé sur disque dur. Ce dernier devient une pièce de la procédure à laquelle les avocats ont accès ; la consultation du dossier requiert un matériel adapté que nous n’avons pas, si bien que les avocats ne peuvent pas voir les pièces. Nous devrons en outre dupliquer six cents fois le matériel informatique pour le mettre à disposition de chaque partie civile – sans compter les mis en examen. Ce sera matériellement impossible et même dangereux, car les enquêteurs joignent souvent, sur CD-ROM, une vidéo significative qui doit figurer dans le dossier ; or, dans le cadre d’une demande de liberté, l’avocat doit pouvoir consulter le dossier à la chambre de l’instruction et, s’il n’a pas accès à ces données, la remise en liberté doit être ordonnée automatiquement dans les deux jours précédant le passage devant la chambre de l’instruction. Ces supports de données sont devenus incontournables, mais il n’existe pas d’autre solution que de les placer sous scellés.
M. le président Georges Fenech. La prolongation de la garde à vue tous les quatre mois concerne bien les seules procédures délictuelles ?
Mme Laurence Le Vert. Oui. En matière criminelle, la première détention peut durer un an et le renouvellement a lieu tous les six mois. Nous aurions souhaité que l’on retienne ce même délai de six mois pour les détentions correctionnelles.
M. le président Georges Fenech. Selon le procureur de la République, vous êtes de plus en plus saisis sur un fondement criminel, via l’incrimination d’association de malfaiteurs.
M. David Benichou, vice-président chargé de l’instruction au pôle antiterroriste du tribunal de grande instance de Paris. Oui, le parquet a commencé à faire évoluer sa doctrine.
Mme Laurence Le Vert. En fin d’information, il faut correctionnaliser pour éviter d’engorger la cour d’assises spécialement composée, car les dossiers sont lourds et il n’y a que deux chambres. Nous devons veiller à ne pas exposer notre pays à être condamné par la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH), qui estime que, sauf circonstances exceptionnelles, une cour d’assises doit juger une personne en détention provisoire depuis un an.
M. le président Georges Fenech. Combien de magistrats travaillent sur les dossiers de co-saisine ?
Mme Laurence Le Vert. Nous sommes au moins deux.
M. le président Georges Fenech. Et sur ceux des attentats du 13 novembre dernier ?
Mme Laurence Le Vert. Nous sommes six. Au bout de deux semaines, 56 tomes de pièces sont arrivés, dont beaucoup d’actes urgents à réaliser – poursuivre l’action du parquet sur les restitutions de corps et les identifications des victimes, lancer des investigations urgentes comme les commissions rogatoires internationales en Allemagne, en Belgique et en Autriche, qui ont nécessité des déplacements. Nous ne sommes pas trop de six pour ce dossier, le plus gros que j’aie vu.
M. le président Georges Fenech. Cela signifie que les deux tiers des juges d’instruction antiterroristes sont mobilisés par ce dossier ?
Mme Laurence Le Vert. Oui, tout en continuant l’instruction des autres dossiers.
M. le président Georges Fenech. Vous n’êtes pas déchargés des autres affaires ?
Mme Laurence Le Vert. Non, mais notre effectif permet de traiter en urgence ce qui doit l’être.
M. le président Georges Fenech. Qui est le juge directeur dans ce dossier ?
Mme Laurence Le Vert. M. Christophe Teissier.
M. David Benichou. Il est vrai que nos moyens augmentent ; nous avons ainsi reçu cette semaine un assistant spécialisé, qui nous sera très utile. Il n’en reste pas moins que nous avons encore besoin d’aide, et que nous sommes encore, sur le plan législatif, en demande d’ajustements.
En avril 2015 a été publié un essai intitulé « Le Jihadisme » aux éditions Plon, dans lequel je proposais des pistes de réflexion très concrètes. Certaines d’entre elles sont déjà débattues, d’autres le seront bientôt.
M. le président Georges Fenech. Par exemple ?
M. David Benichou. La question de l’articulation entre le judiciaire et le renseignement. Depuis 2001, les États-Unis ont compris qu’il fallait abattre la muraille de Chine entre les services. En France, on maintient la séparation entre le renseignement et le judiciaire ; or, dans le domaine du terrorisme, une information non partagée ne sera pas bien exploitée. Nous sommes plombés par cette culture de division, héritée de l’Histoire ; dans le renseignement, on évolue dans le secret pour effectuer du contre-espionnage et on ne partage pas l’information, alors qu’elle doit être communiquée, dans le domaine de l’antiterrorisme, à tous les services concernés, voire à nos partenaires internationaux.
Changer cette culture se révèle lent dans notre pays, et nécessite de mener une réflexion philosophique sur l’organisation de l’État. Y a-t-il aujourd’hui un impératif justifiant la séparation du renseignement et du judiciaire ? Peut-être dans certains domaines, mais pas forcément dans d’autres.
C’est la pratique qui m’a permis de dresser ce constat. Les juges ont la légitimité pour employer certains moyens d’enquête, mais ils n’en disposent pas, alors que la situation est inverse pour le renseignement. La situation a évolué pour le renseignement, qui a le droit, depuis la promulgation de la loi du 24 juillet 2015, de faire ce qu’il faisait déjà dans les faits. La judiciarisation du renseignement reste néanmoins une course d’obstacles : la déclassification des documents est complexe et les entretiens administratifs, normalement systématisés, ne sont pas définis ; ils peuvent donner lieu à des notes classifiées, alors qu’ils constituent parfois le point de départ de poursuites pénales.
Magistrat, je suis attaché au respect des textes et à leur cohérence avec le fonctionnement des institutions. En application de l’article 40 du code de procédure pénale l’opportunité des poursuites est de la responsabilité du procureur de la République. Or, dans le contre-terrorisme, celui qui détient l’information décide de la judiciariser ou non, la judiciarisation entraînant de facto l’ouverture de poursuites. Le procureur de la République se trouve donc dépossédé de son pouvoir d’apprécier l’opportunité d’engager des poursuites ; le service de renseignement ne se tournera vers lui que lorsqu’il considérera la judiciarisation nécessaire. Le renseignement occupera toujours une place essentielle dans le dispositif, mais il y a lieu de trouver une articulation lui permettant de travailler plus étroitement avec le judiciaire.
M. le président Georges Fenech. Le procureur nous a en effet dit qu’il était tributaire du renseignement, mais il juge excellentes les relations entre le parquet et les services. Il y a quelques semaines, M le rapporteur et moi-même avons rencontré M. Molins et lui avons demandé si l’on pouvait envisager de détacher une cellule de la DGSI auprès du parquet pour favoriser la judiciarisation. Il ne l’a pas estimé utile. Que proposez-vous pour décloisonner le renseignement et le judiciaire ?
M. David Benichou. Je ne vous suggérerai pas de créer une commission, je souhaitais juste poser le problème… Cela n’est pas parce que cela fonctionne parfois mal que les relations ne sont pas bonnes au quotidien ; en revanche, si l’on raisonne en termes de synergie entre les institutions, certaines choses sont à améliorer. Le judiciaire est ainsi complètement étranger à l’activité de l’unité de coordination de la lutte antiterroriste (UCLAT), le ministère de l’intérieur et les services de renseignement font circuler leurs informations entre eux et définissent ensemble des priorités. On pourrait imaginer une instance offrant une place au parquet et à chaque service, afin d’échanger des informations, de dégager des priorités et d’exprimer des préoccupations générales ou concrètes – comme l’opportunité de judiciariser pour protéger une source. Les magistrats ont intérêt à connaître ces éléments le plus précocement possible pour ne pas avoir à gérer des situations invraisemblables, comme, par exemple, une réquisition de la direction centrale de la police judiciaire (DCPJ) nous faisant retomber sur un ordinateur utilisé par un agent de la DGSI !
M. le président Georges Fenech. Vous développez une vision « parquetière », très en amont du renseignement, mais vous pouvez, en tant que juge d’instruction, délivrer une commission rogatoire en co-saisine avec la DCPJ et la DGSI, et avez donc autorité sur le renseignement et accès à l’information.
M. David Benichou. Mon autorité se limite au judiciaire, et mes interlocuteurs à la DGSI trahissent parfois des secrets pour m’informer – tous les renseignements étant classifiés –, si bien que la gestion des relations entre le judiciaire et le renseignement reste toujours difficile. Je n’ai pas de solution pour régler ce problème, qui mériterait une vraie réflexion.
On peut néanmoins envisager des initiatives concrètes, comme le développement de formations communes aux magistrats et aux agents du renseignement. Depuis peu, je présente, à l’académie du renseignement, notre activité à des gens dont on ne me dit ni le nom ni la fonction. Ces échanges s’avèrent très utiles, sans doute parce que chaque partie ignore largement le travail de l’autre. Il est très important, d’un point de vue opérationnel, de rapprocher les hommes : cela permet de connaître les contraintes de chacun et de dissiper la défiance naturelle du renseignement envers le judiciaire, les services craignant que toute information transmise au judiciaire ne se retrouve dans la presse.
Les magistrats instructeurs devraient également recevoir les notes de synthèse envoyées aux cabinets des ministres sur la lutte contre le terrorisme, car certaines informations pourraient les intéresser pour des enquêtes en cours. Or, aucun retour n’est effectué.
Certains moyens techniques nous font également défaut ; depuis la loi du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, dite « LOPPSI 2 », les juges peuvent capter des données à distance en mettant en place des « chevaux de Troie » légaux dans les ordinateurs et dans les téléphones. En novembre 2014, cette faculté a été fort opportunément étendue à la prise d’images et de son, mais le régime juridique d’emploi de ces outils prévoit une autorisation administrative, délivrée par l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI) et soumise à des conditions très strictes. Il a été proposé un assouplissement visant à permettre aux magistrats de désigner des experts judiciaires – personnes honorables et compétentes qui ont parfois reçu la même formation que les personnes travaillant à l’ANSSI – capables de développer un outil spécifique pour un dossier, car une grande flexibilité est nécessaire, la fenêtre d’opportunité pour traiter une affaire pouvant se refermer en deux semaines. Mais, en novembre 2014, M. Cazeneuve, ministre de l’intérieur, estimant indispensable l’agrément de l’ANSSI, avait convaincu le Sénat de retirer un amendement proposant cette évolution.
Ce sujet m’intéresse particulièrement, et je vous lis un extrait du compte rendu du débat qui s’est tenu le 3 mars dernier devant votre Assemblée, dans lequel M. Urvoas, garde des sceaux, ministre de la justice, féru de ces questions, avait déclaré, à propos d’un amendement identique, défendu par M. Ciotti : « Maintenant que l’offre est construite et que les habilitations sont demandées, nous pouvons considérer que ce problème est derrière nous ». Je me suis réjoui de cette déclaration et ai appelé mon correspondant au ministère de la justice, car ces outils peuvent m’aider dans une dizaine d’affaires. Mon correspondant m’a expliqué que deux sociétés ont reçu l’agrément, mais qu’elles développent des produits qui ne fonctionnent que sous un système d’exploitation. Ce système d’autorisation administrative privilégie les grands industriels capables, de consacrer du temps et des moyens à commercialiser des systèmes leur permettant de décrocher des commandes publiques sur l’important marché qu’est la captation de données à distance. Nous allons donc nous retrouver avec des outils d’enquête lourds et peu réactifs, comme c’est le cas de la plateforme nationale des interceptions judiciaires (PNIJ), à peine en service, déjà dépassée.
Il conviendrait d’autoriser les magistrats à recourir à des experts qui développeraient des outils d’intrusion adaptés à chaque affaire. Une autre solution consisterait à utiliser le centre technique d’assistance (CTA), qui concilie le besoin de confidentialité exprimé par les services et le besoin de résultat de la justice. Le code de procédure pénale permet au juge de requérir les moyens de l’État protégés par le confidentiel défense pour décrypter des supports, et l’on pourrait confier au CTA la mission de mettre en œuvre des moyens de captation à distance. La manière dont est réalisée cette captation importe peu, puisqu’elle est légale par nature, étant ordonnée par un juge dans une affaire particulière et pour des raisons précises. La légalité ne doit pas découler de l’agrément d’un service technique. Les services de renseignement se servent de ces outils, mais ils ne veulent pas les partager avec le judiciaire, par crainte légitime de divulgation et de menace sur l’emploi qu’ils en font. Pourtant, la priorité est la lutte contre le terrorisme, et nous avons besoin de ces instruments que l’État possède et que le contribuable a financés. Mutualisons-les pour qu’ils soient utilisés à plein rendement ; des députés inventifs sauront bien trouver les moyens juridiques de garantir leur confidentialité... Etant donné que l’on s’appuie sur le CTA pour le décryptage, on pourrait faire de même pour la captation de données à distance.
Cette problématique ne concerne pas que le terrorisme. Vous avez sans doute entendu parler des escroqueries au « faux président », dont j’ai instruit l’une des premières affaires, qui concernait le vol d’un million d’euros à la Caisse des dépôts et consignations (CDC) en 2012. Je souhaitais mettre en place une captation de données à distance pour identifier les auteurs, et un expert, ancien agent de la direction générale de la sécurité extérieure (DGSE), pouvait développer un outil efficace. Cependant, des personnes lui ont dit qu’il n’avait pas d’agrément et qu’il n’était pas autorisé à me fournir cet instrument. Cela n’aurait peut-être pas permis de résoudre l’affaire, mais ces escrocs, qui sont connus et qui ont volé au total plusieurs centaines de millions d’euros à des entreprises françaises, ne seront jamais arrêtés si on ne les traque pas en temps réel. Notre pays a les moyens techniques de faire face à cette forme de criminalité, mais nous nous créons parfois des difficultés juridiques qui nous rendent incapables de mobiliser utilement toutes les forces à notre disposition pour faire appliquer la loi.
Le renseignement peut servir le judiciaire, mais l’inverse est également vrai.
Nous ne disposons pas toujours du cadre juridique le plus adapté à nos besoins, et il faut vraiment établir des passerelles de communication entre les mondes judiciaire et du renseignement. Je n’ai pas de solution miracle, et les évolutions seront complexes car chaque service possède sa propre culture. Lançons donc au moins la réflexion ! Nous avons tenu la semaine dernière, avec la DRM et le service juridique du ministère de la défense, une réunion au cours de laquelle nous avons évoqué les échanges que nous souhaiterions développer ; pour chacun d’entre eux, le service juridique, faisant son métier, a rappelé le besoin de disposer d’un véhicule juridique.
Lorsque l’on trouve des téléphones et des disques durs lors d’une perquisition, on réalise des copies pour exploiter les données, et ces copies de travail des scellés numériques posent un problème aigu. Nous avions l’habitude de les confier à un expert judiciaire qui nous les rendait six mois plus tard dans des brouettes de papier... Cette méthode s’étant avérée improductive, nous en avons changé, d’autant qu’il était devenu impossible d’imprimer le contenu de toutes les données recueillies : l’impression des données d’un disque dur de 80 gigaoctets représente une hauteur de papier égale à trois fois celle de la tour Eiffel. Nous devons donc travailler avec des supports numériques, qui deviennent des éléments de la procédure, mais nous nous trouvons dans l’impossibilité matérielle d’en délivrer des copies. Or la chambre de l’instruction libère les prévenus si l’on n’a pas mis l’ensemble des supports à leur disposition. On peut placer ces éléments sous scellés pour sauver la procédure, mais alors on n’exploite pas les données ; inversement, on peut les exploiter, mais cela fait courir des risques à la procédure. Pour sortir de ce dilemme, il faudrait que la loi dispose que la copie de travail d’un scellé obéit au même régime juridique que le scellé, que l’on n’est pas obligé de transmettre aux parties. Cela provoquerait certes des protestations, mais l’avocat pourrait toujours demander un examen contradictoire des scellés. En tout cas, il faut que les enquêteurs et le juge puissent exploiter ces supports pour remplir leur mission.
M. Sébastien Pietrasanta, rapporteur. Quelle méthode employez-vous pour partager l’information entre vous ? Parvenez-vous à établir les ramifications entre les différentes affaires qui portent souvent sur des nébuleuses et des réseaux ? Comment faites-vous pour ne pas perdre l’information, essentielle en matière de terrorisme ?
Par ailleurs, la loi du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme a créé l’incrimination d’entreprise terroriste individuelle. L’avez-vous déjà utilisée ? Des condamnations ont-elles déjà été prononcées sur son fondement ?
M. David Benichou. Le partage de l’information entre nous s’avère empirique, car nous ne disposons pas d’outil de partage des informations de nos dossiers. La version supérieure, NPP4, du logiciel de numérisation des procédures constitue un net recul à mes yeux. On mettait trente secondes pour accéder à un dossier, et ce temps s’élève désormais à cinq minutes. Nous nous parlons donc entre collègues, mais ce sont parfois les enquêteurs ou le parquet qui font le lien entre nos affaires. Il nous faudrait une base de données contenant tous les noms apparaissant dans nos dossiers, comme celle dont disposent les services de renseignement. Le déploiement d’un tel fichier nécessiterait une simple autorisation juridique, la ressource humaine étant déjà disponible et la technique n’étant pas complexe : il suffit d’un serveur et d’un logiciel.
M. le rapporteur. Un fichier de données personnelles, le FSPRT, commun et alimenté par différents services, a été instauré. Comment ne pas perdre la mémoire des dossiers lorsqu’un juge quitte le pôle antiterroriste ? Vous prônez la création d’une base de données judiciaire permettant de rassembler les informations, mais, sans aller jusqu’à la rendre commune avec les services de renseignement, pourrait-on l’harmoniser avec ce qui est déjà utilisé ailleurs dans l’État ? Dans les moments de crise, l’accès rapide à l’information s’avère primordial, si bien qu’il importe que les enquêteurs aient accès à vos connaissances. Comment établir de tels circuits de transmission ?
M. David Benichou. Lorsque des noms apparaissent dans une affaire, j’aimerais savoir s’ils sont connus, et un fichier comme le FSPRT nous serait des plus utiles. Aujourd’hui, je dois appeler mon correspondant pour qu’il sollicite les services de renseignement.
M. le rapporteur. L’UCLAT est responsable de la base de données du FSPRT, que l’état-major opérationnel de prévention du terrorisme (EMOPT) alimente. Pouvez-vous demander la fiche d’un individu pour l’un de vos dossiers ?
M. David Benichou. Dans notre domaine, nous avons toujours besoin de disposer de toutes les informations, car un simple détail, même insignifiant pour celui qui en a connaissance, peut s’avérer important pour telle ou telle affaire. Quant au FSPRT, aucun agent de la DGSI ne m’a parlé de ce fichier de pur renseignement, qui pourrait être utile pour le judiciaire. Nous récoltons également beaucoup de matière qui pourrait intéresser les services de renseignement. Nos dossiers sont numérisés et indexés, et un simple moteur de recherche permettrait d’en tirer parti. Néanmoins, le secret de l’instruction autorise le juge à n’avoir accès qu’aux dossiers dans lesquels il est désigné, même si la codésignation permet de partager les informations.
M. le rapporteur. Dans les services de renseignement, l’alimentation de ce fichier s’est révélée complexe : pensez-vous pouvoir nourrir un tel fichier au fil de l’eau ?
Un fichier commun au renseignement et au judiciaire, au-delà des problèmes juridiques qu’il poserait, serait-il utile et permettrait-il de réduire la séparation entre ces deux mondes ?
M. David Benichou. L’idée d’un fichier commun est trop ambitieuse, car sa création se heurterait à trop de difficultés. En revanche, on pourrait aménager des instances de concertation et d’échange. Les Américains ont mis en place des groupes de travail – joint task forces – dans lesquels plusieurs services se réunissent, présentent leurs demandes aux autres et étudient ce qui peut être réalisé.
On n’a pas forcément besoin de créer un nouveau fichier traitant les données, puisque tous nos dossiers sont déjà numérisés et indexés en plein texte. Une recherche par mots-clés permet d’accéder à l’information.
M. le rapporteur. Avez-vous ce moteur de recherche ?
M. David Benichou. Oui, j’en ai un. J’ai obtenu, au bout de six mois, le financement d’un serveur pour mon cabinet ; on y insère tous les scellés des procédures, ce qui permet de trouver ensuite toutes les données immédiatement.
M. le rapporteur. Mais il n’est pas commun au pôle antiterroriste ?
M. David Benichou. Non, ce n’est pas possible juridiquement. Pourtant, on pourrait installer un serveur avec un moteur de recherche comme le mien à l’échelle d’un service entier. Il faut savoir ce que l’on veut : avancer vite dans les enquêtes, ou privilégier la protection des données ?
J’ai interrogé hier une personne dans le cadre d’une procédure d’entreprise terroriste individuelle, mais les cas sont rares. Pour un temps, cet outil ne sera utile qu’à la marge. En effet, on retombe presque toujours sur une entreprise d’au moins deux personnes ; les projets individuels sont souvent montés par des fous. En revanche, on peut imaginer que cette incrimination serve pour une personne très déterminée et ne communiquant avec personne.
M. Alain Marsaud. Vos souhaits quant à la communication entre le judiciaire et le renseignement correspondent au monde idéal, mais lorsque j’ai défendu cette idée, Mme Le Vert en a été témoin, le ministre de l’intérieur de l’époque m’a reproché de vouloir lui prendre « sa » direction de la surveillance du territoire (DST) ! On a quand même réussi à ce que les enquêteurs de la DST deviennent officiers de police judiciaire (OPJ).
Les agents des services de renseignement ne souhaitent pas communiquer l’identité de leurs sources, encore moins expliquer la manière dont ils se sont procuré leurs informations, leurs méthodes étant presque toujours illégales. Les magistrats ne se trouveraient-ils pas en difficulté s’ils avaient accès à ces éléments ?
M. David Benichou. On peut partager une information sans fournir l’identité de la source. Dans le domaine judiciaire, nous gérons des sources humaines depuis des années pour les affaires de stupéfiants. Le monde du renseignement croit toujours que nous sommes novices en la matière, mais en matière de stupéfiants, une source identifiée est condamnée à mort.
Nous n’avons pas besoin de connaître les raisons incitant une source à travailler pour un service de renseignement. Il nous faut simplement l’information et sa vérification. Cet exercice est complexe, mais il faut que le juge puisse avoir des échanges confidentiels avec les services de renseignement. Dans certaines affaires, je constate une grande différence entre les informations recueillies par le renseignement et ce qui figure dans le dossier judiciaire. Il arrive qu’une personne s’accuse elle-même devant quelqu’un pour apparaître comme un caïd, en ignorant qu’elle parle à une source.
M. Alain Marsaud. Et si Salah Abdeslam vous demandait de bénéficier du statut de repenti en vous informant sur un réseau à Molenbeek, en France, en Syrie ou ailleurs, quelle serait votre attitude ?
M. David Benichou. Selon la procédure, je ne peux interroger un mis en examen que pour mon dossier. S’il souhaite parler à un service de renseignement, je peux le mettre à disposition et établir des permis de communiquer. Cependant, certains services ne veulent même pas apparaître sur un permis de communiquer alors qu’il faut s’enregistrer pour entrer dans une prison.
M. Olivier Marleix. Connaissez-vous des systèmes judicaires de pays démocratiques où l’on a su surmonter certains des obstacles que vous avez évoqués ?
M. David Benichou. En 2014, j’ai effectué un séjour d’étude en Israël. Ce pays a développé une jurisprudence et des procédures en la matière, et il était intéressant d’examiner la façon dont un État démocratique réussissait à intégrer l’usage de la force dans son fonctionnement. Une démocratie moderne doit disposer des outils juridiques lui permettant d’employer la force selon des conditions prévues et écrites. Les autorités israéliennes évoquent souvent leur procédure de détention administrative, mais elles rêveraient de disposer de notre détention provisoire. Elles ont adopté un système anglo-saxon qui s’avère complexe pour les enquêteurs, et elles nous envient notre juge d’instruction, guichet unique et informel pour les enquêteurs, qui constitue notre force. En effet, celui-ci peut délivrer très rapidement des autorisations. Le renseignement s’est inspiré de ce fonctionnement en créant la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR). Certains agents de la DGSI se plaignent de la complexité de la mise en place d’une écoute administrative, alors que le processus des écoutes judiciaires est très simple du fait de la proximité entre le juge et l’enquêteur. Ce dernier ne prendra pas le risque de tromper le juge avec lequel il travaille tous les jours. Il y a des échanges féconds à développer entre la France et Israël dans ces domaines, Israël bénéficiant malheureusement d’une certaine expérience.
Je viens de faire un séjour d’étude aux États-Unis, où le renseignement est prédominant. Les structures d’échange d’informations entre les agences fonctionnent plutôt bien et seraient encore plus adaptées à notre taille, les Américains rencontrant des difficultés à coordonner les structures de coordination.
Les États-Unis ont une procédure pénale très contraignante, mais d’excellentes peines, soit l’inverse de notre pays, qui a une excellente procédure pénale mais de moins bonnes peines. J'ai instruit une affaire, jugée en 2014, concernant des djihadistes très radicalisés qui revenaient en Europe en provenance de la zone pakistano-afghane avec des projets d’attentat. Ces individus, au profil extrêmement préoccupant, n’ont rien « lâché » ; poursuivis en correctionnelle pour association de malfaiteurs à caractère terroriste (AMT), ils ont été condamnés à huit et neuf ans de prison. Arrêtés en 2008 et 2011, ils vont bientôt sortir. On poursuivait alors systématiquement pour AMT correctionnelle, pour laquelle la peine maximale s’élève à dix ans. Les Américains m’ont dit qu’un tel dossier donnerait lieu à vingt-cinq ans au moins d’emprisonnement dans leur pays. Je constate avec satisfaction que la politique du parquet commence à changer et qu’il utilise davantage les poursuites en AMT criminelle pour les gens passés par la Syrie, cette procédure pouvant déboucher sur une condamnation à vingt ans d’emprisonnement. Cette évolution suscite des débats, mais il faut comprendre à quoi l’on fait face. Une très longue peine d’emprisonnement représente le seul moyen de neutraliser durablement une personne ; parfois, elle ne suffit même pas, comme le montre l’exemple d’un condamné qui a encore tenté, il y a deux ans, de s’évader à l’explosif du quartier de haute sécurité où il avait réussi à faire entrer du C-4 ! Des personnes comme lui, nous en aurons par dizaines à l’avenir !
M. Olivier Marleix. L’article 411-4 du code pénal incrimine le fait d’entretenir des intelligences avec un autre État ou une organisation étrangère : pourrait-il constituer un fondement pertinent pour des poursuites pénales ? J’ai posé la même question au procureur de la République de Paris tout à l’heure. On recherche des peines efficaces pour les nombreux djihadistes qui reviendront de Syrie, sachant qu’il sera difficile de recueillir des preuves quant aux actes commis sur le théâtre des opérations. En matière criminelle, l’intention suffisant à caractériser l’infraction, on pourrait s’interroger sur l’utilisation de l’article 411-4 qui prévoit une peine de détention criminelle de trente ans.
M. David Benichou. Je connais mal cette disposition et ne sais pas si elle a déjà été utilisé. Il est intéressant d’explorer toutes les pistes, mais s’appuyer sur cet article reviendrait à reconnaître à DAECH le statut d’organisation étrangère, voire d’Etat étranger, ce qui poserait un problème politique. Il faudrait alors capter des communications pour démontrer l’existence de l’entente avec DAECH et donc effectuer des progrès en matière d’interception de contenus chiffrés.
On peut agir dans le dispositif en obtenant la conversation avant le cryptage ou après le décryptage : cette action s’appelle la captation de données à distance. Le législateur nous a autorisés à le faire en 2011, mais nous n’en avons toujours pas les moyens.
M. le rapporteur. Comment travaillez-vous avec la police et la gendarmerie en matière de contrôle judiciaire ? On a constaté des difficultés dans ce domaine ; quelles sont vos réflexions sur ce sujet ?
Mme Laurence Le Vert. Les contrôles judiciaires s’avèrent en effet difficiles. Soit l’on procède à des contrôles classiques reposant sur des pointages dans un service de police ou de gendarmerie, sur des interdictions en lien avec les infractions reprochées, comme le fait d’entrer en communication avec certaines personnes, et, éventuellement, sur le port du bracelet électronique ; celui-ci est cependant un outil faillible, les personnes pouvant partir sans que l’on s’en aperçoive. Soit l’on met en place des contrôles judiciaires organisés par les services pénitentiaires d’insertion et de probation (SPIP), mais le processus est lourd car le service aide la personne à chercher du travail et la suit dans ses obligations, comme le pointage ou le compte rendu hebdomadaire de ses activités. Lunel est la ville française ayant fourni le plus grand nombre de djihadistes, dont beaucoup sont morts en Syrie, et une fois que j’en ai placé deux auprès du SPIP de Nîmes et deux auprès de celui de Montpellier, il n’y a plus de capacité d’accueil. En outre, le contrôle judiciaire géré par le SPIP ne vaut que pour les personnes les moins radicalisées. Parmi les individus revenant de Syrie, seuls des mineurs ou des femmes peuvent entrer dans cette procédure. De nombreuses personnes placées sous contrôle judiciaire disparaissent – ce fut le cas de djihadistes ayant défrayé la chronique –, si bien que la détention s’avère bien plus indiquée pour celles que l’on estime dangereuses. L’administration pénitentiaire a mis en place des mesures de déradicalisation, dont on peut espérer la réussite afin de substituer la mise en liberté sous contrôle judiciaire à la détention provisoire.
J’ai instruit de nombreux dossiers relatifs au terrorisme basque. L’ETA cherche aujourd’hui à négocier sa reddition totale, car elle a été démantelée grâce aux fréquents accidents de la circulation impliquant des terroristes basques clandestins en France dans des voitures volées et, surtout, grâce à des opérations conduites sur le fondement de renseignements fournis par les services espagnols. Ces derniers, à partir de l’assassinat de deux gardes civils à Capbreton en 2007, ont eu la possibilité de travailler armés en France ; cela a contribué à développer fortement la coopération franco-espagnole en matière de renseignement. Afin que la procédure soit valable, les services français établissaient un rapport destiné à la police judiciaire, en l’occurrence à la sous-direction antiterroriste (SDAT), indiquant que des renseignements mettaient en évidence la présence de tel et tel individu dans un gîte rural ou un chalet. Ces éléments n’étaient pas probants, mais suffisaient pour que le parquet ouvre une enquête préliminaire qui se transformait le plus souvent en flagrance, puisque les renseignements étaient exacts. On pouvait ensuite ouvrir l’information, et la procédure était totalement régulière. Des services espagnols et français ont donc fourni des renseignements et le processus fonctionnait parfaitement.
En matière de terrorisme international, les services de renseignement ne peuvent pas communiquer toutes leurs informations, car certaines proviennent de services étrangers qu’ils ne peuvent transmettre à aucun prix. Les services de renseignement opérationnels français ne vont pas se tourner vers les juges d’instruction, mais vers leurs homologues du judiciaire. Une fois couchés sur procès-verbal, les éléments sont transmis au procureur de la République qui peut ouvrir une enquête préliminaire. Celle-ci utilisera les renseignements fournis pour établir des charges qui serviront à obtenir des résultats judiciaires.
Le renseignement ne peut se faire que dans l’anonymat des enquêtes. Si l’on judiciarisait ces informations dans le cadre de la criminalisation de l’association de malfaiteurs djihadistes, on contraindrait l’agent des services à témoigner devant la cour d’assises. Or on ne peut pas leur faire courir le risque de briser leur anonymat. Dans l’exemple cité par M. Benichou, l’agent de la DRM a été désigné comme expert et ne savait pas que ce statut pouvait l’amener à témoigner. On ne peut pas faire courir un tel risque à des membres des services de renseignement, qui assument une tâche lourde et difficile et qui, pour certains, s’exposent dans le cadre d’infiltrations et de traitements de sources. Les magistrats doivent avoir conscience de cette situation et en tenir compte. Lorsque le renseignement peut être utilisé dans un cadre judiciaire adapté et suivant une procédure légale et claire, faisons-le, mais nous ne devons pas judiciariser le renseignement si nous ne sommes pas certains de conduire la procédure jusqu’à la juridiction de jugement sans encourir la moindre suspicion, sans risquer l’annulation et sans mettre en danger des gens qui consacrent leur vie à trouver les auteurs des attentats ou les personnes pouvant en commettre.
M. le président Georges Fenech. Madame la première vice-présidente, monsieur le vice-président, nous vous remercions d’avoir répondu à nos questions au cours de cette audition intéressante et utile.
Audition, à huis clos, de M. Denis Couhé, premier vice-président adjoint du TGI de Paris, M. Laurent Raviot, vice-président du même TGI, présidents de la 16e chambre correctionnelle, et M. Régis de Jorna, président de chambre à la cour d'appel de Paris
Compte rendu de l’audition, à huis clos, du mercredi 30 mars 2016
M. le président Georges Fenech. Avec le procureur de la République de Paris et les responsables du parquet antiterroriste, d’une part, et les magistrats du pôle antiterroriste chargés de l’instruction, d’autre part, nous nous sommes intéressés cet après-midi au volet judiciaire.
Nous allons poursuivre avec vous, messieurs les présidents, dans le respect – naturellement – de la séparation des pouvoirs, nos investigations sur les moyens de lutte contre le terrorisme. En particulier, nous allons nous pencher sur le rôle spécifique des juridictions parisiennes, en particulier le tribunal de grande instance et la cour d’appel, où siège la cour d’assises, ainsi que sur la pertinence des dispositions législatives que vous mettez en œuvre.
Cette audition, en raison de la confidentialité des informations que vous êtes susceptibles de nous délivrer, se déroule à huis clos. Elle n’est donc pas diffusée sur le site internet de l’Assemblée. Néanmoins, et conformément à l’article 6 de l’ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, son compte rendu pourra être publié en tout ou partie, si nous en décidons ainsi à l’issue de nos travaux. Je précise que les comptes rendus des auditions qui auront eu lieu à huis clos seront au préalable transmis aux personnes entendues afin de recueillir leurs observations. Ces dernières seront soumises à la commission, qui pourra décider d’en faire état dans son rapport. Je rappelle que, conformément aux dispositions du même article, « sera punie des peines prévues à l’article 226-13 du code pénal » – un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende – « toute personne qui, dans un délai de vingt-cinq ans […], divulguera ou publiera une information relative aux travaux non publics d’une commission d’enquête, sauf si le rapport publié à la fin des travaux de la commission a fait état de cette information ».
Conformément aux dispositions de l’article 6 précité, je vais maintenant vous demander de prêter le serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité.
Veuillez lever la main droite et dire : « Je le jure. »
MM. Denis Couhé, Laurent Raviot et Régis de Jorna prêtent successivement serment.
M. Denis Couhé, premier vice-président adjoint du tribunal de grande instance de Paris, président de la 16e chambre correctionnelle. Je vais vous présenter succinctement la 16e chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Paris, chambre que nous présidons, M. Raviot et moi-même, ainsi que Mme Faivre, qui n’a pas pu venir aujourd’hui. Depuis le 1er janvier 2016, on a attribué à cette chambre le traitement de tous les dossiers de terroristes dont le tribunal est saisi. Ce n’était pas le cas jusqu’à présent puisque les dossiers de terrorisme étaient répartis entre trois chambres, la 10e, la 14e et la 16e, lesquelles étaient elles-mêmes subdivisées en deux sections, chacune composée d’un président et de deux assesseurs, soit au total six sections qui ne siégeaient que deux après-midi par semaine.
Outre les dossiers de terrorisme, les trois chambres traitaient également des dossiers de la juridiction interrégionale spécialisée (JIRS), c’est-à-dire liés à la criminalité organisée, au trafic de drogue, au trafic d’armes, aux réseaux de proxénétisme, à la traite des êtres humains, aux filières d’immigration clandestine… Cet éparpillement des attributions avait pour inconvénient majeur de morceler le traitement de ces dossiers qui, pour nombre d’entre eux, requerraient plusieurs jours d’audience. Ainsi, au rythme de deux audiences par semaine, trois dans le meilleur des cas, ces affaires monopolisaient certaines sections pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois.
À partir de 2012, il a été envisagé la création d’une chambre spécialisée « JIRS », autrement dit appelée à traiter de toute la criminalité organisée, mais également les dossiers de terrorisme. Cette chambre a été mise en place en septembre 2013 et a la particularité de siéger non pas à raison de deux ou trois audiences par semaine, mais en continu, c’est-à-dire au rythme de cinq audiences par semaine. La 16e chambre, où il n’y avait plus de section, est désormais composée de trois présidents, aujourd’hui Mme Faivre, M. Raviot et moi-même, et de trois assesseurs, les six magistrats siégeant en alternance.
Il convient néanmoins de rappeler que cette chambre a conservé toutes ses attributions en matière de délinquance organisée aux côtés des dossiers de terrorisme. Ces derniers dossiers, qu’ils concernent le terrorisme islamiste, le terrorisme basque, le terrorisme du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), le terrorisme corse – même si les derniers cas remontent ici à plusieurs années –, ne représentent, en jours d’audiences, que le tiers du contentieux qui nous est confié, alors même que, depuis le 1er janvier 2016, nous avons reçu une compétence exclusive en matière de terrorisme. Cet état de fait a créé, dès les premiers mois de fonctionnement de la 16e chambre, un engorgement de l’audiencement. Malgré sa réorganisation ou bien du fait de celle-ci, elle a rapidement été dans l’incapacité d’absorber tous les gros dossiers touchant au terrorisme, au grand banditisme, etc. L’engorgement a concerné des dossiers pour lesquels il n’y avait pas de détenus et qui passaient toujours après les autres, l’urgence étant bien entendu de traiter les dossiers pour lesquels il y avait des détenus. Aussi, le stock des dossiers de terrorisme et de grand banditisme augmentant, fallait-il trouver une solution pour les purger.
C’est dans ces conditions que M. Hayat, président du tribunal de grande instance de Paris, a sollicité et obtenu de la Chancellerie du personnel supplémentaire pour créer, au sein de la 16e chambre, une deuxième section – nous sommes donc revenus au système antérieur –, mise en place le 1er janvier 2015, donc sans rapport avec les événements survenus quelques jours plus tard. Cette deuxième section, destinée, à l’origine, à absorber ces stocks, ne fonctionne malheureusement pas comme la première, mais comme les autres chambres du tribunal, avec uniquement un président et deux assesseurs, et elle ne siège que trois jours par semaine – elle ne peut donc pas absorber ce que nous, première section, devons absorber.
L’arrivée massive de dossiers de terrorisme islamiste, jointe au fait que le nombre d’affaires relevant du crime organisé ne diminue pas, bien au contraire, a tout récemment conduit M. Hayat à solliciter un renfort de cette fameuse deuxième section pour obtenir un président supplémentaire et pouvoir siéger une audience supplémentaire par semaine. Ce renfort ne devrait être effectif qu’à compter de septembre 2016. Toutefois, il nous est apparu évident que cet appoint ne sera pas suffisant pour absorber tous les dossiers qui s’annoncent. Le procureur a été entendu par votre commission, et j’imagine qu’il vous a dit quel était le volume des dossiers qui arrivaient et que nous allions devoir prendre en charge dans la mesure où ils relèvent de notre compétence exclusive. A l’évidence, il serait nécessaire de créer une deuxième section qui soit à l’égal de la première, c’est-à-dire fonctionnant avec trois présidents et trois juges assesseurs – c’est à mon sens le minimum que l’on puisse imaginer.
M. le président Georges Fenech. La douzième proposition du rapport de la commission d’enquête sur la surveillance des filières et des individus djihadistes, commission aux travaux de laquelle le rapporteur et moi-même avons participé, prévoyait de confier à la JIRS, avec l’accord et sous le contrôle du parquet de Paris, l’instruction, la poursuite et le jugement des affaires terroristes de faible gravité.
M. Denis Couhé. Le problème est que nous sommes à la fois JIRS et juridiction traitant du terrorisme. Nous traitons donc tous les gros dossiers de la JIRS. Du fait que nous sommes la seule chambre à fonctionner en continu, à chaque fois qu’arrive un dossier relevant de la JIRS lié au terrorisme et fixé sur cinq, dix voire quinze audiences…
M. le président Georges Fenech. Sans doute me suis-je mal exprimé : est-il possible de confier ce type de dossier à des JIRS de province ?
M. Denis Couhé. Cela me paraît très délicat.
M. le président Georges Fenech. La proposition à laquelle j’ai fait allusion envisage de confier « la poursuite, l’instruction et le jugement d’infractions terroristes de faible gravité » à des JIRS de province. Souhaitez-vous que toutes les affaires soient centralisées, même celles de faible gravité ?
M. Denis Couhé. Personnellement, dans la mesure où il y a un parquet antiterroriste à Paris, où les cabinets des juges d’instruction sont à Paris, il paraît logique que toutes les affaires soient jugées à Paris. En outre, ces affaires ont tout de même une particularité dont on prend la mesure en pratiquant ce type de dossiers. Il me paraît donc important de limiter le nombre de juridictions qui ont à en traiter. C’est d’ailleurs pourquoi M. Hayat a décidé, ce qui est tout à fait nouveau, de confier tous les dossiers de terrorisme, depuis janvier 2016, à la 16e chambre, ce qui n’était absolument pas le cas auparavant : j’ai ainsi présidé il y a une dizaine d’années la 10e chambre, où parvenaient, notamment, les dossiers de terrorisme basque. La volonté est désormais de concentrer tous les dossiers non seulement à Paris mais au sein d’une seule et même chambre, quitte à demander que ces chambres soient étoffées, à l’instar de ce qui existe concernant l’instruction ou le Parquet.
Or nous savons qu’un nombre très important de dossiers va nous parvenir, et nous nous interrogeons sur les conditions dans lesquelles nous allons réellement pouvoir les traiter tous, étant entendu que nous ne souhaitons pas, par expérience, être spécialisés de façon exclusive. Il nous paraît en effet quelque peu dangereux que des chambres ne traitent que de dossiers de terrorisme : il y a un risque d’identification par les terroristes des cinq ou six magistrats qui n’exerceraient que cette activité et qui constitueraient donc des cibles ; de plus, nous avons besoin de nous extraire, de temps en temps, de ce type de dossiers tout de même particulièrement lourds sur le plan psychologique et sur celui du stress, sans compter l’aspect médiatique…
M. le président Georges Fenech. C’est pourtant le sort des juges d’instruction spécialisés.
M. Denis Couhé. Certes, mais ils sont au nombre de dix et ne traitent que de terrorisme, alors que nous ne sommes, de notre côté, que trois présidents à traiter de terrorisme entre autres choses. Cela mérite qu’on y réfléchisse. C’est pourquoi notre proposition que deux chambres travaillent en continu avec deux fois six magistrats ne paraît pas ahurissante – d’autant, j’y insiste, que les dossiers de la JIRS nous arrivent en nombre et qu’ils monopolisent nos journées pendant trois semaines au mois de juin, soit quinze audiences. Cela pose des problèmes inextricables d’audiencement, surtout quand il nous faut organiser des audiences-relais et prolonger les détentions parce que nous ne sommes pas en mesure de juger ces dossiers dans le délai de deux mois fixé par la loi. Nous sommes ainsi, désormais, presque systématiquement contraints de prolonger les délais au maximum, soit deux fois deux mois, pour un total de six mois, ce qui n’est satisfaisant pour personne.
M. le président Georges Fenech. Ces problèmes sont probablement pris en compte par le président Hayat ainsi que par la Chancellerie.
M. Denis Couhé. Nous craignons qu’à très court terme, c’est-à-dire dès la rentrée de septembre, comme nos collègues du parquet nous l’indiquent, il n’y ait un problème réel : nous n’allons pas pouvoir absorber tous les dossiers.
M. le président Georges Fenech. Tenez-vous également, dans le domaine du terrorisme, des audiences de comparution immédiate ?
M. Denis Couhé. Non, aucune.
M. Sébastien Pietrasanta, rapporteur. Et en ce qui concerne l’apologie du terrorisme ?
M. Denis Couhé. Elle relève d’une autre chambre.
M. le président Georges Fenech. Partagez-vous le même sentiment, monsieur Raviot ?
M. Laurent Raviot, premier vice-président du tribunal de grande instance de Paris, président de la 16e chambre correctionnelle. Je partage l’avis de mon collègue sur la centralisation, pour deux raisons : d’abord elle permet la spécialisation des juges et une meilleure connaissance des dossiers terroristes, qui présentent une vraie particularité ; elle permet ensuite une harmonisation de la jurisprudence, car il convient d’éviter des jurisprudences dissonantes qui seraient difficilement compréhensibles pour l’opinion et même pour le justiciable.
J’ai bien conscience toutefois du caractère paradoxal d’une telle centralisation car, comme mon collègue, je ne souhaite pas devenir une cible potentielle de la part des gens que nous jugeons ou de ceux qui leur sont proches, risque auquel peut conduire la spécialisation exclusive d’une chambre. Je pense notamment aux difficultés rencontrées par la JIRS de Marseille, qui traite du banditisme marseillais et corse et qui fait l’objet de critiques très fortes de la part des avocats locaux et de la presse – phénomène que nous ne rencontrons pas à Paris. On reproche donc à cette JIRS sa compétence trop restreinte.
M. le président Georges Fenech. C’est un peu le lot de tous les magistrats répressifs.
M. Laurent Raviot. Certes mais, j’y insiste, cette critique nous est rarement faite à Paris, même si l’on évoque parfois le spectre de la Cour de sûreté de l’État, d’une chambre inféodée au pouvoir. En tout cas, à titre personnel, je n’ai jamais subi cette critique.
M. Denis Couhé. Elle est plus fréquente en province, en effet. Lorsque je présidais la JIRS de Bordeaux, on entendait plus régulièrement qu’à Paris la chambre se faire traiter de juridiction d’exception. Dans la mesure, en outre, où nous sommes trois à coprésider cette chambre, et où nous avons presque toujours affaire aux mêmes avocats, ils se rendent compte que la composition n’est pas strictement la même, ce qui montre que nous sommes un certain nombre à pouvoir traiter de ces dossiers avec des sensibilités différentes et qu’une forme de jurisprudence se crée notamment grâce aux assesseurs. En effet, par définition, les présidents ne participent pas aux procès présidés par leurs deux collègues ; en revanche, nos assesseurs, eux, tournent et nous informent que, sur tel dossier, ils ont rendu telle décision, que sur tel autre s’est posé tel problème qui a été réglé de telle façon. Or, même deux chambres, avec six présidents et six assesseurs, ne seraient pas suffisantes pour faire éclater cette jurisprudence. Car je suis tout à faire d’accord avec M. Raviot pour considérer que disperser le traitement du terrorisme dans toute la France provoquerait des disparités qui rendraient la jurisprudence peu compréhensible.
M. le président Georges Fenech. Vos décisions sont-elles souvent frappées d’appel ?
M. Denis Couhé. En matière de terrorisme, très peu.
M. le président Georges Fenech. Et lorsqu’elles le sont, ont-elles tendance à être confirmées ?
M. Denis Couhé. Les rares appels étaient plutôt à l’initiative du parquet et portaient sur le quantum de la peine.
M. le président Georges Fenech. Et dans quel sens va la cour ?
M. Denis Couhé. La cour va en général dans le sens du parquet et aggrave la peine.
M. le rapporteur. Le faible nombre d’appels sur les questions de terrorisme est-il lié au fait que les djihadistes ne reconnaissent que la justice divine ? Il y a quelques mois, le barreau de Paris m’avait fait rencontrer un certain nombre d’avocats de djihadistes ; or j’ai été frappé par le fait que la plupart ne reconnaissaient pas la justice française.
M. Denis Couhé. Ce n’est pas le discours auquel nous sommes confrontés en matière de terrorisme islamiste. Cette contestation-là, nous la rencontrons plutôt avec les Basques qui, régulièrement, refusent de s’exprimer, ne se défendent pas et ne font pas appel puisqu’ils ne reconnaissent pas notre juridiction et se considèrent comme des détenus politiques. Or, je le répète, nous ne rencontrons pas cette argumentation chez les terroristes islamistes ou les personnes que nous jugeons pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, qui, eux, sont très bavards. Ils contestent, discutent, argumentent, rationalisent énormément – leurs audiences sont très lourdes. Et, d’une manière générale, ils se plient à notre décision, sachant que la cour d’appel a tendance à aggraver les peines que nous prononçons.
M. le rapporteur. Depuis combien de temps jugez-vous des affaires liées au terrorisme ?
M. Denis Couhé. Depuis douze ou treize ans. Il s’agissait au début de dossiers touchant essentiellement au terrorisme basque et accessoirement au terrorisme corse.
M. le rapporteur. Avez-vous noté, avec le terrorisme lié à l’islam radical, un changement d’attitude des personnes qui vous font face ?
M. Denis Couhé. Pour ce qui concerne les clients jugés en correctionnelle, c’est-à-dire ceux poursuivis pour des actes préparatoires – ceux qui partent ou projettent de partir en Syrie –, il est faux d’imaginer, contrairement à ce qu’on entend très régulièrement dans la presse, qu’il y ait un profil-type. On entend systématiquement dire que ces gens ont un casier judiciaire. Or, il y a quinze jours, j’ai jugé un dossier dont pas un des douze protagonistes n’avait de casier judiciaire. Le prochain dossier que j’aurai à juger concerne quinze personnes dont une seule a un casier. C’est donc une erreur absolue, j’y insiste, de penser et de dire qu’il y a un profil-type.
Ce qui réunit tous ces gens est l’idéologie, même si, en creux, certains profils ne se retrouvent pas : je n’ai pas encore rencontré de fils de famille provenant du 16e arrondissement de Paris... Nous avons, en tout cas, de très nombreux convertis, et en particulier de converties ; l’intervention des femmes a en effet, au départ, très largement échappé aux services d’enquête. L’importance des femmes dans ce type de dossier, et leur nombre désormais, sont très inquiétants. Les premières femmes – la plupart du temps des converties – commencent à être renvoyées devant le tribunal.
Certes, les personnes concernées ont dans leur famille, leur histoire personnelle, des failles, mais c’est aussi le cas, souvent, des délinquants liés au trafic de stupéfiants…
M. le président Georges Fenech. Vous risquez, messieurs les présidents de la 16e chambre correctionnelle, d’être quelque peu soulagés, si l’on en croit la nouvelle politique pénale annoncée par le procureur de Paris, visant à criminaliser l’association de malfaiteurs pour les terroristes. Ce sera toutefois une charge pour vous, monsieur le président de la cour d’assises, puisque l’on peut penser que, d’ici quelque temps, il puisse y avoir davantage d’affaires à juger.
M. Régis de Jorna, président de chambre à la cour d’appel de Paris. On compte à Paris trois cours d’assises non spécialisées. Aucune n’est spécialisée en matière de terrorisme, ou spécialement composée, c’est-à-dire ne comprenant donc pas de jurés mais des magistrats professionnels.
En matière de terrorisme, on vient presque de terminer tout ce qui a trait au terrorisme national, qu’il s’agisse du terrorisme corse – hormis quelques dossiers disjoints très secondaires – ou du terrorisme basque – hormis, si je ne m’abuse, un appel encore en cours –, et il ne reste qu’un dossier lié au PKK. En revanche, vont arriver les premiers dossiers terroristes lourds, criminalisés, d’association de malfaiteurs en bande organisée. Viennent de sortir des cabinets d’instruction ce que j’appellerai les attentats déjoués peu médiatisés.
Ces attentats déjoués ressemblaient de beaucoup aux attentats du mois de novembre 2015, avec la même logistique, la même intention… C’est grâce à des failles qu’ils ont pu être déjoués.
M. le président Georges Fenech. Vous nous l’apprenez ! Êtes-vous bien en train de nous dire qu’ont été déjoués des attentats du type de ceux du 13 novembre ?
M. Régis de Jorna. Tout à fait.
M. le président Georges Fenech. C’est une bonne nouvelle, que nous ignorions.
M. Régis de Jorna. Je fais allusion à la filière Cannes-Torcy.
M. le rapporteur. Nous avions connaissance d’attentats déjoués récemment comme celui du Thalys, ceux que Ghlam voulait commettre dans des églises, d’autres encore, mal préparés, contre deux forts militaires… Quant à la filière de Cannes-Torcy, elle était très organisée.
M. Régis de Jorna. En effet : vingt-deux personnes sont renvoyées en cour d’assises et, à l’occasion du procès, le grand public constatera la similarité de pans entiers de l’affaire avec les attentats du mois de novembre dernier.
M. le président Georges Fenech. Sont-ils en cours d’audiencement ?
M. Régis de Jorna. L’instruction est terminée. La chambre d’instruction a rendu son arrêt mais il y a un pourvoi. Reste qu’on est prêt à audiencer.
M. le rapporteur. Quels sont les délais ?
M. Régis de Jorna. La chambre criminelle n’a pas encore rendu son arrêt, mais l’audiencement aura vraisemblablement lieu en 2017.
Un dossier sera médiatiquement important, avec une ordonnance de mise en accusation qui, sauf erreur, n’est pas frappée d’appel : l’affaire Merah – plus exactement, ce qui reste de l’affaire Merah. Je connais non le détail mais le gros du dossier, et je crois qu’est renvoyé un des frères Merah pour le vol du scooter notamment. Si l’affaire devait venir devant la cour d’assises – je ne sais pas du tout ce qu’il en est –, sur un plan judiciaire on pourrait considérer que la montagne accouchera d’une souris…
M. le président Georges Fenech. En effet, il ne s’agira pas de l’auteur principal.
M. Régis de Jorna. Non, mais l’affaire aura pour autant un certain impact médiatique.
M. le président Georges Fenech. Pouvez-vous revenir sur le rôle des trois cours d’assises parisiennes ?
M. Régis de Jorna. Jusqu’à présent, ces trois cours d’assises traitaient les dossiers en fonction de leur sortie, si je puis dire. À partir de 2017, se posera la question de savoir s’il ne faudra pas une quatrième cour d’assises qui ne se consacre qu’au terrorisme, ou qui se charge également de dossiers comme ceux liés aux génocides, qui prennent beaucoup de temps. Face à l’afflux des dossiers de droit commun, dont le traitement dure en moyenne de trois à cinq jours, il est nécessaire, à Paris, de disposer de trois cours d’assises. Jusqu’à présent, chaque année, un ou deux dossiers – essentiellement liés au terrorisme national corse ou basque – faisaient l’objet d’une cour spécialement composée. Or, on risque désormais d’avoir des dossiers lourds et longs. On peut ainsi penser que l’affaire Cannes-Torcy fera l’objet de deux ou trois mois d’audience : vingt-deux personnes, plusieurs faits incriminés… Il va falloir faire face à l’éventuelle montée en puissance de ce type de dossier.
M. le rapporteur. Le parquet souhaite criminaliser l’association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, ce qui implique une adaptation de nos moyens. Dans cette perspective, est-il possible de réduire les délais et de prévoir plus de personnels ?
M. Régis de Jorna. C’est un problème qui affecte en général les cours d’assises et qui fait l’objet de projets de réforme. Les délais de chaque affaire augmentent : alors que, voici dix ans, nous jugions une affaire moyenne en deux jours, il en faudra bientôt quatre. En effet, les avocats plaident de plus en plus, font de la procédure, si bien que chaque affaire devient de plus en plus chronophage.
M. le président Georges Fenech. C’est valable aussi pour la juridiction correctionnelle. Avez-vous une formation particulière, une sensibilisation particulière au phénomène du djihadisme, à ce qu’est le salafisme ? Des séminaires sont-ils organisés par l’École nationale de la magistrature (ENM) pour les magistrats spécialisés tels que vous, ou bien vous faites-vous sur le tas votre propre culture sur ces phénomènes nouveaux et complexes ?
M. Denis Couhé. Nous nous formons à cette question principalement sur le tas, en examinant les dossiers. Néanmoins, il y a deux ans, j’ai suivi un stage très intéressant d’une semaine sur le terrorisme, organisé par l’ENM. L’expérience se forge aussi au contact des individus eux-mêmes, contact en effet très important et qui apprend beaucoup.
Par ailleurs, vous annoncez la criminalisation par le parquet de l’association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste – le juge d’instruction devant tout de même être d’accord. On sait qu’à la cour d’assises une procédure de ce type prend beaucoup plus de temps qu’au tribunal correctionnel. On sait que les cours d’assises de Paris sont particulièrement encombrées, et je vois très mal certains dossiers quitter le tribunal correctionnel pour la cour d’assises sans déperdition d’énergie. Ainsi, il y a quinze jours, treize personnes étaient mises en examen dans tel dossier, dont certaines sur mandat d’arrêt car se trouvant en Syrie, et le juge d’instruction a choisi de faire une disjonction pour une seule d’entre elles, toujours en Syrie, qui sera donc jugé par défaut. Cela signifie que j’ai été obligé de prendre connaissance de l’intégralité du dossier pour juger douze personnes ; mais le président de la cour d’assises va, lui, être obligé de prendre connaissance de l’intégralité du dossier pour en juger une personne, qui de plus ne sera pas là. S’agit-il bien du bon système ?
Mon prochain dossier concerne quatorze personnes et nécessitera huit audiences ; or, quatorze prévenus devant la cour d’assises, cela représente une durée de deux mois. Combien de magistrats mobilisés sur une seule affaire, alors que nous ne sommes que trois magistrats à être mobilisés sur une affaire en correctionnelle ? Nous avions suggéré à Mme Taubira, quand elle était garde des sceaux, que, dans les projets de réforme, au lieu de criminaliser l’association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, avec toutes les difficultés que cela comporte, l’on aggrave plutôt les peines maximales, aujourd’hui de dix ans, pour les porter à quinze ans.
M. le président Georges Fenech. Comme cela existe en matière de stupéfiants.
M. Denis Couhé. Tout à fait ! Cette possibilité existe et je ne sais pas pourquoi elle n’a pas l’heur de plaire alors que, manifestement, dans certains dossiers, nous sommes bloqués sur la peine de dix ans. Si, en cas de récidive, nous pouvons aller jusqu’à prononcer une peine de vingt ans, la plupart du temps, comme je vous l’indiquais tout à l’heure, les prévenus n’ont pas de casier judiciaire. Or il serait plus intéressant de pouvoir aggraver les peines maximales tout en gardant la qualification correctionnelle. La difficulté pour nous est que nous nous retrouvons avec, d’un côté, celui qui donne cinquante euros pour permettre à un ami de prendre un billet d’avion pour aller en Syrie, et, de l’autre, celui qui se rend en Syrie et dont on sait qu’il va combattre : or nous ne disposons que d’une fourchette de peines de dix ans pour les deux. Si l’on ajoute ceux qui s’arrêtent à la frontière syrienne mais qui vont revenir, on va se retrouver avec des fourchettes de plus en plus réduites : entre six ans et dix ans, ce qui peut être largement insuffisant ; on préférerait parfois prononcer une peine beaucoup plus longue pour certains dont on sait qu’ils ont combattu, afin que notre décision soit cohérente par rapport à l’implication des uns et des autres. Aussi la criminalisation envisagée ne va-t-elle pas nécessairement régler grand-chose.
M. le président Georges Fenech. Sauf que la criminalisation permet des détentions provisoires plus longues…
M. Laurent Raviot. Depuis deux ans et demi, sur une dizaine de procédures concernant des prévenus pour terrorisme djihadiste, un seul dossier a été criminalisé. Je ne pense donc pas qu’on puisse attendre de la criminalisation un miracle. J’ai ainsi eu à connaître, dernièrement, d’un dossier lié à une filière de soutien à des islamistes qui comptaient rejoindre la Syrie et qui, pour cela, avaient financé leur projet en commettant un vol à main armée – qualification ici typiquement criminelle. Or le parquet a fait le choix de la correctionnalisation, auquel personne ne s’est opposé. Les peines prononcées par le tribunal correctionnel ont été de sept et huit ans selon les participants. Personne n’a fait appel : ni le parquet ni les prévenus. J’ignore si c’est le gage d’une bonne décision, mais c’est déjà un signe. Ce dossier aurait pu, certes, être renvoyé devant la cour d’assises, mais pour quoi faire ? Si le parquet requiert des peines à peu près identiques à celles prononcées par le tribunal, cela n’a pas d’intérêt.
Je ne suis pas certain qu’à long terme, j’y insiste, la criminalisation soit une solution, sauf pour certains dossiers.
M. président Georges Fenech. S’agissant de l’échelle des peines, vous avez sans doute suivi le débat politique et judiciaire sur la peine perpétuelle. Pouvez-vous, monsieur le président de Jorna, nous faire part de votre opinion ?
M. Régis de Jorna. Vous m’interrogez sur la peine incompressible…
M. le président Georges Fenech. Oui. L’avez-vous déjà prononcée ?
M. Régis de Jorna. Non. La réclusion à perpétuité n’a pas été prononcée dans les cas de terrorisme basque ou corse. Quant à l’affaire Carlos, la période de sûreté était alors limitée à vingt-deux ans.
Il existe déjà, juridiquement, la possibilité de prononcer des peines incompressibles, mais il faut qu’elles soient compatibles avec les exigences – notamment – de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH). Autrement dit, une peine incompressible ne doit pas être exclusive de la possibilité de tout recours.
M. le président Georges Fenech. Il faut également compter avec le droit de grâce du Président de la République.
M. Régis de Jorna. Tout à fait. Il y a actuellement, je crois, deux ou trois individus dont les condamnations sont effectivement incompressibles ; mais demeure toutefois la possibilité d’un recours afin que cette incompressibilité ne soit que théorique.
M. Georges Fenech. Il s’agit de trois ou quatre cas, comme celui de Fourniret ou ceux de meurtriers d’enfants.
M. Régis de Jorna. Voilà.
Je crois qu’on va arriver à cela. Si l’on examine la législation en vigueur, la peine incompressible existe, avec la possibilité d’y déroger par le biais de certains recours. C’est un peu la bouteille à moitié pleine ou à moitié vide. Si l’on veut appliquer les textes, en tout cas, c’est possible.
M. David Comet. Pour en revenir à la centralisation, que vous jugez positive dans la lutte antiterroriste, on nous a parlé du modèle italien, qui semble avoir fait ses preuves en la matière.
Par ailleurs, les liens entre la communauté du renseignement et la justice sont-ils solides ? Faudrait-il changer de paradigme et faire en sorte qu’il y ait une coopération plus étroite entre ces deux « communautés » ?
Ensuite, l’endoctrinement des apprentis djihadistes est-il similaire à celui pratiqué par les sectes pour enrôler leurs adeptes ?
Enfin, pourquoi la propagande djihadiste est-elle aussi facilement accessible sur internet ? Pourquoi ces publications ne sont-elles pas bloquées ?
M. le président Georges Fenech. Le modèle italien est en effet décentralisé, notamment pour les grands procès de mafieux, et cela semble donner des résultats.
M. Denis Couhé. Nous sommes en effet plutôt favorables, pour ce qui nous concerne, à la centralisation.
Par ailleurs, au stade du jugement, il va de soi que nous n’avons aucun contact avec le renseignement. Il serait du reste délicat d’imaginer qu’il puisse y avoir des contacts puisque, par principe, ils seraient souterrains et ne pourraient donc être officialisés, alors que la loi nous oblige à être totalement transparents.
Quant à l’endoctrinement des djihadistes, je ne pense pas qu’il soit similaire à celui des sectes. Il est souvent individuel et, comme je l’ai indiqué précédemment, il n’y a pas de profil idéal : on ne sait pas pourquoi, tout à coup, un jeune se fait endoctriner. Certes il ne va pas s’endoctriner tout seul ; il le sera par le biais, notamment, d’internet, mais aussi en allant assez régulièrement à la mosquée – qui n’est pas nécessairement le lieu où il va s’endoctriner, mais plutôt le lieu où trouver le moyen de s’endoctriner. Dans le prochain dossier que j’aurai à traiter, les réunions ne se tenaient pas à la mosquée, qui n’était que le point de rendez-vous, mais à l’extérieur. Reste, j’y insiste, qu’on ne sait pas réellement pourquoi ils se font endoctriner, sinon à cause de failles dans leur personnalité, je l’ai dit, mais ce sont des failles que l’on retrouve assez régulièrement dans d’autres cas.
M. Laurent Raviot. Si les profils sont en effet très individualisés, il y a tout de même des filières d’endoctrinement. J’ai eu à connaître dernièrement d’un dossier concernant des gens partis en Syrie et qui venaient de Trappes. En examinant le dossier dans le détail, on remarque qu’il y avait dans cette commune un vrai foyer d’endoctrinement, avec des gens qui ont dirigé une vraie filière : des passeurs, des contacts en Syrie… Il existe donc un processus assez commun, malgré des cas individuels très différents, qui peut conduire à ces départs pour le djihad.
M. le rapporteur. Avez-vous eu à juger des entreprises terroristes individuelles depuis le 13 novembre ?
M. Laurent Raviot. Pour ce qui me concerne, oui.
M. le rapporteur. Et votre troisième collègue ?
M. Denis Couhé. Non, d’autant qu’elle est arrivée très récemment. La plupart des dossiers concernent en effet des filières, et je partage ce que vient de dire M. Raviot sur les foyers d’endoctrinement qu’on trouve dans certaines communes.
M. le rapporteur. Quel était le profil de l’individu en question, monsieur Raviot ?
M. Laurent Raviot. Il s’agissait d’un individu parti pour le Mali afin de rejoindre les rangs d’Al-Qaïda au Maghreb islamique (AQMI) et qui a combattu contre l’armée française, notamment lors de l’offensive de Diabaly. Il a été arrêté à la faveur de l’intervention française alors qu’il avait trouvé refuge dans un village au nord de Tombouctou.
À la réflexion, j’ai eu à traiter une seconde affaire du même type. Il s’agissait d’un djihadiste parti dans les mêmes conditions que le premier, pour rejoindre AQMI au Mali et qui a combattu contre l’armée française, et qui a été découvert par les soldats français dans l’Adrar des Iforas, donc après la déroute d’AQMI aux alentours de Tombouctou.
M. le rapporteur. Quelles condamnations ont-elles été prononcées contre ces individus ?
M. Laurent Raviot. Huit ans d’emprisonnement pour les deux.
J’ajoute qu’à la différence des Basques, qui revendiquent leur appartenance à une organisation que par ailleurs ils ne considèrent pas comme terroriste, les prévenus suspectés de participation et d’organisation terroriste islamiste, ne reconnaissent pas, voire contestent, le fait même d’avoir voulu intégrer une organisation terroriste. La plupart des prévenus, après maints revirements, admettent être partis en Syrie, mais sans qu’il ait jamais été question, selon eux, d’y avoir une activité combattante. Ils disent s’y être rendus pour mener des activités humanitaires, pour parfaire leur connaissance de l’islam, mais pas pour intégrer un groupe combattant.
M. le rapporteur. A contrario, avez-vous eu affaire à des repentis sincères, ou vous donnant à penser qu’ils l’étaient ?
M. Laurent Raviot. C’est très difficile à apprécier, car on est là au cœur de la difficulté de juger, non pas par rapport à un acte commis dans le passé, mais par rapport au risque de réitération et à la dangerosité potentielle de nos prévenus. Au sein de ma chambre, nous avons eu une expérience malheureuse. Ni M. Couhé ni moi-même ne présidions l’audience. Parmi nos assesseurs, une jeune femme avait participé au procès d’une filière djihadiste dans lequel était impliqué Coulibaly. Après les événements de janvier 2015, elle m’a expliqué qu’elle était atterrée par ce qu’il s’était passé : Coulibaly avait bénéficié de la mansuétude judiciaire puisqu’il présentait le meilleur profil de réinsertion par rapport aux autres prévenus – c’est celui qui a été le moins sévèrement condamné. Comment vais-je aujourd’hui pouvoir juger ce type de prévenu, s’est-elle demandée, si j’ai à l’esprit que, de toute façon, il ne dira que des mensonges ? Or, j’y insiste, Coulibaly présentait un vrai profil de réinsertion. Nous sommes tous confrontés à cette difficulté : certains prévenus paraissent sincères, d’autres pas du tout ; comment faire la part des choses ? C’est la difficulté de juger, il n’y a pas de règle pour cela. Je n’aurai jamais la garantie qu’une personne à laquelle on va accorder confiance ne deviendra pas un meurtrier.
M. Denis Couhé. Je partage ce qui vient d’être dit. Je pense même que des gens peuvent être des repentis sincères le jour de l’audience et, dans les mois qui suivent, au contact de gens qui ne le sont pas du tout, vont redevenir de véritables bombes humaines.
M. Laurent Raviot. On ne peut exclure que, parmi les gens que nous jugeons et qui sont arrêtés après un retour de Syrie, il y en ait qui soit sincèrement repentants. Ils ont vu ce qu’était l’État islamique et décident de revenir en France parce qu’ils ne sont pas du tout d’accord avec les pratiques de cette organisation.
M. le rapporteur. Notamment avec la pratique de la takiya.
Peut-il exister, selon vous, des alternatives à la prison pour ce genre d’individus ? On parle de centres de déradicalisation… Pourriez-vous être amenés, pour les cas les moins problématiques, les moins dangereux, à proposer ce genre d’alternative ?
M. Laurent Raviot. J’y suis favorable. Dans tous les cas, même après la sanction, même après une période d’incarcération plus ou moins longue, il faudrait que ces gens-là soient suivis de façon très active.
M. le rapporteur. Et comme mesure alternative ?
M. Laurent Raviot. Sur le principe, on ne peut pas l’exclure, tout dépend des situations. Nous avons des prévenus qui comparaissent sous contrôle judiciaire, qui n’ont donc pas fait de détention ou très peu.
M. le rapporteur. Forts de votre expérience, auriez-vous pu, si cette mesure était prévue, la prononcer comme alternative à la prison ? Pour certains individus, vous demandez-vous si, étant donné leur apparente fragilité, il ne vaudrait pas mieux éviter de les envoyer en prison, lieu de « socialisation », si je puis dire, entre personnes radicalisées ?
M. Laurent Raviot. Là encore, il s’agit d’une question complexe. Ce n’est pas que je veuille me défausser mais, quoi qu’il arrive, qu’une personne séjourne en prison ou qu’elle soit laissée libre, même sous mesure de contrainte, même dans un centre de déradicalisation, on ne peut jamais exclure que, au contact de certaines personnes… En prison, selon ses fréquentations, un détenu va pouvoir accéder à un début de repentir ou non. Cela pose le problème de savoir si l’on met ensemble les détenus islamistes ou si on les sépare. Là encore, je ne pense pas qu’il puisse y avoir une réponse certaine. Il faut vraiment juger cas par cas. Il faut absolument isoler certains détenus islamistes des autres détenus islamistes, dès lors qu’on sent chez eux une possibilité de changement.
M. le rapporteur. Il s’agit notamment de les éloigner de ceux qui ont une aura particulière.
M. Laurent Raviot. Évidemment. Il ne faut surtout pas mettre ces derniers avec d’autres détenus de droit commun, afin d’éviter tout prosélytisme, et il faut éviter, si possible, de les mettre avec des détenus fragiles étiquetés islamistes. Il n’y a pas de règle, je le répète, et les situations sont vraiment à apprécier cas par cas – compte tenu, notamment, de l’évolution des gens.
M. le président Georges Fenech. Nous retiendrons vos précisions fort intéressantes et importantes, ainsi que votre inquiétude quant aux moyens nécessaires pour faire face à la masse des dossiers que vous allez avoir à traiter. Nous aborderons, bien sûr, ces questions avec le garde des sceaux dans la perspective de la discussion du projet de loi de finances pour 2017.
M. Laurent Raviot. Si vous permettez, monsieur le président, je souhaite vous donner quelques chiffres montrant l’évolution du contentieux lié au terrorisme islamiste.
M. le président Georges Fenech. Je vous en prie.
M. Laurent Raviot. De septembre 2013 – date de création de notre chambre – au 31 décembre 2013, nous avons eu, sur 79 jours d’audience, 16 jours consacrés au terrorisme islamiste soit 3 dossiers.
En 2014, sur 208 jours d’audience, 25 jours ont été consacrés au terrorisme islamiste, soit 8 dossiers.
En 2015, nous avons eu, toujours pour ce type d’affaires, 14 dossiers pour 40 jours d’audience.
En 2016, nous en sommes déjà à 9 dossiers pour 30 jours d’audience.
Ces chiffres montrent bien que nous avons à traiter de plus en plus de dossiers de cette nature.
M. le président Georges Fenech. Et il n’y a malheureusement aucune raison pour que cela s’arrête.
M. Laurent Raviot. Au regard des prévisions qui nous ont été données par le parquet, le phénomène va en effet être amené à s’accentuer.
M. le président Georges Fenech. Nous vous remercions pour ces informations fort intéressantes.
Audition, à huis clos, de Mme Isabelle Gorce, directrice de l'administration pénitentiaire, et de Mme Fabienne Viton, cheffe du bureau du renseignement pénitentiaire
Compte rendu de l’audition, à huis clos, du lundi 4 avril 2016
M. le président Georges Fenech. Madame la directrice, madame, nous vous remercions d’avoir répondu à la demande d’audition de notre commission d’enquête relative aux moyens mis en œuvre par l’État pour lutter contre le terrorisme depuis le 7 janvier 2015.
Avec le procureur de la République de Paris, ainsi que les responsables du parquet antiterroriste, les magistrats du pôle antiterroriste chargés de l’instruction et les présidents de la cour d’assises spéciale et de la seizième chambre du tribunal de grande instance de Paris, nous nous sommes intéressés mercredi dernier au volet judiciaire. Nous allons poursuivre avec vous nos investigations sur les moyens de la lutte contre le terrorisme en nous intéressant à la facette pénitentiaire du sujet. Nous allons pouvoir vous interroger sur des questions sensibles comme les problèmes posés par la détention des personnes radicalisées ou encore aborder celle des moyens humains et matériels du renseignement pénitentiaire. Les informations que vous nous donnerez nous seront d’autant plus précieuses que certains d’entre nous se rendront au centre pénitentiaire de Fresnes immédiatement après votre audition.
En raison de la confidentialité des informations que vous êtes susceptibles de nous délivrer, cette audition se déroule à huis clos. Elle n’est donc pas diffusée sur le site internet de l’Assemblée nationale. Néanmoins, et conformément à l’article 6 de l’ordonnance 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, son compte rendu pourra être publié en tout ou partie, si nous en décidons ainsi à l’issue de nos travaux. Je précise que les comptes rendus des auditions qui auront eu lieu à huis clos seront au préalable transmis aux personnes entendues afin de recueillir leurs observations. Ces observations seront soumises à la commission, qui pourra décider d’en faire état dans son rapport. Je rappelle que, conformément aux dispositions du même article, « sera punie des peines prévues à l’article 226-13 du code pénal toute personne qui, dans un délai de vingt-cinq ans divulguera ou publiera une information relative aux travaux non publics d’une commission d’enquête, sauf si le rapport publié à la fin des travaux de la commission a fait état de cette information ».
Conformément aux dispositions de l’article 6 précité, je vais maintenant vous demander de prêter le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité.
Mme Isabelle Gorce et Mme Fabienne Viton prêtent serment.
Madame la directrice, la lutte contre le terrorisme est une nécessité absolue, et nous sommes nombreux à considérer que l’administration pénitentiaire doit prendre part à ce combat, notamment en renforçant ses moyens, afin non seulement d’assurer la sécurité des établissements pénitentiaires et de ses personnels mais également de créer en son sein un service de renseignement susceptible d’apporter des informations issues de la détention quelquefois décisives aux forces chargées de lutter contre les atteintes les plus graves à la sécurité de notre pays. Je pense aux parcours en prison de Mohamed Merah, des frères Kouachi ou d’Amedy Coulibaly. L’un de vos prédécesseurs, le préfet Didier Lallement, avait pris en compte cette nécessité, en créant au sein de l’administration pénitentiaire une grande sous-direction de la sécurité, intitulée « état-major de sécurité », qui disposait de moyens importants. Cette sous-direction faisait un travail remarquable et reconnu par tous. Alors que la France était confrontée à des attentats cruels, vous avez cependant décidé de revenir sur cette organisation et vous avez supprimé, par arrêté du 30 juin 2015, l’état-major de sécurité et délayé cette question de sécurité dans plusieurs sous-directions.
Aujourd’hui, le bureau du renseignement pénitentiaire est placé au sein de la sous-direction des missions, aux côtés du bureau de gestion de la détention, du bureau des politiques sociales, d’insertion et d’accès aux droits, du bureau de l’action juridique et du droit pénitentiaire et du bureau des alternatives à l’incarcération et des aménagements de peine. Dans ces circonstances, madame la directrice, ce choix vous paraît-il judicieux en termes d’implication et de visibilité, notamment en vue de l’insertion du renseignement pénitentiaire au sein du deuxième cercle des services de renseignement ? Et, depuis les attentats de Charlie Hebdo, comment avez-vous organisé l’échelon central de coordination de la sécurité et du renseignement pénitentiaire ? Enfin, pour que la commission puisse faire d’utiles recommandations, il serait utile que nous connaissions les instructions que vous avez reçues ou, à défaut, votre propre position sur la création d’un service de renseignement pénitentiaire spécifique au sein de l’administration pénitentiaire.
Mme Isabelle Gorce, directrice de l’administration pénitentiaire au ministère de la justice. La réorganisation de l’administration centrale avait très largement précédé, bien entendu, les attentats de janvier et de novembre 2015. L’organigramme est néanmoins entré en vigueur au mois de septembre dernier, donc au beau milieu de l’année.
Pourquoi cette réorganisation ? Pourquoi avoir supprimé l’état-major de sécurité ? Lorsque j’ai pris mes fonctions, j’ai estimé que l’administration pénitentiaire était très bien charpentée, avec une loi et un système réglementaire plutôt bien faits, et des services déconcentrés assez structurés. Ce qui lui manquait considérablement et qui n’était quasiment jamais traité par l’administration centrale ni par les services déconcentrés, c’était un travail suffisant sur ses métiers – j’en savais quelque chose, puisque j’avais déjà travaillé douze ans à l’administration centrale, de 1990 à 2002, j’avais d’ailleurs participé à l’une des premières réorganisations de l’administration centrale. C’est là l’une des grandes carences de l’administration pénitentiaire, et ce constat est toujours valable : elle travaille sur ses missions, mais elle ne travaille pas sur la manière de faire. C’est l’une de ses grandes faiblesses : elle manque de réflexion sur l’exercice de ses missions. Il était donc pour moi absolument indispensable de restructurer l’administration centrale pour mieux travailler sur les savoir-faire de l’administration pénitentiaire et sur les pratiques professionnelles, qu’il s’agisse des métiers de la surveillance, des greffes ou des services pénitentiaires d’insertion et de probation (SPIP), des personnels de direction ou des autres fonctions.
Une sous-direction des métiers a donc été créée, qui est aujourd’hui la sous-direction totalement intégratrice de tout ce qui peut être décidé sur les missions de l’administration pénitentiaire. Tout passe par cette sous-direction et on mesure à quel point il est absolument indispensable d’avoir un service totalement dédié aux savoir-faire, aux méthodes de travail et à la manière d’intervenir dans les établissements – on le voit avec les équipes régionales d’intervention et de sécurité (ERIS), avec les transferts des extractions judiciaires, avec l’énorme travail de restructuration des méthodes d’intervention des SPIP qu’a nécessité la mise en œuvre de la réforme pénale.
Dans ce contexte, il fallait évidemment faire des choix, et je n’étais pas convaincue, douze ans après sa création, de l’efficacité de l’état-major de sécurité. J’ai estimé que cette sous-direction s’était totalement cloisonnée et ne travaillait que très peu avec les autres. Le bureau du renseignement, notamment, s’était refermé sur lui-même et j’avais très peu d’informations sur ce qu’il faisait. Je savais qu’il travaillait beaucoup avec les services spécialisés du renseignement mais, à plusieurs reprises, j’ai pu constater que je ne parvenais pas à obtenir les informations que je lui demandais. J’ai donc estimé qu’il devait être replacé au cœur des missions de l’administration pénitentiaire et de la sécurité des établissements, de la gestion des détenus, car c’est bien cela notre mission première, avant de travailler pour les services spécialisés du renseignement : gérer des détenus.
M. le président Georges Fenech. « J’ai estimé », dites-vous, mais je suppose que vous aviez l’accord de la garde des sceaux ?
Mme Isabelle Gorce. Bien entendu. J’ai présenté ce projet très tôt…
M. le président Georges Fenech. La suppression de l’état-major de sécurité s’est donc faite avec l’accord du garde des sceaux de l’époque.
Mme Isabelle Gorce. Bien sûr.
Aujourd’hui, les questions de sécurité sont traitées de façon transversale, au sein de l’administration pénitentiaire. Je rappelle que le premier bureau de la sous-direction des missions se consacre à la gestion des établissements pénitentiaires et de la détention, c’est notamment le bureau qui gère les crises. Il fonctionne vingt-quatre heures sur vingt-quatre, une permanence remonte l’ensemble des incidents – le matin et le soir – et toute la chaîne, jusqu’au ministre, est ainsi informée deux fois par jour des crises et des incidents qui ont lieu dans les établissements pénitentiaires. Ce bureau, essentiel, est totalement tourné vers les établissements pénitentiaires et la gestion des détenus, y compris les plus dangereux, ceux qu’on appelle les détenus particulièrement signalés, gérés en étroite collaboration avec le bureau M3, qui est le bureau du renseignement.
Nous avons profité de cette réorganisation, mais aussi des deux plans de lutte contre le terrorisme, le PLAT 1 et le PLAT 2, pour renforcer le rôle du renseignement et surtout restructurer l’ensemble de la chaîne, que ce soit au niveau central, régional ou local. À mon sens, le positionnement de ce bureau au sein de l’administration centrale ne pose pas de problème. Il est bien intégré dans sa sous-direction et travaille mieux avec les autres services de l’administration centrale.
On peut toujours s’améliorer. Demain, un autre mode d’organisation pourra peut-être se dessiner, à la faveur, éventuellement, de l’intégration de l’administration pénitentiaire dans le second cercle du renseignement – ce n’est pas encore totalement voté. À la lumière de mon expérience et de ce qu’est devenu au fil du temps l’état-major de sécurité, il me paraît en tout cas très important que le bureau du renseignement reste totalement amarré à l’administration pénitentiaire et au ministère de la justice. Les informations dont il dispose doivent servir d’abord à la sécurité des établissements et des personnes qui travaillent en leur sein. Mais il peut et doit évidemment transmettre des informations utiles aux services spécialisés du renseignement, soit à la demande, soit de sa propre initiative. Je pense essentiellement à la Direction générale de sécurité intérieure (DGSI) et au Service central du renseignement territorial (SCRT), avec lesquels nous avons des protocoles, mais également à l’Unité de coordination de la lutte antiterroriste – avec laquelle nous avons des réunions hebdomadaires avec l’UCLAT. Je reçois moi-même le correspondant de l’administration pénitentiaire, puisque j’ai mis un directeur des services pénitentiaires à la disposition de l’UCLAT, qui travaille maintenant à plein-temps au sein de ce service. Cela nous permet d’avoir une interface avec l’Unité. Ce cadre pénitentiaire participe chaque premier lundi du mois au comité de direction que nous organisons sur la lutte contre la radicalisation. L’administration pénitentiaire entretient donc des liens très forts, au plus haut niveau, avec l’UCLAT. De ce point de vue, je pense que l’intégration du bureau du renseignement dans le fonctionnement de l’administration centrale est meilleure.
Quid de l’éventuelle intégration de l’administration pénitentiaire dans le second cercle du renseignement ? J’ai suivi tout le débat qui a commencé au début de l’année 2015. Pour ne rien vous cacher, je n’avais pas d’idée totalement arrêtée sur le sujet. J’y voyais des avantages incontestables, notamment celui d’une meilleure prise en considération d’un savoir-faire qui existe au sein de l’administration pénitentiaire en matière de renseignement. S’il y a en effet des gens qui savent observer ce qui se passe dans un établissement, ce sont bien les personnels pénitentiaires, qui ont ce don particulier, et le temps, surtout, d’observer des individus dangereux et d’obtenir des informations. J’y voyais donc des avantages mais aussi des risques, car, comparés aux services spécialisés du renseignement, nous sommes de petits artisans : nous ne disposons pas de l’infrastructure nécessaire pour superviser toutes les techniques de renseignement et appliquer les dispositions de la loi. Les débats ont donc suivi leur cours, y compris au sein de l’institution, où les positions sont assez partagées. On ne peut pas dire qu’il y ait unanimité sur la question entre les directeurs interrégionaux, au sein de l’encadrement supérieur de l’administration pénitentiaire ou même des organisations professionnelles.
Aujourd’hui, ma position a évolué. Je ne sais pas si nous devons faire partie du second cercle, mais il est certain que nous devons être beaucoup plus professionnels que nous l’avons jamais été, et il est absolument indispensable que nous disposions d’une capacité à faire ce que nous ne pouvons pas faire aujourd’hui. Ainsi, alors que nous sommes confrontés à l’introduction massive de téléphones portables dans les établissements pénitentiaires, nous n’avons pas le pouvoir d’exploiter cette mine d’informations. Certes, tous ces téléphones ne présentent pas le même intérêt, mais lorsqu’ils sont trouvés chez des détenus qui nous intéressent, nous ne pouvons que le faire savoir à nos collègues de la police judiciaire. Or, comme ils sont eux-mêmes débordés, on ne peut pas dire qu’ils en fassent un usage à la hauteur de ce que nous pensons possible. Il serait bon que nous puissions faire une première analyse de ce que contiennent ces téléphones portables – déterminer par exemple quelles personnes ils ont mis en contact – avant de passer la main. L’administration pénitentiaire ne revendique pas le statut d’un service de renseignement, au sens noble du terme – ce n’est pas son métier –, mais il y a là une mine d’informations et nous gérons des gens qui posent des problèmes de sécurité massifs. Nous pourrions recueillir un certain nombre d’éléments dont l’exploitation par les services spécialisés du renseignement serait utile. Or, en l’état du droit, nous n’avons pas la possibilité d’agir.
Cela nécessite-t-il une réforme du code de procédure pénale ou bien une intégration de l’administration pénitentiaire dans le second cercle ? Je ne saurais le dire, mais il est certain que les possibilités d’action de l’administration doivent être améliorées.
M. le président Georges Fenech. Si nous avons bien compris, une réflexion est en cours, sur une question qui nous a déjà occupés en commission des lois, à l’époque où celle-ci était présidée par M. Jean-Jacques Urvoas et où nous examinions le projet de loi sur le renseignement. Vous avez décidé de supprimer l’état-major de sécurité, et le bureau du renseignement pénitentiaire est aujourd’hui intégré au sein de la sous-direction des missions. Selon vous, cela fonctionne bien mais cela pourrait encore être amélioré, sans doute par une intégration de l’administration pénitentiaire dans le deuxième cercle du renseignement.
M. Sébastien Pietrasanta, rapporteur. Je suis l’auteur avec Philippe Goujon de l’amendement visant à permettre que le bureau du renseignement pénitentiaire intègre le deuxième cercle des services de renseignement. Comment envisagez-vous la possibilité d’utiliser des techniques de renseignement ? Nous avions bien senti une réticence de la garde des sceaux, Mme Taubira, dont je pense qu’elle était partagée par un certain nombre de responsables de l’administration pénitentiaire. Aujourd’hui, la discussion se poursuit au Sénat. Comment envisagez-vous concrètement votre réorganisation à la faveur de cette intégration au second cercle ?
Mme Isabelle Gorce. En l’état de ma réflexion, il me semble qu’il y a deux moyens d’envisager la question – en tout cas, je n’en ai pas trouvé d’autres. Soit la direction de l’administration pénitentiaire se dote d’un service ad hoc, une nouvelle sous-direction du renseignement, rattachée directement au directeur, avec tout un réseau qui se décline, soit nous conservons un système intégré. Les organisations sont faites pour évoluer, et il est tout à fait possible que l’organigramme soit modifié eu égard à l’évolution de la situation, mais c’est aujourd’hui un bon organigramme. Au-delà du renseignement, en effet, il y a tout le reste : l’activité de l’administration pénitentiaire consiste quand même, très majoritairement, à s’occuper des détenus et des personnes suivies en milieu ouvert. Or, en la matière, nous avons de vraies carences en termes de méthode.
Pour que le système reste cohérent, le bureau du renseignement doit rester intégré dans les missions de l’administration pénitentiaire et amarré au fonctionnement de celle-ci. Si le service se déconnectait progressivement de l’administration pénitentiaire, il y aurait un vrai risque. Quand bien même serait-il finalement décidé que l’administration pénitentiaire rejoint le second cercle, il faut absolument que son réseau du renseignement reste amarré à ses missions et à la prise en charge des personnes placées sous main de justice, qu’elles soient détenues ou pas. Aujourd’hui, nous comptons 67 000 détenus, et 175 000 personnes suivies en milieu ouvert. Une partie de la question, pas la plus simple ni la plus mince, concerne ainsi le milieu ouvert. Nous avons donc aussi besoin d’être très proches des services du milieu ouvert, au plus près du suivi des personnes en milieu ouvert – je pense notamment à tout ce qui concerne l’approche des publics. En milieu ouvert, les conseillers pénitentiaires d’insertion et de probation travaillent énormément en proximité avec les justiciables. Leur demander d’être vigilants, par exemple, sur les processus de radicalisation, cela ne se fait pas du jour au lendemain, et il faut absolument irriguer l’ensemble de l’institution pour que chacun comprenne les enjeux de cette observation et de la remontée d’informations vers les directions interrégionales.
Pour moi, le centre névralgique de l’administration pénitentiaire se situe principalement dans les directions interrégionales. C’est là que se capitalise l’essentiel des informations, et que s’y croisent ce qui vient du niveau national et ce qui remonte du niveau local et départemental, des SPIP. Quel que soit le choix final – maintien du renseignement à l’intérieur d’une sous-direction ou mise en place d’une entité directement rattachée au directeur de l’administration pénitentiaire –, c’est la structuration du réseau du renseignement pénitentiaire qui est aujourd’hui l’une des questions majeures.
L’essentiel de l’activité des collaborateurs de Mme Viton au sein du bureau du renseignement est de saisir des données qui viennent du terrain dans le logiciel CAR. Les capacités d’analyse du bureau sont aujourd’hui très faibles. J’exerce donc une réelle pression pour que le bureau devienne capable de faire des analyses sur ce qui se passe au cours des détentions, pour que nous sachions à quels processus nous sommes exposés. En Rhône-Alpes, particulièrement en Isère, la mafia albanaise est très importante. Qu’en fait-on ? Comment se comportent les gens en détention ? On sait que la mafia albanaise a des intérêts communs avec l’islam radical – trafic d’armes, trafic de stupéfiants, trafics d’êtres humains –, et beaucoup d’argent transite par l’Albanie. Il faut donc la surveiller étroitement notamment en détention. Or nous manquons aujourd’hui de capacités d’analyse sur ce qui se passe dans les détentions. Comment les réseaux se forment-ils ? Qui parle avec qui ? Comment les gens échangent-ils les uns avec les autres ? Ce sont ces analyses que j’attends du bureau du renseignement au niveau national, plus que du traitement, de la saisie et de la gestion au cas par cas. C’est au niveau des directions interrégionales et des établissements, bien sûr avec des remontées au niveau central, que l’essentiel de l’activité du renseignement de terrain doit se faire. C’est ce que nous avons commencé à développer grâce aux moyens obtenus, surtout dans le cadre du PLAT 1, au mois de janvier 2015.
M. le rapporteur. Pour résumer, vous avez rattaché le bureau du renseignement à la sous-direction des missions parce que, s’il avait de bonnes relations avec les autres services de renseignement, il ne répondait plus vraiment à vos sollicitations.
S’il devait intégrer le deuxième cercle, serait-ce pour vous un véritable service de renseignement à part entière ? Ou un lien très fort doit-il demeurer entre vous, directrice, et ce bureau ?
Mme Isabelle Gorce. Le bureau du renseignement était l’un des bureaux d’une sous-direction, l’état-major de sécurité, qui en comptait trois : le bureau de gestion de la détention, le bureau du renseignement et le bureau de la sécurité des établissements, lequel gérait, grosso modo, la sécurité passive, faisait des audits sur la sécurité des établissements et pilotait les équipes régionales d’intervention et de sécurité. Lorsque j’ai pris mes fonctions, j’ai constaté que ce bureau EMS3 du renseignement pénitentiaire fonctionnait en autarcie au sein de cette sous-direction, et ne rendait pas, à mon sens, le service attendu de lui en termes de gestion tant des établissements que des détenus posant des difficultés – les détenus particulièrement signalés, et les autres. Je vous confirme que je ne parvenais pas à obtenir de ce bureau un certain nombre d’analyses, voire d’informations sur des personnes détenues. Je le sentais très tourné vers les services spécialisés du renseignement mais plus suffisamment amarré à la direction de l’administration pénitentiaire.
La priorité, pour moi, était de travailler sur les métiers pénitentiaires. Cela étant, si la réorganisation a nécessairement affecté l’état-major de sécurité, je n’ai évidemment pas voulu supprimer le bureau du renseignement, qui est très important au sein de la direction de l’administration pénitentiaire – c’est si vrai que mon adjoint et moi le pilotons quasiment en permanence. Ainsi, avec Mme Viton, nous avons fait un voyage de trois jours au Maroc, la semaine dernière, consacré à la question du renseignement et de la radicalisation. Je m’intéresse donc personnellement à ce bureau : compte tenu de l’importance des enjeux, il faut avoir l’œil en permanence sur son fonctionnement. J’ai aussi changé l’équipe qui le dirigeait : Mme Viton a donc pris ses fonctions à la fin de l’année 2015 ainsi que son adjoint. J’ai demandé à cette nouvelle équipe de reprendre en main le bureau pour qu’il soit beaucoup plus amarré à l’administration pénitentiaire et qu’il se consacre davantage aux services qu’on lui demande.
Si nous intégrons le second cercle, je ne sais pas si ce bureau se densifiera, mais il devra en tout cas piloter des techniques que nous ne maîtrisons pas aujourd’hui et animer un réseau encore en phase de construction. C’est un très grand défi, que nous ne renoncerons évidemment pas à relever.
M. le rapporteur. Qu’est devenu le prédécesseur de Mme Viton à la tête du bureau du renseignement pénitentiaire ?
Mme Isabelle Gorce. Il a été nommé directeur de l’hôpital pénitentiaire de Fresnes.
M. Meyer Habib. Je souhaite tout d’abord revenir sur les téléphones portables. Dans le cadre d’une précédente commission d’enquête, nous avions appris que près de 22 000 « items » avaient été saisis en prison : téléphones, puces, etc. C’est considérable, voire invraisemblable. En outre, plus les détenus sont aisés, plus ils arrivent à faire entrer des téléphones – mais cela requiert évidemment des complicités au sein de l’administration pénitentiaire. Faut-il brouiller les communications ou, au contraire, faciliter cette introduction de téléphones pour permettre un meilleur suivi des détenus radicalisés ? Cela se fait dans d’autres pays. Faut-il, par ailleurs, regrouper les détenus radicalisés ou les séparer ? De l’extérieur, il me semble qu’il faut éviter toute dynamique de groupe.
En France, on ne classe pas les détenus selon leur religion. Or ce tabou favorise les rumeurs les plus farfelues. Peut-être le nombre de repas halal peut-il donner une indication, même si, heureusement, l’écrasante majorité de ceux qui mangent halal ne sont pas radicalisés. Notre hantise est qu’un détenu envoyé en prison pour des faits de délinquance en sorte radicalisé – songez à Mehdi Nemmouche.
M. Pierre Lellouche. Au cours de cette législature, j’ai participé à l’examen des sept lois antiterroristes, de la loi renseignement et de celle qui modifie le code de procédure pénale, et j’en passe. Lorsque je me suis rendu à la prison de Fresnes avec mon collègue Guillaume Larrivé il y a un an et demi, nous avons été stupéfaits d’apprendre du directeur de l’établissement que l’administration pénitentiaire n’avait pas le droit d’écouter les téléphones portables qui entrent en prison. Nous venions pourtant de voter une loi sur le renseignement qui permet d’écouter tous les Français ! Cherchez l’erreur. Faut-il donc un texte législatif supplémentaire, madame la directrice, alors même que la loi sur le renseignement permet d’écouter tout le monde ? Et, faute d’empêcher l’introduction de ces téléphones portables en prison, le Gouvernement a-t-il prévu de vous accompagner avec des moyens d’interception ? On sait qu’une grande partie des personnes radicalisées se sont radicalisées sur internet ou en prison.
Deuxième question, qu’en est-il de la gestion du retour des djihadistes ? Le directeur de la prison de Fresnes avait, à l’époque, commencé à séparer les nouveaux venus, arrivés du djihad, des détenus de droit commun en les installant dans une galerie à part, mais Mme Taubira était plutôt sceptique, comme vous le savez. Où en êtes-vous ? Les retours de Syrie et d’Irak seront plus nombreux à mesure que la pression s’accentuera sur Daech …
Troisièmement, il semblerait, d’après des syndicalistes de l’administration pénitentiaire, que des surveillants posent un certain nombre de problèmes de sûreté. Certains, recrutés dans des conditions baroques, seraient des repris de justice, tandis que d’autres témoigneraient une certaine compréhension au milieu intégriste à l’intérieur des établissements. Le confirmez-vous ?
Quatrième question, de combien d’agents disposez-vous pour exercer votre mission de renseignement avec 67 000 détenus et 175 000 personnes en milieu ouvert. Et de combien d’agents faudrait-il disposer ?
Enfin, où en sont ces fameux programmes de déradicalisation ? Y a-t-il un budget, une méthode ? Je me suis intéressé à la manière dont est abordée la question dans d’autres pays, y compris en Arabie saoudite, car il se trouve qu’il en existe là-bas… N’entrent en fait dans ces programmes que des débutants du djihad, pas des djihadistes confirmés. Quelle est votre doctrine sur ce point ?
M. le président Georges Fenech. J’ai moi-même reçu de certains syndicats pénitentiaires des informations selon lesquelles 300 surveillants de prison seraient eux-mêmes l’objet de fiches S, et il y aurait des tensions au sein du personnel pénitentiaire, dont une partie fréquenterait des mosquées salafistes. Est-ce exact ?
Mme Isabelle Gorce. Les téléphones portables, je l’ai déjà dit, sont incontestablement un fléau pour l’administration pénitentiaire, et le nombre de saisies ne diminue pas, il augmente.
M. Pierre Lellouche. Ça, c’est parce qu’on a supprimé la fouille !
Mme Isabelle Gorce. Oui et non.
Une modification de l’article 57 de la loi pénitentiaire de 2009 vient d’être adoptée par le Sénat sur la proposition du Gouvernement. Je ne conteste pas que l’application de cette disposition ait posé un problème d’autant que je suis la directrice qui a mis en œuvre l’article 57. Quand j’ai pris mes fonctions, la loi, pourtant adoptée par le Parlement, n’était pas appliquée. Cependant, s’il n’y a plus de fouilles systématiques à l’issue des parloirs, les détenus sont quand même fouillés à d’autres occasions.
M. le président Georges Fenech. Cet article avait été adopté par la précédente majorité, en conformité avec une directive européenne. On peut effectivement se demander s’il ne faudrait pas revenir sur cette disposition.
Mme Isabelle Gorce. Ayons cependant à l’esprit que le nombre de téléphones portables, clés USB et tout petits éléments matériels liés à l’usage d’un téléphone portable a augmenté dans les établissements pénitentiaires même lorsque l’article 57 n’était pas appliqué. Cette augmentation n’est donc pas particulièrement liée à la mise en œuvre de cette disposition. Je crois que les fouilles n’étaient pas si bien faites que cela. Un certain nombre d’objets entraient déjà dans les établissements pénitentiaires à une époque où, en théorie au moins, elles étaient systématiques à la sortie des parloirs.
Il y a trois types de moyens pour faire entrer des téléphones portables en prisons : les projections, et il y en a beaucoup ; les parloirs, sûrement ; le personnel ou des intervenants extérieurs, cela arrive. Régulièrement, des agents sont interpellés, placés en garde à vue, condamnés et révoqués.
M. le président Georges Fenech. « Régulièrement » ?
Mme Isabelle Gorce. Oui. J’ai révoqué près de quarante agents ces deux dernières années. La direction de l’administration pénitentiaire est intransigeante en cas d’implication du personnel dans les différents trafics.
M. le président Georges Fenech. Le chiffre que vous donnez est quand même considérable. Ces agents éprouvent-ils quelque sympathie à l’égard du mouvement salafiste ? Agissent-ils à des fins lucratives ?
Mme Isabelle Gorce. La religion des détenus n’est pas forcément en cause. C’est surtout un commerce, même s’il peut aussi y avoir des pressions sur les surveillants. Et ce commerce n’est pas propre à la France.
Comment lutter contre l’introduction des téléphones portables ? Il y a plusieurs manières de voir les choses.
Le plus simple est de développer les brouilleurs. Si on tue la demande, on tuera le trafic, qui engendre par ailleurs des tensions entre détenus ; des pressions s’exercent sur un certain nombre d’entre eux, souvent les plus vulnérables, puisque ce sont ceux qui ne sont pas fouillés. C’est à eux que l’on demande d’introduire, au moment des parloirs avec leurs familles, des téléphones portables pour les caïds. C’est un effet pervers. Le meilleur moyen de lutter contre l’introduction des portables, c’est donc le brouillage.
Pourquoi cela ne fonctionne-t-il pas aujourd’hui comme on veut ? Parce que les systèmes de brouillage installés dans les établissements pénitentiaires ne sont pas évolutifs. Ainsi, un certain nombre de brouilleurs ne peuvent brouiller que la 2G ou la 3G, mais pas la 4G. Dans de nouveaux établissements comme ceux que nous ouvrons actuellement, par exemple à Valence, la 4G est brouillée et aucun téléphone portable n’y circule. Mais lorsque la 5G arrivera sur le marché les brouilleurs ne seront plus adaptés. Il faut donc des équipements évolutifs.
M. le rapporteur. Combien y a-t-il de brouilleurs actuellement ?
Mme Isabelle Gorce. Plus de 400… Je vous transmettrai le chiffre exact, je ne l’ai pas en tête.
Deuxième sujet, les brouilleurs sur le marché n’ont pas été pensés pour les prisons, avec leurs coursives, leurs couloirs, leurs escaliers, leurs différents niveaux. Faut-il alors faire en sorte de brouiller massivement, au risque de brouiller dans les environs et sans doute de poser quelques problèmes de santé publique ? Nous brouillons certains quartiers de détention : les quartiers d’isolement, ou certaines ailes où se trouvent des détenus susceptibles de poser problème.
Nous recherchons donc des solutions techniques : premièrement, un système de brouillage évolutif ; deuxièmement, un système de brouillage adapté à l’architecture des prisons. J’ai beaucoup de contacts avec les Belges, qui me disent que tout marche bien chez eux, mais ils ont certainement fait comme nous : ils ont installé des systèmes de brouillage 4G. Cela fonctionne donc bien, mais je ne sais comment ils feront lorsque la 5G arrivera – je doute qu’ils soient plus performants que nous. Le problème du caractère évolutif des dispositifs demeure.
Surtout, se pose la question de l’adaptation à l’architecture. Nous avons travaillé avec des industriels pour tester un dispositif innovant. Sur la base de cette expérimentation, nous avons lancé un marché pour mettre en concurrence des industriels sur un dispositif adapté à notre besoin ; c’est ce qu’on appelle un dialogue compétitif. Neuf entreprises ont répondu. Elles pourront tester un système sur site, dans un établissement, et nous choisirons à l’automne celle avec qui nous passerons un marché pour développer un nouveau système de brouillage, adapté à nos besoins.
M. Pierre Lellouche. Et vous faut-il un nouveau texte législatif, madame la directrice ?
Mme Isabelle Gorce. Selon l’analyse de nos juristes, oui.
La loi nous permet d’écouter et d’enregistrer les communications téléphoniques passées légalement par les détenus dans les cabines installées dans les établissements pénitentiaires. En revanche, aucun texte ne nous permet de détecter les communications téléphoniques illicites, de les écouter ni de les enregistrer.
L’une des difficultés est que les détenus téléphonent à des personnes à l’extérieur. Nous écouterions donc non seulement les détenus mais aussi leurs interlocuteurs à l’extérieur.
M. Pierre Lellouche. Cela ne tient pas ! On peut écouter tous les Français !
Mme Isabelle Gorce. Un service de renseignement le peut. Les services spécialisés du renseignement peuvent ainsi écouter les détenus, et il peut arriver que les autorités judiciaires, ayant appris en écoutant des personnes à l’extérieur qu’un détenu avait un téléphone portable, nous demandent de surtout le lui laisser, mais c’est bien sur décision d’un juge que les conversations de ce détenu seront enregistrées par un système d’écoute téléphonique.
L’administration pénitentiaire n’a ni compétence propre ni attributions pour le faire. En revanche, si elle rejoint le second cercle, elle pourra faire comme les autres services spécialisés du renseignement.
M. le président Georges Fenech. Elle pourra alors utiliser toutes les techniques prévues par la loi sur le renseignement.
M. Pascal Popelin. Selon la loi sur le renseignement, ce sont le ministère de l’intérieur, via ses services, le ministère de la défense et le ministère du budget qui peuvent constituer un dossier.
M. le président Georges Fenech. Je rappelle que M. Popelin est membre de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR).
M. Pascal Popelin. Un certain nombre de services sont habilités à faire ce type de demande, mais rien n’empêche le bureau du renseignement pénitentiaire de solliciter la DGSI. Ensuite, le dossier arrive, et il est visé, dans le cas qui concerne la DGSI, par le directeur de cabinet du ministre de l’intérieur. La CNCTR rend un avis sur l’opportunité et c’est le Premier ministre, ou son représentant, qui décide d’autoriser l’écoute pour une période de quatre mois renouvelable autant qu’il est jugé nécessaire.
M. le président Georges Fenech. Entre les autorisations administratives et les interceptions judiciaires, en quoi un nouveau dispositif législatif vous est-il nécessaire ?
M. Pierre Lellouche. L’administration pénitentiaire ne peut pas écouter.
M. Pascal Popelin. Même en l’état actuel des choses, rien n’empêche l’administration pénitentiaire de solliciter les services habilités – je pense en particulier, compte tenu des sujets qui nous occupent, à la DGSI – pour qu’une écoute soit diligentée.
M. le président Georges Fenech. Êtes-vous d’accord avec cela ?
Mme Isabelle Gorce. C’est exactement ce qui se passe. L’administration pénitentiaire ne peut pas elle-même, toute seule, écouter quelqu’un. Elle peut faire appel à d’autres services pour le faire.
M. Pierre Lellouche. C’est cela qu’il faut changer !
M. Pascal Popelin. Actuellement, seuls trois ministères peuvent solliciter l’usage de techniques de renseignement. Lors de l’examen du projet de loi renforçant la lutte contre le crime organisé et le terrorisme, l’Assemblée nationale a prévu d’y ajouter le ministère de la justice, et le Sénat a confirmé cette possibilité. Il faudra ensuite que le garde des sceaux sollicite lui-même l’intégration du bureau du renseignement pénitentiaire dans la communauté du renseignement au titre du deuxième cercle. Aujourd’hui, le recours à ces techniques est quand même possible, moyennant une étape supplémentaire.
M. le président Georges Fenech. Nous allions aborder la question du regroupement des détenus radicalisés.
Mme Isabelle Gorce. Islamistes radicaux ou pas, les détenus dangereux sont en règle générale gérés sur le mode de la dispersion par toutes les administrations pénitentiaires du monde, à quelques exceptions près. Et, parfois, elles les font tourner entre établissements.
Après l’initiative prise par le directeur de l’établissement de Fresnes, nous avons décidé de créer des unités dédiées pour gérer les islamistes radicaux, pour plusieurs raisons.
Tout d’abord, nous avons constaté qu’un certain nombre posaient de vrais problèmes en détention, se livrant au prosélytisme auprès d’autres détenus, avec parfois de grandes capacités à rassembler autour de leur personne. Il fallait donc intervenir pour éviter que trop de détenus se fassent prendre dans les mailles du filet. D’autant que ces prosélytes sont souvent des caïds ; ils ne s’intéressent pas qu’à l’âme de leurs codétenus : ils les pourvoient aussi en biens matériels. Il s’agissait donc, en premier lieu, d’éviter le prosélytisme.
Ensuite, si un grand nombre de ces personnes qui reviennent de Turquie ou de Syrie ont été placées sous mandat de dépôt, en fait, nous ne savons rien d’elles : d’où viennent-elles ? qui sont-elles ? Pourquoi sont-elles parties ? Ce qu’elles nous racontent n’est pas forcément la vérité. Nous avons donc décidé de consacrer les unités dédiées, celle de Fresnes, du fait de la proximité du Centre national d’évaluation (CNE), puis celle de Fleury-Mérogis parce que nous avions besoin d’étendre notre dispositif, à l’évaluation de ces détenus qui reviennent essentiellement de Turquie ou même qui sont arrêtés dans le cadre d’opérations de police contre des associations de malfaiteurs. L’idée est de faire un bilan pour savoir pourquoi ils en sont arrivés là. Nous savons qu’un certain nombre s’est converti, que d’autres n’avaient pas particulièrement eu de liens avec la délinquance, ou alors seulement avec la petite et moyenne délinquance, sans avoir fait parler d’eux au titre de l’islam radical. Ce bilan est nécessaire pour savoir comment les gérer, c’est-à-dire comment mettre en place un programme de prise en charge. J’ai estimé qu’il fallait essayer de faire quelque chose avec eux à partir du moment où nous les avions sous la main.
Nous pouvons les gérer à l’isolement ou les disperser dans les établissements de la région parisienne, mais, pour mettre en place un programme spécifique de prise en charge, alors que le taux d’encombrement des établissements de la région de la région parisienne atteint des niveaux inédits, il fallait s’organiser et les regrouper.
Nous avons donc commencé à les regrouper par petits groupes à la maison d’arrêt du Val-d’Oise, à Osny. Pendant un an, nous y avons testé, avec l’Association française des victimes de terrorisme, un programme de prise en charge pour des groupes d’une quinzaine de détenus. Certains appellent cela un programme de « déradicalisation » : nous n’avons pas cette prétention, nous ne cherchons pas nécessairement à intervenir sur la question religieuse, nous nous intéressons plutôt au comportement. Notre problème n’est pas tant qu’ils se soient convertis que de déterminer s’ils sont dangereux et risquent de passer à l’acte.
Au bout d’un an, le résultat s’est révélé suffisamment intéressant pour que nous décidions de développer ce type de programme. Nous avons donc créé une unité dédiée à Osny, et une autre à Fleury-Mérogis, où nous travaillons avec un autre partenaire, la Fondation pour la recherche stratégique, pour tester une autre approche.
À Osny, douze détenus, qui viennent essentiellement de Fresnes et de Fleury-Mérogis, ont été intégrés au programme. Regroupés pour une durée de six mois, ils sont pris en charge du matin jusqu’au soir. Ils sont seuls en cellule, et suivent un programme qui leur est imposé – cela fait partie du contrat qui leur a permis de quitter des établissements surencombrés pour venir à Osny. Évidemment, c’est expérimental. Nous essayons de tester une approche individuelle et collective pour les amener à une remise en question de leur engagement et de leur comportement, et nous avons obtenu quelques changements d’attitude ou de discours qui nous laissent présager que la démarche est intéressante et qu’il faut continuer.
Ce ne sont évidemment pas les détenus complètement enfermés dans leur islam radical qui vont dans ces unités dédiées de déradicalisation – ceux-là ne veulent pas communiquer avec nous. Il faut des détenus capables de faire preuve d’auto-critique. C’est pourquoi un bilan initial, à Fresnes ou à Fleury-Mérogis, est nécessaire.
S’agissant des plus radicalisés, soit nous les gérons à l’isolement, en région parisienne, soit nous essayons de les transférer au centre pénitentiaire de Lille-Annœullin, où nous avons créé une autre unité dédiée, destinée, celle-ci, à des détenus beaucoup plus ancrés dans l’islam radical. Dans leur cas, une approche plus individuelle nous paraît nécessaire. En outre, nous travaillons beaucoup plus avec des imams, car il faut entrer dans le vif de l’approche religieuse des choses.
Nous essayons, nous testons. J’ai toujours dit qu’il fallait en tout état de cause nous organiser pour prendre en charge ce problème. Tant mieux, si nous obtenons quelque résultat ; si cela ne marche pas, nous en tirerons les conclusions et nous ferons autrement. En tout cas, l’approche est extrêmement intéressante, et certains détenus « se réveillent », presque au sens propre du terme, à une analyse critique et deviennent capables de remettre en cause les engagements pour lesquels ils sont incarcérés.
En ce qui concerne les surveillants, je sais ce que disent les organisations professionnelles, mais tout cela n’est pas crédible. Non, il n’y a pas 300 surveillants qui font l’objet de fiches S. Il n’y a pas un nombre important de surveillants suivis au titre de l’islam radical par les services de renseignement. Quelques cas isolés posent toutefois problème, et nous sommes en train de nous organiser au niveau de l’administration centrale pour créer une cellule de veille sur ces remontées d’informations. Nous allons nous rapprocher de l’UCLAT pour échanger des informations sur ces surveillants et nous assurer qu’ils ne présentent pas de risques. Le sujet est extrêmement délicat et exige beaucoup de sang-froid.
Vous m’avez interrogée sur les moyens. Nous avons créé plus de cinquante emplois en 2015 pour renforcer le renseignement pénitentiaire. Il faut encore en créer une centaine. Nous avons renforcé le bureau du renseignement pénitentiaire, mais nous connaissons actuellement un petit creux de vague, parce qu’un certain nombre d’agents sont partis à la faveur de notre déménagement de la rue du Renard, dans le Marais, à la porte d’Aubervilliers. Nous sommes donc en phase de recrutement.
Dans les directions interrégionales des services pénitentiaires, quatorze agents étaient positionnés sur le renseignement pénitentiaire, nous en avons trente-quatre aujourd’hui. Nous avons créé onze emplois d’analystes-veilleurs, douze emplois d’investigateur numériques, trois emplois de traducteurs – nous en avons encore sept à recruter. Nous avons des délégués du renseignement pénitentiaire dans tous les établissements. Notre objectif est d’atteindre quarante-quatre emplois d’officiers à temps plein en 2016 ; nous sommes en train de les recruter. Des commissions administratives paritaires se sont tenues la semaine dernière. Nous n’avons pas fait le plein, mais nous aurons dorénavant des officiers spécialisés sur ces questions à temps plein. Nous avons également demandé aux 103 SPIP d’identifier un référent du renseignement pénitentiaire – c’est quasiment chose faite. Celui-ci fait le lien entre leurs collègues qui ont des informations à donner, les services de renseignement et les directions interrégionales ; ces référents participent avec leur chef de service à l’état-major de sécurité des préfectures.
La phase de déploiement de moyens n’est pas terminée. En outre, nous devons parallèlement former les agents, les professionnaliser. Il faut tout simplement qu’ils sachent ce qu’ils doivent observer. Qu’est-ce qu’un islamiste radical ? Quels changements de comportement doivent être repérés ? Quelles informations faut-il absolument faire remonter, au niveau régional et au niveau national ? C’est tout un réseau qui est en cours de constitution. Nous sommes passés du petit artisanat à la PME.
M. Pierre Lellouche. Si la mission d’un agent est de renseigner sur d’éventuels dommages à l’établissement ou sur ce qui se passe à l’intérieur de la prison, il ne s’agit pas là du travail de renseignement dont le pays a besoin : il faudrait plutôt repérer d’éventuelles connexions entre ces gens et des groupes djihadistes à l’extérieur des prisons. Il est bon d’avoir un service de renseignement… encore faut-il savoir quelle est sa mission ! S’agit-il de rester dans le cadre pénitentiaire ou bien de contribuer au renseignement général et à la lutte contre le terrorisme ? La question n’est pas sans implications sur la formation de vos agents.
Mme Isabelle Gorce. Les services de renseignement ne s’occupent pas seulement de djihadisme et d’islam radical mais aussi du grand banditisme, de criminalité organisée, de terrorisme basque lié à l’ETA – cela concerne encore une centaine de détenus de nos établissements. En outre, il n’y a pas d’islamistes radicaux dans tous les établissements pénitentiaires français.
Il y a donc un travail de renseignement, de suivi et de recueil d’informations au sein de l’établissement : qui sont les détenus ? Que font-ils ? Avec qui sont-ils dans les cours ? Avec qui parlent-ils ? Changent-ils de comportement ? Ces informations sont ensuite transmises et partagées avec les services spécialisés du renseignement. Elles irriguent également la chaîne de l’administration pénitentiaire. Si nous pensons qu’un détenu présente des risques ou pose des problèmes dans un établissement pénitentiaire, notre premier devoir est de le changer d’établissement, pour assurer la sécurité de l’établissement et des codétenus. Ainsi, les prosélytes islamistes de la prison de Béziers dont le cas a été évoqué la semaine dernière par BFM ont été transférés dans un autre établissement ou placés à l’isolement. Si un certain nombre d’informations recueillies par l’officier de renseignement laissent penser que tel détenu est dans une situation de vulnérabilité vis-à-vis d’autres, qu’il est en train de devenir le caïd du lieu ou qu’il commence à faire du prosélytisme, il faut d’abord gérer cette personne au niveau de l’administration pénitentiaire – c’est ce qu’on appelle la gestion de la détention. Ensuite, les services spécialisés du renseignement seront saisis puisque les officiers de renseignement les voient toutes les semaines et partagent avec eux les informations nominatives sur les détenus suivis. Par ailleurs, ces échanges sont aussi l’occasion, pour l’administration pénitentiaire, de recevoir des informations de l’extérieur : les services spécialisés de renseignement nous signalent les détenus suivis par eux, et nous demandent de les informer de ce qui se passe à l’intérieur des détentions avec ces détenus-là. Il s’agit donc de gérer le collectif des détenus et d’assurer la sécurité à l’intérieur des établissements tout en contribuant à la sécurité publique.
M. le président Georges Fenech. Pouvez-vous préciser cela, madame Viton ?
Mme Fabienne Viton, cheffe du bureau du renseignement de la direction de l’administration pénitentiaire. Je confirme ce que vient de dire Mme Gorce. Il y a, depuis plusieurs années, des échanges permanents entre le bureau du renseignement pénitentiaire et les services centraux de renseignement ou de police. Ils ont lieu aujourd’hui au niveau le plus local, donc finalement au plus près du phénomène, au niveau où on en a la connaissance la plus fine. Nous sommes nettement passés à une vitesse supérieure ces derniers temps.
M. Alain Marsaud. Je ne porte pas de jugement sur la décision de dissoudre l’état-major de sécurité en pleine période de crise ; elle vous appartenait – ou elle appartenait à la garde des sceaux de l’époque.
D’après les échos que nous en avons des différents services spécialisés, ce qui manquerait au sein du bureau pénitentiaire, ce sont des analystes, des personnes vraiment en mesure de traiter l’information « brute ». Or, en matière de djihadisme, vous êtes l’une des administrations qui a le plus d’informations, que ce soit sur ce qui se passe en milieu fermé ou en milieu ouvert. Ne vous serait-il pas possible d’« emprunter » ces analystes – par voie de détachement, par exemple – aux services spécialisés ? J’ai cru comprendre qu’ils étaient assez favorables à l’idée de travailler davantage avec vous.
Ma deuxième question concerne les détenus condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité en matière de terrorisme dont l’un, Georges Ibrahim Abdallah, fut de mes « clients » – il doit en être à sa trente-troisième ou trente-quatrième année à Lannemezan, où il reçoit régulièrement la visite de parlementaires qui le soutiennent. Ont-ils un statut spécial ?
Mme Isabelle Gorce. Je le répète, le bureau du renseignement n’était pas une sous-direction. C’est l’état-major de sécurité qui était une sous-direction, composée de trois bureaux : celui de la gestion de la détention, qui existe toujours ; celui du renseignement, qui, lui aussi existe toujours ; et celui de la sécurité, réintégré dans la sous-direction des métiers. Les compétences de l’état-major de sécurité n’ont donc pas disparu de la direction de l’administration pénitentiaire, je pense même qu’elles se sont plutôt développées.
En ce qui concerne les compétences propres du bureau du renseignement, oui, nous avons besoin de passer à la vitesse supérieure et de nous charpenter sur notre capacité à analyser ce qui se passe à l’intérieur de nos établissements et à corréler ce qui se passe à l’intérieur avec ce qui se passe à l’extérieur. Nous avons besoin d’aider nos services à mieux comprendre les phénomènes qui se déroulent au sein des établissements pénitentiaires. Comme je l’ai dit tout à l’heure, l’essentiel des effectifs actuels du bureau du renseignement est composé d’agents qui font de la saisie sur le logiciel CAR, qui n’existe actuellement qu’au niveau central. C’est une petite machine un peu artisanale que nous souhaitons complètement restructurer pour pouvoir la décliner au niveau régional ; quand les saisies seront faites à ce niveau, le bureau de l’administration centrale pourra se consacrer à autre chose. Pour passer à la vitesse supérieure, nous avons besoin de moyens : un système d’information complètement redéfini, des compétences différentes de celles que nous avons aujourd’hui et, effectivement, des analystes. Je ne désespère pas de pouvoir recruter – pourquoi pas par voie de détachement – des personnels qui viendraient, notamment, du ministère de l’intérieur.
Quant à nos « terroristes historiques », condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité, ils sont presque tous répartis entre les différentes maisons centrales. Souhaitant savoir comment ils étaient gérés par ces établissements, notamment en termes de dispersions et regroupements, j’ai demandé à l’inspection des services pénitentiaires de procéder à un audit. L’inspection a fait le tour de toutes les maisons centrales dans lesquelles sont incarcérés ces détenus. Il en ressort – c’est assez positif – que les établissements savent gérer ces détenus, dont une grande partie sont totalement restés enfermés dans leur islam radical, et n’ont pas évolué depuis des dizaines d’années. On peut dire, aussi, qu’on ne s’est pas vraiment occupé d’eux non plus… Une partie d’entre eux travaille et continue de pratiquer son culte en détention. Leur engagement, leur comportement n’ont pas vraiment changé, mais ils sont sous contrôle – étroit.
M. Olivier Falorni. L’administration pénitentiaire a fermé les yeux : elle a été aveugle pour acheter la paix à l’intérieur des prisons. J’ai fait valoir mes droits de parlementaire pour aller visiter la maison centrale située dans ma circonscription, celle de Saint-Martin-de-Ré. J’y ai découvert des préfabriqués, appelés « casinos ». L’un a été pris en main par les Basques, un autre par les Haïtiens, et un troisième, dont les fenêtres ont été calfeutrées, est en fait une mosquée clandestine salafiste, où les personnels ont beaucoup de mal à entrer. Quand j’y suis allé, une affichette en arabe au-dessus de la porte prônait le djihad. Et cela dure depuis des années !
Aussitôt après cette visite, lors des questions d’actualité au Gouvernement, j’ai demandé à la ministre de la justice de détruire ces casinos – appelés ainsi parce que c’étaient à l’origine des salles où on jouait aux cartes. L’aumônier musulman m’a dit qu’il ne rencontrait plus de détenus à Saint-Martin-de-Ré : visiblement, l’islam républicain qu’il professe n’y a plus d’audience, ou alors la pression est forte sur les détenus qui seraient susceptibles d’aller voir cet homme, considéré comme un « collaborateur » et un espion de l’État français. Mme Taubira m’a répondu qu’il serait procédé à la destruction de ces casinos, mais j’attends toujours confirmation que celle-ci a bien eu lieu. Cette situation est parfaitement scandaleuse.
Mme Isabelle Gorce. Les « casinos » de Saint-Martin-de-Ré existent depuis des années, et ont toujours été des lieux de regroupement des détenus, qui s’y retrouvent par affinités. Très sincèrement, je ne peux pas vous préciser aujourd’hui si les casinos ont été détruits ou pas, mais je peux vous dire que cette destruction a été programmée et budgétée. En tout cas, il n’est pas dans mes intentions de maintenir des situations de cette nature.
Si une mosquée clandestine s’est installée dans le casino, c’est qu’on a laissé faire. Il y a là un travail de reprise en main de l’établissement, ce n’est pas qu’une question de bulldozer – je le dis aussi pour l’ensemble du personnel de cette centrale.
M. Olivier Falorni. On abandonne les maisons centrales ?
Mme Isabelle Gorce. Non, mais il faut que le personnel soit aussi là. Un certain repli du personnel de surveillance peut avoir pour effet des comportements qui ne sont pas admissibles de la part des détenus, des regroupements qui ne sont plus sous contrôle. Nous devons reprendre le contrôle partout.
M. Pierre Lellouche. Mais les directeurs des maisons centrales dépendent de votre direction, madame !
M. le rapporteur. Je ne comprends pas. Si la situation est connue de vos services, pourquoi ne pas fermer tout simplement ce « casino » ? Pourquoi des agents n’entrent-ils pas pour arracher les affiches ? Sans doute un certain nombre d’agents trouvent-ils plus confortables d’éviter d’aller au contact pour préserver la « paix sociale » dans l’établissement, mais cette situation est problématique – et sans doute pas unique en France. Il faut réaffirmer l’autorité de l’administration pénitentiaire.
Mme Isabelle Gorce. Je partage entièrement votre point de vue. Simplement, dans ces casinos très anciens, il y avait aussi une bibliothèque et une laverie.
M. Olivier Falorni. Il n’y a plus de bibliothèque ni de laverie ! On n’y trouve que des affichettes salafistes.
M. Meyer Habib. Y a-t-il d’autres cas similaires ?
Mme Isabelle Gorce. Je viens de vous dire que j’ai fait faire une inspection de l’ensemble des maisons centrales. Je n’ai pas de retour de cette nature.
M. le président Georges Fenech. C’est donc très spécifique à Saint-Martin-de-Ré. Nous allons nous intéresser à ce problème.
Mme Françoise Dumas. Avez-vous le sentiment que la radicalisation concerne plutôt certains territoires, certaines populations ? Ma région – le Sud-Est – est très fortement concernée par le radicalisme. Y a-t-il des zones plus préservées ? Sentez-vous une évolution inquiétante ? Je voudrais aussi savoir combien de mineurs incarcérés sont concernés et quelle est la proportion de femmes ou de filles ?
Des mesures de prévention peuvent-elles être prises ? Qu’en est-il du rôle des aumôniers religieux ? Vous sont-ils utiles, ou vous mettent-ils des bâtons dans les roues ?
Mme Isabelle Gorce. Nous avons cinq mineurs écroués pour terrorisme, une dizaine de femmes, et une seule jeune fille mineure.
Nous avons commencé à cartographier les signalements faits au niveau des établissements sur la question de l’islam radical. Se dessine un axe Paris-Lyon-Marseille, qui n’est pas tellement étonnant, auquel s’ajoute le Languedoc-Roussillon, ce qui n’est pas totalement étonnant non plus. Cela recoupe ce qui est dit également par les services de renseignement. Évidemment, il est intéressant de voir comment cela évolue, notamment pour les services de milieu ouvert, qui sont vraiment au contact du tout-venant des personnes placées sous main de justice.
Le nombre de mineurs écroués est à peu près stable : 700 à 800 en permanence. Ils sont difficiles. Écroués dans des quartiers de mineurs ou des établissements pour mineurs, ils peuvent assez facilement être dans la provocation. Une action spécifique est donc nécessaire, assez différente de celle menée avec les majeurs. Nous travaillons beaucoup avec l’éducation nationale sur l’éducation à la citoyenneté, la laïcité, les valeurs républicaines, en mobilisant des partenaires extérieurs, culturels ou autres. On ne peut pas dire qu’il y ait un mouvement massif de radicalisation chez les mineurs. Ils sont plus ambivalents dans leur comportement.
Vous m’interrogiez sur le nombre de musulmans dans les établissements pénitentiaires : on comptabilise le nombre de personnes qui déclarent faire le ramadan – et non le nombre de personnes qui mangent halal. Sur 67 000 détenus, 18 000 ont déclaré le faire, l’année dernière. On ne sait pas si tous sont musulmans. Compte tenu de la surpopulation carcérale, des détenus qui ne sont pas musulmans peuvent en effet faire le ramadan parce qu’ils sont détenus avec d’autres, qui le font. Du fait d’un phénomène de conformation sociale en prison, on suit parfois la majorité du groupe. Dans un établissement pour mineurs, la proportion de détenus faisant le ramadan peut atteindre 80 %. Dans celui de Porcheville, à l’ouest de Paris, la quasi-totalité des mineurs a déclaré faire le ramadan l’année dernière. Cela ne veut pas dire qu’ils le feront pendant toute la période, mais il y a bien un phénomène de groupe et de conformation sociale. C’est un risque auquel il faut être particulièrement attentif.
Les aumôniers sont des partenaires très importants dans la lutte contre la radicalisation. Nous avons créé 39 emplois d’aumôniers en 2015, sur un volume de 60 prévus dans le cadre du premier plan de lutte antiterroriste du mois de janvier 2015. Et nous avons évidemment des contacts réguliers et étroits avec l’aumônier national des prisons. L’aumônerie musulmane est complexe ; les courants, les obédiences, les luttes d’influence n’y sont pas neutres. Il peut arriver ainsi que les détenus refusent de voir un aumônier non parce qu’ils se sont radicalisés mais parce qu’ils sont majoritairement algériens et que l’aumônier est marocain.
M. Pierre Lellouche. Il manque donc une vingtaine d’aumôniers.
Mme Isabelle Gorce. Nous ne les recrutons pas nous-mêmes. C’est l’aumônier national qui, avec les aumôniers régionaux, recherche les personnes qui acceptent d’exercer les fonctions d’aumônier. Il s’agit d’une activité à temps partiel assez mal payée, et le recrutement n’est pas facile car, pour les aumôniers musulmans, c’est quasiment une activité professionnelle alors que les aumôniers catholiques et protestants sont très majoritairement bénévoles. Nous avons obtenu une revalorisation des indemnités dans le cadre du PLAT 2. Elle devrait intervenir dans les semaines à venir – il faut modifier un arrêté pour augmenter le montant versé.
M. Meyer Habib. Vos aumôniers sont-ils au-dessus de tout soupçon ?
Mme Isabelle Gorce. Il est procédé à enquête préfectorale avant tout agrément.
M. Serge Grouard. Quelle est la proportion de musulmans dans la population carcérale ? Je suis certain que l’on peut avoir des indications relativement précises.
Par ailleurs, vous avez dit, madame la directrice, que le rapport d’inspection que vous aviez demandé ne mentionnait pas d’autre cas que celui évoqué par notre collègue Olivier Falorni, mais ce cas lui-même figurait-il dans le rapport rendu ?
Mme Isabelle Gorce. Le rapport ne mentionne pas la persistance d’un phénomène tel que constaté par M. Falorni.
M. Serge Grouard. Cela laisse augurer qu’il y en a d’autres.
M. le président Georges Fenech. Pourriez-vous nous tenir informés sur ce point, madame la directrice ? Et pouvez-vous nous donner des précisions sur le nombre de musulmans ?
Mme Isabelle Gorce. Nous ne tenons pas le compte du nombre de détenus musulmans.
M. le président Georges Fenech. Le sociologue Khosrokhavar, dans le cadre des travaux de la commission d’enquête sur la surveillance des filières et des individus djihadistes, dont Éric Ciotti était le président et Patrick Mennucci le rapporteur, s’était livré à une estimation, de même que notre collègue Guillaume Larrivé dans un précédent rapport, mais la loi interdit ce genre de chiffrage.
M. Pierre Lellouche. Si la loi interdit de dire la vérité, alors il faut la changer !
M. le président Georges Fenech. Ils estimaient à environ 60 % la proportion de détenus de confession musulmane.
Mme Isabelle Gorce. Je ne tiens évidemment pas ce genre de statistiques. Encore une fois, nous ne connaissons que le nombre de détenus qui font le ramadan. Et celui-ci est proportionnellement beaucoup plus important en région parisienne qu’au plan national, où il représente 25 % à 30 % de la population carcérale totale – je pense que M. Khosrokhavar évoquait plutôt la région parisienne.
Gardons en outre à l’esprit qu’un établissement pénitentiaire est aussi un lieu où s’exercent des pressions. Il y a une forme de conformation sociale, qui est très importante. Des détenus qui ne sont pas a priori particulièrement pratiquants seront, en prison, soumis à la loi du groupe, mais il en allait déjà ainsi hier et cela n’en faisait pas des terroristes !
M. Pierre Lellouche. Certes, vous ne tenez pas ce genre de statistiques, mais si vous en aviez la possibilité, vous serait-il utile de savoir qui est qui dans un établissement pénitentiaire ?
M. le rapporteur. Avez-vous des chiffres précis sur le nombre de détenus incarcérés pour terrorisme lié à l’islam radical ? Qu’en est-il des détenus de droit commun dont vos services remarquent qu’ils sont liés à l’islam radical ? Au sein du bureau du renseignement pénitentiaire, ces personnes font-elles l’objet d’un suivi individuel ? Le cas échéant, sous quelles modalités ? Existe-t-il un fichier au niveau central ? Le cas échéant, comment, est-il utilisé par les services de renseignement autres que l’UCLAT ?
Mme Isabelle Gorce. Nos chiffres reposent sur des déclarations. Nous avons fait une recherche sur la demande cultuelle auprès de l’ensemble des établissements pénitentiaires mais elle est très variable. Il est extrêmement difficile de déterminer établissement par établissement dans quelle mesure la présence d’un aumônier musulman est nécessaire.
M. le rapporteur. Le niveau de certains aumôniers musulmans laisse à désirer.
Il semblerait que nous ayons un problème de formation et de contenu. On m’a ainsi raconté qu’un aumônier musulman avait involontairement fait passer des textes salafistes à des détenus sans même le savoir ! Il a été évidemment écarté.
En fait, les aumôniers musulmans peuvent être utiles pour éviter une certaine contagion du « ventre mou », mais ne sont guère écoutés des plus radicalisés.
Mme Isabelle Gorce. Incontestablement, nombre d’aumôniers musulmans n’ont pas le niveau suffisant pour tenir tête à des islamistes radicaux, ou pour avoir le bon discours face à des jeunes de banlieue qui n’ont pour connaissance de l’islam qu’une espèce de prêt-à-penser truffé d’erreurs trouvé sur internet. Il faut une forte personnalité pour affronter cette rhétorique islamiste. Construire du contre-discours n’est pas à la portée de tout le monde. Beaucoup de nos imams n’en sont pas capables ; ils le reconnaissent et sont d’ailleurs demandeurs de formation, de soutien technique.
M. le président Georges Fenech. Vous allez bientôt avoir la charge de la détention de Salah Abdeslam. Nous espérons que, contrairement à l’ex-instituteur de Villefontaine, il ne sera pas en mesure de mettre fin à ces jours. Cela provoquerait un séisme, car les victimes attendent un procès et, pour l’instant, il est le seul survivant des auteurs des attentats de Paris. Le garde des sceaux a indiqué que ce détenu serait particulièrement surveillé. Pouvez-vous nous en dire un mot ?
Mme Isabelle Gorce. Nous préparons effectivement l’arrivée en France de Salah Abdeslam, dans un grand établissement de la région parisienne. Il y sera placé à l’isolement, dans des conditions de sécurité maximales, comme tous les détenus de ce type.
M. Meyer Habib. Quelles chaînes de télévision les détenus reçoivent-ils ?
Mme Isabelle Gorce. Il s’agit d’un bouquet, dont je ne saurais vous préciser le détail.
M. le président Georges Fenech. Mme Viton, pouvez-vous nous donner quelques chiffres et répondre aux questions du rapporteur ?
Mme Fabienne Viton. Il n’existe pas aujourd’hui de fichier des radicalisés dans les établissements pénitentiaires. Les services de police tiennent un certain nombre de fichiers. Si nos détenus y figurent, nous en sommes informés, mais nous n’établissons pas de fiches « AP », à la manière des fiches « S », pour les détenus qui seraient radicalisés.
Ce qui compte avant tout, pour le renseignement pénitentiaire, c’est de pouvoir observer et de capitaliser un certain nombre d’informations : qui sont-ils ? Qui fréquentent-ils ? Que veulent-ils faire demain ? Ces observations sont fondamentales. Une fois capitalisées et exploitées, elles peuvent nous permettre de repérer des phénomènes – c’est le côté « analyse » du processus de renseignement. C’est tout le sens de l’exploitation des données qui, grâce à notre savoir-faire en matière de renseignement, sont collectées tous les jours dans les établissements pénitentiaires.
M. Christophe Cavard. D’après nos informations, il peut arriver que les services de police ne soient pas informés de l’incarcération, pour un motif de droit commun, d’une personne radicalisée qu’ils suivaient. Est-ce toujours le cas ?
Mme Fabienne Viton. J’aimerais pouvoir affirmer que cela n’arrive plus. En tout cas, il y a eu des progrès. Un certain nombre d’événements, notamment l’année dernière, ont obligé tout le monde à progresser dans les deux ministères.
Quant aux chiffres, le 1er avril dernier, 256 terroristes issues des mouvances islamistes radicales étaient écroués dans nos établissements pénitentiaires, parmi lesquels 186 prévenus et 70 condamnés.
Mme Isabelle Gorce. Selon les informations remontées par les directions interrégionales et les établissements, entre 800 et 1 000 détenus seraient de près ou de loin concernés par l’islam radical. Soyons cependant très prudents : la détection de ces cas n’est pas scientifique.
M. le président Georges Fenech. Mesdames, je vous remercie de votre contribution aux travaux de la commission d’enquête.
Audition, à huis clos, de M. Marc Trévidic, premier vice-président du TGI de Lille
Compte rendu de l’audition, à huis clos, du Mercredi 6 avril 2016
M. le président Georges Fenech. Nous vous remercions d’avoir répondu à la demande d’audition de notre commission d’enquête ; vous avez occupé de nombreuses années les fonctions de juge d’instruction au pôle antiterroriste et votre expérience nous est précieuse. Nous nous intéressons au rôle spécifique de ce pôle ainsi qu’à la pertinence des dispositions législatives qui s’appliquent ou à celles susceptibles d’être prises, et je sais que vous avez pris très récemment position contre certaines dispositions du projet de loi en cours de discussion au motif qu’elles affaibliraient l’institution du juge d’instruction.
Vous aviez été entendu, le 12 février 2015, par la commission d’enquête sur la surveillance des filières et des individus djihadistes. Ensuite se sont produits les événements gravissimes de novembre 2015. Or, vous aviez déclaré publiquement, en particulier dans une interview publiée le 30 septembre 2015 par le magazine Paris Match, que nous n’étions pas en mesure de prévenir un attentat de cette sorte. Quelles raisons expliquent votre constat ? Y a-t-il toujours des lacunes dans l’arsenal législatif, bien que nous ayons légiféré plusieurs fois sur ces questions – en tenant compte de vos suggestions, par exemple par la création du délit d’« entreprise individuelle de terrorisme », idée que vous aviez défendue ? Pour prévenir les attentats, faut-il optimiser encore la coordination entre les forces de l’ordre et les services de renseignement ?
Cette audition, qui se déroule à huis clos, n’est pas diffusée sur le site internet de l'Assemblée. Néanmoins, conformément à l’article 6 de l’ordonnance 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, son compte rendu pourra être publié, en tout ou partie, si nous en décidons ainsi à l’issue de nos travaux. Les comptes rendus des auditions qui auront lieu à huis clos seront au préalable transmis aux personnes entendues afin de recueillir leurs observations qui seront soumises à la commission, qui pourra décider d’en faire état dans son rapport. Conformément aux dispositions du même article, « sera punie des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal – un an d'emprisonnement et 15 000 euros d’amende – toute personne qui, dans un délai de vingt-cinq ans, divulguera ou publiera une information relative aux travaux non publics d’une commission d’enquête, sauf si le rapport publié à la fin des travaux de la commission a fait état de cette information ».
Avant de vous laisser la parole, je vous demande, conformément aux dispositions de l'article 6 précité, de prêter le serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité.
M. Marc Trévidic prête serment.
M. Marc Trévidic, premier vice-président au tribunal de grande instance de Lille. Je rappellerai brièvement dans quelle situation nous nous trouvions avant le 7 janvier 2015. En premier lieu, le nombre d’enquêteurs était très insuffisant. Certes, quand on a affaire à un tel exode vers la Syrie, on ne peut se mettre à niveau très vite, mais l’effectif était extrêmement déficitaire. Cela explique la découverte, plusieurs fois au cours d’enquêtes ultérieures, que des Français ou des personnes résidant en France étaient parvenus à se rendre en Syrie ou à en revenir sans qu’on le sache. Le nombre inquiétant de gens revenus alors qu’on ignorait qu’ils étaient partis démontrait une efficacité qui n’était pas entière.
À cela s’ajoutait l’incapacité d’empêcher de partir ceux qui étaient surveillés. Je me souviens d’anciens d’Artigat : être l’objet d’une information judiciaire quand ils sont sortis de prison ne les a pas empêchés de partir en Syrie eux aussi. Certes, ces gens aguerris avaient pour première préoccupation, chaque matin, de démonter leur voiture pour trouver le micro dont ils soupçonnaient l’installation. Il n’empêche qu’ils se sont volatilisés alors qu’ils étaient surveillés.
D’autre part, nous étions considérablement gênés par l’attitude des Turcs – et je pense que cela dure toujours – qui nous renvoyaient des Français sans aucune explication. Peut-être les informations qui les concernaient étaient-elles passées de service de renseignement à service de renseignement, mais les individus débarqués à l’aéroport en France ne faisaient jamais l’objet d’une procédure judiciaire de la part des Turcs, ce qui posait problème à l’enquêteur français. Imaginez l’arrivée à Roissy, depuis la Turquie, d’un jeune homme dont les services de renseignement disent qu’il est sans doute allé en Syrie : comme on ignorait qu’il était parti, aucune enquête ne le concerne ; il faut donc monter un dossier judiciaire en urgence, en quelques jours. De tels épisodes se produisant chaque semaine, l’absence de coopération judiciaire de la part des Turcs soulève d’importantes difficultés puisqu’il nous faut pouvoir prouver, lorsque nous saisissons le juge des libertés et de la détention, que la personne que nous lui présentons s’est effectivement rendue en Syrie ; il ne suffit pas qu’elle soit allée en Turquie.
J’ai aussi dit à la commission d’enquête sur la surveillance des filières et des individus djihadistes ma très grande inquiétude lorsqu’il nous est progressivement apparu qu’étaient parties en Syrie des personnes qui s’étaient rendues en Afghanistan dans les années 1990. Disposant de carnets d’adresses phénoménaux, elles peuvent très facilement actionner des relais en France et en Belgique et se constituer immédiatement un réseau de soutien. La Belgique a fait le même constat. Contrairement à l’idée que nous avions au tout début, il ne s’agit pas seulement de départs spontanés de la jeune génération, mais aussi de terroristes confirmés « reprenant du service ».
À partir du 7 janvier 2015, le pôle antiterroriste dont, je vous l’ai dit, l’effectif était déjà mince, s’est trouvé dans une situation compliquée. Nos moyens ne sont pas extensibles, et lorsque 70 % de l’effectif des enquêteurs antiterroristes sont, comme il est logique, assignés à l’enquête sur les attentats, il n’en reste que 30 % pour l’ensemble des autres dossiers. Aussi, entre la mi-janvier 2015 et la fin du mois d’août, date de mon départ pour Lille, mon obsession a été de savoir comment j’allais pouvoir travailler mes dossiers sans personne pour m’aider à les mener à bien. Nous avons annulé des opérations et nous en avons retardé beaucoup – l’une concernait en particulier un réseau à La Réunion. Devant enquêter sur ces attentats de grande ampleur, nous étions confrontés à l’incapacité de la machine à gérer tous les autres dossiers. Mais ne pas le faire, c’était passer, potentiellement, à côté d’autres préparations d’attentats ; c’est un facteur de grande angoisse. Ayant vu ce qui a été commis en janvier, savoir que quelques individus rentrés de Syrie sont laissés dans la nature parce que l’on n’a pas les moyens de monter des opérations pour les interpeller est tout sauf anodin.
Ensuite ont eu lieu plusieurs attentats ou tentatives d’attentats qui ont occupé ce qui restait d’enquêteurs. Ces épisodes étaient difficiles à décrypter : pourquoi lancer des opérations impliquant des individus isolés, alors qu’Abaaoud aurait pu envoyer trois personnes faire une tuerie dans le Thalys ? Selon moi, il s’agissait d’occuper le terrain pour préparer une opération d’envergure par ailleurs. On retrouve là une technique utilisée par Al Qaida dans le passé et consistant à multiplier les petites opérations à peu de frais : si elles marchent, tant mieux, si elles ne marchent pas, tant pis. Pendant ce temps, tous les enquêteurs sont pris, et quelque chose de beaucoup plus solide peut se mettre en place. C’était mon état d’esprit lorsque je suis parti, fin août 2015. Mais, avant cela, le 15 août, un jeune homme interpellé quatre jours plus tôt à son retour de Syrie nous a dit clairement qu’un attentat était projeté lors d’un concert de rock.
M. le président Georges Fenech. Vous avez donc rédigé un procès-verbal ?
M. Marc Trévidic. Oui, puisque j’instruisais le dossier.
M. le président Georges Fenech. Mais vous n’avez pas fait le lien avec le procès-verbal de 2009, qui mentionnait le Bataclan comme cible d’une attaque ? Étiez-vous au courant de son existence ?
M. Marc Trévidic. Non, car je n’avais pas instruit ce dossier à l’époque. La difficulté tient aussi à ce qu’une personne interrogée évoque différents projets.
M. le président Georges Fenech. Lorsqu’on vous donne des indications telles que celles qui vous ont été données le 15 août dernier, partagez-vous ces informations ? Faites-vous part d’une menace d’attentat ?
M. Marc Trévidic. J’ai pris ces indications très au sérieux, car la personne à qui j’avais affaire était précise et ses allusions à la préparation d’un attentat de très grande ampleur sur le territoire étaient très claires. Le 15 août, en première comparution, il a mentionné explicitement un attentat projeté en France à l’occasion d’un concert de rock, mais il ne savait pas quelle était la cible exacte.
M. le président Georges Fenech. Que s’est-il passé ensuite ?
M. Marc Trévidic. Je ne saurais vous dire, car j’ai changé d’affectation le 28 août.
M. le président Georges Fenech. Mais lorsque l’information vous est donnée par cet homme qu’un attentat pourrait viser une salle de spectacle, vous la prenez au sérieux ?
M. Marc Trévidic. Très au sérieux, parce que tout ce qu’il disait par ailleurs avait été recoupé et était vrai, qu’il s’agisse de la manière dont il avait été recruté et entraîné ou des personnes qu’il avait rencontrées, dont Abaaoud.
M. le président Georges Fenech. Je sais que les salles de spectacle sont nombreuses à Paris, mais quelle est votre opinion sur le fait que des mesures de sécurité préventives n’aient pas été prises pour les protéger ? Votre interlocuteur mentionnait-il Paris explicitement ?
M. Marc Trévidic. Non. Il ignorait quelle était la cible précise. J’ai pensé qu’il pourrait s’agir de Rock en Seine, principal festival de rock de la saison, accessible à tous en passant par le parc de Saint-Cloud.
M. le président Georges Fenech. Donc, vous n’avez pas été surpris par l’attentat commis au Bataclan ?
M. Marc Trévidic. Non, mais cela aurait pu être ailleurs, car il y a un très grand nombre de festivals et de concerts de rock en France et, à l’époque, je n’avais pas du tout en mémoire que le Bataclan avait été mentionné en 2009.
M. Sébastien Pietrasanta, rapporteur. Considérez-vous qu’il y ait une « affaire Bataclan » ? Pour vous, était-ce une salle de concerts de rock parmi d’autres, ou bien le recoupement de votre procès-verbal du 15 août 2015, de celui de 2009 et des attaques répétées dont le Bataclan faisait l’objet sur l’internet au motif que la salle accueillait des galas de bienfaisance au bénéfice de Tsahal et que ses propriétaires seraient de confession juive aurait-il dû mettre plus particulièrement en garde ?
M. Marc Trévidic. Je pense que si j’avais instruit le dossier Farouk Ben Abbes en 2009, je me serai rappelé ce nom, mais cela n’a pas été le cas. De plus, de nombreux projets d’attentats ont été mentionnés au long de toutes ces années, et ceux qui les évoquent changent parfois de cibles. Mais il est exact que si l’on avait fait la relation avec le fait que beaucoup d’anciens d’Afghanistan dont les noms étaient apparus dans des procédures étaient à présent en Syrie, on aurait pu faire le travail de fond consistant à rechercher les cibles qui avaient alors été mentionnées comme cibles potentielles. Qu’ils se revendiquent d’Al Qaida ou de l’État islamique, ces gens sont les mêmes, et qui a songé s’en prendre au Bataclan en 2009 peut avoir le même projet en 2015.
M. le président Georges Fenech. En 2014, la DGSI a succédé à la direction centrale du renseignement intérieur (DCRI) qui a rédigé le procès-verbal de 2009 mentionnant le Bataclan comme cible potentielle. La DGSI ne pouvait-elle établir le lien ?
M. Marc Trévidic. Si, à condition que quelqu’un, au sein du service, s’en souvienne ; mais le turnover y est assez fort. Il me manque très certainement un épisode, mais, prenant mes fonctions le 1er septembre à Lille, j’ai travaillé à Paris jusqu’au 28 août et commencé mon déménagement le 29 août. Il y a eu très peu de discussions, excepté une réunion à propos de ce dossier.
M. le président Georges Fenech. Il est très surprenant de vous entendre mentionner l’important turnover au sein de la DGSI pour expliquer cette déperdition d’informations. Je ne peux croire que la continuité des services soit tributaire de la mémoire humaine. Les dossiers restent, et qui arrive s’y plonge !
M. Marc Trévidic. Bien sûr, mais je ne pense pas qu’un dossier recense toutes les cibles mentionnées par les terroristes pendant leur garde à vue.
M. Pierre Lellouche. Vous semble-t-il normal de ne pas recenser quelque part les cibles et les modes opératoires quand on travaille à l’antiterrorisme ? Est-il normal que, si les juges changent, les recoupements et les croisements ne puissent plus se faire ? Un procureur m’a dit récemment que, les parquets n’étant connectés ni entre eux ni avec la DGSI, les enquêtes ne sont pas reliées les unes aux autres ; il en résulte que des informations ne passent pas de la DGSI aux procureurs, et vice-versa. Cela vous semble-t-il normal dans un contexte de lutte contre le terrorisme ?
M. Marc Trévidic. Il faudrait bien sûr partager les informations au maximum. Dans le temps, quand deux juges d’instruction seulement visaient l’islam radical, ils avaient une vision globale de l’ensemble des dossiers anti-terroristes à l’instruction ; mais ensuite, par la force des choses, leur nombre est passé à huit et l’on a changé de registre. À cela s’ajoute que la saisine des juges se fait au « tour de bête », sans tenir compte des dossiers déjà instruits par les collègues ; ainsi, je n’étais pas de ceux qui ont instruit le cas Merah, alors que l’on savait l’importance de l’affaire Artigat I dans ce dossier. La déperdition des informations s’explique par de multiples facteurs. Enfin, un groupe terroriste suivi pendant un an a des cibles très fluctuantes et change dix fois de projet.
M. le président Georges Fenech. Pourquoi, en 2009, ni le juge d’instruction ni la DCRI n’ont-ils alerté les propriétaires du Bataclan de ce qu’une menace pesait sur leur établissement ? Cette interrogation hante les familles des victimes.
M. Marc Trévidic. Je les comprends parfaitement, mais je ne peux répondre puisque je n’étais pas juge d’instruction dans le dossier de 2009. À l’époque, les choses étaient assez confuses et le dossier Ben Abbes était éclaté en plusieurs morceaux – l’un donnant lieu à une enquête préliminaire au parquet, un autre à l’information… – en raison de l’absence complète de connexion du parquet à l’époque. Cela s’est amélioré ces derniers temps, et les échanges d’informations entre le parquet et l’instruction sont beaucoup plus clairs. En 2009, le parquet « gardait en préliminaire » ; ainsi, l’affaire Artigat I l’est restée dix-huit mois.
M. le président Georges Fenech. Pourquoi, lorsqu’un juge ou un service apprend une information de cette sorte, n’est-elle pas transmise ?
M. Marc Trévidic. Il existe à votre question une réponse juridique. Dans un dossier d’association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, même si les personnes incriminées ne sont pas passées à l’action, ceux qui sont visés par un projet d’attentat sont des victimes potentielles ; à ce titre, ils doivent recevoir un avis à victime.
M. François Lamy. Quelques jours à peine après les attentats, la presse donnait une foule d’informations sur les terroristes concernés : leur nom, les attentats précédents dans lesquels ils avaient été impliqués, leurs réseaux et le nombre de personnes – de 110 à 120 – suspectées d’envisager de commettre de tels actes, ce que les services de renseignement savaient d’eux… Cela pose question.
Vous avez fait état des difficultés éprouvées pour empêcher les départs vers la Syrie, compte tenu des outils juridiques à votre disposition. Je comprends mal que vous ne receviez pas d’informations de la direction générale de la sécurité extérieure (DGSE), alors même que de nombreuses relations existent avec la Syrie, y compris avec des informateurs. Ces réseaux ont certes dû être partiellement détruits par la guerre, mais la DGSE sait faire son travail. Comment ces gens, une fois partis, ont-ils pu revenir de Syrie sans que vous en soyez avertis ? La DGSI a peut-être tenté d’entrer en contact avec Abaaoud après l’audition que vous avez consignée sur procès-verbal le 15 août 2015, mais que sait réellement la DGSE de ce qui se passe en Syrie ? Vous-même, en votre qualité de juge d’instruction au pôle antiterroriste, entreteniez-vous des relations régulières avec la DGSE, ou le secret-défense posait-il problème ?
Sur le fond, moyens exceptés, que manque-t-il aux juges antiterroristes pour bien faire leur travail ? Considérez-vous que l’instauration de l’état d’urgence et l’assignation à résidence auraient été de bons outils pour maintenir en France ceux qui sont malheureusement partis en Syrie ?
M. Pierre Lellouche. Pour répondre à la question de M. Lamy, on ne peut faire l’impasse sur la dimension de politique étrangère. Depuis qu’en 2012 la France a décidé de couper les relations avec la Syrie, les rapports entre les services de renseignement se sont interrompus, si bien que nous n’avons plus eu d’informations sur qui entrait et qui ressortait. Et si la Turquie n’a jamais vraiment coopéré à la lutte anti-terroriste, c’est pour d’autres raisons, de politique étrangère.
M. Marc Trévidic. Je suis personnellement à l’origine de réunions entre la DGSE et ce qui était à l’époque la DCRI – à la demande de celle-ci. La police judiciaire n’a pas et n’a pas à avoir de contacts institutionnels directs avec la DGSE, direction dont toute l’action est couverte par le secret-défense. Il est cependant arrivé que la DCRI nous demande d’intervenir, en particulier parce que la DGSE traitait, en Égypte notamment, des Français qui étaient des cibles judiciaires. Cela ne se pouvait, et il fallait le leur faire savoir.
Effectivement, après que l’ambassade de France à Damas a été fermée, nous avons vu revenir le commissaire divisionnaire de la DCRI, ainsi que les agents « officiels » de la DGSE qui étaient en poste là-bas. J’ignore si, depuis lors, des renseignements ont transité par les services « action », mais personne ne m’a jamais dit que telle ou telle information provenait de Syrie ; c’est le noir absolu. Il n’en va pas de même avec le Liban.
M. Pierre Lellouche. Si l’on vous entend bien, la DCRI, ne parlant pas à la DGSE, devait passer par vous pour organiser une réunion ? C’est glaçant.
M. Marc Trévidic. Ce n’est pas tant que l’on ne se parlait pas, c’est que personne ne décidait. En l’espèce, l’Égypte a été, un moment, un nid de terroristes français – la plupart des membres du réseau Artigat I, par exemple – qui fréquentaient des universités cairotes. Évidemment, la DGSE souhaitait s’en occuper, voire les approcher. Il fallait lui faire savoir, à la demande de notre service enquêteur, que cela ne se pouvait. Nous ne l’aurions pas fait de notre propre initiative, mais je suppose qu’ils n’arrivaient pas à se mettre d’accord. Les épisodes de ce genre sont relativement rares, mais il s’en est produit.
M. Pascal Popelin. Considérez-vous que la création de la communauté du renseignement a fluidifié les relations entre les services ?
M. Marc Trévidic. Je n’ai pas eu ce problème depuis longtemps, mais je ne peux parler que des dossiers dont j’étais chargé. Le procureur de la République de Paris pourrait mieux vous répondre, car il a une vue d’ensemble. Je ne mettrais pas ma main au feu que tout soit pour le mieux dans le meilleur des mondes aujourd’hui encore.
M. François Lamy. Si on lit l’intégralité du pedigree d’Abaaoud dans la presse le 16 novembre 2015, trois jours après que les attentats ont été commis à Paris, cela signifie que ces informations étaient connues d’un service – et c’est forcément la DGSI, laquelle n’a pas le droit d’intervenir hors de nos frontières.
M. Marc Trévidic. Permettez-moi une rectification. Cent vingt agents très gradés de la DGSI sont en poste dans nos ambassades. Ils sont têtes de réseau pour les demandes d’entraides judiciaires mais, à mon avis, un agent de la DGSI posté à Damas passe 90 % de son temps à faire du renseignement.
L’état d’urgence m’inquiète car, en assignant un individu à résidence parce que l’on n’a pas de preuves contre lui – s’il en allait autrement, il ferait l’objet d’une procédure judiciaire –, ne le pousse-t-on pas dans les bras de l’État islamique ? Au terme de trois mois d’assignation à résidence, ne sera-t-il pas aussi dangereux qu’il l’était auparavant ? À mon sens, il faut parvenir à être suffisamment performant pour recueillir des preuves de sorte que les individus incriminés soient traduits en justice, et les peines alors prononcées doivent être suffisamment longues pour qu’ils soient empêchés de nuire durablement. Toutes les formules qui ne les contraignent que très temporairement et de façon indifférenciée sont dangereuses.
Au tribunal de Lille, je préside beaucoup d’audiences en comparution immédiate. Plusieurs individus ont été déférés en raison de découvertes faites à leur domicile lors de perquisitions administratives et l’on a l’impression très nette que ces perquisitions ont servi à beaucoup de choses autres que la lutte contre le terrorisme. Si les assignés sont effectivement des salafistes, ils ne nous aimeront pas plus après l’assignation à résidence qu’auparavant ! Je vous donnerai pour exemple celui d’un jeune salafiste encore indécis, qui a donné une interview au quotidien La Voix du Nord. Il explique qu’après la perquisition administrative et l’assignation à résidence qui s’en est suivie, il a perdu son travail ; ensuite, ne pouvant plus payer son loyer, il a reçu un ordre d’expulsion. Il se demandait donc ironiquement où, étant désormais expulsé de chez lui, il serait assigné à résidence.
La question fondamentale est : qu’est-ce qui peut favoriser le recrutement par Al Qaida ou par l’État islamique ? Toute mesure que l’on envisage de prendre doit être évaluée à cette aune. Si personne ne les rejoint plus, ces organisations sont finies. Dans cette perspective, une assignation à résidence rendra-t-elle des jeunes gens encore hésitants moins haineux à notre égard, moins réceptifs aux idées salafistes, ou non ? À mon avis, elle risque de précipiter leur décision. Les individus chez qui l’on s’est rendu au début de l’état d’urgence sont des gens qui étaient encore tangents ; je crains l’évolution que ces mesures ont pu entraîner. L’état d’urgence est nécessaire immédiatement après un attentat, alors que les gens sont dans les rues et qu’un autre attentat peut être commis, qu’il faut éviter. Mais, à long terme, cela peut avoir des effets pervers.
M. le président Georges Fenech. Vous avez exprimé dans la presse des opinions très critiques sur les perquisitions administratives également. Ainsi le quotidien belge Le Soir vous cite comme il suit : « N’imitez pas la France, l’état d’urgence, c’est débile ; les flopées de perquisitions administratives qui ne servent à rien, c’est très lourd, très dérogatoire à notre système, pour une efficacité très limitée ».
M. Marc Trévidic. C’est une version synthétique d’une réflexion plus globale…
M. le président Georges Fenech. Mais vous estimez néanmoins que les perquisitions administratives ne sont pas utiles dans la lutte contre le terrorisme.
M. Marc Trévidic. Elles sont utiles pendant un temps réduit, parce qu’il y a urgence et une potentialité immédiate d’autres attentats ; ensuite, les vrais méchants ont caché tout ce qu’ils avaient à cacher. Je vois passer en comparution immédiate des gens chez qui l’on a trouvé du shit au cours d’une perquisition administrative ; qu’en penser ? Cela n’a rien à voir avec la lutte contre le terrorisme, qui justifie les assignations à résidence. J’attends que l’on me démontre le contraire : combien d’affaires terroristes ont été mises à jour à la suite des perquisitions administratives ?
M. le président Georges Fenech. Cinq, dit-on.
M. Marc Trévidic. Est-ce davantage que ce que l’on fait d’habitude ? Il faut trouver des solutions, mais observez l’efficacité d’une belle enquête menée avec des moyens suffisants : cela permet, par exemple, d’arrêter l’homme qui a été interpellé à Boulogne, de mettre à jour la cache d’Argenteuil et d’éviter un attentat. Je crois aux enquêtes approfondies ; elles permettent de trouver des liens, des gens et des caches, et l’on parvient à prévenir des attentats. Il faut donc des capacités d’enquête permettant d’aller au fond des choses. Le renseignement se nourrit du judiciaire : tout ce que l’on découvre au cours d’une enquête judiciaire est une mine d’or pour les services de renseignement.
M. Alain Marsaud. Je rappelle à notre président que, le juge d’instruction n’étant pas chargé de l’ordre public, on ne peut lui demander de prendre l’initiative d’alerter des victimes éventuelles.
M. le président Georges Fenech. Si le juge est un tant soit peu consciencieux, il passera un appel téléphonique au procureur de la République ou lui adressera un courrier pour l’informer.
M. Alain Marsaud. J’en suis d’accord ; il peut aussi en référer au préfet. Mais il n’est pas de sa responsabilité première d’alerter directement les victimes potentielles.
M. Marc Trévidic. La loi fait obligation au juge d’instruction d’aviser la victime de l’ouverture d’une procédure d’information judiciaire. Mais, lorsqu’est en cause une association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, il faut prendre le temps d’apprécier si la victime est caractérisée et bien ciblée. Or des individus que l’on suit pendant un an changent de cible sans arrêt ; on ne peut aviser toutes les victimes potentielles qu’ils ont pu mentionner. Sur le fond, je suis gêné de devoir vous entretenir d’un dossier que je n’ai pas instruit : j’ignore si la menace était très concrète ou si elle ne l’était pas.
M. Christophe Cavard. Vous avez été entendu en 2013 par la commission d’enquête créée à la suite de l’affaire Merah. Vous aviez fait état à l’époque de grandes difficultés dans l’échange d’informations entre le parquet et les services de la sécurité intérieure. Vous aviez expliqué que certaines informations restaient dans les services de renseignement et que vous aviez souvent beaucoup de mal à y accéder. Qu’en est-il aujourd’hui ? Il se dit par ailleurs qu’après les attentats, les services de renseignement fournissent subitement des notes blanches en grand nombre aux services judiciaires. Est-ce la réalité ? Enfin, quel peut être le rôle des parquets locaux dans la lutte anti-terroriste ?
M. Marc Trévidic. Il est exact qu’après l’affaire Merah les agents de la DCRI sont arrivés chez nous avec des vingtaines de dossiers, souhaitant judiciariser ce qu’ils gardaient jusqu’alors sous le coude. Je pense qu’il en est de même après chaque attentat. Nous sommes dans un système où il revient aux services de renseignement, dont l’activité est couverte par le secret-défense, de décider si et quand ils judiciarisent un dossier. Il est difficile de trouver un système entièrement satisfaisant. Cependant, certaines informations nous auraient suffi, puisque très peu de choses suffisent pour ouvrir une enquête préliminaire, qui vise à déterminer l’existence d’une infraction éventuelle. J’ignore ce qu’il en est pour la hiérarchie, mais je sais que les agents de la DGSI regrettent de ne pouvoir judiciariser les dossiers. Ils savent le système judiciaire engorgé et pensent ne pouvoir le charger davantage, alors même que chacun sait qu’il faut judiciariser pour arrêter les gens. Mais le système judiciaire ne peut avoir la maîtrise de ce qui est judiciarisé : pour la DGSI, l’article 40 du code de procédure pénale n’a aucune signification, puisque toute l’activité de ses agents est couverte par le secret-défense. Il y a là une contradiction intrinsèque, et l’on ne peut reprocher à un service de garder pour lui un renseignement qu’il n’a pas le droit de donner puisqu’il est classifié.
Mme Anne-Yvonne Le Dain. Où consolide-t-on les informations recueillies lors des différentes instructions ? Est-il même possible de les consolider, et avec quelles garanties du respect des libertés publiques et individuelles ? Comment rendre accessible la perception ou le pressentiment d’un danger trois ou quatre ans avant la commission d’un fait ?
M. Marc Trévidic. On a tendance à penser que tout élément apparaissant dans un dossier entre dans une « grande mémoire » informatisée à la DGSI, et qu’il ressortira des années plus tard quand on appuiera sur un bouton. Ce n’est pas le cas, et c’est pourquoi j’ai parlé de la mémoire humaine. La justice n’a pas d’outil permettant de faire des rapprochements et de garder en mémoire tous les dossiers, globalement ; chaque juge d’instruction le fait pour ce qui le concerne. Lorsqu’un nom me disait quelque chose, je fouillais mes dossiers – que j’avais scannés ; c’est ainsi, par exemple, que j’ai finalement retrouvé celui d’un individu apparu en 1998 lors d’une enquête sur la filière afghane. J’ai souvent opéré de cette manière des rapprochements que la DGSI n’avait pas faits. Cela signifie que la mémoire individuelle fonctionne mieux que les banques de données ; il y a un problème de recoupement des renseignements.
M. Serge Grouard. Cela signifie que les banques de données ne sont pas formatées comme elles devraient l’être.
M. Marc Trévidic. J’ai aussi le souvenir, au sujet de l’attentat de la rue Copernic, que l’on est allé piocher dans les archives de 1988 du juge Boulouque grâce à un policier de la DGSI parti à la retraite, qui s’est souvenu d’un nom évoqué pendant la garde à vue d’un tiers. La transmission de la mémoire individuelle ne se fait pas. Le collègue qui vous succède arrivant le jour où vous êtes nommé à une autre fonction au tribunal d’une autre ville, comment faire le passage du relais, sauf à venir le week-end en question lui parler des dossiers ? Il en résulte une déperdition d’informations massive. Il en va de même à la DGSI lors du départ des responsables fonctionnels : du jour au lendemain, leur mémoire disparaît. Je ne sais quel outil informatique on pourrait créer pour interconnecter tous les dossiers ; pour la justice, cela signifierait aussi scanner tous les dossiers anciens qui ne l’ont pas été.
Mme Anne-Yvonne Le Dain. La question est morale avant d’être pratique. En mettant en regard les libertés individuelles et l’intérêt collectif, estimez-vous souhaitable le principe de la consolidation des informations?
M. le rapporteur. On ne peut se fonder uniquement sur la mémoire des hommes – on voit les limites d’un tel système, avec une perte importante d’informations cruciales lors des mutations. Outre ce que vous allez chercher dans vos dossiers anciens, y a-t-il des échanges informatisés entre magistrats instructeurs ? En vous entendant, on a le sentiment que les mêmes noms reviennent depuis de nombreuses années, parfois des décennies ; la DGSI et les juges d’instruction ne pourraient-ils se réunir pour afficher les portraits de leurs « clients » sur les murs afin de partager et compléter leurs informations ? Comment centraliser les informations relatives à des affaires différentes ? Est-ce vous qui donnez des informations à la DGSI ? Considérez-vous que les renseignements disponibles sont réellement partagés, dans le respect des prérogatives de chacun ?
M. Marc Trévidic. Curieusement, nous n’avons pas de données statistiques sur les informations recueillies au cours des enquêtes judiciaires en matière terroriste, si bien que j’ignore si le taux de récidive est plus élevé que pour un autre type de criminalité. Cela peut paraître anodin, mais cela aiderait, étant donné l’idéologie des personnes considérées. Au moins faudrait-il croiser les informations recueillies sur les individus ou les cibles et pour cela constituer une banque de données des affaires judiciaires traitées ; elles seraient alors à disposition des juges dans le cadre de toute autre procédure. Le problème tient à ce que renseigner la banque de données pour chaque affaire ouverte représente un travail très important. Le fichier ainsi constitué serait à usage judiciaire. Ensuite, le renseignement aspire tout le judiciaire, puisque la DGSI, étant donné sa double casquette, traite tous les dossiers : l’ensemble des informations – connexions, carnets d’adresses… – issues d’un dossier judiciaire se retrouvent dans les banques de données des services de renseignement et sont traitées en renseignement. La DGSI a d’ailleurs demandé au procureur à être systématiquement désignée dans tous les dossiers « syriens », même ceux qui sont arrivés par le biais de la sous-direction antiterroriste (SDAT). Parfois, les agents de la DGSI ne rédigent pas un seul procès-verbal : ils sont là uniquement pour nourrir la banque de données « renseignement » de tout ce qui est trouvé lors des enquêtes judiciaires.
Tout dépend ensuite de savoir l’utilisation qui est faite de la banque de données, à quelles fins, par qui, sous quel contrôle, et si le contrôle est efficace. L’avantage d’un dossier judiciaire est que si une information n’est pas fiable, si un fait n’est pas avéré ou pas prouvé, la chose est débattue publiquement, en présence d’un avocat, et le tribunal constate que nous avons commis un « loupé ». Il n’y a pas de secret-défense, le contrôle et la sanction se font naturellement : si un dossier ne tient pas, il est dit qu’il ne tient pas.
M. le président Georges Fenech. Je crois me rappeler que dans un cas au moins vous avez eu à connaître d’un loupé magistral : un contrôle judiciaire non respecté sans que vous en soyez informé suivi d’une fausse déclaration de perte de papiers d’identité conduisant à l’établissement de nouveaux documents qui ont permis à l’intéressé de quitter le territoire alors qu’il en avait l’interdiction. Est-ce exact ?
M. Marc Trévidic. Il est arrivé plusieurs fois que des gens sous contrôle judiciaire cessent de pointer et que nous ne le sachions que bien plus tard. Cela s’est produit aussi dans le dossier concernant notamment l’un des auteurs de l’attentat contre le Bataclan et deux autres individus. Je ne sais si ceux-là se sont fait refaire des pièces d’identité. Dans ce dossier, deux juges d’instruction avaient été désignés. Je n’avais pas interrogé Amimour mais les deux autres qui, à un moment, m’ont tous deux demandé la levée de l’interdiction de sortie du territoire qui les visait : l’un parce que son grand-père venait de mourir – mais je n’ai jamais reçu le certificat de décès que j’avais demandé –, l’autre pour voir sa famille. J’ai refusé dans les deux cas. Quelque temps plus tard, avec un an de décalage par rapport au début de l’enquête, il ressort de l’exploitation de leurs boîtes mail par la DGSI que l’un d’entre eux veut toujours partir en Syrie. Je le convoque alors pour interrogatoire ; il ne se présente pas et j’apprends, avec difficulté, qu’aucun des trois ne pointait plus au commissariat depuis au moins quatre semaines sinon davantage, alors même qu’ils étaient tenus à un contrôle hebdomadaire.
Ce n’est pas le seul dossier dans lequel cela s’est produit. Les juges d’instruction en matière antiterroriste sont logés à la même enseigne que leurs collègues : ils ont deux outils en tout et pour tout à leur disposition, la prison ou le contrôle judiciaire de base. Autrement dit, trafiquants de shit et terroristes font l’objet du même traitement, les seconds n’étant pas plus surveillés que les autres : s’ils ne viennent pas pointer, on s’en rend compte ou non selon la charge de travail du commissariat. Telle est la réalité. Entre le contrôle judiciaire classique et la prison, il n’y a jamais eu de troisième voie. Il faudrait, éventuellement, des centres où ils seraient très encadrés et où l’on traiterait les différents aspects de la question, mais de tels centres n’existent pas. On a aussi utilisé le bracelet électronique – ce qui n’a pas empêché un de mes collègues de se rendre compte qu’un ou deux individus étaient partis en Syrie après les avoir enlevés. Il faut donc relativiser l’efficacité de ces mesures.
M. le président Georges Fenech. Comment ces départs en Syrie ont-ils été possibles ? J’imagine que, en prononçant l’interdiction de sortie du territoire, vous vous faites remettre les documents d’identité ?
M. Marc Trévidic. L’affaire est ancienne ; comme elle a été jugée, vous devriez pouvoir, pour plus de précisions, vous faire communiquer la cote du dossier. J’ai le souvenir précis d’une affaire dans laquelle la personne concernée avait fait refaire ses papiers d’identité après en avoir faussement déclaré le vol, mais je ne sais plus si c’est celle-là. À l’époque, en tout cas, il n’y avait pas d’interconnexion entre le fichier des interdictions de sortie du territoire et celui des documents d’identité, si bien que la préfecture à laquelle les documents étaient déclarés volés en établissait de nouveaux.
M. le président Georges Fenech. Que des individus soumis à un contrôle judiciaire pour faits de terrorisme puissent quitter le territoire national en toute quiétude à la suite d’un tel enchaînement de circonstances montre qu’il y a quelques failles dans notre système.
M. le rapporteur. Le problème tient, comme cela a été dit, à ce que les services de police ou de gendarmerie appliquent le contrôle judiciaire de la même manière, qu’il soit question de trafic de stupéfiants ou de terrorisme, et que l’information sur le non-respect du contrôle judiciaire ne parvient au juge que tardivement ou s’il en fait la demande. Mais il me semble qu’une circulaire a été diffusée à ce sujet.
M. Marc Trévidic. Toute demande de nouveaux papiers d’identité déclenche normalement la consultation par la préfecture du fichier national des personnes recherchées (FPR), dans lequel sont portées les interdictions de sortie du territoire ; il faut croire que la consultation n’est pas systématique.
M. le président Georges Fenech. Est-ce qu’établir un fichier national des contrôles judiciaires aurait une utilité, comme le suggère notre collègue Alain Marsaud ?
M. Marc Trévidic. S’il est consulté, sans doute. Mais si le FPR est bien alimenté, il n’est pas nécessaire de créer un autre fichier. Le problème est que les agents des préfectures, face à la masse de documents qu’il leur faut établir, ne consultent pas systématiquement le FPR. En outre, que les commissariats doivent faire preuve d’une vigilance extrême quand on leur adresse pour contrôle judiciaire quelqu’un qui a la qualification de terroriste me paraissait être une évidence ; j’ai vu que ce n’était pas le cas.
M. François Lamy. Ne pourrait-on admettre que la DGSE transmette les informations dont elle dispose aux juges d’instruction spécialisés et qu’à cette fin ces derniers soient habilités au secret-défense ?
On comprend le principe en vertu duquel la permanence dans certaines fonctions spécialisées est limitée à dix ans mais, étant donné le manque de moyens, ne pourrait-on concevoir des dérogations à cette règle, pour une durée donnée et pour certaines fonctions ?
M. Marc Trévidic. J’ai été habilité au secret-défense parce que la section antiterroriste du parquet de Paris traite aussi des dossiers de compromission de ce secret : il faut qu’au cours d’une perquisition le juge puisse reconnaître le document qui a été banalisé. Mais parce que les éléments couverts par le secret-défense, n’étant pas ouverts à la discussion contradictoire, ne peuvent être inclus dans un dossier judiciaire, je ne voulais avoir que le minimum d’informations que je ne pouvais partager, notamment avec les parties civiles ; sinon, cela signifie ne dire aux victimes qu’une partie de la vérité, ce qui ne se conçoit pas. C’est un gros problème. Aussi, quoique habilité, n’ai-je jamais utilisé cette faculté, sinon dans les cas de compromission du secret-défense ; pour le reste, je m’en tenais à la demande classique de déclassification, les éléments déclassifiés entrant dans la procédure contradictoire. Parce que l’on me savait habilité, il est arrivé que l’on me donne des informations « off », mais qui ne sont pas une preuve qui puisse être versée au dossier judiciaire. Le juge d’instruction est soumis au contradictoire ; il doit être honnête et fair-play, et se battre avec les avocats sur le fondement de ce qui figure dans le dossier. Nous ne sommes pas un service de renseignement, et l’on voit bien que l’on se trouve en porte-à-faux si l’on penche trop du côté : « Je suis dans le secret. »
Dans certaines fonctions très fortement spécialisées et qui conduisent à traiter de dossiers complexes relatifs à des matières qui le sont tout autant, il faudrait sans doute prévoir un passage de relais de deux ou trois mois pendant lesquelles la République payerait le juge qui s’en va pour qu’il reste avec celui qui arrive. Cela faciliterait les choses, éviterait de très longues ruptures dans les instructions et, étant donné le faible nombre de personnes concernées, je ne pense pas qu’il en résulterait une dépense considérable dans les caisses de l’État.
M. Christophe Cavard. Des délinquants de droit commun peuvent intéresser les services de la sécurité intérieure ; aussi, sans remettre en cause le rôle du parquet parisien de lutte antiterroriste, comment faire pour que les juridictions territoriales jouent aussi un rôle dans ce combat ? D’autre part, quel jugement portez-vous sur le partage des informations avec vos homologues des autres pays européens, la Belgique notamment ?
M. Marc Trévidic. Il est vrai que la population sur laquelle travaille la section antiterroriste est à présent beaucoup plus disséminée sur le territoire qu’elle ne l’était. On pourrait imaginer, sans casser le parquet à compétence nationale, de créer des antennes – par exemple au sein des juridictions interrégionales spécialisées, qui traitent de la criminalité organisée. Mais cela n’aurait de sens que si les antennes locales de la DGSI avaient un pouvoir d’intervention très important : une synergie se créerait alors, l’enquête débuterait et un dialogue s’établirait avec Paris. Ce serait une bonne idée, mais j’ai observé que tout ce qui est traité par les services locaux de la DGSI en province « remonte » à Paris quoi qu’il en soit. Je crains donc que des antennes décentralisées du parquet national ne servent à rien si elles n’ont pas d’interlocuteurs du côté des enquêteurs : les équipes doivent pour commencer déterminer si un dossier donné est terroriste ou s’il ne l’est pas. Pour Mohamed Merah, il n’y avait pas de correspondant judiciaire spécialisé, si bien que tout est remonté à Paris ; ensuite, les informations redescendent – ou pas.
La coopération européenne est une question compliquée. On commence à évoquer l’idée d’un « FBI à l’européenne », mais l’Union européenne, n’étant pas un État fédéral, n’a pas de tribunaux fédéraux. Aux États-Unis, quand un agent du FBI a une affaire, il en réfère au procureur fédéral. Il est difficilement envisageable de créer une communauté européenne du renseignement sans savoir à quelle autorité ses membres feront rapport ni qui, ensuite, traitera l’information.
Il ne faut pas croire pour autant que les services judicaires européens ne travaillent pas ensemble. Ainsi avons-nous toujours bien travaillé avec les Belges et, d’un point de vue judiciaire, n’avons-nous jamais eu besoin de beaucoup plus que ce dont nous disposons déjà : des équipes communes d’enquête, l’espace Schengen, des relations téléphoniques, des visites à nos homologues si besoin est… Je n’ai vu que souplesse dans le fonctionnement judiciaire, ce n’est pas là que le bât blesse.
M. le président Georges Fenech. Quelle est votre opinion sur la « filière Molenbeek » ?
M. Marc Trévidic. Au moins 160 combattants belges ont été recrutés là ; c’est énorme. Il y avait donc un vrai problème dans ce quartier. Si un quart de vos nationaux recrutés par les réseaux djihadistes proviennent du même endroit, cela devrait vous faire penser que c’est là qu’il faut « mettre le paquet ».
M. le président Georges Fenech. Est-ce ce qui a eu lieu ?
M. Marc Trévidic. Manifestement pas, ou un peu tardivement car nous péchons tous par un temps de retard important au regard de ce qui s’est produit. Mais cela a fini par être fait ces deux dernières années, si bien que Khalid Zerkani et Fouad Belkacem – le dirigeant du groupe Sharia4Belgium – ont été arrêtés. Contre le premier, dont on s’est rendu compte qu’il était le grand recruteur de Molenbeek, une lourde peine – quinze ans de détention – a été requise.
M. le président Georges Fenech. Y a-t-il, selon vous, « une centaine de Molenbeek » en France ?
M. Marc Trévidic. Il y en a. En ma qualité d’ancien juge d’instruction, j’estime dangereux l’existence de zones complètement salafistes, ou du moins de zones dans lesquelles aucune enquête sérieuse ne pourra être menée si des gens y trouvent refuge. J’ai eu à connaître d’un dossier très important à Trappes ; il a fallu un temps extraordinairement long pour trouver le moment de poser un micro dans un appartement ou une voiture. Si vous devez opérer en milieu hostile et que, lorsqu’un policier apparaît, tout le monde l’a remarqué, il est extrêmement difficile d’utiliser les moyens modernes d’investigation et de surveillance : il faut arriver à l’appartement visé sans que les voisins crient au loup, et l’on ne parvient pas davantage à faire des filatures physiques. C’est dangereux car on ne peut plus enquêter, et cela nous rend aveugles.
M. Pierre Lellouche. Il est marquant d’entendre un juge dire qu’il existe en France des « zones hostiles » dans lesquelles on ne peut pas mettre un micro – parce que c’est la guerre, en somme !
Je constate qu’en matière antiterroriste la machine judiciaire ne se parle pas à elle-même : nous venons d’entendre qu’il n’y a pas de connexions entre les dossiers et que chaque juge, le nez sur son guidon, ne bénéficie pas des résultats des enquêtes faites ailleurs. Il me semble donc qu’il faut faire tomber les murailles culturelles entre les services et mettre ces informations dans un pot commun, de manière à pouvoir les croiser en tant que de besoin.
Il faudrait aussi rapprocher la justice de la communauté du renseignement. Nous avons déjà évoqué cette question en matière pénitentiaire ; chacun a à l’esprit les résistances de l’ancienne garde des sceaux à ce sujet, mais on y arrive progressivement. De même, il faut parvenir à un partage d’informations entre les enquêteurs judiciaires et les services. Pour l’instant, la justice ne les a pas toutes, et je ne suis pas certain que les services de renseignement les aient toutes non plus – même si, théoriquement, ils aspirent ce qui s’est dit dans le cabinet des juges, je ne suis pas certain que soit systématique.
Il est un autre domaine où tout est à faire : ce qui concerne les 175 000 personnes qui ne sont pas détenues mais qui font l’objet d’un contrôle judiciaire. En conséquence de la révision générale des politiques publiques (RGPP) et parce qu’il fallait vider des prisons surpeuplées, les lois de 2010 et de 2014 ont organisé la libération anticipée de nombreux condamnés – dont celle de « clients » pour le terrorisme. Cette libération est assortie d’une probation, mais, chaque agent de probation étant chargé de 60 à 70 anciens détenus, aucun n’est effectivement suivi. Tenir le fichier des terroristes ou de ceux qui ont un lien avec le terrorisme dans cette population particulière me semble vital.
S’agissant enfin de la coopération européenne en ces matières, la commission des affaires étrangères a entendu M. Didier Le Bret, coordonnateur national du renseignement, le 8 décembre 2015. Il revenait d’un conseil de défense, au lendemain duquel avait eu lieu la première réunion des chefs des services de renseignement de l’Union européenne jamais organisée, ce qui signifie que les services de renseignement des États membres ne se parlent pas. Il est illusoire de penser que les informations remontraient à M. Gilles de Kerchove, coordinateur de l’Union européenne pour la lutte contre le terrorisme : pas un service de renseignement européen ne le fera. Autant dire que la communauté européenne du renseignement n’existe pas. Il faut donc être bon en interne, et avoir des contacts avec les pays clefs que sont la Belgique mais aussi la Turquie et la Syrie – et là se posent, comme je l’ai dit, des questions de politique étrangère.
M. le président Georges Fenech. Nous discuterons évidemment ces questions avec les services de renseignement, Europol, Eurojust et les instances européennes.
M. Marc Trévidic. Tout service de renseignement a la culture du secret et il lui est par nature difficile de partager ses informations, que ce soit avec un juge ou avec un autre service.
M. Serge Grouard. L’importance de la connexion des dossiers et de la préservation de la mémoire des affaires ne saurait être sous-estimée. Toutes nos propositions, aussi bonnes soient-elles, resteront lettre morte si la gouvernance et les outils opérationnels ne sont pas définis qui permettent leur mise en œuvre efficace. À ce jour, des informations disparaissent à mesure que ceux qui ont bouclé les dossiers changent d’affectation, ou parce que les données ne sont pas saisies, ou encore parce que les moteurs de recherche ne sont pas performants ni même, parfois, compatibles entre eux. Chacun doit donc se débrouiller. Cet ensemble ne résulte pas obligatoirement d’une volonté délibérée des uns ou des autres ; il faut revoir dans son ensemble un système inadapté. Tous les services en ont besoin.
Avez-vous été menacé, monsieur le juge, et si oui, avez-vous été protégé ? Certains de vos collègues ont-ils, dans l’exercice de vos fonctions délicates, fait l’objet de menaces ou de pressions ? Est-ce à craindre ?
M. Marc Trévidic. J’ai eu des gardes du corps pendant dix ans. J’ai cessé d’en avoir le 28 août 2015, date à laquelle j’ai rendu les clefs de mon bureau parisien, puisqu’ils ne sont pas attachés à l’homme mais à la fonction. Si j’étais en danger jusqu’au 28 août 2015, l’étais-je moins le 29 août ? Je vous laisse en juger. Mais beaucoup de gens doivent être protégés, et il y a là une question budgétaire. Je ne me suis jamais senti véritablement menacé. J’ai reçu quelques lettres et courriels menaçants de divers abrutis, mais cela ne m’a pas inquiété outre-mesure. À l’étranger, dans des périodes difficiles, au Liban notamment, ce qui devait être fait l’a été. Et, étant donné les atrocités que peuvent commettre les terroristes, s’ils s’en prennent à un individu en particulier, c’est un moindre mal…
M. François Lamy. Je souhaite revenir sur le parallèle qui a été fait entre la situation à Molenbeek et la situation en France, de manière que l’on s’entende sur les termes. Pour avoir été ministre délégué à la ville, je suis pleinement conscient de ce que l’on ne peut entrer dans certains quartiers sans que tout le monde sache immédiatement que la police est là, mais la difficulté du travail des forces de l’ordre tient au trafic de stupéfiants et au banditisme. Dites-vous que l’on ne peut pénétrer dans certaines zones parce qu’elles sont entièrement contrôlées par les salafistes ? Ce n’est pas la même chose.
M. Marc Trévidic. Il existe, si vous permettez ce néologisme, des zones très « salafisées », et ceux qui y vivent savent qu’ils y seront en sécurité. J’ai parlé de Trappes mais c’est également vrai à Toulouse, comme le prouvent les hommages à Mohamed Merah écrits sur certains murs. Il ne faut pas se leurrer, ce n’est pas depuis ces zones-là que quelqu’un appellera le numéro vert pour signaler que son voisin se radicalise ! Donc, oui, il existe en France des zones contrôlées par les salafistes, mais elles n’ont sans doute pas l’étendue de Molenbeek, qui compte 100 000 habitants. En certains lieux, on restera neutres. Mon propos n’était pas polémique, c’était le constat d’un praticien. J’estime qu’il n’est pas anodin qu’en matière terroriste on ne puisse pas aller travailler en certains lieux, raison pour laquelle les personnes recherchées iront s’y réfugier.
M. François Lamy. Je peux citer quatre ou cinq quartiers de ce type en France, mais on est loin de la centaine, et je ne pense pas que Molenbeek soit un exemple judicieux pour qui veut lutter contre le terrorisme en France.
M. Marc Trévidic. Mieux vaut, pour agir, être pessimiste et se dire que l’on n’en est pas loin.
M. le président Georges Fenech. Je vous remercie.
Audition, à huis clos, de M. Vincent Le Gaudu, vice-président chargé de l’application des peines au TGI de Paris
Compte rendu de l’audition, à huis clos, du mercredi 6 avril 2016
M. le président Georges Fenech. Nous recevons M. Vincent Le Gaudu, vice-président chargé de l’application des peines au tribunal de grande instance (TGI) de Paris. Votre audition, monsieur le président, s’inscrit dans la suite de celles de magistrats, de procureurs, de juges d’instruction, de présidents de chambre, de présidents de cour d’assises, des présidents de la 16e chambre du TGI de Paris. Nous allons avec vous poursuivre nos investigations sur la question plus particulière de l’application des peines et sur les moyens dont vous disposez et sur la pertinence des dispositions que vous mettez en œuvre.
Cette audition, en raison de la confidentialité des informations que vous êtes susceptibles de nous délivrer, se déroule à huis clos. Elle n’est donc pas diffusée sur le site internet de l’Assemblée. Néanmoins, et conformément à l’article 6 de l’ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, son compte rendu pourra être publié en tout ou partie, si nous en décidons ainsi à l’issue de nos travaux. Je précise que les comptes rendus des auditions qui auront eu lieu à huis clos seront au préalable transmis aux personnes entendues afin de recueillir leurs observations. Ces dernières seront soumises à la commission, qui pourra décider d’en faire état dans son rapport. Je rappelle que, conformément aux dispositions du même article, « sera punie des peines prévues à l’article 226-13 du code pénal » – un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende – « toute personne qui, dans un délai de vingt-cinq ans […], divulguera ou publiera une information relative aux travaux non publics d’une commission d’enquête, sauf si le rapport publié à la fin des travaux de la commission a fait état de cette information ».
Conformément aux dispositions de l’article 6 précité, je vais maintenant vous demander de prêter le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité.
Veuillez lever la main droite et dire : « Je le jure. »
M. Vincent Le Gaudu prête serment.
M. Vincent Le Gaudu, vice-président chargé de l’application des peines au tribunal de grande instance de Paris. Je rappellerai le cadre légal de mon intervention : la fonction de juge d’application des peines compétent en matière de terrorisme a été créée par la loi du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers, M. Pascal Clément étant garde des sceaux. L’article 14 de cette loi, devenu l’article 706-22-1 du code de procédure pénale, dispose que, « par dérogation aux dispositions de l’article 712-10, sont seuls compétents le juge de l’application des peines du tribunal de grande instance de Paris, le tribunal de l’application des peines de Paris et la chambre de l’application des peines de la cour d’appel de Paris pour prendre les décisions concernant les personnes condamnées pour une infraction entrant dans le champ d’application de l’article 706-16 », à savoir les actes de terrorisme, cela « quel que soit le lieu de détention ou de résidence du condamné ». Ce même article prévoit que « pour l’exercice de leurs attributions, les magistrats des juridictions mentionnées au premier alinéa peuvent se déplacer sur l’ensemble du territoire national, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 706-71 sur l’utilisation de moyens de télécommunication ».
En adoptant ce texte, le législateur a manifesté la volonté de centraliser auprès des juridictions de l’application des peines de Paris le suivi de toutes les personnes condamnées pour des faits de terrorisme, quel que soit leur lieu de résidence ou de détention, probablement dans le but d’aboutir à une jurisprudence unifiée et à un traitement plus homogène des situations pénales des condamnés, qui relevaient auparavant de différents juges d’application des peines sur tout le territoire national. En outre, sur le plan pratique, ces dispositions ont sans doute été prises pour éviter les extractions de détenus particulièrement surveillés et pour limiter les déplacements des magistrats par le recours aux moyens de télécommunication audiovisuels.
Une fois ce cadre légal rappelé, il convient d’avoir à l’esprit que l’application des peines, en matière de terrorisme, fonctionne selon certaines dispositions particulières. D’abord, il s’agit d’une juridiction dont la compétence est exclusive et non concurrente comme c’est le cas pour les juridictions locales en matière d’instruction et de jugement. Cette compétence exclusive n’en est pas moins quelque peu limitée par les textes puisque, sauf dans les hypothèses d’urgence, je dois, à chaque fois que je prends une décision, prendre préalablement l’avis du juge d’application des peines du lieu d’écrou du condamné ou, s’il est libre, de son lieu de résidence. D’où la pratique des doubles dossiers, à la fois chez le juge d’application des peines territorialement compétent, et chez le juge d’application des peines de Paris – ce qui complique un peu les choses.
Ce principe de centralisation impose au juge d’application des peines compétent en matière de terrorisme de présider, habituellement, les commissions d’application des peines (CAP) dans les différents établissements pénitentiaires, c’est-à-dire sur tout le territoire national, lorsque doivent être examinées des demandes relatives aux permissions de sortie, aux réductions de peine supplémentaires ou à l’examen des crédits de réduction de peine. À cette fin, je me déplace – je vais assez régulièrement en Corse car vous savez probablement que la plupart des condamnés de la mouvance corse exécutent leur peine à Borgo –, mais je peux également utiliser la visioconférence – ce qui est le plus fréquent –, notamment lorsque je dois présider des CAP pour plusieurs condamnés qui purgent leur peine dans un même établissement. Je préside ainsi des CAP en visioconférence avec le parquet de Paris pour le centre pénitentiaire de Lannemezan, la maison centrale de Saint-Maur, la maison d’arrêt de Fresnes, le centre de détention de Tarascon… Enfin, surtout au cas où l’établissement concerné n’a qu’un seul condamné pour des faits de terrorisme et afin d’éviter les lourdeurs administratives, le juge d’application des peines local peut me remplacer et présider la CAP ; dès lors, il émet un avis qu’il me transmet et je statue par ordonnance.
En ce qui concerne les débats d’aménagement de peine, le code de procédure pénale prévoit qu’ils ont lieu au tribunal de grande instance de Paris, donc en présence du parquet de Paris. Ils se tiennent en général par visioconférence avec l’établissement pénitentiaire où se trouve le condamné ; toutefois, des déplacements, avec le parquet de Paris, sont régulièrement organisés quand les circonstances l’exigent et plus particulièrement lorsque nous avons affaire à une première demande pour un condamné qui purge une peine particulièrement lourde. Dès lors, donc, le tribunal d’application des peines – à savoir le juge, les assesseurs, les représentants du parquet et du greffe – se déplace dans l’établissement pour tenir le débat contradictoire. J’ai ainsi présidé un tribunal d’application des peines au centre pénitentiaire de Lannemezan pour examiner la demande de libération conditionnelle de Georges Ibrahim Abdallah. Je préside également des débats contradictoires lorsque, dans un même établissement, plusieurs condamnés ont fait des demandes.
Il me paraît en outre nécessaire que nous nous déplacions lorsqu’une demande de suspension de peine pour raisons médicales nous est soumise : il est important, pour statuer, de voir physiquement le condamné, de constater ses conditions de détention. Je me suis ainsi rendu récemment à la maison centrale de Rennes à la suite d’une telle demande formulée par une condamnée basque, Mme Guimon.
Il faut par ailleurs retenir que j’ai de multiples interlocuteurs : je suis seul à Paris pour gérer tous les condamnés pour des faits de terrorisme, mais j’ai vocation à travailler avec les quelque 95 services pénitentiaires d’insertion et de probation (SPIP) de France, en fonction du lieu d’incarcération des condamnés ou de leur lieu de résidence s’ils ont été libérés. Je travaille également avec 40 établissements pénitentiaires où des condamnés purgent une condamnation pour des faits de terrorisme. Je travaille en outre avec des experts psychologues, des experts psychiatres de toutes les cours d’appel. Ce n’est pas sans difficulté, car les prises en charge sont plus ou moins homogènes d’un SPIP ou d’un établissement pénitentiaire à l’autre.
Je vais maintenant vous donner quelques éléments chiffrés sur le fonctionnement de mon cabinet. Lorsque la juridiction de l’application des peines de Paris a été instituée, en 2006, la chancellerie a créé deux postes : un poste de juge d’application des peines compétent en matière de terrorisme et un poste de substitut. Le cabinet s’est dès lors vu attribuer le suivi de 111 condamnés pour des faits de terrorisme. En décembre 2015, on comptait 240 condamnés suivis par mon cabinet, ce qui représente une hausse de 26 % par rapport à 2014 – elle était de 43 % l’année précédente par rapport à 2013. L’augmentation du nombre de condamnés pris en charge est donc massive et rapide, ce nombre atteignant, à l’heure actuelle, 264 condamnés.
M. Sébastien Pietrasanta, rapporteur. Combien sont issus de la filière djihadiste ?
M. Vincent Le Gaudu. J’y reviendrai dans un instant.
Sur les 240 condamnés que je suivais en décembre 2015, 181 sont suivis en milieu fermé, qu’il s’agisse des établissements pénitentiaires, des placements sous surveillance électronique, pour onze d’entre eux, ou des semi-libertés pour un condamné. Les 59 autres condamnés sont suivis en milieu ouvert, essentiellement sous le régime de la libération conditionnelle, en général après une période probatoire ; une quinzaine d’entre eux sont en sursis avec mise à l’épreuve – ils sont de plus en plus nombreux dans ce cas, avec des condamnations mixtes prononcées par le tribunal correctionnel de Paris – ; enfin, on dénombre cinq interdictions de séjour et une suspension médicale de peine.
M. le président Georges Fenech. Et aucune contrainte pénale ?
M. Vincent Le Gaudu. Non, aucune contrainte pénale n’a été prononcée par la 16e chambre du TGI de Paris.
M. le président Georges Fenech. Comment cela se fait-il ?
M. Vincent Le Gaudu. Cela paraît probablement assez peu adapté à la population pénale concernée.
Pour répondre à votre question, monsieur le rapporteur, sur l’ensemble de ces condamnés pour des faits de terrorisme, 38 % de ceux suivis par mon cabinet appartiennent à la mouvance islamiste : 64 sont suivis en milieu fermé et une vingtaine en milieu ouvert. Pour vous donner un élément de comparaison, les condamnés de la mouvance basque représentent encore 35 % du total et ceux de la mouvance corse un peu plus de 12 %, le reste étant composé de condamnés liés au Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), au Parti-Front révolutionnaire de libération du peuple (DHKP-C) et aux Tigres tamouls, sans oublier quelques cas liés à Action directe.
La forte croissance du nombre de condamnés suivis par mon cabinet devrait encore s’accélérer en 2016, en raison de la multiplication des audiences correctionnelles au tribunal correctionnel de Paris pour des faits de terrorisme en lien avec le djihadisme. La loi du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme a inclus dans ma sphère de compétence - ce qui, à mon avis, n’est pas une très bonne chose – les faits de provocation et d’apologie d’un acte de terrorisme qui relevaient auparavant du droit commun et de la loi sur la liberté de la presse.
Parallèlement à la hausse très significative du nombre de condamnés suivis, on relève une hausse non moins importante du nombre de demandes d’aménagement de peine, de jugements et d’ordonnances rendues.
J’ai constaté, au cours de ces deux dernières années, que les condamnés de la mouvance islamiste sont très demandeurs d’aménagements de peine, contrairement, par exemple, aux Basques. En général, d’ailleurs, la durée de leur détention provisoire leur permet, au moment où ils passent en jugement, de prétendre à un aménagement de peine presque immédiatement après l’audience.
Par ailleurs, la loi du 15 août 2014 relative à l’individualisation des peines et renforçant l’efficacité des sanctions pénales – en particulier sa disposition imposant l’examen systématique de la situation des condamnés aux deux tiers de leur peine – a considérablement affecté le fonctionnement de mon cabinet.
J’en viens à quelques pistes de réflexion. D’abord, en matière d’aménagement de peine, la législation en vigueur pour les condamnés pour faits de terrorisme est la législation de droit commun. Cela signifie que la législation actuelle ne prévoit pas de critère d’ordre public permettant d’écarter une demande au motif que la personne est condamnée pour des faits de terrorisme et qu’il y a un risque de trouble à l’ordre public. Il faut en effet savoir que, souvent, les condamnés appartenant à la mouvance islamiste ne posent pas de difficultés particulières en détention et que leurs demandes d’aménagement de peine sont recevable sur le fond : ces personnes sont assez bien insérées socialement, leurs familles proposent de les accueillir, elles sont bien insérées professionnellement – les propositions d’embauche, que je vérifie par l’intermédiaire des services de police ou des services pénitentiaires d’insertion et de probation, sont solides. Enfin, il ne faut pas omettre que ces condamnés sont épaulés par de très bons avocats : à Paris, pour les demandes formées devant le juge d’application des peines, la pratique consiste à désigner systématiquement, au titre de la commission d’office, des secrétaires de la conférence des avocats du barreau. Aussi est-il bien souvent difficile de trouver des arguments juridiques pour écarter les demandes.
C’est pourquoi il serait sans doute souhaitable d’introduire dans la législation un critère d’ordre public permettant d’écarter certaines demandes. En effet, en recevant ces condamnés à l’audience, lors des débats contradictoires, malgré un dossier solide, malgré une bonne promesse d’insertion sociale, professionnelle et familiale, le parquet et nous-mêmes avons parfois de réelles inquiétudes…
Quand il est fait droit aux demandes d’aménagement de peine, elles prennent la forme presque exclusive de libérations conditionnelles assorties de mesures probatoires préalables, à savoir, le plus fréquemment, des placements sous surveillance électronique, ou bien, plus rarement, des semi-libertés probatoires. Quand les libérations conditionnelles sont accordées sous ce régime, le délai d’épreuve est systématiquement allongé de façon à permettre un suivi plus long, ce qui a néanmoins pour conséquence, pour les services pénitentiaires d’insertion et de probation dont on connaît les faibles moyens, une charge plus lourde.
M. Pierre Lellouche. Combien d’agents de probation compte-t-on, et pour combien de personnes concernées ?
M. Vincent Le Gaudu. Je travaille avec 95 SPIP, puisque les condamnés sont répartis sur l’ensemble du territoire national. Je travaille plus avec certains qu’avec d’autres – je pense aux services pénitentiaires de Corse, du Pays Basque ou de la région parisienne. Dans chaque service pénitentiaire, ce sont en général les plus aguerris, les plus solides qui sont désignés pour le suivi des condamnés pour faits de terrorisme, ce qui n’exclut pas une certaine hétérogénéité dans leur prise en charge selon qu’on se trouve, par exemple, dans la Creuse ou dans les Yvelines.
Pour en revenir au placement sous surveillance électronique, il s’agit de l’outil d’aménagement de peine le plus souvent utilisé. S’il est intéressant, il a ses limites : il est difficilement supportable et supporté par les condamnés sur de très longues périodes ; ensuite, il n’assure pas la déradicalisation des individus concernés – la surveillance électronique, ce n’est que la prison à la maison…
M. Pierre Lellouche. Ils sont libres de huit heures à vingt heures et le week-end aussi, c’est bien cela ?
M. Vincent Le Gaudu. Non, pas les week-ends, en tout cas pas pour les dossiers traités par mon cabinet. Ils sont placés sous surveillance électronique en fonction de leurs horaires de travail : le temps du trajet depuis le domicile jusqu’au lieu de travail et le temps de travail proprement dit sont seuls pris en compte. Le reste du temps, ils doivent être chez eux et, le week-end, ils peuvent sortir pour faire du sport, moyennant un justificatif et pour un temps très réduit : deux heures le samedi et deux heures le dimanche ou bien quatre heures le seul samedi.
M. Pierre Lellouche. Avez-vous la preuve qu’ils travaillent ?
M. Vincent Le Gaudu. Je fonctionne différemment du service de droit commun : les contrôles sont beaucoup plus soutenus. D’une part, le régime horaire est différent et, d’autre part, les vérifications sont régulièrement opérées par le SPIP à ma demande. Il n’est pas rare que j’envoie les services de police pour vérifier que la personne qui bénéficie d’un aménagement de peine se trouve bien sur son lieu de travail à l’heure où elle doit s’y trouver. Sinon, bien sûr, nous n’en aurons jamais la certitude.
M. le président Georges Fenech. Que je comprenne bien : combien êtes-vous de magistrats au tribunal d’application des peines spécialisés aux termes de l’article 706-22-1 du code de procédure pénale ?
M. Vincent Le Gaudu. Moi-même, c’est tout.
M. le président Georges Fenech. C’est-à-dire que vous seul gérez toute cette population ? Vous êtes seul ?
M. Vincent Le Gaudu. En effet, je suis complètement seul.
M. le président Georges Fenech. Cette situation vous paraît-elle normale ?
M. Vincent Le Gaudu. Non, mais lors de la dernière visite de la garde des sceaux, Mme Taubira, après les attentats de janvier 2015, puis après les attentats de novembre 2015, il m’a été promis la création d’un second poste de juge d’application des peines compétent en matière de terrorisme. Je dois dire que, pour le moment, la Chancellerie n’a pas pourvu ce poste puisque, si un poste supplémentaire a bien été créé, il a été attribué à une personne qui avait une décharge syndicale à temps complet.
M. le président Georges Fenech. C’est extraordinaire !
M. Vincent Le Gaudu. Si le poste en question n’a donc pas été créé par la Chancellerie, il l’a été, en revanche, par le président de la juridiction : le président du TGI de Paris a en effet décidé qu’à la rentrée de septembre, un second poste serait créé, pris sur les effectifs de l’application des peines de droit commun. Donc, en septembre, nous serons deux.
M. le président Georges Fenech. Nous en avons bien pris note.
Vous avez bien rappelé le dispositif légal dérogatoire au droit commun – aux termes de l’article 706-22-1 du code de procédure pénale – dans le cadre duquel vous travaillez, et, en même temps, vous nous expliquez que vous appliquez les mêmes textes que ceux applicables aux condamnés de droit commun. Puis vous lancez une piste de réflexion selon laquelle il faudrait introduire un critère dérogatoire, qui serait celui de l’ordre public, pour refuser, éventuellement, une libération conditionnelle aux deux tiers de la peine, l’examen de la demande de cet aménagement étant désormais automatique.
Ne croyez-vous pas que, si nous introduisions ce critère, que de nombreux avocats contestent comme étant pour le moins fourre-tout, et plutôt flou – comment apprécier le trouble à l’ordre public ? –, cela reviendrait à vous donner non pas trop de pouvoir mais une trop grande responsabilité, celle d’apprécier par vous-même, seul, le trouble à l’ordre public ? N’estimez-vous pas préférable de légiférer pour instaurer un dispositif plus objectif en matière d’aménagement des peines pour les terroristes ? Ne pensez-vous pas qu’il faudrait revenir sur l’alignement des primo-délinquants et des récidivistes en matière de crédit de réduction de peine et de réduction de peine ?
En effet, on voit bien, en lisant la presse, que nos concitoyens s’interrogent : Amedy Coulibaly a été condamné en 2013 à cinq ans d’emprisonnement ; il aurait donc dû sortir en 2018, sauf imputation des délais de détention provisoire ; or il s’est passé ce que nous savons, en janvier 2015, à l’Hyper Cacher de la porte de Vincennes. S’il n’avait pas été libéré… Vous connaissez la suite du raisonnement qu’on tient habituellement. Il est vrai que les juges d’application des peines sont confrontés à ce risque à chaque fois qu’ils remettent quelqu’un en liberté, non pas prématurément, mais dans le cadre des aménagements de peine.
Vous êtes donc demandeur d’un critère de trouble à l’ordre public, mais celui-ci vous mettrait seul face à une responsabilité très lourde car, le jour où vous aurez décidé de remettre en liberté tel terroriste parce que vous considérez qu’il ne menace pas l’ordre public, si celui-ci récidive le lendemain, vous aurez la France entière contre vous !
M. Vincent Le Gaudu. Je comprends parfaitement. Je pense davantage, pour être précis, au risque de trouble à l’ordre public. En outre, les critères de la libération conditionnelle sont particulièrement flous, mais ils ne nous permettent pas, ni au parquet ni à moi-même, de refuser des aménagements de peine qui « tiennent la route ». Si, en effet, un condamné se comporte parfaitement bien en détention, fait des efforts de réinsertion évidents, en travaillant, ou en suivant des cours, voire une formation qualifiante à l’extérieur, s’il présente ensuite un projet solide, s’il peut certifier qu’il disposera d’un logement, nous serons, juridiquement parlant, en grande difficulté pour refuser un aménagement de peine alors que, dans certains cas, nous sommes légitimement inquiets en raison de ce qui s’est dit – et surtout de ce qui n’a pas été pas dit – au cours de l’audience.
Il faudrait s’efforcer de définir un dispositif plus précis ; la définition de la libération conditionnelle, aux termes de l’article 729 du code de procédure pénale, n’est aujourd’hui pas très claire : il est question de bonnes perspectives de réinsertion, de réadaptation sociale… Cette imprécision laisse beaucoup de pouvoir au juge. C’est pourquoi je souhaite l’ajout d’un critère plus strict et spécifique à cette catégorie de condamnés, même s’il convient, certes, de le définir.
M. le président Georges Fenech. Sans aller jusqu’à introduire ce critère, on pourrait imaginer la suppression de tout aménagement de peine pour les faits de terrorisme.
M. Vincent Le Gaudu. La question m’a été posée à plusieurs reprises. Vous avez évoqué l’alignement entre récidivistes et non-récidivistes. En tant que juge d’application des peines, j’ai été choqué par cette mesure : ce n’est pas du tout la même chose d’avoir affaire à une personne condamnée à plusieurs reprises ou à un primo-délinquant. Cet alignement a sans doute été mal vécu ailleurs qu’au sein de mon cabinet.
M. le président Georges Fenech. Pourquoi ?
M. Vincent Le Gaudu. Parce que des personnes, du jour au lendemain, sont devenues admissibles au régime de la libération conditionnelle ; parce que des personnes, du jour au lendemain, ont bénéficié de crédits de réduction de peine importants alors que, manifestement, on n’avait constaté aucun changement dans leur comportement en détention. Notre travail consiste à aménager les peines en fonction des parcours individuels, et lorsque, d’un seul coup, les règles sont modifiées, le fonctionnement d’un cabinet s’en trouve affecté.
M. le président Georges Fenech. Et en ce qui concerne l’idée de supprimer tout aménagement de peine pour des faits de terrorisme ?
M. Vincent Le Gaudu. Je pense sincèrement qu’il ne s’agit pas de la bonne solution. Il faudrait par contre prévoir un critère de temps différent. Actuellement, lorsque nous examinons des demandes à mi-peine, nous savons pertinemment, le condamné comme le tribunal d’application des peines, que la démarche est vaine en raison de la jurisprudence de la cour d’appel de Paris selon laquelle il faut attendre un certain niveau d’exécution de la peine pour pouvoir obtenir un aménagement.
M. le rapporteur. Vous décidez en fonction de critères objectifs que vous avez rappelés, mais aussi en fonction de vos impressions d’audience. Quelle est la part de ces dernières dans votre choix final ?
Nous nous trouvions lundi dernier à la maison d’arrêt de Fresnes, et plusieurs responsables nous ont fait part de l’importance croissante de la pratique de la takiya, c’est-à-dire de la stratégie de dissimulation à laquelle recourent de nombreux détenus, qui s’efforcent, pour sortir plus tôt de prison, de paraître vouloir se réinsérer tout en gardant, au fond d’eux-mêmes, leurs convictions.
Avez-vous été confronté à des condamnés qui ont été détenus dans le quartier dédié de la maison d’arrêt de Fresnes ? Quel est votre sentiment sur la question ?
M. Vincent Le Gaudu. En ce qui concerne les débats contradictoires qui ont lieu devant moi ou devant le tribunal d’application des peines, il est en effet tenu compte du dossier et des impressions d’audience. Ces dernières, pour les faits de terrorisme, sont très importantes, car les débats sont très longs. Chaque audience devant un tribunal d’application des peines dure en moyenne une heure et demie ou deux heures par condamné, ce qui permet dans une certaine mesure de se faire une opinion sur la stratégie de celui-ci, et j’ai en effet constaté, notamment parmi les condamnés de la mouvance islamiste, une volonté de dissimulation évidente.
M. le rapporteur. Ils ont un discours rodé.
M. Vincent Le Gaudu. En effet, et ce phénomène est assez récent. Les anciens du Groupe islamique armé (GIA), eux, ne dissimulent rien du tout. En revanche, les condamnés de la mouvance islamiste en lien avec le djihadisme adoptent, au cours de leur détention mais aussi, a fortiori, pour les audiences de débat contradictoire, un profil complètement lisse ; d’où l’importance de ces débats car, au bout d’un certain temps, on finit par percevoir certains détails. Il est difficile néanmoins de retranscrire les impressions d’audience : on ne peut pas rejeter une demande d’aménagement de peine en s’appuyant uniquement sur elles. Il faut expliquer pourquoi on la rejette et faire état de critères légaux, car une impression d’audience n’est pas un critère légal.
Nous sommes donc parfois confrontés à une personne qui présente un projet parfait, au parcours en détention sans aspérité, mais sur laquelle il manque des informations. C’est une expérience que, comme le parquet de Paris, je vis depuis plusieurs mois, et assez difficilement. Après ces audiences, nous avons « froid dans le dos » – c’est vraiment l’expression qui convient –, et pourtant le dossier est parfait.
M. le président Georges Fenech. Et en ce qui concerne les quartiers dédiés ?
M. Vincent Le Gaudu. Il faut distinguer entre, d’une part, les quartiers dédiés de Fleury-Mérogis, d’Osny et de Lille-Annœullin, et, d’autre part, l’expérience, plus empirique, menée à Fresnes. Je suis allé à la maison d’arrêt du Val-d’Oise, à Osny, pour examiner les projets de l’unité dédiée : l’équipe a lancé, pour commencer, un programme action recherche de déradicalisation qui me paraît assez sérieux. Cette unité, comme celle de Fleury-Mérogis, paraît bien fonctionner, en tout cas pour le début de la prise en charge. Quant à Fresnes, il ne s’agit pas vraiment d’une unité dédiée, mais d’un quartier à part, qui n’est pas complètement fermé : les promenades se font avec les autres condamnés de droit commun.
M. le président Georges Fenech. C’est toujours le cas ?
M. Vincent Le Gaudu. Oui. Aussi l’expression de « quartier dédié » ne me semble-t-elle pas adéquate s’agissant de Fresnes.
M. le rapporteur. Je connais très bien la maison d’arrêt d’Osny, où je me suis rendu à plusieurs reprises et où, au printemps dernier, une quinzaine de détenus ont participé à un programme de déradicalisation. Parmi les arguments avancés par les détenus pour demander un aménagement de peine, certains ont-ils fait valoir qu’ils avaient participé à un programme de déradicalisation ?
M. Vincent Le Gaudu. Pas encore. La direction du SPIP a posé comme préalable que les condamnés ne devaient pas attendre quelque avantage que ce soit de leur participation à un programme de déradicalisation, faute de quoi ces programmes ne manqueraient pas d’être instrumentalisés. Il n’a donc été promis ni réduction de peine supplémentaire ni bénéfice secondaire en cas de participation.
On pourrait réfléchir à l’idée de subordonner des mesures de libération conditionnelle à la participation, par exemple, à un programme de déradicalisation, mais à condition qu’il soit adapté à la personne concernée.
M. le rapporteur. Un second type de centre de déradicalisation est en préparation. Il serait entre les mains de la justice et permettrait d’éviter les sorties sèches. Que pensez-vous d’un tel dispositif ?
M. Vincent Le Gaudu. Je participe à un groupe de travail, à la Chancellerie, sur cette question. On pourrait très bien envisager, les textes le permettent, le passage par ces centres de désengagement – terme que je préfère à celui de déradicalisation – sous forme de placement extérieur. C’est le dispositif vers lequel nous nous orientons pour les condamnés pour faits de terrorisme purgeant des peines modérées. Il s’agit d’une bonne idée à creuser.
M. Jean-Michel Villaumé. Comment pouvez-vous évaluer la dangerosité d’un terroriste djihadiste qui pratique la dissimulation ?
Je souhaite également vous entendre sur l’échelle des peines, et en particulier sur ce qu’on appelle la perpétuité réelle.
M. Vincent Le Gaudu. Avec les services pénitentiaires d’insertion et de probation, en établissement ou à l’extérieur, nous tâchons de vérifier l’authenticité du discours tenu par le condamné, afin de n’être pas complètement dupes de certaines stratégies. Reste que nous manquons de moyens : ces évaluations ne peuvent être réalisées que par des équipes pluridisciplinaires. Il était question, à une époque, de faire passer les condamnés demandant un aménagement de peine par un centre national d’évaluation. La formule retenue des unités dédiées est un peu différente, mais l’idée demeure de faire intervenir des équipes pluridisciplinaires.
J’insiste particulièrement sur le positionnement du condamné à l’égard des faits qu’il a commis. Cela va en effet du déni à la reconnaissance, en passant par la reconnaissance partielle. On note, dans le temps, des évolutions, et cette dynamique est importante : passer du déni à la reconnaissance est un bon signe car on peut parler de prise de conscience. En revanche, quand le condamné se mure dans le déni, on peut estimer qu’il ne mène pas de réflexion personnelle sur le sens de sa condamnation. L’avantage, quand on intervient en tant que juge d’application des peines, c’est de pouvoir mesurer comment la condamnation est vécue, et surtout comprise. Tout cela demande beaucoup de temps.
Mme Françoise Dumas. Vous vous occupez de 264 dossiers ; or l’année ne compte que 365 jours et vous êtes seul. Vous nous indiquez de surcroît que vous avez besoin de disposer d’une équipe pluridisciplinaire pour vous aider à prendre la bonne décision. Depuis quand êtes-vous seul ?
M. Vincent Le Gaudu. Depuis toujours.
Mme Françoise Dumas. À aucun moment vous ne vous êtes retrouvés à deux ?
M. Vincent Le Gaudu. Non.
Mme Françoise Dumas. Donc, vous êtes seul à traiter 264 dossiers, vous êtes dépourvu d’équipe pluridisciplinaire… Aussi ne faut-il pas qu’il vous arrive quoi que ce soit. Je ne vois pas comment vous pouvez ne pas vous mettre en difficulté, notamment en matière de sécurité. Je trouve cette situation assez dangereuse, pour vous, certes, mais aussi pour nous.
M. Vincent Le Gaudu. Je suis heureux de vous l’entendre dire. Reste que les décisions importantes sont prises par le tribunal d’application des peines, où nous sommes trois, si cela peut vous rassurer. Il est vrai néanmoins que, pour les compétences relevant du juge d’application des peines, c’est-à-dire pour les peines inférieures à dix ans, je suis complètement seul, ce qui n’est pas sans poser certaines difficultés, notamment quand je suis en formation ou en congé – auquel cas mes collègues chargés du droit commun traitent les urgences, et seulement les urgences. C’est pourquoi, je vous l’ai dit, le président du TGI a décidé de m’adjoindre un collègue à la rentrée, collègue qui sera prélevé sur le service général puisque la Chancellerie, manifestement, n’a pas encore créé le poste.
Il est vrai que c’est difficile. Je ne dispose d’aucune protection. Quand je me déplace dans un établissement pénitentiaire, j’y vais avec le parquet et ma greffière. Nous sommes plus ou moins bien accueillis selon les établissements et il est vrai que, quand je me rends en Corse, je ne suis pas forcément rassuré.
Pour ce qui concerne les islamistes, si la plupart sont incarcérés, certains sont sous le régime du milieu ouvert et purgent des peines de placement sous surveillance électronique – ce qui n’est certes pas toujours facile.
M. le président Georges Fenech. Nous comprenons parfaitement qu’il y ait une spécialisation concernant les magistrats du parquet antiterroriste, le juge d’instruction, les magistrats des juridictions de jugement, puisqu’ils appliquent des textes dérogatoires au droit commun – en matière de garde à vue, de perquisition notamment – et qu’ils ont des contacts avec des services eux-mêmes spécialisés. Mais pour vous, juge d’application des peines, quelle est la justification d’une compétence exclusive et nationale, puisque vous appliquez exactement les mêmes règles que pour les condamnés de droit commun ? Pourquoi vous obliger à prendre des avions, à vous rendre en Corse, à aller dans les prisons basques ou ailleurs alors que, j’y insiste, vous appliquez les mêmes peines que vos homologues des autres juridictions ? Craint-on des décisions plus laxistes ? Craint-on que d’autres juges d’application des peines soient moins sensibilisés ou moins bien formés que vous au phénomène terroriste ?
M. Vincent Le Gaudu. Cette spécialisation se justifie surtout par la nécessité d’une jurisprudence unifiée et d’une prise en charge homogène. Avant la loi de 2006, les condamnés, selon qu’ils étaient écroués à Lannemezan ou à Poissy, n’étaient pas pris en charge par les mêmes juges d’application des peines et, selon les juridictions et surtout selon les cours d’appel, on constatait des jurisprudences divergentes.
M. le président Georges Fenech. Toutefois l’aménagement de peine répond au principe de l’individualisation et non à une règle d’uniformité…
M. Vincent Le Gaudu. Les parcours d’exécution de peine des condamnés pour des faits de terrorisme sont souvent longs, et ces condamnés passent par différents établissements pénitentiaires. Le fait que les dossiers soient centralisés à Paris permet d’avoir une vision complète de la prise en charge du début jusqu’à la fin.
M. le président Georges Fenech. D’où le maintien de la spécialisation. Vous traitez 264 dossiers ; quel est le nombre moyen de dossiers par juge d’application des peines ?
M. Vincent Le Gaudu. Pour un juge d’application des peines de droit commun, la moyenne se situe entre 600 et 800 dossiers.
M. le président Georges Fenech. Vous en avez donc moins…
M. Vincent Le Gaudu. Beaucoup moins, en effet ; on peut voir les choses ainsi. J’ajoute que la majorité des 800 dossiers concernent des personnes placées sous le régime du milieu ouvert.
M. François Lamy. Quels types de formations suivez-vous ? Vous traitez des dossiers de terroristes islamistes, corses, basques, liés aux Tigres tamouls… Au-delà du fait qu’ils ont peut-être tous eu le même mode opératoire ou la même volonté de commettre des attentats, il n’y a pas grand-chose de commun, en termes idéologiques, entre toutes ces personnes. Ne faudrait-il pas que vous soyez spécialisés, afin de mieux cerner le condamné ?
M. Vincent Le Gaudu. L’intérêt de mon travail est précisément de ne pas avoir à traiter que des personnes condamnées pour des faits similaires et appartenant à la même mouvance. La spécialisation d’un juge d’application des peines dans la prise en charge des islamistes, d’un autre dans la prise en charge des Basques, d’un troisième dans la prise en charge des Corses, ne me paraît pas une bonne idée, le risque étant précisément celui d’une trop grande personnalisation. Je suis en effet sans doute davantage perçu comme le représentant de l’institution judiciaire en étant « multicarte » alors que, si je ne traitais que la mouvance corse, je pourrais être davantage assimilé à un juge désigné spécialement pour faire face à la question corse.
Les régimes de prise en charge des condamnés pour des faits de terrorisme sont les mêmes, d’après la loi, que ceux prévus pour les condamnés de droit commun, mais la spécificité réside dans le fait que toutes les demandes d’aménagement de peine passent par moi, si bien que la jurisprudence est assez unifiée, ne serait-ce que pour les permissions de sortir et les réductions de peine supplémentaires. Les condamnés savent à peu près, ainsi, à quoi s’en tenir : ils s’attendent à obtenir telle ou telle réduction de peine supplémentaire et pas telle autre parce que, précisément, il y a une jurisprudence. S’il y avait des juges spécialisés par mouvance, nous aurions différentes jurisprudences, ce qui, je le répète, ne me paraît pas nécessairement une bonne chose.
Pour ce qui est des formations, je me suis formé « sur le tas ». J’ai exercé différentes fonctions au sein du système judiciaire français : j’ai été juge d’application des peines à Beauvais et à Paris pour les affaires de droit commun et, après ces expériences, on m’a demandé de prendre en charge le cabinet antiterroriste. Une formation aux différentes mouvances terroristes et à la prise en charge des condamnés pour faits de terrorisme est dispensée par l’École nationale de la magistrature (ENM) une fois par an pendant une semaine, que j’ai bien évidemment suivie.
M. le rapporteur. Avez-vous des échanges d’informations avec les services de renseignement ou pas du tout ? Par ailleurs, êtes-vous compétent pour traiter les affaires concernant les mineurs et quelles sont vos relations avec le juge des enfants ? Enfin, si vous êtes compétent, décelez-vous une évolution ?
M. Vincent Le Gaudu. Je rencontre régulièrement les services de renseignement de l’administration pénitentiaire. En revanche, je n’ai pas de liens avec les autres services de renseignement, à la différence de la section A2 du parquet de Paris qui a des contacts avec la section C1, laquelle prend en charge les actes de terrorisme et entretient des relations avec le renseignement.
M. le rapporteur. Pouvez-vous, dans votre décision, prendre en compte les informations des services de renseignement de l’administration pénitentiaire ? Vos échanges sont-ils informels ? Vous communiquent-ils des notes blanches ?
M. Vincent Le Gaudu. Je ne consulte pas les services de renseignement de l’administration pénitentiaire au cas par cas, pour éviter d’être conduit à disposer d’une information et ne pas pouvoir la traiter judiciairement et la mentionner dans ma motivation. En revanche, par l’intermédiaire des services pénitentiaires, j’ai des informations sur le comportement en détention de la personne qui peuvent m’être transmises par écrit et qui, dès lors, sont versées au dossier et alimentent le débat contradictoire.
Pour répondre à votre première question, c’est le juge des enfants qui est compétent concernant les personnes condamnées et suivies en étant mineures. Par contre, je suis compétent pour traiter le dossier d’une personne, mineure quand elle a été condamnée, une fois qu’elle est devenue majeure.
M. le président Georges Fenech. Il nous reste à vous remercier, monsieur le président, pour votre disponibilité.
Table ronde, ouverte à la presse, de syndicats de la presse : M. Jean Viansson- Ponté, président du Syndicat de la presse quotidienne régionale (SPQR), Mme Haude d’Harcourt, conseillère chargée des relations avec les pouvoirs publics, et M. Jacques Lallain, secrétaire général de la rédaction du Parisien ; M. Denis Bouchez, directeur du Syndicat de la presse quotidienne nationale (SPQN) ; M. Jean-Christophe Boulanger, président du Syndicat de la presse indépendante d’information en ligne (SPIIL)
Compte rendu de la table ronde, ouverte à la presse, du lundi 25 avril 2016
M. le président Georges Fenech. Nous poursuivons nos travaux en recevant aujourd’hui des représentants des médias, et tout d’abord des syndicats de la presse écrite. Nous accueillons ainsi M. Jean Viansson-Ponté, président du Syndicat de la presse quotidienne régionale (SPQR), accompagné de Mme Haude d’Harcourt, conseillère chargée des relations avec les pouvoirs publics, et de M. Jacques Lallain, secrétaire général de la rédaction du Parisien ; M. Denis Bouchez, directeur du Syndicat de la presse quotidienne nationale (SPQN) ; M. Jean-Christophe Boulanger, président du Syndicat de la presse indépendante d’information en ligne.
Je rappelle que cette table ronde est ouverte à la presse et fait l’objet d’une retransmission en direct sur le site internet de l’Assemblée nationale ; son enregistrement sera également disponible pendant quelques mois sur le portail vidéo de l’Assemblée nationale, et la commission pourra décider de citer dans son rapport tout ou partie du compte rendu qui sera fait de cette audition.
Conformément aux dispositions de l’article 6 de l’ordonnance du 17 novembre 1958, relatif aux commissions d’enquête, je vous demande de prêter le serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité.
M. Jean Viansson-Ponté, Mme Haude d’Harcourt, M. Jacques Lallain, M. Denis Bouchez et M. Jean-Christophe Boulanger prêtent serment.
M. Jean Viansson-Ponté, président du Syndicat de la presse quotidienne régionale (SPQR). La presse régionale et départementale, ce sont aujourd’hui 18 millions de lecteurs quotidiens pour l’imprimé et 18 millions de visiteurs uniques tous les mois pour la presse en ligne, ce qui signifie qu’avec ses 5 000 journalistes et ses 20 000 correspondants, elle est le premier vecteur d’information en France.
Pour ce qui concerne ses pratiques, elles n’ont pas substantiellement évolué sur le fond depuis le 7 janvier 2015. Il s’agit davantage pour nous de poursuivre une évolution qui repose sur une base solide : la réflexion déontologique de nos rédacteurs en chef qui, dès 1991, ont codifié nos règles et usages, lesquels figurent dans un document annexé aux statuts de notre syndicat. Ces règles et usages ont été considérablement revus en 2011 et font désormais l’objet d’un suivi par un observatoire, émanation de la commission de l’information de l’Union de la presse en région.
La presse quotidienne régionale traite essentiellement l’information de manière contradictoire, ce qui n’exclut pas, parfois, l’inquisitoire, mais donne à nos règles et usages, ordonnés autour des quatre piliers que sont l’exigence de rigueur, l’affirmation du respect de la personne, le respect de la présomption d’innocence et la pratique du droit de réponse, un caractère extrêmement concret qui implique que chaque journaliste embauché dans nos journaux en prenne connaissance.
Une autre des raisons pour lesquelles nous n’avons pas eu à modifier notre façon de faire en profondeur est que plusieurs événements survenus en régions avant 2015 – je pense notamment à AZF ou à l’affaire Merah – nous avaient déjà conduits à une réflexion sur la conduite à tenir dans des situations extrêmement sensibles.
En revanche, notre environnement évolue, lui, de manière de plus en plus rapide, du fait du développement de réseaux sociaux de plus en plus organisés, et il est important que les journalistes aient une bonne connaissance de la manière dont l’information est produite à travers ces circuits d’information et qu’ils soient parfaitement avertis des risques de dérive ou de manipulation que recèlent ces flux non contrôlés.
La force de nos 5 000 journalistes est précisément qu’ils sont formés à pratiquer leur métier sur une multiplicité de supports. L’information en continu n’est pas leur seule culture. Même si celle-ci répond à une forte attente des citoyens, ils travaillent en parallèle pour les différents canaux numériques et pour la presse papier, où, une fois les nouvelles imprimées, il n’y a plus de rémission possible.
Je ferai remarquer ici que, s’agissant des événements qui dépassent le champ local, nous sommes tributaires des agences, et notamment de la plus grande d’entre elles, l’Agence France Presse (AFP). Ainsi, il nous a fallu, pour couvrir les événements de Bruxelles et obtenir des photographies, attendre deux heures avant de disposer de données validées ; pendant ces deux heures, nous avons dû nous débrouiller et aller chercher l’information sur les réseaux sociaux, la vérifier, pour pouvoir ensuite la traiter, ce qui pose naturellement la question de notre réactivité et des délais de production de l’information.
Je voudrais également insister sur le fait que la loi du 13 novembre 2014 a sorti de la loi de 1881 le délit d’apologie du terrorisme pour l’introduire dans le code pénal, modifiant ainsi un cadre dont la pertinence et l’efficacité ne sont plus à prouver. Ce cadre, qui résulte d’équilibres internes jusqu’ici préservés, a fait ses preuves, et il ne saurait être modifié sans qu’ait été menée auparavant une réflexion approfondie sur les changements souhaitables, notamment en matière de délais de prescription. Or, si j’ai évoqué la loi du 13 novembre 2014, c’est précisément parce qu’elle est revenue sur les délais de prescriptions abrégés, qui faisaient partie des équilibres à préserver.
Au-delà de ces observations, il faut néanmoins souligner que, dans la situation difficile où nous sommes et malgré la mise en place de l’état d’urgence, aucune des libertés essentielles de la presse n’a été remise en cause, ce dont nous ne pouvons que nous féliciter.
M. le président Georges Fenech. Le procureur de Paris et le procureur de Bruxelles nous ont fait part de leur préoccupation et de leurs inquiétudes au sujet de fuites dans la presse écrite française, notamment sur l’identification de Salah Abdeslam avant son interpellation à Forest, alors que les médias belges, de leur côté, avaient respecté un gentlemen’s agreement et n’avaient pas diffusé l’information. Au-delà des grands principes que vous avez réaffirmés à juste titre, quel est votre sentiment sur ce problème, sachant que nous parlons ici d’attaques terroristes ? Ne pensez-vous pas qu’il y a un équilibre à trouver entre la liberté de l’information et le respect de l’enquête en cours ? Avez-vous, depuis les attentats de janvier 2015, procédé à des retours d’expérience ? Avez-vous revu les règles et usages qui codifient la diffusion de ce type d’informations ?
M. Jean Viansson-Ponté. Je doute qu’aucun de nos adhérents ait eu un quelconque contact avec les Belges dans la perspective d’un gentlemen’s agreement. Ce qui est certain, en revanche, c’est que nous considérons qu’il est contre-productif que les pouvoirs publics ne fournissent aucune information aux médias. Dans des affaires délicates, lorsque le procureur fournit à la presse des informations objectives et validées, il n’y a jamais de problème. En ce qui concerne le point précis que vous évoquez, j’en entends parler pour la première fois, et je ne suis pas certain que la presse quotidienne régionale soit concernée.
Quant à la révision de nos règles et usages, ceux-ci font l’objet d’une réflexion permanente de la part de nos rédacteurs en chef, qui se sont plus particulièrement penchés ces derniers temps sur la question du droit à l’oubli ; les retours d’expérience, après des événements d’importance, peuvent en effet donner lieu à des modifications de ces règles et usages.
M. le président Georges Fenech. Vous ne tirez donc pas de conséquence particulière de ce qui s’est produit en 2015. Vous estimez donc que, d’une manière générale, la presse écrite française n’a pas failli à ses règles déontologiques, ce qui, pourtant, - et je pense que c’est aussi l’avis du rapporteur - ne semble pas être l’avis des autorités judiciaires belges.
M. Sébastien Pietrasanta, rapporteur. En effet, même si la PQR est sans doute moins concernée que la presse nationale, le fait que L’Obs ait révélé dès le vendredi matin que la présence de Salah Abdeslam avait été détectée à Forest a posé de vraies difficultés opérationnelles, qui auraient pu compromettre son arrestation. D’où le fort mécontentement des autorités fédérales belges, sachant que la presse belge, en possession de ces informations depuis quarante-huit heures, ne les avait pourtant pas diffusées. Au-delà de cette affaire précise, sont par ailleurs régulièrement diffusés dans les médias des procès-verbaux d’audition comportant des informations sensibles. Quelle réflexion menez-vous sur la nécessité de préserver le travail des enquêteurs tout en informant vos lecteurs ?
M. Denis Bouchez, directeur du Syndicat de la presse quotidienne nationale (SPQN). Mon témoignage ne peut être que général, et je ne peux répondre pour chacune des rédactions que nous représentons. Je me suis néanmoins efforcé de les contacter toutes dans la perspective de cette audition, pour les interroger sur les trois points susceptibles de nourrir nos échanges : les règles adoptées par chacun des journaux pour ne pas diffuser d’informations susceptibles de nuire aux enquêtes de police ; les règles concernant la diffusion d’informations susceptibles de gêner l’action des forces d’intervention et d’occasionner un danger pour d’éventuels otages ; les règles visant à protéger la dignité des personnes et la présomption d’innocence.
Il importe ici de garder à l’esprit que la PQN comme la PQR sont des médias historiquement issus du papier, qui ont diffusé leurs règles déontologiques – déclinées dans des chartes internes aux entreprises de presse – aux rédactions numériques, à mesure que ces dernières se développaient, sachant que, si la fabrication, la vérification et la diffusion de l’information sur papier obéissent à un rythme quotidien et qu’on ne peut revenir sur une information imprimée, la presse numérique se caractérise quant à elle par un flux d’informations continu. Les rédactions, conscientes que cette diffusion en continu sur le web n’est pas exempte de risques de dérive, ont réfléchi à leur pratique et l’ont fait évoluer entre l’attentat contre Charlie Hebdo et ceux du 13 novembre. Toutes m’ont affirmé, d’une part, prendre le temps de vérifier leurs informations et ne jamais relayer, sans les vérifier, des informations parues ailleurs, y compris dans d’autres médias ; elles m’ont garanti, d’autre part, qu’elles retenaient les informations susceptibles de perturber les enquêtes de police ou les forces d’intervention.
M. le rapporteur. Vous vous référez ici à de grands principes, dont on sait qu’ils sont régulièrement bafoués lorsque l’actualité l’impose. Vous évoquez la rétention d’informations, mais vous savez comme nous que, dans un climat de concurrence exacerbée, il est difficile de renoncer au scoop. Or, je le répète, lorsque la presse sort le nom d’un suspect, cela nuit au travail des enquêteurs. Dans ces conditions, où placez-vous le curseur entre l’information légitime de vos lecteurs et la protection des enquêtes ?
M. le président Georges Fenech. Notre commission d’enquête s’efforce de mettre en lumière ce qui a fonctionné ou non dans la gestion des attentats. Il est essentiel, en effet, que nous améliorions nos dispositifs, dont vous êtes partie intégrante puisque vous intervenez « en live » sur des événements tragiques, que nous suivons grâce à vous minute par minute.
Vous affirmez que la PQN s’est fixée pour règle de retenir les informations sensibles, mais qui prend cette décision ? Est-elle prise en lien – qu’il s’agisse de procédures codifiées ou d’échanges informels – avec le parquet ? Existe-t-il des protocoles établis en collaboration avec tel ou tel ministère, ou avec l’autorité judiciaire, ou bien agissez-vous de votre propre initiative pour apprécier l’opportunité de publier telle ou telle information ? Encore une fois, la révélation de la présence de Salah Abdeslam à Forest a précipité l’intervention de la police, et les choses auraient pu mal tourner.
M. Jean Viansson-Ponté. Aucun directeur de publication ni aucun journaliste ne demandera jamais l’autorisation de publier une information, et c’est heureux. Cela n’empêche pas l’esprit de responsabilité. J’ai été cadre dirigeant dans les journaux bourguignons Le Bien public et Le Journal de Saône-et-Loire, à une époque où un groupe terroriste a été arrêté lors d’une intervention musclée dans la banlieue de Dijon. Il a été demandé aux journalistes qui étaient sur l’affaire de ne pas divulguer certaines informations en leur possession, et l’embargo a été respecté le temps nécessaire.
Reste qu’en dehors des cas bien circonscrits où les interlocuteurs sont clairement identifiés de part et d’autre, il est difficile, dans un monde ouvert, de codifier la diffusion de l’information. Vous prétendez que les médias français ont commis une faute à l’égard des forces de sécurité belges, mais l’information n’est-elle sortie que dans la presse française ? N’a-t-elle pas été diffusée aux Pays-Bas, en Allemagne ou en Grande-Bretagne ? Dès lors que des informations confidentielles sont dévoilées par ceux qui ont la responsabilité de les tenir secrètes, il est un peu facile d’incriminer celui qui dispose de l’information en même temps que tout le monde et choisit de la diffuser.
M. le président Georges Fenech. J’entends ce que vous nous dites, mais restons-en à l’Hexagone avant de nous intéresser à ce qui se passe ailleurs. Il est heureux selon vous que les journalistes n’aient pas d’autorisation à demander à qui que ce soit avant de publier quoi que ce soit, mais dois-je vous rappeler le rôle qu’a joué la presse dans l’affaire d’Outreau, ce qui l’avait d’ailleurs conduite à faire son autocritique, avec beaucoup de lucidité ? Nous parlons ici d’un domaine couvert par le secret, qu’il s’agisse du secret de l’enquête ou du secret de l’instruction. Vous devez respecter la loi, et, quand un journaliste publie sans précaution un élément de l’enquête couvert par le secret – en l’occurrence, le nom de celui à qui appartient une empreinte digitale relevée par les enquêteurs –, non seulement il n’y est pas autorisé, mais il a de surcroît l’obligation de ne pas le faire. Tout en étant aussi attaché que vous à la liberté de la presse, je suis obligé de rappeler qu’il existe des lois et une éthique professionnelle qui n’ont pas vocation à être transgressées, surtout lorsque l’on a affaire à des terroristes.
M. Jacques Lallain, membre du SPQR, secrétaire général de la rédaction du Parisien. Je peux témoigner ici, en tant que rédacteur en chef du Parisien, ayant couvert à la fois les attentats de janvier et ceux de novembre 2015, sur les outils mis en place ou les leçons tirées de ces événements dramatiques, qui ont secoué l’opinion publique, mais également les journalistes, lesquels sont aussi des citoyens.
Il est avant tout essentiel qu’il y ait, dans chaque rédaction, des journalistes spécialisés dans la police, la justice ou la vie politique, et qui disposent, dans leur domaine de compétence, de sources fiables auxquelles les lient depuis longtemps des relations de confiance. Cela garantit, en particulier face à des événements dramatiques qui se produisent dans un temps extrêmement ramassé, que les informations récoltées sont dignes d’être publiées et cela permet au journaliste de faire son travail d’information dans le respect de l’enquête.
M. le président Georges Fenech. De quelles sources parlez-vous ? S’agit-il de sources officielles ou officieuses ?
M. Jacques Lallain. Je parle de sources officielles.
M. le président Georges Fenech. Une source officielle n’est pas une source. C’est un procureur de la République qui fait son point de presse. Les sources dont vous parlez sont plutôt des contacts informels entre une personne proche de l’enquête ou ayant accès à des procédures confidentielles et un journaliste auquel l’unit un lien de confiance.
M. le rapporteur. Notre débat porte moins sur la fiabilité des sources – votre professionnalisme n’est pas remis en cause – que sur ce qui vous autorise ou non à divulguer telle ou telle information couverte par le secret de l’instruction, sachant que cette divulgation peut présenter un risque pour l’action des forces de l’ordre, comme cela a été le cas en Belgique.
Puisque vous ne demandez par l’autorisation de publier ces informations, qui prend donc ce type de décisions, qui peuvent parfois être lourdes de conséquences, comme dans le cas des révélations faites par L’Obs le vendredi matin de l’arrestation de Salah Abdeslam ? Qu’en est-il ensuite des relations informelles entre les journalistes et les autorités compétentes ? Enfin, selon quels critères se décide la divulgation d’une information ?
M. le président Georges Fenech. Notre tradition latine nous fait placer la liberté de la presse au-dessus de tout, ce qui n’est pas le cas chez les Anglo-saxons, lesquels appliquent la règle du contempt of court – « outrage au tribunal » –, en vertu de laquelle, lorsqu’un journaliste viole l’interdiction décrétée par un juge de divulguer des informations concernant une enquête en cours, il est puni de deux ans de prison et d’une peine d’amende si lourde qu’un journal y regarde à deux fois avant de publier des informations confidentielles.
Compte tenu de la menace que les chaînes d’information en continu ont fait peser sur la vie de certains otages, notre commission d’enquête se demande si nous ne devrions pas prévoir un dispositif répressif – et je n’ai pas peur du mot. Lorsque l’on a des responsabilités aussi importantes que les vôtres, il me semble en effet que l’on a des comptes à rendre à la société. Or aujourd’hui, en dehors de vos chartes déontologiques et de votre conscience professionnelle, rien ne pose de limites aux journalistes, y compris quand il y va de la vie de certaines personnes.
M. Jacques Lallain. J’ignore qui, à L’Obs, a pris la décision de publier l’information sur Salah Abdeslam, mais c’est en général soit le directeur de la rédaction, soit le rédacteur en chef qui assume la responsabilité d’une telle décision. La seule autorisation qui peut nous être donnée sera formulée, le cas échéant, par la voix officielle, et c’est pourquoi nous sommes très demandeurs de points de presse réguliers de la part du procureur de la République, car ils sont l’occasion de voir des rumeurs se transformer en vérités officielles, susceptibles d’être publiées.
Lorsque nous sommes détenteurs d’informations qui n’ont pas été validées par le porte-parole des pouvoirs publics, les journalistes agissent alors en responsabilité, sous l’autorité du directeur de la rédaction et du rédacteur en chef. Cela signifie, en d’autres termes, que, dans un premier temps, ils évaluent la fiabilité de l’information en fonction de la crédibilité de la source, dont ils s’efforcent de recouper les déclarations avec celles d’autres sources, avant de décider, dans un second temps, de l’opportunité de la publier – ce point fait souvent l’objet d’un débat au sein de la rédaction. Vous citez le cas de L’Obs, mais nous avons, pour notre part, été détenteurs de multiples informations liées aux attentats que nous n’avons pas divulguées, malgré notre souci d’informer nos lecteurs, et il me semble que l’exercice responsable de notre métier de journaliste a permis à la presse de limiter le nombre des bavures.
M. le président Georges Fenech. Monsieur Boulanger, en tant que représentant de la presse en ligne, sans doute êtes-vous plus concerné que quiconque par ces questions, compte tenu de l’instantanéité de votre diffusion et de son impact. Comment vous organisez-vous pour informer sans nuire ?
M. Jean-Christophe Boulanger, président du Syndicat de la presse indépendante d’information en ligne (SPIIL). Nous sommes en effet particulièrement concernés par cette problématique, dans la mesure où la presse en ligne – je rappelle ici que les entreprises indépendantes de presse en ligne sont plus de cent cinquante, employant 700 journalistes – a non seulement l’avantage de l’instantanéité, mais également celui de pouvoir modifier a posteriori les informations publiées.
En ce qui concerne les conséquences que notre profession a pu tirer de la couverture des attentats, elles sont au nombre de deux. En premier lieu, nous y avons gagné un sens accru de nos responsabilités. Nous avons bien compris, lors de ces événements dramatiques, l’importance de la presse en ligne, qui constitue le premier média d’information. Cela lui confère une responsabilité particulière en matière de déontologie. En effet, les principes déontologiques rappelés par mes confrères s’appliquent à la presse en ligne, qui est avant tout de la presse et a hérité à ce titre des principes séculaires qui gouvernent la presse écrite. J’ajoute que le fait d’avoir sur le web une presse en ligne qui garantisse ces principes est particulièrement utile lorsqu’il se produit des événements comme ceux que nous évoquons.
Nous promouvons la charte de Munich, qui confère aux journalistes des droits et des devoirs – notamment celui de se préoccuper de l’impact de ce qu’ils publient. Nous avons également un guide des bonnes pratiques des éditeurs de presse, régulièrement mis à jour.
Quant à nos procédures de décision, elles sont les mêmes que dans la presse papier, la décision de publication relevant en dernier ressort du directeur de la publication ou du rédacteur en chef, qui évalue en responsabilité l’opportunité de sortir une information.
M. le rapporteur. Le 7 janvier 2015, lors de la tuerie de Charlie Hebdo, on a d’abord ignoré l’identité des terroristes jusqu’à ce qu’un internaute, détenteur d’une carte de presse sans être affilié à aucune entreprise de presse, diffuse sur les réseaux sociaux le nom des frères Kouachi ainsi que la photocopie de la pièce d’identité de Saïd Kouachi. Comment la presse a-t-elle concrètement réagi à la diffusion de cette information, qui s’est répandue comme une traînée de poudre, avec toute la pression que cela faisait peser sur vos journalistes, et qui a par ailleurs contraint les autorités à confirmer officiellement dans la soirée l’identité des frères Kouachi ?
Mme Haude d’Harcourt, conseillère du SPQR, chargée des relations avec les pouvoirs publics. Les rédacteurs en chef que j’ai consultés pour préparer cette audition m’ont spontanément cité l’exemple de l’un des suspects du Bataclan dont ils connaissaient l’identité, mais qu’ils n’ont pas divulguée avant d’avoir le feu vert de la police, preuve qu’ils sont attentifs à ne pas compromettre les enquêtes de police ou la vie des populations. Le fait qu’on puisse les interroger sur cette question les a même étonnés.
M. Jacques Lallain. Le Parisien n’a divulgué le nom des frères Kouachi que dès lors qu’ils ont été officiellement identifiés. Auparavant, nous les désignions par des initiales.
M. Jean-Christophe Boulanger. Notre métier est de fabriquer de l’information, ce qui implique de la vérifier. À ma connaissance, aucun pure player n’a relayé l’information concernant l’identité des frères Kouachi diffusée sur les réseaux sociaux, notre rôle étant précisément de nous différencier de ces réseaux dans la manière dont nous publions l’information.
M. le rapporteur. La plupart de vos journalistes possèdent désormais un compte Twitter, dont ils précisent bien que le contenu n’engage qu’eux-mêmes et non leur rédaction – ce qui est d’ailleurs assez contestable. Que pensez-vous des cas où un journaliste publie d’un côté, au sein de son journal, une information officiellement validée, tout en diffusant, de l’autre, sur son compte Twitter, des éléments dont les pouvoirs publics n’ont pas explicitement autorisé la diffusion ? Cela fait-il débat au sein des rédactions ?
M. Jacques Lallain. L’irruption des réseaux sociaux dans la vie des journalistes est assez récente, puisqu’elle date du procès de Dominique Strauss-Kahn à New York, au cours duquel les rédactions nationales françaises ont, pour la première fois, utilisé le réseau Twitter pour diffuser de l’information.
Par rapport à la pratique traditionnelle qui consistait à publier de l’information à J+1, l’exercice consistant à concentrer en quelques mots une information s’avère beaucoup plus complexe et nécessite que nos journalistes soient formés à utiliser les bons mots, sachant que la valeur juridique de l’information est la même que si elle paraissait dans la presse écrite. Par ailleurs, il s’agit d’une pratique qui fait l’objet d’âpres discussions, et la plupart des rédactions sont en train d’élaborer des chartes concernant l’utilisation des réseaux sociaux, afin d’éviter le mélange des genres entre l’expression personnelle du citoyen et le travail du journaliste.
Les réseaux sociaux sont pour la presse une source d’informations extraordinaire, mais il faut savoir gérer cette surabondance et n’en retirer que le plus fiable. Nous sommes parfaitement conscients que les réseaux sociaux sont une chance pour nos journalistes, mais qu’ils peuvent également représenter un danger pour nos marques d’information si nous n’établissons pas des règles extrêmement précises en matière de diffusion.
M. Jean-Christophe Boulanger. Le média que je dirige sur le web a créé une charte d’utilisation de Twitter, et nous avons décidé que, dès lors qu’un journaliste fait mention de notre journal sur son compte, il engage la responsabilité de ce dernier et doit donc appliquer les principes déontologiques qui ont cours au sein de la rédaction.
M. Jean Viansson-Ponté. La question des réseaux sociaux est l’une de celle qui mobilise beaucoup la commission des rédacteurs en chef de l’Union de la presse en région, sachant qu’en droit français la notion de free-lance n’existe pas et qu’un journaliste est nécessairement défini par l’exercice de son métier dans le cadre d’une publication. Vouloir diffuser sous la même signature des informations imputables d’un côté au citoyen et de l’autre au journaliste relève donc de la schizophrénie.
M. le président Georges Fenech. À la suite des attentats de janvier 2015, le Conseil supérieur de l’audiovisuel, réuni en formation plénière, a relevé trente-six manquements imputables aux chaînes de télévision et de radio, dont quinze ont donné lieu à des mises en garde, et vingt et un, plus graves, ont justifié des mises en demeure. Cela ne vous concerne pas directement bien sûr, mais, au vu de ces chiffres, seriez-vous favorables à la création d’un Conseil supérieur de la presse écrite ?
M. Jean Viansson-Ponté. Ma réponse est clairement non. La presse est régie en France par la loi de 1881, qui n’existe nulle part ailleurs. Cette loi définit une chaîne de responsabilités clairement identifiée : dans un délit de presse, le premier condamné est le directeur de la publication, les décisions se prenant ensuite au sein des rédactions, avec le souci de conjuguer droit à l’information et respect des personnes.
M. le président Georges Fenech. Ce que vous dites vaut également pour la presse audiovisuelle. Qu’est-ce qui, au bout du compte, vous distingue de cette dernière ?
M. Jean Viansson-Ponté. Avant tout, nos histoires respectives. La presse audiovisuelle se résumait à l’origine à l’ORTF et à une seule chaîne d’information, ce qui a influé sur le développement du secteur jusqu’aux années 2000. On peut toujours, par une proposition de loi, tenter d’étendre à la presse écrite des dispositions spécifiques à l’audiovisuel, afin de renforcer le contrôle que l’on exerce sur elle. Il n’en reste pas moins que les deux secteurs sont différents. Le poids de l’histoire est un facteur déterminant pour le monde de l’audiovisuel qui est devenu multipolaire avec des audiences hétérogènes.
M. Jean-Christophe Boulanger. À la question de savoir s’il faudrait créer un Conseil supérieur de la presse écrite, la presse indépendante en ligne répond « non, mais ». Nous sommes défavorables à la création d’une instance dotée de pouvoirs de régulation, mais prônons la mise en place d’une autorité morale, telle qu’il en existe dans l’immense majorité des démocraties. Elle servirait de garde-fou à la profession, en signalant les manquements déontologiques. Cette autorité que l’on peut imaginer tripartite – éditeurs, journalistes et lecteurs – contribuerait à renforcer la confiance des lecteurs dans la presse.
M. le président Georges Fenech. Monsieur Viansson-Ponté, cette autorité morale vous fait-elle peur ?
M. Jean Viansson-Ponté. Plus grand-chose ne nous fait peur aujourd’hui. Nous vivons des temps qui nécessitent surtout de l’énergie et de la réactivité sans qu’il soit besoin d’ajouter des limites supplémentaires à l’exercice de notre profession, d’autant que le recours devant les juridictions compétentes permet déjà de sanctionner les manquements, qui ne sont pas si fréquents. J’observe en outre que les autorités autoproclamées sont assez peu représentatives de la profession et rassemblent davantage de journalistes honoraires et d’universitaires soi-disant spécialistes des médias que de journalistes en activité.
M. le président Georges Fenech. Savez-vous combien il y a eu, en 2015, de condamnations pour violation du secret de l’instruction ou de l’enquête ?
M. Jean Viansson-Ponté. Je l’ignore, monsieur le président.
M. le président Georges Fenech. Aucune. Cela étant dit, et en vous accordant qu’il est préférable de prévenir plutôt que de réprimer, je constate une divergence d’appréciation entre la presse papier et la presse en ligne sur la nécessité de réguler le secteur. J’entends que le terme d’autorité morale puisse faire peur, car la liberté de la presse caractérise la démocratie, mais, dans la situation exceptionnelle où nous nous trouvons, la proposition de M. Boulanger consistant à créer une autorité constituée de membres de la profession et qui pourrait, comme le CSA – dont je ne pense pas qu’il porte atteinte à la liberté de la presse audiovisuelle –, être non pas le gendarme, mais le régulateur de la presse écrite me semble pertinente.
M. Jean-Christophe Boulanger. Les éditeurs indépendants de presse en ligne ne sont pas favorables à la création d’une autorité ayant des pouvoirs de sanction. À cet égard, le CSA, qui dispose de ces pouvoirs de sanction, est précisément un exemple de ce que nous ne voulons pas faire. En outre, le CSA est une instance politico-administrative, qui ne représente nullement le secteur qu’elle contrôle. Nous souhaitons, nous, la mise en place d’une autorité morale, qui soit réellement représentative de l’ensemble des parties prenantes, éditeurs de presse, journalistes et lecteurs.
M. Denis Bouchez. Ma position est plus proche de celle de Jean Viansson-Ponté que de celle de Jean-Christophe Boulanger.
J’ajouterai au fait que le régime juridique de la presse écrite fondé sur la responsabilité pénale unique du directeur de publication offre un système de sanctions efficace le fait que, à la différence de la presse audiovisuelle, la presse écrite en France est majoritairement une presse d’opinion. Les valeurs défendues par chaque journal déterminent son contenu éditorial : ainsi, il ne vous aura pas échappé que Les Échos privilégient les informations économiques quand l’information, dans La Croix, est plutôt présentée à travers un prisme culturel et religieux.
Chaque rédaction est donc amenée à avoir une réflexion déontologique spécifique, et il importe de préserver cette diversité si l’on veut entretenir une presse d’opinion. En effet, vouloir soumettre l’ensemble des organes de la presse écrite aux prescriptions d’un déontologue unique affadirait inéluctablement notre presse, garante dans sa diversité de notre démocratie.
Hormis le journal auquel il a été fait référence, personne n’a mis en évidence dans nos discussions de manquement ou de dérive dont se serait rendue coupable la presse d’information générale et politique. Ce cas unique justifie-t-il alors la mise en place d’une autorité nationale dotée de pouvoirs de sanction ? Il me semble que les rédactions ont fait la preuve de leur capacité à s’adapter et qu’elles ont su, entre les attentats de janvier et ceux de novembre 2015, faire évoluer leurs principes déontologiques, notamment en matière de vérification et de rétention des informations.
M. le rapporteur. Personne ici ne remet en cause l’existence d’une presse d’opinion dans notre pays. Loin de nous l’idée de censurer un éditorial ou une tribune, et nous ne contestons pas votre professionnalisme.
Vous êtes majoritairement favorables à un système d’autorégulation, assurant pratiquer la rétention d’information lorsqu’il le faut. C’est un fait que la presse écrite n’a fait l’objet d’aucune condamnation pour violation du secret de l’instruction dans sa couverture des attentats, mais notre commission se demande précisément s’il ne faudrait pas durcir la législation en la matière, et je vous demande votre avis sur ce point.
Vous prétendez ne pas avoir d’exemple de manquement dont se serait rendue coupable la presse écrite, mais je vous repose une nouvelle fois la question : qu’est-ce qui peut décider un journaliste à publier une information ou un procès-verbal d’audition couverts par le secret de l’instruction, quand bien même cela risque de compromettre une arrestation ou le démantèlement d’un réseau terroriste ? C’est une grave question, puisque, ces dernières semaines, de telles révélations ont mis en émoi les autorités belges comme les autorités françaises, et envenimé les relations entre nos deux pays.
M. le président Georges Fenech. Personne ne peut prétendre ici que les grands principes, comme celui de la présomption d’innocence, ne sont pas régulièrement violés dans notre pays, malgré l’adoption de plusieurs textes de loi, qui ne sont jamais appliqués. Cela se termine en général devant un tribunal par un procès en diffamation, dont on sait à quel type de condamnation il aboutit.
Le problème est qu’il n’est plus question ici d’atteinte à l’image de tel ou tel, mais bien de mise en danger de la vie d’autrui : le Président de la République l’a rappelé, nous sommes en guerre contre le terrorisme. Tandis que sortent dans la presse des procès-verbaux d’auditions menées dans le cadre de la lutte antiterroriste, vous refusez de vous soumettre à une autorité de régulation, vous estimant suffisamment capables pour décider seuls de ce qui doit être publié ou non. Qu’est-ce qui vous autorise à dire cela, dès lors qu’en publiant des informations couvertes par le secret de l’enquête vous violez la loi ? Nous ne pouvons qu’insister sur cette question tant le procureur de Paris et le procureur de Bruxelles nous sont apparus contrariés par ces fuites préjudiciables au bon déroulement des enquêtes. Je ne sais si nous nous faisons bien comprendre…
M. Jean Viansson-Ponté. Il n’y a rien de contradictoire entre les opinions que je défends et vos propos. L’autorisation préalable n’existe plus depuis la fin du Second Empire, et il me paraît normal que nous n’ayons pas à demander la permission avant de publier quelque chose. Que l’on exerce en revanche notre métier avec le sens des responsabilités et que la loi soit appliquée me paraît une évidence ; il faut faire en sorte que ceux qui violent la présomption d’innocence ou se rendent coupables de diffamation soient systématiquement condamnés. Quant à censurer la presse comme pendant la Première Guerre mondiale, cela me paraît excessif. Nous préférons défendre la loi de 1881 et la responsabilité de l’éditeur, puis de l’auteur. Mais je précise que les exemples que vous avez évoqués ne paraissent pas concerner les journaux que je représente.
J’ajoute qu’une grande part de l’information ou de la pseudo-information qui circule aujourd’hui sur le net ne provient pas de la presse, mais d’un univers où toutes les manipulations et toutes les dérives sont possibles sans que les dispositifs que vous proposez puissent y mettre un terme.
M. le président Georges Fenech. Je tiens à préciser ici que, dans sa grande sagesse, en faisant voter la loi sur l’état d’urgence, le législateur a pris soin d’écarter toute atteinte à la liberté de la presse, à laquelle nous sommes attachés autant que vous. Mais cette liberté a un prix, et il me semble que, en matière de responsabilité, vous n’avez pas tiré toutes les leçons des attentats de 2015.
M. Jean-Christophe Boulanger. À la question de savoir s’il faut une nouvelle législation pour garantir le secret de l’instruction il existe trois niveaux de réponses possibles : une réponse légale, une réponse déontologique et une réponse éditoriale.
Au plan légal, il me semble dangereux de modifier l’équilibre fragile de la loi de 1881, qui prévoit déjà des sanctions pour les manquements que vous avez évoqués ; nous ne sommes pas en l’occurrence dans le néant juridique. Au plan déontologique, nous manquons en revanche, en France, d’une autorité permettant à la profession de réfléchir collectivement aux bonnes pratiques, lesquelles sont actuellement du ressort de chaque rédaction et de la ligne éditoriale qu’elle s’impose.
M. Jean-Michel Villaumé. J’aimerais connaître votre sentiment sur les fausses nouvelles qui se propagent sur internet à la manière d’un virus, contribuant, en ces périodes de terrorisme, à installer dans le pays un climat de peur et d’anxiété. J’avais proposé, pour endiguer le phénomène, de renforcer la répression du délit de fausses nouvelles dans le cadre de la loi sur la République numérique, ce qui a immédiatement suscité une levée de boucliers au nom de la liberté de l’information.
M. Jean-Christophe Boulanger. Si je peux oser cette analogie, internet, c’est un café du Commerce à l’échelle mondiale. Comme autour du comptoir, les gens y discutent sur Twitter ou sur Facebook. Leurs discussions sont libres, même si elles contribuent à propager des mauvaises nouvelles, et il ne faut pas oublier que, sur le comptoir, traînent souvent un ou deux journaux qui sont les garants d’une information fiable. En ce sens, le phénomène que vous évoquez ne fait que renforcer la valeur de notre métier.
M. Denis Bouchez. En ce qui concerne la presse, la loi de 1881 pose le principe de la responsabilité des journalistes et sanctionne la divulgation de fausses nouvelles. Pour ce qui est des informations qui circulent ailleurs sur internet, elles ne relèvent pas de notre responsabilité et ne sont soumises ni aux mêmes normes juridiques ni aux mêmes exigences déontologiques. Mais, si l’on peut regretter la prolifération des fausses nouvelles sur internet, cela contribue paradoxalement à renforcer la crédibilité des marques de presse qui, elles, effectuent un vrai travail d’analyse, comme en témoignent les fortes audiences réalisées par les sites de presse en ligne.
J’aimerais ici m’arrêter sur l’exemple de la rédaction du Monde numérique et sur la manière dont elle s’est organisée pour couvrir les attentats. Deux équipes de journalistes ont été mises en place. La première, en lien avec le ministère de l’intérieur et les forces de police, a été chargée de vérifier les informations et de s’assurer que leur diffusion ne portait pas préjudice au travail des forces de l’ordre, ce qui montre bien que les rédactions ont su évoluer, acceptant de retenir l’information sans chercher le scoop à tout prix, et privilégient la responsabilité sur la course à l’audience ; quant à la seconde équipe, c’est une équipe de « décodeurs » chargés de surveiller tout ce qui circule sur le web et de faire le départ entre rumeurs, vraies et fausses nouvelles.
M. le rapporteur. Il faut en effet souligner la valeur pédagogique du travail des « décodeurs » du Monde comme d’autres journalistes, en particulier pour démonter les théories du complot.
M. Jacques Lallain. Une des grandes leçons que nous avons tirées de la couverture des attentats de janvier et de novembre, c’est que les rédactions de la presse papier, qui travaillent plutôt à J+1 et sont formées de spécialistes, doivent, sur ce type d’événements, travailler en étroite relation avec les rédactions qui fournissent de l’information numérique en continu. Le Parisien s’est ainsi donné pour règle de ne publier en ligne que des informations auparavant validées par les journalistes spécialistes.
Nous avons également, au sein de nos rédactions numériques, marié les talents, organisant nos équipes autour, d’une part, de journalistes expérimentés à qui incombe la responsabilité de la mise en ligne et, d’autre part, de journalistes plus « geeks », chargés d’opérer une veille sur les réseaux sociaux.
J’ajoute que nos rédactions sont extrêmement compétentes, composées de journalistes tous issus d’écoles de journalisme reconnues par la profession et dotés d’un solide bagage culturel et juridique.
Enfin, je pense qu’il faut prendre toute la mesure de la mobilisation extraordinaire de l’ensemble des rédactions à l’occasion de ces attentats. Comme les forces de police et de gendarmerie ou les magistrats, les journalistes se sont massivement mobilisés. Le soir du 13 novembre, Le Parisien disposait de quatre envoyés spéciaux au Stade de France et d’une vingtaine de journalistes présents à la rédaction nationale, à Saint-Ouen ; une heure après le début des attentats, c’étaient une centaine de journalistes qui assuraient la couverture des événements. Se présentant spontanément au journal, ils ont travaillé toute la nuit, de manière responsable – et je salue en effet ici le fait que le législateur ait choisi de laisser à la presse les moyens de travailler en responsabilité.
Cette responsabilité, nous nous efforçons d’en être dignes. Je ne dis pas qu’il n’y a jamais de bavure, mais l’état d’esprit qui anime nos journalistes dans ces moments dramatiques est dominé par la volonté de témoigner sans se laisser guider par l’émotion, en contrôlant les informations comme les images.
Dire qu’aucune leçon n’a été tirée des attentats me semble donc inexact. Les rédactions ont, à l’occasion de ces événements, montré qu’elles étaient capables de s’organiser. Le Parisien a ainsi décidé de désigner plusieurs « chefs de projet » chargés respectivement de l’enquête, des victimes, de la traque des terroristes ou encore des répercussions économiques, politiques et internationales des attentats. Je pense que cela nous a permis de produire une information respectable, à la fois dans nos journaux papier et dans nos médias en ligne.
M. le président Georges Fenech. Nous vous remercions pour cette belle conclusion mais vous comprendrez que notre commission d’enquête se doit de s’intéresser aux quelques bavures qui ne remettent pas en cause pour autant la qualité de la presse dans notre pays.
Table ronde, ouverte à la presse, de représentants de médias audiovisuels : Groupe TF1 : M. Antoine Guélaud, directeur de la rédaction de TF1, M. Nicolas Charbonneau, directeur général de LCI, M. Philippe Moncorps, directeur juridique de l’information, Mme Nathalie Lasnon, directrice des affaires réglementaires et concurrence ; Groupe France Télévisions : M. Michel Field, directeur exécutif chargé de l’information, M. Alexandre Kara, directeur de la rédaction, Mme Audrey Goutard, adjointe au chef de service enquêtes et reportages ; BFM TV : M. Hervé Béroud, directeur de l’information, Mme Cécile Ollivier, reporter police ; iTélé : M. Guillaume Zeller, directeur de la rédaction, M. Alexandre Ifi, directeur adjoint de la rédaction ; Groupe Radio France : M. Olivier Zegna Rata, directeur des relations institutionnelles et internationales de Radio France ; M. Grégory Philipps, directeur adjoint de la rédaction de France Info, Mme Angélique Bouin, directrice adjointe de la rédaction de France Inter ; RMC : M. Hervé Béroud, directeur de l’information
Compte rendu de la table ronde, ouverte à la presse, du lundi 25 avril 2016
M. le président Georges Fenech. Mesdames, messieurs, nous vous remercions d’avoir répondu à la demande d’audition de notre commission d’enquête relative aux moyens mis en œuvre par l’État pour lutter contre le terrorisme depuis le 7 janvier 2015.
Nous poursuivons nos travaux en recevant aujourd’hui des représentants des médias. Après avoir entendu les syndicats de la presse, nous nous intéressons maintenant aux radios et télévisions qui, pour rendre compte au public des événements, ont produit des éditions spéciales en se rendant immédiatement sur place ou en recherchant des témoignages lors des attentats de janvier et de novembre 2015. Mais leur intervention n’est pas allée sans susciter de légitimes questions et notre commission a souhaité faire le point sur le traitement de l’information en abordant les problèmes que peut soulever ce traitement, pour les victimes comme pour les services de sécurité.
Nous accueillons :
Pour le groupe TF1 : M. Antoine Guélaud, directeur de la rédaction de TF1, M. Nicolas Charbonneau, directeur général de LCI, M. Philippe Moncorps, directeur juridique de l’information, et Mme Nathalie Lasnon, directrice des affaires réglementaires et concurrence ;
Pour le groupe France Télévisions : M. Michel Field, directeur exécutif chargé de l’information, M. Alexandre Kara, directeur de la rédaction, et Mme Audrey Goutard, adjointe au chef de service enquêtes et reportages ;
Pour BFMTV : M. Hervé Béroud, directeur de l’information, et Mme Cécile Ollivier, reporter police ;
Pour I-Télé : M. Guillaume Zeller, directeur de la rédaction, et M. Alexandre Ifi, directeur adjoint de la rédaction ;
Pour Radio France : M. Olivier Zegna Rata, directeur des relations institutionnelles et internationales de Radio France, M. Grégory Philipps, directeur adjoint de la rédaction de France Info, et Mme Angélique Bouin, directrice adjointe de la rédaction de France Inter ;
Et, pour RMC, le même M. Hervé Béroud, directeur de l’information.
Je rappelle que cette table ronde est ouverte à la presse et fait l’objet d’une retransmission en direct sur le site internet de l’Assemblée dont le portail vidéo mettra à disposition l’enregistrement pendant quelques mois. Enfin, je vous signale que la commission pourra décider de citer dans son rapport tout ou partie du compte rendu qui sera fait de cette audition.
Conformément aux dispositions de l’article 6 de l’ordonnance du 17 novembre 1958, relatif aux commissions d’enquête, je vous demande de prêter le serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité.
MM. Antoine Guélaud, Nicolas Charbonneau, Philippe Moncorps, Mme Nathalie Lasnon, MM. Michel Field, Alexandre Kara, Mme Audrey Goutard, M. Hervé Béroud, Mme Cécile Ollivier, MM. Guillaume Zeller, Alexandre Ifi, Olivier Zegna Rata, Grégory Philipps et Mme Angélique Bouin prêtent serment.
M. Nicolas Charbonneau, directeur général de LCI. Je suis aujourd’hui directeur général de LCI, mais, l’année dernière, j’étais directeur de l’information du groupe TF1 et c’est à ce titre que j’ai couvert les attentats de janvier et de novembre 2015. Les rédactions de TF1 et de LCI sont indépendantes l’une de l’autre, mais bénéficient de moyens communs et sont soumises à des règles valant pour toutes nos rédactions – qu’elles soient de broadcast ou numériques.
Les attentats de novembre ayant conduit au basculement de l’antenne de LCI sur celle de TF1, vous comprendrez qu’Antoine Guélaud et moi-même souhaitions introduire notre propos à deux voix – du reste, la direction de l’information est commune au sein du groupe.
M. Antoine Guélaud, directeur de la rédaction de TF1. La situation a été inédite pour tout le monde, à la fois pour les Français, pour les journalistes, qui ont joué un rôle d’interface, pour les autorités en général et celles de police en particulier. En ce qui concerne le groupe TF1, nous avons diffusé quelque vingt-cinq heures de direct – à raison de 150 directs dans le cadre d’éditions spéciales et des journaux télévisés – et 200 sujets, mobilisé des dizaines de journalistes et de collaborateurs au sein de la rédaction et sur le terrain.
Depuis la vague d’attentats de 1995, la France n’avait pas connu pareille situation et les attentats de 2015 ont provoqué un effet de sidération qui nous a tous touchés à la fois par leur ampleur, par leur durée et par le fait qu’ils ont été perpétrés dans plusieurs lieux simultanément. Il est évident que, depuis 1995, le paysage médiatique a beaucoup changé, avec le développement des chaînes d’information et, surtout, celui des moyens techniques permettant la retransmission en direct – aussi bien par les professionnels que par les particuliers – de tous les faits qui peuvent se passer sur la voie publique. Tout Français détenteur d’un smartphone peut en effet filmer une scène et la diffuser quasiment en direct. Reste que, si les réseaux sociaux ont ainsi joué un rôle éminemment important, les médias traditionnels ont joué le leur.
M. Nicolas Charbonneau. Nous avons des relations constantes avec les autorités. Les unes sont officielles et ont le mérite d’offrir un cadre. Le ministère de l’intérieur, notamment, nous invite parfois à adopter tel ou tel comportement – car, si nous sommes des journalistes, nous sommes aussi des citoyens. Ainsi, lors de la prise d’otages de l’Hypercacher, il nous a recommandé de ne pas diffuser en direct les images de l’assaut : nous l’avons non seulement écouté, mais nous n’avons montré aucune image des préparatifs. De même, nous avons respecté le périmètre de sécurité à Dammartin-en-Goële.
Les autres relations, officieuses, sont celles de nos journalistes spécialisés avec des sources qui leur fournissent des informations que, en conscience, les rédactions décident ou non de diffuser après les avoir vérifiées.
M. Antoine Guélaud. Des règles s’imposent déjà aux journalistes : il s’agit d’un cadre juridique contraignant comprenant la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, la charte d’éthique professionnelle des journalistes, qui date de 1918, mais a été révisée à plusieurs reprises jusqu’en 2011, des conventions signées avec le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA), des textes législatifs permettant qu’on dépose plainte, sans oublier les chartes internes de déontologie établies par certains médias, dont TF1. En outre, des filtres éditoriaux définis par les rédacteurs en chef constituent autant de limites. Enfin, nous restons vigilants quant aux images qui nous parviennent de façon non traditionnelle – et, si nous pouvons toujours être plus performants en la matière, nous avons mis en place une formation « Recherche et validation des contenus sur internet » afin de remonter plus efficacement à la source, ce qui n’est pas toujours aisé ; et, quand nos journalistes spécialisés y parviennent, selon les cas, nous ne donnons pas certaines informations et ne diffusons pas certaines images.
Par ailleurs, en ce qui concerne précisément le 13 novembre 2015, on relèvera la continuité des programmes : nous n’avons pas interrompu la retransmission du match de football afin d’éviter un mouvement de panique, nous n’avons pas interrompu non plus les programmes destinés à la jeunesse le 18 novembre au matin.
Bref, nous avons des collaborateurs responsables, des journalistes responsables et des dirigeants responsables.
M. Nicolas Charbonneau. Comme ce fut le cas pour les autorités, nous avons, à TF1, tiré les conclusions des attentats de janvier 2015, si bien que nous avons travaillé différemment, plus prudemment, à l’occasion de ceux de novembre 2015, ainsi que lors des récents attentats perpétrés à Bruxelles.
Je rappelais que, journalistes, patrons de rédaction, nous étions aussi des citoyens – et notre traitement de l’information en porte la marque : nous sommes régulièrement amenés à retenir des informations. Je pense en particulier au modèle et à la plaque d’immatriculation de la voiture du commando qui a commis les attentats sur les terrasses, information que nous possédions plusieurs heures avant qu’elle ne soit divulguée et qu’il était bien sûr hors de question pour nous de diffuser afin de ne pas entraver les recherches des policiers. De même, lors de l’assaut à Saint-Denis, le mercredi matin, alors que nous avions connaissance d’une piste depuis la veille, nous avons refusé de divulguer quelque information que ce soit.
M. Michel Field, directeur exécutif chargé de l’information du groupe France Télévisions. Je ne reviendrai pas sur bon nombre de remarques formulées par nos confrères de TF1, car nous avons tous vécu le même type de situations. Je précise qu’Alexandre Kara et moi-même n’étions pas en fonctions au moment des attentats de janvier 2015. J’étais en revanche membre du comité exécutif – mais pas encore directeur de l’information – de France Télévisions au mois de novembre 2015 et nous nous trouvions chacun à notre poste actuel, M. Kara et moi-même, lors des attentats de Bruxelles en mars 2016.
J’observe, dans un premier temps, une grande maturation des médias d’un événement à l’autre. Si les plus récents n’ont pas été traités de la même manière que ceux de l’année dernière, c’est notamment dû à l’expérience, à l’analyse des effets pervers de telle ou telle attitude. Le curseur s’est déplacé : lors des premiers attentats, le réflexe journalistique du droit à l’information, quel qu’en soit le prix, a prévalu sur la prudence. Le dialogue avec les autorités et le « retour d’expérience » de situations totalement inédites ont permis une maturation à grande vitesse. Nous avons tous, désormais, pleine conscience de notre rôle en tant que citoyens. Restent bien sûr des points à améliorer : nous avons besoin, par exemple, de référents au sein de la préfecture de police ou du ministère de l’intérieur pour entendre les demandes des autorités. Libre à nous ensuite, en conscience, de les suivre ou non.
Ma seconde réflexion porte sur les réseaux sociaux. La décision de ne pas diffuser telle ou telle image, telle ou telle déclaration serait assez aisée si nous n’étions qu’entre nous ; seulement, ces images et ces déclarations, les réseaux sociaux peuvent, eux, les divulguer. Qu’en est-il donc de leur usage sauvage ? Quelles images devons-nous, pour notre part, sélectionner dès lors qu’elles constitueront une source d’information fiable et qu’elles n’auront donc pas le même statut ? Quid de la diffusion de l’image ou de la voix des preneurs d’otages ? Que faire quand un preneur d’otages menace de s’en prendre à eux s’il n’obtient pas de pouvoir s’exprimer à la télévision ? Nous avons organisé plusieurs séminaires au cours desquels nous avons examiné tous ces sujets – reste que nous nous posons plus de questions que nous ne pouvons apporter de réponses. Dans de telles situations de crise, les journalistes sont confrontés à des choix de conscience sans qu’il existe de réponses a priori ou une sorte de cahier des charges fixe qui permette de prendre la bonne décision – elle ne peut se prendre que dans des circonstances particulières et mouvantes.
Mme Audrey Goutard, adjointe au chef de service enquêtes et reportages de France Télévisions. En janvier comme en novembre, la difficulté a été d’avoir vécu tout cela en direct. J’étais en plateau lors des attentats, comme ma consœur de BFMTV, et nous avons suivi tout le processus des reportages, des directs.
Ce qui nous est apparu le plus important, dans un premier temps, était le décryptage : une multitude d’informations et d’images circulaient sur les réseaux sociaux – c’était la grande nouveauté à laquelle nous étions confrontés – et il s’agissait pour nous de donner aux téléspectateurs les informations les plus précises. Nous entendions certes faire comprendre, mais aussi apaiser, car, on l’a dit, nous sommes nous aussi des citoyens. Depuis, Michel Field l’a dit, nous avons beaucoup réfléchi, nous nous sommes réunis à de nombreuses reprises, pour progresser, pour faire évoluer notre manière d’aborder de tels événements afin d’être aussi objectifs et calmes que possible, et afin de maîtriser le déferlement des informations. Grâce à l’application Periscope, n’importe qui peut filmer et retransmettre en direct sur internet les images d’un attentat, d’un assaut ou de tout autre événement. On peut certes instruire le procès des grandes chaînes en leur reprochant d’avoir filmé telle scène, d’avoir interrogé telle personne. Mais, si elles ne font pas, d’autres s’en chargeront. Notre mission ne consiste-t-elle pas précisément à traiter ces informations et ces images pour aider le téléspectateur à faire la part des choses, à comprendre ce qui se passe, et à ne pas se laisser entraîner par ce que diffusent les réseaux sociaux ?
Michel Field évoquait également la manière dont nous devions traiter les terroristes. Je me suis demandé ce qu’il faudrait faire si l’un d’eux appelait en direct et exigeait de passer à l’antenne, faute de quoi il exécuterait un otage. Nous devons pouvoir nous poser ces questions de façon sereine pour définir des procédures. Reste que l’idée de ne plus diffuser aucune image, de ne plus donner aucune information pour protéger l’action de la police me paraît absurde et irréaliste, puisque d’autres, qui seront sans doute moins bien intentionnés que nous, le feront à notre place.
M. le président Georges Fenech. Je note d’ores et déjà, de la part des représentants des groupes TF1 et France Télévisions, le souci de réfléchir à la manière dont les informations reçues lors des attentats de janvier 2015 ont été traitées. Nous percevons bien la différence, de ce point de vue, entre janvier et novembre 2015.
On peut d’ailleurs rappeler que, à la suite des attentats de janvier 2015, le CSA, réuni en formation plénière, a relevé trente-six manquements imputables aux chaînes de télévision et aux radios, dont quinze ont donné lieu à des mises en garde et vingt et un, plus graves, ont justifié des mises en demeure. Le problème est donc bien réel. Aussi avons-nous tous à cœur d’essayer de trouver les solutions qui préservent le droit à l’information sans porter atteinte ni à l’enquête ni, surtout, à la vie des otages.
Ce qui m’amène à évoquer BFMTV et les incidents regrettables qui ont eu lieu et que je rappelle : lors de la prise d’otages à l’Hypercacher, l’un de vos journalistes a dévoilé en direct que six otages, qui n’étaient pas connus d’Amedy Coulibaly, toujours présent sur les lieux, étaient retranchés dans la chambre froide, au sous-sol. Pourquoi avoir diffusé cette information ? Votre rédaction a d’ailleurs été l’objet d’une plainte contre X pour mise en danger de la vie d’autrui, qui a déclenché l’ouverture d’une enquête préliminaire au parquet de Paris. L’avocat de ces six ex-otages, Me Patrick Klugman, a déclaré que le traumatisme suscité par le traitement médiatique de l’Hypercacher avait été aussi vif que celui provoqué par la prise d’otages elle-même.
Le 8 janvier, après médiation entre votre chaîne et l’avocat précité, la plainte a été retirée. Vous avez d’ailleurs reconnu, semble-t-il, une faute dans le traitement de l’information lors de la prise d’otages de l’Hypercacher et vous avez en conséquence établi une charte déontologique que je me suis procurée et sur laquelle nous vous poserons éventuellement quelques questions. Je souhaitais, avant de vous céder la parole, rappeler cet événement qui doit être riche d’enseignements pour l’avenir.
M. Hervé Béroud. Mes confrères de TF1 et de France Télévisions ayant déjà largement exprimé ce que je comptais dire en préambule, je vous épargnerai les répétitions. J’avais de toute façon prévu d’évoquer d’entrée de jeu la faute commise en direct sur notre antenne par l’un de nos journalistes, le vendredi 9 janvier 2015. Pour être précis, cependant, je rappellerai qu’il n’a pas dit que six otages étaient retranchés dans la chambre froide de l’Hypercacher, mais il a évoqué, en vingt secondes, « une femme qui se serait cachée dans la chambre froide et qui y serait toujours » – je reprends les termes de Dominique Rizet puisque c’est de lui qu’il s’agit. Cette information n’a été donnée qu’une fois à l’antenne ce vendredi à quinze heures, la rédaction en chef ayant aussitôt demandé au journaliste de ne pas la répéter. Elle n’est en outre jamais apparue sur les bandeaux à l’écran. Reste que la phrase a été prononcée une fois, et une fois de trop, nous en avons bien conscience. Nous en avons longuement parlé, pendant plusieurs mois, avec les victimes et leurs représentants, afin que le temps permette l’apaisement. Nous y sommes parvenus et en sommes très heureux, mais nous n’oublions évidemment pas l’incident.
Je dois également préciser que, même si nous reconnaissons la gravité de ces vingt secondes, elles ne peuvent évidemment pas résumer les dizaines d’heures de direct de notre chaîne pendant les attentats de janvier 2015. Pour d’innombrables raisons, ces événements furent, pour toutes les chaînes de télévision, les plus difficiles à traiter. Pendant trois jours, nous sommes restés comme suspendus à ces rebondissements tragiques auxquels nous n’étions pas forcément préparés. Aujourd’hui, Michel Field l’a souligné, nous le sommes davantage, ainsi que nous l’avons prouvé au mois de novembre et plus récemment lors des attentats de Bruxelles, sans oublier des épisodes comme celui du Thalys.
Je tiens donc à répéter que, si cet épisode est regrettable, il ne saurait résumer le travail remarquable réalisé par nos équipes de journalistes pendant ces attentats.
M. le président Georges Fenech. J’en viens à un autre élément : la retransmission d’un dialogue avec Amedy Coulibaly.
M. Hervé Béroud. Il s’agit d’un élément totalement différent.
M. le président Georges Fenech. Mme Goutard se demandait ce qu’il fallait faire si un terroriste exigeait de passer à la télévision en menaçant d’exécuter l’un de ses otages.
M. Hervé Béroud. Le vendredi 9 janvier, nous avons été en contact à deux reprises avec Amedy Coulibaly…
M. Pierre Lellouche. C’est vous qui l’avez appelé ?
M. Hervé Béroud. C’est lui qui, peu après quinze heures, a appelé notre rédaction. Alexis Delahousse, directeur adjoint de la rédaction, a reçu l’appel et a parlé avec lui, très calmement et très efficacement, pendant quatre à cinq minutes, non pas à l’antenne, mais au sein de la rédaction. Il est parvenu à le « maîtriser » – à faire en sorte qu’il reste calme –, à lui poser des questions sur ce qui était en train de se passer dans l’Hypercacher. Et Amedy Coulibaly nous a donné des informations très importantes : le nombre de victimes, le nombre d’otages encore avec lui, le fait qu’il était seul… Sitôt la conversation terminée, nous en avons informé la police et, à peine une heure plus tard, un motard venait récupérer l’enregistrement. Le Premier ministre et le ministre de l’intérieur ont été prévenus. J’ai moi-même discuté avec le négociateur du RAID (Recherche, Assistance, Intervention, Dissuasion) présent porte de Vincennes pour lui faire part de ce qu’Amedy Coulibaly venait de déclarer à Alexis Delahousse. Or à aucun moment il n’a été fait état de cette conversation à l’antenne ! C’est ensuite, quand tout était terminé, le soir du vendredi 9, que nous avons décidé d’en diffuser un court extrait. Je ne regrette pas ce choix. À aucun moment nous n’avons mis la vie de qui que ce soit en danger : au contraire, nous avons immédiatement saisi de ce document les forces de police et les autorités politiques.
Mme Cécile Ollivier, reporter police à BFMTV. J’ajouterai que, par la suite, M. Béroud a demandé à plusieurs reprises un rendez-vous au ministère de l’intérieur afin de savoir quelle ligne suivre si un terroriste nous appelait ; or on ne lui a jamais répondu. Ce sont des policiers spécialisés, des négociateurs qui nous ont communiqué une petite fiche comportant quelques directives. Nous avons dès lors rédigé une note que nous avons diffusée en interne. Nous tâchons donc d’établir nos propres règles.
M. Sébastien Pietrasanta, rapporteur. L’une des préoccupations des terroristes, nous l’avons constaté aussi bien à l’occasion des attentats de janvier avec Amedy Coulibaly et avec les frères Kouachi, qu’à l’occasion de ceux de novembre – et ce fut l’une des premières questions posées au cours de leur négociation avec les policiers de la Brigade de recherche et d’intervention (BRI) – est de savoir si les chaînes d’information continue sont présentes sur les lieux. On perçoit donc bien l’instrumentalisation dont ces dernières peuvent faire l’objet. Comme Michel Field l’a mentionné, vous êtes d’ailleurs, à ce sujet, en pleine phase de réflexion.
J’en reviens à la prise d’otages de l’Hypercacher. Lorsque nous avons auditionné les représentants du RAID, ils nous ont indiqué être arrivés sur les lieux vers quatorze heures trente, la BRI étant déjà sur place. Le premier contact avec Amedy Coulibaly est établi vers quinze heures trente, soit plus d’une heure plus tard. J’ai demandé au patron du RAID les raisons d’un tel délai et il nous a répondu que le téléphone d’Amedy Coulibaly était occupé parce qu’il était en contact avec les chaînes d’information continue. Or vous venez de préciser que la conversation entre le terroriste et votre adjoint avait duré quatre minutes. Je peux me tromper, mais il me semble que vous êtes la seule chaîne que Coulibaly ait appelée.
Avez-vous pris l’initiative d’entrer en contact avec les terroristes ou vous l’interdisez-vous ? Et avez-vous, depuis les événements, adopté une marche à suivre en la matière ?
M. Hervé Béroud. Nous n’avons jamais appelé l’Hypercacher et c’est Amedy Coulibaly qui nous a appelés vers quinze heures dix pendant cinq minutes. L’enregistrement de l’intégralité de la conversation a très vite été remis à la police.
M. le rapporteur. Y a-t-il eu d’autres tentatives, de part et d’autre ?
M. Hervé Béroud. Pour ce qui nous concerne, non, mais je ne représente pas l’ensemble des médias.
M. le rapporteur. Le RAID indique qu’il a mis plus d’une heure pour contacter Amedy Coulibaly et vous-même considérez que la conversation entre Coulibaly et votre adjoint n’a duré que quatre minutes…
M. Hervé Béroud. Je ne le « considère » pas, c’est un fait, et l’enregistrement a été remis à la police dès le vendredi.
J’en viens à la prise d’otages de Dammartin-en-Goële. Le vendredi matin, a commencé de se répandre une information selon laquelle deux hommes – nous ignorions qu’il s’agissait des frères Kouachi – étaient retranchés dans les locaux d’une imprimerie de cette commune. L’un de nos journalistes a appelé l’imprimerie pour savoir ce qui se passait. La personne qui a décroché était Chérif Kouachi. La conversation a duré deux minutes et, aussitôt après, nous avons appelé directement Manuel Valls pour l’informer que nous venions, malgré nous, d’avoir Chérif Kouachi au téléphone. Or, là encore, cette information n’a jamais été diffusée.
M. le président Georges Fenech. Le CSA a mis en demeure BFMTV, Euronews, France 2, France 24, I-Télé, LCI, TF1, Europe 1, France Info, France Inter, RFI, RMC et RTL de respecter l’impératif de sauvegarde de l’ordre public, après avoir considéré que le fait d’annoncer en direct que des affrontements avaient éclaté entre les forces de l’ordre et les terroristes à Dammartin-en-Goële aurait pu avoir des conséquences dramatiques pour les otages de l’Hypercacher, dans la mesure où – tout le monde le sait désormais – Amedy Coulibaly avait déclaré lier leur sort à celui de ses complices de Dammartin-en-Goële.
Comment, les uns et les autres, avez-vous pris cette décision ? De quelle manière avez-vous jugé de l’opportunité de divulguer une information qui aurait pu, en effet, avoir des conséquences dramatiques ? Y a-t-il eu des remontrances de la part des forces de l’ordre ou des autorités politiques ?
M. Guillaume Zeller, directeur de la rédaction d’I-Télé. Je ne suis arrivé à la rédaction d’I-Télé qu’au mois de septembre dernier, mais nous avons, depuis, largement évoqué la question. Il convient pour en juger de revenir sur la configuration des lieux et sur le dispositif sécuritaire mis en place. Nous sommes alors déployés, comme nombre de nos confrères, à l’extérieur du périmètre de sécurité établi par les forces de l’ordre. Au moment de l’assaut, notre reporter voit un nuage de fumée, entend des détonations et informe donc de ce qu’il observe à la distance imposée par les forces de l’ordre. Si j’avais été à I-Télé à l’époque, j’aurais sans doute été en phase avec la rédaction pour considérer que nous étions là au cœur de notre métier et que nous n’agissions pas de façon irresponsable en donnant cette information simple : une fumée s’élève au-dessus des lieux, nous entendons des détonations et nous supposons donc que l’assaut est en cours.
M. Alexandre Ifi, directeur adjoint de la rédaction d’I-Télé. Il ne faut pas interpréter les faits en fonction de l’information selon laquelle Amedy Coulibaly entendait lier le sort des otages au sort de ses complices de Dammartin-en-Goële, car nous ne disposions pas alors de cet élément. Toutes les rédactions sont animées de la même volonté d’informer de manière fiable, sans mettre en danger la vie de qui que ce soit, et avec dignité. Ces principes sont ceux d’I-Télé et je ne doute pas que ce sont également ceux de tous mes confrères ici présents.
Je reviens sur le cas de Dammartin-en-Goële. Nous nous sommes d’emblée demandé si nous devions ou non diffuser les portraits-robots des frères Kouachi dès lors qu’ils avaient été identifiés – et l’information venait d’abord d’internet. Il se trouve que toutes les rédactions connaissaient alors leur nom et leur photographie ; or, pendant cinq heures, elles n’ont pas donné cette information parce qu’on le leur avait demandé.
M. le président Georges Fenech. Qui vous l’avait demandé ?
M. Alexandre Ifi. Notre spécialiste pour les affaires de police et de justice, Jean-Michel Decugis, nous a indiqué que le ministère de l’intérieur ne souhaitait pas que l’information soit connue. Nous ne l’avons donc pas diffusée, et aucune autre rédaction ne l’a fait. Mais une agence de presse britannique, Reuters, l’a publiée à vingt et une heures trente. Dès lors, l’Agence France Presse (AFP) l’a à son tour publiée.
M. le rapporteur. Cette information circulait abondamment sur les réseaux sociaux, un de vos confrères – si j’ose dire, mais il a sa carte de presse – ayant diffusé l’identité des frères Kouachi dès le mercredi en fin d’après-midi. Vous êtes donc tout de même soumis à la pression des réseaux sociaux.
M. Alexandre Ifi. Dans ce cas précis, je n’ai pas ressenti cette pression.
Je vais vous donner un autre exemple : quand, pendant toute la nuit des attentats du 13 novembre, des médias annoncent une attaque au Châtelet ou au Louvre, nous envoyons une équipe motorisée pour vérifier l’information.
Pour ce qui est des frères Kouachi, je le répète, je dispose de l’information à quinze heures via les réseaux sociaux ; nous la confirmons assez vite, mais nous décidons de ne pas la divulguer. Ainsi, en janvier déjà, les rédactions se comportent de façon responsable.
En ce qui concerne Dammartin-en-Goële, la mise en demeure du CSA évoque un manquement à l’impératif de sauvegarde de l’ordre public. Or, à ce moment précis, la situation est assez compliquée : un immense périmètre de sécurité a été établi, si bien que les journalistes sont placés très loin – de même qu’à l’Hypercacher. Dès lors que nos envoyés spéciaux – et nous le constatons aussi depuis la régie – voient de la fumée s’élever et entendent des tirs, faut-il ne rien dire ? Ensuite, on fait valoir qu’Amedy Coulibaly regardait peut-être les chaînes d’information continue ; mais personne du ministère de l’intérieur ne nous a avertis du fait qu’il entendait lier le sort de ses otages à celui de ses complices. Or, si l’on m’avait donné cette information, j’aurais peut-être agi autrement. Privé de cette information, j’ai pris la décision qui m’a semblé la plus responsable. Je suis persuadé que toutes les rédactions ont agi en leur âme et conscience.
M. le président Georges Fenech. Plusieurs médias – France 2, TF1, BFMTV, LCI et RMC – ont signalé la présence d’une personne cachée dans l’imprimerie où les frères Kouachi s’étaient retranchés. Nous sommes ici loin des « fumées aperçues de loin »…
M. Alexandre Ifi. Vous n’avez pas cité ma rédaction, je ne sais guère que vous dire sur le sujet.
Mme Audrey Goutard. Le premier à avoir évoqué la présence d’une personne dans l’imprimerie est le député de la circonscription au cours d’un entretien qu’il a accordé à TF1 à dix heures. La deuxième personne qui a mentionné la présence d’un otage dans l’imprimerie est la sœur de l’otage lui-même qui, folle d’inquiétude, nous a appelés en direct sur le plateau – et nous ne savions pas du tout qu’elle allait en parler. Elle nous a alors dit, paniquée, que son frère, qui travaillait à l’imprimerie, y était sans doute caché… Aussi, à aucun moment un journaliste des chaînes incriminées n’a donné spontanément l’information.
M. Nicolas Charbonneau. J’ajouterai, puisque c’était sur l’antenne de TF1, que c’est en effet un élu de la République – qui siège dans cette assemblée – qui a donné en direct cette information que nous avons tue aussitôt après.
Mme Audrey Goutard. De même pour nous.
M. le président Georges Fenech. Je vous remercie pour ces précisions. Les représentants de Radio France souhaitent-ils ajouter un mot ?
Mme Angélique Bouin, directrice adjointe de la rédaction de France Inter. Comme le suggérait à l’instant mon confrère, il faut partir de l’idée que nous avons vécu deux événements exceptionnels.
M. Pierre Lellouche. Souhaitons qu’ils le restent.
Mme Angélique Bouin. Il faut prendre en compte la mobilisation des rédactions qui, à cette occasion, ont travaillé de façon responsable. D’ordinaire, quand une information nous parvient – et il est vrai que les réseaux sociaux, depuis quelques années, ont bousculé notre façon de travailler – nous la recoupons. C’est la base de notre métier.
Face aux attentats de janvier et de novembre 2015, nous retrouvons tous nos réflexes et envoyons quelqu’un sur le terrain pour vérifier l’information. Pour ce qui touche au terrorisme, nous disposons de services très professionnels, de journalistes qui sont en contact avec des policiers, avec la préfecture de police de Paris, avec le ministère de l’intérieur. Imaginez que, le vendredi, dans les rédactions, tout le monde travaille depuis trois jours et trois nuits ; certains de nos reporters, sur le terrain, n’ont pas dormi pendant trois jours. Certaines rédactions – dont la mienne – ont été endeuillées à l’occasion des attentats de janvier 2015. Bref, imaginez les conditions dans lesquelles nous avons travaillé. Je suis émue en y repensant. Mais j’insiste vraiment sur le fait que nous avons tous été responsables : nous avons défendu notre métier, nous avons fait prendre des risques à des reporters – j’en ai envoyé un à Saint-Denis en pleine fusillade, sans gilet pare-balles, sans lui avoir donné la moindre consigne de sécurité…
Ces événements nous ont donc tous amenés à réfléchir à nos pratiques. Si nous sommes bousculés par les réseaux sociaux, nous gardons tout de même nos réflexes de tous les jours : envoyer quelqu’un sur le terrain, mettre quelqu’un en cabine pour téléphoner dans le voisinage immédiat de l’endroit où l’on nous signale une fusillade ou une explosion… Ainsi, il y a quinze jours, une explosion retentit dans Paris : nous recevons à la rédaction l’appel d’une jeune fille paniquée qui nous indique qu’une bombe vient d’exploser dans sa rue. En quelques minutes, l’ensemble de nos rédactions mobilisent des dizaines de journalistes, mais nous ne disons rien à l’antenne et, bientôt, la préfecture de police de Paris nous informe qu’il s’agit d’une explosion due au gaz. Nous avons simplement traité l’information le soir sur le thème de l’émotion dans un quartier dans un contexte d’attentat possible.
Au cours des semaines qui ont suivi l’attentat du 13 novembre, je n’ai cessé d’envoyer des gens pour des attaques sous la tour Eiffel ou dans des musées. Si vous n’en avez jamais entendu parler, c’est parce que nous avons fait notre travail, même s’il arrive que nous commettions des erreurs.
Comme d’autres, France Inter a annoncé l’assaut de Dammartin-en-Goële. J’étais alors en régie. Il est vrai qu’aucun d’entre nous ne possédait l’information selon laquelle annoncer l’assaut mettrait en danger les otages de l’Hypercacher. J’étais reporter à France Inter et à France Info en 1994, à l’époque du détournement de l’Airbus qui assurait la liaison entre Alger et Paris. Quand l’Airbus arrive à Marignane, je suis envoyée pour couvrir l’événement. Le directeur de la rédaction m’appelle pour m’annoncer que le Groupe d’intervention de la gendarmerie nationale (GIGN) va donner l’assaut dans les quinze à vingt minutes. France Info est à l’époque l’une des rares radios d’information continue, sinon la seule. On nous informe, mon confrère de Marseille et moi-même, que nous allons probablement voir les hommes du GIGN s’approcher de l’avion et on nous demande de n’en rien dire. Nous n’en avons rien dit. Or, à Dammartin-en-Goële, personne ne nous a donné ce type d’information. Il va de soi que, si l’on nous avait prévenus, nous aurions procédé différemment, car, quand nos contacts de la police judiciaire nous communiquent de tels éléments, nous retenons l’information. Nous avons donc plusieurs solutions, dès lors que nous avons des interlocuteurs.
M. le rapporteur. Qu’il soit entendu que personne ici ne remet en cause le professionnalisme des journalistes : nous sommes, les uns et les autres, suffisamment en contact avec vos confrères pour connaître leur conscience professionnelle. Cependant, on a pu constater des difficultés, certaines de vos rédactions ont été rappelées à l’ordre par le CSA et vous-mêmes posez des questions.
Lors de la traque des frères Kouachi, le 7 janvier, plusieurs adresses ont été examinées, notamment par le RAID, dont l’une à Reims. Or les hommes du RAID ont constaté avec étonnement que, en se rendant à Reims, ils ont été dépassés sur l’autoroute par des véhicules de journalistes – lesquels attendaient les forces de police à l’adresse supposée des frères Kouachi, ce qui pose un problème non seulement concernant la protection des journalistes, mais aussi du point de vue opérationnel. Imaginez que les frères Kouachi se soient effectivement trouvés à cette adresse ! Quel est votre avis sur cet épisode ?
M. Grégory Philipps, directeur adjoint de la rédaction de France Info. Nous sommes alors, en janvier puis en novembre 2015, face à de tels événements, le bruit médiatique est si fort, que je donne la consigne à tous mes présentateurs d’éteindre la concurrence, de ne pas consulter les réseaux sociaux, de ne divulguer aucune rumeur, aucune information qui ne serait pas vérifiée. Les seules informations diffusées par France Info, pendant trente-sept heures d’édition spéciale à compter du 13 novembre au soir, ont été vérifiées et validées par nos spécialistes en matière de police et de justice, quitte à être en retard par rapport à la concurrence. Ainsi n’avons-nous pas évoqué la piste de Reims ; quand des rumeurs ont fait état d’une fusillade au Châtelet, nous avons envoyé un reporter les vérifier, et jamais il n’en a été fait état à l’antenne.
France Info a également été mise en demeure par le CSA à propos de la couverture des événements de Dammartin-en-Goële. Si un représentant du ministère de l’intérieur nous avait appelés pour nous informer qu’évoquer l’assaut mettrait en danger la vie des otages de l’Hypercacher et nous demander de retenir l’information, nous l’aurions évidemment tue pendant quinze ou vingt minutes, avec le plus grand sérieux, le plus grand calme, la plus grande rigueur, et en conservant notre libre arbitre, car il n’est pas question non plus que nous nous pliions aux exigences du ministère de l’intérieur. Nous pouvons en effet décider par nous-mêmes de ne pas divulguer une information qui risque de nuire aux opérations des forces de l’ordre et de mettre la vie d’otages en danger.
Hervé Béroud a indiqué avoir appelé directement Manuel Valls…
M. Hervé Béroud. Parce que je ne savais pas qui appeler !
M. Grégory Philipps. Quel interlocuteur appeler place Beauvau ? Le ministère ne peut-il pas disposer de nos lignes directes ? Tous les patrons de rédaction sont joignables vingt-quatre heures sur vingt-quatre, et a fortiori à de tels moments. Si l’on nous explique sans retard les enjeux que représente telle ou telle information, nous pouvons ensuite, en conscience, décider de les retenir pour une durée donnée. Un des anciens patrons de France Info, Pascal Delannoy, disait que la vérité pouvait attendre cinq minutes – c’est encore plus vrai dans les situations que nous sommes en train d’évoquer.
M. Hervé Béroud. À l’inverse de ce qui s’est passé pour Dammartin-en-Goële, à l’Hypercacher, à la suite de nos contacts avec Amedy Coulibaly, j’ai reçu un peu plus tard, dans l’après-midi, un appel d’un proche du préfet de police de Paris qui m’a informé de l’imminence de l’assaut contre l’Hypercacher. Or la caméra de l’AFP filmait la façade de l’Hypercacher, et les images étaient diffusées par TF1, France 2, BFMTV, I-Télé et LCI. Mon interlocuteur m’a demandé si nous pouvions couper cette caméra. Comme il n’avait pas les coordonnées de mes confrères, je lui ai donné les numéros de téléphone de Catherine Nayl, de Thierry Thuillier et de Céline Pigalle, qui ont donc été appelés par la préfecture de police, et nous tous avons décidé au même moment d’arrêter la diffusion en direct de cette image. C’est ainsi que l’assaut s’est déroulé sans qu’aucune image ne soit diffusée en direct sur les chaînes de télévision françaises. Si nous avions, de la même manière, été prévenus de l’assaut à Dammartin-en-Goële, nous aurions très certainement agi de même.
Mme Audrey Goutard. Nous aussi avons été stupéfaits de voir, à Reims, ces hordes de journalistes qui suivaient les policiers. Il faut se souvenir que, en 1995, moins de dix médias suivaient les attentats ; or, aujourd’hui, nous nous retrouvons avec une cinquantaine de médias traditionnels et de journalistes qui s’improvisent « médias », parce qu’ils sont sur place avec leur téléphone portable.
Il paraît étonnant que, depuis des années, et même entre janvier et novembre 2015, les forces d’intervention n’aient jamais pris en compte les médias dans leurs procédures d’intervention. Le ministère de l’intérieur s’est sans doute trouvé aussi dépourvu que nous face à cet événement extraordinaire. Pourquoi n’avions-nous pas d’interlocuteur ? Parce que le ministère de l’intérieur n’y avait pas pensé ! Les forces d’intervention rouspètent, mais elles n’ont jamais pensé « gérer » les journalistes. Les pays anglo-saxons font bien mieux que nous : un représentant du ministère, toutes les heures, fait le point, qu’il ait quelque chose à dire ou non, ce qui présente l’avantage de regrouper les journalistes à un endroit tandis que les policiers travaillent ailleurs. Il est tout de même surprenant que nous n’ayons pas été capables d’y réfléchir en France. En janvier, le problème s’est posé avec la course-poursuite à Reims, en effet surréaliste, mais il en est allé de même en novembre. Le ministère de l’intérieur a pris conscience qu’il faudrait désormais compter avec les médias et pas seulement avec les médias traditionnels. Reste que nous sommes très loin derrière les Anglo-saxons.
M. Alexandre Ifi. Je n’ai toujours pas d’explications sur ce qui s’est passé exactement à Reims, car, en général, quand des services comme le RAID veulent établir un périmètre de sécurité, ils nous empêchent d’avancer avec eux. Je suis par ailleurs étonné du nombre de citoyens qui circulaient dans ce quartier de Reims au moment que nous évoquons. Je n’ai toujours pas compris pourquoi autant de forces de l’ordre, de journalistes et de citoyens ont pu se retrouver en même temps, au même endroit.
M. Pierre Lellouche. Mon intervention ne me fera peut-être pas que des amis. Je rappelle néanmoins aux honorables journalistes ici présents que j’ai été détenteur de la carte de presse pendant une dizaine d’années et que j’en étais très fier.
Madame Bouin, je m’intéresse à la protection des journalistes sur les théâtres de guerre et j’ai même été l’auteur, avec François Loncle, qui n’appartient pas au même camp que moi, d’une résolution que défendrait par la suite la France aux Nations Unies, portant précisément sur la protection des journalistes en temps de guerre.
Il ne s’agit pas ici de mettre en doute l’honnêteté intellectuelle ni le professionnalisme de la presse française ou étrangère. Le Président de la République l’a dit, nous sommes en guerre : c’est malheureusement vrai et il y aura d’autres attentats. Dans ces conditions, comment faire en sorte que l’information circule sans être un instrument de la bataille que nous livrent les terroristes ? Comment éviter que le bruit médiatique ne participe à l’effet de terreur recherché par nos adversaires ? C’est à mes yeux le but de la présente audition. Et c’est ce qui est intéressant dans vos interventions : vous avez pris conscience que nous sommes bel et bien en guerre et qu’il convient de changer de modus operandi.
Il est un point qui me gêne davantage au regard de l’intérêt général. Est-il possible, dans un système hyperconcurrentiel, de produire une information « fiable et sûre », respectant la vie et la dignité d’autrui ? L’information en continu oblige les journalistes à être les premiers à publier une nouvelle. Au moment où survient un événement grave, qui est aussi celui où l’on va avoir un maximum d’informations, il paraît difficile de les retenir dans un système où tout est soumis à la recherche du buzz, et donc du bruit. Il ne s’agit donc pas de vous faire un mauvais procès, mais de reconnaître vos difficultés. Mme Goutard remarquait que, si le traitement de l’information n’était pas assuré par les médias traditionnels, il le serait par les réseaux sociaux. Bref, il faut s’interroger sur la course à l’audience qui pousse à trouver un sujet, voire plusieurs, par jour – raison d’être d’une chaîne d’information continue.
Je souhaite que nous soyons tous conscients de la nécessité de tenir compte à la fois du droit à l’information – central dans une démocratie – et du fait que, dans le contexte d’une guerre contre le terrorisme, vous pouvez être les vecteurs de la terreur si vous entrez dans la logique de l’adversaire. Il faut donc mettre en place des pare-feu. Peut-être, en effet, la police doit-elle apprendre à travailler avec les médias de façon intelligente. Les policiers que nous avons auditionnés nous ont expliqué qu’il leur était très difficile d’intervenir si les préparatifs sont filmés. Je ne prétends pas détenir la solution, mais il me semble indispensable de trouver, à l’occasion des prochains attentats – car il y en aura d’autres –, le moyen d’informer le public en gardant une certaine distance.
En tout cas, une chose est sûre : vous ne pourrez pas diffuser une information « fiable et sûre » en instantané, quand bien même vous seriez le meilleur professionnel au monde. Une certaine distance s’impose, qui implique du temps. Vous devez donc établir une règle du jeu entre vous tous, à moins de considérer que la concurrence sera toujours gagnante : ce n’est pas moi, c’est Reuters, et si ce n’est pas Reuters, ce sont les réseaux sociaux… nous n’en sortirons jamais.
Je crois donc qu’il faudrait organiser une sorte de lit de justice entre les organes de presse sur cette affaire.
M. le président Georges Fenech. La course à l’audimat est-elle un critère, monsieur Field ?
M. Michel Field. Sans doute la concurrence a-t-elle été quelquefois cause de dérapages ou d’accélérations inconsidérées, mais nombre des critiques formulées sur le traitement des premiers attentats ont été prises en compte. J’ai suffisamment croisé le fer, très amicalement, avec mes confrères de BFMTV pour noter que ce qui avait pu me choquer il y a un an et demi ne s’est pas du tout reproduit.
M. le président Georges Fenech. Je le confirme. Le CSA, à l’occasion des attentats du 13 novembre 2015, n’a pas relevé de manquements dans l’exercice de la responsabilité éditoriale, contrairement aux attentats du mois de janvier.
M. Michel Field. Je n’entends pas me faire l’arbitre des élégances, mais nous sommes tous convaincus de la difficulté de notre métier.
Je reviens sur l’intervention de Pierre Lellouche, que je connais bien et avec qui je croise aussi volontiers le fer en d’autres lieux. Le rêve d’une guerre sans images, nous l’avons eu lors de la guerre du Koweït ; quant au rêve des militaires de n’avoir à leurs côtés que des journalistes embarqués qui ne font que réciter les textes de l’état-major, j’ai peur, quand je vous entends dire que nous sommes en guerre, que ce ne soit le modèle que vous ayez en tête.
M. Pierre Lellouche. Cela s’appelle un procès d’intention.
M. Michel Field. C’est ce que vos propos m’ont inspiré. Nous avons des contradictions à résoudre…
M. Pierre Lellouche. Ce n’est pas ce que j’ai dit, monsieur Field.
M. Michel Field. J’entends bien, mais il n’est jamais naturel pour un journaliste de retenir une information : son métier est de la donner. Convenez que, il y a quelques années, il n’était pas si évident, pour aucun d’entre nous, d’admettre qu’il pouvait être nécessaire de retenir une information dès lors que les autorités nous le démontraient.
J’abonderai en revanche dans le sens de Pierre Lellouche pour considérer que nous n’avons sans doute pas assez pris la mesure que nous sommes confrontés à une guerre par l’image. Les questions que nous pouvions déjà nous poser sur l’usage des médias par tel ou tel truand à l’occasion d’une prise d’otages crapuleuse n’ont rien à voir avec l’instrumentalisation des médias par les groupes terroristes. La résonnance fait partie de leur plan. Dans le cas d’attentats, l’immédiateté rend la décision potentiellement fautive. Au début de l’année, quand une nouvelle vidéo de Daech a circulé sur les réseaux sociaux, Alexandre Kara et moi-même avons décidé, par une note du 15 février, qu’aucune image de l’État islamique ne serait diffusée sur les antennes de France Télévisions, mais que, après avoir fait état de l’existence de ces vidéos, nous expliquerions aux téléspectateurs pourquoi nous ne les diffuserions pas. En effet, nous anticipons l’instrumentalisation dont nous sommes susceptibles de faire l’objet.
Il est facile de reconstituer a posteriori le fil des événements et de considérer que, ici ou là, nous nous sommes trompés. Quand on ignore que la divulgation d’une information peut entraîner de telles conséquences, on ne peut pas se voir reprocher de l’avoir diffusée.
Mme Cécile Ollivier. Vous avez raison, monsieur Lellouche, quand vous évoquez un univers très concurrentiel, mais nous ne pratiquons pas la course au scoop à tout prix : nous retenons de nombreuses informations même quand on ne nous le demande pas. Ainsi, nous savions que l’ADN de Salah Abdeslam avait été retrouvé dans la planque de Forest et, sans qu’on nous le demande, nous avons décidé de ne pas en parler, parce que nous nous doutions qu’une arrestation était imminente.
M. le président Georges Fenech. Tout le monde n’a pas agi de la sorte.
Mme Cécile Ollivier. C’est la presse écrite qui a sorti l’information.
M. le président Georges Fenech. Il s’agit de L’Obs.
Mme Cécile Ollivier. Un autre exemple : la veille ou l’avant-veille de l’assaut de Saint-Denis, nous savions qu’Abaaoud était en France. Nous n’avons pas divulgué ce qui aurait pu être un énorme scoop, car nous ne voulions pas compromettre cette arrestation en diffusant l’information. Nous ne sommes donc pas des canards sans tête, nous ne courrons pas après le scoop à tout prix. Bref, nous évoluons certes dans un univers concurrentiel, mais nous ne correspondons pas à la caricature qu’on fait parfois de nous.
M. Pierre Lellouche. J’ai tâché tout à l’heure – et Michel Field l’a relevé – de montrer que, depuis l’émergence d’Al-Qaïda, la guerre se menait par l’image, sur internet et à la télévision. Dès lors, ou bien on rentre dans ce jeu-là, ou bien on garde ses distances. Or il y a une contradiction entre le mode de fonctionnement capitalistique de l’information, qui est concurrentiel et s’attribue une dimension morale – la morale du journaliste est de donner l’information –, et l’utilisation de ce système à des fins militaires contre nous.
En consultant sur internet la revue Dabiq, on trouve toutes sortes de vidéos passionnantes : un imam saoudien explique l’art de battre sa femme – voilà qui est pédagogique ! – ; une fondation financée par l’État du Qatar explique à de jeunes enfants comment Mahomet a conquis l’Europe… Voilà des reportages tout à fait intéressants, dont je n’entends pas assez, sur France Info ou sur BFMTV…
M. le président Georges Fenech. C’est un autre sujet.
M. Pierre Lellouche. Au contraire : c’est la même guerre.
M. Nicolas Charbonneau. Nous sommes intervenus très vite sur ces questions. Je ne voudrais pas que cette commission d’enquête instruise le procès de qui que ce soit. J’entends ce que vous dites et trouve plutôt positif que nous ayons cette discussion. Nous sommes responsables. Après les attentats de janvier 2015, le CSA nous a infligé quelques avertissements, quelques rappels à l’ordre, ce qu’il n’a pas fait après ceux de novembre dernier. Michel Field le rappelait, nous sommes confrontés à une guerre d’images. Or nous sommes aujourd’hui très vigilants sur l’emploi des images, même s’il est parfois difficile de parler d’un événement sans en rien montrer. Nous avons travaillé – notamment avec le CSA – sur l’image, le son – qui a son importance : souvenons-nous, après l’attentat contre la rédaction de Charlie Hebdo, du son des frères Kouachi. Leur traitement fait l’objet d’une vigilance de tous les instants : nous ne faisons pas n’importe quoi.
Le 13 novembre, les explosions autour du Stade de France retentissent vers vingt et une heures trente ou vingt et une heures quarante. L’état-major de TF1 est sur place et décide en toute responsabilité de ne pas interrompre le match. Dès qu’il se termine, Christian Jeanpierre rend l’antenne en annonçant qu’il s’est passé quelque chose de dramatique dans Paris. Il aurait été irresponsable d’interrompre cette retransmission à la fois vis-à-vis de ceux qui se trouvaient dans le stade et vis-à-vis des 6 millions de téléspectateurs. Le mercredi suivant, au moment de l’assaut à Saint-Denis, nous n’avons évidemment pas interrompu les programmes pour la jeunesse – nous n’aurions du reste pas encore vraiment su quoi annoncer.
Je suis, comme mes confrères, plutôt dubitatif sur ce qui s’est passé à Reims le mercredi soir. Bien sûr, nous nous y sommes rendus, le travail d’un journaliste étant d’aller sur place vérifier ce qui se passe plutôt que d’attendre la diffusion d’informations ou d’images par Twitter ou Periscope. L’attentat contre la rédaction de Charlie Hebdo a eu lieu le mercredi matin et nous savons que les frères Kouachi sont dans la nature. Or nous avons une information selon laquelle une intervention va avoir lieu à Reims. Je reste stupéfait en songeant qu’en arrivant sur place nos équipes n’ont vu aucun périmètre de sécurité. Bien plus, les habitants, munis de smartphones, étaient pour leur part à deux mètres derrière les intervenants du RAID ! Je n’aurais pas crié au scandale si, arrivés à Reims, nous avions trouvé le quartier bouclé. Cela avait d’ailleurs été le cas à Toulouse quand Mohamed Merah s’était retranché dans son appartement : nous étions tenus à 200 mètres de distance. La situation de Reims est tout de même baroque : on voit les membres du RAID surarmés, surprotégés et, derrière eux, des riverains en short !
M. Antoine Guélaud. Derrière eux, voire devant eux !
M. Nicolas Charbonneau. Nous n’allons pas instruire le procès du ministère de l’intérieur, de la police ou des forces d’intervention. Reste que le journalisme n’est pas une science exacte – c’est peut-être ce qui fait son charme. Nous avons commis des erreurs, mais il s’est agi d’erreurs collectives, et aucun d’entre nous n’a été épargné par le CSA. Nous les avons reconnues, analysées et corrigées, puisque, à la suite des attentats de novembre, le même CSA nous a délivré un satisfecit.
Bien sûr, nous sommes concurrents, mais je pense, moi aussi, que la vérité peut attendre cinq minutes.
M. le rapporteur. Vous êtes tous dubitatifs sur ce qui s’est passé à Reims. Il convient néanmoins de rappeler que cette intervention a été réalisée dans un cadre judiciaire. Leurs représentants nous ont expliqué que, sur l’autoroute, les forces du RAID se faisaient dépasser par les journalistes.
Mme Audrey Goutard. Pas forcément par nos équipes, monsieur le rapporteur. On comptait sur place plus de badauds que de journalistes.
M. le rapporteur. Soit, mais accordez-moi que des journalistes partis de Paris ont dépassé le RAID sur l’autoroute et sont arrivés avant lui ; ce qui pose tout de même un problème d’ordre opérationnel. Imaginez en effet que les frères Kouachi se soient vraiment retranchés à Reims : l’arrivée d’équipes de télévision leur aurait évidemment mis la puce à l’oreille ! De tels comportements, outre qu’ils mettaient en danger vos collègues, mettaient le RAID en difficulté et pouvaient nuire à la qualité de son intervention.
J’en viens à la question de la confidentialité. Vous regrettez l’absence d’interlocuteur au ministère de l’intérieur. En même temps, un tel interlocuteur ne vous aurait pas annoncé qu’une opération était en préparation à Reims pour vérifier les adresses supposées des présumés terroristes. Encore une fois, la présente commission d’enquête n’a pas vocation à instruire un procès à charge contre le rôle des médias, mais au contraire à définir des propositions constructives. Or, en l’espèce, vous devez pouvoir concilier votre travail, qui consiste à diffuser des informations, avec une nécessaire retenue pour ne pas gêner les opérations en cours. Aussi, en ce qui concerne cet épisode de Reims, je souhaite savoir où vous avez placé le curseur.
M. Nicolas Charbonneau. Nous sommes de ceux qui sont allés à Reims assez rapidement mercredi en fin de journée. L’attentat a eu lieu dans les locaux de Charlie Hebdo le matin même et nous avons appris que ses auteurs sont deux frères en cavale dont on ne sait plus très bien s’ils se trouvent au nord ou au nord-est de Paris. Selon une rumeur, ils seraient en train de rentrer à Paris et les forces de l’ordre prendraient position à certaines portes pour sécuriser la capitale. Or l’une de nos équipes, dont je ne sais plus si elle se trouve porte de Vincennes ou place de la Nation, voit les véhicules du RAID prendre l’autoroute qui mène à Reims. Dans le même temps, les journalistes qui, à TF1, sont spécialistes des questions de justice, de police et de terrorisme, apprennent l’imminence d’une intervention quelque part vers l’Est.
Le travail d’un journaliste, c’est d’aller sur place, de recueillir des informations, des images qui seront ensuite triées. Or à aucun moment nous n’avons dit que les frères Kouachi se trouvaient à Reims et que le RAID allait intervenir. En effet, la situation sur place est quelque peu baroque, vers vingt-deux heures, avec des spécialistes des interventions, au pied des immeubles, avec la population tout entière deux mètres derrière eux. Encore une fois, cela ne m’aurait posé aucun problème que le RAID nous demande de rester derrière un cordon de sécurité établi à 300 ou à 400 mètres à la ronde.
Mme Angélique Bouin. Si nous commençons, en effet, à nous interroger sur la nécessité d’aller ou non sur place quand nous disposons de ce genre d’information, il ne nous reste plus qu’à arrêter notre travail. La situation telle que nous l’avons décrite doit toutefois nous amener à réfléchir. Reste que, s’il fallait reprendre la décision d’aller sur place, je la reprendrais.
M. Alexandre Ifi. Nous apprenons que l’un des frères Kouachi est originaire du quartier de la Croix-Rouge à Reims et nous allons sur place sans même être au courant du projet d’intervention du RAID, pour recueillir des témoignages, faire du porte-à-porte, ne serait-ce que pour vérifier l’information. Je pense que deux phénomènes se sont croisés.
J’ai pu m’entretenir, après les attentats de novembre 2015, avec certains hauts responsables de la police et de la justice qui m’ont affirmé qu’ils avaient eu des informations via BFMTV et I-Télé et que c’est ainsi qu’ils avaient compris ce qui était en train de se passer.
M. Pierre Lellouche. Ils nous l’ont dit aussi.
M. Alexandre Ifi. Au-delà de la réflexion sur l’image, au moment où surviennent les attentats, notre rôle est d’informer les citoyens sur une crise qui les concerne. Or, je me permets de le répéter, de hauts responsables de la police et de la gendarmerie, parfois très critiques sur notre travail, nous ont tout de même affirmé que nous les aidions à s’informer !
M. Grégory Philipps. J’ajoute, en ce qui concerne l’assaut à Saint-Denis, que nous avons vocation à informer les habitants alentour qu’une opération est en cours et qu’il vaut mieux rester à l’abri chez soi et s’éloigner des fenêtres. Cela fait aussi partie de notre travail de recommander la prudence quand il se passe quelque chose.
M. Pierre Lellouche. Ce n’est pas votre travail, mais celui de l’État !
M. Alexandre Ifi. Mais les gens nous appellent, nous, à ce moment-là, pour nous demander ce qui se passe dans leur quartier.
M. Olivier Falorni. On vous dit « concurrence » et vous répondez « maturation », ce qui me paraît assez logique. Nous nous sommes rendu compte, d’ailleurs, que la concurrence n’était pas un trait propre aux médias, puisque nous savons désormais que des terroristes, sur un site, qu’il s’agisse de l’Hypercacher, du Bataclan ou d’autres, sont attentifs, d’une part, à la présence des médias et, d’autre part, au fait de savoir quelles forces d’intervention vont mener l’assaut. On nous a dit très clairement que les terroristes souhaitaient en effet mourir sous les balles d’unités spéciales d’intervention, parce que, de leur point de vue, ce serait plus noble. Vous le savez, la concurrence existe aussi au sein même des services d’intervention. D’ailleurs, le ministre de l’intérieur vient de définir une nouvelle doctrine selon laquelle les trois forces d’intervention concurrentes seraient mieux coordonnées. Aussi la concurrence concerne-t-elle les deux facteurs qui intéressent les terroristes : les médias et les groupes d’intervention de la police et de la gendarmerie.
Comment traiter cette question dans un contexte ultrasensible d’attentats ? Ne peut-on concevoir une coordination des médias, laquelle prendrait le pas sur la concurrence ? On doit certes compter avec la pression des réseaux sociaux, mais ils ne font pas tout et vous gardez tout de même la responsabilité principale de l’information.
Ensuite se pose la question de l’information à l’échelle européenne, voire mondiale : on sait très bien que, sur les sites d’attentats, on ne trouve pas que des médias français.
Nous avons évoqué votre retour d’expérience des attentats de janvier 2015, qui s’est traduit par la couverture que vous avez réalisée des attentats de novembre 2015. Or le camion satellite d’une chaîne privée flamande, VTM, était installé devant la maison où se cachait Abdeslam, à Molenbeek, avant même l’arrivée des forces de l’ordre venues pour l’arrêter. En outre, trait qui rappelle la situation précédemment décrite à Reims, quand les forces d’intervention se tiennent devant la porte de la maison, on voit des gens, au même moment, dans la rue ou derrière la vitrine d’un magasin. Je n’ai pas le sentiment que la maturation sur laquelle vous avez insisté se soit étendue à vos collègues étrangers. Peut-on dès lors envisager une réflexion plus globale sur les médias à l’échelle européenne, voire internationale ?
Enfin, je reviendrai sur la diffusion des images après les événements. La chaîne M6 a diffusé dimanche soir un documentaire sur les attentats de novembre 2015, comportant des images inédites. Je ne remets pas en cause la qualité du documentaire, mais, du point de vue de la dignité, certaines scènes m’ont choqué ou ne me paraissaient en tout cas pas forcément nécessaires, même a posteriori. Et même s’il est davantage question, dans le cadre de cette table ronde, de la diffusion des images en direct, il me semble que la notion de dignité perdure. Or certaines images de ce reportage ne me paraissaient pas opportunes.
M. le président Georges Fenech et M. Alain Marsaud. Quelles images ?
M. Olivier Falorni. Certaines images de blessés, prises à l’aide de téléphones portables, et pas forcément, d’ailleurs, par des journalistes.
M. le président Georges Fenech. Autrement dit, il en va du droit à l’image.
M. Olivier Falorni. En effet.
Qu’en est-il, par ailleurs, du filtrage des images ? Certaines images de l’attentat du métro de Moscou en 2010 ont ainsi été diffusées pour illustrer celui du métro de Bruxelles.
Mme Françoise Dumas. Vous avez à raison estimé qu’il fallait prendre en compte la dimension citoyenne dans l’exercice de votre métier, l’un des plus nobles qui soit puisque vous servez également l’intérêt général, l’information ayant son importance en démocratie. Or vous êtes devenus des instruments de l’action des terroristes, qui ont besoin de vous pour passer pour des héros : cette donnée fait partie de leur stratégie guerrière. La place des médias est donc fondamentale pour eux.
Malheureusement, les événements que nous avons connus se renouvelleront sans doute et nous devons tous faire évoluer nos réactions, les faire mûrir – mais déjà le CSA a noté les progrès que vous avez réalisés.
Comment serait-il possible, dans cette perspective, de parvenir à communiquer de manière plus pragmatique avec le ministère de l’intérieur ? Je trouve assez inconcevable que, dans les circonstances que vous avez rappelées, il ait été nécessaire de joindre directement le Premier ministre pour lui communiquer des informations. Comment l’État pourrait-il vous aider à construire des outils – profitant de cette période de sérénité propice à la réflexion ? Je pense à l’établissement d’une boucle téléphonique, à la nomination d’un référent… Avez-vous envisagé de créer ce type d’outil ?
Votre capacité à obtenir une large audience dépend également de votre capacité à diffuser l’information la plus précise et la plus fiable possible. Je suis aussi une citoyenne et, à ce titre, à la recherche de l’information la plus fiable. Si cette information est fiable, même si elle n’est pas divulguée immédiatement, elle vous permettra de gagner des parts de marché.
M. Pierre Lellouche. Il est vrai, monsieur Ifi, que de hauts responsables de la police ont été informés par BFMTV de ce qui se passait. Nous avons été plusieurs députés à en rester stupéfaits en l’apprenant. Cela signifie qu’il n’y avait pas de centre de coordination, et la présente commission doit chercher à savoir pourquoi. Ensuite, il paraît nécessaire de coordonner l’action des chaînes d’information en continu, mais également avec les forces d’intervention, faute de quoi nous deviendrons les jouets de gens qui utilisent les médias et publieront les images de notre désordre dans leurs magazines.
Je répondrai ensuite à M. Philipps : ce n’est pas à France Info de dire aux citoyens comment se comporter dans tel ou tel quartier. Quand c’est la presse qui informe la police d’un problème et que ce sont les journalistes qui remplacent l’État pour l’information du public en matière de sécurité, c’est que nous avons un vrai problème.
Pour ce qui me concerne, j’ai demandé que l’essentiel des travaux de la commission soient tenus à huis clos, précisément pour éviter leur instrumentalisation par nos adversaires.
M. le président Georges Fenech. Un vœu qui a été satisfait.
M. Pierre Lellouche. En effet, et je vous en remercie, monsieur le président.
M. le président Georges Fenech. Nous étions majoritaires, sinon unanimes, à le souhaiter. Les commissaires travaillent en toute bonne entente, comme peut en témoigner M. le rapporteur.
Les dernières interventions mettent l’accent sur la coordination de l’information. Peut-on l’imaginer ?
Mme Audrey Goutard. On pourrait en tout cas imaginer une meilleure coordination entre le ministère de l’intérieur et nous-mêmes. J’évoquais précédemment le modèle anglo-saxon, qui certes n’est pas idéal, mais à retenir.
M. le président Georges Fenech. Pouvez-vous nous en dire un mot ?
Mme Audrey Goutard. Les États-Unis ont hélas l’habitude des tueurs de masse, et donc de traiter des événements extraordinaires dans des lieux publics, avec l’établissement de périmètres de sécurité, etc. Or, depuis des dizaines d’années, à l’occasion de ce genre de meurtres de masse, une personne se trouve systématiquement sur les lieux et s’exprime toutes les demi-heures en période de grande crise, au nom des autorités policières et judiciaires. Il s’agit de contenir les journalistes, et de donner ou de ne pas donner des informations.
Il serait important que nous ayons, au ministère de l’intérieur, un interlocuteur dont le rôle serait de diffuser des informations ou de nous mettre en garde. Il est vrai que ces moments sont inquiétants, nous avons peur de laisser passer une information. Il ne faut dès lors pas tomber dans un autre excès, ainsi que le soulignait Michel Field, consistant à vouloir tout retenir. J’ai en effet entendu un journaliste se demander pourquoi il n’y aurait pas un représentant de la police dans les rédactions pour nous conseiller… C’est sans doute confortable, mais en même temps très risqué. J’ai par ailleurs entendu un de ses membres se demander pourquoi le CSA ne serait pas présent au sein des rédactions à l’occasion de ce type de crise. Je ne pense pas non plus qu’il s’agisse d’une idée très judicieuse : le mieux est parfois l’ennemi du bien. Mais, si, sur les lieux mêmes de la crise, se trouvait une personne à même de nous retenir, de nous donner des informations, si nous pouvions en outre disposer d’un interlocuteur au ministère de l’intérieur, ce serait un énorme progrès.
On ne peut toutefois pas avancer que nous n’avons pas de liens avec le ministère de l’intérieur. Pour ma part, quand je suis en plateau, je suis en contact permanent avec le cabinet du ministre. Et l’on doit noter des progrès, en la matière, entre les attentats de janvier et ceux de novembre 2015.
M. Falorni a abordé la question de la diffusion d’images. Je n’ai pas vu le reportage de M6, mais nous avons tous reçu, dès les premiers jours qui ont suivi les attentats, les images de ces jeunes gens mourant autour du Bataclan. Nous avons décidé de ne pas les divulguer : nous diffusons à peine un dixième de ce que nous voyons. Sachez que ces images me hantent et que je suis traumatisée à vie par ce que j’ai visionné.
Vous avez raison, par ailleurs, de souligner que nous sommes en guerre de communication. Je suis moi-même spécialiste du terrorisme : je sais donc de quoi sont capables les membres de l’État islamique en la matière. Peut-être commettons-nous des erreurs, mais nous avons en permanence cette donnée en tête. Ainsi, lorsque nous recevons une vidéo montrant l’assaut de l’Hypercacher, et plus précisément Amedy Coulibaly tomber sous les balles des policiers, nous décidons de ne pas la montrer, car cette image peut être utilisée. Nous essayons en effet de nous mettre dans la tête des terroristes pour nous demander si telle ou telle image leur profiterait et pour tâcher de savoir de quelle manière ils pourraient s’en servir. C’est par souci de la dignité humaine que nous n’avons jamais divulgué les vidéos de l’horreur des attentats de novembre 2015.
M. le président Georges Fenech. On peut d’ores et déjà relever que vous êtes d’accord sur la nécessaire réorganisation des relations entre le ministre de l’intérieur et les organes de presse – M. Béroud nous a dit que, faute de référent, il ne savait pas qui appeler.
M. Hervé Béroud. Aussitôt après les attentats de janvier 2015, nous avons évoqué auprès du ministère de l’intérieur la nécessité d’une meilleure organisation, car nous pensions que cela recommencerait. Or rien n’a été fait à ce jour.
M. le président Georges Fenech. M. Philipps remarque également que personne du ministère de l’intérieur n’a appelé sa rédaction ; M. Field nous a de son côté montré qu’il fallait établir un dialogue avec les autorités et sans doute désigner un référent ; enfin Mme Goutard et les représentants du groupe TF1 sont allés dans le même sens. Au total, on perçoit donc bien la nécessité d’une meilleure articulation entre les autorités, policières comme judiciaires, et vous-mêmes. Pour avoir discuté de ces questions avec les procureurs de Paris et de Bruxelles, je vous indique que, de leur côté, l’attente est également très forte en la matière.
M. Guillaume Zeller. Je souhaite revenir – pour lui tordre le cou – sur une idée mentionnée à plusieurs reprises : celle de concurrence. S’il est bien des moments, en effet, où nous ne nous trouvons pas soumis à une logique de concurrence – je fais plus précisément allusion aux chaînes d’information continue –, ce sont ces phases d’attentats de masse. Non seulement nous sommes des citoyens et vivons ces événements de façon très forte, mais nous mesurons la gravité de ce qui est alors en train de se passer.
Dans ce contexte, nous ne nous demandons pas qui va détenir un scoop. Notre souhait est évidemment de donner rapidement l’information – car telle est la vocation des chaînes d’information en continu –, mais à condition qu’elle soit fiable. Et cela n’empêche pas, bien sûr, que certains points restent à améliorer.
On a soutenu tout à l’heure que cette concurrence se doublait d’un enjeu capitalistique. Or il faut savoir que, quand nous passons en édition spéciale – ce qui fut le cas, pour I-Télé pendant presque une semaine lors des attentats du 13 novembre 2015 –, nous supprimons tous les écrans publicitaires, alors que l’audience est maximale.
M. Pierre Lellouche. Mais ces éditions spéciales servent aussi l’image de la chaîne !
M. Guillaume Zeller. Je ne peux pas m’empêcher de réagir à l’idée que, dans ce genre de contexte, nous subirions une pression capitalistique.
M. Pierre Lellouche. Pardonnez-moi, mais ce ne sont pas des arguments sérieux !
M. le président Georges Fenech. C’est votre point de vue, monsieur Lellouche.
M. Pierre Lellouche. On ne peut pas soutenir une telle position. Bien sûr que vous allez supprimer la publicité pendant les éditions spéciales, mais celles-ci vont contribuer à la réputation de votre chaîne. Ne me dites pas qu’il n’y a pas de compétition capitalistique entre vous !
M. le président Georges Fenech. Monsieur Marsaud, je vous trouve bien silencieux aujourd’hui…
M. Alain Marsaud. Vous allez sans doute penser que j’en fais une idée fixe, mais je réitère mon souhait que nous entendions les ministres belges de la justice et de l’intérieur qui avaient tous deux proposé de démissionner, ce qui laisse entendre qu’ils avaient quelque chose à se reprocher.
M. Grégory Philipps. Je reviens sur la notion de concurrence. Je représente la plus « historique » des chaînes d’information continue, puisque nous opérons depuis trente ans. Nous avons de nouveaux concurrents et, si la concurrence joue, c’est davantage sur la qualité de nos informations que sur la rapidité de leur diffusion. Nous partageons tous le souci de donner une information vérifiée et rigoureuse. On a précédemment suggéré l’institution de pare-feu. Il se trouve qu’à France Info, avant même les attentats de janvier 2015, nous avons créé une agence interne composée de douze journalistes chargés de chercher les informations sur les réseaux sociaux pour les vérifier, les valider en tant qu’informations France Info afin que nous puissions les diffuser immédiatement. La concurrence porte donc bien sur la qualité de nos informations : pour ma part, je n’ai pas envie de raconter des sottises à l’antenne, et surtout pas dans les moments que nous évoquons.
Ensuite, je suis en désaccord avec vous, monsieur Lellouche, sur la fonction d’alerte, qui fait partie des prérogatives des radios de service public. Ainsi, le réseau France Bleu est chargé d’une mission de service public pour prévenir la population en cas d’accident nucléaire. Certes, le contexte des attentats n’est pas comparable, mais nous avons bel et bien cette mission d’alerte de la population en cas de danger.
M. Pierre Lellouche. Certes, mais il faut pour cela que vous ayez un message de l’État : il n’est pas question que vous agissiez de votre propre chef !
M. Alexandre Ifi. Mme Dumas a évoqué les médias comme instruments de l’action terroriste. Il y a peut-être un défaut de confiance. On a cité l’exemple des États-Unis où, certes, il y a un référent, mais où les hélicoptères sont immédiatement sur les lieux d’un événement qui est donc vécu en direct. Les Américains aiment leur presse et peut-être que les Français n’aiment pas la leur – ce qui doit nous faire réfléchir. Pour que les choses aillent un peu mieux, il doit s’établir un rapport de confiance avec la presse qui, dans une démocratie, est un pouvoir important.
M. le président Georges Fenech. Nous en resterons à cette belle conclusion sur la liberté de la presse et la démocratie. Soyez assurés que la commission d’enquête partage entièrement ce point de vue. Aussi était-il important de vous entendre et de réfléchir ensemble. Nous ferons des propositions qui iront probablement dans le sens que vous avez indiqué.
Audition, ouverte à la presse, de M. Guillaume Blanchot, directeur général du Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA), et de M. Thomas Dautieu, adjoint à la directrice des programmes
Compte rendu de l’audition, ouverte à la presse du mercredi 27 avril 2016
M. le président Georges Fenech. Messieurs, la commission d’enquête relative aux moyens mis en œuvre par l’État pour lutter contre le terrorisme depuis le 7 janvier 2015 achève, avec votre audition, le chapitre de ses travaux qu’elle consacre aux médias. Après avoir reçu, lundi, les syndicats de la presse, puis des représentants des chaînes de radio et de télévision, nous avons souhaité entendre le Conseil supérieur de l’audiovisuel qui a été conduit, à la suite des attentats de janvier 2015, à relever de nombreux manquements de la part de ces dernières et à prononcer des mises en garde, voire des mises en demeure. Notre commission d’enquête a souhaité faire le point sur le traitement de l’information en abordant les problèmes que celui-ci peut soulever pour les victimes comme pour les services de sécurité, et la réponse de l’organe de régulation.
Cette audition, ouverte à la presse, fait l’objet d’une retransmission en direct sur le site internet de l’Assemblée nationale. Son enregistrement sera disponible pendant quelques mois sur le portail vidéo de l’Assemblée, et la Commission pourra décider de citer dans son rapport tout ou partie du compte rendu qui sera fait de cette audition.
Conformément aux dispositions de l’article 6 de l’ordonnance du 17 novembre 1958, relatif aux commissions d’enquête, je vous demande de prêter le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité.
M. Guillaume Blanchot et M. Thomas Dautieu prêtent successivement serment.
À la suite des attentats de janvier 2015, le Conseil supérieur de l’audiovisuel, réuni en formation plénière, a relevé trente-six manquements imputables aux chaînes de télévision et aux radios, dont quinze ont donné lieu à mise en garde et vingt et un, plus graves, ont justifié des mises en demeure. Les sanctions que la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication autorise le CSA à prononcer sont-elles, de votre point de vue, adaptées aux manquements constatés ? Était-il possible, d’un point de vue juridique, de prononcer des sanctions plus lourdes ? Faut-il compléter la liste des sanctions que la loi autorise ?
Le CSA a-t-il été conduit à mettre en garde ou en demeure un ou plusieurs médias pour des manquements aux obligations résultants des textes, constatés à l’occasion d’autres attentats terroristes que ceux des mois de janvier et novembre 2015 ?
À la suite des attentats de janvier 2015, il semble que le CSA ait réuni les responsables des chaînes de télévision et des radios pour une « réflexion commune ». Qu’en est-il résulté ? Les chaînes de télévision et les radios ont-elles défini un cadre ou une charte de bonnes pratiques pour le traitement médiatique des attaques terroristes ?
À l’occasion des attentats du 13 novembre 2015, le CSA n’a pas relevé de manquement dans l’exercice de la responsabilité éditoriale des télévisions et des radios, mise à part une signalétique jeunesse qu’il a estimée inadaptée. Quelles en sont les raisons ? D’après vous, quelles ont été les principales différences dans le traitement de l’information en janvier et en novembre 2015 ?
Pensez-vous que la couverture médiatique des attaques terroristes devrait faire l’objet d’un encadrement plus strict ? Qu’il faudrait définir la nature des informations susceptibles d’être communiquées, ainsi que les contours de la collaboration entre les médias et les différents acteurs mobilisés à l’occasion d’attaques terroristes – les parquets, le préfet de police ou les préfets de département, les représentants des forces de sécurité et des secours ?
Quel regard portez-vous sur les dispositifs de lutte contre les fuites d’informations mis en place par les médias audiovisuels ? Comment pourrait-on les améliorer ?
M. Guillaume Blanchot, directeur général du Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA). Les événements tragiques de l’année 2015 ont rappelé combien les médias audiovisuels jouent un rôle essentiel dans l’information du public sur le fait terroriste. De ce point de vue, une question primordiale est de savoir comment la liberté d’information, qui est fondamentale, peut être conciliée avec la nécessaire sauvegarde de l’ordre public et la préservation de la cohésion nationale.
Une réponse est apportée par l’article 1er de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, qui précise que l’exercice de cette liberté « ne peut être limité que dans la mesure requise » par un certain nombre d’éléments précis parmi lesquels la « sauvegarde de l’ordre public », le « respect de la dignité de la personne humaine », et la protection du jeune public. Il appartient aux médias audiovisuels soumis à cette loi d’assurer cette conciliation sous le contrôle du Conseil supérieur de l’audiovisuel. Il convient de rappeler à cet égard que ce contrôle n’intervient jamais avant la diffusion des programmes. L’intervention du CSA se fait a posteriori, de son propre chef ou sur saisine d’un tiers, afin, le cas échéant, de faire respecter les grands principes posés par la loi.
Le CSA dispose, pour ce faire, d’un pouvoir de sanction, qu’il se doit d’exercer de façon graduée. La sanction, qui peut prendre différentes formes et qui est prononcée après engagement des poursuites et instruction du dossier par un rapporteur indépendant, ne peut intervenir qu’après une mise en demeure, elle-même souvent précédée d’une lettre de rappel ferme à la loi et à la réglementation, et d’une mise en garde.
J’en viens à la question de l’action du CSA à l’égard des médias traditionnels que sont les radios et télévisions lors des attaques terroristes des mois de janvier et novembre 2015.
Il y a un peu plus d’un an, le président du Conseil, Olivier Schrameck, rappelait, devant la commission d’enquête de votre assemblée sur la surveillance des filières et des individus djihadistes, selon quelles modalités et dans quel esprit le CSA était intervenu auprès des éditeurs de services, radios et télévisions, au cours des premières semaines de l’année 2015. Les avertissements qu’il avait été amené à prononcer se fondaient sur des faits peu nombreux mais largement répandus, car répétés par de nombreux éditeurs. Vous l’avez rappelé, monsieur le président, quinze manquements ont donné lieu à des mises en garde, et vingt et un, jugés plus sérieux, à des mises en demeure. Je rappelle que Conseil avait procédé à un examen attentif de l’ensemble des séquences diffusées lors de ces tragiques événements, soit près de 500 heures de programmes. Il avait également été saisi d’un nombre particulièrement élevé de plaintes de téléspectateurs ou d’auditeurs, émus des conditions de traitement des attentats.
Je veux insister sur la différence de traitement par les radios et les chaînes de télévision des événements de janvier 2015 et de ceux de novembre 2015. Après avoir visionné les programmes diffusés sur les chaînes qu’il contrôle, le Conseil a fait part, dans un communiqué de presse diffusé dès le 25 novembre 2015, de sa satisfaction d’avoir constaté la quasi-absence de manquement. La couverture des événements de novembre 2015 n’a conduit le Conseil à intervenir qu’une seule fois jusqu’à maintenant, pour une signalétique jeunesse mal adaptée s’agissant d’une émission d’information.
Certes, les circonstances des attentats de novembre étaient différentes de celles du mois de janvier 2015, mais je souhaite souligner que le Conseil voit dans cette différence de situation le reflet d’une meilleure prise de conscience par les médias audiovisuels des exigences particulières, en termes de respect de l’ordre public et de respect de la dignité de la personne humaine, qu’impose le traitement médiatique d’événements aussi sensibles. Il y voit également le fruit de l’action pédagogique qu’il a souhaité mener dès janvier 2015, indépendamment des procédures de contrôle engagées qui ont abouti aux mises en demeure et aux mises en garde que j’ai citées.
En effet, face aux critiques et aux interrogations sur les conditions de traitement des attentats de janvier 2015 par les médias audiovisuels, le Conseil avait pris l’initiative de réunir, le 15 janvier, les représentants des radios et des télévisions afin d’avoir avec eux « une réflexion commune sur les questions et les difficultés qui ont pu être soulevées par l’accomplissement de leur mission ». Au cours de cette réunion, les éditeurs avaient notamment fait part de la difficulté à résister à la concurrence des réseaux sociaux sur lesquels étaient données des informations diverses et variées, souvent non vérifiées. Cette asymétrie comportait, selon eux, le risque qu’ils soient perçus comme les porte-parole d’une information « officielle ». Ils avaient également souligné les risques que comportait la diffusion d’une information trop aseptisée au regard de l’horreur de ces journées. De façon plus générale, ils avaient évoqué les difficultés particulières rencontrées dans l’exercice de la mission d’informer en raison des conditions exceptionnelles d’urgence et de gravité de la situation.
Le CSA considère que cette réunion a été extrêmement bénéfique pour lui-même, car cela lui a permis de nourrir sa réflexion, mais aussi pour les éditeurs, qui ont pu ainsi discuter avec le Conseil et confronter entre eux leurs points de vue sur leurs difficultés communes. Le traitement médiatique des attentats du mois de novembre 2015 me semble résulter de la prise de conscience et des enseignements postérieurs aux événements du mois de janvier. Je note par ailleurs, sans me prononcer sur le fond, puisque des procédures sont en cours, qu’un nombre significatif d’éditeurs a décidé de se désister des recours engagés contre les mises en demeure que leur avait signifiées le Conseil en février 2015.
S’agissant des moyens mis en œuvre par le CSA dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, je voudrais, à la suite de ces premiers constats, vous faire part de plusieurs considérations.
Le CSA s’est doté d’outils internes, à la mesure de ses moyens humains et financiers, pour assurer un contrôle en continu et immédiat des principaux médias lors de la survenance d’événements tragiques. Il a mis en place un dispositif particulier qui permet à ses agents de suivre les principales chaînes gratuites françaises qui traitent des sujets d’information, les chaînes d’information en continu, et les principales radios. Une cellule de veille, composée d’agents volontaires, permet ainsi, lors d’événements tels que les attentats de 2015, une remontée instantanée et efficace de l’information vers le président et les membres du collège du CSA. Cette cellule, qui peut fonctionner durant plusieurs jours si la situation l’exige, est composée d’une dizaine d’agents.
Une telle mobilisation représente un coût non négligeable pour le Conseil, tant en termes de moyens humains que matériels. Il conviendrait d’amplifier cet effort mais, dans le contexte de maîtrise et de réduction de la dépense publique, le Conseil, et c’est bien normal, prend sa part d’effort.
Monsieur le président, vous m’interrogez sur la possibilité d’étoffer les pouvoirs de sanction dont dispose le CSA. Ceux-ci sont nécessairement gradués. Après l’examen des programmes par les services du Conseil, un dossier peut être instruit puis présenté au collège qui en délibère. Si des faits ayant déjà donné lieu à une mise en demeure sont répétés, le rapporteur indépendant chargé d’engager les poursuites et d’instruire le dossier est saisi par le directeur général du Conseil. Le cas échéant, le rapporteur propose des sanctions au collège, qui en délibère. Dans l’état actuel du droit, le Conseil ne peut donc pas sanctionner immédiatement un manquement, car les sanctions, qu’elles soient pécuniaires ou le retrait de l’autorisation d’émettre, par exemple, ne peuvent être prononcées qu’après une mise en demeure et la répétition des manquements qui ont motivé cette dernière.
Nous ne contestons évidemment pas le cadre juridique dans lequel le Conseil exerce son pouvoir de sanction. L’éventail des sanctions prévues par la loi de 1986 nous paraît suffisamment large pour qu’il puisse réagir à la diversité des situations de manquement qu’il peut constater.
Il faut, par ailleurs, souligner les interrogations soulevées par l’évolution globale du paysage de l’information. S’interroger sur les conditions du traitement médiatique des attentats conduit inévitablement à s’interroger sur l’information relayée sur internet, en particulier par les plateformes numériques.
Pour ce qui est du prolongement sur internet des médias traditionnels, tels les services en ligne des journaux ou des radios, des réflexions et des analyses sont en cours pour déterminer s’il s’agit de services de médias audiovisuels à la demande – les SMAD selon un acronyme très en vogue en droit audiovisuel communautaire et dans le milieu de l’audiovisuel. Dans ce cas, ils seraient soumis à la directive européenne du 10 mars 2010 régissant les services de médias audiovisuels. Ces réflexions ont été éclairées par un arrêt récent de la Cour de justice de l’Union européenne qui a statué sur la qualité de SMAD d’un organe de presse autrichien.
La question posée par la profusion d’informations sur internet est surtout sensible s’agissant des plateformes numériques. Le caractère ouvert de ces plateformes – je pense en particulier aux réseaux sociaux et aux plateformes de vidéos – offre un outil de communication de très large portée à ceux qui veulent propager des discours d’incitation à la discrimination, à la haine raciale, des discours faisant l’apologie du terrorisme ou portant atteinte à la dignité de la personne. Or le rôle de ces plateformes est de plus en plus difficile à appréhender selon le régime de responsabilité prévu par la loi pour la confiance dans l’économie numérique du 21 juin 2004, qui, transposant le droit communautaire, distingue les hébergeurs et les éditeurs, la responsabilité des premiers étant moins large que celle des seconds.
Considérées aujourd’hui comme des hébergeurs, quand bien même il apparaît qu’elles jouent, sous certains aspects et dans des proportions variables, un rôle d’éditeur et de distributeur, les plateformes numériques bénéficient d’un régime de responsabilité qui leur laisse une très large marge de manœuvre pour exercer un contrôle a posteriori sur les contenus qu’elles diffusent, selon des critères qui restent flous et qui changent d’une plateforme à l’autre, sachant par ailleurs que le juge n’intervient que rarement. À notre sens, cette situation n’est pas satisfaisante. Du CSA au Conseil d’État, en passant par la Commission nationale consultative des droits de l’Homme, de nombreux travaux ont été menés sur ce sujet afin de dégager des propositions et de faire évoluer le cadre juridique actuel. Ils montrent l’intérêt d’une plus grande intervention de la puissance publique afin d’éviter la critique relative à une « police privée » des contenus, parfois formulée lorsqu’une plateforme décide de retirer un contenu qu’elle juge illicite. Cette intervention pourrait, par exemple, prendre la forme de délivrance de labels ou de la rédaction de chartes, qui associeraient, outre les acteurs privés concernés, la société civile, les représentants des internautes et les pouvoirs publics. Dans ce cadre, l’expérience du CSA en matière de conciliation entre la liberté d’expression et la protection des valeurs nécessaires à notre démocratie peut sembler utile.
Cette réflexion est également menée au plan européen. Pour ce qui concerne le CSA, elle se tient notamment au sein du groupe des régulateurs européens des services de médias audiovisuels (ERGA), afin que la spécificité de ces plateformes soit mieux prise en compte par le droit européen.
Je veux, enfin, souligner la difficulté posée par certains programmes diffusés par voie satellitaire depuis des pays situés hors de l’Union européenne. Le sujet est rarement évoqué mais il a son importance, en particulier au regard du sujet dont traite votre commission d’enquête. La compétence du CSA s’exerce à l’égard de très nombreux services – ils seraient un millier – transmis par voie satellitaire et soumis à la loi de 1986, car reçus en Europe. Cette compétence s’exerce soit parce que les éditeurs de services utilisent une liaison montante vers un satellite à partir d’une station située en France, soit parce qu’ils utilisent une capacité satellitaire française – en l’espèce, Eutelsat.
Lorsque le CSA constate l’existence de contenus qui peuvent être jugés contraires aux principes posés par la loi du 30 septembre 1986, il peut intervenir auprès de l’opérateur satellitaire pour demander la cessation de la diffusion de la chaîne concernée. Il l’a fait à plusieurs reprises ces dernières années, en particulier pour certaines chaînes diffusées du Moyen-Orient par des satellites d’Eutelsat, en raison de la diffusion d’images très crues et violentes, portant atteinte à la dignité de la personne humaine ou incitant à la haine ou à la violence pour des raisons de race ou de religion.
L’exercice de cette mission est difficile, car elle soulève deux questions.
L’une est la définition de la compétence du CSA en la matière au regard du critère de la liaison montante. Or il est difficile pour le Conseil de s’y référer, notamment parce que la localisation de cette liaison peut être facilement modifiée. Dans le cadre de la réflexion engagée par la Commission européenne sur l’évolution de la directive sur les services de médias à la demande, le CSA est favorable à ce que soit envisagée la suppression de ce critère pour s’en tenir à la seule capacité satellitaire.
L’autre question est celle des moyens alloués au CSA pour le contrôle des programmes satellitaires d’un millier de chaînes diffusées en langues étrangères – le plus souvent en arabe. Nous recevons certes parfois des signalements – l’ambassade d’Égypte, par exemple, nous en a adressés de façon récurrente –, mais la masse des informations à traiter est telle que nous ne sommes pas en mesure d’exercer pleinement notre mission. Nous nous sommes ouverts à plusieurs reprises aux pouvoirs publics de ces difficultés et de la nécessité que le CSA dispose, pour effectuer cette mission, de ressources supplémentaires, en particulier de moyens humains.
M. le président Georges Fenech. Pouvez-vous nous donner des précisions sur les manquements constatés par le CSA dans le traitement médiatique des événements de janvier 2015 ?
En l’état actuel du droit, le CSA ne peut prononcer une éventuelle sanction qu’en cas de réitération d’un manquement après une mise en demeure. Selon vous, la sanction devrait-elle être possible dès le premier manquement ? Souhaitez-vous la mise en place d’un dispositif plus répressif ? Des mises en demeure et des rappels à la loi ont été adressés aux chaînes, mais des sanctions ont-elles été prononcées ?
Quelles leçons le CSA a-t-il tirées du fait que BFM TV a donné une information relative à la présence de personnes dans la chambre froide de l’Hypercacher de Vincennes durant la prise d’otages, ce qui aurait pu mettre la vie de ces derniers en danger ? La charte de bonnes pratiques rédigée depuis par cette chaîne vous semble-t-elle intéressante ? Doit-elle constituer un modèle pour les autres médias ?
M. Guillaume Blanchot. Quelque sept motifs ont justifié les décisions prises par le Conseil en février 2015, à la suite des manquements constatés dans le traitement des attentats du mois de janvier.
Le 7 janvier 2015, France 24 a diffusé les images de l’assassinat du policier Ahmed Merabet par les auteurs de l’attentat contre Charlie Hebdo. Même si l’instant précis de la mort n’a pas été montré, la séquence faisait entendre des détonations d’arme à feu ainsi que la voix de la victime. Le Conseil a considéré que « la diffusion de cette séquence n’était pas nécessaire à l’information du public », et qu’elle portait atteinte à la dignité de la personne humaine. Il a mis la chaîne en demeure de respecter ce principe fondamental.
M. le président Georges Fenech. France 24 n’est pas la seule chaîne à avoir diffusé ces images : les derniers mots de la victime ont été entendus par un grand nombre d’entre nous sur d’autres chaînes.
M. Thomas Dautieu, adjoint à la directrice des programmes du CSA. À la différence des autres chaînes, France 24 a diffusé la séquence complète, de l’arrivée du terroriste aux coups de feu, en passant par le moment où la victime implorait ce dernier.
M. Sébastien Pietrasanta, rapporteur. Le CSA considère-t-il que les images vues sur les autres chaînes ne portaient pas atteinte à la dignité de la personne humaine ?
M. Thomas Dautieu. Il n’est pas facile de trouver l’équilibre entre la nécessité d’informer le public lors du déroulement d’un événement tragique, et le respect de la dignité de la personne humaine. Le Conseil a estimé, en février 2015, que la diffusion d’une photographie, sur laquelle le visage du policier avait été préalablement flouté, rendait compte de l’horreur de la journée du 7 janvier, mais que le choix de diffuser la séquence complète était attentatoire à la dignité de la personne humaine.
M. le président Georges Fenech. Nous avons tous entendu, et si je m’en souviens bien, sur d’autres médias que France 24, le policier s’adresser au terroriste et lui dire : « C’est bon, chef ! » Ce moment est sans doute, à la fois, l’un des plus douloureux de la séquence et des plus attentatoires à la dignité de la malheureuse victime ; pourtant, aucun autre média n’a été mis en demeure à ce sujet ?
M. Guillaume Blanchot. Non, aucun autre.
M. le président Georges Fenech. Et en ce qui concerne les manquements à la nécessaire prudence afin de ne pas porter préjudice à la sécurité ?
M. Guillaume Blanchot. Le collège a mis en demeure un certain nombre de chaînes pour divulgation d’informations concernant l’identification des frères Kouachi avant le lancement d’un appel à témoins par la préfecture de police. Ces médias ont donné des informations en dépit des demandes précises et insistantes du procureur de la République qui en avait appelé à leur responsabilité sur ces sujets.
M. le rapporteur. Quelles sont les chaînes concernées ?
M. Guillaume Blanchot. iTélé et LCI.
M. le président Georges Fenech. Par quels moyens le procureur de la République demande-t-il aux médias de ne pas diffuser une identité ?
M. Thomas Dautieu. Ce n’est pas par notre truchement. Je ne saurais vous dire si c’est de manière informelle ou lors d’une conférence de presse. Sauf erreur de ma part, il s’est exprimé lors d’une conférence de presse. En tout cas, des médias ont diffusé cette information, puis le parquet a rendu public ce qui circulait déjà.
M. le rapporteur. Monsieur Blanchot, vous évoquiez dans vos propos liminaires la mise en place d’un outil de contrôle immédiat. Dans un cas comme celui que nous venons d’évoquer, sachant que la divulgation de l’identité des frères Kouachi risque de gêner l’action des forces de l’ordre, le CSA peut-il, de son propre chef, contacter les chaînes dès qu’il a connaissance du manquement pour leur demander d’y mettre fin ? Avez-vous eu l’occasion de les appeler au mois de janvier ou de novembre, ou en êtes-vous restés à un contrôle a posteriori ? Dans des situations comme celle-là, l’immédiateté est tout l’enjeu. Il est bon qu’une sanction tombe un ou deux mois après les faits, mais, d’un point de vue opérationnel et pour préserver des vies humaines, il faudrait pouvoir intervenir instantanément.
M. Guillaume Blanchot. Au mois de janvier puis au mois de novembre 2015, le CSA a diffusé une note aux rédactions les appelant à la prudence et à la mesure. Le CSA a ainsi souhaité intervenir pendant le cours des événements en s’attribuant une compétence qui ne lui est pas explicitement dévolue par la loi.
La note du 9 janvier 2015 était rédigée en ces termes : « Face aux événements tragiques que connaît actuellement le pays, le Conseil supérieur de l’audiovisuel invite les télévisions et les radios à agir avec le plus grand discernement, dans le double objectif d’assurer la sécurité de leurs équipes et de permettre aux forces de l’ordre de remplir leur mission avec toute l’efficacité requise. » Dans celle du 14 novembre 2015, le Conseil a appelé « très vivement l’attention des rédactions des télévisions et des radios sur la nécessité de ne donner aucune indication susceptible de mettre en cause le bon déroulement des enquêtes en cours dans les circonstances tragiques que vit notre pays ».
Ni les missions ni les moyens du CSA ne lui permettent, en revanche, de détecter en temps réel les manquements des chaînes. En tout état de cause, pour prononcer une sanction, des procédures de contrôle seraient nécessaires et une décision nécessiterait une délibération du collège.
M. le rapporteur. Vous parliez d’un « outil de contrôle immédiat » « composé d’une dizaine d’agents », mis en place lors d’événements comme des attentats avec une « remontée instantanée » des informations. Quel est le rôle de ces agents s’ils ne gèrent pas vraiment l’immédiat ?
M. Guillaume Blanchot. Les agents en charge de ce contrôle font remonter l’information aux membres du collège. Si un manquement est constaté, nous entrons dans une procédure d’instruction classique qui peut aboutir, le cas échéant, au prononcé d’une sanction.
M. le rapporteur. Il n’existe donc aucune procédure en temps réel : vous ne disposez d’aucun moyen d’intervenir pour faire cesser la diffusion d’une information qui mettrait en cause la sécurité d’une opération en cours ?
BFM TV nous a dit, lundi dernier, n’avoir annoncé qu’une seule fois, pendant quelques secondes, la présence de personnes dans la chambre froide de l’Hypercacher. Si la chaîne avait repris cette information en boucle, sachant que Coulibaly regardait cette antenne, vous n’auriez rien pu faire en temps réel ?
Mise à part la question des moyens que vous avez évoquée, pensez-vous que vous devriez disposer de cette faculté ? Cela pourrait constituer une piste de réflexion pour les préconisations de notre commission d’enquête.
M. Guillaume Blanchot. Aujourd’hui, la loi ne donne pas au CSA la compétence pour une intervention en temps réel. Par ailleurs, cette démarche ne correspond pas à la philosophie du Conseil fondée sur des interventions a posteriori. Très attaché au respect de la liberté éditoriale des chaînes, le Conseil a bien conscience des enjeux liés à la protection de l’ordre public et au respect de la dignité de la personne humaine, mais ce type d’intervention n’entre pas dans ses missions.
M. le président Georges Fenech. Cela ne relève peut-être pas de votre compétence, mais pensez-vous que le procureur de la République pourrait prononcer une injonction afin d’imposer la rétention d’une information durant un certain temps ? Ce type de procédure existe dans certaines législations étrangères.
M. Guillaume Blanchot. Cette question ne relève, en effet, pas de mon champ de compétence. Il me semble toutefois, si l’on considère les enseignements tirés par les chaînes de ce qui s’est passé au mois de janvier, que la rédaction de chartes de bonne conduite et l’amélioration des relations entre les médias et les forces de l’ordre constitueraient des voies privilégiées pour faire évoluer les choses.
Parmi les autres manquements relevés par le Conseil au mois de janvier 2015, certaines chaînes ont désigné une personne comme étant l’un des terroristes recherchés.
M. Thomas Dautieu. Le nom et le prénom d’une personne potentiellement impliquée ont circulé très rapidement, information qui s’est révélée totalement fausse.
M. Guillaume Blanchot. Le Conseil a considéré que les chaînes avaient manqué de mesure dans le traitement de l’enquête, et qu’elles avaient pris le risque d’alimenter les tensions dans la population. Il a mis en garde les cinq chaînes concernées contre le renouvellement de tels manquements.
Le Conseil s’est aussi penché sur la diffusion d’images ou d’informations concernant le déroulement des opérations en cours, alors que les terroristes étaient encore retranchés à Dammartin-en-Goële et à l’Hypercacher de la Porte de Vincennes. Le Conseil a considéré que la diffusion de ces informations et de ces images aurait pu être préjudiciable au déroulement des opérations ainsi qu’à la sécurité des otages et des membres des forces de l’ordre. Il a mis en garde les télévisions concernées au regard de la nécessaire conciliation entre la sauvegarde de l’ordre public et le respect de la liberté de communication.
L’annonce que des affrontements contre les terroristes avaient lieu à Dammartin-en-Goële alors qu’Amedy Coulibaly était encore retranché à la Porte de Vincennes a posé un autre problème. Le Conseil a considéré que la divulgation de cette information aurait pu avoir des conséquences dramatiques pour les otages de l’Hypercacher de la Porte de Vincennes, dans la mesure où Amedy Coulibaly avait déclaré lier leur sort à celui de ses complices de Dammartin-en-Goële.
M. le rapporteur. Les représentants des chaînes d’information que nous avons entendus lundi nous ont expliqué qu’au moment de l’assaut de Dammartin-en-Goële, ils ne savaient pas que Coulibaly était lié aux frères Kouachi. Ils considèrent, en conséquence, que la mise en demeure prononcée par le CSA à leur égard est assez injuste.
M. Thomas Dautieu. Le Conseil a établi une chronologie extrêmement précise des informations disponibles durant la journée du 9 janvier 2015. Elle montre sans ambiguïté possible que le lien entre le sort des otages de la Porte de Vincennes et celui des deux terroristes de Dammartin-en-Goële était connu avant l’assaut – je crois que l’information a été donnée par une radio. Le CSA s’est prononcé dans le cadre d’une procédure contradictoire en se fondant sur cette certitude.
M. le président Georges Fenech. Monsieur Blanchot, vous pourrez nous transmettre des éléments sur l’ensemble des manquements relevés pas le CSA. Au final, en dehors de mises en demeure et de mises en garde, aucune sanction n’a été prononcée contre aucun média.
M. Guillaume Blanchot. Cela s’explique par la nécessité d’une réitération du manquement. L’instruction d’un éventuel dossier reste, de plus, à l’initiative du rapporteur indépendant.
M. le rapporteur. Dans quel délai cette répétition doit-elle avoir lieu ? Doit-elle concerner un même événement ? Que se passerait-il si le manquement avait lieu aujourd’hui ?
M. Guillaume Blanchot. Il y aurait indubitablement répétition, à condition que le manquement soit constaté sur les mêmes fondements.
M. Pierre Lellouche. Lundi dernier, nous avons assisté à une sorte de mea culpa gêné mais prudent des chaînes de télévision. Elles nous ont surtout dit qu’elles ne faisaient finalement que leur métier dans une très saine ambiance de concurrence.
Estimez-vous que les mises en demeure consécutives aux événements du mois de janvier ont eu des conséquences positives sur le comportement des chaînes à la fin de l’année ? Serait-il utile que le législateur permette au Conseil ou au parquet de se saisir des manquements dès qu’ils se produisent, plutôt que de vous placer dans l’obligation d’attendre leur répétition ?
En l’état du droit, les chaînes s’en tirent très bien : elles ont failli mettre en danger la vie de dizaines de personnes, et elles n’en subissent aucunement les conséquences. Ce qui s’est passé est extrêmement grave, mais cela n’a rien changé pour elles. Si vos avertissements n’ont pas été entendus, ne faut-il pas en arriver à l’échelon supérieur et prévoir des sanctions pénales ? À mes yeux, ce qui s’est produit relève de la complicité et ressortit au domaine du pénal.
M. Guillaume Blanchot. J’ai déjà dit la différence de traitement de l’information des attentats par les médias entre janvier et novembre 2015. Elle est sans doute due à une prise de conscience générale de la part des médias, qui est probablement imparfaite mais qui reste, à notre sens, réelle. Elle résulte notamment des avertissements, des mises en garde et des mises en demeure prononcés par le CSA, mais aussi de la réflexion qu’il a souhaité engager avec les médias, des actions pédagogiques menées et de l’expérience.
M. Jean-Luc Laurent. Toutes les institutions et tous ceux qui sont partie prenante des événements de 2015 sont amenés à s’interroger sur ce qui s’est passé et sur les enseignements qui peuvent en être tirés pour améliorer nos pratiques et nos méthodes. Les forces de sécurité ou les secours ont fait l’objet d’une évaluation ; il est logique que ceux qui ont le pouvoir de diffuser de l’information ne soient pas exclus de ce travail.
Quelles sont vos réflexions sur le cadre légal actuel de l’action du CSA ? Doit-il évoluer ? La défense du droit à l’information ne peut pas tout justifier : la course à l’audimat, l’antenne pour l’antenne, les informations qui n’en sont pas, les experts dont on ne sait pas quelle expertise ils apportent… Ne croyez-vous pas que des règles sont nécessaires pour la diffusion de l’information – par exemple, sur la durée maximale du direct dans certaines circonstances ? Des records d’audience ont été enregistrés au cours de directs qui n’apportaient rien d’objectif ou de positif. Ne faudrait-il pas également organiser l’expertise, par exemple en délivrant une sorte de « brevet » aux experts ?
M. le président Georges Fenech. L’analyse de la qualité des experts relève-t-elle de votre mission ?
M. Thomas Dautieu. La loi du 30 septembre 1986 pose un certain nombre de grands principes généraux. À la fin de l’année 2013, le CSA les a déclinés dans une recommandation relative au traitement des conflits internationaux, des guerres civiles et des actes terroristes par les services de communication audiovisuelle.
Au début de l’année 2015, il nous est apparu que cette recommandation concernait davantage les actes terroristes se déroulant à l’étranger que ceux ayant lieu en France. Lorsqu’il a rendu publiques ses mises en demeure, en février, le CSA a annoncé qu’il engagerait un cycle de réflexions avec les médias afin d’adapter le texte de 2013 à la lumière de l’expérience de janvier 2015. Ces réflexions n’ont pas été entamées dans l’attente de la décision du juge administratif saisi des recours contre les mises en demeure. Le travail d’adaptation différera selon que les positions du CSA seront validées ou non.
M. Pierre Lellouche. Qui a attaqué les mises en demeure formulées par le CSA ?
M. Thomas Dautieu. Tous les éditeurs ont introduit un recours gracieux devant le CSA. Après son rejet, ils ont tous attaqué les mises en demeure devant le Conseil d’État. À ce jour, environ la moitié d’entre eux se sont désistés.
M. Jean-Luc Laurent. Et s’agissant des événements de novembre ?
M. Thomas Dautieu. Nous nous inscrivons dans la même logique. Nous attendons de savoir si le raisonnement du CSA en termes d’atteinte à la dignité humaine ou au respect de l’ordre public est validé par la justice administrative pour engager une réflexion et modifier la recommandation du Conseil sur le traitement des actes terroristes.
M. Pierre Lellouche. La saisine du juge administratif vous a-t-elle empêchés d’agir en novembre dernier ?
M. Thomas Dautieu. En aucun cas ! Les modalités de traitement des attentats ont été examinées par le CSA de la même façon en novembre et en janvier, même si elles ont été extrêmement différentes, du fait en particulier des circonstances, car il n’y a pas eu de prises d’otages multiples au mois de novembre. Nous attendons seulement de disposer d’un socle juridique stable pour faire évoluer la recommandation dans un sens plus restrictif.
Mme Françoise Dumas. Pourrait-on prévoir un cadre particulier d’urgence qui permettrait de traiter de façon différente les cas où des vies sont mises en danger ?
Dans de telles circonstances, un point de communication régulier ne serait-il pas utile ? Il faut, en tout cas, véhiculer avec beaucoup de professionnalisme et de rigueur les messages politiques, sans que la sécurité des personnes soit jamais mise en cause.
Vous évoquiez les difficultés rencontrées pour contrôler les chaînes satellitaires. Le recours à une police européenne pourrait-il constituer une solution ? La mise en commun des efforts des polices nationales faciliterait le travail de tous.
M. Guillaume Blanchot. L’intervention en temps réel ne correspond ni aux missions du CSA ni à la philosophie de son rôle de régulateur. Le Conseil est, en revanche, en mesure de traiter des dossiers de manquement dans des délais qui peuvent être extrêmement brefs – de quelques heures à quelques jours après les faits pour une mise en demeure, par exemple. Reste que le CSA a pris la liberté de transmettre les notes que je vous ai lues aux rédactions.
Les éditeurs de services et les rédactions souhaitent voir s’améliorer la coordination de l’action des pouvoirs publics en général, et la relation de ces derniers aux médias s’agissant notamment de l’échange et de la délivrance d’informations. Cette responsabilité ne relève pas du domaine de compétence du CSA mais de celui des ministères concernés.
Au sujet de votre dernière question, madame Dumas, je me permets de rebondir sur le terme de « police » que vous avez utilisé. Nous ne sommes pas une police, nous sommes un régulateur. Je ne crois pas qu’une police européenne soit nécessaire. Du fait de l’existence d’un opérateur satellitaire français, nous exerçons une compétence en matière de chaînes satellitaires pour l’ensemble du territoire européen et pour le compte des États membres en vertu des directives communautaires.
M. le président Georges Fenech. Combien de plaintes de téléspectateurs avez-vous reçues concernant le traitement des événements de janvier et de novembre ?
M. Thomas Dautieu. Nous avons reçu plusieurs centaines de plaintes au mois de janvier, et quelques dizaines au mois de novembre.
M. le président Georges Fenech. Messieurs, il nous reste à vous remercier pour ces intéressantes informations.
Audition, à huis clos, de M. Jérôme Bonnafont, directeur d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient à l’administration centrale du ministère des Affaires étrangères et du Développement international, M. Didier Chabert, sous-directeur du Moyen-Orient, M. Philippe Errera, directeur général des relations internationales et de la stratégie du ministère de la Défense, et M. Fouad El Khatib, chef du département Afrique du Nord et Moyen-Orient
Compte rendu de l’audition, à huis clos, du mercredi 27 avril 2016
M. le président Georges Fenech. Messieurs les directeurs, nous vous remercions d’avoir répondu à la demande d’audition de notre commission d’enquête. Nous entamons avec vous un nouveau chapitre de nos investigations en nous intéressant aux aspects géostratégiques du terrorisme, aux menaces qui pèsent sur nos intérêts à l’étranger et aux actions à entreprendre pour y faire face.
Cette audition, en raison de la confidentialité des informations que vous êtes susceptibles de nous délivrer, se déroule à huis clos. Elle n’est donc pas diffusée sur le site internet de l’Assemblée. Néanmoins, son compte rendu pourra être publié en tout ou partie si nous en décidons ainsi à l’issue de nos travaux. Je précise que les comptes rendus des auditions qui ont lieu à huis clos sont au préalable transmis aux personnes entendues afin de recueillir leurs observations. Ces observations sont soumises à la Commission, qui peut décider d’en faire état dans son rapport. Je rappelle que toute personne qui, dans un délai de vingt-cinq ans, divulguerait ou publierait une information relative aux travaux non publics d’une commission d’enquête, s’exposerait aux foudres de la loi pénale.
Conformément aux dispositions de l’article 6 de l’ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, je vais maintenant vous demander de prêter le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité.
MM. Jérôme Bonnafont, Didier Chabert, Philippe Errera et Fouad El Khatib prêtent successivement serment.
Messieurs les directeurs, je vais vous laisser la parole pour un exposé liminaire qui sera suivi par un échange de questions et de réponses. Nous vous interrogerons sur la situation au Levant, du point de vue de l’état des forces en présence et de l’évolution au cours de ces derniers mois. S’agissant de la coalition mondiale contre Daech, formée en septembre 2014, quels sont les buts poursuivis et le niveau de la participation de la France ? Nous voudrions également connaître la position de la France vis-à-vis du régime syrien.
La résolution 2254 adoptée par le Conseil de sécurité de l’ONU en décembre 2015 prévoit notamment de mettre en place, « dans les six mois », « une gouvernance crédible, inclusive et non sectaire ». Où en est-on aujourd’hui ? Quels sont les points de blocage ?
Quel est l’état des forces de l’opposition modérée en Syrie ? Quel soutien lui apportent la France et les pays de la coalition mondiale ? Quel rôle joue l’Arabie Saoudite dans la fédération des groupes d’opposition ?
Quel bilan dressez-vous de la trêve intégrale instaurée le 27 février dernier ?
Qu’en est-il de l’accès libre et sans entrave de l’aide humanitaire à toutes les zones de Syrie ?
Comment jugez-vous la situation en Irak ? Où en est la mise en œuvre du programme de réconciliation nationale annoncé à l’automne 2014, et quel soutien la France apporte-t-elle au régime irakien ?
Quels sont les résultats des frappes militaires en Irak et en Syrie ? Quel a été l’impact de l’intensification des frappes françaises à compter de septembre 2015 ?
Comment jugez-vous l’intervention russe ? Quels résultats a-t-elle obtenu ?
Quels sont les moyens mis en place par la Turquie pour lutter contre le retour des djihadistes en Europe ?
Quelles sont les principales menaces pour les intérêts français en Afrique du Nord et au Moyen-Orient ? Où se situent-elles ?
La protection des bâtiments diplomatiques a-t-elle été renforcée au cours de la période récente ? Quid de la protection des sites occupés par des entreprises françaises ?
Enfin, comment jugez-vous la situation en Libye ? Pouvez-vous nous présenter l’accord interlibyen et l’action de la France dans sa mise en œuvre ?
M. Jérôme Bonnafont, directeur d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient au ministère des affaires étrangères. Je concentrerai mon intervention liminaire sur les aspects purement diplomatiques de la lutte contre le terrorisme.
Tout d’abord, on peut dire, de façon très générale, que l’on a pu observer au cours des derniers mois un changement d’atmosphère s’agissant de la lutte contre Daech. De fait, alors que sa progression paraissait difficilement résistible, on constate que la contre-offensive enregistre des succès grâce à la combinaison des forces de la coalition et des forces nationales irakiennes en particulier. Il me paraît important de souligner ce changement d’atmosphère pour expliquer la manière dont se situe notre diplomatie dans ce contexte.
En ce qui concerne la Syrie, nos motivations sont doubles : d’une part, obtenir des succès décisifs contre Daech et Jabaht al-Nosra (JAN), les deux grands groupes terroristes actifs sur le territoire syrien et, d’autre part, aboutir au règlement politique des affrontements armés qui ont fait, au cours des cinq dernières années, plusieurs millions de réfugiés et de déplacés et, selon l’envoyé spécial de l’ONU, 400 000 victimes. À cet égard, monsieur le président, vous avez mentionné à juste raison la résolution 2254 de l’ONU, adoptée en décembre 2015, qui prévoit un mécanisme de négociation politique pour tenter de régler la question syrienne. C’est dans ce cadre que se réunissent, depuis l’automne, à Vienne et maintenant à Munich, les principaux protagonistes régionaux, dont l’Iran, ainsi que les États-Unis et la Russie, qui sont en dialogue, la France et un certain nombre d’autres pays européens participant de façon extrêmement active à ces discussions.
La résolution, qui se fonde sur les conclusions d’une ancienne conférence de Genève, prévoyait un cessez-le-feu qui devait conduire à l’engagement d’une négociation sur la transition politique de façon à mettre en place un organe de gouvernement intérimaire capable de préparer les arrangements pour la Syrie de demain. Après le vote de cette résolution, une cessation des hostilités a été obtenue à Munich au mois de mars, avec trois éléments concomitants : cessation des hostilités, sauf contre Daech et Jabaht al-Nosra, accès de l’aide humanitaire à un ensemble de sites assiégés, essentiellement par le régime, et ouverture par l’envoyé spécial des Nations unies, Staffan de Mistura, de négociations entre le régime et la coalition d’opposants réunie à l’issue de la conférence de Riyad, qui rassemble l’opposition non terroriste, qu’il s’agisse d’opposants politiques de l’étranger ou de groupes armés de l’intérieur.
Au début, les choses se sont passées de façon relativement prometteuse, puisque les combats, notamment les bombardements, ont cessé, l’aide humanitaire a commencé d’avoir accès à certaines villes et Staffan de Mistura a réuni les deux délégations à Genève. Mais, depuis quelques jours, elles se sont à nouveau dégradées de façon sérieuse. Tout d’abord, l’aide humanitaire n’accède plus que de façon très parcellaire à l’ensemble des villes où elle devait arriver. Ensuite, si l’opposition est arrivée avec des propositions politiques et constitutionnelles jugées intéressantes et constructives par Staffan de Mistura, en revanche le régime n’a mis sur la table aucune forme de proposition politique. Enfin, le régime a repris ses offensives, en particulier contre Alep, en prétendant se concentrer sur les forces de Jabaht al-Nosra mais en causant des dégâts civils et en ciblant d’autres groupes, ce qui constitue une infraction à la cessation des hostilités. La délégation de l’opposition a donc décidé de suspendre sa participation aux négociations, et la communauté internationale recherche actuellement les moyens de relancer la dynamique diplomatique. Aujourd’hui même, Staffan de Mistura doit s’exprimer devant le Conseil de sécurité des Nations unies sur la situation pour que celui-ci l’apprécie et étudie les moyens d’aller plus loin.
Cette situation est, selon nous, préoccupante du point de vue de la lutte contre Jabaht al-Nosra et Daech. En effet, le Gouvernement estime que la mobilisation des efforts contre ces groupes terroristes ne peut être efficace et définitive tant que la discussion politique n’aura pas accompli un progrès décisif permettant de tourner la page de la guerre civile en Syrie. L’arrêt des négociations retarde, bien entendu, le moment où l’ensemble des forces syriennes réconciliées pourront se tourner contre Daech. Dans le cadre des contacts que nous avons avec l’opposition, nous lui demandons de mobiliser ses forces contre Daech également, ce qu’elle a accepté à certaines conditions. En tout état de cause, nous pensons qu’il faut trouver le moyen de renouer la discussion politique.
En ce qui concerne l’Irak, vous avez sans doute constaté que le gouvernement de ce pays a connu, ces derniers jours, des difficultés politiques importantes. Ces difficultés sont liées au fait que le Premier ministre, M. Abadi, a souhaité nommer un nouveau gouvernement de « technocrates », dans le contexte d’importantes manifestations organisées par le mouvement dit « sadriste » – du nom d’un des chefs religieux chiites – autour de la zone verte à Bagdad. Ce nouveau gouvernement a été présenté au Parlement, qui ne l’a pas accepté comme tel, estimant notamment que le Premier ministre ne devait pas céder à la pression de la rue. Après des négociations compliquées et une certaine agitation parlementaire, le Premier ministre a pu faire adopter une partie de son remaniement ministériel, repoussant l’autre partie à plus tard.
Qu’en est-il de la réconciliation nationale ? Cette agitation populaire est due au fait que, depuis quelques mois, les réformes marquent le pas, faute pour le Gouvernement de parvenir à les faire adopter par le Parlement. Le remaniement avait pour but de remédier à cette situation puisqu’il s’agissait de constituer un gouvernement capable de soumettre plus rapidement un certain nombre de projets au Parlement. Nous continuons à plaider, dans le cadre de nos contacts politiques avec le gouvernement irakien, pour que la réconciliation nationale soit conduite de façon dynamique. Nous avons également intensifié notre coopération militaire avec ce gouvernement, et nous menons dans le cadre de la coalition de lutte contre Daech et au plan européen une politique d’aide à la stabilisation, qui consiste dans le rétablissement des services publics et de la concorde civile dans les villes reprises à Daech.
On ne peut pas ignorer la situation au Kurdistan, particulièrement affecté par la crise économique profonde qui résulte de la baisse des cours du pétrole. Le Kurdistan connaît, en outre, une crise politique due à la décision du président du gouvernement de prolonger son mandat, hors cadre constitutionnel et au débat avec les deux grands partis – Goran, qui était dans sa majorité jusqu’à récemment, et l’UPK, qui est dans l’opposition –, qui porte sur le point de savoir comment se fera la normalisation institutionnelle. Mais, parallèlement à ces difficultés politiques, les progrès de la lutte contre Daech ont produit un changement d’atmosphère. J’étais à Bagdad il y a quelques semaines, et j’ai été frappé de constater à quel point l’ensemble des dirigeants politiques – chiites, sunnites et kurdes – sont déterminés à faire en sorte que la lutte contre Daech progresse rapidement, avec pour objectif, désormais, la reprise de Mossoul.
S’agissant de la Libye, le Gouvernement était préoccupé notamment par le fait que l’instabilité politique qui prévalait jusqu’à tout récemment favorisait l’extension de l’emprise de Daech, en particulier à Syrte, avec une agressivité notable contre les bases pétrolières et les terminaux pétroliers, et contre la Tunisie où l’organisation a fait plusieurs incursions. Il était donc urgent que soit mis en œuvre l’accord politique sur un gouvernement d’entente nationale et un conseil présidentiel qui avait été conclu à Skhirat il y a quelques mois. Avec le nouveau représentant des Nations unies, M. Martin Kobler, et le nouveau premier ministre, M. Sarraj, les choses ont récemment avancé dans la bonne direction. Nous sommes en train de définir avec ce dernier les modalités de sa reprise de contrôle de l’ensemble des administrations publiques et financières et d’entreprendre des discussions sur le type de soutien militaire qui peut être apporté.
Un mot sur le Yémen où la présence d’Al-Qaïda, sous la forme d’AQPA (Al-Qaïda dans la péninsule arabique), et de Daech est très importante et se nourrit de l’instabilité politique et de la guerre qui s’y prolonge. Les discussions de paix qui, sous la pression de la communauté internationale, de l’ONU et de l’Arabie saoudite, ont débuté il y a quelques jours à Koweït sont une bonne nouvelle, d’autant qu’elles s’accompagnent d’un cessez-le-feu globalement respecté par les parties au conflit et doivent aboutir à un processus de réconciliation nationale. Il est clair que, comme la Libye, le Yémen doit être stabilisé politiquement si l’on veut pouvoir lutter efficacement contre Daech.
Il y aurait évidemment beaucoup à dire sur les autres régions, et je suis à votre disposition pour répondre à vos questions sur le sujet. Je veux simplement souligner que nous ne nous méprenons pas : les succès militaires enregistrés contre Daech ou Al-Qaïda comme les progrès des règlements politiques ici ou là ne doivent pas nous conduire à sous-estimer l’ampleur de la menace qui demeure. N’oublions pas, en effet, que ces organisations terroristes, lorsqu’elles sont menacées sur le plan militaire classique, ont encore des moyens de représailles par la guerre asymétrique, notamment l’organisation d’attentats tels que ceux que nous avons subis en Europe et que subissent le Koweït, l’Arabie Saoudite ou la Turquie.
M. le président Georges Fenech. Nous aimerions connaître la nature des propositions mises sur la table par les opposants au régime de Bachar el-Assad et savoir sur quel point les discussions ont achoppé. Le départ de Bachar el-Assad avait-il été posé comme préalable ? Il nous avait semblé que le discours du Président de la République devant le Congrès, à Versailles, marquait une inflexion de la position de notre pays à cet égard. Le départ de Bachar el-Assad – pour lequel, je le précise, personne, ici, n’a de sympathie particulière – est-il toujours un préalable pour la diplomatie française ?
M. Jérôme Bonnafont. Les membres de l’opposition se sont accordés, à Riyad, sur une plateforme qui décrit une Syrie démocratique, pluraliste, dotée d’un gouvernement civil et respectueuse des composantes du peuple syrien – et cela vaut pour les groupes qui seraient qualifiés en France de laïcs comme pour les groupes islamistes. Cette plateforme était intéressante, car elle rassemblait des chrétiens, des Kurdes, des sunnites, des Alaouites, des Druzes, etc. L’opposition est venue avec un préalable, le départ de Bachar el-Assad, qui est pour elle un élément non négociable, mais en acceptant ensuite l’idée qu’un gouvernement de transition doté des pleins pouvoirs, en particulier du contrôle des services de sécurité et de l’armée, serait chargé d’élaborer une nouvelle constitution sur la base de laquelle des élections pourraient avoir lieu dans dix-huit mois, ce qui correspondait à l’esprit de Genève.
Le gouvernement français estime, pour sa part, que, de toute façon, il faut discuter avec le régime, car c’est avec lui que l’on peut définir la transition. Par ailleurs, instruits par des expériences passées – je pense notamment à l’Irak –, nous avons pour objectif, non pas l’effondrement de l’État syrien, mais le remplacement de la tête de cet État, qui doit être dirigé par des personnes capables de se faire accepter par l’ensemble des composantes du peuple syrien.
M. le président Georges Fenech. Y compris des personnes appartenant au régime ?
M. Jérôme Bonnafont. Y compris des personnes appartenant au régime. Mais nous ne pouvons pas imaginer que Bachar el-Assad puisse être, au bout du compte, celui qui conduira cette transition, tout simplement parce qu’il ne peut pas être accepté par tous ceux qui ont quitté la Syrie ou qui ont pris les armes contre lui. Nous ne faisons donc pas de son départ un préalable, mais nous ne voyons pas comment l’avenir de la Syrie peut se construire sur le maintien de Bachar el-Assad.
M. Sébastien Pietrasanta, rapporteur. Vous dites discuter avec des éléments du régime. La fermeture de l’ambassade de France, en mars 2012, signifie-t-elle que les relations diplomatiques ont cessé ? Dès lors, ces discussions sont-elles officieuses ou officielles, et la fermeture de l’ambassade est-elle un écueil dans la recherche d’une solution politique ?
M. Jérôme Bonnafont. Si j’ai indiqué que nous discutions avec le régime de Bachar el-Assad, c’est un abus de langage dont je vous prie de m’excuser, car ce n’est pas la France en tant que telle qui discute, mais l’ONU. La discussion est confiée à l’envoyé spécial des Nations unies, M. Staffan de Mistura, à qui incombe la responsabilité de rencontrer les négociateurs du régime, à savoir M. Jaafari, qui est le représentant permanent de la Syrie à l’ONU, de recevoir ses propositions et de discuter avec lui. Parmi les pays qui discutent effectivement avec le régime figurent, bien entendu, la Russie et l’Iran. Tel n’est pas notre cas, car nous estimons que la nature de ce régime et la politique qu’il a menée – qui nous a conduits à fermer notre ambassade et donc à ne plus entretenir de relations diplomatiques avec le gouvernement – ne nous permettent pas de nouer avec lui un dialogue utile. Ce serait envoyer un signal politique inapproprié que de reprendre langue avec lui tant qu’il n’a pas décidé d’entrer dans la transition qui est attendue.
M. le rapporteur. La question de la réouverture de l’ambassade ne se pose donc pas aujourd’hui ?
M. Jérôme Bonnafont. Elle n’est absolument pas posée aujourd’hui.
M. le rapporteur. Je suppose – mais cette question s’adresse peut-être davantage à M. Errera, qui pourra y répondre ultérieurement – que la fermeture de l’ambassade a posé un certain nombre de difficultés en matière de recueil du renseignement, dans la mesure où elle a sans doute entraîné la rupture de nos relations avec les services syriens. Est-ce exact ou est-ce plus compliqué que cela ?
M. le président Georges Fenech. Monsieur Errera, avant que vous ne répondiez à cette question, je souhaiterais que vous nous indiquiez, car c’est cela qui nous intéresse au premier chef, quels sont les résultats des frappes militaires en Irak et en Syrie, notamment depuis leur intensification au mois de septembre.
M. Philippe Errera, directeur général des relations internationales et de la stratégie du ministère de la défense. Je compléterai le propos de Jérôme Bonnafont en insistant davantage sur le volet militaire de l’action de la France. Avant de répondre à votre question, je souhaiterais évoquer notre intervention depuis que celle-ci a débuté, à l’été 2014, en la replaçant dans le cadre de l’action de la coalition, car c’est ainsi que l’on peut en dresser le bilan le plus complet et envisager précisément les objectifs de la suite de la campagne.
Après avoir lancé l’opération Chammal et les premières frappes en Irak, en septembre 2014, nous avons renforcé notre dispositif au cours des derniers mois de l’année 2014 puis, de manière plus nette, après les attentats de Paris du 7 et du 9 janvier 2015. Nous avons engagé pour la première fois le groupe aéronaval dans l’opération Chammal en février 2015, et les formations que nous dispensons à l’ICTS (Iraqi Counter Terrorism Service) et à l’état-major de la 6e division d’infanterie, qui est la division rempart de Bagdad, ont débuté en mars et en avril. Les premiers vols de reconnaissance de Rafale au-dessus de la Syrie ont eu lieu le 8 septembre et les premières frappes contre un site de Daech en Syrie sont intervenues le 27 septembre. Mais c’est au lendemain des attentats du 13 novembre que nous avons intensifié de manière substantielle nos frappes contre Daech, puisque, dès le 16 novembre, ont été annoncés et l’intensification de ces frappes et le déploiement du groupe aéronaval. Celui-ci comprend dix-huit Rafale et huit Super-Étendard modernisés, qui nous ont permis, en 48 heures, de mener six raids et de détruire trente-cinq objectifs. L’intensité de notre engagement n’a pas décru, malgré le retour du groupe aéronaval ; il est, du reste, vivement salué par les autorités irakiennes, comme le ministre de la défense a pu le constater lors de son récent déplacement à Bagdad et à Erbil, les 10 et 11 avril.
Depuis le retour du groupe aéronaval, à la mi-mars, près de 1 300 hommes sont déployés sur le théâtre. Nous assurons notamment la formation des commandos des unités antiterroristes irakiennes et des instructeurs et cadres de la 6e division irakienne, formation qui s’ajoute à celle des peshmergas au Kurdistan irakien. La composante aérienne de nos capacités militaires est constituée de quatorze avions de chasse – six Rafale depuis les Émirats et huit Mirage 2000-D depuis la Jordanie –, un avion de patrouille maritime Atlantique 2, un AWACS et, si besoin est, un avion ravitailleur projeté depuis la France. S’agissant de la composante navale, une Frégate assure en permanence la collecte du renseignement en Méditerranée orientale.
Sachant que vous auditionnerez ultérieurement le chef d’état-major des armées, je n’entrerai pas dans le détail des opérations, sauf pour mentionner un chiffre important : la France est le deuxième contributeur de la campagne en termes de capacités militaires et elle est, avec les États-Unis, le seul pays dont les capacités couvrent l’ensemble du spectre, de la formation au sol, à Bagdad et au Kurdistan, aux moyens aériens de recueil de renseignement et de frappe, en Irak et en Syrie, en passant par les moyens navals. Depuis le début de la campagne, nous avons réalisé environ 5 % des frappes de la coalition, les États-Unis en assurant 90 %, les 5 % restants étant réalisés par les autres membres de la coalition réunis.
La France n’agit pas seule dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, que ce soit dans le domaine du renseignement ou dans celui de l’action militaire. La coalition, dirigée par les États-Unis, regroupe soixante-trois pays, dont à peine une demi-douzaine participe aux frappes aériennes : outre les États-Unis et la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, le Danemark et l’Australie. Au sein de cette coalition, nous ne nous contentons pas d’apporter une contribution militaire dans le cadre d’un plan de campagne décidé par d’autres : ce n’est pas la vision que nous avons de l’emploi de nos moyens militaires, quel que soit le théâtre d’opérations. Nous cherchons à agir comme force de proposition afin de contribuer à en définir les objectifs et les axes d’effort, notamment en amenant les États-Unis et les autres acteurs à accroître leurs efforts sur la Syrie, sachant que leur objectif prioritaire, notamment en 2014, lorsqu’ils sont entrés dans la campagne aux côtés des forces irakiennes, était l’Irak.
Pour garantir la cohésion de la coalition et nous permettre de contribuer à sa direction politico-militaire, nous avons lancé, avec les États-Unis, des réunions de coordination des ministres de la défense. Les ministres concernés sont bien entendu ceux des pays les plus actifs militairement dans la campagne : Jean-Yves Le Drian et son homologue américain, Ashton Carter ont coprésidé, à ce titre, le 20 janvier, à Paris, une réunion regroupant une demi-douzaine de pays, et ils se retrouveront à Stuttgart la semaine prochaine. Mais ce format a été élargi, à l’initiative de la France et des États-Unis, afin que des réunions regroupent les ministres de la défense des pays engagés contre Daech : une réunion de ce type s’est tenue en février 2016 à Bruxelles et une autre doit avoir lieu, en juillet 2016, à Washington.
On parle beaucoup des Américains, mais il ne faut pas sous-estimer l’apport de nos partenaires européens à cette coalition. À la suite des attentats du 13 novembre, le Président de la République avait demandé au ministre de la défense d’appeler ses homologues européens à la solidarité en invoquant l’article 42-7 du traité sur l’Union européenne. Cet appel a permis de faciliter politiquement la consolidation et l’accélération de l’engagement d’un certain nombre de nos partenaires européens. Je pense en particulier au Royaume-Uni, qui a étendu ses frappes de l’Irak à la Syrie, et à l’Allemagne, qui a procédé à des vols de recueil de renseignements au-dessus de la Syrie. Ce processus a pu prendre un peu plus de temps s’agissant d’autres partenaires européens en raison leur débat politique intérieur et de la nécessaire validation parlementaire de leur engagement. C’est ainsi, par exemple, que le Danemark a approuvé, la semaine dernière, une contribution, importante au regard de la taille de ce pays, puisqu’elle consiste dans l’envoi de sept F-16, d’un C-130, de formateurs et de forces spéciales en Irak et, si nécessaire, en Syrie. Un certain nombre d’autres partenaires, notamment la Finlande, la République tchèque et la Pologne, ont, comme nous les y avions invités, annoncé des contributions, non pas directement en Syrie et en Irak, mais sur d’autres théâtres, où ils peuvent assumer une partie du fardeau actuellement supporté par nos forces, en particulier en Afrique subsaharienne, au sein des missions des Nations unies au Mali et en République centrafricaine.
Quels sont les résultats de cette campagne et de nos actions en particulier ? Il est difficile de chiffrer le total des forces de Daech. Plus significatif nous paraît être le territoire repris, car il donne une indication sur la population soustraite à l’emprise de Daech et sur les ressources dont il est privé. S’agissant de l’Irak, l’action combinée des reconquêtes effectuées au sol par les forces irakiennes, au sens large – c’est-à-dire les forces de sécurité intérieure, l’ICTS, les peshmergas et les milices chiites de la mobilisation populaire –, a permis de reprendre 30 % à 40 % du territoire que Daech contrôlait en Irak. En 2015, les victoires de Tikrit, Baïji, Sinjar et Ramadi ont été significatives à cet égard. S’agissant de la Syrie, l’action de l’opposition et des forces syriennes, avec l’appui de la Russie, de l’Iran et du Hezbollah, a permis de reprendre 15 % à 20 % du territoire de Daech, la reprise de Palmyre étant la plus symbolique mais pas nécessairement la plus importante au regard de nos objectifs militaires.
En somme, l’expansion de Daech au Levant est stoppée et l’ennemi n’est plus capable d’actions militaires offensives d’envergure. Il conserve la capacité de mener des opérations d’opportunité, de multiplier les attaques de harcèlement. Mais, sa liberté d’action étant de plus en plus contrainte, ses bascules de ressources entre les théâtres irakien et syrien, qui lui offraient des marges de manœuvre importantes, sont de plus en plus contrariées par la perte progressive de l’axe entre Mossoul et Raqqah et les frappes le long de la vallée de l’Euphrate.
Parmi les éléments importants pour Daech, au plan non seulement symbolique mais aussi politique, figurent la notion de continuité territoriale du califat – à laquelle nous nous attaquons en frappant les axes logistiques – et l’accès aux ressources. Nous avons ainsi entrepris, dès l’automne dernier, en grande partie grâce à l’insistance de la France auprès de son allié américain, une campagne visant de manière beaucoup plus systématique les richesses de Daech, en particulier ses infrastructures pétrolières. Nous estimons qu’aujourd’hui, son assise financière est fragilisée par les frappes soutenues contre la production pétrolière, ce qui l’oblige à augmenter ses prélèvements fiscaux, au risque d’accroître l’hostilité des populations administrées, ce qui est positif à long terme.
Faut-il être optimiste à l’énoncé de ces résultats ? Il est clair que nous sommes passés sur l’autre versant du combat contre Daech – les autorités irakiennes le disent clairement, et cela correspond à l’analyse de nos responsables militaires –, puisque nous avons brisé son mouvement d’expansion et qu’il recule territorialement. Nous sommes donc sur la bonne voie, au plan militaire. Cependant, il ne faut pas négliger la capacité de résilience de Daech. En effet, moins il pourra mener des actions militaires d’envergure, plus il mènera des actions asymétriques : attentats-suicide, emploi – en augmentation, du reste – d’armes chimiques et d’engins explosifs improvisés (EEI ou IED en anglais, pour Improvised Explosive Device) sur véhicules, dont nous avons constaté la technicité croissante puisque certains de ces engins sont désormais chimiques.
Nous devons donc persévérer dans notre action. Pour la fin de l’année 2016 et l’année 2017, nous continuons de défendre le principe d’une analyse systémique qui découle de notre analyse des vulnérabilités de Daech. En d’autres termes, les atouts – en particulier la notion de califat et de continuité territoriale – que Daech met en avant, notamment dans sa propagande destinée aux opinions occidentales, moyen-orientales ou asiatiques, auprès desquelles il cherche à faire des recrues, sont autant de centres de gravité sur lesquels nous cherchons à faire pression. Après une première phase qui visait à affaiblir Daech, nous avons entamé une deuxième phase, validée à la fin de l’année dernière par la réunion des chefs d’état-major de la coalition, qui vise davantage à démanteler l’organisation.
Nous allons concentrer le plan de campagne sur l’Irak, dans un premier temps, avec pour objectif la libération de Mossoul, d’Alambar et des vallées du Tigre et de l’Euphrate, ainsi que la reprise du contrôle des frontières avec la Turquie, la Jordanie et la Syrie, afin de couper Daech de ses bases arrière. Par ailleurs – là encore, sur l’insistance de la France, notamment auprès des États-Unis, mais les ministres de la défense de la coalition se sont accordés sur ce point en février dernier –, nous estimons indispensable de faire de la reprise de Raqqah l’objectif principal de notre action en Syrie, car elle est pour nous essentielle en termes de sécurité intérieure. Parallèlement, nous continuerons à accroître nos efforts pour affaiblir les capacités financières de Daech, qu’il s’agisse de revenus pétroliers, de devises ou de trafics, et ses capacités humaines en poursuivant la lutte contre les allers-retours des foreign fighters.
La réussite de ces objectifs, qui s’inscrit désormais dans un horizon réaliste – je n’aurais pas dit la même chose en 2014 –, même si je ne m’aventurerai pas à avancer une date, ne signifiera pas la fin des opérations ni celle de notre engagement ni, hélas ! celle de la menace terroriste pesant sur le sol français. D’une part, parce que Daech n’est pas le seul groupe terroriste auquel nous sommes confrontés : Al-Qaïda, qu’il s’agisse de ses groupes affiliés en Syrie, notamment le JAN, d’AQPA ou d’AQMI, reste une source de préoccupations. D’autre part, parce que nous pouvons craindre que, lorsqu’ils n’auront plus les marges de manœuvre dont ils disposent aujourd’hui en Irak et en Syrie, les combattants de Daech ne recherchent d’autres territoires pour s’y implanter. Le Yémen et, plus encore, la Libye, sont une préoccupation à cet égard.
M. le président Georges Fenech. Je note que vous n’avez pas du tout évoqué l’intervention russe. Pourriez-vous nous dire un mot de ses résultats ? Par ailleurs, vous nous avez exposé l’état des forces en présence : d’un côté, la coalition, composée de quelque soixante-trois pays contributeurs et disposant de moyens militaires importants, notamment aéronavals ; de l’autre, environ 25 000 hommes. Dès lors, il est difficile, pour un béotien comme moi, de comprendre pourquoi cette force internationale, composée notamment des Russes et des Américains, ne parvient pas à vaincre plus rapidement une horde de 25 000 hommes. On peut d’ailleurs se demander, à ce propos, pourquoi il faudrait exclure totalement l’hypothèse d’une intervention au sol. Est-ce le précédent irakien qui nous empêche d’envisager cette solution ?
M. le rapporteur. Il nous paraît, en effet, incroyable que 25 000 à 30 000 hommes fassent la pluie et le beau temps. Les résultats que vous nous avez exposés sont encourageants, certes, mais comment expliquer que l’on mette autant de temps pour venir à bout de Daech ? On a pu lire dans Le Canard enchaîné qu’une bombe coûtait 1 million d’euros. Si le coût des frappes est effectivement de cet ordre, on peut comprendre que l’on soit très attentif aux cibles visées. Confirmez-vous ce coût ? Au reste, les bombardements sont-ils suffisants ? Certes, la solution politique et la solution militaire ne vont pas l’une sans l’autre, mais j’ai le sentiment que l’on ne veut pas aller trop vite ni trop loin, précisément parce que, pour le moment, aucune solution politique n’existe. Enfin, la fermeture de l’ambassade a-t-elle compliqué le recueil du renseignement ?
M. Patrice Verchère. Il me semble que vous n’avez pas évoqué la Turquie, alors qu’elle reste, même si elle l’est peut-être moins qu’auparavant, un lieu de passage pour les Français qui se rendent en Syrie ou qui en reviennent. Il est clair que la Turquie d’Erdoğan entretenait, jusqu’aux récents attentats commis sur son sol, des relations ambiguës avec Daech. A-t-on une stratégie vis-à-vis de ce pays ? Je suis étonné que vous n’ayez pas évoqué cette problématique, qui suscite de nombreuses interrogations dans la population et chez certains parlementaires.
M. Serge Grouard. Je m’excuse par avance pour le caractère disparate de mes questions. Pourrions-nous avoir des précisions sur l’appréciation par le Quai d’Orsay de la politique américaine vis-à-vis de la nébuleuse terroriste ? Dispose-t-on d’éléments sur les liens que les États-Unis entretiennent, ou non, avec d’autres groupes que Daech – je pense notamment à al-Nosra ? Et, si tel est le cas, quels sont leurs objectifs et comment la France se situe-t-elle par rapport à cela ?
Par ailleurs, comment évaluer les résultats des frappes aériennes ? Je sais qu’une telle évaluation est difficile, notamment lorsque l’ennemi est très mobile et se dissimule assez facilement sur un territoire vaste et difficile à appréhender du point de vue du renseignement. Mais j’ai en mémoire les Balkans et la guerre du Kosovo, où les résultats des frappes étaient sous-évalués ou mal évalués.
Vous avez indiqué que la reprise de Raqqah était essentielle pour la sécurité intérieure. Pouvez-vous développer ce point ? Nourrissez-vous des inquiétudes quant à l’usage d’armes chimiques ? Pensez-vous que ce qui est fait là-bas dans ce domaine puisse être exporté ?
La Libye est-elle en train de devenir un nouveau centre de gravité pour Daech ? Avons-nous des éléments qui laisseraient craindre un regroupement de cette mouvance ou qui attesteraient de transferts de la Syrie vers la Libye ou le Yémen ?
Enfin, on sait que, dans la lutte contre le terrorisme, le « décloisonnement » est important. Vous disposez d’informations importantes sur le Moyen-Orient. On peut également avoir des éléments sur les Français et les Françaises qui sont partis combattre. Or j’ai le sentiment que, malgré tous les efforts qui sont faits, il existe encore des marges de progression pour parvenir à ce décloisonnement entre les services qui relèvent du Quai d’Orsay et du ministère de la défense, d’une part, et ceux du ministère de l’intérieur, d’autre part. Les éléments dont vous disposez peuvent-ils être transmis notamment au ministère de l’intérieur ?
M. Jean-Luc Laurent. Les progrès dans la lutte contre Daech sont nets et encourageants, mais la prudence s’impose puisque vous avez vous-mêmes souligné les dangers de la guerre asymétrique. Il nous faut nommer les choses. On a longtemps parlé de guerre contre le terrorisme ; or il me paraît important d’être précis et de cibler la guerre contre Daech. On constate, à cet égard, un certain réalisme dont témoignent la loi de programmation militaire et les discussions qui l’ont entourée.
L’éradication de Daech est une absolue nécessité et elle doit être rapide, car nous savons que les risques demeurent. Quelle articulation est possible avec la Russie et les pays de la région, qui n’ont pas été cités jusqu’à présent, pour avancer davantage ? Même s’il existe des difficultés de nature politique, pouvez-vous nous confirmer que des contacts existent ? Si tel n’était pas le cas, ce serait terrible.
Par ailleurs, quels enseignements tirez-vous des printemps arabes, du point de vue des mesures de précaution à prendre ? Il est évident que ces événements ont créé une certaine déstabilisation et offert un terreau fertile au terrorisme en Syrie et en Irak.
M. Philippe Errera. Tout d’abord, pourquoi cela prend-il autant de temps ? C’est une excellente question. Il est important de garder présent à l’esprit que nous ne faisons pas face à 25 000 ou 30 000 combattants composant des unités constituées, comme ce pourrait être le cas dans un combat conventionnel. Dans une telle hypothèse, la guerre serait terminée de longue date. Malheureusement, cela fait longtemps que l’on ne mène plus de guerre de ce type, en particulier contre des groupes terroristes. Nous sommes confrontés à des adversaires qui allient les capacités militaires conventionnelles de certains États et les atouts d’un groupe terroriste, c’est-à-dire l’aptitude à se fondre dans la population et à opérer en zone urbaine, de sorte que l’emploi de l’arme aérienne – notre principal outil, dès lors que nous ne déployons pas de troupes au sol – est limité par la nécessité d’éviter les dommages collatéraux, conformément au droit des conflits armés. Notre capacité à mener des frappes efficaces en volume suffisant est ainsi directement liée aux renseignements dont nous disposons, en particulier l’ISR (Intelligence, Surveillance and Reconnaissance). C’est pourquoi nous avons été particulièrement actifs auprès de nos partenaires européens pour que même ceux qui, pour des raisons politiques, ne souhaitaient pas s’engager dans des frappes puissent mettre à notre disposition des moyens de recueil du renseignement – je pense en particulier à des drones de surveillance –, lesquels sont nécessaires pour constituer un dossier d’objectif et évaluer le résultat des frappes.
En outre, pendant une bonne partie de l’année 2014, voire de l’année 2015, nos alliés américains. Or il nous semblait que, si un tel effort était important, d’autant plus que le gouvernement de ce pays menait des opérations au sol, l’action des États-Unis, au titre de la coalition ou non, devait être plus ambitieuse en Syrie – le Président de la République ainsi que Jean-Yves Le Drian ont insisté auprès d’eux en ce sens – et que nous devions aller plus loin dans le type d’objectifs visés, par exemple les infrastructures pétrolières.
S’agissant de la Russie, je ne l’ai pas mentionnée, en effet, dans ma description de l’action de la coalition, car elle n’en fait pas partie. Néanmoins, elle mène une action militaire. Selon nous, elle s’est engagée dans la campagne en Syrie avec pour premier objectif, non pas de lutter contre Daech, mais de sauver le régime de Bachar el-Assad, à un moment, à la fin de l’été dernier, où ce régime était réellement sous pression, le réduit situé autour de Damas et Lattaquié se trouvant sous la menace de l’opposition. La Russie a donc mené, à partir du 30 septembre, des frappes qui, dans un premier temps, visaient substantiellement l’opposition non djihadiste, c’est-à-dire ni Daech ni le JAN, mais l’ensemble des groupes qui menaçaient le régime.
M. le président Georges Fenech. Est-ce une certitude ?
M. Philippe Errera. C’est une certitude.
M. le président Georges Fenech. Elle est totalement réfutée par Poutine.
M. Philippe Errera. Nous avons beaucoup de certitudes totalement réfutées par Poutine ; celle-là en fait partie. Il suffit de voir, grâce à nos propres moyens de renseignement, les localités où la Russie a frappé : l’essentiel de ces frappes ont visé des zones dans lesquelles Daech n’était pas physiquement présent mais où seule l’opposition se trouvait.
Les choses ont néanmoins évolué après l’attentat contre l’Airbus russe au-dessus de l’Égypte, mais à la marge : si nous dressons le bilan de l’intervention russe, l’essentiel des frappes a visé l’opposition et c’est encore le cas aujourd’hui, dans le cadre de l’appui que les forces russes apportent aux forces syriennes. La Russie a mené des frappes contre Daech et le JAN, mais dans une faible proportion. Elle a annoncé son retrait de Syrie au mois de mars dernier. Or nous constatons surtout qu’elle a réaménagé son dispositif, de façon à tirer, de manière assez habile, le bénéfice politique et diplomatique maximal de cette annonce sans pour autant mettre en péril sa présence et son assistance aux forces syriennes. Elle a même renforcé un certain nombre de ses composantes militaires, en particulier les hélicoptères d’attaque.
Quoi qu’il en soit, nous maintenons nos contacts avec la Russie. Le Président de la République s’y est rendu dès le 26 novembre, deux jours après son déplacement à Washington, le ministre de la défense le 21 décembre et le chef d’état-major le 23 décembre. M. Jean-Marc Ayrault, quant à lui, s’y est rendu la semaine dernière, et les contacts entre fonctionnaires se poursuivent. Au plan militaire, nous entretenons des contacts à travers nos services de renseignement militaires respectifs, et, à ma connaissance, la DGSE n’a jamais rompu ses contacts avec les services extérieurs civils russes. Pour autant, l’idée d’une politique de lutte contre Daech partagée avec la Russie est contrariée par le fait que celle-ci n’est pas engagée militairement contre Daech. Par ailleurs, nous estimons que tant que Bachar el-Assad restera au pouvoir, le moteur de l’instabilité en Syrie, qui a nourri Daech et lui a offert ses marges de manœuvre, demeurera. Dès lors, tant que la Russie ne s’engage pas de manière entière dans une transition crédible, qui implique que Bachar el-Assad ne soit pas à la tête des autorités syriennes, notre effort de lutte contre Daech restera fortement contraint.
S’agissant de la fermeture de l’ambassade à Damas, je laisserai répondre M. Bernard Bajolet que vous entendrez sans doute. Mais je dirai de manière générale que nos services ne dépendent pas que des ambassades, et c’est heureux, pour leurs activités de recueil du renseignement.
J’en viens à la Turquie. Oui, nous constatons des ambiguïtés, des ambivalences, dans la politique turque. Cela dit, nous avons constaté une évolution de la politique turque s’agissant du contrôle de la frontière et, selon nos collègues du ministère de l’intérieur, des combattants français. Pour autant, il nous semble important de poursuivre les efforts diplomatiques et nos contacts avec la Turquie, notamment pour nous assurer que la position turque, dans la lutte contre Daech et, plus globalement, dans son rôle dans la région et sa relation avec Bagdad, ne va pas créer un autre foyer d’instabilité.
Comment évaluer la réalité des frappes ? Nous disposons aujourd’hui de tout un ensemble de moyens que nous n’avions pas en 1999, lors de la campagne du Kosovo, qu’il s’agisse du recueil de renseignements d’origine satellitaire ou des Pod Reco équipant les Rafale ou les Mirage, qui nous permettent de dresser le bilan de nos frappes. En outre, le renforcement de nos échanges de renseignements militaires avec les États-Unis concernant ce théâtre s’est accéléré après les attentats du 13 novembre.
Par ailleurs, si Raqqah est liée à notre sécurité intérieure, c’est parce que c’est là que sont formés des Français pour mener des attentats sur le sol français.
M. Serge Grouard. Cela mérite d’être dit. C’était l’objectif de ma question !
M. Philippe Errera. C’est l’un des centres de gravité de Daech en Syrie. Plus celui-ci est affaibli à Raqqah, plus il l’est globalement et moins la menace pesant sur la France est importante.
M. le président Georges Fenech. Je souhaiterais tout de même que vous répondiez à ma question sur l’envoi de troupes au sol. Sans trop vous avancer, pouvez-vous nous dire quand tout cela va-t-il cesser, selon vous ?
M. le rapporteur. J’ajoute que, selon les Israéliens, en quinze jours, au sol, cela pourrait être « plié ».
M. Jérôme Bonnafont. Ils veulent peut-être parler de Gaza…
M. Philippe Errera. Il existe des forces au sol, monsieur le président, en Irak : les forces irakiennes et les forces kurdes. Ce sont les seules qui, de notre point de vue, sont à même d’assurer dans la durée une situation locale qui empêche le retour de Daech.
M. le président Georges Fenech. C’est un raisonnement que j’ai du mal à accepter entièrement. Avez-vous le sentiment que si les Européens ou les Américains font ce travail, ils n’auront pas la même légitimité vis-à-vis des populations ? Autrement dit, l’exemple irakien est-il dissuasif ?
M. Philippe Errera. À supposer qu’un accord politique intervienne, soutenu par les opinions, pour engager 150 000 forces en Irak et en Syrie, nous pourrions, à court et moyen terme, réduire l’empreinte de Daech, mais je ne crois pas que nous serions en mesure de l’éradiquer, c’est-à-dire de mettre fin à sa capacité d’attraction. Au contraire, le fait que des « croisés » les combattent validerait l’idée qu’ils mènent bien le djihad et faciliterait le recrutement de combattants. Par ailleurs, l’action menée en Irak, pour ce qui était des Américains et de leurs alliés, et en Afghanistan pour ce qui nous concerne, a été dans un premier temps une action de combat, puis une action de formation. Nous estimons que, si cette action de formation et de renforcement des capacités locales peut être entamée dès maintenant, cela favorisera la pérennité de nos résultats.
M. le président Georges Fenech. Imaginons que, demain, une série d’attentats se produisent en France, y compris avec des bombes sales, qui fassent 2 000 à 3 000 morts. Croyez-vous que nous continuerons à raisonner ainsi ? Nous sommes engagés dans une guerre ; nous avons eu à déplorer 130 morts en 2015. Faut-il attendre des massacres, car on peut très bien craindre des actions coordonnées en Europe, pour décider d’employer d’autres moyens que de simples frappes ?
M. Philippe Errera. Vous ne m’en voudrez pas si je vous réponds que ce sera au Président et à la représentation nationale de prendre cette décision, le cas échéant. Si jamais une telle situation devait se produire – mais tout est fait pour que ce ne soit pas le cas –, les responsables politiques français seraient obligés de s’interroger sur l’ensemble des menaces pesant sur la France. Car, si nous voulions déployer un nombre significatif de troupes françaises au sol en Syrie et en Irak, cela nous obligerait, compte tenu du volume de nos forces, à dégarnir le territoire national et à réduire substantiellement notre présence au Mali et plus largement au Sahel. S’agissant de la menace terroriste globale pesant sur la France, ce ne serait pas forcément un avantage.
M. le rapporteur. Pour mener une intervention au sol en Syrie et en Irak, il faudrait réduire l’opération Sentinelle et affaiblir considérablement les autres opérations. Est-ce bien cela ?
M. Serge Grouard. Il faut le dire clairement : nous n’avons pas la disponibilité militaire nécessaire ! L’armée de terre compte 100 000 hommes, et elle est actuellement utilisée à plein rendement. L’armée française, qui est engagée dans tous les théâtres que l’on sait, y compris sur le sol national, n’a absolument pas, aujourd’hui, les moyens d’intervenir au sol en Irak et en Syrie. Les militaires qui rentrent d’opérations extérieures ne peuvent même plus bénéficier du temps de repos nécessaire avant de repartir en opération Sentinelle ! Le fait est que, dans le cadre du Livre blanc et de la loi de programmation militaire, on a très sensiblement réduit la voilure. Certes, la loi précédente était probablement illusoire, mais la réalité est celle-là.
M. Jérôme Bonnafont. Quelle est l’articulation entre les différents services de l’État ? Une « task force Daech » a été créée. Ce groupe de travail interministériel rassemble les différents services du ministère des affaires étrangères, la direction de M. Errera, la direction du renseignement militaire, le Centre de planification et de conduite des opérations (CPCO) et la DGSE pour le ministère de la défense, et les différents services du ministère de l’intérieur. Cette task force se réunit chaque semaine.
M. le rapporteur. Il n’y a pas de chef ?
M. Jérôme Bonnafont. Non, c’est un échange d’informations et une coordination. Un certain nombre de documents, classés « confidentiel défense » évidemment, nous permettent de faire un point très précis des actions menées par les uns et les autres.
J’ajoute que l’action de notre service diplomatique comporte une dimension de coopération avec les services. Celle-ci est naturellement animée par la DGSE, la DGSI et les autres services de renseignement compétents. Cela participe du dialogue diplomatique constant que nous entretenons avec l’ensemble des pays avec lesquels nous avons des relations de confiance. Il y a indiscutablement un continuum diplomatie-défense-intérieur, à l’intérieur et à l’extérieur. Nous pouvons toujours progresser et, nous nous y efforçons, mais la volonté existe.
Pour revenir sur le point que vous venez d’évoquer, monsieur le président, quelle serait la base légale d’une intervention en Irak ou en Syrie ? Il existe une base juridique actuellement, qui est celle avec laquelle nous opérons contre Daech, sur la base de la légitime défense et d’une demande explicite du gouvernement irakien. C’est cependant un environnement extrêmement complexe, vu le nombre d’acteurs nationaux et internationaux déjà présents sur le terrain. Il y a donc une multiplicité de facteurs à prendre en compte.
M. le président Georges Fenech. C’est ce que semblaient avoir oublié les Américains lorsqu’ils sont intervenus en Irak.
M. Jérôme Bonnafont. En effet, et c’est ce que l’on paye aujourd’hui, sous bien des aspects.
La Libye est-elle un centre de gravité pour Daech ? L’organisation a rapidement progressé en Libye au cours des derniers mois, jusqu’à ce qu’elle se trouve confrontée à un phénomène qu’elle n’avait pas prévu : l’hostilité des populations locales. Elle a donc de grandes difficultés à se maintenir. Le pouvoir qu’elle exerce sur Syrte et sur certains quartiers est un pouvoir de terreur. Elle bénéficie de complicités locales ici et là, mais elle exerce le pouvoir sans le consentement des populations. Le rétablissement de l’autorité de l’État, auquel nous travaillons avec les nouvelles autorités libyennes, vise à construire l’opération militaire et les conditions politiques pour empêcher la Libye de devenir un centre de gravité de Daech. Pour l’instant, elle ne l’est pas, mais elle pourrait le devenir si cet effort échouait.
La question des enseignements à tirer des printemps arabes est complexe, car les printemps arabes ne sont pas nés avant le terrorisme : celui-ci existait déjà de longue date. Au cours des dernières années, Al-Qaïda a été affaiblie par les coups qui lui ont été portés depuis le 11 septembre, et Daech s’est substitué à elle, avec un nouveau projet, mais en Irak, et non dans les pays où sont survenus les printemps arabes. Daech est né de l’incapacité de l’Irak à se rétablir et de l’incapacité des chiites et des sunnites à trouver une formule nationale de coexistence après l’intervention américaine. Certains de ses combattants viennent de France, de Tunisie, du Maroc et d’Algérie, mais, auparavant, ils étaient sur d’autres théâtres, en Afghanistan ou au Yémen, avec Al-Qaïda. Je rappelle également que Boko Haram ou les Shebab de Somalie ne sont pas nés des printemps arabes mais de ce terreau, très difficile à définir et à comprendre, que ce soit en France ou dans ces pays-là, du terrorisme djihadiste.
Le fait est qu’aujourd’hui, nous avons été confrontés au cours des deux ou trois dernières années au sentiment d’invincibilité qu’a donné Daech, sentiment qui a captivé l’imagination des djihadistes, qui se sont alors portés en nombre auprès de cette organisation. S’il était si important qu’existe un pivot dans la lutte militaire contre Daech, c’est parce qu’il a permis que le mythe de son invincibilité soit détruit. Ainsi, les gens qui combattent à ses côtés commencent à revenir, non plus avec la belle histoire du Djihad triomphal qu’ils se racontaient à eux-mêmes, mais avec des histoires de défaite, de reculs. Et, pour ses chefs, il devient nécessaire de redéfinir le projet politique et militaire de Daech.
Pour revenir aux printemps arabes, ils n’ont donc qu’un lien très ténu avec Daech. Si, après les révolutions, un certain nombre de mouvements islamistes ont conquis le pouvoir, généralement par les urnes, les choses ont ensuite évolué de manière très diverse. Au Maroc, la Couronne a su construire un nouvel équilibre politique dans lequel la majorité conduite par les Frères musulmans, qui ont d’ailleurs gagné les élections locales récemment, entretient un dialogue étroit avec le palais. En Tunisie, après une année de tensions très fortes qui ont donné le sentiment que la situation allait se dégrader très vite, le Quartet, composé de l’union des syndicats, des ligues de droits de l’homme, de l’ordre des avocats et des organisations d’employeurs, a su inciter la classe politique à se mettre autour de la table et à adopter une Constitution qui se réfère à l’islam mais sur laquelle repose un système politique civil dans lequel une coalition non islamique soutenue par Ennahdha, parti islamiste, a obtenu la majorité. En Égypte, le président Morsi a conduit une politique qui lui a rapidement aliéné des pans entiers de la population qui a manifesté contre lui, si bien que l’armée a mis fin à l’expérience et que le maréchal Sissi a pris le pouvoir et est devenu le président de la République arabe d’Égypte. Son discours sur les Frères musulmans est très différent de celui que tiennent les Marocains ou les Tunisiens. Il faut observer cette diversité des discours : certains estiment que la lutte contre le terrorisme passe par l’éradication des Frères musulmans ; d’autres jugent, au contraire, que ces derniers peuvent être intégrés dans une vie politique démocratique normale.
Le phénomène Daech, je le répète, n’est pas né dans les pays des printemps arabes. En Syrie, il faut souligner que son émergence est due à la décision de Bachar el-Assad de libérer les islamistes qui étaient dans ses prisons et de leur concéder une partie de son territoire dans le cadre d’un pacte implicite de non-agression, de façon à pouvoir se présenter, s’il n’a plus que ce moyen pour se justifier vis-à-vis de la communauté internationale, comme un élément indispensable dans la lutte contre l’islam terroriste. Vous observerez, du reste, que de même que Palmyre est tombée entre les mains de Daech quasiment sans combats, de même elle a été reprise par le régime et les Russes quasiment sans combats. Vous observerez également qu’y étaient présents, certes, quelques soldats du régime, mais qu’il s’agissait, pour beaucoup, d’unités du Hezbollah, des Pasdaran et de l’armée régulière iranienne appuyées par des forces russes. Ainsi, si les opérations militaires en Syrie sont conduites nominalement par le président Bachar el-Assad, elles le sont effectivement par cette coalition de troupes étrangères, qui mènent l’assaut contre les cibles que le régime leur désigne – Alep actuellement –, afin de consolider ce que l’on appelle « la Syrie utile » et de préserver le pouvoir de Bachar el-Assad.
Un dernier mot sur la politique américaine contre Daech. Deux groupes terroristes sont listés comme tels par le Conseil de sécurité des Nations unies : Daech et Jabaht al-Nosra. Daech a une emprise territoriale extrêmement limitée géographiquement – très vaste mais très exclusive –, tandis que Jabaht al-Nosra s’est arrangé pour s’insérer dans les autres groupes armés actifs en Syrie. La difficulté à laquelle nous nous heurtons n’est pas de savoir si nous allons traiter ou non avec Jabaht al-Nosra, car personne, ni les Américains ni nous-mêmes, ne traite avec eux. Elle est liée au fait que, lorsqu’il s’agit pour les Russes de frapper, ils voient Jabaht al-Nosra partout et frappent donc partout, alors que nous, nous voyons des filins de Jabaht al-Nosra dans des environnements extrêmement disparates où se trouvent des groupes non terroristes. Toutefois, je ne crois pas qu’il y ait la moindre trace d’une coopération opérationnelle ou d’un dialogue politique entre les Américains et Jabaht al-Nosra. Les Américains ont un ennemi, le terrorisme islamiste, qui est le même que le nôtre et qu’ils combattent avec tous les moyens disponibles, car ils ont été frappés dans leur chair.
M. le président Georges Fenech. Monsieur Errera, vous risqueriez-vous à nous dire à quel horizon, selon vous, on assistera à la fin de Daech ?
M. Philippe Errera. Pour ce qui est de la fin de Daech, cela se compte en années – c’est une estimation personnelle. Surtout, nous devons nous attendre à ce que ses groupes combattants s’installent dans d’autres territoires lorsque les Irakiens auront remporté la victoire militaire en Irak. Nous devons également être attentifs à des mutations du terreau idéologique qui peuvent être similaires à celles auxquelles nous avons assisté entre Al-Qaïda et Daech.
M. le président Georges Fenech. Messieurs, il me reste à vous remercier pour vos réponses.
Audition, à huis clos, du colonel Bruno Arviset, secrétaire général du Conseil de la fonction militaire de la gendarmerie nationale, du chef d’escadron Philippe-Alexandre Assou, du chef d’escadron Y, du major Emmanuel Franchet, de l’adjudant-chef Frédéric Guaignier, de l’adjudant Raoul Burdet, de l’adjudant Vincent Delaval, de l’adjudant Sébastien Perrier et de la gendarme Annaïk Kerneis
Compte rendu de l’audition, à huis clos, du lundi 9 mai 2016
M. le président Georges Fenech. Nous poursuivons nos travaux en recevant les représentants du Conseil de la fonction militaire de la gendarmerie (CFMG), instance nationale de concertation créée en 1990 et qui constitue le véritable instrument du dialogue social interne à la Gendarmerie nationale. Nous accueillons le colonel Bruno Arviset, secrétaire général du Conseil, le chef d’escadron Philippe-Alexandre Assou, le chef d’escadron Y, le major Emmanuel Franchet, l’adjudant-chef Frédéric Guaignier, l’adjudant Raoul Burdet, l’adjudant Vincent Delaval, l’adjudant Sébastien Perrier et la gendarme Annaïk Kerneis.
Vous allez pouvoir, madame et messieurs, faire part à notre commission de vos observations et de vos critiques éventuelles quant aux moyens et aux missions de la gendarmerie, de vos attentes en matière de formation des personnels et de votre appréciation quant à la coopération entre les forces de sécurité intérieure.
Le cabinet du directeur général de la Gendarmerie nationale nous a demandé ce matin même que votre audition ait lieu à huis clos, alors que nous avions envisagé une audition ouverte à la presse, comme nous l’avions fait avec les syndicats de la police nationale. Nous avons souhaité faire droit à cette requête. L’audition n’est donc pas diffusée sur le site internet de l’Assemblée nationale. Néanmoins, et conformément à l’article 6 de l’ordonnance 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, son compte rendu pourra être publié en tout ou partie si nous en décidons ainsi à l’issue de nos travaux. Je précise que les comptes rendus des auditions ayant lieu à huis clos sont transmis aux personnes entendues afin de recueillir les observations de ces dernières. Ces observations sont ensuite soumises à la commission qui peut décider d’en faire état dans son rapport. Conformément aux dispositions du même article, sera punie des peines prévues à l’article 226-13 du code pénal toute personne qui, dans un délai de vingt-cinq ans, divulguera ou publiera une information relative aux travaux non publics d’une commission d’enquête, sauf si le rapport publié à la fin des travaux de la commission a fait état de cette information.
Conformément aux dispositions de l’article 6 précité, je vais maintenant vous demander de prêter le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité.
Le colonel Bruno Arviset, le chef d’escadron Philippe-Alexandre Assou, le chef d’escadron Y, le major Emmanuel Franchet, l’adjudant-chef Frédéric Guaignier, l’adjudant Raoul Burdet, l’adjudant Vincent Delaval, l’adjudant Sébastien Perrier et la gendarme Annaïk Kerneis prêtent successivement serment.
M. le président Georges Fenech. Nous allons vous céder la parole afin que vous nous fassiez part de votre analyse de l’état des moyens et des effectifs du corps de la gendarmerie. Quels sont les principaux besoins en matériel identifiés dans les brigades territoriales ? Selon quelle périodicité les militaires de la gendarmerie nationale bénéficient-ils d’un entraînement au tir ? Cette périodicité a-t-elle évolué depuis les attentats de janvier 2015 ? Avez-vous des propositions à formuler en la matière ?
Le matériel des pelotons de surveillance et d’intervention de la gendarmerie (PSIG) doit évoluer conformément au plan BAC-PSIG 2016. Que pensez-vous de ce nouveau matériel ? Est-il réservé aux « PSIG-Sabre » ? Est-il déjà disponible sur l’ensemble du territoire ? Les 150 PSIG-Sabre sont-ils répartis de façon optimale sur le territoire ?
Un nouveau schéma national d’intervention des forces de sécurité a été présenté par le ministre de l’intérieur le 19 avril dernier. Quelles sont les actions mises en œuvre par la direction générale de la Gendarmerie nationale (DGGN) pour préparer les PSIG-Sabre à remplir leur mission d’unités primo-intervenantes en cas d’attaques terroristes ? Avez-vous le sentiment que la nouvelle doctrine d’emploi est parfaitement intégrée par les unités concernées ?
Colonel Bruno Arviset. Je suis ici entouré de gendarmes couvrant à peu près l’ensemble du spectre de la lutte contre le terrorisme – notamment de militaires de la force d’intervention, en particulier du chef d’escadron Y. La présence de ce dernier explique en partie la demande de huis clos de la DGGN puisque, en tant que membre du Groupe d’intervention de la gendarmerie nationale (GIGN), le chef d’escadron Y est protégé par l’anonymat. Sont également présents des militaires couvrant les domaines du renseignement et de la police judiciaire, ainsi que des militaires représentant les unités territoriales, tant à l’échelon de la compagnie de gendarmerie que du PSIG-Sabre lui-même.
La gendarmerie s’est bien évidemment mise en ordre de marche, sans attendre les attentats du mois de novembre, pour apporter une réponse globale au terrorisme. Qu’un événement ait eu lieu en zone de police ou en zone de gendarmerie, nous restons dans tous les cas au moins une force concourante, et avons des missions de contrôle de flux à assurer, quand bien même un événement serait projeté ou aurait déjà eu lieu en zone de police. J’ajoute que, sur la « plaque » parisienne – qui focalise le maximum de risques –, travaillent de nombreuses unités de gendarmerie, à commencer par la Garde républicaine, ici représentée par un adjudant et chargée de la protection de tous les palais nationaux. Tous les escadrons de gendarmerie mobile de France passent également en région parisienne et sont à ce titre intégrés à cette mission.
Nous sommes à votre disposition pour répondre à vos questions. En fonction de la nature de ces dernières, chacun prendra la parole dans son domaine de compétence privilégié, la parole étant naturellement libre.
Chef d’escadron Philippe-Alexandre Assou. Je précise à titre liminaire que je commande 200 gendarmes dans la compagnie de Nantes.
Dès la publication de la note relative à la gestion des tueries planifiées par la gendarmerie, les unités se sont attachées à prendre en compte le changement de doctrine, et notamment le passage d’une posture de bouclage et de recours aux unités spécialisées à une posture de contact avec l’adversaire, sans négociation possible. Ont ainsi été mis en place les PSIG-Sabre, et je commande d’ailleurs l’un des premiers PSIG à avoir été transformé en PSIG-Sabre. Les moyens nouveaux devraient nous arriver d’ici au 1er septembre – nous en avons reçu confirmation de la direction générale tout à l’heure.
M. le président Georges Fenech. N’était-il pas initialement prévu qu’ils arrivent au début du mois de juillet ?
Colonel Bruno Arviset. Les livraisons de matériel sont prévues d’ici à la fin du mois du juin, mais pourraient être anticipées au profit des quelques PSIG-Sabre les plus exposés du fait de l’Euro 2016. Ainsi tous les PSIG-Sabre de la première phase seront-ils dotés de moyens entre juin et août.
Chef d’escadron Philippe-Alexandre Assou. La formation a cependant déjà commencé, qu’il s’agisse d’entraînements, d’alertes, ou de la détermination des tâches de chacun – l’objectif étant, comme on dit au centre national d’entraînement des forces de gendarmerie à Saint-Astier, la « guerre du temps ». Notre doctrine, qui vous a déjà été exposée, est celle du « primo-engagé primo-intervenant ». Je pense sincèrement que les gendarmes de terrain ont pris conscience, depuis les attentats, que les gens en armes sont, tout un chacun, en mesure d’intervenir n’importe où, que ce soit dans un supermarché, dans un théâtre ou dans un autre lieu. J’ai donc, au niveau de ma compagnie, de nombreux contacts avec les élus locaux, qui n’hésitent pas à mettre à notre disposition qui des théâtres, qui des supermarchés, qui des écoles, pour y faire de l’instruction et de l’entraînement.
M. le président Georges Fenech. À quelle fréquence vous entraînez-vous au tir ?
Chef d’escadron Philippe-Alexandre Assou. L’entraînement, au-delà du tir, consiste déjà à déterminer qui fait quoi. En effet, dans les circonstances qui nous intéressent, tout comme lorsqu’est commise une infraction de droit commun de gravité assez élevée, par exemple un homejacking, toutes les forces, de police comme de gendarmerie, sont concentrées sur la recherche des malfaiteurs. Cette concentration des forces existe donc déjà : c’est la coordination opérationnelle qu’il nous faut mettre en place. Nous y travaillons, à notre niveau, avec les élus.
L’entraînement des gendarmes des brigades territoriales, c’est-à-dire des primo-engagés, englobe le tir, mais aussi la capacité à intervenir sur des sites ouverts au public : ce type d’entraînement a lieu au moins une fois par mois au niveau des compagnies. Il ne peut évidemment concerner tous les personnels simultanément, puisque certains d’entre eux restent à la brigade et que d’autres sont en permission.
Quant au PSIG-Sabre, il a obligatoirement une journée mensuelle d’entraînement, tous gendarmes réunis, mais aussi des alertes au quotidien. Son entraînement au tir s’effectue une fois tous les quinze jours – sachant que nous avons la chance, à Nantes, d’avoir une antenne du GIGN pour nous entraîner – mais ne regroupe tous les personnels qu’une fois par mois. Ces personnels s’entraînent alors spécifiquement au tir, ce qu’ils ne faisaient pas forcément auparavant.
M. Sébastien Pietrasanta, rapporteur. Combien tirez-vous de cartouches par an en moyenne, sachant qu’un policier en tire quatre-vingt-dix ?
Chef d’escadron Philippe-Alexandre Assou. Il convient ici de distinguer les gendarmes en unité territoriale, qui en tirent entre cinquante et soixante par an, – des gendarmes des PSIG. Au titre de nos nouvelles dotations, j’ai reçu 4 500 cartouches pour un PSIG de 38 gendarmes. Je ne puis vous dire combien de cartouches tirera chacun d’eux, d’autant que j’exclus pour l’instant de cette instruction-entraînement les gendarmes adjoints volontaires. Je ne connais pas le nombre exact de cartouches tirées par gendarme du PSIG – qu’il s’agisse de tir aux armes longues ou à l’arme de poing.
M. le rapporteur. Afin de préciser les choses, pourriez-vous me confirmer qu’un gendarme de brigade ne tire que cinquante à soixante cartouches par an ?
Chef d’escadron Philippe-Alexandre Assou. Tout à fait. C’est une moyenne, encore une fois, mais j’insiste sur le contenu de ces séances de tir qui combinent mise en situation opérationnelle, maniement de sécurité, rappels juridiques.
Major Emmanuel Franchet. C’est une moyenne, mais encore faut-il distinguer entre les armes. Nous parlons ici du tir au Sig Sauer, qui est l’arme de poing du gendarme. Vous pouvez ajouter à cela les cartouches qu’ils tirent au pistolet mitrailleur HK ainsi qu’au fusil à pompe. Les gendarmes tirent environ soixante-dix cartouches par an au Sig Sauer, mais aussi une cinquantaine de cartouches par arme supplémentaire.
Colonel Bruno Arviset. Il ne faut pas non plus limiter la préparation à la lutte contre le terrorisme à l’entraînement au tir : elle comporte aussi un entraînement à la manœuvre, permettant d’acquérir ou de réacquérir les actes individuels du combattant. Ceux de nos gendarmes qui entrent en école nationale de sous-officiers reçoivent une formation militaire assez poussée, que beaucoup complètent en participant à des opérations extérieures en cours de carrière. La préparation à la lutte contre le terrorisme comporte un entraînement à la manœuvre opérationnelle, à la progression en binôme et à la progression en groupe, formation qui vient s’ajouter à l’entraînement au tir lui-même – le tir étant l’acte ultime que nous essayons d’ailleurs d’éviter. Avant de tirer, il faut déjà savoir se protéger, protéger son camarade et progresser.
M. le rapporteur. J’entends bien ce que vous dites, mais tant les attentats du mois de janvier que de ceux du mois de novembre ont montré l’importance du tir : au mois de janvier, il n’a pas été simple pour la police de neutraliser les frères Kouachi à la sortie de Charlie Hebdo, et, au mois de novembre, c’est grâce au tir de précision d’un commissaire de la brigade anti-criminalité (BAC) que nous avons pu neutraliser un terroriste. Avec le changement de doctrine d’emploi, qui fait des primo-arrivants les primo-intervenants, les gendarmes, où qu’ils soient sur le territoire, peuvent être amenés à en faire autant. Si un gendarme ne sait pas bien tirer, cela peut avoir des conséquences dramatiques, d’où l’importance de la formation au tir, et d’où cette question sous-jacente : considérez-vous votre entraînement au tir comme suffisant ? Faut-il le renforcer ? J’entends bien qu’il y ait une distinction entre les PSIG-Sabre, dont le ministre de l’intérieur a rappelé l’importance de même que celle des BAC, et les brigades de gendarmerie. Mais, encore une fois, ces dernières, où qu’elles soient, sont potentiellement susceptibles d’intervenir. Les PSIG et les brigades seront-ils suffisamment formés pour faire face à la menace ? J’ai bien entendu vos propos, mon colonel, quant aux autres volets de cette formation, mais je vous interroge spécifiquement sur le tir.
Chef d’escadron Philippe-Alexandre Assou. À Dammartin-en-Goële, c’est tout de même un brigadier qui a blessé les frères Kouachi et permis de les fixer dans l’imprimerie, mettant un terme à leur cavale. Ensuite, je tiens à souligner que les unités s’efforcent d’organiser des séances de tir, malgré les contraintes. Les unités territoriales exercent énormément de missions, et sont d’ailleurs les unités les plus polyvalentes, de sorte que leur commandement est assez difficile. Il est donc très compliqué de parvenir à regrouper l’ensemble des militaires, ce qui n’est pas le cas d’un PSIG-Sabre, que l’on peut neutraliser et qui est toujours prêt à intervenir. Les unités territoriales sont en permanence sollicitées, que ce soit pour des plaintes ou pour autre chose. C’est déjà bien lorsqu’on arrive à faire tirer cinquante à soixante cartouches par militaire car, encore une fois, cela se passe dans le cadre de scénarios et non dans celui d’un strict entraînement au tir. Nous essayons d’éprouver le militaire et de le mettre en état de stress.
M. le rapporteur. Cela vous paraît-il suffisant ?
Chef d’escadron Philippe-Alexandre Assou. Au niveau auquel se trouvent les gendarmes territoriaux, oui. Mais, encore une fois, si nous pouvions augmenter cet entraînement continu, nous le ferions. Car, pour l’instant, nous en avons les moyens.
Colonel Bruno Arviset. Se posent aussi des problèmes d’infrastructures : il faut non seulement des cartouches pour s’entraîner, mais aussi des champs de tir. Nous n’en avons pas dans chaque brigade. Dans le cadre de la feuille de route, la DGGN a permis de faciliter l’accès des gendarmes aux infrastructures civiles notamment.
M. le rapporteur. Il faut aussi des formateurs…
Colonel Bruno Arviset. Nous pouvons encore en trouver en interne. Le plus difficile, à l’échelon d’un groupement, reste de trouver des stands de tir qui ne soient pas trop éloignés des brigades et qui nous permettent de nous entraîner au tir en situation crédible et non pas simplement debout derrière une cible.
M. le rapporteur. Existe-t-il des stands de tir communs avec la police ?
Colonel Bruno Arviset. Lorsqu’il existe un stand de tir, qu’il appartienne à la gendarmerie, à la police ou aux armées, des conventions conclues au niveau départemental nous permettent d’en mutualiser l’utilisation.
Major Emmanuel Franchet. C’est pourquoi mon camarade a souligné la difficulté de trouver des créneaux horaires. Dès lors qu’on mutualise un stand de tir, on doit y faire tirer les policiers, les gendarmes et les policiers municipaux.
M. le rapporteur. Peut-il y avoir des formateurs communs à la police nationale, à la gendarmerie et à la police municipale ?
Major Emmanuel Franchet. Les moniteurs d’intervention professionnelle forment les gendarmes ainsi que les policiers municipaux. La police nationale a ses propres techniciens.
Adjudant-chef Frédéric Guaignier. Il nous arrive, à la section de recherche de Paris, d’aller nous entraîner au tir dans les commissariats de police des 12e et 20e arrondissements, lorsque nous avons des créneaux disponibles, ou bien d’aller tirer le dimanche sur des stands de la gendarmerie. Nous profitons de nos permanences pour tirer, toutes les cinq à six semaines, vingt cartouches par séance.
Adjudant Raoul Burdet. Je confirme les propos de mes camarades. Le même problème se pose pour la Garde républicaine : il lui faut trouver des stands parisiens. Nous mutualisons notamment à Vincennes un stand assez réduit, puisqu’il n’a que deux places de tir. Cela nécessite donc une organisation assez précise.
Adjudant-chef Frédéric Guaignier. Nous avons nos propres moniteurs mais il nous est déjà arrivé de tirer au stand de tir du commissariat du 12e arrondissement, en étant encadrés par un moniteur de la police car il était disponible ce jour-là. Cela nous a permis de nous familiariser avec d’autres méthodes.
M. le président Georges Fenech. Pour en terminer sur ce volet des interventions et des primo-intervenants, je résumerai ainsi votre point de vue : il vous arrive du matériel adapté, et vous êtes également en train de recevoir des formations adéquates. Mais les militaires de l’arme ont-ils vraiment intégré cette nouvelle doctrine de combat ? Le changement de doctrine se fait-il naturellement, ou y a-t-il encore des interrogations ?
Major Emmanuel Franchet. Le changement s’est fait très naturellement, car nous sommes des militaires. Aujourd’hui, le gendarme – primo-engagé ou primo-intervenant – travaille en mode d’intervention professionnelle. Et je m’exprime là en tant que militaire de PSIG-Sabre : lorsque nous intervenons au cours d’une tuerie planifiée ou d’un attentat, nous passons tout naturellement en mode de combat.
M. le président Georges Fenech. Dès lors, pourquoi ne pas avoir adopté cette doctrine plus tôt, compte tenu du contexte apparu en France voici une bonne dizaine d’années ?
Colonel Bruno Arviset. On a toujours considéré, depuis vingt ou trente ans, que, dans une prise d’otages, le temps jouait en faveur des forces de l’ordre. À ce titre, il était parfaitement logique de partir du principe qu’en cas de début de prise d’otages ou de tir, mieux valait que les unités non spécialisées bouclent la zone concernée pour éviter que la situation empire, en attendant l’arrivée d’unités spécialisées. Je pense que cette doctrine n’a pas lieu d’être remise en cause pour un certain nombre de faits, mais que, face à des tueries planifiées par des gens qui veulent faire un massacre et non prendre des otages, puis mourir en martyrs dans un ultime affrontement avec les forces de l’ordre, nous sommes obligés d’adapter notre mode opératoire et de revoir la doctrine. Je parle sous le contrôle d’un chef d’escadron, qui ajoutera ce qu’il souhaite.
Chef d’escadron Y. Il y a quatre ans déjà, le général Thierry Orosco, qui commandait le GIGN à l’époque, avait précisé le concept de tuerie planifiée dans un contexte de terrorisme low cost et, dès cette époque, nous avions commencé à travailler à l’échelle du GIGN, petite unité en termes d’effectifs, sur la guerre du temps et l’intervention la plus rapide sur site. Est alors apparu le concept de plan d’assaut immédiat, qui nous permet d’intervenir très rapidement sur tout point de la grande couronne parisienne. Désormais, ce concept est décliné à tous les échelons de la gendarmerie jusqu’au niveau de la brigade ou du PSIG-Sabre, pour les unités plus spécialisées.
M. le président Georges Fenech. Il s’agit donc d’une adaptation aux nouvelles menaces.
Major Emmanuel Franchet. Quant à savoir si les PSIG-Sabre sont implantés de façon optimale, je vous répondrai que oui : notre maillage territorial fait notre force. La direction générale de la gendarmerie a décidé d’implanter 150 PSIG-Sabre au niveau national pour pouvoir intervenir dans un délai très rapide, en y intégrant également les six antennes du GIGN.
M. le président Georges Fenech. Ce que vous dites en matière d’implantation des PSIG-Sabre vaut non seulement pour le territoire métropolitain mais également outre-mer, me semble-t-il.
Major Emmanuel Franchet. Nous avons effectivement des groupes de pelotons d’intervention (GPI) outre-mer et une antenne du GIGN à Mayotte, dont la création a été décidée cette année.
Colonel Bruno Arviset. Nous avons des GPI dans chaque territoire d’outre-mer. Nous avions donc déjà des spécialistes sur ces territoires. En métropole, nous étions en revanche plus éloignés en certains lieux de nos anciens pelotons d’intervention, d’où l’idée des PSIG-Sabre. Je pense que la répartition de ces derniers s’est faite selon une approche pragmatique, mais je parle sous votre contrôle : on a créé 150 PSIG Sabre, à raison d’au moins un par département, étant entendu qu’ils ne sont pas nécessairement implantés dans le chef-lieu de département, mais plutôt là où peut résider la principale menace. Le major est modeste, lui qui commande le PSIG-Sabre d’Avranches… Cette ville ne dit peut-être pas grand-chose à tout le monde, et l’on pourrait se demander pourquoi Avranches plutôt que Saint-Lô. C’est parce que le PSIG-Sabre d’Avranches est précisément chargé d’intervenir le cas échéant au Mont Saint-Michel, deuxième site touristique de France.
Chef d’escadron Y. Aux Antilles, comme dans tous les départements et collectivités d’outre-mer, les GPI sont bâtis selon la même structure et remplissent les mêmes missions que les antennes du GIGN en métropole.
Chef d’escadron Philippe-Alexandre Assou. Pour en revenir à votre question initiale, l’existence d’un tronc commun facilite la réversibilité de doctrine dans l’esprit de chaque militaire, mais je tiens quand même à préciser trois points. Tout d’abord, lors d’une conférence à laquelle j’ai assisté en 2009, l’ancien commandant du GIGN parlait déjà du phénomène « Amok », qui était donc connu à cette époque de tous les chefs présents. Ensuite, pour ceux qui ont participé à des opérations extérieures, comme moi qui suis allé en Afghanistan en 2011, ce phénomène de tueries de masse ou d’attaques dites « complexes » était hebdomadaire. De nombreux militaires ont donc déjà pris conscience de l’existence de ces phénomènes, mais doivent encore se rendre compte qu’ils ont lieu sur le territoire français. Enfin, je tiens à préciser, s’agissant des gendarmes d’unités territoriales, qu’une information relative à cette menace de tuerie planifiée est diffusée sur notre intranet et dispensée à chaque instruction collective.
M. le président Georges Fenech. Je vous remercie. Nous allons maintenant passer à une deuxième série de questions, relatives aux missions de garde statique et dynamique qui sont affectées à la Gendarmerie nationale. Ces missions ont-elles évolué depuis janvier 2015 ? Ces gardes vous paraissent-elles efficaces ? Les gardes dynamiques, évoquées par le ministre de l’intérieur devant notre commission d’enquête le 7 mars dernier, sont-elles suffisamment efficaces pour remplacer les gardes statiques ?
Adjudant Raoul Burdet. La surveillance des palais nationaux constitue l’un des piliers missionnés de la Garde Républicaine. C’est clairement en termes d’effectifs que l’impact des attentats s’est fait sentir sur la Garde républicaine : par endroits, ses effectifs ont doublé, tant en nombre qu’en termes de difficulté d’emploi, puisqu’ils ont notamment été équipés de gilets pare-éclats et d’armes de dotation collective. Mes camarades, qui montaient auparavant six gardes mensuelles au maximum, en montent désormais huit, voire davantage. Les conséquences sur l’emploi sont donc réelles. Peut-être sommes-nous aujourd’hui confrontés à des logiques croisées : il faut à la fois augmenter les effectifs sur le terrain, compte tenu du contexte, et revoir leur doctrine d’emploi, mais également augmenter leur niveau d’instruction. Accroître nos moyens en matériel technique de surveillance – je pense notamment à la vidéosurveillance des quartiers et casernes et non seulement à celle des palais – permettrait de résoudre une des données de l’équation. La Garde républicaine est clairement en attente de moyens techniques supplémentaires, ce qui permettrait de mettre davantage d’effectifs sur le terrain, car, actuellement, les gardes républicains sont quotidiennement déployés en mission, qu’il s’agisse de la cavalerie ou des pelotons d’intervention des régiments d’infanterie.
M. le président Georges Fenech. La vidéosurveillance, qui pourrait résoudre certains problèmes d’effectifs, reste encore sous-dimensionnée. Une réflexion est-elle menée à ce sujet ?
Colonel Bruno Arviset. Sur la plaque parisienne, ou sur le territoire national de manière générale ?
M. le président Georges Fenech. Sur le territoire national.
Colonel Bruno Arviset. De manière générale, de gros efforts ont été accomplis ces dix dernières années en matière de vidéoprotection, mais par endroits, il reste des marges de progrès. Ces efforts reposent encore beaucoup sur la volonté des collectivités territoriales, qui, certes, y sont incitées par l’État par le biais de financements et de participations, mais il est bien des endroits où l’on pourrait aller bien au-delà de ce qui a été fait. Si la vidéoprotection n’est pas l’alpha et l’oméga de la protection, il n’empêche qu’elle permet de réduire les gardes statiques et d’améliorer l’élucidation des infractions commises.
M. le président Georges Fenech. Le rapporteur me fait remarquer à juste titre que le Premier ministre a annoncé ce matin une montée en puissance de la vidéoprotection.
M. le rapporteur. En dehors de la Garde républicaine, qui est très spécifique, êtes-vous beaucoup sollicités pour assurer, de façon statique ou dynamique, la surveillance de lieux situés sur les territoires relevant de votre compétence ? Quelle est votre appréciation à cet égard ? D’autre part, comment travaillez-vous avec Sentinelle ? Comment jugez-vous cette opération ?
Adjudant Vincent Delaval. Je suis adjudant du peloton spécialisé de protection de la gendarmerie (PSPG) de Nogent-sur-Seine. Les PSPG, qui protègent les centrales nucléaires, connaissent une montée en puissance depuis les attentats. Nous agissons en partenariat avec l’opérateur, qui, de son côté, consacre aussi des moyens à la vidéoprotection. Nous augmentons quant à nous nos effectifs pour faire face aux évolutions de la menace.
M. le rapporteur. Peut-être pourrons-nous revenir par la suite sur le cas très spécifique de la surveillance des centrales, qui relève effectivement de la compétence de la gendarmerie. Mais, en dehors des cas précis des palais nationaux et des centrales nucléaires, êtes-vous sollicités pour la surveillance de lieux de culte ou d’établissements particuliers ?
Chef d’escadron Philippe-Alexandre Assou. Une compagnie de province telle que celle de Nantes est sollicitée de manière ponctuelle lors de fêtes religieuses ou des marchés de Noël. Mais, pour des raisons tactiques, nous n’assurerons jamais, du moins en ce qui concerne ma compagnie, de missions dites statiques. Nous attribuons aux militaires des missions dynamiques de contrôle de zone, en lien avec la mission Sentinelle qui est en contact hebdomadaire avec les gendarmes territoriaux chargés de surveiller des points sensibles. L’uniforme étant devenu une cible depuis quelques temps, si nous restons statiques devant un monument ou autre, il est certain que la cible sera attaquée.
Colonel Bruno Arviset. La gendarmerie départementale a effectué très peu de gardes statiques dans sa zone de compétence, y compris dans la période ayant immédiatement suivi les attentats. De toute façon, les effectifs des brigades ne permettent pas de surveiller vingt-quatre heures sur vingt-quatre des points sensibles situés en zone de gendarmerie. Nous avons donc plutôt opté pour des patrouilles dynamiques visibles, dissuasives et destinées à entraver la liberté d’action de terroristes potentiels. Ce n’est qu’en cas de menace particulière ou de rassemblement que nous recourons éventuellement aux gardes statiques.
Ce sont sans doute nos gendarmes mobiles, venus en renfort à Paris en particulier, qui ont été le plus affectés par les gardes statiques. Après les attentats de janvier 2015, ces gendarmes mobiles ont effectivement beaucoup été mis à contribution en vue d’assurer la protection des organes de presse, mais nous avons rapidement évolué vers des missions plus dynamiques, car chacun s’accorde à dire, chez nous, que les gardes statiques sont extrêmement coûteuses en personnel sans toujours être aussi efficaces que les gardes dynamiques, et qu’elles sont même parfois un « remède pire que le mal », en ce sens qu’elles reviennent à faire de la publicité pour des lieux jusqu’alors méconnus du public.
M. le rapporteur. Travaillez-vous avec des militaires de l’opération Sentinelle ? Que pensez-vous de cette dernière ?
Gendarme Annaïk Kerneis. La gendarmerie des transports aériens, que je représente, a connu, en matière de gardes statiques, des changements dans sa façon de travailler. Depuis les attentats, elle a dû renforcer sa présence auprès de certains aéronefs en provenance du Sénégal, du Mali et des pays du Maghreb, et effectue aussi sur les pistes, c’est-à-dire dans la zone réservée des aéroports, des contrôles approfondis des véhicules et personnes travaillant dans cette zone – les passagers étant quant à eux soumis à l’inspection-filtrage de la police aux frontières (PAF). C’est une mission nouvelle pour nous.
Adjudant Sébastien Perrier. Il a aussi été mis en place au sein de chaque département un pôle de lutte contre l’islam radical, animé par le préfet et coordonné avec les services de douane, de police, de gendarmerie, de l’URSSAF et de tout autre service de l’État susceptible d’intervenir – comme l’administration pénitentiaire ou l’éducation nationale. Ce pôle a pour but de lutter contre la montée en puissance de ce phénomène sur le territoire national, ainsi que contre l’économie souterraine qui peut se développer en parallèle. Nous n’effectuons pas de gardes statiques. Nous allons sur place visiter des lieux culturels et d’activité commerciale, une fois les cibles de nos contrôles prédéfinies mensuellement au niveau de la préfecture.
Gendarme Annaïk Kerneis. J’ai oublié de vous préciser que, avant les attentats, nous patrouillions avec Sentinelle dans la zone des pistes des aéroports. Depuis ces événements, nos effectifs ne le permettent plus, car nous sommes appelés pour d’autres missions. Sentinelle patrouille donc souvent seule, de même qu’elle le fait dans les aérogares, avec ou sans la PAF dont elle est indépendante.
Chef d’escadron Philippe-Alexandre Assou. Les unités territoriales sont effectivement en contact avec Sentinelle. Comme je vous le disais, les brigades connaissent le territoire. En tant qu’ancien militaire de l’armée de terre, j’incite donc les militaires des armées à prendre ces contacts. Je pense néanmoins que l’échange d’information pourrait effectivement être amélioré.
M. le rapporteur. Sentinelle vous paraît-elle utile ?
Colonel Bruno Arviset. Le renfort des armées sur le territoire national est utile sinon indispensable à mon sens, qu’il s’appelle Sentinelle ou qu’il revête d’autres formes. Peut-être faut-il encore réfléchir à de nouveaux types de renfort. Je sais par exemple que le mois dernier, dans l’Isère, la gendarmerie a conduit une expérimentation assez intéressante de contrôle de flux conjoint avec des militaires de l’armée de terre. Cette dernière nous apporte un savoir-faire et un renfort de moyens ; nous lui apportons une capacité juridique. Ce type d’opérations de contrôle des flux coordonné mérite selon moi d’être reconduit, même s’il reste encore à en tirer toutes les conclusions. Il est peut-être des territoires en France où le renfort de militaires en zone de gendarmerie serait le bienvenu. Je pense par exemple à la frontière sud-est, au-dessus de Nice, qui se trouve en zone montagneuse. Les gendarmes du groupement de Nice ne peuvent contrôler seuls tous les points de passage en même temps : les unités alpines pourraient tout à fait travailler en synergie avec les gendarmes pour effectuer des contrôles aux frontières sur les cols qui sont des points de passage connus. À mon sens, le renfort de militaires des armées sur le territoire national est très profitable, mais encore faut-il qu’il s’articule correctement avec les missions de la gendarmerie.
M. le président Georges Fenech. Notre troisième série de questions concerne le renseignement territorial. La remontée de l’information depuis vos brigades fonctionne-t-elle bien selon vous ? A-t-elle évolué depuis les attentats de janvier 2015 ?
Adjudant Sébastien Perrier. Actuellement, la gendarmerie occupe toute sa place dans le deuxième cercle du renseignement. Nous travaillons de concert avec la direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) et les services départementaux du renseignement territorial (SDRT), dont le renseignement est la mission régalienne.
La gendarmerie travaille de l’échelon central vers ses unités élémentaires et n’a pas de problème de remontée d’informations. Nous avons, au niveau de chaque département, une cellule de renseignement, commandée par un officier adjoint de renseignement et dont la mission est d’animer et de coordonner le suivi du renseignement dans le département. Cet officier a pour ce faire, au niveau des unités élémentaires, des gendarmes plus particulièrement chargés du suivi, notamment sur l’islam radical, qui lui font remonter les informations. Des signalements peuvent lui être apportés. Il anime la recherche et la remontée de l’information.
Les fichiers de la gendarmerie sont, eux aussi, une mine nous permettant de faire remonter l’information. Je pense notamment à la base de données de sécurité publique (BDSP) : le brigadier peut y faire remonter, sans formalisme particulier, une fiche de renseignement au niveau supérieur, qui est celui du groupement. Là, l’information sera travaillée par la cellule de renseignement pour devenir véritablement un renseignement et s’inscrire dans un cadre de suivi si nécessaire. Il existe également des fichiers plus particuliers, comme le fichier de traitement des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste (FSPRT), que l’on trouve au niveau du groupement. Ce fichier est une mine importante, permettant d’avoir accès à différents renseignements relatifs à des personnes fichées ou suivies en raison d’une radicalisation à caractère terroriste, ou qui sont encore en cours d’évaluation. Les agents qui ont à en connaître peuvent également savoir si cette personne est suivie par d’autres services. La gendarmerie dispose de nombreux autres moyens, tels que le fichier des personnes recherchées, le système d’information Schengen ou le traitement d’antécédents judiciaires (TAJ).
Il existe, outre les cellules de renseignement, des brigades départementales de renseignement et d’investigation judiciaire, qui, elles-mêmes, peuvent inscrire des personnes ou des véhicules dans des fichiers – sur autorisation du commandant de groupement de gendarmerie. Il y a donc, de l’unité élémentaire jusqu’à l’échelon central, une remontée d’informations permanente.
M. le rapporteur. Confirmez-vous que le FSPRT est très utile aux gendarmes ?
Adjudant Sébastien Perrier. L’autorisation d’accès au fichier est très réglementée au sein de la gendarmerie. Dans le département de Vaucluse, par exemple, seuls l’officier adjoint au renseignement et le chef du centre opérationnel de renseignement de la gendarmerie y ont accès. Ils sont là en permanence et assurent le suivi de toutes les personnes figurant sur ce fichier. Ils peuvent également savoir si ces personnes sont suivies par d’autres services.
Colonel Bruno Arviset. Ce fichier est à mon sens indispensable à nos unités. Si vous me permettez d’être un peu critique, nous y avons peut-être encore un accès trop restreint. Quand, dans un département comme le Vaucluse, qui a une population importante en zone de gendarmerie et une population à risque également importante, on n’autorise que deux officiers supérieurs de gendarmerie à consulter ce fichier, il y a, me semble-t-il, une marge de progrès – surtout lorsqu’on sait que le nombre d’inscrits au FSPRT en France est évalué à 14 000.
M. le rapporteur. Quelle est, d’après vous, cette marge de progression, entre la nécessité d’être opérationnel et le souci majeur de la confidentialité ?
Colonel Bruno Arviset. Nous avons 400 compagnies de gendarmerie sur le territoire national, donc 400 commandants de compagnie et leurs adjoints – à l’échelon administratif de l’arrondissement. Il me semble que l’on pourrait leur ouvrir l’accès à ce fichier. Ne voir les choses qu’à l’échelon du département, c’est oublier qu’il y a dans le ressort de bien des compagnies des dizaines d’individus radicalisés.
M. le rapporteur. L’une des idées actuellement à l’étude consisterait à repositionner le service central du renseignement territorial (SCRT) pour qu’il puisse intégrer la gendarmerie : qu’en pensez-vous ?
Colonel Bruno Arviset. En principe, le SCRT est un service commun à la police et à la gendarmerie. Il a cependant encore un trop grand tropisme policier. Étant donné qu’il travaille, y compris au niveau de ses antennes départementales, au profit des deux zones et que 50 % de la population se trouve dans notre zone de responsabilité, il me semble que la codirection devrait être instaurée et que l’équilibre devrait se retrouver à tous les niveaux de la chaîne de ce service.
M. le rapporteur. Si ma mémoire est bonne, tant à Lille qu’à Marseille, où nous nous sommes déplacés pour voir comment les choses fonctionnaient, les gendarmes sont intégrés à l’antenne départementale du SCRT. La gendarmerie est-elle représentée dans toutes les antennes départementales ? D’après ce que vous nous dites, n’est-ce pas tant un problème de positionnement que de culture ?
Colonel Bruno Arviset. Les gendarmes sont certes intégrés dans le SCRT, mais encore faut-il prendre en compte les volumes concernés. En règle générale, on trouve dans chaque service départemental un à deux gendarmes, tous grades confondus – étant entendu que les effectifs des services départementaux varient. Ce n’est pas gênant en soi, puisque nous avons nous-mêmes une cellule de renseignement qui alimente le SDRT. Pour autant, nous n’avons que trois (à l’origine aucune), directions de SDRT, alors qu’il est des départements où les trois quarts de la population sont en zone de gendarmerie. Bref, le renseignement territorial est une mission que nous partageons avec la police, mais la direction n’est pas toujours suffisamment partagée. Il n’est pas question ici de guerre des polices mais d’équilibre dans la représentation, tant à l’échelon national que départemental.
M. Serge Grouard. Je souhaiterais revenir sur la question des fichiers. Rencontrez-vous des problèmes de compatibilité entre logiciels ? Selon quelle procédure interne ces fichiers sont-ils nourris de tel ou tel signalement ? Pendant quelle durée et de quelle manière les informations y sont-elles stockées ? Sont-elles consultables facilement ? Sont-elles intégrées à d’autres fichiers, ce qui pourrait, encore une fois, poser des problèmes de compatibilité ? Avez-vous directement accès à ces informations quand vous en avez besoin ?
Adjudant Sébastien Perrier. Il existe une protection de l’information au sein de la gendarmerie. Toute personne n’a pas à connaître du même degré d’information. L’officier adjoint au renseignement qui est à la tête de la cellule de renseignement n’aura pas le même renseignement que le brigadier qui se trouve en unité élémentaire.
L’enregistrement d’informations sur les fichiers est une décision soumise à l’autorité du commandant de groupement au niveau du département, dans un premier temps. Et, comme je vous le disais, un groupe d’évaluation départemental (GED) associant les différents services de l’État se réunit chaque semaine. C’est le préfet qui décide d’enregistrer ou non dans les fichiers ad hoc les personnes ciblées, en fonction du niveau de radicalisation dont elles font preuve.
La durée d’enregistrement d’une information dans le FSPRT est de cinq ans. Le suivi s’articule en deux niveaux : un premier niveau, dont le suivi est mensuel, pour les cibles du bas du spectre ; et un second, dont le suivi est renforcé, pour les cibles présentant une sensibilité plus marquée. Ce suivi peut notamment conduire à engager des services tels que nos sections de recherche, qui utilisent des techniques de recueil du renseignement spécifiques.
M. Serge Grouard. Vous dites que les informations sont conservées cinq ans. Une fois sorties du fichier, ces informations sont-elles perdues ou au contraire re-stockées ailleurs ? Le renseignement soulève en effet la question majeure de sa durée de conservation. Il faut pouvoir retrouver des parcours, même au-delà de cinq ans.
Adjudant Sébastien Perrier. Les informations ne sont pas perdues. Nous évoquions aussi le fichier FSPRT, outil de l’état-major opérationnel de prévention du terrorisme (EMOPT) qui permet, comme ce fut le cas de l’événement de Saint-Quentin-Fallavier, d’assurer un meilleur suivi des personnes ciblées.
M. le rapporteur. Le FSPRT est le fichier géré par l’EMOPT. Il s’agit donc de la même chose.
Colonel Bruno Arviset. Tout à fait. Mais l’adjudant Perrier aura du mal à vous parler de ce fichier puisque personne autour de cette table n’y a accès. Très peu de personnes au sein de la gendarmerie y accèdent.
M. le rapporteur. Ce fichier est effectivement géré à la fois par l’EMOPT et par l’unité de coordination de la lutte anti-terroriste (UCLAT), que nous auditionnerons. Lorsque vous dites qu’il fait l’objet d’un suivi hebdomadaire ou mensuel selon les cas, cela veut-il dire que vous devez, à cette fréquence, adresser à l’EMOPT une actualisation des fiches ?
Colonel Bruno Arviset. Oui, tout à fait.
Adjudant Sébastien Perrier. Exactement. Il s’agit d’une actualisation assortie d’un contrôle des différentes inscriptions au fichier des personnes recherchées, l’objectif étant de vérifier si une personne est un individu dangereux ou instable. Lorsque la DGSI est saisie d’une cible, la gendarmerie n’est généralement pas chef de file. Lorsque la DGSI ne l’est pas, le GED décide si c’est le SDRT ou la gendarmerie qui le sera. Lorsque nous assurons le suivi d’une cible, nous actualisons sa fiche au fil de l’eau.
M. le président Georges Fenech. Disposez-vous du système de lecture automatisée des plaques d’immatriculation (LAPI) ? Nous en avons eu, à Lille, une petite démonstration que nous avons trouvée très convaincante.
Major Emmanuel Franchet. Dans la Manche, seuls deux de nos véhicules sont dotés de ce système. Au départ, ce type de véhicule était réservé au peloton d’autoroute. Puis, nous étant aperçus qu’ils ne permettaient pas de saisir suffisamment de véhicules, nous les avons confiés aux PSIG. Ce système fonctionne très bien. Malheureusement, nous manquons de véhicules de ce type. Si tous les véhicules d’intervention de la gendarmerie nationale ou de la police nationale étaient dotés d’un tel système, nous obtiendrions bien davantage de résultats positifs.
M. le rapporteur. Nous avons également été séduits par le nouvel outil connecté NéOGEND. On nous a expliqué que l’ensemble des gendarmes devraient en être équipés d’ici à 2017 : est-ce le cas ?
Colonel Bruno Arviset. Le déploiement du dispositif est effectivement en cours. Il est déjà achevé dans le nord de la France – ce qui tombe bien, d’ailleurs. Ce déploiement est en cours en Bourgogne, et toutes les zones du territoire devraient en être dotées d’ici à un an. C’est un atout efficace et convivial, permettant de démultiplier le nombre de contrôles et d’alléger la tâche de chacun lors de ces opérations de contrôle. C’est vraiment l’outil de l’avenir.
Adjudant Sébastien Perrier. Pour avoir été administrateur fonctionnel lorsque je servais en PSIG, j’ajouterai que le système LAPI est une base précieuse, permettant à la fois d’enregistrer et de stocker les données, ce qui permet ensuite de faire des recherches très précises de personnes ou de véhicules, par le biais de la réquisition. Il regorge de précieux renseignements pour nous.
M. le rapporteur. Le soir du 13 novembre 2015 et dans les jours qui ont suivi, les véhicules dotés de systèmes de LAPI ont-ils été déployés ? Des dispositifs particuliers sont-ils utilisés les soirs d’attentats pour démultiplier partout sur le territoire les moyens de récupérer des informations ?
Adjudant-chef Frédéric Guaignier. En unité judiciaire, nous nous servons du système LAPI pour effectuer des contrôles de zone ou d’itinéraire dans toutes les affaires importantes d’atteinte aux biens ainsi que dans certaines affaires d’atteinte aux personnes.
Chef d’escadron Philippe-Alexandre Assou. Le soir des attentats du 13 novembre 2015, bien que nous ayons été assez éloignés des événements en Loire-Atlantique, ordre a été donné au niveau national de procéder à une manœuvre de contrôle de flux. Les échelons territoriaux ont donc automatiquement sorti leurs véhicules LAPI en plus de leurs compléments d’effectifs.
M. le président Georges Fenech. Le Conseil de la fonction militaire de la gendarmerie n’étant pas un syndicat au sens où on l’entend habituellement, êtes-vous quand même soumis à une obligation de réserve ?
Colonel Bruno Arviset. Oui, en partie. Le code de la défense prévoit que les membres des conseils de la fonction militaire peuvent s’exprimer librement – même si, par ailleurs, un devoir de réserve incombe à chaque militaire.
M. le président Georges Fenech. Compte tenu de votre liberté de parole, je vais vous interroger et vous me répondrez comme vous le souhaiterez.
J’ai fait partie de la mission d’information sur la lutte contre l’insécurité sur tout le territoire, présidée par Jean-Pierre Blazy, qui avait auditionné le général Soubelet. Vous avez suivi, comme tous les Français d’ailleurs, les propos tenus par ce dernier, puis son affectation nouvelle et sa mise hors cadre récente, à la suite de la publication de son ouvrage. Chacun pensera ce qu’il voudra de la manière dont il s’est exprimé. Toujours est-il qu’il l’a fait dans le cadre d’une mission d’information parlementaire et non d’une commission d’enquête. Le corps de la gendarmerie a-t-il vraiment le sentiment d’une insuffisance de la réponse judiciaire et pénale à la délinquance « habituelle » – qui peut aussi être liée au basculement dans l’islam radical ? Vous jouissez dans l’ensemble d’une excellente réputation, d’une véritable reconnaissance et d’un grand respect – tout à fait justifiés – dans le pays, même si quelques extrémistes utilisent des méthodes tout à fait condamnables pour critiquer l’action des forces de sécurité dans des circonstances telles que les manifestations. Cela étant, avez-vous le sentiment, exprimé par le général Soubelet, de devoir fournir davantage d’efforts dans vos missions d’identification et d’interpellation des auteurs d’actes de délinquance sans que ce travail très prenant sur le terrain soit toujours suivi d’effets – tant en termes d’exécution des peines que de lutte contre la récidive ? Vous n’êtes pas obligés de me répondre, mais vous pouvez le faire si vous le souhaitez.
Adjudant-chef Frédéric Guaignier. Ce sentiment existe effectivement. Lorsque vous travaillez pendant des jours, des semaines, des mois, voire des années, sur des individus, avec de bonnes équipes, mais que ce travail n’est pas suivi d’une véritable réponse pénale, cela engendre un certain découragement des personnels. Je pense notamment à tous les brigadiers qui arrêtent dix fois la même personne pour devoir ensuite dix fois la relâcher – et quand je dis dix fois, c’est un euphémisme. Peut-être, il est vrai, nous manque-t-il certains éléments lorsque nous présentons un dossier aux magistrats.
Cela étant dit, lorsque nous présentons une personne à la justice, nous sommes, la plupart du temps, à peu près sûrs de notre résultat et il s’ensuit obligatoirement une réponse pénale. Le problème se pose davantage pour la délinquance de masse, la petite et moyenne délinquance, en territoire périurbain et même dans les campagnes. Parfois, la personne est effectivement dehors avant le gendarme. Le temps que vous vous expliquiez avec le magistrat – procureur ou juge –, la personne sera déjà quasiment relâchée alors que vous serez encore en train de rédiger des documents…
M. le président Georges Fenech. La logique judiciaire n’est pas tout à fait identique à la logique d’enquête, d’identification et d’interpellation : dans le cadre judiciaire, on étudie le dossier de l’individu, ses antécédents et la possibilité de le mettre sous contrôle judiciaire. Cela apparaît souvent aux enquêteurs comme une non-réponse, alors qu’il y a bien réponse judiciaire. Simplement, ce n’est peut-être pas celle qu’on aurait pu attendre, d’un certain point de vue. C’est peut-être aussi ce qui crée un malaise.
Chef d’escadron Philippe-Alexandre Assou. C’est justement – et fort heureusement – ce qui fait la richesse de notre République. Nous avons ainsi un double travail à faire. Nous devons, en tant que commandants d’unité, accomplir un gros travail de communication envers les enquêteurs – qui, pris qu’ils sont depuis des jours ou des mois par leur dossier, ont souvent peu dormi lorsqu’arrivent les phases d’interpellation et de fin de garde à vue. Il nous faut aussi fournir un travail d’information auprès des magistrats et maintenir avec eux une relation de confiance. Cela étant, on ne peut mélanger l’action et la décision.
Colonel Bruno Arviset. Je précise qu’à aucun moment ce ne sont les magistrats qui sont en cause dans les propos qui sont tenus ici. Notre Conseil rencontre d’ailleurs le garde des sceaux à peu près une fois par an. L’adaptation de la réponse pénale à la délinquance des mineurs est un sujet que nous avons abordé tout à fait librement avec l’ancienne garde des sceaux et son cabinet. Nous évoquons ce sujet sans langue de bois, tout en étant conscients des contraintes de chacun.
Chef d’escadron Philippe-Alexandre Assou. Et, in fine, la frustration est logique.
M. le rapporteur. Chef d’escadron, que pensez-vous de la nouvelle doctrine d’emploi des forces d’intervention annoncée par le ministre de l’intérieur ? Nous avons certes identifié, à la suite de nos différentes auditions, les difficultés que posait la règle de compétence territoriale. Néanmoins, cette nouvelle doctrine du « primo-arrivant primo-intervenant » ne risque-t-elle pas d’exacerber une sorte de concurrence entre le GIGN, le RAID et la Brigade de recherche et d’intervention (BRI) ?
Chef d’escadron Y. Le schéma national d’intervention qui a été présenté par le ministre de l’intérieur était très attendu, notamment au GIGN, pour la raison précise qu’il vient mettre un terme au principe de territorialité – dans le seul cadre du contre-terrorisme – en mettant en avant la réactivité des unités et le secours aux personnes.
Il y a toujours une saine concurrence entre les unités, mais le GIGN, le RAID et la BRI ne jouent pas à essayer d’être les premiers sur place, dans la mesure où les règles du jeu sont clairement définies. Les antennes du RAID et du GIGN sont réparties le plus harmonieusement possible afin que les unités d’intervention maillent le territoire de manière assez uniforme.
En ce qui concerne la région parisienne, point le plus sensible, le dispositif actuellement en place est fondé sur la primauté de la BRI dans Paris intra-muros, celle du RAID dans la petite couronne et celle du GIGN dans la grande couronne, quelle que soit la zone. La petite couronne est une zone exclusivement confiée à la police, tout comme Paris, mais dans la grande couronne, qui est une zone mixte associant police et gendarmerie, primauté est donnée, dans le cadre du contre-terrorisme, au GIGN. Cela nous ouvre donc l’accès à des zones de police qui nous étaient fermées auparavant.
M. le rapporteur. La concurrence entre forces est une vraie difficulté, que nous avons identifiée au cours de nos auditions. Dans des situations de crise comme celles que nous avons connues en janvier et en novembre 2015, de nombreux exemples ont montré que cette concurrence n’était pas forcément des plus saines. Remettre en cause la compétence territoriale me paraît une bonne chose, compte tenu de ce qui a été vécu, mais je crains que, par effet boomerang, le premier arrivé devienne le leader et que cela engendre des difficultés importantes.
Chef d’escadron Y. Ce ne sont pas les ordres que nous recevons actuellement, ni le message que nous faisons passer au sein de notre unité.
M. le rapporteur. J’entends bien. J’ai un profond respect pour les trois forces. Pour avoir passé une journée au GIGN il y a deux ans, je mesure le travail qui est le vôtre et les risques que vous prenez. Mais je sais aussi qu’il existe une concurrence entre forces. Peut-être est-elle saine, mais on a vu, aussi bien lors de la traque des frères Kouachi que lors de la tuerie du Bataclan, que les uns et des autres avaient la volonté d’exister et d’intervenir. La répartition des rôles semble bien calibrée en région parisienne, mais j’ai peur que, sur un territoire à cheval entre zone de police et zone de gendarmerie, chacun veuille y aller le premier pour être « leader ».
Chef d’escadron Y. Peut-être, en effet ; d’où l’intérêt de répartir les unités d’intervention de manière harmonieuse sur le territoire. Si une tuerie de masse se déclenche dans la grande zone commerciale de Vezin-le-Coquet, près de Rennes, qui se trouve en zone de gendarmerie, il me paraît normal que ce soit l’antenne RAID de Rennes qui s’y rende en premier car elle est à côté, et qu’a contrario, s’il se passe la même chose au Zénith de Nantes, qui est en zone de police, ce soit l’antenne GIGN de Nantes qui intervienne.
M. le rapporteur. Vous pensez donc que la répartition des antennes du RAID et du GIGN permet ce maillage territorial et évitera cette concurrence.
Chef d’escadron Y. Tel est bien le but de cette répartition. En outre, nous avons fait au sein de la gendarmerie un gros effort d’intégration des antennes GIGN, qui étaient auparavant des pelotons d’intervention interrégionaux de gendarmerie (PI2G), vis-à-vis du GIGN central. Je pense que cet effort sera poursuivi et qu’il faut aller dans le sens d’une plus grande intégration de ces unités régionales pour les amener à un niveau supérieur à celui qu’elles ont actuellement.
M. le rapporteur. Ma question est provocatrice, mais je m’en voudrais de ne pas vous la poser : une fusion des trois forces d’intervention serait-elle pour vous une hérésie ?
Chef d’escadron Y. Oui. Non seulement notre nature et nos statuts sont différents – les uns sont des civils, les autres des militaires –, mais nous n’avons en outre ni la même culture ni la même manière de travailler. En l’état actuel des choses, il me paraît donc difficile, et peu souhaitable, de mélanger les unités et de les faire travailler de manière intégrée. En revanche, une coopération entre unités est tout à fait envisageable et se pratique déjà dans certains domaines : par exemple, le GIGN est engagé aux côtés du RAID, dans le cadre de la cellule interministérielle de négociation, concernant certains enlèvements à l’étranger.
M. le président Georges Fenech. En cas de concurrence entre les deux services, je n’imagine pas du tout que l’un ou l’autre puisse chercher à arriver le premier sur les lieux pour prendre en charge une opération. Je suppose que la décision ne peut être prise que par le préfet ou le ministre.
Colonel Bruno Arviset. Nous déterminons celle des unités implantées dans le bassin qui est la plus proche du lieu des faits, qu’elle soit en zone de police ou en zone de gendarmerie. Puis intervient a minima une décision du préfet, ou, plus souvent, du ministre.
M. le rapporteur. Certes, mais tant lors des attentats de janvier que de ceux de novembre, le GIGN, le RAID et la BRI sont tous intervenus de leur propre initiative. Le GIGN s’est positionné aux Célestins à l’initiative – heureuse – du directeur général de la gendarmerie, le RAID est intervenu de sa propre initiative et la BRI, compétente sur le plan territorial, s’est également mobilisée. Il est vrai que ces initiatives ont été régularisées par le préfet de police ou par le ministre mais seulement après coup.
Chef d’escadron Y. Le GIGN s’est effectivement prépositionné aux Célestins, puis s’est annoncé comme étant en mesure d’intervenir si jamais une crise se déclenchait sur un autre point.
M. le rapporteur. Lorsque nous nous sommes rendus à Lille, nous avons pu constater que la protection des centrales nucléaires était une préoccupation majeure pour la gendarmerie. Pourriez-vous nous confirmer que, le 13 novembre au soir et dans les jours qui ont suivi, la sécurité a été renforcée dans l’ensemble de celles-ci ? Depuis cette date, a-t-on renforcé les effectifs chargés de cette mission ? Des contrôles supplémentaires ont-ils été effectués ? Les informations que nous avons recueillies après ce qui s’est produit à Bruxelles – que ce soit dans le cadre de notre commission d’enquête ou dans la presse – montrent bien que la potentialité d’attaques visant des centrales nucléaires ou leurs personnels n’est pas purement théorique.
Adjudant Vincent Delaval. Dès le lendemain matin des attentats de janvier 2015, nous avons établi avec l’opérateur un état des lieux des effectifs présents. Ensuite, la DGGN a tout de suite pris des mesures. À l’échelon local, les militaires des PSPG se sont eux aussi proposés au niveau du commandement pour grossir ces effectifs. En novembre, il a fallu refaire cette manœuvre. Nous sommes depuis en posture de vigilance, le temps de l’état d’urgence – qui devrait être prorogé.
M. le rapporteur. Quelles sont les conséquences concrètes de cet état ?
Adjudant Vincent Delaval. Avant les attentats de janvier 2015, nos patrouilles étaient un peu plus à l’extérieur des centrales. Désormais, elles ont été recentrées sur leur mission principale de protection des installations nucléaires. Ensuite, l’opérateur a déployé de nouveaux moyens tels que la mise en place de nouveaux badgeurs à Nogent-sur-Seine. Nos effectifs ont été accrus de six à sept militaires supplémentaires par centrale, sachant qu’il existe des PSPG de 38 gendarmes et d’autres de 56. Celui de Nogent-sur-Seine est ainsi passé de 38 à 44 ou 45 gendarmes. Cette décision, établie en parfaite harmonie avec l’opérateur, devrait être effective au 1er juillet. Nous sensibilisons également les personnels des centrales concernant les signaux faibles.
M. le rapporteur. La gendarmerie s’occupe-t-elle du criblage du personnel des centrales ?
Adjudant Vincent Delaval. Les personnes susceptibles de travailler dans des centrales font l’objet de vérification sur fichiers.
M. le rapporteur. Certes, mais cela relève de la responsabilité de la DGSI. Contribuez-vous aux enquêtes sur le personnel des centrales ?
Adjudant Vincent Delaval. Dans les centrales nos militaires sont impliqués à cet effet, notamment celle de Nogent où nous vérifions si ces personnes figurent ou non dans différents fichiers mis à disposition par la gendarmerie. La police effectue elle aussi le même travail. Un avis est ensuite émis à l’échelon préfectoral, qui détermine en dernière instance si une personne peut rentrer dans une centrale ou pas.
M. le rapporteur. Si je ne m’abuse, parallèlement aux vérifications que vous effectuez, la DGSI examine l’environnement et les fréquentations de ces individus.
Adjudant Vincent Delaval. Tout à fait. Je voulais simplement préciser que toute personne susceptible de pénétrer dans une centrale fait aussi l’objet de vérifications sur la base des fichiers de la gendarmerie et de la police.
M. le président Georges Fenech. Je vous remercie d’avoir contribué utilement aux travaux de notre commission d’enquête.
Audition, à huis clos, de M. Jean-Jacques Colombi, chef de la division des relations internationales à la direction centrale de la police judiciaire (DCPJ),
et de M. Alexandre Pichon, son adjoint
Compte rendu de l’audition, à huis clos, du lundi 9 mai 2016
M. le président Georges Fenech. Mes chers collègues, nous accueillons maintenant M. Jean-Jacques Colombi, chef de la division des relations internationales à la Direction centrale de la police judiciaire (DCPJ) et son adjoint, M. Alexandre Pichon.
Messieurs, nous vous remercions d'avoir répondu à la demande d'audition de notre commission d'enquête relative aux moyens mis en œuvre par l'État pour lutter contre le terrorisme depuis le 7 janvier 2015.
Nous allons nous intéresser avec vous aux aspects internationaux de la lutte menée par les services de police contre le terrorisme. Vous allez notamment pouvoir informer la commission d'enquête sur les actions de coopération entre la division que vous dirigez et ses homologues à l’échelon européen.
Cette audition, en raison de la confidentialité des informations que vous êtes susceptibles de nous délivrer, se déroule à huis clos. Elle n'est donc pas diffusée sur le site Internet de l'Assemblée. Néanmoins, et conformément à l'article 6 de l'ordonnance 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, son compte rendu pourra être publié en tout ou partie, si nous en décidons ainsi à l'issue de nos travaux. Je précise que les comptes rendus des auditions qui auront eu lieu à huis clos seront au préalable transmis aux personnes entendues afin de recueillir leurs observations. Ces observations seront soumises à la commission, qui pourra décider d'en faire état dans son rapport.
Je rappelle que, conformément aux dispositions du même article, « sera punie des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal toute personne qui, dans un délai de vingt-cinq ans divulguera ou publiera une information relative aux travaux non publics d'une commission d'enquête, sauf si le rapport publié à la fin des travaux de la commission a fait état de cette information ».
Conformément aux dispositions de l'article 6 précité, je vais vous demander de prêter le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité.
Veuillez lever la main droite et dire : « Je le jure ».
M. Jean-Jacques Colombi et M. Alexandre Pichon prêtent serment.
Nous allons aborder avec vous le rôle précis de la division des relations internationales (DRI). Nous aimerions savoir quels sont ses effectifs et comment ils ont évolué au cours des dernières années.
La DRI dispose d'une section centrale de coopération opérationnelle de police (SCCOPOL) en charge de l'échange d'informations. Quels sont les principaux interlocuteurs de la DRI ? Quelle est la nature des informations échangées ? Quels sont les pays avec lesquels l'échange d'informations se fait de manière satisfaisante ou, au contraire, insatisfaisante ? Pour quelles raisons ?
Nous serions également intéressés par le fonctionnement du bureau SIRENE – acronyme de « supplément d'informations requis à l'entrée nationale des étrangers ».
Quel regard portez-vous sur le Système d'information Schengen (SIS) ? En France, qui alimente cette base de données ? Est-elle alimentée de manière satisfaisante par les autres États membres de l'Union européenne ? Faudrait-il ajouter d'autres catégories de personnes, d'objets ou encore des informations complémentaires sur les personnes et objets qui y figurent ?
Pouvez-vous présenter le traité de Prüm qui instaure un système automatisé de comparaison des profils ADN présents dans les fichiers nationaux des États membres de l'Union européenne ? En France, qui alimente cette base de données ? Quelles sont les autorités qui y ont accès ? Quel regard portez-vous sur son efficacité ?
Quel regard portez-vous sur l'efficacité d'Europol ? La coopération policière donne-t-elle des résultats satisfaisants en matière de lutte contre la criminalité organisée et contre le terrorisme ?
Quelles sont les conséquences du déclenchement du dispositif « alerte attentat » sur l'organisation de la DRI ?
À la suite de l'attaque du 7 janvier 2015, la direction centrale de la police judiciaire (DCPJ) a été chargée des actes d'enquête relatifs aux frères Kouachi. Quel rôle la DRI a-t-elle été amenée à jouer ?
À la suite des attentats du 13 novembre 2015, la direction de l'enquête a été confiée à la sous-direction anti-terroriste (SDAT) de la DCPJ. Cette décision a-t-elle eu des conséquences particulières pour l'organisation et le rôle de la DRI ?
Le 14 novembre au matin, une équipe d'Europol a rejoint les locaux de la SDAT. Êtes-vous son principal interlocuteur ? Quelle est la nature de la coopération entre la SDAT et Europol ? Quelle est la plus-value d'Europol dans la recherche des terroristes alors en fuite ?
Le 16 novembre, une équipe commune d'enquête franco-belge a été mise en place. Quel rôle la DRI joue-t-elle dans ce dispositif ? Quels résultats cette équipe commune d'enquête a-t-elle obtenus ?
Quelle est la nature des échanges entre la DRI et ses homologues européens à partir du 13 novembre au soir et dans les semaines qui suivent ? Ces échanges ont-ils permis d'obtenir des résultats concrets dans la recherche des auteurs des attentats et de leurs complices ?
La DRI a-t-elle eu des échanges avec les services de renseignement français – direction générale de la sécurité intérieure (DGSI), direction du renseignement de la préfecture de police de Paris, direction générale de la sécurité extérieure (DGSE) – à la suite des attentats du 13 novembre ? Le cas échéant, quelle en a été la nature ?
Je vais maintenant vous laisser la parole pour un exposé liminaire qui sera suivi par un échange de questions et de réponses.
M. Jean-Jacques Colombi, chef de la division des relations internationales à la direction centrale de la police judiciaire (DCPJ). Monsieur le président, après une rapide présentation de la division des relations internationales, je me consacrerai au rôle qu’elle a joué après les attentats du 7 janvier et du 13 novembre 2015 ainsi que lors des attentats ayant touché des ressortissants français à l’étranger – Ouagadougou, Grand-Bassam, Bamako. Pour compléter mon propos, je vous transmettrai un document relatif aux divers outils de coopération que mettent à la disposition des enquêteurs Interpol, Europol et les instances relevant de Schengen et du traité de Prüm en matière de lutte contre le terrorisme.
La DRI dépend du directeur central de la police judiciaire et de son adjoint ; elle est en quelque sorte une « sous-direction à l’international » sans en avoir le nom. Dirigée par un commissaire divisionnaire – ce qui est mon cas – ou par un contrôleur général – ce qui était le cas de mon prédécesseur –, elle gère les canaux de coopération avec Interpol, Europol et le Système d’information Schengen (SIS) pour l’ensemble des forces de sécurité nationales – police, gendarmerie, services douaniers – et la magistrature française. Elle est immédiatement mobilisée en cas de survenance d’un attentat majeur pour traiter les échanges avec nos partenaires étrangers.
Son organisation repose sur deux entités principales.
Il s’agit tout d’abord de la section centrale de la coopération opérationnelle de police, qui est sa salle des machines. Cette plateforme interministérielle est dirigée par un commissaire de police assisté d’un officier supérieur de la gendarmerie nationale. Elle mobilise actuellement soixante-treize personnes : quarante-six policiers, vingt-cinq gendarmes et deux douaniers. La SCCOPOL fonctionne vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept, et constitue le point d’entrée unique des demandes émises par les enquêteurs français auprès des services étrangers comme des sollicitations en provenance de l’étranger. Vous noterez que je n’ai pas parlé des services de renseignement. Nous travaillons, le cas échéant, pour la division judiciaire de la DGSI.
Il s’agit, par ailleurs, du service chargé des actions de coopération européenne et internationale (SCACEI), composé d’une dizaine d’éléments, tous policiers, placé sous la direction d’un commissaire. Il est chargé des aspects institutionnels et stratégiques du fonctionnement d’Europol et d’Interpol. Autrement dit, ce service participe à l’élaboration des orientations que nous souhaitons voir imprimer à ces deux organismes.
Depuis l’année dernière, la DRI a été chargée de la gouvernance du Système d’information Schengen de deuxième génération (SIS 2) pour notre pays.
Enfin, nous participons à l’élaboration des positions françaises relatives à l’avenir de l’échange d’informations en Europe.
En cas d’attentats, la mobilisation de la DRI se fait toujours selon le même schéma. Notre service ne procède pas à des enquêtes, il fournit un appui et une aide aux enquêteurs et aux magistrats. Je précise que l’organisation de notre plateforme nationale est marquée par une particularité : au sein de la DRI est installée une unité du bureau de l'entraide pénale internationale (BEPI) de la direction des affaires criminelles et des grâces (DACG) du ministère de la justice. Des greffiers et des greffiers en chef y sont présents en permanence pour faciliter les échanges avec les magistrats du BEPI joignables vingt-quatre heures sur vingt-quatre sur les dossiers qui nécessitent une avalisation judiciaire – mandats d’arrêt européens, observations transfrontières. Cela nous apporte un avantage notable par rapport à nos partenaires européens en termes de réactivité et de traitement des dossiers, car la prise de décision est immédiate.
Lorsque survient un attentat majeur, la DRI renforce les capacités de sa plateforme SCCOPOL, qui fonctionne vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Nous affectons deux équipes permanentes : l’une au poste de commandement (PC) de crise de la direction centrale de la police judiciaire, l’autre au PC de crise de la SDAT. Nous prenons, à notre initiative ou en lien avec les services enquêteurs, toutes les mesures à même de faciliter les échanges bilatéraux avec nos partenaires étrangers directement concernés par les investigations ainsi qu’avec les grandes organisations internationales que sont Interpol et Europol.
Le 7 janvier 2015, conformément aux dispositions du plan attentat de la DCPJ et de la note de service de la DRI du 15 septembre 2014, un commissaire de police de la DRI a rejoint le PC de la SDAT pour faciliter la prise en compte des demandes de coopération internationale. Il a ensuite été relayé par le chef d'état-major de la SCCOPOL. Pour ma part, j’ai rejoint le PC de la direction centrale, place Beauvau. Durant les jours qui ont suivi, mon adjoint ou le chef de la SCACEI ont assuré une présence permanente auprès du directeur central ou de ses adjoints. L'officier de permanence de la SCCOPOL a quant à lui rejoint le service.
Aucun personnel n'a été rappelé, mais les congés et absences ont été réduits au strict minimum, sauf nécessités personnelles impérieuses.
La SCCOPOL fonctionne déjà vingt-quatre heures sur vingt-quatre et il n'a pas été nécessaire de renforcer davantage ses équipes car la dimension internationale de l'enquête était limitée.
Le 13 novembre 2015, dès que nous avons eu connaissance des attentats, les commissaires de la DRI ont rejoint les différents PC. Un dispositif de rotation « H24/7 » a été mis en place au PC de la DCPJ et au PC de la SDAT, tandis que mon adjoint et d’autres responsables de l'état-major de la SCCOPOL sont restés au service pour assurer le fonctionnement de l’ensemble de la machinerie. Comme après le 7 janvier, les congés et absences ont été réduits au strict minimum.
Les attentats du 13 novembre avaient une dimension internationale nettement plus marquée que ceux du 7 janvier et cela a eu une incidence directe sur le nombre et la diversité des demandes de coopération internationale émanant des services enquêteurs co-saisis – SDAT, DGSI, préfecture de police.
Une cellule de suivi spéciale a en conséquence été mise en place à la SCCOPOL, composée du chef d'état-major et d'un officier de l'unité nationale d’Europol. Outre un « chrono » général des demandes et réponses, cette cellule a constitué des tableaux spécifiques pour des demandes particulières : identifications biométriques via Prüm ou Interpol, demandes d'identification d'armes à feu, demandes particulières telles celles portant sur les migrants de l’île grecque de Leros.
La DRI a par ailleurs rapidement proposé aux services enquêteurs de demander l'appui d'Europol et d'Interpol. Les deux organisations n'ont pas été sollicitées pour les mêmes services, chacune offrant des outils spécifiques.
Europol a été mobilisée principalement pour ses capacités en matière d'analyse criminelle et d'échanges d'informations. Le bureau de liaison français d’Europol – qui relève fonctionnellement de mon autorité – a mis en place dès le 13 novembre un dispositif de rotation H24/7 et a pris part aux briefings quotidiens organisés avec les autres bureaux de liaison nationaux et les représentants de l'agence.
Dès le 15 novembre, l'agence a dépêché au PC de la SDAT, à la demande de la DRI, un bureau mobile composé d’analystes ayant un accès distant aux bases de données de l'agence. J’ai insisté pour que cette équipe soit dirigée par un fonctionnaire de police français, que nous connaissons personnellement, issu lui-même de la police judiciaire.
Le choix a rapidement été fait de transmettre de très nombreuses données recueillies dans le cadre de l'enquête à Europol, en vue de leur exploitation par ses analystes. Je me suis rendu à La Haye le 23 novembre pour m'assurer du plein soutien du directeur d'Europol, Rob Wainwright, et pour mieux définir les modalités de ce soutien apporté à l'enquête.
Compte tenu du volume des données fournies et de l'importance du dossier, l'agence a mis en place le 1er décembre une task force dédiée composée d'une quinzaine d'analystes baptisée « Fraternité ». Comprenant plusieurs Français, elle est co-dirigée par un commissaire de police français ayant le statut d'expert national détaché auprès de l'agence, conformément à une revendication que nous avions formulée auprès du directeur d’Europol qui y a très rapidement accédé. Cette task force avait besoin de compter dans ses rangs des francophones et des spécialistes connaissant la procédure pénale française et belge, et nécessitait des effectifs resserrés au plus près de l’enquête.
Le 16 décembre 2015, l'agence a été formellement associée à l'équipe commune d'enquête franco-belge mise en place le 16 novembre. Pourquoi ce délai d’un mois ? Parce que, comme vous le savez, l’équipe commune d’enquête est un dispositif de coopération judiciaire, et il a fallu que les magistrats français et belges saisis du dossier s’accordent sur les modalités de sa participation. Un avenant a permis qu’elle jouisse d’un accès total à l’ensemble des données. Eurojust a été également associé à cette équipe.
Au 12 mars 2016, 2,7 tétraoctets de données issues des enquêtes française et belge ont été communiquées dans ce cadre, parmi lesquelles 9 millions de communications téléphoniques et 614 000 fichiers informatiques, dont 330 000 fichiers média comprenant des photos ou des vidéos. À cette même date, l'agence avait organisé dans le cadre de l'enquête cinq réunions opérationnelles et produit trente et un rapports, dont quatorze rapports d'analyse opérationnelle.
Ce très fort investissement de l'agence a coïncidé avec la création en janvier 2016 du Centre européen de lutte contre le terrorisme – European Counter-Terrorism Centre –, nouvelle structure unissant les divers outils d'Europol dédiés à cette thématique. Ce centre accueille notamment l'équipe de liaison conjointe anti-terroriste – Counter-Terrorism Joint Liaison Team –, au sein de laquelle la France, avec l’aide de la DRI, a délégué un policier spécialisé dans la lutte contre le terrorisme, qui a été affecté en urgence dès le 4 janvier 2016 au bureau de liaison français à La Haye.
Interpol a de son côté été sollicité pour ses compétences en matière d'identification des victimes de catastrophes.
Le secrétariat général de l'organisation, basé à Lyon, a dépêché du 16 au 22 novembre à Paris une cellule de crise de cinq experts au sein de la cellule « ante mortem » de l’unité nationale d'identification des victimes de catastrophes – UNIVC – mise en place par la sous-direction de la police technique et scientifique de la DCPJ. Ces experts se sont chargés du recueil de renseignements auprès des pays membres, concernant une trentaine de dossiers de victimes décédées de nationalité étrangère ou de double nationalité et une quinzaine de personnes disparues. Un officier de la DRI était présent auprès d'eux afin de faciliter leur action.
Indépendamment de ces services spécifiques, les messageries sécurisées des deux organisations ont été mises à contribution pour des demandes de coopération avec nos partenaires. Par réseau d'échange sécurisé d'informations d’Europol – dit SIENA pour Secure Information Exchange Net Application –, 996 messages ont été échangés dans le cadre de l'enquête, ce qui est considérable par rapport aux flux habituels – pour un important dossier relevant du droit commun, on parvient à une dizaine voire une centaine d’échanges – ; ils ont concerné des demandes de coopération, des vérifications, des informations financières TFTP/ICE, des demandes d'identification biométriques. Par le canal 1-24/7 d'Interpol ont été échangés 1641 messages portant sur des émissions de notices, des demandes de coopération ou d'identification biométrique.
De nombreux échanges ont par ailleurs eu lieu par le canal SIRENE afin de traiter les « hits » liés aux signalements d'individus ou d'objets par les services anti-terroristes français et européens.
Enfin, avec l'aval du directeur central et dans le respect du secret de l'enquête, mon adjoint et moi-même avons diffusé des messages d'information relatifs aux faits et aux principales évolutions de l’enquête à nos partenaires étrangers – les vingt-huit pays membres de l’Union et les treize États ou organisations internationales associés à Europol et les cent quatre-vingt-dix États membres d’Interpol.
Nous avons par ailleurs réuni à plusieurs reprises les attachés de sécurité intérieure étrangers des pays les plus concernés – Royaume-Uni, Pays-Bas, Italie, Espagne – afin de les tenir informés et de solliciter leur appui sur des points particuliers.
Divers contacts téléphoniques informels ont également eu lieu avec des chefs de police étrangers ainsi qu'avec le directeur d'Europol et le secrétaire général d'Interpol.
À ma demande, une réunion d'information plus formelle a été organisée le 23 novembre au siège d’Europol en présence des chefs de bureau de liaison et des représentants de l'agence afin de faire un point de situation et d'expliquer l'importance de certaines demandes. L’une d’elles portait sur les migrants de Leros : l’enquête ayant montré que deux des terroristes du Stade de France avaient sans doute gagné l’Union européenne en transitant par cette île grecque, il était nécessaire de localiser les cent-quatre-vingt-seize autres passagers de l’embarcation qu’ils avaient empruntée et de déterminer si d’autres terroristes avaient gagné l’Europe par le même moyen.
En outre, le 1er décembre 2015, j’ai fait un point de situation devant le conseil d'administration d'Europol et plus récemment, lors de la dernière conférence des chefs des bureaux centraux nationaux d’Interpol qui s’est tenue à Lyon du 26 au 28 avril, j’ai effectué une présentation.
Cette communication, plus rapide, plus régulière et plus complète qu'après les attentats de janvier, a été appréciée par nos partenaires.
La DRI est également mobilisée après la commission d'attentats à l'étranger, lorsque la présence de victimes françaises donne lieu à l'ouverture d'une enquête judiciaire nationale. Le déplacement des enquêteurs de la SDAT ou de la police technique scientifique fait l'objet de messages Interpol adressés au pays concerné. Lorsque la situation l'exige, comme ce fut le cas après les attentats de Ouagadougou le 15 janvier dernier, un responsable de la DRI conduit une mission sur place.
M. le président Georges Fenech. Je vous remercie pour votre présentation, qui montre bien comment fonctionne la coopération à l’échelon européen et international. Nous voyons que la DRI est en mesure d’avoir un œil sur tout cela.
Notre commission aimerait avoir des précisions sur le Système d’information Schengen, parfois décrié, dont le bureau SIRENE gère les données.
M. Jean-Jacques Colombi. Le bureau SIRENE gère ce que nous appelons les « post-hits ». Le SIS repose sur une diffusion internationale d’informations relatives à des individus ou des objets. Celles-ci sont d’abord diffusées au plan national puis reprises sous certaines conditions dans le SIS. Lorsqu’un individu signalé pour être localisé, surveillé ou interpellé, ou lorsqu’un objet signalé pour être saisi fait l’objet d’un contrôle positif – ce que nous appelons un « hit » –, l’information est transmise dans chacun des États au bureau SIRENE.
Le Système d’information Schengen est en effet largement décrié. C’est pourtant l’outil de la coopération internationale qui fonctionne le mieux, c’est même la Rolls Royce de la coopération internationale. Il est utilisé quotidiennement par tous les policiers et tous les gendarmes d’Europe, parfois sans qu’ils le sachent. Lorsque, à Châteauroux ou à Potsdam, un policier contrôle un individu ou un véhicule et lance une recherche dans la base de données nationale pour savoir si l’individu ou le véhicule est signalé pour être localisé ou surveillé, il utilise le SIS sans le savoir. Si cet individu ou ce véhicule fait l’objet d’une signalisation de la part de l’un des pays partenaires, le policier répond alors aux prescriptions qui apparaissent sur son téléscripteur informatique et qui consistent à contacter le bureau SIRENE de son pays. Le bureau SIRENE, une fois contacté, lui indique alors une conduite à tenir, toujours très simple : « interpeller », si l’individu fait l’objet d’un mandat d’arrêt européen, « conduire devant la magistrature », « saisir », « surveiller discrètement », « effectuer un contrôle spécifique ».
M. Sébastien Pietrasanta, rapporteur. Nous aimerions avoir des précisions sur le fonctionnement du bureau SIRENE.
Le 14 novembre 2015, les gendarmes contrôlent Salah Abdeslam à 9 heures 30. Ils interrogent alors le bureau SIRENE qui répond qu’aucune information ne le concerne et qu’il peut repartir. Quelques dizaines de minutes après – on ne connaît pas le délai exact –, le bureau SIRENE les rappelle pour leur demander de l’interpeller mais il est déjà reparti. Les gendarmes nourrissaient pourtant des suspicions fortes à son égard car, en dehors de toute procédure habituelle, ils ont tenté de le garder le plus longtemps possible.
Quel était le degré d’information du bureau SIRENE ? Qu’est-ce qui aurait pu permettre d’interpeller Salah Abdeslam ?
M. Jean-Jacques Colombi. En l’occurrence, le Système d’information Schengen a bien fonctionné, même très bien. Comme tout le monde, je ne peux que regretter que Salah Abdeslam ait pu rejoindre le territoire belge alors qu’il a été contrôlé en France. La question que vous me posez, vous l’imaginez bien, m’a déjà été adressée. Nous disposons d’une note spécifiquement consacrée au contrôle d’Hordain.
Le 14 novembre, un peu après 9 heures du matin, le peloton de gendarmerie de Cambrai contrôle dans le sens France-Belgique au péage autoroutier d’Hordain une Volkswagen Golf immatriculée en Belgique à bord de laquelle se trouvent Hamza Attou, Mohamed Amri et Salah Abdeslam. La consultation du fichier des personnes recherchées en France par le peloton autoroutier fait apparaître que Salah Abdeslam fait l’objet d’un signalement dans le SIS et que la conduite à tenir est de « recueillir discrètement toutes informations utiles et contacter le bureau SIRENE ». L’un des gendarmes contacte donc le bureau pour obtenir davantage de précisions. Nous lui confirmons l’existence d’un signalement valide dans le SIS émis par la Belgique le 9 février 2015 au titre de l’article 36-2 de la décision 2007/533 du Conseil, lequel autorise le signalement « pour la répression d'infractions pénales et pour la prévention de menaces pour la sécurité publique », donc pour des infractions de droit commun, l’article 36-3 autorisant, lui, les signalements quand la sûreté de l’État est menacée.
M. le rapporteur. Cette précision est intéressante. Quand, en février 2015, la Belgique a procédé à l’inscription dans le SIS de Salah Abdeslam, c’est donc pour des raisons liées au droit commun et non à sa radicalisation. Or, d’après ce que j’ai compris lorsque je me suis rendu en Belgique et en lisant la presse – car il y a eu beaucoup de fuites, malheureusement –, Salah Abdeslam avait déjà été repéré comme radical.
M. Alexandre Pichon, adjoint au chef de la division des relations internationales. L’article 36-2 ne couvre pas spécifiquement les infractions de droit commun. Les articles 36-2 et 36-3 peuvent concerner des faits relevant du terrorisme comme des faits n’en relevant pas. Ce qui distingue les deux articles, c’est la nature de l’autorité qui procède au signalement. Les signalements effectués dans le cadre de l’article 36-2 étant liés à la répression des infractions pénales, ils sont généralement issus des services d’enquête criminelle, donc de la police judiciaire. Ceux qui sont effectués dans le cadre de l’article 36-3, en cas de menace de la sûreté de l’État sont généralement issus des services de renseignement, de la DGSI par exemple.
Je ne sais quel service a émis le signalement en Belgique mais quand nous avons demandé le motif, nos homologues belges nous ont précisé qu’il s’agissait de l’islam radical et non d’un motif de droit commun. Le service à l’origine de l’information doit sans doute être un service de police judiciaire.
M. le rapporteur. Comment avoir la certitude que le motif du signalement n’a pas été modifié ? Il est facile de réécrire l’histoire après-coup.
M. Jean-Jacques Colombi. Je reprends la chronologie. Nous précisons au gendarme que les Belges demandant un contrôle discret, le peloton doit poursuivre le contrôle, rappeler pour nous donner une description du véhicule, sa plaque d’immatriculation, l’identité des occupants – si possible, une copie des documents d’identité –, la provenance et la destination des passagers et le motif de leur déplacement.
À 9 heures 40, l’un des gendarmes rappelle le bureau SIRENE et communique les informations demandées, à l’exception des copies des pièces d’identité qui ne nous parviendront que plus tard dans la matinée en raison de difficultés liées à la transmission des images par voie électronique.
À 9 heures 44, l’opérateur du bureau SIRENE de Paris transmet au bureau SIRENE de Belgique le formulaire habituel de découverte, dit « formule G », accompagné d’une demande de précision quant au motif du signalement, en précisant que les copies des documents d’identité seraient transmises dès réception.
Vers 10 heures 45, le bureau SIRENE de Belgique rappelle le bureau SIRENE de France et l’informe que Salah Abdeslam était d’après leurs services un individu radicalisé, candidat au djihad en Syrie.
M. le rapporteur. Voici des informations extrêmement importantes. Il a fallu attendre une heure pour que le bureau SIRENE de Belgique opère un rapprochement entre les attentats du 13 novembre et un individu se rendant en Belgique identifié comme islamiste radical dans le SIS. Ce délai vous paraît-il raisonnable ? Je cherche à comprendre et non à accabler, je tiens à le préciser.
M. Jean-Jacques Colombi. Les bureaux SIRENE fonctionnent par envoi de formulaires. C’est après avoir reçu le formulaire transmis par le bureau SIRENE de France que le bureau SIRENE de Belgique a pris les dispositions qu’il avait à prendre. J’imagine qu’il est entré en contact avec le service d’enquêteurs belge à l’origine du signalement. Mais je n’ai aucune assurance à cet égard : je ne dirige pas le bureau SIRENE de Belgique et je ne sais pas du tout quelles vérifications ont été opérées en Belgique. Ce qui est certain, c’est que le nombre d’individus surveillés dans le SIS est très élevé et que les contrôles discrets ou spécifiques font l’objet d’une remontée qui prend un certain laps de temps.
M. le rapporteur. Dans la nuit du 13 au 14 novembre, combien d’informations issues du SIS vous ont été transmises ? Combien ont concerné des signalements pour islam radical ?
M. Jean-Jacques Colombi. Je ne sais pas. Je pourrai vous fournir ces données ultérieurement.
M. le rapporteur. Quelle est la proportion de ces « hits » ? Quelques dizaines ? Quelques centaines ?
M. Jean-Jacques Colombi. Non, je pense que le chiffre est peu élevé.
M. le rapporteur. Je ne veux pas faire de politique-fiction, mais je voudrais comprendre le déroulement des événements.
Au lendemain du 13 novembre, si la situation avait été inversée et que le bureau SIRENE de Belgique avait contacté le bureau SIRENE de France, combien de temps auriez-vous mis pour obtenir l’information auprès du service à l’origine du signalement ? Quel est le délai normal ?
M. Jean-Jacques Colombi. Cela dépend.
M. le rapporteur. Qu’en est-il en situation de crise ?
J’imagine que, dans la nuit du 13 au 14 novembre, vous-même, monsieur Colombi, et vos personnels avez eu à contacter les services prescripteurs. Combien de temps cela a-t-il pris pour avoir un retour ?
J’aimerais savoir s’il y a eu un dysfonctionnement du côté belge ou s’il s’agit d’un fonctionnement habituel.
M. Jean-Jacques Colombi. Honnêtement, monsieur le rapporteur, je suis incapable de dire s’il y a eu ou non dysfonctionnement du côté belge. Et je ne suis pas là pour exonérer qui que ce soit.
Les délais sont variables selon les cas. Lorsque vous contactez un service d’enquête pour obtenir des précisions sur une fiche qu’il a émise, la réponse peut être très rapide. Cela peut supposer, quelquefois, de se rapprocher du chef d’unité ou du chef de service en charge du dossier.
Sur le moment, ce délai d’une heure ne m’a pas semblé exagéré, même si j’aurais préféré, bien sûr, qu’ils répondent dans les cinq minutes.
M. le rapporteur. Au niveau du bureau SIRENE de France, pouvez-vous avoir connaissance en consultant le fichier SIS des catégories qui ont motivé le signalement : droit commun, terrorisme, etc. ? Pouviez-vous savoir, en consultant son signalement, que Salah Abdeslam était lié à l’islam radical ? Si ce n’est pas le cas, ne serait-il pas nécessaire de créer une catégorie spécifique pour l’islam radical ou le terrorisme ?
M. Alexandre Pichon. La présidence néerlandaise de l’Union travaille à cette idée avec les autres États. En France, nous n’y sommes pas trop favorables.
M. le rapporteur. Pour quelle raison ?
M. Alexandre Pichon. Créer une nouvelle catégorie n’a de sens que si elle est associée à une conduite particulière à tenir. Or, pour le terrorisme, trois conduites différentes sont possibles : interpeller si l’on dispose d’un mandat d’arrêt, effectuer un contrôle discret, ou opérer un contrôle plus approfondi, comprenant par exemple des fouilles de bagages. C’est ce à quoi aboutissent les divers signalements : dans le cadre de l’article 26 pour le mandat d’arrêt européen ; dans le cadre de l’article 36 pour le contrôle discret ou le contrôle spécifique. Il me semble plus pertinent d’introduire la catégorie d’infraction par signalement, ce qui est envisagé. Elle sera visible au moins pour les bureaux SIRENE. Il sera alors possible de dire qu’il s’agit d’un signalement pour terrorisme relevant de l’article 36.
M. le rapporteur. Ne peut-on imaginer, dans les heures suivant un attentat, lorsque l’on traque leurs auteurs, un mécanisme de dérogation autorisant une autre conduite à tenir, comme la retenue ou l’interpellation, même si la loi relative à la lutte contre le crime organisé permettra déjà une retenue de quatre heures ?
M. Alexandre Pichon. Il faudrait revoir chacun des fichiers de personnes recherchées des vingt-neuf États raccordés au SIS pour déclencher un nouveau mode de conduite à tenir. Cela concernerait 66 000 personnes inscrites au SIS II au titre de l’article 36-2 et un peu plus de 8 000 personnes au titre de l’article 36-3. Beaucoup de personnes seraient donc susceptibles d’être retenues, dans des conditions qui restent à définir. Il n’existe aucune base légale européenne qui permettrait de retenir une personne de la sorte. Aujourd’hui, les seules bases de coercition sont le mandat d’arrêt européen et les mesures de protection des mineurs ou des majeurs protégés.
Pour revenir au contrôle du 14 novembre, même si nous avions su que le signalement de Salah Abdeslam était lié au terrorisme ou à l’islam radical, nous n’aurions pas pu l’interpeller car il aurait fallu un mandat d’arrêt européen, lequel n’a été émis que le 15 novembre. La seule conduite à tenir possible aurait été de faire durer le contrôle.
M. le rapporteur. La France aurait-elle pu disposer de l’information concernant la radicalisation de Salah Abdeslam ?
M. Alexandre Pichon. Nous aurions pu l’obtenir si le signalement avait été effectué dans le cadre de l’article 36-3 car au moment de l’inscription, les États doivent envoyer aux autres bureaux SIRENE un formulaire M. En ce cas, l’accès à l’information aurait été plus rapide.
M. le rapporteur. Il n’y avait donc pas d’autre moyen d’avoir connaissance de cette information que de passer par le bureau SIRENE de Belgique ?
M. Jean-Jacques Colombi. Je pense même que l’opérateur du bureau SIRENE de France a rappelé le bureau SIRENE de Belgique pour lui demander des précisions, compte tenu du contexte. Il faut quand même avoir à l’esprit que toutes ces fiches de signalement intégrées dans le SIS par les services de police judiciaire ou les services de renseignement visent à relocaliser des individus dont il n’est pas possible de surveiller les allées et venues quotidiennement. Tout ceci doit se faire, bien évidemment, dans un souci de confidentialité. L’échange d’informations n’est pas total.
Comme le soulignait Alexandre Pichon, si le signalement avait été fait dans le cadre non de l’article 36-2 mais de l’article 36-3, l’opérateur du bureau français aurait peut-être pu avancer.
M. le président Georges Fenech. Que disent les Belges à ce sujet ?
M. Jean-Jacques Colombi. Les Belges nous ont indiqué qu’il s’agissait d’un individu radicalisé, puis, nous n’avons plus eu d’informations jusqu’au lendemain, 15 novembre, date à laquelle la Belgique a délivré un mandat d’arrêt contre Salah Abdeslam.
Cela étant, monsieur le président, il faut tout de même garder à l’esprit que c’est le contrôle d’Hordain qui a permis l’identification des deux individus venus récupérer Abdeslam et qui a conduit à établir avec certitude qu’il revenait de Paris.
M. le président Georges Fenech. Voyons le verre à moitié vide, maintenant : si Salah Abdeslam avait été interpellé, la fusillade de Forest n’aurait pas eu lieu, non plus que les attentats de Bruxelles qui ont fait plus de trente morts.
M. Jean-Jacques Colombi. Je suis d’accord avec vous.
M. le président Georges Fenech. Quelle est la réponse des Belges ?
M. Jean-Jacques Colombi. Je ne la connais pas, monsieur le président.
M. le président Georges Fenech. Il n’y a pas eu de retour d’expérience entre vous et les Belges ?
M. Jean-Jacques Colombi. Dans le cadre de l’équipe commune d’enquête, beaucoup d’éléments sont traités au niveau judiciaire. Des relations bilatérales très étroites lient les magistrats d’abord et les services d’enquête qui travaillent pour leur compte. La DRI transmet ce qu’elle a à transmettre mais ces questions sont traitées par d’autres que nous. Certains de mes collègues que vous allez entendre ultérieurement seront peut-être davantage en mesure de vous apporter cette réponse.
M. Alexandre Pichon. Il faut préciser que le signalement de Salah Abdeslam est intervenu juste avant l’introduction dans le SIS, en mars 2015, d’une nouveauté qui consiste à associer aux signalements effectués dans le cadre de l’article 36-2 ou de l’article 36-3 une conduite supplémentaire à tenir, dite « action immédiate » – immediate reporting –, lorsqu’il s’agit de combattants étrangers. C’est l’aboutissement d’une réflexion destinée à améliorer la prise en compte spécifique des combattants étrangers partant pour la Syrie ou l’Irak. La conduite à tenir « action immédiate » est désormais interprétée par les différents bureaux SIRENE comme un code lié aux combattants étrangers. Il est probable que, si le signalement d’Abdeslam avait été effectué un mois plus tard, il aurait comporté cette mention.
Nous savons qu’après les attentats de novembre 2015, la Belgique a été incitée à procéder à davantage de signalements, notamment des signalements de combattants étrangers, et à recourir à l’article 36-3 plutôt qu’à l’article 36-2. La France, pour sa part, promeut depuis longtemps le recours à l’article 36, que nous avons toujours davantage utilisé que les autres pays européens.
M. le président Georges Fenech. Où se situe l’unité de coopération policière internationale Schengen, l’UCCPI ?
M. Alexandre Pichon. Elle n’existe plus que sous forme de mention dans l’article D8-2 du code de procédure pénale, qui va bientôt être modifié. Les échanges d’informations entre États membres ne s’effectuent plus sur la base des accords de Schengen mais sur celle de la décision-cadre de 2006, dite « initiative suédoise », qui en a repris les dispositions. L’UCCPI a donc laissé place à un point de contact national qui est la SCCOPOL pour la France. Ce sont l’unité nationale d’Europol et le bureau central national d’Interpol qui assurent les échanges bilatéraux avec les autres États membres de l’Union européenne. Cela revient au même, simplement la base légale a changé.
Pour ce qui est du SIS, il existe deux organes de gouvernance en France : l’Office national SIS 2, dont la responsabilité nous a été confiée en 2015, s’occupe de la partie nationale du SIS – la partie informatique qui concerne l’alimentation et la consultation automatisée ; d’autre part, le bureau SIRENE gère les échanges d’informations liés aux « hits » à travers une application dédiée. Toute la gouvernance des applications informatiques concernant le SIS est donc concentrée depuis février 2015 à la DCPJ. Pour ce qui concerne l’office national SIS 2, elle travaille avec une myriade de services et d’administrations du ministère de l’intérieur, du ministère des affaires étrangères car elle doit être en contact avec tous les services qui alimentent ou interrogent le SIS.
M. le président Georges Fenech. Le profil ADN d’Abdelhamid Abaaoud a-t-il figuré dans les outils liés au traité Prüm ?
M. Jean-Jacques Colombi. Vous voulez savoir si l’empreinte ADN d’Abaaoud était répertoriée dans l’un des fichiers nationaux des États signataires du traité de Prüm, c’est bien cela ?
M. le président Georges Fenech. Effectivement.
M. Jean-Jacques Colombi. Je ne me le rappelle pas, mais c’est une information facile à vérifier.
M. le rapporteur. Lors de l’assaut de Verviers, Abaaoud était localisé en Grèce. Il était entendu que les services belges devaient agir en coordination avec les services grecs. Or l’intervention à Verviers a été lancée sans que les Grecs en soient informés, et Abaaoud a pu s’échapper.
Cela m’amène à vous demander votre sentiment sur la coordination européenne en matière de lutte contre le terrorisme.
M. le président Georges Fenech. Lors de notre récent voyage en Grèce, nous avons pu constater le mécontentement des Grecs après cet épisode.
M. Jean-Jacques Colombi. Je ne dispose pas d’éléments particuliers sur l’épisode de Verviers. Visiblement, la commission en sait plus que moi.
Il est difficile de mettre en place une véritable coopération européenne. En ce domaine, la coopération est plus facile au plan bilatéral, même si elle n’est pas toujours simple. Pour qu’elle fonctionne, il faut que chaque pays accepte de sortir de sa culture propre, de définir des objectifs communs clairs, de déterminer le niveau décisionnel adapté et de se tenir ensuite à ce qui a été décidé.
M. le président Georges Fenech. Comment se fait-il qu’Abaaoud ait pu circuler avec une facilité déconcertante à plusieurs reprises dans l’espace Schengen, alors qu’il faisait l’objet de multiples signalements ?
M. Jean-Jacques Colombi. Je vais être prudent, monsieur le président, car, demain, les voyages d’Abaaoud au sein de l’Union européenne seront peut-être reconstitués et je suis donc susceptible d’être démenti.
L’espace Schengen, c’est une évidence, a été constitué par un renforcement des frontières extérieures. Le principal outil compensatoire qui a été envisagé, c’est le SIS. Aujourd’hui, le système souffre d’une faiblesse principale : le report des contrôles sur les frontières extérieures a écarté l’attention de la nécessité de mettre en place des contrôles à l’intérieur de l’espace Schengen. Cette même problématique se rencontre lorsqu’il est question de mise en place de l’outil PNR – Passenger Name Record : l’ensemble de la DCPJ et la DRI en particulier ont beaucoup insisté pour que les vols intracommunautaires soient intégrés. Une fois dans l’Union, il est très facile pour une personne de s’y déplacer – c’est une faculté dont nous profitons tous. Il faudra réfléchir aux manières d’exercer des contrôles à l’intérieur des États de l’Union.
M. le président Georges Fenech. Les chiffres sont impressionnants. La frontière électronique dématérialisée est mise en œuvre à partir de 500 000 terminaux d’interrogation dans les vingt-huit États. Le SIS représente 36,5 millions de signalements, dont 1,204 million porte sur des personnes recherchées.
M. Alexandre Pichon. Nous n’avons pas les mêmes données. Aujourd’hui, le SIS compte près de 65 millions de signalements : le système atteint donc presque ses limites, puisque sa capacité maximale est de 70 millions. Elle sera portée à 100 millions à la fin de l’année. Ces fiches concernent 800 000 personnes signalées, recherchées ou à surveiller. Elles concernent en très grande majorité des documents perdus ou volés (49,1 millions) et dans une moindre mesure d’autres objets, dont 3,5 millions de véhicules et près de 500 000 armes à feu.
En 2015, le nombre de consultations se sont élevées à près de 3 milliards sur l’ensemble des vingt-neuf pays connectés au système, l’augmentation étant liée au raccordement du Royaume-Uni. Il s’agit de consultations manuelles, opérées dans les aubettes des aéroports ou effectuées à l’occasion de contrôles de police, ou bien automatiques, par interrogation d’un fichier à l’autre. Je citerai le réseau mondial Visas qui interroge une catégorie particulière de données – les décisions d’interdiction du territoire Schengen – pour l’examen des demandes de visa, les préfectures qui lancent des recherches à propos des véhicules ou les interdictions d’entrée sur le territoire, ou encore les lecteurs automatisés de plaques d’immatriculation (LAPI), qui vérifient si tel ou tel véhicule est signalé comme volé dans le SIS. Pour la France, le total des consultations a atteint 555 millions en 2015, ce qui fait de notre pays le premier en matière de consultations.
M. Jean-Jacques Colombi. Ajoutons qu’Abaaoud a peut-être été contrôlé sans que nous le sachions, ou sous une autre identité. L’une des limites du système actuel, c’est qu’il n’intègre pas de données biométriques.
M. le président Georges Fenech. Pourriez-vous nous indiquer le nombre de personnes interpellées grâce au fichier SIS en 2015 ?
M. Alexandre Pichon. Je ne dispose pas de chiffres pour l’ensemble des pays connectés mais pour la France, les mandats d’arrêt européens, seuls à pouvoir justifier une interpellation, permettent chaque année d’interpeller à l’étranger 750 personnes signalées par la France, et en France, 450 personnes faisant l’objet d’un signalement étranger.
M. le rapporteur. Et quelle est la proportion pour le terrorisme ?
M. Alexandre Pichon. Je ne peux pas vous le dire, car les statistiques sont établies par type de signalement et non par catégorie d’infraction.
M. le rapporteur. Et combien relèvent de l’article 36-3 ?
M. Alexandre Pichon. Cet article concerne les contrôles et non pas les interpellations.
M. Jean-Jacques Colombi. Je peux également vous fournir les chiffres concernant les « hits » positifs en France.
S’agissant des signalements étrangers effectués par la France dans le SIS 2, les chiffres s’élèvent à 7 546 en 2014, dont 5 389 personnes, et à 11 412 en 2015, dont 8 228 personnes.
S’agissant de l’ensemble des pays connectés au système, le nombre de « hits » positifs » était de 129 136 en 2014, dont 88 961 personnes, et de 156 447 en 2015, dont 116 994 personnes.
M. le président Georges Fenech. Lorsque l’on vous écoute, on est frappé par l’étroite coopération qui lie les pays européens : qu’il s’agisse de la SCCOPOL, de la task force « Fraternité », des équipes communes d’enquête ou des analyses d’Europol. Malgré cela, l’idée répandue selon laquelle l’Europe est une passoire continue de prévaloir.
M. Jean-Jacques Colombi. Les attentats du 13 novembre ont créé un choc et un bouleversement, y compris dans l’appréhension de la coopération internationale.
J’ai exercé tout au long de ma carrière dans des services de police judiciaire et centraux comportant une dimension internationale. Pendant longtemps, la coopération internationale, sans être accessoire, était optionnelle. Aujourd’hui, un changement de paradigme s’est produit : un enquêteur ne peut envisager son travail autrement que dans un espace européen.
Il existe un certain nombre d’outils que les enquêteurs doivent s’approprier. C’est un processus qui a débuté il n’y a pas très longtemps et qui avance à grands pas. La survenance de faits gravissimes comme ceux que nous avons vécus a accéléré cette évolution.
L’équipe commune d’enquête constitue le nec plus ultra de la coopération internationale. L’utilisation des outils d’Europol progresse beaucoup, mais elle n’a pas été sans mal, en particulier dans notre pays. La coopération internationale repose purement et simplement sur l’échange d’informations, et les enquêteurs, dans presque tous les pays européens – davantage dans les pays méditerranéens que dans les pays nordiques, il faut le dire –, ont une culture très ancrée de la possession d’informations. C’est un travail de tous les jours que nous menons avec mes camarades pour leur faire comprendre qu’utiliser les services d’Europol ne leur retire rien, bien au contraire, et que le concept de propriété de l’information n’est pas remis en cause dans ce cadre.
Je vous ai indiqué dans ma présentation que nous avions confié l’ensemble de nos données à Europol, qui a créé la task force « Fraternité ». Il faut souligner que c’est la première fois en Europe qu’un État membre confronté à un tel drame décide de se défaire du pan de l’enquête relevant de l’analyse criminelle pour le confier à Europol. C’est naturellement Mireille Ballestrazzi, la directrice centrale de la police judiciaire, qui a pris cette décision, en suivant immédiatement la voie que nous avions choisie. C’est moi qui ai contacté le directeur de la police judiciaire belge pour le convaincre que la coopération entre nos deux États n’aurait de sens que si lui aussi confiait ses données. Et c’est ce qu’il a fait immédiatement. Pour Europol, la task force « Fraternité » constitue un test, car elle a toujours demandé que les États lui confient les analyses criminelles en cas d’affaires importantes, comme ses responsables l’ont fait savoir au sein du conseil d’administration, où je conduis la délégation française depuis que j’occupe ces fonctions. La justice et la police françaises viennent de lui donner la possibilité de démontrer le bien-fondé de sa création et la plus-value qu’elle peut apporter aux enquêtes. Et je suis certain que tout cela va fonctionner.
M. le président Georges Fenech. Peut-on imaginer une pérennisation de la task force en matière de terrorisme européen et international ? Vous savez que la question d’un parquet européen a déjà été soulevée : certains y sont favorables mais cela soulève un problème de souveraineté nationale. Pourrait-on s’orienter vers une compétence supplémentaire sans défaire le parquet de Paris de ses compétences s’agissant des attentats commis à Paris ?
M. Jean-Jacques Colombi. Je suis trop vieux pour voir un jour cette évolution se concrétiser, mais je pense que c’est le sens de l’histoire.
Lorsque j’ai commencé ma carrière à l’international il y a près de quarante ans, personne n’imaginait que nous pourrions confier nos données à un organisme international. Europol est un outil, un outil qui nous appartient. Cette agence a la possibilité de mener des actions que nous ne sommes pas en mesure d’effectuer parce qu’elle dispose de moyens que nous n’avons pas. Elle est par exemple la seule organisation en charge de police criminelle capable d’analyser du big data – je ne parle pas des services de renseignement.
Je suis certain qu’un parquet européen remplissant des fonctions de coordination verra le jour. Sans doute des personnels d’Europol participeront-ils à des enquêtes sur les sols nationaux au-delà du simple envoi d’analystes. Mais vous avez raison de souligner que ce sera un processus long parce que les capacités en matière de police criminelle dans les différents États membres ne sont pas les mêmes pour des raisons historiques : tous n’ont pas l’expérience du terrorisme. Il sera difficile dans un délai bref de voir le parquet de Paris se défaire de sa compétence au profit d’un parquet supranational qui aurait à sa tête un responsable venant d’un pays ayant eu la chance de ne pas avoir été touché au cours du siècle dernier.
M. le rapporteur. Lors de notre voyage en Grèce la semaine dernière, nous avons constaté qu’Europol n’est intervenu en matière de flux de migrants qu’en décembre 2015, très tardivement donc. Qu’en pensez-vous ?
M. le président Georges Fenech. Et, aujourd’hui, une personne seulement au sein de l’agence en est chargée.
M. Jean-Jacques Colombi. Ce sujet sera traité au conseil d’administration d’Europol la semaine prochaine. L’agence sollicite les États membres pour définir un nouveau modèle de fonctionnaires de police mis à disposition : le guest officer. Cela consisterait pour les États membres à « prêter » des spécialistes du trafic de migrants pour permettre à Europol de remédier aux difficultés qu’elle éprouve à prendre en compte ce phénomène. Il faut savoir que l’intromission de l’agence dans la crise des migrants s’est faite à partir d’une incitation politique des États, dont la France. Rob Wainwright, son directeur, a eu quelques doutes, dont il s’est ouvert à moi, car il considérait que cette action relevait davantage du mandat de Frontex. En réalité, il y a un trou dans le dispositif : Frontex a compétence pour traiter du problème migratoire aux frontières extérieures, mais ne couvre pas les mouvements de migrants à l’intérieur de l’Union. Souvenons-nous de la controverse germano-danoise : les Danois avaient fortement reproché aux Allemands de ne pas les avoir avisés de l’arrivée massive de plusieurs milliers de migrants par le Schleswig-Holstein, arrivée qui les avait contraints à fermer les autoroutes et à couper les lignes ferroviaires durant un week-end.
Née d’une unité de lutte contre le trafic de stupéfiants, Europol a vu son mandat s’élargir jusqu’à embrasser tous les champs de la criminalité. Elle est dotée de moyens importants – 100 millions d’euros de budget – car l’Union européenne n’est pas avare : chaque fois qu’elle se voit confier une nouvelle mission, son budget est abondé. Toutefois, elle se heurte à une difficulté : elle doit en quelque sorte être spécialiste de tous les domaines. À l’origine, l’agence était composée avant tout d’analystes criminels, car les États membres voulaient qu’elle s’attache essentiellement à l’analyse criminelle, pour des raisons de propriété de l’information que j’évoquais tout à l’heure. Maintenant, elle a besoin de spécialistes dans tous les champs thématiques. Elle fait appel aux États membres qui, confrontés à une pression criminelle forte, ont des difficultés à se défaire de leurs meilleurs éléments – pour travailler à Europol, non seulement il faut maîtriser la matière qui est votre spécialité, mais aussi être linguiste et être doté de diverses autres compétences. En outre, le statut des guest officers pose le problème des responsabilités de l’État qui met à disposition des personnels soit au bureau de liaison soit au sein de l’agence. Ce type de collaboration représente toutefois une voie d’avenir.
Pour finir, j’aimerais préciser la volumétrie des échanges annuels au sein de la SCCOPOL : en 2015, plus de 450 000 messages entrants ou sortants ont été enregistrés sur l’ensemble des flux, contre 350 000 l’année précédente. Le développement du terrorisme, la crise des migrants, l’explosion de la cybercriminalité font craindre une augmentation encore marquée. Les ajustements des systèmes d’information au niveau européen et au niveau national devront être accompagnés d’une montée en puissance de la SCCOPOL, outil envié par nos partenaires, mais structure contrainte en termes de personnels, lesquels sont obligés de traiter un très fort ratio de messages.
M. le président Georges Fenech. Vous dirigez la SCCOPOL ?
M. Jean-Jacques Colombi. La SCCOPOL est dirigée par un commissaire de police qui relève de mon autorité.
M. le président Georges Fenech. En dehors des administrations régaliennes – douanes, économie, sécurité intérieure, justice –, avez-vous des liens avec les collectivités territoriales ?
M. Jean-Jacques Colombi. Non, nos interlocuteurs sont la justice, la police, la gendarmerie et les douanes.
M. le président Georges Fenech. Nous vous remercions, messieurs, pour cette importante contribution.
Audition, à huis clos, du général Pierre de Villiers, chef d’état-major des armées
Compte rendu de l’audition, à huis clos, du lundi 9 mai 2016
M. le président Georges Fenech. Chers collègues, nous avons l’honneur et le plaisir de recevoir le général Pierre de Villiers, chef d'état-major des armées.
Mon général, nous vous remercions d'avoir répondu à la demande d'audition de notre commission d'enquête relative aux moyens mis en œuvre par l'État pour lutter contre le terrorisme depuis le 7 janvier 2015.
Vous savez que nous avons déjà tenu plusieurs auditions de membres des forces armées et que nous avons reçu, la semaine dernière, le directeur général des relations internationales et de la stratégie du ministère de la défense.
Avec le chef d'état-major des armées que vous êtes, la commission d'enquête va pouvoir s'intéresser aux aspects militaires de la lutte contre le terrorisme aussi bien en France, avec l'opération Sentinelle, que sur les théâtres d'opérations extérieurs.
Cette audition, en raison de la confidentialité des informations que vous êtes susceptible de nous délivrer, se déroule à huis clos. Elle n'est donc pas diffusée sur le site internet de l'Assemblée. Néanmoins, et conformément à l'article 6 de l'ordonnance de 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, son compte rendu pourra être publié en tout ou partie, si nous en décidons ainsi à l'issue de nos travaux. Je précise que les comptes rendus des auditions à huis clos seront au préalable transmis aux personnes entendues afin de recueillir leurs observations. Ces observations seront soumises à la commission, qui pourra décider d'en faire état dans son rapport. Je rappelle que, conformément aux dispositions du même article, « sera punie des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal – un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende – toute personne qui, dans un délai de vingt-cinq ans divulguera ou publiera une information relative aux travaux non publics d'une commission d'enquête, sauf si le rapport publié à la fin des travaux de la commission a fait état de cette information. »
Conformément aux dispositions de l'article 6 précité, je vais maintenant vous demander de prêter le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité. Veuillez lever la main droite et dire : « Je le jure ».
Le général Pierre de Villiers prête serment.
Mon général, je vais vous laisser la parole pour un exposé liminaire qui sera suivi par un échange de questions et réponses. Je vous propose d’intervenir tout d’abord sur l’opération Chammal puis sur l’opération Sentinelle.
L’opération Chammal suscite certaines questions qui intéressent directement nos travaux. Nous aimerions avoir un point de situation sur le théâtre du Levant : évolution de la menace, situation territoriale, forces en présence.
Pouvez-vous nous présenter la coalition contre l’État islamique : pays contributeurs et participants, commandement opérationnel, stratégie poursuivie, évolutions du dispositif ?
En ce qui concerne l'opération Chammal, nous souhaiterions connaître son cadre d'intervention, les buts poursuivis, sa chaîne de commandement et la coordination avec la coalition, les moyens humains et techniques mis en œuvre et leur évolution. Pourriez-vous nous informer notamment sur les changements effectués après les attentats de janvier et novembre 2015 ? Pourriez-vous nous donner le nombre de militaires actuellement engagés dans l'opération en détaillant les données par type de missions, armées et services ?
Nous aimerions aussi connaître le nombre de sorties aériennes effectuées depuis le déclenchement de l'opération. Pourriez-vous nous apporter des précisions sur l’évolution de ces sorties au fil des mois, sur le type de missions effectuées – renseignement, frappe –, sur les objectifs visés et les zones géographiques ciblées ?
Pourriez-vous nous présenter un premier bilan de l'opération : nombre de frappes effectuées, de cibles détruites, de combattants neutralisés ? Nous souhaiterions notamment nous faire une idée des résultats obtenus par l'intensification des frappes aériennes décidée par le Président de la République à la suite des attentats de novembre 2015. Combien de cibles francophones ont été identifiées comme devant être frappées ? Combien l'ont été ? À combien peut-on estimer le nombre de décès de Français résultant de ces frappes ?
Pourriez-vous nous présenter l'état de la coopération militaire avec l'Irak et les modalités de coordination de l'action de la coalition mondiale avec celle de la Russie ?
Compte tenu des engagements actuels des forces armées, quel effort supplémentaire seriez-vous capable de fournir au Levant sans dégarnir vos autres opérations ?
Enfin, je vous soumets cette question récurrente : un engagement au sol est-il totalement irréaliste dans les mois qui viennent ?
Général Pierre de Villiers, chef d'état-major des armées. Monsieur le président, mesdames et messieurs les députés, je voudrais en tout premier lieu vous remercier sincèrement pour avoir pris l’initiative de cette audition. Vous le savez, j’attache la plus grande importance à la continuité et à la qualité des échanges que les armées entretiennent avec la représentation nationale, quel qu’en soit le cadre.
Les terribles attentats du 13 novembre dernier à Paris et ceux du 22 mars à Bruxelles ont marqué le franchissement d’un nouveau seuil de la menace terroriste qui pèse sur les pays européens. Conscient de cette réalité, le Président de la République a décidé de mener une lutte résolue contre les groupes terroristes et de renforcer l’effort de défense.
Il en résulte un engagement massif de nos armées, parfois d’ailleurs au-delà de leurs contrats opérationnels tels qu’arrêtés dans le Livre blanc de 2013. Chacune des composantes de notre outil de défense est impliquée dans cette lutte.
La question sur laquelle votre commission travaille est absolument fondamentale, parce que l’essentiel est en jeu : les moyens consentis à la lutte contre le terrorisme sont-ils tout à la fois adaptés et suffisants pour assurer la protection de la France et des Français ? Cet impératif de protection est la raison d’être et la mission première des armées. Voilà pourquoi vous pouvez compter sur moi pour m’exprimer cet après-midi sans langue de bois.
Tous les moyens militaires qui pouvaient être engagés dans cette lutte l’ont été et le restent, avec la volonté d’apporter une réponse immédiate à l’extrême gravité des coups portés à notre pays. Le très haut degré d’engagement de nos armées, depuis plus d’un an, en porte témoignage. Cet engagement ne se dément pas et je crois pouvoir dire qu’il apporte un concours essentiel au combat mené courageusement par notre pays. Pour autant, nous devons continuellement adapter nos moyens à l’évolution – et à l’accroissement – de cette menace terroriste.
En effet, l’engagement massif de nos armées a révélé certains effets de seuil qui nécessitent une adaptation permanente de l’outil et la révision de certains de nos modèles. Par ailleurs, j’ai la conviction que l’action des armées doit toujours être envisagée comme le concours apporté à la mise en œuvre d’une stratégie plus large, impliquant l’ensemble des acteurs institutionnels de notre pays, la population française ainsi que les pays alliés et amis.
Avant de répondre plus directement à vos questions sur l’opération Chammal, je vais illustrer ce que je viens de dire sous l’angle de l’adéquation des moyens à la mission. J’articulerai mon propos en trois parties. Je vais d’abord vous donner une analyse militaire de la singularité de la menace terroriste actuelle, de ce qui la distingue de ce que nous avons pu connaître par le passé. Pour un militaire, la question centrale est toujours la même : qui est l’ennemi ? Je ferai ensuite l’état des lieux de la lutte contre le terrorisme, une lutte qui n’est pas nouvelle mais qui a dû changer brusquement de dimension. Enfin, je vous donnerai mes points d’attention, en toute transparence.
Pour commencer donc, il m’apparaît intéressant de définir la menace terroriste telle que je la perçois. Pensée et utilisée au service d’une idéologie destructrice, la terreur, autrefois localisée, est devenue terrorisme mondialisé. Elle s’est répandue dans des zones jusque-là préservées, frappant quatre des cinq continents au cours des douze derniers mois.
Certes, le terrorisme n’est pas nouveau en soi – le monde et la France ont déjà été confrontés à plusieurs reprises à ce fléau – mais nous sentons bien que l’ampleur et les ressorts du terrorisme de l’islam radical sont singuliers. La différence se fonde avant tout sur l’ambition hégémonique et la logique destructrice de ce terrorisme. La surenchère de la violence est érigée par les organisations terroristes comme le moyen privilégié d’asseoir leur pouvoir. Elle a été théorisée par Abu Bakr Naji dès 2004, dans un texte traduit en français en 2007, que j’ai ici, sous un titre parfaitement clair : Gestion de la barbarie. Ce qui est singulier ici, c’est que la violence est envisagée au-delà du simple moyen ; elle devient une fin. Cette idéologie de mort emporte toute rationalité. Elle n’a, en réalité, d’autre finalité que l’avènement d’un terrorisme nihiliste érigé en système qui se revendique comme État islamique ou califat.
Deux traits supplémentaires complètent la physionomie hideuse de ce terrorisme : il est mouvant et fait vaciller les repères ; il est opportuniste. Nous sommes confrontés à une menace en mutation permanente et les visages changent : hier al Qaïda, aujourd’hui Daech, Jabhat al-Nosra ou Boko Haram. En réalité, la menace perdure sous les traits d’un mutant qui se transforme et se démultiplie pour se répandre. Le terrorisme islamiste fait aussi vaciller les repères en ce sens qu’il revendique un enracinement territorial tout en ignorant totalement les frontières des États et en venant frapper jusque sur notre sol. Il revendique la pureté quand il n’est en réalité que crime. On le croit éradiqué ici mais il renaît là-bas sous une forme nouvelle. La menace est protéiforme et nébuleuse ; elle n’en est que plus difficile à contrer.
Ce terrorisme est aussi opportuniste. Il prolifère partout où les institutions sont fragiles, faibles ou inexistantes et où la pauvreté incline à la désespérance. Il se sert des facilités qu’offrent internet et les réseaux sociaux, qui ouvrent l’accès au cœur même des sociétés, pour embrigader la part de la population la plus exposée et la plus influençable, en particulier au sein de la jeunesse.
De ces observations je crois que nous pouvons tirer une certitude : les dynamiques de la violence et de la peur sont enclenchées, mettant au défi la réponse de la force légitime. Un nouveau cycle guerrier s’est ouvert ; il nous oppose à un ennemi qui cherche à imposer son idéologie. Nous ne faisons pas la guerre à un terrorisme désincarné ; nous faisons la guerre à des groupes djihadistes.
C’est bien un ennemi que nous avons à combattre. Il a des objectifs, des ressources et des besoins. Pour autant, l’ennemi a aussi des faiblesses qu’il faut savoir exploiter pour mettre un terme à son projet. J’en citerai deux : le défi de la régénération ; la division.
Le défi de la régénération s’appuie nécessairement sur la conservation de zones refuges. La capacité à durer des groupes terroristes repose sur l’existence de sanctuaires qui leur sont indispensables pour s’entraîner, se réarticuler et s’approvisionner. La perte de ces sanctuaires porte à chaque fois un coup très sérieux à l’ennemi, comme ce fut le cas des opérations conduites par nos armées dans l’Adrar des Ifoghas au Nord-Mali. C’est d’ailleurs encore le cas. Sur ce sujet, il faut souligner que notre stratégie de régionalisation et de partenariat élargi dans la bande sahélo-saharienne (BSS) est une réussite. Elle est en cohérence avec la réalité de la menace et les besoins critiques de l’ennemi. Elle privilégie des modes d’action basés sur la surprise, facteur clé qui permet de contrer les groupes armés terroristes, et sur des opérations transfrontalières conduites en partenariat avec les armées du G5 Sahel, c'est-à-dire le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad. Finalement, Barkhane rend les espaces du Nord-Mali et du Niger de plus en plus hostiles aux terroristes et de plus en plus difficiles aux trafiquants. Cette même stratégie est également mise en œuvre par la coalition au Levant. Mossoul en Irak et Raqqah en Syrie sont des objectifs qui, une fois repris, contribueront indéniablement à affaiblir sérieusement le pseudo-État islamique.
Deuxième faiblesse : la division, la compétition entre groupes djihadistes. La revendication de Daech d’établir un pseudo-État territorial, de part et d’autre de la frontière séparant l’Irak de la Syrie, peine à masquer l’absence d’une véritable vision partagée par l’ensemble de la mouvance djihadiste. Les groupes terroristes, dans leur diversité, ne s’accordent guère sur la voie à suivre. Leurs ambitions restent diverses et concurrentes, ce qui constitue une nouvelle preuve de leur logique nihiliste. Sur ce plan, les luttes fratricides entre al-Qaïda et Daech représentent un atout pour nous.
Lors des réunions avec les chefs d’état-major des pays de la coalition, je partage souvent avec mes homologues la conviction qu’une des clés de notre succès sera l’exploitation de ces oppositions, notamment au moyen d’opérations ciblées dans le domaine de la cyberdéfense et de la contre-information. Il s’agit d’un domaine sensible et très consommateur en moyens, d’où l’effort que nous devons poursuivre pour étoffer nos capacités en cyberdéfense.
Cette stratégie ne sera pleinement efficace que si elle ne se limite pas aux seuls effets militaires. L’action des armées doit en effet s’intégrer dans une approche globale. C’est la condition du succès. Seule l’action globale peut permettre d’étouffer cette menace en s’attaquant simultanément à toutes les dimensions de cette dernière pour révéler l’incohérence entre le discours et les crimes de Daech.
Soyez certains que cette vision est partagée par l’ensemble des chefs d’états-majors des armées engagées dans la coalition. Tous insistent sur le fait que la résolution du conflit passe nécessairement par une telle approche globale. Elle doit permettre de redynamiser l’engagement des pays de la région dans la lutte contre Daech et la reconstruction de ce qui aura été endommagé ou détruit. Gagner la guerre ne suffit pas pour gagner la paix. Je le dis à temps et à contretemps, car je pense que c’est essentiel dans ce combat. Les armées concourent à cette impérieuse nécessité d’approche globale en apportant l’expertise et les capacités, dont je vais maintenant dresser l’état des lieux.
Au moment des attentats de janvier 2015, nos armées étaient déjà en action. Pour démultiplier leur effort, elles ont pu s’appuyer sur deux socles essentiels : l’expérience opérationnelle ; la posture de nos armées.
Premier socle : l’expérience opérationnelle. Depuis 2001, nos armées sont engagées dans la lutte contre des groupes armés terroristes, d’abord en Afghanistan contre les talibans ou le réseau Haqqani, puis dans la BSS contre al-Qaïda au Maghreb islamique (AQMI), Ansar al-din ou le Mouvement pour l’unicité et le jihad en Afrique de l’Ouest (MUJAO). Nos soldats se trouvent fréquemment, les yeux dans les yeux, à moins de quinze mètres d’un ennemi fanatisé qui ne recule pas. Telle est la réalité des combats que nous menons, loin de toute exposition médiatique. Nos soldats ont prouvé leur capacité à conduire des actions militaires dans des situations opérationnelles et climatiques extrêmement exigeantes. Ils y ont remporté des succès déterminants. C’est sur cette somme d’expériences que des réponses ont pu se construire dès le premier jour. C’est grâce à cette expérience que nous avons neutralisé environ 200 terroristes au Sahel, dans le cadre de l’opération Barkhane, pendant la seule année 2015.
Deuxième socle : la posture de nos armées qui possèdent deux atouts principaux. Notre premier atout réside dans le caractère complet de notre modèle d’armée qui possède la gamme la plus large possible de capacités et nous permet d’adapter la posture à la menace terroriste où qu’elle se manifeste. Notre deuxième atout consiste en notre capacité autonome d’appréciation, grâce à nos capteurs de renseignement, nos satellites, nos capacités de cyberdéfense. Avec ces atouts, nos armées peuvent apporter une réponse à la continuité de la menace terroriste au plus loin comme sur le territoire national. Et c’est ce qu’elles font.
Nous avons actuellement plus de 30 000 militaires en posture opérationnelle, toutes armées et tous services inclus. Au plus loin, ce sont les opérations extérieures : c’est la défense de l’avant. Nous sommes d’abord présents au Sahel où nous agissons en leader au sein de l’opération Barkhane, à dominante aéroterrestre. Ce que nous faisons là-bas est un modèle et une matrice pour beaucoup de nos opérations futures, avec une force modulable dont les actions conjuguent toujours plus de mobilité, de souplesse et de capacité à créer l’effet de surprise. Nous remportons au Sahel d’indéniables succès, aux côtés de nos frères d’armes africains. Cette réussite est le fruit de l’engagement total de nos soldats déployés là-bas. Ils connaissent les risques et les acceptent avec courage et dignité. La mort de nos trois camarades sur la piste de Tessalit, il y a moins d’un mois, en porte témoignage. Je tenais à leur rendre hommage devant vous car il ne faut pas les oublier.
Au Levant, nos armées agissent au sein d’une coalition anti-Daech. En détruisant leurs postes de commandement et d’entraînement, en appuyant de nos bombes l’action des forces locales au sol, nos armées aident à contenir les terroristes et elles permettent de réduire l’emprise territoriale de Daech. Je tiens à souligner ici combien les frappes conduites à partir des bases aériennes, renforcées pendant plusieurs semaines par celles des avions du groupe aéronaval, ont joué un rôle déterminant dans les revers récents des groupes armés terroristes en Irak et en Syrie.
Je profite aussi de ce constat pour insister sur la nécessité de conserver, sur le sujet des effets de nos actions, une approche équilibrée. Pendant des mois, certains observateurs expliquaient que les frappes de la coalition ne servaient à rien. Depuis quelques semaines, d’autres observateurs – à moins que ce ne soient les mêmes – croient pouvoir affirmer que la situation évolue vite et qu’une résolution est en vue. En réalité, nous savons d’expérience que la combinaison des actions exige du temps pour produire ses effets. Qui plus est, le temps des forces locales, qui agissent au sol en complément de nos actions, n’est pas le nôtre. Surtout, une approche globale, agissant sur les champs de la gouvernance et de l’économie, est indispensable pour permettre l’émergence d’une solution durable. Il nous faut conjuguer l’action politique et l’action militaire, ce qui demande du temps. Voilà pour la défense de l’avant.
En périphérie de notre territoire, il s’agit de protéger les approches de notre pays, avec des postures permanentes de sûreté et de sauvegarde dans leurs composantes aérienne et maritime et une veille opérée par nos forces prépositionnées. Là encore, nos armées protègent notre pays, notamment contre les infiltrations terroristes dans le contexte méditerranéen.
Au plus près, sur le territoire national, la menace terroriste s’installe dans la durée. La contribution des armées – en complément des forces de sécurité intérieures et bien sûr sous la responsabilité du ministre de l’intérieur – est naturelle. La finalité des armées réside tout entière dans la protection des ressortissants français, quel que soit l’endroit où ils se trouvent. On peut discuter de la doctrine – et il le faut – mais on ne peut pas discuter du principe ou alors il faut écrire un autre code de la défense.
La contribution des armées dépasse de beaucoup la dimension dissuasive et rassurante de la présence visible de soldats sur notre sol. Les capacités de planification, d’intervention et de gestion de crise, l’autonomie logistique et la maîtrise de certains moyens spécialisés rares sont autant d’atouts utiles à la lutte déterminée que nous avons à mener contre le terrorisme. Ceux d’entre vous qui appartiennent à la commission de la défense nationale et des forces armées m’ont déjà entendu sur ce thème.
La prise en compte de l’ensemble de ces dimensions débouche sur une posture nouvelle que nous devons parfaire et intégrer au sein d’un ensemble plus large qui nous oblige : la mission de protection de la France et des Français. Je suis bien sûr à votre disposition pour répondre à toutes les questions que vous aurez à me poser sur le sujet. Concrètement, nous avons l’obligation d’adapter les moyens de nos armées aux menaces immédiates. Nous le faisons à l’extérieur ; il faudra aussi le faire sur le territoire national. Nous devons préparer l’avenir dans un monde de multiplication et de superposition des crises. L’une de mes préoccupations quotidienne est d’ailleurs de garder à l’esprit que les menaces qui pèsent sur le pays ne se résument pas aux seules menaces terroristes. C’est en rappelant cette réalité que j’en viens à aborder la troisième partie de mon intervention liminaire : mes points d’attention relatifs aux moyens nécessaires pour soutenir la lutte contre le terrorisme.
Ces points d’attention sont concentrés autour d’une seule idée simple : assurer notre efficacité et notre endurance opérationnelle dans une situation où toutes les composantes de nos forces armées sont à un niveau d’engagement qui va parfois au-delà de leurs contrats opérationnels. Le dimensionnement des moyens militaires ne saurait être envisagé sans considération pour le temps long dans lequel s’inscrit nécessairement l’action des armées. Choisir une voie différente, c’est prendre le risque de voir les moyens s’éroder plus vite qu’ils ne se régénèrent, c’est hypothéquer l’avenir en pariant sur l’utopie d’un retour rapide à une situation ante.
Notre capacité à vaincre dépend de la stricte cohérence entre la menace, les missions confiées et les moyens octroyés. L’équipe que je forme avec les chefs d’état-major d’armée, derrière notre ministre de la défense, Jean-Yves Le Drian, est particulièrement attentive à ce besoin de cohérence qui s’articule autour de trois volets : les ressources humaines, les capacités opérationnelles, le modèle d’armée.
En ce qui concerne le volet des ressources humaines, l’effort de mise en cohérence a trouvé sa traduction dans la décision du Président de la République d’annuler plus de 10 000 déflations d’effectifs sur les années 2017 à 2019, qui viennent s’ajouter aux 18 750 annulations de la précédente actualisation de la LPM. Deux tiers de ces postes préservés seront redéployés en faveur du renforcement direct des unités opérationnelles et de la chaîne de cyberdéfense et de renseignement.
Les chaînes recrutement, formation et protection de nos armées, directions et services sont totalement mobilisées pour réussir cette manœuvre d’envergure. Mais pour être effective, elle doit être soutenue par un effort budgétaire cohérent qui prenne en compte la masse salariale et le surcoût financier associé à ces effectifs en soutien, en entraînement, en fonctionnement, en équipements et en infrastructure. Actuellement, le soutien et la préparation au combat de nos soldats sont des domaines sous extrême tension. Tout renoncement budgétaire supplémentaire, dès la gestion 2016, affecterait gravement l’endurance opérationnelle de nos armées dans la lutte contre le terrorisme.
Au-delà de la nécessaire traduction budgétaire des décisions prises, j’estime qu’il est juste que la nation reconnaisse le haut degré d’engagement et l’excellent état d’esprit avec lesquels nos soldats, marins et aviateurs s’acquittent de leurs missions respectives et en supportent les contraintes. C’est pour cette raison que, lors du dernier Conseil de défense du 6 avril, le Président de la République a décidé l’adoption d’un plan d’amélioration de la condition du personnel. Il y a derrière ces mesures un véritable enjeu d’attractivité, de fidélisation et de maintien du moral. C’est la légitime compensation face à des sujétions croissantes en matière d’absence et de suractivité. Beaucoup de nos soldats dépassent 100 jours d’absence de leur domicile en 2015.
Venons-en aux capacités opérationnelles qu’il s’agit de renforcer suivant trois axes : optimiser l’emploi des armées sur le territoire national ; appuyer l’effort en renseignement et en cyberdéfense ; soutenir l’intensité de nos engagements en opérations extérieures.
Pour optimiser l’emploi des armées sur le territoire national, nous avons fait le choix d’adopter une posture plus dynamique, qui privilégie les patrouilles mobiles plutôt que les gardes fixes. Pour qu’elle ne reste pas lettre morte, cette volonté doit s’accompagner d’une augmentation du parc des véhicules. Actuellement, nous avons 700 véhicules de tous types en Île-de-France, dans le cadre de l’opération Sentinelle. Avec le ministre de la défense, nous travaillons à l’achat de nouveaux véhicules tactiques adaptés, au cours des mois à venir. D’autres capacités doivent également être renforcées, notamment les moyens de transmissions et les moyens d’échange d’information nécessaires au développement de l’interopérabilité entre les armées et les forces de sécurité intérieures.
Notre deuxième axe consiste à appuyer l’effort en renseignement et en cyberdéfense. Le spectre des besoins identifiés est large : il va de la cyber-protection de la force aux capacités de sauvegarde et de veille sur internet, en passant par les moyens de traitement de l’image ou d’interception. L’ambition est bien de rehausser rapidement les moyens en renseignement et cyberdéfense à la hauteur des nouvelles menaces qui, dans ce domaine, évoluent très rapidement au point d’atteindre un niveau que je qualifierais de préoccupant. La guerre se mène aussi dans ce domaine.
Le troisième axe consiste à soutenir l’intensité de nos engagements en opérations extérieures, qu’il s’agisse des opérations que nous menons dans la BSS ou celles auxquelles nous participons au Levant, car toutes se traduisent mécaniquement par une surconsommation du potentiel et une usure des matériels. Certains de nos matériels – avions, bateaux et véhicules – sont actuellement sur-employés et leurs taux de disponibilité sont difficiles à maintenir à un niveau satisfaisant, compte tenu de leur âge pour la plupart d’entre eux. Certaines de nos réserves, comme nos stocks de pièces de rechange et de munitions, pourraient s’épuiser malgré le recomplètement. C’est bien l’ensemble de l’outil qu’il nous faut régénérer en permanence pour pouvoir répondre à l’intensité et à la durée de nos opérations.
Venons-en au troisième et dernier volet, le modèle d’armée, auquel j’attache une importance toute particulière. Il ne faudrait pas que les nécessaires adaptations, que je viens de brosser rapidement, se traduisent par la rupture de l’équilibre des fonctions stratégiques : dissuasion, prévention, protection, intervention, connaissance et anticipation. Affaiblir une fonction, c’est prendre le risque d’un effet d’entraînement, dont on ne maîtrise pas les conséquences induites sur les autres fonctions et sur leurs capacités. Par exemple, c’est bien la capacité expéditionnaire qui nous permet de nous porter au plus près des foyers du terrorisme ; c’est notre dispositif de prévention, constitué notamment de nos forces prépositionnées, qui nous permet d’assurer une veille et nous offre, au besoin, une capacité de réaction. Je le vis au quotidien. Je le répète, la pérennité de ce modèle d’armée passe par un respect scrupuleux des engagements budgétaires pris dans la LPM actualisée. Sinon, il faudra réviser nos ambitions. Nous n’avons pas le choix, quel que soit le contexte budgétaire étatique que je ne méconnais pas.
Avant de conclure, je voudrais aborder un sujet qui me tient à cœur, au plus profond de moi-même : l’état d’esprit de nos armées. La victoire sur la barbarie se joue aussi sur le terrain de l’exemple. Il nous faut investir ce champ pour démonter la mécanique du mensonge : projet contre fantasme, authenticité contre propagande. Le 8 mai, que nous commémorions hier, nous conforte dans la certitude que la victoire revient à ceux qui désirent plus que tout la liberté et la justice, et qui sont prêts à se battre pour elles ; la victoire ne peut revenir à ceux qui s’enferment dans une logique de haine et de destruction. J’ai la conviction que les armées, par ce qu’elles font et par ce qu’elles sont, peuvent porter ce témoignage sur la richesse et la pertinence des valeurs de notre République. La liberté, nos militaires combattent pour elle, quand d’autres la combattent avec la rage du désespoir. L’égalité, ils la vivent sous l’uniforme. La fraternité, notre carburant, ils la construisent au quotidien.
Cette réalité, les armées la rappellent en actes tous les jours. Plutôt que l’embrigadement, notre pays a choisi la mobilisation, et votre commission en est une illustration. Cette mobilisation s’exprime dans la dynamique qui traverse nos armées. La résilience de la nation se renforcera avec la prise de conscience de cette nécessité de mobilisation et de rassemblement, en particulier dans notre jeunesse. La création de trois centres de service militaire volontaire est, sur ce plan, un bon exemple et une source d’espérance pour cette jeunesse en quête de sens.
Monsieur le président, mesdames et messieurs les députés, la défense est plus que jamais au cœur de l’intérêt national. Nos armées prennent toute leur part dans la lutte déterminée que le pays mène contre le terrorisme, sous toutes ses formes et où qu’il se trouve. Cet effort exige un engagement total des hommes et des femmes de nos armées pour relancer l’action avec imagination, en s’adaptant en permanence, sans faiblir jusqu’à la neutralisation définitive des terroristes qui ciblent notre pays. Ces hommes et femmes de nos armées savent pouvoir compter en retour sur la nation, dont vous êtes l’incarnation, pour disposer de moyens en cohérence avec leur mission, pour le succès des armes de la France.
Je vous remercie et me tiens à votre disposition pour répondre à vos questions, en particulier sur l’opération Chammal que vous avez abordée dans votre introduction.
M. le président Georges Fenech. Je vous remercie beaucoup, mon général, et je me fais le porte-parole de la commission d’enquête pour saluer votre engagement total. Soyez assuré de la reconnaissance de la représentation nationale pour les actions que vous menez en faveur de la défense des libertés, de la sécurité de nos concitoyens et de la démocratie. Nous en venons aux questions.
M. Serge Grouard. Merci, mon général, pour votre exposé à la fois très concis et très dense. Il faut vous écouter très attentivement pour comprendre la portée réelle de chacune de vos phrases.
Général Pierre de Villiers. J’ai beaucoup travaillé pour cette audition car la question posée est fondamentale.
M. Serge Grouard. Je m’en rends compte. Quand vous parlez du maintien en condition opérationnelle, vous dites tout en une phrase dense qui signifie que nous avons actuellement le plus grand mal à maintenir l’outil en condition. Nous avons des exemples très précis de difficultés qui, d’ailleurs, ne datent pas d’hier.
Pour ma part, j’aimerais d’abord vous entendre sur les moyens. Pensez-vous que les quelque 34 milliards d’euros prévus initialement dans la loi de programmation militaire (LPM) sont suffisants au regard de la menace que vous avez décrite et des besoins de nos forces ? Vous connaissez de longue date mon sentiment : ces 34 milliards – qu’il faut déjà sanctuariser – ne sont pas suffisants.
À la suite du président, j’aimerais vous poser sur Daech des questions simples qui appellent des réponses extraordinairement compliquées. Nous revenons de Turquie où nous avons beaucoup parlé de la Syrie et des forces de Daech estimées à 20 000 ou 25 000 combattants. Quelle est votre propre estimation ? Nous voyons bien le lien qui existe entre le territoire tenu par Daech et le flux de terroristes qui nous arrive. Peut-on éradiquer Daech ? Cette éradication nécessite-t-elle une opération terrestre ? En tant que militaire, pensez-vous qu’une telle opération, menée par une coalition, aurait un sens ? Si c’est le cas, quels moyens faudrait-il engager ?
En Turquie, nous avons aussi beaucoup parlé de la Libye. Pourquoi n’éradiquons-nous pas la menace à ce stade, c'est-à-dire à un moment où elle n’est pas encore complètement structurée ? Pourquoi n’y allons-nous pas ? Un peu par provocation, je pourrais reformuler ainsi ma question : pourquoi n’allons-nous pas plus en Libye qu’en Syrie ?
M. Pierre Lellouche. Nous nous connaissons un peu et, vous le savez, j’ai la plus grande estime pour vous. Du reste, nous avons tous un immense respect pour ce que font nos soldats. Pour les avoir vus en opération du Mali en Irak, en passant par la Jordanie et ailleurs, nous ne pouvons qu’être admiratifs, surtout connaissant les contraintes et les problèmes de vieillissement de matériel auxquels ils sont confrontés. Même si vous avez été très poli dans votre façon de vous exprimer, ainsi que l’a relevé Serge Grouard, nous savons que certains véhicules – par exemple les véhicules de l'avant blindé (VAB) – ont parfois deux ou trois fois l’âge de leur conducteur.
Vous faites au mieux avec les moyens que vous avez, mais cette commission peut aider à aborder un débat de fond : vous êtes à la tête d’une machine qui a été conçue pour faire totalement autre chose que ce qu’on lui demande de faire. L’histoire militaire montre qu’on est souvent en retard parce que le monde change plus vite que l’outil. Celui dont nous disposons date de la guerre froide, il est largement orienté vers la dissuasion nucléaire et doté de forces d’infanterie lourde. Nous avons commencé à le transformer après la guerre froide mais il reste assez inadapté à cette guerre de long terme que nous avons à mener. Vous avez eu raison d’inscrire votre réflexion sur le long terme. Quel modèle d’armée peut répondre à une situation de ce type, dont nous savons seulement qu’elle va durer et contaminer un bon nombre de pays de la périphérie immédiate de l’Europe ? Les travaux de cette commission peuvent être utiles pour aider à poser et résoudre cette question. Nous devons commencer à y réfléchir.
Je dresserais un constat plus sévère que le vôtre car chaque niveau de votre description fait apparaître des problèmes, même si nos soldats et vous-mêmes faites au mieux avec ce que vous avez. Prenons le cercle de l’avant. Il faut avoir la franchise de dire que nos bombardements représentent un faible pourcentage de ceux opérés par la coalition occidentale et qu’ils apparaissent encore plus modestes quand on les compare aux frappes massives des Russes. On ne gère pas pour autant la question de fond : comment gagne-t-on cette guerre ? Pour gagner la guerre, il faut occuper le terrain. Comme il est hors de question que nous occupions le terrain nous-mêmes, nous devons trouver des alliés pour le faire. Or nous ne savons pas les trouver. Même si nous faisons des progrès, nous ne pouvons pas répondre à la question que vous avez posée vous-même : comment gagner la paix ? Dans cette région, la haine entre sunnites et chiites est telle que, même si nous dégradons l’État islamique à tel ou tel endroit, il se reconstitue ailleurs. Regardez ce qui se passe en ce moment au niveau du gouvernement irakien !
Le principe d’une intervention durable sur un théâtre comme celui-là me pose problème. La formule est encore plus problématique dans le Sahel. Je peux comprendre une opération courte comme Serval – on entre, on frappe, on sort – même si j’estime qu’elle n’était pas encore assez brève. En revanche, je suis très réservé en ce qui concerne des opérations telles que Barkhane où 3 500 soldats doivent intervenir dans la durée sur des surfaces immenses qui font la taille de l’Europe. Comment et avec qui gère-t-on la menace terroriste dans telle ou telle région ? Le pays manque de réflexion sur cette question.
Vous avez parlé des actions de l’armée dans le Sahel. Or nous avons tendance à militariser notre politique dans les pays de cette zone, comme nous l’avons fait en Afghanistan : l’aide économique est insignifiante par rapport à l’argent que nous dépensons sur le plan militaire. L’aide au développement n’arrive pas dans les villages sahéliens et nous n’avons rigoureusement aucune politique dans le domaine, pourtant essentiel, de la démographie : dans ces cinq pays, les plus pauvres du monde, le taux de natalité est encore de 7,5 enfants par femme, et le Sahel comptera 200 millions d’habitants dans trente ans. Mon général, je vous félicite pour Barkhane mais ce n’est pas une solution pour les trente ans à venir. Les militaires gèrent le quotidien, c’est leur job, mais ils doivent aussi réfléchir à des solutions de long terme.
En ce qui concerne la défense des approches, je vous le demande : comment fait-on pour protéger les frontières de l’Europe, où sont les armées françaises et européennes ? Que faisons-nous en Méditerranée sinon du sauvetage en mer qui garantit l’emploi des passeurs et garnit leur compte en banque suisse ? Ces passeurs mettent les gens dans des Zodiac en leur disant qu’ils seront pris en charge par la marine italienne ou une autre. Au cours des dernières années, les marines européennes ont tenu ce rôle, en raison du jeu de gouvernements comme celui de Matteo Renzi. À quoi pourrait ressembler la défense des frontières européennes par l’armée française et les autres armées ? Il n’y a pas de réflexion sur le sujet.
En interne, se pose la question du maintien de l’opération Sentinelle qui rassure la population même si certains parisiens sont moyennement rassurés de voir des militaires en treillis investir la place de la Madeleine. Avec tout le respect que je leur dois, les soldats ne sont pas faits pour cela. Il y a un vrai problème de doctrine. Je vous entends, le ministre de la défense et vous-même, dire que le même soldat doit aller au Mali et ensuite participer à l’opération Sentinelle. Je suis absolument convaincu du contraire. Pour le coup, je me demande si la solution ne consiste pas à revenir à une forme de conscription. Sur tous ces points, je pense que nous manquons cruellement de réflexion. Je souhaiterais que nous arrivions à progresser sur ces sujets de long terme, tout en vous donnant acte du travail que vous accomplissez à court terme et sous les ordres du Président de la République. Vous faites le travail que l’on vous demande de faire avec l’outil que vous avez. Personnellement, je m’intéresse à l’outil qu’il faut avoir afin de répondre à la menace qui va continuer à peser sur nous au cours des années à venir.
M. le président Georges Fenech. Chers collègues, je vais vous demander de ramasser davantage vos questions compte tenu du temps imparti et de l’importance des réponses que nous attendons de la part du général de Villiers.
Général Pierre de Villiers. Monsieur Grouard, votre première question est fondamentale. Il faut que les choses soient claires. Nous avons rétabli la cohérence entre la menace, les missions et les moyens, grâce aux actualisations de la LPM qui ont eu lieu après le 7 janvier puis après le 13 novembre. Ces actualisations successives portent notamment sur l’annulation de réductions d’effectifs à hauteur de 28 750 postes, sur l’octroi d’un socle de ressources exceptionnelles et de 3,8 milliards d’euros de crédits supplémentaires et sur la budgétisation des ressources exceptionnelles.
Ces mesures permettent de faire face à la situation actuelle. Il faut envisager la période 2016-2019. Je reste vigilant sur la gestion de 2016 : compte tenu de la loi de finances initiale (LFI), du surcoût lié aux opérations extérieures, et des 600 millions d’euros de reports de crédits, nous arrivons à un montant de 33,5 milliards d’euros tout compris. Je reste également vigilant concernant le projet de loi de finances (PLF) pour 2017. Quand on ajoute la LFI telle que prévue dans la LPM initiale et les mesures qui viennent d’être prises par le Président de la République lors du Conseil de défense, nous ne sommes pas loin de 33 milliards d’euros hors surcoût lié aux opérations extérieures et intérieures. Je regarde de près le processus budgétaire suivre son cours car je ne peux pas effectuer les missions si je n’en ai pas les moyens. Nous affrontons des ennemis qui, eux, ne se posent pas la question des moyens puisqu’ils sont dans une guerre asymétrique. Si je ne peux pas équiper, entraîner et former correctement les soldats, il ne sera pas possible de remplir correctement les missions. Il en va de ma responsabilité.
Il faudra ensuite s’intéresser à la période 2018-2019.
Ce modèle d’armée est-il viable avec un budget de 34 milliards d’euros dont vous avez parlé pour 2019 ? Non, il faut aller vers un budget équivalent à 2 % du produit intérieur brut (PIB), ce à quoi se sont engagés les pays de l’Organisation du traité de l'Atlantique nord (OTAN) lors du sommet de Newport. Cet engagement devrait être réitéré lors du sommet de Varsovie. Ce pourcentage de 2 %, que j’estime nécessaire pour la période 2020-2022, inclut les pensions, c’est-à-dire qu’il se compare au taux actuel de 1,78 %.
Cette hausse représente des milliards d’euros, dans un contexte budgétaire que je connais. Je comprendrai toutes les décisions politiques, mais je ne comprendrai pas que l’on veuille nous fixer des ambitions sans les moyens de les atteindre. Cela, je ne l’accepterai pas. Nous sommes allés au bout du bout de cette logique-là, notamment au cours des dix dernières années, et nous ne pouvons pas aller plus loin : il y a longtemps qu’il n’y a plus de gras, que nous avons épuisé toutes les sources d’économie potentielles. J’ai été major général, c'est-à-dire numéro deux des armées, durant quatre ans. Je connais parfaitement la situation des armées, et je suis prêt à discuter avec tous les spécialistes du contenu physique et financier du budget.
Vous m’avez interrogé sur les forces de Daech, une organisation qui s’étend depuis la Syrie et l’Irak jusqu’à la Libye, mais nous devons aussi à faire face à AQMI et ses ramifications, à Boko Haram au Nord-Nigeria, au Front de libération de la Macina (FLM), à al-Mourabitoun, l’ancien MUJAO, à Ansar Eddine, etc. Le panorama, d’une complexité extrême, s’étend à bien d’autres composantes que Daech. La même idéologie est reprise par des mouvements différents. Pour caricaturer, AQMI, c'est-à-dire al-Qaïda, sévit plutôt dans la BSS, tandis que Daech est surtout implanté en Syrie, en Irak et en Libye. Les procédés sont à peu près identiques dans la barbarie mais, pour la première fois, Daech a théorisé un proto-État qui lève l’impôt, emploie des para-fonctionnaires et possède une organisation para-étatique.
Comment combattre cette menace ? Dans l’urgence, je ne vois pas d’autre solution que l’emploi de la force légitime pour faire reculer la violence, mais cela ne suffit pas. Il faut attaquer le mal à la racine : les jeunes qui rejoignent ce combat, notamment depuis l’Europe et l’Afrique du Nord, en raison de la pauvreté, de la désespérance, du manque de sens de leur vie. C’est le cœur du combat contre Daech. En tant que militaire, je me permets d’insister : l’action militaire n’est qu’une partie urgente et essentielle de la solution. Il existe un lien entre sécurité et développement ; l’un ne va pas sans l’autre. Vous y avez fait allusion, monsieur Lellouche.
Vous m’interrogez aussi sur l’action terrestre. C’est évidemment la conjugaison des bombardements aériens et de l’action terrestre qui nous a permis de reprendre l’offensive en Irak et en Syrie. Daech recule en Irak, que ce soit dans la vallée de l’Euphrate, dans celle du Tigre ou dans la province d’al-Anbar. En Irak, notre objectif est Mossoul, le cœur du cœur de l’organisation. Daech recule aussi en Syrie, mais la situation est beaucoup plus complexe dans ce pays où l’on dénombre 1 500 katibats qui se font et se défont au gré des intérêts, et où interviennent, directement ou indirectement, l’Iran, l’Arabie saoudite, la Turquie, la Russie, l’armée de Bachar al-Assad et la coalition. Daech, privé de capacités d’offensive massives, recule néanmoins sous la pression des bombardements aériens conjugués à l’intervention au sol de forces locales. Pourquoi est-ce aussi long ? Parce que nous n’avons pas de forces locales suffisantes au sol. C’est simple. Les forces locales au sol sont celles de l’armée irakienne auxquelles il faut ajouter les peshmergas en Irak et les forces démocratiques syriennes. Il faut reformer et entraîner ces forces dont le moral a été atteint par la cuisante défaite qu’elles ont subie face à Daech. Il faut du temps.
On pourrait imaginer une coalition de pays occidentaux qui accroîtrait substantiellement cette action au sol. Pour ma part, je recommande une très grande prudence concernant ce scénario : c’est celui que Daech veut nous pousser à adopter. Daech veut nous attirer au sol pour pouvoir enlever des otages, couper des têtes et faire basculer les opinions publiques. C’est un piège. En revanche, il faut évidemment que des forces locales et régionales interviennent, mais ce domaine – politique et diplomatique – ne relève pas de ma responsabilité. En tant qu’expert militaire, je pense que plus nous aurons de forces locales au sol et plus vite nous irons. La bonne idée est de conjuguer les bombardements et les actions au sol ; la mauvaise idée est d’envoyer des forces occidentales au sol. Voilà ce que je dis régulièrement au chef des armées, le Président de la République.
Pourquoi ne pas aller tout de suite en Libye pour y éradiquer Daech ? Parce qu’il faut définir une stratégie globale et internationale avant de se lancer dans une nouvelle action militaire dans ce pays. Nous devons tirer les enseignements du passé : nous avons gagné la guerre mais nous n’avons pas gagné la paix en Libye. Commençons par déterminer ce que nous attendons vraiment d’une éventuelle action militaire et, ensuite, préparons-la. Nous sommes dans le temps politique et diplomatique dans ce pays où la situation est éminemment complexe. Sur le terrain, il y a les forces du général Haftar en Cyrénaïque et des milices islamistes de différentes natures en Tripolitaine, chacun soutenu par des pays différents. Pour corser le tout, il faut compter avec une approche tribale générale et de nombreuses katibats.
Pour y éradiquer Daech, il faut aussi des forces locales au sol. Lesquelles ? Daech est présent notamment de Benghazi à Syrte où il a une forte concentration de forces. Sur le plan militaire, la victoire implique des actions aéroterrestres et éventuellement des opérations d’embargo et de blocus pour contrer les trafics entre Misrata et Benghazi. Le problème de la Libye est d’abord politique. Il ne se règlera pas avec l’armée française. Nous pouvons contribuer à une action internationale, à condition qu’il y ait une stratégie globale.
S’agissant du modèle que nous choisissons pour l’armée française afin de gagner la guerre contre le terrorisme, je ne partage pas votre vision critique. Je pense que notre modèle fait face à toutes les hypothèses : la guerre marquée par le retour des puissances, que nous qualifions de haute intensité et qui nécessite une machine puissante ; le terrorisme qui nécessite plus de souplesse et plus de moyens dans les domaines que j’ai essayé de vous décrire. Il faut garder ce modèle global, sachant que nous avons affaire à deux types de conflictualité.
M. Pierre Lellouche. Au sein des armées, vous avez une véritable expertise pour penser l’avenir et offrir aux dirigeants politiques des modèles plus ou moins différents, compte tenu de l’analyse que l’on peut se faire de la menace. Les politiques ne peuvent pas faire cela à votre place parce que vous connaissez votre outil mieux qu’eux. C’est sur ce point que la réflexion doit être intensifiée au sein des armées. Il ne s’agit pas de vous demander de prendre les décisions des politiques, mais nous aimerions avoir votre avis pour préparer une évolution du modèle si nécessaire.
Général Pierre de Villiers. Nous réfléchissons bien sûr à tout cela, en élaborant une vraie stratégie militaire générale : vouloir, pouvoir, agir. Reconstruire ou infléchir un modèle ? La réflexion nécessiterait beaucoup de temps. Comme je vous l’ai dit, ce modèle aura un coût estimé à 2 % du PIB à l’horizon 2020-2022, en prenant le périmètre que je vous ai décrit. Sinon, nous n’aurons pas les moyens nécessaires – et c’est bien ici le lieu où en parler.
En ce qui concerne le territoire national, nous avons déjà eu un échange en commission de la défense. Ce serait une erreur d’imaginer que les armées françaises incarnent seules la sécurité du territoire national, qui est d’abord du ressort du ministre de l’intérieur ; nous apportons un complément. Ce serait aussi une erreur de penser que nous nous désintéressons de la protection de la France, des Français et du territoire national. Les Français ne comprendraient pas une telle vision.
Parlons de Sentinelle, même si cet angle de vue est un peu réducteur dans la mesure où la protection des Français passe aussi par la dissuasion, la défense aérienne et maritime, par la cyberdéfense, etc. S’agissant de Sentinelle, vous avez raison : notre doctrine doit évoluer Nous devons devenir plus mobiles et imprévisibles, surprendre l’adversaire. C’est un changement qui s’inscrit dans une démarche interministérielle.
C’est la même logique qui nous a amenés à complètement changer notre organisation en passant de l’opération Serval à l’opération Barkhane. Nous sommes maintenant organisés sur un mode extrêmement souple. Finies les logiques figées de bataillon, d’armée de grand-papa ! On a tout changé. L’effet de surprise a changé de camp. C’est ce qu’il faut faire sur le sol national. Et pour le faire, il faut que nos doctrines évoluent. Loin d’être un aboutissement, le rapport relatif aux conditions d’emploi des forces armées sur le territoire national présenté au Parlement constitue une étape. Nous irons plus loin.
À la faveur de cette question, je vais vous donner quelques exemples illustrant l’ampleur des changements. D’abord, nous avons progressé très rapidement dans le rapprochement avec le ministère de l’intérieur, même si ce n’est jamais suffisant. J’ai moi-même rencontré M. Cazeneuve à plusieurs reprises pour essayer de rapprocher les points de vue des armées et de l’intérieur, avec comme seul objectif : conserver une paix d’avance.
Nous avons modifié notre système de commandement. À Paris, trois groupements remplacent une vingtaine de commandements différents. La semaine dernière, nous avons créé quinze îlots de sécurisation renforcée, en particulier autour des emprises confessionnelles, en appliquant les principes que j’ai déjà évoqués : jouer sur la mobilité, l’imprévisibilité et l’effet de surprise. C’est tout le contraire de la ligne Maginot que d’aucuns ont décrite ; c’est tout le contraire de ce qu’était Vigipirate.
Parlons de la réserve. Nous sommes passés de 200 à 400 réservistes engagés quotidiennement sur le territoire national, et nous devrions arriver au nombre de 700 à la fin de l’année, sachant que notre objectif est d’en employer 1 000 à terme. En cyberdéfense, nous avons fait énormément de progrès. Dans le domaine du renseignement, le général Gomart, que vous allez auditionner, vous décrira la cellule Hermès qui consiste à mettre tous les services de renseignement dans une même salle pour qu’ils partagent leurs analyses. En termes de moyens, je vous ai parlé des véhicules. Nous faisons aussi des efforts sur la qualité du soutien des soldats : en Île-de-France, 97 % des logements sont équipés de vrais lits et non plus de lits Picot. Nous améliorons aussi l’alimentation, les loisirs, et la protection des emprises militaires avec le plan Cuirasse. Il faut le reconnaître, la protection des emprises militaires avait été désarmée, « civilianisée », externalisée.
L’ampleur de la tâche liée à la menace terroriste est gigantesque. Nous menons de nouvelles expérimentations pour y faire face. En avril, par exemple, nous avons conduit un exercice conjoint avec la gendarmerie, l’exercice Minerve. L’idée était de faire basculer en opération réelle, sur le territoire national, une unité élémentaire qui était présente dans le département dans le cadre d’un entraînement. La réquisition sans préavis de cette unité a été facilitée par le dialogue permanent qui existe entre le préfet de zone de défense et l’officier général de zone de défense et de sécurité (OGZDS).
Le modèle futur s’inspirera de tous ces changements et expérimentations. Quoi qu’il en soit, dans le contexte actuel, je souhaite que la défense soit davantage un enjeu qu’elle ne l’a été au cours des dernières décennies.
M. François Lamy. Sur Sentinelle, je vais vous présenter les choses de manière différente. S’il y avait eu 10 000 à 12 000 gendarmes et policiers supplémentaires après les attentats du mois de janvier, je pense qu’il n’y aurait pas eu d’opération Sentinelle. D’ailleurs, le Président de la République et le ministre ont bien présenté les choses de cette manière : l’armée est venue compléter les effectifs de police et de gendarmerie, pour protéger les lieux de culte et d’autres sites publics.
Vous avez parlé des contraintes auxquelles vous avez dû faire face suite à cette opération Sentinelle, et j’ai travaillé sur le sujet dans le cadre du rapport budgétaire sur l’armée de terre. Nous constatons que près des deux tiers des sessions de formation ont été annulées l’année dernière. Les cadres que nous avons rencontrés nous ont expliqué que si la situation perdurait, l’armée ne serait bientôt plus capable que de garder des lieux de culte. En outre, l’opération Sentinelle n’a pas empêché les attentats du 13 novembre. Étant donné que l’intensité de la menace va durer, je m’inquiète du rapport que la nation va entretenir avec ses armées, sans même parler de l’efficacité du dispositif. Au bout d’un moment, tout le monde se demande ce que font ces soldats dans les rues alors que des attentats continuent à se produire. Dans le même temps, l’armée souffre de perte de compétences en raison de cette opération. Ne pensez-vous pas qu’il serait temps de diminuer fortement le nombre de soldats impliqués dans l’opération Sentinelle, afin que l’armée puisse retrouver une respiration ?
Ma deuxième question est très liée à la première. Pensez-vous que nos armées seraient capables d’intervenir sur un nouveau théâtre, que ce soit par le biais d’un engagement avec d’autres forces militaires terrestres ou d’une opération aérienne de même nature que celle qui est menée au Levant ?
Ma troisième question porte sur la nature du renseignement dont nous disposons en Syrie et en Irak. Je suppose que la direction du renseignement militaire (DRM) travaille pour préparer les frappes. Travaille-t-elle uniquement à la préparation de ces frappes ou a-t-elle des échanges avec d’autres services de renseignement sur les combattants eux-mêmes ? Je vous pose la question parce que, deux jours après les attentats, les Français impliqués étaient identifiés, on était capable de dire qui était le commanditaire, etc. Nos armées participent-elles à la recherche de renseignements sur ces individus ?
M. Philippe Goujon. Mon général, dans votre très complète intervention, vous avez dit que si vous n’avez pas les moyens, vous ne pourrez pas accomplir les missions. C’est assez logique et cohérent. Or, à l’énoncé de la multitude des missions de nos armées, on se dit qu’il sera difficile de les mener à bien, d’autant que les effectifs ont diminué de manière considérable au cours des dernières années. Il sera encore plus difficile d’accomplir toutes ces missions dans de bonnes conditions si les armées doivent intervenir dans de nouveaux théâtres d’opération, comme cela vient d’être envisagé.
En tant que Parisien, j’aimerais aussi dire un mot de l’opération Sentinelle qui représente une partie importante du dispositif de sécurisation de la capitale. Se pose la question de votre capacité à accepter cette opération dans la durée, sachant que les effectifs mobilisés ne peuvent pas accomplir les missions pour lesquelles ils ont été formés. Y a-t-il des perspectives d’évolution de la mission, impliquant ou non des réductions d’effectifs ? Les gardes statiques, qui consomment beaucoup d’effectifs, représentent encore 50 % de vos missions à Paris. Ne serait-il pas possible d’en transformer certaines en gardes dynamiques ? Je sais que tout cela ne dépend pas de vous, et qu’il y a des impératifs politiques. Il faut aussi reconnaître que le passage d’une garde statique à une garde dynamique peut inquiéter les personnes protégées et les populations.
En la matière, la coordination avec la préfecture de police de Paris est-elle suffisante ? Vous nous dites que vous vous êtes beaucoup rapprochés du ministère de l’intérieur. Qu’en est-il avec la préfecture de police, sous l’autorité de laquelle vous êtes placé, d’une certaine façon, dans le cadre de l’opération Sentinelle ? Le ministère de l’intérieur a beaucoup d’informations et il dispose notamment d’un réseau de caméras de vidéo-protection auquel vous n’êtes pas forcément relié. Il y a d’autres choix possibles que la garde statique pour protéger les points sensibles.
Concernant votre rapprochement avec le ministère de l’intérieur, vous avez fait allusion avec une expérience menée en Isère. Pourriez-vous nous donner plus de détails sur cette expérimentation qui vous permet de travailler de façon plus harmonieuse, plus imbriquée avec la gendarmerie, et nous tracer les voies d’amélioration qui existent avec la préfecture de police ?
Un dernier problème me semble très important : à Paris, vous n’avez quasiment plus de possibilité d’hébergement d’effectifs. Vous avez indiqué que vous hébergez 70 % des effectifs en région Île-de-France, c'est-à-dire à Satory, à Saint-Germain-en-Laye ou d’autres lieux qui sont très loin de la capitale. Cet éloignement fait perdre beaucoup de temps aux soldats et ne permettrait pas de les mobiliser très rapidement en cas de crise. On va encore supprimer deux casernes de gendarmerie parisiennes – Exelmans et Minimes – qui pourraient très bien être récupérées par les armées. Vous n’avez plus d’endroits où installer des effectifs alors que nous sommes en état de guerre, si j’en crois les déclarations du Président de la République et du Premier ministre.
M. Meyer Habib. Mon général, je vais vous parler avec mes tripes. Le terrorisme vient en grande partie de la faiblesse dont ont fait preuve nos politiques – et je parle au niveau mondial – au cours des dernières années. Les terroristes prospèrent dans des pays où ils ont des camps d’entraînement. Nous avons fréquenté certains de ces pays, nous avons même flirté avec eux, nous avons fermé les yeux. Le terrorisme djihadiste, qui n’a rien à voir avec le terrorisme nationaliste, peut être sunnite ou chiite. En ne s’occupant que de l’un des deux, on risque d’arriver à l’effet inverse de celui escompté.
Daech n’existait pas il y a trois ou quatre ans. Il est arrivé parce qu’on a fermé les yeux, et que les sunnites ont eu l’impression que nous donnions l’Irak, la Syrie, le Yémen aux chiites, sous le contrôle de l’Iran. Les sunnites ont eu l’impression qu’ils étaient en train de perdre. C’est une guerre de religion entre les deux tendances de l’islam et les pays occidentaux, les États-Unis en tête, se sont montrés très faibles. Le 27 août 2013, lors d’une conférence d’ambassadeurs, le président Hollande avait indiqué que la France s’était mise d’accord avec les États-Unis sur le principe d’une intervention militaire en Syrie. Au dernier moment, Obama a décidé de demander l’accord du Congrès.
Quand on fait la guerre, on doit s’engager totalement, sans avoir peur. Quand notre ministre des affaires étrangères indique que nos avions iront seulement en Irak, qu’ils ne franchiront pas la frontière syrienne, on a perdu. Quand on fait la guerre, on va au bout. Mon général, si on doit intervenir au sol, il faut le faire. Dire que l’on n’interviendra pas dans une opération terrestre parce que l’on a peur, c’est envoyer un mauvais message. Évidemment, il ne s’agit pas d’y aller de façon massive et totale. Il faut intervenir par commandos. Mais on doit envisager une intervention terrestre pour les éradiquer.
Que fera-t-on si un, deux, trois, quatre, cinq ou six nouveaux attentats se produisent ? C’est possible. Mettrons-nous un policier derrière chaque citoyen, à la porte de chaque synagogue, église et école, dans tous les stades et métros ? C’est impossible. Le terrorisme se combat en amont. Nous sommes très tolérants. Ce reproche, je l’adresse à nos politiques, pas aux militaires. Nous sommes faibles, nous avons peur alors qu’il faut savoir aller au bout des choses quand il s’agit d’une question de vie ou de mort. Telle est mon intime conviction.
J’ai une question plus précise à vous poser. Est-on prêt à réagir à une attaque terrorise non conventionnelle, chimique ou autre ?
Ma dernière question se rapporte à la Turquie, pays dont nous rentrons. Je représente les Français vivant en Turquie, en Grèce et en Israël et je suis très inquiet. Connaissant bien cette région du monde, j’ai l’impression que la Turquie est en train de basculer doucement et que nous cédons à ses desiderata. Je suis évidemment favorable à une grande coopération avec la Turquie, mais l’éviction du Premier ministre Ahmet Davutoğlu n’est pas pour me rassurer. Le fait que les Turcs puissent entrer en Europe sans visa risque de poser un énorme problème sécuritaire, pour en rester à cette seule considération.
Général Pierre de Villiers. Commençons par les questions sur l’opération Sentinelle. Je crois à cette opération. Nous n’y participons pas seulement parce qu’il aurait manqué 10 000 gendarmes. Nous pouvons contribuer à la protection des Français d’une manière différente de la sécurité intérieure, avec des moyens qu’elle n’a pas. Ayant le privilège de l’expérience – quarante-deux ans de service –, j’ai connu deux parties dans ma carrière : avant et après la chute du mur de Berlin. La deuxième période, marquée par le terrorisme, a été beaucoup plus mouvante. Avant la chute du mur, ne l’oublions pas, nos quartiers étaient protégés par des militaires en armes, nous avions des zones de desserrement et un système de défense opérationnelle du territoire contre d’éventuels spetsnaz parachutés. Dorénavant, nous avons un ennemi sur le sol national, qui nous a frappés deux fois. L’armée peut jouer un rôle spécifique en matière de planification, d’organisation, de maîtrise de spécialités rares, et de contrôle de zone. Il ne s’agit plus de copier ou prolonger Vigipirate, une opération qui mobilisait moins de 1 000 soldats dans quelques gares et lieux publics.
Nous avons déployé 10 000 soldats, de manière inopinée, en trois jours et demi, à l’issue des attentats du 7 janvier 2015. Nous avons ensuite évolué, vers plus de mobilité, de manière à nous rendre moins prévisibles. Mais il n’est pas évident de faire comprendre à nos concitoyens que les militaires sont plus efficaces lorsqu’ils ne sont plus statiques, postés en continu au pied du bâtiment à protéger. Les quinze îlots de sécurisation renforcée, dont je vous ai parlé, permettent le contrôle de zone, ce qui est plus efficace. Ils ont été créés la semaine dernière. Nous sommes en train de protéger différemment des lieux confessionnels, en vertu de cette approche. La majorité de nos forces déployées à Paris est mobile, ce qui n’était pas le cas il y a quelques mois, voire quelques semaines.
Le grand plan « réserve » annoncé simultanément, car tout cela est cohérent, va nous permettre de territorialiser les réservistes sur le sol national. Qui connaît mieux un canton ou une circonscription que celui qui y habite ? Cette approche est cohérente. Elle prévoit d’employer 1 000 réservistes par jour sur les 7 000 à 10 000 soldats déployés dans le cadre de l’opération Sentinelle. Il y a beaucoup à construire et l’affaire ne se résume pas à un calcul arithmétique : 10 000 soldats contre 10 000 gendarmes et policiers. Nous avons des choses à apporter en plus, mais nous ne devons pas chercher à nous substituer à ce que font les forces de sécurité intérieure dans le cadre de certaines missions. Cantonner les armées à l’extérieur du territoire national ne permettrait pas d’apporter une réponse adaptée à la lutte contre le terrorisme. Quand je vois comment nous avons révolutionné nos modes d’action à l’extérieur, je me dis que nous avons des marges de manœuvre importantes à l’intérieur, en appliquant des principes simples : l’action est placée sous l’autorité du ministre de l’intérieur ; nous devons nous appuyer sur la chaîne de l’organisation territoriale interarmées de défense (OTIAD) qui fonctionne très bien avec le préfet, les OGZDS, les réquisitions, etc. Cela nous permet d’être plus rapides et efficaces. Nous avons fait des pas de géant, en particulier à Paris.
Je comprends que le débat sur le rôle des armées sur le territoire national ait lieu. Je suis persuadé que le dispositif est amené à évoluer.
Nos armées seraient-elles capables d’intervenir sur un nouveau théâtre ? Tout dépend de la nature, de la durée et de l’intensité de cette nouvelle intervention. Actuellement, je le répète, nous sommes au maximum de nos capacités et de nos contrats opérationnels, et même légèrement au-dessus. Vous pouvez en tirer les conclusions : il faudrait se désengager d’un autre théâtre. Sur la durée, je ne peux pas faire plus que ce que je fais actuellement.
J’en profite pour apporter une précision concernant la durée de l’opération Sentinelle. Pourquoi sommes-nous en difficulté et pourquoi l’armée de terre fait-elle face à d’énormes contraintes d’entraînement ? Parce que nous attendons l’arrivée de 11 000 personnels supplémentaires dans la force opérationnelle terrestre, dont certains commencent à arriver. Insistons sur un phénomène qui ne s’était plus produit depuis la fin de la guerre d’Algérie : nous recréons des unités élémentaires, des compagnies. En attendant ces effectifs supplémentaires, nous avons dû réduire le soutien pour pouvoir affecter des combattants à l’opération Sentinelle et renforcer les fusiliers marins, les commandos de l’air, etc. Nous allons ainsi recréer une partie des quelque 48 000 postes supprimés – c’est beaucoup – au cours de la période 2008-2013.
Quand nous aurons récupéré les 11 000 personnels dans la force opérationnelle terrestre, à la mi-2017, nous pourrons reprendre le cycle d’instruction. Nous nous y préparons. Nous savions que nous traverserions une période difficile, le temps de recruter et de former les nouvelles recrues, sachant que la formation initiale dure six mois. À partir de 2017, je pourrai assumer dans la durée une opération Sentinelle aménagée et adaptée, avec une armée de terre qui pourra tenir, à périmètre d’engagement constant. Il ne faut pas se fier à la photographie actuelle que je ne méconnais pas : nous traversons une période difficile et de nombreux soldats ont cumulé plus de 200 jours d’absence de leur domicile.
Vous m’interrogez sur l’expérience menée en Isère. Mes excellentes relations avec le général Favier ne datent pas des attentats. Il y a six ans que je travaille avec la gendarmerie et, lorsque j’étais major général, j’ai mis en place des groupes de travail spécifiques pour que la mutation de la gendarmerie au ministère de l’intérieur se passe bien. Je connais quelque peu le sujet. Nous expérimentons de nouvelles procédures, comme dans le cas de l’exercice Minerve. En cas de menace, si une unité élémentaire est en cours d’entraînement, nous changeons de posture « de l’instruction à l’opération ». Lors de cette expérimentation, nous nous sommes intéressés à la manière dont les personnels adaptaient leurs équipements, matériels complémentaires et munitions. Nous avons observé la manière dont s’articulait le commandement et essayé de détecter d’éventuels problèmes d’interopérabilité ou de transmission. Nous allons poursuivre ces expérimentations qui ont été riches d’enseignement, très intéressantes. J’y crois.
En ce qui concerne la coopération avec la préfecture de police de Paris, nous avons atteint un niveau de confiance et de dialogue qui n’a rien à voir avec celui qui existait il y a encore quelques mois. Le préfet de police et le gouverneur militaire de Paris pourront vous confirmer que la liste des améliorations serait longue à détailler. L’un des points critiques, se situe au niveau des systèmes de communication. Nous avons beaucoup travaillé sur la question et, dans les semaines à venir, de nouveaux systèmes vont être mis en place. C’est indispensable, et l’armée de terre a beaucoup évolué dans ce domaine.
Monsieur Goujon, vous avez raison de souligner l’importance des infrastructures d’hébergement dans Paris. Un certain niveau de confort est nécessaire pour tenir dans la durée, mais il faut aussi se battre pour conserver ces emprises militaires. Entre l’îlot de Saint-Germain et le Val-de-Grâce, il est possible d’héberger 1 000 soldats. Nous savons que nous allons perdre ces locaux qui seront vendus. Nous sommes donc en train de reconstruire ces 1 000 places ailleurs, après élaboration d’un vrai schéma directeur qui nous amène jusqu’à la fin de 2017. Il s’agit là d’une vraie manœuvre d’infrastructure.
Monsieur Habib, vous avez fait une analyse du terrorisme que je ne me permettrais pas de commenter. Cela étant, je vois comme vous le fond de tableau : la rivalité entre sunnites et chiites, entre l’Arabie saoudite et l’Iran, qui est prise en compte dans toutes les négociations sur la Syrie, qu’elles soient diplomatiques, politiques ou militaires. Il faut avoir cet arrière-plan en permanence à l’esprit pour comprendre ce qui se passe en Syrie, mais aussi au Yémen ou au Liban. Ayant la chance d’avoir accès à mes homologues des pays du Proche et Moyen-Orient lors des réunions de la coalition, je peux vous dire que rien n’est simple. C’est pourquoi les dossiers syrien et libyen sont avant tout diplomatiques et politiques : il faut mettre tout le monde autour de la table.
Il faudra certes gagner cette guerre et éradiquer le terrorisme, mais la solution n’est pas seulement militaire. On ne peut gagner qu’en éradiquant le mal à la racine, ce qui est un sujet éminemment politique. Pourquoi ces jeunes partent-ils chez Daech ? Que vont-ils y chercher ? Que pourrait-on leur procurer pour éviter qu’ils ne s’en aillent là-bas ? Voilà les questions auxquelles il faut répondre. Selon les chiffres officiels, Daech aurait recruté un peu plus de 2 000 combattants d’origine française, mais il ne s’agit là que des combattants. Je suis vraiment frappé des choix de cette jeunesse, qui appartient souvent aux populations les plus pauvres. Il faut réfléchir à cela. Nous gagnerons cette guerre quand nous tarirons définitivement le flux de ceux qui partent.
Les armées incarnent vraiment l’ensemble de la nation et je prétends bien connaître ces populations défavorisées qui cherchent à donner un sens à leur vie.
M. Meyer Habib. Il y a 30 % de convertis !
Général Pierre de Villiers. Certes, mais je crois qu’il faut se battre pour tarir le flux et que l’action militaire ne suffira pas à éradiquer le terrorisme. Sur le plan sécuritaire, je pense que l’on ne détruit la violence que par la force légitime.
M. le président Georges Fenech. Mon général, pourriez-vous compléter votre réponse à la question de M. Lamy sur le renseignement ?
Général Pierre de Villiers. Le général Gomart, directeur du renseignement militaire, entrera plus que moi dans les détails. Je peux cependant vous dire qu’il existe un continuum entre la sécurité intérieure et la sécurité extérieure. Nous échangeons des informations. Cela étant, il ne faudrait pas se méprendre sur la façon dont se passe la préparation des dossiers d’objectifs de bombardement. D’abord, nous participons à une coalition : la décision de bombarder telle ou telle cible est collégiale. Ensuite, quand bien même nous déciderions de cibler tel ou tel objectif, il est impossible d’imaginer des lieux où il n’y aurait que des Français. Nous avons considérablement progressé dans le domaine de l’échange de renseignements avec nos alliés, notamment avec nos amis américains, et nous échangeons aussi et de mieux en mieux lors de réunions interministérielles. Si notre priorité est évidemment d’éviter que des gens en provenance de Syrie ne viennent nous frapper, nous faisons aussi partie d’une coalition qui a une stratégie globale.
Je voudrais insister sur cette dimension internationale. Comme nous avons été attaqués sur notre sol, nous avons légitimement tendance à voir l’aspect national. Pour autant, la menace est globale. L’éradication du mal à la racine passera par une coopération internationale profonde. Quand vous avez soixante pays autour de la table, c’est saisissant. Tous les matins, quand j’arrive au bureau, j’ai le point de ce qui s’est passé au cours des dernières vingt-quatre heures. Il y a des attentats partout. Il ne se passe pas un jour sans qu’il y ait un attentat djihadiste quelque part dans le monde. D’où la nécessité d’avoir une approche globale.
En réponse à votre question, monsieur Lamy, les échanges de renseignement se sont effectivement améliorés au plan interministériel et au plan international.
M. Meyer Habib. Le fait qu’il y ait autant de point d’impact du terrorisme à travers le monde montre bien que le djihadisme radical n’a rien à voir avec la désespérance et la pauvreté. On bat sa coulpe en se reprochant de ne pas donner assez alors que la France est le pays qui a le plus donné. Avec tout le respect que j’ai pour vous, je suis assez sceptique sur cette explication du djihadisme.
Général Pierre de Villiers. Chaque cas de terroriste en puissance est unique mais, dans les grands nombres, la stratégie de Daech, écrite noir sur blanc, est bien de neutraliser les forces de sécurité des différents pays occidentaux pour s’adresser aux masses pauvres et les convaincre d’aller rejoindre le califat. Il y a évidemment des conversions par le biais de réseaux sociaux, de mosquées radicales, de la prison, etc. La pauvreté est essentielle, mais elle n’est pas le seul terreau ; Daech attire des jeunes en quête de sens, qu’ils soient pauvres ou pas.
Au passage, je peux dire que ceux qui s’engagent dans les armées, au service de la France trouvent du sens, que c’est l’une des raisons de leur engagement. Contrairement à ce qui se passait il y a deux ou trois ans, ils ne s’engagent pas pour avoir un emploi et une rémunération. Ils s’engagent parce qu’ils cherchent à donner du sens à leur vie. C’est caractéristique, fascinant et extraordinaire. Nous avons une belle jeunesse que je rencontre dans toute sa diversité. C’est un signe d’espérance.
M. Sébastien Pietrasanta, rapporteur. Mon général, j’avais plusieurs questions précises à vous poser.
Tout d’abord, combien de Français ont-ils été tués par nos frappes aériennes ?
En second lieu, un changement de doctrine a eu lieu en ce qui concerne les interventions lors d’attaques terroristes : les primo-arrivants deviennent des primo-intervenants. On a beaucoup parlé des primo-intervenants de la police et de la gendarmerie. Les militaires de l’opération Sentinelle pourraient-ils être des primo-intervenants dans une salle de spectacle s’ils sont les premiers à arriver sur place, ce qui est possible compte tenu du maillage en place ? Les militaires de l’opération Sentinelle pourraient-ils ainsi être amenés à ouvrir le feu et à entrer d’eux-mêmes dans une salle de spectacle ou un autre lieu ?
Avec tout le respect que je vous dois, vos réponses aux questions sur une éventuelle intervention au sol me laissent un peu sur ma faim. D’après vous, qui êtes le chef d’état-major des armées et qui cumulez quarante-deux ans de service, combien de temps les bombardements actuels mettront-ils à éradiquer Daech ? Faisons un peu de politique fiction et imaginons qu’une coalition formée par les États-Unis, la France et d’autres pays, notamment du Moyen-Orient, décide de s’engager dans une opération terrestre. Combien de temps lui faudrait-il pour éradiquer Daech ?
Nous revenons de Turquie. Au fil des auditions, dans cette commission où les clivages politiques habituels sont transcendés, nous avons l’impression d’être dans un entre-deux. Depuis septembre 2015, il a été décidé d’effectuer des bombardements en Syrie, qui ont donné les résultats significatifs que vous avez rappelés. Pourtant, de l’extérieur, nous avons le sentiment que les choses n’évoluent pas suffisamment vite et que nous sommes même dans une certaine forme d’hypocrisie. On agit, on frappe et on affaiblit Daech, ce qui est très utile. À titre personnel, je considère néanmoins que nous ne sommes pas forcément à la hauteur de l’enjeu.
Combien de Bataclan faudra-t-il pour qu’un engagement au sol soit décidé ? En cas de nouvelle attaque de ce type, la pression de l’opinion publique et la pression politique seront fortes. Le 13 novembre au soir, on est monté très haut avec le décret d’état d’urgence, le contrôle aux frontières et les annonces du Président de la République. Au prochain attentat – et on sait qu’il y en aura d’autres – quelle sera l’étape suivante en termes de réaction ? Y aura-t-il une intervention au sol ? La réponse est oui. Je sais que c’est compliqué mais se prépare-t-on à cette hypothèse ?
M. le président Georges Fenech. Je vais compléter ces questions que nous nous posons avec de plus en plus d’acuité. Daech veut nous attirer au sol et c’est un piège, avez-vous dit, en précisant que vous déconseillez aux politiques de se laisser entraîner dans cette voie. Vous donnez ainsi un avis plus politique que militaire puisque vous vous placez après une intervention militaire. Comment ne pas se poser la question alors que nous avons tous en tête le malheureux exemple de l’intervention militaire américaine en Irak ? Quoi qu’il en soit, votre position a un caractère un peu politique, dans le bon sens du terme.
Mais au fond, qu’en savez-vous ? Comment pouvez-vous être certain que le piège ne se refermerait pas sur ceux qui veulent le tendre ? Et s’il se produisait un Bataclan puissance dix en France, comme le redoute le rapporteur ? Et s’il y avait une attaque chimique, comme Meyer Habib en émet l’hypothèse ? La réponse politique et militaire pourrait-elle être une augmentation des frappes aériennes ? C’est d’autant plus douteux que vous avez clairement indiqué que Daech ne peut être éradiqué que par une action conjuguée de forces aériennes et terrestres. Nous tournons autour du problème depuis le début, et nous en arrivons à nous dire, avec de plus en plus de conviction, que tôt ou tard, une coalition terrestre devra s’imposer. C’est une réponse purement politique qui nous échappe autant qu’à vous puisqu’elle dépend du Président de la République. Nous restons sur notre faim à nous demander quand Mossoul et Raqqah vont tomber.
Général Pierre de Villiers. Combien de Français ont été tués par nos frappes ? Nous ne faisons pas de décompte lors de frappes aériennes ou de combats au sol, même si nos écoutes font parfois état de francophones tués. Je n’ai aucun chiffre à vous donner. Nous avons quelques certitudes sur le fait que tel ou tel combattant étranger a été tué. Nous frappons le plus possible les groupes qui, d’après les renseignements dont nous disposons, sont le plus susceptibles de venir faire des attaques en France.
Les militaires de l’opération Sentinelle pourraient-ils agir en primo-intervenants en cas d’attaque terroriste ? Je connais la thématique de la non-assistance à personne en danger. Prenons un exemple : lors de la prise d’otage au Radisson de Bamako, je n’ai pas fait intervenir les soldats qui étaient à proximité de l’hôtel car ce n’était pas leur métier et que le remède aurait pu être pire que le mal. En revanche, depuis le commandement des opérations spéciales (COS) basé au Nord-Mali, nous avons fait venir des soldats spécialisés qui sont intervenus et ont procédé à la libération d’otages, en soutien des forces maliennes.
Il est extrêmement complexe d’entrer dans un lieu sans avoir un minimum de renseignements, et les soldats de l’opération Sentinelle ne sont pas entraînés pour ce faire. Nous ne pourrions prendre ce genre de décision qu’en ultime recours.
J’ai la chance de pouvoir suivre l’entraînement des forces spécialisées qui sont capables de libérer des personnes retenues en otage dans des lieux confinés. Je recommande tout de même la plus grande prudence en ce qui concerne de telles interventions. De plus, lorsque nous sommes primo-intervenants, nous sommes aux ordres des autorités préfectorales et de la sécurité intérieure qui nous confient généralement des missions correspondant à nos savoir-faire. Enfin, M. Cazeneuve a présenté le système mis en place depuis les attentats : tout le dispositif a été modifié pour qu’il y ait des possibilités de réaction à proximité de n’importe quel lieu.
M. le président Georges Fenech. Mon général, vous parlez de milieux confinés.
Général Pierre de Villiers. Comme une salle de spectacle.
M. le président Georges Fenech. Sur les faits qui se sont déroulés en novembre dernier, nous avons auditionné des fonctionnaires de la brigade anticriminalité (BAC) qui se trouvaient à l’extérieur de l’établissement, dans l’impasse Amelot, où il y a eu des échanges entre les terroristes et la BAC. Les policiers avaient des armes de poing et les militaires présents ont refusé de leur prêter leurs armes longues.
Général Pierre de Villiers. Un militaire ne prêtera jamais son arme.
M. le président Georges Fenech. C’est la question que l’on vous pose.
Général Pierre de Villiers. Ne posez pas cette question. Un militaire ne se sépare jamais son arme.
M. le président Georges Fenech. C’est une réponse.
Général Pierre de Villiers. Il faut arrêter de poser la question. Cette réponse a déjà été donnée dix fois. C’est la première chose qu’on apprend à Coëtquidan, en entrant à Saint-Cyr : on ne se sépare jamais de son arme. Qu’est-ce qu’un combattant sans son arme ? Quant à savoir pourquoi on n’a pas tiré, c’est parce qu’au moment où les soldats ont vu une arme qui dépassait, ils ne voyaient pas la personne. Pour le reste, nous sommes formés au combat en localité et nous utiliserons évidemment cette compétence en cas de besoin, sinon il serait inutile que nous soyons déployés au sein de l’opération Sentinelle. Nous l’avons fait à Valence, par exemple.
Pour ce qui est de l’intervention au sol contre Daech, je vous répète que je ne recommande pas l’envoi de forces occidentales parce que je ne suis pas sûr que cela ne se retournerait pas contre nous. C’est une appréciation militaro-politique ou politico-militaire, je vous l’accorde. Je pense que la solution passe, comme toujours, par les forces locales. C’est ce que nous faisons avec le G5 Sahel dans la BSS. Dans cette pièce, nous sommes tous confrontés à un dilemme : la gestion du temps. Il faut accepter qu’une guerre – surtout de ce type – puisse être longue, comme nous l’enseigne l’histoire, mais il faut aussi agir vite pour ne pas avoir ensuite à se reprocher mutuellement de ne pas être intervenu suffisamment tôt, pour éradiquer Daech avant qu’il ne nous frappe. La notion de temps long est néanmoins importante. Il n’est pas possible d’éradiquer une idéologie en quelques semaines ou en quelques mois. Il faudra du temps. Si l’on s’attend à une attaque chez nous, on peut décider de lancer une opération terrestre pour ne pas avoir à se reprocher de ne pas l’avoir fait. Pour le coup, c’est une question politique.
M. le rapporteur. En tant que militaire, à combien estimez-vous le temps qu’il faudrait pour éradiquer Daech en continuant seulement les bombardements actuels ou en les doublant d’une intervention au sol ?
Général Pierre de Villiers. La guerre ne se passe pas ainsi. Il n’est pas possible de prévoir la fin d’une guerre.
M. le rapporteur. Nous avons interrogé nombre de personnes, y compris des militaires français, il y a encore quelques jours, qui nous ont dit que cela durerait cinq ans ou dix ans, qui nous donnaient des éléments.
Général Pierre de Villiers. C’est très bien mais, pour ma part, je ne me risquerais pas à donner une estimation. Tout dépend de l’importance des forces au sol. Les forces démocratiques syriennes ont repris Cheddadi beaucoup plus vite que nous ne l’avions prévu, par exemple, mais elles y sont bloquées. Elles vont peut-être aller vers l’ouest, c’est une question de rapport de force. Je ne sais pas combien de temps nous allons mettre à former les forces locales. Je ne sais pas à quelle vitesse les gens de Daech vont reculer, s’ils vont se replier sur les sanctuaires de Mossoul et Raqqah, ni ce qu’ils vont faire dans ces deux villes. Vont-ils obliquer ailleurs ? Je ne sais pas. Pour résumer, je ne sais pas combien de temps va prendre l’éradication de Daech. Je peux seulement vous dire que plus il y aura de combattants au sol et plus cela ira vite : c’est bien la combinaison des bombardements et de l’action au sol qui nous fera avancer.
Lors de l’intervention en Libye en 2011, on nous posait constamment des questions du genre : pourquoi est-ce que rien n’avance ? Pourquoi ne s’est-il rien passé alors qu’on bombarde depuis quatre mois ? En fait, l’édifice s’est brutalement effondré, comme c’est souvent le cas. Oui, Daech recule. Quand vous subissez une telle masse de frappes par une coalition de soixante pays, vous finissez par reculer. Oui, les forces locales sont de mieux en mieux organisées. C’est le cas des peshmergas et des forces gouvernementales irakiennes notamment de l'Iraqi Counter Terrorism Service (ICTS) qui est l’équivalent de nos forces spéciales. Néanmoins, il faudra du temps. Avec de nouvelles troupes au sol, nous irions incontestablement plus vite, mais il faut mesurer le risque politique que cela représente par rapport à la plus-value militaire.
S’agissant des risques d’attaque chimique, on peut dire que Daech a des capacités en la matière. Cela étant, l’organisation préfère utiliser d’autres outils : des véhicules piégés (vehicle-borne improvised explosive device – VBIED), des engins explosifs improvisés (improvised explosive device – IED), des bombes humaines, des mines, des snippers. On peut imaginer l’utilisation de tous ces moyens en France. Est-ce que nous nous y préparons ? Par principe, nous nous préparons en permanence. Cependant, je vous le répète, nous sommes actuellement au maximum de nos capacités opérationnelles.
M. le président Georges Fenech. Je ne voudrais pas vous donner l’impression que la commission d’enquête ne se préoccupe que de la sécurité de nos compatriotes, avec beaucoup d’égoïsme. À l’heure où nous parlons, le risque terroriste reste très élevé chez nous mais il ne faut pas oublier ces quelque 8 millions de personnes qui vivent sous le joug de la barbarie la plus totale. À chaque reprise de territoire, on découvre des charniers. On a le sentiment que l’Occident est en train d’abandonner des populations qui sont victimes d’une barbarie inouïe. Il s’agit aussi de prêter main-forte à ces populations, souvent de confession musulmane d’ailleurs, qui sont les premières victimes de cette barbarie.
Général Pierre de Villiers. Vous me dites cela à moi qui commande tous les jours, 24 heures sur 24, des actions au sol. Monsieur le président, nous sommes engagés dans des opérations terrestres. C’est dur. On va chercher l’ennemi à quinze mètres. Quels pays sont engagés dans l’action au sol ? Vous venez nous dire qu’il faut aller combattre au sol. Nous y allons, en BSS par exemple.
M. le président Georges Fenech. Vous avez donné le chiffre de 32 000 soldats français en posture opérationnelle. Combien y a-t-il d’Allemands, d’Espagnols, d’Italiens, de Danois ?
Général Pierre de Villiers. Il y a différents stades d’engagement. La coalition est composée de soixante pays. Certains fournissent la logistique, d’autres bombardent, d’autres font de la formation, etc. En tout cas, je constate que nous sommes dans les trois premiers pays occidentaux les plus engagés au Levant. Nous étions en deuxième position après les États-Unis quand il y avait le groupe aéronaval. Au Levant nous sommes membres d’une coalition. Dans la BSS, nous sommes pilote et nous avons des équipiers et quelques alliés. Pour aller dans le sens de votre remarque, je trouve insupportable de voir ces populations massacrées ou vivant sous le joug de ce terrorisme. Mais je suis chef militaire 24 heures sur 24 et j’ai très régulièrement des blessés et des morts parmi mes soldats. J’entends dire qu’on ne prend pas de risques et qu’on ne participe pas à des opérations au sol, alors que j’ai vu les familles des trois soldats tués il y a quinze jours ! Ce que fait la France est tout à son honneur et je ne vois pas ce qu’elle pourrait faire de plus. J’ai le sentiment que toute la population française soutient cet engagement. Quoi faire de plus ? Une opération au sol en Irak et en Syrie ? Comment et avec qui ? Se poserait aussi la question des moyens. Il faudrait alors que le budget de l’armée passe à 2 % du PIB dès demain matin.
M. Serge Grouard. Si je puis me permettre, mon général, les questions qui reviennent un peu en boucle ne portent pas au fond sur l’engagement des forces françaises, que chacun a salué. Nous savons que nous sommes au taquet. Le problème est la dimension internationale de ce conflit, qu’illustrent les frappes quotidiennes dans le monde. En Syrie, il y a 20 000 ou 30 000 affiliés à Daech, si je puis les nommer ainsi. Les pays occidentaux ne doivent effectivement pas tomber dans le piège qui consisterait à s’engager seuls dans une opération terrestre. Mais d’autres pays, pour certains musulmans, qui subissent eux-mêmes ce terrorisme, devraient y aller alors qu’ils sont totalement absents ou presque. Sans parier sur une issue rapide, on peut néanmoins se dire que si une coalition internationale telle que l’on en a connu pour d’autres conflits intervenait au sol face à ces 20 000 ou 30 000 hommes installés dans un territoire quasi désertique, il serait peut-être possible d’éviter qu’un nouvel attentat ne se produise. La communauté internationale nous paraît incroyablement faible. La France et l’armée française ne sont pas en cause.
Général Pierre de Villiers. Je partage votre analyse politique, même si je n’ai pas à m’exprimer sur ce plan. C’est l’honneur de la France que d’avoir ce niveau d’engagement militaire. Ce n’est pas à nous de culpabiliser à l’égard d’un engagement qui serait insuffisant face à cette menace terrifiante pour les populations. Ce doit être une démarche internationale. Pour le reste, avec l’outil militaire dont nous disposons, nous pouvons difficilement faire plus contre le terrorisme.
M. le président Georges Fenech. Souvenez-vous de ce qu’avait déclaré Jean-Claude Juncker, président de la Commission européenne : la France a sauvé l’honneur de l’Europe. Nous terminerons peut-être sur cette appréciation. Il me reste à vous remercier, mon général.
Général Pierre de Villiers. Je vous remercie aussi pour l’intérêt que vous portez à ces sujets graves et importants, et j’espère que votre démarche et votre rapport joueront un rôle moteur.
M. le président Georges Fenech. Nous l’espérons. C’est vraiment l’objectif que nous nous fixons.
Audition, à huis clos, de M. Grégoire Doré, chef-adjoint de l'unité de coordination des forces d'intervention (UCOFI)
Compte rendu de l’audition, à huis clos, du mercredi 11 mai 2016
M. le président Georges Fenech. Nous recevons M. Grégoire Doré, chef adjoint de l’Unité de coordination des forces d’intervention (UCOFI). Il est accompagné du colonel Samuel Dubuis, membre du cabinet du directeur général de la gendarmerie nationale.
Monsieur le commissaire, nous vous remercions d’avoir répondu à la demande d’audition de notre commission d’enquête. Nous sommes d’autant plus désireux de vous entendre sur la rationalisation du commandement des opérations d’intervention, que le ministre de l’intérieur a présenté, le 19 avril dernier, le nouveau schéma national d’intervention des forces de sécurité qui crée notamment une procédure d’urgence absolue (PUA) permettant à toutes les unités d’intervenir en urgence sur tous les points du territoire sans critère de compétence autre que la proximité et la disponibilité immédiate.
En raison de la confidentialité des informations que vous êtes susceptible de nous délivrer, cette audition se déroule à huis clos. Elle n’est donc pas diffusée sur le site internet de l’Assemblée nationale. Néanmoins, et conformément à l’article 6 de l’ordonnance 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, son compte rendu pourra être publié en tout ou partie si nous en décidons ainsi à l’issue de nos travaux. Je précise que les comptes rendus des auditions ayant lieu à huis clos sont au préalable transmis aux personnes entendues afin de recueillir leurs observations. Ces observations sont soumises à la commission d’enquête, qui peut décider d’en faire état dans son rapport. Conformément aux dispositions du même article, sera punie des peines prévues à l’article 226-13 du code pénal toute personne qui, dans un délai de vingt-cinq ans, divulguera ou publiera une information relative aux travaux non publics d’une commission d’enquête, sauf si le rapport publié à la fin des travaux de la commission a fait état de cette information.
Conformément aux dispositions de l’article 6 précité, je vous demande maintenant de prêter le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité.
M. Grégoire Doré prête serment.
L’UCOFI a été créée en 2010, sous l’impulsion du ministre de l’intérieur Brice Hortefeux et à la demande du Président de la République Nicolas Sarkozy, afin de faciliter la collaboration des forces spéciales d’intervention. Elle était placée, à l’époque, sous l’autorité d’un général de gendarmerie secondé par un commissaire de police. Elle est devenue une passerelle, un lieu d’échange de connaissances, de partage des savoirs, des méthodes de négociation et d’action, des procédures radios, l’objectif étant qu’il n’y ait pas de perte de temps lors de la préparation d’un assaut. Elle est censée permettre aux unités réunies dans la force d’intervention de la police nationale (FIPN) – RAID, BRI de la préfecture de police, et groupes d’intervention de la police nationale (GIPN) outre-mer – et au GIGN d’harmoniser leurs techniques d’intervention.
Comment s’organise l’UCOFI ? Quels sont ses effectifs et comment se répartissent-ils entre les forces que j’ai citées ? Quelles procédures met-elle en place lors des interventions, je pense évidemment à celles qui ont eu lieu à l’Hypercacher et au Bataclan ?
M. Grégoire Doré, chef adjoint de l’Unité de coordination des forces d’intervention (UCOFI). Je suis très honoré d’être auditionné par votre commission d’enquête. D’une part, parce que c’est la première fois que l’UCOFI est sollicitée pour un tel exercice, d’autre part, en raison de l’importance de la problématique qui a motivé cette sollicitation et sur laquelle vous travaillez depuis plusieurs mois.
Mon propos liminaire portera sur les missions initiales et les réalisations de l’UCOFI depuis sa création ainsi que sur les mesures prises depuis les attentats de janvier 2015, puis de novembre 2015, ayant impliqué ou concerné l’UCOFI. Je conclurai en évoquant les perspectives de l’unité, notamment dans le cadre du schéma national d’intervention et de la procédure d’urgence absolue.
L’unité de coordination des forces d’intervention a été créée au sein du ministère de l’intérieur, le 1er juin 2010, à la suite de l’une des recommandations de la mission d’étude conduite par le général d’armée Guy Parayre et le contrôleur général Luc Presson. Organiquement rattachée à la direction générale de la gendarmerie nationale (DGGN), elle est fonctionnellement subordonnée aux deux directeurs généraux de la gendarmerie nationale et de la police nationale, et au préfet de police de Paris. Elle est animée par un officier de gendarmerie et par un commissaire de la police nationale. À sa création, elle était dirigée par un général de brigade de gendarmerie, secondé par un commissaire divisionnaire. Aujourd’hui, en tant que commissaire de la police nationale, j’ai l’honneur d’être à sa tête, secondé par un lieutenant-colonel de la gendarmerie. Cette structure est très rapidement appelée à être étoffée.
Aucun lien hiérarchique ne la rattache aux unités d’intervention de la gendarmerie et de la police nationales. Elle est chargée, sans remettre en cause leurs identités respectives, de donner davantage de cohérence, de transparence et d’efficience collective au dispositif des forces d’intervention du ministère de l’intérieur. Elle doit aussi les préparer à l’interopérabilité, qui est le cœur de mission de l’unité.
Au titre de son mandat initial, l’UCOFI a plusieurs missions :
Faciliter la coordination et la coopération entre les unités sans rechercher l’homothétie mais en favorisant, au contraire, les partenariats et les synergies opérationnelles. L’UCOFI a notamment permis d’élaborer un langage tactique opérationnel commun emprunté à celui de l’OTAN, car pour bien travailler ensemble, il faut employer les mêmes mots, par exemple « neutraliser », « fixer », « confiner ». L’unité suit aussi actuellement les travaux du service des technologies et des systèmes d’information de la sécurité intérieure (ST(SI)2) sur l’interopérabilité radioélectrique afin que les postes radio de l’ensemble des unités d’intervention soient interopérables, ce qui n’est pas le cas actuellement ;
Évaluer la mise en application des directives communes édictées par les directeurs généraux de la gendarmerie et de la police nationales ainsi que par le préfet de police, tant par des réunions fréquentes et régulières que par des visites sur le terrain ;
Faire la synthèse et évaluer, à l’attention des directeurs généraux et du préfet de police, les points de vue des chefs des unités d’intervention de la gendarmerie et de la police nationales, favorisant les convergences afin de tendre vers des interopérabilités ;
Élaborer des exercices conjoints et proposer des entraînements, des formations, des échanges, voire des procédures d’engagement commun. Elle peut ainsi proposer l’organisation de retours d’expérience (RETEX) des missions majeures, des entraînements et des exercices importants, et y participer ;
Assurer le suivi hebdomadaire et mensuel des activités des unités et en effectuer la diffusion aux autorités, services et unités qui ont droit et besoin d’en connaître. Elle doit être informée en amont des projets de convention et protocole qui lient ces unités à des partenaires publics ou privés, afin de veiller à leur cohérence au sein du ministère. Elle veille à la cohérence et à la pertinence des partenariats avec les armées en évitant les concurrences et en préservant les identités et cultures propres aux unités – je pense notamment au groupe interarmées d’hélicoptères (GIH). Elle doit être informée de toutes les actions internationales conduites par les deux forces, GIGN et RAID. Enfin, elle organise des réunions régulières avec les chefs des unités, et elle en adresse les comptes rendus aux deux directeurs généraux et au préfet de police de Paris.
À l’époque de sa création, l’UCOFI a effectué un premier recensement des différentes capacités développées par les unités d’intervention spécialisée du haut du spectre : le RAID, le GIGN, la BRI dans sa configuration BAC, les groupes d’intervention de la police nationale (GIPN), les groupes de pelotons d’intervention (GPI), les ex-pelotons interrégionaux d’intervention de la gendarmerie (PI2G), devenus des antennes du GIGN. Ce recensement, déclaratif, a été effectué en 2011, mis à jour une première fois en 2013, puis une deuxième fois en 2016, dans le cadre de l’élaboration du schéma national d’intervention.
Une note conjointe, rédigée par l’UCOFI en juillet 2014, a permis de formaliser la coopération et la coordination des unités d’intervention spécialisée de la gendarmerie et de la police nationales. Cette note, élaborée en concertation avec les unités d’intervention spécialisée, a posé des principes essentiels, dont celui du menant-concourant.
Dès sa création, l’UCOFI s’est penchée, avec les forces d’intervention, sur des scénarios concernant des tueries de masse ou planifiées, ou des prises d’otage de masse qui nécessiteraient des interventions conjointes. Un exercice de réaction à une tuerie de masse, avait été prévu en janvier 2015, au centre commercial Belle Épine, dans le Val-de-Marne, mais avait dû être annulé ; reprogrammé au centre commercial de Vélizy 2, le 17 novembre 2015, il avait de nouveau été annulé. Vous voyez, en tout cas, que la problématique des prises d’otages et des tueries de masse a été traitée très tôt par l’UCOFI, en particulier à partir de 2013 et l’attaque du centre commercial de Nairobi.
J’en viens aux mesures prises après les attentats de janvier 2015.
Le mardi 31 mars 2015, l’UCOFI a organisé un retour d’expérience sur la coordination entre les unités lors des attaques terroristes de janvier 2015. Ce RETEX s’est tenu à Bièvres, au siège du RAID, en présence des chefs du RAID, du GIGN, de la BRI et de l’UCOFI. Il en est notamment ressorti que l’articulation entre les deux forces a été efficace grâce à l’application du principe du menant-concourant dans la mission de recherche d’individus en fuite, en l’occurrence les frères Kouachi. Le GIGN a fait état d’une réflexion interne sur sa faculté à se déployer sur plusieurs crises avec des capacités dimensionnées aux besoins opérationnels.
Les événements de janvier 2015 ont également été l’occasion de mettre en œuvre un schéma simple de coordination : un assaut coordonné sans application du menant-concourant, chacun intervenant dans sa zone de compétence. Les deux forces se coordonnent au niveau des structures de commandement par l’intermédiaire d’officiers de liaison, sans conséquence sur l’organisation des postes de commandement. Ce premier niveau de coordination est acquis par les unités.
Au mois d’avril 2015, les sept groupes d’intervention de la police nationale (GIPN) de métropole, qui étaient tous rattachés à la direction centrale de la sécurité publique (DCSP), ont été intégrés à l’échelon central du RAID, à Bièvres, afin d’assurer une meilleure coordination et d’optimiser l’emploi des opérateurs qui composent ce « grand RAID ».
Réclamée par un mandat du ministre de l’intérieur, le 8 juin 2015, l’évolution de la doctrine d’intervention conjointe entre la police et la gendarmerie a été mise au point et a donné lieu à une note conjointe entre DGPN, DGGN et préfet de police, le 16 octobre 2015. Cette note met, en particulier, en avant le développement de la primo-intervention des forces d’intervention intermédiaire, notamment avec le plan BAC-PSIG, pour engager sans attendre les unités spécialisées Cette question a fait l’objet d’une annonce du ministre, le 30 octobre 2015, à Rouen. Ce principe constitue une véritable révolution doctrinale pour la police et la gendarmerie dans la gestion de ce type d’événement.
La doctrine d’intervention conjointe prévoit également la mise en place d’un volet équipement et formation pour optimiser la réponse en cas de crise – un plan d’équipement a été mis en place très rapidement.
S’agissant des attentats de novembre 2015, le RETEX a été intégré dans les réflexions du groupe de travail pour la rédaction du schéma national d’intervention.
Les deux directions, DGPN et DGGN, ont formulé le fruit de leurs réflexions respectives dans des notes spécifiques sur la gestion des tueries de masse, au mois de décembre 2015. La préfecture de police a adapté son dispositif de gestion de crise au moyen de la disposition générale EVENGRAVE, le 16 novembre 2015. Un mandat a été confié à l’UCOFI afin qu’elle élabore le schéma national d’intervention. Ce mandat a été signé et validé par les directeurs généraux et le préfet de police, le 31 décembre 2015, mais l’UCOFI y travaillait déjà depuis le 23 novembre.
Le schéma national d’intervention a été validé par les deux directeurs généraux et par le préfet de police le 23 mars 2016. Il a été présenté par le ministre le 19 avril 2016. Un exercice majeur, organisé par l’UCOFI, a eu lieu avec succès dans la nuit du 19 au 20 avril, à la gare de Montparnasse, pour illustrer le schéma national d’intervention. RAID, GIGN et BRI sont intervenus de manière coordonnée sur trois points distincts pour neutraliser une équipe de terroristes fictive lors d’une simulation de tuerie de masse.
Je termine avec les perspectives qui sont aujourd’hui les nôtres.
La mise en œuvre du schéma national d’intervention doit débuter par l’évaluation de trois premières capacités des forces d’intervention au cours de ce mois de mai. Dans ce cadre, l’UCOFI doit monter en puissance. L’unité a été renforcée par l’arrivée, le 28 mars 2016, d’un lieutenant-colonel de gendarmerie. Deux officiers, l’un de police, l’autre de gendarmerie, viendront prochainement l’étoffer.
L’UCOFI se positionne également comme le point d’entrée des forces d’intervention dans le cadre des travaux d’élaboration du protocole GIH et des plans gouvernementaux « Pirate » pour les forces d’intervention. Elle se rapprochera aussi des structures de coopération internationale pour savoir si une structure similaire de coordination existe à l’étranger, et éventuellement s’en inspirer.
Si vous le souhaitez, je vous communiquerai une synthèse des points principaux du schéma national d’intervention.
M. le président Georges Fenech. Il nous intéresserait, en effet.
Nous disposons d’un document du RAID, datant du 20 février 2014, qui indique que les auteurs des attaques de Bombay, In Amenas et Nairobi ont abattu la majorité des victimes dès les premières minutes. Il est précisé que « la volonté affichée de laisser le temps aux forces de sécurité d’arriver est flagrante. Bien qu’engagé dans une action suicidaire, les agresseurs ne se comportent pas en kamikazes mais combattent jusqu’au dernier moment, tentant de tuer le plus de victimes possible. Néanmoins l’assaut rapide des forces de l’ordre peut les surprendre et contrecarrer leur projet. »
Depuis lors, le nouveau mode opératoire de la FIPN préconise une intervention sans négociation. Cette doctrine a été fournie au ministre de l’intérieur ainsi qu’au directeur de l’UCOFI. Pourquoi ne pas avoir suivi cette recommandation au Bataclan ? La FIPN avait été déclenchée au mois de janvier, mais pas au Bataclan. Le document du 20 février 2014 indique pourtant clairement : « À la lumière de ces exemples récents, et devant la détermination dont font désormais preuve les terroristes islamistes radicaux, la FIPN travaille désormais sur une doctrine basée sur des assauts immédiats et sans négociation. » Pourquoi cette procédure n’a-t-elle pas été appliquée au Bataclan ?
M. Grégoire Doré. Lors de sa création, en 2009, la FIPN était composée de plusieurs entités : le RAID, les GIPN de la direction centrale de la sécurité publique et la BRI-BAC de la préfecture de police. La FIPN est une structure non permanente activée par le directeur général de la police nationale sur le territoire.
M. le président Georges Fenech. Les choses sont différentes à Paris.
M. Grégoire Doré. En effet, à Paris, il s’agit, en quelque sorte, d’une décision concertée car, si le DGPN reste l’autorité qui active la FIPN, il le fait sur proposition du préfet de police.
Aujourd’hui, les GIPN ayant rejoint « le grand RAID », la FIPN se compose du RAID et de la BRI-BAC. Il me semble que lors des événements que vous évoquez, la BRI-BAC, qui fait bien partie de la FIPN, a bel et bien appliqué la doctrine et les directives issues du retour d’expérience de la FIPN du mois de janvier.
M. le président Georges Fenech. Certes, mais si la FIPN avait été déclenchée, le RAID aurait pris les commandes. Nous sommes bien d’accord sur ce point ?
M. Grégoire Doré. Si elle avait été déclenchée, c’est en effet le chef du RAID qui aurait pris le commandement de la FIPN.
M. le président Georges Fenech. Pourquoi n’y a-t-il pas eu déclenchement de la FIPN lors des événements du Bataclan ?
M. Grégoire Doré. Je n’ai pas la réponse à cette question : je n’étais pas l’un des décisionnaires.
M. le président Georges Fenech. Nous le savons bien, mais, sous la foi du serment, vous devez pouvoir nous expliquer pourquoi, selon vous, la FIPN n’a pas été déclenchée lors de l’attaque du Bataclan, alors qu’elle l’avait été à l’Hypercacher.
M. Grégoire Doré. Parce que le directeur général de la police nationale n’a pas pris la décision de l’activer et que le préfet de police ne l’a pas proposé.
M. le président Georges Fenech. Quels critères, quels éléments ont-ils pu, selon vous, fonder cette décision ?
M. Grégoire Doré. Je ne peux que faire des suppositions. Les effectifs de la BRI-BAC étaient peut-être suffisants pour mener l’assaut. Le RAID étant intervenu en renfort, y avait-il nécessité d’activer la FIPN ? Je dois me contenter de formuler des hypothèses. Ces questions doivent être posées au directeur général de la police nationale et au préfet de police.
M. le président Georges Fenech. Monsieur le commissaire, j’ai le sentiment, qui n’est pas nécessairement partagé par tous les membres de la commission d’enquête, qu’il y a eu une véritable volonté de la BRI de conserver la direction de cette opération alors que l’ampleur de l’attaque aurait pu justifier que « l’antigang » en laisse la direction à une unité spécialisée dans ce type d’attaque. Nous avons entendu parler d’une sorte de « guerre des polices » – qui peut aussi éventuellement constituer une forme de saine émulation entre services. Je ne dis pas que la BRI a mal fait son travail, mais n’avez-vous pas le sentiment qu’il y a eu une espèce de concurrence entre les services ?
M. Grégoire Doré. En l’occurrence, je n’ai pas de sentiment : si la BRI a estimé qu’elle était capable d’intervenir, il est normal qu’elle ait pu intervenir. Cette unité est parfaitement légitime à intervenir d’initiative sur une tuerie de masse dans Paris.
M. le président Georges Fenech. Ce n’est pas à elle de prendre une telle décision !
M. Grégoire Doré. Pas exactement. Si cette décision relève du préfet de police, la BRI conserve néanmoins une certaine marge d’initiative, notamment en situation d’urgence. Concernant l’activation de la FIPN, il n’est pas de mon ressort de commenter les décisions du directeur général de la police nationale et du préfet de police.
M. le président Georges Fenech. Durant l’opération, avez-vous eu un lien avec le chef opérationnel de la BRI ou avec le préfet de police ?
M. Grégoire Doré. Je n’ai eu aucun contact avec eux. En effet, je tiens à rappeler que L’UCOFI n’est pas une structure de commandement opérationnel. À aucun moment, elle ne doit intervenir pour coordonner ou commander les forces d’intervention en opération. Sa mission consiste à tirer les conséquences de l’action.
Nous avons tiré un certain nombre de leçons de ce qui s’est passé au Bataclan, s’agissant notamment du commandement et de la coordination des unités intervenant dans une crise majeure ou multiple. Nous sommes chargés d’une réflexion stratégique pour que l’organisation soit la plus efficace possible lors des interventions opérationnelles, mais nous n’avons aucun rôle à jouer durant les opérations elles-mêmes.
M. le président Georges Fenech. Le soir de l’attaque du Bataclan, vous n’avez eu aucun contact avec le RAID ni avec le poste de commandement sur place ?
M. Grégoire Doré. Non.
M. le président Georges Fenech. C’est une procédure normale ?
M. Grégoire Doré. C’est normal, monsieur le président.
M. le président Georges Fenech. Cette procédure n’a pas été revue depuis ?
M. Grégoire Doré. Pour l’instant, elle n’a pas été revue.
M. le président Georges Fenech. Elle doit l’être ?
M. Grégoire Doré. Ce n’est pas prévu : nous laissons les opérations aux opérationnels. L’UCOFI est une unité de réflexion stratégique dont les missions ont été énumérées en propos liminaires.
M. Sébastien Pietrasanta, rapporteur. Quels sont les effectifs de l’UCOFI ?
M. Grégoire Doré. À ce jour, nous sommes deux. Dans sa configuration initiale, l’UCOFI était composée d’un policier et d’un gendarme, et ce dernier dirigeait l’unité.
M. le rapporteur. Pourquoi l’unité est-elle rattachée à la DGGN ?
M. Grégoire Doré. De nombreuses unités de coordination ont été mises en place lors du rapprochement entre la police et la gendarmerie. Elles doivent nécessairement être rattachées à une structure. L’unité de coordination des forces mobiles ou l’unité de coordination de sécurité des transports en commun sont, par exemple, rattachées à la DGPN, alors que l’unité de coordination de la lutte contre l’insécurité routière est organiquement rattachée à la DGGN. Mis à part le ministre, les deux directions générales sont les autorités suprêmes, il n’y a donc pas d’autre choix que de rattacher une unité à l’une ou l’autre d’entre elles.
M. le rapporteur. Comme le disait notre président, nous avons senti qu’il existait une « saine » concurrence entre les trois forces d’intervention. Dans ce contexte, le commissaire de police que vous êtes considère-t-il que le rattachement de l’UCOFI à la DGGN permet à l’unité d’être suffisamment écoutée par le RAID et par la BRI ?
M. Grégoire Doré. Lorsque le directeur général de la gendarmerie nationale m’a convoqué pour m’expliquer qu’il sortait du bureau du ministre et qu’il fallait mettre en œuvre un schéma national d’intervention, il a fait entièrement confiance à un commissaire de police pour rédiger ce document.
M. le rapporteur. Cela marche-t-il aussi bien dans l’autre sens ? Le RAID et la BRI font-ils confiance à l’UCOFI, unité rattachée à la DGGN ? L’unité dispose-t-elle de l’autorité nécessaire pour accomplir les nombreuses missions que vous nous avez décrites ?
M. Grégoire Doré. Assurément, j’en veux pour preuve la mise au point du schéma national d’intervention en si peu de temps. Cette rédaction n’aurait pas été possible si les forces d’intervention n’avaient pas coopéré ni ne s’étaient intégrées volontairement aux travaux menés par l’unité de coordination.
M. le rapporteur. Le schéma national d’intervention constitue une avancée, notamment parce qu’il assouplit le principe des compétences territoriales, mais le principe selon lequel le premier sur place intervient me paraît porteur d’effets pervers. Hors de Paris, l’on me dit que le maillage territorial des antennes du RAID et du GIGN éviterait tout risque de chevauchement. Qu’en pensez-vous ?
M. Grégoire Doré. La procédure d’urgence absolue prévue par le schéma national d’intervention permet à l’unité disponible la plus proche d’intervenir. Cette procédure concerne évidemment les unités d’intervention spécialisée du haut du spectre, mais également les unités d’intervention intermédiaire, comme les BAC ou les PSIG. Il ne s’agit pas d’organiser une course, mais d’évaluer, à l’instant où une crise se produit, qui est en mesure d’intervenir le plus rapidement.
Le schéma national d’intervention a permis de revoir la cartographie des forces d’intervention spécialisée. Sept nouvelles unités se répartissent sur le territoire national de façon cohérente. Des antennes du RAID et du GIGN ont été créées dans plusieurs villes de métropole, et une autre a été ouverte en outre-mer par la gendarmerie de manière à ce que l’ensemble du territoire national soit couvert.
Il n’y a pas de course à qui interviendra le premier. Simplement, la procédure permet à l’unité la plus proche et la plus disponible d’intervenir.
M. le rapporteur. Il y a la théorie et la pratique. Rien ne prévoyait, par exemple, que le GIGN se positionne en plein cœur de Paris, à la caserne des Célestins, comme il l’a fait lors des attaques du 13 novembre. Cela était pourtant extrêmement utile.
Dans la pratique, en cas d’attentats multiples sur une zone restreinte, plusieurs forces pourraient converger en même temps vers le site. Dans ce cas, les premiers arrivés prendraient donc la responsabilité des opérations ?
M. Grégoire Doré. Non, car, selon le principe du menant-concourant, l’unité qui se trouve dans sa zone prend le commandement des opérations. En zone police nationale, le RAID dirigerait les opérations ; en zone gendarmerie, ce rôle reviendrait au GIGN, et, à Paris, il échoirait à la BRI, sauf activation de la FIPN, auquel cas le RAID prendrait les rênes.
Le principe du menant-concourant permet aux unités territorialement compétentes d’avoir recours, si nécessaire, à d’autres qui ne le sont pas. Pour autant, la procédure d’urgence absolue permet à des unités qui ne sont pas territorialement compétentes mais qui sont proches et disponibles de se rendre sur place et de prendre provisoirement le commandement des opérations jusqu’à l’arrivée de la force menante.
M. le rapporteur. Les trois forces d’intervention que nous avons interrogées nous ont expliqué que, sur le plan opérationnel, il était préférable que la force présente sur place en premier devienne menante, quelle que soit la compétence territoriale : elle a davantage d’informations, elle a pris possession des lieux, elle a figé la situation… La modification du commandement en cours d’opération et le rétablissement du critère de la compétence territoriale ne posent-ils pas un problème ?
M. Grégoire Doré. Il ne faut pas sous-estimer le bon fonctionnement des unités, leur capacité à coopérer et la bonne volonté de leurs chefs. La reprise du commandement par une unité qui arrive sur un lieu se fait en concertation. Si une action est engagée par une unité, elle ne va pas s’interrompre parce qu’une autre unité se présente.
M. le rapporteur. À quel moment une action est-elle engagée ? La BRI était présente à l’Hypercacher bien avant le RAID. C’est pourtant ce dernier qui a engagé l’action.
M. Grégoire Doré. Les opérationnels pourront vous répondre sur les détails des événements. Disons qu’une action est opérationnellement engagée au « top assaut » ou, par exemple, lorsque des colonnes progressent vers un point névralgique.
M. le rapporteur. Dès lors que le schéma national d’intervention et la nouvelle doctrine d’emploi préconisent d’intervenir immédiatement, le fait d’attendre l’unité territorialement compétente n’a plus de sens.
M. Grégoire Doré. Vous avez raison de souligner ce point. De façon générale, les forces d’intervention spécialisée ne sont pas nécessairement primo-intervenantes sur tout le territoire.
Imaginons qu’il se produise quelque chose à Orléans, où le RAID ne se trouve pas. Qui interviendra immédiatement ? Ce sera la police territoriale, la BAC, le PSIG de la compagnie. Si nous nous trouvons en limite de zone police, dans la périphérie d’Orléans, et qu’un véhicule du PSIG se trouve à proximité, il interviendra en premier, avant la BAC.
Le schéma national d’intervention prévoit l’organisation des forces d’intervention spécialisée mais aussi intermédiaire, qui sont réparties sur tout le territoire national, soit presque huit cents unités au total. Les forces d’intervention spécialisée ont quasiment toujours besoin d’un délai avant d’intervenir, sauf à Paris. Avec le RAID à Bièvres, le GIGN à Satory, et la BRI sur place, le problème à Paris n’est pas le délai de réaction, c’est l’organisation des forces.
M. le président Georges Fenech. Dans le cadre de la procédure d’urgence absolue, la force qui intervient en premier est celle qui se trouve la plus proche du lieu de crise. À Paris, ce devrait être la BRI puisque, comme vous venez de l’indiquer, elle se trouve sur place. Or, dans la simulation que vous avez organisée le mois dernier à la gare Montparnasse, le RAID a pris le commandement. L’unité parisienne aurait pourtant dû être la force menante.
M. Grégoire Doré. Dans une tuerie de masse, il faut agir immédiatement. Le schéma national d’intervention organise l’immédiateté de l’intervention. Une unité doit d’abord « fixer » la situation. Au Bataclan, un commissaire de la BAC 75N est intervenu le premier : il a abattu l’un des terroristes, ce qui a mis fin à la tuerie. Ensuite, il faut « réduire » définitivement la crise, ce qui ne relève pas des forces d’intervention intermédiaire – BAC, PSIG, pelotons d’intervention d’escadron de gendarmerie mobile ou CRS (SPI-4G). L’unité d’intervention spécialisée – GIGN, RAID, BRI – disponible la plus proche intervient alors rapidement, avant que ne s’organise éventuellement par la suite une reprise de commandement. En fait, c’est la chronologie qui guide l’organisation des opérations.
M. le président Georges Fenech. Pourquoi le RAID est-il intervenu d’entrée de jeu à la gare Montparnasse ?
M. Grégoire Doré. Le RAID n’est pas exactement intervenu d’entrée de jeu. Selon le scénario que nous avions établi pour simuler une attaque de la gare Montparnasse, neuf terroristes étaient répartis en trois équipes, l’une commettant une tuerie dans la galerie commerciale, pendant que les deux autres faisaient de même dans un TGV. C’est la BAC 75N qui est intervenue la première, aidée par la force d’intervention rapide de la BRI qui a abattu un terroriste. Après quoi, les autres se sont retranchés. C’est ensuite que les forces d’intervention spécialisée sont intervenues.
M. le président Georges Fenech. À nouveau, pourquoi le RAID ?
M. Grégoire Doré. En l’espèce, nous avons décidé qu’il était arrivé rapidement et que la FIPN avait été activée. Nous aurions pu faire une autre hypothèse. La restitution correspondait au scénario élaboré.
M. le rapporteur. Dans le cadre du nouveau schéma national d’intervention, la FIPN a-t-elle encore un sens ?
M. Grégoire Doré. Elle permet de regrouper les forces de la police nationale si nécessité il y a.
M. Philippe Goujon. Le critère de proximité semble être le seul à jouer pour savoir quelle force intervient lors d’une attaque. N’en existe-t-il pas d’autres ? Une unité peut disposer d’un savoir-faire plus adapté qu’une autre à un type d’opération, elle peut avoir une meilleure connaissance du terrain, bénéficier de spécialistes absents d’une autre force.
Si l’on tient compte du seul critère de proximité, et que deux forces se disent prêtes à intervenir – imaginons que ce soit le cas, à Paris, de la BRI, du RAID et du GIGN –, qui choisit l’unité à engager ?
Dans les faits, les BAC ou PSIG que vous décrivez comme les primo-intervenants seront rarement les premiers sur place : il y a davantage de chance que ce soit des personnels de la brigade de gendarmerie ou du commissariat le plus proche – appelons-les primo-arrivants. Comment les choses s’articulent-elles entre ces derniers et les primo-intervenants, sachant qu’il faut détruire immédiatement l’élément terroriste pour éviter un massacre ?
La doctrine d’emploi a-t-elle évolué s’agissant des militaires de l’opération Sentinelle ? Ils sont plusieurs milliers à Paris notamment, où ils seront nécessairement amenés à intervenir d’une façon ou d’une autre en cas d’attaque.
M. Jean-Michel Villaumé. Je souhaite, moi aussi, savoir comment votre mission de coordination s’articule avec l’opération Sentinelle menée par l’armée.
Estimez-vous qu’il soit aujourd’hui toujours pertinent de disposer de trois unités d’élite également performantes et qualifiées ? Ne pourraient-elles pas travailler ensemble et, à terme, être regroupées ? Il s’agit d’une réflexion personnelle, sans doute partagée par certains d’entre nous qui ont du mal à suivre la description de dispositifs touffus aux intervenants multiples. Ce regroupement me semble constituer un objectif prioritaire à moyen terme. La synthèse des travaux de notre commission d’enquête devra en faire état.
M. Olivier Marleix. Je suis surpris de ne jamais entendre évoquer le rôle du ministre. Il est pourtant, à ma connaissance, la seule autorité hiérarchique directe de commandement de la police nationale et de la gendarmerie nationale. Si l’on excepte son directeur de cabinet, qui peut le seconder, il n’existe aucune autre autorité de coordination.
Sur une attaque multisite, comme celle du 13 novembre 2015, le choix de ne pas déclencher la FIPN peut se comprendre – on nous a expliqué que le fait de ne pas savoir ce qui pouvait se produire ailleurs avait poussé à conserver la capacité du RAID et du GIGN en réserve. Dont acte ! Toutefois, à mon sens, un tel choix, relève du ministre.
À l’avenir, qui décidera de la mise en œuvre de la procédure d’urgence absolue ? Qui décidera de la mise en œuvre de la fonction de commandant et de coordinateur des opérations d’intervention spécialisée, telle qu’elle est prévue dans le nouveau schéma national d’intervention ? Quel doit être le rôle du ministre dans ce type d’intervention ?
M. Grégoire Doré. Toutes ces questions ont été prises en compte dans le schéma national d’intervention.
La proximité n’est pas le seul critère à prendre en compte pour faire intervenir une unité. Il faut savoir si elle est disponible : elle peut être en déplacement pour un entraînement loin de son lieu implantation, donc ne pas pouvoir intervenir, mais elle peut le faire, si besoin, là où elle se trouve. En outre, certaines unités ont développé davantage que d’autres des capacités spécifiques. Le schéma national d’intervention prend cette donnée en compte : il recense cent trente capacités nécessaires et fixe huit domaines qu’il faut maîtriser pour pouvoir intervenir dans les cas de tuerie. Ces capacités ont été normées et seront testées sous l’égide de l’UCOFI.
Une unité qui maîtrise moins bien qu’une autre une capacité peut avoir recours à celle-ci grâce à la procédure de concours capacitaire. Cette procédure s’applique soit par modularité – par exemple, pour effectuer une effraction complexe, on fait appel au module « effraction » d’une autre unité très spécialisée dans ce domaine –, soit par complémentarité, pour compléter avec des membres d’une autre unité un effectif qui ne serait pas suffisant. En tout état de cause, tout est organisé de manière à optimiser la réponse.
Si deux forces arrivent en même temps sur un lieu, il n’est pas nécessaire de prendre une décision. Les unités savent où elles doivent intervenir ; elles connaissent leur zone de compétence. Le principe du menant-concourant permet ensuite de définir un cadre, sauf en cas d’application de la procédure d’urgence absolue qui fait primer l’unité arrivée sur place en premier. Par ailleurs, les unités se parlent et s’entendent : si elles arrivent concomitamment sur place, l’unité menante prendra le commandement des opérations. Cela ne pose aucune difficulté majeure.
La note conjointe de la DGGN, de la DGPN et de la préfecture de police, du 16 octobre 2015, organise l’articulation de la primo-intervention en cas de tuerie de masse. Elle révolutionne une doctrine séculaire, partagée par la police et la gendarmerie, selon laquelle les unités non spécialisées dans le contre-terrorisme n’intervenaient pas. Désormais, l’objectif étant de mettre fin à la tuerie, tous les personnels qui arrivent sur place armés y contribuent. Quand ils ont les moyens de mettre fin à la tuerie, alors ils ont l’obligation de la faire – comme le commissaire de la BAC 75N au Bataclan.
Cependant, il ne s’agit pas que les primo-arrivants ou les primo-engagés « aillent au carton » ; il ne faut pas en faire des cibles. Un îlotier, un vététiste, une équipe de police-secours ne disposent pas de l’équipement nécessaire pour intervenir ; ils doivent donner l’alerte afin que les unités d’intervention intermédiaire arrivent dans les délais les plus brefs – il peut s’agir de quelques secondes. C’est dans cet esprit que le plan BAC-PSIG dévoilé par le ministre de l’Intérieur en octobre 2015 a permis de « monter en gamme » les BAC et les PSIG Sabre, afin de leur donner des capacités de primo-intervention avec le souci d’une couverture géographique rehaussée. Les unités d’intervention spécialisée ne prennent le relais qu’ensuite, afin de réduire définitivement la crise, s’il y a lieu.
Le schéma national d’intervention, dans sa version actuelle, est circonscrit aux forces de sécurité intérieure. Si les forces armées donnent aujourd’hui un coup de main essentiel aux forces de sécurité intérieure, elles sont considérées comme un élément visible qui rassure la population sans intervenir. Si elles intervenaient, elles le feraient après avoir été sollicitées dans le cadre de protocoles spécifiques. Les forces de sécurité intérieure détiennent l’ensemble des capacités d’assaut nécessaires.
Le schéma national d’intervention est néanmoins révisable : chaque fois que cela est nécessaire, et au moins chaque année. Il est donc possible de réfléchir à la place des forces armées. Cela dit, nous ne sommes pas encore en état de siège – espérons ne jamais y être – et certains principes juridiques empêchent les forces armées d’intervenir au même titre que les forces de sécurité intérieure. Une expérimentation de collaboration entre les forces a néanmoins été menée en Isère ces deux dernières semaines. Ce n’est pas vraiment mon domaine, mais je crois savoir qu’elle a donné totalement satisfaction. Elle doit désormais faire l’objet d’un RETEX qui permettra d’évaluer l’articulation entre les forces.
Est-il pertinent de disposer de trois unités d’élite ? À vrai dire, il y a bien trois unités principales, mais il faut aussi compter toutes les antennes du RAID et du GIGN, et toutes les forces d’outre-mer.
M. le président Georges Fenech. Elles sont trois même si elles se déclinent sur le territoire. Pourrait-on imaginer qu’il n’existe qu’une seule force ?
M. Grégoire Doré. Votre question implique qu’il n’y ait plus qu’une seule force de sécurité intérieure.
M. le président Georges Fenech. Il n’y aurait plus de distinction entre gendarmerie nationale et police nationale, pour la force d’élite.
M. Grégoire Doré. Le GIGN a un statut militaire qui lui permet notamment d’intervenir à l’étranger. Il entretient des relations avec les forces spéciales et fonctionne avec le commandement des opérations spéciales. Le RAID constitue une force civile de police nationale qui travaille régulièrement sur des missions de police judiciaire et de renseignement avec la DGSI. La complémentarité s’opère d’excellente manière : elle me paraît constituer un atout majeur. Il me semble, à titre personnel, que la remise en question des différents statuts ne mérite pas que l’on s’y penche.
M. le président Georges Fenech. Certains pays ne disposent pourtant que d’une seule force d’intervention spécialisée.
M. Grégoire Doré. Les opérateurs du GIGN, du RAID, de la BRI se connaissent, se fréquentent et se parlent. Les statuts civils et militaires permettent de mener des opérations différentes sur des théâtres différents. Peut-être vouliez-vous m’emmener sur le terrain d’une éventuelle réflexion sur un commandement unique…
M. le président Georges Fenech. Quid du rôle du ministre qu’évoquait M. Olivier Marleix ?
M. Grégoire Doré. Le ministre a piloté lui-même les travaux du schéma national d’intervention. Il a pris connaissance personnellement du compte rendu de chacun de nos travaux et de chaque avancée du schéma, dont il suit aujourd’hui chaque étape de la mise en œuvre. Il a ainsi rédigé le courrier saisissant l’UCOFI au sujet de la vérification des capacités. Il est donc totalement impliqué.
M. Olivier Marleix. En lisant le schéma national d’intervention, je n’ai pas vu à quel moment le ministre de l’intérieur intervenait lui-même ni quand il prenait des décisions.
M. Grégoire Doré. Ce document est à l’en-tête du ministère de l’intérieur. Le ministre est présent à chaque ligne et à chaque page du schéma national.
M. Olivier Marleix. Nous avons constaté, lors de la dramatique soirée du 13 novembre, en particulier au Bataclan, que la coordination entre police et gendarmerie devait, à un moment donné, pouvoir s’incarner. Concrètement et opérationnellement, elle ne peut être endossée, place Beauvau, que par le ministre lui-même. Physiquement, personne d’autre ne peut donner d’ordres à la fois au DGPN et au DGGN. Je suis surpris que le schéma d’intervention n’explicite pas de façon plus précise la part de responsabilité que le ministre prendra en cas de crise majeure se déroulant simultanément en plusieurs points du territoire.
M. Grégoire Doré. Il me semble clair que le ministre pilote les opérations quelle que soit la crise. On a vu que la coordination, tant au salon-fumoir du ministère de l’intérieur qu’au sein de la cellule interministérielle de crise, était assurée par le ministre en personne. Au salon-fumoir, où se trouvaient les directeurs généraux de la police et de la gendarmerie ainsi que le préfet de police, c’est bien le ministre qui était à la manœuvre.
Le schéma national d’intervention confie un rôle opérationnel aux « sachants » que sont les directeurs généraux de la police et de la gendarmerie, et le préfet de police. Le ministre prend évidemment les décisions nécessaires et assure la coordination. En cas de crise multizone de compétence, le ministre pilote nécessairement les opérations. Le schéma national d’intervention prévoit (p.27) que le coordinateur des opérations d’intervention spécialisée, i.e. le chef du RAID et/ou du GIGN, qui coordonne en cas de crises multiples, « se positionne toujours auprès de l’autorité qui coordonne les opérations (préfet de police, directeur général, ministre de l’Intérieur) comme conseiller technique ».
M. Serge Grouard. La modification, en avril dernier, de la doctrine d’intervention par le schéma national démontre qu’il a fallu attendre les attentats en France, en particulier ceux de novembre, pour adapter notre outil opérationnel alors que d’autres attentats de masse avaient eu lieu à l’étranger – y compris dans des pays européens – et que nos services de renseignement n’étaient pas avares d’avertissements au sujet de la menace.
S’agissant des structures des unités d’intervention spécialisée, on peut comprendre qu’il existe des statuts différents et des histoires spécifiques. Mais pourquoi n’avoir pas organisé un commandement unique ? Nous souhaitons effectivement vous emmener sur ce terrain, car cette solution résoudrait toutes les questions de coordination. Un gendarme et un policier pourraient diriger ces forces à tour de rôle – de la même façon que le chef d’état-major des armées est alternativement issu de l’armée de l’air, de l’armée de terre et de la marine.
Par ailleurs, avez-vous tiré d’autres conséquences des événements de 2015 que celles traduites dans le schéma national d’intervention ?
M. Grégoire Doré. Il est vrai que les travaux relatifs au schéma national d’intervention ont commencé après les attentats de novembre 2015. Pour autant, le ministère de l’intérieur n’était pas resté sans rien faire alors que des attentats se déroulaient à l’étranger et que la menace était annoncée.
J’ai présenté dans mon propos liminaire ce qui avait été décidé, notamment dans le cadre des tueries de masse. Ainsi, le 8 juin 2015, un mandat du ministre définissait l’organisation pour faire évoluer la doctrine, dont découlent la note du 16 octobre relative à la primo-intervention et le plan BAC-PSIG présenté par le ministre à Rouen, le 30 octobre. L’instruction commune aux forces d’intervention spécialisée date, elle, de 2014. Elle a été rédigée après le retour d’expérience des attentats de Bombay et de Nairobi qui a permis de définir le principe menant-concourant. Elle comportait déjà deux articles essentiels qui ont été repris dans le schéma national d’intervention : la procédure du concours capacitaire et celle de l’urgence absolue. En réalité, le schéma national reprend des éléments existants en les précisant et en les élargissant après les événements de 2015, mais nous n’avons pas eu besoin d’être au pied du mur pour engager une réflexion.
Un commandement unique des forces d’intervention fait partie des solutions évoquées ; c’est l’une des pistes de réflexion. L’exemple du commandement des opérations spéciales (COS) est souvent cité, mais outre qu’il existe une différence de statut entre civils et militaires, il n’y a pas d’état-major des forces de sécurité intérieure comme il existe un état-major des armées auquel le COS est rattaché. Qui plus est, le chef de l’État est chef des armées, alors que le ministre de l’intérieur est le « premier flic de France ». Si le commandement unique semble constituer, en apparence, une solution évidente et simple, elle n’est peut-être pas la réponse la plus efficace qui soit.
M. Jean-Luc Laurent. L’exercice récent qui a eu lieu en Isère avec les forces armées me conduit à penser qu’une nouvelle entité issue de ces forces, impliquant des hommes et des matériels, va venir s’ajouter aux unités d’intervention spécialisée déjà nombreuses sur le terrain. Je suis inquiet à ce sujet. Quel est votre niveau d’information sur l’exercice en question et sur les matériels mobilisés ? Des projets d’acquisition sont-ils en cours afin de poursuivre l’expérimentation engagée ?
M. Grégoire Doré. Il ne faut pas se tromper s’agissant de nos forces armées qui contribuent à la sécurité nationale dans le cadre de l’opération Sentinelle : en matière de sécurité publique, elles n’agissent pas de manière autonome et elles ne disposent d’aucun pouvoir juridique. Un retour d’expérience permettra d’évaluer cette expérimentation qui ne relève pas du tout de mon domaine. Nous pourrions vous faire passer une note à ce sujet.
M. le président Georges Fenech. Monsieur le commissaire, il me reste à vous remercier pour votre importante contribution à nos travaux.
Table ronde, ouverte à la presse, de spécialistes du Moyen-Orient : M. Pierre-Jean Luizard, historien, directeur de recherche au Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ; M. Béligh Nabli, directeur de recherche à l’Institut de relations internationales et stratégiques (IRIS) ; M. Wassim Nasr, journaliste à France 24 ; M. Pierre Razoux, directeur de recherche à l’Institut de recherche stratégique de l’École militaire (IRSEM)
Compte rendu de la table ronde, ouverte à la presse, du jeudi 19 mai 2016
M. le président Georges Fenech. Nous vous remercions, messieurs, d’avoir répondu à notre demande d’audition. Nous allons nous intéresser avec vous aux aspects politiques, diplomatiques et militaires de la situation au Levant et approfondir notre réflexion sur des questions dont nous mesurons, bien entendu, la complexité.
Cette table ronde est ouverte à la presse et fait l’objet d’une retransmission en direct sur le site internet de l’Assemblée nationale. Son enregistrement sera également disponible pendant quelques mois sur le portail vidéo de l’Assemblée, et la commission pourra décider de citer dans son rapport tout ou partie du compte rendu qui sera fait de cette audition.
Conformément aux dispositions de l’article 6 de l’ordonnance du 17 novembre 1958, relatif aux commissions d’enquête, je vous demande de prêter le serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité.
M. Pierre-Jean Luizard, M. Béligh Nabli, M. Wassim Nasr et M. Pierre Razoux prêtent successivement serment.
Quels phénomènes ou événements expliquent, selon vous, l’émergence et la progression de Daech en Irak, et de Daech et Jabhat al-Nosra en Syrie ?
Quels sont les soutiens extérieurs dont pourraient bénéficier ces deux organisations ?
Comment le nombre de combattants étrangers qui y sont intégrés a-t-il évolué au cours de l’année écoulée ?
Dans quelle mesure les deux organisations bénéficient-elles du soutien des populations locales dans les territoires qu’elles contrôlent ? Y a-t-il eu des soulèvements populaires contre leurs combattants ?
Quel est votre point de vue sur l’action de la coalition mondiale contre Daech, formée en septembre 2014, notamment sur la place de la France en son sein ?
Que pensez-vous de la position du gouvernement français vis-à-vis du régime de Bachar el-Assad ? Le départ de celui-ci vous apparaît-il comme une condition préalable à la reconstruction politique du pays ?
Que pensez-vous du soutien apporté par la France au régime irakien ?
Quel est votre point de vue sur les résultats militaires des frappes aériennes en Irak et en Syrie ? Quel a été l’effet de l’intensification des frappes françaises à compter de septembre 2015 ?
Les frappes aériennes en Irak et en Syrie ont-elles des conséquences sur l’attractivité de Daech et, si oui, lesquelles ?
Les frappes aériennes en Irak et en Syrie ont-elles un effet sur la capacité de Daech à organiser et à mettre à exécution des attaques terroristes au Moyen-Orient et en Europe ?
Les récents revers militaires subis par Daech et la contraction des territoires qu’elle contrôle sont-ils susceptibles d’entraîner la multiplication d’actions de guerre asymétrique, c’est-à-dire d’attaques terroristes en guise de « représailles » ?
La guerre contre Daech peut-elle, selon vous, être remportée sans intervention de troupes au sol ?
Quel est votre point de vue sur le rôle joué par la Turquie dans la lutte contre Daech et contre le retour des djihadistes en Europe ?
Comment jugez-vous la situation en Libye et au Yémen ? Quel est l’état des forces de Daech dans ces deux pays ?
Enfin, quel est l’état de la menace que représente, pour la France et les intérêts français à l’étranger, Al-Qaida en général et Jabhat al-Nosra en particulier ?
Sur ces nombreuses questions, nous aimerions avoir l’éclairage des spécialistes reconnus que vous êtes.
M. Pierre-Jean Luizard, historien, directeur de recherche au Centre national de la recherche scientifique (CNRS). Merci beaucoup de votre invitation.
On entend très souvent parler de la manière de lutter contre le terrorisme ou de déradicalisation, et ces questions sont certainement légitimes, mais elles relèvent souvent d’une vision « psychologisante » du djihadisme, qui fait de celui-ci une maladie ou une déviance que l’on pourrait traiter à la façon d’une addiction. Or, si cette dimension psychologique a son importance dans chaque cas individuel, elle ne saurait occulter les enjeux politiques et historiques du chaos auquel le Moyen-Orient est aujourd’hui en proie et dont est né un vaste mouvement qui nous touche jusque dans nos pays, puisqu’il existe désormais un volet occidental, sinon dans la stratégie de Jabhat al-Nosra, du moins dans celle de l’État islamique qui vise un djihad globalisé.
L’origine du conflit se situe, à mon avis, en Irak. La faillite et l’échec de la reconstruction politique de l’État irakien par les Américains à la suite de leur intervention en 2003 – qui n’avait elle-même fait que porter les derniers coups, après de nombreuses crises et guerres, à l’État irakien fondé en 1920 par la puissance mandataire britannique – ont entraîné dans leur sillage la crise et la déliquescence d’autres États. L’État syrien est la première victime de la guerre en Irak. La division du territoire irakien en trois entités – kurde, chiite, sunnite – à prétention étatique pose directement le problème de l’avenir de l’État irakien dans ses frontières actuelles et de la communauté arabe sunnite en Irak, qui représente 20 % de la population et qui ne se reconnaît plus dans l’État irakien, dont elle a eu le monopole pendant plus de quatre-vingts ans, entre 1920 et 2003. On voit aujourd’hui – j’étais à Bagdad il y a quelques jours – les limites de ce système politique, avec l’intrusion de milliers de manifestants dans un Parlement totalement paralysé par les allégeances communautaires. Mais ce système n’est pas réformable, car il entrave le développement des institutions publiques et d’un espace public minimal, et il empêche l’État de répondre sur une base citoyenne à des revendications fondamentales de la société civile, telles que l’accès à l’électricité. Les coupures d’électricité sont ainsi monnaie courante à Bassora, ce qui paraît d’autant plus scandaleux qu’il s’agit d’une ville riche, car située au milieu d’une zone pétrolière.
On assiste aujourd’hui à une remise en cause généralisée de certains États arabes au Moyen-Orient, dont trois – l’Irak, la Syrie, le Liban – qui ont en commun leur genèse mandataire. Les crises propres à chacun de ces trois États interagissent entre elles. La crise dont l’origine se situe en Irak, berceau de l’État islamique, s’est déplacée en Syrie par un jeu de dominos, et l’on n’imagine pas que l’effondrement de l’État syrien puisse laisser l’État libanais indemne.
Ce volet oriental pose à nos diplomaties une question grave : devons-nous œuvrer à restaurer les États en crise et en faillite ou, au contraire, devancer, ce qui a fait la force de l’État islamique, la mort programmée d’institutions politiques qui ne sont pas réformables et qui sont incapables de répondre aux revendications basiques de la société civile ? C’est un grand défi, dans la mesure où les diplomaties ont pour fonction de reconnaître les États et les frontières en place. Mais c’est une question qui se pose dès lors que le système étatique et frontalier est remis à plat au point que des acteurs interviennent sur le territoire d’un pays depuis le pays voisin comme s’il n’y avait plus de frontières entre eux. Nous anticipons, d’une certaine façon, cette évolution lorsque les autorités françaises traitent directement avec les autorités kurdes pour leur livrer de l’armement et leur apporter une aide militaire, sans en référer au ministère compétent à Bagdad.
Voilà pour ce qui concerne le volet oriental de l’origine du terrorisme qui s’est ensuite emparé de certains pays occidentaux. Le volet occidental de l’État islamique est très différent, car le passé colonial et mandataire ainsi que le contexte confessionnel en sont absents. Mais d’autres facteurs y sont habilement exploités par ceux qui appellent au djihad.
D’abord, une histoire coloniale au cours de laquelle les principes républicains ont été systématiquement mis en contradiction avec eux-mêmes, spécifiquement en France. Ainsi, par le décret Crémieux, des élites laïques et républicaines ont accordé aux juifs d’Algérie, sur une base confessionnelle, la citoyenneté française qu’ils refusaient aux musulmans et qu’ils ont ensuite octroyée en Algérie aux Européens d’obédience catholique. De même, la loi de 1905 n’a pas été appliquée aux musulmans d’Algérie. De manière générale, les idéaux républicains ont été perçus par les populations colonisées comme une légitimation du fait colonial – à juste titre, comme le montre le discours de Jules Ferry sur la colonisation. Même Clemenceau qui, de l’intérieur du camp républicain, avait critiqué cet a priori pro-colonial a à son tour justifié, une fois au pouvoir, le protectorat au Maroc.
Si cette histoire n’est évidemment pas connue des apprentis djihadistes qui partent de nos pays pour faire la guerre en Syrie et en Irak, elle alimente un grand récit dans lequel les musulmans se présentent comme les adeptes de la religion du colonisé, un discours très confus et très vague mais qui, dans le contexte français en particulier, fait mouche. En effet, nous vivons aujourd’hui une crise identitaire dont témoignent notamment les impasses de notre laïcité, dont ni la laïcité stricte de notre Premier ministre ni celle du président de l’Observatoire de la laïcité ne permet de sortir. La laïcité, qui fut une religion civile pour la France pendant plus d’un siècle, est aujourd’hui remise en cause et ne suffit plus à poser les fondements du vivre-ensemble. Pour vivre ensemble, il faut un minimum d’identité, et la demande d’identité se renforce à mesure que l’on descend l’échelle sociale. Ce sont très probablement ces no man’s land identitaires, joints à la perception confuse d’un passé colonial où l’islam a joué le rôle que j’ai décrit, qui expliquent que des jeunes qui ont de l’islam une notion vague et de l’histoire coloniale une notion encore plus vague s’engagent sur la foi d’un discours idéologique dans lequel ils trouvent des raisons d’espérer. Pourquoi un tel discours donne-t-il de l’espoir alors que les idéaux républicains semblent y avoir échoué, en tout cas pour une fraction de notre jeunesse ? C’est sans doute sur ce point que nous devons réfléchir.
M. le président Georges Fenech. Vous insistez surtout sur la désagrégation de l’État irakien. Qu’en est-il de la question syrienne ?
M. Wassim Nasr, journaliste à France 24. Ce qu’a dit M. Luizard à propos de l’État irakien s’applique tout à fait à l’État syrien. Il faut tenter de sortir du point de vue occidental sur cette région pour considérer ses dynamiques internes selon lesquelles, à chaque fois, les communautés passent du statut d’opprimé à celui d’oppresseur. Ainsi, ce qui se passe en Syrie n’est ni plus ni moins qu’une guerre de survie pour les deux communautés qui s’affrontent – car c’est bien de cela qu’il s’agit : ne nous voilons pas la face. Les alaouites comme les sunnites s’estiment en danger de mort dans le cas où ils perdraient la guerre. Ce n’est pas la première fois que les sunnites se rebellent : il y a eu des précédents, notamment à Hama en 1982. On ne peut pas remettre en question l’oppression en Syrie, qui a touché toutes les communautés sans exception – chrétienne, druze, chiite,… L’expérience libanaise en atteste également.
En raison du vide étatique et du fait que les populations ne se sentent pas représentées par leur État, l’État est l’enjeu d’un combat pour la survie et la domination de la part des chiites en Irak, des alaouites en Syrie. En Occident, nous portons sur cette situation un regard laïc et rationnel qui n’est pas toujours pertinent.
L’État islamique se nourrit donc des dynamiques locales – l’oppression des sunnites, en Irak comme en Syrie –, mais il incarne également une révolution, comme je l’écris dans mon livre État islamique, le fait accompli, et propose un nouveau système, en rébellion contre les États corrompus et sectaires, mais aussi contre les sociétés traditionnelles, contre l’islam coutumier et contre le pouvoir des clans, en Irak et en Syrie. En Irak, au motif que les chefs de clan corrompus qui ont accepté le deal avec les Américains n’ont pas tenu leurs promesses, une frange de la jeunesse sunnite s’est retrouvée de facto dans les rangs de l’État islamique. En Syrie, après cinq ans de guerre, beaucoup de jeunes ont rejoint cette révolution, de manière civile ou militaire – quoi qu’il en soit, elle s’est militarisée très vite, dès le début 2012. Certains ont gagné les rangs de l’État islamique faute de mieux, parce que l’organisation représente une révolution contre les systèmes établis : contre les États de la région, et même contre le capitalisme et le système mondial.
L’État islamique a gagné en aura avec l’instauration du califat, imaginé et rêvé par une frange de la population musulmane dans le monde depuis la fin du califat en 1924. Ce qui attire les jeunes – du moins occidentaux – vers l’État islamique plus que vers Al-Qaida, c’est cette dimension historique et mystique de la Syrie et de l’Irak, et le fait que l’organisation ait réussi à installer un proto-État avec des institutions, des mécanismes de redistribution, des bureaux des plaintes pour les consommateurs, un système éducatif, des écoles anglophones – au grand dam des francophones !
Avec la guerre en cours, ce système ne va peut-être pas perdurer. Mais l’État islamique aura mis en œuvre ce qu’il faut bien appeler, abstraction faite de tout jugement de valeur, un projet politique. Il y a dans l’histoire humaine des projets politiques horribles et, au risque que cette comparaison vaille un point Godwin, le nazisme était un projet politique. Ce que je répète depuis quatre ans, c’est qu’il faut prendre ces personnes au sérieux et estimer leur action à sa juste valeur. Si on la minimise, si on considère l’État islamique comme une secte et ses membres comme des paumés, des drogués, on ne mesure pas le danger qu’il représente matériellement et dans l’imaginaire de bien des gens, faute d’alternative.
Je développe aussi dans mon livre l’idée que l’on ne peut pas dire que « ce n’est pas l’islam ». De même, on ne saurait soutenir que les croisés n’étaient pas chrétiens. Simplement, les croisés, qui ont assiégé Constantinople et massacré d’autres chrétiens, ne représentaient pas toute la chrétienté. Les conquistadores étaient chrétiens, mais ils ont décimé des peuples aborigènes. De même, les combattants de l’État islamique font partie de l’islam, ce sont des musulmans, mais ils ne représentent pas tous les musulmans du monde. En revanche, ils constituent un véritable pôle d’attraction pour de vastes franges de la population.
Vous nous avez interrogés sur le rôle joué par les États de la région. Ces États, l’Arabie Saoudite à leur tête, sont aujourd’hui en danger de mort à cause de l’État islamique et de sa dimension révolutionnaire. Il est en révolution contre la monarchie saoudienne qu’il estime corrompue. Tous les djihadistes saoudiens avec lesquels j’ai pu discuter répètent qu’ils reviendront en conquérants détrôner ces corrompus de Saoud. Car l’État islamique se veut une théocratie pure, alors que l’Arabie Saoudite est une monarchie.
Quant aux Turcs, ils ont essayé de contrebalancer le danger du PKK – et non des Kurdes, car il existe des Kurdes pro-Erdogan, des Kurdes pro-iraniens, des Kurdes communistes comme les adeptes du PKK – par l’État islamique, mais ils n’ont pas réussi. Toutefois, il faut se souvenir que la fameuse prise de Kobané n’aurait pas été possible sans l’aide des Turcs. Ceux-ci ont certes fermé la porte au PKK et à sa branche syrienne YPG, mais ils ont permis l’acheminement des peshmergas depuis le Kurdistan irakien pour venir en aide aux Kurdes de Kobané.
Les États de la région sont donc en première ligne, surtout l’Arabie Saoudite qui voit un État révolutionnaire se construire à ses portes. Lénine, qui allait créer l’Union soviétique, n’a-t-il pas été accueilli comme réfugié en Suisse et aidé par l’Empire allemand ? Les impérialistes de l’Empire allemand pouvaient-ils deviner que l’Union soviétique allait naître et qu’elle deviendrait un danger imminent pour toute l’Europe pendant soixante-dix ans ? Il en va toujours ainsi des constructions historiques, fondées sur des convergences et des divergences d’intérêts.
Cet État islamique révolutionnaire, très attirant pour une bonne partie de la population du monde arabe, l’est aussi pour des Occidentaux qui reviennent frapper les pays dont ils sont ressortissants, ce qui est inédit. Les raisons en sont multiples. À celles qu’a citées M. Luizard s’ajoutent les interventions des pays occidentaux à l’étranger. La France est engagée dans des guerres contre des mouvements djihadistes sur plusieurs territoires, depuis des décennies. La nouveauté, c’est que l’État islamique parvient à recruter des Occidentaux pour commettre des attentats chez eux. Ceux qui ont frappé à Paris et à Bruxelles sont des Belges et des Français ; c’est ici qu’ils ont monté des équipes, fabriqué les explosifs, acheté des armes et frappé.
Est-ce parce que l’État islamique est en recul qu’il frappe ? Je ne le pense pas. Le terrorisme est un mode opératoire, non une fin en soi. L’État islamique a démontré sa capacité d’anticipation dès qu’il a commencé à kidnapper des journalistes occidentaux, alors que le califat n’était pas encore proclamé et que l’État islamique en Irak et au Levant était encore au stade embryonnaire : il savait pertinemment que les pays occidentaux allaient réagir. Les djihadistes avaient alors les otages sous la main. Heureusement, les otages français – je connais certains d’entre eux personnellement – ont été libérés à temps, mais les autres n’ont pas tardé à être exécutés. Quand l’État islamique a commencé à envoyer en France des équipes ou des personnes chargées de tâter le terrain, comme Mehdi Nemmouche, il n’était pas du tout en recul. C’est dès l’été 2014, au début des frappes, qu’il a envoyé en Libye l’Irakien Al-Anbari, émir opérationnel très proche de Baghdadi. On ne peut donc pas dire que la Libye fasse partie d’un plan de retrait : elle était dans le viseur de l’État islamique dès le début de l’année 2013.
L’État islamique a donc un vrai projet, si condamnable soit-il, qui risque d’être viable et doit être estimé à sa juste valeur. Il ne s’agit ni d’une secte, ni d’une déviance, ni d’une maladie.
M. Sébastien Pietrasanta, rapporteur. Nous sommes très heureux d’avoir de vrais experts autour de la table et de pouvoir tirer profit de leur expertise.
On comprend en vous écoutant que le problème est notamment né du démantèlement des États-nations qu’étaient l’Irak et la Syrie. Au vu de la situation actuelle sur place, en particulier en Syrie, ce problème peut-il avoir, selon vous, une solution politique ? Jusqu’à présent, on s’en tient aux bombardements aériens, ne voulant pas intervenir au sol au motif que cela ne résoudrait pas durablement le conflit et pour ne pas créer un Irak bis. Si une solution politique est possible, de quelle manière ? Croyez-vous à une intervention au sol ? Je n’ai pas dit de qui. Quelle pourrait en être la suite ?
M. Béligh Nabli, directeur de recherche à l’Institut de relations internationales et stratégiques (IRIS). J’aimerais formuler quelques remarques liminaires sur le phénomène djihadiste avant de dire quelques mots de la donne géopolitique.
Il est intéressant d’avoir organisé cette table ronde autour de l’idée de contexte régional, dans la mesure où le phénomène djihadiste, caractérisé par sa dimension transnationale et sa tendance à la dématérialisation, voire à la déterritorialisation, est difficile à encadrer en termes territoriaux. Toutefois, en analysant le jeu transnational et le jeu des puissances étatiques elles-mêmes, qu’elles soient internationales ou régionales, il faut aussi garder à l’esprit la donne locale. On a tendance à l’ignorer ou à la minimiser alors que c’est elle qui nourrit, sinon le phénomène, du moins le succès de l’offre politique que représente l’État islamique.
En deuxième lieu, le phénomène djihadiste s’inscrit dans un cadre historique, géopolitique et idéologique : il serait naïf ou simpliste de le réduire à un phénomène religieux. Cependant, le projet de l’État islamique est à la fois politique, car il vise à créer un État, et religieux : c’est le prisme de la religion qui permet de qualifier cet État et la religion y est un facteur de mobilisation idéologique. Il y a là une imbrication du fait politique et du fait religieux qui rend cette créature difficile à identifier et complexe à analyser. Mais c’est aussi cette double dimension qui explique son succès.
Troisièmement, s’agissant des grilles de lecture en vogue, celle qui consiste à réduire la géopolitique contemporaine à un choc des civilisations est simpliste : nous assistons non à une confrontation entre civilisations ou entre religions, mais à des conflits au sein même de communautés relevant a priori d’une même religion. Cet état de fait échappe à la lecture binaire qui nous a été proposée et qui continue de connaître une certaine fortune. D’où, je le répète, l’importance de l’infranational ou du local lorsqu’il s’agit d’expliquer ces phénomènes régionaux, voire globaux, mais dotés d’un ancrage parfois purement local.
J’en viens au contexte régional et à la géopolitique. Il est difficile de délimiter le territoire pertinent. À cet égard, votre réflexe est juste : bien que le Bataclan soit très loin de la Syrie, nous savons tous que ce qui s’y est passé est intimement lié à la situation syrienne. En même temps, peut-on vraiment circonscrire les frontières à l’intérieur desquelles s’inscrirait la « guerre contre le terrorisme » dont on nous parle ? J’en doute, comme je doute du concept même de guerre contre le terrorisme – j’aurai l’occasion d’y revenir. Il me semble néanmoins que le Bassin méditerranéen est incontestablement au cœur des enjeux stratégiques qui sont directement ou indirectement liés au phénomène djihadiste. Sa rive sud, sa rive est, mais aussi, aujourd’hui, sa rive nord – l’Europe – subissent les effets de la montée en puissance du djihadisme. Il y a donc une réflexion stratégique à mener sur notre rapport à la Méditerranée comme espace géopolitique pertinent. Ainsi, l’analyse du djihadisme me semble donner un intérêt particulier à la question, classique chez les géopoliticiens, de savoir si la Méditerranée existe comme espace cohérent, géopolitique.
Pour étayer cette hypothèse, soulignons le cadre général et structurel plus large dans lequel s’inscrit le phénomène djihadiste. Ces dernières années, une série d’événements majeurs a bouleversé la donne géopolitique en Méditerranée : les soulèvements populaires sur ses rives sud et est, la dislocation et la faillite d’un certain nombre d’États, voire d’États-nations, ainsi que des faits insuffisamment soulignés comme la découverte d’hydrocarbures en Méditerranée orientale, qui pourrait représenter une source de tensions à moyen terme.
S’y ajoute le rôle contrasté joué par les deux grandes puissances mondiales que sont les États-Unis et la Russie. D’un côté, sous les deux mandats de Barack Obama, on a assisté à la définition et à la mise en pratique d’une doctrine prudentielle, qui s’est concrétisée au Moyen-Orient par un retrait au moins apparent ; de l’autre, au contraire, la Russie a adopté une stratégie diplomatique et, désormais, militaire relativement agressive. Ce contraste assez saisissant doit lui aussi nourrir notre réflexion géopolitique.
Par ailleurs, le Moyen-Orient est aujourd’hui en proie à deux types de guerre : une guerre froide et une série de guerres chaudes, locales, qui sont autant de guerres par procuration que se livrent les deux protagonistes de la guerre froide, à savoir l’Iran et l’Arabie Saoudite. Là encore, la grille de lecture purement confessionnelle ne saurait suffire à expliquer les sources de cette confrontation, qui a abouti notamment à la rupture des relations diplomatiques entre les deux puissances régionales. Il y a là, à mon avis, une configuration beaucoup plus classique, celle d’une confrontation pour l’exercice d’un leadership, sur fond d’un jeu assez trouble de la part des États-Unis.
M. le président Georges Fenech. Vous vous dites sceptique quant à la notion de guerre contre le terrorisme, à laquelle font régulièrement référence le chef de l’État et le Premier ministre. Pourquoi ? N’est-ce pas une guerre que nous livrons au terrorisme ?
M. Béligh Nabli. Lutter contre les actes terroristes, y compris de manière préventive, et, naturellement, de manière répressive, va de soi. Il ne s’agit pas de discuter le fait que l’on consacre à cet objectif tous les moyens qui sont à la disposition de l’État. En revanche, il est très problématique de basculer dans une rhétorique guerrière s’agissant du fait terroriste, en particulier de Daech et du djihadisme. Car on aurait alors affaire à une guerre sans fin, puisque le principal facteur de mobilisation du djihadisme est d’ordre immatériel : il est idéologique. Si nous pouvons vaincre militairement l’État islamique, l’assécher financièrement, casser ses infrastructures et sa capacité à répondre à des besoins sociaux qui relèvent de ce que nous appelons les services publics, si nous pouvons remettre en cause les fondements du système qu’il tente d’instaurer, cette victoire – qui ne serait pas une victoire à la Pyrrhus – ne suffira pas à éradiquer le mal, pour parler en termes plus moraux. Ses racines, en effet, sont aussi idéologiques et l’État islamique incarne une offre politique dont il faut tenir compte.
Vous avez évoqué la possibilité de reconstituer un État-nation véritable en Syrie, mais aussi en Irak : c’est l’une des solutions que l’on pourrait envisager. D’autres suggèrent de créer un État proprement sunnite en Irak, ce qui signifierait la fin de l’Irak comme État-nation – à supposer que celui-ci ait véritablement existé un jour.
M. le président Georges Fenech. Certains imaginent aussi une partition.
M. Béligh Nabli. C’est effectivement une autre hypothèse. Quoi qu’il en soit, là est l’enjeu : notre réponse politique, voire – je songe aux jeunes djihadistes européens – notre offre spirituelle ou quasi spirituelle. Car je doute que faire la guerre au sens militaire du terme suffise à retenir nos jeunes.
M. Pierre Razoux, directeur de recherche à l’Institut de recherche stratégique de l’École militaire (IRSEM). Pour ma part, n’étant spécialiste ni du terrorisme ni du djihadisme, je vous parlerai de géopolitique – c’est mon métier, que je pratique au quotidien.
Quels sont nos intérêts sur place ? Quel est le jeu des acteurs régionaux et globaux dans la région ?
Si le Moyen-Orient demeure aussi crucial pour nous autres Occidentaux, ce n’est plus du tout à cause du pétrole ou du gaz, contrairement à ce que l’on croit, mais pour des raisons commerciales. L’essentiel de notre production industrielle, les échanges commerciaux entre l’Europe, l’Asie et une partie du monde passent par la route maritime qui part d’Asie et chemine par l’océan Indien, le détroit de Bab el-Mandeb, puis par la mer Rouge, le canal de Suez et la Méditerranée, pour aboutir dans les grands ports européens. Dans un sens, on achète des matières premières, des pièces de rechange ; dans l’autre, on réexpédie des biens de consommation. Si l’on coupe cette artère vitale, on met à genoux une partie de nos industriels, non seulement français mais européens.
D’autres options existent. D’abord emprunter la route du Cap, comme on l’a fait par le passé. Le problème est que cette route est de 25 % plus longue et de 20 à 22 % plus chère. Dans ce monde très compétitif, nos industriels seraient-ils capables de payer le surcoût ? On pourrait également passer par la voie du Nord, mais pas tout de suite, peut-être dans dix à vingt ans. Il y a aussi la nouvelle route de la soie que les Chinois tentent de nous proposer ; mais elle se résume à une voie ferrée et deux autoroutes, de sorte qu’elle ne pourrait drainer qu’une part marginale du trafic, 20 à 25 % tout au plus, alors que le trafic maritime mondial devrait doubler d’ici à quinze à vingt ans.
Cette route cruciale qui passe par le Moyen-Orient et par la Méditerranée, nous sommes donc condamnés à la défendre si nous voulons défendre notre économie.
Elle possède une sorte de goulet d’étranglement : la mer Rouge, avec une porte d’entrée et une porte de sortie qui sont alternativement le canal de Suez et le détroit de Bab el-Mandeb. Celui-ci est, pour nous autres Européens, infiniment plus important que le détroit d’Ormouz, lequel ne sert qu’au passage du pétrole et concerne essentiellement les pays d’Asie qui achètent leur pétrole au Moyen-Orient. C’est parce que le détroit de Bab el-Mandeb est crucial que tout le monde est aujourd’hui présent à Djibouti : les Français et les Américains – c’est bien connu –, mais aussi l’Union européenne, l’Allemagne, l’Italie, le Japon, la Chine, l’Arabie Saoudite et bientôt les Émirats arabes unis, sans compter l’Inde et la Russie qui frappent à la porte.
L’accès à cet espace de la mer Rouge est facile à interdire. Ainsi, Al-Qaida dans la péninsule Arabique (AQPA) peut assez rapidement menacer le détroit de Bab el-Mandeb, et Daech pourrait être tenté, en cas de fragmentation de l’Arabie Saoudite, de fondre sur la mer Rouge depuis la Syrie et l’Irak, mettant ainsi en péril l’axe d’approvisionnement commercial vital de nos démocraties européennes. Je n’insiste pas sur le canal de Suez, absolument essentiel puisqu’il sert, je l’ai dit, de porte d’entrée et de sortie.
Comme le disait fort justement Béligh Nabli, une nouvelle donnée géopolitique est en train d’apparaître : les très grandes réserves de gaz naturel offshore qui sont découvertes toutes les semaines, tous les mois et qui représentent un véritable eldorado gazier. Israël et l’Égypte exploitent déjà ce gaz ; le Liban rêve de le faire mais, empêtré dans ses problèmes politiques, il n’y parvient pas encore ; Chypre, la Syrie et l’Autorité palestinienne voudraient aussi leur part du gâteau. Cette région de Méditerranée orientale, qui couvre l’entrée du canal de Suez, devient ainsi une zone de turbulences et de conflits potentiels, mais pourrait aussi apporter l’apaisement à moyen, voire à long terme : si la raison prévalait, tous s’assiéraient autour de la table pour tenter de se répartir la manne.
J’aimerais enfin vous présenter ce que sont, pour le géopoliticien que je suis, les défis sécuritaires en Méditerranée et en Afrique du Nord. De ce point de vue, où faire passer la frontière sud de nos intérêts européens pour lutter le plus efficacement possible contre le djihadisme et éviter l’unification des fronts djihadistes ? Ces derniers sont au nombre de cinq : en Irak et en Syrie, bien sûr ; dans la péninsule du Sinaï ; dans la zone côtière libyenne, que je qualifie de « chaos libyen », soit toute la moitié nord et côtière de la Libye, la frontière égyptienne, le sud de la Tunisie et une petite partie de l’Est algérien ; dans l’immense bande sahélo-saharienne ; au Yémen. Notre intérêt vital est de tout faire pour que les mouvements djihadistes aient le moins possible accès à la Méditerranée et à la mer Rouge, afin de défendre à tout prix notre sécurité maritime et commerciale ainsi que les navires de tourisme, et d’éviter absolument que ces cinq foyers se réunissent, ce qui signifierait que nous aurions perdu le contrôle de la région.
La stratégie la plus efficace pour compartimenter les fronts djihadistes consiste à projeter notre ligne de défense sécuritaire le plus au sud possible, de manière à séparer le front libyen, la bande sahélo-saharienne et la péninsule du Sinaï. En d’autres termes, il me semble que se fourvoient tous ceux qui, en Europe, disent en substance que nous devrions, si vous me permettez l’expression, laisser les Arabes se débrouiller entre eux et nous concentrer sur la défense de l’Europe par des opérations maritimes, en établissant, comme à la Renaissance, une grande ligne de défense face à l’Empire ottoman, passant par Chypre, la Crète, Malte, la Sicile et Gibraltar. Car si nous en arrivions là, c’est sur notre dernière ligne de défense que nous serions : en d’autres termes, nous aurions déjà perdu. Nous devons construire une défense de l’avant, le plus en amont possible.
Pour la France, le sujet de préoccupation prioritaire est la Libye. Daech n’a pas encore accès à la Méditerranée – ni face à la Syrie ni dans la péninsule du Sinaï. Mais les mouvements djihadistes présents dans le « chaos libyen » sont actifs et menacent directement nos intérêts.
Un pays est décisif, car situé à l’intersection de trois fronts djihadistes, voire quatre : l’Égypte. Nous avons donc intérêt à le soutenir. Je ne parle pas de morale, mais de géopolitique. Nous pourrons ainsi sécuriser plus facilement la Méditerranée orientale, la mer Rouge et le canal de Suez, le but étant de maintenir la « ligne de front » le plus loin possible de la ligne de communication maritime.
Que veulent les États-Unis ? On dit souvent qu’ils se sont désengagés ou qu’ils se désengagent du Moyen-Orient. Ce n’est absolument pas le cas ; simplement, ils se regroupent pour pouvoir intervenir de manière aussi décisive que par le passé, mais non plus à tout bout de champ, face à toute crise : conformément à la doctrine d’Obama et de son administration, uniquement si leurs intérêts stratégiques sont menacés. Ces intérêts sont la liberté de navigation – ils convergent sur ce point avec les nôtres –, la sécurité des citoyens américains répartis le long de l’axe de communication, la sécurité d’Israël et le contrôle de l’énergie en partance vers l’Asie. Celle-ci représente 75 % du pétrole et du gaz produits au Moyen-Orient, et en représentera 85 % après-demain. Aujourd’hui, les plus gros consommateurs de pétrole local sont les pays asiatiques – la Chine en tête, mais aussi le Japon et la Corée du Sud.
M. le président Georges Fenech. Je me permets de vous interrompre, monsieur Razoux. Votre présentation des enjeux économiques et géostratégiques du Moyen-Orient est fort intéressante, mais elle dépasse un peu le cadre de notre commission d’enquête. M. le rapporteur a posé une question à laquelle il n’a pas encore été apporté de réponse. Dans l’hypothèse où les groupes terroristes, en particulier de Daech et Jabhat al-Nosra, seraient éradiqués, comment envisagez-vous la reconstruction d’États viables ?
M. Pierre Razoux. Tout d’abord, une intervention au sol, notamment en Syrie, est un piège absolu. Ce que souhaite Daech, c’est précisément que les Occidentaux s’engagent massivement au sol dans la région, pour pouvoir dénoncer le retour des croisades et la volonté des Occidentaux, non pas de libérer, mais de conquérir les deux sièges du califat historique, Bagdad et Damas.
M. le rapporteur. Cet argument revient systématiquement lorsque nous posons la question de l’opportunité d’une intervention au sol. Mais existe-t-il une réelle différence de perception entre des frappes aériennes et l’envoi de troupes au sol ?
M. Pierre Razoux. Les bombardements sont, en fait, une mesure conservatoire. Chacun comprend que la solution sera politique et militaire. Dans son aspect militaire, cette solution ne pourra être, au sol, que le fait de pays musulmans. En attendant que les gens de la région s’entendent sur ce qu’il faut faire, cela permet de gagner un peu de temps.
M. le rapporteur. Permettez-moi de réagir à votre dernière phrase. Ce que vous dites, c’est que, dans l’attente d’une solution politique, il faut bombarder Daech pour le faire reculer un peu, mais sans chercher à l’éradiquer parce qu’on ne saurait que faire une fois qu’il aura été vaincu et que l’on ne veut pas se retrouver dans la même situation que les Américains en Irak. Mais quelle solution devons-nous attendre et combien de temps ?
N’oublions pas l’enjeu de l’opinion publique. Le soir du 13 novembre, nous avons été très durement frappés sur notre territoire national. L’état d’urgence a été décrété, les frappes aériennes se sont intensifiées en Syrie. Quelle est l’étape suivante ? On sait que la France sera de nouveau frappée, et probablement encore plus durement. Faut-il attendre deux ou trois autres Bataclan pour se décider à éradiquer Daech sans attendre une solution géopolitique ?
M. Béligh Nabli. Dans votre manière de présenter le champ des possibles, vous raisonnez un peu trop en termes strictement militaires. La réponse ne peut pas être exclusivement militaire, y compris dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et de notre réaction à une attaque terroriste. C’est pourquoi je remets en question l’idée de guerre contre le terrorisme. Les principaux moyens que nous devons utiliser relèvent, me semble-t-il, des services de renseignement, des services de police et des enquêtes judiciaires. Peut-être faudrait-il se doter, dans ce domaine, de moyens d’une autre nature puisqu’il semble qu’il y ait eu des dysfonctionnements. Si ceux-ci sont avérés – mais je ne suis pas spécialiste de la question –, peut-être devrait-on privilégier ces priorités-là. De fait, la France n’a pas les moyens de répondre seule à l’enjeu militaire et, en tout état de cause, la solution, à terme, est forcément d’ordre politique. Mais elle est complexe et, surtout, elle est dans les mains des protagonistes locaux.
Or, en Irak, l’état de corruption des élites, quelles que soient les communautés concernées, provoque un blocage politique qui ne permet pas que se dessine un système institutionnel susceptible de donner une consistance à un État nation irakien souverain. Quant à la Syrie, on peut se demander comment il serait possible d’y reconstituer un État nation au terme d’une guerre civile menée par celui qui est à la fois le chef de l’État et le chef d’une communauté. Néanmoins, les protagonistes du conflit sont les seuls à même de définir les termes du compromis à venir, et les puissances internationales et régionales doivent se mettre au service de cette négociation.
M. le rapporteur. On a le sentiment, en vous écoutant, qu’il est urgent d’attendre. Bien entendu, je partage votre point de vue selon lequel la solution militaire ne peut être la seule. Mais nous sommes engagés militairement depuis septembre 2014 en Irak et depuis septembre 2015 en Syrie. Pourquoi n’allons-nous pas jusqu’au bout ? Vous réfutez la notion de guerre au terrorisme, et je respecte votre opinion, mais si nous nous disons en guerre, si la France est frappée sur son territoire, pourquoi ne cherchons-nous pas à éradiquer Daech ? Combien de temps cela prendra-t-il si l’on se contente de frappes aériennes ?
M. Béligh Nabli. Vous raisonnez toujours dans un cadre strictement militaire.
M. le rapporteur. On essaie de trouver une solution politique, mais de qui peut-elle venir ? Pas de Bachar el-Assad. De l’Iran ? De l’Arabie saoudite ?
M. le président Georges Fenech. Vous comprenez bien, messieurs, les interrogations de notre commission d’enquête. Nous avons posé la même question au chef d’état-major. Nous savons bien que la solution militaire n’est pas un but en soi – les dimensions politique, géopolitique, religieuse et régionale sont importantes –, mais elle est tout de même, selon nous, une étape nécessaire.
M. Béligh Nabli. Peut-être l’urgence est-elle d’une autre nature : essayons d’abord de remédier aux défaillances qui ont été constatées et de nous prémunir contre de futures attaques. Si nous parvenons à les éviter, ce sera déjà une victoire. Elle ne serait pas d’ordre militaire, certes, mais ce serait une victoire contre le terrorisme.
M. Wassim Nasr. Comme je vous l’ai dit dans mon exposé liminaire, il faut s’efforcer d’appréhender le terrorisme actuel à travers une nouvelle grille de lecture. Le terrorisme qui a menacé l’Occident au cours du XXe siècle, qu’il soit le fait des factions palestiniennes, du Hezbollah ou des Brigades rouges, était toujours un terrorisme d’État ; la négociation était donc possible. Par ailleurs, les terroristes venaient d’au-delà des mers. Aujourd’hui, ce n’est plus du tout le cas : frapper en Irak et en Syrie ne change rien à la capacité de nuisance terroriste de groupes comme Al-Qaida ou l’État islamique. Lorsque l’on a commencé à annoncer que l’État islamique reculait, un avion de ligne russe a été descendu au-dessus du Sinaï, à l’aide – peut-être ne le savez-vous pas – d’une canette de boisson piégée. On a annoncé une nouvelle fois son recul, et on a eu le 13-novembre. Plus tard, on a encore évoqué son recul, et on a eu des attaques à Bruxelles et en Tunisie. À chaque fois, les acteurs des attentats étaient des nationaux. Les équipes qui ont frappé en France et en Belgique étaient composées en partie de personnes qui revenaient de Syrie mais aussi de personnes qui n’y étaient jamais allées. Les armes ne leur ont pas été fournies par un acteur obscur ; elles ont été achetées sur le marché noir. Le TATP, un explosif très volatil, était « fait maison ».
M. le président Georges Fenech. Tout de même, les attaques ont été commanditées depuis la Syrie !
M. Wassim Nasr. D’une manière très diffuse. On leur a donné un « Go ! », ils sont venus avec les réfugiés – c’est une réalité –, mais ils ont réussi à monter leurs équipes ici, avec très peu de moyens. Rappelez-vous, le lendemain des premières frappes en Syrie, un citoyen français a été égorgé en Algérie par des Algériens se revendiquant de l’État islamique. Voilà ce qu’il faut comprendre : la nature de la menace terroriste a muté.
On dénie à l’État islamique la qualité d’État, mais on le frappe comme un État, en visant ses infrastructures, sa logistique. On essaie de frapper là où ça fait mal dans l’espoir que la population se retourne. Mais il faut tenir compte des dynamiques locales : cela pourrait fonctionner en Syrie, beaucoup moins en Irak. Toujours est-il qu’en Europe, la menace est le fait de ressortissants européens, qui agissent avec des moyens trouvés sur place et des financements très faibles. Dès lors, je ne sais pas si frapper en Syrie et en Irak contribuera à sécuriser l’Europe.
M. Pierre-Jean Luizard. Je crois que nous nous accordons tous à dire que, pour vaincre les mouvements djihadistes, qu’il s’agisse de l’État islamique, de Jabhat al-Nosra ou d’autres mouvements actifs dans la région, il faut coupler la force militaire et la solution politique. Mais l’on n’y parvient pas parce que nous n’avons toujours pas pris de décision politique : nous ne savons pas sur qui nous reposer localement pour combattre. Dans la mesure où nous ne voulons pas nous engager militairement, nous déléguons, au sol, à des forces qui ne font qu’aggraver le conflit parce qu’elles en sont parties prenantes. Mossoul ne sera libérée ni par les Kurdes ni par l’armée irakienne, qui est considérée comme une armée ennemie par une très grande majorité de la population de la ville.
Là est le grand défi : la crise est telle, dans ses dimensions politique et historique, que la solution ne peut pas passer par les États en place. Nous ne pouvons nous reposer ni sur le régime de Bachar el-Assad, ni sur l’armée irakienne, qui est une armée, non plus nationale, mais confessionnelle, comme en témoignent les exactions commises contre les populations sunnites lors de la reprise de Tikrit.
Ce défi exige que nous prenions des décisions qui ne relèvent pas de la pure politique dans la mesure où de ces décisions dépendra le fait de savoir si nous devons intervenir ou déléguer au sol, et à qui. Selon moi, la délégation au sol est la pire des solutions, car elle ne fait qu’aggraver le conflit. On l’a vu avec l’intervention russe, qui a condamné toute solution politique dans le cadre de l’État syrien puisque les Russes ont pris fait et cause pour la communauté chiite, avec le soutien de l’Iran, du gouvernement de Bagdad, du Hezbollah et du gouvernement de Damas. Pourquoi soutenir une communauté contre une autre, si nous voulons la paix ? Car tel est bien notre but, en définitive : rétablir une forme de stabilité pour assurer notre propre protection.
Cette stabilité, les États en place ne sont plus à même de nous l’apporter. Cela signifie que nous devons nous pencher sur la question de l’avenir des Arabes sunnites d’Irak. En effet, bombarder ne sert à rien si l’on ne propose pas une solution politique à ces populations qui ont accueilli l’État islamique comme des libérateurs. Or, dans le cadre du système politique actuel tel que nous le reconnaissons, puisque nous avons une ambassade à Bagdad, les Arabes sunnites d’Irak sont condamnés à une situation que, très majoritairement, ils refusent. Se pose donc la question de l’avenir de l’État irakien et éventuellement celle du rattachement des régions sunnites à une Syrie majoritairement sunnite, ce qui suppose une remise à plat du système frontalier et étatique.
M. le président Georges Fenech. On a le sentiment, en vous écoutant, les uns et les autres, que les frappes ne servent à rien, que l’intervention au sol est un piège.
M. Pierre-Jean Luizard. Je pense, au contraire, que nous n’échapperons pas à une intervention au sol lorsque nous reconnaîtrons que nous reposer sur l’armée irakienne, les Peshmergas et l’armée syrienne ne fait qu’aggraver la situation.
M. le président Georges Fenech. Vous pensez à une intervention au sol des armées occidentales, n’est-ce pas ?
M. Pierre-Jean Luizard. J’ai appris, par des contacts que j’ai encore à Mossoul, que, pour beaucoup de ses habitants, le scénario cauchemardesque serait un retour de l’armée irakienne. En revanche, il leur paraîtrait acceptable qu’elle soit occupée par une force internationale, même à dominante américaine.
M. Wassim Nasr. Ou turque.
M. Pierre-Jean Luizard. Ou turque. Mais le problème des pays voisins, c’est qu’ils sont impliqués dans le conflit. Lorsque je parle d’une intervention au sol, je parle d’une intervention qui exclurait, après un accord politique, l’armée turque, l’armée iranienne et les armées arabes qui sont parties prenantes d’un conflit confessionnel. Nous n’avons aucun intérêt à prendre parti pour une confession contre une autre. On ne fera pas le coup des « conseils de réveil » aux Arabes sunnites, qui a plus ou moins fonctionné dans les années 2000, une seconde fois. La question cruciale est bien celle de savoir sur qui nous devons nous reposer. Il ne peut s’agir en aucun cas d’États qui sont, non pas une partie de la solution, mais le problème essentiel auquel nous devons penser.
M. Wassim Nasr. Je vais préciser ma pensée : en l’état actuel des choses, les frappes ne changent rien à la menace terroriste en Europe.
M. Olivier Marleix. Je retiens de vos interventions que la stabilité n’est, hélas ! pas pour demain. Dans son livre passionnant, M. Luizard explique bien que le conflit actuel est l’héritage de l’éclatement de l’empire ottoman et de la création d’États artificiels, la Syrie et l’Irak, auxquels les peuples eux-mêmes n’adhèrent pas. Dès lors, même si nous parvenons à réduire l’importance du prétendu califat, la solution ne consiste-t-elle pas, pour nous, à rétablir en Europe des frontières extérieures dignes de ce nom ?
Certes, ce type de mesures semble d’un autre temps, comme en témoigne la réaction outrée exprimée par les opinions publiques lorsque certains pays situés aux frontières extérieures de l’Union européenne ont décidé d’ériger des murs ou de dérouler des fils barbelés. Pourtant, les Américains eux-mêmes ont été contraints de construire un tel mur à la frontière mexicaine pour maîtriser les flux migratoires, et ce, indépendamment de toute menace terroriste. Sachant ce que vous savez de l’instabilité de cette région, pensez-vous que nous pourrons faire l’économie de frontières hermétiques à l’est de l’Europe ?
M. Pierre Razoux. Je ne suis pas du tout expert en terrorisme, mais il me semble que des frontières hermétiques n’empêcheront pas les attentats. La plupart des membres des groupes qui ont agi en Europe ont été recrutés sur place. Quant à ceux d’entre eux qui viennent de Syrie ou d’Irak, ils pourront emprunter un autre chemin.
La solution, selon moi, est fondamentalement géopolitique. Pour résoudre la crise irakienne et syrienne, une triple entente est nécessaire : entre l’Iran et l’Arabie saoudite, qui doivent comprendre que leurs intérêts vitaux sont menacés et négocier afin de lutter contre Daech et faire monter les prix du pétrole ; entre les États-Unis et la Russie, qui s’entendent déjà car, de fait, M. Kerry et M. Lavrov se sont partagés le Moyen-Orient ; enfin, entre la Turquie et l’Union européenne, pour les raisons qui viennent d’être évoquées.
Mais, comme le disait Pierre-Jean Luizard, la question-clé est fondamentalement politique : c’est celle du territoire des sunnites irakiens et syriens et de leur avenir. Vous pouvez multiplier les bombardements ou envoyer au sol trois divisions blindées, cela ne changera rien ! Tant que les acteurs locaux et régionaux ne se seront pas mis d’accord sur ce point, rien n’avancera. Telle est, en tout cas, ma conviction profonde.
M. Christophe Cavard. La France et d’autres pays européens entretenaient avec certains États des relations particulières dans le domaine du renseignement en matière de terrorisme, ce qui permettait de créer une sorte de zone tampon. De nombreux débats portent sur le rôle de la Turquie. Pensez-vous que ce pays lutte effectivement contre le terrorisme, en particulier contre Daech ?
Par ailleurs, il n’a pas du tout été question dans vos interventions du salafisme, notamment de ses liens avec l’Arabie saoudite – ce qui ne veut pas dire qu’il n’y a que des terroristes en Arabie saoudite. Ce courant religieux a-t-il, selon vous, des rapports avec le terrorisme et, si oui, lesquels ?
M. Patrice Verchère. On ne peut qu’être inquiets en vous écoutant, car vous confirmez que les difficultés actuelles, intérieures et extérieures, vont perdurer encore de nombreuses années et que nous ne sommes donc pas à l’abri de nouveaux attentats en France et en Europe.
Pensez-vous que certains pays jouent un double jeu et financent officieusement le terrorisme islamiste en Europe ?
Est-il possible aujourd’hui de nouer, en France, un dialogue avec des représentants d’un islam modéré, au sens littéral du terme ? Peut-on envisager la création d’un islam de France, doté d’un « clergé », ou bien l’existence de nombreux courants religieux au sein de l’islam rend-elle impossible la constitution d’un clergé qui pourrait lutter en interne contre l’islamisme ?
M. Béligh Nabli. Monsieur Marleix, une sacralisation des frontières est une fiction, en particulier au regard d’un phénomène tel que le djihadisme, qui s’appuie sur des vecteurs de diffusion dématérialisés. L’un des principaux moyens de mobilisation et de recrutement des djihadistes, notamment européens, c’est internet. Cela souligne, non seulement la dimension transnationale du phénomène djihadiste, mais aussi et surtout les limites de l’action de l’État contre des organisations qui savent utiliser des moyens modernes bien que leur discours soit présenté comme archaïque. Pour l’instant, l’État n’est pas encore parvenu à apporter une réponse efficace à ce problème.
M. Wassim Nasr. Je tiens à répéter que le terrorisme est un mode opératoire que ni l’État islamique ni Al-Qaida n’ont inventé. Il a été utilisé par de nombreux autres groupes au cours de l’histoire : les anarchistes, les communistes… Il faut donc appréhender l’idéologie djihadiste, qui a des ressorts religieux et sociopolitiques, comme on appréhenderait celle d’un autre mouvement. Le communisme révolutionnaire violent a profité de la dissolution des États européens après la Première Guerre mondiale ; aujourd’hui, l’idéologie djihadiste profite de la dissolution des États nations au Moyen-Orient.
Existe-t-il des États complices ? Certains États ont fermé les yeux au début de la révolution syrienne, pour diverses raisons. Mais, aujourd’hui, l’État islamique est un électron libre qui représente un danger imminent pour les Turcs, les Saoudiens et les autres États de la région. Sa dangerosité a d’ailleurs été perçue par les décideurs occidentaux dès 2014. C’est ainsi que certaines brigades rebelles syriennes ont été incitées à combattre l’État islamique bien avant que les frappes n’interviennent. Cette idéologie transnationale et transethnique est apparue comme un véritable danger pour la région et, éventuellement, pour les pays occidentaux, ce qui s’est confirmé par la suite. Les dynamiques locales sont bien réelles, mais cette idéologie attire des djihadistes de plus d’une centaine de pays différents.
Par ailleurs, existe-t-il des interlocuteurs dans le monde musulman ? Encore une fois, l’État islamique traduit une révolte. Les responsables musulmans reconnus, qu’il s’agisse d’al-Azhar, des responsables saoudiens ou des Frères musulmans, voire de certains idéologues d’Al-Qaida, sont honnis par les djihadistes de l’État islamique, qui les considèrent comme des apostats. Il s’agit d’une véritable idéologie révolutionnaire qui est en train de bouleverser le Moyen-Orient et le monde, tout en s’inscrivant dans des dynamiques locales. La réponse devrait venir, ne peut venir même, que de ces sociétés.
L’époque actuelle se caractérise par un certain vide idéologique, si bien que beaucoup de gens sont attirés par cette idéologie. Le panarabisme et le panafricanisme n’existent plus, non plus que les luttes ouvrières communistes qui ont pu, par le passé, conduire de jeunes Européens à aller se battre en Espagne ou à rejoindre l’Union soviétique pour construire un nouvel État. Or nombreux sont ceux qui ne se reconnaissent pas dans la société de consommation ; beaucoup, dans le monde arabe ou le tiers-monde, savent qu’ils n’auront jamais le chien, la voiture et le boulot qui va avec. Ils cherchent donc un autre modèle de société, et cela passe par cette violence à outrance et par cette rébellion contre tout, y compris contre leurs anciens mentors d’Al-Qaida. C’est cela que l’on devrait prendre en considération.
Encore une fois, je ne crois pas qu’ils soient aidés par certains États, car ils représentent un danger imminent. Les prisons saoudiennes sont remplies de djihadistes ! On a beaucoup parlé du chef religieux chiite exécuté par les Saoudiens, il y a quelques mois, mais personne n’a évoqué les quarante-deux chefs djihadistes sunnites qui ont subi le même sort. Les Saoudiens se sentent en danger, aujourd’hui. Quant au gouvernement turc, il a essayé de se préserver, car il sait pertinemment que se trouvent, au sein même de la société turque, des partisans du djihad. N’oublions pas que les premiers djihadistes en Irak étaient kurdes et que l’on compte des émirs kurdes dans les rangs de l’État islamique. Je rappelle qu’après les attentats des frères Kouachi, leurs funérailles imaginaires ont été organisées dans l’une des plus grandes mosquées d’Istanbul. Il faut prendre ces faits en considération lorsqu’on pense à la Turquie ou à l’Arabie saoudite, qui fournit un important contingent de djihadistes. Elle a mis sur pied un programme de déradicalisation – je n’aime pas ce terme – complètement lunaire, auquel elle a consacré des moyens importants, y compris la torture, et qui n’a pas fonctionné. Certains djihadistes saoudiens ont rejoint la Syrie en chaise roulante !
Cette idéologie a des ressorts religieux, mais elle transcende l’idée que l’on se fait de l’islam traditionnel, car ses adeptes se révoltent contre celui-ci. Croyez-vous que ceux qui ont rejoint les brigades communistes en leur temps ou les Vietcongs qui se faisaient exploser face aux chars français connaissaient Karl Marx par cœur ? Bien sûr que non ! On dit que les djihadistes ne connaissent pas l’islam et n’ont jamais lu le Coran. Et alors ? Ce n’est pas le sujet. Ce ne sont pas leurs penseurs ou des étudiants altermondialistes comme le jeune Roy – que j’ai suivi – que l’on envoie commettre des attentats en France, mais les délinquants, car eux savent où acheter des armes et des munitions, où trouver des points de chute. Lorsqu’ils ont envoyé un étudiant algérien, il s’est tiré une balle dans le pied et il a appelé une ambulance…
M. Pierre-Jean Luizard. Cela est passé inaperçu, mais les printemps arabes et l’échec des islamistes qui ont été élus notamment en Égypte et en Tunisie ont provoqué un basculement très important au sein de la scène islamique mondiale. La mouvance salafiste, piétiste et quiétiste depuis environ un siècle, était opposée à ceux que l’on a appelés, à tort, les « islamistes » – je pense notamment aux Frères musulmans et à Ennahdha en Tunisie – et qui étaient prêts à jouer le jeu des élections, du parlementarisme et du système constitutionnel. Or le coup d’État du maréchal Sissi – avalisé, il faut le dire, par les puissances démocratiques – a semblé donner raison à ceux qui mettaient en garde les musulmans en leur disant : « Nos ennemis ne croient pas à leurs propres règles puisque, si le résultat des élections ne leur plaît pas, ils organisent un coup d’État ». Cet échec a effectivement permis à la mouvance salafiste de sortir de l’apolitisme militant et a signé l’arrêt de mort, programmé je crois, des partis islamistes, qui sont aujourd’hui en perte de vitesse au profit de l’État islamique ou de Jabhat al-Nosra, qui refusent quant à eux les règles de la représentation politique telle que nous l’envisageons. L’État islamique ne croit pas aux élections, ni à la règle majoritaire, au système constitutionnel ou au parlementarisme.
De fait, les printemps arabes ont libéré des segments multiformes des sociétés civiles, parmi lesquels ces partis islamistes qui avaient été très longtemps réprimés chacun dans son pays, et dont on voit aujourd’hui que très peu ont réussi, à l’exception, il faut le dire, de l’AKP en Turquie. Mais celui-ci a remporté les élections dans un contexte extrêmement conflictuel, puisque l’identité turque telle qu’elle a été recréée par Mustapha Kemal sur les ruines de l’empire ottoman s’est bâtie sur la fiction selon laquelle tout le monde est turc parce que musulman. Or, on le voit, parmi les musulmans, il y a aussi les Kurdes, et tous les musulmans ne sont pas sunnites. Le cancer de la communautarisation confessionnelle, qui vient du Moyen-Orient arabe, menace aujourd’hui directement la Turquie, qui voit les bases de son identité sapée notamment par la « kurdité » qui refait surface. Par ailleurs, nombre d’intellectuels turcs redécouvrent leurs ancêtres arméniens, bessarabiens ou tcherkesses, pour mettre à distance l’identité totalisante turque qui a permis à la Turquie de fonctionner jusqu’à aujourd’hui. Enfin, la communauté alévie turque a des revendications multiples, mais elle veut être reconnue. Or elle ne le sera jamais dans le cadre de l’islam turc, car elle serait considérée comme une communauté hérétique.
La mouvance salafiste, issue de ces mouvements historiques, inspire aujourd’hui directement les mouvements djihadistes et se pose en ennemi irréductible des États en place, considérés comme illégitimes. Ainsi, comme l’a dit Wassim Nasr, les mouvements djihadistes se proclament héritiers des printemps arabes, car ils estiment être ceux qui portent les espoirs des musulmans trahis par les régimes en place et – on commémorera demain le centième anniversaire des accords Sykes-Picot – par les promesses non tenues des puissances occidentales.
M. le président Georges Fenech. À vous entendre, messieurs, nous n’avons guère de raisons d’être optimistes. La situation est d’une telle complexité que, si je vous ai bien compris, nous en avons encore pour quelques années.
M. Wassim Nasr. Quelques décennies…
M. le président Georges Fenech. Pas de solution militaire, pas de solution religieuse, pas de solution politique, pas de solution diplomatique, pas de frontières !
M. Wassim Nasr. Le djihadisme peut, à mon humble avis, représenter le même bouleversement que celui qu’ont provoqué, en leur temps, le communisme, le fascisme ou l’idée d’État nation.
M. le président Georges Fenech. Certes, vous n’êtes pas là pour nous rassurer, mais le constat des experts que vous êtes n’est pas d’un optimisme extraordinaire.
M. Wassim Nasr. On parle peu d’Al-Qaida, mais il s’agit d’un mouvement plus subtil et tout aussi puissant que l’État islamique : avec AQMI, AQPA, leur présence en Somalie et leur branche indienne, ils sont très forts. Quant au Front al-Nosra, il est aujourd’hui profondément ancré dans la rébellion syrienne. C’est un élément à prendre en considération, car ils ont, comme le prouve la manière dont ils ont négocié la libération des otages, une expérience politique que n’a pas l’État islamique.
De fait, l’échec des révolutions arabes a joué un rôle. Ainsi Al-Zawahiri, le chef d’Al-Qaida, a déclaré qu’ils incarnaient désormais l’espoir né des révolutions arabes. Lorsque Morsi, le président égyptien, a été emprisonné, des affiches ont été diffusées sur les réseaux djihadistes qui montraient côte à côte, d’une part, Morsi derrière les barreaux avec, à ses pieds, une urne – une caisse d’élection, en arabe – et, d’autre part, al-Baghdadi avec, à ses pieds, une caisse de munitions, en train de prêcher à Mossoul. Sur Morsi était dessiné un « X » rouge, sur al-Baghdadi un « Juste » vert.
Au Sinaï, Ansar Baït al-Maqdis, l’un des plus grands groupes djihadistes, bien qu’étant égyptien comme Al-Zawahiri, n’a pas fait allégeance à Al-Qaida mais à l’État islamique, avec armes et bagages. C’est un groupe très fort qui monte en puissance depuis plusieurs années. Ils sont en Libye, dans le fief de Kadhafi, car ils ont capitalisé sur le fait que le clan de ce dernier a été exclu de la solution politique. Idem pour les sunnites en Irak et en Syrie. Aujourd’hui, ils attirent au-delà de leurs frontières, dans des pays comme l’Indonésie.
M. le président Georges Fenech. Et la Tunisie ?
M. Wassim Nasr. La Tunisie fournit le contingent le plus important. Il ne faut pas regarder ce pays à travers le prisme de la société civile de Tunis. Les kamikazes qui se font exploser en Libye sont tunisiens, alors que la Tunisie nie cette réalité, en prétendant que ces djihadistes viennent de l’étranger. Lors des opérations à Ben Gardane, l'État islamique avait un plan A et un plan B : ils ont tué le chef des renseignements local et ont tenu le centre-ville pendant plusieurs heures en établissant des check points. Ils étaient soixante ; l’opération était bien préparée. Certes, ils ont ensuite été écartés par l’armée, mais ils ont marqué un point.
Aujourd’hui, l’idée du djihad militaire transcende les calculs géopolitiques rationnels. Ses adeptes veulent construire un nouveau système, comme d’autres avant eux. Cela n’a rien d’exceptionnel, mais on a parfois la mémoire courte et, dans nos sociétés laïques, on a tendance à nier que la religion puisse être le moteur d’un mouvement politique. Pourtant, le Président américain jure sur la Bible, le Patriarche Kirill a béni les avions russes qui survolent la Syrie. Le ressort religieux peut motiver des populations.
M. Pierre Razoux. Je serai, pour ma part, un peu plus optimiste. Au-delà de l’aspect irrationnel, il faut compter avec des facteurs rationnels, notamment le prix du baril de pétrole. Je ne crois pas du tout que la guerre durera des décennies. Pour qu’une solution émerge, il faut que l’Iran et l’Arabie saoudite s’entendent sur la manière dont ils peuvent se partager à nouveau la région et sur le sort qu’il faut réserver aux sunnites irakiens et syriens. Admettons qu’ils s’entendent. Si cette solution est acceptable par les États-Unis, la Russie et la Turquie, cela peut aller relativement vite. Or les Iraniens et les Saoudiens seront acculés à la négociation lorsqu’ils n’auront plus d’argent. C’est pourquoi le prix du baril du pétrole est un élément crucial, de même que le nombre d’années de réserve dont chacun dispose.
M. le président Georges Fenech. Messieurs, merci pour cette intéressante contribution à nos travaux, qui fera l’objet d’un compte rendu publié dans notre rapport.
Audition, à huis clos, de M. David Skuli, directeur central de la police aux frontières (PAF), M. Fernand Gontier, directeur central adjoint, et M. Bernard Siffert, sous-directeur des affaires internationales, transfrontières et de la sûreté
Compte rendu de l’audition, à huis clos, du jeudi 12 mai 2016
M. le président Georges Fenech. Mes chers collègues, nous accueillons ce matin M. David Skuli, directeur central de la police aux frontières (PAF), accompagné de M. Fernand Gontier, directeur central adjoint, et de M. Bernard Siffert, sous-directeur des affaires internationales, transfrontières et de la sûreté.
Monsieur le directeur, messieurs, nous vous remercions d’avoir répondu à la demande d’audition de notre commission d’enquête relative aux moyens mis en œuvre par l’État pour lutter contre le terrorisme depuis le 7 janvier 2015.
Nous allons nous intéresser avec vous à la sûreté de l’ensemble des zones portuaires, aéroportuaires, ferroviaires et des moyens de transport internationaux, ainsi qu’aux questions de coopération internationale et européenne dans un contexte d’accroissement de la menace terroriste.
Cette audition, en raison de la confidentialité des informations que vous êtes susceptibles de nous délivrer, se déroule à huis clos. Elle n’est donc pas diffusée sur le site internet de l’Assemblée. Néanmoins, et conformément à l’article 6 de l’ordonnance 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, son compte rendu pourra être publié en tout ou partie, si nous en décidons ainsi à l’issue de nos travaux. Je précise que le compte rendu de la présente audition vous sera au préalable transmis afin de recueillir vos observations. Ces dernières seront soumises à la commission qui pourra décider d’en faire état dans son rapport. Je rappelle que, conformément aux dispositions du même article, « sera punie des peines prévues à l’article 226-13 du code pénal toute personne qui, dans un délai de vingt-cinq ans […], divulguera ou publiera une information relative aux travaux non publics d’une commission d’enquête, sauf si le rapport publié à la fin des travaux de la commission a fait état de cette information ».
Conformément aux dispositions de l’article 6 précité, je vais vous demander de prêter le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité.
Veuillez lever la main droite et dire : « Je le jure. »
MM. David Skuli, Fernand Gontier et Bernard Siffert prêtent successivement serment.
La commission se pose un certain nombre de questions sur lesquelles vous voudrez bien nous faire un exposé liminaire :
La hausse de la menace terroriste et les attentats perpétrés en 2015 ont-ils conduit la PAF à modifier son organisation ?
Comment la répartition du contrôle des flux de personnes sur le territoire national est-elle opérée entre la PAF et la douane ?
La PAF contribue à la sûreté de l’ensemble des moyens de transport internationaux et à la sécurité générale mise en œuvre sur les emprises portuaires, aéroportuaires et ferroviaires placées sous sa responsabilité. De quels moyens dispose-t-elle pour y parvenir ? Ces moyens ont-ils évolué au cours de l’année écoulée et même depuis le 7 janvier 2015 ?
Quel regard portez-vous sur le soutien apporté à la PAF par l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne (FRONTEX) ? Les situations qui exigent une assistance technique et opérationnelle de FRONTEX sont-elles fréquentes ? Pouvez-vous donner un exemple de situation de cette nature ?
Les méthodes de travail de la police aux frontières dans les gares et les aéroports ont-elles évolué depuis les attentats de janvier 2015 et ceux de novembre 2015 ? Sont-elles appelées à évoluer à court terme ?
Quels sont les points de passage qui font l’objet d’une surveillance renforcée depuis le début de l’année 2015 ?
La formation initiale et continue des agents de la PAF a-t-elle été modifiée depuis les attentats de janvier 2015 et ceux de novembre 2015 ?
À quelles informations les agents de la PAF ont-ils accès lorsqu’ils contrôlent l’identité d’un passager ? Des évolutions sont-elles souhaitables ?
Des patrouilles mixtes sont organisées entre la PAF et les unités des pays limitrophes, en particulier la Belgique, l’Allemagne, la Suisse, l’Italie et l’Espagne. Quels en sont les résultats ? Ce dispositif a-t-il été renforcé au cours de l’année 2015 ?
La PAF a-t-elle des échanges avec les services de renseignement français ? Dispose-t-elle d’officiers de liaison au sein de ces services ? Accueille-t-elle des officiers de liaison en provenance de ces services ?
Enfin, comment les échanges d’informations entre la PAF et ses homologues européens sont-ils organisés ?
M. David Skuli, directeur central de la police aux frontières (PAF). Je commencerai par vous présenter l’organisation de la PAF.
La direction centrale de la police aux frontières est une direction de police spécialisée qui porte ce nom depuis 1999. Elle s’appelait auparavant DICCILEC et, avant 1973, était une sous-direction de la police de l’air et des frontières qui appartenait au grand service des Renseignements généraux. Avant les accords de Schengen, la PAF tenait 181 postes frontières.
Cette direction centrale compte 10 300 fonctionnaires parmi lesquels 8 500 sont actifs et interviennent tant sur le territoire métropolitain qu’outre-mer – Polynésie, Nouvelle Calédonie, Saint-Pierre-et-Miquelon… Elle est divisée en sept directions zonales – six pour le territoire métropolitain et une pour les territoires ultramarins –, elles-mêmes subdivisées en directions interdépartementales, directions départementales et services PAF.
Les décrets d’organisation de la PAF, publiés le 12 avril dernier, nous permettent d’augmenter nos capacités de projection, de traitement des flux migratoires – dans les zones frontalières mais aussi à l’intérieur du territoire puisque la frontière est devenue une notion des plus mouvantes.
Des directions départementales, quant à elles, agissent dans le cadre du département en raison de contentieux spécifiques – c’est le cas des Alpes-Maritimes, de l’Oise, de la Savoie, de départements ultramarins…
Nous disposons par ailleurs d’un service national de police ferroviaire, chargé de la sécurité des lignes et qui effectue des patrouilles communes avec les services étrangers, enfin de dix bureaux de police aéronautique.
Le contrôle transfrontière, l’une des missions de la PAF, est effectué en commun avec la DGDDI, à savoir la douane. Il s’agit de contrôler les documents, de prendre – surtout en ce moment – des mesures de non-admission sur le territoire français, que ce soit par voie aérienne, ferroviaire, terrestre ou portuaire.
Nous devons ensuite lutter contre l’immigration irrégulière et démanteler les filières – 251 l’ont été en 2015 par l’OCRIEST, l’un des seuls offices, au sein de la PAF, qui n’appartient pas à la police judiciaire.
Nous sommes également chargés de la sûreté des moyens de transport – en particulier aéroportuaires –, secteur que nous partageons avec la DGAC.
Nous intervenons aussi en matière de police aéronautique concernant les accidents aériens et le contrôle des espaces aériens dans le cadre de missions spécifiques que nous confient les préfets.
En outre, un vivier d’une centaine d’experts, sous l’égide de FRONTEX, sont engagés, dans le cadre du renforcement des frontières extérieures, en Grèce, en Italie et dans d’autres pays européens dans lesquels l’Agence demande le soutien des experts français, qu’ils soient screeners, debriefers voire experts en fraude documentaire.
Nous animons par ailleurs le réseau des officiers de liaison en poste dans les pays sensibles – Afrique de l’Ouest, Grèce… – où il est attesté que de nombreuses personnes, munies de faux documents, tentent de prendre l’avion pour la France. Aussi nos agents procèdent-ils aux contrôles pré-embarquement.
Enfin, avec nos principaux voisins européens, nous animons les dix centres de coopération policière et douanière, vecteurs d’échanges d’informations et qui parfois organisent les réadmissions ou les procédures des patrouilles mixtes qui opèrent à nos frontières. La PAF est en effet chargée d’appliquer les procédures d’éloignement forcé lorsque des personnes en situation irrégulière ont été interpellées sur notre territoire.
J’en viens à notre action en 2015. Depuis la fin de 2014, jamais la PAF n’avait été confrontée à une telle crise migratoire. Près de 1,8 million de personnes sont entrées dans l’espace Schengen, selon les chiffres FRONTEX, dont 157 000 en Italie. Notre proximité avec ce pays a entraîné la mise en place d’un dispositif important destiné à endiguer cette vague migratoire. Vous savez en outre quelle est la situation dans le Calaisis où 6 000 migrants, répartis entre Calais et Dunkerque, essayent de franchir la frontière pour se rendre au Royaume-Uni.
L’année 2015 a également été marquée par l’organisation de la COP21 et, bien sûr, par les terribles attentats des 7, 8 et 9 janvier et du 13 novembre 2015.
Comment le contrôle aux frontières était-il organisé dans ce contexte ? Avant 2015, à savoir avant les attentats, il était régi par les dispositions du code des frontières Schengen, en particulier par son article 7-2 – devenu par la suite l’article 8 – qui prévoit le principe d’une vérification minimale pour les ressortissants des États membres et d’une vérification systématique pour les ressortissants des pays tiers. Le projet du PNR était déjà envisagé mais il était bloqué par le Parlement européen et en particulier par la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (LIBE).
Pour le reste, les contrôles étaient effectués dans la bande des vingt kilomètres, comme le prévoit le code de procédure pénale.
Par ailleurs, suite à un accord entre le ministre de l’intérieur et son homologue turc, définissant une procédure concernant les djihadistes revenant de Turquie, il a été permis la récupération de 89 d’entre eux en 2015 et de 6 autres depuis le début de l’année 2016.
La loi du 13 novembre 2014 a pour sa part créé l’interdiction administrative du territoire (IAT) et l’interdiction de sortie du territoire (IST), qui s’appliquent aux individus, qu’ils soient mineurs ou majeurs, dont il est avéré qu’ils souhaitent se rendre en des lieux où l’on pratique le djihad. Au moment où je m’exprime, les fichiers comptent 319 IST et 115 IAT.
S’y ajoutent les missions « vols entrants » que la PAF effectue avec la DGAC et la GTA et qui visent à s’assurer que, dans les pays sensibles, les mesures de sûreté sont bien prises par les compagnies aériennes et par les compagnies de sûreté. Un décret du 3 avril 2015 nous donne la possibilité d’exiger que des mesures additionnelles soient prises par ces compagnies de façon à s’assurer que les vols provenant d’aéroports étrangers sensibles puissent être contrôlés selon des normes se rapprochant des nôtres.
Le système SETRADER, créé en 2013, a été renforcé depuis les attentats. Il remplissait, d’une certaine manière, les fonctions du PNR puisqu’il était fondé sur l’exploitation des données d’enregistrement – alors que le PNR prendra en compte les données de réservation – permettant un criblage FPR concernant 38 pays sensibles – dont la liste a été établie par les services anti-terroristes –, 15 aéroports et 46 compagnies aériennes.
À la suite des attentats des 7, 8 et 9 janvier, le contrôle des 22 aéroports dont nous sommes chargés a été renforcé – il s’agit des grands aéroports parisiens et de ceux de Toulouse, Nice, Marseille, Bordeaux… celui de Montpellier relevant de la compétence des douanes. Depuis la commission des attentats jusqu’à la neutralisation des terroristes, il fallait s’assurer qu’ils ne puissent fuir le pays ou que d’autres terroristes ne viennent de l’étranger. Les patrouilles dynamiques effectuant des contrôles dans la bande des vingt kilomètres ont été mobilisées. Au moment des attentats, près de 4 000 personnels de la PAF se sont positionnés sur les vecteurs terrestres, ferroviaires et aéroportuaires.
Après les attentats, la France a fait valoir sa volonté de relancer la procédure de contrôle systématique des personnes souhaitant entrer dans l’espace Schengen. Je me souviens avoir participé à plusieurs réunions, avec mes homologues, en février 2015, visant à déterminer des critères pour chaque pays. Cette procédure est en vigueur depuis peu. De plus, des mesures ont été prises – elles ont été sensiblement renforcées depuis – concernant le contrôle des badges et des habilitations. Bien avant le déclenchement de l’état d’urgence, nous avons en effet commencé à contrôler l’ensemble des personnes pourvues d’un badge leur permettant d’accéder aux zones réservées des aéroports. Puis le projet du PNR a été relancé.
À la demande du ministre de l’intérieur, nous avons commencé à étudier les hypothèses de rétablissement de contrôle aux frontières qui, vous l’imaginez, est de nature à mobiliser d’énormes moyens. Nous avons présenté nos propositions à la Commission européenne dans la perspective de l’organisation de la COP21.
C’est dans ce contexte qu’est survenue la tentative d’attentat du Thalys du 21 août 2015, au cours de laquelle le dénommé Khazzani, venant de Bruxelles, a cherché à s’attaquer aux autres passagers. Des mesures ont dès lors été décidées que reprend la loi Savary mais qui déjà permettaient la sécurisation permanente des 28 Thalys quotidiens. Le dispositif a été renforcé par l’installation de portiques par la SNCF dans le sens France-Belgique. Par ailleurs, les patrouilles ferroviaires mixtes ont été intensifiées, notamment avec l’Espagne, l’Italie et l’Allemagne.
Après les attentats du 13 novembre, les autorités ont décidé de rétablir le contrôle aux frontières. Nous y étions du reste tout à fait prêts puisque, au même moment, commençait la COP21. Nous en avions déjà informé la Commission européenne et, lorsque le Président de la République a déclenché l’état d’urgence et prescrit le rétablissement du contrôle aux frontières, nous en étions déjà, pour notre part, à la phase 3. Cette procédure concernait 285 points de passage autorisés (PPA). Je rappelle que les PPF concernent une frontière extérieure – aéroports, ports des façades nord, ouest et sud – et que les PPA – terrestres, ferroviaires ou aériens – s’appliquent aux frontières intérieures, à savoir celles qui nous séparent de nos voisins immédiats. Juste avant les attentats du 13 novembre, la PAF a ainsi mobilisé 5 000 agents, auxquels s’ajoutaient les agents des douanes chargés de 71 PPA. Et, en profondeur, c’est-à-dire dans la bande des vingt kilomètres, une action a été menée à la fois par les services de sécurité publique et de douane et par trois compagnies républicaines de sécurité mises à disposition du directeur zonal de la PAF du Nord, pour tenir les 15 points frontières déclarés comme PPA.
Pour ce qui est des renforts d’effectifs, nos services ont bien sûr modifié leurs méthodes puisque nous avons décidé – de notre propre initiative – de contrôler 100 % des voyageurs provenant de pays extracommunautaires, mais aussi tous les ressortissants de l’UE en provenance de pays hors Schengen. Dans les aéroports de province, nous contrôlons tous les passagers empruntant des vols Schengen et, à Roissy et à Orly, compte tenu de l’importance du nombre de vols et, par conséquent, pour ne pas bloquer ces grandes plateformes aéroportuaires, nous contrôlons entre 30 et 40 vols Schengen par jour à Roissy et une vingtaine de vols sensibles par jour à Orly.
Toujours dans les aéroports, dans la perspective de l’Euro 2016, le nouveau schéma national d’intervention de la police nationale sera bientôt complètement opérationnel. Des exercices impliquant l’ensemble des services de la PAF ont été menés avec le RAID afin de réagir en cas de tuerie de masse. Les services sont en train de recevoir, avec des équipements spécifiques, 112 HK G36, utilisant des munitions de 5,56 millimètres. Les formations à l’emploi de cette nouvelle arme sont en train de s’achever. En outre, une nouvelle formation est dispensée pour les primo-intervenants. Aux effectifs de la PAF s’ajoutent ceux du dispositif Sentinelle, renforcés depuis le 13 novembre – ainsi, 289 militaires sont déployés dans les différents aéroports.
Quelque 400 fonctionnaires vont gonfler les rangs de la PAF à la faveur des différents plans définis par le Président de la République et par le ministre de l’intérieur.
Enfin, le fameux PNR, dont la France avait décidé de se doter depuis 2014, a entraîné la dévolution d’effectifs spécifiques sur les sites dédiés.
M. Sébastien Pietrasanta, rapporteur. Vous nous expliquez que le processus du contrôle aux frontières était déjà amorcé au moment des attentats de janvier 2015, sachant que les frontières devaient être fermées le 13 ou le 14 novembre au soir dans la perspective de la COP21. Vous avez précisé que 4 000 agents de la PAF avaient été mobilisés à cette fin. Or nous avons pu constater que ce contrôle, notamment le contrôle routier, restait aléatoire, et que dans certains aéroports comme Roissy, il n’était pas systématique. Quel est le pourcentage de personnes réellement contrôlées ? Plus précisément, le contrôle routier est-il vraiment utile ?
M. David Skuli. La France compte 2 940 kilomètres de frontières terrestres. Aussi, comme vous le soulignez, le contrôle aux frontières est-il très difficile à assurer. Il existe en effet des phénomènes de contournement : on trouve par exemple 400 points de passages carrossables entre la Belgique et la France. Il faut savoir également que 1,7 million de travailleurs frontaliers se rendent chaque jour dans l’un ou l’autre de nos pays voisins. Je précise également tout l’intérêt de mettre en œuvre des contrôles dynamiques sur les axes routiers sensibles.
Le principe de l’espace Schengen veut qu’on assure un contrôle fort aux frontières extérieures et que prévale à l’intérieur la libre-circulation telle que définie en 1995. L’application des accords de Schengen a entraîné le démantèlement de postes frontières. Il a fallu, après les attentats, les rétablir et réactiver des BCNJ avec certains pays.
Ensuite, la France est soumise à des dispositions européennes et ne saurait rétablir les points frontières en en faisant abstraction : il convient de suivre des procédures d’information, d’invoquer des motifs – en l’occurrence celui prévu par l’ancien article 23 du code des frontières Schengen. Cette opération est donc assez difficile à mener, sans compter que le contrôle aux frontières n’a de sens, pour peu qu’on le veuille efficace, que si s’établit un véritable échange d’informations entre les services. Les bases de données doivent ainsi être renseignées par l’ensemble des pays. La difficulté à contrôler ne peut du reste que s’accroître dès lors que la Syrie ou l’Irak ne semblent pas avoir fait figurer la totalité des passeports dérobés dans la base de données SLTD, d’Interpol.
En revanche, ce contrôle est efficace dans les aéroports, dans les gares frontières. Nous avons développé un programme de contrôle automatique avec les sas PARAFE et je rappelle que la Commission européenne projette de mettre en place, à partir de 2020, le Entry-Exit System où chaque ressortissant entrant et sortant de l’espace Schengen va faire l’objet d’un contrôle avec le décompte de la durée de son séjour. Il n’en est pas moins évident qu’il faut prendre en compte les effets de masse : à Roissy, on dénombre 1 600 mouvements d’avions par jour ; on recense 890 vols Schengen en France chaque jour. Toutes les compagnies aériennes, tous les gestionnaires d’aéroports réclameront, pour leur part, une amélioration de la fluidité du trafic – d’où le paradoxe consistant à assurer dans le même temps une sécurité optimale et la nécessaire fluidité que je viens d’évoquer.
En 2015, 15 000 personnes ont fait l’objet d’une mesure de non-admission. Depuis le 13 novembre, date à laquelle le contrôle aux frontières a été rétabli, ce chiffre atteint 17 363 personnes. Plus de 4 700 fichés S et plus de 7 000 individus faisant l'objet d’une fiche de recherche ont été détectés et les fichiers de police ont été interrogés 9 millions de fois. Même si l’étanchéité du contrôle aux frontières n’est pas parfaite, pour des raisons géographiques, ces chiffres en montrent tout de même la réalité.
J’ajouterai que le dispositif d’un contrôle aléatoire est peut-être plus pertinent qu’un dispositif de contrôle fixe.
M. le rapporteur. À Roissy, par exemple, contrôlez-vous les passagers qui partent, qui reviennent, ou bien les deux ?
M. David Skuli. Grâce au dispositif SETRADER, précédemment évoqué, nous contrôlons les personnes qui partent. En outre, des procédures ont été mises en place depuis les attentats comme le passage par l’aubette ou par le sas PARAFE en fonction du type de passeport présenté. D’autres contrôles sont effectués aux postes d’inspection filtrage tenus par des sociétés sous le contrôle de la PAF. Enfin, un ultime contrôle a été imposé aux compagnies aériennes : celui de la concordance entre le billet et la pièce d’identité.
M. le rapporteur. J’imagine que la Turquie est pour vous une priorité.
M. David Skuli. Les vols à destination de la Turquie sont évidemment particulièrement contrôlés et les IST s’appliquent notamment aux vols pour Istanbul ou autres destinations.
M. le rapporteur. Pour tout vous dire, monsieur le directeur, une délégation de la commission est partie en Turquie la semaine dernière, depuis Roissy, et a été assez étonnée, pour ne pas dire plus, de l’absence de contrôles : nous sommes allés en Turquie comme n’importe où ailleurs. Le contrôle auquel nous avons été soumis s’est révélé somme toute très habituel.
M. David Skuli. Qu’entendez-vous par « très habituel » ?
M. le rapporteur. Nous avons enregistré nos bagages puis passé le filtre de sécurité et c’est à peine si la concordance entre passeport et carte d’embarquement a été vérifiée.
M. David Skuli. Je n’étais pas présent au moment de ce contrôle et je prends acte de ce que vous indiquez ; reste que, pour les vols sensibles comme ceux à destination de la Turquie, un premier contrôle, essentiel, est celui réalisé à l’aubette de police où les documents que vous présentez sont confrontés à l’ensemble des fichiers de police.
M. le rapporteur. À quel moment exactement ? Celui de l’enregistrement des bagages ?
M. David Skuli. Au moment où vous présentez aux personnels de la PAF votre billet et votre titre de voyage – votre passeport –, l’ensemble des fichiers est consulté.
M. le rapporteur. Nous n’avons pas compris à quel moment ce contrôle a eu lieu.
M. David Skuli. Vous ne l’avez pas vu mais je puis vous assurer qu’il a été réalisé. Quand vous passez par l’aubette de police pour quitter l’espace Schengen, tous vos documents sont contrôlés de façon à en vérifier la validité, à vérifier ensuite que vous ne faites pas l’objet d’une fiche particulière. Le nombre de personnes interpellées faisant l’objet d’un signalement IST, à savoir des personnes qui voulaient quitter le territoire national pour aller faire le djihad, dépasse la centaine. Ces contrôles sont réalisés quand des personnes sont signalées. Je vous assure en tout cas, j’y insiste, que sont ainsi contrôlées les destinations sensibles – qu’il s’agisse des vols au départ pour la Turquie ou pour la Grèce.
M. le rapporteur. Et pour les retours de Grèce ?
M. David Skuli. Les vols charter ou les vols qui, depuis la Grèce, arrivent à Roissy sont considérés comme des vols sensibles : nous connaissons l’état de faillite de la Grèce. D’abord, notre OLI, en Grèce, contrôle les passagers qui embarquent ; ensuite, ces vols sont contrôlés à 100 % dans les aéroports de province comme s’ils provenaient d’un pays n’appartenant pas à l’espace Schengen. Et ces contrôles sont parfois même effectués en porte d’avion.
M. le rapporteur. Nous n’avons donc vraiment pas eu de chance car, après la Turquie, nous sommes allés en Grèce et, au retour, le contrôle s’est révélé encore plus faible. C’était le vendredi suivant le jeudi de l’ascension, aussi, peut-être, les effectifs étaient-ils moins mobilisés, ce que je peux comprendre par ailleurs. Nous n’avons vu personne en Grèce et il nous a suffi de montrer notre passeport, ce qui a pris environ trois secondes par passager. Et à l’arrivée, à Roissy, nous sommes passés assez facilement.
Quand le Président de la République évoque le rétablissement du contrôle aux frontières, aux yeux de l’opinion publique, il s’agit d’un contrôle systématique ; mais j’entends bien, au regard de vos considérations, que ce dernier est impossible à mettre en œuvre.
Des personnels sont-ils formés, au sein de la PAF, au profilage ? Allez-vous développer cette pratique ? On a l’impression que le dispositif FRONTEX se révèle assez faible, compte tenu de l’enjeu représenté par les migrants et compte tenu de l’éventualité d’infiltrations terroristes. Vous avez indiqué qu’une centaine d’experts français avaient rejoint l’Agence dans le cadre de la lutte contre la fraude documentaire.
M. David Skuli. Nous avons en effet développé une formation de comportementalistes s’inspirant de techniques développées par les Israéliens, qui disposent d’une certaine expérience en la matière. Nous avons déjà assisté à une conférence donnée à Tel Aviv sur le sujet et nous allons être partie prenante, bientôt, d’une prochaine conférence. Cette formation est également suivie par la Gendarmerie des transports aériens (GTA). La gendarmerie va concentrer son attention sur les personnels qui contrôlent les bagages de soute, alors que nous allons agir, pour notre part, dans les zones publiques et les zones réservées. Nous allons ensuite étendre cette action aux trains internationaux.
Cette formation, organisée avec des chercheurs de l’Université de Toulouse, indépendamment des aspects liés au « flair policier » et aux techniques d’observation du comportement, fait appel à quatre critères médicaux dont la sudation et les battements cardiaques. Des capteurs seront installés à cet effet dans les aéroports, à des endroits spécifiques.
M. le rapporteur. Cette formation concerne-t-elle l’ensemble des agents ou bien des experts en particulier ?
M. David Skuli. Cette formation vient d’être lancée et concernera, dans un premier temps, une trentaine de personnels des différents aéroports français, avant d’être étendue. Ensuite, j’y ai fait allusion, elle doit être menée en coopération avec le monde universitaire et dans le cadre d’échanges internationaux. Ainsi, le recours à la technologie de reconnaissance faciale et à des paramètres médicaux aidera l’agent dans son travail de détection. Il s’agira de l’un des moyens permettant de contrôler les gens qui se présentent dans les espaces publics des aéroports qui sont devenus les vraies zones de vulnérabilité.
En ce qui concerne les hotspots, quatre sur cinq sont actifs dans les îles grecques. Nous sommes quasiment le premier contributeur en termes de personnels présents – screeners, debriefers, experts en fraude documentaire… Les hotspots sont plutôt opérationnels et les phases de passage des migrants sont assez bien définies : elles permettent de s’assurer du parcours du migrant, de son histoire et d’intégrer ses documents dans la base Eurodac. Nous avons projeté 122 experts auxquels il convient d’ajouter des escorteurs pour les personnes qui vont faire l’objet d’un retour vers la Turquie dans le cadre de l’accord récemment signé entre l’UE et ce pays.
La présence de policiers européens et notamment français est donc assez importante dans ces hotspots. Face à l’afflux de migrants en Méditerranée centrale, FRONTEX réoriente son dispositif en direction des hotspots italiens où nous sommes amenés à envoyer des experts. Aussi le nombre de policiers qui opèrent en dehors du pays commence-t-il de devenir considérable ; mais la frontière gréco-turque, en fin de compte, est notre frontière et il convient de la protéger au mieux.
M. Christophe Cavard. Les outils qui permettent l’échange d’informations avec nos partenaires européens vous paraissent-ils suffisamment performants ou bien nécessitent-ils des améliorations du fait du terrorisme ou de la crise migratoire qui impliquent pour vos services une surcharge de travail ? À cet égard, quels sont, au-delà de l’éventuelle présence d’officiers de liaison, vos liens avec Europol ? Quels circuits permettent-ils de travailler à la vitesse des événements ? Il semble que l’accès à certains fichiers doit faire l’objet de demandes spécifiques.
Quel est votre point de vue sur le risque d’infiltration terroriste parmi les flux de réfugiés ? Quelles sont, dans ce contexte, vos relations avec les services du renseignement ? Nous travaillons en effet depuis plusieurs années sur les flux d’échanges et les outils de communication entre des services qui n’ont pas toujours l’habitude de coopérer.
M. David Skuli. Il existe des outils à l’échelon européen : le fichier du Système d’information Schengen (SIS), dont une seconde version va bientôt être mise en place ; le fichier SLTD, d’Interpol, qui recense les documents volés ou perdus ; enfin le PNR qui sera bientôt établi. Il faut y ajouter, au plan national, le fichier FPR.
Quelle est la capacité des différents pays à transférer les informations de leurs fichiers nationaux vers ces outils transversaux ? Le ministre a évoqué le sujet au cours d’une récente réunion à Bruxelles où il était question d’interopérabilité des fichiers, la présidence néerlandaise, c’est l’un des éléments de sa feuille de route, souhaitant s’assurer que chaque pays veille bien au transfert des données de ses fichiers nationaux vers le SIS. Si j’avais une suggestion à faire, j’insisterais sur le grand effort qu’il reste à réaliser en matière de compatibilité des réseaux et en ce qui concerne la rigueur de leur alimentation. D’ailleurs, la France est un gros contributeur à en juger par le nombre considérable de fiches qu’elle a transmises à Interpol ou au SIS.
Un accord a été passé entre l’agence FRONTEX et Europol puisque le risque existe d’une infiltration terroriste parmi les cohortes de réfugiés, comme l’a montré le cas des deux terroristes qui se sont fait exploser au Stade de France le 13 novembre dernier. L’ampleur de la crise rend ce risque difficile à maîtriser. Or l’accord en question permet de recueillir une masse d’informations qui parviendra, désormais, aux services d’Europol qui pourra donc les analyser et les redistribuer aux différents services et notamment à l’OCRIEST, chargé du démantèlement des filières. Europol a décidé depuis peu de créer une sorte de sous-direction de lutte contre l’immigration irrégulière et les réseaux organisés, structure qui va concentrer l’ensemble des initiatives permettant de mieux échanger les informations entre les pays sur les flux migratoires.
En ce qui concerne la lutte contre le terrorisme, il est essentiel que les services de renseignement échangent entre eux et reversent certaines données dans des fichiers accessibles à d’autres services. C’est le cas en particulier des fiches S, dont je vous rappelle que la DGSI et le SCRT sont les grands pourvoyeurs, qui alimentent le fichier FPR consultable par la PAF.
Nos relations avec les services de renseignement sont quotidiennes puisque, dans de gros aéroports comme Roissy ou Orly, on trouve des antennes de la DGSI, de la DRPP et du SCRT. Dans le cadre du retour des djihadistes, nous avons des échanges permanents avec ces services. La consultation des fiches S qui, je le rappelle, ne sont pas des fiches d’interpellation mais de signalement, nous conduit à échanger quotidiennement avec eux, à signaler, précisément, ces personnes lorsqu’elles entrent sur le territoire national ou qu’elles le quittent. Ces relations existent également dans chaque zone où les directeurs zonaux ont des points de liaison avec les services du renseignement intérieur voire avec les services de renseignement extérieur. D’ailleurs, mon service accueille un officier de liaison de la DGSE qui elle-même compte un officier de liaison de la PAF.
La marge de progression de ces relations réside surtout dans l’interopérabilité des fichiers : on pourrait imaginer un meilleur accès des services de renseignement. C’est l’un des thèmes abordé par le ministre récemment à Bruxelles : les services de renseignement ou ceux chargés de la lutte antiterroriste doivent avoir un meilleur accès au fichier Eurodac ainsi qu’au VIS – système d’échange de données sur les visas entre pays membres de l’espace Schengen. Outre l’interopérabilité, il convient de réfléchir à la conservation des données, sachant que le système Schengen n’avait pas été conçu pour faire face à une menace prenant corps en son sein même : les fauteurs d’attentats étaient des ressortissants de l’Union européenne.
M. Christophe Cavard. Prenons le cas d’un individu qui reviendrait de Syrie en passant par plusieurs pays membres de l’UE qui n’ont pas tous encore mis en place les mêmes normes de contrôle. Il va réaliser des sauts de puce qui rendront le suivi de son parcours plus difficile que s’il rentre directement depuis la Turquie… Or, si j’ai bien compris, les services de renseignement, si la personne est susceptible d’être dangereuse, vous préviennent et c’est à partir de ce moment que vous êtes associés aux opérations. Mais vos agents peuvent très bien, directement, avoir des doutes ; dès lors, se contentent-ils de demander leur avis aux services de renseignement, interviennent-ils directement ? Il s’agit pour nous de tâcher de comprendre qui fait quoi.
M. David Skuli. Concernant les procédures de retour, un dispositif plutôt performant a été mis en place après l’accord entre les deux ministres. Tout dépend de deux vecteurs : l’information, d’abord, car nous sommes des services « capteurs » ; la coopération avec les Turcs, ensuite – j’ai été entendu par une autre commission parlementaire au moment où les Turcs, sans en avertir les services français, avaient renvoyé des individus à Marseille plutôt qu’à Paris.
Aujourd’hui, les données concernant tous ceux qui se trouvent dans les centres de rétention en Turquie et en particulier à Istanbul sont communiquées à deux services : la DGSI et la DCI qui nous informent immédiatement afin que nous envoyions des forces de sécurité récupérer directement tel ou tel individu à Istanbul pour l’accompagner lors de son vol retour. Nous l’interceptons à son arrivée à la frontière et le remettons aux services de renseignement.
Qu’une personne puisse, au départ comme au retour, emprunter un autre aéroport européen, voilà qui justifie l’établissement du PNR pour les vols intra-européens. Le Parlement européen n’en avait pas compris l’intérêt et empêchait son adoption depuis 2007. Jusque-là, il était quasiment impossible de contrôler une personne considérée comme sensible aux termes des 32 critères retenus. Le dispositif PNR enfin voté, les différents pays doivent s’en doter dans les deux ans qui viennent. La France, je l’ai dit, a anticipé puisqu’elle a mis en place son propre PNR qui devrait commencer d’être opérationnel d’ici à la fin du mois de mai pour l’être complètement en fin d’année.
Reste évident qu’il faut pallier l’absence d’un système européen d’échanges d’informations sur les voyageurs. Dans un premier temps, il faut que les services de renseignement partagent leurs fiches concernant les individus suspectés d’appartenir à une mouvance terroriste, que ces fiches soient versées au SIS afin que l’ensemble des services capteurs soient informés de la dangerosité des individus en question afin de tenir telle ou telle conduite au moment où ils franchissent une frontière.
La PAF transmet quotidiennement de multiples informations aux services de renseignement. Nous leur communiquons même des photocopies de documents de voyage des personnes signalées, notamment pour faits d’islamisme, ou qui partent pour des destinations particulières – par exemple pour les pays du Maghreb. Nous travaillons également dans le cadre des IST, nouveau dispositif qui nous permet d’entrer en contact fréquent avec les services de renseignement.
Pour me résumer, la réponse à votre question tient dans la mise en place d’outils à l’échelle européenne, outils que promouvait la France dès avant les attentats de janvier 2015. Le 1er janvier 2017, nous pourrons systématiquement contrôler l’ensemble des personnes faisant l’objet d’un signalement.
M. le rapporteur. On compte 4 700 fiches S depuis le 13 novembre. Que se passe-t-il quand un agent de la PAF contrôle un individu faisant l’objet d’une telle fiche, à qui envoie-t-il l’information ?
M. David Skuli. Les fiches S sont des fiches de sûreté de l’État qui ont suscité un grand débat car la presse n’avait pas compris leur objet. On compte 11 profils différents, correspondant à 11 conduites à tenir, dont la numérotation peut prêter à confusion puisqu’une partie de ces fiches sont dénommées S 15 ou S 16. Il s’agit de fiches de signalement et seule la fiche S 15 exige des agents de contrôle aux frontières qu’ils retiennent la personne qui en fait l’objet jusqu’à l’arrivée des services de renseignement. C’est assez compliqué car sur quelle base juridique retenir la personne en question ? Il faut alors faire durer le contrôle quitte à faire intervenir les agents des douanes.
M. le rapporteur. Vous disposez désormais d’une base juridique avec le vote par la CMP du projet de loi renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale.
M. David Skuli. En effet, mais les fiches S existaient avant. Chacune prévoit une conduite à tenir. Dès que l’agent constate qu’un individu contrôlé fait l’objet d’une fiche S, il signale aux services de renseignement la provenance de l’individu et sa destination.
M. le rapporteur. Ce signalement se fait-il en temps réel et auprès de qui ?
M. David Skuli. L’information est transmise en temps réel soit par voie téléphonique soit par voie informatique ou encore par l’appel à l’agent de la DGSI présent sur la plateforme aéroportuaire : tout dépend de ce que contient la fiche S : il est parfois demandé de photocopier le document de voyage pour transmission aux services de renseignement.
M. le rapporteur. Mais concrètement ? Vous avez bien décrit la pression commerciale en matière de fluidité du trafic. Quand vous détectez une personne faisant l’objet d’une fiche S…
M. David Skuli. Le contrôle ne présente aucune difficulté dès lors que nous disposons d’un contrôle de première ligne et d’un contrôle de seconde ligne. Lorsque nous détectons une personne faisant l’objet d’une fiche S, nous l’invitons à venir en seconde ligne afin qu’elle libère son poste dans la queue de première ligne. Il importe d’être attentifs aux individus ainsi fichés car 80 % d’entre eux le sont pour un lien avec l’islam radical. Concrètement, on demande à la personne concernée de se mettre sur le côté et elle est prise en compte par les agents de deuxième ligne. La fiche S 15 demande en outre de retenir la personne contrôlée jusqu’à l’arrivée des services de renseignement, ce qui est l’affaire de quelques minutes sur les grandes plateformes aéroportuaires parisiennes. Toutefois, en province, quand ces services ne sont pas présents, nous faisons passer l’individu en deuxième ligne où nous effectuons, avec le concours des services douaniers, un contrôle approfondi en attendant l’arrivée des services de renseignement. Les informations téléphoniques que j’évoquais sont transmises lors du passage en deuxième ligne.
M. le rapporteur. La conduite à tenir prévoit parfois que les agents doivent agir en toute discrétion…
M. David Skuli. En effet. Quand la conduite à tenir consiste à relever les éléments d’information concernant l’individu en toute discrétion, l’avis téléphonique n’a pas à être donné simultanément : l’appel est passé une fois que la fiche S a été traitée et que l’individu est passé en deuxième ligne. À Roissy, une unité d’information a chaque jour pour mission de traiter l’ensemble des fiches S détectées aux lignes frontières.
M. le rapporteur. Le 14 novembre au matin, Salah Abdeslam est contrôlé avec deux autres individus par la gendarmerie…
M. David Skuli. À neuf heures dix.
M. le rapporteur. À neuf heures dix, en effet. Ils viennent de Paris et se rendent en Belgique à bord d’un véhicule immatriculé en Belgique. Salah Abdeslam, notamment, fait l’objet d’une fiche S… Bref, si j’ose dire, tous les voyants sont au rouge. Ce contrôle a-t-il été effectué dans le cadre du renforcement des contrôles aux frontières annoncés par le Président de la République ?
J’imagine que, dans les heures qui suivent un attentat, vous déployez du personnel aux frontières. Une procédure particulière est-elle prévue, dans un tel contexte, concernant les fichés S, des mesures de retenue, de contrôle renforcé ? Certes, quand Salah Abdeslam est contrôlé, la situation juridique, si je puis dire, est très bancale : les gendarmes le retiennent plus d’une demi-heure, à la limite de toutes les règles juridiques. En même temps – et ce n’est en rien une accusation – si les gendarmes étaient allés jusqu’au bout de leur initiative, nous aurions évité quelques péripéties ultérieures désastreuses. Donc, je le répète, lors d’une telle crise, une procédure particulière est-elle prévue pour les agents de la PAF, notamment concernant les fiches S ?
M. David Skuli. Le 14 novembre au matin, tous les éléments d’identification de Salah Abdeslam n’étaient pas connus. Il est très facile, a posteriori, une fois le dossier complété de tous les éléments de l’enquête, de dire ce qu’il aurait fallu faire. Reste que, le 14 au matin, personne ne savait que Salah Abdeslam avait abandonné sa ceinture d’explosifs, personne ne connaissait les liens entre les personnes qui étaient en train d’assurer son retour logistique vers Molenbeek.
M. le rapporteur. Mais il circulait à bord d’un véhicule immatriculé en Belgique, identifié…
M. David Skuli. J’étais alors en cellule de crise donc j’ai bien vu de quelle manière les informations sont parvenues.
Ensuite, le rétablissement des contrôles ne signifie pas la fermeture de nos 2 940 kilomètres de frontières. Seuls sont concernés les points de passage autorisé, c’est-à-dire ceux signalés comme étant des points d’entrée, ce qui ne supprime en rien les points carrossables qui permettent de passer d’un pays à un autre, comme c’est le cas chaque jour pour les travailleurs frontaliers qui ne sont contrôlés par personne.
Comme vous l’avez indiqué, pour en revenir à Salah Abdeslam, les gendarmes ont tout de même effectué un contrôle approfondi puisqu’ils l’ont gardé plus d’une demi-heure.
Pour ce qui est de la procédure, à la suite d’un tel attentat, le centre ministériel de crise est activé, décliné par la direction générale de la police nationale (DGPN) qui fixe à chaque direction une mission particulière. Au sein de ce dispositif global, la PAF doit renforcer sa présence aux frontières et donc renforcer les contrôles de sortie – pour intercepter ceux qui auraient pu commettre un attentat – et les contrôles d’entrée – pour éviter l’arrivée d’autres terroristes. Le soir-même, l’ensemble des autres pays a été avisé et ont, pour ceux qui le pouvaient, renforcé immédiatement le contrôle de leurs frontières.
En ce qui concerne les fiches S, elles ne font pas l’objet d’une procédure spécifique. Elles existent dans les fichiers en fonction du signalement opéré par la DGSI et le SCRT. Lorsque le fichier FPR est interrogé, la fiche S est automatiquement détectée et s’affiche sur l’écran de contrôle dont dispose l’agent à moins que l’existence de la fiche ne lui soit signalée par radio.
Après les attentats, toute notre action a consisté à renforcer notre présence aux frontières voire à rétablir les contrôles aux PPA qui sont les principaux points de passage terrestres : autoroutes, routes nationales, gares frontalières ou aéroports. Cette action, j’y insiste, est coordonnée par la DGPN et, au niveau supérieur, par le centre ministériel de crise où sont prises l’ensemble des décisions.
M. le rapporteur. J’entends bien, monsieur le directeur, mais, dans les heures qui suivent un attentat, les agents de la PAF ne pourraient-ils pas systématiquement utiliser la retenue de quatre heures prévue par le projet de loi renforçant la lutte contre le crime organisé et le terrorisme ?
M. David Skuli. Vous me demandez si nous pourrions appliquer cette disposition ?
M. le rapporteur. Oui, à l’ensemble des individus faisant l’objet d’une fiche S.
M. David Skuli. Non, parce que, comme je l’ai indiqué, la totalité des fiches S ne sont pas des fiches d’interpellation. Ou alors, il faut changer la nature de la fiche S. Elle est, je le rappelle, destinée aux services de renseignement afin qu’ils soient informés des mouvements des individus concernés. À l’exception, je l’ai dit, de la fiche S 15 ; or on compte très peu de fiches S 15.
M. le rapporteur. Je sais très bien ce qu’est une fiche S, monsieur le directeur, et j’en ai même largement défendu le principe à l’époque où personne n’y comprenait rien. Et je suis personnellement d’avis d’en faire évoluer la définition pour une meilleure compréhension et une meilleure efficacité.
Dès lors que survient un attentat, nous ne disposons pas d’une multitude d’outils. La fiche S, vous avez raison de le rappeler, est un outil de renseignement et non d’interpellation ; mais quand, d’un point de vue pragmatique, un attentat est commis, l’ensemble des agents de la PAF, par exemple, n’a pas accès au fichier FSPRT – et c’est tant mieux. Or si les agents de la PAF contrôlent un fiché S lié à l’islam radical, on peut imaginer, alors que le contexte est troublé, qu’ils retiennent systématiquement l’individu en question pour procéder aux vérifications nécessaires. Certes, l’exploitation d’une fiche S a pour vocation de renseigner les services sur le lieu où se trouve l’individu, à quel moment et avec qui, dans quel véhicule… Mais on peut aussi imaginer, je le répète, qu’en cas d’attentat, cette fiche S serve à autre chose qu’à recueillir des informations, qu’on l’utilise de façon « dérivée » pour assurer la sécurité des Français de manière que la retenue de quatre heures que j’ai mentionnée puisse être utilisée pour éviter qu’un Salah Abdeslam ne s’échappe pendant plusieurs mois et ne commette éventuellement d’autres attentats.
M. David Skuli. Il ne faut pas confondre les outils et oublier le rôle de la justice: c’est elle qui dirige les enquêtes. On ne peut pas faire n’importe quoi au motif que des attentats viennent d’être perpétrés. Il est important de garder aux outils leur vocation, ce qui n’empêche pas d’en créer de nouveaux en cas de besoin. Si la fiche S est un moyen de signalement et d’échange d’informations entre les services de renseignement, informations qui vont peut-être permettre de détecter des actions terroristes, il ne convient pas d’en faire un outil d’interpellation. Pour cela, ou l’on institue un nouveau système de fiches ou bien l’on inscrit les individus concernés au FPR avec un code établissant une fiche PJ permettant l’interpellation. Il y a aussi cette possibilité qui sera offerte d’une retenue de 4 heures dans un cadre bien précis.
Lorsqu’un attentat est commis et que nous disposons d’un signalement suffisamment précis pour être versé au FPR, nous utilisons en effet un autre code, celui des fiches PJ qui, je le répète, permet, le cas échéant, d’interpeller une personne impliquée dans une affaire judiciaire. La fiche S a une vocation et si l’on souhaite lui en donner une nouvelle, il convient de revoir le dispositif. Il faut en outre bien prendre en compte les réticences de certains de nos partenaires à l’idée de procéder ainsi à la retenue de personnes sans aucune base juridique. Nous devons nous montrer très pragmatiques, certes, mais sans que ce pragmatisme nous conduise à détourner la fiche S de son utilisation régulière.
En effet, il faut prendre en considération les critères de signalement qui ne sont pas les mêmes d’un pays à l’autre. Quelle est, ainsi, l’appréciation des services du renseignement belge pour considérer un ressortissant belge, en l’occurrence Salah Abdeslam, comme un terroriste ou comme susceptible de se livrer à une action terroriste ? Quelle est, de leur côté, l’appréciation des services français, allemands, italiens… ? La situation est donc assez complexe.
Bref, il faut laisser à la fiche S sa vocation et créer, le cas échéant, un autre outil ou se servir des fiches PJ du FPR.
Il faudra aussi considérer cette nouvelle disposition de « retenue de 4 heures » prévue par le projet de loi contre le crime organisé et le terrorisme.
M. Serge Grouard. J’ai le sentiment que nous nous trouvons dans une logique défensive, ce que reflète d’ailleurs le titre même de cette commission d’enquête. Depuis quelque temps, je me dis que, même si les dispositifs dont nous discutons sont bien sûr nécessaires, il va bien falloir se poser la question de la stratégie avant de réfléchir aux « moyens mis en œuvre par l’État pour lutter contre le terrorisme ». Aussi notre stratégie doit-elle continuer d’être défensive ou bien doit-elle devenir offensive ?
Nous revenons des Balkans. J’ai le sentiment que l’on contrôle de mieux en mieux les aéroports. On n’empêchera pas, évidemment, malgré le solide maillage, une fourmi de passer, mais les contrôles se sont organisés, densifiés et semblent, en tout cas pour la partie française, de plus en plus opératoire.
Je reprends l’exemple des voies terrestres. En Grèce, en 2015, un million de réfugiés sont arrivés. Quelque 500 000 s’y trouveraient toujours sans avoir été identifiés. Beaucoup sont de simples réfugiés qui préféreraient être dans une autre situation, mais il a pu y avoir infiltration parmi eux de terroristes. On nous a par ailleurs parlé de « l’autoroute des Balkans ». Je connais quelque peu cette région et sais qu’il existe de vraies passoires. Comment peut-on contrôler tout cela ? C’est mission impossible. On nous a indiqué que la mer Égée était un lieu de trafic en tous genres. On nous a parlé à ce sujet du « marché des réfugiés »…
Bref, cette région – Istanbul, Athènes, entre les deux – grouille de monde, si bien qu’on cherche en permanence des aiguilles dans une botte de foin. Or comme vos services sont efficaces et bien organisés, vous allez en trouver, des aiguilles, mais pas toutes.
Je n’ai pas de solution mais cette situation me rappelle notre stratégie militaire défensive de 1940. L’idée de la ligne Maginot n’était pas si stupide, mais les Allemands sont passés ailleurs, justement, encore une fois, par la Belgique – il y a des fatalités dans l’histoire.
Mes propos sont certes quelque peu décousus, mais je me heurte, intellectuellement à ce problème. On propose de multiplier les fichiers, les dispositifs… Prenons l’exemple du trafic de drogue : il emprunte également des autoroutes et, bien qu’elles soient connues, la drogue passe tout de même. Que doit-on donc faire ? Voilà quel est l’état de ma réflexion.
M. le président Georges Fenech. Quelle est votre question, mon cher collègue ?
M. Serge Grouard. En ce qui concerne l’agence FRONTEX, monsieur le directeur, combien compte-t-on de personnels et combien de Français parmi eux ? J’ai entendu qu’ils étaient 122 mais je ne suis pas sûr qu’il s’agisse du bon chiffre.
Ensuite, vous avez évoqué la conservation des données. Qu’en est-il ? J’ai en effet le sentiment que les données de certains fichiers ne sont pas conservées dans la durée, ce qui peut rendre difficile la recherche des antécédents d’un individu, par exemple.
M. David Skuli. Il est en effet préférable d’avoir une stratégie plutôt que de réagir. Reste qu’il est déjà difficile de définir une stratégie pour soi-même, alors à vingt-huit, ce l’est encore plus. On a d’ailleurs pu constater qu’il a fallu des morts pour que le Parlement européen vote la mise en place d’outils essentiels d’échanges de données ou de contrôle. Il convient donc de mener une action de fond et qui doit être poursuivie afin de faire évoluer les systèmes. Les causes du terrorisme sont sans doute internes, mais elles sont également externes – on songe à des conflits identifiés nécessitant des actions fortes.
Pour ce qui est de l’agence FRONTEX, elle va changer de nature puisque la Commission européenne a étendu son action aux garde-côtes, augmenté ses personnels. Actuellement, on compte 300 permanents sur un volume global de personnels mobilisables par l’ensemble des États membres qui est de plusieurs milliers. La France est quant à elle un contributeur assez important : le vivier de screeners et de debriefers compte cent personnes, nombre qui va être augmenté. S’y ajoutent des personnels que nous pouvons envoyer répondant aux 13 ou 14 profils de l’Agence, notamment en matière de fraude documentaire et d’assistance aux prises d’empreintes digitales.
Assurer l’interopérabilité au sein de FRONTEX est complexe : un garde-frontière français doit pouvoir effectuer un contrôle à la frontière gréco-turque ; il doit donc bien maîtriser la langue anglaise – nous exigeons de nos agents un niveau B1. En outre, ces derniers doivent être titulaires d’une certification européenne du métier de garde-frontière qui nécessite un background commun. Des viviers de personnels formés par FRONTEX se constituent ainsi dans chaque pays.
J’en viens à la conservation des données – thème sensible au sein de l’Union européenne, au point que certains de nos partenaires, à cause d’une sensibilité à fleur de peau, ont bloqué nombre de nos dispositifs en la matière. Reste que la position française a été retenue pour le PNR : les données seront conservées pendant cinq ans, un masquage étant effectué au bout de six mois. Une action française est engagée pour que les données Eurodac soient conservées même après le retour de la personne concernée, ce qui me semble une bonne démarche car il s’agit du seul fichier renfermant des éléments biométriques et des éléments d’identité déclarés ou certifiés. Quant aux fichiers français FPR et autres, les données peuvent en être conservées jusqu’à des dizaines d’années en fonction de la nature de la fiche et de la nature de l’infraction qui a justifié l’inscription au fichier.
M. le président Georges Fenech. Avez-vous des informations sur les circonstances de l’attentat contre l’avion russe dans le Sinaï en octobre 2015 ?
M. David Skuli. Non, je n’ai que des bribes d’information ou des hypothèses. Nous avons échangé sur le sujet avec la DGAC avec laquelle nous coopérons étroitement. Or en son sein la DGAC comprend une cellule d’analyse du risque qui étudie les catastrophes ou les accidents aériens.
Les seuls éléments d’information dont je dispose concernent la nature de l’explosif – on évoque l’emploi de TATP, d’une bonbonne, ce qui pose le problème du contrôle des bagages de soute. Nous avons eu l’occasion d’échanger sur ce thème avec la DGAC lors d’une mission en Tunisie. Reste que je ne dispose pas d’informations très précises ni très claires, certifiées, qui me permettent de vous affirmer quoi que ce soit dans le cadre de la présente commission.
M. le président Georges Fenech. Un journaliste de France 24, spécialiste du Moyen Orient, nous a parlé d’une cannette de bière.
M. David Skuli. J’ai entendu également cette information. Un tel moyen de stockage de l’explosif est susceptible de provoquer des dégâts importants dans l’avion, mais tout dépend du positionnement du passager, de l’endroit où se trouvait cette cannette… J’ai entendu comme vous cette information sans que je sache si elle a été divulguée par un agent impliqué dans l’enquête.
Tous les éléments sont analysés et pris en compte et l’on s’adapte à la menace – comme l’indiquait M. Grouard. Nous nous organisons aujourd’hui en fonction des tueries de masse parce que nous avons été victimes de tueries de masse et qu’il est très difficile de penser le futur.
M. le président Georges Fenech. Nous vous remercions pour toutes vos réponses.
Audition, à huis clos, de Mme Hélène Crocquevieille, directrice générale des douanes et des droits indirects, M. Jean-Paul Balzamo, sous-directeur des affaires juridiques et contentieuses, des contrôles et de la lutte contre la fraude, et M. Jean-Paul Garcia, directeur national du renseignement et des enquêtes douanières
Compte rendu de l’audition, à huis clos, du jeudi 12 mai 2016
M. le président Georges Fenech. Après l’audition du directeur de la police aux frontières (PAF) qui vient d’avoir lieu, nous sommes heureux d’accueillir Mme Hélène Crocquevieille, directrice générale des douanes et des droits indirects, accompagnée de M. Jean-Paul Garcia, chef de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, et de M. Jean-Paul Balzamo, sous-directeur des affaires juridiques et contentieuses, des contrôles et de la lutte contre la fraude.
Madame la directrice, messieurs, nous vous remercions d’avoir répondu à la demande d’audition de notre Commission d’enquête. Nous allons nous intéresser avec vous, dans un contexte d’accroissement de la menace terroriste, aux moyens dont vous disposez pour tarir les circuits de financement et aux méthodes mises en œuvre pour assurer un partage efficace du renseignement.
Cette audition, en raison de la confidentialité des informations que vous êtes susceptibles de nous délivrer, se déroule à huis clos. Elle n’est donc pas diffusée sur le site internet de l’Assemblée. Conformément à l’article 6 de l’ordonnance 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, son compte rendu pourra néanmoins être publié en tout ou partie, si nous en décidons ainsi à l’issue de nos travaux. Je précise que les comptes rendus des auditions qui auront eu lieu à huis clos seront au préalable transmis aux personnes entendues afin de recueillir leurs observations. Ces observations seront soumises à la Commission, qui pourra décider d’en faire état dans son rapport. Je rappelle que, conformément aux dispositions du même article, « sera punie des peines prévues à l’article 226-13 du code pénal toute personne qui, dans un délai de vingt-cinq ans […], divulguera ou publiera une information relative aux travaux non publics d’une commission d’enquête, sauf si le rapport publié à la fin des travaux de la commission a fait état de cette information ».
Conformément aux dispositions de l’article 6 précité, je vais vous demander de prêter le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité.
Veuillez lever la main droite et dire : « Je le jure. »
Mme Hélène Crocquevieille, M. Jean-Paul Garcia et M. Jean-Paul Balzamo prêtent successivement serment.
Nous souhaitons vous interroger sur plusieurs sujets. La douane a-t-elle modifié ses méthodes de contrôle dans les aéroports et autres points de passage frontaliers depuis les attentats de janvier 2015 ? Pouvez-vous par ailleurs présenter la nature et le fonctionnement de la coopération entre les agents de la douane et de la PAF ? Quels résultats avez-vous obtenus depuis le rétablissement des contrôles aux frontières après le 13 novembre 2015 ? Comment participez-vous au dispositif Frontex ?
En 2015, vos résultats en matière de lutte contre le trafic d’armes à feu ont augmenté de 40 % par rapport à 2014 : comment l’expliquez-vous ? Quelle est la tendance pour les premiers mois de l’année 2016 ?
Pouvez-vous également présenter votre dispositif de contrôle du fret international ? Quelles actions ont été entreprises le soir du 13 novembre 2015 et pour quels résultats ? Dans le cadre de la lutte antiterroriste, la douane a-t-elle mis à disposition des autres administrations les moyens opérationnels et les outils techniques dont elle dispose : centre de commandement, lecteurs de plaques d’immatriculation, Cyberdouane… ?
Nous aborderons ensuite, avec la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED), des questions relatives au renseignement, notamment sur votre usage du fichier FSPRT et votre participation à l’Unité de coordination de la lutte anti-terroriste (UCLAT).
Mme Hélène Crocquevieille, directrice générale des douanes et des droits indirects. L’administration des douanes, que je dirige depuis plus de trois ans, se caractérise par la multiplicité de ses missions : économique, fiscale et de protection du territoire. C’est essentiellement au titre de sa mission de protection que la douane contribue, aux côtés des ministères de l’intérieur et de la défense, à la lutte contre le terrorisme. Grâce à la diversité de ses outils mais également à ses méthodes de travail, la douane est aujourd’hui considérée par les administrations en charge de la sécurité comme un partenaire fiable dans ce domaine.
Dès 2014, les services douaniers ont procédé à l’interpellation de Mehdi Nemmouche, à l’occasion du contrôle d’un bus Eurolines à Marseille, et, en janvier 2015, une brigade de surveillance en contrôle à Modane appréhendait deux individus soupçonnés d’être impliqués dans les tentatives d’attentats ayant donné lieu la veille en Belgique au démantèlement de la cellule dite de Verviers. Ainsi, la douane, dans le cadre de ses missions normales de surveillance du territoire, peut être en première ligne dans la lutte contre le terrorisme.
J’exposerai dans un premier temps les grandes lignes de la contribution de mon administration à la lutte contre le terrorisme et, dans un second temps, j’apporterai un éclairage sur le plan de renforcement de notre action en matière de lutte contre le terrorisme et de contrôles aux frontières présenté par le secrétaire d’État au budget le 22 janvier.
L’administration des douanes dispose de moyens juridiques et opérationnels lui permettant d’intervenir dans la lutte contre le terrorisme et son financement. Grâce à son positionnement privilégié sur les frontières, à son expertise et à ses moyens en matière de sécurisation des flux de marchandises et de personnes, mais également grâce à sa capacité de lutte contre les grands trafics, la douane inscrit son action dans une démarche de complémentarité et de coopération avec les services spécialisés.
Les contributions de la douane à la lutte contre le terrorisme sont de différentes natures. Tout d’abord, la douane assure la prévention des actes terroristes dans le cadre de ses missions spécifiques de contrôle en matière de sûreté et de sécurité du fret aérien et portuaire. Elle met ainsi en œuvre le programme communautaire ICS (Import Control System) – véritable PNR de la marchandise – qui impose aux opérateurs et logisticiens d’adresser à la douane, au premier point d’entrée dans l’Union européenne, une déclaration sommaire décrivant le contenu du fret, ainsi que des éléments en matière d’origine et de destination. Sur la base de ces transmissions – plus de sept millions de déclarations déposées auprès de la douane française en 2015 –, les services douaniers conduisent une analyse de risque et un ciblage afin de procéder à des contrôles efficients.
Toujours en matière de sécurisation des échanges de marchandises, la douane participe très activement à l’initiative de sécurité contre la prolifération, le programme PSI (Proliferation Security Initiative), qui a pour objectif d’intercepter les flux illicites de biens proliférants par mer, air et terre. L’administration des douanes apporte une expertise juridique et assure le plus souvent le contrôle et la saisie des marchandises déroutées ou arrivant par voie maritime pour le compte du secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale (SGDSN).
S’agissant du contrôle des personnes, la douane mobilise un peu plus de 500 agents pour assurer la sûreté des flux de marchandises et de voyageurs empruntant le site du tunnel sous la Manche et les gares Eurostar. Elle est ainsi en charge de la détection d’armes et d’explosifs sur les individus et dans les bagages.
Comme vous le savez, l’administration des douanes s’est particulièrement investie dans les travaux de préparation du PNR, qui vise à faciliter le traitement des données des passagers pour rendre plus efficaces les contrôles. Depuis septembre 2015, la nouvelle plateforme interministérielle, l’unité d’information passagers (UIP), est ouverte dans les locaux de la douane à Roissy. L’UIP est chargée de la collecte, du traitement et de la diffusion des données provenant des compagnies aériennes. Sa montée en charge opérationnelle est prévue courant 2016 et le PNR français devrait être opérationnel d’ici à la fin de l’année. Les données de cette plateforme seront mises à la disposition des services de contrôle dans chaque aéroport de France.
Dans un cadre interministériel, la douane participe également à la lutte contre l’immigration irrégulière. Les services de la surveillance terrestre et aéromaritimes sont ainsi mobilisés sur quatre-vingt-deux des 131 points de passage frontaliers (PPF) en métropole et sur quatorze PPF sur trente-sept en outre-mer. Dans le cadre de cette mission, l’administration des douanes met en œuvre le régime des interdictions de sortie du territoire qui participe au dispositif de lutte contre le phénomène des combattants étrangers.
En ce qui concerne le contrôle des flux financiers, la douane, par le biais de sa législation sur les transferts physiques de capitaux, est un acteur majeur de la lutte contre le blanchiment de fonds et le financement du terrorisme. Les contrôles opérés sur le respect de l’obligation déclarative des capitaux entrants et sortants du territoire permettent d’intercepter des sommes, titres ou valeurs susceptibles de provenir d’une activité illicite ou d’y être destinés. Ainsi, en 2015, parmi les dossiers de constatations de manquement à l’obligation déclarative (MOD), le service national de la douane judiciaire (SNDJ) a démontré un blanchiment douanier dans cinquante-deux dossiers et, dans les quatre-vingt-quatorze autres dossiers, un blanchiment de droit commun, soit un total record de 146 dossiers judiciaires pour blanchiment.
Cela montre que la détection de MOD est un moyen juridique formidable pour mettre en lumière des délits de blanchiment. Ces derniers mois, les services douaniers ont constaté plusieurs MOD sur des sommes d’argents importantes – plus de 3 millions d’euros – détenues par des personnes de nationalité syrienne résidant en Europe. Les enquêtes judiciaires en cours auront vocation à démontrer les liens éventuels entre le MOD et le blanchiment ou le financement du terrorisme.
En ce qui concerne la lutte contre les trafics et la criminalité organisée, la DNRED, service à compétence nationale, est en charge du renseignement et de la lutte contre la grande fraude internationale douanière. Elle travaille notamment sur des infractions douanières sensibles à la menace terroriste, comme les trafics de tabac ou de contrefaçons, qui constituent des sources potentielles de financement d’individus appartenant à des mouvances islamistes radicales. À titre d’exemple, des enquêtes de la DNRED ont pu démontrer l’implication d’individus radicalisés dans des trafics de contrefaçons de vêtements ou de matériel informatique ; les gains issus de ces trafics servaient à financer des groupes islamistes radicaux en France et à l’étranger.
Vous l’aurez constaté, les contributions de mes services à la lutte contre le terrorisme sont nombreuses et variées. Des résultats significatifs ont pu être obtenus ces derniers mois dans ce domaine.
J’en viens au renforcement des moyens de la douane à la suite des attentats. Début 2015, face à la dégradation de la situation sécuritaire liée au terrorisme, l’administration des douanes a accéléré la modernisation de ses structures, renforcé la sensibilisation de ses agents à la menace terroriste et mis en place des circuits de remontée du renseignement vers un service dédié, le groupe opérationnel de lutte contre le terrorisme (GOLT), au sein de la DNRED.
Suite aux attentats de novembre 2015, conformément aux engagements du Président de la République, un plan de renforcement de l’action de la douane en matière de lutte contre le terrorisme et de contrôles aux frontières a été présenté par le secrétaire d’État au budget. S’inscrivant dans le prolongement de mesures qui avaient déjà été décidées en interne au début de l’année 2015, ce plan prévoit un renforcement de nos effectifs, moyens opérationnels et outils juridiques. Il consacre définitivement la douane comme un acteur essentiel du pacte de sécurité évoqué par le Président de la République et une administration incontournable dans le dispositif de réponse à la menace terroriste.
Ce plan vise en premier lieu à renforcer notre capacité de contrôle aux frontières en cas de crise majeure, comme celle que nous avons connue fin 2015. À ce titre, la douane bénéficie de mille agents supplémentaires en 2016 et 2017, ce qui inverse la courbe d’évolution de nos effectifs, en décroissance depuis vingt ans. Ces agents seront affectés en priorité aux brigades de surveillance chargées des contrôles aux frontières terrestres et dans les lieux sensibles de passage de marchandises comme les centres de tri de fret express ou de fret postal. Des effectifs supplémentaires doivent également être consacrés au renforcement des contrôles de sûreté, en matière de recherche d’armes et d’explosifs, sur la liaison Transmanche et le fret routier.
Le plan d’action prévoit en outre un programme d’équipement permettant d’accroître les capacités d’action des douaniers et de renforcer leur sécurité. Les capacités de dissuasion et de riposte des unités de la surveillance terrestre doivent être adaptées afin de garantir la sécurité des agents et l’efficacité des interceptions. C’est pourquoi, après une formation spécifique, les unités exposées vont progressivement être dotées de pistolets-mitrailleurs, armes collectives qui compléteront les armes de poing individuelles insuffisamment dissuasives. En outre, une enveloppe de plus de 6 millions d’euros va être allouée à la dotation des unités douanières en équipements de protection – gilets pare-balles – et d’interception. Ces équipements ont été commandés et leur distribution est en cours.
La communication en période de crise étant fondamentale, le plan prévoit d’accélérer la dotation de nos services en nouveaux moyens radio, qui seront raccordés à ceux du ministère de l’intérieur.
Par ailleurs, les services de la surveillance doivent pouvoir s’appuyer sur des centres opérationnels terrestres réactifs, assurant la coordination de nos équipes entre elles et avec les autres services de sécurité intérieure, pour une transmission de l’information en temps réel. C’est au sein de ces centres opérationnels que remonte l’information issue des lecteurs automatiques de plaques minéralogiques (LAPI), dont la douane poursuit le déploiement ; d’ici à 2017, elle devrait compter quatre-vingt-cinq capteurs répartis sur l’ensemble du territoire, en réseau avec les LAPI du ministère de l’intérieur.
Outre le renforcement des moyens humains et matériels, la collecte, l’analyse et le partage du renseignement sont au cœur du plan de lutte contre le terrorisme. Le GOLT a été profondément réorganisé et ses effectifs renforcés afin de dynamiser le renseignement douanier. Les modalités de remontée de l’information vers le GOLT ont été formalisées fin 2015 et un réseau de correspondants du GOLT mis en place au sein des services douaniers. Le GOLT est désormais l’unique point de contact en matière d’antiterrorisme en douane. Il reçoit en moyenne de soixante à soixante-dix fiches de signalement par semaine et travaille en étroite collaboration avec la DGSI et les services de renseignement locaux.
Il a en outre été décidé de renforcer les moyens de la cellule Cyberdouane. Sur le plan opérationnel, la douane porte actuellement une mesure dans le cadre du projet de loi tendant à renforcer la lutte contre le crime organisé, afin de permettre aux agents de la cellule Cyberdouane d’effectuer des enquêtes sous pseudonyme et de lutter ainsi plus efficacement contre les grands trafics, y compris dans le Darknet. Je souligne le besoin pour mon administration de disposer de cet outil juridique. À défaut, nous resterons dans l’incapacité d’enquêter efficacement sur internet.
L’ensemble de la communauté douanière a été sensibilisée à la problématique du terrorisme et de la collecte du renseignement. Les modules de formation ont été adaptés.
Acteur incontournable du contrôle des flux de marchandises, la douane doit également accroître son efficacité dans la lutte contre les grands trafics, susceptibles d’avoir des connexions avec le terrorisme, notamment le trafic d’armes et d’explosifs. La douane est l’autorité en charge de la délivrance des autorisations de circulation intracommunautaire des armes à feu, de leurs éléments et munitions. Dans le cadre du projet de révision de la directive européenne relative au contrôle de l’acquisition et de la détention des armes, la douane soutient actuellement la création d’un système dématérialisé et automatisé d’échange d’informations au niveau européen afin de sécuriser les flux et d’assurer une traçabilité réelle des armes, des munitions et de leurs éléments. Ce dispositif devrait prendre la forme d’une plateforme européenne dématérialisée.
Au plan national, la douane vient de finaliser un plan d’action de lutte contre le trafic illicite d’armes à feu, complémentaire du plan national présenté par le ministre de l’intérieur le 13 novembre 2015. Ce plan vise à renforcer les moyens juridiques, opérationnels et de renseignement de la douane. Parmi les mesures envisagées, figurent la possibilité pour les agents spécialisés de mettre en œuvre des procédures d’infiltration et de coup d’achat pour lutter contre le commerce illicite d’armes. Ce plan d’action prévoit également de constituer au sein de la DNRED un groupe d’investigation spécialisé en matière d’armes, mais également d’orienter les outils d’analyse de risque et de ciblage aux fins d’identification des flux suspects, en particulier dans le fret express et postal.
Afin de renforcer l’efficacité des contrôles et d’identifier les flux illégaux, le plan de lutte contre le terrorisme de janvier 2016 prévoit non seulement de renforcer les effectifs des cellules en charge du ciblage ICS, du fret postal et du fret express, mais également de doter les unités douanières de nouveaux moyens de détection non intrusifs plus performants – appareils à rayons X – sur les plateformes portuaires et aéroportuaires.
Enfin, le plan consacre la douane comme un acteur essentiel de la lutte contre le financement du terrorisme. Grâce aux constatations de manquements à l’obligation déclarative et aux déclarations de capitaux, la douane est en mesure de mettre à jour des phénomènes criminels de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Pour accroître ses capacités, le projet de loi relatif à la lutte contre le crime organisé et le terrorisme et leur financement crée l’article 415-1 du code des douanes de manière à faciliter la charge de la preuve en matière d’infraction douanière de blanchiment, imposant à l’infracteur de prouver la licéité de l’origine des fonds qu’il transporte frauduleusement.
Afin d’être en capacité de traiter les nouveaux dossiers de contentieux liés au blanchiment, les services d’enquête administratifs nationaux mais également le SNDJ verront leurs effectifs renforcés courant 2016.
En conclusion, grâce à une mobilisation forte de l’ensemble de la communauté douanière, les progrès que nous avons réalisés ces dernier mois pour nous adapter à cette nouvelle menace sont significatifs. Le soir du 13 novembre dernier, notre dispositif a été adapté dans l’urgence afin de répondre aux circonstances exceptionnelles. Cette urgence s’est transformée en un mode d’organisation à moyen terme.
Une cellule de crise a immédiatement été mise en place au sein de la direction générale et la DNRED a mobilisé l’ensemble de ses services spécialisés. Pendant plusieurs jours, la douane a travaillé en étroite collaboration avec les autres services spécialisés, DGSI, PAF…, contribuant à l’identification des individus et des véhicules soupçonnés d’être impliqués dans des attentats ou d’en préméditer. Cela a abouti à des dispositifs pérennes de coopération renforcée.
Je me tiens à votre disposition pour répondre à des questions complémentaires.
M. le président Georges Fenech. Vous faites état d’un renversement de la charge de la preuve ; pouvez-vous nous donner des précisions ?
M. Jean-Paul Balzamo, sous-directeur des affaires juridiques et contentieuses, des contrôles et de la lutte contre la fraude. La commission mixte paritaire s’est réunie hier matin et les deux assemblées sont d’accord sur la rédaction d’un article 415-1 du code des Douanes.
Lorsque les agents des douanes constatent un manquement à l’obligation déclarative de capitaux (MOD), ils ont pour objectif de rechercher si cette infraction s’accompagne d’un délit de blanchiment douanier ou éventuellement de droit commun. À l’instar du délit de blanchiment de droit commun (article 324-1 du code Pénal), le futur article 415-1 du code des douanes assouplit le régime de la preuve du blanchiment douanier. Il appartient à l’infracteur qui a commis le MOD de justifier de l’origine licite des fonds qu’il transporte. Le Parlement est même allé au-delà de notre demande car le projet de loi comporte également une disposition qui soumet les déclarations de capitaux d’un montant supérieur à 50 000 € à la production de documents justifiant de leur provenance.
Les moyens juridiques du SNDJ ont par ailleurs été étendus. Ont ainsi été ajoutés à son champ de compétences le blanchiment du terrorisme et le financement du terrorisme. En effet, le SNDJ participe à la stratégie globale de la douane en matière de lutte contre le financement du terrorisme et le blanchiment. Or, ce service dispose d’un champ de compétence limité dans la lutte contre le terrorisme. Il ne peut agir que lorsque les infractions liées au terrorisme sont connexes aux infractions entrant dans son périmètre d’attribution. Ce projet de loi comble désormais cette lacune.
M. le président Georges Fenech. Mme la directrice générale a évoqué 3 millions d’euros en possession de Syriens. Ces personnes vivent-elles en France ? Qui sont-elles ?
M. Jean-Paul Balzamo. Deux des Syriens ayant commis des MOD résidaient en Espagne, le troisième en Allemagne, et étaient en transit en France. Les sommes, en liquide, étaient conséquentes et n’avaient fait l’objet d’aucune déclaration en douane, et les justificatifs présentés pour justifier une prétendue activité commerciale étaient par ailleurs totalement inopérants. Nous avons donc saisi l’autorité judiciaire, qui a décidé d’ouvrir une information judiciaire et les informations ont également été communiquées à la DGSI.
M. le président Georges Fenech. Vous allez pouvoir appliquer immédiatement le dispositif de renversement de la charge de la preuve, n’est-ce pas ?
M. Jean-Paul Balzamo. Oui, car la loi et la procédure sont immédiatement applicables.
M. le président Georges Fenech. Vous souhaitez un nouveau dispositif juridique pour les procédures anonymisées en matière de cybercriminalité. La sécurité juridique de ces procédures n’est pas suffisante, si j’ai bien compris.
Mme Hélène Crocquevieille. Il s’agit de la sécurité juridique des procédures mais aussi de celle de nos personnels. Pour que la procédure soit valide, il faut qu’un agent soit nommément désigné. Compte tenu de la dangerosité de certains individus, il est important, notamment dans le cadre de coups d’achat sur internet, que nos agents habilités puissent avoir recours à des procédures anonymisées.
M. Jean-Paul Balzamo. Le coup d’achat nous est ouvert en matière de stupéfiants, de trafic de cigarettes et de contrefaçons. Nous avons été la première administration européenne à réaliser des coups d’achat sur le Darknet mais nous avons été très rapidement confrontés au problème de l’anonymat. Il y a environ deux ans, le Parlement a accordé à l’administration des douanes la possibilité de réaliser des coups d’achat de manière anonymisée car la sécurité de nos agents était en jeu.
Avant de basculer sur un coup d’achat, il faut patrouiller sur le Net et, pour entrer sur des sites particuliers, montrer patte blanche. D’où l’intérêt de permettre d’acter des procès-verbaux sous pseudonyme, afin de relever les sites vendant des produits de manière illégale. Cette disposition a été actée dans la commission mixte paritaire hier.
M. le président Georges Fenech. Votre demande est donc satisfaite.
Vous n’avez pas évoqué vos relations avec Tracfin.
Mme Hélène Crocquevieille. Tracfin est membre de la communauté du renseignement, tout comme la DNRED. Les relations de Tracfin avec la direction générale des douanes sont fluides. Nous avons un protocole de coopération bilatérale, sur laquelle a lieu une revue annuelle de mise en œuvre. J’ai par ailleurs repositionné, début 2015, un officier de liaison au sein de Tracfin. Enfin, nous poursuivons la mise en service d’accès automatisé à certains fichiers de données douanières.
M. le président Georges Fenech. Vous avez reçu en 2015 des gilets pare-balles et des pistolets-mitrailleurs. Des agents des douanes sont-ils aujourd’hui munis de pistolets-mitrailleurs ?
Mme Hélène Crocquevieille. La loi de finances pour 2016 comporte un premier volet de 29 millions d’euros supplémentaires, et 15 millions sont prévus pour 2017, en vue de renforcer les équipements des services douaniers. Nous en avons profité pour généraliser les dotations individuelles en gilets pare-balles. Par ailleurs, les brigades de surveillance sont de plus en plus fréquemment confrontées à des refus d’obtempérer dans le cadre de la criminalité classique, avec des individus qui n’hésitent plus à foncer dans les véhicules ou les dispositifs piétons mis en place, ce qui nous a conduits à prévoir, pour les situations à risque, la présence d’au moins un agent équipé d’une arme lourde. Une expérimentation a été conduite. Nous doterons en priorité les unités sur les axes les plus sensibles et à proximité des points frontaliers, à raison d’une arme lourde par unité. La dotation sera collective, affectée à la brigade. Nous commençons à déployer ces équipements.
M. Jean-Paul Balzamo. Ce n’est pas nouveau en douane : les garde-côtes disposent d’armes lourdes depuis des années. Nos moniteurs de tir sont déjà formés.
Nous sommes confrontés à plus de 400 oppositions à fonction par an, avec passage de vive force – plus d’une par jour. Une a eu lieu hier sur le péage autoroutier du Capitou à Aix-en-Provence. Non seulement le véhicule n’a pas obtempéré mais il a par deux fois tenté de forcer nos motards, ce qui les a contraints à tirer en bas de caisse du véhicule. L’affaire est judiciarisée. La fouille du véhicule n’a rien donné mais les identités des deux individus sont totalement fausses.
M. le président Georges Fenech. Le rapporteur et moi nous sommes rendus à Marseille où nous avons rencontré vos services qui ont réussi la prise de Mehdi Nemmouche. Est-ce suite à une vigilance renforcée ou bien après un contrôle aléatoire que ce dernier a été interpellé ?
M. Jean-Paul Balzamo. À la suite des événements relatés par la presse, la vigilance de nos agents était naturellement plus grande. Par ailleurs, nos services, et c’est moins connu, contrôlent les lignes sensibles de bus et de train. Certaines lignes sont plus propices que d’autres à certains trafics. Le contrôle est certes aléatoire mais nous travaillons à partir d’éléments concrets.
M. Sébastien Pietrasanta, rapporteur. Quelle a été l’attitude de la douane le 13 novembre au soir, dans les heures qui ont suivi les attentats ? Par ailleurs, comment se passe votre collaboration avec les autres services du renseignement, notamment la DGSI ? Quelles seraient, selon vous, les pistes d’amélioration ?
Mme Hélène Crocquevieille. Nous étions prêts à nous déployer rapidement, le 13 novembre, car nous préparions la COP21 et la mise en place de contrôles renforcés dans ce cadre. Des points de passage autorisés (PPA) sur les frontières intracommunautaires avaient été répartis entre la PAF, et la douane avec l’appui de la gendarmerie. La nuit du 13 novembre, le Président de la République a annoncé le rétablissement des contrôles aux frontières. J’ai donc veillé, dans la nuit, à informer l’ensemble de la chaîne de commandement. Au moment de leur prise de poste tôt le lendemain matin, les unités douanières se sont déployées sur les PPA en priorité, et ont mis en œuvre des modalités de contrôle systématique. Les unités de l’hinterland sont ensuite venues renforcer le dispositif afin de permettre des rotations. L’organisation des contrôles physiques s’est par la suite ajustée, sous la responsabilité des préfets, en fonction des flux observés et des contraintes induites pour la population, notamment les travailleurs transfrontaliers.
M. le président Georges Fenech. Depuis la création de l’espace Schengen, vous étiez en effet en baisse d’effectifs. Aujourd’hui, la courbe est inversée, pour cinq ans.
Mme Hélène Crocquevieille. Le plan annoncé couvre deux ans. La cohérence voudrait que l’on ne pratique pas trop de yo-yo en matière de ressources humaines mais, pour le moment, les annonces n’ont été faites que pour les deux exercices 2016 et 2017.
M. Jean-Paul Balzamo. Dès le lendemain des événements, sur la base des éléments d’information fournis à la DNRED par le ministère de l’intérieur, nous avons injecté les numéros d’immatriculation dans nos portiques LAPI. Nous avons ainsi pu connaître dès l’après-midi les passages de véhicules concernés par les attentats : quand ils sont venus sur Paris et quand ils sont retournés en Belgique. Nous avons fait la même chose pour nos collègues belges à la suite des attentats de Bruxelles.
S’agissant des LAPI, la douane a fait un choix différent de ce qui avait été prévu en interministériel, à savoir des LAPI mobiles, car si un tel dispositif est adapté à la police et à la gendarmerie, la douane recherche quant à elle une infraction dont personne n’a encore connaissance. En utilisant les LAPI de manière fixe, nous avons démultiplié les informations. Avec trente-six lecteurs fixes, l’administration des douanes fonctionne H24, recueille ainsi plus d’informations que les 500 lecteurs mobiles du ministère de l’intérieur. Nous enrichissons les fichiers de ce ministère avec nos données.
M. le rapporteur. On nous a expliqué que les radars automatiques avaient également été utilisés dans la nuit du 13 novembre.
M. Jean-Paul Balzamo. Cela n’empêche pas.
M. Jean-Paul Garcia, chef de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières. Si, après les attentats de janvier, nous avons eu quelque peine à recueillir les informations permettant au réseau douanier de se positionner dans des conditions d’efficacité immédiate, en novembre, en revanche, nous étions prêts immédiatement. Avant vingt-deux heures, le relai de la cellule de crise de la direction générale était installé à la DNRED et notre officier de liaison au sein de la cellule Allat, cellule inter-agences installée à la DGSI, était à son poste à Levallois et pouvait informer l’ensemble de la structure douanière d’alerte, de crise et de réaction avant minuit. Cette différence est essentiellement due à une meilleure intégration de la direction générale des douanes dans le dispositif de la DGSI. La difficulté, pendant la première moitié de l’année 2015, était d’obtenir de ce partenaire des informations pratiques d’utilisation immédiate, la DGSI étant extrêmement réticente à l’idée d’échanger des informations dès lors qu’une partie de l’opération est judiciarisée.
Les progrès à cet égard ont été considérables en raison de la création au sein de la DGSI de la cellule Allat réunissant des représentants de chacune des six centrales de renseignement ainsi que des services du second cercle, le service central du renseignement territorial (SCRT) et la direction du renseignement de la préfecture de police (DRPP).
Le GOLT a été créé au sein de la DNRED au lendemain du 11 septembre 2001, en lien étroit avec Tracfin et les autres services de renseignement. Ce service a été très actif dans les mois et les années suivantes, puis il est progressivement devenu secondaire dans la mesure où, pendant la décennie 2005-2015, le terrorisme n’était plus un objectif majeur de la direction générale des douanes, et le trafic d’armes lui-même était plutôt secondaire, derrière les stupéfiants, le tabac, les contrefaçons et les mouvements de capitaux.
Ce sont les événements marseillais qui ont conduit la douane à renforcer sa mobilisation contre le trafic d’armes. Dès l’entrée en fonction de la nouvelle majorité en 2012, le ministre des Finances a demandé aux directeurs des douanes marseillaises de jouer un rôle plus important dans la lutte contre le trafic d’armes alimentant la délinquance marseillaise. La DNRED a mobilisé à cet effet ses compétences et ses moyens notamment ceux du GOLT. C’est ainsi que nous avons été conduits à renforcer le GOLT dès avant les attentats de janvier 2015.
Le GOLT participe depuis 2001 aux réunions de l’UCLAT. Mon point de vue personnel est que l’UCLAT est une structure de rencontre, non opérationnelle, où s’échangent des informations générales. Très différente est l’approche au sein de la coordination nationale du renseignement, qui débouche sur des échanges entre services au plan opérationnel. La direction du renseignement douanier a acquis entre 2010 et 2015 une véritable légitimité tant dans ses publications de niveau stratégique que dans le ciblage, le criblage et l’analyse issue du ciblage et du criblage. Nous échangeons des renseignements opérationnels et conduisons même des opérations conjointes, davantage avec la DPSD ou la DGSE qu’avec la DGSI, laquelle, en raison de sa finalité judiciaire peut moins aisément échanger du renseignement opérationnel avec des services non judiciaires.
Néanmoins, dès la fin de l’année 2014, une cellule inter-agences a été créée au sein de la direction du renseignement militaire (DRM) et du centre de planification et de conduite des opérations (CPCO), la cellule Hermès, ayant vocation à faire travailler ensemble les six centrales afin de fournir des informations en rapport avec le théâtre irako-syrien. Cette cellule a été en quelque sorte le brouillon de la cellule Allat, du point de vue organisationnel, sachant que dans l’une et l’autre, les deux grands services, la DGSE et la DGSI, donnent le ton aux autres partenaires.
Après les événements de 2015, le coordinateur national du renseignement pousse la DGSI à créer la cellule Allat, qui est opérationnelle en juin 2015 et produit tous ses effets à partir de novembre de la même année. La cellule est dirigée par un commissaire de la DGSI et comprend des agents de catégorie A ou officiers des six centrales ainsi que du renseignement territorial, dont le rôle est capital car c’est le réseau vivant du renseignement sur le terrain, et de la DRPP et du SCRT.
M. le rapporteur. Pour résumer votre propos, vous considérez la cellule Allat comme un progrès en matière d’échange d’informations et, a contrario, l’UCLAT comme n’étant guère qu’une sorte de club. Que pensez-vous de l’état-major opérationnel de prévention du terrorisme (EMOPT), créé à l’été 2015, et quels sont vos rapports avec cette structure ?
M. Jean-Paul Garcia. Qu’est-ce que l’EMOPT ? La question est une réponse.
M. le rapporteur. L’EMOPT est rattaché à la place Beauvau et gère le FSPRT. Je m’étonne que le patron d’un des principaux services de renseignement ne connaisse pas l’EMOPT un an après sa création. Je ne vous mets pas en cause mais je m’interroge.
M. Jean-Paul Garcia. Monsieur le rapporteur, cela ne me gêne aucunement d’être mis en cause en la matière. Avant de vous répondre, deux précisions. Tout d’abord, la DNRED compte 700 agents, dont 200 s’occupent de gestion ou de fonctions fiscales et douanières, à savoir le recouvrement et le redressement des droits, 400 travaillent sur les stupéfiants, le tabac, les contrefaçons, et une centaine font du renseignement pour la communauté douanière, un renseignement à finalité douanière avant tout. L’ensemble de ces agents ont été mobilisés sur l’objectif prioritaire de la lutte contre le terrorisme, ce qui, pour la majorité d’entre eux, est quelque chose de nouveau.
Ensuite, il existe dans le milieu de l’anti-terrorisme une multitude de structures au sein du ministère de l’intérieur, l’UCLAT, la sous-direction anti-terroriste (SDAT), la DRPP…, et la DGSI, qui est à la fois une structure de renseignement et une structure judiciaire. Depuis 2015, les rapports avec les services opérationnels du ministère de l’intérieur se sont améliorés, grâce à la cellule Allat. Nous sommes par ailleurs toujours au sein de l’UCLAT, où s’échangent des formules de politesse et des informations générales.
Sur ce qui est organisé au sein du ministère de l’intérieur, apparemment à un très haut niveau puisque vous parlez d’état-major, si cela ne relève pas de la coordination du renseignement ni ne participe aux conseils nationaux du renseignement, je me retire pour laisser la parole à la direction générale des douanes, qui se situe au niveau des états-majors. Mon service n’a quelque autonomie qu’au sein de la coordination nationale du renseignement.
M. le rapporteur. Vous n’avez donc jamais entendu parler non plus du FSPRT, un fichier concernant les personnes jugées pour radicalisme et terrorisme, créé à l’été 2015 en vue d’éviter les « trous dans la raquette » en centralisant les signalements départementaux de la gendarmerie, par exemple. Alors que les informations douanières sont, j’imagine, des éléments importants, utiles dans la lutte contre le terrorisme, le FSPRT, si je comprends bien, ne comporte pas d’éléments douaniers.
M. Jean-Paul Garcia. Les rapports avec les services du ministère de l’intérieur ne sont pas toujours simples.
Les conditions du partage ont été fixées dès après les événements de janvier 2015 afin d’éviter, en effet, les trous dans la raquette. Par conséquent, nous n’avons pas accès à l’ensemble du fichier tel que vous venez de le décrire. En revanche, nous avons accès, par la cellule Allat mais aussi dans le cadre de nos partenariats avec les services, à celles des « fiches S » dont la thématique est la radicalisation.
M. le président Georges Fenech. L’EMOPT semble rester limité au ministère de l’intérieur. Ne voyez en tout cas aucune mise en cause personnelle ou de votre administration dans la remarque du rapporteur ; c’est simplement une interrogation sur la coordination du renseignement.
M. Christophe Cavard. Nous avons voté il y a peu la loi sur le renseignement. Considérez-vous que son impact, en particulier en termes de moyens et de techniques de renseignement, soit réel sur les services des douanes ?
Beaucoup se demandent comment peuvent entrer des armes de guerre dans un pays comme la France, dont les services sont efficaces. Quels sont les réseaux ? Cela a-t-il toujours existé ou bien est-ce dû aux déstabilisations géopolitiques de certains pays, dont certains se trouvent en Europe ? On a par exemple beaucoup parlé de l’ex-Yougoslavie.
M. Jean-Paul Garcia. Avant la loi Renseignement, les interceptions administratives de sécurité étaient codifiées, avec un contrôle par la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité (CNCIS) et un quota de lignes, qui est devenu par la suite un quota de cibles, globalement suffisant. Je n’étais pas demandeur de la loi car je mettais déjà des techniques en œuvre : balisage de véhicules et de bateaux, interception de communications par satellite, IMSI-catcher – la presse s’est fait l’écho de la possession de cet outil par la douane –, et tout le reste, y compris l’intrusion dans des lieux privés, et c’était globalement satisfaisant. Aucun de mes agents n’a jamais invoqué un risque juridique personnel pour décliner une mission qui lui était confiée.
La loi sur le renseignement n’a donc pas apporté à la DNRED un surcroît de capacités. Elle offre en revanche un confort juridique appréciable car la responsabilité de la mise en œuvre des techniques de renseignement, qui n’était que la mienne et celle de l’opérateur, au niveau pénal, est désormais prise en compte au plus haut niveau de l’État. Les rapports de la DNRED avec la Commission nationale de contrôle des techniques du renseignement (CNCTR) sont excellents.
L’essentiel des agents opérationnels de la DNRED est constitué d’agents de catégories B et C, ce qui est une exception au sein des centrales de renseignement. Il a fallu que ces agents apprennent à écrire de manière intelligible pour les services de Bercy et nous avons donc eu un petit temps d’adaptation. J’indique cependant ma satisfaction de la réactivité de la CNCTR car nous obtenons les autorisations utiles très rapidement. Le processus a vocation à être informatisé, ce qui nous fera encore gagner du temps. Par ailleurs, nous n’avons jamais essuyé un refus depuis l’entrée en vigueur du dispositif.
À l’exception des techniques nécessitant une intelligence humaine et artificielle de niveau très élevé – algorithmes d’analyse de métadonnées… –, nous recourons à toutes les techniques de renseignement, en France et à l’étranger. Lorsque nous opérons à l’étranger, nous ne le faisons jamais dans la clandestinité : cela se passe toujours dans un pays partenaire, qui assure la sécurité de l’opération.
M. Christophe Cavard. Les objets d’art sont une source de financement potentielle du terrorisme. Avez-vous monté en puissance sur cette problématique ? Quand les objets proviennent de Syrie ou d’Irak, vous ne pouvez pas tellement opérer dans ces pays, j’imagine.
M. Jean-Paul Garcia. Le sujet des biens culturels est en soi complexe. Je dispose de quelques spécialistes, à la direction des enquêtes. Ils travaillent essentiellement sur l’exportation – la protection de notre patrimoine – car l’interdiction de l’importation est très récente. Les États-Unis nous avaient déjà demandé d’intervenir sur l’importation de biens culturels amérindiens, et force avait été de reconnaître que nous n’avions pas alors la capacité juridique d’agir ; nous ne pouvions que recueillir du renseignement. Les informations sur les pays que vous citez, qui sont des théâtres d’opérations, sont beaucoup plus difficiles à obtenir. Par ailleurs, les « aviseurs », les personnes qui nous informent, ont, concernant les biens culturels, un profil différent de ceux qui nous informent pour le reste. Ce sujet est un nouveau défi qu’il nous faut relever.
S’agissant du trafic d’armes, la DNRED, comme je l’ai expliqué, s’est mobilisée en raison de la préoccupation marseillaise. Nous avons comme toujours cherché à être dans l’anticipation, c’est-à-dire à connaître les réseaux. Le travail accompli entre 2013 et 2014, dans des opérations concrètes contre le trafic d’armes destituées à la délinquance, nous a permis de développer une compétence aujourd’hui largement remise au service de la lutte contre l’environnement du terrorisme.
M. Jean-Paul Balzamo. Nous avions traditionnellement deux modes d’intervention classiques, à l’importation dans le fret et par les contrôles aléatoires de la surveillance, mais nous avons aujourd’hui recours à d’autres moyens sur le trafic d’armes, des moyens spécifiques à l’administration des douanes et complémentaires de l’action des autres services répressifs de l’État.
La finalité de l’ICS est que les frets à destination du territoire européen ne soient pas contaminés par des produits dangereux, tels qu’armes et explosifs. C’est un moyen d’intervention sur lequel nous montons en puissance.
Le fret express permet, avec une facilité déconcertante, l’acquisition via internet, de nombreuses marchandises prohibées. Dans ce secteur, nous montons en puissance en amont, sur l’analyse et le ciblage, et dans l’intracommunautaire, et nos résultats progressent. Plus d’un tiers des saisies réalisées par les douanes en matière de contrefaçons, qui correspondent à 99,9 % des résultats de l’ensemble des services répressifs de France en contrefaçons, sont réalisées dans le fret express. Nous en sommes à quarante-huit constatations pour des armes en fret express. Nous voulons faire mieux.
Le plan armes dont a parlé la directrice générale ne pourra prendre toute son ampleur que dans un cadre interministériel. C’est pourquoi nous sollicitons le ministère de l’intérieur, qui dispose de bases de données sur les armes utilisées par des malfaiteurs grâce aux laboratoires de la police et de la gendarmerie. Si les services de l’Intérieur nous transmettent les noms des expéditeurs ou des destinataires d’armes, nous pouvons conduire une action très en amont et diligenter des contrôles extrêmement ciblés et efficaces. Cela déclencherait un cercle vertueux : les services judiciaires, policiers et de gendarmerie récupèreraient en enquête les constatations d’infraction réalisées par les services des douanes. Le travail en commun est indispensable. La victoire ne pourra être que collective.
M. Jean-Paul Garcia. Nous souhaitons discuter sérieusement avec l’autorité judiciaire sur la lutte contre le trafic d’armes. Il convient aussi d’avoir avec les pays de l’Europe de l’Est, où circulent tant d’armes, sans même parler des Balkans, une coopération comme celle que nous avons avec les États-Unis, par exemple. La lutte contre ce trafic implique par ailleurs un travail sur internet ; Cyberdouane va chercher sur le Darknet les gens qui vendent des armes ou des pièces détachées d’armes.
M. le président Georges Fenech. Serait-il possible, monsieur Balzamo, de nous communiquer un document écrit sur ce que vous venez de dire au sujet du trafic d’armes ?
Mme Hélène Crocquevieille. Les ministres viennent tout juste de valider notre plan armes, que nous pourrons vous transmettre. Le besoin de coordination existe entre les différents services nationaux mais aussi au plan communautaire où il est impératif que la réglementation sur le contrôle de la circulation des armes à feu soit renforcé et puisse s’appuyer sur des outils informatiques.
M. le président Georges Fenech. Nous vous en remercions.
Audition, à huis clos, de M. Didier Le Bret, coordonnateur national du renseignement (CNR)
Compte rendu de l’audition, à huis clos, du mercredi 18 mai 2016
M. le président Georges Fenech. Nous avons le plaisir d’accueillir M. Didier Le Bret, coordonnateur national du renseignement (CNR), accompagné de Mme Agnès Deletang, magistrate, conseillère juridique auprès du CNR. Merci, monsieur l’ambassadeur, d’avoir répondu à notre demande d’audition.
Nous avons déjà commencé à nous intéresser aux questions qui concernent le renseignement en recevant la semaine dernière les responsables des douanes et de la police aux frontières (PAF). Mais avec vous, comme avec le président de la commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR) que nous entendrons ensuite, nous allons aborder le cœur même du sujet. Je rappelle que le coordonnateur du renseignement, qui est, selon le Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale de 2008, le « point d’entrée des services de renseignement auprès du Président de la République », centralise les informations relatives au renseignement et anime le Conseil national du renseignement, créé en 2008.
En raison de la confidentialité des informations que vous êtes susceptibles de nous délivrer, cette audition se déroule à huis clos. Elle n’est donc pas diffusée sur le site internet de l’Assemblée nationale. Néanmoins, et conformément à l’article 6 de l’ordonnance 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, son compte rendu pourra être publié en tout ou partie, si nous en décidons ainsi à l’issue de nos travaux. Je précise que les comptes rendus des auditions qui auront eu lieu à huis clos seront au préalable transmis aux personnes entendues afin de recueillir leurs observations. Ces observations seront soumises à la commission, qui pourra décider d’en faire état dans son rapport.
Je rappelle que, conformément aux dispositions du même article, « sera punie des peines prévues à l’article 226-13 du code pénal toute personne qui, dans un délai de vingt-cinq ans […], divulguera ou publiera une information relative aux travaux non publics d’une commission d’enquête, sauf si le rapport publié à la fin des travaux de la commission a fait état de cette information ».
Conformément aux dispositions de l’article 6 précité, je vous demande de prêter le serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité.
M. Didier Le Bret prête serment.
Nos questions vont évidemment tourner autour de la sombre année 2015. Nous sommes d’ailleurs intéressés par votre analyse des différences entre janvier et novembre, à la lumière des retours d’expérience et d’éventuels audits internes réalisés par vos services spécialisés. Quelles leçons en avez-vous tirées ? Qu’est-ce qui, le cas échéant, a fait défaut ? Les cibles étaient-elles trop nombreuses ? La dangerosité de certains individus a-t-elle été mal évaluée ? A-t-on manqué d’informations de la part des services de renseignement étrangers ?
Avec le recul, comment expliquez-vous l’interruption des écoutes des frères Kouachi et d’Amedy Coulibaly, alors même que, selon nombre d’analystes, l’adoption d’un comportement discret est le signe que le passage à l’acte approche ? Comment expliquer que Samy Amimour ait pu quitter le territoire français alors qu’il était sous contrôle judiciaire ? Pourquoi n’était-il pas surveillé par les services de renseignement ? Comment expliquer qu’Ismaël Omar Mostefaï, qui faisait l’objet d’une fiche S, ait pu lui aussi quitter le territoire ? Comment comprendre que les services de renseignement aient été incapables, tout au long de l’année 2015, de localiser Abdelhamid Abaaoud ?
Aujourd’hui, combien d’individus sont identifiés par les services comme représentant une menace terroriste islamiste et surveillés à ce titre ? Quelle évolution avez-vous observée à cet égard au cours des derniers mois ? Dans quels fichiers leurs noms apparaissent-ils ? Qui les suit ? Ces noms sont-ils partagés avec toute la communauté du renseignement ? Quelle est la valeur ajoutée du nouveau fichier FSPRT (fichier des signalés pour la prévention et la radicalisation à caractère terroriste) ? Sur les 1 000 individus concernés présents sur notre territoire, combien font l’objet d’une procédure judiciaire ? À quel moment décide-t-on de judiciariser ?
Pouvez-vous nous présenter les différentes instances de coordination et de partage des données des services de renseignement en matière d’antiterrorisme ? Quelle est la valeur ajoutée des cellules Hermès et Allat ? Combien de dossiers traitent-elles ? Faut-il aller vers l’interconnexion des fichiers des différents services ? Comment jugez-vous la coopération entre les services de renseignement et les magistrats antiterroristes ? Comment améliorer le recueil d’informations par le renseignement pénitentiaire ? Où en est la collaboration de celui-ci avec les autres services de renseignement, notamment le renseignement territorial et la direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) ? Qu’en est-il de la coopération avec les services de renseignement européens, américains, russes ?
S’agissant enfin des moyens, quel premier bilan dressez-vous de l’application des nouveaux articles L. 851-2 – sur le suivi en temps réel d’une liste d’individus – et L. 851-3 – sur les algorithmes – introduits dans le code de la sécurité intérieure par la loi du 24 juillet 2015 ? Les plans de recrutement des services se déroulent-ils correctement ? Le nombre d’arabisants, par exemple, est-il suffisant ?
M. Didier Le Bret, coordonnateur national du renseignement. Je répondrai au fil de l’eau aux questions précises que vous m’avez posées ; si d’aventure j’en oublie, je pourrai y revenir au cours de la discussion qui suivra.
Avant de vous répondre sur le bilan de l’année 2015, j’aimerais, pour éclairer la manière dont nous avons orienté notre action, insister sur la singularité des événements auxquels nous avons assisté alors et jusqu’au premier trimestre 2016, et qui sont à tous égards exceptionnels, voire extraordinaires.
D’abord par leur volume inédit : quatre attaques, dont deux massives ; deux tentatives et six projets déjoués, auxquels se sont ajoutées deux nouvelles attaques au premier trimestre de cette année.
Ensuite, une série de seuils ont été franchis. Le premier a trait à la diversité même des actes qui ont été commis. Nous avons tout eu : des actes d’ampleur, préparés, planifiés, coordonnées – les deux attaques de janvier et novembre ; des actes isolés, perpétrés par des acteurs revenant de théâtres de guerre en Syrie ou par d’autres qui, sans jamais quitter le territoire national, ont pu agir à l’instigation d’un contact sur place ; enfin, des individus relevant de la fameuse catégorie des « loups solitaires » qui, autoradicalisés, ont pris leur décision sur un fondement strictement personnel, mais le plus souvent à partir d’internet, comme, au début de 2016, lors de l’attaque du commissariat de la Goutte-d’Or et de la tentative d’assassinat d’un enseignant juif à Marseille. On retrouve en somme ici toute la typologie qui a été décrite dans la littérature relative au terrorisme.
Le deuxième seuil concerne la progression constante des flux de départs. Certes, celle-ci a enfin, pour la première fois, atteint un palier que nos voisins européens, avec qui j’ai eu l’occasion d’en discuter, ont connu il y a près de six mois. Autrement dit, la croissance des départs a tendance à se stabiliser : c’est une bonne nouvelle. Mais, en 2015, elle a aussi été plus spectaculaire en France que dans tout autre pays concerné : le nombre de Français partis à l’étranger – principalement en Syrie – est passé de 360 en début d’année à près du double, soit 600 personnes, en fin d’année, et à 636 aujourd’hui, ce qui représente une progression, tout à fait insolite, de 62 % en un an.
Un troisième seuil a été franchi dans la furtivité du comportement des terroristes. L’ensemble de la gamme des actions clandestines a ainsi été mobilisé lors des différentes attaques dont j’ai parlé, singulièrement celles de janvier et de novembre : utilisation de filières d’immigration illégale, infiltration de flux de migrants le cas échéant, communications cryptées, cartes bancaires prépayées, recours quasi systématique aux frappes dites obliques, qui consistent à cibler un pays depuis une base arrière logistique située dans un autre pays.
Le quatrième seuil, qui a beaucoup frappé l’opinion publique française, est l’appel aux modes opératoires qui caractérisent un théâtre de guerre – actions kamikazes, usage d’armes de guerre.
Le cinquième seuil concerne la diversification permanente du choix des cibles, qui produit un effet maximal – le fameux effet de sidération, la saturation de nos forces, mais aussi une inquiétude constante touchant l’ensemble des sites potentiellement concernés. Ainsi, dans le cadre de la préparation de l’Euro 2016, les services travaillent en priorité sur les stades – auxquels l’accès peut, on l’a vu, être restreint de manière assez dissuasive – et les fan zones ; mais, en durcissant les conditions d’accès à certains sites, on crée nécessairement des cibles « molles » qui peuvent apparaître tentantes à ceux qui cherchent à commettre des actes terroristes. On voit ici à l’œuvre une démarche assez sophistiquée, caractérisée par une faculté de mobilité permanente, dont témoignent la conception d’une attaque multiple comme la capacité de frapper une cible chaque fois différente.
J’en terminerai par le recours massif aux instruments de communication moderne, qui saute aux yeux et fait partie des principales caractéristiques et nouveautés de l’État islamique. Il permet à la fois de toucher un très large public et d’adopter une approche très ciblée, en fonction des relais locaux susceptibles de prendre contact avec les personnes qui se manifestent sur la Toile.
À tous ces éléments, qui étaient peut-être même décelables avant l’année dernière, le Gouvernement a entrepris de répondre dès cette période antérieure à janvier 2015, en tenant compte à la fois de l’échelle du défi à relever et des différents seuils que j’ai évoqués. Le premier aspect engage les personnels, les budgets et les outils.
En ce qui concerne les personnels, dès la fin 2013, au moment où s’est constituée la DGSI, issue de la direction centrale du renseignement intérieur (DCRI), les moyens humains ont été accrus de 432 agents. De même, pour le service central du renseignement territorial (SCRT), 800 postes ont été créés. Je rappelle que la création en 2008 de la DCRI, née de la fusion des renseignements généraux et de la direction de la surveillance du territoire (DST), avait fait perdre 2 000 effectifs à la structure – lesquels ne se sont naturellement pas évaporés, mais ont été transférés ailleurs.
M. le président Georges Fenech. Pardonnez-moi de vous interrompre. Nous aimerions en venir au cœur du sujet : votre mission de coordination, sur laquelle portaient les questions que je vous ai posées concernant votre rôle, les moyens dont vous disposez ou les raisons pour lesquelles les individus que j’ai cités ont échappé à la surveillance des services. Cela permettra à mes collègues de vous poser ensuite des questions utiles.
M. Didier Le Bret. Je poursuis néanmoins mon propos, si vous m’y autorisez, car j’ai aussi pour mission de conseiller le Président de la République à propos des questions que j’ai commencé d’évoquer, et il me semble important de mesurer le chemin parcouru à cet égard.
Au total, ce sont plus de 2 600 nouveaux personnels qui auront été intégrés à la communauté du renseignement, que je suis chargé d’animer et de coordonner, de 2014 à 2018 – date limite d’exécution du plan de recrutement.
Le budget, en exécution, est passé de 1,242 milliard d’euros en 2013 – pour les six services du premier cercle – à 1,329 milliard en 2015.
Quant aux outils législatifs, que vous connaissez mieux que personne, leur volume est lui aussi exceptionnel. Je citerai la loi de 2012, qui permet de poursuivre les actes de terrorisme commis à l’étranger, la loi de programmation militaire de décembre 2013, qui renforce les moyens d’investigation, la loi de novembre 2014, qui renforce la répression, allonge la liste des infractions, crée le délit d’entreprise terroriste individuelle et permet le blocage des sites internet, enfin les lois de juillet et de novembre 2015, qui définissent le nouveau cadre d’exercice des missions des services de renseignement, leur donnent des outils supplémentaires et permettent de faire profiter les services du deuxième cercle d’instruments auxquels ils n’avaient pas accès auparavant.
J’en viens à vos questions, monsieur le président.
En ce qui concerne la centralisation et la coordination, compte tenu du volume et du flux que j’ai évoqués, il était impératif que l’appareil d’État se dote d’un tableau de bord présentant l’ensemble des signalements. C’était le b.a.-ba du suivi des personnes signalées – principalement, mais pas exclusivement, par le biais de la plateforme créée au printemps 2013 ; il y a eu 14 000 signalements, dont 4 000 venant de la DGSI, le solde se répartissant entre le renseignement territorial, les préfectures et d’autres services. Cette action de centralisation, menée dans le cadre de l’état-major opérationnel de prévention du terrorisme (EMOPT), a permis de constituer le FSPRT, qui permet de savoir exactement qui est suivi par qui, afin d’éviter les doublons et, pire encore, l’absence de traitement par un ou plusieurs services. La réponse est essentiellement déconcentrée : les préfets, avec leurs états-majors, peuvent mobiliser l’ensemble des services de l’État pour réagir à tel ou tel signalement.
Voici l’enseignement majeur que je tire de ce qui s’est passé : le défi que nous avons à relever est la distinction des signaux faibles. Nous ne sommes plus au temps où le nombre de personnes signalées ne dépassait pas quelques centaines, ou plutôt quelques dizaines. Il s’agit donc désormais de concentrer les efforts des services, notamment de la DGSI, sur ce qui fait sens et qui permet d’identifier le passage à l’acte. Je reviendrai sur les différentes réunions du Conseil national du renseignement qui ont été organisées à cet effet.
Au nombre des différentes formes que la coordination a prises courant 2015 figurent Allat et Hermès. Les enseignements que l’on peut tirer de l’expérience ne sont pas identiques pour ces deux plateformes. Allat apporte une véritable valeur ajoutée à la DGSI et à l’ensemble des services : ceux-ci arrivent avec leurs bases de données respectives et interagissent directement en fonction des questionnements et des signalements émanant de la DGSI ou de tout autre d’entre eux. La fonction d’Hermès est d’identifier plus finement les filières à l’étranger, et d’aider la défense et les services concernés à préparer des dossiers d’objectifs et à étudier les sites qui nous intéressent. Les enjeux sont donc très différents. Pour Hermès, les marges de progression sont réelles, tandis qu’Allat apparaît utile à tous les services que je réunis à ce sujet.
M. Sébastien Pietrasanta, rapporteur. On a l’impression que les structures existent, mais qu’il y en a peut-être trop.
Ainsi, Hermès a été installée par la direction du renseignement militaire (DRM) et par la DGSE, Allat par la DGSI. Mais Allat ne traite que de quelques individus du haut du spectre – elle obtient d’ailleurs des résultats significatifs. Cela pose le problème de l’interconnexion des fichiers.
De même, avec l’EMOPT et l’UCLAT, n’a-t-on pas superposé deux structures chargées à peu près de la même mission ? Est-ce parce que l’UCLAT était mal positionnée au sein de la direction générale de la police nationale (DGPN) que l’on a créé l’EMOPT, rattaché au ministère de l’intérieur ? Pourtant, lorsque l’on interroge les services de renseignement du premier cercle qui ne dépendent pas du ministère de l’intérieur, on s’aperçoit qu’ils ne connaissent même pas l’existence de l’EMOPT, et encore moins celle du FSPRT ! Ils n’y ont pas intérêt, me direz-vous.
Mais pourquoi n’assureriez-vous pas cette mission de coordination et de connexion entre les fichiers ? N’est-ce pas votre rôle de coordonnateur ? Ne pourriez-vous constituer une véritable organisation autonome ? Combien de membres votre équipe compte-t-elle ?
M. Didier Le Bret. Moins de dix : j’ai cinq conseillers.
M. le président Georges Fenech. Mais vous êtes installés à l’Élysée.
M. le rapporteur. N’est-ce pas à vous de coordonner l’ensemble des services, de faire vivre un fichier, d’animer Hermès et Allat ? N’avez-vous pas l’autorité suffisante pour réunir tous les services de renseignement dans une même pièce afin qu’ils mettent en commun leurs fichiers ?
M. Didier Le Bret. L’EMOPT n’a pas d’existence juridique : cette structure a été conçue et créée à partir de l’apport de différents services qui concourent à la lutte contre le terrorisme au sein du ministère de l’intérieur. Il s’agit d’un état-major placé auprès du ministre lui-même, rattaché à son cabinet, et dont le « secrétariat » est assuré par l’UCLAT, si je puis m’exprimer ainsi sans manquer de respect à celle-ci. De l’extérieur, on peut effectivement se demander si les deux structures ne sont pas concurrentes. En réalité, le mérite de l’EMOPT est d’avoir permis d’asseoir tout le monde autour d’une même table, et ce au sein du ministère de l’intérieur. Reste la coordination des services en dehors de celui-ci.
M. le rapporteur. Pour nous en tenir au ministère de l’intérieur, n’aurait-il pas suffi de rattacher directement l’UCLAT au cabinet du ministre, au lieu de créer l’EMOPT ? Vous pouvez me dire le contraire, mais l’EMOPT fait ce qu’est censé faire l’UCLAT. Il se contente de gérer un fichier – et encore, puisque c’est l’UCLAT qui l’administre. On ne comprend pas la répartition des rôles entre l’UCLAT et l’EMOPT. On a l’impression que l’on n’a pas voulu déshabiller l’UCLAT pour habiller l’EMOPT, mais que l’on a contourné la première en créant le second. Qu’en pensez-vous, sans enfreindre votre devoir de réserve ?
M. Didier Le Bret. J’ai interrogé l’ensemble des services directement rattachés au ministre de l’intérieur : ils ont le sentiment d’un progrès…
M. le rapporteur. Avec le FSPRT ?
M. Didier Le Bret. …ce qui laisse penser que l’UCLAT n’avait peut-être pas l’autorité suffisante pour mener à bien ce travail. En ce sens, la création d’une structure qui, sans la doublonner, est directement placée sous l’autorité ministérielle, et dont le fichier est impérativement nourri par tous les services, apparaît comme une amélioration. On aurait peut-être pu faire autrement, mais c’est la décision qu’a prise le ministre.
Le CNR devrait-il coordonner l’ensemble des services, au-delà de ceux qui dépendent du ministre ? D’abord, ces derniers sont déjà nombreux. Je n’irai pas jusqu’à dire que l’essentiel se joue en leur sein, car tous les services doivent être mis à contribution : la DGSE, la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED), que vous avez auditionnée, la direction de la protection et de la sécurité de la défense (DPSD), Tracfin, etc. Mais, à titre administratif ou dans le cadre des enquêtes judiciaires, les services sont en grande partie dans la main du ministre de l’intérieur – la sous-direction antiterroriste (SDAT) pour la préfecture de police, la section antiterroriste (SAT) de la préfecture de police de Paris, la sous-direction antiterroriste de la DGSI, et même les services de la gendarmerie. Sans doute le besoin de rationaliser l’approche et la politique publique de contre-terrorisme se faisait-il sentir en interne.
Ma fonction, comme CNR, est de veiller à ce que cette politique publique nationale fonctionne en amont et en aval.
Ainsi, en janvier dernier, s’est tenu sous la présidence du chef de l’État un conseil national du renseignement dont l’un des points principaux consistait à acter le leadership de la DGSI dans la définition de la manœuvre globale de lutte contre le terrorisme. Cela peut paraître redondant étant donné la compétence nationale de la DGSI. Néanmoins, c’était la première fois que l’on posait clairement ce principe : c’est la DGSI qui, sous l’autorité du Président de la République et des ministres concernés, donne les orientations majeures à l’ensemble des capteurs de la communauté du renseignement afin de sanctuariser le territoire national. Cette politique pourrait sembler aller de soi à tel ou tel endroit extérieur au territoire, mais l’on part du principe que ce sont les enquêtes de la DGSI qui doivent permettre aux autres services de remonter les différentes filières et de concourir à la manœuvre globale.
La seconde décision entérinée par le conseil national du renseignement consiste à mobiliser l’ensemble des possibilités qu’offre la loi – rien que la loi, mais toute la loi –, notamment les deux articles que vous avez mentionnés, monsieur le président, afin d’aider la DGSI à faire son travail de discrimination, en créant des ETP et en formant des analystes capables de traiter la matière brute recueillie par les différents services, dont la DGSE, grâce à ces nouvelles dispositions législatives.
Tout cela se met en place. C’est compliqué, car la loi définit très précisément ce qui est permis. Ainsi, le suivi renforcé instauré par l’article L. 851-2 concerne les seuls terroristes qui représentent une menace. Il va donc falloir travailler sur les textes pour voir jusqu’où nous pouvons aller, par le dialogue et grâce à la compréhension qu’en a la CNCTR, afin que la DGSI puisse disposer de ces outils pour distinguer, au sein des 14 000 signalements, ce qui fait sens et permet de remonter les filières et d’identifier les comportements à risque.
M. le rapporteur. Avez-vous le sentiment que la coordination entre nos services a été suffisante au moment des attentats ? Y a-t-il eu un problème d’échange d’informations ? Que pensez-vous de notre coopération avec les services de renseignement étrangers, notamment européens et turcs ? Enfin, aujourd’hui, la coordination entre nos services peut-elle encore progresser ou est-elle parfaitement satisfaisante, notamment grâce à Allat et à Hermès ?
M. Didier Le Bret. On peut toujours progresser. Peut-être ces deux cellules préfigurent-elles une mutualisation accrue des moyens. Nous avons en France une organisation particulière, héritée de l’histoire, qui a accumulé plusieurs strates de politique publique en matière de renseignement. Certains pays ont fait d’autres choix, par exemple celui de plateformes techniques au service de l’ensemble de la communauté ; chez nous, c’est la DGSE qui intègre une direction technique puissante, laquelle doit elle aussi servir l’ensemble de la communauté.
L’évolution du système demande du temps. À supposer que je puisse exploiter demain, grâce aux outils de la DGSE, toutes les données qui intéressent la DGSI, il n’est pas certain que celle-ci dispose, malgré les efforts consentis depuis plusieurs années, de la capacité d’analyser ces données brutes qui, en tant que telles, ne signifient rien. Évitons le fétichisme du data mining (exploration des données) qui voudrait qu’en mettant 14 000 sélecteurs dans une machine on puisse savoir quand, comment et à quelle heure va se produire le prochain attentat ! Au mieux, nous parviendrons à des triangulations, à des éléments concernant l’environnement d’individus dont nous ne connaissions pas les relations auparavant, ce qui nous permettra d’affiner notre approche.
M. le rapporteur. Pour vous, il n’y a eu en 2015 aucun problème de coordination entre les services, aucun « trou dans la raquette » ?
M. Didier Le Bret. Je ne peux vous l’affirmer : il y a toujours des « trous dans la raquette ».
M. Meyer Habib. Le résultat, c’est que nous n’avons pas été bons.
M. Didier Le Bret. Dès lors que nous avons été frappés, il faut dire que nous n’avons pas été bons. Mais nous n’avons pas été frappés entre 1996 et 2012.
La menace a changé, je l’ai montré, et nous avons pris une série de mesures en conséquence.
Pour lutter contre le terrorisme, la mutualisation des données doit être la norme, et non l’exception, et il faut échanger en temps réel, car le temps joue toujours contre nous. C’est le choix qu’ont fait certains pays au lendemain du 11 septembre 2001. Entre le 11 septembre, les attentats de 2004-2005 en Espagne et au Royaume-Uni et l’année 2012, il n’y a pas eu beaucoup de réformes de structure en France pour créer, comme aux États-Unis, un super-pôle contre-terroriste. Nous avons choisi de maintenir des structures qui avaient chacune leur raison d’être, leur spécialisation, leurs moyens et leurs approches spécifiques. C’est aujourd’hui mon rôle de les amener à exploiter les outils techniques qui ont été développés au service de la communauté.
M. le président Georges Fenech. Je vous ai posé des questions très précises. Ce qui frappe, d’emblée, c’est que tous les individus qui ont commis les attentats, sans exception, étaient connus de nos services. Le problème n’est pas qu’ils aient échappé à leur surveillance à un moment ou à un autre. Je le répète, pourquoi avoir interrompu les écoutes visant les frères Kouachi et Amedy Coulibaly ? Comment Samy Amimour, qui était sous contrôle judiciaire, a-t-il pu quitter le territoire ? Pourquoi n’était-il pas surveillé ? Comment Ismaël Omar Mostefaï, objet d’une fiche S, a-t-il pu quitter lui aussi le territoire ? Comment expliquer que, tout au long de l’année, Abdelhamid Abaaoud ait pu rester hors des radars ? Il faut faire un constat : ils nous ont échappé, on ne peut le nier.
M. Didier Le Bret. Vous avez certainement tous participé, à un titre ou à un autre, à l’élaboration des deux lois de juillet et novembre 2015. Vous savez donc combien les interceptions de sécurité, pour ne parler que d’elles, sont encadrées. Aux termes de l’article L. 851-2, je le répète, il faut que la menace terroriste soit avérée ; ce dispositif, qui a tant fait parler de lui, ne peut en réalité être appliqué à n’importe qui : il est très sélectif. En outre, la durée d’écoute ou de collecte des données de connexion ne peut excéder deux mois. Cela signifie que, si nous devions exploiter l’ensemble des sélecteurs qui nous intéressent, il nous faudrait demander toutes les dix minutes à la CNCTR de renouveler une autorisation.
Je ne réponds pas à votre question s’agissant de savoir ce qui s’est passé lorsque c’était la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité (CNCIS) qui décidait du renouvellement des autorisations touchant les interceptions de sécurité ou permettant d’accéder au fichier des personnes que vous avez citées. Mais, vous le savez mieux que personne, l’exécutif suit quasi systématiquement les recommandations de l’autorité administrative indépendante. C’est en tout cas ce qui se passe aujourd’hui.
Bref, les services de renseignement ne « branchent » pas les gens de manière sauvage, mais dans le cadre de procédures triplement encadrées – par la CNCTR, le Conseil d’État et le contrôle parlementaire.
Il y a eu des interruptions, mais celles-ci étaient motivées par le fait que les individus ne semblaient plus particulièrement dangereux à ce moment-là.
Le quota maximal d’interceptions simultanées était fixé à 2 190 en 2014. Même en en renouvelant le nombre par tiers, on finit nécessairement par atteindre cette limite.
M. le président Georges Fenech. Cela a donné Charlie Hebdo et l’Hypercacher !
M. Didier Le Bret. Oui, mais c’est aussi le résultat d’une politique publique assumée par nos autorités et par le Parlement.
M. Christophe Cavard. Voilà plusieurs années que nous réfléchissons aux évolutions du renseignement. Ainsi, la commission d’enquête sur le fonctionnement des services de renseignement français dans le suivi et la surveillance des mouvements radicaux armés, dont Jean-Jacques Urvoas était le rapporteur et moi-même le président, a formulé des préconisations concernant le recrutement. Les chiffres que vous citez s’étendent sur plusieurs années ; nous aimerions savoir ce qui a été fait à ce jour, sachant que le risque s’est hélas accru. Quant aux profils, nous recommandions l’embauche de linguistes et de techniciens, notamment en informatique, car nous avions découvert avec une grande surprise, lors des auditions, l’existence de graves failles techniques qui obligeaient les services à externaliser une partie de ces compétences, ce qui pose évidemment des problèmes s’agissant de renseignement. Ces aspects ont-ils évolué sous l’effet des demandes du Président de la République et des travaux récents ? Nous interrogerons également les directeurs des services à ce sujet.
Ce qui ressort de la réunion du 14 janvier dernier entre le Président de la République et l’ensemble des services de renseignement nous pousse à nous interroger. Il s’agissait d’améliorer la mutualisation et la complémentarité du travail des services. Finalement, selon la presse – parfois mieux informée que les parlementaires –, il n’a pas été décidé grand-chose, sinon que l’on affectera des effectifs sur des terrains où il n’y avait plus personne. C’est du moins ce que j’ai lu dans Le Monde. Quel était l’enjeu de cette réunion et que fait-on pour rendre les services de renseignement plus efficaces ?
Enfin, en ce qui concerne les branchements et débranchements, il me semble que l’on était loin, ces dernières années et notamment du temps de la CNCIS, d’atteindre le quota maximal d’écoutes. Les responsables peuvent tout à fait décider de « débrancher », mais cela ne semble pas pouvoir être pour cette raison. Nous allons aussi interroger le nouveau président de la CNCTR sur ce point. L’autorité exprime des avis, mais c’est l’exécutif qui décide en dernière instance.
M. Alain Marsaud. Monsieur le coordonnateur national, j’ai eu l’occasion de travailler avec vous dans le cadre de vos précédentes fonctions à la tête du centre de crise du Quai d’Orsay, et d’apprécier votre engagement au service de la nation, compte tenu des contraintes de notre politique étrangère.
Le vétéran que je suis constate que, depuis quelque trente ans, au sein du contre-terrorisme, on bricole, on crée des organismes de coordination – j’ai ainsi participé à la création de l’UCLAT, du comité interministériel de lutte antiterroriste (CILAT), du service central de la lutte antiterroriste (SCLAT) –, on connaît des succès, des échecs. Voilà pourquoi je suis très indulgent vis-à-vis des échecs observés autour des attentats de janvier comme de ceux de novembre, et qui concernent les services de renseignement et de sécurité. Naturellement, nous avons à l’esprit le point de vue des victimes et de leurs familles. Mais il ne s’agit pas d’une science exacte et je sais combien il est difficile d’obtenir des résultats en permanence.
Le parcours d’Abaaoud est tout de même extraordinaire : il est dans le viseur des services et se promène un peu partout, du Moyen-Orient à l’Europe.
Mais en ce qui concerne ceux que vous identifiez, que vous interceptez et que vous localisez, existe-t-il une doctrine d’emploi permettant leur élimination préventive – et répressive, quand on sait ce que ces gens ont pu faire et ce dont ils sont capables ? Je vous pose cette question au risque de choquer certains membres de la commission d’enquête ; je la poserai également au patron de la DGSE et à d’autres que nous auditionnerons.
J’étais il y a une semaine à Djibouti, sur la base américaine d’où les drones Predator, armés de missiles Hellfire, décollaient vers le Yémen. Des officiers américains et des agents des services de renseignement, notamment de la CIA, nous ont expliqué que ces drones partaient le soir vers des cibles et qu’ils tuaient – de préférence des Américains, nous a-t-on dit, même s’ils en tuent aussi d’autres. C’est une doctrine d’emploi ; manifestement, au plus haut niveau de l’État – qu’il s’agisse de M. Obama ou de ses collaborateurs –, on décide de faire tuer des gens. Il y a aussi des opérations spéciales dont nous pouvons être informés par nos services, notamment du fait des forces spéciales – qui agissent déjà ainsi, semble-t-il, mais ce sont, dit-on, des actions de guerre.
Ne peut-on envisager de pratiquer l’élimination pure et simple ? J’étais tout récemment avec quelques collègues à Washington, au département de la sécurité intérieure ; les Américains nous ont expliqué que 150 de leurs ressortissants étaient partis en Syrie et, surtout, en Irak, qu’ils ne rentreraient pas puisque trente ans de prison les attendaient à leur retour, et qu’ils allaient tous être « dronés ».
J’ai posé la même question au ministre de la défense.
M. le rapporteur. Mais on le fait déjà !
M. Alain Marsaud. On « drone » ? Le ministre de la défense m’a pourtant répondu que nous n’avions pas de doctrine d’emploi de ce type et que nos drones Reaper n’étaient pas équipés pour mener des actions de guerre. Et on utilise des Rafale. Avec le dronage, on peut cibler un individu, une voiture, etc. Mais cela suppose une doctrine d’emploi : il faut que quelqu’un, au plus haut niveau de l’État français, décide d’éliminer ces gens-là.
Est-ce déjà fait, est-ce faisable ? Pouvons-nous nous donner une telle doctrine ?
M. le président Georges Fenech. Je ne sais si cette question est du ressort de M. Le Bret.
M. Alain Marsaud. C’est le coordonnateur national !
M. Didier Le Bret. En ce qui concerne la doctrine d’emploi, le concept de high value individual (individu de grande valeur) vaut pour la France comme pour les États-Unis et pour tous ceux qui sont engagés dans la coalition de lutte contre le terrorisme. Le commandement des opérations spéciales (COS) du ministère de la défense, avec à sa tête le général de Saint-Quentin, pilote par exemple l’opération Sabre, dans le cadre de l’opération Barkhane. Mais cela répond en partie à votre question : nous préférons que ces cibles soient arrêtées vivantes, de manière à les interroger et à enrichir ainsi les informations dont nous disposons. Quand on compare ce que l’on savait de ces gens au début de l’opération Serval, en janvier 2013, et ce que l’on en sait aujourd’hui, on mesure le chemin parcouru.
M. Alain Marsaud. Si on identifiait un Abaaoud aujourd’hui, serait-on en mesure d’agir ?
M. Didier Le Bret. Lorsque le Président donne des instructions sur nos opérations militaires au ministre de la défense ou au chef d’état-major des armées en conseil de défense ou en conseil restreint, il n’est pas question de cibler des individus. On identifie à Raqqah, à Mossoul ou à Deir ez-Zor les états-majors, les centres de propagande, d’entraînement, les dépôts d’armes, bref les lieux stratégiques du point de vue logistique. Ce sont les fameux dossiers d’objectifs. Ce sont eux qui sont ciblés dans le cadre de la guerre que nous menons contre l’État islamique, en Syrie comme en Irak. Si par malheur – ou par bonheur – il se trouve que les individus dont nous parlons s’y trouvent, nous ne revendiquons pas explicitement, surtout s’ils sont français, le fait de les frapper à l’instar des Britanniques ou d’autres. Nous ciblons des objectifs qui font sens afin de réduire la surface occupée par notre ennemi.
M. le rapporteur. J’imagine que vous avez lu le dossier du Parisien daté du 13 mai, selon lequel, si nous avons commencé à bombarder la Syrie, c’est parce que nous savions qu’Abaaoud et consorts préparaient des attentats sur notre territoire. Cela tend à contredire votre propos : nous aurions alors précisément ciblé des individus.
M. Didier Le Bret. C’est bien ce que je viens de vous dire.
M. le rapporteur. Vous dites que les cibles sont générales.
M. Didier Le Bret. Vous imaginez bien que ce dont vous parlez est aussi l’effet recherché dès lors que nous avons identifié des lieux de commandement stratégique, des états-majors, des centres de propagande, des endroits où se préparent des attaques dirigées contre notre pays.
La question des peines encourues par les Américains dont a parlé M. Marsaud évoque un enjeu essentiel dont nous avons récemment débattu avec le ministère de la justice : l’évolution de la politique pénale française en vue de criminaliser ce qui relève aujourd’hui du délit.
Pour le dire très clairement, 80 % au moins des personnes actuellement détenues pour des actes de terrorisme vont être libérées au cours des cinq années à venir, soit plus de 70 individus au cours des deux prochaines années. La courbe sera fortement exponentielle puisque près de 300 personnes sont actuellement mises en examen ; or, en l’état actuel de notre politique pénale, ces gens-là – ceux qui ont préparé les attentats, puisque l’on n’arrête jamais ceux qui les ont commis – encourent des peines maximales de dix ans, sans compter les non-lieux, ce qui revient en pratique à sept ou huit ans, trois ans compte tenu des remises de peine. Bref, des cohortes d’individus qui ont été mis en examen, jugés et détenus vont commencer à sortir de prison au cours des mois qui viennent.
Pour notre sécurité, il est donc essentiel de modifier notre politique pénale afin de ne plus faire de différence entre le crime et le délit, entre le soutien logistique et la participation directe à une action terroriste. Lorsque, dans six mois, vous me demanderez, cette fois à propos de ces anciens détenus, si un suivi continu est possible, ma réponse sera la même : non. Ces individus vont sortir de prison, adopter un comportement très furtif, ils ne se présenteront pas à Pôle emploi, ils ne commettront aucun délit, et aucune obligation de pointer, aucun bracelet électronique ne les empêchera de disparaître quand ils le voudront pour revenir ensuite nous frapper ! La durée de détention et les peines sont un véritable problème.
Monsieur Cavard, en ce qui concerne les moyens, les chiffres que j’ai cités correspondent aux renforts qui ont été déployés par vagues successives, après janvier, au printemps et au moment où le Président en a fait l’annonce devant le Congrès. Sans en détailler la liste par services, en voici le total : en 2016, 1 339 effectifs ; en 2017, 2 228 en cumulé, et 2 617 en 2018. Malheureusement, les directeurs des services vous le diront, il faut un délai de recrutement et de formation avant que ces personnels ne soient opérationnels. Ce qui a été fait depuis deux ou trois ans commence à produire ses effets, mais la montée en puissance est progressive.
Le vrai problème est celui des profils. Jusqu’à une date récente, pour des raisons statutaires, la DGSI n’a pas été en mesure d’opérer la mue fantastique qu’a accomplie la DGSE en s’ouvrant à des administrateurs civils, d’anciens élèves de Sciences Po, des analystes, des ingénieurs, des polytechniciens. La direction technique de la DGSE ne s’est pas constituée en six mois : il a fallu quinze ans d’investissements, d’ouverture, de communication. Mais la DGSE n’a pas de problème de statut : elle peut s’adapter, rémunérer ses agents – car le tout n’est pas de recruter, encore faut-il fidéliser ses cadres, qui ne doivent pas s’évaporer au bout de quelques années après avoir eu accès à des informations sensibles. Cela dit, le fait que la DGSI ait été séparée de la DGPN pour devenir une direction générale lui donne sans doute plus de flexibilité pour recruter des non-titulaires hors du corps des policiers.
Quoi qu’il en soit, les choses suivent leur cours. Patrick Calvar vous le confirmera. Elles ne changeront pas d’un seul coup, comme par magie.
Les décisions prises lors du conseil national du renseignement du 14 janvier sont couvertes par le secret défense et ce qu’en dit Le Monde est une extrapolation à partir du communiqué. Dans ce communiqué, on pouvait certes décrypter plusieurs éléments, comme certains journalistes ont tenté de le faire.
D’abord, le leadership renforcé de la DGSI en matière d’antiterrorisme. Cette dynamique nouvelle est claire, voulue et assumée.
Ensuite, la mobilisation par l’État des moyens techniques existants, dans le cadre de la loi. Pour le dire clairement, il s’agit de s’assurer que les moyens de la DGSE sont à la disposition de la DGSI, afin de pouvoir soumettre à un travail de discrimination l’environnement sinon des 14 000 signalés, du moins d’une partie d’entre eux, de manière à ce que nous nous concentrions ensuite sur le segment qui nous intéresse.
M. le rapporteur. On a l’impression qu’aujourd’hui, une multiplicité de fichiers coexistent. La DGSI estime que le FSPRT ne lui sert à rien, alors que la gendarmerie et le SCRT le trouvent utile. Les cellules Allat et Hermès ont une liste de noms gérée en temps réel, chacun avec son fichier puisque l’interconnexion n’est pas possible : les représentants de chaque service se réunissent dans une même salle, chacun avec son ordinateur, et font état de leurs informations.
Le haut du spectre est traité par le fichier DGSI. Or celui-ci est la chasse gardée de la DGSI.
M. Didier Le Bret. Non : sauf pour les actions en cours qui peuvent être extrêmement sensibles, notamment parce que les sources doivent être protégées, ce fichier est en interface avec les bases de données utilisées dans le cadre de la cellule Allat.
Quoi qu’il en soit, les services ont une grande habitude de travail opérationnel ensemble. Il ne faut pas s’exagérer leur cloisonnement. Ce travail en commun sert leur intérêt : ainsi, quand un service perd la trace d’un individu qui ne se trouve plus sur le territoire national, il lui faut bien dialoguer avec la DGSE et d’autres services, y compris étrangers, pour le localiser.
M. le rapporteur. En effet, on ne peut pas soupçonner les services de faire de la rétention d’information : l’enjeu est trop important. Mais il est tout de même extraordinaire qu’il faille réunir les représentants des six services dans une salle pour récupérer des informations, au lieu de créer un fichier commun ! Cela vaut du haut du spectre, au sein d’Allat, comme du FSPRT, que la DGSI qualifie de « fichier des préfets » et dont certains services du premier cercle ne connaissaient même pas l’existence quand nous les avons interrogés.
La question des fichiers est donc un enjeu essentiel, qui concerne la mise en commun des bases de données, donc la coordination.
M. Olivier Marleix. En novembre 2015, Bernard Squarcini, ancien patron de la DCRI, révélait qu’il aurait transmis à la France un message des services de renseignement syriens proposant, à condition que nous reprenions contact avec eux, de nous transmettre une liste de djihadistes français présents en Syrie ; cette proposition se serait heurtée à une fin de non-recevoir. Êtes-vous au courant de cette affaire et de la façon dont elle a été traitée ?
La chaîne britannique Sky News dit avoir récupéré une liste de 22 000 Européens ayant rejoint les rangs de l’État islamique. Les services du ministère britannique de l’intérieur et leurs homologues allemands déclarent travailler sur ce document, dont les commentaires publics semblent attester la réalité, même s’il comporte sans doute des redites qui réduisent le nombre de personnes concernées. Les services français ont-ils eu communication de cette liste, et travaillent-ils sur elle ?
M. François Lamy. Je ne vous demanderai pas de confirmer ou non qu’une frappe a visé Abdelhamid Abaaoud le 27 septembre 2015, comme l’affirme l’article du Parisien déjà cité. Il semble en tout cas que nous ne nous contentions pas de cibler des centres de décision, mais que nous le faisions pour atteindre quelqu’un en leur sein. Est-ce légal ? Car si le service action de la DGSE est par définition chargé d’actions secrètes qui échappent au cadre légal, ce n’est le cas ni de l’armée de l’air ni, a fortiori, du COS, dont les actions sont discrètes, ce qui n’est pas la même chose. Je ne suis pas choqué que l’on agisse ainsi, mais je me demande dans quel cadre juridique on peut le faire. Il ne s’agit même pas de savoir qui doit prendre la décision, mais de protéger ceux qui sont chargés de l’exécuter le cas échéant.
Après le 13 novembre ont été diffusées beaucoup d’informations sur les terroristes et l’on a vu se dessiner sinon des organigrammes, du moins des contacts entre les cellules impliquées dans les différents attentats. Certes, il est toujours facile de reconstituer ces structures après coup. Toujours est-il que les données ne peuvent jouer leur rôle, qui est essentiel, que s’il y a quelqu’un pour les analyser correctement, en comprenant la manière dont ces individus raisonnent, vivent, ont vécu et en en déduisant l’existence de tel ou tel lien.
À votre niveau, avez-vous vu passer ce type d’organigrammes avant les attentats ? Quelqu’un, au sein des services, est-il chargé d’établir ces connexions ? J’ai posé la même question au juge Trévidic. Car nous nous intéressons bien entendu à ce qui s’est passé, mais aussi à la manière de nous protéger à l’avenir. Le nombre de Français partis a atteint au moins un millier, sans parler de ceux qui sont présents sur le territoire ; mais ces organigrammes ne concernent que 120 à 150 personnes. À cet égard, où faites-vous porter vos efforts ? Il ne s’agit plus de mener des recherches tous azimuts, mais d’identifier des connexions permettant de circonscrire la menace une fois pour toutes.
M. Didier Le Bret. En ce qui concerne l’offre supposée des services syriens, je n’ai rien vu de pareil. Comme vous le savez, nous n’avons aucun contact avec ces services. Même dans des domaines plus ordinaires où ils auraient pu nous aider, sans même que nous ayons à le demander, par l’intermédiaire de la Russie ou de la Jordanie, ils ne nous ont jamais fourni le moindre renseignement utile. Je songe par exemple aux séries de passeports vierges récupérés par Daech et sur lesquelles il nous serait très précieux d’avoir des informations. De mon point de vue, tout ce qui a été dit sur la bénévolence et les dispositions à coopérer de M. Mamlouk et de ses affidés est donc dénué de fondement. Quand bien même la situation serait différente, il n’est pas conforme à notre vision des choses, comme vous le savez, de travailler avec un service qui torture et se fait le principal exécuteur des basses œuvres de Bachar al-Assad. Nos services sont tenus de respecter cette injonction politique.
En ce qui concerne Sky News, j’ai interrogé les services à plusieurs reprises ; pour l’instant, et sous bénéfice d’inventaire, je n’ai pas le sentiment que notre capacité à identifier qui que ce soit en ait été révolutionnée.
M. Olivier Marleix. Les services français ont-ils la liste ?
M. Didier Le Bret. Oui, bien sûr. Ils sont en contact avec les Britanniques et nous croisons nos informations. Mais, encore une fois, je ne crois pas que cela ait changé grand-chose à notre connaissance des « stocks ».
Monsieur Lamy, je ne peux que vous répéter ce que je disais tout à l’heure : nous ne revendiquons pas des frappes individuelles, surtout dans le cadre d’une opération militaire officielle. Le fondement juridique est la légitime défense, qui justifie l’action de nos forces armées. Mais nous nous refusons à agir comme les Britanniques, en ciblant précisément des individus.
La reconstitution des organigrammes est l’un des principaux objets du travail de la DGSE, en lien avec les autres services. Ce n’est pas simple, car beaucoup d’acteurs ont des alias multiples, et les choses changent souvent au moment même où nous commençons, grâce à une interception, à nous faire une vague idée de leur identité et de leurs activités. Mais nous savons à peu près qui fait quoi dans les états-majors qui nous intéressent.
M. François Lamy. Depuis quand ?
M. Didier Le Bret. C’est difficile à dire : je vois beaucoup d’organigrammes, mais qui évoluent.
M. François Lamy. Puisque vous en voyez beaucoup, vous pouvez identifier ceux qui sont fondés sur des faits. Cela donne une base de travail, même si certains peuvent se recouper, voire se contredire.
M. Didier Le Bret. Nous avons peu d’informations avérées, étayées sur des fichiers ou des interceptions, concernant les contacts de telle cellule avec tel état-major. En revanche, nous savons quels ont pu être les donneurs d’ordre dans la plupart des attaques.
M. Serge Grouard. En ce qui concerne les bases de données, j’ai la même impression de flou que le rapporteur.
Si un agent de la DGSI veut suivre tel ou tel individu, peut-il aller directement consulter les fichiers de la DGSE, ou doit-il solliciter celle-ci ? Dans cette dernière hypothèse, il ne s’agit pas d’une base de données commune, mais de compatibilité des systèmes. Or j’ai le sentiment que les systèmes ne sont pas compatibles. Qu’en est-il exactement ? Concrètement, les ordinateurs sont-ils compatibles ? Le dispositif a-t-il été conçu dans la perspective d’une gestion commune ? Non ! Or, quand les systèmes informatiques sont différents, il est redoutablement difficile de les rendre compatibles. Vient un moment où il faut changer tous les systèmes techniques. Cette question se pose-t-elle ? Ne veut-on pas le faire ? Existe-t-il d’autres procédures d’échange auxquelles on pourrait recourir ?
Vous disiez tout à l’heure qu’il fallait travailler en temps réel ; cela peut sembler évident, c’est pourtant essentiel. Mais comment faire lorsque les systèmes ne le permettent pas ? Il faut téléphoner, être assuré de joindre son correspondant, qui doit obtenir une autorisation. Tout cela, bien sûr, a été organisé de manière à préserver la sécurité des données, qui ne doivent pas pouvoir être consultées par chacun à son gré. Mais est-ce encore adapté ? Ne faut-il pas accepter de perdre un peu de cette sécurité pour gagner beaucoup en efficacité et en réactivité ?
M. Didier Le Bret. Il est nécessaire de distinguer plusieurs aspects. D’abord l’interconnexion des fichiers, qui est redoutablement complexe et soumise aux contraintes juridiques que vous connaissez et que la Commission nationale de l’informatique et des libertés veille à faire respecter – même s’il existe des fichiers de souveraineté.
Ensuite, au sein des cellules qui ont été citées, les différents services dialoguent directement, en temps réel, à propos de tel ou tel individu qui les intéresse.
Enfin, la plupart de ces services ont des personnels mis à disposition dans les autres services, au niveau des sous-directions, de la direction du renseignement, de la direction technique, de la sous-direction anti-terroriste de la DGSI.
En réalité, donc, les intéressés s’appellent et se parlent en permanence. L’interopérabilité, y compris humaine, existe. Cela ne résout pas entièrement le problème ; mais, nous y travaillons.
Le problème n’est pas seulement l’interopérabilité ou l’interconnexion entre les bases de données des services de renseignement ; il s’agit aussi de s’assurer que les moyens techniques dont disposent nos services peuvent être pleinement exploités par les services d’enquête judiciaire – en Grande-Bretagne, cela ne pose aucune difficulté – et que l’on ne nous oppose plus des obstacles techniques à l’exploitation des données de tel ou tel téléphone. C’est un autre aspect sur lequel nous travaillons beaucoup.
De même, et cela fait partie des quatre-vingts mesures, dont cinquante nouvelles, du plan d’action contre la radicalisation et le terrorisme annoncé il y a peu par le Premier ministre, nous aidons le service de renseignement pénitentiaire à se doter d’outils et à se mettre à niveau.
M. Serge Grouard. C’est un très bon exemple !
M. Didier Le Bret. Ce faisant, je suis pleinement dans mon rôle d’animation des services. La loi va d’ailleurs – dans les semaines qui viennent, je l’espère – faire du renseignement pénitentiaire un service du deuxième cercle à part entière, ce qui lui permettra d’accéder à certaines techniques et de coopérer davantage avec l’ensemble des services. Cela devrait produire d’importants résultats.
M. le président Georges Fenech. Le rapporteur et moi-même avons rencontré hier M. Calvar, que nous devons auditionner la semaine prochaine. Il estime que l’on ferait un progrès considérable en trouvant une formule juridique permettant de partager l’information judiciarisée, comme le font les Américains. En France, lorsqu’un renseignement est judiciarisé, la DGSI, cosaisie, peut l’utiliser, mais non le communiquer à la DGSE, ce qui pourrait pourtant se révéler précieux, à cause du secret de l’instruction. Cela fait-il l’objet d’une réflexion ?
M. le rapporteur. Confirmez-vous que la DGSI ne peut pas avoir accès au simple fichier STIC (système de traitement des infractions constatées) ?
M. Didier Le Bret. Non : elle y a accès puisqu’elle est à la fois service de renseignement et service de police judiciaire.
M. Meyer Habib. Comment qualifieriez-vous vos liens avec les services étrangers, en particulier américains, britanniques, russes, arabes, israéliens ?
En ce qui concerne l’UCLAT, des gens de la maison, des policiers me disent ne pas bien comprendre son fonctionnement, son classement, etc. Le caractère secret de ces matières crée une sorte de chape de plomb à laquelle ils ont tendance à se résigner. Mais il nous appartient de nous interroger sur ce fonctionnement et sur les possibilités de l’améliorer.
Qu’en est-il de l’utilisation des « taupes », des agents infiltrés, payés pour cela et censés ressembler à tous points de vue aux terroristes ? Beaucoup de services, notamment les services israéliens, que je connais bien, privilégient le renseignement humain.
Cela dit, le domaine technologique connaît des avancées considérables et très rapides. J’ai été récemment approché par des start-up qui sont en train de développer de nouveaux systèmes utilisables en milieu pénitentiaire et qu’ils cherchent à vendre, notamment en France. Ces systèmes permettent de cibler le brouillage, de savoir, au mètre près, dans quelle cellule on parle, etc. Une autre entreprise disait être en contact avec les principaux opérateurs téléphoniques aux États-Unis, et stocker ainsi des informations portant non sur une personne ciblée, mais sur tout le monde, en permanence. On peut ainsi savoir où tel ou tel se trouvait un an et demi plus tôt et utiliser cette information si le juge l’autorise. Cela ne sera sans doute jamais envisageable chez nous. Car de telles prouesses technologiques, presque difficiles à croire, ont quelque chose de terrifiant : n’importe lequel d’entre nous peut être fiché vingt-quatre heures sur vingt-quatre par l’intermédiaire de son smartphone.
M. Didier Le Bret. En ce qui concerne notre coopération avec les autres services, notre premier partenaire reste, de très loin, les États-Unis. Je me suis rendu sur place à plusieurs reprises, et, lorsqu’il a fallu intensifier notre collaboration, en particulier sur le théâtre du Levant, nous avons signé des instructions spéciales, selon la formule américaine, en vue d’être traités comme l’un des Five Eyes : nous bénéficions du même accès aux informations sensibles, ce qui nous permet de construire ensemble des dossiers d’objectifs dans le cadre de la coalition. Cela a fonctionné ; cette étape a représenté un véritable changement. Les Américains ont pu voir que nous étions des partenaires sérieux et que nous maîtrisions nos techniques.
Quant aux autres services européens, j’ai organisé début février la première rencontre des coordonnateurs européens, afin d’accompagner les actions de nos ministres de l’intérieur, singulièrement à Bernard Cazeneuve, s’agissant du PNR (Passenger Name Record), du contrôle des frontières extérieures et internes ou du fichier SIS (système d’information Schengen), en allant aussi loin que possible dans la coopération entre services dans ce domaine de souveraineté qui n’est pas communautarisé. C’est nécessaire, car certains outils à la disposition des pays ne sont pas exploités. J’ai invité Gilles de Kerchove, coordonnateur européen du renseignement, à nous aider à identifier tous les points de blocage. Nous promouvons petit à petit cette orientation avec nos amis européens. Sans faire doublon avec les structures plus opérationnelles de lutte contre le terrorisme au sein des services eux-mêmes, il s’agit d’assurer l’efficacité des décisions actées par les ministres de l’intérieur en conseil « Justice et affaires intérieures » (JAI).
Avec les services des autres pays, notre partenariat est moins soutenu, mais nous dialoguons, naturellement. Le service israélien est un service ami ; les Israéliens sont de très bons analystes de la situation.
M. le rapporteur. Et les Turcs ?
M. Didier Le Bret. Je suis allé voir le patron du MİT pour convaincre les Turcs du fait que nous aider à rapatrier nos returnees était une bonne chose, mais qu’il était encore préférable de nous permettre d’obtenir d’eux le maximum d’informations. Jusqu’à cette période, en effet, nous les récupérions un peu « secs » : ils n’ouvraient plus la bouche une fois arrivés en France. Il s’agissait pour nous d’avoir davantage d’éléments, notamment par l’intermédiaire de ce que les Turcs eux-mêmes pouvaient capter, par exemple en mettant la main sur des téléphones. Nous sommes en dialogue avec eux à ce sujet. Il existe des marges de progression, mais nous avons obtenu beaucoup : nous avons un agent de liaison, nous sommes les seuls à bénéficier d’un accompagnement de nos ressortissants d’aéroport à aéroport ; il y a peu de pays avec lesquels la Turquie ait poussé aussi loin la coopération. Nous allons voir les Turcs, nous les écoutons, car il faut travailler avec eux : la Turquie est un partenaire important, bien que compliqué.
M. le président Georges Fenech. Il y a aussi eu la visite du ministre de l’intérieur.
M. Didier Le Bret. Oui, bien sûr.
En qui concerne l’UCLAT, la tentation est toujours grande de tout mettre à plat, mais il est difficile d’envisager une énième réforme à un moment où les services sont très sollicités. J’entends les doutes dont certains se sont fait l’écho auprès de vous à ce sujet, monsieur le député ; mais il s’agissait, me semble-t-il, d’une étape en vue de créer du lien, comme l’EMOPT aujourd’hui. Nous ne pouvons pas faire abstraction de notre histoire, dont nous avons hérité l’existence de la préfecture de police, la coexistence des forces de police et de gendarmerie, la présence de services de renseignement au sein de la gendarmerie, de la police et au niveau territorial. Peut-être y aura-t-il un « grand soir » où l’on refondra tout cela pour créer un grand service de lutte contre le terrorisme. Dans le contexte actuel, cela me paraît compliqué.
En ce qui concerne les « taupes », de plus en plus de personnes vont revenir, dont nous espérons qu’elles nous donneront des informations qui permettront des infiltrations. La protection de nos sources est un autre problème sur lequel nous travaillons. Elle suppose de prendre des mesures exorbitantes du droit commun, pour services rendus à notre pays : exfiltration, changement d’identité, création pour la personne concernée d’un petit commerce à l’autre bout du monde… Or ces mesures sont complexes à prendre en l’état actuel du droit. Il existe des dispositions, mais elles ne sont pas suffisantes. Il faudra donc sans doute apporter une petite modification au code de la sécurité intérieure pour assurer aux sources une véritable protection.
M. Christophe Cavard. S’agissant des rapports entre renseignement et justice, il ressort régulièrement de nos travaux – cette commission d’enquête est la troisième sur le sujet – que le pôle antiterroriste, notamment ses juges d’instruction, se plaint de n’obtenir les informations qu’au compte-gouttes. La question de la judiciarisation continue donc de se poser, notamment eu égard aux principes du droit français, dont le droit à la défense. Des évolutions sont-elles possibles ? Est-il envisageable que la justice soit considérée comme un service d’action à part entière, qui ne se contente pas de réparer ou de condamner ?
Je suis récemment intervenu dans un lycée sur ces questions. La proviseure et les enseignants m’ont alors présenté un jeune homme de seize ans dont ils m’ont dit qu’il faisait l’objet d’une fiche S. Ce qui m’inquiète n’est pas qu’il soit fiché S – il y a certainement une raison à cela –, mais que ce soient la proviseure et l’ensemble de l’équipe enseignante qui me le disent. Certes, l’information doit être partagée, quelle que soit d’ailleurs la dangerosité réelle de ce jeune homme – car nous avons tous bien compris à quoi servent ces fiches. Ce sont les services qui ont prévenu la proviseure. Nous ne sommes pas ici en haut du spectre, plutôt dans le registre des signaux faibles. Nous arrivons justement de Belgique où certains élus locaux montent au créneau à propos du partage d’informations. Si le maire de la commune découvre que le chef d’établissement et les enseignants sont au courant alors que lui ne l’est pas, il risque de mal le prendre !
M. Didier Le Bret. C’est une question délicate. Chacun doit rester dans son rôle : on ne peut pas se faire le substitut ou le bras armé des services dans l’exercice d’un mandat électif ou de fonctions de chef d’établissement. Il y a là un glissement qui n’est pas très sain. Je crois en revanche que ce qui, à long terme, fera la différence, c’est la contribution que chacun d’entre nous, là où il est, sera capable d’apporter. J’ai été frappé par le nombre de personnes qui, depuis janvier et plus encore depuis novembre, viennent nous trouver en nous demandant ce qu’ils peuvent faire. Parmi eux figurent des start-up et de grandes entreprises du CAC 40 qui ont développé des logiciels pour détecter des têtes de réseau, qui nous parlent de processus chimiques, etc.
Voilà pourquoi j’ai sollicité il y a plusieurs mois Alain Fuchs, président du CNRS, et Thierry Mandon, secrétaire d’État chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche : je suis convaincu que, à long terme, la communauté du renseignement se portera mieux si elle est plus fluide, plus ouverte au monde. Un appel à projets lancé par le secrétaire d’État va permettre d’attribuer 5 000 à 10 000 euros à des chercheurs ; on ne sait pas ce que cela va donner, mais, dans le lot, il y aura certainement quelques projets intéressants. Il est important de s’appuyer non seulement sur nos services qui sont à la manœuvre, sur la justice et sur les administrations compétentes, mais aussi sur ces apports et ceux de la société civile. Un rapport de l’Alliance Athéna a également recensé l’ensemble des productions intellectuelles des dix dernières années sur le sujet : c’est passionnant.
Les services doivent s’approprier ces informations, pour être au fait de l’état de la recherche et diversifier leurs sources. Aujourd’hui, l’information ouverte, si elle est bien exploitée, représente déjà près de 80 % du résultat. Naturellement, les 20 % qui viennent en propre des services font la différence. Mais il est fondamental de bien traiter l’information. Voilà pourquoi chaque service se dote de structures d’analyse de l’information ouverte ou du darknet.
Au demeurant, il n’y aura jamais de mutualisation entre les services si nous ne prenons pas acte du fait que les nouveaux entrants doivent être formés dans un moule commun, par exemple par l’académie du renseignement. Sans interface avec la recherche, dans le respect du secret des activités, ces personnes risquent la sclérose et ne pourront construire un parcours à long terme. La possibilité de carrières dans le renseignement dépend de notre capacité à organiser la mobilité et la reconnaissance d’équivalences de statut.
Ces questions relèvent de chantiers au long cours qui sont eux aussi importants. Car les résultats que nous pourrons obtenir à moyen terme – prendre Mossoul et Raqqah, entamer les finances de Daech, incarcérer le plus grand nombre possible de personnes présentes sur notre territoire et qui incarnent une menace – ne résoudront pas le problème à long terme.
M. le rapporteur. Si vous pouviez accroître vos prérogatives, en quel sens le feriez-vous ? Quel devrait être selon vous, idéalement, le rôle du coordonnateur français du renseignement ?
J’ai critiqué le nombre déjà élevé de structures existantes, mais il me semble que nous manquons d’un équivalent de l’OCAM belge (Organe de coordination pour l’analyse de la menace). Depuis 1995, le niveau du plan Vigipirate n’a pas été abaissé, car le pouvoir politique ne peut prendre la responsabilité de le faire – on assiste au même phénomène s’agissant de l’état d’urgence, mais c’est un autre débat. Le coordonnateur, qui centralise toutes les informations, ne devrait-il pas formuler des préconisations en la matière ? Cela ne permettrait-il pas de dépolitiser la décision ?
M. Didier Le Bret. Aux États-Unis, deux rapports du Congrès, dont l’un s’appuyait sur près de deux ans de travaux, ont débouché en 2004 sur la création du Director of National Intelligence (DNI), instance de coordination de l’ensemble des services. Il faut dire que les États-Unis en comptaient seize, qui n’étaient pas de petits services et qui avaient chacun étendu leur compétence, de manière quasi entropique, à l’ensemble des champs du renseignement, ce qui créait d’importants problèmes de chevauchement. Vous connaissez les enseignements du 11 septembre : toute l’information était disponible, mais il n’existait pas de passerelle entre les différents services. À l’origine, le DNI comptait une centaine de personnes ; ils sont aujourd’hui plus d’un millier.
Je serais surpris que nous en venions à créer une super-agence de coordination de ce type, même si cela peut faire partie de vos recommandations. L’essentiel est ailleurs. Voici en effet ce qui donne du pouvoir au général Clapper, l’actuel DNI. D’abord, c’est son accès au Président ; or rien n’empêche le CNR de bénéficier de la même prérogative dans le cadre de ses fonctions. Ensuite, c’est sa relation d’information quotidienne au Président, grâce au brief qu’il lui délivre tous les matins dans le Bureau ovale ; sous une forme différente, le Président de la République est lui aussi briefé tous les jours. Troisièmement, c’est le DNI qui arbitre les budgets des seize agences : cela lui donne un moyen de pression dans le cas où la CIA ne jouerait pas le jeu, où la NSA ferait de la rétention d’information ou se doterait de services qui dupliqueraient inutilement ceux du FBI ou de la CIA et parasiteraient le système. Or ce moyen de pression, je ne l’ai pas, du fait de notre organisation administrative où le budget est organisé par programme et les chefs de programme sont les ministres et leurs représentants. Je n’en dispose qu’à travers les fonds spéciaux : j’adresse une proposition de répartition au Premier ministre, qui la valide ou non. Mais cela ne représente qu’une partie dérisoire des budgets des services. Pourtant, le budget pourrait être un formidable levier face à un service qui se refuserait à mutualiser tout ou partie de ses moyens.
Quant à l’organisation, je crois beaucoup à la vertu des plateformes, sur le modèle du GCHQ (Government Communications Headquarters) britannique et de ses structures, dont l’équivalent de notre GIC (Groupement interministériel de contrôle) et à l’unité d’analyse : chaque service y délègue des personnes qui travaillent ensemble, non six mois à un an comme au sein d’Allat ou d’Hermès, mais pendant des années. Les cadres y apprennent à œuvrer de concert pour s’approprier les données liées au terrorisme et l’analyse que l’on peut en produire. C’est un système qui a fait ses preuves et qui ouvre des perspectives. Je ne sais si nous ferons de même demain, mais nous ne devrions pas nous interdire d’y réfléchir.
Je ne pense pas que nous soyons moins bons que les Britanniques ou les Américains. Ces derniers ne devraient pas nous donner de leçons, car ils ne sont pas dans la même situation que nous : ils n’ont que deux frontières et s’apparentent pour le reste à une île, où l’on a déjà fait une bonne partie du travail lorsque l’on a contrôlé les arrivées par avion. Pour nous, les choses seront toujours plus compliquées. De même, quelle que soit l’organisation que l’on adopte, les instruments techniques peuvent améliorer la performance globale, mais, comme l’a rappelé M. Marsaud, il est difficile de tout verrouiller dans la vieille Europe : nous aurons toujours des maillons faibles.
En tant que CNR, je suis chargé de mettre de l’huile dans les rouages et d’aider les services, non de pratiquer le name and shame (nommer et couvrir de honte) ni de tirer des plans sur la comète ou de monter des Meccano administrativo-politiques qui absorberaient toute l’énergie de services déjà sous pression.
Quant à l’OCAM, je ne crois pas que ce soit une structure très opérationnelle.
M. le rapporteur. Il détermine le niveau de la menace.
M. le président Georges Fenech. Mais la décision reste politique.
M. Didier Le Bret. En ce qui concerne Vigipirate, le rôle apolitique dont vous parliez est joué par le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale (SGDSN). C’est lui qui fait remonter l’ensemble des éléments qui contribuent à l’analyse de la menace. En réalité, il ne vous a pas échappé qu’une évolution est quasiment impossible : la rigidité est totale, puisque la seule question que nous nous posions porte sur le moment où nous allons être frappés de nouveau. Mais, dans l’absolu, vous avez raison : il faut une structure qui objective l’analyse de la menace et qui n’hésite pas à abaisser son niveau lorsque c’est nécessaire.
M. le président Georges Fenech. Nous vous remercions pour cette audition riche d’enseignements.
Audition, à huis clos, de M. Francis Delon, président de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR), accompagné de M. Marc Antoine, conseiller auprès du président
Compte rendu de l’audition, à huis clos, du mercredi 18 mai 2016
M. le président Georges Fenech. Nous avons le plaisir d’accueillir M. Francis Delon, président de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR), accompagné de M. Marc Antoine, conseiller auprès du président.
Monsieur le président, nous vous remercions d’avoir répondu à la demande d’audition de notre commission d’enquête relative aux moyens mis en œuvre par l’État pour lutter contre le terrorisme depuis le 7 janvier 2015.
Nous poursuivons nos investigations sur le renseignement en nous intéressant maintenant à son contrôle. Je rappelle que la CNCTR, qui, aux termes de la loi sur le renseignement, a succédé à la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité (CNCIS), veille à ce que les techniques de recueil du renseignement soient mises en œuvre sur le territoire national conformément aux textes et qu’elle donne son avis avant la mise en œuvre de moyens de surveillance par les services de renseignement français.
En raison de la confidentialité des informations que vous êtes susceptibles de nous délivrer, votre audition se déroule à huis clos. Elle n’est donc pas diffusée sur le site internet de l’Assemblée. Néanmoins, et conformément à l’article 6 de l’ordonnance 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, son compte rendu pourra être publié en tout ou partie, si nous en décidons ainsi à l’issue de nos travaux. Je précise que les comptes rendus des auditions qui auront eu lieu à huis clos seront au préalable transmis aux personnes entendues afin de recueillir leurs observations. Celles-ci seront soumises à la commission, qui pourra décider d’en faire état dans son rapport.
Je rappelle que, conformément aux dispositions du même article, « sera punie des peines prévues à l’article 226-13 du code pénal toute personne qui, dans un délai de vingt-cinq ans […], divulguera ou publiera une information relative aux travaux non publics d’une commission d’enquête, sauf si le rapport publié à la fin des travaux de la commission a fait état de cette information ».
Conformément aux dispositions de l’article 6 précité, je vais vous demander de prêter le serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité.
M. Francis Delon et M. Marc Antoine prêtent serment.
La commission s’intéresse particulièrement à la manière dont sont contrôlées les techniques de renseignement mises à la disposition de nos services.
Après les attentats de janvier et de novembre 2015, avez-vous constaté un afflux des demandes d’autorisation en provenance des services et, parmi ces dernières, quelle part représentent désormais celles liées au terrorisme ?
Quelle proportion d’avis défavorables émettez-vous concernant les demandes liées au terrorisme et pour quels motifs ? Quelle est l’évolution constatée ces dernières semaines ?
La CNCIS avait refusé la prolongation des écoutes des frères Kouachi et d’Amedy Coulibaly en 2013 et 2014. Quels sont les critères qui permettent à la CNCTR de donner un avis favorable ? Comment mieux prendre en compte les individus qui appartiennent au bas du spectre ?
En matière d’interceptions de sécurité, le contingent annuel – 2 700 – est-il suffisant compte tenu du nombre d’individus impliqués dans les filières terroristes ?
Comment vous organisez-vous pour faire face à l’afflux de demandes, notamment en matière de données de connexion ?
Dans quels délais la CNCTR est-elle capable de répondre aux demandes des services ?
Quel premier bilan tirez-vous de l’application des nouvelles techniques introduites par la loi du 24 juillet 2015 relative au renseignement ? Cette loi est-elle pleinement entrée en vigueur ou des décrets d’applications restent-ils à publier ? Combien la liste prévue à l’article L. 851-2 du code de la sécurité intérieure – donc le suivi en réel des individus – comprend-elle de noms ? Où en est l’application de l’article L. 851-3 relatif aux algorithmes ? Les dispositions permettant d’écouter l’entourage sont-elles utilisées par les services ? Comment contrôlez-vous l’usage des techniques décentralisées telles que les IMSI catchers (International Mobile Subscriber Identity) ou les balises ?
Les services du second cercle se sont-ils pleinement emparés de la possibilité qui leur est offerte d’utiliser les techniques de renseignement ? Combien de demandes ont été formulées par ces services depuis l’apparition du décret ?
Estimez-vous que la CNCTR dispose de moyens suffisants pour remplir sa mission ?
Enfin, comment contrôlez-vous a posteriori l’usage des interceptions de sécurité ? Combien de recommandations d’interruption des écoutes ont été adressées à la CNCTR ces derniers mois ?
M. Francis Delon, président de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR). La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, vous l’avez indiqué, a été créée récemment, par la loi du 24 juillet 2015 relative au renseignement. Elle a succédé à la CNCIS avec des compétences élargies sur lesquelles je reviendrai.
La mission principale de la CNCTR est de vérifier au quotidien que les techniques de renseignement sollicitées sont conformes à la loi et qu’elles portent au respect de la vie privée une atteinte proportionnée aux menaces invoquées.
La CNCTR comprend neuf membres, dont quatre parlementaires représentants, à parts égales, la majorité et l’opposition. L’un de ces parlementaires est d’ailleurs ici présent en la personne de Pascal Popelin. Trois membres de la commission exercent leurs fonctions à plein-temps – parmi lesquels moi-même, comme la loi m’y oblige. Cette collégialité renforce l’indépendance de la commission, favorise le débat et améliore l’effectivité de son contrôle.
Pour ce qui concerne ses effectifs, la CNCTR, lorsqu’elle s’est installée, le 5 octobre dernier, a repris le personnel de la CNCIS, soit cinq agents. Elle a recruté et s’appuie aujourd’hui sur un secrétariat comptant une douzaine d’agents. Notre objectif est d’atteindre le chiffre de dix-huit équivalents temps plein d’ici à la fin de l’année, afin de faire face aux demandes dont nous sommes saisis et d’assurer les contrôles a posteriori que nous devons réaliser. Un budget de fonctionnement un peu inférieur à 400 000 euros est alloué à la commission.
Avant la loi du 24 juillet 2015, seules les demandes d’interception de sécurité et de géolocalisation en temps réel suivaient un processus d’autorisation par le Premier ministre après un avis préalable rendu par la CNCIS. La loi ne précisait pas que cet avis était préalable, mais la pratique avait conduit à ce qu’il le fût. Aujourd’hui – c’est là une grande novation de la loi de 2015 –, toutes les demandes de mise en œuvre sur le territoire national d’une technique de recueil de renseignements sont autorisées par le Premier ministre après avis de la CNCTR.
Reste que la commission n’est compétente qu’en matière de renseignement. Notre activité relève de la police administrative et s’arrête au seuil de la police judiciaire. Quand une affaire est traitée par un juge judiciaire, aucune autorisation de technique de renseignement n’est donnée. Nous veillons au respect de la distinction entre police administrative et police judiciaire.
Pour ce qui est de son activité, depuis sa mise en place le 3 octobre 2015, la CNCTR a rendu plus de 9 000 avis, compte non tenu des demandes d’accès aux données de connexion que la commission contrôle depuis le 1er février 2016 et sur lesquelles je vais revenir. Le nombre d’avis rendus représente un accroissement supérieur à 50 % du volume de demandes traitées par la CNCIS sur la même durée.
La loi du 24 juillet 2015 a prévu que les techniques de renseignement pouvaient être mises en place pour un certain nombre de finalités – vous les connaissez, je n’y reviendrai donc pas –, parmi lesquelles la prévention du terrorisme.
La loi donne également la liste des techniques de renseignement auxquelles les services peuvent avoir recours, à condition qu’elles soient autorisées par le Premier ministre après avis de la CNCTR. On dénombre une quinzaine de techniques qu’on peut regrouper par catégories.
La première regroupe les interceptions de sécurité – c’est-à-dire le contenu et le contenant – et couvrait le champ de compétence de la CNCIS. Il s’agit de la part la plus importante – mis à part l’accès aux données de connexion – des demandes dont nous sommes saisis. Ces interceptions de sécurité sont réalisées par les opérateurs de téléphonie sur demande du service et sont autorisées par le Premier ministre après avis de la commission. Un intercesseur fait la demande auprès de l’opérateur ; c’est le groupement interministériel de contrôle (GIC). C’est également le GIC qui assure l’accès des services au contenu des communications interceptées au sein de ses centres. Les services ne peuvent avoir un accès direct à ces communications que dans les locaux du GIC.
La loi de juillet 2015 a autorisé l’usage d’une nouvelle technique d’interception du contenu des communications à l’aide d’IMSI catchers – grâce auxquels on peut recueillir le contenu des correspondances – permettant d’intercepter les communications. Nous n’avons donné un avis favorable à cette technique qu’en de très rares occasions et pour des motifs d’urgence opérationnelle, notamment en matière de prévention d’actes de terrorisme (crainte de la préparation d’un attentat, d’une prise d’otages,…).
Une deuxième catégorie de techniques concerne l’accès aux données de connexion, à savoir le contenant. Il existe un accès aux données de connexion en temps différé. Depuis le 1er février 2016, c’est la CNCTR qui rend un avis sur ces demandes. Une autre possibilité est donnée par la loi du 24 juillet 2015 : l’accès aux données de connexion en temps réel – mais pour le seul motif de prévention du terrorisme et à l’égard de personnes qui ont été identifiées comme présentant une menace. Cette disposition est également en vigueur depuis le 1er février 2016.
On rattache à l’accès aux données de connexion tout ce qui a trait à la géolocalisation en temps réel, qui permet la localisation d’un téléphone portable et son suivi.
Enfin, on peut accéder à des données de connexion par le biais d’un IMSI catcher, mais qui ne s’intéresse qu’aux données de connexion. Il s’agit d’une technique beaucoup plus répandue, notamment en matière de terrorisme.
Le troisième type de technique implique l’accès à un lieu ou à un système informatique, qu’il s’agisse, dans ce dernier cas, du recueil de données informatiques sur un ordinateur, de l’accès à distance au contenu d’une messagerie et, éventuellement, du piégeage d’un ordinateur à distance ou par contact. L’accès à un lieu privé ou à un lieu d’habitation pour réaliser cette opération nécessite une autorisation spécifique. De même, une telle autorisation est nécessaire pour l’accès à un lieu privé ou d’habitation pour capter des images – vidéo ou photo – ou pour le sonoriser. La loi a prévu que, lorsqu’il y a pénétration dans un lieu d’habitation, la décision est nécessairement prise en formation collégiale par la commission.
Le quatrième type de technique, qui a suscité de nombreux débats à l’occasion de l’examen par le Parlement de ce qui deviendra la loi du 24 juillet 2015, relève de l’article L. 851-3 du code de la sécurité intérieure. C’est ce qu’on appelle l’algorithme qui permet le traitement automatisé des données de connexion d’un grand nombre de personnes, avec pour objectif de déterminer ce qui pourrait justifier une alerte et une surveillance particulière. À l’heure où je vous parle, cette technique n’est pas mise en œuvre. La loi prévoit que la CNCTR se prononce sur l’algorithme et fasse, le cas échéant, des recommandations de modification si elle l’estime nécessaire. À ce stade, nous n’avons été saisis par le Gouvernement d’aucune proposition.
M. Sébastien Pietrasanta, rapporteur. Savez-vous où nous en sommes en la matière ?
M. Francis Delon. C’est plutôt aux services du renseignement qu’il faut poser la question ; nous l’examinerons dès que nous en serons saisis.
M. le président Georges Fenech. Y a-t-il un problème technique ?
M. Francis Delon. Il faut savoir qu’il s’agit d’un outil très complexe et qui ne s’achète pas sur le marché. Il faut par conséquent le fabriquer, ce qui nécessite un peu de temps, et, pour cela, d’utiliser des compétences particulières dont dispose l’État. Le travail se poursuit et, lorsque la demande nous sera soumise, nous l’examinerons avec attention.
Enfin, je mentionnerai la surveillance internationale qui peut avoir un intérêt en matière de lutte contre le terrorisme. Cette surveillance est prévue par la loi du 30 novembre 2015. Le cadre juridique est ici assez différent, puisque la CNCTR n’exerce qu’un contrôle a posteriori. Sont utilisés en l’espèce des algorithmes qui analysent des données de connexion.
M. le président Georges Fenech. Disposez-vous de ce type de technique de surveillance sur les théâtres d’opérations extérieures ?
M. Francis Delon. La loi du 24 juillet 2015 s’applique exclusivement sur le territoire national. Ainsi, si la direction du renseignement militaire (DRM) veut appliquer des techniques particulières sur un théâtre extérieur, cela ne relève pas du contrôle a priori de la CNCTR, puisque les techniques en question seraient mises en œuvre en dehors du territoire national.
Les services qui ont recours aux techniques de renseignement sont les six formant ce qu’on appelle la communauté du renseignement ou services du premier cercle : la direction générale de la sécurité intérieure (DGSI), la direction générale de la sécurité extérieure (DGSE), la direction de la protection et de la sécurité de la défense (DPSD), la DRM, la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED) et TRACFIN (traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins).
Un décret du 11 décembre 2015 prévoit qu’un certain nombre d’autres services, dits du second cercle, peuvent avoir accès, pour certaines finalités, à certaines techniques de renseignement. Tous ces services sont placés sous l’autorité du ministre de l’intérieur – ils relèvent de la gendarmerie, de la police nationale, de la préfecture de police de Paris, du service de police judiciaire ; il s’agit donc de services qui ont une compétence mixte, à la fois judiciaire et administrative, ou de services qui n’agissent que dans le cadre de la police administrative, comme la direction du renseignement de la préfecture de police (DRPP). Les demandes de techniques de renseignement peuvent, pour certains services, concerner le terrorisme.
Dans la pratique, les services du premier cercle, plus aguerris, ont d’emblée fait appel aux nouvelles techniques de renseignement prévues par la loi du 24 juillet 2015, tandis qu’il a fallu attendre le décret du 11 décembre 2015 pour les services du second cercle La montée en puissance se révélant ici plus lente – faute d’expérience pour mettre en œuvre ces techniques. D’où la mise en place de programmes de formation afin d’assurer l’application des techniques sollicitées dans des conditions raisonnables de sécurité et de légalité.
Le fonctionnement quotidien de la CNCTR s’insère dans la chaîne opérationnelle du renseignement. En effet, si un service de renseignement veut réaliser une opération de renseignement, il revient au chef du service d’en valider la demande. Après quoi celle-ci est transmise au cabinet du ministre de l’intérieur, du ministre de la défense ou du ministre des finances. Si le ministre valide la demande, elle est communiquée à la CNCTR qui se prononce dans un délai très court, que la loi a fixé à vingt-quatre heures.
Le dossier est instruit par l’un des membres du secrétariat de la commission pour être ensuite validé par un membre magistrat, à savoir moi-même ou l’un des trois autres membres magistrats de la CNCTR. Cette procédure concerne environ 95 % des affaires.
M. Meyer Habib. Quel délai s’écoule entre la demande et la validation par le ministre ?
M. Francis Delon. Les délais parisiens sont très courts et leur éventuelle prolongation est imputable au service. Toutefois, entre le moment où l’antenne d’un service, dans une région, demande l’application d’une technique, et le moment de la validation de la demande, il peut s’écouler un délai assez long. À Paris, je l’ai dit, le traitement est très court : nous n’utilisons le plus souvent pas les vingt-quatre heures dont nous disposons. Entre le moment où le ministre reçoit la demande et celui où elle nous est transmise, il s’écoule au maximum quelques heures. Et, entre le moment où nous rendons notre avis et celui où le Premier ministre prend la décision, il s’écoule également quelques heures. Au total, le délai parisien est donc d’environ deux jours, trois au plus.
M. Pascal Popelin. Et, en cas d’urgence, le délai peut être de dix minutes !
M. Francis Delon. En effet, nous pouvons, en cas d’urgence, donner notre avis en moins d’une heure. Cela s’est produit. Nous sommes mobilisables vingt-quatre heures sur vingt-quatre et sept jours sur sept – une permanence est assurée.
Nous faisons tout pour ne pas ralentir inutilement le processus du renseignement. Nous contrôlons que la demande qui nous est formulée est légale et proportionnée. Si elle l’est, nous n’allons pas compromettre une opération par des délais excessifs.
M. le président Georges Fenech. Il y a bien une procédure qui permet, en cas d’extrême urgence, de ne requérir l’avis de la CNCTR qu’a posteriori ?
M. Francis Delon. La loi prévoit en effet une procédure d’urgence absolue. Elle n’a été mise en œuvre qu’une seule fois, pour un motif de terrorisme. Nous avons été alertés par le cabinet du Premier ministre, lui-même prévenu par téléphone, d’une menace d’attentat imminent. Le Premier ministre nous a fait savoir qu’il ne souhaitait pas prendre le risque d’attendre ne serait-ce que trente minutes pour que la commission se prononce – ce qu’elle aurait de toute façon été en mesure de faire –, et qu’il prenait immédiatement la décision. Il s’est trouvé – tant mieux – qu’il s’était agi d’une fausse alerte. Le souhait du Premier ministre a toujours été de passer par la commission. Nous nous sommes organisés pour que le passage par la CNCTR ne soit pas un élément de retard anormal ; aussi statuons-nous dans des délais toujours très brefs.
La loi prévoit en outre deux cas où la demande doit être examinée en formation collégiale : le cas où il s’agit d’autoriser la pénétration dans un lieu d’habitation et celui où la technique, quelle qu’elle soit, concerne une personne exerçant une profession protégée – parlementaire, magistrat, journaliste, avocat… Dans ce dernier cas, c’est même la formation plénière qui est requise.
Nous nous réunissons trois fois par semaine en formation collégiale – ce qui ne doit pas être le cas de beaucoup de commissions –, sans compter les réunions impromptues qu’il faut parfois organiser, en formation plénière, pour examiner un cas de profession protégée.
M. le président Georges Fenech. Est-ce déjà arrivé ?
M. Francis Delon. C’est déjà arrivé.
M. Pascal Popelin. Pour la constitution de son quorum, la formation plénière de la CNCTR, aux termes de la loi, ne nécessite pas la présence de parlementaires, lesquels ont toutefois accédé au souhait du président de faire en sorte qu’à chacune de ces réunions l’un d’eux eu moins soit présent – sauf lors de l’examen des demandes de renouvellement de cas sur lesquels nous nous sommes déjà prononcés.
Pour ce qui concerne la profession de journaliste – l’une de celles, protégées, justifiant que la commission se prononce en formation plénière –, la CNCTR en a une conception extensive, si bien qu’il nous arrive d’examiner le cas d’individus dont la qualité de journaliste est sujette à caution.
M. le rapporteur. Ces cas concernaient-ils davantage l’espionnage que le terrorisme ?
M. Francis Delon. Je ne puis malheureusement pas me montrer plus précis, puisque je suis contraint par le secret de la défense nationale.
Reste que, heureusement, il n’est pas si fréquent que nous ayons à examiner des demandes concernant des individus exerçant des professions protégées. L’esprit de la loi implique que la représentation nationale soit présente au sein des formations plénières. Comme l’a souligné Pascal Popelin, si l’affaire n’est pas nouvelle, s’il s’agit du renouvellement d’un cas sur lequel les parlementaires se sont déjà prononcés, leur présence n’est en effet pas indispensable.
Dans le cas où une réunion collégiale est nécessaire, le délai pour donner un avis est porté à soixante-douze heures. Or, même dans ces circonstances, nous faisons en sorte que les délais soient plus courts et qu’ils ne dépassent pas vingt-quatre heures. Nous attachons donc une très grande importance à la gestion des délais – c’est même l’une des tâches principales du président. La loi a du reste prévu que, si nous ne donnons pas d’avis dans les temps prévus, il est réputé rendu – cela n’est jamais arrivé et nous nous efforcerons qu’il en soit toujours ainsi.
Les demandes d’accès aux données de connexion – recueil de fadettes, identification de numéros – n’étaient pas traitées, auparavant, par la CNCIS, mais par une personnalité qualifiée, un temps placée auprès du ministre de l’intérieur et qui, depuis le 1er janvier 2015, était placée auprès du Premier ministre. Pour les traiter, nous avons repris les deux collaborateurs de la personnalité qualifiée susmentionnée et chacun des autres chargés de mission de la commission est également sollicité.
M. le président Georges Fenech. Comment exercez-vous le contrôle a posteriori ? Selon des critères de légalité ou d’opportunité ?
M. Francis Delon. Lorsque nous autorisons une technique, nous nous disons, dans certains cas, qu’il va falloir la suivre. Ainsi, après avoir donné un avis favorable et après que la technique a été mise en œuvre, nous allons vérifier au sein du service comment cette technique a été appliquée.
Le contrôle a posteriori suppose une centralisation des données : ce que nous contrôlons doit rester accessible. C’est l’une de nos premières demandes au Premier ministre. Cette centralisation est déjà acquise pour les interceptions de sécurité, pour les géolocalisations en temps réel, mais pas pour les IMSI catchers qui peuvent être utilisés en différents points du territoire. Nous organisons avec les services une centralisation parisienne de ces données ; nous y avons accès au siège des services, sans avoir à nous déplacer en province, ce qui ne nous empêche pas de nous y rendre pour examiner la manière dont les services travaillent à l’échelon régional. Nous travaillons donc sur pièces et sur place.
Il s’agit de dialoguer avec les services qui sont demandeurs d’explications sur la manière dont la loi doit être appliquée. Nous leur faisons donc part de nos attentes et prenons note de leurs difficultés – qui nous conduisent, dans certains cas, à adapter nos jurisprudences.
Les contrôles sont différents selon la technique utilisée : ceux concernant la surveillance internationale ne sont pas les mêmes que ceux exercés sur la mise en œuvre de la pose d’une balise par un service sur le territoire national.
M. le président Georges Fenech. Je mesure l’importance de votre responsabilité, mais la CNCTR n’est pas un service enquêteur, elle est un service administratif de contrôle. Quels sont dès lors les critères objectifs en fonction desquels vous refusez une demande, sans avoir à juger de l’utilité de tel ou tel système de surveillance ? Je rappelle que la CNCIS avait refusé la prolongation des écoutes des frères Kouachi et d’Amedy Coulibaly. Forts de quels critères prenez-vous la responsabilité d’accepter ou de refuser une prolongation ?
M. Francis Delon. La CNCIS a publié un communiqué démentant qu’elle ait jamais refusé la poursuite de la surveillance des frères Kouachi.
M. le président Georges Fenech. Nous l’ignorions !
M. Francis Delon. Ce communiqué a été publié par Le Figaro.
Le communiqué de la CNCIS dément l’information donnée initialement par Le Figaro. À notre connaissance, il n’y a pas eu du tout d’interruption de la surveillance à la demande de la CNCIS.
M. le président Georges Fenech. D’où est sortie cette affirmation ?
M. le rapporteur. Elle précisait en effet que la surveillance avait été interrompue en août 2014.
M. Pascal Popelin. Indépendamment de ce cas, il faut savoir que nous avons accès, en particulier concernant les interceptions de sécurité, à toutes les productions, c’est-à-dire au contenu des écoutes téléphoniques.
M. Francis Delon. Nous avons en effet accès à tout.
M. Pascal Popelin. Et en direct.
Monsieur le président, vous avez à mon avis employé à mauvais escient le terme d’enquête, dans la mesure où nous intervenons préalablement à celle-ci, dès lors qu’un service estime que l’on doit mettre sur écoute une personne qu’il suspecte et motive les raisons pour lesquelles il sollicite l’autorisation de mettre en œuvre une interception de sécurité. Nous exerçons alors un contrôle technique et juridique permettant de vérifier que la personne à surveiller correspond bien aux critères prévus par la loi. Si c’est le cas, l’autorisation est valable pour quatre mois, délai au terme duquel la demande doit être renouvelée. Entre-temps, on peut espérer que le service aura pu rassembler des éléments de nature à étayer sa demande de renouvellement. Or, comme nous avons accès aux productions, s’il n’y a rien de probant dans les enregistrements, la commission va forcément se poser la question de la pertinence de la poursuite de la surveillance. Il en ira de même si, par ailleurs, les motifs allégués par le service pour solliciter une interception ne se sont pas étoffés au fil du temps.
M. le président Georges Fenech. Vous jugez donc en opportunité, non en légalité.
M. le rapporteur. L’écoute des frères Kouachi n’a rien donné. C’est que les interceptions sont rendues difficiles par le recours de plus de plus fréquent à des techniques de cryptage de la part des personnes suspectes. Votre doctrine a-t-elle évolué en conséquence ? Par ailleurs, avez-vous émis des refus de demandes d’interceptions de sécurité liées au terrorisme ? Si c’est le cas, les services sont-ils revenus à la charge concernant tel ou tel individu au point de vous faire changer d’avis ?
M. Francis Delon. Nous devons nous assurer que la demande entre bien dans le cadre fixé par la loi : correspond-elle à l’une des finalités prévues et l’autorité demanderesse est-elle compétente ? Ensuite, nous devons apprécier la proportionnalité entre l’atteinte à la vie privée portée par la recherche de renseignements et la menace à laquelle il s’agit de faire face. Cela ne signifie pas que nous agissons en opportunité : il revient au Premier ministre de prendre la décision de réaliser la surveillance de telle ou telle personnalité, ce qui relève de l’opportunité politique. Nous-mêmes, nous examinons seulement si la demande est légale.
Nous exerçons par ailleurs un contrôle de subsidiarité prévu par la loi pour l’usage des techniques les plus intrusives : avant d’autoriser la pénétration dans un appartement pour y poser un micro, on s’assure que le service ne peut pas avoir le même renseignement par des techniques moins intrusives.
J’en reviens plus précisément au terrorisme, objet des travaux de votre commission. En 2014, le terrorisme représentait 28 % des demandes d’interception de sécurité traitées par la CNCIS, contre 42 % des dossiers concernant la prévention de la criminalité organisée. Depuis 2015, ces pourcentages se sont inversés : le terrorisme est devenu la première raison de demandes de mise en œuvre de techniques de renseignement, à hauteur de 42 %, tandis que les demandes concernant la criminalité organisée sont passées à 28 %. Ensuite, pour répondre au rapporteur, il nous est arrivé de donner des avis défavorables à telle demande relative au terrorisme, mais c’est rare. Le refus tient le plus souvent à une erreur du service – ce qui peut arriver. Il est par ailleurs arrivé que deux services visent la même cible : dans ce cas, nous prévenons le Premier ministre.
M. le rapporteur. Cela arrive-t-il souvent ?
M. Francis Delon. Non, c’est également très rare.
M. le rapporteur. Mais deux services ne peuvent-ils vouloir surveiller un même individu pour des motifs totalement différents ?
M. Francis Delon. Dans ce cas, il n’y a pas de difficulté, mais, s’il s’agit de la même finalité, nous le signalons au Premier ministre, qui choisira le service qui sera autorisé à surveiller. Nous jouons donc ici, de façon certes marginale, un rôle de coordination.
M. Pascal Popelin. Il faut savoir que la cible n’est pas forcément M. Untel, né à tel endroit et habitant à tel endroit. La cible peut être un numéro de téléphone…
M. Francis Delon. En effet, la cible peut ne pas être identifiée.
Le taux d’avis défavorables est de l’ordre de 1 % en général. Il est inférieur pour les demandes liées au terrorisme.
M. le président Georges Fenech. Motivez-vous vos avis ?
M. Francis Delon. Les avis favorables ne le sont en général pas – sauf quand nous voulons apporter une précision. On peut nous demander une interception de sécurité pour une durée de quatre mois ; or nous pouvons estimer que, dans les circonstances particulières de l’affaire examinée, la durée devrait être plus courte et, dans ce cas, nous expliquons pourquoi. Évidemment, quand l’avis est défavorable, il est motivé.
M. Meyer Habib. Avez-vous déjà donné un avis défavorable à une demande liée au terrorisme ?
M. Francis Delon. C’est arrivé dans quelques cas.
Les demandes que nous examinons ne concernent pas le seul terrorisme islamique.
M. Christophe Cavard. Quelles sont vos relations – à supposer qu’elles existent – avec la DGSE ?
Une grande partie de l’application de la loi du 24 juillet 2015 repose sur vous, puisque vous êtes censés contrôler la destruction des données recueillies. Comment procédez-vous ? Certains services, on s’en souvient, souhaitaient les garder plus longtemps que la loi ne le prévoit – quel est votre sentiment sur la question ?
Enfin, pour ce qui est des IMSI catchers, il y a un problème technique de transfert des données, qui pose la question de leur centralisation. En outre, la loi prévoit qu’on peut autoriser l’écoute des personnes les plus proches – on pense au débat portant sur le fait de savoir s’il était utile ou non d’écouter les épouses des frères Kouachi. Vous est-il arrivé d’être saisi d’une demande de surveillance de l’entourage d’une personne suspecte ?
M. Francis Delon. Bien sûr, nous avons des relations avec la DGSE comme avec tous les services de renseignement. Nous dialoguons avec eux en permanence et disposons à cet effet de lignes sécurisées. La DGSE est placée sous deux régimes : le régime domestique, car, contrairement à ce qu’on croit souvent, elle peut mener des opérations sur le territoire français – aussi peut-elle nous soumettre des demandes au titre de la loi du 24 juillet 2015 – ; et le régime qui recouvre l’essentiel de son activité : la surveillance internationale, dans le cadre de la loi de novembre 2015 – dont nous contrôlons le respect a posteriori.
Pour ce qui est des destructions de données, vous avez raison de rappeler que notre rôle consiste à veiller à ce que la loi soit appliquée et, notamment, à ce que les délais de conservation des données soient respectés. C’est pourquoi j’ai évoqué la nécessité d’une centralisation nous permettant d’avoir accès à toutes les données et de nous assurer que les délais légaux sont respectés. Ainsi, pour les IMSI catchers, qui interceptent les données de connexion, la loi a prévu que, à l’issue d’un délai de quatre-vingt-dix jours au maximum, le service doit avoir détruit toutes les données qui ne concernent pas directement la cible, ce qui suppose un tri entre de nombreux numéros. Nous y veillons et c’est pourquoi nous avons effectué plusieurs contrôles sur cette technique.
Enfin, en ce qui concerne l’entourage des personnes surveillées, la loi prévoit que, en matière d’interceptions de sécurité, peuvent être autorisées des mesures d’écoute sur des personnes qui ne sont pas directement impliquées, mais qui ont une relation étroite avec une cible et avec laquelle cette cible va communiquer – c’est, par exemple, la mère qui appelle son fils en Syrie. La CNCIS considérait qu’on ne pouvait pas autoriser de telles écoutes. La loi l’autorise désormais et nous appliquons donc la loi : nous avons bien sûr autorisé des interceptions de sécurité au titre de l’entourage.
M. le président Georges Fenech. Pourquoi estimez-vous faire partie de la chaîne opérationnelle du renseignement, alors que la CNCTR est un organisme d’autorisation et de contrôle ?
M. Francis Delon. Nous nous situons dans la chaîne opérationnelle parce que nous sommes l’organisme de contrôle qui intervient avant que la décision ne soit prise par le Premier ministre. Et c’est notre avis qui va avoir une grande influence sur cette décision. Jusqu’à présent, le Premier ministre a toujours suivi nos avis défavorables, ce qui n’était pas le cas avec la CNCIS. J’ajoute que, s’il ne suivait pas notre avis défavorable, nous pourrions saisir le Conseil d’État pour contester la décision – ce que ne pouvait faire la CNCIS.
M. le président Georges Fenech. Est-ce déjà arrivé ?
M. Francis Delon. Non. Le Premier ministre ayant toujours suivi nos avis défavorables, la question ne s’est pas posée.
Présidence de M. Meyer Habib, vice-président.
M. Serge Grouard. Comment contrôlez-vous concrètement la destruction des données ? Opérez-vous à partir des données elles-mêmes, de leur contenu, afin de vérifier que la partie qui n’aurait pas trait au domaine couvert par l’autorisation a bien été détruite ?
Ensuite, comment appréciez-vous une demande de renouvellement ? Le service demandeur va-t-il vous communiquer des informations qu’il aura pu recueillir ? Est-ce à partir de là que vous jugez de l’opportunité du renouvellement ?
M. Francis Delon. Pour contrôler la destruction des données, il faut qu’elles soient « traçables ». S’il s’agit d’une interception de sécurité, c’est très facile, car la centralisation est réalisée par le GIC qui s’assure, sous notre contrôle, que les données sont conservées pendant la durée légale. C’est plus compliqué pour les opérations décentralisées. Il faut ici construire un système de centralisation des données qui n’existe pas. C’est compliqué, parce qu’on ne peut transporter les données que dans des conditions qui préservent le secret de la défense nationale. On a par conséquent le choix entre les valises accompagnées, si je puis dire, ou des réseaux sécurisés qui n’existent pas toujours et qu’il faut bâtir. Les données nous parviennent donc soit de manière électronique, soit de manière physique et elles sont étiquetées afin d’être rattachées à telle ou telle opération. Nous vérifions ensuite, si nous effectuons un contrôle dans le service concerné, que la donnée n’a pas été conservée au-delà de la durée légale. Nous opérons au cas par cas selon la technique utilisée.
Il faut avoir présent à l’esprit que nous ne pouvons pas contrôler a posteriori la mise en œuvre de toutes les techniques. Nous procédons par sondage, par échantillonnage. Pour tout contrôler, il faudrait des moyens considérables.
M. Pascal Popelin. Le pourcentage d’aléas n’est pas le même selon les techniques.
M. Francis Delon. Nous faisons en effet des choix. Lorsque nous autorisons une technique, si elle nous paraît particulière, nous décidons de la contrôler.
Pour ce qui est du renouvellement, tout dépend, ici aussi, de la technique employée. S’il s’agit d’interceptions de sécurité, nous avons accès à tout moment, dans nos locaux, à l’intégralité des conversations interceptées. Quand une demande de renouvellement nous est soumise, nous allons donc vérifier ce qu’a donné la précédente autorisation. Si les résultats sont en lien avec la finalité invoquée, si le service, qui doit motiver sa demande, nous explique que le renouvellement est nécessaire pour la bonne réussite de l’opération en cours, si nous sommes convaincus par les résultats obtenus, nous répondrons par l’affirmative. En cas de doute, il va falloir porter une appréciation qui varie selon les finalités.
M. Christophe Cavard. Vous avez indiqué précédemment que le taux de demandes d’interceptions concernant le terrorisme était passé de 28 % à 42 % depuis le début de 2014. Qu’en est-il des quotas ? Je crois savoir que l’on n’avait jamais atteint celui fixé par la loi concernant les interceptions de sécurité.
M. le rapporteur. Une liste est prévue par l’article L. 851-2 du code de la sécurité intérieure, concernant le suivi en temps réel d’individus. Pouvez-vous nous en dire un mot ?
M. Francis Delon. Il existe deux quotas, l’un, connu, pour les interceptions de sécurité, qui est de 2 700, l’autre, qui n’est pas public, pour les utilisations simultanées d’IMSI catchers, beaucoup plus bas pour des raisons évidentes. Aucun de ces deux quotas n’a été à aucun moment atteint ni même approché. Le quota concernant les interceptions de sécurité est suffisant. Il faut tenir compte de la capacité des services : on aura beau mettre en œuvre des interceptions de sécurité, encore faut-il pouvoir disposer d’analystes pour les exploiter. Bref, ces quotas ne sont pas du tout un frein à l’action des services.
J’en viens à la question sur l’article L. 851-2 du code de la sécurité intérieure. Ce dispositif permet de recueillir en temps réel les données de connexion d’une personne suspectée de représenter une menace en matière de terrorisme – et de terrorisme uniquement. Il s’agit, en pratique, d’effectuer une surveillance à bas bruit d’une personne qui ne justifie pas une surveillance plus poussée – de type interception de sécurité ou autre –, mais qui peut présenter un risque, par exemple parce qu’elle se serait radicalisée. La loi prévoit ici que les autorisations permettent de recueillir non pas le contenu des conversations, comme c’est le cas pour les interceptions de sécurité, mais les données de connexion : qui cette personne appelle-t-elle ? Par qui est-elle contactée ? À quel endroit se déplace-t-elle ? Quel site consulte-t-elle sur internet ? Cette technique commence à être mise en œuvre, mais, pour l’heure, sur un nombre assez réduit de personnes.
M. le rapporteur. Que je comprenne bien : s’agit-il des fadettes ?
M. Francis Delon. C’est cela : on sait qui la personne surveillée appelle, qui l’appelle, où elle se promène sur internet…
M. le rapporteur. Le service demandeur, quand il s’agit de terrorisme, est donc forcément la DGSI ?
M. Francis Delon. Pas seulement. Cette technique est ouverte à plusieurs services.
M. le rapporteur. Mais il doit s’agir pour 90 % des cas de la DGSI ?
M. Francis Delon. La DPSD est elle aussi concernée par la lutte antiterroriste – notamment dans le milieu militaire –, la DGSE également ou encore la DNRED qui peut apporter sa contribution. Reste que, vous avez raison, les demandes proviennent essentiellement de la DGSI.
M. le rapporteur. Il est ici question des « signaux faibles ». Si je comprends bien, vous vérifiez le degré de radicalité d’un individu. Combien des personnes figurant sur cette liste ont fait l’objet, par la suite, d’une interception de sécurité ? Comment décide-t-on de passer d’une surveillance à bas bruit à une interception de sécurité ?
M. Francis Delon. Je puis vous donner ma vision des choses, sachant que le dispositif est en train de se mettre en place et que des ajustements sont encore nécessaires. La surveillance à bas bruit permet le déclenchement éventuel d’alertes. Dès lors que cette dernière est déclenchée, le service demandeur décide éventuellement d’aller plus loin dans la surveillance.
M. le rapporteur. Pourquoi nos 10 500 fichés S liés à l’islam radical ne sont-ils pas soumis à cette surveillance à bas bruit ?
M. Francis Delon. Il faut poser la question aux services. Je rappelle que l’article 851-2 du code de la sécurité intérieure s’applique à des personnes qui représentent une menace en matière de terrorisme. On est donc au-delà d’une simple suspicion. Il faut un minimum d’éléments tangibles pour la mise en œuvre de cette technique – c’est ce qu’a prévu le législateur.
M. le rapporteur. Pouvez-vous nous donner un ou deux exemples ? Qu’est-ce qu’une menace tangible justifiant une surveillance à bas bruit ?
M. Francis Delon. Est concerné un individu, par exemple, qui, sans être lié à Daech, s’est radicalisé, tient des propos manifestant une empathie à l’égard de mouvements terroristes ou qui peut avoir un comportement qui inquiète. Reste que l’on en juge au cas par cas.
Lorsque nous avons été saisis de demandes par les services, nous les avons examinées chacune avec attention et en avons autorisé une bonne partie ; nous sommes toutefois loin des chiffres que vous indiquez…
M. le rapporteur. Je me demande simplement pourquoi, en matière de surveillance à bas bruit, on ne pêche pas plus large, si vous me passez l’expression.
M. Francis Delon. Parce que la loi ne le permet pas. La loi dispose expressément que l’individu considéré doit représenter une menace.
M. le rapporteur. Toute l’ambiguïté est là. Aujourd’hui 14 000 personnes figurent dans le fichier FSPRT (fichier de traitement des signalés pour la prévention et la radicalisation à caractère terroriste).
M. Pascal Popelin. Il tient compte de tous ceux qui ne sont pas sur le territoire national.
M. le rapporteur. Soit, enlevons-en donc 2 000.
M. le rapporteur. De nouvelles données alimentent régulièrement le FSPRT. Pourquoi les pratiques évoquées ne sont-elles pas couplées ?
M. Francis Delon. Ma réponse est très simple : nous examinerons toutes les demandes que les services formulent.
M. le rapporteur. Les demandes sur ce sujet sont-elles en augmentation ?
M. Francis Delon. Nous en sommes aux débuts de la mise en œuvre de cette technique qui est pointue.
M. le rapporteur. Les services ont-ils pris la mesure de cette technique ?
M. Francis Delon. Ils recueillent des données de connexion, qui sont illisibles pour des personnes non initiées au maniement de l’informatique. Il faut donc des techniciens capables de les exploiter. Cette technique commence à être mise en œuvre sur un périmètre beaucoup plus étroit que celui que vous évoquez. Reste que, si nous sommes saisis de demandes s’inscrivant dans un périmètre plus large, nous les examinerons bien sûr.
M. Meyer Habib, président. Merci, monsieur le président, pour toutes ces précisions et pour la clarté de vos propos.
Table ronde, ouverte à la presse, de spécialistes du renseignement : M. Jean-François Clair, ancien directeur-adjoint de la direction de la surveillance du territoire (DST) ; M. Philippe Hayez, responsable de la spécialité « renseignement » de l'École des affaires internationales de l'Institut d'études politiques de Paris ; M. François Heisbourg, conseiller spécial du président de la Fondation pour la recherche stratégique ; M. Sébastien-Yves Laurent, professeur à la faculté de droit et de science politique à l'Université de Bordeaux ; M. Damien Martinez, secrétaire général du Centre d'analyse du terrorisme (CAT)
Compte rendu de la table ronde, ouverte à la presse, du jeudi 19 mai 2016
M. le président Georges Fenech. Nous poursuivons nos investigations concernant le renseignement, en commençant tout d’abord par une réunion ouverte à la presse, sous la forme d’une table ronde réunissant des chercheurs spécialistes du renseignement.
Nous avons le plaisir d’accueillir M. Philippe Hayez, magistrat à la Cour des comptes, responsable de la spécialité « renseignement » de l’école des affaires internationales de l’Institut d’études politiques de Paris ; M. Sébastien-Yves Laurent, politologue, professeur à la faculté de droit et de science politique de l’Université de Bordeaux ; M. Jean-François Clair, inspecteur général honoraire de la police nationale, ancien directeur-adjoint de la direction de la surveillance du territoire (DST) ; M. François Heisbourg, conseiller spécial du président de la Fondation pour la recherche stratégique (FRS) ; et M. Damien Martinez, secrétaire général du Centre d’analyse du terrorisme (CAT).
Messieurs, nous vous remercions d’avoir répondu à la demande d’audition de notre Commission d’enquête. Nous allons pouvoir aborder avec vous l’ensemble des problématiques concernant le renseignement, qu’il s’agisse de la coordination des services, de la coopération internationale, notamment européenne, ou du renforcement des moyens, humains et juridiques.
Cette table ronde fait l’objet d’une retransmission en direct sur le site internet de l’Assemblée nationale ; son enregistrement sera également disponible pendant quelques mois sur le portail vidéo de l’Assemblée et la Commission pourra décider de citer dans son rapport tout ou partie du compte rendu qui sera fait de cette audition.
Conformément aux dispositions de l’article 6 de l’ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, je vais vous demander de prêter le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité.
Veuillez lever la main droite et dire : « Je le jure ».
MM. Philippe Hayez, Sébastien-Yves Laurent, Jean-François Clair, François Heisbourg et Damien Martinez prêtent successivement serment.
Comment expliquer l’interruption des écoutes des frères Kouachi et d’Amedy Coulibaly, auteurs des attentats de l’Hypercacher et de Charlie Hebdo, alors que les analystes soulignent que c’est lorsque des individus radicalisés adoptent un comportement discret qu’ils sont le plus près d’un passage à l’acte ? De même, comment se fait-il que Samy Amimour, l’un des kamikazes du Bataclan, ait pu auparavant quitter le territoire français alors qu’il était sous contrôle judiciaire ? Pourquoi ne faisait-il l’objet d’aucune surveillance de la part des services de renseignement ? Comment expliquer qu’Ismaël Omar Mostefaï, qui faisait l’objet d’une « fiche S », ait également pu quitter le territoire français et, par ailleurs, que les services de renseignement n’aient pu localiser Abdelhamid Abaaoud tout au long de l’année 2015 ? Cela pose également la question de la coopération avec les autres services européens. Nous cherchons à comprendre ces trous dans la raquette.
Que pensez-vous de la création de l’état-major opérationnel de prévention du terrorisme (EMOPT) ? Ne fait-il pas doublon avec l’Unité de coordination de la lutte antiterroriste (UCLAT) ? Nous avons constaté que l’EMOPT n’était même pas connu de tous les services de renseignement, et cela nous interpelle.
Enfin, ne devrions-nous pas tirer les mêmes conséquences que les Américains après les attentats du 11 septembre et créer une base commune de renseignement antiterroriste ?
M. François Heisbourg, conseiller spécial du président de la Fondation pour la recherche stratégique. L’UCLAT a été créée en 1984 à la suite de défaillances graves en matière de lutte antiterroriste, notamment la non-transmission en temps et en heure des informations de nature à prévenir l’attentat de la rue Marbeuf, une affaire relatée dans mon précédent livre, Secrètes Histoires.
Ce qui est frappant, tout au long de ces dernières années, c’est la très grande difficulté d’intégrer pleinement la gendarmerie, dans sa fonction de renseignement, au sein des deux cercles du renseignement. Au moment de l’élaboration du Livre blanc sur la défense nationale de 2008, j’ai été responsable du groupe de travail sur la réforme des pouvoirs publics et membre du groupe informel créé pour procéder à la réforme de la communauté du renseignement. Pour des raisons que j’ignore, l’Élysée avait décidé que la gendarmerie n’appartiendrait pas au Conseil national du renseignement (CNR) que nous préconisions de créer. La gendarmerie a créé une sous-direction de l’anticipation opérationnelle à Issy-les-Moulineaux, que je vous invite à visiter ; c’est un extraordinaire poste de commandement de gestion du renseignement opérationnel.
Alors que la gendarmerie fait partie du ministère de l’intérieur depuis le 1er janvier 2009, je n’ai pas le sentiment que cette fusion ait été pleinement réalisée. Je ne sais s’il fallait créer un EMOPT pour assurer cette intégration : cela aurait pu passer par l’UCLAT. En revanche, si nous souhaitons lutter contre le terrorisme avec du renseignement intérieur, il vaut mieux que la gendarmerie soit intégrée dans le premier cercle du renseignement, non seulement au ministère de l’intérieur mais aussi au niveau du CNR et du coordonnateur national du renseignement. Personnellement, je suis consterné que l’on n’ait toujours pas pris acte du fait que la gendarmerie fait du renseignement intérieur.
En ce qui concerne l’interconnexion des fichiers, qui est le sujet de votre dernière question, les États-Unis sont clairement allés trop loin dans cette direction car cette interconnexion est devenue elle-même un problème de sécurité. Quand le jeune soldat Manning a livré à WikiLeaks quelque 750 000 télégrammes classifiés du département d’État, il opérait à partir d’un fichier intégré.
Comme beaucoup de nos concitoyens, j’ai été frappé par le fait que la voiture emmenant M. Salah Abdeslam vers la Belgique dans la nuit du 13 au 14 novembre ait été contrôlée trois fois sans que cela pose de problème à son occupant. Je note que les Belges ont capturé M. Abdeslam vivant au bout de quatre mois, tandis qu’il a fallu quatre ans à nos services pour arrêter M. Colonna, présumé coupable de l’assassinat d’un préfet en Corse, dans une île de 200 000 habitants, soit à peu près la population de Molenbeek. Nous ne sommes donc pas bien placés pour donner des leçons aux Belges ou à nos autres partenaires européens en matière de renseignement.
Quand un individu cesse d’avoir recours à son téléphone, le réflexe professionnel est non pas de prolonger les écoutes, puisqu’il ne se passe plus rien, mais d’essayer de pister l’individu autrement. Je note que la surveillance du frère Kouachi en question était bonne quand il était dans le ressort de la préfecture de police de Paris, et qu’il est complètement sorti des radars une fois rendu à Reims ; j’en déduis que le dispositif parisien ne fonctionnait pas de la même manière que le dispositif en province, ce qui nous renvoie à la question des conséquences du démantèlement des renseignements généraux (RG) et à celle de l’intégration du renseignement d’origine gendarmesque en province.
M. Damien Martinez, secrétaire général du Centre d’analyse du terrorisme (CAT). La spécialité du Centre d’analyse du terrorisme (CAT) est le renseignement financier. Il est aujourd’hui possible aux individus susceptibles de commettre des actes terroristes de se dissimuler grâce à des outils nouveaux. Hayat Boumeddiene, par exemple, cette jeune femme impliquée dans les attentats, a pu fuir le territoire national en utilisant une carte prépayée anonyme lui permettant d’enregistrer un billet d’avion sous une fausse identité. De même, certains véhicules sont loués avec des moyens de paiement anonymes. Ces nouveaux outils rendent difficile un suivi en temps réel.
S’agissant des croisements de fichiers, la France a l’un des systèmes de protection de données les plus contraignants au monde. Dans le domaine de la lutte contre le financement du terrorisme, on se rend compte des limites du système. Le secteur privé britannique dispose de masses de données concernant les crédits ; en France, pour des raisons liées à la protection de la vie privée, ce type de données n’existe pas, alors qu’elles permettent de détecter des profils à risque.
M. Jean-François Clair, inspecteur général honoraire de la police nationale, ancien directeur-adjoint de la direction de la surveillance du territoire (DST). J’ai dirigé la section antiterroriste, puis la division, le département, la sous-direction – au fur et à mesure qu’elle prenait de l’ampleur – de 1983 à 1997, avant de devenir directeur-adjoint de la DST. Je connais donc les difficultés du travail quand le nombre de suspects passe de quelques dizaines à des centaines, voire des milliers. Lorsque le Livre blanc de 2008 a créé la communauté du renseignement, la DGSE s’est vu affecter 900 effectifs supplémentaires sur cinq ans tandis que le renseignement intérieur ne recevait rien ; il a fallu attendre 2014 pour qu’il reçoive du personnel en plus.
Si la gendarmerie est intégrée dans la communauté du renseignement, il faudra aussi intégrer la police, car la gendarmerie est une police qui travaille sur une partie du territoire tandis que la police travaille sur l’autre partie.
La réforme de 2008 n’a pas été complète. Il y avait longtemps que nous souhaitions mettre fin à la très nuisible concurrence entre les RG et la DST dans la lutte antiterroriste. Avant l’apparition du terrorisme djihadiste, la plupart des terroristes venaient de l’extérieur – depuis lors, il s’agit d’une population française. Les RG surveillaient les communautés à risque et recevaient des tuyaux mais, la coordination n’existant pas, ils les gardaient pour eux. La sous-direction de l’information générale (SDIG) a donc été créée, mais cela a été mal pensé. Les anciens de la DST qui n’ont pas rejoint la direction centrale du renseignement intérieur (DCRI) née de la fusion des RG et de la DST se sont sentis abandonnés. Il a fallu attendre la création de la direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) et du renseignement territorial en 2014 pour que les attributions soient clairement définies. Les gendarmes font partie du renseignement territorial.
Une coordination permanente a lieu dans les locaux de la DGSI entre services de renseignement, le but étant de se répartir le travail. Le renseignement territorial est présent dans tous les départements mais il ne s’occupe pas de toutes sortes de sujets comme les RG le faisaient à la demande des préfets, qu’ils informaient de la situation dans les départements. L’UCLAT n’est pas un service opérationnel. La seule fois où elle l’a été, c’est pendant les attentats de 1995, quand le directeur général de la police nationale l’a dirigée personnellement, avec l’autorisation des services n’appartenant pas à la police. L’UCLAT sert à échanger des renseignements. C’est elle qui gère, d’après ce que j’ai compris, le fichier des djihadistes.
S’agissant des écoutes, quand il n’y a plus d’appels, on passe à autre chose. Quant aux fiches S, ce sont des fiches d’attention ; pour qu’elles soient utiles, il faut que les gens soient contrôlés.
L’échange entre services de renseignement intérieur marche très bien en Europe – ces services se rencontrent dans le cadre du Club de Berne –, mais ce n’est pas de la coopération opérationnelle, laquelle se fait entre services travaillant sur une affaire commune. Pour que la coopération internationale fonctionne, il faut que tous les pays s’investissent. Or, quand un pays n’a pas été frappé, il ne s’investit pas pleinement, et il y a en effet des « trous dans la raquette ». La France s’investit depuis les années quatre-vingt-dix, de même que l’Angleterre, depuis qu’ils ont eu le représentant du GIA algérien sur leur sol.
M. Sébastien-Yves Laurent, politologue, professeur à la faculté de droit et de science politique à l’Université de Bordeaux. Tout au long de l’année 2015 s’est fait entendre la demande que le renseignement soit amélioré. Cela peut se faire en améliorant les capteurs, humains ou techniques, ou en réorganisant les structures administratives et le cadre juridique, et cela a été fait, mais le véritable levier passe par l’analyse des informations dans une perspective d’anticipation.
Il s’agit d’un travail qualitatif sur la base d’informations factuelles. La principale difficulté de ce que j’appelle « l’analyse renseignement » est de dépasser la pure description des phénomènes pour faire de l’anticipation à l’échelle stratégique. Cette analyse renseignement fait l’objet de réflexions, de recherches opérationnelles et de formations, notamment à l’université, à l’image de différents masters, dont le master SGAT (sécurité globale et analyse trilingue) de l’Université de Bordeaux.
Les trois grands défis de l’analyse renseignement sont la temporalité – les analystes ou traitants du renseignement doivent réfléchir aux différentes échelles de temporalité qui font appel à des compétences différentes –, la spatialité et altérité – les intérêts français se situent sur des aires géographiques et culturelles extrêmement variées, et il est nécessaire que les analystes disposent des outils leur permettant de comprendre les phénomènes dans ces environnements qui ne sont pas ceux de la France et de l’Occident –, enfin l’incertitude. Sur ce dernier point, le directeur de la DGSE écrivait dans la Revue Défense nationale début 2014 qu’il faut réduire le champ de l’incertitude à défaut de réduire l’incertitude elle-même.
Pour relever ces trois défis, les services de renseignement ont deux atouts. Ils ont tout d’abord la possibilité de quitter le registre de l’intuition, parfois fragile, en s’appuyant sur des méthodes et des savoirs précis dans les sciences humaines et sociales. Ce ne sont pas là des savoirs théoriques mais des connaissances de terrain, concrètes, qui permettent de répondre à des questions précises, par exemple sur le passage à l’acte, que vous avez évoqué, monsieur le président. Le second atout est le recours aux « données massives », au big data ; il faut en faire du smart data et à cette fin réfléchir à la création de logiciels d’aide à l’analyse. L’analyse doit utiliser le quantitatif pour produire de l’information qualitative. Il convient, à mon sens, que ces logiciels soient produits sur la base des besoins des utilisateurs, qui peuvent participer à leur élaboration.
M. le président Georges Fenech. Ce que nous avons autorisé dans la dernière loi sur le renseignement, au sujet des algorithmes, y répond, n’est-ce pas ?
M. Sébastien-Yves Laurent. En partie. Les algorithmes de détection permettent d’identifier des individus susceptibles de passer à l’acte, mais c’est autre chose de détecter des groupes qui, sans échelle de temps identifiée, sont en voie de criminalisation ou de radicalisation.
M. Philippe Hayez, magistrat à la Cour des comptes, responsable de la spécialité « renseignement » de l’école des affaires internationales de l’Institut d’études politiques de Paris. La menace a changé. Nous sommes aujourd’hui confrontés à une menace d’origine externe avec une population sur le territoire européen connectée de manière profonde à cette menace. Cela signifie que la réponse ne peut pas être déplacée entièrement sur le champ du renseignement intérieur. Il n’y a eu à ce jour qu’un exercice approfondi sur la nature de la menace terroriste : le Livre blanc de 2006. Cette réflexion, qui a déjà dix ans, a été conduite à une époque où l’ennemi principal était Al-Qaïda. Il est temps de refaire un exercice global.
La communauté du renseignement, une création tardive en France puisqu’elle date de 2008, est définie depuis la loi du 24 juillet 2015 de manière fonctionnelle : un service de renseignement est un service habilité à utiliser les dix techniques que la loi réserve à ces services. Cela dit, le paysage administratif français est fracturé : police nationale, gendarmerie nationale, préfecture de police, qui peut être efficace mais aussi insulaire, forces armées, qui prétendent désormais contribuer à la détection… Surmonter ces difficultés ne passe pas principalement par une coordination opérationnelle. Je crois comprendre que l’EMOPT a été créé pour résoudre les difficultés engendrées par la sortie de la DGSI du périmètre de la police nationale et la nécessité de reconstituer au sein du ministère de l’intérieur une entité coordonnant la gendarmerie, la police nationale et la DGSI. Mais c’est une réponse circonstancielle ; le vrai sujet, c’est qu’il nous manque un échelon.
M. le président Georges Fenech. Le coordonnateur national du renseignement est-il utile ?
M. Philippe Hayez. Créé pour incarner physiquement la communauté nationale, il a une fonction symbolique forte, mais c’est plus un conseiller du Président de la République en matière de renseignement qu’un véritable coordonnateur.
M. le président Georges Fenech. Qui est donc le coordonnateur opérationnel ?
M. Philippe Hayez. C’est de fait le ministère de l’intérieur et les services qui en dépendent. Il manque un échelon intermédiaire entre la coordination politique et la coordination opérationnelle. C’est la leçon qu’ont tirée les Britanniques et les Américains en créant un service dédié au pilotage stratégique. Il s’agit de planification. La lutte antiterroriste sera longue et ample, elle doit mobiliser non seulement les services de renseignement mais aussi les services de l’État, les collectivités territoriales, les gestionnaires d’infrastructures…
M. le président Georges Fenech. Vous n’ignorez pas que la DGSI a été désignée comme le service organisateur de l’antiterrorisme en France.
M. Philippe Hayez. Je ne suis pas certain que cela suffise. J’ai visité à plusieurs reprises, aux États-Unis, le National Counterterrorism Center (NCTC), rattaché au Director of National Intelligence (DNI), le coordonnateur américain. C’est la fonction de strategic planning, ou pilotage stratégique, du NCTC qui est intéressante : il entraîne l’ensemble de la communauté nationale américaine pour avancer dans la résolution des difficultés, y compris en impliquant les acteurs diplomatiques – un rôle que le ministère de l’intérieur en France n’est pas en mesure de jouer.
En ce qui concerne le renseignement intérieur, au moment où la France faisait face à des violences urbaines, il existait un outil formidable de remontée d’informations, « l’échelle de Lucienne », du nom d’une commissaire divisionnaire des RG, normalienne, Mme Lucienne Bui Trong. Il s’agit d’une échelle des menaces de violences, signaux faibles. J’espère que le service central du renseignement territorial (SCRT) montera en puissance. Je ne suis pas certain que l’échelon départemental soit le plus pertinent. Il faudra s’assurer que des liaisons s’établissent avec les magistrats et les gestionnaires des collectivités.
Le système britannique en matière de coordination territoriale repose sur un organe de planification stratégique, le Joint Terrorism Analysis Centre (JTAC). Les responsables britanniques que je rencontre me disent que nous étions meilleurs qu’eux il y a dix ans mais qu’ils nous ont rattrapés depuis lors.
J’ai des doutes sur la DGSI car nous sommes parvenus, par tâtonnement, à un modèle hybride. Le service a été sorti de la direction générale de la police nationale, mais le décret dit malgré tout que c’est un service de la police nationale, car il est dirigé par des policiers. Il a par ailleurs conservé une compétence judiciaire. Le Security Service britannique, quant à lui, n’est pas rattaché à la police, n’a pas de compétence judiciaire, n’est pas dirigé par des policiers et a donc développé une culture plus spécifiquement « renseignement », par rapport à une culture policière plus intuitive. Chez nous, certaines fiches S servent à la judiciarisation, alors que le renseignement consiste surtout, par nature, à projeter des sources.
Le Livre blanc est devenu caduc en matière de technologie. Notre législation de 1978, révisée en 2005, nous interdit, au nom de la protection de la vie privée, d’interconnecter des fichiers alors que nous avons besoin de travailler sur du big data pour déceler certains comportements. Il faut avoir le courage de revoir cet équilibre entre la protection de la vie privée et les capacités de nos services, mais c’est une question taboue dans notre pays.
M. le président Georges Fenech. Pour vous résumer, notre organisation du renseignement manque d’un organisme de planification stratégique.
M. Philippe Hayez. Il faut un nouveau Livre blanc, une fonction durable de planification stratégique assurée au sein de l’État central, ainsi qu’une réflexion sur l’organisation interne du ministère de l’intérieur et la question des fichiers.
M. Sébastien Pietrasanta, rapporteur. N’y a-t-il pas un problème d’organisation structurel ? Par exemple, nos services de renseignement ne sont-ils pas trop nombreux, ou faut-il au contraire intégrer d’autres services à la communauté du renseignement ? Serions-nous plus efficaces si nous décidions une sorte de Big Bang ou bien, dans cette période difficile pour nos services, un Big Bang risquerait-t-il de déstabiliser leur travail ?
Il existe plusieurs fichiers, et on a parfois le sentiment que chacun a ses fichiers, sa chasse gardée, que les uns et les autres se contentent de mettre en commun des informations ponctuelles de temps en temps, sur certaines cibles. Ne faudrait-il pas un fichier commun à l’ensemble des services du premier cercle ?
M. Philippe Hayez. Je ne suis pas partisan d’un Big Bang. Nous sommes tout de même dans une logique vertueuse : depuis dix ans, nous adaptons nos services. Il n’y a pas non plus de nombre d’or en la matière. Il convient de réfléchir aux moyens et aux outils plutôt que de faire du mécano sur les périmètres.
Je ne partage pas le scepticisme de François Heisbourg sur l’interconnexion des fichiers. Manning a révélé des fichiers peu classifiés. Il convient certes de prévoir des mesures de sécurité mais il ne faut pas s’interdire l’interconnexion à cause du risque de fuites. Ma suggestion serait de permettre aux services d’accéder à une sorte de fichier TIDE, la base de données antiterroriste du NCTC comptant plusieurs millions de noms. L’interconnexion me paraît essentielle mais elle supposera plus de contrôles, notamment a posteriori, pour s’assurer qu’il n’y a pas de dérapages ; actuellement, la Commission nationale de contrôle des techniques du renseignement (CNCTR) contrôle seulement la justification des demandes d’accès.
M. François Heisbourg. Je fais partie des six personnes qui ont rédigé le Livre blanc de 2006. C’est notre seul corps de doctrine et il faut évidemment le mettre à jour. Cela dit, j’invite la Commission d’enquête à regarder les scénarios envisagés dans ce Livre blanc : ils sont très voisins des faits qui se sont déroulés l’an dernier.
La création de la communauté du renseignement à la suite du Livre blanc de 2008 a été une sorte de Big Bang. Ce Big Bang comportait deux données d’entrée dont nous souffrons encore : la fusion de la DST et des RG et le statut la gendarmerie. Le groupe de travail n’a pas évoqué ces deux sujets car le Président de la République avait pris sa décision. La gendarmerie a essayé de faire procéder à un contre-arbitrage, mais la décision a été maintenue de la sortir du premier cercle.
Je considère que le renseignement de proximité devrait être intégré dans le premier cercle. Par ailleurs, s’il a été décidé de faire de la DGSE la plateforme technique principale de la communauté du renseignement, le modèle de base pour la coordination évoqué par certains membres du groupe de travail était le modèle britannique avec, au sein du Cabinet Office, un pouvoir d’arbitrage sur la planification des moyens des services et non un rôle stratégique de conduite des opérations. Cette option n’a pas été retenue mais elle peut être ressuscitée. Enfin, il nous manque, également sur le modèle britannique, plus voisin du nôtre que le système américain, un Joint Intelligence Committee (JIC), c’est-à-dire un organe de pilotage stratégique. Nous ne l’avions pas envisagé à l’époque car il faut pouvoir marcher avant de courir et nous n’avions pas alors de communauté du renseignement.
M. le président Georges Fenech. Pourquoi l’EMOPT ne remplit-il pas cette mission ?
M. François Heisbourg. Il faut que cela se fasse dans l’interministériel le plus complet. Face à des événements comme ceux du 13 novembre, c’est l’ensemble de la République qui doit être mobilisée, et pas seulement les Brigades du Tigre, si vous me passez l’expression.
M. le président Georges Fenech. Il faudrait, en fait, un EMOPT auprès du Premier ministre.
M. François Heisbourg. Il faudrait que ce soit auprès du chef de l’État.
M. le rapporteur. L’UCLAT et l’EMOPT sont rattachés au ministère de l’intérieur. Le coordonnateur, placé auprès du chef de l’État, a certes permis la création des cellules Hermès et Allat mais il ne conduit pas vraiment un travail d’analyse. Peut-on envisager une véritable coordination et analyse au plus haut niveau, peut-être à l’instar de l’Organe de coordination pour l’analyse de la menace (OCAM) en Belgique, pour ajuster, indépendamment de la situation politique, le niveau d’alerte en matière de terrorisme ? Le plan Vigipirate, par exemple, n’a jamais évolué depuis 1995 car c’est politiquement compliqué.
M. François Heisbourg. Je fais partie de ceux qui considèrent que le JTAC est un bon modèle. Un organisme extérieur peut faciliter la prise de décision politique, délicate dans le cas d’une baisse de niveau d’alerte dans la mesure où la sanction peut être très dure si, une semaine après une baisse du niveau d’alerte, un attentat se produit, ce qui s’est passé à Londres en juillet 2005. Que le niveau d’alerte soit en Angleterre décidé par un organisme dont c’est le métier a réduit le coût politique de la mesure.
M. Pierre Lellouche. La Commission d’enquête devra dire si la suppression des RG est à l’origine du désordre dénoncé par certains. Je pense que les RG étaient un instrument baroque qui faisait beaucoup de renseignement politique alors que le problème terroriste a changé en France. En matière intérieure, il est important de s’assurer que le renseignement remonte depuis les zones sensibles car le problème est l’importation au sein de communautés musulmanes d’un terrorisme issu des contradictions de l’islam au Proche-Orient. Le renseignement doit être tourné en direction des zones où le risque existe, et où il est d’ailleurs souvent mêlé à la criminalité de droit commun, telle que le trafic de drogue. Les moyens doivent être bien sûr à la hauteur ; l’écart entre un pays comme Israël et la France en nombre d’agents de renseignement est d’un à dix.
S’agissant de la coordination au niveau stratégique, je rejoins l’analyse de M. Hayez. Il manque un lieu de coordination, ce que les Israéliens appellent « l’Aquarium ». J’ai créé, pendant la campagne de 2007 de Nicolas Sarkozy, le coordonnateur national du renseignement afin que le Président de la République dispose d’un outil de centralisation du renseignement, sachant que le secrétariat général de la défense nationale (SGDN) à l’époque ne remplissait pas ce rôle – je ne sais d’ailleurs toujours pas ce que fait ce service, rattaché au Premier ministre alors que les décisions remontent au Président de la République. Si le coordonnateur, coincé entre le conseiller diplomatique et le chef d’état-major particulier, n’a pas d’espace pour exister et se contente de transmettre les notes, il ne joue bien évidemment pas son rôle. Les Américains ont créé un Office of the Director of National Intelligence (ODNI) où existe un bureau de coordination des dix-sept agences de renseignement, avec un rôle de chien de garde de façon que l’information parvienne au directeur et soit coordonnée avec le niveau opérationnel. Nous n’avons rien de tel.
Je laisse de côté la coopération internationale et le total capharnaüm qui existe au plan européen.
M. Jean-François Clair. En ce qui concerne le Big Bang, à part la coordination stratégique, nous disposons de tous les outils. Si le coordonnateur joue son rôle et si le Président de la République donne l’impulsion, le système peut fonctionner. Il faut une direction effective.
Nous réclamions depuis longtemps la fusion des services intérieurs, je l’ai dit, et nous avons frôlé la catastrophe en 1995 parce que la DST et les RG ne se parlaient pas ; nous n’avons pas évité les attentats mais nous les avons solutionnés. Le service de renseignement territorial remplit le même rôle que les RG mais en plus concentré et il dépend de la sécurité publique. Quand la SDIG a été créée, la sécurité publique n’y croyait pas ; aujourd’hui, ils sont motivés. Contrairement à certains, je ne pense pas que la DGSI devrait s’occuper de tout, y compris de renseignement territorial.
La plupart des agents des services de renseignement intérieurs de l’Europe ne sont pas des policiers. Que la majorité de nos agents de renseignement intérieur le soient est un avantage de la France qui lui est reconnu. N’oubliez pas non plus que le FBI américain a lui aussi la compétence judiciaire. En matière de contre-terrorisme, le renseignement naît du judiciaire et le judiciaire naît du renseignement. Nous recueillons des informations à partir des affaires judiciaires.
M. Georges Fenech. Il n’en demeure pas moins qu’à partir du moment où le renseignement est judiciarisé, il ne peut plus être partagé avec d’autres services.
M. Jean-François Clair. Je ne pense pas que ce soit une règle absolue.
M. Philippe Hayez. Je confirme que, dès lors que les affaires sont judiciarisées, les services ne peuvent plus accéder aux renseignements. Par exemple, les services capables de décrypter et d’exploiter ce type de données ne peuvent le faire sur les téléphones ayant été saisis lors des perquisitions après le 13 novembre.
Il faut se demander si notre modèle antiterroriste, datant des années quatre-vingt et caractérisé par une forte relation entre le juge, spécialisé, et le service de sécurité intérieure, est encore un bon modèle. Il ne fait aucun doute qu’il faut pouvoir judiciariser mais ce n’est pas la seule voie. Chez nos amis britanniques, le service de sécurité intérieure n’a pas de compétence judiciaire et n’est pas non plus composé de policiers, mais il ne fait pas état de difficultés particulières pour transmettre des éléments à l’autorité judiciaire.
Je me permets d’appeler votre attention sur la publication, le 8 juillet prochain, du rapport de la commission Chilcot, le dernier avatar de l’examen de conscience britannique après l’Irak. Ce rapport relate la relation étrange qui s’est nouée sous Tony Blair entre l’autorité politique et les services, avec le constat que la proximité a aussi des limites. On y trouve une critique du JIC.
Aux États-Unis, on reprochait aux services, après le 11 septembre 2001, d’avoir oublié de « connecter les points », connecting the dots. Ils ont donc créé l’ISA, qui vise à s’assurer que les systèmes sont connectés.
Le mot « opération » n’a pas été prononcé. C’est un mot absent du langage politique et administratif français. Vous n’en trouvez la mention que dans la loi créant la délégation parlementaire au renseignement (DPR), qui indique que cette DPR n’a pas le droit de connaître des opérations en cours ou passées, mais personne ne sait ce qu’est une opération de renseignement. Une opération est une prise de risque qui nécessite une autorisation. Nous avons besoin d’un système bien défini d’autorisation et de prise de responsabilité ; la procédure n’existe pas.
La coopération internationale est la dimension la moins régulée du paysage français du renseignement. Dans la première lettre de mission du coordonnateur, le Président de la République demandait à M. Bajolet de s’assurer de cette coordination. Je crois comprendre qu’il n’en est rien. La seconde dimension du pilotage, c’est de faire en sorte que quelqu’un veille à ce que nous ayons de bonnes relations avec les partenaires étrangers ; la procédure, là non plus, n’existe pas.
Le renseignement est une affaire de tribus et de cultures, policière, militaire, d’autres encore ; il y a, comme disent les Américains, chiens et chats. Si l’on n’intègre pas cette dimension sociologique dans la réforme du renseignement intérieur de 2006-2008, et la forte sociologie policière de ces services, on ne peut comprendre pourquoi nous en sommes là.
M. Sébastien-Yves Laurent. Un premier rapport, celui de Lord Butler, a très bien montré que, dans l’entrée en guerre de la Grande-Bretagne en Irak, le JIC avait failli. La politisation du renseignement a joué un rôle très fort dans l’anticipation de la prétendue menace d’armes de destruction massive. Cela s’explique par le fait que davantage de conseillers politiques que d’analystes ont été recrutés au JIC dans les années quatre-vingt-dix. S’il est nécessaire de se doter d’un organe de pilotage stratégique, il faut cependant se garder du risque de porosité entre analyse et politisation du renseignement.
L’appareil de renseignement français a été modifié de 2007 à 2015 de façon considérable. Jamais depuis la Libération l’appareil de renseignement français n’avait été autant transformé. Il faut que les services absorbent ces réorganisations successives. C’est une révolution technocratique du renseignement, il convient à présent d’engager une réforme plus discrète et peu coûteuse : la mutation culturelle du renseignement. Pour anticiper les menaces, ce ne sont pas les savoirs juridiques ou les sciences administratives qui sont les plus pertinentes.
M. Christophe Cavard. Le renseignement a un rôle de prévention, d’où l’importance de l’analyse des informations. Or tous les services ne sont pas égaux en termes de moyens : M. Clair a rappelé la part de la DGSE, sauf en 2014, dans l’affectation d’effectifs supplémentaires. Pensez-vous que la situation soit équilibrée à cet égard, sachant en particulier que c’est aujourd’hui la DGSI qui joue le rôle de chef de file ? Quels sont par ailleurs les moyens du renseignement en matière de recherche technologique ?
Quel est votre point de vue sur l’organisation territoriale des services de renseignement, et notamment sur l’interconnexion entre services et sur la création du SCRT ? Faut-il selon vous développer un service de renseignement européen, lié par exemple à Europol ? On y oppose souvent la question de la souveraineté, mais les terroristes se déplacent facilement sur l’ensemble du territoire européen.
M. Damien Martinez. En 1990 a été créé Tracfin, qui a recensé l’an dernier 46 000 déclarations de soupçon – dont certaines concernent le financement du terrorisme –, avec une croissance annuelle d’environ 20 %. Face à une organisation telle que l’État islamique, il faut penser en dehors des codes. De ce point de vue, les exemples américains et britanniques sont intéressants. En visitant l’Office of Foreign Assets Control (OFAC), l’équivalent américain de Tracfin, avec beaucoup plus de moyens, j’ai pu me rendre compte, sur le traitement technologique du renseignement, non seulement d’une différence d’échelle mais quasiment d’une différence de nature.
Une grande partie du renseignement européen en matière financière est opérée aujourd’hui dans le cadre d’un protocole d’échange entre l’Union européenne et les États-Unis, le Terrorism Finance Tracking Program (TFTP), qui a donné lieu à plus de 3 600 pistes d’enquête ces deux dernières années.
Le Joint Money Laundering Intelligence Taskforce (JMLIT), en Grande-Bretagne, est une façon de penser innovante qui mêle opérateurs publics et privés, en particulier les établissements bancaires, au sein d’une même unité. En France, le projet de loi Sapin sur le renforcement des moyens de lutte contre le blanchiment comporte des dispositions pour renforcer les liens entre les deux secteurs.
S’agissant de la technologie, les investissements, aux États-Unis, se chiffrent en plusieurs dizaines de milliards de dollars. Nous ne sommes pas démunis en France, nous avons de très gros opérateurs de la défense ; l’utilisation du big data pourrait être un facteur de développement important pour notre industrie, notamment dans la sécurité et la lutte contre le terrorisme.
M. François Heisbourg. La DGSI est clairement sous-financée. Je ne considère pas qu’il faille viser une parité avec la DGSE, pour la bonne raison que cette dernière est mère porteuse dans le domaine technologique – c’est une différence de nature entre les deux services –, mais il y aurait tout de même intérêt à faire converger les moyens.
La France a fait le choix d’avoir une gendarmerie d’un côté et des polices de l’autre ; à moins de remettre un tel choix en cause, à l’instar des Néerlandais quand ils ont supprimé la maréchaussée royale il y a une trentaine d’année, il faudra continuer à vivre avec ce modèle. Je ne suis d’ailleurs pas certain qu’il soit mauvais, mais je partage le point de vue de M. Clair sur le fait que le renseignement de proximité ne doit pas être incorporé dans la DGSI. Une façon de dire que c’était une erreur de tenter de fusionner les RG et la DST.
Je suis frappé par la difficulté que nous avons à vivre avec les conséquences du développement technologique. Quand on acquiert la capacité d’intercepter simultanément des millions de communications, comment gère-t-on, intellectuellement, conceptuellement, doctrinalement ? On ne le sait pas. Dans l’affaire Manning, ce n’est pas le niveau de classification des données livrées par M. Manning qui était le problème majeur, c’était surtout le côté big data. Comme beaucoup d’autres, j’ai regardé si je figurais dans les télégrammes : c’était le cas. Je constate qu’y figurait une autre personne dont l’anonymat était censé être protégé par les Américains ; ils avaient écrit, à côté du nom, « strictly protect ». J’ai entré ces mots « strictly protect » dans le moteur de recherche et j’ai ainsi obtenu, en l’espace d’un click, quelque 3 200 noms. Tel chef d’entreprise allemand a dû céder sa place car il travaillait contre les intérêts de son pays pour les Américains, et ainsi de suite. C’est un exemple très pratique de ce que donne le big data. L’affaire Snowden a été de ce point de vue l’étalon or. La maîtrise conceptuelle et doctrinale de la technologie compte peut-être plus encore que le développement technologique lui-même.
M. Serge Grouard. J’ai le sentiment que l’on a beaucoup parlé ce matin du renseignement intérieur. J’évoquerai deux problèmes. Le premier est la coordination nationale des services. Tracfin a été évoqué mais d’autres services ne sont pas totalement intégrés à la communauté du renseignement, et c’est un souci. Par ailleurs, avec le nombre de services, le problème de la coordination rétroagit sur la coopération européenne, en raison des multiples portes d’entrée et de sortie, des multiples flux dans tous les sens alors que l’analyse suppose un minimum de centralisation des informations. Dans une logique nécessaire de réactivité immédiate, c’est préoccupant. Plus nous avons de services et plus la coordination européenne est difficile.
M. Philippe Hayez. Il n’y a pas de nombre d’or. Six services, cela peut paraître beaucoup et c’est un peu plus que la moyenne européenne. Mais vous observerez que ce sont des paires et que trois ministères sont impliqués : l’intérieur, la défense et les finances. Tracfin et les douanes font partie du périmètre, contrairement aux douanes britanniques, par exemple. Il existe un problème de coordination, nous l’avons dit, mais la réduction du nombre de services ne me paraît pas répondre à la question.
Pour répondre à M. Cavard, il n’y a pas de science des moyens humains en matière de renseignement. Les gouvernements successifs ont consenti des investissements continus. Le sujet est plutôt celui de la diversité de ces moyens. Les services aujourd’hui, ce sont de bons fonctionnaires recrutés par concours ; il faut être capable de recruter des contractuels, des analystes, des techniciens, des gens d’expérience… Le sujet est plus qualitatif que quantitatif.
La doctrine en matière technologique est celle de la mutualisation des moyens : la DGSE porte les moyens technologiques les plus sophistiqués et elle a le devoir de les partager. Il est important d’investir mais sans doublon.
S’agissant de la dimension territoriale, l’échelon pertinent est à mon avis régional. Nous pourrions avoir à cet échelon une entité rassemblant un représentant de l’État qui soit le coordonnateur régional, les services de renseignement de sécurité, les services de police, les administrations concernées, les collectivités publiques, ainsi que les acteurs privés : les gestionnaires d’infrastructures, les grands établissements recevant du public et les « organismes d’importance vitale » qui sont des cibles privilégiées d’actions terroristes.
Je ne crois pas à une agence européenne. Ne confondons pas police et renseignement. Nous pouvons progresser sur Europol mais ce n’est pas une agence de renseignement. Il existe une toute petite entité à Bruxelles, l’Intelligence Center, dépendant du Service européen pour l’action extérieure, mais elle n’est pas pertinente en matière antiterroriste. En revanche, s’il y a un domaine où l’Europe pourrait être mobilisée, c’est celui des investissements de sécurité.
M. Jean-François Clair. S’agissant des canaux internationaux, j’ai connu l’époque où les services étrangers donnaient les mêmes informations aux RG, à la DST, à la DGSE. Inutile de vous dire que ce n’était pas satisfaisant. Depuis la création de la DGSI, il y a un canal unique.
M. François Heisbourg. À la suite des attentats de Madrid en 2004, la Commission européenne a créé un programme européen de recherche de sécurité qui existe toujours et qu’elle cofinance avec les industriels à hauteur d’environ 200 millions d’euros par an.
L’Europe est une structure d’échange et de coopération mais aussi de partage. Le système d’information Schengen est totalement commun. Le problème est que certains partagent plus que d’autres. Je crois comprendre que la France partage plus que certains de ses partenaires.
M. Damien Martinez. Selon les fonctionnaires d’Europol, le partage est beaucoup plus fréquent après les attentats de l’an dernier. La coopération française était un peu lacunaire auparavant, selon eux.
J’invite les députés à rencontrer les responsables de l’Intelligence Center, l’organisme de renseignement extérieur de l’Union européenne, qui est porteuse de nombreux progrès.
M. le président Georges Fenech. Merci à tous pour cette intéressante table ronde.
Audition, à huis clos, de M. Jérôme Léonnet, chef du service central du renseignement territorial (SCRT)
Compte rendu de l’audition, à huis clos, du jeudi 19 mai 2016
M. le président Georges Fenech. Nous accueillons ce matin M. Jérôme Léonnet, chef du service central du renseignement territorial (SCRT). Monsieur le directeur, nous vous remercions d'avoir répondu à la demande d'audition de notre commission d'enquête relative aux moyens mis en œuvre par l’État pour lutter contre le terrorisme depuis le 7 janvier 2015.
Nous poursuivons avec vous nos investigations dans le domaine du renseignement, en nous intéressant à l'état de la menace terroriste et à l'organisation du renseignement territorial.
Cette audition, en raison de la confidentialité des informations que vous êtes susceptible de nous délivrer, se déroule à huis clos et n'est donc pas diffusée sur le site internet de l'Assemblée nationale. Néanmoins, conformément à l'article 6 de l'ordonnance 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, son compte rendu pourra être publié en tout ou partie, si nous en décidons ainsi à l'issue de nos travaux. Les comptes rendus des auditions qui auront eu lieu à huis clos seront au préalable transmis aux personnes entendues afin de recueillir leurs observations. Ces dernières seront soumises à la commission, qui pourra décider d'en faire état dans son rapport. Conformément aux dispositions de l’article précité, « sera punie des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal toute personne qui, dans un délai de vingt-cinq ans divulguera ou publiera une information relative aux travaux non publics d'une commission d'enquête, sauf si le rapport publié à la fin des travaux de la commission a fait état de cette information ».
Conformément aux dispositions du même article, je vous demande de prêter le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité.
M. Jérôme Léonnet prête serment.
Monsieur Léonnet, les auteurs des attentats de janvier et novembre 2015 étaient-ils connus du renseignement territorial ? Avaient-ils fait l'objet d'une surveillance par le passé ? Le renseignement territorial avait-il été destinataire d'informations sur les personnes en question ? Le cas échéant, par quel(s) service(s) ?
Quelles ont été les actions entreprises par le renseignement territorial après la commission des attentats de janvier et novembre 2015 ? A-t-il contribué – et si oui, comment – à localiser les familles et les proches des protagonistes ? Disposait-il déjà d'informations sur ces personnes ?
Plus généralement, quel est l'état de la menace ? Comment l'intensité de celle-ci a-t-elle évolué depuis janvier 2015 ? Depuis novembre 2015 ?
Comment le renseignement territorial est-il organisé à l'échelon central et local ? Les attentats perpétrés en 2015 l'ont-ils conduit à modifier son organisation ?
Combien de personnes le renseignement territorial suit-il à ce jour ? Comment ce chiffre a-t-il évolué depuis le début de l'année 2015 ?
Pensez-vous que le rattachement du renseignement territorial à la direction centrale de la sécurité publique (DCSP) demeure pertinent ? Comment la place de la gendarmerie au sein du renseignement territorial a-t-elle évolué au cours de la période récente ?
Les méthodes de travail des agents du renseignement territorial ont-elles évolué depuis janvier 2015 ? Estimez-vous que le renseignement territorial dispose des outils juridiques et techniques nécessaires pour mener à bien ses missions ?
Quel usage faites-vous des techniques de renseignement prévues par la loi du 24 juillet 2015 relative au renseignement ?
Quel regard portez-vous sur les antennes de renseignement territorial mises en place récemment par la gendarmerie au sein de ses brigades territoriales ?
Quelles raisons conduisent au passage d'une surveillance par le renseignement territorial à une surveillance par la direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) ? En d'autres termes, comment un individu surveillé passe-t-il du « bas du spectre » au « haut du spectre » ?
Quel est l'état de la coopération entre le renseignement territorial et la sécurité intérieure ? Quelle est la nature des informations échangées ? Par quels canaux ? Selon quelle fréquence ? L'intensité de l'échange d'informations a-t-elle évolué depuis les attentats de janvier 2015 ?
Quel est l'état de la coopération entre le renseignement territorial et les autres services de renseignement, notamment le renseignement pénitentiaire ?
Quelle est la plus-value de la participation du renseignement territorial à l'Unité de coordination de la lutte anti-terroriste (UCLAT) ? Quels bénéfices le renseignement territorial en retire-t-il ?
Quelle est la plus-value de la participation du renseignement territorial à l'état-major opérationnel de prévention du terrorisme (EMOPT) ? Quels bénéfices le renseignement territorial en retire-t-il ?
Quelle utilisation le renseignement territorial fait-il du FSPRT ? Quel regard portez-vous sur l'utilité de ce fichier ?
Quelle est la plus-value de la participation du renseignement territorial à la cellule Allat mise en place au sein de la DGSI ?
Le renseignement territorial et l'autorité judiciaire échangent-ils des informations ?
M. Jérôme Léonnet, chef du service central du renseignement territorial (SCRT). La montée en puissance du SCRT est récente. En 2008, une réforme essentielle a opportunément désigné un leader en matière de renseignement antiterroriste en France – la direction centrale du renseignement intérieur (DCRI) devenue aujourd’hui DGSI –, car la situation antérieure à 2008 s’avérait davantage concurrentielle que collaborative entre les services. Cette réforme de 2008 a laissé affaiblie la nouvelle sous-direction de l’information générale par rapport à l’ancienne direction centrale des renseignements généraux (DCRG), puisque l’effectif de cette dernière comptait 3 500 personnes quand celui de l’information générale ne dépassait pas 1 600 agents. L’information générale, ancêtre du renseignement territorial (RT), souffrait d’un grave problème capacitaire, que les différentes missions d’inspection n’ont eu de cesse de signaler. En outre, en 2008, on a oublié la gendarmerie nationale, qui, fort légitimement compte tenu du déploiement de l’arme dans l’ensemble du territoire, souhaitait accéder à la mission de renseignement dans son acception la plus large. Entre 2008 et 2012, on a progressivement renforcé les moyens et les effectifs de l’information générale, puis on a accueilli les premiers gendarmes en 2012.
En 2012, le ministre de l’intérieur, Manuel Valls, a lancé une réflexion sur le travail de l’information générale visant à renforcer quantitativement et qualitativement le service. Après une préfiguration en 2013, cette démarche a abouti à la création du RT en mai 2014. On a reconnu, à cette occasion, la mission du RT, notamment par le retour de l’appellation « renseignement » qui, pour les agents, revêtait une grande importance. Le nom de renseignement territorial présente la double vertu d’affirmer le travail de renseignement et l’ancrage territorial du service. En 2014, pour la première fois, le SCRT s’est doté d’une doctrine de fonctionnement et d’emploi, étape essentielle car on avait souvent reproché aux Renseignements généraux (RG) de faire un peu tout et n’importe quoi, sans guide et sans domaine de compétence défini – contrairement, sur ce dernier point à la direction de la surveillance du territoire (DST). Ce document balaie l’ensemble des thématiques que le SCRT traite.
Le SCRT a totalement intégré le concours de la gendarmerie au fonctionnement du service ; ainsi, un colonel de gendarmerie a été nommé adjoint du chef du SCRT en mai 2014. En outre, on a confié le commandement de deux divisions du service central et de trois services départementaux du RT à des officiers de gendarmerie. Un commissaire de police a été désigné à la sous-direction de l’anticipation opérationnelle (SDAO) de la direction générale de la gendarmerie nationale (DGGN). Depuis mai 2014, toutes les productions écrites du RT affichent le double sigle de la police et de la gendarmerie nationales et sont transmises en temps réel aux échelons central et territoriaux de la gendarmerie nationale.
L’effectif du RT atteignait 1 622 personnes en 2008, 1 870 en 2010, 1 880 en 2012, 1 976 en septembre 2014, et s’élève à 2 350 aujourd’hui. La force du RT ne réside pas, contrairement aux services du premier cercle de la communauté du renseignement, dans son échelon central, mais dans ses implantations dans le pays. Ainsi, seuls 150 de ses 2 350 agents sont affectés en centrale.
Nous avons développé deux nouvelles spécialités au RT : une division se trouve chargée de la veille sur internet et une autre effectue de la recherche, de la surveillance et de l’appui.
L’antiterrorisme n’appartenait pas au cœur du métier de l’information générale à sa création. En 2008, le pilotage du renseignement antiterroriste a été confié à la DCRI, devenue la DGSI. En revanche, l’information générale avait à connaître de la prévention du terrorisme sous trois aspects : la lutte contre les dérives urbaines, l’économie souterraine et la criminalité organisée par la surveillance du parcours de petits délinquants pouvant, comme Mohamed Merah, devenir terroriste ; le suivi des grandes religions dont l’islam de France, a conduit le RT à travailler avec des imams modérés, qui font l’objet d’attaques et de tentatives de déstabilisation de la part de prêcheurs salafistes et qui aident le service à obtenir le signalement de personnes en voie de radicalisation ; enfin, la plateforme de signalement de l’UCLAT permet d’indiquer au RT les cas de radicalisation. En septembre 2014, le RT était amené à s’intéresser à moins d’une centaine de radicalisés, ce chiffre ayant atteint 476 au 1er janvier 2015 et s’élevant aujourd’hui à 3 600.
Le suivi de la radicalisation, qui mobilisait 5 % des capacités du service et qui en absorbe aujourd’hui 40 %, s’inscrit dans la répartition des compétences avec la DGSI. Dès qu’un individu que nous suivons a le début d’un lien, même faible, avec un réseau terroriste ou commence à émettre l’idée de vouloir partir en terre de djihad, le dossier est transmis au bureau de liaison de la DGSI au sein du service central du RT – la DGSI est également présente au sein du RT dans l’ensemble des zones de défense et dans les grands centres. Entre le RT et la DGSI, la situation se révèle bien plus vertueuse qu’une simple liaison de coordination, puisque le RT ouvre l’ensemble de sa production, dès la réalisation de celle-ci, à la DGSI. Cette dernière évoque les sujets qu’elle considère relever de son domaine de compétence.
Les 3 600 signalements de radicalisation appartiennent au bas ou au milieu de spectre et non à son haut. Néanmoins, de 700 à 800 personnes présentent, à nos yeux et à titre individuel, des fragilités telles qu’un passage à l’acte violent, comme ceux de Bertrand Nzohabonayo à Tours et de Moussa Coulibaly à Nice, est envisageable. Nous avons développé une large palette d’outils pour assurer notre mission : contact avec les personnes signalant la radicalisation – parents, milieu professionnel ou scolaire –, suivi en lien avec les services de sécurité publique et de gendarmerie nationale d’une personne inquiétant son entourage, et, pour les profils des plus inquiétants, travail en milieu fermé reposant sur de la surveillance humaine et technique dans le cadre de ce qu’autorise la loi.
Les effectifs du RT ont été fortement renforcés en 2015, le plan de lutte contre le terrorisme couvrant les années 2015, 2016 et 2017 ayant prévu de doter le RT de 350 policiers et de 150 gendarmes supplémentaires – 162 policiers nous ont déjà rejoints en 2015. À la fin de l’année 2017, le RT devrait comprendre entre 2 650 et 2 700 personnes. La priorité du RT résidant dans son maillage territorial, nous avons implantés des antennes du renseignement territorial dans des brigades de gendarmerie. Cette évolution me paraît essentielle, car elle nous permet d’étendre le maillage du renseignement territorial dans les zones de gendarmerie. Le rattachement à la sécurité publique nous oblige à veiller à développer notre action avec la gendarmerie ; cet effort s’avère quotidien, et l’un de mes adjoints, membre de la gendarmerie, consacre une bonne partie de son temps à entretenir les liens d’échange et de coopération avec son arme d’appartenance. Le bilan des premières antennes du RT dans les brigades de gendarmerie, créées en 2015, s’avère très positif.
M. le président Georges Fenech. On en a visité une à Marseille.
M. Jérôme Léonnet. Nous allons en ouvrir 25 cette année et 25 autres en 2017.
Nous avons reçu l’autorisation de recruter des contractuels, élément important pour notre service, car nous avons besoin du concours de hauts potentiels universitaires, de traducteurs et d’informaticiens. Ils ne sont que sept à ce jour, mais ils constituent un apport notable pour le RT, et nous en recruterons d’autres à l’avenir.
La doctrine de fonctionnement et d’emploi du RT était très généraliste, si bien que j’ai souhaité que l’on élabore une annexe spécifique sur la radicalisation visant à donner aux services territoriaux des outils, des pistes et une méthode de travail. Nous sommes souvent confrontés à des radicalisés de moyen spectre, pour lesquels il convient de mener des entretiens administratifs plutôt que de s’épuiser en surveillance ; l’annexe comprend ainsi une trame destinée aux agents conduisant ces entretiens. Cela permet parfois de mettre en veille des dossiers, même si on ne les clôture jamais du fait de la fragilité manifestée par les personnes en voie de radicalisation. Ces personnes, à l’instar de celles entraînées dans des dérives sectaires, sont extrêmement vulnérables, mais peuvent parfois se sortir de cette spirale infernale.
Nous avons organisé deux séminaires consacrés à la radicalisation, dans lequel tous les chefs de service et leurs adjoints ont écouté nos recommandations et celles de la DGSI sur le sujet de la radicalisation (mai 2015 - mars 2016).
En 2015, deux agents du RT ont intégré la cellule Allat (DGSI) à temps plein, le chef du dispositif étant un lieutenant-colonel de gendarmerie, ancien adjoint du chef de la division de la radicalisation et formé pendant plus d’une année. Notre production est totalement ouverte à la DGSI, et il nous manquait ce lien opérationnel pour traiter certains dossiers susceptibles d’entrer dans le domaine de compétence de la DGSI, sans que cette dernière puisse trancher définitivement la question. La cellule Allat représente le lieu idéal pour évoquer ces dossiers et assurer un passage de relais fluide ente le RT et la DGSI.
Nous avons également ouvert en septembre 2015 trois nouveaux services zonaux de recherche et d’appui (SZRA) à Bordeaux, Rennes et Metz, qui sont venus compléter le dispositif créé un an auparavant avec la division nationale de recherche et d’appui et les trois SZRA de Lille, Lyon et Marseille. Nous allons en outre instaurer un groupe de recherche et d’appui à Toulouse, après ceux déjà en place à Strasbourg et à Nice. La capacité du RT dans le domaine de la recherche et de l’appui s’élève à 200 agents.
Un décret du 27 juillet 2015 a intégré la prévention du terrorisme dans le champ des attributions du RT, ce qui nous a permis d’obtenir de nouveaux moyens techniques.
En décembre 2015, un décret d’application de la loi relative au renseignement a permis au RT, dans le cadre de la prévention du terrorisme, d’avoir accès, en plus des moyens classiques de renseignement technique – interceptions de sécurité et données de connexions –, aux nouvelles techniques de renseignement que sont les interceptions International mobiles subscriber identity (IMSI), le balisage, les sonorisations et les vidéos.
Le RT n’avait pas accès à l’intégralité du fichier TAJ (traitement des antécédents judiciaires) dans les départements, mais un décret a levé cet obstacle, notamment, élément essentiel, pour les procédures en cours. Lors d’une filature d’un individu, on prend un risque si l’on ignore la nature d’une procédure en cours le concernant. Par ailleurs, le RT souhaitait être associé au traitement du Passenger name record (PNR), ce qui nous a été accordé.
M. Sébastien Pietrasanta, rapporteur. Monsieur Léonnet, êtes-vous favorable à l’intégration du SCRT dans le premier cercle de la communauté du renseignement ? Tout le monde reconnaît la nécessité de voir le renseignement territorial monter en puissance ; le processus est en marche, mais ne faudrait-il pas passer un cap quantitatif et qualitatif ? Le Premier ministre a veillé à la progression des effectifs du SCRT, mais l’intégration au premier cercle représenterait une avancée qualitative.
Ne conviendrait-il pas de créer, à l’image de la DGSI et de la direction générale de la sécurité extérieure (DGSE), une direction générale du renseignement territorial afin de rendre le RT plus puissant et de lui conférer un plus grand rayonnement ?
La gendarmerie réalisant du renseignement territorial, ne pourrait-on pas resserrer encore davantage les liens entre la SDAO et le SCRT ? Que pensez-vous d’un éventuel rapprochement entre les deux structures ?
Nous nous sommes déplacés à Lille et à Marseille où la gendarmerie s’est montrée très satisfaite du nouveau fichier FSPRT, vos services nous ont fait part de leur satisfaction en la matière et les services de la DGSI ont avoué ne pas lui reconnaître d’intérêt pour eux. Quelle est votre opinion sur ce fichier ? Vos services l’utilisent-ils et de quelle manière ? Comment évaluez-vous l’articulation entre l’EMOPT et l’UCLAT ?
On oppose artificiellement le renseignement humain au renseignement technique ; vous avez rappelé que le RT s’appuyait sur des hommes comme les imams modérés dont vous avez parlé, mais quelle est la situation du renseignement humain dans votre service ?
M. Jérôme Léonnet. La montée en puissance capacitaire, l’intégration de la prévention du terrorisme dans le champ de compétence du RT, la proximité du SCRT avec les services du premier cercle et sa présence dans la cellule Allat démontrent l’effectivité d’un rapprochement avec la notion de premier cercle qui n’existait pas il y a encore deux ans. La réflexion est incontournable, mais il faut veiller à ce qu’un rattachement du RT au premier cercle ne crée pas de blocages dans le service. Nos effectifs comptent des gens qui ne pourraient pas obtenir les tests d’habilitation au plus haut niveau ; je ne souhaite pas qu’une intégration au premier cercle induise une impossibilité d’accueillir des profils indispensables pour suivre un épisode de malaise dans le monde agricole ou un mouvement social classique. Ces agents, anciens de directions départementales de la sécurité publique ou des renseignements généraux (RG), ont une culture de travail différente de celle du premier cercle. Comme celles de la direction du renseignement de la préfecture de police de Paris (DRPP), les missions de la SCRT le conduisent à évoluer dans des milieux à la fois ouverts et fermés ; si l’un de ces aspects l’emportait sur l’autre, un déséquilibre se créerait. En outre, les services du premier cercle classifient l’ensemble de leur production, y compris interne, alors que le RT a besoin de fluidité et d’écrire rapidement pour rendre compte de situations ; cela ne signifie pas bien entendu que nous ne classifions pas les sujets confidentiels. Les contraintes plus fortes entourant l'appartenance au premier cercle pourrait entraîner une difficulté pour le SCRT.
Les RG rencontraient de nombreuses difficultés à obtenir les informations de terrain, notamment dans les zones de compétence de la sécurité publique. Tous les matins, de 8 à 9 heures, tous les chefs du RT participent à la séance d’information quotidienne de l’ensemble de l’activité de la veille et de la nuit de la sécurité publique. Le lien est le même avec nos camarades de la gendarmerie, et la SDAO nous transmet toutes les informations. Ce matin, j’ai ainsi reçu des points sur les blocages de transporteurs routiers émis par la gendarmerie comme par la sécurité publique ; cela m’a permis de disposer très rapidement d’un tableau complet de la situation dans tout le pays. L’autonomisation du RT pourrait induire, comme cela avait été le cas pour les RG, une moindre fluidité des échanges entre le RT et les services de police et de gendarmerie. Le RT doit se trouver au plus près des services de terrain.
M. le rapporteur. Le degré de la menace a engendré un décloisonnement, si bien que la transformation du SCRT en direction générale ne ferait pas perdre d’informations à votre service.
M. Jérôme Léonnet. Lorsque les RG existaient, les brigades d’information de voie publique (BIVP), composées d’agents habiles, agissaient dans le domaine du renseignement sur le terrain au profit de la sécurité publique, dans des domaines comme le lien avec les manifestants ou l’anticipation des manifestations. Les prévisions de ces brigades s’avéraient souvent bien précises. Dans ces matières du renseignement quotidien hors terrorisme, un petit incident pouvant passer inaperçu peut s’avérer important, si bien que le lien avec la sécurité publique est évident. Le RT n’est pas omniscient, il a développé une coopération avec les services de sécurité publique, qui nous transmettent tous leurs éléments ; le SCRT se charge de faire le tri et bénéficie ainsi d’une grande richesse d’informations. La sécurité publique s’est totalement appropriée le RT et y consacre beaucoup de moyens : les renforts se trouvent très souvent gagés sur les effectifs de la sécurité publique et cette dernière utilise 78 % de son budget dédié à la formation est destiné au RT, soit plus des trois quarts de cette ressource pour 2 500 agents alors qu’elle en compte 65 000. La sécurité publique apporte beaucoup au RT et celui-ci, même s’il ne peut pas tout prévoir, lui fait bénéficier d’une proximité très utile, par exemple, pour la gendarmerie, au barrage de Sivens ou le week-end dernier à Pont-de-Buis. Nos notes parviennent immédiatement aux services de police et de gendarmerie et avant même d’arriver sur mon bureau.
La SDAO est un service très efficace pour remonter de l’information. Toutes les informations du terrain dans les zones de gendarmerie ne me sont pas forcément transmises en direct, mais tous les éléments de la SDAO me parviennent en direct. Cela fait souvent doublon avec les renseignements déjà en ma possession, mais, depuis ma prise de fonctions en septembre 2014, il n’y a jamais eu d’informations perdues entre la gendarmerie et le SCRT – toutes nos notes, sans exception, leur sont transmises. D’ailleurs, l’un de mes meilleurs commissaires travaille à la SDAO et l’un des meilleurs officiers de gendarmerie est au SCRT ; l’un comme l’autre sont totalement intégrés dans les dispositifs de chaque service. L’été dernier, le général Sauvegrain a pris ses congés et le commissaire de police du RT placé à la SDAO a assuré l’intérim du poste ; cela prouve la confiance qui règne entre les deux services. Je ne méconnais cependant pas l’importance pour la gendarmerie nationale de se voir reconnaître une place à part dans le renseignement. Le RT essaie de la lui donner en employant 198 gendarmes, même si j’espère que ce chiffre progressera, notamment dans des secteurs compliqués ; parmi les sept divisions du service central, deux sont pilotées par un officier de gendarmerie, l’adjoint du chef de la division de la radicalisation est un gendarme, et le RT est représenté par un gendarme dans la cellule Allat, qui constitue le saint des saints.
La création de l’EMOPT répondait à la nécessité d’assurer un vrai contrôle de la manière dont les services associés traitaient le sujet de la radicalisation, dont l’importance n’a cessé de croître depuis l’été 2014. Il fallait s’assurer que le réseau préfectoral, qui pilote le dispositif d’évaluation et de suivi, et l’ensemble des services de renseignement travaillaient bien ensemble sur la radicalisation pour que tous les cas le méritant soient suivis. Suite au déploiement de la plateforme de signalement, le FSPRT permet de recenser les différents signalements. Il constitue un atout pour le RT car le fichier de prévention des atteintes à la sécurité publique (FPASP) du SCRT n’appréhende que les risques d’atteintes à la sécurité ; on n’entre pas dans le FPASP un individu signalé par son milieu professionnel car il ne serre plus la main aux femmes ou ne mange plus de cochon à la cantine sans avoir procédé à une évaluation préalable. Il n’en restera pas moins signalé au sein du FSPRT car il importe qu’un traitement dédié aux questions de radicalisation le garde en mémoire.
Qui plus est, les services du RT étaient beaucoup trop mobilisés par la fabrication des tableaux de suivi, que le FSPRT effectue en temps réel. En mars 2016, j’ai organisé un nouveau séminaire où tous les services départementaux du RT ont tous accepté que ce fichier remplace les tableaux d’évaluation et de clôture, ce qui se concrétisera en juillet prochain. Le FSPRT sera donc pour le RT un outil de comptabilisation dans le domaine de la radicalisation.
Monsieur le rapporteur, vous ne pouvez pas me faire plus plaisir que de rappeler l’intérêt de faire principalement reposer le travail de renseignement sur de l’humain. Je viens de la culture de la DST qui privilégie le renseignement humain sur toute dimension technique. Malgré les possibilités offertes par la loi, jamais nous ne lancerons de dispositifs techniques sans disposer au départ d’une validation humaine.
Nous avons refondé le code de traitement des sources au début de l’année 2015, car mon expérience à l’IGPN m’a montré la nécessité d’appliquer un traitement rigoureux des sources humaines, car on met en jeu des informations importantes et la destinée des collaborateurs et de leurs sources. On apprend à traiter avec méthode des sources humaines, cette tâche n’est pas innée et doit être contrôlée. Dans ce domaine, le RT a réalisé un travail considérable. En outre, pour combattre l’idée selon laquelle le renseignement technique peut tout faire, on impose aux départements une recherche systématique de sources humaines. Ces dernières nous apportent, dans tous les secteurs d’action du RT, les meilleures informations, celles qui débouchent sur des surveillances humaines et techniques.
M. le rapporteur. Bon nombre de personnes auditionnées par la commission ont affirmé qu’il était difficile de pénétrer dans certains quartiers pour y déposer des balises et déployer un dispositif de surveillance. Rémunérez-vous des sources pour des affaires de terrorisme ? Si tel n’est pas le cas, est-ce que cela serait utile ?
M. Jérôme Léonnet. On le fait déjà en suivant le dispositif en vigueur dans la police nationale, à savoir l’immatriculation centralisée des sources par la police judiciaire (PJ).
M. le rapporteur. En matière de terrorisme, les rémunérations des sources sont-elles élevées ou non ? Avez-vous besoin de davantage de moyens pour cette dépense ou les problèmes de recrutement et de formation rendent-ils inutile une progression de ce poste budgétaire ?
M. Jérôme Léonnet. Le recrutement de sources humaines est une priorité car la prévention du terrorisme, compétence récemment reconnue au RT, nous a conduits à réorienter le travail de certaines de nos sources à la fin de l’année 2014 et au début de 2015 ; il nous reste de la marge pour accomplir davantage et il y a lieu de recruter davantage de sources humaines opérant dans ce champ, ce que nous sommes en train de faire.
M. le rapporteur. Vous n’avez pas de problème budgétaire ?
M. Jérôme Léonnet. Pas pour l’instant. Je peux rémunérer les sources qui doivent l’être, les émoluments restant modestes puisqu’ils ne dépassent pas quelques dizaines d’euros sauf pour quelques gros coups où l’on peut donner quelques centaines d’euros. Nous avons d’abord recruté dans les quartiers, certaines des sources de ces milieux nous permettant aujourd’hui de déployer des opérations de prévention du terrorisme. À Lyon et à Strasbourg, on a récemment pu judiciariser des affaires à partir d’informations provenant de sources du RT et transmises à la DGSI et à la PJ.
M. François Lamy. La force des RG résidait dans son maillage territorial, animé par un tissu humain composé, entre autres, d’élus et de membres d’association. La fusion d’une partie des RG avec la DST a brisé cette architecture ; dans l’Essonne, tout ce qu’avaient construit les RG a disparu et n’a pu bénéficier au RT. Avez-vous retrouvé la qualité de la toile élaborée les RG ?
Avez-vous déjà mis en place une structure réunissant l’ensemble des services travaillant dans les quartiers ? Lorsque j’étais ministre de la ville, seul le préfet des Bouches-du-Rhône avait instauré une telle cellule réunissant des délégués du préfet, des responsables de centres sociaux et les services de police. Est-ce que ces groupes ont essaimé dans le pays et, si tel n’était pas le cas, envisagez-vous d’opérer cette structuration ?
Pouvez-vous mener un travail analysant les ressorts de la radicalisation ? On parle toujours des quartiers – une récente polémique a concerné l’existence ou non de quartiers comme celui de Molenbeek en France –, mais je rappelle que les frères Kouachi ont été élevés en Corrèze. Je ne suis pas sûr que la surreprésentation des musulmans dans certains quartiers urbains suffise pour affirmer que ces zones constituent un terreau favorable au terrorisme. Parvenez-vous à déterminer les causes poussant un individu faisant du trafic dans un quartier sensible à basculer dans la radicalisation puis dans le terrorisme ?
M. Meyer Habib. Monsieur le directeur, la progression du nombre de personnes radicalisées suivies par vos services – de 476 en janvier 2015 à 3 600 aujourd’hui – est sidérante. Après les attentats de janvier 2015, près de 20 000 tweets ont affirmé « Je suis Kouachi » ou « Je suis Coulibaly » : j’avais dit à ce moment-là que ces 20 000 personnes devaient être contrôlées, arrêtées et mises en garde à vue pour apologie du terrorisme. Vous avancez le chiffre de 3 600, mais ces personnes sont peut-être 36 000 voire 360 000. Comment s’assurer que les mailles du filet sont assez denses ? Yassin Salhi, qui a décapité son patron dans l’Isère, n’était pas suivi par les services.
M. le rapporteur. Il l’avait été, mais il était sorti des radars.
M. Meyer Habib. On a décuplé nos moyens, mais il n’est pas certain que ce soit suffisant.
La dimension humaine du renseignement prime, et il s’avère nécessaire que de nombreuses personnes accompagnent l’utilisation des nouvelles technologies. Des rémunérations de sources ne dépassant pas quelques dizaines d’euros sont insuffisantes ! En Israël, le Shabak, qui est le service de sécurité intérieure, déploie une technologie très performante et salarie des sources infiltrées pour prévenir les attentats. L’imam Chalghoumi est protégé par la police car il reçoit des menaces ; des dizaines et des dizaines d’imams devraient être en contact régulier avec la police. Cela ne ferait pas d’eux des délateurs, mais on ne peut pas se taire face au terrorisme.
Que fera-t-on si l’on subit trois, quatre, cinq ou six attentats simultanés ? J’espère que cela n’arrivera pas, mais si tel était le cas, que pourrait-on faire de plus ? Où en sommes-nous de la politique de contrôles, notamment dans les aéroports ? Cette question se pose avec acuité aujourd’hui avec la disparition d’un avion parti de Roissy vers Le Caire.
Un quart des radicalisés sont des convertis – un peu moins chez les hommes et un peu plus chez les femmes : quelles actions mettez-vous en œuvre pour suivre cette population ?
Comment qualifierez-vous la coopération de votre service avec la DGSE pour suivre les personnes quittant la France pour une zone de djihad ?
M. Jérôme Léonnet. Monsieur Lamy, on a évidemment beaucoup perdu du tissu développé par les 3 500 agents des RG. Nous nous efforçons de retrouver l’intégralité de ce réseau, et l’on dispose d’atouts que les RG n’avaient pas, le premier d’entre eux étant l’appui de nos camarades de la sécurité publique. L’ensemble des instances partenariales, des associations locales, des bailleurs sociaux travaillent ouvertement avec nous et ne mettent aucun obstacle à l’action du RT, au contraire.
Cette action de terrain nous permet de recruter des sources, et l’on bénéficie de nos très bonnes relations avec l’ensemble du tissu associatif pour trouver ces personnes dont la tâche est très particulière. Lorsqu’un chef du RT prend ses fonctions, je le reçois et lui demande de développer des contacts avec tous les partenaires. Compte tenu de la mission et du cahier des charges du RT dans l’organisation actuelle de la lutte antiterroriste, la présence au plus près du terrain et les liens avec l’imam, le bailleur local et l’association de quartier s’avèrent essentiels. Grâce à cela, on peut avoir des contacts voire recruter des sources.
La forte émergence de la radicalisation – quelques dizaines de cas en 2014, 476 au début de l’année 2015 et 3 600 aujourd’hui – nous empêche d’être totalement lucides sur le phénomène, et je m’efforce de demander un point hebdomadaire sur les dossiers emblématiques. On dispose néanmoins de quelques certitudes : le cocktail associant la délinquance, les contacts en milieu carcéral et la radicalisation s’avère très dangereux ; en outre, l’association entre la fragilité mentale diagnostiquée ou non – et la radicalisation se révèle également menaçante. On considère que 700 à 800 personnes radicalisées sont dangereuses, dont 150 relèvent du domaine psychiatrique. Nous sommes en train de développer nos échanges avec la médecine psychiatrique, après des années de difficultés ; les agences régionales de santé (ARS) et les médecins ont pris conscience que lorsqu’une personne cessait ses soins ou cherchait à échapper à un diagnostic tout en développant une terminologie religieuse, il fallait donner l’alerte. Parmi les 3 600 personnes, des profils se dessinent et des situations se recoupent, comme la fragilité des mineurs et l’inquiétude des parents face à la conversion d’un enfant n’ayant pas évolué dans un milieu culturel musulman ; on a connu des cas comparables lorsque l’on a étudié les sectes. Dans la radicalisation, on va de la simple dérive sectaire au pré-terrorisme. Tous les cas sont uniques, et je recommande de rencontrer une personne signalée, lorsque, comme dans la grande majorité des cas, elle n’est pas dans une démarche conduisant au terrorisme qui oblige à agir en milieu fermé. Ces entretiens n’ont pas toujours d’issue favorable car un profil fragile le restera ; en outre, des contractuels, dont une psychologue, travaillent avec nous sur la déradicalisation.
M. François Lamy. Y a-t-il des territoires plus exposés au phénomène de la radicalisation ?
M. Jérôme Léonnet. À partir de l’échantillon du RT, on constate que les personnes suivies sont plus nombreuses dans l’Est, dans le Nord, à Marseille, à Montpellier et à Toulouse qu’ailleurs et notamment que dans le grand Ouest. Les raisons sont d’ordre culturel, social et économique. Le département le plus touché par ce phénomène est le Nord.
Je ne commenterai pas la formule de « Molenbeek à la française », mais nous travaillons dans des territoires où l’islam militant cherche à peser sur la structure associative et économique des territoires. En lien avec nos camarades de la PJ, de la direction centrale de la police aux frontières (DCPAF), de la DGSI et de la gendarmerie, nous déployons des actions opérationnelles ciblées visant à empêcher toute prise en main d’un territoire, comme à Trappes. La cellule Allat nous permet de travailler avec les services du premier cercle ; agir avec le service de traitement du renseignement et de l’action contre les circuits financiers clandestins (Tracfin) lorsque l’on soupçonne des financements délictueux se révèle très efficace.
Monsieur Meyer Habib, dans un cas signalé sur trois, on évalue au final que la personne n'est pas radicalisée, mais inquiète son environnement familial ou professionnel. Je me concentre sur les profils dont le passé délinquant et la fragilité, exprimée par exemple sur les réseaux sociaux par des prises de position démentielles méritent un suivi poussé, sans épuiser la capacité du RT dans le traitement de cas assez simples, que d’autres structures comme l’Éducation nationale ou les organismes sociaux peuvent gérer. Le fichier FSPRT est riche de 13 000 signalements, dont beaucoup sont suivis par des services qui ne sont pas ceux de l’État. À l’époque de la parution du rapport parlementaire sur les sectes, on a découvert l’étendue de l’emprise sectaire. Certains de nos concitoyens sont fragiles, et nous devons surveiller sur leur évolution, mais ils ne basculeront pas forcément dans le terrorisme.
Le RT a connu une phase de renforcement significatif, puisque les effectifs sont passés de 1 800 à 2 600 en trois ans, cette progression est difficile à digérer. Nous devons en effet former les gens et leur donner des missions claires. La capacité du service a été largement entamée par la mission de suivi de la radicalisation, qui absorbe 40 % de notre activité contre 5 % il y a peu. Cette proportion est lourde, surtout lorsque des événements du type malaise agricole ou journées nationales d’action contre le projet de loi relatif au travail nous mobilisent. Lors d’un séminaire de la sécurité publique, j’ai félicité les 101 chefs RT, dont plus de soixante sont des commandants de police, que l’on peut joindre à tout moment, samedis et dimanches compris et qui sont capables de parler aussi bien de radicalisation que de manifestations classiques. Le RT a pris conscience des attentes placées en lui dans ce domaine sensible et son engagement se révèle total. On continuera de progresser, car on affine nos analyses, on écrit beaucoup, on est très lu et on échange beaucoup avec la DGSI. Le RT doit continuer de prendre en compte des signaux faibles et de les évaluer pour déterminer ceux qui doivent être vraiment suivis des autres. Le SCRT aide également la DGSI qui se trouve en première ligne dans la lutte contre les réseaux radicaux, notamment en mettant en œuvre de la surveillance dans des cas de quasi-terrorisme.
On commence toujours par verser de modestes rémunérations à nos sources, car on recrute dans les quartiers et non dans des réseaux terroristes ou à l’étranger. En partant du quartier, on peut parfois arriver à l’étranger ; ainsi, le SCRT mène actuellement une opération avec la DGSI et la DGSE où une personne, recrutée dans un quartier, se projettera, à l’étranger. Cet individu pourra énormément apporter aux services du premier cercle, qui lui verseront une rémunération incomparable avec les quelques dizaines d’euros perçus après son recrutement par le SCRT.
Les liens avec la DGSE sont fluides grâce à Allat et aux échanges que l’on entretient ; j’ai été reçu par le directeur général de la sécurité extérieure, et nos deux structures conduisent ensemble un travail opérationnel et documentaire. Les gens du RT qui s’occupent de radicalisation ont besoin d’une petite culture dans le domaine de l’islam ; on a accès à beaucoup d’études publiques sur le salafisme et le tablighi. En revanche, c’est la DGSE qui nous transmet les informations relatives à l’évolution de telle école ou de tel courant de pensée en Égypte ou en Arabie saoudite.
M. Meyer Habib. Des imams, comme Hassen Chalghoumi nous mettent en garde de ne pas installer de nouvelles mouvances ou des courants proches des Frères musulmans et de Tariq Ramadan au Conseil français du culte musulman (CFCM).
M. Jérôme Léonnet. Là réside tout le problème que nous rencontrons avec les salafistes : leur discours condamne le terrorisme, mais il véhicule l’idée d’une autre République. Le RT assiste à toutes les conférences et réunions du type du congrès de l’Union des organisations islamiques de France (UOIF) au Bourget pour appréhender et répercuter la situation. Dans sa conception la plus rigoriste, la religion musulmane développe des messages qui, sans être de nature terroriste, ne me paraissent pas compatibles avec les valeurs républicaines, et le rôle du SCRT consiste à le dire et à l’écrire. Beaucoup d’éléments que nous transmettons irriguent les réflexions et les réactions des autorités politiques ; ainsi, les récents propos du Premier ministre sur les salafistes se nourrissent des écrits du SCRT et de la DGSI alertant sur leur volonté de remplacer le code pénal par la charia.
M. Serge Grouard. Les 3 600 personnes que vous suivez sont-elles signalées ou suivies ? On a entendu un chiffre global de 10 000 personnes radicalisées. Qui suit les autres et comment s’opère la répartition entre les services ? Parmi ces 3 600 individus, vous avez affirmé que 700 à 800 étaient potentiellement dangereuses. La police renforce-t-elle vos effectifs pour assurer leur suivi ? Celui-ci est-il physiquement permanent ? Élaborez-vous un compte rendu permanent de la surveillance de ces personnes ?
Je rejoins les propos de M. Meyer Habib : face à cette menace, nouvelle et massive, on s’adapte et vous faites le maximum avec les moyens qui vous sont alloués. Ainsi, on se rassure, mais je me demande si on ne se leurre pas. On n’arrivera pas à ficher et à suivre toutes les personnes potentiellement dangereuses, et la commission doit réfléchir aux réponses à apporter à ce défi. Ces chiffres m’inquiètent, car il n’a pas fallu beaucoup de monde pour organiser la tuerie du Bataclan : combien de Bataclan se cachent dans cette population radicalisée ?
Lorsque vous avez évoqué les relations que vous tissez localement pour remplir votre mission, vous n’avez pas parlé du maire. J’ai été maire d’Orléans pendant quinze ans et jusque récemment : je connais ces problèmes et la situation des quartiers difficiles. Certaines villes ont mis en place des systèmes de prévention et de médiation comme les conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD) et les groupes locaux de traitement de la délinquance (GLTD) qui permettent d’aller au-delà des contacts, car le point fondamental réside dans le suivi. Les CLSPD, qui réunissent la police, les services du maire, les services sociaux et l’Éducation nationale, assurent un suivi permanent lorsqu’ils fonctionnent, ce qui n’est pas le cas partout dans le pays. Monsieur le directeur, êtes-vous d’accord avec moi pour reconnaître qu’un chaînon manque localement ? En effet, votre service ne fait hélas pas partie de cette structuration locale – ou indirectement par la voix du directeur départemental de la sécurité publique.
Monsieur le directeur, avez-vous des signaux non pas faibles, mais forts ?
M. Jérôme Léonnet. Le FSPRT gère 13 000 signalements, ce qui correspond à l’intégralité de ceux recensés par l’UCLAT depuis le printemps 2014. Le RT est le chef de file dans 3 600 dossiers. Les autres cas sont suivis par les services de sécurité, sociaux, associatifs et de l’Éducation nationale présents autour de la table de la réunion hebdomadaire, présidée par le préfet et où l’on évalue et répartit les profils et où rend compte de leur suivi.
L’intérêt de ce dispositif local, consacré par la création de l’EMOPT, est d’amener le préfet à piloter personnellement l’évaluation de tous les dossiers de son département. Devant la progression du phénomène, il était nécessaire de savoir quel service traitait quelle question afin de vérifier que tout était couvert : là réside la plus-value de l’EMOPT.
Les 3 600 individus suivis par le RT ne méritent pas tous une attention soutenue. Quant aux 700 à 800 les plus radicaux, l’effectif de 2 350 personnes du SCRT ne nous permet d’assurer que moins d’une dizaine de dispositifs de surveillance active au même moment. Cependant, le suivi s’effectue également grâce à l’ensemble des relais dont nous disposons. Si une personne radicalisée vient de sortir de prison, est proche de milieux délinquants et développe une attitude inquiétante qui le place dans le vivier des 700 à 800 individus, on demande à la brigade anti-criminalité (BAC) de prendre attache avec ses contacts habituels pour connaître l’évolution de la personne. On développe également des systèmes de sonnettes avec son milieu professionnel ou familial. Une femme a récemment signalé que son mari sortant de prison était dangereux ; on a travaillé avec elle jusqu’au moment où on a vu que l’on pouvait lever le doute avec lui. On les a rencontrés ensemble et on s’est aperçu que le cas de cet individu relevait plutôt de la médecine. On a donc d’abord compté sur ce premier atout qu’est le contact avec la personne qui signale une menace. Les capacités du RT sont avant tout dédiées aux cas très lourds, sur lesquels on travaille avec la DGSI et la PJ.
Monsieur Grouard, je suis tout à fait d’accord avec vos propos sur les maires. Quand je reçois un chef RT qui prend son poste, je lui demande d’aller voir le maire, interlocuteur le plus important avec le préfet et le procureur de la République.
M. Serge Grouard. C’est le maire qui connaît la réalité, et non le préfet et le procureur. J’ai quinze ans d’expérience de maire, et je peux vous signaler tous les cas à Orléans. Comparez avec ce que vous diront le préfet et le procureur, et vous verrez que mon tableau s’avérera bien plus exhaustif !
M. Jérôme Léonnet. En termes de connaissance du territoire, vous avez tout à fait raison, et c’est pour cela que le contact avec l’autorité municipale, la présence parfois dans les instances de la ville et le lien permanent avec les services municipaux sont si importants. Cela est valable partout, et je n’ai pas d’exemples d’endroits où le RT n’aurait pas de relations fluides avec les maires. Une convention entre l’Association des maires de France (AMF) et les services de l’État sur la déradicalisation sera signée cet après-midi à Matignon, et le RT sera présent. Celui-ci participera également à la table ronde sur la déradicalisation organisée à l’occasion du prochain congrès de l’AMF. Le maire est le premier à pouvoir signaler une évolution dans un quartier et à orienter les services du RT vers tel ou tel interlocuteur.
M. le président Georges Fenech. Monsieur le directeur, les auteurs des attentats de janvier et de novembre 2015 étaient-ils connus du renseignement territorial ?
M. Jérôme Léonnet. Non, si ce n’est qu’Amedy Coulibaly avait été mentionné dans un document du service comme membre d’une bande de l’Essonne dans les années 2005.
M. le président Georges Fenech. Monsieur Léonnet, nous vous remercions pour cette intéressante audition.
Audition, à huis clos, du général Pierre Sauvegrain, sous-directeur de l’anticipation opérationnelle de la gendarmerie nationale (SDAO), et de M. Olivier Métivet, son adjoint
Compte rendu de l’audition, à huis clos, du lundi 23 mai 2016
M. le président Georges Fenech. Mes chers collègues, nous accueillons le général de brigade Pierre Sauvegrain, sous-directeur de l’anticipation opérationnelle de la gendarmerie nationale, accompagné de M. Olivier Métivet, adjoint au sous-directeur.
Mon général, nous vous remercions d’avoir répondu à la demande d’audition de notre commission d’enquête relative aux moyens mis en œuvre par l’État pour lutter contre le terrorisme depuis le 7 janvier 2015.
Nous allons poursuivre avec vous nos investigations dans le domaine du renseignement, en nous intéressant à la coopération entre votre service et les autres services de renseignement, aux moyens humains et techniques dont vous disposez pour mener à bien vos missions et aux rapprochements qui pourraient intervenir.
Cette audition, en raison de la confidentialité des informations que vous êtes susceptibles de nous délivrer, se déroule à huis clos. Elle n’est donc pas diffusée sur le site internet de l’Assemblée. Néanmoins, et conformément à l’article 6 de l’ordonnance 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, son compte rendu pourra être publié en tout ou partie, si nous en décidons ainsi à l’issue de nos travaux. Je précise que les comptes rendus des auditions qui auront eu lieu à huis clos seront au préalable transmis aux personnes entendues afin de recueillir leurs observations. Ces observations seront soumises à la commission, qui pourra décider d’en faire état dans son rapport. Je rappelle que, conformément aux dispositions du même article, « sera punie des peines prévues à l’article 226-13 du code pénal (un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende) toute personne qui, dans un délai de vingt-cinq ans divulguera ou publiera une information relative aux travaux non publics d’une commission d’enquête, sauf si le rapport publié à la fin des travaux de la commission a fait état de cette information ».
Conformément aux dispositions de l’article 6 précité, je vais vous demander de prêter le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité.
Veuillez lever la main droite et dire : « Je le jure ».
Le général Pierre Sauvegrain et M. Olivier Métivet prêtent successivement serment.
Notre Commission d’enquête souhaite obtenir des réponses de votre part aux questions suivantes.
Comment la sous-direction de l’anticipation opérationnelle (SDAO) est-elle organisée à l’échelon central et local ?
La SDAO perçoit-elle une évolution de la menace au sein des territoires situés en zone gendarmerie ?
Les attentats perpétrés en 2015 ont-ils conduit la SDAO à modifier son organisation ?
Comment la remontée d’informations des brigades de gendarmerie vers la SDAO s’opère-t-elle ? Quel rôle les antennes de renseignement territorial mises en place par la gendarmerie au sein de ses brigades territoriales jouent-elles dans ce domaine ?
Quel est l’état de la collaboration entre la SDAO et le renseignement territorial ? A-t-elle évolué depuis les attentats de janvier 2015 ? De novembre 2015 ?
Quel est l’état de la collaboration avec les autres services de renseignement, notamment la DGSI et le renseignement pénitentiaire ?
La SDAO dispose-t-elle des moyens humains et techniques pour mener à bien ses missions ?
Quelles sont les principales méthodes de travail des personnels de la SDAO ? Ces méthodes ont-elles évolué depuis janvier 2015 ? Depuis novembre 2015 ?
Pensez-vous que le rattachement du service central du renseignement territorial (SCRT) à la direction centrale de la sécurité publique (DCSP) demeure pertinent ?
Un rapport d’information sur les moyens consacrés au renseignement au sein des programmes « Police nationale » et « Gendarmerie nationale » fait au nom de la commission des finances du Sénat par le sénateur Philippe Dominati en octobre 2015 évoque la possibilité d’un rapprochement entre la SDAO et le SCRT à moyen terme. Quel regard portez-vous sur cette proposition ?
Quelle est la plus-value de la participation de la SDAO à l’Unité de coordination de la lutte antiterroriste (UCLAT) ? Quels bénéfices la SDAO en retire-t-elle ?
Quelle utilisation la SDAO fait-elle du FSPRT ? Quel regard portez-vous sur l’utilité de ce fichier ?
Je vais vous laisser la parole pour un exposé liminaire qui sera suivi par un échange de questions et réponses.
Général Pierre Sauvegrain, sous-directeur de l’anticipation opérationnelle de la gendarmerie nationale (SDAO). Monsieur le président, madame et messieurs les députés, merci de m’accueillir au sein de votre commission d’enquête relative aux moyens mis en œuvre par l’État pour lutter contre le terrorisme depuis le 7 janvier 2015. Je suis très heureux de pouvoir m’exprimer devant vous sur l’activité de la sous-direction de l’anticipation opérationnelle au cours des mois qui viennent de s’écouler dans le cadre du défi posé par la menace terroriste à laquelle notre Nation est exposée. Le niveau de la menace n’a en effet n’a jamais été aussi élevé, et la mobilisation de tous est nécessaire pour y faire échec.
Mes propos liminaires viseront à brosser le tableau le plus complet possible de l’activité de la SDAO, service du second cercle du renseignement en France. Je veillerai surtout à vous présenter les adaptations et évolutions qu’a connues notre dispositif au cours des derniers mois. Mon propos s’articulera autour de trois points : dans un premier temps, je présenterai l’organisation de l’exercice de la mission renseignement en gendarmerie, dont la SDAO est la clé de voûte ; dans un deuxième temps, je décrirai la façon dont s’organisent les relations avec les deux principaux services partenaires, à savoir le service central de renseignement territorial (SCRT) d’une part, la DGSI d’autre part.
Je reviendrai sur les progrès accomplis dans l’amélioration des échanges à la faveur des drames que nous avons connus en 2015 ; sur le suivi par la gendarmerie des individus radicalisés, en vous donnant des chiffres précis sur l’action de la gendarmerie dans ce domaine ; enfin dans un troisième temps, je décrirai les mesures à étudier pour améliorer la lutte contre le terrorisme.
Le renseignement est une nécessité pour la gendarmerie nationale afin de réaliser avec succès sa mission globale définie à l’article 1er de la loi 2009-971 du 3 août 2009, codifiée à l’article L. 3211-3 du code de la défense selon lequel « la gendarmerie nationale est destinée à assurer la sécurité publique et l’ordre public, particulièrement dans les zones rurales et périurbaines, ainsi que sur les voies de communication. Elle contribue à la mission de renseignement et d’information des autorités publiques, à la lutte contre le terrorisme, ainsi qu’à la protection des populations. Elle participe à la défense de la patrie et des intérêts supérieurs de la nation, notamment au contrôle et à la sécurité des armements nucléaires ».
Cette nécessité s’impose à la gendarmerie compte tenu de l’étendue de sa zone de compétence – 95 % du territoire national et plus de 50 % de la population, et encore davantage lors des mouvements pendulaires estivaux – sur le territoire métropolitain et dans les outremers ; de la diversité des territoires dont elle a la charge ; de l’implantation dans ses territoires de 544 points d’importance vitale, civils et militaires ; enfin, de son implication dans la politique de défense de la France au travers de sa présence au côté des armées sur les théâtres d’opérations extérieures et sur les emprises du ministère de la défense, notamment les gendarmeries spécialisées – la gendarmerie assure la protection de 113 points d’importance vitale relevant des armées –, de son rôle dans la protection rapprochée de hautes autorités et de sa mission de protection des installations nucléaires, qui constituent le fondement historique de la politique d’indépendance nationale.
Depuis 2013, la gendarmerie nationale a procédé à deux transformations emblématiques. En premier lieu, elle s’est dotée d’un organe centralisé de traitement du renseignement : en vertu de l’arrêté du 6 décembre 2013, elle dispose désormais d’une structure spécialisée dans le traitement du renseignement nécessaire à l’exécution de ses missions : la sous-direction de l’anticipation opérationnelle (SDAO).
Cette création répondait à deux objectifs, dont le premier consiste à permettre l’interface entre le renseignement territorial (RT) et la gendarmerie nationale, sans toutefois créer une structure équivalente au SCRT et encore moins à la DGSI. J’insiste sur ce point : le dispositif de la gendarmerie nationale n’a pas pour ambition de concurrencer d’autres structures ou de faire doublon avec celles-ci, mais bien d’aboutir à une complémentarité indispensable en offrant une garantie de couverture intégrale des territoires.
Le deuxième objectif est de fournir du renseignement afin de répondre aux besoins opérationnels de la gendarmerie nationale, à l’instar de ce qui se fait dans les armées durant la phase de préparation d’une opération. Lors des manifestations organisées en ce moment contre la loi El Khomri, ou de celles ayant eu lieu contre le projet d’aéroport de Notre-Dame-des-Landes, je vais commencer par m’intéresser aux modes opératoires adverses selon les angles d’approche spécifiques à la mission de la gendarmerie. En parfaite complémentarité avec le SCRT, je vais surtout concentrer la recherche de renseignement sur l’adversité, là où la gendarmerie va devoir engager des forces, afin de savoir précisément comment nos adversaires s’organisent.
La création de la SDAO, service appartenant au second cercle du renseignement, a été rendue nécessaire pour permettre à la gendarmerie nationale d’améliorer les conditions d’exercice de sa mission de renseignement. Conformément à son arrêté de création, la SDAO « propose la doctrine relative aux missions de renseignement au sein de la gendarmerie (…) ; traite l’information interne et externe permettant l’alerte des autorités, ainsi que le suivi des situations sensibles à court terme (…) ; participe à la recherche, au recueil, à l’analyse et à la diffusion des informations de défense, d’ordre public et de sécurité nationale nécessaires à l’exécution des missions de la gendarmerie (…) ; assure le traitement du renseignement opérationnel d’ordre public et du renseignement de sécurité économique en métropole et en outre-mer (…) ; anime ou participe, avec les autres sous-directions de la direction des opérations et de l’emploi de la DGGN, aux gestions interministérielles de crise (…) ; suit et coordonne l’action des unités dans son domaine de responsabilité. »
Schématiquement, la SDAO peut se comparer à une maison comprenant un « circuit d’eau chaude » et un « circuit d’eau froide ». Le circuit d’eau chaude permet la transmission d’informations dans le cadre de la fonction « veille-alerte » pour informer le directeur général, qui rend compte au ministre, sur la situation sur le territoire national. Le « circuit d’eau froide » dédié à l’analyse, permet l’exploitation des données brutes et informations avant de délivrer du renseignement en s’appuyant sur une chaîne « anticipation et connaissance » qui compte 540 analystes répartis sur l’ensemble du territoire national et 170 référents en intelligence économique. Cette chaîne s’articule en échelons territoriaux, à savoir les cellules renseignement au plan départemental et les bureaux renseignement au plan régional.
Le recueil des informations est réalisé par chaque militaire dans le cadre de ses missions quotidiennes et animé par les différents échelons de commandement, l’ensemble du dispositif étant piloté depuis Paris par la SDAO. L’information est intégrée dans le système d’information qu’est la base de données de sécurité publique (BDSP) en vue de son exploitation et de son analyse. Système d’information global devenu performant au fil du temps, la BDSP assure le stockage et le traitement de l’information et du renseignement collectés par l’ensemble des 60 000 capteurs de la gendarmerie que sont les gendarmes départementaux. La BDSP est le ciment assurant la cohérence du dispositif du renseignement gendarmerie et je suis moi-même l’administrateur de cette base de données, au nom du directeur général de la gendarmerie.
M. le président Georges Fenech. C’est une base de données et non un fichier.
Général Pierre Sauvegrain. C’est une base de données comportant quatre fichiers, dont trois sont déclarés à la CNIL. Je pense que celui qui vous intéresse le plus est le module « renseignement », appelé GIPASP (gestion de l’information et la prévention des atteintes à la sécurité publique).
M. Sébastien Pietrasanta, rapporteur. Pourquoi l’un des fichiers n’est-il pas déclaré à la CNIL ?
Général Pierre Sauvegrain. En plus du GIPASP, la base de données comprend deux autres fichiers : le fichier SIP (sécurisation des interventions professionnelles), et le fichier GSI (gestion des sollicitations et des interventions). Le module EVT, quant à lui, ne comporte pas de données nominatives et est uniquement destiné à établir des statistiques sur des phénomènes observés par les unités (violences urbaines, rave party, etc.). Il ne s’agit donc pas d’un fichier nécessitant une déclaration auprès de la CNIL.
En second lieu, la SDAO s’est vu attribuer, du fait de la loi relative au renseignement et du décret d’application de l’article L.811-4 du code de la sécurité intérieure, la qualité de service du second cercle du renseignement. Depuis la prise d’effet du décret 2015-1639 du 11 décembre 2015, la SDAO est compétente pour les finalités suivantes prévues à l’article L. 811-3 de la loi relative au renseignement : l’indépendance nationale ; l’intégrité du territoire et la défense nationale (finalité 1) ; la prévention du terrorisme (finalité 4) ; enfin, la prévention des atteintes à la forme républicaine des institutions, des actions tendant au maintien ou à la reconstitution de groupements dissous, des violences collectives de nature à porter gravement atteinte à la paix publique (finalité 5).
L’action de la gendarmerie nationale dans le domaine du renseignement est indispensable à l’accomplissement de sa mission globale et s’accomplit en complémentarité avec les autres services.
Concrètement, l’action de la SDAO dans le domaine de la prévention du terrorisme se décline dans deux domaines : d’une part, le travail classique d’un service de renseignement de recherche et d’analyse du renseignement, d’autre part, la coordination avec les autres services.
L’action d’animation de la recherche et l’exploitation du renseignement reposent sur l’organisation décrite précédemment. L’information est recueillie par les unités opérationnelles, intégrée dans la BDSP, criblée et valorisée par les analystes des cellules et bureaux renseignement, exploitée au niveau de l’échelon central par la SDAO dans le cadre de la mise en œuvre des techniques de recherche de renseignement, et enfin transmise aux services partenaires.
La BDSP est le cœur de cette architecture du renseignement qu’est la SDAO. À titre d’exemple, le module « Rens » (renseignement), qui comptait 450 fiches portant sur des individus signalés pour radicalisme fin 2014, en compte aujourd’hui environ 8 000. Cela ne signifie pas que la gendarmerie nationale suit 8 000 personnes, mais que notre base de données comporte 8 000 noms de sources diverses – au passage, je veux souligner que cette base de données ne doit pas être confondue avec le FSPRT.
M. le rapporteur. Extrayez-vous des données du FSPRT pour intégrer au BDSP celles relevant de la zone gendarmerie ? En tout état de cause, comment avez-vous pu passer de 450 fiches à 8 000 ?
Général Pierre Sauvegrain. Premièrement, le fichier a été régulièrement alimenté au fil des mois, les services partenaires ayant produit énormément de renseignements, que nous avons partiellement intégré. Quand la BDSP a été déployée à compter du dernier trimestre 2011, nous sommes partis de zéro.
M. le président Georges Fenech. La BDSP a donc été constituée avant le décret de création de la SDAO ?
Général Pierre Sauvegrain. C’est exact : nous nous sommes en quelque sorte structurés autour d’un outil préexistant. Les acquisitions de données ont augmenté en volume en 2014, mais c’est évidemment en 2015 qu’elles ont connu un fort accroissement, et le rythme ne semble pas appelé à diminuer en 2016. Au fil du temps, la BDSP devient donc un outil de plus en plus performant, et à titre personnel j’estime qu’il est vraisemblable que le Mohamed Merah ou le Yassin Salhi de la décennie à venir y figure déjà.
Bon an mal an, la base de données s’accroît d’environ 10 % chaque mois. Les fiches proviennent du travail des analystes renseignement de la gendarmerie, mais aussi, pour une grande part, des services partenaires, notamment du RT.
M. le rapporteur. Je dois vous dire que notre Commission s’étonne de la multiplicité des fichiers auxquels ont recours les différents services de renseignement en France. Les fiches produites par le RT alimentent-elles également le FSPRT ?
Général Pierre Sauvegrain. Non, car la BDSP et le FSPRT n’ont pas la même vocation. Les 8 000 fiches entité personne du fichier GIPASP sont toutes liées à des activités de radicalisme, ou concernent des personnes susceptibles de porter atteinte à la sécurité publique.
M. le rapporteur. Pourquoi disposez-vous de votre propre fichier, alors que la vocation du FSPRT était justement de consolider les fichiers existants afin d’éviter les « trous dans la raquette », comme on a pu en faire le constat après l’attentat de Saint-Quentin-Fallavier ? Par qui le fichier de la BDSP peut-il être consulté : en particulier, l’état-major opérationnel de prévention du terrorisme (EMOPT) et l’UCLAT y ont-ils accès ?
Général Pierre Sauvegrain. Chaque institution, que ce soit la DGSI, le RT ou la gendarmerie nationale, dispose de son fichier, correspondant aux besoins qui lui sont propres. Si le FSPRT est destiné à permettre un meilleur suivi des individus radicalisés, la BDSP dépasse largement le cadre du radicalisme violent et inclut les personnes susceptibles de porter atteinte à la sécurité publique.
M. le rapporteur. Quand notre Commission s’est déplacée à Marseille et à Lille, les colonels de gendarmerie qui nous ont accueillis nous ont beaucoup parlé du FSPRT, qui constitue pour eux un outil important, mais ils ne nous ont rien dit du GIPASP et de la BDSP. Quand vous entrez une nouvelle fiche dans la BDSP, celle-ci est-elle automatiquement transmise à l’UCLAT ou à l’EMOPT pour être intégrée au FSPRT ? Dans la négative, à quoi sert le FSPRT, qui est censé être un fichier consolidé ?
Général Pierre Sauvegrain. La création et les premiers mois d’existence du FSPRT n’ont pas été faciles – c’est le cas de la plupart des fichiers –, mais il est désormais entré dans une phase de stabilisation. Pour ce qui est de la cohérence entre la BDSP et le FSPRT, nous atteignons actuellement un taux de cohérence de l’ordre de 95 % entre les individus suivis au titre du FSPRT et les informations contenues dans la BDSP. Quand on intègre une personne à la BDSP, c’est parce qu’on la considère susceptible de troubler l’ordre public. Les individus fichés au FSPRT le sont, eux, en raison d’activités liées à la radicalisation, et se voient attribués à un chef de file qui n’est pas forcément la gendarmerie – ce qui justifie que nous disposions de notre propre fichier. Ce n’est d’ailleurs pas le seul objet de la BDSP qui concerne avant tout la sécurité publique.
M. le président Georges Fenech. On trouvera donc aussi bien des personnes radicalisées que des zadistes dans la BDSP, alors que le FSPRT est réservé aux individus radicalisés.
Général Pierre Sauvegrain. Effectivement, le FSPRT est le fichier de la radicalisation violente, alors que la BDSP inclut un ensemble plus large de profils, et, ainsi que vous le dites, monsieur le président, on peut trouver des zadistes et des casseurs.
M. le rapporteur. Les 8 000 personnes faisant l’objet d’une fiche au BDSP sont-elles intégrées au FSPRT ?
Général Pierre Sauvegrain. Elles le sont à 95 % – c’est le taux de cohérence que j’ai cité il y a quelques instants.
M. le rapporteur. On peut donc considérer que le FSPRT est un fichier consolidé ?
Général Pierre Sauvegrain. Je sais qu’il faut du temps pour qu’un fichier se consolide. Il ne suffit pas d’exprimer une volonté forte : de nombreuses actions d’animation et d’explication sur le terrain sont pour cela nécessaires.
M. le président Georges Fenech. Combien de personnes sont inscrites en tout dans la BDSP ?
Général Pierre Sauvegrain. On compte 260 000 données environ, dont 8 000 fiches entité personne sur les personnes radicalisées ou susceptibles de l’être.
M. le rapporteur. Les 8 000 fiches entité personne de la BDSP représentent une bonne partie du volume des fiches du FSPRT, qui recense pour sa part environ 15 000 personnes.
M. Olivier Métivet, adjoint au sous-directeur de la SDAO. En vertu de la circulaire du 21 mars 2014, le SCRT est chargé de centraliser l’information sous le double timbre de la police et de la gendarmerie. Les 8 000 individus figurant au fichier BDSP ne sont pas, stricto sensu, 8 000 personnes relevant de la zone gendarmerie : certaines peuvent être en zone police mais en lien avec une personne située en zone gendarmerie – car le fichier prend en compte les réseaux de connaissances. Parmi les 8 000 fiches, on trouve donc une zone grise très importante, celle des personnes figurant à la fois dans le FPASP de la police et dans le GIPASP de la gendarmerie, quand un intérêt opérationnel le justifie.
Général Pierre Sauvegrain. Je précise qu’auront accès à la quasi-totalité des informations du GIPASP toutes les personnes ayant le profil « analyste » – leur nombre a été déclaré à la CNIL –, et seulement elles : nos services partenaires n’ont pas accès à notre fichier. Cela dit, les informations dont disposent les différents services font régulièrement l’objet d’échanges, dans un travail mené en étroite coopération.
M. le président Georges Fenech. Vous semblez attacher de l’importance au fait que le RT ne puisse pas accéder directement à votre fichier ?
Général Pierre Sauvegrain. Je ne le dirais pas comme cela. Nous répondons d’abord à une exigence de la CNIL, qui n’autorise pas l’accès libre et permanent à un fichier.
M. le rapporteur. Qu’en est-il d’un point de vue opérationnel ?
Général Pierre Sauvegrain. Il est normal que l’administrateur de la BDSP qu’est le DGGN, conserve la maîtrise de son fichier : de la même manière, le patron de la DGSI sera peu enclin à offrir un accès permanent au fichier CRISTINA, même à ses partenaires les plus proches. Il y a donc des règles très strictes d’accès à la BDSP, même pour les gendarmes servant au sein du SCRT, qui ne peuvent disposer que d’une partie des informations de la base de données – en fonction du profil qui leur est attribué.
La gendarmerie nationale a fixé définitivement son dispositif de suivi des individus signalés comme radicalisés ou en voie de radicalisation en octobre 2015. Ce dispositif est aujourd’hui articulé en deux niveaux selon le degré de radicalisation, voire de dangerosité des individus concernés. Le niveau 1 correspond à un suivi effectif réalisé dans le cadre du service courant : par exemple, une patrouille de gendarmerie peut aller voir le maire d’une commune où réside un individu radicalisé, afin de lui demander confirmation de l’adresse de la personne concernée, et de savoir si celle-ci s’est récemment signalée par quelque fait que ce soit. Le niveau 2 met en œuvre des techniques spécifiques de recueil du renseignement eu égard à la sensibilité de l’objectif : recours à un IMSI-catcher, sonorisation, interception de sécurité, filature, et toutes techniques justifiées par la dangerosité supposée de l’individu.
Au 20 mai 2016, la gendarmerie nationale exerce le suivi de 577 individus radicalisés en qualité de service traitant. Au sein de ce volume, elle exerce le suivi effectif de 322 individus radicalisés en tant que chef de file : 289 individus font l’objet d’un suivi de premier niveau, et 33 individus font l’objet d’un suivi de second niveau.
M. le président Georges Fenech. Parmi les 577 individus radicalisés dont la gendarmerie exerce le suivi en qualité de service traitant, qui sont les 255 dont elle n’exerce pas le suivi en tant que chef de file ?
Général Pierre Sauvegrain. Ces personnes sont suivies « pour traitement », c’est-à-dire qu’un autre service assurant le rôle de chef de file – la DGSI ou le RT – nous a demandé de procéder à un acte positif de suivi pour son compte : par exemple, si la personne réside en zone gendarmerie, nous pouvons être chargés de rencontrer son employeur ou le maire de sa commune. Dans ce cas, nous avons accès aux informations concernant cette personne dans le FSPRT, et nous abondons nous-mêmes les informations de ce fichier, en indiquant les démarches que nous avons effectuées et ce qui en a résulté.
M. le président Georges Fenech. Le nombre de 33 personnes suivies au niveau 2 semble peu élevé.
Général Pierre Sauvegrain. Les techniques mises en œuvre au niveau 2 ayant un coût relativement élevé et nos moyens étant comptés, nous devons sélectionner les personnes dont le profil justifie qu’on leur applique ce niveau de suivi. Par ailleurs, j’attire votre attention sur la répartition des compétences en matière de suivi des personnes radicalisées : la DGSI assure le suivi des personnes les plus sensibles, le RT est chargé du suivi des personnes dont le profil est moins inquiétant et la gendarmerie intervient pour le suivi des cas relevant de sa zone de compétence nécessitant un suivi dans le cadre normal du service ou une levée de doute. Le nombre de personnes que nous suivons au niveau 2 croît de manière modérée mais continue depuis trois mois. Enfin, l’expérience récente a démontré que la détermination d’un profil de dangerosité fondé sur le seul passé des individus ne permet pas toujours d’anticiper sur les passages à l’acte.
M. le président Georges Fenech. Si vous n’assurez le suivi que de 577 personnes sur les 8 000 fiches entité personne constituant votre base de données, qui assure le suivi des autres ?
Général Pierre Sauvegrain. Ces autres personnes ne sont pas forcément suivies : elles peuvent figurer dans le fichier uniquement parce qu’elles font partie d’un réseau de connaissances. Quand Yassin Salhi passe à l’acte à Saint-Quentin-Fallavier – une affaire ayant donné lieu à la création de l’EMOPT –, l’une des premières choses que fait la gendarmerie consiste à dresser son réseau de connaissances afin d’identifier d’autres profils sensibles au sein de son entourage.
M. le président Georges Fenech. Votre fichier comprend tout de même plus de 7 400 personnes non suivies. De deux choses l’une : soit ces personnes ne sont pas radicalisées, et elles n’ont pas à figurer dans votre fichier ; soit elles le sont, et devraient à ce titre être suivies.
Général Pierre Sauvegrain. Ces personnes peuvent être suivies par un service partenaire.
M. le président Georges Fenech. Sans que vous le sachiez ?
Général Pierre Sauvegrain. Nous pouvons le savoir dans le cadre des échanges ayant lieu avec l’EMOPT et dans les groupes d’évaluation départementaux (GED).
M. le président Georges Fenech. Les 7 400 personnes que vous ne suivez pas sont-elles forcément suivies par un autre service ?
Général Pierre Sauvegrain. Je ne suis pas en mesure de vous répondre sur ce point, mais je pourrai me renseigner.
Sur l’ensemble des perquisitions administratives réalisées en zone gendarmerie dans le cadre de l’état d’urgence, 113 ont été effectuées au domicile d’individus faisant actuellement l’objet d’un suivi effectif par la gendarmerie : 105 perquisitions ont été menées au domicile d’individus faisant l’objet d’un suivi de niveau 1, et 8 l’ont été au domicile d’individus faisant l’objet d’un suivi de niveau 2.
Après avoir abordé le travail de recherche, d’exploitation et d’analyse des données de la SDAO, je vais maintenant m’attacher à présenter les modalités de coordination avec les services partenaires, dans le contexte particulier du terrorisme. Nous avons des rapports quotidiens de très bonne facture avec le RT – au niveau central et au niveau territorial –, formalisés par une rencontre hebdomadaire obligatoire entre les officiers-adjoints renseignement (OAR) et les chefs des services départementaux du renseignement territorial (SDRT). Des bureaux de liaison sont créés à tous les échelons territoriaux – département, région, zone ; par ailleurs, RT et gendarmerie font partie des groupes d’évaluation des états-majors de sécurité qui traitent des individus signalés comme radicalisés.
Au plan central, la fluidification de la communication entre les services est assurée quotidiennement par des échanges de cadres de haut niveau : ainsi le commissaire Olivier Métivet, ici présent, assure-t-il les échanges d’informations avec le SCRT, tandis qu’au titre de la réciprocité, un colonel de gendarmerie en poste au SCRT est chargé d’une mission similaire.
Pour ce qui est de la DGSI, elle est rendue destinataire par la gendarmerie de tout renseignement intéressant son champ de compétence. La DGSI et la gendarmerie nationale échangent sur l’ensemble des thématiques partagées, au besoin avec les directions et sous-directions de la DGSI.
M. le président Georges Fenech. La DGSI peut-elle préempter des informations ?
Général Pierre Sauvegrain. La DGSI dispose d’un droit que vous qualifiez « de préemption » découlant des attributions fixées par le décret du 30 avril 2014, à savoir rechercher, centraliser et exploiter le renseignement intéressant la sécurité nationale et les intérêts fondamentaux de la nation. Concrètement, dès lors qu’une information la concerne, nous la lui transmettons. À la suite des attentats de janvier 2015, ayant entraîné la traque des frères Kouachi en zone gendarmerie, les échanges d’informations – consistant notamment en des levées de doute sur de possibles points de chute des terroristes en Picardie – ont été constants.
Les relations avec l’UCLAT, enfin, se sont densifiées. Désormais, la sous-direction assiste aux réunions hebdomadaires d’évaluation de la menace qu’organise l’UCLAT.
Globalement, même si les choses sont toujours perfectibles, j’estime que nous sommes parvenus à un très bon niveau de partenariat entre le SDAO et les services partenaires que sont le SCRT, la DGSI et l’UCLAT. Nos relations avec la DPSD et la DRM sont également satisfaisantes.
M. le président Georges Fenech. Que pouvez-vous nous dire au sujet des mesures à étudier ?
Général Pierre Sauvegrain. Deux sujets me paraissent particulièrement importants. Le premier consiste en l’insertion de gendarmes au sein de la DGSI : à l’instar de notre présence au sein des autres entités du premier cercle, la gendarmerie est favorable au détachement de gendarmes au sein de la DGSI sous une forme qui reste à définir – un officier de liaison ou des analystes.
Par ailleurs, il nous semble qu’instituer un copilotage du SCRT par les deux directeurs généraux permettrait de conforter le haut niveau de coopération entre le renseignement territorial et la gendarmerie ; à cet égard, envisager un nouveau positionnement du SCRT serait de nature à améliorer la coopération – déjà très bonne – entre le RT et la gendarmerie.
M. le président Georges Fenech. C’est d’autant plus souhaitable quand on sait que la gendarmerie couvre 95 % du territoire et 50 % de la population.
Général Pierre Sauvegrain. Effectivement. J’ajouterai que les gendarmes ont besoin de se reconnaître davantage dans un dispositif qui fonctionne très bien, mais peut encore progresser.
M. le président Georges Fenech. Dans la mesure où des gendarmes sont présents au sein du SCRT et vice versa, et où vous préconisez un copilotage du SCRT par les deux directeurs généraux, ne faudrait-il pas aller au bout d’une logique voulant que l’on procède à la fusion des deux services ?
Général Pierre Sauvegrain. Cette idée correspond à l’une des préconisations du sénateur Dominati. Je ne sais pas si le terme « fusion » est vraiment approprié…Quoiqu’il en soit, les missions de ces deux services ne se situant pas dans un registre identique, une fusion apporterait peu au SCRT mais, en revanche, entraînerait un affaiblissement pour la gendarmerie nationale.
M. le président Georges Fenech. On peut parler de « rapprochement », si vous préférez.
Général Pierre Sauvegrain. …car il sera toujours nécessaire de faire remonter de l’information et de préparer des opérations. En fusionnant les deux services, je ne sais pas si nous serions toujours en mesure d’assurer ces deux missions comme nous le faisons actuellement.
M. le président Georges Fenech. Ne peut-on distinguer le renseignement pur de l’opérationnel ?
Général Pierre Sauvegrain. Je ne suis pas en mesure de vous répondre sur ce point actuellement : peut-être conviendrait-il d’engager une réflexion.
M. le rapporteur. J’aimerais savoir quel était votre niveau d’information le 14 novembre 2015 en tout début de matinée : en particulier, connaissiez-vous l’identité de Salah Abdeslam ?
Général Pierre Sauvegrain. Dans la nuit du 13 au 14, nous avons pris connaissance des faits dramatiques qui venaient de survenir, mais aucun nom n’est apparu spontanément.
M. le rapporteur. L’information selon laquelle les terroristes auraient utilisé une voiture immatriculée en Belgique avait-elle été portée à votre connaissance ?
Général Pierre Sauvegrain. Oui, mais la directive nationale de recherche n’était pas arrivée.
M. Olivier Métivet. À ma connaissance, le seul document qui nous ait été communiqué au sujet d’une voiture immatriculée en Belgique recherchée était une mise en intention du Centre de coopération policière et douanière (CCPD) de Tournai.
M. le rapporteur. Quand des gendarmes contrôlent le véhicule de Salah Abdeslam le 14 novembre 2015 vers neuf heures dix, celui-ci leur semble suspect, ce qui justifie qu’ils le retiennent une demi-heure – contrevenant aux règles juridiques en vigueur – alors même qu’ils ne disposent pas d’informations particulières. À ce moment, la SDAO n’était-il pas en mesure de transmettre des informations aux brigades de gendarmerie au sujet d’un véhicule immatriculé en Belgique ?
Général Pierre Sauvegrain. Nous ne disposions pas d’informations suffisamment précises pour justifier que nous lancions un appel concernant un véhicule à rechercher ou des personnes à interpeller.
M. le rapporteur. Le fait de savoir qu’il fallait prêter une attention particulière aux véhicules immatriculés en Belgique et se dirigeant de Paris vers la Belgique n’aurait-il pas été utile aux gendarmes présents sur le terrain ?
Général Pierre Sauvegrain. Le 14 novembre au matin, nous ne disposions malheureusement pas d’un niveau d’information suffisant pour justifier de recourir à un dispositif plus important que celui qui a été mis en œuvre. Nous connaissions seulement les lieux des attentats et ne disposions que d’un début de bilan non consolidé. Sur la base de ces seules informations, nous avions mis en place un dispositif d’alerte des brigades de gendarmerie des régions limitrophes, réparti en cercles concentriques autour de Paris. Rien ne nous permettait de savoir qu’il fallait rechercher une personne ou un véhicule en particulier.
M. le rapporteur. D’après vous, d’autres services avaient-ils recueilli ces informations durant la nuit ?
Général Pierre Sauvegrain. Je ne suis pas en mesure de vous répondre sur ce point.
M. le rapporteur. Pouvez-vous nous indiquer pourquoi vous avez fait le choix de ne pas perquisitionner au domicile de l’ensemble des 33 personnes suivies par la gendarmerie au niveau 2 ?
Général Pierre Sauvegrain. Effectivement, seules 8 perquisitions ont été menées au domicile de ces personnes. D’une part, nous ne souhaitions pas donner inutilement l’alerte quand les éléments de l’enquête ne le justifiaient pas. D’autre part, je rappelle que la perquisition administrative est du ressort du préfet, et que dans ce domaine les gendarmes et policiers font des propositions qui ne sont pas forcément suivies.
M. le rapporteur. Vous nous avez indiqué que 544 points d’importance vitale, civils et militaires, étaient situés sur les territoires relevant de la compétence de la gendarmerie. Au printemps 2015, plusieurs vols ont été commis dans des entrepôts d’armements et de munitions, ce qui a mis en évidence des défaillances dans la surveillance de certains sites – un audit interne aux armées a même été effectué sur ce point. La responsabilité de la surveillance de ces sites incombe-t-elle à la gendarmerie ?
Général Pierre Sauvegrain. La garde des dépôts – j’entends le fait d’en assurer physiquement la surveillance – n’est pas de notre ressort. En revanche, nous avons la responsabilité de savoir ce qui se passe dans leur environnement s’ils sont situés dans des zones relevant de notre compétence, ce qui était le cas du dépôt de Miramas, où des munitions ont été volées en juillet 2015.
M. le rapporteur. La garde de tels dépôts est-elle assurée par l’armée ?
Général Pierre Sauvegrain. Oui, par la direction de la protection des installations, moyens et activités de la défense (DIPD) – en tout cas pas par la gendarmerie.
M. Pierre Lellouche. Le site de Miramas n’était pas gardé par l’armée, mais par des personnels contractuels !
Général Pierre Sauvegrain. Peut-être l’armée avait-elle sous-traité cette mission, je ne suis pas en mesure de vous répondre.
M. le président Georges Fenech. Depuis combien de temps disposez-vous des 540 analystes que vous avez évoqués, et y a-t-il parmi eux des spécialistes arabisants et connaisseurs du monde de l’islam ?
Général Pierre Sauvegrain. On peut considérer que je dispose de ces personnels depuis le début car, si la gendarmerie n’était pas structurée autour d’une sous-direction en 2013 – la structuration ne s’est faite que fin 2013, début 2014 –, les analystes, eux, étaient déjà là aux plans départemental et régional : il ne restait plus qu’à mettre en place un chef pour coordonner leur action.
Le fait de disposer de deux personnels arabisants (deux sur la trentaine d’analystes de l’administration centrale) – une ressource malheureusement rare – à la sous-direction représente un avantage considérable.
M. Pierre Lellouche. Deux arabisants pour dix millions de musulmans, c’est peu ! Vous avez une belle marge de progression !
Général Pierre Sauvegrain. Nous n’avons pas à suivre tous les musulmans de France ! En tout état de cause, je dois m’accommoder des effectifs modestes qui me sont attribués, même si j’aimerais pouvoir disposer d’un plus grand nombre d’arabisants.
J’aurai plus de mal à vous donner des chiffres pour le plan local. Je sais que l’antenne départementale du renseignement territorial de Méru dispose d’un arabisant, en la personne d’un adjudant polyglotte absolument remarquable. Il faut reconnaître qu’en matière de connaissance de la langue arabe et de la culture de l’islam, nous avons une marge de progression.
M. le président Georges Fenech. Ce point pourrait donc faire partie des évolutions que vous préconisez ?
Général Pierre Sauvegrain. Il est certain que la capacité à comprendre plus rapidement certains messages, notamment ceux véhiculés par internet, nous faciliterait la tâche.
M. Jean-Michel Villaumé. Pouvez-vous nous renseigner sur les moyens budgétaires dont dispose la structure spécialisée qu’est la SDAO, notamment en matière de personnel et de formation ?
Général Pierre Sauvegrain. Les moyens humains de la SDAO sont comptés : je dispose au plan central d’environ 75 militaires et je m’adosse aux 540 analystes que j’ai évoqués précédemment.
En matière de renseignement, les ressources budgétaires dont nous disposons relèvent de la responsabilité des régions de gendarmerie. En propre, je ne suis pas le responsable budgétaire, et notre sous-direction ne dispose que d’un budget modeste. Pour ce qui est de la dotation en matériel, la gendarmerie s’est vu affecter 78 millions d’euros, dont 69,4 millions d’euros en autorisations d’engagement et 54,2 millions d’euros en crédits de paiement dans le cadre du plan de lutte antiterroriste gendarmerie (PLAT) mis en œuvre après les attentats de janvier 2015. Cela comprend des armements et des moyens d’intervention, ainsi qu’un million d’euros dégagé pour le commandement des forces aériennes de la gendarmerie. Plus spécifiquement, il a été affecté 1,5 million d’euros, dont 0,7 million d’euros en crédits de paiement, aux moyens d’observation et de recherche judiciaire – drones, appareils photo, analyse balistique dématérialisée – et 6,2 millions d’euros, dont 6 millions d’euros en autorisations d’engagement et 2,5 millions d’euros en crédits de paiement, aux moyens de captation de données et de géolocalisation en lien avec la loi sur le renseignement.
M. Pierre Lellouche. Si l’on voulait résumer votre rôle en une phrase, serait-il exact de dire qu’il consiste à faire remonter de l’information dans le cadre de la lutte antiterroriste, à partir de 95 % du territoire et 50 % de la population française ?
Général Pierre Sauvegrain. Cette proposition appelle quelques amendements de ma part, monsieur le député. Si 50 % de la population vit dans la zone de compétence gendarmerie, une partie des personnes concernées peut être suivie par d’autres services. Ainsi, quand la DGSI suit un radicalisé, elle ne va pas s’arrêter au fait qu’il travaille ou réside en zone gendarmerie ; de même, le RT a une compétence nationale, s’étendant également en zone gendarmerie. Nous avons vocation à être des contributeurs au titre du renseignement, aux côtés d’autres services – à commencer par le RT, puisque la SDAO a été créée dans le cadre de la réforme de 2013 pour assurer un lien fonctionnel avec le RT. La responsabilité que vous évoquez est donc partagée avec le SCRT et la DGSI, dans le cadre d’un dispositif où les compétences des différents services sont très imbriquées.
M. Pierre Lellouche. Si l’on additionne vos gendarmes, les policiers du renseignement territorial et ceux de la DGSI, combien de personnels sont affectés au contreterrorisme en dehors des grandes agglomérations ?
Général Pierre Sauvegrain. Si l’on s’en tient très précisément à la notion de contreterrorisme, on peut déjà compter les 540 analystes que j’ai mentionnés. Au sein de la SDAO, les suivis de niveau 2 ne seront pas forcément effectués par des analystes. En gendarmerie, on demandera plutôt à des unités spécialisées, appelées groupes d’observation et de surveillance, d’effectuer certaines missions – je pense notamment aux filatures.
Pour ce qui est de la police nationale, je ne dispose pas des derniers chiffres, mais je crois que l’on compte actuellement 2 300 à 2 400 ETP affectés à la lutte antiterroriste au sein du SCRT. Je ne connais pas du tout les chiffres relatifs à la DGSI, ceux-ci étant classifiés. En tout, pour les trois services de renseignement du ministère de l’intérieur que vous avez cités, ce sont quelques centaines voire des milliers de personnes qui concourent à la lutte antiterroriste.
M. le rapporteur. Pour la DGSI, environ 3 600 personnes sont affectées à la lutte antiterroriste.
M. Pierre Lellouche. Comment expliquez-vous que l’on découvre du jour au lendemain qu’une vingtaine de jeunes de la commune de Lunel soient partis faire la guerre en Syrie et en Irak ? En étiez-vous informés avant que cette information ne soit révélée au grand public ?
Général Pierre Sauvegrain. Nous n’avons pas découvert du jour au lendemain que Lunel était une terre de départ pour le djihad : les gendarmes et le renseignement territorial avaient fait remonter l’information conjointement. Des antennes du renseignement territorial y ont été implantées très tôt, ainsi que deux gendarmes détachés pour emploi auprès du chef du service départemental du renseignement territorial, en poste à la gendarmerie de Lunel mais ayant pour mission exclusive de recueillir des renseignements auprès de la population afin de détecter les individus radicalisés.
M. Pierre Lellouche. Quand cette mesure a-t-elle été prise ?
Général Pierre Sauvegrain. Dans le courant de l’année 2015, après les événements survenus au mois de janvier. Parmi les renforcements d’effectifs accordés à la gendarmerie, 150 ETP ont été répartis en trois groupes de cinquante gendarmes appelés à prendre leurs fonctions en 2015, 2016 et 2017. Sur l’annuité de 2015, on a prélevé deux gendarmes pour les affecter à Lunel.
M. Pierre Lellouche. Je ne comprends pas comment on peut espérer recueillir du renseignement en envoyant pour cela deux gendarmes en uniforme en milieu salafiste ou cryptosalafiste, dans les banlieues arabes et musulmanes de Trappes, Lunel ou Grenoble, où tout le monde se connaît et parle un mélange de français et d’arabe.
M. le rapporteur. Pour compléter cette question, je vous demanderai, comme je l’ai fait au SCRT, si vous disposez de moyens financiers pour rémunérer des sources.
Général Pierre Sauvegrain. Contrairement à ce que l’on pourrait croire, l’uniforme n’est pas systématiquement un obstacle à la parole : certaines personnes font plus facilement confiance à un homme en uniforme qu’à un autre en civil.
Cela dit, les hommes affectés à une antenne de renseignement territorial (ART), notamment à Lunel, travaillent en civil.
M. le président Georges Fenech. Avec des voitures banalisées ?
Général Pierre Sauvegrain. Bien sûr. Cela dit, il ne faut pas se faire trop d’illusions : les cryptosalafistes que vous évoquez ont généralement une grande aptitude à détecter les policiers et les gendarmes, même lorsque ceux-ci évoluent en civil.
M. Pierre Lellouche. Quelle est la fonction des deux arabisants de la SDAO ?
Général Pierre Sauvegrain. Ce sont des analystes.
M. Pierre Lellouche. Existe-t-il, au sein de la gendarmerie, un programme d’apprentissage de l’arabe et de formation au contreterrorisme ?
Général Pierre Sauvegrain. Il existe des certificats militaires de langues et nous disposons d’un établissement de formation où nos personnels apprennent l’arabe. Par ailleurs, ils reçoivent une formation opérationnelle en techniques utiles au contre-terrorisme (filatures, etc.).
M. Pierre Lellouche. Selon vous, mettre en place de tels établissements serait-il utile ?
Général Pierre Sauvegrain. Cela pourrait être utile à condition de dépasser largement le cadre de la gendarmerie, c’est-à-dire si l’on en faisait bénéficier l’ensemble des services : non seulement les gendarmes, mais aussi les services de la DGSI et du renseignement territorial. Par ailleurs, je rappelle que les gendarmes ne sont en principe appelés à connaître que du bas du spectre en matière de radicalisme, c’est-à-dire des cas les moins sensibles – étant précisé, bien sûr, que les individus qui passeront à l’acte dans les années à venir peuvent très bien être situés dans le bas du spectre pour le moment.
Pour ce qui est des sources, nous n’en avons actuellement que dans le domaine judiciaire. Dans le domaine du renseignement administratif, ce dispositif est en cours de construction.
M. le rapporteur. Vous pourriez donc rémunérer vos sources et les intégrer à votre fichier ?
Général Pierre Sauvegrain. Le principe même des sources consiste à les rémunérer. Actuellement, le SDAO ne dispose pas de sources attribuées, mais cela fait partie des chantiers restant à conduire.
M. le rapporteur. Est-il déjà arrivé que vos gendarmes se trouvent dans l’incapacité de recueillir un renseignement, faute de disposer des moyens financiers pour cela ?
Général Pierre Sauvegrain. Comme vous le savez certainement, il y a une forte porosité entre la délinquance – parfois la petite délinquance – et le terrorisme. Il arrive donc que, dans le cadre d’une enquête judiciaire relative à une affaire de stupéfiants ou de criminalité organisée, une source procure aux enquêteurs du renseignement intéressant les services de lutte contre le terrorisme. Cela dit, la capacité dont pourrait disposer prochainement la SDAO à recourir elle-même à des sources est très intéressante.
M. le rapporteur. Dans le contexte de crise sociale que nous traversons, qui entraîne de nombreuses manifestations dans le pays, quelles sont vos priorités ? La surveillance de l’islam radical occupe-t-elle en ce moment la même part que d’habitude parmi l’ensemble de vos tâches ?
Général Pierre Sauvegrain. Certes, on ne fait que passer d’une priorité à une autre : en ce moment, par exemple, nous sommes très occupés avec les casseurs qui sévissent en marge des manifestations contre la loi El Khomri, ainsi qu’avec les actions de blocage des raffineries et dépôts de carburant. Cela dit, il y a environ dix-huit mois, c’est-à-dire avant l’attentat contre Charlie Hebdo, j’ai commencé à dédier des effectifs à la surveillance de la radicalisation, qui ne font que cela, et ne sont soustraits à cette occupation qu’en cas d’extrême urgence – en ce moment même, en dépit de l’actualité que je viens d’évoquer, ils restent affectés à leur mission habituelle.
M. le rapporteur. À quel pourcentage d’activité de la SDAO évalueriez-vous la lutte contre l’islam radical ?
Général Pierre Sauvegrain. Je dirai que cela représente 35 % à 40 % de notre activité.
M. Pierre Lellouche. Et en termes d’effectifs ?
Général Pierre Sauvegrain. En termes d’effectifs, ce serait un peu moins, même si le traitement du radicalisme reste la priorité de la SDAO. Cela représente une dizaine d’ETP.
M. Pierre Lellouche. Si je comprends bien, une centaine de vos agents sont actuellement affectés à la lutte contre la radicalisation et le djihadisme ?
Général Pierre Sauvegrain. J’ai bien dit que les 35 % à 40 % représentaient la part de notre activité, et non celle des effectifs employés à cette mission. Sur les 75 ETP que compte la SDAO, une dizaine de personnels sont affectés à plein-temps à la lutte contre la radicalisation.
M. le rapporteur. Les analystes ne dépendent pas de la sous-direction ?
Général Pierre Sauvegrain. Non, ils dépendent de leur commandant de groupement ou de région, et 30 % à 40 % de leur emploi du temps sont actuellement consacrés à la lutte contre la radicalisation.
M. Pierre Lellouche. Ils ne sont donc pas formés spécifiquement à cette tâche ?
Général Pierre Sauvegrain. Non, schématiquement, cette mission n’occupe qu’un tiers de leurs journées.
M. Pierre Lellouche. Selon le Président de la République et le Premier ministre, notre pays est en guerre contre le djihadisme. Est-il possible de savoir combien d’agents de la gendarmerie se consacrent exclusivement à cette guerre ? Vous avez commencé à nous dire que vous aviez un effectif de 540 personnels, avant de corriger ce chiffre en le ramenant à 75 personnels, puis à dix – appuyés, il est vrai, par d’autres personnels qui ne sont pas formés spécifiquement à cette mission. Je tiens à savoir quelle est notre force de frappe dans la guerre que nous menons actuellement : se résume-t-elle à dix personnes, dont deux parlent arabe ?
Général Pierre Sauvegrain. C’est bien cela si l’on s’en tient exclusivement aux équivalents temps plein de la SDAO.
M. le président Georges Fenech. Messieurs, je vous remercie pour vos interventions qui ont été riches d’enseignements.
Audition, à huis clos, de M. Olivier de Mazières, chargé de l’état-major opérationnel de prévention du terrorisme (EMOPT)
Compte rendu de l’audition, à huis clos, du lundi 23 mai 2016
M. le président Georges Fenech. Mes chers collègues, nous accueillons maintenant le préfet de Mazières, chargé de l’état-major opérationnel de prévention du terrorisme (EMOPT).
Monsieur le préfet, nous vous remercions d’avoir répondu à la demande d’audition de notre commission d’enquête relative aux moyens mis en œuvre par l’État pour lutter contre le terrorisme depuis le 7 janvier 2015.
Nous allons poursuivre avec vous nos investigations dans le domaine du renseignement, en nous intéressant à la coordination des services, aux moyens dont vous disposez et aux rôles respectifs de l’EMOPT et des autres structures de coordination.
Cette audition, en raison de la confidentialité des informations que vous êtes susceptible de nous délivrer, se déroule à huis clos. Elle n’est donc pas diffusée sur le site internet de l’Assemblée. Néanmoins, et conformément à l’article 6 de l’ordonnance 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, son compte rendu pourra être publié en tout ou partie, si nous en décidons ainsi à l’issue de nos travaux.
Je précise que les comptes rendus des auditions qui auront lieu à huis clos seront au préalable transmis aux personnes entendues afin de recueillir leurs observations. Ces observations seront soumises à la commission, qui pourra décider d’en faire état dans son rapport.
Je rappelle que conformément aux dispositions du même article, « sera punie des peines prévues à l’article 226-13 du code pénal (un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende) toute personne qui, dans un délai de vingt-cinq ans, divulguera ou publiera une information relative aux travaux non publics d’une commission d’enquête, sauf si le rapport publié à la fin des travaux de la commission a fait état de cette information. »
Conformément aux dispositions de l’article 6 précité, je vais vous demander de prêter le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité. Veuillez lever la main droite et dire : « Je le jure ».
M. Olivier de Mazières prête serment.
Monsieur le préfet, votre audition est très attendue par notre commission d’enquête, puisque que vous dirigez cette nouvelle unité de coordination auprès du ministre de l’intérieur. De nombreuses questions tournent autour de l’EMOPT et de son fichier, le FSPRT – fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation terroriste.
Pouvez-vous nous présenter votre mission, ainsi que les moyens dont vous disposez pour la remplir ?
Quelle est l’utilité du FSPRT ? La création de ce fichier a-t-elle produit des résultats concrets ?
Pourriez-vous expliquer la répartition des rôles entre l’Unité de coordination de la lutte antiterroriste (UCLAT) et l’EMOPT dans la gestion du FSPRT ?
Quels sont les services ou les autorités qui alimentent le FSPRT ? Combien de noms y figurent à ce jour ? Quelle est la proportion de personnes inscrites au FSPRT surveillées par les services de renseignement ?
Comment expliquer que la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED) n’ait pas connaissance de l’existence de ce fichier ?
Mais avant d’aborder ces questions, je vous laisse la parole pour un exposé liminaire.
M. Olivier de Mazières, chargé de l’état-major opérationnel de prévention du terrorisme (EMOPT). Je commencerai par quelques mots rapides pour mettre en perspective la création de l’état-major opérationnel de prévention du terrorisme.
Quel était le contexte historique ? Cette institution a vu le jour le 1er juillet 2015, sur la base d’une instruction du ministre de l'intérieur. Cette instruction n’avait pas seulement pour objet de créer l’état-major, puisqu’elle redéfinit complètement le suivi des personnes radicalisées sur le territoire national en confiant d’abord aux préfets de département un rôle pilote dans ce domaine.
Si j’ai parlé de contexte historique, c’est parce que l’on se situe dans les jours qui ont immédiatement suivi l’affaire de Saint-Quentin-Fallavier, qui s’est déroulée le 26 juin 2015 et au cours de laquelle un individu, M. Salhi, a décapité son employeur, s’est livré à une mise en scène photographique, puis a tenté de se faire exploser en heurtant des citernes de gaz dans son entreprise. Il est apparu en effet que cet individu avait été repéré par les services plusieurs mois auparavant, alors qu’il résidait dans le département du Doubs, qu’il s’était ensuite déplacé en Isère et qu’il avait été perdu par les services à l’occasion de ce déplacement.
En réaction à cette affaire, et d’une manière plus générale, le ministre de l'intérieur a donc souhaité revoir le dispositif de suivi des radicalisés sur le territoire national, notamment pour en garantir la traçabilité. L’objectif premier de cette réforme vise à s’assurer que chacun des individus repéré comme radicalisé et susceptible de passer à une action violente est pris en charge et suivi par un service chef de file bien identifié, et le cas échéant par des services cotraitants.
Le deuxième objectif est de pouvoir procurer, au premier chef à l’autorité politique, une cartographie la plus complète possible de la radicalisation sur le territoire français. Auparavant, ce n’était pas le cas puisque les individus radicalisés pouvaient faire l’objet d’un suivi par les services de renseignement, ou d’un suivi au niveau local. Enfin, une troisième composante existait déjà au début du mois de juillet 2015 : la plateforme nationale, qui permet des signalements, soit par téléphone, soit par internet et qui est gérée par l’UCLAT.
Il s’agissait, avant tout, de mettre en place une organisation au plus près du terrain, qui permette une circulation de l’information et un décloisonnement du travail de suivi entre les services. C’est une révolution copernicienne pour nombre d’entre eux, à commencer par la DGSI, qui n’avait pas forcément l’habitude de partager ses objectifs avec les préfets ou les autres services intervenant sur le territoire.
Cette méthode de partage de l’information repose sur deux outils principaux :
Premier outil : les groupes d’évaluation départementaux. C’est une structure qui réunit autour du préfet, et sous sa présidence, l’ensemble des services qui ont à connaître de la problématique des radicalisés susceptibles de passer à l’action violente. Se retrouvent donc autour de la table : le représentant départemental ou interdépartemental de la sécurité intérieure, le représentant départemental ou régional de la police judiciaire, le représentant départemental de la gendarmerie nationale et le représentant départemental du service du renseignement territorial. Dans la pratique, au fil des mois, d’autres services ont fini par s’agréger à ce premier cercle. Je pense principalement à l’administration pénitentiaire et à la direction de la protection et de la sécurité de la défense (DPSD).
Ces groupes d’évaluation se réunissent à un rythme hebdomadaire pour passer en revue l’ensemble des personnes signalées dans le département et mettre à jour les informations les concernant. Lorsque ce sont de nouveaux entrants, on détermine le service chef de file qui est chargé de les surveiller.
Deuxième outil : une application nationale accessible, comme toutes les applications de sécurité du ministère de l’intérieur, sous le portail CHEOPS, et qui s’appelle le FSPRT. Je détaillerai un peu plus tard ce que contient ce fichier, puisque c’est effectivement le point dur de notre organisation, et le principal support de notre action.
Dans ce contexte, l’état-major que j’ai l’honneur de diriger depuis la mi-juillet est en quelque sorte la tête de réseau de cette organisation nationale. En réalité, il y a trois étages : les préfets de département, dont j’ai déjà parlé ; les préfets de zones de défense, à qui l’on confie un rôle de supervision, le cas échéant d’affectation de moyens supplémentaires, notamment dans les petits départements, et de détermination de priorités propres à la zone ou à telle ou telle région composant la zone ; et un niveau national, avec l’état-major.
Selon la lettre de mission qui m’a été confiée par le ministre le 12 octobre 2015, le rôle de l’état-major consiste à « veiller au caractère effectif et cohérent du dispositif, proposer les axes d’effort, et informer le ministre ». Dans ce cadre, nous nous sommes organisés en trois pôles.
Premier pôle : le « suivi qualité » du fichier. J’ai une petite équipe de cinq personnes, dont le travail est d’analyser ce fichier quotidiennement, de s’assurer qu’il est régulièrement mis à jour et que les informations qui y figurent sont fiabilisées, notamment lorsque les individus sont dans une situation de mobilité, d’un département à un autre ou d’une zone de défense à une autre. On retrouve là le fait générateur initial de Saint-Quentin-Fallavier.
Le travail de ces personnes consiste également à extraire, à partir des données qui figurent dans ce fichier, une forme de cartographie de la radicalisation : cartographie géographique mais aussi en termes de risque et de menace prioritaire. Nous sommes notamment très vigilants sur les métiers que l’on qualifie de « sensibles », ce que j’appelle le « risque métiers ». En effet, certains individus, qui figurent dans ce fichier, ont des activités professionnelles dans le secteur des transports, des services publics, des entreprises au sens large (industrielles, stratégiques) et dans un secteur un peu mieux circonscrit mais auquel nous sommes très attentifs : les sociétés de sécurité privée.
Deuxième pôle : l’appui territorial. Il s’agit de se déplacer sur le terrain, dans le cadre d’une démarche d’explication, de motivation et de conviction : dialogue avec les préfets ; cadrage des organisations locales ; rappel des priorités nationales ; envoi de messages positifs aux services sur le terrain, pour qu’ils aient des retours sur leur travail et se rendent compte que celui-ci n’est pas absorbé dans une boîte noire mais qu’il est au contraire analysé et utilisé au niveau national ; enfin, recueil et diffusion des bonnes pratiques.
Troisième pôle : les liens avec les capteurs nationaux. Nous avons développé des relations avec des acteurs publics comme privés qui, dans leur domaine d’activité, peuvent être des capteurs de signalement, ou de vulnérabilité.
Dans le secteur public, ce sera très clairement le Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale (SGDSN), compte tenu de sa compétence sur les points d’importance vitale ; ce peut être aussi le haut fonctionnaire de défense et de sécurité (HFDS) du ministère de l’écologie et du développement, notamment sur toute la problématique des sites Seveso, des centrales nucléaires et du transport de substances dangereuses ; c’est également la DPSD, puisqu’il existe un phénomène de radicalisation au sein des forces armées, qui doit être pris en compte ; c’est l’administration pénitentiaire dont j’ai parlé tout à l’heure ; c’est enfin le Conseil national des activités privées de sécurité pour ce qui concerne les vigiles.
Ce peut être encore des partenaires privés ou parapublics : SNCF, RATP, EDF, RTE, Air France ou Aéroports de Paris. Je pourrai, si vous le souhaitez, développer les modalités de travail que l’on a mises en place avec ces différentes institutions.
Enfin, nous sommes amenés à participer à certains travaux interministériels. Je pense aux groupes de travail aujourd’hui constitués par le SGDSN en matière de réforme du criblage.
Quelles sont les spécificités de l’état-major ? Je vais ainsi répondre à votre question sur l’articulation avec l’UCLAT.
Tout d’abord, l’état-major est rattaché au cabinet du ministre et n’appartient donc à aucune des grandes directions générales. Composé de manière interservices, il est constitué de douze personnes : outre son chef et une assistante, cinq binômes qui viennent respectivement de la DGSI, du service central du renseignement territorial, de la direction centrale de la police judiciaire (DCPJ), de la préfecture de police de Paris et de la gendarmerie nationale. De ce fait, il a pour particularité d’être dirigé par un préfet, qui n’émane d’aucune de ces directions. Il s’agit bien entendu de cadres permanents.
Ces spécificités de l’EMOPT constituent autant de différences avec l’UCLAT : elle est rattachée à une direction générale, même si elle a un important travail de lien avec d’autres services, n’a pas une telle composition interservices, et est dirigée par haut fonctionnaire de police.
On relève deux croisements essentiels avec l’UCLAT :
Tout d’abord, c’est l’UCLAT qui assure la direction d’application du FSPRT. J’insiste sur ce point. Vous avez bien voulu dire dans votre propos introductif que le FSPRT était le fichier de l’EMOPT, mais ce n’était pas tout à fait exact, même si l’état-major en est un des principaux utilisateurs. Cela s’explique par des raisons historiques, que je pourrais développer.
Bien sûr, nous travaillons en lien étroit avec l’UCLAT. Par exemple, dans le cadre des déplacements que j’effectue et des remontées émanant des préfectures et des acteurs locaux, nous suggérons des évolutions du fichier. Celles-ci sont prises en compte par l’Unité qui demande ensuite au service informatique qui gère les applications de sécurité du ministère de l’intérieur, le STSISI, de les mettre en quelque sorte « en musique ». Le 12 avril dernier, a ainsi été lancée la V8 du fichier, qui lui-même avait été mis pour la première fois en application le 15 octobre 2015. Cette dernière version est particulièrement importante puisqu’elle intègre un grand nombre de demandes des préfets et des utilisateurs locaux, notamment pour renforcer l’ergonomie de l’outil.
Par ailleurs, l’UCLAT est le gestionnaire de la plateforme nationale d’appel, le Centre national d’assistance et de prévention contre la radicalisation (CNAPR), qui est une des sources qui permettent d’alimenter le fichier et qui doivent être prises en compte par les préfets au niveau local.
De ce fait, Loïc Garnier, chef de l’UCLAT, et moi-même sommes en contact quasi quotidien. Il nous arrive de nous déplacer conjointement sur le terrain, même si c’est moins le cœur de métier de l’UCLAT que celui de l’EMOPT – mais quand je tiens des réunions dont je sais qu’elles vont avoir un aspect technique très prononcé, notamment sur le fichier, je lui propose de m’accompagner. De même, j’associe systématiquement l’UCLAT aux visioconférences que j’organise avec les préfets de zone – j’en ferai encore une cette semaine en présence du directeur de cabinet du ministre.
Faisons à présent un focus sur le FSPRT, comme vous l’avez souhaité, monsieur le président.
Tout d’abord, quelques chiffres. Au jour où nous parlons, le FSPRT, qui compte quatre statuts essentiels, contient environ 13 000 signalements actifs, dont une très grande majorité est prise en compte par un chef de file.
Il y a par ailleurs des signalements en cours d’évaluation : cela concerne les individus qui viennent d’être signalés, notamment par la plateforme d’appel, mais dont on n’est pas encore certain de la réalité de leur radicalisation. Il faut vérifier qu’il ne s’agit pas de dénonciations calomnieuses, d’erreur ou d’une mauvaise interprétation. Ce travail sur le terrain est généralement accompli par le renseignement territorial.
Enfin, plusieurs centaines de signalements sont, soit en veille, soit clôturés. Ces deux statuts assez proches sont relatifs à des individus dont on considère qu’ils ne présentent plus aujourd’hui de dangerosité. Nous avons le droit de les conserver dans la base pendant cinq ans.
Vous m’avez interrogé sur la répartition du travail entre les services.
La principale charge incombe au renseignement territorial pour 30 % des individus, et aux préfectures pour 30 % également. Sont ensuite concernées la sécurité intérieure, la préfecture de police, la gendarmerie nationale et la police judiciaire.
Comment se fait la répartition ? Le haut du spectre est presque le plus simple à traiter : il concerne les personnes identifiées comme présentant un niveau de risque élevé, qui vont relever de la sécurité intérieure.
Le bas du spectre, qui présente les signaux les plus faibles, principalement pris en charge par les préfectures. Cela signifie que ces individus font l’objet d’un traitement social ou para-social dans le cadre des cellules de prévention, qui se réunissent généralement de manière mensuelle dans les préfectures. Je reviendrai sur l’articulation entre prévention et action policière, car il est très important de souligner le continuum entre les deux.
La difficulté réside dans le milieu du spectre où l’on trouve des individus qui peuvent relever à la fois d’un travail social et d’un travail policier, qui peuvent passer du signal faible au signal fort rapidement. Ce fut le cas de Yassin Salhi, qui avait été initialement repéré parce qu’il fréquentait des mosquées salafistes et assistait à des prêches radicalisés. Il en fut de même d’Ayoub El-Khazzani, l’auteur de l’attentat manqué du Thalys.
Aujourd’hui, et c’est l’une de nos grandes préoccupations, nous devons faire en sorte que le suivi ne pèse pas exclusivement sur le renseignement territorial, la sécurité intérieure et les préfectures : la gendarmerie nationale doit notamment monter en puissance dans le dispositif. Si l’on veut assurer un suivi efficace et réduire « les trous dans la raquette », la charge de travail doit être mieux répartie.
J’ai évoqué le « risque métiers » : plusieurs centaines de fiches concernent des personnes qui exercent des professions sensibles ou ont accès à des publics sensibles, et plusieurs dizaines ont déjà fait l’objet de mesures d’entrave. Ce sont surtout des individus qui exercent des professions réglementées, sur lesquels il est possible de mettre mettre en place un retrait d’agrément, de carte professionnelle, de carte d’habilitation ou d’accès. C’est vrai, par exemple, pour des agents de sécurité privée, pour des personnes travaillant dans des zones d’accès réservé d’aéroports ou prétendant avoir accès à des installations nucléaires.
Sur le plan géographique, la majorité des individus concernés sont concentrés dans quatre grandes régions : l’Île-de-France ; Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées ; Auvergne-Rhône-Alpes ; et Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Le nombre de prises en compte dans les départements est très variable, mais il n’y a aujourd’hui aucun département, aucune zone du territoire qui n’ait pas de personne radicalisée sur son secteur.
La moitié des départements comptent 41 signalements ou moins. C’est intéressant car cela signifie que dans ces départements, on peut assurer un pilotage très fin du suivi.
J’en viens aux zones à risques.
Les départements qui ont les plus hauts ratios sont concentrés dans des zones à forte densité urbaine.
L’on trouve aussi des ratios relativement élevés dans des départements un peu moins denses du point de vue urbain, mais qui sont souvent situés dans la sphère d’attraction de grands centres urbains.
C’est le cas également dans certains territoires à dominante rurale, souvent dans d’anciens bassins industriels.
Pourquoi ces zones à risque et cette localisation ? Il ne m’appartient pas de livrer une vision universitaire sur ce sujet – même si on manque de réflexions de cette nature et de recherche en la matière. On peut néanmoins discerner quelques traits dominants.
Il y a d’abord les lieux en quelque sorte historiques, marqués par l’antériorité de la pratique salafiste et du soutien au djihad.
Parfois, et c’est encore plus fréquemment le cas, le phénomène est lié à l’existence de leaders prosélytes.
Enfin, il y a des petites communautés rurales, composées de personnes qui souhaitent s’isoler, généralement autour d’un leader, et « se mettre à l’ombre » – si on peut considérer qu’Artigat, en Ariège, est une zone ombragée – selon une stratégie finalement assez analogue à celle d’une partie de l’ultra gauche.
Voilà, monsieur le président, mesdames et messieurs, les points essentiels de la présentation que je souhaitais faire.
M. Sébastien Pietrasanta, rapporteur. Monsieur le préfet, au mois de novembre, l’EMOPT existait déjà et le FSRPT montait en puissance : les auteurs des attentats du 13 novembre étaient-ils dans le fichier FSPRT ?
M. Olivier de Mazières. Non, ils n’y étaient pas. La raison est simple, et j’aurais peut-être dû commencer par-là : le dispositif du FSPRT, mis en place le 1er juillet, n’a de justification que dans l’ancrage territorial des personnes radicalisées. En clair, il ne suit que des personnes qui sont localisées sur le territoire national.
M. le rapporteur. Et une fois qu’elles ont quitté le territoire national ?
M. Olivier de Mazières. Elles relèvent alors de la compétence de la DGSI, le cas échéant de la DGSE. Mais comme vous l’avez bien compris, le dispositif que je supervise s’appuie sur les préfets. Pour moi, ce qui compte, c’est de m’assurer qu’un individu radicalisé qui se trouve sur le territoire national est bien pris en compte dans un département, sous l’égide d’un préfet et par un service chef de file. Dès lors qu’il part à l'étranger, voire sur des zones de combat, il peut rester, comme je vous l’ai indiqué, cinq ans dans le fichier. Nous avons plusieurs cas ainsi répertoriés.
Les personnes résidant depuis longtemps à l’étranger ne sont pas inscrites dans le fichier, ce qui est en revanche le cas des individus mentionnés comme « récemment partis à l’étranger ».
M. le rapporteur. Vous avez prévu une telle rubrique ?
M. Olivier de Mazières. Il y a un champ libre dans le fichier. Il est donc possible, lorsque vous entrez ou mettez à jour la fiche d’un individu, de mentionner qu’il est parti à l’étranger. Certains partent pour plusieurs mois, par exemple au Maroc, en Algérie ou en Égypte. S’ils sont bien pris en compte par un service, celui-ci intègrera le renseignement au sein du FSPRT.
M. le rapporteur. Le FSPRT et l’EMOPT relèvent du ministère de l’intérieur. D’où notre étonnement, lorsque nous avons auditionné des membres de la DNRED qui fait tout de même partie du premier cercle de la communauté du renseignement, de constater qu’ils ne connaissaient pas l’existence de l’EMOPT et n’avaient pas accès au FSPRT – sans vouloir les accabler, bien sûr.
Ne serait-il pas intéressant d’avoir un fichier consolidé, à l’échelle des services de renseignement, notamment du premier cercle ? La douane, par exemple, qui dispose d’un service de renseignement à part entière, possède sans doute des renseignements qui pourraient être utiles. Ne serait-il pas judicieux de gravir un échelon supérieur et d’aller au-delà des services de renseignements internes au ministère de l’intérieur ?
UCLAT, coordonnateur national du renseignement, EMOPT : nous avons le sentiment d’une superposition de structures, un ensemble où tout le monde fait tout, sans savoir pour autant ce que chacun fait réellement. Sans vouloir vous froisser, on a l’impression que l’EMOPT a été créé parce que l’UCLAT était mal placée au sein d’une direction générale, et qu’aucune structure n’était rattachée directement auprès du ministre. N’aurait-il pas fallu plutôt déplacer l’UCLAT, lui donner un rôle important ? Ou bien donner des prérogatives supplémentaires au coordonnateur national du renseignement, avec par exemple les moyens de l’UCLAT et de l’EMOPT ?
Plus globalement, ne faut-il pas dépasser le seul cadre du ministère de l’intérieur, même si je sais qu’au dernier Conseil national du renseignement, le ministre de l’intérieur – et donc la DGSI – était chef de file en matière de lutte contre le terrorisme à l’échelle nationale ?
M. Olivier de Mazières. S’agissant de l’association à la démarche de services ne relevant pas du ministère de l’intérieur, le décret en Conseil d’État du 30 octobre 2015 redéfinit le contenu et les accès du FSPRT – un premier décret, pris le 15 mars 2015, avait créé le fichier. Initialement, il a été créé pour répondre aux besoins de l’UCLAT, et pour enregistrer les signalants et les signalés qui utilisent la plateforme nationale d’appel. Lorsque le nouveau dispositif que je vous ai décrit a été mis en place le 1er juillet, on a modifié le contenu et les accès du FSPRT pour en faire un fichier utilisable à la fois par l’EMOPT et par les acteurs locaux. Cela a entraîné le décret du 30 octobre 2015.
Celui-ci prévoit d’ouvrir l’accès du fichier à d’autres acteurs que les services du ministère de l’intérieur : la DGSE, l’administration pénitentiaire et la DPSD. L’hypothèse d’une extension des accès en dehors des administrations relevant du ministère de l’intérieur est donc d’ores et déjà prévue. Plus récemment – mais je sors de mes compétences puisque cela relève de l’UCLAT –, j’ai noté que l’administration pénitentiaire avait accepté le principe d’accéder à ce fichier, de l’utiliser et d’en être éventuellement une source d’alimentation. Il est vrai que la question de la radicalisation au sein de la population pénitentiaire se pose de façon extrêmement forte. Du reste, le garde des Sceaux a lancé il y a quelques semaines une mission pour examiner dans quelle mesure les moyens du renseignement pénitentiaire pourraient être améliorés.
J’imagine qu’à terme, la DPSD pourrait faire la même démarche, dans la mesure où elle est très souvent associée au niveau départemental, au moins dans les départements à forte présence militaire, au groupe d’évaluation hebdomadaire que préside le préfet.
S’agissant de la direction nationale des recherches et enquêtes douanières, non seulement, je ne verrais aucun inconvénient à cette démarche, mais je n’y trouverais que des avantages. Pour ne rien vous cacher, j’ai une réunion le 7 juin avec certains de ses représentants pour leur présenter le dispositif que nous mettons en place.
M. le rapporteur. Donc, ils vous connaissent ?
M. Olivier de Mazières. Il semble que oui. D’autant mieux d’ailleurs que dans ma précédente affectation en Corse, j’ai été amené à travailler avec eux. Je n’ai eu qu’à me féliciter du travail remarquable de la DNRED, qui tient certes à ses moyens d’investigation, mais aussi à la qualité de ses hommes. En tout état de cause, même si ce service n’accède pas au fichier aujourd’hui, il est susceptible d’être associé au travail local. Rien ne s’oppose à ce que les représentants des directeurs régionaux ou interrégionaux des douanes participent, comme la DPSD et l’administration pénitentiaire, aux groupes d’évaluation que président les préfets dans les zones frontalières ou ailleurs. C’est possible, sans qu’il soit nécessaire de faire évoluer le FSPRT. Ce fichier, j’insiste sur ce point, est un outil : ce n’est pas toute la réforme du 1er juillet.
Est-ce qu’à terme, une approche interministérielle serait pertinente ? Bien sûr, et je n’y verrais que des avantages. Depuis dix mois que l’EMOPT existe, notre travail a consisté en priorité à favoriser le bon échange de pratiques et de renseignements, et le décloisonnement entre les services du ministère de l’intérieur. Le niveau d’implication de la DGSI et du Service central du renseignement territorial, dont le rôle était assez profondément remis en cause– comme celui de la gendarmerie, même si c’est d’une manière différente – a été remarquable.
S’agissant de l’éventuelle superposition des structures, je vous ferai deux réponses.
La première est qu’en l’occurrence, je reste à ma place : le ministre de l’intérieur a décidé de créer un état-major opérationnel de prévention du terrorisme, et m’a fait l’honneur de me nommer à la tête de ce dispositif. Je n’ai aucune légitimité politique pour décider de la manière dont doit être organisée l’administration. Donc, si le Gouvernement a considéré qu’il y avait une place pour l’EMOPT et pour l’UCLAT, j’en prends acte. D’ailleurs, et très honnêtement, il y a assez de travail pour tout le monde. Celui que nous assurons nous occupe à 100% et s’agissant de l’activité de l’UCLAT, je n’ai pas le sentiment qu’elle chôme non plus.
Le cœur de notre métier, à l’EMOPT, c’est le réseau local territorial et, notamment, le lien avec les préfets. À cet égard, les retours que j’ai me laissent penser qu’ils sont satisfaits d’avoir un référent identifié, à qui ils peuvent faire remonter leurs desiderata, leurs demandes d’arbitrage et les signalements qui leur posent problème.
M. le rapporteur. L’UCLAT a présenté le même type de description et d’analyse que vous. Il est évident que vous ne chômez pas, vu l’état de la menace dans notre pays. Il ne s’agit pas de vous accuser : vous avez un rôle éminent, que l’on ne sous-estime pas. Pour autant, n’aurait-il pas fallu doter de moyens supplémentaires l’UCLAT, voire le déplacer ? Encore une fois, je n’ai toujours pas compris, et ce n’est pas faute d’avoir organisé des auditions en province et ici, qui fait quoi sur ce fichier FSPRT. Je ne vois pas pourquoi deux structures gèrent le même fichier.
M. Olivier de Mazières. Reprenons le rôle de chacun.
Pour l’EMOPT : assurer le suivi individuel des personnes radicalisées sur le territoire ; vérifier que ces personnes sont prises en compte et que lorsqu’elles bougent, leur suivi continue ; s’assurer, lorsqu’elles présentent des facteurs de risque aggravé en raison de la profession qu’elles exercent, des publics auxquels elles ont à faire, de leurs antécédents psychiatriques ou des activités sportives à risque qu’elles pratiquent, qu’elles sont effectivement prises en compte et suivies individuellement. Si l’UCLAT vous a dit qu’elle fait ce travail, j’en serais très surpris, puisque c’est le nôtre.
M. le rapporteur. Reste que je ne vois pas pourquoi elle n’aurait pas pu le faire.
M. Olivier de Mazières. J’allais venir à la deuxième partie de ma réponse.
Pourquoi y a-t-il deux structures, et pourquoi ne confie-t-on pas tout le travail à une même structure, quels que soient son nom et sa composition ? Encore une fois, c’est un choix qui relève de l’autorité politique.
J’appelle simplement l’attention sur les conditions de succès d’une telle fusion ou d’une telle simplification. J’en vois deux absolument majeures : premièrement, la structure en question doit être rattachée au ministre, au cabinet du ministre, et pas intégrée dans l’une des directions, pour une raison évidente que je n’ai pas besoin de développer ; deuxièmement, elle doit être interservices, et chaque acteur doit pouvoir y trouver sa place et y jouer son rôle.
Nous ne parviendrons pas au décloisonnement du fonctionnement entre les services et à la circulation de l’information, cœur de la réforme du 1er juillet, si l’entité en charge de la structure est dirigée par le représentant d’un des services acteurs de cet échange.
M. le président Georges Fenech. L’EMOPT n’est pas complètement interservices puisque la DGSE n’est pas incluse dans les binômes.
M. Olivier de Mazières. Elle relève du ministère de la défense. Nous sommes interservices au sein du ministère de l’intérieur.
M. le président Georges Fenech. La DGSE, acteur majeur, ne fait pas partie de vos services. Or vous avez expliqué que les auteurs des attentats du 13 novembre, que ce soit Abaaoud, Mostefaï ou d’autres, n’étaient pas dans votre fichier, puisque vous n’enregistrez pas ceux qui sont à l’étranger ou partis à l’étranger.
M. Olivier de Mazières. Absolument.
M le président Georges Fenech. Il y a donc un problème.
M. le rapporteur. Lorsque certains individus partent à l’étranger, transmettez-vous l'information à la DGSE ?
M. Olivier de Mazières. Le lien avec la DGSE relève de la DGSI. C’est elle qui a la responsabilité du travail sur les personnes se trouvant à l’étranger.
M. le rapporteur. Admettons qu’un individu répertorié dans le FSPRT, et suivi par le SCRT quitte le territoire national. Comment va-t-on transmettre l’information à la DGSE pour éviter les « trous dans la raquette » ?
M. Olivier de Mazières. Cela se fera par l’intermédiaire du fichier. Lorsqu’un individu part à l’étranger, l’information est portée à la connaissance de la direction départementale de la sécurité intérieure, dans le cadre du groupe d’évaluation départementale dont j’ai parlé tout à l’heure et remonte via la sécurité intérieure à la direction générale.
Je comprends très bien votre approche, qui relève du bon sens et qui consiste à imaginer un seul et unique grand service interministériel qui aurait la responsabilité du suivi de l’ensemble des personnes radicalisées, à la fois sur le territoire national et à l’extérieur. Je n’ai aucun jugement à porter en la matière. Je dis simplement que telle n’est pas la mission de l’EMOPT, qui doit, quant à lui, veiller à ce que les personnes dont on pense qu’elles sont radicalisées et qu’elles peuvent passer à l’action violente à un moment ou un autre sur le territoire national sont bien prises en compte.
M. le président Georges Fenech. Monsieur le préfet, vous rassurez notre commission d’enquête en évoquant la rencontre qui aura lieu la semaine prochaine avec la DNRED – je rappelle qu’elle nous a dit ne pas connaître l’existence de votre service, et vous-même n’êtes pas sûr qu’elle ait accès à votre fichier.
M. Olivier de Mazières. Je me suis mal exprimé : le décret prévoit des accès pour un certain nombre de services mais tous ne sont pas encore activés. L’administration pénitentiaire a engagé la démarche à son niveau central – l’UCLAT pourra vous le confirmer car c’est elle qui est à la manœuvre sur le sujet. Pour le reste, ce sont des possibilités qu’offre le texte.
M. le rapporteur. Pourquoi les autres services ne s’emparent-ils pas de cette possibilité ?
M. Olivier de Mazières. Il faut poser la question à l’UCLAT.
M. le président Georges Fenech. L’UCLAT travaille avec vous, non ?
M. Olivier de Mazières. La direction d’application du FSPRT, c’est l’UCLAT. Je ne suis qu’un utilisateur du fichier. Il ne m’appartient donc pas de prévoir les évolutions techniques du fichier – même si je peux faire des suggestions – ou de décider qui va y accéder ou pas. De même, s’il faut faire un jour évoluer le décret, c’est à la direction d’application qu’il reviendra de prendre la décision.
M. le rapporteur. Vous dites être un simple utilisateur. Mais lors de la création du fichier, où donc ont été remplis les tableaux ? Au sein de l’EMOPT ou de l’UCLAT ? Des organisations syndicales se sont plaintes eu égard à la mobilisation des effectifs.
M. Olivier de Mazières. Ils ont été remplis conjointement puisqu’il s’agissait de créer un outil mettant en commun des sources qui, jusqu’alors n’étaient pas articulées entre elles : listes d’individus émanant de la DGSI ou du SCRT, ou encore repérés au titre du travail de terrain, personnes signalées dans le cadre de la plateforme nationale d’appel gérée par l’UCLAT.
Ainsi, chacun a apporté sa contribution même si, ensuite, le travail de fusion, de correction, de fiabilisation des données, d’élimination des doublons, a été opéré par l’EMOPT.
M. le rapporteur. Ce fichier a-t-il évolué depuis sa mise en place ?
M. Olivier de Mazières. Le travail dont je vous parle a été effectué entre juillet et fin septembre 2015.
M. le rapporteur. A-t-on créé depuis des entrées supplémentaires ? Les clubs sportifs, etc.
M. Olivier de Mazières. Vous voulez parler des rubriques ?
M. le rapporteur. Oui.
M. Olivier de Mazières. Bien sûr …
M. le rapporteur. Combien y a-t-il de rubriques aujourd’hui ? Une quarantaine ?
M. Olivier de Mazières. Plus que cela.
M. le rapporteur. A-t-il été procédé à cette augmentation à la demande de l’EMOPT ?
M. Olivier de Mazières. Oui.
M. le rapporteur. Donc, vous n’êtes pas qu’utilisateur : vous êtes aussi prescripteur.
M. Olivier de Mazières. Comme je vous l’ai dit, nous avons demandé des évolutions du fichier, qu’il s’agisse de son contenu ou des droits d’accès, avant le lancement de la version 1. Depuis, nous n’avons cessé d’en réclamer d’autres, qui sont prises en compte par l’UCLAT et le STSISI pour faire évoluer encore cet outil, qui rencontre aujourd’hui moins de difficultés d’appropriation et de difficultés techniques. C’est en tout cas le sentiment que je retire quand je me déplace dans les départements.
M. Serge Grouard. Comment a été établi le FSPRT ? J’ai cru comprendre que l’on avait cherché à réunir des données éparses. Techniquement, s’agit-il d’un nouveau fichier ou d’un ancien fichier que l’on a fait évoluer en l’alimentant différemment ?
Quoi qu’il en soit, nous ne comprenons pas que des services importants dans le domaine du renseignement n’y aient toujours pas accès, plus de six mois après sa création. Est-ce dû à un problème informatique ?
Deuxièmement, ne pensez-vous pas qu’il serait judicieux d’y raccrocher des services du ministère des finances, comme TRACFIN ou la DNRED ?
Troisièmement, j’ai bien entendu que la DPSD, que je connais bien, participait aux groupes d’évaluation départementale (GED) en tant que de besoin. Est-ce pour avoir des informations sur les personnes qui se présentent au recrutement, ou sur des militaires ?
Quatrièmement, quand j’étais maire, entre 2001 et 2015, j’ai eu l’occasion de faire des signalements – et j’ai encore des noms en tête. Je pense donc que dans certains cas, et dans certains cas seulement, la participation du maire aux groupes d’évaluation départementale pourrait être intéressante. Elle permettrait de faire circuler des informations que les services de renseignements n’ont peut-être pas. Je pense notamment aux signaux faibles ou moyennement faibles, milieu ou bas du spectre.
M. Olivier de Mazières. Sur les accès au fichier : à ma connaissance, et même si je ne suis pas en charge de la maintenance du dispositif, il n’y a pas de problèmes informatiques – l’UCLAT pourra vous le confirmer.
Quant à savoir s’il faut associer les services du ministère des finances, je ne m’étendrai pas sur la première partie de ma réponse, que vous connaissez déjà : la décision relève de l’autorité politique.
La seconde partie de ma réponse reflétera un avis personnel : j’ai eu l’occasion, lorsque j’étais en Corse, de travailler sur la coordination d’un certain nombre de services ; or les deux plus actifs dans ce domaine étaient la direction des services fiscaux et TRACFIN. Je suis donc mal placé pour vous dire que je ne vois pas d’intérêt à associer des services qui ont à la fois cette puissance d’investigation et cette spécialité, dont on sait qu’elle est fondamentale pour les individus qui nous intéressent. De fait, les circuits de financement sont un des moyens d’accès aux réseaux, y compris de grande délinquance et de radicalisation.
La DPSD participe-t-elle à la détection des personnes radicalisées au moment du recrutement, ou de celles qui sont déjà au sein des armées ? Les deux. Il s’agit principalement d’assurer un lien entre les services du type « sécurité intérieure » ou « renseignement territorial » qui vont suivre l’individu lorsqu’il est en dehors de la caserne, c’est-à-dire dans son activité privée, et lorsqu’il est au sein de la caserne. Certains individus qui adoptent des comportements, voire des prises de position très radicalisés dans la sphère privée, peuvent être irréprochables à la caserne. Mais la DPSD peut aussi repérer des individus à l’occasion de recrutements. À l’inverse, on peut lui signaler des individus qui postulent à un emploi militaire, et qui ont été repérés par ailleurs.
J’ajoute que la DPSD joue aussi un rôle important, s’agissant des anciens militaires. Il est en effet parfois utile de savoir quel a été le passé militaire d’un individu et quels éléments on peut en tirer. Il y a au sein de la population radicalisée un certain nombre de personnes ayant un passé militaire.
Enfin, la participation des élus est fondamentale. Les situations sont différentes, et les approches qu’ont les élus de la radicalisation le sont aussi. Les collectivités sont plus ou moins touchées par le phénomène. J’ai à l’esprit les grandes communes de la région parisienne, notamment celles de la petite couronne. Il me semblerait assez pertinent de développer un dispositif du type groupe d’évaluation départementale présidé par le préfet, avec un focus sur telle ou telle commune particulièrement frappée par le problème. Dans ce cas-là, évidemment, il faudrait y associer le maire. Cela suppose toutefois un certain nombre de conditions, que vous imaginez bien : que l’élu ait un intérêt soutenu pour cette question, et que toutes les garanties de confidentialité soient données.
Aujourd’hui, des informations ou des signalements sont échangés de manière informelle entre le préfet et les maires des grandes villes ou entre leurs collaborateurs immédiats, les directeurs de cabinet, par exemple. Il serait intéressant d’avoir une structure spécifiquement dédiée dans certaines communes particulièrement touchées.
Notre dispositif est encore jeune. Voilà pourquoi, monsieur le président, quand je parle d’interservices, on peut l’interpréter comme une première étape vers une inter-ministérialité. Mais il fallait déjà construire cet ensemble au sein du ministère de l’intérieur.
De la même façon, les GED peuvent être amenés à s’élargir. On peut imaginer un système en cercles concentriques, avec des séances restreintes et des séances plénières. On sait, par exemple, que dans certains départements, le procureur de la République participe au groupe d’évaluation départementale ; dans d’autres, cela se fait moins. C’est, là encore, une possibilité d’évolution et d’élargissement du dispositif.
M. le rapporteur. Les personnes faisant l’objet d’une fiche S – S13, S14 ou S15 – sont-elles toutes inscrites au FSPRT ?
Par ailleurs, le ministre de l’intérieur communique régulièrement sur 1 800 individus – ceux qui sont sur place, ceux qui ont des velléités de départ, ceux qui sont revenus. Figurent-ils dans le fichier ?
M. Olivier de Mazières. Toutes les fiches S ne sont pas dans le fichier. Et pour cause puisque, comme vous le savez, certaines fiches S ne sont pas liées à la radicalisation. En outre, la fiche S est une « sonnette », c’est un outil de police, servant notamment à repérer un individu qui tente de passer les frontières. Elle ne justifie pas, à elle seule, l’inscription au fichier comme personne radicalisée pouvant passer à l’action violente.
M. le rapporteur. Et les fiches S13, S14, S15 ?
M. Olivier de Mazières. Toutes les fiches S ne sont pas dans le FSPRT. Au moment de la constitution du fichier, les services qui sont les principaux créateurs de fiches S, principalement la sécurité intérieure, le renseignement territorial, la SR ou la Préfecture de police, ont en effet alimenté le fichier avec des individus dont elles considéraient que la combinaison de leur radicalisation et de leur dangerosité justifiait l’inscription. Ils ont en quelque sorte procédé à un tri préalable. Si tel n’avait pas été le cas, nous serions au-delà de 13 000 individus, le nombre de fiches S étant clairement supérieur.
Quant aux « returnees » et aux velléitaires, ils figurent dans le FSPRT puisque ce sont des personnes qui sont sur le territoire national. Ils sont donc suivis à ce titre par les services à compétence nationale sous l’égide des préfets de département.
M. le rapporteur. Imaginons un individu fiché S, qui n’est pas dans le FSPRT et qui change de département, alors qu’il a été suivi au départ par un service. On est exactement dans la même situation qu’avant la création de l’EMOPT. En quoi le risque de perdre sa trace est-il moins important aujourd’hui ?
M. le président Georges Fenech. C’est le cas de Yassin Salhi.
M. Olivier de Mazières. Yassin Salhi aurait figuré dans le FSPRT, du moins je l’espère…
M. le rapporteur. Vous dites qu’il appartenait à chaque service prescripteur d’une fiche S d’apprécier l’opportunité d’inscrire l’individu dans le FSPRT. Mais on ne sait pas comment évolue l’individu. Que se passe-t-il s’il n’est pas intégré dans un fichier centralisé ? Je m’interroge.
M. Olivier de Mazières. Les individus fichés S, par définition, ne sont pas suivis par un service. C’est d’ailleurs pour cela qu’il font l’objet d’une fiche S, mais pas d’un travail technique ou opérationnel plus avancé du service…
M. le président Georges Fenech. Cela peut aussi être le cas.
M. Olivier de Mazières. Oui. La fiche S permet d’avoir une remontée d’information au moment où la personne va être contrôlée à l’occasion d’un passage de frontière, par exemple.
Les individus inscrits dans le FSPRT ne le sont pas exclusivement sur la base d’une fiche S. Il faut qu’il existe d’autres facteurs aggravants. De même, toutes les fiches S ne sont pas dans le FSPRT, et vous pouvez trouver dans le FSPRT des individus qui ne sont pas fichés S.
M. le rapporteur. J’ai du mal à comprendre la logique : on va inscrire dans le FSPRT une gamine de seize ans, que les parents ont signalée comme radicalisée via le numéro Vert mais pas celui qui fait l’objet d’une fiche S pour islam radical ?
M. Olivier de Mazières. D’abord, la jeune fille de seize ans figurera dans le FSPRT sur la base d’une évaluation des services locaux qui devront confirmer sa dangerosité et sa radicalisation.
Imaginons par ailleurs un individu suivi par les services, et repéré à la sortie d’un lieu de prière salafiste. Il est observé et photographié dans ce cadre-là. On le voit parler à la sortie de l’office avec une dizaine de personnes qui ne sont pas connues par les services. Par acquit de conscience, par sécurité, s’ils arrivent à identifier les individus avec lequel leur objectif a parlé, les services vont alors créer des fiches S pour en savoir plus le jour où, à l’occasion d’un contrôle, des informations leur seront remontées à ce titre. Cela ne signifie pas que les dix individus en question présentent une dangerosité telle qu’ils sont susceptibles de passer à l’action violente à un moment ou un autre.
La fiche S est un outil de suivi policier parmi d’autres, mais qui peut être relativement léger dans l’acuité du signal émis. En l’occurrence, c’est une précaution, une « sonnette » qui est mise en place.
M. le rapporteur. La même argumentation vaut pour le FSPRT : il concerne des gens qui ne vont pas forcément passer à l’acte, et qui ne font pas forcément l’objet d’un suivi en temps réel.
M. Olivier de Mazières. Vous avez parfaitement raison. Vous touchez là un point majeur : comment déterminer quelles personnes on va inscrire dans le FSPRT et quelles autres on va écarter ? Il n’y a pas de recette.
Au début, certains services, notamment des préfets, m’ont demandé si je pouvais leur communiquer une grille. Il en existe. Le Comité interministériel de prévention de la délinquance (CIPD) et l’UCLAT, notamment, ont développé un outil permettant de croiser un certain nombre d’indices.
Il faut un faisceau d’indices concordants, un critère pris isolément ne suffisant pas forcément à déterminer l’inscription dans le fichier. J’en ai conscience, ce n’est pas très satisfaisant intellectuellement. Mais dans les faits, c’est comme cela que ça marche. La seule fiche S ne suffit pas. Et puis fondamentalement, il y a l’intuition du policier. Ce sont bien ceux qui vont avoir à opérer l’évaluation de l’individu sur le terrain, au plus près, en ayant connaissance de son environnement, qui pourront déterminer s’il doit, ou non, être inscrit dans le FSPRT.
Pour ma part, et c’est la consigne que j’ai donnée à tous mes collaborateurs, je me refuse à entrer dans ce que je considère comme relevant du travail opérationnel des policiers. Je ne me préoccupe pas de savoir quelle est la nature de la surveillance ou du suivi qu’ils opèrent sur un individu. Je leur fais confiance, comme en matière d’évaluation.
Le dispositif mis en place depuis le 1er juillet a toutefois engendré une amélioration : la décision est devenue collégiale. Encore une fois, c’est dans le cadre du groupe d’évaluation, sous l’égide du préfet, que l’on passe en revue chaque situation et qu’on détermine si l’individu doit ou non être intégré dans le FSPRT. Cela permet d’avoir sur lui une évaluation plus objective, donc plus fiable.
Cela étant, vous avez parfaitement raison, il n’y a pas de critères imparables – sauf évidemment pour les personnes qui relèvent du risque haut et à ce titre de la sécurité intérieure.
M. le rapporteur. À combien estimez-vous les personnes suivies par la DGSI, mais qui ne sont pas inscrites dans le FSPRT ?
M. Olivier de Mazières. Je n’ai pas de chiffre, mais j’ai la faiblesse de considérer que toutes les personnes qui présentent une dangerosité réelle et sont suivies comme telles par la DGSI figurent dans le fichier. Il y a moins de doute pour les individus qui sont des objectifs de la sécurité intérieure – dans la mesure où il n’y a pas d’ambiguïté sur leur dangerosité – que pour le bas ou le milieu du spectre. À la limite, le problème se pose davantage pour les personnes prises en compte par le renseignement territorial. C’est pour elles que l’appréciation ne peut être qu’extrêmement circonstancielle, et il faut bien le reconnaître, subjective.
Notre travail consiste à essayer de prévoir la dangerosité d’un individu. On nous a déjà reproché d’avoir inscrit 13 000 personnes dans le fichier, dont certaines n’ayant aucun antécédent judiciaire et qui relèvent, à ce stade, uniquement d’un travail social. Nous les avons pourtant fait entrer dans le FSPRT car nous devons anticiper que la situation dégénère. Encore une fois, il y a une part de subjectivité qui doit être assumée.
M. Serge Grouard. Les individus qui pourraient être signalés par l’administration pénitentiaire, ne peuvent figurer dans le fichier puisque, jusqu’à présent, l’administration pénitentiaire ne participait pas au dispositif.
M. Olivier de Mazières. Oui et non. En effet, dans la quasi-totalité des cas, l’administration pénitentiaire est associée au travail qui est mené sur le terrain sous l’égide des préfets. Elle peut donc rendre compte du degré de radicalisation des individus. Surtout, il y a un échange d’informations très fluide entre les services de police et l’administration pénitentiaire, notamment sur les dates de libération des individus. Cela joue pour les personnes incarcérées pour des faits de terrorisme ou d’apologie du terrorisme, ou encore de droit commun, mais qui se sont radicalisés en prison. L’administration pénitentiaire signale ces cas aux services pour qu’ils soient pris en compte au moment de leur sortie. Cette technique d’échanges d’informations fonctionne bien.
M. le président Georges Fenech. En conclusion, peut-être serait-il utile d’intégrer dans les groupes d’évaluation départementale sur lesquels vous vous reposez beaucoup, non seulement la DNRED et les services financiers, dans la mesure où les infractions économiques et le blanchiment sont liés au terrorisme, mais encore le procureur qui, avec ses services, a une vision globale.
M. Olivier de Mazières. Il y a un point sur lequel je suis passé très vite : il existe dans chaque département, à côté du groupe d’évaluation hebdomadaire, une cellule de prévention. Ce dispositif plus ancien, mis en place en avril 2014, travaille notamment sur l’action sociale et para-sociale, et traite, entre autres, les personnes inscrites au FSPRT, dans le bas du spectre.
Ces cellules de prévention sont systématiquement co-présidées par le préfet et par le procureur de la République. Les services de police – au moins le renseignement territorial, parfois la sécurité intérieure et la gendarmerie – assistent aux deux instances. On y trouve aussi la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ), l’éducation nationale…
M. le président Georges Fenech. Mais elles n’ont rien à voir avec le renseignement !
M. Olivier de Mazières. C’est pour cela que l’on sépare les deux instances. Mais il est tout de même nécessaire d’établir une continuité entre les deux, puisqu’on a constaté que le passage d’un signal faible à un signal fort pouvait se faire très rapidement. Et comme vous l’avez noté, il y a au sein du FSPRT, des personnes qui, pour l’instant, ne relève que du « signal faible ».
M. le président Georges Fenech. Si la PJJ est introduite dans ce groupe d’évaluation départementale, plus personne ne dira rien !
M. Olivier de Mazières. Il ne s’agit pas de cela. Je voulais simplement vous signaler que d’autres services sont dans la boucle, mais dans une structure différente de celle du GED.
M. le président Georges Fenech. Monsieur le préfet, nous vous remercions de votre participation à nos travaux.
Audition, à huis clos, de M. Patrick Calvar, directeur général de la sécurité intérieure (DGSI), accompagné de Mme Marie Deniau, cheffe de cabinet
Compte rendu de l’audition, à huis clos, du mardi 24 mai 2016
M. le président Georges Fenech. Monsieur le directeur général, nous vous avons rencontré, le rapporteur et moi-même, la semaine dernière, dans vos locaux, pour un échange préliminaire à cette audition. Nous vous remercions d’avoir répondu à la demande de notre commission d’enquête.
Nous allons poursuivre avec vous nos investigations dans le domaine du renseignement, en nous intéressant à l’état de la menace terroriste et aux réponses que vous êtes en mesure d’apporter. Nous avons pris connaissance de la teneur de votre audition par la commission de la défense nationale et des forces armées puisque cette dernière a décidé d’en publier le compte rendu. Votre audition revêt, à cet égard, une importance essentielle pour nos travaux. Outre les questions que nous nous posons sur les attentats de janvier et de novembre derniers, ce sera l’occasion de vous interroger sur les moyens mis en œuvre, sur l’adaptation des techniques et des procédures aux besoins et sur la coopération entre services aux niveaux tant interne qu’international et principalement européen.
Votre audition, en raison de la confidentialité des informations que vous êtes susceptibles de nous délivrer, se déroule à huis clos. Elle n’est donc pas diffusée sur le site internet de l’Assemblée. Néanmoins, et conformément à l’article 6 de l’ordonnance 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, son compte rendu pourra être publié en tout ou partie, si nous en décidons ainsi à l’issue de nos travaux. Je précise que les comptes rendus des auditions qui ont eu lieu à huis clos sont au préalable transmis aux personnes entendues afin de recueillir leurs observations. Celles-ci sont soumises à la commission, qui peut décider d’en faire état dans son rapport.
J’indique que, conformément aux dispositions du même article, sera punie des peines prévues à l’article 226-13 du code pénal toute personne qui, dans un délai de vingt-cinq ans, divulguera ou publiera une information relative aux travaux non publics d’une commission d’enquête, sauf si le rapport publié à la fin des travaux de la commission a fait état de cette information.
Conformément aux dispositions de l’article 6 précité, je vais vous demander de prêter le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité.
M. Patrick Calvar et Mme Marie Deniau prêtent successivement serment.
Nous avons de nombreuses questions à vous poser, et d’abord sur l’intensité de la menace qui pèse sur la France, mais aussi des questions sur la DGSI, sur les retours d’expérience que vous avez pu réaliser concernant les attentats de 2015. Nous vous interrogerons ensuite sur les auteurs de ces attentats, notamment Samy Amimour et Ismaël Omar Mostefaï, sans oublier Abdelhamid Abaaoud. Enfin, nous vous demanderons des éléments d’information sur la stratégie de la DGSI, notamment pour ce qui est de l’utilisation du nouveau fichier FSPRT – à propos duquel nous nous posons de nombreuses questions : les réponses que nous avons obtenues ce matin en visitant l’Unité de coordination de la lutte antiterroriste (UCLAT) ne nous ayant pas totalement convaincus –, ainsi que sur les outils utilisés et les moyens à disposition de la DGSI et, pour finir, sur la coopération internationale.
M. Patrick Calvar, directeur général de la sécurité intérieure (DGSI). Avant d’entrer dans le vif du sujet, je souhaite vous rappeler rapidement les avancées considérables réalisées en France depuis 2007 dans le domaine du renseignement, notamment les différentes réformes structurelles mais aussi les évolutions législatives et méthodologiques.
Je me contenterai de les citer ; elles feront l’objet de questions, le cas échéant, de votre part :
- Octobre 2007 : création de la délégation parlementaire au renseignement (DPR) ;
- 2008 : le Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale fait du renseignement une mission stratégique au sein de l’État, et le plan national d’orientation du renseignement (PNOR) est créé ;
- Juillet 2008 : création de la direction centrale du renseignement intérieur (DCRI), fusion de la direction de la surveillance du territoire (DST) et d’une partie de la direction centrale des renseignements généraux (DCRG), au sein de la direction générale de la police nationale (DGPN) ; création du service de l’information générale – aujourd’hui supprimé ;
- Juillet 2009 : dans le cadre de la loi de programmation militaire, la notion de défense et de sécurité nationale prend en compte le renseignement comme fonction stratégique de l’État – connaissance et anticipation ;
- Juillet 2010 : création de l’académie du renseignement ;
- Mars 2011 : loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (LOPPSI 2), dont un titre entier est consacré au renseignement, en particulier à la protection de ses agents ;
- 2013 : mise en œuvre des orientations stratégiques du Livre blanc 2013 dans la loi de programmation militaire de décembre ; élargissement des pouvoirs de la délégation parlementaire au renseignement ; intégration de la commission de vérification des fonds spéciaux au sein de la DPR ;
- Avril 2014 : création de la direction générale de la sécurité intérieure (DGSI), suivie de la création du service central du renseignement territorial (SCRT) ;
- Juillet 2014 : création d’une inspection des services de renseignement (ISR) ;
- Juillet 2015 : promulgation de la loi relative au renseignement, entrée en vigueur en octobre 2015.
Le renseignement français a donc connu une véritable révolution ces dernières années, à la fois sur les plans politique et juridique, mais aussi structurel. Parallèlement, le code pénal et le code de procédure pénale ont fait l’objet de réformes, passées ou en cours, qu’il ne m’appartient pas d’évoquer – vous avez pu rencontrer des membres de la magistrature, notamment du parquet de Paris.
Pour ce qui est de la DGSI, sa création a répondu à l’impérieuse nécessité de disposer en France d’un véritable service de sécurité intérieure, pendant naturel de la DGSE à l’extérieur, à l’image de ce qui existe chez nos principaux partenaires étrangers avec lesquels nous coopérons. De fait, il convenait que ce nouveau service puisse se voir assigner des missions très précises – pour éviter de nous heurter à certains écueils comme par le passé –, au service des intérêts fondamentaux de notre pays, avec des pouvoirs précisément décrits et contrôlés, le vote de la loi relative au renseignement en ayant constitué l’aboutissement.
Parmi les missions cardinales de la DGSI, la lutte contre le terrorisme occupe, bien sûr, une place prépondérante, mais on ne saurait méconnaître les autres formes de menaces qui visent la France et ses intérêts, comme l’espionnage – mal endémique, insensible, mais ô combien dévastateur dans un monde où les grandes puissances se livrent à une lutte acharnée pour préserver leur leadership sur les plans politique, économique, militaire, industriel. Découlent de cette mission non seulement la protection de nos intérêts économiques dans un univers particulièrement concurrentiel, mais aussi la lutte contre les proliférations ou encore la cyberdéfense, les cyber-attaques représentant un nouveau péril qui ne cesse de prendre de l’ampleur ; bref, tout ce dont l’État a besoin pour protéger les intérêts fondamentaux de la nation.
Pour ce qui concerne ses moyens, la DGSI compte aujourd’hui plus de 3000 agents, dont 73 % de fonctionnaires actifs de la police nationale, 16 % de fonctionnaires administratifs et 10 % de contractuels. Ces chiffres tiennent compte des recrutements déjà réalisés depuis la mise en œuvre des trois plans de recrutement décidés par le Gouvernement, sachant qu’à terme, en 2018, avec l’achèvement de ces plans, l’effectif total de la DGSI sera de plus de 4000 agents, à raison de 68 % de fonctionnaires actifs de la police nationale, 14 % de fonctionnaires administratifs et 17 % de contractuels. Autrement dit, la croissance en effectifs, sur une période de cinq ans, sera de près de 40 %. Aussi, je vous laisse imaginer les difficultés auxquelles nous sommes confrontés en matière de recrutement, de formation, de professionnalisation et de fidélisation.
Cela suppose également une définition précise, dans le cadre d’un plan stratégique de montée en puissance, de nos besoins, une mise en place de parcours de carrière ; en quelques mots, cela implique une gestion très fine de nos moyens humains, sans compter le défi majeur qui consiste à faire travailler ensemble des personnels venus d’horizons divers et pour certains à forte culture professionnelle.
Quels sont les principaux défis de la DGSI pour devenir définitivement ce service de sécurité attendu ?
Le premier est technique : on ne peut désormais faire abstraction de l’avènement du numérique et de ses conséquences profondes sur nos modes d’enquête ; nous avons donc recruté et continuons de recruter des ingénieurs et des techniciens ; j’y reviendrai en évoquant la lutte contre le terrorisme.
Le défi analytique, ensuite : la complexité des problèmes et menaces traités nous impose de recourir à des personnels non issus de la police nationale mais spécialisés dans l’économie, la finance, voire dans d’autres domaines plus opérationnels, tels que des psychologues ou des linguistes.
Le dernier défi est juridique : la loi relative au renseignement, outil indispensable à notre action et qui la légitime, nous a amenés à former plus de 2 500 fonctionnaires à sa mise en œuvre.
Pour clore le chapitre, je rappellerai que la DGSI a une compétence judiciaire, comme bien d’autres de nos partenaires, contrairement à ce que l’on peut lire ici ou là – je pense, notamment, aux Norvégiens, aux Suédois, aux Danois, aux Autrichiens.
Dernier point : nous avons une couverture nationale et sommes présents dans soixante-dix-neuf départements ainsi qu’en outre-mer. Nous disposons enfin de représentations à l’étranger où nos officiers ont pour seule mission d’assurer la coopération avec les services de renseignement et de sécurité locaux.
Pour ce qui est de la lutte antiterroriste, il me semble m’être clairement exprimé devant la commission de la défense nationale et des forces armées en dressant les constats que nous pouvions établir en l’état actuel des informations dont nous disposons sur l’état de la menace.
La DGSI a pour mission d’agir préventivement afin d’empêcher la commission d’actes terroristes ; en cas de commission d’actes violents, elle vient en appui aux structures de la police judiciaire. Cela signifie que la DGSI recueille le renseignement puis, en cas d’éléments précis, dénonce les faits au procureur de la République de Paris et exécute, dans le cadre de l’État de droit, les instructions reçues afin de neutraliser les groupes ou individus impliqués dans des projets terroristes. Ainsi, depuis le début de la crise syrienne, nous avons empêché quinze projets d’actions violentes et arrêté plus de 350 personnes.
Nous mettons également en œuvre une stratégie administrative dans le cadre de laquelle nous proposons notamment des mesures d’expulsion, d’assignation à résidence, de retrait ou de non-renouvellement de passeport, etc.
Plus de deux tiers de nos capacités sont consacrées à la lutte contre le terrorisme. À cet effet, sont mobilisés : la sous-direction parisienne spécialisée en la matière, l’ensemble des fonctionnaires de nos implantations territoriales, nos capacités de surveillance physique et technique, sans oublier notre sous-direction judiciaire et ses antennes provinciales.
Notre priorité absolue est de recueillir du renseignement aux fins d’action. Le recueil est effectué au moyen de trois modes principaux : humain, technique et par la coopération nationale ou internationale. Contrairement à ce que prétendent certains commentateurs avisés, nous ne privilégions aucun moyen par rapport à un autre. Il y a le renseignement et peu importe la manière dont on l’obtient, sachant qu’ensuite il faut l’analyser, donc le hiérarchiser puis l’exploiter. Il n’y a pas non plus des services nobles et d’autres qui le seraient moins : il y a des services spécialisés qui disposent de plus de moyens et dont c’est le métier principal. Enfin, dans une chaîne de renseignement, ce qui compte avant tout, c’est la complémentarité des services, pour éviter les angles morts, et leur coordination.
Je ne m’attarderai pas sur le renseignement humain, ne serait-ce pour préciser qu’il est particulièrement difficile, comme vous pouvez l’imaginer, de trouver des volontaires pour nous aider en se rendant en Syrie, en Irak ou en Libye – et l’on pourrait citer d’autres théâtres d’opérations. Nous œuvrons donc principalement sur notre territoire. Sachez que nous disposons d’équipes formées au recrutement et au suivi des sources humaines, cela dans un cadre légal et déontologique bien précis. Nous n’hésitons pas non plus à travailler en partenariat, notamment sur le plan national.
Le renseignement technique est aujourd’hui un enjeu majeur. Nous nous heurtons au quotidien au problème du chiffrement, à la multiplication des moyens de communication, aux masses de données que nous pouvons recueillir. C’est la raison pour laquelle nous opérons en permanence des sauts qualitatifs, notamment avec notre partenaire principal, la DGSE. Il s’agit, en l’espèce, d’être le plus efficace possible et non pas de doublonner, sans compter que ces investissements sont très lourds sur le plan financier. Nous nous appuyons sur la loi relative au renseignement et nous sommes à la recherche des outils de big data (mégadonnées) qui doivent faciliter le travail des enquêteurs, conscients que nous sommes que les progrès du numérique constituent une véritable révolution culturelle qui, au passage, marque et marquera l’ensemble de la société. J’imagine que vos différentes visites aux États-Unis et en Israël vous montreront l’importance du renseignement technique et combien une partie des commentaires sont totalement décalés par rapport à la réalité.
Le chiffrement est assurément une question majeure que seules des conventions internationales pourront régler, les frontières des États étant désormais le plus souvent inopérantes pour fixer les termes de la loi.
Dans le cadre de nos coopérations au plan national, il s’agit pour nous d’être au plus près de nos différents partenaires, à commencer par la police nationale et la gendarmerie nationale. Cela s’est traduit par la mise en place du bureau central et des bureaux zonaux de liaison, mais aussi, dans le cadre de l’état-major opérationnel de prévention du terrorisme (EMOPT), par la forte implication des préfets. Il nous faut détecter tous les signaux faibles et ensuite nous assurer que les cas sont suivis, même si, du fait de leur nombre, tous ne peuvent pas faire l’objet d’un même traitement compte tenu de la ressource. La fluidité aujourd’hui est totale.
Notre autre partenaire privilégié est la DGSE : depuis mars 2014, nous disposons d’une cellule commune DGSI-DGSE à Levallois-Perret, qui suit l’ensemble des dossiers de terrorisme en temps réel, les agents de la DGSE disposant de moyens d’accès à leurs bases de données pour accélérer et faciliter les échanges et les évaluations.
Pour améliorer l’action opérationnelle, nous avons créé, en juin 2015, toujours à Levallois, une cellule interservices, dite cellule Allat, qui comprend des représentants des six services du premier cercle – DGSE, direction du renseignement militaire (DRM), direction de la protection et de la sécurité de la défense (DPSD), direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED), TRACFIN (traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins) et DGSI – ainsi que des représentants du service central du renseignement territorial (SCRT) et de la direction du renseignement de la préfecture de police (DRPP). Ils ont également accès à leurs bases de données – condition sine qua non pour être efficaces. Dans cette cellule, on interroge les partenaires, on oriente les recherches, on les hiérarchise et, le cas échéant, on « déconflicte ». Tous les services manifestent leur satisfaction de participer au fonctionnement de cette cellule.
La question se pose de savoir pourquoi nous n’accueillerions pas, demain, le renseignement pénitentiaire, étant donné que le milieu de la prison est pour nous une préoccupation de premier plan.
Les coopérations internationales, quant à elles, sont avant tout le fait de la DGSE et de la DGSI. Nous avons un besoin impératif de l’aide de nos partenaires, de la même façon que nous les informons de ce que nous recueillons et qui les concerne. Contrairement à des idées répandues ici ou là, la coopération est totale et fluide. Ce sont les différences entre systèmes légaux qui peuvent donner parfois cette impression – qu’elle soit de bonne ou de mauvaise foi – de manque de communication.
En Europe, il existe le Groupe Antiterroriste (GAT) qui regroupe l’ensemble des services de sécurité de l’UE auxquels on doit ajouter ceux de Norvège et de Suisse. Au sein de cet organisme, nous avons des groupes spécialisés notamment en ce qui concerne la zone syro-irakienne.
Je terminerai mon propos en indiquant des pistes d’amélioration.
Tout d’abord, il faut que nous puissions avoir plus de renseignements en amont pour anticiper les attaques. Le fonctionnement du réseau belge nous a montré comment il était en contact avec ses commanditaires, recevant instructions et conseils pratiques. Les surveillances techniques doivent pouvoir nous aider dès lors que les problèmes de chiffrement seront surmontés en tout ou partie.
La deuxième piste concerne le fichier Schengen : il faut que tous les États membres inscrivent dans ce fichier les personnes suspectées à un titre ou à un autre d’activités liées au terrorisme. Nous avons, pour notre part, inscrit plus de 9 000 personnes, ce qui nous vaut ensuite d’être régulièrement cités à propos de nos fiches S, qui sont simplement un moyen d’enquête, un indicateur parmi d’autres, permettant une meilleure évaluation des individus concernés.
Toujours au sujet du fichier Schengen, les identités n’ont, de nos jours, plus grande signification du fait des contrôles aléatoires et des possibilités de falsification grandissantes. Aussi convient-il désormais d’introduire systématiquement des éléments de biométrie, incluant la possibilité de croisement des fichiers, y compris avec Eurodac pour les demandeurs d’asile.
Quant au Passenger Name Record (PNR) et au Terrorist Finance Tracking Program (TFTP) : combien de temps a-t-il fallu pour adopter le premier ? Et Quid du second ?
Pour ce qui est des métadonnées, à l’exemple de nos partenaires américains et britanniques, la question se pose de la pertinence de la séparation entre le renseignement et le judiciaire, dès lors qu’il s’agit de les analyser et de les croiser. Américains et Britanniques, notamment, les rassemblent à des fins opérationnelles alors que notre loi ne le permet pas. Cela est dommageable à l’action d’anticipation.
Dans la même veine, on doit s’interroger sur les durées de conservation des données recueillies dans le cadre de la loi relative au renseignement. Une fois détruites, celles-ci ne sont plus exploitables en judiciaire alors même qu’elles pourraient servir de moyens de preuve sous réserve de pouvoir en produire le support.
Enfin, concernant le statut des sources humaines et des repentis, il conviendrait de mieux les protéger, jusqu’à l’exonération, dans certains cas, de toute responsabilité pénale. Ne doit-on pas également, comme aux États-Unis, disposer d’un réel pouvoir de « marchandage » avec les personnes mises en examen afin de les amener à coopérer réellement ?
Je dirai, pour finir, que les États les plus sécuritaires n’ont jamais pu empêcher la commission d’actions violentes. La vraie question est de savoir quel est le prix que la société est prête à payer pour plus de sécurité, même si cette dernière ne sera jamais totale. Sachez que, dans mon service, chaque attentat est vécu comme un échec ; mais doit-on pour autant conclure, comme on en a souvent l’impression, que ce n’est pas la maladie qui tue, mais le médecin qu’il faut tuer ?
M. le président Georges Fenech. Merci pour cette présentation. Commençons par évoquer les attentats de janvier et novembre 2015 et leurs auteurs, afin d’essayer de mieux comprendre comment ils ont échappé à la surveillance. Il serait également intéressant que vous expliquiez le rôle de la DGSI qui devient pilote du renseignement en France.
M. Patrick Calvar. Nous sommes pilote de la lutte antiterroriste dès lors que le territoire national est concerné. Nos intérêts sont également frappés à travers le monde et, là, ce sont plutôt nos amis de la DGSE qui sont concernés. Mais sur le territoire national, en effet, nous concentrons l’ensemble des renseignements pour pouvoir agir.
M. le président Georges Fenech. Quels sont les auteurs des attentats de janvier et novembre 2015 qui n’avaient jamais fait l’objet d’une surveillance par la DGSI par le passé ?
M. Patrick Calvar. Coulibaly. Son cas était traité par nos collègues de la police judiciaire et aucun indice ne laissait soupçonner que l’intéressé, en tout cas à notre connaissance, était impliqué dans des projets d’attentat terroriste.
Les frères Kouachi, quant à eux, nous les connaissions, et ils ont fait l’objet d’une très longue surveillance – même s’il nous a été difficile de savoir lequel des deux s’était rendu au Yémen. Je rappelle que les moyens dont nous disposions à l’époque étaient très simples : écoutes téléphoniques, surveillance physique et données de connexion. Nous n’avions aucun moyen de renseignement intrusif pour pouvoir agir.
M. Sébastien Pietrasanta, rapporteur. Confirmez-vous que la surveillance des frères Kouachi n’a pas été interrompue ? Un communiqué de la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité (CNCIS), diffusé notamment par le biais de M. Urvoas, alors membre de la CNCIS, a démenti que les écoutes téléphoniques aient cessé à sa demande à partir de l’été 2014.
M. Patrick Calvar. La CNCIS n’a joué aucun rôle en la matière. Les demandes n’émanaient d’ailleurs pas seulement de mon service mais aussi de la DRPP. Aucun élément ne permettait d’établir de la part des frères Kouachi une activité terroriste.
Je vous rappelle que nous disposons aujourd’hui d’un quota limité d’interceptions de sécurité, interceptions dont l’exploitation implique des moyens. Nous avons affaire à des gens rompus à la clandestinité et qui connaissent parfaitement nos moyens d’action – il leur suffit de lire les différents journaux qui ne cessent de les étaler au grand jour, ce qui ne facilite pas notre tâche... C’est pourquoi la loi relative au renseignement a constitué pour nous une avancée considérable puisque, désormais, nous pouvons utiliser des moyens beaucoup plus intrusifs : nous pouvons nous attaquer à l’informatique, pénétrer dans les domiciles afin de les piéger. Au cours de n’importe quelle perquisition, dans n’importe quel domaine de délinquance de droit commun, vous allez trouver plusieurs supports de communication, plusieurs puces téléphoniques, voire plusieurs boîtiers. Nous constatons, au vu des enquêtes en cours, que nous devons aller au cœur du système, c’est-à-dire pénétrer dans les lieux où se trouvent les personnes que nous surveillons, ce qui n’est pas facile puisque nous devons agir en milieu hostile. Ensuite, si nous disposons de sources humaines, nous sommes en mesure d’anticiper. Il nous appartient alors de protéger leur avenir pénal et leur avenir physique.
Reste, j’y insiste, que la CNCIS n’a joué aucun rôle en la matière.
M. Georges Fenech. Le rapporteur a raison de rappeler cette polémique, d’ailleurs publique, puisque Jean-Jacques Urvoas qui, à l’époque, en tant que parlementaire, faisait partie de la CNCIS, avait clairement démenti que celle-ci ait refusé la prolongation de la surveillance des frères Kouachi. L’arrêt de cette surveillance a donc bien été décidé par les services pour les raisons que vous venez d’indiquer ?
M. Patrick Calvar. Oui. Et nous n’avons jamais mis en cause la CNCIS.
M. le rapporteur. C’est la presse qui a lancé cette rumeur.
M. Patrick Calvar. En effet, c’est la presse.
M. le président Georges Fenech. Avez-vous mis un terme à cette surveillance à cause de votre quota d’interceptions de sécurité ?
M. Patrick Calvar. Les écoutes ont été interrompues parce qu’elles ne donnaient rien au bout de deux ans de surveillance pour l’un et d’un an pour l’autre.
M. le rapporteur. Depuis les attentats de janvier 2015, vos pratiques en matière d’écoutes ont-elles changé ? Avez-vous tendance à prolonger les écoutes téléphoniques ?
M. Patrick Calvar. Non, nous nous efforçons avant tout de hiérarchiser les informations qui nous parviennent, l’idéal étant de pouvoir utiliser des méthodes beaucoup plus intrusives permises par la loi relative au renseignement. Sans vouloir me faire l’avocat de mon service, il faudra m’expliquer pourquoi on ne peut pas empêcher nombre de personnes de continuer à commettre des vols à main armée ou des trafics de stupéfiants. Or on relève avec obsession nos manquements – que du reste nous ne nions pas.
Il faut savoir que nous ne disposons pas nécessairement du renseignement utile et que plus la personne est dangereuse, moins nous aurons ce renseignement utile à même de nous permettre d’intervenir. D’où l’obligation pour nous d’avoir les moyens de procéder à des attaques informatiques ou, sinon, de pouvoir pénétrer dans les domiciles pour pouvoir déterminer les activités des individus surveillés.
M. Pierre Lellouche. Si vous aviez pu, à l’époque, appliquer les méthodes plus intrusives que vous permet désormais la loi relative au renseignement, pensez-vous que vous auriez pris connaissance des signaux émis par les frères Kouachi ? Avec les moyens dont vous disposez aujourd’hui, pensez-vous pouvoir mieux surveiller ce type d’individus ?
M. Patrick Calvar. Oui, nous nous trouvons dans une situation bien plus favorable pour anticiper.
M. le président Georges Fenech. Samy Amimour, membre d’un club de tir de la police nationale, a été auditionné par la DCRI en octobre 2012. Cette année-là, il est placé sous contrôle judiciaire et échoue dans un projet de départ pour la Syrie. Il y parvient finalement en septembre 2013 en compagnie d’Ismaël Omar Mostefaï. Comment ce départ a-t-il été rendu possible ? Pourquoi ne faisait-il l’objet d’aucune surveillance de la part des services de renseignement ?
M. Patrick Calvar. Vous touchez là du doigt un problème pour nous très important. Vous venez de rappeler que nous avions arrêté Samy Amimour, par la suite déféré, mis en examen et placé sous contrôle judiciaire. Or nous ne pouvons mettre en œuvre aucune technique de renseignement concernant un individu mis en examen afin qu’il ne soit pas porté atteinte aux droits de la défense. Nous ne pouvons donc agir dans cette circonstance : il s’agit d’un angle mort.
Il appartient à un contrôle judiciaire de permettre le suivi de l’intéressé.
M. le président Georges Fenech. Le contrôle judiciaire signifie donc la cessation de la surveillance par les services.
M. Patrick Calvar. Oui, et c’est un vrai problème que nous avons soulevé à plusieurs reprises. Nous ne pouvons plus suivre ni intercepter les gens les plus dangereux dès lors qu’ils sont mis en examen, à moins, s’ils sont impliqués dans un autre projet, qu’une autre enquête soit ouverte. Sauf dans ce dernier cas, ils disparaissent donc pour nous du paysage.
M. le rapporteur. À combien estimez-vous le nombre d’individus se trouvant dans cette situation, à savoir des individus que vous avez surveillés et qui vous échappent du fait d’être mis en examen ?
M. Patrick Calvar. Tous ceux qui sont mis en examen et sous contrôle judiciaire.
M. le président Georges Fenech. Omar Mostefaï a été mis en examen et donc « judiciarisé » ; vous n’en avez pas moins des compétences en matière de police judiciaire, vous êtes service enquêteur : une sorte de co-saisine ne vous permet-elle pas de continuer à surveiller un individu mis en examen ?
M. Patrick Calvar. Non. Dès lors qu’un individu est mis en examen, continuer de le surveiller reviendrait à porter atteinte aux droits de la défense, et nous ne pouvons donc absolument pas intervenir. Nous intervenons en amont avec tous les moyens qui nous sont accordés aux termes de la loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, dite loi Perben II, dès lors que les magistrats nous les confient.
M. Pierre Lellouche. Autrement dit, tout bon terroriste doit demander à être mis en examen.
M. le président Georges Fenech. C’est un comble, en effet. Quelle solution préconisez-vous, monsieur le directeur général, pour remédier à cette anomalie ?
M. Patrick Calvar. Il est nécessaire de prévoir des mesures de contrôle judiciaire qui soient très fortes et appliquées à la lettre. Il faut faire en sorte que si, à un moment ou à un autre, ces gens-là ne se rendent pas au commissariat pour pointer comme il est prévu, une réaction immédiate soit envisagée. Samy Amimour a pu partir dès qu’il a pu échapper à son contrôle judiciaire.
M. le président Georges Fenech. Son complice, lui, Omar Mostefaï, n’était pas mis en examen, il faisait l’objet d’une fiche S et il a pu quitter le territoire français.
M. Patrick Calvar. Soit, mais est-on contrôlé à la sortie du territoire ? Prenez l’exemple de l’entourage de Coulibaly : il part en voiture en Espagne d’où il prend un vol pour la Turquie. Comment fait-on pour empêcher des gens d’aller et venir librement dès lors qu’ils ne sont pas judiciairement recherchés et donc ne font pas l’objet d’un mandat ?
M. le rapporteur. Quel était le niveau de surveillance de Mostefaï ? Était-il dans votre viseur ? Faisait-il partie des individus prioritaires ?
M. Patrick Calvar. Ne dirigeant pas l’enquête, de nombreux détails me restent inconnus ; mais tous les individus surveillés ne le sont pas 24 heures sur 24.
M. le rapporteur. Omar Mostefaï faisait-il l’objet d’une surveillance avant le 13 novembre ?
M. Patrick Calvar. Non. Aujourd’hui, plus de 800 personnes ont l’intention de se rendre en Syrie ; or mon service compte 3 500 personnes dont beaucoup ne sont pas impliquées dans la partie opérationnelle. En outre, il faut bien avoir conscience d’une réalité : on n’entre pas dans les cités comme cela. La mise en œuvre de la mesure sur le terrain n’est pas aussi simple que cela.
M. François Lamy. On s’aperçoit a posteriori de l’existence de cellules, et que celles dont les membres ont commis des attentats ou qui font l’objet d’une surveillance importante ont toutes un lien.
Je me souviens que, dès le 16 novembre, la presse a été capable de décrire Abaaoud, de le désigner comme le probable commanditaire, de décliner tout son pedigree et ainsi de suite. Ce qui m’amène à vous demander si vous établissez une hiérarchie parmi les centaines de personnes que vous surveillez. En outre, disposiez-vous, avant les attentats, des organigrammes publiés ensuite par la presse sur les liens entre les cellules ?
M. Patrick Calvar. C’est la DGSI qui a signalé la dangerosité d’Abaaoud dès l’été 2015, en indiquant que cet individu était impliqué dans de nombreux projets avortés. C’était après l’attaque du Thalys. Nous savions pertinemment qu’Abaaoud avait joué un rôle dans plusieurs affaires, et nous l’avons donc signalé. Ensuite, le problème est simple : Abaaoud est en Syrie ; nous savons qu’il veut agir mais comment faire pour le bloquer ? J’en reviens, par conséquent, à ce que j’ai rapidement évoqué : faire des contrôles d’identité n’a plus aucun sens ; les papiers produits étant de qualité, il est nécessaire d’avoir recours à la biométrie.
Le projet des attentats du 13 novembre est conçu en Syrie, l’équipe est constituée en Syrie et la logistique est fournie en Belgique. Les membres des commandos vont arriver par des routes diverses et variées dont certaines nous sont inconnues ; et celles que nous connaissons sont empruntées par les migrants. Or si vous interrogez, sur ces routes, des individus de façon aléatoire, ils seront irakiens et tout ce qu’ils diront paraîtra naturel, notamment s’ils disent provenir d’un endroit contrôlé par Daech – c’est là qu’ils mentiront s’ils en font partie. Faute de renseignements en amont, les individus interrogés ne seront donc pas nécessairement suspects.
Ils se regroupent ensuite en Belgique, y louent leurs véhicules et leurs appartements ; et ils se projettent sur le territoire national la veille de nous frapper. Qu’on m’explique comment bloquer Abaaoud quand il se trouve en Grèce, visé par une enquête – celle concernant les attentats déjoués de Verviers ?
Par conséquent, un investissement très important s’impose dans le renseignement en amont. Je pense au chiffrement et au déchiffrement, car n’oublions pas que nous avons en face de nous de vrais professionnels. Ensuite, se pose la question de l’entrée en Europe et des contrôles à effectuer.
Enfin, il reste beaucoup à faire en matière de logistique : une fois arrivés sur place, il faut à ces gens-là des armes et des explosifs. Si ces derniers peuvent être composés, à partir de produits artisanaux, par des artificiers de qualité, il faut bien acheter les armes. Or que fait l’Europe pour lutter contre le trafic d’armes ? Que fait l’Europe pour dissuader des gens de vendre des armes ?
Je ne vois donc pas comment les services intérieurs auraient pu neutraliser Abaaoud avant qu’il n’agisse, quand bien même nous l’avions identifié à travers toutes les enquêtes judiciaires et de renseignement. Et je ne jette pas la pierre à mes camarades des services extérieurs : la situation est suffisamment complexe pour que nous ne soyons pas en mesure de régler tous les problèmes.
M. Christophe Cavard. J’ai peur d’avoir mal compris vos propos, au sujet du service de renseignement pénitentiaire : vous seriez prêt à l’intégrer dans le premier cercle ?
M. Patrick Calvar. Au sein de la cellule Allat, nous avons des personnels de la DRPP et du SRT – qui font partie du second cercle. Si nous créons un service du renseignement pénitentiaire, il y aura toute sa place.
M. Christophe Cavard. Très bien.
Certains, le président y a fait allusion, considèrent la DGSI comme l’acteur principal du renseignement intérieur, tâchant d’utiliser la complémentarité des différents services. Vous avez déclaré devant la commission de la défense – j’ai lu attentivement le compte rendu de votre audition – que la coordination entre votre service et la DGSE n’a jamais été aussi bonne. S’agit-il d’une coopération technique, d’une autre forme de coopération – je pense au renseignement de terrain, sur certains théâtres comme la Libye, où l’on ne trouve plus grand monde pour nous renseigner ?
Un autre passage de votre audition m’a marqué, celui où vous évoquez les 400 enfants qui se trouvent en Syrie avec leur famille, nés de parents français et qui représentent à terme, pour nous, un vrai danger potentiel. Comment envisagez-vous de traiter cette question ?
Se pose, dès lors, la question des moyens humains, dont j’ai discuté avec les représentants de votre service dans la région où je suis élu : comment organiser le renseignement sur le plan territorial et avec qui ? Qui évalue le haut du spectre et le bas du spectre, autrement dit, de quelle manière décide-t-on qu’untel sera plus particulièrement suivi par vos services et que tel autre sera pris en charge par d’autres services ?
Certains élus locaux, qui se sentent démunis, essaient de faire le lien entre les préfectures et vos services. Comment faire en sorte, selon vous, que tout le monde prenne sa part dans le renseignement territorial ? Ce n’est pas avec des effectifs de 3 600 personnes ni, demain, de près de 4 500 personnes, que vous parviendrez à faire un travail précis, dans nos villes, nos villages, nos quartiers.
M. Pierre Lellouche. Si je prends l’exemple d’Omar Mostefaï et celui du retour d’Abaaoud, nous nous trouvons, au fond, dans une catch twenty two situation (situation sans issue), pour parler comme les Américains : si la personne est mise en examen, elle ne peut pas être mise sur écoute ; si elle n’est pas judiciarisée, faisant l’objet d’une simple fiche S, vous ne pouvez pas l’empêcher de sortir du territoire ; et si elle est identifiée comme une menace mais que cette personne se trouve à l’extérieur du territoire, vous ne pouvez pas l’empêcher de rentrer. Je ne vois qu’une solution : soit vous avez l’autorisation légale d’intercepter les gens que vous avez fichés, ce qui n’est pour l’instant pas le cas…
M. Patrick Calvar. Si, si nous avons une autorisation administrative.
M. Pierre Lellouche. Je voulais dire que vous avez beau écouter tel individu, l’information selon laquelle il fait l’objet d’une fiche S ne peut pas être immédiatement transmise à un poste frontière qui n’existe pas puisqu’il n’y a pas de frontières nationales. Aussi, le système ne peut-il fonctionner que si l’information selon laquelle une personne est surveillée est communiquée à des postes frontières que l’on aura donc recréés.
Je présente demain, devant la commission des affaires étrangères, un rapport sur le projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant l’approbation de l’accord relatif au site technique de l’Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, autrement dit, un texte concernant les trois réseaux qui existent et les deux qui sont prévus. C’est un véritable fatras : ces réseaux sont très incomplets, ils ne sont pas vraiment interconnectés et ils sont différents d’un État à l’autre !
Or, pour que ce système marche, je le répète, et pour que vous sachiez qui sort de France et qui y rentre, avons-nous, selon vous, besoin de rétablir les contrôles nationaux avec communication automatique, immédiate à des postes frontières rétablis, de l’information selon laquelle un individu est mis sous surveillance ? Par exemple, les fiches S sont-elles transmises ou non au système Schengen ? Vous ne les transmettez pas ?
M. Patrick Calvar. Si.
M. Pierre Lellouche. Vous les transmettez, mais sont-elles exploitées ?
M. Patrick Calvar. Nous avons communiqué plus de 9 000 noms au fichier Schengen. Reste que, comme je vous l’indiquais, l’identité ne signifie pas nécessairement grand-chose : vous pensez bien qu’Abaaoud ne se promenait pas avec des documents d’identité à son nom. J’y insiste, nous souhaitons la systématisation de la biométrie. Il conviendra ensuite de croiser les fichiers nationaux et d’y intégrer la base Eurodac et la base des demandeurs d’asile. Si nous ne franchissons pas cette étape, nous irons au-devant de problèmes.
Le système des fiches S est appliqué dans chaque pays ; ensuite, on agit en fonction de la loi nationale, sauf si une procédure judiciaire est enclenchée sur notre territoire, auquel cas nous pouvons demander une assistance, mais, encore une fois, dès lors qu’une enquête judiciaire n’est pas ouverte, nous ne disposons pas de moyens coercitifs. Je le répète, la clef, c’est l’utilisation de la biométrie. Les contrôles, au sein de l’espace Schengen, sont aléatoires, ils ne peuvent pas être systématiques. Abaaoud devait circuler grâce à des papiers qui le lui permettaient sans trop de problèmes, et même s’il avait été arrêté, encore eût-il fallu que l’on relève ses empreintes digitales et qu’on puisse les croiser avec toutes les bases de données.
Vous souvenez-vous de l’individu qui a voulu poignarder un officier de police au commissariat du XVIIIe arrondissement ? On l’a annoncé Marocain, puis Irakien, enfin Tunisien. Il avait été arrêté en Allemagne et au Luxembourg pour des infractions de droit commun. Je me souviens très bien que, alors que sa mère s’exprimait à la télévision en disant que la police avait tué son fils, une partie de nos partenaires pensaient toujours qu’il s’agissait d’un Marocain alors que nous avions confirmation par les Tunisiens eux-mêmes qu’il était ressortissant tunisien.
Nous procédons bien à la consultation de certaines bases mais les différentes lois nationales ne le permettent pas toujours. Prenons l’exemple des fiches S : certains services de sécurité sont dans l’incapacité légale d’en créer. C’est ce qu’il faut changer. Le problème pour l’Europe n’est pas la coopération entre les différents services de renseignement mais sa capacité à disposer d’un droit pénal à peu près identique partout.
La DGSE et la DGSI sont intégrées dans une structure bilatérale. Nous échangeons toutes nos informations en temps réel. Suivant les cas, l’un ou l’autre service joue le rôle de pilote selon que l’individu concerné est en France ou à l’étranger, mais notre stratégie demeure celle du démantèlement judiciaire. La vraie différence avec les pratiques passées est que les deux directions sont, j’y insiste, totalement intégrées. Tous les moyens sont mis en œuvre pour prendre en compte les individus dont nous savons qu’ils ciblent le sol français. Tout se passe de façon très fluide entre les deux services.
J’en viens à la question de M. Cavard sur les enfants. Les chiffres que je vous ai donnés sont probablement en dessous de la réalité. Honnêtement, je ne sais pas comment nous ferons. Reste que nous ne prenons pas suffisamment conscience de ce phénomène. Beaucoup d’enfants sont nés là-bas et n’ont pas d’existence légale. Ceux qui sont maintenant âgés d’une dizaine d’années sont de véritables dangers ambulants. Même en faisant abstraction de leur implication dans les organisations terroristes, il faut s’interroger sur leur état psychologique. Il faudra donc que nous fassions avec, ce qui signifie que nous sommes encore loin d’être sortis de cette crise.
Autre point : si nous ne lançons pas de réforme territoriale visant à regrouper nos moyens pour renforcer nos capacités de projection, c’est parce que nous attendons que nos collègues du renseignement territorial soient en mesure de couvrir l’ensemble du spectre des signaux faibles, ce qui n’empêche pas que nous communiquions. L’EMOPT représente 14 000 personnes et mon service, qui se situe en haut du spectre, en regroupe quelque 4 000 ; nous sommes par conséquent bien obligés de définir des priorités.
J’en reviens à l’affaire de Bruxelles : ces gens parlaient très clairement mais personne n’interceptait leurs communications ; et quand bien même nous les aurions interceptées, il n’est pas sûr que nous aurions été à même de les déchiffrer. Il s’agit de vrais soldats – nous avons changé de dimension.
M. Christophe Cavard. Vous avez affirmé, devant la commission de la défense, qu’il n’y avait pas de cellule organisée en France.
M. Patrick Calvar. J’ai dit qu’il n’y avait pas de cellule en France liée à celle de Bruxelles.
M. Christophe Cavard. Vous avez sonné l’alarme. Dès lors, qu’en est-il du risque terroriste en ce qui concerne la tenue de l’Euro 2016 ?
M. Patrick Calvar. L’organisation qui, aujourd’hui, planifie les attaques sur le sol européen est formée de professionnels qui viennent des milieux islamistes mais également du baasisme de Saddam Hussein, à savoir des officiers totalement rompus à la clandestinité et qui, par le passé, ont déjà démontré leur savoir-faire.
À propos de Bruxelles, je précisais qu’il s’agissait de cellules étanches et qui n’avaient pas de logistique sur le territoire français, ce qui ne signifie en rien qu’il n’y a pas de cellules en France. Il faut bien voir que nous avons affaire à une organisation compartimentée et hiérarchisée. Ils savent très bien qu’ils ont en face d’eux des puissances très fortes.
M. Alain Marsaud. Vous avez expliqué devant la commission de la défense que la France serait le pays le plus visé par des actions terroristes en provenance du Moyen-Orient. Du moins c’est ce que j’ai vu dans la presse, car je n’ai pas encore lu le compte rendu qui a été réalisé de votre audition. Pourquoi sommes-nous ainsi les plus visés ? Est-ce, selon vous, parce que nous aurions mené une politique étrangère aventureuse au Moyen-Orient ces dix dernières années ? Il fut une époque « bienheureuse » où c’étaient les Américains, éventuellement les Britanniques, qui étaient en tête de liste et nous à la suite. Ou bien le fait que nous soyons subitement passés en tête de liste tient-il à la politique intérieure – je pense aux affaires liées au voile islamique, aux accusations d’islamophobie ?
Même si, après les attentats du mois de novembre, nous nous doutions bien que nous étions ciblés, je vous avoue que votre déclaration m’a surpris. Or vous n’avez pas dit pourquoi nous étions le premier pays visé.
M. Patrick Calvar. La situation géopolitique de la région concernée a favorisé la venue de combattants étrangers, parmi lesquels un certain nombre de Français. Or plus il y a de Français qui partent là-bas, plus on peut s’attendre en retour à être menacés.
M. Pierre Lellouche. Et par le Levant.
M. Patrick Calvar. Sans chercher à aller plus loin, je constate que nous sommes en première ligne ; mais j’estime que si nous nous limitons à une réponse sécuritaire, nous allons droit dans le mur.
M. Alain Marsaud. Faut-il donc envisager une refonte de notre politique étrangère ?
M. le président Georges Fenech. Je crains que cette question ne concerne pas le directeur général de la sécurité intérieure.
M. Alain Marsaud. Monsieur le président, nous avons la chance de pouvoir interroger le directeur général qui a déclaré que nous étions les premiers menacés. Or, pour ma part, j’ignore pourquoi. M. Calvar a une expertise que je n’ai pas, non plus que certains d’entre nous, et je souhaite savoir ce qu’il pense vraiment. Je suis non seulement un citoyen mais je suis aussi parlementaire, je dois donc rendre des comptes à mes compatriotes. Pourquoi sommes-nous les premiers ciblés et que faire pour ne plus l’être ? Devons-nous intervenir à un moindre degré en Syrie et en Irak ? Doit-on partir en chasse contre l’islamophobie ambiante ?
M. Patrick Calvar. Les cibles sont multiples et les terroristes frappent là où cela leur est le plus facile. Les Britanniques sont sans doute aussi menacés que nous, sauf qu’il est beaucoup plus difficile de se projeter et d’agir sur leur territoire puisqu’il s’agit d’une île et qu’il est très compliqué de se procurer une arme au Royaume-Uni. Reste que si vous regardez la vidéo de revendication des attentats du 13 novembre, elle se termine avec les images de Big Ben et David Cameron, le message étant : on arrive ! Les terroristes, j’y insiste, frappent là où ils le peuvent, forts des compétences dont ils disposent. Pour ce qui est de la France, on doit ajouter ce qui se passe dans la bande sahélo-saharienne.
Sur le théâtre syro-irakien, ils en veulent à tous les membres de la coalition. Les Russes risquent ainsi, après la fin du conflit syro-irakien, de payer très cher le retour des populations du nord Caucase voire des anciennes républiques de l’Union soviétique.
M. Pierre Lellouche. Il y en a au moins 5 000.
M. le président Georges Fenech. Pour en revenir aux auteurs des attentats du mois de novembre, les autorités grecques vous ont-elles avisé de la localisation d’Abaaoud, en janvier 2015, à Athènes ? C’était juste avant l’assaut contre la cellule de Verviers. Les Grecs en ont informé les Belges qui, en retour, ne les ont pas prévenus de l’assaut, et les Grecs étaient particulièrement remontés contre l’absence de ce retour d’information.
M. Patrick Calvar. Je suis dans l’incapacité de vous répondre. Reste que si les Grecs nous avaient informés, cela restait une affaire entre services grecs et belges.
M. le rapporteur. En janvier 2015, Abaaoud n’était donc pas identifié par vous.
M. Patrick Calvar. Abaaoud était connu puisqu’il était apparu sur toutes les vidéos. Nous savions pertinemment à quoi il s’intéressait quand il se trouvait en Syrie, mais l’absence de connaissance que nous avions en janvier 2015 de ses projets terroristes nous visant n’en faisait pas une priorité. Nous avons suffisamment de ressortissants français qui, depuis la Syrie, veulent nous frapper, soit en projetant sur notre territoire des gens, soit en faisant appel à des amis qui vivent ici, pour ne pas nous être préoccupés directement des cellules en Belgique ou dans d’autres pays, dès lors que nous ne pouvions établir de connexions.
M. le rapporteur. Outre Mostefaï, Amimour et Abaaoud, d’autres individus ayant participé de près ou de loin aux attentats du 13 novembre ont-ils échappé à vos radars ?
M. Patrick Calvar. Il y avait beaucoup de gens dans ce cas : les Irakiens…
M. le rapporteur. Je pensais aux ressortissants français.
M. Patrick Calvar. Il y en avait trois, dont Mostefaï et Amimour. Les autres vivaient depuis leur tendre enfance en Belgique, nous n’avions donc aucune raison de les prendre en compte, à moins d’avoir une information selon laquelle ils auraient été susceptibles de venir sur notre territoire.
M. le rapporteur. La question que tout le monde se pose est de savoir si les individus connus de vos services, et des services belges, sont parvenus à sortir des écrans radars ou non. A-t-on rencontré des difficultés dans la surveillance de ces individus ?
M. Patrick Calvar. Nous n’avions aucune raison de surveiller ces gens-là. Abaaoud a commencé à être un vrai problème pour nous dès lors que nous avons pu déterminer qu’il était impliqué dans de nombreux projets concrets nous visant.
M. Pierre Lellouche. Voulez-vous dire qu’il revenait en fait à la DGSE de s’occuper de la cellule belge ?
M. Patrick Calvar. Non, la surveillance de la cellule belge, c’est le travail des Belges.
M. Pierre Lellouche. Certes, mais si les services belges obtiennent des informations sur cette cellule et qui concernent la France, ils vont les communiquer à la DGSE et pas à vous.
M. Patrick Calvar. À nous aussi.
M. le rapporteur. En fait, la seule difficulté que vous ayez rencontrée, et vous vous en êtes bien expliqué, concerne les frères Kouachi.
M. Patrick Calvar. Les attaques du mois de janvier 2015 ont été conçues ici et par des gens qui vivaient en France. L’enquête apportera peut-être des précisions sur ce point mais, entre le séjour au Yémen et le passage à l’action, beaucoup trop d’années se sont écoulées. Coulibaly, lui, s’est revendiqué de l’État islamique et les deux autres d’Al-Qaïda dans la Péninsule arabique (AQPA). On en conclut qu’on a ici plutôt affaire à des gens qui se sont rencontrés et ont mené ensemble un projet. Nous devons nous interroger sur les raisons pour lesquelles nous ne les avons pas identifiés et donc pour lesquelles nous n’avons pas pu les neutraliser, même si, malheureusement, nous ne pouvons pas tout empêcher.
M. le rapporteur. La surveillance des individus a-t-elle failli du côté français ?
M. Patrick Calvar. Qui, aujourd’hui, dispose de renseignements à Raqqah ?
M. le rapporteur. La DGSE.
M. Patrick Calvar. Les services de renseignement extérieur, effectivement, mais avec quels moyens ? Que sait-on de ce qui se passe à Raqqah ? Voilà le problème. On en revient à la question des interceptions techniques, du chiffrement, des sources humaines…
M. Patrice Verchère. Nous constatons, depuis les attentats de 2015, que de plus en plus d’agents de sécurité sont employés par des entreprises privées, les forces de l’ordre ne pouvant être partout. De nombreux agents de sécurité vont encore être embauchés à l’occasion de l’Euro 2016 et notamment pour encadrer les fan-zones. Contrôlez-vous les personnes ainsi recrutées, vous transmet-on leur nom, sachant que les entreprises de sécurité vont jouer un rôle très important et qu’elles recrutent souvent, on le sait très bien, au noir ?
M. Patrick Calvar. Nous procédons à des vérifications dès lors que les listes nous sont communiquées. Les situations les plus compliquées à gérer sont celles qui préexistaient avant la période – embauches, candidatures non retenues, licenciements. Nous ne procédons pas à des contrôles seulement liés à l’Euro, les fan-zones et les sociétés de sécurité qui en sont chargées, nous en faisons également dès lors qu’il s’agit d’entreprises sensibles. Il va falloir trouver le moyen de garantir les libertés tout en assurant la sécurité ; reste à savoir quel prix nous sommes prêts à payer. Les assignations à résidence, les perquisitions administratives, les criblages sont des mesures soumises au contrôle du juge parce que les conséquences en sont lourdes.
M. Pierre Lellouche. Entre ceux qui veulent partir et ceux qui veulent revenir, à combien estimez-vous le nombre de Français posant problème pour la sécurité du pays ?
Ensuite, et j’ai posé la même question au ministre de l’intérieur tout à l’heure, est-il raisonnable, à votre sens, de rassembler sous la tour Eiffel, pendant un mois, 92 000 spectateurs devant de grands écrans et derrière un grillage, avec de l’alcool, – j’évoque ici la fan-zone parisienne ?
M. Patrick Calvar. La menace la plus forte est représentée par des gens qui ont combattu, qui ont été entraînés en Syrie et en Irak, à l’exemple de ceux qui ont attaqué le Bataclan, de ceux qui étaient en France le 13 novembre. Ce sont ceux-là qui mèneront les actions terroristes d’ampleur. Ils sont au nombre de 400 ou 500. Néanmoins, nous ne devons plus raisonner en termes de Français ou de personnes résidant en France mais de francophones. Des milliers de Tunisiens, des milliers de Marocains et d’Algériens peuvent être projetés sur notre territoire. Qui plus est, n’oublions pas la leçon du 13 novembre : deux Irakiens sortis de nulle part faisaient partie du commando. Il est donc très difficile de répondre précisément à votre question. Voilà pour la menace la plus dangereuse.
Ensuite, d’autres groupes, tels ceux formés par les frères Kouachi et Coulibaly, sont capables de commettre des actions d’ampleur.
Enfin, toute une catégorie d’individus voudraient agir mais n’en ont pas les moyens. Certains pourraient aller au-delà dans la mesure où ils sont issus des milieux de la délinquance et mener des actions de basse intensité, certes, mais qui n’en sont pas moins de nature à frapper les esprits.
Au total, nous suivons à peu près 2 000 personnes. Mon souci, c’est que je n’ai aucune visibilité sur les francophones issus d’Afrique du Nord qui, par des alliances linguistiques puis opérationnelles nouées là-bas – puisqu’ils ont combattu ensemble –, peuvent s’engager dans un projet ou être désignés pour être partie prenante au même projet.
M. le rapporteur. Vous évoquiez tout à l’heure le chiffre de 4 000 personnes et ici celui de 2 000 personnes.
M. Patrick Calvar. Le chiffre de 4 000 personnes concernait l’EMOPT ; j’évoque ici le « point dur » : entre ceux qui se trouvent en Syrie, ceux qui en sont revenus et ceux qui voudraient s’y rendre, nous atteignons le chiffre de 2 000 individus.
M. Pierre Lellouche. Sans compter les Nord-Africains.
M. Patrick Calvar. Tout à fait.
M. Pierre Lellouche. Parmi lesquels on compte de nombreux Tunisiens.
M. Patrick Calvar. Ils sont nombreux, en effet.
M. Pierre Lellouche. Combien sont-ils, 5 000 environ ?
M. Patrick Calvar. C’est très difficile à dire.
Pour ce qui est de la fan-zone, elle présente l’avantage de pouvoir contrôler ceux qui vont y entrer. Reste qu’il y a toujours des zones à frapper. Qu’il s’agisse des cafés ou autres lieux publics, les cibles ne manquent pas.
M. Pierre Lellouche. Auriez-vous persisté à organiser l’Euro 2016 ?
M. Patrick Calvar. Il ne faut absolument pas céder. Je pense que nous gagnerons contre le terrorisme ; je suis, en revanche, beaucoup plus inquiet de la radicalisation de la société et du mouvement de fond qui l’entraîne. C’est ce qui m’inquiète quand je discute avec tous mes confrères européens : nous devrons, à un moment ou à un autre, dégager des ressources pour nous occuper d’autres groupes extrémistes parce que la confrontation est inéluctable.
M. le président Georges Fenech. Vous voulez parler de l’extrême droite et de l’extrême gauche ?
M. Patrick Calvar. L’ultra gauche est dans une autre logique. Vous aurez une confrontation entre l’ultra droite et le monde musulman – pas les islamistes, mais bien le monde musulman.
M. le président Georges Fenech. Revenons-en plus précisément à l’objet de la commission d’enquête, c’est-à-dire les moyens de l’État.
Nous souhaitons que vous nous fassiez part de votre analyse sur la coordination du renseignement en France. L’UCLAT dépend du directeur général de la police nationale et échappe donc à la coordination interministérielle. C’est également le cas de l’EMOPT, créé en 2015 par le ministre de l’intérieur et directement rattaché à son cabinet. L’UCLAT administre le fichier FSPRT ; l’EMOPT s’assure de la continuité du suivi des individus radicalisés. Outre ces structures, on a un coordinateur à l’Élysée. On se demande s’il n’y a pas une strate de trop et si la coordination du renseignement est bien assurée. Ne pourrait-on imaginer, pour le haut du spectre, comme l’ont fait les Américains, une base de données commune, qui puisse être partagée par tous les acteurs de la lutte antiterroriste ? Chez nous, le partage d’informations n’est pas total à travers un seul fichier, étant précisé que le FSPRT est un fichier de suivi, de circulation et que l’EMOPT ne l’alimente pas. C’est vous qui, en réalité, êtes chef de file du renseignement en France. L’UCLAT ne pourrait-elle pas prendre une dimension supérieure ? Qu’est-ce qui justifie l’existence de l’EMOPT, en fin de compte, d’autant plus qu’il expose directement le ministre de l’intérieur puisque dépendant directement de lui ?
M. Patrick Calvar. L’UCLAT a une fonction interministérielle ; elle réunit chaque semaine des gens de tous les ministères concernés – défense nationale, économie et finances, auxquels on peut ajouter le renseignement pénitentiaire – et son rôle est d’évaluer la menace. Le FSPRT est notamment en charge du traitement des signalements fournis d’une part par le centre national d’assistance et de prévention de la radicalisation (CNAPR) et d’autre part par les groupes d’évaluation qui se trouvent sous la direction des préfets de département L’EMOPT joue, pour sa part, parfaitement son rôle qui est d’assurer le suivi des signaux faibles et que chaque acteur a bien pris en compte ses objectifs.
M. le président Georges Fenech. L’UCLAT n’aurait-elle pas pu s’en charger ?
M. Patrick Calvar. Il faudra que vous en parliez avec le ministre.
M. le président Georges Fenech. On aurait pu positionner l’UCLAT à cette fin plutôt que d’avoir deux structures.
M. Patrick Calvar. Il s’agissait d’adresser un message fort après tous ces événements : celui de l’implication totale du ministère de l’intérieur et donc des préfets. Aussi l’EMOPT répondait-il à ce besoin. Je ne suis pas certain que l’UCLAT aurait pu remplir cette mission à moins de la repositionner.
M. le président Georges Fenech. C’est cela. N’aurait-il pas été plus simple de procéder ainsi ? En tout cas la question se pose.
En outre, le FSPRT vous est-il vraiment utile ?
M. le rapporteur. À ce sujet, l’ensemble des cibles, les quelque 2 000 personnes que vous avez évoquées, sont-elles inscrites au FSPRT ? Les mêmes font-elles l’objet d’une fiche S ?
M. Patrick Calvar. Tous les gens que nous suivons font l’objet d’une fiche S. Aussi n’importe quel service de police, de gendarmerie, de douane, bref tous ceux qui ont accès au fichier des personnes recherchées (FPR), peuvent-ils savoir en temps réel que tel individu est suivi par notre service. J’insiste, en outre, sur le fait que chaque fiche indique les conduites à tenir. Nous avons ainsi environ 11 000 fiches S liées au terrorisme.
M. le président Georges Fenech. Utilisez-vous le FSPRT ?
M. Patrick Calvar. Le FSPRT est le moyen pour nous de discuter en permanence avec nos collègues des autres services pour évaluer les cas dont nous n’aurions pas décelé la dangerosité. À l’inverse, on peut rétrocéder à un autre service tel cas jugé moins dangereux après évaluation.
M. le rapporteur. Toutes vos cibles figurent-elles dans le fichier FSPRT ?
M. Patrick Calvar. La plus grande partie.
M. le président Georges Fenech. Pas toutes ?
M. Patrick Calvar. L’essentiel de nos cibles s’y trouvent.
M. le président Georges Fenech. Appliquez-vous l’article L. 851-2 du code de la sécurité intérieure, concernant le suivi en temps réel d’une liste d’individus ?
M. Patrick Calvar. Oui. La loi est très précise : la mesure prévue à cet article ne pouvant s’appliquer qu’à une personne à la fois, la motivation, précise, ne peut concerner que cette personne et dans la mesure où elle présente une menace terroriste.
M. le président Georges Fenech. Concrètement, techniquement, comment cela se passe-t-il ?
M. Patrick Calvar. Nous formulons une demande concernant un individu et, choisissant parmi les techniques dont nous souhaitons la mise en œuvre, nous demandons l’application de l’article L. 851-2 du code de la sécurité intérieure dans sa rédaction issue de la loi sur le renseignement, en indiquant les éléments dont nous disposons sur l’intéressé et qui en font une potentielle menace terroriste sur le territoire.
M. le rapporteur. Au moment du vote de la loi relative au renseignement, on avait estimé à 3 000 le nombre d’individus à surveiller de près. Où en est-on ?
M. Patrick Calvar. Nous en surveillons plusieurs centaines mais, encore une fois, il faut que nous justifiions l’existence d’une menace terroriste et que nous fassions une demande pour chaque individu. Je rappelle, en outre, que cette mesure ne peut s’appliquer que pendant deux mois et qu’au terme de ce délai nous devons demander son renouvellement et donc montrer qu’en effet, menace il y avait. Si nous n’avons rien trouvé, il y a une chance pour que la mesure ne puisse être reconduite. À cet égard, nous entretenons une relation de très grande confiance avec la commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR) qui se montre très bienveillante à l’égard des services tout en étant dans son rôle de contrôle absolu de la légalité administrative de la mise en œuvre des techniques de renseignement.
M. Christophe Cavard. Vous avez expliqué tout à l’heure que les terroristes étaient très coordonnés, mais qu’en est-il des services de renseignement ? Lors de votre audition par la commission de la défense, quand vous évoquez l’attaque dans le Thalys, vous indiquez que l’individu part d’Espagne, se rend en Allemagne puis en Belgique, et vous déclarez : « Nous perdons dès lors sa trace puisque nous n’avons plus aucune raison de nous en occuper ». Si je traduis bien vos propos, vous perdez sa trace parce qu’il n’est plus sur le territoire français. Que faudrait-il mettre en place pour une meilleure coordination des services de renseignement des différents pays ?
M. Patrick Calvar. J’ai, en fait, déclaré que nous n’avions jamais pu établir la présence de l’intéressé sur le sol national et que, par précaution, nous avions émis une fiche S le concernant au cas où il ferait l’objet d’un contrôle. Ce contrôle a eu lieu un an plus tard à Berlin, alors qu’il embarquait sur un vol à destination d’Istanbul. Nous avons immédiatement pris contact avec les Espagnols, puisqu’il vivait auparavant en Espagne, pour leur demander s’ils en étaient informés et s’ils savaient où se trouvait l’intéressé. Ils nous ont répondu qu’il était en Belgique et que les Belges étaient informés de sa présence à Bruxelles. Seulement, et je reviens sur ce que je précisais au cours de mon exposé liminaire, certains services n’ont pas la capacité d’inscrire leurs objectifs dans le fichier Schengen. C’est le cas de la sûreté de l’État belge ; et cette incapacité est légale : il ne s’agit pas d’un service de police. Encore une fois, si nos échanges avec certains services étrangers sont très fluides, il n’y a aucune harmonisation du système européen. C’est de là que viennent les problèmes. Il faut qu’à l’occasion d’un contrôle, la douane, la police ou la gendarmerie puisse faire remonter en temps réel une information à un service unique à même de l’évaluer. C’est pourquoi j’ai pris l’exemple du Thalys : nous ne connaissions pas Khazzani ; il nous est signalé par les Espagnols ; il réapparaît en Allemagne ; on nous dit qu’il est en Belgique – et c’est depuis la Belgique qu’il montera dans le train dont il tentera d’attaquer les passagers.
M. le président Georges Fenech. Au début de nos travaux, les victimes et leurs avocats ont évoqué devant nous un procès-verbal dressé par la DCRI en 2009 évoquant un projet d’attentat contre le Bataclan. Ils ont ajouté qu’en 2015, le juge Trévidic a reçu une information de Farouk Ben Abbes, mis en examen, qui fait état d’un projet d’attentat contre une salle de spectacle. Les victimes nous demandent avec insistance pourquoi les propriétaires de cet établissement n’ont pas été prévenus de ces menaces. Le procureur de Paris, quand on l’interroge, fait référence au secret de l’instruction, estimant en outre qu’il n’appartient pas au juge de donner cette information. Quant au ministre de l’intérieur, il a considéré qu’il ne s’agissait pas de son domaine de compétences. Pouvez-vous vous-même nous apporter des réponses sur ce point ?
M. Patrick Calvar. Vous venez de me dire que le procureur de la République ne souhaitait pas répondre…
M. le rapporteur. Je pense qu’il a plutôt renvoyé la balle dans votre direction.
M. Patrick Calvar. Je vais vous répondre clairement tout en tâchant de respecter le secret de l’instruction. Farouk Ben Abbes se trouve à la jonction de deux dossiers différents, celui lié au projet d’attentat de 2009 contre le Bataclan et celui lié à la mort de notre jeune compatriote Cécile Vannier lors de l’attentat perpétré au Caire la même année.
Farouk Ben Abbes est interpellé une première fois en Belgique – pays dont il est ressortissant – parce qu’il est suspecté d’appartenir à une filière d’envoi de combattants en Irak. Un non-lieu sera prononcé et il ne sera donc pas poursuivi. Il s’installe ensuite en Égypte d’où il part pour Gaza. Là, il entre en relation avec un mouvement extrémiste et il va regagner l’Égypte en 2009, où il sera trouvé porteur d’une clef USB contenant de la documentation sur la fabrication d’engins explosifs. Passé par l’un des tunnels clandestins, il a été arrêté et interrogé. Un service tiers déclarera que les Égyptiens auraient obtenu des aveux de l’intéressé selon lesquels il était missionné pour perpétrer une attaque en France et qui aurait pu viser le Bataclan, cet établissement organisant – nous sommes en 2009 – des galas de bienfaisance au profit de l’armée israélienne alors engagée dans l’opération « Plomb durci ».
Jamais les Égyptiens n’ont répondu à aucune demande d’entraide et n’ont apporté aucun élément concret à ce sujet. Néanmoins, quand Farouk Ben Abbes a été libéré, après un passage par la Belgique où il a été à nouveau interrogé, il s’est rendu en France où il a été interpellé, mis en examen et incarcéré. Toutes les investigations réalisées à partir de là n’ont pas permis de le relier à ce pseudo-projet dont on ignore, encore une fois, s’il a existé ou non – on n’en sait strictement rien, les Égyptiens n’ayant jamais donné, je le répète, aucun élément. La justice ne pouvait donc conclure qu’à un non-lieu, indépendamment du fait qu’elle avait parfaitement fait son travail, allant jusqu’à demander et obtenir son incarcération.
L’affaire Cécile Vannier est toute autre et concerne un attentat perpétré au Caire. On veut y lier Farouk Ben Abbes via des témoins qui ensuite ne le reconnaîtront pas. L’instruction n’est ici pas terminée. L’intéressé a été récemment placé en garde à vue dans ce cadre.
Reste que tous les éléments susceptibles de faire avancer l’enquête, s’ils existent, sont entre les mains des autorités égyptiennes. Aussi, aujourd’hui, rien ne relie les affaires Bataclan et Vannier, de 2009, et les attentats du 13 novembre 2015. D’aucuns vous diront cependant qu’en Égypte il a croisé les frères Clain. Mais les frères Clain n’étaient en rien concernés par ce qui se passait à Gaza, et quant à l’attentat qui a causé la mort de Cécile Vannier, les Clain étaient déjà rentrés depuis bien longtemps en France quand il a été commis.
Dès lors qu’on ne peut établir un lien entre ce qui s’est passé en 2009-2010 et ce qui s’est passé en 2015, pourquoi voulez-vous qu’il y ait eu une information directe des responsables ou des propriétaires du Bataclan ?
Rien, absolument rien n’indique qu’il y ait un lien. La justice a parfaitement fait son travail. Farouk Ben Abbes a été incarcéré pendant une période assez longue, des investigations tous azimuts ont été menées et aucun élément n’est venu corroborer cet éventuel lien ; de plus, je le répète, nous n’avons obtenu aucune réponse aux demandes d’entraide internationale formulées auprès des autorités égyptiennes. On ignore donc jusqu’au fait que l’intéressé aurait pu, un jour ou l’autre, tenir les propos qu’on lui attribue.
M. Pierre Lellouche. Je souhaite vous interroger sur l’escalade éventuelle d’attaques qui seraient portées à un niveau « non conventionnel », avec l’utilisation d’armes radiologiques combinant des produits fissiles issus du milieu hospitalier, comme le césium 137 et le cobalt 60, ou d’armes chimiques dont nous constatons qu’elles sont désormais employées chaque semaine en Syrie par les deux parties au conflit – la fabrication de ce type d’armes à Mossoul atteint un stade très inquiétant. Toutefois, avant même que nous n’encourions le risque d’une attaque avec ces armes, nous devons nous préparer aux engins explosifs improvisés (Improvised Explosive Device – IED) et aux voitures-béliers bourrées d’explosifs, utilisés là-bas quotidiennement. Comment envisagez-vous la gradation de la menace ?
Ensuite, au cours de mes conversations en Israël, je me suis rendu compte que l’on y avait modifié l’organisation du ministère de l’intérieur, tout comme les Américains ont créé le Department of Homeland Security (département de la sécurité intérieure). La présente commission pourrait se poser la question de savoir s’il convient de changer le modèle du ministère de l’intérieur à la française, qui s’occupe de décentralisation, des collectivités territoriales en même temps que de la sécurité et de la lutte antiterroriste. Je verrais bien, pour ma part, un ministère de la sécurité intérieure et, à côté, un ministère des collectivités locales – comme c’est désormais le cas, donc, chez les Israéliens et les Américains. Je pense que ce type d’évolution institutionnelle est nécessaire et que la campagne présidentielle prochaine devrait être l’occasion de se poser ce genre de question.
M. Patrick Calvar. Vous vous souvenez que dans le passé, on avait mis au jour des projets visant à récupérer dans les poubelles un ensemble de produits radioactifs d’origine hospitalière et dont l’assemblage aurait permis la création d’une bombe sale. On a arrêté plus tard, aux États-Unis, un individu qui avait conçu un tel projet. C’est donc un projet que les islamistes ont toujours eu en tête. Par ailleurs, le groupe islamique armé (GIA), à la même époque, effectuait des recherches sur la ricine. Ne pouvant, à l’aide de cet agent biologique, tuer beaucoup de personnes en même temps, il s’agissait de créer un effet de panique en enduisant de ricine les poignées des portières des véhicules afin que les personnes ainsi contaminées en meurent. L’effet médiatique aurait été désastreux. D’autres recherches sur le sujet ont été menées dans la vallée de Pankissi, en Géorgie, puis dans le Nord de l’Irak. Les islamistes ont donc, j’insiste, toujours marqué leur intérêt pour ce type d’armes.
La différence avec aujourd’hui est qu’ils ont acquis en la matière une capacité quasi-industrielle. En tout cas, ils ont récupéré ce dont disposait l’armée de Saddam Hussein ou l’armée de Bachar el-Assad et ils n’hésitent pas à l’utiliser sur le terrain. S’ils en ont l’opportunité, ils vont exporter ces armes. La vraie difficulté pour eux est d’y parvenir, notamment à cause de la dangerosité des produits en question. Aussi, pour l’heure, en restent-ils à des attaques basiques et, comme vous, je suis persuadé qu’ils passeront au stade des véhicules piégés et des engins explosifs, et qu’ainsi ils monteront en puissance.
M. le président Georges Fenech. Est-ce une conviction ou bien vous fondez-vous sur des éléments matériels précis, des indices ?
M. Patrick Calvar. D’abord, il faut nous souvenir que c’est ce que nous avons connu en 1986 et en 1995 : il s’agit de modes opératoires classiques. Ensuite, ils vont finir par projeter des commandos dont la mission consistera à organiser des campagnes terroristes sans nécessairement aller à l’assaut avec la mort à la clef. Pour cela, il leur faut des artificiers et organiser toute une logistique, c’est-à-dire s’installer sur notre territoire, acquérir tous les produits…
M. Pierre Lellouche. Vous vous souvenez du vol du dépôt militaire de Miramas, l’année dernière ? Des armements et des explosifs ont disparu. Savez-vous où ils se trouvent ?
M. Patrick Calvar. Non. Mais ils peuvent, de toute façon, fabriquer des bombes de manière artisanale, en achetant du nitrate d’ammonium par exemple. Rappelez-vous 1995. La pire catastrophe a pu être évitée grâce à un timer (minuteur) défaillant : à l’école juive de Villeurbanne, une voiture piégée avec une centaine de kilogrammes d’explosifs a sauté à un moment qui, contrairement à ce qui avait été programmé, n’était pas celui de la sortie des enfants. Sinon, c’eût été un massacre.
Nous savons très bien qu’ils vont recourir à ces modes opératoires : ils ont bien vu les effets provoqués par une opération massive. Ce qui s’est passé en Belgique résulte du fait que, coincés, ils ne pouvaient plus s’engager dans des actions multiples. Mais, encore une fois, dès qu’ils auront projeté sur notre territoire des artificiers, ils pourront éviter de sacrifier leurs combattants tout en créant le maximum de dégâts.
Ensuite, vous comprendrez que, sur le renseignement, je ne puisse pas vous répondre.
M. Pierre Lellouche. Évidemment.
M. le président Georges Fenech. Mais votre analyse repose tout de même sur le renseignement ?
M. Patrick Calvar. Oui. Ce n’est pas nouveau.
M. le président Georges Fenech. Nous en sommes bien convaincus.
M. le rapporteur. J’en reviens aux fichiers. Nous avons le sentiment qu’il en existe de nombreux dans la lutte antiterroriste, chacun possédant le sien – la gendarmerie, le renseignement territorial, la DGSI avec le fichier CRISTINA (centralisation du renseignement intérieur pour la sécurité du territoire et des intérêts nationaux)… Ne serait-il pas envisageable de disposer, à l’avenir, d’un fichier commun, à l’américaine, qui puisse être utilisé par l’ensemble des services ? C’est un peu la vocation du FSPRT mais il reste très cantonné. Nous avons assisté ce matin à une démonstration de ce dernier, et elle nous a paru assez convaincante alors que nous étions, au départ, assez critiques. Quel est votre avis sur la création d’un super-fichier ?
M. Patrick Calvar. Tous les individus que nous suivons sont inscrits au FPR où ils apparaissent avec une fiche S. Donc les services qui veulent se rapprocher de nous pour en savoir davantage peuvent le faire.
M. le rapporteur. D’où le fait que vous ne versiez pas au FSPRT tous les éléments en votre possession ?
M. Patrick Calvar. Il est clair que nous n’y mettons pas certains éléments : nous indiquons seulement qu’il s’agit d’objectifs que nous prenons en compte et nous protégeons impérativement l’information et la source de l’information puisqu’il s’agit d’un fichier de souveraineté – nous sommes tenus par le secret de la défense nationale.
M. le rapporteur. Nous avons effectué deux déplacements en province, à Lille et Marseille, où nous avons pu rencontrer vos collègues du renseignement pour lesquels – ils nous l’ont déclaré assez explicitement – le FSPRT n’est pas très fonctionnel, au contraire des gendarmes et du renseignement territorial qui le trouvent utile. Confirmez-vous qu’en la matière votre service aide plus qu’il n’est aidé par le FSPRT ?
M. Patrick Calvar. Il fallait faire passer le message que tout le monde était concerné et non quelques soi-disant spécialistes.
M. le rapporteur. Vous n’êtes donc pas favorable, si je comprends bien, pour des raisons de confidentialité, à l’établissement d’un fichier plus important, partagé avec d’autres services que ceux de l’Intérieur.
M. Patrick Calvar. Si, nous partageons des informations avec les services des douanes, avec TRACFIN dans le cadre de la cellule Allat. Ainsi, les 2 000 noms que j’ai précédemment évoqués ont-ils été diffusés à l’ensemble des services du premier cercle.
M. le rapporteur. Ce n’est pas du tout ce que nous avions compris, si je puis me permettre. Pouvez-vous nous expliquer brièvement ce qu’est la cellule Allat ? Nous avons l’impression que les six services du premier cercle, plus un ou deux autres, sont dans la même salle et que, en gros, quand un service est demandeur d’informations sur un individu, chaque service cherche dans sa base de données.
M. Patrick Calvar. Nous avons, au départ, donné l’ensemble des noms – les 2 000 concernés par les filières syro-irakiennes – afin qu’ils soient criblés par chaque service.
M. le rapporteur. Concrètement, quelle est la fréquence des réunions de la cellule Allat ?
M. Patrick Calvar. Il s’agit d’une cellule permanente et les représentants des services concernés se trouvent dans la même pièce. Par exemple, si l’un d’eux déclare s’intéresser à M. Untel, nous désignons un pilote et chacun lui apporte ensuite son concours.
M. le rapporteur. Considérez-vous que la cellule Allat comme la cellule Hermès obtiennent des résultats tangibles ?
M. Patrick Calvar. Oui, bien sûr. La cellule Allat est l’instance de coordination opérationnelle. Tous les renseignements sont dirigés vers le service pilote, à charge pour lui de poursuivre ensuite l’affaire avec ses moyens.
M. le rapporteur. Cette cellule se réunit donc au quotidien. Ceux qui l’animent travaillent-ils à temps plein ?
M. Patrick Calvar. Ils travaillent à temps plein et peuvent être mobilisés 24 heures sur 24 en temps de crise.
M. le président Georges Fenech. Pouvez-vous nous dire un mot du groupe antiterroriste (GAT) ?
M. le rapporteur. Et quelle est la différence entre le GAT et le club de Berne ?
M. Patrick Calvar. Le club de Berne, c’est autre chose : il ne regroupe pas toujours les mêmes acteurs et traite davantage de questions de souveraineté, d’espionnage. Le GAT, quant à lui, réunit l’ensemble des services de sécurité des pays membres de l’Union européenne ainsi que ceux de la Suisse et de la Norvège. Certains groupes de travail du GAT sont spécialisés, par exemple dans le problème syro-irakien.
L’échange au sein de ce groupe s’effectue en temps réel. Toutes les indications nominatives sont communiquées entre services. Des opérations peuvent être montées entre services selon une configuration bi ou multilatérale. Le GAT a une vocation opérationnelle. Au cours de séances élargies, sont invités le coordinateur européen pour la lutte contre le terrorisme, Gilles de Kerchove, le représentant du directeur d’Europol.
M. le rapporteur. Vous avez évoqué les 4 414 agents qui composeront votre service en 2018, parmi lesquels 17 % de contractuels. Rencontrez-vous des problèmes de recrutement, de formation, de fidélisation ? Les autres services de renseignement nous ont fait part de l’insuffisance d’arabisants parmi leurs agents ; qu’en est-il à la DGSI ?
Avez-vous des difficultés à rémunérer vos sources humaines ?
Enfin, dans la nuit du 13 au 14 novembre 2015, aviez-vous identifié les liens des terroristes avec la Belgique ?
M. Patrick Calvar. Nous ne rencontrons pas de problème majeur de recrutement dans le sens où nombreux sont ceux tentés de nous rejoindre. Le problème est davantage de déterminer ce dont nous avons besoin puis d’organiser des parcours de carrière. Enfin, il est surtout de faire en sorte que les gens travaillent en synergie et non en opposition.
Pour répondre à votre deuxième question, nous n’avons pas de problème pour financer les sources humaines.
M. le rapporteur. Comme les autres services, vous rémunérez les sources ?
M. Patrick Calvar. Bien sûr.
M. le rapporteur. Certains « spécialistes », dans les médias, ont considéré que nous avions sacrifié le renseignement humain au profit du renseignement technique. Vous avez déclaré qu’il ne fallait pas les opposer. Reste que, lors de notre visite en Turquie, l’importance des sources humaines de la DGSE nous a marqués. Qu’en est-il pour votre service ?
M. Patrick Calvar. La DGSI dispose d’un nombre très important de sources humaines.
M. le rapporteur. Aussi, pourrons-nous indiquer dans le rapport que, de votre point de vue, nous n’avons pas du tout sacrifié le renseignement humain au profit du renseignement technique ?
M. Patrick Calvar. En effet !
M. le rapporteur. C’est important, car nous l’avons beaucoup entendu.
M. Patrick Calvar. Soi-disant je suis un vétéran de la guerre froide et, pour ceux qui l’ignorent, je rappellerai que je me consacre à l’antiterrorisme depuis 1993. Je suis devenu un aficionado des nouvelles technologies – même si je n’ai aucun diplôme technique en la matière. En réalité, peu importe la méthode avec laquelle vous obtenez le renseignement. Ce qui compte ensuite, c’est votre capacité à l’analyser et à l’exploiter.
Il n’en est pas moins vrai qu’on ne peut pas, aujourd’hui, ne pas prendre en compte l’évolution du numérique. Nous devons donc investir en la matière. Vous verrez que l’évolution en cours posera demain de nombreux problèmes démocratiques tant s’élargira le fossé, déjà grand, entre les élites politiques et administratives et les élites scientifiques. On ne comprend pas la vitesse à laquelle va le progrès – même si les avancées de la médecine, par exemple, nous en donnent une idée. Vous verrez que les bouleversements seront profonds.
Mais, encore une fois, non, nous ne sacrifions absolument pas le renseignement humain, même si, dans certaines zones, vous aurez beaucoup de mal à en avoir. De même, il faut anticiper en matière d’interception et de déchiffrement. Nous aurons, un jour ou l’autre, un bras de fer avec les opérateurs et pas seulement les opérateurs américains – le principal réseau utilisé par les terroristes, Telegram, est russe. Je ne donnerai pas de chiffres, certes, mais je puis vous assurer que nous menons de nombreuses opérations avec des sources humaines. Seulement, nous préférons la confidentialité, du fait de notre culture du secret.
Pour ce qui est de la nuit du 13 au 14 novembre, nous avons immédiatement pointé la responsabilité d’Abaaoud du doigt.
M. le rapporteur. Mais, à 9 heures 10, la gendarmerie contrôle Salah Abdeslam. Les gendarmes sentent quelque chose et ils le retiennent un peu. N’y a-t-il pas eu, ce matin du 14 novembre, un problème de transmission d’informations ? N’aurait-on pu interpeller Salah Abdeslam en toute connaissance de cause ?
M. Patrick Calvar. Non, Salah Abdeslam était signalé comme appartenant au milieu de la délinquance mais n’ayant aucun lien avec le terrorisme. Les gendarmes n’avaient donc aucune raison objective de penser qu’il pouvait avoir un lien avec ce qui s’était passé à Paris la veille.
Par ailleurs, nous entretenons des relations très étroites avec les Belges avec lesquels nous coopérons depuis de nombreuses années.
M. le rapporteur. J’en reviens au nombre d’arabisants, votre service en manque-t-il ?
M. Patrick Calvar. Cette question commence à devenir un souci pour nous, car nous rencontrons des difficultés en matière d’habilitation : en tant que service de sécurité, nous faisons très attention à ne pas être pénétrés. Nous devons donc trouver des formules nouvelles pour pouvoir embaucher des gens dont nous soyons certains de la loyauté.
M. le président Georges Fenech. En matière de judiciarisation, quels sont les critères en fonction desquels vous considérez qu’il vaut mieux sortir du milieu fermé et judiciariser ? On a posé la question au procureur de Paris qui nous a expliqué que les relations étaient tout à fait bonnes entre son parquet et vos services. À la question de savoir s’il ne faudrait pas détacher en permanence des fonctionnaires de la DGSI au parquet antiterroriste, le procureur a répondu qu’une telle mesure ne lui paraissait pas nécessaire.
M. Patrick Calvar. Nous rencontrons régulièrement les représentants du parquet pour évoquer l’état de la menace. La décision de la judiciarisation est prise en commun, à moins que nous n’arrivions avec un dossier clés en main. Reste, j’y insiste, que nos relations avec le parquet de Paris sont très étroites.
M. le rapporteur. Au regard de ce que vous avez déclaré tout à l’heure, à partir de la mise en examen…
M. Patrick Calvar. C’est la loi.
M. le rapporteur. Précisément, pensez-vous, dès lors, qu’il faut continuer à approfondir votre travail pour éviter le déclenchement d’une procédure judiciaire ?
M. Patrick Calvar. Non, jamais. Et il faut savoir que le déclenchement d’une procédure judiciaire peut présenter de grands avantages : on peut, grâce aux perquisitions à domicile, pénétrer au cœur du problème.
M. le rapporteur. A contrario, après les attentats, n’avez-vous pas voulu judiciariser trop tôt ?
M. Patrick Calvar. Non. Nous devons traiter des informations aux conséquences immédiates.
M. le rapporteur. Pour vous, en janvier et en novembre 2015, a-t-il manqué quelque chose ?
M. le président Georges Fenech. Je compléterai cette question. Vous vous souvenez que le Premier ministre lui-même, après les attentats, avait déclaré qu’il y avait forcément eu des failles, jugement apparemment objectif. Les terroristes sont passés à l’acte en plein Paris, provoquant le plus grand nombre de morts depuis la Libération sur notre sol. Quel est votre sentiment quand vous lisez tous ces articles de presse sur « la faillite du renseignement », qui remettent en cause le travail de nos services ? Estimez-vous qu’il s’agit d’un procès d’intention, d’une injustice ? Ou peut-on, en effet, mieux faire ?
M. Patrick Calvar. Tout attentat est un échec puisque nous n’avons pas pu l’empêcher.
M. le président Georges Fenech. Le risque zéro n’existe pas.
M. Patrick Calvar. Ensuite, il faudrait organiser – ce que vous faites ici – des retours d’expérience sans esprit partisan ni polémique pour essayer de comprendre ce qui a marché, ce qui a moins marché, bref, pour réaliser une sorte d’autopsie.
Or nous sommes systématiquement confrontés à des attaques infondées, non documentées et mal intentionnées. Certains, certes, posent les vraies questions et il est normal que, dans une démocratie, on rende compte et qu’on essaie de progresser.
Les attentats de 2015 représentent un échec global du renseignement.
Il faut faire très attention au fait que les jeunes, dans mon service, vivent très mal qu’on puisse laisser des familles imaginer que leurs proches sont morts à cause d’incompétents. Il faut s’interroger sur la capacité de résilience de la société. Voilà qui vous interpelle en tant que politiques et qui nous préoccupe également : nous sommes supposés être responsables de tout. Et si vous créez un climat d’anxiété et de peur dans les services, c’est très dangereux : on peut être tenté par la fuite en avant ou l’abdication. Ce n’est pas le cas aujourd’hui, mais les personnels ont besoin d’un peu de soutien même si, je le répète, un attentat est un échec et même si nous devons, par conséquent, nous interroger sur les raisons pour lesquelles nous n’avons pas pu l’empêcher.
J’en reviens à mon image : on a l’impression que ce n’est pas la maladie qu’il faut guérir mais le médecin qu’il faut tuer. Or c’est le médecin qu’il faut mieux former sachant, comme vous l’avez souligné, que le risque zéro n’existe pas.
M. Jean-Luc Laurent. Ne pensez-vous pas qu’il faudrait créer un organisme d’évaluation et de la stratégie du renseignement, voire une autorité indépendante qui pousserait encore plus loin la réflexion ?
M. Patrick Calvar. Le renseignement a acquis des lettres de noblesse démocratiques. La loi relative au renseignement a donné sa légitimité à l’action, la délégation parlementaire au renseignement exerce son contrôle, ainsi que les commissions auxquelles vous appartenez.
Nous avons, pour notre part, tendance à superposer les structures, à les remettre en cause, à changer les procédures. Néanmoins, j’y insiste, nous avons accompli une vraie révolution depuis 2007.
Je ne crois pas à l’idée d’une commission indépendante. En France, nous avons la délégation parlementaire au renseignement, indépendante par nature puisqu’elle ne relève pas du pouvoir exécutif et qu’elle exerce le contrôle du pouvoir législatif sur les activités de renseignement. Nous sommes sans doute allés suffisamment loin dans la réforme et sa mise en œuvre, qui se poursuit, est loin d’être achevée. Il ne faut pas vouloir en permanence détricoter ce qui existe.
Ensuite, à chaque fois que quelque chose se passe, il convient de procéder à une analyse, j’y insiste, sans esprit polémique ou partisan. Or on a un peu de mal à le faire dans ce pays.
Il conviendra, à l’avenir, de rapprocher le monde académique du monde opérationnel. En effet, les difficultés que nous vivons ne seront pas résolues par les seuls moyens sécuritaires, aussi faudra-t-il mettre autour de la table des personnalités provenant d’horizons très divers afin que de leur dialogue se dégage une vision commune.
Voilà trente-neuf ans que j’exerce ce métier : je pense que l’Europe est en très grand danger ; on ne perçoit pas la montée de la colère et on ne voit pas venir l’affrontement entre communautés qui risque d’être brutal.
M. le président Georges Fenech. Nous vous remercions monsieur le directeur général.
Audition, à huis clos, de M. Louis Gautier, secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale (SGDSN)
Compte rendu de l’audition, à huis clos, du mercredi 25 mai 2016
M. le président Georges Fenech. Nous avons le plaisir d’accueillir, cet après-midi, M. Louis Gautier, secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale (SGDSN), accompagné du colonel Hervé de Courrèges, conseiller pour la protection et la sécurité de l’État, et du colonel Gwénaël Jézéquel, conseiller pour les relations institutionnelles.
Monsieur le secrétaire général, nous vous remercions d’avoir répondu à la demande d’audition de notre commission d’enquête relative aux moyens mis en œuvre par l’État pour lutter contre le terrorisme depuis le 7 janvier 2015. Nous avons déjà auditionné de nombreux représentants des forces armées, et nous entendrons la semaine prochaine le ministre de la défense. Je rappelle que le SGDSN est un service du Premier ministre qui assiste le chef du Gouvernement dans l’exercice de ses responsabilités en matière de défense et de sécurité nationale. Il est doté depuis 2009, conformément au Livre blanc sur la défense, de missions élargies, tout particulièrement en matière de sécurité. Nous allons vous interroger notamment sur votre mission de coordination opérationnelle et sur les moyens mis en œuvre pour sécuriser le territoire.
En raison de la confidentialité des informations que vous êtes susceptible de nous délivrer, cette audition se déroule à huis clos. Elle n’est donc pas diffusée sur le site internet de l’Assemblée. Néanmoins, conformément à l’article 6 de l’ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, son compte rendu pourra être publié en tout ou partie, si nous en décidons ainsi à l’issue de nos travaux. Je précise que les comptes rendus des auditions qui ont lieu à huis clos sont au préalable transmis aux personnes entendues afin de recueillir leurs observations. Ces observations seront soumises à la commission, qui pourra décider d’en faire état dans son rapport.
Je rappelle que, conformément aux dispositions du même article, « sera punie des peines prévues à l’article 226-13 du code pénal toute personne qui, dans un délai de vingt-cinq ans, divulguera ou publiera une information relative aux travaux non publics d’une commission d’enquête, sauf si le rapport publié à la fin des travaux de la commission a fait état de cette information ».
Conformément aux dispositions de l’article 6 précité, je vous demande de prêter le serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité.
M. Louis Gautier prête serment.
Nos questions peuvent être regroupées sous trois chapitres relatifs respectivement à l’opération Sentinelle, à la coordination opérationnelle et à la menace actuelle.
Tout d’abord, nous souhaiterions savoir ce qui a présidé au déclenchement de l’opération Sentinelle.
Combien d’interventions les militaires de l’opération ont-ils effectuées au cours de l’année 2015 ? Combien de fois ont-ils fait usage de leur arme à feu ?
Comment s’effectue la coordination de l’opération avec les forces de sécurité intérieure ?
Quels sont les outils de communication utilisés, ainsi que les outils de planification et de commandement ? Quels exercices communs ont été effectués ?
Quel bilan opérationnel tirez-vous de l’opération ? Quelle est la valeur ajoutée des armées dans la sécurisation du territoire national ?
Comment expliquez-vous que, le soir du 13 novembre, les militaires déployés à Paris aient disposé de si peu d’informations opérationnelles ? Comment améliorer le partage de cette information ?
N’aurait-il pas été plus pertinent de créer 10 000 postes supplémentaires au profit de la gendarmerie nationale, par exemple ?
Quelles sont les voies possibles d’amélioration ? Les savoir-faire des militaires pourraient-ils être mieux mis à profit ?
L’opération est-elle appelée à s’inscrire dans la durée ?
Quelles sont les règles précises d’engagement des soldats de l’opération et en quoi diffèrent-elles de celles des forces de sécurité intérieure ? Quelles sont les instructions précises données aux militaires ?
Enfin, quelles suites ont été données à votre rapport du 17 février 2016 relatif à l’engagement des armées sur le territoire national et à ses vingt-deux recommandations ?
M. Louis Gautier, secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale. Ainsi que vous l’avez rappelé, monsieur le président, le rôle du secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale est celui d’un architecte global en matière de sécurité, ses compétences dans ce domaine ayant été consolidées en 2009 dans le cadre des évolutions intervenues après le Livre blanc de 2008. Il joue également un rôle opérationnel dans les domaines de la sécurité informatique, avec l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI), et de la transmission gouvernementale, avec le Centre de transmission gouvernemental (CTG). Depuis cette année, le Groupement interministériel de contrôle (GIC) est rattaché organiquement au SGDSN. Pour le reste, l’essentiel de sa mission consiste à préparer et à suivre les décisions prises au niveau gouvernemental par le Premier ministre en matière de sécurité nationale et de défense et au Conseil de défense et de sécurité nationale, présidé par le chef de l’État. Au cours de l’année 2015, ce conseil a été activé à plusieurs reprises, notamment dans le cadre du suivi des décisions prises après les attentats.
Les postulats à l’origine de cette évolution ont été confortés par la crise de l’année 2015. En effet, en 2012, avec l’affaire Merah, les menaces et la dimension des répliques restaient encore de l’ordre de la sécurité intérieure. En revanche, à partir de 2015, après l’attaque contre Charlie Hebdo et l’Hypercacher et surtout après l’attentat du Bataclan, la réponse de l’État, que ce soit au plan international – frappes sur Raqqah – ou national – déploiement de l’opération Sentinelle, mutualisation du renseignement et coordination des chaînes de renseignement relevant de ministères distincts –, montre bien qu’une riposte d’ampleur nationale était nécessaire face à une menace qui avait évolué et qui relevait dorénavant de la sécurité nationale.
Cette menace, vous le savez, se caractérise notamment par le nombre des personnes à surveiller – je pense à celles qui peuvent être tentées de commettre des actes terroristes ou de rejoindre des théâtres de conflit –, par l’effacement de la frontière entre sécurité nationale et sécurité intérieure – par l’intermédiaire de ces réseaux et de ces filières, les théâtres de conflit ont un écho sur le territoire national, qui peut être ciblé – et par le passage à l’acte. Dans le passé, notre pays a été très souvent confronté à la menace terroriste, et peut-être, dans les années 1970 ou 1980, les sympathisants de certaines causes idéologiques extrêmes se comptaient-ils en milliers. Mais la situation actuelle diffère de celles que nous avons pu connaître en ce qu’elle se caractérise par l’aguerrissement, la fréquentation des théâtres de conflit, l’habitude de la violence, la brutalisation, la faculté de passage à l’acte des personnes radicalisées. Nous devons donc éviter non seulement que des personnes ne rejoignent les théâtres de conflit ou passent à l’acte, mais aussi que celles qui ont été en contact avec une idéologie et des individus violents ne s’engagent eux aussi dans une spirale terroriste.
On constate également une militarisation des actions : utilisation d’armes de guerre au Bataclan, attentats kamikazes à Bruxelles… Et d’autres types de menaces sont référencés dans une littérature suffisamment accessible, notamment sur internet, pour que l’on s’en alarme. Lors de ces actions, le but était non seulement d’exploiter les vulnérabilités de notre système de sécurité, mais aussi de saturer les dispositifs d’intervention et de secours. Il revient ainsi au SGDSN de pratiquer un audit systématique de tous les dispositifs de sécurité en tenant compte du caractère évolutif de la menace, et donc d’étudier l’hypothèse de scénarios qui seraient pires encore : attentats multiples, drones utilisés à des fins terroristes, attaque à l’explosif couplée à la dispersion de produits chimiques, etc.
Face à cette menace qui vise le territoire national dans son ensemble, comme en témoignent les nombreuses alertes ou les attentats que nous avons connus – je pense en particulier à ce qui s’est passé à Saint-Quentin-Fallavier –, il nous fallait procéder à une révision systématique de nos dispositifs, ainsi que de nos moyens d’intervention et de secours. L’année 2015 a ainsi été principalement consacrée à l’anticipation, à l’adaptation des mesures, à l’augmentation des moyens et à l’amélioration de la formation des personnels. Cette question est évidemment centrale. Il n’est, hélas, pas possible, face à ce type de menaces, de supprimer tout risque, notamment en raison du phénomène d’auto-radicalisation. Cependant, nous manquerions à nos responsabilités si nous ne réalisions pas un audit systématique de nos dispositifs de sécurité. C’est pourquoi le SGDSN a revisité, tout au long de l’année 2015, les grands cadres d’organisation de la réponse de l’État.
Parmi ceux-ci, je pense évidemment au plan Vigipirate, qui a montré ses atouts, en termes de réactivité et de mobilisation de l’ensemble des ministères, mais qui s’est trouvé très rapidement dans une situation de thrombose. Aussi réfléchissons-nous, en tenant compte des changements législatifs que vous êtes en train d’adopter, à ce que doit être le prochain plan après l’état d’urgence. L’opération Sentinelle, quant à elle, a été déclenchée pour répondre à un besoin, mais aussi à une demande de protection de nos concitoyens, certaines communautés étant directement l’objet de menaces. Nous avons par ailleurs amélioré le fonctionnement de la cellule interministérielle de crise et le dispositif de sécurité de ce que l’on appelle les activités d’importance vitale.
En ce qui concerne Vigipirate, les difficultés auxquelles nous avons été confrontés s’expliquent par le fait que nous avons été obligés de maintenir dans la durée une posture « alerte attentat » qui, initialement, impliquait une mobilisation très forte de l’ensemble des forces de sécurité mais sur une période limitée. De fait, le précédent plan – et c’est ce qui inspire toute ma réflexion – liait de manière trop étroite les niveaux de posture de Vigipirate et les effectifs, notamment parce que cela était en concordance directe avec les contrats opérationnels des armées et un contingentement extrêmement strict, dans les Livres blancs précédents, des effectifs que les armées devaient déployer sur le territoire pour protéger la population : 1010 hommes, en permanence, seulement.
Par ailleurs, en France, contrairement à ce qui se passe à l’étranger, les différentes postures se déclinent immédiatement, en fonction d’une planification de crise, en mesures juridiquement contraignantes. Ainsi, les renseignements indiquant que la menace restait à son maximum, nous avons prolongé la posture d’alerte attentat, qui avait été conçue comme le niveau maximal de déploiement des effectifs. Or, très vite, nous avons dû renoncer à appliquer toutes les mesures de contrainte applicables dans le cadre de cette posture.
Je rappelle que, après les attentats contre Charlie Hebdo et l’Hypercacher, le SGDSN a transmis au cabinet du Premier ministre, qui l’a d’ailleurs souvent cité, en juillet, un document intitulé « Le jour même », qui envisageait les mesures qu’il faudrait prendre immédiatement en cas d’attentat majeur. Ce sont ces mesures, parmi lesquelles figurait du reste l’état d’urgence, qui ont été appliquées : cellule de crise, activation de la cellule d’aide aux victimes, etc.
S’agissant de l’opération Sentinelle, le déploiement de ces effectifs militaires s’est fait d’abord sous le coup de l’urgence, en fonction des besoins ou des demandes de protection. Puis, au cours de l’année 2015, la réponse a été organisée et rationalisée. Lorsque l’on m’interroge sur la pertinence de ce dispositif, je fais deux réponses. Premièrement, on peut se demander, comme le disait le chef d’état-major des armées, ce que nos concitoyens auraient pensé des armées si, dans un tel contexte, celle-ci n’avait pas déployé davantage de militaires sur le territoire national pour assurer leur protection ? La seconde réponse est inspirée d’une comparaison internationale : tous les pays font appel aux capacités de renfort que sont les armées. Du reste, nous-mêmes avons toujours procédé ainsi, par le passé. Vigipirate n’est pas un document récent : il a été élaboré au début des années 1980 – à une époque où la conscription permettait d’impliquer plus facilement l’armée dans des missions de service public – et activé pour la première fois au moment de la guerre du Golfe.
Pourquoi se retourner vers les armées ? Parce que, à la différence des forces de sécurité intérieure, qui sont nécessairement réparties sur l’ensemble du territoire, les armées ont la possibilité de mobiliser des forces supérieures au millier d’hommes, qui est le niveau régimentaire. Le volume d’effectif des unités d’intervention de la gendarmerie ou des CRS est de l’ordre de la centaine. Par comparaison, la souplesse de commandement qu’offre ce gisement exceptionnel – adossé qui plus est à une structure, l’armée de terre, comptant plusieurs dizaines de milliers d’hommes – est au regard un élément déterminant.
Par ailleurs, il s’agit d’une mission très spécifique. Des inquiétudes se sont exprimées à ce sujet, mais, dans le cadre du travail mené au cours de l’année 2015, nous avons reprécisé que l’opération Sentinelle consistait bien à utiliser les armées pour une mission de protection, et non pour une mission de maintien de l’ordre public ou de police judiciaire. Et l’on a eu raison – alors que d’autres idées étaient présentes au début de la réflexion – de s’en tenir à cette conception assez limitative selon laquelle les armées, sur réquisition du pouvoir civil – ministre de l’intérieur ou préfets –, interviennent en appui des forces de sécurité intérieure.
M. Sébastien Pietrasanta, rapporteur. À ce propos, nous avons été marqués par l’audition des militaires de l’opération Sentinelle qui se trouvaient à proximité du Bataclan le soir du 13 novembre – mais nous y reviendrons. Vous affirmez que les armées doivent être exclusivement utilisées pour la protection. Pourtant, il me semble que, dans votre rapport d’évaluation de l’opération Sentinelle, vous préconisez d’équiper les militaires d’armes de poing. Pouvez-vous nous éclairer sur ce point ?
M. Louis Gautier. Le rapport s’en tient à la logique de la réquisition et de la mission de protection. Cependant, dans le cadre de cette mission, les militaires peuvent se trouver dans des situations d’urgence qui impliquent des réponses. C’est bien entendu le point le plus difficile à définir – cela renvoie du reste à leur formation et à la nécessité de préciser les règles d’engagement et les mandats des armées. Au départ, il était prévu de ne pas modifier l’équipement des militaires, pour ne pas compliquer leur entraînement. Actuellement, les officiers et les sous-officiers ont une arme de poing. Faut-il en doter également le caporal ou le caporal-chef qui guide une équipe de trois militaires ? La question n’a pas été définitivement tranchée, mais il nous semblait qu’elle devait être étudiée, car, dans certaines situations, notamment d’autoprotection, une arme de poing peut être plus facilement employable qu’un FAMAS.
M. le rapporteur. Vous évoquez l’emploi d’une arme de poing uniquement en cas de riposte. En aucun cas, les militaires de l’opération Sentinelle ne peuvent être des primo-intervenants ?
M. Louis Gautier. J’allais y venir. Dans notre rapport, nous avons préconisé une certaine harmonisation des règles de responsabilité pénale applicables aux militaires, aux gendarmes et aux policiers – c’est du reste la solution qui a été retenue par le législateur. Il est en effet possible que, dans certaines situations – qui ont été précisées, après un travail interministériel visé par le Conseil d’État et voté par le Parlement –, les militaires doivent intervenir pour faire cesser un péril imminent ou sa répétition, et non plus simplement en cas de légitime défense, cas qui avait initialement justifié une extension des dotations en armes de poing.
S’agissant de Sentinelle, il y a eu deux phases de réflexion dans la conduite des travaux interministériels. La première phase est celle d’une décantation interne aux armées. Pour celles-ci, il s’est agi d’un bouleversement quasi historique, puisque, à cause de l’opération Sentinelle, la mission nationale a retrouvé, par rapport aux opérations extérieures, une prévalence qu’elle n’avait plus depuis vingt ans. En 2015, 8 000 soldats étaient déployés sur le territoire national pour Sentinelle, soit davantage qu’en opérations extérieures. Lorsque l’on examine l’évolution de la doctrine militaire, on constate que la mission des armées, hormis la dissuasion, consiste dans la projection extérieure, laquelle implique une réduction de leur empreinte au sol en raison de la réduction des effectifs, de la fin de la conscription et de la constitution de bases de défense. L’armée retrouve ainsi, avec l’opération Sentinelle, une sorte d’empreinte territoriale, un ancrage, un contact avec la population, qui avaient tendance à disparaître.
Cette réappropriation, qui a été surtout essentielle pour l’armée de terre – et qui a pu faire débat, certains craignant que la mission de protection intérieure ne la détourne de ses autres missions, notamment extérieures – cette réappropriation, disais-je, a d’abord permis de retrouver un équilibre entre les trois armées. De fait, l’armée de l’air et la marine continuaient à remplir quotidiennement une mission de sécurisation du territoire à travers la protection des approches maritimes et la sûreté aérienne. On avait craint, au départ, que cela ne provoque une désorganisation, y compris doctrinale, mais un effort de travail interne aux armées a permis de retrouver une forme de cohérence. Certes, la mission de protection du territoire national est présente dans tous les Livres blancs, mais elle était devenue de facto résiduelle puisqu’en raison de la réduction du format de l’armée de terre et de la rétractation de sa présence territoriale, cette dernière était de moins en moins appelée à participer à des missions de service public que dans les années 1970 ou 1980.
La question s’est ensuite posée de savoir si, au sein des armées, un certain nombre d’unités, de régiments, devaient se spécialiser dans l’accomplissement de cette mission. La réponse a été négative, même si dans les faits, certaines unités ont été davantage mises à contribution que d’autres. Il s’agissait d’une situation temporaire, car la remontée du format de l’armée de terre permettra de retrouver une forme d’harmonisation. Aussi les arbitrages qui ont été rendus ont-ils été, me semble-t-il, les bons : il a été décidé que l’opération de protection territoriale serait accomplie à tour de rôle par les unités, de sorte que les militaires l’intégreront à leurs autres missions, notamment celle de projection extérieure.
N’oublions pas que, dans le cadre de ses interventions extérieures, l’armée de terre assure bien souvent la protection des populations, avec également les mêmes réserves quant à l’usage des armes. Ainsi l’armée de terre a-t-elle fait le choix, au départ, de privilégier l’homogénéité, en considérant que le FAMAS, le bâton et la bombe lacrymogène étaient un équipement suffisant. Puis elle a évolué, estimant – au départ, je le répète, pour des raisons liées à la légitime défense – que la dotation en armes de poing pouvait être utile ; nous l’avons suivie dans cette évolution. Se pose alors la question de la participation éventuelle des militaires à une intervention en tant que premiers arrivés – j’y reviendrai.
À partir de l’attentat du Bataclan, les interrogations liées à l’utilisation de l’opération Sentinelle – je pense à la présence des militaires pour sécuriser Saint-Denis ou à proximité du Bataclan – proviennent essentiellement du ministère de l’intérieur. Par ailleurs, une réflexion sur les moyens de sécurité intérieure a conduit Bernard Cazeneuve à annoncer, en avril, une réforme importante s’agissant des forces d’intervention. Nous avons en effet appris de l’attentat du Bataclan que face aux modes d’action des terroristes nous n’avions pas le temps de la préparation, de sorte que, si nous voulions sauver le plus grand nombre possible de vies humaines, il fallait que les moyens d’action qui arrivent en premier sur les lieux interviennent en premier, quelle que soit la chaîne d’appartenance ou la territorialisation. D’où la nécessité d’être en mesure de dépêcher très promptement, dans n’importe quelle partie du territoire, une force capable d’intervenir et formée pour cela : RAID, GIGN, BRI, mais aussi la BAC et des Pelotons de surveillance et d’intervention de la gendarmerie (PSIG).
Dès lors, la question s’est posée de savoir si et comment les militaires pourraient intervenir. Ce point a été très récemment abordé avec le GIGN et les commandos de marine à propos du terrorisme maritime. Dans ce cas, la logique veut que les forces qui sont en situation de réactivité puissent intervenir, l’arbitrage étant rendu par les autorités chargées de la sécurité – ministre de l’intérieur et préfet – qui tiendront compte de la zone, territoriale ou portuaire. Nous travaillons donc pour que la réactivité puisse être densifiée au maximum en fonction des forces disponibles.
M. François Lamy. Dans mon dernier rapport budgétaire sur l’armée de terre, qui date du mois d’octobre dernier, c’est-à-dire avant les attentats du 13 novembre, je m’interrogeais sur l’utilité de l’opération Sentinelle ; aujourd’hui encore, je suis perplexe. Certes, on peut dire que les bâtiments protégés par l’armée n’ont pas été la cible d’attentats, mais personne n’est en mesure de démontrer que la présence des militaires a été dissuasive. Au demeurant, les services de renseignements ne nous ont pas avertis d’un projet d’attentat visant tel ou tel établissement cultuel. Quoi qu’il en soit, on peut se dire, au vu du rapport entre le nombre des forces mobilisées dans le cadre de cette opération et leur utilité, qu’il faudrait pouvoir redescendre en puissance afin que chacun reprenne son rôle, d’autant que, selon le chef d’état-major des armées, d’autres opérations extérieures ne pourraient être actuellement engagées faute d’effectifs.
J’ai bien entendu vos arguments, monsieur le secrétaire général, mais les armées se trouvent dans une situation qui les conduisent – et vous-même aussi d’ailleurs – à refabriquer la doctrine. Vous nous avez ainsi expliqué que l’armée de terre retrouvait son empreinte, de sorte qu’un rééquilibrage s’était opéré avec la marine et l’armée de l’air. Mais ces théories ont été conçues après le déploiement de 10 000 hommes sur le terrain. Quelle serait la valeur ajoutée des armées si de nouveaux attentats se produisaient ? Je n’en vois pas. En revanche, je sais quelle est l’utilité des militaires pour faire la guerre – à l’intérieur ou à l’extérieur –, qui est tout de même leur véritable métier.
M. Louis Gautier. Je retiens un point, celui de la réversibilité des dispositifs. Comme je l’ai indiqué, les armées sont les seules à pouvoir générer rapidement un effectif important de forces, pour la mission de protection. Si l’on pousse votre raisonnement jusqu’à l’absurde, il n’y aurait donc rien à opposer en cas d’urgence, car, si l’on avait créé des postes de gendarmes ou de policiers, on aurait dû, compte tenu de l’organisation de leur carrière, progressivement les répartir et les diluer sur l’ensemble du territoire. Ou alors il aurait fallu créer des unités de gendarmerie mobile ou de CRS chargées exclusivement de ces missions, ce qui n’aurait pas de sens.
M. François Lamy. Ou une force spécialement dédiée à la protection.
M. Louis Gautier. Mais si cette mission monotone, répétitive – je reviendrai sur son intérêt –, est supportable par les armées, c’est précisément parce que ce n’est pas la seule : un soldat peut se rendre en Nouvelle-Calédonie, passer quatre semaines à Paris ou à Lyon dans une posture Vigipirate, puis repartir au Mali. Au départ, on a évidemment paré au plus pressé, car, dans une telle situation, l’État doit être en mesure d’apaiser les inquiétudes de la population. L’opération Sentinelle a donc été une manière de répondre à cette attente – de toute façon, il n’y en avait pas d’autres. Ensuite, nous avons adapté le dispositif : mieux vaut, pour un militaire, faire des gardes dynamiques ou du périmétrage de zone autour d’aéroports. On peut également convaincre les responsables de certains sites de se doter de moyens d’autoprotection en faisant appel à des sociétés de sécurité privée. En tout état de cause, n’oublions pas une chose : ces militaires – et on le voit bien aujourd’hui – relèvent les forces de police et de gendarmerie, qui doivent également préparer l’Euro et assurer l’ordre public. L’idée demeure donc que l’armée est bien une force de recours, de soutien.
Par ailleurs, on peut imaginer que, dans l’urgence, la protection d’une frontière, un barrage routier ou un filtrage de foule puissent être assurés par les militaires, sans changer pour autant leurs pouvoirs ou leurs compétences : cela n’implique pas qu’ils exécutent une mission judiciaire. Je prends un exemple. Si l’on veut réaliser un tri à l’entrée d’une manifestation en demandant aux personnes qui s’y rendent de présenter une pièce d’identité, les militaires peuvent s’assurer que ceux qui refusent de présenter ce titre ne passeront pas. Ils peuvent servir de soutien dans ce type de mission qui repose habituellement uniquement sur les forces de sécurité. En outre, il revient toujours aux armées, parce qu’elles disposent d’un certain nombre de moyens propres – équipement, capacité de projection, soutien logistique – d’intervenir dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, mais aussi en cas de catastrophes – on l’a vu lors de l’accident de l’avion de la Germanwings.
L’arrêt des déflations augmente la capacité qu’a l’armée de terre de remplir toutes ses missions, non seulement la lutte contre le terrorisme, mais aussi les missions de service public, qui étaient devenues de plus en plus problématiques, notamment en cas de catastrophe. Rétrospectivement, à condition d’en avoir amélioré l’usage et d’avoir mieux spécifié ses missions – des gardes dynamiques plutôt que des gardes statiques –, on retrouve une justification à l’emploi des armées sur le territoire national. Bien sûr, on peut dire que cette justification est fournie ex-post, y compris au plan doctrinal. Mais pourquoi s’en plaindre puisque la cohérence est trouvée ? De toute façon, il fallait apporter une réponse dans l’urgence. Les travaux interministériels ont permis de consolider cette décision et de mieux adapter encore l’emploi des forces militaires au soutien des forces de sécurité intérieure.
M. Christophe Cavard. En ce qui concerne la place des forces armées dans le dispositif général, je souhaiterais que vous nous donniez votre point de vue sur la coordination des ordres. Nous savons en effet que les militaires n’agissent que sur ordre de leur hiérarchie. Or, sur un théâtre opérationnel, peuvent être présents des officiers de police ou de gendarmerie.
Ma deuxième question porte sur vos missions. Vous avez évoqué une réflexion sur les différents types d’attaques possibles : attaques chimiques, attaques aériennes… L’ensemble du dispositif vous paraît-il adapté à ces risques – je pense notamment au transport ferroviaire ?
Enfin, en ce qui concerne le secret-défense, certaines notes ne sont actuellement accessibles qu’à un certain nombre de personnels habilités. Or il paraît nécessaire, dans certains cas, de fluidifier l’information.
M. Philippe Goujon. On a le sentiment que l’emploi des forces de police et de gendarmerie et des forces militaires dans le cadre des différents plans a atteint son maximum. Cette situation n’est certainement pas durable, surtout si l’état d’urgence est maintenu et que la menace terroriste persiste. Ne pensez-vous pas qu’il faudrait établir différents niveaux de mobilisation ?
En ce qui concerne l’opération Sentinelle, l’armement des militaires est-il parfaitement adapté aux missions de garde statique en ville ? Je remarque en effet qu’à Paris, la moitié des gardes sont encore statiques.
Enfin, lors de l’Euro 2016, de nombreuses missions de surveillance relèveront d’agents de sécurité privée, même si le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a fait sur ce point des observations plus ou moins désagréables. Or il se trouve que, lors des Jeux olympiques de Londres, les agents de sécurité privée ont été totalement défaillants, de sorte qu’ils ont dû être remplacés en urgence par les militaires – 3 000 ou 4 000 hommes ont été mobilisés. Ce type de solution est-il envisagé dans le cas où les agents de sécurité privée seraient incapables de remplir correctement leurs missions durant l’Euro ?
M. François Lamy. Je souhaiterais compléter ma question, car je n’ai pas été totalement satisfait par votre réponse, monsieur le secrétaire général. Il est en effet logique que, dans l’urgence, les autorités politiques aient répondu à l’inquiétude de la population en lançant l’opération Sentinelle. Mais qu’en est-il quinze mois après ? Le dispositif a certes évolué : il mobilise un peu moins d’hommes. Cependant, les armées ont re-fabriqué une doctrine a posteriori. À ce propos, le chef d’état-major des armées ne dit pas tout à fait la même chose que vous : selon lui, intervenir en Centrafrique ou en Libye et surveiller une synagogue, c’est le même métier. Or ce n’est pas vrai. Je crois d’ailleurs me souvenir qu’au temps de la conscription, ce sont les appelés qui surveillaient les bases aériennes et les bâtiments.
J’en viens à ma question. Nous savons que le niveau de la menace demeurera élevé pendant des années, voire des décennies. Si, demain, une nouvelle série d’attentats se produit, les Français attendront que les responsables politiques fassent quelque chose de plus. Or on ne le pourra pas. Au demeurant, ils finiront par s’interroger sur l’efficacité de la présence des militaires s’ils s’aperçoivent que cette présence n’empêche pas la commission d’attentats. La décision est d’ordre politique, mais ne faudrait-il pas envisager de basculer, à un moment donné, d’un dispositif vers un autre afin de redonner aux armées – qui, au passage, auront vu réduire la déflation de leurs effectifs – la possibilité de se concentrer sur leurs autres missions ?
M. Louis Gautier. Je répondrai tout d’abord à M. Lamy. Ce qu’a voulu dire, me semble-t-il, le chef d’état-major des armées, c’est que, d’un point de vue militaire, la nature de la mission est sa préparation sont les mêmes, que l’on protège une église orthodoxe dans une zone albanophone du Kosovo ou une synagogue à Paris. De fait, les militaires exercent également, et ils y sont formés, des missions de protection en opération extérieure.
Par ailleurs, sur la réversibilité, nous sommes d’accord. Notre souhait n’est pas de maintenir systématiquement 10 000 hommes sur le terrain. Du reste, à certaines périodes, durant l’année 2015, nous sommes redescendus en dessous de ce chiffre, de façon à permettre aux soldats de retrouver un peu de disponibilité. Toutefois, cela dépend en partie de l’appréciation politique de la menace. Or, actuellement, force est de constater que, compte tenu du retour d’individus dont on ne connaît ni les intentions ni les relais en Europe, cette menace reste sérieuse. En outre, les circonstances sont particulières puisque nous nous préparons à accueillir l’Euro 2016. Les difficultés ont toujours existé dans ce domaine. C’est d’ailleurs pour cette raison que l’on a supprimé les couleurs associées aux différents niveaux du plan Vigipirate, car, lorsque l’on arrivait au rouge écarlate, cela soulevait toujours une difficulté politique. En tout état de cause, l’arrêt des déflations a été décidé pour se donner une souplesse par le haut.
Nous ne pourrions pas aller plus loin, dites-vous. Si ! Si la situation l’exigeait, je ne vois pas pourquoi nous ne mobiliserions pas 15 000 hommes, par exemple, dans le cadre de l’opération Sentinelle. Bien sûr, cela impliquerait des arbitrages capacitaires au plus haut niveau. Mais la protection est une mission des armées parmi d’autres, et rien n’indique qu’elle est plafonnée à ce qui est aujourd’hui prévu dans le contrat d’emploi protection des armées.
Si la situation l’exigeait, il faudrait modifier le contrat. Cela signifie, certes, que d’autres opérations ou missions ne pourraient pas être assurées comme elles le sont aujourd’hui.
L’opération Sentinelle est aujourd’hui calibrée à 10 000 hommes, ce qui permet à la fois d’assurer, avec une réversibilité souhaitable, la mission telle qu’elle est définie sur le territoire national, de conserver des forces de souveraineté et d’assurer des opérations extérieures.
M. le rapporteur. Si nous le devions, serions-nous capables, en l’état actuel de nos forces, d’intervenir demain en Libye ?
M. Louis Gautier. Il est vrai que nous traversons actuellement une période de tension liée à l’activité opérationnelle menée à la fois sur des théâtres extérieurs et sur le territoire national. Si la France devait participer à une autre opération, des choix s’imposeraient – mais c’est toujours le cas. N’oubliez pas que le format des armées tel qu’il était prévu en programmation envisageait la disparition de 19 000 effectifs ! Si la décision n’avait pas été prise d’alléger les déflations et d’augmenter la dotation de l’armée de terre, notamment la force d’action terrestre, qui doit compter à terme 10 000 hommes de plus, la contrainte serait extrêmement forte et impliquerait de dégrader les autres missions. Tel n’a pas été le cas, puisque la modification du contrat opérationnel de protection débouche sur une révision du format des armées.
J’en viens aux autres questions. Je vous transmettrai un tableau qui retrace l’ensemble des mesures prises depuis 2012 et après 2015 dans divers domaines. Je pense, par exemple, à la question des drones, au criblage ou aux points d’importance vitale classés Seveso, dont le Premier ministre vient de décider d’augmenter le périmètre. Le domaine maritime était un angle mort en matière de protection. Des contrôles ont donc été organisés, notamment des fouilles de véhicules sur les ferries à destination de la Corse, de l’Algérie ou de l’Angleterre. Ce travail est accompli dans tous les domaines, y compris dans le transport ferroviaire qu’a évoqué M. Cavard. Ensuite, des arbitrages sont nécessairement rendus. Mais ce qui ne serait pas acceptable, c’est qu’un tel diagnostic n’ait pas été posé, que les failles n’aient pas été identifiées et comblées lorsque c’est possible.
Nous accomplissons ce travail en nous fondant sur les signalements et les informations que nous transmettent les services de renseignement sur la nature de la menace. S’agissant de la menace chimique, il est de la responsabilité du SGDSN de veiller à l’application du contrat interministériel de protection. Nous avons ainsi passé des commandes en urgence, rectifié un certain nombre de situations, mis sous tension les différentes chaînes : protection civile, services de santé, équipement des forces d’intervention... Ce travail peut être très conséquent, mais il nous incombe de le faire de manière systématique.
Au moins bénéficions-nous, en France, d’outils de planification. En outre, cette catégorie un peu à part que forment les opérateurs d’importance vitale, qui n’existe pas dans les autres pays, nous permet d’avoir des relais favorisés avec la SNCF, Aéroports de Paris, EDF, etc. Nous pouvons ainsi, par l’intermédiaire des hauts fonctionnaires de défense et de sécurité présents dans les grandes chaînes ministérielles, établir des diagnostics avec les opérateurs et les industriels et discuter avec eux de leur niveau de protection et de son éventuel renforcement. Dans le domaine du transport aérien, par exemple, nous nous sommes occupés, avec la Direction générale de l’aviation civile (DGAC), du contrôle des vols entrants ou de la sécurisation des aéroports dans les pays qui sont des destinations touristiques prisées des Français. Au cours de l’année 2015, les adaptations ont été recherchées dans tous les grands secteurs.
Par ailleurs, vous avez évoqué, en creux, la problématique de la résilience et de la prévention. Le SGDSN est en bout de chaîne entre les administrations et l’échelon politique gouvernemental. Élaborer des plans Vigipirate à destination des préfets, c’est très bien, mais, depuis les attentats du Bataclan, les demandes appellent des réponses extrêmement concrètes. On l’a vu récemment, par exemple, lorsque certains proviseurs se sont demandé s’il fallait continuer d’imposer aux élèves de fumer à l’extérieur des établissements. Nous avons répondu rapidement à ces demandes, notamment en lançant des campagnes de prévention – affichage, distribution de guides… – même si, au départ, cela a suscité quelques interrogations. Ce sont les directeurs de théâtre, de cinéma, d’école ou les responsables d’association sportive qui en ont fait la demande à l’État. Nous y avons répondu, SGDSN et SIG conjointement.
La menace risque de perdurer plusieurs années. Elle implique donc l’apprentissage par nos concitoyens des réactions appropriées et des gestes qui sauvent. Par ailleurs, nos systèmes d’alerte dataient du XIXe siècle. Nous sommes donc en train de créer, avec la Direction générale de la protection civile, une application mobile qui permettra à ceux qui l’auront téléchargée de savoir, en cas de crise ou d’urgence, où il ne faut pas se rendre, quelle est la ligne de métro qu’il ne faut pas emprunter, où sont les hôpitaux les plus proches, etc. Tout cela me semble répondre aux attentes de la population. Il est également important que la menace puisse être signalée. Or on sait bien que, comme en matière de radicalisation, la remontée des signaux faibles passe par la formation de ceux qui sont en bout de chaîne.
Par ailleurs, les Britanniques, dont je rappelle qu’ils ont été confrontés durant de longues années au terrorisme irlandais, ont maintenu un dispositif équivalent à l’opération Sentinelle qu’ils appellent « Opération Temperer » et qui mobilise 5 100 soldats pendant une durée d’au plus 14 jours. Presque tous les pays recourent à leurs armées pour faire face à des situations exceptionnelles et alléger le travail des forces de sécurité.
Quant au rééchelonnement des plans, nous nous employons à ce que le plan Vigipirate nouvelle formule prenne le relais de l’état d’urgence, en tenant compte de la récente modification de notre droit – je pense à la loi sur le renseignement ou à celle qui concerne l’action des forces de police. Ce plan comportera trois postures : une posture de vigilance, une posture de vigilance renforcée – qui ont toutes deux vocation à être permanentes et pour lesquelles les niveaux de déploiement militaire ne doivent pas être figés, de manière à permettre la réversibilité –, et une posture « Urgence attentat » ou « Alerte attentat », qui doit être momentanée et permettre d’imposer, pendant un court laps de temps, une série de mesures de contrainte. Au moment de l’assaut de Saint-Denis, par exemple, la posture « Alerte attentat » signifiait notamment que le trafic routier pouvait être interrompu et que les activités périscolaires étaient interdites.
Comment mieux coordonner les ordres ? Cette question a fait l’objet d’une double réflexion. Au sein du ministère de la défense, tout d’abord. Je rappelle en effet que, si la planification de la mission de l’opération Sentinelle et de ses objectifs est définie par le ministère de l’intérieur et le préfet de zone, la planification de ses moyens, quant à elle, relève de l’état-major. S’est donc toujours posée, en particulier à Paris, la question de l’ajustement entre ses deux chaînes de planification afin d’améliorer l’adéquation entre les missions et les moyens. Ainsi le préfet de police de Paris a-t-il proposé un système de sectorisation, d’îlotage, qui a permis d’alléger la charge de travail des militaires d’environ soixante-dix gardes statiques.
Le premier travail a été réalisé, je le disais, au sein des armées. En effet, dans le cadre de l’ancienne mission de protection, la nécessité d’impliquer les échelons d’encadrement intermédiaire n’avait pas été suffisamment perçue. Pour les lieutenants et les capitaines, leur place au cœur de la mission n’était pas claire : la patrouille est menée par un caporal-chef ou un sergent et le contact avec les élus locaux, le préfet ou le commissaire de police est pris par un officier supérieur. Il a donc été décidé – et je pense que le général Bosser vous le confirmera – de réengager les chefs de proximité, de façon à mieux les former à la mission, à mieux baliser les règles d’engagement et à les impliquer davantage sur le terrain. Ainsi, ce sont eux qui prennent désormais contact avec les responsables du site d’accueil et les commissariats de police ou les brigades de gendarmerie.
M. Christophe Cavard. Je me permets de vous interrompre. Nous avons auditionné les militaires qui, le soir du 13 novembre, étaient présents près du Bataclan. Leur officier – l’intermédiaire dont vous parlez – s’est rendu place de la République pour essayer de maîtriser un peu mieux ce qui se passait. Mais il nous a indiqué que les ordres passaient au-dessus de sa tête.
M. Louis Gautier. Vous avez parfaitement raison. C’est pourquoi, tout au long de l’année 2015, nous avons travaillé sur le retour d’expérience. Encore une fois, l’opération Sentinelle a été déclenchée dans l’urgence, et nous avons constaté des défectuosités. C’est précisément ce à quoi le chef d’état-major de l’armée de terre entend remédier en rétablissant cette hiérarchie intermédiaire qui était insuffisamment impliquée et intégrée à la chaîne d’information. Il est très important de rétablir le bon niveau de contact des cadres dans le suivi de ces missions. Il a également fallu résoudre d’autres problèmes, beaucoup plus concrets. Par exemple, les systèmes de communication n’étaient pas interopérables ; des mesures ont donc été prises également dans ce domaine. Il est en partie de la responsabilité du SGDSN de faire apparaître les dysfonctionnements et les problèmes rencontrés, pour y apporter le plus rapidement possible les solutions adéquates.
M. Christophe Cavard. Je souhaiterais vous entendre sur la question du secret-défense. De fait, un certain nombre des personnes qui interviennent, notamment les militaires qui sont sur le terrain, n’ont pas accès à certains documents qui pourraient leur être utiles.
M. Louis Gautier. Il y a plusieurs types de renseignements. Le renseignement de terrain doit être protégé mais n’a pas vocation à être classifié ; je pense aux plans d’accès, par exemple. En revanche, les informations relatives à l’état de la menace ou à l’existence d’un réseau resteront toujours confinées à ceux qui ont des raisons de les connaître. Mais, là encore, les chaînes intermédiaires sont importantes, car les soldats qui sont sur place doivent pouvoir comprendre la mission qui leur est confiée, notamment les raisons pour lesquelles tel site doit faire l’objet d’une protection. Par ailleurs, dans l’urgence, en cas d’alerte, l’information doit circuler entre les capitaines et les commissaires de police, notamment. Cela, ce sont les retours d’expérience du Bataclan et de l’assaut de Saint-Denis qui nous l’ont appris. Les choses ont forcément été difficiles, car, lorsque vous faites apparaître des ratés, vous isolez des responsabilités. Ce qui est important, c’est de parvenir à combler les failles une fois qu’elles ont été repérées. Du côté de l’armée, la décision qui a été prise est la bonne. Quant aux décisions interministérielles concernant notamment les communications, elles ont également été prises. Par ailleurs, les problèmes, internes aux armées, liés au transport, à l’autoprotection ou à l’hébergement des soldats sont en passe d’être résolus.
M. le président Georges Fenech. Tout ce que vous avez dit est très utile, mais, pour être très concret, je souhaiterais revenir sur la présence de la force Sentinelle au Bataclan. Les policiers de la BAC nous ont dit qu’ils s’étaient retrouvés sous les tirs nourris d’un des trois terroristes qui se trouvait, armé d’une kalachnikov, dans l’impasse Amelot. Dotés uniquement d’armes de poing, ces policiers n’ont pas pu soutenir cet échange de tirs. Ils se sont alors adressés spontanément aux membres de la force Sentinelle qui étaient présents pour leur demander d’intervenir, et même, puisqu’ils ont reçu une réponse négative à cette première demande, de leur prêter leurs armes, ce qui leur a été également refusé. Certes, les militaires n’ont fait qu’appliquer le règlement. Mais l’on peut imaginer que la force militaire, qui est dotée de l’armement adéquat, aurait pu neutraliser ce terroriste.
Les retours d’expérience ont-ils fait évoluer la doctrine sur ce point ? Que se passerait-il aujourd’hui ?
M. Louis Gautier. Ce sujet est le plus complexe : qui donne l’ordre ? Quelles sont les règles d’engagement ? Quelle était la responsabilité ? Tout d’abord, nous avons répondu à une question essentielle, puisque, auparavant, le droit n’autorisait le militaire à user de son arme que lorsqu’il se trouvait en situation de légitime défense. Sur ce point, la doctrine a évolué et le droit aussi. Ensuite, se pose la question des règles du feu et d’engagement : c’est à la hiérarchie militaire de les fixer précisément, en fonction des conditions et des circonstances. Enfin, l’ordre de feu ne peut être donné que par l’autorité civile, un commissaire de police, par exemple, s’il n’a pas d’autres moyens à sa disposition ou s’il considère, dans une situation d’urgence absolue, qu’il doit agir immédiatement. Vous comprenez combien ces questions sont sensibles.
Si l’on examine les statistiques d’autres pays, on s’aperçoit qu’en France, et c’est heureux, la tradition qui prévaut en matière d’usage des armes a permis de limiter grandement le nombre des bavures. Il faut trouver un équilibre et, cet équilibre, on le trouve forcément sur le terrain.
M. le président Georges Fenech. La réflexion est-elle en cours sur ce sujet ?
M. Louis Gautier. Oui, c’est en cours d’élaboration. Il revient aux autorités militaires d’expliquer plus précisément les règles d’ouverture de feu et, dans une situation donnée, il revient à l’autorité civile, notamment au préfet, de définir un cadre exact, compte tenu des circonstances, en donnant l’autorisation à tel ou tel d’ouvrir le feu. Désormais, ce cadre est le même, dans une situation d’urgence, que pour les forces de douane, de police ou de gendarmerie. Le code pénal s’applique à tous de façon identique.
M. Christophe Cavard. Pour être précis, si on lui tire dessus, le sergent qui est sur place n’attend pas un ordre : il riposte – mais, en l’espèce, il était à l’extérieur du Bataclan. Les policiers de la BAC, eux, ont décidé, sans en avoir reçu l’ordre, d’intervenir également à l’intérieur de la salle. Les militaires n’entrent pas, sauf si l’autorité hiérarchique de l’armée leur en donne l’ordre. Si je vous comprends bien, un commissaire de police pourrait demander aux militaires de l’opération Sentinelle de l’accompagner à l’intérieur du Bataclan. Est-ce bien cela ?
M. Louis Gautier. Si le pouvoir civil a requis la force militaire et a fait parvenir cet ordre par la chaîne militaire et la chaîne policière, cela se passera ainsi.
M. le président Georges Fenech. Le préfet était injoignable, à ce moment-là !
M. Louis Gautier. Une réflexion est en cours sur ce sujet. L’instruction interministérielle relative à l’engagement des armées sur le territoire national (IG 10100), qui concerne l’emploi des armées sur le territoire national, sera entièrement refondue cette année, en tenant compte notamment des conclusions de votre commission d’enquête. Des instructions destinées aux préfets sont également en cours d’élaboration au ministère de l’intérieur pour préciser les modalités, les conditions et le cadre dans lesquels la force militaire doit être requise.
M. le président Georges Fenech. Dans quels délais cette élaboration peut-elle être finalisée ?
M. Louis Gautier. C’est une question de semaines. Je rappelle que les règles d’engagement de feu, pour un militaire, relèvent de sa chaîne hiérarchique. Les militaires sont une force de protection. La question est très difficile, car il faut être très prudent dans la manière dont on fige les choses. Une appréciation est faite dans l’urgence, qui peut être très particulière en raison des circonstances exceptionnelles. Mais la règle, et il est important qu’elle soit précise et sûre, c’est que les forces d’intervention sont les forces de sécurité intérieure. Ce n’est que dans des circonstances très exceptionnelles et selon des règles d’engagement de feu qui ont été précisées par la hiérarchie militaire que les choses se font.
M. le rapporteur. Imaginons que des soldats de la force Sentinelle soient confrontés, au cours d’une garde dynamique, à une opération terroriste, dans un supermarché par exemple. Interviennent-ils ? Aujourd’hui, la réponse est non. Qu’est-il envisagé à ce sujet dans la réflexion qui est en cours ?
M. Louis Gautier. Les choses sont compliquées. Les instructions ministérielles et l’IG 10100 doivent réduire au maximum la zone d’incertitude et repréciser les règles. Dans une situation d’urgence, il faut également mesurer les risques que représente l’intervention de personnes qui n’y sont pas préparées parce que ce n’est pas leur mission. C’est pourquoi j’évoque, à ce propos, des circonstances exceptionnelles et l’urgence.
M. le rapporteur. Je ne comprends pas quelle utilité a l’opération Sentinelle, sinon celle d’alléger le travail de la police et de la gendarmerie et de rassurer la population, ce qui n’est certes pas négligeable. De fait, aujourd’hui, non seulement les militaires ne peuvent pas être primo-intervenants, mais ils sont des cibles potentielles, comme on l’a constaté notamment à Nice en janvier 2015 – d’où l’intérêt, comme vous l’observez dans votre rapport, de remplacer les gardes statiques par des gardes dynamiques. Je reste donc perplexe.
Depuis le lancement de l’opération Sentinelle, combien de fois les militaires qui y participent ont-ils fait usage du feu et ont-ils effectué des opérations remarquables, telles que des arrestations ?
M. Louis Gautier. Je comprends que vous insistiez sur ces questions. Mais vous admettrez que lorsque l’on a la responsabilité de fixer des règles sur des sujets aussi importants, on ne peut pas laisser planer une équivoque. L’appréciation est largement liée aux circonstances. Je vais prendre un exemple. En médecine, dans un contexte d’urgence classique, on cherche à sauver celui qui est le plus mal en point ; dans une situation de guerre, on cherche à sauver celui qui a le plus de chance de s’en sortir. Dans quel manuel de déontologie médicale est-ce écrit ?
M. le rapporteur. Pour reprendre votre exemple, tous ceux que nous avons auditionnés, qu’il s’agisse du SAMU ou de la BSPP, nous ont dit qu’ils s’étaient retrouvés dans une situation d’urgence de guerre et qu’ils s’y étaient adaptés.
M. Louis Gautier. Alors que ma responsabilité est de veiller à la détermination de normes, vous me demandez de décrire ce que pourrait être l’exception. Celle-ci est fixée par le droit, qui dispose que l’usage des armes ne peut être justifié que par une situation exceptionnelle, l’urgence et la légitime défense éventuellement élargie à la protection d’autrui, et que la réponse doit être proportionnée.
M. le rapporteur. Et la non-assistance à personne en danger ?
M. Louis Gautier. La règle est fixée. Ensuite, il y a une déclinaison, qui implique que le militaire, comme le policier ou le gendarme du reste, ait conscience que son usage des armes doit être restreint et qu’il ait la certitude qu’il ne risque pas d’aggraver la situation par un comportement qui ne serait pas responsable ou suffisamment médité.
M. le président Georges Fenech. Je crois savoir, pour avoir travaillé sur le texte en commission des lois, que le cadre de la légitime défense a été élargi au fait d’empêcher toute nouvelle action. Il me semble que cette loi, qui concerne la police, doit s’appliquer également à la force Sentinelle. Êtes-vous d’accord sur ce point ?
M. Louis Gautier. Le travail que nous allons accomplir à partir de l’état du droit consiste à rappeler les règles d’engagement, les conduites, le reporting, puis d’envisager dans quelles circonstances l’ouverture du feu est possible et qui l’ordonne.
M. le rapporteur. Pouvez-vous nous dire à combien de reprises le feu a été utilisé par la force Sentinelle ?
M. Louis Gautier. Je vérifierai, mais, à ma connaissance, cela n’est pas arrivé, hormis une fois en légitime défense, à Valence.
M. le président Georges Fenech. Doit-on en tirer une conclusion ?
M. Louis Gautier. J’entends une critique sous-jacente, qui serait que la seule présence de la force Sentinelle ne serait pas suffisante. Mais cette présence est dissuasive, comme au Bataclan l’entrée du commissaire de police a été un élément décisif. On ne peut pas dire que la présence militaire n’a pas d’intérêt en soi.
Encore une fois, ce travail sera accompli à partir de la loi existante. Mais la problématique demeure celle de la « pesée » de l’ordre donné par ceux qui vont se retrouver dans ces situations particulières. Les définir de manière trop générale, c’est prendre le risque inverse : je ne peux pas établir une typologie des cas où l’ouverture de feu serait automatique. L’intervention elle-même, je le répète, ne doit pas compromettre l’opération. La logique veut donc que l’on envoie plutôt le GIGN, le RAID ou la BRI, s’ils sont immédiatement disponibles, plutôt que le premier arrivé.
M. le président Georges Fenech. Vous connaissez la nouvelle doctrine définie par le ministre de l’intérieur concernant les primo-intervenants à propos des PSIG-Sabre et des BAC, bien que ce ne soit pas leur vocation première. On peut donc imaginer que quelques-uns des effectifs de la force Sentinelle pourraient être formés pour être des primo-intervenants.
M. Louis Gautier. Le ministre de l’intérieur a donné la réponse en remettant en avant, au titre des capacités d’intervention, les forces de sécurité intérieure, ce qui est conforme à leur mission. La règle, c’est que ce sont des forces de police, a fortiori parce qu’elles y auront été formées, qui doivent intervenir. Les militaires ne le peuvent que dans une situation d’urgence absolue. Les choses ont tout de même été relativement précisées : les forces primo-intervenantes sont les forces de sécurité intérieure. Les primo-arrivants, s’il s’agit de militaires, de policiers municipaux ou de douaniers, ne seraient amenés à intervenir et à ouvrir le feu que dans des situations très exceptionnelles.
M. le président Georges Fenech. Ce qui n’était pas le cas jusqu’à présent…
M. Louis Gautier. En effet. Mais désormais, la loi le permet depuis l’insertion dans le code pénal d’un article 122-4-1, par la loi du 3 juin 2016.
M. François Lamy. Une patrouille dynamique de la force Sentinelle se trouvant face au Bataclan à 21 h 28, le 13 novembre au soir, ne serait pas intervenue. Elle aurait appelé ses supérieurs, la police. On peut le comprendre. Mais si cette situation se reproduisait ce soir, personne ne le comprendrait. Il est vrai que l’acte terroriste est difficile, voire impossible à définir. Mais personne n’admettrait que, passant devant un stade où des terroristes sont en train de tuer des civils, une patrouille n’engage pas le feu. Je ne pense pas à des effectifs spécialisés, mais à des soldats qui, par ailleurs, sont intervenus au Mali ou ailleurs et qui sont formés pour faire la guerre. Je comprends qu’il y ait des risques et que l’on ne tire pas au FAMAS comme on tire à l’arme de poing, encore que les forces de sécurité aient été équipées de fusils d’assaut.
M. le président Georges Fenech. Monsieur le secrétaire général, si le commissaire de la BAC n’était pas intervenu de sa propre initiative dans le Bataclan – alors que la doctrine est d’attendre les forces spécialisées –, nous aurions peut-être eu cent morts de plus, puisqu’il a tué l’un des trois terroristes…
M. Louis Gautier. Je le répète, la première responsabilité de la patrouille qui se trouverait sur place serait d’informer les autorités et de solliciter un ordre ou une instruction, qu’ils soient donnés par leurs supérieurs hiérarchiques ou par l’autorité civile.
M. le rapporteur. Je souhaiterais que nous abordions un autre sujet. Les analyses qui figurent dans vos rapports sont très performantes, notamment en ce qui concerne la menace et son anticipation. Toutefois, l’Unité de coordination de la lutte antiterroriste (UCLAT) et le coordonnateur national du renseignement jouent également ce rôle. Ne serait-il pas judicieux de charger une seule instance, le SGDSN par exemple, de mener cette analyse transversale ?
M. Louis Gautier. Un effort important a été fait dans le domaine de la coordination du renseignement. En tant que représentants de la nation, vous serez sans doute sensible à ce que je vais dire. Longtemps, notre organisation républicaine, en matière de sécurité et de renseignement, a cherché la duplication, pour avoir la certitude de la redondance, et le cloisonnement, pour éviter le débordement. Or la lutte contre le terrorisme implique un décloisonnement, d’une part, dans le domaine du renseignement, notamment en faisant collaborer plus étroitement les services, et, d’autre part, dans celui de la sécurité intérieure, en facilitant les liens entre la police, la gendarmerie, le RAID, le GIGN et éventuellement les militaires. Il est donc nécessaire de repenser les choses, sans pour autant aller forcément à l’encontre de ce qui fait la spécificité et le métier de chacun des services. Ainsi, au plan juridique, les renseignements doivent demeurer polarisés, d’un côté, sur le territoire national et, de l’autre, sur la problématique internationale. En matière de terrorisme, il faut que ces services travaillent mieux ensemble, grâce à des officiers de liaison, des cellules d’analyse et de traitement et des bases de données. Des moyens ont été alloués à cette fin. Ce qu’il faut, c’est encore améliorer la capacité d’analyse du renseignement et le traitement automatique de certaines données pour que les signalements soient plus rapides. Il convient également – cela fait partie du retour d’expérience – de mieux associer les services qui peuvent collecter du renseignement au plan territorial et d’incorporer le renseignement pénitentiaire.
S’agissant de l’appréciation de la menace, nous faisons un travail de back-office. Nous avons en effet accès à presque toutes les sources de renseignement, de sorte que nous offrons aux autorités politiques, dans des synthèses hebdomadaires, une bonne connaissance de la menace générale, qui permet d’éclairer les décisions ou de favoriser la prise de conscience des responsables, par exemple le réseau des hauts fonctionnaires de défense et de sécurité, de la nature de la menace. Par ailleurs, dans les domaines très opérationnels, la logique est celle du confinement et les chaînes sont nécessairement « verticalisées ». Un grand brassage de l’information est donc impossible. Du reste, ce n’est même pas le rôle du coordonnateur national du renseignement, qui est là pour éclairer le Président de la République. Le détail opérationnel relève de la responsabilité du ministre de l’intérieur, du procureur de la République ou des juges. Notre rôle est celui d’un back-office qui livre une appréciation de la menace, en évitant bien entendu de compromettre des éléments d’information et de nuire ainsi à une enquête ou à la traque menée par un service de renseignement.
M. le rapporteur. Il y a quelques mois, vous avez rendu un rapport qui concluait à la nécessité de légiférer sur la question des drones. Or vous avez sans doute pu lire dans la presse quelles étaient les cibles potentielles qui figuraient dans l’ordinateur de Salah Abdeslam, cibles qui correspondent d’ailleurs à une liste dressée par la Direction du renseignement militaire (DRM) en janvier 2015. On a ainsi appris qu’il envisageait notamment des attaques de drone. Considérez-vous que nous sommes suffisamment préparés en la matière ? Les drones représentent-ils une menace imminente ?
M. Louis Gautier. Mon métier exige que je sois inquiet et vigilant. C’est pourquoi nous nous sommes rapidement saisis de la question des drones, dont nous avions perçu la dangerosité, au-delà des provocations ou des démonstrations auxquelles nous avons assisté – je pense au survol des centrales nucléaires. Grâce à vous, lorsque la loi sera définitivement adoptée, nous disposerons de la législation la plus avancée en la matière. Des arrêtés permettront notamment de mieux distinguer un usage dommageable, mais involontaire, d’un usage malveillant. Par ailleurs, le SGDSN s’est fait opérateur en ce domaine. En effet, il manque un pilotage des grands programmes interministériels de sécurité, pour fixer une commande publique, maintenir en France des industriels intéressés à ces questions... Nous avons donc financé un certain nombre d’études concernant les drones qui ont été menées par les sociétés CS et Roboost, ainsi que par l’Office national d'études et de recherches aérospatiales (ONERA). Ainsi, des démonstrateurs seront déployés durant l’Euro, qui permettront de disposer de solutions intégrées allant de la détection à des systèmes de brouillage. Il s’agit d’un programme d’urgence opérationnelle : nous avons lancé les études l’an dernier.
Il nous faut, en outre, tenir compte, surtout à Paris, des risques d’interférence, car les aéroports du Bourget et de Roissy sont proches. Si un drone apparaît, le système d’alerte doit également être au point pour que les plateformes des aéroports soient immédiatement prévenues. Nous faisons évidemment très attention à ce type de menaces, mais, malheureusement, l’ingéniosité malfaisante des terroristes est sans limites…
Quoi qu’il en soit, sur ce sujet, nous jouons un rôle de pionnier dans un groupe européen qui réunit le Danemark, les Pays-Bas, l’Allemagne et la Grande-Bretagne. Nous souhaiterions par ailleurs faire adopter une réglementation dans ce domaine au niveau européen.
M. le président Georges Fenech. Merci beaucoup, monsieur le secrétaire général.
Audition, à huis clos, de M. Bernard Bajolet, directeur général de la sécurité extérieure (DGSE)
Compte rendu de l’audition, à huis clos, du mardi 24 mai 2016
M. le président Georges Fenech. Monsieur le directeur général, nous vous remercions d’avoir répondu à la demande d’audition de notre commission d’enquête relative aux moyens mis en œuvre par l’État pour lutter contre le terrorisme depuis le 7 janvier 2015.
Nous allons poursuivre avec vous nos investigations dans le domaine du renseignement, en nous intéressant maintenant à son volet extérieur. Votre audition revêt à cet égard une importance essentielle pour nos travaux. Outre les questions que nous nous posons sur les attentats de janvier et de novembre derniers, ce sera l’occasion de vous interroger sur l’état de la menace, sur les moyens mis en œuvre et l’adaptation des techniques et des procédures, et sur la coopération entre services aux niveaux tant interne qu’international.
En raison de la confidentialité des informations que vous êtes susceptibles de nous délivrer, cette audition se déroule à huis clos. Elle n’est donc pas diffusée sur le site internet de l’Assemblée. Néanmoins, et conformément à l’article 6 de l’ordonnance 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, son compte rendu pourra être publié en tout ou partie, si nous en décidons ainsi à l’issue de nos travaux. Je précise que les comptes rendus des auditions qui auront eu lieu à huis clos seront au préalable transmis aux personnes entendues afin de recueillir leurs observations. Ces observations seront soumises à la commission, qui pourra décider d’en faire état dans son rapport. Je rappelle que, conformément aux dispositions du même article, « sera punie des peines prévues à l’article 226-13 du code pénal (un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende) toute personne qui, dans un délai de vingt-cinq ans, divulguera ou publiera une information relative aux travaux non publics d’une commission d’enquête, sauf si le rapport publié à la fin des travaux de la commission a fait état de cette information ».
Conformément aux dispositions de l’article 6 précité, je vous demande de prêter le serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité.
M. Bernard Bajolet prête serment.
Nos questions porteront sur les attentats de janvier et novembre 2015, sur la situation au Levant et sur la coopération.
Les auteurs des attentats de janvier et novembre 2015 étaient-ils connus de la DGSE ? Avaient-ils fait l’objet d’une surveillance par le passé ?
Quelles ont été les actions entreprises par la DGSE après la commission des attentats de janvier et novembre 2015 ? La DGSE disposait-elle d’informations sur les familles et les proches des protagonistes ?
Après la commission des attentats du 13 novembre 2015, la DGSE a-t-elle été destinataire de la part de services de renseignement étrangers d’informations sur les membres des commandos terroristes ?
Quelles sont les principales conclusions des retours d’expérience que vous avez effectués après les attentats de janvier et de novembre 2015 ?
M. Bernard Bajolet, directeur général de la sécurité extérieure (DGSE). La DGSE a plusieurs particularités. Tout d’abord, c’est un service intégré, qui regroupe des capacités de renseignement humain, technique et opérationnel. Le renseignement opérationnel est celui que nous n’obtenons pas par des sources, mais que nous allons chercher directement, à mains nues, en quelque sorte. Nous avons aussi une capacité d’entrave. L’entrave ne consiste pas nécessairement à éliminer tel ou tel individu, mais à empêcher une action. Ces interventions ne sont pas seulement menées par la direction des opérations, mais elles peuvent aussi l’être par la direction du renseignement, par exemple en portant un cas devant la justice, en faisant arrêter des individus, en faisant arraisonner par la Marine nationale ou une marine étrangère un bateau qui transporte de la drogue ou des armes. Ces actions peuvent prendre des formes très différentes. Nous pouvons aussi apporter un soutien aux forces armées françaises ou à des services étrangers pour obtenir une action particulière.
Dans un service comme le mien, le renseignement humain est soutenu par le renseignement technique. Ainsi, plusieurs agents en rapprochement de la direction technique appuient les officiers de recherche ou les analystes dans chaque bureau de la direction du renseignement. À l’inverse, le renseignement humain soutient la recherche technique et les capacités opérationnelles. Il est très important, pour obtenir du renseignement technique, d’accéder à certains réseaux à l’étranger : c’est grâce au renseignement humain ou opérationnel que nous sommes en mesure d’en dresser la cartographie. C’est pourquoi, dans certains pays, nous avons des capacités dont de très grands services, telle la National Security Agency (NSA), ne disposent pas.
En outre, nos moyens techniques sont mutualisés et mis à la disposition des autres services de renseignement français. Dans la pratique, cela se traduit par des postes déportés auprès d’autres services, en particulier la direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) et la direction du renseignement militaire (DRM).
M. le président Georges Fenech. Qu’est-ce que la DGSE savait des auteurs des attentats de janvier et novembre et de leur entourage ? Avez-vous eu des informations en provenance des services de renseignement étrangers ?
M. Bernard Bajolet. Je ne veux pas être trop spécifique. Nous connaissions plusieurs des auteurs des attentats de novembre. Nous suivions en particulier, depuis le mois de janvier 2015, le réseau Abaaoud, en liaison avec un projet d’attentat du « groupe de Verviers ». Nous avons aidé nos homologues belges à déjouer cet attentat. Comme vous le savez, Abaaoud a pu s’échapper. Si nous ne l’avons pas vu sortir de Syrie, nous avons appris, en coopération avec la DGSI, sa présence sur le sol français après les attentats du 13 novembre. Nous pensons que ceci a peut-être contribué à empêcher une autre vague d’attentats, mais nous n’avons malheureusement pas pu prévenir ceux du 13 novembre.
Le rôle de mon service est la détection en amont, à l’étranger, des attentats visant le sol français, et nous travaillons alors en collaboration avec la DGSI, qui est chef de file en ce qui concerne la menace visant le territoire français. Les personnes que nous suivons circulent entre l’Europe et les zones de jihad, syro-irakiennes, libyennes ou autres. Ce n’est donc du renseignement ni purement extérieur ni purement intérieur, ce qui amène à une étroite imbrication des deux services.
M. Sébastien Pietrasanta, rapporteur. Notre commission d’enquête s’est rendue en Turquie et en Grèce. Les services grecs nous ont dit qu’Abaaoud avait été identifié et localisé en janvier 2015. Au moment de l’assaut de Verviers, il était donc à Athènes, mais les services belges avec lesquels ils étaient en liaison ne les ont prévenus que vingt minutes avant l’assaut, et il a donc pu s’échapper. Avez-vous eu connaissance de la présence d’Abaaoud à Athènes à ce moment-là ?
Après l’assaut de Verviers, on ne sait pas ce que devient Abaaoud. Avez-vous pu suivre sa piste et le localiser ? Comment expliquer qu’il arrive incognito sur notre territoire, alors que, pour la DGSI et pour vous, il représente une cible prioritaire au regard de son implication dans la cellule de Verviers, dans la tentative d’attentat dans le Thalys et à Villejuif ?
Vous dites que vous connaissiez plusieurs des auteurs des attentats, en plus d’Abaaoud. Avez-vous rencontré des difficultés avec les Belges ? Avons-nous perdu la trace d’autres individus ? Pourquoi, alors que nous connaissions ces personnes, nous ont-elles échappé ?
M. Alain Marsaud. Vous dites que vous suiviez Abaaoud : qu’est-ce que cela signifie ?
M. Bernard Bajolet. Nous connaissions parfaitement la dangerosité du personnage et savions qu’il nourrissait ce type de projets. Tous les moyens ont été mis en œuvre : moyens humains, techniques, et coopération avec les partenaires. Cette coopération ne nous a jamais fait défaut, y compris s’agissant des Belges. Les Belges ont les capacités qui sont les leurs, mais leur bonne volonté et leur professionnalisme ne sont pas en cause. Nous savions donc qu’Abaaoud était retourné en Syrie, mais nous ne l’avons pas vu ressortir. Nous avons retrouvé sa trace peu après l’attentat du 13 novembre. Il a ensuite été localisé et neutralisé.
La difficulté à laquelle nous nous heurtons est que ces terroristes sont rompus à la clandestinité et font une utilisation très prudente, très parcimonieuse, des moyens de communication : les téléphones ne sont utilisés qu’une seule fois, les communications sont cryptées et nous ne pouvons pas toujours les décoder. De plus, pour connaître leurs projets, il faut avoir des sources humaines directement en contact avec ces terroristes : or ces réseaux sont très cloisonnés, ils peuvent recevoir des instructions de caractère général, mais avoir ensuite une certaine autonomie dans la mise en œuvre de la mission qui leur est confiée. Cet ensemble de moyens fait que, en dépit de la mobilisation des moyens humains et des sources techniques des services, un certain nombre d’individus peuvent nous échapper.
M. le président Georges Fenech. Les Grecs l’avaient localisé.
M. Bernard Bajolet. Après coup. On n’a pas su qu’il était à Athènes au moment où il y était.
M. le rapporteur. Si, car le jour même de l’assaut à Verviers, les Grecs ont lancé une opération là où ils avaient localisé le téléphone d’Abaaoud : il leur a échappé de quelques heures.
M. Bernard Bajolet. Il est toujours facile de raconter certaines choses a posteriori. Les Belges n’étaient pas censés savoir qu’Abaaoud était en Grèce et n’avaient donc pas de raison de prévenir les Grecs. Je ne fais que formuler une hypothèse, je ne sais pas ce qu’il en est réellement, mais, au moment où l’on engage une opération comme celle que les Belges ont lancée à Verviers, le nombre des interlocuteurs qu’on prévient n’est pas infini, pour d’évidentes raisons de confidentialité. Il faut toujours prendre avec précaution ce qui se dit après coup.
M. le rapporteur. Malgré les difficultés techniques que vous évoquez, vous n’êtes pas totalement démunis pour la surveillance de ces individus. Mais nous avons du mal à comprendre qu’Abaaoud, qui est une cible ultra-prioritaire de vos services, puisse entrer sur notre territoire sans que personne ne soit au courant.
M. Bernard Bajolet. Nous suivons un grand nombre d’individus : nous savons qu’ils sont dangereux et que certains ont des projets – mais cela ne veut pas dire que nous serons en mesure de les déjouer. Ces individus voyagent sous de fausses identités, suivent des itinéraires extrêmement compliqués et disposent d’une certaine autonomie dans leurs agissements. Dès lors, quand bien même on sait qu’un attentat va être commis, quand bien même on connaît le nom des terroristes, on ne peut pas toujours le prévenir si l’on en ignore le lieu et la date.
Cela explique certains échecs, car les attentats du 13 novembre représentent évidemment pour moi un échec. Je l’ai dit, le rôle de mon service est de détecter et d’entraver les menaces situées à l’étranger et visant soit le territoire national – nous travaillons alors en coopération avec la DGSI –, soit nos intérêts à l’extérieur. Mais, souvent, nous détectons sans être en mesure d’entraver. Des attentats comme ceux du 13 novembre marquent bien un échec du renseignement extérieur : ils ont été planifiés à l’extérieur de nos frontières et organisés en Belgique, c’est-à-dire dans l’aire de compétence de la DGSE. Ils représentent aussi sans doute un échec pour le renseignement intérieur, dans la mesure où ils se sont produits sur notre sol, même si le commando ne disposait pas de base en France – mais d’autres schémas peuvent être envisagés, qui mettraient en jeu des cellules dormantes sur le sol français.
M. le président Georges Fenech. Je vous remercie de votre franchise. C’est la première fois qu’un chef de service reconnaît cet échec de nos services. Il n’est d’ailleurs pas péjoratif de reconnaître qu’il y a eu une faille.
M. Bernard Bajolet. Je n’ai pas dit qu’il y avait eu une faille, monsieur le président. Après un attentat, nous faisons un retour d’expérience. On pourrait parler de faille si, en remontant le fil des événements, nous découvrions que nous disposions d’un renseignement que nous n’avons pas correctement exploité, ou qui serait passé inaperçu parmi de très nombreux autres. Nous avons accompli ce travail de manière honnête et rigoureuse, et nous n’avons pas découvert a posteriori d’éléments permettant de penser que nous aurions pu éviter ces attentats.
Cela ne veut pas dire, cependant, que nous n’avons aucune leçon à tirer des événements. Je ne vais pas vous expliquer que nous aurions pu éviter ces attentats si nous avions eu plus de moyens : nous avons ceux que nous avons demandés, même s’il faudra plusieurs années pour les mettre en œuvre. Après de tels attentats, nous nous interrogeons pour savoir ce que nous pouvons faire pour améliorer notre capacité de renseignement technique et humain, de façon à réduire la probabilité que quelque chose nous échappe. C’est ce que nous faisons tous les jours, et nous avons tiré les conséquences des attentats de janvier et novembre 2015.
M. Meyer Habib. Quelle est la différence entre une faille et un échec ? Vous dites qu’il y aurait eu une faille si vous n’aviez pas exploité les renseignements dont vous disposiez. Mais ne pas disposer de certains renseignements que vous auriez dû avoir peut aussi être une faille.
M. Bernard Bajolet. Même avec les moyens dont disposent les États-Unis, nous ne ferions pas forcément mieux. Ce n’est pas une question de moyens. Simplement, nous ne sommes pas infaillibles. Le but est de réduire la probabilité que nous laissions passer un incident.
Quand des attentats ont lieu à Bamako, à Ouagadougou ou au Grand-Bassam, c’est également un sujet de grande frustration pour mon service. Nous entretenons une coopération forte avec ces pays, nous y sommes fortement implantés, nous les soutenons et les aidons. Encore ne déplorerait-on aucune victime française, des attentats y font des victimes parmi nos alliés, les affaiblissent, peuvent les déstabiliser. Notre rôle est aussi d’éviter ces attentats.
Mais il faut mettre cela en rapport avec des réussites dont, par définition, vous n’avez pas connaissance, puisqu’il s’agit d’attentats que nous avons empêchés. Depuis janvier 2013, mon service a contribué à la conception, à la planification et à la conduite de soixante-neuf opérations d’entrave de la menace terroriste : douze ont permis d’éviter des attentats contre des intérêts français à l’étranger, six des projets d’attentats susceptibles de frapper des intérêts occidentaux – puisqu’ils n’ont pas eu lieu et que nous ne savions pas s’ils nous visaient spécifiquement, on ne peut pas savoir s’il y aurait eu des victimes françaises – et cinquante et une opérations ont eu lieu afin de réduire la menace terroriste, c’est-à-dire faire arrêter des gens, déjouer des projets ou mettre des terroristes hors d’état de nuire. Ces opérations ont eu lieu dans les régions suivantes, par ordre décroissant : l’Afrique subsaharienne, la zone afghano-pakistanaise, la corne de l’Afrique, la Syrie, l’Europe, la Libye et l’Égypte.
Pour présenter ces mêmes chiffres sous un autre angle, notre rôle a consisté à transmettre des renseignements à nos partenaires pour leur permettre de déjouer les attentats dans vingt-neuf cas, et, dans quarante opérations, nous avons directement contribué à la mise en œuvre de celles-ci. Parfois les sources étaient uniquement des sources humaines, mais, le plus souvent, les informations étaient de source humaine et technique.
M. le président Georges Fenech. Lorsque vous parlez de « mettre des terroristes hors d’état de nuire », vous voulez dire les éliminer physiquement ?
M. Bernard Bajolet. Pour nous, mettre hors d’état de nuire signifie neutraliser par des arrestations ou d’autres moyens. Nous intervenons en appui des forces armées françaises et de nos partenaires de la coalition. Nous fournissons des renseignements à la coalition, notamment ce que nous appelons des points d’intérêt. Nous avons fourni, aussi bien pour l’Irak que pour la Syrie, de très nombreux points d’intérêt, qui sont ensuite exploités et complétés par la direction du renseignement militaire.
Nous avons accru le rythme et l’intensité de nos opérations, notamment celles du service action. Il est utilisé au plein de ses capacités sur ces différents théâtres.
Pour en revenir aux leçons tirées des attentats, nous ne sommes pas partis de zéro. Depuis plusieurs années, tout particulièrement depuis les années 2010, la coopération avec la DCRI devenue DGSI s’est renforcée. Mais nous sommes passés à un stade supplémentaire après les attentats du mois de janvier 2015, puisque nous avons une cellule insérée à la DGSI, à Levallois, dirigée par un cadre de très haut niveau de mon service. Cette cellule, qui comporte des agents de la direction du renseignement et de la direction technique, a accès aux bases de données de mon service et peut donc fournir en temps réel à ses collègues de la DGSI tous les éléments dont ils ont besoin.
La stratégie de mon service est le renforcement de la coopération et une totale transparence avec la DGSI. Notre coopération a atteint un niveau sans précédent, mais l’objectif que je partage avec Patrick Calvar est encore plus ambitieux, car, malgré cela, des différences culturelles, des différences de méthode et d’approche subsistent. Le rapprochement des cultures ne veut d’ailleurs pas dire leur fusion : chacune d’elles a son mérite, il n’est pas souhaitable de les faire disparaître. Mais cette relation n’est pas encore arrivée à un degré d’irréversibilité. Mon but est de l’ancrer dans la durée.
La collaboration entre la DGSE et la DGSI est confortée par la cellule Allat, qui comporte, outre ces deux services, les quatre autres du premier cercle, plus deux des services dits « du deuxième cercle », à savoir le service du renseignement territorial (SRT) et la direction du renseignement de la préfecture de police de Paris (PP). À l’instar de ce que nous avons fait avec la DGSI, chacun des services participants doit avoir accès à ses bases de données. C’est la valeur ajoutée. Ces deux cellules, qui sont installées dans des lieux contigus, contribuent à donner une fluidité sans précédent aux échanges d’informations entre les services. Le risque de faille du fait d’une information qui n’aurait pas été transmise d’un service à l’autre est considérablement réduit.
Ce renforcement de la coopération est perfectible, mais il constitue une révolution silencieuse en cours, qui a plus de valeur, à mes yeux, que ces changements d’organigramme qui ont parfois les faveurs des soi-disant experts qui se répandent dans la presse.
Deuxième conséquence des attentats du 13 novembre, nous avons franchi une étape supplémentaire, en particulier sur le plan technique, en décidant d’un partage beaucoup plus systématique des données. Jusqu’à une date récente, elles étaient quasiment la propriété de chacun des services, qui ne les échangeaient qu’avec parcimonie. Nous sommes passés à un autre stade en nous appuyant sur une disposition de la loi du 24 juillet 2015, codifiée à l’article L. 863-1 du code de la sécurité intérieure, qui permet des échanges de données entre les services. Ce partage est réciproque, étant entendu que chaque service intervient dans le cadre de ses missions. Et nous restons soucieux d’éviter toute fuite de ces données : plus on échange, plus ce risque existe. Il y a donc des protections particulières.
D’autre part, mon service a la responsabilité des grands programmes techniques mutualisés. Nous avons mis au point des instruments qui sont prêts aujourd’hui, et sur le point d’être utilisés par les différents services. Ils doivent permettre une gestion beaucoup plus fluide du suivi des terroristes, et une priorisation, car, étant donné le nombre de cas que nous devons suivre, il est très important de les hiérarchiser et de savoir qui fait quoi. Nous avons élaboré ces instruments pour les mettre à la disposition des autres services.
Nous avons procédé de même avec la direction du renseignement militaire. La DRM apporte des renseignements en vue de l’attrition des groupes terroristes. Un groupe de travail s’est créé sous l’égide de la DRM, en vue du ciblage en zone Syrie-Irak, et nous y participons avec les autres groupes de la communauté du renseignement.
M. Christophe Cavard. Monsieur le directeur général, on parle beaucoup de la Syrie, de l’Irak et de la question africaine. J’aimerais connaître votre point de vue sur la Libye. Comment faites-vous au vu de la déstructuration évidente de ce territoire ? Comment intervient la DGSE ? Est-elle en relation avec d’autres pays, notamment européens ?
En ce qui concerne les moyens techniques de suivi des cibles, on s’interrogeait encore sur les moyens d’intercepter des communications par Skype en 2013. Où en sont les évolutions techniques ? On apprend que les auteurs des attentats prennent des ordres, et que des relations existent avec leur groupe sur les zones de combat.
Pensez-vous que des évolutions soient possibles, notamment l’utilisation de techniques telles que celles utilisées par les États-Unis ? Ou pensez-vous que, étant donné les relations que nous avons avec ces pays, ils peuvent répondre aux commandes que nous passons ?
Vous avez fait une déclaration commune avec M. Calvar afin de souligner le rôle de la prévention. Il sera intéressant de savoir de quel type de prévention vous parlez.
M. Bernard Bajolet. Ma réponse sur la Libye portera aussi sur la prévention. Nous combattons le terrorisme par l’aval – les opérations ciblées ou l’attrition des moyens armés, puisque Daech est la rencontre d’un projet terroriste avec des moyens militarisés. Mais, en amont, les problèmes sont toujours politiques, et ce sont les problèmes politiques non résolus qui nourrissent le terrorisme.
C’est le cas pour la Syrie et l’Irak : la marginalisation des Sunnites depuis 2003 en Irak et depuis les années soixante en Syrie fait que Daech peut s’appuyer sur des populations sunnites qui ne se sentent pas reconnues par l’État. Ce n’est pas une excuse, mais c’est la raison pour laquelle la prise de villes comme Mossoul, Raqqah ou Syrte est difficile si l’on ne résout pas d’abord les problèmes politiques.
En Irak, le problème politique n’a pas vraiment été abordé. Certes, le Premier ministre Haïder al-Abadi essaie, sans succès à ce jour, de régler la question, mais il doit faire face à des pressions internes ou externes et n’arrive pas, pour le moment, à intégrer les Sunnites au pouvoir. Quelques-uns sont présents, mais ils ne sont pas suffisamment représentatifs. Tant que ce problème ne sera pas résolu, il sera très difficile de prendre une ville sunnite comme Mossoul, car il faudra y affronter la population si les troupes engagées ne sont pas en majorité sunnite.
De même, en Syrie, le problème n’est pas seulement celui de la personne de Bachar al-Assad, mais celui de savoir si le gouvernement sera ou pas représentatif des différentes composantes de la population. Tant que ces problèmes n’auront pas été résolus, le nombre de terroristes ne cessera d’augmenter. Plusieurs centaines de Français combattent actuellement en Syrie et en Irak, mais raisonner en termes de nationalité n’a pas beaucoup de sens : il faudrait plutôt compter les francophones, et ne pas oublier que les membres du commando qui a attaqué à Paris le 13 novembre n’étaient pas tous francophones. Même si le problème était résolu sur les plans politique et militaire, il resterait cette foule de djihadistes, auxquels il faut ajouter ceux qui sont revenus de Syrie et ceux qui cherchent à s’y rendre.
La Libye représente un défi bien différent : là, il n’y a pas d’opposition entre Sunnites et Chiites, mais des problématiques tribales, qui ne sont pas moins complexes. Là aussi, nous avons besoin d’un gouvernement d’union nationale représentant l’ensemble de la Libye et il reste encore beaucoup à faire pour que ce soit le cas.
Dans ce pays, il faut surtout éviter une intervention militaire occidentale qui serait la meilleure façon d’unir tous les Libyens contre nous. Ça ne veut pas dire qu’il ne faut rien faire, mais qu’il faut agir de façon extrêmement discrète contre le terrorisme. L’action politique requiert un temps long, tandis que l’action contre le terrorisme demande un temps plus court. Pour le moment, Daech n’est pas structuré, en Libye, de façon aussi solide qu’en Syrie et en Irak. Une intervention intempestive ne pourrait que transformer la Libye en une terre de jihad plus attrayante. Quoi qu’il en soit, nous avons évidemment le souci d’éviter un transfert des combattants étrangers de la zone syro-irakienne vers la Libye.
M. François Lamy. La France a entretenu avec la Syrie des relations étroites : ce fut même un protectorat français, ce qui nous a permis d’y tisser des réseaux au fil des années. La fermeture de l’ambassade a-t-elle été un handicap pour le recueil de renseignements ?
Connaît-on les commanditaires des attentats du mois de janvier – le cas d’un Yéménite qui aurait été tué par un drone américain a été évoqué – et de ceux du mois de novembre ? Si Abaaoud les a organisés, ce n’est pas lui qui a pris la décision de les perpétrer.
On évoque toujours le millier de Français qui combattent en Syrie ou en Irak, mais il s’agit de cellules bien identifiées, qui sont en lien les unes avec les autres par l’intermédiaire de certains personnages : cellules de Verviers, d’Artigat ou des Buttes-Chaumont. C’est assez logique : pour organiser ce type d’attentats, il faut une logistique, et donc des gens qui se connaissent. Peut-on considérer que le problème est globalement sérié ?
De votre point de vue, sommes-nous face à une guerre entre Sunnites et Chiites dont le monde occidental serait une victime collatérale, ou s’agit-il vraiment d’une guerre globale ?
M. Guillaume Larrivé. Votre service coopère-t-il avec les autorités syriennes pour identifier des ressortissants français impliqués ?
Vous semble-t-il que, au plan législatif ou réglementaire, vous avez des besoins qui n’ont pas encore été satisfaits ?
M. Meyer Habib. Le terrorisme se combat à la source. Des pays financent, soutiennent et abritent les terroristes, chiites et sunnites. Je dînais récemment avec le fils du Shah d’Iran, qui était à Paris. Selon lui, c’est l’Iran des mollahs qui a théorisé le terrorisme islamique. Avant eux, il y avait des mouvements terroristes panarabistes : Abou Nidal, OLP et FPLP. Tant que l’hégémonie iranienne sur le Yémen, le Liban et la Syrie perdurera, le problème ne pourra pas être résolu du fait de l’excitation des Saoudiens et des autres pays sunnites.
Selon certaines rumeurs, la bombe qui a explosé dans l’avion Egyptair aurait été introduite à l’aéroport Charles de Gaulle. Avez-vous des informations à ce sujet ?
Vous deviez être du récent voyage du Premier ministre en Israël. Quelles sont vos relations avec les services israéliens ?
M. Bernard Bajolet. Nous n’avons pas de contacts avec les services syriens. Les derniers petits contacts que nous avons eus remontent à octobre 2013, dans des conditions un peu rocambolesques. À ce moment, les Syriens soumettaient la reprise des relations avec les services de sécurité à des conditions politiques. J’ai le sentiment que les Syriens n’ont jamais fait de la lutte contre le terrorisme une priorité.
D’autre part, il n’y a pas de GSM dans les zones contrôlées par Daech, et je ne suis pas convaincu que les services syriens y aient tellement de sources, bien que plusieurs personnes qu’ils ont relâchées de la prison de Sednaya soient des terroristes qui ont rejoint le Jabhat al-Nosra et Daech. Enfin, je constate que ceux de nos partenaires européens qui ont des contacts avec eux ne paraissent pas en tirer des renseignements bien extraordinaires.
Il ne faut jamais dire jamais, mais nous avons des doutes sur l’intérêt de tels contacts en termes de renseignement : il faudrait d’ailleurs connaître, au préalable, les contreparties politiques qui nous seraient demandées, car de tels contacts seraient forcément instrumentalisés par le régime.
Quant à la fermeture de l’ambassade, elle n’a pas eu d’impact en termes de renseignement.
Renseignement humain et renseignement technique vont toujours de pair, et il faut s’assurer que le renseignement humain est toujours au niveau. Le renseignement technique est surabondant, mais ce serait une erreur de tout lui sacrifier. J’ai le souci de promouvoir le renseignement humain, au même titre que le renseignement technique.
M. Christophe Cavard. Les Russes jouent-ils un rôle avec vous ?
M. Bernard Bajolet. Nous coopérons avec les Russes de façon tout à fait concrète.
Il est vrai qu’Abaaoud était un coordonnateur, mais pas le commanditaire. Nous connaissons le commanditaire, mais je resterai discret sur ce point. Nous avons maintenant une bonne connaissance de l’organigramme et de la façon dont s’organise le soi-disant État islamique, qui n’est pas un État, et qui est encore moins islamique. Nous avons bien progressé sur ces sujets, nous avons donc une idée de l’identité du commanditaire.
M. le président Georges Fenech. Quels sont les buts poursuivis par ceux qui sont à la tête de Daech ?
M. Bernard Bajolet. Même si le substrat chiite-sunnite alimente la guerre, il n’en est pas la cause. Il y a deux organisations terroristes rivales. L’une, Daech, a actuellement le vent en poupe, mais il ne faut pas négliger le réseau Al-Qaïda, qui reste dangereux, comme on le voit au Yémen, qui est présent en Syrie et, fortement, au Sahel. Al-Qaïda dans la péninsule arabique (AQPA) a même des velléités territoriales, puisque le groupe contrôlait quasiment Al Moukalla, dont il a été chassé – sans combattre – par la coalition arabe, avant de s’installer ailleurs. D’autres franchises d’Al-Qaïda ont la volonté d’établir des bases territoriales, mais cela ne s’est pas concrétisé pour le moment.
L’objectif de ces groupes est la guerre globale, l’établissement de la charia sur l’ensemble du monde. Ils cherchent à créer des clivages dans nos sociétés, et donc à déstabiliser la démocratie, qui est leur véritable ennemi. La France est particulièrement visée, pour deux raisons. Tout d’abord, elle est au combat, là où d’autres ont baissé les bras : elle lutte contre le terrorisme en Syrie, en Irak et ailleurs, dans la bande saharo-sahélienne ; elle a empêché le basculement du Mali et sans doute d’autres pays. C’est pour cela que nous sommes dans le peloton de tête des ennemis de cette organisation. L’autre raison est l’influence de la composante francophone, qui agit depuis la Syrie. Ce qui est vrai pour Daech l’est également pour AQPA.
M. le président Georges Fenech. Qui a baissé les bras ?
M. Bernard Bajolet. Je ne veux pointer personne du doigt, mais, si vous regardez qui combat en Europe et qui ne combat pas, vous noterez que la France a une position plus engagée que d’autres. Les Américains sont engagés, on ne peut pas le nier, même si la période particulière qu’ils connaissent sur le plan intérieur a une influence sur leur diplomatie et la conduite de certaines affaires.
Nous comptons 600 Français combattant en Syrie pour les djihadistes. Mais il faut élargir ce chiffre pour y intégrer tous les francophones, tenir compte de ceux qui sont déjà revenus et de ceux qui voudraient bien partir.
Daech est une organisation relativement structurée, mais les groupes gardent une certaine autonomie. Nous avons assez bien identifié des katibat, avec des regroupements qui peuvent se faire par nationalité ou par affinité.
M. François Lamy. Nous voyons que certaines personnes relient les différentes cellules entre elles. Pour constituer ce type de cellule, il faut une histoire commune et disposer d’un milieu, comme à Molenbeek, ou d’une fratrie, comme pour les Kouachi.
M. Bernard Bajolet. Un noyau était actif dès les années 1990, avec le Groupe islamique armé (GIA) algérien, le Groupe islamique combattant marocain (GICM) ou le Groupe islamique combattant en Libye (GICL). Des gens qui avaient combattu en Afghanistan jouaient un rôle assez important dans ces groupes. La nouvelle génération, qui part faire le jihad pour des raisons variées, est encadrée par ces personnes plus aguerries qui ont toute une histoire dans le jihad.
En ce qui concerne les besoins juridiques, je tiens tout d’abord à remercier le Parlement du vote des deux lois très importantes de juillet et novembre, qui donnent une base juridique beaucoup plus solide à l’activité de nos services. Contrairement à ce que j’ai pu lire dans la presse, cela ne veut pas dire qu’avant la loi, nous espionnions « massivement les Français sans aucune base légale ». Les seuls Français que nous espionnions étaient des terroristes, et nous travaillions sur le fondement d’une jurisprudence de la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité (CNCIS). Mais, dans notre système juridique, la jurisprudence n’a pas la même force que la loi. Ces lois apportent donc une vraie sécurité juridique à nos services. Elles ont pour contrepartie des contrôles beaucoup plus serrés et beaucoup plus étendus, car, au-delà des seules interceptions de sécurité, toutes les techniques font maintenant l’objet d’un contrôle, ce qui est une bonne chose.
Ces textes comportent naturellement des imperfections, car ils sont le résultat d’un débat démocratique. Lorsque l’on débat de sujets techniques, les résultats ne sont parfois pas complètement satisfaisants. Mais, dans l’ensemble, ce sont de très bonnes lois. Je ne pense pas qu’il en existe ailleurs dans le monde d’aussi détaillées et aussi précises sur l’activité des services, notamment en matière de surveillance internationale. Et contrairement à ce que j’ai lu, si je dis que ces lois sont bonnes, cela ne signifie pas qu’elles ont été dictées par les services, et ce n’est pas parce que les services sont satisfaits de ces lois qu’elles ne sont pas bonnes. Ces textes sont une grande avancée, car, contrairement à ce que je lis encore parfois sur de soi-disant « barbouzeries » imputées à la DGSE, il n’est aujourd’hui plus imaginable qu’un agent d’un service comme le mien puisse agir en contrariété avec la loi française.
Si la loi a comblé nombre de nos besoins, il en reste un qui n’a pas été satisfait : nous avons besoin d’accéder à certaines données judiciarisées. Pour autant, il faut éviter la judiciarisation du renseignement. Quand les juges ont besoin de documents classifiés, une procédure de déclassification est prévue : avis de la Commission consultative du secret de la défense nationale (CCSDN) et décision du ministre de la défense pour ce qui concerne la DGSE. Mais il faut évidemment utiliser cette procédure avec circonspection, car, si le renseignement était systématiquement judiciarisé, cela poserait un problème pour nos sources et pour la discrétion et la clandestinité de nos opérations. Nous n’écririons ni ne ferions plus rien. Il faut donc travailler à aider la justice tout en étant conscient des limites, que nous impose d’ailleurs le principe de la séparation des pouvoirs. Des solutions sont sans doute possibles pour permettre à chacun d’exercer au mieux sa mission : le juge pour la manifestation de la vérité et l’officier de renseignement pour la prévention de la menace.
Une fois qu’un renseignement est judiciarisé, il serait souhaitable d’éviter de faire le vide trop largement autour, au point que cela nous empêcherait de faire notre travail de prévention, en amont. Lorsqu’un portable ou un ordinateur est saisi dans une perquisition, le cas est judiciarisé. Nous n’avons pas accès aux données d’investigation numériques, ce qui constitue un handicap. Le juge travaille en répression, mais nous devons pouvoir travailler en prévention d’autres attentats, en remontant les données contenues dans un téléphone ou un ordinateur pour identifier les membres d’un réseau déterminé, qui peut encore frapper, en particulier depuis l’étranger. Certains de nos partenaires européens et d’outre-Atlantique nous disent que les données d’investigation numériques sont un élément essentiel de leurs activités de contre-terrorisme : une copie des données numériques est systématiquement communiquée aux services, avec l’autorisation du juge.
M. le président Georges Fenech. Cette question a été soulevée, notamment à l’Unité de coordination de la lutte antiterroriste (UCLAT). Nous avons compris l’importance de ce frein : dès qu’une information entre dans une procédure, le secret de l’instruction interdit aux services de vous communiquer quoi que ce soit. Les Américains et les Britanniques ont levé cet obstacle. Pourrait-on imaginer que le parquet puisse demander au juge d’instruction, pour la défense des intérêts fondamentaux de la nation, qu’un certain nombre d’éléments présents dans le dossier d’instruction soient transmis par le biais du parquet à d’autres services ?
M. Bernard Bajolet. Comment instaurer cette collaboration dans le respect de la séparation des pouvoirs ? Le juge doit avoir le pouvoir de décider.
M. le président Georges Fenech. Actuellement, le juge ne peut pas lui-même violer le secret de l’instruction auquel il est soumis. Il y a un obstacle juridique évident sur lequel il va falloir que notre commission d’enquête travaille.
M. Bernard Bajolet. Cette situation place la DGSI dans une position délicate vis-à-vis de nous DSGE, car la DGSI a la compétence de police judiciaire, mais elle n’a pas le droit de nous transmettre ces informations. Or nous coopérons de façon extrêmement étroite avec la DGSI.
S’agissant de l’impression d’hégémonisme de l’Iran, elle tient aussi au fait que, en 2003, le renversement de situation en Irak a considérablement accru l’influence iranienne, au moment où les grands leaders traditionnels du monde arabe s’affaiblissaient : la Syrie est dans l’état que vous connaissez, nous venons de parler de l’Irak, et l’Égypte a connu une situation qui l’a marginalisée à un moment. La situation est donc non seulement due à l’Iran, mais aussi à de grands pays arabes.
Je n’ai pas d’informations sur les raisons du crash du vol d’Egyptair, et je ne peux donc confirmer les rumeurs dont M. Habib fait état. Je constate que, avant le trajet entre l’aéroport Charles de Gaulle et l’Égypte, l’avion avait effectué un long périple comportant plusieurs escales. Aucun élément n’indique qu’il se soit passé quelque chose à l’aéroport Charles de Gaulle plutôt qu’ailleurs. Au moment où nous parlons, aucune revendication n’a été authentifiée, ce qui doit être noté.
En ce qui concerne Israël, le Premier ministre avait en effet souhaité, entre autres, m’associer à des entretiens avec le gouvernement israélien. Il se trouve que les patrons des principaux services israéliens ont fait savoir qu’ils n’avaient pas été informés en temps voulu et n’étaient pas disponibles.
Je ne connais pas mon nouveau collègue du Mossad. Nos relations avec ces services sont très professionnelles, en particulier sur des sujets très précis.
Mme Marianne Dubois. Pensez-vous que nous ayons des craintes à avoir concernant le ramadan, qui débute très prochainement ?
M. Bernard Bajolet. Oui. Nous sommes toujours sous la menace, mais la période des prochaines semaines est particulièrement délicate, à cause de l’organisation du championnat d’Europe de football et du ramadan.
M. le rapporteur. Je voudrais comprendre comment les choses se passent lorsqu’un individu suivi par la DGSI part pour l’étranger, notamment pour la Syrie. Comment se fait le relais ? Quelle est l’action de la DGSE ? Comment est assuré le suivi à l’étranger ?
Quel est l’état de vos relations avec vos homologues turcs et les principaux autres services de renseignement ?
Nous avons le sentiment qu’il existe beaucoup de fichiers. Nous avons eu une démonstration du FSPRT à l’UCLAT. Dans la mesure où il s’agit d’un fichier du ministère de l’intérieur, pouvez-vous y avoir accès ? Pourriez-vous l’alimenter ? Pensez-vous qu’il serait intéressant de mettre en place un fichier plus global ?
Enfin, nous tenons à saluer le professionnalisme de votre personnel en poste en Turquie.
M. Bernard Bajolet. Je vous remercie. En effet, nous avons du personnel de très grande qualité à la tête de ce poste, et nous avons aussi une antenne très étoffée à Istanbul, composée de gens de première qualité.
En ce qui concerne le suivi d’individus à l’étranger, ces personnes vont et viennent constamment. Quand nous le pouvons, nous nous efforçons de favoriser leur retour en France afin qu’ils puissent être entendus par la DGSI.
Pour nous, le cœur de la coopération se fait avec la DGSI, car nous sommes les deux services référents en matière de contre-terrorisme. Cela étant, les autres services nous apportent beaucoup, notamment pour avoir tous les éléments dont dispose la communauté du renseignement sur un individu particulier. Si l’on veut connaître les renseignements disponibles sur une personne, notamment ses liens familiaux ou amicaux, nous sommes certains d’avoir tout ce qui est disponible grâce à Allat.
Il n’y a pas de transfert des dossiers entre la DGSI et nous : nous les suivons en commun. Si nous savons que des individus sont en Syrie, la DGSE sera menante, mais la DGSI est toujours informée, car ces individus sont susceptibles de revenir.
M. le rapporteur. Si un individu repéré par la DGSI part pour la Syrie, comment se fait la répartition du travail ?
M. Bernard Bajolet. Si l’individu est à l’extérieur, c’est un dossier qui relève plutôt de la DGSE, mais qui continue à être suivi par la DGSI sous l’angle d’un possible retour. C’est pourquoi ce travail en commun est vraiment indispensable. Les choses se font de manière très informelle : c’est en fonction des charges de travail qu’il est décidé que le dossier est suivi par un officier traitant de la DGSI ou de la DGSE.
M. le rapporteur. La DGSE peut écouter l’environnement familial ou amical d’une personne en France ?
M. Bernard Bajolet. Non, ce n’est pas notre travail. Nous ne le faisons que si nous avons une autorisation d’interception. Dès lors qu’il s’agit de personnes établies sur le sol français, c’est à la DGSI qu’il revient d’en assurer le suivi. Ce qui nous intéresse, ce sont les communications entre cette personne et l’étranger. Nous pouvons les obtenir par notre système de surveillance internationale, et la loi le permet.
Dans ce groupe Allat, nous apportons nos très importantes archives. On nous demande de cribler des individus qui apparaissent à un moment ou à un autre dans la surveillance des autres services, lesquels nous demandent si nous connaissons ces personnes : nous fournissons alors ce type de renseignement. Nous délivrons également des informations sur le contexte politique. Dans ces cellules, les échanges sont très complémentaires.
En matière de contre-terrorisme, la coopération internationale est beaucoup plus systématique que dans d’autres domaines. Elle est sans limites avec les partenaires occidentaux, notamment les États-Unis et la Grande-Bretagne, et en Europe continentale avec nos principaux partenaires.
Nous faisons partie de l’UCLAT, et nous sommes favorables à la mise en place d’un outil commun aux différents services en charge de la lutte contre le terrorisme permettant de partager, de hiérarchiser et en même temps de savoir qui fait quoi. Techniquement, un tel outil de travail en commun est au point pour mieux gérer les fichiers.
M. le rapporteur. À qui serait-il accessible ?
M. Bernard Bajolet. Il serait accessible aux autres services compétents en matière de lutte anti-terroriste, à commencer par la DGSI.
M. le rapporteur. Et il comporterait vos données ?
M. Bernard Bajolet. Il comporterait les données qui peuvent être partagées avec d’autres services au terme de l’article L 863-1 du code de la sécurité intérieure : ce ne sont pas seulement les nôtres.
M. le rapporteur. Mais elles ne seraient accessibles qu’à la communauté du premier cercle ?
M. Bernard Bajolet. Elles ne seraient accessibles qu’à la communauté du renseignement : la DGSI, mais aussi à d’autres en fonction de leur besoin d’en connaître, du cadre légal et de nos possibilités techniques.
M. le rapporteur. À terme, il ne vous semble pas absurde de disposer d’une seule base de données, à l’image du FSPRT pour le ministère de l’intérieur ?
M. Bernard Bajolet. C’est loin d’être absurde, mais ceci doit être fait sous le contrôle de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR), et dans le cadre de la loi. Pour le moment, il n’est question que de contre-terrorisme. Mais c’est bien ce qui est envisagé.
M. le rapporteur. M. Calvar nous faisait part de son scepticisme, car il craint que l’on ne perde en confidentialité.
M. Bernard Bajolet. Il a raison, dans la mesure où nous ne pouvons pas toujours étendre l’information à tout le monde. Le besoin d’en connaître est une notion relative, et je souhaite avancer avec prudence. C’est pourquoi je parlais de la DGSI, qui est vraiment notre priorité, mais l’idée est ensuite d’étendre à d’autres services, dont la Direction de la protection et de la sécurité de la défense (DPSD), qui a des besoins très précis. Mais il faut savoir s’arrêter à un certain niveau pour préserver la confidentialité.
M. Meyer Habib. Dans un monde en perpétuel changement, comment faites-vous pour sélectionner les nouveaux outils technologiques ? Beaucoup d’entreprises de sécurité proposent leurs services : comment faites-vous pour sélectionner ? C’est forcément difficile pour quelqu’un qui n’a pas la formation technique.
M. Bernard Bajolet. Il faut simplement avoir les meilleurs ingénieurs, et nous tâchons d’être attrayants pour nous assurer leurs services. En même temps, nous devons créer. Il ne faut pas se contenter de suivre, il faut donc toujours anticiper sur les nouvelles technologies. Nous créons et développons nos propres systèmes. Bien sûr, nous sommes modestes par rapport aux Américains, mais, quand je suis en face d’eux, je ne rougis pas. Nous avons l’avantage d’avoir des moyens intégrés : la NSA n’a pas de renseignement humain, et la CIA n’a ni le renseignement technique ni le renseignement opérationnel. Le MI-6 britannique a le renseignement humain – il est même très bon en la matière –, mais il nous envie le renseignement technique et nos capacités opérationnelles. Nous avons la chance de tout avoir, mais, en contrepartie, notre devoir est de partager nos capacités techniques avec nos partenaires de la communauté française du renseignement, et donc de mettre à leur disposition des outils qui leur permettent d’avoir accès, depuis leurs bureaux, à nos capacités.
M. le rapporteur. Vous n’utilisez pas le FSPRT. Avez-vous des liens avec l’EMOPT ?
M. Bernard Bajolet. J’en connais l’existence.
M. le président Georges Fenech. Sauriez-vous développer le sigle ?
M. Bernard Bajolet. Je l’ai su, mais je n’ai pas fait l’effort de le retenir. C’est une structure interne au ministère de l’intérieur. Il n’a pas paru utile que mon service y soit représenté. Notre relation avec le ministère de l’intérieur – pas seulement la DGSI – est cependant excellente.
M. le président Georges Fenech. Quand en aurons-nous fini avec Daech ?
M. Bernard Bajolet. C’est une lutte de longue haleine. Je lisais récemment une déclaration d’Abou Mohamed Al-Adnani, le numéro deux de l’organisation. Anticipant la perte de Mossoul, de Raqqah et de Syrte, alors que nous en sommes encore assez loin – même si elle semble inéluctable, dans une échéance de quelques mois –, il disait que cela ne l’empêcherait pas de continuer. Ce serait certes un revers considérable pour Daech, mais, même si l’organisation est militairement vaincue – ce qui, j’en suis persuadé, sera le cas –, la menace prendra une autre forme.
Nous le disions tout à l’heure : il faut traiter les problèmes politiques, dans nos pays aussi. Ce n’est pas de mon ressort, mais nous savons tous que, pour prévenir le phénomène de radicalisation, il faut prendre des mesures politiques, sociales, éducatives. Ce sont des phénomènes profonds dans nos sociétés.
Quand bien même Daech aura été vaincu sur le plan militaire, les services de renseignement savent que la menace subsistera pendant plusieurs années. Le nombre des individus concernés est significatif. N’oublions pas que, pendant toute la guerre d’Afghanistan, il n’y a eu que quelques dizaines – peut-être quarante – djihadistes français. Nous en sommes à plusieurs centaines de Français, auxquels il faut ajouter les francophones, les Tunisiens, les Marocains, et ceux que nous ne connaissons pas.
La question de la résilience de la société française se pose. Cela me rappelle les « années de plomb » qu’ont connues des pays tels que l’Italie, dans des conditions certes complètement différentes. Il faut que la France s’arme, moralement d’abord, pour pouvoir mener cette lutte de très longue haleine.
M. le président Georges Fenech. Monsieur le directeur général, nous vous remercions.
Audition, à huis clos, de M. René Bailly, directeur du renseignement à la préfecture de police de Paris (DRPP)
Compte rendu de l’audition, à huis clos, du jeudi 26 mai 2016
M. le président Georges Fenech. Nous accueillons ce matin M. René Bailly, directeur du renseignement à la préfecture de police de Paris (DRPP).
Monsieur le directeur, nous vous remercions d’avoir répondu à la demande d’audition de notre commission d’enquête relative aux moyens mis en œuvre par l’État pour lutter contre le terrorisme depuis le 7 janvier 2015.
Nous poursuivons avec vous nos investigations dans le domaine du renseignement, en nous intéressant maintenant à son volet parisien. Outre les questions que nous nous posons sur les attentats de janvier et de novembre derniers, ce sera l’occasion de vous interroger sur l’état de la menace, sur les moyens mis en œuvre et bien sûr, la coopération et la coordination entre services.
Cette audition, en raison de la confidentialité des informations que vous êtes susceptibles de nous délivrer, se déroule à huis clos. Elle n’est donc pas diffusée sur le site internet de l’Assemblée nationale. Néanmoins, et conformément à l’article 6 de l’ordonnance 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, son compte rendu pourra être publié en tout ou partie, si nous en décidons ainsi à l’issue de nos travaux. Je précise que les comptes rendus des auditions qui auront eu lieu à huis clos seront au préalable transmis aux personnes entendues afin de recueillir leurs observations. Ces dernières seront soumises à la Commission, qui pourra décider d’en faire état dans son rapport. Je rappelle que, conformément aux dispositions du même article, « sera punie des peines prévues à l’article 226-13 du code pénal toute personne qui, dans un délai de vingt-cinq ans divulguera ou publiera une information relative aux travaux non publics d’une commission d’enquête, sauf si le rapport publié à la fin des travaux de la commission a fait état de cette information ».
Conformément aux dispositions de l’article 6 précité, je vais vous demander de prêter le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité.
M. René Bailly prête serment.
M. le président Georges Fenech. Nous avons tout d’abord des questions générales à vous poser concernant la DRPP. Quelle est sa place au sein de la préfecture de police de Paris ? Quels sont ses liens avec les autres services – direction de la sécurité de proximité de l’agglomération parisienne (DSPAP), d’une part, et direction régionale de la police judiciaire (DRPJ), d’autre part ? Quelle est sa place dans la communauté du renseignement et parmi les acteurs de la lutte antiterroriste ? Quelles ont été les actions entreprises par elle après les attentats de janvier et novembre 2015 ? Quelles sont les principales conclusions des retours d’expérience que vous avez effectués après ces attentats ?
Nous voudrions ensuite vous interroger sur les attentats de janvier et de novembre proprement dits. Pour quelle raison la surveillance des auteurs de ces attentats avait-elle été abandonnée ? La DRPP disposait-elle d’informations concernant ces individus et leurs proches ? Pourriez-vous expliquer le laps de temps de fuite des frères Kouachi après l’attaque de Charlie Hebdo ? La DRPP disposait-elle d’informations permettant d’anticiper leur trajectoire de fuite ? Comment expliquer par ailleurs qu’Abdelhamid Abaaoud n’ait pas été identifié avant 2015 comme une cible prioritaire des services français ?
Enfin, nous aurons des questions relatives à la stratégie mise en œuvre par la DRPP et aux moyens et outils qu’elle utilise.
M. René Bailly, directeur du renseignement à la préfecture de police de Paris. Les questions que vous soulevez me paraissent d’une grande amplitude par rapport à la modestie de cette direction, dont je vous rappellerai les proportions au sein de la préfecture de police et de la police nationale. La DRPP compte aujourd’hui 870 fonctionnaires. Plus petite direction de service actif de la préfecture de police, c’est une institution très ancienne.
Je souhaite à cet égard revenir sur la réforme du 1er juillet 2008. J’étais à cette époque le dernier directeur central adjoint des renseignements généraux. La réforme de 2008 a entraîné la fusion de la direction de la surveillance du territoire (DST) et de la direction centrale des renseignements généraux (DCRG). Le changement de sigle des anciens renseignements généraux de la préfecture de police de Paris (RGPP), rebaptisés DRPP, est la seule évolution qu’ait connue cette structure dans le cadre de cette réforme plus globale du renseignement. Toutes ses activités – l’information générale, la lutte contre la subversion violente et la lutte contre le terrorisme – ont été maintenues telles quelles. Si j’évoque ce point, c’est qu’il me paraît intéressant avec le recul. J’ai été par la suite directeur central adjoint de la direction centrale du renseignement intérieur (DCRI) et c’est le 2 juin 2009 que je suis revenu à la DRPP. Les ponts ayant été coupés entre l’île de la Cité et le reste du monde, j’ai été nommé à ce poste pour y « rétablir la circulation ». Ce fut assez facile à faire : il suffisait d’indiquer la direction de la DCRI à Levallois, ce que nous avons fait dès le 3 juin 2009. Lorsqu’il occupait d’autres fonctions, l’actuel garde des sceaux m’avait demandé en audition pourquoi les ponts entre la DRPP et le reste du monde du renseignement avaient été rétablis si tard : je lui avais alors répondu que je n’étais arrivé que la veille… Depuis, la DRPP a gardé toutes ses attributions. Elle fait de l’information générale, rebaptisée « renseignement territorial », et de la sécurité intérieure. J’ai d’ailleurs tenu à ce que les sigles concernant les thématiques et les missions de la DRPP soient calqués sur ceux des autres missions menées sur le plan national.
La DRPP traite actuellement de trois thématiques d’action particulières.
Celle du renseignement territorial, tout d’abord. Une petite réforme est intervenue en ce domaine en septembre 2009 lorsque la police d’agglomération a été créée. Car, à la suite de la réforme de 2008 et de la fusion du monde du renseignement, l’information générale avait basculé dans une autre direction centrale : celle de la sécurité publique. Avec le recul, j’estime à titre personnel que cela n’a pas obligatoirement été un bon choix stratégique. J’en veux pour preuve le fait que, en septembre 2009, on a demandé à la DRPP de reprendre la main sur le renseignement territorial de la petite couronne. Les trois anciens services départementaux d’information générale (SDIG) sont donc revenus dans le giron et sous l’autorité de la direction du renseignement de la préfecture de police. Ils ont alors été rebaptisés services de renseignement territorial de Seine-Saint-Denis, des Hauts-de-Seine et du Val-de-Marne. Aujourd’hui, le renseignement territorial est exercé par la DRPP au niveau de l’agglomération. Il est presqu’une évidence de dire qu’il était nécessaire de procéder ainsi. On ne peut séparer la gestion de l’ordre public de part et d’autre du périphérique, les conflits sociaux des trois départements de la petite couronne ayant une très forte incidence sur la capitale.
Quant à la sous-direction de la sécurité intérieure, c’est une petite structure. Ayant été directeur central adjoint des renseignements généraux, je me souviens très bien du volume et du maillage territorial que nous occupions, de même qu’à la DCRI. La sous-direction de la sécurité intérieure de la DRPP, elle, comporte au total quatre sections regroupant 225 personnes – à comparer au volume de fonctionnaires qu’il peut y avoir à Levallois.
La section de lutte anti-terroriste est composée actuellement de 123 fonctionnaires. Cette section a beaucoup de travail depuis plusieurs semaines. La section spécialisée dans la lutte contre la subversion violente – phénomène qui nous occupe depuis plusieurs semaines, compte tenu de la contestation du projet de réforme du code du travail – compte 31 fonctionnaires. La section dite T3, qui suit les communautés étrangères et tous les mouvements d’opposition en compte 29. La section dite T4, chargée plus précisément du suivi institutionnel de l’islam de France – c’est-à-dire de la surveillance des lieux de culte susceptibles d’abriter des points de rencontre d’islamistes radicaux ou de servir de lieux de recrutement de futurs combattants – comporte 31 fonctionnaires. Ces effectifs sont relativement modestes. Je pourrai détailler, si vous le souhaitez, l’activité spécifique de ces sections.
M. le président Georges Fenech. Ce ne sera pas nécessaire.
M. René Bailly. Nous avons bien évidemment réagi aux attentats du 7 janvier 2015 dans les locaux de Charlie Hebdo ainsi qu’à la demande des autorités d’amplifier et de rendre plus cohérente l’action de notre service. Cela s’est traduit par notre participation à de nombreux dispositifs, une coordination renforcée entre nous et la direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) par le biais d’une cellule appelée « Allât », placée auprès de la DGSI, et la création de l’état-major opérationnel de prévention du terrorisme (EMOPT), au sein duquel j’ai placé un commissaire. Je précise que, sur les 870 fonctionnaires de notre direction, le corps des commissaires est représenté par seize personnes. C’est un ratio à retenir, compte tenu des volumes d’emploi des autres directions. Nous avons contribué à la création et à l’animation du fichier de traitement des signalés pour la prévention et la radicalisation à caractère terroriste (FSPRT). Nous avons créé une plateforme spécialisée en vue du recueil et du suivi des signalements de radicalisation : elle a réceptionné les signalements téléphoniques effectués par les particuliers via un numéro vert.
M. le rapporteur. Quelle est l’apport spécifique de votre plateforme par rapport à celui du FSPRT ?
M. René Bailly. C’est grâce à cette plateforme que nous alimentons le FSPRT, créé de toutes pièces en 2015. Les cellules de traitement des signalements et de suivi de la radicalisation créées à la DRPP comme ailleurs ont passé au crible tous les signalements que nous avions reçus, en les classant selon un code couleur – vert, orange et rouge.
M. le rapporteur. La totalité de votre plateforme a-t-elle alimenté le FSPRT ?
M. René Bailly. Nous avons tout transmis à ce fichier, y compris les objectifs que nous traitions avant sa création, depuis plusieurs mois voire plusieurs années. Mais nous ne « rentrons » évidemment pas dans le FSPRT ceux des signalements verts qui sont dus, bien souvent, à des problèmes de couple, sans quoi ce fichier n’aurait plus guère de sens. Cette cellule mobilise une vingtaine de personnes car nous traitons les signalements dans une grande capitale.
Nous avons également, depuis le 1er janvier, réactivé le plan de prévention et de lutte contre l’islam radical, créé en 2004 ou 2005 avant de tomber en désuétude. J’ai d’ailleurs créé le premier plan à la préfecture de police, à la demande du préfet de police Jean-Paul Proust. Ce plan consistait à pratiquer des opérations de contrôle interministérielles, faisant intervenir des agents du renseignement, de la police judiciaire, des groupes d’intervention régionaux (GIR), des douanes, des impôts et de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) – opérations visant des commerces, des librairies et des garages, soit autant de points de rencontre ou de financement pouvant contribuer à la cause islamiste.
J’ai animé personnellement des réunions d’état-major de sécurité au niveau parisien avec nos partenaires institutionnels – les ministères de la Justice et de l’Éducation nationale et l’administration pénitentiaire. Le préfet de police m’a également demandé d’animer aux niveaux régional et zonal les mêmes réunions avec nos partenaires du ministère de l’Intérieur, le service central du renseignement territorial et ses représentants, l’unité de coordination de la lutte anti-terroriste (UCLAT), la police judiciaire (PJ), la gendarmerie nationale et la DGSI.
Voilà déjà une partie des éléments que je puis porter à votre connaissance, sur la réactivation de certains dispositifs, outre le suivi des objectifs et le travail classique que nous menons au quotidien depuis bien avant les attentats de janvier 2015.
Enfin, a été déployé l’état d’urgence, qui a entraîné beaucoup de travail pour mettre en œuvre des assignations à résidence, des perquisitions administratives et des interdictions de sortie du territoire – mesures que nous avons proposées dans des proportions qui étaient fonction de notre capacité d’investigation.
M. le président Georges Fenech. Les auteurs des attentats de janvier et novembre 2015 avaient-ils déjà été sous surveillance de la DRPP par le passé ? Si oui, cette surveillance a-t-elle été abandonnée, et pourquoi ?
M. René Bailly. Avant janvier 2015, Saïd Kouachi et Salim Benghalem – qui figure dans le « top 10 » des représentants français combattant dans les rangs islamistes dans la zone irako-syrienne – avaient été placés sous surveillance en 2011. Ce sont des individus qui nous avaient semblés intéressants parce qu’ils fréquentaient des mosquées ainsi que des noyaux d’individus pouvant présenter un jour une certaine dangerosité. Saïd Kouachi et Salim Benghalem sont partis en 2011 pour le sultanat d’Oman, ce qui nous a intrigués car cela leur permettait de se rendre ensuite au Yémen, ce qu’ils n’ont pas dû manquer de faire. Saïd Kouachi en est revenu quelques semaines plus tard. Il a fait l’objet en 2011 d’une interception de sécurité qui n’a rien apporté d’intéressant. Salim Benghalem est quant à lui resté sur zone. La surveillance de Saïd Kouachi a repris en février 2014.
M. le président Georges Fenech. A-t-elle été interrompue ?
M. René Bailly. Oui car nous sommes passés à d’autres objectifs nous ayant alors paru plus intéressants. Reprise en 2014, sa surveillance a été abandonnée en juin 2014 parce qu’il a été établi que Saïd Kouachi n’était plus en région parisienne mais installé à Reims.
M. le rapporteur. Dans ces cas-là, comment le lien s’établit-il entre vous et la DGSI ?
M. René Bailly. J’allais vous en parler. Je ferai d’abord un retour en arrière pour expliquer comment le lien s’établit avec la DGSI, ce qui vous permettra de comprendre la réponse que je vous ferai ensuite. La DRPP a un officier de liaison à Levallois, et la DGSI en a un de son côté à la DRPP. La DGSI a connaissance, quotidiennement et en temps réel, de toutes les informations traitées, rédigées et transmises par la DRPP. Nous sommes passés, entre le 2 juin 2009 – date de mon arrivée – et le 2 juin 2010, de zéro à 1600 ou 1700 notes transmises à la DGSI. L’an dernier, nous avons transmis à celle-ci 1 662 notes d’information, soit toute notre production en ce qui concerne la lutte anti-terroriste et la lutte contre la subversion violente – c’est-à-dire la surveillance de l’extrême droite et de l’ultra gauche.
D’autre part, j’envoie tous les mois à Levallois une liste exhaustive de toutes nos interceptions de sécurité concernant ces deux thématiques – les deux seules que nous ayons en commun avec la DGSI puisque nous ne faisons pas de contre-ingérence, de contre-espionnage ni de contre-prolifération. Bien évidemment, si nous avions des informations concernant ces domaines – ce qui est très rare –, nous les transmettrions in extenso à la DGSI. La DRPP est totalement transparente à l’égard de la DGSI sur l’activité qu’elle déploie et l’information qu’elle détient. Car la DGSI peut, à tout moment, nous demander des extensions de ces interceptions – ce qu’elle fait dans des proportions variables. Le principe est que la DGSI a accès à toutes les extensions d’interceptions qu’elle souhaite.
M. le président Georges Fenech. À Reims, les écoutes ont-elles été reprises par la DGSI ?
M. René Bailly. Je vais y revenir. Mais je souhaite auparavant vous préciser un troisième point. Tout ce qui concerne les notes d’information qui émanent de sources humaines traitées par nos services est bien évidemment envoyé à la DGSI.
J’en reviens maintenant à l’abandon de la ligne en juin 2014. La DGSI en a bien évidemment été avisée. Nous avons même eu une réunion de travail au début du mois de juillet avec nos correspondants de la DGSI qui ont été avisés de l’abandon de ce dispositif et qui s’étaient engagés à prendre le relais.
M. le président Georges Fenech. Nous voudrions comprendre pourquoi il a paru opportun d’interrompre ces écoutes. Techniquement, il ne s’agit pas d’auditions effectuées en simultané par un fonctionnaire, mais de bandes enregistrées par un logiciel pouvant tourner sans difficulté. Puis des contrôles hebdomadaires ou mensuels peuvent être effectués. Pourquoi avoir arrêté ces écoutes alors que Saïd Kouachi était bien identifié ? Est-ce en raison d’un problème de quota de lignes ?
M. René Bailly. Nous abordons là les problèmes de terrain et ma conception du métier. Il n’est pas la peine, selon moi, de procéder à une interception de sécurité si elle n’est pas suivie d’un travail de terrain et si elle n’est exploitée qu’en termes d’écoutes. Depuis très longtemps, les interceptions de sécurité – à une seule exception près, que je pourrais évoquer mais qui nous ferait remonter très loin en arrière – vous apprennent peu de choses. Elles vous disent néanmoins quelques petites choses sur la vie d’un individu, notamment sur ses rendez-vous – aux trois quarts desquels il n’ira pas car ces gens-là ne sont pas très fiables en la matière. Ces interceptions nous permettent d’entendre parler la personne. Elles doivent selon moi servir à engager des dispositifs de surveillance de terrain afin de voir vivre dans la rue l’individu dont vous entendez parfois la voix. C’est là que se révèle véritablement la personnalité d’un objectif. Quand ce dernier est chez lui, il peut raconter n’importe quoi. Ce n’est peut-être même pas lui qui parle. Les choses se compliquent encore davantage lorsqu’on intercepte des données informatiques car il n’y a alors même plus de voix. L’interception de sécurité doit nous servir à voir vivre un individu, à identifier ses contacts et à connaître sa fiabilité s’il annonce au téléphone un horaire de rendez-vous.
Bref, l’interception de Saïd Kouachi a été abandonnée dans la mesure où il s’était transporté à Reims.
M. le président Georges Fenech. Qu’en est-il de son frère ainsi que d’Amedy Coulibaly, de Samy Amimour et d’Omar Mostefaï ?
M. René Bailly. Il s’agit d’une autre série d’individus. Nous n’avons jamais travaillé sur Amedy Coulibaly. Il est parfois apparu dans le cadre de nos surveillances d’autres individus – notamment en raison de sa fréquentation de mosquées sensibles. Il est apparu sur un réseau assez ancien de filière irakienne une décennie plus tôt. Il était aussi apparu, comme un des frères Kouachi, et condamné pour cela avec Djamel Beghal, dans le cadre d’un projet de tentative d’évasion visant la « star » Aït Ali Belkacem, artificier du Groupe islamique armé (GIA) lors des attentats de 1995.
Mais Amedy Coulibaly n’a pas attiré plus particulièrement notre attention. C’était davantage le cas des frères Kouachi.
M. le président Georges Fenech. Amedy Coulibaly avait pourtant déjà un bon pedigree, compte tenu de tout ce que vous venez de nous dire.
M. René Bailly. Oui mais il y avait beaucoup d’autres individus dans ce cas dont certains étaient, à nos yeux, en mesure de faire pire que ces jeunes.
M. le président Georges Fenech. Amedy Coulibaly n’a donc pas fait l’objet d’une surveillance particulière.
M. René Bailly. Non. Nous n’avons jamais travaillé sur lui.
M. le président Georges Fenech. Qui l’a fait, alors ?
M. René Bailly. Je ne sais pas, monsieur le président. La section T1 compte 123 fonctionnaires aujourd’hui, mais, au cours du dernier trimestre 2015, elle en avait cinquante de moins.
M. le président Georges Fenech. Qu’en est-il de Samy Amimour et d’Omar Mostefaï ?
M. René Bailly. Ils sont apparus sur nos écrans, si je puis dire, en 2013. Samy Amimour était chauffeur à la RATP. Sa radicalisation avait été signalée, sans plus. Il a quitté la RATP puis la capitale, pour partir en Syrie. Nos surveillances ont donc été interrompues d’office. Quant à Omar Mostefaï, nous ne le connaissions pas.
M. le rapporteur. Samy Amimour était signalé pour sa radicalisation, mais il ne faisait pas l’objet d’interceptions de votre part ?
M. René Bailly. Non.
M. le rapporteur. Et il faisait l’objet d’un contrôle judiciaire.
M. René Bailly. Je ne m’en souviens pas.
M. le rapporteur. Il était mis en examen et faisait l’objet d’un contrôle judiciaire qu’il a violé. S’agissant des individus que vous surveillez, qui font l’objet d’un contrôle judiciaire et qui, un jour, cessent de pointer, disposez-vous d’un système d’alerte ? On s’aperçoit en effet maintenant que ces individus ne respectent pas vraiment leurs obligations de contrôle judiciaire et que certains signalements n’étaient pas remontés en temps réel aux services de renseignement.
M. René Bailly. Je n’ai pas souvenir que ce type de cas précis ait concerné l’un de nos objectifs. Il est en revanche arrivé que certains d’entre eux n’aillent pas pointer alors qu’ils faisaient l’objet d’une assignation à résidence. Mais ce dispositif n’a été institué que tout récemment, après les attentats de novembre 2015.
En ce qui concerne nos relations avec les autres services de la préfecture de police, la majorité des notes d’information que je destine à la DGSI sont communiquées à mon collègue Christian Sainte, de la police judiciaire de la préfecture de police de Paris (PJPP). Ces notes sont souvent rédigées très en amont, car nous n’avons pas de pouvoir judiciaires. Je trouve d’ailleurs cela très bien car il y a selon moi – et c’est une position très personnelle - une incompatibilité entre le judiciaire et le renseignement. J’ai cependant fait le choix de toujours alerter les services de la PJPP en amont. Lorsque nous travaillons sur des groupes et découvrons des individus qui pourraient se livrer quelques mois ou années plus tard à des actions violentes, nous gagnons beaucoup de temps en avisant nos collègues de la PJ pour qu’ils puissent se préparer à se saisir de certains dossiers, plutôt qu’en leur transmettant au dernier moment des comptes rendus de surveillance établis cinq ou six mois auparavant. Et ce d’autant plus que les orientations d’investigation qu’ils peuvent me donner dans le cadre de l’ouverture d’une information judiciaire me paraissent toujours assez intéressantes. On gagne ainsi du temps.
M. le rapporteur. Aviez-vous des éléments concernant Abdelhamid Abaaoud ?
M. René Bailly. Nous ne le connaissions que par l’intermédiaire de notes que nous avait transmises la DGSI – qui, en 2015, a dû m’en transmettre 350. Il est normal que ce volume soit plus réduit que ma production, car la DGSI ne me transmet que les notes pouvant intéresser la région parisienne.
M. le rapporteur. Samy Amimour était signalé pour sa radicalisation, mais ne faisait pas l’objet d’une surveillance de la part de vos services. Néanmoins, il a été surveillé jusqu’à une certaine date par la DGSI. Disposiez-vous de cette information ? Savez-vous quand la DGSI suit le « haut du spectre » des individus situés dans votre champ de compétence territoriale ?
M. René Bailly. Non.
M. le rapporteur. Aviez-vous des éléments concernant Reda Kriket ? Avez-vous participé, avec la DGSI, à son identification et à son interpellation ? Aviez-vous identifié, repéré et surveillé Sid Ahmed Ghlam ?
M. René Bailly. S’agissant des informations qui sont transmises par la DGSI à la DRPP, je suis avisé des dossiers suivis par la DGSI lorsque nous avons des objectifs partagés. La DGSI étant avisée des investigations que nous menons, une jonction opérationnelle s’établit lorsque nous travaillons sur des objectifs également suivis par cette direction. En revanche, je ne suis pas avisé des objectifs traités par la DGSI, pas même de ceux qui se trouvent dans la capitale et la région parisienne, lorsqu’ils ne sont pas suivis par la DRPP en propre.
M. Pierre Lellouche. Trouvez-vous cela normal ?
M. René Bailly. La réponse est dans la question : non.
Quant à Sid Ahmed Ghlam, nous ne le connaissions pas. Nous avons su a posteriori qu’il avait fait l’objet d’un signalement de radicalisation tout à fait banal qui ne méritait pas une attention particulière. En revanche, nous travaillions à l’époque sur des individus qui sont apparus par la suite comme ayant pu lui servir de support logistique – notamment l’un qui tenait un petit garage automobile dans le Val-d’Oise. Il était vraisemblablement l’un des correspondants de Sid Ahmed Ghlam, voire peut-être l’un de ses premiers supports logistiques, puisqu’a été établi un lien entre un des véhicules utilisés par lui – la Mégane retrouvée à Aubervilliers – et ce garage. Les éléments d’investigation traités par la police judiciaire et la DGSI ont établi qu’il y avait des systèmes de communication cryptée – Sid Ahmed Ghlam étant étudiant en informatique, il était très disposé à utiliser ce type de dispositif – entre certains objectifs que nous surveillions en lointaine banlieue parisienne et cet individu. Mais nous n’avons jamais établi de lien entre Sid Ahmed Ghlam et cette personne lui apportant un soutien logistique en temps réel.
M. le rapporteur. Vous nous avez dit tout à l’heure qu’Amedy Coulibaly n’était pas surveillé par vos services. La DGSI nous a dit la même chose. Néanmoins, d’après les informations dont je dispose, en prison à Fleury-Mérogis, il était lié – vous l’avez rappelé – à Djamel Beghal. Et l’administration pénitentiaire connaissait sa radicalisation. Par ailleurs, il avait fait de la prison pour avoir projeté l’évasion d’Aït Ali Belkacem. À un moment donné, Coulibaly sort de prison et est même reçu à l’Élysée. N’y a-t-il pas de relations entre l’administration pénitentiaire et vos services concernant ce type d’individus ?
M. René Bailly. Nous avons des relations assez étroites avec l’administration pénitentiaire : elles ne datent pas d’hier mais elles ont été réactivées. Elles concernent le suivi de certains détenus et les signalements qui peuvent nous être communiqués. Nous avons aussi établi des liens entre certains individus qui sont hors de prison et d’autres qui y sont enfermés. J’ai toujours pensé – et continuerai à penser encore longtemps – que les premiers terroristes sur lesquels on doit travailler sont ceux que l’on détient. La question que vous posez en est une démonstration flagrante. Nous faisons des réunions de sensibilisation…
M. le rapporteur. La relation existe donc. Mais pourquoi, alors que tous les clignotants étaient au rouge, Amedy Coulibaly, emprisonné pour avoir tenté de faire évader un détenu important en matière de terrorisme et en lien avec Djamel Beghal, n’a-t-il pas été surveillé à sa sortie de prison ?
M. René Bailly. Je n’ai pas de réponse à cette question, qu’il faut poser à l’administration pénitentiaire. Dans une relation, il ne peut pas n’y avoir qu’un seul sens de circulation. Nous avons des relations assez fréquentes avec l’administration pénitentiaire. Nous leur faisons même des séances de sensibilisation. Pour encourager ceux de mes collaborateurs qui hésiteraient encore à s’intéresser à ce qui se passe dans les prisons, je rencontre moi-même certains détenus. Ce n’est pas nécessairement dans mon statut, mais j’ai cru bon de remettre la main à la pâte récemment, car beaucoup d’indicateurs nous laissent penser qu’il y a une très grosse activité dans les maisons d’arrêt de la région parisienne. Les échos que nous avons concernant les individus qui sont hors de prison et qui sont en contact avec des détenus méritent aussi d’être suivis. Mais je ne sais pas pourquoi l’administration pénitentiaire ne nous a pas alertés – ni la DRPP ni la DGSI, avec laquelle elle a des contacts sur l’ensemble du territoire national.
M. le président Georges Fenech. On peut penser qu’avec l’intégration de l’administration pénitentiaire dans la communauté du renseignement ces hiatus ne devraient plus se produire.
M. Meyer Habib. Monsieur le directeur, qu’est-ce qui a changé dans votre façon de fonctionner, entre les attentats de janvier et de novembre 2015 et aujourd’hui ? À vous entendre, on a l’impression que les services sont bien cloisonnés. Vous avez certes réussi à faire en sorte de travailler aussi de l’autre côté du périphérique, mais lorsqu’un individu est à Reims, il y a changement de compétence. L’autre jour, le ministre de l’Intérieur a organisé une réunion place Beauvau pour expliquer aux services d’intervention qu’ils devaient non seulement changer de doctrine, mais aussi mutualiser leur action et mettre un terme à la concurrence qui existait entre eux. Ne pensez-vous pas qu’il faudrait faire de même dans la communauté du renseignement et organiser une véritable pyramide ? J’ai l’impression que la DRPP est limitée en nombre de fonctionnaires. Vous avez d’ailleurs expliqué tout à l’heure au président Fenech que vous aviez été obligé de cesser votre action concernant Saïd Kouachi pour accorder la priorité, compte tenu de vos moyens, à de « gros poissons ». Nous avons bien compris qu’à l’impossible nul n’est tenu, mais que diriez-vous d’une refonte totale du mode de fonctionnement des services ?
D’autre part, quel est votre avis concernant l’Union des organisations islamiques de France (UOIF) ? Suivez-vous cette organisation ?
Enfin, on entend dire qu’il y aurait 25 à 30 % de convertis parmi ceux qui partent faire le djihad. Avez-vous, parmi les agents chargés des écoutes téléphoniques, suffisamment de fonctionnaires parlant l’arabe ?
M. Pierre Lellouche. Il ressort de ce que vous dites, Monsieur le directeur, que vous êtes en sous-effectif flagrant par rapport à votre mission de surveillance de la radicalisation dans la capitale et la petite couronne – où sont susceptibles de se commettre la plupart des attentats. Si j’ai bien compris, votre service compte 123 agents chargés de la lutte contre le terrorisme, 29 chargés des communautés étrangères et 31 chargés des lieux de culte. Combien y a-t-il de lieux de culte musulmans à Paris et en région parisienne ? Combien d’entre eux posent problème ? Combien vous faudrait-il d’agents pour être en mesure de les surveiller ? Si je compare vos 123 agents au nombre de « clients » qui se sont rendus en Syrie et en Irak et qui en reviennent, j’en déduis que vous en suivez 10 % et que les 90 % restants se baladent dans la nature sans faire l’objet d’une surveillance. Pourriez-vous le confirmer ? Et avez-vous confiance dans le reste de la communauté du renseignement pour s’occuper de ces éléments ?
Concernant les interceptions, ce que vous dites est frappé au coin du bon sens. Il faut des gens sur le terrain, mais aussi des gens capables de pénétrer des systèmes cryptés. Il n’est pas étonnant que les individus expérimentés qui rentrent du Proche-Orient ne disent rien au téléphone. Il y a aussi mille façons d’utiliser un téléphone avec des puces différentes. Que faites-vous vis-à-vis du dark cloud et des modes de communication employés par ces véritables soldats, aguerris à ces techniques une fois de retour du Proche-Orient ?
Quid, par ailleurs, de l’infiltration des milieux salafistes à Paris et en banlieue parisienne ? Avez-vous des personnels susceptibles de s’en charger ? Ou ne le faites-vous que sur les signalements qu’on veut bien vous adresser ?
J’ai été choqué par ce que vous avez dit sur l’absence de réelle coordination entre les différents services. Si j’ai bien compris, vous alimentez la DGSI, mais celle-ci vous laisse complètement dans l’ignorance de ce qui peut se passer à Paris et en région parisienne dans le cadre de ses propres activités. Et, jusqu’à présent, il y a eu une coupure totale entre vous et l’administration pénitentiaire. Pensez-vous que cela va s’améliorer aujourd’hui ?
Enfin, qui sont les « casseurs » et les auteurs de violences envers les policiers ? S’agit-il de l’ultra-gauche ou d’un mélange de l’ultra gauche et de radicalisés des banlieues ?
M. René Bailly. Si vous avez l’impression d’un cloisonnement entre services, c’est peut-être que je me suis mal exprimé. Je pense au contraire qu’il y a un décloisonnement total en ce qui concerne l’activité de la DRPP à l’égard du reste de la communauté du renseignement, DGSI incluse. Je vous le répète : nous travaillons en toute transparence avec cette direction.
M. Pierre Lellouche. Dans ce sens-là, oui. Mais dans l’autre sens ?
M. René Bailly. Dans l’autre sens, je pourrais effectivement bénéficier d’informations sur les objectifs suivis par la DGSI, mais j’ai déjà du mal à traiter ce que j’ai « en magasin », si je puis dire. Je suppose que les informations que pourrait nous communiquer la DGSI sur les objectifs qu’elle traite ne sont pas suffisamment mûres, ou pas en relation avec nos propres objectifs. Ce ne serait donc que de l’information pour l’information.
M. Pierre Lellouche. Mais ces éléments pourraient croiser d’autres éléments en votre possession sur les objectifs que vous suivez.
M. René Bailly. La DGSI ayant connaissance de tout notre dispositif, le croisement se fait tout naturellement. Je ne pense pas du tout qu’il y ait de faille à cet endroit – et je ne dis pas cela pour chercher à dédouaner ce grand service. De toute façon, je ne pourrais pas m’y associer davantage en termes d’investigations de terrain, de suivi de lignes ni d’utilisation de nouvelles techniques du renseignement.
M. Meyer Habib. Vos moyens n’ont-ils pas augmenté ?
M. René Bailly. Si, ils ont augmenté. Dans le cadre du plan de lutte anti-terroriste, le ministère de l’Intérieur a spécifiquement affecté à la lutte anti-terroriste 100 fonctionnaires supplémentaires : 50 à la fin de 2015, 25 en 2016 et 25 en 2017.
M. Pierre Lellouche. Sont-ils formés à la lutte anti-terroriste ?
M. René Bailly. J’ai l’avantage de pouvoir les choisir. Pour sélectionner les 50 fonctionnaires que j’ai recrutés à la fin de 2015, j’ai lancé un avis de recrutement et reçu un peu plus de 120 candidatures. Bien évidemment, nous choisissons des gens qui ont, selon nous, des capacités policières adaptées à la mission que nous entendons leur confier. Nous ne prendrons pas, par exemple, des agents des brigades d’information de voie publique (BIVP) pour leur faire faire, du jour au lendemain, du suivi et des filatures dans des contextes difficiles ou dans des zones géographiques délicates où l’on peut être soi-même en danger.
M. le rapporteur. Recrutez-vous seulement des fonctionnaires de police ?
M. René Bailly. Essentiellement.
M. le rapporteur. Embauchez-vous des contractuels ?
M. René Bailly. La question m’a été posée récemment. Nous y réfléchissons, pour des domaines bien spécifiques. Pour répondre à la question sur les langues étrangères parlées par nos agents, il est évident qu’il nous faut des interprètes lorsque nos interceptions portent sur des individus parlant l’arabe. Nous les avons. J’ai un service d’interceptions installé encore aujourd’hui aux Invalides, mais qui va déménager bientôt vers une plateforme plus moderne rue du Cherche-Midi. Je considère mon service d’interceptions comme très satisfaisant. Bien sûr, nous pourrions avoir plus d’interprètes, mais il faut rentabiliser l’utilité de ces collaborateurs et contractuels. Se posent ensuite des questions de financement. J’ai d’ailleurs oublié de vous indiquer un point. Et c’est plutôt cela qui devrait vous choquer et vous permettre de plaider la cause de la DRPP : le budget de notre direction pour 2016 est de 980 000 euros pour 870 fonctionnaires.
M. le président Georges Fenech. Hors salaires ?
M. René Bailly. Oui. On ne peut pas faire grand-chose avec une telle somme.
M. le rapporteur. Payez-vous vos sources ?
M. René Bailly. Oui, mais cela représente peu de chose en termes budgétaires. Dans le domaine du renseignement territorial, le financement des sources est assuré par mon propre budget. Il est relativement faible : entre 10 000 et 15 000 euros par an. Dans le domaine de la sécurité intérieure, les sources sont financées par la DGSI, à hauteur de 30 000 euros sur l’année. Ce budget paraît dérisoire, mais il est suffisant. Si une source peut nous permettre de déjouer un attentat très grave dans la capitale, je sais que je pourrai demander à la DGSI de récompenser cette source.
Encore une fois, l’aspect le plus dramatique pour la DRPP est la faiblesse de son budget par rapport à ses missions et à son volume de fonctionnaires, en comparaison d’autres services.
En tout cas, je ne pense pas qu’il y ait cloisonnement. Vous semblez considérer que la DGSI pourrait communiquer davantage avec nous. Je trouve pour ma part que nous communiquons suffisamment et que la DRPP travaille en toute transparence à vis-à-vis de ce grand service. Cela me satisfait pleinement et parfois, la DGSI nous associe au suivi de certains groupes d’objectifs. Nous pouvons répondre à la commande mais compte tenu du volume d’effectifs dont je dispose, nous sommes limités et avons des choix qualitatifs à faire.
M. Serge Grouard. Qu’en est-il du cloisonnement entre vous et l’administration pénitentiaire ?
M. René Bailly. On a beaucoup parlé ces derniers temps de l’inclusion du renseignement pénitentiaire dans la communauté du renseignement. J’y suis très favorable car il s’agit d’agents très engagés dans leur mission et déterminés. Il serait bon qu’ils soient vraiment associés au second cercle du monde du renseignement, auquel nous sommes nous-mêmes en partie cantonnés.
Le dispositif de sécurité intérieure de la DRPP mériterait pleinement, au même titre que la petite structure TRACFIN, d’être dans le premier cercle. Mais je comprends très bien que le caractère hybride de notre mission puisse inquiéter les grands services de renseignement, qui souhaitent que le secret défense soit complètement garanti. Je rappellerai simplement, et sans nostalgie, que la DCRG entretenait des relations internationales et faisait de la lutte antiterroriste. Or la confidentialité de sa mission dans un domaine bien précis ne posait pas de problème au reste du monde du renseignement. La DRPP fait du renseignement territorial et de la sécurité intérieure : au titre de cette dernière, elle pourrait très légitimement participer au premier cercle.
Pour en revenir à votre question, je pense très sincèrement que ce serait un atout de rendre plus officielle la participation du renseignement pénitentiaire au dispositif du second cercle. C’est d’ailleurs à ce titre que l’Académie du renseignement nous a fait la faveur, en 2015, d’organiser la première réunion de travail, déconcentrée au second cercle, sur le phénomène de la radicalisation. Je l’ai organisée à la DRPP, avec trente fonctionnaires – dix de la DRPP, dix du service central du renseignement territorial (SCRT) et dix de l’administration pénitentiaire. Cette session de trois jours sur la radicalisation a été très importante et très intéressante, au point que l’on m’en parle encore comme d’un exercice à renouveler. L’administration pénitentiaire peut donc sans doute nous fournir plus d’éléments, à condition qu’elle en ait elle-même les moyens. En outre, elle ne peut pas faire n’importe quoi. Elle peut faire du renseignement pénitentiaire, mais peut-elle avoir accès aux techniques du renseignement ? Si elle se lance dans cette aventure, il faudra renforcer de manière significative ses effectifs. J’ai en tout cas constaté dans cette administration une vraie détermination et les échanges entre nous sont très fréquents. Je ne sais pas pour quelle raison elle ne nous a pas parlé d’Amedy Coulibaly. Elle nous a parlé d’autres individus sur lesquels nous avons travaillé.
M. le président Georges Fenech. Nous les interrogerons. Pouvez-vous répondre aux questions de M. Lellouche ?
M. René Bailly. Nos services sont effectivement toujours en sous-effectif. Cela étant, lorsqu’on m’a laissé entendre qu’on allait les renforcer au dernier trimestre de l’année 2015, on m’a demandé combien de personnes je voulais. Or, les murs épais – à l’histoire ancestrale – de la préfecture de police de Paris, à la caserne de la Cité, ne sont pas à géométrie variable, contrairement à ceux du 84 rue de Villiers à Levallois. Dans l’espace dont je dispose, je pouvais loger dix fonctionnaires. On m’a dit que j’en aurais cinquante – je ne savais où les mettre. Et voilà finalement que je vais en avoir cent ! J’ai donc dû faire camper les 50 fonctionnaires qui sont arrivés à la fin de l’année 2015, le temps de réaménager l’ensemble du service et du dispositif – ce qui a eu des conséquences notables sur le positionnement géographique de ces fonctionnaires. Il faut leur trouver du travail, mais aussi des locaux. J’ai dit au ministre de l’Intérieur que je voulais bien des renforts et que je savais très bien la mission que j’allais leur confier, mais que je ne donnerais pas obligatoirement un ordinateur à chacun de ces cent fonctionnaires. Je ne néglige pas le travail technique ni la recherche du dark web, mais je crois que les conversations cryptées d’Amedy Coulibaly la semaine précédant son action du 8 janvier contre la jeune Clarissa Jean-Philippe et celle du lendemain à l’Hyper Cacher ne sont toujours pas décryptées. Il y a donc en effet un vrai problème.
M. Meyer Habib. Amedy Coulibaly est arrêté, trois jours avant les faits, avenue Simon-Bolivar dans le 19e arrondissement de Paris, à soixante mètres de l’école Lucien-de-Hirsch, la plus grande école juive de la capitale, qui se trouve avenue Secrétan. On lui demande son permis, on sait qu’il est fiché S, et il est relâché, deux jours avant qu’il commette un meurtre à Montrouge.
M. René Bailly. Ne soyez pas excessivement choqué qu’il ait fait l’objet d’une fiche S et ait été relâché. D’abord, c’est, je crois, la DGSI qui avait diffusé cette fiche. En tout cas, ce n’était pas nous. Ensuite, les fiches S ne sont que des fiches de signalement. Ce ne sont pas des fiches d’arrestation ni d’interpellation. La fiche S d’un individu sert à apprendre aux services de renseignement que l’individu a été contrôlé à tel ou tel moment à tel ou tel endroit, qu’il était en compagnie – si le travail a été bien fait – de telles ou telles personnes, et où il comptait se rendre. Elle ne sert qu’à cela. Mais cela a au moins le mérite d’alerter en temps réel son diffuseur. Je ne sais pas si cela a été fait.
M. Pierre Lellouche. Pareille situation justifie que vous soyez informés, puisqu’elle se passe dans Paris. Si un individu fiché S est intercepté à proximité d’une école juive, vous ne savez pas si l’émetteur de la fiche a été informé, mais le système devrait au moins vous permettre de l’être.
M. René Bailly. Non. 1167 fiches S émises par la DRPP sont actuellement actives. Si M. Coulibaly ne figurait pas parmi les fiches que je détenais, le service qui l’a interpellé n’avait pas à m’appeler. Sur une fiche figurent les raisons de son émission, l’identité du service émetteur et le numéro à joindre auprès de ce service.
M. Pierre Lellouche. J’ai bien compris. Mais trouvez-vous normal que vous, patron du renseignement à Paris, ne soyez pas destinataire d’interceptions d’individus fichés S, même si vous n’êtes pas émetteur de la fiche ? Sachant qu’il y a 9 000 fiches, il peut s’agir d’un individu arrivant d’un autre département. S’il s’apprête à cibler un objectif dans votre zone, vous ne serez pas au courant.
M. René Bailly. Non.
M. Pierre Lellouche. Est-ce normal ?
M. René Bailly. Quand bien même je serais avisé, je ne pourrais rien faire de cette information s’il s’agissait d’un objectif que je ne connais pas. Nous ne pourrions que nous rapprocher du service émetteur pour nous assurer qu’il a été prévenu et pour lui demander pourquoi il a émis cette fiche. Et, comme vous le dites, il y a 9 000 fiches.
M. le président Georges Fenech. Pourriez-vous répondre à la question annexe qui vous a été posée concernant l’origine des casseurs ? Ont-ils un lien avec la radicalisation ? Qu’en est-il de l’infiltration des mosquées ? Je vous rappelle qu’il vous faut faire les réponses les plus courtes possible. Je vais être obligé de partir et nous avons beaucoup de questions à vous poser.
M. René Bailly. S’agissant des violences urbaines, le seul lien qui puisse exister entre les casseurs et les terroristes est d’ordre sémantique et tient au terme de « radicalisation » que vous utilisez.
M. le président Georges Fenech. Il ne s’agit pas d’une radicalisation islamique.
M. René Bailly. Pas du tout.
M. le président Georges Fenech. Et qu’en est-il de votre infiltration dans les milieux salafistes ?
M. René Bailly. Je l’ai presque évoquée tout à l’heure en vous parlant du recrutement des sources, qui se fait uniquement par le biais de ce dispositif. Il y a plusieurs centaines de mosquées en région parisienne, que j’ai répertoriées l’an dernier. La majeure partie d’entre elles sont loin de présenter une dangerosité et une radicalité pouvant constituer une source de recrutement.
M. Pierre Lellouche. Combien d’entre elles posent problème ?
M. René Bailly. Nous en surveillons actuellement moins d’une dizaine dans la capitale. Nous en avons fait fermer une, qui était extrêmement dangereuse, à Lagny-sur-Marne, au terme d’un combat acharné. La DRPP a mis plus d’un an à obtenir le décret de dissolution de cette mosquée.
M. le président Georges Fenech. Un an de combat contre qui ?
M. René Bailly. Contre le droit. Je ferai un parallèle avec la question précédente sur les casseurs. Nous connaissons très bien la mouvance dite contestataire radicale, qui n’a rien à voir avec la radicalisation. Lorsque des individus de cette mouvance arrivent dans une manifestation, nous sommes capables, parmi un groupe de deux cents personnes, d’en identifier formellement plus de la moitié. Mais, en l’espace d’une seconde, lorsqu’ils remontent leur capuche et qu’ils mettent leur masque à gaz et leur k-Way noir, ils se ressemblent tous et nous ne pouvons plus les identifier. C’est d’ailleurs la grande difficulté que nous avons rencontrée avec les interdictions de paraître : même si nous savons que les individus concernés sont dans une manifestation, ils se dissimulent et se griment si bien qu’il est impossible de les identifier et d’associer un nom à un affrontement spécifique de CRS. Nous avons eu beaucoup de chance, grâce à deux fonctionnaires de la DRPP ayant suivi ce petit noyau quai de Valmy, puisque nous l’avons vu en action lors de l’agression du véhicule sérigraphié mais il ne s’agit pas là d’une infiltration comme nous en faisons dans les mosquées.
Dans les milieux salafistes et les mosquées sensibles, ou aux points de rencontre tels que les restaurants et les commerces, nous avons recours à des surveillances physiques, à des prises de photographies, à la vidéo – puisque la loi nous y autorise – et, surtout, nous recrutons des sources humaines.
M. François Lamy. Je n’aurai qu’une seule question d’ordre général à vous poser après vous avoir entendu. Quelle plus-value un service territorialisé comme le vôtre apporte-t-il à la lutte globale contre le terrorisme, qui est sans frontières ? Ne serait-il pas plus efficace que les fonctionnaires et l’ensemble des moyens que vous consacrez au renseignement et la lutte contre le terrorisme soient reversés à la DGSI afin d’avoir un service plus global ?
Présidence de M. Meyer Habib, vice-président.
M. Philippe Goujon. Dieu sait si je suis un ardent défenseur de la préfecture de police. Cette institution me semble adaptée à la sécurité de Paris et du grand Paris. Mais depuis que cette audition a commencé, en écoutant vos réponses, je ne trouve pas de justification à l’existence de votre service que la réforme a effectivement épargné. Je peux comprendre que l’on souhaite conserver une spécificité à la préfecture de police pour des raisons d’ordre général mais votre service n’a pas de justification opérationnelle. Si votre service n’a ni moyens ni locaux ni de personnel – ni peut-être même d’IMSI-catchers –, il ne sert pas à grand-chose, car il n’a pas de moyens suffisants pour mener efficacement la lutte contre le terrorisme et les autres missions qui sont les vôtres. Qui plus est, il y a des zones d’ombre et des difficultés d’articulation avec la DGSI et l’administration pénitentiaire. On ne comprend donc pas l’existence de cette couche supplémentaire, qui peut même amener à ignorer certaines situations ou à manquer des terroristes. Vous n’êtes même pas dans le premier cercle de la communauté du renseignement.
Votre situation présente donc beaucoup d’inconvénients. Quelle est votre implantation territoriale à Paris et dans l’agglomération ? Comment travaillez-vous avec les services locaux comme la DSPAP, le service régional de police judiciaire (SRPJ), la brigade de recherche et d’intervention (BRI) ou la direction de l’ordre public et de la circulation (DOPC) ? S’il y a des insuffisances par rapport aux échelons nationaux, y a-t-il au moins, au niveau territorial, des échanges d’informations qui vous permettent de travailler de façon opérationnelle ?
M. René Bailly. Vous me demandez de justifier l’existence du service que je dirige actuellement. Je ne peux en parler qu’à travers l’activité que nous développons.
Je peux ainsi vous informer que les investigations que nous avons menées dans le cadre de la lutte anti-terroriste ces dernières années ont permis à la DGSI et à la PJ du 36 quai des Orfèvres de démanteler des réseaux terroristes.
Je peux aussi vous citer le réseau Forsane Alizza, que nous avons identifié en 2012 et dont personne n’avait connaissance. Nos investigations se poursuivant, nous nous sommes aperçus qu’il « étoilait » sur l’ensemble du territoire national, ce qui a permis à la DGSI de préempter ce dossier – chose tout à fait normale –, de le judiciariser et d’interpeller une quinzaine d’individus, dont un commando bien identifié qui s’apprêtait à commettre des attentats dans la capitale et, notamment, à éliminer le recteur Dalil Boubakeur. Les faits ont été établis, jugés et condamnés.
Nous avons détecté récemment un autre réseau appelé Sanabil – « le blé » en arabe –, piloté par un individu qui apparaissait déjà lorsque j’étais à la DCRG, dans la commune d’Artigat, dont sont issus les frères Clain – qui ont revendiqué les attentats du 13 novembre commis à Paris – et qui a généré le jeune Mohamed Merah. Ce réseau a été démantelé. Ses avoirs ont été gelés, puisque l’aide et le soutien moral que cette association prétend apporter aux détenus sont essentiellement consacrés à des détenus inculpés pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste. Bref, l’affaire est partie de la DRPP et a été exploitée par la DGSI.
Voilà quelques exemples marquants de nos activités. Je ne vous citerai pas, tant elles sont nombreuses, toutes les notes d’information que nous avons rédigées sur des groupes se livrant à du trafic d’armes ou de faux papiers et servant la cause terroriste. La facture de tous les attentats de Paris est relativement modeste, presqu’autant que le budget de la DRPP, pour commettre les pires atrocités dans la capitale depuis la Seconde Guerre mondiale. Nous contribuons donc malgré tout, sans nécessairement en faire la publicité, à la lutte antiterroriste. Quand la DGSI revendique le démantèlement d’un certain nombre de réseaux depuis 2013, je peux vous dire que la DRPP y a apporté, malgré ses modestes moyens, une contribution non négligeable. L’information que nous communiquons quotidiennement doit aussi être recherchée et travaillée. Je pense donc sincèrement que nous apportons une plus-value à l’information globale détenue par la DGSI.
M. François Lamy. Certes, mais si vos hommes étaient à la DGSI, ils apporteraient le même type d’informations. Quelle plus-value le fait que vous soyez territorialisés apporte-t-il ?
M. René Bailly. Je vous suggèrerai une autre question : pourquoi n’y a-t-il pas de direction régionale de la DGSI à Paris, alors qu’il y en a partout ailleurs ? La DRPP, dans sa dimension de sécurité intérieure, pourrait très bien constituer une direction régionale de la DGSI. Il me semble bien que la DCRG considérait les renseignements généraux de la préfecture de police (RGPP) comme une de ses directions régionales, ce qui n’empêchait pas ces derniers de travailler ni de sortir des affaires. Je vous rappelle – avec nostalgie – que les plus grosses affaires de terrorisme en France – qu’il s’agisse des Basques, des Corses ou des islamistes – ont été démantelées par les renseignements généraux.
M. François Lamy. C’était leur mission.
M. René Bailly. Pas la seule, me semble-t-il. L’islam me semble avoir été une préoccupation bien avant 1994.
M. le rapporteur. Je souhaiterais revenir à la question que je vous ai posée tout à l’heure concernant Reda Kriket.
M. René Bailly. J’en ai entendu parler à la suite de la diffusion, par la DGSI, d’une note d’information qui venait d’être alertée par un service étranger de l’éventuelle présence de Reda Kriket en France, voire peut-être en région parisienne.
M. le rapporteur. Au moment de l’interpellation, ou plusieurs mois avant ?
M. René Bailly. Je pense que c’était en janvier, mais je n’en suis pas sûr.
M. le rapporteur. Avez-vous contribué à la localisation de cet individu ? Il était clairement situé dans votre champ de compétence territoriale : à Courbevoie et à Argenteuil, mais aussi à Boulogne-Billancourt ou à Issy-les-Moulineaux.
M. René Bailly. Il avait un appartement à Boulogne et une cache à Argenteuil.
M. le rapporteur. Et il est né à Courbevoie.
M. René Bailly. Nous l’avons découvert par le biais de la note de la DGSI.
M. le rapporteur. Dernier point, vous avez indiqué tout à l’heure que l’on n’arrivait toujours pas à décrypter les appels téléphoniques d’Amedy Coulibaly. Ma question sera peut-être hors sujet, car je ne m’y connais guère sur le plan technique, mais si l’on a récupéré des conversations de Coulibaly datant d’avant les attentats de janvier 2015, c’est bel et bien qu’un service le surveillait…
M. René Bailly. Non.
M. le rapporteur. …à moins qu’on n’ait pu écouter ces conversations a posteriori ?
M. René Bailly. Je pense que c’est effectivement ce qui s’est passé, grâce aux messages envoyés puis restés en mémoire sur les téléphones qui ont été récupérés.
M. le rapporteur. Il ne s’agit donc pas de conversations, mais de « fadettes » ou de messages ?
M. René Bailly. Ce sont des messages. Les fadettes, c’est encore autre chose.
M. le rapporteur. On a donc récupéré des SMS ?
M. René Bailly. Oui, c’est plutôt cela. Ou des e-mails, sur support informatique. Techniquement, ces messages n’ont pas encore été décryptés.
M. Philippe Goujon. Je vous poserai une question d’actualité. Dans quelques semaines aura lieu l’Euro 2016, en particulier à Paris. Compte tenu de ce qu’on a pu voir il y a quelques jours au Stade de France – et dont vous n’êtes pas responsable – et de l’installation d’une fan zone pouvant accueillir 100 000 personnes au Champ-de-Mars, au pied de la Tour Eiffel, sachant d’autre part que la cellule belge qui a été démantelée avait notamment pour objectif cet événement et que des terroristes arrêtés récemment à Bari, dans les Pouilles, avaient sur eux une photo de la Tour Eiffel, quelle est votre analyse des menaces qui pèsent sur cet événement sportif et sur la fan zone du Champ-de-Mars ?
M. René Bailly. L’information dont je dispose concernant cette menace est connue de tout le monde. Je pense que l’Euro 2016, tribune internationale, constitue une cible prioritaire de frappe pour Daech – qui ne s’en cache pas. Cela a été révélé lors de certaines arrestations. Les terroristes ont déjà tenté de frapper le Stade de France. Si Daech pouvait interdire la tenue de l’Euro 2016, ne serait-ce qu’en frappant, il le ferait. De plus, les matchs n’auront pas lieu seulement à Paris ; Daech sera peut-être tenté de faire ailleurs ce qu’il ne peut faire dans la capitale. Aucun service – pas mêmes les grands services extérieurs – n’avait présumé, avant le 13 novembre, qu’il y aurait des attentats kamikazes, malgré les nombreuses analyses effectuées.
Je suis très terre-à-terre sur ces questions. Je fais confiance au travail basique des policiers, aux filatures et aux surveillances. Je sais que nos collègues de la DGSI en tiennent compte aussi, mais ils sont prioritairement orientés vers la technique. Bien évidemment, il faut de la technique, puisque l’ennemi l’utilise, mais elle ne résoudra pas tout. Dans la lutte antiterroriste, il nous faut aussi des sources humaines, de la « pâte humaine ». Pour en revenir à la menace pesant sur l’Euro 2016, comme à celle de 2013, il faut aussi faire appel à sa mémoire : on a su, dans la mesure où un hebdomadaire l’avait publié, que le Bataclan n’était pas une cible sortie du chapeau de Farouk Abbes, qui en avait parlé dès 2009. Cela ne relève pas strictement du domaine de compétence de la DRPP. Il faut, à cet égard, partager avec les autres le devoir de mémoire.
M. le rapporteur. Pourriez-vous nous dire le fond de votre pensée concernant le Bataclan ? Paris Match a effectivement publié le procès-verbal de la DCRI dans lequel Farouk Ben Abbes citait cette salle de spectacle. Mais lorsque vous dites que ce lieu n’est pas « sorti du chapeau », considérez-vous qu’il continue à être une cible permanente ?
M. René Bailly. Non. Je veux dire qu’en termes de réflexion et d’analyses nous sommes tellement pris dans une masse d’informations à trier que, parfois, nous n’arrivons plus à avoir le recul nécessaire sur des éléments basiques. Demander pourquoi l’administration pénitentiaire n’a pas attiré l’attention sur Coulibaly, c’est poser une question basique. Pourquoi ne se souvient-on pas qu’en 2009 le Bataclan a été ciblé alors que Daech, dans sa revue Dar-al-Islam, avait proféré certaines menaces ? Il me semble intéressant de retenir que les terroristes écrivent toujours à l’avance ce qu’ils vont faire. Je vous renvoie aux numéros 4 et 5 de cette revue, dans lesquels Daech nous avertissait qu’il frapperait des centres commerciaux, des policiers, des militaires, des moyens de transport – il a déjà frappé un TGV – et des salles de spectacle. Bref, il y déclinait ses objectifs. Bien évidemment, l’Euro 2016 a également été ciblé. La menace pesant sur cet événement est donc très forte.
M. Serge Grouard. Quels sont les pourcentages respectifs d’individus de la mouvance terroriste que l’on connaissait avant les attentats et que l’on ne connaissait pas du tout ou presque pas ? Si je pose cette question, c’est pour savoir si les mailles du filet sont plutôt satisfaisantes, ou si nous sommes de toute façon face à un leurre puisque, malgré tout le travail que vous faites avec vos collègues des autres services, la masse est telle qu’il y a toujours des individus qui passeront entre ces mailles et qu’on ne connaissait pas a priori.
D’autre part, vous dites que les terroristes écrivent toujours avant ce qu’ils feront après. Cela fournit une grille de lecture et permet d’anticiper. Mais si les exécutants ne sortent pas forcément tous de Polytechnique ou d’autres grandes écoles, les commanditaires font preuve, eux, d’une intelligence stratégique et tactique, au sens proprement militaire. Ne vont-ils pas justement, comme le conseillait il y a longtemps l’auteur d’un ouvrage intitulé Le Paradoxe de la stratégie, faire ce que l’on n’attend pas d’eux ? Tout ce qui est dit actuellement sur l’Euro 2016 ne participe-t-il pas d’une stratégie visant à nous fatiguer pour que, à un moment ou à un autre, nous baissions la garde et que des attentats soient alors perpétrés ? Il me semble que le Royaume-Uni a vécu ce type de scénario. Les terroristes ne cherchent-ils pas à nous mettre sur les dents ? Si, comme je le souhaite, il ne se passe rien pendant l’Euro 2016, peut-être faudra-t-il en tirer la conclusion que, certes, nous avons été très efficaces, mais aussi qu’une autre stratégie est à l’œuvre.
M. René Bailly. Il est certain que nous faisons face, depuis 2015, à une nouvelle forme de terrorisme. Nous avions été, en 1994-1995, confrontés à des commandos venus de l’étranger pour s’installer quelque temps dans la clandestinité sur le territoire et frapper la France. Désormais, près des trois quarts des auteurs d’attentats, voire davantage, sont des nationaux. Certains d’entre eux, mais pas tous, sont allés suivre une semaine d’entraînement, au Yémen ou dans la zone irako-syrienne. C’est une nouvelle forme de menace et d’action, dont il faut tenir compte et qui interpelle.
À l’exception de Sid Ahmed Ghlam et Yassin Salhi – l’auteur du crime de Saint-Quentin-Fallavier –, les individus qui ont frappé le pays depuis janvier 2015 étaient pratiquement tous connus pour des faits antérieurs : non pas des faits de radicalisation, mais de petits délits de droit commun, c’est-à-dire des activités relevant plutôt de la police judiciaire que de la lutte anti-terroriste et du monde du renseignement. Nous devons donc porter notre attention aujourd’hui, un peu comme avant-hier mais surtout comme demain, sur les individus que nous surveillons, que nous voyons progresser et qui réunissent ces deux critères – de petits voyous qui ne sont d’ailleurs pas obligatoirement issus de Seine-Saint-Denis, puisque les frères Kouachi habitaient les Hauts-de-Seine.
M. le rapporteur. Vous avez évoqué tout à l’heure la cellule « Allât ». Vous en êtes partie intégrante au même titre que les six autres services du premier cercle, ainsi que le SCRT. Cette cellule est-elle fonctionnelle selon vous ?
D’autre part, à quel moment considérez-vous qu’il est opportun de basculer en mode judiciaire ? Avez-vous une doctrine en la matière ?
M. Meyer Habib, président. Je vous ai interrogé tout à l’heure à propos de l’UOIF, mais je n’ai pas eu de réponse. Les imams de tendance plus modérée, en particulier Hassen Chalghoumi, nous accusent, nous les politiques, d’être responsables non pas du terrorisme, mais du contenu de certains discours – aux effets plus graves à long terme. Les prêches sont-ils compatibles avec la République ? On sait que la direction de l’UOIF ne présente pas de danger direct en termes de menace terroriste. Plus dangereux est sans doute, par contre, l’endoctrinement à long terme qui fait partie de sa stratégie.
M. René Bailly. Pour répondre sur la judiciarisation : c’est le principe de réalité qui s’impose. Nous le faisons lorsque nous nous apercevons que des individus que nous surveillons commencent à changer de comportement – et je ne parle pas simplement d’attributs physiques : ceux que je redoute le plus sont ceux qui me ressemblent physiquement, et non ceux qui ont des signes distinctifs. Nous le faisons dès lors que nous sentons entre ces individus une petite cohésion, et qu’ils font du trafic d’armes ou de pièces mécaniques permettant de récupérer de l’argent, ou encore qu’ils prennent des crédits. Amedy Coulibaly a financé son opération en prenant un crédit Cofinoga pour l’achat d’une Austin à 30 000 euros, qu’il a immédiatement revendue 20 000 euros. Cela lui a permis d’acheter des Kalachnikov et des Tokarev – mais pas sur le site du Bon Coin ni ailleurs sur internet. Il lui a fallu sortir de chez lui pour rencontrer quelqu’un, qui n’était pas forcément un islamiste radical, et qui a été mesure de lui fournir des armes. Dès lors que nous nous apercevons de trafics de ce type, nous ne cherchons pas plus loin : nous transmettons immédiatement l’information pour exploitation à la PJ ou à la DGSI, qui nous disent alors de continuer notre surveillance et de les aviser si tel ou tel comportement est intéressant à judiciariser. Nous sommes pilotés en vue d’une saisine judiciaire. Il me semble important de le faire très en amont, et c’est pourquoi j’avertis systématiquement la PJ de toutes les investigations que nous menons sur des individus potentiellement dangereux.
M. René Bailly. La cellule « Allât » a été créée après novembre, me semble-t-il. Elle est donc de facture très récente.
M. le rapporteur. Elle a été créée en juin.
M. René Bailly. Cette cellule me donne entièrement satisfaction : elle a précisément été instituée pour permettre des relations beaucoup plus directes entre tous les dispositifs qui y participent. Elle m’est notamment fort utile pour faire des criblages – que ce soit dans le cadre de la COP21 ou de l’Euro 2016 par exemple : sans avoir besoin de saisir tel ou tel sous-directeur, je peux faire appel au correspondant adéquat de la cellule, qui m’apportera immédiatement des réponses.
Quant aux mosquées, certaines d’entre elles attiraient effectivement l’attention. Il y en a beaucoup moins maintenant. On sait très bien que les prêches sont, depuis plusieurs années maintenant, totalement lissés, et que ce n’est pas du tout là que cela se passe. L’éducation religieuse des terroristes qui nous ont frappés était vraiment proche du néant. Coulibaly, lorsqu’il revendique les attentats qu’il s’apprête à commettre, a même du mal à prononcer en arabe le nom de son chef. Bien sûr, il faut continuer de suivre les mosquées car des messages peuvent y être diffusés – y compris de façon insidieuse, à long terme. Mais, dans l’avenir immédiat, ce n’est pas là que se situe la vraie menace.
M. Meyer Habib, président. Nous vous remercions, monsieur le directeur.
Audition, à huis clos, du général Christophe Gomart, directeur du renseignement militaire (DRM), Mme Lorraine Tournyol du Clos, adjointe au directeur, chargée de la stratégie, et du colonel N, assistant militaire
Compte rendu de l’audition, à huis clos, du jeudi 26 mai 2016
M. le président Georges Fenech. Nous accueillons le général de corps d’armée Christophe Gomart, directeur du renseignement militaire, accompagné de Mme Lorraine Tournyol du Clos, adjointe au directeur, chargée de la stratégie, et du colonel N, assistant militaire.
Mon général, nous vous remercions d’avoir répondu à la demande d’audition de notre Commission d’enquête relative aux moyens mis en œuvre par l’État pour lutter contre le terrorisme depuis le 7 janvier 2015.
Nous allons achever avec vous nos investigations dans le domaine du renseignement, en nous intéressant aux indispensables apports du renseignement militaire pour notre défense et notre sécurité, et, bien sûr, outre les moyens humains et techniques dont vous disposez pour mener à bien vos missions, à la coopération et à la coordination entre votre direction et les autres services de renseignement.
Cette audition, en raison de la confidentialité des informations que vous êtes susceptibles de nous délivrer, se déroule à huis clos. Elle n’est donc pas diffusée sur le site internet de l’Assemblée. Néanmoins, et conformément à l’article 6 de l’ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, son compte rendu pourra être publié en tout ou partie, si nous en décidons ainsi à l’issue de nos travaux. Je précise que les comptes rendus des auditions qui auront eu lieu à huis clos seront au préalable transmis aux personnes entendues afin de recueillir leurs observations. Ces observations seront soumises à la Commission, qui pourra décider d’en faire état dans son rapport. Je rappelle que, conformément aux dispositions du même article, « sera punie des peines prévues à l’article 226-13 du code pénal toute personne qui, dans un délai de vingt-cinq ans divulguera ou publiera une information relative aux travaux non publics d’une commission d’enquête, sauf si le rapport publié à la fin des travaux de la commission a fait état de cette information ».
Conformément aux dispositions de l’article 6 précité, je vais vous demander de prêter le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité.
Veuillez lever la main droite et dire : « Je le jure. »
Le général Christophe Gomart, Mme Lorraine Tournyol du Clos et le colonel N prêtent successivement serment.
Mon général, nous avons préparé des séries de questions regroupées sous deux chapitres : la situation au Levant et en Libye et la coopération interservices.
Quelle est votre analyse de la situation au Levant et quelles évolutions avez-vous constaté ces derniers mois ? Que représente aujourd’hui Daech en termes d’effectifs, d’équipements et de moyens d’action ? Comment jugez-vous l’efficacité des frappes aériennes ? Quels changements avez-vous pu constater depuis leur intensification en septembre 2015 ? Comment choisissez-vous vos cibles ? Quelles régions privilégiez-vous ? De quels moyens disposez-vous pour cela ? Quels résultats avez-vous obtenus ? Que représente la participation de la France dans l’activité totale de la coalition mondiale ? Comment s’effectue la coopération avec les autres pays de la coalition ? Quels sont les outils ou cellules de coordination dont vous disposez ? Comment s’effectue la « déconfliction » avec la Russie ? Comment s’effectue la coopération avec les troupes irakiennes et kurdes ? Comment s’effectue le partage des tâches avec la DGSE ? Comment jugez-vous votre coopération ? Pouvez-vous présenter la cellule Hermès, son fonctionnement, la participation de chacun des services et les résultats obtenus ? Quelle est votre appréciation de la situation en Libye et quelles évolutions avez-vous constaté ces derniers mois ?
En ce qui concerne la coopération interservices, quelle est la valeur ajoutée, pour la DRM, de la cellule Allat ? Quelle contribution y apportez-vous ?
Général Christophe Gomart, directeur du renseignement militaire. Monsieur le président, monsieur le rapporteur, messieurs les députés, permettez-moi tout d’abord de vous dire l’honneur qui est le mien de m’exprimer devant vous aujourd’hui.
Je centrerai mon propos sur la DRM, les moyens qu’elle met en œuvre en soutien de l’opération Chammal et ses relations avec les autres services de renseignement, avant de dresser un état de la situation au Levant.
La mission de la DRM est de fournir du renseignement d’intérêt militaire (RIM). Le RIM est la partie du renseignement qui s’intéresse aux parties des forces vives – États, organisations militaires ou paramilitaires, ou encore guérilla – et de l’environnement qui sont susceptibles d’avoir des conséquences sur nos forces et nos intérêts vitaux. Par le RIM il s’agit donc d’éclairer la décision des responsables politiques – le ministre de la défense, dont le DRM est le conseiller RIM – et des chefs militaires – chef d’état-major des armées (CEMA), auquel est subordonnée au premier chef la DRM – et d’appuyer nos forces armées dans leur manœuvre en opérations et lorsqu’elles se préparent à être déployées.
Le défi de la DRM est donc de couvrir un spectre large : appuyer directement les opérations en cours – Barkhane, Sangaris, Daman et Chammal – en participant à la conception et à la conduite de la manœuvre des forces engagées par la connaissance de l’adversaire – combien sont-ils, comment sont-ils organisés, quelles sont leurs capacités, leurs faiblesses ? –, maintenir une capacité d’anticipation pour planifier les opérations potentielles et être vigilants sur les théâtres potentiels d’opération dans des zones « crisogènes » – Libye, Nigeria, Ukraine, Yemen, Syrie où l’on s’apprêtait à bombarder fin août 2013 –, enfin contribuer à la veille stratégique indispensable à la définition des outils de notre dissuasion nucléaire et à la conception de nos armements par la connaissance des grandes puissances militaires potentiellement adverses.
Pour accomplir ses missions, la DRM dispose aujourd’hui de 1 800 personnes, dont un quart de personnel civil, réparties sur trois emprises principales : le site Balard à Paris – 150 personnes –, Creil – 850 personnes – et Strasbourg – environ 150 personnes au Centre de formation interarmées au renseignement (CFIAR), qui doit être déménagé à Creil dans un avenir proche. L’organisation de la DRM repose sur trois sous-directions – recherche, exploitation et appui –, un pôle stratégie qui travaille de manière transversale de façon à améliorer l’efficacité et la pertinence de la Direction, et un centre de coordination du cycle du renseignement.
En termes de moyens, je dispose de cinq centres d’expertise : le Centre de formation et d’interprétation interarmées de l’imagerie (CFIII) pour le domaine image, le Centre de formation et d’emploi relatif aux émissions électromagnétiques (CFEEE) pour le domaine électromagnétique, le Centre interarmées de recherche et de recueil du renseignement humain (CI3RH) pour la recherche humaine, le Centre de renseignement géo-localisé interarmées (CRGI) pour le renseignement géospatial et le Centre de recherche et d’analyse cyber (CRAC) pour le renseignement d’origine cybernétique. Je mets en œuvre des moyens de recueil qui me sont dédiés : je dispose de neuf centres d’interception satellitaires, d’un bateau de recueil électromagnétique, le Dupuy de Lôme, de régiments dédiés à la recherche humaine, comme le treizième régiment de dragons parachutistes, de satellites d’observation, ou encore d’avions légers de surveillance et de reconnaissance (ALSR) qui sont aujourd’hui principalement déployés au profit des opérations Chammal et Barkhane et combinent des capacités de recueil d’images et de recueil électromagnétique. Je peux également disposer des moyens mis à disposition des armées, comme les Rafale, les ATL2, les bateaux de la marine nationale et les régiments de transmission.
Dans le domaine capacitaire, je souhaite enfin évoquer les lois du 24 juillet 2015 et du 30 novembre 2015 relatives au renseignement. Elles ont offert à la DRM des possibilités d’utilisation de techniques de recueil de renseignement sur le territoire national sous le contrôle du groupement interministériel de contrôle (GIC) et de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR). Cela me permet notamment d’assurer la surveillance de communications émises ou reçues par des cibles situées à l’étranger.
À la suite des attentats qui ont frappé notre sol en 2015, il a été décidé d’augmenter les effectifs de la DRM au même titre que les autres services de renseignement. Pour ce qui concerne la DRM, le renforcement en effectifs est de 432 personnes supplémentaires sur la période 2016 à 2019 dans le périmètre du CEMA, et ce en deux vagues : 212 personnes suite aux attentats de janvier 2015 visant Charlie Hebdo et 220 personnes, ainsi que des financements supplémentaires, à la suite des attentats du 13 novembre 2015, le Président de la République ayant décidé de stabiliser les effectifs au sein des armées tout en demandant de poursuivre les efforts de réorganisation au bénéfice des forces opérationnelles, du renseignement et de la cyberdéfense.
Cet effort budgétaire nous permet par exemple de développer nos systèmes d’information et de communication pour mieux partager le renseignement avec les unités militaires qui appartiennent à la fonction interarmées du renseignement mais surtout avec les services partenaires de la communauté nationale du renseignement, de nous doter de moyens supplémentaires de traitement des données, de développer la capacité de cybernétique essentielle pour la DRM, ce qui nous permettra de continuer à nous adapter aux nouvelles applications qui ne cessent d’être mises sur le marché ou encore de renforcer nos capacités d’investigation du Web, de disposer d’ALSR en plus grand nombre, des avions que nous louons, les armées françaises n’en disposant pas en patrimonial à l’heure actuelle – l’achat de deux ALSR en patrimonial est planifié dans le cadre de la LPM.
Je vous propose à présent d’examiner la manière dont la DRM est organisée pour répondre aux besoins de l’opération Chammal au Levant.
Le suivi de la crise au Levant nécessite une approche fine en termes de renseignement en raison de la complexité de la situation. Nous devons mettre en œuvre des moyens adaptés afin de disposer d’une appréciation autonome.
La stratégie renseignement de la DRM au Levant repose sur quatre axes : une organisation optimisée autour d’une nouvelle structure, le plateau Levant, que j’ai créée en janvier 2015, un dispositif de capteurs dense fondé sur la complémentarité des capteurs, humains et techniques, complétés par des moyens de surveillance, d’acquisition d’objectifs, de renseignement et de reconnaissance (SA2R) déployés sur le terrain, le développement d’échanges avec les pays accueillant les détachements renseignement ainsi qu’avec d’autres partenaires comme les États-Unis, et le travail en inter-agences au sein de la communauté nationale du renseignement.
Sur le plan organisationnel, tout d’abord, la DRM a mis en place au niveau stratégique une structure intégratrice du renseignement appelée « plateau Levant », située à Paris, au sein du J2, c’est-à-dire du bureau de renseignement du Centre de planification et de conduite des opérations (CPCO), de façon à améliorer l’efficacité du cycle de renseignement et mieux répondre aux besoins des opérations. Ce plateau intègre en un même lieu, au plus près de ceux qui conduisent les opérations, les spécialistes de la recherche et les analystes de l’exploitation de façon à échapper à la logique de silo qui prévalait auparavant. Il permet ainsi de combiner les différentes expertises liées à l’analyse, au renseignement à fin de ciblage et à l’orientation des capteurs, le renseignement inter-agences, avec la cellule Hermès, dont je reparlerai, ainsi qu’une cellule de coordination et d’analyse du renseignement d’origine électromagnétique basée à Balard et qui couvre également la Libye dans une logique de suivi transversal de Daech.
Ce plateau a pour mission d’exploiter les renseignements recueillis sur le théâtre, puis de les croiser, de les synthétiser et de les diffuser. Il est également responsable des briefings aux hautes autorités militaires et de la diffusion des points de situation aux différents organismes militaires ou politiques. De plus, le plateau DRM appuie tous les jours les opérations conduites par la force Chammal en orientant la recherche et en manœuvrant les capteurs de niveau stratégique pour au final frapper avec la plus grande justesse possible le groupe Daech.
Il est en lien permanent avec le niveau opératif situé à Abu Dhabi, par l’intermédiaire d’un adjoint au renseignement issu de la DRM, qui dispose d’une structure renseignement dédiée, appelée « J2 Chammal » et armée par du personnel des armées et de la DRM. Cet adjoint conseille le COMANFOR, coordonne les efforts de tous les acteurs du renseignement du théâtre – mis à disposition par les armées – et de la DRM en veillant au bon fonctionnement de la chaîne de renseignement.
Enfin, j’ai mis en place un officier de renseignement auprès du général français à Tampa, au central command américain en charge des opérations américaines au Levant.
En termes de capteurs, je dispose de moyens propres tels que les satellites d’observation, comme Hélios et Pléiades, et recours également aux satellites allemand SAR-Lupe et italien COSMO-SkyMed. J’ai par ailleurs un lien avec la National Geospatial-Intelligence Agency américaine. Parmi les autres moyens propres, je dispose de centres d’interceptions satellitaires fixes tout autour du monde, du bateau de recueil Dupuy De Lôme, d’un ALSR doté de capacités de renseignement d’origine image (ROIM) et électromagnétique (ROEM), d’un détachement spécialisé en ROEM, d’un détachement auprès de l’Iraqi Counter Terrorism Service (ICTS) à Bagdad, de renforts en ambassade à Beyrouth et Amman, d’un Centre de recherche et d’analyse cybernétique (CRAC), à partir de Creil, qui se charge notamment de l’exploitation des sources ouvertes.
Je dispose également des moyens aériens, terrestres et maritimes mis en œuvre par les armées et déployés à proximité du théâtre. Il s’agit par exemple d’un détachement et d’un C-160G « Gabriel », de baies d’interceptions COMINT embarquées sur des bâtiments de la marine nationale en Méditerranée orientale et dans le Golfe arabo-persique, d’un avion AWACS, ainsi que d’un ATL2 avec communication intelligence (COMINT), et, dans le domaine du renseignement image, de Rafale air et marine lorsque le groupe aéronaval (GAN) est déployé, ainsi que d’un autre ATL2 en Jordanie.
Il est indispensable pour moi de combiner tous les types de renseignement et donc tous les types de capteurs, distants ou de proximité, pour pouvoir caractériser l’activité ennemie.
Ainsi, malgré une maîtrise par Daech des techniques de dissimulation vis-à-vis des capteurs images – à Raqqah, par exemple, ils ont couvert les rues de bandes de tissu qui empêchent nos satellites et nos avions de reconnaissance de voir ce qui se passe au-dessous –, une discipline notable dans l’emploi des moyens de communication et une migration vers des systèmes numériques chiffrés, voire filaires – ils reprennent les bons vieux téléphones –, Daech reste régulièrement intercepté sur des réseaux V/UHF, de courte portée, ce qui prouve l’opportunité de déployer nos moyens d’interception dans cette gamme de fréquence. À ce titre, le dispositif déployé au Kurdistan revêt une très grande importance car il permet de s’approcher du front entre Daech et les Peshmerga et d’obtenir du renseignement de contact en complément des moyens distants.
Depuis le déclenchement des opérations au Levant, la DRM, via son centre image de Creil, le CF3I, et sa composante spatiale optique et radar, a produit plus de 2 200 dossiers de renseignement image. De même, les pods de reconnaissance de nouvelle génération de l’armée de l’air et de la marine ont permis la réalisation de 5 160 dossiers image sur l’Irak et 1 020 dossiers image sur la Syrie depuis le début de la crise.
L’imagerie, les écoutes, le renseignement humain ou le cyber ont ainsi permis d’élaborer une analyse systémique de Daech qui permet de mieux comprendre les modes opératoires de cette organisation au Levant et se révèle précieuse en Libye. Cette analyse systémique a également conduit à l’élaboration de dossiers militaires de ciblage utilisés par la France et également par la coalition.
Pour satisfaire les besoins en renseignement de l’opération Chammal, la DRM s’appuie également sur un vaste réseau d’alliés et de partenaires. Ces coopérations permettent à la DRM d’alimenter ses données sur l’ennemi et de disposer de renseignements complémentaires à ceux collectés par nos propres capteurs. Les échanges de renseignements s’effectuent de manière fluide au sein de la coalition de pays participant aux frappes contre Daech. Ainsi, des dossiers de renseignement à fins de ciblage sur Daech en Irak et en Syrie sont régulièrement échangés, la DRM fournissant par ailleurs un grand nombre de dossiers images à la coalition, plus de 3 400 sur l’Irak et 600 sur la Syrie.
La présence d’insérés et d’officiers de liaison de la DRM auprès de chacune des structures de la coalition contribue également à la fluidité des informations dans ces lieux privilégiés pour l’échange de renseignement. À titre d’exemple, la DRM dispose d’un inséré au sein de la Coalition Intelligence Fusion Cell (CIFC) du Combined Air Operation Center (CAOC) d’Al-Udeid au Qatar. Cet organisme produit des points de situation sur toute la zone de responsabilité et développe des dossiers d’objectifs dans sa zone de responsabilité située dans l’Ouest Anbar. En résumé, la CIFC est le point de rencontre principal du personnel renseignement des Five Eyes et alliés du CAOC. Elle représente donc un lieu privilégié pour l’échange de renseignement et la constitution de dossiers d’objectifs. Les renseignements mis à disposition par la France sont intégrés dans les différentes productions de cet organisme. Nous n’en avons pas forcément un suivi précis.
Je développe parallèlement des échanges bilatéraux avec certains de mes partenaires, sur des points spécifiques et en fonction des compétences développées par certains pays sur des thématiques ou connaissances pouvant être utilement exploitées.
C’est le cas du partenaire majeur que sont les États-Unis, auprès desquels la DRM est présente au travers de ses d’officiers de liaison. Je dispose ainsi d’officiers de liaison auprès des commandements américains opérationnels, à Tampa, j’en ai parlé, mais également au United States European Command (EUCOM) à Stuttgart, des officiers de liaison qui sont intégrés aux structures américaines et apportent une réelle plus-value aux échanges de renseignement.
La signature, en novembre 2015, de special instructions avec les Américains a eu pour effet de renforcer ce partage de renseignements dans le cadre de la lutte contre le terrorisme notamment. À ce sujet, les entretiens avec les autorités américaines se sont multipliés : douze visites ou réceptions de haut niveau avec les partenaires militaires américains ont eu lieu entre le 16 novembre 2015 et le 11 mai dernier, date à laquelle je me suis réuni avec le sous-secrétaire d’État au renseignement, M. Marcel Lettre, pour le premier comité Lafayette faisant le point sur les six mois passés. De nombreuses actions bilatérales sont planifiées pour les prochains mois. Cela s’inscrit dans une dynamique sur un long terme qui porte déjà ses fruits : globalement, la DRM est largement gagnante.
En parallèle, des accords spécifiques signés récemment offrent à la DRM accès à de nombreuses informations dans le domaine de l’imagerie et du ROEM. Aujourd’hui, les Américains nous communiquent du renseignement très secret défense, ce qui n’était pas le cas auparavant.
La DRM intervient également en appui de nos alliés sur le terrain, les forces irakiennes, par exemple, à qui elle fournit des renseignements sous diverses formes, susceptibles d’être exploités à des fins d’action pour neutraliser l’ennemi. Les relations de confiance ainsi créées permettent à la DRM et, au-delà, à la France de bénéficier de relations privilégiées avec ces partenaires, en termes d’accès à du renseignement de terrain.
En ce qui concerne la Russie, des pistes d’échanges se mettent en place depuis les rencontres entre les ministres de la défense ainsi que les chefs d’état-major des armées de nos deux pays, sur certains sujets spécifiques, tels que les combattants étrangers, russophones et francophones, dans les rangs de Daech. Il y a environ 4 000 combattants russophones en Irak et en Syrie – des Tchétchènes, des Daguestanais… – que les Russes suivent de très près.
Le partage des tâches entre les services de la communauté du renseignement découle de leurs champs de responsabilité respectifs, défini dans le plan national d’orientation du renseignement. La DRM, service de renseignement des armées françaises, est chargé du renseignement d’intérêt militaire. Dans le cadre de l’opération Chammal, je suis, dans la mesure où une force est déployée, responsable de la manœuvre du renseignement. La DRM est dans ce cas qualifiée de « menante ». Elle est par ailleurs appuyée les autres services français, dont la DGSE, qui sont alors qualifiés de « concourants ».
Au lendemain du 13 novembre, l’ensemble des acteurs du renseignement français ont constitué des dossiers d’objectifs qui ont permis au Président de la République de décider des frappes, les 15, 16 et 17 novembre, sur la ville de Raqqah et à proximité, à la suite d’interceptions.
Face à la nouvelle menace constituée par Daech, qui brouille la distinction entre sécurité intérieure et opérations extérieures, le travail en interservices est plus que jamais indispensable. En effet, seule une fusion efficace du renseignement issu de toute la communauté nationale peut permettre de détecter en amont les projets d’attaque contre le territoire, nos forces ou nos intérêts à l’étranger. Le partage de l’information est crucial.
Cet enjeu a donc conduit à créer de deux cellules inter-agences, Hermès et Allat. Sur mon initiative, la première cellule de renseignement inter-agences regroupant la DRM, direction de la protection et de la sécurité de la Défense (DPSD), la DGSE, la DGSI, la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED), Tracfin et le commandement des opérations spéciales (COS), a vu le jour le 1er octobre 2014. Hébergée au sein du CPCO, son but est d’enrichir le renseignement nécessaire à la planification et à la conduite des opérations en zone Levant et d’améliorer la connaissance des services de renseignement dans leurs domaines d’expertises autour de thématiques transverses : organisation et activités de Daech et des autres groupes insurgés.
Depuis le 1er février 2016, la cellule a été rattachée au plateau Levant, pour contribuer le plus efficacement possible à l’action des armées au Levant, en participant au recueil, à l’exploitation et à la diffusion du renseignement d’intérêt militaire issu des partenaires nationaux. Hermès permet de décloisonner les services, de regrouper les spécialistes de tous les domaines du renseignement et les analystes sur une même thématique, de renforcer les synergies et de favoriser le partage du renseignement.
Initialement, les combattants étrangers francophones présents au Levant étaient le fil d’Ariane unique permettant de mieux comprendre notre ennemi et d’agir contre lui dans le cadre de l’opération Chammal, tout en contribuant par ricochet à la défense de l’intégrité du territoire national. Cette thématique demeure prégnante.
Toutefois, les apports se sont progressivement diversifiés, permettant une connaissance plus approfondie de l’ennemi, une analyse systémique de ses forces et faiblesses aussi bien qu’une étude très précise d’objectifs. Si nécessaire, et en accord avec le service à l’origine du renseignement, celui-ci est transmis à la coalition au sein de laquelle nous opérons, notamment au sein de dossiers de renseignement à fins de ciblage, comme pour les frappes qui ont suivi les attentats du 13 novembre.
À titre de réciprocité, la DRM, ou la coalition via la DRM, transmet à la communauté le renseignement élaboré ou non, recueilli sur les théâtres d’opération et susceptible d’intérêt, ce qui se fait dans le cadre d’une autre structure, la cellule Allat.
Cette dernière, créée et activée le 15 juin 2015, regroupe au total huit services de renseignement : les six services composant la communauté et deux autres services du ministère de l’intérieur. Chaque service a un représentant permanent. La DRM est présente au travers d’un binôme d’officiers de liaison afin d’assurer une présence permanente. Cette cellule était opérationnelle lors des attentats de Paris du 13 novembre 2015.
Les officiers de liaison de la DRM à Allat échangent des renseignements d’origine militaire et de capteurs uniquement DRM. L’officier de liaison doit être en mesure de préciser à la cellule Allat le capteur, le contexte et les conditions de recueil. Ces renseignements sont bruts ou élaborés, en fonction du degré d’urgence.
J’ai ainsi apporté le signalement de Français radicalisés susceptibles de rejoindre le territoire national, notamment de sept Français de retour du Yémen en transit à Djibouti. L’intérêt de transmettre ce type de renseignement à la DGSI est que celle-ci peut alors suivre les individus s’ils reviennent sur notre sol. J’ai également signalé des étrangers susceptibles de conduire des actions terroristes sur le territoire national. Je suis en outre des individus potentiellement dangereux en transit dans l’espace Schengen, à l’instar d’un certain individu repéré en Libye et répertorié comme combattant étranger qui s’apprêtait à entrer sur le territoire français a fait l’objet d’un signalement à Allat. Je fournis par ailleurs des renseignements relatifs à des menaces ou projets d’actions terroristes concernant le territoire national, commandités ou en lien avec le théâtre d’opération Chammal : en 2016, près de quatre actions de ce type ont fait l’objet d’un traitement interservices suite aux renseignements DRM.
Je peux également apporter un éclairage via les savoirs de la DRM ou la mise à disposition de nos capteurs. Cette implication s’est notamment traduite par la transmission de renseignements sur la provenance d’armes, sur des explosifs, sur des éléments de contexte en Irak et en Syrie. La DRM offre en outre son concours au suivi d’objectifs à l’étranger ou encore à l’évaluation de sources et de la fiabilité des renseignements fournis. Au moins trois sources évoquant des sites de Daech dans plusieurs villes syriennes ont ainsi pu être évaluées grâce au capteur et aux connaissances DRM. En retour, ces échanges permettent de recouper et de confirmer des renseignements sur les théâtres d’opération.
M. le président Georges Fenech. Je n’avais pas entendu parler de ce ressortissant brésilien qui s’apprêtait à commettre des attentats contre la délégation française aux Jeux olympiques. Comment pouvez-vous le savoir ?
Général Christophe Gomart. Par nos partenaires.
M. le président Georges Fenech. Galileo fonctionne-t-il ?
Général Christophe Gomart. Pas encore. J’utilise les satellites Helios, Pléiades, ce dernier à la fois civil et militaire, et, en termes d’imagerie radar, car nous ne disposons pas de cette capacité en France, l’Italien COSMO-SkyMed et l’Allemand SAR-Lupe, dans le cadre d’échanges de partenariat. Il est très difficile, pour prendre l’exemple de l’avion d’Air Egypt qui s’est crashé en Méditerranée, de trouver des éléments flottant sur l’eau avec de l’imagerie optique seulement. L’imagerie radar permet de produire un écho radar avant d’appliquer alors l’imagerie optique de manière plus ciblée. Cela avait été le cas également après le crash de l’avion de la Malaysia Airlines dans l’océan Indien.
M. Sébastien Pietrasanta, rapporteur. Considérez-vous que nos frappes aériennes en Syrie et en Irak ont des effets concrets ? Vous avez rappelé notre modeste participation, à hauteur de 5 %, à la coalition internationale. Depuis novembre, nous avons cependant intensifié nos frappes en Syrie. Avez-vous des éléments chiffrés ? Les frappes sont-elles suffisantes pour éradiquer Daech ou bien faudra-t-il passer à une étape supérieure ?
Hier, BFMTV a divulgué des informations concernant le contenu de l’ordinateur de Salah Abdeslam, qui comportait des éléments sur sept cibles d’attaques potentielles en France. Ces sept sites étaient sortis dans les médias en janvier 2016 sur France 3 Midi-Pyrénées et seraient issus d’un travail d’analyse des messages sur internet réalisé par la DRM. Cette fuite pose la question du rôle de la presse. Existe-t-il un document de la DRM sur ces sept sites ?
Général Christophe Gomart. Ce genre d’articles et de reportages dans les médias donnent à nos adversaires beaucoup de renseignements et, au bout du compte, ceux-ci nous connaissent mieux que nous ne les connaissons. Nous avons eu beaucoup de mal, au départ, à savoir ce qu’était Daech. Nous en avons aujourd’hui une bonne vision : nous savons qui est le chef, qui sont les chefs intermédiaires…
Dans l’affaire Salah Abdeslam, il ne s’agit pas du tout d’une note de la DRM. France 3 a parlé, à l’époque, de renseignement militaire, et j’ai été mis en cause. En réalité, ces éléments sont issus d’un exercice monté par un état-major dans le Sud-Est, dans lequel les personnes impliquées avaient réfléchi aux sites qui pourraient être visés par Daech en France. D’où ces sept sites, qui peuvent en effet constituer des cibles intéressantes. Salah Abdeslam, après avoir vu le reportage de France 3, a fait des recherches sur internet au sujet de chacun de ces sites.
M. le rapporteur. Il est question d’un travail d’analyse de messages sur internet.
Général Christophe Gomart. Ce n’est en tout cas pas le travail d’un professionnel de service de renseignement.
M. le rapporteur. Il n’y a pas un document de la DRM qui parle de ces sites ?
Général Christophe Gomart. Non.
En ce qui concerne les bombardements, la coalition a frappé 12 685 fois depuis les premières frappes jusqu’au 6 mai 2016 : 8 775 fois en Irak et 3 910 fois en Syrie.
M. le président Georges Fenech. Combien coûte une frappe ?
Général Christophe Gomart. Cela dépend du type de bombe. La GBU-12, par exemple, une bombe de 500 kilos avec un simple guidage laser, coûte plusieurs centaines de milliers d’euros.
M. le rapporteur. Quelle est la part prise par la France dans ces frappes ?
Général Christophe Gomart. Le chiffre dont je dispose est de 675 frappes françaises.
M. le rapporteur. Combien en Syrie ?
Général Christophe Gomart. Je n’ai pas le chiffre. Si je fais un raccourci, la coalition frappe en Irak et la Russie frappe en Syrie. La coalition a cependant beaucoup frappé en Syrie aussi, par exemple à Raqqah après le 13 novembre.
M. Pierre Lellouche. Combien de frappes ont conduit les Russes ?
Général Christophe Gomart. Je ne dispose pas de cette information.
M. le rapporteur. Les Russes frappent-ils vraiment Daech ?
Général Christophe Gomart. Au départ, les Russes ont frappé sur la Syrie pour consolider le terrain que tenaient encore les forces armées du régime de Bachar el-Assad. Ils frappaient davantage l’Armée syrienne libre, à savoir l’opposition modérée. Dans ces zones le régime de Bachar el-Assad se battait davantage contre l’opposition modérée que contre Daech, qui n’était pas présente aux mêmes endroits, si ce n’est à Palmyre, à Deir ez-Zor et du côté d’Idlib. Aujourd’hui, les Russes frappent Daech : Palmyre, région d’Alep, Deir ez Zor, à proximité de Raqqah ou encore de Manbij.
Vous avez parlé de « déconfliction ». Il existe une répartition entre Américains et Russes pour éviter que les avions se croisent en l’air. Il n’y a pas de coordination au sens que revêt ce terme dans une coalition, avec des fréquences radios partagées, et les uns et les autres ne savent pas où et quand volent les avions, mais c’est tout de même une collaboration.
Sur le terrain, le territoire occupé par le « califat » se réduit, tant en Irak qu’en Syrie. Les forces de sécurité irakiennes ont pris plusieurs villes situées sur l’Euphrate – à leur rythme. Leur prise la plus récente est celle de la ville de Rutbah, dans le sud-ouest irakien, qui a permis de rouvrir le lien entre l’Irak et la Jordanie. Nous pensions que la prise de Rutbah prendrait bien plus longtemps, mais les hommes de Daech ont quitté la ville pour éviter de se laisser piéger : en effet, au-delà de Rutbah s’ouvre le désert et, s’ils étaient partis trop tard, les avions de la coalition les auraient bombardés. Ils ont laissé derrière eux des merlons et des pièges, ainsi que des munitions. Les forces spéciales ont pris position dans Rutbah et libéré l’axe menant à la Jordanie.
Toute la rive méridionale de l’Euphrate est tenue par les forces de sécurité irakiennes. La situation est plus complexe sur la rive septentrionale : les forces irakiennes ciblent désormais Falloujah, qu’elles se sont donné quatre-vingt-dix jours pour prendre – soit d’ici à la fin août. Les premiers combats sont en leur faveur.
Les villes situées le long du Tigre ont peu à peu été reprises, à l’exception du verrou que constitue Qayyarah, au sud de Mossoul. Daech y a installé des défenses en profondeur pour empêcher les forces de sécurité irakienne de remonter vers le nord.
Mossoul a deux millions d’habitants pour une superficie équivalente à celle de Paris intra-muros. Tous les types de populations s’y trouvent : sunnites, chrétiennes ou encore chiites. On sait qu’une partie de la population de la ville a tenté de se soulever contre Daech, qui est plus dur à l’égard des populations qui se trouvent sous contrôle – en multipliant les exécutions sommaires – lorsqu’il recule.
De Mossoul, les hommes de Daech ont avancé vers le nord pour attaquer les peshmergas kurdes, dont ils ont dans un premier temps réussi à percer les lignes en utilisant toujours la même méthode : des véhicules-suicide sont envoyés pour exploser dans les lignes ennemies, suite à quoi la troupe s’engouffre dans la brèche en profitant de l’effet de choc massif. Sans les frappes de la coalition, le front kurde était enfoncé. C’est d’ailleurs toujours le cas : à chaque offensive de la sorte, Daech réussit à percer sur quelques kilomètres et ce sont les frappes de la coalition qui l’empêchent d’emporter la victoire. De ce point de vue, ces bombardements sont extrêmement efficaces.
En Syrie, les Russes ont d’abord déployé des avions d’attaque au sol, les Soukhoï Su-25 dits Frogfoot, qui ont stabilisé le front. M. Poutine a ensuite annoncé que l’armée russe se retirait, son travail étant accompli. En réalité, elle a remplacé ses Soukhoï Su-25 par des hélicoptères de combat et d’attaque au sol, que l’on a davantage de mal à détecter puisqu’ils volent sous l’altitude de surveillance des radars déployés en Méditerranée orientale, parfois dans l’espace.
À Palmyre, les Russes ont bâti un véritable centre équipé d’un hôpital de campagne, de défenses sol-air et de canons, et y ont déployé des conseillers auprès des forces syriennes dans la perspective d’avancer vers Deir ez-Zor. Curieusement, cette ville tient encore après cinq années de guerre. La garnison de 1 500 à 2 000 hommes qui s’y trouve n’a jamais cédé, même s’il lui est arrivé de perdre un peu de terrain. Elle n’est ravitaillée par le régime que par avion.
Plus au nord se trouve la ville d’Alep, autour de laquelle s’étend une zone en forme de croissant que les Kurdes, alliés au régime, tentent de refermer – ce qui finira par être fait, même si ce combat urbain est très coûteux en munitions, en hommes et en temps. Tous les groupes prennent part à cette bataille : Daech, Jabhat al-Nusra, les Kurdes et les forces armées du régime, ainsi que tous les groupes de l’opposition modérée qui, en fonction de leurs objectifs locaux, s’allient avec les uns ou avec les autres – comme les Russes le constatent sur le terrain. Autrement dit, il est extrêmement difficile de savoir qui a été bombardé, de Daech, Jabhat al-Nusra ou d’autres. Les opposants, modérés ou non, tirent parti de notre méconnaissance – celle des Occidentaux, mais aussi celle des Russes – pour s’entraider.
En direction de Lattaquié se trouve la zone montagneuse de Jisr al-Choghour où le régime syrien occupe les positions dominantes pour progresser le long de la frontière turque et, ainsi, permettre aux Kurdes de faire le lien entre les cantons d’Afrin et de Jarabulus, soit une zone frontalière de quatre-vingts kilomètres par laquelle transite le ravitaillement de la ville d’Alep, mais aussi de Daech et des autres groupes qui combattent dans les environs.
C’est là que se trouve la fameuse poche de Manbij, qui n’en est pas vraiment une : Manbij – où se trouvent des combattants francophones – est une ville située à l’ouest de l’Euphrate et au nord du barrage de Tichrine, lequel a été pris par les troupes kurdes, de sorte qu’elles ont pu traverser le fleuve – fait inacceptable pour les Turcs. Les Kurdes veulent désormais prendre le nœud routier majeur de Manbij – autre chiffon rouge pour les Turcs.
J’en viens à la ville de Raqqah, où se trouvent trois à quatre mille combattants de Daech, à quoi s’ajoutent deux mille autres qui peuvent venir de l’extérieur pour renforcer cette position. Il faudrait environ 20 000 soldats pour prendre Raqqah, étant entendu qu’en ville le rapport de forces doit être au moins cinq fois supérieur pour être efficace. Raqqah finira par tomber. À ce stade, toutefois, Daech dispose toujours de deux capitales, Raqqah et Mossoul, en dépit de la prise par les Kurdes de la ville de Sinjar, qui coupe l’axe logistique reliant ces deux villes. Les hommes de Daech ont en effet trouvé des voies de contournement.
La stratégie de combat de Daech s’appuie sur des forces spéciales qui se trouvent grosso modo sur la frontière irako-syrienne, et qui peuvent rapidement basculer par la route – puisque c’est leur seul moyen de déplacement – d’un point à un autre en fonction des faiblesses de l’adversaire.
Quoi qu’il en soit, Daech perd du terrain, même si ce groupe conserve de réelles capacités militaires. La question à se poser est désormais celle-ci : où iront les combattants étrangers si Daech est entièrement défait en Irak et en Syrie ? En Libye sans doute, mais aussi au Yémen, en Afghanistan, au Pakistan – comme c’est déjà le cas. Les Russes nous le disent : ils se préoccupent naturellement de Daech et de ses combattants russophones qui pourraient retourner sur le territoire russe, mais aussi de la Libye ainsi que de l’Afghanistan et du Pakistan. Dans la province afghane de Nangarhar, par exemple – dont la capitale est Jalalabad, où ont été stationnés des soldats français – se trouve la wilaya de Khorasan, qui se bat contre les Talibans et qui gagne peu à peu du terrain, même si elle reste très modeste.
Nous n’avons pas mesuré les flux de combattants de Daech, mais nous savons par exemple que des combattants tchétchènes se trouvent à Abou Grein, en Libye. Selon nous, il existe un véritable flux maritime entre les ports turcs et la Libye, en particulier Misrata. Outre son port de commerce, cette ville abrite un port métallurgique qui ravitaille Daech en Libye, ainsi que la ville de Benghazi. Des bâtiments mouillent au large de Misrata, déchargent leur cargaison sur des caboteurs qui rejoignent Misrata, d’où des caboteurs plus petits encore gagnent Benghazi.
Daech est très présent dans le sud de la ville de Benghazi, précisément, où se battent les troupes nationales libyennes du général Haftar. A Derna, Daech a quitté les lieux, mais Al-Qaida, en particulier le groupe Ansar al-Charia, demeure très présent. Tous ces gens se retrouvent dans la ville de Syrte, l’ancienne capitale de Kadhafi qui marque la limite entre le Maghreb et le Mashrek. S’y trouvent donc d’ex-kadhafistes et des combattants de Daech qui, de là, rayonnent dans une zone assez large en adoptant la stratégie suivante : prendre des grandes villes et détruire les puits de pétrole pour empêcher le gouvernement national et l’armée régulière d’en tirer des bénéfices. De surcroît, Daech a cherché à s’implanter en Tunisie, et a notamment tenté d’installer un califat à Ben Gardane – avec le soutien d’une partie de la population locale. Les forces de sécurité tunisiennes ont repoussé les hommes de Daech, dont un certain nombre ont regagné la région d’Abou Grein et de Syrte.
M. François Lamy. Vous avez évoqué les hélicoptères russes ; avons-nous les capacités de conduire des activités de renseignement, voire des frappes, par hélicoptère ?
Le problème du filaire existe dans de nombreux conflits asymétriques. Comment pouvez-vous y remédier ?
Enfin, menez-vous des programmes spécialement destinés à repérer les combattants francophones sur le terrain, ou cette tâche relève-t-elle de la DGSE ?
M. Serge Grouard. Sur ce point, vous est-il demandé de rechercher des cibles précises et, au-delà de nos capteurs, disposons-nous pour ce faire d’une présence humaine sur le terrain ? Des opérations sont-elles conduites dans le but d’éliminer des combattants francophones, voire français ?
Plus généralement, j’ai le sentiment que notre capacité de renseignement, initialement limitée, s’est peu à peu structurée et focalisée. Nous avons désormais une compréhension systémique de Daech, de ses actes et de ses mouvements, nous dites-vous. Nous pouvons évaluer ses forces. Je conçois qu’il soit très difficile de conduire une opération de destruction, mais je ne peux tout de même pas renoncer à vous poser la question suivante : avec vingt à trente mille combattants, Daech ne représente pas une force colossale et, qui plus est, nous connaissons ses modes opératoires, même si ses combattants se fondent aisément dans la population. Nous savons néanmoins identifier ses mouvements, et ses axes de circulation, comme nous l’avons constaté à la frontière turque. À défaut de détruire cette force, nous devrions donc pouvoir la réduire si nous le voulions vraiment ! Certes les jeux d’alliance changent constamment dans cette nébuleuse très complexe à laquelle s’ajoutent les puissances extérieures. Je m’interroge toutefois : avons-nous fait le choix politique et stratégique de ne pas détruire Daech, ce qui peut se comprendre afin d’éviter que ses combattants essaiment ailleurs, ou craignons-nous l’embourbement sans fin ? Entre ces deux hypothèses, où se trouve la vérité ?
M. Pierre Lellouche. Quel est l’état de nos relations avec les services syriens ? Je me doute de votre réponse, mais pouvez-vous nous dire depuis quand cette relation est interrompue et ce qu'il est prévu à l’avenir ?
Pouvez-vous nous expliquer ce qu’est l’accord dit Five Eyes ?
Quelles sont nos capacités en matière de cyberintelligence et de pénétration des réseaux de Daech, y compris ceux qui touchent la France ?
Que pensez-vous qu’il s’est passé dans l’avion de la compagnie Egypt Air ?
Enfin, comment évaluez-vous l’implantation de Daech en France ? Son organisation s’appuie-t-elle sur trois niveaux, à savoir l’ordonnateur en Syrie, la cellule d’artificiers en Belgique et les petits soldats à Paris, ou bien des centres de commandement sont-ils en cours d’installation en Europe, et en particulier en France ?
Général Christophe Gomart. L’hélicoptère, monsieur Lamy, est un outil formidable mais vulnérable aux tirs – je dirigeais le commando d’opérations spéciales au Mali lorsque l’un de nos hélicoptères y a été abattu ; l’équipage a pu être sauvé mais le pilote, le commandant Damien Boiteux, est décédé. Si les Russes utilisent désormais davantage d’hélicoptères en Syrie, c’est sans doute parce qu’ils les jugent plus maniables que leurs avions d’attaque au sol. Les hélicoptères, cependant, ne permettent pas de conduire des activités de renseignement ; ils peuvent avoir une fonction de reconnaissance.
Nous n’effectuons pas de bombardements ciblés sur des combattants francophones. En revanche, nous suivons leurs actions et leurs déplacements. S’il est si difficile de cibler Daech, c’est parce que ses combattants se fondent dans la population. Ils habitent dans les hôpitaux, installent leurs centres de commandements dans les écoles. C’est pourquoi la coalition bombarde davantage les troupes qui sont au contact de leur ennemi, car nous sommes certains, alors, d’avoir affaire à des combattants, et la probabilité d’erreur est beaucoup plus faible.
Il est exact, monsieur Lellouche, que nous n’avons aucune relation avec les services de renseignement militaire syriens.
M. Pierre Lellouche. Serait-il utile de les rétablir, selon vous ?
Général Christophe Gomart. Tout dialogue est utile.
L’accord Five Eyes associe depuis la fin de la deuxième guerre mondiale les services de renseignement de cinq pays anglo-saxons – États-Unis, Canada, Royaume-Uni, Australie, Nouvelle-Zélande. Cette communauté, à laquelle nous n’appartenons pas, a mis au point un système d’interceptions déployées dans le monde entier et échange des données de renseignement brutes, avant analyse – ce qui révèle les limites et les capacités des uns et des autres. Si nous ne partageons pas nos données brutes, c’est parce que nous connaissons nos faiblesses – et nos forces. La France souhaite néanmoins discuter avec ce « club », afin d’entretenir un dialogue plus direct avec les États-Unis, notamment, dans le cadre de la coalition.
J’en viens à la question de la cyberintelligence. Ma tâche ne consiste pas à effectuer des opérations de pénétration, mais plutôt à analyser le matériel recueilli sur le terrain – qu’il s’agisse de clefs USB, d’ordinateurs, d’appareils de photographie ou d’instruments de géolocalisation, par exemple – et d’effectuer des recherches ouvertes sur internet. Sans mener d’opérations de pénétration, nous disposons donc d’une grande quantité d’éléments, car tous les combattants de Daech communiquent, en particulier en cas de victoire. Les recherches ouvertes que nous conduisons permettent de récolter de très nombreuses informations que nous recoupons avec les renseignements issus de sources fermées et de capteurs, grâce à quoi nous pouvons dresser un tableau assez proche de la réalité.
Concernant le vol de la compagnie Egypt Air, l’hypothèse la plus plausible me semble être celle d’une explosion, même si nous n’en avons pas la confirmation. Nous avons participé aux recherches de l’épave par satellite, mais les boîtes noires n’ont pas encore été trouvées. La fumée apparue dans l’appareil n’a pu être produite que par un départ de feu, mais j’ignore ce que les capteurs de l’avion pouvaient encore détecter à ce stade. L’engin explosif, le cas échéant, a pu être embarqué dans un aéroport où l’avion a fait escale avant Paris.
L’évaluation de l’implantation de Daech en France relève davantage de la DGSI, avec laquelle il va de soi que je dialogue. De mon point de vue, il n’y a pas de base de Daech en France. Lors des derniers attentats, les ordres sont venus de Syrie, comme le directeur général de la sécurité intérieure, M. Calvar, vous l’a peut-être dit. Les combattants qui sont passés à l’action étaient infiltrés depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois. S’ils ont frappé à Bruxelles, c’est parce qu’ils ont dû agir plus vite qu’ils ne l’avaient prévu en raison de l’arrestation de Salah Abdeslam. Reste à savoir si toutes ces personnes ont été retrouvées ; il est tout à fait plausible qu’il reste des cellules dormantes.
M. Pierre Lellouche. Vous êtes un militaire : pensez-vous que cette guerre peut être gagnée ? A-t-elle une fin ou risque-t-elle de durer pendant des années ? Même si Raqqah et Mossoul sont prises – encore faudra-t-il y occuper le terrain, ce qui est une autre épopée –, le cancer se répandra. Comment voyez-vous les décennies qui viennent ?
Général Christophe Gomart. Gagnera-t-on la guerre en Syrie et en Irak ? Oui. Après, en revanche, ces deux pays seront-ils capables d’instaurer un système politique viable et durable ? Quoi qu’il en soit, sur le plan militaire, nous parviendrons à gagner car la volonté et les moyens existent – même si l’on peut toujours souhaiter davantage d’avions ou de drones. Il faudra du temps, néanmoins, car Daech est une organisation résiliente qui se défend et qui est soutenue par une partie de la population. J’ajoute qu’outre le combat entre sunnites et chiites, il faut aussi tenir compte du combat entre sunnites.
M. le président Georges Fenech. Mon général, nous vous remercions.
Audition, ouverte à la presse, de M. Jean-Jacques Urvoas, garde des Sceaux, ministre de la Justice
Compte rendu de l’audition, ouverte à la presse, du mercredi 1er juin 2016
M. le président Georges Fenech. Monsieur le garde des Sceaux, nous vous remercions d’avoir répondu à la demande d’audition de notre commission d’enquête. Nous achevons nos auditions par celles des membres du Gouvernement ; vous succéderont ainsi M. Le Drian, ministre de la défense, et, demain matin, M. Cazeneuve, ministre de l’intérieur.
Nous vous interrogerons bien entendu sur l’état du droit applicable et sur ce qu’il convient d’attendre des réformes intervenues récemment avec la loi du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme et celle, en instance de promulgation, relative au renforcement de la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement. Nous sommes également désireux de vous entendre sur la coopération entre la justice et les services de renseignement, ainsi que sur le volet pénitentiaire, c’est-à-dire le suivi des personnes radicalisées au sein des établissements pénitentiaires, le rôle du renseignement pénitentiaire et les moyens techniques mis en œuvre dans ces établissements : vidéosurveillance, brouillage des télécommunications…
Je rappelle que cette audition est ouverte à la presse et qu’elle fait donc l’objet d’une retransmission en direct sur le site internet de l’Assemblée nationale ; son enregistrement sera également disponible pendant quelques mois sur le portail vidéo de l’Assemblée. Je vous signale par ailleurs que la commission pourra décider de citer dans son rapport tout ou partie du compte rendu qui sera fait de cette audition. Nous avons en effet décidé que, d’une manière générale et lorsque cela ne soulève pas de difficultés pour les personnes entendues ou au regard de la confidentialité des informations recueillies, nos auditions seraient ouvertes à la presse, car nous devons mener cette enquête en toute transparence.
Conformément aux dispositions de l’article 6 de l’ordonnance du 17 novembre 1958 relatif aux commissions d’enquête, je vous demande de prêter le serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité.
M. Jean-Jacques Urvoas, garde des Sceaux, ministre de la justice, prête serment.
Monsieur le ministre, vous avez pris vos fonctions le 27 janvier 2016, à la suite de la démission de votre prédécesseur. Vous n’étiez donc pas en fonction lors des attentats sur lesquels se penche notre commission. Cependant, tous les députés ici présents vous connaissent bien, puisque vous présidiez alors – et ce, depuis le début de la législature – la commission des lois de l’Assemblée nationale. Tous savent combien vous vous êtes personnellement engagé dans la discussion de chacun des textes de loi ayant renforcé la lutte contre le terrorisme. Tous connaissent également votre grande expertise en matière de renseignement, puisque vous êtes l’auteur, avec notre collègue Patrice Verchère, d’un rapport remarquable sur le sujet. J’ajoute que vous avez été, en tant que député, membre de la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité (CNCIS), qui a donné naissance à la Commission nationale de contrôle des communications et techniques de renseignement (CNCTR), dont nous avons entendu le président, M. Delon. C’est dire combien vous êtes familier des préoccupations de notre commission d’enquête.
Mais vous êtes aujourd’hui responsable d’une politique pénale, notamment en matière de lutte contre le terrorisme. Or, comme le Président de la République et le Premier ministre en ont eux-mêmes fait le constat, la frontière entre la criminalité de droit commun et le terrorisme est poreuse : la quasi-totalité des auteurs des attentats de 2015 avaient eu un parcours de délinquant.
Je ne prendrai qu’un seul exemple, celui d’Amedy Coulibaly, l’auteur de l’assassinat d’une jeune policière et de l’attaque de l’Hyper Cacher. En 2001, le tribunal d’Évry l’avait condamné à trois ans d’emprisonnement puis, la même année, à quatre ans pour des vols aggravés, et il l’avait à nouveau condamné en 2002. En 2004, la cour d’assises des mineurs du Loiret lui avait infligé six ans de prison pour vol avec arme dans un établissement bancaire. Ensuite, le tribunal correctionnel de Paris l’avait condamné, en 2005, à trois ans pour vol aggravé et, en 2007, à dix-huit mois pour trafic de stupéfiants. Enfin, le 20 décembre 2013, il avait été condamné à cinq ans d’emprisonnement, mais, par le jeu des réductions de peine automatiques, il s’est retrouvé en liberté sans avoir effectué toute sa peine. Quelle politique pénale entendez-vous mener à l’égard de ces récidivistes ? Certains dispositifs ont été renforcés par la dernière loi que nous avons adoptée, mais nous souhaiterions vous entendre sur la question des réductions de peine, qui est une des préoccupations exprimées par le parquet de Paris : doivent-elles s’appliquer de la même manière aux récidivistes et aux primodélinquants ?
Nous avons entendu l’ensemble des acteurs judiciaires : le procureur de Paris, les juges du tribunal correctionnel, ceux de la cour d’appel et de la cour d’assises spécialisée, ceux du pôle d’instruction antiterroriste, les juges d’application des peines et les responsables de l’administration pénitentiaire. Vous ne serez pas étonné si je vous dis que la question des moyens de la justice est revenue de manière récurrente au cours de ces auditions. Puisque vous avez fait vous-même de cette question une priorité de votre action, peut-être pourrions-nous commencer par aborder ce sujet.
Je précise que nous avons prévu de vous interroger sur d’autres thèmes, notamment les moyens juridiques de la lutte contre le terrorisme, les personnes détenues radicalisées et le renseignement pénitentiaire. Mais peut-être pourriez-vous nous indiquer au préalable le nombre des personnes qui ont été condamnées ou qui se trouvent en détention provisoire pour fait de terrorisme et les moyens qui sont mis en œuvre dans le cadre de leur détention par l’administration pénitentiaire.
M. Jean-Jacques Urvoas, garde des Sceaux, ministre de la justice. Je vous remercie de votre invitation, à laquelle je réponds avec plaisir. Convaincu – et cela ne surprendra personne – que le Gouvernement doit être à la disposition du Parlement, je me dois d’être disponible et de vous répondre de manière précise et utile afin de contribuer à la réflexion de votre commission d’enquête. Celle-ci émettra certainement des préconisations auxquelles le Gouvernement sera d’autant plus attentif que ses travaux bénéficient, monsieur le président, monsieur le rapporteur, de votre expertise reconnue en la matière. Si, lorsque je la présidais, la commission des lois a pu travailler utilement, c’est précisément parce que nous avons su faire fi de nos divergences apparentes pour nous rassembler sur l’essentiel, et les sujets dont nous traitons aujourd’hui sont absolument essentiels.
Je veux tout d’abord saisir l’occasion que m’offre votre invitation pour remettre en perspective le modèle français de lutte contre le terrorisme et la radicalisation, que l’on présente trop souvent comme une accumulation de textes qui seraient autant de réactions du pouvoir en place aux événements qui surviennent. Comme si nous n’avions pas construit une architecture cohérente et réfléchie pour, sinon éradiquer, du moins combattre ces phénomènes ! Or, il existe un modèle français dans ce domaine, modèle qui confie au ministère de la justice et à l’autorité judiciaire un rôle très étendu, qui va de la prévention à la répression. Bien entendu, je vais répondre à vos questions, que je crois essentielles, sur ce que Gilles Kepel a appelé avec beaucoup de pertinence « l’incubateur carcéral », mais peut-être dois-je évoquer au préalable ce modèle français de lutte contre le terrorisme.
Jusqu’au début des années 1980, la France ne s’était pas dotée d’un dispositif spécifique en ce domaine. Certes, un certain nombre d’infractions, notamment les attentats à l’explosif, relevaient de la compétence de la Cour de sûreté de l’État. Mais, en défendant sa suppression devant l’Assemblée nationale, le 17 juillet 1981, Robert Badinter avait souligné les difficultés que soulevait l’existence d’une telle juridiction – et si je l’évoque, c’est pour souligner que nous avons évité, depuis, de tomber dans les mêmes travers. En effet, dérogatoire au droit commun, la Cour de sûreté de l’État « [traduisait] une intrusion intolérable du pouvoir exécutif dans le pouvoir judiciaire » et constituait « une justice politique permanente d’exception » dans laquelle « les officiers jugent aux côtés de magistrats des accusés civils en temps de paix ».
La suppression de la Cour de sûreté de l’État n’a pas créé de vide juridique, puisque 75 % des procédures dont elle connaissait ont été transférées aux cours d’assises. Cependant, comme le reconnaît Robert Badinter dans ses mémoires, intitulés Les Épines et les roses, elle a révélé une carence du code pénal en matière d’enquête et de répression des actes de terrorisme. C’est pourquoi, à partir de 1981, en raison du renforcement de la menace, le Gouvernement a entrepris d’adapter l’arsenal répressif aux nécessités de la lutte contre le terrorisme.
Ainsi, à la suite de menaces proférées contre les jurés lors du procès de Carlos, la loi du 21 juillet 1982 a créé les cours d’assises spéciales. Puis, la loi du 9 septembre 1986, inspirée par les juges Boulouque et Marsaud, marque un premier tournant en créant ce qui reste aujourd’hui l’incrimination pivot de la lutte antiterroriste, à savoir l’association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste (AMT), en prévoyant – et je dois souligner la pertinence de ce choix – la centralisation des poursuites à Paris et en créant des règles de procédure dérogatoires au droit commun, qu’il s’agisse des gardes à vue ou des méthodes d’enquête. Plus que le droit pénal lui-même, c’est en effet la procédure pénale qui, dans ce domaine, déroge au droit commun.
L’évolution se poursuit avec l’adoption, en 1994, du nouveau code pénal, qui entrera en vigueur deux ans plus tard. Celui-ci construit un dispositif autour de l’AMT, avec des règles spéciales de poursuite, d’instruction et de jugement applicables à la répression non seulement du terrorisme, mais aussi du trafic de stupéfiants et du proxénétisme. L’incrimination d’AMT permet, grâce à sa souplesse, de prévenir la survenance d’un attentat en permettant d’appréhender, en amont, l’entente établie en vue de sa préparation.
Depuis lors, les textes se sont multipliés pour renforcer cet arsenal : lois du 15 novembre 2001, du 29 août 2002, du 9 mars 2004, du 21 juin 2004, du 23 janvier 2006, du 1er décembre 2008, du 14 mars 2011, du 14 avril 2011. Ces textes ont procédé à des ajustements de la loi fondatrice, sans modifier les équilibres fondamentaux. De fait, à l’exception de la loi du 13 novembre 2014, qui a créé le délit d’entreprise individuelle terroriste, les textes que je viens de citer ont précisé les règles de procédure pénale applicables à la poursuite et à la répression de ces infractions – qu’il s’agisse des techniques d’enquête, de l’instruction ou du jugement des infractions en matière de terrorisme –, avec le souci constant de moderniser et d’adapter l’arsenal répressif à l’évolution de la menace. Qui pourrait le déplorer ? Si nous n’avions pas modifié la loi de 1986, les services de police judiciaire et les magistrats instructeurs seraient aujourd’hui fort démunis.
Je ne crois donc pas que cette succession de textes législatifs soit un empilement incohérent. Ils s’inscrivent, au contraire, dans une logique qui a été définie il y a plusieurs années, si bien que, après une période de maturation bien compréhensible, l’architecture globale du système n’a guère évolué.
Outre cet appareil juridique, il faut souligner la pertinence de la centralisation des poursuites au parquet de Paris et de la spécialisation fonctionnelle parisienne. J’insiste sur ce point, car j’ai pu lire, ici ou là, que la tentation existait de créer un parquet national antiterroriste sur le modèle du parquet financier. C’est la plus mauvaise des idées ! L’organisation actuelle du parquet de Paris est en effet extrêmement pertinente parce qu’elle permet une spécialisation des magistrats et, grâce à la continuité de la structure, si ce n’est celle des hommes qui y servent, une bonne connaissance de la menace. Surtout, cette organisation a permis que, le soir du 13 novembre, les magistrats du parquet de Paris spécialisés dans l’antiterrorisme ne soient pas les seuls magistrats mobilisés. Ainsi, la procureure générale de Poitiers me confiait, vendredi dernier, lors d’un déplacement dans cette ville, que, ce soir-là, tous les parquetiers s’étaient déclarés disponibles. De même, le procureur de Paris a dit avoir pu compter sur la totalité des parquetiers à sa disposition.
Un parquet national antiterroriste ou une audience nationale s’inspirant du modèle espagnol nous priverait de cette capacité d’adaptation et de mobilisation des personnels en cas de crise, car le Gouvernement, quel qu’il soit, ne pourrait créer des postes pour les besoins de l’enquête. Parce que la menace est durable et que la gestion des ressources humaines est nécessairement tendue, notre modèle est bon.
Parallèlement, le dispositif de sécurité, comme les services de renseignement, de police judiciaire et les forces de sécurité intérieure, a été structuré afin de renforcer sa cohérence et son efficacité. La spécificité, contestée, de la Direction de la surveillance du territoire (DST), à savoir sa double compétence administrative et judiciaire, a été confirmée lors de la création de la Direction centrale du renseignement intérieur (DCRI), qui lui a succédé, puis de la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI), qui est le service pilote dans la lutte contre le terrorisme. Cette spécificité, qui se retrouve dans peu de services avec lesquels la DGSI est amenée à travailler, a largement démontré son efficacité. Le système n’est évidemment pas parfait, mais il serait inopportun d’envisager de remettre en cause ce dispositif de prévention et de répression du terrorisme qui est solidement établi.
J’en viens maintenant à question de la radicalisation. Celle-ci est évidemment consubstantielle au terrorisme, mais on ne lutte pas de la même façon contre l’une et contre l’autre. La problématique de la lutte contre la radicalisation est en effet apparue plus récemment, de manière brutale et pour longtemps et, si cette lutte mobilise des moyens toujours plus importants, elle est encore relativement nouvelle pour le ministère de la justice et ses fonctionnaires.
Je vous signale à ce propos que le premier Plan de lutte antiterroriste (PLAT 1) s’est traduit, pour le ministère de la justice, par la création de 1 050 emplois – vous mesurez le choix que cela a représenté en cette période de vaches maigres – et l’allocation de 175 millions hors dépenses de personnels. Quant au PLAT 2, il prévoit la création de 2 530 emplois et l’octroi de près de 390 millions de crédits. Ces deux programmes créent ainsi près de 3 700 postes au profit du ministère de la justice. Quant au Plan d’action contre la radicalisation et le terrorisme (PART), récemment annoncé par le Premier ministre, il aura des effets tout aussi positifs, même si je ne suis pas, aujourd’hui, en mesure de vous les présenter sous la forme de statistiques.
Grâce à ces moyens, le ministère a structuré des politiques de prise en charge des publics radicalisés ou en voie de radicalisation. Je n’évoquerai pas d’emblée l’administration pénitentiaire. Il est bien entendu légitime que je vous rende des comptes à ce sujet, sur lequel je serai le plus précis et le plus exhaustif possible – même si je sais que vous avez déjà reçu la directrice de l’administration pénitentiaire, Isabelle Gorce –, mais je souhaiterais évoquer tout d’abord l’action de la Protection judiciaire de la jeunesse (PJJ), qui contribue à la prise en charge des publics jeunes et peut, à ce titre, jouer un rôle préventif déterminant.
La PJJ s’est vue dotée, le 1er avril 2015, d’une mission nationale de veille et d’information, soit un réseau de soixante-neuf référents – que j’ai d’ailleurs réunis à l’école de la PJJ, à Roubaix – présents sur l’ensemble du territoire. Ces référents « laïcité » ont pour fonction d’offrir aux professionnels une meilleure compréhension de ces enjeux, en particulier grâce à un plan de formation, et d’accompagner les établissements et les services dans la mise en œuvre des orientations nationales en matière de respect de la laïcité – qui n’est jamais acquis et doit faire l’objet d’une vigilance particulière – et de la neutralité, notamment à travers l’élaboration des projets de fonctionnement. Les professionnels ont pu ainsi effectuer un repérage des difficultés, établir, en quelques mois, une cartographie des risques et améliorer leur évaluation et leur prise en charge des mineurs ainsi que l’accompagnement de leurs familles. L’hétérogénéité du public conduit à privilégier l’individualisation de la prise en charge, qui nécessite des moyens importants, lesquels devront sans doute monter en gamme, car la situation actuelle n’est pas tout à fait satisfaisante.
Il convient de mentionner également le dispositif des « unités dédiées » – expression discutable, car elle ne paraît pas suffisamment explicite – mis en place, de manière d’ailleurs très empirique, au sein de l’administration pénitentiaire. Nous avons peu de recul dans ce domaine, puisque la première de ces unités a été créée le 25 janvier dernier.
Ces structures ne concernent que les maisons d’arrêt ou les quartiers « maison d’arrêt » des centres pénitentiaires. Elles n’existent donc pas, pour le moment, dans les maisons centrales, ce qui est assez logique, eu égard à la faible proportion de personnes détenues condamnées pour des faits de terrorisme islamiste. Par ailleurs, l’affectation en unité dédiée est réservée aux hommes majeurs, qui constituent la population statistiquement la plus importante. J’ajoute que les personnes détenues et condamnées pour ces faits sont affectées en maison centrale.
Les unités dédiées, qui comprennent entre vingt et vingt-huit places, se trouvent dans les maisons d’arrêt de Fleury-Mérogis et d’Osny, en Île-de-France, ainsi que dans le quartier « maison d’arrêt » du centre pénitentiaire de Lille-Annœullin. Deux autres structures, d’évaluation celles-là, ont été créées : l’une à Fleury-Mérogis, l’autre à Fresnes. Ces cinq structures accueillent aujourd’hui soixante-six personnes. Le personnel qui y est affecté est composé d’une équipe de surveillants sédentarisés qui se consacrent entièrement à ces structures, de conseillers d’insertion et de probation, et d’un binôme, formé par un psychologue et un éducateur, par établissement.
Au sein de ces unités dédiées s’appliquent automatiquement le principe de l’encellulement individuel et celui de la séparation des personnes prévenues et des personnes condamnées. Je précise que toute personne qui y est détenue est prise en charge dans le respect du régime ordinaire de détention, avec les mêmes droits et obligations que les autres détenus.
Il s’agit, j’y insiste, de structures expérimentales qui ne sont pas encore stabilisées au point de devenir un modèle. Je rappelle en effet qu’elles ont été créées pour répondre à un besoin, né dans une maison d’arrêt dont le directeur avait choisi de procéder à un regroupement des détenus radicalisés. Ce choix était discutable, et il a été légitimement discuté. En effet, la doctrine n’est pas la même dans tous les pays de l’Union européenne ayant une expérience en la matière : si les Anglais, par exemple, sont très réservés sur le principe d’un regroupement et d’une détention spécialisés, d’autres, en revanche, comme les Italiens, y semblent plutôt réceptifs. En tout état de cause, nous avons considéré que cette expérience méritait d’être tentée, car elle correspond à la nécessité de proposer une prise en charge adaptée des personnes radicalisées ou en voie de radicalisation et de faire régner le bon ordre au sein des établissements pénitentiaires concernés. De fait, à l’origine, le regroupement de ces détenus avait pour but d’éviter la dissémination des difficultés, voire leur prolifération ou le prosélytisme. Aujourd’hui, je ne suis pas en mesure de vous dire s’il s’agit d’une bonne ou d’une mauvaise solution. Je souhaite donc que cette expérimentation se poursuive et qu’elle donne lieu à une évaluation solide, ne serait-ce que pour savoir si la formation dispensée aux personnels, la disponibilité qui leur est garantie par l’administration et les moyens mis à leur disposition sont suffisants.
Actuellement, nous nous attachons à formaliser le cadre de cette expérimentation. Il s’agit de définir un ensemble d’outils, s’appuyant autant que possible sur le savoir-faire et les pratiques professionnelles existantes. En tout état de cause, il importe – et c’est un point non négociable – de limiter l’influence de ces personnes identifiées comme des « détenus particulièrement surveillés » – pour reprendre une catégorie déjà utilisée dans nos prisons – sur le reste de la population pénale et de prévenir les risques de troubles en détention. Ainsi les chefs d’établissement peuvent-ils prendre des mesures de gestion adaptées, telles que le placement en quartier d’isolement, une prise en charge individuelle ou l’inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés.
Outre ces dispositifs, il faut souligner le travail accompli par les Services pénitentiaires d’insertion et de probation (SPIP), tant en milieu fermé qu’en milieu ouvert. Leur connaissance de la population pénale, leur professionnalisme et leur rôle premier traduisent les efforts déployés pour enrayer les phénomènes de radicalisation et pour accompagner les individus dans la société. Toutefois, nous avons décidé, conformément aux annonces réalisées dans le cadre du Plan d’action contre la radicalisation et le terrorisme, de procéder à une réelle évaluation du principe de ces unités dédiées et de leur fonctionnement. Une telle évaluation est nécessaire avant d’envisager l’extension du dispositif à un public plus large.
Par ailleurs – et cela concerne aussi bien la direction de l’administration pénitentiaire que la PJJ et les Services pénitentiaires d’insertion et de probation pour la prise en charge en milieu ouvert –, nous allons créer, au sein du ministère de la justice, un comité scientifique pour nous aider à bâtir une doctrine sur la prise en charge des individus radicalisés. Il réunira des chercheurs, des praticiens et des représentants des différentes directions du ministère. Ses missions seront d’évaluer, de coordonner et d’explorer : évaluer les dispositifs de prise en charge, les coordonner pour les harmoniser et explorer de nouvelles pistes.
Mais ces efforts d’évaluation seraient vains si l’on ne détectait pas les détenus concernés ; j’en viens donc à la question du renseignement pénitentiaire, qui est un des éléments importants du nouveau plan d’action contre la radicalisation et le terrorisme. Ce sujet m’est un peu plus familier que d’autres, car j’y avais réfléchi en tant que parlementaire. Je remercie, du reste, la commission des lois d’avoir doté le ministère de la justice en la matière d’une base légale tout à fait satisfaisante, puisqu’un amendement au projet de loi relatif à la procédure pénale a fait du Bureau du renseignement pénitentiaire un membre éminent du deuxième cercle de la communauté du renseignement. Le Sénat a d’ailleurs suivi l’Assemblée sur ce point en complétant à son tour l’article 727-1 du code de procédure pénale, et la commission mixte paritaire a lissé les quelques éléments de discordance qui persistaient après la lecture du texte par les deux chambres.
Pour vous dire les choses simplement, je crois que tout est à faire dans ce domaine, tout ! Le renseignement pénitentiaire n’a en effet aucune réalité au ministère de la justice aujourd’hui. Il existe des outils, des services, des bureaux, des personnels ; nous avons donc de quoi travailler. Mais tout reste à définir, qu’il s’agisse de la manière de travailler des personnels, de la formation dont ils ont besoin, des moyens humains, techniques et financiers qui doivent leur être alloués ou, surtout, de l’élaboration d’une doctrine.
Il m’est arrivé, au cours de ma vie de député, d’avoir accès, en tant que président de la délégation parlementaire au renseignement, à des documents produits par les services de renseignement ; j’ai donc une idée assez précise de ce que peut être une de leurs analyses. Or, depuis que j’ai pris mes fonctions Place Vendôme, il y a quatre mois, je n’ai jamais été destinataire d’un document à en-tête du renseignement pénitentiaire. Je n’ai donc jamais eu connaissance des réflexions de ce service. Non pas que les personnels n’en aient pas l’envie, mais, depuis la création, en 2002, du renseignement pénitentiaire par le directeur de l’administration pénitentiaire de l’époque, Didier Lallement, ce sujet a été géré de manière très empirique. La menace, du reste, n’était pas aussi intense que celle que nous subissons actuellement.
Aujourd’hui, la responsabilité nous incombe de doter réellement l’administration pénitentiaire d’un outil spécifique. Il ne s’agit pas de copier ce qui existe en milieu ouvert, car un service de renseignement opérant en milieu fermé nécessite évidemment des qualités différentes. Nous nous attelons donc à construire ce service avec rigueur et tempérance, en étant précautionneux, car nous touchons là à des choses essentielles.
M. le président Georges Fenech. Que l’on vous comprenne bien, monsieur le ministre : le ministre de la justice est-il destinataire des procès-verbaux ?
M. le garde des Sceaux. Non, je ne parle pas de procédure.
M. le président Georges Fenech. Le fait que vous n’ayez pas eu de tels documents en main ne signifie donc pas qu’il n’y ait pas eu de contacts directs entre le renseignement pénitentiaire et le renseignement.
M. le garde des Sceaux. Je vais préciser mon propos. Je m’attendais à ce que l’on me donne une analyse, par exemple, de la progression de la radicalité à l’intérieur des établissements pénitentiaires : le prosélytisme y est-il avéré ? Certains personnages sont-ils devenus des références ? Certains établissements sont-ils plus particulièrement affectés ? Des surveillants eux-mêmes – puisque j’avais été interrogé à ce sujet à l’Assemblée – sont-ils en voie de radicalisation ? Bref, j’avais besoin d’un élément de « climatologie pénitentiaire », et il me semblait logique que cela relève de la responsabilité du renseignement pénitentiaire. Or je n’ai rien vu de tel. Je ne dis pas que c’est bien ou mal ; je le constate.
Nous devons donc poursuivre la structuration d’un échelon central d’animation, d’orientation, de synthèse et de transmission de l’information, car cet échelon est actuellement beaucoup trop faible pour que l’on puisse dire du Bureau du renseignement pénitentiaire qu’il est un service de renseignement.
Les effectifs sont là, notamment grâce aux PLAT. Si l’on fait le compte des personnels de l’administration pénitentiaire qui, à un moment donné, discutent avec le renseignement pénitentiaire ou se voient confier cette tâche, marginalement ou à plein-temps, on arrive à un total de 389 personnes. Il ne s’agit pas d’équivalents temps plein travaillé : parmi ces personnes, on peut trouver un délégué local du renseignement pénitentiaire qui consacre, par exemple, 10 % de son temps au renseignement et un autre qui y consacrera 100 % de son temps.
Les effectifs sont donc importants, mais ils ont été utilisés, pour le moment, à l’échelon interrégional, et non à l’échelon central, de l’administration pénitentiaire. Chaque établissement comprend ainsi un référent en matière de renseignement. Il s’agit donc maintenant de créer la « tête » qui définit des orientations et réalise des synthèses. À cette fin, nous devons continuer de recruter des personnels, dont la qualité sera déterminante pour nous permettre de réaliser un bond qualitatif. Nous envisageons ainsi de recruter des personnels venant des services de renseignement du premier ou du deuxième cercle afin d’accélérer la transmission des savoirs. Je souhaite également que le service du renseignement pénitentiaire intègre l’Académie du renseignement, afin que les personnels bénéficient d’une formation et fassent partie de ses promotions. Enfin, pour que cet investissement initial ait des effets dans la durée, il nous faut parvenir à fidéliser ces personnels. Or c’est une gageure au sein de la pénitentiaire. Un chiffre témoigne de la volatilité de ses personnels : dans les trois années qui suivent la sortie de l’École nationale de l’administration pénitentiaire, nous perdons 25 % des effectifs. On ne peut pas se contenter d’un tel constat ; nous devons trouver des solutions, en termes de statuts et d’indice, mais aussi du point de vue de l’intérêt de la tâche à accomplir.
L’inspection de l’administration pénitentiaire et l’inspection des services judiciaires – qui seront bientôt regroupées au sein d’une seule Inspection générale de la justice – mènent actuellement, au sein du ministère, un travail sur le renseignement pénitentiaire dont les conclusions me seront remises fin juin. Nous examinerons également les relations que le Bureau doit entretenir avec les services de renseignement du premier et du deuxième cercle. Actuellement, seuls deux protocoles ont été signés : l’un, en 2012, avec la DGSI, l’autre, en 2015, avec l’UCLAT. Il me paraît nécessaire d’en conclure d’autres avec le Service central du renseignement territorial, TRACFIN, la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED) et même avec la DGSE. Par la suite, nous mènerons une réflexion sur les outils techniques dont a besoin le renseignement. Pour l’instant, en effet, la question du recueil des données, qu’il s’agisse du recours aux IMSI catchers ou aux interceptions, ne se pose pas. Elle ne se posera qu’une fois que nous nous serons dotés d’une doctrine, d’une formation et d’outils performants.
M. le président Georges Fenech. Je vous remercie pour cet exposé, monsieur le garde des Sceaux. Avant de laisser la parole au rapporteur, je souhaiterais vous poser une première question concernant le renseignement judiciaire. Les services de renseignement ont évoqué, au cours de nos travaux, un certain blocage des enquêtes. De fait, lorsque le renseignement apparaît au cours d’une enquête judiciaire, notamment une instruction, celle-ci étant couverte par le secret de l’instruction, les services saisis, tels que la DGSI, par exemple, ne peuvent pas partager ce renseignement avec d’autres services – cette question s’était posée aux Américains après les attentats du 11 septembre, et elle a été réglée. Je souhaiterais donc savoir si la Chancellerie mène actuellement une réflexion sur la manière dont, tout en respectant le secret de l’instruction, on pourrait éviter de freiner le renseignement en cas d’enquête judiciaire, ce qui est tout de même un comble.
M. le garde des Sceaux. C’est un sujet sur lequel je suis extrêmement prudent. Le principe, qui figure dans le code de procédure pénale, est celui du secret de l’enquête, et il ne s’agit pas de l’écorner. Cependant, je vois bien que cela soulève une difficulté. Sur ce sujet comme sur les autres, je n’ai aucun tabou : je souhaite que l’on pose le problème, que l’on examine les solutions possibles, les protections et les interdits. Nous avons créé, il y a peu de temps, le dossier distinct en matière de géolocalisation. Cet outil, qui permet à la fois d’agir et de garantir un certain nombre de secrets, peut prospérer, dans son principe. J’ajoute qu’il existe déjà des dérogations au principe du secret de l’enquête et de l’instruction en matière de procédures fiscales et douanières – cela est prévu dans un article du code de la sécurité intérieure. Et, récemment, nous avons créé la possibilité d’informer les administrations en cas d’infraction sexuelle.
Je ne suis donc pas hostile par principe à une évolution ; ce serait stupide et dogmatique. Mais je ne veux pas me précipiter : je sens bien qu’il y a des appétits. Il arrive même que des demandes masquent des fragilités d’organisation et que l’on explique d’éventuelles carences par un manque d’outils. Il faut toujours « balayer devant sa porte » avant de réclamer de nouveaux pouvoirs. Je n’ai pas reçu, à ce stade, en tant que garde des Sceaux, une demande explicite à propos d’un cas où le droit existant aurait été une entrave à l’action de tel ou tel service.
M. le président Georges Fenech. Cela nous a été présenté comme un véritable obstacle par les responsables des services du premier cercle. Cette question doit sans aucun doute faire l’objet d’une réflexion, et notre commission d’enquête vous fera certainement des propositions dans ce domaine.
M. le garde des Sceaux. En tant que garde des Sceaux, monsieur le président, je n’ai jamais reçu de demandes à ce sujet de la part de services du premier ou du second cercle.
M. le président Georges Fenech. Nous, nous l’avons reçue.
M. le garde des Sceaux. D’où l’utilité de la séparation des pouvoirs.
M. Sébastien Pietrasanta, rapporteur. Dans le prolongement de la question de M. le président, je souhaiterais évoquer le parcours de Samy Amimour. Celui-ci avait été auditionné par la DCRI en 2012, puis mis en examen et placé sous contrôle judiciaire. Or les services de renseignement ont dû cesser de le surveiller à partir de sa mise en examen. Je souhaiterais avoir votre sentiment sur un tel paradoxe.
Par ailleurs, Amedy Coulibaly avait effectué de multiples séjours en prison, notamment à Fleury-Mérogis, où il fut le voisin de cellule de Djamel Beghal, et des écoutes téléphoniques réalisées en 2010 ont montré qu’il existait un lien fort entre les deux hommes. En outre, Coulibaly a été condamné pour avoir projeté l’évasion de Smaïn Aït Ali Belkacem, l’un des auteurs des attentats de 1995. Pourtant, à sa sortie de prison, il n’a été surveillé par personne : selon les services de renseignement que nous avons auditionnés, il n’apparaissait pas sur les écrans radar. Je souhaiterais donc connaître votre sentiment sur le rôle joué par le Bureau du renseignement pénitentiaire en 2010 et par la suite, car le parcours de Coulibaly soulève la question du lien entre l’administration pénitentiaire et la DGSI.
Enfin, les effectifs du renseignement pénitentiaire ont été largement renforcés au cours de l’année 2015. Par ailleurs, j’ai défendu, avec Philippe Goujon, un amendement, qui a été adopté, visant à intégrer le renseignement pénitentiaire au deuxième cercle de la communauté du renseignement. Que va-t-il se passer dans ce domaine dans les mois qui viennent ?
M. le garde des Sceaux. Entre 1999 et 2009, Coulibaly a été condamné six fois et il a fréquenté, au cours de ses errances pénitentiaires, cinq établissements différents : Melun, Fleury-Mérogis, Villejuif, Orléans-Saran… Votre remarque est tout à fait juste, monsieur le rapporteur ; elle pose la question de ce qu’est le renseignement pénitentiaire. Le bureau du renseignement pénitentiaire ne dispose ni de document ni de retour d’expérience sur le parcours de Coulibaly. D’où deux exigences. Tout d’abord, nous devons renforcer le lien entre dehors et dedans, et c’est pourquoi je souhaite que des protocoles soient signés avec l’ensemble des services, notamment le service central du renseignement territorial. Celui-ci est certes, compte tenu de la répartition des tâches décidée avec la DGSI, un interlocuteur des délégués locaux du renseignement pénitentiaire, mais il n’a pas normalisé les attentes mutuelles et les processus. Car l’information peut être également préalable à l’incarcération : lorsqu’un individu est suivi, il est utile que l’administration pénitentiaire le sache.
Le parcours de Coulibaly ne démontre que des carences de notre part ; il nous faudra y remédier.
En ce qui concerne le renseignement pénitentiaire, je ne suis en mesure de vous dire que ce que je suis capable de voir pour le moment. J’ai la volonté – et cela ne vous étonnera pas – que nous disposions d’un outil dans ce domaine. Mais j’attends les résultats du travail mené par l’inspection, qui nous aideront à baliser les différents domaines sur lesquels il nous faut progresser. À la rentrée, un décret doit nous permettre d’être intégré à la communauté du renseignement et nous devrions également disposer d’ici la fin de l’année des éléments d’application découlant des modifications du code de procédure pénale. D’ici à la rentrée ou au début de l’hiver, nous aurons donc l’outil issu des modifications que vous avez apportées au cadre législatif. Ensuite, il nous faudra structurer le renseignement pénitentiaire. Une fois l’outil construit au début de l’année 2017, nous pourrons alors nous poser la question des moyens.
Par ailleurs, je suis très attentif à la question de la rupture entre le moment où un individu est suivi par un service de renseignement dans le cadre d’une procédure administrative et le moment où il fait l’objet d’une procédure judiciaire. On ne peut pas, en effet, être suivi au plan administratif et au plan judiciaire pour le même motif : tel est le principe fixé par la loi sur le renseignement. Cet équilibre relève du droit au procès équitable. Toutefois, le service de renseignement en question peut suivre cet individu pour un autre motif. Je crois donc que cette rupture apparente n’est pas une réalité. Je ne pense pas qu’il y ait un vide. Vous savez, en outre, monsieur le rapporteur, que les techniques d’enquête sont beaucoup plus souples en matière judiciaire qu’administrative.
M. le rapporteur. Amimour était également sous contrôle judiciaire. Or on a constaté que ces contrôles étaient assez aléatoires et que les remontées sur leur violation n’étaient pas toujours très bien respectées. Dès lors, ne faudrait-il pas renforcer le contrôle judiciaire des personnes mises en examen pour association de malfaiteurs en vue d’une entreprise terroriste ? J’ajoute que les renseignements turcs avaient averti les Français du passage du duo Mostefaï-Amimour en 2013, c’est-à-dire à une date où ce dernier était sous contrôle judiciaire.
M. le garde des Sceaux. Comment pourrais-je répondre non à votre question, monsieur le rapporteur ? Si vous me suggérez de renforcer les modalités du contrôle judiciaire, je ne peux qu’y être favorable. Ce n’est ni une question de volonté ni une question de droit ; c’est une question de moyens. Je compte beaucoup sur le Parlement à cet égard.
M. Christophe Cavard. Monsieur le ministre, pourriez-vous dresser un bilan de l’intégration dans le code pénal des délits d’apologie du terrorisme et de provocation à la commission d’actes terroristes ? Concrètement, des personnes sont-elles poursuivies sur le fondement de cette incrimination et que deviennent-elles ?
On sait que ce type de publicité se fait notamment sur internet, et vous avez vous-même rédigé, en 2013, un rapport dans lequel vous abordiez la question de l’opportunité de fermer les sites concernés. Quant aux propos tenus sur les réseaux sociaux – Facebook, Twitter… –, s’ils relèvent bien du cadre légal lorsqu’ils sont publics, leur statut est plus difficile à définir lorsqu’ils sont prononcés dans le cadre de discussions privées. Quel est votre regard sur ces questions ?
Par ailleurs, le Premier ministre a évoqué, dans le cadre du plan de lutte contre la radicalisation, la création de centres spécialisés. Ces derniers pourront-ils être utilisés dans le cadre de procédures judiciaires, comme c’est le cas des centres éducatifs fermés, ou accueilleront-ils uniquement des individus volontaires ?
Enfin, les éducateurs spécialisés, en tant que travailleurs sociaux, sont liés par le secret professionnel, s’interrogent donc sur les échanges qu’ils peuvent avoir avec les services de sécurité, voire avec la justice. Les plateformes existantes fonctionnent plutôt bien, mais comment peut-on protéger ces personnels au niveau légal ?
M. le président Georges Fenech. Monsieur Cavard, nous avons fait le choix, vous le savez, de ne pas nous appesantir sur les phénomènes de radicalisation, qui ont été étudiés par la commission d’enquête sur la surveillance des filières et des individus djihadistes.
M. Christophe Cavard. Certes, mais reconnaissez, monsieur le président, qu’il est difficile d’évoquer la lutte contre le terrorisme sans aborder ce sujet.
Pour conclure, monsieur le ministre, je souhaiterais savoir si le renseignement pénitentiaire est présent au sein de l’Unité de coordination de la lutte antiterroriste (UCLAT).
M. François Lamy. J’ai été surpris que, au sein du tribunal de grande instance de Paris, un seul juge d’application des peines traite l’ensemble des affaires de terrorisme, quelles qu’elles soient. Je précise que, lors de son audition, ce magistrat semblait satisfait de cette situation et ne réclamait pas de moyens supplémentaires. Toutefois, le terrorisme basque ou corse et le terrorisme djihadiste, ce n’est pas la même chose. J’aurais donc souhaité connaître votre sentiment sur ce point.
Lorsque nous avons auditionné des juges antiterroristes, nous leur avons demandé s’ils avaient des relations suivies avec les services de renseignement extérieur. Or ils ont répondu par la négative. Ne serait-il pas utile que ces magistrats soient habilités secret-défense afin d’avoir accès aux documents classés et de savoir ce qui a précédé la judiciarisation ?
M. Pierre Lellouche. Même si l’affaire Merah est plus sérieuse que ce que l’on en a dit à l’époque, y compris après l’alternance de 2012, les attaques les plus importantes ont commencé en janvier 2015. Or vous nous dites, s’agissant du service de renseignement pénitentiaire – et il ne s’agit pas pour moi de vous mettre en cause –, que l’outil sera disponible dans le meilleur des cas début 2017. Certes, nous savons que l’idée même de renseignement pénitentiaire n’enthousiasmait pas votre prédécesseur, de sorte qu’un travail de persuasion et la construction d’un consensus ont été nécessaires. Mais il aura fallu attendre deux ans, et beaucoup de morts, avant qu’on admette qu’il ne serait pas mauvais de surveiller les personnes incarcérées, la prison étant, avec internet, un des lieux majeurs de radicalisation. Ce délai est-il raisonnable, du point de vue de la sécurité nationale ? Combien de cellules djihadistes, de Kouachi ou de Coulibaly, aura-t-on fabriquées pendant ces deux années ? Ni le Parlement ni l’exécutif ne semblent capables d’être à la hauteur de l’urgence. Ou bien l’on prend le terrorisme au sérieux, et on traite le problème maintenant, ou bien l’on attend que l’outil se mette en place. Je me permets de vous le dire, il faut agir beaucoup plus fortement !
Par ailleurs, la question soulevée par le rapporteur est fondamentale. Ainsi, il suffit qu’un terroriste, bien conseillé par un avocat, lui-même branché sur les réseaux terroristes, braque une station-service et soit mis en examen pour que sa surveillance par les services de renseignement s’arrête. C’est tout de même incroyable ! Et comment expliquer aux Français qu’un individu sous contrôle judiciaire puisse déclarer la perte de son passeport et en obtenir un nouveau auprès de la préfecture pour partir en Syrie ? Ce sont là des dysfonctionnements majeurs ! On ne peut pas se contenter de les constater, et nous comptons sur vous, car nous savons que vous êtes un homme efficace, pour y remédier. Je suis moi-même juriste, monsieur le ministre, et je suis conscient de ce qu’implique l’ouverture d’une enquête judiciaire. Mais, lorsqu’on est en guerre, on ne peut pas laisser un terroriste utiliser la procédure judiciaire pour échapper à la surveillance. Cela n’a aucun sens et nos concitoyens ne peuvent l’admettre !
Enfin, j’ai entendu les propos du Premier ministre au sujet du dispositif de déradicalisation qu’il est envisagé de créer. De tels dispositifs existent, notamment dans des pays arabes – j’ai moi-même pu visiter des centres de ce type en Arabie saoudite. Peut-être avez-vous mené une étude comparative, mais j’ai pu observer que la déradicalisation fonctionne avant la condamnation ou la détention. Une fois que les individus sont pris dans la machine judiciaire ou pénitentiaire, il est très difficile de revenir en arrière. Il me semble donc que, si l’on décide de faire un effort dans ce domaine, il faut travailler avec des imams, très en amont.
M. le président Georges Fenech. En tout cas, en ce qui concerne le renseignement pénitentiaire, il me semble que la réponse que vous nous avez faite, monsieur le garde des Sceaux, est très claire. On peut déplorer le retard pris, mais vous avez clairement affirmé votre volonté de créer un outil du renseignement pénitentiaire. Je vous invite cependant à relire le compte rendu de l’audition de la directrice de l’administration pénitentiaire : je ne suis pas certain que nous ayons entendu la même affirmation. Votre position nous rassure : encore faut-il qu’elle soit appliquée par la direction du ministère.
M. le garde des Sceaux. Je vous propose de répondre tout d’abord à l’ensemble des questions concernant le renseignement pénitentiaire, qui est un sujet passionnant. Aucun pays démocratique ne dispose d’un service de renseignement pénitentiaire.
M. Pierre Lellouche. En Israël, cela existe !
M. le garde des Sceaux. Non ! Lorsque j’étais président de la commission des Lois, j’ai écrit aux ambassadeurs de tous les pays démocratiques – Australie, États-Unis, Israël, Nouvelle-Zélande… – parce que, dans ce domaine, le benchmarking était inexistant. Je n’ai pu trouver ni un ouvrage, ni une étude universitaire, ni même un article sur le sujet. J’ai fait cette recherche car j’estime que, si un système vertueux existe ailleurs, il n’est pas utile de s’épuiser à en inventer un autre. Quoi qu’il en soit, je tiens les réponses de ces ambassadeurs à votre disposition. Dans certains pays, il existe des départements, à l’intérieur de services, qui s’occupent de la pénitentiaire, mais il n’existe pas de services de renseignement comparables à ce qui existe pour le renseignement intérieur ou le renseignement extérieur. C’est un sujet nouveau, que nous devons traiter et pour lequel il y a évidemment une hésitation.
Au regard de ce qu’est selon moi un service de renseignement pénitentiaire, je considère qu’il n’en existe pas. Le mot « renseignement », du reste, n’est pas défini. La loi de 2009, qui a rattaché la gendarmerie au ministère de l’intérieur, précise que le renseignement est une des prérogatives de cette dernière. Or je ne crois pas que le directeur général de la gendarmerie revendiquerait, pour sa sous-direction de l’anticipation opérationnelle (SDAO), la qualité de service de renseignement, tout simplement parce qu’il s’agit d’un service de collecte. Il existe une collecte du renseignement dans l’univers carcéral – des personnels observent, constatent, recueillent de l’information –, mais je n’appelle pas cela du renseignement. Selon moi, celui-ci suppose une mise en perspective, une capacité de prévision, une anticipation, la compréhension de faits qui se sont déroulés…
Je ne mets la conscience professionnelle de personne en cause. Je considère, au contraire, que ces personnels sont extrêmement dévoués, car ils défrichent un domaine qui fait l’objet d’une forte attente sociale – les interrogations que vous avez formulées existent au-delà de ces murs. Mais on ne se décrète pas agent du renseignement : cela nécessite, en milieu ouvert, des années d’expertise. En milieu fermé, il convient tout d’abord de définir ce que doit être un agent du renseignement. Il est pour le moins délicat de désigner un surveillant, connu des détenus, agent du renseignement pénitentiaire.
Je préférerais vous présenter une synthèse du renseignement pénitentiaire sur le prosélytisme en prison, mais je n’en ai pas. Comme je n’ai pas été nommé pour faire des constats, nous allons agir dans ce domaine. Nous avons déjà fait beaucoup : les personnels sont présents, la motivation existe et, grâce à vous, les difficultés juridiques ont été aplanies. Il nous reste maintenant à agir.
Quant à la directrice de l’administration pénitentiaire – j’ai relu, hier, le compte rendu de son audition par votre commission d’enquête –, elle a évoqué les problèmes de remontée de l’information. C’est bien de cela qu’il s’agit. Lorsque je me rends dans le ressort d’un TGI, d’une cour d’appel ou dans un établissement pénitentiaire, je demande comment les choses se passent. J’ai rencontré récemment le directeur de la DGSI, Patrick Calvar, qui m’a dit que les relations étaient bonnes avec ses interlocuteurs, mais des lacunes demeurent, et je crois qu’Isabelle Gorce a été assez franche. Nous avons beaucoup à faire dans ce domaine.
M. Alain Marsaud. Nous sommes d’accord avec vous !
M. le garde des Sceaux. M. Cavard m’a interrogé sur le délit d’apologie du terrorisme. Entre le 13 novembre et le début de l’année 2016, 472 procédures ont visé l’apologie du terrorisme, dont 149, qui visaient 151 auteurs, ne concernent que ces faits ; 71 % ont donné lieu à des poursuites devant les tribunaux correctionnels et, à ce jour, 34 personnes ont été jugées, dont 17 ont été condamnées à de l’emprisonnement ferme.
M. Alain Marsaud. Jean-Marc Rouillan figure-t-il parmi ces personnes ?
M. le garde des Sceaux. Le garde des Sceaux ne s’exprime pas sur les affaires en cours, monsieur le député.
Par ailleurs, aucun blocage judiciaire de site internet n’a été engagé, même si des centaines le sont au plan administratif – je crois à l’effet disruptif que peuvent avoir ces blocages. En ce qui concerne le secret professionnel, la loi de 2007 a créé des dispositifs de partage, lequel est limité à des personnes elles-mêmes soumises au secret. Je crois néanmoins que nous devons réexaminer cette question, compte tenu des nouveaux défis que nous devons relever. Je n’ai pas reçu de demandes de ce type, mais je n’y suis pas opposé par principe. Enfin, un directeur de service pénitentiaire a intégré l’UCLAT il y a déjà quelque temps, lorsque Christiane Taubira était ministre de la justice, mais l’UCLAT n’est pas une structure opérationnelle.
Monsieur Lamy, nous avons prévu d’alléger le travail du juge d’application des peines antiterroriste, car certains éléments, notamment l’apologie du terrorisme, ne relèvent plus de sa compétence. En outre, un second magistrat va être nommé.
M. le président Georges Fenech. À ce propos, pourriez-vous répondre à ma question sur les réductions de peine automatiques dont continuent à bénéficier les condamnés pour fait de terrorisme ?
M. le garde des Sceaux. C’est un sujet que vous connaissez bien, monsieur le président ; nous l’avons évoqué chaque fois que votre assemblée a examiné un projet de loi touchant au code de procédure pénale. La question a été tranchée : il a été décidé qu’il n’était pas nécessaire de faire évoluer la législation sur ce point.
M. le président Georges Fenech. Les terroristes bénéficieront donc toujours de réductions de peine automatiques.
M. le garde des Sceaux. Je vous donne l’état du droit actuel et la position défendue par le Gouvernement.
M. le président Georges Fenech. Merci de la clarté de votre réponse, monsieur le ministre.
M. François Lamy. Mon autre question portait sur le secret-défense. Nous nous sommes en effet aperçus, lorsque nous avons auditionné les juges antiterroristes, qu’ils n’avaient pas de liens réguliers avec les services de renseignement, notamment le service de renseignement extérieur. Je sais bien que cela peut poser problème au regard de la séparation des pouvoirs, mais puisque les parlementaires membres de la délégation au renseignement y ont accès, ne pourrait-on pas habiliter secret-défense au moins certains juges antiterroristes ?
M. le garde des Sceaux. Les juges antiterroristes sont habilités secret-défense intuitu personae. Du reste, lors de l’examen du projet de loi sur le renseignement, nous avions discuté de la question de savoir s’il fallait habiliter les structures ès qualités, ce que nous avons fini par faire. Toutefois, ces magistrats n’ont pas besoin de tout connaître.
M. Alain Marsaud. Quand j’étais au parquet antiterroriste, nous avions une habilitation de fait : nous avions accès à des informations provenant des services de renseignement, DGSE ou DST, mais sans passer par un système d’habilitation contraignant, lequel pourrait, du reste, être considéré comme contraire à la séparation des pouvoirs.
M. le garde des Sceaux. Je précise que des enquêtes sont réalisées en vue de l’habilitation.
M. Alain Marsaud. On peut imaginer en effet que, lorsqu’un magistrat du siège est désigné juge antiterroriste, sa hiérarchie s’est au préalable informée sur sa fiabilité.
M. Meyer Habib. Je souhaiterais revenir sur le problème des téléphones en prison. Lorsque j’avais interrogé votre prédécesseur sur ce point, elle m’avait indiqué que plus de 20 000 téléphones avaient été saisis en l’espace d’un an, ce qui est colossal. Or il est indispensable que les détenus radicalisés ou condamnés pour terrorisme n’aient pas de téléphone ou, s’ils en ont un, qu’ils soient écoutés. J’ai cru comprendre, du reste, que certains services mettaient des téléphones en circulation pour pouvoir les écouter. Aujourd’hui, des technologies permettent de savoir, pour chaque cellule, si un téléphone s’y trouve et, si tel est le cas, de l’écouter. Bien entendu, il faudrait utiliser un tel système pour tous les détenus, mais ce n’est pas possible, faute de moyens. Cependant, aujourd’hui, nous sommes en guerre et les détenus radicalisés doivent être une priorité.
Par ailleurs, un jour ou l’autre, les détenus radicalisés qui se trouvent dans les différentes « unités dédiées » seront libérés. Ne pourrait-on pas leur imposer le port d’un bracelet électronique ? Je sais que cela peut être contraire à certains principes, mais avons-nous réellement le choix ?
Enfin, nous avons assisté, ces derniers jours, sur internet, à des débordements antisémites invraisemblables suite à un article que Martine Gozlan a consacré dans Marianne au dernier film d’Yvan Attal. Quels moyens a-t-on de lutter contre de tels débordements ?
M. le garde des Sceaux. S’agissant des brouilleurs, il en existe 804 dans les établissements pénitentiaires, ce qui signifie que 53 % d’entre eux en sont équipés. Toutefois, la technologie de la plupart de ces brouilleurs est obsolète, puisqu’ils ont été conçus pour brouiller la 2G. Il est donc prévu – des crédits ont été programmés à cet effet – d’acheter des brouilleurs de nouvelle génération. Je précise, du reste, que les systèmes les plus performants sont installés en priorité dans les unités dédiées que j’ai évoquées tout à l’heure, mais à peine les nouveaux appareils seront-ils déployés que l’on passera à la 5G, et nous nous retrouverons dans la même situation qu’aujourd’hui.
Il existe plusieurs techniques de brouillage. Nous avons ainsi expérimenté, à Osny, un brouillage chirurgical qui peut cibler une cellule, par exemple. On peut également installer un brouillage aérien, avec une antenne centrale, mais, si l’établissement se trouve dans une zone très urbanisée, les riverains vont immédiatement protester.
Quoi qu’il en soit, je rappelle que le principe est l’interdiction des téléphones en prison. Or il y en a 30 000. J’ai d’ailleurs invité les deux commissions des lois à m’accompagner lors d’un déplacement pour que nous sachions ce que sont ces téléphones, qui sont beaucoup plus petits et discrets que ceux que vous et moi utilisons. J’ai ainsi découvert la technique dite du « Big mac », qui permet de faire entrer ces téléphones en prison. Elle consiste à placer trois ou quatre téléphones entre deux grosses éponges entourées de ruban adhésif et à jeter le tout par-dessus le mur d’enceinte de la prison.
M. le président Georges Fenech. Il n’est peut-être pas nécessaire de donner trop de détails, monsieur le ministre…
M. le garde des Sceaux. Tout cela était dans la presse, monsieur le président, et il faut dénoncer ces pratiques.
Nous allons expérimenter, dans un établissement de la Meuse, me semble-t-il, l’équipement de chaque cellule d’un téléphone filaire qui pourra donc être écouté. Ainsi tout téléphone portable perdra de son intérêt pour ceux qui veulent en faire un usage légitime, notamment le maintien des liens avec leur famille. Par ailleurs, plutôt que de les brouiller, il serait plus utile de détecter ces téléphones. Nous avons actuellement un dialogue compétitif avec des entreprises, afin de trouver des réponses techniques à nos besoins dans ce domaine, besoins que nous avons précisément identifiés.
J’en viens à la question des aumôniers. Au 25 mai 2016, les aumôniers musulmans agréés pour intervenir en détention étaient au nombre de 222 – ils étaient 200 au début de l’année. Chaque PLAT a prévu des capacités de recrutement. Évidemment, ils doivent être formés et nous avons un regard sur leur recrutement et leurs conditions d’exercice. Par exemple, tous ne sont pas indemnisés à la hauteur de ce qui serait nécessaire. Or, si nous menons avec eux un travail au long cours, il ne faut pas négliger cette forme de fidélisation. Leur formation est actuellement assurée par les directions interrégionales de l’administration pénitentiaire.
Pour le reste, monsieur Habib, on peut partager votre avis sur beaucoup des points que vous avez évoqués, mais il convient d’appliquer la loi. Or, à ce stade, les modalités auxquelles vous avez fait référence ne sont pas vraiment légales.
M. le président Georges Fenech. Il est de notoriété publique que l’autorité judiciaire, notamment le parquet de Paris, mais aussi celui de Bruxelles, a rencontré des difficultés en raison de la relation par la presse d’un certain nombre d’informations capitales pour l’enquête, voire pour la sécurité des otages. Une réflexion est-elle en cours à la Chancellerie pour que la presse soit tenue de garder le secret pendant un certain temps, comme c’est le cas, me semble-t-il, en Grande-Bretagne ? C’est une véritable aspiration de l’autorité judiciaire, qui ne nous a pas caché son irritation face à la fuite d’éléments de l’enquête.
M. le garde des Sceaux. Il m’est en effet arrivé d’avoir des conversations à ce sujet. J’ai même lu des articles évoquant la réticence des autorités belges à procéder à des transferts par crainte que cela n’entraîne des perturbations. Je sais également les solutions auxquelles aspirent ceux qui souhaitent remédier à cette situation ; je ne les crois pas, en l’état, très praticables. Le problème est extrêmement complexe et, pour le moment, nous n’avons pas de piste de réponse.
M. le président Georges Fenech. Cette question nous paraît vraiment importante. Nous avons du reste auditionné les organes de presse ainsi que le Conseil supérieur de l’audiovisuel. Manifestement, l’autorité judiciaire et la presse elle-même sont désireuses qu’au moins une charte, ou un protocole, permette de réguler leurs relations lors de moments critiques, d’autant que l’information est désormais continue et instantanée. Sans revenir sur les faits qui ont suscité cette réflexion, je rappellerai que, en Belgique, la révélation d’une information a précipité la perquisition à Forest et a donc eu une incidence sur le déroulement de l’enquête.
M. le garde des Sceaux. Certains éléments devraient nous inciter à l’optimisme, monsieur le président. Après les débordements que nous avons constatés après l’attentat contre Charlie Hebdo, le Conseil supérieur de l’audiovisuel a adressé une quarantaine de rappels à l’ordre aux différentes chaînes de télévision, lesquelles paraissent avoir retenu la leçon, car nous n’avons pas eu à déplorer les mêmes excès lors des attentats du 13 novembre. La presse s’est en effet comportée de manière beaucoup moins critiquable lors de ces événements. Il n’empêche que, en dehors des périodes de haute intensité, cette course à la révélation peut perturber le cours des enquêtes, ce qui est évidemment regrettable.
M. le rapporteur. Le procureur de la République de Paris nous a alertés sur le fait qu’il était de plus en plus souvent confronté à des mineurs très radicalisés et que les prisons ou les centres éducatifs fermés n’étaient pas les structures les plus adaptées. Quelle est la réflexion du ministère sur la prise en charge des mineurs radicalisés ?
Par ailleurs, la détention de Salah Abdeslam se déroule dans des conditions assez inédites, puisqu’il est placé sous vidéosurveillance vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Quelles sont les raisons qui vous ont conduit à mettre en œuvre ce dispositif, et celui-ci présente-t-il toutes les garanties juridiques nécessaires ?
M. le garde des Sceaux. Il est légitime que vous évoquiez ce sujet, mais il est très sensible. J’ai en effet pris la décision de placer la personne détenue sous vidéosurveillance, d’abord dans un souci de protection de la personne elle-même. Cette vidéosurveillance impliquant l’enregistrement de données personnelles, j’ai saisi la Commission nationale de l’informatique et des libertés pour solliciter son avis sur la durée de leur stockage et les conditions de l’enregistrement. La CNIL a rendu un avis positif, et je ne verrais d’ailleurs que des avantages à ce que cet avis soit publié. Je vais prendre l’arrêté qui donnera sa base juridique à cet enregistrement. Celui-ci doit être extrêmement précis et entouré d’un certain nombre de garanties. Le caractère exceptionnel du dispositif est évident. Le texte devrait correspondre à la fois aux aspirations de la CNIL et à celles qui relèvent de ma responsabilité.
Quant à la question des mineurs, il s’agit d’un sujet en devenir, car, si ce que je peux en lire est exact, les nombreux mineurs – autour de 400, dit-on – présents sur le théâtre irako-syrien sont susceptibles de revenir sur le territoire national. Aujourd’hui, seuls huit mineurs sont placés en détention pour des mises en examen liées au terrorisme. Notre réflexion est donc, pour l’instant, embryonnaire sur ce sujet. Je suis, par exemple, très prudent sur l’intérêt d’un regroupement, dans leur cas.
Par ailleurs, on observe une augmentation des signes de radicalisation en milieu ouvert. Personne ne nie la réalité du problème. Nous essayons donc d’anticiper avec la PJJ, qui a pris beaucoup d’initiatives, notamment en s’informant sur ce qui peut se faire dans d’autres pays. De nombreux travaux existent, qui circulent au sein de l’administration et dont nous essayons de nous inspirer.
M. Alain Marsaud. Monsieur le garde des Sceaux, le directeur général de la sécurité intérieure nous a annoncé le retour éventuel, peut-être précipité, d’un nombre sans doute important d’individus partis pour la Syrie. Il serait lié au fait que l’État islamique voit son territoire se réduire peu à peu. La Chancellerie réfléchit-elle à une modification de la législation ou à une nouvelle législation plus imaginative concernant ces individus ? Je pense également aux mineurs. Vous avez supprimé le tribunal correctionnel pour mineurs – même si je sais que, sur ce point, votre réflexion n’est pas très éloignée de la mienne. Soit. Mais imaginez, si vous deviez envisager des poursuites à leur égard, la réaction du juge pour enfants face à des enfants qui, à dix ans, ont déjà manié la kalachnikov et tiré sur leurs voisins…
En ce qui concerne les majeurs, de deux choses l’une : soit on n’a rien contre eux, et ils vaqueront à leurs occupations, soit ils tombent sous le coup de l’association de malfaiteurs terroriste, mais celle-ci est difficile à établir. Je vais peut-être choquer, mais ne pourrait-on pas imaginer une solution analogue à celle qu’ont choisie les Américains ? Je ne pense pas forcément à Guantanamo, mais le Homeland Security envisage d’envoyer systématiquement en prison, sans qu’ils passent par la case « liberté conditionnelle », tous ceux qui rentrent de Syrie – ce qui les dissuadera peut-être de rentrer, du reste. Imaginez-vous une autre forme de délit, voire de crime, pour « pénaliser » systématiquement les individus qui rentrent de Syrie ? Certes, ils ont pu y faire la plonge ou y être garagistes ou ambulanciers, mais c’est tout de même peu vraisemblable…
M. le président Georges Fenech. Monsieur Marsaud, il me semble que, depuis 2012, le fait de se rendre sur un théâtre extérieur est une infraction.
M. Alain Marsaud. Certes, mais les individus sont immédiatement remis en liberté sous contrôle judiciaire. Ce n’est pas une véritable répression. Or il s’agit de protéger l’ordre public.
M. le président Georges Fenech. Quelle est la politique pénale en la matière, monsieur le ministre ?
M. le garde des Sceaux. M. Marsaud plaide ici, comme il l’a fait lors d’un récent débat, en faveur de la création d’un délit de séjour. Je me dois donc de lui rappeler que son amendement n’a pas été adopté, et je ne peux qu’exposer les arguments que je lui avais opposés lors de cette discussion : ma conviction – mais M. Marsaud est un orfèvre en la matière et c’est avec prudence que j’engage la controverse avec lui – est que l’AMT est suffisamment souple pour couvrir ce type de risques.
M. le président Georges Fenech. Je souhaiterais clarifier un point, monsieur le garde des Sceaux. Une information est parue dans la presse selon laquelle la Place Beauvau aurait expliqué l’interruption, fin 2013 et en juin 2014, de la surveillance téléphonique dont faisaient l’objet les frères Kouachi par le fait que la CNCIS – dont vous étiez membre, en tant que député – n’avait pas autorisé sa prolongation. Or vous avez publié un communiqué dans lequel vous avez formellement démenti cette information. Pourriez-vous le confirmer devant la commission d’enquête ?
M. le garde des Sceaux. Je n’ai pas publié de communiqué, pour une raison très simple : les travaux de la CNCIS, comme ceux de la CNCTR, qui lui a succédé, sont couverts par le secret-défense.
M. le président Georges Fenech. J’ai ce communiqué sous les yeux !
M. le garde des Sceaux. Je me rappelle ce que j’ai fait, monsieur le président. J’ai repris la position que le président Delarue avait exprimée publiquement dans un communiqué qu’il avait signé : il y a eu une discussion au sein de la CNCIS et nous avons effectivement pris la position publique que vous venez de rappeler et qui était conforme à ce que nous avions vécu.
M. le président Georges Fenech. Donc, à l’époque, la prolongation des écoutes des frères Kouachi n’a jamais été refusée.
M. le garde des Sceaux. Le communiqué du président Delarue dit tout ce qu’il y a à dire sur cette question.
M. le président Georges Fenech. Très bien. Je vous remercie pour la clarté de votre réponse.
M. Christophe Cavard. En ce qui concerne le centre de déradicalisation dont le Premier ministre a annoncé la création, ceux qui y séjourneront seront-ils volontaires ou certains pourraient-ils y être obligés par une procédure judiciaire ?
M. le garde des Sceaux. Le Premier ministre a en effet annoncé l’ouverture, en juillet, d’un centre de déradicalisation. Ce projet est en cours de discussion : locaux, personnel, public accueilli… Le ministère de la justice ne serait concerné que si ce centre devait accueillir les personnes sous main de justice.
M. Christophe Cavard. Les juges peuvent prononcer une injonction de soins…
M. le garde des Sceaux. Pour le moment, ce centre accueillerait plutôt des personnes volontaires, et non des personnes sous main de justice. Je ne peux pas vous en dire plus. En revanche, je peux vous indiquer que 317 procédures judiciaires ont été ouvertes à propos de retours de Syrie ; 263 sont encore en cours. Ces procédures ont donné lieu à la mise en examen de 259 personnes, dont 163 sont en détention provisoire.
M. le président Georges Fenech. Monsieur le garde des Sceaux, la commission d’enquête vous sait gré de lui avoir consacré ces deux heures très riches et vous remercie pour la très grande clarté et la franchise de vos réponses.
Audition, ouverte à la presse, de M. Jean-Yves Le Drian, ministre de la Défense
Compte rendu de l’audition, ouverte à la presse, du mercredi 1er juin 2016
M. le président Georges Fenech. Nous vous remercions, monsieur le ministre de la défense, d’avoir répondu à la demande d’audition de notre commission d’enquête relative aux moyens mis en œuvre par l’État pour lutter contre le terrorisme depuis le 7 janvier 2015.
Nous achevons notre travail avec l’audition des membres du Gouvernement. Nous venons d’entendre le garde des sceaux et nous entendrons demain le ministre de l’intérieur. Avec vous, monsieur le ministre de la défense, nous allons nous intéresser aux aspects militaires de la lutte contre le terrorisme aussi bien sur les théâtres d’opérations extérieurs, avec notamment la conduite de l’opération Chammal, qu’en France, avec l’opération Sentinelle, et bien sûr aux moyens budgétaires, humains et matériels, dégagés par l’État. Nous allons également aborder les questions relatives au rôle du renseignement militaire et à la coopération et à la coordination entre ce dernier et les autres services de renseignement.
Nous vous entendrons avec d’autant plus d’intérêt après avoir auditionné les responsables, placés sous votre autorité, des forces armées et du contre-espionnage. Nous avons notamment reçu le gouverneur militaire de Paris et des militaires de l’opération Sentinelle ; mais nous avons également eu l’honneur d’auditionner le général Pierre de Villiers, chef d’état-major, ainsi que le général Pierre Sauvegrain, sous-directeur de l’anticipation opérationnelle de la gendarmerie nationale, et le général Christophe Gomart, directeur du renseignement militaire (DRM).
Une première série de questions tournera autour de notre présence militaire au sein de la coalition dans la zone irako-syrienne notamment. Nous vous interrogerons ensuite sur le rôle de la force Sentinelle.
Je rappelle que cette audition est ouverte à la presse et fait l’objet d’une retransmission en direct sur le site internet de l’Assemblée nationale ; son enregistrement sera également disponible pendant quelques mois et je vous signale que la commission pourra décider de citer dans son rapport tout ou partie du compte rendu qui sera fait de cette audition. Nous avons en effet décidé que, d’une manière générale, et quand cela ne soulèvera pas de difficulté pour les personnes entendues ou au regard de la confidentialité des informations recueillies, nos auditions seraient ouvertes à la presse, car nous devons mener cette enquête en toute transparence.
Conformément aux dispositions de l’article 6 de l’ordonnance du 17 novembre 1958, relatif aux commissions d’enquête, je vous demande de prêter le serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité.
M. Jean-Yves Le Drian, ministre de la défense, prête serment.
M. Jean-Yves Le Drian, ministre de la défense. Je vous remercie de m’avoir invité dans le cadre de vos travaux. Avant de revenir sur les conséquences des attentats de 2015 en termes de capacités et d’action, je souhaite évoquer la situation antérieure afin de vous livrer quelques observations sur le débat qui avait alors cours sur le contre-terrorisme et sur les menaces.
La menace terroriste avait en effet déjà été identifiée en 2008 comme « majeure » dans le Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale. Ce statut de la menace terroriste a été confirmé dans le Livre blanc de 2012, après des discussions portant essentiellement sur la réalité de l’affaiblissement d’Al-Qaïda, sur le fait de savoir si la menace identifiée en 2008 était toujours aussi forte. Il y a été répondu par l’affirmative et cela bien avant l’émergence fulgurante de Daech avec la prise de Falloujah, au début de 2014, et celle de Mossoul, au printemps de la même année. La gravité de la situation au Sahel avait déjà largement sensibilisé la commission du Livre blanc et en 2008, et en 2012 au moment de la préparation de la loi de programmation militaire (LPM) pour 2013. Le contre-terrorisme était dès lors déjà une priorité impliquant l’octroi de moyens supplémentaires.
Dès lors, quand je suis devenu ministre de la défense, en harmonie avec les préconisations du Livre blanc et en application des dispositions prévues par la loi de programmation militaire, avant même les événements en question, j’ai été amené à engager un certain nombre de programmes de renforcement du renseignement, en particulier en matière capacitaire. J’ai donc décidé de renforcer des programmes d’investissements, tels ceux liés à la stratégie des drones – qui avait suscité de longues discussions, voire des affrontements. Nous avons ainsi acheté des drones Reaper aux États-Unis, puisque les nôtres avaient un caractère intérimaire. J’ai également fait inscrire dans la loi de programmation l’acquisition de drones tactiques – c’est désormais chose faite – et pris des initiatives avec l’Allemagne, l’Italie et l’Espagne afin d’engager un programme visant à élaborer une nouvelle génération de drones européens pour l’horizon 2025.
La nécessité de renforcer nos capacités de renseignement impliquait la modernisation de nos dispositifs d’interception et d’observation dans le domaine satellitaire. Le renseignement d’intérêt militaire bénéficiera rapidement de la livraison des satellites CSO (composante spatiale optique) du programme MUSIS (Multinational Space-based Imaging System), et de la réalisation du système satellitaire d’écoute CERES (capacité de renseignement électromagnétique spatiale) qui sera opérationnel en 2020.
À cette augmentation des moyens capacitaires s’est ajouté un renforcement des moyens humains : la loi de programmation militaire initiale avait prévu une augmentation de plus de 1 000 postes rattachés au ministère de la défense, personnels directement liés au renseignement ou à la cyberdéfense, qu’il s’agisse de spécialistes indispensables à ces nouvelles capacités, de linguistes, d’interprétateurs d’images, de spécialistes de capacités critiques pour la détection...
J’ajoute que l’engagement du ministère de la défense dans la lutte contre le terrorisme s’est aussi traduit, avant même le 7 janvier 2015, par un effort sur le terrain des prérogatives juridiques offertes aux services de renseignement. En effet, la LPM de décembre 2013 comporte déjà des dispositions renforçant l’accès des services de renseignement du ministère de la défense à certains fichiers, notamment de la police administrative ou judiciaire ; elle prévoit en outre un régime d’accès des services de renseignement aux données de connexion détenues par les opérateurs de télécommunication, la création en France du fichier PNR (Passenger Name Record) ou encore la protection des systèmes d’information des opérateurs d’importance vitale contre la cybermenace.
Tout ce que je viens de rappeler montre bien à quel point nous étions déjà conscients de la menace terroriste, même si, depuis les attentats de 2015, la donne a complètement changé.
En ce qui concerne l’évolution de la situation depuis ces événements, je vous ferai part de plusieurs observations, en commençant par le déploiement des militaires sur le territoire national, pour en venir ensuite aux théâtres extérieurs.
Contrairement à ce que j’ai pu lire, ce n’est pas la première fois que nos armées se voient confier des missions de protection sur le territoire national : c’est une réalité ancienne et clairement exprimée dans tous les livres blancs successifs depuis 1972 ; elle fut accentuée dans celui de 2008, qui crée le contrat opérationnel de déploiement de 10 000 hommes sur le territoire, et consolidée dans celui de 2013. En effet, les trois grandes priorités stratégiques du ministère de la défense – dissuasion, intervention, protection – sont étroitement complémentaires et la protection reste première dans notre stratégie de défense et de sécurité nationale, même si la projection extérieure a constitué un axe d’effort majeur depuis la fin de la guerre froide. Par conséquent, la protection de la nation contre toute menace de nature militaire ou susceptible de porter atteinte à la continuité des institutions est sans conteste une mission prioritaire des forces armées.
J’entends y insister parce que, dans les scénarios d’emploi des armées qui sous-tendent les préparatifs des livres blancs de 2008 et 2013, le risque d’une combinaison de menaces visant la France ou l’Europe, à la fois à l’extérieur et à l’intérieur du territoire, est considéré comme le plus important et le plus exigeant en termes de capacités à déployer. Les événements de janvier et novembre 2015 nous ont tragiquement rappelé la pertinence de ce travail d’anticipation.
Dès les premières heures de la crise du 7 janvier, j’ai donc ordonné le renforcement des détachements Vigipirate. Je rappelle que, puisque nous nous trouvions pendant la période des fêtes, le dispositif était activé, mais pas à son « plafond » puisque mobilisant de 700 à 800 personnels militaires. J’ai dès lors décidé de le déployer à son maximum avec l’engagement de 1 100 personnels afin de soulager l’effort des forces de sécurité intérieure. Il s’agissait d’assurer une présence plus visible et plus rassurante pour nos concitoyens, en particulier sur les sites de transport des grandes villes.
Compte tenu de l’analyse de la menace, c’est une décision d’activation du contrat de protection lui-même, à son plus haut niveau, qui a été prise par le Président de la République le 12 janvier et afin de montrer que nous avions vraiment changé de perspective, que nous dépassions le cadre du dispositif Vigipirate, l’opération Sentinelle a été décidée. C’était un signal politique fort de la part du chef des armées et la Nation a compris que le péril terroriste, militarisé à l’extérieur de nos frontières, pouvait la frapper en son cœur, et que la réponse devait être à la mesure de sa dangerosité : une réponse forte, déterminée et cohérente.
La mobilisation du ministère de la défense et des armées a été, pendant ces heures dramatiques, exemplaire. En moins de soixante-douze heures, en effet, 10 000 militaires ont été projetés sur tout notre territoire, à la disposition du ministre de l’intérieur et, à travers lui, des préfets de zone de défense, pour ce qui a constitué la première véritable opération intérieure de l’armée professionnelle. C’est de cette manière que l’opération Sentinelle a vu le jour : elle a été conçue dès ses premières heures, non plus comme un complément d’effectifs de Vigipirate, mais bien comme une opération en soi de protection sur notre sol, en complément de l’action des forces de police et de gendarmerie. Il va de soi que cette opération militaire s’insère dans la manœuvre globale de sécurité intérieure pilotée par le ministre de l’intérieur et qu’en aucun cas nos forces ne peuvent intervenir sans une réquisition du ministre ou de son représentant.
La prolongation de ce premier dispositif et son organisation ont ensuite été confirmées par le chef de l’État au cours d’un conseil de défense d’avril 2015. Face au développement de la menace terroriste militarisée, le contrat de protection a été précisé et redéfini, avec une capacité cette fois permanente d’engager 7 000 hommes des armées dans la durée, et jusqu’à 10 000 pour un mois. Cette redéfinition, jointe au constat de nos fortes sollicitations en opérations extérieures, a conduit à la décision d’augmenter, par rapport aux prévisions de la LPM, de 11 000 hommes la force opérationnelle terrestre (FOT) qui passera de 66 000 à 77 000 hommes. À cette occasion, j’ai précisé qu’il s’agissait bien d’une seule et même armée : nous n’avons pas retenu les propositions d’armée à deux vitesses, l’une territoriale, l’autre de projection, qui eût été la source de trop de complexité, d’iniquité et, éventuellement, de gaspillage.
L’opération Sentinelle s’est depuis lors continûment adaptée, dans une logique de protection prioritaire des personnes et avec une volonté de souplesse et de dynamisation accrues de nos dispositifs – moins de gardes statiques et, progressivement, plus de patrouilles – articulés avec ceux du ministère de l’intérieur.
Au lendemain des attentats du 13 novembre, la mobilisation des armées s’est de nouveau confirmée avec le redéploiement – en application du nouveau contrat opérationnel – de 3 000 soldats en trois jours, dont 1 000 dès les deux jours qui ont suivi les événements. Là encore, la mobilisation dans l’urgence a été totale, jusqu’à la mobilisation des hôpitaux des armées. Je tiens à signaler que nous avons, dans le même temps, renforcé l’ensemble de nos postures de sécurité du territoire national, tant aériennes, maritimes que de cyberdéfense, qui peuvent tout autant faire l’objet d’attaques terroristes.
Une telle évolution appelait un recadrage de la doctrine d’emploi des armées sur le territoire national ; c’est ce qui a été fait, conformément aux conclusions du conseil de défense d’avril 2015, à travers l’article 7 de la LPM actualisée du 25 juillet. Le rapport relatif aux conditions d’emploi des armées sur le territoire national a été présenté au Parlement et a donné lieu à deux débats très riches, à l’Assemblée et au Sénat, les 15 et 16 mars derniers.
Ce rapport présente le cadre d’ensemble dans lequel nous menons nos opérations intérieures et les évolutions qu’il a connues depuis les attentats du 7 janvier. Il tire les conséquences de l’évolution des menaces et de leur confrontation avec les savoir-faire spécifiques de l’armée professionnelle : réactivité et disponibilité permanentes ; centralisation des forces ; maîtrise des armes de guerre ; capacité de planification complexe et multi-milieux ; mobilité et aéromobilité, pour ne prendre que les exemples les plus marquants.
En outre, le rapport met en place la posture permanente de cyberdéfense ainsi que les principes des contrats capacitaires du service de santé ou de celui des essences. Il donne également une nouvelle impulsion à l’emploi de nos réserves militaires. C’est bien tout le champ de nos opérations de protection intérieure qui a été revisité à cette occasion et adapté à la situation que connaît le pays.
Il décrit également le cadre juridique applicable à l’emploi des armées sur le territoire national, et notamment à l’emploi de la force par nos militaires. À ce titre, je souligne que le régime de la légitime défense, qui est celui qui, à titre principal, régit l’emploi de la force par les policiers comme par les militaires réquisitionnés pour agir sur le territoire national, constitue un cadre adapté à la situation. On a pu notamment mesurer ces derniers mois – par exemple à Valence ou lors de la neutralisation d’un individu qui s’attaquait à un commissariat parisien – qu’il permettait de prendre en compte la spécificité du métier des forces de l’ordre et qu’il ne constituait pas un facteur d’inhibition dans l’usage des armes.
Reste que le rapport discuté en mars dernier par le Parlement relève aussi le grand intérêt que présentent les dispositions qui figurent aujourd’hui à l’article 51 de la loi renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale, votée définitivement le 25 mai. Ces dispositions ont pour objet de prendre en compte le cas particulier d’individus engagés dans des périples meurtriers, dont il convenait de permettre qu’ils puissent être empêchés d’agir alors même que la condition d’immédiateté de la riposte qui caractérise le mécanisme de la légitime défense ne serait pas respectée. Pour dire les choses plus clairement, le Gouvernement a entendu permettre la mise hors d’état de nuire d’individus auteurs d’homicides et s’apprêtant à en commettre d’autres alors même que, au moment précis où ils seraient mis hors d’état de nuire, ils ne seraient en train de menacer des vies humaines. Ce nouveau régime d’excuse pénale pour usage de la force s’applique indistinctement aux policiers, aux gendarmes, aux douaniers et aux militaires réquisitionnés, comme à ceux qui sont engagés dans le cadre de l’opération Sentinelle. Les conditions en sont précises et permettent d’écarter tout reproche de création d’un quelconque permis de tuer. En revanche, il s’agit d’un régime qui devrait éviter toute inhibition inutile dans l’usage des armes et inviter les autorités judiciaires à poursuivre dans la voie d’une prise en compte accrue de l’inévitable spécificité de l’usage de la force par les forces de sécurité intérieure, quelles qu’elles soient.
M. le président Georges Fenech. Le point que vous venez d’évoquer est très important pour la commission et je souhaite que nous nous y arrêtions un instant.
Nous nous sommes longuement interrogés sur le rôle de la force Sentinelle le 13 novembre, à l’occasion de l’attaque contre le Bataclan. Des militaires membres de ce dispositif sont venus en renfort des forces d’intervention de la sécurité intérieure pour sécuriser les périmètres extérieurs, mais sans jamais engager le feu.
La question s’est posée d’une meilleure coordination des forces de sécurité intérieure et de la force militaire, et vous évoquez à ce sujet, monsieur le ministre, l’inhibition qui prévalait jusque-là dans l’usage du feu.
M. le ministre. J’ai au contraire évoqué un cadre juridique ne constituant pas un facteur d’inhibition, monsieur le président.
M. le président Georges Fenech. En effet, mais j’évoquais la situation antérieure.
Je rappelle que l’un des terroristes avait ouvert le feu, avec sa kalachnikov, à l’extérieur du Bataclan, dans le passage Saint-Pierre-Amelot. Or les hommes de la brigade anticriminalité (BAC), arrivés les premiers sur les lieux, n’étaient pas équipés pour riposter à une kalachnikov. Notons qu’ils le seront désormais puisque le ministre de l’intérieur a revu ses doctrines d’emploi et fait équiper et former les BAC et les pelotons de surveillance et d’intervention de la gendarmerie (PSIG-Sabre). Mais au moment des faits, la BAC ne pouvait intervenir davantage. L’un des policiers a appelé l’état-major de la direction de la sécurité de proximité de l’agglomération parisienne (DSPAP) pour demander si les militaires, alors au nombre de huit et porteurs de FAMAS, pouvaient engager le feu ; il lui a été répondu par la négative : les militaires ne pouvaient qu’assister et non intervenir directement. Le secrétaire général adjoint du syndicat des commissaires de la police nationale nous a même révélé qu’un policier avait demandé à un militaire de lui prêter son FAMAS : il a essuyé un refus catégorique.
Au vu de ce que vous venez de nous expliquer concernant le nouveau cadre juridique de l’article 51 de la loi renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale, et compte tenu du nouveau régime, élargi, de la légitime défense qui s’applique aussi aux militaires de l’armée, dans une situation telle que celle du Bataclan le 13 novembre dernier, les militaires seraient-ils aujourd’hui amenés à engager le feu aux côtés des forces de sécurité intérieure ?
La question est très importante et lancinante, les victimes et leurs familles se demandant pourquoi la force Sentinelle, qui était présente, n’a pas participé directement à la neutralisation du terroriste qui se trouvait dans le passage Saint-Pierre-Amelot. La nouvelle doctrine d’emploi apporterait-elle des réponses différentes en matière de collaboration entre les forces de sécurité intérieure et les forces militaires ?
M. le ministre. Si les militaires ne sont pas intervenus dans les circonstances que vous évoquez, ce n’est pas pour un motif juridique. Je vais rappeler les faits tels qu’ils m’ont été rapportés par les autorités militaires et dont je n’ai pas de raison de douter.
Dans tous les cas de figure, c’est sur réquisition du préfet de police – approuvée par le ministre de l’intérieur – que se déploient les unités de l’opération Sentinelle. C’est dans ce cadre que certains membres du 1er régiment de chasseurs, se trouvant dans le XIe arrondissement et y percevant une situation anormale, ont pris l’initiative de se mettre à la disposition des forces de sécurité intérieure. Ce groupe de huit militaires a donc rejoint le secteur du Bataclan à vingt-deux heures et est entré immédiatement en contact avec les policiers de la BAC. Tout au long de la soirée, et en étroite coordination avec les forces du ministère de l’intérieur, placés sous l’autorité du préfet de police, nos soldats ont contribué à la sécurisation de la zone en appuyant et en protégeant les interventions des forces de sécurité, mais aussi en portant secours aux victimes.
Il n’y a en effet qu’une chaîne de commandement – hier comme aujourd’hui, comme demain. Dans le cadre d’une opération extérieure, elle est placée sous l’autorité militaire ; à l’intérieur, conformément à la loi, les militaires sont en revanche sous la responsabilité du ministère de l’intérieur.
Quatre soldats ont été positionnés par les forces de police au passage Saint-Pierre-Amelot pour sécuriser les groupes d’intervention spécialisés de la brigade de recherche et l’intervention (BRI). Ils ont reçu l’ordre oral de neutraliser, le cas échéant, un terroriste qui sortirait du Bataclan.
Je réponds à présent plus précisément à votre question sur le refus du « prêt » du FAMAS. Je rappelle très fermement un principe de base : prêter son arme est contraire à tout règlement d’engagement de nos forces en opération. Jamais un soldat engagé sous le feu – et c’était le cas ce soir-là – ne se sépare de son arme, sinon c’est toute sa plus-value militaire qui s’effacerait. J’ajoute que de telles armes automatiques, conçues pour neutraliser un adversaire, ne se manipulent pas aisément – même pour un professionnel des forces de l’ordre – à moins d’être entraîné.
Ensuite, nos militaires ne sont pas intervenus à l’intérieur du Bataclan parce que tels n’étaient pas les ordres donnés par les responsables de la sécurité intérieure ; or, j’y insiste, il ne peut y avoir qu’une seule chaîne de commandement. En outre, ces soldats appartiennent aux forces conventionnelles de l’armée de terre, c’est-à-dire qu’ils ne sont pas formés aux interventions avec prise d’otages, et c’est encore plus vrai lorsque de telles interventions ne sont en rien anticipées – comme c’est le cas lors des opérations extérieures où les interventions sont exécutées dans le respect des règles de l’emploi de la force pour neutraliser un ennemi repéré, identifié et circonscrit ; contexte dans lequel, souvent, interviennent également des forces spéciales avec l’appui de forces conventionnelles. Ainsi, à Bamako, à Ouagadougou ou à Grand-Bassam, les forces spéciales de l’armée ont été soutenues et sécurisées par des forces plus classiques.
En revanche, nos soldats sont rompus aux missions de contrôle de zone, de sécurisation des périmètres, à l’appui de forces spécialisées, comme je viens de le souligner ; or c’est bien cette mission qui leur a été dévolue ce soir-là par l’autorité compétente, et il importait qu’ils répondent à ses ordres. Aussi étaient-ils en situation, si un terroriste sortait du Bataclan, d’agir sans état d’âme et sans inhibition.
M. Sébastien Pietrasanta, rapporteur. Si, demain, des militaires participant au dispositif Sentinelle étaient amenés à être primo-arrivants sur le théâtre d’une prise d’otages ou d’une tuerie de masse, pourraient-ils être des primo-intervenants ?
M. le ministre. Je ne l’exclus pas. Mon seul souci, dans ce type de situation, c’est l’unité de commandement, faute de quoi on risque une très mauvaise gestion de crise.
M. Alain Marsaud. Ce soir-là, les soldats participant à l’opération Sentinelle ont-ils été requis ?
M. le ministre. Ils n’ont pas été requis, mais se sont eux-mêmes rapprochés du lieu, parce qu’ils ont pris contact avec les autorités des forces de sécurité intérieure qui se trouvaient sur place.
M. le rapporteur. Je reviens à ma question : des militaires de l’opération Sentinelle pourraient-ils, le cas échéant, être primo-intervenants ?
M. le ministre. Oui, s’ils sont en état de légitime défense…
M. le rapporteur. Non, pas en cas de légitime défense. Par exemple, s’ils patrouillent et voient qu’on exécute des gens…
M. le ministre. C’est l’état de nécessité qui, dans ce cas, prévaut, bien sûr. La loi énumère les cas dans lesquels ils interviennent : légitime défense, état de nécessité, périple meurtrier.
M. le rapporteur. Dans des endroits confinés, la question de l’armement se pose : le FAMAS est-il adapté ? Dans un rapport du secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale (SGDSN), déclassifié à ma demande, daté du 17 février 2016 et portant sur l’engagement des armées sur le territoire national, une réflexion est préconisée, à la page 17, sur le principe d’une double dotation : fusil d’assaut et pistolet automatique. Armer ainsi « systématiquement au moins tous les chefs d’équipe […] offrirait […] une possibilité supplémentaire de graduer une éventuelle riposte ». Quel est l’état de la réflexion du ministère sur cette double dotation ?
M. le ministre. Pour les interventions en milieu confiné sur le territoire national et en cas de prise d’otages, il existe des unités très spécialisées, que les soldats de l’opération Sentinelle peuvent appuyer et sécuriser.
En ce qui concerne l’armement, je rappelle un principe majeur : celui d’une seule et même armée. Ce principe est d’autant plus important que, désormais, nous sommes confrontés à des risques de tueries de masse. Nous avons en effet changé de registre, y compris par rapport à l’affaire Merah, puisque nous nous trouvons face à des attaques de type commandos. L’unité des forces armées composées de militaires habitués à intervenir en opérations extérieures et en opérations intérieures contre une menace de plus en plus militarisée est, d’une certaine manière, une bonne chose pour la cohérence de l’action, mais nécessite le maintien du maniement d’armes de guerre. Nous pouvons donc envisager l’hypothèse que vous mentionnez, mais, fondamentalement, le maniement de l’arme de guerre est le même qu’il s’agisse d’opérations extérieures ou d’opérations intérieures, puisqu’il est destiné à sécuriser et à appuyer l’action des unités d’intervention.
M. François Lamy. Au Bataclan, nous sommes à la fois confrontés à une prise d’otages et à une tuerie de masse, ce qui ne revient pas au même.
M. le ministre. Plutôt à un phénomène de tuerie de masse.
M. François Lamy. Tout à fait. Le rapport que vous nous avez remis sur les Conditions d’emploi des armées lorsqu’elles interviennent sur le territoire national pour protéger la population, précise, pages 30 et 31, concernant les règles d’emploi de la force, que « pour les soldats engagés dans une opération intérieure, si de fortes présomptions permettent d’établir que des vies humaines sont menacées, que la mise à exécution de la menace est imminente et que les moyens de dissuasion mis à la disposition des militaires autres que les armes à feu ont été épuisés ou sont inopérants, il est permis de faire usage des armes à feu dans le cadre de la légitime défense et de l’excuse de nécessité définis aux articles 122-5 et 122-7 du code pénal ».
Sommes-nous bien d’accord sur le fait que ces conditions d’emploi permettraient aujourd’hui à nos soldats d’intervenir immédiatement dans un contexte de tuerie de masse – afin d’empêcher que de nouvelles personnes ne soient tuées ? Il ne serait donc pas nécessaire d’attendre que le préfet de police, par exemple, donne des instructions ?
M. le ministre. L’application du texte que vous venez de citer va dans ce sens, sachant que la légitime défense ne vaut pas que pour soi, mais aussi pour autrui.
Ce qui importe par-dessus tout, vous me pardonnerez de me montrer répétitif, c’est l’unité de la chaîne de commandement, ce qui n’est pas contradictoire avec ce que vous dites, monsieur le député.
M. François Lamy. Précisément. On a toutefois pu constater en la matière certaines lourdeurs – en l’occurrence policières, certes.
M. le ministre. En l’occurrence, la présence de ces huit soldats était, d’une certaine manière, aléatoire. Ils constatent une agitation, se rendent sur place et se mettent immédiatement – avec raison – sous l’autorité de la BAC. C’est leur rôle.
M. le rapporteur. Vous soulignez l’importance, monsieur le ministre, qu’il n’y ait qu’une seule autorité. Cela signifie-t-il donc, par exemple, que des militaires primo-arrivants devraient demander l’autorisation d’intervenir ?
M. François Lamy. Ce n’est pas ce que dit le texte.
M. le ministre. Le texte que vient de citer M. Lamy permet l’intervention des primo-arrivants. Encore une fois, tout dépend des circonstances, je ne peux pas imaginer tous les scénarios. Reste que, aussitôt après une primo-intervention éventuelle, les militaires doivent être placés sous l’autorité de la cellule de crise du ministère de l’intérieur.
M. David Comet. Vous avez évoqué, monsieur le ministre, la manœuvre globale de sécurité intérieure sous l’autorité du ministre de l’intérieur, par l’intermédiaire des préfets. Pourriez-vous nous indiquer comment et pourquoi les réquisitions des soldats de l’opération Sentinelle ont évolué au cours des derniers mois ? Nous sommes passés d’une approche statique à une approche plus dynamique.
M. le ministre. L’opération Sentinelle a connu deux temps : la mise en place du contrat opérationnel, puis son approfondissement après le conseil de défense du mois d’avril 2015. Il s’agissait au début de rassurer la population en protégeant certains lieux, ce qui a été réalisé rapidement sur réquisition du préfet de police. Au fur et à mesure que s’étendait la présence des soldats de l’opération Sentinelle en France et plus particulièrement dans la région parisienne, les patrouilles se sont faites plus dynamiques, afin de mieux répondre aux préoccupations de sécurité – même si la population ne l’a peut-être pas perçu immédiatement ainsi – ; en effet, il valait mieux que les soldats patrouillent, sauf exception. Et c’est le cas de 80 % des militaires participant à ce dispositif en région parisienne. Il a fallu du temps et faire preuve de pédagogie, mais cette dynamique correspond beaucoup mieux à la vocation des forces armées et donne à la population un plus grand sentiment de sécurité. L’Euro 2016 fera peser de nombreuses contraintes sur l’organisation que le préfet de police de Paris doit mettre en place, mais on en reviendra ensuite à cette bonne logique.
M. François Lamy. Quand le dispositif de l’opération Sentinelle s’arrêtera-t-il ? Pouvons-nous nous permettre de mobiliser ainsi autant d’hommes pendant un long temps ? Certes les soldats engagés dans cette mission alterneront missions extérieures et protection de sites, mais ils ont avant tout été formés pour faire la guerre et seraient peut-être utiles à une éventuelle opération extérieure supplémentaire, si l’on ne veut pas dégarnir les opérations extérieures en cours. Où en est la réflexion à ce sujet ? On a un temps évoqué la création d’une garde nationale, l’utilisation de la réserve... Ces forces, qui interviennent en complément des forces de sécurité intérieure, ne pourraient-elles être remplacées, à terme, pour la garde de bâtiments, par des forces plus spécialisées ? Ainsi nos soldats pourraient-ils mieux s’entraîner et participer à des interventions correspondant à leur mission véritable.
M. le ministre. Que dit la loi ? Concernant le territoire national, les armées doivent pouvoir mettre en œuvre un contrat opérationnel qui prévoit la mobilisation, au minimum, de 7 000 hommes en permanence et de 10 000 au plus pour une durée de un mois, contre la menace terroriste. La loi ne prévoit donc pas de terme. Aussi nous faut-il intégrer cette nouvelle donne dans nos dispositifs de formation, de renouvellement et de recrutement. C’est pourquoi la force opérationnelle terrestre va passer de 66 000 à 77 000 hommes. Et, puisque nous devons faire face à ce qu’on peut assimiler à des actes de guerre, il faut que ces militaires agissent à la fois en opérations extérieures (OPEX) et en opérations intérieures (OPINT), et donc qu’ils acquièrent les compétences et les réflexes qui conviennent. Chaque opération intérieure fait l’objet d’une formation spécialisée, même en période de grande tension, comme celle que nous vivons depuis les événements de 2015.
Le recrutement des 11 000 soldats a commencé en 2015 et se poursuit en 2016, si bien que, une fois formés aux actions spécifiques d’OPEX et d’OPINT, on peut considérer qu’on parviendra au niveau normal de la force opérationnelle terrestre à l’été 2017.
Dans le même temps, j’ai décidé de renforcer les réserves qui passeront de 28 000 à 40 000 hommes d’ici à la fin de la LPM, c’est-à-dire d’ici à 2019. À la fin de l’année, sur les 7 000 soldats que comporte au minimum le dispositif Sentinelle, quelque 500 proviendront des réserves, contre moins de 300 au début de l’opération, et j’entends que nous parvenions au chiffre de 1 000 permanents rattachés à des unités. Il s’agit ainsi d’assurer une cohérence plus globale débouchant ensuite, éventuellement, sur une territorialisation. En attendant, nous allons devoir poursuivre nos efforts : discuter avec les organisations professionnelles, avec les collectivités locales pour améliorer le fonctionnement et l’engagement de cette réserve. Bref, le processus est en cours et il est plutôt bien accueilli, et ma volonté en la matière est partagée par le chef d’état-major des armées : nous sommes convaincus que nous atteindrons l’objectif.
M. Christophe Cavard. La commission d’enquête comprend bien l’utilité des militaires déployés et pas seulement dans une optique statique, puisqu’ils sont susceptibles de se retrouver en situation. Se pose néanmoins à leur égard la question de la formation. Ainsi, le primo-arrivant au Bataclan, et qui y est entré, était un commissaire de police. Imaginons que les primo-arrivants soient des soldats de l’opération Sentinelle. Sont-ils capables d’entrer dans un lieu ? En effet, si, d’habitude, il s’agissait d’abord de fixer les malfaiteurs, puis de laisser agir des équipes spécialisées comme le groupe d’intervention de la gendarmerie nationale (GIGN), il est ici question, pour le primo-arrivant, d’intervenir directement. Nous avons bien compris que des évolutions étaient en cours concernant les procédures, mais le grand public pourrait trouver surprenant que des hommes lourdement armés se rendent sur un théâtre et s’arrêtent à la porte.
M. le ministre. Je veux bien répéter ce que j’ai déjà indiqué : la question, pour moi, n’est pas d’être primo-arrivant, mais d’être primo-compétent. Quand vous vous trouvez dans un lieu clos, à tel moment, il vaut mieux que ce soient des forces spéciales qui interviennent plutôt que l’unité de l’armée de terre qui a une vocation de sécurisation de zone. C’est aussi une question d’appréciation du chef, même s’il est primo-arrivant. Dans le contexte d’une opération extérieure, la question est réglée par le commandement militaire ; dans celui d’une opération intérieure, à moins d’être primo-arrivant, ce sont les forces de sécurité intérieure qui décident.
M. le président Georges Fenech. Comment un primo-arrivant devient-il primo-compétent ?
M. le ministre. Cette appréciation revient au chef.
M. le président Georges Fenech. Quel chef ?
M. le ministre. Le chef local, celui qui se trouve sur place.
M. le président Georges Fenech. Ils doivent donc apprécier eux-mêmes s’ils sont capables de gérer cette crise ?
M. le ministre. Comment font-ils en opération extérieure ?
M. le président Georges Fenech. Sauf qu’ici il est question du territoire national et que des innocents sont en train de se faire tuer.
M. le ministre. C’est à ce moment qu’il faut apprécier si l’unité en question a la capacité d’opérer ou s’il faut attendre du renfort pour agir.
M. le président Georges Fenech. Le commissaire de la BAC qui, lui, est entré au Bataclan avec son arme de poing ne s’est pas posé ce genre de question philosophique. Il s’est dit : je suis policier, j’ai une arme, des gens sont en train de se faire tuer, j’entre. Et, s’il est certain qu’il n’a pas respecté la procédure habituelle, sans doute a-t-il sauvé des vies.
M. Pierre Lellouche. Monsieur le ministre, j’ai beaucoup d’estime pour vous et pour le travail que vous avez accompli au ministère de la défense. Cependant, je suis en désaccord total avec vous, depuis le début, quant à l’utilisation de l’armée pour des missions de contre-terrorisme sur le sol national. Vous faites fausse route. Si le chef d’état-major des armées et si le chef d’état-major des armées de terre vous ont rejoint, c’est pour de tout autres raisons que celles que vous invoquez ici, c’est-à-dire, essentiellement, pour des raisons budgétaires. Au-delà de ces raisons d’opportunité, c’est une faute contre l’armée que de la mobiliser pour des missions de police qui ne correspondent pas à son métier. Vous ne pouvez pas prétendre, comme je l’ai entendu plusieurs fois dans votre bouche, que le soldat qui était hier à Gao, qui est aujourd’hui à Kandahar et qui sera demain en Syrie, pourra aussi s’occuper de la place de la Madeleine ou de la rue des Martyrs. Ce n’est tout simplement pas possible. D’abord, si vous le faites circuler dans les rues de Paris ou de Bordeaux, équipé pour la guerre, vous le privez d’entraînement opérationnel. Ensuite, vous l’affectez à une mission qu’il ne peut pas remplir.
La commission d’enquête revient d’un voyage très instructif en Israël où, je crois, l’on a une certaine expérience de la lutte antiterroriste puisque le terrorisme sévissait dans cette région avant même la naissance de cet État. Qu’y avons-nous constaté ? Que l’armée ne s’occupe pas du tout de la question : ce sont des forces spécialisées de la police, des gardes-frontières qui luttent contre le terrorisme. Les forces militaires, elles, font la guerre. On ne peut pas mélanger les genres. On ne peut pas avoir des soldats pourvus d’armes longues automatiques dans les rues de Paris : ils ne font que servir de cibles. Ils ne sont en outre d’aucune efficacité parce qu’ils ne sont pas formés pour appréhender une situation comme celles que nous évoquons, ce n’est pas leur métier, ils n’ont pas l’instinct policier. Vous ne pouvez pas demander à un soldat qui, demain, va aller faire la guerre à Gao de faire la police à Roissy – c’est impensable. D’ailleurs, à l’aéroport de Lod, à Tel-Aviv, vous ne verrez pas un seul soldat : les forces de protection sont composées de policiers en civil.
Bref, je le répète, vous faites fausse route. Vous êtes en train d’appauvrir notre armée, de lui donner des missions impossibles. La solution passe par un meilleur entraînement des forces de police de base ; il faut en outre travailler avec des forces dédiées à ce type de mission. Étudiez-vous d’autres hypothèses ou vous enferrez-vous dans le discours selon lequel le même soldat doit accomplir deux missions totalement différentes ?
M. le ministre. Nous sommes en effet en désaccord sur ce point. Le contrat opérationnel n’est pas nouveau : il figurait dans tous les livres blancs depuis 1972, et même si, à l’époque, il portait un autre nom, en 2008 on parlait bien de contrat opérationnel.
Je ne vois pas comment les Français pourraient comprendre que nos forces armées interviendraient à Kidal et pas sur le territoire national lorsque celui-ci est victime d’attentats terroristes. D’autre part, pour votre information, les Italiens, les Espagnols, les Britanniques viennent de prendre les mêmes options que nous – certes avec des variantes en matière de réquisition, de mobilisation, de liens avec le ministère de l’intérieur ; mais les options sont identiques. Les Britanniques sont même venus observer chez nous notre manière d’agir – j’ai eu à ce sujet des discussions avec mon homologue Michael Fallon depuis les attentats. Cette posture n’est donc pas propre à la France. Nous venons d’entamer la préparation opérationnelle, mais il y avait urgence ! Qu’auraient dit les Français si nous leur avions répondu que, à cause de la préparation opérationnelle, nous ne pouvions pas assurer la sécurité du territoire national ? S’il est vrai que, en 2015 et 2016, cette préparation a été réduite, elle est de nouveau plus importante, puisque nous avons recruté pour atteindre les objectifs fixés par la loi.
Je sais bien que je ne parviendrai pas à vous convaincre, monsieur Lellouche, mais au moins vous aurai-je donné une explication. N’oubliez pas non plus notre stratégie concernant les réserves et celle de la territorialisation à partir du régiment.
M. le président Georges Fenech. Nous avons passé plus d’une heure sur l’opération Sentinelle. Je vous propose de passer à l’action de nos forces à l’extérieur.
Mme Françoise Dumas. Comment envisagez-vous, monsieur le ministre, l’évolution du coût global des actions antiterroristes dans le Sahel et au Levant ? Pensez-vous que les moyens engagés, à terme, suffiront ? Il va en effet falloir que nous adaptions notre présence et notre action face au terrorisme qui évite le combat et s’étend vers des pays voisins, privilégiant des cibles qui sont pour l’heure peu ou pas défendues. Il va également falloir que nous répondions à l’évolution catastrophique de la région du Sahel : la croissance démographique, l’évolution économique et une certaine forme de radicalisation nous conduisent à revoir nos modes opératoires. De quelle manière anticipez-vous ces questions ?
Par ailleurs, vous avez évoqué le renforcement de la coopération internationale en matière de renseignement, notamment au Levant. Nos alliés américains disposent, avez-vous déclaré au cours de différentes auditions, de nombreuses capacités dans cette zone. Pouvez-vous, ici aussi, nous en dire un peu plus ?
M. Jean-Luc Laurent. J’en reviens à l’opération Sentinelle sur laquelle, je l’ai dit en séance publique, je reste très réservé en ce qu’elle mobilise nos troupes pour des missions qui devraient être attribuées aux forces de l’ordre et de sécurité : les militaires ont d’autres tâches à accomplir. Toutefois, dans le cadre fixé et que vous venez de rappeler, monsieur le ministre, si des militaires étaient appelés à intervenir davantage en cas d’attentat, de tuerie de masse, quels moyens et quelles dispositions sont prévus en matière de préparation, d’entraînement, pour éviter des dommages collatéraux qui pourraient être très lourds ? Quelles modalités nouvelles peuvent être prises en termes de coordination ? Quid de l’unité de commandement si les militaires sont primo-arrivants ? Comment les acteurs coordonnent-ils leur action ?
Du point de vue de la préparation militaire à ces nouvelles missions dévolues au dispositif Sentinelle, j’ai lu dans la presse que vous aviez mené une opération expérimentale d’entraînement en Isère. Préfigure-t-elle une évolution de doctrine qui consisterait à définir les conditions d’une intervention plus importante des forces armées en cas de nouvel attentat ?
M. François Lamy. Les forces armées ont une obligation de résultat : celle de remplir le contrat opérationnel si les autorités politiques – en l’occurrence le Président de la République – le demandent.
La présente commission d’enquête a en particulier pour vocation de faire des propositions à court, moyen et long terme. Seriez-vous opposé, à terme, à une montée en puissance des forces de sécurité intérieure de façon à réserver, précisément, la mise en œuvre du contrat opérationnel pour des opérations ponctuelles ? On pourrait dès lors très bien comprendre que, dans le contexte de grandes manifestations comme l’Euro 2016, un sommet de chefs d’État, le tour de France, on mobilise 7 000, voire 10 000 hommes, de façon à assurer la sécurité des opérations et celle des frontières.
M. Guillaume Larrivé. Pensez-vous, monsieur le ministre, que le cadre juridique d’intervention des services de renseignement est désormais stabilisé ? Nous y avons beaucoup travaillé ces dernières années. Or il ressort de diverses auditions que certains services s’interrogent sur leur incompétence lorsqu’une matière est judiciarisée : le directeur général de la sécurité extérieure (DGSE) nous a lui-même indiqué qu’il s’interrogeait sur sa capacité d’intervention lorsqu’une personne était mise en examen. En effet, le respect des droits de la défense s’oppose à ce que les services de renseignement « tracent » un individu faisant l’objet d’une procédure judiciaire. Aussi nous interrogeons-nous sur le cadre juridique en vigueur et sur l’éventuelle nécessité de créer un régime permettant aux services de renseignement d’entrer dans cette matière.
M. le président Georges Fenech. Cette question relève plus spécifiquement des procédures judiciaires et du garde des sceaux, auquel nous avons posé la question tout à l’heure. La demande vient néanmoins, également, de la DGSE qui se trouve là face à un obstacle juridique de nature à constituer un frein au renseignement.
M. le ministre. Mme Dumas m’a interrogé sur les coûts. L’actualisation de la loi de programmation militaire a permis une augmentation, sur l’ensemble de l’exercice, de 3,8 milliards d’euros. Ensuite, le surcoût, pour l’année 2015, des opérations intérieures a été de 174 millions d’euros et de 650 plus 450 millions d’euros pour les opérations extérieures. Ce surcoût a été entièrement couvert par le dispositif de mutualisation applicable en fin d’exercice. Nous avons aujourd’hui les moyens de remplir les engagements prévus par la première actualisation de la LPM et les moyens de respecter la décision prise par la suite de renoncer à toute forme de déflation des effectifs militaires.
Pour répondre aux questions de M. Laurent et de M. Lamy sur l’opération Sentinelle, je répète qu’une préparation systématique des unités destinées aux opérations intérieures est prévue : préparation au combat, à la maîtrise, au sang-froid, à l’usage de l’arme…
Pour ce qui est de la coordination : il s’agissait de la première opération aussi massive ; aussi nous a-t-il fallu organiser en des matières aussi concrètes que le logement et la nourriture, mais aussi harmoniser le commandement. J’ai pu observer que, en région parisienne, à la relation directe entre le gouverneur militaire et le préfet de police, se sont ajoutées des relations d’échanges du commandement beaucoup plus proches du terrain. À Paris, nous avons divisé l’opération Sentinelle en trois groupements tactiques afin d’obtenir une bien meilleure opérabilité. Chaque groupement est commandé par un colonel représentant généralement l’unité la plus nombreuse sur le territoire concerné, ce qui rend beaucoup plus facile l’acte de commandement. Le groupement étant en relation avec les autorités des forces de sécurité intérieure voisines, tous se voient régulièrement et, de ce fait, leur complémentarité est particulièrement efficace, s’inscrivant dans la dynamique déjà évoquée.
Monsieur Lamy, la loi prévoit que 7 000 soldats sont mobilisables en permanence et 10 000 pour un mois. Il est évident qu’ils ne sont mobilisés qu’en cas de menace. L’Euro 2016 figurait parmi vos exemples ; je choisirais plutôt pour ma part le risque d’un attentat pouvant nous conduire, pour assurer la sécurité, à mobiliser les 7 000 soldats prévus, ou 5 000 si la menace est moindre. Il ne s’agit donc pas d’une force de présence permanente.
Monsieur Larrivé, aucun écho ne m’est pour l’heure parvenu de la DGSE, ni de la DRM, ni de la DPSD. Au contraire, le cadre juridique en vigueur – à l’élaboration duquel vous avez contribué – nous convient assez bien. Il faut attendre que l’ensemble des procédures se mette en place afin que nous en vérifiions la réalité et l’efficacité. En tout cas, pour l’instant, nous avons singulièrement progressé. Je suis convaincu que plusieurs des attentats qui ont été déjoués n’auraient pas pu l’être si l’on n’avait pas appliqué certains des dispositifs prévus par la loi relative au renseignement.
Pour ce qui concerne l’opération Minerve, qui s’est déroulée fin avril dans la région de Grenoble, elle nous a permis de vérifier l’efficacité d’un engagement coordonné de l’armée de terre et de la gendarmerie en vue d’une manœuvre de sécurité publique. Nous avons ainsi pu élaborer des procédures et des modes d’action en commun et élaborer les modalités de la préparation opérationnelle. Ce dispositif, utile, sera sans doute suivi d’effet. Cette opération a montré en tout cas l’agilité, la réactivité de nos forces et notre capacité à travailler ensemble.
M. le président Georges Fenech. Nous allons passer à l’opération Chammal et plus généralement aux opérations extérieures.
M. le ministre. L’opération Chammal, au Levant, a commencé le 19 septembre 2014 – soit avant les attentats – à la demande du gouvernement irakien. Notre dispositif comprend des moyens aériens comme des moyens maritimes, des instructeurs présents en Irak au profit des forces de sécurité irakiennes et des peshmergas. La coalition qui organise l’intervention en Irak a été formée au moment du sommet de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN) à Newport, également en septembre 2014.
Après les attentats du 7 janvier 2015, le groupe aéronaval, avec le Charles de Gaulle, a été déployé du 23 février au 17 avril dans le golfe arabo-persique. Avec une trentaine d’aéronefs à bord, sa présence a multiplié par trois le dispositif aérien français engagé au Levant. Puis, avec l’accumulation de renseignements sur les filières djihadistes au départ de Syrie et à destination de la France, le Président de la République a pris la décision, au début du mois de septembre 2015, d’autoriser les vols de reconnaissance au-dessus de la Syrie, et, trois semaines plus tard, d’y autoriser les frappes.
Après les attaques du 13 novembre 2015, le Président de la République a donné l’ordre d’intensifier les frappes et de planifier, au sein de la coalition, des interventions notamment sur Mossoul et Raqqah en vue d’éradiquer progressivement Daech. Cela s’est traduit, en particulier pour nos propres forces, par le retour du groupe aéronaval dans le Golfe arabo-persique, du mois de novembre 2015 au mois de février 2016. Lors de cette mission, nos avions ont effectué un total de 532 sorties et jusqu’à 18 par jour durant les phases d’intensification, pour un total de 102 frappes en Irak et en Syrie contre Daech, et une trentaine de missions de reconnaissance qui ont permis la constitution de 1 000 dossiers de renseignement au profit de la coalition.
J’appelle votre attention sur le fait que la France est le seul pays, avec les États-Unis, à déployer la totalité des moyens nécessaires aux opérations de la coalition en Irak, puisque nous disposons à la fois de moyens aériens, de moyens maritimes, de moyens de renseignement et des outils de formation des forces irakiennes ou des forces peshmergas.
C’est sans doute la première fois que je le dis ainsi, car je suis d’un naturel prudent, mais je considère aujourd’hui que Daech est nettement sur le recul. Nous menons en ce moment une opération à Falloujah, ville située au bord de l’Euphrate à cinquante kilomètres au sud-ouest de Bagdad, et qui devrait tomber après des combats qui risquent d’être assez durs. Or je rappelle qu’il s’agissait de la première ville prise par Daech : c’est dire l’importance symbolique de l’action en cours. Le régiment le plus performant de l’armée irakienne – formé dans la banlieue de Bagdad par des instructeurs français –, l’Iraqi ounter-Terrorism Service (ICTS), est à la manœuvre. Cette unité, forte de différents appuis, devrait reprendre Falloujah.
Au Nord de l’Irak, nous sommes en train de préparer l’attaque de Mossoul. Les combats visant à reprendre Qayyarah se déroulent en ce moment et mettent les peshmergas – avec la formation et l’appui, entre autres, de militaires français – directement aux prises avec Daech. J’ai eu l’occasion d’aller sur le front, il y a très peu de temps, pour me rendre compte de cette action déterminante. Daech recule d’autant plus que les frappes successives effectuées par la coalition commencent à toucher cette organisation au cœur, en particulier ses ressources pétrolières et les centres de raffinerie qu’elle pouvait contrôler et dont les revenus permettaient de payer les combattants étrangers. J’ai été surpris de constater, lors de mon dernier déplacement, que mes interlocuteurs évoquent déjà l’après-Daech. Or ces préoccupations sont nouvelles. En Irak, Daech a perdu à peu près 40 % de son territoire, et ce mouvement se poursuit.
En Syrie, la situation est plus complexe. Une action significative est menée en ce moment même sur Raqqah ; les opérations se déroulent plutôt bien, même si la ville ne devrait pas être prise immédiatement. Je rappelle au passage que ces reconquêtes ne sont pas simples : Mossoul compte tout de même 2 millions d’habitants et Raqqah 300 000 – avec de nombreux combattants français. Raqqah est le lieu de formation de tous les groupes terroristes qui peuvent intervenir à partir de la Syrie. Les forces démocratiques syriennes (FDS) ont tout récemment engagé une opération contre cette ville.
J’appelle particulièrement votre attention sur la zone de Manbij. Deux zones kurdes forment la frontière avec la Turquie ; l’une, assez longue, s’étend vers l’Est et rejoint le Kurdistan irakien, l’autre, plus courte, court vers l’Ouest. Des opérations ont commencé avant-hier dans le secteur de Manbij – où se trouvent de nombreux combattants étrangers, dont des Français –, point central pour fermer le corridor qui mène vers la Turquie. Si les forces démocratiques syriennes, à la fois arabes et kurdes, arrivent à prendre l’ensemble de ce corridor, la frontière sera entièrement fermée.
Grâce aux actions simultanées sur Raqqah, sur Mossoul et sur Falloujah, à quoi il faut ajouter désormais celle menée sur Manbij, grâce à la présence russe à Palmyre, Daech sera complètement encerclée, ce qui provoquera des événements intéressants. Pour la première fois, mon regard est relativement optimiste concernant le Levant.
M. le président Georges Fenech. Merci, monsieur le ministre, de nous apporter la primeur de ces éléments d’information, car nous ignorions l’état d’avancée de nos forces dans les zones que vous avez mentionnées et qui peut en effet laisser espérer tôt ou tard la chute de Daech.
M. le ministre. Je prends néanmoins des précautions. Je donne d’ordinaire ce genre d’informations aux commissions de la défense de l’Assemblée et du Sénat, généralement à huis clos. Même si la présente audition ne se déroule pas à huis clos, je puis néanmoins me permettre de me montrer, pour la première fois, relativement positif concernant la suite. Cela ne signifie pas que nous devions relâcher notre effort, au contraire, car, quand Daech se sentira acculé, ses réactions risquent d’être encore plus fortes et la pacification ne sera donc pas immédiate. Mais tel est le sens dans lequel évolue la situation, avec une diminution du nombre de combattants étrangers – dont on évaluait le nombre, dans cette zone, à 15 000, alors qu’ils ne seraient plus désormais qu’environ 12 000 sur quelque 35 000 combattants.
J’en viens à la situation en Libye. Ce territoire sans État unifié est le point de convergence de nombreux problèmes : il est à la fois une zone refuge pour les groupes d’Al-Qaïda au Maghreb islamique (AQMI) au Sahel, une zone de déploiement de Daech – à Syrte notamment –, une zone de trafics et le point de passage des migrations. Il faut savoir que la présence de Daech dans la région de Syrte est significative, à raison de 3 500, voire 4 000 combattants, qui pour la plupart ne sont pas passés par le Levant et qui n’étaient pas là il y a un an et demi.
En outre, la situation politique est compliquée. La communauté internationale a désigné M. El-Sarraj comme premier ministre. Celui-ci a eu le courage de s’installer à Tripoli, mais il peine à unifier politiquement le territoire puisque le parlement officiel de Tobrouk n’a toujours pas investi le gouvernement d’union nationale. La communauté internationale soutient l’initiative, notamment en la personne du représentant de Ban Ki-moon, M. Kobler, avec qui j’ai d’ailleurs pu m’entretenir de la situation hier à Paris. La difficulté est la lenteur avec laquelle M. El-Sarraj avance depuis qu’il s’est installé à Tripoli, cependant que des combats ont lieu à l’Est impliquant les forces du général Haftar, soutenu par l’Égypte et par les Émirats, forces qui sont en train de reprendre Benghazi à Daech et d’engager une offensive par le Sud-Est sur le territoire pour l’heure tenu par cette organisation ; tandis que, de l’autre côté, les milices de Misrata ont entamé elles aussi une action militaire contre Daech. Il n’est pas aisé de coordonner l’action de ces forces qui ont le même adversaire, d’autant qu’entre celles de Haftar et celles de Misrata, on note des tensions, voire des échanges de feu.
Notre objectif est le rétablissement de l’État libyen, de sensibiliser tous nos partenaires pour que le premier ministre ait l’autorité nécessaire pour coordonner l’action de son pays, en particulier sur le plan militaire. Ensuite, il nous faut contenir Daech en soutenant les efforts de contre-terrorisme de l’Égypte et de la Tunisie en particulier. Enfin, nous devons tâcher d’empêcher les migrations à risque – il ne faudrait pas que ces migrations permettent à Daech de se reconstituer militairement et financièrement. Si elle devenait opérationnelle, la mission Sophia, diligentée par l’Union européenne, constituerait un bon moyen d’enrayer ce processus. L’inquiétude est donc plus marquée dans cette région, mais des solutions pourraient se profiler si, d’aventure, l’autorité de M. El-Sarraj était respectée et reconnue, et si les efforts menés par les uns et les autres à cette fin étaient couronnés de succès.
M. le président Georges Fenech. Merci, monsieur le ministre, pour ces informations importantes et qui laissent un espoir, même si, comme vous l’avez souligné, il convient de continuer de faire preuve de prudence.
Tout au long de nos travaux, nous nous sommes demandé pourquoi les troupes occidentales ou, parmi elles, les troupes françaises, n’intervenaient pas au sol.
M. le rapporteur. Vous avez indiqué que Daech avait perdu 40 % du territoire qu’elle avait conquis en Irak. Avez-vous les chiffres concernant la Syrie, où l’on évoque 15 à 20 % de perte ?
Ni le président ni moi-même ne sommes membres de la commission de la défense. Les informations que vous nous avez données sur l’Irak et la Syrie sont encourageantes, mais pensez-vous que les frappes aériennes sont suffisantes pour éradiquer Daech ? Ne va-t-il pas falloir, à un moment ou à un autre, aller au sol ? C’est toute la complexité géopolitique de cette intervention… Si toutefois nous en restons aux frappes aériennes, à quelle échéance pensez-vous que nous viendrons à bout de Daech ? Vous avez en effet mentionné que, plus Daech va être acculé, plus cette organisation risque de frapper notre territoire.
Ensuite, des frappes sont-elles envisagées en Libye ? Comment nous préparons-nous pour faire face à l’inquiétude dont vous avez fait part à la fin de votre propos ?
Enfin, je souhaite connaître votre sentiment sur le fonctionnement de la cellule Hermès : est-il optimal, au bout d’un peu plus d’un an, ou existe-t-il encore des marges de progression ?
M. Christophe Cavard. Je souhaite vous interroger sur le traitement réservé à ceux qu’on n’appellera pas « soldats », mais « terroristes armés ». Dès lors qu’on ne considère pas ces combattants comme formant une armée régulière, sont-ils déférés vers d’autres services, sont-ils appréhendés par nos militaires comme des soldats, bien que nous les considérions comme des terroristes ?
M. le ministre. Je commencerai par répondre à cette dernière question. Il y a un droit international et, lorsque des terroristes sont capturés par nos forces, ils sont remis aux autorités locales : ils sont faits prisonniers et sont transférés aux tribunaux locaux. Le seul cas connu est celui du Mali où le président est élu au suffrage universel et où la justice fonctionne, malgré, parfois, des délais. Je me suis moi-même rendu compte de la situation en allant à Gao où étaient emprisonnés provisoirement les intéressés et pour m’assurer qu’ils seraient bien transférés aux instances concernées.
J’en profite pour répondre à une question qui ne m’a pas été posée. J’ai souvent lu que nous essayions de prendre des combattants français pour cibles, au cours de nos interventions aériennes, soit à Raqqah, soit dans la zone de Manbij. Non. Il n’y a pas d’identification préalable : nous frappons l’ennemi qui est Daech et dont les combattants sont de toutes les origines.
Je n’affirme pas que Daech sera bientôt éradiquée – la suite sera même compliquée ; reste que, depuis trois semaines, la conjonction des événements nous pousse à un certain optimisme.
J’en viens à la question du rapporteur : il ne faut pas envoyer de soldats au sol, ni en Libye ni au Levant. Notre rôle est de faire en sorte que les territoires concernés disposent de forces que nous formons, que nous aidons à manœuvrer, auxquelles nous livrons éventuellement du matériel ; de faire en sorte que ces territoires se libèrent par eux-mêmes. Le précédent en Irak n’a en effet pas donné de bons résultats et, si nous nous substituions aux forces locales, ce serait ingérable. Aussi nous revient-il de former les forces locales et, par des frappes, non seulement d’accompagner leurs opérations, mais aussi d’agir préventivement en détruisant des centres de commandement, des centres d’entraînement, des lieux de ressource – si bien que Daech en vient, si vous avez lu les dernières dépêches, à anticiper ses propres difficultés dans ses déclarations publiques, ce qui est une grande nouveauté.
Il convient, en Syrie, de renforcer les frappes et l’accompagnement. En Libye, nous faisons d’abord du renseignement ; ensuite, nous avons pour tâche de répondre à ce que le premier ministre El-Sarraj demande à la communauté internationale, qu’il s’agisse de sa sécurité ou de la formation de ses troupes ; enfin, les Nations-Unies doivent pouvoir réagir assez rapidement à une proposition en cours de discussion au sein du Conseil de sécurité, proposition lancée par la France, l’Allemagne et le Royaume-Uni – qui est à la manœuvre –, visant à faire en sorte que l’opération Sophia, qui vise à interdire le trafic d’armes et à empêcher les passeurs de faire leur commerce en Méditerranée, soit possible. Nous sommes prêts, à cette fin, à engager des bâtiments. J’ajoute qu’en Libye a cours un trafic d’armes très important qui traverse la Méditerranée et que nous devons enrayer. Là non plus notre présence au sol n’est pas la bonne solution. À la différence de la Syrie et de l’Irak, nous avons affaire, en Libye, à un gouvernement reconnu, que nous souhaitons renforcer et qui peut du reste faire état lui-même de demandes particulières pour assurer son autorité.
En ce qui concerne l’opération Hermès, elle fonctionne bien. L’ensemble de nos services se retrouvent pour obtenir des informations en temps réel. Cette expérience très utile n’avait encore jamais été menée. J’ai eu l’occasion de me rendre sur place à plusieurs reprises pour voir comment les opérations se déroulaient, et j’ai pu constater qu’il s’agissait d’un très bon système. Une autre cellule de fusion de services de renseignement – DGSE, DGSI et autres –, la cellule Allat, fonctionne elle aussi très bien. Le travail entre services de renseignement est difficile parce que chacun a son pré carré, ses réseaux, ses compétences, mais, pour ce qui me concerne, j’ai constaté la bonne coordination des trois services de renseignement qui dépendent de mon autorité, la nouveauté étant l’élargissement de la coopération aux autres services de renseignement, qui, honnêtement, se passe de mieux en mieux.
J’ajouterai, pour ce qui est des relations avec les autres pays en matière de renseignement, que, très vite après les attentats, nous avons passé un accord avec les États-Unis. Je puis affirmer qu’aujourd’hui règne une vraie transparence, comme jamais auparavant, à la fois dans le domaine du renseignement, mais aussi dans le domaine militaire. J’ai pu moi-même le constater en me rendant dans les salles d’opération.
M. le rapporteur. On a le sentiment d’une rivalité accrue entre Al-Qaïda et Daech. Dès lors, Al-Qaïda – et AQMI en particulier – représente-t-elle pour vous une inquiétude grandissante ? Les intérêts français à l’étranger sont-ils davantage menacés ? AQMI sera-t-elle, à terme, selon vous, capable de frapper notre territoire ?
M. le ministre. Il faut être très vigilant. On parle plus souvent de Daech que d’Al-Qaïda ; or cette dernière est présente en Syrie par le biais de Jabhat al-Nosra. Il ne faudrait pas que le retrait de Daech, qu’on sent poindre, suscite des allégeances à AQMI de la part de groupes qui retrouveraient un autre destin. Al-Qaïda est présente au Mali de manière significative. Ce réseau a été très touché par nos opérations.
Reste que, par rapport à celle de 2013, la situation est très différente. En 2013, il s’agissait d’une opération visant à transformer un État en sanctuaire terroriste, notamment par le regroupement de katibat. Grâce à l’opération Serval, cette stratégie a échoué, permettant la restauration de la démocratie et l’organisation d’élections. Néanmoins, les terroristes ont changé de posture et nous avons désormais affaire à des groupes plus petits, moins militarisés – contrairement à Daech – et pratiquant un terrorisme « classique » avec l’emploi de kamikazes. Les attentats de Bamako, Ouagadougou et Grand-Bassam, avec l’utilisation régulière d’engins explosifs improvisés (EEI) contre nos propres forces – trois de nos soldats en sont morts récemment –, ont montré que la pratique avait changé, une pratique en outre beaucoup plus difficile à repérer.
Dans le cadre de l’opération Barkhane, nous avons coordonné nos actions contre le terrorisme avec les pays du G5 Sahel – Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger et Tchad. Face à ce nouveau risque, nous devons maintenir un effort militaire singulier pour empêcher que cette logique ne produise des effets aussi insupportables que ceux produits par Daech.
Il convient par ailleurs que les autorités politiques maliennes fassent en sorte que les accords politiques d’Alger qui concernent en particulier les groupes armés signataires, à savoir les combattants non terroristes, soient respectés de part et d’autre. Il s’agit notamment de hâter la mise en place de l’opération « Désarmement, démobilisation, réintégration » (DDR). Nous appelons en permanence les parties à y œuvrer, faute de quoi on court le risque d’une porosité entre les groupes armés signataires et les groupes armés terroristes chapeautés essentiellement par le groupe Al-Mourabitoune, dirigé par un Algérien résidant en Libye, Mokhtar Belmokhtar, et qui est en train, avec Iyad Ag Ghali, de reprendre une forme de coopération qui ne me paraît pas des plus encourageantes – aussi mon sentiment sur cette situation-ci est-il plus négatif.
M. le président Georges Fenech. Nous tenons vraiment, monsieur le ministre, à vous remercier de nous avoir consacré du temps, de nous avoir donné toutes ces informations qui seront utiles à notre commission d’enquête.
Je tiens par ailleurs à vous faire part de l’hommage de la commission à nos troupes pour leur travail remarquable.
Audition, ouverte à la presse, de M. Bernard Cazeneuve, ministre de l’Intérieur
Compte rendu de l’audition, ouverte à la presse, du jeudi 2 juin 2016
M. le président Georges Fenech. Monsieur le ministre, nous vous remercions d’avoir répondu à la demande d’audition de notre commission d’enquête relative aux moyens mis en œuvre par l’État pour lutter contre le terrorisme depuis le 7 janvier 2015.
Nous avons entendu hier le garde des sceaux et le ministre de la défense, et nous achevons avec vous cette semaine d’auditions ministérielles. Je précise que nous entendrons, le 16 juin prochain, Mme la secrétaire d’État chargée de l’aide aux victimes. Nous avions commencé nos travaux en recevant des victimes, témoignant ainsi de notre intérêt pour elles ; symboliquement, nous souhaitons les conclure autour de cette même préoccupation.
Monsieur le ministre, nous avons déjà eu l’occasion de vous entendre au début de nos travaux, le 7 mars dernier, et nous étions convenus que vous reviendriez devant la commission d’enquête pour aborder plus spécifiquement les questions relatives au renseignement. Vous savez que nous avons entendu les responsables des différents services concernés : leurs témoignages ne laissent pas parfois de nous interroger en ce qui concerne la coopération et surtout la coordination entre eux.
Cette audition sera l’occasion pour vous de dresser un premier bilan de la loi du 24 juillet 2015, mais elle nous permettra également de faire le point sur les résultats de la lutte antiterroriste, sur l’emploi des forces de sécurité intérieure, et sur le nouveau schéma national d’intervention que vous avez présenté en avril dernier.
Je rappelle que cette audition, ouverte à la presse, est diffusée en direct sur la chaîne parlementaire, et qu’elle fait l’objet d’une retransmission, en direct également, sur le site internet de l’Assemblée nationale. Son enregistrement sera disponible pendant quelques mois sur le portail vidéo de l’Assemblée, et je vous signale que la commission d’enquête pourra décider de citer dans son rapport tout ou partie du compte rendu qui sera fait de cette audition. Nous avons en effet décidé que d’une manière générale, et quand cela ne soulèvera pas de difficulté pour les personnes entendues ou au regard de la confidentialité des informations recueillies, nos auditions seraient ouvertes à la presse, car nous devons mener cette enquête dans toute la transparence.
Conformément aux dispositions de l’article 6 de l’ordonnance du 17 novembre 1958, relatif aux commissions d’enquête, je vais vous demander, monsieur le ministre, de prêter le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité.
M. Bernard Cazeneuve prête serment.
Monsieur le ministre, lors de votre première intervention vous aviez pu vous exprimer longuement dans un propos liminaire qui avait duré plus d’une heure. Dans l’intérêt de notre commission d’enquête, il serait souhaitable que nous disposions d’un temps suffisant après votre présentation initiale pour aborder toutes les questions. Cela ne vous empêche évidemment pas de développer comme vous le souhaitez les points qui vous paraissent importants.
Notre commission d’enquête arrive au terme de ses travaux, et nous remettrons notre rapport au début du mois de juillet. Je saisis cette occasion pour rendre hommage aux hommes et aux femmes qui relèvent de votre ministère, dont l’abnégation et, parfois, l’esprit de sacrifice honorent notre pays. Je pense en particulier au commissaire de la BAC, que nous avons auditionné, qui n’a pas hésité, au péril de sa vie, le 13 novembre 2015, à entrer dans le Bataclan pour neutraliser l’un des trois terroristes qui s’y trouvaient.
Monsieur le ministre, notre commission d’enquête doit établir l’existence d’éventuelles failles, d’éventuels dysfonctionnements. Force est de constater qu’aucun responsable de haut niveau n’a fait l’objet de remise en cause sur le plan professionnel depuis les attentats du mois de janvier 2015. Je rappelle que nous parlons d’attentats qui ont fait cent quarante-sept morts et des centaines de blessés sur l’ensemble du territoire à l’occasion des journées tragiques de janvier et de novembre. Nous nous demandons s’il n’y a aucune responsabilité, qu’elle soit administrative ou politique, concernant ce qu’il faut bien appeler l’échec de nos services de renseignements qui n’ont pu empêcher ces événements.
Nous devons la vérité aux victimes, à leurs familles, et aux Français sur les conditions dans lesquelles les attentats de janvier et novembre 2015 ont pu être perpétrés, sur ce qui n’a pas fonctionné. Je rappelle que le 13 novembre 2015, nous avons subi le plus grand nombre de victimes sur le sol français depuis la Seconde Guerre mondiale. Il faut apporter des réponses et faire des propositions utiles dans l’esprit transpartisan qui a été celui de cette commission d’enquête depuis le début de ses travaux. Elle n’a été animée que par le souci de la vérité, et par celui de permettre une meilleure efficacité de nos services dans l’avenir.
Qui pourrait prétendre, monsieur le ministre – je ne pense pas que cela sera votre cas –, que les attentats de 2015 ne sont pas un échec collectif, même si chacun comprend en ce domaine que le risque zéro n’existe pas ? Le Premier ministre, lui-même, déclarait le 9 janvier 2015 : « Il y a une faille bien évidemment. Quand il a dix-sept morts, c’est qu’il y a eu des failles. » Que dire alors, après les attentats du 13 novembre au Bataclan, à Saint-Denis, et sur les terrasses des cafés-restaurants de Paris ?
Après quelque deux cents heures d’auditions, et des déplacements à l’étranger – nous revenons d’Israël où je sais que vos services vont chercher une coopération efficace –, notre commission d’enquête est bien décidée à passer nos failles au crible, et à faire des propositions fortes pour y remédier. Vous-même, d’ailleurs, avez commencé à tirer les conséquences de ces événements, tant pour la nouvelle organisation du renseignement que s’agissant des doctrines d’emploi de nos forces d’intervention et de secours.
Pour une meilleure clarté de votre intervention, je propose d’aborder dans un premier temps les questions relatives au renseignement et à la coopération européenne en la matière. Dans un deuxième temps, nous pourrions en venir aux nouvelles doctrines d’emploi des forces d’intervention et de secours.
Pour ce qui concerne les questions relatives au renseignement, on entend souvent dire qu’il est facile de refaire le film a posteriori. Mais c’est précisément notre mission pour essayer de comprendre ce qui s’est produit. Nous nous posons une question essentielle : alors que la quasi-totalité des auteurs des attentats de janvier et de novembre 2015 étaient connus de nos services, comment ont-ils pu échapper à tous les radars et commettre leurs attentats en plein Paris ?
Vous connaissez les cas qui nous ont été soumis, et qui sont les plus emblématiques. Samy Amimour, le terroriste abattu sur la scène du Bataclan par le commissaire de la BAC que j’évoquais, avait été auditionné par la direction centrale du renseignement intérieur (DCRI), en octobre 2012. Cette année-là, il avait été placé sous contrôle judiciaire, et il avait échoué dans un projet de départ vers la Syrie où il s’est finalement rendu en septembre 2013 avec Ismaël Omar Mostefaï. Ce dernier faisait lui-même l’objet d’une fiche S, mais il avait pu quitter le territoire national.
Chérif Kouachi avait été arrêté pour avoir participé à la filière de recrutement djihadiste dite « des Buttes-Chaumont ». Il avait séjourné dans un camp militaire en Irak. Il s’était radicalisé en prison entre 2005 et 2008, avant de réapparaître, en 2013, dans l’enquête relative à la tentative d’évasion de Smaïn Aït Ali Belkacem, condamné comme artificier de l’attentat du RER Saint-Michel de 1995.
Il y a également son frère, Saïd Kouachi, dont les services de renseignements savaient qu’il était allé s’entraîner au Yémen, en 2011, au côté d’Al-Qaïda, et qu’il faisait l’objet d’un mandat de recherche depuis le 7 janvier 2015.
Enfin, citons le cas d’Abdelhamid Abaaoud, qui a pu circuler en 2015, en Europe, alors qu’il avait été localisé à Athènes – nous avons pu le vérifier sur place –, juste avant l’assaut de la cellule de Verviers en Belgique.
À l’évidence, c’est un échec. Les grands chefs de vos services l’ont dit eux-mêmes au cours de leurs auditions. Vous en avez tiré les conséquences immédiatement après la décapitation perpétrée à Saint-Quentin-Fallavier par Yassin Salhi qui avait échappé à toute surveillance alors qu’il avait été fiché par les renseignements généraux (RG) de 2006 à 2008 pour s’être radicalisé dans sa ville natale de Pontarlier. Je crois que c’est à la suite de cet événement tragique que vous avez pris la décision de créer l’état-major opérationnel de prévention du terrorisme (EMOPT), sur lequel vous voudrez bien nous apporter quelques précisions. Nous avons en effet découvert, au cours de nos travaux et de nos déplacements en province, l’extrême complexité de l’organisation du renseignement français, qui peut faire craindre un défaut de coordination ou, en tout cas, une déperdition d’information.
Je rappelle, pour mémoire, le nom des principaux services que nous avons auditionnés et qui disposent chacun de leur propre fichier : la direction générale de la sécurité intérieure (DGSI), la direction générale de la sécurité extérieure (DGSE), le service central du renseignement territorial (SCRT), la sous-direction de l’anticipation opérationnelle (SDAO) de la gendarmerie nationale, la sous-direction anti-terroriste (SDAT) de la direction centrale de la police judiciaire, la direction du renseignement militaire (DRM), la direction du renseignement de la préfecture de police de Paris (DRPP), et la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED). Je le répète, tous ces services utilisent leur propre ficher – certains se recoupent, mais ce n’est pas toujours le cas.
Il existe également plusieurs cellules de coordination que nous avons pu visiter : l’unité de coordination de la lutte antiterroriste (UCLAT), le coordonnateur national du renseignement auprès du Président de la République, et, désormais l’EMOPT, sans compter les cellules de coordination interservices, qu’il s’agisse par exemple des cellules Allat ou Hermès. Au point où nous en sommes, on peut se demander s’il ne faudrait pas un « super-coordonnateur » pour coordonner les coordonnateurs, tant le millefeuille est complexe. Le chef de l’antiterrorisme israélien que nous avons rencontré avant-hier nous a avoué qu’il ne savait toujours pas aujourd’hui qui était son interlocuteur en France !
Monsieur le ministre, pouvons-nous continuer à entretenir ces querelles de chapelles en France ? Ne faut-il pas rationaliser et hiérarchiser le renseignement sous un seul commandement, comme l’on fait les Américains après le 11 septembre, en créant notamment une base commune du renseignement. Le sénateur Philippe Dominati, dans le rapport d’information qu’il a consacré au renforcement de l’efficacité du renseignement écrivait, en octobre 2015 : « L’éclatement de l’architecture administrative actuelle se traduit par une déperdition de moyens et un risque de conflit d’attribution entre les services. »
Je vous cède la parole, monsieur le ministre, après avoir sans doute été un peu long, mais il était important que nous fassions part des premiers résultats de nos travaux.
M. Bernard Cazeneuve, ministre de l’intérieur. Monsieur le président, si j’ai bien compris, vous faites long dans votre propos introductif, et vous me demandez de faire court dans le mien. Je répondrai aux questions que vous venez d’évoquer, et, bien entendu, je le ferai en étant libre de mon propre propos, parce que je tiens à rendre compte de l’activité des services qui sont sous ma responsabilité avec un esprit qui n’est pas tout à fait le vôtre. Vous partez en effet du principe qu’il y a des failles, et que vous estimez que votre commission doit le démontrer. Moi je pars du principe que seule la vérité compte – et j’entends la dire devant votre commission. C’est de la vérité, c'est-à-dire des faits, que l’on déduit l’existence de failles, et non à partir de failles que l’on présuppose, que l’on doit ensuite articuler les faits.
Je m’assigne cette méthode, car j’ai sous ma responsabilité des services qui donnent le meilleur d’eux-mêmes, et que je lis sur les activités qu’ils conduisent des choses extrêmement approximatives. L’exercice qui consiste a priori à pointer des failles avant que l’on ait démontré leur existence est extraordinairement facile. Dans la responsabilité qui est la mienne, et compte tenu de la complexité du sujet que nous avons à traiter, je n’entends pas, parce que c’est mon honneur et celui de mes collaborateurs, les laisser mettre en cause sans les défendre lorsque ce qui est dit les concernant n’est pas juste.
C’est d’ailleurs la raison pour laquelle je vais m’employer à répondre de façon extrêmement méticuleuse à tous les sujets que vous avez évoqués, ce qui me permettra de remettre un certain nombre de faits à leur place.
J’ai déjà eu l’occasion, en me présentant une première fois devant les membres de votre commission d’enquête, le 7 mars dernier, de vous dire qu’il me semblait à la fois tout à fait normal et absolument sain et nécessaire que le Parlement puisse examiner dans le détail l’action menée par les pouvoirs publics face aux sanglants attentats de janvier et novembre 2015 tant dans l’urgence, que dans l’histoire de l’antiterrorisme.
Il y aurait en effet une certaine naïveté à considérer que ce que font les services aujourd’hui ne résulte que des décisions prises à partir de 2012. Ils sont impactés par des décisions qui s’inscrivent dans le temps long de l’histoire de l’antiterrorisme, et qui ont été prises par tous les gouvernements, quelle que soit leur sensibilité politique, ce qui doit appeler chacun à l’humilité.
Je veux donc remercier à nouveau les membres de la commission d’enquête pour les travaux importants qu’ils conduisent, et leur dire le respect que ces travaux nous inspirent. Je souhaite y contribuer pour ma part de façon aussi utile que possible, et c’est dans cet esprit que j’ai remis ce matin même à votre rapporteur, le document de synthèse que les services du ministère de l’intérieur ont consacré à leur « retour d’expérience » à la suite des attentats des mois de janvier et novembre 2015.
La première audition à laquelle vous avez bien voulu me convier nous avait déjà permis, me semble-t-il, d’éclaircir un certain nombre de points concernant des sujets extrêmement importants pour la protection des Français face au risque terroriste. Je pense, en particulier, à la coordination générale des moyens engagés en cas d’attentat, aux procédures d’enquête, à l’organisation des opérations de secours aux victimes, ou encore à la mobilisation des forces d’intervention.
Ce dernier sujet a du reste évolué depuis lors, puisque j’ai présenté le 19 avril dernier, comme vous le savez, un nouveau schéma d’intervention des forces spécialisées en cas d’attaque terroriste. Il a pour objectif de garantir la cohérence et l’unité des forces, et, surtout, de permettre une intervention plus rapide, en tout point du territoire, en cas de tuerie de masse. C’est pourquoi ce schéma prévoit en particulier la création de nouvelles antennes du RAID et du GIGN permettant d’assurer une couverture optimale de notre territoire.
À la suite de ma première audition, vous avez également, comme cela était prévu, interrogé plusieurs responsables des forces de sécurité. Vous connaissez le sang-froid et le professionnalisme avec lesquels ils ont réagi face aux épreuves exceptionnelles que notre pays a connues. Je vous remercie de leur avoir rendu hommage. Au cœur de la tragédie, avec les femmes et les hommes placés sous leurs ordres, ils ont accompli leur mission avec un sens du devoir qui m’inspire une très grande gratitude et, pour ce qui me concerne, un immense respect. Je ne doute pas que les échanges qu’ils ont eus avec les membres de votre commission d’enquête auront été placés sous le signe des mêmes sentiments, et qu’ils auront contribué eux aussi à éclairer votre réflexion.
J’en viens au sujet sur lequel vous avez souhaité m’entendre de nouveau : la politique du renseignement. Elle constitue un autre volet fondamental de la politique globale de notre pays pour lutter avec efficacité contre la menace terroriste. À nouveau, il est essentiel que le Parlement soit pleinement informé des orientations retenues par le Gouvernement dans ce domaine.
Certes, à l’évidence, certaines informations particulières concernant telle ou telle opération, ou la mise en œuvre de telle ou telle technique, ne peuvent être publiquement discutées sans que nous courions le risque de perdre en efficacité, voire de faciliter les projets de nos adversaires. Mais ce principe de discrétion ne saurait être invoqué pour vous empêcher d’examiner les objectifs que poursuit notre politique du renseignement, les méthodes qu’elle emploie, et les moyens sur lesquels elle s’appuie. Le grand débat qui a précédé l’adoption de la loi du 24 juillet 2015 relative à notre politique publique du renseignement a ainsi déjà permis d’engager au sein du Parlement des discussions extrêmement riches et utiles.
Avant d’en venir aux mesures que le Gouvernement a adoptées pour permettre à nos services de renseignement de répondre au nouvel état de la menace terroriste, je voudrais vous faire part de deux réflexions préalables qui ont trait l’une et l’autre à l’efficacité qui est prêtée ou non à nos services. Ce sera une manière de répondre aux questions que vous avez posées.
D’abord, il me semble parfois que les questions de renseignement suscitent, plus que d’autres, des jugements à l’emporte-pièce fondés sur des informations tronquées, souvent mal interprétées, et des approximations que l’on a d’autant plus intérêt à évoquer que l’on sait qu’elles recueilleront toujours un écho maximal dans la presse.
Ainsi, lorsqu’un attentat se produit, la première question que se posent de nombreux observateurs avant même que les conditions de cet attentat n’aient été déterminées est : « Où est la faille des services ? »
Pour en rester aux faits, les attentats de novembre 2015 ont résulté d’une action terroriste coordonnée, d’après les premières informations dont nous disposons, par Abdelhamid Abaaoud, qui était belgo-marocain – il n’avait donc pas la nationalité française –, et qui ne résidait pas en France – il vivait en Syrie. Cet individu a pris pour complices des personnes dont la plupart étaient, elles aussi, belgo-marocaines. Certaines évoluaient à proximité de lui en Syrie ; elles sont arrivées en Europe par l’île de Leros, en Grèce, où leurs empreintes ont été prises sous de fausses identités. Abdelhamid Abaaoud a également enrôlé des complices vivant en Belgique, cachés dans des appartements conspiratifs où ont été préparés les attentats. Enfin, il a également trouvé le concours de deux Français, Samy Amimour, qui était parti en Syrie en 2013 après avoir violé son contrôle judiciaire, ainsi que Omar Mostefaï. Ces deux Français sont revenus en Europe dans les mêmes conditions que les autres auteurs des attentats de novembre, en utilisant vraisemblablement de faux papiers, et en franchissant plusieurs frontières.
Je veux rappeler que la direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) n’a pas pour mission d’enquêter sur des ressortissants étrangers opérant à l’étranger, tous ceux qui connaissent bien ces sujets le savent. Quant aux terroristes, y compris les Français Amimour et Mostefaï, qui ont traversé de nombreux pays de l’Union européenne avant de perpétrer leurs crimes en France, je confirme solennellement devant votre commission d’enquête qu’aucun service de renseignement, ni aucun service de police des pays en question ne les a signalés. Les services américains, eux non plus, ne les ont pas identifiés lorsqu’ils ont traversé l’Europe centrale, bien qu’ils disposent de moyens très puissants qui justifient de la qualité de notre coopération avec eux.
Il est donc pour le moins réducteur d’imputer aux services de sécurité intérieure français, et à eux seuls, un défaut de vigilance ou de clairvoyance, compte tenu de la complexité de ce qui s’est passé et que je viens de relater. À bien des égards, c’est l’absence d’un système d’alerte européen et d’une coordination efficace des services européens, j’y reviendrai tout à l’heure, qui a été mise en évidence en novembre dernier, et qui appelle des réactions extrêmement fortes et des initiatives efficaces dont la France…
M. le président Georges Fenech. Monsieur le ministre, pardonnez-moi de vous interrompre : pour la clarté de cette audition, pourrions-nous arrêter sur le cas de Samy Amimour, que vous venez d’aborder …
M. le ministre. Monsieur le président, si vous le voulez bien, et pour la clarté de mon propre propos, je souhaiterais pouvoir aller jusqu’au bout de ma démonstration. Ce serait courtois à mon égard ; je me mettrai ensuite, bien entendu, à la disposition de votre commission pour répondre à la totalité des questions qu’elle souhaite poser. Je n’ai pas du tout l’intention de m’y soustraire,…
M. le président Georges Fenech. Monsieur le ministre, je souhaite véritablement…
M. le ministre. …mon propos repose sur une cohérence, et je pense qu’il serait tout à fait courtois de me laisser aller jusqu’à son terme, si vous acceptez de respecter les convenances.
M. le président Georges Fenech. Monsieur le ministre, il ne s’agit pas de courtoisie : il s’agit de mener cette audition avec le maximum d’efficacité et j’entends bien pouvoir le faire. Je cède la parole à M. le rapporteur pour que nous puissions développer le cas de Samy Amimour.
M. le ministre. Monsieur le président, j’ai moi-même été président d’une commission d’enquête parlementaire, et je n’ai jamais procédé ainsi, par respect et par courtoisie pour les personnes auditionnées.
M. le président Georges Fenech. Monsieur le ministre, puisque vous voulez mener ces débats, faites-le sous le regard des Français qui nous regardent !
M. le ministre. Monsieur le président, je ne souhaite pas conduire les débats. Je souhaite simplement pouvoir aller jusqu’au bout de mon propos, et lorsque cela sera fait, je tiens – ce qui est normal, vous m’avez invité pour cela –, à répondre à toutes vos questions et à pouvoir le faire dans le détail, question par question.
M. le président Georges Fenech. Moi, je maintiens ma position, monsieur le ministre. Je pense qu’il sera plus utile, puisque vous venez d’expliquer que la plupart des auteurs des attentats ne relevaient pas de la surveillance de vos services, mais de celle des services étrangers, d’évoquer immédiatement le cas de Samy Amimour, qui nous interpelle.
M. le ministre. Monsieur le président, je n’ai pas dit cela du tout. J’ai indiqué qu’on aurait tort d’imputer à la seule direction générale de la sécurité intérieure une responsabilité compte tenu du parcours effectué par les individus en cause, de leur origine, de leur nationalité, et du fait qu’aucun service de renseignement ne nous a communiqué, avant les attentats, d’information les concernant, alors qu’ils avaient traversé de nombreux pays. Voilà ce que j’ai dit précisément.
J’ai, bien entendu, l’intention de répondre à vos questions. Soucieux néanmoins d’apporter une information complète à la commission d’enquête, et n’entendant pas être dans la confusion, je vous demande d’avoir la courtoisie de me laisser aller au bout de mon propos. Si l’objectif n’est pas d’avoir un propos clair, mais d’entretenir une polémique avec moi, vous perdez votre temps car, encore une fois, j’essaie simplement d’aller au bout de mon propos pour la clarté de nos échanges. Cela dit, si vous voulez que je réponde à vos questions et que je range mes feuilles, je le ferai volontiers, mais je le regretterai tant pour nos débats, qu’au nom des principes de courtoisie qui, généralement, président au déroulement des commissions d’enquête parlementaire.
M. le président Georges Fenech. Monsieur le ministre, je crois que vous n’avez pas perçu à quel point cette commission a travaillé dans un esprit transpartisan. Tous les collègues présents peuvent en témoigner : chacun a pu s’exprimer librement avec le seul souci de la vérité et de la transparence. S’il s’agit de vous rassurer, je le répète : il n’y a aucune recherche de polémique avec qui ce soit, et certainement pas avec vous dont nous connaissons parfaitement le sens des responsabilités et le souci de la transparence. Que ce soit bien clair !
Vous souhaitez aller jusqu’au bout de vos propos ; je trouve que c’est un peu préjudiciable à l’intérêt de nos échanges mais, puisque vous insistez, je vous laisse le faire. De grâce, qu’ils ne soient pas trop longs, cependant, afin que nous puissions tous vous poser les questions qui nous brûlent les lèvres depuis maintenant quatre mois que nous travaillons.
M. le ministre. Monsieur le président, vous aurez tout le temps de poser des questions puisque, par respect pour le Parlement, j’ai réservé toute ma matinée à cette audition de manière à pouvoir être absolument complet. Vous n’avez aucune inquiétude à avoir : vous aurez des réponses extrêmement précises sur tous les sujets que vous avez bien voulu évoquer.
J’en viens donc à ma seconde réflexion sur les « failles » supposées des services. Il est extrêmement rare que soient évoqués les attentats qui n’ont pas eu lieu, précisément parce que nos services de renseignement ont arrêté ceux qui les planifiaient avant même qu’ils puissent être commis. Je veux sur ce sujet apporter des informations sur des événements qui se sont produits depuis ma précédente audition par votre commission. Je pense à l’arrestation de Reda Kriket à Argenteuil, qui a porté à quinze le nombre des attentats déjoués depuis 2013 grâce au travail minutieux de nos services – dont sept depuis janvier 2015.
Par ailleurs, toujours depuis janvier 2015, 335 individus impliqués d’une façon ou d’une autre dans des filières djihadistes ont été interpellés par la DGSI. Parmi eux, 173 ont été mis en examen, et 130 ont été écroués. D’une manière générale, la DGSI est saisie, en propre ou avec la police judiciaire, du suivi de 271 dossiers judiciaires concernant 1 183 individus en raison de leur implication dans des activités liées au terrorisme djihadiste. C’est cette activité intense de nos services de renseignement intérieur qui permet, jour après jour, d’éviter que de nouveaux attentats soient commis. Il me semble important de ne jamais l’oublier.
Cependant, ce constat ne signifie pas, bien entendu, que notre dispositif de renseignement ne doive pas être réformé, renforcé, adapté à l’évolution de la menace terroriste qui a frappé notre pays en 2015. Bien au contraire, le Gouvernement s’est attaché à agir simultanément sur quatre terrains : la réorganisation de nos services de renseignement, afin de couvrir l’ensemble du spectre et de mieux partager l’information ; la modernisation du cadre juridique dans lequel agissent nos services face à un adversaire qui adapte en permanence sa stratégie et ses moyens d’action ; le renforcement continu des moyens d’action de nos services sur le plan matériel et humain, et la recherche d’une coordination plus efficace des services européens spécialisés ainsi que le renforcement des instruments dont ils disposent.
Je veux aujourd’hui revenir devant vous sur les principales décisions que nous avons prises depuis le début du quinquennat, et surtout depuis janvier 2015, pour renforcer nos capacités de renseignement intérieur, qu’il s’agisse de la surveillance du « haut du spectre », confiée à la DGSI, ou bien de la détection des signaux faibles de radicalisation, tâche décisive qui revient désormais au service central du renseignement territorial (SCRT) et aux autres acteurs du « deuxième cercle ».
Pour leur donner une pleine et entière capacité d’action, et par là même corriger certains effets négatifs engendrés par la réforme de 2008, il nous fallait tout d’abord rationaliser l’organisation de nos services. Dès 2013, nous avons commencé à réformer en profondeur l’architecture générale de notre dispositif, lequel repose désormais sur une articulation extrêmement claire et dynamique entre le « premier cercle » du renseignement intérieur, et le « deuxième cercle » composé principalement, s’agissant des services de renseignement, du service central du renseignement territorial (SCRT), de la direction du renseignement de la préfecture de police de Paris (DRPP), et de la sous-direction de l’anticipation opérationnelle (SDAO) de la gendarmerie nationale.
Nous poursuivions alors deux objectifs complémentaires, qui sont aujourd’hui pleinement atteints : d’une part, achever la transformation de la direction centrale du renseignement intérieur (DCRI) en direction générale de la sécurité intérieure (DGSI), et d’autre part, et c’est très important compte tenu des préoccupations que vous avez exprimées, monsieur le président, recréer un véritable service de renseignement de proximité en milieu ouvert.
Sur le premier point, les choses sont faites depuis la publication du décret du 30 avril 2014 portant création de la DGSI et la plaçant directement sous l’autorité du ministre de l’intérieur, à l’instar des autres grandes directions générales du ministère. Nous avons ainsi parachevé la réforme de 2008, dans ses aspects les plus pertinents, pour aller dans le sens d’une plus forte intégration et d’une plus grande coopération entre les services. La DGSI est désormais un acteur pleinement consacré du renseignement français, placé à égalité avec la DGSE, et siégeant dans les conseils de défense que le Président de la République réunit régulièrement. Par ailleurs, son autonomisation lui a permis de gagner en fluidité dans son organisation, et, par là même, en efficacité dans son action. Il lui est désormais possible de procéder aux recrutements dont elle a besoin, notamment en analystes, en linguistes ou en ingénieurs et en informaticiens.
Surtout, dès 2012, et il s’agit du deuxième pilier de notre réforme, le Gouvernement a remis sur pied un service de renseignement territorial digne de ce nom, en prise directe avec les évolutions profondes de la société, notamment dans les quartiers où s’est enkystée une délinquance de plus en plus poreuse à l’influence des réseaux djihadistes. C’était là une priorité absolue. La réforme conduite en 2008 avait supprimé les renseignements généraux (RG), sans pour autant leur substituer un nouveau modèle permettant la détection des signaux faibles. Elle avait donc affaibli la possibilité de détecter ces derniers sur les territoires. Elle avait réduit nos capacités de renseignement en milieu ouvert et, par là même, nos moyens de détection des phénomènes de radicalisation.
Par souci de clarté et pour expliciter notre propre démarche, je veux revenir brièvement sur la logique qui a présidé à la réforme de 2008 – laquelle a débouché sur la création de la DCRI –, et sur les effets qu’elle a provoqués sur le renseignement à moyen terme.
La fusion de la direction de la surveillance du territoire (DST) et des RG pour créer la DCRI a provoqué une désorganisation de notre dispositif de renseignement intérieur. Elle l’a affaibli en méconnaissant les spécificités de ces deux services complémentaires. Chacun sait parfaitement ici que la disparition des RG a constitué un facteur d’affaiblissement. Elle nous a amputés d’un service composé de policiers habitués à travailler sur le terrain et à partager leurs informations avec les autres services de sécurité. À partir de 2008, le maillage territorial assuré par les RG a été systématiquement réduit dès lors que ces derniers ont été en partie absorbés par la DCRI. Plusieurs dizaines de leurs implantations locales ont alors été fermées, au détriment du renseignement en milieu ouvert tel qu’il se pratiquait sur l’ensemble du territoire national.
En dehors de la DCRI, dont la vocation était dès lors exclusivement centrée sur les menaces du « haut du spectre », le reste du renseignement intérieur a ainsi été réduit à un simple service d’information générale, la sous-direction de l’information générale, en charge, pour l’essentiel, des phénomènes économiques et sociaux, ainsi que de la surveillance du hooliganisme. Ce service n’avait aucune attribution en matière de terrorisme, ni pour le « bas du spectre » ni pour la détection des signaux faibles, et il ne disposait pas des outils techniques nécessaires au renseignement. L’accès aux principaux fichiers de police lui était même interdit.
La réforme de 2008 reposait sur des diagnostics qui méritaient d’être revisités, notamment concernant la nature et l’évolution des menaces susceptibles de nous frapper. Nous avons donc, dès 2012, au lendemain des attentats de Toulouse et de Montauban, décidé de recréer un véritable service de renseignement de proximité. Entamé dès 2012, ce processus a débouché, en mai 2014, sur la création du service central du renseignement territorial (SCRT), dont le positionnement a été renforcé par rapport à celui des RG. Ses attributions ont été élargies pour lui permettre de retrouver pleinement ses compétences d’appui à la prévention du terrorisme, notamment par la détection en amont des signaux faibles de radicalisation. C’est la raison pour laquelle son maillage a été renforcé, en métropole comme en outre-mer, pour densifier le réseau de ses capteurs. De même, nous avons décidé de développer des relais du renseignement territorial dans les compagnies ou les brigades de gendarmerie ainsi que dans les commissariats de police, à chaque fois que cela se révèle nécessaire.
Par ailleurs, pour mieux prendre en compte le caractère diffus de la menace djihadiste ainsi que les phénomènes de porosité entre délinquance et terrorisme, priorité a été donnée à la coopération et au partage de l’information entre les différents services. Coordonner davantage est apparu comme une exigence. Nous avons ainsi consolidé l’articulation entre le « premier cercle » et le « deuxième cercle », dont le décret du 11 décembre 2015 a fixé la composition, principalement le SCRT et la DRPP, cette dernière couvrant le ressort territorial de la préfecture de police, à Paris et dans l’agglomération parisienne. À cet égard, l’unité de coordination de la lutte antiterroriste (UCLAT) joue bien sûr un rôle décisif d’analyse et de synthèse. L’UCLAT ne constitue pas un service « opérationnel », et l’échange d’informations entre services « de terrain » passe par des relations directes, notamment par la constitution de bureaux de liaison et de coordination.
De surcroît, comme vous l’avez indiqué dans vos propos introductifs, monsieur le président, j’ai pris la décision, après le drame survenu au mois de juin 2015, à Saint-Quentin-Fallavier, de créer un état-major opérationnel de prévention du terrorisme (EMOPT), afin de renforcer encore davantage la coopération entre les services. Je tiens à préciser que, sans la création préalable du SCRT, jamais l’EMOPT n’aurait pu voir le jour, dans la mesure où celui-ci s’appuie sur le fichier de traitement des signalements, de la prévention de la radicalisation à caractère terroriste (FSPRT), largement alimenté par les agents du renseignement territorial.
Vous avez posé une question très importante à laquelle je souhaite apporter une réponse précise – ce sujet a également été abordé dans le rapport du sénateur Dominati. N’y a-t-il pas trop de structures de coordination ?
En matière de renseignement, il existe plusieurs sujets de coordination qui ne relèvent pas des mêmes logiques, même si in fine, l’ensemble de toutes les informations recueillies doivent être assemblées afin que l’on puisse comprendre de façon extrêmement fine ce qui se passe en matière de terrorisme.
Il faut analyser les phénomènes de radicalisation. On peut partir d’individus identifiés, mais il faut aussi recourir aux chercheurs et à l’université qui permettent d’avoir en permanence une réflexion « rétro-prospective » sur les phénomènes de radicalisation et l’émergence d’activités, d’actions et de groupes terroristes. L’analyse géopolitique et internationale est également indispensable. Elle justifie que soit maintenue une relation constante entre les services intérieurs et extérieurs. Il faut aussi assurer le suivi des individus eux-mêmes. Si chaque service suivait les individus relevant de sa compétence, il n’y avait pas de lieu où l’ensemble des services du ministère de l’intérieur pouvait effectuer le suivi individualisé de chaque cas, et échanger des informations de manière à bien identifier le passage d’un individu du « bas vers le haut du spectre ». Nous n’avions pas non plus de structure qui, sur le fondement de cette analyse individualisée et de ces échanges, permette d’identifier les risques s’attachant à tel ou tel individu en raison de son activité professionnelle ou de son réseau relationnel.
C’est la raison pour laquelle j’ai mis en place ce dispositif : les représentants des grandes directions se retrouvent au sein de l’état-major au plan central. Cet état-major est dupliqué au plan local. Il permet au préfet, sur la base des signalements des services, et de signalements effectués auprès de la plateforme téléphonique installée Place Beauvau, au mois d’avril 2014, de disposer d’une liste exhaustive des personnes à suivre, et d’échanger toutes les informations disponibles sur ces dernières.
Il n’y a donc pas de dispositif de coordination redondant : ce qui relève de l’analyse géopolitique, de l’analyse rétro-prospective des phénomènes de radicalisation, et du suivi individualisé de chaque cas est confié à l’EMOPT, et permet, dans une articulation parfaite avec l’UCLAT, lieu de l’analyse des phénomènes de radicalisation, d’avoir, Place Beauvau, un dispositif complet de suivi. Bien entendu, ce travail que nous effectuons Place Beauvau, cette organisation spécifique, qui donne satisfaction aux préfets – je pense que vos visites dans les territoires l’ont montré – et, désormais, aux services – la constitution du fichier a été laborieuse mais, maintenant que c’est chose faite, son utilisation opérationnelle est extrêmement efficace –, nous permet aussi de faciliter nos relations avec certains autres acteurs du renseignement comme la DNRED, la DGSE ou TRACFIN.
Je souhaite dire un mot de la loi du 24 juillet 2015 relative au renseignement, qui donne à nos services un cadre légal moderne et cohérent adapté aux nouvelles menaces, aux mutations technologiques les plus récentes, et à l’évolution du droit national et international. Pour la première fois dans l’histoire de la République, ce cadre fixe des règles d’emploi claires des techniques de renseignement afin de protéger les agents qui y ont recours, tout en garantissant le respect des libertés individuelles. La loi renforce ainsi les indispensables dispositifs d’évaluation de l’action des services.
Je signale d’ailleurs à votre attention, car c’était une demande du Parlement, que les décrets d’application ont été publiés, dans leur quasi-totalité, dans des délais très rapides, entre le 28 septembre 2015 et le 29 janvier 2016, pour ceux nécessitant divers avis. Nous allons ainsi pouvoir très vite commencer à mettre en œuvre des innovations telles que le fichier des antécédents judiciaires terroristes (FIJAIT), lequel sera installé dès le début du mois de juillet, de même que nous avons commencé, dans une logique de décloisonnement et de partage de l’information, à élargir l’accès administratif au traitement des antécédents judiciaires ainsi qu’aux données de connexion, pour les services qui en avaient besoin et ne pouvaient jusqu’à présent y accéder.
Nous avons considérablement renforcé les moyens humains mis à disposition des services de renseignement. Entre 2007 et 2012, les services de sécurité intérieure ont perdu 13 000 emplois, et cela n’a pas été sans conséquence sur l’activité des services de renseignement qui ont eux-mêmes perdu de la substance. Durant la même période, les crédits de fonctionnement hors titre 2 ont diminué de 17 %. Depuis le début de ce quinquennat, nous les avons augmentés d’autant, ce qui permet d’accroître les effectifs, d’équiper en matériels nouveaux les services de renseignement qui en avaient grandement besoin, mais aussi de moderniser les infrastructures informatiques. En la matière, je pense au dispositif de contrôle CHEOPS, utilisé dans les aéroports, qui est absolument indispensable pour l’identification des terroristes lors de leur franchissement des frontières extérieures, et qui n’avait pas fait l’objet d’investissements depuis de nombreuses années. Les augmentations de crédits que je viens d’évoquer permettent sa remise à niveau.
Depuis 2013, un plan spécifique a été initié pour renforcer les effectifs de la DGSI, qui concerne 432 effectifs en dehors des plans particuliers de renforcement des moyens du ministère de l’intérieur dans le cadre de la lutte antiterroriste. Il est accompagné d’un effort budgétaire sur crédits hors titre 2 pour un montant de 12 millions d’euros par an.
Le plan de lutte antiterroriste a conduit au mois de janvier 2015 à augmenter cet effort de 1 400 emplois répartis de la manière suivante : 500 emplois dans le renseignement intérieur, 500 emplois dans le renseignement territorial pour redonner de la densité à nos réseaux de capteurs, 100 emplois au sein de la direction du renseignement de la préfecture de police de Paris, 130 emplois au sein de la direction centrale de la police judiciaire dans le domaine de la lutte contre la cybercriminalité. Cela permet de renforcer considérablement les moyens de nos services dans le cadre de la lutte antiterroriste.
Je veux également rappeler que certaines des 5 000 créations nettes d’emplois annoncées par le Président de la République lors de la réunion du Congrès, à Versailles, le 16 novembre 2015, viendront conforter significativement les effectifs de nos services de renseignement. Ces derniers diversifient par ailleurs le recrutement de leurs agents : ils ont désormais la possibilité d’avoir recours à des recrutements contractuels, ce qui permet de faire entrer dans les services des analystes, des universitaires qui travaillent en croisant les données afin d’avoir une meilleure perception de ce que sont les risques réels.
Sur le plan des capacités technologiques de surveillance et de recueil de renseignement, nous avons également consenti un effort important, dans le cadre du plan de renforcement des moyens d’équipement, d’investissement et de fonctionnement. Au titre du plan de lutte antiterroriste de janvier 2015, ce sont 233 millions d’euros sur trois ans qui ont été ouverts, dont 90 millions d’euros pour la modernisation et le renforcement des infrastructures et applications informatiques.
Avant de conclure, je veux dire un mot du débat qui se déroule dans la presse concernant l’opposition entre l’investissement dans les ressources humaines et l’investissement dans la technologie. Certains considèrent que nous avons trop investi dans cette dernière, que nous faisons un renseignement trop technologique qui ne donne pas les résultats qu’il devrait faute de ressources humaines ; d’autres estiment au contraire que la formation de nos ressources humaines vieillit, et que nous devrions investir davantage en faveur de la technologie. En fait, les chiffres que je viens de vous présenter en matière de recrutement et d’investissement pour les crédits hors titre 2 montrent que nous investissons à la fois en faveur de l’un et de l’autre. Si nous ne faisons pas les deux à la fois, nous perdrons incontestablement en substance.
Je répondrai dans un instant à la question que vous m’avez posée sur Amimour et Mostefaï de façon extrêmement précise, car je ne veux pas qu’il y ait de frustration, mais je souhaite préalablement évoquer la dimension européenne de nos sujets.
J’ai montré tout à l’heure la complexité du parcours des terroristes, et j’ai évoqué les conditions dans lesquelles ils étaient entrés sur le territoire européen. Daech a récupéré des milliers de passeports vierges en Irak et en Syrie, et s’est doté d’une véritable usine du faux document. Il n’est pas exclu, puisque cela s’est déjà produit, que d’autres commandos puissent entrer sur le territoire de l’Union européenne, munis de faux documents, pour nous frapper et commettre de nouveaux attentats, en profitant des flux migratoires et de la détresse de ceux qui sont persécutés en Irak et en Syrie.
Les contacts que votre commission d’enquête a eus au niveau européen vous l’auront confirmé : la France mène une action extrêmement déterminée pour que des mesures soient prises, le plus rapidement possible, afin d’éviter cela, même si l’Europe met trop de temps à prendre des décisions – et, quand elle les a prises, trop de temps à les appliquer.
Premièrement, il nous paraît indispensable de mettre en place un contrôle puissant aux frontières extérieures de l’Union européenne. Cela suppose la montée en puissance de l’agence européenne FRONTEX, et cela implique également que lorsque les étrangers arrivent sur le territoire, un contrôle extrêmement efficace et solide soit pratiqué avec l’interrogation systématique du système d’information Schengen (SIS). C’est la raison pour laquelle nous avons demandé et obtenu la modification de l’article 7-2 du code frontières Schengen, qui permet désormais de consulter le SIS pour les ressortissants de l’Union qui en franchissent les frontières extérieures. Cette modification risque cependant d’être altérée par la proposition de l’Union européenne relative au dispositif de frontière intelligente, entrée et sortie, qui préconise une application à tous sauf aux ressortissants de l’Union. Nous aurions donc une contradiction complète entre ce que l’Union européenne a acté à la demande de la France pour modifier l’article 7-2, et ce qu’elle propose de mettre en place concernant le dispositif entrée-sortie.
Deuxièmement, pour être interrogé avec efficacité, le SIS doit nécessairement être alimenté par tous les pays de l’Union européenne de la même manière. Tel n’est pas le cas aujourd’hui. La France est actuellement le pays qui alimente le plus le SIS. S’il n’est pas alimenté de façon homogène et identique par les autres membres de l’Union, son interrogation au moment du franchissement des frontières extérieures n’aura pas d’intérêt. Cela conduira, de nouveau, pour le coup, à des failles et à des pertes en ligne.
Troisièmement, nous devons connecter le SIS aux autres fichiers criminels et aux autres fichiers. Je pense au SLTD – pour Stolen or Lost Travel Documents – d’Interpol, ou au fichier d’empreintes digitales EURODAC dont le règlement de l’Union européenne ne permet pas l’utilisation à des fins de sécurité. Ce dernier point constitue un énorme problème lorsque l’on sait que deux des kamikazes du Stade de France sont entrés dans l’Union grâce à des empreintes prises à Leros, posées sur de faux passeports sur lesquels ils apparaissaient sous de fausses identités. Il est donc fondamental d’utiliser EURODAC à des fins de sécurité intérieure, de même qu’il est essentiel que nous disposions d’une task force européenne composée de nos meilleurs spécialistes de la lutte contre les faux documents, car, encore une fois, tout ce que je viens de dire n’a de sens que dès lors que les documents interrogés sont les bons, et que si l’on peut identifier ceux qui ne le sont pas – nous pourrons alors neutraliser les terroristes dès l’instant où ils entrent en Europe.
Je veux enfin insister sur la directive armes à feu. Si nous ne parvenons pas à modifier la directive de 1991 afin d’obtenir davantage de marquages, ainsi que l’intensification de l’éradication des armes et de la lutte contre la vente d’armes à feu sur le net, l’efficacité de notre action en matière de lutte antiterroriste sera obérée.
Voilà ce que je souhaitais dire. J’en viens à Mostefaï et Amimour. Il s’agit de deux cas différents. Bien qu’étant tous les deux ressortissants français…
M. le président Georges Fenech. Merci pour ce très long exposé des réformes en cours ainsi que de celles passées puisque vous avez longuement rappelé les circonstances de la réforme de la DCRI.
En ce qui concerne l’EMOPT, nous nous sommes demandés si sa création était nécessaire, et s’il n’aurait pas mieux valu, plutôt que d’ajouter une nouvelle structure, élargir le domaine de l’UCLAT. Vous avez souligné que la création du FSPRT, le fichier de l’EMOPT, avait été laborieuse. Ce qui nous a surpris, c’est que la DNRED ne connaissait même pas l’EMOPT il y un mois et que la DGSE était incapable de donner la signification de l’acronyme.
M. Sébastien Pietrasanta, rapporteur. Il nous a été indiqué, notamment par la DGSI, qu’à partir du moment où Samy Amimour avait été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire, le suivi par les services de renseignement avait cessé. N’y a-t-il pas là un « trou dans la raquette » ?
M. le ministre. Il ne faut pas considérer comme une faille ce qui est l’application du droit. Aucun service ne peut faire autre chose que d’appliquer la législation en vigueur.
M. le président Georges Fenech. Le droit peut avoir des failles.
M. Pierre Lellouche. On peut changer le droit. Nous sommes là pour ça.
M. le ministre. Absolument. Je me contente de vous dire ce qu’est l’état du droit et ce que j’en déduis.
Dès lors qu’un individu est placé sous contrôle judiciaire, et qu’il fait par conséquent l’objet d’interceptions judiciaires, il n’est pas possible de procéder à des interceptions de sécurité administratives. Cela résulte de la séparation des pouvoirs, qui empêche les autorités administratives de perturber les enquêtes judiciaires. Dans le débat sur la loi « Renseignement » et dans celui sur l’état d’urgence, nous avons eu des discussions sans fin, avec des parlementaires de toutes sensibilités, sur la nécessité pour le juge judiciaire de conserver, s’agissant de dispositifs attentatoires aux libertés, la totalité de ses prérogatives. Les mesures de police administrative étant considérées comme des dispositifs attentatoires aux libertés car elles interviennent sans que soient réunies la totalité des preuves qui seraient mobilisées dans une procédure judiciaire, je ne suis pas sûr qu’une modification du droit en la matière puisse se faire sans réviser la Constitution. En tout état de cause, il ne faut pas interpréter ce retrait d’un service de renseignement intérieur comme une faille mais comme une application du droit.
M. le président Georges Fenech. Personne ne l’a fait ici.
M. le ministre. D’autres l’ont fait, par exemple dans la presse.
M. le président Georges Fenech. Notre presse est libre.
M. le ministre. Cela a été dit aussi par des responsables politiques.
Nous avons appliqué le droit. Quand des individus présentant un risque terroriste sont placés sous contrôle judiciaire, nous ne sommes plus armés pour assurer leur suivi. C’est incontestablement un problème.
M. le rapporteur. Il est paradoxal qu’une personne mise en examen pour des affaires de terrorisme ne soit plus suivie par nos services de renseignement qui luttent contre le terrorisme. Notre Commission fera des propositions en la matière.
M. le ministre. J’indique que la mise en place du FIJAIT obligera ceux qui font l’objet d’un contrôle judiciaire ou d’une condamnation à signaler leurs déplacements. Nous nous sommes donc déjà dotés de moyens nouveaux qui permettront de corriger pour partie les imperfections de notre droit.
M. Pierre Lellouche. Pour un terroriste, le mieux, finalement, est de se faire mettre en examen pour le braquage d’une station d’essence car les services de renseignement cesseront alors de l’écouter ! Ce sujet doit être traité, mais il y avait dans le cas d’Amimour un autre dysfonctionnement, à savoir que le contrôle judiciaire n’a pas été véritablement assuré. Alors qu’on lui avait retiré son passeport, Amimour est allé déclarer la perte de ce document à la préfecture et reçu un autre passeport, avec lequel il est parti en Syrie avant de revenir en France. Cela fait beaucoup, à côté des failles européennes que vous avez pointées à juste titre. Je rapportais hier un texte sur les mesures de contrôle de Schengen, qui sont très défaillantes, mais nous avons des « trous dans la raquette » en interne aussi.
M. Alain Marsaud. Dans les procédures de contrôle judiciaire, notamment en cas d’obligation de pointer au commissariat ou à la brigade de gendarmerie, le service où pointe la personne mise en examen pour terrorisme n’est pas forcément au courant de la dangerosité de cette personne, qui est traitée comme n’importe quel individu sous contrôle judiciaire de droit commun, et un défaut de pointage n’est pas toujours signalé immédiatement. Il faudrait donc que la dangerosité soit connue au lieu où se fait le pointage.
M. le ministre. Ce que dit Pierre Lellouche serait en effet très préoccupant si son passeport avait été rendu à Samy Amimour pendant son contrôle judiciaire. C’est ce que j’ai lu en plusieurs occasions, alors que c’est totalement faux. Amimour a été placé sous contrôle judiciaire en octobre 2012 mais avait demandé le renouvellement de son passeport en mars. Il n’y avait en mars aucune raison de ne pas lui délivrer son passeport. J’en parle d’autant plus volontiers que c’est un gouvernement de droite qui était alors aux responsabilités. Il n’est pas permis de refuser un document d’identité de façon discrétionnaire.
Il faut en effet, monsieur Marsaud, que la communication entre les services soit totale afin d’éviter ce type de dysfonctionnement. C’est précisément la raison pour laquelle j’ai créé l’EMOPT, au sein duquel se réunissent tous ceux qui ont à connaître de la situation de chaque individu porté au FSPRT, et où l’information circule.
La nature de l’activité terroriste à laquelle nous sommes confrontés est un phénomène extrêmement nouveau. J’essaye de faire en sorte que les mailles du filet soient aussi fines que possible, afin que personne ne passe au travers, mais ce n’est pas parce que l’on essaie de faire au mieux que l’on est garanti de toujours bien faire. Sur les deux points en question, ma réponse est précise : la chronologie dans le premier cas et le dispositif que j’ai mis en place pour éviter que ce type de situation se perpétue dans le second.
M. le rapporteur. Trois autres questions, monsieur le ministre, la première sur l’articulation entre l’UCLAT et l’EMOPT. Pourquoi avoir créé une nouvelle structure, plutôt que de déplacer l’UCLAT, actuellement au sein de la DGPN, auprès de vous-même en tant qu’unité de coordination de la lutte antiterroriste ?
Lors de nos déplacements à Lille et Marseille, les services de renseignement, en particulier la SDAO et le SCRT, ont souligné l’utilité et l’efficacité du FSPRT. Ne faut-il pas aller plus loin ? Chaque service de renseignement a son propre fichier. Certains alimentent le FSPRT, à l’instar de la DGSI, mais d’autres, y compris dans le premier cercle, ni ne l’alimentent ni n’y ont accès. Ne conviendrait-il pas de créer une base commune, avec différents niveaux d’habilitation, accessible à l’ensemble des services du premier cercle, voire à certains services du second ?
Enfin, nous avons constaté une volonté forte de la gendarmerie d’aller plus loin en matière de renseignement. La gendarmerie couvre la moitié du territoire et de la population et fait déjà partie du second cercle du renseignement. Ne peut-on envisager la création d’une direction générale du renseignement territorial par la fusion de la SDAO et du SCRT ? Cela permettrait, après la disparition des RG, de remailler le territoire avec le renseignement territorial.
M. le ministre. Il fallait créer l’EMOPT parce que nous avions des exemples d’individus passant du bas au haut du spectre ou vice-versa dont le suivi m’apparaissait, compte tenu du niveau de menace, trop aléatoire faute d’une méthode et d’un dispositif permanent. L’EMOPT, c’est, plus qu’une structure, une méthode conduisant l’ensemble des services du ministère de l’intérieur pouvant avoir à connaître de l’activité d’individus radicalisés ou engagés dans des activités à caractère terroriste à échanger des informations de manière permanente, de façon que personne n’échappe aux radars.
Mettre en place une telle méthode au sein de l’UCLAT présentait des avantages et des inconvénients. Le rôle de l’UCLAT n’est pas d’assurer un suivi individualisé. Nous aurions risqué de compromettre son travail d’analyse des phénomènes de radicalisation et de terrorisme. Comme les sujets sont connexes, j’ai cependant souhaité que les deux travaillent ensemble, et je n’exclus pas une intégration à terme.
J’ai également souhaité que l’EMOPT regarde ce qui se passe dans certains secteurs professionnels où peuvent se trouver des individus radicalisés. C’est grâce à son travail d’identification que nous avons pu interdire l’accès aux aéroports à un certain nombre d’individus présentant des risques. L’intérêt opérationnel de l’EMOPT est avéré.
Que certains services ne connaissent pas l’EMOPT ou son sigle n’est pas forcément choquant. Je ne connais pas tous les dispositifs de coordination ni tous les acronymes des autres ministères. Ce qui compte, c’est que l’information récupérée par l’EMOPT soit portée à la connaissance des autres ministères lorsque nous sommes ensemble en réunion. L’échange est constant sur les noms posant problème. Les autres services ne connaissent peut-être pas l’acronyme mais ils connaissent les signalements.
En outre, à ma demande le FSPRT est depuis trois semaines accessible à certains services : la direction de l’administration pénitentiaire (DAP), la DGSE, la direction de la protection et de la sécurité de la défense (DPSD). Depuis trois semaines au moins, ces services doivent donc savoir ce que signifie l’acronyme.
M. le rapporteur. L’UCLAT administre le FSPRT et l’EMOPT assure le suivi individualisé des personnes : ce sont deux structures différentes en deux lieux différents. N’aurait-il pas mieux valu prévoir une seule structure ?
M. le ministre. Cela ne se passe pas ainsi. L’UCLAT me fournit des analyses et l’EMOPT, qui encore une fois n’est pas une structure mais une méthode de travail, rassemble autour d’Olivier de Mazières des personnes issues des services pour assurer un suivi en continu des individus portés au FSPRT. Ce travail est relayé par les correspondants de ces services du ministère sur le territoire puisque, depuis avril 2014, se réunissent régulièrement autour des préfets et des procureurs l’ensemble des services du ministère pour un suivi localisé. L’UCLAT et l’EMOPT ne sont pas dans les mêmes locaux mais ils se réunissent chaque semaine autour de mon cabinet et de moi-même pour agréger la totalité des données. La connexion est permanente.
Une fusion des fichiers est problématique. Les informations dont nous disposons sont classifiées et tous les services ne sont pas habilités à recevoir ce type d’informations. Par ailleurs, la constitution d’un fichier immense pose des problèmes au Conseil d’État et à la CNIL. Cela dit, l’absence de fichier unique n’empêche nullement la communication entre services ; vous avez évoqué la cellule Allat, il y en a d’autres. Nous avons fait le choix du pragmatisme.
La SDAO et le SCRT sont des structures complémentaires et nous craignons qu’une fusion prive la gendarmerie de sa capacité de renseignement sans améliorer pour autant le renseignement territorial. Le SCRT exploite les renseignements concernant tous les domaines de la vie institutionnelle, économique et sociale, et étudie les faits de société susceptibles de remettre en cause les valeurs républicaines, telle que les dérives sectaires et les phénomènes de repli communautaire et identitaire. Il centralise le renseignement et réalise des synthèses au profit des autorités gouvernementales et administratives. En tout, 200 gendarmes servent dans ses rangs : 40 au niveau central, 160 dans les services locaux. Dans le cadre du plan de lutte antiterroriste, 100 militaires de plus renforceront le SCRT.
La SDAO joue un rôle central dans la gestion des événements en zone gendarmerie, grâce à deux structures indispensables. Le premier pilier en est le centre d’opérations et de renseignement de la gendarmerie, qui suit en direct l’ensemble des opérations conduites par les gendarmes, plus de 8 000 par jour, soit 2,9 millions par an. Le second pilier est le centre d’analyse et d’exploitation, qui joue un rôle d’anticipation. Il ne faut pas reproduire ce qui a été fait en 2008. Je tiens à maintenir tous les capteurs ouverts sur le territoire national. Ce qui n’empêche pas d’introduire, comme nous l’avons fait, des gendarmes dans le SCRT de manière à créer les conditions d’un rapprochement entre les structures.
M. Christophe Cavard. Un tournant a eu lieu en France en 2012, avec l’affaire Merah, puis avec l’année noire qu’a été 2015.
Il ressort de nos auditions que la DGSI est devenue le chef de file de la coordination des services de renseignement, au moins sur le territoire national. Comment cette coordination se passe-t-elle concrètement ?
Nous avons par ailleurs été alertés sur le fait que des notes blanches produites par les services de renseignement ne sont pas toujours transmises au pôle antiterroriste. À l’inverse, quand il se passe quelque chose, le pôle est tout à coup bombardé de notes blanches. Quelle est votre analyse ?
Comment se passe la coordination du renseignement au plan mondial et européen ? Des officiers de liaison du monde entier se croisent à Europol mais ils n’y traitent guère du terrorisme. N’y aurait-il pas intérêt de prévoir une réorganisation de ces moyens au plan européen ?
M. Pierre Lellouche. Si Amimour a été placé sous contrôle judiciaire en octobre, il est parti l’année suivante en Syrie. Le ministère de l’intérieur sait-il comment il est parti ? La chronologie n’ôte rien à la pertinence de la question que je posais sur cette personne qui relevait de la surveillance de vos services.
Dans la mesure où il y a eu une certaine tension au début de la réunion ce matin, je tiens à dire que ce ne sont pas du tout des querelles partisanes qui nous animent au sein de cette Commission. Nous cherchons à assurer à nos concitoyens une sécurité sinon totale du moins maximale, en tirant les leçons des événements, sans a priori politique. Je suis de ceux qui ont demandé que les travaux soient à huis clos, de façon que nous puissions parler sans détour avec les décideurs et qu’il n’y ait pas de grand exposé sur qui a été responsable de quoi. Cette audition est publique et vous avez tout à fait le droit de parler quarante minutes ; vous êtes d’ailleurs sans doute dans votre rôle en faisant cela.
Vous avez indiquez que vous ne partiez pas des failles mais des faits. Quand un attentat terroriste fait 150 morts, c’est un échec. Quand le crime a été commis, le système a été défaillant. La gageure, en matière terroriste, consiste à défaire les attentats avant qu’ils se produisent. Il ne s’agit pas pour nous de remettre en cause la qualité et le dévouement des hommes, car nous avons au contraire de la gratitude et du respect pour tous ceux qui servent notre pays, mais, face à 147 morts, onze attaques contre la France en 2015, on est en droit de se demander ce qui ne va pas. Vous étiez sur la défensive, pointant du doigt les Européens ou la réforme des RG de 2008.
Nous savons qu’il existe deux formes d’attaques contre notre pays : il y a, d’une part, des gens qui se radicalisent tout seuls, soit en prison soit devant leur écran, et vont poignarder un soldat ou un policier – c’est typiquement le genre de choses qui se produisent aussi en Israël et sont très difficiles à prévenir – et, d’autre part, des opérations complexes téléguidées par des cerveaux à Mossoul, à Raqqah, dans les Émirats ou en Arabie saoudite, avec des artificiers quelque part en Belgique ou ailleurs et la piétaille des soldats qui commettent les attentats en France. Il faut que les services français soient capables de travailler ensemble et avec leurs homologues européens.
On sait que quelque 5 000 Russes sont aujourd’hui en Syrie, des Tchétchènes, et il y a des Tchétchènes en France aussi. Quelque 5 000 citoyens européens se trouvent en Syrie ou en Irak, dont au minimum 1 600 Français. Invoquer le fait que nos services ne peuvent surveiller des citoyens non français n’est pas une bonne réponse ; il faut être capable de travailler sur l’ensemble du spectre, en sachant que plus nous serons efficaces à Raqqah ou Mossoul au plan militaire, plus nous risquons de voir revenir ces gens en grand nombre.
Hier, j’ai rapporté, à ma demande, une convention sur l’agence de Strasbourg qui gère Eurodac, VIS, Schengen, SIS 2, et devra gérer tous les autres systèmes qui vont théoriquement arriver. Cela ne fonctionne pas. Nous donnons nos fiches S au système Schengen mais les autres, à commencer par les Belges, ne le font pas. Un Big Bang européen doit avoir lieu. Cela dépend de la volonté politique du Gouvernement français. Il est entré, sans contrôle, 1,8 million de personnes en Europe l’an dernier, dont des terroristes qui ont frappé en France. Les systèmes de contrôle ne fonctionnent pas. Il faut, je vous rejoins, des contrôles biométriques. Tout est à faire mais nous sommes au point mort au plan européen. Cela fait des mois que j’entends dire qu’il y aura Frontex ou que SIS 2 va être renforcé, mais rien ne se passe. Il a fallu cinq ans pour mettre le PNR en place. À ce rythme, nous subirons de nombreux autres attentats.
En dehors du fait que la coordination européenne doit progresser, des questions se posent aussi sur le fonctionnement interne de nos services, à la suite d’affaires concernant des citoyens français, tels que Coulibaly ou les frères Kouachi, des gens radicalisés en prison, qui ont été écoutés et dont les écoutes ont été interrompues. Avez-vous les moyens d’écouter les gens ? Pourquoi les écoutes des frères Kouachi ont-elles été interrompues ? Si ces écoutes ne donnaient rien, s’est-on demandé si c’était parce qu’ils utilisaient d’autres moyens de communication ?
Ce ne sont pas des critiques politiques, mais je suis inquiet devant l’ampleur du problème, le nombre de gens concernés, les dispositifs inexistants en Europe et les moyens que je trouve perfectibles du côté français.
Il se pose aussi la question des opérations : comment utiliser la force, qui doit l’utiliser… Est-il raisonnable de demander aux militaires de faire un travail de police ?
M. Georges Fenech. Merci d’avoir rappelé que nous ne faisons pas de politique dans cette Commission.
M. Meyer Habib. Les travaux de cette Commission sont en effet conduits dans un esprit non partisan.
Vous avez, monsieur le ministre, tenu une réunion le 19 avril à Beauvau et pris l’initiative de réorganiser les services. Lors d’une première audition, vous avez indiqué que vous étiez favorable à un changement de doctrine d’intervention, et vous avez essayé de le mettre en place, en prévoyant en particulier une intervention sur les lieux en vingt minutes maximum. Vingt minutes, cela reste beaucoup. Entre le début des coups de feu au Bataclan et le premier tir de la police, il s’est passé moins de quinze minutes, mais cela a suffi à faire près de cent morts. Ne pourrait-on prévoir que le primo-intervenant ait la possibilité et même le devoir de tirer ? Avec la guerre que nous connaissons aujourd’hui, il faut aller plus loin.
L’aéroport Charles de Gaulle n’est pas suffisamment sécurisé, ainsi que l’écrasante majorité des aéroports en Europe. Nous avons passé une demi-journée à l’aéroport Ben-Gourion. Il y a aujourd’hui à Charles de Gaulle des militaires et plus de policiers, mais on ne peut rien faire contre quelqu’un qui viendrait se faire exploser avec une valise piégée. Il faut un premier cercle hermétique à quelques kilomètres de l’aéroport, avec un contrôle de toutes les voitures par des hommes et des caméras examinant les plaques minéralogiques.
Il faut en outre contrôler le personnel de l’aéroport et le catering à destination des avions : l’empoisonnement d’un pilote peut transformer un avion en arme de destruction massive. Ne convient-il pas également d’envisager la présence d’un policier en civil armé dans chaque avion d’Air France ? Les terroristes du 11 septembre 2001 n’étaient pas armés mais ils ont détourné des avions pour en faire de véritables bombes.
Je suis député, entre autres, de Franco-Turcs. Contrairement à ce que peut penser Mme Merkel, je considère que le fait de supprimer les visas, comme le souhaite à tout prix M. Erdogan, pour les ressortissants turcs est une très mauvaise idée.
Enfin, je suis inquiet de la doctrine d’une partie des Frères musulmans, telle qu’on la trouve au sein de l’Union des organisations islamiques de France (UOIF). Même s’ils ne sont pas dans leur écrasante majorité des gens dangereux, leur discours est parfois contraire aux valeurs de la République et à notre pratique de la laïcité. Si le danger n’est pas immédiat, la question doit tout de même être traitée dès à présent.
M. le président Georges Fenech. Il vaut mieux, monsieur le ministre, réserver votre réponse sur les forces d’intervention, qui feront l’objet d’une seconde série de questions.
M. le ministre. Son rôle de chef de file conduit la DGSI à centraliser les informations en matière de sécurité intérieure. Elle a besoin pour cela de recueillir des informations émanant d’autres services que ceux du ministère de l’intérieur. C’est dans cet esprit qu’a été créée la structure Allat. Des mouvements suspects sur des comptes bancaires, par exemple des déclenchements de crédits à la consommation, peuvent révéler, chez certains publics, l’intention de commettre des actes terroristes ou une volonté de départ, et des relations avec Tracfin ou les douanes sont à ce point de vue très utiles.
Ce ne sont pas les services qui sont destinataires des notes blanches ; ils en sont les émetteurs, à destination des juges. Lorsque, dans le cadre de mesures de police administrative, le juge administratif doit apprécier la pertinence de ces mesures, les services lui communiquent des notes blanches en appui de la mesure prise par l’administration.
M. Christophe Cavard. Les notes blanches ne parviennent pas toujours au juge et notamment au pôle antiterroriste, nous a-t-il été dit. En revanche, elles arrivent toutes d’un seul coup lors d’un événement dramatique.
M. le ministre. La difficulté, c’est que les notes blanches permettent de communiquer des informations sur le fondement desquels une décision de police administrative a été prise mais que la communication de certains éléments peut obérer les enquêtes ultérieures. C’est pourquoi il est prévu dans la loi relative au renseignement une formation spécialisée du juge administratif du Conseil d’État, qui pourra connaître de la totalité des informations. Le juge administratif est désormais aussi exigeant sur les mesures de police administrative que le juge judiciaire sur les mesures concernant des individus judiciarisés ; il faut s’adapter à cette jurisprudence.
Il est nécessaire de renforcer la coopération au sein d’Europol. Nous déléguons dans cette organisation nos meilleurs policiers et communiquons l’ensemble des informations dont nous disposons pour lutter contre les organisations internationales du crime. Nous sommes parmi les pays européens les plus enclins à conforter Europol dans son rôle.
M. Pierre Lellouche. Un des points examinés lors de l’examen du système Schengen, c’est qu’Europol consulte très peu les systèmes d’information européens : de mémoire, ce sont 740 consultations par an. Est-ce parce que ces systèmes ne sont pas bons ? Il n’existe même pas de classification « terroriste » à l’intérieur du système Schengen.
M. le ministre. Je commencerai par répondre à vos autres questions.
En ce qui concerne, tout d’abord, l’état d’esprit qui est le mien, je n’ai jamais dit que cette Commission poursuivait des objectifs politiques ou partisans, mais si vous m’expliquez tous que ce n’est pas le cas je vais finir par avoir des doutes. J’ai simplement souhaité pouvoir aller au bout de mon propos car j’estime utile de profiter de ces échanges pour vous communiquer les informations dont je dispose. Je ne suis pas du tout sur la défensive, mais j’ai l’obsession des faits car, sur ces questions extrêmement complexes, il y a trop d’approximations.
Ma position ne consiste nullement à dire que la France n’a rien à se reprocher et que tout est la faute de l’Europe. J’ai expliqué ce que nous avions fait et à faire en France en matière de renseignement, comme recruter des contractuels pour analyser la masse d’informations et mieux appréhender la réalité des risques, un domaine dans lequel nous avons beaucoup de retard. Je souhaite simplement que les sujets que nous traitons soient les vrais sujets. Dans votre question, monsieur Lellouche, vous en avez pointé beaucoup.
Les sujets sur lesquels nous sommes en retard au plan européen sont nombreux. Sur ces sujets, la France est très déterminée et active. Il a été question du contrôle aux frontières pendant des années et il ne s’est effectivement rien passé, mais nous venons justement de prendre une décision et nous avons débloqué des financements : nous avons décidé d’augmenter de 250 millions d’euros le budget de FRONTEX. C’était une demande de la France. C’est une première étape mais cela ne suffira pas, et c’est pourquoi j’ai proposé de déléguer 120 policiers de la police aux frontières – nous sommes même prêts à aller jusqu’à 200 – en Grèce, pour garantir que les contrôles seront effectués. Une grande confiance n’exclut pas une petite méfiance. J’ai également délégué quatre-vingts personnes à l’EASO (European Asylum Support Office).
Ce que vous avez dit sur le SIS est juste. Nous avons obtenu lors de l’avant-dernier Conseil JAI la connexion des fichiers : SIS, SLTD, EURODAC… Nous nous battons pour que la décision soit appliquée.
M. Pierre Lellouche. Vous pourriez expliquer ce qui s’est passé à Cambrai le lendemain de l’attaque du 13 novembre, quand la gendarmerie a arrêté Abdeslam en train de remonter vers la Belgique et interrogé le fichier Schengen. Cela montre la déroute des systèmes d’information européens.
M. le ministre. Il faut que le Système d’Information Schengen – je l’ai dit dans mon propos introductif – soit alimenté de façon homogène et identique par tous les pays de l’Union européenne. Si le fichier est incomplet et qu’une personne n’y est pas signalée comme présentant un risque terroriste, le consulter ne sert à rien.
La France signale des individus comme radicalisés ou terroristes. Le fichier donne la conduite à tenir ainsi que le motif de cette conduite à tenir, ce qui permet d’appeler la vigilance des services de contrôle. Nous alimentons beaucoup le SIS 2, avec tout le débat que cela suscite sur les fiches S. On me demande maintenant de contrôler les fiches S à l’entrée des « fan zones » afin d’empêcher les personnes d’y pénétrer, mais si vous informez quelqu’un qu’il fait l’objet d’une fiche S à l’entrée d’une « fan zone », vous pouvez supprimer ces fiches car elles n’auront plus d’intérêt en termes de suivi et de renseignement. Les pays qui voient ces débats chez nous ne sont pas incités à alimenter le SIS. C’est aussi pourquoi la consultation du SIS à Cambrai ne fait pas apparaître le caractère terroriste de la personne arrêtée.
Le SIS 2 est alimenté par les vingt-six États membres de l’espace Schengen ainsi que par la Roumanie, la Bulgarie et le Royaume-Uni. Les combattants étrangers sont spécifiquement signalés, à travers l’article 36-3 du SIS, par des données issues du renseignement. L’article 37-2 prévoit par ailleurs un signalement pour la répression d’infractions pénales et la prévention du crime, alimenté par les services judiciaires. Des progrès doivent être faits en ce qui concerne l’alimentation du fichier.
Les frères Kouachi ont été mis sur écoute dans le cadre d’interceptions de sécurité administratives, autorisées par la CNCIS, pendant quelque quatre ans. Ces interceptions n’ont rien donné. Compte tenu de ce fait, la CNCIS a indiqué, dans sa dernière autorisation, que ce serait la dernière si celle-ci ne donnait toujours rien. C’est ce qui s’est passé.
M. Pierre Lellouche. Vous savez que notre Commission a contredit la version de M. Calvar sur ces écoutes.
M. le président Georges Fenech. Pour que les choses soient bien claires : la CNCIS n’a jamais refusé une autorisation ?
M. le ministre. M. Delarue s’est exprimé sur ce sujet. La CNCIS n’a pas eu à dire non car elle a indiqué que ce serait sa dernière autorisation si celle-ci ne permettait pas d’obtenir quelque chose.
M. Pierre Lellouche. Ce n’est pas une décision que la CNCIS peut prendre. Elle n’a pas à contrôler l’opportunité.
M. le président Georges Fenech. C’est un élément nouveau, et important, que vous apportez. Nous avons entendu hier le garde des sceaux hier et n’avons pas eu cet élément.
M. le ministre. Ce sont les informations dont je dispose.
En ce qui concerne Coulibaly, le problème, que nous avons commencé à régler avec le garde des sceaux, est qu’il faut une plus grande communication entre le renseignement pénitentiaire et le renseignement intérieur. Lorsque les individus sortent de prison, nous devons être systématiquement informés de ce qu’a été leur comportement, de manière que le renseignement intérieur prenne le relai du renseignement pénitentiaire. L’insuffisante coordination entre les deux est une faille.
M. le président Georges Fenech. Comment se traduit la continuité entre milieu fermé et milieu ouvert ?
M. le ministre. Par deux choses : d’une part, la montée en puissance, voulue par Jean-Jacques Urvoas, du renseignement pénitentiaire et, d’autre part, une articulation entre la chancellerie et le ministère de l’intérieur par laquelle la chancellerie, quand des individus dangereux sortent de prison, en informe l’intérieur afin que celui-ci prenne le relai. Et nous avons introduit l’administration pénitentiaire dans les groupes d’évaluation locaux autour de ce qui se fait avec l’EMOPT, de manière à fluidifier la communication.
En ce qui concerne la sécurité dans les aéroports, nous avons pris de nouvelles dispositions. Nous avons d’abord considérablement renforcé les effectifs et les moyens. Au-delà des unités de forces mobiles et les militaires de Sentinelle, signalons une augmentation des effectifs de la police aux frontières, une modernisation des équipements pour améliorer l’efficacité du contrôle, et l’interrogation du SIS sur les aéroports. Nous avons également renforcé les moyens de la gendarmerie des transports aériens (GTA), de la compétence de laquelle relèvent l’espace des pistes et le contrôle autour des avions. Cela nous a d’ailleurs récemment permis de faire assez rapidement le point s’agissant de l’avion d’EgyptAir au départ de Paris. Nous avons notamment une idée très précise des personnes qui sont intervenues, car nous avons clarifié les compétences de chacun et mis en place des dispositifs garantissant la traçabilité de l’intervention des acteurs sur les aéroports afin de pouvoir être informés et améliorer les dispositifs préventifs.
M. le président Georges Fenech. Avant d’aborder la question des forces d’intervention, nous souhaiterions un éclaircissement. Vous avez déclaré que d’ici à la fin du quinquennat, et en ajoutant les 900 postes supplémentaires créés dans le cadre du plan de lutte contre l’immigration clandestine, ce sont 9 000 emplois qui auront été créés dans la police et la gendarmerie. Or le rapport de la Cour des comptes sur l’exécution budgétaire fait état de 240 298 ETP en 2011 et de 239 470 en 2015, soit une réduction du nombre d’ETP de 828. Ce n’est pas cohérent avec les augmentations que vous annoncez, mais sans doute quelque chose nous échappe-t-il.
M. Olivier Marleix. Sur la question des effectifs, je vous donne bien volontiers acte, Monsieur le ministre, de votre volonté de renforcer ces effectifs, au moins depuis 2015, notamment dans le cadre du plan de lutte contre le terrorisme – 500 emplois supplémentaires par an sur trois ans. Cependant, la Cour des comptes montre qu’en réalité cet effort est quelque peu contrebalancé par des départs à la retraite plus nombreux que prévu dans la gendarmerie – près de 400 départs à la retraite. Quelle que soit votre bonne volonté, notamment en cette année 2015 et probablement encore en 2016, quel que soit l’effort particulier fait pour renforcer les moyens du renseignement, le solde global des effectifs des forces de l’ordre montre au moins une inertie, une difficulté dans l’exécution. Le président, l’a dit, la Cour des comptes dénombrait, dans ses rapports annuels de performance, 239 470 ETP à la fin de l’année 2015, alors qu’il y en avait 240 298 en 2011. Je parle bien d’emplois consommés, pas de plafonds d’emplois. Voilà qui n’est pas tout à fait cohérent avec les chiffres sur lesquels vous aimez communiquer, que vous nous avez rappelés.
Je voudrais prolonger la question du rapporteur sur la réforme du renseignement – « votre » réforme. Vous n’hésitez pas, monsieur le ministre, à être sévère avec vos prédécesseurs, à l’exception de votre prédécesseur immédiat – prudence que je peux comprendre. Aujourd’hui, le service du renseignement territorial est intégré à la direction centrale de la sécurité publique (DCSP) et, dans nos départements, les fonctionnaires du renseignement territorial sont sous l’autorité des directeurs départementaux de la sécurité publique. Cependant, avec votre réforme du renseignement, qui est aussi celle de votre prédécesseur, la direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) est devenue autonome par rapport à la direction générale de la police nationale (DGPN). Autrefois, le directeur général de la police nationale coordonnait l’ensemble des informations : ce que vous avez appelé vous-même le haut du spectre, qui émanait de la direction centrale du renseignement intérieur (DCRI), et le bas du spectre, qui émanait des services territoriaux de renseignement. Aujourd’hui, le haut du spectre relève de la DGSI, et le bas du spectre du service territorial de renseignement, intégré à la sécurité publique. Votre réforme n’a-t-elle pas créé un hiatus qui justifie, finalement, la création de cet état-major opérationnel pour la prévention du terrorisme (EMOPT), aujourd’hui seul à même d’assurer cette coordination autrefois faite assez naturellement par le directeur général de la police nationale ? J’aurais voulu quelques éléments prospectifs sur la question. D’un point de vue structurel, ce cloisonnement entre DGSI et DGPN sera-t-il vraiment approprié à terme, lorsque le ministre de l’intérieur ne s’occupera plus forcément quotidiennement des questions qui nous préoccupent aujourd’hui ?
M. le ministre. Monsieur le député, je ne reprendrai pas le débat que nous avons eu au moment de l’examen de la loi de finances initiale mais je vous ferai parvenir cet après-midi une note extrêmement complète qui montre qu’il n’y a pas décalage entre les chiffres de la Cour des comptes et les miens. Simplement, des crédits ont été transférés d’une ligne à l’autre et l’on travaille sur des périmètres différents. C’est pourquoi les chiffres consolidés sont ceux que vous citez.
Un chiffre confirmera notre sincérité budgétaire : lorsqu’en 2012, vous avez quitté le pouvoir, il y avait 500 élèves dans les écoles de police par an – je me rends d’ailleurs cet après-midi à celle d’Oissel – il y en a aujourd’hui 4 600, et l’on peut en dire autant pour la gendarmerie. Nous avons multiplié par dix le nombre d’élèves dans les écoles. À la fin du quinquennat, 9 000 postes nouveaux auront bel et bien été créés dans les services de police et de gendarmerie. Je vous remets d’ores déjà un document budgétaire extrêmement précis du ministère de l’intérieur, qui en détaille la ventilation, qui précise les emplois créés et exécutés, les évolutions budgétaires et les crédits hors T 2.
Autonomie de la DGSI ou pas, la coordination s’impose, monsieur Marleix. Les échanges d’information réguliers entre les services ne sont effectivement pas dans la culture du ministère de l’intérieur. Ils ne sont possibles qu’avec un pilotage très serré, avec l’organisation d’échanges d’informations. Je n’ai pas créé l’EMOPT parce que nous avons créé la DGSI. Dans le contexte actuel, nous aurions eu besoin d’organiser ce dispositif d’échange d’informations même dans une configuration comme celle qui existait avant la création de la DGSI ou avant la réforme du renseignement territorial de 2008. Et je suis absolument convaincu que les ministres de l’intérieur qui me succéderont, quelle que soit leur sensibilité politique, veilleront, face à une telle menace terroriste, à ce que l’échange d’informations soit continu et organisé.
M. le président Georges Fenech. Nous arrivons aux questions relatives aux forces d’intervention et de secours.
Nous avons suivi, de l’extérieur, une simulation à la gare Montparnasse – vous nous y aviez invités, mais nous n’avons pu nous y rendre. Vous avez revu les doctrines d’emploi des primo-intervenants, notamment en équipant les brigades anticriminalité et les pelotons de surveillance et d'intervention de la gendarmerie (PSIG) dits « Sabre » de matériel adapté pour leur permettre d’intervenir immédiatement sans attendre l’arrivée des forces d’élite. Quel est le niveau d’implication sur l’ensemble du territoire de ces forces, qui existent déjà mais dont le rôle et la définition ont changé ? Pourquoi ne pas l’avoir fait plus tôt ?
Nous n’arrivons pas vraiment à comprendre ce que la remise en cause du critère de territorialité d’intervention des trois forces – BRI, RAID et GIGN – change vraiment. La BRI de Paris n’est-elle plus la seule qui puisse intervenir dans sa zone de compétence territoriale ? Comment cette intervention première s’organisera-t-elle entre GIGN et RAID ? Il y a forcément une logique, mais quelle est-elle précisément ?
Question beaucoup plus générale, souvent posée : ne pourrait-on pas imaginer une force d’élite unique ?
M. Pierre Lellouche. Au sujet des forces d’intervention, vous avez pris toute une série de décisions, monsieur le ministre, mais nous aimerions savoir ce qu’il en est aujourd’hui de votre doctrine. Tout d’abord, du point de vue du système de commandement, que se passe-t-il en cas d’attaque ? Il y eut beaucoup de flottement, le 13 novembre – des chefs de service nous ont dit avoir appris les événements en écoutant BFM. La question est-elle réglée ? Nous avons par ailleurs noté, au début, des rivalités entre forces d’intervention spécialisées. Vous y avez sans doute mis bon ordre, mais la question de M. président de la commission d’enquête est extrêmement pertinente : pour plus d’efficacité, ne faut-il pas une seule force, comme dans d’autres pays ?
Que prévoyez-vous, ensuite, en ce qui concerne la préparation des forces de police « de base », celles qui arrivent tout de suite et évitent un grand nombre de morts ? Je vous rappelle qu’un héros a changé la donne au Bataclan. Ne faut-il pas créer une sorte de « super-BAC » dotée de moyens de nature à éviter un grand nombre de morts dans les premières minutes, décisives ?
J’en viens à l’opération Sentinelle. Le moins que l’on puisse dire, c’est que les conditions d’emploi des soldats n’étaient pas franchement claires, y compris devant le Bataclan. Sans doute avez-vous aussi réglé cela mais, comme je l’ai dit hier soir au ministre de la défense, je n’en reste pas moins réservé au plus haut point sur l’utilisation des soldats pour des opérations de ce type : ils ne sont pas faits pour cela, ce n’est pas leur métier. Il faut évidemment rassurer et prendre des mesures de sûreté immédiates, mais, à terme, ce n’est pas jouable d’utiliser, pour surveiller des aéroports ou monter la garde dans les rues de Paris, des soldats habituellement en mission en Afghanistan ou au Mali. Ils ne sont pas formés pour ce travail de police. En outre, nous ne leur rendons pas service : le temps d’entraînement de nos forces militaires, à qui il est ainsi beaucoup demandé, se trouve en effet réduit.
Par ailleurs, il a fallu plus de deux heures ou deux heures et demie avant que les forces de secours n’interviennent au Bataclan. La doctrine d’emploi des forces de secours va-t-elle changer ? Je sais que vous y avez beaucoup travaillé : pouvons-nous aujourd’hui être à peu près sûrs qu’il n’est plus possible d’entrer dans Paris pour mitrailler des terrasses et d’en repartir sans être neutralisé ? Pardon de vous poser la question aussi directement, mais ce sont précisément ces faits extrêmement choquants qui se sont produits et qui ne sont pas pensables dans d’autres capitales. De même, saurait-on réagir autrement en cas de prise d’otages dans un bâtiment accueillant du public ? Disant cela, je n’entends nullement prononcer un réquisitoire. Il est normal qu’un certain temps d’adaptation soit nécessaire à une démocratie en paix, lorsqu’elle est confrontée à de tels événements.
Tel est le sujet qui nous a occupés ces derniers mois, et qui vous occupent en permanence. Cela implique de revoir la formation des hommes, leur équipement, leur commandement. Il ne doit plus être possible que quelques types armés de kalachnikovs aient le temps de tuer des dizaines et des dizaines de personnes, avant de quitter la capitale.
M. le ministre. Je suis très soucieux de dire la vérité aux Français. Quel que soit le gouvernement et quelque dispositif qu’il mette en œuvre, il ne pourra garantir, en France ou ailleurs en Europe, qu’on ne peut entrer dans une capitale avec des armes. À moins d’instaurer un contrôle généralisé, cela pourra toujours arriver. Il est important d’expliquer rigoureusement et précisément toutes les dispositions prises pour éviter que cela ne se produise mais, pour ma part, je ne prétendrai jamais, ni devant votre commission ni devant les Français, que les meilleures précautions nous apporteront cette garantie. La liberté de circulation qui règne en France et en Europe n’empêche pas de contrôler des véhicules susceptibles de contenir des armes mais, à moins de contrôler en permanence tous les véhicules sur tous les axes routiers et dans toutes les rues des capitales, je ne vois pas comment garantir que de tels événements ne se reproduiront pas.
Nous pouvons lutter résolument contre le trafic d’armes pour qu’il n’y ait aucune arme dans les véhicules circulant dans les capitales d’Europe ; nous nous y employons et vous savez que j’ai engagé un combat au sein de l’Union européenne pour la modification de la directive 91/477 relative au trafic d’armes. Nous pouvons également nous mobiliser pour que nos forces de sécurité soient rééquipées, dotées de moyens modernes qui leur permettent de réagir en cas de tueries de masse ; c’est notre devoir de le faire, et nous le faisons. Nous pouvons aussi développer nos moyens de renseignement de manière à mieux connaître la réalité des intentions de ceux qui entrent sur le territoire de l’Union européenne avec des objectifs criminels, même si nous sommes confrontés – la vérité m’oblige à le dire – au chiffrement des messages, problème considérable pour tous les services de renseignement.
Mais je ne peux affirmer que les événements que nous avons connus ne pourront plus se produire en France ou dans d’autres pays européens. Je ne veux pas mentir aux Français, et je suis peut-être le mieux placé pour savoir qu’il peut y avoir d’autres attaques en dépit de l’activité très intense des services et des dispositions que nous prenons. Nous sommes face à des groupes barbares, déterminés, qui veulent nous livrer une guerre à tout prix et sont prêts à utiliser tous les moyens de la dissimulation pour y parvenir, en France et ailleurs. Le principe de réalité, de lucidité, d’humilité me conduit donc à dire que nous devons tendre à ce que vous demandez, nous devons faire le maximum d’efforts pour y parvenir, mais je ne peux rien garantir devant cette commission : le faire serait mentir et prendre le risque d’être démenti ultérieurement par les faits.
Je reviens sur le dispositif que nous avons arrêté. Mon objectif est de faire en sorte, dès lors que des tueries de masse sont possibles, que l’État soit organisé pour pouvoir intervenir dans les délais les plus brefs afin que le maximum de vies soit épargné. Nous n’étions pas en situation de le faire, pour plusieurs raisons. D’abord du fait d’un sous-équipement des PSIG et des brigades anticriminalité, dont nous avons vu le 13 novembre qu’elles sont parfois les premières en mesure d’agir – vous avez souligné à juste titre le courage des policiers de la BAC. J’ai donc pris des mesures en ce sens. Mais j’ai constaté au cours des derniers mois, notamment après l’affaire de l’Île-Saint-Denis et la très grave blessure dont a été victime le policier Yann Saillour de la BAC de Saint-Denis, que les décisions que j’avais prises de rééquiper ces BAC et ces PSIG, en changeant leurs moyens de protection, leurs casques, leurs armes, en les dotant de véhicules neufs, en permettant l’embarquement du HK G36, qui s’inscrivaient dans des procédures budgétaires classiques, impliquaient des délais trop longs. Nous avons donc décidé de mettre en place des procédures d’urgence pour que toutes les BAC et tous les PSIG soient équipés des nouveaux matériels avant la fin de ce mois de juin – la plupart le sont d’ores et déjà. Sans ces équipements, les primo-arrivants n’étaient pas en situation de faire le travail.
Je vous raconte une anecdote qui m’a beaucoup marqué et qui m’a poussé à tout accélérer en matière d’équipement des BAC et des PSIG. Lorsque je me suis rendu au chevet de Yann Saillour, j’ai vu un de ses collègues, qui avait un gilet pare-balles dans un état effrayant. Il m’a dit : « Monsieur le ministre, ce gilet ne me protège de rien, mais je le mets quand même car il est la seule garantie, s’il m’arrive quelque chose, que mon épouse pourra bénéficier de tout l’accompagnement social prévu et percevoir ma pension. » Quand vous êtes ministre de l’intérieur, que vous entendez cela, que vous voyez le niveau de sous-équipement des BAC et des PSIG, fruit d’années de non-investissement, vous ne pouvez que décider d’agir très vite pour les rééquiper.
S’agissant des forces d’intervention spécialisées, nous avons procédé à deux changements. Pour faire face à une tuerie de masse, il faut un réseau dense de forces spécialisées qui permette d’intervenir rapidement sur la totalité du territoire national. Il y avait vingt-deux unités d’intervention spécialisées : j’ai décidé d’en créer sept supplémentaires – quatre de la gendarmerie et trois de la police nationale – pour qu’avec les 750 unités d’intervention intermédiaire, c’est-à-dire les BAC et les PSIG, l’ensemble du territoire national soit couvert. C’est grâce à l’augmentation des effectifs que nous avons pu prendre une telle mesure. J’ai proposé d’autre part que ce soit la force la plus proche du territoire où se produit la tuerie de masse qui intervienne. Il y a eu sur ce point un débat, qui résulte d’une incompréhension totale du dispositif. Vous avez remarqué que j’ai placé des antennes du GIGN en zone police et des antennes du RAID en zone gendarmerie. L’idée est non pas d’organiser une compétition entre la BRI, le GIGN et le RAID mais de faire en sorte que la force la plus proche du lieu concerné intervienne ; il s’agit donc d’une clarification et non d’une mise en concurrence, comme j’ai pu le lire. L’objectif est d’avoir plus de forces, mieux réparties sur le territoire national, avec des règles d’engagement, sous l’autorité des préfets de zone, qui permettent de faire travailler les forces ensemble en évitant toute concurrence.
Il est un troisième sujet que j’ai souhaité traiter. Pierre Lellouche évoquait la guerre des polices… Je n’ai aucune naïveté et je sais que, malgré toute l’énergie que je déploie pour que cette réalité appartienne au passé, nombreux seront mes successeurs qui auront encore à lire des articles sur ce sujet. Cela fait partie de la culture d’une maison et, malgré de grandes améliorations, la maison s’emploiera à garder un peu de ce travers pour ne pas cesser d’être elle-même. Peut-être faudra-t-il des générations de ministres de l’intérieur pour parvenir à changer tout cela. Soyons humbles. Qu’ai-je proposé aux forces ? Toutes ont des compétences éminentes, mais dans certains secteurs précis certaines ont des compétences que n’ont pas les autres – je ne m’étendrai pas plus sur la question dans le cadre d’une audition publique, mais je peux communiquer ces éléments à la commission d’enquête, sous réserve qu’ils ne soient pas publiés pour ne pas compromettre l’efficacité de nos forces. J’ai donc demandé une analyse sectorielle et segmentaire de ces compétences, de manière que, notamment sur le territoire de Paris, une force puisse intervenir plutôt qu’une autre si elle dispose de la compétence requise pour garantir l’efficacité de l’intervention. J’ai également souhaité que nous puissions, en cas de tueries de masse et d’attentats multisites, engager toutes les forces indépendamment de leurs compétences géographiques, à Paris notamment, pour éviter des morts, et empêcher les auteurs des crimes de repartir. C’était l’objet de l’opération que nous avons menée gare Montparnasse. Voilà, très précisément et très concrètement, ce que nous faisons.
Pourquoi ne l’avons-nous pas fait auparavant ? Parce que nous avions jusqu’à présent procédé à des recrutements et des allocations de moyens budgétaires dans le cadre des procédures budgétaires de droit commun. Or je ne pouvais pas répartir sur le territoire national des effectifs que je n’avais pas. Ce sont les décisions de janvier 2015 de rehaussement significatif de nos effectifs, à hauteur de 1 500 postes, et les crédits débloqués qui m’ont permis de prendre, dans des délais très courts, des mesures indispensables pour lutter efficacement contre le terroriste. Il est faux de dire que ces décisions sont le résultat d’une réaction de l’exécutif aux attentats de novembre. Si en janvier 2015, et dès 2012 sur certains points, le Gouvernement n’avait pas pris la décision d’augmenter significativement les moyens des services de police et de renseignement, je ne serais pas aujourd’hui en situation d’organiser les choses comme je viens de les décrire.
M. le président Georges Fenech. Vous nous apprenez quelque chose qui me paraît très important, sur les capacités spécifiques de certaines unités, plus appropriées pour tel ou tel type d’attentat. Des distinctions sont donc opérées entre nos trois forces d’élite – je le comprends parfaitement.
À l’Hyper Cacher, vous avez mobilisé la force d’intervention de la police nationale (FIPN), qui a permis au RAID de mener l’opération. Pourquoi ne pas l’avoir fait au Bataclan, étant entendu que les uns et les autres peuvent avoir des capacités spécifiques ? Je ne mets pas en cause la qualité de la BRI, brigade antigang au départ, mais il y avait 1 500 personnes à l’intérieur du Bataclan. Pourquoi l’autorité de tutelle – vous-même, avec le préfet de police et le directeur général de la police nationale – n’a pas tenu compte de ces capacités spécifiques pour mobiliser la FIPN ?
M. Meyer Habib. Je vous ai bien écouté sur ce point, monsieur le ministre, mais la réponse ne me paraît pas suffisante. Je fais la distinction entre les événements de l’Hyper Cacher – il s’agit d’une prise d’otages, non d’une tuerie de masse, et on dispose d’un peu de temps pour attendre l’arrivée des forces d’intervention – et ceux du 13 novembre. Au Bataclan, et aux terrasses des cafés, c’était un massacre immédiat, qui ne laissait pas une seconde pour appeler BRI, RAID ou GIGN. Chaque minute qui passait entraînait plus de morts. La plupart des victimes ont été touchées dans le premier quart d’heure. Dans pareil cas, il n’y a qu’une seule solution : les primo-intervenants, qui seront peut-être des policiers « de base », doivent pouvoir y compris au péril de leur vie, évaluer la situation, aller au contact et tirer. On pourrait aussi imaginer que les fonctionnaires de police soient autorisés à rentrer chez eux avec leur arme à la fin de leur service.
Les mesures que vous avez prises vont dans le bon sens, mais ne seront utiles que si nous ne sommes pas en présence d’une tuerie de masse.
M. le ministre. Sur ces sujets, soyons extrêmement précis sur les conditions de droit et sur ce que nous faisons. Je ne veux pas qu’on donne le sentiment qu’en France on laisse les gens se faire tuer sans réagir.
En cas de tuerie de masse, demain, l’intervention des forces de l’ordre doit être immédiate et maîtrisée. On ne sait jamais en pareil cas si l’auteur des faits est équipé d’explosifs ni s’il existe un risque d’effets collatéraux. Intervenir, ce n’est pas simplement tirer sur des tireurs sans évaluer les conséquences : il faut un certain niveau de professionnalisme et des protocoles d’engagement précis ; sinon, nous ajouterons des mots aux morts.
Quel dispositif préconisons-nous pour répondre à la préoccupation que vous venez d’exprimer, M. Meyer Habib ? D’abord, nous avons articulé autour des préfets de zone et des préfets de département un dispositif extrêmement précis qui répartit les compétences. Les plus proches, qui ne sont pas forcément toujours armés pour faire face à une tuerie, c’est-à-dire les primo-arrivants, doivent sécuriser la zone, évaluer le risque, le comportement des personnes, et appeler immédiatement les brigades anti-criminalité et les PSIG. BAC et PSIG sont positionnés sur le territoire national de manière à pouvoir arriver le plus rapidement possible et sont désormais équipés de moyens qui leur permettent de faire face, dans l’attente de l’arrivée des forces spécialisées si leur mobilisation est justifiée par une prise d’otages, un risque de surattentat, etc. Tout cela fait l’objet de protocoles précis et implique une maîtrise opérationnelle totale. Je vous rappelle, monsieur le député, qu’une disposition adoptée lors du récent examen du projet de loi renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, définit très précisément les conditions dans lesquelles les policiers peuvent engager le feu en cas de tuerie de masse. Ces mesures, protectrices des policiers, leur permettent d’intervenir dans des conditions beaucoup plus solides que celles qui prévalaient jusqu’à présent. Ces nouvelles conditions de droit, l’articulation entre primo-intervenants, primo-arrivants et forces spécialisées, le renforcement des forces spécialisées et des équipements des BAC et des PSIG doivent répondre à la préoccupation que vous exprimez.
Aujourd’hui, un policier qui intervient sur le site d’une tuerie de masse peut, compte tenu des dispositions législatives adoptées, ouvrir le feu pour faire cesser cette tuerie. Nous avons remaillé le territoire avec l’implantation des forces spécialisées et nous avons rehaussé le niveau d’équipement. Que signifie alors « aller plus loin » ?
Le président Fenech est revenu sur la question de l’intervention des différentes forces – BRI, RAID, etc. Les services du ministère de l’intérieur ont fourni une chronologie extrêmement précise de l’intervention. Le délai de deux heures et demie ne correspond pas à la réalité. J’ignore ce que votre commission fera des éléments que nous lui avons transmis. Je crois que vous vous êtes rendus, mesdames et messieurs, au Bataclan, où vous avez pu reparler avec les responsables du RAID et de la BRI. Ils ont montré que la BRI avait fait ce qu’elle avait à faire, et que, s’il avait été possible en la circonstance de sauver davantage de vies, bien entendu nous l’aurions fait. Votre commission a eu connaissance de toutes les informations dont nous disposions.
Y a-t-il des compétences spécialisées que nous aurions pu mobiliser ? Pas à cette occasion-là, mais cela peut arriver. Je ne veux pas m’attarder sur ce sujet publiquement mais je peux vous recevoir, monsieur le rapporteur, monsieur le président pour vous donner des exemples concrets que je vous demanderai de ne pas rendre publics – leur divulgation rendrait très difficiles l’action des forces spécialisées. Oui, chacune des forces a des compétences que les autres n’ont pas. Et si ces compétences doivent être mobilisées dans des conditions d’intervention particulières, je pense qu’il vaut mieux faire bloc.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, j’ai invité les trois patrons des services spécialisés à venir me voir, sans les directeurs généraux de la police nationale et de la gendarmerie nationale, sans le préfet de police de Paris. Je leur ai dit que, certes, il était possible de perpétuer la tradition de la « guerre des services », mais que le pays était confronté à une menace terroriste extrême et que les Français attendaient que la République les protège des terroristes. Dès lors que celle-ci parvient à le faire, ils ne se demanderont guère quelle entité spécialisée l’aura permis. Notre devoir ce n’est pas d’être forts séparément ou de prouver que tel peut être plus fort que tel autre : c’est d’être forts ensemble. Comme chacune des trois forces est excellente dans son domaine, soyons capables de mobiliser la force la plus à même d’intervenir dans un contexte particulier. Les autorités du ministère de l’intérieur, au premier rang desquelles moi-même, doivent pouvoir faire intervenir la bonne force au bon moment. Peu importe si le cas de figure est très marginal, il peut se révéler utile d’agir ainsi – la zone géographique concernée ne doit pas nous l’interdire.
M. le président Georges Fenech. Je vous ai interrogé sur la possibilité d’une force unique mais M. le rapporteur veut préciser la question.
M. le rapporteur. Monsieur le ministre, vous aviez écarté l’idée d’une fusion des trois forces, d’un « grand soir » en la matière. Cependant, ne pourrait-on envisager une telle fusion à l’avenir ?
Par ailleurs, l’unité de coordination des forces d’intervention (UCOFI) a été créée il y a quelques années. Avez-vous prévu de lui donner un plus grand rôle, par exemple en matière de formation ? Je sais qu’il existe d’ores et déjà des modules de formation communs, notamment entre la BRI et le RAID. Une montée en puissance de l’UCOFI est-elle envisageable pour éviter cette guerre des polices que nous avons sentie ?
Enfin, nous savons qu’un certain nombre d’exercices se déroulent pour faire face à d’éventuelles tueries de masse ou d’éventuels multi-attentats. Combien y en a-t-il eu depuis le 15 novembre ?
M. le ministre. En effet, monsieur le rapporteur, l’UCOFI monte sensiblement en puissance. Je lui ai précisément demandé de préfigurer la réforme que j’ai envisagée et de le faire en mobilisant les trois forces, les deux directions générales et la préfecture de police de Paris, de manière que la proposition ait été suffisamment préparée en amont. Il ne s’agit pas de décréter une meilleure coordination, encore faut-il la préparer pour que sa mise en œuvre ne soit pas un échec, auquel cas tout n’aura été que discours ou impulsion sans lendemain. L’UCOFI a été le maître d’œuvre de ce travail, l’ensemblier et l’interlocuteur des forces, auxquelles j’ai demandé d’articuler davantage leurs missions. C’est également à l’UCOFI que j’ai demandé de faire l’inventaire, en liaison avec les trois forces, des capacités rares dont j’ai parlé. C’est à elle de faire des propositions pour que je puisse prendre des décisions. Tout n’est pas achevé, mais ce travail progresse de manière très significative – sans compter que beaucoup de ce que je souhaitais voir mis en œuvre est déjà gravé dans le marbre.
Une fusion des trois forces n’aurait de sens que si elle permettait une amélioration générale par rapport à l’existant. Si des disparités de culture et de statut conduisent à remplacer trois forces qui marchent par une seule qui ne fonctionne pas, au plaisir bref d’avoir procédé à la fusion succéderont des difficultés opérationnelles pour l’éternité. Le grand soir est toujours très à la mode, il est toujours présenté comme la solution à tout. Je suis, pour ma part, extrêmement pragmatique et prudent. Je souhaite que les forces puissent travailler ensemble. Pour y parvenir, organisons-les de façon optimale, sur le territoire national et en termes de compétences. Je souhaite que les éventuels conflits cessent, et je dépense beaucoup d’énergie pour faire passer le message. Si cela fonctionne, nous passerons à une étape supérieure, mais, face à la menace terroriste actuelle, ne courons pas le risque de nous retrouver avec une force unique moins efficace que nos trois forces actuelles.
Ma démarche, extrêmement pragmatique, a consisté à répartir ces forces, à les faire monter en gamme en leur donnant des équipements et des effectifs supplémentaires, à redéfinir leurs conditions d’emploi, pour faire face aux conditions particulières de tueries de masse dans les grandes villes ou la capitale, ou pour mener des interventions sectorielles segmentées, avec la mobilisation de compétences spécifiques. Compte tenu du temps de maturation de ces différents sujets, ce n’est certainement pas moi qui mènerai cette fusion, qui pourra faire l’objet d’une réforme ultérieure si les conditions sont réunies ; nous avons déjà fait beaucoup de réformes.
Mme Françoise Dumas. Pour avoir participé à un certain nombre de déplacements à l'étranger, je peux témoigner de la très bonne appréciation dont bénéficient les services français ; ils y sont souvent loués. Ainsi, en Israël, les services de la police israélienne se félicitent de la qualité des relations qu’ils entretiennent avec nos services. D’une certaine façon, c’est extrêmement rassurant et je tenais à le souligner.
Je reste persuadée que la prévention et la permanence des personnels sont les deux outils d’une lutte efficace. C’est d’ailleurs ce qu’on nous a répété partout – Israël a, malheureusement, une expérience très ancienne en la matière. Grâce à la prévention, on peut agir à la source avant que les faits ne soient commis. Et rien ne remplace la relation humaine, qu’il s’agisse de renseignement ou de coordination entre les différents services, elle est plus importante que la technique. De même, la permanence des personnels sur le terrain est un atout. Vous vous êtes donné les moyens d’y parvenir. Vous avez en partie répondu aux questions que je me posais à propos du schéma d’intervention, au plus près du terrain, avec les BAC et PSIG. Quel est votre avis sur le niveau de la menace, en France et en Europe ? Comment la percevez-vous ? Les Français doivent s’habituer à cette notion de risque permanent, qui implique un plus grand civisme de la part de tous.
M. Christophe Cavard. Nous aimerions connaître votre sentiment sur le partage de la gestion de la sécurité avec le personnel de sociétés privées, notamment dans le cadre de l’Euro 2016. Les modes opérationnels des terroristes pourraient évoluer et nos services travaillent sur cette question, mais jusqu’à quel point notre sécurité intérieure peut-elle s’appuyer aussi sur des personnels qui, s’ils travaillent très bien, ne sont pas spécifiquement formés pour faire face à ces menaces ?
Quant à la question des primo-arrivants, une intervention trop rapide, directe, sur le théâtre d’actes terroristes, ne présente-t-elle pas des risques ?
Mme Anne-Yvonne Le Dain. J’aimerais en savoir plus sur la répartition des forces sur le territoire national, notamment dans le sud de la France, où des faits graves ont été commis il y a quelques années, sans parler du fait que beaucoup y sont tentés par un départ pour le djihad.
M. Pierre Lellouche. Une question me taraude depuis le début de nos travaux. Aux États-Unis, à la suite des travaux de la commission dite « du 11 septembre », les institutions ont été repensées, notamment le département de la sécurité intérieure des États-Unis.
Notre ministère de l’intérieur a son histoire, et exerce toutes sortes de métiers. Malheureusement, nous allons être confrontés pendant des décennies au terrorisme. Le ministère de l’intérieur ne devrait-il donc pas devenir le ministère de la sécurité intérieure, en laissant de côté un certain nombre de tâches plus administratives, qui touchent aux collectivités territoriales. Ne doit-il pas évoluer pour se concentrer sur la sécurité intérieure, du renseignement aux opérations, tandis qu’une autre instance piloterait le travail des collectivités, l’organisation des élections et ce qui relève, en réalité, d’un autre métier ? Il me semble qu’il gagnerait grandement en efficacité.
M. le président Georges Fenech. Monsieur le ministre, peut-être pourrez-vous conclure en évoquant la sécurité des « fan zones » ?
M. le ministre. Tout d’abord, le niveau de la menace reste extrêmement élevé, compte tenu du fait que 2 000 de nos ressortissants sont, de près ou de loin, concernés par les activités des groupes terroristes en Irak et en Syrie – 1 000 s’y sont rendus, dont certains sont morts et d’autres sont revenus. Par conséquent, le niveau de la menace terroriste est plus élevé qu’il ne l’a jamais été. Par ailleurs, ceux qui cherchent à nous frapper utilisent des moyens de dissimulation permis par une technologie qui a conduit les gouvernements de l’Union européenne à adapter les moyens des services de renseignement mais qui complique aussi considérablement le travail de ces services. Je pense à l’utilisation de faux documents et de moyens cryptés, à la dissimulation par le chiffrement des échanges et des conversations en vue de la commission d’actes terroristes, à l’utilisation de multiples puces ou de téléphones prépayés, à la possibilité de diffuser sur internet une propagande bien faite qui marque les esprits. Tout cela contribue à ce que la menace soit élevée. En outre, l’efficacité des frappes en Syrie peut conduire ceux qui sont frappés à vouloir intensifier leurs attentats.
Cette menace plus élevée que jamais mobilise entièrement le ministère de l’intérieur. Cela me conduit parfois à rappeler chacun à ses responsabilités lorsque des commentaires sont faits sur les forces de sécurité, par exemple dans le cadre des conflits sociaux actuels. Je souhaite que les forces de sécurité soient irréprochables, et aucun acte qui pose problème n’est laissé sans suite, mais je n’accepte pas pour autant qu’elles soient l’objet de campagnes. Mises à rude épreuve, elles font, avec les services de renseignement, un travail considérable pour assurer la sécurité des Français. Ce sont les mêmes forces qui protègent les édifices publics et, parfois, sont chargées du maintien de l’ordre ; n’étant pas extensibles à l’infini, nos effectifs sont l’objet d’énormément de sollicitations. Dans ce contexte, j’essaierai toujours de faire prévaloir les principes de sagesse et de responsabilité sur l’outrance. Cela me conduit à être extrêmement rigoureux sur chaque sujet. S’il y a des manquements parmi les forces de sécurité, il faut prendre toutes les dispositions, et l’inspection générale de la police nationale (IGPN) fait un travail remarquable, mais les manquements de quelques-uns ne doivent pas conduire à des campagnes qui nuisent à la réputation de tous les autres, qui sont en première ligne. C’est très injuste, et tout à fait irresponsable. Là aussi, la vérité doit conduire à convoquer d’autres arguments et développer d’autres discours.
L’Euro se rapproche. Si, sous le prétexte que la menace est élevée, nous y cédons en cessant d’être nous-mêmes, alors nous organisons la victoire des terroristes. Aucun gouvernement ayant la passion de la France et de la République ne le ferait, qu’il soit de droite ou de gauche. Mais, dès lors que nous prenons la décision de rester nous-mêmes, il faut bien entendu que nous prenions toutes les précautions. Les « fan zones » sont sécurisées par une mobilisation exceptionnelle de nos services dans un contexte où ils sont déjà très sollicités. Cela implique chaque maire de chaque ville, et l’ensemble des maires, regroupés dans une association présidée par Alain Juppé. Je dois présenter avec lui la semaine prochaine, devant la commission des lois, les dispositions que nous avons prises en vue de la sécurisation de l’Euro 2016. Sachez que des forces significatives seront mobilisées – près de 90 000, incluant d’ailleurs les agents de sécurité privée. Les clauses contractuelles sur lesquelles la France s’est engagée en 2009 seront scrupuleusement respectées. À ces engagements de notre pays devant les instances du football s’ajoutent des précautions supplémentaires que nous avons prises compte tenu du contexte. Je détaillerai devant la commission des lois la répartition de ces 90 000 personnes entre les unités de forces mobiles et le reste de la sécurité publique, entre sécurité publique et sécurité privée. Je reviendrai sur la répartition des compétences entre les stades, les fans zones et le reste des espaces, sur lesquels s’exerce une compétence spécifique de chaque organisation et de chaque structure.
En ce qui concerne les agents de sécurité privée, notamment pour l’Euro, 100 % de précautions sont prises pour veiller à l’efficacité du dispositif et éviter son contournement. Cela garantit l’efficacité de notre action, qui a mobilisé beaucoup de moyens et beaucoup de services au sein du ministère de l’intérieur.
Comment les forces sont-elles réparties dans le sud de la France, madame Le Dain ? Je vous remets, ainsi qu’au président et au rapporteur, une carte précise de la répartition des forces sur le territoire national. Vous aurez ainsi une réponse détaillée.
Monsieur Lellouche, je pense que l’efficacité de notre action de lutte contre le terrorisme dépend de notre capacité à faire en sorte que le ministère de l’intérieur soit le ministère de la sécurité mais aussi celui de l’État. J’entends par là : le ministère de l’organisation territoriale de l’État et de ce qui exerce une autorité sur elle dans les territoires, par conséquent le ministère des préfets. Ceux-ci sont fortement mobilisés sur les enjeux de la lutte antiterroriste, tout comme les administrations des préfectures. Je prendrai des exemples très concrets : les services des préfectures qui assurent le contrôle des armes ou sont chargés de la lutte contre la fraude à l’identité sont absolument stratégiques pour la lutte antiterroriste. Le périmètre du ministère de l’intérieur peut être l’objet d’une réflexion politique, intellectuelle, au cours des prochaines années, mais, si on me demande mon avis au moment où je quitterai mes fonctions, je préconiserai surtout que le ministère de l’intérieur soit non pas simplement celui de la sécurité mais celui de l’État, en incluant la dimension sécurité des missions du ministère de l’intérieur. L’articulation entre la place Beauvau, les préfets, les territoires et l’administration territoriale est déterminante pour le succès de la lutte antiterroriste, y compris en matière de sécurité civile. Les services départementaux d’incendie et de secours (SDIS), les militaires de Nogent-le-Rotrou, tout cela doit rester entre les mains du ministère de l’intérieur, avec un souci d’efficacité absolue. Par ailleurs, je tiens beaucoup à ce que le ministère de l’intérieur reste celui des valeurs et des libertés publiques. Notre action en matière de sécurité doit être constamment guidée par le souci des libertés publiques.
M. le président Georges Fenech. Monsieur le ministre, je tiens à vous remercier de nous avoir consacré trois heures. Avec votre audition se terminent presque nos travaux. Il nous reste à nous rendre à Washington, et à entendre votre collègue secrétaire d’État aux victimes. Symboliquement, il nous a paru important en effet de terminer par son audition, comme il nous avait paru important de commencer par celle des victimes. Nous avons toujours eu à l’esprit le travail de vérité dû aux victimes et aux Français. Soyez assuré également que précision et rigueur – vous avez employé les termes à plusieurs reprises – feront la qualité des travaux du rapporteur, dont je tiens aussi à saluer le dévouement, de même que je salue celui de tous les membres de la commission d’enquête ici présents. Au-delà de la précision et de la rigueur, je demanderai au rapporteur, mais je suis certain qu’il le fera, d’être animé par le courage et l’audace, car il s’agit de la sécurité de nos compatriotes.
Audition, ouverte à la presse de Mme Juliette Méadel, secrétaire d’État chargée de l'aide aux victimes
Compte rendu de l’audition, ouverte à la presse, du jeudi 16 juin 2016
M. le président Georges Fenech. Mes chers collègues, nous sommes particulièrement heureux de recevoir Mme Juliette Méadel, secrétaire d’État chargée de l’aide aux victimes.
Nous vous remercions, madame, d’avoir répondu à la demande d’audition de notre commission d’enquête relative aux moyens mis en œuvre par l’État pour lutter contre le terrorisme depuis le 7 janvier 2015.
Nous avons entendu il y a deux semaines le garde des sceaux, le ministre de la défense et le ministre de l’intérieur. Nous avons décidé d’achever avec vous le cycle d’auditions ministérielles. Comme vous le savez, nous avons commencé nos travaux en entendant les représentants des victimes et de leurs familles, qui ont droit à toute la considération de la représentation nationale. Nous avons souhaité symboliquement les terminer en entendant le membre du Gouvernement chargé des victimes, nommé en février dernier. Madame la secrétaire d’État, nous attendons de vous un retour d’expérience de leur prise en charge, un bilan du rôle de la cellule interministérielle d’aide aux victimes – CIAV – et les éventuelles pistes d’amélioration que vous souhaiteriez présenter.
Je rappelle que cette audition est ouverte à la presse et fait l’objet d’une retransmission en direct sur le site internet de l’Assemblée nationale ; son enregistrement sera également disponible pendant quelques mois sur le portail vidéo de l’Assemblée nationale. Je vous signale que la commission pourra décider de citer dans son rapport tout ou partie du compte rendu qui sera fait de cette audition. Nous avons en effet décidé que, d’une manière générale, et quand cela ne soulèvera pas de difficulté pour les personnes entendues ou au regard de la confidentialité des informations recueillies, nos auditions seraient ouvertes à la presse car nous devons mener cette enquête dans toute sa transparence.
Conformément aux dispositions de l’article 6 de l’ordonnance du 17 novembre 1958 relative aux commissions d’enquête, je vais vous demander de prêter le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité.
Veuillez lever la main droite et dire : « Je le jure ».
Mme Juliette Méadel prête serment.
Je vais maintenant vous laisser la parole pour un exposé liminaire qui sera suivi par un large échange de questions et réponses.
Parmi ces questions, je peux d’ores et déjà citer : la prise en charge des victimes du 13 novembre dans les heures et les jours qui ont suivi ; les principaux enseignements des retours d’expérience effectués par la CIAV, après ces attentats ; le rôle qu’a pu jouer le Fonds de garantie des victimes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) ; les rôles respectifs du Secrétariat d’État et du Comité interministériel de suivi des victimes de terrorisme dans l’accompagnement des victimes ; les actions concrètes mises en œuvre ; les principales nouveautés contenues dans la circulaire du 13 avril 2016 relative à la prise en charge des victimes d’actes de terrorisme ; et d’une manière générale, les actions qui ont été entreprises pour améliorer la prise en charge des victimes.
Mme Juliette Méadel, secrétaire d’État chargée de l’aide aux victimes. Monsieur le président, dès le début de vos travaux, vous avez déclaré que c'était « avant tout pour les victimes que cette commission parlementaire [avait] été décidée » et de fait, il y a quatre mois, vous avez entamé vos travaux par l'audition des victimes et des associations d’aide aux victimes.
J’ai l’honneur de clôturer ces auditions, et je veux rendre hommage à la cohérence de ce plan de travail. En tant que secrétaire d'État chargée de l'aide aux victimes, je ne peux que partager votre souci de repenser nos dispositifs d'urgence en cas d'attentats, et votre volonté d'améliorer la prise en charge des victimes, aussi bien dans l'urgence qu’au long cours – j’y reviendrai. Mais auparavant, je souhaite revenir sur le bilan.
Depuis le 7 janvier 2015, 151 personnes ont perdu la vie sur le sol français en raison d'attentats – 130 le 13 novembre. C'est autant de victimes en une année que depuis 1945. Jessica Schneider et Jean-Baptiste Salvaing, assassinés le 14 juin 2016 à Magnanville, à leur domicile, devant leur jeune fils sont venus grossir ce déjà trop lourd bilan.
Au total, ce sont 2 179 victimes d'attentats terroristes commis en France ou ressortissants français victimes d'attentats à l'étranger entre 2015 et 2016. Des centaines de personnes resteront durablement marquées, physiquement et/ou psychologiquement, parfois pour le restant de leurs jours. Le bilan de ces attentats est terriblement lourd. Aussi, après un attentat, après un accident collectif, après un drame de cette nature, l'État doit-il être là pour soutenir les victimes dans l'épreuve immédiate. Cela passe non seulement par la parole, mais surtout par des actes concrets.
De quoi les victimes ont-elles eu besoin le soir du 13 novembre et dans les jours qui ont suivi ?
Dans les premiers temps, elles ont eu besoin : de protection pour assurer leur sécurité et celle de leurs proches, et c'est le travail des forces de l'ordre et du ministre de l'intérieur ; d'information sur l'état de la situation pendant les événements et sur leurs conséquences, et c'est le travail du Parquet ; d'une prise en charge rapide de leur état de santé par les forces de secours, les sapeurs-pompiers, et les médecins-hospitaliers ; de soins immédiats et d'un lieu d'accueil médico-psychologique, et c'est le travail du ministère des affaires sociales et de la santé ; d'une identification rapide des corps, et c'est le travail de la police judiciaire, en lien avec la médecine légale. Enfin, elles ont besoin d'une parole de soutien et d'humanité, et c'est le devoir de chacun d'entre nous.
Or, à l'évidence, le 13 novembre, nous n'étions pas totalement prêts à répondre à l'ensemble de ces besoins suscités par un drame d'une ampleur inédite sur le sol français. Nous n'étions pas totalement prêts à satisfaire aux grandes, aux légitimes attentes des victimes envers la puissance publique.
Et pourtant, les Français, vous le savez, attendent beaucoup de l'État. C'est même l'une de nos spécificités nationales. Dans de telles circonstances, ils attendent de la puissance publique qu'elle les accompagne, qu'elle les protège, qu'elle les guide et qu'elle les soutienne. Dans aucun autre pays au monde, l'État n'a été conduit à remplir autant de fonctions dans de telles circonstances.
Qu'est-ce qui a posé problème le 13 novembre, et qui a empêché un traitement optimal de ces attentes ?
La situation exceptionnelle du 13 novembre a obligé à mobiliser une grande diversité d'acteurs – pompiers, médecins, policiers, gendarmes, psychologues, magistrats, associations d'aide aux victimes, bénévoles, etc. – en un temps très bref. Cette situation a mis en lumière le manque de coordination entre les acteurs, mais aussi les différences de modes opératoires.
Ce manque de coordination s'est avéré particulièrement criant lorsqu’il s’est agi de faire circuler les informations, conduisant à ralentir les réponses apportées aux victimes et aux proches, voire à engendrer des erreurs absolument dramatiques. Celles-ci n'étaient pas si nombreuses, mais elles ont eu un retentissement important, et pour cause.
Le président de la République et le Premier ministre ont donc voulu la création d'un secrétariat d'État à l'aide aux victimes, placé auprès du Premier ministre. Cette position au cœur de l'action gouvernementale nous permet de construire une politique interministérielle d'aide aux victimes. Cela signifie que les pouvoirs publics doivent être en mesure de penser aux réponses que doivent apporter les services publics face à toutes les difficultés rencontrées par les victimes, pendant l'événement et ensuite.
Pour bien concevoir et organiser la réponse aux besoins, non seulement des victimes d'attentats mais aussi – et c'est l'objet de mon secrétariat d'État – des victimes d'accidents collectifs, il faut distinguer deux moments essentiels dans leur parcours : l'urgence pendant l'événement dramatique puis le suivi dans les jours, les mois et les années qui suivent.
Commençons par le temps de la crise.
Je l'ai dit, le manque de coordination a été un des problèmes clef du 13 novembre. Comment améliorer l'organisation et la synchronisation des acteurs publics pendant l'événement ? Mon programme s'établit en deux points – comme le détaille l'instruction interministérielle du 13 avril 2016 : d’abord, l'accès immédiat à une information fiable par téléphone ou mail ; ensuite, l'accès pour les victimes au personnel compétent pour répondre aux premiers besoins des victimes dans un lieu d'accueil unique.
L'accès à l'information fiable est garanti par l'ouverture d'un numéro d'appel unique par la CIAV, localisée au Quai d'Orsay. C’est là qu’est remonté l'ensemble des informations nécessaires aux victimes. Ces informations concernent principalement l'identification des victimes, la localisation des blessés dans les hôpitaux, et les coordonnées du centre d'accueil des familles. L'accès au personnel compétent pour répondre aux premiers besoins des victimes dans un lieu d'accueil unique est indispensable dans les premiers instants du drame.
À Paris, les familles seront accueillies sur le site de l'École militaire, au centre d'accueil des familles. Il s'agit d'un lieu d'accueil unique pour les victimes et leurs proches qui leur permet de se signaler, d'être informés de la situation de la personne qu'ils recherchent, de bénéficier d'un soutien psycho-traumatologique adapté et, le cas échéant, de fournir les éléments nécessaires à l'identification des victimes – dans le cadre de la cellule ante mortem.
En cas d'événement en province, les préfets ont identifié des centres d'accueil des familles – CAF – et des centres d'accueil des impliqués – CAI. Le secrétariat d'État à l'aide aux victimes veillera à l'envoi en province d'une équipe déléguée de la CIAV dont la mission sera d'assister le préfet sur toutes les questions relatives aux victimes et à l'accompagnement des familles.
La politique d'aide aux victimes, c'est aussi, concrètement, après le temps de l'urgence, le temps du suivi dans les jours, les mois et les années qui suivent.
Après le temps de la crise, le long terme.
Dans les jours qui suivent le drame, la vie des victimes et de leurs familles est bouleversée, mais elle continue – autrement. Dès lors, le second objectif du secrétariat d'État chargé de l'aide aux victimes est de veiller à leur bonne prise en charge dans le temps, pour les accompagner et les aider à retrouver un équilibre.
Au lendemain d'un attentat, les victimes ont des besoins différents. Les victimes blessées ou choquées n'ont pas les mêmes besoins que les victimes ayant perdu un proche. D’ailleurs la définition même de victime n'est pas la même pour toutes les institutions administratives, ce qui complexifie la réponse apportée par les pouvoirs publics et n'aide pas les victimes à s'y retrouver.
D'une manière générale, les victimes ont besoin de comprendre comment elles vont pouvoir être remboursées de leurs dépenses et indemnisées, tant du point de vue des frais liés à leur santé, que de tous les frais annexes. Pour celles qui sont blessées et handicapées, la vie change du tout au tout : de la prise en charge de leur frais d'appareillage à celle des consultations de psychologues, l'accès à un logement adapté ou encore l'aide à l'obtention d'une formation professionnelle nécessaire pour leur réadaptation et leur retour à l'emploi. Les besoins des victimes sont, à long terme, d'une grande variété et exigent une réponse publique qui doit conserver sa cohérence en dépit de la multiplicité des intervenants.
La réponse institutionnelle à ces nouveaux besoins passe par le pilotage, de la part du secrétariat d'État à l'aide aux victimes, de l'action menée par les administrations concernées pour les victimes. C'est dans cet esprit que je préside le Comité interministériel de suivi des victimes.
Je l'ai réuni deux fois, et sa prochaine session est prévue pour le 4 juillet. Le Comité de suivi assure la continuité de l'aide apportée par l'État, et notamment par les différents ministères concernés. Il assure le suivi non seulement des victimes du 13 novembre 2015, mais aussi des victimes françaises d'attentats survenus à l'étranger. Il rassemble les associations d'aide aux victimes et les associations de victimes, ainsi que les principaux ministères concernés : les ministères de la justice, de la santé, des finances, avec le FGTI, le ministère de la défense avec l’ONACVG, et à présent, le ministère du logement.
Le suivi des victimes repose aussi sur le traitement des cas particuliers qui exigent une intervention spécifique. À cet égard, avec mon équipe, je reçois les victimes qui nous sollicitent, je me déplace pour les rencontrer et je veille au règlement de leurs difficultés administratives en intervenant directement quand c'est le seul moyen de débloquer une situation. Ainsi, avec mon équipe, nous avons traité en quatre mois près quatre-vingts situations ; et pour environ soixante d'entre elles, nous avons trouvé une solution concrète.
Le suivi des victimes repose aussi, bien entendu, sur l'action indispensable des associations de victimes et d'aide aux victimes. La spécificité de ce secrétariat d'État est son lien fort et intrinsèque avec les associations de victimes et d'aide aux victimes et ce pour une raison simple : répondre aux besoins des victimes, c'est d'abord écouter ce que leurs représentants ont à nous dire. De fait, parce que ce sont les premières concernées, les victimes participent à la politique que nous sommes en train de construire pour elles. Elles attendent des réponses précises, claires et concrètes. J'ai donc choisi une méthode de décision qui repose sur la participation des associations à la définition des outils que je veux mettre au service de nos objectifs.
J'ai ainsi mis en place une table-ronde des associations intitulée « Construisons ensemble » qui rassemble périodiquement l'ensemble des associations de victimes et d'aide aux victimes d'attentats terroristes. Ensemble, nous avons ainsi bâti une stratégie de simplification des outils d'information au service des victimes. C'est dans cette perspective que je présenterai en avant-première à ces associations le projet de site internet unique d'ici à la mi-juillet.
J’aborderai maintenant l'identification, pour mon secrétariat d’État, de cinq priorités, les cinq piliers de la mise en place d’une véritable politique d’aide aux victimes.
Mes échanges réguliers et quotidiens avec les associations m'ont convaincue que la politique d'aide aux victimes repose sur cinq principes d'action : une information fiable, claire et adaptée à chaque étape de la prise en charge ; une prise en charge globale, médicale et psychologique, garantie dans le temps, et prévisible – démarches nécessaires, délais et phasage ; une indemnisation juste et un dispositif axé sur la transparence dans la relation avec le FGTI ; la simplification et l'humanisation des démarches administratives ; le soutien de la Nation.
Première priorité : une information fiable, claire et adaptée
En dehors de la phase de crise, quand les victimes et leurs familles doivent entamer des démarches administratives pour faire valoir leurs droits, l'information est éparpillée et donc délicate à obtenir, ce qui n'est pas acceptable. Aussi avons-nous décidé de tout mettre en œuvre pour simplifier, accompagner les démarches administratives, et centraliser l'ensemble des informations disponibles sur le portail internet dénommé « GUIDE » – information et démarches.
Deuxième priorité : une prise en charge globale, médicale et psychologique, garantie dans le temps.
Dans le cadre du comité interministériel de suivi des victimes – CISV – j'ai demandé aux ministères compétents, notamment au ministère des affaires sociales et de la santé, d'explorer toutes les pistes pour améliorer la prise en charge des victimes, à l'hôpital puis à sa sortie, tant sur le plan médical et psychologique que financier – prise en charge des remboursements de soins. Je pense aussi aux victimes choquées, c'est à dire traumatisées. Les chocs psychologiques sont, on le sait, de plusieurs natures : les victimes physiques n'ont pas les même besoins d'accompagnement que celles qui ont été choquées ou impliquées.
Au terme de ces premiers mois de travail et de ces multiples rencontres avec des victimes directes ou indirectes, j'ai pu mesurer l'importance de la prise en charge du traumatisme psychique dans ses aspects médicaux, psychologiques, et organisationnels.
Dès le début, c'est à dire dans les vingt-quatre premières heures de l'événement, la présence du thérapeute, est indispensable pour aider la victime à penser de nouveaux repères. La première mission des psychologues mais aussi de tout le personnel aidant est « d'être là ». C'est-à-dire d'être, non seulement présent physiquement, mais surtout d'être présent psychiquement, d'être disponible, à l'écoute de ces premières verbalisations de la souffrance qui peut être dans certains cas massive et envahissante.
Les soignants, auxquels je tiens à rendre un vibrant hommage, sont d’une certaine manière les « réceptacles » de ce temps de crise psychique. Je n'oublie pas les personnels de secours qui sont souvent, eux aussi victimes de cette agression psychique. Les aidants, les soignants, les sauveteurs doivent être accompagnés.
Et puis, passées les premières semaines de l'attentat, les victimes ont besoin d'être aidées par un accompagnement psychologique. Or elles se sont parfois isolées, faute d'interlocuteur. Le suivi des victimes dans la durée, du point de vue de l'accompagnement psychologique, est encore aujourd’hui, hélas, trop parcellaire. Un effort doit être engagé, notamment dans le prolongement du travail engagé par les cellules d'urgences médico-psychologiques – CUMP.
Parallèlement, en lien avec l'AP-HP, j'ai confié à Mme Françoise Rudetzki une mission de préfiguration et de réflexion sur la notion de résilience. L'opinion publique s'interroge en effet sur ces nouvelles approches cognitives, ou parfois expérimentales, du soin du traumatisme. Il était donc de mon devoir d'engager une réflexion et une recherche à ce sujet pour en tester la solidité.
Troisième priorité : une indemnisation juste et transparente
Si pour les victimes et les familles endeuillées, aucune indemnisation ne peut remplacer la perte d'un être cher ou un traumatisme causé par un attentat terroriste, l'opacité du processus d'indemnisation par le FGTI, qui reste pourtant un des plus réparateurs au monde, peut-être insupportable.
Il faut donc rendre plus transparent le processus d'indemnisation. La clarification des critères d'indemnisation est en effet essentielle pour permettre aux victimes de comprendre l'évaluation de leur indemnisation et lever tout sentiment d'arbitraire.
En outre, et c'est un des principes auxquels je suis particulièrement attachée, les victimes et leurs proches, dont la vie a basculé à la suite d'attaques terroristes, doivent être indemnisés à hauteur du préjudice qu'ils ont subi. C'est le principe même de la réparation intégrale. Il est indispensable de maintenir ce principe, même si les dépenses d'indemnisation devaient augmenter en raison des attentats terroristes. Une mission d'inspection a d’ailleurs engagé un travail de réflexion pour maintenir la soutenabilité financière du FGTI et, qu'elles qu'en soient les conclusions, je veillerai à ce que soit maintenu le principe de la réparation intégrale.
Enfin, au-delà de l'indemnisation des victimes, il faut alléger, autant que possible, le poids des difficultés administratives et fiscales liées à la perte d'un être cher victime d'attentat. C'est la raison même pour laquelle nous avons pris, le mois dernier, avec le ministre des finances et des comptes publics et le secrétaire d'État au budget, des mesures d'exonération fiscale fortes en faveur des ayants droit des victimes.
Quatrième priorité : la simplification et l'humanisation des démarches administratives.
Les jours et les semaines qui suivent l'attentat, les démarches administratives, nécessaires à l'activation des droits des victimes et à leur prise en charge, ne doivent pas ajouter du tracas à la douleur. Rien n'est plus insupportable, quand on souffre, qu'une administration complexe, froide et rigide. La diversité des interlocuteurs – FGTI, ONACVG, sécurité sociale, etc. – censés répondre à la diversité des droits représente alors une difficulté supplémentaire.
Voilà pourquoi la simplification et l'humanisation des démarches administratives sont aujourd'hui nécessaires. Aussi ai-je décidé la création d'un guichet unique afin de faciliter l'ensemble des démarches existantes. Ce guichet unique sera décliné de deux manières : d’abord un guichet unique numérique, avec le site internet que j'ai déjà évoqué, qui centralisera l'ensemble des démarches administratives à réaliser ; ensuite un guichet unique territorial, avec un lieu physique d'accueil et un réfèrent associatif, désignés au sein de chaque département. Ces deux modalités sont en cours d'étude et devraient être concrétisées d'ici à l'été 2016 pour la première, d'ici à la fin de l'année 2016 pour la seconde. Cela permettra aux victimes et à leurs proches d'effectuer leurs démarches comme ils l'entendent, et de choisir le mode d'accompagnement qu'ils souhaitent.
Cinquième et dernière priorité : le soutien de la Nation
Parce qu'elles ont été victimes d'actes de terrorisme, d'un terrorisme qui trouve sa source dans une lutte contre une société, un gouvernement ou un État, les victimes d'attentats – victimes simplement d'avoir été là – demandent autre chose qu'une simple indemnisation ou une prise en charge : elles demandent aussi le soutien de la Nation.
J'ai déjà évoqué la création de ce secrétariat d'État, le principe de réparation intégrale, les exonérations fiscales : ce sont des formes de solidarité de l'État. Nous sommes tous potentiellement visés par les attentats. L'état de victime d’attentat terroriste ou d’accident collectif n'est conditionné que par le hasard, celui d'avoir été là au mauvais moment. Les conséquences de cet aléa dramatique, cruel, doivent être partagées par la collectivité, par l'État et ne peuvent pas être assumées uniquement par l’individu.
Selon moi, nous devons aller plus loin. Cela peut prendre plusieurs formes, au-delà des hommages officiels. Je pense ainsi à l'officialisation d'une journée nationale en mémoire des victimes d'attentats terroristes. Il faut en tout cas satisfaire cette demande de soutien des victimes et des associations.
Dernier élément fondamental auquel je tiens tout particulièrement : l'exigence d'égalité.
Au-delà de ces différentes demandes – information fiable, prise en charge globale, indemnisation juste, simplification et humanisation des démarches et reconnaissance de la nation – je voudrais insister sur une exigence supplémentaire : l'égalité de traitement entre toutes les victimes d'actes de terrorisme. Il ne peut y avoir de concurrence victimaire.
En effet, quel que soit l'attentat, sa médiatisation ou son bilan, quel que soit le lieu de résidence des victimes, le principe d'égalité nous oblige à répondre aux besoins des victimes de la même manière, avec le même soutien de l'État. À cet égard, j'ai préparé une circulaire adossée à l'instruction interministérielle du 13 avril, complémentaire à la circulaire du ministère de l'intérieur et du ministère des affaires sociales et de la santé, afin de décliner le schéma national au niveau local de la prise en charge des victimes.
Je souhaite en effet que le comité interministériel de suivi soit décliné en comités de suivi départementaux, de sorte que les victimes résidant en province puissent disposer d'un réfèrent unique au niveau associatif et d'une instance de l'État, deux piliers nécessaires pour les accompagner dans leurs démarches et débloquer d'éventuelles difficultés.
En conclusion, mesdames et messieurs les députés, je veux vous dire que ces enjeux sont, certes, d’une immense complexité et doivent été appréhendés dans un souci d'équilibre, entre égalité formelle et équité de traitement, entre rapidité des processus et personnalisation des réponses, entre gestion administrative et humanité des relations. C'est un défi quotidien, exigeant, nécessaire que nous devons tous relever.
Le travail mené avec les victimes et les associations permet à présent de disposer d'une doctrine d'accompagnement qui dépasse le champ des victimes de terrorisme. Les efforts de mise en réseau et de professionnalisation des acteurs doivent se poursuivre pour généraliser le savoir-faire et la méthodologie que nous avons acquis dans tous les domaines de la prise en charge en urgence et dans la durée.
Pour aller plus loin, de nouvelles dispositions législatives sont nécessaires pour faire naître un service public de l'aide aux victimes, en prise avec toutes les dimensions que comportent les accidents de la vie quels qu'en soient les qualificatifs – catastrophes naturelles, accidents collectifs, drames de nature pénale. Car il y a naturellement de nombreux points communs entre les politiques d’aide aux victimes de terrorisme et aux victimes d’autres catastrophes. Je sais pouvoir compter sur la représentation nationale pour aller plus loin et promouvoir au sein de l'État une culture commune de l'aide aux victimes.
Mesdames et messieurs les députés, je vous remercie pour votre attention et me tiens naturellement prête à répondre à toutes les questions que vous voudrez bien me poser.
M. le président Georges Fenech. Merci, madame la ministre, pour cet exposé exhaustif des actions que vous avez menées en peu de temps, puisque votre secrétariat d’État est de création récente. Le rapporteur et moi-même sommes à l’écoute de tout le travail qui a déjà été accompli et qui répond en très grande partie, voire en totalité, aux demandes, aux inquiétudes et parfois à la saine colère des victimes qui se sont trouvées confrontées à une situation à laquelle nous n’étions pas préparés. L’important est d’apporter des réponses pour l’avenir, et le programme que vous nous communiquez aujourd’hui, avec ses cinq axes, correspond à cette attente et à ces besoins.
Nous aimerions toutefois approfondir plusieurs points avec vous.
Le secrétariat d’État chargé de l’aide aux victimes ne devrait-il pas aussi s’occuper des mineurs recrutés par Daech sur les réseaux sociaux et qui partent à l’étranger ? Même s’ils entrent dans un processus de terrorisme, ne pensez-vous pas que ces recrues sont aussi des victimes ? Les parents de ces jeunes gens, qui vivent sur notre territoire, sont pris de cours. La plupart du temps, ils ne s’étaient même pas rendu compte de leur endoctrinement.
Par ailleurs, à l’occasion de notre mission aux États-Unis, nous avons constaté combien était déterminante la rapidité des secours apportés aux victimes de ce que l’on peut qualifier de véritables actes de guerre. Or nous nous sommes rendu compte, au cours de nos travaux, que l’accès aux blessés, notamment au Bataclan, avait pris un certain temps et qu’il avait notamment fallu attendre que le périmètre de sécurité ait été levé.
Aux États-Unis, ils ont recours à un corps mixte, composé de colonnes d’assaut accompagnées par des médecins formés à l’intervention de crise, équipés et à même d’agir. Ce dispositif permet, et c’est ce qui s’est notamment passé à Orlando, une rapide prise en charge médicale, déterminante pour la survie des victimes.
Mme la secrétaire d’État chargée de l’aide aux victimes. Sur les mineurs ou les jeunes adultes recrutés par les filières, c’est une réalité très récente en Europe, et qui n’est pas spécifique à la France. D’autres pays européens, comme l’Angleterre, connaissent eux aussi ce type d’instrumentalisation de la part de Daech.
Comme vous le savez, le Gouvernement est très mobilisé sur ce point et a mis en place un plan de lutte contre la radicalisation, qui comporte 80 mesures. Les familles sont bien souvent désemparées, en effet, face à une radicalisation qui se fait sur internet, et la question des réseaux sociaux est centrale dans les drames que nous vivons. Le sujet n’est pas mince. Croyez-bien que j’en suis consciente et que je m’investis, comme tout membre du Gouvernement, et comme tout citoyen français.
S’agissant de la compétence stricto sensu du secrétariat d’État d’aide aux victimes, je ne peux pas ne pas m’intéresser à ce qui a produit l’abomination. J’ai demandé au secrétariat général du Fonds interministériel de prévention de la délinquance – FIPD – de lancer de nouveaux projets. Il faut pouvoir travailler, de manière interministérielle, sur la question de la prévention et de l’aide aux familles. Cette démarche est aujourd’hui au cœur de l’action du Gouvernement. Elle prendra probablement du temps. Vous vous doutez bien que ce n’est pas d’un coup de baguette magique que l’on pourra mettre en place une politique de lutte contre ce phénomène de radicalisation. Mais je suis évidemment sensible au fait que les mineurs peuvent être victimes de ce type de réseaux.
S’agissant des premiers secours, vous devez d’abord savoir que l’action des pompiers et du personnel de secours a été immédiate. Elle a été engagée avec la plus grande détermination, et même avec une part d’abnégation sur ces terrains dangereux.
Je vous indique par ailleurs que depuis avril 2016, les médecins et les personnels civils reçoivent une formation spécifique à ce type d’attaques. Les équipes de secours, la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris – BSPP – apprennent des techniques particulières de prise en charge médicale, qu’on utilise sur les théâtres de guerre. Vous avez sans doute entendu parler de ces techniques américaines appelées damage control par lesquelles on met en place un certain nombre de soins d’urgence, afin d’éviter que l’état de la victime ne s’aggrave avant qu’elle puisse rejoindre un hôpital.
Enfin, les forces d’intervention, le RAID, la BRI, le GIGN, sont elles-mêmes engagées dans un travail de formation avec les pompiers et le SAMU pour assurer une bonne coordination entre les forces d’intervention et les forces de secours. Cette coordination doit être assurée à tous les degrés de l’action publique, sur le terrain comme dans les administrations.
M. Sébastien Pietrasanta, rapporteur. Madame la ministre, ma première question porte sur les attentats du 13 novembre. Au départ, les appels téléphoniques ont été gérés par la Préfecture de police – c’est ce qui était prévu dans la circulaire. Mais du fait de l’ampleur de l’événement, le standard téléphonique de la Préfecture de police a sauté à quatre reprises et un certain nombre de familles n’ont pu contacter la CIAV. Le samedi en fin d’après-midi, le dispositif a basculé sur le ministère des affaires étrangères. Qu’est-ce qui a présidé à cette décision ? Comment est-elle intervenue ? En avez-vous tiré des leçons ? Vaut-il mieux utiliser un lieu unique pour recevoir, puis traiter les appels téléphoniques ?
Ma deuxième question, qui a été évoquée par les victimes que nous avons auditionnées, comme par la presse, porte sur la liste unique des victimes. Il semblerait qu’aujourd’hui encore, certaines personnes qui souhaitent y figurer rencontrent des problèmes. Ceux-ci ont-ils été résolus ? Avez-vous été sollicitée par certaines d’entre elles ? Les difficultés ont-elles été identifiées ? Pouvez-vous nous donner quelques éléments précis sur cette liste unique des victimes ?
Mme la secrétaire d’État chargée de l’aide aux victimes. Monsieur le rapporteur, il y a eu en effet un afflux massif d’appels, notamment à la Préfecture de police – plus de 90 000 appels – et celle-ci n’était évidemment pas en capacité d’y répondre.
Quel enseignement en a-t-on tiré ? Désormais, la CIAV, qui dispose d’un numéro d’appel unique, sera techniquement en capacité de répondre à un afflux massif d’appels. Surtout, nous avons collectivement veillé à faire en sorte que dès la survenance de l’attentat, ce numéro unique s’affichera partout sur tous les médias – télévision, internet, etc. La CIAV est dotée des infrastructures humaines et techniques qui lui permettront de faire face à un afflux massif d’appels. Il s’agit en effet d’éviter ce qui s’est passé au soir du 13 novembre. Ayant pu tester le numéro unique au cours des cinq exercices NOVI – les exercices de préparation à un attentat de grande ampleur – que nous avons organisés, je peux vous dire que le système fonctionne bien.
Vous m’avez par ailleurs interrogée sur la liste unique des victimes (LUV). Celle-ci est constituée par la section C1 du Parquet de Paris. C’est un document de travail interne au Parquet, qui est devenu avec le temps un outil partagé et qui ouvre des droits. Il n’a pas d’existence juridique autonome.
Seules les victimes directes figurent sur la LUV. On considère comme une victime directe celle qui se trouvait sur les lieux de l’attaque terroriste, qui a été directement exposée au risque. Il y en a trois catégories : les victimes décédées ; les victimes blessées et les victimes choquées, c’est-à-dire blessées psychiquement – sans blessures physiques mais ayant été témoins des événements et étant naturellement traumatisées.
Je reconnais que la définition des victimes mériterait probablement d’être clarifiée. La définition de la LUV, qui se limite aujourd’hui aux victimes directes, ne rend pas compte en effet de la définition des victimes utilisée par le FGTI qui va jusqu’aux victimes indirectes, à savoir les ayants droit des victimes.
Voilà pourquoi, au secrétariat d’État d’aide aux victimes, nous avons engagé un travail pour clarifier les définitions et surtout, faire en sorte que toutes les institutions publiques utilisent les mêmes. Je pense, par exemple, à la notion de « victime impliquée », qui souffre elle aussi d’un manque de précision. Nous souhaitons mettre en place un référentiel unique pour définir les différents types de victimes.
M. le rapporteur. Le secrétariat d’État a-t-il été sollicité pour régler des cas de non-intégration à la liste unique des victimes ? À combien s’élève le nombre de personnes figurant sur la LUV ?
Mme la secrétaire d’État chargée de l’aide aux victimes. Nous avons été saisis de quelques cas de victimes s’étonnant de ne pas être sur la LUV, que nous suivons très précisément – je ne donnerai évidemment aucun nom. Mais nous y travaillons avec la plus grande diligence.
Je précise que l’on figure sur la liste unique des victimes au terme d’une enquête effectuée par le Parquet, lequel s’appuie sur des documents probants : procès-verbaux, etc. C’est le Parquet qui établit sa liste unique des victimes, et qui dispose de tous les éléments juridiques.
S’agissant des attentats du 13 novembre : à la date d’aujourd’hui, on compte 1 747 victimes sur la dernière LUV, dont 130 décédées, 493 blessées et 1 124 choquées.
M. le rapporteur. Lors des auditions, notamment celle de SOS Attentats, il a été fait allusion à l’opacité du système d’indemnisation du FGTI – que vous avez-vous-même évoquée tout à l’heure. Comment envisagez-vous l’évolution éventuelle de son fonctionnement?
Certes, il est toujours très compliqué d’évaluer financièrement la perte d’un proche. Le fonds se détermine à partir d’un certain nombre de critères. Mais au terme de la conjugaison de ceux-ci, la perte par exemple d’un compagnon, d’une compagne, d’un époux ou d’une épouse sera mieux indemnisée que la perte d’un enfant. Qu’en pensez-vous ?
Le secrétariat d’État pourrait-il faire évoluer ce fonds vers plus de transparences ? Vous parliez de la nécessité d’une prise en charge plus humaine. De fait, un certain manque d’humanité a pu être déploré.
Vous souhaitez par ailleurs une simplification des démarches administratives : c’est ce qu’attendent en effet les victimes et leurs représentants. Ils ont appelé notre attention sur la prise en charge des frais d’avocat. Quel est votre sentiment en la matière ?
Mme la secrétaire d’État chargée de l’aide aux victimes. Revenons sur la procédure d’indemnisation devant le FGTI.
Le FGTI ouvre des dossiers d’indemnisation pour les victimes directes, qui figurent sur la LUV, et pour les victimes indirectes qui sont les ayants droit et les proches des victimes directes. Sont considérées comme victimes indirectes par le FGTI : les conjoints, les ascendants, les descendants jusqu’au deuxième degré, les frères et les sœurs des personnes décédées ; mais aussi les conjoints et les ascendants, les descendants au premier degré des personnes blessées ; enfin toute personne justifiant d’un lien particulier avec toute personne décédée ou blessée. Tels sont les critères d’éligibilité.
Concrètement, le FGTI prend l’attache des victimes qui sont inscrites sur la LUV, ou de leurs ayants droit. Mais cela n’empêche pas que toute personne puisse saisir directement le FGTI si celui-ci ne l’a pas contactée et qu’elle s’estime victime d’un acte de terrorisme.
Une fois le contact pris, le FGTI verse une première provision au plus tard un mois après avoir reçu la demande de la victime – et après l’avoir analysée. Ensuite, des provisions complémentaires peuvent être accordées sur demande.
Le FGTI présente une offre d’indemnisation définitive au plus tard trois mois après avoir reçu les justificatifs – certificats médicaux, rapports d’expertise médicale, justificatifs de perte de revenus ou justificatifs d’état-civil. Mais pour les blessés graves ou pour les victimes qui ont subi un traumatisme psychologique, il faut attendre ce que l’on appelle la « consolidation » de l’état de santé physique ou psychologique. On peut aussi parler de « stabilisation ». Or cette phase nécessite du temps. Par exemple, l’effet blast d’une blessure par balle peut avoir une résonance sur la consolidation des os. L’attente dépend de l’état de santé de la victime : un mois, deux mois, trois mois, voire beaucoup plus. Ainsi, le processus d’indemnisation définitive dépend lui-même de la consolidation de l’état de santé.
Vous avez ensuite posé la question essentielle de l’évaluation du préjudice, les victimes ayant souvent le sentiment qu’il y a deux poids deux mesures lorsqu’il s’agit d’indemniser un préjudice. Je serai donc précise et concrète sur la façon dont le préjudice est évalué.
Les principaux postes de préjudice sont fixés par la nomenclature Dintilhac, parmi lesquels figurent : les dépenses de santé, les pertes de revenus, le déficit fonctionnel, les souffrances endurées, les éventuels frais résultant de l’assistance d’une tierce personne, le préjudice d’affection, les frais d’obsèques pour les ayants droit, etc. Mais il n’y a ni montant fixe ni barème, car ce serait contraire au principe de réparation intégrale.
Le FGTI se réfère à la pratique des tribunaux judiciaires, et en particulier au référentiel d’indemnisation des cours d’appel pour estimer les préjudices. Celui-ci peut parfois est majoré par le fonds, sur production de documents d’expertise et sur analyse fine du dossier.
S’agissant de votre interrogation sur l’amélioration de la transparence du référentiel d’indemnisation, le conseil d’administration du FGTI s’est prononcé contre la diffusion de ce référentiel. Il n’est donc pas possible de communiquer sur l’évaluation des postes de préjudice faite par le fonds.
Enfin, il existe une réparation forfaitaire complémentaire qui est accordée au titre du PESVT – le préjudice exceptionnel spécifique des victimes d’actes de terrorisme. Cette réparation a été décidée en 2014 par le conseil d’administration du FGTI, précisément pour tenir compte de la spécificité des préjudices subis par les victimes du terrorisme. Ainsi, 30 000 euros sont accordés aux personnes blessées au cours d’un acte de terrorisme ; pour les proches, le montant varie de 3 500 à 17 000 euros en fonction du lien de parenté.
Toutefois, ce type de réparation, qui est mal compris par les victimes, soulève un certain nombre de difficultés : ce n’est pas un poste de préjudice de droit commun, son montant est relativement faible et il est mal expliqué par le FGTI.
Pour les victimes directes, on distingue celles qui sont directement exposées auxquelles on accorde 30 000 euros, des victimes indirectement exposées, qui perçoivent 10 000 euros. Or cette distinction est ténue. Cela a entraîné à plusieurs reprises des débats au sein du conseil d’administration, et a conduit à des évolutions après chaque attentat. Par la suite, les critères d’attribution du PESVT pour les victimes directes sont devenus peu lisibles. C’est la raison pour laquelle je pense qu’un effort de clarification doit être engagé notamment sur le PESVT.
Quels sont les leviers du secrétariat d’État sur le FGTI ? Avons-nous un rôle direct sur le FGTI ? Aujourd’hui, j’ai un rôle d’action dans la mesure j’ai la responsabilité de travailler à la bonne coordination de chaque ministère représenté au sein du conseil d’administration du fonds. Mais je n’ai pas un rôle direct de pilotage. Vous le savez, le FGTI a un statut juridique particulier de droit privé. Une mission réfléchit néanmoins à l’évolution de son statut.
Cela étant, j’ai mené plusieurs types d’actions pour alerter le FGTI sur certains cas particuliers, qui justifieraient l’accélération et la simplification des démarches. Je réponds ainsi à votre dernière question : le secrétariat d’État a lancé une action concertée sur la révision des formulaires du FGTI. Il faut que ceux-ci soient lisibles et faciles à remplir, et que les victimes n’aient pas à renseigner plusieurs fois le même formulaire, car cela leur est très pénible. De nouveaux formulaires actualisés et simplifiés sont en ligne depuis le 20 mai, et seront validés par le prochain conseil d’administration du FGTI. Comme vous pouvez le constater, nous avons donc d’ores et déjà contribué à la simplification des démarches.
Nous avons également travaillé à l’amélioration des courriers qui seront adressés aux victimes. Dès que j’ai été nommée, nous nous sommes mobilisés sur ce point. Nous avons fixé au FGTI des indicateurs pour que chaque demande reçoive une réponse dans un délai raisonnable. Je suis aujourd’hui en mesure de vous dire que d’ici à la fin de l’année, aucune demande ne sera laissée sans réponse de la part du FGTI.
S’agissant des frais d’avocat, dans le cadre d’une procédure pénale, ceux-ci sont pris en charge par l’aide juridictionnelle – et pour les victimes de terrorisme, elle est acquise sans conditions de ressources. Tel n’est pas le cas en revanche lorsqu’on est en phase transactionnelle. Les frais d’avocat devant le FGTI ne peuvent donc pas être pris en charge. Ils peuvent néanmoins aller jusqu’à10 % de l’indemnité.
J’ai engagé trois types de réflexion pour régler cette situation.
Premièrement, l’extension de l’aide juridictionnelle à la phase transactionnelle.
Deuxièmement, la prise en charge des frais d’avocat par le FGTI. Mais il faut que ceux-ci ne rentrent pas dans la réparation intégrale, car il faut absolument éviter les effets d’aubaine.
Troisièmement, la prise en charge par l’assurance protection juridique de ces frais. Il y a plusieurs occurrences dans le travail que nous menons : soit le déplafonnement, soit une convention de prise en charge des frais et des honoraires entre le FGTI, le Conseil national des barreaux et les assureurs, sur le modèle des accidents collectifs. À ce stade, le travail que nous menons n’est pas encore achevé.
M. Christophe Cavard. Madame la ministre, on ne peut que se réjouir de l’existence officielle du secrétariat d'État chargé de l’aide aux victimes qui, je l’espère, s’inscrira dans le temps puisque les risques sont malheureusement grands d’être à nouveau confrontés à d’autres situations comparables. J’insiste sur son rôle de coordination et d’information car, en cas d’attentat terroriste, les victimes reçoivent peu d’éléments – secret défense, volonté des personnels de justice de réunir ou pas les victimes pour les informer. Et lorsque les attentats ont lieu à l’étranger, les relations avec les familles des victimes sont encore plus compliquées.
Ne pensez-vous pas que le secrétariat d’État d’aide aux victimes pourrait jouer un rôle particulier en la matière ? Vous pourriez, au nom du Gouvernement, donner directement des informations aux victimes ou à leurs représentants, ce qui leur éviterait, ce qui est toujours très désagréable, d’en prendre connaissance par voie de presse.
Par ailleurs, l’instruction des affaires de terrorisme est particulièrement longue. Celle de l’affaire Merah a duré plus d’un et un certain nombre de familles de victimes ont déploré que, pendant tout ce temps, elles ne savaient pas comment la situation évoluait. Certes, la justice fait son travail et il faut attendre le procès. Mais quel est votre point de vue sur ce point ?
Mme la secrétaire d’État chargée de l’aide aux victimes. Monsieur le député Christophe Cavard, il est en effet difficile pour les victimes d’attendre que l’enquête aboutisse. Le temps de la justice ajoute à leur souffrance. Les victimes, comme nous tous, ont envie de savoir ce qui s’est passé, et le plus vite possible. Mais je ne peux que rappeler la loi et nos principes, et notamment le II de l’article préliminaire du code de procédure pénale qui dispose que « L’autorité judiciaire veille à l’information et à la garantie des droits des victimes au cours de toute procédure pénale. »
Ainsi, personne d’autre que le juge d’instruction ne peut s’adresser aux victimes pour rendre compte et dire les éléments de l’enquête, pour des raisons de principe, mais aussi pour préserver la conduite de l’enquête dans les meilleures conditions possibles. Il s’agit d’éviter, en particulier, que la divulgation par d’autres que par l’autorité judiciaire ne puisse avoir une répercussion, soit sur le bon déroulement de l’enquête, soit même sur son issue, qui est de trouver la vérité.
Je reconnais volontiers que cela ne répond pas à l’attente des victimes qui, elles, veulent avoir des informations. Le secrétariat d’État à l’aide aux victimes peut-il se substituer aux magistrats ? La réponse est clairement non. Il n’est pas question que, même en termes de communication, qui que ce soit s’exprime à la place des magistrats.
Cela étant, il y a deux façons d’améliorer les choses, et elles sont déjà mises en place.
Premièrement, lorsqu’on se constitue partie civile, on a accès au dossier. Donc, pendant une information judiciaire, l’avocat de la partie civile dispose des mêmes droits que le conseil de la personne mise en examen. Il peut obtenir des copies des pièces de la procédure et les transmettre à son client. C’est l’article 114, alinéa 5 et suivants du code de procédure pénale. En outre, depuis la loi du 27 mai 2014, les copies peuvent être demandées par les parties, et les rapports d’autopsie font bien partie des pièces communicables.
Deuxièmement, le code de procédure pénale prévoit également que, pour les magistrats instructeurs, une réunion d’information doit avoir lieu tous les six mois avec les victimes qui se sont constituées partie civile. Il y a une dizaine de jours, se sont ainsi tenues à l’École militaire les journées d’information des victimes. Le ressenti a été positif : les victimes ont apprécié d’être reçues par les magistrats qui s’occupent du dossier. De fait, six magistrats instructeurs – ce qui suppose une mobilisation de moyens assez exceptionnelle – sont chargés de ces dossiers d’une immense complexité. Les échanges ont été d’une grande précision et les victimes ont eu le sentiment d’un grand professionnalisme. Il y a eu des exposés très nourris, parfois de deux heures, et on leur a présenté le compte rendu d’investigations multiples. Cela n’a pu que rassurer les victimes qui ont ainsi eu accès à tous les éléments d’information. Certaines questions sont restées sans réponse, mais pour une raison simple : elles ne relevaient pas de la procédure en cours.
Au moment où ces journées se sont tenues, Salah Abdeslam venait d’indiquer qu’il ne s’exprimerait pas, ce qui a légitimement suscité une immense frustration. À l’issue de ces journées, certaines victimes s’en sont plaintes. On peut le comprendre, mais chacun doit aussi rester conscient du rôle des magistrats instructeurs qui, bien entendu, ne peuvent pas se prononcer dans un tel cas.
Je rappelle, pour m’en réjouir, que vous avez voté à l’unanimité, dans le cadre du projet de réforme pénale, un amendement visant à réduire le délai à partir duquel une association peut se constituer partie civile, ce qui a été salué par les associations comme étant un grand progrès. Le fait de pouvoir se porter partie civile sans délai préalable de constitution d’une association perme en effet aux victimes d’avoir accès à l’information.
M. le président Georges Fenech. Je vous remercie de l’avoir rappelé. Cette avancée, qui est issue de nos travaux, a été portée par notre collègue Pascal Popelin.
M. Christophe Cavard. Le président avait prévu dans le cadre de nos travaux des auditions avec les médias, qui peuvent parfois mettre en danger les personnes impliquées. Nous-mêmes ne vivons pas très bien d’apprendre certaines informations dans les journaux. En l’occurrence, je m’intéresse davantage aux éléments qui sont donnés dans la presse sans que les victimes ou leur famille en aient eu connaissance. Certes, le droit doit être respecté. Mais, de par votre rôle de coordination, peut-être pouvez-vous recueillir les informations qui peuvent être partagées.
Les victimes – et même les magistrats, mais c’est un autre problème – ne comprennent pas que certaines informations ne leur soient pas données sous prétexte qu’elles relèveraient de dispositifs particuliers et tomberaient sous le coup du secret. Je pense notamment à des éléments qui sont dans les mains des services de renseignements. Peut-être que la police, via le ministère de l’intérieur, pourrait livrer aux victimes les informations qu’un journaliste spécialiste du renseignement a réussi à obtenir.
Mme la secrétaire d’État chargée de l’aide aux victimes. Vous posez une très bonne question, qui a d’ailleurs un certain nombre d’implications sur d’autres éléments d’information, comme le nom de proches qui se retrouvent dans les journaux avant même que l’identification des corps ait eu lieu, ou de photos qui circulent sur internet au mépris de la dignité des personnes. Bref, nous parlons de la liberté d’information et d’expression, et de la grande capacité des réseaux sociaux à divulguer tout et n’importe quoi en un quart de seconde d’un bout à l’autre de la planète. Face à cela, que peut faire l’État ?
D’abord, s’agissant des services de renseignement, de l’instruction et de l’enquête, notre rôle à tous, représentation nationale, Gouvernement, autorité publique, est de dire qu’il y a une seule information fiable, une seule information vraie : la parole des magistrats.
Ce principe est important et nous devons le rappeler, y compris dans les relations que nous avons avec les victimes. Donc, quand je reçois les victimes, je leur dis de ne pas croire ce qu’elles peuvent lire car un certain nombre d’informations fausses circulent. Il est de notre responsabilité de ne donner d’informations que lorsqu’elles sont vraies, c’est-à-dire vérifiées, ce qui suppose que l’ensemble des services de l’État aient eu le temps de procéder à cette vérification. La rapidité va souvent de pair avec la rumeur, et la rumeur est quasiment toujours fausse.
Nous pouvons néanmoins agir.
Prenons tout d’abord le cas d’une image ou une d’information – vraie ou fausse – heurtant la dignité des victimes et qui circule dans la presse ou sur les réseaux sociaux. Je pense ici à la photo d’un proche d’une victime au lendemain du crash aérien de l’avion d’EgyptAir. J’ai contacté les journaux concernés et leur ai demandé, au nom de la déontologie et de leur propre charte éthique, de retirer cette photo, le principe étant que toute victime qui ne souhaite pas que la photo ou le nom d’un proche soit divulgué(e) doit être entendue. Nous pouvons donc agir non pas par la contrainte, car la presse est libre, mais par un travail mettant en avant la déontologie et renvoyant les journalistes à leur propre éthique.
Par ailleurs, les réseaux sociaux sont aussi un vecteur d’information précieux, que le secrétariat d’État à l’aide aux victimes utilise énormément. Ainsi, dès la survenance d’une catastrophe aérienne, nous pouvons envoyer par ce biais le numéro de téléphone permettant d’avoir accès à des informations. Nous le faisons naturellement en lien avec le ministère des affaires étrangères et le centre de crise et de soutien. Mes équipes vérifient très concrètement que le numéro de téléphone fonctionne, puis nous le mettons immédiatement en ligne sur les réseaux sociaux. Et vu le nombre de retweets, je pense qu’il y a là une vraie utilité. Les victimes et leurs proches demandent en effet une information vraie et fiable tout de suite, dès les premières minutes de la catastrophe. Donc, les réseaux sociaux peuvent aussi être utilisés pour renforcer la qualité des informations auxquelles les victimes ont accès.
Enfin, et pour finir, j’ai lancé une réflexion, au sein du secrétariat d’État, sur l’impact délétère de la circulation, dans la presse, des photos des terroristes. J’ai bien conscience qu’on est, là encore, sur le terrain de la liberté d’information et que celle-ci est indispensable. Je ne suis pas sûre cependant qu’il soit de bon aloi pour les victimes de voir circuler partout sur les réseaux sociaux et dans la presse les photos des terroristes, leur nom, le récit de leur vie ; même si cela satisfait probablement des besoins narcissiques cela heurte les survivants et leur famille. La juxtaposition, dans les journaux, des photos des victimes et des terroristes dont on parle beaucoup et qui renvoient à des actes abominables, ne sert pas, selon moi, l’intérêt général. Mais nous sommes là sur le terrain de la déontologie et de l’éthique.
M. le président Georges Fenech. Madame la ministre, la France a été bouleversée par le double assassinat d’un couple de fonctionnaires de police. Quelles mesures vont être prises pour leur enfant, désormais orphelin ? Je crois savoir qu’il aurait le statut de pupille de la Nation. Pouvez-vous nous le confirmer ?
Mme la secrétaire d’État chargée de l’aide aux victimes. Monsieur le président, ce petit enfant de trois ans remplit tous les critères pour devenir pupille de la Nation. Nous avons saisi l’ONACVG. J’ajoute qu’à l’issue des attentats de 2015 et 2016, plus de cinquante enfants, au total, sont aujourd’hui pupilles de la Nation.
Au secrétariat d’État, nous avons immédiatement pris contact avec la famille pour savoir comment nous pouvions lui être utiles. Nous sommes à leur disposition pour les recevoir. J’insiste sur ce point essentiel : une fois passés les premiers jours, quand la presse ne s’y intéressera plus, le suivi de cet enfant devra être permanent et contrôlé. Même dans plusieurs mois, le sort des proches de ce couple et de ce petit garçon sera pris en charge par le secrétariat d’État aux victimes. Par ailleurs, un hommage aura lieu à Versailles vendredi, en la mémoire de ses parents.
M. le président Georges Fenech. Madame la ministre, il ne me reste plus qu’à vous remercier. Nous sommes très attentifs au sort des victimes et nous ne pouvons que nous féliciter de toutes ces mesures qui ont été annoncées en un temps record et qui recueillent, j’imagine, l’assentiment des associations. Elles participent du reste aux décisions que vous prenez, ce qui est très important.
Mme la secrétaire d’État chargée de l’aide aux victimes. Merci, monsieur le président.
© Assemblée nationale