

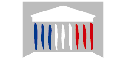
N° 2677
______
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 25 mars 2015.
RAPPORT D’INFORMATION
DÉPOSÉ
en application de l’article 145 du Règlement
PAR LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION
ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE,
sur l’indignité nationale
ET PRÉSENTÉ PAR
M. Jean-Jacques URVOAS
Président
——
SOMMAIRE
___
Pages
INTRODUCTION 5
I. LE RETOUR DE L’INDIGNITÉ NATIONALE DANS LE DÉBAT POLITIQUE 7
II. QU’EST-CE QU’ÊTRE INDIGNE DE LA CITÉ ? 9
A. LES ORIGINES D’UN CRIME POLITIQUE FONDÉ SUR L’INDIGNITÉ 9
B. LES ORIGINES D’UNE PEINE INFAMANTE FONDÉE SUR L’INDIGNITÉ 11
III. L’INDIGNITÉ NATIONALE À LA LIBÉRATION, UN PRÉCÉDENT HISTORIQUE FONDAMENTALEMENT DATÉ 13
A. UN CRIME POLITIQUE NÉ D’UN CONTEXTE TRÈS PARTICULIER 13
1. Le contexte historique : rétablir l’honneur républicain après Vichy 13
2. Une répression rétroactive de faits accomplis durant une période strictement limitée 15
3. Un droit pénal d’exception sous le contrôle de juridictions spéciales 16
4. Une sanction pénale visant in fine à réintégrer l’indigne dans la Cité 17
5. Un régime juridique instable dont l’efficacité et la mise en œuvre ont finalement été largement contestées 18
B. UN PRÉCÉDENT FONCIÈREMENT DATÉ POUR RÉPONDRE À LA MENACE ACTUELLE 19
1. Sur le plan institutionnel : une technique de réaffirmation de la justice étatique sans rapport avec la situation française actuelle 21
2. Sur le plan symbolique : une technique de proclamation nationale inadaptée à la situation française actuelle 23
C. UN CHOIX POSSIBLE MAIS PEU SOUHAITABLE 25
1. Moralement compréhensible 25
2. Juridiquement possible 26
3. Politiquement séduisant mais ambigu 27
4. À très faible plus-value 29
5. Susceptible d’alimenter la martyrologie djihadiste 30
IV. UNE LEÇON DE L’HISTOIRE PLUS PERTINENTE : LA POUSSÉE ANARCHISTE À LA FIN DU XIXE SIÈCLE 31
A. UN PARALLÈLE FRAPPANT ENTRE TERRORISME ANARCHISTE ET TERRORISME DJIHADISTE 32
1. Des similitudes troublantes 33
2. Le choix d’une répression de droit commun 34
B. DES OUTILS EFFICACES POUR LE XIXE SIÈCLE MAIS SANS LES GARANTIES CONSTITUTIONNELLES D’AUJOURD’HUI 35
CONCLUSION : DEUX VOIES POSSIBLES 38
1. Inventer de nouvelles sanctions, respectueuses de l’État de droit, pour conforter la confiance dans notre capacité à réprimer le terrorisme 39
2. Redonner force à l’idéal républicain 40
RÉUNION DE LA COMMISSION DES LOIS DU MERCREDI 25 MARS 2015 43
ANNEXE : LISTE DES PROFESSEURS DE DROIT AYANT REMIS DES CONTRIBUTIONS ÉCRITES 65
Hegel énonçait sans appel dans ses Leçons sur la philosophie de l’histoire que « l’expérience et l’histoire nous enseignent que peuples et gouvernements n’ont jamais rien appris de l’histoire, qu’ils n’ont jamais agi suivant les maximes qu’on aurait pu en tirer ». Il était ainsi convaincu que le passé n’est d’aucun secours pour résoudre les problèmes du présent car nul cas ne ressemble exactement à un autre.
Le débat qui s’est ouvert voici quelques mois à propos de l’indignité nationale, à laquelle pourraient ou devraient être condamnés les terroristes djihadistes, illustre ce dilemme. Le précédent historique de la Libération, aussi attractif soit-il, peut-il dicter la réponse politique et juridique que la République doit opposer en 2015 à des nouvelles formes de menaces qui frappent autant les femmes et les hommes qui en sont victimes que les valeurs que nous partageons ? En ces matières, il ne faut pas se payer de mots. Les actes seuls comptent et ceux-ci doivent avoir autant un sens qu’une portée effective.
Certes, il est tentant, et compréhensible, d’opérer un rapprochement entre djihadistes et collaborateurs vichystes. Dans les deux cas, des Français ne se sont-ils pas exclus de facto de la communauté nationale en se compromettant avec le mal, en se vautrant dans l’ignominie, en foulant aux pieds les fondements mêmes des valeurs humanistes consubstantielles à notre pacte démocratique ? Pourquoi alors ne pas restaurer certains outils juridiques d’essence punitive qui furent institués à la Libération en vue de rétablir l’ordre républicain ?
C’est à cette réflexion qu’a appelé le Premier ministre, M. Manuel Valls, lors de la conférence de presse du 21 janvier 2014 consacrée au renforcement du dispositif de lutte contre le terrorisme, en se refusant toute prise de décision « dans la précipitation ». Il a ainsi proposé aux présidents des commissions des Lois de l’Assemblée nationale et du Sénat de mesurer les conséquence d’une possible réintégration dans notre droit du crime d’indignité nationale et de la peine de dégradation civique – lesquels marqueraient symboliquement « les conséquences de la transgression absolue que constitue la commission d’un acte terroriste ».
Estimant qu’il appartenait au « Sénat et [à] sa commission des Lois de déterminer eux-mêmes le calendrier et le contenu des réflexions et propositions qu’ils entendent faire », M. Philippe Bas a, le même jour, décliné la suggestion.
La présente communication est donc destinée à nourrir un échange au sein de notre Commission sur un sujet aussi sensible que complexe, qui nous impose de revenir sur quelques-unes des heures sombres de notre histoire pour en tirer les plus justes et les plus utiles leçons.
Cette contribution est construite autour de la notion de « réactivation », expressément avancée par le Premier ministre, qui implique par définition sinon la reproduction de situations exactement identiques à certains moments de notre histoire nationale, du moins l’existence de contextes politiques proches qui justifieraient l’usage de dispositifs juridiques eux-mêmes apparentés. Autant dire que le présent rapport s’inscrit dans une approche diachronique, afin de déterminer si les conditions qui ont conduit les acteurs des temps passés à recourir à plusieurs reprises à des mécanismes d’affirmation de démérite national ou de non-appartenance nationale sont actuellement réunies ou si, au contraire, la configuration actuelle ne présente que peu de rapport, au-delà du degré de gravité des violences perpétrées, avec les configurations antérieures – ce qui, partant, aurait pour effet de délégitimer toute tentative de restauration d’un mécanisme tel que l’indignité nationale.
Bien entendu, c’est d’abord aux mesures prises en 1944 par le Gouvernement provisoire de la République française (GPRF) qu’il sera ici fait essentiellement référence, puisque c’est cet épisode historique qui a inspiré notre collègue Philippe Meunier, auteur et rapporteur de la proposition de loi n° 996 (1), qui proposait de réintroduire un crime d’indignité nationale assorti d’une peine complémentaire de dégradation nationale automatique à l’encontre des Français, non binationaux, portant les armes contre les forces armées et de police.
Pour son auteur, il s’agissait de contribuer à la lutte contre les départs de ressortissants français à l’étranger pour combattre les forces armées et les forces de sécurité françaises au nom d’une organisation terroriste islamiste. La proposition ne fut pas adoptée par l’Assemblée nationale lors de son examen en séance publique le 4 décembre 2014.
Au demeurant, un retour sur d’autres périodes permettra d’utiles éclairages. L’idée même de soustraire à la communauté civique les citoyens qui ont rompu avec les valeurs de la Cité n’est, en effet, pas si originale. Elle a traversé les siècles, et prospéra notamment à l’occasion de la première phase de la Révolution (1789-1792), au moment de la Terreur (1793-1794) comme lors de la répression du mouvement anarchiste dans les années 1890-1914.
Enfin, au vu des éléments présentés et des enseignements qu’il est possible d’en tirer, des propositions seront formulées, visant à répondre de la manière la plus efficace et la plus équilibrée à une menace dont l’irréductible singularité implique sans doute plus un effort d’imagination et de bon sens qu’une réhabilitation de vieilles recettes.
Afin de se forger une conviction et en prenant appui sur le maître ouvrage de Mme Anne Simonin, Le déshonneur dans la République. Une histoire de l’indignité 1791-1958 (2), a été sollicité l’avis de plusieurs professeurs d’histoire du droit et de droit pénal (3) sur l’intérêt que représenterait aujourd’hui pour notre société le retour à cette forme de « mort civique symbolique ». Leurs contributions se signalent par leur grande richesse et les éléments qui suivent puisent dans chacune d’entre elles. Que chacun des universitaires qui a consenti, dans un très bref délai, à se livrer à cet exercice soit ici profondément remercié pour sa disponibilité et son expertise incomparable.
Pour autant, naturellement, les réflexions et les conclusions qui suivent n’engagent que l’auteur de ces lignes.
I. LE RETOUR DE L’INDIGNITÉ NATIONALE DANS LE DÉBAT POLITIQUE
Le phénomène récent mais brutal occasionné par le départ de certains de nos concitoyens vers la Syrie pour combattre dans les rangs de l’organisation terroriste Daech suscite des inquiétudes fondées et impose des mesures efficaces de lutte contre la radicalisation et ses conséquences. Chacun cherche les réponses les plus adaptées et les parlementaires ont souhaité contribuer à ce processus en déposant des textes, par la voie de propositions de loi.
Ainsi a procédé, comme il vient de l’être rappelé, M. Philippe Meunier, qui suggéra cependant lors de l’examen de sa proposition de loi en commission, le 26 novembre 2014, de réécrire intégralement le dispositif qu’il préconisait par deux amendements :
– le premier consistait à substituer à la procédure de déchéance de nationalité une procédure de perte de nationalité qui concernerait tous les Français binationaux, qu’ils soient nés français ou qu’ils aient acquis la nationalité française a posteriori (4). Cet amendement proposait également de préciser le champ géographique des faits reprochés et d’instaurer des mesures administratives d’expulsion ou de refus d’accès au territoire français pour les individus concernés (5) ;
– le deuxième visait à sanctionner tout Français qui commettrait les mêmes faits que ceux visés par la perte de nationalité, mais qui n’aurait pas de double nationalité et que l’on ne saurait rendre apatride (6), pour crime d’indignité nationale assorti d’une peine complémentaire de dégradation nationale (7).
S’inspirant ouvertement du crime et de la peine d’indignité nationale instaurés par l’ordonnance du 26 août 1944 pour sanctionner le comportement des Français ayant collaboré avec le régime de Vichy pendant l’Occupation, cet amendement prévoyait de créer, au sein du code pénal :
– un crime d’indignité nationale, puni de trente ans de détention criminelle et de 450 000 euros d’amende à l’instar de la peine encourue pour avoir entretenu des intelligences avec l’ennemi en vue de susciter des hostilités ou des actes d’agression contre la France, en application de l’article 411-4 du code pénal ;
– une peine de dégradation nationale, obligatoirement prononcée à titre complémentaire, soit à titre définitif, soit pour une durée de trente ans au plus. Comme la peine d’indignité nationale introduite par l’ordonnance du 26 août 1944, elle emporterait un certain nombre d’interdictions indivisibles pour le condamné : privation de tous ses droits civils, civiques et familiaux, diverses interdictions professionnelles dans le secteur public et privé, impossibilité de paraître dans certains lieux déterminés par la juridiction.
Pour la poursuite, l’instruction et le jugement du crime d’indignité nationale, cet amendement renvoyait aux règles de procédure pénale applicables en matière de terrorisme prévues par le titre XV du livre IV du code de procédure pénale.
Rejetés en commission le 26 novembre 2014 puis en séance publique le 4 décembre 2014 suivant l’avis défavorable du Gouvernement, ces amendements n’ont donc pas prospéré, pas plus que la proposition de loi initiale. Sur la question spécifique du rétablissement du crime d’indignité nationale, le Gouvernement avait à l’époque considéré que les faits visés par cette nouvelle incrimination étaient déjà susceptibles d’être réprimés par le droit pénal en vigueur (8).
Néanmoins, ce débat a resurgi et connu un fort retentissement politique à la suite des attentats terroristes contre la rédaction de Charlie Hebdo, à Montrouge, et contre le magasin Hyper Casher, qui ont provoqué la mort de 17 personnes entre le 7 et le 9 janvier 2015.
Il ne faut pas s’en étonner. Un rapide regard porté sur notre histoire montre que, en dehors même du précédent de 1944, l’idée de « flétrir » ceux qui renient par leurs actes la Cité, le Roi, la Nation ou la République est récurrente. Être membre de la Cité est un honneur et se montrer indigne de cet honneur est passible de sanctions depuis des siècles.
II. QU’EST-CE QU’ÊTRE INDIGNE DE LA CITÉ ?
A. LES ORIGINES D’UN CRIME POLITIQUE FONDÉ SUR L’INDIGNITÉ
Comme l’explique le professeur Boris Bernabé, la question de la dignité du citoyen ou du sujet par rapport à l’honneur d’un État, d’une République, d’un royaume, d’une cité est ancienne et se pose nécessairement en termes politiques.
À Athènes, l’ostracisme permettait déjà « d’exiler pour dix ans, sans confiscation de ses biens, un citoyen considéré comme « dangereux » pour la cité et la démocratie » (9).
À Rome, la notion de crimen maiestatis est d’abord introduite pour réprimer les atteintes à la res publica – la chose publique, c’est-à-dire l’État, conçu comme une émanation du peuple romain –, puis également pour réprimer les atteintes à la personne du prince et à la majesté de la Cité. À partir du Ier siècle avant notre ère, cette majesté politique « devient une institution au sens propre et concret du terme, en ce qu’elle doit sa réalité aux faits (et pas seulement aux mots) que la légalité détermine : elle surgit dans les transgressions qui la lèsent, s’impose dans les procédures qui la préservent, triomphe dans les condamnations par lesquelles elle est rétablie » (10). Diverses lois punissent le crimen maiestatis, toutes liées à la dignitas et à l’honor. Se rendre coupable de lèse-majesté, c’est avoir volontairement porté atteinte à cette « grandeur et dignité de la Cité », c’est-à-dire commettre une indignité.
Cette incrimination politique perdurera jusqu’à la fin de l’Empire romain puis réapparaîtra de nouveau, après la rupture du haut Moyen-Âge, à partir de la fin du XIIe siècle. Les rois de France vont donc reprendre cette idée mais aussi, dans une grande continuité, les Constituants de 1789-1791 qui instaurent le crime de « lèse-nation ».
L’étude du professeur Jean-Christophe Gaven sur la « lèse-nation » (11) montre que cette nouvelle incrimination est aussi bien dirigée contre les ennemis contre-révolutionnaires (aristocrates, anciens ministres, comploteurs présumés, organisateurs de la fuite du roi en 1791…) que contre les révolutionnaires trop zélés comme Marat, Danton ou Desmoulins par exemple. Le crime de « lèse-nation » est alors fondé sur la volonté de respecter le plus possible les nouvelles garanties et la nouvelle organisation du procès pénal (publicité, principe de la contradiction, assistance d’un conseil, inspiration de la justice pénale ordinaire…). Il s’avère néanmoins d’une faible efficacité pour stopper les progrès de la contre-révolution, malgré le développement d’une intense activité de recherche policière hors des institutions judiciaires et des garanties procédurales entendues au sens strict (12).
Au demeurant, ce dispositif ne se signale pas par son excessive sévérité puisque, en deux ans et demi, il ne permet l’organisation que de quarante procès, aboutit à une seule condamnation à mort et, a contrario, à un grand nombre de relaxes et d’amnisties. Pourtant, cette expérience judiciaire du crime de « lèse-nation » est certainement décisive pour l’histoire contemporaine de la justice politique en ce qu’elle place celle-ci au cœur de la justice ordinaire.
M. Jean-Christophe Gaven révèle que la Révolution française a connu une autre phase de mise au ban de la communauté nationale pour cause d’indignité, de déshonneur ou de démérite, beaucoup plus connue, celle de la Terreur.
La « loi des suspects » votée le 17 septembre 1793 ordonne l’arrestation de tous les ennemis, avoués ou susceptibles de l’être, de la Révolution (nobles, parents d’émigrés, fonctionnaires destitués, officiers suspects de trahison, et accapareurs). L’exécution de cette loi, dont le contenu fut encore durci en 1794, ainsi que les arrestations furent confiées aux comités de surveillance et non aux autorités légales, ce qui tranche avec l’expérience précédente sur plusieurs points : rupture avec la justice ordinaire et les garanties qui y sont attachées au bénéfice de la multiplication d’institutions judiciaires spéciales, sévérité et ampleur de la répression… Les services de police et de recherche du renseignement sont renforcés et des mécanismes d’exclusion nationale institués. Comme la mémoire collective en a conservé la trace, ce dispositif se révéla particulièrement expéditif.
L’instauration d’une incrimination politique fondée sur l’indignité du citoyen ne remonte donc pas à l’ordonnance du 26 août 1944, ainsi que pouvait le laisser penser la proposition de loi de notre collègue Philippe Meunier. Une telle sanction est au contraire consubstantielle à la naissance de la République, comme l’est également la mise en œuvre d’une peine infamante prononcée à l’encontre de ceux qui la déshonorent.
B. LES ORIGINES D’UNE PEINE INFAMANTE FONDÉE SUR L’INDIGNITÉ
Sous la République athénienne, la perte des droits de citoyenneté constituait une peine sévère. Il existait deux sanctions de nature différente, punissant des fautes et ayant des conséquences diverses : l’ostracisme, déjà évoqué précédemment qui conduisait à la déchéance des droits de citoyenneté accompagnée d’un bannissement d’une durée de dix ans à l’encontre des citoyens jugés dangereux pour la Cité et son régime politique ; l’atimie qui entraînait une déchéance des droits à la citoyenneté à titre définitif ou temporaire, selon la gravité des faits. Elle sanctionnait des jugements d’ordre privé (spoliations, violences contre les personnes) mais surtout des délits d’ordre public tels que la corruption, les malversations ou les offenses aux magistrats. Une offense avérée à l’esprit de la démocratie pouvait notamment en être la cause, le citoyen étant alors jugé indigne de l’honneur que lui avait rendu la République en lui conférant la qualité de citoyen.
Comme l’évoque le professeur Boris Bernabé, le « déclassement » du citoyen trouve un écho, une fois de plus, en droit romain, où un citoyen déclassé était qualifié de sacer. Si le mot sacer, développe-t-il, a donné « sacré » en français, il ne faut pas se méprendre : l’homo sacer est bien ce citoyen qui est sorti, séparé, par un rituel procédural strict, de la sphère de la citoyenneté (13). Ainsi peut-il être tué ou vendu comme esclave. Il est mort civilement – et cette mort civile (c’est-à-dire « citoyenne ») peut être le préalable (nécessaire) à sa mise à mort physique. Le problème que pose la « mort civile » est lié à la réification de la personne. Le condamné devient une chose dont on peut se débarrasser ou tirer profit. La « mort civile », applicable aux condamnés à mort non exécutés, était perpétuelle et emportait privation de tous les droits civils et politiques – en somme de toute capacité juridique (tester, succéder, ester en justice, voter…). La succession de ceux qui la subissaient était ouverte et, parfois, leurs biens confisqués.
Au-delà de la mort civile, de nombreuses peines ont été créées en relation avec les notions d’honneur et de considération, et avec leur antithèse de déshonneur et d’infamie, dans le droit pénal de l’Ancien Régime. Celui-ci connaissait, à côté des sanctions corporelles et afflictives, des peines infamantes, comme l’amende honorable, la marque au fer rouge, l’exposition au carcan, la perte de la noblesse…
Si la « mort civile » de l’ancien droit finit par tomber en désuétude après la Révolution de 1789, vint s’y substituer dans le code pénal de 1791 une autre peine, tout aussi infamante : la « dégradation civique ».
Comme le souligne le professeur Jean-Louis Halpérin, son idée sous-jacente est la suivante : dès lors que tous les hommes naissent et demeurent égaux en droit, chacun dispose d’un honneur dont la valeur n’est pas liée à la naissance ou à la place dans la société. Or, cette honorabilité est susceptible d’être perdue au titre de huit infractions, assez hétéroclites, commises par des agents du pouvoir exécutif ou, par exemple, pour violation du secret de la poste. Les effets de la dégradation civique sont la privation perpétuelle de tous les droits attachés à la qualité de citoyen actif, sauf réhabilitation.
La spécificité de la dégradation civique de 1791 réside dans un cérémonial exécuté en place publique, destiné à humilier l’indigne devant la société. Le greffier y lit en effet la formule suivante : « Votre pays vous a trouvé convaincu d’une action infâme : la Loi et le Tribunal vous dégradent de la qualité de citoyen français. »
Dans le code pénal de 1810, la dégradation civique n’est plus accompagnée d’un cérémonial. Elle entraîne privation du droit de vote, d’élection et d’éligibilité ainsi que la destitution de toute fonction, emploi ou office public. C’est la peine qui s’applique pour sanctionner les différentes formes de forfaiture commises par des juges, procureurs et fonctionnaires publiques dans l’exercice de leur activité.
Elle se trouve élargie en 1832 dans ses fondements et sa portée. La dégradation civique devient alors une peine complémentaire des travaux forcés, de la réclusion et de la détention et s’applique à des milliers de condamnés chaque année. Elle est encore étendue par la loi du 18 mars 1849 aux condamnés à toutes les peines afflictives et infamantes.
En 1848, une autre procédure est introduite, destinée à déchoir de la nationalité les Français pratiquant la traite après l’abolition de l’esclavage. Elle n’a alors que peu voire aucun lien avec la question de l’indignité.
Néanmoins, durant la Première guerre mondiale, la déchéance de nationalité est étendue aux Français originaires de pays ennemis et, de manière plus pérenne en 1927, aux naturalisés ayant commis des crimes contre l’État à l’instar de la trahison. En 1938-1939, elle est encore élargie aux Français d’origine étrangère ayant commis des crimes ou délits, ou même à des Françaises ayant épousé des étrangers et demandant à être réintégrées dans la nationalité française. Enfin, on sait, et dans quelles circonstances, que le régime de Vichy a considérablement intensifié le recours à ces procédures et, même si l’expression « indignité nationale » n’est pas utilisée dans les textes normatifs, les documents de l’époque évoquent les personnes considérées comme « indignes » de conserver la nationalité française. La loi du 23 juillet 1940, enfin, a frappé de déchéance de nationalité les « dissidents » qui avaient quitté la France en juin 1940 : parmi les 446 personnes que le régime de Vichy a ainsi décrétées indignes de conserver la nationalité française figuraient notamment le Général de Gaulle, René Cassin et Pierre Mendès-France.
Ces précédents complexes, que les juristes de la France libre et de la Résistance connaissaient, éclairent les circonstances dans lesquelles a vu le jour le crime d’indignité nationale, institué par l’ordonnance du 26 août 1944 pour sanctionner l’aide apportée par des nationaux à un régime antirépublicain, Vichy, ayant délibérément choisi de se mettre au service de l’ennemi.
I. L’INDIGNITÉ NATIONALE À LA LIBÉRATION, UN PRÉCÉDENT HISTORIQUE FONDAMENTALEMENT DATÉ
L’ouvrage de Mme Anne Simonin (14) qui constitue la référence sur ce sujet, montre à quel point la restauration d’un crime et d’une peine d’indignité nationale par l’ordonnance du 26 août 1944 (15) est liée à des circonstances historiques exceptionnelles. Dans la mesure où le contexte actuel est en réalité très différent, le rétablissement de ces mécanismes pénaux semble relever d’un contresens historique et être inadapté à la lutte contre la menace terroriste et djihadiste que nous devons mener aujourd’hui.
A. UN CRIME POLITIQUE NÉ D’UN CONTEXTE TRÈS PARTICULIER
Rétroactive, l’ordonnance du 26 août 1944 sanctionnait des actes circonscrits à une période de l’histoire strictement bornée. La mise en œuvre de ce droit pénal d’exception était confiée à des juridictions spéciales. L’idée était dans un premier temps d’exclure de la Cité les personnes qui s’en étaient trouvées indignes pour leur permettre ensuite de la réintégrer. Toutefois, l’efficacité et la mise en œuvre du crime et de la peine d’indignité nationale ont très vite montré les limites de ce dispositif.
1. Le contexte historique : rétablir l’honneur républicain après Vichy
Comme l’indique Mme Anne Simonin : « Au sortir du régime de Vichy jamais peut-être la nécessité de rétablir l’honneur-vertu dans la République n’a été si pressante. De l’armistice " conclu dans l’honneur ", à la collaboration avec l’Allemagne nazie " dans l’honneur et pour maintenir l’unité française ", le maréchal Pétain n’a cessé de revendiquer le monopole de " l’honneur ", l’un des mots les plus fréquents de son vocabulaire politique. » (16).
Dès lors, la première tâche du Général de Gaulle et de l’ensemble des juristes résistants était double : d’une part, purifier la notion d’honneur en frappant de déshonneur les « Vichystes », c’est-à-dire tous les Français ayant volontairement apporté leur aide à un régime antirépublicain au service des nazis ; d’autre part, élever l’honneur au rang des principes de l’ordre républicain rétabli.
L’exposé des motifs de l’ordonnance du 26 août 1944 était ainsi particulièrement révélateur des enjeux auxquels les promoteurs de cette nouvelle incrimination entendaient répondre : « [Les deux ordonnances des 26 et 27 juin 1944] ne permettent pas de résoudre tous les problèmes soulevés par la nécessité d’une purification de la patrie au lendemain de sa libération. Les agissements criminels des collaborateurs de l’ennemi n’ont pas toujours revêtu l’aspect de faits individuels caractérisés susceptibles de recevoir une qualification pénale précise aux termes d’une règle juridique soumise à une interprétation de droit strict. » Autrement dit, un tri était opéré en dérogeant aux principes fondamentaux du droit pénal tels que la non-rétroactivité et l’interprétation stricte de la loi pénale, le principe de légalité des délits et des peines.
Ces entorses avaient une même conséquence, toujours exprimée dans l’exposé des motifs de l’ordonnance du 26 août : « Il ne s’agit pas de prononcer une pleine afflictive ou même privative de liberté mais d’édicter une déchéance. Le système de l’indignité nationale ne se place pas sur le terrain de l’ordre pénal proprement dit ; il s’introduit délibérément sur celui de la justice politique où le législateur retrouve son entière liberté et plus particulièrement celle de tirer, à tout moment, les conséquences de droit que comporte un état de fait. »
Pourtant Albert Camus estimait alors que ce texte était une « loi d’honneur » visant, à travers la notion d’indignité nationale, à sanctionner « ceux qui ont su trahir leur pays sans cesser de respecter la loi » (17). De fait, ses rédacteurs admettaient volontiers qu’une « discrimination juridique entre les citoyens [entre les dignes et les indignes] peut paraître grave car la démocratie répugne à toute mesure discriminatoire. Mais le principe d’égalité devant la loi ne s’oppose pas à ce que la nation [et non le juge] fasse le partage entre les mauvais et les bons citoyens. »
L’indignité nationale sanctionnait donc une allégeance idéologique hostile, mais les actes relevant de son périmètre n’étant pas susceptibles de donner lieu à l’engagement de poursuites pour collaboration avec l’ennemi ou trahison, les sentences auxquelles aboutissait la procédure excluaient les condamnations les plus lourdes – mort, déportation ou incarcération. Bref, elle impliquait une peine conçue comme relativement douce – ce qui permettait notamment de justifier le caractère rétroactif du dispositif – même si, dans la pratique, les juridictions compétentes se montreront souvent d’une grande sévérité.
Aux côtés des infractions les plus graves, donc, l’indignité nationale n’en était pas moins qualifiée de crime, lequel frappait aux termes de l’article 1er de l’ordonnance du 26 août 1944 « tout Français qui aura postérieurement au 16 juin 1940, soit strictement apporté en France ou à l’étranger une aide directe ou indirecte à l’Allemagne ou à ses alliés, soit porté atteinte à l’unité de la nation, ou à la liberté des Français ou à l’égalité entre ces derniers ».
Les faits incriminés étaient définis de façon très large, englobant des comportements variés tels que la participation aux « gouvernements ou pseudo gouvernements » ayant exercé en France entre le 16 juin 1940 et l’installation du Gouvernement provisoire de la République française (GPRF) mais également le fait d’avoir exercé une fonction de direction au commissariat aux questions juives ou au service chargé de la propagande, d’avoir participé à des manifestations artistiques, économiques, politiques ou autres en faveur de la collaboration avec l’ennemi, d’appartenir à un organisme de collaboration ou d’avoir apporté une aide morale ou matérielle à un journal antinational. Finalement, seules les relations amicales, voire sentimentales avec l’ennemi n’étaient pas sanctionnées en tant que telles, sauf à avoir été accompagnées d’autres actes eux-mêmes répréhensibles au titre de l’indignité nationale.
2. Une répression rétroactive de faits accomplis durant une période strictement limitée
L’ordonnance du 26 août 1944 était rétroactive puisqu’elle sanctionnait des faits s’étant déroulés sur une période strictement définie entre le 16 juin 1940 – date du dernier gouvernement de la IIIe République avant l’arrivée au pouvoir du Maréchal Pétain – et l’installation du GPRF sur le territoire métropolitain à la suite de la libération de Paris le 25 août 1944.
La répression du crime d’indignité nationale, à travers la création d’une nouvelle peine d’indignité nationale, emportait la privation de tous les droits civiques, civils et politiques, certaines incapacités ainsi que certaines interdictions professionnelles. Cette peine, infamante et indivisible, pouvait en outre être assortie d’une peine complémentaire, l’interdiction de résidence sur certaines zones du territoire. La gravité de la peine était liée à son caractère perpétuel sauf amnistie, grâce ou réhabilitation. Ainsi déclassé, le citoyen indigne était placé au ban de la société.
La justification du caractère rétroactif de cette ordonnance instituant un nouveau crime politique et une nouvelle peine infamante reposait sur trois arguments :
– le fait que le crime d’indignité nationale relevait de la « loi pénale plus douce » que la peine capitale (cf. infra) ;
– la nécessité de sanctionner des actes inconnus dans la tradition républicaine : il apparaissait plus clair de créer un crime nouveau attaché à des circonstances historiques exceptionnelles à l’encontre des Français ayant « méconnu l’idéal et l’intérêt de la France au cours de la plus douloureuse épreuve de son histoire » (18) ;
– le fait que l’incrimination était temporaire car l’infraction ne pouvait être constatée que dans un délai de six mois après la Libération totale du territoire, fixée le 8 mai 1945.
3. Un droit pénal d’exception sous le contrôle de juridictions spéciales
Outre l’instauration d’un nouveau crime politique assorti d’une nouvelle peine infamante, l’ordonnance du 26 août 1944 instituait des juridictions d’exception.
En effet, il incombait à l’origine à une « section spéciale » puis selon les changements contenus par l’ordonnance codificatrice du 26 décembre 1944 à une « chambre civique », de constater le crime. Réparties sur l’ensemble du territoire, elles se prononçaient après audience publique, sur le rapport oral d’un commissaire du gouvernement assumant à la fois la fonction de juge d’instruction et de procureur de la République, en présence ou non de l’accusé. Leur jugement pouvait être contesté seulement par la voie du pourvoi en cassation, non pas devant la chambre criminelle de la Cour de cassation mais devant la chambre de mise en accusation de la cour d’appel de Paris.
La peine consistait en un long catalogue de quatorze sanctions (19) : privations de droits (droits civiques, permis de port d’armes), destitutions et exclusions professionnelles (emplois publics, professions juridiques, judiciaires et bancaires, professions en lien avec la jeunesse, certaines professions artistiques, fonctions de direction), déchéances (notamment militaires), incapacités (juré, tuteur, curateur). À ces différentes sanctions pouvaient le cas échéant s’ajouter deux peines complémentaires : la possible interdiction de résidence « dans un certain nombre de localités » précisées par le jugement de la chambre civique, ainsi que la confiscation soit de la totalité, soit d’une quote-part des biens du condamné – à l’image de ce qui a été mis en place à la Révolution à l’encontre des Émigrés. Dans cette optique, la dégradation nationale était en réalité un peu plus qu’une peine seulement « infamante », dans la mesure où elle ne flétrissait pas uniquement la réputation (fama) du coupable, mais lui rendait aussi la vie plus difficile matériellement (20).
Il importe en revanche de noter que les ordonnances de 1944 ne prévoyaient nullement pour les condamnés la privation de la nationalité française. Même si la peine pouvait être prononcée à perpétuité, la vocation du mécanisme, souligne M. François Saint-Bonnet, était en effet de ne punir que temporairement, le temps que ceux auxquels elle était infligée paient pour leur crime, qu’ils s’amendent et qu’ils regagnent au plus vite la société dont ils sont issus et qu’ils n’ont quitté que moralement.
Relevons cependant que le crime revêtait un caractère transitoire, puisqu’il renvoyait à des faits constatés au plus tard le 8 novembre 1945, soit six mois après la date de la libération totale du territoire (8 mai 1945)21. En d’autres termes, le crime d’indignité nationale, manifestation d’un état d’exception, n’avait pas vocation à être pérennisé…
4. Une sanction pénale visant in fine à réintégrer l’indigne dans la Cité
Dans l’esprit des juristes de la Résistance, l’instauration du crime d’indignité nationale devait donc répondre à une double finalité :
– juger les vaincus, accusés d’avoir déshonoré la République, pour les condamner à une nouvelle « mort civique », certes plus douce que la peine capitale mais revêtant une gravité toute particulière, tout en leur laissant néanmoins la possibilité d’être réintégrés à la Cité, par la voie de la « réhabilitation » ;
– obtenir l’adhésion des populations libérées aux institutions mises en place par le GPRF, autrement dit à la restauration de la République, à travers la diffusion d’une morale politique permettant de distinguer le « bon » citoyen du « mauvais ».
Cette ordonnance, qui ambitionnait de purifier la Nation à la suite de la période de collaboration avec l’ennemi reposait ainsi sur un préalable incontournable : l’importance attachée à cette valeur qu’est l’honneur d’être un « bon citoyen » dans la Cité, tant par les personnes poursuivies que par les populations libérées.
À cet égard, la possibilité d’être réhabilité, en application de l’article 2 de l’ordonnance du 26 août 1944, par « les personnes qui, postérieurement aux agissements retenus contre elles, [s’étaient distinguées] par des actions de guerre contre l’Allemagne ou ses alliés ou par la participation active à la résistance contre l’occupant ou le pseudo-gouvernement de l’État français », montre que l’important était bien d’avoir, à un moment ou à un autre, « sauvé l’honneur ». En tout état de cause, l’indigne national, une fois purgé sa peine, redevenait citoyen de plein exercice dans la République.
5. Un régime juridique instable dont l’efficacité et la mise en œuvre ont finalement été largement contestées
Comme le souligne Mme Anne Simonin, l’ordonnance de 1944 fut modifiée à trois reprises durant la même année (22) alors même que les sections spéciales avaient à peine commencé à siéger, la première audience ayant eu lieu à Paris le 2 janvier 1945. Elle fut de nouveau modifiée et complétée par l’ordonnance n° 45-199 du 9 février 1945 (23).
La raison de ces modifications incessantes était notamment liée aux imperfections initiales tenant à la confusion dans les principes et à une lacune dans la mise en œuvre. L’ordonnance considérait en effet l’indignité à la fois comme un crime, une peine et un état juridique. Sur le plan de la mise en œuvre, la création des sections spéciales sur le territoire a donné lieu à des difficultés avec une large et inévitable part d’arbitraire.
Le gouvernement tenta de réparer ces imperfections en distinguant d’une part le crime d’indignité nationale de la peine de « dégradation nationale », d’autre part en remplaçant, comme cela a été mentionné, les « sections spéciales » par les « chambres civiques » de la Seine dans le ressort de la cour d’appel de Paris. La peine fut néanmoins alourdie par de nouvelles privations de droits auxquelles le législateur résistant n’avait jamais songé : interdiction totale du territoire, majoration de 10 % des impôts, perte de tout droit à indemnité pour les dommages de guerre, non-restitution du corps des victimes de guerre à un indigne national…
Dans les faits, les chambres civiques de la Seine ont condamné 98 436 personnes pour indignité nationale, ce qui en fait la sanction la plus massivement appliquée par les juridictions françaises à la Libération. À titre de comparaison, le nombre de condamnés à mort exécutés s’est élevé à 1 500 personnes (24).
En outre, l’application de la peine par les juridictions s’est traduite par un durcissement des sanctions puisque, selon les chiffres présentés dans l’ouvrage d’Anne Simonin, près de 2 000 personnes ont été condamnées par contumace. Or, en l’absence du condamné, les juridictions d’exception appliquaient la peine de dégradation nationale à son maximum, c’est-à-dire à vie, assortie d’une interdiction totale du territoire et d’une confiscation générale des biens présents et à venir. De plus, alors que le législateur résistant s’était expressément refusé à associer indignité nationale et déchéance de nationalité, trente personnes naturalisées depuis moins de dix ans et condamnées à la dégradation nationale à vie ont été déchues de la nationalité et sont devenues apatrides.
Cette nouvelle « mort civile » (qui comportait 27 incapacités en 1951 contre 13 seulement en 1944) a conduit à des complications extrêmes de situations personnelles et à l’existence de plus de 250 personnes dans un état perpétuel de « non sujet de droit » selon l’expression du doyen Jean Carbonnier. Cette situation a d’une certaine manière « inversé le stigmate et transformé les Vichystes, sinon en martyrs, du moins en victimes de la Libération » (25), conduisant le législateur à adopter une loi d’amnistie le 5 janvier 1951(26). Cette amnistie a concerné près de 80 % des condamnés et réduit, pour les autres, le nombre d’incapacités à huit et leur durée à un maximum de vingt ans.
C’est le code pénal de 1992 qui supprimera la dégradation civique et la privation des droits civiques de tous les condamnés – cette privation dépendant depuis lors de la gravité du délit ou du crime. Et la notion de peine infamante a elle-même été considérée comme abolie selon un avis du Conseil d’État du 2 avril 2003 (27)
Le rappel du contexte historique exceptionnel et de la déception qui a résulté de l’application de cette « loi d’honneur » incite à une très grande circonspection quant à l’intérêt de remettre au goût du jour cette incrimination et cette sanction pénales datées pour lutter efficacement contre la menace terroriste et djihadiste.
A. UN PRÉCÉDENT FONCIÈREMENT DATÉ POUR RÉPONDRE À LA MENACE ACTUELLE
La France de 2015 n’est plus celle de 1944. Depuis lors, le Parlement, en accord avec les engagements internationaux contractés par notre pays, a aboli la peine de mort, a supprimé le bannissement (contraire à la Convention européenne des droits de l’homme) et a renoncé, comme cela vient d’être rappelé, à la dégradation civique obligatoire. Certains processus, communs à l’ensemble des démocraties occidentales, sont aujourd’hui irréversibles. La France, dès lors, ne dispose plus des marges de manœuvre politiques et juridiques qui pouvaient être les siennes à la Libération, a fortiori en 1789 ou en 1794. Ce constat irréfutable n’est évidemment pas sans incidence sur le sujet traité. Il était sans doute loisible au législateur en 1944 d’instituer une nouvelle incrimination appliquée de manière rétroactive par des juridictions d’exception, au mépris des principes fondamentaux du droit pénal, mais fort heureusement l’exercice de cette faculté se heurterait de nos jours à de sérieux obstacles !
Surtout, le crime d’indignité nationale a vu le jour à la Libération dans un contexte historique très particulier. S’ils ont certes en commun d’avoir pris les armes contre leur pays, la psychologie du vichyste n’en diffère pas moins très considérablement de celle du djihadiste. La dégradation nationale a sans nul doute été vécue comme une infamie par le premier, dont un patriotisme dévoyé mais non moins réel a servi de prétexte à sa participation à l’entreprise de collaboration, alors que le second, bien que Français, se soucierait vraisemblablement fort peu de perdre sa qualité de citoyen… Autre différence de taille, le combat des vichystes avait pris fin à la Libération, alors que les djihadistes, bien entendu, ne perçoivent nullement le leur comme dépassé, ni sur le plan idéologique, ni sur le plan militaire. Comme le souligne à juste titre M. François Saint-Bonnet, ils ne se considèrent pas comme les anciens sectateurs d’une cause perdue, mais bien au contraire comme les fiers combattants d’une guerre qu’ils pensent être en mesure de gagner à terme.
Notons encore que si l’incrimination d’indignité nationale, ainsi qu’on l’a vu, était en 1944 triplement limitée sur le plan temporel, la transposition d’un tel mécanisme en 2015 impliquerait nécessairement, au vu des singularités des actions terroristes, de renoncer à de telles limitations. Nul terme ne peut en effet être fixé dès lors que rien n’indique que les djihadistes aient l’intention de déposer les armes ; la condamnation à temps serait inappropriée dans la mesure où le mal visé ne s’éteindrait pas nécessairement avec la fin de la peine ; enfin la logique de l’amnistie ne peut trouver à s’appliquer dans le cas d’espèce car elle suppose l’existence de groupes structurés, homogènes et disciplinés disposés à renoncer à la violence – autant de conditions qui, dans la présente configuration, ne sont absolument pas réunies (28).
L’on voit mal en conséquence comment le crime d’indignité nationale institué il y a soixante et onze ans pourrait servir de modèle à un nouvel outil juridique ayant vocation à réprimer le mal auquel la France cherche aujourd’hui à répondre. Il n’y a rien ou presque de commun entre les situations, spécialement quant au nombre des personnes concernées (100 000 condamnations à la Libération, quelques dizaines de terroristes et quelques centaines de sympathisants de la « doctrine » djihadiste de nos jours) et quant au caractère temporaire ou non de la question à traiter (en 1944, une « épuration » de gens qui ne sont plus dangereux, actuellement un combat contre des combattants prêts à sacrifier leur vie pour la cause qu’ils défendent).
Une analyse historico-juridique plus large des mécanismes d’indignité nationale vient confirmer ce jugement. M. Jean-Christophe Gaven constate qu’ils ont toujours vu le jour dans un contexte spécifique, caractérisé par certains traits communs dont on chercherait en vain la trace dans la France de 2015 :
– sur le plan institutionnel, ces mécanismes sont toujours utilisés dans des périodes de troubles où l’enjeu essentiel est de consolider la substitution de la justice légale de l’État à la justice expéditive et sommaire des foules ;
– sur le plan symbolique, ils sont un moyen de consécration d’une conception de la Nation sur une autre, ce qui suppose que celles-ci soient en présence équivalente l’une de l’autre.
1. Sur le plan institutionnel : une technique de réaffirmation de la justice étatique sans rapport avec la situation française actuelle
Quelles que soient leurs différences, les mécanismes pénaux auxquels les pouvoirs publics ont recouru en 1789, 1793 et 1944 ont en partage d’avoir été utilisés dans un contexte particulier où l’enjeu premier de l’État, sur fond de rassemblement national et de tranquillité publique, était de mettre fin aux exactions populaires, aux vengeances particulières et d’y substituer l’autorité de la justice étatique. Une telle substitution a servi à canaliser les « pulsions justicières ». La disqualification des foules vengeresses visait en effet non seulement une meilleure garantie des droits des suspects et des accusés, qu’il s’agissait d’arracher aux passions vindicatives et aux risques d’injustice, mais aussi le renforcement de la crédibilité même des nouvelles institutions à l’origine de ces mécanismes – car ceux-ci, historiquement, voient toujours le jour à l’occasion de transitions, lorsqu’à un régime politique s’en substitue un autre.
Révolutionnaires de 1789 ou de 1793, Résistants de 1944 avaient tous une conscience très aigüe de la nécessité vitale, pour la nouvelle forme du pouvoir qu’ils portaient, de démontrer leur capacité à assurer l’ordre public, d’où l’on déduirait une bonne part de leur légitimité. Tel fut le cas des constituants dès l’été 1789 lorsque les désordres de la Grande Peur risquèrent de faire regretter l’Ancien régime. Tel fut aussi le cas des conventionnels lorsqu’au souvenir des massacres populaires de septembre 1792, ils acceptèrent d’être, pour reprendre les mots de Danton devant la Convention le 10 mars 1793 « terribles pour éviter au peuple de l’être ». Tel fut encore le cas en 1944 lorsque les premiers succès de la Résistance ouvrirent inévitablement le champ d’une épuration populaire expéditive et sommaire, parfois même organisée par des résistants de la dernière heure qui trouvaient là l’occasion de vengeances et de calculs personnels étrangers aux questions de collaboration.
Chaque fois, la nécessité impérieuse d’incarner le nouvel ordre a conduit à faire reposer celui-ci sur le fonctionnement de la justice étatique et à disqualifier les mouvements de foule prétendant exercer une justice immédiate, naturelle ou de bon sens. Si les réponses judiciaires ont varié d’une expérience à l’autre, l’unité de ces expériences n’en a pas moins été réelle, comme en témoignent les références à la Révolution française de Léon Julliot de La Morandière, doyen de la faculté de droit de Paris en 1944, figure morale et scientifique du rétablissement républicain, inspirateur de l’ordonnance du 26 août 1944 et peu suspect de sympathies ou d’emportements révolutionnaires.
Dénoncer un individu en tant que « criminel de lèse-nation » en 1789, de « traître à la patrie » en 1793 ou le frapper d’« indignité nationale » en 1944 n’avait donc pas seulement pour but de qualifier les faits qu’on lui reprochait, mais apparaissait comme un moyen pour les nouveaux pouvoirs d’affirmer très fortement, avec toute la charge symbolique des mots choisis, que l’État s’occupait lui-même de ceux qui faisaient le plus horreur à la communauté et constituaient la plus grave menace contre son existence et sa cohésion. Bref, il s’agissait pour une autorité encore en phase de constitution d’imposer l’idée qu’elle avait conscience de la menace, qu’elle la prenait à sa juste mesure et qu’elle se chargeait elle-même, par les outils qu’elle allait légalement établir, de la réprimer.
Les premiers effets de ces mécanismes se situent d’ailleurs bien sur ce plan. Plus que l’élimination de tous les opposants, c’est bien la canalisation des vengeances populaires qui fut attendue et parfois obtenue par ces nouveaux pouvoirs. Ce fut le cas à partir du mois d’août 1789 lorsque ceux que l’on suspectait de fomenter un complot aristocratique cessèrent d’être lynchés par les foules, pour être remis aux nouvelles autorités. Ce fut même le cas à l’occasion de la Terreur judiciaire – laquelle optant pour une justice d’exception et implacable, choquant la plupart de nos principes pénaux, rechercha sa légitimité dans une violence mimétique à celle des foules et dans la canalisation minimale que lui permit ce déplacement. Ce fut le cas, enfin, des procès conduits à partir de 1944, qui parvinrent progressivement à endiguer les vengeances privées.
L’on voit bien combien diffèrent radicalement de celui que nous connaissons aujourd’hui les contextes historiques dans lesquels émergèrent les mécanismes d’indignité nationale. Trois points en particulier, dans cette perspective, méritent d’être soulignés.
Tout d’abord, la nécessité de la prévention et de la répression des actes de terrorisme ne saurait suffire à justifier le recours à l’incrimination d’indignité nationale. Celle-ci sert en même temps d’autres enjeux, d’autres finalités, inséparables de la lutte contre les « ennemis de la Nation ». Ignorer ces finalités particulières et les confondre avec celle, globale, du combat contre le terrorisme risque d’activer un moyen qui se révélera totalement inefficace, en tout cas institutionnellement inutile.
Ensuite, l’État n’est pas, aujourd’hui, en situation de transition institutionnelle. Aucun régime n’est en train de se substituer à la Ve République. La nécessité d’une incrimination signifiant la volonté et la puissance d’un nouveau pouvoir, sa capacité à incarner la nouvelle justice s’avère donc hors de propos et de contexte.
Enfin, il n’existe aujourd’hui en France aucun phénomène de justice populaire à canaliser ou à disqualifier. Les « agressions antimusulmanes » – concept préférable à celui « d’islamophobie », qui même s’il signifie littéralement « phobie envers l’Islam », traduit une confusion facilitant l’amalgame entre la critique des idées et celles des identités – n’entrent évidemment pas dans cette catégorie. Ce sont des actes haineux et violents qui sont, à ce titre, rejetés par la société et combattus par les pouvoirs publics. Ils ne sauraient être qualifiés d’actes de justice populaire. Ils relèvent de la lutte contre les crimes tels qu’ils sont définis par le code pénal ou la loi du 29 juillet 1881 par l’expression de « discrimination, haine ou violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, à une nation, une race ou une religion déterminée ».
Ces agressions racistes et xénophobes ne peuvent donc être interprétées comme des actes populaires justifiant, à des fins de substitution ou de disqualification, le jugement étatique du crime d’indignité nationale. Commettre une telle confusion signifierait que l’on donnerait acte à de telles proscriptions populaires, qu’on leur reconnaîtrait le mérite d’identifier spontanément les indignes de la Nation, et qu’il s’agirait seulement d’y substituer les formes et les garanties de la justice étatique. Le glissement ne serait pas seulement juridique, mais aussi moral – et mettrait en péril ce qu’il faut précisément sauvegarder : la cohésion de la communauté nationale.
2. Sur le plan symbolique : une technique de proclamation nationale inadaptée à la situation française actuelle
Historiquement et judiciairement, le recours aux mécanismes d’indignité nationale ou de déshonneur national renvoie à un contexte commun, marqué par le besoin non seulement d’affirmer une conception de la Nation mais plus encore de substituer une définition à une autre.
En 1789, ainsi, ce contexte de substitution est évident. À une Nation non souveraine, regardée comme une mineure sous la tutelle paternelle du roi de France, le Tiers état et les états généraux opposent la conception d’une Nation souveraine, dotée de ses propres institutions, origine de l’ensemble des pouvoirs ainsi que des délégations et représentations. Pour autant, la nouveauté des principes choque une partie de l’opinion, et cette Nation nouvelle, très « politique », a ses opposants, bientôt ses ennemis. Quoi qu’il en soit, dès le début de la Révolution, deux conceptions s’affrontent, sont en présence l’une de l’autre sans que le sort de la Nation souveraine, c’est-à-dire révolutionnaire, ne soit assuré. L’une ou l’autre version peut l’emporter. Et nul doute que l’idée même de « lèse-nation » concourt à identifier un groupe tout autant qu’une conception qu’il s’agit de tenir à l’écart. Et nul doute non plus que dans un processus révolutionnaire en mouvement continu, rappeler régulièrement au moyen d’une expression très symbolique ce que n’est pas la Nation est une façon de conserver la conscience de ce qu’elle est et de renforcer le sentiment d’appartenance de ceux qui n’en sont pas bannis.
En 1793, la situation n’est guère différente. La répression judiciaire emprunte d’autres voies, clairement exceptionnelles, mais comme en 1789, deux conceptions opposées de la Nation sont en présence l’une de l’autre. Non seulement la substitution de 1789 n’est pas encore assurée, mais l’implication militaire de la quasi-totalité des monarchies européennes auprès des contre-révolutionnaires français renforce la dualité et l’incertitude de la conception de la Nation. Rassembler les patriotes autour d’un projet commun, d’une conception commune passe donc, là encore, par l’usage de techniques opposant ceux qui sont dedans et ceux qui sont dehors. Avec des conséquences plus drastiques qu’en 1789 puisqu’être « dehors » désormais est prononcé avant le déclenchement des procédures judiciaires, ce qui permet de réputer hors de la Cité ceux qui s’attaquent à elle, et donc hors des protections qu’elle assure à ses membres, c’est-à-dire les citoyens.
La Libération, enfin, signe une nouvelle circonstance où le changement d’institutions publiques s’accompagne d’un nouveau besoin de substitution d’une conception de la Nation à l’autre. Certes, à la nation pétainiste, définie dès 1940 par le programme de la « Révolution nationale », le GPRF oppose la continuité de la République. Mais derrière l’usage très politique des mots et des symboles, cette idée de continuité dissimule mal celle de « réinstallation ». De la même manière que Vichy a substitué ses propres institutions à celles de la IIIe République, le régime du maréchal Pétain a imposé et diffusé ses propres valeurs, ses propres représentations de la communauté nationale. En 1944, la tâche du GRPF est doublement délicate. Il s’agit en effet non seulement de proclamer hautement que Vichy n’était ni la République, ni la Nation, et que ces deux dernières vont enfin reprendre leur cours, mais aussi d’éviter la disqualification de la très grande majorité du peuple français, autrement dit, sur fond de nuances entre maréchalisme et collaborationnisme, écrire l’histoire d’un peuple que l’on détache de celle de ses représentants et de ses institutions.
Tâche délicate que cette nouvelle expression du « nous » et du « eux », à laquelle participe activement le crime d’indignité nationale. Celui-ci, en effet, permet non seulement d’éviter à chacun de tracer sa propre ligne de démarcation nationale et d’appliquer une forme de justice privée, mais surtout il permet de circonscrire officiellement le cercle des indignes : 100 000 personnes à écarter de la refondation républicaine et nationale sur 40 millions de Français – voilà ce que l’incrimination offre le moyen d’affirmer. La reconstruction peut donc commencer. L’indignité nationale vient de servir d’élément de clarification : absolution d’une partie des Français, affirmation d’une continuité républicaine de la conception de la Nation, mise à l’écart d’un groupe d’individus servant de repoussoir par effet miroir et neutralisés au moment de prendre des responsabilités dans le nouveau régime politique et économique : telles sont les vertus collectives et symboliques de l’incrimination et de la dégradation civique qui la punit.
Si l’on admet que les mécanismes d’indignité nationale ont eu essentiellement pour vocation de protéger une conception de la Nation contre une conception concurrente, réelle et de force équivalente (ne serait-ce que par sa présence préalable), tout recours à un tel dispositif dans la situation présente se révélerait pour le moins contestable. En effet, si les actes commis par les terroristes impliquent bien un rejet de nos valeurs fondamentales et de nos institutions, ils ne constituent pas pour autant en eux-mêmes un courant d’idées contraires auquel se serait ralliée une partie de la population. Il n’y a en France ni guerre civile, ni programme idéologique de substitution d’une nouvelle conception de la Nation, justifiant la protection de la conception actuelle par des techniques de disqualification. De même, la conception actuelle est, par essence, la conception en vigueur : elle ne vient pas se substituer à une définition de la Nation qu’il s’agirait de chasser. De ce point de vue, l’histoire des recours aux mécanismes d’indignité nationale est d’un très faible secours à sa réactivation.
Naturellement, ce n’est pas parce que les conditions qui, hier, ont favorisé l’émergence d’une telle incrimination ne sont pas aujourd’hui réunies qu’il faut pour autant renoncer à toute tentative visant à l’adapter aux circonstances du temps présent. La question qu’il faut à présent se poser est celle de l’opportunité de rétablir une telle sanction, moyennant les nécessaires aménagements, dans la France de 2015.
B. UN CHOIX POSSIBLE MAIS PEU SOUHAITABLE
L’objectif ici est d’évaluer la portée d’une restauration d’un tel mécanisme sur les plans moral, juridique, politique et fonctionnel. Cet état des lieux doit nous permettre de déterminer si, oui ou non, le rétablissement du crime d’indignité nationale ainsi que de la peine de dégradation civique est envisageable, et, surtout, s’il est souhaitable.
Si les contextes passés qui ont permis l’émergence d’une telle incrimination diffèrent radicalement de l’environnement dans lequel, aujourd’hui, nous évoluons, tous ces épisodes sans exception ont du moins en commun la gravité des faits commis, l’émotion populaire qu’ils ont suscitée et une forme de consensus sur la nécessité de leur apporter une réponse forte et adaptée.
Dans cette optique, l’invitation à la réflexion sur les conditions d’une éventuelle réactivation de l’infraction d’indignité nationale s’avère sans aucun doute moralement compréhensible. La tentation ne peut être que forte, à la suite des attentats de janvier 2015, de qualifier le terroriste d’indigne. Les immenses manifestations qui se sont déroulées sur l’ensemble du territoire dans les jours qui ont suivi les attentats – moments intenses de communion nationale(29) –, ont témoigné de la volonté de nos concitoyens de réaffirmer haut et fort les valeurs de la République contre le terrorisme ou toute forme de barbarie.
Or les exactions perpétrées révèlent assurément chez leurs auteurs un mépris envers ces valeurs essentielles qui fondent notre pacte républicain. Elles attestent chez ceux qui s’en rendent coupables une sorte de rébellion caractérisée contre la France : en prenant les armes contre elle, les criminels peuvent sembler se placer eux-mêmes, de facto, en dehors de la communauté nationale, faisant la preuve qu’ils ne méritent plus de lui appartenir. Dans ces conditions, il incomberait à la Nation d’en tirer les conclusions qui s’imposent, en condamnant ces individus à une forme de mort civile dont la durée et l’intensité seraient déterminée par la gravité des faits commis.
Il n’y a aucun obstacle juridique majeur au rétablissement d’un crime politique d’indignité nationale et d’une peine de dégradation nationale. Par le truchement de ce dispositif, il s’agirait, comme le soulignent MM. Philippe Conte et Didier Rebut, de sanctionner, ou mieux de punir tout criminel qui, s’étant de lui-même placé hors de la communauté nationale, mériterait d’être privé des avantages liés à la citoyenneté. Selon les mots de M. Boris Bernabé, cette justice politique prendrait nécessairement la forme d’une justice de droit commun – elle se confondrait même avec elle, sous réserve :
– de définir précisément les champs matériel et personnel de cette nouvelle incrimination et de cette nouvelle peine ;
– de respecter les principes de non-rétroactivité des lois pénales plus sévères, de légalité (définition précise des faits constitutifs de l’infraction, du contenu de la peine et de sa durée), de nécessité (absence de disproportion manifeste entre l’infraction et la peine encourue), d’individualisation des crimes, des délits et des peines (prise en compte des circonstances de l’espèce par le juge) ainsi que les droits de la défense.
M. Éric Desmons, M. Éric Gasparini et Mme Raphaële Parizot considèrent néanmoins que le rétablissement d’un crime politique fondé sur l’indignité nationale et, plus encore d’une peine infamante de dégradation nationale, contreviendrait à la logique retenue en France depuis l’entrée en vigueur du nouveau code pénal, qui a supprimé toute peine infamante issue de l’Ancien régime, et se heurterait sans doute à la censure de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) au nom du respect intangible dû au principe de la dignité humaine – qu’elle considère comme constituant « l’essence même de la Convention [européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales] » (30). De surcroît, le respect de ce principe est consacré par de nombreuses conventions internationales que la France a ratifiées en 1980 (31).
M. Martial Mathieu souligne néanmoins qu’à la différence de la dignité humaine, à laquelle est attachée la jouissance des droits de l’homme, la dignité de citoyen peut être perdue, emportant la privation de tout ou partie des droits attachés à cette dignité. Si tous les citoyens sont présumés égaux en honneur et dignes de jouir des droits civiques, cette présomption n’est pas absolue : le citoyen qui manque gravement à ses devoirs peut se rendre indigne des droits qui en dépendent.
Si l’on fait sienne cette interprétation, reste à déterminer si ce nouveau crime politique et cette nouvelle peine infamante devraient relever du ressort des juridictions ordinaires – comme en 1789-1791 – ou de juridictions d’exception
– comme en 1793-1794 et en 1944-1951. Or, la justice politique a toujours oscillé, depuis 1789, entre l’ambition visant à la réintégrer dans le champ de la justice ordinaire et la tentation de l’en extraire en raison de la gravité de menaces qui justifieraient l’instauration d’un droit pénal d’exception.
3. Politiquement séduisant mais ambigu
On saisit sans peine le sens politique que l’on pourrait donner à une telle mesure.
Le terrorisme ne serait plus ainsi uniquement perçu comme un acte criminel d’une gravité toute particulière du fait de l’horreur de ses procédés et de la lâcheté de son exécution.
Par l’institution d’un crime d’indignité nationale, l’accent serait mis sur le défi que lancent les terroristes à la République et à ses valeurs. Nous quitterions le champ strict de la criminalité sous une de ses formes les plus dures, les plus graves, les plus odieuses, pour envisager le terrorisme comme une guerre ouverte menée contre notre régime démocratique. Une telle interprétation peut s’entendre. Mais répondre ainsi par cette forme de flétrissure républicaine en faisant référence au précédent historique de 1944 ne serait cependant pas sans ambiguïté en raison de la complexité des concepts juridiques invoqués.
Il n’est pas rare de relever dans les commentaires relatifs à l’indignité nationale une certaine confusion puisqu’elle est souvent présentée comme une peine, alors qu’il s’agit en réalité d’une incrimination susceptible d’être sanctionnée par un mécanisme de dégradation civique. Plus grave, l’idée s’est désormais imposée dans une partie de l’opinion publique que le rétablissement de ce crime doit permettre de déchoir de leur nationalité française les auteurs d’actes terroristes.
Or, en réalité, une telle déchéance ne correspond absolument pas à l’esprit de cette incrimination. Ainsi que le fait observer M. Eric Desmons, la perte de « la qualité de citoyen français » n’est pas une perte de nationalité, mais une perte de jouissance des droits politiques, correspondant à une rétrogradation dans l’échelle de la citoyenneté (une « citoyenneté infâme » ou une « sous-citoyenneté » passive). Il s’agit donc de retirer à un citoyen un statut auquel sont attachés droits et obligations, étant entendu qu’il reste membre de la communauté nationale en étant frappé d’incapacités, électorales et professionnelles essentiellement (32). Autrement dit, l’indignité nationale n’a pas pour but d’exclure un citoyen de la communauté nationale, mais de le désigner à cette communauté comme étant un « mauvais citoyen ».
Soulignons ensuite que cette infraction suppose une peine – la dégradation civique – dont l’exécution répond à un esprit très particulier : il s’agit de déshonorer, voire d’humilier et d’admonester publiquement (et avec le maximum de publicité) le condamné. Ainsi, sous la Révolution, la perte des droits civiques s’accompagnait d’une humiliation publique lors d’un rituel bien défini, essentiel et fort spectaculaire (exposition en place publique, carcan…). C’est là toute la singularité et toute la force symbolique d’une telle condamnation, qui la distingue d’une simple perte des droits civiques et civils. Or, d’un point de vue juridique, il est difficile d’imaginer aujourd’hui l’équivalent de la mise au carcan ou d’une quelconque humiliation publique et médiatisée, puisqu’il s’agirait d’un traitement dégradant au sens de la Cour européenne des droits de l’homme.
Sur le plan du droit et de la philosophie, l’instauration d’une telle infraction soulève d’autres difficultés majeures. D’abord le concept d’indignité nationale fait bien entendu appel en creux à la notion juridique de « dignité », qui est très contestée et contestable. Dès lors que le code civil sanctionne l’atteinte à la dignité de la personne, s’interroge M. Jean-Louis Halpérin, comment pourrait-on reconnaître à la loi le pouvoir de retirer à un individu, fût-il le plus endurci des criminels, cette même dignité ? Par ailleurs, l’adjectif « national » renvoie à la question de la nationalité : faut-il alors comprendre que la gravité d’un attentat est supérieure lorsqu’il est le fait de ressortissants français que d’étrangers ? Est-il encore cohérent de vouloir restreindre le champ potentiel de l’incrimination aux seuls actes terroristes, certes à la portée symbolique indéniable, sans y intégrer par exemple les crimes contre l’humanité ou l’esclavagisme, autant de comportements qui eux aussi, à l’évidence, bafouent nos principes républicains ? Enfin, la réintroduction dans notre code pénal d’une peine infamante, vingt ans après la grande refonte de 1994, est-elle conforme au sens de l’histoire et ne risque-t-elle pas d’être interprétée comme une tentative malheureuse d’instaurer un « droit pénal de l’ennemi » (33) au mépris de toute garantie constitutionnelle ?
Le code pénal contient d’ores et déjà des mécanismes très étroitement apparentés à ceux envisagés par les partisans du rétablissement de l’indignité nationale.
S’agissant de l’opportunité d’une nouvelle incrimination politique, faut-il rappeler que le livre VI de ce code définit dès à présent toute une série de crimes et délits contre la Nation, l’État et la paix publique ?
S’agissant de la possibilité d’introduire une nouvelle peine de dégradation nationale qui n’aurait d’infamante que le nom, M. Philippe Conte montre bien que le seul intérêt de la démarche serait de regrouper, sous cette nouvelle appellation, un ensemble de sanctions qui existent déjà : privation des droits civils, civiques et familiaux (article 131-26 du code pénal), interdictions professionnelles ou sociales diverses (article 131-28 du même code), interdiction de la détention ou du port d’une arme (article 131-16 du même code), assignation à résidence, obligation de remise du passeport, mention de la condamnation dans un fichier, mesures de sûreté, voire confiscation du patrimoine du condamné…
Certes, à la différence de l’ancien code pénal qui faisait de la dégradation civique une peine automatique, générale et perpétuelle (une mort civique en somme), le nouveau code pénal, en conformité avec les exigences de la Convention européenne des droits de l’homme, conçoit l’interdiction des droits civiques, civils et de famille comme une peine devant être prononcée par un juge (comme toute peine d’ailleurs, les peines accessoires – c’est-à-dire automatiques – ayant disparu), particulière (le juge peut prononcer une interdiction portant sur tout ou partie des droits civiques, civils et de famille) et temporaire (le maximum de 10 ans pour les crimes et de 5 ans pour les délits est porté, en matière terroriste, à 15 ans pour les crimes et à 10 ans pour les délits).
Ces principes s’imposent à la France et il ne saurait être question d’y déroger. Mme Raphaële Parizot constate à juste titre que la Cour européenne des droits de l’homme interdit les peines inhumaines, ce qu’était la « mort civique », qu’elle protège également contre toute atteinte disproportionnée au droit de vote, ce qui l’a conduit à condamner à plusieurs reprises les États – en particulier le Royaume-Uni – qui privent de manière automatique les détenus de l’exercice de ce droit. Il est exclu, de même, qu’une juridiction prononçant la peine de dégradation civique puisse frapper le condamné, de manière indistincte, de l’ensemble des sanctions qu’elle recouvrirait, sans avoir à les détailler, puisque pareille option serait contraire au principe d’individualisation des sanctions prôné par le Conseil constitutionnel.
En l’état, l’arsenal juridique fournit déjà tous les outils nécessaires pour réprimer la menace terroriste, et faute d’être en capacité de le développer, tout au plus le législateur pourrait-il envisager de conférer à la nouvelle peine une vertu principalement symbolique, en stigmatisant de façon plus spécifique certains coupables, en conformité avec la vocation dite « expressive » du droit pénal.
5. Susceptible d’alimenter la martyrologie djihadiste
Comme le souligne M. Sébastien Le Gal, la restauration du crime d’indignité nationale conduirait à politiser la qualification juridique des actes terroristes, ce que le législateur pénal a su éviter jusqu’à présent.
Cette tentation est légitime puisque la motivation des auteurs d’actes terroristes est précisément politique. Toutefois, comme nous l’avons souligné précédemment, elle se heurte à la nécessité de déterminer précisément le champ matériel et personnel de cette nouvelle incrimination dont la sanction serait notamment de placer les individus au ban de la société. Or, ils s’y placent eux-mêmes et s’en vantent suffisamment sur les réseaux sociaux et dans les médias pour attirer toujours plus de candidats au djihad.
En conséquence, réintroduire dans le débat politique d’abord, puis dans notre droit pénal, une nouvelle incrimination politique fondée sur l’indignité nationale risquerait de faire passer ces individus pour des « martyrs ».
Sur le plan de la prévention dissuasive, il y a fort à parier que la crainte d’être frappé de dégradation civique ne détourne pas les auteurs d’actes terroristes de la préparation de leurs forfaits. Attaquant les fondements mêmes de la société à laquelle ils appartiennent, il n’est pas sûr que les prévenir qu’ils seront bannis de la communauté en cas de crime touche réellement des individus qui se vivent déjà comme des bannis ou ne souhaitent pas avoir une place dans la société qu’ils rejettent. C’est d’ailleurs là une difficulté que les juristes du XIXe siècle avaient déjà identifiée : « La dégradation civique consistant […] dans la perte des droits politiques et publics serait dépourvue de toute efficacité à l’égard de ceux qui n’ont pas ou ont perdu la qualité de citoyen ou de ceux qui se soucient peu de la perte des droits de cette espèce (34). » Tel est bien le cas des djihadistes de 2015, qui ont sans doute peu usé des droits politiques inhérents à leur qualité de citoyen. Dès lors, interdire le droit de vote, rendre inéligible, priver de l’exercice de professions juridiques et bancaires, rendre impossible l’accès à la fonction publique n’emportent pas de conséquences concrètes pour eux. L’exemplarité de la peine n’est nullement avérée.
Sur le plan répressif ensuite, on peut également s’inquiéter, ainsi que le fait M. Serge Guinchard, de ce qu’une déclaration d’indignité nationale ne sonne, à rebours de l’effet recherché, comme une confirmation glorieuse de la non-appartenance à la communauté nationale. Autrement dit, l’incrimination ne ferait qu’accréditer ce que les actes terroristes de leurs auteurs signifient déjà en eux-mêmes. Plus qu’une condamnation, de telles affirmations seraient une confirmation et une reconnaissance. Et il ne fait pas de doute que les jugements des tribunaux auraient un retentissement médiatique certain, servant encore et toujours la cause terroriste plutôt que la capacité de la République à lutter contre de tels individus et contre leur idéologie fondamentaliste.
*
* *
L’opportunité de réintroduire un crime d’indignité nationale et d’une peine de dégradation nationale ne convainc pas. Le précédent de la Libération est daté et lié à des circonstances historiques extrêmement particulières. La situation actuelle n’a rien de commun avec les années noires que connut la France de 1940 à 1945. L’indignité nationale fut alors introduite pour marquer clairement et symboliquement, par le droit, la distinction entre ceux qui s’étaient compromis avec Vichy et l’ennemi et ceux qui avaient été fidèles à la République. Nul besoin aujourd’hui de formuler une pareille distinction par la voie du droit. Chacun sait discerner l’infamie qui réside dans le terrorisme djihadiste comme dans toute forme de terrorisme et nul n’a de doute – hormis les djihadistes eux-mêmes – sur les valeurs qui s’attachent à notre Nation.
En revanche, d’autres épisodes de notre Histoire pourraient offrir matière à réflexion, toutes choses étant, encore une fois, égales par ailleurs. Ainsi la lutte menée par la République contre les mouvements anarchistes terroristes à la fin du XIXe siècle offre des éléments de comparaison plus suggestifs.
I. UNE LEÇON DE L’HISTOIRE PLUS PERTINENTE : LA POUSSÉE ANARCHISTE À LA FIN DU XIXE SIÈCLE
Les anarchistes qui, à partir des années 1880-1890, en France comme dans le reste de l’Europe, ont opté pour la « propagande par le fait » s’apparentaient assurément beaucoup plus aux djihadistes d’aujourd’hui qu’aux collaborateurs de 1944. Se pose dès lors la question de savoir s’il serait opportun de s’inspirer des outils de répression mis en œuvre à l’époque pour venir à bout des mouvements anarchistes. Quelles leçons peut-on tirer de ces menées terroristes visant à abattre la République et des moyens que celle-ci déploya pour y mettre un terme ?
A. UN PARALLÈLE FRAPPANT ENTRE TERRORISME ANARCHISTE ET TERRORISME DJIHADISTE
La fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle sont marqués en France par une répression inflexible à l’égard des anarchistes qui ont choisi la voie de la terreur à partir des années 1890 pour diffuser leur idéologie.
Fondé sur la négation du principe d’autorité dans l’organisation sociale et le refus de toute contrainte découlant des institutions dont la raison d’être repose sur ce principe, à commencer par l’État, l’anarchisme a alors pour but de développer dans le monde entier des contre-modèles politiques, institutionnels, économiques, sociaux et culturels : les anarchistes prônent une société sans domination et sans exploitation, où les individus-producteurs coopèrent librement dans une dynamique d’autogestion et de fédéralisme.
Afin d’imposer ce modèle, ils recourent aux méthodes les plus dures : terrorisme, actions de récupération et de reprise individuelle, expéditions punitives, sabotage, boycott, voire certains actes de guérilla. Parmi leurs opérations les plus retentissantes qui, alors, marquèrent tant les esprits figurent les assassinats du tsar Alexandre II le 13 mars 1881 ou du président de la République Sadi Carnot à Lyon le 24 juin 1894 par Caserio, les tentatives d’assassinat de l’empereur Guillaume 1er d’Allemagne, des rois Alphonse XII d’Espagne et Humbert Ier de Savoie, ou encore divers attentats à la bombe et homicides.
Or, comme le démontrent très justement les professeurs Saint-Bonnet (35) et Gaven, par bien des aspects, le terrorisme djihadiste auquel la France est aujourd’hui confrontée est comparable au terrorisme anarchiste de la fin du XIXe siècle. Ses affidés s’attaquaient déjà à des symboles de la « classe bourgeoise », de l’État, par définition oppresseur (magistrats, Chambre des députés, président de la République) et s’en prenaient parfois aussi, au hasard, à des anonymes (36).
Peu organisés et parfois « auto-radicalisés » pour reprendre un néologisme contemporain, ils agissaient souvent seuls ou en petit nombre, comme les auteurs des récents attentats terroristes à Paris notamment.
Ils étaient animés par un véritable esprit de vengeance (37) et ne semblaient pas craindre la mort (38) à l’instar des actuels terroristes djihadistes.
Les actions terroristes anarchistes provoquèrent une véritable psychose collective tandis que la réprobation de l’opinion, de la presse et de la classe politique était générale et transcendait les clivages politiques.
Ébranlant la société avec une force inattendue, à un moment où la République était encore jeune et combattue par les monarchistes et autres contre-révolutionnaires, le terrorisme anarchiste a été perçu comme une menace grave risquant de porter atteinte à tout l’édifice républicain.
1. Des similitudes troublantes
Les ressemblances sont évidemment frappantes entre les expériences anarchistes et djihadistes, et peuvent donner lieu à des rapprochements très convaincants. Le contexte des années 1880-1910, d’abord, est plus proche du nôtre que les périodes de la Révolution ou de la Libération, en ce sens qu’il s’agit pour la République d’éliminer une forme de violence déstabilisatrice, mais pas de rejeter une conception de la Nation qui aurait eu un temps d’effectivité. Même si les anarchistes étaient porteurs d’un contre-modèle, ils ne divisaient pas la France en deux, et deux conceptions nationales n’étaient pas en présence équivalente l’une de l’autre.
La détermination affichée par ces mêmes militants lors de leurs procès, ensuite, n’est pas sans rappeler certains caractères observés chez les auteurs des attentats du mois de janvier 2015. On peut en effet retrouver chez les uns et les autres le même refus d’appartenir à la société (« bourgeoise » ou « occidentale »), le même regard porté sur un monde jugé décadent et condamné, la même indifférence aussi à sa propre mort justifiée par le sort des victimes du système dominant en place. Hier comme aujourd’hui, les postures adoptées par les terroristes, leur état d’esprit et leur psychologie sont étroitement apparentés.
En 1890, la coordination policière et le renseignement sont apparus par ailleurs comme une pièce centrale du dispositif de répression – lequel a impliqué, en raison des objectifs très spécifiques qu’il visait, une profonde réforme des organes de sécurité : coopération internationale, renseignement intérieur, fichage, coordination nationale des forces policières… La France d’aujourd’hui, depuis les années quatre-vingt, a plutôt fondé son action contre le terrorisme autour d’un dispositif judiciaire puissant avec en particulier des juges antiterroristes disposant de pouvoirs spécifiques. Mais on sait aussi que cette lutte contre l’hydre qu’est le terrorisme passe par le renseignement et des techniques de prévention, de surveillance et de découverte de projets d’actes violents. Ramené à une dimension internationale, c’est tout l’effort de coopération judiciaire et policière à l’échelle de la planète qui se trouve ainsi sollicité et sommé d’accomplir une nouvelle mue.
Il faut signaler, enfin, l’investissement particulier consenti en matière de lutte contre la propagande et la diffusion des idées anarchistes. La loi de 1881 a ainsi été modifiée en 1893 aux fins d’intégrer la provocation indirecte et l’apologie par voie de presse. On notera que ce dispositif existe déjà dans notre arsenal pénal, la loi du 13 novembre 2014 ayant modifié, entre autres, l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse (39). L’incrimination d’apologie du terrorisme a d’ailleurs été largement et diversement consacrée par les juges depuis les attentats de janvier 2015.
Ces rapprochements évidents entre les deux époques ne doivent cependant pas nous conduire à passer outre une distinction de taille dans la réponse apportée à la menace terroriste – c’est que les autorités de la IIIe République n’ont jamais envisagé l’indignité nationale comme une incrimination susceptible d’être activée avec profit dans le contexte politique des années 1890-1900.
2. Le choix d’une répression de droit commun
Les dirigeants de la IIIe République ont délibérément fait le choix de traiter les anarchistes, non pas hors de la République ou de la Nation, mais hors du débat politique. Selon toute vraisemblance, ces derniers auraient pourtant considéré comme un honneur d’être frappés d’indignité nationale, eux qui n’ont jamais sollicité leur grâce, eux qui sont morts sans crainte, dans l’ambition d’apparaître comme des martyrs d’une répression étatique et bourgeoise aveugle, arbitraire et sanguinaire. Loin de voir ces espoirs satisfaits, ils furent simplement traités comme des accusés de droit commun.
Pour autant, la nature politique de leurs crimes et délits ne faisait aucun doute. Destinés à propager et à provoquer des idées développées en amont et parallèlement aux actes incriminés, ces forfaits relevaient du débat de l’époque, lequel portait, pour une partie des penseurs, sur les fondements même de la société démocratique « réelle ». Concepteurs comme on l’a vu de contre-modèles, les anarchistes étaient clairement des opposants politiques et, à ce titre, de véritables participants à la vie de la Cité.
Ébranlant la société avec une force inattendue, à un moment où les républicains se méfiaient surtout sur leur flanc droit des oppositions monarchistes et bonapartistes, les actes anarchistes ont nourri un fort sentiment de péril et, de ce fait, suscité une réponse pénale absolument implacable de la part des autorités. Une réponse qui a permis en une vingtaine d’années, au début du XXe siècle, d’étouffer les formes d’actions violentes et de canaliser l’expression anarchiste, ou du moins une partie d’entre elle, au sein de l’organisation républicaine – on songe en particulier à l’anarcho-syndicalisme.
B. DES OUTILS EFFICACES POUR LE XIXE SIÈCLE MAIS SANS LES GARANTIES CONSTITUTIONNELLES D’AUJOURD’HUI
Refusant le statut de « martyrs judiciaires » aux anarchistes, les dirigeants républicains ont donc choisi de traiter leurs forfaits comme des crimes et délits de droit commun. L’on peut y voir de prime abord l’illustration d’une régulation « heureuse » d’une justice politique soumise aux principes et à l’organisation de la justice ordinaire.
Mais derrière cette première lecture, il apparaît qu’en procédant à un tel choix, ceux qui poursuivaient alors les anarchistes cherchaient surtout à éviter deux obstacles majeurs de la justice politique « officielle » des hautes cours : d’une part, l’impossibilité d’appliquer aux condamnés la peine de mort si leurs forfaits étaient qualifiés de crimes et délits politiques – cette peine avait en effet été abolie en 1848 en matière politique, ce qui expliquait la faveur pour les procès de droit commun, où elle pouvait encore être prononcée – et, d’autre part, comme on vient de le voir, le risque de reconnaître officiellement, fût-ce au prix d’une condamnation pénale, la nature politique des actes incriminés, qu’il s’agissait au contraire de réduire à des exactions de droit commun (assassinats, violences sur les personnes, destructions de biens…).
Pour parvenir à leurs fins, les autorités ont alors réactivé une autre incrimination tombée en désuétude après la Révolution de 1789, qu’ils ont modernisée pour les besoins de la répression : « l’association de malfaiteurs (40)».
Une série de trois lois a ainsi été votée dans l’urgence :
Le 11 décembre 1893, soit deux jours après l’attentat d’Auguste Vaillant visant les députés, Jean Casimir-Perier propose à la Chambre des députés de modifier la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse pour sauvegarder « la cause de l’ordre et celle des libertés publiques ». Alors que seule la provocation directe était jusqu’alors réprimée, la provocation indirecte, l’apologie, deviennent elles aussi objets de poursuites, et un juge peut ordonner la saisie et l’arrestation préventive. Le texte est adopté le 12 décembre 1893 par 413 voix contre 63.
La seconde loi est discutée le 15 décembre 1893, à peine quatre jours après avoir été déposée. Elle concerne les associations de malfaiteurs et vise particulièrement les groupes anarchistes, alors nombreux et très actifs. C’est une loi qui permet d’inculper tout membre ou sympathisant de ces groupes sans faire de distinction. Elle encourage également la délation : « Les personnes qui se seront rendues coupables du crime mentionné dans le présent article seront exemptes de peine si, avant toute poursuite, elles ont révélé aux autorités constituées l’entente établie ou fait connaître l’existence de l’association. » Elle est votée le 18 décembre 1893.
La troisième loi, adoptée le 28 juillet 1894, vise directement les anarchistes en les nommant et en leur interdisant tout type de propagande. C’est suite à la promulgation de cette loi que de nombreux journaux anarchistes, comme Le Père peinard, qui avait déjà été saisi précédemment, sont interdits. Ce texte a conduit à une véritable « chasse aux sorcières », à des milliers de perquisitions et d’arrestations, qui ont notamment débouché sur le Procès des Trente (41).
Parmi les éléments principaux qu’il faut retenir de ce dispositif, l’on peut signaler le recours à une incrimination principale de droit commun – l’association de malfaiteurs –, à des juridictions ordinaires, à diverses peines d’ores et déjà en vigueur dont la relégation et la mort, ainsi que la prise en compte de la dimension internationale des « réseaux » anarchistes.
Qualifiées de « scélérates » (42) et restées comme telles dans les mémoires, ces lois ont fait l’objet de vigoureuses critiques en raison des atteintes qu’elles portaient à des libertés fondamentales. Présentées comme temporaires, elles ne l’ont en réalité pas été : la dernière n’a été abrogée qu’avec l’adoption du code pénal de 1992, entré en vigueur en 1994. Ce qui démontre que la justice politique peut parfaitement s’inscrire dans les formes et les institutions ordinaires de la justice de droit commun, parfois même à des fins de sévérité accrue…
Ces outils répressifs se sont néanmoins avérés efficaces pour annihiler la poussée anarchiste en France.
Quelles leçons peut-on tirer de ce précédent historique dans un contexte juridique fort différent – il faut le souligner – puisque les libertés fondamentales sont désormais et heureusement protégées par les juges constitutionnels et européens ?
La coordination policière et le renseignement sont apparus à l’époque comme un outil central du dispositif de répression du terrorisme. Or, l’on sait que l’essentiel de la lutte actuelle dans ce domaine tient à ces techniques de prévention, de surveillance et de détection renforcées par le développement de la coopération internationale au niveau étatique. Le projet de loi relatif au renseignement, qui entend renforcer les moyens de nos services moyennant un contrôle plus efficace, s’inscrit aujourd’hui dans cette perspective.
De même, la notion de crime organisé est régulièrement utilisée pour démanteler des organisations internationales de trafic d’armes, de drogue ou de traite qui servent souvent au financement d’activités terroristes djihadistes.
Par ailleurs, de nouveaux outils plus adaptés à la lutte contre ce dernier fléau ont récemment été introduits par le législateur par les lois du 21 décembre 2012 et du 13 novembre 2014 (43). Rappelons notamment la pénalisation de l’entreprise terroriste individuelle ou collective, l’assimilation des délits de provocation à la commission d’actes terroristes et d’apologie du terrorisme sur Internet à des délits terroristes justifiant le blocage de ces sites Internet, la possibilité pour les enquêteurs de perquisitionner les « clouds » et d’intercepter les discussions sur les logiciels d’appels téléphoniques sur Internet, ou encore la faculté de prononcer une interdiction administrative d’accès au territoire…
Néanmoins, à la différence des outils de prévention du terrorisme créés sous la IIIe République et mis à disposition de l’exécutif pour lutter contre le développement du phénomène anarchiste, le dispositif de lutte contre le terrorisme actuellement en vigueur, qui a été maintes fois validé par le Conseil constitutionnel, est essentiellement placé sous le contrôle et l’autorité du juge spécialisé qui est le juge antiterroriste. Le projet de loi relatif au renseignement permettra de compléter efficacement ce dispositif en donnant aux services de renseignement les moyens d’agir en amont pour prévenir les menées terroristes et ce, dans un cadre légal robuste respectueux de l’État de droit et conforme à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme.
Or, il faut souligner qu’en la matière le législateur, sous l’œil vigilant du Conseil constitutionnel, a toujours eu la volonté de concilier respect des libertés fondamentales et préservation de l’ordre public. Il faut donc poursuivre dans cette voie et s’écarter, comme nous y invite Mme Geneviève Giudicelli, de toute tentative de développement d’un « droit pénal de l’ennemi » ou d’un droit pénal d’exception au nom de la lutte contre le terrorisme et le djihadisme (44).
CONCLUSION : DEUX VOIES POSSIBLES
L’histoire ne bégaie pas. On peut en tirer des enseignements, mais vouloir la rejouer à plusieurs décennies d’intervalle par des parallèles incertains – les djihadistes seraient les nouveaux vichystes –, c’est prendre le risque de ne pas saisir la portée nouvelle de phénomènes qui, pour en rappeler certains plus anciens, s’en distinguent assurément.
A la réflexion, la réactivation de l’indignité nationale, qui correspond d’une certaine façon à une laïcisation de l’excommunication, issue du droit canonique, serait indéniablement, pour la République, l’aveu d’un échec. Car, comme le fait remarquer M. Jean-Christophe Gaven, l’esprit démocratique implique l’obligation morale, ontologique pour la communauté de prendre en charge l’ensemble de ses membres, c’est-à-dire de ne pas abandonner ceux-là même dont le comportement ignominieux semblerait pourtant devoir les condamner à une exclusion perpétuelle.
« Ne pas abandonner » ne signifie évidemment pas excuser, tolérer, laisser faire ou pardonner. Au contraire même, l’approche ici prônée exige de punir ceux qui portent atteinte au contrat social. Mais la méfiance s’impose dès lors que le débat porte sur tout mécanisme reposant sur des procédés d’exclusion symbolique. Au-delà de leur inadéquation institutionnelle, dont il a été largement question dans la présente communication, le recours à ceux-ci témoigne inévitablement, de manière implicite, d’un renoncement de la République à sa vocation pastorale, dans le sens où l’entendait Michel Foucault. D’où l’importance d’avoir d’abord précisé les différences de contexte entre 1789, 1793, 1944 et aujourd’hui. Dans les trois premiers cas historiques, il s’agissait bien d’instituer un socle nouveau, opération justifiant la mise à l’écart de ceux qui ne pouvaient pas prendre part à l’édification du nouveau système.
Mais aujourd’hui, la situation est radicalement différente. Le terrorisme djihadiste nous place devant des situations inédites. À nous de faire preuve d’imagination sans compromettre nos valeurs.
Deux pistes sont alors envisageables qui ne sont pas incompatibles :
– inventer de nouvelles sanctions dans le respect de l’État de droit, qui auraient essentiellement une portée symbolique à destination de nos concitoyens pour conforter leur confiance en notre appareil répressif ;
– engager un travail plus profond pour redonner à ceux de nos concitoyens les plus fragiles, qui pourraient devenir des proies faciles pour les réseaux djihadistes ou leur propagande, les moyens de croire en la République et en ses promesses d’avenir.
1. Inventer de nouvelles sanctions, respectueuses de l’État de droit, pour conforter la confiance dans notre capacité à réprimer le terrorisme
Selon M. Jean-Louis Halpérin, une première voie pourrait consister à étendre la peine de perpétuité incompressible (article 221-4 du code pénal). Cette perpétuité qualifiée parfois de « réelle » s’applique aujourd’hui aux auteurs de meurtre avec viol ou torture sur mineur de moins de quinze ans et meurtre en bande organisée ou assassinat d’une personne dépositaire de l’autorité publique. Ce dernier forfait était l’un de ceux commis par les auteurs des attentats de janvier 2015. Pourquoi donc ne pas appliquer cette peine, qui se trouve au sommet de notre hiérarchie répressive, aux actes de terrorisme comprenant des crimes de sang ? La perpétuité « réelle », accompagnée de la sanction complémentaire de privation des droits civiques pour les nationaux témoignerait qu’un crime terroriste est, à l’égal des deux crimes punis de la sorte depuis 1994, l’atteinte la plus grave aux valeurs de la République.
Une autre voie pourrait être, selon le même auteur, de renforcer la sévérité de la peine complémentaire, prévue à l’article 422-3 du code pénal, interdisant l’exercice des droits civiques, civils et de famille ainsi que de certaines professions prévues en cas de condamnation pour terrorisme. La singularité des attentats de janvier réside dans le fait qu’ils ont délibérément porté atteinte à certaines garanties constitutionnelles : la liberté d’expression, l’obéissance et le respect dus aux détenteurs de l’autorité publique, l’égalité indifférente aux croyances, la laïcité. On peut se demander s’il n’y a pas là, dans le choix de ces cibles, une circonstance aggravante par rapport aux actes « aveugles » de terrorisme – de la même manière que l’intention antisémite ou l’atteinte aux détenteurs de l’autorité constituent des circonstances aggravantes de nombreux crimes. Il est alors envisageable de concevoir que cette circonstance aggravante (d’atteinte délibérée par le terrorisme aux libertés et droits constitutionnels) entraîne une perte renforcée, dans sa durée, des droits civiques. Cette peine nouvelle ne serait qu’un effet de la répression du terrorisme, une peine complémentaire et non principale. S’il lui fallait un nouveau nom à titre de symbole, celui de « dégradation républicaine », portant perte des droits civiques à perpétuité pour des nationaux condamnés à perpétuité, marquerait l’attachement des Français à ces règles républicaines attaquées par le terrorisme.
Dans la même optique et sans vouloir se prononcer sur son opportunité, le professeur Didier Rebut estime qu’il n’y aurait pas d’obstacles constitutionnels à ajouter à la peine complémentaire prévue par l’article 422-3 du code pénal (45), d’autres sanctions existantes ou nouvelles : interdiction temporaire du bénéfice de certaines prestations sociales telles que le revenu de solidarité active ou les allocations pour le logement, interdiction de séjour, confiscation de biens... Une évolution du droit est également envisagée par le professeur Martial Mathieu.
2. Redonner force à l’idéal républicain
Si de telles modifications de notre droit pénal peuvent être livrées au débat, elles nous paraissent cependant sans commune mesure avec les enjeux du terrorisme djihadiste. L’arsenal pénal dont nous disposons semble suffisamment étoffé pour réprimer avec une extrême sévérité les terroristes pour que ceux-ci connaissent « le feu de la loi » pour reprendre l’expression de Jaurès dans son discours de juillet 1884 à la Chambre des députés. Mieux vaut se concentrer sur les moyens de lutter concrètement contre leurs crimes. Une fois encore, le projet de loi relatif au renseignement permettra de progresser considérablement en ce domaine.
Si l’on ne souhaite pas pousser l’État à réagir à la violence terroriste par une violence équivalente ou supérieure, ou a minima par l’intervention récurrente du législateur en matière de terrorisme, la solution la plus sage est sans aucun doute de réaffirmer la force du droit en vigueur. Les outils de détection, de prévention et de répression des actes terroristes existent déjà. Certains ont été créés il y a à peine quelques mois et commencent seulement à produire leurs effets. Autant éviter d’entrer dans le schéma, que souhaitent nous imposer les terroristes, consistant à pousser l’État à devenir toujours plus répressif au mépris des valeurs qui nous unissent.
Notre responsabilité est sans doute de nous interroger sur les raisons qui ont pu pousser les auteurs des attentats de janvier 2015, tous nés en France, élevés dans notre pays, et ayant grandi au sein de l’ensemble des institutions républicaines (sociales, scolaires, culturelles et politiques), à commettre des actes d’une telle barbarie, sous l’influence d’une idéologie meurtrière pseudo-religieuse.
Il importe de trouver les voies et moyens pour mettre fin à la tentation de nombreux Français, de tous horizons, de rejoindre des pays étrangers au nom du djihad, et plus encore, de parvenir à réintégrer dans la communauté nationale ceux qui en reviendraient. Le choix du Gouvernement de traiter ces individus comme des « endoctrinés », sur le modèle de la lutte contre les mouvements sectaires, paraît davantage pertinent. Comme le souligne M. Éric Gasparini, « la refondation de la citoyenneté, qui est une nécessité absolue dans le contexte actuel, ne peut donc se faire le regard tourné vers le passé, sachant que les conceptions de la morale républicaine et de la vertu civique ont considérablement évolué. ».
Il faut conforter les outils destinés à diffuser les valeurs fondamentales de la République et les compléter en mobilisant toute la communauté nationale pour raviver l’adhésion à notre modèle de vivre-ensemble, en s’appuyant sur l’éducation, les acteurs sociaux et, surtout, la politique du logement. Le plan du Premier ministre pour favoriser la mixité sociale dans les quartiers et combattre « l’apartheid social, territorial et ethnique » en France, présenté le 6 mars 2015, constitue un premier pas important.
*
* *
En fait, face au terrorisme, la plus belle des réponses consiste à redonner du sens à l’idéal républicain. Comme l’écrit M. François Saint Bonnet : « C’est une attente de ceux qui veulent recoudre le vivre-ensemble, c’est aussi une nécessité à l’égard de ceux qui sont susceptibles d’être séduits par le monde enchanté de l’islam radical parce qu’ils perçoivent le monde qui est le leur comme désenchanté. Cela ne suppose pas seulement des emplois et du bien-être matériel, mais sans doute de se féliciter davantage chaque jour de pouvoir vivre dans un monde de liberté, d’égalité et de fraternité » (46).
RÉUNION DE LA COMMISSION DES LOIS
DU MERCREDI 25 MARS 2015
Présentation d’une communication par le président de la commission
des Lois, M. Jean-Jacques Urvoas, et échange de vues.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. La question de la réintroduction dans notre droit du crime d’indignité nationale créé en 1944 a resurgi à la fin de l’an passé quand nous avons examiné la proposition de loi de notre collègue Philippe Meunier qu’il reprend d’ailleurs en substance aujourd’hui. L’Assemblée nationale a rejeté ce premier texte le 4 décembre dernier.
Depuis cette date, notre pays a connu la tragédie que l’on sait avec les attentats de janvier. Et la question de l’indignité nationale a été à nouveau posée. Faut-il condamner les terroristes djihadistes à l’indignité nationale pour les exclure en quelque sorte de la communauté républicaine ou nationale ?
Le Premier ministre s’est alors refusé à toute décision précipitée lorsqu’il a présenté les mesures visant à renforcer le dispositif anti-terroriste le 21 janvier dernier. Dans cet esprit ouvert mais responsable, il a proposé aux présidents des commissions des Lois des deux assemblées de mesurer les conséquences d’une telle réintégration dans notre droit de ce crime d’indignité nationale et de la peine de dégradation civique.
Mon homologue du Sénat n’a pas souhaité répondre à cette proposition. Pour ma part, il m’a semblé utile que nous puissions en débattre. C’est pourquoi j’ai souhaité faire cette communication en vous adressant le document écrit sur lequel je m’appuie et que j’ai remis hier au Premier ministre.
En termes de méthode, je me suis naturellement fondé sur le livre de référence en la matière, celui de l’historienne Anne Simonin, Le déshonneur dans la République. Une histoire de l’indignité 1791-1958. J’ai aussi proposé à une quinzaine de professeurs de droit pénal et d’histoire du droit de me faire part de leurs réflexions sur le sujet, ce qu’ils ont bien voulu accepter ,et je les en remercie. Il va de soi que les propos qui vont suivre ne les engagent pas.
On doit partir d’un constat : l’idée même de soustraire à la communauté civique les citoyens qui ont rompu avec les valeurs de la Cité n’est pas si originale : traversant les siècles, de l’ostracisme à Athènes aux pratiques à Rome au premier siècle avant notre ère, elle a prospéré sous la Révolution, avec l’institution d’un crime de lèse-nation, puis sous la Terreur lorsque fut adoptée la loi des suspects, et enfin à la Libération lorsque fut promulguée l’ordonnance de 1944. Cette idée est donc consubstantielle à la naissance de la République.
Cette incrimination a été liée à des transitions institutionnelles particulières et a trouvé une justification dans la mise à l’écart de ceux qui ne pouvaient pas prendre part à l’édification du nouveau système politique.
Je comprends que la tentation puisse être forte et légitime, à la suite des attentats de janvier 2015, de qualifier le terroriste djihadiste en tant qu’indigne. Il rejette nos valeurs et la République. Il entend même les détruire. Il n’est plus digne de faire partie de la Cité.
Mais le recours aux exemples du passé n’est pas une évidence. Nous pouvons en tirer des leçons, mais plaquer les solutions d’hier pour résoudre les problèmes d’aujourd’hui ne me semble pas s’imposer naturellement. Je suis même convaincu du contraire.
La question de l’indignité nationale s’est donc focalisée sur les dispositions introduites le 26 août 1944 par le Gouvernement provisoire de la République française pour punir les vichystes. Ce texte est né d’un contexte historique très particulier et il est essentiel d’y revenir pour mesure l’intérêt de s’en inspirer ou non.
Le crime d’indignité nationale a été introduit pour punir le comportement des Français ayant collaboré avec le régime de Vichy pendant l’Occupation. Il s’agissait de sanctionner rétroactivement par une incrimination nouvelle des actes accomplis avant son édiction et qui ne relevaient pas nécessairement d’une qualification pénale existante.
Mais il s’agissait aussi, plus politiquement et symboliquement, de montrer clairement alors que l’honneur se trouvait du côté de la République et non du côté de Vichy. Qui s’était compromis avec ce régime avait perdu son honneur et était donc indigne de la Nation.
La sanction du crime d’indignité nationale était la privation de tous les droits civiques, civils et politiques, certaines incapacités et certaines interdictions professionnelles. Cette peine infamante pouvait en outre être assortie d’interdiction de séjour dans certaines parties du territoire.
Cette sanction pénale ayant été conçue comme plus douce que, par exemple, la peine capitale que certains réclamaient pour les collaborateurs, c’est paradoxalement sa relative clémence qui a rendu acceptable sa rétroactivité.
L’incrimination était temporaire et ne pouvait être constatée que dans un délai de six mois après la libération totale du territoire, le 8 mai 1945. Des juridictions d’exceptions –les sections spéciales dans un premier temps– étaient chargées de juger les coupables. Il faut insister sur le fait que, dans l’esprit des juristes de la Résistance, cette incrimination devait permettre à celui frappé d’indignité de réintégrer la Cité un fois sa peine accomplie. On entendait ainsi purger le corps national en « purifiant » ceux qui s’y étaient compromis.
Le régime de cette sanction pénale fut revisité à plusieurs reprises en quelques mois. Non moins de 98 436 personnes furent condamnées à l’indignité nationale, et, bien souvent, ces « morts civils », ces « sujets de non-droit », pour reprendre l’expression du doyen Carbonnier, ont pu apparaître comme des « victimes » de la Libération.
On peut donc observer qu’il s’agissait d’une peine infamante de nature politique, relevant d’un droit pénal d’exception, appliqué par des juridictions spéciales dont le régime juridique fut instable et la mise en œuvre finalement peu convaincante. Cette incrimination introduite en 1944 me paraît, pour tout dire, trop datée pour offrir une solution efficace contre le terrorisme tel que nous le connaissons aujourd’hui.
Il me semble tout d’abord évident que la psychologie du vichyste et celle du djihadiste n’ont rien à voir. On aura du mal à penser que les terroristes djihadistes se soucient vraiment de perdre leur qualité de citoyen, alors qu’ils sont prêts à sacrifier leur vie pour la folie à laquelle ils entendent obéir.
En outre, à l’époque l’idée était de refermer un chapitre noir de notre histoire : les vichystes avaient cessé le combat en 1944, ce qui ouvrait la possibilité d’une sanction qui était le préalable à un retour dans le giron de la République. Tel n’est malheureusement pas le cas des terroristes actuels, qui n’entendent pas déposer les armes.
Par ailleurs, sur un plan institutionnel, il n’est pas aujourd’hui question de réaffirmer la justice étatique comme ce fut le cas en 1944. Si, à la Libération, on a créé l’indignité nationale, c’était aussi pour éviter des exactions populaires et canaliser la colère. Tel n’est pas l’enjeu en 2015, et c’est heureux, car il serait irresponsable de jouer cette partition. Pour reprendre les mots de Danton en 1793, il n’est pas question pour nous d’être « terribles pour éviter au peuple de l’être ».
Il ne s’agit pas plus pour nous de réaffirmer solennellement les valeurs de la République en flétrissant ceux qui entendent les assassiner. Je crois que les manifestations que la France a connues le 11 janvier dernier suffisent à montrer que les Français savent quelles sont leurs valeurs et le prix qu’ils y attachent.
Je crois, après mûres réflexions, que l’on peut absolument comprendre le besoin moral de s’interroger sur une mise au ban de ceux qui nient la République avec une violence insupportable. Juridiquement, il n’y aurait sans doute pas d’obstacle à la réinstauration de ce crime pourvu que l’on définisse clairement son champ, qu’on respecte les principes de non-rétroactivité des lois pénales, de nécessité et d’individualisation des peines, des droits de la défense...
La solution peut paraître politiquement séduisante, mais elle ne serait pas dénuée d’ambiguïtés. Nous entrerions dans une logique consistant à créer ce que l’on appelle un « droit pénal de l’ennemi », à l’instar des États-Unis après les attentats du 11 septembre 2001. Je réfute un tel choix.
Surtout, je ne pense pas que la remise en vigueur d’une telle incrimination nous permette de lutter plus efficacement contre le terrorisme. Des sanctions d’une nature proche existent déjà, comme la privation des droits civils, civiques et familiaux prononcée en complément des peines qui sanctionnent principalement les actes terroristes.
Nous avons un arsenal pénal extrêmement fourni – et complété encore récemment – pour lutter contre le djihadisme et le terrorisme. La priorité me semble plutôt devoir être donnée au déploiement de moyens et la définition d’un cadre juridique et d’action pour les services de renseignement comme s’y emploie le projet de loi que nous allons examiner la semaine prochaine.
Nous risquons même, par la création de ce nouveau crime d’indignité nationale, d’alimenter la martyrologie djihadiste en faisant de ces terroristes des héros pour leur cause au risque de créer encore plus de vocations. Je ne suis pas donc convaincu par la réintroduction d’une telle incrimination et c’est le sens du rapport que j’ai remis au Premier ministre et que je vous ai communiqué.
J’ai voulu tout de même explorer d’autres voies. J’ai été ainsi frappé par le fait que le terrorisme djihadiste auquel la France est confrontée s’apparente, par bien des aspects, aux actions isolées des terroristes anarchistes de la fin du XIXe siècle. C’est un précédent très intéressant, sur lequel je vous invite à vous pencher.
Ces terroristes s’attaquaient déjà à des symboles du « système », à des symboles de l’État. Peu organisés et parfois « auto-radicalisés », ils agissaient souvent seuls ou en petit nombre, animés par un fort esprit de vengeance et ne semblant pas craindre la mort, à l’instar des actuels djihadistes. Leurs actions provoquèrent d’ailleurs une véritable psychose collective, suscitant une réprobation de l’opinion, de la presse et des politiques qui transcenda tous les clivages. Refusant le statut de « martyrs judiciaires » aux anarchistes, les institutions de la IIIe République firent le choix de les traiter, non pas hors de la République ou hors de la Nation, mais bien plutôt comme des accusés de droit commun.
C’est le choix qui est le nôtre depuis maintenant plusieurs décennies. Sommes-nous prêts à rompre avec ce choix ? Personnellement, je ne le suis pas.
Nourri de ces réflexions, j’invite donc dans mon rapport écrit à éviter toute tentative de développement d’un « droit pénal de l’ennemi » ou d’un droit pénal d’exception au nom de la lutte contre le terrorisme et le djihadisme. Les armes pénales dont nous disposons semblent suffisamment nombreuses et en phase avec la réalité pour réprimer avec une extrême sévérité les terroristes.
La meilleure réponse est de redonner de la force à l’idéal républicain tout en réaffirmant la valeur de notre droit et en punissant les crimes terroristes avec les outils de droit pénal commun.
Le plan de lutte contre le terrorisme présenté par le Premier ministre le 21 janvier dernier s’inscrit dans cette perspective. Le projet de loi relatif au renseignement aussi, de manière résolue. Et surtout il nous faut redonner confiance en la République là où le terrorisme djihadiste recrute. De ce point de vue le plan pour favoriser la mixité sociale présenté le 6 mars 2015 me paraît également compléter parfaitement ces dispositifs.
C’est un combat de long terme, et nous devons miser sur des politiques de fond plus que sur des mesures certes symboliques – ce qui n’est pas rien – mais dépourvues de portée concrète déterminante.
*
* *
À l’issue de cette communication de M. le président Jean-Jacques Urvoas, la Commission examine, sur le rapport de M. Philippe Meunier, la proposition de loi qu’il a déposée visant à faire perdre la nationalité française à tout individu arrêté ou identifié portant les armes ou se rendant complice par la fourniture de moyens à des opérations armées contre les forces armées ou les forces de sécurité françaises ou tout civil Français et à rétablir le crime d’indignité nationale pour les Français sans double nationalité (n° 2570).
A l’occasion de la discussion générale de cette proposition de loi, un échange de vues se déroule sur la question de l’indignité nationale.
M. Philippe Meunier, rapporteur. Monsieur le président, mes chers collègues, c’est la deuxième fois que le groupe UMP décide d’inscrire à l’ordre du jour une proposition de loi ayant pour objet de priver de la nationalité française les terroristes qui ont pris les armes contre la France et de créer un crime d’indignité nationale. Le 4 décembre dernier, la majorité et le Gouvernement se sont opposés à cette mesure, au motif que le droit en vigueur serait suffisant, et qu’elle serait à la fois « stigmatisante » et disproportionnée par rapport à la gravité des faits. Les amendements que nous avions déposés en ce sens lors de l’examen du projet de loi relatif à la lutte contre le terrorisme, en septembre 2014, ont également été rejetés.
Les attentats odieux qui ont frappé notre pays en ce début d’année et le nombre croissant de Français engagés en Syrie et en Irak dans les rangs de l’organisation terroriste DAECH démontrent pourtant, de façon tragique, que la mesure que nous proposons est indispensable.
Selon le dernier état des lieux dressé par le ministère de l’Intérieur, à la fin du mois de février, 413 Français étaient engagés dans les zones de combat en Syrie, et 294 seraient en transit vers ces zones. Selon le Premier ministre, le nombre des Européens engagés devrait plus que tripler d’ici la fin de l’année. Ces milliers de Français radicalisés, devenus des ennemis de notre pays, disposent d’un droit au séjour sur notre territoire ainsi que de celui de circuler librement dans toute l’Union européenne.
La menace constituée par ces individus à leur retour est considérable. Elle exige qu’ils fassent l’objet d’une surveillance continue, vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Imagine-t-on les effectifs policiers qu’une telle surveillance mobiliserait, au détriment des autres missions de sécurité publique incombant aux forces de l’ordre ?
La seule mesure susceptible d’assurer la sécurité de nos concitoyens est de priver les individus concernés de la nationalité française, afin de pouvoir leur interdire notre territoire à leur retour ou les en expulser, le cas échéant après qu’ils aient purgé une peine de prison.
Monsieur le Président, vous qui êtes spécialiste de ces questions et qui rapporterez prochainement sur le projet de loi relatif aux services de renseignement, je ne pense pas que vous me contredirez sur ce point : si nous ne parvenons pas, d’une manière ou d’une autre, à empêcher le retour de ces centaines, voire milliers de Français radicalisés sur notre sol, la sécurité de nos concitoyens ne pourra être assurée. De ce point de vue, la privation de la nationalité n’est pas qu’une mesure symbolique, même si les symboles ont leur importance : c’est une mesure aux conséquences concrètes, indispensable pour assurer notre sécurité.
Le gouvernement britannique l’a parfaitement compris et a agi en conséquence : une première loi a étendu, en juillet 2014, la possibilité de priver un citoyen britannique, même de naissance, de sa nationalité, et autorisé la perte de nationalité d’un citoyen naturalisé même si cela le rend apatride. Une seconde loi antiterroriste, en date du 12 février 2015, autorise désormais le gouvernement à interdire temporairement l’accès au territoire britannique à des nationaux engagés dans des activités terroristes à l’étranger. D’autres États, tels que le Canada ou la Belgique, envisagent ou ont réformé leur droit de la nationalité pour lutter contre le terrorisme.
Lors de l’examen de la précédente proposition de loi que nous avions déposée et du projet de loi relatif à la lutte contre le terrorisme, le Gouvernement a affirmé que le droit de la nationalité française en vigueur serait suffisant sur ce point. C’est malheureusement inexact.
En effet, en application des articles 25 et 25-1 du code civil, seuls les Français d’acquisition – par la voie de la naturalisation ou du mariage, par exemple – possédant une autre nationalité peuvent être déchus de leur nationalité française pour actes de terrorisme, dans des délais encadrés par la loi. Deux catégories de Français échappent donc totalement à ce dispositif : les Français de naissance, d’une part ; les Français d’acquisition ne possédant pas une autre nationalité, d’autre part. Aucun d’entre eux ne peut se voir retirer leur nationalité pour acte de terrorisme. Ce sont deux graves lacunes.
Il suffit, pour s’en convaincre, de se pencher sur le profil de certains des terroristes français ayant frappé notre pays et la Belgique au cours de la période récente : Mohammed Merah, Mehdi Nemmouche, les frères Kouachi et Amedy Coulibaly étaient ou sont tous Français de naissance. Certains d’entre eux n’étaient en outre pas binationaux. Aucun d’entre eux n’aurait donc pu faire l’objet d’une procédure de déchéance de la nationalité française, les conditions légales n’étant pas remplies.
Le second argument qui nous a été opposé, tout aussi inexact, est que notre proposition serait inconstitutionnelle. Dans une décision rendue le 23 janvier 2015, le Conseil constitutionnel, confirmant une décision du 16 juillet 1996, a validé le recours à la déchéance de nationalité à rencontre des terroristes « eu égard à la gravité toute particulière que revêtent par nature les actes de terrorisme ». Si la privation de nationalité est constitutionnelle, parce que proportionnée, lorsqu’elle est prononcée à l’encontre d’un Français par acquisition pour les actes de terrorisme, elle l’est nécessairement lorsqu’elle est prononcée à l’encontre des Français de naissance. Si le Conseil constitutionnel en jugeait autrement, cela reviendrait à contraindre le législateur à traiter les Français différemment, selon qu’ils le sont de naissance ou par acquisition, alors qu’il a lui-même jugé que tous les Français étaient égaux au regard du droit de la nationalité ! Prétendre que notre proposition, dans sa nouvelle rédaction, soulèverait une difficulté constitutionnelle, c’est considérer qu’il y a deux catégories de Français au regard de la privation de nationalité : les Français « de fraîche date » et les Français de naissance.
C’est la raison pour laquelle, au lieu de recourir à la déchéance de nationalité, qui est réservée aux Français d’acquisition, nous avons retenu la perte de nationalité, qui vise tous les Français, sans distinction. Ce qui importe, c’est la particulière gravité des faits : peu importe que l’intéressé soit Français depuis quinze générations ou depuis trois ans ! Notre proposition de loi met fin à une inégalité de traitement, ce qui devrait tous nous réunir. J’observe d’ailleurs, mais nous aurons l’occasion d’y revenir lors de l’examen des amendements, que la distinction entre déchéance et perte de nationalité est, de toute évidence, ignorée par les auteurs de l’amendement de suppression de l’article 1er, alors qu’elle est essentielle.
Notre proposition de loi comporte deux articles. Le premier prévoit un nouveau cas de perte de la nationalité française, qui s’appliquera au Français qui a participé à des opérations armées contre les forces armées françaises ou contre un civil français, ou qui s’est rendu complice de telles opérations, à l’étranger ou en France. Un nouvel article 23-8-1 du code civil serait ainsi créé. Tout Français, d’acquisition ou de naissance, pourra être ainsi privé de sa nationalité française, à condition qu’il possède une autre nationalité. Cette perte de nationalité sera prononcée par décret pris après avis conforme du Conseil d’État – j’ai en effet déposé un amendement transformant en avis conforme l’avis simple prévu initialement – après avoir été entendu ou invité à présenter ses observations, conformément à l’actuel article 23-8 du code civil. L’intéressé fera alors l’objet d’une mesure d’expulsion du territoire national, s’il s’y trouve, ou d’une mesure d’interdiction administrative du territoire s’il est à l’étranger.
L’article 2 tend à modifier le code pénal afin de créer un crime d’indignité nationale, accompagné d’une peine complémentaire de dégradation nationale, à l’encontre de tout Français auteur ou complice des mêmes faits que ceux visés à l’article 1er. Il complète à cette fin la section du code pénal relative aux « intelligences avec une puissance étrangère ».
Cette nouvelle incrimination s’inspire du dispositif mis en place à la fin de la Seconde Guerre mondiale par l’ordonnance du 26 août 1944 pour sanctionner les Français ayant collaboré avec l’ennemi, et qui était assorti, lui aussi, d’une peine de dégradation nationale emportant la privation de tous les droits civiques, civils et politiques, ainsi que certaines interdictions professionnelles. Notre proposition reprend cette peine, et la complète par une peine de trente ans de détention criminelle, ce qui n’était pas envisageable il y a soixante-dix ans compte tenu du caractère rétroactif de l’incrimination créée par l’ordonnance du 26 août 1944.
Si le Président m’y autorise, je souhaite, pour conclure, dire un mot de l’un des amendements que j’ai présentés pour améliorer le dispositif.
Comme je l’ai exposé précédemment, notre proposition de loi vise à combler l’une des deux lacunes du dispositif actuel, en permettant de priver également les Français de naissance de leur nationalité française s’ils ont perpétré des actes de terrorisme. Elle ne permet cependant pas, dans sa rédaction actuelle, de priver les Français, d’acquisition ou de naissance, de leur nationalité si cela avait pour effet de les rendre apatrides. C’est une grave lacune car beaucoup de nos compatriotes qui combattent dans les rangs de DAECH n’ont pas d’autre nationalité. Nous avons prévu cette exception parce qu’il a toujours été affirmé que le droit international interdisait de rendre apatride un de ses propres ressortissants.
Or, une expertise approfondie a révélé que cette idée répandue était fausse. Le droit international n’interdit pas à la France de rendre apatride un de ses ressortissants. L’instrument de référence en la matière est la convention du 30 août 1961 sur la réduction des cas d’apatridie, adoptée dans le cadre des Nations unies. Si la France a signé cette convention le 31 mai 1962, elle ne l’a pas ratifiée. Elle n’est donc pas liée par cette dernière.
Au surplus, ladite convention n’interdit aucunement aux États parties de priver un individu de sa nationalité, y compris dans le cas où cette privation doit le rendre apatride, si cette privation est motivée par un manque de loyalisme envers l’État concerné ou s’il a eu un comportement de nature à porter un préjudice grave aux intérêts essentiels de l’État concerné ou encore s’il a manifesté par son comportement sa détermination de répudier son allégeance envers l’État contractant – article 8, paragraphe 3. Du reste, la France, lors de la signature de la convention, a effectué une déclaration par laquelle elle a indiqué qu’elle se réservait le droit d’user, en cas de ratification, de la faculté qui lui est ouverte par l’article 8, paragraphe 3.
De plus, l’article 23-8 du code civil permet déjà de rendre un Français apatride, s’il a apporté son concours à l’armée ou au service public d’un autre État ou à une organisation internationale dont la France ne fait pas partie, malgré l’injonction du Gouvernement de cesser son activité. La législation de nombreux États européens comporte des dispositions similaires, les autorisant à rendre leurs ressortissants apatrides. Tel est le cas de l’Autriche, de l’Espagne, de l’Estonie, de la Grèce, de l’Italie et de la Lituanie, ainsi que du Royaume-Uni.
Mon amendement CL6 consiste donc à insérer un nouvel article 23-8-2 au sein du code civil, visant à prévoir un nouveau cas de perte de la nationalité française, applicable aux Français d’origine comme d’acquisition, qu’ils possèdent une autre nationalité ou non. Ce nouveau cas de perte de la nationalité française concernera les Français condamnés pour un crime ou un délit constituant un acte de terrorisme. Cette perte prendra la forme d’un décret pris après avis conforme du Conseil d’État, comme en matière de déchéance de nationalité.
Le sujet dont nous débattons est un sujet grave, sur lequel aucun d’entre nous ne devrait adopter de posture politicienne. Tel est malheureusement le cas des amendements de suppression déposés par nos collègues du groupe écologiste, dont la lecture révèle une méconnaissance profonde du droit de la nationalité et une volonté délibérée de caricaturer les propositions qui vous sont soumises : ils n’ont manifestement pas pris la peine de lire le dispositif ou de regarder ce qui se fait au-delà de nos frontières pour lutter contre le terrorisme. Il nous faut au contraire dialoguer pour parvenir, je l’espère, à une solution susceptible de faire consensus.
M. Alain Tourret. Monsieur le président, votre communication nous permettra de mieux réfléchir à une situation bien difficile.
Nous avons lutté dans notre histoire contre les nihilistes et les anarchistes, qui se rendaient responsables d’atteintes à l’ordre public aussi importantes que celles que commettent les djihadistes. Or il n’a pas été jugé utile, à l’époque, de transformer le code pénal. Une exception a été faite en 1944 : elle n’a pas été reprise lors de la guerre d’Algérie, notamment contre l’OAS, bien que cela eût été concevable.
En 1944, le crime d’indignité nationale vise plus les collaborateurs, dans le cadre de règlements de comptes politiques, que les auteurs de crimes. C’est en 1951 qu’on y a renoncé – il a notamment visé Sacha Guitry et Arletty.
Faut-il prévoir de nouvelles incriminations ? Des peines qui ont disparu pourraient également être réactivées : la déportation, les travaux forcés, les galères, la confiscation des biens, le bannissement ou l’ostracisme. Je rappelle qu’on a beaucoup hésité, s’agissant de l’ex-maréchal Pétain, entre le droit pénal général et le bannissement. Il a été condamné à mort. L’histoire de France compte des bannis célèbres : Villon, Charles X, Déroulède.
Je ne pense pas qu’il faille créer de nouvelles infractions : les moyens prévus, notamment dans le cadre de la future loi sur le renseignement, pour poursuivre ceux qui attaquent à l’heure actuelle la République, me semblent plus efficaces et consensuels.
Faut-il transformer des infractions spéciales en infractions générales ? Ce serait une erreur. Nous devons rester dans le cadre de la loi de 1881 et ne pas passer vers le droit pénal général. Je suis très inquiet de voir qu’on emprisonne de plus en plus pour délit d’opinion : c’est très perturbant. Certes, me direz-vous, Brasillach a été condamné à mort et exécuté pour délit d’opinion : François Mitterrand m’a dit un jour que cette condamnation avait été la pire faute politique jamais commise.
Quant à la perte des droits civils et civiques, elle est déjà prévue : son champ peut être étendu, comme peine principale ou comme peine complémentaire. C’est vers une telle solution qu’il convient à mes yeux de nous orienter si nous voulons être efficaces.
Créer une nouvelle incrimination d’indignité nationale ne servirait pas à grand-chose.
M. Jean-Frédéric Poisson. Monsieur le président, comme vous l’avez souligné dans votre communication, dont j’ai apprécié le contenu, les sociétés ont toujours cherché à désigner et punir ceux qui s’excommunient, c’est-à-dire qui se retranchent de la communion nationale.
Les cités antiques étant plus petites, elles se trouvaient davantage fragilisées par les comportements erratiques ou déviants : c’est pourquoi les solutions alors proposées étaient radicales. On a ainsi proposé à Socrate de partir ou de boire la ciguë ; il a préféré le poison. Aristote, placé devant le même dilemme, a préféré partir, considérant que deux crimes de lèse-philosophie dans la même cité, c’était beaucoup ! Cette réflexion traverse donc les siècles.
Je n’ai rien à ajouter à votre présentation de l’application de l’ordonnance de 1944, ordonnance qui a « déçu », selon le mot de Mme Simonin au terme de ses travaux, la fragilité juridique du dispositif ayant donné les clés de son application aux tribunaux. Ceux-ci en ont fait ce qu’ils ont voulu, les lampistes ayant été, en fin de compte, plus condamnés que les organisateurs du crime visé par l’ordonnance. Cette injustice générale a fait l’objet d’un éditorial, cité par Mme Simonin, d’Albert Camus, éditorial écrit dès janvier 1945, c’est-à-dire quelques jours seulement après la mise en œuvre de l’ordonnance : l’écrivain s’y interrogeait sur les personnes visées par le dispositif. Les débordements observés ont fait dévier l’ordonnance de son objectif. C’est un point d’insatisfaction, dont il faut tirer la conséquence suivante : la solidité de la rédaction du texte adopté fera une grande part de son efficacité et donc de son succès.
Vous soulignez également que les circonstances ont changé et qu’il serait inopérant de plaquer sur la situation actuelle un contexte historique radicalement différent puisque datant de soixante-dix ans. Or la proposition de loi de M. Meunier ne plaque ni les concepts ni les circonstances de l’époque sur la situation actuelle. Simplement, notre société recherche, comme toutes les sociétés, le moyen de sanctionner les comportements erratiques et déviants qui, non seulement, excluent leurs auteurs de la communauté nationale mais, de plus, la combattent dans ses principes. Comme vous l’avez souligné vous-même, monsieur le président, les attentats de janvier sont une attaque contre les principes les plus fondamentaux de la République, que sont la liberté d’expression, la laïcité, l’autorité publique et l’égalité des croyances.
À mes yeux, le droit actuel ne suffit pas pour traiter de telles attaques, dont la gravité doit nous conduire, pour condamner leurs auteurs, à inventer des outils qui n’existent pas encore ou existent insuffisamment. C’est le point sur lequel je me distingue de M. Tourret.
Enfin, le caractère symbolique du dispositif doit-il être considéré comme une faiblesse ? Vous vous interrogez sur l’efficacité réelle de l’incrimination prévue. Je pense qu’une République, une cité ou une organisation politique quelconque gagne toujours à rappeler les conditions à remplir pour en faire partie, même si cela n’emporte pas de conséquences pratiques spectaculaires. De plus, la proposition de loi ne se contente pas du symbole pur : son adoption emporterait des conséquences.
S’agissant de la fin du XIXe siècle, nous avons tous à l’esprit la création des « Brigades du Tigre », visant à combattre les anarchistes. Nous devons nous montrer capables, lorsqu’il le faut, de décider d’écarter de la communauté nationale des personnes qui sont dans une opposition radicale à ce qu’elle représente. La solidité juridique de la proposition de loi repose sur la définition très claire de ceux qu’elle vise, à savoir tout individu arrêté ou identifié portant les armes ou se rendant complice par la fourniture de moyens à des opérations armées contre les forces armées ou les forces de sécurité françaises ou tout civil français.
Le texte pose également de manière satisfaisante la question de l’apatridie. La France n’ayant pas ratifié la convention de 1961, celle-ci ne s’applique pas en droit français.
Assumons-nous le fait que les circonstances actuelles sont, sinon similaires, du moins comparables dans leur portée à d’autres circonstances tragiques de notre histoire ? La portée de ces crimes justifie-t-elle la création de nouvelles dispositions ? À ces deux questions, je réponds oui.
C’est la raison pour laquelle je soutiens la proposition de loi de M. Meunier.
Mme Cécile Untermaier. Monsieur le président, je tiens à vous féliciter de la qualité de votre communication, qui nous permet de jeter un regard éclairé sur le texte que nous examinons ce matin.
Si la proposition de loi pose une question importante, toutefois, elle envisage l’avenir à partir du passé. Serait-il efficace de construire la France de demain en réactivant l’indignité nationale, une peine infamante prévue par les résistants français à une époque radicalement différente de la nôtre ?
Je regrette que cette proposition ne puisse nous aider à répondre au défi mondial que constitue le terrorisme et plus généralement aux problèmes majeurs que nous rencontrons. Elle n’aura aucun effet ni dissuasif ni correctif sur des individus prêts à sacrifier leur vie pour des valeurs éloignées des nôtres. Non seulement elle n’aurait pas pu éviter les attentats du mois de janvier dernier, mais elle pourrait avoir l’effet inverse. En effet, l’assimilation qu’elle induit avec la libération du territoire au sortir de la Seconde Guerre mondiale pourrait laisser penser à nos concitoyens, de manière dangereuse ou fallacieuse, que, de nouveau, deux France s’opposent.
Le terrorisme est le fait d’individus qui ne représentent ni la France ni même une partie de celle-ci. Ils ne prétendent ni ne veulent du reste la représenter. Le droit pénal actuel offre des outils suffisants pour réprimer leurs actes. La vraie question qui se pose à nous, si nous voulons nous montrer efficaces, est celle de la prévention, dont ne fait pas partie l’arsenal pénal. Chacun le sait, quelle que soit sa dureté, une peine n’empêchera pas un terroriste de passer à l’action.
La future loi sur le renseignement répondra de manière adaptée aux aspects policiers et judiciaires de la question soulevée par la prévention, l’arsenal social et éducatif demeurant essentiel en la matière.
Je crains, comme le président de la Commission, que le dispositif prévu par le texte ne finisse par faire des djihadistes des martyrs, ce dont nous ne voulons à aucun prix. Ne laissons pas nos concitoyens penser que nous aurions trouvé une solution en ajoutant un outil inefficace à l’arsenal pénal existant.
Mme Marie-Anne Chapdelaine. Cette proposition de loi, qui met à l’ordre du jour de notre Commission la question du crime d’indignité nationale et de la perte de la nationalité française, s’inscrit dans le cadre d’un calendrier actif en matière sécuritaire : je citerai pour mémoire la récente loi antiterroriste, le plan de lutte contre la radicalisation violente et l’examen prochain de la loi sur le renseignement.
Il importe donc de peser chacune de nos propositions non seulement à l’aune de la gravité de la situation mais également à celle de leur cohérence et de leur efficacité. Deux motifs non exhaustifs justifient à mes yeux le rejet du texte. Le premier est d’ordre juridique. Bien que retravaillée, cette proposition de loi ne présente toujours pas les garanties procédurales nécessaires et suffisantes. Le dispositif, par son manque d’équilibre entre le code civil et le code pénal, ne résistera pas au contentieux. Le second motif est le plus important : il vise l’efficacité du texte, qu’il s’agisse du retrait de la nationalité française ou du crime d’indignité nationale.
Ceux qui font le choix de porter atteinte, par des actes terroristes, aux valeurs républicaines et à la nation n’ont que faire de n’être plus membres de celle-ci. Leur action s’inscrit dans une quête d’une telle folie que la menace de perdre le lien qui les relie à leur pays d’origine ou d’accueil ne provoquera chez eux aucun questionnement sur le sens des actes meurtriers qu’ils prévoient d’exécuter. Enfin, notre connaissance de ceux qui prennent les armes est désormais assez fine pour savoir qu’il ne s’agit pas seulement de descendants d’immigrés ou de doubles nationaux, mais bien souvent d’adultes ou de jeunes sans lien récent avec l’immigration.
Le sujet est donc trop complexe pour être réduit à un public sommairement défini. À ces deux motifs, je pourrais en ajouter un troisième : la création des peines d’exception. Notre histoire comme celle des autres nations n’a pas encore fourni de preuve suffisante permettant de conclure à l’efficacité d’un recul de l’État de droit pour lutter contre la barbarie. La meilleure réponse est, comme l’a souligné le président de la Commission, de redonner force à l’idéal républicain et de réaffirmer la valeur de notre droit en punissant les auteurs des crimes visés par le texte avec les outils du droit pénal commun.
C’est pourquoi le groupe SRC votera contre la proposition de loi.
M. Pascal Popelin. Je vous remercie, monsieur le président, du travail complet que vous avez effectué sur un sujet aussi sensible et complexe.
Il était utile, pour alimenter notre réflexion et forger notre conviction, que nous disposions de références historiques et juridiques documentées.
Cela nous permettra en effet d’éviter deux écueils. Le premier eût été d’écarter d’un revers de main l’idée de réactiver dans notre droit le crime d’indignité nationale ou toute autre forme de peine de dégradation civique, dispositions qui ont accompagné, dans certaines circonstances, l’histoire de la République. Le second eût été de nous précipiter dans le vote d’une loi d’émotion, de réaction ou de circonstance, comme ce fut trop souvent le cas, sous le coup de la légitime indignation, suscitée au sein de la représentation nationale comme dans l’opinion publique, par les actes ignobles perpétrés sur notre territoire par des individus de nationalité française.
Votre travail, monsieur le président, a contribué à forger mon opinion, qui n’était pas arrêtée sur le sujet, même si j’avais déjà pointé des références historiques hasardeuses au cours de l’examen, en séance publique, le 4 décembre 2014, de la première version de cette proposition de loi.
Votre travail a conforté mon sentiment : les idées qui semblent frappées au coin du bon sens peuvent dissimuler des vices, qu’un regard attentif permet de déceler. Autrement dit : l’enfer peut être pavé de bonnes intentions.
Le principe qui vise à retrancher un concitoyen de la communauté nationale, c’est-à-dire à le priver de droits civiques ou à lui interdire l’accès à la fonction publique, avait un sens en 1944, lorsqu’il s’agissait de sanctionner des citoyens qui avaient collaboré avec l’occupant nazi et pour lesquels cette sanction avait incontestablement un impact, puisqu’il s’agissait souvent de notables revendiquant pleinement leur appartenance à la communauté nationale, aspirant même, parfois, à l’incarner. C’était une forme de sanction pour crime politique, que seules les circonstances exceptionnelles pouvaient rendre concevable et justifiable, par dérogation aux principes traditionnels du droit républicain, qui ne reconnaît pas le crime politique. Cette sanction trouvait sa justification, vous l’avez souligné, dans la volonté de mettre à l’écart de la reconstruction du pays et de la démocratie ceux qu’on jugeait indignes d’y participer.
Il n’y a là rien de comparable avec la menace à laquelle notre pays est aujourd’hui confronté. Qui peut en effet imaginer que l’obscurantisme qui embrouille l’esprit d’un terroriste avant, pendant et après son passage à l’acte, lui permettrait d’être impressionné par le risque d’encourir l’indignité nationale ? Au mieux, la perspective d’une telle sanction lui inspirera la même crainte qu’un pistolet à bouchon ; au pire – il serait peu sage d’écarter ce risque –, une telle peine pourrait devenir une sorte de « médaille du travail » du terroriste, dont chacun connaît le goût à figurer sur une liste de martyrs.
M. Urvoas a évoqué la manière dont la République a traité, à la fin du XIXe siècle, les anarchistes : elle leur a refusé le statut de martyrs judiciaires en faisant le choix de les traiter non pas hors de la République et hors de la nation mais comme des accusés de droit commun. Ceux qui nous ont précédés nous ont montré le chemin : les crimes commis aujourd’hui par les terroristes ne méritent pas d’être distingués par une peine particulière. Ils doivent être sanctionnés sans faiblesse pour ce qu’ils sont : des crimes de droit commun, qui exposent leurs auteurs à une large palette de sanctions sévères, lesquelles emportent, d’ailleurs, les mêmes conséquences que l’indignité nationale en matière de droits civiques ou d’accès aux emplois publics.
C’est pourquoi je ne voterai pas une proposition de loi recyclée par rapport à celle que nous avons déjà examinée en décembre 2014.
M. Jean-Frédéric Poisson. Retravaillée et non pas « recyclée », monsieur Popelin : ne soyez pas si méprisant envers le texte.
M. Pascal Popelin. Je n’ai aucune volonté d’être polémique ou méprisant. Je ne fais aucun procès d’intention à l’auteur du texte. Si vous le préférez, j’accepte le mot « retravaillée ». Je crois même me rappeler que c’est la troisième version sur laquelle nous nous penchons : nous en avons déjà refusé deux.
M. Gilbert Collard. J’ai le grand regret, monsieur le président, de vous dire que votre communication m’a passionné. J’en suis désolé. (Sourires.)
Je tiens toutefois à souligner mon désaccord, s’agissant de votre référence aux anarchistes : vous avez oublié les « lois scélérates » – c’est Léon Blum qui a inventé l’expression –, dont Ludovic Trarieux, alors président de la Ligue des droits de l’homme et radical-socialiste, fut à l’origine. Il est vrai toutefois que ces lois n’ont jamais dérogé au droit commun. C’est un trait essentiel pour juger l’histoire de la IIIe République.
Un membre de la commission des Lois connaît-il le texte d’abrogation de l’ordonnance de 1944 ? Je l’ai cherché ; je ne l’ai pas trouvé – l’amnistie de 1951 ne valant pas abrogation. C’est pourquoi je pose la question : ne débattons-nous pas d’une incrimination non abrogée et qui, donc, existerait toujours ?
Il est vrai, monsieur le président, que la notion d’indignité nationale paraît aujourd’hui bien anachronique, car nous renvoyant à une période historique radicalement différente de la nôtre. Toutefois, comme je crois aux symboles, je serai satisfait de savoir que l’homme qui tue un policier à terre n’a pas la même dignité nationale que sa victime. Pour cette seule raison, je serai satisfait du rétablissement du crime d’indignité nationale. Je le répète : l’homme qui abat un policier à terre ne doit pas avoir la même dignité nationale que sa victime.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Je n’ai pas omis les « lois scélérates » : je les évoque dans ma communication écrite. L’expression constitue le titre d’un ouvrage, publié en 1899 et signé par trois auteurs : Francis de Pressensé, Émile Pouget, et « un juriste » qui était, en fait, Léon Blum.
S’agissant de l’ordonnance de 1944, sa rédaction même prévoyait son abrogation puisqu’elle précisait que l’infraction ne pouvait être constatée que six mois après la libération totale du territoire fixée au 8 mai 1945.
La loi d’amnistie de 1951 a amnistié 80 % des condamnés.
M. Patrick Mennucci. J’ai travaillé, au nom du groupe socialiste, sur la première proposition de loi de M. Meunier : le travail réalisé entre les deux textes est incontestable, les débats en commission puis dans l’hémicycle ayant conduit notre collègue à s’apercevoir qu’il s’était engagé dans une impasse juridique.
Le présent texte doit être contesté à la fois sur le plan juridique – votre communication y a contribué, monsieur le président – et sur son opportunité.
Le travail que je conduis avec Éric Ciotti dans le cadre de la commission d’enquête sur les filières djihadistes m’amène à deux considérations sur l’opportunité de cette proposition de loi.
S’agissant du retour des djihadistes, j’entends bien les arguments de M. Meunier. Mais peut-on laisser 400 à 500 individus animés d’une haine des principes républicains aller de la Syrie à la Libye, de la Libye à la Tunisie, voire au Maroc ou au sud de l’Algérie, et agir en tant que militants de l’anti-France à l’extérieur de nos frontières ? Non. Il faut leur permettre de revenir pour les traduire devant la justice et les juger pour les actes qu’ils ont commis. C’est parce que nous nous conformerons à l’État de droit que nous pourrons affirmer notre supériorité morale face à ces gens. Leur place est en prison, à Fresnes, aux Baumettes, à La Farlède, et pour longtemps. Notre commission d’enquête aura d’ailleurs des éléments à apporter sur la question des quartiers d’isolement.
Par ailleurs, votre proposition de loi tend à faire du terrorisme un crime politique, ce qu’il n’est pas à mon sens. On ne saurait accorder une médaille du travail aux djihadistes. Pensez-vous vraiment que les djihadistes français qui crucifient et lapident des femmes redoutent de perdre leur nationalité française ? Pensez-vous vraiment que les membres de Jund al Khalifa, Ansar al Charia, Ansar Dine ou du MUJAO, groupes satellites ou concurrents de DAECH, se soucient de cela ?
Votre proposition de loi est simplement destinée à rassurer l’opinion. Les actions de lutte contre le terrorisme, c’est le Gouvernement qui les mène : loi sur le renseignement, surveillance d’internet, collaboration entre les services de renseignement et les juges, renforcement du renseignement pénitentiaire, dont je tiens à souligner qu’il est beaucoup plus efficace que ce que nous entendons ici ou là.
Pour toutes ces raisons, monsieur le rapporteur, je ne voterai pas votre texte.
M. Hugues Fourage. Les dispositions de votre proposition de loi ont une connotation historique particulière, ce qui rend leur approche délicate. Par ailleurs, dans votre exposé des motifs, vous replacez ce texte dans le contexte des « attentats qui ont frappé la France à Noël et début janvier 2015 ». Il me paraît un peu dommage de lui donner cette tonalité teintée d’émotion. La question de l’indignité nationale n’est pas une simple question de circonstances.
De notre discussion, qui a d’une certaine manière un caractère transpartisan, je retiens deux dimensions principales : la force du symbole et l’efficacité.
Vous écrivez, monsieur le rapporteur, qu’« il serait proprement scandaleux que de tels individus jouissent des bienfaits et des droits attachés à la qualité de citoyen français, alors même qu’ils bafouent les devoirs les plus élémentaires que l’on doit à sa patrie et à la République. » Nous pouvons effectivement nous poser la question de la force symbolique de la loi dans notre République. Elle est fondamentale, beaucoup d’entre nous l’ont évoquée. Doit-on élaborer des lois en raison de leur force symbolique ? C’est tout l’enjeu de cette proposition de loi.
Un argument de Jean-Jacques Urvoas a particulièrement retenu mon attention : « En effet, si les actes commis par les terroristes impliquent bien un rejet de nos valeurs fondamentales et de nos institutions, ils ne constituent pas pour autant en eux-mêmes un courant d’idées contraires auquel se serait ralliée une partie de la population. Il n’y a en France ni guerre civile, ni programme idéologique de substitution d’une nouvelle conception de la Nation justifiant la protection de la conception actuelle par des techniques de disqualification. » Il m’a convaincu qu’il n’était pas nécessaire de recourir à la force symbolique de la loi en adoptant cette proposition loi rétablissant l’indignité nationale.
J’en viens à l’efficacité de la loi. Je ne crois pas, mes chers collègues, qu’en votant une loi de cette nature, on puisse empêcher que des actes terroristes soient commis. De même, je n’ai jamais considéré que la peine de mort pouvait empêcher d’une quelconque manière que des meurtres soient commis. Robert Badinter, dans le discours qu’il a prononcé à l’Assemblée nationale pour défendre l’abolition de la peine de mort, a rappelé que, dans la foule rassemblée devant le palais de justice où se tenait le procès de deux meurtriers, l’un des manifestants qui criait « À mort ! » avait commis lui-même des crimes odieux.
Par ailleurs, il faut se demander si, en dehors des dispositions proposées, les actes visés resteraient impunis. Je constate qu’il existe déjà dans notre droit des moyens de les sanctionner de manière claire et précise. Par conséquent, les nouvelles dispositions portées par votre proposition de loi ne me semblent pas nécessaires.
Je ne la voterai donc pas.
M. Guillaume Larrivé. Je n’ai pas co-signé cette proposition de loi, afin de me laisser le temps de la réflexion, mais je la voterai pour une raison de fond, bien mise en avant dans le débat de qualité que nous avons.
Qu’est-ce qu’une nation ? Une communauté de citoyens qui se reconnaissent les uns les autres en tant que tels, dotés de droits et de devoirs mutuels et unis par un contrat social, comme l’a montré la philosophie politique. Lorsque l’un de nos compatriotes va jusqu’à porter les armes contre la France, il fait le choix de s’exclure de la communauté nationale. Je crois profondément que la République française est fondée à reconnaître par un acte positif que ce citoyen s’est exclu de la communauté nationale. C’est le cœur du débat qui nous rassemble ici.
Cela posé, il faut se demander si la peine d’indignité nationale est toujours adaptée aux réalités de notre époque. Je le crois plus que jamais. D’une part, elle renvoie à des principes qui ne dépendent pas de la conjoncture. D’autre part, elle s’inscrit dans un contexte de guerre, une guerre non-conventionnelle, une guerre asymétrique, mais une guerre dans laquelle certains de nos concitoyens ont fait le choix de se déclarer ennemis de la nation en ayant pour projet d’affaiblir voire de détruire la France par la terreur.
La proposition de loi a deux objets. Elle vise, premièrement, à étendre les cas de perte de la nationalité, mesure juridiquement fondée, que je voterai. Elle tend, deuxièmement, à instaurer une peine d’indignité nationale, que j’approuve également.
Je conclurai ce bref propos en m’adressant à ceux et celles qui ont invoqué l’État de droit. L’État de droit n’a pas s’excuser d’être fort. S’il est faible, il n’y a plus d’État et in fine plus de droit. Notre mission en tant que législateurs est de renforcer l’État de droit par divers moyens. Ce texte constitue une réponse à la menace terroriste. Il y en a d’autres, comme le projet de loi relatif au renseignement. Et vous le savez, les députés de l’UMP le voteront pour l’essentiel. Nous avons déjà démontré notre esprit de responsabilité lorsque nous avons voté la loi anti-terroriste de 2014, un esprit de responsabilité que les députés socialistes ont oublié en 2006 puisqu’aucun d’entre eux n’a voté la loi anti-terroriste présentée par Nicolas Sarkozy.
Nous sommes prêts à vous accompagner pour voter les mesures que vous proposez lorsqu’elles nous paraissent utiles mais estimons de notre devoir de les compléter quand cela nous semble nécessaire. C’est ce que se propose de faire ce texte plus que symbolique.
M. Guy Geoffroy. Je voudrais dire à M. le rapporteur toute la satisfaction qui est la mienne de compter parmi les premiers signataires de sa proposition de loi. Vous avez immédiatement compris sa portée, monsieur le président, et avez fait le choix d’introduire son examen par une communication, issue d’un travail très approfondi, d’une grande qualité, que je salue. Je regrette toutefois les conclusions trop hâtives que vous avez pu tirer de vos recherches.
Je vous invite à la modération, chers collègues de l’opposition. L’un de vous a posé la question de savoir si l’adoption de la proposition de loi initiale de Philippe Meunier aurait empêché les drames de début janvier. Je lui renvoie sa question : la loi anti-terroriste de novembre 2014 les a-t-elle évités ? Non. Méfions-nous de tels parallélismes, ils se retournent rapidement contre ceux qui les établissent.
Je confirme à M. Collard – mais M. le président Urvoas l’a déjà dit – que l’ordonnance du 26 août 1944 ne prévoyait l’application de la peine d’indignité nationale que pour une période limitée : elle s’est éteinte d’elle-même. Le fait qu’une loi d’amnistie ait été votée quelques années plus tard n’a rien d’incohérent. Elle est venue effacer ce qui avait été marqué par cette incrimination.
Pascal Popelin a posé une vraie question : les actes auxquels nous sommes confrontés relèvent-ils du crime ordinaire ? Si ce n’est pas le cas, y a-t-il lieu de marquer de manière différence la riposte de la nation ?
M. Pascal Popelin. Vous considérez qu’il s’agit de crimes politiques ?
M. Guy Geoffroy. Ne nous racontons pas d’histoires : le raisonnement politique de ceux qui commettent ces crimes est nul. Toutefois, leur objectif est bien de tuer la nation en portant atteinte à certaines de ses représentations très puissantes.
Ne vous fourvoyez pas, chers collègues : considérez plutôt cette proposition de loi comme un élément supplémentaire dans un ensemble que nous essayons de construire ensemble pour montrer que l’État de droit dans notre pays ne recule pas et pour rassembler notre peuple autour de valeurs fondamentales que nous voulons continuer de défendre après le 11 janvier. Le relâchement de notre vigilance aurait de graves conséquences. Il est bon d’envoyer des messages forts s’agissant des symboles qui fondent notre République.
En refusant cette proposition de loi, vous commettez l’erreur de ne pas répondre aux attentes que nos concitoyens ont à l’égard de la représentation nationale.
Cette proposition de loi, bien retravaillée, n’est pas un texte de circonstance. C’est un texte qui tient compte des circonstances, nuance qui ne me semble pas négligeable. C’est la raison pour laquelle je souhaite qu’il soit adopté.
Mme Élisabeth Pochon. Je me pose une question à laquelle je n’ai pas vraiment de réponses, peut-être pourrez-vous m’en fournir. Ce n’est pas la première fois que la nation est mise en péril par des actions terroristes. Nous avons déjà été confrontés aux terrorismes basque et corse, à Action directe, mais personne n’a alors invoqué la déchéance de nationalité. Pourquoi la met-on en avant aujourd’hui ?
Je suis d’accord avec vous, monsieur Geoffroy, pour dire que le message qu’une telle proposition envoie à la nation a son importance. Simplement, je ne l’envisage pas de la même manière que vous. Il me semble de nature à stigmatiser une partie de la population, en raison de son appartenance religieuse.
M. le rapporteur. Monsieur le président, je tiens à vous dire que j’ai apprécié votre communication : elle me renforce dans ma détermination à défendre cette proposition de loi.
« Dans l’esprit des juristes de la Résistance », soulignez-vous à la page 17, « l’instauration du crime d’indignité nationale devait donc répondre à une double finalité : juger les vaincus, accusés d’avoir déshonoré la République ; obtenir l’adhésion des populations libérées aux institutions mises en place par le GPRF, autrement dit à la restauration de la République à travers la diffusion d’une morale politique permettant de distinguer le "bon" citoyen du "mauvais". » J’approuve totalement ces principes. Vous affirmez encore – élément essentiel – que le contenu de cette proposition de loi est un choix juridiquement possible.
Rappelons que le président de la République et le Premier ministre ont manifesté la volonté que le pouvoir exécutif noue un dialogue constructif avec le pouvoir législatif, notamment avec les membres de l’opposition. À cette volonté, monsieur le président, nous répondons par cette proposition de loi. Semblable texte ne peut manquer de provoquer des divergences entre nous mais elles sont susceptibles d’être gommées par le dépôt d’amendements. Or les deux seuls amendements déposés par la majorité sont des amendements de suppression. Cela me paraît désolant au regard de ce que doit être l’union nationale.
Monsieur Tourret, j’ai beaucoup de respect pour vos analyses. Vous n’êtes pas d’accord avec l’introduction d’une peine d’indignité nationale, et c’est votre droit, d’autant que vous avez fait preuve d’honnêteté intellectuelle. Toutefois, je déplore qu’à l’instar de vos collègues de la majorité, vous n’ayez dit aucun mot de l’article 1er concernant la perte de nationalité. Les attentats du mois de janvier ont-ils changé votre positionnement politique ? C’est à vous de me le dire. Par ailleurs, M. Poisson a souligné que la peine d’indignité s’appliquait aux Français portant les armes. Un Sacha Guitry ne pourrait donc être inquiété.
Madame Untermaier, cette proposition de loi relève selon vous du passé. Je viens de rappeler que les principes sur lesquels elle repose sont toujours d’actualité. Vous avez insisté sur le rôle primordial que joue à vos yeux la prévention. Je laisse nos compatriotes réfléchir à vos propos. Ils jugeront par eux-mêmes si cela leur paraît suffisant pour régler le problème du terrorisme qui frappe sur notre territoire, en Europe et dans le monde entier.
Madame Chapdelaine, le problème n’est pas de savoir si les djihadistes veulent ou non rester français, mais s’ils doivent le rester. Les Français ne veulent plus partager leur territoire avec ces personnes : elles n’ont plus à faire partie de la communauté nationale car elles ont souillé la République en portant les armes contre elle.
Monsieur Popelin, nous ne réagissons pas en fonction de nos émotions. Cette proposition de loi, je le rappelle, a été débattue en 2014. Le groupe UMP n’a pas attendu les attentats de Noël et du mois de janvier pour la déposer. Si nous l’avons à nouveau défendue, c’est tout simplement que M. Hollande et M. Valls ont exprimé le souhait de travailler avec l’opposition. À vous d’en tirer les conséquences et d’assumer vos responsabilités politiques.
Aux interrogations de M. Collard sur la durée d’application de l’ordonnance, vous avez parfaitement répondu, monsieur le président. Je n’y reviendrai pas.
Les impasses juridiques qu’a évoquées M. Mennucci sont réelles, mais elles ont pu être contournées par des amendements, qui ont malheureusement été rejetés. Quant à la volonté d’empêcher le retour des djihadistes, elle n’est pas incompatible avec la possibilité qu’ils fassent l’objet de poursuites.
Monsieur Fourage, je ne remets pas en cause votre honnêteté intellectuelle. Votre raisonnement se tient.
Monsieur Larrivé, vous avez raison d’affirmer que, plus que jamais, il est important d’appeler à la nécessité de sauvegarder notre cohésion nationale dans ces moments extrêmement difficiles que nous traversons. Et, monsieur Geoffroy, vous avez aussi raison de souligner que les raccourcis hâtifs ne servent pas le débat. Cette proposition de loi n’a pas pour objet de donner dans la politique politicienne mais d’essayer de répondre à la main tendue par le président de la République et le Premier ministre au mois de janvier.
Enfin, madame Pochon, je ne peux nier que le terrorisme basque a été très sanglant. Mais il y a une différence majeure.
Mme Élisabeth Pochon. Huit cents morts !
M. le rapporteur. Les conséquences des actes terroristes que nous connaissons aujourd’hui en France et dans le monde ne sont pas de même nature.
*
* *
À la fin de sa réunion, la Commission a autorisé la publication du présent rapport d’information en application de l’article 145, alinéa 7, du Règlement.
ANNEXE :
LISTE DES PROFESSEURS DE DROIT AYANT REMIS DES CONTRIBUTIONS ÉCRITES
— M. Boris Bernabé, professeur d’histoire du droit, Université Paris-Sud
— M. Philippe Conte, professeur de droit pénal, Université Panthéon-Assas (Paris 2)
— M. Éric Desmons, professeur de droit public, Université Paris-Nord 13
— M. Éric Gasparini, professeur, Université Paul Cézanne (Aix-Marseille 3)
— M. Jean-Christophe Gaven, professeur d’histoire du droit, Université Toulouse 1 Capitole
— M. Serge Guinchard, professeur émérite de droit pénal, Université Panthéon-Assas (Paris 2)
–– M. Jean-Louis Halpérin, professeur d’histoire du droit, École normale supérieure
— M. Sébastien Le Gal, maître de conférences en histoire du droit, Université de Reims Champagne-Ardennes
— M. Martial Mathieu, professeur d’histoire du droit, Université Pierre Mendès France Grenoble 2
— Mme Raphaële Parizot, professeure de droit pénal, Université de Poitiers
— M. Didier Rebut, professeur de droit pénal, Université Panthéon-Assas (Paris 2)
— M. Laurent Reverso, professeur d’histoire du droit, Université de Toulon
— M. François Saint-Bonnet, professeur d’histoire du droit, Université Panthéon-Assas (Paris 2)
1 () Proposition de loi de M. Philippe Meunier et plusieurs de ses collègues du groupe UMP (n° 996) visant à déchoir de la nationalité française tout individu portant les armes contre les forces armées françaises et de police, http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0996.asp.
2 () Anne Simonin, Le déshonneur dans la République. Une histoire de l’indignité 1791-1958, Grasset, 758 p.
3 () MM. Boris Bernabé, professeur d’histoire du droit à l’Université de Paris-Sud (Paris XI), Philippe Conte, professeur de droit pénal à l’Université Panthéon-Assas (Paris II), Eric Desmons, professeur de droit public à l’Université Paris-Nord (Paris XIII), Eric Gasparini, professeur d’histoire du droit à l’Université d’Aix-Marseille, Jean-Christophe Gaven, professeur d’histoire du droit à l’Université Toulouse 1 Capitole, Serge Guinchard, professeur émérite de droit privé et de sciences criminelles à l’Université Panthéon-Assas (Paris II), Jean-Louis Halpérin, professeur de droit à l’École Normale Supérieure, Sébastien Le Gal, maître de conférences en histoire du droit à l’Université de Reims, Martial Mathieu, professeur d’histoire du droit à l’Université Pierre Mendès-France–Grenoble 2, Mme Raphaële Parizot, professeur de droit privé et de sciences criminelles à l’Université de Poitiers, MM. Didier Rebut, professeur à l’Université Panthéon-Assas (Paris II), Laurent Reverso, professeur d’histoire du droit à l’Université de Toulon, François Saint-Bonnet, professeur d’histoire du droit à l’Université Panthéon-Assas (Paris II).
4 () Rappelons en effet que la déchéance de nationalité prévue par les articles 25 et 25-1 du code civil n’est applicable qu’aux Français ayant acquis la nationalité française et ne concerne donc pas les binationaux nés en France.
5 () Voir l’amendement : http://www.assemblee-nationale.fr/14/amendements/0996/AN/4.asp.
6 () Par parallélisme avec la disposition prévue à cet égard à l’article 25 du code civil relatif à la déchéance de nationalité.
7 () Voir l’amendement : http://www.assemblee-nationale.fr/14/amendements/0996/AN/6.asp.
8 () Voir le compte-rendu de la deuxième séance publique du 4 décembre 2014, http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2014-2015/20150087.asp.
9 () Annette Peignard-Giros, Dictionnaire de l’Antiquité, sous la direction de Jean Leclant, Paris, PUF, Quadrige 2005, voir « Ostracisme », p. 1594-1595.
10 () Yan Thomas, « L’Institution de la Majesté », Revue de synthèse, 3-4, 1991, p. 331-386.
11 () Voir la thèse de Jean-Christophe. Gaven, Le crime de lèse-nation. Histoire d’une brève incrimination politique (1789-1791), thèse dactylographiée. Toulouse 1, 2003 ; et son intervention lors du 57e congrès de la Commission Internationale pour l’Histoire des Assemblées d’État (CIHAE) : Protéger la nation au début de la Révolution. L’Assemblée nationale constituante face à la menace contre-révolutionnaire (1789-1791), dans l’ouvrage dirigé par Jean Garrigues et al., Assemblées et parlements dans le monde, du Moyen-Âge à nos jours., p. 496.
12 () Plus de 500 affaires auraient été traitées au stade policier uniquement.
13 () Robert Jacob, La question romaine du sacer. Ambivalence du sacré ou construction symbolique de la sortie du droit, Revue historique, 639 (2006) 3, p. 523-588 ; Claire Lovisi, Contribution à l’étude de la peine de mort sous la République romaine, Paris, De Boccard, 2000.
14 () Anne Simonin, Le déshonneur dans la République. Une histoire de l’indignité 1791-1958, op. cit.
15 () Journal officiel de la République française, 28 août 1944, pp. 767-768.
16 () Anne Simonin, op.cit, p. 11.
17 () Éditorial d’Albert Camus, 28 septembre 1944. In Jacqueline Lévi-Valensi, Camus à Combat, éditions Gallimard, 2003, 745 p.
18 () Exposé des motifs de l’ordonnance du 26 août 1944 instituant l’indignité nationale.
19 () A peu de choses près identiques à celles prévues dans le mécanisme de dégradation civique de 1810.
20 () La majoration des impôts, d’ailleurs, était également prévue dans le dispositif, tout comme la privation des soins pour les invalides ainsi que des pensions civiles ou militaires.
21 () Article 24 de l’ordonnance du 26 décembre 1944.
22 () Ordonnance du 30 septembre 1944 modifiant l’ordonnance du 26 août 1944 sur l’indignité nationale, ordonnance du 17 octobre 1944 modifiant l’ordonnance du 26 août 1944 sur l’indignité nationale, ordonnance du 26 décembre 1944 portant modification et codification des textes relatifs à l’indignité nationale.
23 () Journal officiel de la République française, 10 février 1945, p. 674.
24 () D’après Henry Rousso, « L’épuration en France. Une histoire inachevée ». Vingtième Siècle. Revue d’histoire, 1992, volume 33, pp. 78-105.
25 () Anne Simonin, Rétablir l’indignité nationale ? Une perspective historique, note n° 12, Fondation Jean Jaurès, Thémis, Observatoire justice et sécurité, 28 janvier 2015.
26 () Loi n° 51-18 du 5 janvier 1951 portant amnistie, instituant un régime de libération anticipée, limitant les effets de la dégradation nationale et réprimant les activités antinationales.
27 () CE, avis n° 249475.
28 () C’est d’ailleurs là, sur le plan moral, une vraie difficulté. D’aucuns, à l’instar de M. Serge Guinchard, considèrent en effet que l’indignité nationale, la dégradation civique n’ont de sens que dans la mesure où l’on peut y mettre fin pour réintégrer la personne ainsi flétrie dans la communauté nationale. « Faute de quoi, insiste pour sa part M. Laurent Reverso, on la laisse dans un espace de non droit, dans un espace d’indétermination juridique qui présente les plus grands dangers et qui s’apparente en effet à l’espace (in)défini par le droit pénal de l’ennemi. ».
29 () Le nombre total de manifestants à travers la France est estimé par le ministère de l’Intérieur à plus de 4 millions sur les deux journées, dont plus de 1,5 million le dimanche 11 janvier à Paris, ce qui en fait le plus important rassemblement de l’histoire contemporaine. Parallèlement, de nombreuses manifestations et rassemblements de soutien ont eu lieu dans le monde.
30 () CEDH, SW c. Royaume‐Uni, arrêt du 22 novembre 1995, § 44. D’une manière générale, la Cour condamne toute atteinte disproportionnée au droit de vote et qu’elle a condamné à plusieurs reprises le Royaume-Uni qui prive automatiquement tous les détenus de leur droit de vote (CEDH, 10 février 2015, McHugh et autres contre Royaume-Uni).
31 () Déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH) du 10 décembre 1948 (article 18), Pacte international relatif aux droits civils et politiques et Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966.
32 () Au demeurant, c’était le même principe qui prévalait dans les ordonnances des 26 août et 11 décembre 1944 : comme on l’a vu, il n’y était nullement question d’une perte de nationalité.
33 () Mireille Delmas-Marty, « Violences et massacres : entre droit pénal de l’ennemi et droit pénal de l’inhumain », RSC, 2009, n° 1, p. 59 sq.
34 () Répertoire Fuzier-Herman, Dégradation civique, n° 12. « Une peine n’est réelle qu’autant qu’elle enlève au délinquant un bien appréciable », observe dans la même optique le juriste Pellegrino Rossi au XIXe siècle.
35 () Voir François Saint-Bonnet, Note sur l’opportunité de l’incrimination d’indignité nationale pour les djihadistes (à paraître).
36 () Tel Léon Léauthier, ouvrier cordonnier, qui poignarda au hasard un client, décoré, d’un restaurant parisien.
37 () Ravachol s’en est pris en 1892 au président du tribunal et à l’avocat général qui étaient intervenus dans le procès d’anarchistes inquiétés l’année précédente. Les frères Kouachi ont, pour leur part, pris pour cible la rédaction d’un journal qu’ils considéraient comme impie et blasphémateur.
38 () Ravachol a été exécuté le 11 juillet 1892 sans avoir signé son recours en grâce et s’avança vers la mort, dit-on, sourire aux lèvres en chantant un chant anarchiste.
39 () Loi n° 2014-1353 du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme.
40 () Utilisée sous la Révolution contre les bandes censées semer désordres et terreur dans les campagnes, cette incrimination avait déjà une forte teneur politique en ce sens que l’on cherchait, avec elle, à saisir et punir tous les éléments de déstabilisation de la Révolution (propagateurs de fausses rumeurs, auteurs de violences sur les personnes, de destructions de récoltes, d’interceptions de grains, etc.). La peur du complot aristocratique faisait alors redouter tout commencement d’association, d’assemblée en armes, de regroupement. À partir du XIXe siècle, l’urbanisation de la société française déplaça sur les villes le regard attentif des législateurs et des spécialistes de la criminalité. De nouvelles formes de délinquance émergèrent, ou du moins, reléguèrent au second plan l’association de malfaiteurs et la bande organisée.
41 () Le procès des Trente est un procès célèbre qui s’ouvrit en France le 6 août 1894, devant la cour d’assises de la Seine. Durant son déroulement, qui constitua alors l’apogée de la lutte contre l’anarchisme, trente inculpés furent jugés, allant de théoriciens de l’anarchie à de simples cambrioleurs, tous rassemblés dans une même accusation d’association de malfaiteurs ; le procès visait aussi à justifier par leur application les « lois scélérates » de 1893-1894. La quasi-totalité des inculpés furent cependant acquittés, dans un verdict dont la modération contribua à calmer les esprits.
42 () Selon l’expression de Francis de Pressensé, Émile Pouget et Léon Blum (qui signe "un juriste") dans un pamphlet publié en 1899, Les Lois scélérates de 1893-1894.
43 () Loi n° 2012-1432 du 21 décembre 2012 relative à la sécurité et à la lutte contre le terrorisme et loi n° 2014-1353 du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme.
44 () Le droit pénal de l’ennemi étant « essentiellement basé sur l’idée que les règles juridiques en vigueur pour le citoyen ne peuvent s’appliquer à qui rejette totalement les règles à la base de la société parce qu’il y porte atteinte brutalement, totalement, précisément sans aucune règle », Michèle Papa, « Droit pénal de l’ennemi et de l’inhumain : un débat international », RSC, 2009-1, p 3.
45 () Art. 422-3 : « Les personnes physiques coupables de l’une des infractions prévues par le présent titre encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L’interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l’article 131-26. Toutefois, le maximum de la durée de l’interdiction est porté à quinze ans en cas de crime et à dix ans en cas de délit ;
2° L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, le maximum de la durée de l’interdiction temporaire étant porté à dix ans, soit, pour les crimes prévus par les 1° à 4° de l’article 421-3, l’article 421-4, le deuxième alinéa de l’article 421-5 et l’article 421-6, d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice peuvent être prononcées cumulativement ;
3° L’interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l’article 131-31. Toutefois, le maximum de la durée de l’interdiction est porté à quinze ans en cas de crime et à dix ans en cas de délit. ».
46 () Voir François Saint-Bonnet, Note sur l’opportunité de l’incrimination d’indignité nationale pour les djihadistes (à paraître).
© Assemblée nationale