


______
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 26 septembre 2012.
RAPPORT
FAIT
AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES SUR LE PROJET DE LOI n° 197 (Procédure accélérée), autorisant la ratification du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l’Union économique et monétaire,
par Mme Elisabeth GUIGOU
Députée
___
ET
INTRODUCTION 7
I – LA CRISE DE LA ZONE EURO EST UNE CRISE POLITIQUE 11
A – L’ENGAGEMENT INITIAL : CONSTRUIRE UNE UNION ÉCONOMIQUE ET PAS SEULEMENT MONÉTAIRE 11
1. Le traité de Maastricht : les fondements de l’Union économique et monétaire 11
a) Les objectifs de l’Union économique et monétaire 11
b) La monnaie unique 12
c) Les jalons de la coordination des politiques économiques et de l’harmonisation des règles sociales 13
2. Le pacte de stabilité et de croissance : le mode d’emploi de la discipline budgétaire 15
B – LES ANNÉES 2000 : LES DÉRIVES DE L’UNION ÉCONOMIQUE ET MONÉTAIRE 16
1. Une union économique inaboutie 16
2. Des règles communes régulièrement bafouées depuis l’avènement de l’euro 18
C – UNE CRISE DE LA ZONE EURO RÉVÉLATRICE DES INSUFFISANCES DE LA CONSTRUCTION EUROPÉENNE 23
1. Une crise qui a pris naissance aux États-Unis et s’est propagée en Europe par les banques 24
2. Une crise multiforme 25
a) La Grèce : mauvaise gouvernance et défaut de compétitivité 25
b) L’Irlande : coût exorbitant du sauvetage des banques et bulle immobilière 26
c) La bulle immobilière espagnole 26
d) Le Portugal : défaut de compétitivité et de dynamisme économique 27
e) L’Italie : un endettement élevé hérité du passé 27
f) La persistance de déséquilibres macroéconomiques importants internes à la zone euro 28
3. Dans un premier temps, des plans nationaux de sauvetage des banques et de relance 30
4. Une réponse commune tardive et insuffisante, mais qui déploie des instruments successifs de solidarité financière 32
a) Les premières mesures de sauvetage de la Grèce 32
b) La création d’un dispositif provisoire de solidarité financière 33
c) Des dispositifs d’aide très sollicités 35
d) Un dispositif à vocation durable : le Mécanisme européen de solidarité 37
e) Les interventions de la Banque centrale européenne 40
5. Des mesures pour renforcer la convergence budgétaire et la gouvernance économique commune, parmi lesquelles s’inscrit le traité de stabilité budgétaire 42
a) Le renforcement de la législation communautaire sur la discipline budgétaire 42
b) Le « pacte pour l’euro plus » 46
c) Les origines du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance dans l’Union économique et monétaire 47
II – LE TRAITÉ BUDGÉTAIRE RESPECTE LA SOUVERAINETÉ DES ÉTATS ET S’INSCRIT DÉSORMAIS DANS UNE STRATÉGIE D’ENSEMBLE RÉÉQUILIBRÉE 51
A - UN TRAITÉ DONT LA PORTÉE NE DOIT PAS ÊTRE SURESTIMÉE 51
1. Un traité voulu par l’Allemagne et destiné à rassurer les marchés 51
2. Un traité compatible avec le droit communautaire et qui y ajoute peu 52
3. Une référence au déficit « structurel » qui laisse des marges de manœuvre aux politiques budgétaires nationales 52
4. Une prise en compte des spécificités de chacun pour l’application par les États 55
B – LES TROIS PILIERS DU TRAITÉ 55
1. Champ d’application, portée et entrée en vigueur du traité 56
2. Le pacte budgétaire 57
3. La coordination des politiques économiques 63
4. La gouvernance de la zone euro 64
C – AU-DELÀ DU TRAITÉ, LES PRÉMICES D’UN COMPROMIS GLOBAL POUR ROMPRE AVEC DES PLANS UNIQUEMENT CENTRÉS SUR L’AUSTÉRITÉ 65
1. Une approche nouvelle bienvenue, impulsée par le nouvel exécutif français et désormais soutenue par nos partenaires 65
2. Le Conseil européen des 28 et 29 juin 2012 : des mesures nécessaires et cohérentes 68
a) Le soutien à la croissance 68
b) La création d’une taxe sur les transactions financières 69
c) La mise en place d’une supervision bancaire européenne 69
d) Une solidarité financière accrue 69
III – LA MISE EN œUVRE DU TRAITÉ DOIT OUVRIR DE NOUVELLES PERSPECTIVES POUR LA CONSTRUCTION EUROPÉENNE 71
A – LA « RÈGLE D’OR » : LE CHOIX D’UNE LOI ORGANIQUE PROTÈGE LA SOUVERAINETÉ NATIONALE 72
1. La diversité des réponses choisies par nos partenaires européens 72
2. Le projet de loi organique relatif à la programmation et à la gouvernance des finances publiques 77
B – LA MISE EN œUVRE DES DÉCISIONS DU CONSEIL EUROPÉEN DES 28 ET 29 JUIN 2012 82
1. Le pacte de croissance 82
2. La taxe sur les transactions financières 83
3. La supervision bancaire 85
4. L’assouplissement des mécanismes de solidarité financière 87
C – LA NÉCESSITÉ D’UN CONTRÔLE PARLEMENTAIRE ACCRU 87
D – QUELLES PERSPECTIVES POUR LA POURSUITE DE LA CONSTRUCTION EUROPÉENNE ? 91
1. Vers un gouvernement économique européen 91
a) Une gouvernance économique commune « tous azimuts » 91
b) Plus de solidarité pour sortir de la crise des dettes publiques 93
2. Vers une union politique ? 94
a) Pour des institutions européennes dynamiques, dirigées par des personnalités fortes et légitimes 95
b) Pour une plus grande légitimité démocratique, appuyée à la fois sur le Parlement européen et les parlements nationaux 96
CONCLUSION 99
EXAMEN EN COMMISSION 101
ANNEXE : TEXTE DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES 125
ANNEXE : Liste des personnes rencontrées par la rapporteure 127
Mesdames, Messieurs,
Lorsque la crise financière s’est profilée aux États-Unis en 2007, puis y a éclaté en 2008, il paraissait raisonnable d’espérer que l’Europe ne serait touchée que par ricochet, car, prise globalement, son économie ne présentait pas au même degré les caractéristiques qui sont à l’origine de cette crise aux États-Unis : financiarisation, consommation et accès au logement soutenus par un endettement excessif des ménages, donc bulle immobilière et graves difficultés des établissements financiers qui y ont contribué. Dans la zone euro, ce type de dérives n’étaient présentes que dans quelques pays – l’Irlande, l’Espagne –, depuis lors d’ailleurs gravement touchés par la crise, mais les principales économies en étaient exemptes.
Pourtant, dès cette époque, des esprits clairvoyants, comme M. Tommaso Padoa-Schioppa, grand serviteur de l’Europe et ministre de l’économie et des finances de M. Romano Prodi, avaient pressenti que l’Europe pourrait être la principale victime de la crise. Effectivement, la crise née outre-Atlantique des excès des financiers et de l’endettement privé est devenue une crise bancaire aux États-Unis, puis en Europe, avant de devenir une crise de confiance dans la capacité de certains États de la zone euro à rembourser leur dette publique. Cette crise est par nature une crise politique, puisque sa principale manifestation réside dans le rejet de la signature d’États ; et c’est une crise politique qui met en cause la construction européenne, puisque ce qui fait problème, ce n’est pas globalement l’avenir de la monnaie européenne – prise dans son ensemble, la zone euro constitue toujours la première économie du monde et sa solvabilité n’est pas contestée –, mais la capacité des Européens à réagir ensemble, efficacement, et à se montrer solidaires, quoi qu’il arrive, des États les plus en difficulté. Cette crise politique est double : d’une part, une crise de la décision au niveau européen ; d’autre part, une crise de la légitimité démocratique. Cette crise européenne se joue aussi au niveau des États et des peuples : les difficultés économiques et l’insuffisance des réponses européennes favorisent les réactions de rejet de l’Europe. Dans certains cas, on assiste même à la montée de partis extrémistes et xénophobes. La montée de ces phénomènes rend à son tour plus difficile une réponse commune efficace à la crise.
Le problème étant posé en ces termes, la réponse paraît évidente : il nous faut une Europe plus forte, plus réactive et plus solidaire, votre rapporteure en est convaincue. À défaut, les États européens risquent de subir le sort des Dix petits nègres du célèbre roman d’Agatha Christie, selon l’analogie développée à Rome devant votre rapporteure par M. Pier Luigi Bersani, secrétaire national du Parti démocrate : être victimes les uns après les autres de la crise, de même que dans ce roman les personnages isolés sur une île sont successivement assassinés.
La solidarité ne se conçoit pas sans la responsabilité et il est légitime que le renforcement de l’une s’accompagne de celui de l’autre. Le fait est aussi que le traité de Maastricht et le pacte de stabilité et de croissance (qui en a précisé les modalités de mise en œuvre) n’ont guère été respectés durant la dernière décennie, pas seulement du fait de la Grèce ou du Portugal, mais aussi des grands États, dont la France. Le « traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l’Union économique et monétaire », dit TSCG ou traité budgétaire, qu’il vous est demandé ce jour de ratifier, doit sans doute être vu d’abord comme un rappel à l’ordre de l’Allemagne à ses principaux partenaires, à commencer par la France, laquelle, sur les dix années 2002-2011, aura tout de même affiché sept fois un déficit public supérieur au plafond fixé en principe à 3 % du PIB.
Ce traité à vocation principalement « disciplinaire » ne peut pas être considéré comme « sympathique ». Pour autant, son examen montre qu’en lui-même, il n’impose guère de contraintes supplémentaires : en termes d’obligations de discipline budgétaire, il ajoute finalement assez peu au droit communautaire représenté par le pacte de stabilité et de croissance durci par le « Six pack » ; pour sa transposition juridique dans chaque État, sa rédaction laisse une grande liberté – c’est ainsi qu’une révision de la Constitution n’est pas utile en France ; de même, en matière de politique économique et budgétaire, la référence à un objectif de déficit structurel de 0,5 % du PIB au plus laisse en fait des marges de manœuvre significatives. Nous devons être conscients que les engagements pris par le Président de la République et le Gouvernement sur la réduction du déficit public dès 2013 et le retour à l’équilibre en 2017 ne proviennent pas du traité budgétaire – ils vont au-delà de ce qu’il impose. Si ces engagements ont été pris et seront tenus, c’est parce qu’ils correspondent à l’intérêt national – la France doit restaurer son capital de crédibilité économique et budgétaire entamé par dix années d’une gestion erratique et souvent tentée par la facilité – et qu’annoncés par le Président de la République avant les élections, ils font partie du contrat passé avec les Français.
Mais évidemment, le traité budgétaire, qu’il est nécessaire de ratifier pour aller de l’avant, ne saurait suffire. Dès le Conseil européen des 28 et 29 juin derniers, le Président de la République a obtenu que ce traité soit complété par le Pacte pour la croissance et l’emploi et que d’autres dossiers soient accélérés : la taxe européenne sur les flux financiers, la supervision bancaire européenne. Pour que se poursuive l’intégration solidaire de l’Europe, votre rapporteure insiste, en conclusion du présent rapport, sur les points qui lui semblent particulièrement cruciaux pour une relance de la construction européenne :
– la réalisation, enfin, du programme initial de l’union « économique et monétaire », laquelle n’a guère été que « monétaire » jusqu’à présent, en coordonnant enfin les politiques macroéconomiques et en reprenant le processus stoppé d’harmonisation fiscale et sociale ;
– dans un équilibre entre responsabilité et solidarité, la mise en place progressive d’une mutualisation des dettes publiques, au fur et à mesure que les efforts de redressement et le respect des règles communes le permettront ;
– une progression pragmatique vers l’union politique, en cherchant les moyens concrets d’avoir des institutions européennes plus dynamiques, dirigées par des personnalités fortes, et une plus grande légitimité démocratique, appuyée à la fois sur le Parlement européen et les parlements nationaux.
À plus court terme, votre rapporteure souligne enfin l’absolue nécessité d’une implication plus active de notre Assemblée dans les processus de dialogue régulier qui se mettent en place entre les institutions européennes et chaque État membre sur sa politique économique et budgétaire.
I – LA CRISE DE LA ZONE EURO EST UNE CRISE POLITIQUE
Depuis deux ans, la crise financière touche particulièrement la zone euro (même si les difficultés ne sont pas finies ailleurs) en raison d’une défiance généralisée dans la capacité des pays européens à être suffisamment solidaires et à construire des institutions communes aptes à surmonter ce genre de crise. Cependant, cette crise ne remet pas en cause le principe de l’union monétaire telle qu’elle a été conçue il y a deux décennies. Bien au contraire, elle résulte de la non-réalisation du programme prévu à l’origine de l’euro en matière de coordination économique, de résorption des déséquilibres internes et d’harmonisation sociale et fiscale.
A – L’engagement initial : construire une union économique et pas seulement monétaire
On a perdu de vue les objectifs du traité de Maastricht : il s’agissait de construire l’« Union économique et monétaire », décidée au Conseil européen de Madrid en juin 1989 sur la base du rapport du comité présidé par M. Jacques Delors. Cette construction devait comprendre la monnaie unique, qui en était sans doute l’élément le plus visible, mais ne se limitait pas à cela. Le traité sur l’Union européenne, conclu au Conseil européen de Maastricht en décembre 1991, a institué une monnaie unique, mais aussi posé les bases d’une union économique.
1. Le traité de Maastricht : les fondements de l’Union économique et monétaire
a) Les objectifs de l’Union économique et monétaire
L’article B du traité de Maastricht a fixé les objectifs que se donnait l’Union européenne. Le premier était la promotion d’un « progrès économique et social équilibré et durable, notamment par la création d’un espace sans frontières intérieures, par le renforcement de la cohésion économique et sociale et par l’établissement d’une union économique et monétaire comportant, à terme, une monnaie unique ». Venaient ensuite l’affirmation d’une identité européenne sur la scène internationale, l’instauration d’une citoyenneté européenne et la coopération dans le domaine de la justice et des affaires intérieures.
La monnaie unique devait donc aller avec l’union économique, elle-même indissociable des objectifs de progrès économique, mais aussi social, équilibré et durable, et de cohésion.
Dans le champ économique, l’article 2 du traité instituant la Communauté économique européenne, tel que rédigé par le traité de Maastricht, précisait : « La Communauté (1) a pour mission, par l’établissement d’un marché commun, d’une union économique et monétaire et par la mise en œuvre des politiques ou des actions communes visées aux articles 3 et 3 A [lesquels définissaient les compétences communautaires dans le champ économique et social et posaient les principes de la coordination des politiques économiques et de la monnaie unique], de promouvoir un développement harmonieux et équilibré des activités économiques dans l’ensemble de la Communauté, une croissance durable et non inflationniste respectant l’environnement, un haut degré de convergence des performances économiques, un niveau d’emploi et de protection sociale élevé, le relèvement du niveau et de la qualité de vie, la cohésion économique et sociale et la solidarité entre les États membres ».
Parmi les objectifs que se sont donnés les Européens avec l’établissement de l’Union économique européenne figuraient donc la croissance non inflationniste, mais aussi le respect de l’environnement, un niveau élevé d’emploi et de protection sociale, la qualité de la vie, la cohésion et la solidarité.
Le traité de Maastricht a défini les conditions de mise en place et de fonctionnement de l’union monétaire. Une clause d’exemption – les autorisant à ne pas se joindre à la monnaie unique quand elle serait établie – a été accordée à la Grande-Bretagne et au Danemark, afin qu’ils puissent signer le traité.
Les signataires acceptaient le pacte initial conclu : la monnaie unique serait gérée par une banque centrale européenne indépendante des États. Des critères stricts d’accès à la monnaie unique et de gestion de celle-ci ont été posés par le traité :
– l’obligation, pour les États désireux d’adhérer à la monnaie unique, d’exciper d’un taux d’inflation n’excédant pas de plus de 1,5 % le taux moyen des trois pays membres ayant les plus faibles taux et de taux d’intérêt à long terme n’excédant pas de plus de 2 % ceux des trois pays membres ayant les plus faibles taux ;
– l’obligation de respecter, également pour accéder à la monnaie unique, mais aussi de manière pérenne ensuite, les deux plafonds de 3 % du PIB pour le déficit public annuel et de 60 % pour la dette publique ;
– la mise en place, en conséquence, d’un système de surveillance du respect de cet engagement, la procédure de « déficits publics excessifs » (article 104 C du traité instituant la communauté européenne – TCE –, devenu l’article 126 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne – TFUE – suite au traité de Lisbonne), dans laquelle la Commission est chargée de surveiller l’évolution de la situation budgétaire et de la dette des États membres au nom de la « discipline budgétaire ». Il était ensuite prévu que le Conseil (des ministres), statuant à la majorité qualifiée sur recommandation de la Commission, puisse décider qu’il y a ou non « déficit excessif », ouvrant la voie à une procédure de correction de plus en plus impérative : d’abord des « recommandations » non publiques à l’État membre en cause ; puis une éventuelle publicité donnée à celles-ci ; puis une éventuelle mise en demeure de prendre des mesures de réduction des déficits et d’en rendre compte par des rapports périodiques ; enfin diverses sanctions pouvant aller jusqu’à l’obligation pour l’État membre en cause d’opérer un dépôt, voire de verser une amende ;
– l’indépendance de la Banque centrale européenne (BCE) et des banques centrales, avec l’interdiction pour leurs organes de décision (et leurs membres) de solliciter ou de recevoir des instructions provenant soit des institutions communautaires, soit des gouvernements nationaux (article 107 du TCE, devenu l’article 130 du TFUE) ;
– l’affichage de la stabilité des prix comme « objectif principal » du système européen des banques centrales, qui doit cependant, sans préjudice de cet objectif, « apporter son soutien aux politiques économiques générales » dans l’Union (article 105 du TCE, devenu l’article 127 du TFUE) – à ce titre, on peut considérer que si les gouvernements s’étaient donné la peine de déterminer une politique économique commune, comme le traité les y incitait mais comme ils ne l’ont pas fait (voir infra), du moins jusqu’à présent, la BCE aurait dû tenir compte des orientations de cette politique ;
– l’interdiction pour la BCE et les banques centrales nationales d’accorder des découverts ou crédits aux autorités, organismes ou entreprises publics, interdiction également valable pour « l’acquisition directe, auprès d’eux », des instruments de leur dette (article 104 du TCE, devenu l’article 123 du TFUE) ;
– l’interdiction pour l’Union européenne de répondre d’engagements d’autorités, organismes ou entreprises publics des États membres ou de les prendre en charge (article 104 B du TCE, devenu l’article 125 du TFUE).
c) Les jalons de la coordination des politiques économiques et de l’harmonisation des règles sociales
Le traité de Maastricht a aussi posé les jalons d’une coordination des politiques économiques, développant les principes très généraux qui figuraient déjà dans le traité de Rome – l’article 103 de ce dernier stipulait que « les États membres considèrent leur politique de conjoncture comme une question d’intérêt commun » sur laquelle il convient de se consulter, tandis que l’article 105 affirmait, mais sans véritables modalités de mise en œuvre, que « les États membres coordonnent leurs politiques économiques ».
Avec le traité de Maastricht, les Européens ont voulu donner une forme à cette coordination, en instituant une procédure concernant les politiques économiques. C’est pourquoi, après avoir posé que « les États membres conduisent leurs politiques économiques en vue de contribuer à la réalisation des objectifs de la Communauté » (article 102 A du TCE, devenu l’article 120 du TFUE), ils ont stipulé que « les États membres considèrent leurs politiques économiques comme une question d’intérêt commun et les coordonnent au sein du Conseil » et déterminé les modalités de cette coordination, comprenant l’élaboration par le Conseil (des ministres), sur recommandation de la Commission, d’un « projet pour les grandes orientations des politiques économiques des États membres et de la Communauté », puis l’adoption par le Conseil européen d’une « recommandation fixant ces grandes orientations », enfin un dispositif de « surveillance multilatérale ». À ce titre, il appartient donc au Conseil de « surveiller l’évolution économique dans chacun des États membres et dans la Communauté, ainsi que la conformité des politiques économiques avec les grandes orientations » (précitées), sur la base de rapports de la Commission et d’informations transmises par les États, et le cas échéant d’émettre des « recommandations », « lorsqu’il est constaté (…) que les politiques économiques d’un État membre ne sont pas conformes aux grandes orientations [précitées] ou qu’elles risquent de compromettre le bon fonctionnement de l’Union économique et monétaire » (article 103 du TCE, devenu l’article 121 du TFUE).
Comme on le voit, ce dispositif, qui figure toujours dans le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, a été partiellement conçu sur le même modèle que la procédure des déficits publics excessifs, avec là aussi un mécanisme de surveillance en principe assez contraignant, la principale différence entre les deux procédures tenant aux rôles respectifs des institutions européennes dans leur mise en œuvre : la Commission a un rôle moteur, quoique non décisif, pour ce qui est des déficits excessifs, tandis que la coordination des politiques économiques est essentiellement du ressort des instances intergouvernementales, Conseil européen et Conseil.
Par ailleurs, le traité de Maastricht a aussi donné un contenu potentiel au rapprochement des politiques économiques, en continuant l’élargissement des compétences communautaires potentielles à de nouveaux domaines, dans la continuité de l’« acte unique » européen de 1986 : environnement, politique industrielle, recherche, développement de réseaux transeuropéens, etc. Dans le « livre blanc » La croissance, la compétitivité et l’emploi : les défis et les pistes pour entrer dans le XXIème siècle qu’il déposa en décembre 1993 au nom de la Commission européenne, M. Jacques Delors proposa de donner un contenu concret et ambitieux à ce qui aurait pu être une véritable politique économique commune si ses préconisations avaient été mises en œuvre. En effet, ce livre blanc comprenait un certain nombre d’orientations générales, notamment sur le renforcement des moyens consacrés à la recherche et à la formation, mais aussi et surtout des propositions chiffrées d’investissements communs, en particulier dans les grands réseaux (transports, énergie, communications, eau) : il était suggéré que vingt milliards d’euros y soient consacrés annuellement sur le budget communautaire, dont le tiers environ aurait été dégagés par l’émission d’obligations communautaires. Si le livre blanc avait été mis en œuvre, des eurobonds seraient émis depuis vingt ans !
Enfin, tandis qu’était adoptée en 1989 par les chefs d’État et de gouvernement (à l’exception du Royaume-Uni) la « Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs », l’acte unique, puis l’« accord sur la politique sociale » (annexé mais non intégré au traité de Maastricht lui-même compte tenu du veto britannique), prenaient également en compte la dimension nécessaire de progrès social et de lutte contre le « dumping social » entre États membres : ainsi est-il prévu d’aller vers une harmonisation européenne a minima dans des domaines tels que les conditions de travail, la santé et la sécurité des travailleurs, leurs instances consultatives, l’égalité professionnelle des hommes et des femmes, etc. – ce qui conduira, malgré l’opposition acharnée de certains, à l’adoption de nombreuses directives, par exemple sur le temps de travail ou la sécurité au travail ; le principe d’un niveau de protection sociale élevé est posé ; le rôle des partenaires sociaux européens dans l’élaboration des normes les concernant est reconnu et valorisé ; l’éducation et la formation professionnelle entrent dans les politiques communautaires… Grâce à l’action résolue de M. Lionel Jospin, devenu Premier ministre en 1997, et à la levée de l’opposition britannique avec l’arrivée au pouvoir de M. Tony Blair, ces dispositions sociales pourront finalement être intégrées, à l’occasion du traité d’Amsterdam, dans le traité CE lui-même.
2. Le pacte de stabilité et de croissance : le mode d’emploi de la discipline budgétaire
L’expression « pacte de stabilité et de croissance » s’applique en fait à l’ensemble formé par trois textes : une résolution du Conseil européen en date du 17 juin 1997 et deux règlements du Conseil (2) du 7 juillet 1997. Il ne s’agit donc pas de modifications des traités européens, l’objet étant seulement de préciser le modus operandi de la surveillance budgétaire et de la procédure de déficits excessifs inscrites dans le traité de Maastricht.
D’après les règlements précités, chaque État de la zone euro (ou désirant y entrer) doit se doter d’un « objectif à moyen terme d’une position budgétaire proche de l’équilibre ou excédentaire » (OMT). Un « programme de stabilité » actualisé chaque année présente cet OMT et la « trajectoire d’ajustement » y conduisant. Il est également à noter que ce programme de stabilité doit en principe « favoriser une coordination plus étroite des politiques économiques », la surveillance portant aussi sur la conformité des politiques économiques nationales aux « grandes orientations » communautaires ; l’objectif de coordination économique et de croissance reste donc présent, au moins dans les textes. Un système d’alerte doit permettre au Conseil des ministres de l’économie et des finances (Écofin) d’adresser une recommandation à un État en cas de dérapage budgétaire.
S’agissant de la procédure de déficits excessifs, elle est censée être déclenchée dès que le plafond des 3 % du PIB est dépassé, sauf circonstances exceptionnelles, lesquelles ont été définies rigoureusement en 1997 (il fallait par exemple exciper d’une récession d’au moins 2 points de PIB). Des sanctions sévères sont prévues, avec la possibilité d’imposer à l’État pénalisé un dépôt non rémunéré représentant entre 0,2 % et 0,5 % de son PIB, dépôt susceptible d’être transformé en amende définitive en l’absence de mesure corrective pendant deux ans.
B – Les années 2000 : les dérives de l’Union économique et monétaire
Au 1er janvier 1999, les taux de conversion des monnaies des onze premiers membres de la zone euro – Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas et Portugal – ont été figés irrévocablement, l’euro devenant leur monnaie légale, avant de devenir également leur monnaie fiduciaire et divisionnaire au 1er janvier 2002. Les entrées successives de la Grèce (2001), de la Slovénie (2007), de Chypre et de Malte (2008), de la Slovaquie (2009) et de l’Estonie (2011) ont depuis lors étendu la zone euro à dix-sept pays. Cependant, cet élargissement progressif ne s’est pas accompagné de l’approfondissement de l’Union économique et monétaire que l’on pouvait attendre en application du traité de Maastricht. Or cet approfondissement aurait été nécessaire, non pas pour que survive la monnaie unique – l’euro, monnaie forte, monnaie de référence, n’est pas aujourd’hui menacé dans son existence –, mais pour qu’elle contribue pleinement à un développement économique et social équilibré au bénéfice de chacun des peuples qui l’ont adoptée.
Lors du Conseil européen tenu à Lisbonne les 23 et 24 mars 2000, les dirigeants européens, conscients notamment du retard relatif du continent dans le développement des « nouvelles technologies », ont acté ce qu’il est convenu d’appeler la « stratégie de Lisbonne », en donnant à l’Union un objectif stratégique ambitieux : « devenir l’économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde, capable d’une croissance économique durable accompagnée d’une amélioration quantitative et qualitative de l’emploi et d’une plus grande cohésion sociale ». Cet objectif était décliné en plusieurs volets : l’un centré sur la compétitivité et l’innovation ; un autre sur le fait de « moderniser le modèle social européen en investissant dans les ressources humaines et en luttant contre l’exclusion sociale » ; le dernier sur l’usage judicieux des politiques macroéconomiques. Lors du Conseil européen de Göteborg en 2001, un volet consacré à l’environnement a en outre été ajouté.
Pour conduire la « stratégie de Lisbonne », il a été décidé de recourir à la « méthode ouverte de coordination » (MOC), afin de surmonter les blocages juridiques (les limites posées par les traités) ou politiques au processus précédemment engagé d’harmonisation des règles et de rapprochement des politiques. La MOC est présentée dans les documents européens comme un processus volontaire de coopération politique fondé sur l’établissement d’objectifs et d’indicateurs communs : chaque État conduit librement les réformes qu’il décide, mais le rapprochement des expériences, grâce à l’« examen par les pairs », est supposé favoriser la diffusion des « bonnes pratiques » et donc la convergence des politiques. Pour mettre en œuvre la MOC, il était donc simplement demandé aux États d’élaborer des plans d’action traduisant à leur niveau les objectifs communs et de les soumettre à l’évaluation de la Commission et du Conseil, dans le cadre de rapports conjoints analysant les résultats obtenus.
b) La dérive libérale des politiques européennes
Très vite, les résultats de ce processus non contraignant se sont révélés décevants, comme l’a constaté en 2004 le groupe d’analyse dirigé par M. Wim Kok. Suite à ce rapport, il fut décidé de recentrer la stratégie de Lisbonne sur l’emploi et la croissance, qui devaient être favorisés par des « réformes structurelles ». Cela signifiait l’abandon des ambitions sociales et environnementales et n’a pour autant pas donné de résultats très significatifs sur les objectifs plus restreints qui avaient été conservés, tandis que le processus plus contraignant d’élaboration de normes minimales communes était fortement ralenti.
Dès lors, avec des instruments de gestion macroéconomique disparus (la dévaluation…) ou restreints dans leur usage (par la discipline budgétaire commune) et en l’absence de normes minimales communes, nombre d’États ont été tentés par des réformes dites « structurelles » réduisant les droits sociaux et par la concurrence fiscale et sociale, qui apparaissait comme un des moyens qui restaient de prendre un avantage comparatif sur les partenaires européens – un pays comme l’Irlande est allé loin dans cette voie.
Cette analyse a été faite par M. Jean-Paul Fitoussi dès 2005, dans La politique de l’impuissance : « Les instruments traditionnels de la gestion macro-économique sont soit inexistants soit empêchés. De ce fait, les ajustements des économies nationales ne peuvent se faire que par des variations de prix et de coûts relatifs. D’où l’insistance des autorités monétaires et de la Commission sur la suppression des obstacles à la concurrence et les nécessaires réformes structurelles au risque de voir les inégalités se creuser davantage, les services publics et la protection sociale se réduire comme peau de chagrin (…). La logique actuelle de la constitution économique de l’Europe crée ainsi une dynamique "objective" d’évolution vers une économie de plus en plus libérale, portée par des institutions qui ne peuvent choisir une autre direction. Leur seul pouvoir est celui d’accroître l’intensité de la concurrence dans le marché unique, non de la réduire (…). Moins-disant social et moins-disant fiscal. C’est la dynamique où se joue l’avenir de l’Union européenne car c’est la seule dynamique que peuvent contrôler les gouvernements nationaux. Pourtant, rien n’est moins assuré que le bénéfice supposé de la concurrence fiscale et sociale. En réduisant les recettes des États, elle amoindrit leur capacité à fournir les biens publics essentiels pour la croissance et le développement : santé, éducation, recherche, infrastructures, cohésion nationale… À terme, elle est donc une stratégie perdante qui réduit le potentiel de croissance des nations ». |
2. Des règles communes régulièrement bafouées depuis l’avènement de l’euro
Dès lors que l’euro fut définitivement en place, les États membres de la zone euro, du moins certains, prirent l’habitude de s’affranchir de leurs engagements de discipline budgétaire.
Ce comportement marquait une rupture avec la période précédente, celle de la sélection des membres de la zone euro et du déploiement de la monnaie unique, ou tous s’étaient efforcés de respecter les règles communes et où certains avaient fait des efforts budgétaires considérables, notamment la Belgique et l’Italie, qualifiées pour l’euro malgré un endettement historiquement très élevé et supérieur au plafond des 60 % du PIB : de 1995 à 2001, le taux de dette publique brute de la première est passé de 130 % à 106 % du PIB, celui de la seconde de 121 % à 108 % !
Les choses ont ensuite changé. Le tableau ci-après relatif aux soldes publics, au sens européen, des États membres est à cet égard assez significatif : par rapport au plafond de 3 % du PIB et pour la décennie 2002-2011, sur 137 données pertinentes – correspondant aux niveaux de solde annuel de chacun des membres de la zone euro –, on relève 71 dépassements de ce seuil. En d’autres termes, en moyenne, plus d’une fois sur deux, selon les États et les millésimes, le plafond de 3 % a été dépassé. En analysant ces dépassements, on constate que 26 d’entre eux correspondent aux années 2002 à 2007 (et donc 45 aux années 2008 à 2011) : avant même la crise financière, on avait donc à peu près, une année « moyenne » un membre de la zone euro sur trois en situation potentielle de déficit excessif, certains, comme la Grèce et le Portugal, l’étant systématiquement.
Les grands États, Allemagne, France et Italie, on peut le voir sur le tableau, ne se sont pas toujours non plus caractérisés par un comportement exemplaire. On se rappelle que dès l’automne 2003, le chancelier Gerhard Schröder et le président Jacques Chirac, confrontés aux déficits respectifs des deux pays, s’étaient entendus pour obtenir de la Commission ce que le premier avait alors appelé une « interprétation souple et flexible » du pacte de stabilité et de croissance. À la différence de la coordination des politiques économiques, censée relever essentiellement du Conseil, donc des gouvernements, l’initiative de la procédure de déficits excessifs appartient en effet à la Commission, laquelle, en gardienne des traités, s’est efforcée d’appliquer les règles communes, mais a dû aussi composer avec les États membres.
Capacité (+) ou besoin (-) de financement des administrations publiques au sens de la procédure des déficits publics excessifs, rapportée au PIB (3)
(en %)
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 | |
Zone euro (17 pays) |
- 2,6 |
- 3,1 |
- 2,9 |
- 2,5 |
-1,3 |
- 0,7 |
- 2,1 |
- 6,4 |
- 6,2 |
- 4,1 |
Allemagne |
- 3,8 |
- 4,2 |
- 3,8 |
- 3,3 |
-1,6 |
0,2 |
- 0,1 |
- 3,2 |
- 4,3 |
- 1 |
Autriche |
- 0,7 |
- 1,5 |
- 4,4 |
- 1,7 |
- 1,5 |
- 0,9 |
- 0,9 |
- 4,1 |
- 4,5 |
- 2,6 |
Belgique |
- 0,1 |
-0,1 |
- 0,1 |
- 2,5 |
0,4 |
- 0,1 |
- 1 |
- 5,6 |
- 3,8 |
- 3,7 |
Espagne |
- 0,2 |
- 0,3 |
- 0,1 |
1,3 |
2,4 |
1,9 |
- 4,5 |
- 11,2 |
- 9,3 |
- 8,5 |
Finlande |
4,1 |
2,6 |
2,5 |
2,8 |
4,1 |
5,3 |
4,3 |
- 2,5 |
- 2,5 |
- 0,5 |
France |
- 3,1 |
- 4,1 |
- 3,6 |
- 2,9 |
- 2,3 |
- 2,7 |
- 3,3 |
- 7,5 |
- 7,1 |
- 5,2 |
Grèce |
- 4,8 |
- 5,6 |
- 7,5 |
- 5,2 |
- 5,7 |
- 6,5 |
- 9,8 |
- 15,6 |
- 10,3 |
- 9,1 |
Irlande |
- 0,4 |
0,4 |
1,4 |
1,7 |
2,9 |
0,1 |
- 7,3 |
- 14 |
- 31,2 |
- 13,1 |
Italie |
- 3,1 |
- 3,6 |
- 3,5 |
- 4,4 |
- 3,4 |
- 1,6 |
- 2,7 |
- 5,4 |
- 4,6 |
- 3,9 |
Luxembourg |
2,1 |
0,5 |
- 1,1 |
- |
1,4 |
3,7 |
3 |
- 0,8 |
- 0,9 |
- 0,6 |
Pays-Bas |
- 2,1 |
- 3,1 |
- 1,7 |
- 0,3 |
0,5 |
0,2 |
0,5 |
- 5,6 |
- 5,1 |
- 4,7 |
Portugal |
- 3,4 |
- 3,7 |
- 4 |
- 6,5 |
- 4,6 |
- 3,1 |
- 3,6 |
- 10,2 |
- 9,8 |
- 4,2 |
Slovénie |
- 2,4 |
- 2,7 |
- 2,3 |
- 1,5 |
- 1,4 |
- |
- 1,9 |
- 6,1 |
- 6 |
- 6,4 |
Chypre |
- 4,4 |
- 6,6 |
- 4,1 |
- 2,4 |
- 1,2 |
3,5 |
0,9 |
- 6,1 |
- 5,3 |
- 6,3 |
Malte |
- 5,8 |
- 9,2 |
- 4,7 |
- 2,9 |
- 2,8 |
- 2,4 |
- 4,6 |
- 3,8 |
- 3,7 |
- 2,7 |
Slovaquie |
- 8,2 |
- 2,8 |
- 2,4 |
- 2,8 |
- 3,2 |
- 1,8 |
- 2,1 |
- 8 |
- 7,7 |
- 4,8 |
Estonie |
0,3 |
1,7 |
1,6 |
1,6 |
2,5 |
2,4 |
- 2,9 |
- 2 |
0,2 |
1 |
Source : Eurostat.
Les États membres ont finalement décidé, lors du Conseil européen des 22-23 mars 2005, de réviser le pacte de stabilité et de croissance, que beaucoup s’accordaient à juger trop rigide. Comme les controverses s’éternisaient, le président de la Commission, M. Romano Prodi, avait même qualifié le pacte de stabilité de « stupide » et le commissaire Antonio Vittorino avait eu cette boutade : « il semble que le pacte de stupidité doive rester stable ».
Les aménagements apportés en 2005 visaient donc à remédier aux défauts du pacte, dont l’application stricte dans sa version initiale aurait été absurde. C’est ainsi que pour être exempté de ses obligations, il fut décidé qu’un État membre n’aurait plus à exciper d’une récession de 2 %, mais d’une simple récession, voire d’une période prolongée de très faible croissance. En outre, la procédure de déficits excessifs ne serait plus engagée et poursuivie qu’après examen de divers « facteurs pertinents » susceptibles d’excuser un dépassement du plafond de 3 % de déficit, tels que des investissements publics exceptionnels, les « efforts budgétaires visant à accroître ou à maintenir à un niveau élevé les contributions financières destinées à encourager la solidarité internationale et à réaliser des objectifs de la politique européenne, notamment l’unification de l’Europe », ou encore l’éventuelle mise en œuvre de réformes structurelles, en particulier d’une réforme des retraites comprenant un étage obligatoire de capitalisation… La réforme de 2005 fut aussi l’occasion de préciser certains points : c’est là qu’il fut décidé que l’objectif budgétaire à moyen terme de chaque État de la zone euro devrait se situer, « en données corrigées des variations conjoncturelles et déduction faite des mesures ponctuelles et temporaires », entre un déficit de 1 % du PIB et l’équilibre ou l’excédent, et que les trajectoires d’ajustement y conduisant devraient prévoir une amélioration annuelle du solde budgétaire public d’au moins 0,5 point de PIB.
La révision du pacte de stabilité et de croissance était donc nécessaire. Mais elle a pu aussi servir à couvrir les facilités que certains États s’accordaient. Les prises de liberté par rapport à la discipline budgétaire pouvaient, dans certains cas, être justifiées par de réelles difficultés. Il a pu en être ainsi s’agissant de l’Allemagne, confrontée aux coûts durables de la réunification et à un problème de compétitivité, qu’elle a surmonté par des réformes sans doute très dures, mais qui du moins ont atteint leurs objectifs. Pour d’autres, comme l’Italie et la France, les justifications sont moins évidentes. Et par ailleurs, dès lors que les grands États se donnaient en quelque sorte l’absolution mutuelle, ils se sont abstenus de se pencher sur la situation d’autres membres de la zone euro dont les finances publiques déjà obérées auraient pourtant mérité un redressement précoce, en particulier la Grèce. À cet égard, on doit rappeler que la France et l’Allemagne furent d’accord, en 2005, pour bloquer la tentative de donner à Eurostat des pouvoirs d’investigation qui lui auraient permis de conduire des enquêtes sur place pour vérifier la crédibilité des statistiques transmises par les États membres ; de telles prérogatives auraient pourtant pu être utiles en Grèce…
Ces facilités par rapport à la discipline commune ont aussi conduit à une augmentation significative, avant même l’éclatement de la crise financière, de certaines des dettes souveraines européennes. Le tableau ci-après, relatif à l’endettement public rapporté au PIB, montre bien le nombre croissant de membres de la zone euro qui se sont trouvés passer le plafond fixé à 60 % du PIB.
Dette publique brute des pays de la zone euro, rapportée au PIB
(en %)
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 | |
Zone euro (17 pays) |
68 |
69,2 |
69,6 |
70,2 |
68,6 |
66,3 |
70,1 |
79,9 |
85,3 |
87,2 |
Allemagne |
60,7 |
64,4 |
66,3 |
68,6 |
68,1 |
65,2 |
66,7 |
74,4 |
83 |
81,2 |
Autriche |
66,2 |
65,3 |
64,7 |
64,2 |
62,3 |
60,2 |
63,8 |
69,5 |
71,9 |
72,2 |
Belgique |
103,4 |
98,4 |
94 |
92 |
88 |
84,1 |
89,3 |
95,8 |
96 |
98 |
Espagne |
52,6 |
48,8 |
46,3 |
43,2 |
39,7 |
36,3 |
40,2 |
53,9 |
61,2 |
68,5 |
Finlande |
41,5 |
44,5 |
44,4 |
41,7 |
39,6 |
35,2 |
33,9 |
43,5 |
48,4 |
48,6 |
France |
58,8 |
62,9 |
64,9 |
66,4 |
63,7 |
64,2 |
68,2 |
79,2 |
82,3 |
85,8 |
Grèce |
101,7 |
97,4 |
98,6 |
100 |
106,1 |
107,4 |
113 |
129,4 |
145 |
165,3 |
Irlande |
31,9 |
30,7 |
29,4 |
27,2 |
24,5 |
24,8 |
44,2 |
65,1 |
92,5 |
108,2 |
Italie |
105,1 |
103,9 |
103,4 |
105,4 |
106,1 |
103,1 |
105,7 |
116 |
118,6 |
120,1 |
Luxembourg |
6,3 |
6,1 |
6,3 |
6,1 |
6,7 |
6,7 |
13,7 |
14,8 |
19,1 |
18,2 |
Pays-Bas |
50,5 |
52 |
52,4 |
51,8 |
47,4 |
45,3 |
58,5 |
60,8 |
62,9 |
65,2 |
Portugal |
56,6 |
59,2 |
61,9 |
67,7 |
69,3 |
68,3 |
71,6 |
83,1 |
93,3 |
107,8 |
Slovénie |
27,8 |
27,2 |
27,3 |
26,7 |
26,4 |
23,1 |
21,9 |
35,3 |
38,8 |
47,6 |
Chypre |
65,1 |
69,7 |
70,9 |
69,4 |
64,7 |
58,8 |
48,9 |
58,5 |
61,5 |
71,6 |
Malte |
59,1 |
67,6 |
71,7 |
69,7 |
64,4 |
62,3 |
62,3 |
68,1 |
69,4 |
72 |
Slovaquie |
43,4 |
42,4 |
41,5 |
34,2 |
30,5 |
29,6 |
27,9 |
35,6 |
41,1 |
43,3 |
Estonie |
5,7 |
5,6 |
5 |
4,6 |
4,4 |
3,7 |
4,5 |
7,2 |
6,7 |
6 |
Source : Eurostat.
À cet égard, la gestion de notre pays apparaît particulièrement décevante depuis 2002, comme on peut le voir sur la graphique ci-après.
Évolution du ratio dette publique/PIB dans les principales économies de la zone euro, par rapport à une base 100 en 2002
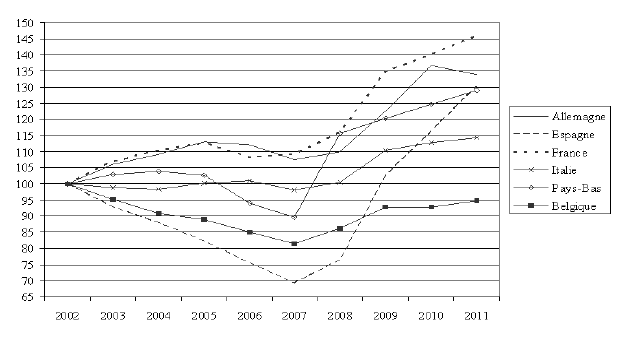
Source: élaboré à partir des données d’Eurostat.
Ce graphique propose de mesurer l’évolution du ratio de la dette publique rapportée au PIB, bon indicateur du caractère soutenable à terme d’une politique budgétaire, dans les principales économies de la zone euro en partant d’une base 100 en 2002. On voit qu’en France, ce ratio, passant de moins de 59 % à plus de 85 % de 2002 à 2011, a augmenté de plus de 45 % sur la période, tandis que l’évolution était plus mesurée – de l’ordre de 30 % ou moindre encore – chez nos principaux partenaires de la zone euro, soit qu’ils aient moins recouru au déficit et à l’endettement pour gérer la crise depuis 2008 – cas de l’Allemagne –, soit qu’ils aient mis à profit les années 2002-2007 pour réduire le poids de leur endettement – comme l’ont fait l’Espagne, la Belgique et les Pays-Bas.
Ce comportement de la France tranche avec la période précédente : de 1997 à 2001, notre déficit public global (au sens européen) avait constamment été réduit, passant de 3 % du PIB en 1997 à 1,4 % en 2001, et le taux d’endettement public, toujours inférieur au seuil des 60 % du PIB, avait été ramené de 59,2 % à 56,9 %. Le gouvernement de M. Lionel Jospin avait su concilier politique de croissance et stabilité budgétaire.
Pour conclure sur ces années qui ont précédé la crise – et anticiper sur les racines de celles-ci, on ne peut que se référer au résumé très éclairant qu’en fait le « père » de l’Union économique et monétaire :
M. Jacques Delors, en avril 2012 (4) : « Mon avertissement essentiel, vous le connaissez : il faut un pilier économique et un pilier monétaire dans l’Union économique et monétaire. Il n’y avait qu’un pilier monétaire et l’économique n’existait pas (…). Nous avons été pris à la fois dans la crise internationale et par l’absence d’équilibre entre la coordination des politiques économiques et la coordination des politiques monétaires. S’il y avait eu coordination des politiques économiques, si les ministres des finances avaient voulu se parler franchement, cela aurait pu fonctionner. Mais à ma connaissance, cela n’a jamais été le cas, ils se ménageaient entre eux et cherchaient ailleurs les causes des difficultés. Ce qui explique pourquoi on a voulu monter au plus haut niveau, celui des chefs d’État et de gouvernement européens. Mais si les ministres des finances avaient voulu se rendre compte de la situation, ils auraient vu que l’Irlande faisait des folies avec ses banques, que l’Espagne en faisait autant avec le crédit immobilier, que la Grèce nous cachait ses véritables statistiques. Mais ils n’ont rien vu. Ce qui fait que j’ai toujours considéré, dès le début de la crise, que l’Eurogroupe était moralement et politiquement responsable de la crise et qu’il aurait dû agir dès 2008 pour réparer ses erreurs ». |
C – Une crise de la zone euro révélatrice des insuffisances de la construction européenne
Nous assistons depuis 2010, non pas à une crise de l’euro, non plus qu’à une crise de la dette publique européenne, mais bien à une crise de la zone euro.
En effet, l’euro lui-même reste une monnaie de référence – la deuxième monnaie de réserve au monde – et sa dépréciation par rapport aux autres grandes monnaies reste mesurée, d’autant que de nombreux économistes considèrent que l’euro était antérieurement surévalué.
Quant au niveau de la dette publique, il n’est pas nécessairement plus élevé dans la zone euro en général, et dans certains des pays les plus frappés par la crise en particulier, que dans les autres économies développées : sans même évoquer les cas du Japon, dont la dette publique a une structure très spécifique, ou des États-Unis, qui restent la première puissance mondiale, on peut observer que le taux d’endettement public du Royaume-Uni, soit près de 86 % du PIB fin 2011, est très proche de celui de l’ensemble de la zone euro à la même date, soit 87 %. Quant au déficit public annuel britannique, il a dépassé 10 % du PIB en 2009 et 2010 et 8 % en 2011, contre respectivement un peu plus de 6 % et de 4 % pour la zone euro dans son ensemble. Pourtant, le trésor britannique n’a aucune difficulté à emprunter sur les marchés financiers à des taux presque aussi faibles (moins de 2 % sur les emprunts à dix ans en septembre 2012) que son homologue allemand. Dans l’autre sens, la dette publique de l’Espagne, durement touchée par la crise, la défiance des investisseurs et la hausse des taux qui lui sont appliqués, ne représentait pourtant que 36 % de son PIB avant la crise financière (2007) et 68 % fin 2011…
En réalité, c’est bien une crise politique que nous vivons : après que la diffusion de la crise financière américaine et surtout de la défiance toute nouvelle des investisseurs par rapport à certaines fragilités structurelles a lourdement déstabilisé plusieurs des pays de la zone euro, les réponses communes apportées n’ont pas été assez fortes, unies et rapides pour convaincre ces investisseurs de la solidarité et donc de la pérennité de la zone.
Dans un article prémonitoire rédigé avant que la crise de défiance ne touche successivement les pays de la zone euro et publié en 2010, M. Tommaso Padoa-Schioppa (5), malheureusement décédé depuis lors, expliquait pourquoi, à son avis, l’Europe serait victime de la crise, alors même que son économie ne présentait pas, du moins au même point, les dérives qui ont été à l’origine de la crise financière qui a éclaté aux États-Unis :
M. Tommaso Padoa-Schioppa, en 2010 (6) : « Pourtant [bien qu’elle soit moins concernée que d’autres parties du monde par de grands déséquilibres macroéconomiques et un modèle de croissance fondé sur la consommation et la dette], l’Europe risque d’être la principale victime de la crise ! Car elle n’existe pas en tant qu’acteur capable de la gérer. Elle est, en partie, une Union déjà faite, mais en partie aussi, une Union qui reste à faire. Dans cet état intermédiaire, elle parvient à résister aux conditions normales, mais elle survit difficilement en situation de crise ». |
1. Une crise qui a pris naissance aux États-Unis et s’est propagée en Europe par les banques
Les origines de la crise financière ne doivent pas être oubliées, car elles sont sans rapport avec l’Europe, non plus qu’avec les dettes publiques.
Techniquement, la crise est apparue aux États-Unis lorsque les investisseurs ont commencé à mettre en doute la solidité des institutions financières dont l’activité reposait à l’excès sur la distribution de prêts immobiliers hypothécaires ou sur le montage de « produits dérivés » à partir des actifs que constituaient les créances hypothécaires ; on a donc eu une bulle immobilière entretenue par des pratiques de crédit irresponsables et qui a finalement explosé. Mais avec la diffusion dans toute la sphère financière des produits dérivés à partir de ces actifs « toxiques » qu’étaient devenus les crédits hypothécaires, la défiance a rapidement concerné l’ensemble des acteurs financiers et la crise s’est donc, du fait des nouvelles techniques financières, propagée très rapidement à l’ensemble des banques américaines, puis européennes. C’est par la mise en cause de la solidité des banques et l’assèchement du crédit interbancaire consécutif que la crise est arrivée en Europe dès septembre 2008, au lendemain de la faillite de Lehman Brothers.
Alors que certains commentaires présentent régulièrement l’existence de déficits publics et de dettes souveraines élevés comme un facteur qui devait « inévitablement » amener un jour ou l’autre à une correction sévère, nous devons donc garder à l’esprit que la crise présente a d’abord été celle d’un modèle économique centré sur l’endettement privé et la financiarisation. Et si les déficits publics et les dettes souveraines ont effectivement atteint en Europe un niveau difficilement supportable, c’est en grande partie parce qu’il a fallu, en 2008-2009, sauver les banques à grand renfort d’argent public et tenter de relancer l’économie.
Jusqu’à la crise financière américaine de 2008, les marchés financiers ne s’interrogeaient manifestement pas sur la capacité des membres de la zone euro à rembourser la dette souveraine qu’ils souscrivaient. Le risque de change s’étant par ailleurs fortement atténué (l’euro apparaissant comme une « monnaie forte »), l’ensemble des États de la zone pouvaient emprunter à bas taux, facilité qui se répercutait ensuite sur les crédits privés. La crise de 2008, outre qu’elle a entraîné une onde de choc économique qui a pesé sur la conjoncture et les budgets nationaux, a amené les investisseurs à se préoccuper lourdement de risques jusque là sous-estimés ; appliquée d’abord aux ménages américains titulaires de prêts hypothécaires, puis aux institutions financières qui avaient accordé ces prêts, puis à l’ensemble des banques américaines ou européennes, la crainte du défaut de paiement a fini par concerner les dettes souveraines. D’où l’explosion des taux appliqués à plusieurs membres de la zone euro et ses conséquences catastrophiques pour des pays obligés tout à la fois de réduire drastiquement leurs déficits et de consacrer une part croissante des ressources publiques au service de la dette, au risque d’une véritable asphyxie économique et d’une accélération de la crise budgétaire.
Pour ce qui est du risque de défaut sur les dettes souveraines, la zone euro, compte tenu de ses règles de fonctionnement, notamment de l’interdiction de renflouement par la Banque centrale européenne, présentait nécessairement une fragilité spécifique. Cependant, la crise ne se serait pas diffusée de la sorte sans les fragilités propres, de natures différentes, de certaines des économies européennes, en lien avec la persistance de déséquilibres macroéconomiques que les membres de l’union monétaire ont omis de corriger dans les années 2000.
a) La Grèce : mauvaise gouvernance et défaut de compétitivité
Les raisons pour lesquelles la crise a frappé la Grèce avec une particulière rudesse sont bien connues : taux d’endettement public déjà supérieur à 100 % du PIB avant la crise financière ; déficits publics constamment très au-delà de la barre des 3 % du PIB durant les années 2000 ; statistiques publiques maquillées (7) ; système fiscal archaïque, injuste compte tenu de multiples « niches » et abondamment fraudé (cette fraude est parfois évaluée à 12-15 % du PIB) faute d’une administration correcte ; effectifs d’agents publics gonflés par le clientélisme pratiqué par les partis politiques ; plus généralement, déficit de compétitivité en raison de l’accumulation d’importants écarts d’inflation par rapport au reste de la zone euro…
Le cas de la Grèce illustre clairement la cécité volontaire de certains dirigeants européens dans les années 2000.
C’est d’abord, nous ne le rappellerons jamais assez, un drame pour le peuple grec, qui connaît de manière continue la récession économique depuis 2008 et la diminution brutale des salaires et des revenus de remplacement, tandis que le taux de chômage (officiel) est passé de 8 % avant la crise à près de 18 % en 2011.
b) L’Irlande : coût exorbitant du sauvetage des banques et bulle immobilière
La crise irlandaise est d’une nature très différente. Le pays a connu dans les années qui ont précédé la crise une très forte croissance permise notamment par un accès facile au crédit lié à l’adoption de l’euro, mais aussi par le bénéfice d’importants transferts financiers du budget communautaire et par le choix d’un taux d’impôt sur les sociétés très faible (12,5 %), constitutif d’un véritable dumping fiscal déloyal aux dépens du reste de l’Union européenne. Dans ce contexte, l’Irlande a connu une bulle immobilière, qui a explosé en 2007. Les banques irlandaises, très exposées à leur marché immobilier national, ont ensuite été fortement affectées par la crise financière américaine. Pour les sauver, le gouvernement irlandais a dû engager depuis lors plusieurs plans d’aide consécutifs – nationalisation généralisée, recapitalisation, fermeture de trois établissements sur six, réductions de périmètre et cantonnement des « actifs toxiques » – dont le coût total serait de l’ordre de 70 milliards d’euros, soit la moitié du PIB annuel ! Alors que l’Irlande avait enregistré des excédents budgétaires de 2003 à 2007 (s’élevant à près de 3 % du PIB en 2006), le déficit public a dans ce contexte atteint jusqu’à 31 % du PIB (en 2010) et le taux d’endettement public est passé de moins de 25 % du PIB à la veille de la crise à 108 % fin 2011 !
L’Irlande a connu une récession de 3 % en 2008, puis de 7 % en 2009, avant une certaine stabilisation du niveau du PIB. Quant au taux de chômage, il est passé de moins de 5 % avant la crise à 14,4 % en 2011.
c) La bulle immobilière espagnole
L’Espagne fournit un autre exemple caractéristique de bulle immobilière entretenue, notamment, pas les bas taux d’intérêt pratiqués avant la crise grâce à l’appartenance à la zone euro. Alors que les banques octroyaient des prêts pour une durée allant jusqu’à cinquante ans – parfois à des taux inférieurs à l’inflation – et que la dette des ménages augmentait sur un rythme de 25 % par an, les prix de l’immobilier ont augmenté de plus de 90 % de 1995 à 2007. Le retournement a été brutal : selon des articles de presse, 28 % des maisons construites de 2001 à 2007 se seraient retrouvées vacantes fin 2008.
L’Espagne a connu la récession en 2009 et 2010 et le taux de chômage est passé de 8,3 % en 2007 à 21,7 % en 2011.
d) Le Portugal : défaut de compétitivité et de dynamisme économique
Les difficultés espagnoles ont contribué à déstabiliser le Portugal voisin, caractérisé par ailleurs par des fragilités économiques différentes, à certains égards proches de celles de la Grèce – la mauvaise gouvernance mise à part : déficits publics récurrents et dettes publique élevée ; faible taux d’épargne des ménages ; compétitivité insuffisante.
De plus, malgré des facteurs extérieurs identiques (faibles taux d’intérêt consécutifs à l’adhésion à l’euro et bénéfice des fonds structurels), le Portugal n’avait pas connu dans les années 2000 la même croissance que d’autres pays depuis lors en crise : on peut l’observer sur le tableau ci-après, sur la décennie 1998-2007, son PIB n’avait augmenté que de 17 %, contre 69 % pour Irlande, 43 % pour la Grèce et 38 % pour l’Espagne.
Croissance depuis 1998
(en %)
2007/1998 |
2011/1998 | |
Irlande |
69,2 |
53,1 |
Suède |
34,5 |
40 |
Espagne |
37,9 |
35,9 |
Finlande |
37 |
34,4 |
États-Unis |
28,7 |
29,6 |
Autriche |
25,4 |
29 |
Royaume-Uni |
32,4 |
28,7 |
Pays-Bas |
24,8 |
26,1 |
Belgique |
22,7 |
25,5 |
Grèce |
43,3 |
24,2 |
France |
21,6 |
21,9 |
Allemagne |
15,8 |
18,6 |
Portugal |
17 |
13,4 |
Italie |
14,8 |
9,6 |
Japon |
12,6 |
9,1 |
Source : OFCE, « les notes », n° 21, juin 2012 ; Eurostat.
e) L’Italie : un endettement élevé hérité du passé
La diffusion de la défiance des « marchés » à la dette publique italienne peut apparaître plus surprenante que pour d’autres pays : il s’agit d’une économie stable, assise sur une industrie qui reste puissante et exportatrice, sans déséquilibres macroéconomiques massifs.
Ce qui est sans doute entré en premier lieu en ligne de compte, c’est le niveau de l’endettement public, constamment supérieur à 100 % du PIB dans les années 2000 et atteignant 120 % en 2011. À cela s’ajoute probablement un doute récurrent sur la crédibilité des politiques économiques et financières de l’Italie, malgré l’action très courageuse du gouvernement actuel : le passé a été marqué par les scandales des années 1980, qui ont débouché sur l’opération Mani pulite en 1992-1993 et une refonte totale du système politique, puis plus récemment par les frasques de M. Silvio Berlusconi, notamment ses tentatives d’utiliser sa position de pouvoir pour échapper à diverses poursuites judiciaires liées à des faits de corruption ; plus généralement, le niveau d’endettement public actuel rend compte d’une gestion peu rigoureuse sur le long terme. Enfin, il faut bien relever, comme on le voit sur le tableau ci-dessus, le faible dynamisme de l’économie italienne dans les années 2000 – avec une des croissances les plus faibles des pays développés, inférieure à 10 % en cumul de 1998 à 2011 –, qui amène à s’interroger sur son potentiel à moyen terme, lequel détermine lourdement la soutenabilité du stock de dette publique existant.
f) La persistance de déséquilibres macroéconomiques importants internes à la zone euro
Globalement, si on la prend comme un territoire économique, la zone euro présente à moyen terme assez peu de déséquilibres, comme le relevait M. Tommaso Padoa-Schioppa dans son article précité : l’équilibre extérieur global y a toujours été assuré ; le solde budgétaire global, grâce notamment aux règles du pacte de stabilité et de croissance (même peu respectées par certains États), y a généralement été mieux maîtrisé qu’ailleurs ; il en est de même de l’endettement privé et des bulles spéculatives qui vont avec.
Cependant, la zone euro est caractérisée par des déséquilibres internes récurrents, notamment en termes de solde courant externe de chacun de ses membres. Ainsi qu’on peut le voir sur le tableau ci-après, certaines grandes ou moyennes économies de la zone, principalement l’Allemagne et les Pays-Bas, accumulent durablement des excédents courants considérables, qui ont eu tendance à augmenter dans la dernière décennie pour représenter jusqu’à plus de 6 % de leur PIB par an. A contrario, d’autres économies sont constamment et lourdement déficitaires, certaines de taille modeste – la Grèce –, d’autres importantes – l’Espagne.
La permanence de certains excédents ou déficits extérieurs se reflète nécessairement dans la position extérieure globale nette des pays, qui mesure la différence entre leurs actifs et passifs financiers accumulés par rapport au reste du monde. Comme on peut le voir dans le graphique qui suit, la position extérieure nette de certains membres de la zone euro rapportée à leur PIB est désormais assez impressionnante.
Balance des transactions courantes des pays de la zone euro, rapportée au PIB, en moyenne sur trois ans
(en %)
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 | |
Allemagne |
0,1 |
1,3 |
2,9 |
3,9 |
5,3 |
6,3 |
6,6 |
6,5 |
6,1 |
5,9 |
Autriche |
0,4 |
1,2 |
2,2 |
2 |
2,4 |
2,8 |
3,7 |
3,7 |
3,5 |
2,6 |
Belgique |
4 |
3,8 |
3,7 |
2,9 |
2,3 |
1,8 |
0,6 |
- 0,5 |
- 0,6 |
- 0,4 |
Espagne |
- 3,7 |
- 3,6 |
- 4 |
- 5,4 |
- 7,2 |
- 8,8 |
- 9,5 |
- 8,1 |
- 6,3 |
- 4,3 |
Finlande |
8,2 |
7,2 |
6,5 |
4,8 |
4,6 |
3,9 |
3,7 |
2,9 |
1,9 |
0,7 |
France |
1,5 |
1,2 |
0,8 |
0,3 |
- 0,2 |
- 0,7 |
- 1,1 |
- 1,4 |
- 1,5 |
- 1,6 |
Grèce |
- 7,1 |
- 6,8 |
- 6,3 |
- 6,7 |
- 8,3 |
- 11,2 |
- 13,6 |
- 13,6 |
- 12,1 |
- 10,4 |
Irlande |
- 0,7 |
- 0,5 |
- 0,5 |
- 1,4 |
- 2,5 |
- 4,1 |
- 4,8 |
- 4,6 |
- 2,7 |
- 0,6 |
Italie |
- 0,1 |
- 0,3 |
- 0,5 |
- 0,7 |
- 0,9 |
- 1,2 |
- 1,9 |
- 2 |
- 2,8 |
- 2,9 |
Luxembourg |
10,8 |
9,1 |
10,2 |
10,5 |
11,3 |
10,7 |
8,5 |
7,2 |
6,4 |
7,1 |
Pays-Bas |
2,4 |
3,6 |
5,3 |
6,9 |
8,1 |
7,8 |
6,8 |
5 |
5,1 |
6,6 |
Portugal |
- 9,6 |
- 8,3 |
- 7,7 |
- 8,4 |
- 9,8 |
- 10,4 |
- 11,1 |
- 11,2 |
- 11,2 |
- 9,1 |
Slovénie |
- 0,5 |
0,1 |
- 0,8 |
- 1,7 |
- 2,3 |
- 3 |
- 4,5 |
- 3,9 |
- 2,5 |
- 0,4 |
Chypre |
- 4,1 |
- 3,1 |
- 3,7 |
- 4,4 |
- 5,9 |
- 8,2 |
- 11,4 |
- 12,7 |
- 12,1 |
- 10,3 |
Malte |
- 4,6 |
- 1,5 |
- 2,2 |
- 5,9 |
- 8,2 |
- 8,3 |
- 7 |
- 6,5 |
- 6,5 |
- 6 |
Slovaquie |
- 6,5 |
- 7,4 |
- 7,2 |
- 7,4 |
- 8,1 |
- 7,2 |
- 6,5 |
- 4,7 |
- 3,8 |
- 1,7 |
Estonie |
- 7,1 |
- 9 |
- 11,1 |
- 10,9 |
- 12,2 |
-13,8 |
- 13,7 |
- 7,3 |
- 0,8 |
3,4 |
Source : Eurostat.
Position extérieure de l’investissement net des membres de la zone euro
(2011, en % du PIB)
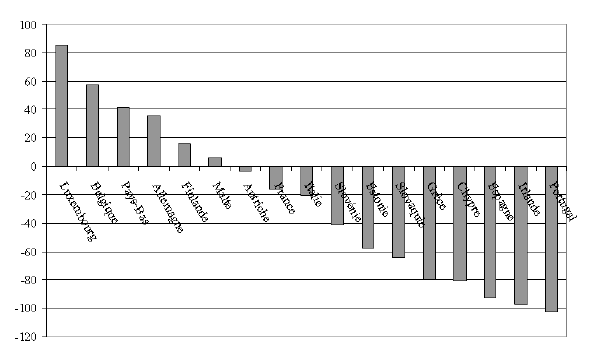
Source : Eurostat.
L’importance des déséquilibres internes à la zone euro pointe la responsabilité de tous ses membres, qui ont laissé subsister ces déséquilibres. Cette responsabilité ne peut être imputée aux seuls pays connaissant des déficits.
3. Dans un premier temps, des plans nationaux de sauvetage des banques et de relance
Lorsque les pays européens ont subi, à l’automne 2008, le choc de la crise financière et économique américaine, ils ont, dans un premier temps et alors que leur situation budgétaire ne suscitait pas encore de défiance particulière, réagi en mettant en place :
– d’abord, dès septembre 2008, des plans de sauvetage des banques, en réponse à la paralysie des marchés obligataire et interbancaire ;
– ensuite, dès novembre 2008, des plans de relance de l’économie, fondés sur une impulsion budgétaire (dépenses publiques et baisses de charges et d’impôts).
Les mesures destinées aux banques ont fait l’objet d’une coordination de principe au niveau international (G7) et européen. Cependant, chaque pays a adopté son propre plan, même si l’on y retrouve sous des formes différentes le même type de mesures : octroi de garanties de l’État pour permettre aux banques de lever des fonds ; refinancement des banques par des structures publiques ou semi-publiques ; renforcement de leurs fonds propres, parfois prises de participations publiques ou nationalisations dans les cas extrêmes ; éventuellement cantonnement des « actifs toxiques ». Globalement, des sommes considérables ont été annoncées : on a parlé de 1 700 milliards d’euros pour l’ensemble de l’Europe ; toutefois il ne s’agissait pas nécessairement de dépenses publiques effectives, mais d’enveloppes maximales d’intervention publique sous forme notamment de garanties.
En France, le dispositif d’aide aux banques a reposé sur trois instruments :
– la mise en place d’une structure ad hoc, la société de financement de l’économie française (SFEF), bénéficiant de la garantie de l’État (à hauteur de 265 milliards d’euros au plus) pour lever des fonds destinés à être prêtés aux banques (confrontées à l’assèchement des marchés financiers) ;
– l’apport, par le biais d’une autre structure publique, la société de prise de participation de l’État (SPPE), de quasi-fonds propres aux banques afin d’améliorer leurs ratios prudentiels, pour un montant maximal fixé à 40 milliards d’euros ; cet apport s’est fait notamment à travers l’achat par la SPPE de « titres de dette supersubordonnés » émis par les banques et rémunérés autour de 8 % ;
– l’apport de garanties directes, pour un montant maximal de 55 milliards d’euros, à des établissements en difficulté, tels que Dexia ou Natixis.
D’après la Cour des comptes (8), le plafond global d’engagements publics de 360 milliards d’euros n’a jamais été approché : on aurait atteint un maximum mi-2009 avec environ 120 milliards engagés. De plus, ces montants ne correspondaient pas à des dépenses définitives, mais à des prêts – depuis lors remboursés – et à des garanties, qui ont donné lieu à rémunération par les banques (la Cour estimait à 1,3 milliard d’euros la commission de garantie qui serait versée à l’État pour 2008 et 2009 et à 0,7 milliard ses intérêts sur les titres dits supersubordonnés en 2009).
Les plans de relance budgétaire ont été l’objet d’une coordination formelle au niveau communautaire, la Commission ayant présenté un projet de « plan européen pour la relance économique » le 26 novembre 2008 et le Conseil européen des 11 et 12 décembre suivants l’ayant approuvé. Mais en fait ce plan d’un montant annoncé d’environ 200 milliards d’euros, soit 1,5 % du PIB communautaire, prévoyait un appel très limité aux fonds communautaires et consistait surtout en une consolidation des différents plans de relance nationaux prévus et en un appel à une action concertée des gouvernements. En pratique, les différents plans nationaux n’ont pas été coordonnés et ont eu une ampleur et un contenu variables :
– les plans de l’Espagne et de l’Allemagne ont été importants (28 milliards d’euros pour les plans espagnols successifs ; plus de 80 milliards pour les deux plans allemands) ; le plan français a finalement représenté un coût de 34 milliards d’euros selon la Cour des comptes, proche de 1,5 % du PIB national ; le plan italien ne s’est en revanche élevé selon les sources qu’à 4 ou 6 milliards d’euros, soit au plus 0,5 % du PIB national, et le plan néerlandais a également été en deçà des recommandations communautaires ;
– s’agissant du contenu des plans, même si de manière générale priorité a été donnée à l’investissement, qu’il s’agisse de celui des entreprises (à travers des mesures améliorant leur trésorerie) ou des infrastructures, la répartition par grandes catégories de mesures a été différente : les investissements représentaient 77 % du premier plan français et étaient également très prédominants en Espagne et en Italie, alors qu’en Allemagne, un meilleur équilibre a été recherché entre les mesures pour l’investissement (48 % des fonds), l’emploi (20 %) et la consommation (22%) (9). Et dans leur détail, les multiples mesures des différents plans ont été très diverses.
En tout état de cause, l’effort de relance européen, chiffré globalement à 200 milliards d’euros, a été sans commune mesure avec celui des États-Unis. Pour un PIB moins important que celui de l’Union européenne, ceux-ci ont en effet inscrit dans leur plan de relance de février 2009 un effort global de 787 milliards de dollars en allègements fiscaux et dépenses publiques supplémentaires. S’y est ajouté en septembre 2011 – dans le temps même où les pays européens se voyaient contraints, à des degrés divers, à des restrictions budgétaires – un plan pour l’emploi chiffré à 447 milliards de dollars.
4. Une réponse commune tardive et insuffisante, mais qui déploie des instruments successifs de solidarité financière
La crise de la zone a conduit à la mise en place progressive d’un dispositif de stabilisation financière afin d’éviter que les attaques spéculatives sur les signatures publiques ne débouchent sur un défaut souverain et un effondrement de l’ensemble du système financier européen. Ce dispositif de stabilisation a été mis en place par touches successives, au gré des épisodes de la crise, et toujours assorti de conditions restrictives de mise en œuvre, compte tenu des réticences de pays comme l’Allemagne – alors même que pour assurer les « marchés » de la détermination et de la solidarité des Européens, il aurait probablement été plus efficace d’afficher rapidement, au moins dans le principe, une solidarité tendant à être inconditionnelle et illimitée.
Parallèlement, la convergence européenne et la surveillance des politiques nationales ont été renforcées.
a) Les premières mesures de sauvetage de la Grèce
Fin 2009, les investisseurs se mirent à douter de plus en plus de la capacité de la Grèce à faire face à ses engagements.
Le 15 janvier 2010, le gouvernement grec annonça un programme de stabilité, lequel fut complété par de nouvelles mesures le 2 février et le 3 mars suivants. Le Conseil européen informel du 11 février 2010 posa le principe de la solidarité européenne vis-à-vis de la Grèce, les États s’engageant à prendre toutes les mesures nécessaires pour maintenir la stabilité financière de la zone euro. Le 16 février 2010, le Conseil Écofin, dans le cadre de la procédure de déficit excessif engagée depuis avril 2009 contre la Grèce, mit cette dernière en demeure de ramener son déficit public à moins de 3 % du PIB d’ici 2012 et fixa un calendrier de mesures à prendre.
Le risque de défaut fut rapidement avéré sous l’effet des attaques spéculatives. Il devenait impératif d’agir vite eu égard à la possible contagion de la crise à d’autre pays de la zone euro. Le 11 avril 2010, l’Eurogroupe précisa les modalités d’un plan d’assistance à la Grèce prévu pour trois ans avec une enveloppe globale de 110 milliards d’euros. Il se composait d’une série de prêts bilatéraux d’un montant maximal de 80 milliards d’euros, dont 30 milliards d’euros la première année (dont 6,3 milliards à la charge de la France). Le taux des prêts, quoique inférieur aux conditions de financement de la Grèce (près de 7,5 % à trois ans), a été largement supérieur aux taux auxquels se finançaient les autres États membres de la zone euro. S’y ajoutait parallèlement une aide du Fonds monétaire international (FMI), de 30 milliards d’euros (dont 10 milliards la première année). Le contrôle des engagements pris par la Grèce devait être assuré par la Commission européenne, la Banque centrale européenne et le FMI, dans le cadre de la procédure pour déficit excessif. Au titre de ce plan, la Grèce a à ce jour reçu six tranches de prêts, pour un total de 73 milliards d’euros, dont 11,4 milliards d’euros délivrés par la France.
b) La création d’un dispositif provisoire de solidarité financière
Une fois l’aide à la Grèce mise en place, au printemps 2010, un mécanisme de gestion de crise fut institué, en urgence, par le Conseil Ecofin du 9 mai 2010. L’objectif était de pouvoir soutenir, pendant un certain temps, les États n’ayant plus accès au marché afin d’éviter le probable effondrement du système financier que leur défaut entraînerait. Le but était aussi de leur conférer le temps nécessaire à la résolution de leurs problèmes budgétaires.
L’article 122, paragraphe 2 (10), du traité sur le fonctionnement de l’UE (TFUE) servit de base juridique au nouveau dispositif, lequel devait de surcroît veiller à ne pas entrer en conflit avec l’article 125 du même texte qui interdit tout renflouement (11).
Habilité à intervenir jusqu’au mois de juin 2013, ce dispositif, créé aux mois de mai et juin 2010, est composé de deux volets : le mécanisme européen de stabilisation financière (MESF) et le Fonds européen de stabilité financière (FESF), dont les interventions sont systématiquement complétées par un abondement du FMI à hauteur d’un tiers du montant total requis. Son activation est conditionnée à l’adoption d’un programme d’assainissement budgétaire et d’adaptation de la structure productive, déterminé conjointement par la Commission européenne, la Banque centrale européenne et le Fonds monétaire international (la « Troïka »).
Le MESF est un programme autorisant la Commission à contracter, au nom de l'Union européenne – et à hauteur de 60 milliards d’euros –, des emprunts sur les marchés des capitaux ou auprès d'institutions financières pour venir à aide, en urgence, aux États membres en difficulté.
Le FESF intervient, lui, en empruntant directement des fonds sur les marchés pour ensuite octroyer des financements à un État en difficulté. Les émissions du FESF sont garanties par les États membres à hauteur de la quote-part de leur banque centrale dans le capital libéré de la BCE augmenté de 20 %, en application du principe de « sur-garantie » permettant de compenser la non-participation d’un éventuel État bénéficiaire.
Relevant du droit privé, le FESF n’est pas intégré à l’ordre juridique européen. Il a été créé par un accord-cadre signé le 7 juin 2010. Il s’agit d’un contrat international qui engage les États membres de l’Union européenne dont la monnaie est l’euro. Société anonyme de droit luxembourgeois, le FESF voit son capital détenu par les États de la zone euro à concurrence, là aussi, de leur quote-part dans le capital libéré de la Banque centrale européenne. L’économiste allemand Klaus Regling en a été nommé directeur général. Il est institué pour une durée limitée de trois ans et ne pourra donc pas accorder de nouvelle assistance financière après le 30 juin 2013(12).
Plusieurs modifications ont été apportées au FESF depuis sa création. Sa capacité effective de prêt, d’abord inférieure aux 440 milliards d’euros prévus et nécessaires à lui garantir la notation la plus élevée, à savoir AAA, fut effectivement portée à ce seuil en augmentant le plafond global de garantie et les sur-garanties de chaque État membre. Dans un second temps, les prérogatives du FESF furent étendues. En juillet 2011, il fut ainsi autorisé, notamment, à intervenir à titre de précaution ainsi qu’à financer la recapitalisation des banques et établissements financiers par des prêts aux gouvernements. Enfin, en octobre 2011, le principe d’un renforcement des capacités du FESF par effet de levier fut annoncé afin de les porter à 1 000 milliards d’euros. Les engagements pris à ce jour par le FESF dans le cadre des différents plans d’assistance financière décidés s’élèvent, selon le ministère des finances, à 192 milliards d’euros, dont 103,3 milliards ont déjà été déboursés.
En janvier dernier, toutefois, après la dégradation de la note de neuf pays de la zone euro – dont la France –, l’agence américaine Standard & Poor’s a dégradé la note du FESF d’un cran en le faisant passer à AA+. Pour cette agence, seuls quatre pays contributeurs restent désormais noté AAA : l’Allemagne, la Finlande, le Luxembourg et les Pays-Bas. Les deux autres agences maintiennent à ce jour la note la plus haute et, pour le moment, la décision de Standard & Poor’s n’a pas dégradé les conditions de financement.
c) Des dispositifs d’aide très sollicités
● La Grèce
Le 21 juillet 2011, les États de la zone euro se sont accordés sur un second plan d’aide à la Grèce permettant de couvrir les tombées de dette prévues jusqu’en 2014 et les déficits cumulés sur la période, à la suite des révisions à la hausse du déficit public par suite notamment d’une croissance plus faible que prévue. A cette occasion, il a été décidé que, jusqu’au troisième trimestre 2014, les besoins de financement de l’État grec seraient satisfaits :
– à hauteur de 28 milliards d’euros par des privatisations ;
– à hauteur d’environ 50 milliards d’euros par une contribution volontaire des créanciers privés ;
– à hauteur d’environ 109 milliards d’euros, par les États européens et le Fonds monétaire international, cet effort se rajoutant aux 110 milliards d’euros du premier programme d’aide.
En prévoyant des effacements de dettes, ce second plan consacra l’organisation d’un défaut partiel de la Grèce mais il s’avéra malheureusement rapidement insuffisant, les mesures d’austérité s’accumulant sans parvenir à rassurer sur la capacité de l’État grec à rembourser sa dette. Comme votre rapporteure l’a indiqué précédemment, les pays de la zone euro, en octobre 2011, parvinrent à un accord sur un renforcement des moyens d’action du FESF afin d’en faire une force de frappe de l’ordre de 1 000 milliards d’euros. 130 milliards d’euros (s’ajoutant au premier plan de 2010) pourraient dès lors, par ce biais, bénéficier à la Grèce en échange d’un strict renforcement de la contrainte collective.
Comme on pouvait l’envisager, la mise en œuvre de ce plan fut chaotique. Les conditions qui furent imposées à la Grèce furent terribles. On ne doit pas sous-estimer leur dureté et leurs conséquences tant sociales que politiques avec la réapparition, dans la vie publique, d’idées plus que détestables. De surcroît, une crise sérieuse affecta la classe politique grecque à l’automne 2011. Le 31 octobre, sans consulter ses partenaires européens, le Premier ministre George Papandréou annonça la tenue d'un référendum sur le plan d'aide annoncé à peine quatre jours plus tôt. Cette décision provoqua consternation et colère, chez les partenaires européens et en Grèce même. Le 4 novembre, le ministre grec des finances fit part à ses homologues européens que le projet de référendum était abandonné et, à Athènes, le Parlement vota la confiance au gouvernement à une très courte majorité. Le 6 novembre, le Pasok et les conservateurs s’entendirent pour former un gouvernement de coalition et, deux jours plus tard, M. Lucas Papademos, ancien vice-président de la Banque centrale européenne, prit la tête du nouveau gouvernement. Le parlement grec vota un nouveau plan d’austérité le 12 février 2012, préalable à la mise en œuvre de l’aide extérieure. Le 15 mars 2012, l’Eurogroupe approuva définitivement le nouveau plan d’aide à la Grèce et autorisa le FESF à débloquer les premières tranches d’aide.
Les plans de soutien à la Grèce ont tous été accompagnés d’exigences draconiennes d'ajustement budgétaire, sous le contrôle étroit de la « Troïka » constituée par la Commission européenne, la BCE et le FMI. A terme, le but est de ramener le taux d'endettement du pays à 120 % du PIB en 2020, contre 160 % prévus cette année.
● L’Irlande et le Portugal
L’Irlande est le deuxième pays à avoir bénéficié de l’aide de l’Union européenne et du FMI, en novembre 2010. D’un montant de 85 milliards d’euros, le plan mis en œuvre a notamment mobilisé 22,5 milliards d’euros du FMI, 22,5 milliards d’euros de l’Union européenne via le MESF, mais aussi la même somme en provenance du FESF, du Royaume-Uni, du Danemark et de la Suède. D’après les éléments transmis par le ministère des finances, les contributions apportées dans le cadre de ce plan s’élèveraient à ce stade à 52,3 milliards d’euros. En contrepartie, il a été demandé à l’Irlande un effort très strict réparti sur quatre années et composé pour deux tiers de coupes budgétaires et pour un tiers d’une hausse de la fiscalité. Le taux de TVA devrait passer à 22 % l’an prochain et à 23 % en 2014. En revanche, votre rapporteure déplore que le taux de l’impôt sur les sociétés n’ait pas été relevé. Cette question aurait dû être prise en compte lors de l’établissement du plan d’aide car il est quelque peu choquant que tout en bénéficiant du soutien de l’Europe, l’Irlande continue un « dumping » fiscal qui nuit aux autres États membres. L’Irlande est encore loin d’être sauvée mais, contrairement à la Grèce, a renoué avec une croissance qui reste toutefois fragile. Récemment, ce pays est même parvenu à retourner sur les marchés financiers et à réussi à placer des obligations à court terme à un taux de 1,8 %.
S’agissant du Portugal, ce pays a également bénéficié de la solidarité financière européenne au printemps 2011, pour un montant de 78 milliards d’euros, dont 57,3 milliards versés à ce jour. Ce soutien sur trois ans intervient en échange de trois contreparties : un ajustement budgétaire réalisé sur la base notamment d'une réduction des dépenses, une réforme du système de santé et de l’administration publique, ainsi qu’un ambitieux programme de privatisations, des réformes visant à doper la compétitivité et le potentiel de croissance de l'économie portugaise et, enfin, des mesures visant à assainir le secteur financier et à renforcer la structure de capital des banques. Les 78 milliards d'euros du plan d’aide sont apportés, à parts égales – soit 26 milliards d’euros – par le FESF, le MESF et le FMI. A ce jour, 5 tranches d’aide ont été débloquées par la « Troïka », la dernière en juin dernier. Le Portugal reste pour autant fragile. S’il ambitionne de revenir sur les marchés à l’automne 2013, des doutes demeurent quand même très présents notamment parce que l’augmentation du chômage, supérieur à 15 % en 2012, pèse grandement sur l’équilibre des comptes.
d) Un dispositif à vocation durable : le Mécanisme européen de solidarité
Le Conseil européen des 28 et 29 octobre 2010 adopta le principe de la mise en place d’un dispositif permanent de soutien à la stabilité ainsi que celui d’une modification limitée du traité pour lui garantir une base juridique solide. En effet, l’option d’une révision des traités était ardemment défendue par l’Allemagne pour asseoir la crédibilité du nouveau mécanisme, notamment afin de consacrer le principe de conditionnalité attaché à ses interventions.
Prenant en compte cette exigence, le Conseil européen des 24 et 25 mars 2011 compléta, conformément à la procédure de révision simplifiée fixée par l’article 48 du TFUE et après l’approbation du Parlement européen, l’article 136 de ce même texte qui permet aux États de la zone euro d’adopter des mesures spécifiques liées à la coordination de leurs politiques économiques, en disposant que « les États membres dont la monnaie est l’euro peuvent instituer un mécanisme de stabilité qui sera activé si cela est indispensable pour préserver la stabilité de la zone euro dans son ensemble. L’octroi, au titre du mécanisme, de toute assistance financière nécessaire, sera subordonné à une stricte conditionnalité ».
La réunion de l’Eurogroupe du 20 juin 2011 permit aux ministres des finances de la zone euro de stabiliser le contenu d’une première version du projet de traité intergouvernemental fixant les caractéristiques du MES. Ce texte fut officiellement signé le 11 juillet 2011, à Bruxelles, par les ministres des finances de la zone euro. Or, à peine dix jours plus tard, le 21 juillet 2011, les chefs d’État et de gouvernement décidèrent de modifier les modalités d’intervention du FESF. Ce dernier se voyait octroyer la possibilité d'intervenir sur le marché secondaire et d'accorder une assistance financière pour la recapitalisation d'institutions financières. Il convenait dès lors de transposer ses changements dans le projet de traité signé le 11 juillet. Une nouvelle phase de négociation s’ouvrit. Outre ce travail d’« actualisation », les discussions permirent certaines avancées qui furent approuvées lors de la réunion des chefs d’État ou de Gouvernement de la zone euro du 9 décembre 2011 :
– abandon du principe de mise à contribution systématique des créanciers privés afin de reprendre la ligne suivie par le FMI en la matière ;
– introduction d’une procédure de décision en urgence à une majorité qualifiée de 85 %, sous réserve de l’accord du parlement finlandais, cette décision requérant en l’état un vote de ce dernier à la majorité qualifiée ;
– prévision de l’entrée en vigueur du traité dès lors que les États membres représentant 90 % des engagements en capital l’auraient ratifié (contre 95 % initialement prévus). Ceci tendait à éviter le blocage du mécanisme suite à l’opposition d’un pays de peu de poids économique dans la zone euro.
C’est aussi cette réunion qui décida l’accélération de l’entrée en vigueur du traité avec l’objectif de juillet 2012 (13). La France craignait, en effet, la perte de son « triple A », en particulier à la suite de la dégradation de la note souveraine des États-Unis par Standard & Poor’s le 5 août 2011.
Le traité définitif instituant le mécanisme fut signé par les ministres des finances de la zone euro le 2 février 2012. La France a été le premier État à le ratifier(14).
Le dispositif créé des différences importantes avec le FESF. Il constituera un instrument pérenne prêt à répondre aux éventuelles crises à venir, dans des conditions fixées par un traité et non à définir au cas par cas. Le MES pourra décider une intervention sans l’unanimité des États lorsque l’absence de décision mettrait en danger la zone euro.
Le traité instituant le MES est régi par les règles du droit public international et le MES sera une organisation internationale et non pas une société de droit privé comme le FESF. Le MES aura trois organes de décision : le conseil des gouverneurs, le conseil d’administration et le directeur général. Les États seront représentés au premier par leurs ministres des finances et au deuxième par un administrateur « possédant un haut niveau de compétence dans les matières économiques et financières ». Concrètement, chaque membre du MES désignera son premier gouverneur dans les deux semaines suivant l’entrée en vigueur du traité. Chaque gouverneur désignera ensuite un administrateur. Le directeur général sera quant à lui nommé – et pourra être révoqué à tout moment – par le conseil des gouverneurs, pour une durée de cinq ans renouvelable une fois. Il présidera le conseil d’administration et participera également aux réunions du conseil des gouverneurs.
Le MES prendra ses décisions les plus importantes (comme l'octroi d'une aide, l'appel de capital ou la modification du capital autorisé) « d'un commun accord », c'est-à-dire à l’unanimité des votants. Certaines décisions seront prises à la majorité qualifiée (80 % des voix) ou à la majorité simple. Par ailleurs, une procédure d’urgence est prévue : lorsque la Commission et la BCE considèreront toutes deux que le défaut d'adoption urgente d'une décision relative à l'octroi ou à la mise en oeuvre d'une assistance financière, la soutenabilité économique et financière de la zone euro serait menacée, 85 % des voix exprimées seront nécessaire pour prendre la mesure appropriée. Contrairement à ce qui est le cas pour le FESF, où chaque État dispose d'une voix, le nombre de voix sera proportionnel à la part dans le capital du MES. En l’état actuel des choses, la France devrait détenir 20,3859 % des voix (voir infra) ce qui lui assurera une minorité de blocage dans tous les cas.
Le MES sera doté d’un capital de 700 milliards d’euros, dont 80 milliards d’euros de capital appelé, susceptible de couvrir des pertes. Il empruntera donc sur capitaux propres et non pas en s’appuyant sur la garantie des États membres. La sensibilité de ses conditions de financement à la notation desdits États sera donc plus que réduite. Dans l’autre sens, les financements levés par le MES ne viendront pas accroître l’endettement public brut des États, sauf naturellement en cas de constatation de pertes. Enfin, le MES disposera du rang de créancier privilégié, seul le FMI disposant d’une priorité de remboursement par rapport au mécanisme.
Sont membres du MES les États de la zone euro et eux seuls. Pourront le rejoindre les nouveaux États membres de la zone. Le mécanisme ne pourra être activé que si cela est indispensable pour préserver la stabilité de la zone euro et de ses États membres et si l’intervention s’accompagne d’une stricte conditionnalité.
Le MES pourra intervenir sur demande d’un État membre, après analyse des risques, de la soutenabilité de la dette et des besoins de financements effectuée par la Commission européenne en liaison avec la BCE. Pour une intervention sur le marché secondaire, une analyse de la BCE devra conclure à une situation exceptionnelle avec risque de contagion. En cas d’octroi d’une aide, un protocole d’accord définissant la conditionnalité sera conclu, de même qu’un accord sur les modalités financières.
La contribution des États au capital de 700 milliards est fixée en fonction de la clé de souscription au capital de la BCE corrigée pour les États dont le PIB est inférieur à 75 % de la moyenne européenne. La France contribue pour 20,3859 %. Elle devra verser 16,309 milliards d’euros au titre du capital libéré et sa part dans le total du capital s’élèvera à 142,7 milliards.
Le MES n’est pas un instrument communautaire mais un mécanisme intergouvernemental. Il ne participe donc pas d’un renforcement de l’intégration européenne. Il n’est ainsi pas une coopération renforcée. Cependant, son autonomie juridique par rapport à l’Union européenne est tempérée par l’appartenance de ses États membres à celle-ci, qui le soumet de droit à l’ordre juridique européen, et par le rôle indispensable de certaines institutions européennes, sans que les procédures et compétences ne soient celles qui s’appliqueraient dans un cadre communautaire.
Il faut souligner enfin le rôle de certains tiers. C’est le cas d’abord du FMI. S’il n’est plus systématiquement associé comme avec le FESF, il doit l’être chaque fois que cela est possible : demande d’aide concomitante de l’État en difficulté, participation à l’analyse de la situation, à la définition du programme de conditionnalité et à sa mise en œuvre. C’est aussi le cas des États non membres de la zone euro qui interviendraient en assistance d’un État et seraient alors associés à des réunions du Conseil des gouverneurs et verraient leurs prêts bénéficier aussi du statut de créancier privilégié.
D’après le ministère des finances, les engagements déjà pris par le MES à ce jour, dans le cadre des différents plans d’assistance décidés, s’élèvent à 48,5 milliards d’euros.
Le traité instituant le MES entend être complémentaire avec le TSCG. Un État ne pourra bénéficier d’une aide du MES s’il n’a pas ratifié le TSCG à compter du 1er mars 2013, mais aussi s’il n’applique pas, un an après son entrée en vigueur, l’article 3 de ce texte qui, comme votre rapporteure le décrira ultérieurement, énonce les règles de discipline budgétaire.
e) Les interventions de la Banque centrale européenne
L’article 123 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne écarte toute monétisation des dettes publiques en disposant qu’il « est interdit à la Banque centrale européenne et aux banques centrales des États membres […] d’accorder des découverts ou tout autre type de crédit aux institutions, organes ou organismes de l’Union, aux administrations centrales, aux autorités régionales ou locales, aux autres autorités publiques, aux autres organismes ou entreprises publics des États membres ; l’acquisition directe, auprès d’eux, par la Banque centrale européenne ou les banques centrales nationales, des instruments de leur dette est également interdite ». Comme on l’a dit supra, l’Allemagne est particulièrement attachée à cette clause restrictive qui conditionnait la création de la monnaie unique.
Cependant, une lecture a contrario de l’article 123 rend possible l’acquisition « indirecte » de créances, c’est-à-dire le rachat d’obligations publiques sur le marché secondaire. Et dès le début de la crise, la BCE a su en faire un usage avisé et utile. Dans sa décision (BCE/2010/5) du 14 mai 2010 (15), elle a en effet décidé de procéder à des interventions sur les marchés obligataires publics et privés de la zone euro. Ce programme, intitulé « SMP » (Securities markets programm) a conduit la BCE à racheter des titres grecs, irlandais, portugais, espagnols ou italiens « afin de garantir la profondeur et la liquidité des compartiments de marché qui connaissent des dysfonctionnements et affectent le mécanisme de transmission de la politique monétaire » (16). Toutefois, sous la pression de la Bundesbank, le SMP a été limité à une dizaine de milliards d’euros par mois. Intervenant dans les périodes de dangereuses tensions sur les taux principalement en mai et juin 2010, juillet et août 2011 et en novembre 2011, la BCE a racheté 214 milliards d’euros de dettes souveraines, un montant très inférieur au volume d’obligations détenu par la Réserve fédérale américaine ou la Banque d’Angleterre : les achats de la BCE ont représenté environ 2,5 % du PIB de la zone concernée (zone euro), quand ce taux atteint 8 % pour son homologue américaine et 20 % pour son homologue britannique.
Plus récemment, au mois d’août dernier, la BCE a annoncé son intention d’intervenir plus massivement – et si nécessaire, selon les mots de son Président, de manière « illimitée » – sur le marché secondaire de la dette afin, notamment, de soulager l’Espagne et l’Italie, deux pays particulièrement visés par les marchés en dépit de lourdes réformes. Ce projet a été formalisé le 6 septembre 2012 avec le lancement d’un programme intitulé « OMT » (Outright monetary transaction). Comme l’a déclaré M. Mario Draghi, le programme OMT devrait permettre « de traiter les graves perturbations affectant les marchés des obligations d’État qui proviennent, en particulier, de craintes infondées de la part des investisseurs concernant la réversibilité de l’euro. Par conséquent, dans des conditions appropriées, nous disposerons d’un mécanisme de soutien pleinement efficace pour éviter les scénarios destructeurs pouvant gravement compromettre la stabilité des prix dans la zone euro » (17). Pour bénéficier de cette aide, un pays devra d’abord s’adresser aux mécanismes de solidarité financière existants (FESF/MES) et, ainsi, se soumettre à un programme d’ajustement.
Votre rapporteure se félicite d’une telle évolution. Le financement, qu’il soit direct ou indirect, des dettes souveraines par la BCE, ne doit pas être écarté a priori et dogmatiquement. Mené de manière constructive et pertinente, il peut être envisagé comme l’un des instruments de la politique monétaire et comme un facilitateur de sortie de crise. Surtout, le fait que la BCE ait publiquement assumé sa volonté d’intervenir en cas de nécessité est source de confiance pour les investisseurs et donc de stabilité. Elle a rappelé à tous qu’elle détenait une arme de gros calibre et elle a fait savoir qu’elle pourrait s’en servir(18). Espérons que cela soit suffisamment dissuasif pour qu’elle ne le fasse pas. En tout état de cause, la décision de la BCE a eu des effets immédiats : « entre la veille du sommet de juin et le lendemain des annonces de la BCE début septembre, le coût des financements à deux ans a baissé de 2 à 3 points pour l’Espagne et l’Italie » (19).
5. Des mesures pour renforcer la convergence budgétaire et la gouvernance économique commune, parmi lesquelles s’inscrit le traité de stabilité budgétaire
Suite à la crise des dettes souveraines et parallèlement à la mise en place de mécanismes de soutien aux États-membres en difficulté, l’Union européenne a adopté – ou est en train d’adopter – un ensemble de dispositifs destinés au renforcement de la gouvernance de la zone euro par le biais d’une convergence et d’une discipline accrue des politiques budgétaires nationales.
Ces mesures trouvent leur source dans les travaux du Conseil européen des 25 et 26 mars 2010, qui, comme votre rapporteure a eu l’occasion de l’indiquer précédemment, avait chargé son président, Herman Von Rompuy, de diriger un groupe de travail chargé d’élaborer des recommandations de réforme de l’Union économique et monétaire (UEM), en faisant évoluer le pacte de stabilité et de croissance. Le rapport de ce groupe a été présenté le 21 octobre 2010.
Les formes juridiques prises par ces dispositions sur la gouvernance sont diverses. Elles relèvent du droit dérivé ou de simples engagements. Elles ont aussi pris la forme d’un traité international, le « traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance dans l’Union économique et monétaire ».
a) Le renforcement de la législation communautaire sur la discipline budgétaire
1. Le « Six pack » :
L’expression Six pack désigne un ensemble de six textes (cinq règlements et une directive (20)).Cet ensemble est entré en vigueur le 13 décembre 2011, après plus d’un an de procédure d’adoption : la Commission européenne avait fait connaître ses propositions initiales le 29 septembre 2010 et un accord entre le Parlement européen et le Conseil a été trouvé le 14 septembre 2011.
Le Six pack vise à la fois à améliorer la prévention des difficultés, notamment en encadrant les choix économiques nationaux (au-delà des seuls aspects financiers), et à durcir et automatiser la sanction des dérives budgétaires :
– le dispositif du « semestre européen » (mis en œuvre dès 2011) a pour objet de permettre pratiquement la mise en cohérence entre les politiques nationales, budgétaires mais aussi économiques, et l’« examen annuel de croissance » réalisé en début d’année par la Commission européenne et destiné à fixer les priorités de l’Union en matière de relance de la croissance et de création d’emplois pour l’année à venir. En mars, les chefs d’État et de gouvernement doivent sur cette base formuler des lignes directrices de l’Union concernant les politiques nationales ; en avril, c’est aux États-membres de présenter en conséquence leurs programmes de stabilité et de convergence ; en mai/juin, la Commission évalue ces programmes et adresse des recommandations propres à chaque pays, lesquelles sont ensuite approuvées par le Conseil européen et adoptées fin juin ou début juillet par le Conseil ;
– la surveillance – assortie le cas échéant de sanctions – est élargie aux déséquilibres macro-économiques, sur la base du suivi d’un tableau de bord où figurent dix indicateurs (la balance courante, le solde des investissements internationaux, la variation des parts de marché à l’exportation, les coûts de main d’œuvre, les taux de change réels, le niveau de la dette privée, celui des flux de crédit au secteur privé, l’évolution des prix de l’immobilier, la dette publique et le taux de chômage) ;
– le volet préventif du pacte de stabilité et de croissance est renforcé, avec notamment une modification des règles de vote (dans certains cas, les recommandations de prendre des mesures correctrices seront votées à la majorité simple du Conseil) et un suivi des trajectoires de croissance des dépenses publiques des États-membres, cette croissance devant – sauf mesures discrétionnaires d’augmentation des recettes pour couvrir les dépassements – être inférieure à la croissance potentielle du PIB tant que l’objectif budgétaire à moyen terme n’est pas atteint ;
– les sanctions pour déficit public excessif sont rendues « semi-automatiques », étant adoptées par le Conseil à la « majorité qualifiée inversée » (la recommandation de la Commission est réputée adoptée sauf opposition du Conseil) ;
– l’application de la procédure de déficit excessif aux dettes publiques excessives est précisée ; toute dette dépassant 60 % du PIB devra être réduite d’un vingtième de l’écart à ce seuil par an ;
– des sanctions pourront aussi être imposées en cas de déviation majeure dans l’exécution budgétaire d’un État-membre ; de même, si un projet de budget n’est pas conforme avec les engagements pris dans le cadre du volet préventif, l’État-membre en cause pourra se voir demander de présenter un nouveau projet, ce qui est arrivé à la Belgique.
2. Le « Two pack » :
Le 23 novembre 2011, la Commission européenne a présenté un second paquet sur la gouvernance économique composé de deux projets de règlements communautaires (« Two pack »). L’objectif de ces textes est de renforcer la coordination et la surveillance budgétaire tant ex-ante qu’au stade de l’exécution budgétaire. Ils visent aussi à préciser la manière dont s’organisera la surveillance spécifique des États confrontés à des difficultés sérieuses, en particulier lorsqu’ils bénéficieront d’un programme d’assistance en contrepartie de conditionnalités.
Contrairement au Six pack dont certaines dispositions concernent l’ensemble des États membres de l’Union européenne, le Two Pack ne s’adresse qu’aux seuls États membres de la zone euro. Les deux projets de règlements qui le constituent sont encore en cours d’examen : publiés par la Commission européenne le 23 novembre 2011 et approuvés par le Conseil Écofin le 21 février 2012, ils ont été examinés en commission par le Parlement européen le 14 mai 2012 et en séance plénière le 13 juin. Le Parlement a adopté les deux textes, mais en les amendant. Toutefois, l’ampleur et le caractère divers, voire parfois paradoxal, de ces amendements, destinés à satisfaire différentes sensibilités, laisse présager que la recherche d’un accord avec le Conseil sera complexe (21).
● Le projet de règlement « relatif au renforcement de la surveillance économique et budgétaire des États membres connaissant ou risquant de connaître de sérieuses difficultés du point de vue de leur stabilité financière au sein de la zone euro » est parfois présenté, de manière peut-être simpliste mais assez réaliste, comme destiné à donner une base juridique aux interventions de la Commission européenne (ou de la « Troïka ») dans les États-membres qui sollicitent l’assistance des mécanismes de solidarité. Selon ce texte, la surveillance renforcée qu’il envisage serait applicable non seulement aux États-membres bénéficiant d’une assistance financière, mais aussi, sur décision de la Commission, à tout « État-membre confronté à de sérieuses difficultés du point de vue de sa stabilité financière ». Le projet prévoit dans les pays concernés des missions régulières de la Commission, ainsi que l’obligation de fournir des informations « désagrégées » sur la situation de leurs banques et de réaliser des tests de résistance de celles-ci. Le Conseil pourrait éventuellement rendre publique une « recommandation » demandant à un pays de solliciter une assistance financière.
Le Parlement européen a amendé ce projet, en y introduisant notamment une sorte de procédure de sauvegarde pour les États-membres au bord de la banqueroute (sous l’autorité de la Commission, à laquelle les créanciers devraient se faire connaître).
● Le projet de règlement « établissant des dispositions communes pour le suivi et l’évaluation des projets de plans budgétaires et pour la correction des déficits excessifs dans les États membres de la zone euro » affiche dans son préambule des objectifs clairs : « c’est au stade de la planification que l’on peut le mieux garantir la viabilité des finances publiques ; il convient donc de déceler les erreurs manifestes le plus tôt possible. Les États membres devraient retirer un avantage (…) d’une surveillance synchronisée de leurs politiques budgétaires (…). Il est indispensable d’instaurer des règles budgétaires nationales en phase avec les objectifs budgétaires fixés au niveau de l’Union (…) notamment (…) des règles en matière d’équilibre structurel des budgets qui transposent en droit national les grands principes du cadre budgétaire de l’Union ».
À ce titre, ce projet propose notamment :
– l’établissement d’un calendrier budgétaire commun : les États membres devraient rendre public chaque année, au plus tard le 15 avril, un plan budgétaire à moyen terme ; les projets de lois budgétaires seraient rendus publics au plus tard le 15 octobre ;
– une forme de normalisation du contenu des documents budgétaires, les projets de budget devant être accompagnés d’un projet de « plan budgétaire » annuel, qui devrait comporter obligatoirement certaines données et devrait reposer sur des prévisions macroéconomiques « indépendantes » ;
– la possibilité pour la Commission d’émettre un avis, avant le 30 novembre, sur ces documents ;
– l’obligation pour les États-membres de recourir à un « conseil budgétaire indépendant » pour le suivi dans la procédure budgétaire nationale des engagements budgétaires européens (ce qui n’est sans doute pas satisfait par le fonctionnement français actuel, mais le sera une fois créé le Haut conseil des finances publiques – voir infra) ;
– l’obligation pour les États-membres d’adopter « des règles budgétaires chiffrées concernant le solde budgétaire [qui] revêtent un caractère contraignant, de préférence constitutionnel » – c’est la « règle d’or » ;
– un renforcement de la surveillance des États-membres en procédure de déficit excessif, auxquels des rapports sur leur exécution budgétaire infra-annuelle seraient demandés.
Le Parlement européen a adopté de nombreux amendements à ce projet. En particulier :
– dans l’article relatif à la « règle d’or », la référence au caractère « de préférence constitutionnel » de la transposition a été retirée, au bénéfice d’une formule plus souple et proche de celle de l’article 3 du TSCG (le respect des règles concernant le solde budgétaire devrait être « garanti » dans le cadre du processus budgétaire national) ; dans l’autre sens, le texte a été durci avec l’obligation nouvelle d’inscrire, dans les dispositions de droit national qui feront office de « règle d’or », un mécanisme de correction automatique en cas d’écart par rapport à la trajectoire de réduction des déficits ;
– un chapitre nouveau concernant la dette souveraine a été inséré, prévoyant la transmission à la Commission des plans d’émission, la coordination des émissions, le dépôt d’un rapport de la Commission sur les euro-obligations et la création d’un fonds européen d’amortissement pour la part des dettes excédant 60 % du PIB des États concernés (« fonds de rédemption »).
Il reste naturellement à savoir ce que les gouvernements voudront bien garder de ces amendements.
b) Le « pacte pour l’euro plus »
La France et l’Allemagne ont proposé début février 2011 la signature d’un « pacte de compétitivité », qui permettrait de faire le lien entre le renforcement de la discipline budgétaire incarnée par le semestre européen (puis le Six pack) et la stratégie de croissance de l’Union européenne.
Cette initiative a été adoptée sous l’intitulé : « pacte pour l’euro plus » par les chefs d’État et de gouvernement de la zone euro le 11 mars 2011, la Bulgarie, le Danemark, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne et la Roumanie, non membres de la zone euro, ayant décidé de s’y joindre. Les États membres qui ont souscrit au pacte s'engagent, sur la base des indicateurs et des principes qu'il prévoit, à annoncer chaque année une série d'actions concrètes à mettre en œuvre dans les douze mois qui suivent. Ces engagements se refléteront également dans des « programmes nationaux de réforme » et dans « des programmes de stabilité » présentés chaque année, qui seront évalués par la Commission, le Conseil et l'Eurogroupe dans le cadre du semestre européen.
Ce pacte ne se limite pas à une coordination globale mais pose le principe de mesures concrètes permettant d’aboutir à une convergence économique et sociale axée sur le renforcement de la compétitivité.
Le pacte pour l’euro plus repose sur quatre « règles directrices » :
– il s’intègre dans le modèle de gouvernance économique qui existe déjà dans l'UE (stratégie Europe 2020, semestre européen, lignes directrices intégrées, pacte de stabilité et de croissance et nouveau cadre de surveillance macroéconomique) et le renforce avec de nouveaux engagements intégrés aux programmes nationaux de réforme et de stabilité, relevant du cadre de surveillance régulier ;
– il privilégie l'action avec des domaines d'action prioritaires pour la compétitivité et la convergence : des objectifs communs feront l'objet d'un accord au niveau des chefs d'État ou de gouvernement, chaque État étant libre dans la mise en œuvre ;
– chaque année, des engagements nationaux concrets seront pris par chacun des chefs d'État ou de gouvernement, en tenant compte des meilleures pratiques et prendront comme référence les pays les plus performants. La mise en œuvre des engagements et les progrès accomplis en matière de réalisation des objectifs politiques communs feront l’objet d'un suivi annuel au niveau politique. De plus, les États membres s'engagent à consulter leurs partenaires avant l'adoption de chaque grande réforme économique ayant un impact ;
– les États membres participants sont déterminés à réaliser l’achèvement du marché unique.
c) Les origines du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance dans l’Union économique et monétaire
Au cours de l’automne 2011, l’aggravation de la crise de la dette souveraine et les difficultés accrues de financement rencontrées par plusieurs pays conduisirent les chefs d’État et de gouvernement à envisager une révision des traités afin de consolider la gouvernance économique et budgétaire au sein de la zone euro et, ainsi, de lancer un signal positif aux marchés et de desserrer quelque peu leur étreinte. Une telle évolution n’alla pas de soi et suscita de nombreux débats lors de plusieurs sommets ou rencontres « de la dernière chance ». La France et l’Allemagne s’opposèrent sur ce sujet, en particulier sur les modalités d’assurer le respect de la discipline budgétaire au sein de la zone euro. À une méthode plutôt « intergouvernementale » laissant une large part de responsabilité au Conseil, défendue par le président Nicolas Sarkozy, la chancelière Angela Merkel préférait une plus grande « intégration » rendant plus aisé le prononcé de sanctions et accordant une place accrue à la Cour de Justice. L’Allemagne faisant de la réforme des traités la condition sine qua non de sa solidarité financière, la perspective d’une révision fut officiellement ouverte par le Conseil européen du 23 octobre 2011.
Lors du Conseil européen du 9 décembre 2011, il est cependant apparu que l’unanimité des vingt-sept, requise pour engager, sur le fondement de l’article 48 TUE, une révision des traités n’était pas possible. Le Royaume-Uni refusait en effet une telle évolution. Dans ces conditions, c’est la voie d’un traité international, de nature intergouvernementale, qui fut retenue. Les principaux éléments de ce futur traité ont été précisés dans une déclaration des chefs d’État ou de gouvernement de la zone euro en date également du 9 décembre :
– des budgets à l'équilibre ou en excédent. En tout état de cause, le déficit structurel annuel ne devra pas excéder 0,5 % du PIB. La procédure de sanction pour déficit excessif reste cependant applicable aux déficits supérieurs à 3 % du PIB ;
– cette limitation du déficit sera introduite dans les systèmes juridiques nationaux des États membres au niveau constitutionnel. La Cour de justice est reconnue compétente pour vérifier la transposition de cette règle au niveau national ;
– en cas de déficit excessif, la « règle d’or » devra prévoir un mécanisme de correction automatique. Celui-ci sera mis au point par chaque État sur la base de propositions formulées par la Commission ;
– lorsqu’un État fait l'objet d'une procédure pour déficit excessif, il devra soumettre à la Commission et au Conseil, pour approbation, un programme de partenariat économique détaillant les réformes structurelles nécessaires pour assurer une correction véritablement durable des déficits excessifs. La mise en œuvre du programme, et les plans budgétaires annuels compatibles avec celui-ci, seront surveillés par la Commission et le Conseil ;
– un mécanisme sera mis en place afin que les États membres puissent donner à l’avance des indications sur leurs plans nationaux d'émission de dette.
Il a également été décidé à cette occasion d’intégrer au traité la création d’un « gouvernement économique » de la zone euro, incarné par le sommet des chefs d’État et de gouvernement de la zone euro qui se réunira au moins deux fois par an, disposant d’un président stable désigné pour deux ans et demi. Il s’agit de la traduction d’une proposition franco-allemande datée du 16 août 2011 et endossée par le Conseil européen du 26 octobre 2011.
La négociation du traité commença rapidement. Un groupe ad hoc fut mis en place, associant les représentants des États membres de la zone euro, ainsi que ceux des pays ne l’étant pas mais ayant accepté de prendre part au futur texte. Le Royaume-Uni y fut invité à titre d’observateur. Participèrent également aux réunions du groupe ad hoc des représentants de la Commission et du Parlement européen (22) ainsi que de la Banque centrale européenne.
La négociation du texte fit l’objet d’une transparence inhabituelle. Plusieurs versions du traité furent rendues publiques permettant ainsi de faire apparaître l’évolution des dispositions clefs et les autres changements significatifs entre la première version, datée du 16 décembre 2011 et la version finale (23).
Le lundi 30 janvier 2012, les chefs d’État et de gouvernement européens se sont réunis à Bruxelles pour un Conseil consacré à la croissance et à l’emploi, qui a été l’occasion de finaliser le « pacte budgétaire » et le traité sur le Mécanisme européen de stabilité. L’Allemagne souhaitait en effet lier ces deux textes, en conditionnant l’accès aux prêts du MES à la ratification du pacte, ce dernier constituant en effet le pendant disciplinaire de la solidarité organisée au travers d’un mécanisme de stabilité.
Ce sommet du 30 janvier 2012 fut marqué par le refus du premier ministre Tchèque Petr Necas d’engager son pays dans ce nouveau traité. Au delà des mesures budgétaires fixées par le traité, les plus vives discussions portèrent sur la participation aux sommets de l’euro institués par le traité. Alors que la France souhaitait réserver ces sommets aux seuls membres de la zone euro, la Pologne revendiquait une place pour les États n’ayant pas encore adopté l’euro. Comme votre rapporteure le décrira ultérieurement, un compromis a été trouvé en décidant que les pays non membres de la zone euro seraient invités à participer aux sommets « au moins une fois par an » lorsque serait discutée des politiques de compétitivité et lorsque les règles de fonctionnement de la zone euro, ou son « architecture générale », seraient changées.
Le TSCG fut signé le 2 mars 2012 par les chefs d’État ou de gouvernement de tous les États membres de l’UE, à l’exception du Royaume-Uni et de la République tchèque. Votre rapporteure entend maintenant le décrire et en apprécier la portée au regard, notamment, de la stratégie d’ensemble désormais mise en œuvre pour faire face à la crise de l’euro.
II – LE TRAITÉ BUDGÉTAIRE RESPECTE LA SOUVERAINETÉ DES ÉTATS ET S’INSCRIT DÉSORMAIS DANS UNE STRATÉGIE D’ENSEMBLE RÉÉQUILIBRÉE
A - Un traité dont la portée ne doit pas être surestimée
1. Un traité voulu par l’Allemagne et destiné à rassurer les marchés
Le traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l’Union économique et monétaire (TSCG) était-il indispensable ? Pour certains, « il n’était nullement besoin de passer par une modification des traités européens ou par la conclusion d’un traité ad hoc : la législation secondaire permet[tait] d’arriver au même résultat » (24). D’autres ont même évoqué « un traité pour rien » (25). Il est vrai que, sur bien des points, la valeur ajoutée du TSCG est relativement limitée. Comme votre rapporteure entend l’indiquer, la plupart de ses dispositions figurent déjà dans le Six pack et dans le Two pack. La portée du nouveau traité est donc d’abord symbolique et politique. Il a été fermement promu par l’Allemagne qui y a vu le pendant disciplinaire des mécanismes de solidarité mis en place à partir de 2010. Les autorités allemandes ont entendu consacrer dans une norme de haut niveau, ayant quasiment rang de « droit primaire », la volonté politique de respecter la discipline budgétaire et, ainsi, d’éviter les errements des années 2000 au cours desquelles de nombreux États européens, et notamment la France, ont peu à peu déconstruit le pacte de stabilité et de croissance.
Dans la mesure où le TSCG n’était pas vraiment nécessaire vis-à-vis des États en difficulté – ceux-ci ayant déjà dû, soit demander le bénéfice de plans de secours assortis de conditions bien plus rudes (cas de la Grèce, de l’Irlande et du Portugal), soit s’engager d’eux-mêmes dans des politiques sévères de restriction budgétaire (cas de l’Espagne et de l’Italie) –, on est même en droit de penser que c’est spécifiquement la France que l’Allemagne a voulu viser en obtenant le ralliement du précédent Président de la République à ce texte.
Le TSCG constitue également un signal adressé aux marchés. Celui de la prise de conscience, par les États membres, de l’effet néfaste de certains comportements passés mais aussi de leur volonté de reprendre pleinement en main leur avenir en réduisant leur dépendance financière et l’influence potentiellement dangereuse des marchés financiers.
2. Un traité compatible avec le droit communautaire et qui y ajoute peu
Comme votre rapporteure l’a déjà souligné, le TSCG ne fait pas formellement partie du droit de l’Union européenne. Il n’a été signé que par 25 États membres et la République tchèque et le Royaume-Uni n’entendent pas à en faire partie.
Pour autant, ce traité n’est pas étranger au droit communautaire.
En premier lieu, ainsi que le stipule son article 16, il a vocation, « dans un délai maximum de cinq ans à compter de son entrée en vigueur » et « sur la base d’une évaluation de l’expérience acquise lors de sa mise en œuvre », à voir son contenu intégré dans le cadre juridique de l’Union européenne.
En outre, le TSCG s’appuie sur les traités européens et les institutions actuelles. Il ne les remet absolument pas en cause et est parfaitement compatible avec le droit existant, notamment avec le pacte de stabilité et de croissance conclu en 1997 et révisé en 2011 par le Six pack. Les 25 États qui ont conclu le TSCG « sont liés par les obligations qui leur incombent en vertu des traités européens. De nouvelles règles peuvent s’y ajouter ; elles ne peuvent pas y déroger » (26). L’article 2 du traité précise qu’il doit être interprété et appliqué conformément au droit de l’Union européenne et qu’il ne s’applique que dans la mesure où il lui est compatible.
Au demeurant, ces « nouvelles règles » issues du TSCG sont finalement peu nombreuses. C’est principalement le cas de l’interdiction, à moyen terme, des déficits structurels supérieurs à 0,5 % du PIB. Pour le reste, comme on y reviendra, le traité reprend largement des dispositions déjà adoptées ou en voie de l’être dans des cadres juridiques communautaires plus classiques.
3. Une référence au déficit « structurel » qui laisse des marges de manœuvre aux politiques budgétaires nationales
L’interdiction, à moyen terme, des déficits structurels supérieurs à 0,5 % du PIB constitue le cœur du traité, son principal apport.
Or, la contrainte représentée par cette stipulation, si elle est réelle, laisse pourtant des marges de manœuvre significatives aux politiques nationales :
● D’abord, la notion de déficit « structurel » peut être définie de plusieurs manières. Ainsi certains États souhaiteraient-ils que l’on ne prenne pas en compte les dépenses d’investissement, ce que n’a pas demandé le gouvernement français.
● Ensuite, au-delà de la question de la définition, il y a celle du calcul, notamment du calcul du taux de croissance « potentiel » dont l’écart par rapport au taux effectif détermine le solde structurel.
● Plus généralement, sur le principe, on observera que le choix d’une référence au déficit public structurel, après neutralisation de l’impact de la conjoncture, a l’avantage d’écarter les politiques procycliques contraintes, dans lesquelles, face à une dégradation des comptes publics consécutive à une panne de croissance, les États se voient obliger d’y ajouter une contraction budgétaire qui accroît les difficultés.
● Enfin, il semble, pratiquement, que la contrainte imposée par le traité soit en fait inférieure à celles résultant des engagements politiques pris par les gouvernements.
Dans un article publié en juillet 2012, des économistes de l’OFCE ont défendu l’option d’un choix généralisé, dans la zone euro, de s’en tenir au respect du déficit structurel de 0,5 % du PIB au maximum posé dans le TSCG, mais en renonçant à l’objectif d’atteindre en 2017 un équilibre effectif des finances publiques (solde réel nul) – tout en respectant naturellement la « règle d’or » d’origine, à savoir ne pas dépasser le plafond de 3 % de déficit effectif. Selon eux et d’après des calculs économétriques, cette option, si elle laisserait subsister un certain niveau de déficit public en 2017 (1,5 % pour l’ensemble de la zone euro, 1,7 % pour la France), aurait l’avantage de moins comprimer la croissance et de sauvegarder de nombreux emplois ; elle ne conduirait pas nécessairement à un niveau de dette publique rapportée au PIB plus élevé (il y aurait plus de dette, mais aussi plus de PIB).
Les différents scénarios économiques et budgétaires, selon MM. Éric Heyer, Mathieu Plane et Xavier Timbeau (Évaluation du projet économique du quinquennat, OFCE, les notes, n° 23, juillet 2012) : Les auteurs, partant du projet économique et des engagements budgétaires du Gouvernement, s’efforcent d’en évaluer les conséquences sur les grands équilibres économiques. Ils relèvent en premier lieu que les résultats que l’on peut attendre d’une politique qui comporte une forte restriction budgétaire (puisque l’on réduit les déficits publics) dépendent largement de la valeur du « multiplicateur budgétaire », indicateur qui mesure l’effet sur le PIB des mesures budgétaires. Les différents modèles macroéconomiques en vigueur reposent sur des valeurs très variables de ce multiplicateur et les auteurs de l’article testent en conséquence trois valeurs, 0,5, 1 et 1,5, dont l’application serait susceptible de conduire à des résultats très différents en fin de quinquennat (plus le multiplicateur est élevé, plus les mesures de restriction budgétaire nuisent à la croissance et l’emploi, et par ricochet à la consolidation des finances publiques) : selon l’hypothèse choisie, le solde budgétaire reviendrait à l’équilibre (comme le Gouvernement s’y est engagé) ou non en 2017 ; le taux d’endettement public pourrait dans les hypothèses extrêmes baisser à un peu plus de 80 %, mais aussi rester proche de 95 % ; le taux de chômage pourrait revenir à 8 %, mais aussi atteindre 12 %... Les auteurs testent ensuite deux scénarios alternatifs à leur « scénario central » fondé sur un multiplicateur budgétaire égal à 1 et sur la mise en œuvre des mesures fiscales et budgétaires annoncées à ce jour : – celui où l’ensemble des gouvernements européens parviennent coûte que coûte, conformément aux engagements pris, à l’équilibre budgétaire en 2017 (ce qui pour les auteurs implique d’aller au-delà des mesures de restriction déjà annoncées) ; – celui où, prenant au mot les termes du traité budgétaire, les gouvernements européens se bornent à atteindre un objectif de 0,5 % de déficit structurel, sans viser l’équilibre effectif des finances publiques : « dans ce scénario, l’Allemagne, l’Italie et la Finlande arrêtent leur politique d’austérité dès 2013. La France et le Portugal doivent la poursuivre jusqu’en 2014. La Grèce doit la maintenir jusqu’en 2015. Les autres doivent la poursuivre jusqu’en 2017. Sous ces conditions, l’impulsion budgétaire en zone euro resterait négative chaque année au cours de la période mais plus faible (…). Pour l’économie française, le supplément d’activité économique induit par cette stratégie serait significatif : à l’horizon 2017, il s’élèverait à 1,4 %. Cela permettrait au chômage de baisser à partir de 2015 pour s’établir à 9 % en 2017 (…). Certes en 2017, contrairement aux engagements, l’équilibre des finances publiques ne serait pas atteint dans ce scénario : le déficit s’établirait à 1,7 point de PIB (…). En revanche, sous l’effet d’une croissance plus dynamique et sous l’hypothèse d’un maintien des taux d’intérêt à un niveau faible, la dette publique en points de PIB ne serait pas plus élevée dans ce scénario [que dans le scénario central reposant sur la mise en œuvre des mesures annoncées et sur l’hypothèse d’un multiplicateur budgétaire égal à 1]. En ce qui concerne l’emploi, le scénario alternatif (…) permettrait de sauvegarder-créer près de 230 000 emplois en cinq ans [par rapport au scénario central précité]. |
Cet article, on le voit, met aussi en lumière de grandes incertitudes quant à la modélisation de l’effet des différentes politiques possibles. Il ne s’agit donc pas de se rallier nécessairement à la position des auteurs, mais d’acter plusieurs points :
– la référence, dans le TSCG, à un objectif de 0,5 % du PIB en termes de déficit structurel est susceptible de laisser de réelles marges de manœuvre ;
– le débat sur la meilleure trajectoire économique et budgétaire est très sérieusement ouvert chez les économistes, qui reconnaissent au demeurant la nécessité d’affiner les modèles de prévision ; le débat politique devrait suivre, dans le cadre des débats sur la future loi organique et surtout la future loi de programmation des finances publiques ;
– les choix budgétaires courageux déjà annoncés par le Président de la République et le Gouvernement font plus que satisfaire les obligations du traité et ne sont pas imposés par ce dernier. Outre la nécessité de rassurer les investisseurs financiers aussi bien que nos partenaires européens sur le sérieux de la politique budgétaire française, ces choix répondent tout simplement à l’inquiétude des Français, lassés de la « culture de la dette » que la précédente majorité a laissé se développer (nonobstant les discours), et aux engagements pris durant la campagne électorale. Alors que le service de la dette est devenu le premier budget de la nation, le retour progressif à l’équilibre des comptes peut seul nous éviter de tomber dans la dépendance des marchés financiers. C’est aussi un devoir moral : nous ne pouvons pas faire supporter aux jeunes générations le poids du surendettement de leurs aînés.
Le ministre des affaires étrangères, M. Laurent Fabius, a très clairement exprimé devant la commission des affaires étrangères (27) les marges de politique économique que préserve le traité budgétaire : « le traité n’est pas incompatible avec une politique de croissance. Contrairement à une idée reçue, la limite de 0,5 % de déficit public autorisé par le traité n’est pas plus exigeante que celle prévue dans le traité de Maastricht, puisqu’il s’agit cette fois de déficit structurel – corrigé, donc, du déficit conjoncturel. Le traité n’impose de contraintes ni sur le niveau de la dépense publique, ni sur sa répartition, ni sur la méthode à suivre pour revenir à l’équilibre ». Sa conclusion était très simple : « si la France est amenée à faire des efforts de discipline budgétaire, ce n’est pas à cause du TSCG mais en raison de la situation objective dans laquelle elle se trouve ».
4. Une prise en compte des spécificités de chacun pour l’application par les États
On doit enfin noter que la rédaction du traité renvoie largement aux États pour les modalités de mise en œuvre de ses principales stipulations et est en fait assez peu directive en la matière : c’est ainsi qu’à l’article 3 du traité la transposition en droit national de la règle d’équilibre (« règle d’or ») n’impliquera finalement pas obligatoirement son inscription dans la Constitution, ou encore que le mécanisme de correction dit automatique en cas d’écarts par rapport à la trajectoire d’ajustement devra être mis en place par chaque État sur la seule base de « principes communs » et en tout état de cause dans le plein respect des prérogatives des parlements nationaux. C’est d’ailleurs en se fondant sur l’analyse de ces souplesses que le Conseil constitutionnel a jugé qu’une révision de notre Constitution ne s’imposait pas. Votre rapporteure reviendra naturellement plus en détail sur ces points en présentant les différentes stipulations du traité et la décision du Conseil constitutionnel.
B – Les trois piliers du traité
Le TSCG est divisé en trois parties principales (outre les parties consacrées conformément à l’habitude au champ d’application, à l’entrée en vigueur, etc.) : ces parties sont consacrées respectivement au pacte budgétaire, à la coordination des politiques économiques et à la gouvernance de la zone euro. Cette architecture rend compte d’un souci d’équilibre entre la surveillance budgétaire, chère en particulier à l’Allemagne, et des thèmes promus traditionnellement par d’autres pays, en premier lieu la France, comme celui du « gouvernement économique » européen. Le fait est cependant que cet équilibre est assez formel, les stipulations les plus substantielles concernant naturellement le volet budgétaire, tandis que celles des autres volets apparaissent parfois purement « cosmétiques », avec une rédaction assez vague ou une simple reprise d’éléments déjà acquis du droit communautaire.
1. Champ d’application, portée et entrée en vigueur du traité
Classiquement, le TSCG contient plusieurs articles déterminant son champ d’application, sa portée et les modalités de son entrée en vigueur. Ils sont regroupés dans le titre Ier (« objet et champ d’application ») et dans le titre VI (« dispositions générales et finales »).
Article 1er
L’article 1er définit l’objet et le champ du traité. Il indique notamment la volonté des parties contractantes « de renforcer le pilier économique de l’Union économique et monétaire » par une discipline budgétaire accrue, une coordination des politiques économiques et une amélioration de le gouvernance de la zone euro.
Cet article établit également un champ d’application différencié en fonction de la qualité de l’État contractant : si ce dernier appartient à la zone euro, tout le traité lui est applicable ; si tel n’est pas le cas, il peut choisir, ainsi que le précise l’article 14 (voir infra), les titres du TSCG auxquels il entend être liés.
Article 2
L’article 2 stipule que le TSCG doit être interprété et appliqué conformément au droit de l’Union européenne et qu’il ne s’applique que dans la mesure où il lui est compatible. Ainsi, droit primaire et droit dérivé priment sur le traité.
Article 14
De manière traditionnelle, l’article 14 rappelle que le traité doit être « ratifié par les parties contractantes conformément à leurs règles constitutionnelles respectives » et fait du secrétariat général du Conseil de l’Union européenne le dépositaire du texte. Le TSCG entrera en vigueur le 1er janvier 2013 si, à cette date, douze États membres de la zone euro l’ont ratifié. A défaut, cette entrée en vigueur interviendra dès que ce seuil sera atteint (28).
Au 19 septembre 2012, neuf États avaient transmis au Conseil leur instrument de ratification (29). L’Irlande a été le seul pays signataire du traité à choisir la voie référendaire. Le peuple irlandais l’a approuvé le 31 mai dernier par un peu plus de 60 % des voix mais les autorités de ce pays n’ont pas encore notifié l’achèvement de la procédure. La Belgique, quant à elle, est dans une situation quelque peu particulière : eu égard aux règles constitutionnelles propres à ce pays, le Roi ne pourra ratifier le TSCG qu’après l’autorisation du Parlement fédéral et de toutes les entités fédérées (régions et communautés).
Des États non membres de la zone euro ont signé ce traité. A la condition qu’ils l’aient ratifié, il s’appliquera pleinement à eux lorsqu’ils auront adopté la monnaie unique. Avant la réalisation de cette étape, ils pourront faire connaître leur intention d’être liés par « tout ou partie des dispositions des titres III et IV du traité ». Concrètement, les États n’ayant pas l’euro comme monnaie bénéficieront d’un régime « à la carte » tant qu’il en sera ainsi. Ils pourront par exemple choisir d’être liés par le « pacte budgétaire » mais pas par les dispositions relatives à la « coordination des politiques économiques ». En revanche, les dispositions relatives à la « gouvernance de la zone euro » (titre V) seront applicables à toutes les parties contractantes dès l’entrée en vigueur du traité.
Votre rapporteure constate que le TSCG peut ne revêtir aucune contrainte à l’égard des États extérieurs à la zone euro qui l’auraient signé. Aussi les refus britannique et tchèque de parapher le traité n’en sont-ils que plus décevants. Ils ne peuvent trouver comme justification que des considérations purement politiques et laissant une grande part à la méfiance à l’encontre du projet européen.
Article 15
L’article 15 autorise les États membres de l’Union européenne qui n’ont pas signé le TSCG à y adhérer. Comme votre rapporteure vient de l’évoquer, cette clause vise le Royaume-Uni et la République tchèque mais trouvera également à s’appliquer à l’occasion des élargissements à venir, notamment, la Croatie dès 2013.
Article 16
Enfin, l’article 16 prévoit l’incorporation du contenu du traité dans le cadre juridique de l’Union européenne dans un délai de cinq ans à compter de son entrée en vigueur.
Intitulé « Pacte budgétaire », le titre III du traité (articles 3 à 8) entend renforcer la discipline budgétaire au sein des États membres de la zone euro.
Article 3
L’article 3 constitue assurément le cœur du traité.
Son premier paragraphe pose tout d’abord le principe de l'équilibre ou de l'excédent des budgets des administrations publiques. Ce qu’il est coutume d’appeler désormais la « règle d’or » est cependant aussitôt tempéré : poussé à l’extrême, ce principe serait assurément absurde et dangereux. Aussi ne sera-t-il pas enfreint « si le solde structurel annuel des administrations publiques correspond à l’objectif à moyen terme spécifique à chaque pays, tel que défini dans le pacte de stabilité et de croissance révisé, avec une limite inférieure de déficit structurel de 0,5 % du produit intérieur brut au prix du marché ». En outre, ce même article appelle les États contractants à une « convergence rapide vers leurs objectif à moyen terme » selon un calendrier établi sur proposition de la commission européenne. La principale modification par rapport au droit en vigueur consiste dans le taux de 0,5 % visé. En effet, aujourd’hui, le règlement n°1466/97 tel que modifié par le Six pack prescrit que l’objectif à moyen terme (OMT) doit être compris, selon les États, « entre - 1 % du PIB et l’équilibre ou l’excédent ». Sur cette question du taux, on notera que l’article 3 du traité autorise les États à relever la limite inférieure de leur OMT à un déficit de 1 % du PIB si leur ratio d’endettement « est sensiblement inférieur à 60 % et lorsque les risques pour la soutenabilité à long terme des finances publiques sont faibles ». Il autorise également un État à s’écarter temporairement de son OMT ou de sa trajectoire d’ajustement vers l’OMT « en cas de circonstances exceptionnelles », ce qui inclut les cas de récession économique. A cet égard, le dernier alinéa de l’article 3 donne une définition de ces « circonstances exceptionnelles » qui reprend celle du pacte de stabilité réformé. On a donc une double souplesse avec, d’une part la prise en compte des variations conjoncturelles avec la référence au déficit structurel, d’autre part, la possibilité cumulative d’invoquer des circonstances exceptionnelles.
Ce même paragraphe stipule que chaque État contractant se dote d’un mécanisme de correction pouvant se déclencher automatiquement « si des écarts importants sont constatés par rapport à l’objectif à moyen terme ou à la trajectoire d’ajustement propre à permettre sa réalisation ». Ces mécanismes nationaux devront comporter l’obligation pour un État concerné de mettre en œuvre des mesures visant à corriger ces écarts sur une période déterminée et devront être mis en place « sur la base de principes communs proposés par la Commission européenne ». Cette dernière l’a fait le 20 juin dernier (COM(2012) 342 final (30)). Le traité dispose enfin que les mécanismes de correction respecteront « pleinement les prérogatives des parlements nationaux ».
Par ailleurs, le paragraphe 2 de l’article 3 du TSCG exige que des institutions indépendantes soient désignées, au niveau national, pour contrôler l’application et le respect de la règle de l’équilibre budgétaire. Il ne fait que reprendre, ici, une des dispositions contenues dans le Two pack, qui invite chaque État à mettre en place un « conseil budgétaire indépendant », chargé d'évaluer la mise en oeuvre des règles budgétaires nationales (31). La création d’une telle instance sera un vrai « plus » pour les parlements nationaux. Elle ne pourra qu’accroître la qualité et l’indépendance de leur jugement vis-à-vis des projets gouvernementaux.
Le traité n’est pas un ensemble de déclarations d’intention. Il pose des règles qui ont vocation à être effectivement prises en compte par les États signataires. Ce même article 3 stipule ainsi que, dans l’année qui suit l’entrée en vigueur du texte, les parties devront inscrire dans leur droit national une règle d’équilibre budgétaire compatible avec les dispositions du traité, « au moyen de dispositions contraignantes et permanentes, de préférence constitutionnelles, ou dont le plein respect et la stricte observance tout au long des processus budgétaires nationaux sont garantis de quelque autre façon ». Cette obligation de transcription de la « règle d’or » dans une norme stable et protégée constitue assurément la principale innovation du TSCG par rapport au droit actuel. Comme votre rapporteure entend le préciser ultérieurement, le Conseil constitutionnel, dans sa décision 653 DC du 9 août 2012 a précisé la portée de l’article 3 du TSCG au regard du droit français. D’ores et déjà, le Gouvernement en a tiré toutes les conséquences en déposant un projet de loi organique définissant une règle d’équilibre budgétaire conforme au traité et prévoyant les modalités de sa mise en œuvre dans le plein respect des prérogatives du Parlement.
Article 4
L’article 4 oblige tout État présentant un ratio d’endettement supérieur à 60 % du PIB à réduire sa dette dépassant cette valeur à un rythme moyen d’un vingtième par an. Le renvoi opéré par l’article 4 au Six pack (plus précisément au règlement n° 1177/2011 du 8 novembre 2011 modifiant le règlement n° 1467/97 visant à accélérer et à clarifier la mise en œuvre de la procédure concernant les déficits excessifs) permet de préciser que ce rythme sera apprécié sur trois années.
La rigueur apparente de cet article doit en outre être atténuée du fait de ce renvoi au Six pack. En effet, le deuxième alinéa du paragraphe 1 bis de l’article 2 du règlement n° 1467/97 modifié stipule que « pour un État membre soumis à une procédure concernant les déficits excessifs à la date du 8 novembre 2011 et pendant une période de trois ans à compter de la correction du déficit excessif, l’exigence relative au critère de la dette est considérée comme remplie si l’État membre concerné réalise des progrès suffisants vers la conformité, tels qu’évalués dans l’avis formulé par le Conseil sur son programme de stabilité ou de convergence ».
Ainsi, la France, tout comme vingt autres États membres faisant, aujourd’hui, l’objet d’une procédure pour déficit excessif (32), ne sera pas concernée avant 2017 par l’article 4 du TSCG.
Article 5
L’article 5 prévoit que tout État contractant sous le coup d’une procédure pour déficit excessif établira un « programme de partenariat budgétaire et économique » qui devra, entre autres, comporter « une description détaillée des réformes structurelles à établir et à mettre en œuvre » et qui devra recevoir l’aval de la Commission et du Conseil. La définition du contenu et du format de ces programmes de partenariat est renvoyée à un acte européen de droit dérivé. Cette disposition s’inscrit dans la continuité des pratiques existantes de dépôt périodique de documents et de dialogue entre les États et les institutions européennes : par exemple, dans le cadre du pacte de stabilité et de croissance, les États doivent présenter des « programmes de stabilité » au Conseil et à la Commission.
Article 6
L’article 6 invite les parties à transmettre à l’avance au Conseil et la Commission leurs plans d’émission de dette publique. Comme l’indique l’étude d’impact adossée au projet de loi qui nous est soumis, « cette disposition vise à prévenir les situations de concomitance d’émissions susceptibles de provoquer des tensions sur les marchés ». Elle figure déjà dans le Two pack en cours de négociation et constitue un premier pas dans le sens de la coordination des émissions des dettes des États de la zone euro.
Le Gouvernement a indiqué à votre rapporteure que les modalités de mise en œuvre de cet article ne sont pas encore arrêtées. Comme le rappelle le préambule du traité, l’information sur les plans nationaux d’émission de dette publique doit encore faire l’objet d’une proposition législative de la Commission.
Article 7
L’article 7 du TSCG vise à revenir sur une des lacunes du droit actuel, lequel rend quasi-impossible le déclenchement des procédures pour déficit excessif. En effet, même après l’entrée en vigueur du Six pack, le Conseil restera toujours un verrou difficile à franchir puisqu’il lui appartient, à la majorité qualifiée habituelle, de « constater » le déficit excessif, préalable indispensable à tous les autres étapes.
A travers l’article 7, les États membres de la zone euro « s’engagent » à appuyer les propositions ou recommandations de la Commission relatives à un État en situation de déficit excessif, sauf si une majorité qualifiée d’entre eux n’y est pas favorable. Cette rédaction étrange vise à éviter que le texte du TSCG n’apparaisse en contradiction avec les règles de majorité qui figurent explicitement à l’article 126 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Mais, concrètement, cela reviendra à appliquer le principe de majorité qualifiée inversée lorsqu’un État ne respectera pas le critère du déficit. Cette disposition s’inscrit encore dans la continuité du Six pack, qui a prévu la même chose pour le vote sur les sanctions éventuelles. Le traité empêchera ainsi de renouveler l’expérience de 2003 lorsqu’une simple minorité de blocage avait pu mettre un terme aux procédures engagées contre la France et l’Allemagne.
Cet article 7 appelle toutefois trois commentaires. Tout d’abord, il n’est pas contraire à la Constitution. Ainsi en a décidé le Conseil constitutionnel lorsqu’il a été saisi du TSCG (voir infra). En effet, il ne contient qu’un simple engagement d’appliquer une règle de majorité plus contraignante que celle prévue par le droit de l’Union européenne. Il ne vient pas se substituer à une règle imposant l’unanimité. En outre, l’article 7 ne vise que les seules procédures fondées sur la méconnaissance du critère de déficit public et non celles liées à l’évolution de la dette dont l’insuffisance ne pourra être constatée et sanctionnée que si le Conseil, à la majorité qualifiée, lance la procédure. Enfin, cet article a une portée procédurale mais, sur le fond, il ne remet pas en cause la logique des sanctions pécuniaires qui prévaut dans le pacte de stabilité. On peut s’interroger sur l’opportunité et la crédibilité de sanctions pécuniaires. Car « sanctionner financièrement un État dont les finances publiques sont déjà dégradées n’apparaît guère réaliste »(33). Des sanctions plus politiques et donc plus crédibles, comme, par exemple, la suspension du droit de vote au Conseil, seraient sans doute plus adaptées.
Article 8
L’article 8 précise les conditions du contrôle, par la Cour de justice de l’Union européenne, de la transposition de la règle d’équilibre budgétaire prévue au paragraphe 2 de l’article 3. La Commission devra présenter un rapport concernant la mise en œuvre par chaque État contractant de ces dispositions. Si la Commission, après avoir donné à l’État concerné la possibilité de présenter ses observations, conclut qu’il n’a pas rempli ses obligations, l’affaire pourra être portée devant la Cour de justice par un autre des État parties au TSCG. En outre, si l’un d’eux estime, indépendamment du rapport de la Commission, qu’un autre État ne s’est pas conformé au deuxième paragraphe de l’article 3, elle pourra également porter la question devant la Cour de justice. Dans les deux cas, l’arrêt de la Cour aura une portée contraignante et devra fixer un délai à l’État fautif pour prendre les mesures nécessaires. Dans un second temps, tout État pourra demander à la Cour de justice d’infliger des sanctions financières à un État qui, ayant fait l’objet d’un arrêt constatant qu’il n’avait pas transposé la règle d’équilibre budgétaire, ne se serait pas conformé à cet arrêt. La Cour pourra alors infliger une amende ne pouvant dépasser 0,1 % du PIB de l’État incriminé. Cette somme, si elle est imputable à un État de la zone euro, sera versée au mécanisme de stabilité financière et au budget général de l’Union européenne dans les autres cas.
Il convient d’avoir à l’esprit que cet article du TSCG n’autorisera pas la Cour de justice de l’Union européenne à connaître du respect de la règle d’équilibre budgétaire par le législateur national. En aucun cas les lois de finance de chaque État membre ne seront déférées aux juges de Luxembourg afin que ceux-ci en examinent la teneur et sanctionnent, éventuellement, leur incompatibilité avec les règles de discipline budgétaire. Ces lois sont et demeureront des actes de souveraineté, adoptés par chaque parlement, conformément aux constitutions nationales. Le vote du budget est un moment fort dans la vie publique et est à l’origine du parlementarisme moderne. Le TSCG n’entend pas le remettre en cause. Cette neutralité, toutefois, n’empêchera pas le droit commun de s’appliquer en cas de déficit excessif : la procédure définie à l’article 126 du TFUE continuera de pouvoir être exercée à l’encontre des États concernés.
Par ailleurs, le troisième – et dernier – paragraphe de l’article 8 précise que ce dernier « constitue un compromis entre les Parties contractantes au sens de l’article 273 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne », lequel dispose que « la Cour de justice est compétente pour statuer sur tout différend entre États membres en connexité avec l’objet des traités, si ce différend lui est soumis en vertu d’un compromis ». Cette référence à l’article 273 constitue la base juridique de la compétence de la Cour de justice dans le cadre du TSCG dans la mesure où celui-ci n’appartient pas au cadre juridique de l’Union européenne. Elle était indispensable pour que la Cour puisse agir et le choix de ce fondement juridique explique aussi que, sous l’empire de l’article 8 du TSCG, les recours devant la Cour puissent être portés seulement par les États membres et non par la Commission.
Enfin, l’exposé sommaire annexé au projet de loi soumis à l’Assemblée nationale indique que l’article 8 a fait l’objet d’arrangements, qui, sans faire partie du traité, ont été annexés au procès-verbal lors de sa signature. Ils précisent les conditions de mise en œuvre de l’article en prévoyant, en particulier, que c’est au « trio de présidences » (34) du Conseil de l’Union européenne qu’il revient, dans les trois mois suivant la réception du rapport de la Commission, de déposer devant la Cour de justice la requête visant à faire constater qu’un État contractant n’a pas respecté l’obligation de transposer la règle d’or dans son droit national. Un tel arrangement dispensera ainsi un État en particulier d’agir ouvertement à l’encontre d’un autre État, ce qui pourrait être source de vives tensions. Le fait de confier au « trio » la tâche de saisir la Cour devrait ainsi avoir pour effet de rendre plus aisée la poursuite de la procédure.
3. La coordination des politiques économiques
Le titre IV du traité, intitulé « Coordination des politiques économiques et convergence », comprend trois articles.
Article 9
La portée juridique de l’article 9 est loin d’être évidente. Il contient l’engagement des États contractants à renforcer la coordination de leurs politiques économiques dans un sens favorable au bon fonctionnement de l’UEM et au renforcement de la croissance et de la compétitivité. Dans ce but, il fixe un champ extrêmement large à la coordination économique, englobant « tous les domaines essentiels au bon fonctionnement de la zone euro, en vue de réaliser les objectifs que constituent le renforcement de la compétitivité, la promotion de l’emploi, une meilleure contribution à la soutenabilité des finances publiques et un renforcement de la stabilité financière ».
Votre rapporteure ne peut qu’approuver cet appel à la coordination des politiques économiques, même si sa portée normative est faible, tout en regrettant vivement que les dimensions sociale et environnementale y aient été omises.
Article 10
L’article 10 prévoit que les États contractants recourent, si cela s’avère nécessaire, aux mesures spécifiques aux États membres ayant adopté l’euro et aux coopérations renforcées « pour les questions essentielles au bon fonctionnement de la zone euro, sans porter atteinte au marché intérieur ».
Pour mémoire, les mesures propres aux États de la zone euro sont prévues par l’article 136 du TFUE, lequel les autorise à prendre des dispositions pour « renforcer la coordination et la surveillance de leur discipline budgétaire » ou « élaborer, pour ce qui les concerne, les orientations de politique économique, en veillant à ce qu’elles soient compatibles avec celles qui sont adoptées pour l'ensemble de l'Union, et en assurer la surveillance » (35).
Article 11
Comme les deux articles qui le précèdent, l’article 11 n’a pas de valeur juridique évidente. Dans le but d’évaluer les meilleures pratiques et œuvrer à une politique économique plus coordonnée, il prescrit que toutes les grandes réformes de politique économique envisagées soient préalablement débattues voire coordonnées entre elles.
4. La gouvernance de la zone euro
Le titre V (articles 12 et 13) tend à formaliser davantage la gouvernance de la zone euro.
Article 12
Cet article consacre l’existence de sommets de la zone euro, convoqués régulièrement depuis l’automne 2008. Ces sommets « réunissent de manière informelle » les chefs d’État et de gouvernement des pays dont la monnaie est l’euro. Y participent également le président de la Commission européenne ainsi que le président de la BCE. Le président du Parlement européen peut, lui, être invité à être entendu.
De manière générale, l’article 12 stipule que ces sommets se réunissent au moins deux fois par an pour examiner les questions propres aux pays dont la monnaie est l’euro. Son paragraphe 3 précise cependant que les chefs d’État ou de Gouvernement des États contractants, non membres de la zone euro, participent aux discussions « concernant la compétitivité pour les Parties contractantes, la modification de l’architecture globale de la zone euro et les règles fondamentales qui s'appliqueront à celle-ci dans l’avenir ».
Pour assurer « la préparation et la continuité » des travaux des sommets, les chefs d’État ou de gouvernement des parties contractantes dont la monnaie est l’euro désignent, à la majorité simple, un « président du sommet de la zone euro ». Cette désignation intervient lors de l’élection du président du Conseil européen et pour un mandat de durée identique.
Si M. Herman Van Rompuy, le président du Conseil européen, a été désigné président des sommets de la zone euro en mars dernier, rien n’impose un tel cumul. A l’avenir, il serait tout à fait possible de nommer le président de la Commission européenne ou de désigner une personne n’exerçant que cette fonction(36).
A l’issue de chaque sommet, il reviendra à son président de présenter un rapport au Parlement européen et de tenir informés les États parties au TSCG mais n’ayant pas l’euro comme monnaie des préparatifs et résultats des réunions.
Enfin, l’article 12 reconnaît l’Eurogroupe comme l’organe chargé de la préparation et du suivi des sommets de la zone euro.
Article 13
L'article 13 soulève la question du contrôle démocratique de la mise en œuvre du traité. Le sujet est d’importance et votre rapporteure vous soumet une proposition de résolution pour associer notre Assemblée au suivi des différentes étapes qui rythment désormais les processus budgétaires en Europe.
Cet article prévoit l’organisation d’une conférence réunissant les représentants des commissions compétentes du Parlement européen et des Parlements nationaux, afin de discuter des politiques budgétaires et d'autres questions régies par le traité.
Il est indispensable qu’un tel organe puisse rapidement être mis en place dès l’entrée en vigueur du traité. Les représentants des commissions des finances des différents parlements auront naturellement vocation à y siéger, mais il est souhaitable que le format retenu soit suffisamment large pour permettre à des parlementaires issus d’autres commissions, telles que celles chargées des affaires étrangères et des affaires européennes, de participer aux travaux de la conférence.
C – Au-delà du traité, les prémices d’un compromis global pour rompre avec des plans uniquement centrés sur l’austérité
1. Une approche nouvelle bienvenue, impulsée par le nouvel exécutif français et désormais soutenue par nos partenaires
L’arrivée aux responsabilités de M. François Hollande et de la majorité de gauche s’est immédiatement traduite par une réorientation du cours de la politique européenne. Les résultats obtenus lors du Conseil européen fin juin, sur lesquels on reviendra naturellement, en sont la manifestation la plus concrète. Mais au-delà, c’est un nouvel équilibre politique qui se dessine entre les grands pays européens, équilibre dans lequel la France est désormais en mesure de plaider efficacement pour une relance de l’Europe qui ne soit pas centrée exclusivement sur la discipline budgétaire.
Votre rapporteure s’est rendue du 12 au 14 septembre à Berlin et à Rome, où elle a pu rencontrer de nombreux responsables politiques, certains de très haut niveau. L’objet de ce déplacement était moins un échange technique sur le traité budgétaire qu’un échange politique sur la crise européenne actuelle. Dans la situation présente, non seulement les gouvernants, mais aussi les parlementaires doivent entretenir des relations régulières : d’une part, c’est une réponse au déficit démocratique de l’Europe ; d’autre part, il nous est nécessaire de bien comprendre, au-delà des déclarations politiques, la perception générale qu’ont nos partenaires – tant au niveau des parlements que des opinions publiques – de la crise et des solutions à y apporter ; eux-mêmes, réciproquement, souhaitent mieux comprendre les fondements des positions prises par la France.
En Allemagne, votre rapporteure a pu observer que ce pays, après avoir subi une vive récession en 2009, au lendemain de la crise américaine, a connu une véritable embellie ensuite et conserve une situation enviable à ce jour, malgré la crise de la zone euro. Le chômage n’a cessé de baisser jusqu’à ces derniers mois (une inversion de tendance se dessine) et les salaires augmentent (enfin !). L’opinion publique de ce pays à la situation plutôt favorable est marquée par la référence aux hyperinflations du passé (1923, 1948) et convaincue des mérites de la « culture de stabilité » : les recettes allemandes éprouvées semblent les seules à donner de bons résultats. Cette opinion vit également dans la crainte que la prospérité présente soit remise en cause par une diffusion de la crise de l’Europe du sud, sur fond d’une inquiétude extrêmement aiguë sur l’avenir d’une Allemagne en déclin démographique. Cette opinion est enfin – légitimement – très attachée au concept de contrôle démocratique du budget, ce contrôle étant assuré par le Bundestag.
C’est au regard de ces craintes qu’il faut analyser la décision rendue le 12 septembre dernier sur le Mécanisme européen de stabilité (MES) par la Cour constitutionnelle de Karlsruhe et l’accueil reçu par cette décision. Pourquoi la Cour constitutionnelle a-t-elle cru bon de demander au Gouvernement de prendre de nouvelles assurances sur une chose qui paraît évidente à la lecture du traité MES, à savoir qu’en application de ce traité l’Allemagne ne peut être appelée à contribuer au-delà de 27 % des 700 milliards d’euros de capital appelable maximal, soit 190 milliards ? Sans doute parce que la crainte la plus communément diffusée dans l’opinion publique porte aujourd’hui sur une éventuelle responsabilité illimitée de l’Allemagne : en cas de défaillance des autres contributeurs au MES (et plus généralement à tous les mécanismes de solidarité), l’Allemagne ne risque-t-elle pas d’être en quelque sorte appelée en « comblement de passif » à payer pour tous ? La notion de responsabilité limitée apparaît à ce jour essentielle dans le débat interne allemand. Un député membre de la CSU (Union chrétienne sociale, dominante en Bavière) rencontré par votre rapporteure prône ainsi l’établissement pour la zone euro d’une sorte de « règlement de faillite » qui garantirait la responsabilité limitée de chaque État membre et organiserait l’éventuelle banqueroute de l’un d’entre eux. À son avis, pour sauver la zone euro, l’expulsion de la Grèce est inévitable, solution heureusement rejetée par la Chancelière, qui, après quelques hésitations, a marqué sur ce sujet son accord avec le Président de la République.
Dans ce contexte, la classe politique allemande prend ses responsabilités. Elle a dans son ensemble, à l’exception de quelques personnalités minoritaires, salué la décision de la Cour constitutionnelle, alors que l’opinion publique aurait sans doute souhaité un coup de frein plus net sur la solidarité financière européenne.
Les positions politiques ont évolué ces derniers mois dans le sens de la préservation de l’intégrité de la zone euro :
– la chancelière fédérale, Mme Angela Merkel, s’est ainsi prononcée clairement pour le maintien de la Grèce dans la zone euro – le 24 août dernier, à l’occasion de la visite du premier ministre grec à Berlin –, après une période où la position allemande avait pu apparaître plus dubitative (37) ;
– de même, l’annonce le 6 septembre dernier d’une possibilité de rachat illimité des titres de dette des pays en difficulté par la Banque centrale européenne peut être présentée comme un contournement de la clause de non renflouement des États, a suscité l’opposition formelle de la Bundesbank et passe très mal dans l’opinion publique allemande (selon un sondage, 50 % des Allemands seraient hostiles aux rachats de titres par la BCE contre 13 % favorables). Cette évolution marquée et remarquable a cependant été saluée par la Chancelière, même si c’est en des termes ambigus, qui rappellent l’une des « lignes rouges » qui restent infranchissables pour l’Allemagne : « la BCE agit de manière indépendante et dans le cadre de son mandat ».
Cette atténuation de certaines des positions allemandes les plus dures doit sans doute beaucoup à la capacité du nouveau Président de la République à agir en étroite liaison avec M. Mario Monti, Président du conseil italien. À Rome, votre rapporteure a pu constater la très grande convergence entre les positions défendues par la nouvelle majorité en France et celles de la grande majorité de la classe politique italienne qui soutient le gouvernement de M. Monti, qu’il s’agisse de parlementaires membres du Parti démocrate, de l’Union du centre ou de Peuple de la liberté (parti de M. Silvio Berlusconi).
Il convient de garder à l’esprit qu’ensemble la France et l’Italie, en contribuant au Mécanisme européen de solidarité respectivement à hauteur de 20 % et 18 %, apporteront plus à ce dispositif que l’Allemagne (27 %). Du point de vue de nos partenaires allemands, chez qui se répand la crainte que leur pays risque d’être amené à payer pour tous les autres, il est essentiel, cela a été répété à votre rapporteure à Berlin, que les autres contributeurs, à commencer par la France et l’Italie, restent solides et soient totalement crédibles. Cela explique le soulagement qui a suivi l’arrivée au pouvoir de M. Monti et l’appui résolu (et admiratif – légitimement) dont il bénéficie à Berlin. Cela doit nous convaincre aussi de l’enjeu des décisions récemment annoncées à Paris quant au respect de l’objectif de 3 % du PIB de déficit public en 2013, quelque soit l’effort considérable que cela implique. Face aux inquiétudes allemandes, il est déterminant que les autres grands pays aient une politique économique et budgétaire crédible ; à ce prix, on a déjà pu le constater, ils sont et seront en mesure d’infléchir les positions de l’Allemagne.
2. Le Conseil européen des 28 et 29 juin 2012 : des mesures nécessaires et cohérentes
Le Conseil européen des 28 et 29 juin 2012 restera dans l’histoire de l’Union comme celui où les dirigeants européens auront réussi à définir, pour la première fois, une réponse équilibrée et cohérente à la crise de la zone euro et à tracer une perspective globale pour l’avenir de l’Union européenne. Au cours des deux années précédentes, de Conseil en Conseil – celui-ci était le dix-neuvième –, l’Union n’avait fait qu’apporter des réponses tardives et insuffisantes à la crise. Surtout, les décisions étaient profondément déséquilibrées, la généralisation de plans d’austérité ayant compromis la croissance, fait exploser le chômage et la pauvreté et rendu plus difficile encore la réduction des déficits et de la dette.
Grâce notamment à l’action du Président de la République, les dirigeants européens ont adopté une stratégie d’ensemble comprenant des mesures immédiates et concrètes de soutien à la croissance, une supervision bancaire européenne, une taxe sur les transactions financières, des mesures de solidarité pour diminuer le coût des emprunts et aider les États en difficulté à maîtriser leur dettes ; des perspectives pour améliorer le fonctionnement de la zone euro par une « intégration solidaire ».
Un des principales conclusions du Conseil européen des 28 et 29 juin 2012 a été l’adoption d’un « Pacte pour la croissance et l’emploi » (38) destiné à « stimuler le financement de l’économie » par la mobilisation de 120 milliards d’euros « en faveur de mesures de croissance à effet rapide »(39). Selon le ministre des affaires étrangères, l’impact de cette mesure devrait même être plus que doublé si l’ont tient compte de l’effet de levier que l’injection de ces 120 milliards d’euros aura sur l’investissement privé (40).
Ce pacte comprend tout d’abord une augmentation de 10 milliards d’euros du capital de la Banque européenne d’investissement, et ce, afin de permettre d’accroître de 60 milliards d’euros la capacité de prêts de l’institution.
En outre, le Conseil a décidé de redéployer 55 milliards d’euros de fonds structurels qui n’avaient pas encore été engagés. Cette réorientation devra bénéficier aux PME et à l’emploi des jeunes.
Par ailleurs, le pacte pour la croissance et l’emploi implique une accélération de la mise en œuvre de project bonds– c’est-à-dire d’emprunts pour financer des projets – pouvant aller jusqu’à 4,5 milliards d’euros.
Enfin, il a été décidé que l’ensemble des politiques de l’Union européenne serait mobilisées pour favoriser la production et améliorer la compétitivité industrielle. A ce titre, le Conseil des 28 et 29 juin 2012 est parvenu à un accord historique sur le « brevet unitaire » européen qui « permettra de réduire considérablement les coûts pour les PME et dopera l’innovation grâce à un brevet abordable et de grande qualité en Europe et à une juridiction spécialisée unique » (41).
b) La création d’une taxe sur les transactions financières
Le Conseil européen des 28 et 29 juin 2012 a permis une avancée significative vers la création d’une taxe sur les transactions financières. L’unanimité ne pouvant être atteinte à ce sujet, plusieurs États membres ont émis le vœu que soit mise en place une coopération renforcée en la matière avec l’objectif qu’un tel mécanisme soit adopté d'ici décembre prochain.
c) La mise en place d’une supervision bancaire européenne
Autre perspective importante, le Conseil européen des 28 et 29 juin derniers a décidé d’instituer un système de supervision bancaire, impliquant la Banque centrale européenne. Cette évolution devrait permettre au mécanisme européen de solidarité d’intervenir en recapitalisation directe des banques en difficulté et de replacer le soutien apporté aux banques dans le cadre du renforcement de la régulation financière et d’une volonté de favoriser le financement de l’économie réelle. A cet égard, la supervision bancaire intégrée constitue la première étape vers une « Union bancaire », comprenant également un cadre intégré de garantie des dépôts des épargnants et de résolution bancaire.
d) Une solidarité financière accrue
Enfin, les chefs d’État et de gouvernement de la zone euro sont convenus d’une recapitalisation du secteur bancaire espagnol, l’aide étant apportée par le FESF, en attendant la mise en place effective du MES. Le gouvernement espagnol a obtenu de plus que le MES ne soit pas considéré comme un créancier prioritaire, afin de rassurer les autres investisseurs.
Ultérieurement et de manière générale, le MES pourra recapitaliser directement les banques une fois la supervision bancaire commune en place.
Par ailleurs, les chefs d’État et de gouvernement ont ouvert la voie à un « recours aux instruments existants du FESF/MES de manière souple et efficace afin de stabiliser les marchés pour les États membres qui respectent leurs recommandations par pays et leurs autres engagements, y compris leurs calendriers respectifs, dans le cadre du semestre européen, du pacte de stabilité et de croissance et de la procédure concernant les déséquilibres macroéconomiques » (42). Cette phrase sibylline, correspondant aux attentes de l’Italie, laisse ouverte la possibilité d’octroyer l’aide des fonds de secours sans que les pays bénéficiaires aient à négocier un plan d’aide spécifique (comme ont dû le faire la Grèce, l’Irlande et le Portugal), dès lors qu’ils respectent les engagements pris dans le cadre des procédures communautaires de surveillance « de droit commun ».
Ces différentes décisions convergent vers une mise en œuvre plus souple et plus réactive des instruments de secours.
Enfin, le Conseil européen a chargé M. Van Rompuy, son président, en collaboration avec les présidents de la Commission, de la Banque centrale européenne et de l’Eurogroupe, de préparer une « feuille de route spécifique et assortie d'échéances précises pour la réalisation d'une véritable union économique et monétaire » (43). Dans l’esprit des propositions déjà formulées par M. Van Rompuy, l’idée est de promouvoir, à terme, la notion d’« intégration solidaire » : à chaque étape de l’intégration doit désormais correspondre un réel approfondissement de la solidarité. Un rapport intermédiaire sera présenté en octobre 2012 et un rapport final avant la fin de l’année. Ce document devra distinguer ce qu’il est possible de faire dans le cadre des traités existants de ce qui nécessiterait leur révision.
III – LA MISE EN œUVRE DU TRAITÉ DOIT OUVRIR DE NOUVELLES PERSPECTIVES POUR LA CONSTRUCTION EUROPÉENNE
Le traité budgétaire doit être ratifié, compte tenu des marges de souplesse permises par sa rédaction, de son apport limité au regard des autres dispositions du droit européen et des engagements de redressement des finances publiques pris de toute façon, dans l’intérêt national, par le Président de la République. De plus, il faut garder à l’esprit que le TSCG et le traité instituant le Mécanisme européen de solidarité sont complémentaires ; les États qui n’auraient pas ratifié le premier ne pourront bénéficier du second (non plus que leurs banques dans le cadre de la nouvelle possibilité de recapitalisation directe de celles-ci). Enfin, le TSCG est désormais complété par les acquis du sommet européen de juin dernier.
Mais après cette ratification que nous allons, je l’espère, opérer pour permettre la poursuite de la dynamique initiée en juin, il nous appartiendra de veiller à ce que sa mise en œuvre s’accompagne de perspectives nouvelles pour l’Europe et ses citoyens. C’est pourquoi il nous faut certes transposer dans nos processus budgétaires la règle d’équilibre, mais il faut aussi que les décisions de principe du sommet des 28 et 29 juin débouchent rapidement sur des réalisations concrètes.
Dans ce contexte, votre rapporteure souligne les enjeux qui s’attachent à une implication fortement accrue de notre Parlement. Le fait est que les mécanismes de coordination et de surveillance qui se mettent en place avec le traité budgétaire, le semestre européen et le futur Two pack touchent de près aux prérogatives budgétaires des parlements, qui sont fondamentales ; le fait est aussi que ces nouveaux mécanismes comportent un dialogue formalisé entre les institutions européennes et les États membres. Il est essentiel que le parlement français prenne toute sa place dans ce dialogue. Nous aurons par ailleurs à surveiller l’avancée des chantiers ouverts lors du sommet de juin.
À plus long terme, le renforcement de la coordination et de la discipline budgétaires dans lequel la zone euro est engagée conduit inévitablement à reposer les questions du gouvernement économique européen, voire de l’union politique.
A – La « règle d’or » : le choix d’une loi organique protège la souveraineté nationale
1. La diversité des réponses choisies par nos partenaires européens
Le traité budgétaire laissant, ainsi qu’on l’a dit, une large liberté aux États pour la transposition de ses clauses dans leur droit interne, les options retenues apparaissent multiples.
● Pour ce qui est de la transposition de la règle d’équilibre budgétaire (« règle d’or »), d’après les éléments transmis par les ministères des affaires étrangères et des affaires européennes, plusieurs États ne semblent pas en avoir encore choisi les modalités. C’est le cas de la Belgique, du Portugal, de la Suède, de la Slovénie, du Luxembourg, de la Grèce ou de Malte.
Les États qui envisagent la voie de la révision constitutionnelle sont ceux qui, dans la majorité des cas, s’étaient dotés, avant même la signature du traité, de règles d’équilibre budgétaire inscrites dans leur Constitution ou ayant un ancrage constitutionnel. Dans ce cas de figure, les interrogations portent aujourd’hui sur les modalités d’adaptation de leur « règle d’or » interne aux exigences du TSCG ; faut-il ou non une nouvelle modification de la Constitution ? Dans plusieurs cas, les règles d’équilibre insérées dans les constitutions avant la signature du traité semblent avoir en fait anticipé sur celui-ci. On reviendra plus en détail, infra, sur les options de nos principaux partenaires, Allemands, Italiens et Espagnols.
D’autres États parties semblent avoir l’intention d’inscrire leur règle d’équilibre budgétaire dans une loi ordinaire. Ce serait le cas du Danemark, du Luxembourg, de l’Estonie et de la Hongrie. L’Irlande a effectué une révision constitutionnelle de façon à assurer la compatibilité du traité avec sa Constitution, mais envisage d’inscrire la règle d’équilibre budgétaire dans une loi ordinaire. Les Pays-Bas envisagent d’inscrire la règle d’équilibre budgétaire dans une « loi sur la soutenabilité des finances publiques ».
● S’agissant de l’indépendance des organismes chargés des prévisions macroéconomiques et du suivi des règles budgétaires, les pratiques nationales en vigueur sont diverses. De tels organismes existent déjà dans certains pays, tandis que dans d’autres on se borne à comparer les prévisions officielles à celles fournies par d’autres instituts.
Ainsi, les Pays-Bas disposent-ils ainsi depuis l’après-guerre d’un organisme de 110 agents, le Centraal Planbureau, chargé de fournir les prévisions et les chiffrages des mesures au Gouvernement et d’évaluer régulièrement les politiques publiques. Son indépendance n’est pas garantie en droit mais reconnue en pratique.
Dans le cadre de la transposition du traité via le fiscal responsability bill de 2012, l’Irlande a confié au Fiscal advisory council, organisme indépendant créé en 2011, la tâche de veiller au respect des dispositions de l’article 3 du traité budgétaire.
Votre rapporteure souhaite présenter plus spécifiquement les choix institutionnels faits dans les trois autres principales économies de la zone euro.
On peut considérer que suite à la révision constitutionnelle qu’elle a opérée en 2009, l’Allemagne satisfait par avance aux prescriptions du traité budgétaire.
La Loi fondamentale allemande a toujours posé un principe d’équilibre des recettes et des dépenses budgétaires (article 110, paragraphe 1), auquel a été ajouté, en 1969, un plafonnement du niveau des emprunts à hauteur des dépenses d’investissement (règle proche de celle d’équilibre réel qui s’applique à nos collectivités territoriales), avec des possibilités de dérogations pour lutter contre une « perturbation de l’équilibre économique global » (article 115).
Ces dispositions, qui n’avaient pas empêché d’importants déficits budgétaires compte tenu de ces dérogations, ont été remplacées en 2009 par un dispositif dit de « frein à l’endettement » (Schuldenbremse). Un principe d’équilibre strict des recettes et des dépenses (sans exception pour les dépenses d’investissement) est désormais inscrit à l’article 115 de la Loi fondamentale et doit s’appliquer au budget fédéral à partir de 2016. Toutefois trois aménagements atténuent ce principe rigoureux :
– la condition d’équilibre sera considérée comme satisfaite si les recettes provenant d’emprunts ne dépassent pas l’équivalent de 0,35 % du PIB ;
– c’est en fait l’équilibre structurel qui est imposé, car il pourra être tenu compte des variations conjoncturelles, sous réserve que les effets sur le budget de ces variations soient traités symétriquement (en d’autres termes que l’on profite des périodes de forte croissance pour amortir l’endettement) ;
– en cas de catastrophe naturelle ou de situation d’urgence exceptionnelle, les limites supérieures d’endettement pourront être dépassées sur décision de la majorité des membres du Bundestag et sous réserve d’établir un plan d’amortissement de la nouvelle dette correspondante.
C’est donc un plafonnement du déficit structurel à 0,35 % du PIB qui est imposé au niveau fédéral. Les Länder seront soumis à ces règles à compter de 2020, sans bénéficier de la marge de 0,35 % du PIB. L’objectif de la réforme, fruit d’un compromis compliqué entre l’État fédéral et les Länder, semble bien être de garantir un déficit structurel n’excédant pas 0,5 % du PIB, comme le prévoit le traité budgétaire.
Un Conseil de stabilité est aussi créé, qui a pour mission de prévenir les crises budgétaires en assurant un contrôle permanent de la gestion de l’État fédéral et des Länder.
Le Conseil de stabilité (Stabilitätsrat), constitué depuis avril 2010, est composé du ministre fédéral des finances, de celui de l’économie et de la technologie et des ministres des finances des Länder. Il est présidé conjointement par le ministre fédéral des finances et le président de la conférence des ministres des finances des Länder. Les décisions y sont prises par accord entre le gouvernement fédéral et les deux tiers des Länder. Le conseil a d’abord une mission de « surveillance budgétaire » des autorités publiques. S’il constate une « situation d’urgence budgétaire », il convient avec l’entité concernée d’un « programme d’assainissement », dont il contrôle ensuite la mise en œuvre. Il est à noter que plusieurs Länder connaissant des difficultés budgétaires (Berlin, Brême, la Sarre, la Saxe-Anhalt et le Schleswig-Holstein) sont engagés dans un programme de consolidation à l’échéance de 2020 ; dans ce cadre ils doivent bénéficier de 2011 à 2019 d’aides financières à hauteur totale maximale de 800 millions d’euros par an, sous le contrôle du conseil. Le conseil de stabilité a aussi un rôle consultatif plus général dans les domaines économique et budgétaire, avec un objectif de coordination budgétaire entre les différents niveaux de collectivités publiques et de respect des obligations européennes. |
Comme on peut le voir, la composition du Conseil de stabilité, constitué de ministres fédéraux et des Länder, ne permet pas de le considérer comme un organisme indépendant de l’exécutif.
Le ministère des finances a proposé, dans une lettre du 3 mai dernier adressée aux Länder, de créer un nouveau conseil auprès du Conseil de stabilité, afin de renforcer son indépendance. Cette nouvelle instance serait constituée de représentants des instituts économiques, de la Bundesbank et du Conseil des sages.
Le « Conseil des sages » ou Conseil des experts économiques (Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung) a été institué en 1963 par une loi fédérale. Ses cinq membres sont nommés pour cinq ans par le Président fédéral sur proposition du Gouvernement ; ils sont choisis en raison de leurs compétences économiques et un certain nombre d’incompatibilités avec d’autres fonctions sont prévues pour garantir leur indépendance. Le conseil est assisté par une équipe scientifique et s’appuie, pour sa logistique et pour les statistiques, sur l’Office fédéral des statistiques. Sa mission est de conseiller l’ensemble des responsables politiques en évaluant la situation économique, les éventuelles tensions ou orientations mauvaises, sans cependant, dispose la loi, qu’il puisse recommander des mesures précises de politique économique et sociale. Conformément à la loi, il publie en novembre un rapport annuel auquel le Gouvernement répond dans les deux mois. Il publie également de nombreux documents de travail. Les commentateurs s’accordent à reconnaître l’influence des prises de position du conseil sur la gestion de la crise de la zone euro par le Gouvernement fédéral. |
Dans sa décision du 12 septembre dernier portant sur le traité budgétaire, la Cour constitutionnelle de Karlsruhe a validé la constitutionnalité de ce traité avec des arguments assez proches de ceux employés par notre Conseil constitutionnel sur la portée mesurée de ses stipulations ; elle a notamment observé que le traité ne crée pas de restrictions nouvelles de l’autonomie budgétaire des États membres, mais met en termes concrets les dispositions existantes du droit de l’Union européenne.
En Italie, une loi du 20 avril 2012 a substantiellement modifié l’article 81 de la Constitution pour y insérer une stricte obligation d’équilibre budgétaire, du moins d’équilibre structurel, car il pourra être tenu compte des fluctuations du cycle économique. En conséquence, le recours à l’emprunt est strictement encadré : il ne sera autorisé qu’au regard des fluctuations cycliques (pour couvrir le déficit conjoncturel, qui reste autorisé) et, sous réserve d’une autorisation parlementaire donnée à la majorité absolue des membres de chaque assemblée, pour faire face à des évènements exceptionnels. En outre, l’article 97 de la Constitution a été modifié pour confier aux administrations publiques une mission générale d’assurer l’équilibre budgétaire et la soutenabilité de la dette, ce, est-il précisé, « en conformité avec le cadre juridique de l’Union européenne ».
Selon des éléments transmis par le ministère des affaires étrangères, l’Italie devrait compléter la « loi d’application » (comparable à nos lois organiques) à laquelle renvoient les dispositions constitutionnelles précitées, afin d’en assurer la compatibilité avec les obligations découlant du traité budgétaire.
D’après les informations recueillies à Rome par votre rapporteure auprès de M. Lamberto Dini, président de la commission des affaires étrangères du Sénat (et ancien Président du conseil), des discussions sont en cours au sein du Parlement et avec le Gouvernement pour établir, conformément au traité budgétaire, un organe indépendant chargé de vérifier la conformité des lois de finances avec les engagements constitutionnels, en s’inspirant du « Congressional budget office » américain. Cet organe serait placé auprès du Parlement ; constitué d’experts des deux chambres, il pourrait compter 30 à 40 personnes et bénéficier de l’appui d’autres institutions comme la Cour des comptes. Il serait présidé par une personnalité indépendante reconnue, acceptée par le Gouvernement et par les commissions parlementaires compétentes.
L’Espagne a modifié sa Constitution dès septembre 2011. Désormais, l’article 135 de celle-ci pose le principe de l’adéquation de toute l’action des administrations publiques (au sens communautaire) avec le principe de stabilité budgétaire.
Il est fait référence à la limitation des déficits structurels établie par l’Union européenne : l’État et les communautés autonomes doivent respecter cette limitation, tandis que les collectivités locales sont tenues à l’équilibre budgétaire strict. Il est de même fait référence pour la dette publique au plafond prévu par le TFUE, qui doit être respecté. Des dérogations sont prévues seulement en cas de catastrophe naturelle, récession économique et situations exceptionnelles échappant au contrôle de l’État (force majeure) ; elles doivent être décidées à la majorité absolue de la Chambre des députés.
Une loi organique du 27 avril 2012 a développé les nouvelles règles, disposant notamment que :
– l’ensemble des autorités publiques sont tenues à une politique budgétaire en adéquation avec les principes de « stabilité budgétaire » et de « soutenabilité financière », la stabilité budgétaire signifiant équilibre (ou excédent) structurel, la soutenabilité financière s’entendant comme la capacité à couvrir les engagements présents et futurs dans les limites de déficit et d’endettement prévues par les règles européennes ;
– dans le principe, le déficit structurel est prohibé ; cependant, un déficit structurel de 0,4 % du PIB pour l’ensemble des administrations publiques peut être toléré en cas de mise en œuvre de réformes structurelles ayant un impact budgétaire à long terme ; des dérogations supplémentaires sont autorisées cas de catastrophe naturelle, de récession grave et de force majeure, sous réserve de ne pas mettre en cause la soutenabilité budgétaire à moyen terme ;
– le plafond communautaire d’endettement public, soit 60 % du PIB, est décomposé en sous-plafonds applicables à l’État central (44 % du PIB), aux communautés autonomes (13 %) et aux collectivités locales (3 %) ;
– l’augmentation des dépenses de l’État, des communautés autonomes et des collectivités locales est plafonnée au taux d’augmentation du PIB à moyen terme.
Ces dispositions s’appliqueront pleinement à partir de 2020, la loi organique régissant aussi la période transitoire, pendant laquelle, par exemple, le déficit public global devra diminuer en moyenne de 0,8 point de PIB par an.
Dans ce pays très décentralisé qu’est l’Espagne, la loi organique détermine enfin des procédures complexes d’établissement d’objectifs de stabilité budgétaire et d’endettement pour chaque collectivité publique. Elle prévoit ensuite divers niveaux de mesures correctives, voire coercitives, en cas de dérives au niveau des communautés autonomes ou des collectivités locales : limitation des opération d’endettement à la seule trésorerie si l’on atteint 95 % du plafond de dette ; obligation de demander l’autorisation de l’État pour tout nouvel emprunt si l’objectif d’endettement qui a été fixé est dépassé ; obligation d’établir des plans de redressement si les objectifs ne sont pas respectés ; voire sanctions allant jusqu’à des dépôts obligatoires à la Banque d’Espagne et des amendes.
Le gouvernement espagnol n’a pas caché son intention d’utiliser la nouvelle loi pour contraindre les communautés autonomes à ramener leur déficit cumulé à 1,5 % du PIB en 2012, contre plus de 2,9 % en 2011.
2. Le projet de loi organique relatif à la programmation et à la gouvernance des finances publiques
a) La décision n° 2012-653 DC du Conseil constitutionnel
Signé le 2 mars 2012 par le président Nicolas Sarkozy, le TSCG a été soumis au Conseil constitutionnel par son successeur, le 13 juillet dernier, en application de l’article 54 de la Constitution.
Dans sa décision n° 2012-653 DC du 9 août 2012, le Conseil a confirmé l’analyse faite par le nouvel exécutif en estimant que la ratification du traité et sa mise en œuvre, notamment l’inscription de la règle relative à l’équilibre budgétaire dans le droit national, ne nécessitaient pas de révision préalable de la Constitution. A cette occasion, il a également apporté un précieux éclaircissement quant à la façon dont il convient désormais de transposer, dans notre droit, la « règle d’or » énoncée à l’article 3 du traité.
La succession des traités européens qui lui ont été soumis a permis au Conseil constitutionnel de dégager une jurisprudence sur les transferts de souveraineté impliqués par la construction européenne : appellent une révision de la Constitution les clauses qui opèrent, au profit de l’Union européenne, des transferts de compétence mettant en cause les conditions essentielles d’exercice de la souveraineté nationale. Ainsi, appelé en 1992 à se prononcer sur le traité de Maastricht, le Conseil avait-il estimé, dans sa décision n° 92-308 DC du 9 avril 1992, qu’une révision de la Constitution était nécessaire en raison de trois séries de stipulations qui mettaient en cause ces conditions essentielles d’exercice de la souveraineté (ou étaient plus directement contraires à des articles de la Constitution) : celles relatives au droit de vote et d’éligibilité aux élections municipales des ressortissants des États membres ; celles prévoyant une politique monétaire et de change unique ; enfin celles prévoyant l’abandon de la règle de l’unanimité pour la politique commune des visas à l’égard des pays tiers. Mais le Conseil n’avait alors pas jugé contraires à la Constitution les stipulations du traité et de son protocole annexé qui prohibaient les déficits publics excédant 3 % du PIB et les dettes excédant 60 % de celui-ci et établissaient une procédure de surveillance et de sanction des déficits excessifs.
C’est donc dans la continuité de cette jurisprudence que le Conseil constitutionnel a admis la constitutionnalité du renforcement de la discipline budgétaire voulu par le TSCG et précédemment décrit par votre rapporteure. Imposer l’équilibre ou l’excédent des finances publiques ne procède à aucun transfert de compétences en matière de politique économique ou budgétaire et « ne [porte] pas atteinte aux conditions essentielles d'exercice de la souveraineté nationale ». Cela est d’autant plus vrai que la France est déjà tenue de respecter des règles de discipline budgétaire en vertu du traité de Maastricht, règles qui ont déjà été durcies, notamment avec l’adoption du Six pack en novembre 2011, le TSCG ne faisant que reprendre et renforcer des engagements existants.
Indépendamment de la jurisprudence sur le respect des conditions essentielles d’exercice de la souveraineté, le TSCG devait aussi être examiné au regard des exigences constitutionnelles qui s’appliquent à nos procédures budgétaires, dont les principaux éléments figurent dans la Constitution. Dans un second temps, le Conseil constitutionnel a donc procédé à l’analyse du paragraphe 2 de l’article 3 du TSCG, lequel prévoit que les règles d'équilibre des finances publiques énoncées au paragraphe précédent « prennent effet dans le droit national des parties contractantes […] au moyen de dispositions contraignantes et permanentes, de préférence constitutionnelles, ou dont le plein respect et la stricte observance tout au long des processus budgétaires nationaux sont garantis de quelque autre façon ». Le Conseil a été conduit à examiner l’alternative ainsi ouverte et en a proposé une grille de lecture qui, si elle a pu surprendre certains commentateurs, n’en demeure pas moins incontestable (44).
Pour le Conseil constitutionnel, la première branche de l’alternative consiste à introduire, dans le droit national, des « dispositions contraignantes et permanentes, de préférence constitutionnelles », c'est-à-dire des normes ayant un niveau supérieur aux lois de finances. La seconde branche, elle, autorise les États contractants à garantir « le plein respect et la stricte observance » des règles européennes de discipline budgétaire « de quelque autre façon », c’est-à-dire, selon le Conseil, par des dispositions non « contraignantes » au sens où leur méconnaissance ne conditionnerait pas la constitutionnalité du budget. Le choix de l’une ou l’autre des branches a des conséquences opposées quant à la nécessité de réviser ou non notre Constitution. La première branche, en effet, en introduisant directement des « dispositions contraignantes et permanentes » imposant le respect des règles relatives à l’équilibre des finances publiques, se heurterait aux dispositions constitutionnelles actuellement en vigueur qui déterminent les prérogatives du Gouvernement et du Parlement en matière budgétaire et consacrent le principe d’annualité. La choisir impliquerait alors une révision préalable de la Constitution. Tel n’est pas le cas, en revanche, si, pour respecter les engagements du TSCG, il est fait appel à la seconde branche. En effet, le Conseil constitutionnel a relevé que la Constitution habilite déjà le législateur organique à fixer le cadre des lois de programmation pluriannuelle des finances publiques, des lois de finances et des lois de financement de la sécurité sociale. Sur ces divers fondements, il peut dès à présent répondre aux exigences procédurales relatives à la seconde branche de l’alternative.
Par ailleurs, le Conseil constitutionnel s’est interrogé sur une autre stipulation du traité : le « mécanisme de correction » qui doit être mis en place dans chaque État et doit être « déclenché automatiquement » en cas d’écart importants par rapport à l’objectif à moyen terme. Il a estimé que cette clause n’était pas contraire à la Constitution, car les États demeuraient libre de définir les modalités de déclenchement de leur mécanisme et les mesures à mettre en œuvre, le traité mentionnant de surcroît qu’un tel dispositif devait respecter « pleinement les prérogatives des Parlements nationaux ».
Enfin, le Conseil constitutionnel a apporté des précisions quant à l’institution indépendante devant être désignée pour vérifier, au niveau national, le respect des règles budgétaires introduites par le premier paragraphe de l’article 3 du TSCG. Le Conseil a estimé que rien dans la Constitution n’interdisait qu’une ou plusieurs institutions indépendantes vérifient le déroulement de la procédure budgétaire. Il a souligné la compétence du législateur organique pour procéder au choix de cet organe mais aussi pour déterminer sa composition et le cadre de ses interventions. Votre rapporteure tient à souligner que le Conseil a aussi estimé qu’il aurait, à l’avenir, à contrôler le respect de la sincérité des lois de finances « en prenant en compte l’avis des institutions indépendantes » préalablement mises en place. Il sera intéressant de voir quel sera l’impact réel de cette mention dans les futures décisions, puisque, jusqu’à présent, le Conseil a été prudent dans le contrôle de la sincérité budgétaire, principe dégagé par sa jurisprudence et figurant depuis 2001 dans la loi organique relative aux lois de finances – la sincérité se définissant, selon le Conseil, comme « l’absence d’intention de fausser les grandes lignes de l’équilibre déterminé par la loi de finances » (45).
b) Le contenu du projet de loi
Logiquement, parce qu’il importe de ratifier dans les meilleurs délais le TSCG mais aussi de mettre en œuvre le dispositif global adopté lors du Conseil européen des 28 et 29 juin 2012, le Gouvernement a choisi la seconde branche de l’alternative précédemment évoquée par votre rapporteure, c'est-à-dire la branche n’imposant pas de révision de la Constitution. Un projet de loi organique en ce sens a été déposé, le 19 septembre dernier, sur le bureau de l’Assemblée nationale(46). Il vise à répondre à plusieurs questions. Comment, notamment, définir notre objectif budgétaire de moyen terme (OMT) et une trajectoire pour l’atteindre en termes structurels ? Quelle forme prendra le « mécanisme de correction » ? Enfin, à qui confier la mission de surveillance dévolue à des institutions nationales indépendantes dans le TSCG ?
Si ce projet de loi sera examiné au fond par la commission spéciale à laquelle il a été renvoyé, votre rapporteure a toutefois jugé nécessaire d’en présenter brièvement la teneur, eu égard à l’importance que revêt ce texte au regard de la mise en œuvre du traité budgétaire dont il nous est demandé d’autoriser la ratification.
● Inscription des lois financières annuelles dans une perspective pluriannuelle
Le projet de loi organique s’attache d’abord à définir les règles qui permettront au Gouvernement et au Parlement d’inscrire les lois annuelles dans une perspective pluriannuelle conforme à nos engagements européens. Tel est l’objet de son chapitre Ier qui porte essentiellement sur le contenu des lois de programmation des finances publiques et modifie, à la marge, le contenu des projets de loi de finances et des projets de loi de financement de la sécurité sociale. Si certaines de ces dispositions auraient donc très bien pu être enchâssées dans la loi organique relative aux lois de finances ou dans la partie organique du code de la sécurité sociale, le Gouvernement a fait le choix d’en présenter l’intégralité dans un seul texte dans le but d’assurer la lisibilité et la clarté de la réforme. Les principales dispositions du chapitre Ier du projet de loi organique peuvent être brièvement décrites sous forme de tableau.
Article du chapitre 1er |
Loi (s) |
Principal apport |
Article 1er |
LPFP |
Les LPFP fixent, pour la période qu’elles couvrent, l’OMT et la trajectoire des soldes structurels et effectifs annuels successifs. Elles déterminent aussi l’évolution de la dette publique et présentent l’évolution des soldes effectifs par sous-secteur des administrations publiques. |
Article 2 |
Dispositions figurant également dans les LPFP : plafonds annuels de dépenses pour l’État, objectifs de dépenses pour les régimes obligatoires de base de la sécurité sociale, ONDAM… | |
Article 3 |
Les LPFP couvrent une période d’au moins 3 ans. | |
Article 4 |
Les LPFP peuvent contenir des règles relatives à la gestion des finances publiques ne relevant pas du domaine des LF et des LFSS. | |
Article 5 |
Dispositions figurant dans un rapport annexé à la LPFP : hypothèses et méthodes retenues pour établir la programmation, réformes et mesures destinées à garantir la programmation, projections de finances publiques à politique inchangée… | |
Article 6 |
LFI et LFR |
Dans les LFI et LFR : création d’une partie liminaire contenant un tableau de synthèse présentant pour l’année en cours les prévisions de soldes effectif et structurel pour l’ensemble des administrations publiques (Dans la LFI, ce tableau présentera également l’exécution pour la dernière année écoulée et la prévision d’exécution pour l’année en cours). |
Article 7 |
LFSS |
Un rapport annexé à la LFI détaille l’évaluation prévisionnelle de l’effort structurel par sous-secteur. Un rapport annexé à la LFSS détaille l’évaluation prévisionnelle de l’effort structurel des régimes obligatoires de base. |
LPFP : loi de programmation des finances publiques ; LF : lois de finance, LFI : loi de finances initiale ; LFR : loi de finances rectificative ; LFSS : loi de financement de la sécurité sociale.
Le choix de faire désormais figurer dans les lois de programmation des finances publiques les engagements résultant du TSCG, tels que la définition d’un objectif budgétaire à moyen terme et d’une trajectoire d’ajustement, a le double intérêt :
– de préciser ce que doit être le contenu de ces lois, prévues à l’article 34 de la Constitution depuis la révision de 2008, et de garantir ainsi la pérennité de l’exercice de programmation financière pluriannuelle dont le principe a été constitutionnalisé ;
– de cependant respecter le principe de l’annualité des lois de finances, dont le Conseil a rappelé dans sa décision précitée le caractère constitutionnel, puisque les engagements européens pluriannuels ne seront donc pas directement inscrits dans une loi de finances, mais dans une loi de programmation, laquelle, n’étant pas de nature organique, n’aura pas de valeur normative supérieure à celle des lois de finances.
● Création d’un Haut conseil des finances publiques
Le chapitre II du projet de loi organique créé un « Haut conseil des finances publiques » et détermine les modalités de son « intervention tout au long du processus budgétaire ». Ce nouvel organe aura pour mission d’exercer les tâches dévolues à l’institution indépendante prévue par le TSCG (et envisagée dans le Two pack) et chargée de vérifier l’application des règles chiffrées et du mécanisme de correction.
Le Gouvernement a souhaité adosser le Haut conseil à la Cour des comptes, qui exerce déjà une partie des missions d’un comité budgétaire indépendant.
Le projet de loi organique prévoit que le Haut conseil des finances publiques sera présidé par le premier président de la Cour des comptes et sera composé de huit autres membres nommés pour cinq ans : quatre magistrats de la Cour des comptes et quatre membres nommés par les présidents des assemblées parlementaires et les présidents des commissions des finances de chaque chambre (article 8).
Le Haut conseil sera chargé de se prononcer sur les prévisions macroéconomiques servant de fondement aux lois de programmation des finances publiques, aux lois de finances et aux lois de financement de la sécurité sociale. Ainsi, par ses avis publics, il éclairera le législateur pour lui permettre d’apprécier la crédibilité des hypothèses macroéconomiques retenues dans les projets de textes financiers (articles 9 et 10). Afin de pouvoir faire face aux situations d’urgence, l’intervention du Haut conseil en matière de lois de finances rectificatives et de lois de financement de la sécurité sociale rectificatives sera facultative (article 11). Par ailleurs, le Gouvernement devra saisir le Haut conseil s’il entend réviser les hypothèses macroéconomiques lors de l’examen parlementaire d’un projet de loi de finances (article 12). Le Haut conseil devra se prononcer sur les hypothèses macroéconomiques sur lesquelles est fondé le programme de stabilité et son avis sera public (article 13). Enfin, il pourra procéder à l’audition de représentants de l’administration et faire appel à des personnalités ou organismes extérieure à celle-ci (article 14). Un décret en Conseil d’Etat pourra préciser les modalités de son fonctionnement (article 15).
Votre rapporteure n’oublie pas, cependant, que rien n’est encore figé. Le projet de loi organique doit, par définition, être adopté et la représentation nationale aura son mot à dire. Il importera d’être attentif au contenu des débats et de veiller à ce que le Parlement soit tenu informé, en même temps que le Gouvernement, des avis émis par le Haut conseil.
● Instauration d’un « mécanisme de correction »
Le chapitre III du projet de loi organique est relatif au « mécanisme de correction » qui doit être mis en place pour parer aux écarts importants qui pourraient être constatés par rapport à l’objectif de moyen terme ou à la trajectoire permettant de l’atteindre.
Le projet de loi prévoit qu’un avis soit systématiquement rendu par le Haut conseil sur l’exécution de l’année échue au moment du débat d’orientation des finances publiques. Il pourra ainsi identifier les éventuels écarts significatifs à la trajectoire et le Gouvernement aura à expliquer les raisons de ces écarts et à proposer des mesures de correction à l’occasion du débat parlementaire. Par ailleurs, le TSCG ne précisant pas les modalités concrètes de cette correction, le projet de loi organique dispose que le Gouvernement devra tenir compte de tout écart important au plus tard dans l’élaboration du plus prochain projet de loi de finances de l’année ou projet de loi de financement de la sécurité sociale (article 16).
B – La mise en œuvre des décisions du Conseil européen des 28 et 29 juin 2012
● L’augmentation du capital de la Banque européenne d’investissement
Pour ce qui est de l’augmentation du capital (souscrit et versé) de la Banque européenne d’investissement (BEI) à hauteur de 10 milliards d’euros, le conseil d’administration de la banque, réuni le 24 juillet 2012, a marqué son accord sur un projet de décision qui est actuellement soumis à l’approbation du conseil des gouverneurs (composés des ministres des finances des États membres) par procédure écrite avant le 31 décembre 2012 (la décision doit prendre effet plus tôt, dès ratification unanime des gouverneurs ). Il est prévu que les États membres versent en une fois leur contribution nationale d’ici fin mars 2013. Toutefois, les États membres en ayant formulé la demande pourront étaler le règlement de leur souscription en trois paiements en 2013, 2014 et 2015, mais aucun des quatre grands actionnaires de la banque (Allemagne, France, Italie et Royaume-Uni) n’a demandé à bénéficier de cette possibilité.
La part de la France dans cette augmentation de capital représente 1,6 milliard d’euros. L’autorisation de souscription à cette augmentation fera l’objet d’un article dans le projet de loi de finances pour 2013.
Cette augmentation du capital libéré doit permettre quelques 60 milliards d’euros de nouveaux prêts sur la période 2013-2015, pour quelques 180 milliards d’euros d’investissements supplémentaires par effet de levier.
● Les emprunts obligataires pour le financement de projets
Le règlement n° 670/2012 du 11 juillet 2012 instituant la phase pilote (2012-2013) pour les emprunts obligataires pour le financement de projets, ou project bonds, prévoit d’allouer en 2012-2013 jusqu’à 200 millions d’euros de garanties à des projets dans le domaine des transports, jusqu’à 10 millions d’euros de garanties à des projets dans le domaine de l’énergie et jusqu’à 20 millions d’euros à des projets dans le domaine des technologies de l’information et de la communication.
L’instrument de partage de risques relatif aux emprunts obligataires pour le financement de projets est un instrument commun à la Commission et à la BEI dans cette phase pilote ; ses modalités et conditions détaillées de mise en œuvre seront définies dans un accord de coopération entre la Commission et la BEI devraient signer d’ici la fin du mois de septembre 2012.
Durant son audition par les commissions des affaires étrangères et des affaires européennes de l’Assemblée nationale le 25 septembre dernier, M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué chargé des affaires européennes, a fait état des premières retombées concrètes que l’on peut attendre de l’augmentation de capital de la BEI et des obligations de projet. Il a estimé qu’au regard des taux de retour habituellement constatés pour la France dans les interventions de la BEI, environ 5 milliards d’euros pourraient revenir à notre pays sur les 60 milliards de prêts supplémentaires de cette institution. Il a indiqué que plusieurs projets susceptibles de bénéficier de ces fonds avaient déjà été identifiés : par exemple, le projet de centre hospitalier universitaire (CHU) d’Amiens, le canal Seine-Nord ou encore l’équipement numérique du département de la Haute-Savoie (lequel pourrait aussi être financé par l’émission d’obligations de projet).
2. La taxe sur les transactions financières
Le projet de taxe sur les transactions financières en Europe est entré dans une phase très concrète en septembre 2011 avec une proposition de directive visant à introduire une telle taxe. Cette initiative faisait suite à une invitation non seulement du Conseil européen, mais aussi du Parlement européen.
C’est en effet au seul niveau européen que la taxe sur les transactions financières peut être mise en place à la suite du constat, renouvelé lors du G 20 de novembre 2011 en France, de l’impossibilité d’envisager une taxe au niveau mondial. Une taxe au niveau mondial serait en effet l’option la plus favorable car elle priverait de toute portée la principale critique émise à l’encontre de cette taxe : une perte de compétitivité des places financières qui devront l’appliquer et autant de menaces sur les emplois concernés.
Toutefois, l’impossibilité d’une unanimité des États membres au sein du Conseil Écofin, laquelle est encore exigée pour l’adoption de toute proposition européenne à caractère fiscal, a très tôt conduit à envisager une coopération renforcée, laquelle exige la participation d’au moins neuf États membres. En effet, le Royaume-Uni, mais aussi la Suède – qui a connu une expérience malheureuse en la matière à la fin des années 1980 – et le Luxembourg sont hostiles à la taxe sur les transactions financières et d’autres États tels que l’Irlande et les Pays-Bas n’y sont pas non plus très favorables.
Comme votre rapporteure a eu l’occasion de l’indiquer, le Conseil européen des 28 et 29 juin derniers a donc relancé la perspective d’une coopération renforcée sur ce sujet. Ses conclusions permettent d’envisager une adoption avant la fin 2012, le nombre minimal d’États étant atteint. Outre la France, l’Allemagne, la Belgique, le Portugal, la Slovénie, la Grèce, l’Espagne, l’Italie, la Pologne, la Slovaquie et l’Estonie ont fait part de leur intérêt pour le projet de taxe. En tout état de cause, une participation la plus large possible, en particulier s’agissant de la zone euro, est souhaitable, et ce, quand bien même le seuil de 9 pays participants serait atteint. Car, à défaut de pouvoir l’appliquer à l’ensemble de l’Union européenne, la taxe sera d’autant plus efficace qu’elle concernera toute la zone euro, pour éviter la concurrence des places financières utilisant la même monnaie et sur lesquelles sont implantées les mêmes bourses après l’intégration des dernières années. De ce point de vue, les Pays-Bas, avec Euronext, constituent dans la négociation du champ territorial de la taxe un État clef.
Sur le fond, une fois prise la décision de principe, il conviendra d’être très attentifs aux modalités de sa mise en œuvre. Il est souhaitable que l’assiette soit la plus large possible afin d’éviter les arbitrages entre produits taxés et substituts ou produits concurrents non taxés. Son taux devra également être modéré, car l’objectif est de supprimer la « mauvaise finance », notamment celle à très haute fréquence, qui ne repose sur aucune réalité économique, mais pas toute l’activité financière, qui est utile au fonctionnement de l’économie.
L’affectation de la ressource sera également une question d’une grande sensibilité. Faudrait-t-il l’affecter aux budgets nationaux, ce qui permettrait d’aider au rétablissement des finances publiques mais ne ferait pas apparaître de « plus-value européenne » ? Serait-t-il préférable de l’affecter directement au budget communautaire et, si oui, sous quelle forme ? Ceci aurait l’avantage de substituer « une ressource dynamique à une ressource fortement contrainte qui ne l'est pas et [d’ouvrir] des perspectives budgétaires positives pour l’Union européenne » (47). Le cas échéant, serait-il possible de créer un fonds ne concernant que les États participant à la coopération renforcée et qui serait, par exemple, consacré à l’emploi et à l’environnement (48)?
Le Conseil européen des 28 et 29 juin derniers a donné un coup d’accélérateur au projet d’instaurer une supervision bancaire intégrée en Europe.
La base juridique existe déjà. Il s’agit du paragraphe 6 de l’article 127 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, lequel stipule que « le Conseil, statuant par voie de règlements conformément à une procédure législative spéciale, à l'unanimité, et après consultation du Parlement européen et de la Banque centrale européenne, peut confier à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de contrôle prudentiel des établissements de crédit et autres établissements financiers, à l'exception des entreprises d'assurances ».
Dans ce cadre, le 12 septembre 2012, la Commission européenne, grâce notamment à l’action de M. Michel Barnier, commissaire européen chargé du marché intérieur et des services, a accompli un pas important en présentant trois textes dessinant les contours d’une véritable union bancaire en Europe (49) :
– une proposition de règlement confiant à la BCE d'importants pouvoirs en vue de la surveillance de toutes les banques de la zone euro, et prévoyant un mécanisme qui permettra aux pays hors zone euro qui le souhaitent de participer au processus ;
– une proposition de règlement qui adapte l’actuel règlement instituant l’Autorité bancaire européenne (ABE) au nouveau dispositif de surveillance bancaire, de manière à ce que le processus décisionnel de l’ABE reste équilibré et que l’ABE continue de veiller à l’intégrité du marché unique ;
– enfin, une communication qui décrit la manière dont la Commission envisage globalement l’union bancaire, avec notamment la mise en place d’une réglementation unique (ou « règlement uniforme ») et d’un mécanisme de surveillance unique, et qui annonce les étapes suivantes, dont la création d'un mécanisme unique de résolution des défaillances bancaires.
Partant de l’idée qu’une des réponses à la crise de l’euro réside dans un contrôle plus étroit des banques commerciales, la Commission entend que soit confié à la BCE un rôle central dans la supervision des établissements bancaires en Europe. Cette institution se verrait octroyer un pouvoir de surveillance sur toutes les banques de la zone euro. À terme serait mis en place un fonds destiné à faire face aux faillites bancaires ainsi qu’un mécanisme pour protéger les dépôts des particuliers dans toute la zone euro.
Cette proposition de la Commission européenne – qui a été favorablement accueillie par la BCE –, si elle est suivie d’effet, conduira à confier à une autorité supranationale et indépendante la surveillance d’un pan sensible et symbolique des prérogatives des États membres. Il importe désormais de suivre attentivement les suites qui seront données à cette initiative, d’autant plus que plusieurs questions restent en suspens. Comment, par exemple, la BCE parviendra-t-elle a assumer une nouvelle mission politiquement sensible mais également très exigeante et dans laquelle ont souvent échoué les instances nationales ? Parviendra-t-elle à séparer efficacement ses activités traditionnelles liées à la politique monétaire de son nouveau rôle prudentiel ? Comment le rôle de la BCE sera-t-il articulé avec celui de l’ABE ? Peut-on ou non envisager, en cas par exemple d’opposition britannique, une union bancaire fondée sur une coopération renforcée et ne couvrant donc que les pays volontaires ?
Quel sera, par ailleurs le champ de compétence du nouveau dispositif ? L’ensemble des banques de la zone euro ou seulement les établissements « systémiques », c’est à dire ceux à même de menacer, en cas de faillite, la zone euro ? La question est très sensible en Allemagne car le système bancaire y est organisé d’une manière très spécifique : il reste très décentralisé, avec environ 2 000 établissements, et marqué par le poids des banques de droit public, en premier lieu les banques des différents Länder (Landesbanken), que ces derniers garantissent et qui sont soumises à un contrôle administratif, et les caisses d’épargne, et des banques à statut mutualiste (banques populaires, crédit mutuel agricole) ; le poids cumulé des banques publiques (qui ont en compte plus de 30 % des actifs du système bancaire allemand) et des banques mutualistes (près de 12 % des actifs) dépasse celui des banques commerciales (36 % des actifs (50)). Dans ce système, les banques, principalement locales, ont des relations beaucoup plus continues et exclusives avec les entreprises et bénéficient de connexions politiques. Les craintes sont fortes quant à une remise en cause de cet équilibre avec l’intrusion d’un contrôleur/régulateur européen et les partis politiques sont prudents, pour ne pas dire réticents, sur cette évolution. L’Allemagne plaide donc pour une supervision européenne limitée, au moins dans un premier temps, aux très grands établissements. On ne saurait toutefois occulter le fait que Bankia, en Espagne, n’était pas considérée comme une banque systémique.
Ces questions sont importantes et méritent un suivi attentif, a fortiori dans une période d’intense réflexion et qui a vu la Commission constituer un groupe de travail présidé par M. Erkki Liikanen, gouverneur de la Banque de Finlande et chargé d’étudier la faisabilité de réformes structurelles du secteur bancaire européen.
4. L’assouplissement des mécanismes de solidarité financière
Le programme d’assistance au secteur bancaire espagnol a été formellement approuvé le 20 juillet 2012 par l’Eurogroupe. Son montant maximum a été fixé à 100 milliards d’euros, les autorités espagnoles devant encore préciser d’ici la fin septembre l’évaluation exacte des besoins. D’ores et déjà, le versement dés juillet d’une première tranche de 30 milliards d’euros a été mis en réserve par le FESF pour parer à un éventuel cas d’urgence.
En parallèle, une nouvelle recommandation pour l’Espagne au titre de la procédure de déficit public excessif a été adoptée par le Conseil Écofin du 10 juillet, afin de reporter de 2013 à 2014 l’échéance de retour du déficit sous la valeur de référence de 3 % du PIB. La recommandation établit des objectifs d’ajustement structurel de 2,7 % du PIB en 2012, 2,5 % en 2013 et 1,9 % en 2014, qui correspondent, au vu des prévisions actuelles, à un déficit nominal de 6,3 % du PIB pour 2012, 4,5 % pour 2013 et 2,8 % pour 2014.
S’agissant de la recapitalisation directe du secteur bancaire, les travaux en la matière demeurent conditionnés par des progrès préalables sur la supervision bancaire (voir infra), conformément aux termes de la déclaration du sommet de la zone euro. Les travaux techniques devraient être lancés en octobre pour mettre en place ce nouvel instrument.
C – La nécessité d’un contrôle parlementaire accru
1. Une redéfinition du rôle du Parlement dans le processus budgétaire
Le semestre européen, le Two pack et le TSCG créent de nouvelles contraintes pour les gouvernements. En revanche, ils n’affectent pas directement les pouvoirs des parlements nationaux. En ce qui concerne le Parlement français, ils pourraient même lui permettre de conquérir une place dans un domaine qui lui est aujourd’hui pratiquement inaccessible : celui des réflexions et des débats qui précédent l’élaboration du projet de loi de finances.
Votre rapporteure tient à rappeler que le Parlement dispose aujourd’hui d’une marge de manœuvre singulièrement limitée par rapport à ses homologues. Certes, il vote la loi de finances au terme d’une discussion longue et dense. Les dispositions organiques et constitutionnelles l’autorisent à diminuer les dépenses et augmenter les impôts, c’est à dire, éventuellement, à réduire le niveau du déficit budgétaire par rapport à celui proposé par le gouvernement… En revanche, il ne peut, de sa propre initiative, ni augmenter les dépenses, ni diminuer les recettes de l’État. En d’autres termes, le Parlement ne pourrait amender un projet de loi de finances qui lui paraîtrait réduire de manière trop brutale les dépenses de l’État et le déficit budgétaire, sauf à engager une épreuve de force avec le Gouvernement en menaçant de rejeter le projet de budget dans son ensemble.
Aucun de ces principes ne sont remis en cause par les nouveaux textes européens qui n’ajoutent, ni ne retranchent, aucun pouvoir aux assemblées de chaque État membre mais vont en revanche encadrer plus étroitement la marge de manœuvre des gouvernements dans la définition de leurs politiques économiques et budgétaires. En effet, si une pression accrue en faveur d’une réduction des déficits budgétaires va désormais s’exercer, les États définiront souverainement la répartition des efforts entre les dépenses et les recettes et a fortiori les arbitrages internes au sein de ces deux catégories.
Mais la « règle d’or » n’est pas le seul apport du nouveau cadre budgétaire européen. D’autres dispositifs ont pour effet de soumettre les États à une supervision de leur politique économique beaucoup plus complète que précédemment. Les outils statistiques européens et nationaux vont gagner en indépendance. La Commission européenne va devenir la « mauvaise conscience » des États et un dialogue permanent va se développer au sein de l’Union européenne. A différentes étapes, tout au long de l’année, les institutions européennes publieront ainsi divers documents, avis, recommandations, orientations, sans force juridique, qui de ce fait n’entameront pas la souveraineté des États mais les obligeront à se justifier en permanence.
C’est notamment le cas du « semestre européen » qui, pour mémoire, est constitué des étapes suivantes :
– fin novembre : la Commission publie son « examen annuel de croissance » ;
– en mars, le Conseil européen formule des orientations stratégiques pour les politiques économiques ;
– fin avril, au plus tard, chaque État communique son programme de stabilité qui détaille sa trajectoire budgétaire ;
– début juin, la Commission présente ses propositions d’avis et éventuellement des recommandations sur chaque programme national ;
– en juin ou début juillet, le Conseil examine ces recommandations et le Conseil européen les approuve, puis le Conseil les adopte formellement.
C’est également le cas du Two pack. Comme votre rapporteure l’a précédemment souligné, il est constitué de deux projets de règlement et est encore en cours d’examen. Il devrait avoir pour conséquence d’ajouter deux étapes au calendrier du semestre européen :
– avant le 15 octobre, les États devront présenter leurs projets de budgets, ce qui, pour la France, ne pose pas de problèmes puisque le projet de loi de finances est déposé à la fin du mois de septembre pour une discussion qui commence un peu après le 15 octobre ;
– la Commission européenne pourrait émettre un avis sur un projet de budget et aurait jusqu’au 30 novembre pour le faire (cette dernière possibilité est encore incertaine, le Conseil européen étant très opposé à cette option).
Le dialogue public institué par les nouveaux textes européens est une occasion pour les parlements nationaux d’accéder à un espace qui leur est aujourd’hui pratiquement interdit, celui des discussions et réflexions préalables à l’élaboration des politiques économiques et budgétaires. Votre rapporteure estime qu’il y a là une chance à saisir pour permettre à la représentation nationale de donner son avis, dans les meilleures conditions possibles, tout au long des différentes étapes budgétaires de l’année.
Le semestre européen étant en vigueur depuis septembre 2010, l’Assemblée a eu l’occasion d’en tirer des conséquences dès 2011(51). Son suivi a pris la forme :
– le 30 mars, d’une réunion commune entre la commission des affaires européennes et les eurodéputés français sur les orientations stratégiques de politique économique ;
– le 2 mai, d’un débat en séance, suivi d’un vote, sur une déclaration du gouvernement sur le programme de stabilité européen ;
– le 9 juillet, d’une résolution de la commission des affaires européennes, adoptée explicitement par la commission des finances, sur les recommandations de la Commission européenne.
Cet exercice s’est toutefois heurté à certaines limites. Ainsi, le débat de la commission des affaires européennes du 30 mars 2011 est-il intervenu toutefois postérieurement à la réunion du Conseil européen qui a défini les orientations stratégiques de politique économique. De même, en ce qui concerne la résolution du 9 juillet 2011, elle n’a pas été discutée en séance publique, mais seulement en commission des affaires européennes puis au sein de la commission des finances, essentiellement car la session parlementaire arrivait à son terme.
Des améliorations sont donc sans doute possible, sans changer le Règlement ni la Constitution, afin que l’Assemblée débatte plus fréquemment, plus solennellement et à des moments plus opportuns. Les présidents des commissions concernées – affaires étrangères, affaires européennes et commission des finances – disposent à cet effet de certaines prérogatives qu’ils auraient tout intérêt à exercer conjointement.
Tout d’abord, les présidents de commission peuvent proposer à la Conférence des présidents d’organiser des débats, notamment pendant les semaines réservées au contrôle parlementaire.
Les présidents de commission ont également la maîtrise de la procédure des résolutions européennes. Celles-ci peuvent être déposées sur n’importe quel texte européen puisque la procédure de l’article 88-4 de la Constitution est désormais déconnectée des activités purement législatives de l’Union. Il appartient à la commission des affaires européennes de déposer des propositions de résolution ou d’examiner en premier les propositions de résolution déposées par des députés. La procédure permet ensuite à la commission permanente compétente au fond soit d’examiner le texte adopté par la commission des affaires européennes, soit de l’adopter tacitement au terme d’un délai d’un mois. Puis, il appartient à la Conférence des présidents d’inscrire cette résolution à l’ordre du jour de l’Assemblée ; si la Conférence ne le décide pas au terme d’un délai de quinze jours, le texte adopté par la commission est considéré comme adopté définitivement par l’Assemblée nationale.
Les présidents de commission jouent donc un rôle décisif dans l’écho qui peut être donné à une proposition de résolution. Sous la précédente législature, peu de propositions de résolution européenne ont été examinées en séance publique ; la procédure d’adoption tacite est restée privilégiée.
Une troisième piste de réflexion serait d’intégrer le semestre européen à la discussion budgétaire ce qui soulève deux difficultés. Tout d’abord, la discussion budgétaire est aujourd’hui un processus particulièrement complexe et dense. Elle occupe trois semaines d’ordre du jour de l’Assemblée et 115 rapports budgétaires sont publiés à cette occasion. La densité de cette discussion pose un réel problème d’organisation et de visibilité. En outre, l’Assemblée ne pourrait pas adosser ses délibérations sur un texte européen précis. En effet, le semestre européen commence en novembre alors que l’Assemblée adopte généralement la première partie du projet de loi de finances vers le 25 octobre. Le Parlement européen souhaiterait que la Commission puisse donner son avis et formuler des recommandations sur les projets de budget nationaux en novembre, c'est-à-dire après cette date.
En tout état de cause, il est indispensable d’agir sans tarder dans le sens d’un contrôle accru de la représentation nationale. La décision prise par Conférence des présidents de notre Assemblée, le 31 juillet dernier, va dans ce sens : à l’initiative des commissions des affaires étrangères, des finances et des affaires européennes, la discussion du projet de loi de finances pour 2013 débutera par un « débat sur la prise en compte des orientations budgétaires européennes ». Il importera d’en suivre attentivement le déroulement et d’en tirer les conséquences afin d’en perfectionner le fonctionnement à l’occasion des exercices budgétaires suivants.
D – Quelles perspectives pour la poursuite de la construction européenne ?
Votre rapporteure souhaiterait, de manière plus prospective, conclure sur les perspectives qui lui paraissent ouvertes pour continuer, de manière pragmatique, la réorientation de la construction européenne qui est engagée depuis quelques mois.
Dans son discours devant la XXème Conférence des ambassadeurs, le 27 août dernier, le Président de la République a très clairement rappelé ce que doivent être les objectifs, dans le champ économique et social, de l’approfondissement de l’Europe : « cet approfondissement doit aussi nous permettre de mettre en place des instruments de solidarité. À terme, je pense que l’union budgétaire devra évoluer vers une mutualisation des dettes, dans les meilleures conditions pour chacun, de façon à régler les stocks de dettes existantes mais aussi d’emprunter pour l’avenir. Ce sera un élément de discussion. Enfin, l’intégration doit permettre d’avancer vers l’harmonisation fiscale et la convergence sociale et environnementale ».
a) Une gouvernance économique commune « tous azimuts »
Sans entrer dans le détail de ce qui pourrait être fait, votre rapporteure plaide pour une gouvernance économique commune qui n’oublie aucun des champs des politiques économiques. Parfaire le marché unique est peut-être utile, mais cela n’a de sens que si les autres politiques communes sont actives :
– la résorption des déséquilibres, notamment des balances des paiements, ce qui implique une coordination des politiques macroéconomiques et un effort partagé entre pays déficitaires et excédentaires. Des économistes estiment que dans les années 2000, le coût salarial unitaire (coût salarial ramené à la productivité) aurait diminué de 20 % dans l’industrie allemande quand il évoluait peu en France (52) ; c’est l’équivalent d’une dévaluation compétitive d’autant. Aujourd’hui, l’effort de rééquilibrage doit être partagé ; il est nécessaire que nos partenaires allemands desserrent leurs salaires ;
– la reprise du processus interrompu d’harmonisation fiscale et sociale, car il n’est pas acceptable que subsistent dans l’Union de véritables paradis fiscaux, comme l’Irlande pour l’impôt sur les sociétés, laquelle a bénéficié d’un plan d’aide massif sans contrepartie en la matière. Il n’est pas non plus acceptable que des travailleurs détachés dans d’autres pays de l’Union y restent payés au salaire de leur pays d’origine, car alors les différences de salaire ne rendent pas compte de différences de productivité des économies, mais constituent une concurrence déloyale (selon certaines estimations (53), en l’absence de salaire minimum légal et de minimum conventionnel dans de nombreuses branches, 7,8 millions de personnes, soit 23 % des salariés employés en Allemagne, percevaient en 2010 un salaire horaire inférieur à 9,15 euros, soit sensiblement le SMIC français ; pour 1,4 million d’entre eux au moins, le salaire horaire était même inférieur à 5 euros). La concurrence fiscale et sociale est une forme de concurrence déloyale à laquelle il faudra un jour mettre un terme ;
– le développement, au niveau communautaire qui est le niveau pertinent, de mécanismes efficaces de régulation des activités bancaires et financières (supervision, mais aussi le cas échéant séparation des activités de crédit et d’investissement et interdiction de certains types d’opérations) ;
– l’élargissement de la construction européenne à des champs nouveaux, dans les domaines d’avenir. Votre rapporteure se félicite de ce point de vue que lors de la Conférence environnementale de Paris des 14 et 15 septembre derniers, le Président de la République ait réactivé le projet de « communauté de l’énergie » porté par M. Jacques Delors et qu’il ait souhaité que ce projet puisse être discuté avec l’Allemagne à l’occasion du soixantième anniversaire du traité de l’Élysée.
Et cette nouvelle gouvernance économique, qui doit favoriser une intégration européenne solidaire, ne pourra se faire sans que le budget communautaire, instrument de solidarité, n’augmente quelque peu. Le principe de solidarité doit conduire les États membres contributeurs nets à modérer leurs demandes de restriction du budget communautaire ; il doit aussi amener à une remise en cause des multiples « ristournes » accordées au fil des ans aux uns et aux autres.
b) Plus de solidarité pour sortir de la crise des dettes publiques
Le débat sur les perspectives de mutualisation des dettes souveraines et de création d’une « dette européenne » n’est manifestement pas clos. Il se mêle au débat, un peu différent, sur la monétisation de ces dettes, c’est-à-dire le rôle de la Banque centrale européenne. L’objectif dans les deux cas est le même : écarter le risque de défaut, de sorte de diminuer les taux actuellement mis à la charge des États en difficulté.
Malgré les oppositions, des pas significatifs ont été franchis avec les programmes de rachat de dettes par la BCE, le dernier présenté comme illimité, ou avec la décision d’expérimenter les project bonds dans le cadre du Pacte pour la croissance et l’emploi.
L’attribution au MES d’une licence bancaire, qui lui permettrait d’être financé par la BCE, constituerait un pas supplémentaires très significatif en accélérant la monétisation d’une dette qui serait bien, par ailleurs, celles de l’ensemble des Européens (le capital du MES étant partagé entre les États).
D’autres projets permettant d’avancer sur le chemin des « euro-obligations » ont été mis en avant :
– la possibilité d’euro-bills, c’est-à-dire de titres à court terme ;
– la mise en place d’un « fonds de rédemption », proposée par les « cinq sages » du Conseil des experts économiques allemands. Les États membres concernés (à l’exception de ceux inscrits dans un plan d’aide) mettraient en commun la part de leur dette publique excédant 60 % du PIB et, en contrepartie, transféreraient définitivement au fonds des ressources fiscales permettant un remboursement en 25 ans. La France pourrait ainsi faire prendre en charge un surplus de dette de 27 % de son PIB en transférant des recettes d’un montant de 1,3 % de celui-ci. Les taux concédés seraient faibles et le ratio de dette diminuerait rapidement, revenant par exemple pour la France à 53,5 % ;
– la proposition en quelque sorte inverse émise par MM. Jacques Delpla et Jakob von Weizsäcker, pour le think tank européen Bruegel. Ce serait la fraction de la dette émise sous le seuil des 60 % du PIB de chaque État qui serait fusionnée et garantie collectivement, devenant une dette « bleue » très recherchée par les investisseurs pour sa sécurité et sa liquidité (vu la taille du marché qu’elle représenterait, équivalente à celle du marché de la dette publique américaine), tandis que la dette émise au-delà du seuil resterait une dette « rouge » nationale (avec la possibilité donc qu’un défaut de paiement concerne cette seule dette « rouge »).
Le Président de la République a développé le 27 août dernier, devant les ambassadeurs, la feuille de route de l’union politique telle qu’il la conçoit : « d’une manière générale, j’ai proposé que l’Union avance autour de l’idée d’une intégration solidaire qui permette qu’à chaque étape, des mécanismes nouveaux soient accompagnés par des avancées démocratiques. C’est l’union politique. Mais je veux aussi faire des propositions. Le rôle de l’Eurogroupe et de son président – et j’en ai saisi le ministre de l’économie et des Finances – doit être renforcé. Je propose également que les chefs d’État et de gouvernement se réunissent beaucoup plus régulièrement lorsqu’il s’agit de la zone euro ; donc les chefs d’État et de gouvernement de la zone euro et pas simplement deux fois dans l’année (…) ». Intégration solidaire, avancées démocratiques et propositions pragmatiques s’inscrivant dans le cadre institutionnel actuel, tels sont les mots-clefs.
Votre rapporteure a pu constater qu’en Italie l’adhésion à l’idée d’une Europe fédérale reste large dans les partis de gouvernement et que la perspective d’une éventuelle nouvelle révision des traités européens y est sereinement envisagée.
Après une période où les dirigeants allemands ont semblé parier sur la gestion intergouvernementale de la crise (et particulièrement sur le couple franco-allemand), la perspective d’une future « union politique » de l’Europe est réapparue dans le paysage politique allemand à partir de novembre 2011, quand le congrès de la CDU, parti de Mme Angela Merkel, a appelé faire de l’Union européenne « une union politique forte », puis que la Chancelière a fait elle-même diverses déclarations en faveur de « plus d’Europe » et de « solutions politiques » qui seraient seules à même de résoudre la crise et pourraient impliquer une révision des traités. Mme Merkel ou son ministre des finances, M. Wofgang Schaüble, ont fait diverses propositions institutionnelles audacieuses, telles que l’élection du président de la Commission européenne au suffrage universel ou encore l’institution d’un ministre des finances européen qui aurait un droit de veto sur les budgets nationaux.
Naturellement ces appels à l’union politique présentent en partie un caractère tactique en Allemagne ; ils apparaissent comme une manière de réaffirmer l’engagement européen du pays à un moment où il semble quelque peu isolé en Europe et où son intransigeance sur les questions budgétaires est parfois qualifiée d’égoïsme. Mais ces appels sont également profondément cohérents au regard d’un principe à propos duquel aucun Allemand ne paraît prêt à transiger, celui du contrôle démocratique, et en particulier du contrôle démocratique du budget, sur lequel la Cour constitutionnelle de Karlsruhe veille en défendant les prérogatives du Bundestag. Dans cette optique, plus de solidarité budgétaire européenne – au détriment des compétences du Bundestag – implique obligatoirement une réelle avancée dans le contrôle démocratique des institutions européennes.
Dans son tout récent Discours sur l’état de l’Union 2012, le président de la Commission José Manuel Barroso s’est rallié à un concept employé il y a vingt ans par son prédécesseur Jacques Delors : la « fédération d’États-nations ». Dans quelle mesure et surtout à quelle échéance une évolution en ce sens imposerait-elle de réviser les traités européens ? La question est ouverte. Votre rapporteure estime que la priorité doit être donnée aux marges de progression compatibles avec le cadre institutionnel actuel, qui sont considérables.
a) Pour des institutions européennes dynamiques, dirigées par des personnalités fortes et légitimes
En premier lieu, plutôt que de multiplier les postes de responsabilité dans les institutions communautaires en vue d’en accroître la visibilité, ainsi qu’on l’a fait, mais en les confiant à des personnalités qui n’en ont pas toutes l’envergure, il s’agit de parvenir à redonner à l’Europe, comme elle a l’a eue dans le passé, la capacité de prendre des orientations claires, sous l’impulsion de personnalités fortes et légitimes. Cela peut impliquer un changement des modes de désignation des responsables européens, trop dominés par les compromis intergouvernementaux, mais peut aussi provenir d’évolutions compatibles avec le cadre institutionnel actuel. De ce point de vue, il serait certainement utile que de véritables acteurs politiques européens se dégagent, de vrais « partis » à l’échelle de l’Europe avec de vrais leaders reconnus par les citoyens.
Dans cette optique, votre rapporteure souligne le caractère novateur des décisions prises par le Parti socialiste européen (PSE) lors de son congrès à Prague en 2009, puis de sa convention à Bruxelles en novembre 2011 : le futur candidat des Socialistes européens à la présidence de la Commission sera désigné avant les élections européennes de 2014, dans le cadre d’une procédure démocratique, transparente et ouverte qui s’apparentera à des « primaires ». Cette personnalité mènera, au nom de tous les partis socialistes ou sociaux-démocrates européens adhérents du PSE, une campagne européenne sur un projet commun. En mettant ainsi en lumière une personnalité, qui portera un projet politique à l’échelon européen, on peut espérer susciter l’intérêt des citoyens et donc combattre l’abstention aux élections européennes. A fortiori si les autres partis européens, notamment le Parti populaire européen et les Libéraux (Parti européen des libéraux, démocrates et réformateurs), s’engagent dans la même démarche, car alors le débat électoral européen commencera à ressembler à ce qui se passe dans chacun des États, avec des différences programmatiques identifiables par tous, des personnalités qui s’exposeront pour convaincre les électeurs de leur aptitude à occuper un des mandats essentiels de l’Union, des engagements de campagne… Et au terme de ce processus, le nouveau président de la Commission pourra revendiquer une réelle légitimité démocratique. Une telle évolution permettrait donc d’atteindre le même objectif que celui de la proposition consistant à élire le président de la Commission au suffrage universel, et ce à beaucoup plus court terme et sans avoir à passer par une révision hasardeuse des traités européens.
b) Pour une plus grande légitimité démocratique, appuyée à la fois sur le Parlement européen et les parlements nationaux
L’autre enjeu à court terme, c’est celui de la légitimité démocratique. Dans une fédération d’États-nations, cette légitimité peut être double, reposant à la fois sur le Parlement européen et sur les parlements nationaux.
Ces derniers – et en particulier, on l’a dit supra, le Parlement français – doivent assumer pleinement leur mission de contrôle de l’action de leurs gouvernements dans les institutions européennes, mais aussi dialoguer directement avec ces dernières.
S’agissant du Parlement européen, pour ce qui concerne spécifiquement les questions en lien avec le traité budgétaire, on relèvera qu’en application du Six pack, un rôle nouveau lui est dévolu dans le cadre des procédures mises en œuvre, notamment en cas de sanctions envisagées contre un État membre : dans le cadre du « dialogue économique », la commission compétente du Parlement pourra inviter le président du Conseil, la Commission et, le cas échéant, le président du Conseil européen ou le président de l’Eurogroupe à débattre avec elle.
Mais il convient aussi de trouver des modalités opérationnelles permettant un travail en coopération du Parlement européen et des parlements nationaux, ce à quoi invite d’ailleurs l’article 13 du TSCG en instituant une « conférence réunissant les représentants des commissions concernées du Parlement européen et les représentants des commissions concernées des parlements nationaux afin de débattre des politiques budgétaires et d’autres questions régies par le présent traité ».
Plusieurs propositions ont déjà été faites s’agissant du contrôle démocratique dans le champ économique et budgétaire :
– certains de nos collègues (MM. Bernard Accoyer, Jérôme Cahuzac, Gilles Carrez et Pierre Lequiller) ont suggéré en 2010 de constituer une « conférence budgétaire » composée de représentants des commissions des finances, des affaires étrangères et des affaires européennes des différents parlements ;
– de son côté, le Parlement européen a engagé une réflexion qui s’inscrit dans une démarche visant à obtenir à terme que les orientations stratégiques pour les politiques économiques soient soumises à la procédure de codécision. Cette démarche entend s’appuyer notamment sur les parlements nationaux. Le président Martin Schulz a transmis aux groupes parlementaires une proposition qui sera examinée en septembre. Selon cette proposition, qui s’inspire largement d’un rapport de Mme Pervenche Beres, les commissions compétentes du Parlement européen formeraient un « groupe de travail élargi sur le semestre européen » qui coordonnerait les travaux d’élaboration, deux fois par an, d’un « rapport d’initiative ». L’un sortirait juste avant le Conseil européen de printemps (fin février, début mars) à partir de l’« examen annuel de croissance » de la Commission ; l’autre, préparé à partir de la fin du mois de juin, en vue d’une adoption en plénière d’octobre, avant le nouveau rapport de croissance de la Commission. Le Parlement européen souhaiterait associer les parlements nationaux à cette démarche à deux moments précis : au début de l’année, via « une semaine parlementaire » ; au début de l’automne, via une conférence interparlementaire. Votre rapporteure observe toutefois qu’une extension de la procédure de codécision nécessiterait une révision des traités qui n’est pas opportune, de son point de vue, tant que la crise présente n’aura pas été surmontée ;
– M. Jean-Louis Bourlanges a proposé la création d’une assemblée de la zone euro, composée de représentants des parlements des pays membres de celle-ci. Mais, du point de vue de votre rapporteure, créer une nouvelle institution européenne n’est pas souhaitable.
Plusieurs options sont donc sur la table. Votre rapporteure est attachée à ce qu’un dispositif associant les parlements nationaux soit rapidement mis en place pour jouer son rôle dans le renforcement de la coordination et de la surveillance économiques et budgétaires. L’intervention accrue des institutions européennes dans ces domaines qui touchent aux souverainetés nationales ne sera acceptée que si leur légitimité démocratique est également renforcée.
Ce pourrait être une « conférence parlementaire », constituée de membres des parlements nationaux, qui serait dotée d’une sorte de commission permanente restreinte afin d’en assurer l’efficacité et la continuité. Dans le même temps, le contrôle démocratique assuré par le Parlement français doit être renforcé.
C’est le sens de la proposition de résolution que Christophe Caresche et votre rapporteure vous soumettront en même temps que le présent traité. Dans cette résolution, qui s’inscrit dans le cadre de l’article 88-4 de la Constitution, il est proposé que l’Assemblée nationale :
– « demande la création rapide de la Conférence prévue à l’article 13 du traité » ;
– demande que cette conférence débatte « de l’ensemble des enjeux relatifs à l’Union économique et monétaire, en particulier des politiques budgétaires et de leurs conséquences sociales, selon des modalités aptes à garantir que ses délibérations soient prises en compte aux diverses étapes de la coordination économique et budgétaire européenne » ;
– suggère à cette fin l’organisation annuelle de deux réunions plénières de la nouvelle institution, au printemps et à l’automne, en cohérence avec les échéances du « semestre européen », de façon à ce que le Conseil de l’Union européenne (Conseil des ministres) puisse prendre en compte ses délibérations ;
– suggère de même la constitution au sein de cette conférence d’une « commission spéciale » spécifique à la zone euro ;
– demande qu’à chaque étape du « semestre européen » et de toute procédure analogue, telle que celle prévue sur les budgets nationaux dans le Two pack en discussion, puisse être formalisé un contrôle parlementaire renforcé sur la ces procédures ;
– estime indispensable l’harmonisation des calendriers budgétaires national et européen.
C’est sans hésitation que votre rapporteure votera pour la ratification du traité budgétaire et vous invite à le faire, ce pour plusieurs séries de raisons qui ont été développées dans le présent rapport.
Un premier ensemble d’observations a pour objet la portée réelle du traité budgétaire. Pour certains commentateurs, il nous enserrerait dans un corset financier sans précédent. Mais cette opinion ne résiste pas à l’analyse. Tout d’abord, on l’a dit, l’essentiel des clauses du traité étaient déjà présentes dans le droit européen avant sa signature, plus précisément dans le pacte de stabilité et de croissance revu par le Six pack : il en est ainsi de l’obligation de réduire (avec des aménagements que l’on a vus) les dettes publiques d’un vingtième de la fraction excédant 60 % du PIB par an ; il en est de même sur les règles de vote, le traité ne faisant que poursuivre la démarche engagée de généralisation de la « majorité qualifiée inversée » pour la procédure de surveillance des déficits excessifs ; c’est encore le cas pour la référence non seulement au déficit public effectif – plafonné en principe à 3 % depuis le traité de Maastricht –, mais aussi au déficit structurel. Sur ce point, le traité se borne à fixer à 0,5 point de PIB et non plus un point de PIB le maximum à viser. Mais la référence à un déficit « structurel » est en soi à saluer, car outre les marges de souplesse qu’elle laisse sur sa définition et son calcul, elle permettra, enfin, de prendre en compte les cycles économiques et d’éviter les politiques procycliques. Et l’analyse d’économistes comme ceux de l’OFCE montre bien que l’objectif de déficit structurel posé par le traité est en fait en deçà des engagements pris par le Président de la République et le Gouvernement, engagements qui seront tenus car ils ont été annoncés avant l’élection présidentielle et correspondent à l’intérêt national – indépendamment de tout engagement communautaire.
Quant à la transposition du traité dans le droit interne des États membres, le fait est que sa rédaction laisse ouvertes des options multiples. Pour la règle d’équilibre, ou « règle d’or », nous n’avons ainsi pas besoin d’une révision de la Constitution et pouvons nous en tenir à une loi organique qui confortera un instrument utile, les lois de programmation des finances publiques. Car qui peut contester l’utilité d’une projection pluriannuelle des finances publiques, dont le principe est posé depuis 2001 dans la loi organique relative aux lois de finances ? Quant à l’obligation de disposer d’un organisme de conseil « indépendant » sur les questions budgétaires, comment le Parlement pourrait-il s’en offusquer après tant d’années à discuter de la validité des prévisions économiques et budgétaires des gouvernements successifs et à chercher à développer sa propre expertise ?
Ensuite, le traité qui nous est soumis doit être ratifié.
Tout d’abord, ce texte est un compromis. Il a été, en quelque sorte, imposé par l’Allemagne à ses partenaires, afin de consolider la discipline budgétaire en Europe après plusieurs années de laxisme, en particulier dans notre pays. Il a aussi été la contrepartie pour plus de solidarité dans la zone euro. TSCG et traité instaurant le MES sont d’ailleurs liés puisqu’à l’avenir, un État n’ayant pas ratifié le premier ne saurait bénéficier de l’aide du second. Refuser de ratifier le TSCG aurait donc pour conséquence, pour la France, de se priver, à l’avenir, de la possibilité de bénéficier du principal outil de solidarité financière de la zone euro, un outil capable de venir en aide aux États mais aussi aux banques en difficulté en les recapitalisant.
Le TSCG est aussi l’élément d’un tout. Grâce à la nouvelle impulsion donnée par le Président de la République, le Conseil européen des 28 et 29 juin 2012 a accompli des progrès remarquables avec notamment le pacte de croissance pour développer des projets concrets, la taxe sur les transactions financières pour bénéficier à l’emploi des jeunes ou à la formation, la supervision bancaire pour empêcher les dérives qui ont conduit à la crise financière. Ces éléments complètent le TSCG. Il convient de les mettre en œuvre sans tarder. Rejeter le traité aurait pour conséquence de faire voler en éclats ces avancées qui ont été voulues et négociées par vingt-cinq États, à un moment où notre continent traverse une crise éprouvante.
Car le TSCG n’est pas une fin en soi. Avec les décisions prises à la fin du mois de juin, il constitue une première étape de la réorientation de la politique européenne.
Il nous faut une Europe plus forte, plus réactive et plus solidaire, votre rapporteure en est convaincue.
La perspective d’une union budgétaire, bancaire, fiscale et sociale est indispensable. Il n’est pas concevable que, dans un marché unique, les États se fassent une concurrence par le dumping fiscal et social avec pour conséquence, inéluctable de brouiller l’image du projet européen aux yeux de nos concitoyens.
Le renforcement de la coordination économique et budgétaire conduit inévitablement à reposer la question de l’union politique. Celle-ci doit être envisagée d’une manière pragmatique en privilégiant les deux axes de progression qui correspondent aux déficits actuels de l’Europe : une Europe qui prend des décisions fortes sous la direction de personnalités légitimes auprès de l’ensemble des citoyens européens ; une Europe à la légitimité démocratique refondée, s’appuyant à la fois sur le Parlement européen et les parlements nationaux.
C’est donc au bénéfice de ces observations que votre rapporteure vous invite à adopter le projet de loi qui nous est soumis.
La Commission examine le présent projet de loi au cours de sa réunion du mercredi 26 septembre 2012.
Mme Élisabeth Guigou, rapporteure. Notre Commission examine ce matin le traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l’Union économique et monétaire. Il n’a échappé à personne à quel point ce traité, et au-delà le « paquet européen » qui l’accompagne, le complète, mobilise et intéresse les responsables politiques que nous sommes. D’une certaine manière, je vois dans cette implication une chance pour l’Europe car, ces dernières années, me semble-t-il, l’idée même d’Europe a été abimée par les dérives libérales et la crise de la zone Euro. Or, il est de notre responsabilité, femmes et hommes politiques, de remettre le projet européen, l’ambition européenne au cœur du débat public.
Les ministres Laurent Fabius et Bernard Cazeneuve – ce dernier encore hier – se sont largement exprimés devant votre Commission et ont répondu – je l’espère – à l’ensemble de vos questions. Avant d’entrer dans le vif du sujet, je voudrais rappeler, mais vous le trouverez également dans le rapport que je vous ai fait parvenir, quelques éléments de notre histoire européenne tant j’entends ou je lis d’inexactitudes.
Premier point, les règles fondamentales de l’union monétaire remontent au traité de Maastricht, qui est à l’origine de la monnaie unique. Car il a toujours été clair pour tout le monde qu’une union monétaire ne pouvait se construire sans règles communes. C’est pourquoi les Européens ont alors décidé que la monnaie unique serait gérée par une Banque centrale indépendante des États et ont édicté des règles qui plafonnent leurs déficits publics à 3 % du PIB et leur dette publique à 60 %. C’est aussi au traité de Maastricht que remonte l’établissement d’une procédure de surveillance du respect de ces règles. Le peuple français l’a accepté, par référendum, en septembre 1992.
Ces règles ont été ensuite précisées, complétées, amendées par des dispositions dites de droit dérivé : le pacte de stabilité et de croissance en 1997, sa réforme en 2005, enfin l’ensemble de règlements et de directive que l’on appelle le Six pack en 2011.
Le traité budgétaire dont nous débattons aujourd’hui s’inscrit dans la continuité de ces dispositions. Quand on l’analyse, on se rend compte que les innovations qu’il apporte sont limitées. C’est pourquoi, d’ailleurs, nous pouvons l’approuver et le transcrire dans notre droit national sans avoir à modifier la Constitution. Comme l’a jugé le Conseil constitutionnel, le 9 août dernier, ce traité ne comporte pas de nouveaux transferts de souveraineté.
Le traité comprend trois parties principales. Elles sont respectivement consacrées au « pacte budgétaire », à la coordination des politiques économiques et à la gouvernance de la zone euro.
L’article 3 constitue la principale disposition du traité. Il pose le principe d’un déficit structurel annuel des administrations publiques qui ne peut excéder 0,5 % du PIB. Il autorise en outre les États à s’écarter temporairement de cette obligation « en cas de circonstances exceptionnelles » – ce qui inclut, par exemple, les cas de récession économique grave – et lorsque cela ne remet pas en cause la soutenabilité, à moyen terme, de leur budget.
Selon certains commentaires, cette limite de - 0,5 % nous enserrerait dans un corset financier sans précédent. De mon point de vue, cette opinion ne résiste pas à l’analyse.
Tout d’abord, la volonté de limiter le déficit n’est pas nouvelle. Comme je l’ai dit, elle est présente, dans le droit européen, depuis le traité de Maastricht. Quant à l’introduction d’une référence non plus au déficit tout court mais au déficit structurel, elle remonte à la révision du pacte de stabilité en 2005. Ce que le traité budgétaire change, c’est de fixer la limite maximum de déficit structurel à 0,5 % du PIB au lieu de 1 %. C’est un fait, la règle devient ainsi plus stricte.
La notion de déficit structurel appelle des précisions. Elle laisse ouverte des possibilités de négociation et des marges de manœuvre importantes aux politiques nationales, et ce, pour plusieurs raisons.
– Première raison, il y a plusieurs manières de calculer le taux de croissance dit « potentiel », dont l’écart par rapport au taux de croissance réel permet ensuite de calculer le solde structurel. En France, il en existe trois ou quatre différentes. Ensuite, au-delà de cette question du calcul, il y a des débats sur la définition même du périmètre de ce que l’on met ou non dans le solde structurel. Ainsi certains États souhaiteraient-ils que l’on ne prenne pas en compte les dépenses d’investissement. Je pense à l’Italie où je me suis rendue récemment et où mes interlocuteurs m’ont confirmé cette demande. Cela dit, le gouvernement français ne la partage pas.
– Deuxième raison, du fait du choix d’une référence au déficit public structurel calculé après avoir neutralisé l’impact de la conjoncture et du fait que l’on définisse une trajectoire à moyen terme pour l’atteindre, nous pourrons avoir, si nous le souhaitons, des politiques contracycliques. Cela évitera les situations absurdes et dramatiques où, face à une dégradation des comptes publics consécutive à une panne de croissance, les États se voient obliger d’y ajouter une contraction budgétaire qui accroît les difficultés.
– Enfin, vous avez sans doute lu les analyses qu’ont faites des économistes, notamment ceux de l’OFCE en juillet dernier, sur ce point. Sans entrer dans leur détail, il ressort de ces analyses un constat essentiel : viser 0,5 % de déficit structurel laisse en fait de nombreuses options budgétaires et économiques possibles.
Les choix budgétaires que notre majorité a faits ne sont pas imposés par le traité. Nous les tiendrons parce que le Président de la République a été élu par les Français sur ce programme et parce qu’ils correspondent à notre intérêt national.
Nous devons en effet rassurer nos partenaires européens et les investisseurs financiers sur le sérieux de la politique budgétaire française, après une décennie où la France, je le souligne, n’a pas été un exemple en la matière. Je veux rappeler que, sept années sur dix, entre 2002 et 2011, notre pays a affiché un déficit public global de plus de 3 % du PIB, ne respectant pas les engagements de Maastricht.
M. Jacques Myard. Comme l’Allemagne !
Mme la rapporteure. Notre pays a dépassé ce taux de 3% à partir de 2008 avec la crise, mais aussi en 2002, 2003 et 2004, avant la crise. De 2007 à 2012, notre dette a augmenté de 600 milliards d’euros. Son poids dans le PIB s’est accru de 45 %. Certes il y a eu la crise, mais cette augmentation a été plus forte que chez tous nos principaux partenaires : de l’ordre de 30 % en Allemagne, en Espagne et aux Pays-Bas ; quant à la Belgique et l’Italie, elles ont fait encore mieux.
Ce comportement de la France tranchait avec la période précédente : de 1997 à 2001, sous le gouvernement de Lionel Jospin, notre déficit public global avait constamment été réduit, passant de 3 % du PIB en 1997 à 1,4 % en 2001, et le taux d’endettement public, toujours inférieur à 60 %, avait également diminué.
Plus généralement, alors que le service de la dette est devenu le premier budget de la nation, avec 50 milliards d’euros, le retour progressif à l’équilibre des comptes peut seul nous éviter de tomber durablement dans la dépendance des marchés financiers. Si nous voulons retrouver des marges de manœuvre pour nos politiques, il est impératif de réduire notre dette.
C’est enfin un devoir moral : nous ne pouvons pas faire supporter aux jeunes générations le poids du surendettement de leurs aînés.
Pour en revenir à l’article 3, il faut préciser qu’il stipule également que chaque État se dote d’un mécanisme de correction qui peut se déclencher automatiquement s’il s’écarte de ses obligations liées au déficit. Il exige également que des organismes indépendants soient désignés, au niveau national, pour contrôler l’application et le respect de la règle de l’équilibre budgétaire. Enfin, il impose que, dans l'année qui suit l’entrée en vigueur du traité, les États signataires transcrivent, dans leur droit national, l’ensemble des obligations que je viens de décrire. Ils devront le faire, « au moyen de dispositions contraignantes et permanentes, de préférence constitutionnelles, ou dont le plein respect et la stricte observance tout au long des processus budgétaires nationaux sont garantis de quelque autre façon ».
Cette rédaction laisse ouvertes des possibilités multiples quant à la transposition de cette clause en droit national.
Les options prises par nos partenaires sont très diverses. Certains ont l’intention d’inscrire leur règle d’équilibre budgétaire dans une loi ordinaire. Ce serait, par exemple, le cas du Danemark, du Luxembourg, de l’Estonie et de la Hongrie. L’Irlande a effectué une révision constitutionnelle de façon à assurer la compatibilité du traité avec sa Constitution, mais envisage d’inscrire la règle d’équilibre budgétaire dans une loi ordinaire, ce qui est notable dans un pays qui recourt systématiquement au referendum pour toute révision des traités européens. Les Pays-Bas envisagent d’inscrire la règle d’équilibre budgétaire dans une « loi sur la soutenabilité des finances publiques » qui serait une loi simple. D’autres, comme l’Espagne, prendront ou ont pris des lois organiques après avoir révisé leur constitution antérieurement au traité.
En France, pour la règle d’équilibre, ou « règle d’or », nous n’avons pas besoin d’une révision de la Constitution. Comme l’a indiqué le Conseil constitutionnel, nous pouvons nous en tenir à une loi organique qui confortera un instrument utile, les lois de programmation des finances publiques. Et il me paraît difficile de contester l’utilité d’une projection pluriannuelle des finances publiques, dont le principe est posé depuis 2001 dans la loi organique relative aux lois de finances.
De même, comme l’a observé le Conseil constitutionnel, le mécanisme dit « automatique » de correction des dérives sera en fait modérément contraignant, le traité laissant à chaque État le soin de le définir et garantissant en tout état de cause le respect des prérogatives des parlements. Comme nous le verrons avec la loi organique, le Gouvernement nous proposera effectivement une transposition respectueuse de nos prérogatives budgétaires.
Quant à l’obligation de disposer d’un organisme de conseil « indépendant » sur les questions budgétaires, comment le Parlement pourrait-il s’en offusquer après tant d’années à discuter de la validité des prévisions économiques et budgétaires des gouvernements successifs et à chercher à développer sa propre expertise ? Comment, en tant que parlementaires, ne pas être satisfaits que le Conseil constitutionnel, dans sa décision sur le traité budgétaire, ait annoncé son intention de développer une jurisprudence sur la sincérité budgétaire, qui se fondera sur les travaux de l’organisme indépendant que nous allons établir dans la loi organique ?
L’article 4 du traité oblige tout État présentant un ratio d’endettement supérieur à 60 % du PIB à réduire sa dette dépassant cette valeur à un rythme moyen d’un vingtième par an. Cette exigence n’est pas nouvelle. Elle a été introduite en 2011 par le Six pack. Elle doit en outre être nuancée car elle ne s’appliquera pas aux États membres soumis à une procédure concernant les déficits excessifs, ce qui est le cas de la France, ni pendant une période de trois ans à compter de la correction de leur difficulté. Dès lors, elle ne risque pas de concerner notre pays avant 2017.
L’article 5 prévoit que tout État sous le coup d’une procédure pour déficit excessif établira un « programme de partenariat budgétaire et économique ».
L’article 6 invite les États à transmettre à l’avance au Conseil et la Commission leurs plans d’émission de dette publique. Cette disposition pourrait constituer un premier pas dans le sens de la coordination des émissions des dettes des États de la zone euro.
L’article 7 constitue, comme l’article 3, une des principales innovations du traité. Les États membres de la zone euro s’engagent à appuyer les propositions ou recommandations de la Commission relatives à un État en situation de déficit excessif sauf si une majorité qualifiée d’entre eux n’y est pas favorable. Concrètement, cela reviendra à appliquer le principe de majorité qualifiée inversée lorsqu'un État ne respectera pas le critère du déficit. Cette disposition s’inscrit encore dans la continuité du Six pack, qui a prévu la même chose pour le vote sur les sanctions éventuelles. Le traité empêchera ainsi de renouveler l’expérience de 2003, lorsqu’une simple minorité de blocage avait pu mettre un terme aux procédures engagées contre la France et l’Allemagne. Je rappelle que le président Jacques Chirac et le chancelier Gerhard Schröder avaient imposé cela. C’est aussi à cette époque qu’ils ont refusé de donner des prérogatives de contrôle sur place à l’Office statistique de l’Union européenne (Eurostat), parce qu’ils ne voulaient pas qu’il aille regarder comment leurs statistiques nationales étaient élaborées. Mais si Eurostat avait eu ces pouvoirs, il aurait pu enquêter sur la fiabilité des statistiques grecques et l’on n’aurait peut-être pas attendu 2009 pour découvrir qu’elles étaient maquillées, découverte tardive qui a précipité la crise.
Enfin, l’article 8 est le dernier article de la partie du traité consacrée au « pacte budgétaire ». Il donne compétence à la Cour de justice de l’Union européenne pour contrôler la transposition, par les États, de la règle d’équilibre budgétaire prévue à l’article 3. La portée de cet article ne doit pas être surestimée : en aucun cas les lois de finance de chaque État membre ne seront déférées aux juges de Luxembourg afin que ceux-ci en examinent la teneur et sanctionnent, éventuellement, leur incompatibilité avec les règles de discipline budgétaire. Ces lois sont et demeureront des actes de souveraineté, adoptés par chaque parlement, conformément aux constitutions nationales.
Le titre IV du traité, consacré à la coordination des politiques économiques, comprend trois articles. L’article 9 contient l’engagement des États contractants à renforcer la coordination de leurs politiques économiques. L’article 10 autorise le recours aux coopérations renforcées ou aux mesures spécifiques à la zone euro, conformément aux traités européens. Enfin, l’article 11 prescrit que toutes les grandes réformes de politique économique envisagées soient préalablement débattues voire coordonnées entre États.
Le dernier pilier du traité dont nous sommes saisis a trait à la gouvernance de la zone euro. L’article 12 consacre l’existence de sommets de la zone euro, lesquels existaient, de manière informelle, depuis l’automne 2008. L'article 13 soulève, lui, la question du contrôle démocratique de la mise en œuvre du traité. Il prévoit l’organisation d’une conférence réunissant les représentants des commissions compétentes du Parlement européen et des Parlements nationaux, afin de discuter des politiques budgétaires et d'autres questions régies par le traité. Nous y reviendrons naturellement avec l’examen de la proposition de résolution.
Ce traité que je vous ai présenté est est indissociable des compléments qui lui ont été apportés grâce à l’action du Président de la République.
Ces compléments se sont concrétisés lors du Conseil européen des 28 et 29 juin 2012. Les chefs d’État et de gouvernement ont alors décidé l’adoption d’un pacte pour la croissance et l’emploi comportant des actions immédiates, à hauteur de 120 milliards d’euros. Selon le ministre des affaires étrangères, que nous avons entendu le 11 septembre dernier, l’effet de ces actions sera même plus que doublé du fait de leur effet de levier sur l’investissement privé. Ce pacte comprend notamment l’augmentation du capital de la Banque européenne d’investissement, afin de permettre d’accroître de 60 milliards d’euros la capacité de prêts de l’institution. Il comprend aussi le redéploiement de 55 milliards d’euros de fonds structurels qui n’avaient pas encore été engagés, afin d’en faire bénéficier les PME et l’emploi des jeunes. Il implique aussi une accélération de la mise en œuvre de project bonds – c’est-à-dire d’emprunts pour financer des projets – pouvant aller jusqu’à 4,5 milliards d’euros.
Le Conseil européen des 28 et 29 juin dernier a également accompli d’importants progrès vers la mise en place prochaine d’une taxe sur les transactions financières par le biais d’une coopération renforcée. Il en a fait de même s’agissant de la supervision bancaire, qui pourrait constituer la première étape vers une « union bancaire ». Je ne vais pas m’attarder sur ces mesures car nous avons longuement entendu les ministres des affaires européennes, hier, sur ce point.
Enfin les chefs d’État et de Gouvernement ont souhaité mettre l’accent sur l’approfondissement de la solidarité financière. Ils ont notamment accepté que le Mécanisme européen de stabilité puisse recapitaliser directement les banques. Ceci est extrêmement important.
La mise en œuvre de ces mesures a déjà débuté. Ainsi la Commission européenne vient-elle de publier des propositions concrètes pour la supervision bancaire. Les négociations intergouvernementales pour parvenir à une coopération renforcée sur la taxe sur les transactions financières progressent. L’augmentation de capital de la BEI est actée et nous allons, en loi de finances, voter les crédits correspondant à la part de la France. Bernard Cazeneuve nous a dit hier que les retombées pour notre pays pourraient s’élever à environ 5 milliards d’euros, en se fondant sur les taux de retour constatés dans le passé. Il a cité plusieurs exemples concrets de programmes d’investissement susceptibles d’en bénéficier.
Rejeter le traité aurait pour conséquence de faire voler en éclats ces avancées. Plus généralement, ce traité, comme tout traité, s’inscrit dans un compromis global. Certains pays, l’Allemagne en premier lieu, y sont très attachés. Il est la contrepartie pour plus de solidarité dans la zone euro. Nous pouvons comprendre que l’on demande plus de responsabilité pour plus de solidarité. Nous pouvons comprendre que l’Allemagne ait pu vouloir marquer une rupture avec une période où les États membres, la France en particulier, n’ont pas toujours respecté leurs engagements budgétaires. En tout état de cause, il n’est pas possible de retirer un élément d’un compromis global sans compromettre tout le reste.
D’ailleurs, le compromis global que j’évoque est directement inscrit dans les textes. Le traité budgétaire et celui qui a instauré le mécanisme européen de stabilité sont liés : à l’avenir, un État n’ayant pas ratifié le premier ne pourra bénéficier de l’aide du second. Refuser de ratifier le traité budgétaire aurait donc pour conséquence, pour la France, de la priver, à l’avenir, de la possibilité de bénéficier du principal outil de solidarité financière de la zone euro, un outil capable de venir en aide aux États mais aussi, c’est pour la France le plus important, aux banques en difficulté en les recapitalisant directement.
Enfin, le TSCG n’est pas une fin en soi. Les décisions prises à la fin du mois de juin constituent une première étape de la réorientation de la politique européenne. Le Président de la République a développé le 27 août dernier, devant les ambassadeurs, la feuille de route de la construction européenne telle qu’il la conçoit. Centrant son propos sur l’« intégration solidaire », il a évoqué la nécessité d’aller vers une mutualisation des dettes publiques et celle d’avancer vers l’harmonisation fiscale et la convergence sociale et environnementale. Il a aussi développé sa vision de l’union politique : l’Union doit avancer de sorte « qu’à chaque étape, des mécanismes nouveaux soient accompagnés par des avancées démocratiques ». Il y a ajouté des propositions concrètes sur le rôle de l’Eurogroupe et la fréquence des réunions des chefs d’État et de gouvernement de la zone euro. Intégration solidaire, avancées démocratiques et propositions pragmatiques s’inscrivant dans le cadre institutionnel actuel, tels sont les mots-clefs.
Partageant cette feuille de route pour l’Europe, je voudrais insister sur quelques points que je considère comme particulièrement importants.
Premier point : dans le domaine économique, je crois qu’il est essentiel d’en revenir au projet initial inscrit dans le traité de Maastricht, à savoir l’union économique et monétaire, et pas seulement monétaire. Il nous faut coordonner nos politiques économiques, comme le traité nous y invitait et comme nous ne l’avons pas fait. Sur ce point, la responsabilité est d’ailleurs partagée par plusieurs gouvernements. Ainsi pourrons-nous résorber certains déséquilibres croissants qui sont pour beaucoup dans les difficultés de la zone euro. Je pense en particulier à ceux des balances courantes, où l’on voit des pays tels que l’Allemagne et les Pays-Bas accumuler des excédents croissants, de l’ordre de 6 % de leur PIB, en grande partie aux dépens de leurs partenaires.
Sur cette question, je voudrais citer Jacques Delors, en avril dernier : « Mon avertissement essentiel, vous le connaissez : il faut un pilier économique et un pilier monétaire dans l’Union économique et monétaire. Il n’y avait qu’un pilier monétaire et l’économique n’existait pas (…). S’il y avait eu coordination des politiques économiques, si les ministres des finances avaient voulu se parler franchement, cela aurait pu fonctionner (…). Si les ministres des finances avaient voulu se rendre compte de la situation, ils auraient vu que l’Irlande faisait des folies avec ses banques, que l’Espagne en faisait autant avec le crédit immobilier, que la Grèce nous cachait ses véritables statistiques. Mais ils n’ont rien vu ».
Deuxième point, l’union économique impose de reprendre le processus interrompu d’harmonisation fiscale et sociale. Je citerai seulement deux exemples : est-il tolérable que les taux de l’impôt sur les sociétés de certains États membres soient proches de 10 % et que quand l’un de ces États sollicite l’aide massive des autres – je pense naturellement à l’Irlande – personne ne lui demande de mettre fin à ce dumping fiscal ? Deuxième exemple : on constate en l’Allemagne, qu’en l’absence de salaire minimum légal et suite à la réunification, à l’immigration de travailleurs de l’est et à la directive dite Bolkestein, un quart des salariés, soit huit millions, gagnent moins que le SMIC horaire français, et peut-être deux millions moins de 5 euros. Dans ces conditions, la concurrence est-elle loyale ? Est-ce compatible avec une union économique ? Je ne le pense pas. Il nous faudra un jour un salaire minimum dans chaque État membre de l’Union européenne et, à plus forte raison, dans la zone euro.
Je conclurai sur l’union politique, car nous ne pouvons pas éluder ce débat quand nous renforçons l’union monétaire, budgétaire, bancaire et économique. Deux problèmes se posent à l’Europe, qui sont d’ailleurs liés : le premier, c’est l’incapacité à prendre de vraies décisions, le syndrome « trop peu, trop tard » ; le second, c’est le déficit démocratique, ce qui me conduit à penser que la crise de la zone euro est avant tout une crise politique. Je pense qu’il y a beaucoup de progrès que nous pourrions obtenir dans cette voie sans avoir à réviser les traités européens.
Prenons par exemple la désignation du futur président de la Commission européenne en 2014. Pour lui donner une légitimité démocratique, Mme Merkel a proposé qu’il ou elle soit élu au suffrage universel. Ce que propose le Parti socialiste européen est beaucoup plus simple, car cela s’inscrit dans les traités actuels pour un résultat voisin. Je vous rappelle que le PSE a décidé que le futur candidat des Socialistes européens serait désigné avant les élections européennes de 2014, dans le cadre d’une sorte de primaire européenne. Cette personnalité mènera, au nom de tous les partis adhérents au PSE, une campagne européenne sur un projet commun. En mettant ainsi en lumière une personnalité, qui portera un projet politique à l’échelon européen, nous espérons susciter l’intérêt des citoyens et donc combattre l’abstention. A fortiori si les autres partis européens, notamment le Parti populaire européen et les Libéraux, s’engagent dans la même démarche, car alors le débat électoral européen commencera à ressembler à ce qui se passe dans chacun des États. Nous aurons en effet des différences programmatiques identifiables par tous, des personnalités qui s’exposeront pour convaincre les électeurs de leur aptitude à diriger l’Union, des engagements de campagne.
Je vais conclure sur le contrôle démocratique en vous présentant la proposition de résolution adoptée hier par la commission des affaires européennes. Je souhaite naturellement que nous l’adoptions.
Ce qui sous-tend cette résolution, c’est l’idée que la légitimité démocratique peut être double dans une fédération d’États-nations : elle repose à la fois sur le Parlement européen et sur les parlements nationaux. Je suis d’ailleurs heureuse que M. Barroso ait repris à son compte cette idée de fédérations d’États-nations évoquée par Jacques Delors il y a plus de vingt ans !
La résolution a donc d’abord pour objet la mise en place rapide d’une conférence réunissant des représentants des parlements nationaux et du Parlement européen, conformément à l’article 13 du traité budgétaire. Dans ce domaine, nous ne partons pas de rien. Plusieurs propositions, plus ou moins différentes, ont déjà été faites, que ce soit par certains de nos collègues ou ex-collègues des commissions des finances et des affaires européennes pendant la législature précédente, par le Parlement européen ou encore par des personnalités telles que Jean-Louis Bourlanges. En ce qui me concerne je souhaite surtout que nous allions vite et que nous ayons une institution efficace. C’est pourquoi je plaiderai pour que cette conférence parlementaire soit dotée d’une sorte de commission permanente restreinte pour assurer un contrôle continu.
L’autre objet de la proposition de résolution, c’est une implication plus grande du Parlement français dans les processus de dialogue économique et budgétaire qui se mettent en place entre les institutions européennes et les États membres. Avec le « semestre européen », nous avons ainsi depuis deux ans un dialogue sur les choix économiques avec des échéances prédéterminées. Les propositions de nouveaux règlements dites Two pack actuellement en discussion entre les institutions européennes prévoiraient un peu la même chose sur les budgets nationaux. Le Parlement français doit systématiquement pouvoir jouer son rôle dans ce dialogue, ce qui implique que nous devons pouvoir en débattre aux dates qui conviennent.
En conclusion, je vous invite, chers collègues, à adopter le projet de loi de ratification du traité budgétaire et la proposition de résolution, afin que nous puissions poursuivre une construction européenne, je l’espère, plus solidaire et plus démocratique.
M. Pierre Lequiller. Le groupe UMP votera la ratification de ce traité et il votera le projet de loi organique établissant la règle d’or, même s’il considère qu’il aurait été préférable d’inscrire cette règle dans le marbre de la Constitution.
M. Jacques Myard. Jamais !
M. Pierre Lequiller. Nous souscrivons à la quasi-intégralité de l’argumentaire de la rapporteure. Comment pourrait-il en être autrement, s’agissant d’un texte que nous défendons depuis des mois ? Nous aurions préféré une ratification bien plus rapide, mais, à l’époque, la gauche n’en voulait pas.
Lorsque le Premier ministre et Mme la présidente Guigou exhortent les députés à approuver le traité, ce n’est pas à nous qu’ils s’adressent : c’est à leur propre majorité ! Le Premier ministre va jusqu’à affirmer que ceux qui voteront contre ou qui s’abstiendront veulent la mort de l’euro. Mais, pendant la campagne électorale, M. Hollande a tant répété que le traité n’était pas bon et devait être renégocié qu’il a semé le trouble non seulement dans l’opinion mais aussi dans sa majorité, qui apparaît fortement divisée. Phénomène singulier sous la Ve République, certains ministres du Gouvernement appartiennent à un mouvement qui votera contre la ratification.
Pour notre part, nous restons parfaitement logiques avec nous-mêmes : le traité a été négocié par le président Sarkozy, la chancelière Merkel et les chefs d’État des vingt-cinq pays signataires. Notre vote signifie aussi que nous entendons mener une opposition constructive et non pas systématique.
Vous nous dites que le pacte de croissance a changé la donne. Pourtant, il se résume à la réaffectation de 55 milliards d’euros de fonds structurels non utilisés et à une extension – prévue dès le début de 2012 – du rôle de la Banque européenne d’investissement : ce n’est pas avec cela que l’on pourra lancer des projets importants en France. On nous parle de 7 milliards pour notre pays. C’est évidemment insuffisant pour relancer la croissance.
Notre vote favorable tient aussi à l’absence de judiciarisation du dispositif : aux termes de l’article 8, il n’appartient pas à la Cour de justice de l’Union européenne de veiller au respect du pacte budgétaire par chaque pays.
Quelques observations : les administrations publiques visées à l’article 3 sont à la fois celles de l’État et celles des collectivités territoriales. Un tel dispositif fonctionne déjà en Espagne et en Allemagne. Étant donné l’importance des budgets des collectivités territoriales en France – et sachant que celles-ci sont en majorité tenues par la gauche –, comment entendez-vous leur faire respecter le pacte ?
Je note que le sommet des chefs d’État et de gouvernement de la zone euro, prévu à l’article 12, confirme une initiative que le président Sarkozy avait prise au plus fort de la crise, durant la présidence française de l’Union.
La conférence des représentants du Parlement européen et des parlements nationaux, à l’article 13, est un projet que j’avais soutenu lorsque j’exerçais la présidence de la commission des affaires européennes. En liaison avec le représentant permanent de la France à Bruxelles, nous avons obtenu la création de cette instance interparlementaire en dépit des réticences de certains partenaires, notamment de l’Allemagne. La coordination entre les États est satisfaisante : il faut maintenant qu’elle s’établisse aussi au niveau des parlements.
À cet égard, je souscris à l’opinion de Mme la rapporteure : notre Assemblée doit améliorer son contrôle de l’action du Gouvernement. Sur les sujets importants, il nous faudrait auditionner systématiquement le ministre avant qu’il ne se rende à Bruxelles. En Allemagne, le contrôle est très rigoureux. La Chancelière est auditionnée avant de participer aux conseils de chefs d’État et de gouvernement et elle est tenue de rendre compte au Parlement après ces réunions. Sans aller jusqu’à copier ce système, nous ferions bien de nous en inspirer.
Hier, le ministre a laissé entendre que je « défendais » les propositions allemandes. Tel n’est évidemment pas mon propos. Je constate seulement que l’Allemagne a fait des propositions et j’aimerais que la France y réponde. Ce que je reproche au Gouvernement, c’est son silence. Mme Merkel et M. Schäuble souhaitent la création d’un ministre européen des finances, l’élection du président de la Commission au suffrage universel, différents transferts de souveraineté vers le niveau européen, ainsi que la réunion d’une « convention » qui réfléchirait à un nouveau traité. Il est temps que la France, deuxième puissance en Europe, se prononce. Elle peut être d’accord ou non, formuler, le cas échéant, des contre-propositions, mais il faut engager le dialogue.
Je partage enfin le vœu de la rapporteure en faveur d’une harmonisation fiscale, environnementale et sociale. Mais je doute que l’augmentation de 20 milliards de la fiscalité française, supportée pour moitié par les ménages et pour moitié par les entreprises, aille dans le sens d’une telle harmonisation. Nos prélèvements obligatoires, supérieurs de 10 points à ceux de l’Allemagne et de la moyenne des pays de l’Union, sont déjà parmi les plus élevés d’Europe. La politique engagée par le Gouvernement ne laisse pas de surprendre nos partenaires. Politique européenne et politique intérieure sont étroitement imbriquées. Mieux vaudrait mettre en actes les propositions que nous formulons et les textes que nous signons !
M. François Rochebloine. Pour les raisons excellemment exposées hier par Charles de Courson, le groupe UDI votera ces textes.
Les centristes ont été les premiers à réclamer la « règle d’or ». Ils se félicitent aujourd'hui de son adoption, tout en regrettant qu’elle ne soit pas inscrite dans la Constitution. Ils se réjouissent également de la conversion du ministre des affaires européennes, dont le discours était par le passé quelque peu différent.
M. Noël Mamère. Je ne m’exprime pas en mon nom personnel mais pour exposer la position majoritaire du groupe écologiste qui, par ailleurs, laisse la liberté de vote à ses membres. Les députés écologistes s’opposeront, dans leur majorité, à la ratification du traité, quelques-uns la voteront, d’autres s’abstiendront.
Cette position est conforme à la décision du conseil fédéral d’Europe Écologie-Les Verts, qui s’est prononcé à 70 % contre la ratification. On ne peut pourtant accuser les écologistes d’être anti-européens, eux qui, depuis près de quarante ans, réclament la construction d’une Europe fédérale !
Ce traité, le candidat François Hollande en disait beaucoup de mal et assurait que la France ne le ratifierait pas avant d’obtenir des concessions dans le cadre d’une renégociation. Or, le texte qui nous est soumis est celui-là même que Mme Merkel et M. Sarkozy ont élaboré et signé. Nous sommes donc cohérents : ce que nous n’aimions pas lundi, nous ne l’aimons pas plus mardi !
Cela dit, il est vrai que le Président de la République a obtenu des avancées dans la construction économique et politique de notre continent. Nous approuvons ces avancées mais nous constatons que le pacte de croissance est assez limité. Les 120 milliards annoncés sont peu de chose au regard du budget des pays de l’Union européenne, d’autant que, sur ce montant, 80 milliards étaient déjà engagés avant la négociation du pacte.
Un pacte pour quelle croissance, du reste ? S’agit-il de mettre en œuvre avec des fonds européens des projets que, pour notre part, nous considérons comme inutiles ? S’agit-il de multiplier des aéroports comme celui de Notre-Dame-des-Landes ? S’agit-il de tracer de nouvelles lignes à grande vitesse et de détruire ainsi des hectares de friches que l’on pourrait reconquérir, moyennant une politique agricole commune reverdie, pour rapprocher les terres agricoles du consommateur ? S’agit-il de poursuivre de grands projets que nous estimons contraires à la transition énergétique et à la transition écologique de l’économie ?
Selon Pierre Lequiller, la politique budgétaire de la France rendrait difficile une harmonisation fiscale européenne. Pour notre part, nous déplorons surtout qu’il n’existe toujours pas d’harmonisation fiscale avec le Luxembourg, l’Irlande ou la Belgique si chère à M. Arnault et à certain de ses amis.
De même, nous sommes encore très loin de la démocratisation de l’Union européenne que Mme Guigou vient de défendre avec vigueur. Mme Merkel a formulé des propositions, le parti socialiste européen également, mais les députés européens Verts ne sont pas en reste. Ils proposent en particulier que la gouvernance économique et politique de l’Europe rende des comptes au Parlement européen, seule instance européenne dont les membres sont directement élus par les citoyens. Il y a aussi beaucoup à faire en matière de taxation des transactions financières. La France a fait un effort, certes, mais bien peu de pays européens sont prêts à accepter un tel dispositif.
Enfin, une politique sociale, économique et environnementale véritablement protectrice suppose que l’on introduise des clauses en ce sens dans le périmètre de compétences de l’Union européenne. S’agissant du nucléaire, par exemple, l’harmonisation des politiques énergétiques semble très éloignée. Il en va de même pour les transports : mieux vaudrait, plutôt que de transporter 85 % de nos marchandises dans des camions, poser ces camions sur des trains. Ce n’est pas en libéralisant l’Union européenne à tour de bras que l’on pourra mener des politiques publiques communes contribuant à réduire notre consommation d’énergie !
Dernier exemple emblématique, la querelle faite à l’un de nos chercheurs qui se trouve obligé, alors qu’il travaille dans un institut public français, de faire appel à une fondation pour mener une étude sur l’impact éventuel des organismes génétiquement modifiés sur la santé...
M. André Santini. On est loin de la question du traité !
M. Noël Mamère. Pas du tout. Il existe au sein de l’Union une structure, l’Autorité européenne de sécurité des aliments, dont certains membres ont des intérêts dans l’industrie privée.
Quoi qu’il en soit, ce traité est dépassé. Nous savons bien que les États membres travaillent déjà à la rédaction d’un nouveau traité. Les Verts du Parlement européen ont appelé à la mise en place d’une assemblée constituante. La construction politique de l’Europe est donc en voie de consolidation, même si l’on est encore loin des États-Unis d’Europe que souhaitent les écologistes.
En l’état, ce texte est avant tout un signe envoyé aux marchés qui, paraît-il, ont besoin d’être rassurés. Il n’impose rien d’autre que l’austérité. Alors que nous faisons face à une récession qui commence à se propager à l’Allemagne, une ratification n’est pas acceptable. Le renforcement de l’austérité pénalisera d’abord les personnes les plus vulnérables socialement, économiquement et écologiquement.
M. François Asensi. Nous sommes tous d’accord pour constater le désamour profond et durable entre les Européens et l’institution européenne. La décision de ne pas soumettre le traité à référendum ne fera qu’aggraver ce sentiment. Le déni de démocratie est patent. Pouvait-il en être autrement ? En 2005, les Français se prononcent mais on ne tient pas compte de leur avis et, en 2008, le traité de Lisbonne reprend dans ses grandes lignes le traité constitutionnel qu’ils ont rejeté. Le Congrès réuni à Versailles ratifie le nouveau texte grâce à l’abstention du parti socialiste. Devant cette dérive antidémocratique, Français et Européens en viennent à douter du bien-fondé de cette magnifique idée qu’est la construction européenne.
Si je souligne mon attachement à cette idée, madame la présidente, c’est que vous affirmez dans votre rapport que les personnes opposées au traité sont soit des xénophobes, soit des populistes.
Mme la rapporteure. Je n’ai pas dit cela !
M. François Asensi. Mes amis du Front de gauche et moi nous sommes pourtant sentis visés !
Aux yeux des élites européennes, les problèmes sont si complexes qu’on ne saurait demander aux peuples d’émettre un avis à leur sujet. Le philosophe allemand Jürgen Habermas, européen convaincu et partisan du « oui » en 2005, considère du reste que l’Europe est entrée dans une ère « post-démocratique ». Il y a là quelque chose de grave, une sorte de soviétisme politiquement correct par lequel on considère que l’on peut faire le bonheur des peuples à leur place et s’exonérer du suffrage universel.
Le parti socialiste, j’y reviens, s’était abstenu au sujet du mécanisme européen de stabilité et le président Hollande s’était engagé à renégocier le présent traité. Je rappelle aussi que les socialistes avaient déposé en 2008 une motion référendaire sur le traité de Lisbonne. Ils auront sans doute changé d’avis.
De notre point de vue, ce traité qui inscrit dans le marbre l’austérité budgétaire modifie profondément la nature de notre République parlementaire et sociale telle qu’elle est définie à l’article 1er de la Constitution : « La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. » Avec l’ère d’austérité que nous allons connaître, la République sociale restera largement virtuelle !
S’agissant du transfert de souveraineté, le contenu du traité a vocation à être intégré au droit communautaire dans cinq ans. Le Conseil constitutionnel sera-t-il amené, de ce fait, à se prononcer à nouveau ? Nous estimons pour notre part qu’il y a transfert de souveraineté : la Commission européenne définira la trajectoire budgétaire ; les choix des États souverains qui n’auront pas strictement suivi les orientations du traité pourront être contestés par d’autres États, dits vertueux, devant la Cour de justice de l’Union européenne. Où est la solidarité entre États membres ? C’est un nouveau pas vers une Europe fédérale autoritaire et bureaucratique.
Entendons-nous bien : ce ne sont pas les notions de transferts de souveraineté et de fédéralisme qui nous posent problème, mais bien la vision de l’Europe qui est proposée. Si la perspective était celle d’une Europe sociale, démocratique, où la fiscalité est harmonisée, des transferts de souveraineté seraient envisageables.
Quant aux avancées en matière de droits du Parlement, elles relèvent de l’alibi : on va permettre au Parlement français de « discuter », c’est-à-dire de donner un avis très formel. Nous nous sommes concertés à l’instant sur la proposition de résolution et nous allons voter contre.
Pour ce qui est du pacte de croissance, les 120 milliards obtenus par le Président de la République n’auront qu’un impact assez faible sur la croissance. En revanche, nous prenons un grand risque avec le retour à l’équilibre et la limitation du déficit public à 3 % en 2013. Je doute fort que nous atteignions ce chiffre. On table sur une croissance à 0,8 %, alors que les 30 milliards d’euros que l’on soustrait à l’économie vont l’obérer. Je crains des difficultés importantes.
Ce traité est contraire à l’intérêt général. Vous avez parlé, madame la présidente, d’harmonisation fiscale et sociale. Il en est question depuis trente ans, mais rien n’avance. La situation en Belgique, évoquée par M. Mamère, ne laisse pas de nous surprendre : certains s’y expatrient pour ne pas payer d’impôts ! La Belgique est pourtant un membre fondateur de l’Union.
Pour toutes ces raisons, nous allons voter contre la ratification du traité. Nous déplorons que l’on ne fasse pas appel au peuple français, qui est capable d’en comprendre la complexité et qui – les sondages l’indiquent – le rejetterait. On décide aujourd’hui à sa place en empruntant la voie parlementaire. On en reparlera dans quelques mois ou dans quelques années.
De même, je serais curieux de connaître la situation économique de l’Allemagne dans un an ou deux ans, compte tenu des difficultés qu’elle rencontre : vieillissement de la population, précarité, augmentation de la part des travailleurs pauvres. L’Allemagne n’est pas, contrairement à ce qui est avancé, le modèle vertueux qu’il convient de proposer pour l’Europe.
Le groupe de la Gauche démocrate et républicaine votera donc contre le projet de loi et la proposition de résolution.
Mme Estelle Grelier. Au nom du groupe socialiste, radical et citoyen, je vous remercie, madame la présidente, de votre exposé.
Il est important que nous puissions débattre, y compris à l’intérieur d’une famille politique, de sujets aussi essentiels que la construction européenne. Le contenu du traité n’a pas valeur constitutionnelle, il revêt dont un caractère réversible. C’est un point important aux yeux des socialistes, qui les conduit à apprécier la situation de manière différente aujourd’hui. Je le précise à l’attention des collègues qui ironisent sur l’évolution des positions de tel ou tel.
Ce traité n’est pas extraordinaire, mais il constitue une étape nécessaire : il nous permet de nous projeter dans l’avenir et d’obtenir ce que nous n’aurions pas obtenu sous un gouvernement différent. Le pacte de croissance, nous avons pu le constater lors d’un voyage en Allemagne avec Mme la présidente, n’a pas les faveurs de nos amis allemands, en particulier des membres de la majorité. Des négociations très dures ont été nécessaires pour l’obtenir. Il ne faut pas déprécier cette victoire.
Ce texte de sérieux budgétaire, qui n’a pas de valeur constitutionnelle, est accompagné d’un pacte pour la croissance et, surtout, confère à l’Union des fonctions régulatrices, ce que nous demandions depuis longtemps : supervision bancaire et taxe sur les transactions financières, dont nous souhaitons que le produit soit pour partie affecté au budget de l’Union pour financer un projet européen qui s’adresse aux citoyens. Nous devons aller plus loin en dotant le Mécanisme européen de stabilité d’une licence bancaire.
De même que la taxe sur les transactions financières, que nous obtenons enfin, nous appelons de nos vœux l’harmonisation sociale et fiscale. Le calendrier annoncé par le ministre du redressement productif sur la question du juste échange et la mise en place d’une vraie politique industrielle qui protège les emplois et les salariés va dans le bon sens. Nous suivons également avec attention les travaux du groupe Van Rompuy sur la mise en place d’une assurance chômage à l’échelle européenne.
S’agissant du contrôle parlementaire, je rejoins – une fois n’est pas coutume – M. Lequiller : les parlementaires français obtiennent une voix pour s’exprimer, mais ils n’effectueront pas un contrôle de même nature que leurs collègues du Bundestag. De ce point de vue, l’édifice reste déséquilibré au profit de l’Allemagne. Le renforcement du rôle des parlements et du contrôle démocratique n’en constitue pas moins une avancée importante.
M. Paul Giacobbi. Le groupe radical, républicain, démocrate et progressiste votera dans sa grande majorité en faveur de la ratification du traité. Certains de nos collègues pourraient éventuellement s’abstenir, mais réfléchissent encore.
M. Jacques Myard. Et la Corse, elle vote ?
M. Paul Giacobbi. Je vous prie de cesser de considérer que je ne représente que la Corse. En ma qualité de député, je représente l’ensemble de la France et j’ai, tout comme ma famille, quelques titres à le faire. De la même manière, vous représentez la Corse tout autant que le reste de la France – surtout sur un sujet de cette nature.
M. Jacques Myard. Très bien.
M. Paul Giacobbi. Trois raisons essentielles expliquent notre position.
La première est simple et pragmatique : dans la situation actuelle et quoi qu’on en pense, le rejet de la ratification entraînerait sur les marchés une augmentation du taux de recours à l’emprunt rédhibitoire pour les finances publiques françaises. Le taux à dix ans s’établit aujourd’hui pour la France à 2,24 %. Nous passerions instantanément, par le simple effet d’un rejet, à 5,80 %, taux auquel l’Espagne emprunte actuellement, voire davantage. À 7 %, on atteint une limite physique, au-delà de laquelle il n’est plus possible d’emprunter. Un rejet conduirait donc la France à l’effondrement financier à court terme.
Deuxième raison : la portée juridique réelle de ce traité est très limitée – l’exposé de Mme la rapporteure s’en est largement fait l’écho et l’amendement de notre collègue Jacques Myard le met en lumière. Selon la décision du Conseil constitutionnel, le traité n’est conforme à la Constitution que dans la mesure où il n’est pas véritablement contraignant et sous réserve que les actes adoptés et les instruments mis en place en application dudit traité seront soumis au contrôle du Conseil constitutionnel. De plus, les obligations qui découlent du traité de Maastricht ou du Pacte de stabilité et de croissance figurent parmi les dispositions les plus violées depuis cinq ans. À ma connaissance, aucun pays de l’Union européenne ne les a respectées.
Troisième raison, de fond : l’expérience des peuples et les études économiques – je fais référence aux travaux des professeurs Rogoff et Reinhart – montrent que l’équilibre des finances publiques se révèle, sur un terme moyen de sept à dix ans, toujours – il n’y a pas de contre-exemple – un facteur de croissance et d’emploi. À l’inverse, le déficit conduit à la récession sur des périodes de temps comparables.
En outre, des décisions importantes ont été prises au niveau européen en matière de recapitalisation des banques par le Fonds européen de stabilité financière et de supervision bancaire, même si cette dernière doit encore faire la preuve de son efficacité.
Pour finir, je souhaiterais dénoncer deux faux-semblants : le plan de relance de 120 milliards d’euros et la fameuse taxe sur les transactions financières.
Le plan de relance est constitué, tout d’abord, de 60 milliards d’euros de crédits déjà inscrits au budget et dont rien ne garantit qu’ils seront utilisés mieux et plus vite dans les années à venir. Il consiste, ensuite, en une recapitalisation de la Banque européenne d’investissement, qui avait déjà été décidée et qui devrait permettre, éventuellement et à terme, de dégager une capacité de prêt de l’ordre de 55 milliards d’euros. Il s’agit, enfin, des project bonds, très importants dans leur principe, mais dont le montant demeure limité.
L’effet de la taxe sur les transactions financières peut être mesuré aux réactions très modérées, pour ne pas dire positives, de la communauté bancaire internationale : personne ne proteste contre cette taxe. Toute personne connaissant le monde bancaire le sait : d’une part, cette taxe ne rapportera que très peu aux finances publiques ; d’autre part, elle ne freinera en rien la spéculation.
En revanche, toutes les banques, en particulier aux Etats-Unis, sont vent debout contre l’interdiction des opérations pour compte propre – proprietary trading – votée par le Congrès, mais que les autorités monétaires américaines tardent à mettre en œuvre. Dans ce cas de figure, une banque ne peut plus procéder à des opérations autres que pour le compte de ses clients, à leur demande et dans leur intérêt. Si l’on veut vraiment, au niveau européen, avoir une action efficace contre la spéculation, mieux vaut introduire cette règle appelée Volker rule – qui figurait d’ailleurs au programme du candidat élu à la Présidence de la République – que d’amuser la galerie, si vous me passez l’expression, avec la taxe sur les transactions financières, dont la portée sera limitée, si elle est jamais mise en œuvre.
M. Pierre Lellouche. Un éditorialiste du Monde vous invitait hier, chers collègues de la majorité, à ne pas biaiser. Or, vous continuez à le faire.
Vous êtes, madame la présidente, une des personnes qui connaissent le mieux l’histoire de la monnaie unique, puisque vous étiez aux côtés du Président François Mitterrand lorsqu’elle a été mise en place, il y a vingt ans. À l’époque, les fronts étaient renversés : j’étais aux côtés de M. Chirac dans un RPR divisé sur le référendum, vous apparteniez à une gauche favorable à la monnaie unique et au référendum. Aujourd’hui, c’est la majorité de gauche qui doit défendre un traité signé par l’opposition actuelle et qui est divisée sur le sujet.
Cela vous amène à récrire l’histoire à votre façon : vous ne pouvez pas expliquer aux Français que le seul responsable des déficits est M. Sarkozy. Les déficits publics sont, hélas, une habitude prise depuis quarante ans – le dernier budget présenté en équilibre l’a été en 1974 par le ministre Christian Poncelet – qui mène le pays à la ruine, point sur lequel je vous rejoins.
En outre, les 600 milliards d’euros d’endettement que vous attribuez à M. Sarkozy sont le produit de la crise, dont il était nécessaire d’amortir le choc en préservant les filets sociaux : nous avons ainsi maintenu le niveau de vie des retraités et des plus modestes. L’endettement est également la conséquence du plan de relance de l’industrie, que vous êtes en train de mettre à bas.
Vous en venez à dire que ce qui était un mal hier – pendant la campagne – devient un bien aujourd’hui. Pour convaincre vos propres troupes, vous êtes obligés de réinventer une histoire. Vous écrivez par exemple, madame la présidente, à la page 65 de votre rapport, que « l’arrivée aux responsabilités de M. François Hollande et de la majorité de gauche s’est immédiatement traduite par une réorientation du cours de la politique européenne ». À qui allez-vous faire croire cela ? En quoi cela a-t-il changé l’hétérogénéité des économies européennes ? En quoi cela a-t-il modifié la phobie allemande pour les transferts, que vous rappelez cinq pages plus loin ? La majorité des Allemands est opposée au rachat des dettes souveraines par la Banque centrale européenne. Ils ne veulent pas payer pour l’Europe du Sud. Les États-nations et les budgets nationaux existent toujours.
Vous vous glorifiez, en outre, de votre relation avec le président du conseil italien Mario Monti. Si ce dernier suscite l’admiration – de l’OCDE, de l’Allemagne – que vous relevez dans votre rapport, c’est parce qu’il mène des réformes de structures. Or, vous faites l’inverse, notamment en matière de relance industrielle.
Le pays a besoin de clarté. Si vous souhaitez ratifier ce traité, expliquez pourquoi et précisez la logique économique que vous suivez. Ne nous dites pas que ce traité est désormais un bien, au motif que M. François Hollande aurait inventé une politique économique nouvelle en Europe, ce qui est absolument faux : les fondamentaux de l’Europe dans la mondialisation restent les mêmes. Vous devez vous adapter à la réalité ou changer de politique. Je préfère l’attitude cohérente de nos collègues communistes, qui proposent une autre voie, à celle d’un parti socialiste qui louvoie. Ce traité doit nous donner les armes d’une discipline budgétaire qui n’est pas le contraire de la relance économique, mais sa condition. C’est pourquoi nous allons voter en faveur de la ratification de ce traité sans aucune difficulté. C’est à vous qu’il pose problème et c’est ce qui est gênant.
M. Philip Cordery. M. Lellouche sait bien qu’on ne peut pas voter un texte hors de son contexte. Si le traité était présenté seul avec la constitutionnalisation de la règle d’or, comme cela était prévu auparavant, nous serions un grand nombre dans la majorité à voter contre. Cependant, c’est un paquet qui nous est proposé aujourd’hui : non seulement le traité, mais aussi un pacte de croissance, l’union bancaire et la taxe sur les transactions financières. Ces éléments ne sont pas séparables les uns des autres. Ce paquet nous permet d’avoir à la fois des comptes équilibrés et une politique de relance au niveau européen.
Le précédent gouvernement et ses homologues européens ont mené une politique d’austérité, et rajouté la crise à la crise. Grâce à l’action du Président de la République et du Gouvernement, nous sommes aujourd’hui dans une phase complètement différente. Si l’on souhaite continuer à soutenir cette réorientation, on ne peut que voter en faveur de ce paquet.
S’agissant de la proposition de résolution, madame la présidente, quelles initiatives la commission pourrait-elle prendre pour mettre en œuvre les points 5 et 6 relatifs au renforcement du contrôle parlementaire sur la politique européenne du Gouvernement ?
M. Jacques Myard. Vous savez, madame la présidente, que nous ne sommes pas tout à fait d’accord. Vous dites que l’Europe libérale a abîmé l’Europe. Je vous accorde que la Direction générale de la concurrence est autiste. J’ai moi-même présenté deux rapports sur la nécessité d’une politique industrielle européenne : on en est très loin et c’est un problème majeur. En réalité, ce qui abîme l’Europe, c’est l’utopie. En vous écoutant, on comprend que l’Europe est un fonds de commerce, un credo quasi religieux défendu au mépris des réalités. Il faut que cela cesse.
La réalité, la voilà : ce traité va accélérer l’implosion de la zone euro. On confond crise de liquidités et crise de compétitivité. Une union économique et monétaire dans laquelle les activités sont très hétérogènes ne peut se maintenir que par l’union de transferts. Il est en effet indispensable d’aider les maillons faibles. Or, c’est ce que refuse l’Allemagne. Les études montrent, vous le savez, qu’il faudrait transférer chaque année entre 8 à 12 points du PIB allemand pour maintenir la zone euro. C’est impossible.
La zone euro est morte, il est grave de ne pas le comprendre. Je l’ai dit au précédent Président de la République, en tête-à-tête. L’euro va tuer tout gouvernement qui s’acharnera à le sauver alors qu’il n’existe plus.
S’agissant du déficit structurel, l’OCDE l’a évalué pour la France à 0,7 % du PIB en 2007 et à 3 % en 2010. Si ce traité avait été en vigueur, le gouvernement précédent n’aurait pas pu mener la politique néo-keynésienne qui a évité la récession à la France. L’économie est comme l’amour : elle ne connaît pas de lois, c’est de la contingence au quotidien. Vouloir qu’elle se plie à des règles juridiques est une ineptie. Je continuerai à le dire.
Que va-t-il se passer, en outre, avec le mécanisme de majorité inversée ? Si d’aventure le Commission estime qu’un État ne respecte pas ses engagements et qu’il n’y a pas de majorité pour la contredire, la Cour de justice devient compétence. Or, la condamnation d’un État – la France ou l’Allemagne – sera politiquement intolérable et le système explosera.
Quant au pacte de croissance, c’est un cautère sur une jambe de bois. La seule solution à court terme – mais non à long terme – est la monétisation de la dette, à laquelle procèdent les Etats-Unis et le Royaume-Uni avec le quantitative easing. Elle permettrait de s’affranchir du totalitarisme des marchés, M. Giacobbi l’a relevé, et redonnerait du souffle à l’investissement.
Mme la rapporteure. Concernant la renégociation du traité, monsieur Lequiller, le Président de la République, lorsqu’il était candidat, ne délivrait qu’un seul message : renégocier pour compléter. Lors de son discours prononcé au Bourget, il avait ainsi déclaré qu’il fallait « renégocier ce traité pour y mettre ce qui lui manque ». C’était d’ailleurs parfaitement clair.
Je voudrais d’ailleurs rendre hommage au travail effectué par la commission des affaires européennes sous la présidence de M. Pierre Lequiller, au cours de la précédente législature, sur la question de la conférence interparlementaire. Nous souhaitons approfondir le contrôle démocratique conduit par notre Parlement. Néanmoins, nous ne comptons pas copier le système allemand dont la généralisation aboutirait à un blocage des décisions dans l’Union européenne. Par ailleurs, n’oublions pas que nous avons la faculté de voter des résolutions présentant des demandes et des exigences au Gouvernement.
M. Lequiller s’insurge de l’absence de réponse française aux propositions allemandes. Cela est inexact. Le Président de la République, lorsqu’il a défini à l’occasion de la Conférence des ambassadeurs, les pistes d’action en matière d’harmonisation fiscale et sociale et d’union politique, participe bien au débat européen. Cependant, il n’y a aucune raison de brûler les étapes. Aux yeux du Président de la République, le calendrier est fixé : la ratification du traité s’inscrit dans le contexte du paquet obtenu au Conseil européen de juin dernier – pacte de croissance, taxe sur les transactions financières et supervision bancaire – dont la mise en œuvre doit se traduire par des décisions avant la fin de l’année. Dans l’intervalle, rien ne nous empêche, mes chers collègues, de formuler des avis sur le rapport que remettra M. Van Rompuy à la fin de l’année. J’ai déjà émis des propositions sur l’harmonisation fiscale et sociale et sur l’union politique ; notre commission pourrait, sur ces thèmes, fournir un travail très utile.
Il est faux d’affirmer que la politique fiscale du précédent Gouvernement aurait été vertueuse. Le taux de l’impôt sur les sociétés a été baissé, celui de la TVA – qui pèse sur les plus modestes – devait augmenter, l’ISF a été allégé, les plus riches de nos compatriotes ont reçu, année après année, des avantages fiscaux, sans parler des niches auxquelles nous allons nous attaquer dans le projet de loi de finances pour 2013. Ces mesures n’étaient pas les plus heureuses pour procéder à une harmonisation fiscale avec nos partenaires européens. Au temps de la présidence de la Commission par Jacques Delors, on avait amorcé une convergence fiscale avec l’harmonisation des assiettes et des taux de TVA. Mais vous avez raison, monsieur Myard, il reste beaucoup à faire pour rapprocher les impositions sur les sociétés et, surtout, les fiscalités de l’épargne – un projet de directive sur ce thème étant bloqué depuis trente ans. J’exprime l’espoir qu’un président de la Commission se ressaisisse à l’avenir de ces questions ; il disposerait du soutien de notre Gouvernement. Depuis que la Commission européenne est présidée par M. Barroso, aucune proposition n’a été avancée, et les gouvernements français ont été tout aussi inertes.
MM. Rochebloine et Lequiller ont regretté que la règle budgétaire contenue dans le traité ne soit pas introduite dans la Constitution. Cette insertion n’est pas nécessaire puisque le Conseil constitutionnel a affirmé très clairement que la Constitution n’avait pas à être révisée du fait de l’absence de transfert de souveraineté.
M. Mamère a estimé, comme d’autres, que le pacte de croissance était d’un montant limité. Sans doute ne s’agit-il en effet que d’un premier pas, mais je vous conseille, mes chers collègues, de ne pas dédaigner un dispositif de 120 milliards d’euros qui, grâce au levier des financements privés, peuvent représenter au total une somme de 240 milliards. Afin d’avoir accès aux fonds structurels qui vont être débloqués, aux project bonds et aux prêts de la BEI, il nous appartient de réfléchir à des projets. Dans la situation actuelle et avec l’héritage que nous devons gérer, il ne me semble pas que notre pays puisse refuser la mise en place d’actions représentant cinq, six, voire sept milliards d’euros.
M. Noël Mamère a également insisté sur la nécessité d’adopter des mesures de transition énergétique. Dans mon rapport, je mentionne le projet du Gouvernement, exposé par le Président de la République lors de la Conférence des ambassadeurs, de créer une communauté européenne de l’énergie. Une telle initiative représenterait un retour aux sources de la Communauté européenne. Il s’agirait de faire naître un consensus sur la transition énergétique, de dégager des financements communs et de parler d’une même voix avec nos fournisseurs d’énergie – alors que la Russie et les pays du Moyen-Orient profitent de notre dispersion actuelle. À ce sujet, je vous recommande la lecture d’un excellent rapport de l’association que préside M. Jacques Delors, Notre Europe, qui traite en détail de cette question.
M. Mamère justifie en partie le vote négatif du groupe écologiste par la timidité du traité dans la voie de l’Europe fédérale et des États-Unis d’Europe. Je crois que les États-Unis d’Europe ne verront jamais le jour. La France n’est pas le Nebraska ou l’Arkansas. D’où l’importance du concept porteur et fécond de fédération d’États-nations.
Monsieur Asensi, les références aux partis xénophobes et populistes contenues dans le rapport ne visaient en rien les mouvements comme le vôtre qui expriment avec constance leur opposition aux traités européens. J’avais à l’esprit l’organisation nazie qui a fait son irruption dans la vie politique grecque. Si la moindre ambiguïté existe dans le texte, nous le modifierons.
J’ai noté avec intérêt que vous concevez la réalisation de transferts de souveraineté et que vous n’excluez pas la démarche fédéraliste si elle est accompagnée d’une harmonisation fiscale et sociale. Nous sommes résolus à progresser dans cette voie même si, comme M. Myard l’a souligné, elle est ardue. Cette orientation nous paraît indispensable et même inéluctable. L’effort visant à ramener le déficit budgétaire à 3 % du PIB l’année prochaine est en effet considérable ; il repose sur une hypothèse de croissance de 0,8 % du PIB, cible qu’il n’est pas exclu que l’économie française atteigne et qui donnera lieu à un bilan d’étape au cours de l’année 2013.
Quant à l’Allemagne, elle subit également la crise, ce dont ont conscience les dirigeants de ce pays. Cela permettra peut-être de leur faire davantage entendre le fait qu’ils sont, eux aussi, dépendants de leurs partenaires, notamment en matière de commerce extérieur.
Mme Estelle Grelier a rappelé à propos notre souhait de voir le MES doté d’une licence bancaire.
Vous avez eu raison, monsieur Giacobbi, de faire état des risques qu’entraînerait le rejet du traité. S’agissant de la taxe sur les transactions financières, le produit en sera peut-être limité mais nous ne pouvons pas encore l’évaluer puisque ni son assiette ni son taux n’ont été fixés. Le ministre des affaires européennes a révélé, lors de son audition d’hier, la liste des neuf pays qui sont nécessaires à sa mise en œuvre. Il serait préférable que cette taxe repose sur l’assiette la plus large possible mais que son taux soit modéré afin qu’elle ne suscite pas d’opposition trop vigoureuse. Elle ne dissuadera pas la spéculation, mais elle pourra procurer des ressources non négligeables au budget de l’Union européenne. Quant à la lutte contre la spéculation financière, un travail au titre de la supervision bancaire est effectué par la Commission européenne et un rapport a été commandé à M. Erkki Liikanen sur la séparation des activités commerciales des banques et des opérations de marché. Dans l’attente de sa parution, nous savons qu’il y est fait référence au système américain, aux propositions britanniques et à la définition d’une troisième voie que nous pourrions emprunter.
Lorsque j’entends M. Pierre Lellouche affirmer que la politique budgétaire de M. Nicolas Sarkozy a préservé les retraités et les plus modestes, les bras m’en tombent !
Un récent déplacement en Italie m’a permis de constater que tous mes interlocuteurs étaient soulagés de la réorientation de la construction européenne que rend possible l’élection de François Hollande. Certes, M. Mario Monti ne sera plus président du Conseil à partir de la fin d’avril 2013 mais il restera probablement investi au plus haut niveau dans la vie politique de son pays.
Votre interrogation, monsieur Cordery, sur les initiatives qui pourraient être prises pour la mise en œuvre des points 5 et 6 de la proposition de résolution européenne présentée au nom de la Commission des affaires européennes, par M. Christophe Caresche, me semble essentielle. Dans le cadre de l’examen du projet de loi organique, il conviendrait de demander au ministère des finances de coordonner les calendriers budgétaires national et européen. Cette tâche sera difficile à accomplir mais elle est cruciale si nous voulons voir un contrôle de notre Parlement national sur l’action du Gouvernement dans le processus européen de suivi et d’évaluation budgétaires.
Vous avez raison, monsieur Myard, de souligner le fossé existant entre l’opinion publique allemande – majoritairement opposée au maintien de la Grèce dans la zone euro – et ses responsables politiques qui ont été soulagés par la décision du Tribunal de Karlsruhe du 12 septembre dernier, autorisant la ratification du TSCG. De notre côté, nous estimons que l’expulsion de la Grèce serait une folie dont personne n’est capable de mesurer les répercussions. Contrairement à vous, monsieur Myard, je pense que si nous n’avions pas eu l’euro ou, pire encore, si nous en sortions, la situation de notre État nation, qui nous est cher à tous deux, serait bien pire que celle qui prévaut aujourd’hui.
M. Jacques Myard. Nous avons perdu un point de croissance par an depuis 1992 !
Mme la présidente Élisabeth Guigou. Le vrai défi auquel nous devons faire face aujourd’hui – mais qui n’est pas l’objet de ce traité – est celui de la conciliation de la réduction de la dette publique avec la stimulation de la croissance. Il me semble possible de le relever. Vous souhaitez monétiser la dette, monsieur Myard ; de notre côté, nous proposons de la mutualiser et avons bon espoir d’arriver à une telle solution dans un futur pas si lointain.
La Commission est saisie d’un amendement de M. Jacques Myard.
M. Jacques Myard. Je propose de subordonner le dépôt de l’instrument de ratification du traité au fait que la loi organique qui viendra compléter le TSCG n’ait pas été déclarée contraire à la Constitution par le Conseil constitutionnel. En effet, si la loi organique était censurée par le Conseil constitutionnel après la ratification du traité, nous nous trouverions dans une situation juridique fort complexe.
Mme la rapporteure. N’ayant pas été transmis au secrétariat de la commission dans le délai imparti, votre amendement n’est pas recevable. En outre, le droit d’amendement sur les projets de loi autorisant la ratification d’un traité est strictement encadré par le Conseil constitutionnel : si vous voulez que votre amendement soit examiné, il faut le déposer à la présidence de l’Assemblée nationale qui en déterminera la recevabilité.
Sur le fond, votre amendement me paraît inutile. Dans sa décision du 9 août 2012, le Conseil constitutionnel a précisé la portée du TSCG au regard de notre droit national et a affirmé qu’une loi organique permettrait à la France de remplir ses obligations ; il a fourni, à cette occasion, des indications très claires sur les dispositions que devrait contenir cette loi pour être conforme à la Constitution. Dans l’hypothèse que vous soulevez - improbable au regard des orientations fixées par le Conseil constitutionnel -, il appartiendrait au législateur organique d’intervenir à nouveau. La France disposera d’une année à compter de l’entrée en vigueur du traité pour transposer dans son droit interne la règle d’équilibre budgétaire. Le Gouvernement a déposé son projet de loi organique en même temps que le projet de loi de ratification du traité et l’a inscrit immédiatement à l’ordre du jour de notre Assemblée. Il me paraît donc hautement improbable que la loi organique ne puisse être promulguée d’ici un an, même si elle devait être réécrite après une censure du Conseil constitutionnel.
Suivant les conclusions de la Rapporteure, la Commission adopte sans modification le projet de loi (no 197).
*
* *
La Commission vous demande donc d’adopter, dans les conditions prévues à l’article 128 du Règlement, le présent projet de loi dans le texte figurant en annexe du présent rapport.
TEXTE DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
Article unique
(Non modifié)
Est autorisée la ratification du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l’Union économique et monétaire, entre le Royaume de Belgique, la République de Bulgarie, le Royaume de Danemark, la République fédérale d’Allemagne, la République d’Estonie, l’Irlande, la République hellénique, le Royaume d’Espagne, la République française, la République italienne, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la Hongrie, Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d’Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la Roumanie, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande et le Royaume de Suède signé à Bruxelles, le 2 mars 2012, et dont le texte est annexé à la présente loi.
NB : Le texte du traité figure en annexe au projet de loi (n° 197).
Liste des personnes rencontrées par la rapporteure lors de sa mission en Allemagne et en Italie (par ordre chronologique)
1) À Berlin (12 et 13 septembre 2012) :
– M. Ruprecht Polenz, député, président de la commission des affaires étrangères (CDU)
– M. Gunther Krichbaum, député, président de la commission des affaires européennes (CDU)
– Réunion avec des journalistes francophones : M. Rainer Laska (ZDF), M. Norbert Carius (ARD), Mme Louisa Maria Giersberg (ARD), M. Thomas Fricke (Financial Times Deutschland) et M. Andreas Rinke (Reuters)
– M. Axel Schäfer, député, vice-président du groupe parlementaire SPD
– M. Günter Gloser, député, ancien ministre délégué aux affaires européennes (SPD)
– M. Thomas Silberhorn, député, membre de la commission des affaires européennes (CSU)
2) À Rome (13 et 14 septembre 2012) :
– M. Pier Luigi Bersani, secrétaire national du Parti démocrate
– M. Enzo Moavero Milanesi, ministre chargé des affaires européennes
– S.E. Giorgio Napolitano, Président de la République
– M. Enrico Pianetta, député, rapporteur sur le traité instituant le Mécanisme européen de stabilité à la commission des affaires étrangères (Peuple de la liberté)
– M. Francesco Tempestini, député, rapporteur sur le traité budgétaire à la commission des affaires étrangères (Parti démocrate)
– Mme Rossana Boldi, sénatrice, présidente de la commission des politiques de l’Union européenne et membre de la délégation parlementaire italienne auprès du Conseil de l’Europe (Ligue du nord)
– M. Sandro Gozi, député, chef du groupe parlementaire du Parti démocrate à la commission des politiques de l’Union européenne et président du comité d’examen des politiques communautaires
– M. Enrico Morando, sénateur, rapporteur sur le traité budgétaire à la commission du budget (Parti démocrate)
– M. Mario Pescante, député, président de la commission des politiques de l’Union européenne (Peuple de la liberté)
– M. Lamberto Dini, ancien président du Conseil, sénateur, président de la commission des affaires étrangères (Peuple de la liberté)
– M. Massimo D’Alema, ancien président du Conseil, président de la fondation Italianieuropei
1 () Le traité de Maastricht a institué l’« Union » européenne, mais laissé subsister le terme de « Communauté » dans les traités préexistants.
2 () Règlements n° 1466/97 relatif au renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques et n° 1467/97 visant à accélérer et à clarifier la mise en oeuvre de la procédure concernant les déficits excessifs.
3 () Sur le tableau, les soldes budgétaires des États entrés dans la zone euro pendant la période considérée sont en grisé pour les années antérieures à cette entrée.
4 () Notre Europe, 11 avril 2012, tribune de M. Delors.
5 () M. Tommaso Padoa-Schioppa a été, entre autres fonctions, directeur général pour l’économie à la Commission européenne, directeur général adjoint de la Banque d’Italie et ministre de l’économie et des finances du gouvernement de M. Romano Prodi (2006-2008).
6 () Projet 317-2010, L’Europe face à la crise.
7 () La crédibilité de l’État grec a été sérieusement entamée par la révélation de la mauvaise qualité des statistiques en octobre 2009.
8 () Les concours publics aux établissements de crédit, rapports publics particuliers, juin 2009 et mai 2010.
9 () Source : http://www.euractiv.fr/la-france-et-lue/article/plan-relance-allemand-pourrait-etre-modele-france-selon-etude-001505.
10 () Cet article énonce que « lorsqu’un État membre connaît des difficultés ou une menace sérieuse de graves difficultés, en raison de catastrophes naturelles ou d’événements exceptionnels échappant à son contrôle, le Conseil, sur proposition de la Commission, peut accorder, sous certaines conditions, une assistance financière de l’Union à l’État membre concerné. Le président du Conseil informe le Parlement européen de la décision prise ».
11 () Clause dite de « no bail-out ».
12 () Il convient également d’indiquer que, le 27 janvier 2011, l’Office statistique de l’Union européenne (Eurostat) a pris une décision sur la comptabilisation des fonds levés dans le cadre du FESF. Ces fonds « doivent être enregistrés dans la dette publique brute des États membres de la zone euro participant à une opération de soutien, en proportion de leur part dans la garantie accordée » de même que les financements accordés seront également enregistrés. Ces opérations seront neutres en termes de dette nette et de solde.
13 () Cet objectif n’a pas été atteint. Au 18 septembre 2012, l’Estonie et l’Allemagne n’ont pas encore ratifié le texte. La ratification allemande était notamment soumise à l’accord préalable de la Cour constitutionnelle de Karlsruhe, lequel est intervenu le 12 septembre dernier (voir infra).
14 () La ratification a été autorisée par la loi n° 2013-324 du 7 mars 2012. La France a notifié cette ratification au Secrétariat général de l’Union européenne le 2 avril 2012. Le dépôt de l’instrument de ratification allemand est attendu après l’arrêt rendu le 12 septembre 2012 par la Cour constitutionnelle de Karlsruhe, ce qui permettra de dépasser le seuil requis de 90 % des souscriptions. La première réunion du Conseil des gouverneurs du MES est prévue le 8 octobre à Luxembourg.
15 () http://www.ecb.int/ecb/legal/pdf/l_12420100520fr00080009.pdf.
16 () Liste des décisions du conseil des gouverneurs de la BCE, mai 2010 (http://www.banque-france.fr/fileadmin/user_upload/banque_de_france/Eurosysteme_et_international/La_BCE/Decisions_du_Conseil_des_gouverneurs_de_la_BCE/decisions-conseil-gouverneurs-bce-100521.pdf).
17 () Conférence de presse de M. Draghi à la suite de la décision de la BCE (http://www.banque-france.fr/fileadmin/user_upload/banque_de_france/Eurosysteme_et_international/declaration-introductive-06-09-2012-v2.pdf).
18 () À l’image de ce que déclarait M. Henry Paulson, alors secrétaire américain au Trésor, en juillet 2008, devant le Sénat des États-Unis : « IF you have a bazooka in your pocket and people know it, you probably won't have to use it » (Si vous avez un bazooka dans les poches et que les gens le savent, il y a de peu de chance que vous ayez à vous en servir).
19 () Chronique de M. Jean Pisani-Ferry, Le Monde éco & entreprises, mardi 18 septembre 2012, p.12.
20 () Le règlement n° 1173/2011 du 16 novembre 2011 sur la mise en oeuvre efficace de la surveillance budgétaire dans la zone euro ; LE Règlement n° 1174/2011 du 16 novembre 2011 établissant des mesures d’exécution en vue de remédier aux déséquilibres macroéconomiques excessifs dans la zone euro ; LE Règlement n° 1175/2011 du 16 novembre 2011 modifiant le règlement (CE) n° 1466/97 du Conseil relatif au renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques ; le Règlement n° 1176/2011 du 16 novembre 2011 sur la prévention et la correction des déséquilibres macroéconomiques ; LE Règlement n° 1177/2011 du 8 novembre 2011 modifiant le règlement (CE) n° 1467/97 visant à accélérer et à clarifier la mise en oeuvre de la procédure concernant les déficits excessifs ; ENFIN, LA Directive 2011/85/UE du 8 novembre 2011 sur les exigences applicables aux cadres budgétaires des États membres.
21 () Des « trilogues » entre Parlement européen, présidence du Conseil et Commission sont menés en vue de parvenir à un accord en première lecture sur les deux textes, si possible d’ici la fin de l’automne.
22 () MM. Brok (PPE, Allemagne), Gualtieri (S&D, Italie) et Verhofstadt (ADLE, Belgique).
23 () Voir notamment : Valentin Kreilinger, Le « making-of » d’un nouveau traité : six étapes de négociations politiques, Notre Europe, Les Brefs n° 32, février 2012.
24 () Jean Quatremer, Le traité sur « l’union budgétaire » : « serment du jeu de Paume » de la rigueur, blog « les coulisses de Bruxelles », 13 décembre 2011.
25 () Daniel Cohn-Bendit (cité par Jean Quatremer dans L’esprit de Maastricht regravé dans le marbre allemand, Libération, 19 septembre 2012).
26 () Renaud Dehousse, Notre Europe, Les Brefs, n° 33, février 2012.
27 () Audition du 11 septembre 2012.
28 () Plus précisément, le premier jour du mois suivant le dépôt du douzième instrument de ratification.
29 () Il s’agit de l’Autriche, de Chypre, du Danemark, de la Grèce, de l’Italie, de la Lituanie, de la Lettonie, du Portugal et de la Slovénie.
30 () http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0342:FIN:FR:PDF.
31 () Proposition de règlement établissant des dispositions communes pour le suivi et l'évaluation des projets de plans budgétaires et pour la correction des déficits excessifs dans les États membres de la zone euro (COM(2011) 821 final).
32 () Autriche (procédure ouverte en décembre 2009), Belgique (décembre 2009), Chypre (juillet 2010), Danemark (juillet 2010), Espagne (avril 2009), Grèce (avril 2009), Hongrie (juillet 2004), Irlande (avril 2009), Italie (décembre 2009), Lettonie (juillet 2009), Lituanie (juillet 2009), Malte (juillet 2009), Pays-Bas (décembre 2009), Pologne (juillet 2009), Portugal (décembre 20R9), République tchèque (décembre 2009), Roumanie (juillet 2009), Royaume-Uni (juillet 2008), Slovaquie (décembre 2009) et Slovénie (décembre 2009).
33 () Jean Arthuis, Avenir de la zone euro : l’intégration politique ou le chaos, rapport au Premier ministre, mars 2012, p. 30.
34 () C’est-à-dire le pays exerçant la présidence du Conseil, son prédécesseur et son successeur.
35 () La décision de modifier cet article 136 a été prise le 25 mars 2011 afin de permettre la création du MES. L’article a été complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les États membres dont la monnaie est l'euro peuvent instituer un mécanisme de stabilité qui sera activé si cela est indispensable pour préserver la stabilité de la zone euro dans son ensemble. L'octroi, au titre du mécanisme, de toute assistance financière nécessaire, sera subordonné à une stricte conditionnalité ». La ratification de cette modification par les 27 États membres de l’Union européenne est en voie d’achèvement.
36 () Dans ce cas, il serait cependant possible d’envisager que le président du sommet de la zone euro soit dans la même position que le Haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, c'est-à-dire qu’il soit également un des vice-présidents de la Commission européenne.
37 () On se rappelle les propos de M. Wofgang Schaüble, ministre fédéral des finances, rapportés le 11 mai dernier dans la presse (Rheinische Post) : « Nous voulons que la Grèce reste dans la zone euro. Mais elle doit le vouloir aussi et tenir ses engagements. Nous ne pouvons forcer personne. L’Europe ne sombrera pas dans le chaos aussi rapidement (…). [En cas de sortie de la Grèce], le risque de contagion à d’autres pays de la zone euro a diminué et la zone euro dans son ensemble est devenue plus robuste ».
38 () Conclusions du Conseil européen des 28 et 29 juin 2012 (EUCO 76/12), p. 11 (http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/fr/ec/131408.pdf .
39 () Idem.
40 () « L’accord budgétaire qui a été trouvé est équilibré par un volet sur la croissance qui, grâce aux effets induits, s’élève à 250 milliards d’euros et non, seulement, à 120 milliards. Autant dire que l’effet récessif du traité évoqué par certains n’est pas à redouter » (audition de M. Laurent Fabius, ministre des affaires étrangères, par la commission des affaires étrangères de l’Assemblée nationale, mardi 11 septembre 2012).
41 () Conclusions du Conseil européen des 28 et 29 juin 2012 (EUCO 76/12), p. 11.
42 () Déclaration du sommet de la zone euro, 29 juin 2012.
43 () Conclusions du Conseil européen des 28 et 29 juin 2012 (EUCO 76/12), p. 3.
44 () Voir notamment Noëlle Lenoir, Le Conseil constitutionnel et la règle d’or, Le Figaro du 16 août 2012.
45 () S’y ajoute pour les seules lois de règlement l’obligation d’exactitude des comptes. Décision n° 2001-448 DC du 25 juillet 2001.
46 () Projet de loi organique relatif à la programmation et à la gouvernance des finances publiques, enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 19 septembre 2012, n° 198. Ce texte a été renvoyé à une commission spéciale.
47 () M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué chargé des affaires européennes, audition de la commission des affaires étrangères de l’Assemblée nationale, 10 juillet 2012.
48 () L’Assemblée nationale a eu l’occasion de prendre position sur ces différents points à la fin de la législature précédente, par une résolution devenue définitive le 17 mars 2012, sur le rapport de MM. Jean-Yves Cousin et Pierre-Alain Muet au nom de la Commission des affaires européennes. Ce texte s’est prononcé en faveur d’une assiette large, d’un taux unique de 0,05% et non d’un taux différencié tel que proposé par la Commission européenne et d’une éventuelle affectation du produit de la taxe comme ressource propre du budget de l’Union européenne, venant en réduction des contributions nationales. La résolution a également prôné également une coopération renforcée entre un groupe pionnier d’États membres ou au niveau de la zone euro.
49 () http://ec.europa.eu/internal_market/finances/committees/index_fr.htm#maincontentSec1.
50 () Données 2010. Source : Le système bancaire allemand et la crise financière, 2011, par MM. Patrick Brämer, Horst Gischer et Toni Richter.
51 () En 2012, toutefois, ce schéma n’a pu être reproduit en raison de l’interruption des travaux pendant la période électorale.
52 () Source : Un modèle qui ne fait guère envie, Arnaud Lechevalier, Alternatives Economiques n° 300, mars 2011.
53 () Source : L’Expansion.com avec AFP, publié le 14/03/2012 et se référant à une étude de l’institut de recherche sur le travail de l’université de Duisbourg-Essen.
