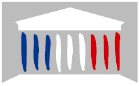______
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 30 janvier 2014.
AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES SUR LE PROJET DE LOI relatif à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale
TOME I
Rapport
Député.
Voir les numéros :
Assemblée nationale : 1721 et 1733.
SOMMAIRE
___
Pages
INTRODUCTION 9
I. FORMATION PROFESSIONNELLE : ACCOMPLIR LA MUTATION 13
A. SIMPLIFIER ET RÉORIENTER L’OBLIGATION DE FINANCEMENT 14
B. APPORTER DE NOUVELLES GARANTIES D’ACCÈS À LA QUALIFICATION 18
1. Le compte personnel de formation 18
2. L’inscription de la formation professionnelle au cœur du dialogue social dans les entreprises et les branches professionnelles 19
3. Le recentrage des dispositifs d’insertion sur une ambition qualifiante et sur les publics les plus fragiles 21
II. FAVORISER L’APPRENTISSAGE, L’INSERTION ET L’EMPLOI 22
III. CONSTRUIRE LE NOUVEAU VISAGE DE LA GOUVERNANCE DE L’EMPLOI, DE LA FORMATION ET DE L’ORIENTATION PROFESSIONNELLES 28
A. ATTRIBUER À LA RÉGION UN VÉRITABLE "BLOC DE COMPÉTENCES" EN MATIÈRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE 22
B. RATIONALISER LES INSTANCES ET LES OUTILS 22
1. Favoriser la mise en œuvre du service public régional de l’orientation 29
2. Faire évoluer les contrats de plans 31
3. Instaurer une nouvelle gouvernance de l’emploi et de la formation professionnelle 31
IV. RENFORCER LE SOCLE DE LA DÉMOCRATIE SOCIALE 33
A. LA RÉFORME DE LA REPRÉSENTATIVITÉ PATRONALE, UNE INNOVATION MAJEURE 33
B. LA REPRÉSENTATIVITÉ SYNDICALE : UN ACQUIS IMPORTANT, QUI SE VOIT ENCORE CONFORTÉ DANS LE CADRE DU PRÉSENT PROJET DE LOI 34
C. LE PARACHÈVEMENT DE LA TRANSPARENCE DU FINANCEMENT DES ORGANISATIONS SYNDICALES ET PATRONALES 36
D. LA TRANSPARENCE FINANCIÈRE DES COMITÉS D’ENTREPRISE 39
V. VERS UN DROIT DU TRAVAIL MIEUX CONTRÔLÉ ET DONC PLUS EFFECTIF 42
A. UNE INSPECTION DU TRAVAIL PLUS COLLECTIVE ET AUX POUVOIRS ÉTENDUS 42
B. UN CONTRÔLE DE L’APPRENTISSAGE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE MIEUX ASSURÉ 43
TRAVAUX DE LA COMMISSION 45
AUDITIONS DES PARTENAIRES SOCIAUX ORGANISÉES PAR LA COMMISSION 45
AUDITION DU MINISTRE 115
EXAMEN DES ARTICLES 137
TITRE IER FORMATION PROFESSIONNELLE ET EMPLOI 137
Chapitre Ier – Formation professionnelle continue 137
Article 1er (art. L. 1233-67 à -69 ; L. 2241-6, L. 2323-37, L. 5212-11, L. 6111-1, L. 6312-1, L. 6323-1 à L.6323-21, L. 6323-22 (nouveau) :, L. 6324-7, L. 6324-9, L. 6325-24, L. 6331-14, L. 6331-26 et L. 6523-1 du code du travail) : Mise en œuvre du compte personnel de formation 137
Après l’article 1er 202
Article 2 (art. L. 1222–14, L. 1225–27, L. 1225–46, L. 1225–57, L. 2241–4, L. 2242–15, L. 2323–34, L. 2323–35, L. 2323–36, L. 3142–29, L. 3142–95, L. 6313–13 [nouveau], L. 6313–14 [nouveau], L. 6315–1, L. 6315–2, L. 6321–1, L. 6321–8 et L. 6353–1 du code du travail) : Obligation de l’employeur, entretien professionnel, développement des compétences et des qualifications 203
Après l’article 2 223
Article 3 (art. L. 6324–1, L. 6324–2, L. 6324–3, L. 6324–4, L. 6324–5, L. 6324–5–1, L. 6325–2–1 [nouveau], L. 6325–3–1 [nouveau], L. 6326–1 et L. 6326–3 du code du travail ; art. 21 de la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011) : Contrat de professionnalisation, périodes de professionnalisation, préparation opérationnelle à l’emploi 224
Après l’article 3 235
Article 4 (art. L. 6322-37, L. 6331-1, L. 6331-2, L. 6331-3, L. 6331-9, L. 6331-10, L. 6331-11, L. 6331-13, L. 6331-14, L. 6331-16, L. 6331-17, L. 6331-18, L. 6331-19 à L. 6331-27, L. 6331-28, L. 6331-29, L. 6331-30, L. 6331-31 et L. 6331-32 du code du travail) : Simplification des obligations de financement par les employeurs de la formation professionnelle continue 236
Article 5 (art. L. 6322-21, L. 6325-12, L. 6331-8, L. 6332-1, L. 6332-1-1, L. 6332-1-2, L. 6332-1-3 [nouveau], L. 6332-3, L. 6332-3-1, L. 6332-3-2 à L. 6332-3-6 [nouveaux], L. 6332-5, L. 6332-6, L. 6332-7, L. 6332-14, L. 6332-15, L. 6332-16-1 [nouveau], L. 6332-19 à L. 6332-22, L. 6332-22-2, L. 6333- 1 à L. 6333-8 [nouveaux], L. 6361-1, L. 6361-2, L. 6362-1, L. 6362-4 et L. 6362-11 du code du travail) : Amélioration de la mutualisation et du ciblage des financements de la formation professionnelle continue 248
Après l’article 5 261
Chapitre II – Apprentissage et autres mesures en faveur de l’emploi 262
Article 6 (Art. L. 6211-3, L. 6232-1, L. 6232-2, L. 6232-6 à L. 6232-8, L. 6241-10, L. 6252-1 du code du travail) : Renforcement des compétences des régions en matière d’apprentissage 262
Après l’article 6 270
Article 7 (art. L.6221-2 [nouveau], L. 6233-1-1 [nouveau], L. 6222-2, L. 6222-7, L. 6222-7-1 [nouveau], L. 6222-8 à L. 6222-12-1, L. 6222-18, L. 6222-22-1, L. 6223-8, L. 6225-2, L. 6225-3 et L. 6225-5 du code du travail) : Principe de gratuité et élargissement du contrat d’apprentissage aux contrats à durée indéterminée 271
Après l’article 7 279
Article 8 (art. L. 6231-1 du code du travail) : Renforcer les missions des centres de formation des apprentis 280
Article 8 bis (art. L. 6231-4-2[nouveau] du code du travail) Affichage des symboles républicains dans les centres de formation des apprentis 285
Article 9 (art. L. 6233-1, L. 6241-2, L. 6241-4, L. 6241-5, L. 6241-6, L. 6242-1, L. 6242-2, L. 6242-3-1 [nouveau], L. 6242-4, L. 6242-6 à L. 6242-10 du code du travail) : Coût des formations et circuit de la collecte de la taxe d’apprentissage 286
Article 10 (art. L. 5121-28, L. 5135-1 à L. 5135-8 [nouveaux], L. 5132-5, L. 5132-11-1, L. 5132-15-1, L. 5134-20, L. 5134-23-1, L. 5134-25-1, L. 5134-29, L. 5134-71 et L. 5522-13-5 du code du travail) : Mesures visant à favoriser l’insertion dans l’emploi 304
Après l’article 10 314
Chapitre III – Gouvernance et décentralisation 315
Article 11 (Art. L. 5211-2, L. 5211-3, L. 5211-5, L. 5214-1 A, L. 5214-1 B, L. 5214-1-1, L. 5214-3, L. 5314-2, L. 6121-1, L. 6121-2, L. 6121-2-1 [nouveau], L. 6121-4 à L. 6121-7 [nouveaux], L. 6341-2, L. 6341-3, L. 6341-5, L. 6342-3 et L. 6521-2 [nouveau] du code du travail ; art. 9 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ; art. L. 451-1, L. 451-2 et L. 452-1 [nouveau] du code de l’action sociale et des familles ; art. L. 4383-2 du code de la santé publique) : Compétences des régions 315
Article 12 (art. L. 6111-3, L. 6111-4, L. 6111-5, L. 6111-6, L. 6111-7 et L. 6314-1 du code du travail ; art. L. 214–14, L. 214–16–1, L. 214–16–2, L. 313–6, L. 313–7, et L. 313–8 du code de l’éducation) : Service public de l’orientation – Conseil en évolution professionnelle 347
Après l’article 12 361
Article 13 (art. L. 211-2, L. 214-12, L. 214-12-1 et L. 214-13 du code de l’éducation ; art. L. 4424-1 du code général des collectivités territoriales) : Contrat de plan régional de développement des formations et de l’orientation professionnelles 363
Article 14 (art. L. 2, L. 5112-1, L. 5112-2, L. 5312-12-1, L. 6111-1, L. 6123-1, L.6123-2, L.6123-3, L.6123-4, L.6123-5, L.6123-6 et L.6123-7 du code du travail et art. L. 232-1 et L. 237-1 du code de l’éducation) : Gouvernance – Institutions 372
Article 15 Compensation financière des transferts de compétences opérés en direction des régions 389
TITRE II DÉMOCRATIE SOCIALE 395
Chapitre Ier – Représentativité patronale 395
Article 16 (art. L. 2151-1 à L. 2152-5 [nouveaux], L. 2135-6, L. 2261-19, L. 2261-32 du code du travail) : Réforme de la représentativité patronale 395
Chapitre II – Représentativité syndicale 425
Article 17 (art. L. 2122-3-1 [nouveau], L. 2122-10-6, L. 2143-3, L. 2143-11, L. 2312-5, L. 2314-1, L. 2314-3, L. 2314-3-1, L. 2314-10, L. 2314-11, L. 2314-12, L. 2314-13, L. 2314-20, L. 2314-22, L. 2314-23, L. 2314-31, L. 2322-5, L. 2324-1, L. 2324-2, L. 2324-4, L. 2324-4-1, L. 2324-7, L. 2324-12, L. 2324813, L. 2324-18, L. 2324-20, L. 2324-21 et L. 2327-7 du code du travail) : Représentativité syndicale 425
Chapitre III – Financement des organisations syndicales et patronales 451
Article 18 (Art. L. 2135-9 à L. 2135-18 [nouveaux], L. 2145-2, L. 2145-3, L. 3142-8 et L. 3142-9 du code du travail) : Financement des organisations syndicales et patronales 451
Chapitre IV – Transparence des comptes des comités d’entreprise 490
Article 19 (Art. L. 2325-34-1 à L. 2325-34-4, L. 2325-45 à L. 2325-55, L. 2327-12-1, L. 2327-14-1 [nouveaux] et L. 2327-16 du code du travail) : Transparence des comptes des comités d’entreprise 490
TITRE III INSPECTION ET CONTRÔLE 520
Article 20 (art. L. 4721-8 ; L. 4722-1 ; L. 4722-2 ; L. 4723-1 ; L. 4723-2 ; L. 4731-1 à L. 4731-5 ; L. 4732-1 à L. 4732-3 ; L. 4741-3 ; L. 4751-1 ; L. 4751-2 ; L. 8111-1 ; L. 8112 -1 à L. 8112-5 [nouveaux] ; L. 8113-4 et L. 8113-5 [nouveaux] ; L. 8113-7 ;
L. 8114-1 ; L. 8114-4 à L. 8114-7 [nouveaux] ; L. 8115-1 à L. 8115-8 [nouveaux] ; L. 8122-1 et L. 8122-2 [nouveaux] ; L. 8123-2 ; L. 8123-4 du code du travail ; art. 524 du code de procédure pénale) Réforme de l’inspection du travail 520
Après l’article 20 561
Article 21 (art. L. 6252-4, L. 6252-6, L. 6252-7-1 [nouveau], L. 6252-8, L. 6252-9,
L. 6252-12, L. 6361-3, L. 6362-2, L. 6263-3 du code du travail ) : Renforcement du dispositif de contrôle de l’apprentissage et de la formation professionnelle 562
Article 22 (art. 27 de la loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012 relative à la régulation économique outre-mer et portant diverses dispositions relatives aux outre-mer) : Habilitation du Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance diverses dispositions d’application de la législation à Mayotte 567
ANNEXE LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES 569
En transposant l’accord national interprofessionnel du 14 décembre 2013, le projet de loi qui vous est soumis fait le choix d’une mutation profonde de notre système de financement de la formation professionnelle tout en s’inscrivant dans la continuité des différents accords nationaux interprofessionnels intervenus depuis deux décennies.
La loi de 16 juillet 1971 sur la formation professionnelle, en instituant une obligation légale, pour l’employeur, de « payer », c’est-à-dire d’acheter de la formation pour ses salariés, a certes permis la montée en puissance de notre système de la formation professionnelle continue. Mais les modalités actuelles de son financement ne contribuent plus à conforter, ni individuellement, ni collectivement, « l’obligation de former ». Elles sont, au contraire, sources d’inégalités dans l’accès à la formation.
Celui-ci nécessite d’orienter ces financements plus résolument vers les formations permettant l’accès à la qualification au bon moment et pour ceux qui en ont le plus besoin et également vers les besoins du tissu productif au regard de ses mutations permanentes. Le projet de loi va ainsi parachever la réforme engagée par la loi de sécurisation de l’emploi de faire de la formation un objet de négociation entre salariés et employeurs.
Aussi, le projet de loi conforte-t-il l’obligation de former, en asseyant le financement de la formation professionnelle sur une contribution unique des employeurs, largement mutualisée. Dès lors, l’employeur ne considérera plus la formation professionnelle comme une dépense le libérant d’une obligation fiscale mais comme un investissement visant d’abord à améliorer la qualification du salarié.
Face à l’employeur, le salarié sera conforté par les droits qu’il tire du compte personnel de formation (CPF) qui n’est pas seulement un droit virtuel, comme l’était le droit individuel de formation (DIF), mais qui est assorti de garanties :
– une utilisation réservée à l’accès à des qualifications reconnues ;
– une opposabilité à l’employeur pour l’acquisition du socle de connaissances et de compétences ou l’accompagnement à la Validation des acquis de l’expérience (VAE) ;
– une entière transférabilité des droits et une gestion extérieure à l’entreprise ;
– l’entretien professionnel et le conseil en évolution professionnelle qui font système avec le compte personnel de formation ;
– un financement dédié et mutualisé à hauteur de 0,2 % de la masse salariale.
Ces assises solides permettront au compte personnel de formation de concrétiser l’engagement de faire accéder à une première qualification professionnelle ceux qui en sont dépourvus. Le droit à une formation initiale différée trouve enfin un secteur, applicable à tous, quels que soient les parcours et les statuts.
La réussite d’un tel changement dépend de la capacité des acteurs à se l’approprier. Dès lors, il me semble crucial que les listes des formations éligibles ne soient pas trop restrictives afin de ne pas décourager l’usage, tout en veillant à ce qu’elles ne recouvrent que des formations réellement qualifiantes.
Et la réussite de la réforme devra être mesurable dans les faits : la réduction des inégalités d’accès à la formation doit en être un des grands marqueurs. Les abondements au compte personnel de formation sont décisifs à ce titre : abondement supplémentaire de 100 heures, financé par l’employeur, lorsque le salarié n’a pas bénéficié de formations ou d’évolution de carrière dans les six dernières années ; mais également abondements complémentaires des entreprises, des branches, des Régions à destination des salariés prioritaires, ou des demandeurs d’emploi.
En cohérence avec ces objectifs, ce texte propose d’aller au bout du processus de régionalisation de la politique de formation professionnelle et de l’apprentissage, dont le socle a été posé dès la loi du 7 janvier 1983 et dont le mouvement a été poursuivi par la loi du 13 août 2004 : avec la présente réforme, la région devient le véritable chef de file de la politique de formation professionnelle et de l’apprentissage, avec l’attribution d’un véritable bloc de compétences en la matière.
Le projet de loi propose, en outre, une réforme de grande ampleur de l’apprentissage, l’objectif étant de porter le nombre d’apprentis en France à 500 000 en 2017 conformément aux engagements du Pacte national pour la croissance, la compétitivité et l’emploi.
Outre le renforcement du rôle des régions en matière d’apprentissage, ce texte propose de favoriser la sécurisation du parcours de l’apprenti – notamment par la possibilité de conclure un contrat d’apprentissage dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée et par le renforcement des missions des centres de formation des apprentis – et poursuit surtout la réforme initiée par la loi de finances rectificatives pour 2013 en proposant de simplifier la collecte de la taxe d’apprentissage en réduisant le nombre de collecteurs et de rendre sa répartition plus transparente et plus efficiente.
Le projet de loi renforce la cohérence d’action au sein d’une gouvernance unifiée et élargie aux partenaires sociaux.
Par souci de cohérence et d’efficacité de l’action, il fusionne au sein d’une seule instance nationale, le Comité national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles (CNEFOP), le suivi des politiques publiques de l’emploi et de la formation professionnelle, compétences jusqu’alors respectivement exercée par le Conseil national de l’emploi (CNE) et le Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie (CNFPTLV). En outre, il étend le champ d’action au suivi de l’orientation professionnelle, déterminante pour l’insertion des publics fragiles dans le marché du travail et l’évolution professionnelle des salariés.
La coordination de l’action est exercée, au niveau local, au sein des comités régionaux de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles (CREFOP) qui se voient désormais dotés d’un bureau, lieu de concertation quadripartite des principaux financeurs de la formation – région- État-partenaires sociaux.
Présents au sein du CNEFOP et du CREFOP, les partenaires sociaux voient leur participation confortée, le texte reconnaissant l’existence des comités paritaires national et régionaux respectivement chargés de définir les orientations politiques paritaires en terme de formation et d’emploi et d’en assurer le déploiement, en région, en coordination avec les autres acteurs.
Ce texte devrait permettre de consacrer la place de la région qui se voit reconnaître un rôle de chef de file dans la mise en œuvre opérationnelle de ces politiques publiques et lui confie enfin la possibilité de mettre en œuvre des SIEG et de construire un véritable service public régional de la formation et de coordonner le service public de l’orientation sur son territoire.
Le projet de loi propose, ensuite, de conforter la démocratie sociale, en renforçant la légitimité des acteurs qui y participent et en clarifiant les règles de leur financement.
Il engage, ainsi, la réforme de la représentativité patronale. Le développement d’un dialogue social de qualité suppose, en effet, d’établir des règles claires quant à la composition des tours de table de négociation et aux conditions dans lesquelles un accord peut être étendu et donc appliqué à l’ensemble des entreprises d’une branche. À l’heure de la publication du présent rapport, reste pendante la question de la place à accorder, au sein du système des relations collectives, aux organisations représentant les secteurs dits « hors champ ». Un protocole d’accord venant d’être conclu, il convient d’examiner favorablement les suites à lui donner pour intégrer dans la loi un niveau multiprofessionnel permettant d’associer aux négociations collectives l’UNAPL, la FNSEA et l’UDES.
Le texte aujourd’hui soumis à la représentation nationale est également l’occasion de dresser un premier bilan de la réforme de la représentativité syndicale initiée par la loi du 20 août 2008 relative à la démocratie sociale. Il propose une série d’ajustements, faisant l’objet de consensus, destinés à affiner un certain nombre de règles relatives aux élections professionnelles au sein de l’entreprise, dont le rôle a été profondément modifié depuis 2008, celles-ci étant devenues les clés de l’audience syndicale au niveau national.
Les organisations syndicales et patronales font vivre le dialogue social dans notre pays. Conforter la légitimité de ces organisations revient à conforter la légitimité de la démocratie sociale. Le présent projet de loi avance résolument dans cette direction, en proposant de compléter les règles relatives à la transparence du financement des organisations syndicales et patronales issues de la loi de 2008 par la mise en place d’un système de financement désormais clair et lisible. La création d’un fonds paritaire de financement des organisations syndicales et patronales alimenté par une contribution sur la masse salariale est un véritable point d’aboutissement de ce chantier si important pour faire vivre un dialogue social exempt de tout soupçon.
Confirmant ce volontarisme, le principe de transparence financière est également transposé aux comptes des comités d’entreprise, qui sont les institutions qui incarnent la négociation collective et sont ainsi au fondement de la démocratie sociale. Rien de plus légitime que d’exiger de ces institutions représentatives des salariés, qui sont les plus proches du terrain, qu’elles rendent des comptes aux salariés qu’elles représentent selon des modalités calquées sur celles de la vie associative (trésorier, certification, archivage…). C’est chose faite dans le cadre de ce projet de loi, et il convient de le saluer.
Le projet de loi vise, enfin, à renforcer le dispositif de contrôle du droit du travail et à moderniser son organisation pour l’adapter aux réalités de l’économie et surtout pour garantir son effectivité. Il procède ainsi dans le respect du principe d’indépendance à une réforme d’ensemble de l’inspection du travail, et améliore fortement les prérogatives des agents de contrôle de l’apprentissage et de la formation professionnelle.
La réforme proposée fait donc système : elle accroît les droits des salariés, en matière de formation, poursuit le processus de régionalisation de l’apprentissage, de l’orientation et de la formation professionnelles, fonde la participation des partenaires sociaux sur des bases législatives et financières solides, et définit clairement les lieux et la portée des concertations et des coordinations nécessaires à une plus grande efficacité des politiques d’emploi et de formation.
Car in fine, tel est bien l’enjeu des multiples modifications contenues dans ce projet de loi et que nous n’avons pas pu toutes citer (comme la réforme de l’insertion par l’Activité économique, les évolutions du Contrat de génération, la création du CDI apprentissage…) : clarifier, simplifier, décloisonner les dispositifs en faveur de l’emploi et du développement des qualifications et des compétences afin d’améliorer la promotion sociale des salariés et la compétitivité des entreprises.
I. FORMATION PROFESSIONNELLE : ACCOMPLIR LA MUTATION
Un accord national interprofessionnel, signé le 9 juillet 1970, a fondé le système actuel de formation professionnelle continue. Il a assis la légitimité des partenaires sociaux en matière de formation professionnelle continue et a créé un droit individuel pour le salarié : le congé individuel de formation. Il a prévu le recours à la formation pour les salariés menacés de licenciement. Il a été transposé par la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 qui établit le financement du système de formation professionnelle continue sur une obligation pour l’employeur de « payer » la formation du salarié, pour partie de façon directe, pour partie par la collecte réalisée par les organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA).
L’accord national interprofessionnel du 14 décembre 2013, transposé par le projet de loi, accomplit la mutation de ce système de formation professionnelle, mais en s’inscrivant dans la continuité de réformes amorcées tout au long des deux dernières décennies. Elles visent à infléchir profondément ce système de financement tout en s’appuyant sur les acquis des réformes qui y ont été progressivement apportées, tels la consolidation du réseau de collecte et le développement de l’appui apporté aux employeurs et aux salariés par les organismes paritaires et les branches.
Les inflexions sont profondes. Elles sont motivées d’abord par le constat des inégalités d’accès à la formation professionnelle continue. Contrairement aux objectifs assignés par le législateur en 1971, la formation professionnelle continue ne compense pas les inégalités créées par les systèmes d’enseignements scolaire ou supérieur : les salariés initialement les plus qualifiés utilisent plus souvent leurs droits à formation.
Aux inégalités entre les salariés selon leurs niveaux de qualification s’ajoutent les écarts selon la taille des entreprises mais aussi entre salariés en emploi et demandeurs d’emploi. Les employeurs n’ont en effet aucune incitation à cibler sur les salariés les moins qualifiés ou les plus précaires les dépenses de formation provenant de l’obligation légale. Les salariés en contrat à durée indéterminée accèdent ainsi beaucoup plus à la formation que les salariés en contrat à durée déterminée, alors que la formation devrait être un levier pour permettre aux salariés en CDD de construire un parcours vers l’emploi stable.
La montée de la concurrence internationale et la persistance du chômage de masse, dont les effets combinés ont fragilisé les parcours professionnels des salariés, assignent un objectif supplémentaire, en cohérence totale avec le précédent : sécuriser les parcours professionnel en concentrant les financements sur les phases du parcours professionnel et les publics pour lesquels il est le plus utile.
À ce titre, le renforcement du droit d’initiative de formation constitue une piste majeure, initiée par l’accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003 qui a abouti à la création du droit individuel de formation (DIF). De même, l’accord national interprofessionnel du 5 octobre 2009 relatif à l’accès des salariés à la formation professionnelle tout au long de la vie professionnelle a constaté que « dans une économie de plus en plus ouverte sur le monde (…) le renouvellement accéléré des techniques de production et de distribution des biens et des services sollicite toujours davantage l’initiative et la compétence de chacun des salariés ; leurs aspirations à une meilleure maîtrise de leur évolution professionnelle nécessitent de renouveler les objectifs et les moyens de la formation professionnelle continue. » Un compte personnel mobilisable lors des transitions professionnelles, voulues ou subies, a donc été envisagé, au fil de différents rapports (1), comme le moyen de répondre à cet objectif.
Ces différents enjeux ont en outre conduit au renouvellement de la définition des objectifs de la formation professionnelle continue, rappelés à l’article 1er de la loi n°2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l’orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie, et figurant à l’article L. 6111-1 du code du travail selon lequel elle « vise à permettre à chaque personne, indépendamment de son statut, d’acquérir et d’actualiser des connaissances et des compétences favorisant son évolution professionnelle, ainsi que de progresser d’au moins un niveau de qualification au cours de sa vie professionnelle ». Il en découle l’engagement collectif d’apporter un premier niveau de qualification professionnelle à ceux qui en sont dépourvus.
La mise en œuvre de l’ensemble de ces objectifs est garantie par le présent projet de loi au moyen d’une réforme du financement de la formation professionnelle et la mise en œuvre de nouvelles garanties d’accès à la formation : compte personnel de formation et conseil en évolution professionnelle au premier chef. Elle doit être confortée par une nouvelle gouvernance du système de la formation professionnelle et par le parachèvement du transfert aux Régions de la compétence en la matière.
• Passer de l’obligation de payer à l’obligation de former
La loi du 16 juillet 1971 a placé les entreprises au centre du dispositif de formation professionnelle continue, en instituant une obligation légale de formation au bénéfice des salariés sous la forme de l’obligation soit de dépenses directes dans le cadre d’actions de formation mises en place par les entreprises, soit de dépenses indirectes, au travers d’une cotisation versée à un organisme agréé qui en assure la mutualisation partielle.
Dépense des financeurs finaux par public bénéficiaire, en 2011
(en milliards d’euros)
Apprentis |
Jeunes en insertion professionnel |
Demandeurs d’emploi |
Actifs occupés du privé |
Agents publics |
Total | |
Employeurs |
1,16 |
1,00 |
0,11 |
11,43 |
- |
13,70 |
État |
2,35 |
0,51 |
0,89 |
0,97 |
2,71 |
7,43 |
Régions |
2,02 |
0,87 |
1,17 |
0,41 |
0,10 |
4,57 |
Autres collectivités territoriales |
0,05 |
0,01 |
- |
0,03 |
2,50 |
2,59 |
Unédic-Pôle emploi |
0,11 |
- |
1,64 |
0,02 |
0,70 |
2,47 |
Ménages |
0,19 |
- |
0,26 |
0,75 |
- |
1,20 |
Total |
5,88 |
2,39 |
4,07 |
13,61 |
6,01 |
31,96 |
Lecture : en 2011, les employeurs ont dépensé 1,16 milliards d’euros pour les apprentis, 1 milliard pour les jeunes en insertion professionnelle (alternance, accompagnement…), 0,11 milliard pour les demandeurs d’emploi et 11,43 milliard pour la formation continue des salariés du privé, etc. (Champ : France entière).
Source : Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques (Dares).
Plus de 40 ans après la loi de 1971, on constate que les employeurs consacrent ainsi plus de 13,70 milliards d’euros à la formation professionnelle continue dont 11,43 pour leurs salariés. À peine la moitié de cette dépense provient de leurs obligations légales dont le produit s’élève à 6,3 milliards d’euros.
La grille initiale des contributions envisagée en 1971 est par ailleurs devenue plus complexe : elle distingue les entreprises selon leur taille et a créé progressivement des contributions spécifiques différentes pour chaque dispositif.
LES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES ACTUELLES | |||
1 à 9 salariés |
10 à 19 salariés |
Plus de 20 salariés | |
Plan de formation |
0,4 |
0,9 |
0,9 |
Professionnalisation |
0,15 |
0,15 |
0,5 |
CIF |
0 |
0 |
0,2 |
TOTAL |
0,55 |
1,05 |
1,6 |
Si l’ « obligation de payer » a permis d’ancrer l’implication des employeurs dans le financement, ses effets se sont essoufflés. Le système de financement est déconnecté des finalités nouvelles de la formation professionnelle continue : permettre l’accès de tous à la connaissance et aux compétences ; sécuriser les parcours ; rendre possible la promotion sociale et professionnelle ; renforcer la compétitivité des entreprise.
Les sommes mobilisées par les dispositifs de formation dans lesquels le salarié dispose d’une initiative sont modestes : les organismes paritaires collecteurs agréés ont dépensé 276 millions d’euros en 2010 au titre du DIF et les OPACIF ont collecté 1 milliard d’euros en moyenne au titre du CIF chaque année depuis trois ans.
Faute de ciblage résolu des financements, rien ne compense la disparité de la demande de formation professionnelle. L’obligation d’achat direct de formation par l’employeur ne répond pas aux besoins de renforcement du financement des publics qui en ont le plus besoin et qui ne sauraient être définis spontanément par l’entreprise dans le cadre du plan de formation.
Pourtant, pour la mise en œuvre du plan de formation, le maintien de cette obligation est d’autant moins nécessaire que la part des dépenses à ce titre mutualisées de façon volontaire par les entreprises auprès des OPCA est en moyenne de 40 %.
Enfin fonder le financement obligatoire sur cette modalité de dépense est d’autant moins nécessaire que la participation de l’employeur se fonde également sur la relation de travail elle-même, dans le cadre de la loyauté des relations contractuelles : l’employeur doit assurer au salarié les conditions du maintien dans l’emploi en fonction des moyens dont il dispose, parmi lesquels figure le financement d’actions de formations. L’article L 6321-1 du code du travail consacre cette obligation puisqu’il prévoit que l’employeur « assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations. »
L’inadaptation du système actuel de financement aux enjeux de l’accès de tous les actifs à la qualification se traduit désormais par un tassement des dépenses de formation. Ainsi que le montre la carte ci-après, la France est au nombre des pays où l’espérance de formation du salarié était supérieure à la moyenne en 1999 mais a baissé depuis lors. En 2012, les formations d’une durée de moins de 20 heures représentaient 62 % des formations alors que les formations d’une durée supérieure à 500 heures ne représentaient que 0,57 %.
TYPOLOGIE DES PAYS EN FONCTION DE LA DURÉE MOYENNE DE FORMATION PAR SALARIÉ ET PAR AN (NIVEAU EN 1999 ET ÉVOLUTION DE 1999 À 2019)


Source : Jean-François Mignot, Formation continue des salariés en Europe. Céreq, Bref n°312, juillet 2013.
• Adapter le financement de la formation
Aussi, l’article 4 du projet de loi substitue pour les employeurs une « obligation de faire » à une « obligation de financer directement » en supprimant la cotisation obligatoire due au titre du financement du plan de formation.
Elle est remplacée par une contribution unique de 1 % de la masse salariale pour les employeurs de plus de 10 salariés et de 0,55 % pour les employeurs de moins de 10 salariés destinée à financer prioritairement les dispositifs ciblés sur l’accès aux qualifications et sur les publics prioritaires.
L’OPCA devient le collecteur unique de cette contribution. Les fonds sont intégralement mutualisés, quelle que soit la taille de l’entreprise, pour le financement du congé individuel de formation et du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP), dans des proportions définies par la loi, à l’article 5 du projet de loi.
Ils sont également entièrement mutualisés pour financer les actions de professionnalisation et le compte personnel de formation créé par l’article 1 du projet de loi. Enfin, une part est conservée au titre du financement du plan de formation, mutualisée par sections en fonction de la taille des entreprises, et destinée prioritairement à financer le plan des PME et des TPE, dans lesquelles les services des ressources humaines en charge de la formation sont les moins développés. Ces dernières pourront s’appuyer sur les nouvelles missions de conseil et d’appui conférées aux OPCA.
Outre l’effet de simplification du système de collecte, d’affectation et de mobilisation des fonds pour le rendre plus transparent, plus lisible et plus simple d’accès pour les employeurs comme pour les salariés, il en résulte un meilleur ciblage des financements.
Les ressources du FPSPP sont sécurisées et il pourra pérenniser ses interventions de péréquation des fonds de la professionnalisation entre OPCA, contribuer au financement de la formation des demandeurs d’emploi et remplir une nouvelle mission, souhaitée par les partenaires sociaux à l’article 40 de l’accord national interprofessionnel : la mutualisation interprofessionnelle visant à contribuer à l’accès à la formation des salariés des TPE, à hauteur de 20 % de ses ressources.
Sur la base de ce renouvellement du financement, le projet de loi apporte des garanties d’accès à la formation, à la fois pour les salariés et pour les demandeurs d’emploi.
L’article 1 du projet de loi concrétise la mise en œuvre du compte personnel de formation établi par l’article 5 de la loi de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 de sécurisation de l’emploi.
Le compte personnel de formation se substitue au DIF afin de mettre à disposition de tous les actifs un cadre individuel permettant d’exercer un droit d’initiative pour l’accès à la qualification, en acquérant progressivement des heures permettant de financer une durée de formation. Les garanties de liberté d’utilisation par le salarié sont nombreuses. Les droits sont conservés tout au long de la vie professionnelle, quel qu’en soit le parcours : comptabilisé en heures, le compte est en effet intégralement transférable, contrairement au DIF. Le compte ne peut jamais être mobilisé sans l’accord exprès du titulaire. Bénéficiant d’une gestion extérieure à l’entreprise, il peut être utilisé sans autorisation de l’employeur en dehors du temps de travail.
Au-delà du socle des heures acquises chaque année par le salarié, ou de droits supplémentaires éventuellement prévus par des accords, le compte est le support de subventions, qualifiés d’« abondements », des différents financeurs de la formation professionnelles continue qui permettent de compléter les droits pour accéder à des formations longues et qualifiantes. Dans ce cadre, le compte consacre le droit à la formation initiale différée par des abondements spécifiques pour les personnes ayant quitté le système scolaire sans diplôme.
L’utilisation de ces droits à des fins de qualification est garantie par la définition des formations éligibles dans la loi, avec une déclinaison par les partenaires sociaux au niveau des branches et des régions. Aussi, la demande de formation est-elle orientée vers les priorités collectives liées à l’évolution de l’emploi et aux mutations industrielles. Et le compte peut être utilisé pour accéder au socle commun de connaissances et de compétences, prérequis indispensable à toute primo-accession à une qualification. Il faut rappeler ici qu’il s’agit désormais d’un droit opposable à l’employeur.
Enfin, contrairement au DIF, le compte personnel de formation dispose d’un financement dédié : 0,2 point de la contribution unique des entreprises de plus de 10 salariés financeront les frais pédagogiques des heures de formation mobilisées par les salariés, ce qui représente près de 900 millions d’euros. En outre, le FPSPP prendra en charge les formations des demandeurs d’emploi au titre du compte, pour environ 300 millions d’euros.
2. L’inscription de la formation professionnelle au cœur du dialogue social dans les entreprises et les branches professionnelles
Le nouveau dispositif renforce la définition et le suivi des actions de formation.
L’article 2 vise à faire de la formation professionnelle et des compétences des salariés un élément central du dialogue entre salariés et employeurs au sein des branches professionnelles et des entreprises. La mise en place du compte personnel de formation nécessite des outils renouvelés permettant aux salariés d’être véritablement acteurs de leur avenir professionnel tout en s’inscrivant dans les orientations stratégiques définies par son entreprise.
De nouveaux leviers ont ainsi été institués tels que l’entretien professionnel, l’information et la consultation des instances représentatives du personnel dans le cadre du plan de formation, et des organisations syndicales de salariés dans le cadre de la négociation relative à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.
● La généralisation des entretiens professionnels
Afin de favoriser la progression des salariés, le projet de loi renforce le suivi, par l’employeur, de leurs actions de formation avec la généralisation des entretiens professionnels tous les deux ans. Tous les six ans, il sera aussi l’occasion d’établir un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel dans l’entreprise. Il permettra de vérifier si le salarié a bénéficié des entretiens professionnels et des trois mesures suivantes : une action de formation, une progression salariale ou professionnelle et l’acquisition des éléments de certifications, par la formation ou par une validation des acquis de l’expérience. Lorsqu’un salarié n’aura bénéficié, au cours des six années précédents, ni des entretiens professionnels ni d’au moins deux des trois mesures précédemment citées, le compte de formation pourra être crédité de cent heures que le salarié pourra utiliser pour couvrir ses besoins en formation.
L’effectivité de ce droit est garantie par un abondement correctif de 100 heures sur le compte personnel de formation que le salarié peut en outre utiliser sur le temps de travail, sans accord préalable de l’employeur.
● Le caractère incontournable du plan de formation
Ce projet de loi permet de mieux articuler les besoins des salariés, acteurs de leur formation, et les obligations des employeurs dans le domaine de la formation.
Le dispositif relatif à l’association des représentants des salariés à l’élaboration du plan de formation, est ainsi amélioré. Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, la consultation du comité d’entreprise portant sur ce plan portera désormais sur l’exécution de l’année en cours, en sus de l’exécution de l’année précédente et du projet de l’année à venir. Pour tenir compte des spécificités de l’entreprise et de son activité, un accord d’entreprise pourra prévoir un plan triennal de formation, ce qui permettra aux entreprises de se concentrer sur les enjeux stratégiques en se dispensant d’avoir à un renouveler cet exercice tous les ans.
Le texte fait également entrer dans la modernité les actions de formation en les élargissant aux formations ouvertes et à distance. En effet, jusqu’à présent, l’absence de cadre approprié avait empêché leur développement.
Le texte définit également les obligations de l’employeur lorsque le salarié a suivi avec assiduité la formation portant sur le développement de ses compétences. Les engagements de l’employeur portent notamment sur les conditions dans lesquelles le salarié accède, en priorité, aux fonctions disponibles correspondant aux connaissances ainsi acquises et sur l’attribution de la classification correspondant à l’emploi occupé.
● Une meilleure connaissance de l’environnement économique et de l’emploi avec la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC)
Afin d’inciter à l’anticipation des mutations économiques, le législateur a instauré, dans le cadre de la loi de programmation pour la cohésion sociale, une obligation triennale de négocier sur la GPEC formalisée désormais au sein de l’article L. 2242-15 du code du travail. Le projet de loi, qui tient compte des orientations de l’ANI, renforce ce dispositif.
Dans le cadre de leur mission d’appui aux entreprises et les salariés, les branches professionnelles devront ainsi se doter d’outils de référence afin de consolider la conduite des négociations relatives à la GPEC.
Au niveau de l’entreprise, deux modifications sont apportées par le projet de loi. En premier lieu, c’est le contenu obligatoire de la négociation prévue par l’article L. 2242-15 qui est enrichi, avec la prise en compte de l’abondement du compte personnel de formation. En second lieu, c’est le rôle du comité d’entreprise qui sera renforcé puisqu’il sera dorénavant consulté sur le contenu de la négociation, à défaut d’accord d’entreprise.
3. Le recentrage des dispositifs d’insertion sur une ambition qualifiante et sur les publics les plus fragiles
L’article 3 a pour objet de réformer les périodes de professionnalisation, les conditions de mise en œuvre du contrat de professionnalisation ainsi que la préparation opérationnelle à l’emploi des demandeurs d’emplois.
Le bilan des périodes de professionnalisation n’est pas satisfaisant, certains employeurs ayant eu recours à ce dispositif pour financer ou cofinancer des actions classiques et habituelles du plan de formation, bien loin du dispositif initial visant à favoriser l’insertion de public ciblé. L’objectif visant à permettre l’obtention d’une qualification n’est pas non plus atteint, 67 % des périodes n’étant pas sanctionnées par un diplôme, un titre ou une qualification reconnue.
Le projet de loi recentre le dispositif des périodes de professionnalisation sur les salariés les moins qualifiés. Il sera dorénavant accessible aux salariés des structures d’insertion par l’activité économique. Le texte renforce également l’ambition qualifiante des périodes de professionnalisation, favorise leur dimension certifiante et permet l’accès à des formations visant l’acquisition du socle de compétences au profit des salariés dont le niveau d’études est peu élevé. Dans le même esprit, la durée minimale de la période de professionnalisation, qui fera l’objet une fixation par décret, sera relevée. En effet, avec le renforcement de la dimension qualifiante, la période de professionnalisation permettra d’abonder le compte personnel de formation contribuant ainsi à l’allongement de la durée de la formation.
Le contrat de professionnalisation, quant à lui, est un dispositif qui a prouvé son utilité et son efficacité mais il convient de le sécuriser. Il est ainsi nécessaire de consacrer, par la voie législative, l’obligation de tutorat et de permettre au plus grand nombre de bénéficier de ce contrat en interdisant la sollicitation de concours financiers auprès de ses bénéficiaires.
Enfin l’article étend l’accès à la préparation opérationnelle à l’emploi (POE), individuelle et collective, aujourd’hui réservée aux demandeurs d’emploi, aux catégories les plus fragiles. La POE est désormais accessible aux salariés des structures d’insertion par l’activité économique et aux salariés bénéficiaires d’un contrat unique d’insertion.
Le présent projet de loi vise, ensuite, à encourager le développement de l’apprentissage, pour se donner les moyens d’atteindre l’objectif de 500 000 apprentis en 2017, et à favoriser l’insertion dans l’emploi, en créant un nouvel outil résidant dans une période de mise en situation en milieu professionnel en faveur des personnes faisant l’objet d’un accompagnement social.
Au 31 décembre 2012, on dénombrait 441 709 apprentis en France. Mêlant formation théorique et apprentissage en entreprise, l’apprentissage obtient de très bons résultats en termes d’insertion professionnelle. Ainsi, parmi les 100 000 apprentis formés chaque année par le réseau des chambres de commerce et d’industrie, près de 80 % trouvent un emploi dans les trois mois suivant la fin de leur formation, et 82 % occupent un poste quatre ans plus tard.
C’est pourquoi, le Pacte national pour la croissance, la compétitivité et l’emploi a fixé l’objectif de faire progresser le nombre d’apprentis à 470 000 en 2015 puis 500 000 en 2017.
Pour atteindre cet objectif, le Gouvernement a lancé une large concertation réunissant les partenaires sociaux, les régions, les chambres consulaires, les branches professionnelles et les réseaux de l’enseignement supérieur. Deux grands objectifs étaient au cœur de cette concertation :
– soutenir la montée en puissance de l’apprentissage, conformément aux objectifs du Pacte pour la croissance, la compétitivité et l’emploi ;
– sécuriser davantage le parcours de formation des apprentis, pour favoriser leur embauche, prévenir les ruptures de contrats et favoriser leur intégration durable dans l’emploi.
La première étape de cette concertation s’est conclue à la fin du mois d’octobre par la production d’un document de propositions du Gouvernement pour la réforme de l’apprentissage, visant à la fois à augmenter les ressources dédiées au financement de l’apprentissage, à simplifier et rendre plus efficace le système de collecte de la taxe d’apprentissage, et à favoriser l’accès à la qualification et à l’emploi durable des apprentis.
L’enjeu du financement est majeur, l’apprentissage représentant 5,88 milliards d’euros en 2011 et impliquant de multiples financeurs. Or, le schéma de financement de l’apprentissage se caractérise par une très grande complexité, puisqu’il combine éclatement des sources de financement et multiplicité des contributeurs.
En effet, de très nombreuses sources concourent au financement de cette politique. Il s’agit principalement en 2013 :
– de la taxe d’apprentissage, à hauteur de 2 milliards d’euros en 2012 ;
– de la contribution au développement de l’apprentissage (CDA), destinée à abonder les fonds régionaux de l’apprentissage et de la formation professionnelle, à hauteur de 750 millions d’euros en 2012 ;
– de la contribution supplémentaire à l’apprentissage (CSA), pour un montant prévisionnel de 314 millions d’euros en 2014 ;
– de l’exonération de cotisations sociales sur les salaires des apprentis, en vertu de l’article L. 6243-2 du code du travail, totale pour les entreprises artisanales et de moins de onze salariés, partielle pour les autres, pour un montant prévisionnel de 1,2 milliard en 2013 ;
– de l’exonération d’impôt sur le revenu de l’apprenti, pour la fraction du salaire n’excédant pas le montant annuel du SMIC, en vertu de l’article 81 bis du code général des impôts, pour un montant prévisionnel de 305 millions d’euros en 2013 ;
– de la dotation générale de décentralisation (DGD) pour l’apprentissage, visant à compenser aux régions le versement de l’ICF ;
– et du crédit d’impôt en faveur de l’apprentissage, pour un montant prévisionnel de 500 millions d’euros en 2013.
ÉVOLUTION DES SOURCES DE FINANCEMENT DE L’APPRENTISSAGE
(en millions d’euros)
2010 |
2011 |
2012 |
2013 | |
Taxe d’apprentissage |
1 902 |
1 944 |
2 033 |
– |
Exonération des cotisations sociales |
939 |
1 289 |
1 335 |
1 249 |
Dotation générale de décentralisation (DGD) pour l’apprentissage |
801 |
801 |
801 |
801 |
Contribution au développement de l’apprentissage (CDA) |
724 |
722 |
750 |
750 |
Crédit d’impôt en faveur de l’apprentissage |
430 |
462 |
470 |
500 |
Contribution supplémentaire à l’apprentissage (CSA) |
– |
– |
108 |
235 |
Exonération de l’impôt sur le revenu de l’apprenti |
265 |
279 |
290 |
305 |
Source : Ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
Alors qu’au regard des montants considérables en jeu, la taxe d’apprentissage devrait constituer un levier efficace de soutien de l’apprentissage, ses dispositifs de collecte et de répartition souffrent d’importants défauts :
– de fortes disparités entre les régions sont observées s’agissant des montants collectés, alors que les fonds attribués au titre de la péréquation présentent également de fortes variations. Ainsi, en 2012, alors que l’Île-de-France a bénéficié de 27,8 millions d’euros et les régions Rhône-Alpes et Pays de la Loire de 18,5 millions d’euros et 16,9 millions d’euros respectivement, le Limousin et la Corse ont reçu 1,8 million d’euros et 1,2 million d’euros ;
– le circuit de collecte et de répartition de la taxe est dispersé et peu efficient comme l’a souligné le rapport d’information du sénateur François Patriat de mars 2013 (2).
Le Gouvernement a donc lancé une réforme de grande ampleur de l’apprentissage poursuivant quatre objectifs : renforcer le financement de l’apprentissage afin de permettre son développement, simplifier la collecte de la taxe d’apprentissage, renforcer le rôle des régions et sécuriser le parcours de formation des apprentis.
• Renforcer le financement de l’apprentissage
Dans le but de recentrer l’intervention des régions sur les très petites entreprises, la loi de finances pour 2014 a supprimé l’indemnité compensatrice forfaitaire versée par les régions aux employeurs pour la remplacer par une nouvelle prime à l’apprentissage, dont le bénéfice est restreint aux entreprises de moins de 11 salariés. Le montant minimal de cette prime demeure fixé à 1 000 euros par année de formation, les régions pouvant décider d’accorder un montant supérieur aux employeurs.
La loi de finances précitée a également recentré le crédit d’impôt en faveur de l’apprentissage, dont bénéficient les entreprises, sur les seuls apprentis ayant un faible niveau de formation initiale.
Par ailleurs, L’article 60 de la loi de finances rectificative pour 2013 (3) a fusionné, à compter du 1er janvier 2014, la taxe d’apprentissage et la contribution au développement de l’apprentissage. Le taux de la taxe sera désormais de 0,68 % et de 0,44 % en Alsace-Moselle.
Par ailleurs, la loi de finances rectificatives pour 2013 a déterminé la répartition des fonds collectés par la nouvelle taxe d’apprentissage :
– en instituant une première fraction du produit de la nouvelle taxe d’apprentissage dont le montant est au moins égal à 55 % du produit de la taxe affectée aux régions afin de réaffirmer leur rôle de pilote dans la répartition des fonds de la taxe d’apprentissage ;
– en prévoyant que la seconde fraction, dénommée « quota », ainsi que la contribution supplémentaire de l’apprentissage, seraient affectées aux centres de formation d’apprentis et aux sections d’apprentissage afin d’augmenter leurs financements.
Cette seconde partie de la réforme a cependant été censurée par le Conseil constitutionnel dans une décision du 29 décembre 2013 (4). Le Gouvernement s’est engagé à mener cette réforme à terme par de nouvelles mesures législatives.
Le présent projet de loi s’inscrit donc parfaitement dans la politique de réforme de l’apprentissage initiée par le Gouvernement en renforçant le rôle de chef de file de la région, en sécurisant le parcours de l’apprenti et en simplifiant le circuit de collecte de la taxe d’apprentissage.
• Renforcer les compétences des régions en matière d’apprentissage
L’article 6 renforce le rôle des régions en mettant fin aux contrats d’objectifs et de moyens conclus entre l’État et les régions. Dans la nouvelle rédaction proposée, l’article L. 6211-3 du code du travail dispose que la région pourra élaborer des contrats d’objectifs et de moyens avec l’État, les organismes consulaires et les organisations représentatives d’employeurs et de salariés. Ces contrats ne reposeront donc plus sur un cofinancement État-région.
Par ailleurs, l’article 6 achève la décentralisation complète des centres de formation des apprentis en proposant le transfert des deux derniers CFA à recrutement national. L’article 15 du projet de loi prévoit, dès lors, les transferts financiers nécessaires.
• Sécuriser le parcours des apprentis
L’article 7 du projet de loi affirme clairement la gratuité de la formation de l’apprentissage pour l’apprenti comme pour l’employeur, y compris en ce qui concerne les frais « hors formation » et introduit la possibilité de conclure un contrat d’apprentissage dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, sans remettre en cause la protection particulière dont bénéficie l’apprenti pendant sa période de formation théorique et pratique.
Cette nouvelle possibilité devrait permettre notamment pour les jeunes qui en seront bénéficiaires de se trouver en position plus favorable dans leurs recherches de logement ou de prêts bancaires, l’employeur pouvant aussi y trouver un intérêt en termes d’attractivité et de fidélisation à l’issue de la période de formation.
Enfin l’article 7 prévoit la conclusion d’accords collectifs pour permettre la généralisation progressive d’une formation adaptée des maîtres d’apprentissage.
Afin de favoriser la réussite des jeunes entrants en contrat d’apprentissage, l’article 8 du présent projet de loi renforce et précise les missions confiées aux centres de formation d’apprentis (CFA) sur différents registres, notamment la consolidation du projet de formation, l’appui aux jeunes pour la recherche d’employeurs en lien avec le service public de l’emploi et la relation avec les maîtres d’apprentissage.
• Réformer la collecte de la taxe d’apprentissage
L’article 9 du projet de loi propose de réformer en profondeur l’architecture de la collecte de la taxe d’apprentissage en dotant, au niveau national, les seuls OPCA agrées d’une habilitation à collecter la taxe d’apprentissage, et au niveau régional, en confiant la collecte à un collecteur interconsulaire régional unique.
Cette simplification de la collecte aboutit à réduire des deux tiers le nombre d’organismes collecteurs, avec un passage de 147 organismes de collecte à moins de 50.
Par ailleurs, afin d’achever la simplification de la collecte et améliorer la transparence des fonds collectés, l’article 9 prévoit que les entreprises devront verser la taxe d’apprentissage et la contribution supplémentaire de l’apprentissage à un seul organisme collecteur, que ce soit au niveau régional ou national et que les régions seront consultées sur la répartition des fonds non affectés.
L’article 9 prévoit aussi que la taxe d’apprentissage due au titre de la masse salariale des intermittents du spectacle devra être versée à un OCTA unique désigné par une convention ou un accord professionnel national étendu afin de permettre à la branche professionnelle de résoudre la problématique de financements des formations des CFA et sections d’apprentissage des métiers du spectacle.
Enfin, afin de s’assurer de la bonne gestion de la collecte, l’article 9 propose :
– qu’une convention triennale d’objectifs et de moyens, conclue entre l’État et les organismes collecteurs habilités définit les modalités de financement et de mise en œuvre des missions de l’organisme collecteur habilité ;
– d’interdire le cumul d’une fonction d’administrateur ou de salarié dans un centre de formation d’apprentis, une unité ou une section d’apprentissage avec une fonction au sein d’un organisme collecteur habilité ou son délégataire;
– de poser l’obligation d’une comptabilité analytique séparée pour les collecteurs à activité multiples ;
– de prévoir des règles de dévolution des biens en cas de cessation d’activité d’un organisme collecteur.
Enfin, afin d’harmoniser les couts de formation sur le territoire national, l’article 9 propose de définir une méthode de calcul de ces coûts proposée par le conseil national de formation professionnelle tout au long de la vie (CNFPTLV) et arrêtée par un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
L’article 10 du présent projet de loi propose, ensuite, plusieurs mesures visant à favoriser l’insertion dans l’emploi. Il s’agit de développer de nouveaux outils pour combattre plus efficacement le chômage et, en particulier, celui des jeunes, une des priorités du Gouvernement et de la majorité.
Il crée, tout d’abord, des périodes de mise en situation en milieu professionnel, destinées aux personnes éloignées du marché du travail ou y éprouvant des difficultés. Ces périodes se substitueraient, au sein d’un cadre unifié, aux outils existants, qui apparaissent variables et éclatés, car réservés à des publics et des opérateurs distincts.
Elles permettraient, ainsi, à toute personne faisant l’objet d’un accompagnement social ou professionnel personnalisé de bénéficier d’une période de travail en entreprise, tout en conservant son régime d’indemnisation. Des conventions viendraient encadrer ce dispositif, qui ne pourrait, en aucun cas, être mis en œuvre pour exécuter une tâche régulière correspondant à un poste de travail permanent.
Au-delà de la création de ce nouvel outil d’insertion professionnelle, l’article 10 propose de relever à 30 ans la limite d’âge pour accéder à l’aide versée au titre des contrats de génération liés à la transmission d’une entreprise, au lieu de 26 ans aujourd’hui.
Il vise également à anticiper le déploiement de la réforme de l’insertion par l’activité économique, dont certains volets prendront effet dès cette année. Il adapte, en conséquence, le cadre juridique actuel pour prévenir toute difficulté de mise en place.
Enfin, au vu de l’avancée insuffisante des négociations en matière de temps partiel, entreprises par les branches professionnelles en application de la loi du 14 juin 2013 sur la sécurisation de l’emploi, il a pour objet de suspendre temporairement l’application des nouvelles dispositions sur la durée de travail minimale que cette loi a instaurées.
III. CONSTRUIRE LE NOUVEAU VISAGE DE LA GOUVERNANCE DE L’EMPLOI, DE LA FORMATION ET DE L’ORIENTATION PROFESSIONNELLES
Le présent projet de loi vise, ensuite, à construire le nouveau visage de la gouvernance de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles, en attribuant à la région un véritable « bloc de compétences » et en procédant à une rationalisation des instances et des outils existants.
A. ATTRIBUER À LA RÉGION UN VÉRITABLE « BLOC DE COMPÉTENCES » EN MATIÈRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE
La loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et aux responsabilités locales a attribué aux régions une compétence de droit commun en matière de formation professionnelle : elle est en effet désormais le premier financeur de cette politique publique s’agissant des jeunes et des demandeurs d’emploi. Elle est surtout responsable de la définition et de la mise en œuvre de cette politique, qui repose sur un outil dédié : le contrat de plan régional de développement des formations professionnelles.
Ainsi, d’après les données fournies dans le cadre du « jaune budgétaire » consacré à la formation professionnelle et annexé au projet de loi de finances pour 2014, les régions ont contribué au financement de la formation à hauteur de 4,5 milliards d’euros pour la formation professionnelle continue et l’apprentissage, dont 2,7 milliards d’euros pour la formation des jeunes et 1,15 milliard d’euros pour la formation des demandeurs d’emploi. Le tableau suivant retrace la répartition des financements régionaux de la formation professionnelle et de l’apprentissage.
DÉPENSES DES CONSEILS RÉGIONAUX PAR PUBLIC BÉNÉFICIAIRE EN 2011
(en millions d’euros)
Montant des dépenses en 2011 | |
Pour les jeunes |
2 742 |
dont apprentissage |
1 872 |
dont stages de formation |
616 |
dont rémunération des stagiaires |
254 |
Pour les demandeurs d’emploi |
1 151 |
dont stages de formation (y compris formations sanitaires et sociales) |
778 |
dont rémunération des stagiaires |
373 |
Pour les actifs occupés du secteur privé |
405 |
Investissement |
166 |
Total régions sans secteur public |
4 464 |
Pour les agents du secteur public |
101 |
Total régions avec secteur public |
4 565 |
Source : annexe au projet de loi de finances pour 2014, jaune budgétaire « Formation professionnelle »
Toutefois, l’État conserve une capacité d’intervention importante en matière de formation professionnelle continue, dans la mesure où il continue d’assurer le financement de la formation de publics spécifiques, transférée par le projet de loi aux régions, que ce soit dans le cadre de la lutte contre l’illettrisme, la formation des détenus, celles des Français hors de France ou des résidents ultra-marins, ou encore en matière d’accompagnement à la validation des acquis de l’expérience (VAE). En outre, Pôle emploi contribue également à financer des aides individuelles à la formation ainsi que des formations collectives à destination des demandeurs d’emploi. Enfin, s’agissant des personnes handicapées, les financements restent très largement partagés entre l’État, la région et l’Association de gestion du fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées (AGEFIPH).
L’article 11 du présent projet de loi a clairement pour objectif de rationaliser la mise en œuvre de la politique de formation professionnelle, en mettant fin à l’enchevêtrement des compétences qui continue d’exister aujourd’hui, particulièrement pour certains publics.
Il fait ainsi de la région le chef de file de la mise en œuvre de la politique de formation professionnelle des personnes handicapées, et parachève le mouvement de régionalisation de la formation professionnelle, en transférant aux régions les compétences actuellement encore détenues par l’État pour la formation de publics spécifiques ou en matière de VAE.
La région sera ainsi détentrice d’un véritable bloc de compétences en la matière, utilement complété par la mise en place d’un certain nombre d’outils destinés à la mettre en capacité de coordonner efficacement les différents acteurs de cette politique sur le terrain. Ainsi, la région devient a priori le point unique pour la commande de formations collectives, le texte conduisant à recentrer Pôle emploi sur l’achat de formations individuelles. Une procédure d’habilitation est également mise en place pour permettre à la région de financer des programmes de formation à destination de publics en difficulté d’insertion, dans un cadre sécurisé et conforme au droit communautaire de la commande publique.
Enfin, alors que la loi de 2004 avait déjà transféré aux régions une compétence de droit commun en matière de formation des travailleurs sociaux et de formations paramédicales, l’article 11 du présent projet de loi parachève ce transfert, en renforçant les pouvoirs des régions en matière d’agrément des établissements de formation sociale et de fixation des quotas d’élèves à admettre dans les filières de formation paramédicale.
B. RATIONALISER LES INSTANCES ET LES OUTILS
Élevée au rang d’obligation nationale, la formation professionnelle tout au long de la vie prend appui sur le service public de l’orientation.
L’article 12 fait de la région un chef de file en matière d’orientation et précise également les contours du conseil en évolution professionnelle créé par la loi du 14 juin 2013 (5). Il clarifie la répartition des compétences entre l’État et la région en lui reconnaissant explicitement, au sein du code du travail, une compétence qu’elle exerce déjà dans le cadre de sa compétence générale. Ces évolutions ont été préparées, en 2013, par la mise en œuvre, dans huit régions et neuf académies, d’une expérimentation relative au SPRO dont l’évaluation interviendrait au cours du deuxième trimestre de l’année 2014. Le calendrier de la promulgation de loi permettra de généraliser le nouveau dispositif dès la rentrée scolaire 2014 en tenant compte des enseignements tirés de l’évaluation.
Le service public de l’orientation demeurant sous la responsabilité conjointe d’une multitude d’acteurs locaux, il est apparu nécessaire de désigner une autorité organisatrice, au plan local, pour renforcer l’efficacité du service rendu.
La région, eu égard à sa compétence de droit commun en matière de formation professionnelle, est apparue la mieux placée pour endosser le rôle de coordination des dispositifs dans le cadre du service public régional de l’orientation (SPRO). En sa qualité d’autorité organisatrice, la région sera désormais chargée de la labellisation des organismes concourant au SPRO.
L’État, quant à lui, conserve la définition, au niveau national, de la politique d’orientation des élèves et des étudiants dans les établissements scolaires et d’enseignement supérieur.
Cette répartition des compétences s’applique également dans le domaine de la lutte contre le décrochage scolaire. L’engagement des actions ressortissant de cette politique publique échoit désormais aux régions, qui se voient reconnaître un rôle de coordination, en lien avec les autorités académiques. L’État conserve la mise en œuvre coordonnée du dispositif de collecte et de transmission des données relatives aux jeunes « décrocheurs ».
Principal dispositif du SPRO, le conseil en évolution professionnelle est une offre de service gratuite d’accompagnement visant l’évolution et la sécurisation professionnelle des salariés. Il permet de déboucher sur un projet de mobilité dans l’emploi, de mobilité externe, de vie autonome ou sur un projet de formation.
Un cahier des charges national définira l’offre de services qui sera délivrée par cinq opérateurs nationaux ainsi que par les opérateurs régionaux désignés par la région, après concertation au sein du bureau du comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles institué à l’article 14 du projet de loi. Des conventions de coordination conjointes de l’État et de la région avec chacun des opérateurs du CEP favoriseront la mise en œuvre des actions de ces différents réseaux entre eux comme avec les autres membres du service public régional de l’orientation.
L’article 13 fait évoluer les modalités d’élaboration du contrat de plan régional de développement de la formation professionnelle conclu entre représentant du conseil régional, représentant de l’État et autorités académiques, et les partenaires sociaux étant associés à son élaboration.
La région établira désormais un contrat de plan régional de développement des formations et de l’orientation professionnelles (CPRDFOP) qui devra prendre en compte l’orientation et l’articuler avec les politiques d’emploi et de formation.
S’inscrivant dans la dynamique partenariale observée au moment de l’établissement de la première génération de contrat, le nouveau dispositif verra ses modalités d’élaboration sensiblement modifiées.
Le comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles (CREFOP), qui rassemblera notamment des représentants de la région, de l’État et des partenaires sociaux sera le lieu de négociation du contrat. Les partenaires sociaux, déjà parties prenantes à l’élaboration du contrat, auront dorénavant la possibilité de le signer. Cette signature conférera un poids politique supplémentaire et attestera de la qualité de la concertation.
L’article 14 simplifie la gouvernance nationale et régionale de la formation professionnelle et de l’emploi.
Les politiques en matière de formation, d’orientation et d’emploi sont liées mais relèvent d’autorités et d’organismes distincts. Le projet de loi renforce la coordination de ces politiques publiques en confiant à une même institution le soin d’organiser la concertation nationale et régionale quadripartite entre l’État, les régions et les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs. Les débats seront désormais organisés au sein d’une même enceinte nationale et d’un même comité régional.
Au niveau national, le texte procède à la fusion du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie (CNFPTLV) et du Conseil national de l’emploi, réunis en un Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles (CNEFOP). Les missions du futur CNEFOP seront enrichies par rapport à celles de l’actuel CNFPTLV en matière d’orientation professionnelle, de système d’information, de suivi de l’engagement des principaux financeurs de la formation professionnelle et de l’apprentissage.
Au niveau régional, le projet de loi procède à la création du comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles, issu de la fusion du comité de coordination régional de l’emploi et de la formation professionnelle avec le conseil régional de l’emploi (CREFOP). Les missions du CREFOP s’articulent en cohérence avec les compétences du CNEFOP, afin de garantir une certaine cohérence méthodologique, s’agissant tout particulièrement de l’évaluation des résultats.
L’avancée majeure de cette nouvelle gouvernance réside dans la création d’un bureau, au sein du CREFOP qui rassemblera des représentants de l’État, de la région et des partenaires sociaux. Ce bureau, dont la vocation est d’être un lieu de concertation, leur permettra de s’accorder sur la désignation des opérateurs régionaux chargés du conseil en évolution professionnelle, sur la répartition des fonds de la taxe d’apprentissage non affectés par les entreprises et sur les listes des formations éligibles au compte personnel de formation.
Enfin, des conventions régionales de coordination seront signées entre la région et l’État, d’une part et les représentants régionaux des opérateurs de l’emploi, tels que Pôle emploi, les missions locales et les organismes de placement spécialisés dans l’insertion professionnelle des personnes handicapées d’autre part, afin de mieux coordonner la mise en œuvre opérationnelle des politiques de l’orientation, de la formation professionnelles et de l’emploi.
L’article 14 définit la gouvernance nationale et régionale des partenaires sociaux représentatifs. Cette consécration législative se justifie par la responsabilité, incombant aux instances paritaires, de constituer les listes de formation éligibles au compte personnel de formation pour les salariés et les demandeurs d’emploi.
Le Comité paritaire national pour la formation professionnelle et l’emploi (CPNFPE), renommé Comité paritaire interprofessionnel national pour l’emploi et la formation (COPINEF) par votre commission, constitué des organisations syndicales et d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, aura pour mission de définir les orientations politiques paritaires en matière de formation et d’emploi, d’assurer leur suivi et leur coordination avec celles des autres acteurs. Il devra élaborer la liste des formations éligibles au compte personnel de formation au niveau national et interprofessionnel.
Au niveau régional, le comité paritaire régional pour la formation professionnelle et l’emploi (CPRFPE), renommé comité paritaire interprofessionnel régional pour l’emploi et la formation (COPIREF), a notamment pour mission d’animer en région le déploiement territorial des politiques paritaires définies par les accords nationaux interprofessionnels en matière de formation professionnelle et d’emploi, Par ailleurs, la loi reprend les dispositions de l’ANI relatives à la consultation du comité sur la carte régionale des formations professionnelles initiales et sur l’établissement des listes des formations éligibles au titre du compte personnel de formation.
Le titre II du présent projet de loi vise, ensuite, à renforcer le socle de la démocratie sociale, en procédant à la réforme de la représentativité patronale, en affinant les critères gouvernant la représentativité syndicale, en parachevant l’évolution des règles de financement applicables aux organisations d’employeurs et de salariés, et en engageant celle des règles applicables aux comités d’entreprise, vers toujours plus de transparence.
La réforme de la représentativité patronale, proposée par l’article 16 du présent projet de loi, constitue une innovation majeure et certainement l’une des réformes les plus attendues du droit du travail.
Le cadre juridique présidant aujourd’hui à la représentativité patronale demeure, en effet, très limité, voire indigent, puisque l’établissement de celle-ci repose sur un principe de reconnaissance mutuelle, parfois opéré sous le contrôle de l’administration ou du juge. Or cette situation n’apparaît plus acceptable au regard des évolutions récentes du droit et de la pratique des relations collectives, qui ont conduit à associer toujours davantage les partenaires sociaux à l’élaboration de la norme commune. Par ailleurs, la réforme de la représentativité des syndicats de salariés étant arrivée au terme de son processus, il semble naturel que celle des organisations patronales ait lieu.
Soucieux de promouvoir un dialogue social de qualité, reposant sur des acteurs à la légitimité incontestable, le Gouvernement s’est fortement investi pour que cette réforme puisse aboutir. Il a ouvert ce chantier dès la Grande conférence sociale de juillet 2012, en demandant aux organisations patronales de formuler des propositions. Après une longue phase de concertation, ces dernières ont trouvé un terrain d’entente et pu signer une position commune, le 19 juin 2013, définissant les principes devant guider l’édiction d’un nouveau cadre juridique.
Afin de permettre une mise en œuvre rapide de ces principes, le Gouvernement a décidé, au cours de la Grande conférence sociale de juin 2013, de mandater le directeur général du travail pour conduire une mission visant à élaborer un dispositif opérationnel, dont les contours ont été rendus publics dans un rapport d’octobre 2013.
Les options de réforme retenues par l’article 16 du présent projet de loi s’inscrivent dans la continuité de la position commune et du rapport du directeur général du travail.
Il propose, ainsi, de refonder la représentativité patronale sur des critères généraux de représentativité semblables à ceux applicables aux syndicats de salariés, sauf s’agissant de celui de l’audience, qui serait mesurée par rapport au nombre d’entreprises adhérentes. Il établit des règles propres à chaque niveau de négociation et résout, en particulier, le problème des adhésions multiples aux organisations nationales et interprofessionnelles, en posant un principe de liberté dans la pondération des voix, moyennant un pourcentage de répartition minimal.
Tirant toutes les conséquences induites par cette réforme, l’article 16 du présent projet de loi renforce, ensuite, les obligations auxquelles sont soumises les organisations d’employeurs en matière de transparence financière, et crée un droit d’opposition majoritaire à l’extension d’un accord collectif, en faveur des organisations patronales dont les entreprises adhérentes emploient la majorité des salariés d’un secteur.
Enfin, il vise à doter l’autorité administrative de nouveaux outils lui permettant de procéder à la restructuration des branches professionnelles, en conférant au ministre chargé du travail, sous réserve du respect de conditions précises, le droit de prononcer une mesure d’élargissement ou de fusion à l’encontre de branches ne justifiant pas d’une activité suffisante, ainsi que de refuser l’extension d’une convention.
B. LA REPRÉSENTATIVITÉ SYNDICALE : UN ACQUIS IMPORTANT, QUI SE VOIT ENCORE CONFORTÉ DANS LE CADRE DU PRÉSENT PROJET DE LOI
La loi n° 2008-789 du 20 août 2008 relative à la démocratie sociale a profondément revu les règles de la représentativité syndicale et a, de ce fait, largement contribué à conforter la légitimité des partenaires sociaux.
Elle a, en premier lieu, procédé à une refonte complète du fondement de la représentativité syndicale, en supprimant la présomption irréfragable de représentativité et en fondant désormais celle-ci sur de nouveaux critères, au nombre de sept. Si ces critères sont bien cumulatifs, la jurisprudence a confirmé qu’ils devaient être répartis en deux catégories. D’une part, le respect des valeurs républicaines, d’indépendance et de transparence financière doivent être satisfaits de manière autonome. D’autre part, les critères relatifs à l’influence, aux effectifs d’adhérents et aux cotisations, à l’ancienneté d’au moins deux ans et à l’audience doivent faire l’objet d’une appréciation globale.
La loi a prévu les règles de détermination de la représentativité syndicale au niveau de l’entreprise et de l’établissement, du groupe, de la branche et au niveau interprofessionnel : l’audience est ainsi désormais prise en compte à partir des résultats des élections professionnelles dans les entreprises, donnant lieu à une appréciation périodique – tous les quatre ans – de la représentativité. Le critère de représentativité est fixé à 10 % des suffrages exprimés au premier tour de ces élections au niveau de l’entreprise, de l’établissement et du groupe, et à 8 % au niveau de la branche et au niveau interprofessionnel.
La loi est également venue modifier les dispositions du code du travail relatives aux élections des délégués du personnel et des représentants du personnel au comité d’entreprise, en octroyant une plus grande liberté de choix aux salariés électeurs, par l’ouverture plus large du premier tour des élections professionnelles à des syndicats légalement constitués. Elle a rénové la désignation des délégués syndicaux et organisé, pour les organisations syndicales, la possibilité de désigner un représentant de la section syndicale.
La loi a, en second lieu, posé le principe de nouvelles règles de validité des accords collectifs, dans la perspective du passage à un mode de conclusion majoritaire des accords. : en effet, tout accord collectif qu’il soit d’entreprise, de branche ou interprofessionnel, doit, pour être valide, avoir été signé par des syndicats qui ont recueilli au moins 30 % des suffrages, lors de la mesure de l’audience, et ne pas faire l’objet de l’opposition de syndicats ayant recueilli une majorité de suffrages. Un nouveau cadre régissant la négociation avec les représentants du personnel ou les salariés mandatés est également posé par la loi de 2008, afin de développer le dialogue social dans les petites entreprises.
Enfin, la loi a posé le principe de la transparence financière des organisations syndicales et patronales, avec l’obligation d’établir et de publier les comptes, ainsi que l’obligation de certification des comptes pour les organisations dont les ressources dépassent un certain seuil.
Conformément à ce qui était prévu par la loi de 2008 elle-même, le Haut conseil du dialogue social (HCDS) créé par cette même loi, a dressé un bilan de cette réforme avant la fin de l’année 2013, destiné à en tirer les principaux enseignements et d’élaborer le cas échéant des propositions d’amélioration du dispositif en vue de leur mise en œuvre pour la prochaine mesure de l’audience syndicale. Cet objectif avait été expressément repris dans le cadre de la feuille de route de la Grande conférence sociale des 20 et 21 juin 2013, qui prévoyait que ce bilan devait « prendre en compte les observations des partenaires sociaux, les éléments issus de la jurisprudence et les normes internationales du travail ».
L’article 17 du présent projet de loi constitue l’aboutissement, sur le plan législatif, de ce travail de bilan.
Il propose principalement une série d’ajustements touchant spécifiquement trois thématiques : la sécurisation du processus électoral dans les entreprises, l’approfondissement de la légitimité des organisations syndicales et le renforcement de l’action syndicale. Sur la quasi-totalité de ces points, il est proposé d’entériner les interprétations jurisprudentielles intervenues depuis la mise en œuvre de la loi de 2008 ou de consacrer des points de consensus entre les organisations syndicales.
S’agissant du protocole préélectoral, les principales modifications visent à sécuriser les modalités de sa négociation, en précisant le délai imparti pour sa négociation, à délimiter le périmètre de compétence de l’administration qui est susceptible d’intervenir en cas de désaccord entre les organisations syndicales et l’employeur, et enfin, à harmoniser les règles de validité des différentes clauses du protocole préélectoral.
Concernant l’approfondissement de la légitimité des organisations syndicales dans l’entreprise, il s’agit d’aller au bout de la logique qui consiste à faire des élections professionnelles au sein de l’entreprise la clé de la mesure de l’audience syndicale, en incitant les syndicats présentant des listes à déclarer leur affiliation à une organisation syndicale, lorsque tel est le cas. À défaut d’une telle déclaration d’affiliation, les suffrages exprimés en faveur d’un syndicat ne sauraient entrer dans le décompte de l’audience de l’organisation syndicale.
Le renforcement de l’action syndicale passe par la clarification de la date de fin du mandat de délégué syndical, la redéfinition du périmètre de désignation des délégués syndicaux, afin que celui-ci soit le plus proche possible des salariés, mais également l’assouplissement des règles de désignation d’un délégué syndical pour une organisation syndicale afin de ne pas mettre celle-ci dans l’impossibilité d’en désigner un.
Enfin, il est proposé, sur un dernier point, de revenir sur une disposition introduite par la loi de 2008 : le texte propose en effet de rétablir les conditions antérieures à cette loi pour la désignation du représentant syndical au comité d’entreprise. En effet, la loi de 2008 avait introduit, pour les entreprises de plus de 300 salariés, la condition de disposer d’au moins deux élus au comité d’entreprise pour pouvoir y désigner un représentant syndical. Cette condition doit être supprimée, car elle conduit dans les faits à exclure potentiellement la présence de syndicats représentatifs dans l’entreprise au comité d’entreprise.
La loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale a consacré le principe de la transparence financière des comptes des organisations syndicales et patronales, celui-ci ayant d’ailleurs, comme on l’a dit, été posé comme un critère à part entière de la représentativité syndicale. On notera à ce titre que l’article 16 du présent projet de loi, qui définit les critères de la représentativité patronale, reprend également celui de la transparence financière. Depuis l’entrée en vigueur de la loi de 2008, les organisations syndicales et patronales sont donc soumises aux obligations comptables de droit commun. Elles sont également tenues de publier leurs comptes. Enfin, les organisations dont les ressources annuelles excèdent 230 000 euros doivent faire procéder à la certification de leurs comptes par un commissaire aux comptes.
Au-delà de ce principe de transparence financière, l’accord national interprofessionnel du 17 février 2012 relatif à la modernisation et au fonctionnement du paritarisme a jeté les bases d’une clarification des modalités et des règles de financement des organisations syndicales et patronales par les organismes gérés paritairement, – qu’il s’agisse des organismes gérés exclusivement par les partenaire sociaux comme l’Unédic, qu’il s’agisse d’une gestion assumée par les partenaires sociaux, mais sur la base de règles définies par l’État, comme c’est par exemple le cas pour les caisses de sécurité sociale ou l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS), ou qu’il s’agisse d’une gestion véritablement tripartite, partagée avec l’État, comme c’est le cas pour Pôle emploi.
Cet accord procède notamment à une clarification et à une harmonisation des règles applicables dans chaque organisme en matière de gouvernance et de répartition des mandats paritaires, de certification et de publication des comptes, de remboursement des frais des administrateurs, de gestion financière, de formation des administrateurs et de contrôle de l’ensemble des financements ainsi assurés.
Si des progrès importants ont donc été réalisés dans les dernières années pour accroître la transparence du financement des organisations syndicales et patronales, le système actuel continue de souffrir d’un réel manque de lisibilité. De l’illisibilité à l’opacité, il n’y a qu’un pas, que d’aucuns n’hésitent pas à franchir, contribuant à alimenter un esprit de suspicion, qui tend à décrédibiliser les organisations syndicales et patronales et à mettre à mal leur légitimité.
C’est précisément pour tordre le cou à ce type de cliché que l’article 18 du présent projet de loi propose de parachever le dispositif de transparence financière des organisations syndicales et patronales, en leur offrant un cadre unique et globalisé de financement, à travers la mise en place d’un fonds paritaire dédié, qui a vocation à retracer l’ensemble des financements qui bénéficient actuellement aux organisations syndicales et patronales, à l’exclusion bien sûr de leurs ressources propres.
Le fonds paritaire de financement des organisations syndicales et patronales, géré par une association paritaire, doit être créé par les partenaires sociaux eux-mêmes, sur la base d’un accord national interprofessionnel (ANI) agréé par le ministre du travail. À défaut d’accord ou à défaut de son agrément par le ministre, l’ensemble des dispositions législatives encadrant la mise en place, l’organisation et le fonctionnement du fonds doivent être prises par voie réglementaire.
Le fonds paritaire se voit affecter plusieurs types de ressources, qui doivent recouvrir l’ensemble des financements actuels, en l’occurrence une contribution des employeurs, à hauteur d’un taux compris entre 0,014 % et 0,02 % de la masse salariale, qui recouvre les financements actuellement issus du Fonds national de gestion paritaire de la formation professionnelle continue (FONGEFOR) ainsi que des OPCA ; le cas échéant, une participation volontaire des organismes gérés paritairement, qui recouvre les actuels « préciputs » versés par ces mêmes organismes ; une subvention de l’État, destinée à couvrir les actuels financements publics de la formation syndicale des salariés, ainsi qu’une subvention nouvelle, complémentaire, au titre de l’appui apporté par les partenaires sociaux à la mise en œuvre des politiques publiques ; et enfin, le cas échéant, toute autre ressource qui pourrait être prévue en complément par des dispositions législatives, réglementaires ou sur la base d’un accord national interprofessionnel ou par un accord de branche étendu.
Les modalités de financement des organisations syndicales et patronales par le fonds paritaire répondent à un système strict de « fléchage » des crédits : si les missions liées au paritarisme de gestion ont vocation à être financées par la contribution des employeurs et par les éventuelles contributions volontaires des organismes paritaires eux-mêmes, la mission d’appui aux politiques publiques qui incombe aux partenaires sociaux sera exclusivement financée par la subvention de l’État. La formation syndicale sera enfin financée pour une très large part par les actuels financements de l’État à ce titre, et marginalement, par une fraction de la contribution des employeurs, en lieu et place de l’actuel financement du congé de formation syndicale que financent les entreprises.
S’agissant de la clé de répartition des crédits, les missions liées au paritarisme bénéficieront bien évidemment à parité aux organisations syndicale et aux organisations patronales. La répartition des fonds entre organisations syndicales est fixée uniformément – comme c’est aujourd’hui le cas dans la quasi-totalité des organismes – et entre organisations patronales, soit en fonction du nombre de mandats paritaires exercées, soit à terme, lorsqu’elle sera connue, en fonction de l’audience patronale. Les financements afférents aux missions d’appui aux politiques publiques feront, pour leur part, l’objet d’une répartition uniforme, sur la base d’une base forfaitaire identique pour l’ensemble des organisations, syndicales comme patronales, représentatives au niveau national et interprofessionnel, et sur une base forfaitaire d’un montant inférieur pour les organisations syndicales non représentatives mais qui ont néanmoins recueilli plus de 3 % des suffrages exprimés, au niveau national, aux dernières élections professionnelles. Enfin, les financements afférents à la formation syndicale doivent faire l’objet d’une répartition par décret en fonction de l’audience syndicale des organisations, ces financements pouvant là encore bénéficier à la marge aux organisations syndicales de salariés non représentatives, mais qui ont recueilli plus de 3 % des suffrages, au niveau national, aux dernières élections professionnelles.
En conséquence de la redéfinition complète des sources et des modalités de financement des organisations syndicales et patronales par le fonds paritaire, le projet de loi interdit tout financement, direct ou indirect, de ces organisations par les organismes gérés paritairement : il s’agit là de répondre au principal reproche adressé au financement actuel, et à la source de l’opacité qui caractérise aujourd’hui ce financement. De ce point de vue, la présence d’un commissaire du Gouvernement auprès de l’association paritaire de gestion du fonds est également de nature à garantir la clarification de ce financement.
Les organisations syndicales et patronales sortiront indéniablement renforcées de cette réforme de leur financement, qui, tout en garantissant un niveau de ressources équivalent aux ressources existantes, accroît fortement la lisibilité de ce dernier. Il n’en reste pas moins que se pose la question du traitement qui doit être fait, dans ce cadre, des organisations patronales non représentatives au niveau national et interprofessionnel, mais qui sont représentatives au niveau d’une ou plusieurs branches d’activité, c’est-à-dire des organisations dites « hors champ ». Si les entreprises qui leur sont affiliées doivent contribuer au financement du fonds paritaire, il est légitime que ces organisations puissent également bénéficier des financements du fonds : si tel est bien le cas pour ces organisations au niveau de leur branche, tel n’est pas le cas au niveau interprofessionnel, puisque ces organisations ne sont pas représentatives à ce niveau. Dès lors, faut-il les associer à la mise en place, au financement du fonds et les rendre éligibles aux crédits du fonds paritaire et à sa gestion ? Faut-il au contraire les en exclure et aménager un dispositif de financement spécifique de ces organisations ? Le protocole d’accord signé le 29 janvier 2014 par les organisations patronales représentatives au niveau interprofessionnel et les trois organisations patronales multi-professionnelles représentatives au plan national ne règle pas la question du financement du secteur « hors champ ».
La discussion du présent projet de loi dans notre Assemblée doit être utilement mise à profit pour trouver une solution adaptée à ce secteur. Votre rapporteur considère qu’il appartient en effet à la représentation nationale de compléter sur ce point les dispositions du projet de loi.
Les données de la direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques (DARES) issues de l’enquête « Relations professionnelles et négociations d’entreprise » (REPONSE), évaluent à 53 100 le nombre de comités d’entreprise ou d’établissement et à 378 400 le nombre d’élus, titulaires ou suppléants, à ces comités.
Si l’on ne dispose d’aucune donnée consolidée sur les ressources des comités d’entreprise, dans la mesure où ceux-ci sont précisément gérés de manière autonome par les élus, l’étude d’impact fournit néanmoins un certain nombre d’éléments issus conjointement des études menées par la DARES et de la déclaration annuelle des données sociales (DADS). D’après ces sources, les entreprises de plus de 50 salariés seraient au nombre de 40 340 : rappelons que ce seuil est celui de la mise en place obligatoire d’un comité d’entreprise. Si les ressources totales des comités d’entreprise dans les entreprises entre 50 et 100 salariés sont estimées à moins de 20 000 euros en moyenne, celles des comités présents dans les entreprises entre 250 et 500 salariés s’établiraient autour de 108 000 euros en moyenne. Dans les entreprises de 2 000 à 5 000 salariés, les ressources des comités d’entreprise seraient de l’ordre de 1 million d’euros en moyenne, et dans les entreprises de plus de 5 000 salariés, ces ressources montent même jusqu’à plus de 5 millions d’euros en moyenne. Ces estimations demeurent néanmoins limitées puisqu’elles ne tiennent pas compte des éventuelles autres ressources des comités d’entreprise et que, si certains comités d’entreprise n’ont pas de budget lié à des activités sociales et culturelles, d’autres bénéficient d’une contribution à ce titre qui est largement supérieure à la moyenne estimée autour de 0,8 % de la masse salariale brute.
Le sujet de la transparence financière des comités d’entreprise rencontre un intérêt marqué depuis plusieurs années, intérêt encore accentué depuis la mise en place, par la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale, d’une obligation d’établissement, de certification et de publication des comptes des organisations syndicales et patronales. Si les comités d’entreprise ne disposent pas, au même titre que les organisations syndicales et patronales, de ressources publiques, ils représentent néanmoins les intérêts des salariés et assurent la gestion d’un certain nombre d’activités sociales et culturelles à leur profit : il est donc normal que les comités d’entreprise rendent des comptes aux salariés à ce titre.
La Cour des comptes a, à plusieurs reprises au cours des dernières années, mis en cause le manque de transparence financière des fonds gérés par certains grands comités d’entreprise, en particulier celui de la RATP ainsi que les institutions sociales des industries électriques et gazières (IEG). La représentation nationale s’est également emparée du sujet, – que ce soit à travers les travaux de la commission d’enquête dite « Perruchot » sur le financement des organisations syndicales et patronales, la proposition de loi n° 306, adoptée par l’Assemblée nationale à l’initiative du même auteur le 26 janvier 2012, et plus récemment, la proposition de loi n° 679 déposée par notre collègue sénatrice Catherine Procaccia, et qui a été adoptée par la commission des Affaires sociales du Sénat le 10 octobre 2013.
Alors même que ces initiatives pouvaient contribuer à jeter une suspicion généralisée – et, partant, logiquement infondée – sur l’ensemble des comités d’entreprise, il devenait urgent d’intervenir, et ce, d’autant plus qu’un changement des règles actuellement applicables aux comptes des comités d’entreprise faisait largement consensus au sein des organisations syndicales. Certaines d’entre elles ont même pris l’initiative de demander aux pouvoirs publics une avancée en matière de transparence financière des comptes des comités d’entreprise, jugeant la réglementation actuelle trop incertaine et inapplicable dans les faits.
L’initiative visant à clarifier le financement des comités d’entreprise a donc été actée dans le cadre de la grande conférence sociale des 20 et 21 juin 2013, sur la base des travaux menés au cours de l’année 2012 par un groupe de travail animé par le directeur général du travail et associant l’ensemble des partenaires sociaux membres de la Commission nationale de la négociation collective – autrement dit, les organisations représentatives au niveau national et interprofessionnel, auxquelles sont jointes l’Union nationale des professions libérales (UNAPL) et la Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles (FNSEA).
Le texte de l’article 19 du présent projet de loi reprend fidèlement les conclusions de ce groupe de travail, pour poser le principe de la transparence financière des comités d’entreprise.
Les comités d’entreprise se voient en premier lieu soumis aux règles générales de la comptabilité, avec toutefois, la mise en place d’une comptabilité ultra-simplifiée pour les « petits » comités d’entreprise, autrement dit, ceux dont les ressources annuelles sont inférieures à 153 000 euros. Pour les comités d’entreprise qui dépassent deux des trois critères suivants : 50 salariés, 1,55 million d’euros de bilan et 3,1 millions d’euros de ressources, l’obligation de tenue des comptes est assortie d’une obligation de certification des comptes par un commissaire aux comptes.
Le texte pose également clairement le principe selon lequel seuls les membres élus du comité d’entreprise peuvent arrêter les comptes.
Afin de véritablement imposer le principe de transparence des comptes, tout comité d’entreprise est désormais soumis à l’obligation de rédiger un rapport de gestion annuel, qui doit être présenté aux membres élus du comité d’entreprise. L’ensemble des comptes et le rapport de gestion doivent ensuite être portés à la connaissance de l’ensemble des salariés de l’entreprise.
Les « grands » comités d’entreprise, qui dépassent deux des trois critères déjà évoqués (50 salariés, 1,55 million d’euros de bilan et 3,1 millions d’euros de ressources), sont également soumis à l’obligation de créer en leur sein une commission des marchés, chargée de choisir les fournisseurs et prestataires du comité d’entreprise. Enfin, le commissaire aux comptes désigné par ces « grands » comités d’entreprise peut déclencher une procédure d’alerte face à des difficultés qui mettraient en cause la continuité de l’exploitation du comité d’entreprise.
Il n’est évidemment pas question d’imposer des lourdeurs comptables aux comités d’entreprise de petite taille, qui constituent la très grande majorité des comités d’entreprise en France. Il s’agit surtout de poser, pour ces structures, une obligation de transparence : en effet, même un petit comité d’entreprise doit rendre des comptes aux salariés, à la mesure toutefois de ses moyens, et tel est bien l’objectif de la mise en place de la tenue d’une comptabilité ultra-simplifiée. En revanche, on sait que certains « grands » comités d’entreprise disposent de budgets très élevés et emploient même parfois un nombre assez conséquent de salariés. Pour ces derniers, il est légitime que les exigences en matière de tenue des comptes, de contrôle et de publicité soient accrues : tel est le sens de la mise en place d’une obligation de certification des comptes et d’une commission des marchés, destinée à rendre transparentes les procédures de passation des marchés des comités d’entreprises concernés.
À l’aune des données figurant dans l’étude d’impact, on peut estimer que les comités des entreprises de moins de 500 salariés, qui représentent plus de 92 % de l’ensemble des comités d’entreprise, devraient être soumis à une comptabilité ultra-simplifiée, leurs ressources moyennes étant estimées à moins de 153 000 euros – autour de 108 000 euros en moyenne pour les comités des entreprises entre 250 et 500 salariés. Les règles comptables de droit commun devraient donc s’imposer aux seuls comités d’entreprise des entreprises de plus de 500 salariés, qui représentent moins de 8 % du total. Au sein de cette tranche, l’obligation de certification des comptes devrait concerner essentiellement les comités d’entreprise des entreprises de plus de 5 000 salariés, et à la marge, une partie des comités des entreprises dont les effectifs sont compris entre 2 000 et 5 000 salariés, soit de l’ordre de 1 % à 1,2 % de l’ensemble des comités d’entreprise.
La transparence des comptes des comités d’entreprise ainsi organisée par l’article 19 du présent projet de loi permet résolument de consolider la légitimité de ces institutions phares de notre démocratie sociale.
Le titre III du présent projet de loi vise, enfin, à renforcer le dispositif de contrôle du droit du travail, par une réforme de grande envergure de l’inspection du travail, ainsi que par une amélioration des prérogatives des agents de contrôle de l’apprentissage et de la formation professionnelle. Il s’agit de mieux garantir l’effectivité du droit du travail, un objectif essentiel de la politique du Gouvernement et de la majorité.
L’article 20 du présent projet de loi propose, tout d’abord, une réforme d’ensemble de l’inspection du travail, pour rendre son organisation plus collective et efficace, étendre les pouvoirs d’intervention de ses agents, et améliorer le dispositif de sanction des infractions au code du travail, tout en préservant l’indépendance de ce corps d’administration.
Cette réforme comporte donc trois volets complémentaires, qui constituent la déclinaison législative du projet « ministère fort » et du plan de transformation des emplois. En effet, les évolutions récentes de l’organisation de l’inspection du travail, liées au plan de modernisation et de développement de l’inspection du travail (PMDIT) et à la fusion des quatre services d’inspection du travail dans le cadre de la révision générale des politiques publiques (RGPP), ont produit des résultats discutés et n’ont pas réussi à enrayer plusieurs problèmes de fond auxquels sont confrontés les agents, tels que leur sentiment d’isolement et un besoin de coordination et de compétence technique accrus face aux changements du monde du travail.
C’est pourquoi l’article 20 du présent projet de loi vise, tout d’abord, à rendre cette organisation plus collective, en créant des unités locales de contrôle, nouveaux échelons territoriaux d’intervention dans l’entreprise, qui regrouperaient entre huit et dix agents. Au niveau régional, seraient instituées des unités de contrôles spécialisées sur des thématiques qui requièrent un traitement dépassant le cadre local, comme la lutte contre le travail illégal. Au niveau national, un groupe de contrôle, d’appui et de veille apporterait un soutien aux agents de terrain sur des affaires concernant l’ensemble du territoire ou nécessitant la coordination de nombreuses unités.
Afin que les agents de l’inspection du travail soient mieux armés dans l’exercice de leurs missions quotidiennes, l’article 20 étend, ensuite, leurs pouvoirs de contrôle. Il accroît, ainsi, leurs prérogatives d’enquête, en améliorant leur droit d’accès aux documents et de faire procéder à des analyses, et simplifie le recours aux procédures d’arrêt temporaire de travaux et d’activité pour risque chimique.
Il enrichit, enfin, la palette des sanctions pouvant être appliquées en cas d’infraction au code du travail, en créant des amendes administratives, pour réprimer des manquements ciblés, et ouvre la possibilité à l’administration et à la justice de recourir à deux nouveaux mécanismes en matière de droit du travail, à savoir la transaction et l’ordonnance pénale.
L’article 21 du présent projet de loi vise, ensuite, à renforcer le dispositif de contrôle de l’apprentissage et de la formation professionnelle, deux leviers fondamentaux du marché du travail et qui mettent en jeu des volumes financiers conséquents.
S’agissant de l’apprentissage, il élargit doublement le champ de contrôle de cette politique, en y soumettant un nombre d’organismes et de sources de financement plus important. Il instaure, de plus, un droit de communication de documents et de pièces en faveur des agents de l’État chargés de ce contrôle.
S’agissant de la formation professionnelle, l’article 21 ouvre aux agents de contrôle la possibilité de solliciter l’avis d’un expert, adapte le cadre juridique des opérations suite à la réforme de la formation professionnelle et crée une nouvelle sanction à l’encontre d’organismes qui, sous couvert de dispenser des formations, poursuivent en réalité d’autres buts. Il s’agit, en particulier, de permettre aux agents de mieux appréhender et lutter contre les dérives sectaires.
Enfin, de manière transversale, l’article 22 vise à habiliter le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance les dispositions d’application à Mayotte de l’ensemble des améliorations proposées par le présent projet de loi.
AUDITIONS DES PARTENAIRES SOCIAUX
ORGANISÉES PAR LA COMMISSION
1. Audition des représentants de la CFDT, CFE-CGC, CFTC, et CGT-FO
La Commission des affaires sociales entend des représentants des salariés (CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT-FO) sur le projet de loi relatif à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale, lors de sa première séance du mercredi 15 janvier 2014
Mme la présidente Catherine Lemorton. Nous allons aujourd’hui commencer nos travaux sur un texte très important : le projet de loi relatif à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale. Après le projet de loi sur les retraites, c’est le deuxième grand texte dont notre commission est saisie au cours de la présente session.
Avant de céder la parole aux représentants des organisations de salariés, que je remercie de leur présence, je voudrais donner quelques indications sur l’organisation des auditions d’aujourd’hui, les documents mis en distribution et le calendrier d’examen de ce texte.
Nous avons décidé d’auditionner séparément les organisations signataires de l’accord national interprofessionnel (ANI) du 14 décembre dernier, et celles qui ne l’ont pas signé. Ainsi allons-nous entendre jusqu’à onze heures trente les quatre organisations de salariés signataires, à savoir la CFDT, la CFE-CGC, la CFTC et la CGT-FO ; nous accueillerons ensuite, entre onze heures trente et douze heures quinze, la CGT. Cet après-midi, nous entendrons, de seize heures quinze à dix-sept heures quarante-cinq, le MEDEF et l’UPA puis, de dix-sept heures quarante-cinq à dix-huit heures trente, la CGPME. Je rappelle que ces auditions ne sont pas limitées au seul volet de la formation professionnelle et qu’elles concernent l’intégralité des dispositions de ce texte.
Les documents mis à disposition à l’entrée de la salle se composent du texte de l’ANI du 14 décembre dernier et de celui de la position commune de la CGPME, du MEDEF et de l’UPA sur la représentativité patronale du 19 juin 2013 ainsi que de l’avant-projet de loi. Ce dernier étant un document de travail avant passage en Conseil d’État, il est susceptible de modifications. Comme ce texte, qui est le seul dont nous disposons, circule, j’ai décidé de le faire distribuer, afin que chacun bénéficie du même niveau d’information.
Le calendrier de travail de la Commission sur ce projet de loi, qui sera présenté en conseil des ministres mercredi prochain, s’organisera comme suit : mercredi 22 janvier, à seize heures quinze, audition de M. Michel Sapin, ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social ; mercredi 29 janvier, matin, après-midi et soir – éventuellement très tard dans la nuit et si nécessaire le lendemain matin –, examen des articles. La discussion du projet de loi en séance publique est programmée le mercredi 5, le jeudi 6 et le vendredi 7 février.
Encore une fois, je remercie sincèrement nos invités d’être présents, car leur emploi du temps est tout aussi chargé que le nôtre. Nous avons été pressés par le calendrier du Gouvernement et, par voie de conséquence, ils l’ont été par la Commission.
M. Stéphane Lardy (CGT-FO). Merci d’avoir bien voulu nous auditionner sur ce projet de loi de démocratie sociale. Je précise que je suis accompagné de Mme Marie-Alice Médeuf-Andrieu, également secrétaire confédérale, en charge des questions de négociation collective et de salaires, qui interviendra sur la partie du texte hors formation professionnelle.
Le projet de loi dont vous discuterez en séance publique dans une dizaine de jours n’ayant pas encore été soumis au Conseil d’État, permettez-moi d’indiquer que la position de notre organisation à son sujet restera prudente. Ce texte transpose l’accord interprofessionnel du 14 décembre 2013 que Force ouvrière a signé pour quatre raisons principales : cet accord ne déroge pas au code du travail ; il maintient un certain nombre de dispositifs, tels le plan de formation, les périodes de professionnalisation, le congé individuel de formation et le contrat de professionnalisation ; il enrichit la négociation collective et la consultation des instances représentatives du personnel ; il renforce, selon nous, l’obligation de formation qui incombe à l’employeur.
L’ANI crée le compte personnel formation (CPF), dix ans après l’institution, par l’accord de 2003, du droit individuel à la formation (DIF). Contrairement au DIF, le CPF est un droit portable – avancée importante, qui fut longue à obtenir. Les publics concernés sont plus larges que ceux du DIF puisque, dans l’accord et dans le projet de loi, l’ouverture du compte se fait dès l’âge de seize ans. Le nombre d’heures de formation est également plus important : il passe de 120 heures pour le DIF à 150 heures pour le CPF. On aurait pu aller beaucoup plus loin, mais n’oublions pas que cet accord est le fruit d’un compromis. En outre, il sera possible d’abonder ce quota de 150 heures.
Conformément à l’une de nos revendications, le CPF dispose d’un financement dédié, ce qui n’était pas le cas du DIF. Un milliard d’euros devrait ainsi lui être consacré : à peu près 880 millions au titre de ce financement dédié, auxquels il convient d’ajouter les abondements. La mobilisation du compte se fait avec l’accord exprès du salarié et du demandeur d’emploi, ce qui était important à nos yeux. Je tiens à insister sur la portabilité complète de ce dispositif. S’il était possible de garder son droit à DIF lorsque l’on changeait d’employeur, cette possibilité était toutefois limitée à deux ans. Le seul cas où le salarié peut perdre le bénéfice de son CPF est la faute lourde. Encore est-ce dans les termes de l’accord : j’ai bien l’impression que cette disposition a été retirée du projet de loi.
L’objectif du CPF est d’élever le niveau de qualification des salariés. Reste à savoir ce qu’est une « formation qualifiante ». Sans doute aurez-vous l’occasion d’en débattre. Je ne suis pas sûr que nous ayons réglé le problème dans le cadre de la négociation. Pour autant, nous avons essayé de faire en sorte que le CPF ne soit pas utilisé pour n’importe quel type de formation.
Le congé individuel de formation (CIF) recevra, quant à lui, davantage de financements, sans que l’on puisse pour autant parler de miracle. À l’heure actuelle, 40 000 CIF sont mobilisés par an. Les entreprises, notamment à partir de dix salariés, contribueront un peu plus à ce dispositif. En outre, les 13 % du Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP) ne seront plus pris sur la « collecte CIF ». En conséquence, on peut espérer une augmentation de 10 à 20 % du nombre de CIF, ce qui n’est pas négligeable.
Dans le cadre de la négociation, nous avons souhaité rationaliser les entretiens professionnels dont certains relevaient de la loi et d’autres d’accords interprofessionnels. Nous avons obtenu qu’un entretien professionnel ait lieu tous les deux ans et que cet entretien fasse l’objet d’une formalisation pour que l’on sache ce qui s’est passé entre l’employeur et le salarié. Au bout de six ans, un bilan de ces entretiens sera dressé. S’il montre que l’employeur n’a pas respecté son obligation de formation, le salarié concerné bénéficiera d’un abondement correctif de 100 heures. Une telle disposition renforce l’obligation de l’employeur de former ses salariés, ce qui constitue pour nous un progrès important.
Parallèlement, la négociation de branche et d’entreprise, qui est un élément de la régulation collective, se trouve renforcée. Le compte personnel est un bon dispositif, mais il nécessite un accompagnement des salariés et des demandeurs d’emploi concernés : d’une part, le compte ne doit pas être utilisé pour n’importe quel type de formation ; d’autre part, il est essentiel qu’il réponde aussi aux besoins prévisibles de l’économie. La négociation de branche va jouer un rôle extrêmement important en matière de conditions d’éligibilité au CPF ou d’abondements du nombre d’heures. De même, la négociation d’entreprise, qui fait l’objet d’un volet assez important, viendra enrichir les possibilités d’abondements complémentaires du compte. Ces aspects de la régulation collective sont extrêmement importants, et nous serons attentifs à ce que le projet de loi les reprenne fidèlement, voire les améliore.
Le financement a donné lieu à de nombreux débats. En particulier, on a pu observer des confusions – intentionnelles ou pas – entre « obligation de dépense » et « obligation de formation », ce qui n’est pas tout à fait la même chose. De fait, les entreprises qui sont actuellement soumises à une obligation de dépense, à hauteur de 1,6 % de la masse salariale, peuvent utiliser ces sommes d’argent en interne, sans avoir à les mutualiser. Aujourd’hui, les entreprises, quelle que soit leur taille, dépassent leur obligation de 1,6 %. Elles consacrent en moyenne 2,8 % de la masse salariale à la formation de leurs salariés – et même beaucoup plus pour les entreprises moyennes et grandes.
Nous ne considérons pas que cet accord constitue une révolution copernicienne. Nous sommes au milieu du gué, entre l’obligation de payer et l’obligation de former : l’obligation de dépense a été maintenue à hauteur de 1 % de la masse salariale, et l’obligation de formation a été renforcée. Même s’il s’agit d’une évolution majeure, ce n’est pas le « grand soir de la formation » qui ferait disparaître l’obligation de dépenser et se limiterait à une obligation de former. Sur ce point aussi, cet accord est un compromis entre deux positions antagonistes, le fruit de la négociation collective.
Si tout n’est pas mutualisé, le niveau de mutualisation obligatoire reste élevé. De près de 3,8 milliards d’euros aujourd’hui, il va passer à 4,8 milliards d’euros. Un progrès important est à signaler, que l’on n’avait jamais obtenu dans le cadre d’une négociation interprofessionnelle : une véritable mutualisation descendante de fonds des grandes entreprises vers les petites, par le biais du Fonds paritaire. Ainsi, 175 millions d’euros environ seront consacrés à la formation des salariés des très petites entreprises (TPE).
Un autre progrès est la mise en place d’un financement pérenne pour le Fonds paritaire, qui nous dispensera de la comédie à laquelle nous nous prêtons chaque année de la négociation des taux et de la fixation par arrêté, après consultation du pouvoir exécutif. Ce financement pérenne, entre 0,15 % et 0,20 % de la masse salariale, permettra au Fonds paritaire de travailler sur le long terme – à horizon de trois ou quatre ans, espérons-nous – à ses missions que sont la qualification et la requalification des salariés et des demandeurs d’emploi.
Comme je l’ai dit l’année dernière, que nous signions ou nous ne signions pas des accords, notre position reste la même : ce n’est pas « tout l’accord et rien que l’accord ». Je vous ai expliqué pourquoi nous avons signé celui-ci. Il vous appartiendra ensuite, en tant que représentants du peuple, de faire votre travail. Nous vous apporterons aide et précisions, si vous nous les demandez, mais nous ne confondons pas démocratie sociale et démocratie politique.
Je fais observer que, sur la partie relative au financement mutualisé qui a donné lieu à un grand débat, nous n’étions pas demandeurs. Malgré tout, nous serons très attentifs à la mise en place du fonds paritaire national. Nous avons été surpris que l’on ait rajouté un critère de représentativité à 3 %, tout en comprenant pourquoi et pour qui. Nous souhaitons que l’on supprime ce critère qui ne figurait pas dans la loi de 2008, et que l’on s’en tienne aux 8 % initiaux.
Nous veillerons à ce que soit respectée notre philosophie de la gestion paritaire qui, par définition, se pratique « entre pairs ». Quels que soient le nombre de nos adhérents et notre représentativité au sein des branches ou au niveau interprofessionnel, nous faisons le même travail dans les conseils d’administration. La gestion paritaire doit se faire « à parité » entre organisations patronales et organisations syndicales, et entre organisations syndicales représentatives au niveau national interprofessionnel.
Mme Alice Médeuf-Andrieu (CGT-FO). J’interviendrai sur les aspects de démocratie sociale et sur les points qui n’ont pas fait l’objet de négociations, à commencer par la représentativité patronale, au sujet de laquelle Force ouvrière et bien d’autres organisations syndicales ont demandé au Gouvernement l’ouverture de négociations, à l’instar de celles qui ont eu lieu sur la représentativité syndicale. Malheureusement, nous n’avons pas été entendus. Pourtant, nous avons des observations à faire en ce domaine.
La première concerne les critères liés au nombre d’adhérents. Nous constatons que les commissaires aux comptes, qui sont responsables du décompte du nombre des adhérents à jour de leur cotisation, ont, par voie de conséquence, le pouvoir de déterminer la représentativité des organisations patronales. Or, dans la pratique, les cotisations n’apparaissent pas distinctement dans les comptes des organisations patronales, et leurs montants ne sont pas fixes. Ces cotisations sont souvent négociées et varient selon les entreprises ou les fédérations concernées. Voilà pourquoi nous estimons que la question de la transparence et du montant des cotisations aurait dû être traitée dans le cadre de ce projet de loi.
Notre deuxième observation concerne les adhésions multiples. Dans les faits, une entreprise peut adhérer à plusieurs fédérations patronales. Le texte laisse aux organisations professionnelles le soin de répartir les entreprises adhérentes et leurs salariés entre les différentes fédérations. Nous pensons qu’un tel choix devrait être opéré par l’entreprise. Les entreprises adhérentes devraient au moins être informées de la répartition qui est faite en leur nom. Or le texte ne le prévoit pas.
Troisième observation, en raison du critère retenu de l’audience, qui s’apprécie uniquement à l’aune du nombre d’entreprises adhérentes, les entreprises n’ont pas d’autre choix que d’adhérer à une organisation professionnelle, faute de quoi elles se verraient privées de leur droit de participer à la désignation de leurs représentants. À l’instar du Conseil d’État, dans la position qu’il a adoptée pour les salariés des TPE en matière de représentativité syndicale, nous estimons qu’un dispositif particulier, ou tout au moins une élection, à destination des entreprises non adhérentes permettrait de garder un certain équilibre.
Notre dernière observation concerne le refus des extensions et des arrêtés de représentativité. Le projet de loi donne au ministre du travail la faculté de refuser l’extension et de décider d’un élargissement ou d’une fusion de branche dès lors que les adhérents des organisations d’employeurs représentatives comptent pour moins de 5 % des entreprises de la branche, quand bien même il existerait, dans ces branches, une volonté de négociation. Ce pouvoir lui est accordé alors que la représentativité des signataires n’est pas en cause, que l’accord qui est signé est valable, et que les conditions requises pour l’extension sont remplies. Il s’agit là d’une règle entièrement dérogatoire qui ne peut être laissée à la seule décision du ministre. Voilà pourquoi nous demandons l’avis conforme de la Commission nationale de la négociation collective.
Pour ce qui est de la représentativité syndicale, le ministre du travail a considéré que tous les points faisant consensus entre organisations syndicales patronales au sein du Haut conseil du dialogue social seraient repris dans le texte. C’est en effet le cas, même s’il en manque un. Nous remarquons que la question de l’invitation à négocier le protocole d’accord préélectoral, qui a été introduite dans le texte, n’y a pas été discutée.
Quoi qu’il en soit, nous sommes favorables à ce que l’on porte à quinze jours le délai requis entre l’invitation à négocier le protocole d’accord électoral et la première réunion de négociation. Toutefois, ce délai devrait s’apprécier, non pas à la date d’envoi, ainsi que le prévoit le texte, mais à la date de réception de l’invitation. Nous proposons de modifier la rédaction dans les termes suivants : « l’invitation à négocier est reçue au plus tard quinze jours avant la date de la première réunion de négociation ». De la sorte, les organisations syndicales ne seraient pas empêchées de participer à la négociation des protocoles d’accord à cause de l’arrivée des courriers postérieure à la date effective de la tenue de la réunion.
Nous avions déjà fait remarquer, dans le cadre du Haut conseil du dialogue social, que ce délai de seulement quinze jours n’avait de sens que si l’invitation à négocier était adressée à la structure syndicale à même de traiter la demande. Or, dans la réalité, les invitations arrivent souvent à la confédération ou à une fédération très éloignée plutôt que sur le lieu géographique de l’entreprise. Le délai nécessaire à leur réacheminement met les organisations syndicales dans l’impossibilité de participer à la négociation du protocole d’accord électoral. Pour pallier cette difficulté, nous avions formulé la proposition suivante : « Lorsque l’invitation à négocier est envoyée aux syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel, l’envoi est adressé aux structures syndicales dont le champ géographique et professionnel couvre l’entreprise ou l’établissement concerné par l’élection et dont la liste est disponible auprès de la DIRECCTE concernée. » Nous nous étonnons que cette proposition n’ait pas été reprise dans le texte, d’autant qu’elle semblait faire consensus au sein du Haut conseil.
Par ailleurs, nous nous interrogeons sur une modification législative, relative à la répartition des sièges entre les catégories de personnel dans les collèges électoraux et à la perte ou la reconnaissance de la qualité d’établissement distinct. Il semblerait qu’une décision administrative ne soit plus nécessaire en l’absence d’organisation syndicale dans l’entreprise. Or on ne peut laisser l’employeur décider unilatéralement dans des matières aussi importantes que la représentativité ou les mandats électoraux. C’est à l’autorité administrative de décider de la répartition des sièges, de façon que cela n’affecte ni les mandats ni le nombre de représentants des organisations syndicales. Nous remarquons que ces points n’ont jamais été abordés par le Haut conseil et donc qu’aucun consensus n’a pu être dégagé en la matière. En conséquence, il convient de lever toute ambiguïté en indiquant de nouveau clairement, dans chacune des dispositions concernées, que « ces éléments résultent d’une décision administrative ou d’un accord entre organisations syndicales ».
Sur la partie traitant du délégué syndical, nous nous contenterons de rappeler que le texte ne répond pas à la recommandation de l’Organisation internationale du travail (OIT).
Je passerai très vite sur la transparence des comptes des comités d’entreprise. Le texte, sur lequel toutes les organisations syndicales et patronales ont travaillé, a fait consensus et nous y sommes favorables. Nous nous arrêterons toutefois sur la commission des marchés, dont les membres sont désignés par le comité d’entreprise parmi ses membres titulaires. Compte tenu de la charge importante qui incombe aux élus du comité d’entreprise, nous suggérons que leurs suppléants puissent également faire partie de cette commission. Nous pensons, en outre, que le temps passé en réunion à la commission des marchés doit être assimilé au temps de travail et rémunéré comme tel.
Je terminerai sur les nouvelles modalités de désignation des conseillers prud’homaux, lesquels ont pour nous une importance capitale. Nous ne comprenons pas la méthode retenue, qui consiste à légiférer par ordonnance. La désignation n’est pas une démarche démocratiquement acceptable et nous nous interrogeons sur l’utilisation des votes des salariés dans les entreprises. Nous sommes d’autant moins favorables à cette disposition qu’est prévue la mise en place d’un groupe de travail sur lequel nous n’avons pas d’éléments. À ce stade, nous ne saurions donc nous prononcer.
M. Patrick Le Moigne (CFTC). Nous tenons d’abord à vous remercier pour cette invitation qui nous permet de nous exprimer sur la transposition législative de l’accord interprofessionnel du 14 décembre 2013. Après avoir expliqué pourquoi la CFTC a signé cet accord, je mentionnerai les oublis ou manquements que nous avons relevés dans le projet et ferai part de nos propositions d’amélioration.
Pour la CFTC, cet accord est l’aboutissement de trois mois de négociations entre partenaires sociaux, preuve que le dialogue social est bien vivant dans notre pays, qu’il constitue un axe de progrès à favoriser et à valoriser, qu’il est une alternative constructive à des luttes idéologiques stériles qui se développent au détriment du bien commun. Lors de cette négociation, les organisations syndicales et patronales ont fait preuve de responsabilité quand la situation l’exigeait. Cet accord met en place une réforme sociétale d’une grande ampleur malgré certaines critiques émises ici et là. Les partenaires sociaux ont un rôle essentiel dans l’élaboration des normes, dans l’accompagnement des salariés et des entreprises.
La CFTC a signé cet accord car il est fidèle à la philosophie du statut du travailleur élaboré il y a près de dix ans, et qui consiste à attacher les droits à la personne et non à l’entreprise dans laquelle il travaille. Il permet ainsi d’assurer une continuité des droits en les sécurisant.
La négociation s’est inscrite dans le prolongement des ANI de 2003 et 2009 sur la formation professionnelle, reprenant ainsi la proposition contenue dans le rapport-programme de la CFTC que chaque salarié puisse s’élever d’au moins un niveau de qualification au cours de sa carrière. Le compte personnel de formation est l’un des moyens d’y parvenir.
Suite à l’ANI du 11 janvier 2013, la CFTC désirait donner de la consistance au CPF à travers deux axes : un caractère universel et attaché à la personne, donc transférable – c’est chose faite ; un financement dédié, afin de faire vivre et d’activer plus rapidement ce compte – elle l’a obtenu.
Le compte personnel de formation a un vrai sens pour la CFTC : il mettra au cœur de ce nouveau dispositif la personne telle que définie dans notre statut du travailleur. Pour sa mise en œuvre, il sera accompagné de deux mesures complémentaires : l’entretien professionnel et le conseil en évolution professionnelle.
La CFTC est bien consciente que la transposition législative d’un accord interprofessionnel reste un exercice périlleux. En effet, les rédacteurs doivent respecter l’esprit et la lettre de l’accord qui concrétise un équilibre entre les aspirations patronales et les revendications syndicales.
Ne figurent pas dans le projet les dispositions de l’ANI du 14 décembre 2013 relatives à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) territoriale, prévue à l’article 10, et la possibilité d’un abondement du compte par la CNAF, qui fait l’objet de l’article 30, ainsi que la prise en compte d’accords d’entreprise ou de branche permettant un abondement supérieur à 120 heures, qui figurait à l’article 5 de l’ANI du 11 janvier 2013.
La CFTC considère que pour encourager et favoriser l’engagement associatif des retraités, le compte personnel de formation doit pouvoir être utilisé dans l’année qui suit le départ à la retraite. Elle demande que ce compte soit alimenté à hauteur de 200 heures.
Elle souhaite également que, lors du premier entretien professionnel du salarié, l’employeur lui présente l’ensemble des dispositifs et outils de la formation professionnelle à sa disposition, et lui remette son passeport d’orientation et de formation.
Enfin, la CFTC considère qu’il faut bien distinguer – et cela avait été longuement discuté et négocié auprès du MEDEF – l’entretien annuel de l’entretien professionnel, lequel ne doit porter que sur la formation. Sinon, le salarié risque bien de ne se voir proposer qu’un seul entretien.
M. Franck Mikula (CFE-CGC). Mesdames et messieurs les députés, à mon tour de vous remercier de nous recevoir dans votre commission.
Ce projet de loi transpose de façon fidèle dans son titre Ier la négociation et l’ANI du mois de décembre 2013 sur la formation professionnelle. Le compte personnel de formation, dont le principe avait été posé par l’ANI du mois de janvier 2013, est une évolution significative du droit individuel à la formation (DIF). Cette négociation sur la formation professionnelle a permis d’en développer les modalités d’utilisation. Je rappelle qu’à la différence du DIF, ce compte est opposable à l’employeur : l’employé peut en mobiliser les heures – qui passent de 120 à 150 – sans lui en demander l’autorisation.
Le projet institue un système d’encadrement des formations éligibles sous forme de listes fixées par les partenaires sociaux. Comme l’a fait remarquer M. Lardy, on passe progressivement d’une obligation de dépense à une obligation de formation. La démarche méritait d’être relevée.
Le texte renforce également le dialogue social dans les entreprises, notamment dans les entreprises de plus de 300 salariés où la négociation triennale sur la GPEC va devoir comporter un chapitre sur la formation professionnelle. Ce projet de loi renforce également le contrôle des institutions représentatives du personnel sur les modalités de formation des salariés.
Mme Dominique Jeuffrault (CFE-CGC). Le challenge était osé : offrir un outil au service de la compétitivité des entreprises grâce à un système d’encadrement des formations éligibles dans le cadre de listes fixées préalablement par les partenaires sociaux, tout en répondant aux préoccupations des salariés, notamment à ceux de l’encadrement. À ce propos, nous veillerons à faire en sorte que ces listes comportent des formations de tout niveau de qualification – ce que nous n’avons pas retrouvé dans le projet de loi – afin d’assurer au compte personnel formation (CPF) un caractère réellement universel.
Le recours gratuit à un conseil en évolution professionnelle constitue pour nous une avancée majeure, dans la mesure où il favorisera l’élaboration et la conduite d’un projet professionnel pour le salarié. En outre, la mise en place d’un entretien professionnel tous les deux ans permettra à celui-ci d’obtenir une reconnaissance de sa qualification et favorisera sa promotion. Cela méritait d’être souligné. Pour la CFE-CGC en effet, valoriser le capital humain que constituent les femmes et les hommes de l’entreprise est fondamental. Cet accord permet d’y parvenir tout en garantissant la compétitivité des entreprises.
Nous avons souhaité répondre aux difficultés de financement en créant une contribution dédiée spécifiquement au CPF, à hauteur de 0,20 % de la masse salariale de l’entreprise. La CFE-CGC a obtenu le maintien de la contribution unique « formation » à 1 % au lieu du 0,8 % proposé par le MEDEF et l’UPA, afin de garantir la mutualisation pour les petites entreprises. En contrepartie de la contribution unique, nous avons demandé un certain nombre de garanties. De fait, l’accord prévoit le développement du dialogue social dans l’entreprise sur les questions de formation et d’évolution professionnelle des salariés.
Nous sommes, bien évidemment, conscients des risques que comporte cette évolution, notamment dans les petites et moyennes entreprises. Si les grandes entreprises investissent bien souvent au-delà de leur obligation légale dans la formation de leurs salariés, de nombreuses entreprises de taille plus modeste ne dépassent pas ce plafond. C’est pourquoi notre confédération suivra très attentivement l’évaluation des impacts de cette réforme structurelle, et n’aura de cesse de rappeler, dans les entreprises et dans les branches, que la diminution de la contribution obligatoire ne signifie pas la disparition des obligations de l’employeur en matière d’adaptation au poste de travail. La CFE-CGC veillera au maintien de l’employabilité des salariés.
De la même façon et comme nous l’avons répété tout au long de cette négociation, la CFE-CGC est profondément attachée au principe de mutualisation, favorable aux petites et moyennes entreprises. Le taux de mutualisation prévu par l’accord ne constitue qu’un minimum garanti. Nous avons laissé la possibilité aux branches, en fonction de leurs besoins, d’augmenter ce taux pour répondre aux attentes de leurs entreprises.
D’autres points relatifs à la formation professionnelle sont abordés dans le cadre du projet de loi. Je pense notamment à l’apprentissage et à la gouvernance, dans le cadre de l’acte III de la décentralisation. Nous n’avons jamais caché nos craintes face à un processus de décentralisation toujours plus poussé qui, s’il peut permettre de répondre plus finement aux besoins exprimés dans les territoires, soulève des interrogations sur la place des partenaires sociaux dans la définition et la mise en œuvre des politiques de formation, et sur les outils qui seront à notre disposition pour évaluer, au niveau national, les actions menées. De même, si les dispositions relatives à l’apprentissage comportent des avancées importantes – création d’une période d’apprentissage dans le cadre d’un CDI, renforcement du rôle des centres de formation des apprentis (CFA) dans l’accompagnement des jeunes, réduction du nombre d’organismes collecteurs de la taxe d’apprentissage (OCTA) –, des incertitudes demeurent sur le risque de creusement des inégalités territoriales lié au renforcement de la décentralisation. Nous rappelons notre volonté de conserver un pilotage national des politiques menées tant en matière de formation professionnelle que d’apprentissage.
Nous nous inquiétons également de l’impact qu’aura cette réforme sur les formations en apprentissage dans le supérieur, ainsi que sur le financement des formations hors apprentissage, dispensées par les lycées d’enseignement technologique et les écoles de commerce ou d’ingénieurs, qui bénéficiaient jusqu’à présent d’une partie importante du produit de la taxe.
En conclusion, le vote de la loi relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale, qui doit intervenir avant la fin du mois, ne sera que la fin d’une première étape. De nombreux chantiers restent encore devant nous pour l’année 2014 : la mise en œuvre opérationnelle du système de gestion du CPF et du conseil en évolution professionnelle ; la négociation dans les branches et dans les entreprises pour adapter les accords en vigueur aux nouvelles dispositions de l’ANI. Enfin, une réflexion générale devra être engagée sur la qualité de l’offre de formation. Autant de sujets sur lesquels la CFE-CGC sera mobilisée pour accompagner et faire vivre cette profonde et ambitieuse réforme.
M. Jean-Michel Pecorini (CFE-CGC). Je traiterai du volet « démocratie sociale ».
S’agissant de la représentativité patronale, la CFE-CGC considère que le parallélisme des formes n’a pas été respecté. Nous avions demandé un rapport, une saisine du Conseil économique, social et environnemental, une lettre de saisine des partenaires sociaux, une négociation : rien n’a été fait. Les patrons se sont arrangés entre eux.
Le projet de loi ne prévoit pas de bilan, comme le fait la loi de 2008 pour les organisations syndicales de salariés. Il manque de précision, notamment s’agissant du pouvoir des commissaires aux comptes chargés d’attester du nombre des entreprises adhérentes, qu’il faudrait clarifier. Nous ne savons toujours pas comment sera définie la notion de « représentativité dans les secteurs » par le Haut conseil du dialogue social et la notion d’« entreprise adhérente à jour de cotisations ». Il est impossible de se contenter du rapport de M. Combrexelle : dès lors que des droits sont en jeu, il est indispensable d’avoir une définition officielle. Enfin, comme notre collègue de FO, nous nous demandons comment se fera concrètement la gestion des multi-adhésions.
S’agissant des restructurations de branche, la CFE-CGC regrette que le Gouvernement n’ait pas respecté sa feuille de route de juin 2013, qui prévoyait un groupe de travail et un diagnostic partagé sur cette question. Nous déplorons ce passage direct au projet de loi, qui nous met devant le fait accompli. Nous regrettons aussi les critères de restructuration retenus par le texte.
En matière de représentativité syndicale, la CFE-CGC relève des avancées, parmi lesquelles de nouvelles règles de désignation de représentants syndicaux au comité d’entreprise pour les organisations syndicales représentatives, et l’allongement du délai d’invitation à la première réunion de négociation des protocoles préélectoraux. Sur ce dernier point, nous demandons que ce délai s’apprécie au moment de la réception, et non au moment de l’envoi. Toutefois, le projet de loi n’aborde pas la représentativité territoriale. La CFE-CGC a demandé une saisine des partenaires sociaux sur ce sujet.
Sur le volet traitant de la transparence des comptes des comités d’entreprise, la CFE-CGC émet un avis favorable. C’est un parfait exemple de concertation entre l’État et les partenaires sociaux.
Enfin, s’agissant de la désignation et de la formation des conseillers prud’homaux, la CFE-CGC rappelle qu’elle est attachée au principe de l’élection des conseillers prud’homaux et refuse que l’on désigne les conseillers prud’homaux en fonction de l’audience des organisations syndicales et patronales au niveau régional. Je précise qu’un groupe de travail devrait se réunir au cours du premier semestre au Conseil supérieur de la prud’homie.
M. Christophe Mickiewicz (CFE-CGC). Pour ce qui est de l’aspect « financement de la vie démocratique sociale » de ce texte, nous tenons à rappeler que nous n’étions pas demandeurs et que les délais ont été remarquablement courts. Nous n’avons eu droit qu’à deux réunions de travail avec le cabinet, la dernière étant une réunion conclusive au cours de laquelle on nous a proposé le projet de loi. À titre de comparaison, sur la transparence financière des organisations syndicales, nous avons travaillé pendant un an avec le ministère du travail, avec Bercy et l’Autorité des normes comptables. Sur la transparence financière des comités d’entreprise, nous avons également travaillé pendant un an, ce qui a permis de faire un travail achevé et d’aboutir aujourd’hui à un consensus. Cela n’a pas été le cas pour le financement des organisations syndicales.
Je m’en tiendrai à quelques points, le principal, pour nous, étant que, s’agissant des fonds issus du paritarisme, les mêmes missions justifient les mêmes financements.
Nous n’avons pris connaissance que la semaine dernière de la proposition du seuil de 3 %, qui est arrivé dans ce projet de loi comme un cheveu sur la soupe. Nous n’en avions jamais parlé avec les représentants du Gouvernement. Pour nous, il n’a pas lieu d’être.
Il est difficile de se prononcer sur un texte dans lequel le périmètre des fonds transférés est renvoyé à un décret. On ne sait pas encore de quoi on parle. Les précisions que pourra apporter ce texte, aussi bien sur le périmètre que sur les modalités de répartition, constitueront des garanties. Nous avons des garanties orales de la part du Gouvernement, mais nous préférons qu’elles soient écrites.
Je terminerai sur le tout dernier alinéa relatif au congé de formation syndicale. Il est proposé de le faire passer d’au moins deux jours, comme cela figure dans le code du travail, à une demi-journée. À quoi peut bien servir une demi-journée de formation syndicale ? C’est tout juste le temps de prendre le train pour se rendre sur le lieu de la formation et de revenir ! Deux jours de formation syndicale, c’est un minimum pour que les intéressés apprennent comment fonctionnent les institutions représentatives et à jouer leur rôle de représentants des salariés. Le risque que nous voyons se profiler est que les chefs d’entreprise, en particulier de PME, fassent pression sur les salariés – surtout s’il s’agit de salariés de l’encadrement – pour qu’ils ne prennent dorénavant que des demi-journées plutôt que deux jours pleins pour suivre un stage de formation syndicale. Nous demandons donc que la représentation nationale supprime cette disposition et qu’on en revienne au régime actuel.
M. Marcel Grignard (CFDT). Le projet de loi en débat est pour nous extrêmement important, tant par sa partie « formation » que par sa partie « dialogue social ».
En matière de formation professionnelle, globalement, ce texte est très fidèle à l’accord que nous avons conclu. Il s’agit, d’après nous, d’une réforme structurelle très importante, qui rompt avec nos traditions dans ce domaine. Le projet de loi dépasse les limites des accords précédents qui ont été transcrits dans la loi, et il nous met en meilleure situation pour affronter les défis auxquels notre pays est confronté. J’insiste sur le principe qui prévaut dans l’accord et dans le projet de loi, à savoir que l’amélioration de la compétence des salariés est vitale pour le parcours professionnel des individus, mais aussi pour la compétitivité des entreprises. L’intérêt des individus rejoint celui des entreprises et du pays. Cela tranche fondamentalement avec la manière de faire jusqu’à aujourd’hui.
Mes collègues l’ont dit, le compte personnel de formation (CPF) est au cœur de ce dispositif. De fait, l’entretien professionnel, avec un bilan tous les six ans, et la liste des formations qualifiantes accessibles au compte personnel, constituent deux éléments clés d’un dispositif vertueux et positif. J’ajoute qu’une attention particulière est portée aux salariés les plus en difficulté et aux demandeurs d’emploi à travers les mécanismes d’abondement ou correctifs.
Le deuxième point majeur de l’accord qui est repris dans la loi est le renforcement du dialogue social, en particulier dans les entreprises. Que le financement dédié au CPF puisse se traduire par un accord collectif dans les entreprises nous semble être le bon moyen de susciter un consensus sur les priorités à décider au niveau de l’entreprise et, par voie de conséquence, d’aller au-delà du socle prévu par la loi. C’est notamment le cas pour les formations accessibles au CPF qui devraient faire l’objet d’abondements ou qui devraient se dérouler pendant le temps de travail.
Le troisième point majeur est la responsabilisation des acteurs à tous les niveaux, et la tentative de mise en cohérence. Pour revenir sur les listes de formations qualifiantes, nous avons prévu qu’elles soient établies aux différents niveaux, car cela permet d’avoir un regard sur un secteur professionnel, un territoire ou une réalité d’entreprise. Si nous avons voulu que chaque acteur soit responsabilisé en fonction de ses compétences, ce n’est pas pour créer de nouveaux bastions, c’est par souci de cohérence. L’intérêt général se traduit à des niveaux divers et variés. De ce point de vue, nous considérons que les propositions qui sont faites sur la gouvernance, et notamment sur la relation entre les partenaires sociaux et les pouvoirs publics, en particulier en région, devraient déboucher à terme sur de vraies codécisions. Comme je l’ai déjà dit, c’est l’intérêt commun des entreprises, des salariés et du pays qui est en jeu.
Un dernier point nous paraît extrêmement important, qui est la clarification des circuits financiers. Dans le système actuel, certains dispositifs, malgré les apparences, ne permettent pas de régler les problèmes auxquels les entreprises et les salariés sont confrontés.
Je voudrais maintenant attirer votre attention sur plusieurs chantiers sur lesquels les parlementaires pourraient interpeller les partenaires sociaux. En effet, au-delà de la loi qui sera votée, un travail important reste à accomplir.
Premièrement, la situation des salariés dans les entreprises de moins de cinquante salariés. Un des dispositifs centraux de l’accord repris par la loi est le bilan, établi tous les six ans, de ce qui aura été réellement fait pour le salarié en matière de formation professionnelle. S’il s’avère que l’employeur n’a pas assumé ses responsabilités, il encourra une sanction sous forme d’un abondement correctif d’heures de formation. Pour l’instant, ce dispositif ne concerne pas les entreprises de moins de cinquante salariés, dont la situation est un peu plus compliquée à gérer. Il serait toutefois dommage que des millions de salariés en restent longtemps exclus. Les partenaires sociaux devraient donc, dans les mois qui viennent, reprendre le travail pour trouver, par le consensus, des formules permettant de faire bénéficier tous les salariés du dispositif.
Deuxièmement, les listes de formations qualifiantes dont l’enjeu est double : d’une part, elles doivent être cohérentes les unes avec les autres ; d’autre part, elles doivent être régulièrement révisées. À moyen terme, les branches, les territoires et les entreprises devront se montrer prospectifs, en ne se limitant pas à la connaissance de l’existant, mais en prévoyant ce que seront les métiers de demain afin d’orienter les salariés et les demandeurs d’emploi vers les formations qualifiantes dont on aura besoin. Cela implique de réviser régulièrement les listes.
Un dernier chantier me semble vital s’agissant de cette réforme ambitieuse, qui repose beaucoup sur la volonté des acteurs de porter un autre regard sur la formation professionnelle. Personne ne peut en prédire le déroulement ni le rythme de la mise en œuvre. Nous ne savons pas si les fléchages financiers que nous avons élaborés dans le cadre de la négociation seront les bons. Il sera donc indispensable d’évaluer ce que cette réforme va produire, et de nous donner les moyens d’apporter les corrections qui se révéleront nécessaires. Il faudra également trouver comment articuler le rôle du Parlement, qui est majeur, avec celui, tout aussi important, des partenaires sociaux au regard de l’évaluation de la mise en œuvre de cette réforme.
Je pense qu’au fil de l’eau, cette réforme transformera en profondeur le rôle des branches professionnelles en leur donnant de nouvelles missions, bousculera les organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA), qui deviendront de vrais outils au service des entreprises et des salariés en matière de formation. Dans un tel contexte, l’existence de deux OPCA interprofessionnels n’a qu’un faible intérêt. Peut-être même est-elle contreproductive.
Nous sommes globalement satisfaits du titre II du projet de loi, qui porte sur la réforme de la démocratie sociale. Il prolonge les efforts accomplis depuis la réforme de la représentativité syndicale du 20 août 2008, qu’il complète très positivement.
Il convenait de faire en sorte que le travail des partenaires sociaux et la démocratie sociale soient en phase avec les évolutions de notre pays. Le projet reprend la question de la responsabilité des acteurs ainsi que les apports de la loi de 2008 en matière de transparence financière. Les propositions qu’il contient reposent pour partie, comme l’ont fait remarquer mes collègues, sur un travail mené par les partenaires sociaux, notamment dans le cadre du Haut conseil du dialogue social, dont je tiens à souligner l’importance.
En matière de représentativité patronale, il est indispensable d’avoir des règles claires. La symétrie de représentativité est vitale même si, à la différence de certains de mes collègues, je pense que la symétrie des formes n’implique pas forcément une symétrie des modalités. En dehors de la démarche et de la mission politiques, il n’y a pas de symétrie entre un chef d’entreprise et les représentants syndicaux dans l’entreprise, ni entre une organisation patronale et une organisation syndicale de salariés.
Il est tout aussi primordial de régler la question des branches professionnelles. En effet, le paysage est peu propice à la régulation sociale. De très nombreuses branches ne font pas leur travail parce qu’elles ne sont pas en état de le faire. Il est dramatique, quand nous négocions un accord collectif national interprofessionnel qui appelle des déclinaisons au niveau des branches, de ne pas y parvenir. Il serait tout aussi dramatique, demain, que certaines branches professionnelles ne parviennent pas à établir les cartographies des emplois et des compétences nécessaires à une dynamique de formation professionnelle – au cœur de notre réforme. D’où une nécessaire clarification au niveau des branches. C’est vital pour l’intérêt général.
Tout comme pour les règles de représentativité, il y a très longtemps que nous demandons la clarification des règles de financement du paritarisme et du syndicalisme. Nous sommes convaincus que, globalement, les acteurs agissent dans les règles de l’éthique et dans le sens de l’intérêt général. Mais il arrive que tel ou tel acte pose problème et prête à suspicion, et il suffit d’un acte marginal mettant en cause la probité des acteurs pour affecter la crédibilité de l’ensemble. Il est donc vital de faire la clarté entre le financement du paritarisme et le financement des acteurs. De ce point de vue, il nous semble que le projet de loi va dans le bon sens.
Selon nous, il ne doit pas y avoir d’ambiguïté : les ressources propres des organisations syndicales, qui proviennent majoritairement des cotisations pour les organisations de salariés, doivent rester, ou doivent devenir, leur première source de revenus. Nous pensons que la transition entre un système existant, qui a atteint ses limites, et un système clarifié et transparent doit se faire en douceur. Il n’est pas question de priver, à l’instant « t », certaines organisations de ressources. L’objectif est d’enclencher une nouvelle dynamique dont l’équilibre sera difficile à trouver entre des financements forfaitaires, identiques pour toutes les organisations quel que soit leur poids, et des financements prenant en compte leur représentativité, laquelle se traduit, d’une certaine manière, dans les charges qu’elles ont à assumer.
Le projet de loi prévoit une forme de financement pour des organisations non représentatives et fixe un certain nombre de critères. Cela ne nous choque pas. Nous pensons en effet que la démarche engagée dans la loi de 2008 visait à en finir avec la conception selon laquelle certaines organisations seraient a priori représentatives tandis que d’autres ne le seraient pas quoi qu’il arrive. Si cette loi opère une distinction entre les syndicats dits « représentatifs » et les autres, elle le fait sans aucun ostracisme.
S’agissant de la proposition relative aux prud’hommes, nous y sommes favorables, car elle contribue à consolider, selon nous, cette importante institution. Il fallait faire face à la baisse très régulière et conséquente du nombre des votants aux élections prud’homales. Entre les deux dernières élections, le pourcentage de votants a diminué de 7 %, pour atteindre un quart de l’électorat. Or une élection qui ne mobilise pas les électeurs délégitime l’institution concernée. Il fallait également lever l’ambiguïté qui pesait sur ce type d’élections. Celles-ci visent, bien sûr, à désigner les juges, mais personne ne saurait dire sur quels critères ; elles servent plutôt à mesurer la représentativité des organisations syndicales. Que le projet de loi mette un terme à cette situation va dans le bon sens.
La réforme de l’inspection du travail va également dans le bon sens. Le projet permet d’améliorer son efficacité, et nous en avons bien besoin. Les débats en cours sur la question du détachement des travailleurs européens confirment d’ailleurs qu’un certain nombre de situations sont dangereuses pour les salariés et pour le pays. À un moment où les frontières sont très ouvertes, il était important de renforcer le rôle de l’inspection du travail et d’engager une démarche équivalente à celle d’autres États européens. Il nous restera, évidemment, à nous montrer extrêmement attentifs à la mise en œuvre de ces dispositions – que le texte ne prévoit pas toujours. Nous devrons notamment nous assurer de la cohérence des différents dispositifs mis en place avec les autorités compétentes, qui sont diverses et variées.
M. Jean-Patrick Gille. Je remercie les intervenants, qui nous ont présenté les raisons pour lesquelles ils ont signé cet accord.
Celui-ci établit un équilibre : d’un côté, la baisse de 1,6 % à 1 % de l’obligation légale ; de l’autre, le renforcement, en contrepartie, de l’obligation de former, formalisée par l’entretien individuel. Ne peut-on raffermir cet équilibre ? N’y a-t-il pas, des deux côtés, quelques incertitudes ? La baisse des fonds mutualisés qui résultera de la baisse de l’obligation légale ne risque-t-elle pas d’entraîner un affaiblissement de la formation, notamment dans les petites entreprises, surtout celles qui comptent entre dix et cinquante salariés ? Par ailleurs, que se passera-t-il si l’entretien individuel n’a pas lieu ? Pour les entreprises de plus de cinquante salariés, s’il ne s’est rien passé au bout de six ans, le quota des heures de formation du salarié sera abondé de 100 heures. La sanction est légère. Mais ne faudrait-il pas, par souci de simplicité, l’étendre à l’ensemble des entreprises ? J’aimerais avoir votre avis là-dessus.
Cet accord met en place le compte personnel de formation, qui ouvre un droit à la qualification et à la progression du niveau de qualification. Mais ouvre-t-il un droit à la deuxième chance pour les publics prioritaires ? Comment permet-il d’améliorer la formation des demandeurs d’emploi ?
Les listes sont destinées à réguler le système et à garantir qu’il s’agit bien de formations qualifiantes et de qualité. Mais ne sont-elles pas aussi le moyen, pour les organisations patronales, de « refermer » le système ? Comment trouver un équilibre ? Vous n’avez pas évoqué le cas des demandeurs d’emploi. Qui, des partenaires sociaux, des branches, des conseils régionaux, va se charger des listes les concernant ? Comment tout cela va-t-il s’articuler ?
Vous avez peu évoqué le nouveau mode de gouvernance introduit par cette loi de décentralisation de la formation, qui replace les partenaires sociaux au niveau régional. Comment l’appréhendez-vous ? En particulier, êtes-vous partout en capacité de tenir votre rôle ?
Au titre de la contribution de 1 %, vous avez réintroduit une possibilité de s’exonérer des 0,20 % dédiés au financement du compte personnel formation, revenant finalement au système antérieur. J’imagine qu’il s’agit d’une solution de compromis. Toutefois, un financement dédié systématique préviendrait plus efficacement le risque de voir les entreprises finançant directement le compte personnel formation établir à nouveau une jonction entre plan de formation et compte de formation, dérive que l’on a déjà connue dans le droit individuel à la formation (DIF).
Enfin, je m’étonne que toutes les organisations n’aient pas donné leur avis sur l’inspection du travail alors que ce point est important.
M. Gérard Cherpion. Les partenaires sociaux présents ce matin nous ont fait part de points de vue communs mais aussi de visions différentes de l’évolution du texte.
Je retiens que la question des formations qualifiantes est fortement liée à celle des listes. D’un côté, on donne au salarié la possibilité de choisir, de prendre personnellement son avenir en main ; de l’autre côté, on réduit son choix à des listes. Entre les listes nationales, régionales et de branches, et celles qui s’adresseront aux demandeurs d’emploi et aux salariés règne une confusion qui risque de contrarier l’esprit d’ouverture et de responsabilisation du texte en enfermant dans des systèmes. Peut-être est-ce l’un des points sur lesquels M. Grignard trouvait nécessaire d’aller plus loin.
Pour les demandeurs d’emploi, que signifie le principe de codécision avec les régions ?
Un problème se pose, en effet, s’agissant du compte personnel formation, pour les entreprises de moins de cinquante salariés. Un suivi de l’évolution professionnelle plus poussé serait sans doute de nature à rendre les actions plus efficaces. Quant à la formalisation de l’entretien professionnel, si elle n’a pas eu lieu au bout de six ans, il va être bien compliqué de statuer sur l’éventuel abondement du compte. Par quel moyen la mettre en place sans créer de charge supplémentaire pour l’entreprise ?
Enfin, je souhaiterais quelques précisions concernant l’apprentissage dans le supérieur, où l’application du texte pourrait poser des difficultés.
M. Arnaud Richard. Les auditions auxquelles nous procédons aujourd’hui concernent un sujet d’une importance cruciale à l’heure où la plupart des indicateurs sont au rouge : malgré la promesse répétée d’inversion de sa courbe, le taux du chômage est explosif ; les impôts subissent une hausse massive ; la compétitivité de nos entreprises est aujourd’hui la plus faible, avec un taux de marge au plus bas depuis 1985. En dépit des promesses de la majorité et quoi qu’ait pu en dire le ministre Michel Sapin, les entrées en apprentissage reculent de manière spectaculaire, de moins 9,2 % sur un an à la fin du mois de novembre. Le nombre des contrats d’apprentissage est de 435 000 en France contre 1,5 million en Allemagne. Tous ces éléments soulignent l’importance de mettre en œuvre une réelle politique de l’emploi et de la formation professionnelle.
La formation initiale et continue, plus spécialement professionnelle, est au cœur de la « flexécurité » qui repose sur le principe d’une meilleure employabilité des personnes grâce à une meilleure formation. Chaque année, 32 milliards d’euros sont consacrés à cette politique, avec des résultats jugés peu satisfaisants au regard de ce budget. Dans ce contexte, l’accord national interprofessionnel du 14 décembre dernier est à saluer : les partenaires sociaux ont su trouver, dans le cadre du dialogue social, un accord sur un texte qui devrait permettre une meilleure stabilité juridique. Cet accord doit trouver une traduction législative à travers un projet de loi que nous attendons. Nous serons autant vigilants sur la fidélité à l’accord qu’attachés à formuler des propositions afin d’aboutir à la loi la meilleure possible pour l’emploi, pour nos concitoyens et pour nos entreprises.
Comme dans tout accord, chacune des parties prenantes a dû faire des compromis. Quelles concessions les organisations présentes ce matin ont-elles consenties ? Quels sont les éléments dont elles regrettent la présence ou l’absence ?
Les entreprises de dix à cinquante salariés sont-elles suffisamment concernées par l’accord ? Le groupe UDI est très attaché en particulier au secteur des services à la personne, fort pourvoyeur d’emplois. Serait-il possible d’amender le texte en ce sens, tout en respectant son équilibre ?
Comment les organisations syndicales imaginent-elles la montée en puissance du « paritarisme régional » introduit par ce projet qui décentralise une politique publique importante ?
Le compte personnel de formation (CPF) avait été esquissé dans la loi relative à la sécurisation de l’emploi de juin 2013, qui nous avait paru inaboutie. Nous avions alors proposé d’en préciser les modalités et les contours, à l’époque en vain. L’accord du 14 décembre apporte des avancées significatives que nous ne pouvons que saluer. Pensez-vous qu’il faille aller plus loin et préciser encore ce CPF ?
L’extrême complexité de l’offre de formation dans notre pays nuit à la mise en place des politiques publiques dans ce domaine. Il paraît nécessaire que ce secteur fasse l’objet d’un choc de simplification. À cet égard, l’accord du 14 décembre est-il suffisant ? Que pouvons-nous proposer afin de simplifier la formation professionnelle dans notre pays ?
M. Christophe Cavard. On ne peut que se réjouir de l’accord national interprofessionnel et du projet de loi qui en découle en matière de formation professionnelle, ainsi que du renforcement de la démocratie sociale sous tous ses aspects, déjà engagé à travers le texte sur la sécurisation de l’emploi. S’il ne s’agit encore que d’une étape, gageons que ce renforcement continuera dans le cadre du dialogue social que nous appelons de tous nos vœux.
Nous discutons d’un texte qui est encore susceptible d’évoluer puisqu’il sera présenté en conseil des ministres le 22 janvier prochain. La force du compte personnel de formation tient à son plafond de 150 heures contre 120 pour le DIF, même s’il n’est acquis qu’au bout de neuf ans contre six, ainsi qu’à sa vocation à ouvrir droit à des formations qualifiantes. Or, parmi tous les opérateurs de formation, bien peu sont capables d’offrir une telle formation en 150 heures. L’obligation de cofinancement qui en résulte est prévue, et par l’accord et par le texte, sous forme d’abondement. Toutefois, les OPCA s’inquiètent des moyens que leur donneront les nouveaux mécanismes de financement pour s’inscrire dans le dispositif et concourir à l’objectif.
En tant que représentants syndicaux, vous êtes partie prenante à l’organisme très intéressant qu’est le Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, qui joue un rôle particulier dans le financement de la formation. Des inquiétudes s’expriment également quant aux moyens auxquels il pourra prétendre, sachant qu’il sera géré par la Caisse des dépôts qui aura aussi la charge du CPF des 18 millions de salariés – 25 millions demain –, et sans doute pas à titre gratuit. Comment ces différents éléments s’articuleront-ils pour garantir l’effectivité des moyens en dehors de la possibilité d’abondement du CPF par les collectivités locales ?
Nous sommes nombreux à nous interroger sur les listes, tant du point de vue de la qualité des formations offertes que du risque d’enfermement dans une logique collective qui ne laisserait au salarié que le choix d’effectuer un tri entre les formations qu’on voudrait bien lui accorder.
Si d’aucuns se réjouissent du passage à la gouvernance territoriale partagée, des interrogations demeurent sur la capacité d’installation du dialogue social territorial qui n’a pas d’existence puisque, jusqu’à présent, les discussions se tenaient plutôt à l’échelon national, avec les branches et les interprofessions. Comment ce dialogue social territorial, que nous appelons de nos vœux, pourrait-il s’établir ?
Les interrogations sur la qualité de la formation tiennent également à la capacité des organismes auxquels pourront faire appel les salariés à répondre aux besoins et à la réalité. En filigrane, le texte de loi cherche à introduire une forme de certification de la formation sur un marché où la qualité des organismes est pour le moins inégale.
Une dernière interrogation concerne les publics cibles. Qu’en est-il des demandeurs d’emplois et des publics dits hors champ, qui sont liés au monde agricole et à l’économie sociale et solidaire, à laquelle les écologistes sont très attachés ? La question est d’importance puisque 6 à 8 millions de salariés pourraient être concernés.
Mme Dominique Orliac. Selon les radicaux de gauche, la crise de la démocratie française affecte plus particulièrement les organisations syndicales. Alors que, en dépit des coups portés par la droite, la vie associative est bouillonnante dans notre pays, le syndicalisme attire moins d’adhérents et demeure dispersé malgré le front syndical qui s’était uni contre le CPE ou l’âge du départ à la retraite sous le précédent gouvernement. En se gardant de tout interventionnisme, le parti radical de gauche estime qu’il faut leur donner de nouveaux moyens d’intervention et d’expression. Quelle est votre position concernant la possibilité d’établir la primauté des conventions collectives de branche en France, mais également au sein de l’Europe, indépendamment de l’Union européenne ?
Que penseriez-vous de la création de section syndicales inter-PME et TPE ? Le parti radical de gauche verrait une piste intéressante dans l’autorisation de créer des groupements de syndicats permettant à des confédérations syndicales d’agir et de conduire des négociations ensemble, sans perdre leurs identités respectives.
Je m’interroge sur le principe de la validité des seuls accords ayant reçu l’approbation de syndicats représentant une majorité de salariés. Là aussi, je souhaiterais connaître votre opinion.
Enfin, que penseriez-vous de rendre obligatoire le vote aux élections professionnelles dans les entreprises ? Entendez-vous, comme la CGT, dénoncer la suppression des élections prud’homales ?
Mme Jacqueline Fraysse. Dans la période que nous traversons, le texte est essentiel pour les salariés et pour les entreprises elles-mêmes en ce qu’il traite de sujets cruciaux tels que le droit des salariés à la formation professionnelle, la qualité de cette formation et les moyens mis à son service. Il traite aussi de la démocratie sociale à travers la représentativité patronale et syndicale, le financement de ces organisations, l’information et la transparence des comités d’entreprise ainsi que la désignation des conseillers prud’homaux. Il aborde aussi des aspects essentiels en matière de contrôle de la formation professionnelle et d’apprentissage, et de rôle de l’inspection du travail.
Au début de ce travail important, je prends connaissance des propositions du texte, de l’opinion des différentes organisations syndicales, qu’elles aient ou non signé l’accord. Je n’ai pas à poser de question particulière si ce n’est à indiquer que nous suivrons avec beaucoup d’attention les travaux et les propositions qui seront faites, en essayant de les améliorer si cela est possible.
Mme Monique Iborra. Le ministre avait annoncé que la loi sur la formation professionnelle devait changer la donne, en particulier en matière de formation des demandeurs d’emploi. J’ai l’impression que l’accord ne répond pas tout à fait à cet objectif. Certes, les demandeurs d’emploi peuvent aussi bénéficier du compte personnel de formation mais, même avec trente heures supplémentaires, ce compte sera insuffisant pour obtenir les formations qualifiantes qui leur permettraient de sortir de cette catégorie. En matière de financement, les 300 millions d’euros supplémentaires prévus pour les demandeurs d’emploi sont bien peu par rapport aux 4 milliards dépensés pour la formation des chômeurs. Le CPF est-il en mesure de régler les inégalités dénoncées depuis des années et qui avaient conduit à la création du DIF, utilisé par seulement 6 % des salariés ?
Dans le cadre de l’accompagnement des salariés et des demandeurs d’emploi, le compte peut être abondé par d’autres, en particulier les régions. Ce ne sont certainement pas les mêmes organismes qui assureront la coordination pour les salariés et pour les demandeurs d’emploi. Ce point reste à préciser. Sachant qu’un demandeur d’emploi a surtout besoin d’être accompagné, on peut craindre qu’il ne s’engage dans un parcours du combattant pour arriver à mutualiser l’ensemble des financeurs potentiels.
Compte tenu du croisement entre les niveaux régional et national, on imagine mal qu’il puisse ne pas y avoir de pilote pour la mise en œuvre des listes éligibles au compte personnel de formation. Or je n’ai pas réussi à en identifier un, y compris dans le projet de loi. La nouvelle organisation régionale sera censée faire travailler tout le monde ensemble. S’il suffisait de mettre des gens autour d’une table, cela aurait été fait depuis longtemps. Or tout le monde n’a pas les mêmes objectifs.
On sait que le Fonds de sécurisation des parcours n’est pas régionalisé et qu’il va intervenir dans la formation, en particulier dans celle des demandeurs d’emploi. On connaît l’outil et les flux financiers, mais on ne connaît absolument pas, pas même la Cour des comptes, le retour sur investissement. Seriez-vous opposés à ce que ce fonds remette un rapport annuel au Parlement sur le rapport qualité-prix ?
Mme Isabelle Le Callennec. Entre la CFTC qui parle de réforme sociétale de grande ampleur, la CGT-FO pour qui ce n’est ni le grand soir ni une révolution copernicienne, et la CFE-CGC et la CFDT qui décrivent une réforme structurelle, j’entends que chacun a son opinion. Je n’insiste pas sur la représentativité et le financement du paritarisme sur lesquels j’ai bien compris qu’il y avait encore beaucoup à faire. Puissent les débats nous permettre d’avancer vers plus de transparence et plus de justice !
On dit aujourd’hui du système de formation professionnelle qu’il est illisible, opaque, inefficace et certainement coûteux. On dit aussi que 13 % seulement des demandeurs d’emploi bénéficient de la formation, contre 87 % des personnes occupant déjà un emploi. À vous entendre, j’ai eu le sentiment qu’on se focalisait davantage sur les salariés en entreprise qui disposent déjà de plans de formation, notamment du congé individuel de formation (CIF), et un peu moins des demandeurs d’emploi, alors que l’enjeu est clairement de rapprocher l’offre et la demande et de former les personnes peu qualifiées et les jeunes décrocheurs. Néanmoins, comme vous, je suis attachée à la formation tout au long de la vie, domaine dans lequel il reste des progrès à faire.
Notre propos à nous, législateurs, est de faire plus efficace, plus juste et plus lisible en utilisant mieux les fonds publics.
Le compte personnel de formation a été créé dans la loi de sécurisation de l’emploi. Le groupe UMP avait posé beaucoup de questions sur les moyens de lui donner corps ; vous, les partenaires sociaux, avez tenté de le faire. Moi aussi je m’interroge sur les listes de formations. Je vous entends dire que vous aurez la main dessus ; j’entends aussi le souhait des régions de les piloter. Il faudra donc que, au niveau des territoires, les acteurs se mettent autour de la table pour partager et un diagnostic et une proposition de liste.
Il y a aujourd’hui toute une palette de formations, au point que les demandeurs d’emploi et les salariés ont parfois des difficultés à s’y retrouver. De grâce, essayons de faire simple ! Pour que cette loi soit acceptée et appréciée, employons un vocabulaire simple et courant.
Le conseil en évolution professionnelle, déjà prévu dans la loi de sécurisation de l’emploi, m’apparaît comme une nécessité. Je pensais que les maisons de l’emploi s’en chargeraient mais on leur a coupé les vivres et diminué leur budget de moitié. Quoi qu’il en soit, de tels conseillers sont indispensables pour expliquer aux salariés et aux demandeurs d’emploi quelles sont les entreprises qui recrutent sur leur territoire.
S’agissant du financement, j’ai le sentiment qu’il n’est pas encore très clair. Nous avons auditionné hier la présidente du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie (CNFPTLV) : apparemment, tout le monde ne comprend pas la même chose.
Par ailleurs, j’ai cru comprendre que l’abondement jusqu’aux 150 heures se faisait sur la base du volontariat. L’avez-vous également compris ainsi ? Que feront les régions, les OPCA, les entreprises ?
Enfin, puisque nous parlons de formation professionnelle, n’oublions pas le volet orientation qui est un vrai problème dans notre pays. L’éducation nationale doit définir un cadre national puis, grâce à la décentralisation, un travail doit se faire au niveau des territoires où les postures idéologiques politiques ou syndicales sont beaucoup moins de mise.
M. Jean-Marc Germain. En cette période, il est très important que syndicats de salariés et employeurs soient capables de s’entendre. Je me réjouis que Force ouvrière conçoive que les parlementaires puissent avoir un travail à faire quand bien même un accord a été signé.
Même si je prends acte du progrès que constituent le passage de 120 à 150 heures du compte personnel de formation et les possibilités d’abondement, je ne comprends pas pourquoi le compteur reste bloqué à cette hauteur, insuffisante pour les formations qualifiantes dont le pays a besoin, alors même que l’enjeu n’est pas financier. Pourquoi ne pourrait-on pas aller plus loin ?
S’agissant de la représentation patronale, je suis très attaché à un mode électif qui serait la juste contrepartie de ce qui a été décidé pour les syndicats de salariés en 2008. Pourquoi en rester à l’adhésion ?
Enfin, parmi les organismes de formation, il y en a de très bons mais aussi de très mauvais. Le gaspillage n’est pas seulement une question de mauvaise utilisation des sommes, il est également le fait d’organismes qui ne forment pas du tout utilement les salariés. La liste des formations m’inquiète moins que la qualité des organismes qui les dispensent. Comment améliorer le système ?
M. Gilles Lurton. Nous discutons d’un avant-projet de loi qui n’est pas stabilisé ni passé devant le Conseil d’État. Encore une fois, nous travaillons dans la précipitation sur un sujet dense et complexe. Je ne doute pas, madame la présidente, de la sincérité de vos interventions auprès du Gouvernement, mais je vois bien que les choses ne changent pas.
Le texte organise extrêmement bien la formation des travailleurs, alors que ce sont les publics les plus fragiles, que l’on balade de formation en formation ne débouchant jamais sur l’emploi, qui ont le plus besoin d’attention.
La région devient chargée de la politique régionale d’accès à l’apprentissage et à la formation professionnelle des jeunes et des adultes à la recherche d’un emploi ou d’une nouvelle orientation professionnelle. Comment la représentation syndicale compte-t-elle s’insérer dans ce renforcement de compétences ?
Enfin, malgré un faible taux de participation, je maintiens que les élections prud’homales conféraient une légitimité aux élus et créaient une certaine émulation au sein des entreprises.
Mme Fanélie Carrey-Conte. Visiblement, tous les syndicats ne sont pas d’accord sur la suppression des élections prud’homales. Que le faible taux de participation à ces élections puisse indiquer qu’elles ont perdu leur légitimité et justifier qu’on les supprime est un argument à manier avec précaution dans le débat public : il pourrait créer des précédents préoccupants du point de vue démocratique.
Comme Jean-Marc Germain, je ne vois pas pourquoi la représentativité patronale n’est pas soumise à élections. J’ai aussi le sentiment que la problématique des organisations hors champ – agriculture, professions libérales, économie sociale et solidaire – est loin d’être réglée, notamment sur la partie représentativité patronale.
M. Michel Liebgott. Chacun en convient, le texte apporte opportunément de nombreux progrès. En particulier, il précise en son article 15 que si une organisation patronale représente moins de 5 % des entreprises d’une branche, l’administration pourra lui appliquer la convention collective d’une autre branche ou éventuellement fusionner sa convention collective avec celle d’une autre branche. Que pensez-vous de cette disposition, sachant qu’aujourd’hui de nombreuses conventions collectives sont moribondes et que le rapport récent d’un directeur du travail préconisait de diviser par trois ou quatre le nombre de branches dans les dix ans qui viennent ?
Comme beaucoup, je m’interroge sur l’application de l’accord ou de la future loi dans les petites et moyennes entreprises. Êtes-vous en capacité aujourd’hui de nous proposer des dispositifs susceptibles d’être intégrés dans la loi pour mettre en œuvre des plans de formation dans les TPE et PME ? C’est un enjeu pour nous et pour les entreprises, mais aussi pour vous, au regard de la qualité de votre représentativité.
M. Denys Robiliard. La CFTC n’a pas donné son point de vue sur les titres II et III du projet de loi.
La CFDT s’est prononcée sur l’importance de procéder à la restructuration des branches trop nombreuses. De ce point de vue, je suis intéressé par son analyse de la section VIII de l’article 15, évoquée à l’instant par M. Liebgott, qui permet, dans le cas d’une très faible représentation patronale, de ne pas arrêter les listes ou de ne pas étendre une convention collective.
Nous sommes plusieurs à soulever la question du hors champ. Cette réforme de la démocratie sociale pourrait-elle être l’occasion d’essayer d’intégrer dans le dialogue social interprofessionnel les organisations patronales représentatives hors champ, et de quelle manière ? La question se posera également pour les organismes paritaires, notamment ceux qui gèrent des fonds. Alors que les entreprises du hors champ cotisent, elles ne siègent pas dans ces organismes, non plus que dans le nouveau fonds paritaire de financement de la négociation sociale. Y a-t-il une place pour elles ?
M. Marcel Grignard (CFDT). Je regrette qu’on ait pu comprendre de mes propos qu’une faible participation électorale délégitimait les juges des conseils de prud’hommes et qu’on pouvait donc en supprimer l’élection. On peut supprimer cette élection parce que la réforme de la représentativité, qui a maintenant un cycle complet d’existence, a démontré son efficacité : sur un corps électoral pourtant plus petit, le nombre de salariés à s’exprimer est beaucoup plus important que pour les prud’hommes. Les salariés peuvent donc s’exprimer selon des modalités plus solides que l’élection prud’homale telle qu’elle existait.
La CFDT fait partie des organisations syndicales qui pensent que les partenaires sociaux ont à produire un effort considérable d’adaptation au monde tel qu’il est, et qu’ils ne sont pas en très bonne santé. Rien ne permet de penser que les organisations syndicales de salariés sont plus en forme que les organisations patronales, au contraire.
Le niveau des branches est un facteur central de régulation. À l’issue d’un travail effectué au Haut conseil du dialogue social, 200 branches professionnelles ont été écartées : soit que moins de dix salariés s’étaient exprimés dans l’élection de représentativité dans leur champ, soit que, depuis vingt ans, elles n’avaient posé aucun acte politique. Pour autant, les 500 autres branches ne sont pas forcément en bonne santé. Les pays voisins qui ont un dialogue social de qualité au niveau des branches professionnelles en comptent une dizaine au maximum. La structuration des branches relève de l’unique responsabilité patronale, les organisations syndicales n’ont aucun pouvoir. Si on laisse les acteurs faire, rien ne changera. On a besoin d’une puissance publique quelque peu coercitive pour obliger les employeurs à être efficaces et à arrêter de construire des branches professionnelles de circonstance qui n’ont rien à voir avec l’enjeu de la régulation sociale.
Dans la question du hors champ aussi, la responsabilité patronale est énorme. Certains secteurs d’activité devraient être inclus dans la dimension nationale interprofessionnelle pour tenir compte de l’évolution de la situation, c’est une évidence.
La mesure de représentativité sur sigle dans les très petites entreprises de moins de dix salariés résulte du refus patronal d’un vrai dialogue social pour ces entreprises. Nous avons beaucoup regretté, sous la précédente législature, que le Parlement ait participé à consolider cette vision la moins positive du patronat, sur laquelle il faut revenir. S’il n’y a pas de point de vue commun entre les organisations syndicales de salariés, nous sommes convaincus qu’il n’y aurait aucun sens à organiser un dialogue social structuré à l’intérieur des entreprises de moins de dix salariés. Par contre, des commissions paritaires pourraient tout à fait le faire sur les territoires. Des salariés seraient élus sur listes nominatives dans ces commissions paritaires pour traiter les problèmes quotidiens auxquels leurs collègues sont confrontés. De notre point de vue, la seule réponse à la crise institutionnelle de représentation à tous les niveaux, y compris syndical, c’est la relation directe entre les salariés et les organisations syndicales. À cet égard, la réforme de 2008 nous semblait vraiment la bonne méthode.
En matière de formation professionnelle, nous sommes convaincus que le nouvel espace de négociation collective dans l’entreprise est un vrai facteur de progrès. La possibilité donnée aux entreprises de fonder avec les partenaires sociaux un accord collectif sur l’utilisation du 0,2 % répond pour partie à vos interrogations sur la définition des priorités par accord collectif au sein de l’entreprise. Ces priorités ne seront pas les mêmes dans une entreprise de gardiennage ou dans une entreprise de service informatique, même si les deux ont des publics fragiles quoique différents eux aussi. Il est donc important que la négociation collective trouve des réponses à ce niveau-là. C’est là, pour l’entreprise, le moyen, non pas de récupérer à son profit le compte personnel de formation, mais de trouver une articulation entre le plan de formation, qui est de sa responsabilité, et le CPF, qui est un outil pour le salarié. Si les textes doivent clairement poser que le compte personnel de formation relève de la décision unique du salarié, les faits montrent que les rôles des uns et des autres sont beaucoup plus complémentaires que ne le laisse penser la séparation totale des deux éléments telle qu’elle est prévue.
S’agissant des demandeurs d’emploi, vous accorderez à la CFDT le crédit d’y avoir beaucoup pensé dans la négociation, et ce dans une vision dynamique. Chacun a été marqué par les événements auxquels a donné lieu la crise agroalimentaire en Bretagne. Si l’accord que nous avons signé avait été en vigueur depuis dix ans, le système du bilan à six ans et d’abondement correctif aurait joué, dans les sociétés Gad et Doux, pour beaucoup des salariés qui ont perdu leur emploi aujourd’hui et n’ont pas eu depuis très longtemps de formation professionnelle sérieuse. Avec un crédit de 150 heures et un correctif de 100 heures, ils auraient pu bénéficier d’un mois et demi. Le crédit est certes faible au regard de la longueur de certaines formations, mais 250 heures contre rien pour certains, cela fait une différence.
Les besoins de formation des demandeurs d’emploi ont deux causes principales : soit ils ont quitté le système scolaire sans avoir acquis le minimum vital en matière de compétence professionnelle, soit, malgré une longue carrière, ils n’ont jamais eu aucune expérience de travail qualifiante. Plus on est efficace en amont, moins il est difficile de résoudre la situation des salariés qui deviennent demandeurs d’emploi. C’est pourquoi, dans la négociation, nous avons insisté sur l’acquisition du socle de compétences, qui est liée au problème de l’illettrisme. Ce point transparaît bien dans le projet de loi. À tous les niveaux de la gouvernance, notamment régional, partenaires sociaux et pouvoirs publics doivent pouvoir allier leurs forces pour sortir ces salariés de la situation difficile où ils se trouvent. Nous avons mis l’accent sur cet aspect de l’acquisition du socle de compétences pour plaider, pour certains cas, en faveur de l’utilisation du compte personnel de formation obligatoirement pendant le temps de travail.
Avec la logique d’abondement, nous avons voulu corriger les deux gros défauts du droit individuel à la formation (DIF), qui traitait tous les salariés de la même manière, quels que soient leur parcours et leurs besoins, et qui laissait au seul salarié l’initiative d’aller en formation ainsi que le choix de cette formation. C’est à l’entreprise, à la branche professionnelle et aux territoires que revient la responsabilité politique majeure de définir les publics prioritaires et le mode d’abondement nécessaire pour leur permettre de bénéficier de formations qualifiantes. Dans le même temps, il faudra inciter les organismes de formation à penser de nouveaux modules de formations qualifiantes. Une compétence qui nécessite 600 heures de formation pourrait, par exemple, être acquise en quatre fois 150 heures, ce qui est d’ailleurs plus supportable pour les entreprises qui doivent laisser partir leurs salariés en formation.
J’en viens à la question des listes et de la gouvernance. À un moment, il faut décider si on laisse la liberté totale aux individus ou si on accommode cette liberté à l’intérêt général. De ce point de vue, il nous semble légitime de lister des formations liées à l’utilisation du compte personnel de formation. Les listes sont construites sur trois niveaux. Le premier est la branche professionnelle qui a, dans un secteur d’activité donné, la meilleure vision des emplois et de leur devenir, qu’il tende vers le développement ou l’obsolescence – du moins en théorie. Le deuxième niveau est l’interprofession nationale qui devrait – toujours en théorie, car la réalité est souvent un peu plus délicate – être capable de consolider la vision des branches professionnelles en en comblant les failles. En principe, il ne doit pas y avoir de contradiction entre les besoins sectoriels et la vision nationale interprofessionnelle. Le troisième niveau est la région, lieu de concertation où l’instance politique et les partenaires sociaux doivent s’accorder sur les besoins pour tenter d’articuler la vision sectorielle mentionnée plus haut avec la réalité régionale. L’emploi dans un secteur d’activité comme l’informatique a une dimension verticale évidente, mais la manière de la mettre en œuvre dans les territoires peut être extrêmement variée en fonction de la dynamique du territoire ou de l’implantation des entreprises.
Voilà comment nous voyons les choses. Il est probable que cela ne fonctionne pas immédiatement, mais nous parions sur la forte envie des acteurs de faire réussir le système. Le Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, dont le financement est dorénavant beaucoup plus transparent grâce à un effort conséquent de clarification, est un véritable outil pour aider à concrétiser les choses.
Vous vous êtes inquiétés de savoir si les entreprises, notamment de dix à cinquante salariés, disposeront des moyens de mettre en œuvre des plans de formation. Force est de constater que la mécanique précédente avec obligation fiscale ne permettait pas de répondre aux objectifs politiques poursuivis. La fin de cette obligation fiscale, nous en sommes convaincus, ne modifiera globalement pas le comportement des entreprises vis-à-vis du plan interne de formation destiné à l’adaptation des salariés à l’évolution de l’outil de production. Ou alors c’est qu’elles se désintéressent de l’avenir au point d’être suicidaires.
Quant aux chiffres, remettons-y de l’ordre. L’obligation fiscale de 1,6 % de la masse salariale aboutit à un montant théorique de 7,3 milliards, mais le produit effectif de la collecte par les OPCA est de 6,7 milliards. Dans la mécanique proposée, avec le 1 %, il y a une mutualisation obligatoire de 4,9 milliards, à laquelle s’ajoutent des obligations conventionnelles précédentes qui demeurent, pour 1,4 milliard. Au total, la mutualisation réelle s’élève à 6,3 milliards. Contrairement à certains commentaires, il y a amélioration notable de la mutualisation. On ne peut pas en dire autant du mécanisme actuel qui permet à certains de mettre de l’argent au pot commun puis de le récupérer. La mécanique proposée par l’accord et reprise par le projet de loi améliore donc considérablement la mutualisation.
En tant que syndicat de salariés, notre objet n’est pas la défense des organisations patronales. Pourtant, nous souffrons principalement de leur faiblesse, plus précisément de leur faible capacité d’engagement des entreprises. Celle-ci est même nulle pour des entreprises non adhérentes d’organisations patronales. Pour illustrer l’absence de symétrie des situations entre les entreprises et les salariés que je relevais plus haut, au sein de l’entreprise, si les salariés doivent voter pour décider quelles organisations syndicales vont les représenter, personne n’imagine un vote pour savoir qui va représenter l’employeur.
M. Franck Mikula (CFE-CGC). Après avoir entendu les explications très complètes de M. Grignard sur les incidences de la mutualisation sur les plus petites entreprises, je suis enclin à nuancer ma position : s’il y a effectivement un risque pour ces entreprises, il est moins fort avec l’ANI qu’hier. Les grosses entreprises s’arrangeaient pour récupérer leurs fonds, voire plus, et il ne restait plus rien pour les autres.
La question du pilotage des listes de formation reste pendante. Pour des projets de ce type, mettant en présence régions et État, ce dernier est sans doute mieux à même de répondre. Il faudra sans doute compléter les quelques pistes que nous avons envisagées.
La CFDT parie que la mutualisation ne modifiera pas le comportement des entreprises, considérant qu’elles ont une responsabilité en matière de maintien de l’employabilité et de l’emploi. L’adaptation aux mutations économiques et technologiques est en effet du ressort de l’entreprise. Pour autant, dans nos réflexions sur l’individualisation de la formation, prenons garde à ne pas renvoyer en totalité cette responsabilité sur le salarié. Très peu utilisent le droit individuel à la formation (DIF) et très peu utiliseront le CPF. Pour l’anecdote, lors de notre comité directeur, les participants dont le DIF était encore à son plafond ont été invités à se déclarer : la majorité des mains s’est levée. Cela montre bien que, en matière de formation, on ne peut pas confier toute la responsabilité aux salariés, et que le plan de formation est complémentaire du CPF. L’ANI tente d’apporter une amélioration en responsabilisant encore mieux les acteurs dans l’entreprise, en négociant la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC), en introduisant un plus grand contrôle des instances représentatives du personnel sur le plan de formation et la formation globale. Mais ne perdons pas de vue que la responsabilité première en matière de maintien de l’employabilité revient à l’entreprise, c’est même une obligation.
Il est certain que 150 heures sont insuffisantes pour une formation qualifiante. Si la représentation nationale décidait d’en augmenter le nombre, cela ne nuirait pas forcément à l’équilibre de l’accord.
En matière d’apprentissage dans le supérieur, ce n’est pas tant l’ANI ou le projet de loi qui nous inquiète que tout le discours qui a accompagné la négociation. On sent bien qu’une priorité tente d’être donnée aux formations de premier niveau. Si la fibre citoyenne de chacun l’incite à se préoccuper d’offrir une meilleure formation à nos jeunes, tout ne peut pas reposer sur les fonds de la formation professionnelle. Tout commence à l’école. Les décrocheurs, les jeunes non qualifiés relèvent de la responsabilité familiale, scolaire et citoyenne avant d’être une coresponsabilité des partenaires sociaux et des employeurs. N’oublions donc pas l’ensemble des acteurs quand on aborde ce sujet du manque de qualification. Par ailleurs, nous avons également quelques doutes sur le financement des écoles d’ingénieurs et de commerce.
Illisibilité, opacité, complexité, les mécanismes en place sont, il est vrai, compliqués. Les partenaires sociaux ont tenté de renvoyer cette complexité à ceux qui élaborent les listes de formations qualifiantes pour simplifier le travail de l’utilisateur, qui n’a pas besoin de maîtriser tous les circuits de financement ni les sigles. Rappelons que d’autres systèmes de formation que le CPF existent, notamment le DIF et toutes les périodes de professionnalisation.
S’agissant des inquiétudes sur l’absence de moyens, nous ne serions pas choqués que l’État ou les régions décident d’améliorer encore le financement de la formation professionnelle dans les régions.
Je terminerai en disant que ce n’est pas la formation qui crée l’emploi, non pas pour botter en touche, mais pour rappeler que pour s’interroger sur l’employabilité encore faut-il avoir des emplois.
M. Patrick Le Moigne (CFTC). Beaucoup d’entre vous ont des interrogations sur le hors champ. Sachez que la CFTC est parfaitement d’accord pour l’intégrer, et moi-même a fortiori puisque j’appartiens à une branche hors champ. J’avais d’ailleurs négocié parallèlement au niveau de l’Union nationale des professions libérales (UNAPL) qui n’est pas à la table des négociations. Dans le texte que j’ai vu passer sur la représentativité des employeurs, le hors champ ne figurait pas. Pourquoi ? Peut-être la représentation nationale pourrait-elle rectifier le tir en demandant aux employeurs de l’UNAPL et de l’agriculture de venir à la table des négociations. Sinon, comme à chaque fois, l’ANI ne sera pas applicable au hors champ tant que le texte de loi ne sera pas adopté. Pendant ce temps, ces branches demanderont aux partenaires sociaux et aux organisations syndicales de venir négocier pour leur petit pré-carré. Ce n’est pas bien.
Pour s’assurer de la qualité des organismes de formation, qui sont légion, la CFTC suggère de prévoir dans le texte de loi d’examiner ces organismes tous les deux ou trois ans, en fonction de critères très précis et surtout des résultats obtenus. C’est bien beau de leur donner de l’argent, mais qu’offrent-ils en retour pour les salariés ? Nous, les organisations syndicales, nous sommes encore plus interpellées sur le terrain que vous, mesdames, messieurs les députés. Tous ensemble, nous devrions être d’accord pour revoir ces organismes de formation.
Quant à vous parler des concessions consenties lors de la négociation, je ne le ferai pas. Le temps de la négociation est passé, celui de la conclusion est arrivé. Peut-être les organisations patronales pourront-elles vous répondre si vous les interrogez. Il est vrai que 150 heures de formation, c’est insuffisant. La CFTC avait proposé d’aller jusqu’à 200 heures, niveau plus adapté à une formation qualifiante.
Pour finir, s’agissant des listes, on oublie trop souvent les observatoires des métiers qui fonctionnent très bien et qu’il faut utiliser. Les observations effectuées par leurs soins au niveau des bassins économiques remontent aux branches et peuvent être utilisées par les régions.
Tout n’est pas parfait dans l’accord, mais l’avancée est réelle. C’est maintenant à la représentation nationale d’apporter sa contribution.
M. Stéphane Lardy (CGT-FO). J’aimerais bien, monsieur Richard, qu’il y ait 32 milliards d’euros à gérer pour la formation professionnelle des salariés, mais ce n’est pas le cas. Il n’y a rien d’étonnant à notre inclination pour les salariés puisqu’ils sont notre domaine de compétence. Je ne négocie pas pour les demandeurs d’emploi, même si le fonds paritaire leur consacre 85 % de ses financements. Avec les financements des organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA) de la préparation opérationnelle à l’emploi et du contrat de sécurisation professionnelle, la formation professionnelle des demandeurs d’emploi atteint plus d’un milliard.
Bien sûr, si j’avais été seul à négocier, l’accord ne serait pas celui-là : tout le monde aurait eu droit à mille heures de formation ! Mais il faut « aller vers l’idéal et comprendre le réel », comme disait Jaurès. Le compromis est toujours un élément instable et précaire.
Le compte personnel de formation est un progrès par rapport au DIF en ce qu’il est un droit plus personnel. On aurait pu le laisser à l’entière responsabilité des salariés, mais des exemples étrangers ont montré qu’à les laisser livrés à eux-mêmes, ce sont toujours les mêmes qui profitent, et on renforce les inégalités de traitement. C’est pourquoi il fallait y associer des garanties collectives, en confiant, par exemple, la définition des formations qualifiantes à la négociation de branche et celle des listes de formation pour les demandeurs d’emploi à la négociation d’entreprise. L’objectif des garanties collectives est de faire du compte personnel formation un droit conditionné pour éviter de renforcer les risques d’inégalités de traitement et d’accès à la formation professionnelle qu’il comporte et dont le MEDEF ne se soucie pas vraiment. Le patronat se préoccupe plutôt du plan de formation et de la professionnalisation, mais c’était l’objet du compromis. Nous avons choisi de faire de la régulation collective, par la négociation d’entreprise et de branche, sur les types de formation. Bien évidemment, elle est de nature financière puisque le but des listes est d’éviter d’ouvrir à tout. Nos camarades qui œuvrent dans les branches connaissent les entreprises et savent déjà de quelles formations ont besoin les salariés.
La gouvernance suscite beaucoup d’interrogations. Sur des sujets qui se croisent, les relations entre partenaires sociaux et régions sont assez compliquées. En matière d’éligibilité des listes, nous nous déclarons compétents, mais vous ferez ce que vous avez à faire. Contrairement à certains qui veulent s’accaparer cette responsabilité en considérant que les régions n’ont pas voix au chapitre, nous pensons que la concertation est nécessaire et qu’elle doit même être rendue obligatoire. Une vraie concertation réussie me paraît préférable à la désignation d’un pilote qui déciderait à la fin.
Mme Iborra propose que le Fonds de sécurisation des parcours professionnels présente un rapport au Parlement. L’idée ne nous dérange pas. Quant à la périodicité, mieux vaudrait sans doute tous les trois ans plutôt que tous les ans, compte tenu de la lourdeur du dispositif, même s’il va être réformé avec le fonds paritaire. Nous avons en quelque sorte engagé le travail en procédant à des évaluations, mais n’oublions pas que la formation est une munition à mèche longue.
Les organismes de formation ne sont pas des objets de négociation. Déjà en 2008, la question avait été abordée car ils posent un vrai problème. Aujourd’hui, 56 000 organismes font une déclaration d’activité dans ce secteur qui fonctionne comme un véritable marché sur lequel le Conseil supérieur de la concurrence veille. Les OPCA, par exemple, ne peuvent pas choisir les organismes de formation comme elles l’entendent parce qu’elles sont soumises au droit de la concurrence. Il nous semble que les pouvoirs publics seraient tout à fait dans leur rôle en organisant ce marché de la même manière qu’ils ont organisé celui des services à la personne, qui est régulé par l’Agence nationale des services à la personne. L’État doit utiliser cette possibilité qu’il a de réguler le marché, car la délégation d’activité ne suffit pas. Sur les 56 000 organismes, 2 000 travaillent et 200 font 80 % du chiffre d’affaires. Les grandes entreprises exigent des organismes qu’elles choisissent qu’ils se fassent labelliser et certifier ISO, mais ce n’est que de la procédure. Nous attendons de la représentation nationale qu’elle intervienne sur ce sujet qui relève vraiment du domaine législatif.
L’intégration du hors champ ne nous pose pas de souci non plus, puisque nous y sommes également représentatifs, pourvu toutefois qu’il soit pris en compte sur le quota patronal !
S’agissant d’une réforme structurelle, nous sommes très attentifs aux délais qui permettent de gérer la transition. D’ores et déjà, je peux annoncer que, au 1er janvier 2015, la situation va être compliquée : pour la Caisse des dépôts, d’une part, même si elle fait déjà de la gestion de comptes de droits de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL), l’opération reste techniquement assez compliquée ; pour les branches, d’autre part, sachant que toutes n’ont pas la capacité de négocier très vite et qu’elles ont déjà fort à faire avec les complémentaires santé, le temps partiel, le contrat de génération et la qualité de vie au travail. Si vous leur imposez une date butoir au 1er novembre, attendez-vous à de mauvaises surprises. Il faut donc faire extrêmement attention et donner également aux OPCA la capacité de gérer la transition, selon nous, dans le cadre de conventions d’objectifs et de moyens qui les laisseraient tranquilles sur les frais de gestion sur les TPE et PME pour privilégier des activités de service en direction de ces entreprises. Cette réforme structurelle va demander du temps. Attention au crash sur la piste d’atterrissage !
Mme Marie-Alice Médeuf-Andrieu (CGT-FO). La question de fond, s’agissant de la représentativité patronale, est que les organisations syndicales n’ont pas eu le droit de la négocier comme l’avait été la représentativité syndicale. D’ailleurs, Force ouvrière avait dit, à l’époque, ne pas voir l’intérêt de négocier cette dernière avec les organisations patronales si l’inverse n’avait pas lieu. L’absence d’une telle négociation a donc conduit au choix de l’adhésion plutôt que de l’élection. Force est de constater qu’il y a deux poids, deux mesures, et que tout le monde n’est pas traité de la même façon dans l’espace de dialogue social. De surcroît, en l’absence de négociation, la question du hors champ n’a pas pu être traitée.
Force ouvrière est très attachée au principe de faveur. Nous n’avons donc aucun problème avec la primauté accordée aux conventions collectives de branche.
Pour ce qui est de la faiblesse des organisations syndicales, elle s’explique par le système particulier à la France de la couverture conventionnelle. Que la négociation d’un accord suffise à faire appliquer cet accord à l’ensemble des salariés n’est pas de nature à susciter l’appétence pour l’adhésion syndicale ou la participation aux élections professionnelles qui peut exister dans les pays nordiques ou anglo-saxons. À cet égard, il y aurait autant à dire du taux d’adhésion à des partis politiques que du taux de syndicalisation. C’est notre système qui le veut ainsi : en démocratie, chacun est libre de voter et de participer ou non.
En soi, la restructuration des branches par fusion ou élargissement ne nous pose pas de problème puisque cela existe déjà dans le cadre des négociations de branche, lorsque certaines sont en panne. Nous sommes d’accord avec l’article 15 et la faculté pour le ministre d’élargir ou de fusionner, à condition toutefois de préciser qu’il ne peut le faire qu’après avis conforme de la Commission nationale de la négociation collective et du Haut conseil du dialogue social, de façon à pouvoir faire entendre nos positions dans la défense des intérêts des nombreux salariés qu’une telle opération concernerait.
Mme la présidente Catherine Lemorton. Merci, mesdames, messieurs, pour ce tour d’horizon sinon exhaustif du moins assez complet. Je rappelle que le projet de loi sera présenté mercredi prochain en conseil des ministres.
*
* *
2. Audition des représentants de la CGT
La Commission des affaires sociales entend des représentants de salariés (CGT) sur le projet de loi relatif à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale, au cours de sa deuxième séance du mercredi 15 janvier 2014.
Mme la présidente Catherine Lemorton. Après avoir entendu les syndicats signataires de l’accord national interprofessionnel (ANI) du 14 décembre dernier, nous recevons maintenant la CGT, afin de connaître les raisons l’ayant conduite à ne pas le signer ainsi que les points qui pourraient néanmoins la satisfaire.
Mme Agnès Le Bot, secrétaire confédérale de la CGT. Je présenterai tout d’abord notre délégation : membre de la direction confédérale, Catherine Perret est chargée de la formation professionnelle. Administrateur de la CGT, Éric Lafont s’occupe notamment des questions de financement. Enfin, je suis moi-même membre du bureau confédéral, chargée de la démocratie sociale. Nous vous remercions de prendre le temps de nous auditionner au sein de cette commission.
Le projet de loi qui vous occupe aujourd’hui porte sur des sujets très divers, touchant très concrètement à la vie des salariés dans leur rapport au travail. La CGT considère l’emploi, la formation professionnelle et la démocratie sociale comme des enjeux majeurs. L’élévation du niveau de qualification des salariés nous paraît en effet nécessaire pour assurer le progrès social, la dynamique de l’emploi et le développement économique. Quant à la démocratie sociale, elle doit avoir pour objectif le progrès social et constituer un instrument de citoyenneté pour les salariés.
Le projet comprend trois titres : le premier porte sur la formation professionnelle et l’emploi, le deuxième sur la démocratie sociale et le troisième, sur la dimension régalienne de l’inspection et du contrôle des politiques de l’emploi, du travail et de la formation professionnelle. Derrière ces titres se profilent plusieurs questions majeures qui devraient faire l’objet de vos discussions concrètes : la qualification et la sécurisation des salariés dans leur parcours professionnel ; la représentation collective des salariés et notamment le droit pour tous les salariés à une instance représentative du personnel qui soit utile à leurs yeux ; la qualité des consultations démocratiques des salariés que sont les élections professionnelles et les élections prud’homales ; les conditions d’exercice du droit syndical et du financement des syndicats ; les missions et moyens du service public de l’Inspection du travail ; enfin, la production de normes sociales au niveau de la branche et au niveau interprofessionnel. Or, ce ne sont pas forcément ces enjeux qui ressortent le plus dans le débat public. Il nous faut d’ailleurs admettre que nos efforts pour permettre aux salariés de s’approprier pleinement les enjeux qui les concernent se heurtent à certaines limites – fait qui constitue déjà en soi un problème pour la démocratie sociale.
Quant à la méthode retenue pour élaborer ce projet de loi, elle a varié selon les thématiques abordées. Le volet relatif à la formation professionnelle fait suite à l’ANI de décembre 2013. Le fait que la CGT ne soit pas signataire de cet accord – qui amoindrit les obligations de formation des grandes entreprises et crée des droits virtuels sans prévoir les financements correspondants – ne remet nullement en cause son investissement dans cette négociation. Nous avons en effet défendu la nécessité de plus de formation, en reliant formation, qualification et salaire.
La lettre de cadrage du Gouvernement était extrêmement précise et contraignante : elle fixait le principe, les objectifs à atteindre et la durée de la négociation.
Nous sommes attachés à la consultation systématique des organisations syndicales sur toute réforme du droit du travail, considérant qu’il s’agit là d’une évolution logique de la démocratie sociale. Les organisations syndicales disposent en effet d’une expertise que rien ne remplace puisqu’elle s’appuie sur leurs adhérents, les élus dans les entreprises et leur rapport aux salariés. Ainsi notre participation permet-elle d’enrichir le débat républicain et démocratique. Nous contestons cependant l’idée que les accords nationaux interprofessionnels doivent être rigoureusement transcrits dans la loi, ce qui priverait le législateur de sa légitimité d’intervention. Ces accords entérinent en effet un compromis issu d’un rapport de forces entre des propositions contradictoires. Mais la loi, elle, est censée porter l’intérêt général, et elle doit viser à réduire les inégalités. Vous avez donc, à notre sens, un vrai rôle à jouer dans l’élaboration de ce titre premier.
Il en va d’ailleurs de même des autres volets du texte ayant fait l’objet d’une concertation avec le Gouvernement. Nous avons relevé que l’exposé des motifs qualifiait cette concertation de « large et approfondie ». Or, notre appréciation est sensiblement différente : certes, il y a eu concertation, mais l’on ne retrouve dans ce projet de loi que ce qui fait consensus entre les acteurs syndicaux et patronaux. Nous verrons en quoi cela affaiblit, selon nous, l’ambition d’une véritable démocratie sociale. Il est par ailleurs des thèmes, sur lesquels des désaccords mais aussi des propositions ont été exprimés, qui n’ont pas fait l’objet d’une véritable concertation : c’est notamment le cas de la représentativité patronale et des élections prud’homales.
Enfin, la procédure accélérée souhaitée par le Gouvernement, sur un projet de loi aussi large, nous paraît bien peu valorisante en matière de démocratie sociale.
J’en viens à l’appréciation que nous portons sur les différents titres du projet de loi.
En l’état actuel, le titre premier tend à traduire au niveau législatif les dispositions de l’ANI du 14 décembre 2013 et une partie des conclusions de la concertation relative au compte personnel de formation (CPF) et au conseil en évolution professionnelle. Ce faisant, il s’éloigne fortement des orientations annoncées dans le document remis par le ministre du travail aux organisations syndicales et patronales le 8 juillet 2013. L’ambition exprimée dans la lettre de cadrage a pour le moins été revue à la baisse avec un ANI a minima dont l’équilibre général interroge la première organisation syndicale que nous sommes et sur lequel – fait quasi inédit – une organisation patronale a refusé d’apposer sa signature. La question de l’accès des salariés issus des très petites entreprises (TPE) et des PME à une formation qualifiante reste ouverte. Sans réclamer une nouvelle négociation, la CGT souhaite toujours que le projet de loi permette des avancées en matière de sécurisation des parcours professionnels. Pour y parvenir, il faut que le Parlement joue tout son rôle en vue d’améliorer le projet de loi initial.
Nous partageons tous le diagnostic selon lequel ce qui rend une formation attrayante, c’est la promotion professionnelle qu’elle peut générer. Il convient donc que la loi tende à cette fin. Selon la CGT, le projet de loi doit rétablir un équilibre et notamment encadrer la définition des actions de formation à visée qualifiante entrant dans le périmètre du compte personnel de formation. Il convient de fonder ce nouveau dispositif – qui ne constitue pas un droit à formation mais seulement un droit d’initiative –, en affirmant de nouvelles garanties collectives qui permettent de le rendre opposable dans l’entreprise. Il faut pour cela rendre le plan de formation obligatoire et inscrire sa construction et son suivi dans le cadre d’une délibération sociale au sein de toutes les entreprises. On pourrait ainsi créer un droit d’alerte sur l’employabilité et donner corps à l’obligation de former en instituant une obligation formelle d’adaptation et de maintien de la capacité à occuper un emploi.
L’obligation légale de financement du compte personnel de formation doit s’élever au minimum à 0,2 % de la masse salariale annuelle brute de l’entreprise et être généralisée sous trois ans à l’ensemble des entreprises. Ce compte doit être en effet le même pour toute personne, quelle que soit la région ou l’entreprise dans laquelle elle travaille. C’est pourquoi la CGT réclame également que la gestion de ces 0,2 % soit assurée par une instance nationale interprofessionnelle paritaire telle que le Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels.
Le texte permet à une entreprise de se soustraire pour trois ans à la mutualisation du financement du CPF par accord d’entreprise, sur la base d’un raisonnement proche d’une logique d’assurance individuelle : toucher à hauteur de ce que l’on paie. Il s’agit là d’un fractionnement du financement du CPF qui, compte tenu de la faiblesse des obligations prévues, risque de ne même pas porter le nombre de CPF financés à la hauteur du volume des droits individuels à formation prioritaires (DIF) et des DIF portables constatés en 2012. La CGT est donc résolument opposée à cette échappatoire.
Nous reviendrons sur le détail des différents articles du texte au cours du débat si vous le souhaitez.
Consacré à la démocratie sociale, le titre II aurait dû traiter de la représentativité patronale, comme le revendiquait la CGT. En effet, ce sujet concerne au plus haut point les organisations syndicales de salariés puisque les critères de représentativité patronale conditionnent la production de droits et garanties collectives des salariés. La CGT regrette que ce projet de loi exclue la mesure de l’audience patronale par l’intermédiaire d’un vote des employeurs alors que plusieurs confédérations syndicales de salariés y sont favorables. D’autre part, les propositions formulées pour asseoir l’audience sur un vote des employeurs auraient mérité une concertation approfondie. Il est incompréhensible que la position commune rendue publique par trois organisations patronales constitue la source principale du texte – ainsi que le reconnaît le ministère dans l’exposé des motifs du projet de loi –, d’autant plus que les organisations patronales avaient, elles, participé en 2008 à la négociation relative à la représentativité syndicale et que la négociation collective est un droit constitutionnel des salariés et non du patronat.
Il est pour le moins curieux de faire reposer l’audience sur l’adhésion. Voilà qui pourrait s’apparenter à une forme de suffrage censitaire : pour pouvoir compter, il faut payer ! Ce faisant, le projet de loi ne garantit nullement la transparence nécessaire au contrôle de ce critère, tout particulièrement en ce qui concerne la multi-adhésion. En effet, dans ce cas, ce serait l’organisation de branche qui répartirait les voix entre les organisations nationales interprofessionnelles auxquelles elle est adhérente, ce qui ouvrirait la porte à des abus.
L’instauration d’un droit d’opposition des organisations patronales à l’extension d’un accord, même si elle reste soumise à des conditions d’effectifs, porte atteinte à la procédure d’extension qui doit demeurer de la compétence de l’État. Elle affaiblit ainsi le droit constitutionnel des salariés à la participation et risque d’entraîner une diminution du nombre d’accords étendus.
Sur le volet de la représentativité syndicale, le projet de loi comporte des aménagements de nature à améliorer la mise en application de la loi de 2008. Ceux-ci sont le fruit du travail conséquent qui a été mené au sein du Haut conseil du dialogue social.
Nous saluons la reprise dans le projet de loi d’une disposition importante portée par trois organisations syndicales : les délégués syndicaux pourront à nouveau être désignés dans un périmètre moins important que celui des comités d’entreprise. Le MEDEF s’opposant à cette disposition, qui favorise une activité syndicale de proximité avec les salariés, nous vous invitons à rester vigilants dans le cadre du débat parlementaire.
Pour autant, le projet de loi manque d’ambition et ne permet pas de franchir le cap nécessaire en matière de démocratie sociale. La loi devrait en effet énoncer le principe de validation des accords sur la base d’accords collectifs majoritaires à au moins 50 %, d’autant que les dispositions actuelles, qui fixent cette majorité à 30 % en l’absence d’opposition d’une organisation ayant recueilli une majorité, avaient été conçues comme transitoires dans la position commune.
Le fait qu’il ne soit pas institué de représentants élus ni de commissions paritaires territoriales pour les salariés des TPE entache le volet démocratie sociale de ce projet de loi. Le Gouvernement s’est en effet contenté d’envisager dans l’exposé des motifs une concertation complémentaire au sein du Haut conseil du dialogue social et une éventuelle traduction législative d’ici 2017. Or, les 4,6 millions de salariés qui travaillent dans de très petites entreprises ne disposent pas, pour la majorité d’entre eux, de représentants élus ni d’instances représentatives dotées de compétences. Des propositions existent pour corriger ce défaut de démocratie sociale. Si la concertation a besoin d’être poursuivie, le législateur ne peut se contenter de maintenir le statu quo.
L’article 19 du projet de loi, qui concerne les juges prud’homaux, est inacceptable pour la CGT. La possibilité d’agir devant le conseil de prud’hommes est partie intégrante des garanties collectives dont disposent les salariés pour faire respecter leurs droits – 98 % des 200 000 affaires traitées chaque année par les prud’hommes sont à l’initiative des salariés. Les conseillers prud’hommes sont donc une force inestimable pour les salariés qui veulent obtenir réparation d’un préjudice subi. Leur légitimité ne peut être garantie que par l’élection au suffrage universel. Supprimer le vote prud’homal constituerait un déni de démocratie – ce serait supprimer la dernière élection sociale, qui plus est par ordonnance.
L’idée de désigner les conseillers prud’hommes sur le fondement de la représentativité ne résiste pas à l’analyse. Les salariés ne votent pas aux élections professionnelles pour élire des conseillers prud’hommes mais pour déterminer une représentativité syndicale donnant le pouvoir de négocier en leur nom des accords collectifs. Dès le lendemain du scrutin de 2008, la CGT a exprimé la volonté que soient étudiées les causes de l’abstention pour y porter remède. Or, la seule réponse fut la commande du rapport Richard qui, malgré notre demande, n’a nullement conduit à la création d’un groupe de travail. De plus, les personnes privées d’emploi seraient aussi privées de leur droit de vote, c’est-à-dire sans moyen de s’exprimer ! Autre argument avancé, le coût des élections serait trop important : mais on ne peut sacrifier une élection démocratique qui concerne 19 millions de personnes sous prétexte de faire des économies !
Commandé en 2010 par le précédent Gouvernement, le rapport Richard mettait en garde contre le risque d’inconstitutionnalité que présentait le mode de désignation retenu, compte tenu de l’impossibilité pour des citoyens, dans les conditions définies par la loi, de se présenter à l’élection des juges, dès lors que la représentativité imposerait le « filtre syndical ».
Rien n’oblige à adopter cet article couperet qui entacherait singulièrement la démocratie sociale. La CGT a formulé des propositions sur le sujet et reste disposée à participer à une réflexion qui viserait à conforter la juridiction prud’homale, notamment en instituant un vote dédié des salariés en faveur de leurs conseillers prud’homaux. Cela nécessite d’organiser les élections pour 2015.
L’article 17, qui concerne le financement des organisations syndicales et patronales, met en place un fonds paritaire de centralisation et de répartition des subventions publiques et contributions existantes – la définition des méthodes concrètes de détermination du niveau de ces financements étant renvoyée à des décrets en Conseil d’État et à une négociation nationale interprofessionnelle encadrée par décret. Quelques remarques sur cet article : si la création d’un tel fonds fait partie de nos revendications, il ne s’agit pas selon nous de substituer de nouveaux financements à ceux existants mais de permettre le financement de la mise à disposition de salariés pour l’activité syndicale. Le fonds serait assis sur une cotisation de toutes les entreprises permettant de rembourser la rémunération totale des syndiqués mis à disposition aux entreprises maintenant leur salaire. Or, le fonds institué par le projet de loi ne répond pas à cette revendication. Pour cela, il conviendrait d’instituer un droit des organisations syndicales à la mise à disposition de salariés de toute entreprise ; intégrer le remboursement de la rémunération des salariés mis à disposition parmi les missions du fonds ; et enfin, intégrer ce financement dans la cotisation patronale minimale dont un décret en Conseil d’État déterminerait le niveau.
Deux autres questions importantes ne sont pas traitées dans le projet de loi. Il s’agit, d’une part, du droit des confédérations syndicales de salariés de justifier de l’utilisation de subventions et contributions de façon totalement interprofessionnelle, c’est-à-dire pour les salariés du public comme du privé. On sait que ce droit est nié par la Cour de Comptes. Et d’autre part, du droit à l’hébergement syndical des unions territoriales interprofessionnelles des confédérations.
Question essentielle, la détermination du niveau du fonds concerne tant la cotisation des entreprises que la contribution des institutions paritaires autres que celles de la formation professionnelle et la subvention de l’État. S’agissant de la répartition, il est injuste que l’audience des organisations syndicales ne soit pas prise en considération dans la répartition de la part de la subvention publique. En effet, la répartition forfaitaire des subventions crée d’importantes inégalités dans le financement des confédérations. Alors que les ressources de celles qui ont le plus d’adhérents, c’est-à-dire les plus représentatives, reposent majoritairement sur les cotisations, le financement de celles qui ont peu d’adhérents dépend majoritairement des subventions. Une telle situation est intolérable car elle risque d’alimenter des campagnes médiatiques de dénigrement du syndicalisme amalgamant toutes les organisations.
Le titre III du projet de loi porte sur l’Inspection du travail, service public essentiel à la protection des salariés contre les abus du patronat. Son autorité repose sur trois critères essentiels : son indépendance, assurée par la convention 81 de l’Organisation internationale du travail (OIT) ; sa fonction généraliste, qui lui permet une présence dans toutes les entreprises ; et son maillage territorial de proximité qui la rend accessible à tous. Or en l’état actuel, le projet de loi remet en cause ces critères et, s’il était adopté tel quel, il provoquerait immanquablement un bouleversement parmi le personnel et porterait dangereusement atteinte à la protection des salariés. De fait, le texte remet en question l’indépendance du corps de l’Inspection du travail, transforme ses missions en amoindrissant les contrôles dans les entreprises, et en particulier dans les TPE, et désorganise son maillage territorial. Et, sous couvert d’une évolution de carrière d’une partie des agents, une vraie menace continue de peser sur les effectifs de contrôle et des autres personnels. Or, ce dont a besoin l’Inspection du travail, c’est de moyens humains pour assurer ses missions de contrôle, d’un doublement de ses sections pour pouvoir être encore plus proche des salariés, et de la reconnaissance du travail des agents de contrôle, fondée notamment sur un véritable déroulement de carrière pour les catégories C, B et A. Il convient aussi de permettre aux inspecteurs du travail de constater la situation de travail des salariés, en particulier s’ils sont en situation de vulnérabilité, pour les aider à s’en sortir, et de recevoir localement et directement tout salarié qui le demande.
Si la concertation prévue au niveau départemental en vue de développer les échanges et le partage d’expérience peut constituer une bonne idée, elle ne saurait être confondue avec une subordination des inspecteurs.
Enfin, la lutte contre le travail non déclaré doit pouvoir se construire entre l’inspecteur du travail « local », les organisations syndicales et les représentants du personnel, mieux à même d’être efficaces que n’importe quel « groupe national d’intervention ».
Voilà notre appréciation d’ensemble de ce texte, mais nous répondrons volontiers à vos observations.
M. Jean-Patrick Gille. Votre intervention nous laisse un peu sur notre faim, s’agissant de l’ANI. Sans vous opposer au principe de la mise en place d’un compte personnel de formation, vous semblez exprimer une certaine déception quant aux modalités retenues pour son instauration. Vous appuyant sur une analyse quasi « fiscale » du statut du prélèvement de 0,2 % dédié au financement de ce compte, vous proposez qu’il soit géré par le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP), contrairement à ce que prévoit l’accord. Que pensez-vous du fonctionnement de ce fonds, tel que le redéfinit l’article du projet de loi qui lui est consacré ?
Que pensez-vous de la régionalisation et de la nouvelle gouvernance prévues par le texte en matière de formation ? Le projet de loi tend à remettre les partenaires sociaux « dans la boucle », eux qui avaient été évincés du dispositif lors de la création de Pôle emploi : considérez-vous qu’ils auront partout les moyens de remplir leur mission en ce domaine ? Que pensez-vous du poids important accordé aux branches par le texte ?
Enfin, concernant le compte personnel de formation, quel regard portez-vous sur les modalités d’élaboration des listes prévues par le texte ?
M. Gérard Cherpion. Votre exposé nous a permis de bien comprendre les raisons pour lesquelles vous n’aviez pas signé l’ANI, ainsi que vos positions sur les dispositions du projet de loi qui dépassent le cadre de négociation de cet accord. Si vous rejetez globalement ce texte, quels aspects de celui-ci jugez-vous néanmoins positifs ? Nous estimons pour notre part qu’il représente une avancée, s’agissant en particulier du compte personnel de formation.
Le projet de loi renforce également la participation des partenaires sociaux à la prise de décision non seulement au niveau national mais également au niveau régional – s’agissant notamment de la détermination des formations « qualifiantes » : que pensez-vous du système de listes prévu par le texte ? Nous ignorons en effet si elles seront établies à l’échelon national, régional ou encore au niveau des branches, et si elles concerneront tant les demandeurs d’emploi que les salariés.
Enfin, qu’entendez-vous lorsque vous affirmez que « faire reposer l’audience sur l’adhésion ne garantit pas la transparence » ?
M. Christophe Cavard. Je souhaiterais revenir un instant sur la question du dialogue social, que nous avions déjà abordée lors du débat sur le projet de loi de sécurisation de l’emploi. Selon vous, l’ANI signé en décembre dernier découle d’un rapport de forces entre partenaires sociaux. Vous nous renvoyez donc à nos responsabilités de parlementaires, estimant que nous pourrions faire évoluer le texte. Or, notre groupe considère pour sa part que le dialogue social s’est nettement renforcé et amélioré depuis la précédente législature. Cela faisait en effet bien longtemps qu’un accord national interprofessionnel (ANI) n’avait pas pu être aussi bien retranscrit dans un projet de loi qu’aujourd’hui. Et il ne faudrait pas croire que la négociation et le rapport de forces n’existent pas au Parlement ! Il n’y a pas, d’un côté, la négociation entre les partenaires sociaux et, de l’autre, un Parlement constitué d’un bloc uni. Nous serions donc plutôt enclins à veiller au respect de l’équilibre de l’ANI, ce qui n’empêche pas les parlementaires d’améliorer le texte, voire de trancher certaines questions.
D’autre part, les écologistes se réjouissent de la régionalisation de certains enjeux du dialogue social tels que la formation. De nouveaux organismes seront ainsi amenés à prendre des décisions, et notamment à déterminer la liste des formations pouvant être prises en compte dans le cadre du compte personnel de formation. Les syndicats de salariés n’ayant guère coutume de débattre à ce niveau, comment le vôtre compte-t-il s’organiser à cette fin ?
Si la CGT a toujours soutenu l’idée d’une formation individualisée tout au long de la vie, vous semblez redouter un manque de moyens financiers pour valoriser le compte personnel de formation : quelles seraient vos propositions concrètes pour permettre à ce compte de jouer pleinement son rôle, tant en faveur des salariés que des demandeurs d’emploi ? Il doit en effet constituer selon nous un levier de la politique de l’emploi que nous menons depuis plusieurs mois.
Mme Jacqueline Fraysse. Nous trouvant au tout début de l’examen de ce texte, nous sommes là avant tout pour vous entendre plutôt que pour vous interroger. J’ai bien entendu vos préoccupations quant à la méthode retenue pour élaborer ce texte et à son contenu même. Quel est votre avis sur le plafonnement des heures de formation et sur les listes de formations éligibles ? Nous avons bien compris que vous contestiez le fait que l’on ne discute pas de la représentativité patronale et nous sommes nous aussi très préoccupés par l’éventualité d’une suppression des élections prud’homales. Vous avez également dénoncé le fait que ce texte n’accroisse pas les droits des salariés.
Dans un souci de pragmatisme, il est cependant nécessaire de formuler des propositions afin de tenter d’améliorer ce projet de loi, malgré un contexte que je me passerai ici de commenter. Nous sommes quant à nous prêts à y travailler. J’insisterai donc à mon tour sur le fait que si la démocratie sociale et les accords ont leur importance, ils ne sauraient remettre en cause le rôle des députés qui, compte tenu de leurs responsabilités nationales, doivent imposer les dispositions qui leur paraissent aller dans le sens de l’intérêt des salariés et des entreprises de ce pays.
Mme Monique Iborra. Que pensez-vous du traitement réservé par le projet de loi aux demandeurs d’emploi ? Quelle est votre position sur cette gouvernance qualifiée de « décentralisée » – bien qu’elle ne le soit guère – et sur la détermination des listes de formations ? Enfin, si le MEDEF tend à s’organiser au niveau régional, les organisations syndicales de salariés semblent très attachées au niveau national : cela vous paraît-il efficace pour le dialogue social ?
Mme Isabelle Le Callennec. Dans l’appréciation que vous portez sur l’ANI et le projet de loi, vous accordez une large place à la représentativité, au financement du paritarisme et à l’inspection du travail. Vous êtes moins diserts sur la formation professionnelle, sur laquelle nous sommes pourtant tous attendus, élus comme partenaires sociaux.
La loi doit être garante de l’intérêt général, avez-vous dit, et permettre de lutter contre les inégalités. Mais l’actualité nous rappelle tous les jours que la situation est plus difficile pour certains salariés que pour d’autres – selon que leur emploi est exposé ou non – sans compter les demandeurs d’emploi.
Au sujet de la représentativité, vous avez souligné l’abstention lors des élections prud’homales. Quels sont les causes de ce phénomène selon vous ?
S’agissant du compte personnel de formation, vous estimez, contrairement aux organisations signataires de l’ANI, qu’il ne crée pas de droit à la formation, faute de financement suffisant, et qu’il remet en cause la mutualisation. Avec l’employabilité, vous posez une bonne question, celle de l’attractivité des formations : si les salariés ne perçoivent pas l’utilité d’une formation, ils ne perdront pas leur temps à la suivre.
Dernière question, quelles seront les marges de manœuvre de vos représentants au niveau local ?
M. Michel Liebgott. Sur la méthode, les organisations syndicales qui vous ont précédé ont exprimé le souhait d’une amélioration du texte sur certains points et d’une consultation sur sa mise en œuvre. De votre côté, vous réfutez les grandes lignes de l’ANI et du projet de loi qui en est la traduction.
Pouvez-vous néanmoins nous indiquer quelles dispositions sont à votre avis susceptibles d’améliorer la situation des salariés et quelles sont celles qui portent atteinte à leurs intérêts ? Nous n’entendons pas chambouler le texte mais l’améliorer. Vous défendez une position très différente des autres signataires, mais si vous avez noté une difficulté majeure, nous ne voudrions pas passer à côté. Pour le reste, plusieurs mesures – l’entretien sur la formation, le CPF, la décentralisation – me paraissent plutôt positives.
Mme Véronique Louwagie. L’un de vos arguments pour refuser de signer l’ANI a retenu mon attention : selon vous, l’accord emporte un affaiblissement des obligations des entreprises en matière de formation. Cette analyse ne me paraît pas pertinente. La seule question qui vaille est de savoir si ce dispositif constitue une avancée pour la formation des Français.
Je souhaite connaître votre avis sur le dispositif actuel de mutualisation en matière de formation. Avec un montant collecté de 6,3 milliards d’euros, peut-on considérer qu’elle est effective ?
Vous avez souligné trois caractéristiques essentielles de l’inspection du travail – l’indépendance, la fonction généraliste et le maillage territorial – pour regretter qu’elles disparaissent dans le texte. Celui-ci apporte pourtant, me semble-t-il, des moyens supplémentaires. Comment améliorer la lutte contre le travail non déclaré afin de poursuivre l’indispensable combat contre la fraude ?
Enfin, vous n’avez guère abordé la question de la décentralisation ni évoqué l’utilité d’une cartographie territoriale des emplois et des compétences.
M. Denys Robiliard. Vous n’avez pas commenté les dispositions relatives à la transparence financière des comités d’entreprise : est-ce à dire qu’elles ne posent pas de problème ?
Vous regrettez le défaut de concertation sur la réforme de la représentativité patronale et réclamez une symétrie avec celle de la représentativité salariale, notamment l’organisation d’élections. Mais l’asymétrie est le reflet de situations différentes. Il faut tenir compte de la taille des entreprises, qu’il s’agisse du volume de production ou du nombre de salariés. Comment envisagez-vous la représentativité patronale ? Pensez-vous que le vote de l’usine Renault puisse avoir le même poids que celui du garage de proximité ?
Enfin, l’ordonnance envisagée par le projet de loi entend apporter une réponse à la baisse de la participation aux élections prud’homales. Comment remédier à cette difficulté tout en maintenant ces élections ? Une participation très faible met en cause la légitimité des conseils de prud’hommes. Dans le collège des employeurs, la présentation fréquente de listes uniques ne peut-elle pas expliquer la faible participation ?
M. Pierre Morange. J’aimerais connaître votre opinion sur le compte personnel de formation (CPF) dont la création témoigne d’une philosophie nouvelle, substituant à une logique de statut une logique d’emploi. Quel regard portez-vous sur la portabilité des droits qu’il met en place dans la continuité de la sécurisation des parcours professionnels ? Le CPF doit-il comptabiliser seulement un nombre d’heures ou peut-il intégrer une part de monétisation ?
Mme Catherine Perret, membre de la Commission exécutive confédérale. Ma réponse ne saurait être exhaustive, compte tenu du nombre de questions posées, et je vous prie de m’en excuser.
Vous l’avez compris, la sécurisation des parcours professionnels est une préoccupation majeure de la CGT. Nous défendons l’idée d’une sécurité sociale professionnelle et nous revendiquons la paternité du droit individuel à la formation (DIF) mis en place en 2003.
Nous portons une appréciation négative sur l’accord national interprofessionnel et le projet de loi car on manque l’occasion de mener une réforme de fond permettant la création d’un véritable droit à la formation. Le compte personnel de formation ne constitue pas un droit à la formation. Il donne au salarié un droit d’initiative mais les contraintes auxquelles il est soumis ne permettront pas d’améliorer l’accès à la formation. Aujourd’hui 6 à 7 % seulement des salariés bénéficient d’un DIF. Ce n’est pas suffisant.
Si un diagnostic partagé a permis de remplacer le DIF par le CPF, le projet de loi n’apporte pas les remèdes appropriés, qu’il s’agisse d’augmenter le nombre de bénéficiaires ou de faciliter l’accès pour les salariés, en activité ou non, qui en ont le plus besoin. À cet égard, nous avons souligné le décalage entre l’ANI et la lettre de cadrage du ministre qui relevait les difficultés d’accès des salariés les plus fragiles aux formations qualifiantes. Cela concerne les salariés les moins qualifiés ou ceux travaillant dans les entreprises les plus petites – les cadres des TPE sont ainsi moins formés que ceux des grandes entreprises. Le projet de loi en l’état ne répond pas à ce problème alors que la concertation quadripartite avait permis des avancées. Les éléments positifs du CPF sont d’ailleurs le fruit de cette concertation.
L’universalité du CPF, que nous appelons de nos vœux, exige d’améliorer notablement le projet. Elle suppose de s’intéresser aux salariés du secteur privé mais aussi à tous les autres, le « hors champ » – 5 millions de salariés –, le secteur public ou les travailleurs indépendants, ce que le projet de loi ne fait pas. Les travaux parlementaires devront y remédier.
Nous sommes déçus car notre ambition était plus grande. Le contexte économique exige des efforts importants de la Nation en faveur de la formation. Les attentes fortes des salariés seront déçues car le financement du CPF ne permettra pas l’accès à la formation qu’on leur fait miroiter.
Nous suggérons donc plusieurs modifications.
L’ANI est éloigné de nos propositions en matière de financement. Au cours de la négociation, notre position sur la contribution des entreprises a évolué. Mais nous souhaitions instituer un garde-fou consistant, pour les entreprises, à passer de l’obligation de dépenser à l’obligation de former. Nous avions proposé d’abaisser la cotisation obligatoire mais parallèlement d’obliger toutes les entreprises à établir un plan de formation et à mettre en place un suivi de celui-ci. Conscients des contraintes des petites et moyennes entreprises, nous avions envisagé une mise en place progressive de l’obligation, accompagnée d’un soutien aux plus petites entreprises par le biais des organismes paritaires collecteurs agréés. Cette obligation devait s’inscrire dans le cadre d’une réflexion approfondie en matière de gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences (GPEC) territoriale afin de prendre en compte les spécificités régionales et de bassin. Nous n’avons pas eu gain de cause sur ce dispositif, qui aurait conféré au salarié un droit d’initiative opposable. Il me semble important d’y revenir.
Concernant les listes, nous proposions que soient déterminées dans le cadre de la délibération sociale de l’entreprise des formations prioritaires répondant aux besoins des salariés comme à ceux de l’entreprise. Grâce au compte personnel de formation, le salarié aurait un accès prioritaire à ces formations afin d’évoluer et de se reconvertir. La CGT tient également à ce que le CPF se traduise par un droit à l’évolution et à la promotion professionnelle dans l’entreprise et, au-delà, dans la branche. L’attractivité des formations est liée à la reconnaissance accordée au salarié par l’entreprise ou la branche pour l’effort qu’il a consenti afin d’obtenir une nouvelle qualification. Cette reconnaissance peut s’inscrire dans le cadre de la GPEC. Le projet de loi est loin d’octroyer les garanties collectives que nous attendons.
La CGT a obtenu l’instauration d’un entretien sur la formation professionnelle. Le projet de loi est néanmoins mal rédigé sur ce point. Il importe de préciser que cet entretien doit être distinct des autres entretiens et qu’il n’est pas un entretien d’évaluation. La systématisation de l’entretien de formation professionnelle, ainsi que le plan de formation professionnel délibéré, sont de nature à favoriser une meilleure égalité d’accès à la formation dans l’entreprise. Vous avez encore la possibilité de densifier cette partie.
L’ouverture et la fermeture des droits au CPF sont un autre sujet de débat. Pour créer un CPF universel, l’ouverture doit être possible dès 15 ou 16 ans, quelle que soit l’activité de la personne et sans lien avec l’entrée sur le marché du travail ou une inscription à Pôle emploi. Dans le cas contraire, on réduit l’universalité du CPF. Il faut également tenir compte du cas des femmes. Parce que nous croyons à un droit à la formation équivalent à la sécurité sociale, nous avions proposé que le CPF soit géré par une branche de la sécurité sociale.
Quant à la fermeture des droits, il semble injuste qu’elle intervienne lors de la liquidation de la retraite. Il faut vous interroger sur l’utilité sociale des retraités. Il pourrait être judicieux de conserver les droits à formation non consommés aux retraités qui s’engagent dans le monde associatif ou dans des missions intérêt général. La CGT propose que les droits soient maintenus pendant un an après la liquidation des pensions afin d’inciter les retraités à se former.
Il importe également que le salarié conserve dans le cadre du CPF le droit d’initiative qui avait été acté dans le DIF. La décision d’utiliser le CPF doit appartenir entièrement au salarié, qu’il soit en activité ou privé d’emploi. Cela vaut particulièrement pour les chômeurs signataires d’un contrat de sécurisation professionnelle dont les droits issus du CPF pourraient être siphonnés par leur adhésion à un parcours de sécurisation. Le projet de loi n’est pas suffisamment précis sur ce point. En outre, il convient de bien distinguer le congé individuel de formation et le CPF.
La CGT a plaidé pour un passage du plafond d’heures de formation à 150 heures car, depuis la mise en place du DIF, le nombre d’heures nécessaires à la professionnalisation a augmenté. Il a été décidé que ces 150 heures pourront être utilisées sur neuf ans au lieu des six ans que nous demandions. Ce choix présente un risque de lissage. En l’état, le projet de loi ne préserve pas d’un risque de régression par rapport au droit existant.
Quant au financement, la CGT avait évalué au plus bas à 0,4 % la part de la contribution obligatoire devant être dédiée au CPF pour réussir à cibler les publics les plus fragilisés. Avec 0,2 %, on est loin du compte…
Autre problème majeur, le fonds dédié au CPF n’est pas sécurisé. L’ANI prévoit que les entreprises peuvent s’en affranchir en cas d’accord de branche ou d’accord d’entreprise. Le projet de loi limite cette possibilité à l’accord d’entreprise. Selon nous, il faut la supprimer et obliger toutes les entreprises à dédier 0,2 % de leur masse salariale au CPF. L’existence d’un tel fonds serait un gage d’égalité pour les salariés sur l’ensemble du territoire. Sans cette garantie, le niveau de financement du CPF sera différent d’une région à une autre. Vous risquez de mettre en place une « assurance formation ». Nous demandons donc une généralisation de la contribution dédiée à 0,2 % avec l’espoir d’une montée en puissance qui nous semble inévitable.
La gouvernance a fait l’objet d’un travail approfondi dans le cadre de la concertation quadripartite. Nous approuvons l’instauration de deux niveaux de gouvernance. En revanche, reste posée la question de l’établissement de listes prioritaires. Nous souhaitons que soient définies des listes nationales issues du répertoire national des certifications professionnelles, à même de garantir l’égalité des salariés, la mobilité, la péréquation, etc. Nous ne sommes évidemment pas opposés à la détermination, en complément et par la concertation, de listes répondant aux besoins régionaux et locaux, voire de listes issues d’accords d’entreprise.
M. Éric Lafont, secrétaire confédéral. Les dispositions relatives à la transparence financière des comités d’entreprise sont la transcription pure et simple de la position commune adoptée il y a deux ans par les organisations patronales et syndicales ainsi que l’État – chose suffisamment rare pour être soulignée. Nous ne pouvons que nous en satisfaire.
S’agissant du financement du syndicalisme, nous sommes dans l’incapacité de porter une appréciation sur un texte qui nécessite cinq décrets d’application. Nous demandons d’ailleurs à être associés à leur rédaction, comme ce fut le cas pour la loi de 2008.
Nous déplorons que le dispositif ne repose pas uniquement sur la représentativité syndicale déterminée en 2008. Pis, il contourne la loi en faisant bénéficier toutes les organisations d’un financement public, forfaitaire de surcroît. Nous ne contestons pas le fait que toutes les organisations syndicales soient financées. Nous craignons néanmoins que le dispositif envisagé donne une prime aux petites organisations. Moins vous aurez d’adhérents, plus vous aurez de subventions. La CGT est financée à hauteur de 74,2 % par les cotisations de ses adhérents. Les grosses organisations vont devoir continuer à se défendre contre la fausse accusation selon laquelle elles sont principalement financées par des fonds publics.
Nous souhaitons que la mise à disposition soit le premier mode de financement public des organisations syndicales. Nous n’avons pas reçu de réponse sur ce point.
Enfin, les mesures relatives au fonds paritaire de financement répondent à une revendication de longue date. Elles permettront une plus grande transparence des organisations syndicales de salariés mais aussi d’employeurs.
Mme Agnès Le Bot. Nos échanges témoignent de la densité du projet de loi et sont donc appelés à se poursuivre.
Nous sommes évidemment favorables au dialogue social mais nous sommes soucieux du sens qu’on lui donne. Nous faisons la part des choses. Nous savons que certains peuvent écouter longuement sans entendre. Nous savons aussi qu’un seul acteur syndical peut être entendu.
À chaque accord national interprofessionnel conclu, se pose la question du rapport entre l’accord et la loi. Il interroge les acteurs sociaux comme le législateur avec une acuité singulière alors que les conditions de la négociation collective sont particulièrement dégradées. Depuis des années, les accrocs à la hiérarchie des normes et au principe de faveur sont nombreux. De ce fait, vous ne pouvez pas considérer aujourd’hui qu’un accord est porteur de l’intérêt général. Ce n’est pas vrai ! C’est pourquoi il importe que le législateur joue pleinement son rôle.
Quant à l’adhésion à une organisation patronale, elle obéit à une logique de fourniture de services. Cette préoccupation de l’employeur est légitime, mais très éloignée de l’un des fondements de la représentativité, à savoir le mandat donné pour négocier un accord. Nous ne sommes pas les seuls à proposer des modalités de calcul de l’audience fondées sur un vote des employeurs. Nous regrettons qu’il n’ait pas été possible d’aborder ce sujet, les organisations patronales s’y étant fermement opposées. Il faudra explorer d’autres voies.
Sur la question de la multi-adhésion, je ne vois pas de solution car la pratique est très répandue – les organisations patronales le reconnaissent elles-mêmes.
Nous savons que la participation des salariés aux élections prud’homales est problématique. Le Conseil supérieur de la prud’homie n’a pas travaillé comme cela était prévu depuis les dernières élections sur des pistes d’évolution. Il est possible de simplifier le scrutin – en supprimant des sections –, de faire campagne pour ces élections – celle-ci repose pour beaucoup sur les organisations syndicales – et de les faciliter. Nous avons proposé que le cycle électoral ouvert par la loi de 2008 serve de point d’appui pour travailler à des évolutions du scrutin prud’homal.
Le projet de loi supprime les élections prud’homales alors que des évolutions sont possibles. Il faut organiser les élections de 2015 et examiner les aménagements qui permettent aux salariés de conserver la pleine maîtrise de leur juridiction prud’homale.
Sur l’inspection du travail, la concertation a été difficile, tout comme l’écoute des syndicats du personnel, pourtant unis. Or, il faut renforcer les missions de service public de l’inspection. Dans la lutte contre le travail non déclaré, elle ne doit pas jouer le rôle des services de police, mais travailler avec les organisations syndicales pour éviter la généralisation du dumping social et faire que tout salarié travaillant en France ait accès au droit du travail français.
*
* *
3. Audition des représentants du MEDEF
La Commission des affaires sociales entend des représentants des employeurs (MEDEF) sur le projet de loi relatif à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale, lors de sa troisième séance du mercredi 15 janvier 2014.
Mme la présidente Catherine Lemorton. Nous poursuivons cet après-midi nos échanges avec les partenaires sociaux sur le projet de loi – ou plus exactement sur l’avant-projet de loi – relatif à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale. Après avoir reçu ce matin les représentants des syndicats de salariés, nous auditionnons maintenant ceux des organisations patronales, en commençant à nouveau par les organisations signataires de l’accord national interprofessionnel du 14 décembre 2013. Le secrétaire général de l’UPA ayant dû s’excuser au dernier moment pour raisons personnelles, nous n’entendrons à ce titre que les représentants du MEDEF, que je remercie d’avoir répondu à notre invitation.
Mme Florence Poivey, présidente de la commission éducation, formation et insertion du pôle social du MEDEF. Merci, madame la présidente, de nous accueillir à propos d’un accord que nous avons préparé et négocié trois mois durant, avec un enthousiasme que partageait Pierre Burban, secrétaire général de l’UPA – dont je regrette d’autant plus l’absence.
Je dirige aujourd’hui une PME industrielle du Massif Central, mais je suis née et j’ai grandi en Suisse, où la formation en apprentissage et en alternance constitue une voie d’excellence, de même que la formation continue. Aujourd’hui encore, il n’y a en Suisse romande que 30 % des jeunes à poursuivre des études à l’université ou dans une haute école, 70 % entrant dans la vie active par la voie de l’alternance ou de l’apprentissage. Autodidacte moi-même, je continue de me former en permanence. Je suis donc une militante de la formation professionnelle, convaincue de son rôle stratégique pour l’avenir de nos entreprises dans un monde en évolution auquel nous devons sans cesse nous adapter.
En négociant cet accord, le MEDEF a poursuivi deux objectifs : faire de la formation professionnelle, de la « montée en compétence » des hommes et des femmes de nos entreprises, un levier de compétitivité, et sécuriser leur parcours professionnel et leur mobilité. Nous y sommes d’autant plus déterminés que, selon les experts, 20 à 30 % des métiers qui seront exercés au sein de nos entreprises dans quinze ou vingt ans nous sont encore inconnus à ce jour, cependant que quelque 10 % du temps de travail de nos salariés sera consacré à la formation, sous une forme ou sous une autre.
Nous avons eu aussi deux obsessions : d’abord celle, partagée avec bon nombre de nos interlocuteurs, de placer les utilisateurs au cœur de notre réflexion et de nos propositions ; ensuite celle de simplifier drastiquement un dispositif dont la complexité et l’opacité sont apparues avec le recul comme les principaux obstacles auxquels se heurtaient les entreprises, surtout les TPE et les PME, lorsqu’il s’agissait de former leurs salariés. Sur ce dernier point, nous avons fait de grands progrès ; les précédentes auditions ont sans doute commencé de vous en convaincre.
Pour conférer à l’utilisateur – entreprise, salarié, demandeur d’emploi – un rôle central, nous nous sommes efforcés de lui donner à la fois plus de liberté et plus de responsabilité.
Aux yeux de l’entrepreneur, il fallait ainsi faire apparaître la formation non comme un étau de contraintes et de dépenses, mais comme un investissement d’avenir dans son capital le plus précieux : les hommes et les femmes de son entreprise. Nous avons donc proposé de le libérer de la « contribution obligatoire individuelle » – les 0,9 % de la masse salariale qu’il devait consacrer au plan de formation. En contrepartie, et pour donner corps à la responsabilité qui lui incombe de former ses collaborateurs, en fonction des besoins et de la stratégie de son entreprise, nous avons proposé d’instaurer une obligation d’entretien biennal dont le compte personnel de formation (CPF) sera le pivot, allant jusqu’à prévoir une sanction dans l’hypothèse où, par malheur, ni l’entretien ni la formation ne seraient au rendez-vous.
Pour simplifier la tâche des entreprises, les trois contributions à trois organismes différents seront remplacées par une seule. C’est à nos organismes, et non à l’entrepreneur lui-même, qu’il appartiendra de gérer la complexité résiduelle du système, irréductible car elle résulte de la grande diversité – de taille, de secteur, régionale – qui caractérise nos entreprises. Autre source majeure de simplification : la fin de l’imputabilité, qui représentait un véritable fardeau administratif. Enfin, le CPF sera géré à l’extérieur de l’entreprise, contrairement à ce qu’il en était pour le droit individuel à la formation (DIF).
Pour accroître la liberté du salarié, le MEDEF a souhaité que ce dernier puisse activer son CPF sans en référer obligatoirement à l’employeur lorsque la formation est dispensée en dehors du temps de travail. La mobilité étant appelée à se développer, il nous semble en effet essentiel de la sécuriser afin d’apaiser les craintes des salariés et, selon un cercle vertueux, celles qui retiennent l’employeur d’embaucher. Ainsi, le collaborateur d’un laboratoire qui ne posséderait pas la qualification de préleveur pourra activer son CPF afin de bénéficier d’une formation qualifiante en dehors de son temps de travail, dans l’hypothèse où son patron ne prendrait pas l’initiative de la lui proposer ; cela lui permettra de quitter son entreprise pour se faire embaucher par un autre laboratoire.
Afin de rendre le salarié responsable de sa formation, le CPF sera désormais entre ses mains, attaché à sa personne. S’il travaille deux ans dans une entreprise, puis trois ans dans une autre en ayant éventuellement connu une période de chômage entre-temps, son compte pourra être activé de la même manière, alors que les acquis du DIF étaient perdus lorsque l’on quittait son entreprise. Surtout, le CPF restera sa propriété – il pourra même, s’il le souhaite, garder le secret sur son utilisation. Ainsi, et grâce à l’entretien de compétence, le salarié deviendra coresponsable de son parcours professionnel, qui, jusqu’à présent, était surtout l’affaire de son supérieur ou du chef d’entreprise, du moins dans les PME et TPE.
Dans le même souci de responsabilisation, le CPF ne pourra être activé que pour des formations qualifiantes figurant sur des listes proposées par les branches ou par les régions, et destinées à développer des compétences dont les entreprises ou les territoires – et le « territoire France » lui-même – ont véritablement besoin. Il existe en moyenne 400 000 offres d’emploi non pourvues. Nous, organisations patronales, devrions être de bien meilleurs prescripteurs et, à cette fin, travailler avec les régions de manière beaucoup plus constructive.
La simplification bénéficiera aussi au salarié : il n’aura plus qu’un seul interlocuteur, le Fonds de gestion des congés individuels de formation (FONGECIF), et aura la possibilité de s’adresser à un conseiller en évolution professionnelle qui pourra lui-même mettre à profit tous les éléments disponibles dans les territoires.
Le même triptyque vaudra pour le demandeur d’emploi. Liberté : il pourra activer son CPF sans passer par les arcanes des autorisations de Pôle Emploi. Aujourd’hui, il lui faut attendre en moyenne sept mois avant d’accéder à une formation ; nous espérons diviser par deux ce délai, beaucoup trop long pour lui permettre de rebondir sur le marché du travail. Responsabilité : le demandeur d’emploi, comme le salarié, ne pourra activer son compte qu’afin de bénéficier de formations qualifiantes. Simplification : elle viendra également de l’unicité de l’interlocuteur – en l’occurrence Pôle Emploi.
L’accord responsabilise aussi les autres acteurs de la formation que sont les branches et les organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA). Les branches deviennent de véritables prescripteurs, qui auront à s’ajuster aux besoins réels des entreprises et des territoires. Conscient du fait qu’il n’est pas encore assez performant de ce point de vue, le MEDEF a l’intention de consacrer à cet objectif les moyens nécessaires, sur tout le territoire et dans toutes les branches. L’ensemble des partenaires sociaux nous approuvent et estiment que les observatoires des métiers, bien pilotés, peuvent servir d’instruments stratégiques à cette fin. En outre, les branches devront veiller à la qualité et au suivi des formations proposées à leurs entreprises. Ce que nous faisons au sein de nos entreprises, nous devons, en tant qu’organisation, le faire aussi à leur service.
Quant aux OPCA, dont un certain nombre ne se considèrent encore que comme des collecteurs, ils devront devenir de véritables prestataires de services, des partenaires, voire des ingénieurs de formation, en particulier pour les TPE et les PME, les entreprises qui ont le plus de mal à s’organiser dans ce domaine. Ils pourront ainsi leur proposer des méthodes pédagogiques et, surtout, des programmes sur mesure, d’autant plus nécessaires que l’entreprise est plus petite. Pour ma part, je n’aurais pu permettre à tous les opérateurs de mon entreprise de plasturgie de passer un certificat de qualification professionnelle sans un OPCA qui a su ciseler une formation tenant compte de mes contraintes – il fallait dégager près de 170 heures pour 60 à 70 personnes. Voilà un exemple de ce à quoi l’on peut parvenir en développant la « culture client » au sein des OPCA.
Tel est le cadre général de la réforme, dont nous pourrons préciser la teneur en répondant à vos questions.
M. Jean-Patrick Gille. Au nom du groupe SRC, je vous remercie de cette présentation, la plus enthousiaste qu’il nous ait été donné d’entendre jusqu’ici. Si l’accord vise, vous l’avez souligné, à concilier liberté et responsabilité, on peut craindre qu’il ne confie aux seuls salariés l’entière responsabilité de leur formation et, par là même, de leur employabilité. Certes, la baisse du taux de cotisation – que d’aucuns qualifient de rupture – est censée être compensée par l’obligation de former qui incombe à l’employeur. Mais celui-ci ne risque pas gros s’il ne fait pas le nécessaire tous les deux ans, ni même au bout de six ans – sinon de devoir réabonder le compte d’une centaine d’heures, ce qui ne représente pas grand-chose si l’obligation de formation n’a pas été respectée jusqu’alors.
D’autre part, les entreprises dotées d’une direction des ressources humaines pourront continuer d’investir dans la formation pour préparer l’avenir et accroître leur compétitivité, voire inciter leurs salariés à mobiliser leur compte. Mais qu’en sera-t-il des petites entreprises, qui ne disposent pas des mêmes moyens et qui s’appuyaient jusqu’à présent sur les OPCA, lesquels mutualisaient les fonds et leur servaient de DRH dans ce domaine ? C’est la question que soulève la CGPME.
Les listes de formations font également débat.
Comment le compte pourrait-il inciter plus de demandeurs d’emploi à se former, indépendamment des 300 millions d’euros supplémentaires alloués au financement de leur formation ?
Le « hors champ » pose un autre problème, particulièrement sensible. Comment le faire participer à l’élaboration des listes et aux instances de gouvernance – le CNEFOP et les CREFOP : le Conseil national et les comités régionaux de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles ? Comment l’intégrer à la réforme de la représentativité ? Rappelons que le hors champ contribuera aux fonds destinés à financer le syndicalisme, mais ne siégera pas au comité paritaire qui en fixera la répartition.
Il est exact que les OPCA ne sont pas seulement des collecteurs, mais aussi des prestataires de services ; du reste, leur évolution en ce sens est déjà engagée. Mais comment concevez-vous le rôle du Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, le FPSPP ? S’agissant de la partie mutualisée de la contribution, comment pourra être géré l’éventuel surplus qui résulterait d’un sous-emploi des fonds au cours des premières années ?
M. Gérard Cherpion. Je m’exprimerai au nom du groupe UMP.
Puisque vous avez invoqué l’exemple suisse, madame, je relève aussi que, dans ce pays, le taux de chômage des jeunes ne dépasse pas 4 %, comme d’ailleurs dans une partie de l’Allemagne : on voit que ce n’est pas nécessairement en amenant 80 % d’une classe d’âge au baccalauréat que l’on résoudra le problème de l’emploi des jeunes, puisque ces deux pays ont privilégié l’alternance. Si leurs méthodes respectives ne sont pas transposables en l’état, leur expérience confirme l’intérêt de cette voie, jusque dans l’enseignement supérieur – où se pose toutefois le problème du financement de l’apprentissage.
Je salue l’enthousiasme avec lequel vous avez, madame, défendu la conjonction, trop rarement recherchée dans notre société, de la liberté et la responsabilité, pour l’entreprise comme pour le salarié.
Les listes de formations, destinées aux demandeurs d’emploi, mais aussi aux salariés, dépendront de l’État, des régions, des branches : une telle complexité ne contredit-elle pas l’objectif de simplification que vous avez invoqué ? N’y aura-t-il pas là aussi un élément de contrainte pour le salarié, chargé d’activer son droit à la formation ? En outre, comment dispenser des formations véritablement qualifiantes en 150 heures seulement ? L’abondement supplémentaire, notamment par les régions, risque de poser un problème.
La place du hors champ en soulève un autre, s’agissant notamment du fonds destiné aux partenaires sociaux. Pour certains de ces derniers, il s’agirait d’un problème purement patronal, mais le hors champ comprend les professions libérales, qui incluent des salariés comme des employeurs.
Enfin, je note que vous n’avez rien dit du titre II de l’avant-projet de loi, consacré à la démocratie sociale.
M. Christophe Cavard. Pour s’en tenir – provisoirement, j’espère – au titre Ier de l’avant-projet, le groupe écologiste aimerait en savoir plus sur le financement, en particulier sur la mutualisation des moyens qui fait débat au sein des organisations patronales.
Plutôt que de contraindre les entreprises, vous espérez les convaincre de leur intérêt à investir dans la formation ; mais, dans un contexte économique difficile, la révision des taux de contribution pourrait au contraire les inciter – surtout les TPE – à des économies supplémentaires.
Le CPF sera doté de 150 heures, soit davantage que les 120 heures du DIF, mais peut-être pas assez pour garantir une formation qualifiante, malgré les possibilités d’abondement supplémentaire. À vos yeux, le nombre d’heures peut-il encore être relevé, le cas échéant par des accords de branche plutôt que par la loi ?
Plus généralement, il n’est pas rare que les textes que nous votons renvoient le dialogue social aux accords de branche, ce qui donne fort à faire aux branches, dont une soixantaine seulement – sur 700 à 900 en tout – rassemble 50 000 salariés au moins, les autres en comptant chacune moins de 5 000. Qu’en pensez-vous ?
Quelle est votre position s’agissant du hors champ ? Des organisations représentatives des salariés, mais qui n’ont pas pris part à la négociation, nous font savoir qu’elles souhaitent être associées à la mise en œuvre du dispositif.
Comment s’assurer de la qualité de la formation dispensée par les nombreux organismes existants ? Elle est essentielle pour convaincre les entreprises d’investir dans ce domaine. Le texte permet aux services de l’État d’y veiller ; ne faudrait-il pas fixer également des critères d’évaluation avec les partenaires sociaux ?
Mme Monique Iborra. Le nombre d’heures, certes en hausse par rapport à celui qu’offrait le DIF, ne nous semble pas suffisant pour permettre une formation qualifiante. Le compte peut être abondé par l’entreprise elle-même ou par les régions, mais qui coordonnera l’ensemble ? Comment éviter que le financement de la formation ne s’apparente à un parcours du combattant pour le salarié et, surtout, pour le demandeur d’emploi ? N’oublions pas que la validation des acquis de l’expérience n’a été qu’un demi-succès.
Selon vous, comment expliquer l’échec du DIF, auquel 6 % seulement des salariés ont eu recours ? Pourquoi le CPF aurait-il plus de succès ?
De même, pourquoi réussirions-nous aujourd’hui mieux qu’hier à modifier la « culture de collecteurs » des OPCA, dont la loi de 2009 a déjà réformé, sans grand effet, l’organisation et les prestations ?
Comment le MEDEF, qui se déplace beaucoup en région, conçoit-il la gouvernance régionale des listes ? Au sein du « pilotage quadripartite », qui est le véritable pilote ? Les listes ne dépendront-elles pas à la fois des régions et des partenaires sociaux, plutôt que des unes ou des autres comme vous l’avez dit ? Que se passera-t-il alors en cas de désaccord entre ceux-ci et celles-là ?
Mme Isabelle Le Callennec. Convaincue comme vous, madame, des bienfaits de la formation tout au long de la vie, j’espère que le projet de loi donnera naissance à un dispositif plus lisible, plus efficace et plus juste.
En ce qui concerne le CPF, le principe d’un interlocuteur unique paraît bienvenu. Toutefois, si Pôle Emploi, le FONGECIF et l’OPCA peuvent servir au demandeur d’emploi, au salarié et à l’entreprise d’interlocuteurs privilégiés, comment écarter entièrement les nombreux autres acteurs qui interviennent dans le domaine de la formation ?
Le droit individuel à la formation semble destiné à disparaître entièrement, mais le CPF va coexister avec d’autres dispositifs, dont le congé individuel de formation (CIF), qu’il n’est pas question de supprimer, et les formations que les entreprises peuvent faire financer par Pôle Emploi ou par les régions. Il serait bon de répertorier les différentes possibilités existantes.
Si la formation dispensée hors du temps de travail se fonde sur le volontariat, celle qui aura lieu pendant les heures de travail devra respecter des objectifs. Pour les atteindre, selon quelle hiérarchie le salarié devra-t-il mobiliser le plan de formation de l’entreprise, le CIF, le CPF ?
Les partenaires sociaux, en particulier les entreprises, souhaitent à juste titre être étroitement associés à l’élaboration des listes de formations qualifiantes, mais les régions voudront aussi avoir leur mot à dire. Prenons donc garde aux doublons : les observatoires des métiers existent déjà à tous les niveaux – collectivités, organisations syndicales, branches, missions locales.
Comment le compte personnel de formation se présentera-t-il concrètement ? À quel moment sera-t-il possible de l’ouvrir, la vie professionnelle pouvant durer de 16 à 62 ou 65 ans ? Comment sera-t-il géré par le FONGECIF ? Comment le salarié saura-t-il où il en est de l’utilisation de ses 150 heures ?
Enfin, les fonds dédiés à la formation sont-ils véritablement sécurisés ? Êtes-vous satisfaits des dispositions relatives à la mutualisation ?
M. Michel Liebgott. Je me réjouis pour ma part que nous en soyons au quatrième accord national interprofessionnel et que les partenaires sociaux, syndicats de salariés comme organisations patronales, adhèrent à cette nouvelle démarche.
Cet esprit d’ouverture devrait permettre de rapprocher l’offre de la demande. À titre d’exemple, on recrute encore 100 000 métallurgistes chaque année. Mais, si les employeurs ont du mal à trouver des salariés, ce peut être parce que les métiers ne sont pas assez attractifs, assez bien rémunérés, ou parce que les entreprises préfèrent recourir à des sous-traitants, à des intérimaires, voire au travail à temps partiel. Or, pour se former en toute confiance, les salariés doivent pouvoir se projeter dans l’avenir, sans avoir l’impression que leur entreprise subordonne leur formation à ses propres objectifs à court terme. Il ne s’agit pas là d’un procès d’intention, mais de l’écho d’une inquiétude exprimée lors des auditions par les entreprises elles-mêmes, en particulier par les PME. Celles-ci ont besoin de leurs salariés pour vivre, voire pour survivre : il leur est difficile de les laisser se former en vue de rejoindre une autre entreprise.
Par ailleurs, comment la gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences (GPEC), obligatoire dans les entreprises de plus de 300 salariés, s’articulera-t-elle avec le CPF ?
M. Patrick Hetzel. La formation tout au long de la vie est évidemment essentielle, mais il y a fort à faire pour sensibiliser à cette nécessité notre pays, qui a l’habitude de miser avant tout sur la formation initiale, censée être la plus longue possible, et sur une course aux diplômes sans fin.
Même si ce sont surtout les non-signataires qui souhaitent modifier le texte, l’avant-projet de loi a-t-il selon vous laissé de côté des points stratégiques de l’accord, que nous devrions y réintroduire par voie d’amendement ?
M. Denys Robiliard. Le MEDEF, qui ne s’est pas exprimé sur les titres II et III de l’avant-projet, peut-il nous confirmer qu’ils ne présentent aucune difficulté à ses yeux ?
Au-delà du seul domaine de la formation, comment envisagez-vous d’intégrer le hors champ à la négociation collective, dont on ne saurait exclure les grandes organisations représentatives du secteur agricole, des professions libérales ou de l’économie sociale ?
S’agissant des branches, qui, comme l’a rappelé Christophe Cavard, regroupent pour la plupart peu de salariés, que pensez-vous des moyens d’intervention dont disposerait le Gouvernement en vertu de l’article 15, section VIII, de l’avant-projet de loi ? Sont-ils adaptés, sont-ils suffisants ?
Que pensez-vous de la possibilité également offerte au Gouvernement de légiférer par ordonnance sur le mode de désignation des conseillers prud’hommes ? Comme nous l’ont fait observer les représentants de Force ouvrière, en élisant un délégué du personnel ou un membre du comité d’entreprise, les salariés n’entendent pas nécessairement désigner un juge prud’homal. Il en va ici de la légitimité de cette justice.
Enfin, quel est votre point de vue sur la réforme de l’inspection du travail, en particulier sur le pouvoir de sanction administrative et de transaction pénale que lui donne le texte ?
M. Gérard Sebaoun. Je ne veux pas faire de procès d’intention aux rédacteurs de l’accord, mais pourquoi systématiser l’entretien professionnel à l’issue d’un arrêt longue maladie comme d’un simple congé de maternité ?
Mme la présidente Catherine Lemorton. Selon vous, avant de réformer la justice prud’homale, a-t-on tout essayé pour rendre viables les élections aux conseils de prud’hommes, notamment dans les PME et surtout les TPE, où l’information circule mal faute de représentants du personnel ?
Mme Florence Poivey. En premier lieu, nous sommes tout disposés à intégrer le hors champ aux instances régionales chargées de la formation, car certains des secteurs concernés sont susceptibles d’offrir des postes aux demandeurs d’emploi.
Nous ne sommes pas partisans de porter au-delà de 150 le nombre d’heures de formation disponibles dans le cadre du CPF, et ce pour deux raisons. Tout d’abord, pour responsabiliser l’employeur, il faut lui laisser la possibilité d’abonder les comptes des salariés, en particulier lorsque l’entreprise connaît d’importantes évolutions technologiques ou de marché. Ensuite, c’est en incitant les organismes de formation à étudier les modalités pédagogiques au lieu de renchérir sur le nombre d’heures que nous sélectionnerons les meilleurs d’entre eux. Ce sont les besoins qui doivent déterminer la durée de la formation et, dans ce domaine, il faut savoir faire preuve de créativité. Tous les opérateurs de mon entreprise ont obtenu leur qualification de technicien après 168 heures de formation, ce qui ne représente pas beaucoup plus de 150 heures ; il m’a d’ailleurs paru tout à fait normal de prendre le solde à ma charge. Pour nous, les 150 heures sont donc un maximum.
Notre discours est clair à propos de la mutualisation : il n’existe pas à l’heure actuelle, en ce domaine, de solidarité des plus grandes entreprises à l’égard des plus petites, alors que les TPE et les petites PME ont bien du mal à concevoir des programmes de formation pour leurs salariés. Nous avons donc proposé aux partenaires sociaux, qui l’ont accepté, de porter de 400 à 600 millions d’euros les fonds mutualisés dont bénéficient les TPE grâce à la solidarité des grandes entreprises. Pour fixer le montant de cette hausse de manière à couvrir le salaire de remplacement des collaborateurs partis en formation, nous nous sommes fondés sur le nombre d’heures de formation effectuées dans les entreprises de un à neuf salariés, soit 17 millions. Certes, ce n’est pas assez, car l’argent n’est pas tout : il faut aussi pouvoir s’organiser. Voilà pourquoi les OPCA doivent devenir de véritables prestataires d’ingénierie. Il convient de s’inspirer des expériences déjà menées dans certains secteurs, notamment par l’intermédiaire de groupements collectifs.
Nous avons également instauré un complément de mutualisation destiné aux entreprises de 50 à 300 salariés. Mais il relève plutôt de ce que j’ai pu appeler la « mutualisation des coquins malins », au service des entreprises les plus proches des branches et des OPCA, voire de celles qui peuvent se doter de directeurs de la formation ou de collaborateurs capables d’activer les circuits de financement. Il ne s’agit pas à mes yeux d’une mutualisation de solidarité, vertueuse pour l’économie générale ; du reste, les organisations syndicales ne m’ont pas donné tort lors de nos échanges informels à ce sujet.
Au total, les entreprises de 1 à 49 salariés pourront bénéficier de 1,3 milliard de fonds mutualisés – contre 1,4 aujourd’hui –, compte non tenu des versements volontaires des entreprises aux OPCA. Il y a donc tout lieu de penser que l’accord débouchera sur une hausse des sommes allouées à ces entreprises au titre de la mutualisation.
En quoi un demandeur d’emploi sera-t-il incité à utiliser son compte personnel de formation, demandez-vous. Il y aura tout intérêt puisqu’il pourra ainsi bénéficier des formations qualifiantes lui permettant d’accéder aux postes disponibles. Voilà pourquoi il était important que les partenaires sociaux et les régions soient appelés à travailler le plus possible ensemble, afin d’assurer l’adéquation entre les formations que nous proposons et les offres d’emploi.
M. Antoine Foucher, directeur des relations sociales, de l’éducation et de la formation au MEDEF. S’agissant des listes, l’essentiel est de créer les conditions de la confiance entre les acteurs, afin que les « guéguerres » actuelles entre partenaires sociaux et conseils régionaux laissent place à la coordination, au service des usagers et des bénéficiaires. Voilà pourquoi les partenaires sociaux ont eu à cœur de définir des règles claires, lors de la négociation de l’accord comme de la concertation quadripartite présidée par Jean-Marie Marx et où les régions étaient représentées. Les règles dégagées dans le cadre de la concertation sont publiques : elles figurent dans la synthèse établie par Jean-Marie Marx et mise à disposition des organisations syndicales et patronales par le cabinet de Michel Sapin.
En premier lieu, il a été décidé de prendre pour point de départ les listes des conseils régionaux, les plus gros financeurs de formations collectives destinées aux demandeurs d’emploi. Trois cas ont ensuite été envisagés. Le premier et, espérons-nous, le plus fréquent, est celui où les partenaires sociaux et la région se mettront d’accord sur les propositions de cette dernière : il n’y aura alors aucune difficulté. Le deuxième cas est celui d’un désaccord, non sur l’ensemble, mais sur tel ou tel type de formation figurant sur la liste ; les régions et les partenaires sociaux cofinanceront alors les formations faisant l’objet d’un accord, chaque acteur prenant à sa charge celles dont il est seul à estimer qu’elles correspondent aux besoins en compétences des entreprises de la région. Troisième cas : si les partenaires sociaux – organisations patronales et syndicales – ne parviennent pas à se mettre d’accord dans le cadre de l’actuelle commission paritaire interprofessionnelle régionale pour l’emploi (COPIRE), la liste des formations qualifiantes établie par le conseil régional sera reprise in extenso.
Cet équilibre subtil nous semble devoir être préservé afin d’apaiser la défiance de quelques régions, qui risquerait de compromettre les cofinancements prévus ; les demandeurs d’emploi en feraient alors les frais, ce que nul ne souhaite.
Mme Florence Poivey. Pour que les employeurs aient envie d’investir dans la formation, il faut d’abord leur présenter un produit attractif. Voilà pourquoi il est essentiel de responsabiliser les branches et les organismes paritaires collecteurs agréés. Le contexte général peut certes compliquer la tâche des entreprises, mais c’est en leur permettant d’investir dès que ce contexte s’améliore – et non en les soumettant à une contrainte – que nous les inciterons à relever les défis qui s’annoncent en prenant en compte leurs besoins réels, voire en faisant preuve d’audace. Qu’il s’agisse de la formation ou de l’outil de production, d’innover ou d’exporter, il est risqué de ne pas investir et la grande majorité des entrepreneurs le savent.
Toutefois, parce qu’il s’agit d’opérer un véritable changement de culture et parce qu’en la matière le dialogue social est essentiel, nous créons également une obligation de rencontre régulière avec les salariés. Cela ne vous paraît peut-être pas assez, mais j’ai entendu – non sans surprise – les partenaires sociaux expliquer que beaucoup de salariés n’osent pas parler de compétences avec leur supérieur ou leur employeur, de peur de paraître avouer leur incompétence. Les organisations syndicales n’ont donc guère discuté le bien-fondé de l’entretien biennal.
À l’employeur donc d’engager le dialogue avec chacun de ses collaborateurs, mais en tenant compte de la stratégie de l’entreprise – ce qui répond à votre question sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, monsieur Liebgott. En outre, au sein du 1 %, 0,2 % dédiés au compte personnel de formation pourront rester à la disposition des salariés au titre d’un accord d’entreprise. Cette mesure favorisera elle aussi le dialogue social sur les compétences dans l’immense majorité des entreprises qui établira un tel accord.
Pourquoi le DIF a-t-il échoué ? Au début, on pouvait utiliser ce droit pour financer n’importe quelle formation, sans tenir le moindre compte des besoins de l’entreprise ou du territoire : cela n’a guère encouragé les entrepreneurs à entrer dans le dispositif. En outre, l’accord de l’employeur était nécessaire et le socle payé par l’entreprise. Désormais, même si les 0,2 % sont financés par l’entreprise, le socle sera collectif et non à la seule charge de l’entrepreneur. Mais il faudra aussi faire œuvre de pédagogie à propos du CPF ; nous en avons beaucoup parlé entre partenaires sociaux.
La gestion du CPF, que seuls trois opérateurs avaient les moyens d’assurer, devrait être confiée à la Caisse des dépôts. Le salarié bénéficiera d’un accès direct à son compte en ligne. Nous, partenaires sociaux, devons encore travailler à rendre ce site clair et attractif.
Tous les points stratégiques de l’accord interprofessionnel ont-ils été retenus ? Nous avons veillé à établir un équilibre, à concevoir un tout. Pour préserver cet équilibre, nous devons avoir les moyens de travailler dans des conditions optimales avec les régions, au service des demandeurs d’emploi. Il s’agit d’un point sensible auquel nous demeurerons très attentifs jusqu’au bout.
M. Antoine Foucher. Le Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, créé par l’accord de 2009, a connu un succès assez modéré. Pour lui redonner du souffle, les négociateurs ont jugé bon de le recentrer sur des missions clairement identifiées : l’emploi des jeunes et le financement des contrats en alternance, le financement de la formation dans les TPE, qui augmente de 34 %, et le financement du CPF.
Nous devons trouver les moyens de mieux associer le hors champ à toutes les négociations, au-delà de la seule formation professionnelle. On cite souvent l’exemple du volet sur le temps partiel de l’ANI du 11 janvier 2013, lequel concernait particulièrement une organisation du hors champ. Pour éviter que cette situation ne se reproduise sans pour autant accroître le nombre des organisations participant à la négociation – ce qui pourrait compromettre son bon déroulement –, nous devons définir des mécanismes de consultation, éventuellement contraignants, en amont de la négociation, sur le modèle de ce qui se fait pour la fixation du taux de participation au FPSPP.
En matière de justice prud’homale, le recours à une ordonnance nous paraît bienvenu car il permet d’agir rapidement. Quant au fond, il nous est difficile de nous prononcer dans la mesure où l’avant-projet ne mentionne que les thèmes des décisions qui seront prises par cette voie.
En ce qui concerne l’inspection du travail, la transaction pénale ne nous pose pas de problème. En revanche, il nous semble excessif de permettre à l’inspecteur du travail d’interrompre l’activité dans toutes les entreprises, et inopportun de le dispenser d’en passer par un organisme ou par un tiers pour asseoir sa décision. De plus, l’éventuelle sanction devrait pouvoir être précédée d’une mise en demeure.
Mme Florence Poivey. Enfin, nous sommes résolument favorables à une réduction drastique du nombre de branches tout en sachant que, pour y parvenir, nous aurons fort à faire dans notre propre maison.
Mme la présidente Catherine Lemorton. Merci, madame, messieurs.
*
* *
4. Audition des représentants de la CGPME
La Commission des affaires sociales entend M. Jean-Michel Pottier, président de la commission « formation » et M. Georges Tissié, directeur des affaires sociales de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME), sur le projet de loi relatif à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale, au cours de sa dernière séance du mercredi 15 janvier 2014.
Mme la présidente Catherine Lemorton. Bienvenue, messieurs. La CGPME est la seule organisation patronale qui n’a pas signé l’accord national interprofessionnel (ANI) du 14 décembre dernier : pourquoi ? Voyez-vous malgré tout dans cet accord certains aspects positifs ?
M. Jean-Michel Pottier, président de la commission « formation ». Chef de file de la négociation pour la CGPME, l’ayant donc suivie de très près, je vais essayer de vous expliquer nos réticences vis-à-vis de cet accord.
Son objet principal, la mise en œuvre du compte personnel de formation (CPF) issu de l’accord signé en janvier 2013, ne nous pose pas de problèmes particuliers : nous avons même été parmi les premiers à faire des propositions, que l’on retrouve d’ailleurs largement dans l’accord.
Mais nous n’avons pas signé l’accord. En effet, tout d’abord, la réforme déporte les dispositifs de formation, et leur financement, hors de l’entreprise : ils échappent ainsi à la décision et à l’initiative du chef d’entreprise. Il était pourtant essentiel de préserver un système qui avait fait ses preuves depuis plus de trente ans, celui de la mutualisation, qui permettait de financer les actions de formation au bénéfice des salariés dans le cadre du plan de formation, en particulier dans les entreprises de 10 à 299 salariés. Or ce dispositif se réduit, avec ce projet de loi, comme peau de chagrin, ce qui nous pose vraiment problème.
Le système fonctionne aujourd’hui un peu à la façon d’une assurance – beaucoup d’OPCA (organismes paritaires collecteurs agréés) étaient d’ailleurs, à l’origine, des fonds d’assurance-formation. La formation est évidemment un élément essentiel de compétitivité, et seul un énorme effort de formation a permis la diffusion des progrès technologiques fulgurants que nous avons connus ces dernières décennies. Mais toutes les entreprises n’organisent pas la formation de leurs salariés au même moment : la mutualisation de leurs contributions permet aux entreprises qui utilisent les fonds de la formation professionnelle d’organiser celle-ci au moment le plus opportun pour elles.
Or cet accord fait disparaître l’égalité d’accès aux fonds de la formation professionnelle au titre des actions du plan de formation au bénéfice des salariés des PME : la contribution est réduite de 0,9 % à 0,2 % pour les entreprises de 10 à moins de 50 salariés, et à 0,1 % pour celles de 50 à 299 salariés. C’est pour nous un problème majeur.
La deuxième raison pour laquelle nous ne pouvons pas approuver cet accord, c’est le problème de la solidarité inter-entreprises – celle-ci, et notamment la solidarité des grandes envers les plus petites, ayant pourtant constitué une demande de l’État lors des précédentes négociations ; il y a eu de nombreuses tentatives pour l’organiser. Ici, elle est tout simplement réduite à néant ! C’est un peu fort de café, quand on sait que les grandes entreprises sont souvent pour les PME des donneurs d’ordre très exigeants, et que les premières viennent souvent puiser dans les compétences des secondes ! Rappelons que ce sont majoritairement des PME qui emploient et forment des jeunes en contrat d’apprentissage, en alternance, en contrat de professionnalisation…
L’abandon complet de la solidarité inter-entreprises est donc tout à fait inacceptable : l’accord prévoit en effet non plus une obligation de dépense, mais une obligation de faire – en retirant aux PME les moyens de faire.
En refusant de signer un tel accord, nous sommes fidèles aux valeurs que la CGPME a toujours défendues : liberté de choix du chef d’entreprise pour le plan de formation ; égalité d’accès des entreprises aux fonds de la formation professionnelle, quelle que soit leur taille, et solidarité.
M. Georges Tissié, directeur des affaires sociales. S’agissant des questions relatives à la démocratie sociale, notre jugement est plus nuancé, voire plus favorable. Il nous semble toutefois que le projet de loi comporte quelques lacunes. Je citerai les principales, en commençant par ce qui concerne la représentativité patronale.
Après de nombreux débats, notamment autour du rapport Combrexelle, nous avons donné notre accord à l’idée que, pour être représentatif et donc s’asseoir à la table des négociations, il fallait atteindre le seuil de 8 % des entreprises adhérentes, pourcentage calculé par rapport à l’ensemble des entreprises adhérentes à l’ensemble des organisations patronales, le même schéma étant valable pour les branches professionnelles et pour l’interprofession nationale. Il nous semble toutefois qu’il existe un problème rédactionnel dans le projet de loi : le deuxième paragraphe du 3° de l’article L. 2122-16, que crée dans le code du travail l’article 15 de l’avant-projet de loi, semble introduire – sans doute involontairement –, au-delà du critère de 8 % des entreprises adhérentes, une pondération par le nombre des salariés. Ce point apparaît à l’occasion de la question de l’éventuelle double adhésion. Or le seul critère qui résulte du rapport Combrexelle est celui des 8 % ; nous ne comprenons donc pas la mention des « salariés afférents », que nous souhaitons voir disparaître. La pondération par le nombre de salariés apparaît un peu plus bas, mais uniquement, et conformément au rapport Combrexelle, pour fixer les conditions du droit d’opposition par les organisations patronales.
D’autre part, en cas d’adhésions multiples à des organisations nationales interprofessionnelles, nous pensons qu’il faut une répartition équilibrée des pourcentages. Les pouvoirs publics acceptent l’idée d’un pourcentage plancher, dont on nous avait dit qu’il serait fixé par décret, mais dont le Conseil d’État pourrait estimer qu’il doit l’être par la loi. Pour nous, l’attribution minimale obligatoire doit être de 33 %, dans l’hypothèse où une branche adhérerait à deux organisations nationales interprofessionnelles différentes – ainsi, par exemple, un tiers irait au MEDEF, un tiers à la CGPME, et il y aurait une liberté d’affectation pour le dernier tiers des entreprises adhérentes. À l’extrême limite, nous pourrions accepter d’aller jusqu’à 25 % ; mais la fixation de ce seuil à 10 % – comme la rumeur en a couru – serait pour nous absolument inacceptable ! Ce point est fondamental : nous ne croyons pas au principe du renard libre dans le poulailler libre. Il nous paraît impossible de laisser les branches prendre ces décisions : cela induirait sans aucun doute de grandes inégalités.
Quant au financement des organisations syndicales et patronales, je dois également faire quelques remarques d’ordre essentiellement rédactionnel – ce qui n’est pas un point mineur.
Tout d’abord, au 2° du nouvel article L. 2135-10, nous souhaiterions la suppression des mots « le cas échéant ». Le nouveau fonds est alimenté en effet par deux flux, l’un venant des cotisations des entreprises, l’autre des organisations gérées paritairement, à l’exception des organismes relevant de la formation professionnelle : or, en toute logique, il ne saurait y avoir un flux certain et l’autre incertain.
Ensuite, le nouvel article L. 2135-13 souffre d’une incohérence de rédaction, puisque les missions du nouveau fonds sont visées au 1° de l’article, mais pas au 2°. Le Gouvernement nous dit que l’on vise au 2° les mêmes missions qu’au 1°, mais il vaudrait mieux l’écrire !
Enfin, il est précisé que les subventions liées à la formation professionnelle s’arrêteront au 1er janvier 2015 ; on nous assure que les financements des organisations syndicales et patronales s’arrêteront également dès le début de l’année 2015, même si la date n’est pas donnée. La logique voudrait que, pour les nouvelles subventions issues du grand fonds, nous disposions également d’un calendrier, afin qu’il y ait substitution.
M. Jean-Patrick Gille. Merci. Nous venons d’entendre le MEDEF, et nous voyons bien que vos analyses sur cet accord diffèrent très profondément : pour eux, la solidarité n’existait pas et elle se met en place ; pour vous, elle existait et elle disparaît. Vous craignez une chute brutale de la formation dans les PME. Il va falloir essayer d’y voir plus clair…
Comment, de votre point de vue, serait-il possible d’améliorer ce projet de loi ? Seriez-vous favorables à une modification des taux envisagés – ce qui, je ne vous le cache pas, me paraît difficile ?
Il faut relativiser : les analyses sur la mutualisation et les OPCA sont contrastées, et la mutualisation était jugée limitée par beaucoup. Mais comment pourrions-nous répondre aux inquiétudes des PME, afin que la dynamique de formation ne s’interrompe pas ? Le compte personnel de formation pourrait, au moins en partie, répondre à ces inquiétudes : vous ne l’avez guère évoqué.
M. Gérard Cherpion. En effet, votre diagnostic et celui du MEDEF divergent entièrement. Avec le compte personnel de formation, la responsabilité et la liberté de choix du salarié seront beaucoup plus grandes : j’ai tout de même le sentiment que cela est aussi favorable à l’entreprise, qui a tout intérêt à ce que ses salariés soient bien formés.
J’ai l’impression que vous êtes notamment préoccupés par la question de l’utilisation du compte personnel de formation : vous êtes semble-t-il opposés à ce qu’il puisse être utilisé pendant le temps de travail. Pouvez-vous nous en dire plus ?
Quels sont pour vous les problèmes d’équilibre entre les formations des salariés et les formations de demandeurs d’emploi ? Ne pensez-vous pas que ce texte simplifie tout de même la contribution des employeurs à la formation ?
M. Christophe Cavard. Il y a un débat sur la fonction que doit remplir le fonds paritaire. Le MEDEF estimait tout à l’heure que, parmi ses missions prioritaires, figuraient les jeunes, les demandeurs d’emploi, mais aussi les PME-TPE. Quel est votre point de vue ?
Quels sont pour vous les aspects positifs de cette réforme ? Pour nous, la formation est aussi importante pour le salarié que pour l’entreprise. Quelle est la culture de la formation dans les PME ? Craignez-vous que, dans un contexte économique difficile, certaines renoncent à financer la formation de leurs salariés au-delà de leurs obligations légales ?
Il existe aussi un débat sur le rôle du secteur hors champ, notamment dans la gouvernance du fonds paritaire. Quel est votre point de vue ?
M. Michel Liebgott. Vos interventions sont très anxiogènes : à vous entendre, rien ne serait bon dans ce projet de loi ! Mais la CGPME a été encore plus sévère dans la presse. J’ai par exemple lu que l’accord du 14 décembre avait vocation à instaurer une « session de rattrapage » parce que l’éducation nationale ne ferait pas son travail de formation, que le seul objectif de l’accord et de la loi serait de financer les organisations patronales et syndicales, ou encore que tout cela n’était pas dans l’intérêt des salariés. Peut-être suis-je un peu caricatural, mais c’est ce que vous nous dites aujourd’hui : vous ne voulez pas de cette loi, dont vous seriez les grands perdants – alors que le MEDEF y est très favorable. Je reconnais que son enthousiasme nous interroge. Moi qui suis originaire d’une région très industrialisée, la Lorraine, je sais que les grandes entreprises écrasent souvent les petites. Je peux donc comprendre l’anxiété exprimée par les PME et PMI. Trouvez-vous néanmoins quelque chose de positif dans le dispositif qui a été négocié ? Quelles seraient les mesures à prendre pour que ce texte ait un intérêt pour les PME-PMI, qui sont les entreprises qui créent le plus d’emplois aujourd’hui ?
Mme Isabelle Le Callennec. J’attendais avec intérêt cette audition pour comprendre les raisons pour lesquelles la CGPME n’a pas signé l’accord du 14 décembre. Ce sont en effet les PME qui embauchent et créent des emplois aujourd’hui ; nous avons donc le devoir de vous écouter.
Qu’il s’agisse de la formation professionnelle ou du financement du paritarisme, le système est extrêmement complexe. Nous gagnerions donc à ce que ce texte permette de sortir de l’opacité.
S’agissant du compte personnel de formation, j’ai bien entendu votre message – qui est partagé par les entreprises – sur la liberté de former. Les chefs d’entreprise connaissent en effet leurs besoins. Le texte prévoit l’établissement de listes des formations éligibles auxquelles pourront prétendre les demandeurs d’emploi et les salariés. La CGPME entend-elle participer à l’élaboration de ces listes dans les territoires, même si elle n’a pas signé l’accord ? L’enjeu est tout de même majeur : il importe que les entreprises soient au cœur du dispositif, y compris dans le domaine de l’apprentissage et de la formation en alternance.
S’agissant de la mutualisation, votre position est exactement inverse de celle du MEDEF. Vous estimez que le dispositif actuel est préférable à celui qui est proposé. Par ailleurs, vous avez parlé de déport des financements de la formation vers l’extérieur. Je comprends que pour vous, les demandeurs d’emploi ou les salariés utiliseront les 150 heures du compte personnel de formation à l’extérieur. Or j’ai cru comprendre que ce temps pouvait aussi être utilisé dans le cadre du temps de travail.
Nous avons évoqué à plusieurs reprises dans notre commission la structuration des branches. Partagez-vous le souci de simplification du MEDEF à cet égard ?
Enfin, vous ne nous avez pas parlé du renforcement de l’inspection du travail, qui est un point important du texte, évoqué par de nombreuses entreprises.
M. Denys Robiliard. Permettez-moi d’abord de répondre à M. Tissié sur l’article L. 2122-16 : si nous ne modifions pas cet article, nous ne pourrons pas appliquer l’article L. 2261-19 et les deux alinéas qui lui sont ajoutés. Il faut bien définir où vont les salariés si l’on veut définir la représentation lorsqu’il s’agit de s’opposer.
M. Georges Tissié. Je ne suis pas d’accord avec vous : l’article L. 2122-17 se suffit à lui-même, puisqu’il énonce un principe général.
M. Denys Robiliard. Je m’attacherai principalement aux titres II et III du texte, qui portent respectivement sur la démocratie sociale et l’inspection et le contrôle. Comme Mme Le Callennec, je constate que le renforcement de l’inspection du travail suscite des craintes. Je pense notamment au nouveau pouvoir de sanction administrative et à la possibilité de transaction pénale. Quel est votre point de vue sur le sujet ?
De même, que pensez-vous de la réforme des conseils de prud’hommes, et de l’habilitation du Gouvernement à légiférer par ordonnance sur les nouvelles modalités de désignation des juges prud’homaux ? Indépendamment du procédé, c’est acter le fait qu’il n’y aura plus d’élections prud’homales.
En ce qui concerne la représentativité, le texte est assez proche de la position commune arrêtée par la CGPME, le MEDEF et l’UPA le 19 juin. Néanmoins, il est un peu dommage, alors même que nous nous penchons sur la représentativité patronale, de ne pas travailler sur les hors champ – qui sont restés hors texte. Quelle est votre position sur ce point ? Il devient de plus en plus gênant de voir des entreprises qui représentent 25 % de l’emploi privé rester à la porte des négociations interprofessionnelles.
M. Jean-Michel Pottier. Pardonnez-moi, mais il y a une supercherie. Lorsque nous parlons de la mutualisation, nous additionnons en réalité des choses qui ne sont pas de même nature. Lorsque nous parlons des fonds mutualisés, nous parlons des fonds qui sont mutualisés en vue de financer les actions de formation du plan de formation dans les PME – c’est-à-dire les entreprises de 10 à 299 salariés. Pour les entreprises de moins de 10 salariés, l’accord prévoit en effet un dispositif aux termes duquel le Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP) va consacrer une partie de ses fonds à financer la formation professionnelle au titre du plan pour les TPE. C’est même ce qui a emporté l’adhésion de l’UPA. Nous n’avons donc pas d’inquiétude en ce qui concerne les TPE. Ce dispositif répond d’ailleurs à une demande de la CGPME, qui était que les TPE puissent être traitées comme les grandes entreprises. Le remplacement du salarié était à notre sens un faux problème : ce qu’il faut surtout, c’est que l’entreprise qui envoie un salarié en formation puisse être financée à la fois sur les frais pédagogiques et sur le salaire – afin de pouvoir payer le remplaçant. Il y a des salariés absents dans toutes les entreprises, qu’ils soient malades ou en vacances, et celles-ci savent s’organiser pour y faire face. En revanche, elles ne payent pas deux fois, sauf dans les PME qui sont soumises à une double peine. Ce problème est désormais réglé pour les TPE, mais pas pour les PME.
M. Jean-Patrick Gille. S’agit-il de ces 170 ou 175 millions ? C’est donc le FPSPP qui viendrait prendre en charge la formation professionnelle au titre du plan dans les TPE ?
M. Georges Tissié. Oui : 20 % de ses ressources seraient affectées à la mutualisation du plan.
M. Jean-Michel Pottier. Espérons que ce sera le cas… Mais vous allez me dire que mes propos sont anxiogènes !
Dans l’esprit du MEDEF, la mutualisation concerne les dispositifs qui sont en dehors du champ de décision du chef d’entreprise dans le cadre du plan de formation – je reparlerai tout à l’heure du compte personnel de formation.
Il y a une autre supercherie dans l’accord : ce sont les articles 36 et 38. La supercherie est d’ailleurs si flagrante que le Gouvernement n’a pas retranscrit l’intégralité du texte de l’accord dans le projet de loi.
L’article 36 détaille l’affectation des versements des entreprises par les organismes collecteurs paritaires agréés (OPCA). Avec quatre régimes et 16 taux, on ne peut guère parler de simplification, sachant que pour le même objet – qu’il s’agisse du Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP), du droit individuel à la formation ou de la professionnalisation –, les taux varient suivant la taille des entreprises. On nous a expliqué que ce n’était pas grave, puisque ce sont les OPCA qui s’en chargeront. C’est oublier que la réforme consiste justement – c’est en tout cas l’objectif du MEDEF – à anéantir les OPCA pour s’en remettre à la « main invisible » du marché. Pour notre part, nous pensons que ce n’est pas la bonne solution, et que la raison du plus fort n’est pas toujours la meilleure. C’est tout le sens de mon engagement syndical. Il serait tout de même un peu fort que ce soit le gouvernement actuel qui supprime la solidarité interentreprises et la mutualisation. En tout cas, nous ne le comprendrions pas.
Le dernier alinéa de l’article 36 n’a pas été repris dans le texte du Gouvernement. Nous avions « arraché » dans la négociation cet alinéa qui prévoit que les fonds versés au titre du compte personnel de formation par les entreprises de 10 salariés et plus, et non engagés au 31 octobre de chaque année, peuvent être affectés aux autres actions prises en charge par les OPCA telles que définies à l’article 37. En effet, le compte personnel de formation ne va pas « monter » à 100 % d’utilisation dès le premier jour. Nous souhaitons donc que ces sommes puissent être réorientées vers la mutualisation au titre du plan de formation. La mutualisation dont parle le MEDEF – le 0,8 % – concerne des objets autres que le plan de formation : on développe la mutualisation pour d’autres objets, mais on réduit à peau de chagrin la mutualisation du plan de formation. Vous le voyez, nous parlons de deux choses différentes. Il ne s’agit pas de dire qu’il ne fallait pas prévoir cette mutualisation développée sur ce qui ne concerne pas le plan de formation, mais que ce n’est pas une raison pour supprimer ce qui est mutualisé pour le plan de formation. En l’état, l’accord fait le jeu des grandes entreprises.
Avec l’article 38, la supercherie est double. Cet article donne en effet le mode d’emploi pour que les grandes entreprises puissent s’exonérer du 0,2 % – ce qu’elles peuvent faire dès lors qu’il existe un accord de branche ou d’entreprise. Par précaution, le Gouvernement n’a retenu que l’accord d’entreprise dans le texte – il n’a donc pas retranscrit intégralement le texte de l’accord.
Pour négocier un accord d’entreprise, il faut avoir des délégués syndicaux – ce qui exclut les PME et fait le jeu des grandes entreprises. Les entreprises de plus de 300 salariés ont de toute façon une obligation légale de passer un accord ; cela ne change donc rien à la donne pour elles.
Bref, les grandes entreprises vont pouvoir s’exonérer du 0,2 % et le passer dans les dépenses directes au titre du compte personnel de formation. Elles ont une masse de salariés qui leur permet de faire des formations courtes ou longues ; et lorsqu’elles auront dépensé l’équivalent du 0,2 % qu’elles dépensaient autrefois au titre du plan de formation, elles pourront néanmoins recourir, auprès de leur OPCA, aux 0,2 % qui ont été payés par les petites entreprises. Donc non seulement les petites entreprises se retrouvent dans l’obligation de faire sans en avoir les moyens, mais elles vont payer pour les grandes. C’est ce qui se passera en l’état actuel du texte, le ver étant dans le fruit.
Pour améliorer le texte, il faudrait que les fonds non dépensés dans le 0,2 % du compte personnel de formation puissent servir à financer le plan de formation, comme cela est prévu dans l’accord. Nous souhaitons également la suppression pure et simple de l’article 38 scélérat de l’accord – qui n’a été repris qu’à moitié par le texte.
Au final, les grandes entreprises ont gagné, puisqu’elles vont payer 0,8 %. C’est bien ce que souhaitait le MEDEF à l’origine.
M. Jean-Patrick Gille. Vous souhaitez donc qu’il n’y ait pas de possibilité d’exonération du 0,2 % du compte personnel de formation. C’est aussi la position de la CGT.
M. Georges Tissié. Mais il y a une deuxième partie dans notre proposition : la réaffectation des sommes non dépensées au titre du compte personnel de formation au profit du plan de formation dans les entreprises de 10 à 299 salariés.
M. Jean-Patrick Gille. Vous considérez que cela fait système : on mutualise complètement le 0,2 % du compte personnel de formation…
M. Georges Tissié.… et si tout n’est pas dépensé au 31 octobre, les sommes non engagées sont réaffectées au plan de formation dans les PME – c’est-à-dire là où le bât blesse.
M. Jean-Michel Pottier. Vous nous avez interrogés sur le compte personnel de formation. Nous allons bien sûr participer à la gouvernance. Mais le compte personnel de formation ne sert qu’à financer des actions certifiantes en tout ou partie. Or toutes les formations mises en œuvre dans le développement des entreprises ne sont pas certifiantes. Dans une PME, le passage à une nouvelle technologie est souvent l’occasion de former le personnel pour lui permettre de la mettre en œuvre. Mais lorsque la technologie est nouvelle, il n’y a pas de certification existante. J’emploie moi-même 17 salariés ; lorsque mon entreprise est passée à l’impression numérique sur textile, ma branche professionnelle ne m’a été d’aucun secours – elle ne s’occupe que de la fermeture des entreprises. Il n’existait pas de formation qui puisse entrer dans le cadre du compte personnel de formation.
C’est moi qui ai proposé le premier le principe de convergence. Il s’agit de faire converger le besoin en formation exprimé par l’entreprise avec celui exprimé par le salarié, dans un principe de convergence qui mobilise le compte personnel de formation. Mais en l’état actuel du projet de loi, il y a double punition : la PME paye le 0,2 % à l’OPCA, mais le recours au compte personnel de formation ne financera pas 100 % de la formation au moment où elle voudra y recourir : elle devra donc abonder, autrement dit payer une deuxième fois. Il y a d’un côté les grandes entreprises qui peuvent dépenser le 0,2 % dans le cadre de leurs dépenses habituelles, et de l’autre les petites qui, elles, ne peuvent s’exonérer du 0,2 % et devront en outre payer un complément sur leurs deniers lorsqu’elles voudront former leurs salariés, alors qu’elles ont déjà payé. Le système est profondément inégalitaire ; la dérive inscrite dans l’accord est patente. On fait semblant de considérer qu’il y a là une grande victoire, une baisse des charges, alors qu’en réalité, il s’agit d’arrêter de dépenser pour la formation professionnelle ! J’avoue avoir du mal à comprendre.
Pour notre part, nous allons réagir. Nous vous laisserons d’ailleurs un document dans lequel nous faisons un certain nombre de propositions – dans le cadre actuel. Nous n’allons pas demander de revenir à 1,2 % ou 1,4 % : ce serait irréaliste. En revanche, nous demandons qu’il y ait une meilleure utilisation des fonds dans le cadre du 1 %, afin que l’on trouve un rythme de croisière qui ne « casse » pas la formation professionnelle des salariés.
Nous sommes aujourd’hui dans une dynamique qui permet à la PME de devenir vertueuse. Or nous allons la perdre. Vous savez que nous gérons directement, avec les partenaires sociaux, le plus important des OPCA. La raison de mon engagement personnel, c’est que nous sommes dans un système vertueux, avec un accompagnement sur le terrain, des conseillers qui vont voir les entreprises, essayent de trouver des solutions aux problèmes, et peuvent aussi proposer un financement qui mobilise divers acteurs – conseil régional, État, voire Union européenne. Ce travail d’ingénierie financière va permettre d’inoculer la formation professionnelle dans une PME ou une TPE. Si on réussit à créer une appétence, c’est gagné : l’entreprise a pris goût à la formation professionnelle. On a tendance à se représenter les salariés des TPE et des PME comme très demandeurs de formations. Mais en tant que chef d’entreprise, ma première difficulté est précisément le plus souvent de convaincre mes salariés de l’intérêt d’aller se former ! Bref, cette vision de longues files d’attente devant les organismes de formation est sans rapport avec la réalité d’une PME.
Nous ne voulons donc pas perdre ce dynamisme et cette possibilité de développer l’appétence pour la formation professionnelle dans les entreprises. Nous avons aujourd’hui une obligation de dépense qui a le mérite d’être mutualisée, les fonds versés à l’OPCA par les entreprises étant ensuite répartis. Certes, il y a des OPCA qui ne jouent pas le jeu ; mais d’autres parviennent à engager les entreprises dans ce principe vertueux. Si l’on « casse » ce dispositif et qu’on supprime l’obligation de dépense, la formation professionnelle risque de faire les frais des difficultés conjoncturelles des entreprises.
M. Georges Tissié. Permettez-moi de vous donner quelques ordres de grandeur pour illustrer le propos de M. Pottier. Avec le système actuel, un peu plus de 2 milliards d’euros – sur les 6 ou 7 milliards que gèrent les OPCA – sont mutualisés dans ces OPCA au titre du plan de formation. Si l’on appliquait stricto sensu les dispositions de l’ANI du 14 décembre, les sommes mutualisées au titre du plan de formation pour les entreprises de 1 à 299 salariés seraient de l’ordre de 700 millions d’euros, soit une division par trois : 300 millions d’euros issus des contributions des entreprises de moins de 10 salariés, 200 millions issus des contributions des entreprises de 10 à 49 salariés et un peu plus de 200 millions issus des contributions des entreprises de 50 à 299 salariés. Surtout, dans le cadre du 1 %, les entreprises de 50 à 299 salariés ne verseraient que 0,10 %. Ce n’est pas défendable.
Les taux correspondant aux parts de la contribution de 1 % figureront-ils dans le décret, comme le prévoit le projet de loi ? En tout état de cause, nous souhaitons qu’un rééquilibrage soit opéré dans le cadre de la contribution de 1 % et que la part allouée au plan de formation pour les entreprises de 50 à 299 salariés soit relevée à l’intérieur de ce 1 %.
M. Jean-Michel Pottier. Je terminerai sur une note optimiste. Nous sommes en train de regarder comment recréer des mécanismes facultatifs pour les entreprises que nous avons réussi à entraîner dans des dispositifs de formation professionnelle des salariés. Nous souhaitons leur proposer un système de versements volontaires, sur la base d’un fonds d’assurance formation – qui était le dispositif d’origine – qui permette aux entreprises entrées dans une démarche de formation permanente avec leurs salariés de lisser la charge sur plusieurs années – sans doute trois ans.
Le projet de loi prévoit la possibilité de versements volontaires. Mais pour pouvoir mettre en œuvre ce système, et donc faciliter la possibilité d’un système optionnel, ces dispositions doivent être précisées. Il doit être dit que ces versements volontaires peuvent être collectés à travers toutes les entreprises, et non pas dans un champ défini. Par ailleurs, nous souhaitons pouvoir le faire dans le cadre d’un accord national interprofessionnel PME qui permettrait de créer un système optionnel facultatif volontaire dans un cadre collectif. Or si le projet de loi ne l’interdit pas, les versements obligatoires et volontaires figurent dans la même phrase, ce qui est susceptible d’introduire une confusion. Nous souhaiterions une amélioration sur ce point, afin de trouver des solutions pour pouvoir face à l’enjeu que constitue la formation professionnelle dans le cadre du plan de formation des entreprises, notamment les PME.
M. Georges Tissié. C’est le III de l’article 5.
M. Jean-Michel Pottier. Quant à la réforme de l’Inspection du travail, il est vrai que nous voyons arriver le carnet à souches (sourires). Les entreprises redoutent évidemment que les inspecteurs du travail ne se transforment en « pervenches ». Néanmoins, il faut tempérer leurs craintes : le texte prévoit que cela remonte à la direction régionale avant l’établissement définitif du procès-verbal. Autre bonne nouvelle : le corps des inspecteurs du travail aura un chef. Cela étant, nous attendons surtout des inspecteurs du travail qu’ils fassent un travail de prévention. Or la prévention avec un képi, cela n’a jamais marché. C’est sans doute le principal danger.
M. Georges Tissié. Nos adhérents redoutent également les remarques sur le quatrième domaine, à savoir les questions d’hygiène. Une entreprise qui mobilise deux salariés pour un chantier de deux jours dans une maison individuelle ne va pas installer des toilettes en dur ou en semi-dur dans le jardin… mais il ne faudrait pas qu’elle soit verbalisée pour cette raison.
Mme la présidente Catherine Lemorton. Je regrette une fois encore – même si nous en connaissons les raisons – l’absence de l’UPA, qui représente de toutes petites entreprises et qui a signé l’accord.
M. Jean-Michel Pottier. Je suis moi-même artisan, madame la présidente.
M. Georges Tissié. Et nous avons beaucoup d’adhérents qui le sont dans nos sections territoriales.
Mme la présidente Catherine Lemorton. Je vous remercie d’avoir bien voulu répondre à nos questions.
La Commission entend M. Michel Sapin, ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, au cours de sa séance du mercredi 22 janvier 2014.
Mme la présidente Catherine Lemorton. Merci, monsieur le ministre, d’avoir accepté de nous présenter le projet de loi relatif à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale le jour même où il a été adopté en conseil des ministres mais, compte tenu d’un calendrier très contraint, nous n’avions d’autre choix que de vous auditionner aujourd’hui. En effet, nous commencerons l’examen de ce texte en commission dès mercredi prochain au matin, l’Assemblée devant s’en saisir le mercredi suivant – selon la procédure du temps législatif programmé.
Attendu depuis des années, ce projet de loi est important tant par son contenu que par la méthode suivie pour sa préparation comme cela avait été le cas pour la loi de sécurisation de l’emploi : la méthode de la concertation entre les partenaires sociaux a été privilégiée. Cette réforme procède en effet pour la plus grande part de l’accord national interprofessionnel conclu en décembre dernier, même si toutes les organisations représentatives ne l’ont pas signé.
Avec ce texte, démonstration est faite une fois encore que votre souci premier et celui de la majorité qui soutient le gouvernement est bien de s’appuyer sur le dialogue social pour relancer l’emploi !
M. Michel Sapin, ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. Je veux commencer par vous dire que je pourrais, ô combien, partager les regrets qui ne manqueront pas de s’exprimer sur le caractère contraint du calendrier d’examen de ce texte important. Mais c’est le résultat d’un équilibre entre le temps nécessaire à l’élaboration de la loi et l’urgence qu’il peut y avoir à mettre en œuvre certaines dispositions. S’agissant de la formation professionnelle, l’urgence est évidente même si le sujet est abordé depuis longtemps, donnant lieu à des rapports nombreux mais qui tous aboutissaient à une même conclusion : si la réforme de 1971 a permis des avancées considérables pour les salariés, pour les entreprises et, plus généralement, pour l’économie française, elle est inadaptée à la situation actuelle, celle d’un chômage de masse, touchant déjà deux millions de salariés en 2007 et trois millions aujourd’hui, sous l’effet de la crise et, peut-être aussi, des politiques menées dans son sillage.
Il était donc urgent de réformer et, comme vous l’avez dit, Madame la Présidente, nous avons souhaité le faire suivant une méthode désormais éprouvée : celle du dialogue social et de la négociation. La démocratie sociale ne date pas d’hier et les partenaires sociaux, patronat comme syndicats, ont fait la démonstration de son intérêt. L’accord sur la formation professionnelle est en effet le quatrième conclu en un peu plus d’un an, après ceux qui portaient sur le contrat de génération, sur la sécurisation de l’emploi et sur la qualité de la vie au travail. Nous aurons d’ailleurs bientôt l’occasion de faire un premier bilan de la loi sur la sécurisation de l’emploi : cela nous permettra de constater qu’elle a profondément modifié les relations dans les entreprises.
Le dialogue social est donc aujourd’hui bien vivant mais il était nécessaire, et c’est l’un des aspects très importants de ce texte, d’asseoir définitivement sa légitimité ; pour cela, il fallait assurer la transparence sur le financement des institutions sociales et régler la question de la représentativité des partenaires sociaux.
La question de la représentativité des organisations syndicales a été pour l’essentiel traitée par la loi de 2008 ; l’audience des syndicats est mesurée dans des conditions non discutées et non discutables, et nous savons désormais très précisément quel est le poids de chacun lorsque vient le moment de signer un accord interprofessionnel, de branche ou d’entreprise. Il fallait seulement procéder, ce que nous faisons ici, à quelques ajustements tout à fait consensuels. Il restera, mais ce n’est pas urgent, à discuter du scrutin dans les très petites entreprises, où le vote se fait sur un sigle, sans qu’une personne soit élue : cela pose problème à certaines organisations syndicales, ce que je comprends. Mais nous disposons d’ici aux prochaines élections d’un peu de temps, qu’il faudra mettre à profit, pour trouver une solution satisfaisante.
Sur la représentativité des organisations patronales, en revanche, tout restait à faire : rien ne permet aujourd’hui de mesurer leur poids au niveau national et surtout au niveau des branches professionnelles où, comme j’ai pu le constater à l’occasion de l’accord concernant le cinéma, nous ne retrouvons pas toujours les trois organisations les plus connues, mais d’autres dont la représentativité est bien difficile à apprécier. Nous avons demandé aux organisations patronales de nous faire des propositions, mais elles n’y sont pas parvenues ; j’ai donc demandé au directeur général du travail de me faire, à son tour, des préconisations, qui sont pour l’essentiel reprises dans ce projet de loi. À l’avenir, nous pourrons donc évaluer, de façon transparente, le poids des organisations patronales.
Le financement de la démocratie sociale a fait l’objet de critiques nombreuses, parfois fondées, mais il est aussi la source de nombreux fantasmes et l’occasion fréquente de dénigrer les organisations tant patronales que syndicales. Il était d’ailleurs plus difficile de mettre de l’ordre dans le financement des premières que des secondes. Ce projet de loi applique à toutes le même traitement : celui de la transparence, tant en ce qui concerne l’origine des fonds qu’en ce qui concerne les critères de financement.
Bien entendu, pour assurer l’indépendance de ces organisations, il est nécessaire que les cotisations de leurs adhérents constituent leur première source de revenus. Mais si celles-ci peuvent couvrir leurs dépenses de fonctionnement, nous sommes tous d’accord pour confier aux partenaires sociaux des tâches d’intérêt général, qui entraînent des frais – gestion paritaire d’organismes de formation professionnelle, de l’UNEDIC, de l’ARRCO… ou participation à la gestion des organismes de sécurité sociale. De même, lorsque nous leur demandons de négocier des accords, c’est encore d’une tâche d’intérêt général qu’il s’agit. Il est légitime que ces missions soient financées, de façon transparente.
L’origine des fonds doit être claire : c’est pourquoi nous séparons définitivement l’argent de la formation professionnelle de celui qui est destiné à financer les organisations syndicales et patronales, financement du paritarisme compris. L’attribution des fonds à chaque organisation doit se faire dans la même clarté : le fonds paritaire, dans lequel l’État sera extrêmement présent par l’intermédiaire d’un commissaire du Gouvernement, et qui rendra des comptes très précis, redistribuera ces sommes selon des critères objectifs, en fonction de la représentativité des organisations et de la nature des missions financées, étant entendu que la contribution au paritarisme doit donner lieu, par définition, à une répartition égalitaire.
Visant donc à assurer la pérennité et la transparence de la démocratie sociale, ce projet de loi traite aussi de la formation professionnelle, en transcrivant l’accord national interprofessionnel du 14 décembre dernier. Je ne reviendrai à cet égard que sur quelques principes – mais ceux-ci sont décisifs.
La loi de 1971, votée dans un contexte différent puisque le chômage était alors très bas, avait introduit de très grandes améliorations en créant une obligation de formation : d’où la contribution de 1 % de la masse salariale, ramenée par la suite à 0,9 %, qui a permis pendant des années de renforcer considérablement les qualifications dans l’entreprise. Mais, ensuite, on a atteint un plafond et on a même commencé à constater une diminution de l’effort de formation. On a aussi pu noter que ces formations bénéficiaient plus souvent aux hommes, à ceux qui occupaient une place élevée dans la hiérarchie de l’entreprise et à ceux qui étaient déjà qualifiés – alors qu’elles devraient d’abord aller à ceux qui en ont besoin pour trouver un emploi ou pour obtenir une promotion.
La qualification permet de mieux affronter les aléas économiques, les premières victimes des licenciements étant toujours les salariés les moins qualifiés, c’est-à-dire ceux dans lesquels l’entreprise avait le moins investi comme si, pour elles, la formation n’était pas la clé de la compétitivité. Le projet de loi vise donc à mieux aider ceux qui ont le plus besoin d’une formation professionnelle – les jeunes, les chômeurs, les moins qualifiés. L’outil de cette révolution, c’est le compte personnel de formation (CPF). Vous en aviez voté une première esquisse dans la loi de sécurisation de l’emploi ; il restait à donner un contenu à ce qui n’était encore qu’une coquille vide, comme plusieurs d’entre vous l’avaient souligné. Chaque salarié bénéficiera de ce compte tout au long de sa vie professionnelle, quel que soit son statut et non plus en fonction de celui-ci. Cela permettra aux jeunes d’acquérir les qualifications nécessaires et aux chômeurs de bénéficier des droits acquis comme salariés alors qu’avec le dispositif précédent, le départ de l’entreprise faisait perdre presque tous les droits à la formation. Ce compte sera alimenté par les partenaires sociaux, par les régions et par Pôle Emploi – cela suivant des mécanismes qui, certes, peuvent être compliqués, mais le produit lui-même est simple.
Chacun disposera ainsi de son compte personnel, tout au long de sa vie professionnelle. Même un député pourra disposer d’un compte, qu’il pourra utiliser s’il perd son mandat, circonstance où il peut être utile d’envisager une reconversion, bien sûr momentanée – le temps de reconquérir la confiance de l’électeur ! (Sourires.)
Nous procédons aussi à une grande simplification, pour les entreprises comme pour les salariés. La loi de 1971 avait – ce qui était nécessaire dans un premier temps – créé une obligation de dépenser, à laquelle nous substituons une obligation de former. En effet, cette obligation de dépenser était devenue pour les entreprises une source de tracasseries administratives : il leur fallait démontrer qu’elles avaient rempli leur obligation de dépenser 0,9 % de la masse salariale pour former leurs employés, alors même qu’elles y consacrent plus de 2 % en moyenne. Inversement, pour satisfaire à tout prix à cette obligation de dépense, certaines mettaient parfois un peu n’importe quoi dans leur plan de formation, puisque celui-ci n’était pas négocié ; et celles qui, en dépit de tout cela, n’atteignaient pas les 0,9 % devaient acquitter une cotisation. C’était donc un système extrêmement complexe, et ce projet de loi y remédie.
Mais cela ne veut pas dire qu’il y aura moins d’argent pour la formation, et surtout pour la formation de ceux qui en ont le plus besoin : les diverses cotisations sont fondues en une seule, variable en fonction de la taille de l’entreprise, et qui alimentera les divers mécanismes de mutualisation en faveur des petites et moyennes entreprises et surtout des chômeurs.
Quant aux salariés, ils sauront qu’ils ont désormais droit à 150 heures de formation. Cette durée, que certains jugent insuffisante, est supérieure aux 120 heures offertes dans le cadre du droit individuel à la formation (DIF) – qui a d’ailleurs été un échec – et ce d’autant plus qu’il s’agira d’un plancher, et non plus d’un plafond.
Nous simplifions également les mécanismes de gestion : sans attendre la discussion du deuxième projet de loi de décentralisation, nous inscrivons dans la présente loi que la formation professionnelle et l’apprentissage relèvent de la compétence des régions – l’intervention de l’État n’était pas efficace. J’insiste beaucoup sur le fait que nous introduisons un dispositif nouveau de concertation et de décision au niveau régional, qui associera les organisations patronales, les organisations syndicales, la région et Pôle Emploi, pour définir une liste des formations nécessaires ; cette liste devra être adaptée aux besoins et pourra donc varier suivant les territoires, mais aussi dans le temps.
Enfin, le nombre des organismes chargés de collecter la contribution à la formation professionnelle et la taxe d’apprentissage et d’en répartir le montant – ce sont parfois les mêmes – sera ramené de plus de 200 à un peu plus de 40. Nous pouvons attendre de cette simplification d’importantes économies de gestion, mais aussi une efficacité accrue.
J’en viens ainsi aux dispositions relatives à l’apprentissage et, plus largement, à l’emploi.
Prenant en compte une décision du Conseil constitutionnel, nous précisons d’abord les modalités de la réforme de la taxe d’apprentissage que nous avions inscrites dans la loi de finances rectificative pour 2013. Les partenaires sociaux auront ainsi tous les éléments pour prendre les décisions nécessaires au bon déroulement de la campagne 2015. Certains estimeront sans doute que ces dispositions devraient plutôt figurer dans une loi de finances que dans ce texte-ci : je dispose des arguments juridiques propres à démontrer qu’elle a au contraire toute sa place dans ce projet de loi.
Nous créons également un contrat à durée indéterminée d’apprentissage, qui permettra de sécuriser l’apprenti – ainsi assuré de pouvoir rester dans l’entreprise au-delà de sa période d’apprentissage – mais aussi l’employeur. Les PME font souvent de gros efforts pour former leurs apprentis et trouvent ensuite très désagréable de voir ces jeunes partir vers une autre entreprise… Il s’agit donc de créer une relation plus étroite, et sur une durée plus longue.
Nous améliorons aussi le contrat de génération. Ce dernier est parfois conclu entre un chef d’entreprise – généralement de TPE – et un jeune qui prendra ensuite sa succession. Or assumer la responsabilité d’une entreprise réclame une certaine maturité et nous avons donc décidé, en accord avec les partenaires sociaux, de porter l’âge limite auquel un jeune peut conclure un tel contrat de 25 à 30 ans.
Nous verrons au cours des débats s’il est nécessaire de compléter encore le contrat de génération ; en effet, les partenaires sociaux ont choisi de s’imposer l’obligation d’une négociation dans les entreprises de 50 à 300 salariés, et je souhaite qu’ils prennent conscience que ces négociations sont aujourd’hui en retard, alors que le contrat de génération est déjà mis en œuvre sans négociation dans les entreprises de plus de 300 salariés et est très utilisé dans celles de moins de 50 salariés. J’ai demandé aux partenaires sociaux de démontrer la pertinence de l’obligation qu’ils se sont imposée ; si je n’étais pas convaincu, peut-être serais-je amené à faire de nouvelles propositions dans le cours de la discussion.
La loi de sécurisation de l’emploi a interdit les temps partiels inférieurs à 24 heures par semaine, à partir du 1er janvier 2014 – ce sont les partenaires sociaux qui avaient fixé cette limite. J’ai choisi de maintenir cette obligation tout en donnant six mois de plus pour réussir les négociations dans les branches. Cette pression a d’ailleurs permis d’aboutir, dans certains domaines, à des accords qui, par exemple dans la restauration rapide, aboutissent à des solutions originales pour valoriser ces temps partiels.
Enfin, ce projet de loi accorde des pouvoirs supplémentaires à l’administration et, en premier lieu, à l’inspection du travail, qu’il convenait de réformer sans remettre en cause, bien sûr, une indépendance garantie tant par la Constitution que par des conventions internationales. Mais il convenait de revoir les méthodes de travail de ce corps afin de combattre plus efficacement le travail illégal, parfois très organisé, par exemple dans le cadre du détachement de travailleurs européens. Nous proposons donc une nouvelle organisation, plus collective, et nous renforçons ses pouvoirs de sanction.
Le renforcement des pouvoirs de l’administration vise également à mieux contrôler que l’argent de la formation va vraiment à ceux qui en ont le plus besoin et à garantir la qualité de cette formation, en écartant les offres douteuses, voire en combattant les dérives, parfois sectaires, constatées ici ou là.
Au total, je pense vous avoir démontré que vous avez là un projet de loi court et simple, qui devrait donc donner lieu à des discussions limpides. (Sourires.)
Mme la présidente Catherine Lemorton. …mais dans des délais très serrés, même si vous avez pris soin de nous communiquer ce projet de loi, par voie électronique, dès la fin du conseil des ministres.
Je regrette aussi que le débat sur le bilan de la loi de sécurisation de l’emploi auquel vous avez fait allusion, et qui a été organisé à la demande du groupe GDR, doive avoir lieu en séance publique au moment même où nous serons occupés à examiner le présent texte en commission. J’ai soulevé le problème en conférence des présidents, mais il n’a pas été possible d’y remédier. J’ouvre maintenant la discussion sur ce texte en donnant, dans un premier temps, la parole aux représentants des groupes politiques.
M. Jean-Patrick Gille, rapporteur. Ce texte aussi clair que limpide était effectivement attendu depuis longtemps. Vous avez raison, il y a urgence.
Il faut y insister : ce projet de loi, comme d’ailleurs tous les textes qui ont organisé la formation professionnelle dans notre pays, est le fruit de longues concertations, qui ont abouti à l’accord national interprofessionnel du 14 décembre dernier. Si tous les partenaires sociaux ne l’ont pas signé, tous y ont contribué.
Loin de constituer une suite disparate de mesures diverses, les principales dispositions de ce texte font système, autour d’une rupture décisive : le passage de l’obligation de dépenser, posée par la loi de 1971, à l’obligation de former. Le compte personnel de formation, l’entretien professionnel, l’intervention d’un conseiller en évolution professionnelle – qui devrait conduire à une rénovation de l’orientation professionnelle – sont de véritables innovations. Mais nombre d’autres dispositions étaient attendues, sur tous les bancs, car elles avaient été trop longtemps repoussées ; je pense notamment à la réforme de la collecte de la taxe d’apprentissage – qu’il a fallu remettre sur le métier après la décision du Conseil constitutionnel –, à la régionalisation de la formation, à la réforme de la représentativité patronale, à celle du financement de la démocratie sociale…
Désormais, l’employeur ne considérera plus la formation comme une dépense obligatoire, mais comme un investissement, comme un moyen d’améliorer la compétitivité de son entreprise. Le salarié, quant à lui, sera mis en confiance par le compte personnel de formation, qui ne sera pas virtuel comme pouvait l’être le droit individuel à la formation (DIF), mais qui sera garanti par l’entretien professionnel et par le conseil en évolution professionnelle.
Certains points restent néanmoins à préciser. Quand se fera le basculement du financement de la formation professionnelle ? Ne faudrait-il pas indiquer qu’il se fera sur la masse salariale de l’année 2015 ? C’est une question qui n’est pas simple, je le sais bien.
Comment seront précisément établies les listes de formations ? Trop larges, elles risquent de nous faire retomber dans les travers du DIF ; trop restreintes, elles risquent de décourager l’initiative et de freiner la responsabilisation des salariés. Comment sera concrétisée la priorité accordée aux personnes non qualifiées, aux jeunes, aux demandeurs d’emploi ?
La gouvernance de la formation professionnelle sera, vous l’avez dit, quadripartite mais pouvez-vous nous confirmer qu’un rôle de chef de file sera bien reconnu à la région ? Pouvez-vous nous préciser comment cette organisation décentralisée se mettra en place ? Quelle place sera réservée aux centres de formation des apprentis (CFA) nationaux et à l’Association nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) ?
S’agissant enfin de la démocratie sociale, comment améliorer la situation du « hors champ » dans ce texte ?
M. Gérard Cherpion. Ce texte est tout à fait intéressant, ne serait-ce que parce qu’il est issu d’un accord national interprofessionnel. Cela étant, d’autres accords de ce type avaient été signés auparavant, et celui de 2009 l’avait même été à l’unanimité, ce qui n’est pas le cas de celui-ci. La loi Larcher de 2008 aussi a été importante : n’est-ce pas elle qui vous permet aujourd’hui de défendre ce projet ? Il faut donc prendre en considération tout ce qui a été fait auparavant, même si je vous rejoins pour dire que, sur certains dossiers comme celui de la représentativité, nous avons peut-être tardé à agir.
Je regrette que le projet de loi ne soit pas une simple transposition de l’accord ; d’autres points sont en effet venus s’y ajouter, ce qui produit un texte dense, voire touffu. Certes, la décision du Conseil constitutionnel obligeait de revenir sur la réforme de l’apprentissage mais, au cours des auditions que nous avons menées par anticipation grâce à notre rapporteur, nous avons pu constater des interrogations, voire des inquiétudes. Ainsi l’État – vous ne l’avez pas mentionné – se désengage de la mission de formation professionnelle des personnes handicapées pour la confier aux régions.
D’autre part, nos conditions de travail, je le souligne moi aussi, ne sont pas idéales, même si nous vous sommes reconnaissants, monsieur le ministre, d’être venu très vite devant la Commission. Comme vous l’avez d’ailleurs reconnu, madame la présidente, un autre rythme de travail serait préférable.
Monsieur le ministre, vous avez parlé d’urgence à réformer la formation professionnelle et, de fait, l’article 4 fixe l’entrée en vigueur de la nouvelle contribution au 1er janvier 2015. Dès lors, je reprends la question du rapporteur : comment et quand se fera le basculement de la collecte ? N’y aura-t-il pas discontinuité ? Si la réforme a le succès qu’on espère, les organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA) ne devront-ils pas s’endetter pour financer les formations, une fois dépensé l’argent qu’ils auront perçu dans les derniers mois de 2014 ?
Aux termes de l’article 9, les OPCA transmettront à chaque région une proposition de répartition des fonds non affectés par les entreprises et, après concertation au sein du bureau, le président du conseil régional les informera de ses observations et propositions de répartition, après quoi ces organismes procéderont au versement des sommes aux CFA. Ces dispositions me semblent appeler des précisions : qui décide en définitive, des régions et des OPCA ?
L’article 11 dispose que les régions financeront et organiseront « la formation professionnelle des Français établis hors de France et l’hébergement des bénéficiaires » : comment donc comptez-vous mettre en œuvre une telle mesure ? Les régions devront-elles vraiment financer l’hébergement d’un Français vivant à Londres ou à Singapour et venant se former en métropole ?
À l’article 18, la situation du secteur hors champ pose problème : il financera le fonds paritaire, mais il ne fera pas partie des organismes décideurs. Dès lors, quelles assurances a-t-il de bénéficier de ce fonds ?
Enfin, comment sera calculée la nouvelle contribution des entreprises d’intérim, qui est actuellement de 2 % de la masse salariale ? Sera-t-elle abaissée dans la même proportion que pour les autres entreprises ?
M. Francis Vercamer. Ce projet de loi est très important dans la situation que connaît notre pays, où tous les indicateurs sont au rouge. Le chômage ne cesse d’augmenter, les impôts croissent massivement, le pouvoir d’achat diminue ; la compétitivité des entreprises est en danger et leur taux de marge a atteint son niveau le plus bas depuis 1985, de l’aveu même du Président de la République. Il ne faut donc pas s’étonner du recul spectaculaire des entrées en apprentissage – une baisse de 9,2 % sur un an, à la fin du mois de novembre. Nous avons aujourd’hui 435 000 apprentis, contre 1,5 million en Allemagne – pays où l’âge minimal d’entrée en apprentissage a été ramené à treize ans quand nous l’avons porté à seize ans. Ces données soulignent la nécessité de mettre tout en œuvre au service de l’emploi.
La formation professionnelle est organisée dans notre pays de façon très complexe, et met en jeu beaucoup d’argent – 32 milliards d’euros par an – sans que, de l’avis unanime, les résultats soient en rapport avec les sommes ainsi dépensées. Un choc de simplification est là aussi nécessaire.
Je salue l’accord national interprofessionnel du 14 décembre, qui devrait permettre d’améliorer la situation. Mais c’est ici la troisième réforme de la formation professionnelle en dix ans, chaque réforme s’étant d’ailleurs appuyée sur un accord préalable des partenaires sociaux. Celle-ci est-elle à la hauteur des enjeux ? Pourra-t-elle être la dernière, ou au moins durer dix ans ? Nous l’espérons.
Très attaché au dialogue social, le groupe UDI sera très vigilant sur le respect de l’équilibre auquel les partenaires sociaux sont parvenus dans l’accord qu’ils ont signé. Nous ferons en revanche des propositions soit pour combler les lacunes du projet, soit pour améliorer les dispositions ajoutées par le Gouvernement par rapport à celles qui figuraient dans l’ANI.
S’agissant de la représentativité et du dialogue social, je ne suis pas sûr que votre méthode soit la plus démocratique possible : vous allez empêcher l’émergence de nouvelles organisations d’employeurs. Le texte ne comporte par ailleurs pas de dispositions en ce qui concerne la représentativité des organisations relevant du hors champ. Ce sont, je vous le rappelle, les élections prud’homales qui ont démontré l’importance de l’économie sociale et solidaire dans notre pays – élections que vous vous apprêtez justement à supprimer, même si cette disposition a été retirée du présent texte ! Selon vous, ces élections coûteraient cher et le taux de participation y serait faible, mais ne pourrait-on dire la même chose de bien d’autres élections dans notre pays ? Je m’opposerai donc résolument à cette suppression, le moment venu.
Le compte personnel de formation nous avait paru inabouti en juin 2013 ; des avancées significatives sont présentées ici. Mais 150 heures sur neuf ans, cela paraît bien faible pour procurer une réelle qualification dans certains secteurs !
Nous nous inquiétons de l’impact de ce projet de loi sur les petites et moyennes entreprises – la CGPME n’a d’ailleurs pas signé l’accord. Les PME sont à l’origine de l’essentiel des créations d’emplois, il importe donc de les soutenir : quelles garanties pouvez-vous leur apporter s’agissant du financement de leurs actions de formation ? La solidarité entre les grandes entreprises et les plus petites sera-t-elle assurée ?
Enfin, sur la forme, je regrette moi aussi cet examen à marche forcée, qui nuit à la qualité de nos travaux. C’est d’autant plus dommage que l’importance du sujet est grande. Je note aussi qu’alors qu’on nous annonce une réforme territoriale renforçant le rôle des régions, on trouve des mesures de décentralisation dans ce texte-ci : cette confusion est regrettable.
M. Christophe Cavard. Ce projet de loi, fruit d’un travail partenarial mené dans la ligne de la Conférence sociale de juillet 2012, veut revenir à l’esprit de l’accord de 1970, traduit dans la loi en 1971 : proposer de nouvelles applications de la démocratie sociale, mieux reconnaître les partenaires sociaux. Attachés au principe du dialogue social et convaincus que la formation professionnelle est indispensable au succès de la transition écologique, les écologistes feront des propositions pour renforcer cette loi, dans le respect de l’équilibre de l’accord trouvé entre les partenaires sociaux.
La création du compte personnel de formation (CPF) est attendue depuis longtemps : parce qu’il est attaché à la personne, parce qu’il pourra être mobilisé à la seule initiative de son bénéficiaire, que celui-ci soit salarié ou demandeur d’emploi, c’est une véritable avancée. Malgré de multiples réformes, la formation professionnelle continue en effet de bénéficier davantage à ceux qui en ont le moins besoin – les salariés les plus diplômés et ceux qui travaillent dans les grandes entreprises. Le CPF est conçu pour être accessible aux publics les plus éloignés aujourd’hui de la formation. Cependant, les fonctionnaires ne devraient-ils pas bénéficier d’un dispositif équivalent ?
Il reste que le plafond de 150 heures suffira rarement à l’obtention d’une qualification effective et ne s’adapte pas facilement à l’offre disponible. Nous proposerons donc d’ouvrir la possibilité d’augmenter le nombre d’heures, par accord de branche professionnelle. Les OPCA ou les collectivités territoriales pourront apporter des financements complémentaires. Au reste, le mécanisme de financement ne nous paraît pas stabilisé et il nous paraîtrait utile de prévoir une évaluation permanente de ce dispositif par les partenaires sociaux eux-mêmes, en lien avec les services de l’État.
Nous nous inquiétons d’un décalage entre les ambitions affichées pour le CPF et les moyens engagés, notamment pour les publics cibles. Que deviendront les outils existants, en particulier le congé individuel de formation (CIF), encore difficile d’accès ?
Le texte garantit la gratuité de l’accès à l’apprentissage, ce qui est une bonne chose. Toutefois, certains CFA nous ont avoué facturer des formations : par quoi ces sommes seront-elles remplacées ? Sera-ce à la charge des régions, et en sont-elles d’accord ?
Dans une situation économique qui impose de réorienter notre production, la politique économique de l’offre annoncée par le Président de la République ne sera efficace qu’à condition de sélectionner les filières prioritaires – transports collectifs, énergies renouvelables, éco-construction, rénovation thermique… L’offre de formation doit suivre : c’est un enjeu majeur pour la reconversion des salariés et pour l’acquisition de nouvelles compétences par les demandeurs d’emploi. Il conviendra donc de s’assurer que les formations figurant sur les listes nationale et surtout régionales répondent bien aux besoins des personnes, mais aussi des branches professionnelles.
La formation professionnelle relèvera désormais de la seule compétence des régions. Que se passera-t-il lorsque des salariés ou des chômeurs souhaiteront suivre une formation spécifique offerte dans une région voisine ?
Enfin, les écologistes, promoteurs d’une économie relocalisée, souhaitent le développement de l’économie sociale et solidaire : celle-ci doit être mieux représentée dans les nouvelles instances de gouvernance de la formation professionnelle.
D’autres questions demeurent. Nous voulons nous engager en faveur de ce texte, mais nous croyons aussi qu’il mérite d’être complété. Nous attendrons donc, comme d’habitude, le terme de la discussion parlementaire pour décider du sens de notre vote sur l’ensemble de ce projet de loi.
M. Jean-Noël Carpentier. Comme la loi sur la sécurisation de l’emploi, ce projet de loi est issu de négociations sociales, à l’initiative desquelles se trouvent le Président de la République et notre majorité : cette démarche, dont nous pouvons être fiers, est en rupture avec la méthode de la majorité précédente. Il revient maintenant au Parlement d’enrichir le texte qui nous est présenté, mais qui constitue une très bonne base.
Les organisations patronales et syndicales se sont engagées dans la rénovation de la formation professionnelle. Ce texte marque un net « changement de braquet » en ce qui concerne les objectifs visant à améliorer la situation de millions de salariés, fluidifier notre marché du travail, mais aussi gagner en compétitivité. La formation est bonne pour le salarié, pour l’entreprise, pour l’économie, pour le pays : chacun doit pouvoir bénéficier de formations qualifiantes tout au long de sa vie professionnelle. C’est un droit moderne pour une société moderne.
Nous avons entendu s’exprimer des inquiétudes sur la pérennité du financement du compte personnel de formation : pouvez-vous nous rassurer ? Comment garantir que les formations inscrites sur les listes soient à la fois crédibles et reconnues ?
S’agissant de la démocratie sociale, ce texte apporte de véritables progrès et permettra une clarification de la situation. Certains utilisaient les faiblesses de la loi pour décrédibiliser l’action sociale et syndicale. Il est donc très heureux que les partenaires sociaux aient pu se mettre d’accord sur le sujet. Je veux d’ailleurs saluer ici tous les militants syndicaux, qui font dans leurs entreprises un travail formidable et animent au quotidien le dialogue social. Dans la période troublée que nous traversons, il faut les soutenir : une société sans syndicats serait catastrophique dans un contexte de crise.
J’approuve également les dispositions relatives à la représentativité des organisations patronales, même s’il faudrait apporter certaines précisions en ce qui concerne les petites entreprises.
Nous abordons nous aussi la discussion parlementaire dans un esprit très positif. Toutefois, monsieur le ministre, envisagez-vous de tendre la main dans les semaines à venir aux organisations non signataires de l’accord, de manière à réaliser peut-être l’unanimité en faveur de cette loi ? Enfin, qu’envisagez-vous concernant le hors champ, qui regroupe tout de même plusieurs millions de salariés ?
Mme Jacqueline Fraysse. L’accès à la formation professionnelle est très inégalitaire dans notre pays, au détriment des salariés des TPE et des PME, des travailleurs les moins qualifiés et des chômeurs, et ces disparités se retrouvent également entre territoires. Si le projet de loi vise à remédier à cette situation, il ne le fait que partiellement et des progrès importants restent donc à accomplir.
Le groupe GDR aborde l’examen de ce texte dans un esprit très constructif. La création d’un compte individuel de formation et la portabilité de ce droit à la formation constituent pour nous d’heureuses dispositions. De même, nous soutenons le passage d’une obligation de dépenser à une obligation de former et nous approuvons le fait de porter de 120 à 150 heures le plafond du droit à la formation. Cependant, si nous acquiesçons à l’approche consistant à penser la formation professionnelle en fonction de l’objectif de réduire le chômage et non en termes de moyens, nous estimons qu’en l’état, le texte reste insuffisant pour ce qui est des droits attachés aux salariés. En effet, le compte personnel de formation (CPF), je le répète, est une bonne idée, dans l’esprit d’ailleurs de la sécurité sociale professionnelle que nous prônons de longue date, mais il reste une coquille vide : faute d’opposabilité, il ne crée aucun droit concret pour le salarié. En outre, le texte ne dissipe pas le flou existant depuis la loi de sécurisation de l’emploi sur le financement des heures de formation que ce salarié pourra mobiliser. Et pour ce qui est des demandeurs d’emploi, des éclaircissements seraient souhaitables sur la façon dont sera financé le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP).
La CGT a également exprimé sa préoccupation devant la forte diminution de la contribution obligatoire des entreprises – de près de 2,5 milliards d’euros, soit de près d’un tiers ! Comment justifiez-vous, monsieur le ministre, cette distorsion entre l’objectif que vous affichez de renforcer la formation professionnelle afin de lutter contre le chômage et cette diminution drastique des financements ? S’agit-il, une fois de plus, de satisfaire le désir du patronat de voir baisser le coût du travail ou avez-vous de meilleurs arguments, que j’entendrai alors avec intérêt ?
Les 150 heures de formation n’étant pour vous qu’un minimum, pourquoi en faire un plafond pour le CPF ? D’autre part, que prévoyez-vous pour combattre l’injustice dont souffriront les salariés à temps partiel, qui ne pourront abonder leur CPF qu’au prorata des heures travaillées alors que 80 % d’entre eux déclarent subir leur situation ?
Nous sommes favorables à une réforme du financement des organisations syndicales et patronales qui permettrait d’éviter les abus et les détournements, mais nous nous interrogeons sur le niveau de ce financement – qu’il provienne des entreprises ou de l’État – et sur les périmètres de répartition de ces fonds. Ainsi, comment sera financée la mise à disposition de salariés ayant une activité syndicale ?
Enfin, le projet de loi prévoit de placer les inspecteurs du travail sous l’autorité d’un responsable d’unité de contrôle et de créer des unités de contrôle régionales de lutte contre le travail illégal, ainsi qu’un groupe national de contrôle ; n’est-ce pas s’exposer à des risques de chevauchement entre ces différentes instances ? D’autre part, si vous avez exprimé votre volonté de maintenir l’indispensable indépendance des inspecteurs du travail, leurs représentants continuent de nourrir des doutes à ce sujet.
Mme Ségolène Neuville, rapporteure pour avis de la Délégation aux droits des femmes. Le taux d’accès des femmes à la formation continue serait, dit-on, comparable à celui des hommes : 43 % contre 45 %, mais ces chiffres maintes fois invoqués ont été publiés par le Centre d’études et de recherches sur les qualifications (CEREQ) en 2009 et se rapportent vraisemblablement à une situation encore antérieure. Quoi qu’il en soit, d’autres données attestent que les salariés à temps partiel, majoritairement des femmes, se forment moins que ceux à temps complet – 37 % contre 45 % – et que l’écart s’accentue en fonction du degré de qualification. En outre, les hommes suivent plus souvent que les femmes des formations menant à un diplôme ou à une qualification reconnue. Le problème, quantitatif, est également qualitatif : les femmes suivent des formations les conduisant à des métiers de femmes, les hommes des formations les conduisant à des métiers d’hommes, 83 % des métiers n’étant pas mixtes. L’orientation explique largement ce constat dans la mesure où elle est souvent influencée par les stéréotypes sexués. Ces phénomènes nourrissent les inégalités professionnelles et salariales entre les femmes et les hommes, celles-ci engendrant ensuite de nouvelles disparités en termes de retraite. Il est donc primordial de développer la mixité des métiers et ce projet de loi y concourra grâce au CPF et au service public de l’orientation confié aux régions.
Demeurent néanmoins quelques questions. En premier lieu, si le comité interministériel aux droits des femmes et à l’égalité entre les femmes et les hommes a souhaité donner la priorité à la formation des salariées à temps partiel, nous notons qu’aux termes du projet de loi, le CPF sera abondé à due proportion du temps de travail effectué. Sachant que les salariés à temps partiel sont souvent peu qualifiés, ne serait-il pas préférable de leur attribuer un temps de formation complet, en sorte qu’ils ne soient pas partiellement formés ?
L’éloignement entre le domicile et le lieu de formation constituant un frein important à la formation des femmes, ne pourrait-on pas développer les formations à distance ? Dans le même ordre d’idée, les frais de garde d’enfants ne devraient-ils pas être compris dans les frais annexes « afférents à la formation » dont l’article 1er du projet prévoit la prise en charge ?
Seriez-vous favorable à l’instauration, pour l’ensemble des conseillers d’orientation et d’insertion, d’une formation obligatoire sur les inégalités professionnelles entre les hommes et les femmes et sur la lutte contre les stéréotypes sexués ?
Les organismes paritaires de collecte agréés (OPCA) n’ont pas pu nous indiquer, au cours des auditions que nous avons organisées, la répartition du budget de la formation entre les femmes et les hommes. Disposeriez-vous de chiffres à ce sujet ? Ne pourrait-on mettre à profit la discussion de ce texte pour demander aux OPCA des statistiques sexuées ?
Mme Colette Langlade, rapporteure pour avis de la Commission des affaires culturelles et de l’éducation. Je commencerai par noter que ce projet de loi démontre que la jeunesse reste une priorité dans l’action du Gouvernement. Cependant, l’avis de notre Commission ne porte que sur trois de ses articles, relatifs à l’apprentissage, au service public de l’orientation et à la carte régionale des formations.
L’efficacité de la pédagogie de l’alternance est unanimement reconnue en matière d’insertion professionnelle. Il en résulte une volonté de développer l’apprentissage, de manière équilibrée, à tous les niveaux de formation, de manière à atteindre l’objectif de 500 000 apprentis en 2017, étant entendu que cette croissance ne devra pas s’opérer au détriment des autres voies de formation professionnelle, notamment de la voie scolaire. Cela étant, ne pourrait-on pas obliger les centres de formation des apprentis (CFA) à fournir une assistance aux jeunes pour trouver un nouvel employeur, en cas de rupture de leur contrat d’apprentissage ?
L’orientation, qui fait l’objet de la vingtième mesure du pacte de compétitivité, constitue un droit et un enjeu majeur pour chacun. Elle doit permettre de construire un projet personnel et professionnel, faciliter l’insertion dans l’emploi et, surtout, contribuer à sécuriser les transitions professionnelles ; elle s’inscrit dans une démarche citoyenne d’émancipation et d’élaboration d’un projet de vie. À ce titre, nous nous réjouissons de l’expérimentation conduite actuellement dans huit régions sur le service public régional d’orientation. Le cahier des charges de celui-ci sera-t-il défini au niveau national ou chaque région élaborera-t-elle le sien ? Les centres d’information et d’orientation (CIO) conserveront-ils leur statut actuel ?
Enfin, je me bornerai à saluer l’article du projet de loi relatif au contrat de plan régional de développement des formations et de l’orientation professionnelles, qui organise l’établissement de la carte des formations en étroite collaboration entre le ministère de l’éducation nationale et les régions, après avis des départements. Nous nous félicitons également de la création du campus des métiers, qui permettra de faire travailler ensemble les acteurs de la formation initiale et ceux de la formation continue.
M. Pierre Morange. Le CPF constitue la pierre angulaire de ce texte dont l’ambition est de mettre la formation professionnelle au service de la sécurisation du parcours des travailleurs et du dynamisme économique. Cependant, la gestion du système serait confiée à la Caisse des dépôts et consignations (CDC) ; ce choix est-il pertinent, sachant que le cœur de métier de celle-ci ne la prépare pas à une gestion administrative d’un compte de formation mesuré en heures, et non en argent ? Le CPF reposant sur des principes d’universalité, de transférabilité et de portabilité, la Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV), qui dispose de fichiers importants et qui a démontré sa capacité à garantir les droits liés à la pénibilité et au compte épargne temps, ne serait-elle pas la structure la mieux équipée pour gérer ces droits à la formation, la CDC en assurant la caution financière ?
Les contraintes de présence freinent l’essor de nouvelles pratiques en matière de formation à distance. Pourtant, le développement de ce type de formation contribuerait à rationaliser l’utilisation des moyens et à augmenter l’offre en direction des publics ayant des réticences à s’inscrire dans des dynamiques collectives de formation professionnelle. Qu’en pensez-vous, monsieur le ministre ?
Mme Monique Iborra. En matière de formation professionnelle, le projet de loi dote les régions d’un bloc homogène de compétence mais prévoit aussi un pilotage du système par quatre acteurs – État, régions, représentants des chefs d’entreprise et organisations syndicales. Ne craignez-vous pas que ce système engendre des dérapages ? À qui devront s’adresser les salariés ou les chômeurs désireux de suivre une formation ? On peut admettre que ces quatre acteurs soient associés au sein d’une instance de concertation, mais la désignation d’un chef de file me paraît nécessaire pour rendre la décentralisation des compétences effective. Sur cette question du pilotage, le texte n’est pas satisfaisant.
Mme Martine Carrillon-Couvreur. Je tiens à saluer la qualité de la méthode qui a présidé à l’élaboration de ce projet de loi.
En septembre 2013, le Premier ministre a réuni le comité interministériel du handicap pour la première fois depuis sa création ; à cette occasion, l’emploi est devenu l’un des axes prioritaires des politiques du handicap. Poursuivant cette démarche, le projet de loi introduit un volet consacré au handicap dans la réforme de la formation professionnelle. Je salue ces dispositions de nature à faciliter l’accès à l’emploi des personnes handicapées et à sécuriser leur parcours professionnel.
En la matière, l’enjeu réside avant tout dans l’articulation efficace des dispositifs de droit commun et des mesures spécifiquement destinées aux personnes handicapées les plus éloignées de l’emploi.
Les jeunes en situation de handicap sont plus que les autres soumis aux aléas des parcours professionnels, de sorte qu’il convient de mettre l’accent sur la continuité et sur la fluidité des formations. À cette fin, ne pourrait-on prévoir un « axe jeunes » structuré au sein du plan régional d’insertion des travailleurs handicapés (PRITH) ? Cela permettrait d’améliorer le maillage du territoire et, en particulier, de renforcer les missions locales afin d’impliquer les acteurs en amont du processus.
Ne pourrait-on également envisager un rapprochement entre les établissements et services d’aide par le travail (ESAT) et les dispositifs de droit commun, sachant que le comité interministériel du handicap a souhaité développer les échanges entre les milieux ordinaire et protégé ? Ce rapprochement permettrait de trouver plus facilement une solution pour les travailleurs handicapés sortant d’un ESAT.
Enfin, pour les jeunes en situation de handicap, ne pourrait-on reporter de 25 à 30 ans l’âge limite pour accéder une formation différée ?
M. Michel Liebgott. J’ai été surpris de la violence des propos tenus par la CPGME sur cette réforme de la formation professionnelle. Alors que les PME éprouvent des difficultés à recruter et à former des jeunes, on peut s’étonner de l’absence de soutien à un texte qui fixe l’objectif d’avoir 500 000 apprentis en 2017. Cette position hostile est-elle motivée par je ne sais quelles arrière-pensées ?
Comment s’opérera la coordination entre la politique de formation – que le texte régionalise – et la politique nationale de l’emploi, notamment en vue de soutenir le développement de certaines filières industrielles ?
Il est absolument indispensable de régler le problème de la taxe d’apprentissage pour les lycées professionnels. L’inquiétude sur ce sujet est grande alors que ces formations, très qualifiantes, débouchent sur des emplois.
Enfin, je regrette que Mme Neuville ne soit plus là pour m’entendre mais je ne puis m’empêcher de noter que, lorsque de vieux élus mâles se retirent, il est souvent difficile de les remplacer par des femmes parce que la parité se trouve déjà atteinte. Peut-être faudrait-il revoir la loi si l’on souhaite que les femmes puissent être plus nombreuses que les hommes ?
M. Jean-Marc Germain. Je me réjouis de la présentation – dans les délais prévus par la loi de sécurisation de l’emploi – de ce projet de loi créant le compte personnel de formation que les groupes GDR et SRC appelaient depuis longtemps de leurs vœux.
Comment la formation professionnelle ainsi réformée s’articulera-t-elle avec la formation initiale différée, qui permet de compenser les années de formation initiale perdues par ceux qui quittent prématurément l’école ? Ce beau dispositif sera-t-il décentralisé ou l’État interviendra-t-il en la matière à travers l’Éducation nationale ?
Comment rassurer les salariés des PME et des entreprises de taille intermédiaire sur le maintien du niveau de formation dans un cadre où l’obligation de former doit primer sur celle de dépenser ?
Le choix de l’adhésion plutôt que de l’élection pour fonder la représentativité patronale est regrettable. Dès lors qu’on souhaite renforcer la démocratie sociale, il convient de donner la primauté au processus électif. Pourquoi avez-vous écarté cette option, monsieur le ministre ?
Des textes internationaux garantissent l’indépendance de l’inspection du travail, de sorte qu’on peut écarter toute inquiétude en la matière. Cependant, si vous maintenez globalement les effectifs de contrôleurs et d’inspecteurs, l’évolution de l’échelon de l’encadrement intermédiaire fait craindre un recul de la présence sur le terrain, alors que celle-ci est essentielle.
Mme Fanélie Carrey-Conte. Il serait souhaitable de préciser certains articles du projet de loi afin de s’assurer que l’ensemble des salariés en insertion – quels que soient le statut de la structure d’insertion par l’activité économique (IAE) dans laquelle ils sont employés et le type de leur contrat – aient accès aux dispositifs prévus pour les demandeurs d’emploi. Les acteurs de l’IAE devraient également être associés à l’élaboration et à la conduite des politiques de formation dans les régions.
Il convient d’autre part que les dispositions relatives à la représentativité patronale n’aboutissent pas à figer la situation existante, mais permettent au contraire la traduction d’éventuelles évolutions. Le texte actuel ne lève pas les interrogations que nous pouvons avoir sur la possibilité de prendre en compte cette dynamique. Ainsi, je doute moi aussi de la pertinence qu’il y a à faire prévaloir l’adhésion sur l’élection. Quant à la question du hors champ, elle ne se pose pas seulement à propos des procédures de concertation : elle concerne également le financement des organisations syndicales.
M. Denys Robiliard. Je me réjouis de l’état d’esprit dans lequel tous les groupes politiques abordent l’examen du présent projet de loi. Cela permettra de réfléchir ensemble à la meilleure façon d’améliorer ce texte et, notamment, d’affirmer une véritable priorité en faveur des chômeurs et des personnes peu ou pas du tout qualifiées. Cela étant, grâce à sa portabilité, le compte personnel de formation devrait connaître un succès qui a été refusé au DIF.
Les dispositions de la section 8 de l’article 16 sont bienvenues dans la mesure où elles pallient la faible représentativité des organisations patronales dans certaines branches, y rouvrant ainsi la possibilité de négociations.
Vous avez réaffirmé, monsieur le ministre, l’indépendance de l’inspection du travail, mais il faut veiller, comme l’a souligné M. Jean-Marc Germain, à ce que la présence des inspecteurs et contrôleurs sur le terrain ne diminue pas. Pourriez-vous par ailleurs nous en dire plus sur deux séries de dispositions intéressantes : celles qui ont trait à l’arrêt d’activité et celles qui donnent aux inspecteurs du travail la faculté de prononcer des amendes administratives et de participer à des transactions pénales ?
M. Michel Issindou. La formation constitue la clef de la compétitivité de nos entreprises. La loi de 2009 n’a amené aucune évolution d’ampleur et il convenait donc d’élaborer un nouveau texte. Ce projet de loi crée de fait un vrai droit personnel à la formation, porte une attention particulière aux chômeurs et aux jeunes et clarifie la gouvernance de la politique de formation.
Cependant, les contrôleurs et les inspecteurs du travail que j’ai rencontrés nourrissent des inquiétudes sur la nouvelle organisation de leur mission. Pourriez-vous les rassurer, monsieur le ministre ?
Mme Sylviane Bulteau. La crise économique explique sans doute pour partie la diminution des entrées en apprentissage signalée par notre collègue Vercamer, mais la complexité des dispositifs et les inquiétudes des familles sur les conditions de vie des apprentis peuvent également y avoir contribué. Le projet de loi devrait aider à lever ces difficultés. En tout état de cause, je tiens à saluer l’engagement des professionnels et des entreprises qui forment les apprentis et à les assurer de notre volonté politique de développer l’alternance.
Monsieur le ministre, je reviendrai sur une « question qui fâche » que j’avais déjà posée lors de la discussion de la loi de refondation de l’école. Le jeune entre en apprentissage après la classe de troisième et à l’âge de quinze ans, il n’est pas question d’y revenir. En revanche, je trouve dommage qu’un adolescent qui a ces quinze ans au cours du dernier trimestre de l’année civile ne puisse pas devenir apprenti à la rentrée. Je compte donc déposer un amendement permettant de faire preuve de souplesse. Si l’on veut développer l’apprentissage et atteindre l’objectif de 500 000 apprentis à l’horizon de 2017, il convient de répondre à cette demande et aux besoins des employeurs.
Mme Hélène Geoffroy. Désormais, le statut de demandeur d’emploi ne constituera plus un frein au développement d’un projet professionnel. En effet, si j’ai bien compris les termes du projet, le compte personnel de formation sera accessible aux salariés en congé parental, aux chômeurs, aux bénéficiaires du RSA et aux personnes suivant un parcours d’insertion. Pourriez-vous toutefois nous préciser comment les demandeurs d’emploi ne percevant pas d’allocation chômage pourront utiliser ce dispositif, sachant qu’ils sont souvent réticents à suivre une formation non rémunérée, si indispensable soit-elle, leur priorité étant de trouver un travail ?
La formation se situe à l’intersection de deux mondes : celui de l’emploi et celui des dispositifs d’insertion professionnelle. Comment tout cela sera-t-il coordonné ? Comment les priorités en matière de formation seront-elles établies ? Comment s’assurera-t-on que tous les demandeurs d’emploi ont bien la possibilité d’accéder à cette formation ?
Mme Kheira Bouziane. La régionalisation de la formation professionnelle ne fait-elle pas courir le risque d’une disparité des offres, en fonction des moyens dont dispose chaque région ?
Le compte personnel de formation ouvert dans une région sera-t-il exportable dans une autre ? En effet, certains demandeurs d’emploi ou salariés voulant suivre une formation dans une autre région que la leur rencontrent actuellement des difficultés pour la faire financer.
Enfin, que répondre aux lycées professionnels qui s’inquiètent d’une possible réduction du financement des formations qu’ils dispensent ?
Mme Annie Le Houérou. Le réseau Cap emploi assiste les personnes handicapées, plus touchées que le reste de la population par le chômage, dans leur recherche d’un emploi ou les aide à conserver celui qu’elles ont. Parmi le public ainsi suivi, 40 % ont plus de 50 ans et 75 % ont un niveau de formation V – équivalent au brevet d’études professionnelles (BEP), au certificat d’aptitude professionnelle (CAP) ou au brevet des collèges –, si bien qu’ils quittent difficilement ce dispositif. L’accompagnement de ces personnes s’avère donc complexe et long. Les Cap emploi, opérateurs spécialisés, s’inquiètent aussi de leur positionnement par rapport à Pôle emploi, aux missions locales et, surtout, à l’Association de gestion du fonds pour l’insertion des personnes handicapées (AGEFIPH) qui les finance. D’autre part, l’intensité et la qualité de leur action varient selon les régions. Monsieur le ministre, confirmez-vous leur rôle d’opérateurs spécifiques chargés d’accompagner les personnes handicapées vers l’emploi ou dans l’emploi ?
(Présidence de Mme Martine Carrillon-Couvreur, vice-présidente de la Commission)
M. le ministre. Si, en effet, plusieurs accords sur la formation professionnelle ont été signés depuis 1971, un des plus récents ayant abouti à la création du DIF, les partenaires sociaux considèrent que l’accord de décembre dernier, par son ampleur et sa profondeur, relève d’une autre dimension. En conséquence, l’unanimité était très difficile à atteindre et la rechercher à tout prix aurait d’ailleurs pu être contre-productif. La CGT et la CGPME ont refusé d’approuver le texte, mais non sans de vifs débats en leur sein. La CGT, qui défend depuis longtemps le principe du compte personnel de formation et qui avait signé l’accord sur le DIF ne garantissant que 120 heures de formation, a d’ailleurs indiqué qu’elle ne combattrait pas ce projet, mais qu’elle espérait le voir amélioré. On ne peut que se féliciter de cette position dans la perspective des discussions qui vont s’ouvrir, en vue d’une application effective de ces dispositions, dans les branches et dans les entreprises comme dans les territoires. La CGPME, quant à elle, s’est inquiétée avant tout du financement de la formation dans les PME et des PMI : nous pouvons la rassurer sur ce point grâce au mécanisme de mutualisation et aux dispositions permettant à tout salarié d’ouvrir un compte personnel de formation quelle que soit la taille de son entreprise. M. Liebgott a fait allusion à d’autres types de préoccupations et il est vrai que la CGPME a développé des liens, d’ailleurs légitimes, avec des organismes de formation, mais j’espère que notre action en matière de représentativité et en faveur d’un financement pérenne des organisations patronales la rassurera.
Une entreprise n’est pas une personne physique et ne peut donc pas voter comme un salarié. Au-delà des postures, tout le monde a considéré que l’adhésion devait l’emporter sur l’élection pour mesurer la représentativité d’une organisation patronale. Nous avons évidemment pris en compte le nombre de salariés par entreprise car, si nous avions adopté le principe « une entreprise, une voix », l’organisation représentant l’artisanat serait devenue la plus importante, ce qui n’aurait pas reflété l’état de l’économie française.
La question du hors champ est évidemment importante et les organisations agricoles, de l’économie sociale et solidaire et des professions libérales se sont mises d’accord, à ma demande, sur les modalités de leur prise en compte. Je les ai également sollicitées pour qu’elles discutent avec les trois organisations représentatives au niveau interprofessionnel en vue d’assurer leur participation aux négociations et au financement de la formation. Ces discussions sont en cours. Je déposerai un amendement visant à introduire le hors champ dans le texte, de manière à ce qu’il soit reconnu et occupe la place qui lui revient.
Le projet de loi contient des dispositions importantes sur les branches ; nous fondons beaucoup d’espoir sur le dialogue social et des négociations décisives sont actuellement conduites à ce niveau aussi, par exemple sur le temps partiel ou sur la généralisation de la complémentaire santé. Mais il existe 700 branches professionnelles en France, dont seulement 200 fonctionnent correctement. Les autres pâtissent du nombre très limité d’adhérents du côté patronal ou du côté des salariés et de l’absence de dynamique contractuelle. Je souhaite donc clarifier la situation, notamment en réduisant le nombre de branches, afin que tous les salariés puissent être couverts par un accord de branche.
Je suis fier du corps de l’inspection du travail et je m’attache à défendre effectivement son indépendance. Mais celle-ci doit avoir des effets et il convient donc de veiller au maintien du caractère généraliste et territorial de l’action de l’inspecteur du travail. Pour que cette action gagne en efficacité, le projet propose une nouvelle organisation, permettant le travail en groupe. Pour autant, les agents resteront individuellement indépendants et, après leur constat, décideront seuls de l’opportunité de transférer leurs procès-verbaux ou de prendre des décisions immédiates pour faire cesser des situations dommageables aux salariés.
Nous conduirons à son terme la réforme de l’IAE en cours, sachant qu’elle ouvre tous les dispositifs de formation aux salariés présents dans ce dispositif.
Monsieur Cherpion, dans un souci de simplification, toutes les actions en matière de formation professionnelle encore exercées par l’État seront transférées aux régions : cela concerne la formation des détenus comme celle des Français de l’étranger, publics au reste peu nombreux. Les conseils régionaux désigneront une région de référence, qui assurera un rôle de pivot en matière de financement.
Le taux de 2 % appliqué à l’intérim sera maintenu, à moins qu’un accord de cette branche ne le modifie.
Le CPF a une vocation universelle et il bénéficiera donc à tous les salariés, aux chômeurs ou aux jeunes. Mais il est également appelé à s’ouvrir aux indépendants et aux fonctionnaires – dans ce dernier cas, il y faudra toutefois une négociation entre Mme Marylise Lebranchu, ministre de la réforme de l’État, de la décentralisation et de la fonction publique, et les organisations syndicales.
Tous les dispositifs prévus par cette loi, y compris le CPF, entreront en vigueur le 1er janvier 2015 et seront, à cette date, opérationnels et financés. L’ensemble des acteurs concernés travaillent à régler à cette fin toutes les questions techniques et comptables qui se posent encore et j’entends ne pas céder sur ce point afin que rien ne fasse obstacle à une volonté politique partagée.
Le financement du compte personnel de formation exigera 1,2 milliard d’euros, contre seulement 200 millions d’euros pour le DIF : cette comparaison illustre bien un changement d’échelle, je pense. Alors que la durée de 120 heures était un plafond dans le DIF, celle de 150 heures est plutôt un plancher, qui pourra être dépassé par l’ajout de financements complémentaires. La mesure viendra, je le souhaite, renforcer celles que nous avons prises pour combattre la pénibilité : dans ce dispositif, les points accumulés sur le compte personnel peuvent être convertis en droits à la formation et il ne serait pas malvenu qu’inversement en quelque sorte mais dans le même esprit, les heures de formation suivies au-delà du socle de 150 heures puissent être utilisées pour sortir de la pénibilité. Des abondements supplémentaires seront apportés par les régions ou par Pôle emploi pour les demandeurs d’emploi, afin d’atteindre des quotas d’heures conformes à leurs besoins de qualification. Des accords de branche ou d’entreprise pourront également augmenter la quantité d’heures versées au CPF pour les salariés les moins qualifiés.
Les lycées professionnels, madame Langlade, pourront continuer de bénéficier de la taxe d’apprentissage, y compris hors apprentissage car, lorsqu’un de ces établissements mobilise cette taxe pour acquérir une machine, il va de soi qu’il utilisera aussi celle-ci pour la formation initiale qu’il dispense.
Quant aux CIO, ils conserveront leur statut actuel ; un cahier des charges national du service public de l’orientation sera élaboré mais, dans la continuité du projet de loi sur la décentralisation déposé par le Gouvernement, le projet prévoit sa déclinaison et son adaptation dans chaque région.
Mme Martine Carrillon-Couvreur, présidente. Merci, monsieur le ministre.
Au cours de ses séances du mercredi 29 janvier 2014, la Commission examine, sur le rapport de M. Jean-Patrick Gille, les articles du projet de loi relatif à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale (n° 1721).
Mme la présidente Catherine Lemorton. L’ordre du jour appelle la discussion, sur le rapport de M. Jean-Patrick Gille, du projet de loi relatif à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale (n° 1721). Je vous rappelle que le Gouvernement a engagé la procédure accélérée sur ce texte ; adopté mercredi dernier en conseil des ministres, il sera discuté en séance publique dès le 5 février prochain.
Je remercie de leurs efforts le rapporteur et les parlementaires, majorité et opposition confondues, mais aussi les services de la Commission, qui ont dû travailler ce texte particulièrement complexe dans ces délais extrêmement resserrés. Vous savez ce que je pense de ces calendriers très contraints – je m’en suis d’ailleurs expliquée encore une fois ce matin sur une chaîne de radio.
L’audition de M. le ministre, la semaine dernière, a tenu lieu de discussion générale : nous pouvons donc passer directement à l’examen des articles.
TITRE IER
FORMATION PROFESSIONNELLE ET EMPLOI
Chapitre Ier
Formation professionnelle continue
Article 1er
(art. L. 1233-67 à L. 1233-69 ; L. 2241-6, L. 2323-37, L. 5212-11, L. 6111-1, L. 6312-1, L. 6323-1 à L.6323-21, L. 6323-22 [nouveau], L. 6324-7, L. 6324-9, L. 6325-24, L. 6331-14,
L. 6331-26 et L. 6523-1 du code du travail)
Mise en œuvre du compte personnel de formation
Le présent article précise la portée et les modalités de fonctionnement du compte personnel de formation (CPF) instauré à l’article L. 6111-1 du code du travail par l’article 5 de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 de sécurisation de l’emploi.
Le législateur a renvoyé à la négociation au niveau national entre les partenaires sociaux ainsi qu’à la concertation dite « quadripartite » (6) entre ces derniers, l’État et les régions, le soin d’en préciser le contenu. Sur la base de leur travaux et afin que, dès le 1er janvier 2015, le CPF soit effectif pour l’ensemble des salariés et des demandeurs d’emploi, le présent article établit les dispositions législatives nécessaires à sa mise en œuvre en remplacement de l’ensemble des dispositions actuellement applicables au droit individuel de formation (DIF), dès lors abrogées.
Le CPF devient le support d’un droit d’initiative à formation auquel la loi confère des garanties d’effectivité en l’orientant vers les formations les plus qualifiantes. Les modalités de fonctionnement du compte visent en effet à lui conférer des garanties de deux ordres, individuelles et collectives.
Au niveau individuel, le compte personnel de formation permet à son titulaire, salarié ou demandeur d’emploi, de prendre l’initiative de s’engager dans une formation sur le fondement de droits à heures de formation qu’il a progressivement acquis et qu’il conserve tout au long de son parcours professionnel.
Au plan collectif le présent article entoure le compte personnel de formation de garanties visant à ce que son usage contribue à mieux orienter les financements de la formation professionnelle vers la qualification : la définition de listes des formations éligibles doit permettre de traduire des priorités nationales, régionales et de branches, afin d’améliorer l’employabilité des salariés et la compétitivité des entreprises ; l’abondement en heures de formation complémentaires, par les différents financeurs de la formation professionnelle continue, doit permettre au titulaire du compte de suivre une formation d’une durée supérieure aux heures qu’il a acquises, dans le but de sécuriser son parcours professionnel. Ces garanties s’appuient en outre sur un financement dédié et mutualisé défini aux articles 4 et 5.
5. Les garanties individuelles : un droit d’initiative de formation, capitalisable et pleinement transférable.
a. Les précisions apportées aux principes fixés par la loi sur la sécurisation de l’emploi
Au I du présent article, les alinéas 1 à 3 modifient l’article L. 6111-1 du code du travail dans sa rédaction issue de l’article 5 de la loi du 14 juin 2013 de sécurisation de l’emploi afin de préciser les grands principes régissant le compte personnel formation.
À titre de coordination, diverses dispositions ajoutées à l’article L. 6111-1 par la loi du 14 juin 2013 sont supprimées par l’alinéa 3 car elles sont désormais détaillées dans les nouvelles dispositions figurant au II du présent article : il établit en effet un nouveau chapitre III relatif au compte personnel de formation, du titre premier et du livre premier, relatifs aux principes généraux et à l’organisation institutionnelle de la formation professionnelle, de la sixième partie du code du travail, relative à la formation professionnelle tout au long de la vie.
Ce chapitre III est ordonné en trois sections : une section 1, aux alinéas 7 à 36, relative aux principes communs, ainsi qu’une section 2, aux alinéas 37 à 68, et une section 3, aux alinéas 69 à85, relatives, respectivement, à la mise en œuvre du compte personnel de formation pour les salariés et pour les demandeurs d’emploi. En effet si un objectif d’universalité du compte est assigné par l’article L. 6111-1 qui le destine à « chaque personne (…) indépendamment de son statut », le champ de la négociation des partenaires sociaux n’a pu couvrir que les salariés et les demandeurs d’emploi.
Les non-salariés et les agents publics, qui ne relèvent pas directement du code du travail, ont cependant vocation à disposer du compte personnel de formation. Votre rapporteur souhaite donc que des négociations en ce sens soient engagées au plus vite après le déploiement du CPF pour les salariés et les demandeurs d’emploi: les mobilités professionnelles n’ont pas lieu uniquement dans le cadre du salariat et des transitions, par exemple, entre secteur public et secteur privé ne doivent pas entraîner la perte de droits à formation.
L’alinéa 2 du présent article conforte la vocation du compte à faire mieux contribuer le système de formation professionnelle à la hausse de qualification des travailleurs : il est précisé, que le compte personnel de formation contribue « au développement des compétences et des qualifications » de son titulaire. Il en résulte que le compte n’a pas vocation à financer l’ensemble des formations, mais seulement celles qui contribuent effectivement aux objectifs figurant déjà au premier alinéa du même article : l’évolution professionnelle ainsi que la progression d’au moins un niveau de qualification au cours de la vie professionnelle. Depuis l’accord national interprofessionnel du 5 octobre 2009, ces objectifs sont étroitement associés à celui de sécurisation des parcours professionnels, né du constat fait par les partenaires sociaux que « le renouvellement accéléré des techniques de production et de distribution des biens et des services sollicite toujours davantage l’initiative et la compétence de chacun des salariés ; leurs aspirations à une meilleure maîtrise de leur évolution professionnelle nécessitent de renouveler les objectifs et les moyens de la formation professionnelle continue. »
Aussi l’alinéa 2 précise-t-il que le compte permet à la personne de bénéficier de formations « à son initiative » : le droit d’initiative individuelle du travailleur doit lui permettre suivre une formation à des fins de qualification au moment opportun, notamment lors des transitions professionnelles, voulues ou subies.
Ce choix ressort du constat de l’échec du DIF qui relevait d’une initiative dite partagée du salarié et de l’employeur, selon la rédaction actuelle de l’article L. 6323-9 du code du travail qui dispose que : « la mise en œuvre du droit individuel à la formation relève de l’initiative du salarié, en accord avec son employeur ». Dans un contexte de subordination du salarié à l’employeur, donc de pouvoir de direction de ce dernier, ce défaut de conception du DIF a sans nul doute contribué à sa faible appropriation par les salariés. L’existence d’un droit individuel ne suffit pas à en susciter l’usage ; le contexte, qui détermine les conditions favorables ou non de son application, reste décisif : concernant le DIF, le constat paraît sans appel, mesuré par le taux d’accès de 6,5 % en 2010 (7).
Aussi, le VII du présent article modifie l’article L. 6312-1 afin de supprimer la catégorie d’accès des salariés à des actions de formation professionnelle continue, assuré « à l’initiative du salarié avec l’accord de son employeur ». Il en résulte une dualité plus claire : d’une part les formations à l’initiative de l’employeur, le cas échéant dans le cadre du plan de formation, d’autre part les formations à l’initiative du salarié, qui recouvrait principalement le congé individuel de formation mais qui comprend désormais également le compte personnel de formation.
Enfin, dans sa rédaction actuelle, l’article L. 6111-1 prévoit que chaque personne dispose d’un compte personnel de formation « dès son entrée sur le marché du travail », sans précision sur le terme au-delà duquel le compte ne peut plus être utilisé. L’objectif de « formation professionnelle tout au long de la vie » figurant dans la même phrase maintenait donc une incertitude, laissant entrevoir une utilisation du compte après la fin de la vie active Aussi est-il ajouté que la personne dispose du compte « jusqu’à la retraite », ce qui est cohérent avec l’objectif de concentrer les moyens de la formation professionnelle continue sur l’amélioration de la qualification des actifs occupés et des demandeurs d’emploi, seuls exposés au risque de perte d’employabilité. Aussi l’alinéa 11 précise-t-il, dans la nouvelle rédaction de l’article L. 6323-1 que « le compte est fermé lorsque la personne est admise à faire valoir l’ensemble de ses droits à la retraite ».
Aux alinéas 9 et 10, le même article L. 6323-1 précise les contours de la condition d’ « entrée sur le marché du travail » : le compte est ouvert pour toute personne âgée d’au moins seize ans occupant un emploi ou à la recherche d’un emploi ou accompagnée dans un projet d’orientation ou d’insertion professionnelles, ce qui recouvre manifestement l’ensemble des cas de figure. La condition d’âge est abaissée à quinze ans pour le jeune qui signe un contrat d’apprentissage, possibilité subordonnée par le deuxième alinéa de l’article L. 6222-1 au fait d’avoir accompli la scolarité du premier cycle de l’enseignement secondaire.
b. L’acquisition et la capitalisation des droits à heures de formation
• La comptabilisation des droits en heures de formation
À l’alinéa 12, l’article L. 6323-2 reprend le principe, posé par la loi du 14 juin 2013 de sécurisation de l’emploi, de comptabilisation des droits de formation en heures.
Alors que le DIF reposait in fine sur un forfait réglementaire de l’heure de formation - de 9,15 euros depuis 2009 -, le fait d’écarter toute « monétisation » des heures constitue une garantie de pérennité des droits acquis. Les heures de formation inscrites sur le compte n’ont en effet pas vocation à être utilisées de façon éparse et régulière mais prioritairement de façon importante à certains moments-clés de la vie professionnelle. Dès lors, il importe d’éviter l’érosion de leur « pouvoir d’achat », qui interviendrait sans nul doute en cas d’établissement sur une base monétaire aux règles d’indexation incertaines ou fragiles.
De la part des partenaires sociaux qui ont rappelé ce principe à l’article 13 de l’ANI, c’est le signe manifeste de la volonté d’assurer une nouvelle forme de solidarité interbranche : les heures figurant sur le compte seront financées non pas prioritairement au regard de leur coût mais en fonction du caractère qualifiant de la formation, afin de hausser globalement le niveau du tissu productif et de former les salariés qui en ont besoin au moment opportun. La formation n’est ainsi pas considérée comme une dépense de fonctionnement dont le coût doit être encadré par principe, mais comme un investissement, évalué prioritairement au regard de son utilité propre, et, seulement en second lieu, au regard de son coût.
La comptabilisation en heures de formation constitue également un gage de transférabilité des droits en cas de changement d’emploi ou de perte d’emploi.
• La transférabilité des heures acquises
À l’alinéa 13, l’article L. 6323-3 retranscrit le principe de pleine transférabilité posé par la loi du 14 juin 2013 de sécurisation de l’emploi et dispose que « les heures de formation inscrites sur le compte demeurent acquises en cas de changement de situation professionnelle ou de perte d’emploi de son bénéficiaire ».
Il s’agit d’une rupture avec les principes régissant le DIF dont l’article 6 de la loi n°2009-1437 du 24 novembre 2009, aux articles L. 6323-17 à -21 dans leur rédaction actuelle, a certes prévu la « portabilité » mais a restreint l’application aux ruptures ou arrivées à terme de contrat de travail ouvrant droit à l’assurance chômage, ce qui écarte les démissions volontaires. Le cas de licenciement pour faute lourde a en outre été expressément écarté.
Dans le cadre de la « portabilité » actuelle du DIF, les droits résiduels auprès d’un employeur ne peuvent être conservés que pendant la période de chômage consécutive ou, pendant deux ans, chez un nouvel employeur. L’utilisation des droits est en outre tributaire du fait que l’employeur ait fait porter sur le certificat de travail du salarié le montant des droits DIF qu’il a acquis. Elle nécessite également la bonne identification, sur le même document, de l’organisme paritaire collecteur agréé qui devra les valoriser.
En 2011, près de 21 000 DIF portables ont été financés, pour une prise en charge moyenne de 760 euros et une durée moyenne de 72 heures, les demandes proviennent à 83 % des demandeurs d’emploi. Ceci illustre la non transférabilité de fait du DIF, dans les cas de mobilité professionnelle sans épisode de chômage.
La transférabilité des heures du CPF prévue par le présent article est en outre plus importante que ne l’envisageaient les partenaires sociaux : la restriction applicable aux cas de rupture du contrat de travail pour faute lourde n’est pas maintenue alors que le dernier alinéa de l’article 13 de l’ANI prévoit qu’« en cas de faute lourde, les heures portées au crédit du compte personnel de formation au titre de l’exécution du contrat de travail qui a donné lieu à licenciement pour ce motif sont débitées du compte ».
Votre rapporteur est favorable au retrait de cette condition restrictive : cela évite de fragiliser la mobilisation du compte au regard d’une qualification juridique de la rupture du contrat de travail avancée unilatéralement par l’employeur et susceptible d’être contestée devant la juridiction prudhommale. En outre, ces situations privent déjà le salarié de l’indemnité de licenciement et de l’indemnité compensatrice de préavis et le placent dans une situation de transition professionnelle d’autant plus difficile. Il peut être nécessaire dans ce cas d’accéder à une formation sur la base de l’ensemble des droits régulièrement acquis dans le cadre de la relation de travail.
• Les modalités d’alimentation du compte en heures de formation
Les règles d’acquisition des heures de formation sont fixées par les alinéas 41 à 44. À l’alinéa 41, l’article L. 6323-9 dispose que le compte est alimenté en heures de formation chaque année : il s’agit du socle du compte, constitué des droits propres acquis dans le cadre de la relation de travail, sur le modèle du DIF. Cette règle étant posée dans la section relative à la mise en œuvre du compte personnel de formation pour les salariés, l’alimentation à un rythme annuel ne concerne donc que les personnes en emploi. En situation de recherche d’emploi, le compte personnel de formation n’est plus alimenté, son titulaire se trouvant d’abord en situation d’avoir à utiliser les heures qui y figurent.
À l’alinéa 42, l’article L. 6323-10 reprend les règles d’alimentation du compte proposées par les partenaires sociaux à l’article 15 de l’ANI : l’alimentation du compte se fait à hauteur de 20 heures par année de travail jusqu’à l’acquisition d’un crédit de 120 heures puis de 10 heures par année de travail à temps complet dans la limite d’un plafond total de 150 heures. Ce mécanisme reprend donc celui de l’alimentation du DIF mais en augmente le plafond de 25 %, l’ajout de 30 heures se faisant pendant trois années supplémentaires.
Il en ressort que l’acquisition de ces nouveaux droits est bloquée tant que le titulaire n’a pas épuisé tout ou partie de son crédit d’heure en dessous du plafond de 150 heures: l’alimentation en heure reprend dès que le nombre d’heures créditées est inférieur au plafond.
Le maintien d’un plafond, même augmenté d’un quart par rapport à celui du DIF, peut interroger dans la mesure où le compte personnel de formation vise à favoriser l’accès à des qualifications, donc à des formations longues, notamment en apportant la garantie de conservation et de traçabilité des droits et leur pleine transférabilité.
Mais votre rapporteur y voit deux séries de justifications. En premier lieu, le compte personnel de formation s’inscrit dans un effort collectif visant à améliorer l’accès à la formation de ceux qui en ont le plus besoin : en cas de besoin de formation important, les droits acquis en propre sur le CPF ont vocation à être complétés par des abondements issus de financements apportés par des tiers. Ainsi que l’a indiqué le Ministre du travail lors de son audition par votre commission des affaires sociales, les 150 heures constituent ainsi moins un plafond qu’un plancher.
En second lieu, ce premier bloc de 150 heures s’inscrit dans une tendance, qu’il convient d’encourager, consistant à concevoir les formations en modules, c’est-à-dire en blocs homogènes de savoirs et compétences. Une formation qualifiante de 600 heures peut ainsi être décomposée en plusieurs blocs par oppositions à certaines formations qualifiantes organisées de façon rigide, sans tenir compte du profil du stagiaire ou du nécessaire aller-retour entre la formation et sa mise en pratique, qui évite la déperdition des savoirs acquis. La modularité constituée de validations intermédiaires ou partielles des formations qualifiantes peut en outre faciliter l’accès à des qualifications des publics qui ont le moins d’appétence à la formation. Cette tendance est au demeurant confirmée par l’offre des organismes de formation dont la durée moyenne est en recul depuis plusieurs années, en baisse de dix-neuf heures depuis dix ans.
L’article L. 6323-10 dispose également que l’alimentation se fait sur la base d’une année de travail « à temps complet » et que lorsque le salarié n’a pas effectué cette durée de travail sur l’ensemble de l’année, l’alimentation est calculée à due proportion du temps de travail effectué. Si le principe de proratisation des droits à heures de formation en fonction d’une durée annuelle de travail de 1 600 heures est conforme au souhait des partenaires sociaux, la question de son adéquation aux situations de temps partiel subi peut être posée. Selon l’observatoire des inégalités, 27 % des personnes en situation de travail à temps partiel souhaiteraient bénéficier d’un temps plein. En outre, le travail à temps partiel, qu’il soit considéré comme volontaire ou subi par les intéressés, concerne des femmes à 82 %, majoritairement pour des emplois peu qualifiés. Le besoin de formation qualifiante est dès-lors d’autant plus important. Une meilleure prise en compte des années de travail à temps partiel permettrait donc de renforcer l’usage du compte personnel de formation et le ciblage des financements de la formation professionnelle continue. Mais au vu de la diversité des situations, il parait difficile à établir au travers des droits acquis sur le « socle » du compte personnel de formation.
À l’alinéa suivant, l’article L. 6323-11 précise que les périodes d’absence pour congé de maternité, congé de paternité et d’accueil de l’enfant, congé d’adoption, congé de présence parentale, congé de soutien familial et congé parental d’éducation sont toutes intégralement prises en compte pour le calcul de ces heures : cette précision paraît utile dans la mesure où le code du travail n’applique pas à ces différents congés des règles homogènes de calcul des droits tirés de l’ancienneté.
c. Les garanties d’utilisation
Le titulaire du compte personnel de formation bénéficie de garantie d’utilisation de ses droits, malgré la situation de subordination à l’employeur, ou, pour les demandeurs d’emploi, les difficultés pratiques trop fréquentes d’accès à la formation.
À l’alinéa 12, l’article L. 6323-2 indique clairement que « le compte ne peut être mobilisé qu’avec l’accord exprès de son titulaire ». Les heures acquises entrées dans le « patrimoine » du salarié ne peuvent être débitées de son compte qu’avec un accord dont une trace sera conservée. Cette garantie est donc applicable tant pour les salariés que pour les demandeurs d’emploi.
Concernant les demandeurs d’emploi, par coordination, au IV, les alinéas 84 et 85 précisent à l’article L. 1233-67 relatif au contrat de sécurisation professionnelle (CSP) que lors de l’adhésion à ce dispositif d’accompagnement renforcé vers l’emploi, la mobilisation du compte personnel de formation est une faculté, et non une obligation, alors que, concernant les heures de DIF, elle était automatique.
• Une mobilisation simple des droits acquis
À l’alinéa 57, l’article L. 6323-16 dispose que les formations financées par le compte personnel de formation ne sont pas soumises à l’accord de l’employeur lorsqu’elles sont suivies en dehors du temps de travail.
En effet, lorsque les frais pédagogiques de la formation sont pris en charge par l’organisme collecteur paritaire agréé (OPCA), ce qui constitue le cas le plus général, il n’est pas même nécessaire d’informer l’employeur, ce qui facilite pour le salarié le suivi d’une formation visant à lui permettre de s’engager dans une mobilité externe à l’entreprise. En contrepartie, le salarié ne bénéficie pas d’une rémunération, contrairement au cas prévu pour le DIF à l’article L. 6323-14, dans sa rédaction actuelle, abrogée par le présent article (8).
À l’alinéa suivant, l’article L. 6323-16 précise les conditions de mobilisation du compte pendant le temps de travail : l’accord préalable de l’employeur est nécessaire dans ce cas et porte tant sur le contenu que sur le calendrier de la formation. L’employeur est tenu de notifier sa réponse dans des délais déterminés par décret, son silence, le cas échéant, valant acceptation. Les dispositions réglementaires pourront reprendre les règles proposées par les partenaires sociaux à l’article 18 de l’ANI : la demande du salarié serait formulée auprès de son employeur au minimum 60 jours avant le début de la formation si celle-ci dure moins de 6 mois et au minimum 120 jours si celle-ci dure au moins 6 mois. L’accord tacite serait obtenu au terme d’un délai d’un mois à compter de la demande. L’alinéa 61 indique à l’article L. 6323-17 que les heures de formation effectuées pendant le temps de travail ouvrent droit au maintien de la rémunération et l’alinéa suivant précise, à l’article L. 6323-18 que la protection en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles est applicable, précision nécessaire dans la mesure où la formation n’a pas lieu sous le contrôle de l’employeur ni, dans de nombreux cas, sur le lieu habituel de travail.
Concernant les demandeurs d’emploi, à l’alinéa 78, l’article L. 6323-21 prévoit la validation automatique du projet de formation présenté par le demandeur d’emploi, au titre de son projet personnalisé d’accès à l’emploi, lorsqu’il est financé en totalité par les heures dont il dispose sur son compte personnel de formation.
Ces dispositions sont conformes au souhait des partenaires sociaux, figurant à l’article 20 de l’ANI, de « donner à chaque demandeur d’emploi bénéficiant d’un compte personnel de formation les moyens et la liberté d’accéder à la formation ». Elles procèdent en outre d’une recommandation de l’IGAS dans le cadre d’une mission de modernisation de l’action publique d’évaluation de la formation professionnelle des demandeurs d’emploi (9), visant à permettre à un demandeur d’emploi, dès lors qu’il est considéré comme suffisamment autonome, de mener par lui-même son parcours d’accès à la formation sans recours obligatoire à une validation administrative préalable : la seule condition réside dans le fait que le projet s’appuie sur une offre de formation conventionnée par Pôle emploi. L’utilisation du CPF par le demandeur d’emploi contribue donc à simplifier son parcours de formation tout en garantissant l’accès à une formation de qualité.
La liberté d’utilisation du compte personnel de formation est en outre garantie par une gestion principalement à l’extérieur de l’entreprise.
Ceci le distingue fortement du DIF pour lequel l’article L. 6323-7 dans sa rédaction actuelle prévoit l’information écrite et annuelle par l’employeur de chaque salarié sur les droits qu’il a acquis. Or l’inégale qualité de gestion du compteur DIF par les différents employeurs fait l’objet de constats concordants : elle contribue à amplifier les inégalités entre salariés en fonction des catégories de contrat de travail ou des tailles d’entreprises. Aussi, à l’alinéa 33, le I de l’article L. 6323-8 établit le droit de chaque titulaire du compte à connaître les heures dont il dispose en accédant à un service dématérialisé, conformément à l’article 16 de l’ANI.
Symétriquement, l’employeur n’a pas à fournir de décompte au salarié : selon les informations fournies à votre rapporteur, l’alimentation des droits du compte proviendra de la déclaration annuelle des données sociales (DADS) puis de la déclaration sociale nominative (DSN) généralisée à partir de 2016 et 2017. Ceci constitue un gage de simplicité, la déclaration pouvant être effectuée en ligne, par simple dépôt de fichier lorsque l’entreprise est équipée d’un logiciel de paie, ou par saisie manuelle dans les autres cas.
Pour le salarié, l’espace personnel sécurisé comportant le relevé des heures est un « téléservice » au sens de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique et aux libertés. Il est précisé que le téléservice l’informe également sur les formations éligibles : il s’agit donc service dont les modalités de gestion seront étroitement liées à la mise en œuvre du conseil en évolution professionnelle créé par l’article 2 du projet de loi.
• Le système d’information du compte personnel de formation
Au regard de la nécessité tant de traiter des données à caractère personnel pour les millions de titulaires du compte que de sécuriser le portail d’accès aux informations associées au compte, l’alinéa 34 prévoit au II de l’article L. 6323-8 que la gestion des droits figurant sur le compte procède d’un traitement automatisé de données à caractère personnel, dont les modalités de mise en œuvre sont fixées par décret en Conseil d’État, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL). Des garanties sont donc apportées quant au respect par la personne responsable du traitement des données des obligations découlant de la loi relative à l’informatique et aux libertés.
Puisque le système d’information du compte personnel de formation doit, au minimum, enregistrer et conserver les informations relatives aux qualifications professionnelles obtenues par son titulaire, afin de fonder les opérations de débit des heures acquises, l’alinéa 35 prévoit d’aller plus loin : il précise que le système d’information du compte personnel de formation intègre la possibilité, pour chaque titulaire du compte, de disposer d’un passeport d’orientation, de formation et compétences, qui recense les formations et les qualifications suivies dans le cadre de la formation initiale ou continue ainsi que les acquis de l’expérience professionnelle.
La définition des modalités de présentation du contenu du passeport est renvoyée à un décret. Selon l’avant-projet de cahier des charges fonctionnel du système de gestion du compte personnel de formation établi par l’IGAS en appui aux travaux du groupe de concertation quadripartite, cette fonctionnalité nouvelle pourra s’appuyer sur différents outils existants tels le « Webclasseur Orientation et Folios » de l’élève, développé par l’ONISEP, « E-Portfolio CV du futur » développé par le rectorat de l’académie de Nice et déployé par plusieurs Régions vers le grand public ou le « Passeport orientation formation » de Pôle emploi et destiné aux demandeurs d’emploi.
Le système d’information fournit ainsi l’occasion de fermer la parenthèse malheureuse du « passeport orientation et formation » prévu par l’article 12 de la loi du 24 novembre 2009 relative à l’orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie, qui n’est jamais entré dans les faits. Codifié à l’article L. 6315-2, il s’agit d’un « modèle de passeport orientation et formation», « mis à disposition de toute personne » qui doit recenser les diplômes de la formation initiale et les composantes de la formation continue : expérience professionnelle, actions de formation, qualifications obtenues, etc. La loi ayant renvoyé la mise en œuvre à un décret en Conseil d’État, le projet de décret a décrit le passeport orientation et formation comme « un portefeuille personnel et coordonné de documents recensant les compétences et qualifications » et précisé que « le passeport orientation formation constitue la propriété de son titulaire qui le constitue et décide en toute liberté de son usage ».
Ce projet a reçu en avril 2010 un avis négatif de la section sociale du Conseil d’État, qui a constaté l’absence de définition d’une autorité administrative chargée de l’établir, d’encadrer la liberté de son utilisation ou de valider les éléments qui y seraient inscrits : il paraît en effet difficile de conférer la qualité de document administratif à un recueil de pièces rassemblées par son seul titulaire, sans appui en matière de mise en forme ou de validation du contenu. L’appui du conseil en évolution professionnel, créé à l’article 2 du projet de loi est autrement plus utile : le titulaire du compte personnel de formation pourra au demeurant lui donner accès aux informations figurant dans ce système d’information. Ceci lui permettra, le cas échéant, de l’aider à présenter les données constitutives de son passeport d’orientation, de formation et compétences. En conséquence, l’article L. 6351-2 est utilement abrogé par le VIII de l’article 2 du présent projet de loi.
Enfin l’alinéa 36 dispose, au III du même article, que tant le site internet que le traitement automatisé sont gérés par la Caisse des dépôts et des consignations.
• Le maintien des droits acquis au titre du DIF
La dernière garantie d’utilisation provient des mesures de transitions figurant dans le projet de loi : au regard de l’abrogation du DIF, il importe en effet d’éviter toute perte de droit à formation dans la phase de transition qui pourrait fragiliser la perception du nouveau dispositif par ses utilisateurs potentiels, et donc son appropriation. Mais les dispositions figurant aux alinéas 93 à 95 permettent de garantir ce transfert intégral des droits acquis dans le cadre du DIF.
Le IX, à l’alinéa 93, prévoit une entrée en vigueur au 1er janvier 2015. Le dispositif actuel du DIF est donc maintenu pendant l’année 2014 et les droits existants ou accumulés jusqu’à cette année peuvent être utilisés dans ce cadre. Le X, à l’alinéa 94, prévoit que leur utilisation à partir du 1er janvier 2015 se fera dans le cadre des règles applicables au compte personnel de formation conformément aux stipulations de l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013 dont l’article 5 prévoit que « les heures acquises et non utilisées à ce jour au titre du DIF par le salarié sont réputées acquises au titre du compte personnel de formation ».
Mais les droits au titre du DIF doivent être utilisés dans ce cadre jusqu’au 1er janvier 2021. D’après les informations fournies à votre rapporteur, il a été proposé que la reprise du DIF serait enregistrée dans le compte par l’organisme assurant le conseil en évolution professionnelle (ou à défaut par l’OPCA de l’employeur), sur la base de documents probants produits par le salarié ou le demandeur d’emploi (certificat de travail, bulletin de paie…), ce qui évitera les difficultés liées à l’absence actuelle de gestion consolidée du DIF.
Par ailleurs des heures de DIF dépassant le plafond de 150 heures du CPF ont pu être acquises sur le fondement d’accords de branche, l’article L. 6323-6 dans sa rédaction actuelle, applicable au DIF, prévoyant qu’« une convention ou un accord collectif de branche ou d’entreprise peut prévoir des modalités particulières de mise en œuvre du DIF » permettant d’acquérir un nombre d’heures supplémentaires.
Un décret en Conseil d’État devra préciser les conditions dans lesquelles l’ensemble de ces heures pourront être complétées par les heures qui se seront inscrites sur le CPF à compter de l’année 2015. L’alinéa 95 précise en effet que les heures acquises au titre du DIF ne sont prises en compte, ni sur le mode de calcul des heures créditées sur le CPF, ni pour le plafond de 150 heures, mentionnés à l’article L. 6323-10. Votre rapporteur considère que ces modalités de transition pourront contribuer à l’amorçage du dispositif dès l’année 2015 : il importe en effet que le CPF trouve rapidement son usage.
Enfin, par coordination, le III du présent article, à l’alinéa 83, ainsi que le V, à l’alinéa 85 et le VIII, à l’alinéa 92, suppriment les mentions du droit individuel de formation ou lui substituent celle du compte personnel de formation, dans les différents articles du code du travail où le terme apparaît.
6. Les garanties collectives : un levier d’accès à la qualification
Le projet de loi prévoit les mécanismes collectifs propres à garantir la pleine effectivité du droit d’accès à une formation qualifiante que détient le titulaire du compte personnel de formation.
Les droits propres en heure de formation occasionnés par la durée d’activité professionnelle sont pleinement financés ; l’utilisation du compte est orientée vers les formations les plus utiles au salarié et aux entreprises, au moyen de listes des formations éligibles au compte ; des heures complémentaires de formation peuvent abonder le compte afin de permettre l’accès aux formations longues.
a. Les ressources affectées
• Les financements dédiés
Le compte personnel de formation ne constitue pas un « droit virtuel » car le projet de loi prévoit que des financements provenant des contributions des employeurs lui sont exclusivement dédiés.
Ces mécanismes, établis aux articles 4 et 5 du projet de loi, permettront d’affecter à compter de 2015 près de 900 millions d’euros soit 0,2 % de la masse salariale des entreprises de plus de 10 salariés, auxquels s’ajouteront près de 300 millions d’euros au titre du financement, par le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, des heures de formations mobilisées, au titre du compte, par les demandeurs d’emploi et en cas de congé individuel de formation. Par contraste, le DIF n’occasionne pas plus de 200 millions d’euros de dépense annuelle.
Ces financements dédiés confèrent donc toutes les garanties d’effectivité aux dispositions au présent article relatives à la prise en charge des coûts pédagogiques des formations sollicitées, dans la limite du nombre d’heures inscrites sur le compte personnel de formation du titulaire.
À l’alinéa 66, l’article L. 6323-19 prévoit la prise en charge des frais de formation du salarié qui mobilise son compte par l’OPCA dont relève son employeur. Á l’alinéa 67, le II du même article prévoit que lorsque le salarié mobilise son compte personnel de formation à l’occasion d’un congé individuel de formation, le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels prend en charge le financement des frais pédagogiques associés aux heures du compte. Et à l’alinéa 82, l’article L. 6323-22 dispose que les frais pédagogiques et les frais annexes afférents à la formation du demandeur d’emploi qui mobilise son compte personnel sont pris en charge, dans la limite des heures inscrites au compte, par le même fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels.
• La possibilité de financement direct par l’employeur
En outre, afin d’encourager la négociation sur le développement du compte personnel dans l’entreprise, les partenaires sociaux ont émis le souhait, à l’article 36 de l’ANI, que le compte puisse être financé directement par l’employeur dans le cadre d’un accord d’entreprise d’une durée de trois ans.
À l’alinéa 65, le I de l’article L. 6223-19 prévoit cette possibilité. L’employeur doit alors consacrer au moins 0,2 % du montant des rémunérations versées au financement du compte personnel de formation de ses salariés, tant pour financer les droits propres qui seraient mobilisés que pour financer d’éventuels abondement, à la hauteur du montant du budget annuel qui y est consacré.
Dans ce cas, les frais pédagogiques et les frais annexes afférents à la formation du salarié qui mobilise son compte personnel de formation, pendant son temps de travail comme hors temps de travail, sont pris en charge par l’employeur.
Ce financement collectif au niveau de l’entreprise vise également à apporter des contreparties supplémentaires au salarié. L’article 3 de l’ANI prévoit en effet que « les actions de développement des compétences des salariés (…) en particulier la formation suivie dans le cadre du compte personnel de formation avec l’accord de l’employeur doivent participer à l’évolution de leur qualification et donner lieu à une reconnaissance par l’entreprise. » L’accord d’entreprise prévoyant la prise en charge directe du CPF par l’employeur doit donc constituer le cadre privilégié pour établir les engagements réciproques encadrant l’action de formation. Par exemple, l’employeur pourrait souscrire des engagements portant sur l’attribution de la classification correspondant aux compétences mobilisées par l’emploi occupé ou sur les conditions dans lesquelles le salarié accède en priorité, à l’issue de la formation, aux fonctions disponibles correspondant aux compétences acquises.
b. La définition des formations éligibles
En contrepartie de la liberté d’utilisation et la pleine transférabilité pour le salarié, un encadrement collectif de l’utilisation du compte est prévu, motivé par l’objectif d’intérêt général qui s’attache à l’amélioration des qualifications dans un but de renforcement de compétitivité de nos entreprises.
Les partenaires sociaux, à l’article 12 de l’ANI, ont en effet souhaité que « les formations éligibles au compte personnel de formation permettent aux personnes d’acquérir des compétences attestées (qualification, certification, diplôme), qui sont autant de repères professionnels sur le marché du travail. »
Il s’agit d’une rupture qualitative par rapport au droit individuel de formation dont l’utilisation n’est pas orientée vers un objectif précis de qualification. En outre l’utilisation du DIF était définie tout entière dans l’entreprise du fait de l’initiative dite « partagée » entre l’employeur et le salarié.
Le présent article prévoit que les objectifs d’utilisation du compte personnel de formation seront définis à l’extérieur de l’entreprise au moyen de listes de formations éligibles. Ces dernières constituent une garantie collective d’utilisation du compte à des fins de qualification.
Conformément à l’objectif stratégique poursuivi par la réforme de la formation professionnelle conduite par le projet de loi, le compte personnel de formation va donc orienter les financements qui lui sont consacré vers les formations les plus à mêmes de contribuer à la sécurisation des parcours professionnels des salariés et à la montée en gamme du tissu productif dans son ensemble.
Aussi, à l’alinéa 14, le I de l’article L. 6323-4 subordonne l’utilisation des heures inscrites sur le compte au financement d’une formation « éligible » : il renvoie à trois articles du code du travail qui définissent ces formations en deux temps. En premier lieu, à l’article L. 6323-6, figurent des grandes catégories de formations susceptibles d’être éligibles au compte personnel de formation ; mais, parmi ces dernières, les formations effectivement éligibles devront figurer sur des listes dont la loi prévoit le mode d’élaboration et qui sont prévues, pour les salariés, à l’article L. 6323-15, et pour les demandeurs d’emploi, à l’article L. 6323-20.
• La définition par la loi des formations susceptibles d’être éligibles au compte personnel de formation
À l’alinéa 26, l’article L. 6323-6 définit le « vivier » au sein duquel pourront être choisies les actions éligibles au compte personnel de formation pour les salariés comme pour les demandeurs d’emploi.
Les 1° et 4° de cet article comportent les formations énumérées à l’article 12 de l’ANI au terme duquel le CPF ne doit être utilisées que pour suivre une formation qualifiante « correspondant aux besoins de l’économie prévisibles à court ou moyen terme et favorisant la sécurisation des parcours professionnels des salariés ». Les partenaires sociaux ont envisagé quatre cas de figure.
Tout d’abord il s’agit des formations concourant à une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) : c’est l’objet, à l’alinéa 27, du 1° de l’article L. 6323-6 qui renvoie à l’article L. 335-6 du code de l’éducation. Cet article dispose que le répertoire est établi et actualisé par la Commission nationale de la certification professionnelle qui doit veiller « à la cohérence, à la complémentarité et au renouvellement des diplômes et des titres ainsi qu’à leur adaptation à l’évolution des qualifications et de l’organisation du travail ».
Le RNCP recouvre plus de 14 000 titres et diplômes. Les diplômes et titres à finalité professionnelle peuvent notamment être enregistrés au répertoire à la demande des commissions paritaires nationales de l’emploi (CPNE) des branches professionnelles. Nombreux sont également proposés par les universités.
L’alinéa 28, du 2° de l’article L. 6323-6 vise les formations sanctionnées par un certificat de qualification professionnelle (CQP) mentionnées au 3° de l’article L. 6314-1 et à l’article L. 6314-2 du code du travail. Les CQP sont établis par les CPNE des branches professionnelle ; ils s’appuient sur des référentiels d’activités permettant d’analyser les situations de travail et d’en déduire les connaissances et les compétences à mobiliser, ainsi que sur un référentiel de certification qui définit les modalités et les critères d’évaluation des acquis.
Les CQP sont transmis à la Commission nationale de la certification professionnelle. On en dénombre environ 2 500, plus ou moins utilisés, car leur actualisation est tributaire de l’activité de chaque branche concernée. Les CQP peuvent en outre être définis dans un cadre interbranche.
À l’alinéa 29, le 3° de l’article L. 6323-6 prévoit que sont éligibles les formations sanctionnées par les certifications inscrites à l’inventaire mentionné au cinquième alinéa du II de l’article L. 335-6 du code de l’éducation. Il s’agit des « certifications et habilitations correspondant à des compétences transversales exercées en situation professionnelle (qui) peuvent être recensées dans un inventaire spécifique établi par la Commission nationale de la certification professionnelle ».
Cet inventaire n’a pas encore été élaboré et la mise en œuvre du compte personnel de formation fournit, enfin, l’occasion de le faire. L’inventaire est censé viser l’ensemble des habilitations qui permettent d’exercer une activité : toutes renforcent donc l’employabilité du salarié. Mais certaines sont des habilitations obligatoires qui relèvent donc de la responsabilité de l’employeur et qui n’ont pas vocation à être financées au titre des droits figurant sur le compte personnel de formation. Aussi, les habilitations retenues figureront-elles dans les listes des formations effectivement éligibles au compte personnel de formation.
À l’alinéa 30, le 4° de l’article L. 6323-6 est relatif aux formations visant à acquérir un « socle de connaissances et de compétences », défini par décret.
Cette notion ne doit pas être confondue avec le « socle commun de connaissances, de compétences et de culture » que chaque élève doit pouvoir acquérir grâce à « l’ensemble des enseignements dispensés » au cours de la scolarité obligatoire, conformément à l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation, dans sa rédaction issue de l’article 13 de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République. Ce socle vise à permettre la poursuite d’études, la construction d’un avenir personnel et professionnel et à préparer à l’exercice de la citoyenneté : il concerne donc la définition des programmes scolaires.
Le « socle de connaissances et de compétences » applicable au CPF correspond à l’objectif fixé au point 4.4 de l’accord national interprofessionnel du 5 octobre 2009 : les partenaires sociaux ont rappelé l’importance de la formation initiale, qui relève de la responsabilité de l’éducation nationale, mais également souhaité garantir l’acquisition et l’actualisation d’un socle de compétences de nature à favoriser l’évolution et les transitions professionnelles tout au long de la vie professionnelle. En 2009, les partenaires sociaux ont précisé que ce socle devrait intégrer notamment, l’aptitude à travailler en équipe, la maîtrise des outils informatiques et bureautiques ainsi que la pratique de l’anglais ou de toute autre langue étrangère, et les moyens destinés à en favoriser l’actualisation tout au long de la vie professionnelle. Ils ont également souhaité que ce socle puisse être complété par les CPNE de branches pour tenir compte de la diversité des métiers.
La définition des contours des actions relevant du socle de connaissance et de compétence est enfin en cours, dans le cadre d’un appel à projet du FPSPP. Le décret spécifique, prévu pour établir ce socle, a vocation à reprendre ces travaux.
Ce socle devrait permettre de contribuer à la lutte contre l’illettrisme qui est un motif majeur de blocage dans l’accès à la qualification des salariés ou demandeurs d’emploi les plus fragiles. Défini comme une maîtrise insuffisante de la lecture, de l’écriture ou du calcul par des personnes qui ont pourtant bénéficié d’une formation initiale en langue française, il se distingue de l’analphabétisme. L’illettrisme touche 7 % des adultes de 18 à 65 ans et autant les actifs âgés que des jeunes sortis sans qualification du système scolaire. On estime à près de 2,2 millions le nombre d’actifs qui ne maîtrisent pas ces prérequis nécessaires pour suivre toute action de formation, dès le stade de la pré-qualification.
Votre rapporteur souhaite donc que l’éligibilité des formations définies dans ce « socle de connaissances et de compétences » soit rapidement effective afin que la mise en place du CPF permette de faire progresser le niveau de qualification des travailleurs les plus vulnérables.
Enfin, à l’alinéa 31, le 5° de l’article L. 6323-6 ajoute aux quatre catégories envisagées par les partenaires sociaux les formations « concourant à l’accès à la qualification ». Cet ajout est utile et ne paraît pas trahir les termes de l’ANI : tous les demandeurs d’emploi, notamment les jeunes sans qualification ou les demandeurs d’emploi de longue durée, ne sont en effet pas en capacité de suivre d’emblée une formation qualifiante. Certains ont besoin auparavant de mûrir leur projet professionnel dans le cadre d’une action dite de « pré-formation » ; d’autres doivent acquérir les premiers gestes professionnels dans le cadre d’une action dite « préqualifiante », dans les domaines de l’agriculture, du BTP, de l’industrie, de l’hôtellerie restauration notamment. Ces actions sont nécessaires avant de franchir le cap plus exigeant de l’action qualifiante et de ses pré-requis, souvent quelques semaines à peine après le terme de la première action de formation.
Ces parcours constitués en deux, voire trois étapes expliquent ainsi que l’on décompte chaque année plus d’actions de formation suivies par des demandeurs d’emploi que de demandeurs d’emploi entrant en formation. Ces actions de préformation ou préqualifiantes sont indispensables à l’obtention finale de la qualification au terme du parcours.
• Les modalités d’établissement des listes des formations effectivement éligibles au compte personnel de formation
Les formations effectivement mobilisables par le titulaire du compte sont définies sur des listes énumérées aux articles L. 6323-15 et L. 6323-20, toutes élaborées par les partenaires sociaux.
Concernant les salariés en activité, conformément à l’article 17 de l’ANI, il s’agit, au niveau national, d’une liste mentionnée, à l’alinéa 54, au 2° de l’article L. 6323-15 : élaborée par le comité paritaire national pour la formation professionnelle et l’emploi (CPNFPE), créé, à l’article L. 6123-5 du code du travail, par l’article 14 du présent projet de loi. Le CPNFPE est l’organe de définition des orientations des partenaires sociaux en matière de formation et d’emploi. Dans le cadre de sa mission de définition, de suivi et de coordination, il élabore la liste nationale des formations éligibles au compte personnel de formation.
Ce cadre national et interprofessionnel distingue le CPF du DIF, dont la prise en charge était tributaire des priorités définies par chaque OPCA : il est le gage que le compte pourra être utilisé à des fins de reconversions professionnelle ; il évite que les formations effectivement éligibles ne soit restreintes aux seules priorités définies par chacune des branches ou au niveau régional.
Les priorités propres à chaque branche, au plan national et au niveau régional relèvent, elles des listes définies respectivement à l’alinéa 53, au 1° de l’article L. 6323-15 et à l’alinéa 55, au 3° du même article.
Le 1° vise les formations choisies par la commission paritaire nationale pour l’emploi (CPNE) de la branche professionnelle dont relève le salarié. Mais l’activité de ces dernières étant inégale selon les branches, et l’ensemble des salariés n’étant pas couverts par des branches professionnelles, à défaut, la liste peut être élaborée par un accord collectif conclu entre les organisations représentatives d’employeurs et les organisations syndicales de salariés signataires d’un accord constitutif d’un organisme collecteur paritaire des fonds de la formation professionnelle continue à compétence interprofessionnelle.
Le 3° vise, au niveau régional, les comités paritaires régionaux pour la formation professionnelle et l’emploi (CPRFPE), déclinaison régionale du CPNFPE, définis à l’article L. 6123-6.
Si la liste est adoptée dans cette enceinte strictement paritaire, elle est établie après concertation d’une part avec les commissions paritaires régionales de branches, déclinaisons des CPNE, « lorsqu’elles existent », mais surtout, d’autre part, au sein du bureau du comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles (CREFOP).
Instauré par l’article 14 du présent projet de loi, codifié à l’article L. 6123-3, issu de la fusion du comité de coordination régional de l’emploi et de la formation professionnelle et du conseil régional de l’emploi, le CREFOP comprend, outre les partenaires sociaux, des représentants de l’État dans la région, des représentants de la Région, dont le président du Conseil régional ainsi que, avec voix consultative, des représentants des principaux opérateurs de l’emploi, de l’orientation et de la formation professionnelles.
Au final, la pertinence des listes de branche, au plan national comme régional, dépendra de la qualité des travaux conduits par les observatoire paritaire prospectif des métiers, des qualifications et des compétences (OPMQC) exerçant sous l’autorité de la CPNE compétente pour la branche.
Concernant les demandeurs d’emploi, à l’alinéa 73, le I de l’article L. 6323-20 définit deux listes.
Tout d’abord, à l’alinéa 74, le 1° de l’article L. 6323-20 renvoie à la liste nationale applicable aux salariés en activité, établie par le comité paritaire national pour la formation professionnelle et l’emploi et mentionnée au 2° de l’article L. 6323-20. Gage de cohérence globale, cette identité de traitement permet de transcender les statuts.
À l’alinéa 75, le 2° de l’article L. 6323-20 renvoie à une liste régionale élaborée par le CPRFPE mais distincte de celle que ce comité adopte pour les salariés. Le mode d’élaboration détaillé par cet alinéa traduit en effet le résultat de la concertation quadripartite qui a donné lieu à de longues négociations concernant l’élaboration des listes de formations éligibles au compte personnel de formation des demandeurs d’emploi.
Dans ce cas, les frais pédagogiques sont aujourd’hui principalement financés par les Régions (pour près de 1,3 milliards d’euros en 2012) et par Pôle emploi (pour 250 millions d’euros en 2012). Mais ces actions bénéficieront désormais, via le CPF, de financements supplémentaires, à hauteur de 250 millions d’euros, versés par le Fonds paritaires de sécurisation des parcours professionnels relevant des partenaires sociaux.
La loi retranscrit l’équilibre qui a résulté de la concertation quadripartite : la liste des formations éligibles est élaborée à partir du programme régional de formation professionnelle (PRF) financé par la Région et par Pôle emploi, mais « le comité paritaire régional peut, eu égard à la situation de l’emploi dans la région, ajouter ou, par décision motivée, retrancher des formations par rapport à ce programme régional. »
Il paraît logique que l’établissement de la liste des formations éligible se fasse sur la base du PRF : la liste finale doit être le fruit d’un diagnostic conduit à la fois par les partenaires sociaux, les Régions et les services de l’État dans la région concernant les qualifications utiles et recherchées sur le territoire, pour l’ensemble des secteurs professionnels. Or les programmes régionaux de formation qualifiante destinés aux demandeurs d’emplois et financés par la Région et par Pôle emploi résultent déjà d’une telle démarche de diagnostic et de concertation : ils ont donc, par principe, vocation à être éligibles au titre du compte personnel de formation.
Cependant, est laissée aux partenaires sociaux une capacité encadrée et objectivée de choix. La faculté d’ajout au PRF est bienvenue dans la mesure où elle élargit le périmètre d’usage du compte ; les décisions visant à ne pas rendre éligibles au CPF certaines formations figurant à un programme pourtant adopté par le Conseil régional ne sauraient être qu’exceptionnelles : elles devront être, en tout état de cause, pleinement motivées.
Enfin, pour le cas où les partenaires sociaux, seuls décisionnaires au sein du CPRFPE, ne pourraient adopter cette liste, les formations figurant dans les programmes régionaux financés par la Région et par Pôle emploi seront automatiquement éligibles au CPF.
Aux alinéas 56 et 76 respectivement, le II de l’article L. 6323-15 et le II de l’article L. 6323-20 prévoient que l’ensemble des listes applicables aux salariés et aux demandeurs d’emplois sont transmises au conseil national pour l’emploi, la formation et l’orientation professionnelle (CNEFOP), établi, par l’article 14 du projet de loi, à l’article L. 6213-1. Issu de la fusion du conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie (CNFPTLV) et du conseil national de l’emploi (CNE), placé auprès du Premier ministre, il est chargé d’évaluer les politiques de formation professionnelle continue. Il devrait disposer des moyens adaptés pour conduire cette évaluation. C’est donc dans ce cadre que pourra être mesurée de façon globale la capacité de ces listes à orienter l’utilisation du compte vers les qualifications prioritaires sans être inutilement restrictives, au risque de limiter excessivement l’usage du CPF.
Enfin la Caisse des dépôts et consignations, en tant qu’organisme gestionnaire du système d’information associé au compte, est également destinataire de ces listes, afin de lui permettre de valider les opérations de débit réalisées, au regard des formations effectivement éligibles.
• Des formations parfois opposables à l’employeur
À l’alinéa 58, la deuxième phrase du second alinéa de l’article L. 6323-16 met en œuvre le souhait formulé par les partenaires sociaux à l’article 18 bis de l’ANI de prévoir des catégories d’actions de formations engagées par les salariés pour lesquelles l’utilisation du CPF sur le temps de travail serait de droit.
Aussi est-il prévu que l’accord de l’employeur pour suivre une formation en tout ou partie pendant le temps de travail, donc rémunérée par lui, n’est pas requis dans trois cas de figure.
Il s’agit d’abord des situations où le salarié bénéficie d’un abondement correctif de 100 heures de formation, justifié par le fait que, dans les entreprises de plus de 50 salariés, il n’a pas, dans les six années précédentes, bénéficié de l’entretien professionnel ni de deux des trois mesures établissant que l’employeur lui offre des perspectives d’évolution professionnelle : avoir suivi au moins une action de formation ou avoir bénéficié d’une progression, salariale ou professionnelle, ou avoir acquis des éléments de certification, par la formation ou par une validation des acquis de l’expérience. La rédaction proposée semble limiter l’opposabilité aux seules heures financées à ce titre et non pas à toute la durée de la formation qui pourrait être également financée par les droits acquis en propre sur le compte ou par des abondements complémentaires.
Sont également opposables à l’employeur les formations suivies pour acquérir le socle de compétences. Pour les travailleurs les moins qualifiés, donc les plus fragiles sur le marché du travail, ceci constitue une garantie d’accès aux formations qui renforceront leur faculté de mobilité professionnelle et donc, par contrecoup, leur capacité à peser, au quotidien, dans la relation à l’employeur.
Enfin, en complément des dispositions de l’article L. 6323-13 selon lequel des accords collectifs peuvent prévoir des modalités d’alimentation plus favorable du compte personnel de formation, en définissant « des formations éligibles et les salariés prioritaires », le suivi d’une formation peut être opposable à l’employeur lorsqu’un accord d’entreprise ou un accord de branche le prévoit.
c. Les abondements au compte personnel
Le dernier alinéa de l’article L. 6111-1 dans sa rédaction issue de la loi du 14 juin 2013 de sécurisation de l’emploi prévoit que « peuvent être mobilisés en complément du compte les autres dispositifs de formation auxquels son titulaire peut prétendre ». Cette disposition est au nombre de celles qu’abroge l’alinéa 3 du présent article car l’ambition qu’elle affiche est précisée par le projet de loi. Il définit les cas dans lesquels le compte personnel de formation est le socle d’abondements complémentaires visant à financer des formations d’une durée supérieure aux heures qui y sont créditées.
Il s’agit de la dernière série des garanties collectives visant à ce que le compte personnel de formation soit bien un levier d’accès à la qualification. Ainsi que l’illustre le schéma ci-après, tout au long de sa vie professionnelle, un salarié accumule des heures formations, soumises à plafond, qu’il peut utiliser librement pour les formations éligibles, mais il peut également, afin de bénéficier de formations plus longues, faire appel à des abondements.
LA VIE D’UN COMPTE PERSONNEL DE FORMATION

Source : Mission IGAS – CPF, Laurent CAILLOT, Avant-projet de cahier des charges fonctionnel du système de gestion du compte personnel de formation, p 6.
Aussi, à l’alinéa 15, le II de l’article L. 6323-4 précise que le compte peut faire l’objet d’« abondements en heures complémentaires », lorsque la durée de la formation qui finance le titulaire du compte est supérieure au nombre d’heures inscrites sur le compte. L’attribution d’abondements est donc bien subordonnée à la pleine utilisation de l’ensemble des heures existantes ; dans la mesure où la période d’activité du salarié lui permet d’acquérir à nouveau des heures de formation, il est en effet inutile de favoriser leur thésaurisation. Ces dispositions ne font en outre pas obstacle à ce que soit abondé un compte qui ne serait pas encore crédité, ce qui peut être nécessaire pour des jeunes sortis du système scolaire sans diplôme.
En conséquence, à l’alinéa 25, l’article L. 6323-5 précise que les heures complémentaires mobilisées à l’appui d’un projet de formation sont mentionnées dans le compte sans y être inscrites : dès lors, elles ne sauraient être prises en compte pour appliquer le plafond de 150 heures pour l’alimentation annuelle du compte du salarié.
Au nombre des « abondeurs » potentiels du compte énumérés par l’article L. 6323-4, aux alinéas 16 à 24, figurent l’ensemble des financeurs de la formation professionnelle.
À l’alinéa 21, le 6° de l’article L. 6323-4 mentionne l’État : si la pleine décentralisation des crédits de la formation professionnelle, opérée par le présent projet de loi, ne lui donne pas prioritairement vocation à financer les heures de formation abondant un compte personnel, le maintien de cette faculté peut être utile, notamment dans le cadre de projets industriels relevant d’un intérêt national et nécessitant de financer des actions de formation. En outre, l’Éducation nationale est appelée à proposer une des deux voies d’accès à la durée complémentaire de formation qualifiante prévue à l’article L. 122-2 du code de l’éducation pour le jeune sortant du système éducatif sans diplôme, précisé dans l’encadré ci-après.
À l’alinéa 22, le 7° de l’article L. 6323-4 mentionne les Régions qui contribuent au financement de la formation professionnelle continue à hauteur de 2 milliards d’euros, principalement pour la formation des demandeurs d’emploi et pour les dispositifs de deuxième chance à destination des jeunes sans diplôme.
Un nouveau vecteur de la formation initiale différée
À l’alinéa 32, l’article L. 6323-7 prévoit que la durée complémentaire de formation qualifiante prévue à l’article L. 122-2 du code de l’éducation dont bénéficie le jeune sortant du système éducatif sans diplôme est « mentionnée dans son compte personnel de formation ».
L’article 5 de la loi du 14 juin 2013 a en effet précisé à l’article L. 6111-1 du code du travail que le compte personnel de formation peut être financé par des abondements complémentaires, notamment par l’Etat ou la région« en particulier pour les personnes qui ont quitté le système scolaire de manière précoce ou qui, à l’issue de leur formation initiale, n’ont pas obtenu de qualification professionnelle reconnue » L’article L. 122-2 du code de l’éducation, modifié par l’article 14 de la loi n°2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République, dispose que « tout jeune sortant du système éducatif sans diplôme bénéficie d’une durée complémentaire de formation qualifiante qu’il peut utiliser dans des conditions fixées par décret ».
L’article L. 6323-7, dans la rédaction projetée, vise les jeunes sortis du système éducatif « sans diplôme ». Cette notion est donc plus large que celle des jeunes « non qualifiés » correspondant aux niveaux VI et V bis des nomenclatures de formation restreinte aux jeunes qui ne sont pas entrés au lycée général et technologique ou qui n’ont pas eu accès à une classe terminale de préparation à un BEP ou à un CAP.
Le nombre de jeunes sans diplôme est stable depuis dix ans : environ 160 000, soit près de 20 % d’une génération. Selon l’INSEE, seuls 10 % de ceux qui n’avaient aucun diplôme ont bénéficié d’une formation continue en 2010, contre 34 % des Bac +4.
Pour les jeunes non qualifiés, dès la sortie du système éducatif, le CPF permet ainsi de mettre en œuvre le droit à une durée complémentaire de formation qualifiante par deux voies complémentaires d’accès.
Il s’agit tout d’abord du droit de retour en formation initiale, sous statut scolaire pour les jeunes ne disposant pas d’un premier niveau de qualification professionnelle reconnue : les conditions en seront posées par le décret d’application des dispositions de l’article L. 122-2 du code de l’éducation qui devra en fixer la limite d’âge et définir les conditions de mobilisation des autorités académiques.
Il s’agit ensuite du droit d’accès à la formation professionnelle continue par la mobilisation du service public régional de la formation professionnelle des régions ou des dispositifs dits de la deuxième chance.
Il reviendra donc aux régions d’abonder les CPF des jeunes disposant d’une faible expérience professionnelle (quelques emplois saisonniers, quelques mi-temps) : 80% de l’offre des programmes régionaux concerne en effet les primo demandeurs d’emploi.
À l’alinéa 23, le 8° de l’article L. 6323-4 vise Pôle emploi. À l’article 25 de l’ANI, les partenaires sociaux ont rappelé que l’abondement dans ce cas peut financer la préparation opérationnelle à l’emploi ou le volet formation du contrat de sécurisation professionnelle.
Si le demandeur d’emploi est toujours libre d’entrer en formation sans autorisation préalable, au titre de ses droits propres au CPF, donc pour une formation durant au maximum 150 heures, dans les cas où une formation d’une durée plus importante est nécessaire, le complément peut être pris en charge à la fois par Pôle emploi ou par la Région. Aussi, à l’alinéa 79, le second paragraphe de l’article L. 6323-21 prévoit, outre le cas de validation automatique de mobilisation du CPF par le demandeur d’emploi qui dispose du crédit d’heures suffisant, que « les financements complémentaires disponibles » sont mobilisés « après validation du projet de formation».
À l’alinéa 16, le 1° de l’article L. 6323-4 cite l’employeur lorsque le titulaire du compte est salarié. Les partenaires sociaux ont en effet rappelé, à l’article 22 de l’ANI, que le développement des compétences et des qualifications des salariés relève de l’intérêt de l’employeur et peut passer par un abondement du compte personnel de formation.
Aussi, à l’alinéa 48, l’article L. 6323-13 prévoit la possibilité pour le compte personnel d’être abondé par un accord d’entreprise. Cet article vise également les accords de branche ou « un accord conclu par les organisations syndicales de salariés et d’employeurs signataires de l’accord constitutif d’un organisme collecteur paritaire agréé interprofessionnel ». Ces cas sont donc également prévus à l’alinéa 18, au 3° de l’article L. 6323-4 qui vise directement les OPCA.
Ces différents accords sont habilités à définir, parmi les formations qui figurent sur les listes applicables au CPF, les formations éligibles à des abondements spécifiques. Ils peuvent également, le cas échéant, définir des catégories de salariés prioritaires. De tels accords pourraient par exemple prévoir des modalités d’abondement d’autant plus favorables que le niveau de qualification des salariés est faible ou mieux prendre en compte l’incidence du travail à temps partiel. À l’article 23 de l’ANI, les partenaires sociaux ont en outre envisagé que des accords de branche prévoient des abondements du compte personnel de formation au moyen de périodes de professionnalisation. En tout état de cause, cette faculté de négociation est favorable à la pleine appropriation du compte personnel de formation par les salariés et les employeurs.
Ainsi, sur le socle des heures qui alimentent le compte de tous les salariés, les salariés relevant d’accord peuvent disposer d’heures supplémentaires, le cas échéant également à un rythme annuel, selon les modalités propres à ces accords. Á l’alinéa 49, l’article L. 6323-14 précise logiquement que les heures acquises sur le fondement de ces accords ne sont pas prises en compte pour l’application du plafond de 150 heures qui fait cesser l’alimentation annuelle du compte.
Le tableau ci-dessous récapitule les catégories et les modalités d’acquisition des heures figurant sur le compte afin de financer un projet de formation qualifiante.
LES CATÉGORIES D’HEURES FIGURANT SUR LE COMPTE PERSONNEL DE FORMATION
Alimentation du compte des salariés |
Financement | ||
Alimentation en heures de droit commun |
Droits propres acquis chaque année par le salarié. (L. 6323-10) |
Conservées jusqu’à utilisation. Plafond de 150 heures |
0,2% CPF : - OPCA pour le salarié. - FPSPP pour le demandeur d’emploi - employeur en cas de dépense directe du 0,2% |
Alimentation par suppléments d’heures |
2 cas : -Abondement correctif : droit à 100 heures de formation supplémentaires (L. 6323-12) - Abondements prévus par accords (L. 6323-13) |
Pas de plafond applicable Acquisition sans incidence sur le mode de calcul et le plafond de l’alimentation en heures de droit commun L’abondement correctif est conservé jusqu’à utilisation. Les accords prévoient les modalités d’acquisition, de conservation et d’utilisation des suppléments d’heures. |
Employeur OPCA |
Cas particulier : heures mentionnées et conservées sur le compte pendant 6 ans | |||
Heures de transition |
Droits à des heures de formation acquis au titre du DIF jusqu’au 31 décembre 2014 |
Perdues au 1er janvier 2021. Plafond de 150 heures Utilisables par les salariés et par les demandeurs d’emploi. Le stock est sans incidence sur les modalités d’acquisition des heures inscrites au titre du CPF |
0,2% CPF et employeur ou OPCA, pour les droits à DIF prévus par des accords |
Financements complémentaires pour les salariés et les demandeurs d’emploi | |||
Abondements des comptes des salariés ou des demandeurs d’emploi « en heures complémentaires» Les financements sont mobilisés par le conseil en évolution professionnelle |
Mobilisées à l’appui d’un projet de formation « lorsque la durée est supérieure au nombre d’heures inscrites sur le compte ». (L. 6323-4) Ne figurent sur le compte que lors de leur utilisation |
« heures mentionnées sur le compte sans y être inscrites » (L. 6323-5) Pas de plafond. Leur mobilisation entraîne le débit de tous les droits inscrits sur le compte, avec l’accord exprès du titulaire. |
Les institutions mentionnées à l’article L. 6323-4 |
• Les abondements à destination des travailleurs handicapés
L’alinéa 24 fait figurer au 8e du L. 6323-4 « l’institution mentionnée à l’article L. 5214-1 », c’est-à-dire l’association de gestion du fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées (AGEFIPH).
Les ressources de ce fonds proviennent de la contribution versées par les employeurs de plus de 20 salariés assujettis à l’obligation d’emploi de personnes handicapées qui n’atteignent pas le taux de 6 % de travailleurs handicapés ou n’ont pas signé un accord d’entreprise portant sur l’emploi et le handicap.
Parmi les 128 400 entreprises assujetties, en 2011, à cette obligation, 39 %, soit 50 400 entreprises, versent une contribution à l’AGEFIPH pour un montant total de financements qui s’élevait à 480 millions euros. Le compte personnel de formation pourra donc figurer au nombre des instruments utilisés par le fonds pour déployer des financements en faveur des travailleurs handicapés notamment sous la forme d’actions de compensation du handicap ou d’actions de formation préparatoire.
Mais ces dépenses peuvent également provenir directement de l’entreprise, au titre des abondements directs de l’employeur prévus par le 1° de l’article L. 6323-4. Aussi, par coordination, le VI du présent article, à l’alinéa 87, précise, à l’article L. 5212-11, que l’abondement au compte personnel de formation au bénéfice de personnes handicapées figure au nombre des dépenses supportées directement par l’entreprise qui peuvent être déduites de la contribution annuelle permettant à l’employeur de s’acquitter partiellement de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés due à l’AGEFIPH.
Au vu de l’enjeu majeur de la qualification pour les travailleurs en situation de handicap, bénéficiaires de l’obligation d’emploi, les partenaires sociaux ont en effet demandé, à l’article 26 de l’ANI, que l’abondement réalisé par l’employeur soit déductible de la contribution due à l’AGEFIPH, dans la limite de 20 % : conformément au dernier alinéa de l’article L. 5212-11, les conditions dans lesquelles les dépenses au titre du CPF peuvent être déduites du montant de la contribution seront définies par un décret, qui pourra retenir le pourcentage proposé par les partenaires sociaux, ou un pourcentage plus important, en particulier si le CPF devient bien l’instrument structurant d’accès à la qualification pour l’ensemble des travailleurs et donc pour les personnes handicapées.
• Les effets d’entrainement sur le CIF
À l’alinéa 19, le 4° du II de l’article L. 6323-4 prévoit les abondements complémentaires par l’organisme paritaire agréé au titre du congé individuel de formation (OPACIF), soit les 26 FONGECIF régionaux.
Le congé individuel de formation (CIF), créé par la loi du 16 juillet 1971 suite à l’accord national interprofessionnel du 9 juillet 1970, « a pour objet de permettre à tout salarié, au cours de sa vie professionnelle, de suivre à son initiative et à titre individuel, des actions de formation (qui) doivent (lui) permettre (par exemple) d’accéder à un niveau supérieur de qualification (ou) de changer d’activité ou de profession » (article L 6322-1 du code du travail).
Un million de salariés ont suivi un CIF depuis la création d’une contribution obligatoire des entreprises à ce titre en 1982, et, l’année suivante, la création des FONGECIF contribuant au maillage territorial. Le CIF a ainsi pleinement joué un rôle de « seconde chance » soit au titre d’une formation différée, soit dans le cadre d’une transition professionnelle.
Il permet en effet d’accéder à des formations longues, diplômantes ou certifiantes. La durée moyenne des formations financées en 2012 par le CIF était de 780 heures. 82 % des bénéficiaires sont ouvriers et employés. 28 % sont de niveaux V et V bis (soit, dans la classification des niveaux de formation, les BEP ou CAP ou la sortie un an avant l’année terminale du second cycle court). 29 % sont de niveau IV (équivalent au baccalauréat ou au brevet professionnel).
D’après une évaluation publiée en septembre 2012 par le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, parmi les bénéficiaires d’un CIF terminé en 2010, 52 % avaient changé de catégorie socioprofessionnelle, 70 % de profession, 65 % de responsabilités et 54 % de secteur d’activité. 60 % avait changé d’entreprise.
En pratique, l’abondement du CPF par l’organisme en charge du CIF correspondra à l’utilisation de ses droits propres par le candidat à un CIF afin de compléter le financement de ce dernier. Il s’agira d’un levier supplémentaire de financement des CIF : l’articulation du CPF et du CIF donnera des marges de manœuvre supplémentaires aux FONGECIF. Aujourd’hui, pour 33 000 demandes de financement d’un CIF acceptées par les organismes paritaires, autant de demandes sont refusées, souvent par manque de financement. L’apport du CPF devrait permettre d’augmenter le nombre d’accord de près de 20 % en 4 ans.
• L’utilisation du compte pénibilité
À l’alinéa 20, le 5° du II de l’article L. 6323-4 prévoit un abondement complémentaire par la caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) qui est l’organisme chargée de la gestion du compte personnel de prévention de la pénibilité.
En effet l’article 10 de la loi n°2014-40 du 20 janvier 2014 de réforme des retraites a prévu, au 1° du I de l’article L. 4162-4 du code du travail, que le titulaire de ce compte peut décider d’affecter en tout ou partie les points qui y sont inscrits à la prise en charge des frais d’une action de formation professionnelle continue en vue d’accéder à un emploi non exposé ou moins exposé à des facteurs de pénibilité (10). Dans ce cas, l’article L. 4162-11 prévoit que la CNAV verse les sommes représentatives des points que le travailleur souhaite affecter aux financeurs des actions de formation professionnelle
L’article L. 4162-5 prévoit que les points du compte personnel de prévention de la pénibilité sont convertis en heures de formation pour abonder le compte personnel de formation prévu à l’article L. 6111-1 : l’entrée en vigueur de ces dispositions a logiquement été différée au 1er janvier 2015. La demande d’utilisation des points peut intervenir à tout moment de la carrière du titulaire du compte, que celui-ci soit salarié ou demandeur d’emploi. La fixation du barème de points spécifique à chaque utilisation du compte a été renvoyée à un décret en Conseil d’État qui doit notamment définir les conditions et limites dans lesquelles les points acquis ne peuvent être affectés qu’à l’utilisation visant à la formation : il est prévu que les vingt premiers points acquis ne pourront être utilisés que pour des actions de formation.
L’alinéa 20 du présent article renvoie à nouveau à un décret en Conseil d’État la définition des conditions d’abondement du CPF par la CNAV au titre des droits figurant sur le compte personnel de prévention de la pénibilité : toutes les actions de formation professionnelle continue visant à accéder à un emploi non exposé ou moins exposé à des facteurs de pénibilité ne correspondront en effet pas à des formations éligibles au CPF. Il conviendra donc de définir les critères de validité des demandes d’abondement par la CNAV au titre de la pénibilité de la façon la plus lisible pour les titulaires du CPF.
• La faculté d’abondements par le titulaire
Enfin, à l’alinéa 17, le 2° du II de l’article L. 6323-4 prévoit la faculté pour le titulaire du compte de financer lui-même les heures complémentaires.
D’après les dernières données disponibles, en 2011, 3 % de la dépense totale de formation professionnelle continue provient en effet de dépenses assumées directement par les ménages : les personnes physiques qui autofinancent leurs formations représentent 5,2 % des publics des organismes de formation, contre 70 % pour les salariés et 12 % pour les demandeurs d’emploi. Les durées de formation sont courtes et la nature des formations acquises dans ce cadre est hétérogène.
Votre rapporteur estime que la faculté d’abondement du compte personnel de formation par son titulaire va permettre d’orienter une partie de cette dépense vers les formations les plus utiles tant à la sécurisation du parcours professionnel du salarié qu’à l’amélioration globale de la compétitivité de nos secteurs industriels. Les montants concernés devraient cependant être limités dans la mesure où les financements mutualisés et les abondements publics pourront satisfaire l’essentiel des besoins.
• L’abondement correctif, financé par l’employeur
Enfin, le compte personnel peut être le socle d’une dernière catégorie d’abondements complémentaire, distincte des précédentes, prévue à l’alinéa 45 par l’article L. 6323-12 qui prévoit le mécanisme de sanction associé à l’instauration de l’entretien professionnel par l’article 2 du projet de loi et actuellement réservé aux entreprises de plus de 50 salariés.
Pour mémoire, l’abondement correctif de 100 heures de formation vise à compenser le fait que le salarié n’a pas, dans les six années précédentes, bénéficié de l’entretien professionnel ni de deux des trois mesures manifestant l’effort de l’employeur en matière de formation du salarié : suivre au moins une action de formation ou bénéficier d’une progression, salariale ou professionnelle, ou acquérir des éléments de certification, par la formation ou par une validation des acquis de l’expérience.
Dans ce cas, 100 heures de formation sont inscrites au compte et l’entreprise verse à l’OPCA une somme forfaitaire, dont le montant sera fixé par décret en Conseil d’État. Il a été indiqué à votre rapporteur que le montant de cette somme sera défini après concertation avec les partenaires sociaux. Il ne devrait en aucun cas correspondre à un étalon monétaire des heures de formation inscrites au compte, dans la mesure où sa monétisation a clairement été écartée. La somme correspond en fait à une amende, les alinéas 46 et 47, prévoyant, au même article L. 6323-12 la compétence des agents du contrôle qui constatent un versement insuffisant de mettre l’entreprise en demeure de se conformer à ses obligations, et instaurant, à défaut, l’obligation de verser le double des sommes dues au Trésor public.
Comme pour les heures ajoutées sur le compte du salarié sur le fondement d’accords spécifiques, à l’alinéa 49, l’article L. 6323-14 précise que les heures de l’abondement correctif ne sont pas prises en compte lors de l’alimentation annuelle du compte du salarié : le plafond de 150 heures n’est pas applicable dans ce cas.
*
* *
Lors de son examen du texte du projet de loi, outre divers amendements de rectification ou à portée rédactionnelle, présentés par le rapporteur, votre commission des affaires sociales a adopté les principales modifications suivantes.
Sur proposition du rapporteur, la commission a précisé les objectifs du compte personnel de formation. Elle a rappelé, à l’article L. 6111-1 du code du travail, qu’il contribue « à l’acquisition d’un premier niveau de qualification » : le compte constituera en effet le cadre d’exercice du droit une formation initiale différée et permettra de cibler le financement de la formation professionnelle continue sur les actifs les plus dépourvus de qualifications.
Sur proposition du rapporteur, la commission a conforté le droit d’initiative de formation du titulaire du compte, en prévoyant, à l’article L. 6323-2 que son refus de le mobiliser ne constitue pas une faute. Si le texte déposé prévoit bien l’obligation d’accord exprès pour mobiliser le compte, cette disposition ne concerne que les situations où le compte du titulaire pourrait être débité à son insu. Mais si des formations sont proposées au salarié par son employeur, ou au demandeur d’emploi par Pôle emploi, et subordonnées à la mobilisation du compte personnel de formation, le refus du titulaire ne pourra pas être considéré comme fautif : dès lors, il ne constitue pas un manquement à l’obligation de loyauté dans l’exécution du contrat de travail, ni ne peut être assimilé à un refus de suivre une action de formation dans le cadre du projet personnalisé d’accès à l’emploi.
Sur proposition du rapporteur, la commission a précisé les catégories de formations éligibles au compte en modifiant leur énumération figurant à l’article L. 6323-6. Elle a établi que le socle commun de connaissances et de compétences est automatiquement éligible au compte personnel de formation sans qu’il ne soit nécessaire de le transposer sur une des listes établissant les formations effectivement ouvertes aux salariés et aux demandeurs d’emploi. Cette mesure de simplification répond manifestement à l’intention des partenaires sociaux qui, à l’article 18 bis de l’ANI, ont souhaité que ces formations puissent être suivies, au titre du compte, pendant le temps de travail, même sans l’accord de l’employeur, mesure qui figure au demeurant dans le texte déposé, à l’article L. 6323-16. La commission a également prévu que l’accompagnement à la préparation de la validation des acquis de l’expérience soit automatiquement éligible au compte personnel de formation. L’objectif de développement de la VAE est en effet régulièrement rappelé par les partenaires sociaux. La reconnaissance des acquis de l’expérience comme qualification sécurise le parcours professionnel et facilite l’accès aux qualifications intermédiaires où les acquis du parcours professionnel doivent être combinés avec des compétences nouvelles. Cette mesure va donc renforcer la contribution du compte personnel de formation à l’augmentation du niveau de compétence des salariés.
De même, par deux amendements proposés par le rapporteur, la commission a renforcé les garanties d’utilisation du compte par le salarié en précisant mieux les situations dans lesquelles l’accord de l’employeur est nécessaire. Tout d’abord, elle a levé toute ambiguïté sur les situations où le compte personnel de formation est utilisé en dehors du temps de travail donc n’est pas soumis à accord préalable de l’employeur en indiquant, à l’article L. 6323-16, qu’il s’agit de toutes les formations financées dans le cadre du compte personnel de formation, qu’il s’agisse des heures qui y sont inscrites, ou des abondements. Concernant l’utilisation du compte sur le temps de travail, la commission a précisé que, dans les cas où cette utilisation est opposable à l’employeur, le salarié n’est dispensé de recueillir l’accord de l’employeur que sur le contenu de la formation suivie. Dès lors, les règles habituelles en matière d’autorisations d’absence seront applicables. La commission a en outre donné à l’utilisation du compte pour bénéficier d’un accompagnement à la validation des acquis de l’expérience le même caractère opposable à l’employeur que son utilisation dans les autres cas énumérés dans le texte du projet de loi.
Sur proposition du rapporteur, à l’article L. 6323-9, la commission a précisé que le compte est alimenté à la fin de chaque année. Cette disposition améliorera la lisibilité des droits acquis par les titulaires de comptes. Surtout, à l’article L. 6323-10, sur proposition du rapporteur, la commission a prévu que le compte sera alimenté à hauteur de 24 heures jusqu’à l’accès au palier de 120 heures, puis de 12 heures par an jusqu’à l’application du plafond de 150 heures. Le rythme proposé correspond, de fait, à deux heures puis à une heure par mois. Il s’agit d’une simplification bienvenue en gestion qui accélère en outre l’acquisition de droits par les salariés sur le « socle » de leur compte : il en résulte que le plafond est appliqué au terme de la huitième année et non plus de la neuvième.
Sur proposition du rapporteur, la commission a adapté la terminologie des abondements, tous qualifiés de « complémentaires » dans le texte déposé, afin de distinguer d’une part les heures acquises par le salarié à titre de compensation ou en application d’accords et d’autre part les abondements sollicités auprès des organismes publics au moment où le compte est mobilisé pour suivre une formation. Elle a qualifié la première catégorie d’abondements « supplémentaires » afin de la distinguer des abondements en heures complémentaires qui ne sont pas retracés sur le compte personnel de formation.
En outre, à l’article L. 6323-13, sur proposition de M. Gérard Cherpion, avec l’avis de sagesse du rapporteur, la commission a élargi aux accords de groupe la faculté de prévoir ces abondements supplémentaires que le texte déposé réserve aux accords d’entreprise ou de branche ou interprofessionnel.
Sur proposition du rapporteur, votre commission a prévu, aux articles L. 6323-15 et L. 6323-20, l’actualisation régulière des listes des formations éligibles à la mobilisation du compte par les salariés et par les demandeurs d’emploi. Il s’agira ainsi de garantir la pleine adaptation de ces listes à l’évolution des besoins et à l’utilisation effective du compte personnel de formation.
À nouveau sur proposition du rapporteur, la commission à actualisé les dispositions figurant aux articles L. 114-12-1, L. 133-5-3, L. 133-5-4 du code de la sécurité sociale qui encadrent l’accès aux données du répertoire national commun de la protection sociale (RNCPS), afin de prévoir que l’organisme chargé de gérer le système d’information du compte peut les recevoir et que leur emploi peut avoir pour objet la formation professionnelle. Ceci permettra la construction et l’alimentation du système d’information du compte personnel de formation.
Enfin, sur proposition du rapporteur, la commission a confié au Conseil national de l’emploi, de la formation et l’orientation professionnelles une mission d’évaluation des conditions de mise en œuvre du compte personnel de formation, définie par un article L. 6323-8-1, nouveau. Ce choix est cohérent avec les dispositions du projet de loi, aux II des articles L. 6323-15 et L. 6323-20, qui rendent ce conseil destinataire des listes des formations éligibles au compte. Il sera donc possible de mesurer les modalités d’emploi du compte au regard des objectifs qui lui sont assignés.
*
* *
La Commission examine d’abord l’amendement AS271 de M. Lionel Tardy.
M. Lionel Tardy. Je ne suis pas friand, vous le savez, de bavardage législatif : l’alinéa 2 de cet article ne revêtant aucune portée normative, je propose de le supprimer.
M. Jean-Patrick Gille, rapporteur. Sur le principe – clarification et simplification –, je ne peux qu’être d’accord. Toutefois, ici, il ne me semble pas qu’il s’agisse de bavardage sans portée : en particulier, la précision « jusqu’à la retraite » est importante, comme le montrera l’amendement suivant de Mme Fraysse.
La Commission rejette l’amendement.
Elle examine ensuite l’amendement AS52 de Mme Jacqueline Fraysse.
Mme Jacqueline Fraysse. Je propose effectivement qu’un salarié qui n’aurait pas épuisé son compte personnel de formation (CPF) lorsqu’il prend sa retraite puisse encore en bénéficier pendant une année. Il pourrait ainsi se former pour participer, par exemple, à des activités dans le domaine de l’économie sociale et solidaire.
M. le rapporteur. Avis défavorable. Le CPF s’adresse aux actifs, et même en priorité à ceux qui en ont le plus besoin. Il n’a pas vocation à former les retraités. On peut d’ailleurs imaginer qu’à l’approche de la retraite, ceux qui n’auraient pas utilisé tous leurs droits le feront.
Mme Jacqueline Fraysse. Je regrette le refus du rapporteur. L’activité des retraités est très importante dans notre société, et il serait injuste de priver des salariés d’un droit acquis par des années de travail ; de plus, les heures ainsi perdues ne bénéficieront à personne d’autre. Un délai d’un an après la retraite pour utiliser les heures restantes paraît donc raisonnable et juste.
La Commission rejette l’amendement.
Puis elle se saisit de l’amendement AS528 du rapporteur.
M. le rapporteur. Cet amendement précise que le compte personnel de formation a notamment pour objectif de permettre à ceux qui en ont besoin d’acquérir un premier niveau de qualification, ce qui constitue pour nous une priorité. Depuis 2003, les partenaires sociaux ont en effet fixé un objectif : au cours de sa vie professionnelle, chaque salarié doit pouvoir accéder à une qualification ou progresser d’un niveau de qualification.
Mme Isabelle Le Callennec. Cela signifie-t-il que l’accès à un deuxième ou à un troisième niveau de qualification est exclu ?
M. le rapporteur. Non, absolument pas : il est également dit dans cet alinéa que le compte personnel contribue au développement des compétences et des qualifications.
La Commission adopte l’amendement.
Puis elle adopte l’amendement rédactionnel AS495, également du rapporteur.
Elle examine ensuite l’amendement AS113 de Mme Fanélie Carrey-Conte.
Mme Fanélie Carrey-Conte. Cet amendement vise à appeler l’attention sur un public pour lequel la formation présente un intérêt majeur : les personnes engagées dans un processus d’insertion et, notamment, les salariés des structures de l’insertion par l’activité économique (IAE). Je souhaite donc qu’il soit explicitement précisé que le droit au compte personnel de formation est ouvert aux salariés engagés dans un parcours d’insertion, quels que soient les contrats, les structures et les statuts.
M. le rapporteur. Je comprends votre intention, mais cette précision me semble ici inutile, voire maladroite : les personnes relevant de l’IAE sont considérées comme des salariés, il n’y a donc pas lieu de les mentionner explicitement.
Mme Fanélie Carrey-Conte. Je retire l’amendement, mais il sera important de rappeler en séance publique que tous les salariés, y compris ceux de l’IAE, sont concernés par cette loi.
L’amendement AS113, ainsi que l’amendement de cohérence AS301 de Mme Carrey-Conte, sont retirés.
La Commission examine alors l’amendement AS84 de M. Michel Piron.
M. Francis Vercamer. Le groupe UDI proposera à l’article 6 d’ouvrir l’accès à l’apprentissage dès l’âge de quatorze ans. Par cohérence, nous proposons ici que le bénéfice du CPF soit ouvert, pour les jeunes concernés, dès cet âge. Je rappelle que l’apprentissage peut commencer en Allemagne dès treize ans, et que ce pays compte 1,6 million d’apprentis, quand nous n’en avons que 430 000.
M. le rapporteur. Avis très défavorable. Je suis opposé à l’apprentissage dès quatorze ans, mais c’est un débat que nous aurons un peu plus avant dans la discussion du texte. S’agissant précisément du CPF, j’étais pour ma part favorable à ce qu’il soit ouvert à tous à seize ans, à la fin de l’obligation scolaire ; mais, comme il existe une dérogation permettant d’entrer en apprentissage à quinze ans, le CPF doit pouvoir être ouvert dès quinze ans, pour éviter toute discrimination.
M. Gérard Cherpion. L’amendement me paraît intéressant. Dès lors qu’il existe un contrat de travail, même dérogatoire, un compte personnel de formation doit être ouvert. Mais ne serait-il pas finalement plus simple de supprimer toute référence à l’âge et d’écrire « dès la signature d’un contrat de travail » ?
M. Michel Liebgott. Je partage la position du rapporteur : simplifions et ne multiplions pas les limites d’âge diverses. Quant à l’exemple allemand, il n’est pas nécessaire de le suivre systématiquement !
Mme Isabelle Le Callennec. La référence est-elle ici la date d’anniversaire de l’apprenti, ou bien s’agit-il de l’âge atteint au cours de l’année civile ? La situation est souvent confuse.
M. Denis Jacquat. Monsieur Liebgott, vous qui êtes mosellan comme moi, vous savez que le dispositif du pré-apprentissage en vigueur chez nous a très bien fonctionné. Beaucoup de TPE et de PME cherchent des ouvriers qualifiés, et l’apprentissage est le dispositif idéal pour en former. Pourquoi ce qui a donné satisfaction ici ne le ferait-il pas à nouveau ailleurs ?
M. le rapporteur. Je suis, je le répète, très défavorable à l’apprentissage dès quatorze ans ; en revanche, la modification rédactionnelle proposée par M. Cherpion me paraît judicieuse et propre à simplifier le texte : je lui propose donc d’y réfléchir ensemble.
M. Gérard Cherpion. Très bien.
Mme Véronique Besse. Les élèves qui n’ont pas encore quinze ans à la rentrée sont exclus de l’apprentissage : ne peut-on pas leur ouvrir cette possibilité ?
M. le rapporteur. Cette mesure figurait dans la loi Cherpion, que nous avons corrigée, car cela introduisait de facto l’apprentissage à quatorze ans ; je sais que vous avez vous-même déposé une proposition de loi sur ce sujet.
La règle, c’est qu’il ne peut pas y avoir de contrat d’apprentissage avant quinze ans révolus ; le problème que vous signalez se pose donc pour les élèves atteignant cet âge après la date de la rentrée scolaire. Une circulaire de l’éducation nationale précise qu’ils peuvent être accueillis dans les centres de formation d’apprentis (CFA) dès la rentrée, mais qu’ils ne peuvent signer leur contrat que lorsqu’ils ont effectivement atteint quinze ans. J’ai toutefois le sentiment que cette circulaire est mal comprise et mal appliquée ; peut-être faudra-t-il en reprendre certains éléments au niveau législatif.
M. Francis Vercamer. J’aimerais être associé au travail sur ce qui est après tout mon amendement…
Par ailleurs, monsieur le rapporteur, vous ne pouvez pas vous étonner du fait qu’une circulaire qui va à l’encontre de la loi ne soit pas appliquée !
Mme Sylviane Bulteau. Cette circulaire pose effectivement problème, car elle met en place une véritable usine à gaz… Mais le rapporteur a raison : c’est un débat que nous aurons plutôt à l’article 6.
L’amendement AS84 est retiré.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette ensuite l’amendement AS53 de Mme Jacqueline Fraysse.
Puis elle examine l’amendement AS496 du rapporteur.
M. le rapporteur. Cet amendement précise que le refus de mobiliser le compte ne peut jamais constituer une faute : c’est au titulaire que revient la décision d’utiliser, ou non, les heures acquises. Le CPF doit permettre de renforcer la négociation sur la formation au sein de l’entreprise, et le dialogue direct entre l’employeur et le salarié ; mais il faut aussi éviter que des pressions ne s’exercent sur un salarié pour l’obliger à utiliser ce compte contre son gré.
M. Gérard Cherpion. Cet amendement me semble poser problème : il s’applique au cas d’un salarié, mais pas à celui d’un demandeur d’emploi.
Se pose aussi le problème de l’abondement du compte : pour un demandeur d’emploi, est-il obligatoire ou pas ? Comment le demandeur d’emploi peut-il se tourner vers la collectivité susceptible d’abonder le compte ?
Mme Véronique Louwagie. Il est important, je crois, de définir les fautes : ici, vous définissez au contraire ce qui n’en constitue pas une. Cela me paraît une démarche dangereuse : faudra-t-il énumérer tout ce qui ne constitue pas une faute ? De plus, pourquoi écrire « jamais » ? Un simple « pas » suffit.
Mme Isabelle Le Callennec. Faut-il activer en premier les dispositifs de formation aujourd’hui existants, ou bien le CPF ? Cet amendement montre que la réponse à cette question n’est pas claire.
M. le rapporteur. Si, justement, l’amendement répond à cette question !
Monsieur Cherpion, vous avez raison, je pensais ici plutôt aux salariés. Mais c’est encore plus vrai pour les demandeurs d’emploi : Pôle emploi peut au bout d’un certain temps quasiment obliger un demandeur d’emploi à accepter une formation – ce que nous ne remettons absolument pas en cause –, mais il ne sera pas possible de le contraindre à utiliser pour cela son compte. En quelque sorte, le compte personnel de formation est la propriété de chacun : c’est un argument auquel vous devriez être sensibles…
La modification de « jamais » en « pas » me paraît en revanche acceptable. Je propose de rectifier l’amendement en ce sens.
M. Denys Robiliard. Effectivement, le mot « pas » suffit. Je précise toutefois que l’on trouve déjà dans le code du travail des articles qui précisent que l’exercice d’un droit ne constitue pas une faute. Il est parfois nécessaire d’insister lourdement…
M. Christophe Cavard. Je soutiens cet amendement, car il faut éviter les pressions de Pôle emploi et des employeurs : le CPF est individuel et appartient à son titulaire qui est libre de le mobiliser comme il l’entend. C’est une avancée qui résulte de l’accord signé par les partenaires sociaux.
M. Gérard Cherpion. La substitution de « pas » à « jamais » est effectivement judicieuse. En revanche, si nous sommes d’accord sur le fond, il me semble indispensable de modifier la rédaction pour que l’amendement s’applique bien aux demandeurs d’emploi comme aux salariés.
M. le rapporteur. Votre préoccupation est satisfaite : nous en sommes ici aux principes généraux, qui s’appliquent à tous.
La Commission adopte l’amendement AS496 rectifié.
Elle adopte ensuite l’amendement rédactionnel AS497 du rapporteur, tendant à remplacer le mot « bénéficiaire » par le mot « titulaire ».
Elle examine en discussion commune les amendements AS116 de M. Francis Vercamer et AS185 de M. Gérard Cherpion.
M. Francis Vercamer. L’accord national interprofessionnel (ANI) du 14 décembre dispose que le compte personnel de formation doit pouvoir être mobilisé par le salarié après la rupture de son contrat de travail, sauf si cette rupture résulte d’une faute lourde. Cette dernière clause n’a pas été reprise dans la loi : je propose de l’y ajouter.
M. Gérard Cherpion. Mon amendement tend à la même fin. Cet ajout serait conforme à la volonté des partenaires sociaux.
M. le rapporteur. Avis défavorable. Cette disposition serait non seulement contraire à l’esprit du compte – les crédits d’heures s’accumulent automatiquement sur le CPF, à l’image en quelque sorte de ce qui se passe pour les droits à congé payé –, mais elle créerait de grandes complications et serait une source inépuisable de contentieux.
M. Francis Vercamer. C’est un peu fort de café ! M. le ministre a dit vouloir respecter l’accord ; le Gouvernement et la majorité ne peuvent pas choisir certaines clauses et en écarter d’autres. Cette clause figure noir sur blanc dans l’ANI. Je rappelle tout de même qu’une faute lourde est une faute qui a pénalisé l’entreprise : il est logique que celle-ci récupère les heures versées au CPF, car elle a subi un préjudice.
Mme Isabelle Le Callennec. Le compte est activé à la demande expresse de son titulaire. Que se passe-t-il si cette activation n’est pas intervenue au bout de neuf ans ? Le compte est-il remis à zéro ?
Mme Véronique Louwagie. Est constitutive d’une faute lourde, je le rappelle, une faute commise dans l’intention de nuire à l’employeur.
D’autre part, monsieur le rapporteur, un salarié licencié pour faute lourde est privé de l’indemnité compensatrice de congés payés : comment pourrait-il en être autrement avec le compte personnel de formation ?
M. Gérard Cherpion. Votre position est un déni de l’ANI, qui précise, au nom du parallélisme des formes, que les droits doivent être débités du compte en cas de faute lourde.
M. Denys Robiliard. La faute lourde se définit effectivement selon les termes que vous avez rappelés, madame Louwagie, mais ses conséquences sont doubles : d’une part la perte des droits à l’indemnité compensatrice de congés payés, mais seulement pour la période de référence en cours ; de l’autre, la possibilité, pour l’employeur, de demander au salarié des dommages et intérêts en engageant une action en responsabilité. Je rappelle également qu’un salarié peut avoir accumulé des points sur le CPF auprès de plusieurs employeurs successifs : il serait abusif de le priver de l’ensemble de ses droits. Enfin, l’amendement contrevient au principe, constant dans le droit du travail, de l’interdiction des sanctions pécuniaires.
Nous devons respecter l’esprit de l’ANI, mais pas forcément le retranscrire mot pour mot : dans le cas contraire, autant abolir le Parlement !
Mme Véronique Louwagie. L’amendement AS185 précise bien, monsieur Robiliard, que les heures concernées sont celles « portées […] au titre de l’exécution du contrat de travail qui a donné lieu à licenciement […] », non les heures acquises à travers d’autres contrats de travail.
Comment expliquer à un salarié privé de l’indemnité compensatrice de congés payés – laquelle peut atteindre un mois et demi de salaire – qu’il ne le sera pas des droits acquis au titre du CPF ? Une telle discordance aurait des effets déstabilisateurs sur ses relations avec l’employeur.
M. Gérard Cherpion. Mon amendement AS185 est bien rédigé dans les termes que vient de rappeler Mme Louwagie. Je relève d’autre part que, si l’employeur manque à certaines de ses obligations légales vis-à-vis d’un salarié, il se verra obligé d’abonder son CPF de 100 heures supplémentaires. Le parallélisme des formes exige qu’une faute lourde commise par le salarié se répercute sur son compte.
M. le rapporteur. À moins de préciser que la mesure ne vise que les heures non utilisées, il faudrait récupérer, d’une façon ou d’une autre, celles qui l’ont été. Ce serait une source de complexité inutile au vu de la rareté des fautes lourdes que, pour cette raison, le projet de loi n’évoque pas : évitons de multiplier les sources de contentieux, et tenons-nous en à des principes simples.
Mme Véronique Louwagie. Le législateur doit envisager tous les cas, monsieur le rapporteur, y compris et peut-être surtout lorsqu’ils sont rares, car ils peuvent alors être matière à discussion.
M. Michel Liebgott. Une faute lourde ne remet pas en cause la qualité du travail d’un salarié qui aurait passé deux ou trois décennies au sein d’une entreprise. Parlons-nous de punition ou de droit ? Dans la seconde hypothèse, il faut se ranger aux arguments du rapporteur.
M. Denys Robiliard. Le texte institue quasiment une nouvelle branche de la sécurité sociale : ne rendons pas sa gestion plus complexe qu’elle ne le sera, surtout qu’en l’espèce, les cas sont très rares. J’ajoute qu’un salarié licencié a besoin de formation pour retrouver un emploi.
La Commission rejette successivement les amendements AS116 et AS185.
Puis elle adopte successivement deux amendements du rapporteur : AS498, rédactionnel, et AS499, rectifiant une erreur de référence.
Elle en vient à l’amendement AS169 de M. Lionel Tardy.
M. Lionel Tardy. L’alinéa 24 permet à l’Association de gestion du fonds pour l’insertion des personnes handicapées, l’AGEFIPH, d’abonder le CPF en heures complémentaires lorsque la durée de la formation éligible au compte est plus longue que le nombre d’heures qui s’y trouvent inscrites ; en ce sens, il ne transpose qu’incomplètement l’article 27 de l’ANI, aux termes duquel « les signataires […] demandent au conseil d’administration de l’AGEFIPH d’étudier les conditions et les modalités permettant d’abonder le compte personnel de formation pour les bénéficiaires de l’obligation d’emploi des travailleurs en situation de handicap, dans le respect de ses missions. Cet abondement peut notamment prendre la forme d’actions de compensation du handicap ou d’actions de formation préparatoire. »
Cet alinéa n’est pas assez précis, car l’ANI laisse au conseil d’administration de l’AGEFIPH, et à lui seul, le soin d’étudier les conditions et les modalités de cet abondement, lesquelles doivent également être appréciées au regard des missions et du budget de l’institution. Ce point doit être précisé par voie réglementaire.
M. le rapporteur. Cet amendement ne laisse pas de m’étonner, au vu du souci de simplification qui anime en général son auteur.
Les alinéas 16 à 24 dressent la liste des organismes autorisés à abonder le CPF en heures complémentaires : pourquoi la précision que vous préconisez, monsieur Tardy, ne s’appliquerait-elle pas à chacun d’entre eux ?
Mme Isabelle Le Callennec. Parmi ces organismes figure, à l’alinéa 21, « l’État ». Quelles institutions vise-t-on précisément ?
M. le rapporteur. L’éducation nationale, par exemple et entre autres…
Mme Isabelle Le Callennec. Préciser ce point n’est pas sans intérêt. « L’État » tout court, cela n’a guère de sens... Concrètement, à quelle porte les demandeurs d’emploi, par exemple, pourront-ils frapper pour obtenir un abondement de leur compte ?
M. Denys Robiliard. Les alinéas visés dressent seulement la liste des intervenants qui peuvent abonder le CPF en heures complémentaires. Ces abondements seront décidés ultérieurement, dans le contexte budgétaire contraint que vous connaissez. Renvoyer à la personne morale de l’État laisse toute latitude pour définir ensuite les financeurs à solliciter. L’article 1er, je le rappelle, définit seulement les principes généraux.
La Commission rejette l’amendement.
Puis elle en vient à l’amendement AS500 du rapporteur.
M. le rapporteur. Le CPF, différent en cela du droit individuel à la formation, n’ouvre droit qu’à des formations bien définies, dont les alinéas 26 à 31 établissent la liste. Mon amendement tend à les remplacer par sept nouveaux alinéas, qui ne modifient en rien le « vivier » dans lequel puiser.
Je propose, en premier lieu, que soient éligibles, non seulement les formations qualifiantes, mais aussi celles « visant à acquérir le socle de connaissances et de compétences défini par décret » : pour marquer qu’il s’agit d’une priorité absolue, cette précision fait l’objet du grand I, les autres formations étant ensuite énumérées dans le grand II.
Enfin, je souhaite, dans le grand III, ajouter aux formations éligibles celles « visant l’accompagnement à la préparation de la validation des acquis de l’expérience (VAE) ». Bien que cette disposition ne figure pas dans l’ANI, elle me semble conforme à l’esprit du CPF.
Mme Véronique Louwagie. La prise en compte des formations « visant à acquérir le socle de connaissances et de compétences » me paraît être une ouverture importante ; cependant, je m’interroge sur la définition de ce socle par décret : que peut-on en attendre ?
Mme Isabelle Le Callennec. Les demandeurs d’emploi comme les salariés peuvent d’ores et déjà accéder à des formations leur permettant d’acquérir un socle de connaissances et de compétences. En auront-ils toujours la possibilité sans activer leur CPF ?
M. le rapporteur. Oui, nous avons adopté un amendement en ce sens.
Mme Isabelle Le Callennec. Une ambiguïté demeure sur son caractère facultatif ou obligatoire. Ne pourrait-on préciser que les intéressés n’activeront leur compte que s’ils le souhaitent, tout en conservant par ailleurs le bénéfice de leurs droits actuels ? L’exposé sommaire de l’amendement indique que « ces formations peuvent être suivies, au titre du CPF, pendant le temps de travail même sans l’accord de l’employeur ». Qui remplacera un salarié indisponible parce qu’il suit une formation ? Les dispositifs mentionnés par l’exposé sommaire existent déjà dans le droit actuel : je ne vois donc pas comment vous entendez les articuler avec le CPF.
M. Arnaud Richard. Les partenaires sociaux, soucieux de rigueur, ont souhaité que seules soient éligibles les formations qualifiantes. Ils n’ont donc pas proposé la même chose que vous, à savoir ce capharnaüm où chacun pourra trouver son compte !
Mme Jacqueline Fraysse. Puisque nous en sommes aux principes, il ne me semble pas juste qu’une formation suivie pour sortir de l’illettrisme soit imputée sur le CPF. Aujourd’hui, 8 % de nos concitoyens souffrent de ce fléau, qu’il revient aux pouvoirs publics de combattre. Le CPF, lui, a vocation à être utilisé pour des formations qualifiantes. Je suis donc résolument opposée à cet amendement.
M. Gérard Cherpion. Comme l’a souligné madame la présidente elle-même, le temps dont nous avons disposé pour examiner ce texte a été inversement proportionnel à sa complexité.
Les titulaires d’un CPF pourront, dit-on, l’utiliser comme ils l’entendent ; mais, une fois posé ce principe, des listes viennent borner cette liberté en limitant les formations éligibles. L’amendement est donc lourd de conséquences pour l’ensemble du dispositif.
Sur le fond, je ne suis pas défavorable à un accompagnement dans la préparation à la VAE, mais c’est le système de la VAE dans son ensemble qu’il faut revoir : ce n’est pas au détour d’un amendement qu’on peut le faire. Je voterai donc contre celui qui nous est soumis.
Mme Monique Iborra. Je comprends l’esprit de cet amendement, qui vise à ouvrir le CPF à ceux qui en ont le plus besoin. Cependant, comme l’a observé Mme Fraysse, les formations les plus fondamentales relèvent des seules politiques publiques ; en l’occurrence, on voit mal comment concrétiser les grands principes énoncés par le texte.
M. Francis Vercamer. Le rapporteur prend décidément des libertés avec l’ANI, aux termes duquel les formations éligibles au CPF sont « obligatoirement – j’insiste sur cet adverbe – des formations qualifiantes correspondant aux besoins de l’économie prévisibles à court et moyen terme ».
De plus, examiner un tel projet de loi avant la réforme de la décentralisation revient à mettre la charrue avant les bœufs, tant les régions, véritables moteurs du développement économique, doivent aussi l’être en matière de formation professionnelle. Celle-ci mérite, plutôt que les rustines que l’on nous propose, une véritable réforme systémique : nous ne voterons pas contre ce projet de loi issu d’un accord entre les partenaires sociaux, mais la lettre de cadrage que le Gouvernement leur avait adressée aurait dû insister sur l’exigence d’orienter la formation vers les besoins de l’économie réelle à court et moyen termes. Nous aurons à nouveau ce débat dans l’hémicycle.
M. Denys Robiliard. L’un des objectifs de la réforme est d’ouvrir la formation professionnelle aux personnes sans qualification, ou d’un niveau de qualification très faible, comme celles qui occupent des emplois de manutentionnaire, par exemple. Tout moyen pouvant contribuer à la lutte contre l’illettrisme est bon : le CPF en est un. Au reste, sans connaissances de base suffisantes, il est impossible de recevoir une formation qualifiante. En ce sens, l’amendement s’inscrit dans la logique de l’ANI.
S’agissant des listes, il ne s’agit à ce stade que de poser des principes généraux : les modalités de leur définition ne seront fixées que dans un second temps.
Enfin, si l’on peut s’interroger sur une éventuelle réforme de la VAE, l’amendement ne porte que sur le financement des formations destinées à la préparer. Sur ce point aussi, l’amendement me semble suivre le bon chemin, même si l’accompagnement relève davantage d’une assistance à la préparation que d’une formation visant, par exemple, à compléter les acquis de l’expérience. Je suggère donc de simplifier la rédaction du III pour écrire : « L’accompagnement à la préparation de la validation des acquis de l’expérience mentionnée à l’article L. 6313-11 est également éligible au compte personnel de formation, dans des conditions définies par décret. ».
M. Christophe Cavard. La possibilité d’utiliser le CPF pour accéder à des dispositifs parfois coûteux, comme la préparation à la VAE, nous semble une bonne chose.
Cela dit, l’adoption du présent amendement ferait tomber notre amendement AS226, qui tendait à compléter l’alinéa 31 par les mots : « ou engagées dans un parcours d’insertion sociale et professionnelle ». En effet, les départements financent des contrats d’insertion et les formations reçues par ceux qui en bénéficient nous semblent donc devoir être éligibles au CPF ; faute de quoi, des personnes en recherche d’emploi seraient exclues du dispositif.
Mme Martine Carrillon-Couvreur. La VAE peut revêtir des formes diverses en fonction des parcours professionnels. Si un technicien, par exemple, peut assez facilement y recourir pour devenir technicien supérieur ou ingénieur, il en va différemment pour d’autres salariés, pour lesquels cette validation des acquis ne peut être obtenue qu’au terme d’un parcours long et difficile : ainsi en est-il par exemple des personnes handicapées accueillies dans des entreprises adaptées proposant des VAE. Il vaut donc la peine que nous examinions de près cette question du financement de l’accompagnement.
Mme Monique Iborra. Aujourd’hui, l’accompagnement des demandeurs d’emploi vers la VAE est assuré par les conseils régionaux, sans qu’ils y soient obligés.
M. le rapporteur. Sur le fond, mon amendement change peu de chose.
Monsieur Vercamer, vous avez mal lu l’ANI qui crée le compte personnel de formation pour faciliter l’accès non seulement aux formations qualifiantes, mais aussi aux tout premiers niveaux de qualification, en particulier au socle de connaissances et de compétences, sans lequel aucune autre qualification n’est possible. Dans ce cas, l’ANI crée même en quelque sorte un droit opposable, madame Fraysse. Vous craignez qu’on ne laisse les demandeurs de formation se débrouiller au prétexte qu’ils ont un CPF, mais l’employeur ne pourra pas s’opposer à leur demande et il sera tenu de maintenir leur rémunération. Il s’agit donc d’une mesure progressiste. Le CPF ne remet en cause aucun des dispositifs existants, mais il permet au titulaire qui n’aurait pas été satisfait de sa prise en charge par l’entreprise ou par Pôle emploi de prendre l’initiative d’une formation, puisque, aux termes de l’ANI, « l’utilisation du CPF sur le temps de travail est de droit pour une action de formation engagée par le salarié […] pour acquérir le socle de compétences… ».
Comme cela n’allait pas de soi – vous-même ne l’avez pas vu –, j’ai réécrit une partie de l’article 1er pour préciser les formations éligibles. Peut-être aurait-il fallu deux amendements, pour scinder les débats. En tout cas, je n’ai rien changé, sinon que j’ai ajouté l’accompagnement à la VAE qui doit pouvoir être obtenu sans rien demander à personne, comme les formations permettant d’acquérir le socle de compétences qui étaient déjà incluses dans le projet de loi et que je n’ai fait que mettre en évidence.
Mme Isabelle Le Callennec. Qui va payer la formation ?
M. le rapporteur. L’organisme paritaire collecteur.
Mme Isabelle Le Callennec. Et dans le cas d’un demandeur d’emploi ?
M. le rapporteur. Le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, conformément à l’ANI.
Mme Véronique Louwagie. Sait-on ce que contiendra le décret relatif au socle de connaissances et de compétences ?
Mme Jacqueline Fraysse. Ma réflexion se poursuit à la lumière des échanges que nous avons. Surmonter l’illettrisme doit prendre plus ou moins de temps selon les personnes, mais, sachant qu’il faut cinq ans pour voir son compte crédité de 100 heures, cela signifie que les personnes en situation d’illettrisme devront attendre longtemps avant d’espérer vaincre leur terrible handicap. Pourront-elles ensuite suivre une formation qualifiante alors que ce sont précisément elles qui ont le plus besoin de se former ?
M. Christophe Cavard. Attention, les dispositifs de lutte contre l’illettrisme ne relèvent pas tous du CPF. Les collectivités en proposent qui sont ouverts à tous.
Est-on sûr que les titulaires du revenu de solidarité active en parcours d’insertion, qui sont pris en charge par les départements au titre de l’aide sociale, et non par la région au titre de la formation professionnelle, seront éligibles à toutes les formations figurant sur la liste ?
M. le rapporteur. Oui. Le titulaire d’un compte en dispose librement. L’idée est de laisser les mains libres aux personnes qui veulent « s’en sortir » et acquérir le socle de connaissances ; elles n’auront même pas besoin de l’accord de Pôle emploi. Au-delà, elles seront tributaires des instances qui paient le complément, mais elles auront accès aux formations de la liste. Quant aux formations organisées par les conseils généraux, elles sont évidemment financées.
Madame Fraysse, pour les formations qualifiantes, vous avez de toute façon besoin d’un abondement et c’est celui qui accorde cet abondement qui décide, région ou autre financeur. L’important, c’est de ne pas avoir besoin de demander l’avis de tel ou tel tant qu’on puise dans son compte pour suivre une formation de la liste.
Quant au décret, les partenaires sociaux y travaillent dans le cadre d’un appel à projet lancé par le Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels.
La Commission adopte l’amendement AS500 ; en conséquence, les amendements AS11, AS103, AS12, AS95, AS186, AS302, AS226 et AS227 tombent.
La Commission en vient à l’examen de l’amendement AS272 de M. Lionel Tardy.
M. Lionel Tardy. Amendement rédactionnel consistant à utiliser partout les mêmes termes « service en ligne » figurant dans la loi sur les retraites.
Mme Isabelle Le Callennec. Qui sera derrière ce service dématérialisé ?
M. le rapporteur. La Caisse des dépôts ; le texte le dit.
La dernière loi sur les retraites utilise les deux expressions, « service en ligne » pour ceux qui dispensent une information assez simple, et « service dématérialisé » pour ceux qui par exemple de remplir des formulaires. Avis défavorable.
La Commission rejette l’amendement AS272.
Elle adopte ensuite l’amendement rédactionnel AS501 du rapporteur.
La Commission est saisie de l’amendement AS273 de M. Lionel Tardy.
M. Lionel Tardy. L’article 2 supprime le passeport orientation et formation. Pourtant, il est mentionné à l’article 1er sous un nom légèrement différent et avec une définition assez vague. Pourquoi ne pas le conserver puisque, en pratique, il est utilisé et que ses modalités sont définies à l’article L. 6315-2 du code du travail ?
M. le rapporteur. Le sujet est compliqué. La loi de 2009 prévoyait un passeport formation, mais il n’a jamais fonctionné car mettre en consultation des documents suppose qu’ils aient été en quelque sorte certifiés. Cette démarche se serait alors rapprochée de celle suivie pour le livret du travailleur, dont nous ne voulons pas et qui a été abrogé pour des raisons de respect des libertés publiques. Le conseil en évolution professionnelle pourra se doter d’un outil en ligne, mais on choisira les éléments qui seront publiés. Avoir repris le même terme est malheureux, j’en conviens.
Mme Isabelle Le Callennec. Êtes-vous sûr que la Caisse des dépôts sera prête le 1er janvier 2015 ?
M. le rapporteur. C’est ce qu’elle a indiqué.
M. Pierre Morange. Je me suis déjà inquiété auprès du ministre de la faisabilité du portage du CPF par la Caisse des dépôts. J’émets de sérieuses réserves quant à la capacité technique qu’a une structure dont le cœur de métier est la banque de créer et de gérer 23 millions de comptes potentiels, d’autant que le fichier central est tenu par la Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) qui gère déjà le compte pénibilité. Comme celui-ci est lié au compte personnel formation, j’insiste sur le caractère très aléatoire de la mise en œuvre d’un dispositif législatif voté en urgence et applicable dès le 1er janvier 2015, et sur le risque de nuire à la sécurisation des parcours professionnels qui est pourtant l’objectif.
M. le rapporteur. La CDC a dit être prête à remplir cette mission. Elle gère déjà des régimes de retraite. Une commission quadripartite pilotée par Jean-Marie Marx avec l’appui de l’Inspection générale des affaires sociales a mené le travail de préparation et lancé l’appel à projet, auquel la CNAV n’a pas répondu. De la CDC et de l’Agence de services de paiement (ASP), c’est la première qui a apporté les réponses les plus satisfaisantes. Certes, la CNAV gérera le compte pénibilité qui alimentera le compte personnel formation, mais il y aura d’autres sources d’abondement, et la CDC ne fera que gérer les compteurs, en quelque sorte.
La Commission rejette l’amendement AS273.
Puis elle adopte l’amendement rédactionnel AS502 du rapporteur.
La Commission en vient à l’amendement AS491 du rapporteur.
M. le rapporteur. Sans doute conviendrons-nous tous qu’un dispositif d’une telle ampleur ne peut pas ne pas être évalué. Et il me semble normal de confier cette tâche au Conseil national de l’emploi et de la formation professionnelle (CNEFOP) prévu à l’article 14, et issu de la fusion entre le Conseil national de la formation tout au long de la vie (CNFPTLV) et le Conseil national de l’emploi (CNE). Tous les ministères, les partenaires sociaux et les régions y sont représentés.
Mme Isabelle Le Callennec. Je suis bien sûr favorable à cette évaluation. Mais pourquoi ne pas préciser qu’elle doit être rendue publique, voire faire l’objet d’un rapport au Parlement ?
M. le rapporteur. Les travaux du CNEFOP sont par définition publics. On peut toujours demander un rapport de plus au Parlement, mais sachez que deux députés siégeront au CNEFOP.
Mme Isabelle Le Callennec. Lesquels ?
M. le rapporteur. Gérard Cherpion et moi-même, qui siégeons actuellement au CNFPTLV.
M. Gérard Cherpion. Je suis étonné de cet amendement. Le CNEFOP rassemble beaucoup de monde, mais pas tout le monde – le hors champ notamment en est exclu. En outre, une véritable évaluation ne peut être faite que par un organisme extérieur au système de formation professionnelle, comme le Parlement.
M. le rapporteur. Je voulais que le texte mentionne l’évaluation, mais je veux bien débattre de qui en sera chargé. J’ai réfléchi, mais je n’ai trouvé que le CNEFOP pour la mener. Il pourra faire appel à des experts, mais il a les moyens de commanditer ce travail et sa composition permettra une large discussion.
M. Lionel Tardy. D’ici à l’examen du texte dans l’hémicycle, il faut trouver une solution à ce problème, sans bien sûr créer une nouvelle structure.
M. Christophe Cavard. L’unanimité se fait sur la nécessité de l’évaluation, sinon sur ses modalités. La solution proposée par le rapporteur a au moins le mérite d’associer les partenaires sociaux, ce qui est important quand on entend favoriser le dialogue social. Mais peut-être y a-t-il d’autres outils.
M. Arnaud Richard. C’est tout à l’honneur du rapporteur d’avoir prévu une évaluation, mais c’est au Parlement qu’incombe l’évaluation des politiques publiques. Il faut trouver une autre solution même si je salue le « choc de simplification » consistant à ne plus laisser subsister qu’un seul organisme.
Mme Monique Iborra. Je serais favorable à ce qu’un rapport soit remis au Parlement. Il vote la loi et, par ailleurs, la formation professionnelle reste un dédale compliqué, y compris pour les bénéficiaires. Toutes les politiques publiques doivent être évaluées et ce serait rendre service à tout le monde, y compris aux partenaires sociaux.
M. le rapporteur. Si vous cherchez un terrain neutre, le Parlement, malgré ses qualités, n’est pas le plus indiqué. Cela étant, rien n’empêche une mission d’information sur le sujet. Le CNEFOP réunit tous les partenaires et il centralisera toutes les données. À défaut de le charger de l’évaluation, il faudra une nouvelle instance, avec des dépenses nouvelles… On créerait le CNEFOP pour évaluer l’apprentissage, mais pas la formation professionnelle ? Vos réactions m’étonnent !
M. Gérard Cherpion. Peut-être suffit-il de confier le rapport d’évaluation au CNEFOP, qui viendra le présenter au Parlement.
Mme la présidente Catherine Lemorton. Il ne faut pas mélanger les rapports au Parlement que nous prenons tels quels et les évaluations faites par les parlementaires. Rien n’empêchera le Comité d’évaluation et de contrôle de faire une évaluation, car la formation est une politique transversale.
La Commission adopte l’amendement AS491.
Elle examine ensuite l’amendement AS504 du rapporteur.
M. le rapporteur. L’amendement précise que les heures seront décomptées et créditées au compte à la fin de l’année.
Mme Véronique Louwagie. Et les salariés qui quitteront une entreprise en cours d’année ? Devront-ils attendre la fin de l’année pour pouvoir se former ?
M. le rapporteur. Il faut bien fixer une règle et j’ai opté pour la simplicité. Le mieux est l’ennemi du bien.
La Commission adopte l’amendement AS504.
La Commission est saisie des amendements AS54 de Mme Jacqueline Fraysse, AS202 de Mme Ségolène Neuville, AS505 du rapporteur, AS162 de M. Hervé Morin, AS14 de M. Gérard Cherpion et AS228 de M. Christophe Cavard, pouvant faire l’objet d’une présentation commune.
Mme Jacqueline Fraysse. Le texte actuel dispose que le compte est alimenté à raison de vingt heures par année de travail à temps complet, jusqu’à l’acquisition de 120 heures, puis de dix heures par année de travail à temps complet, dans la limite du plafond de 150 heures. Comment se justifie ce régime qui porte à neuf ans le délai minimum au terme duquel le salarié a droit à 150 heures de formation ?
Mon amendement AS54 propose d’alimenter le CPF à hauteur de 25 heures par année de travail, ce qui simplifiera son fonctionnement et réduira à six le nombre d’années de travail nécessaires pour avoir droit à 150 heures de formation.
Mme Ségolène Neuville. L’amendement AS202, issu de la délégation aux droits des femmes, est centré sur les salariés à temps partiel, dont 80 % sont des femmes et qui sont souvent moins qualifiés et moins formés que les autres salariés. Or ce n’est pas parce que l’on travaille à temps partiel que l’on peut se permettre de n’être qu’à moitié formé – cela s’applique aussi bien à une infirmière qu’à une coiffeuse. L’amendement s’inspire aussi d’une recommandation de la feuille de route du comité interministériel aux droits des femmes – la mesure 6, visant à améliorer l’accès des femmes qui travaillent à temps partiel au compte personnel de formation. Il tend à donner aux salariés à temps partiel les mêmes droits qu’aux salariés à temps complet en termes d’alimentation du compte personnel de formation, soit 20 heures par année de travail, et non pas des droits calculés au prorata de leur temps de travail.
M. le rapporteur. L’amendement AS505 fait bouger les curseurs sans modifier l’équilibre général du dispositif et vise à simplifier le calcul des droits, afin que les personnes concernées puissent mieux s’approprier leur compte de formation. Le crédit de formation passerait à 24 heures par an, jusqu’à ce que soit atteint le plafond de 120 heures, puis à 12 heures par an pour atteindre le plafond de 150 heures – désormais en sept ans et demi au lieu de neuf.
Lors de l’entrée en vigueur du dispositif, au 1er janvier 2015, la plupart des salariés concernés disposeront déjà d’un crédit au titre du droit individuel à la formation, dont les acquis ne seront pas remis en question.
Je tiens à souligner que toutes nos propositions dans ce domaine doivent s’inscrire dans le cadre de l’accord conclu entre les partenaires sociaux, qu’il ne s’agit pas de remettre en cause. Il me semble que la disposition que je propose devrait recueillir l’assentiment des signataires de cet accord.
M. Arnaud Richard. L’insuffisance des droits est un véritable obstacle à la formation des salariés et peut décourager aussi bien ces derniers que les demandeurs d’emploi, en les faisant douter de l’efficacité réelle des dispositifs de formation continue. De fait, alors que le CPF est plafonné à 150 heures, une reconversion professionnelle peut mobiliser 500 heures de formation.
Lors de son audition, le ministre a précisé que le CPF pouvait être abondé et que les 150 heures prévues par le texte pouvaient être comprises comme un plancher. Il faut néanmoins préciser cet aspect du texte. L’amendement AS162 tend donc à déplafonner l’abondement au CPF afin de le faire mieux correspondre aux besoins de formation des salariés ou des demandeurs d’emploi.
M. Bernard Perrut. Le plafond de 150 heures ne permet pas au salarié de suivre une formation qualifiante. En outre, plus le plafond du CPF est bas, plus le salarié risque de dépendre des abondements consentis par les différents acteurs mentionnés dans cet article pour accéder aux formations qu’il souhaite effectuer. Sa liberté reste donc très partielle et nous sommes bien loin de la révolution annoncée en matière de formation professionnelle. L’amendement AS14 tend donc à porter ce plafond à 200 heures.
M. Christophe Cavard. L’amendement AS228 rejoint celui que vient de présenter Mme Neuville en faveur des salariés à temps partiel. Ceux-ci, qui n’ont du reste pas toujours choisi leur situation, doivent pouvoir bénéficier de formations qui leur permettent de travailler à temps complet s’ils le souhaitent. Il importe donc que le droit aux 150 heures de formation soit acquis aussi à ces salariés.
Je suis très étonné d’entendre nos collègues de l’opposition proposer de relever à 300 ou à 500 heures le crédit de formation. Ces propositions sont en effet un casus belli pour les représentants du patronat, car leur financement excède ce que permet le taux de 0,2 % retenu par l’accord – à moins bien sûr que vous n’ayez prévu, chers collègues, des amendements portant ce taux à 0,4 % ou 0,5 % !
M. le rapporteur. Les amendements qui viennent d’être défendus abordent avec des approches différentes la question du nombre d’heures à créditer sur le compte de formation. Je fais partie de ceux qui préconisent de modifier les paramètres sans bouleverser l’ensemble du dispositif, en particulier sans toucher au plafond d’heures, qu’il semble très délicat de relever sans compromettre l’équilibre économique défini par les partenaires sociaux.
Il conviendrait de sortir du système de proratisation des heures inscrites sur le CPF au prorata du temps travaillé, car de nombreuses personnes qui subissent le temps partiel auraient besoin de bénéficier d’un effort de qualification, mais cet argument, si fort soit-il, n’a pas été retenu par les partenaires sociaux. En outre, accorder vingt heures par an à tous les salariés, à temps partiel ou à temps complet, poserait un problème au regard du principe d’égalité.
Enfin, malgré les compensations prévues pour les salariés, cela contribuerait à déresponsabiliser les employeurs qui abuseraient du temps partiel et des contrats à durée déterminée sans assurer la formation de leurs salariés. Une telle logique pourrait même conduire à un mécanisme pervers selon lequel ces employeurs réduiraient encore le temps partiel de leurs salariés pour les inciter à se former durant les heures ainsi libérées.
En conclusion, la réflexion sur la proratisation ne me semble pas encore mûre et nous devrions nous efforcer de trouver une solution lors de l’examen du texte en séance publique. Pour le reste, je m’en remets à votre sagesse tout en restant attaché à la proposition de simplification que j’ai présentée.
Mme Martine Carrillon-Couvreur. Nous avions proposé un amendement similaire à celui que vient de défendre Mme Ségolène Neuville en pensant aux personnes handicapées, qui subissent le temps partiel plus souvent que les autres salariés. Il importe en effet de tenir compte des difficultés que rencontrent ces publics.
M. Gérard Cherpion. Le débat est très ouvert et tous les groupes s’efforcent d’apporter des réponses aux interrogations qui ne manquent pas de se poser – et qui auraient peut-être été moins nombreuses si nous avions eu plus de temps pour travailler sur ce texte avant son examen en commission.
Alors que certains partenaires sociaux souhaitaient que le crédit de formation puisse atteindre 200 heures, le passage opéré par le texte de 120 heures en six ans à 150 heures en neuf ans ne marque pas une très grande avancée – et cela d’autant moins que 150 heures sont loin de suffire pour acquérir une formation qualifiante.
Monsieur le rapporteur, l’idée que l’employeur pourrait pousser un salarié à accepter de réduire son salaire de moitié pour suivre quelques heures de formation ne résiste pas à l’examen. Toutes les entreprises ne se comportent pas comme des voyous.
Mme la présidente Catherine Lemorton. À ce qu’il me semble, le rapporteur nous a simplement invités à la vigilance.
M. Denys Robiliard. Les amendements soulèvent trois questions.
Pour ce qui concerne tout d’abord le rythme d’acquisition des heures de formation, Mme Fraysse propose que ces droits puissent être acquis en six ans au lieu de neuf tandis que le rapporteur ramène ce délai, en fait, à huit ans – et non à sept ans et demi, car les heures acquises seront comptabilisées au 1er janvier de l’année suivante.
Le débat n’est pas encore mûr et des échanges doivent encore avoir lieu avec les partenaires sociaux. La question devra donc être à nouveau abordée lors de l’examen du texte dans l’hémicycle. Il faut par ailleurs travailler sur l’approche la plus compatible avec les modes de financement arrêtés par les partenaires sociaux. De ce point de vue, l’amendement du rapporteur me semble plus prudent que celui de Mme Fraysse, car la montée en puissance, même accélérée, serait moins rapide. En outre, le ratio d’une heure de formation par mois de travail, proposé par le rapporteur, a le mérite d’être clair et pédagogique, ce qui est important dans un dispositif complexe.
En second lieu, s’il arrive que le temps partiel soit subi, notamment par les femmes, il arrive aussi qu’il ne le soit pas et il faut en tenir compte. Le temps partiel peut aussi avoir des durées différentes : celles-ci généreront-elles les mêmes droits ? Enfin, l’adoption de l’amendement de Mme Neuville donnerait un avantage comparatif aux salariés travaillant à temps partiel par rapport à ceux qui travaillent à temps plein.
Quant au plafond, la loyauté envers les partenaires sociaux n’implique pas que l’on reprenne toutes leurs propositions, mais le dispositif de financement qu’ils ont arrêté exclut de porter le plafond à 500 heures : ce ne serait pas la transposition de l’accord, mais sa dénaturation.
Mme Jacqueline Fraysse. Mon amendement AS54 propose une nouvelle rédaction des alinéas 42 et 43 et, ce faisant, supprime la discrimination à l’égard du temps partiel. Je partage donc le souci de créer les conditions permettant aux personnes travaillant à temps partiel de bénéficier des mêmes droits que celles qui travaillent à temps complet. Aussi fondées que soient les interrogations soulevées notamment par M. Robiliard, cette disposition bénéficierait à des personnes qui en ont réellement besoin, comme les femmes ou les personnes handicapées.
Je voterai l’amendement AS505 du rapporteur, qui représente un pas en avant, mais il reste une marge de progression – nous sommes loin, en effet, d’une révolution.
M. Francis Vercamer. Monsieur le rapporteur, notre amendement tendant à supprimer le plafond suit l’argumentation développée la semaine dernière par le ministre, qui déclarait : « Quant aux salariés, ils sauront qu’ils ont désormais droit à 150 heures de formation. Cette durée, que certains jugent insuffisante, est supérieure aux 120 heures offertes dans le cadre du droit individuel à la formation – qui a d’ailleurs été un échec – et ce d’autant plus qu’il s’agira d’un plancher, et non plus d’un plafond ».
M. Lionel Tardy. Dans le système actuel, six années ouvrant droit à vingt heures de formation sont suivies de trois années ouvrant droit à dix heures. Si j’ai bien compris l’amendement du rapporteur, il propose de passer à un système où cinq années ouvrant droit à 24 heures seraient suivies de deux années ouvrant droit à 12 heures et d’une année ouvrant droit à six heures, pour parvenir au total de 150 heures. Est-ce bien cela ?
M. Jean-Noël Carpentier. Monsieur Vercamer, comment financez-vous concrètement vos propositions ?
M. Francis Vercamer. Nous avons déposé plus loin des amendements à cet effet.
M. le rapporteur. Monsieur Tardy, le décompte des heures sur le CPF recommencera lorsque le salarié concerné aura atteint le plafond et utilisé ses droits.
Si le ministre a parlé de plancher, c’est que pourront s’ajouter aux 150 heures des heures que j’appellerai « supplémentaires », issues d’une pénalité imposée à l’entreprise ou du compte pénibilité. Peut-être même peut-on imaginer que dans quelques années, madame Carrillon-Couvreur, lorsque ce dispositif sera bien établi, des bonus soient attribués à certains publics particulièrement en difficulté en termes de formation. Je recommande cependant de ne pas introduire dès maintenant de telles mesures.
À cela s’ajouteront les heures « complémentaires », issues d’abondements par d’autres intervenants.
Je souligne enfin que, si certains accords de branche ou d’entreprise arrêtent des dispositions plus généreuses, comme le permet du reste le projet de loi, ces dispositions sont financées par lesdits accords, ce qui n’est pas le cas du relèvement du plafond proposé par l’amendement AS162.
Je suis donc défavorable à tous les amendements autres que mon amendement AS505. Quant à la question de la proratisation, je recommande de renvoyer cette discussion à l’examen du texte en séance publique. Un dispositif de cette nature serait du reste très difficile à mettre en œuvre et peut-être vaudrait-il mieux, à terme, envisager un dispositif de rattrapage au moyen d’heures supplémentaires.
Mme Ségolène Neuville. Les salariés à temps partiel ne constituent pas un public particulier : il s’agit de M. ou Mme Toutlemonde. À qui ces salariés – hormis les personnes porteuses d’un handicap ou demandeuses d’emploi – iraient-ils demander un abondement ?
Je suis disposée à retirer mon amendement AS202, sous réserve que vous m’assuriez, monsieur le rapporteur, que nous en discuterons à nouveau avant l’examen du texte dans l’Hémicycle.
M. Christophe Cavard. Nous convenons tous qu’il faut tenir compte de la situation des salariés à temps partiel et opérer une avancée en leur faveur en matière de formation professionnelle. Je suis prêt moi aussi à retirer mon amendement AS228, mais je souhaite que nous trouvions des solutions concrètes sur ce point.
Puisque je viens d’évoquer la loi relative à la sécurisation de l’emploi, permettez-moi de relever qu’un décalage de date entre celle-ci et le texte que nous examinons a failli nous échapper, justement à propos de la disposition interdisant les temps partiels de moins de 24 heures !
Mme la présidente Catherine Lemorton. Sans doute peut-on faire confiance au Gouvernement. Voilà quelques jours, en effet, en réponse à la demande de révision des modalités de calcul des indemnités journalières pour les petits temps partiels formulée par le Parlement lors de l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2014, le Premier ministre a annoncé l’abaissement à 150 heures par trimestre du minimum ouvrant droit à ces indemnités.
Les amendements AS202 de Mme Ségolène Neuville et AS228 de M. Christophe Cavard sont retirés.
Mme Jacqueline Fraysse. Je maintiens, quant à moi, mon amendement AS54.
La Commission rejette l’amendement AS54 de Mme Jacqueline Fraysse, puis elle adopte l’amendement AS505 du rapporteur. Elle rejette ensuite successivement les amendements AS162 de M. Hervé Morin et AS14 de M. Gérard Cherpion.
Elle est alors saisie de l’amendement AS229 de M. Christophe Cavard.
M. Christophe Cavard. Cet amendement vise à ce que les personnes peu diplômées, c’est-à-dire ne disposant pas d’un diplôme de niveau IV, voient leur compte alimenté à hauteur de 30 heures par année jusqu’à l’acquisition d’un crédit de 180 heures. Les auditions auxquelles nous avons procédé m’ont confirmé que, compte tenu du faible nombre de personnes concernées, cette mesure pourrait être financée à moyens constants, sans qu’il soit nécessaire de relever le taux actuel de 0,2 %.
M. Arnaud Richard. Une telle modulation mérite d’être étudiée de près.
Mme Monique Iborra. Je suis favorable à cet amendement, qui a le mérite de cibler particulièrement certains publics, même s’il ne correspond pas à l’économie générale du texte où tout le monde est logé à la même enseigne au nom de l’universalité du droit à la formation. Il importe en effet de souligner que l’un des objectifs de la loi est la réduction des inégalités.
M. Denys Robiliard. Cet amendement est très intéressant, mais sommes-nous en mesure de le mettre en œuvre ? Comment la Caisse des dépôts déterminera-t-elle le niveau de qualification de chacun des salariés dont elle aura le numéro ? C’est là un processus très lourd.
Peut-être vaudrait-il donc mieux retirer cet amendement pour expertiser la mesure avant l’examen du texte en séance publique. Au demeurant, si elle semble aller dans le sens de ce que souhaitent les partenaires sociaux, il serait plus prudent de leur poser la question.
M. Christophe Cavard. Je propose plutôt que cet amendement soit adopté et qu’il soit, le cas échéant, modifié en séance publique conformément aux suggestions de M. Robiliard.
M. Gérard Cherpion. Il y a une ambiguïté : la disposition touche à la fois au compte personnel de formation et au régime général. Or le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels a un rôle à jouer dans l’alimentation du compte, dans la mesure où il sera conduit à mobiliser des sommes relativement importantes en faveur de la qualification des personnes concernées. Ne rendons pas plus complexe un régime qui l’est déjà bien trop !
M. le rapporteur. L’amendement repose sur une bonne idée, mais il est prématuré : il faut d’abord stabiliser le compte « socle » avant de développer un régime complémentaire. Si on l’adoptait, lors de l’examen en séance publique, chacun serait amené à faire valoir des cas particuliers.
En outre, le public visé relève de la compétence des régions, qu’il ne faut pas déresponsabiliser. Celles-ci sont d’ailleurs d’accord en la matière. Cela n’empêche pas de prévoir par la suite des bonifications pour certains publics, mais ne retombons pas dans le travers des précédentes lois relatives à la formation professionnelle, consistant à cloisonner les publics visés.
Je vous invite donc à retirer l’amendement, monsieur Cavard.
M. Christophe Cavard. Cet amendement a été soumis aux partenaires sociaux, qui n’y voient pas d’objection. Nous avons par ailleurs rencontré un certain nombre de responsables régionaux, en particulier de l’Association des régions de France (ARF), qui s’inquiètent que l’on ait tendance à tout renvoyer aux régions, compte tenu de leurs contraintes financières.
Sur le fond, cet amendement a donc tout son sens, ce qui n’empêche pas d’avoir un débat sur ce point avec le Gouvernement.
La Commission rejette l’amendement AS229.
Puis elle examine l’amendement AS506 de précision du rapporteur.
M. le rapporteur. Le congé de paternité est devenu un « congé de paternité et d’accueil de l’enfant ».
Mme Véronique Louwagie. Ne faudrait-il pas remplacer « et » par « ou » ?
M. le rapporteur. Non, je ne fais que reprendre l’appellation officielle.
La Commission adopte l’amendement.
Puis elle examine en présentation commune les amendements AS274 de M. Lionel Tardy, AS55 de Mme Jacqueline Fraysse, AS507 du rapporteur et AS203 de Mme Ségolène Neuville.
M. Lionel Tardy. On crée une sanction implicite pour le chef d’entreprise qui n’aurait pas répondu à des obligations relativement vagues. Je propose donc de supprimer les alinéas 45 à 47.
Mme Jacqueline Fraysse. Le texte prévoit que, dans les entreprises de 50 salariés et plus, en cas de manquement de l’employeur à l’obligation d’entretien professionnel ou de bilan du parcours professionnel, 100 heures soient inscrites au CPF du salarié. Or nous estimons que celles-ci ne doivent pas être seulement inscrites, mais abondées, ce qui implique qu’elles s’ajouteraient au plafond de 150 heures. Dans le cas contraire, le dispositif serait inopérant : ainsi, pour un salarié en place depuis six ans au sein d’une entreprise, ayant déjà acquis 120 heures, la pénalité de 100 heures le conduirait à disposer de 220 heures, mais comme il n’aurait droit qu’à 150, l’effet de cette pénalité serait quasiment neutralisé.
M. le rapporteur. Mon amendement répond précisément à votre préoccupation, madame Fraysse. Je vous rassure : les 100 heures de pénalité s’ajoutent au plafond de 150 heures. C’est la raison pour laquelle je propose de distinguer des heures complémentaires les heures supplémentaires, venant au-delà du plafond, inscrites sur le compte – mais non abondées – et qui bénéficieront d’un statut d’opposabilité.
Avis défavorable sur l’amendement AS274.
Mme Ségolène Neuville. L’amendement AS203 tend à compléter l’alinéa 47, aux termes duquel l’entreprise qui n’aura pas effectué le versement prévu à l’organisme paritaire devra verser au Trésor public un montant équivalent majoré de 100 %. Or, pour un employeur, le fait d’empêcher un travailleur à temps partiel de se former est encore plus grave que de faire obstacle à la formation d’un travailleur à temps complet, dans la mesure où e premier a une formation plus réduite. Je souhaite donc aggraver la sanction en portant dans ce cas la majoration à 150 %.
M. le rapporteur. Je ne vois pas comment ce dispositif de sanction se rajoutant à une sanction pourrait être praticable.
Mme Isabelle Le Callennec. Je ne peux m’empêcher de faire le lien avec l’amendement du rapporteur posant que le refus par le titulaire du compte de mobiliser celui-ci ne constitue pas une faute. Dans l’hypothèse où ce titulaire n’aurait pas fait valoir les heures de formation auxquelles il a droit, son entreprise sera-t-elle pénalisée ?
M. le rapporteur. Je rappelle que la majoration est soumise à trois conditions, qui s’ajoutent à celle de l’absence de toute action de formation. D’autre part, tout ne passe pas par le compte personnel de formation : les entreprises continueront à avoir aussi un plan de formation. Et si l’employeur a intérêt à faire en sorte que le salarié mobilise son compte, toutes les mesures ont été prises pour qu’il ne puisse faire pression sur celui-ci.
Les amendements AS55 et AS203 sont retirés.
Puis la Commission rejette l’amendement AS274 et adopte l’amendement AS507.
Elle en vient ensuite à l’amendement AS13 de M. Gérard Cherpion.
M. Gérard Cherpion. Il s’agit de permettre aux accords de groupe de déterminer les modalités d’abondement du compte personnel de formation et de prise en charge des frais de formation par l’employeur. En effet, dans un groupe, il peut y avoir de petites entités pour lesquelles il est difficile de mener une véritable négociation seules.
M. le rapporteur. Je m’en remets à la sagesse de la Commission.
La Commission adopte l’amendement.
Puis elle examine l’amendement AS114 de M. Francis Vercamer.
M. Francis Vercamer. Cet amendement tend à réintégrer dans le texte le « hors champ », que l’accord national interprofessionnel a laissé à l’écart. Les organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA) de branche ou interbranche pourraient ainsi abonder le CPF, de manière à mieux prendre en compte les besoins de formation qui peuvent exister au sein de certaines branches professionnelles spécifiques – économie sociale et solidaire, professions libérales ou agricoles – et à encourager la mobilité des salariés relevant de branches différentes mais qui auront pu fixer des objectifs de formation similaires.
M. le rapporteur. Avis plutôt défavorable. Je propose de renvoyer ce point à l’examen en séance publique, une fois qu’on aura réglé la question du « hors champ », que le ministre s’est engagé à traiter. Je suis, en tout cas, favorable à la reconnaissance de ces secteurs.
M. Denys Robiliard. Nous avons intérêt en effet à régler le point soulevé par cet amendement après que nous aurons adopté un principe sur le « hors champ ». Mais je ne suis pas persuadé que ce soit techniquement nécessaire : je ne vois pas, de fait, ce qui interdit à plusieurs branches de se mettre d’accord sur des politiques de formations communes.
M. Christophe Cavard. Je suis enclin à soutenir cet amendement. L’alinéa 48 est clair : il donne la responsabilité à un certain nombre de partenaires du champ interprofessionnel de venir abonder le CPF. Mais se pose le problème de savoir si certains secteurs relevant du « hors champ » sont reconnus en tant que tels. Le fait de les intégrer dans le dispositif n’empêche pas de revoir ensuite globalement la question du « hors champ » en séance publique, avec le Gouvernement.
M. Francis Vercamer. J’en suis d’accord. Le Parlement doit en attendant jouer son rôle.
M. Denys Robiliard. J’admets que nous n’avons pas à attendre l’avis du ministre mais je ne vois pas ce qui interdit aux OPCA du « hors champ » d’intervenir dans l’abondement du compte personnel. Les accords de branche peuvent suffire sans qu’il soit nécessaire d’introduire une référence à la « multiprofessionnalité ».
M. le rapporteur. Ce point nécessite une expertise. Il est préférable, encore une fois, d’avoir préalablement défini un principe pour le « hors champ », sachant en effet que l’abondement par les OPCA est déjà possible.
M. Gérard Cherpion. Il faut absolument qu’on fasse référence au « hors champ » à cet endroit du texte, car même si on trouve ensuite une solution sur ce point, on ne pourra revenir en arrière pour compléter l’article 1er ; nous voterons donc en faveur de l’amendement.
M. le rapporteur. C’est inutile : lorsque ce point sera réglé, nous proposerons des amendements de coordination.
La Commission rejette l’amendement.
Elle en vient à l’amendement AS231 de M. Christophe Cavard.
M. Christophe Cavard. Il s’agit de faire bénéficier les titulaires d’un contrat précaire venant à échéance, notamment d’un contrat à durée déterminée (CDD), d’une prime à la précarité, incluant un abondement du CPF.
M. le rapporteur. L’idée est séduisante, mais le lien que vous établissez entre abondement du CPF et qualité du contrat de travail nécessite de consulter les partenaires sociaux ; il s’agit d’une forme de taxation du CDD ! Je vous demande donc, en attendant, de retirer l’amendement.
M. Christophe Cavard. Cette mesure est conforme à la logique défendue par les partenaires sociaux, mais il appartient aussi au Parlement d’accélérer parfois la mise en place de certains dispositifs. Je vous propose donc d’adopter cet amendement et de nous assurer ensuite de l’accord des partenaires sociaux, d’ici à l’examen en séance publique.
M. Arnaud Richard. Je suis tout à fait d’accord. Tout à l’heure, le rapporteur a bien fait des propositions dans l’esprit de l’ANI. Cet amendement ne déroge pas à l’esprit du dialogue social et c’est tout à notre honneur d’apporter ce type d’amélioration. L’ANI ne doit pas être pour nous l’alpha et l’oméga !
Mme la présidente Catherine Lemorton. Ce n’est pas ce que j’avais cru comprendre des propos de M. Vercamer !
La Commission rejette l’amendement.
Elle examine ensuite l’amendement AS230 de M. Christophe Cavard.
M. Christophe Cavard. Il s’agit de renvoyer aux accords de branche la faculté de relever le plafond de 150 heures.
M. le rapporteur. Cela est déjà prévu à l’alinéa 48.
M. Christophe Cavard. Hélas non ! Je propose un relèvement du plafond, non un simple abondement. À moins que vous ne me garantissiez que le texte permet à un accord de branche de modifier ce plafond à la hausse…
M. le rapporteur. Cela me paraît évident.
Mme Jacqueline Fraysse. Le doute demeure ; pour être sûr, il serait préférable d’adopter l’amendement.
M. Gérard Cherpion. Soit cet amendement tend à relever le plafond, et dans ce cas il tombe car nous avons écarté cette possibilité tout à l’heure ; soit ce n’est pas le cas, et il est satisfait. Il n’y a donc pas lieu de l’adopter.
M. Denys Robiliard. La mesure proposée par l’amendement n’est pas praticable car le plafond est prévu dans le régime interprofessionnel et universel alors que l’accord dont il est question se situe au niveau de la branche. L’abondement ne sera donc pas universellement opposable en cas de changement de branche. Si vous restez dans la branche, vous aurez droit aux 150 heures, plus ce qui a été prévu par l’accord de branche, mais si vous la quittez, ce ne sera pas possible.
M. le rapporteur. Il va de soi qu’un accord de branche peut porter à plus de 150 le nombre d’heures de formation auxquelles un salarié a droit. C’est pourquoi l’amendement ne me semble pas utile.
La Commission rejette l’amendement.
Elle examine ensuite l’amendement AS163 de M. Hervé Morin.
M. Francis Vercamer. L’accès à la formation est fortement inégal selon que l’on est qualifié ou qu’on l’est moins ; pourtant, le niveau de qualification est un facteur important de l’employabilité. Le compte personnel de formation, dispositif uniforme, ne tient pas compte du niveau de formation initiale, alors qu’il faut augmenter les ressources pour les individus les moins employables. Pour remédier à cette situation, nous proposons un système simple et efficace d’abondement inversement proportionnel au niveau de formation initiale.
M. le rapporteur. Je comprends l’esprit qui inspire cette proposition et j’avais moi-même évoqué l’hypothèse d’un mécanisme de cette sorte, mais personne, à ce jour, n’est parvenu à l’inventer.
M. Francis Vercamer. Eh bien, voilà qui est fait !
M. le rapporteur. L’idée est excellente mais elle n’a pas sa place dans la loi car nul ne sait véritablement comment la mettre en œuvre ; et s’il s’agit de suggérer aux branches professionnelles de procéder à des expérimentations en ce sens, la loi le permet. Avis, pour cette raison, défavorable.
La Commission rejette l’amendement.
Elle examine ensuite en présentation commune les amendements AS15 et AS16 de M. Gérard Cherpion, AS115 de M. Francis Vercamer, AS508 du rapporteur, AS56 de Mme Jacqueline Fraysse, AS233 de M. Denis Baupin, AS234 et AS235 de M. Christophe Cavard et AS492 et AS494 du rapporteur.
M. Bernard Perrut. Le nouvel article L. 6323-15 définit les listes des formations éligibles au compte personnel de formation. Les salariés pourront accéder aux formations figurant sur une liste établie soit par la commission paritaire nationale de l’emploi de la branche, soit par le comité paritaire national de la formation professionnelle et de l’emploi (CPNFPE), soit par le comité paritaire régional (CPRFPE). L’existence de trois listes fait s’interroger sur la légitimité des acteurs et nuit à l’intelligibilité du dispositif pour le salarié. De plus, il est contradictoire de proposer un compte personnel de formation dont les droits sont mobilisables à la demande expresse du salarié et selon ses priorités tout en restreignant le choix de la formation. Il est donc proposé, par l’amendement AS15, de supprimer ces trois listes, et de retenir pour critères d’éligibilité des formations celles que définit l’article L. 6323-6 du code du travail : les formations sanctionnées par une certification enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles ou à l’inventaire, les formations sanctionnées par un certificat de qualification professionnelle et celles qui visent à acquérir un socle de connaissances et de compétences défini par décret.
M. Gérard Cherpion. L’amendement AS16 est un amendement de repli : il convient au moins d’élaborer une liste unique, révisée chaque année, qui peut être le fruit d’une concertation entre les branches, l’État et la région, sous l’égide du futur Conseil national pour l’emploi, la formation et l’orientation professionnelles.
M. Francis Vercamer. L’amendement AS115 a trait au « hors champ ». Il est défendu.
M. le rapporteur. L’amendement AS508 rectifie une erreur de dénomination.
Mme Jacqueline Fraysse. L’amendement AS56 tend à compléter le texte en disposant qu’une liste complémentaire de formations éligibles au compte personnel de formation pourra aussi découler d’un accord d’entreprise. Entreprises et salariés ne s’en trouveront que mieux.
M. Denis Baupin. Je suis venu défendre devant votre Commission plusieurs amendements, dont l’amendement AS233. Tous visent à appeler l’attention sur l’impérieuse nécessité de préparer la transition énergétique par une formation professionnelle efficace. De nombreux métiers vont changer et devenir plus complexes, singulièrement ceux du secteur du bâtiment et de la gestion des flux énergétiques. Cet amendement, comme ceux qui suivront, tend donc à rendre éligibles au compte personnel de formation les formations qui concourent à l’acquisition de compétences dans ces domaines.
M. Christophe Cavard. Par l’amendement AS234, nous proposons de préciser expressément que les formations inscrites au répertoire national des certifications professionnelles sont éligibles au compte personnel de formation. Par l’amendement AS235, nous proposons d’inclure au nombre des mêmes formations éligibles celles qui sont inscrites dans le contrat de plan régional de développement des formations et de l’orientation professionnelles, même si toutes ne débouchent pas sur une certification.
M. le rapporteur. L’amendement AS492 prévoit l’actualisation régulière des listes définissant les formations éligibles au compte personnel de formation ; l’amendement AS494 est rédactionnel.
Nous abordons là une question compliquée dont la solution demeure manifestement inaboutie – la créativité dont chacun a fait preuve en témoigne – : que pouvons-nous changer à la « liste de listes » élaborée par les partenaires sociaux ?
Je pense comme vous, monsieur Baupin, qu’il est nécessaire de préparer la transition énergétique, mais il n’est pas concevable de préciser le projet de loi comme vous proposez de le faire : si l’on ouvrait cette porte, chaque secteur professionnel songerait légitimement à s’y engouffrer. Le texte n’exclut pas que les listes de formation éligibles composées par le secteur du bâtiment comprennent les formations aux métiers de la transition énergétique, mais nous ne saurions alourdir le dispositif en le complétant par des listes par filières. Je ne peux donc me rallier à cet amendement. Cela ne signifie nullement que je mésestime l’enjeu majeur que représente la formation professionnelle pour la transition énergétique, filière cruciale pour l’emploi.
M. Bernard Perrut propose pour sa part de supprimer toutes les listes et de revenir au « vivier » des formations. Cette approche simplificatrice est séduisante, et je suis allé dans le même sens en réécrivant l’alinéa relatif à cette matrice. M. Cherpion propose, lui, d’établir une liste nationale unique ; mais comment ignorer l’échelon régional ? L’enjeu du dispositif est de conjuguer l’approche par branche et l’approche territoriale, au sein du Conseil national mais aussi au sein du Conseil régional pour l’emploi, la formation et l’orientation professionnelles.
M. Vercamer a raison, il faut inclure le « hors champ » – les organismes paritaires collecteurs agréés de branche ou interbranche – dans le dispositif, mais on voit mal comment s’y prendre en l’état.
Vous proposez, madame Fraysse, l’établissement, dans les entreprises, de listes de formations éligibles au compte personnel de formation. Si c’est par le biais d’un accord d’entreprise, la proposition est satisfaite. S’il n’y a pas d’accord d’entreprise, la liste sera la copie conforme du plan de formation d’entreprise ; ce n’est pas souhaitable, et cela me semble aller à l’encontre de l’objectif que vous visez.
Nous nous heurtons donc à une difficulté de taille, ce qui laisse penser que le sujet doit être totalement retravaillé avant l’examen du texte en séance publique. Soit en effet, tout en le considérant comme une usine à gaz, on maintient le dispositif parce qu’il résulte d’un accord entre les partenaires sociaux, soit on trouve collectivement le moyen de l’améliorer – ce à quoi nous ne sommes pas parvenus. Il va sans dire que plus simple serait le mécanisme, mieux ce serait. Mais l’enjeu, pour les partenaires sociaux, était d’être en mesure à la fois de réguler le système et de définir une stratégie de formation. Pour ma part, je serais favorable au retour à la matrice, avec des listes nationales et, impérativement, des listes régionales.
M. Denis Baupin. Je vous remercie, monsieur le rapporteur, d’avoir souligné l’importance de formations destinées à assurer la transition énergétique. Je retire l’amendement AS233.
L’amendement AS233 est retiré.
Mme Monique Iborra. Je ne comprends pas que M. Cherpion propose la constitution de listes uniquement nationales. C’est ce que l’on a fait la dernière fois que l’on a légiféré en matière de formation professionnelle, et chacun a pu constater la complète inefficacité de cette approche. Le mot « emploi » n’a pas été prononcé une seule fois ce matin, mais c’est bien de formation pour l’emploi dont nous parlons, et comment comparer le bassin d’emploi des Pyrénées et celui du Pas-de-Calais ? On fait état de postes libres qui ne trouvent pas preneurs faute de salariés suffisamment qualifiés ; il va sans dire que pour remédier efficacement à cette situation, il faut être au plus près du terrain. Que l’on établisse des listes nationales de formations éligibles au compte personnel de formation, soit, mais prétendre ne pas les croiser avec des listes régionales me paraît aussi éthéré que de débattre du sexe des anges.
M. Gérard Cherpion. Je vois une contradiction dans le texte, qui dote expressément le salarié et le demandeur d’emploi d’un droit à une formation qualifiante mais qui, lorsque ceux-ci veulent l’exercer, restreint leur choix. La déclinaison régionale est importante, mais elle suppose une liste nationale. On voit bien que le dispositif présenté, trop compliqué, ne convient à personne : chacun y va de son amendement de simplification, tout en appelant l’attention sur la situation de certains salariés oubliés !
M. le rapporteur. Tout cela est compliqué, c’est vrai. J’invite au retrait de tous les amendements – sauf les miens, évidemment… – sur lesquels j’émettrai, sinon, un avis défavorable, mais nous devons poursuivre notre réflexion. Je souscris à la proposition de simplification de M. Cherpion, qui devra être retravaillée avec les partenaires sociaux et le Gouvernement.
M. Lionel Tardy. Une mesure radicale consisterait à adopter l’amendement AS15 de M. Cherpion : il n’y aurait alors plus de listes du tout, ce qui contraindrait à retravailler la question à vive allure !
M. Denys Robiliard. Le dispositif ne convient à personne… si ce n’est aux partenaires sociaux ! Parce qu’il fallait articuler le droit à la formation, les besoins de formation des entreprises et les exigences de la décentralisation, le mécanisme trouvé n’est probablement pas ce qu’il y a de plus léger, mais comment ignorer l’une de ces trois composantes ? En l’état, il n’y a pas de meilleure solution que celle qui figure dans le projet de loi.
Mme la présidente Catherine Lemorton. M. Robiliard a raison. Pour autant, je ne peux laisser dire que le dispositif ne conviendrait à personne.
La Commission rejette successivement les amendements AS15, AS16 et AS115.
Elle adopte l’amendement AS508.
Mme Jacqueline Fraysse. Je retire l’amendement AS56.
L’amendement AS56 est retiré.
M. Christophe Cavard. Je retire les amendements AS234 et AS235.
Les amendements AS234 et AS235 sont retirés.
La Commission adopte successivement les amendements AS492 et 494.
La Commission adopte l’amendement de précision AS493 de M. le rapporteur.
Puis elle se saisit de l’amendement AS82 de M. Francis Vercamer.
M. Francis Vercamer. Afin de ne pas laisser le salarié qui souhaite utiliser son compte personnel de formation dans l’incertitude, je propose que l’employeur ait l’obligation de lui répondre dans un délai d’un mois – délai que prévoyait d’ailleurs l’accord national interprofessionnel (ANI).
M. Jean-Patrick Gille, rapporteur. Avis défavorable à cause d’une incertitude rédactionnelle – il paraît difficile de remplacer « des délais » par « un délai d’un mois », car plusieurs délais doivent pouvoir être fixés, celui de la réponse de l’employeur, mais aussi celui applicable à la demande du salarié. Quoi qu’il en soit, ce que prévoit l’ANI en la matière sera transposé par décret.
M. Gérard Cherpion. Il faut prévoir pour la réponse de l’employeur un délai précis : pourquoi ne pas le faire ici ?
M. Denys Robiliard. On est ici dans le domaine du règlement.
M. Francis Vercamer. La loi spécifie déjà de très nombreux délais, pour les préavis, par exemple !
M. le rapporteur. Je crois aussi que ce point relève plutôt du règlement.
La Commission rejette l’amendement.
Puis elle examine l’amendement AS503 de M. le rapporteur.
M. le rapporteur. Le salarié n’a pas à recueillir l’accord de l’employeur sur le contenu de la formation suivie dans les cas où l’utilisation du compte personnel de formation sur le temps de travail est opposable à l’employeur. Seules les règles habituelles en matière d’autorisations d’absence sont applicables.
Par ailleurs, l’utilisation du compte pour suivre une formation d’accompagnement à la validation des acquis de l’expérience (VAE) doit avoir le même caractère opposable à l’employeur que son utilisation dans le but d’acquérir le socle de connaissances et de compétences.
La Commission adopte cet amendement.
L’amendement AS61 de Mme Jacqueline Fraysse est retiré.
La Commission se saisit de l’amendement AS57 de Mme Jacqueline Fraysse.
Mme Jacqueline Fraysse. Les formations destinées à surmonter l’illettrisme – car c’est bien de cela qu’il s’agit avec le « socle de connaissances et de compétences » – ne devraient pas relever du compte personnel de formation : en effet, les salariés concernés ne pourraient plus alors utiliser celui-ci pour une formation qualifiante. C’est une double peine.
À cette question déjà posée ce matin, j’ai entendu plusieurs réponses en partie satisfaisantes. Mais la situation demeure injuste : le ministère du travail, mais aussi les régions, voire les employeurs consciencieux, devraient trouver des moyens pour permettre à tous de sortir de l’illettrisme.
M. le rapporteur. Nous avons eu cette discussion ce matin, et je comprends bien votre intention ; mais mon avis reste défavorable. Cet alinéa rend le nouveau droit opposable à l’employeur, et c’est particulièrement important pour des formations destinées à lutter contre l’illettrisme : il serait donc très regrettable de le faire disparaître du texte.
Mme Jacqueline Fraysse. L’argument de l’opposabilité est recevable, mais il n’en reste pas moins que le compte personnel de formation devrait être destiné à des formations qualifiantes. Il faudrait donc réfléchir à une solution autre, par exemple l’obligation pour l’employeur de dégager des heures pour des formations destinées à remédier à l’illettrisme. Prenons l’exemple de l’entreprise Doux : parmi les mille personnes licenciées, 30 % sont illettrées, quand certaines ont trente ans de maison ! Ce n’est pas normal.
M. le rapporteur. Voilà un excellent exemple : la loi devrait faire disparaître ces situations. En effet, après six années sans formation, les salariés disposeront de 250 heures de formation, opposables à l’employeur. J’admets que ce texte n’est pas parfait, mais ici, il améliorera la situation des salariés, qui auront vraiment les moyens d’accéder à une formation.
M. Gérard Cherpion. Selon cet alinéa, l’accord de l’employeur n’est pas nécessaire pour une formation destinée à acquérir le socle de compétences, et cela va dans le sens souhaité par Mme Fraysse. Mais ce n’est pas à l’employeur de financer ces formations !
M. Christophe Cavard. Il ne paraîtrait pas choquant que les employeurs soient mis à contribution pour financer l’acquisition par leurs salariés du socle commun.
La Commission rejette cet amendement.
Puis elle examine l’amendement AS58 de Mme Jacqueline Fraysse.
Mme Jacqueline Fraysse. Cet amendement vise à garantir au salarié en formation le maintien, non seulement de sa rémunération, mais aussi de toutes les garanties attachées à son contrat de travail. Sans doute cela va-t-il de soi, mais il me semble qu’il vaut mieux l’écrire.
M. le rapporteur. Il me semble également que cela va de soi : le projet de loi renvoie à l’article L. 6321-2 du code du travail, qui dispose que « toute action de formation suivie par un salarié pour assurer son adaptation au poste de travail ou liée à l’évolution ou au maintien dans l’emploi dans l’entreprise constitue un temps de travail effectif et donne lieu pendant sa réalisation au maintien par l’entreprise de la rémunération. »
Ces heures étant considérées comme des heures de travail effectif, votre souci est satisfait.
M. Denys Robiliard. Je n’en serais pas si sûr, monsieur le rapporteur. Il faudrait peut-être nous pencher sur la rédaction de cet alinéa d’ici à la séance publique.
M. Gérard Cherpion. On est dans le cadre du contrat de travail, celui-ci est donc respecté.
Mme Jacqueline Fraysse. Vous avez peut-être raison, mais M. Robiliard semble estimer que ce n’est pas une évidence : il ne me semblerait pas inutile de préciser les choses.
M. Francis Vercamer. Pour ma part, je voterai cet amendement : qui peut le plus peut le moins.
M. le rapporteur. Je maintiens mon avis défavorable.
La Commission rejette cet amendement.
Puis elle se saisit de l’amendement AS139 de Mme Fanélie Carrey-Conte.
Mme Fanélie Carrey-Conte. À l’instar d’amendements déjà présentés ce matin, celui-ci vise à relayer les inquiétudes des structures d’insertion par l’activité économique (IAE) : les salariés engagés dans un parcours d’insertion ne devraient pas être exclus des dispositifs de formation destinés aux demandeurs d’emploi.
M. Francis Vercamer. On est à nouveau hors champ : j’espère, monsieur le rapporteur, que vous ne ferez pas de différence entre les amendements du groupe socialiste et ceux du groupe UDI…
M. Denys Robiliard. Ce n’est pas le même problème.
M. le rapporteur. Pour moi, il est clair que les salariés en parcours d’insertion ont droit aux dispositifs de formation ! Mais ils appartiennent à un ensemble très vaste et très flou : il ne me paraîtrait pas habile de les assigner, de façon rigide, à la catégorie des salariés ou à celle des demandeurs d’emploi. Les statuts et les contrats sont très divers.
Mme Fanélie Carrey-Conte. Je retire l’amendement, mais je vous demanderai de clarifier ce point en séance publique.
L’amendement est retiré.
La Commission examine, en présentation commune, les amendements AS17 et AS18 de M. Cherpion, AS141 de Mme Carrey-Conte, AS509 de M. le rapporteur, AS144 et AS146 de Mme Carrey-Conte, AS511 de M. le rapporteur, AS236 de M. Baupin, et enfin AS237 et AS238 de M. Cavard.
M. Gérard Cherpion. Nous retrouvons ici le problème des listes de formations que nous avons abordé ce matin, mais cette fois pour les demandeurs d’emploi. Il faudra retravailler la question.
M. le rapporteur. De même que l’amendement AS492 voté ce matin, l’amendement AS511 prévoit que les listes seront régulièrement actualisées.
M. Christophe Cavard. Je retire l’amendement AS236, qui vise à rendre éligibles les formations dans les filières d’avenir de la transition écologique. En revanche, je maintiendrai les amendements AS237 et AS238, même si nous avons l’intention de les retravailler d’ici à la séance publique.
Les amendements AS17, AS18, AS141, AS509, AS144, AS146 et AS236 sont retirés.
La Commission adopte l’amendement AS511.
Puis, suivant l’avis défavorable du rapporteur, elle rejette les amendements AS237 et AS238.
L’amendement AS147 de Mme Fanélie Carrey-Conte est retiré.
La Commission se saisit alors de l’amendement AS232 de M. Christophe Cavard.
M. Christophe Cavard. Il serait utile de faire bénéficier les personnes licenciées, hormis celles qui l’ont été pour faute grave, d’un abondement de leur compte personnel de formation, au-delà des 150 heures prévues pour tous.
M. le rapporteur. C’est une proposition astucieuse, mais une concertation avec les partenaires sociaux serait nécessaire. De plus, il faudrait prévoir un circuit de financement.
Mieux vaut mettre d’abord en place le compte personnel de formation tel que le prévoit ce projet de loi, quitte à l’améliorer par la suite.
La Commission rejette l’amendement.
Puis, suivant l’avis défavorable du rapporteur, elle rejette successivement les amendements AS263 et AS239 de M. Christophe Cavard.
Elle se saisit ensuite de l’amendement AS510 de M. le rapporteur.
M. le rapporteur. Cet amendement technique vise à assurer le bon fonctionnement du compte personnel de formation en permettant à la Caisse des dépôts et consignations d’avoir accès à tous les fichiers dont elle aura besoin.
La Commission adopte l’amendement.
Elle examine ensuite l’amendement AS161 de M. Hervé Morin.
M. Francis Vercamer. Il s’agit de prévoir un crédit d’impôt pour les salariés qui décideraient d’abonder leur compte personnel de formation.
M. le rapporteur. Sur la forme, un décret ne suffit pas pour fixer les modalités d’une telle disposition. Sur le fond, l’idée n’est pas inintéressante – j’y ai moi-même réfléchi – mais elle est difficile à mettre en œuvre. Du reste, aucun des partenaires sociaux ne nous a demandé une telle incitation fiscale.
L’amendement AS161 est retiré.
Puis la Commission adopte l’article 1er modifié.
La Commission se saisit de l’amendement AS160 de M. Hervé Morin.
M. Francis Vercamer. Ce projet de loi affiche de grandes ambitions. Mais, pour que la formation professionnelle joue le rôle stratégique que vous lui attribuez, il faut qu’elle soit de qualité : il convient de s’en assurer. Cela pourrait être le rôle d’une nouvelle agence de certification, qui agirait en toute indépendance. C’est le choix qu’ont fait certains pays européens, comme le Danemark.
M. le rapporteur. Le CNEFOP évaluera le compte personnel de formation – nous en avons débattu ce matin.
Il est vrai que l’évaluation des formations est absente du projet de loi. Toutefois, la création du compte personnel de formation devrait permettre une amélioration de l’offre, puisque chacun sera plus attentif à la qualité des formations. De plus, à la différence du DIF, les formations éligibles seront qualifiantes. Enfin, l’époque n’est pas à la création de grandes agences publiques indépendantes.
La Commission rejette cet amendement.
Article 2
(art. L. 1222–14, L. 1225–27, L. 1225–46, L. 1225–57, L. 2241–4, L. 2242–15, L. 2323–34, L. 2323–35, L. 2323–36, L. 3142–29, L. 3142–95, L. 6313–13 [nouveau], L. 6313–14 [nouveau], L. 6315–1, L. 6315–2, L. 6321–1, L. 6321–8 et L. 6353–1 du code du travail)
Obligation de l’employeur, entretien professionnel, développement des compétences et des qualifications
L’article 2 vise à faire de la formation professionnelle et des compétences des salariés un élément central du dialogue entre salariés et employeurs au sein des branches professionnelles et des entreprises.
De nouveaux leviers sont ainsi institués tels que l’entretien professionnel, l’information et la consultation des instances représentatives du personnel dans le cadre du plan de formation, et des organisations syndicales de salariés dans le cadre de la négociation relative à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.
I. LA FORMATION PROFESSIONNELLE, UNE NOUVELLE ARTICULATION DES RELATIONS ENTRE EMPLOYEURS ET SALARIÉS
Les nouvelles dispositions substituent l’entretien professionnel au bilan d’étape professionnel prévu par l’article L. 6315-1 du code du travail ainsi qu’à d’autres entretiens prévus par le même code et abrogent l’article L. 6315-2 relatif au passeport orientation et formation.
A. LES DISPOSITIONS ACTUELLES RELATIVES À L’ÉVOLUTION DE LA SITUATION PROFESSIONNELLE DES SALARIÉS
À l’heure actuelle plusieurs dispositifs permettent aux salariés de faire un point sur leur situation professionnelle, la trajectoire qu’ils entendent suivre et leur formation. Ils peuvent être schématiquement répartis en deux sous-ensembles. Le bilan d’étape professionnel d’une part, et l’entretien professionnel d’autre part. Ces deux rendez-vous ne se situent pas dans la même perspective d’évolution professionnelle. Le premier a vocation à permettre une évolution professionnelle hors de l’entreprise tandis que le second s’inscrit dans le cadre de la gestion des carrières et de l’emploi au sein de l’entreprise. Ils peuvent néanmoins prendre appui sur le passeport orientation et formation.
1. Le bilan d’étape professionnel
Institué par la loi du 24 novembre 2009 (11), le bilan d’étape professionnel, prévu par l’article L. 6315-1 du code du travail, bénéficie, à sa demande, au salarié ayant au moins deux ans d’ancienneté dans la même entreprise. Toujours à sa demande, le bilan peut être renouvelé tous les cinq ans.
À partir d’un diagnostic réalisé en commun par le salarié et son employeur, il doit permettre au salarié d’évaluer ses capacités professionnelles et ses compétences et à son employeur de déterminer les objectifs de formation.
L’article L. 6315-1 renvoie à un accord national interprofessionnel (ANI) la détermination des conditions d’application.
Cet ANI devait notamment préciser l’articulation entre le bilan d’étape avec l’entretien professionnel prévu par l’ANI du 5 décembre 2003 et avec les autres entretiens existants dans l’entreprise. À ce jour, aucune négociation n’avait été engagée sur ce sujet.
2. L’entretien professionnel
Depuis l’ANI du 5 décembre 2003, complété par l’avenant du 20 juillet 2005, les entreprises sont dans l’obligation de mettre en place un entretien professionnel, au profit du salarié, « pour lui permettre d’être acteur dans son évolution professionnelle ». Réalisé au minimum tous les 2 ans, pour les salariés ayant au moins deux années d’activité dans l’entreprise, cet entretien ne doit pas être confondu avec les autres entretiens susceptibles d’être mis en place par les entreprises.
Il en est ainsi de l’entretien d’évaluation destiné à déterminer les objectifs des salariés et à évaluer leur comportement professionnel. Ce rendez-vous, qui se tient le plus souvent selon un rythme annuel, porte essentiellement sur le périmètre d’activité du salarié, les résultats attendus de son travail, les compétences possédées, les compétences qui doivent être développées et parfois sur les souhaits ou les possibilités d’évolution ainsi que sur la rémunération. Il ne fait pas l’objet d’une réglementation spécifique.
L’entretien professionnel, quant à lui, permet à l’entreprise de disposer d’une synthèse des actions conduites en matière de gestion des compétences des salariés. À l’initiative du salarié ou de l’employeur, il doit conduire le salarié à élaborer son projet professionnel à partir de ses souhaits d’évolution dans l’entreprise, de ses aptitudes et en fonction de la situation de l’entreprise. Selon l’avenant du 20 juillet 2005, les points suivants doivent, notamment, être abordés :
– les moyens d’accès à l’information sur les dispositifs d’orientation professionnelle et de formation tout au long de la vie ;
– les objectifs de professionnalisation qui pourraient être définis au bénéfice du salarié pour lui permettre d’améliorer ses compétences ou de renforcer sa qualification ;
– le ou les dispositifs de formation auxquels il pourrait être fait appel en fonction des objectifs retenus ;
– les initiatives du salarié pour l’utilisation son droit individuel à la formation ;
– les conditions de réalisation de la formation, notamment au regard du temps de travail et des engagements réciproques qui peuvent en découler.
L’ANI du 5 décembre 2003 a été étendu par un arrêté du 17 décembre 2004 rendant ainsi l’entretien professionnel obligatoire pour tous les employeurs du commerce, de l’industrie, des services et de l’artisanat. Il a été toutefois remplacé par L’ANI du 5 octobre 2009 qui comporte des dispositions identiques sur l’entretien professionnel mais qui n’a pas fait l’objet d’une extension.
D’après l’étude d’impact jointe au présent texte, « seuls 38 % des salariés ont bénéficié d’un entretien professionnel avec leur supérieur hiérarchique. 53% des entreprises de plus de 10 salariés organisent des entretiens professionnels avec tout ou partie de leurs salariés. Mais parmi celles-ci, seules 15% le font pour l’ensemble du personnel ».
3. Le passeport orientation et formation
Avec l’ANI du 5 décembre 2003, les partenaires sociaux étaient convenus d’instituer un document personnel, le passeport formation, pour favoriser la mobilité interne ou externe des salariés. Il avait notamment pour objet d’identifier et de faire certifier, pour chaque individu, ses connaissances, ses compétences et ses aptitudes professionnelles, acquises soit par la formation initiale ou continue, soit du fait de ses expériences professionnelles.
L’ANI du 5 octobre 2009 (12), qui avait vocation à se substituer à celui du 5 décembre 2003 mais qui n’a pas fait l’objet d’une extension, a repris un dispositif similaire s’agissant du passeport formation.
Ces dispositions ont été intégrées dans le code du travail par la loi du 24 novembre 2009, le document s’appelant désormais passeport orientation et formation aux termes de l’article L. 6315-2 du code du travail.
Mis à la disposition de toute personne, le passeport recense, dans le cadre de la formation initiale, les diplômes et titres ainsi que les aptitudes, connaissances et compétences acquises, susceptibles d’aider à l’orientation. Dans le cadre de la formation continue, il recense :
– tout ou partie des informations recueillies à l’occasion d’un entretien professionnel, d’un bilan de compétences ou d’un bilan d’étape professionnel ;
– les actions de formation prescrites par Pôle emploi ;
– les actions de formation mises en œuvre par l’employeur ou relevant de l’initiative individuelle ;
– les expériences professionnelles acquises lors des périodes de stage ou de formation en entreprise ;
– les qualifications obtenues ;
– les habilitations de personnes ;
– le ou les emplois occupés et les activités bénévoles, ainsi que les connaissances, les compétences et les aptitudes professionnelles mises en œuvre dans le cadre de ces emplois et de ces activités.
Le code du travail protège les candidats à l’embauche, l’employeur ne pouvant exiger du salarié, qui répond à une offre d’embauche, qu’il lui présente son passeport orientation et formation. Est également illicite le fait de refuser l’embauche d’un salarié en raison de son refus ou de son impossibilité de présenter ce document.
Les modalités de mise en œuvre de ce passeport orientation et formation devaient, aux termes de l’article L. 6315-2, faire l’objet d’un décret. Celui-ci n’a toutefois jamais été publié en raison de divergences d’appréciation entre le législateur et le Conseil d’État chargé de donner son avis sur ce texte comme l’a notamment souligné le rapport sur la mise en œuvre de la loi du 24 novembre 2009 (13) : « […] d’après les informations fournies par les services du Gouvernement, le projet précité a reçu en avril 2010 un avis négatif de la section sociale du Conseil d’État, qui a considéré que, pour un tel document, il fallait une autorité administrative chargée de l’établir, un encadrement de la liberté de son utilisation et une validation, voire une authentification (par un tiers) des éléments qui y étaient inscrits. Bref, le Conseil d’État a apparemment estimé que la mention du passeport orientation et formation dans la loi en faisait, en quelque sorte, un document administratif dont la fiabilité devrait être assurée et l’usage contrôlé, alors que tel n’est manifestement pas l’objet poursuivi par le législateur, ni par les partenaires sociaux dans l’accord interprofessionnel que la loi retranscrit. La divergence entre l’esprit dans lequel le passeport orientation et formation a été conçu et la mise en œuvre qu’en demande le Conseil d’État rend donc difficile la recherche d’une rédaction réglementaire satisfaisante. »
Sur la base de l’article 1er de l’accord national interprofessionnel du 14 décembre dernier, les alinéas 21 à 42 du présent article tendent à modifier le chapitre V du titre Ier du livre III de la sixième partie du code du travail en proposant notamment une nouvelle rédaction de l’article L. 6315-1 qui refonde l’entretien professionnel.
Afin de mieux apprécier l’évolution des compétences des salariés et de favoriser leur progression, le présent article tend également à renforcer le suivi par l’employeur des compétences et des formations des salariés par la généralisation des entretiens professionnels.
1. La généralisation de l’entretien professionnel
Les salariés sont ainsi informés, au moment de leur embauche, qu’ils bénéficient d’un entretien professionnel tous les deux ans afin d’étudier leurs perspectives d’évolution professionnelle, notamment en termes de qualification et d’emploi. Ce rendez-vous est proposé systématiquement aux salariés ayant eu une longue période d’absence de l’entreprise, notamment à l’issue d’un congé de maternité, d’un congé d’adoption, d’un congé parental d’éducation, d’un congé de soutien familial, d’un congé sabbatique, d’un période de mobilité volontaire sécurisée, d’une période d’activité à temps partiel prise à l’expiration du congé de maternité ou d’adoption, d’un arrêt longue maladie tel que prévu par l’article L. 324-1 du code de la sécurité sociale ou à l’issue d’un mandat syndical.
Pour les salariés bénéficiant d’un congé de maternité, d’adoption, parental d’éducation ou de soutien familial, le droit à l’entretien professionnel se substitue au droit à l’entretien relatif à son orientation professionnelle.
Le texte n’intègre pas des dispositions de l’ANI dont le rapporteur estime qu’elles pourraient être intégrées dans le texte.
L’ANI mentionne ainsi que l’entretien professionnel est distinct de l’entretien d’évaluation. Il semble toutefois utile de formaliser cette distinction dans le projet dans la mesure où l’entretien d’évaluation n’a jamais fait l’objet d’une consécration par la loi ni d’une réglementation spécifique. Une précision pourrait toutefois être apportée afin que l’entretien professionnel, qui s’apparente à un échange sur les potentialités du salarié, ne s’oriente pas vers une évaluation de son travail.
L’accord précise également que l’entretien donne lieu à une formalisation écrite allégée dont le modèle peut être fourni par l’organisme paritaire collecteur agréé (OPCA). À cet effet, l’article 7 de l’ANI du 14 décembre stipule que les branches professionnelles, qui se voient confier un rôle structurant d’accompagnement, devront notamment se doter d’outils appropriés, tels que l’institution d’un observatoire paritaire prospectif des métiers, des qualifications et des compétences. Les branches professionnelles doivent ainsi construire un service de proximité auprès des entreprises, notamment auprès des très petites, petites et moyennes entreprises, pour diffuser les outils de support à l’entretien professionnel. Dans ce contexte, les OPCA ont vocation à diffuser les instruments nécessaires à la réalisation des entretiens.
Estimant que le dispositif de l’entretien professionnel pouvait être amélioré, la commission a adopté plusieurs amendements, à l’initiative de votre rapporteur. Il s’agit des amendements :
– n° AS517 précisant que l’entretien ne doit pas porter sur le travail du salarié afin de le distinguer nettement de l’entretien d’évaluation ;
– n° AS518 précisant que l’entretien professionnel des deux ans doit faire l’objet d’un document écrit ;
– n° AS520 disposant que l’entretien professionnel des six ans s’apprécie au regard de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise, fait l’objet d’un document écrit et consiste en un état des lieux récapitulatif. La notion d’état des lieux rend mieux compte du caractère contradictoire de l’échange, l’adjonction du terme « récapitulatif » tendant à préciser que l’entretien ne porte pas sur la situation à un temps « t » mais bien sur l’ensemble d’une période, notamment pour vérifier si des mesures ont bien été prises par l’employeur ;
– n° AS521 inversant l’ordre de présentation des mesures dont le salarié a pu bénéficier dans les six années précédant l’entretien professionnel ;
– n° AS522 précisant que l’abondement du compte personnel de formation, en cas de non-respect des mesures prévues par le texte concerne les entreprises d’au moins cinquante salariés par cohérence avec d’autres dispositions contenues dans le code du travail.
2. L’articulation de l’entretien et du parcours professionnel
Tous les six ans de présence continue du salarié dans l’entreprise, l’entretien professionnel est l’occasion d’établir bilan de son parcours professionnel dans l’entreprise.
Il permettra de vérifier si le salarié a bénéficié des entretiens professionnels et des trois mesures suivantes : une action de formation, une progression salariale ou professionnelle et l’acquisition des éléments de certifications, par la formation ou par une validation des acquis de l’expérience (VAE). Cette liste constitue les critères minimaux définis à l’article 1 bis de l’ANI du 14 décembre 2013.
Une précision pourrait être apportée selon votre rapporteur. S’agissant de l’objet de ce rendez-vous, le projet de loi mentionne qu’il permettra d’établir un bilan alors que l’ANI évoque un état des lieux récapitulatif. Votre rapporteur propose de revenir à la formulation retenue par l’ANI. La notion d’état des lieux traduit mieux l’idée d’un constat, établi à une date donnée et de manière contradictoire, de la situation de l’évolution professionnelle du salarié.
3. L’abondement du compte personnel de formation en cas d’absence d’action de l’employeur
S’agissant des entreprises d’au moins cinquante salariés, lorsqu’un salarié n’a bénéficié ni des entretiens professionnels ni d’au moins deux des trois mesures précédemment citées, le compte de formation pourra être crédité de cent heures que le salarié pourra utiliser pour couvrir ses besoins en formation.
Ce système d’abondement, en cas d’absence d’action volontariste de formation, de certification, d’évolution salariale ou professionnelle traduit un changement de logique dans le fonctionnement du système de formation.
L’obligation de faire, qui remplace la simple obligation de financer, se traduit par des mesures compensatoires à la charge de l’employeur au bénéfice des salariés lésés. Aux termes de ce texte, les salariés pourront accéder à une action de formation.
4. Le passeport d’orientation, de formation et de compétences adossé au compte personnel de formation
La mise en place du compte personnel de formation s’appuiera sur un traitement automatisé qui pourra intégrer, pour chaque bénéficiaire, un passeport d’orientation, de formation et de compétences, les modalités devant être précisées par un décret en Conseil d’État. Cette possibilité est prévue par l’article L. 6323-8 du code du travail, institué à l’article premier du présent projet de loi. Cet article dispose, en outre, que ce document recensera « les formations et les qualifications suivies dans le cadre de la formation initiale ou continue ainsi que les acquis de l’expérience professionnelle ». Ce nouveau dispositif rendant inopérant l’article L. 6315-2, l’alinéa 45 procède à son abrogation.
II. LA PORTÉE RENOUVELÉE DU PLAN DE FORMATION ET DES ACTIONS DE FORMATION
A. LE PLAN DE FORMATION, UN SUPPORT INSUFFISAMMENT PRIS EN COMPTE DANS LA POLITIQUE DE FORMATION DES ENTREPRISES
L’employeur dispose d’une large autonomie pour définir la politique de formation de l’entreprise et mettre en place, en fonction des projets de développement de l’entreprise, un plan de formation. Le plan de formation regroupe les actions de formation prévues par la politique de gestion du personnel de l’entreprise. Il peut également inclure des mesures propres à établir des bilans de compétences et de validation des acquis de l’expérience.
1. Le contenu du plan de formation
Aux termes de l’article L. 2323-35 du code du travail, ce projet de plan de formation tient notamment compte des orientations de la formation professionnelle dans l’entreprise dont le comité d’entreprise a eu à délibérer, et des grandes orientations à trois ans ainsi que des objectifs du plan de formation arrêtés, le cas échéant, par l’accord issu de la négociation relative à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, prévue à l’article L. 2242-15 du même code.
Le plan de formation comprend deux catégories d’actions de formation :
– les actions d’adaptation du salarié au poste de travail ou liées à l’évolution ou au maintien dans l’emploi dans l’entreprise. Ces mentions sont indispensables au salarié pour remplir correctement les missions et les tâches que son poste impose. Elles permettent au salarié d’évoluer vers d’autres postes ou de lui apporter les connaissances nécessaires au maintien dans son emploi. Un arrêt de la Cour de cassation du 5 juin 2013 a notamment rappelé l’obligation qui pèse sur l’employeur d’assurer l’effectivité du droit à la formation des salariés (14), ces derniers pouvant prétendre à des dommages et intérêts, en cas de licenciement pour motif économique.
– les actions de développement des compétences du salarié. Ces actions permettent au salarié de développer de nouvelles compétences afin d’acquérir une qualification supérieure.
2. Les représentants du personnel sont associés à l’élaboration du plan de formation
L’élaboration du plan de formation est assurée par l’employeur, après consultation des représentants du personnel :
– dans les entreprises d’au moins cinquante salariés dotées d’un comité d’entreprise, l’employeur est tenu de prendre l’avis de celui-ci ;
– dans les entreprises comptant moins de cinquante salariés ou dans celles comptant au moins cinquante salariés mais ne comportant pas de comité d’entreprise, l’employeur consulte les délégués du personnel s’ils existent.
Chaque année, au cours de deux réunions spécifiques, prévues par l’article L. 2323-34 du code du travail et intervenant respectivement avant le 1er octobre et avant le 31 décembre de l’année en cours, le comité d’entreprise émet un avis sur l’exécution du plan de formation du personnel de l’entreprise de l’année précédente et sur le projet de plan pour l’année à venir :
– la première réunion porte sur la présentation et la discussion de documents dont la liste est prévue par l’article D. 2323-5 du code du travail ;
– la seconde réunion est relative au plan de formation, aux conditions de mise en œuvre du droit individuel à la formation et des périodes et des contrats de professionnalisation pour l’année à venir.
3. La portée de la procédure de consultation
Ces consultations sont impératives : elles entrent dans les prérogatives des comités d’entreprise dont la violation peut entraîner des sanctions.
Aux termes des articles L. 6331-12 et L. 6331-31 du code du travail, un versement égal à 50 % du montant de la participation financière à la formation professionnelle est imposé à l’employeur qui n’a pas consulté le comité d’entreprise sur les orientations de la formation ou ne peut justifier que le comité a effectivement délibéré sur le plan de formation. Le conseil d’État a également considéré que cette sanction était fondée à s’appliquer lorsque l’employeur ne peut pas fournir de procès-verbal de carence en l’absence de consultation du comité d’entreprise (15).
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 2328-1 du même code, la non-consultation ou la consultation irrégulière du comité d’entreprise constitue un délit d’entrave puni d’une amende de 3 750 euros et d’un an de prison au plus.
4. Un bilan insatisfaisant
En dépit de ce dispositif complet, il semble que les entreprises ne se soient pas approprié le plan de formation comme un outil de gestion de leurs ressources humaines. Plusieurs raisons sont avancées par l’étude d’impact.
L’institution d’une obligation de contribution au titre du plan de formation, prévue à l’article L. 6331-1 du code du travail, aurait conduit de nombreuses entreprises, et notamment les plus petites d’entre elles, à considérer l’effort de formation à ce titre comme une simple obligation de dépenses.
L’étude d’impact, qui mentionne le bilan d’une analyse récente (16), menée pour le compte du Commissariat général à la stratégie et à la prospective sur le plan de formation, établit que le système a « produit des mécanismes de gestion entrant en contradiction avec les ambitions initiales : calendrier d’élaboration du plan trop complexe, règles administratives de l’imputabilité des dépenses très contraignantes, priorités de branche trop nombreuses et souvent peu lisibles, consultation [des instances représentatives du personnel] sur le plan de formation déconnectée des enjeux de développement de l’entreprise ».
B. LE DISPOSITIF RENOUVELÉ DU PLAN DE FORMATION
L’article 2 consolide le dispositif du plan de formation en améliorant la procédure de consultation qui préside à son élaboration d’une part, et en réaffirmant la place du plan de formation dans l’acquisition des compétences du salarié d’autre part.
Les alinéas 9 à 17 améliorent la procédure de consultation du comité d’entreprise sur le plan de formation conformément à l’article 6 de l’ANI.
La consultation du comité d’entreprise, dans les entreprises d’au moins cinquante salariés portera dorénavant sur l’exécution de l’année en cours. L’article L. 2323-34 du code du travail est ainsi modifié de telle sorte que les réunions portent non seulement sur le bilan du plan de formation de l’exercice précédent et le projet prévu pour l’année suivante mais aussi sur le bilan de l’exercice en cours. L’objet de cette modification vise à permettre l’établissement d’un bilan sur le début de mise en œuvre du plan.
Cette rédaction s’écarte des précisions apportées par l’article 6 de l’ANI qui séquence le calendrier de consultation en réservant à la première réunion le bilan de l’exercice précédent et celui de l’exercice en cours, et en affectant à la seconde réunion, l’analyse du plan de formation prévisionnel pour l’année suivante. Le projet de loi laisse toutefois la possibilité à un accord d’entreprise d’opter pour le calendrier idoine. Ce n’est qu’à défaut qu’un décret prévoira des dates spécifiques, qui reprendra les dispositions de l’ANI.
Le projet de formation est élaboré annuellement mais, pour tenir compte des spécificités de l’entreprise et de son activité, un accord d’entreprise peut prévoir un plan triennal de formation. L’article L. 2323-35 a été modifié en ce sens, ce qui permettra de mettre le plan de formation en cohérence avec le dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, négocié tous les trois ans dans les grandes entreprises, et de se concentrer dans les moyennes entreprises sur les enjeux stratégiques en se dispensant d’avoir à un renouveler cet exercice tous les ans.
Enfin, le dernier alinéa du IV de cet article complète l’article L. 2323-36 qui dispose que la liste des documents transmis au comité d’entreprise, fixée par décret et précisée aujourd’hui par l’article D. 2323-5, à l’occasion des deux réunions distinctes, en précisant que cette liste peut être utilement complétée par un accord d’entreprise ce qui renforce ainsi la place du dialogue social.
Les alinéas 43 et 44 modifient par ailleurs l’article L. 6321-8 du code du travail dont l’objet est de définir les engagements de l’entreprise lorsque le salarié a suivi avec assiduité la formation portant sur le développement de ses compétences.
Les actions de formation ayant pour objet le développement des compétences des salariés peuvent, en application d’un accord entre le salarié et l’employeur, se dérouler hors du temps de travail effectif soit dans la limite de quatre-vingts heures par an et par salarié, soit, pour les salariés dont la durée de travail est fixée par une convention de forfait en jours ou en heures sur l’année, dans la limite de 5 % du forfait.
Les engagements de l’employeur portent sur les conditions dans lesquelles le salarié accède en priorité aux fonctions disponibles correspondant aux connaissances ainsi acquises et sur l’attribution de la classification correspondant à l’emploi occupé ainsi que sur les modalités de prise en compte des efforts accomplis par le salarié.
Aux termes du présent texte, ces engagements auront vocation à s’appliquer aux formations suivies par le salarié et prévues par le plan de formation de l’entreprise. Ces nouvelles dispositions résultent notamment de l’article 3 de l’ANI qui vise à renforcer l’attractivité et la compétitivité des entreprises tout en sécurisant le parcours de ses salariés. Elles encouragent la prise en compte, par l’employeur, des conséquences d’une formation inscrite au plan de formation, en particulier celle faisant appel au compte personnel de formation et qui bénéficie de l’accord de l’employeur.
C. L’EXTENSION DU CHAMP DES ACTIONS DE FORMATION
L’article 2 tend à modifier le champ de la formation professionnelle par l’élargissement tant des publics éligibles que des modalités de délivrance des formations.
Dans la continuité de l’article 2 de l’ANI, les alinéas 46 à 55 modifient l’article L. 6353-1 du code du travail relatif aux actions de formation professionnelle qui peuvent faire l’objet d’une convention établie entre l’employeur et l’organisme de formation. Ces actions sont réalisées conformément à un programme préétabli qui, en fonction d’objectifs déterminés, précise les moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement mis en œuvre ainsi que les moyens permettant de suivre son exécution et d’en apprécier les résultats.
L’article 2 du présent texte élargit les actions de formation aux formations ouvertes et à distance, l’absence de cadre approprié ayant empêché jusqu’alors leur développement.
La formation pourra être ainsi continue ou non et être réalisée en tout ou partie, à distance. Cette formulation reprend celle de l’article 2 de l’ANI, qui dispose qu’en fonction des besoins de la personne ou des contraintes de l’entreprise, la formation peut être continue ou séquencée, présentielle ou à distance, de durée variable et encadrée ou non par un formateur.
Le programme de formation doit, à cet effet, préciser la nature des travaux demandés, le temps estimé pour les réaliser et les modalités de suivi et d’évaluation, les moyens d’organisation, d’accompagnement ou d’assistance, pédagogique et technique à la disposition du stagiaire.
Le texte formule enfin des exigences adaptées, s’agissant des programmes de formation, disposant qu’ils devront désormais préciser les connaissances préalables requises pour suivre la formation.
Votre rapporteur se réjouit de ces évolutions qui témoignent de la volonté de mettre à la disposition des salariés une gamme encadrée et complète de dispositifs pédagogiques.
Votre rapporteur estime toutefois que le caractère « séquentiel » des formations est plus précis que celui de « continu ou non ». En effet, il convient de conserver le caractère structurant de la séquence pédagogique, qui constitue l’unité élémentaire de connaissances ou de savoir-faire de la formation professionnelle. La séquence pédagogique est structurée par le formateur en vue de contribuer à l’atteinte d’un objectif pédagogique. La formation continue est ainsi une succession de ces séances pédagogiques, la formation séquentielle, étant une suite de séances pédagogiques échelonnées dans le temps. La commission a adopté en conséquence l’amendement n°°AS523.
Par ailleurs, les alinéas 18 à 20 tendent à étendre la catégorie des actions de formations. Sont inclues désormais dans cette catégorie :
– aux termes du nouvel article L. 6313-13 du code du travail, les formations destinées à permettre aux bénévoles et aux personnes en service civique du mouvement coopératif, associatif ou mutualiste d’acquérir les connaissances nécessaires à l’exercice de leur responsabilité.
– aux termes du nouvel article L. 6313-14 du même code, les formations destinées aux salariés en arrêt de travail, organisées dans le cadre des articles L. 323-3-1 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale prévoyant notamment l’accord du médecin traitant, le salarié peut désormais prétendre à une prise en charge par les organismes collecteurs paritaires agréés de tout ou partie des coûts pédagogiques, des frais de transport, de repas et d’hébergement découlant de la formation. Cette mesure est destinée à élargir les possibilités de financement des formations aux salariés en arrêt maladie.
La situation des salariés en arrêt de travail
Un salarié en arrêt de travail, que ce soit pour cause d’accident du travail, de maladie professionnelle ou non professionnelle, peut suivre une action de formation professionnelle au cours de son arrêt, tout en continuant de percevoir les indemnités journalières versées par la sécurité sociale.
Pour conserver le bénéfice de ses indemnités journalières, le salarié doit suivre :
- une action de formation professionnelle continue (bilan de compétences, validation des acquis de l’expérience (VAE), actions de promotion professionnelle, actions d’adaptation et de développement des compétences...) ;
- ou, s’il n’est pas en mesure de reprendre son poste de travail, une action d’évaluation, d’accompagnement, d’information et de conseil organisée par la CPAM. Cette formation permet au salarié de construire un projet professionnel et d’envisager un autre métier au sein de l’entreprise qui l’emploie, ou dans une autre entreprise.
Le contrat de travail du salarié en arrêt de travail est suspendu pendant les périodes au cours desquelles il bénéficie d’actions de formation.
III. DE NOUVEAUX DROITS COLLECTIFS RECONNUS DANS LE CADRE DE LA GESTION PRÉVISIONNELLE DES EMPLOIS ET DES COMPÉTENCES (GPEC)
A. LES DISPOSITIONS ACTUELLES RELATIVES À LA GPEC
Bien que présent dans plusieurs articles du code du travail, le dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) ne fait pas l’objet d’une définition législative. Technique de gestion des ressources humaines dans l’entreprise, la GPEC peut se définir comme la conception, la mise en œuvre et le suivi des politiques et de plans d’actions permettant de réduire de façon anticipée les écarts entre les besoins et les ressources humaines d’une part, impliquant les salariés dans leur projet d’évolution professionnelle d’autre part.
1. La GPEC fait l’objet d’une négociation au niveau de l’entreprise et au niveau de la branche professionnelle.
Afin d’inciter à l’anticipation des mutations économiques, le législateur a instauré, dans le cadre de la loi de programmation pour la cohésion sociale (17), notamment pour les entreprises d’au moins 300 salariés, une obligation triennale de négocier sur la GPEC formalisée désormais par l’article L. 2242-15 du code du travail. Cette obligation concerne en effet des entreprises de taille suffisante, son efficacité étant directement liée à l’importance de la population à laquelle elle s’adresse.
Aux termes de l’article L. 2241-4 du même code, les branches professionnelles sont également tenues, tous les trois ans, de négocier sur la GPEC.
2. Le dispositif de négociation
La négociation sur la GPEC comporte la mise en place d’un dispositif de GPEC ainsi que des mesures d’accompagnement susceptibles de lui être associées, notamment en matière de formation, de validation des acquis de l’expérience, de bilan de compétence.
La formation professionnelle occupant une place importante dans le maintien et le développement des compétences professionnelles des salariés, les parties doivent définir les grandes orientations en la matière à horizon trois ans et assigner des objectifs au plan de formation. L’accord GPEC est ainsi censé définir les catégories de salariés et d’emplois auxquels le plan de formation est consacré en priorité, ainsi que les compétences et qualifications à acquérir pour atteindre cet objectif.
La négociation s’articule également avec les consultations annuelles du comité d’entreprise sur les orientations de la formation dans l’entreprise et sur le projet de plan de formation.
Cet accord définit, en outre, les perspectives de recours aux différents contrats de travail (contrat à durée indéterminée ou déterminée, contrat d’insertion ou en alternance), au travail à temps partiel et aux stages.
Enfin, lorsque l’entreprise est concernée par le recours à la sous-traitance, l’accord définit les modalités d’information de ces sous-traitants sur les orientations stratégiques à trois ans susceptibles de les affecter.
3. Les améliorations apportées par la loi relative à la sécurisation de l’emploi
La loi du 14 juin 2013 (18) a intégré, dans les thématiques obligatoires de la négociation relative à la GPEC, les grandes orientations de la formation professionnelle mais également les objectifs du plan de formation (catégories de salariés et d’emplois prioritaires ainsi que définition des compétences et des qualifications à acquérir) et a fait un lien direct entre négociation GPEC et élaboration du plan de formation.
Elle a également introduit de nouveaux thèmes, facultatifs, de négociation :
– aux termes de l’article L. 2242-15 du code du travail, il s’agit des conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l’entreprise ;
– aux termes de l’article L. 2242-16 du code du travail, il s’agit des modalités d’association des sous-traitants au dispositif de GPEC et des conditions de participations de l’entreprise à des actions de GPEC mises en œuvre à l’échelle de son territoire d’implantation.
4. Un bilan mitigé
S’il existe une obligation de réelle de négocier, aucun dispositif n’invite à la conclusion d’un accord. En cas d’échec, un procès-verbal de désaccord doit être dressé par les parties intéressées, ce document mentionnant l’objet de la négociation obligatoire, l’historique de la négociation et le nombre de réunions, les propositions des parties intéressées en leur dernier état et surtout les mesures que l’entreprise compte appliquer unilatéralement.
L’étude d’impact jointe au présent texte souligne que, « sur la période 2005-2011, sur les 5 000 entreprises ayant engagé des négociations, 3 000 ont signé des accords. Toutefois, sur le plan qualitatif, bon nombre d’accords ne sont qu’une réponse formalisée à l’obligation légale de négocier ». Cette situation, est-il expliqué, procède de l’absence de vision des parties prenantes à la négociation sur la stratégie de l’entreprise ou de la branche et sur l’évolution de son environnement. D’autres raisons sont également avancées comme l’insuffisante articulation avec la politique de gestion des ressources humaines, dont la formation professionnelle continue constitue un important volet.
B. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE TEXTE
Les alinéas 1 à 8 du présent article modifient les dispositions relatives à la GPEC pour tenir compte des nouveautés introduites par l’ANI du 14 décembre, notamment l’instauration du compte personnel de formation. Ces modifications concernent tant le processus de négociation au niveau de la branche professionnelle que celui de l’entreprise, confortant ainsi les dispositions prévues par l’article 5 de l’ANI.
1. La négociation de la GPEC au niveau des branches
Le II du présent article insère un alinéa à l’article L. 2241-4 afin de consolider la conduite des négociations au niveau de la branche professionnelle. Prenant acte de la responsabilité essentielle des branches dans l’accompagnement des entreprises et des salariés, l’ANI les enjoints à se doter d’outils de référence. Il en est ainsi de l’observatoire paritaire prospectif des métiers, des qualifications et des compétences (OPMQC), placé sous l’autorité de la commission paritaire nationale pour l’emploi (CPNE) de chaque branche, dont le rôle décisif et les travaux permettront de fournir des éléments objectifs d’appréciation aux partenaires sociaux lorsqu’ils aborderont les négociations. L’article 10 de l’ANI précise ainsi que les OPMQC doivent mener des travaux d’analyse et d’études dans le cadre de la mise en œuvre de la GPEC de la branche, éventuellement déclinée par région.
La commission a adopté un amendement n° AS19, sous-amendé à l’initiative de votre rapporteur, précisant désormais que la GPEC peut se décliner à l’échelle du territoire.
La qualité de la négociation au niveau des branches s’en trouvera ainsi accrue.
2. La négociation de la GPEC au niveau des entreprises
Au niveau de l’entreprise, deux modifications sont apportées par l’article 2.
En premier lieu, c’est le contenu obligatoire de la négociation prévue par l’article L. 2242-15 qui est enrichi. S’agissant du volet relatif à la GPEC, les mesures d’accompagnement devront désormais inclure la question de l’abondement du compte personnel de formation. En outre, s’agissant plus particulièrement de la formation professionnelle, les grandes orientations à trois ans de l’entreprise et les objectifs du plan de formation devront comporter des dispositions relatives aux critères et à l’abondement du compte personnel de formation.
En second lieu, c’est le rôle du comité d’entreprise qui est renforcé en cas d’échec de la négociation de l’accord d’entreprise portant sur la GPEC.
À l’heure actuelle, le comité d’entreprise n’est informé, qu’en amont, de la mise en œuvre d’un dispositif de GPEC. L’article L. 2323-33 du code du travail prévoit l’articulation entre les orientations à trois ans de la formation professionnelle et la consultation annuelle le comité d’entreprise sur les mêmes orientations dans l’entreprise en fonction des perspectives économiques et de l’évolution de l’emploi, des investissements et des technologies dans l’entreprise. Avec l’adoption du présent article, le comité d’entreprise sera désormais consulté sur le contenu de la négociation prévue par l’article L. 2242-15 à l’issue de celle-ci et à défaut d’accord.
*
* *
La Commission examine l’amendement AS19 de M. Gérard Cherpion, faisant l’objet d’un sous-amendement AS516 du rapporteur.
M. Gérard Cherpion. La territorialisation de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences est régulièrement défendue dans le cadre du dialogue avec les partenaires sociaux : l’amendement propose de l’inscrire dans la loi.
M. le rapporteur. Avis favorable, sous réserve du sous-amendement.
M. Gérard Cherpion. Que j’accepte.
La Commission adopte le sous-amendement, puis l’amendement sous-amendé.
L’amendement AS240 de M. Denis Baupin est retiré.
La Commission en vient à l’amendement AS20 de M. Gérard Cherpion.
M. Gérard Cherpion. Si l’avis du comité d’entreprise sur les orientations de la formation professionnelle dans l’entreprise était rendu au cours de la première des deux réunions de consultation sur le plan de formation, cela éviterait une troisième réunion.
M. le rapporteur. Certaines entreprises sont amenées à consulter le comité d’entreprise, au cours d’une même réunion, sur les orientations, la formation professionnelle et le plan de formation. L’amendement n’a donc pas d’objet. Avis défavorable.
La Commission rejette l’amendement.
Puis elle examine l’amendement AS241 de M. Christophe Cavard.
M. Christophe Cavard. Un avis conforme du comité d’entreprise sur l’exécution du plan de formation serait préférable.
M. le rapporteur. Défavorable.
M. Denys Robiliard. L’avis conforme est inutile, puisqu’il s’agit ici, non du contenu du plan de formation, mais de son exécution.
M. Christophe Cavard. Bien que je ne connaisse pas aussi bien le droit du travail que M. Robiliard, il me semble qu’un avis conforme peut être opposable.
Mme Jacqueline Fraysse. Je suis du même avis : on peut être en désaccord sur l’exécution du plan de formation.
M. Denys Robiliard. Avis conforme, cela signifie qu’on ne peut passer outre. Quel sens cela aurait-il quand il s’agit d’apprécier l’exécution ?
La Commission rejette l’amendement.
Puis elle examine l’amendement AS275 de M. Lionel Tardy.
M. Lionel Tardy. Aux termes de l’alinéa 25, « le salarié est informé », au moment de son embauche, « qu’il bénéficie tous les deux ans d’un entretien professionnel avec son employeur ». Les modalités de cette information n’étant pas précisées, mieux vaut s’en tenir à une obligation.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.
Elle examine ensuite l’amendement AS517 du rapporteur.
M. le rapporteur. Il ne faut pas confondre l’entretien visé ici avec l’entretien annuel classique.
M. Francis Vercamer. Il ne faudrait pas non plus multiplier les entretiens.
M. le rapporteur. Les deux sujets doivent être évoqués séparément.
La Commission adopte l’amendement.
Puis elle examine l’amendement AS518 du rapporteur.
M. le rapporteur. L’entretien professionnel bisannuel permettant de vérifier que l’employeur respecte ses obligations en matière de formation, un document écrit paraît indispensable.
M. Gérard Cherpion. D’accord, si ce document se borne à mentionner que l’entretien a eu lieu.
M. Lionel Tardy. Mon amendement AS277 ira dans le sens inverse du vôtre, monsieur le rapporteur : à mon sens, pour éviter une paperasserie inutile, l’entretien oral ne doit donner lieu à aucun bilan écrit.
M. Denys Robiliard. Une preuve écrite est dans l’intérêt de tous, notamment de l’employeur, qui se verra obligé, si l’entretien n’a pas eu lieu, de créditer le CPF de 100 heures supplémentaires. Cela dit, monsieur Cherpion, il ne s’agit pas de réécrire l’Encyclopædia universalis, nous en sommes d’accord.
Mme Véronique Louwagie. Un document écrit me paraît nécessaire, puisque des sanctions sont prévues ; il doit être simple mais, à tout le moins, être revêtu des signatures de l’employeur et du salarié.
M. le rapporteur. De telles précisions ne relèvent pas de la loi. L’idée, je le répète, est que l’entretien bisannuel fasse l’objet d’une trace écrite ; quant à l’entretien ayant lieu tous les six ans, il sera davantage formalisé.
M. Gérard Cherpion. Le « document écrit » dont il est question ne doit pas faire vingt-cinq pages ! Il faudrait préciser qu’il se résume à quelques indications simples.
M. Francis Vercamer. Une telle imprécision sur le contenu du document est source de contentieux : elle générera une jurisprudence, qui à son tour rendra nécessaire une évolution législative.
M. Denys Robiliard. C’est plutôt l’absence de preuve écrite qui serait source de contentieux. Certaines entreprises formaliseront ce document, d’autres non. Il appartiendra aux juristes saisis de ce genre de dossier, le cas échéant, de se reporter au compte rendu de nos travaux. Il ne s’agit pas de créer un nouveau centre d’enregistrement et de révision des formulaires administratifs (CERFA).
M. Francis Vercamer. L’employeur a tout intérêt à disposer d’une trace écrite de l’entretien : à quoi l’amendement servira-t-il, sinon à générer une jurisprudence sur le contenu du document ?
M. le rapporteur. Ne coupons pas les cheveux en quatre. Je vous propose d’adopter l’amendement, quitte à le compléter par la suite.
La Commission adopte l’amendement.
Puis elle examine l’amendement AS276 de M. Lionel Tardy.
M. Lionel Tardy. Il n’y a pas lieu d’assimiler l’exercice d’un mandat syndical à une longue absence médicale.
M. le rapporteur. Avis défavorable : un mandat syndical peut s’accompagner d’une décharge de travail.
M. Lionel Tardy. Un salarié qui exerce un mandat syndical reste présent dans l’entreprise !
La Commission rejette l’amendement.
Puis elle examine l’amendement AS520 du rapporteur.
M. le rapporteur. Parler d’un « état des lieux récapitulatif » me semble préférable à la notion de « bilan ». D’autre part, la référence à une « présence continue » ouvrant la voie à des contentieux, je préfère que l’on se réfère à l’ancienneté.
La Commission adopte l’amendement. De ce fait, l’amendement AS277 de M. Lionel Tardy n’a plus d’objet.
La Commission adopte ensuite l’amendement rédactionnel AS521 du rapporteur.
Puis elle examine l’amendement AS278 de M. Lionel Tardy.
M. Lionel Tardy. Lorsque les entretiens n’ont pas été menés, le CPF sera crédité de 100 heures supplémentaires. Il en ira de même si le salarié n’a pas bénéficié d’au moins deux des trois mesures suivantes : suivi d’une action de formation ; progression salariale ou professionnelle ; acquisition d’éléments de certification, par la formation ou par une validation des acquis de l’expérience.
Fort heureusement, ces dispositions ne s’appliquent qu’aux entreprises de plus de cinquante salariés, mais la logique qui les inspire me gêne, car elle revient à conduire la formation professionnelle, déjà complexe, à marche forcée. Comment expliquer aux entrepreneurs que celle-ci est une chance si le Gouvernement la conçoit comme une monnaie d’échange ?
M. le rapporteur. Avis défavorable. Les pénalités que vous avez rappelées ne pourront s’appliquer qu’aux entreprises de plus de cinquante salariés ; la question de leur extension à l’ensemble des entreprises se posera peut-être un jour.
La Commission rejette l’amendement.
Puis elle adopte l’amendement rédactionnel AS522 du rapporteur.
Elle examine ensuite l’amendement AS279 de M. Lionel Tardy.
M. Lionel Tardy. Pourquoi rappeler les obligations afférentes à l’entretien dans chaque article du code du travail concerné ? Pour le congé maternité, ces obligations seront inscrites au sein du chapitre qui leur est consacré, et de celui relatif aux entretiens.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement AS280 de M. Lionel Tardy.
Puis elle examine l’amendement AS104 de M. Dominique Tian.
M. Lionel Tardy. Cet amendement tend à redéfinir les actions de formation afin d’y inclure les nouvelles formes qu’elles peuvent prendre. Sont cependant exclues les actions visant au développement des compétences.
M. le rapporteur. Avis défavorable : l’amendement supprimerait en particulier la référence au programme préétabli.
La Commission rejette l’amendement.
Elle en vient à l’amendement AS21 de M. Gérard Cherpion.
M. Gérard Cherpion. Les formations à distance (FOAD), ou l’e-learning, favorisées par l’essor des nouvelles technologies, constituent désormais des voies privilégiées, en particulier pour les personnes éloignées des centres de formation. Il serait bon d’encadrer l’e-learning au moyen d’un document qui formalise les objectifs de la formation et son suivi. Les amendements AS255 et AS256 à venir participent de la même logique.
M. le rapporteur. Avis défavorable. Pour qu’un salarié accède à une formation adaptée, il importe de connaître son niveau de connaissances.
M. Gérard Cherpion. L’e-learning me semble être un bon outil. Il faudra que nous en rediscutions.
La Commission rejette l’amendement.
Puis elle adopte l’amendement AS523 de précision du rapporteur.
Elle examine ensuite les amendements identiques AS182 de M. Francis Vercamer et AS255 de M. Gérard Cherpion.
M. Francis Vercamer. L’enseignement à distance, facilité par l’essor des nouvelles technologies doit être encadré.
M. le rapporteur. Avis défavorable à ces amendements, non sur le fond, mais pour vous inviter à en revoir la rédaction.
La Commission rejette les amendements.
Puis elle rejette, suivant l’avis défavorable du rapporteur, l’amendement AS256 de M. Gérard Cherpion.
Elle adopte enfin l’article 2 modifié.
La Commission examine l’amendement AS200 de M. Pierre Morange.
M. Gérard Cherpion. L’amendement reprend les conclusions du rapport d’évaluation du Comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques (CEC) sur la formation professionnelle, qui préconise d’assouplir la définition légale des conditions de réalisation des actions de formation afin de les rendre compatibles avec la FOAD.
Notre pays accuse un retard en ce domaine – pour des raisons plus juridiques que techniques. La FOAD permet l’innovation pédagogique et peut constituer une réponse adaptée – absence de frais de déplacement et progression individuelle – pour des publics qui, salariés peu qualifiés ou de PME, ont des difficultés à accéder à la formation professionnelle continue.
M. le rapporteur. Cet amendement est redondant avec ceux que nous venons d’adopter.
M. Gérard Cherpion. Où est la redondance ? Il s’agit de préciser le champ des actions de formation.
M. le rapporteur. Je vous invite à relire l’alinéa 53 de l’article 2.
La Commission rejette l’amendement.
Article 3
(art. L. 6324–1, L. 6324–2, L. 6324–3, L. 6324–4, L. 6324–5, L. 6324–5–1, L. 6325–2–1 [nouveau], L. 6325–3–1 [nouveau], L. 6326–1 et L. 6326–3 du code du travail ;
art. 21 de la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011)
Contrat de professionnalisation, périodes de professionnalisation, préparation opérationnelle à l’emploi
L’article 3 a pour objet de réformer les périodes de professionnalisation, les conditions de mise en œuvre du contrat de professionnalisation ainsi que la préparation opérationnelle à l’emploi des demandeurs d’emplois.
A. LE CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION S’ADRESSE AUX JEUNES ET AUX ADULTES ÉLOIGNÉS DU MONDE DU TRAVAIL
Institué par l’ANI de décembre 2003 et transposé ensuite par la loi du 4 mai 2004 (19), le contrat de professionnalisation, prévu par les articles L. 6325-1 à L. 6325-24 du code du travail, s’est substitué au contrat d’insertion en alternance pour les jeunes (contrat de qualification, d’orientation et d’adaptation) et aux contrats de qualification pour les adultes. Les organismes collecteurs paritaires agréés (OPCA) prennent en charge les actions d’évaluation, d’accompagnement et de formation. Ce dispositif a d’ores et déjà prouvé son utilité et son efficacité.
1. Le champ du contrat de professionnalisation
Il s’adresse aux jeunes de 16 à 25 ans révolus, aux demandeurs d’emplois de plus de 26 ans et, depuis la loi du 24 novembre 2009 (20), aux bénéficiaires de minima sociaux (21) et aux personnes ayant bénéficié d’un contrat unique d’insertion. En 2012, les jeunes représentent 80 % des embauches en contrat de professionnalisation, même s’il est constaté une augmentation de l’âge moyen des bénéficiaires : 20 % des bénéficiaires embauchés en 2012 sont âgés de 26 ans et plus contre 16 % en 2010 (22).
À travers ce contrat, les branches professionnelles ont la possibilité de conduire des stratégies de formation mieux adaptées à leurs besoins de qualifications identifiés sur les différents métiers.
Tous les employeurs assujettis au financement de la formation professionnelle peuvent conclure des contrats de professionnalisation. La loi du 28 juillet 2011 (23) ouvre également la possibilité de conclure un contrat pour deux employeurs saisonniers et, à titre expérimental et pour une durée de 3 ans, pour un employeur particulier.
2. La forme du contrat de professionnalisation
Le contrat de professionnalisation est soit à durée déterminée (CDD), soit à durée indéterminée (CDI). Dans ce dernier cas, l’action de professionnalisation se situe au début du contrat. En 2012, la DARES évalue à 91 % la part des nouveaux contrats relevant de CDD, la part des embauches sous la forme d’un CDI se réduisant à 9 %, soit 3 points de moins que pour les trois précédentes années.
La durée du contrat – ou de l’action de professionnalisation dans le cas d’un CDI – doit être comprise entre six et douze mois. Elle peut être étendue jusqu’à vingt-quatre mois par convention ou accord collectif de branche, notamment pour les personnes sorties du système scolaire sans qualification professionnelle reconnue ou lorsque la nature des qualifications visées l’exige. Toujours selon la DARES, la durée des contrats d’une période supérieure à un an représente 38 % des nouveaux contrats, chiffre en diminution constante, soit 2 points de moins qu’en 2011 et 4 points de moins qu’en 2010.
Pour chaque salarié en contrat de professionnalisation, l’employeur peut désigner un tuteur chargé de l’accueillir et de le guider dans l’entreprise. Par le tutorat, les entreprises permettent un transfert de connaissances et de compétence vers le salarié et assurent aussi le suivi de sa formation, en lien avec les organismes de formation.
3. L’objet du contrat de professionnalisation
Le contrat de professionnalisation vise à acquérir un diplôme ou un titre enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles prévu à l’article L. 335-6 du code l’éducation nationale, une qualification reconnue dans les classifications d’une convention collective nationale ou un certificat de qualification professionnelle. Il se distingue de l’apprentissage qui s’inscrit dans une logique de poursuite de formation initiale.
Il associe ainsi des enseignements généraux, professionnels et technologiques et l’acquisition d’un savoir-faire en entreprise.
L’employeur s’engage à assurer aux bénéficiaires une formation leur permettant d’acquérir une qualification professionnelle et à leur fournir un emploi en relation avec cet objectif, pendant la durée du CDD ou de l’action de professionnalisation du CDI. La part de la formation doit être comprise entre 15 % et 25 % de la durée du CDD ou de l’action de professionnalisation dans le cadre d’un CDI, sans être inférieure à 150 heures. Le titulaire du contrat s’engage, quant à lui, à travailler pour le compte de son employeur et à suivre la formation prévue par le contrat.
Les aides à l’embauche en contrat de professionnalisation
Les aides prévues pour le contrat de professionnalisation :
● aide forfaitaire à l’employeur pour les salariés d’au moins 26 ans, plafonnée à 2 000 € et versée par Pôle Emploi ;
● aide à l’embauche d’un demandeur d’emploi âgé de 45 ans ou plus, fixée à 2 000 €, versée par Pôle Emploi ;
● aides à l’embauche et au maintien dans l’emploi d’un travailleur handicapé, versées par l’Association de gestion du Fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées (AGEFIPH) et dont le montant varie selon la nature et la durée du contrat ;
● aide de l’État pour les groupements spécifiques de l’employeur organisant des parcours d’insertion et de qualification, versée en fonction du nombre d’accompagnements et fixée forfaitairement à 686 euros par accompagnement.
Les exonérations de charges sociales :
● les contrats conclus avec les demandeurs d’emploi âgés de 45 ans et plus ouvrent droit à une exonération des cotisations patronales d’assurance maladie, maternité, vieillesse et allocations familiales. Par ailleurs, l’employeur peut bénéficier de la réduction générale des cotisations patronales de sécurité sociales dite « réduction Fillon ». Lorsque le contrat est conclu avec un groupement d’employeurs, l’employeur peut être exonéré des cotisations patronales d’accident du travail et de maladies professionnelles ;
● l’embauche des personnes de moins de 26 ans n’ouvre droit à aucune exonération spécifique des cotisations patronales. En revanche, l’employeur peut bénéficier de la réduction générale des cotisations patronales de sécurité sociales dite « réduction Fillon ». Lorsque le contrat est conclu avec un groupement d’employeurs, l’employeur peut être exonéré des cotisations patronales d’accident du travail et de maladies professionnelles.
Autres dispositifs :
● À partir de 2012, les entreprises de 250 salariés et plus sont soumises à la contribution supplémentaire à l’apprentissage (CSA) lorsqu’elles ne comptent pas au moins 4 % de jeunes en alternance dans leurs effectifs (3 % auparavant, 5 % à partir de 2015). Les entreprises qui dépassent la nouvelle obligation légale bénéficient à l’inverse d’un bonus ;
● Des aides ponctuelles ont par ailleurs été mises en place par les pouvoirs publics pour lutter contre les effets de la crise économique, notamment sur l’emploi des jeunes :
– dans le cadre du plan d’urgence pour l’emploi des jeunes d’avril 2009, une aide spécifique à l’embauche a été versée aux employeurs ayant embauché en contrat de professionnalisation un jeune de moins de 26 ans entre le 24 avril 2009 et le 31 décembre 2010.
– dans le cadre du plan de mobilisation pour l’emploi annoncé le 1er mars 2011, de nouvelles mesures ont été prises telle qu’une aide supplémentaire de 2 000 euros par contrat pour les entreprises embauchant un demandeur d’emploi âgé de 45 ans ou plus en contrat de professionnalisation, ou telle que la compensation pendant un an des charges patronales, pour les entreprises de moins de 250 salariés, pour l’embauche de chaque jeune supplémentaire en alternance.
B. LES PÉRIODES DE PROFESSIONNALISATION S’ADRESSENT AUX SALARIÉS DÉJÀ PRÉSENTS DANS L’ENTREPRISE
La période de professionnalisation, prévus par les articles L. 6324-1 à L. 6324-10 du code du travail, ne doit pas être confondue avec le contrat de professionnalisation en tant qu’elle s’adresse à des salariés déjà présents dans l’entreprise et titulaires d’un contrat à durée indéterminée ou à des salariés bénéficiaires d’un CDD ou d’un CDI conclu en application de l’article L. 5134-19-1 relatif au contrat unique d’insertion (CUI). Les organismes collecteurs paritaires agréés (OPCA) prennent en charge les actions d’évaluation, d’accompagnement et de formation.
1. Le champ des périodes de professionnalisation
S’agissant des salariés en contrat à indéterminée, sont concernés :
– les salariés dont la qualification est insuffisante au regard de l’évolution des technologies et de l’organisation du travail conformément aux priorités définies par accord de branche ou à défaut par accord collectif conclu entre les organisations représentatives d’employeurs et de salariés signataires d’un accord constitutif d’un OPCA à compétence interprofessionnelle ;
– les salariés qui comptent 20 ans d’activité professionnelle ou âgés d’au moins 45 ans et disposant d’une ancienneté minimum d’un an de présence dans la dernière entreprise qui les emploie ;
– les salariés qui envisagent la création ou la reprise d’une entreprise ;
– les femmes qui reprennent leur activité professionnelle après un congé de maternité ou aux hommes et aux femmes après un congé parental ;
– les personnes handicapées ou invalides, bénéficiaires de l’obligation d’emploi mentionnés à l’article L. 5212-13 du code du travail. Appartiennent notamment à cette dernière catégorie les travailleurs reconnus handicapés et les victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à 10 % et titulaires d’une rente attribuée au titre du régime général ;
2. La forme de la période de professionnalisation
La durée minimale des périodes de professionnalisation s’élève, sur douze mois calendaires et pour chaque salarié en bénéficiant, à 35 heures pour les entreprises d’au moins 50 salariés et à 70 heures pour les entreprises d’au moins 250 salariés. Cette durée minimale ne s’applique pas au bilan de compétences ni à la validation des acquis de l’expérience. Elle ne s’applique pas non plus aux périodes de professionnalisation des salariés âgés d’au moins 45 ans.
Pour les salariés en contrat unique d’insertion (CUI), la durée minimale de la formation qu’ils doivent recevoir dans le cadre d’une période de professionnalisation est fixée, par l’article D. 6324-1-1 du code du travail, à 80 heures.
Les actions de formation effectuées dans le cadre de la période de professionnalisation se déroulent en principe pendant le temps de travail. Elles peuvent toutefois également se dérouler, pour tout ou partie, en dehors du temps de travail, à l’initiative du salarié dans le cadre du droit individuel à la formation (DIF), de l’employeur, avec l’accord écrit du salarié, dans le cadre du plan de formation.
Pour les salariés en période de professionnalisation, l’employeur peut choisir un tuteur parmi les salariés qualifiés de l’entreprise. Cette nomination n’est pas obligatoire bien que la majorité des accords de branche imposent la nomination d’un tuteur.
3. L’objet des périodes de professionnalisation
La période de professionnalisation doit permettre à son bénéficiaire d’acquérir une des qualifications prévues à l’article L. 6314-1 du code du travail (24) ou de participer à une action de formation dont l’objectif est défini par la commission paritaire nationale de l’emploi de la branche professionnelle dont relève l’entreprise.
La période de professionnalisation associe des enseignements généraux, professionnels et technologiques à l’acquisition d’un savoir-faire par l’exercice dans l’entreprise d’une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les qualifications recherchées.
Dans le cadre des actions de professionnalisation, l’entreprise s’engage à permettre au salarié d’accéder, en priorité et dans un délai d’un an à l’issue de la formation, aux fonctions disponibles correspondant aux connaissances ainsi acquises et sur l’attribution de la classification correspondant à l’emploi occupé. Pour sa part, le salarié s’engage à suivre avec assiduité la formation et à satisfaire aux évaluations prévues.
4. Un bilan susceptible d’être amélioré
Selon l’étude d’impact, la possibilité de conclure des accords de branche élargissant les publics et l’objet des périodes de professionnalisation a abouti à une certaine dérive du recours aux périodes de professionnalisation, certains employeurs l’utilisant pour financer ou cofinancer des actions classiques et habituelles du plan de formation.
L’objectif visant à permettre l’obtention d’une qualification n’est pas non plus atteint. Selon les données transmises à votre rapporteur environ 317 000 stagiaires ont bénéficié en 2012 d’une période de professionnalisation, pour une durée moyenne de 145 heures. La part des périodes de professionnalisation de moins de 35 heures se situe autour de 41 % du total des périodes, celle des périodes de 35 heures à moins de 300 heures, autour de 48 %. La période de professionnalisation tend à voir sa durée moyenne augmenter, mais reste toutefois trop peu qualifiante au vu des résultats des sanctions de formation, 67 % des périodes n’étant pas sanctionnées par un diplôme, un titre, une qualification reconnue.
C. LA PRÉPARATION OPÉRATIONNELLE À L’EMPLOI S’ADRESSE AUX DEMANDEURS D’EMPLOI
La création du dispositif de préparation opérationnelle à l’emploi (POE) a été instituée par la réforme de la formation professionnelle de 2009 afin de développer les compétences des demandeurs d’emploi préalablement à leur recrutement. La POE est régie par les articles L. 6326-1 à L. 6326-3 du code du travail.
Le dispositif permet de leur faire bénéficier d’une formation pouvant atteindre jusqu’à 400 heures.
La POE peut être individuelle lorsque la formation permet aux demandeurs d’emploi d’occuper un poste de travail correspondant à une offre identifiée déposée par un employeur. Le financement relève de Pôle emploi, le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP) et l’organisme collecteur paritaire agréé (OPCA) dont relève l’entreprise concernée peuvent contribuer au financement du coût pédagogique et des frais annexes de la formation.
Depuis la loi du 28 juillet 2011 (25), la POE peut aussi être collective, la formation ne visant plus l’acquisition des compétences permettant de répondre à une offre d’emploi déterminée, mais répondant à un besoin de main d’œuvre identifié par une branche ou un organisme paritaire collecteur agréé. Dans ce cadre, la formation est financée par l’organisme collecteur paritaire agréé compétent, Pôle emploi et le FPSPP contribuant au financement dans des conditions fixées par une convention avec l’organisme collecteur paritaire agréé.
À l’issue de la formation, l’entreprise s’engage à embaucher le demandeur d’emploi stagiaire à l’issue de sa formation, soit en CDI, soit en CDD d’au moins 12 mois, soit en contrat de professionnalisation d’au moins 12 mois, soit en contrat d’apprentissage.
Le rapport sur la mise en œuvre de la loi du 24 novembre 2009 souligne, que, dès son lancement en novembre 2011, la POE collective a rencontré un succès rapide, les entrées n’ayant pas à être justifiées par une offre d’emploi identifiée et le dispositif pouvant être géré directement par les OPCA.
Selon les données provisoires relatives à l’année transmises à votre rapporteur, un peu plus de 22 600 personnes ont bénéficié de la POE individuelle contre près de 31 000 pour la POE collective. Pour la POE collective, les résultats font apparaître une diminution liée à la mise en œuvre de l’appel à projet du FPSPP durant les premiers mois de l’exercice. En effet, sa rédaction pouvait conduire à réduire la participation du PFSPP au détriment des OPCA. Un avenant signé au mois de juillet, dans le cadre de la dynamique engendrée par le plan « 30 000 formations prioritaires pour l’emploi » a permis de renouer avec un bon rythme de prise en charge.
II. L’AMÉLIORATION DES DISPOSITIFS DE PROFESSIONNALISATION ET DE PRÉPARATION À L’EMPLOI
A. LE RECENTRAGE DU DISPOSITIF DE LA PÉRIODE DE PROFESSIONNALISATION
Les alinéas 1 à 11 élargissent les bénéficiaires potentiels et précisent l’objet de la période de professionnalisation.
1. L’élargissement des bénéficiaires de la période de professionnalisation
Les périodes de professionnalisation s’adresseront aux salariés en contrat à durée indéterminée, aux salariés bénéficiaires d’un contrat unique d’insertion et aux salariés des structures d’insertion par l’activité économique.
L’abrogation de l’article L. 6324-2, qui établit une liste des salariés en CDI susceptibles de bénéficier des périodes de professionnalisation, permet d’ouvrir plus largement la période de professionnalisation à un public moins restreint. Le public éligible se voit donc désormais défini à l’article L. 6324-1.
L’article 3 tend également à compléter l’article L. 6324-1 du code du travail qui établit le champ des bénéficiaires de la période de professionnalisation aux publics les plus fragiles.
Elle est désormais accessible aux salariés des structures d’insertion par l’activité économique pouvant conclure des conventions avec l’État et définies à l’article L. 5132-4 du même code : les entreprises d’insertion, les entreprises de travail temporaires d’insertion, les associations intermédiaires et les ateliers et chantiers d’insertion. Selon l’étude d’impact, jointe au présent projet de loi, « si 45 % des salariés accèdent à la formation durant leur parcours d’insertion, cette part peut descendre à 26 % pour les salariés en association intermédiaire et 30 % pour les salariés en entreprise de travail temporaire intermédiaire ». Les mesures prises permettront d’améliorer sensiblement la situation de ces publics fragiles.
2. Le renforcement de l’ambition qualifiante de la période de professionnalisation
L’objet des périodes de professionnalisation est dorénavant précisé à l’article L. 6324-1 :
– en renforçant leur ambition qualifiante, par la référence à l’article L. 6314-1 du code du travail ;
– en renforçant leur ambition certifiante, par la référence à l’article L. 335-6 du code de l’éducation ;
– en laissant la porte ouverte à des formations visant l’acquisition du socle de compétences défini par décret. Selon les informations transmises à votre rapporteur, les partenaires sociaux sont en train de définir les contours des actions relevant du socle de connaissance et de compétence. Le décret, après consultation des partenaires sociaux, devrait reprendre ces travaux. L’objectif vise à faire des salariés les moins qualifiés les principaux bénéficiaires, notamment ceux présentant un bas niveau d’études.
À l’initiative de votre rapporteur, la commission a adopté l’amendement n° AS524 précisant que les actions de formation doivent permettre l’accès au socle de connaissances et de compétences, précisant ainsi qu’il ne peut y avoir de multiples définitions du socle.
Pour tenir compte de ces modifications, l’article 3 tend à abroger, par coordination, les articles L. 6324-3 et L. 6324-4 du code du travail.
Cette modification, renforçant la dimension qualifiante, permettra de corriger la pratique, visant à financer des actions relevant du plan de formation sur les fonds destinés à la professionnalisation. Avec le renforcement de la dimension qualifiante, la période de professionnalisation permettra d’abonder le compte personnel de formation et d’allonger la durée de la formation des salariés.
Dans cet esprit, l’article L. 6324-5-1 du même code, relatif à la durée minimale de la période de professionnalisation, fait l’objet d’une rédaction globale, afin de prévoir que la durée minimale de la formation fera l’objet une fixation par décret. La fixation de la durée minimale de la formation faisait déjà l’objet d’une fixation par décret s’agissant des seuls salariés bénéficiaires d’un contrat unique d’insertion conformément au second alinéa de l’article L. 6324-5. L’objectif du texte étant de déterminer une durée minimale unique de formation pour tous les bénéficiaires d’une période de professionnalisation, il y a lieu de supprimer cet alinéa. Ce faisant, la nouvelle rédaction de l’article L. 6324-5-1 supprime la notion de « durée minimale de la période de professionnalisation », dans la mesure où c’est la durée minimale de la formation dispensée qui importe désormais.
Le décret devrait ainsi prévoir une durée sensiblement supérieure aux planchers actuels notamment pour satisfaire les besoins de formation qualifiante, 67% des périodes n’étant pas sanctionnée par un diplôme, un titre ou une qualification reconnue.
Par coordination, le second alinéa de l’article L. 6324-5, relatif à la durée minimale relative aux salariés bénéficiaires d’un CUI, fait également l’objet d’une suppression.
B. LA SÉCURISATION DES BÉNÉFICIAIRES DU CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION
En ce qui concerne les contrats de professionnalisation, les alinéas 12 à 16 consacrent le principe de gratuité pour le salarié concerné et réinscrivent au niveau législatif l’obligation de tutorat. Pour les particuliers employeurs, la durée de l’expérimentation est prolongée.
Il est ainsi inséré un nouvel article L. 6325-2-1, aux termes duquel, les organismes publics et privés de formation ne peuvent conditionner l’inscription d’un salarié en contrat de professionnalisation au versement par celui-ci d’une contribution financière. En effet, l’absence de participation financière des bénéficiaires en contrat de professionnalisation au moment de l’inscription favorisera l’accès à la qualification à un plus large public. L’étude d’impact précise, à cet égard qu’un contrôle des organismes de formation recourant à ce type de pratique sera réalisé.
Dans un objectif d’égal accès, d’accompagnement et de qualité de ces contrats, il est aussi inséré un nouvel article L. 6325-3-1 qui consacre, au niveau législatif, le principe du tutorat qui fait, aujourd’hui, l’objet d’une définition réglementaire à l’article D. 6325-6 du code du travail. Cette modification vise à renforcer l’accompagnement du titulaire du contrat. Un décret fixera les conditions de désignation du tuteur et précisera ses missions et l’exercice de sa mission.
Enfin, la durée de l’expérimentation ouvrant aux particuliers employeurs la possibilité de conclure des contrats de professionnalisation, prévue par la loi du 28 juillet 2011 (26), est rallongée de trois ans. Une évaluation de cette expérimentation devait être présentée par le Gouvernement au Parlement avant son terme. Par ailleurs, cet article ne demandait pas de mesure réglementaire d’application, ses modalités de mise en œuvre étant renvoyées à un accord de branche étendu. Selon les informations transmises à votre rapporteur, cet accord n’a toujours pas été conclu. Ne disposant d’aucun élément de nature à justifier d’une telle prolongation, et considérant que cette prolongation n’est pas de nature à sécuriser le parcours des bénéficiaires, votre rapporteur estime qu’il convient de supprimer ces dispositions. À l’initiative de votre rapporteur, la commission a ainsi adopté un amendement n° AS525 portant suppression de cette disposition.
C. L’ÉLARGISSEMENT DES BÉNÉFICIAIRES DE LA PÉRIODE DE LA POE AU PUBLIC FRAGILE
Enfin les alinéas 17 et 18 étendent l’accès à la préparation opérationnelle à l’emploi, qu’elle soit individuelle – article L. 6326-1 du code du travail – ou collective – article L. 6326-3 du code du travail – aux catégories les plus fragiles. La POE est désormais accessible :
– aux salariés des structures d’insertion par l’activité économique pouvant conclure des conventions avec l’État et définies à l’article L. 5132-4 du même code. Il s’agit des entreprises d’insertion, des entreprises de travail temporaires d’insertion, des associations intermédiaires et des ateliers et chantiers d’insertion ;
– et aux salariés bénéficiaires d’un CDD ou d’un CDI conclu en application de l’article L. 5134-19-1 relatif au contrat unique d’insertion (CUI).
Les structures d’insertion par l’activité économique
L’insertion par l’activité économique (IAE) a pour objet de permettre à des personnes sans emploi, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, de bénéficier de contrats de travail en vue de faciliter leur insertion professionnelle. L’accès à la formation professionnelle de ces salariés revêt un caractère stratégique, notamment du point de vue de la sécurisation de leur parcours professionnel.
Ces personnes sont orientées vers des structures, spécialisées en insertion sociale et professionnelle, qui perçoivent, sous condition de la conclusion préalable d’une convention avec l’ État et de l’agrément des salariés qu’elles embauchent par Pôle emploi, certaines aides prenant la forme d’exonérations de cotisations sociales, de prises en charge d’une partie des rémunérations versées aux salariés en insertion ou d’aides au poste d’accompagnement.
L’article L. 5132-4 du code du travail définit quatre types de structures :
– les entreprises d’insertion ;
– les entreprises de travail temporaire d’insertion, qui proposent une insertion dans le cadre d’un contrat de mission pouvant aller jusqu’à 24 mois ;
– les associations intermédiaires, qui mettent des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières à disposition, à titre onéreux, de personnes physiques ou de personnes morales ;
– les ateliers et chantiers d’insertion.
Les personnes en situation d’insertion peuvent être embauchées par une entreprise d’insertion, une association intermédiaire, un atelier ou un chantier d’insertion dans le cadre d’un CDD conclu en application de l’article L. 1242-3 du code du travail. La durée de ces contrats ne peut être inférieure à 4 mois. Ces contrats peuvent être renouvelés dans la limite d’une durée totale de 24 mois.
En 2011, 123 000 salariés ont travaillé dans une structure de l’IAE en moyenne chaque mois, en hausse de 3,8 % par rapport à 2010.
*
* *
La Commission est saisie de l’amendement AS524 du rapporteur.
M. le rapporteur. Le socle de connaissances, défini par décret, sera unique.
La Commission adopte l’amendement.
Puis elle examine l’amendement AS281 de M. Lionel Tardy.
M. Lionel Tardy. La durée minimale de la formation reçue dans le cadre de la perte de professionnalisation est fixée par la loi ; or, le projet tend à la fixer par décret. La voie réglementaire est possible, mais seulement pour des aménagements qui relèvent d’exceptions.
M. le rapporteur. La durée minimale de cette formation est déjà fixée par décret : l’article vise à l’allonger. Avis défavorable.
M. Lionel Tardy. Non, cette durée est définie par la loi.
M. Gérard Cherpion. C’est la loi de 2009 qui a fixé cette durée.
M. le rapporteur. Il ne faut pas confondre la durée minimale de la formation, fixée par décret, et la durée minimale des périodes de professionnalisation, qui, elle, est fixée par la loi.
La Commission rejette l’amendement.
Elle examine ensuite l’amendement AS525 du rapporteur.
M. le rapporteur. Institué par la loi Cherpion de 2011, le contrat de professionnalisation chez les employeurs particuliers avait suscité une certaine perplexité, à l’époque, au sein de la commission mixte paritaire (CMP). Pierre Méhaignerie avait proposé une expérimentation qui, au terme des trois ans prévus, n’a pas fait ses preuves : mon amendement tend donc à y mettre fin plutôt qu’à la proroger.
La Commission adopte l’amendement.
Puis elle adopte l’article 3 modifié.
Les amendements identiques AS527 du rapporteur et AS106 de M. Dominique Tian sont retirés.
Article 4
(art. L. 6322-37, L. 6331-1, L. 6331-2, L. 6331-3, L. 6331-9, L. 6331-10, L. 6331-11, L. 6331-13, L. 6331-14, L. 6331-16, L. 6331-17, L. 6331-18, L. 6331-19 à L. 6331-27, L. 6331-28, L. 6331-29, L. 6331-30, L. 6331-31 et L. 6331-32 du code du travail)
Simplification des obligations de financement par les employeurs de la formation professionnelle continue
L’article 4 simplifie les obligations de financement de la formation professionnelle continue afin de concentrer les financements obligatoires sur les dispositifs mutualisés ou fléchés, selon des modalités précisées à l’article 5. Il instaure une contribution unique, dont le taux ne diffère que selon la taille de l’entreprise, qui remplace les différentes contributions existantes.
• Les limites des obligations actuelles de financement
Les obligations de financement de la formation professionnelle sont aujourd’hui complexes : différentes contributions sont établies en fonction des dispositifs à financer. La faculté, pour certaines entreprises, de déduire les dépenses directement engagées au titre du plan de financement d’une partie des sommes dues conduit trop souvent les employeurs ne pas analyser la valeur de la dépense de formation pour elle-même. Les dispositifs de mutualisation associés à ces dépenses sont en outre imparfaits.
L’assiette des contributions des entreprises au titre de la formation professionnelle continue est celle applicable aux cotisations de sécurité sociale, c’est-à-dire l’ensemble de la masse salariale versée au cours d’une année. Les contributions des entreprises diffèrent selon leur effectif.
Les entreprises employant plus de 20 salariés sont tenues de consacrer au financement de la formation professionnelle continue au moins 1,6% de leur masse salariale brute annuelle. Cette contribution prend la forme d’un versement de 0,2% effectué auprès de l’organisme paritaire agréé collecteur au titre du CIF (OPACIF) compétent et d’un versement de 0,50% à un organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) de branche ou interprofessionnel au titre du financement des contrats et des périodes de professionnalisation et du DIF. Le solde, qui correspond à 0,9% de la masse salariale, est acquitté soit sous forme de versement à un OPCA, soit de dépense directe de l’entreprise. Ce solde permet de financer des actions de formations supplémentaires entrant dans le cadre du plan de formation de l’entreprise, du DIF, du CIF, de la VAE…
Les entreprises comprenant entre 10 et 19 salariés sont soumises à une contribution représentant au moins 1,05% de la masse salariale. Pour s’en acquitter, elles doivent effectuer un versement à hauteur de 0,15% à un OPCA au titre du financement des contrats et des périodes de professionnalisation et du DIF. Le solde, égal à 0,9% de la masse salariale, doit être utilisé pour effectuer un nouveau versement à un OPCA ou pour financer directement des actions de formations dans l’entreprise.
Le taux minimal de participation des entreprises de moins de 10 salariés est fixé à 0,55%. Un versement de 0,15% de la masse salariale à un OPCA doit être réalisé afin de financer les contrats et les périodes de professionnalisation et un second versement de 0,4% doit revenir à un OPCA. Ces très petites entreprises ne peuvent donc pas se libérer de leur obligation de participation au financement de la formation professionnelle continue en réalisant elles-mêmes des dépenses de formation, l’intermédiaire d’un OPCA étant toujours requise.
Ces taux minimums de contribution correspondent à des obligations légales ; ils peuvent être relevés par un accord collectif. Ainsi 75% des branches professionnelles sont couvertes aujourd’hui par un tel accord. De plus, rien n’interdit aux entreprises de consacrer une part supérieure de leur masse salariale à la formation professionnelle continue. Comme l’indique le tableau ci-dessous, on constate, dans les faits, que les contributions effectives des entreprises sont bien plus élevées que les taux légaux.
CATÉGORIES D’ENTREPRISES
- de 10 |
10 à 19 |
20 à 49 |
50 à 249 |
250 à 499 |
500 à 1999 |
+ de 2000 | |
Taux légal actuel |
0,55% |
1,05% |
1,60% |
1,60% |
1,60% |
1,60% |
1,60% |
Taux de financements effectifs |
0,73% |
1,42% |
1,94% |
2,25% |
2,61% |
3,16% |
3,63% |
En effet, le plan de formation, qui finance l’adaptation du salarié au poste de travail ou sa capacité à occuper un emploi recouvre des dépenses que l’employeur a l’obligation d’engager en tout état de cause, et qu’il engage, en pratique, toujours, parce qu’elles sont désormais indispensable pour tout employeur exposé à la concurrence.
L’obligation légale de dépenses de formations au titre du plan de formation, qui représente 60% de l’ensemble des financements obligatoires acquittés par les employeurs, ne répond donc pas à l’objectif qui peut être assigné à dispositif fiscal : il n’oriente pas le financement privé vers un but qu’il n’atteint pas spontanément.
En outre, la mutualisation des fonds de la formation professionnelle continue, conduite par les OPCA, est insuffisante.
Il existe une mutualisation interne aux différentes sections dans lesquelles les fonds sont répartis en fonction de la taille des entreprises : c’est l’effet de solidarité qui joue entre les entreprises de même taille. Les données issues des états statistiques et financiers 2012 permettent d’observer que pour les entreprises de moins de 10 salariés, cet effet est utile puisque la contribution moyenne au titre du plan (394 euros) est inférieure au coût moyen de la formation pris en charge par l’OPCA (1 023 euros) : l’entreprise peut ainsi mobiliser l’OPCA une année pour faire face à des besoins supérieurs au montant de sa cotisation de la même année.
Mais il n’en va pas de même concernant la mutualisation entre sections : c’est-à-dire l’effet de solidarité des plus grandes entreprises vers les plus petites.
En regroupant les cotisations des entreprises de différentes tailles, les OPCA peuvent jouer un rôle redistributif au profit notamment des salariés des petites entreprises. Cet effet est marqué en ce qui concerne le CIF qui, s’il bénéficie aux salariés en CDI de toutes les entreprises, n’emporte de cotisations que pour les seules entreprises d’au moins 20 salariés. A l’inverse, la possibilité offerte aux entreprises de plus de 10 salariés de s’acquitter d’une part de leur participation obligatoire à la formation professionnelle par la réalisation d’actions de formation qu’elles financent directement nuit à la mutualisation des ressources. Et le volume des dépenses mutualisées n’est pas un gage de redistribution selon la taille des entreprises. La mutualisation du plan de formation peut être en trompe l’œil.
Le graphique ci-après compare la part dans le versement aux OPCA et la part dans les dépenses des OPCA de cinq classes de taille d’entreprises, pour 2010 et 2011. La bissectrice correspond à un montant reçu égal au montant versé. Au-dessus de cette ligne, les entreprises reçoivent plus qu’elles ne versent, en dessous, il s’agit de la situation inverse.
EFFET REDISTRIBUTIF DE LA MUTUALISATION AU TITRE DU PLAN DE FORMATION PAR TAILLE D’ENTREPRISE
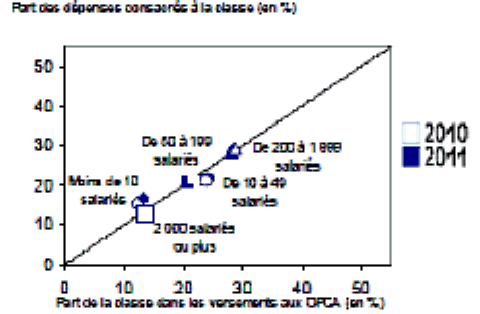
Source : Annexe au projet de loi de finances pour 2014, formation professionnelle, p 26.
On constate que l’effet redistributif des mécanismes actuels de mutualisation au titre du plan de formation sont inexistants : pour chaque classe d’entreprises, les sommes versées aux OPCA sont comparables aux sommes dépensées par les OPCA pour former les salariés de leurs entreprises. Si l’effet redistributif était réel, on devrait trouver les entreprises de moins de 10 salariés et de 50 à 199 salariés très au-dessus de la bissectrice or, il n’en est rien.
• La distinction entre obligation de former les salariés et contribution légale
Le financement d’actions de formation constitue une modalité d’exécution loyale du contrat de travail. Elle se traduit dans l’obligation, définie à l’article L. 6321-1 pour l’employeur d’assurer l’adaptation des salariés à leur poste de travail mais également de veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Cette obligation est au demeurant illustrée par le concept juridique de « prévention » ajouté en 1971 dans la typologie des actions de formation définies dans le code du travail. Selon l’article L. 6313-5 du code du travail, en effet, « les actions de prévention ont pour objet de réduire, pour les salariés dont l’emploi est menacé, les risques résultant d’une qualification inadaptée à l’évolution des techniques et des structures des entreprises, en les préparant à une mutation d’activité, soit dans le cadre, soit en dehors de leur entreprise ».
Cette obligation de l’employeur d’adapter le salarié au poste et à l’évolution de l’emploi est régulièrement rappelée par la Cour de Cassation dans le cadre du contentieux du licenciement (27).
Ce fondement juridique, né de la relation de travail et rappelée solennellement par le législateur et le juge offre la première garantie que l’employeur va financer la formation professionnelle continue de ses salariés.
La contribution financière légale, de nature « fiscale », intervient donc en second lieu. Le présent article a pour objet de la simplifier afin de mieux l’articuler avec les obligations préexistantes, qui sont de nature « sociale », auxquelles le présent projet de loi offre les moyens de mieux se déployer, notamment en instaurant le compte personnel de formation que l’employeur peut abonder.
Au titre VI de l’accord national interprofessionnel (ANI), les partenaires sociaux ont au demeurant distingué les situations d’« investissement direct dans la formation » des salariés, notamment dans le cadre du plan de formation, et le fait que « l’employeur s’acquitte d’une contribution obligatoire ».
Aux alinéas 5 à 8, le II du présent article établit la nouvelle obligation de financement en complétant l’article L. 6331-1 qui dispose que « tout employeur concourt au développement de la formation professionnelle continue en participant, chaque année, au financement des actions de formation ».
À l’alinéa 7, un 1° précise qu’il est assuré en premier lieu par le financement direct par l’employeur d’actions de formation : un renvoi à l’article , L. 6321-1 confirme que le financement se fonde sur l’obligation de maintien de la capacité des salariés à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations. Il est précisé que ce financement peut relever du plan de formation, mais ce dernier ne constitue pas aujourd’hui une obligation légale pour l’employeur.
À l’alinéa 8, le 2° prévoit la seconde modalité par laquelle l’employeur s’acquitte de son obligation de financement : le versement des contributions définies aux articles suivants, en pratique une seule contribution mais dont le taux, diffère selon la taille des entreprises.
• Les contours de la contribution unique
Aux alinéas 9 et 10, le III modifie l’article L. 6331-2 applicable aux employeurs de moins de dix salariés. Le niveau de la charge financière n’est pas modifié : il reste de 0,55% du montant des rémunérations versées mais il correspond désormais à la contribution prévue pour l’OPCA désigné par l’accord de branche dont il relève ou, à défaut, l’OPCA interprofessionnel.
Par coordination, l’alinéa 11 supprime l’article L. 6331-3 qui précisait qu’un seul organisme paritaire reçoit chacune des contributions de l’employeur de moins de dix salariés, rendue inutile par l’instauration de la contribution unique.
Pour les employeurs de plus de dix salariés, aux alinéas 12 et 13, le IV modifie l’alinéa un de l’article L. 6331-9 : il prévoit que l’employeur acquitte à l’OPCA désigné par l’accord de branche dont il relève ou, à défaut, à l’OPCA interprofessionnel, une nouvelle contribution dont le taux est fixé à 1 % du montant des rémunérations versées.
Le deuxième alinéa de cet article n’est pas modifié : pour les rémunérations versées au titre des contrats de mission des entreprises de travail temporaire, le taux de la contribution est donc maintenu à 2 %. L’écart de taux avec les autres entreprises d’au moins 10 salariés s’établit donc du simple au double, alors qu’il n’est actuellement que de 25 %. Votre rapporteur salue le choix de ne pas diminuer le niveau des obligations des entreprises de travail temporaire et au contraire d’accroître mécaniquement le surtaux appliqué dans ce cas : il y voit une incitation supplémentaire pour les entreprises bénéficiaires du contrat de mission à offrir un contrat de travail de droit commun aux intérimaires.
Ces taux sont conformes aux souhaits des partenaires sociaux figurant à l’article 33 de l’ANI.
Aux alinéas 20 à 22, le VIII prévoit la prise en compte de l’accroissement d’effectif en adaptant l’article L. 6331-17 : dès lors les employeurs qui, en raison de l’accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent au titre d’une année, pour la première fois, l’effectif de dix salariés restent soumis, pour cette année et les deux années suivantes, au taux de contribution applicable aux employeurs de moins de dix salariés. Mais ils sont soumis au taux applicable aux employeurs de plus de dix salariés lorsque l’accroissement de l’effectif résulte de la reprise ou de l’absorption d’une entreprise ayant employé au moins dix salariés au cours de l’une des trois années précédentes.
À l’alinéa 36, le XIV abroge l’article L. 6331-13 relatif à la validité des versements directs libératoires de l’ancienne contribution relative au plan de formation. Il abroge également l’article L 6331-14 qui établit les modalité d’exonération des employeurs de dix à vingt salariés de 0,55 point sur le total de 1,6 % de la masse salariale au titre des différentes contributions supportées par les employeurs de plus de dix salariés : il s’agit d’une exonération totale de la contribution de 0,2 % due au titre du CIF et d’une exonération partielle de la contribution due au titre de la professionnalisation. Aussi les articles L 6331-16 et L 6331-18, qui régissent les règles de franchissement de seuil en cas de passage à un effectif de plus de vingt salariés, sont également abrogés.
À l’alinéa 35, le XIII abroge l’ensemble des paragraphes 3 et 5 relatifs aux dépenses libératoire de la contribution due au titre du plan de formation, soit les articles L. 66331-19, L. 66331-20, L. 66331-21, L. 66331-22, L. 66331-23, L. 66331-24, L. 66331-25, L. 66331-26 et L. 66331-27 ainsi que l’article L. 6631-29. Votre rapporteur salue cette démarche de simplification, qui, plus fondamentalement, évite d’assimiler financement direct par l’employeur de la formation des salariés et mesure d’optimisation fiscale ou sociale : la dépense de formation ne saurait constituer une « niche ».
Il en résulte au demeurant un allègement des charges de gestion administrative pour les entreprises. Elles sont remplacées, au XII par une simple obligation de transmission à l’autorité administrative des informations relatives aux modalités d’accès à la formation professionnelle des salariés, prévues par l’article L. 6331-32 et qui seront définies dans un décret en Conseil d’État.
Par coordination, le XI abroge l’article L. 6331-31 qui prévoit une majoration de la contribution au titre du plan de formation en cas de défaut de consultation du comité d’entreprise pour les entreprises soumises à cette obligation.
Enfin, le X, aux alinéas 26 à 31 adapte l’article L.6331-30 relatif aux majorations des versements lorsqu’il est constaté que des montants insuffisants ont été précédemment versés : ces dispositions s’appliquent désormais à la contribution unique.
Comme l’indique le schéma ci-après, l’instauration de la contribution unique aux nouveaux taux de 0,55 % ou 1 % maintient les obligations légales à un niveau bien inférieur aux contributions effectives des entreprises.
LES TAUX DE CONTRIBUTION GLOBALE À LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE SELON LA TAILLE DES ENTREPRISES
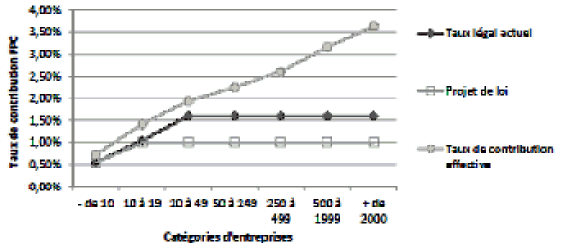 Sources : Pour les taux de contribution effective, état statistique et financier 2012 des OPCA
Sources : Pour les taux de contribution effective, état statistique et financier 2012 des OPCA
Il ne s’agit donc pas de diminuer l’effort de financement mais de concentrer les dispositifs légaux sur les dépenses dont la mutualisation ou le fléchage seront pleinement effectifs, en particulier sur le dispositif du compte personnel de formation.
• La faculté de financement direct du compte personnel de formation
Aussi, la seule faculté maintenue de diminution du montant de la contribution légale en contrepartie d’une dépense directe de l’employeur concerne-t-elle précisément le compte personnel de formation, dans un cas de figure expressément prévu par les partenaires sociaux, à l’article 36 de l’ANI.
Aux alinéas 14 à 16, le VI du présent article établit à l’article L. 6331-10 la possibilité pour un accord d’entreprise, conclu pour une durée de trois ans, de prévoir que l’employeur de plus de dix salariés consacre au moins 0,2 % du montant des rémunérations versées au financement du compte personnel de ses salariés et à son abondement. Le taux de la contribution est fixé à 0,8 % dans ce cas. Aux alinéas 17 à 19, le VII précise, à l’article L. 6331-11, les modalités de contrôle et de reversement des sommes qui n’auraient pas été utilisées dans ce cadre.
L’article 36 de l’ANI prévoit, à ce titre, que « les fonds versés au titre du compte personnel de formation par les entreprises de 10 salariés et plus, et non engagés au 31 octobre de chaque année, peuvent être affectés aux autres actions prises en charge par les OPCA. ». Ceci inclue donc l’ensemble des actions des OPCA et représente un risque de détournement des fonds du CPF vers le plan de formation, notamment des plus grandes entreprises.
Mais le deuxième alinéa de l’article L. 6331-11 prévoit que ces sommes sont reversées à l’OPCA « au titre des financements destinés au financement du compte personnel de formation » dans des conditions fixées par voie réglementaire et le IX prévoit, à l’article L. 6331-28, un versement, à défaut, au Trésor public. Votre rapporteur salue ce choix qui doit sécuriser les financements dédiés au CPF afin de garantir sa montée en charge rapide. Les décrets, élaborés après concertation avec les partenaires sociaux, pourraient utilement flécher les dépenses non engagées vers le financement des comptes personnels de formation des salariés des entreprises petites ou moyennes, les moins susceptible d’être régis par des accords d’entreprises.
• Le maintien du 1 % CIF-CDD
Enfin, dans le cadre du recentrage de l’ensemble des activités de collecte aux seuls OPCA, défini par l’article 5 du projet de loi, le I aux alinéas 1 à 4 modifie l’article L. 6322-37 afin de prévoir le maintien de la contribution supplémentaire de 1 % des rémunérations versées aux salariés en CDD. Cette cotisation est commune à toutes les entreprises, quel que soit leur effectif. Elle est destinée au financement du congé individuel de formation, du congé de bilan de compétences et du congé de validation des acquis de l’expérience bénéficiant aux salariés sous contrat à durée déterminée.
Elle sera donc prélevée par les OPCA et versée aux organismes agréés pour prendre en charge le congé individuel de formation. Il s’agit d’une simple mesure de coordination qui ne modifie donc pas le niveau des contributions obligatoires de l’employeur et évite de fragiliser le financement des FONGECIF.
• Les mesures de transition
Le XV prévoit une entrée en vigueur au 1er janvier 2015 et une application à la seule collecte des contributions dues au titre de l’année 2015. Les sommes perçues par les OPCA au titre de l’année 2014 seront donc calculées sur la base des obligations actuelles.
*
* *
Lors de son examen du texte du projet de loi, sur proposition du rapporteur, votre commission des affaires sociales a précisé que le montant minimum de 0,2 % des rémunérations directement affectés par l’employeur au financement du compte de ses salariés, chaque année pendant trois ans, si un accord d’entreprise le prévoit, doit être établi sur la même base de rémunérations que celle de la contribution légale alors portée à 0,8 % : il s’agit, dans les deux cas, des rémunérations versées pendant l’année civile.
*
* *
La Commission examine l’amendement AS59 de Mme Jacqueline Fraysse.
Mme Jacqueline Fraysse. Cet amendement appelle l’attention sur un problème majeur, la diminution du financement obligatoire de la formation professionnelle par les entreprises, qui passera de 1,6 % de la masse salariale à 1 % seulement. C’est d’ailleurs l’une des raisons pour lesquelles la CGT n’a pas ratifié l’ANI. Cette baisse entérine une réduction d’un tiers des financements, soit 2,5 milliards d’euros, sous prétexte que la baisse du coût du travail créera des emplois.
De surcroît, les alinéas 14 à 16 permettent aux entreprises de déroger à leur obligation de 1 % en cas d’accord d’entreprise, réduisant ipso facto leur contribution obligatoire à 0,8 %. Il faudrait à tout le moins revenir sur cette faculté.
M. le rapporteur. Avis défavorable, puisque votre amendement revient sur la réforme de la formation professionnelle qui était au cœur de l’ANI. Jusqu’à présent, les entreprises payaient une cotisation de 0,7 % sur différentes bases, à laquelle s’ajoutait la contribution légale de 0,9 % de la masse salariale au plan de formation. Dorénavant, elles paieront 1 % à un seul OPCA en remplacement de diverses contributions pour financer le CIF, le plan de formation, la professionnalisation, plus un financement de 0,2 % destiné au compte personnel de formation.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement AS59.
Elle examine ensuite l’amendement AS181 de M. Lionel Tardy.
M. Lionel Tardy. Le texte réduit les obligations de financement au titre du plan de formation des entreprises de 10 salariés et plus, mais les obligations de formation perdurent – formation au poste de travail, à la sécurité, vérification de la capacité à occuper un emploi. Autrement dit, le texte leur laisse la responsabilité de définir le montant de leur effort en faisant l’hypothèse qu’elles maintiendront leur niveau d’investissement, et sans prévoir de solution alternative. Un tel pari est risqué en période de crise, surtout s’agissant des PME qui n’assurent pas elles-mêmes la formation. Il n’est pas exclu que les dépenses de formation s’effondrent avec pour conséquence une baisse de l’employabilité des salariés, une aggravation des inégalités d’accès à la formation et, à terme, un moindre développement économique.
De plus, les sommes collectées par les OPCA au titre de l’obligation légale du plan de formation passant de 1,2 milliard d’euros à 274 millions, un véritable régime de mutualisation ne sera plus possible et les PME qui voudraient préserver leur effort de formation devront augmenter leurs dépenses.
Il est donc indispensable de mettre en place un régime transitoire pendant deux ans, avec un taux dégressif de la contribution au plan de formation, pour laisser aux différents acteurs le temps de s’adapter.
M. le rapporteur. Vous craignez les conséquences de la réforme, comme Mme Fraysse, mais ne faites pas les mêmes recommandations ! Les vôtres non plus ne correspondent pas à ce qu’il y a dans l’accord.
Cela dit, les entreprises, quelle que soit leur taille, dépensent aujourd’hui davantage que ce à quoi elles sont tenues, même si les grandes entreprises dépensent proportionnellement plus. Le risque concerne surtout les PME mais ce n’est pas parce que l’obligation légale est supprimée qu’elles cesseront de contribuer à l’OPCA.
Avis défavorable, tout en convenant qu’il faudra être vigilant.
M. Lionel Tardy. Les entreprises de moins de 10 salariés ne sont pas concernées – c’est le prix de la signature de l’UPA – mais celles qui emploient plus de 10 salariés se voient quasiment privées du mécanisme de mutualisation. L’accord se solde pour elles par un recul de 80 % des ressources dont bénéficiaient les PME pour subvenir à leurs besoins stratégiques. La baisse d’un tiers des cotisations perçues en faveur des PME en 2015 fera chuter d’autant le nombre de contrats de professionnalisation, soit de 40 à 50 000, alors que ce dispositif était réputé favoriser l’insertion professionnelle des jeunes ou des chômeurs. La CGPME a dénoncé à juste titre un accord en trompe-l’œil. Je ne vois pas pourquoi les entreprises de plus de 10 salariés seraient privées de l’actuel mécanisme de mutualisation.
M. Michel Liebgott. L’Union professionnelle artisanale (UPA) a-t-elle été auditionnée ? Quelle a été sa position ?
Mme Jacqueline Fraysse. Je ne suis pas contre la réforme – plusieurs points vont même dans le bon sens – mais elle devrait se faire sans diminuer l’obligation légale de financement. Sans doute n’avons-nous pas eu assez de temps pour rédiger un amendement plus circonstancié, mais nous le ferons pour la séance publique.
M. Francis Vercamer. Je suis d’accord avec mon collègue Tardy. Ce sont les PME qui créent de l’emploi et elles ont en général des marges plus faibles que les grosses entreprises. Si on ampute leurs ressources, on aura un vrai problème pour les contrats d’alternance et même d’emploi. Il faut que le Gouvernement traite le problème en séance car les alertes se déclenchent un peu partout.
M. le rapporteur. L’UPA, auditionnée hier matin, s’est montrée la plus enthousiaste puisque les entreprises de moins de 10 salariés ne sont pas concernées. Elles devraient même récupérer 160 millions du Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP).
La baisse sur les contrats de professionnalisation n’est pas avérée. En revanche, on peut s’inquiéter du financement des plans de formation pour la tranche de 10 à 300 salariés. Je rappelle néanmoins que le 1,6 % n’était pas entièrement mutualisé puisque le 0,9 % pouvait être dépensé directement par les entreprises.
Reste le débat sur le degré de mutualisation. Faut-il faire la réforme et atténuer avec le décret ? Ce sera au Gouvernement d’en décider. Je note que viennent se plaindre ceux qui bénéficiaient du dispositif, ou, pour être précis, ceux qui avaient compris comment récupérer l’argent de la formation à leur profit. Le système drainait partout mais n’arrosait que ceux qui formaient leur personnel. L’idée de la réforme est d’assurer une irrigation plus équitable, en laissant l’initiative au salarié lui-même. Nous faisons ce pari, quitte à voir ensuite s’il faut prendre des mesures pour éviter un effondrement des plans de formation dans les PME.
M. Gérard Cherpion. Il y a de toute façon un décalage d’un an entre la mise en application de la loi – 1er janvier 2015 – et la collecte, qui ne sera faite qu’en janvier 2016. Même s’il n’est pas avéré, le risque d’impasse existe bel et bien.
La Commission rejette l’amendement AS181.
Elle examine, en discussion commune, les amendements AS170 de M. Lionel Tardy et AS60 de Mme Jacqueline Fraysse.
M. Lionel Tardy. L’ANI prévoit une contribution « globale » pour les entreprises de 10 salariés et plus, au titre des dispositifs composant le système de formation professionnelle, de 1 % au lieu de 1,6 % dans le système actuel. Une telle réduction est d’autant plus surprenante que ce sont surtout les grandes entreprises, celles de plus de 300 salariés, qui pourront, par le biais des accords d’entreprise, s’exonérer du versement de 0,20 % au titre du CPF. Nous risquons donc voir des grandes entreprises dispensées de contribuer au financement mutualisé du plan de formation, du CPF, contrairement aux PME comptant entre 50 et 299 salariés. Il s’agit d’un accord en trompe-l’œil qui satisfait les entreprises de moins de 10 salariés défendues par l’UPA, et les plus de 300 salariés, la clientèle du MEDEF. Les autres ne trouvent pas leur compte dans cette réforme.
M. le rapporteur. Nous nous en tenons à l’ANI, mais nous aurons le débat en séance publique. L’exonération de 0,2 % est encadrée puisqu’elle est subordonnée à un accord d’entreprise, qui sera négocié avec les partenaires sociaux. Avis défavorable.
La Commission rejette successivement l’amendement AS170 et l’amendement AS60.
Elle examine ensuite l’amendement AS513 du rapporteur.
M. le rapporteur. Amendement de cohérence, destiné à aligner les bases de calcul des contributions de 0,2 % et de 0,8 %, en retenant les rémunérations versées pendant l’année civile.
La Commission adopte l’amendement.
Elle examine ensuite l’amendement AS171 de M. Lionel Tardy.
M. Lionel Tardy. Plus de 2 milliards d’euros sont mutualisés dans les OPCA au titre du plan de formation dans le cadre du régime actuel alors qu’une application stricte de l’ANI conduirait à collecter seulement 700 millions pour les entreprises de moins de 300 salariés, dont 400 millions pour les entreprises de 10 à 299 salariés. Cette baisse très forte des ressources allouées à ces dernières risque de nuire gravement à la formation et à la qualification de leurs personnels. Pour pallier ce danger, on pourrait transférer au plan de formation les sommes non dépensées au titre du compte personnel de formation au plan de formation.
M. le rapporteur. M. Tardy est cohérent, et sa position est conforme à celle d’une organisation patronale qui n’a pas signé l’ANI et qui s’inquiète de voir se tarir les fonds destinés aux OPCA et à la mutualisation. Vous proposez d’autoriser l’OPCA à basculer vers le plan la fraction du 0,2 % qui n’aura pas été dépensée dès la fin de l’année : je n’y suis pas favorable, car ceux qui n’adhèrent pas à la réforme pourraient être tentés alors de faire en sorte que le compte ne fonctionne pas.
Je vous proposerai aussi de sanctuariser les fonds du 0,2 %, mais de les faire remonter au FPSPP, de façon à mutualiser les excédents du CPF, voire à les destiner aux PME de 10 à 300 salariés. Nous répondrions ainsi à votre inquiétude. Je préfère privilégier la fongibilité au niveau national plutôt qu’à celui de l’OPCA.
M. Francis Vercamer. N’est-ce pas sur le FPSPP que le Gouvernement a pris l’habitude de prélever 300 millions chaque année pour financer tout autre chose ?
M. le rapporteur. Parlons-en ! C’était votre majorité. Elle a réussi à mettre en difficulté un fonds qu’elle avait créé ! Nous avons arrêté cette ponction.
M. Gérard Cherpion. La proposition du rapporteur pose problème puisque le FPSPP se charge de reverser les fonds aux entreprises de moins de 10 salariés. Comment ventilera-t-on entre les entreprises de moins de 10 salariés, et celles qui emploient 50 à 299 salariés ?
M. le rapporteur. Il est déjà prévu de rediriger 170 millions vers les TPE. Pourquoi ne pas imaginer un mécanisme analogue pour drainer les excédents du CPF les premières années ? Si le dispositif démarre lentement, on abondera ; sinon, cela signifiera que nous aurons réussi à individualiser la formation.
La Commission rejette l’amendement AS171.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement AS265 de M. Lionel Tardy.
Puis elle adopte l’article 4 modifié.
Article 5
(art. L. 6322-21, L. 6325-12, L. 6331-8, L. 6332-1, L. 6332-1-1, L. 6332-1-2, L. 6332-1-3 [nouveau], L. 6332-3, L. 6332-3-1, L. 6332-3-2 à L. 6332-3-6 [nouveaux], L. 6332-5, L. 6332-6, L. 6332-7, L. 6332-14, L. 6332-15, L. 6332-16-1 [nouveau], L. 6332-19 à L. 6332-22, L. 6332-22-2, L. 6333- 1 à L. 6333-8 [nouveaux], L. 6361-1, L. 6361-2, L. 6362-1, L. 6362-4 et L. 6362-11 du code du travail)
Amélioration de la mutualisation et du ciblage des financements de la formation professionnelle continue
L’article 5 modifie les dispositions applicables aux organismes de collecte et de mutualisation des fonds de la formation professionnelle continue afin d’adapter les missions de ces structures à la mise en place du compte personnel de formation et du conseil en évolution professionnelle et à l’instauration de la nouvelle contribution unique.
1. Les missions des organismes paritaires
Les organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA) voient leurs compétences en matière de collecte élargie à la part destinée à financer le congé individuel de formation (CIF) et en matière de taxe d’apprentissage. De nouvelles missions d’appui et de conseil en matière de formation professionnelle sont définies, notamment à destination des plus petites entreprises.
• L’approfondissement de la rénovation en cours
Aux alinéas 1 à 6, le I de l’article 5 ne modifie pas les dispositions de l’article L. 6332-1 relatives aux conditions d’agrément des OPCA : ceci atteste le fait que l’objectif principal de la réforme n’est pas de remettre en cause le réseau de collecte au titre de la formation professionnelle continue. Sa rationalisation nécessaire repose en effet sur la mise en œuvre de la loi n° n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l’orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie qui a prévu la baisse du nombre d’OPCA et une redéfinition de champs professionnels cohérents par structure.
Aussi, au regard du caractère récent de cette refonte et afin de ne pas déstabiliser les structures paritaires qui devront se consacrer notamment à la mise en œuvre du compte personnel de formation, les agréments déjà existants sont maintenus. En outre, les partenaires sociaux n’ont pas évoqué dans la négociation de l’accord national interprofessionnel (ANI) la question de l’évolution éventuelle du champ respectif des différents OPCA, au niveau des branches ou au plan interprofessionnel. Cependant, l’alinéa 3 établit que la contribution unique devient l’assiette du seuil de collecte (fixé à 100 millions d’euros par voir réglementaire) : cette modification aura mécaniquement un effet, à terme, sur le nombre d’OPCA éligibles.
L’alinéa 5 habilite en outre les OPCA à collecter les versements des entreprises donnant lieu à exonération de la taxe d’apprentissage, dans le cadre rapprochement avec le réseau des OCTA décrit par votre rapporteur à son commentaire de l’article 9 du présent projet de loi. Celle-ci est illustrée par le XII qui précise à l’article L. 6332-15 que les OPCA peuvent prendre en charge, dans la limite de plafonds mensuels et de durées maximales déterminés par décret, non seulement les coûts liés à l’exercice de la fonction tutorale engagés par les entreprises pour les salariés bénéficiaires de contrats de professionnalisation ou de périodes de professionnalisation mais également « les dépenses engagées par l’entreprise pour la formation pédagogique des maîtres d’apprentissage ». De même l’alinéa 9 établit, au 2° du II de l’article L. 6332-1 que les OPCA sont désormais également compétents pour collecter les fonds dus au titre du congé individuel de formation, actuellement collectés par les seuls OPACIF.
À l’approfondissement de la réforme des réseaux de collecte s’ajoute la rénovation des règles de gestion. Aux alinéas 54 à 59, le VIII modifie l’article L. 6332-6 afin de préciser les règles d’établissement des frais de gestion des OPCA. L’actuel plafond de dépenses composé d’une part fixe exprimée en pourcentage de la collecte et d’une part variable déterminée, pour chaque OPCA, par une convention d’objectifs et de gestion, est remplacé, au 7° de cet article, par une négociation globale dans le cadre de cette convention.
Il s’agit donc de tirer pleinement parti de l’instrument de la convention d’objectifs et de gestion (COM), instituée par la loi du 24 novembre 2009, qui a substitué au plafond réglementaire précédemment applicable de façon identique à l’ensemble des organismes un mécanisme individualisé de conventionnement avec l’État permettant de tenir compte de leurs spécificités et de leurs performances de gestion.
Votre rapporteur considère que la mise en œuvre des COM, par l’appréhension objectivée de l’activité des organismes qu’elle implique, a eu indéniablement des effets positifs. Toutefois il conviendra de modifier les textes réglementaires actuels afin de prendre en compte les nouvelles missions posées par le projet de loi, en particulier le déploiement du compte personnel de formation, et de simplifier sa mise en œuvre.
Enfin, l’alinéa 15 dispose que l’OPCA n’assure aucun financement direct ou indirect des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs. Il peut seulement rembourser, sur présentation de justificatifs, les frais de déplacement, de séjour et de restauration engagés par les personnes qui siègent au sein de l’organe de direction.
• La mise en œuvre du compte personnel de formation
Aux alinéas 7 à 14, sont listées l’ensemble des obligations de financement mises à la charge des OPCA, et au titre desquelles elles peuvent collecter la contribution unique : les formations financées par le compte personnel de formation y figurent, au côté des formations relevant du plan de formation, du congé individuel de formation, des périodes de professionnalisation, du contrat de professionnalisation et enfin de la préparation opérationnelle à l’emploi.
Aux alinéas 68 à 72, le XIII insère, en miroir, un nouvel article L. 6332-16-1 qui ajoute à la liste des dépenses à la prise en charge desquelles peuvent concourir les OPCA, les « coûts de la formation liés à la mise en œuvre du compte personnel de formation ». Elles s’ajoutent aux autres dépenses déjà existantes à savoir, les coûts de formation liés à la mise en œuvre des périodes de professionnalisation et tout ou partie des coûts pédagogiques et des frais annexes de la formation dans le cadre de la préparation opérationnelle à l’emploi.
Aussi, à l’alinéa 65, le X modifie l’intitulé de la section 3 applicable aux OPCA effectivement amenées à financer le compte personnel de formation : elle vise actuellement les « organismes agréés au titre de la professionnalisation et du droit individuel de formation » et recouvre désormais les « organismes collecteurs paritaires agréés pour la prise en charge de la professionnalisation et du compte personnel de formation ». Par coordination, le XI, à l’alinéa 66 supprime la référence au DIF à l’article L. 6332-14.
• La mutualisation des composantes de la contribution obligatoire
Aux alinéas 27 à 42, les IV, V et VI modifient les articles L. 6332-3 et L. 6332-3-1 et ajoutent un article L. 6332-3-2 (nouveau) afin de réformer les modalités de mutualisation des sommes collectées.
Sont abrogées les dispositions de l’article L. 6332-3-1 qui rendent possible une mutualisation limitée du plan de formation des entreprises de 50 salariés et plus vers le plan des entreprises de dix à moins de cinquante salariés ainsi que vers le plan des entreprises de moins de dix salariés, de même qu’une mutualisation du plan de formation des entreprises de dix à moins de cinquante salariés vers le plan des entreprises de moins de dix salariés prévue à l’article L. 6332-3.
Les nouvelles dispositions élargissent le champ de la mutualisation.
L’article L. 6332-3 prévoit que la contribution unique est répartie au sein de différentes sections relatives aux différents objets du financement : le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels ; le congé individuel de formation ; le compte personnel de formation ; les actions de professionnalisation ; le plan de formation.
L’article L. 6332-3-2 prévoit que les versements reçus par l’OPCA sont mutualisés dès leur réception dans ces différentes sections, sauf pour ce qui concerne le plan de formation. Aussi, quelle que soit la taille de l’entreprise contributrice, les financements au titre du Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP), du CIF, du CPF et des actions de professionnalisations sont mutualisés dans les mêmes sections.
Les versements dédiés au financement du plan de formation sont mutualisés au sein de sous-sections définies à l’article L. 6332-3-1 qui, dans sa nouvelle rédaction, pose le principe d’une répartition en quatre sous-sections regroupant respectivement les sommes versées par les employeurs de moins de dix salariés, ceux de dix à moins de cinquante salariés, ceux de cinquante à moins de trois cents salariés, et, le cas échéant, ceux d’au moins trois cents salariés, pour lesquels la contribution au titre du plan n’est plus obligatoire.
À l’alinéa 42, l’article L. 6332-3-2 établit le mécanisme de redistribution spécifique des financements du plan vers les entreprises de moins de cinquante salariés en prévoyant que l’OPCA peut affecter des versements des employeurs de cinquante salariés et plus au financement des plans de formation présentés par les employeurs de moins de cinquante salariés adhérant à l’organisme.
• Les contributions volontaires et les nouvelles missions de conseil
En application des souhaits émis par les partenaires sociaux au titre VI de l’accord national interprofessionnel (ANI), aux alinéas 23 à 26, l’article L. 6332-1-2 établit la capacité des OPCA à collecter des contributions supplémentaires ayant pour objet le développement de la formation continue.
Elles peuvent être versées en application d’un accord professionnel national conclu entre les organisations représentatives d’employeurs et de salariés : elles sont alors mutualisées dès réception par l’organisme.
Le projet de loi a ainsi retranscrit les stipulations de l’article 36 de l’ANI qui prévoient des accords de branches, porteurs d’une politique paritaire adaptée aux besoins spécifiques de leurs entreprises.
Ces contributions peuvent également être versées sur une base volontaire par l’entreprise.
La part volontaire ou conventionnelle des contributions des entreprises représente aujourd’hui une part non négligeable des ressources des OPCA, particulièrement en ce qui concerne le plan de formation. Ainsi, selon les secteurs et les branches, pour les entreprises de moins de 50 salariés, la part volontaire et conventionnelle qui est versée aux OPCA au titre du plan peut représenter jusqu’à 80 % de leur contribution, la moyenne s’établissant à 40 %. Pour les entreprises de plus de 50 salariés, la part moyenne volontaire et conventionnelle qui est versée aux OPCA au titre du plan de formation représente environ 65 % de l’ensemble des contributions.
Il est précisé à l’alinéa 26 que ces contributions font l’objet d’un suivi comptable distinct : ceci permet de distinguer les interventions de l’OPCA qui peuvent entrer dans le champ concurrentiel et atteste que l’entreprise peut verser ses contributions volontaires à n’importe quel OPCA.
Elles visent à permettre aux OPCA de remplir de nouvelles missions. En effet, aux alinéas 17 à 22, le II enrichit la liste des missions des OPCA qui figurait à l’article L. 6332-1-1.
Outre la contribution au développement de l’apprentissage, précisé à l’alinéa 18, suite au rapprochement du réseau des OPCA et des OCTA, l’alinéa 20 confie aux OPCA la mission nouvelle de « s’assurer de la qualité des formations dispensées ». L’alinéa 21 précise que le que « service de proximité au bénéfice des très petites, petites et moyennes entreprises et des entreprises du milieu agricole et rural », déjà défini comme une mission des OPCA à l’article L. 6332-1-1, doit en particulier permettre « d’améliorer l’information et l’accès des salariés de ces entreprises à la formation professionnelle ». Il s’agit d’une transposition de l’article 8 de l’ANI qui donne comme exemple la « diffusion de tous outils nécessaires à la réalisation des entretiens professionnels », créé par l’article 2 du présent projet de loi, ou encore « les informations sur les droits et dispositifs de formation ».
Les dispositions de l’article L. 6332-1-2 dans sa rédaction actuelle, qui prévoient que le FPSPP « établit et publie une charte des bonnes pratiques pour les organismes collecteurs paritaires agréés et les entreprises » sont maintenues mais figurent dans un article L. 6332-1-3, nouveau.
Par coordination, le IX, aux alinéas 60 à 64, étend les modifications applicables aux OPCA aux fonds d’assurance formation des salariés (FAF), organismes paritaires collecteurs hérités des premiers accords de mutualisation des fonds de la formation professionnelle entre entreprises et visés spécifiquement à l’article L. 6332-7.
• L’évolution des organismes paritaires agréés au titre du CIF
Aux alinéas 99 à 121, le XX du présent article insère un chapitre spécifique relatif aux organismes paritaires agréés pour la prise en charge du congé individuel de formation. Ils perdent leur compétence de collecte de la contribution due au titre du CIF, désormais composante de la contribution unique prélevée par les OPCA mais leurs compétences en matière d’attribution des formations au titre du CIF et d’accompagnement de salariés et demandeurs d’emploi qui ont été titulaires d’un contrat à durée déterminée sont précisées.
L’article L. 6333-1, nouveau, prévoit les conditions de l’agrément et renvoie aux conditions applicables aux OPCA, à savoir la capacité financière et la performance de gestion, la cohérence du champ d’intervention géographique et professionnel ou interprofessionnel, le mode de gestion paritaire, l’aptitude à assurer leur mission compte tenu de leurs moyens, l’aptitude à assurer des services de proximité au bénéfice des très petites, petites et moyennes entreprises et l’application d’engagements relatifs à la transparence de la gouvernance, à la publicité des comptes.
L’article L. 6333-2, nouveau, a pour objet de permettre aux OPCA étant également agréés au titre du CIF (28) ainsi qu’aux deux AGECIF (29) de pouvoir continuer à gérer le CIF.
L’article L. 6333-3, nouveau, rappelle les missions des OPACIF et prévoit qu’ils délivrent un conseil en évolution professionnelle et accompagnent les salariés et les demandeurs d’emploi dans leur projet professionnel lorsque celui-ci nécessite la réalisation d’une action de formation, d’un bilan de compétence ou d’une validation des acquis de l’expérience : il s’agit de la reconnaissance par la loi d’un rôle développé de longue date par le réseau des Fongecif et qui les place au premier rang, au côté de Pôle emploi, pour la mise en œuvre du conseil en évolution professionnelle. De même les OPACIF financent les actions organisées dans le cadre du congé individuel de formation, en lien, le cas échéant, avec la mobilisation du compte personnel de formation ; et, de la même façon que les OPCA, ils s’assurent de la qualité des formations financées.
En conséquence, l’article L. 6333-4, nouveau, liste limitativement les dépenses que les OPACIF peuvent engager : dépenses d’information des salariés sur le CIF, dépenses relatives au conseil en évolution professionnelle, rémunérations des salariés durant leur congé individuel de formation etc. De la même façon que pour les OPCA, l’alinéa 116 précise que les OPACIF n’assurent aucun financement direct ou indirect des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs.
L’article L. 6333-5, nouveau, prévoit que les OPACIF perçoivent le pourcentage de la contribution unique qui leur est destinée par le biais d’un versement des OPCA. Pour mémoire, les OPACIF continueront également de bénéficier du 1 % CIF-CDD prélevé également par les OPCA : modifié par le I de l’article 4 du présent projet de loi, l’article L. 6322-37 prévoit désormais que les sommes sont collectées par les OPCA et sont reversées dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État.
L’article L. 6333-6, nouveau, prévoit que les frais de gestion des OPACIF sont définis par des conventions d’objectifs et de moyens, à l’image des OPCA et les articles L. 6333-7 et L. 6333-8, nouveaux, appliquent aux OPACIF les mêmes règles que pour les OPCA en matière d’incompatibilité de fonction des administrateurs ainsi que pour le remboursement des fonds employés en méconnaissance des missions légales.
2. Le nouveau fléchage des financements
Aux alinéas 43 à 52, le présent article définit la répartition des financements tirés de la contribution unique créée à l’article 4.
Il revient à la loi de définir les parts de la contribution collectée par les OPCA qui sont reversées à des organismes extérieurs : il s’agit donc des parts dues au titre du CIF et du financement du FPSPP.
Pour les employeurs de plus de 50 salariés, l’article L. 6332-3-3, nouveau, prévoit que ces deux contributions représentent chacune 0,2 % de la masse salariale. Pour les employeurs de 10 à 49 salariés, l’article L. 6332-3-4, nouveau, fixe ces taux à 0,15 % de la masse salariale. Aux alinéas 46 et 50, chacun de ces deux articles renvoie à un décret la définition des modalités de gestion directe par l’OPCA du financement des actions de professionnalisation, du plan de formation et du compte personnel de formation. Pour les entreprises de moins de dix salariés, l’article L. 6332-3-5, nouveau, prévoit que la contribution est gérée directement pour financer les actions de professionnalisation et le plan de formation : ces entreprises sont donc exonérées de contributions au titre du CIF et du FPSPP ; en outre les OPCA ne sont pas amenées à prélever sur les contributions de ces entreprises les financements qu’elles consacrent à leurs salariés au titre du CPF. Enfin, l’article L. 6332-3-6, nouveau, prévoit qu’un décret en Conseil d’État définit la répartition des sommes gérées directement par l’OPCA pour financer les actions de professionnalisation, le plan de formation et le CPF.
Ces différentes dispositions se traduisent par les taux figurant dans le tableau ci-après.
LA RÉPARTITION DE LA CONTRIBUTION UNIQUE
1 à 9 salariés |
10 à 49 salariés |
50 à 299 salariés |
Plus de 300 salariés |
Norme définissant le taux | |
Contribution unique |
0,55 |
1 |
1 |
1 |
loi |
décomposition : |
|||||
Plan de formation |
0,4 |
0,2 |
0,1 |
0 |
décret |
Professionnalisation |
0,15 |
0,3 |
0,3 |
0,4 |
décret |
CIF |
0 |
0,15 |
0,2 |
0,2 |
loi |
FPSPP |
0 |
0,15 |
0,2 |
0,2 |
loi |
CPF |
0 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
décret |
Le tableau ci-après permet de constater que si le périmètre des montants directement gérés par les OPCA, au titre des financements obligatoires est réduit, passant de 6,3 milliards d’euros à 4,8 milliards d’euros, la part des financements fléchés vers des dispositifs orientés vers la qualification ou la redistribution en fonction de la taille des entreprises augmente, à l’exemple du financement dédié du CPF et de la dotation pour le CIF.
L’ÉVOLUTION DU PÉRIMÈTRE DES FINANCEMENTS OBLIGATOIRES
(en millions d’euros)
Montants actuels |
Nouveaux montants | |
3 700 |
630 | |
Professionnalisation |
1 900 |
1 700 |
Dotation CIF |
700 |
835 |
Prélèvement du FPSPP |
-836 |
– |
CPF |
0 |
886 |
Dotation FPSPP |
890 |
835 |
Total |
6 354 |
4 886 |
Source : DGFPE.
Enfin, par coordination, à l’alinéa 53, le VII abroge l’article L. 6332-5 relatif au reversement au Trésor public en cas d’emploi de fonds irréguliers mais applicable aux anciennes contributions.
3. Le Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP)
Le Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels a été créé par la loi du 24 novembre 2009 afin de financer l’accès à la formation professionnelle des salariés et des demandeurs d’emploi les plus fragilisés à l’égard de l’emploi. À l’article 39 de l’ANI, les partenaires sociaux ont identifié le Fonds comme l’outil d’une politique conduite au niveau national et interprofessionnel : ils ont souhaité que ses financements soient pérennes pour permettre de conduire des politiques dans la durée.
Les ressources du fonds sont aujourd’hui de deux ordres. Le FPSPP reçoit chaque année de la part des OPCA les excédents dégagés sur la collecte réalisée au titre du CIF, du DIF et de la professionnalisation. D’autre part, le FPSPP perçoit un prélèvement, effectué par les OPCA, sur la participation des entreprises à la formation professionnelle continue. Le taux de prélèvement, qui doit être compris entre 5 % et 13 %, est déterminé chaque année par arrêté ministériel. En 2013, ce taux a été fixé à 13 %. Par ailleurs, le financement du FPSPP a, à plusieurs reprises, été fragilisé par des prélèvements opérés par l’État, pratique avec laquelle a rompu le Gouvernement en 2012.
Le FPSPP contribue, via des appels à projets, au financement d’actions de formation concourant à la qualification et à la requalification des publics prioritaires définis par une convention-cadre signée avec l’État. Il assure de plus la péréquation des fonds de la formation professionnelle continue en opérant des transferts de disponibilités entre les OPCA afin de permettre la prise en charge par ces derniers des actions de formation s’inscrivant dans le cadre de la portabilité du DIF, des CIF ou des contrats et périodes de professionnalisation. Enfin, le FPSPP participe au financement du service dématérialisé d’information et d’orientation.
Les alinéas 73 à 97 pérennisent les ressources du FPSPP et comportent les dispositions lui permettant de jouer pleinement son rôle en matière de mutualisation des financements et de déploiement du compte personnel de formation.
Le XIV modifie l’article L. 6332-19 afin de remplacer, à l’alinéa 75, les sources actuelles de financements par le pourcentage de la contribution obligatoire défini par la loi – l’alinéa 81 précise que la somme est versée par chaque OPCA – ; à l’alinéa 77, cette ressource est complétée par les excédents dégagés par les OPCA sur la collecte de l’ensemble de la contribution, en tant qu’ils excèdent, au 31 décembre de chaque année, le tiers des charges comptabilisées au cours du dernier exercice clos. Par coordination, les dispositions de l’article L. 6332-20 relatives aux anciens prélèvements sur les excédents de collecte sont abrogées.
Le XV modifie l’article L. 6332-21 afin de compléter la définition des missions du FPSPP. Il maintient la mission actuelle, figurant au 1° de cet article, de « contribuer au financement d’actions de formation professionnelle concourant à la qualification et à la requalification des salariés et demandeurs d’emploi, au bénéfice de publics dont les caractéristiques sont déterminées par la convention-cadre ». Au 2° de l’article L. 6332-21, l’alinéa 85 confirme la mission de péréquation des fonds par des versements complémentaires OPCA pour le financement de formations organisées dans le cadre des contrats de professionnalisation.
L’alinéa 87, ajoute la mission consistant à « contribuer au développement de systèmes d’information concourant au développement de la formation professionnelle ». Ceci pourrait notamment recouvrer les coûts de fonctionnement du système d’information du compte personnel de formation.
L’alinéa 89 ajoute un 4° à l’article L. 6332-21 afin de prévoir que les ressources du FPSPP permettent de financer les heures acquises et mobilisées au titre du compte personnel de formation, soit en cas de mobilisation conjointe d’un CIF, soit pour financer la formation des demandeurs d’emploi. Conformément à l’article L. 6323-22, modifié par l’article premier du présent projet de loi, cette prise en charge recouvre « les frais pédagogiques et les frais annexes afférents à la formation du demandeur d’emploi qui mobiliser son compte personnel ».
L’alinéa 90 ajoute un 5° à cet article qui vise à contribuer au développement de la formation des salariés des entreprises de moins de dix salariés organisée dans le cadre du plan de formation par des versements complémentaires aux organismes collecteurs paritaires agréés, calculés en fonction de la part de ces entreprises parmi les adhérents de l’organisme. Envisagée par l’article 40 de l’ANI, cette mutualisation interprofessionnelle conduite par le FPSPP et spécifiquement affectée au plan de formation des entreprises de moins de 10 salariés est une contribution essentielle pour la montée en qualification des salariés des très petites entreprises. Elle représentera 20 % des dépenses. Le tableau ci-dessous illustre la portée de cette dépense nouvelle en faveur des plus petites entreprises.
Dispositions actuelles |
Mise en œuvre du projet de loi (FPSPP) | |
Montant des ressources supplémentaires pour le financement d’actions de formation au titre du plan pour les entreprises de moins de 10 salariés |
4 071 000 euros (fongibilité descendante) |
168 000 000 euros (minimum) |
Enfin, dans le but d’améliorer la prise en compte de l’alternance, le XVII modifie l’article L. 6332-22 relatif à la péréquation des fonds consacrés à la professionnalisation afin de subordonner les versements du FPSPP à ce que l’OPCA affecte au moins 50 % des fonds recueillis à ce titre non seulement aux contrats de professionnalisation mais également « au financement des dépenses de fonctionnement des centres de formation des apprentis ». Ceci concrétise le souhait manifesté par les partenaires sociaux à l’article 41 de l’ANI de prise en compte de l’alternance dans son ensemble.
Le XVIII opère les modifications de coordination à l’article L. 6332-22-2 qui comporte les dispositions réglementaires d’application.
Enfin, aux alinéas 122 à 126, les paragraphes XXI à XXV opèrent des modifications rédactionnelles ou de coordination rendues nécessaires par la suppression du DIF ou par l’élargissement du champ de la collecte des OPCA : ils englobent les articles L. 6322-21 relatifs à la demande de prise en charge de la rémunération du salarié bénéficiaire du CIF, L. 6325-12, relatif à la durée des actions de professionnalisation, ainsi que les articles L. 6331-8, L. 6361-1, L. 6362-4, L. 6362-11, L. 6361-2 et L. 6362-1 relatifs au contrôle de la formation professionnelle continue.
Aux alinéas 127 à 130, les paragraphes XXVI et XXVII comportent les dispositions de transition. L’entrée en vigueur des dispositions du présent article est fixée au 1er janvier 2015. La prise en compte des effets sur l’agrément des OPCA et des FAF de l’incidence de la modification du niveau des contributions, susceptible de faire passer certains organismes en dessous du seuil minimal de collecte, est, elle, repoussée au 31 décembre 2015. Il est enfin précisé que la collecte en cours pendant l’année 2014 s’effectue bien selon les règles actuellement en vigueur.
*
* *
Lors de son examen du texte du projet de loi, outre un amendement de rectification, présenté par le rapporteur, votre commission des affaires sociales a adopté les principales modifications suivantes.
Sur proposition du rapporteur, la commission a confirmé le rôle d’animation du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP) à l’égard du réseau des FONGECIF, en prévoyant, à l’article L.6332-1-3, que la charte des bonnes pratiques qu’il publie est applicable à ces organismes paritaires.
Sur proposition du rapporteur, la commission a institué un prélèvement annuel des sommes dont disposent les OPCA pour financer le compte personnel de formation et qui ne trouveraient pas d’utilisation : ces financements seront destinés au FPSPP afin de permettre la mutualisation de leur emploi.
Sur proposition de Mme Monique Iborra et des commissaires du groupe SRC, sur avis favorable du rapporteur, la commission a prévu que tous les deux ans, le FPSPP remette un rapport d’activité au Parlement, qui précise la nature et le type d’actions menées en matière de formation professionnelle des demandeurs d’emploi.
Enfin, sur proposition de M. Gérard Cherpion, sur avis favorable du rapporteur, la commission a précisé, à l’article L. 6332-22, les règles d’emploi des fonds recueillis par l’OPCA au titre de la professionnalisation pour bénéficier des versements complémentaires du FPSPP au titre de la péréquation du financement des contrats de professionnalisation. Si le projet de loi a prévu que ces fonds peuvent être consacrés à la fois aux contrats de professionnalisation et aux dépenses de fonctionnement des centres de formation des apprentis, et si l’article L. 6332-22 subordonne dès lors la péréquation au fait que l’OPCA affecte au moins 50% des fonds à ces deux emplois, la commission a précisé que, dans ce cadre, l’OPCA doit avoir financé « majoritairement » des contrats de professionnalisation. Il s’agit donc de réserver la péréquation des fonds aux OPCA qui financent en premier lieu des contrats de professionnalisation.
*
* *
La Commission examine l’amendement AS512 du rapporteur.
M. le rapporteur. Il s’agit de conserver au FPSPP son rôle d’animation du réseau des FONGECIF.
La Commission adopte l’amendement.
Elle examine ensuite l’amendement AS23 de M. Gérard Cherpion.
M. Gérard Cherpion. Les partenaires sociaux ont voulu favoriser l’accès des titulaires de CPF à des formations de qualité. La définition très concrète qu’ils en donnent dans l’ANI devra être reprise, afin d’orienter l’action des OPCA.
M. le rapporteur. La qualité de la formation relève des OPCA. De plus, le CNEFOP procédera à une évaluation globale. Cela devrait suffire.
La Commission rejette l’amendement.
Elle en vient à l’amendement AS24 de M. Gérard Cherpion.
M. Gérard Cherpion. Je propose que les conditions d’utilisation des contributions volontaires supplémentaires que les entreprises peuvent verser aux OPCA soient précisées dans l’accord constitutif de ces organismes.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.
Puis elle examine l’amendement AS25 de M. Gérard Cherpion.
M. Gérard Cherpion. S’agissant du financement du plan de formation, nous proposons de maintenir la section pour les TPE de moins de 10 salariés afin de sanctuariser leurs ressources, mais de fusionner les trois autres au regard des très faibles montants en jeu.
M. le rapporteur. Défavorable. Il est déjà prévu un mécanisme de fongibilité au profit des moins de 10 salariés. Ce que vous proposez n’est pas conforme à l’ANI.
La Commission rejette l’amendement.
La Commission est saisie de l’amendement AS519 du rapporteur.
M. le rapporteur. Il s’agit de faire remonter au Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP) les éventuels excédents dont pourraient disposer les organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA) au titre du 0,2 % dédié au CPF. Un amendement miroir précisera cette disposition. Un troisième amendement reste à rédiger pour indiquer comment ces fonds redescendront. Ce dispositif pourrait être ciblé sur les PME.
M. Gérard Cherpion. Les fonds resteront-ils bien fléchés dans une sous-section du FPSPP ?
M. le rapporteur. L’amendement tend en effet à garantir que le financement issu du 0,2 % reste dédié au CPF. Il ne s’agit donc pas de créer une fongibilité au niveau de l’OPCA. Cette innovation devrait apaiser les craintes de M. Tardy.
La Commission adopte cet amendement.
Elle est saisie de l’amendement AS526 du rapporteur.
M. le rapporteur. C’est l’amendement miroir que je viens d’annoncer. Il vise à préciser que le FPSPP peut recevoir l’excédent évoqué par l’amendement précédent.
La Commission adopte cet amendement.
Puis elle est saisie de l’amendement AS242 de M. Christophe Cavard.
M. Christophe Cavard. Fixer au 31 mars la date de reversement de l’éventuel excédent au FPSPP, permettra les décaissements liés aux activités de formation financées au titre de l’année précédente.
M. le rapporteur. Bien que cette demande soit récurrente, elle n’est pas formulée – tant s’en faut – par tous les OPCA. Il semble préférable de ne pas modifier la date de calcul des excédents et de la maintenir au 31 décembre. Le texte prévoit en outre de retenir 2015 comme année de référence, même si nous savons que ce point n’est pas encore totalement sécurisé.
M. Gérard Cherpion. Les OPCA ne pourront pas payer les actions engagées si l’argent est déjà remonté au FPSPP.
M. Christophe Cavard. Je maintiens cet amendement car, si certains OPCA, notamment interprofessionnels, peuvent bénéficier de retours du Fonds, d’autres, notamment dans le domaine de l’économie sociale et solidaire, ne sont pas certains de pouvoir y compter.
La Commission rejette cet amendement.
Elle examine l’amendement AS26 de M. Gérard Cherpion.
M. Gérard Cherpion. Je propose de rétablir les dispositions de l’article 42 de l’accord national interprofessionnel du 14 décembre 2013, qui prévoit d’augmenter les ressources de formation des très petites entreprises (TPE) en leur affectant 20 % des ressources du FPSPP. Il prévoit également la répartition de ces 20 % entre les OPCA en fonction du poids des entreprises de moins de dix salariés parmi les entreprises cotisantes à l’OPCA et par rapport à la totalité des entreprises cotisantes de moins de dix salariés.
M. le rapporteur. Avis défavorable. Cet amendement est satisfait par le projet de loi.
La Commission rejette cet amendement.
Elle examine ensuite l’amendement AS298 de Mme Monique Iborra.
M. Denys Robiliard. Nous demandons un rapport biennal du FPSPP au Parlement sur les actions menées en matière de formation professionnelle des demandeurs d’emploi.
M. le rapporteur. Avis favorable.
La Commission adopte cet amendement.
Puis elle est saisie de l’amendement AS27 de M. Gérard Cherpion.
M. Gérard Cherpion. Le respect du principe de péréquation inscrit dans le code du travail exige qu’un OPCA engage un montant minimum au titre des contrats de professionnalisation sur ses fonds propres pour des dépenses éligibles, avant de pouvoir bénéficier de fonds complémentaires.
M. le rapporteur. Avis favorable.
La Commission adopte cet amendement.
Elle adopte ensuite l’amendement de correction AS515 du rapporteur.
Elle adopte enfin l’article 5 modifié.
La Commission est saisie de l’amendement AS199 de M. Pierre Morange.
M. Gérard Cherpion. L’amendement reprend les conclusions du rapport d’évaluation du CEC sur la formation professionnelle, qui étudiait l’impact d’un transfert aux Urssaf de la collecte des contributions des entreprises au titre de la formation professionnelle continue, actuellement assumée par les OPCA. Cette réforme, préconisée par la Cour des comptes dans son rapport de 2008, pourrait permettre de renforcer l’efficacité de la collecte.
M. le rapporteur. Il n’y a pas lieu de déstabiliser un dispositif que nous venons de mettre en place. Avis défavorable.
La Commission rejette cet amendement.
Chapitre II
Apprentissage et autres mesures en faveur de l’emploi
Article 6
(Art. L. 6211-3, L. 6232-1, L. 6232-2, L. 6232-6 à L. 6232-8, L. 6241-10,
L. 6252-1 du code du travail)
Renforcement des compétences des régions en matière d’apprentissage
L’ensemble des acteurs de service public de l’emploi reconnaissent aujourd’hui la nécessité de simplifier la gouvernance de la politique de l’apprentissage en accordant une compétence pleine et entière aux régions. À titre d’exemple, le rapport du comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques sur l’évaluation des politiques publiques en faveur de la mobilité sociale des jeunes (30) constate : « la grande complexité des circuits de financement, la multiplicité des acteurs ne contribuent pas à faciliter [le] développement [de l’apprentissage]. La réelle reconnaissance du rôle de la région en matière de financement serait certainement source de simplification et d’une plus grande efficience. »
Le présent article a pour objet de renforcer les compétences des régions en matière d’apprentissage :
– en renforçant leur rôle dans l’élaboration des contrats d’objectifs et de moyens pour le développement de l’apprentissage afin de les doter d’un outil de pilotage ;
– et en achevant la décentralisation complète des centres de formation des apprentis.
Cette réforme poursuit le même objectif que la réforme de la taxe d’apprentissage initiée par l’article 60 de la loi de finances rectificatives pour 2013 (31) et qui renforce le rôle des régions dans le pilotage des fonds dédiés au financement de l’apprentissage.
A. LE DROIT EXISTANT
Les contrats d’objectifs et de moyens, créés par l’article 32 de la loi du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale (32), ont accompagné le développement de l’apprentissage depuis 2005. En vertu de l’article L. 6211-3 du code du travail, ces contrats sont conclus entre l’État, la région, les chambres consulaires et une ou plusieurs organisations représentatives d’employeurs et de salariés, d’autres parties pouvant également être associées en tant que de besoin.
Ces contrats financent des opérations de construction et de rénovation de centres de formation d’apprentis (CFA), ainsi que des dépenses de fonctionnement liées à l’ouverture de places nouvelles. Ils peuvent également être utilisés pour améliorer les conditions de vie des apprentis, comme la création de logements et l’octroi d’aides au transport, à la restauration ou à l’hébergement.
La contribution financière de l’État à ces contrats est assuré par le fonds de modernisation et de développement de l’apprentissage (FNDMA) devenu le compte d’affectation spéciale « Financement national du développement et de la modernisation de l’apprentissage » depuis la loi de finances rectificative du 29 juillet 2011 (33) auquel est affecté une fraction de 22 % de la collecte de la taxe d’apprentissage.
La première génération de contrats d’objectifs et de moyens (COM) 2005-2010 a représenté un engagement financier de l’État de 1,4 milliard d’euros. Cependant, comme l’a montré notamment un bilan de l’Inspection générale des affaires sociales sur ces contrats (34), le pilotage de la première génération de COM fait apparaître un ciblage insuffisant des crédits, des indicateurs de pilotage imparfaits, des actions qualitatives aux résultats difficilement mesurables et un effet de levier très aléatoire sur les dépenses des régions.
Une deuxième génération de COM a été conclue en 2011, portant sur la période 2011-2015, avec un engagement de l’État portant sur 1,7 milliard d’euros, soit une moyenne de 340 millions d’euros annuels.
De nouvelles modalités de contractualisation ont été adoptées : le déploiement de ces fonds s’effectue selon le principe 1 euro investi par l’État
– 1 euro investi par les régions et ces contrats, – qui doivent être conclus en cohérence avec les orientations des contrats de plans régionaux pour le développement de la formation professionnelle (CPRDFP) – doivent privilégier les opérations d’investissement. Afin de permettre une utilisation plus efficiente des crédits, cette nouvelle génération de COM détermine une enveloppe plafond pluriannuelle, répartie en enveloppes annuelles plafond par région permettant ainsi aux différents partenaires de gérer leur action avec une plus grande visibilité quant aux financements disponibles. Dans le cadre de ces contrats, les vingt-six régions se sont engagées à atteindre un objectif national de 580 000 apprentis en 2015.
La répartition des crédits par région est détaillée dans le tableau suivant :
CRÉDITS VERSÉS AUX RÉGIONS DANS LE CADRE DES COM
(en millions d’euros)
Crédits versés dans le cadre COM 2011 |
Crédits versés dans le cadre COM 2012 |
Enveloppes plafond 2013 inscrites dans les COM | |
Alsace |
9 |
9 |
9 |
Aquitaine |
11,36 |
14,428 |
13,6 |
Auvergne |
4,5 |
6,5 |
9 |
Basse-Normandie |
4,05 |
6,8 |
9,45 |
Bourgogne |
7,5 |
6,284 |
7,5 |
Bretagne |
7 |
14,5 |
14,5 |
Centre |
11,83 |
12,93 |
13,18 |
Champagne-Ardenne |
6 |
6 |
6 |
Corse |
1 |
1 |
1 |
Franche-Comté |
5,43 |
5,033 |
5 |
Haute-Normandie |
4,5 |
8 |
9,25 |
Ile-De-France |
65 |
70 |
65 |
Languedoc-Roussillon |
7,5 |
7,79 |
15 |
Limousin |
6 |
6 |
6 |
Lorraine |
14 |
14 |
14 |
Midi-Pyrénées |
8,2 |
10,68 |
9,61 |
Nord-Pas-de-Calais |
30,55 |
26,62 |
30,3 |
Pays De La Loire |
19,5 |
21 |
19,5 |
Picardie |
7,07 |
9,81 |
10,79 |
Poitou-Charentes |
13,69 |
10,84 |
13,69 |
Provence-Alpes-Côte d’Azur |
20,57 |
20,57 |
20,57 |
Rhône-Alpes |
35,2 |
39,76 |
40,7 |
Guadeloupe |
1,17 |
– |
1,17 |
Guyane |
0,61 |
– |
0,6 |
Martinique |
0,05 |
1,33 |
1,34 |
Réunion |
1,86 |
2 |
2 |
Total |
302,53 |
330,88 |
347,75 |
B. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
Le I de article 6 du projet de loi propose de tirer les conséquences de la pleine responsabilité de la région en matière d’apprentissage et de l’affection directe aux régions des ressources financières correspondantes en mettant fin aux contrats d’objectifs et de moyens conclus entre l’État et les régions.
Dans la nouvelle rédaction proposée, l’article L. 6211-3 du code du travail dispose que la région pourra élaborer des contrats d’objectifs et de moyens avec l’État, les organismes consulaires et les organisations représentatives d’employeurs et de salariés. Ces contrats ne reposeront donc plus sur un cofinancement État-région.
Le V du présent article du projet de loi précise néanmoins que l’actuelle génération de contrats d’objectifs et de moyens se poursuivra jusqu’à son terme c’est-à-dire jusqu’au 31 décembre 2014.
II. TRANSFÉRER AUX RÉGIONS LES CENTRES DE FORMATION DES APPRENTIS NATIONAUX
L’article 6 a aussi pour objet d’achever le mouvement de régionalisation des centres de formation des apprentis engagé, dès 2007, par le ministère de l’éducation nationale. Ainsi, les CFA à recrutement national seraient transférés aux régions et ces dernières disposeraient de la compétence pleine et entière en matière d’apprentissage puisqu’elles seraient les seules à pouvoir créer un CFA.
En vertu de l’article L. 6232-1 du code du travail, la création de centres de formation d’apprentis fait l’objet de conventions conclues entre les conseils régionaux et des partenaires tels que les chambres de commerce, de métiers ou d’agriculture, les établissements d’enseignement public ou privé sous contrat, les entreprises et les associations. En revanche, dans le cas des centres de formation des apprentis à recrutement national, cette convention est passée avec l’État.
Ces conventions fixe les modalités d’organisation administrative, pédagogique et financière du CFA (mode de recrutement des personnels, effectifs d’apprentis pouvant être accueillis, diplômes préparés, aire de recrutement, lieux de formation, modalités de financement, mise en place d’un conseil de perfectionnement…).
L’article 6 procède à une décentralisation complète de la création des centres de formation d’apprentis, la région se voyant investie d’une compétence exclusive en la matière :
Le 1° du II réécrit l’article L. 6232-1 du code du travail afin de supprimer la référence faite aux conventions conclues entre l’État et ses partenaires pour les centres à recrutement national, donnant ainsi une compétence exclusive à la région pour conclure l’ensemble des conventions de création de CFA sur le territoire régional ;
Le 2° du II modifie l’article L. 6332-2 du code du travail et supprime la distinction entre les conventions créant les CFA à recrutement national – qui doivent être conformes à une convention type définie par un arrêté – et les autres conventions – qui doivent être conformes à une convention type définie par la région. Le projet de loi prévoit donc que seules les régions pourront définir les conventions type auxquelles devront se conformer les conventions de création des CFA ;
Le 3° et 4° du II opèrent des modifications analogues aux articles L. 6232-6 et L. 6232-7 du code du travail pour les sections d’apprentissage : la convention créant ces sections comme la convention-type les concernant devrait relever de la compétence exclusive de la région ;
Le 5° du II modifie en conséquence l’article L. 6232-8 du code du travail en prévoyant la compétence exclusive des régions pour l’élaboration des conventions créant les unités de formation en apprentissage.
La référence faite à la compétence de l’État est aussi supprimée s’agissant de l’affectation des fonds de la taxe professionnelle à l’article L. 6241-10 du code du travail (III de l’article 6).
S’agissant du contrôle des centres de formation des apprentis, le IV de l’article 6 prévoit de modifier l’article L. 6252-1 du code précité afin de limiter le rôle de l’État au seul contrôle pédagogique, la région étant seule compétente en matière de contrôle technique et financier.
De même, en cas de fermeture d’un CFA, seule la région devrait être compétente pour imposer à l’organisme gestionnaire l’achèvement des formations en cours et pour désigner un administrateur provisoire chargé d’assurer, pour le compte de l’organisme gestionnaire, l’achèvement des formations en cours (nouvelle rédaction de l’article L. 6252-3 du code du travail).
Tirant les conséquences de cette décentralisation complète, le VI du présent article précise que dans un délai de deux ans les centres de formation des apprentis à recrutement national feront l’objet d’une nouvelle convention conclue entre la région sur le territoire de laquelle ils sont situés et les partenaires de la convention actuelle conclue avec l’État.
Les modalités de transferts de ces CFA devraient être identiques à celles qui ont été mises en œuvre depuis 2007 et devraient prendre la forme d’une convention avec la région concernée et une compensation financière de l’État. En 2007, il existait 18 CFA nationaux. Leur nombre a été réduit à 8 en 2010.
Il ne reste à ce jour que deux centres de formation d’apprentis à recrutement national, financés par le compte d’affectation spéciale « FNDMA » :
– le CFA à recrutement national des compagnons du devoir et du tour de France géré par un organisme gestionnaire unique l’AOCDTF (Association ouvrière des compagnons du devoir du tour de France) –, présent sous forme d’antennes dans trois régions (Basse-Normandie, Haute-Normandie et Franche-Comté) et sous la forme de treize CFA régionaux dans d’autres régions ;
– et le CFA des métiers de la musique (ITEMM) situé dans la région des Pays de la Loire.
L’article 15 du présent projet de loi précise les modalités financières de la compensation des transferts des CFA nationaux aux régions.
*
* *
La Commission est saisie de l’amendement AS28 de M. Gérard Cherpion, tendant à supprimer l’article 6.
M. Gérard Cherpion. L’apprentissage est une voie de formation importante pour l’entrée des jeunes sur le marché du travail. À l’issue de l’obtention de leur diplôme, huit jeunes sur dix trouvent en effet un emploi. C’est pour cette raison que tous les gouvernements ont fait du développement de l’apprentissage une priorité. Toutefois, le nombre de contrats d’apprentissage accusait en novembre dernier une baisse cumulée de près de 25 000 unités pour l’année.
Bien que la politique de l’apprentissage soit une compétence régionale, l’État a toujours pesé sur cette politique par le double biais des centres de formation d’apprentis (CFA) nationaux et de la signature des contrats d’objectifs et de moyens (COM).
La dernière génération de COM, pour la période 2011 à 2015, a ainsi prévu un financement des CFA à parité entre l’État et les régions. Ces COM ont également fixé des objectifs clairs en matière de création de places de formation et d’hébergement.
L’article 6 du projet de loi prévoit le transfert intégral de la politique de l’apprentissage vers les régions, et donc le désengagement total de l’État. Or, si certaines régions sont vertueuses en matière d’apprentissage, un pilotage national n’en est pas moins nécessaire afin d’assurer une harmonie entre les différentes sections d’apprentissage sur tout le territoire national.
M. le rapporteur. La suppression de cet article irait à l’encontre de notre souhait de confier pleinement l’apprentissage aux régions. Je précise que ce transfert de compétence s’accompagne du transfert des moyens correspondants.
M. Gérard Cherpion. Pas du tout.
La Commission rejette l’amendement.
Puis elle est saisie de l’amendement AS29 de M. Gérard Cherpion.
M. Gérard Cherpion. Avec ce projet de loi, l’État se désengage totalement de l’apprentissage en faveur des régions. L’article 6 supprime l’obligation de la signature de contrats d’objectifs et de moyens entre l’État, la région, les chambres consulaires et une ou plusieurs organisations représentatives d’employeurs et de salariés. Les régions pourront ainsi choisir si elles souhaitent conclure ou non de tels contrats. Le présent amendement vise à maintenir la région comme chef de file pour la signature des COM, tout en rendant cette signature obligatoire.
M. le rapporteur. Obliger les régions à signer les contrats d’objectifs et de moyens serait contraire au principe de libre administration des collectivités territoriales et à l’objectif de la loi. Une position si peu décentralisatrice est surprenante de votre part, cher collègue.
La Commission rejette l’amendement.
Elle examine alors l’amendement AS78 de M. Francis Vercamer.
M. Francis Vercamer. L’article 6 vise à encourager le développement de l’apprentissage en impliquant les régions et en instituant des outils de pilotage. Encore faudrait-il préciser les objectifs des contrats d’objectifs et de moyens conclus par les régions et les acteurs de l’apprentissage, et notamment les conditions de la mise en œuvre des programmes de formation par apprentissage, de l’amélioration des formations et de la condition matérielle des apprentis, de l’accès des personnes handicapées à l’apprentissage.
M. le rapporteur. Ces précisions sont inutiles. Les COM relèvent de la seule responsabilité des régions et il ne revient pas au législateur d’en préciser par avance le contenu.
M. Gérard Cherpion. Sans s’impliquer dans la gestion, le législateur doit tout de même définir le cadre général.
La Commission rejette cet amendement.
Elle examine ensuite l’amendement AS223 de M. Jean-Louis Costes.
M. Jean-Louis Costes. Il faut renforcer la coordination entre tous les acteurs en matière de planification des contrats d’apprentissage. Trop souvent, des jeunes cherchent des contrats d’apprentissage sans en trouver, tandis que certaines formations proposées ne correspondent pas aux besoins. Il conviendrait d’assurer une adéquation entre l’offre et la demande et de parvenir à une planification comparable à celle qui, en Allemagne, fonctionne très bien.
M. le rapporteur. La partie du projet de loi que nous examinons en ce moment tend précisément à renforcer la coordination, mais de là à constituer un annuaire. Si nous décentralisons, il faut faire confiance aux régions, qui sauront ce qu’elles ont à faire. Avis défavorable, donc.
La Commission rejette cet amendement.
Puis elle est saisie des amendements AS30 de M. Gérard Cherpion et AS400 de M. le rapporteur.
M. Gérard Cherpion. Deux centres d’apprentis nationaux subsistent actuellement : l’un est consacré aux métiers de la musique et l’autre est celui des compagnons du devoir, institution très ancienne qui forme de nombreux jeunes, lesquels sont tous au travail et créent souvent leur propre entreprise. Si l’on supprime les moyens dont disposent ces deux centres nationaux, on verra en deux ans disparaître les compagnons du devoir et nous perdrons alors une extraordinaire richesse en termes de qualifications et d’emplois.
M. le rapporteur. Mon amendement vise le même objectif. Il me semble cependant inutile de supprimer les alinéas indiquant qu’il n’est plus possible de créer de nouveaux CFA nationaux.
Mme la présidente Catherine Lemorton. Monsieur Cherpion, retirez-vous votre amendement AS30 ?
M. Gérard Cherpion. Je souhaiterais auparavant que la sécurité des CFA nationaux soit garantie.
M. le rapporteur. Je reconnais que, techniquement, ce n’est pas simple. Peut-être pourrions-nous retirer ces deux amendements et les retravailler d’ici l’examen du texte en séance publique.
M. Gérard Cherpion. D’accord. Nous pourrions alors élaborer un amendement commun.
M. Christophe Cavard. La même question se pose pour les centres de formation de l’Association pour la formation professionnelle des adultes (AFPA), dont certains pourraient être entièrement territorialisés et d’autres devenir des centres nationaux. Un amendement déposé en ce sens a été déclaré irrecevable au titre de l’article 40 de la Constitution.
M. le rapporteur. Tout à fait. Quant à l’AFPA, si la problématique est semblable, la réponse n’est pas du tout la même.
Les amendements sont retirés.
La Commission adopte ensuite, sur l’avis favorable du rapporteur, l’amendement rédactionnel AS282 de M. Lionel Tardy.
Puis elle adopte l’article 6 modifié.
La Commission est saisie de l’amendement AS85 de M. Francis Vercamer.
M. Francis Vercamer. On ne compte en France que 450 000 apprentis, contre 1,6 million en Allemagne. Il faudrait arriver à un doublement du nombre d’apprentis dans notre pays. Nos autres amendements ayant été déclarés irrecevables au titre de l’article 40, cet amendement de repli propose d’abaisser à 14 ans l’âge d’entrée en apprentissage et de demander un rapport au Gouvernement.
M. le rapporteur. Il existe des armoires entières de rapports sur l’apprentissage. La volonté de développer l’apprentissage est unanime, mais nous sommes en désaccord sur certains points, comme l’abaissement de l’âge d’entrée en apprentissage. Ne serait-il pas préférable de créer une mission au sein de laquelle nous pourrions travailler ensemble sur ce dossier ? Avis défavorable sur l’amendement.
M. Gérard Cherpion. Ayant moi-même déposé un amendement allant dans le sens de celui de M. Vercamer, mais qui n’a pas été jugé recevable, je le soutiens. La France compte cette année, je le répète, 25 000 apprentis de moins que l’année dernière, du fait des difficultés économiques et des restrictions apportées à l’apprentissage par la loi Peillon.
M. Denys Robiliard. La loi Peillon ne s’appliquait pas !
M. Gérard Cherpion. Même si elles ont été reprises très rapidement, certaines mesures fiscales annoncées en juillet ont fait des dégâts.
La Commission rejette l’amendement.
Article 7
(art. L.6221-2 [nouveau], L. 6233-1-1 [nouveau], L. 6222-2, L. 6222-7, L. 6222-7-1 [nouveau], L. 6222-8 à L. 6222-12-1, L. 6222-18, L. 6222-22-1, L. 6223-8, L. 6225-2, L. 6225-3
et L. 6225-5 du code du travail)
Principe de gratuité et élargissement du contrat d’apprentissage
aux contrats à durée indéterminée
A. UNE NÉCESSAIRE CLARIFICATION
En vertu de l’article L. 6211-2 du code du travail, « l’apprentissage est une forme d’éducation alternée associant : une formation dans une ou plusieurs entreprises, fondée sur l’exercice d’une ou plusieurs activités professionnelles en relation directe avec la qualification objet du contrat entre l’apprenti et l’employeur ; des enseignements dispensés pendant le temps de travail dans un centre de formation d’apprentis ou une section d’apprentissage ». Les objectifs de l’apprentissage sont définis par l’article L. 6211-1 du même code : « L’apprentissage concourt aux objectifs éducatifs de la Nation. Il a pour objet de donner à des jeunes travailleurs, ayant satisfait à l’obligation scolaire, une formation générale, théorique et pratique, en vue de l’obtention d’une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles ».
En déclarant que l’apprentissage concourt aux « objectifs éducatifs de la Nation » et qu’il est une forme « d’éducation alternée », les articles L. 6211-1 et L. 6211-2 du code du travail soulignent le caractère éducatif de l’apprentissage qui entre dans le champ d’application du principe de la gratuité de la formation énoncé par le préambule de la Constitution de 1946 (35) et fixé aux articles L. 132-1 et L. 132-2 du code de l’éducation (36).
En effet, la formation de l’apprenti est gratuite à la fois pour l’apprenti et pour l’employeur, le coût de fonctionnement des centres de formation des apprentis étant pris en charge par la taxe d’apprentissage et par les régions.
En revanche, le code du travail ne contient aucune disposition sur la possibilité pour un centre de formation des apprentis de facturer certains frais de gestion à un apprenti ou à un employeur d’apprenti. En effet, la seule disposition ayant trait à la gratuité est l’article L. 6224-4 du code du travail qui précise que l’enregistrement du contrat par une chambre consulaire ne donne lieu à aucun frais pour l’employeur ou l’apprenti.
Saisi de cette question (37), le tribunal de grande instance de Saint-Etienne, dans une décision du 20 juin 2007, a observé que la convention portant création du CFA qui prévoyait qu’aucun droit d’inscription ou de scolarité ne pouvait être perçu par le centre de formation auprès de l’apprenti ou auprès de l’employeur ne faisait pas obstacle à une demande du CFA de participation financière de l’apprenti dès lors qu’elle ne vise pas à mettre à la charge de ce dernier le coût intrinsèque de la formation. Le tribunal a donc rejeté la demande de restitution de la participation financière faite par l’apprenti au motif que cette participation trouvait sa contrepartie dans les services annexes à la formation tels que la fourniture de documents et de cours polycopiés, l’utilisation d’équipements informatiques et l’accès à la cantine à un moindre coût.
Saisie en appel, la Cour d’appel de Lyon, dans une décision du 25 novembre 2008, a censuré la décision du TGI de Saint-Étienne et fait droit à la demande de restitution de l’apprenti en relevant que le règlement de la participation revêtait un caractère obligatoire pour la réinscription et que l’association gestionnaire du CFA ne démontrait par aucun élément contraire que l’objet de la participation demandée n’était pas lié à la formation de l’apprenti. La Cour a néanmoins précisé que la convention constitutive du CFA n’interdisait pas à l’association gestionnaire du CFA de demander aux apprentis le paiement d’une participation financière pour le financement de services connexes à la formation.
Par conséquent, les décisions du TGI de Saint-Etienne et de la cour d’Appel de Lyon ont établi une distinction entre :
– les frais liés à la formation qui sont les frais couvrant les frais de gestion administrative du centre de formation d’apprentis (CFA) et dont le règlement est obligatoire pour l’inscription de l’apprenti au CFA.
– et les « services hors formation » qui sont les services ne se rapportant pas à la gestion administrative du CFA et dont le paiement facultatif ne détermine pas l’inscription de l’apprenti au centre (acquisition de produits et de matériel qui restent la propriété de l’apprenti, prestations de reprographie, accès à des bases de données documentaires, accès à une cantine, activités extra éducatives) et pour lesquels une participation financière peut être demandée à l’apprenti.
Cependant ces décisions de justice n’ont pas totalement clarifié la question de la gratuité de la formation par la voie de l’apprentissage celle-ci donnant lieu à des positions différentes des différentes directions ministérielles et des régions :
– dans une circulaire du 30 mars 2001 (38), le ministère de l’Éducation nationale distingue les dépenses de fonctionnement administratif et pédagogique relatives aux activités d’enseignement obligatoires des élèves qui ne peuvent être financées par les familles des élèves (39) et les dépenses afférentes aux activités facultatives qui peuvent être laissées à la charge des familles et des apprentis. Sont cités les voyages scolaires, les fournitures strictement individuelles donnant lieu à une appropriation personnelle de l’élève telles que la papeterie et le matériel d’écriture ;
– la délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle a considéré, quant à elle, que la participation financière demandée aux apprentis par un CFA n’a aucun fondement juridique au regard du droit des contrats et a opéré une distinction entre les frais liés à la formation – qui ne font l’objet d’aucun paiement par l’apprenti – et les autres frais qui peuvent faire l’objet d’un paiement soit par l’employeur (frais de dossier et achat d’équipement de protection individuelle), soit par l’apprenti (frais de transport, d’hébergement et de nourriture, achat de petit matériel) ;
– dans une position commune adressée, le 18 janvier 2008, aux CFA de la région, le Préfet de région Ile-de-France et le Président du Conseil régional d’Île-de-France ont affirmé qu’aucune participation financière ne pouvait être demandée aux apprentis au titre de la réalisation de leur formation. Ils ont établi une liste non exhaustive d’exemples pouvant justifier une demande de participation du CFA à l’apprenti (40) tout en précisant que la participation financière demandée par le CFA à l’apprenti au titre de ces frais n’est valable que si l’apprenti conserve le choix de se procurer le bien ou le service concerné par un autre moyen, et que si la participation se rapporte à des achats facultatifs.
Ces différentes positions bien que proches ne se recoupent pas totalement et le régime du financement des frais « hors formation » doit donc être clarifié.
Cette clarification est d’autant plus nécessaire que les frais acquittés par les entreprises au moment de l’inscription d’un apprenti ne sont pas négligeable, notamment dans l’enseignement supérieur.
En effet, lorsqu’une entreprise forme un apprenti, elle doit verser au CFA un « concours financier obligatoire » (CFO) – imputé sur la part « quota » de la taxe –, dont le montant est fixé en référence au coût par apprenti figurant sur des listes préfectorales. Or, il arrive fréquemment que la part « quota » de l’entreprise ne suffise pas à couvrir la totalité du CFO, et certains centre de formation des apprentis – essentiellement dans l’enseignement supérieur – conditionnent l’inscription de l’apprenti au versement d’un versement complémentaire d’un montant non négligeable pour les entreprises.
B. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
Le présent article clarifie le régime juridique des frais « hors formation » des centres de formation des apprentis en affirmant clairement la gratuité de la formation de l’apprentissage pour l’apprenti comme pour l’employeur, y compris en ce qui concerne les frais « hors formation ». L’objectif, comme le rappelle l’exposé des motifs est de réaffirmer le principe de gratuité « au bénéfice de l’employeur, mais également de l’apprenti, afin que le développement de l’apprentissage ne soit pas freiné par des obstacles financiers tant en ce qui concerne la conclusion du contrat que son enregistrement. »
Le I du présent article introduit dans le code du travail un nouvel article L. 6221-2, qui énonce qu’aucune contrepartie financière ne peut être demandée aux parties au contrat d’apprentissage à l’occasion de sa conclusion, de son enregistrement et de sa rupture.
Le II du présent article concerne plus spécifiquement les employeurs et insère un nouvel article L. 6233-1-1 qui rappelle, s’agissant des ressources des centres de formation d’apprentis et des sections d’apprentissage que les organismes gestionnaires de ces derniers ne peuvent conditionner l’inscription d’un apprenti au versement, par son employeur, d’une contribution financière de quelque nature qu’elle soit. Cet article vise à éviter de conditionner l’inscription de l’apprenti – opérée par son employeur – à des frais indus et proscrit donc la pratique des versements complémentaires de la part des entreprises. L’équilibre financier du CFA devra donc être trouvé par le cumul de ses deux sources de financement que sont la taxe d’apprentissage et les subventions des régions.
II. ÉLARGIR LE CONTRAT D’APPRENTISSAGE AUX CONTRATS À DURÉE INDÉTERMINÉE
A. LE CONTRAT D’APPRENTISSAGE : UN CONTRAT À DURÉE DÉTERMINÉE
Le contrat d’apprentissage est un contrat à durée déterminée. En effet, l’article L. 6222-7 du code du travail dispose que la durée du contrat d’apprentissage est au moins égale à celle du cycle de formation qui fait l’objet du contrat : elle fixée en fonction du type de profession et du niveau de qualification préparés et elle peut varier entre un et trois ans, sous réserve des cas de prolongation prévus à l’article L. 6222-11 du même code.
Cette durée peut être réduite et varier entre 6 mois et 1 an lorsque la formation permet d’acquérir un diplôme ou titre :
– de même niveau et en rapport avec un premier diplôme ou titre obtenu dans le cadre d’un précédent contrat d’apprentissage ;
– ou de niveau inférieur à un diplôme ou titre déjà obtenu ;
– ou dont une partie a été obtenue par la validation des acquis de l’expérience ;
– ou dont la préparation a été commencée sous un autre statut (article L. 6622-9 du code du travail).
À l’inverse, la durée du contrat peut être portée à 4 ans pour les personnes reconnues travailleurs handicapés.
En cas d’accord conjoint entre l’apprenti, l’employeur et le centre de formation, le contrat peut être prolongé d’un an pour permettre un redoublement, une réorientation ou une spécialisation complémentaire.
B. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
L’article 7 introduit la possibilité (du III au XIV du présent article) de conclure un contrat d’apprentissage dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, sans remettre en cause la protection particulière dont bénéficie l’apprenti pendant sa période de formation théorique et pratique.
Selon l’exposé des motifs du projet de loi, cette nouvelle possibilité devrait permettre, notamment pour les jeunes qui en seront bénéficiaires, de se trouver en position plus favorable dans leurs recherches de logement ou de prêts bancaires, l’employeur pouvant aussi y trouver un intérêt en termes d’attractivité et de fidélisation à l’issue de la période de formation.
Le V du présent article réécrit l’article L. 6222-7 qui dispose que le contrat d’apprentissage peut être désormais conclu pour une durée limitée ou pour une durée indéterminée.
Dans le cas d’un contrat à durée indéterminée, le deuxième alinéa du nouvel article L. 6222-7 distingue :
– la période d’apprentissage pendant laquelle le contrat est régi par les dispositions relatives au contrat d’apprentissage ;
– la période ultérieure pendant laquelle la relation contractuelle se poursuit dans le cadre du droit commun du travail (titre I à III du livre deuxième de la première partie du code du travail (41)) exceptée les dispositions relatives à la durée de la période d’essai (article L. 1221-19 du code du travail).
Le IV du présent article modifie, en conséquence, l’actuel article L. 6222-7 du code du travail qui devient l’article L. 6222-7-1 et prévoit que la durée du contrat d’apprentissage lorsqu’il est conclu pour une durée limitée, ou de la période d’apprentissage, lorsque le contrat d’apprentissage est conclu pour une durée indéterminée, est au moins égale à celle du cycle de formation préparant à la qualification qui fait l’objet du contrat.
Au III et du VI au XIV du présent article, différentes coordinations sont opérées dans le code du travail pour tenir compte de cette nouvelle possibilité de durée : ainsi, dès lors qu’un article fait référence au « contrat d’apprentissage », la mention « ou de la période d’apprentissage » est ajoutée, permettant ainsi l’application des textes relatifs à l’apprentissage à la période par laquelle débute le CDI créé par le projet de loi :
– l’article L. 6222-7 du code précité devant désormais être le nouvel article L. 6222-7-1 du même code, le VI du présent article remplace la référence faite à cet article dans l’article L. 6222-9 du même code ;
– les III, VII, VIII, IX et X du présent article remplacent la référence faite au contrat d’apprentissage par celle de contrat ou de période d’apprentissage dans les articles L. 6222-2, L. 6222-8, L. 6222-9, L. 6222-10, L. 6222-11, L. 6222-12 et L. 6222-12-1 du code du travail ;
– le XI, XII et XIII du présent article proposent de modifier les articles L. 6225-2, L. 6225-3 et L. 6225-5 du code du travail afin de prendre en compte la possibilité du durée indéterminée du contrat d’apprentissage ;
– le XIV du présent article propose de modifier l’article L. 6222-18 du code précité relatif à la rupture du contrat d’apprentissage afin de prendre en compte la nouvelle possibilité de contrat à durée indéterminée (1° du XIV) et précise que les dispositions relatives à la durée de la période d’essai d’un contrat de travail à durée indéterminée de droit commun peuvent désormais s’appliquer lorsque, après la rupture d’un contrat d’apprentissage, un nouveau contrat est conclu entre l’apprenti et un nouvel employeur pour achever la formation (2° du XIV).
III. LA FORMATION DES MAITRES D’APPRENTISSAGE
La désignation d’un maître d’apprentissage fait partie des mesures nécessaires à l’organisation de l’apprentissage que l’employeur doit déclarer avoir prises, pour engager un apprenti.
Le maître d’apprentissage a pour mission de contribuer à l’acquisition par l’apprenti, dans l’entreprise, des compétences correspondant à la qualification recherchée et au titre du diplôme préparé, en liaison avec le centre de formation d’apprentis (article L. 6223-5 du code du travail).
Le nombre maximal d’apprentis pouvant être accueillis simultanément, dans une entreprise ou dans un établissement est fixé à deux par maître d’apprentissage (article R. 6223-6 du code du travail). Chaque maître d’apprentissage peut, en outre, accueillir un apprenti dont la formation est prolongée.
Pour favoriser l’exercice de sa mission, l’employeur doit permettre au maître d’apprentissage de dégager le temps nécessaire à cette mission, tout en continuant à exercer son activité, de bénéficier des formations lui permettant d’exercer correctement cette mission et de suivre l’évolution du contenu des formations dispensées à l’apprenti et des diplômes qui les valident (articles L. 6223-7 et L. 6223-8 du code précité).
Certains accords de branche incitent à former les maitres d’apprentissage d’autres – plus rares – rendent cette formation obligatoire : c’est le cas notamment de l’accord récent passé dans la branche « hôtellerie-restauration ».
Avenant à la convention collective des hôtels, cafés et restaurants
signé le 10 janvier 2013
Le permis de former visé par cet avenant est une obligation de formation qui incombe aux tuteurs et aux maîtres d’apprentissage du secteur encadrant un contrat de travail en alternance (contrat de professionnalisation et contrat d’apprentissage).
Cette obligation comprend une formation initiale de 14 heures et une formation de « mise à jour » d’une durée de quatre heures consécutives dispensée par l’un des centres de formation désignés par les partenaires sociaux signataires :
– trois ans après pour tous les tuteurs et maîtres d’apprentissage ayant suivi la formation initiale;
– deux ans après l’entrée en vigueur de cet avenant pour tous les tuteurs et maîtres d’apprentissage dispensés de la formation initiale.
Cette formation devra être renouvelée tous les trois ans.
Cependant, aucun texte légal ou réglementaire n’incite à mettre en œuvre une telle formation.
C’est pourquoi le XV du présent article complète l’article L. 6223-8 du code précité par un nouvel alinéa et prévoit qu’un accord collectif peut définir les modalités de mise en œuvre et de prise en charge de ces formations. Cette disposition a pour objet de permettre la généralisation progressive d’une formation adaptée des maîtres d’apprentissage, dans le cadre des conventions de branche applicables.
L’étude d’impact du projet de loi précise : « L’accord collectif de branche devrait permettre de ménager la situation particulière des artisans et très petites entreprises qui pourront moins facilement se libérer facilement de leur activité professionnelle. C’est pourquoi l’option de rendre légalement obligatoire le suivi d’une formation pour pouvoir prétendre à la qualification de maître d’apprentissage n’a pas été retenue. »
*
* *
La Commission est saisie de l’amendement AS187 de M. Gérard Cherpion.
M. Gérard Cherpion. Les chambres consulaires ne se limitent pas à l’enregistrement des contrats d’apprentissage, elles participent également à leur élaboration complète et conforme, vont au-devant des jeunes et assurent la sensibilisation des entreprises, en particulier de celles qui n’ont jamais accueilli d’apprentis. Le présent amendement précise donc le périmètre de la gratuité de l’enregistrement des contrats d’apprentissage pour l’apprenti comme pour le chef d’entreprise.
M. le rapporteur. Les chambres consulaires, tout en affichant la gratuité, souhaitent de plus en plus être rémunérées pour diverses prestations, comme l’établissement des dossiers. Or, le développement de l’apprentissage relève de leur mission.
M. Gérard Cherpion. Les directeurs de CFA ont soulevé le même problème.
M. le rapporteur. Il n’est pas normal qu’il faille payer jusqu’à 5 000 ou 7 000 euros pour certaines formations supérieures.
Mme Véronique Louwagie. Il ne faudrait pas que cette disposition ait des incidences sur les moyens consacrés par les chambres consulaires aux contrats d’apprentissage.
La Commission rejette cet amendement.
Elle est saisie de l’amendement AS243 de M. Christophe Cavard.
M. Christophe Cavard. Nous sommes très attachés à la gratuité, mais certains CFA nous ont fait savoir qu’ils facturaient parfois certaines de leurs prestations aux entreprises – qui s’y prêtent volontairement, car rien ne les oblige à payer. Les CFA craignent, si nous venions à interdire cette pratique, un manque à gagner dont la compensation risquerait d’incomber aux régions, lesquelles s’inquiètent d’apparaître de plus en plus comme la solution à tous les problèmes de financement.
M. le rapporteur. Alors que nous sommes en train de réorganiser tout le financement de l’apprentissage et de mettre en place un système uniforme de calcul du coût d’un parcours, déroger à la gratuité vis-à-vis de l’employeur ne manquerait pas de poser des problèmes. À l’inverse, l’interdiction des dérogations actuelles se solderait par l’interruption brutale de certaines formations. Il faudrait sécuriser le système d’exceptions pour nous assurer que le paiement demandé aux entreprises n’est pas pour elles une manière d’acheter des places. Il faudrait également préciser la notion de « services réels et identifiés », afin qu’il ne s’agisse pas d’une facturation supplémentaire de la formation, ni d’une condition d’inscription de l’apprenti. En l’état, je suis donc défavorable à cet amendement, que je vous demande de retravailler.
L’amendement est retiré.
Puis la Commission adopte l’article 7 sans modification.
La Commission examine l’amendement AS224 de M. Lionel Tardy.
M. Lionel Tardy. Il s’agit de simplifier le système de rémunération des apprentis, qui est d’une complexité pouvant décourager beaucoup de PME. Actuellement, la rémunération d’un apprenti est fonction de son âge et de son ancienneté et, au cours d’une année, il peut changer deux fois de salaire suivant sa date d’anniversaire. Il est donc proposé de supprimer la condition d’âge, ce qui va dans le sens du choc de simplification voulu par le Président de la République.
M. le rapporteur. Je reconnais là l’approche pragmatique de M. Tardy. On pourrait même proposer que les apprentis soient rémunérés au SMIC.
Mais on ne peut improviser une telle réforme : il faut en discuter au préalable avec les employeurs et apprécier les conséquences financières. Avis défavorable.
Mme Véronique Louwagie. Il est en effet difficile d’aborder une question de cette nature dans ce texte. Reste que le dispositif actuel présente une difficulté : il n’est pas favorable aux personnes de 22, 23 ou 24 ans, qui ne trouvent pas de contrats d’apprentissage, les entreprises préférant des personnes plus jeunes.
La Commission rejette l’amendement.
Article 8
(art. L. 6231-1 du code du travail)
Renforcer les missions des centres de formation des apprentis
La lutte contre la rupture des contrats d’apprentissage est un des objectifs du Gouvernement. En effet, le taux d’échec en apprentissage – c’est-à-dire le taux de rupture des contrats – est variable selon les régions et selon les branches professionnelles et se situe entre 10 et 35 % selon le rapport du comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques sur l’évaluation des politiques publiques en faveur de la mobilité sociale des jeunes (42).
Selon la DARES, le taux de rupture nette – c’est-à-dire la proportion de contrats qui ont été rompus déduction faite de ceux qui ont été rapidement suivis d’un autre contrat dans une autre entreprise pour achever le cycle de formation – est d’environ 22 %. Ces taux sont inégaux selon les secteurs d’activité et sont d’autant plus élevés que le niveau de qualification visé est moins élevé.
Des travaux sont en cours pour mettre en place un dispositif national de suivi statistique des ruptures plus performant et pour identifier les apprentis en situation de décrochage à travers le système interministériel d’échanges d’information (SIEI). Par ailleurs, des expérimentations viennent d’être lancées dans quatorze régions pour faire régresser le taux de rupture par un accompagnement renforcé assuré par des tiers aux CFA et à l’entreprise et financé à hauteur de 2 millions d’euros par le FNDMA.
Selon le rapport du comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques sur l’évaluation des politiques publiques en faveur de la mobilité sociale des jeunes, les causes des ruptures de contrat semblent de deux ordres :
– la qualité du travail des jeunes est parfois jugée insuffisante par les employeurs : manque de connaissances directement liées au métier ; manque de motivation ; lacunes sur les compétences de savoir-être en entreprise ; passivité et manque de « proactivité » ;
– un manque de liens pour les apprentis entre leur formation en CFA et l’activité qu’ils mènent dans leur entreprise.
Afin de favoriser la réussite des jeunes entrants en contrat d’apprentissage, l’article 8 du présent projet de loi renforce et précise les missions confiées aux centres de formation d’apprentis (CFA) sur différents registres, notamment la consolidation du projet de formation, l’appui aux jeunes pour la recherche d’employeurs en lien avec le service public de l’emploi et la relation avec les maîtres d’apprentissage.
L’article L. 6231-1 du code du travail indique que les CFA ont pour mission de dispenser aux jeunes travailleurs titulaires d’un contrat d’apprentissage une formation générale associée à une formation technologique et pratique qui complète la formation reçue en entreprise et s’articule avec elle.
Par conséquent, le présent article réécrit l’article L. 6231-1 et ajoute à cette mission (1° du nouvel article L. 6231-1 du code précité), les missions suivantes :
– assurer la cohérence entre la formation dispensée au sein du centre de formation d’apprentis et celle dispensée au sein de l’entreprise en particulier en organisant la coopération entre les formateurs et les maîtres d’apprentissage (2° du nouvel article L. 6231-1 du code précité). Cette mission qui était citée au niveau réglementaire à l’article R. 6233-57 du code du travail est donc affirmée au niveau législatif pour en montrer le caractère essentiel ;
– développer l’aptitude des apprentis à poursuivre des études par les voies de l’apprentissage, de l’enseignement professionnel ou technologique ou par toute autre voie (3° du nouvel article L. 6231-1 du code précité)
– assister les postulants à l’apprentissage dans leur recherche d’un employeur, et les apprentis en rupture de contrat dans la recherche d’un nouvel employeur, en lien avec le service public de l’emploi (4° du nouvel article L. 6231-1 du code précité)
– apporter, en lien avec le service public de l’emploi, en particulier avec les missions locales, un accompagnement aux apprentis pour résoudre les difficultés d’ordre social et matériel susceptibles de mettre en péril le déroulement du contrat d’apprentissage (5° du nouvel article L. 6231-1 du code précité).
*
* *
Lors de son examen du texte, votre commission a adopté une série d’amendements de la commission des affaires culturelles et de l’éducation visant à compléter les missions des centres de formation des apprentis. Ces deniers devront donc :
– concourir au développement des connaissances, des compétences et de la culture nécessaires à l’exercice de la citoyenneté dans la société contemporaine de l’information et de la communication ;
– favoriser la mixité au sein de leurs structures en sensibilisant les formateurs, les maîtres d’apprentissage et les apprentis à la question de l’égalité entre les sexes et en menant une politique d’orientation et de promotion des formations qui met en avant les bénéfices de la mixité afin de lutter contre la sexualisation des métiers ;
– et encourager la mobilité internationale des apprentis, notamment à travers les programmes de l’Union européenne.
Par ailleurs la commission a, dans deux amendements, précisé que les CFA dispensaient aux apprentis une formation générale et technologique « dans un objectif de progression sociale » et qu’ils leur apportaient un accompagnement pour non seulement résoudre mais aussi « prévenir » les difficultés d’ordre social et matériel susceptibles de mettre en péril le déroulement du contrat d’apprentissage.
Enfin, votre commission a adopté un amendement visant à élargir la liste des établissements avec lesquels un centre de formation d’apprentis peut conclure une convention aux termes de laquelle ils assurent tout ou partie des enseignements normalement dispensés par lui et mettent à disposition des équipements pédagogiques ou d’hébergement.
En effet, la rédaction actuelle de l’article L. 6231-3 du code du travail inclut seulement, parmi les établissements d’enseignement supérieur, ceux « habilités à délivrer un titre d’ingénieur diplômé ». Cette restriction étant sans justification et ne reflétant pas la réalité des conventions passées par les CFA, votre commission a élargi le champ des établissements avec lesquels les CFA peuvent passer ce type de conventions à l’ensemble des établissements d’enseignement supérieur habilités à délivrer une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles.
*
* *
La Commission examine l’amendement AS188 de suppression de l’article de M. Gérard Cherpion.
M. Gérard Cherpion. L’article confère aux centres de formation des apprentis (CFA) des missions qu’ils exercent déjà. C’est un exemple de loi bavarde.
M. le rapporteur. Avis défavorable.
La Commission rejette l’amendement.
Elle examine ensuite l’amendement AS339 de la Commission des affaires culturelles et de l’éducation.
Mme Colette Langlade, rapporteure pour avis de la Commission des affaires culturelles et de l’éducation. Il s’agit de lier l’objectif de progression sociale à la poursuite d’études par les apprentis.
M. le rapporteur. Avis favorable.
La Commission adopte l’amendement.
Puis elle examine l’amendement AS340 de la Commission des affaires culturelles et de l’éducation.
Mme Colette Langlade, rapporteure pour avis. Cet amendement vise un objectif simple : que tous les jeunes d’une même classe d’âge, qu’ils soient formés sous statut scolaire ou par la voie de l’apprentissage, disposent des mêmes acquis pour mener une vie de citoyens actifs et responsables.
M. le rapporteur. Avis favorable.
La Commission adopte l’amendement.
Elle en vient à l’amendement AS283 de M. Lionel Tardy.
M. Lionel Tardy. Que signifie « l’aptitude à poursuivre des études » ? Il est évident que les CFA recherchent pour les apprentis la meilleure orientation possible.
M. le rapporteur. Avis défavorable.
La Commission rejette l’amendement.
Elle examine ensuite l’amendement AS342 de la Commission des affaires culturelles et de l’éducation.
Mme Colette Langlade, rapporteure pour avis. L’article 8 propose de doter les CFA d’une mission d’accompagnement des apprentis pour résoudre d’éventuelles difficultés sociales ou matérielles. Mais il convient aussi de prévenir les difficultés.
Une expérience menée en Côte-d’Or, avec un suivi par entretien mensuel avec l’apprenti ou l’employeur, a montré que le risque de résiliation du contrat était sensiblement réduit par un dispositif préventif.
M. le rapporteur. Les CFA mettent déjà en œuvre de telles actions, qu’il est en effet souhaitable d’inscrire dans la loi. La plupart d’entre elles font suite aux expérimentations mises en place par Martin Hirsch, notamment celle tendant à rapprocher les réseaux CFA et missions locales, et à travailler sur la prévention et l’accompagnement social. Avis favorable.
La Commission adopte l’amendement.
Puis elle examine, en discussion commune, les amendements AS107 de M. Dominique Tian et AS183 de M. Francis Vercamer.
M. Lionel Tardy. Je propose d’élargir la liste des établissements avec lesquels un CFA peut conclure une convention.
M. Francis Vercamer. Le code du travail permet aux CFA de passer des conventions avec des établissements d’enseignement supérieur habilités à délivrer un diplôme d’ingénieur. Ces conventions précisent les conditions dans lesquelles ces établissements peuvent dispenser à la place des CFA des enseignements délivrés par ces derniers de manière à ouvrir le champ des formations possibles et à répondre aux besoins des territoires et aux attentes des CFA. Mon amendement élargit cette possibilité de conventionnement à tout établissement d’enseignement supérieur habilité à délivrer une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles.
M. le rapporteur. Il s’agit, là encore, d’inscrire dans la loi des pratiques existantes. Avis favorable à ces deux amendements.
La Commission adopte l’amendement AS107.
L’amendement AS183 tombe.
La Commission en vient à l’amendement AS345 de la Commission des affaires culturelles et de l’éducation.
Mme Colette Langlade, rapporteure pour avis. La loi du 8 juillet 2013 pour la refondation de l’école prévoit que l’orientation et les formations proposées aux élèves « favorisent la représentation équilibrée entre les femmes et les hommes parmi les filières de formation », un objectif que l’on retrouve à l’article 13 du présent projet de loi, s’agissant du contrat de plan régional de développement des formations professionnelles. Nous proposons une disposition analogue à propos des CFA.
M. le rapporteur. Avis favorable.
La Commission adopte l’amendement.
Puis elle examine l’amendement AS348 de la Commission des affaires culturelles et de l’éducation.
Mme Colette Langlade, rapporteure pour avis. Il convient d’encourager la mobilité internationale des apprentis, notamment au travers des programmes de l’Union européenne.
M. le rapporteur. Avis favorable.
La Commission adopte l’amendement.
Puis elle adopte l’article 8 modifié.
Article 8 bis
(art. L. 6231-4-2[nouveau] du code du travail)
Affichage des symboles républicains dans les centres de formation
des apprentis
Lors de son examen du texte, votre commission a adopté un amendement visant à soumettre les centres de formation d’apprentis aux mêmes obligations d’affichage des symboles républicains – définies par l’article 3 de la loi du 8 juillet 2013 – que les écoles et les établissements d’enseignement du second degré publics et privés sous contrat.
Ainsi, la devise de la République, le drapeau tricolore et le drapeau européen devront être apposés sur la façade des centres de formation d’apprentis et la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 devra être affichée de manière visible dans les locaux de ces établissements.
*
La Commission examine l’amendement AS353 de la Commission des affaires culturelles et de l’éducation.
Mme Colette Langlade, rapporteure pour avis. Nous avons adopté, il y a quelques instants, le principe d’une culture citoyenne commune aux élèves et aux apprentis. Je vous invite à faire de même avec les symboles républicains, qui doivent être inscrits sur le fronton des CFA, à l’instar de ce que la loi pour la refondation de l’école a prévu pour les établissements scolaires.
M. le rapporteur. Avis favorable.
La Commission adopte l’amendement.
Article 9
(art. L. 6233-1, L. 6241-2, L. 6241-4, L. 6241-5, L. 6241-6, L. 6242-1, L. 6242-2,
L. 6242-3-1 [nouveau], L. 6242-4, L. 6242-6 à L. 6242-10 du code du travail)
Coût des formations et circuit de la collecte de la taxe d’apprentissage
Nombreux sont les observateurs qui ont constaté la complexité du financement de l’apprentissage. Ainsi, dans un rapport d’information sur la répartition du produit de la taxe d’apprentissage fait au nom de la commission des finances du Sénat (43), François Patriat souligne qu’il « s’agit d’un dispositif d’une redoutable complexité tant dans ses modalités de collecte que de répartition. […] Depuis la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, qui a procédé à une réforme d’ensemble du système de formation professionnelle et de collecte de la taxe d’apprentissage, tous les rapports de l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) ou de l’Inspection générale des finances (IGF) n’ont cessé de mettre en évidence un dispositif juridique de collecte trop complexe pour les entreprises comme pour l’administration, mal respecté et insuffisamment contrôlé. En outre, l’ensemble de ces rapports, mais aussi les auditions, ont permis de souligner le caractère peu transparent et illisible de la redistribution du produit de cette taxe. »
La réforme engagée par le Gouvernement vise donc à simplifier le circuit de financement de la taxe d’apprentissage afin d’en améliorer l’efficacité et la transparence, tout en renforçant les moyens financiers accordés aux centres de formation des apprentis et les moyens des régions. Le présent projet de loi poursuit donc la réforme initiée par la loi de finances rectificatives pour 2013 en simplifiant le circuit de collecte de la taxe d’apprentissage.
La loi de finances rectificative pour 2013 a opéré une réforme de grande ampleur de la taxe d’apprentissage. Cette réforme met en jeu 3,5 milliards d’euros, sur un total de 6 milliards d’euros affectés à l’apprentissage.
Par ailleurs la loi de finances pour 2014 (44) :
– a supprimé l’indemnité compensatrice forfaitaire versée aux employeurs – pour soutenir l’embauche d’apprentis et l’effort de formation – par les régions et compensée par l’État et l’a remplacée par une nouvelle aide ciblée en faveur des entreprises de moins de 10 salariés, versée par les régions (article 140) ;
– et a recentré le crédit d’impôt en faveur de l’apprentissage, dont bénéficient les entreprises, sur les seuls apprentis ayant un faible niveau de formation initiale (article 36).
A. UN FINANCEMENT COMPLEXE
1. La taxe d’apprentissage
Instituée en 1925 et régie par les dispositions des articles 224 à 230 G du code général des impôts, la taxe d’apprentissage est due par la majorité des employeurs, quel que soit leur statut : entreprise commerciale, industrielle ou artisanale, entrepreneur individuel, association, coopérative agricole ou groupement d’intérêt économique (GIE) (45). Elle est assise sur la masse salariale de l’année précédente, définie aux articles 225 et 225 A du code général des impôts, c’est-à-dire le montant total des rémunérations soumises aux cotisations sociales (y compris les rémunérations versées aux salariés expatriés) et des avantages en nature versés par l’entreprise (indemnités, primes, gratifications, pourboires, etc.). Le salaire des apprentis est exonéré totalement ou partiellement selon l’effectif de l’entreprise. Les entreprises redevables de la taxe d’apprentissage s’en acquittent en effectuant des versements auprès d’organismes collecteurs de la taxe d’apprentissage (OCTA). Ces versements doivent être effectués avant le 1er mars de l’année suivant le versement des salaires à raison desquels la taxe est due.
La taxe d’apprentissage est composée de deux parties communément identifiées comme le « quota » et le « hors quota ».
• Le quota
Le quota est la fraction de la taxe d’apprentissage obligatoirement réservée au développement de l’apprentissage. Concrètement, en 2013, les entreprises doivent consacrer à l’apprentissage un « quota » égal à 55 % du montant de leur taxe d’apprentissage. Ce quota est constitué des dépenses libératoires suivantes :
– le versement, au titre du compte d’affectation spéciale « Financement national du développement et de la modernisation de l’apprentissage » (FNDMA), égal à 22 % de la taxe d’apprentissage. Celui-ci doit être effectué préalablement à toutes les autres dépenses libératoires. L’organisme collecteur le reverse intégralement au Trésor public, celui-ci en affectant le produit au FNDMA créé à cet effet ;
– l’autre fraction du quota, dite « quota libre » est destinée au concours financier aux centres de formation des apprentis (CFA) où sont inscrits les apprentis employés par l’entreprise, au prorata du nombre d’inscrits dans chacun d’eux.
• Le hors-quota ou « barème »
Le hors quota – également dénommé « barème » – permet d’assurer le financement des premières formations technologiques et professionnelles. Il est égal à 45 % de la taxe en 2013 (47 % en 2012).
La répartition des fonds du hors quota est effectuée suivant les choix d’affectation des entreprises dans le cadre d’un barème de répartition prenant en compte les niveaux de formation et la liste des établissements habilités au niveau préfectoral :
– 40 % pour les formations de niveaux IV et V (CAP, BEP et Bac pro) ;
– 40 % pour les niveaux III et II (Bac +2 à Bac +4 : BTS, IUT, licence pro, master 1) ;
– 20 % pour les niveaux I (écoles supérieures, écoles d’ingénieurs, master 2).
2. La contribution au développement de l’apprentissage (CDA)
Créée en 2004, la contribution au développement de l’apprentissage est due par les entreprises redevables de la taxe d’apprentissage. Son versement s’effectue en même temps que cette dernière. Le taux d’imposition de cette contribution est de 0,18 %.
Le produit de la CDA (estimé à 749 millions d’euros pour 2012) est réparti directement par la direction générale des finances publiques entre les régions et affecté aux fonds régionaux de l’apprentissage et de la formation professionnelle continue (FRAFPC).
3. La contribution supplémentaire à l’apprentissage (CSA)
La contribution supplémentaire à l’apprentissage (CSA), créée en 2009 et régie par l’article 230 H du CGI, est la plus récente des trois taxes dédiées au développement de l’apprentissage. Elle est versée au compte d’affectation spéciale « FNDMA » et s’est substituée à la majoration de taux de la taxe d’apprentissage due depuis 2006 par les entreprises de plus de 250 salariés ne respectant pas un taux de 3 % d’alternants. La loi de finances rectificative pour 2011 précitée a instauré un dispositif de « bonus-malus ». Pour les entreprises assujetties, le taux de la taxe est modulé selon l’écart entre la proportion d’alternants et la cible de 4 %, selon trois tranches :
– si la proportion d’alternants est inférieure à 1 %, le taux de la CSA est de 0,25 %. Ce taux est porté à 0,3 % pour les entreprises de plus de 2 000 salariés ;
– si elle est comprise entre 1 % et 3 %, le taux de la CSA est de 0,1 % ;
– si elle est comprise entre 3 et 4 %, le taux de la CSA est de 0,05 %.
Les recettes prévisionnelles de CSA s’élèvent à 235 millions d’euros pour 2013 et 314 millions d’euros pour 2014.
Un dispositif de bonus, financé par le compte spécial « FNDMA », a été mis en place au profit des entreprises de 250 salariés et plus dépassant le quota d’alternants. Les montants affectés au titre du bonus versé aux entreprises ont été de 3 millions d’euros en 2012.
Le produit de la CSA est, depuis sa création, intégralement affecté au compte d’affectation spéciale « FNDMA ».
Le schéma ci-après synthétise le dispositif « classique » de financement de l’apprentissage.


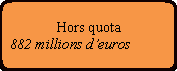
![]()
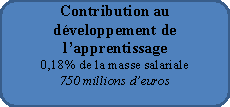
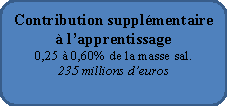
![]()
![]()
![]()
![]()
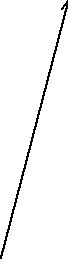
![]()
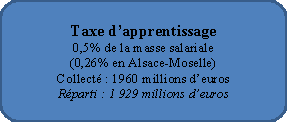
![]()
![]()
![]()
![]()

![]()
![]()
![]()

![]()
![]()
![]()
![]()



![]()
![]()
![]()



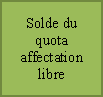


B. UNE RÉFORME AMBITIEUSE
L’article 60 de la loi de finances rectificative pour 2013 (46) a, en premier, lieu, fusionné, à compter du 1er janvier 2014, la taxe d’apprentissage et la contribution au développement de l’apprentissage. Le taux de la taxe sera désormais de 0,68 % et de 0,44 % en Alsace-Moselle.
Par ailleurs, la répartition des fonds collectés par la nouvelle taxe d’apprentissage a été modifiée :
– une première fraction du produit de la nouvelle taxe d’apprentissage, dénommée « fraction régionale de l’apprentissage » dont le montant, fixé par décret en Conseil d’État, est au moins égale à 55 % du produit ;
– une seconde fraction, dénommée « quota », dont le pourcentage du produit de la nouvelle taxe d’apprentissage doit également être déterminé par décret en Conseil d’État mais sans niveau minimal, devrait être affectée aux centres de formation d’apprentis et aux sections d’apprentissage ;
– le principe du libre versement de la part libératoire de l’employeur aux établissements de formation de son choix en fonction de leur éligibilité fixée par la liste préfectorale est conservé ;
– la CSA devrait être affectée directement aux centres de formations des apprentis et aux sections d’apprentissages, via le Trésor public.
Cette seconde partie de la réforme a cependant été censurée par le Conseil constitutionnel dans une décision du 29 décembre 2013 (47). Le Gouvernement s’est engagé à mener cette réforme à terme par de nouvelles mesures législatives.
Le schéma ci-après illustre le nouveau circuit de financement envisagé :
![]()
![]()
![]()
![]()




![]()
![]()
![]()



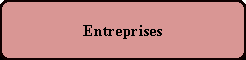
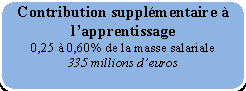


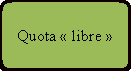
![]()

![]()

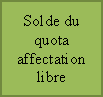

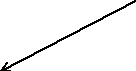

![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()


L’objectif de la réforme est de flécher une part plus grande de la taxe d’apprentissage vers l’apprentissage lui-même.
Ainsi, une part plus importante de la taxe sera désormais régionalisée : les moyens des régions devront être ainsi renforcés, passant de 1,529 milliards d’euros en 2012 à 1,653 milliards d’euros en 2015. Simultanément, les moyens directement affectés aux CFA augmenteront par cumul de la part dite « quota » de la taxe et du montant de la CSA dû par les entreprises.
La part de la taxe dite « barème » sera réduite d’environ 50 millions d’euros en 2015 par rapport à son évolution à la baisse déjà engagée depuis 2011.
La typologie des formations, établissements et organismes pouvant percevoir de la taxe d’apprentissage au titre de la part « barème » a été précisée lors du débat sur loi de finances rectificatives pour 2013 : seront écartés du bénéfice du barème les établissements à but lucratif et, pour ceux qui délivrent des diplômes, les établissements secondaires privés agissant hors contrat d’association avec l’État.
Les CFA, qui sont aujourd’hui éligibles à la part « barème », le seront encore dans le cadre de la nouvelle réforme, mais seulement pour compléter le montant du ou des concours financiers obligatoires que doit verser, dans la limite de son quota, une entreprise qui a des apprentis aux CFA qui les forment, lorsque le montant de la part « quota » de cette entreprise s’avérera insuffisant. Une entreprise qui n’a pas d’apprentis, et qui n’a donc pas à s’acquitter de concours financiers obligatoires, ne pourra donc pas affecter du barème à des CFA.
Le financement de l’apprentissage devrait donc évoluer de la façon suivante :
FINANCEMENT DE L’APPRENTISSAGE
(en millions d’euros)
Situation en 2012 |
Prévisions 2015 | |
Régions |
1 529 (1) |
1 653 |
CFA |
810 |
955 (3) |
Hors quota |
738 (2) |
679 |
(1) Avec reliquat ICF, une péréquation de 200 millions d’euros et une COM de 331 millions d’euros.
(2) Avec déduction des versements aux CFA / 144 millions d’euros.
(3) soit 621 millions d’euros de TA et 335 millions d’euros de CSA.
II. HARMONISER LES COÛTS DE FORMATION
En vertu de l’article R. 6241-3 du code du travail, le préfet de région publie, chaque année, une liste des premières formations technologiques et professionnelles, désignant les centres de formation d’apprentis habilités à percevoir des fonds en provenance de l’apprentissage. Cette liste indique pour chaque CFA le coût par apprenti et par formation. Lorsqu’une entreprise forme un apprenti, elle doit verser au CFA un « concours financier obligatoire » (CFO), la référence étant alors le coût par apprenti figurant sur la liste préfectorale.
Or, ces coûts de formation présentent des disparités très importantes d’une région à l’autre comme l’illustrent les exemples suivants :
– de 3 900 euros à 23 000 euros pour un bac professionnel « Technicien de maintenance des systèmes énergétiques et climatiques » ;
– de 4 860 euros à 22 750 euros pour un bac professionnel « Technicien outilleur » ;
– de 2 210 euros à 23 000 euros pour un CAP « Agent polyvalent de restauration » ;
– de 4 660 euros à 18 900 euros pour un CAP « Conducteur routier marchandises ».
C’est pourquoi, le présent projet de loi prévoit de définir une méthode de calcul de ces coûts proposée par le conseil national de formation professionnelle tout au long de la vie (CNFPTLV) et arrêtée par un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
Le I du présent article propose donc de modifier l’article L. 6233-1 du code du travail relatif aux ressources des CFA et des sections d’apprentissages en précisant que dans le cadre de la convention de création du CFA, les coûts de formation sont déterminés par la région (la collectivité territoriale de Corse et le département de Mayotte) par spécialité et par diplôme préparé selon la méthodologie fixée par l’arrêté du ministre de la formation professionnelle.
Le 2° du III de l’article 9 modifie, en conséquence, l’article L. 6241-4 et prévoit le concours financier versé par les entreprises est égal au coût par apprenti selon les modalités prévues par l’article L. 6233-1 du code du travail.
III. LA RÉFORME DE LA COLLECTE DE LA TAXE D’APPRENTISSAGE
A. LE DISPOSITIF DE COLLECTE DE LA TAXE D’APPRENTISSAGE
Créés par la loi du 16 juillet 1971 (48), les organismes collecteurs de la taxe d’apprentissage – les OCTA – sont chargés de sa collecte. Ces organismes assurent les tâches suivantes :
– collecter les déclarations et les versements des entreprises qui doivent être déposés avant le 1er mars au titre de la taxe d’apprentissage, de la CDA et de la CSA suivant l’exercice de référence pris en compte pour le calcul de l’assiette de l’impôt ;
– reverser les fonds au Trésor public au plus tard le 30 avril ;
– répartir des sommes collectées au titre des dépenses libératoires entre les organismes de formation, au plus tard le 30 juin.
Ces derniers doivent, dans le cadre de leur mission, s’assurer de la réalité et du bien-fondé des dépenses libératoires exposées par les entreprises assujetties à la taxe d’apprentissage. À cet effet, ils délivrent aux entreprises cotisantes un reçu détaillant les dépenses libératoires des différentes taxes relatives à l’apprentissage (taxe d’apprentissage, CDA et CSA) qui permet de justifier le montant qui a été acquitté et du choix des affectations si l’entreprise avait désigné nommément un ou des bénéficiaires (49).
Après déduction de la part de la taxe qui alimente le compte d’affectation spéciale « FNDMA », les fonds dits « libres » des OCTA sont constitués par les versements que les entreprises n’ont pas formellement fléchés.
Pour répartir ces fonds libres, l’OCTA doit consulter une commission composée de représentants d’organisations syndicales de salariés et patronales (article R. 6242-8 du code du travail), cette règle ne s’appliquant pas aux organismes consulaires. En effet, pour ces derniers, les décisions de répartition relèvent de l’instance décisionnelle désignée à cet effet, qui reflète la composition de leur conseil d’administration.
La loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale (50) a procédé à une première réforme du régime juridique de la collecte de la taxe d’apprentissage en définissant les conditions d’habilitation des collecteurs. Depuis, ces organismes sont soit :
– agréés par le ministère de l’emploi et de la formation professionnelle dans des conditions précises dans le cadre d’une demande transmise à la Délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle (DGEFP) ;
– habilités au niveau national au titre d’une convention cadre de coopération conclue avec le ministère de l’éducation nationale, de l’agriculture et/ou des sports ou au titre d’un agrément interministériel ;
– habilités au niveau régional en tant qu’établissement consulaire régional (Chambres régionales de commerce et d’industrie, de métiers, d’agriculture) ou par agrément préfectoral régional.
Il en résulte un triple niveau d’habilitation dont les critères d’attribution n’obéissent pas aux mêmes règles.
Les organismes collecteurs de la taxe d’apprentissage (OCTA) sont aujourd’hui au nombre de 144, répartis entre 63 établissements consulaires, 55 OCTA nationaux et 26 OCTA régionaux. Bien que leur nombre ait déjà été fortement réduit – il en existait 563 en 2003, il semble trop élevé pour permettre une gestion optimale des financements et génère une forte concurrence entre les structures. À titre de comparaison, le nombre total d’organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA) pour la formation professionnelle s’élève à 20.
On constate d’importants écarts de collecte entre les OCTA : trois organismes concentrent 30 % des montants, soit 571,9 millions d’euros, et les dix plus importants réunissent 51 % de la taxe, alors que plus de cent OCTA gèrent moins de 10 millions d’euros, dont 56 moins de 2 millions d’euros.
De nombreux rapports ont souligné, comme celui de M. François Patriat (51), les dérives de ces dispositifs de collecte :
– plusieurs modes d’habilitation des organismes de collecte coexistent. Ils n’obéissent pas aux mêmes critères d’attribution et sont délivrés à des organismes de différentes natures dont les champs géographiques et professionnels peuvent se chevaucher, empêchant ainsi toute visibilité de la collecte et de son processus de répartition ;
– le système conduit à une concurrence entre les principaux organismes de collecte et engendre des pratiques anormales (utilisation des frais de gestion de la taxe d’apprentissage pour le financement de campagnes publicitaires et d’offres de services spécifiques aux grands groupes ; recours à des courtiers ou « rabatteurs » de taxe alors que la réglementation ne l’autorise pas) qui, au final, peuvent être considérées comme un financement déguisé des OCTA aux frais de ressources humaines engagés par les grands groupes pour gérer leurs alternants, et conduisent à orienter le produit de la taxe d’apprentissage au profit de l’enseignement supérieur ;
– une telle situation entraîne une « très grande hétérogénéité » des performances de gestion des organismes de collecte. Les frais de collecte varient selon la DGEFP de 1 à 140 en fonction de l’organisme lorsque les frais de gestion sont ramenés au coût par dossier. Ainsi, il a été calculé que le coût par dossier traité pouvait varier de 6 euros à 842 euros selon l’OCTA gestionnaire ;
– les obligations comptables sont imparfaitement appliquées. L’absence de comptabilité analytique ne permet pas à l’ensemble des OCTA de respecter l’obligation d’inscrire de façon distincte dans leurs comptes les opérations relatives au quota de la taxe d’apprentissage ;
– la dispersion de l’outil de collecte n’est pas sans effet sur la répartition des fonds collectés. L’IGAS considérait dès 2009 que « près de la moitié des dépenses sont littéralement saupoudrées » par des « petits OCTA », sans garantie quant à leur pertinence et leur finalité, et sans véritable contrôle possible.
B. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
1. Rationaliser le circuit de la collecte
L’article 9 propose de réformer en profondeur l’architecture de la collecte de la taxe d’apprentissage :
– au niveau national : il est prévu de doter les seuls OPCA agréés d’une habilitation à collecter la taxe d’apprentissage ;
– au niveau régional : il est prévu de confier la collecte à un collecteur interconsulaire régional unique.
a. La collecte de la taxe d’apprentissage au niveau national
Le VI du présent article réécrit l’article L. 6242-1 du code précité afin de réformer la collecte au niveau national.
Depuis la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale (52), l’article L. 6242-1 du code précité précise que procèdent à la collecte de la taxe les OCTA qui sont soit agréés par le ministère de l’emploi et de la formation professionnelle, soit habilités au niveau national au titre d’une convention-cadre de coopération conclue avec le ministère de l’éducation nationale, de l’agriculture ou des sports ou au titre d’un agrément interministériel.
Le I du nouvel article L. 6242-1 propose que seuls les organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA) – c’est-à-dire les organismes mentionnés à l’article L. 6332-1 et agréés au titre du 1°, 2°, 3° ou 4° de l’article L. 6332-7 – soient habilités par l’État à collecter et redistribuer la taxe d’apprentissage au niveau national. Les OPCA auraient aussi pour mission de répartir les fonds collectés non affectés par les entreprises.
Le nouvel article L. 6242-1 précise que les OPCA ne seront habilités à collecter la taxe que « dans leur champ de compétence professionnelle et interprofessionnelle » : ils ne pourront donc collecter la taxe qu’auprès des entreprises qui sont dans le champ de leur agrément et qui leur versent les contributions au titre de la formation professionnelle continue.
Afin d’encadrer ces missions nouvelles, le II du nouvel article L. 6242-1 prévoit que les OPCA peuvent conclure une convention-cadre de coopération avec l’État pour définir les « conditions de leur participation à l’amélioration et à la promotion des formations technologiques et professionnelles initiales, notamment l’apprentissage ».
En outre, le IX du présent article modifie l’article L. 6242-4 du code du travail et propose que les OPCA puissent dans des conditions fixées par décret, déléguer la collecte et la répartition des fonds affectés de la taxe d’apprentissage. En revanche, les fonds non affectés ne pourront faire l’objet d’aucune délégation.
L’architecture de la collecte, au niveau national, devrait donc être la suivante :
– les quatre OPCA qui remplissent aujourd’hui à la fois les fonctions d’OPCA et d’OCTA (Fonds national d’assurance formation de l’industrie hôtelière – FAFIH – , Association nationale pour la formation automobile, Organisme paritaire collecteur agréé des industries de la métallurgie et Uniformation) poursuivront leurs missions ;
– les autres OPCA deviendront donc des « OPCA-OCTA » et pourront, s’ils le souhaitent, déléguer la collecte de la taxe et la répartition de cette taxe préaffectée par les entreprises à un organisme technique de leur choix ;
– les structures nationales qui ne sont pas OPCA et qui sont aujourd’hui habilitées à collecter la taxe perdront cette habilitation ;
– au niveau régional, hors du champ consulaire, tous les autres OCTA régionaux disparaissent (53).
Le document de proposition du Gouvernement paru à la suite de la concertation sur l’apprentissage souligne l’intérêt d’une telle réforme : « outre la simplification que cela engendrera, agréer les OPCA en tant qu’OCTA présente au moins deux avantages. La gouvernance paritaire serait assurée d’emblée et d’autre part, cela permettrait aux branches professionnelles de bâtir des politiques d’alternance articulant au mieux les contrats d’apprentissage et de professionnalisation. »
Ce document précise, en outre, que tous les OCTA seront agréés par le ministère du travail et que des conventions de coopération seront élaborées avec les ministères certificateurs (Éducation nationale, enseignement supérieur et agriculture en particulier) dans les secteurs professionnels qui les concernent.
Votre Rapporteur constate que c’est une simplification de grande ampleur qui est proposée dans la collecte des fonds de l’apprentissage puisqu’on dénombre aujourd’hui 20 OPCA – qui collectent les fonds de la formation professionnelle – et 54 OCTA nationaux : dans l’architecture proposée par le projet de loi, seuls 20 OPCA-OCTA effectueront la collecte au niveau national.
b. La collecte de la taxe d’apprentissage au niveau régional
Le VII du présent article réécrit l’article L. 6242-2 du code précité afin de réformer la collecte de la taxe d’apprentissage au niveau régional.
Sont aujourd’hui habilités à collecter la taxe d’apprentissage au niveau régional :
– les chambres consulaires régionales ;
– les groupements interconsulaires ;
– ou les organismes professionnels ou interprofessionnels régionaux.
Le nouvel article L. 6242-2 du code du travail prévoit de confier la collecte à un organisme collecteur unique agréé au niveau régional : il s’agirait d’un organisme interconsulaire régional unique, désigné par une convention entre les chambres consulaires régionales. Il est probable que les chambres des métiers et de l’industrie soient désignées par ces conventions.
Comme pour le niveau national, la collecte et la répartition des fonds affectés de la taxe d’apprentissage pourrait faire l’objet d’une délégation à des chambres consulaires dans le cadre d’une convention de délégation.
La simplification de la collecte tant au niveau national qu’au niveau régional aboutit à réduire de deux tiers le nombre d’organismes collecteurs, avec un passage de 147 organismes de collecte à moins de 50.
Le XII du présent article précise que les habilitations dont disposent les OCTA expirent à la date de délivrance des nouvelles habilitations et au plus tard le 31 décembre 2015.
c. Améliorer la traçabilité et le contrôle des fonds collectés
Afin d’achever la simplification de la collecte et améliorer la traçabilité des fonds collectés, le nouvel article L. 6242-3-1 du code précité – créé par le VIII du présent article – prévoit que les entreprises devront verser la taxe d’apprentissage et la contribution supplémentaire de l’apprentissage à un seul organisme collecteur, que ce soit au niveau régional ou national.
Par coordination, les III, IV et V du présent article modifient les articles L. 6241-4, L. 6241-5 et L. 6241-6 afin de préciser qu’un seul organisme peut recevoir la contribution d’une entreprise.
2. Organiser une concertation entre les organismes collecteurs et les régions
La simplification de la collecte de la taxe d’apprentissage doit s’accompagner d’une réelle concertation entre la région et les organismes collecteurs sur la répartition des fonds libres.
C’est pourquoi, le II du présent article propose de renforcer le rôle des régions dans la répartition des fonds non affectés par les entreprises en mettant en place une procédure de consultation de cette collectivité territoriale.
La procédure mise place par le nouvel alinéa de l’article L. 6241-2 du code du travail serait la suivante :
– les organismes collecteurs devraient transmettre aux régions une proposition de répartition sur leur territoire des fonds du quota non affectés par les entreprises ;
– le président de région devrait informer les organismes collecteurs de ses observations et propositions sur la répartition des fonds non affectés par les entreprises après une concertation au sein du comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles (CREFOP) (54) ;
– à l’issue de cette procédure, les organismes collecteurs procéderaient au versement des sommes aux CFA et aux sections d’apprentissage.
L’objectif est d’améliorer la transparence et la lisibilité des circuits de financement de l’apprentissage d’une part, et de renforcer le rôle de la région dans le cadre d’une concertation organisée avec l’ensemble des acteurs de l’apprentissage au sein du CREFOP, d’autre part.
3. Améliorer la gestion de la collecte et de la répartition des fonds collectés
De plus afin de s’assurer de la bonne gestion de la collecte et de la répartition des fonds de la taxe d’apprentissage le XI du présent article insère quatre nouveaux articles dans le code du travail :
– le nouvel article L. 6242-6 du code du travail prévoit qu’une convention triennale d’objectifs et de moyens, conclue entre l’État et les organismes collecteurs habilités – c’est-à-dire les OPCA et les organismes interconsulaires régionaux – définit les modalités de financement et de mise en œuvre des missions de l’organisme collecteur habilité. S’agissant des OPCA, ces modalités sont intégrées aux conventions conclues avec l’État et mentionnées à l’article L. 6332-1-1 ;
– le nouvel article L. 6242-7 du code du travail propose d’interdire le cumul d’une fonction d’administrateur ou de salarié dans un centre de formation d’apprentis, une unité ou une section d’apprentissage avec une fonction au sein d’un organisme collecteur habilité ou son délégataire ;
– le nouvel article L. 6242-8 du code du travail pose l’obligation d’une comptabilité analytique séparée pour les collecteurs à activité multiples ;
– L’article L. 6242-9 du code précité prévoit que les biens d’un organisme collecteur habilité qui cesse son activité sont dévolus sur décision de son conseil d’administration, à un organisme de même nature (OPCA ou chambre interconsulaire). Cette dévolution est soumise à l’accord préalable du ministre chargé de la formation professionnelle. À défaut, les biens sont dévolus à l’État.
Le X du présent article modifie la numérotation de l’actuel article L. 6242-6 qui devient l’article L. 6242-10.
4. Le cas particulier de la taxe d’apprentissage due au titre de la masse salariale des intermittents du spectacle
Le XIII du présent article propose d’insérer une nouvelle section IV bis intitulée « dispositions applicables aux employeurs occupant des salariés intermittents du spectacle » et un nouvel article L. 6241-12-1 qui prévoit que la taxe d’apprentissage due au titre de la masse salariale des intermittents du spectacle devra être versée à un OCTA unique désigné par une convention ou un accord professionnel national étendu afin de permettre à la branche professionnelle de résoudre la problématique de financement des formations des CFA et sections d’apprentissage des métiers du spectacle.
*
* *
Lors de son examen du texte, votre commission a adopté deux amendements précisant les conditions de collecte et d’affectation de la taxe d’apprentissage :
– le premier permet aux organisations professionnelles de signer conjointement les conventions de coopération conclues entre l’État et les OPCA qui définissent les conditions de leur participation à l’amélioration et à la promotion des formations technologiques et professionnelles initiales, notamment l’apprentissage ;
– le second précise que les entreprises peuvent choisir l’organisme collecteur de la taxe d’apprentissage de leur choix, l’objectif étant qu’aucun accord conventionnel ne puisse leur imposer le versement obligatoire à un OCTA désigné par la branche professionnelle dont il relève.
*
* *
La Commission examine l’amendement AS189 de M. Gérard Cherpion.
M. le rapporteur. Il faut laisser aux organismes collecteurs de la taxe d’apprentissage (OCTA) une marge de liberté pour décider de l’affectation des fonds non affectés, sachant qu’il est prévu une procédure de consultation de la région et du comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles (CREFOP). Si on définit au préalable des critères de répartition, le dispositif risque de perdre de son intérêt. Avis défavorable.
M. Gérard Cherpion. Il s’agit seulement de prendre en compte le nombre d’apprentis et leur niveau de formation, qui ont un impact sur le coût.
La Commission rejette l’amendement.
Elle examine ensuite l’amendement AS165 de M. Christophe Borgel.
M. Christophe Borgel. Il s’agit de permettre aux écoles de production d’avoir accès à la part « quota » de la taxe d’apprentissage et de pouvoir ainsi asseoir plus fortement leur action. Ces centres de formation technique, qui permettent à des jeunes en situation de décrochage scolaire âgés de 14 à 18 ans de se former à un métier, allient en effet formation professionnelle et production – dans la mesure où une partie de ce qui est fabriqué en leur sein est en liaison directe avec l’industrie – et donnent lieu à de très bons résultats, comme je l’ai constaté pour l’école de production de Toulouse.
M. le rapporteur. Les établissements privés d’enseignement technique sous contrat d’association sont éligibles : votre amendement est donc satisfait.
M. Christophe Borgel. Les responsables des écoles que j’ai rencontrés n’ont pas aujourd’hui accès à la part « quota » de la taxe d’apprentissage.
M. le rapporteur. Ils ont accès à la part « barème ». Je ne pense pas souhaitable qu’ils aient aussi accès à la part « quota », car ils pourraient être assimilés aux CFA et d’autres organismes luttant contre le décrochage scolaire pourraient également demander à en bénéficier. Avis défavorable.
M. Christophe Borgel. Il faudrait quand même réfléchir aux moyens de conforter ces centres.
L’amendement est retiré.
Puis la Commission examine, en discussion commune, l’amendement AS2 de Mme Sylviane Bulteau et les amendements identiques AS32 de M. Gérard Cherpion, AS76 de M. Paul Salen et AS93 de M. Charles de Courson.
Mme Sylviane Bulteau. Dans le cadre des auditions que j’ai menées, j’ai compris que le secteur des transports travaille de longue date en liaison étroite avec l’éducation nationale grâce à des conventions de coopération. Or, l’article 9 limite la possibilité de conclure de telles conventions. Il me semble qu’il faudrait les préserver.
M. le rapporteur. Avis favorable.
La Commission adopte l’amendement AS2.
En conséquence, les amendements AS32, AS76 et AS93 tombent.
La Commission examine l’amendement AS88 de M. Francis Vercamer.
M. Francis Vercamer. L’article 9 prévoit une rationalisation des OCTA aux niveaux national et régional pour améliorer la lisibilité et l’efficacité de l’affectation des fonds. Mais il convient de rappeler la liberté de l’entreprise, s’agissant de l’affectation de sa contribution au financement de l’apprentissage, en précisant qu’elle verse son financement à l’organisme unique de son choix.
M. le rapporteur. Avis favorable.
La Commission adopte l’amendement.
Elle en vient aux amendements identiques AS75 de M. Paul Salen et AS92 de M. Charles de Courson.
M. Gérard Cherpion. La taxe d’apprentissage est un tout, la délégation de collecte doit donc concerner toute la taxe.
M. Francis Vercamer. Les organismes collecteurs doivent pouvoir déléguer aux organismes consulaires l’ensemble de la collecte et de la répartition des fonds de la taxe d’apprentissage.
M. le rapporteur. Avis défavorable, car cette mesure est contraire à l’objectif du projet de loi, qui est de simplifier le circuit de la collecte et de la répartition de cette taxe. Seuls les OCTA devront s’occuper de la répartition des fonds non affectés par les entreprises.
La Commission rejette les amendements.
Elle examine ensuite les amendements identiques AS33 de M. Gérard Cherpion et AS94 de M. Charles de Courson.
M. Gérard Cherpion. L’efficacité de la mise en œuvre des dispositions de l’article 9 nécessite un calendrier raisonnable d’application. Nous proposons donc que ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2017.
M. le rapporteur. Avis défavorable. Il est contradictoire de vouloir une date d’entrée en vigueur différente pour les OPCA et les OCTA.
La Commission rejette les amendements.
Puis elle adopte l’article 9 modifié.
Article 10
(art. L. 5121-28, L. 5135-1 à L. 5135-8 [nouveaux], L. 5132-5, L. 5132-11-1, L. 5132-15-1, L. 5134-20, L. 5134-23-1, L. 5134-25-1, L. 5134-29, L. 5134-71 et L. 5522-13-5 du code du travail)
Mesures visant à favoriser l’insertion dans l’emploi
Le présent article propose plusieurs mesures visant à favoriser l’insertion dans l’emploi, en créant des périodes de mise en situation en milieu professionnel, destinées aux personnes éloignées du marché du travail ou y éprouvant des difficultés, en relevant la limite d’âge pour le bénéfice des contrats de génération liés à la transmission d’une entreprise, et en anticipant le déploiement de la réforme de l’insertion par l’activité économique. Il s’agit de développer de nouveaux outils pour combattre plus efficacement le chômage et, en particulier, celui des jeunes, une des priorités du Gouvernement et de la majorité.
Par ailleurs, au vu de l’avancée insuffisante des négociations en matière de temps partiel, entreprises par les branches professionnelles en application de la loi du 14 juin 2013 sur la sécurisation de l’emploi, le présent article vise à suspendre temporairement l’application des nouvelles dispositions sur la durée de travail minimale que cette loi a instaurées.
Les II à X du présent article ont pour objet de créer un nouveau dispositif d’insertion dans l’emploi, ouvert à la fois aux travailleurs et aux demandeurs d’emploi, et leur permettant de jouir d’une expérience professionnelle. Outre qu’il enrichirait la palette des outils mobilisables, ce nouveau dispositif garantirait une égalité de traitement entre les personnes bénéficiant d’un accompagnement social, qui ne se trouve pas aujourd’hui assurée.
A. DES DISPOSITIFS AUJOURD’HUI ÉCLATÉS
Il existe, actuellement, trois outils proches du nouveau dispositif proposé, les périodes d’immersion, les périodes d’évaluation en milieu de travail et les périodes en milieu professionnel, dont les cadres juridiques diffèrent et qui sont réservées à des publics distincts.
Peuvent ainsi accéder à une période d’immersion les salariés des entreprises d’insertion, des associations intermédiaires et des ateliers et chantiers d’insertion, lorsqu’ils ont conclu un contrat à durée déterminée insertion (CDDI), ainsi que les salariés sous contrat d’accompagnement dans l’emploi (CAE). En 2010, près de 10 500 périodes d’immersion ont ainsi été réalisées en cours de CAE.
Les demandeurs d’emploi, en revanche, ne peuvent pas bénéficier de cette mesure. Ils peuvent, cependant, accéder à des périodes d’évaluation en milieu de travail, que seul Pôle emploi peut prescrire. Ces périodes d’évaluation prennent différentes formes : évaluation en milieu de travail (EMT), évaluation en milieu de travail pour les jeunes des zones urbaines sensibles (EMT « Jeunes ZUS »), ou évaluation en milieu de travail préalable au recrutement (EMTPR). En 2012, plus de 104 500 demandeurs d’emploi ont réalisé une EMT.
Enfin, les jeunes sous contrat d’insertion dans la vie sociale (CIVIS) peuvent bénéficier, sur prescription de la mission locale, de périodes en milieu professionnel (PMP). En 2012, plus de 37 000 jeunes en ont effectué.
La mise en œuvre de ces trois catégories de mesures, qui poursuivent un objectif identique, s’est donc développée au gré des opérateurs et de manière variable. Au niveau juridique, si les périodes d’immersion et d’évaluation en milieu de travail figurent dans le code du travail, ce n’est pas le cas des périodes en milieu professionnel, qui sont régies par des « conventions type » propres à chaque opérateur.
La situation actuelle n’apparaît donc pas satisfaisante, eu égard à l’éclatement des dispositifs et à la délimitation de leur périmètre qui, au final, en exclut des publics auxquels ils pourraient utilement profiter.
B. LE DISPOSITIF UNIFIÉ PROPOSÉ
C’est pourquoi le présent article propose la mise en place d’un dispositif unifié, et procède aux coordinations législatives nécessaires.
1. Le cadre de la période de mise en situation en milieu professionnel
Le III du présent article rétablit, tout d’abord, un chapitre V, dénommé « Périodes de mise en situation en milieu professionnel », au sein du titre III, consacré aux aides à l’insertion, à l’accès et au retour à l’emploi, du livre Ier de la cinquième partie du code du travail. Ce nouveau chapitre V comporterait huit nouveaux articles L. 5135-1 à L. 5135-8.
• Les objectifs poursuivis
Le nouvel article L. 5135-1 définit, tout d’abord, les objectifs que poursuivrait la période de mise en situation en milieu professionnel, qui devrait permettre à un travailleur ou à un demandeur d’emploi :
– soit de découvrir un métier ou un secteur d’activité ;
– soit de confirmer un projet professionnel ;
– soit d’acquérir de nouvelles compétences ;
– soit d’initier une démarche de recrutement.
• Les publics et les organismes pouvant utiliser la mesure
Le nouvel article L. 5135-2 précise, ensuite, les publics et les organismes pouvant utiliser la période de mise en situation en milieu professionnel.
Pourrait ainsi y accéder « toute personne faisant l’objet d’un accompagnement social ou professionnel personnalisé », à savoir : tout demandeur d’emploi inscrit auprès de Pôle emploi, tout jeune inscrit auprès d’une mission locale, toute personne inscrite auprès de Cap Emploi, toute personne engagée dans un parcours d’insertion socioprofessionnelle pouvant être coordonné par un conseil général, un plan local pluriannuels pour l’insertion et l’emploi (PLIE) ou une association, tout salarié du secteur de l’insertion par l’activité économique, en contrat aidé ou accompagné par une entreprise adaptée ou un établissement et service d’aide par le travail (ESAT).
Serait donc créé un cadre juridique homogène, dépassant les spécificités des outils existants, pour inclure l’ensemble des supports possibles en termes de parcours et d’accompagnement, et bénéficier ainsi à un public fortement élargi. Par ailleurs, un plus grand nombre et une plus grande pluralité d’acteurs seraient concernés par cette mesure et dotés de la capacité de la mettre en œuvre. Celle-ci pourrait, en effet, être prescrite à la fois par Pôle emploi, les missions locales, Cap emploi et toute structure d’insertion par l’activité économique
• Le statut du bénéficiaire de la période
Puis le nouvel article L. 5135-3 détermine le statut du bénéficiaire d’une période de mise en situation en milieu professionnel : ce dernier conserverait le régime d’indemnisation qui lui était auparavant accordé. Il ne serait donc pas rémunéré par la structure dans laquelle il effectuerait sa période.
En revanche, aux termes du nouvel article L. 5135-6, il suivrait les règles applicables aux salariés de la structure pour ce qui aurait trait aux durées quotidienne et hebdomadaire de présence, à la présence de nuit, au repos quotidien, au repos hebdomadaire et aux jours fériés, et à la santé et à la sécurité au travail. En effet, les périodes de mise en situation en milieu professionnel ont pour but de permettre au bénéficiaire de se confronter à la réalité des situations de travail, qui peuvent être très diverses, et il importe, pour que cette mesure puisse donner tout son effet, qu’elle soit accomplie dans les conditions normales et les règles applicables aux salariés de la structure d’accueil.
Dans le même esprit, en vertu du nouvel article L. 5135-8, le bénéficiaire jouirait des mêmes protections et garanties, individuelles et collectives, en matière de droits et de libertés, de harcèlement moral et de harcèlement sexuel, que les salariés. Cette précision vise à prévenir d’éventuels abus.
• Une durée limitée
Le nouvel article L. 5135-5 encadre, ensuite, la durée de la période de mise en situation en milieu professionnel, qui ne pourrait pas excéder, au sein d’une même structure, une durée fixée par décret. D’après les informations fournies par le Gouvernement, la durée envisagée serait de 15 jours renouvelables, sans pouvoir dépasser un mois.
• Des conditions d’exécution fixées par une convention
Puis le nouvel article L. 5135-4 impose, pour fixer les conditions d’exécution de la période, la conclusion d’une convention entre le bénéficiaire, la structure dans laquelle il effectuerait la période, l’organisme prescripteur de la mesure et la structure d’accompagnement, lorsqu’il ne s’agirait pas de l’organisme prescripteur.
Le contenu et les modalités de conclusion de cette convention seraient déterminés par voie réglementaire. Selon les informations transmises par le Gouvernement, un décret devrait intervenir pour définir les différents volets de mise en œuvre de la période, tels que la nature des actions à accomplir, les conditions de suivi par un tuteur, les règles applicables aux ruptures et le partage des responsabilités, notamment en matière d’hygiène et de sécurité.
En tout état de cause, le nouvel article L. 5135-7 interdit le recours à une période de mise en situation en milieu professionnel « pour exécuter une tâche régulière correspondant à un poste de travail permanent, pour faire face à un accroissement temporaire de l’activité de la structure d’accueil, pour occuper un emploi saisonnier ou pour remplacer un salarié en cas d’absence ou de suspension de son contrat de travail ».
2. Les mesures de coordination nécessaires
Tirant les conséquences de la création de la période de mise en situation en milieu professionnel, le présent article opère les mesures de coordination législative nécessaires.
Le II remanie ainsi la numérotation de l’actuel chapitre V, intitulé « Dispositions pénales », pour qu’il devienne le chapitre VI, le nouveau dispositif créé étant inséré dans un chapitre V rétabli.
Le 1° du IV, le 1° du V, le 1° du VI, et les 1° et 2° du VII remplacent, ensuite, les dispositions relatives à la période d’immersion, par celles relatives à la période de mise en situation en milieu professionnel, tout en corrigeant les renvois législatifs, au sein des articles L. 5132-5, L. 5132-11-1, L. 5132-15-1 et L. 5134-20. Puis, à ces mêmes articles, le 2° du IV, le 2° du V, le 2° du VI et le 3° du VII procèdent aux suppressions de phrase nécessaires.
Les 3° et 4° du IV, les 3° et 4° du V, les 3° et 4° du VI, les 1° et 2° du VII, les 1° et 2° du VIII, les 1° et 2° du IX, les 1° et 2° du X substituent, ensuite, aux dispositions relatives à l’évaluation en milieu de travail prescrite par Pôle emploi, celles relatives à la période de mise en situation en milieu professionnel, tout en actualisant les renvois législatifs, au sein des articles L. 5132-5, L. 5132-11-1, L. 5132-15-1, L. 5134-29, L. 5134-71, L. 5522-13-5. Le 3° du VIII supprime, en conséquence, le dernier alinéa de l’article L. 5134-29.
II. DES DISPOSITIONS VARIÉES EN FAVEUR DE L’EMPLOI
Au-delà de la création d’un nouvel outil d’insertion professionnelle, le présent article propose trois mesures de nature distincte en faveur de l’emploi : la première a trait au contrat de génération, la deuxième à l’anticipation du déploiement de la réforme de l’insertion par l’activité économique, et la dernière à l’application des dispositions relatives au temps partiel instaurées par la loi du 14 juin 2013 sur la sécurisation de l’emploi.
A. LE RELÈVEMENT DE LA LIMITE D’ÂGE POUR LES CONTRATS DE GÉNÉRATION LIÉS À LA TRANSMISSION D’UNE ENTREPRISE
Le présent article vise, tout d’abord, à relever la limite d’âge ouvrant droit aux contrats de génération liés à la transmission d’une entreprise.
Aujourd’hui, l’article L. 5121-18 prévoit que les entreprises de moins de 50 salariés peuvent bénéficier d’une aide au titre du contrat de génération, lorsque le chef d’entreprise, âgé d’au moins 57 ans, embauche un jeune de moins de 26 ans, dans la perspective de lui transmettre la société. Pour mémoire, le montant de cette aide s’élève à 4000 euros et celle-ci peut être versée pendant 3 ans.
Or, comme le constate l’étude d’impact, à la fin du troisième trimestre 2013, seules 5% des demandes d’aides formulées au titre du contrat de génération s’inscrivait dans ce cadre. Ce résultat limité s’explique, en partie, par les évolutions du marché de l’emploi, auquel les jeunes accèdent plus tardivement, notamment en raison de l’allongement de la durée des études. Par ailleurs, la reprise d’une entreprise requiert certaines garanties financières et un minimum d’expérience professionnelle.
C’est pourquoi le I du présent article a pour objet de relever à 30 ans le plafond de la limite d’âge du jeune fixé par la loi. À cette fin, il modifie l’article L. 5121-18, pour qu’il indique désormais que le jeune doit être « âgé de moins de trente ans », et qu’il réaffirme que l’entreprise doit continuer de remplir les autres conditions auxquelles l’octroi de l’aide au titre du contrat de génération est subordonné.
B. L’ANTICIPATION DU DÉPLOIEMENT DE LA RÉFORME DE L’INSERTION PAR L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE
Le présent article vise, ensuite, à anticiper le déploiement de la réforme de l’insertion par l’activité économique, qui doit se concrétiser dans les prochains mois, conformément aux annonces du Premier ministre en juillet dernier. Cette réforme poursuit un objectif de simplification des modes de financement, de consolidation des structures d’insertion par l’activité économique (SIAE) et de renforcement de l’efficacité de l’action en direction des publics en difficulté.
Elle a d’ores et déjà été engagée et certains de ses volets prendront prochainement effet. Comme le rappelle l’étude d’impact, la loi de finances pour 2014 a ainsi supprimé le taux de prise en charge financière spécifique des contrats uniques d’insertion – contrats d’accompagnement dans l’emploi (CUI-CAE) effectués en ateliers et chantiers d’insertion (ACI), auparavant fixé à 105 % du SMIC. À partir du 1er juillet 2014, ces structures devront conclure des contrats à durée déterminée d’insertion (CDDI), pour lesquels sera versée une aide au poste.
Afin de préparer l’entrée en vigueur de cette réforme, le XI du présent article propose d’apporter trois modifications à l’article L. 5132-15-1, qui énonce les règles applicables aux contrats signés par les ateliers et chantiers d’insertion :
– le 1° a pour but de préciser que ces structures « quel que soit leur statut juridique » pourraient procéder à des recrutements ;
– le 2° a pour objet d’étendre aux CDDI conclus dans ces structures, la possibilité de déroger à la durée hebdomadaire de travail de 20 heures, actuellement ouverte pour les CUI-CAE, lorsqu’il apparaîtrait nécessaire de « prendre en compte les difficultés particulièrement importantes de l’intéressé », la différence de régime entre ces deux contrats, liée à la forme initiale du recrutement, ne reposant pas sur une raison de fond ;
– en conséquence, le 3° ajoute un nouvel alinéa à cet article, prévoyant qu’« un décret définit les conditions dans lesquelles la dérogation à la durée hebdomadaire de travail minimale (…) peut être accordée ».
Enfin, le XII du présent article tend à abroger, à compter du 1er juillet 2014, des dispositions que l’entrée en vigueur de la réforme rendra obsolètes, à savoir le deuxième alinéa de l’article L. 5134-23-1 et le troisième alinéa de l’article L. 5134-25-1, qui autorisent des exceptions au régime actuel de soutien financier.
C. LA SUSPENSION TEMPORAIRE DE L’APPLICATION DES NOUVELLES DISPOSITIONS SUR LE TEMPS PARTIEL
Le présent article vise, enfin, à suspendre temporairement l’application des nouvelles dispositions sur le temps partiel, instaurées par l’article 12 de la loi du 14 juin 2013 sur la sécurisation de l’emploi.
Ce dernier a, en effet, créé deux nouveaux articles dans le code du travail :
– l’article L. 3123-14-1, qui pose le principe d’une durée minimale de temps de travail de 24 heures par semaine, dont le VIII de l’article 12 de la loi du 14 juin 2013 a prévu l’entrée en vigueur le 1er janvier 2014, soit pour les contrats signés à compter de cette date ;
– l’article L. 3123-14-3, qui ménage la possibilité de déroger à cette durée minimale, par un accord de branche étendu qui contiendrait des garanties quant à la mise en œuvre d’horaires réguliers ou permettant au salarié de cumuler plusieurs activités afin d’atteindre une durée globale d’activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée minimale.
Or, comme le souligne l’étude d’impact, les négociations engagées dans les principales branches concernées par les nouvelles règles relatives au temps partiel, en vue de conclure de tels accords dérogatoires, n’ont pas pu, le plus souvent, encore aboutir.
Dès lors, il apparaît nécessaire de suspendre temporairement l’application des nouvelles dispositions, pour permettre la poursuite de ces négociations. À cette fin, le XII du présent article prévoit que :
– l’application des dispositions de l’article L. 3123-14-1 du code du travail et du VIII de l’article 12 de la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi serait suspendue jusqu’au 30 juin 2014 ;
– cette suspension prendrait effet à compter du 22 janvier 2014, correspondant à la date de présentation du projet de loi en Conseil des ministres.
S’agissant du droit transitoire, les contrats de travail à temps partiel conclus au cours de la période de suspension, soit entre le 22 janvier et le 30 juin 2014, devraient comporter donc une durée de travail sans minimum légal, mais respecter, le cas échéant, une durée minimale conventionnelle. En revanche, les contrats de travail à temps partiel conclus entre le 1er et le 21 janvier 2014 ainsi qu’à partir du 1er juillet 2014, devraient respecter la durée minimale légale de 24 heures hebdomadaires, sauf si une exception légale trouvait à s’appliquer, telle qu’une dérogation encadrée par un accord de branche étendu.
*
* *
Lors de son examen du projet de loi, votre commission a adopté les principales modifications suivantes au texte de l’article 10.
Afin de clarifier le principe selon lequel la nouvelle période de mise en situation en milieu professionnel ne constitue pas une action de formation, votre commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant l’alinéa 9, qui indiquait que cette période pouvait avoir pour objectif « d’acquérir de nouvelles compétences ».
À l’initiative du rapporteur, votre commission a, ensuite, choisi de préciser que la suspension temporaire de l’application des nouvelles dispositions relatives au temps partiel ne vise que la règle de la durée minimale de travail 24 heures hebdomadaires, et non la règle de la majoration de salaire de 10 %.
Enfin, elle a complété l’article 10 pour que le nom de « Pôle emploi » figure dans le code du travail, en adoptant un amendement du rapporteur modifiant l’article L. 5312-1 en ce sens.
*
* *
L’amendement AS151 de Mme Carrey-Conte est retiré.
La Commission examine l’amendement AS401 du rapporteur.
M. le rapporteur. En prévoyant qu’une période de mise en situation en milieu professionnel peut avoir pour objectif « d’acquérir de nouvelles compétences », l’alinéa 9 induit une confusion, qu’il s’agit de supprimer. La période de mise en situation en milieu professionnel ne constitue pas une action de formation.
M. Gérard Cherpion. Je n’y suis pas favorable. On a vu que l’évaluation en milieu de travail (EMT) offrait au salarié la possibilité de développer de nouvelles compétences dans une entreprise.
La Commission adopte l’amendement.
Elle en vient à l’amendement AS341 du rapporteur.
M. le rapporteur. Il s’agit d’inscrire dans le code du travail le nom de Pôle emploi.
La Commission adopte l’amendement.
Elle examine ensuite l’amendement AS 198 de M. Gérard Cherpion.
M. Gérard Cherpion. L’alinéa 61 prévoit de fixer le délai d’entrée en vigueur du seuil minimum de 24 heures par semaine pour les contrats de travail au 30 juin 2014, alors qu’il était initialement fixé au 1er janvier. Cela crée une insécurité juridique, notamment pour la période du 1er au 22 janvier 2014. Il aurait fallu adopter une telle mesure avant l’entrée en vigueur des dispositions de la loi relative à la sécurisation de l’emploi.
M. le rapporteur. Il est proposé de reporter de six mois l’application des accords de branche pour le temps partiel. En effet, les négociations nécessaires n’ont pu toutes aboutir, et ce report est réclamé par les partenaires sociaux.
M. Christophe Cavard. Nous trouvons surprenant que l’on renvoie de six mois la mise en œuvre d’un acquis aussi important. D’autant que le ministre fait pression sur les partenaires sociaux en leur disant qu’il tranchera s’ils ne se mettent pas d’accord avant une date déterminée. Je soutiens donc l’amendement.
M. Gérard Cherpion. Le problème concerne les contrats signés entre le 1er et le 22 janvier 2014.
Mme Jacqueline Fraysse. Je m’associe à ce que vient de dire M. Cavard.
M. Gérard Sebaoun. Il n’est pas question de mettre la loi votée en débat – le ministre vient de le rappeler. Mais il a souligné la difficulté que rencontrent certaines branches dans le cadre des négociations en cours. Il s’agit seulement de leur donner six mois de plus pour leur permettre de déboucher sur des accords.
M. Denys Robiliard. M. Cavard, M. Cherpion et Mme Fraysse arrivent à la même solution pour des raisons complètement différentes. Le dispositif s’applique à partir du 1er janvier dernier puisque le délai pour aboutir à des accords collectifs avait alors expiré : les salariés ayant conclu un contrat avec les employeurs entre cette date et le 22 janvier sont donc régis par le régime prévu par la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi.
Les mois de juillet et août n’étant pas propices pour négocier, il restait quatre mois avant la fin de l’année, ce qui offrait un délai insuffisant. D’où le retard pris et la volonté de le différer de six mois.
Pour les salariés ayant signé un contrat avant le 31 décembre, il n’y a pas de difficulté. Il n’y en aura pas non plus pour ceux ayant signé après le 22 janvier.
Aux signatures intervenues entre le 1er et le 22 janvier 2014 s’appliquera le droit en vigueur à la date de la conclusion du contrat, c’est-à-dire la loi de juin 2013. Toute possibilité de modification rétroactive suppose que le législateur l’a prévue expressément ; ce n’est pas le cas. Il n’y a là, en somme, qu’un problème classique d’application de la loi dans le temps.
Mme Isabelle Le Callennec. Nous avions appelé l’attention sur cette question lors de l’examen du texte, car nous savions que des problèmes se poseraient, par exemple dans le secteur des services à la personne ou dans l’enseignement catholique. L’insécurité juridique est maintenant avérée pour les contrats signés entre le 1er et le 22 janvier 2014, quel que soit leur nombre, et il est permis de douter que l’alinéa 61 lève cette insécurité : le ministre lui-même a dit que les négociations étaient difficiles, et nul ne sait si elles auront abouti en juin prochain.
M. le rapporteur. La disposition a suscité des difficultés d’application ; cela a conduit à donner six mois supplémentaires à la négociation des accords. Mon rapport écrit, auquel je vous prie de vous reporter, détaille le droit transitoire. Pour dissiper toute ambiguïté, l’amendement AS343, dont j’anticipe la présentation, tend à préciser que la suspension temporaire des nouvelles dispositions relatives au temps partiel ne vise que la règle de la durée minimale de travail de 24 heures hebdomadaires et le droit du salarié à se la voir appliquer, et non la majoration de salaire de 10 %.
M. Christophe Cavard. Je comprends la raison qui pousse à suspendre l’application de la disposition. Mais le principe me choque : à quoi bon donner des délais impératifs aux partenaires sociaux pour conclure un accord si, une fois l’accord signé, on recule parce que l’on n’est pas prêt ? Va-t-on étendre cette pratique à tous les sujets ? De nombreux salariés attendaient l’application de la mesure avec une vive impatience, et on leur dit maintenant qu’ils devront patienter six mois supplémentaires !
La Commission rejette l’amendement.
Puis elle adopte l’amendement rédactionnel AS343 du rapporteur.
La Commission est saisie de l’amendement AS108 de M. Dominique Tian.
M. Lionel Tardy. Nous proposons d’allonger de douze mois la durée de l’expérimentation relative aux contrats de travail intermittents, prévue dans la loi relative à la sécurisation de l’emploi.
M. le rapporteur. Avis défavorable.
Mme Isabelle Le Callennec. Pourquoi ? Les agences d’intérim ne font que découvrir cette possibilité.
M. le rapporteur. Personne n’a demandé cette prolongation.
La Commission rejette l’amendement.
Puis elle adopte l’article 10 modifié.
La Commission est saisie de l’amendement AS79 rectifié de M. Francis Vercamer.
M. Francis Vercamer. Étant donné les résultats très encourageants du contrat de sécurisation professionnelle, il serait bon d’étudier la possibilité de le généraliser pour les titulaires de contrats précaires arrivant à leur terme.
M. le rapporteur. L’idée est intéressante, mais elle relève de la discussion des partenaires sociaux sur l’assurance chômage. Avis défavorable.
La Commission rejette l’amendement.
Elle examine ensuite l’amendement AS80 rectifié de M. Francis Vercamer.
M. Francis Vercamer. Nous proposons d’encourager les salariés menacés d’un licenciement économique à conclure un contrat de sécurisation professionnelle par un mécanisme incitatif propre à lever les résistances psychologiques de gens qui n’ont pas l’habitude de se former.
M. le rapporteur. Avis défavorable pour la raison dite précédemment.
La Commission rejette l’amendement.
Chapitre III
Gouvernance et décentralisation
Article 11
(Art. L. 5211-2, L. 5211-3, L. 5211-5, L. 5214-1 A, L. 5214-1 B, L. 5214-1-1, L. 5214-3, L. 5314-2, L. 6121-1, L. 6121-2, L. 6121-2-1 [nouveau], L. 6121-4 à L. 6121-7 [nouveaux], L. 6341-2, L. 6341-3, L. 6341-5, L. 6342-3 et L. 6521-2 [nouveau] du code du travail ; art. 9 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ; art. L. 451-1, L. 451-2 et L. 452-1 [nouveau] du code de l’action sociale et des familles ; art. L. 4383-2 du code de la santé publique)
Compétences des régions
Depuis la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, qui a mis fin à la compétence d’exception de l’État, la région dispose d’une compétence générale en matière de formation professionnelle. En vertu de la loi de 2004, en effet, la région « définit et met en œuvre la politique régionale d’apprentissage et de formation professionnelle des jeunes et des adultes à la recherche d’un emploi ou d’une nouvelle orientation professionnelle ». Le principal support de coordination pour la mise en œuvre de cette politique au niveau régional est constitué par le contrat de plan régional de développement des formations professionnelles (CPRDFP), qui s’est substitué, depuis la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l’orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie, à l’ancien plan régional de développement des formations (PRDF). L’État demeure toutefois compétent pour conduire certaines actions, notamment en matière d’emploi ou au titre de la solidarité nationale. Il continue ainsi par exemple d’assumer la compétence de formation professionnelle de certains publics spécifiques.
Le présent article propose d’approfondir la compétence des régions en matière de formation professionnelle, par la constitution d’un véritable « bloc de compétences ». Sur le plan formel, il reprend les articles 4, 6, 7 et 8 du projet de loi n° 496 de mobilisation des régions pour la croissance et l’emploi et de promotion de l’égalité des territoires, déposé sur le bureau du Sénat le 10 avril 2013 : ces dispositions ont en effet pleinement leur place dans ce projet de loi de réforme de la formation professionnelle.
En vertu du présent article, la région serait désormais compétente vis-à-vis de l’ensemble des publics en matière de formation professionnelle, y compris ceux pour lesquels la compétence reste encore aujourd’hui partagée – c’est le cas pour la formation des personnes handicapées – ou ceux qui relèvent encore pleinement pour l’heure de la compétence de l’État, c’est-à-dire les détenus ou encore les Français établis hors de France. S’agissant des publics handicapés, la région doit également être amenée à financer l’intégralité de la rémunération des stagiaires en centre de réadaptation professionnelle (CRP), aujourd’hui en partie assumée par l’État. La région se verrait également attribuer les actions qui demeurent aujourd’hui financées par l’État en matière de lutte contre l’illettrisme et d’accompagnement à la validation des acquis de l’expérience (VAE).
En outre, le présent article met en place, au profit de la région, de nouveaux outils destinés à permettre une plus grande coordination de la politique de formation professionnelle sur le terrain. Il s’agit :
– d’une mission de coordination par la région de la politique d’achat de formations collectives, coordination qui doit principalement associer Pôle emploi et, dans la mesure où ils le souhaitent, les départements ;
– de la mise en place d’une procédure nouvelle d’habilitation, qui doit devenir pour la région le nouvel outil pour formaliser la commande de formation au niveau régional, dans le respect des règles communautaires, en permettant aux organismes retenus de bénéficier d’une compensation financière au titre de leur obligation de service public ;
– de la possibilité pour les régions de se voir transférer les biens immobiliers de l’Association pour la formation professionnelle des adultes (AFPA), qui appartiennent à l’État.
Enfin, la région serait investie de prérogatives supplémentaires en matière de formations sanitaires et sociales, autant pour la fixation du quota d’étudiants à admettre en première année de chaque type de formation paramédicale, que pour l’agrément des établissements dispensant des formations sociales.
A. UNE COMPÉTENCE PLEINE ET ENTIÈRE S’AGISSANT DE LA FORMATION DES PERSONNES HANDICAPÉES
Le I du présent article a pour objet la redéfinition du rôle de la région en matière de formation professionnelle des personnes handicapées : aujourd’hui acteur parmi d’autres de la définition et de la mise en œuvre de cette politique, la région en sera demain l’acteur central et le pilote.
Le titre 1er du livre II de la cinquième partie du code du travail est consacré aux politiques en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés, son chapitre premier en définissant l’objet.
La définition et la mise en œuvre de cette politique est aujourd’hui partagée entre plusieurs acteurs : il s’agit d’une politique « concertée ». S’agissant des demandeurs d’emploi handicapés, la responsabilité est partagée entre plusieurs intervenants et plusieurs financeurs. Cette situation est source de complexité et contribue à une certaine illisibilité de cette politique sur le terrain.
C’est pourquoi il est proposé de faire de la région le « chef de file » de cette politique, en lui confiant le soin d’organiser désormais l’accès à la formation et à la qualification professionnelle des publics handicapés, dans le cadre de la définition d’un nouvel outil de programmation, le programme régional d’accès à la formation et à la qualification professionnelles des personnes handicapées, qui a vocation à s’articuler avec les dispositifs déjà existants en la matière.
1. L’affirmation claire du rôle prééminent de l’échelon régional
C’est l’article L. 5211-2 qui concerne les politiques d’accès à la formation et à la qualification professionnelles des personnes handicapées. Dans le droit actuel, ces politiques sont définies et mises en œuvre de manière « concertée » par l’État, le service public de l’emploi (SPE), l’association de gestion du fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées (AGEFIPH), les régions, les organismes de protection sociale, ainsi que les organisations syndicales et associations représentatives des personnes handicapées.
Le a) du 1° du I du présent article procède à la réécriture du premier alinéa de l’article L. 5211-2 pour affirmer le rôle central de la région, qui sera désormais « chargée, dans le cadre du service public régional de la formation professionnelle (…) de l’accès à la formation et à la qualification professionnelle des personnes handicapées ». Pour ce faire, la région « définit et met en œuvre un programme régional d’accès à la formation et à la qualification professionnelle des personnes handicapées », en concertation avec l’ensemble des autres acteurs aujourd’hui d’ores et déjà compétents dans ce champ (État, service public de l’emploi (SPE), AGEFIPH, organismes de protection sociale, organisations syndicales et associations représentatives des personnes handicapées).
Le b) du 1° du I supprime logiquement la mention de la région comme un acteur parmi d’autres de mise en œuvre de cette politique, celle-ci en devenant en effet le fer de lance, en conséquence de la nouvelle rédaction du premier alinéa de l’article L. 5211-2.
Le 2° du I modifie quant à lui l’article L. 5211-3, relatif aux objectifs de cette politique spécifique.
Le premier alinéa de l’article L. 5211-3, dans sa rédaction actuelle, fixe ainsi pour objectifs aux politiques d’accès à la formation et à la qualification professionnelle des personnes handicapées le recensement et la quantification des besoins de formation de ces publics ainsi que la garantie de la qualité des formations dispensées. La nouvelle rédaction proposée par le a) du 2° du I conduit à confier au nouveau programme régional d’accès à la formation et à la qualification professionnelle des personnes handicapées le soin de « répondre à leurs besoins de développement de compétences afin de faciliter leur insertion professionnelle ». Outre le rôle de premier ordre désormais attribué aux régions, votre rapporteur considère que cette rédaction est beaucoup plus satisfaisante, dans la mesure où elle fixe un objectif explicite d’insertion professionnelle à cette politique, alors que la rédaction actuelle se limitait finalement à une définition des principaux outils de cette politique : évaluation des besoins de formation et garantie de la qualité des formations délivrées.
Après avoir fixé cet objectif général d’insertion professionnelle, le a) reprend la mention de ces outils de recensement et de quantification des besoins de formation, en prévoyant explicitement que ceux-ci s’appuient sur le « diagnostic intégré dans le plan régional pour l’insertion des travailleurs handicapés (…) et l’analyse contenue dans le contrat de plan régional de développement des formations et de l’orientation professionnelles ». Autrement dit, le nouvel outil de programmation que constitue le programme régional d’accès à la formation et à la qualification professionnelles des personnes handicapées a bien vocation à s’articuler avec les dispositifs déjà existants, qu’il s’agisse du programme régional d’insertion des travailleurs handicapés (PRITH) et du contrat de plan régional de développement des formations et de l’orientation professionnelles, que l’article 13 du présent projet de loi transforme par ailleurs pour y inclure une dimension d’orientation professionnelle et y associer davantage les partenaires sociaux.
Le programme régional d’accès à la formation et à la qualification professionnelle des personnes handicapées a réellement vocation à devenir le socle de la définition des politiques menées dans ce domaine : ainsi, s’il incombait jusqu’alors aux politiques concertées menées en la matière de favoriser « l’utilisation efficiente des différents dispositifs en facilitant la coordination entre les organismes de formation ordinaires et les organismes spécialement conçus pour la compensation des conséquences du handicap ou la réparation du préjudice », cette mission relève désormais du seul programme régional piloté par la région, conformément au b) du 2° du I.
Le c) du 2° du I complète l’article L. 5211-3 désormais consacré au programme régional d’accès à la formation et à la qualification professionnelle des personnes handicapées, en précisant que celui-ci est soumis pour avis au comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles (CREFOP).
Ce même c) prévoit enfin la participation explicite des établissements et services médico-sociaux de réadaptation, pré-orientation et de rééducation professionnelle au service public régional de la formation professionnelle dans le cadre du programme régional. Dès lors que la région est bien chargée de la coordination et de la mise en œuvre de la politique de formation des personnes handicapées et afin que celle-ci soit pleinement articulée avec la politique de formation professionnelle globale, il est indispensable d’associer les établissements et services directement en charge de la formation des publics handicapés au service public régional de la formation professionnelle.
Le 3° du I modifie l’article L. 5211-5, relatif au plan régional pour l’insertion des travailleurs handicapés (PRITH). Au lieu d’être comme aujourd’hui élaboré en coordination avec les politiques d’accès à la formation et à la qualification professionnelles des personnes handicapées, le PRITH sera désormais coordonné avec le programme régional afférent, en vertu des modifications apportées par le a). Le contenu du PRITH demeure quant à lui inchangé. Concrètement, le programme régional d’accès à la formation et à la qualification professionnelles des personnes handicapées a vocation à devenir l’axe de formation du PRITH, qui répond à un objectif plus général.
Le b) du 3° du I précise que les conventions régionales de coordination de l’emploi, de l’orientation et de la formation créées par l’article 14 du présent projet de loi contribuent à mettre en œuvre le plan régional d’insertion des travailleurs handicapés (PRITH).
Ces conventions régionales sont codifiées à l’article L. 6123-4, entièrement refondu dans le cadre du présent projet de loi (55) : il s’agit des conventions conclues chaque année entre d’une part, le préfet de région et le président du conseil régional, et d’autre part, les opérateurs du service public de l’emploi au niveau régional, à savoir Pôle emploi, les missions locales et les Cap emploi, chaque convention déterminant le rôle de l’institution concernée dans la mise en œuvre de la politique de l’emploi, de l’orientation et de la formation au plan régional.
Sont évidemment particulièrement visés dans ce renvoi les Cap emploi, spécifiquement dédiés aux publics en situation de handicap, sans que ces structures n’en soient cependant exclusivement chargées, puisque Pôle emploi d’une part, les missions locales s’agissant des jeunes handicapés de moins de 25 ans d’autre part, sont également amenées à orienter et placer ces publics.
L’articulation entre les différents outils de programmation au niveau régional en matière de politique de formation et d’insertion des personnes handicapées
Le programme régional d’accès à la formation et à la qualification professionnelle des personnes handicapées n’a pas vocation à se substituer à l’actuel plan régional d’insertion des travailleurs handicapés (PRITH) : il en constitue l’un des volets, celui spécifiquement dédié à la formation de ces publics.
Le PRITH est prévu par l’article L. 5211-5, qui prévoit que ce plan est élaboré tous les cinq ans par le service public de l’emploi régional, sous l’autorité du préfet de région. Il devra désormais être coordonné avec le programme régional de formation des personnes handicapées, et doit toujours comprendre :
– un diagnostic régional englobant les diagnostics locaux établis avec la collaboration des référents pour l’insertion professionnelle des Maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) ;
– un plan d’action régional pour l’insertion des travailleurs handicapés comportant des axes d’intervention et des objectifs précis ;
– et enfin, des indicateurs régionaux de suivi et d’évaluation des actions menées au niveau régional.
Le contrat de plan régional de développement des formations professionnelles prévu à l’article 214-13 du code de l’éducation constitue l’actuel outil de programmation, au niveau régional, des actions de formation professionnelle à destination des jeunes comme des adultes : il doit permettre un développement cohérent de l’ensemble des filières de formation sur le territoire régional. Dans le cadre de l’article 13 du présent projet de loi, ce contrat de plan est désormais destiné à intégrer également les aspects relatifs à l’orientation ; en outre, une association plus étroite des partenaires sociaux est prévue, ceux-ci étant désormais expressément invités à signer ce contrat de plan.
Le comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles (CREFOP) est créé par le présent projet de loi (article 14) : il se substitue à l’actuel comité régional de l’emploi et de la formation professionnelle, et intègre également désormais les aspects relatifs à l’orientation. Il réunit l’ensemble des acteurs des politiques d’orientation, de formation professionnelle et d’emploi (opérateurs du service public de l’emploi, acteurs de la formation et de l’orientation, et partenaires sociaux) sous la présidence conjointe du préfet de région et du président du conseil régional. Son bureau est essentiellement chargé de désigner les opérateurs en charge d’assurer le conseil en évolution professionnelle, de procéder à la répartition des fonds de la taxe d’apprentissage non affectés par les entreprises, et d’arrêter les listes de formation éligibles au futur compte professionnel de formation (CPF).
Les conventions régionales de coordination de l’emploi, de l’orientation et de la formation, mises en place par le présent projet de loi (article 14) sont signées par le préfet de région et le président du conseil régional avec chacun des représentants régionaux de Pôle emploi, des missions locales et des organismes de placement spécialisés dans l’insertion professionnelle des personnes handicapées. Elles visent à mieux coordonner avec chacun des opérateurs la mise en œuvre opérationnelle des politiques de l’emploi, de l’orientation et de la formation au niveau régional.
2. La redéfinition du rôle des organismes concourant à l’insertion professionnelle des handicapés
Les 4° à 7° du I opèrent une série de modifications au sein du chapitre 4 du titre premier, consacré aux travailleurs handicapés, chapitre relatif aux institutions et organismes concourant à l’insertion professionnelle des personnes handicapées, en l’occurrence l’État, Pôle emploi, l’AGEFIPH et le Fonds d’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP).
Le 4° du I du présent article modifie l’article L. 5214-1 A, relatif au pilotage par l’État de la politique de l’emploi des personnes handicapées. Cet article précise que les objectifs et les priorités de cette politique sont fixés par l’État, en concertation avec le service public de l’emploi, l’AGEFIPH et le FIPHFP. La modification proposée consiste à y insérer les régions en tant qu’elles sont désormais chargées du service public régional de la formation professionnel, y compris s’agissant des publics en situation de handicap, dans la liste des acteurs participant, sous la houlette de l’État, à la définition des objectifs et des priorités en la matière.
Le 5° du I apporte des modifications non substantielles à l’article L. 5214-1 B, qui prévoit la conclusion, au niveau national, d’une convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens entre l’État, Pôle emploi, l’AGEFIPH, le FIPHFP et la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA). Sans modifier aucunement le contenu de cette convention d’objectifs et de moyens, le a) prévoit que celle-ci est désormais, avant signature, transmise pour avis au Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelle (CNEFOP), dont la création est prévue à l’article 14 du présent projet de loi. Le b) supprime le principe des déclinaisons locales de cette convention, ne laissant subsister que celui des déclinaisons régionales, conformément au rôle de chef de file désormais confié aux régions en la matière. Les déclinaisons de la convention nationale associent les maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) et l’ensemble des acteurs concourant à l’insertion des personnes les plus éloignées de l’emploi. Les organismes de placement spécialisés sont consultés pour avis. Ces conventions s’appuient également sur les PRITH.
Le 6° procède à l’abrogation de l’article L. 5214-1-1, qui pose le principe du financement et de la mise en œuvre des parcours de formation professionnelle pré-qualifiante et certifiante des demandeurs d’emploi handicapés par l’AGEFIPH, qui assure la gestion du fonds de développement pour l’insertion professionnelle des handicapés. En effet, la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 a transféré à l’AGEFIPH la compétence, jusqu’alors détenue par l’État, de financer et assurer la mise en œuvre des parcours de formation pré-qualifiante et certifiante des demandeurs d’emploi handicapés. L’AGEFIPH est ainsi venue se substituer à l’État comme cocontractant de l’Association nationale de formation professionnelle des adultes (AFPA), pour l’exécution du lot du marché de formation professionnelle relatif aux demandeurs d’emploi reconnus travailleurs handicapés.
Le 7° insère cette disposition relative à la compétence de l’AGEFIPH en matière de formation dans l’article L. 5214-3, consacré à l’affectation des ressources du FIPH, en précisant que le fonds finance « tout ou partie des actions de formation professionnelle pré-qualifiantes et certifiantes » à destination des demandeurs d’emploi en situation de handicap.
*
* *
Le 8° du I propose des modifications relativement marginales : il a trait aux compétences des missions locales codifiées à l’article L. 5314-2 : le premier alinéa de cet article dispose que les missions locales sont chargées d’aider les jeunes de seize à vingt-cinq ans à résoudre l’ensemble des problèmes que pose leur insertion professionnelle et sociale en assurant des fonctions d’accueil, d’information, d’orientation et d’accompagnement. Le a) précise ainsi cette dernière mission, en indiquant qu’il s’agit d’accompagner les jeunes pour les aider à accéder « à la formation professionnelle initiale ou continue, ou à un emploi ». Est ainsi mis en exergue le rôle important joué par les missions locales, qui ne se limite pas à un rôle de placement dans l’emploi des publics concernés, mais également d’aide à l’accès à une formation, qu’il s’agisse d’une formation initiale ou d’une formation continue.
Les missions locales, qui sont aujourd’hui au nombre d’environ 450 sur l’ensemble du territoire national, sont déjà dans les faits compétentes en matière de formation initiale, dans la mesure où, dans le cadre de leur suivi de l’accompagnement des jeunes sortis sans diplôme du système scolaire, elles peuvent être amenées à préconiser un retour en formation initiale. Les missions locales travaillent en effet en coordination avec les centres d’information et d’orientation (CIO), mais aussi directement avec les établissements de formation, sur cette problématique de la réorientation vers une formation initiale pour certaines catégories de jeunes. Il s’agit donc d’une précision, destinée à bien confirmer le rôle des missions locales, non pas uniquement en tant qu’organisme de « placement » dans l’emploi, mais bien aussi dans sa dimension d’orientation et de formation.
Le b) renvoie explicitement aux régions comme co-financeurs des missions locales. En effet, le dernier alinéa de l’article L. 5314-2 concerne l’évaluation des résultats atteints par les missions locales, et trace un lien entre ces résultats et les financements accordés à ces structures : ainsi, une convention entre l’État et les collectivités territoriales fixe à l’heure actuelle les conditions d’évaluation du travail accompli par les missions locales. Il s’agit désormais de prévoir explicitement que cette convention est conclue entre l’État, la région et les autres collectivités territoriales participant au financement des missions locales. En effet, les missions locales sont financée en partie par les régions ; la quasi moitié de leur financement (46 %) émane des collectivités territoriales, et en l’occurrence, à hauteur de 19 % des régions. La mention précise de la région vise simplement à tirer les conséquences du rôle définitivement central qui lui est donné en matière de formation professionnelle.
B. LE TRANSFERT À LA RÉGION DES COMPÉTENCES RÉSIDUELLES DE L’ÉTAT EN MATIÈRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE
Le II du présent article est entièrement consacré à la dévolution de la pleine compétence de la mise en œuvre territoriale de la politique de formation professionnelle aux régions : celle-ci passe par l’insertion d’une section intitulée « Compétences des régions » dans le chapitre relatif au rôle des régions, dans le cadre de la définition des principes généraux et de l’organisation de la formation professionnelle, codifiée au livre premier de la sixième partie du code du travail.
L’objectif est bien de conférer à la région une compétence pleine et entière en la matière, alors même qu’aujourd’hui, si la région dispose déjà d’une compétence de droit commun, certains volets de la formation professionnelle continue demeurent de la compétence de principe de l’État : c’est le cas en particulier de la formation des personnes placées sous main de justice, de la lutte contre l’illettrisme et de la formation aux compétences fondamentales, de celle des Français établis hors de France, ou encore de la formation en territoire ultra-marin et de celle des dirigeants d’entreprise.
1. La politique d’accès à l’apprentissage et à la formation professionnelle : une compétence désormais pleine et entière de la région
La compétence actuelle des régions en matière de formation professionnelle
Le rôle des régions en matière de formation professionnelle est aujourd’hui défini aux articles L. 6121-1 à L. 6121-3 du code du travail.
L’article L. 6121-1 renvoie à l’article L. 214-12 du code de l’éducation concernant les compétences des régions en la matière. Cet article dispose :
« La région définit et met en œuvre la politique régionale d’apprentissage et de formation professionnelle des jeunes et des adultes sans emploi ou à la recherche d’une nouvelle orientation professionnelle. Elle élabore le contrat de plan régional de développement des formations professionnelles défini à l’article L. 214-13 et arrête la carte des formations professionnelles initiales du territoire régional définie à l’article L. 214-13-1.
« Elle organise sur son territoire le réseau des centres et points d’information et de conseil sur la validation des acquis de l’expérience et contribue à assurer l’assistance aux candidats à la validation des acquis de l’expérience.
« Elle organise des actions destinées à répondre aux besoins d’apprentissage et de formation en favorisant un accès équilibré des femmes et des hommes aux différentes filières de formation. Elle veille en particulier à organiser des formations permettant d’acquérir une des qualifications mentionnées à l’article L. 6314-1 du code du travail.
« Elle assure l’accueil en formation de la population résidant sur son territoire, ou dans une autre région. Dans ce dernier cas, une convention fixe les conditions de prise en charge de la formation par les régions concernées. ».
L’article L. 6121-2 concerne le contrat de plan régional de développement des formations professionnelles, lui-même défini à l’article L. 214-13 du code de l’éducation.
L’article L. 6121-3 prévoit la conclusion de convention entre les OPCA et les régions pour déterminer l’étendue et les conditions de participation des régions au financement des actions de formation professionnelle ainsi qu’à la rémunération des bénéficiaires du congé individuel de formation.
Le II du présent article procède à une réécriture complète des articles L. 6121-1 et L. 6121-2, afin de donner à la région une compétence exclusive en matière de formation professionnelle. L’article L. 6121-3 n’est en revanche pas modifié dans le cadre du présent projet de loi. Le II insère également de nouveaux articles L. 6121-2-1 et L. 6121-4 à L. 6121-7 au sein de la nouvelle section consacrée aux compétences des régions, afin de préciser les modalités de leur mise en œuvre.
Au sein du chapitre premier consacré au rôle des régions, le 1° du II introduit une nouvelle section, relative aux compétences des régions, en proposant une réécriture des articles L. 6121-1 et L. 6121-2.
Dans le cadre de la nouvelle rédaction de l’article L. 6121-1, la région se voit attribuer pleine compétence en matière de politique régionale d’accès à l’apprentissage et à la formation professionnelle des jeunes et des adultes à la recherche d’un emploi ou d’une nouvelle orientation professionnelle, autrement dit tant les demandeurs d’emploi que les salariés. Cette compétence s’exerce « sans préjudice des compétences de l’État en matière de formation professionnelle initiale des jeunes sous statut scolaire et universitaire et en matière de service militaire adapté prévu à l’article L. 4132-12 du code de la défense ».
L’État reste donc bien compétent s’agissant de la formation initiale scolaire et universitaire, ainsi qu’en matière de service militaire adapté, qui s’applique dans les territoires ultra-marins.
Dans le cadre de cette pleine compétence, la région se voit confier les missions suivantes :
– définir et mettre en œuvre cette politique conformément aux objectifs principiels fixés par l’article L. 6111-1, essentiellement par l’élaboration du contrat de plan régional de développement des formations et de l’orientation professionnelles, et l’adoption de la carte des formations professionnelles initiales du territoire régional définie à l’article L. 214-13-1 du code de l’éducation. Ces dispositions reprennent celles qui figurent aujourd’hui au premier alinéa de l’article L. 214-12 du code de l’éducation ;
– accorder des aides individuelles à la formation et coordonner les interventions contribuant au financement d’actions de formation, dans le cadre du service public régional de l’emploi défini à l’article L. 6121-2 dans sa nouvelle rédaction ;
– conclure des conventions avec les départements candidats pour financer ensemble des formations collectives, dans le cadre de la mise en œuvre par ces derniers du programme départemental d’insertion. En effet, l’article L. 263-2 du code de l’action sociale et des familles prévoit déjà la possibilité d’un tel conventionnement, dans le cadre du pacte territorial pour l’insertion, pour la mise en œuvre de ce programme : les actions aujourd’hui mises en œuvre au titre de cette association concernent l’accompagnement renforcé et les offres de formation professionnelle spécifique pour certains publics très éloignés de l’emploi. Toutefois, cet article n’évoquant pas précisément la possibilité d’un cofinancement – bien que, dans les faits, il s’agisse bien de cela -, une clarification ne semble pas superflue. Elle permet en outre de bien intégrer cette dimension aux missions imparties à la région pour la mise en œuvre de la politique de formation professionnelle ;
– et enfin, organiser la mise en œuvre et participer au financement de l’accompagnement des demandeurs d’emploi candidats à la validation des acquis de l’expérience (VAE), en menant des actions d’assistance et de préparation des candidats une fois leur dossier jugé recevable. Si la région est déjà compétente en matière de VAE, elle le sera désormais pleinement, même en matière d’accompagnement. Un décret en Conseil d’État doit venir définir les modalités d’accompagnement des demandeurs d’emploi lorsqu’ils sont candidats à la VAE, le financement de cet accompagnement étant aujourd’hui assuré par l’État.
2. Un transfert à la région des compétences résiduelles de l’État qui permet de consolider le service public régional de la formation professionnelle
Le 1° du II procède ensuite à une refonte de l’article L. 6121-2, qui concerne aujourd’hui le contrat de plan régional ; il a pour objet de définir le « service public régional de la formation professionnelle ».
a. Un service public régional matérialisé par l’affirmation du droit à la formation à professionnelle
Il incombe désormais de manière explicite, en vertu du I de l’article L. 6121-2, à la région d’organiser et financer le service public régional de la formation professionnelle. En vertu des compétences exercées depuis 2004 par la région en la matière, le service public régional de la formation professionnelle existe en réalité déjà. Il est simplement pour l’heure mis en place de manière plus politique que juridique, et de ce fait, ses contours de même que ses contenus sont à géométrie variable. Il est ainsi proposé de donner lui donner une assise juridique par le biais de la définition et de l’aménagement du droit à la formation professionnelle.
La nouvelle rédaction de l’article commence par définir le droit à la formation professionnelle, qui doit bénéficier à toute personne, quel que soit son lieu de résidence, qui cherche à s’insérer sur le marché du travail, droit qui doit lui permettre d’acquérir un premier niveau de qualification, de faciliter son insertion professionnelle, sa mobilité ou sa reconversion. C’est ce droit que doit venir garantir le service public régional de la formation professionnelle, la région étant chargée à cette fin d’assurer, selon des modalités définies par décret :
– la gratuité de l’accès à des formations sanctionnant un niveau de qualification allant jusqu’au niveau IV du Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) prévu à l’article L. 335-6 du code de l’éducation, équivalent au plus au baccalauréat professionnel. Cela ne signifie évidemment pas que, dans le cadre du service public régional de la formation professionnelle, la région n’est pas compétente au titre des formations allant au-delà de ce niveau, mais bien que la mission du service public régional est d’assurer la gratuité jusqu’à ce niveau de qualification, considéré comme un niveau indispensable pour assurer l’insertion professionnelle, la mobilité ou la reconversion des intéressés ;
– l’insertion et les transitions professionnelles pour lesquelles une formation est nécessaire, au service du développement économique et de l’emploi ;
– et enfin, le droit d’accès à la formation professionnelle pour tous, et notamment les personnes handicapées ou présentant des difficultés particulières d’apprentissage, et quel que soit leur lieu de résidence, induisant une dynamique de complémentarité entre les programmes régionaux. Afin de garantir ce droit à la formation professionnelle sur l’ensemble du territoire en tenant compte de la mobilité des personnes, le texte prévoit que des conventions conclues entre régions ou, à défaut, un décret, doivent fixer les modalités selon lesquelles la région du lieu de résidence d’une personne prend en charge les coûts d’une éventuelle formation organisée dans une autre région.
b. Les actuelles compétences résiduelles de l’État qui sont définitivement transférées à la région
Le II de l’article L. 6121-2 définit les missions spécifiques confiées à la région et liées à ses responsabilités dans le cadre du service public régional de la formation professionnelle. Parmi ces missions, certaines relèvent de compétences déjà exercées par la région ; la plupart d’entre elles correspondent toutefois à de nouvelles compétences, jusqu’alors exercées par l’État.
En vertu du 1° du II de l’article L. 6121-2 dans sa nouvelle rédaction, la région se voit confier la politique de lutte contre l’illettrisme sur le territoire régional, par l’organisation d’actions de prévention et d’acquisition d’un socle de connaissances et de compétences. Aux termes de l’article L. 121-2 du code de l’éducation, la lutte contre l’illettrisme et l’innumérisme constitue une priorité nationale, à laquelle doivent contribuer l’ensemble des services publics dans leurs domaines d’action respectifs.
La politique de lutte contre l’illettrisme constitue un enjeu important d’insertion professionnelle : alors que d’après l’INSEE, 7 % des adultes de 18 à 65 ans sont illettrés, soit 2,5 millions de personnes, il est indispensable d’assurer un accès aux compétences clés à l’ensemble des personnes qui n’en disposent pas aujourd’hui et sont de ce fait exclues à la fois du marché du travail, mais aussi de toute offre de formation qualifiante. Conformément à l’article L. 6111-2 du code du travail qui dispose que « les actions de lutte contre l’illettrisme et en faveur de l’apprentissage de la langue française font également partie de la formation professionnelle tout au long de la vie », l’État met en œuvre, depuis juin 2010, le programme « Compétences clés », qui doit permettre de financer l’entrée en formation de l’ordre de 40 000 à 50 000 apprenants par an. Ce sont même 55 000 apprenants qui ont été formés en 2013. À ce titre, 53 millions d’euros sont prévus en loi de finances initiale pour 2014. Si l’État est donc actuellement pilote en matière de lutte contre l’illettrisme, les conseils régionaux et Pôle emploi développent parallèlement leur programme en la matière. La multiplicité des interventions des différents acteurs nuit à la cohérence d’ensemble de cette politique : c’est pourquoi, – suivant en cela les recommandations de l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) et de l’Inspection générale de l’administration de l’éducation nationale et de la recherche (IGAENR) (56) dans ce domaine, qui jugent que cette politique a davantage vocation à relever du niveau régional -, le présent article confie à la région la compétence en matière de politique de lutte contre l’illettrisme.
Le 2° du II de l’article L. 6121-2 dans sa nouvelle rédaction prévoit que la région favorise l’égal accès des femmes et des hommes aux filières de formation et contribue à développer la mixité de ces dernières. Si l’objectif d’un accès équilibré des femmes et des hommes aux différentes filières de formation est déjà présent dans la rédaction actuelle de l’article L. 214-2 du code de l’éducation, la dimension de développement de la mixité des formations en demeurait absente. Il s’agit donc d’un enrichissement.
Le 3° du II de l’article L. 6121-2 dans sa nouvelle rédaction confie à la région la mission d’assurer l’accès des personnes handicapées à la formation, dans les conditions nouvellement fixées par le présent article, qui prévoit désormais, comme on l’a vu, la mise en place d’un programme régional d’accès à la formation et à la qualification professionnelle des personnes handicapées, et fait de la région le chef de file de la politique de formation de ces publics.
Le 4° du II du nouvel article L. 6121-2 dans sa nouvelle rédaction transfère à la région le financement et l’organisation de la formation professionnelle des personnes sous main de justice, autrement dit, des détenus, aujourd’hui assurée par l’État. Le transfert de cette compétence s’accompagne logiquement de la signature d’une convention avec l’État, afin de préciser les modalités d’accès de ces personnes au service public régional de la formation professionnelle.
L’article 9 de la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 avait mis en place un dispositif expérimental de transfert de cette compétence aux régions qui seraient candidates. Les régions Aquitaine et Pays-de-la-Loire ont choisi d’exercer cette compétence depuis 2011, pour une durée de trois ans. Une première évaluation de cette expérimentation, réalisée par l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) et l’Inspection générale des services judiciaires (IGSJ), tend à montrer son réel intérêt, tant sur le volume de l’offre de formation que sur la qualité et l’adéquation des prestations offertes. Le choix d’une généralisation a donc été opéré, qui conduit à décentraliser la formation des détenus et à abroger, en conséquence, l’article 9 de la loi précitée qui avait institué le dispositif expérimental : c’est l’objet du VI de l’article 11 du présent projet de loi.
Son 5° organise également le transfert à la région du financement et de l’organisation de la formation professionnelle des Français établis hors de France et de l’hébergement des bénéficiaires, mission aujourd’hui assurée par l’État. De la même manière que pour les détenus, une convention conclue entre les régions et l’État doit préciser les modalités d’accès de ces publics au service public régional de la formation professionnelle.
S’agissant de ces deux missions aujourd’hui exercées par l’État, le ministère chargé de l’emploi finance aujourd’hui :
– la participation à la prise en charge des coûts pédagogiques des actions de formation suivies par les détenus et à leur rémunération de stage : 7 millions d’euros sont prévus à ce titre dans la loi de finances initiale pour 2014, qui devraient permettre à l’État de participer à la formation d’environ 11 740 détenus, sur la base d’une durée moyenne de formation de 130 heures. On notera qu’en 2012, 28 144 personnes détenues ont bénéficié d’une formation professionnelle, soit une progression de plus de 10 % par rapport à 2011 ;
– un marché pour la mise en situation d’emploi de certains publics spécifiques, et qui comprend des prestations de formation débouchant sur l’obtention d’un titre professionnel et de remise à niveau générale, d’accompagnement psychopédagogique, de suivi personnalisé, de gestion administrative des stagiaires et prévoit également des prestations d’hébergement et de restauration. Ce marché est composé de plusieurs lots, concernant trois types de publics : les personnes placées sous main de justice, les demandeurs d’emploi résidant outre-mer, et les Français de l’étranger. Pour 2014, une dotation de 17,5 millions d’euros en autorisations d’engagement et de 21,1 millions d’euros en crédits de paiement est prévue pour financer ces trois lots, et les restes à payer. Une partie de cette dotation concerne donc des publics dont la formation ne fait pas l’objet d’un transfert aux régions, en l’occurrence les demandeurs d’emploi ultra-marins.
D’après les informations fournies à votre rapporteur, dans la cadre du marché public conclu avec l’AFPA, en 2013, 4,74 millions d’euros ont été consacrés à la formation des détenus. En outre, de l’ordre de 10 millions d’euros sont venus financer les actions ciblées à destination des détenus. Les dépenses afférentes à la formation des détenus peuvent donc être estimées autour de 15 millions d’euros.
S’agissant de la formation des Français de l’étranger, les financements concernent les ressortissants en situation de recherche d’emploi, d’emploi précaire ou en demande de réinsertion en France, pour lesquels il est impossible d’apporter une solution locale : une cinquantaine de ressortissants bénéficient chaque année d’un parcours financier dans le cadre du marché précité : les crédits ont représenté 0,31 million d’euros en 2013, au titre des actions pédagogique et des frais d’hébergement et de restauration des bénéficiaires.
Au total, de l’ordre de 15,3 millions d’euros sont aujourd’hui consacrés par l’État au financement de la formation des détenus et des Français établis hors de France.
Le 6° du II de l’article L. 6121-2 dans sa nouvelle rédaction ouvre enfin à la région la possibilité de conduire des actions de sensibilisation et de promotion de la validation des acquis de l’expérience (VAE) et de contribuer au financement des projets collectifs mis en œuvre sur le territoire afin de favoriser l’accès à cette validation. Le rôle de la région en matière de VAE n’est pas nouveau : l’actuel article L. 214-2 du code de l’éducation prévoit déjà que la région organise sur son territoire le réseau des centres et points d’information et de conseil sur la VAE et contribue à assurer l’assistance aux personnes qui y sont candidates.
En matière de validation des acquis de l’expérience, l’État reste toutefois aujourd’hui en partie compétent, dans la mesure où il assure la prise en charge de l’accès des demandeurs d’emploi, par la VAE, aux titres du ministère de l’emploi préparés dans les centres agréés, et finance la VAE des publics de premiers niveaux de certification, dans le cadre d’une politique territorialisée de prévention ou d’accompagnement des mutations économiques. Ce sont 6,8 millions d’euros qui sont prévus au bénéfice de ces deux types d’actions pour 2014.
D’après les informations transmises à votre rapporteur, le financement actuel de l’État recouvre deux types d’actions :
– d’une part, les crédits déconcentrés relatifs à la prise en charge des prestations d’accompagnement des demandeurs d’emploi dans une démarche de VAE et des prestations d’assistance renforcée des candidats à la VAE, toutes certifications confondues. Ce sont 2,3 millions d’euros qui ont été consommés à ce titre en 2013 ;
– d’autre part, la subvention octroyée à l’AFPA, à hauteur de 1,7 million d’euros en 2013, au titre du coût des prestations d’accompagnement afférente.
En 2013, la politique de VAE a donc représenté un coût de 4 millions d’euros.
Le texte propose d’étendre le périmètre d’intervention de la région dans ce domaine : d’après l’étude d’impact, le transfert à la région de ces deux axes de financement de la VAE doit permettre de « la positionner comme une entité coordinatrice sur l’accompagnement à la VAE et d’optimiser la régulation des offres de prestations sur ce marché ».
II. DE NOUVEAUX OUTILS MIS EN PLACE AU PROFIT DE LA RÉGION À L’APPUI DE SON RÔLE DE CHEF DE FILE EN MATIÈRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE
A. UN NOUVEL OUTIL JURIDIQUE : L’HABILITATION D’ORGANISMES DE FORMATION
Le renforcement des compétences des régions en matière de formation professionnelle doit aller de pair avec l’attribution des véritables moyens d’agir.
Dans son avis du 18 juin 2008 relatif à l’AFPA (57), l’Autorité de la concurrence rappelait que les règles de la concurrence s’appliquent également en matière de formation professionnelle. En conséquence, tous les donneurs d’ordre se sont trouvés contraints de choisir leurs prestataires de formation par appel d’offres, mandatement ou délégation de service public avec, dans tous les cas, une mise en concurrence préalable.
Si une grande majorité de régions ont choisi d’utiliser les appels d’offres pour construire leurs dispositifs régionaux de formation, certaines se sont rapidement engagées dans une expérimentation du mandatement sous la forme de services d’intérêt économique général (SIEG). Ce régime du mandatement, expressément prévu par le droit communautaire, n’est toutefois pas aménagé dans le droit interne, qui ne permet que de passer soit par une délégation de service public, soit par une procédure d’appel d’offres relevant du code des marchés public. Cette dernière se révèle toutefois inadaptée dans certains cas, et en particulier, lorsqu’il s’agit de programmer des actions de formation au bénéfice des publics les plus fragiles, pour lesquelles une plus grande individualisation doit être permise.
Afin de donner un cadre juridique sécurisé aux régions en matière d’offre de formation en faveur de ces publics, pour lesquels le passage par un appel d’offres n’est pas adapté, le nouvel article L. 6121-2-1 crée un nouveau régime juridique, dit de l’« habilitation », et qui doit permettre, comme l’indique l’étude d’impact, de « confier aux opérateurs sélectionnés des missions d’intérêt économique général au bénéfice des personnes rencontrant des difficultés particulières d’apprentissage ouvrant droit à des compensations de charges de service public ».
Cette nouvelle procédure n’a vocation à être utilisée par les régions que dans un cadre limité, celui du financement d’actions d’insertion et de formation professionnelle au bénéfice de personnes rencontrant des difficultés particulières d’apprentissage ou d’insertion, afin de leur permettre de bénéficier, à titre gratuit, d’un parcours individualisé comportant un accompagnement à caractère pédagogique, social ou professionnel. À cette fin, la région pourra donc désormais habiliter, par voie de convention, des organismes pour mettre en œuvre ces actions, en contrepartie d’une compensation financière. L’habilitation en question, d’une durée maximale de cinq ans, doit notamment préciser les obligations de service public qui pèsent sur l’organisme.
Ce nouveau régime de l’habilitation correspond à la traduction juridique, sur le plan interne, de la procédure du mandatement avec octroi de droits spéciaux, qui existe au plan communautaire, et qui permet de charger des organismes de la réalisation d’une mission d’intérêt général dans le cadre d’une procédure de mise en concurrence ad hoc sans faire peser sur l’opérateur un risque d’exploitation. Il s’inspire du nouveau cadre réglementaire adopté par la Commission européenne dans le cadre du paquet dit « Almunia », le 20 décembre 2011.
Le « paquet Almunia »
En 2003, dans son arrêt « Altmark », la Cour européenne de justice a statué sur l’appréciation des compensations de service public dans le contexte des règles communautaires applicables aux aides d’État. À la suite de cet arrêt, la Commission européenne a adopté en juillet 2005 un premier paquet de règles relatives aux services d’intérêt économique général (SIEG), appelé « paquet Monti-Kroes », afin de préciser les conditions dans lesquelles une aide d’État sous la forme d’une compensation de service public était compatible avec le droit communautaire.
Suite à l’expiration de ce paquet, la Commission européenne a, après avoir consulté les parties prenantes, adopté un nouveau paquet de règles, le « paquet Almunia », afin d’apporter des éclaircissement sur les principes essentiels applicables aux aides d’État et d’assouplir les règles s’agissant des SIEG de faible montant ou poursuivant un objectif social, tout en tenant davantage compte de l’impact sur la concurrence des SIEG de plus grande ampleur.
– Tous les services sociaux sont désormais exemptés de l’obligation de notification à la Commission, quel que soit le montant de la compensation de service public qu’ils prévoient. Alors que précédemment, seuls les hôpitaux et le logement social bénéficiaient de cette exemption, tel est désormais le cas aussi des services répondant « à des besoins sociaux dans le domaine de la santé et des soins de longue durée, de l’aide à l’enfance, de l’accès au marché du travail et de la réinsertion sur ce dernier, du logement social, ainsi que de l’aide aux groupes vulnérables et de leur inclusion sociale ».
– S’agissant des autres SIEG qui ne sont pas considérés comme des services sociaux d’intérêt général (SSIG), une exemption de notification est prévue si le montant de la compensation de service public est inférieur à 15 millions d’euros par an, contre 30 millions d’euros par an auparavant.
– Pour tous les autres services, un montant de compensation en-deçà duquel la mesure est réputée exempte d’aide est fixé à 500 000 euros sur trois ans : il s’agit de la règle de minimis, fixée auparavant à 200 000 euros.
– Les SIEG donnant lieu à des montants de compensation supérieurs à 15 millions d’euros par an et comportant des risques accrus de distorsion de la concurrence au sein du marché intérieur feront l’objet d’un examen plus approfondi. Il convient, chaque fois que cela est possible, d’attribuer les SIEG selon une procédure d’appel d’offres ouverte et transparente, de manière à garantir le meilleur rapport qualité-prix aux contribuables.
Le texte prévoit enfin que cette habilitation est délivrée, dans des conditions de transparence et de non-discrimination et sur la base de critères objectifs de sélection, selon une procédure définie par un décret en Conseil d’État, qui doit ainsi venir préciser les conditions de sélection de financement de ces organismes. Dans la mesure où la mission confiée à ces organismes s’inscrit bien dans un service d’intérêt économique général (SIEG) – puisqu’il s’agit de financer des actions d’insertion et de formation au bénéfice de personnes rencontrant des difficultés particulières d’apprentissage ou d’insertion –, la région sera habilitée à verser à ces organismes des compensations d’obligation de service public, dans le respect des normes communautaires et dans un cadre juridique interne sécurisé.
B. LE NOUVEAU RÔLE DE « CENTRALE D’ACHATS » DE LA RÉGION EN MATIÈRE DE FORMATIONS COLLECTIVES
Le 2° du II du présent article introduit une nouvelle section consacrée à la coordination des régions avec les branches professionnelles, le service public de l’emploi et le service public de l’orientation, pour la mise en œuvre de la politique régionale de formation professionnelle. Cette section reprend l’actuel article L. 6121-3 qui concerne les conventions de financement conclues entre les OPCA et les régions pour le financement de la formation professionnelle. Elle est complétée par quatre nouveaux articles, L. 6121-4 à L. 6121-7, qui traitent des relations entre les régions et, respectivement, Pôle emploi, les autres financeurs de formations et les organismes de formation, ainsi que de la diffusion intégrée de l’offre de formation sur le territoire régional.
1. Une clarification des rôles respectifs de la région et de Pôle emploi en matière de financement de la formation des demandeurs d’emploi
Les demandeurs d’emploi constituent le deuxième poste de dépenses des régions en matière de formation professionnelle : ainsi, en 2010, 44 % des dépenses de formation professionnelle à destination des demandeurs d’emploi ont été assurées par les régions. Parallèlement, Pôle emploi finance des formations collectives et des aides individuelles à la formation à destination de ces publics.
Afin de rationaliser le positionnement des financements de formation professionnelle au bénéfice des demandeurs d’emploi, le présent article propose de faire de la région l’acteur de référence en matière de financement d’actions collectives, afin de recentrer davantage Pôle emploi sur le financement d’aides individuelles à la formation.
Le nouvel article L. 6121-4 dispose ainsi que Pôle emploi attribue des aides individuelles à la formation au bénéfice de demandeurs d’emploi, pouvant naturellement venir abonder le compte de formation professionnelle. Il peut, par ailleurs, procéder ou contribuer à l’achat de formations collectives, dans le cadre d’une convention conclue avec la région, qui en précise l’objet et les modalités. Le principe retenu est donc celui d’une coordination obligatoire avec la région en matière d’achat de formations collectives en faveur des demandeurs d’emploi. Pôle emploi aura donc vocation à s’associer avec la région pour procéder à ses achats de formations collectives ; il conserve néanmoins la possibilité de procéder lui-même à ces achats, dans le cadre d’une convention avec la région qui en déterminera les modalités.
Cette double-possibilité peut apparaître comme une réponse au problème de l’enchevêtrement des initiatives qui reste « au milieu du gué » : en effet, elle ne fait pas réellement de la région une centrale d’achats unique de formations collectives. Au demeurant, une coordination des commandes de formations entre Pôle emploi et la région existe déjà dans la pratique. Le seul progrès dans l’unification consiste dans le fait que désormais, une telle coordination est systématisée : autrement dit, Pôle emploi ne pourra plus faire « cavalier seul » dans la détermination de ses achats de formations collectives.
D’après l’Association des régions de France (ARF), cette disposition ne change rien à l’existant, la possibilité de faire de la région une centrale d’achats de formation pour Pôle emploi existant déjà. Le véritable progrès aurait consisté à imposer la région comme centrale d’achats unique afin de véritablement réguler et rendre plus lisible l’offre de formation.
La même possibilité de conventionnement de la région pour l’achat de formations collectives est, on l’a vu, rendue possible avec les départements qui souhaiteraient coordonner leur politique d’achat de formation avec la région pour la mise en œuvre du plan départemental d’insertion.
2. Un circuit d’échanges d’informations destiné à améliorer la lisibilité des formations offertes aux demandeurs d’emploi
Le nouvel article L. 6121-5 encadre le système de prescription de formation et de suivi de l’offre de formation en faveur des demandeurs d’emploi au niveau régional, en prévoyant que la région et les autres financeurs de formations à destination de ces publics s’assurent que les organismes de formation qu’ils retiennent informent bien, en amont, les opérateurs du service public de l’emploi et du conseil en évolution professionnelle des sessions de formation qu’ils organisent et des modalités d’inscription à ces formations. Notons que les principaux opérateurs du conseil en évolution professionnelle recouvrent Pôle emploi, les missions locales, les Cap emploi, le FONGECIF et l’Association pour l’emploi des cadres (APEC), d’autres opérateurs pouvant être désignés par la région après concertation au sein du bureau du CREFOP.
Les organismes de formation informent également Pôle emploi, dans des conditions précisées par décret, de l’entrée effective en stage de formation d’une personne inscrite sur la liste des demandeurs d’emploi.
La mise en place d’un véritable circuit d’échanges d’informations relatives aux formations offertes aux demandeurs d’emploi est une condition sine qua non de l’efficacité du dispositif au niveau régional : ces échanges d’informations doivent permettre de fluidifier les parcours d’entrée en formation des demandeurs d’emploi, mais également de faciliter la mise à jour, par Pôle emploi, de la liste des demandeurs d’emploi.
Il s’agit là de préfigurer ce qui doit à terme devenir un véritable système d’information intégré sur l’offre de formation au niveau régional, dont les linéaments sont posés par le nouvel article L. 6121-6, qui confie à la région la mission d’organiser sur le territoire régional, en coordination avec l’État et les membres du comité paritaire régional pour la formation professionnelle et l’emploi, et en lien avec les organismes de formation, la diffusion de l’information relative à l’ensemble de l’offre de formation professionnelle continue. Un décret devra préciser les conditions de mise en œuvre du système d’information sur l’offre de formation et de son interopérabilité avec les outils existants.
Notons que c’est l’article 14 du présent projet qui crée le comité paritaire régional pour la formation professionnelle et l’emploi, constitué des représentants régionaux des organisations syndicales et patronales représentatives au niveau national interprofessionnel. Ces structures paritaires existent déjà dans les faits, sous la forme des commissions paritaires interprofessionnelles régionales de l’emploi (COPIRE) qui assurent au niveau régional la négociation paritaire dans le domaine de l’emploi et de la formation : le texte se propose de leur donner une assise juridique, en leur donnant un statut législatif.
D’après les éléments recueillis par votre rapporteur, cette information devra comporter l’ensemble des données relatives à l’offre de formation professionnelle continue, ainsi que les conditions d’éligibilité et les dates actualisées des sessions de formation afférentes, afin de rendre plus aisément identifiables les programmes régionaux de formation accessibles aux demandeurs d’emploi. À l’heure actuelle, ce sont les centres d’animation et de ressources d’information sur la formation (CARIF) qui assurent la mission de documentation relative à l’offre de formation ; l’ensemble des financeurs de formation au niveau régional devront donc veiller à assurer la diffusion de l’information à ce sujet. Un projet de système d’information nationale sur l’offre de formation est en outre en cours de construction, afin de garantir que des critères de diffusion homogènes sur les territoires soient bien mis en œuvre.
Enfin, le nouvel article L. 6121-7 prévoit qu’un décret en Conseil d’État détermine les modalités de mise en œuvre de l’ensemble du chapitre premier relatif au rôle des régions.
C. UN DROIT D’OPTION AUX RÉGIONS POUR LA DÉVOLUTION DU PATRIMOINE IMMOBILIER DE L’AFPA
Le V du présent article prévoit que les régions peuvent, dans le cadre de la mise en œuvre du service public régional de la formation professionnelle qui leur incombe désormais en vertu du présent texte, demander à l’État de leur céder les biens mis par celui-ci à disposition de l’AFPA.
La liste de ces biens est dressée par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle et des collectivités territoriales. Il pourrait potentiellement s’agir de 180 sites au total, d’une surface approximative de 2,3 millions de m², que l’AFPA loue aujourd’hui à l’État pour un montant symbolique, de 15 euros annuels par site, soit un montant global d’environ 3 000 euros.
Le précédent malheureux du transfert à l’AFPA des biens immobiliers de l’État
En 2009, compte tenu des évolutions juridiques, institutionnelles et économiques de l’environnement de l’AFPA, placée dans la nécessité d’adapter son modèle économique aux exigences de la concurrence, l’État a souhaité transférer à l’AFPA les biens immobiliers qu’elle loue à l’État afin de la doter des moyens de son autonomie et de lui permettre de faire face à ses mutations. La perspective de cette dévolution a entraîné la suspension des subventions d’investissements : en 2010, l’AFPA n’a ainsi perçu aucune subvention nationale d’investissement.
Inscrite dans la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l’orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie, la dévolution du patrimoine à l’AFPA n’a toutefois pas été rendue effective : en effet, le Conseil Constitutionnel a censuré cet article (58), considérant que la dévolution à l’AFPA de biens immobiliers à titre gratuit méconnaissait la protection constitutionnelle de la propriété des biens publics. Le juge constitutionnel a ainsi estimé que la disposition attaquée procédait à un transfert de biens immobiliers appartenant à l’État, à titre gratuit et sans aucune condition ou obligation particulière. Par ailleurs, aucune disposition ne permettait de garantir que ces biens demeureraient affectés au service public, et cela, d’autant plus que la même loi retirait à l’AFPA une partie de ses missions service public.
La présente disposition doit être évaluée à l’aune de la décision du Conseil constitutionnel du 17 décembre 2010. Il s’agit, dans le cas présent, non pas d’une obligation de transfert du patrimoine de l’État aux régions, mais d’une simple possibilité, qui peut être actionnée – ou ne pas l’être – par les régions. Par ailleurs, les conditions de la cession de ces biens ne sont pas précisées. Enfin, contrairement au transfert envisagé en 2009, il s’agirait là d’un transfert aux régions, autrement dit, à une collectivité territoriale, et non à une personne privée : le grief retenu par le juge constitutionnel était bien en effet celui de la dévolution sans contrepartie à une personne privée, quand bien même celle-ci serait chargée d’une mission de service public, de biens appartenant au domaine public, dès lors qu’aucune garantie n’était par ailleurs apportée quant au maintien de l’affectation de ces biens à des missions de service public.
Ce transfert, sur droit d’option, aux régions des biens immobiliers de l’AFPA, s’inscrit dans le cadre de l’article L. 3112-1 du code général de la propriété des personnes publiques, qui dispose que « les biens des personnes publiques (…) qui relèvent de leur domaine public, peuvent être cédés à l’amiable, sans déclassement préalable, entre ces personnes publiques, lorsqu’ils sont destinés à l’exercice des compétences de la personne publique qui les acquiert et relèveront de son domaine public ».
Ce droit d’option ouvert aux régions s’inscrit en outre pleinement dans la continuité du mouvement de décentralisation de la formation professionnelle.
III. UNE COMPÉTENCE RÉGIONALE ÉTENDUE EN MATIÈRE DE FINANCEMENT DE LA RÉMUNÉRATION DES STAGIAIRES DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
Dans la continuité de la mise en place d’un véritable « bloc de compétences » régional en matière de formation professionnelle, il est également proposé de revoir la répartition des compétences entre l’État et la région en matière de prise en charge de la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle.
Le dispositif actuel de financement de la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle
Le dispositif actuel de financement de la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle est prévu aux articles L. 6341-1 à L. 6341-12 du code du travail.
Aux termes de l’article L. 6341-1, la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle est aujourd’hui assurée par l’État, les régions, les employeurs et les organismes collecteurs paritaires agréés (OCPA), ainsi que par Pôle emploi, notamment dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle (CSP).
L’article L. 6341-2 prévoit le concours de l’État et des régions pour le financement de la rémunération des stagiaires, pour le cas de stages agréés, lorsque ceux-ci sont suivis par les salariés à l’initiative de leur employeur ou lorsqu’ils sont suivis par des travailleurs non-salariés.
L’article L. 6341-3 prévoit en revanche la prise en charge complète par l’État et la région de la rémunération des stagiaires, dès lors qu’il s’agit de stages agréés, pour les demandeurs d’emploi en fin de droits, pour les travailleurs handicapés ou, dans la limite de trois mois, pour les apprentis en centre de formation des apprentis (CFA) et dont le contrat a été rompu sans qu’ils soient à l’initiative de cette rupture.
L’article L. 6341-5 prévoit en outre que l’État et les régions peuvent concourir à la rémunération des stagiaires bénéficiant d’un congé individuel de formation (CIF).
Les articles L. 6342-2 et L. 6342-3 régissent en outre la prise en charge des cotisations par l’État ou la région au titre des stagiaires de la formation professionnelle :
– dans le cas où le stagiaire est rémunéré par son employeur, l’État participe au paiement des cotisations incombant à l’employeur dans la même proportion qu’il participe à la prise en charge de la rémunération (article L. 6342-2) ;
– lorsque le stagiaire n’est pas rémunéré ou est rémunéré par l’État ou la région, les cotisations sociales sont intégralement prises en charge par l’État ou la région (article L. 6342-3).
Le III du présent article procède à des modifications des modalités de financement de la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle.
Les 1° à 3° du présent III revoient les conditions de la prise en charge financière par l’État et les régions en fonction des publics concernés. Ainsi :
– s’agissant des demandeurs d’emploi en fin de droits, alors que l’État et les régions assurent pour l’heure la totalité du financement, seul un concours financier régional et étatique est désormais prévu ;
– s’agissant des travailleurs handicapés et des apprentis en rupture de contrat, désormais, seule la région a vocation à financer, en totalité, la rémunération de ces stagiaires, alors que celui-ci était jusqu’alors partagé entre l’État et la région ;
– enfin, s’agissant de la possibilité de prise en charge de la rémunération des stagiaires bénéficiant d’un CIF, seule la région a désormais vocation à la financer, alors que cette possibilité est pour l’heure également ouverte à l’État.
Concernant les demandeurs d’emploi en fin de droits, l’architecture actuelle de rémunération des stagiaires est la suivante :
– soit, si le bénéficiaire a d’ores et déjà épuisé ses droits à l’assurance chômage, la rémunération est prise en charge par la région, ou par Pôle emploi si c’est celui-ci qui finance la formation ;
– soit la rémunération de fin de formation (R2F) prend le relais de l’allocation chômage pour certains métiers en tension dont la liste est déterminée par la région, ce dispositif étant financé à parité par l’État et par les partenaires sociaux via le Fonds de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP).
Autrement dit, le financement est aujourd’hui déjà co-financé.
La principale modification concerne donc le financement de la rémunération des stages des personnes handicapées en centre de réadaptation professionnelle (CRP), qui est intégralement transféré à la région. En réalité, l’État ne conserve à ce jour qu’une infime part de la responsabilité du financement des stages de ces publics, puisque comme l’indique l’étude d’impact, la circulaire du 22 avril 1983 prise en application de la loi de décentralisation précise, s’agissant de cette décentralisation partielle aux régions, que les compétences de l’État sont maintenues pour les seuls centres de réadaptation à recrutement majoritairement interrégional.
Le coût global pour l’État de la prise en charge de la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle est estimé, pour 2014, à 172,65 millions d’euros au total, étant entendu que ce montant recouvre également une part de prise en charge qui restera assumée par l’État, notamment la rémunération des demandeurs d’emploi non indemnisés par le régime d’assurance chômage ou de certains publics spécifiques, et notamment les demandeurs d’emploi ultra-marins, mais également plus généralement les stages agréés suivis par des salariés à la demande de leur employeur ou suivis par des non salariés. La totalité de cette somme ne reflète donc pas les nouvelles charges transférées aux régions dans ce domaine : l’étude d’impact fournit une estimation de l’ordre de 100 millions d’euros par an.
D’après les informations fournies à votre rapporteur, l’État a consacré un budget de 135,9 millions d’euros en 2012 à la formation des personnes handicapées.
Le 4° du présent III prévoit des modalités de prise en charge spécifiques des cotisations des stagiaires reconnus travailleurs handicapés : il insère un nouvel alinéa à l’article L. 6342-3 relatif à la prise en charge des cotisations des stagiaires pour prévoir que lorsque les formations sont financées par le fonds de développement pour l’insertion professionnelle des handicapés (FDIPH) géré par l’AGEFIPH ou cofinancées avec le FIPHFP, les cotisations sociales sont prises en charge par ce ou ces fonds, quand bien même ceux-ci ne participeraient pas à la prise en charge de la rémunération des stagiaires en question. Il s’agit là d’améliorer la protection sociale des bénéficiaires des formations financées par ces fonds. En effet, à l’heure actuelle, il n’est prévu de prise en charge des cotisations sociales des stagiaires que dans le cadre du financement de la formation par l’État ou la région, qui assument donc également la prise en charge des cotisations à ce titre. Rien n’est prévu s’agissant de la protection sociale des stagiaires formés dans le cadre d’un dispositif financé par l’AGEFIPH ou cofinancé avec le FIPHFP : le 4° est destiné à remédier à cette lacune.
IV. LE PRINCIPE DU PASSEPORT-MOBILITÉ FORMATION PROFESSIONNELLE POUR LES TERRITOIRES ULTRA-MARINS
Le V du présent article complète les dispositions du code du travail relatives à la formation professionnelle et applicables dans les départements d’outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, qui figurent au titre II du livre V de la sixième partie du code.
Il prévoit de rendre éligibles aux aides de l’État, notamment au titre de la politique nationale de continuité territoriale, les personnes ayant leur résidence habituelle en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, qui poursuivent une formation professionnelle en dehors de leur territoire de résidence.
Rappelons que la politique de continuité territoriale fait l’objet des articles L. 1803-1 à L. 1803-9 du code des transports : elle consiste dans le versement d’aides destinées à rapprocher les conditions d’accès de la population ultra-marine aux services publics de transport, de formation, de santé et de communication de celles de la métropole. Elle est constituée de trois types d’aides :
– l’aide à la continuité territoriale stricto sensu, qui bénéficie, sous conditions de ressources, à tout résident ultra-marin dans le cadre de ses déplacements vers la métropole. Il s’agit d’une aide forfaitaire ;
– le passeport-mobilité études, destiné, en fonction de leur niveau de ressources, aux étudiants inscrits dans une filière d’études non disponible sur leur territoire d’origine ;
– et enfin, le passeport-mobilité formation professionnelle, qui s’adresse aux personnes majeures poursuivant une formation professionnelle hors de leur collectivité de résidence, ou des personnes admissibles à certaines concours de la fonction publique ou d’accès à certains établissements d’enseignement supérieur. Cette aide est également destinée à couvrir une partie des frais d’installation et de formation, ainsi que la prise en charge éventuelle d’une indemnité mensuelle versée au stagiaire. Cette aide est également attribuée sous conditions de ressources : y sont éligibles les personnes dont le niveau de ressources ne dépasse pas le montant supérieur de la troisième tranche d’imposition sur le revenu.
Le nouvel article L. 6521-2 concerne logiquement le passeport-mobilité formation professionnelle. À ce titre, deux commandes publiques sont aujourd’hui actives en la matière et ont vocation à se poursuivre : il s’agit d’un marché national porté le ministère chargé de la formation professionnelle d’une part, d’un marché porté par l’Agence de l’outre-mer pour la mobilité (LADOM) d’autre part.
V. DES COMPÉTENCES RÉGIONALES NOUVELLES EN MATIÈRE DE FORMATIONS SANITAIRES ET SOCIALES
Les VII à X du présent article procèdent à une extension des compétences de la région en matière de formations sanitaires et sociales. Ces formations sont définies à l’article L. 541-1 du code de l’action sociale et des familles comme contribuant « à la qualification et à la promotion des professionnels et des personnels salariés et non salariés engagés dans la lutte contre les exclusions et contre la maltraitance, dans la prévention et la compensation de la perte d’autonomie, des handicaps ou des inadaptations et dans la promotion du droit logement, de la cohésion sociale et du développement social ».
La région est aujourd’hui déjà compétente en matière de formations sanitaires et sociales. En particulier, en vertu de l’article L. 451-2 du code de l’action sociale et des familles, elle définit et met en œuvre la politique de formation des travailleurs sociaux et élabore le schéma régional des formations sociales : elle recense, dans ce cadre et en association avec les départements, les besoins de formation à prendre en compte pour la conduite de l’action sociale et médico-sociale.
En outre, depuis 2004, la région est également compétente pour :
– autoriser les écoles et instituts de formation aux professions paramédicales et de sages-femmes ;
– agréer les directeurs des écoles et instituts de formation aux professions paramédicales.
Elle prend enfin en charge le fonctionnement et l’équipement des écoles et instituts publics de formation ainsi que des centres de formation des préparateurs en pharmacie hospitalière.
Le VII modifie le régime applicable aux établissements dispensant des formations sociales.
Les conditions encadrant ces formations figurent à l’article L. 451-1 du code de l’action sociale et des familles, qui prévoit que les diplômes et titres de travail social sont délivrés par l’État, que les établissements dispensant des formations sociales initiales et continues sont soumis à une obligation de déclaration préalable auprès du préfet de région ainsi qu’aux obligations et interdictions s’imposant aux personnels des organismes de formation, c’est-à-dire de la justification des titres et qualités requis pour assurer les prestations de formation proposées et de l’absence de condamnation pénale pour manquement à la probité, aux bonnes mœurs et à l’honneur. En outre, les établissements dispensant des formations initiales font l’objet d’un agrément par la région, qui contribue en outre à leur financement. Le système d’« autorisation » de ces établissements est donc aujourd’hui double, en l’occurrence s’agissant des établissements de formation initiale.
Le 1° du VII propose en premier lieu de substituer à l’actuelle déclaration préalable d’ouverture déposée auprès du préfet un système d’agrément délivré par la région au regard des besoins recensés dans le schéma régional des formations sociales, sur avis conforme du préfet de région. Ce dispositif d’agrément par la région peut également être délégué par elle aux départements qui le souhaitent pour les établissements se situant sur le ressort de leur territoire. Cette nouvelle rédaction rectifie au passage le renvoi aux articles du code du travail relatifs aux obligations et interdictions qui s’imposent aux personnels des organismes de formation, qui dans le droit actuel, continuent de renvoyer à l’ancienne version du code du travail. Il s’agit donc bien de transférer aux régions le rôle de « régulation » de l’offre de formation des travailleurs sociaux, le préfet de région conservant toutefois un droit de regard sous la forme d’un avis conforme qu’il doit rendre sur toute décision d’agrément donnée par la région.
Le 2° du VII procède à une série d’ajustements. L’État est en effet chargé de contrôler le respect des programmes de ces établissements, la qualification des formateurs et des directeurs d’établissement et la qualité des enseignements délivrés. Il est d’abord proposé de substituer à ce contrôle des programmes un contrôle des textes relatifs aux diplômes délivrés par ces établissements. Il est ensuite proposé de définir le contrôle pédagogique exercé par l’État, en précisant qu’il est « effectué, pour chaque niveau de diplôme, en tenant compte notamment du rôle des partenaires en matière d’alternance, d’enseignements et de recherche ainsi que des démarches d’évaluation interne et d’actualisation des compétences pédagogiques ». Le contrôle pédagogique qui incombe à l’État fait l’objet d’un avis transmis à la région : cette disposition doit mettre en mesure la région d’opérer un suivi du contenu de la formation dispensée par les organismes qu’elle est chargée d’agréer.
Enfin, le 3° du VII prévoit que des dispositions réglementaires doivent intervenir pour préciser les conditions dans lesquelles les régions délivrent un agrément aux organismes de formation, ainsi que les modalités d’enregistrement des établissements qui dispensent une formation préparant à un diplôme de travail social.
Le VIII redéfinit les modalités de financement de ces établissements par les régions, en opérant une distinction entre la formation sociale initiale et la formation sociale continue.
Comme on l’a dit, la région assure déjà le financement des établissements de formation sociale initiale qu’elle agrée, dans les conditions prévues à l’article L. 451-2-1 : ce financement prend la forme d’une subvention annuelle couvrant les dépenses administratives d’une part, les dépenses liées aux activités pédagogiques d’autre part. La région participe également au financement des dépenses d’investissement, d’entretien et de fonctionnement des locaux de ces établissements, dans des conditions définies par une délibération du conseil régional. Le VIII réaffirme le principe du financement des établissements de formation sociale initiale par la région, à l’exclusion des lycées ou établissements d’éducation spéciale et des établissements d’enseignement supérieur. Il associe aussi dorénavant ces établissements de formation sociale initiale au service public régional de la formation professionnelle.
S’agissant des établissements de formation sociale continue, il est prévu de confier désormais leur financement aux régions, dès lors que ceux-ci sont agréés par elles et dans la mesure où ils participent au service public régional de la formation professionnelle.
Le IX du présent article traite des diplômes de travail social consacrant une formation de niveau supérieur. Il consiste à insérer un nouvel article au chapitre 2 du titre 5 du livre IV du code de l’action sociale et des familles, autrement dit au sein des dispositions relatives à la formation supérieure des travailleurs sociaux. Il s’agit de préciser que les diplômes de travail social délivrés après l’obtention du baccalauréat s’inscrivent dans le cadre de l’espace européen de la recherche et de l’enseignement supérieur. La construction de cet espace est l’un des objectifs impartis à l’enseignement supérieur, aux termes de l’article L. 123-2 du code de l’éducation. Afin de faire réellement participer les établissements qui délivrent des diplômes de travail social de niveau supérieur à cet espace européen, il leur est demandé de développer des coopérations avec d’autres établissements d’enseignement supérieur et de recherche.
Le X du présent article concerne le numerus clausus applicable aux formations paramédicales, définies aux titres 1er à 7 du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique : elles concernent spécifiquement, au sein des professions de santé, les auxiliaires médicaux (infirmier, masseur-kinésithérapeute, pédicure-podologue, ergothérapeute, psychomotricien, orthophoniste, orthoptiste, manipulateur d’électroradiologie médicale, technicien de laboratoire médical, audioprothésiste, opticien-lunetier, prothésiste et orthésiste pour l’appareillage des personnes handicapées), aides-soignants, auxiliaires de puériculture et ambulanciers.
En vertu de l’article L. 4383-2 du même code, pour l’ensemble de ces professions paramédicales, le numerus clausus peut être fixé de manière annuelle ou pluriannuelle. Il est en tout état de cause fixé au plan national et pour chaque région :
– conjointement par les ministres chargés de la santé et de l’enseignement supérieur pour les formations sanctionnées par un diplôme de l’enseignement supérieur ;
– par le ministre chargé de la santé pour les autres formations, après avis des conseils régionaux, qui tiennent compte notamment des besoins de la population.
Dans chaque région, ce numerus clausus est ensuite réparti entre les instituts ou écoles par le conseil régional, sur la base du schéma régional des formations sanitaires.
Le texte propose de modifier ces dispositions, en prévoyant que dès lors que le numerus clausus est fixé annuellement, autrement dit, lorsqu’il est fait le choix de déterminer un nombre d’étudiants ou élèves à admettre en première année, celui-ci est fixé :
– toujours conjointement par les deux ministres compétents lorsqu’il s’agit d’une formation de l’enseignement supérieur, mais désormais après recueil préalable de la proposition de la région. Si le quota finalement fixé par les ministres diffère de celui proposé par la région, l’arrêté en question doit être motivé au regard de l’analyse des besoins de la population et des perspectives d’insertion professionnelle ;
– et pour les autres formations, par le ministre chargé de la santé, mais sur la base des schémas régionaux des formations sanitaires et en tenant compte des besoins en termes d’emplois et de compétences.
Il s’agit donc de consacrer un rôle plus important de la région en matière de « planification » des formations sociales sur son territoire : la région sera désormais investie du pouvoir de proposer elle-même le quota d’élèves admis à entreprendre des formations paramédicales.
*
* *
Lors de son examen du texte du projet de loi, votre commission a adopté un amendement de votre rapporteur visant à déclassifier les biens immobiliers de l’État mis à la disposition de l’AFPA, pour les faire passer du domaine public au domaine privé.
En effet, le présent article donne la possibilité aux régions qui le souhaitent d’acquérir le patrimoine de l’État utilisé par l’AFPA pour la mise en œuvre du service public régional de la formation professionnelle. Néanmoins, il est probable que ce droit d’option ne concernera pas l’ensemble des régions, la perspective d’un tel transfert étant accueillie de manière assez inégale par les régions, comme a pu le souligner la Cour des comptes dans le cadre de son enquête menée sur l’AFPA et rendue en décembre 2013 (59).
L’AFPA souhaite en outre depuis longtemps que le patrimoine qu’elle occupe puisse relever du domaine privé de l’État ; en effet, si tel était le cas, les fonds obtenus du « pool » bancaire – constitué autour d’elle dans le cadre du plan de refondation financière de l’Association – en hypothéquant les baux emphytéotiques administratifs (BEA) pourraient être globalisés et utilisés indifféremment sur tout le patrimoine, alors que les règles de la domanialité publique imposent que les fonds issus des hypothèques soient affectés aux biens sur lesquels portent ces hypothèques. Autrement dit, le basculement des biens immobiliers en question dans le domaine privé de l’État, prévu par l’amendement adopté par votre commission, permettrait à l’AFPA de prendre des dispositions en garantie auprès des banques sur la base de la valeur des biens et non seulement des investissements réalisés sur ces biens. Ce déclassement serait réalisé selon des modalités garantissant la continuité des missions de service public réalisées par l’AFPA pour le compte de l’État (certification, hébergement de publics spécifiques en formation, etc.).
*
* *
La Commission est saisie de l’amendement AS117 de suppression de l’article, de M. Francis Vercamer.
M. Francis Vercamer. Étrangement, ce projet transfère aux régions des compétences supplémentaires en matière de formation et d’orientation professionnelles au moment même où le Gouvernement annonce une nouvelle étape de la décentralisation. Je ne conteste aucunement les missions essentielles que les régions peuvent remplir en cette matière ; elles devraient, au contraire, être pilotes. Mais pour déterminer avec précision leurs compétences dans le domaine de la formation professionnelle, il faut avoir une vision d’ensemble des conséquences de la réforme à venir.
M. Denys Robiliard. Vous souhaitez que les régions aient un rôle moteur, mais vous serrez le frein. La réforme à venir visant à donner plus de pouvoirs aux régions, il n’y a aucun risque que les textes se contredisent. Pourquoi perdre du temps ?
M. le rapporteur. Encore un peu d’audace, monsieur le décentralisateur ! Accompagnez-nous alors que nous parachevons la décentralisation de la formation et de l’orientation professionnelles. Avis défavorable.
M. Francis Vercamer. Je maintiens que procéder de la sorte, c’est envisager la décentralisation de la formation professionnelle par le petit bout de la lorgnette. Cela revient, mutatis mutandis, à modifier un plan local d’urbanisme sans avoir aucune idée du schéma de cohérence territoriale – ce qui, chacun en conviendra, est une grave erreur.
La Commission rejette l’amendement.
Elle examine ensuite l’amendement AS34 de M. Gérard Cherpion.
M. Gérard Cherpion. L’amendement tend à ce que les régions établissent une comptabilité transparente de leurs ressources et de l’utilisation qu’elles en font. Ainsi encouragera-t-on une utilisation optimale de ces fonds, tout en s’assurant que les régions disposent des ressources suffisantes pour mettre en œuvre les ambitions affichées par le Gouvernement. Je rappelle que, le Conseil constitutionnel ayant censuré la réforme du financement de la taxe d’apprentissage, la plus grande incertitude pèse sur le montant et la nature de ces ressources.
M. le rapporteur. Avis défavorable à cet amendement bavard et inutile : les régions sont déjà tenues de publier ces données.
Mme Isabelle Le Callennec. J’aimerais une précision : la région est-elle la seule à financer les candidats à la validation des acquis de l’expérience ?
M. Denys Robiliard. Le texte dispose qu’elle participe à son financement, non qu’elle la finance à elle seule.
M. le rapporteur. J’ajoute que le coût de la validation des acquis de l’expérience est faible ; c’est son accompagnement qui coûte cher, nous en avons débattu ce matin.
La Commission rejette l’amendement.
Elle examine ensuite l’amendement AS37 de M. Gérard Cherpion.
M. Gérard Cherpion. L’article fait de la région l’échelon compétent en matière de formation professionnelle pour les Français établis hors de France. Il est précisé qu’une convention conclue avec l’État établit les conditions de leur accès au service public régional de la formation professionnelle. La question du financement demeure irrésolue : quelle région acceptera de prendre en charge ce public, et selon quels critères ? Faute d’information sur ce point, il faut supprimer cette disposition.
M. le rapporteur. Une négociation aura lieu à ce sujet entre les régions. Avis défavorable.
La Commission rejette l’amendement.
Elle est ensuite saisie de l’amendement AS415 du rapporteur.
M. le rapporteur. Il faut permettre aux régions d’acquérir le patrimoine de l’État utilisé par l’AFPA. En permettant la conclusion de baux emphytéotiques administratifs, conformément à l’accord passé avec le pool bancaire qui soutient l’AFPA, le déclassement de ces biens immobiliers commencera d’alléger les difficultés de l’Association. D’autre part, les régions qui le souhaitent pourront acquérir ces biens.
La Commission adopte l’amendement.
Puis elle examine l’amendement AS284 de M. Lionel Tardy.
M. Lionel Tardy. Il est prévu à l’alinéa 93 que, lorsque le choix est fait de déterminer un nombre d’étudiants ou d’élèves à admettre en première année pour une formation donnée, celui-ci est fixé, pour les formations sanctionnées par un diplôme de l’enseignement supérieur, par arrêté des ministres chargés de la santé et de l’enseignement supérieur, « qui recueillent préalablement une proposition de la région ». Cette formulation est imprécise, mieux vaut maintenir la rédaction actuelle de l’article L. 4383-2, qui évoque un avis du conseil régional.
M. le rapporteur. Avis défavorable. C’est bien d’une proposition de la région qu’il doit s’agir, et l’alinéa 95 prévoit qu’un arrêté non conforme à la proposition doit être motivé. Cela étant, on gagnerait sans doute en limpidité en écrivant « sur proposition de la région ». Un amendement en ce sens pourrait être déposé ultérieurement.
M. Denys Robiliard. J’invite à la prudence : l’expression « sur proposition de la région » aurait pour conséquence que l’on serait lié par la décision du conseil régional.
M. le rapporteur. Je vous entends. Il faudra affiner la rédaction de l’amendement.
La Commission rejette l’amendement.
Puis elle adopte l’article 11 modifié.
M. Christophe Cavard. À ce point de notre débat, permettez-moi, madame la présidente, de vous dire le mécontentement du groupe écologiste, dont plusieurs amendements ont été déclarés irrecevables au titre de l’article 40, d’une manière qui nous paraît abusive.
Mme la présidente Catherine Lemorton. Considérant ce qui s’est passé lors de la discussion parlementaire du projet de loi réformant les retraites, durant lequel le Président de la commission des finances, à l’instigation de M. Bernard Accoyer, a considéré que la Commission avait mal appliqué les dispositions de l’article 40, j’ai décidé de confier désormais au président de la commission des finances le soin de trancher. J’avais souhaité, comme Pierre Méhaignerie avant moi, que certains débats importants puissent se dérouler avant que tombe le couperet de l’article 40. Cela ne sera désormais plus possible car la commission des finances sera saisie de tous les amendements « litigieux » au regard de l’article 40 comme il l’a été des amendements à ce texte. C’est donc à lui que vous devez demander des explications.
M. Christophe Cavard. Je ferai donc part de nos doléances à M. Gilles Carrez.
Article 12
(art. L. 6111-3, L. 6111-4, L. 6111-5, L. 6111-6, L. 6111-7 et L. 6314-1 du code du travail ;
art. L. 214–14, L. 214–16–1, L. 214–16–2, L. 313–6, L. 313–7, et L. 313–8 du code de l’éducation)
Service public de l’orientation – Conseil en évolution professionnelle
L’article 12 vise à faire de la région un chef de file en matière d’orientation, eu égard à sa compétence de droit commun en matière de formation professionnelle des jeunes et des adultes à la recherche d’un emploi ou d’une nouvelle orientation professionnelle.
Le projet précise aussi les contours du conseil en évolution professionnelle créé par la loi du 14 juin 2013 (60). Une concertation quadripartite associant l’État, les régions, les organisations syndicales et patronales a en effet permis depuis lors de préciser les contours de ce conseil, ouvert à tous les actifs, qui sera mis en œuvre par au moins cinq réseaux nationaux de conseil et les acteurs régionaux désignés, dans le cadre du service public régional de l’orientation.
I. UN DISPOSITIF DE FORMATION ET D’ORIENTATION PROFESSIONNELLE CONSTITUÉ D’UNE MULTIPLICITÉ D’ACTEURS
Les dispositions générales définissant la formation professionnelle sont prévues par le chapitre Ier du titre Ier du Livre Ier de la sixième partie du code du travail. La formation professionnelle tout au long de la vie, qui est une obligation, trouve à s’exercer avec le compte personnel de formation et prend appui sur un service public de l’orientation. L’article 12 constitue, à cet égard, la rencontre entre le droit de l’éducation et celui du travail autour de la question structurante de la qualification, notamment celle des publics sortis du système éducatif sans titre reconnu.
A. LA FORMATION PROFESSIONNELLE TOUT AU LONG DE LA VIE CONSTITUE UNE OBLIGATION NATIONALE
L’objet et le contenu de la formation professionnelle tout au long de la vie sont définis par les articles L. 6111-1 et L. 6111-2 du code du travail.
L’article L. 6111-1 du code du travail fait de la formation professionnelle tout au long de la vie une obligation nationale. La loi du 24 novembre 2009 (61) a complété cette définition par l’ajout d’une mention relative aux objectifs poursuivis, l’acquisition par chacun « des connaissances et des compétences favorisant son évolution professionnelle », et d’un principe d’organisation, la stratégie nationale coordonnée qui est définie et mise en œuvre par l’État, les régions et les partenaires sociaux.
Elle comprend la formation initiale, notamment l’apprentissage, et la formation professionnelle continue, destinés aux adultes et aux jeunes engagés ou en voie de s’engager dans la vie active.
Pour permettre aux salariés d’accéder à la formation professionnelle tout au long de la vie, la loi du 14 juin 2013 a institué le compte personnel de formation (CPF) en lieu et place du droit individuel à la formation (DIF) et le conseil en évolution professionnelle.
Créé en 2003, le DIF était, pour le salarié, un instrument de maîtrise de son parcours professionnel, celui-ci disposant, tout au long de la vie professionnelle, d’un crédit d’heures de formation. Contrairement au DIF, le compte personnel de formation est ouvert à chaque personne, indépendamment de son statut, dès son entrée sur le marché du travail et est intégralement transférable en cas de changement ou de perte d’emploi.
Le conseil en évolution professionnelle a vocation à accompagner l’utilisateur du compte personnel de formation.
L’article L. 6111-2 établit une relation de complémentarité entre la scolarité sous l’égide de l’éducation nationale et la formation professionnelle, tout en maintenant leur autonomie et leur spécificité. Le texte, qui s’inspire de l’accord national interprofessionnel du 7 janvier 2009, prend acte que le socle commun, défini à l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation, n’est pas suffisant à lui seul pour favoriser l’évolution professionnelle des individus et qu’il doit plutôt être conçu comme la base nécessaire d’actions ultérieures de formation professionnelle qui viendraient le développer.
B. L’INSTAURATION D’UN DROIT À L’INFORMATION ET À L’ORIENTATION PROFESSIONNELLE COMME COMPLÉMENT DE LA FORMATION
Avec l’article L. 6111-3, un droit à l’information et à l’orientation professionnelle, qui vient compléter le droit à la qualification professionnelle, est reconnu au salarié, dans la perspective d’une démarche suivant l’individu tout au long de sa vie.
L’orientation relève de l’ensemble des activités qui visent à aider les individus, à tout moment de leur vie, à faire un choix d’éducation, de formation et de profession. Dans un contexte de mobilités professionnelles accrues et de chômage important, ces activités deviennent toujours plus cruciales. L’information des personnes sur leurs droits, tout comme les mesures d’accompagnement dans leur orientation ou la définition des formations adaptées, dépend de l’organisation des acteurs.
C’est pour cette raison qu’a été mis en place le service public de l’orientation dont l’approche intégrée devait permettre de dépasser la seule approche par acteurs et par publics. La loi du 24 novembre 2009 précitée a ainsi institué un service public de l’orientation (SPO), dont l’objet est de délivrer une information gratuite notamment sur les métiers, formations, certifications. Trois mesures ont été instituées par cette loi :
– l’institution du délégué à l’information et à l’orientation (DIO), placé auprès du Premier ministre. Il est, aux termes de l’article L. 6111-4, chargé de mettre en place avec les régions et les partenaires sociaux le service public de l’orientation tout au long de la vie ;
– la création, sous l’autorité du DIO, d’un service dématérialisé permettant à toute personne de disposer d’une première information et d’un premier conseil personnalisé en matière d’orientation et de formation professionnelle et d’être orientée vers les structures susceptibles de fournir les informations et les conseils nécessaires à une bonne orientation professionnelle.
Le service dématérialisé d’orientation
Les modalités financement du service dématérialisé sont déterminées dans le cadre d’une convention conclue entre l’État, le Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP) et les régions.
Les conventions conclues entre l’État et le fonds paritaire ont ainsi permis d’affecter 5 millions d’euros, les accords couvrant la mise en œuvre, l’hébergement et la maintenance d’un site internet, le fonctionnement d’une plateforme téléphonique et des prestations d’information du grand public. Selon les données transmises à votre rapporteur, les fonds effectivement versés par le FPSPP en 2011 se sont élevés à 1,2 millions d’euros. Depuis le financement du FPSPP s’élève à 0,4 millions d’euros, ces moyens ayant permis la mise en place du site internet www.orientation-pour-tous.fr.
Selon un rapport de l’IGAS, ce site, construit à partir d’un site existant, n’a pas apporté de réelle valeur ajoutée et, surtout, n’a pas permis d’accroître la fréquentation (62). Les régions ne participent pas au financement de ce portail.
– la labellisation des lieux de services et de conseil en orientation concourant au service public de l’orientation, les normes de qualité étant élaborées par le DIO, après avis du conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie. Selon le même rapport de l’IGAS, « le dispositif de labellisation […] a rencontré d’importantes difficultés qui ont retardé la sortie des textes réglementaires et du cahier des charges ». En outre, la mise en œuvre de la labellisation, non pas en « lieux uniques » pour l’ensemble des publics mais de réseaux d’opérateurs territoriaux n’a pas facilité l’accès de tous à une information gratuite et complète. Enfin, la labellisation a été menée par l’État seul, les régions ayant été parfois mises devant le fait accompli. L’IGAS souligne enfin que l’appui du DIO auprès des services déconcentrés dans la démarche de labellisation n’a pas été suffisant. Pour toutes ces raisons, la démarche de labellisation n’a pas permis d’améliorer la qualité du service aux usagers.
C. LE RÔLE SPÉCIFIQUE RECONNU À L’ÉDUCATION NATIONALE DANS LA MISE EN œUVRE DU DROIT AU CONSEIL ET À L’INFORMATION
Prévu par le chapitre III du titre Ier du Livre III de la deuxième partie du code de l’éducation, le droit au conseil en orientation et à l’information sur les enseignements, l’obtention d’une qualification professionnelle dans le cadre de l’apprentissage sur les professions et les débouchés et perspectives professionnelles fait partie du droit à l’éducation.
La mise en œuvre de ce droit s’appuie :
– sur l’action des 3 800 conseillers d’orientation psychologues, dont la formation initiale, encadrée par l’article L. 313-1 du code de l’éducation, leur assure une connaissance générale et actualisée des filières de formation, du monde de l’entreprise et de l’environnement économique ainsi que des dispositifs de qualification, des métiers ;
– sur l’action des centres publics d’orientation scolaire et professionnelle organisés par chaque département, aux termes de l’article L. 313-4, dans lesquels sont amenés à exercer les conseillers d’orientation psychologues. Ces centres sont en principe à la charge du département ou de la commune à la demande desquels ils ont été constitués mais peuvent, aux termes de l’article L. 313-5, également être constitués en services d’État. Sur environ 565 centres, 256 sont du ressort des services des collectivités territoriales et 309 sont à la charge de l’État ;
– sur l’action de l’Office national d’information sur les enseignements et les professions (ONISEP) établissement public sous tutelle du ministère de l’Éducation nationale, qui édite et diffuse des documents écrits, audiovisuels et gère des bases de données sur les études et les professions.
Tirant les conséquences des difficultés rencontrées par tous les acteurs pour identifier et prendre en charge les jeunes sortis prématurément du système scolaire, la loi du 24 novembre 2009 précitée a aussi instauré, au travers de l’article L. 313-7 du code de l’éducation, l’obligation pour chaque établissement d’enseignement du second degré, y compris les établissements privés sous contrat et ceux de l’enseignement agricole, et pour chaque centre de formation d’apprentis ou section d’apprentissage de procéder au repérage des jeunes sortis sans avoir acquis un niveau de diplôme minimal. Au-delà du repérage conduit au niveau de l’établissement, la loi organise également, à partir des structures de formation initiale, le transfert des informations concernant les jeunes qui ont décroché du système de formation initiale sans avoir acquis un niveau de diplôme minimal vers les « personnes et organismes désignés par le représentant de l’État dans le département ainsi qu’à la mission locale pour l’insertion professionnelle et sociale des jeunes. ». Ce dispositif est ainsi mis en œuvre et coordonné dans chaque département par le préfet.
Aux termes de l’article L. 313-8 du code de l’éducation, le service public de l’orientation tout au long de la vie doit être en mesure, régionalement et localement, de permettre à tout jeune de 16 à 18 ans sorti sans diplôme du système de formation initiale et sans emploi de se réinscrire notamment dans un parcours de formation, d’accompagnement ou d’exercer une activité d’intérêt général.
L’étude d’impact, jointe au projet de loi, précise, à cet effet, qu’un partenariat interministériel, piloté par le ministère de l’Éducation nationale, a été mis en place pour faciliter l’accompagnement de ce public prioritaire. Cette action a permis près de 166 000 prises de contact, 35 % d’entre elles ayant débouché sur une solution, qu’il s’agisse d’une « orientation ou insertion » (88 %) ou bien d’un emploi (12 %).
D. LA MULTIPLICITÉ DES OPÉRATEURS DE L’ORIENTATION
L’organisation actuelle de l’orientation se caractérise ainsi par l’intervention de multiples acteurs. Selon les informations transmises à votre rapporteur, les institutions en charge de l’orientation représentent près de 8 000 structures, et plus de 35 000 professionnels répertoriés.
Outre le personnel enseignant, sont fondés à intervenir les personnels de l’État spécialisés dans l’orientation, les collectivités territoriales, les organisations professionnelles, les entreprises et les associations (missions locales, permanences d’accueil, d’information et d’orientation financées principalement par les collectivités territoriales, etc.).
Pour la formation professionnelle continue, les organismes paritaires agréés au titre du congé individuel de formation (OPACIF) ont également développé l’orientation à l’initiative des partenaires sociaux. Il faut ajouter enfin, même s’il ne s’agit pas de leur mission première, les organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA) qui ont pu développer des services aux actifs ou demandeurs d’emploi, dans le cadre de la gestion du DIF portable.
Chacun de ces organismes a pu constituer des réseaux et offre une spécificité en raison des publics visés. Cette dispersion nuit pourtant à l’homogénéité de l’offre et ne facilite pas l’accès à un service lisible. Ce constat avait notamment amené l’IGAS à recommander la mobilisation de ces réseaux par les régions dans le cadre d’une logique de « complémentarité et de partenariat ».
II. L’ACTION DE LA RÉGION CONFORTÉE DANS LE DOMAINE DE L’ORIENTATION
Le service public de l’orientation demeurant sous la responsabilité conjointe d’une multitude d’acteurs locaux, il est apparu nécessaire de désigner une autorité organisatrice au plan local pour renforcer l’efficacité du service rendu. La région, eu égard à sa compétence de droit commun en matière de formation professionnelle, est apparue la mieux placée pour endosser le rôle de coordination des dispositifs.
A. LA RÉGION, CHEF DE FILE EN MATIÈRE D’ORIENTATION
Le texte tend à préciser les rôles respectifs de l’État et de la région dans la mise en œuvre de la politique de formation tant dans le code du travail que dans celui de l’éducation.
1. Les modifications apportées dans le code du travail
Les alinéas 1 à 3 procèdent tout d’abord à une nouvelle articulation du chapitre Ier du titre Ier du Livre Ier de la sixième partie du code du travail en instaurant une section relative à la formation professionnelle tout au long de la vie, comprenant les articles L. 6111-1 et L. 6111-2, et une section intitulée « l’orientation professionnelle tout au long de la vie » comprenant les articles L. 6111-3 à L. 6111-5. C’est dans le cadre de cette deuxième section que l’article procède à des modifications substantielles.
Les alinéas 4 à 14, qui modifient l’article L. 6111-3, reconnaissent à l’État et aux régions un rôle différencié dans la mise en œuvre du service public de l’orientation qui « garantit » désormais à toute personne une information gratuite et complète et qui « concourt à la mixité professionnelle ».
Il revient à ces deux parties prenantes de déterminer l’exercice de leurs compétences respectives par le biais d’une convention annuelle conclue dans le cadre du contrat de plan de développement des formations et de l’orientation professionnelles prévu par l’article L. 214-3 du code de l’éducation et modifié par l’article 13 du présent projet.
L’État conserve la définition, au niveau national, de la politique d’orientation des élèves et des étudiants dans les établissements scolaires et d’enseignement supérieur. Il reste maître de la mise en œuvre de cette politique au sein de ces établissements et délivre à cet effet l’information nécessaire aux élèves et aux étudiants.
La région, quant à elle, coordonnera, sur son territoire, l’action des autres organismes participant au service public régional de l’orientation (SPRO). Elle assurera, en outre, l’information sur la validation des acquis de l’expérience et mettra en réseau les centres de conseil en validation des acquis de l’expérience (VAE). Les points relais conseils en VAE assurent en effet une information spécifique susceptible de réorienter des candidats vers les structures du SPRO amenées à délivrer une information plus généraliste. L’action des régions est également confortée par la contribution des organismes consulaires.
La commission a adopté un amendement n° AS89 précisant que les organismes consulaires « participent » au SPRO.
Aucun transfert de compétence, de structures ou de personnels ne résultera de cette nouvelle orientation, la région jouant un rôle d’ « ensemblier ». En 2013, l’État a mis en œuvre, dans huit régions et neuf académies, une expérimentation relative au SPRO dont l’évaluation interviendrait au cours du deuxième trimestre de l’année 2014. Le calendrier de la promulgation de loi permettra de généraliser ce dispositif dès la rentrée scolaire 2014 en tenant compte des enseignements tirés de l’évaluation.
À l’initiative de la rapporteure pour avis au nom de la commission des affaires culturelles et de l’éducation, la commission a adopté un amendement n° AS357 précisant que l’État met en œuvre la politique d’orientation avec l’appui notamment des organismes des centres d’information et d’orientation et des services universitaires d’information et d’orientation mentionnés respectivement aux articles L. 313 5 et L. 714 1 du code de l’éducation,
Les alinéas 13 et 14 modifient l’article L. 6111-5 et font de la région, l’autorité chargée de la labellisation des organismes d’orientation, compétence jusqu’ici attribuée aux services de l’État en la fonction du délégué à l’information et à l’orientation. La région arrêtera ainsi le cahier des charges sur la base duquel les organismes qui proposent à toute personne un ensemble de services sont reconnus comme participant au service public de l’orientation. Ces normes seront élaborées selon un processus collectif, au sein du comité régional de l’emploi, de la formation et l’orientation professionnelles, assurant la participation et l’adaptation de la démarche aux spécificités du territoire bien mieux que ne pourra jamais le faire une démarche nationale descendante.
Aux termes de l’alinéa 12, qui modifie l’article L. 6111-4, la création du service dématérialisé ne relèvera plus de la responsabilité du délégué à l’information et à l’orientation dont la fonction sera supprimée. Cette modification acte la suppression de la fonction de DIO dont les missions relèveront :
– soit du conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles, dans le cadre de la définition, au niveau national, des orientations pluriannuelles, de la stratégie nationale coordonnée, de la coordination des systèmes d’information, et de l’évaluation des politiques, nationales et régionales, d’information et d’orientation ;
– soit de la région, nouvelle autorité organisatrice du SPRO et désormais chargée de la labellisation.
Tirant les conséquences de ces évolutions, l’alinéa 25 procède à la modification de l’intitulé du chapitre IV du titre Ier du livre III de la sixième partie et à l’article L. 6314-1, les mots : « à l’information, à l’orientation et à la qualification professionnelle » étant remplacés par les mots : « à la qualification professionnelle ».
2. Les modifications apportées dans le code de l’éducation
Les alinéas 26 à 34 procèdent à une nouvelle articulation entre l’État et la région dans le cadre du code de l’éducation.
Dans le cadre de l’organisation du service public de l’orientation, la région se voit reconnaître, au travers d’un nouvel article L. 214-16-1, un rôle de mise en réseau de tous les services, structures et dispositifs qui concourent à cette mission sur l’ensemble de son territoire.
Cette mise en réseau couvre de nombreux acteurs, dont le périmètre comprend explicitement les écoles de la deuxième chance aux termes de la précision apportée, par les alinéas 28 et 29, à l’article L. 214-14.
En outre, un nouvel article L. 214-16-2, dispose que la mise en réseau des services de l’État concourant au SPRO sera précisée dans le cadre d’une convention conclue entre celui-ci et la région.
En conséquence, à l’intitulé actuel de la section est ajouté le mot « orientation » et cet intitulé devient ainsi : « Orientation, formation professionnelle et apprentissage ».
L’alinéa 34 tire les conséquences, à l’article L. 313-6 du code l’éducation, de l’implication de la région dans le service public de l’orientation, l’ONISEP devant désormais mettre à la disposition des représentants des régions la documentation professionnelle, qu’elle établit sous le contrôle technique du ministre chargé du travail.
B. LA RÉGION, COORDINATRICE DES DISPOSITIFS DE LUTTE CONTRE LE DÉCROCHAGE SCOLAIRE
Avec les alinéas 35 à 39, la région se voit reconnaître un rôle dans la mise en œuvre du suivi des publics sortis du système éducatif sans qualification qui se trouve en cohérence avec leurs compétences en matière d’orientation.
Il est proposé que la région coordonne sur son territoire l’action des organismes participant au service public de l’orientation ainsi que des organismes concourant aux plateformes de lutte contre le décrochage. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 313-7 modifié, chaque établissement d’enseignement du second degré, y compris les établissements privés sous contrat et les établissements de l’enseignement agricole, chaque centre de formation d’apprentis ou section d’apprentissage transmet notamment à des personnes et organismes désignés par le président du conseil régional les coordonnées de ses anciens élèves ou apprentis qui ne sont plus inscrits dans un cycle de formation et qui n’ont pas atteint un niveau de qualification fixé par voie réglementaire.
L’État conserve la définition de la politique nationale d’orientation et la mise en œuvre coordonnée du dispositif de collecte et de transmission des données relatives aux jeunes « décrocheurs », l’engagement des actions ressortissant désormais des régions, qui se voient reconnaître un rôle de coordination, en lien avec les autorités académiques.
Les dispositions prévues dans le projet de loi modifient la rédaction actuelle du code de l’éducation en la précisant puisqu’il est dorénavant indiqué que c’est l’absence d’obtention d’un diplôme ou d’un titre inscrit au répertoire national des certifications professionnelles qui confère le statut de « décrocheur ».
III. LE DISPOSITIF DU CONSEIL EN ÉVOLUTION PROFESSIONNELLE EST PRÉCISÉ
A. LE CONSEIL EN ÉVOLUTION PROFESSIONNELLE PARTICIPE DE LA SÉCURISATION DU PARCOURS PROFESSIONNEL
Parce qu’il convient d’éviter aux salariés le risque « d’inemployabilité », les partenaires sociaux s’accordent sur la nécessité de les soutenir afin d’appréhender les évolutions de l’environnement professionnel et les opportunités d’emploi et de formations présentes sur le territoire. Le droit à la connaissance de l’évolution des métiers conditionne la maîtrise par le salarié d’un parcours de formation et de son évolution professionnelle.
Institué par la loi du 14 juin 2013, le conseil en évolution professionnelle est une offre de service d’accompagnement visant l’évolution et la sécurisation professionnelle dans le cadre du service public régional de l’orientation prévu par l’article L. 6111-3 du code du travail. Il doit être en mesure de répondre à des demandes formulées aux moments clés des parcours professionnels, lorsque le besoin d’une information sur les métiers et les qualifications est le plus aiguë. Il permet de déboucher sur un projet de mobilité dans l’emploi, de mobilité externe, de vie autonome (création d’entreprise) ou sur un projet de formation.
La création de ce service, au niveau local, hors de l’entreprise, devrait notamment favoriser l’accès des salariés des très petites entreprises et des petites et moyennes entreprises qui constituent un public dépourvu de cette forme de conseil.
Les missions du conseil en évolution professionnelle sont définies par l’article L. 6314-3 du code du travail. Sa mission d’accompagnement doit tout d’abord permettre au salarié de se situer dans une logique de parcours et de mobilité. C’est pourquoi il doit « être informé sur son environnement professionnel et l’évolution des métiers sur le territoire ». La mission de conseil doit par ailleurs constituer une aide à la lecture de l’offre de formation au regard du parcours du salarié. C’est la raison pour laquelle, le conseil en évolution professionnelle doit l’aider à « mieux connaître ses compétences, de les valoriser et d’identifier les compétences utiles à acquérir pour favoriser son évolution professionnelle », « identifier les emplois correspondant aux compétences qu’il a acquises » et « être informé des différents dispositifs qu’il peut mobiliser pour réaliser un projet d’évolution professionnelle ».
La mise en place du conseil en évolution professionnelle posait toutefois une difficulté. La loi relative à la sécurisation de l’emploi ne prévoyait pas de lien explicite entre la mission de conseil et la mobilisation, par le salarié, de son compte personnel de formation. En effet, l’individualisation des droits, que sous-tend la mise en place du CPF, fait du salarié un acteur de son parcours de formation. Or, il ne peut être en mesure d’exercer cette responsabilité que s’il est à même de connaître ses droits. C’est pourquoi, un amendement avait été adopté par l’Assemblée nationale, en première lecture, afin de préciser l’articulation entre le service public de l’orientation et le compte personnel de formation. Le service public de l’orientation est ainsi organisé pour assurer l’information, le conseil et l’accompagnement des personnes qui envisagent de mobiliser leur compte personnel de formation (63).
B. LE RÔLE DU CONSEIL EN ÉVOLUTION PROFESSIONNELLE EST CONFORTÉ
L’article 12 précise le cadre du conseil en évolution professionnelle (CEP) dont l’objectif est de favoriser l’évolution et la sécurisation du parcours professionnel, notamment des actifs.
Les alinéas 15 à 24 complètent la structure du chapitre Ier du titre Ier du Livre Ier de la sixième partie du code du travail en instaurant deux sections III et IV relatives au conseil en évolution professionnelle et aux supports d’information.
La nouvelle section 3, qui comprendra un nouvel article L. 6111-6, précise le cadre du conseil en évolution professionnelle.
Un cahier des charges national définira ainsi l’offre de service qui sera mise en œuvre, au plan local, dans le cadre du service public de l’orientation. Son contenu a été élaboré de manière concertée dans le cadre du groupe quadripartite regroupant l’État, les régions, et les organisations professionnelles et syndicales, avec l’appui de l’inspection générale des affaires sociales. L’arrêté publiant le cahier des charges du CEP sera pris après publication de la loi. La commission a complété ce dispositif avec l’adoption de l’amendement n AS248 précisant que le cahier des charges devra prendre en compte l’émergence de nouvelles filières dans le domaine de la transition écologique et énergétique.
Selon un avant-projet de cahier des charges établi par l’IGAS, la mise en place du CEP doit permettre de mobiliser trois leviers :
« – des actions de professionnalisation (formation, échanges de bonnes pratiques), des têtes de réseaux en charge de la mise en œuvre du CEP ;
« – une capitalisation et une mise à disposition de ressources et d’outils ;
« – la création d’un titre professionnel de « conseiller en évolution professionnelle » ; »
Les acteurs du groupe quadripartite devront piloter le déploiement de cette nouvelle offre de service au sein des réseaux sous leur responsabilité respective. Au plan régional, la mise en œuvre du CEP fera l’objet d’une concertation au sein du bureau du comité régional de l’emploi, de l’orientation et de la formation professionnelle, portant sur la désignation des opérateurs régionaux de l’orientation.
Par ailleurs, des conventions de coordination conjointes de l’État, responsable de la politique de l’emploi, et de la région, responsable de la politique en matière de formation professionnelle et chef de file de l’orientation, avec chacun des opérateurs du CEP favoriseront la mise en œuvre des actions de ces différents réseaux entre eux comme avec les autres membres du service public régional de l’orientation.
Le financement du CEP sera assuré par chacun des opérateurs appelés à mobiliser ses propres moyens et pourra, le cas échéant, être complété par des fonds des régions.
À l’initiative de votre rapporteur, la commission a adopté un amendement n° AS–529 précisant que la mise en œuvre du conseil en évolution professionnelle est coordonnée par la région.
L’offre de service associée, gratuite, s’inscrit dans le cadre du service public régional de l’orientation dont l’organisation relève, aux termes du présent texte, des régions. Le rôle d’accompagnement, qui s’inscrit dans le cadre de la dynamique économique territoriale, doit permettre de faciliter l’accès des publics concernés à la formation, et notamment l’accès au compte personnel de formation. L’articulation entre le service public régional de l’orientation et le compte personnel de formation, initiée par la loi du 14 juin 2013, se trouve ainsi confirmée dans le présent texte.
Ce service gratuit est délivré par cinq opérateurs nationaux désignés par le texte : les organismes de placement spécialisés dans l’insertion professionnelle des personnes handicapées (réseau Cap emploi), Pôle emploi, l’Association pour l’emploi des cadres, les missions locales et les organismes paritaires collecteurs agréés au titre du congé individuel de formation (OPACIF) ainsi que par des opérateurs régionaux désignés par la région, après concertation au sein du bureau du comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles institué à l’article 14 du projet de loi.
La nouvelle section 4 comprendra un nouvel article L. 6111-7, dont l’objet est la réalisation d’un système d’information national portant sur l’offre de formation professionnelle couvrant l’ensemble du territoire national. Ses modalités opérationnelles de mise en œuvre sont renvoyées à un décret en Conseil d’État notamment pour préciser les conditions techniques de sa réalisation.
D’après les informations transmises à votre rapporteur, le système s’appuiera sur les travaux d’ores et déjà engagés sur le portail national et sur les bases actuelles des Centres d’animation et de ressources de l’information sur la formation (CARIF). Il devra également être adapté aux nouveaux objectifs portés par le projet de loi, relatifs à la construction d’un système d’information spécifique sur le compte personnel de formation, ou les formations éligibles au CPF dont la consultation par le grand public doit être facilitée.
Le pilotage de ce système sera assuré dans le cadre de la gouvernance quadripartite future du compte personnel de formation.
*
* *
La Commission est saisie de l’amendement AS357 de la commission des affaires culturelles et de l’éducation.
Mme Colette Langlade, rapporteure pour avis. L’article 12 propose un cadre pour l’architecture générale du service public de l’orientation tout au long de la vie, en précisant que l’État définit, au niveau national, la politique d’orientation scolaire et universitaire et la met en œuvre dans les établissements d’enseignement. Nous précisons que l’État la met en œuvre avec l’appui, notamment, des centres d’information et d’orientation et des services universitaires d’information et d’orientation – le terme « notamment » permettant de ne pas oublier le réseau d’information et de documentation « jeunesse » qui relève du ministère de la jeunesse et des sports. C’est l’occasion de donner un nouveau départ à ces centres, en leur permettant de tisser des liens avec les autres institutions chargées de l’orientation.
M. le rapporteur. Avis favorable à cet amendement, qui rassurera les salariés des structures concernées.
La Commission adopte l’amendement.
Elle examine ensuite l’amendement AS529 du rapporteur.
M. le rapporteur. Il faut reconnaître le rôle de la région dans la désignation des opérateurs régionaux assurant le conseil en évolution professionnelle.
La Commission adopte l’amendement.
Puis elle examine l’amendement AS190 de M. Gérard Cherpion.
M. Gérard Cherpion. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.
M. le rapporteur. Avis défavorable. Ce ne sont pas les chambres consulaires, organes politiques, qui contribuent au service public régional de l’orientation mais bien les organismes – opérateurs techniques – chargés de ces questions en leur sein. L’amendement n’est pas seulement rédactionnel, et la distinction a son importance.
La Commission rejette l’amendement.
Elle est ensuite saisie de l’amendement AS89 de M. Francis Vercamer.
M. Francis Vercamer. Je propose de rendre plus explicite la participation des organismes consulaires au service public de l’orientation.
Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement.
Elle adopte ensuite successivement les amendements rédactionnels AS530 à AS534 du rapporteur.
Puis la Commission examine l’amendement AS248 de M. Denis Baupin.
M. Christophe Cavard. L’amendement tend à intégrer le champ de la transition écologique et énergétique dans l’offre de formation et d’orientation.
Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement.
Elle examine ensuite l’amendement AS285 de M. Lionel Tardy.
M. Lionel Tardy. Le rôle de conseil en évaluation professionnelle est dévolu à plusieurs acteurs. L’amendement tend à garantir leur coordination et ainsi leur efficacité.
M. le rapporteur. La proposition est satisfaite par l’amendement AS529, adopté par la commission, qui alloue cette coordination à la région.
Mme Isabelle Le Callennec. La région coordonne, mais quelles seront les institutions habilitées ?
M. le rapporteur. Les cinq réseaux nationaux – Pôle Emploi, le réseau des missions locales, Cadremploi, APEC et le Fongecif. Sur le plan local, les régions peuvent aussi habiliter d’autres structures telles les Maisons de l’emploi. Un cahier des charges a été défini, des expérimentations régionales sont en cours, et 30 % des conseillers de Pôle Emploi ont déjà suivi une formation ad hoc.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.
Puis elle adopte l’amendement rédactionnel AS535 du rapporteur.
Elle examine ensuite l’amendement AS118 de M. Francis Vercamer.
M. Francis Vercamer. L’arrêté du 18 décembre 2013 a renforcé les missions des Maisons de l’emploi en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Comme l’a indiqué le ministre du travail lors de l’examen du budget de l’emploi, l’automne dernier, c’est d’ailleurs l’essentiel de leur mission. Il est donc souhaitable qu’au même titre que Pôle emploi, l’APEC et les missions locales, les Maisons de l’emploi participent à la mise en œuvre du conseil en évolution professionnelle. C’est le sens de l’amendement.
M. le rapporteur. Avis défavorable. Le texte prévoit que cette mission revient aux cinq réseaux nationaux cités. En l’état du projet, l’habilitation des Maisons de l’emploi relèvera des régions. J’ajoute que le nouveau cahier des charges des Maisons de l’emploi ne prévoit pas qu’elles assurent des missions d’accompagnement.
Mme Isabelle Le Callennec. Les régions, dites-vous, pourront désigner une sixième institution pour assurer ce conseil en évolution professionnelle ; cela pourrait concerner les maisons de l’emploi. Concrètement, comment cela se passera-t-il ? Y aura-t-il des appels à candidature ?
M. le rapporteur. Nous désignons cinq réseaux nationaux ; ensuite, au niveau du CREFOP – comme le précise l’article 14 –, il sera possible d’habiliter des institutions reconnues et qui fonctionnent bien. La région peut aussi lancer un appel à projet ou appel à intention. Le cahier des charges demeure national. Ce sera tout à fait simple, je pense : il n’y a pas à s’inquiéter.
M. Francis Vercamer. Je m’inquiète pour ma part, et je ne suis pas le seul, de l’avenir réservé aux maisons de l’emploi. On leur impose de s’occuper de la gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences (GPEC). La DIRECCTE devait mettre en œuvre les nouvelles dispositions, et finalement, on nous dit que ce sera la région – mais avec un cahier des charges national. Si l’on voulait tuer les maisons de l’emploi, on ne ferait pas autrement : si c’est là l’intention du Gouvernement, qu’il le dise !
M. le rapporteur. Nous aimons tous ici débattre des maisons de l’emploi, ce que nous faisons chaque année, et nous ne manquerons pas d’en parler encore avec M. le ministre !
La Commission rejette cet amendement.
Elle adopte ensuite successivement les amendements rédactionnels AS536 et AS537 de M. le rapporteur.
Elle se saisit ensuite de l’amendement AS286 de M. Lionel Tardy.
M. Lionel Tardy. Cet alinéa met en place un fichier, dont il confie le traitement à « l’État ». Il me semble qu’il faudrait être plus précis. Pourquoi, de plus, prévoir un fichier national alors que les actions prévues ensuite se feront dans un cadre régional ?
M. le rapporteur. Avis défavorable. Il s’agit ici du système de repérage des « décrocheurs », qui existe déjà.
Mme Isabelle Le Callennec. Cela existe déjà, c’est vrai. Je suppose que ce système est aujourd’hui géré par l’éducation nationale : « l’État », c’est très flou !
M. le rapporteur. En l’occurrence, oui, c’est l’éducation nationale. Il s’agit ici, sur ce sujet des décrocheurs qui n’est pas simple, d’opérer un partage des tâches clair entre l’État et les autres opérateurs. Votre question est curieuse…
Mme Isabelle Le Callennec. Monsieur le rapporteur, hier, on nous a présenté un rapport sur la mobilité sociale des jeunes : il existe pour eux 47 dispositifs, et onze ministères sont concernés. On perd là, concluait le rapport, en efficacité. C’est pourquoi je pose systématiquement la question : sur le terrain, il faut pouvoir expliquer aux gens qui fait quoi – le ministère de l’éducation nationale, le ministère du travail, la région… L’État, c’est désincarné ! Bien sûr, la loi ne doit pas descendre jusqu’aux moindres détails, mais la loi une fois votée doit s’appliquer, et pour cela, être expliquée. Si personne ne sait qui fait quoi, plus personne n’est responsable de rien.
M. Denys Robiliard. Mais personne ne lit le code du travail ou le code de l’éducation pour déterminer ses droits en matière de formation professionnelle ! La loi crée des principes, et il revient au Gouvernement et à l’administration de les mettre en œuvre. Nous n’avons pas les moyens de descendre à un degré de précision extrême : nous ferions du mauvais travail.
La Commission rejette cet amendement.
Puis elle adopte l’article 12 modifié.
La Commission se saisit de l’amendement AS197 de M. Gérard Cherpion.
M. Gérard Cherpion. En fin de collège, les élèves et leurs familles remplissent un dossier d’orientation dans lequel ils font part de leurs vœux. Or ces dossiers, centrés sur les formations relevant strictement de l’éducation nationale, ne mentionnent pas explicitement l’alternance – il n’y a qu’une case « autre ». Chacun s’accorde pourtant à dire qu’il faut valoriser ces voies : je propose donc que l’alternance soit mentionnée. Cela permettrait en outre à l’éducation nationale de ne pas perdre totalement la trace des élèves concernés.
M. le rapporteur. Vous avez raison, et je partage votre préoccupation sur ce sujet essentiel. Toutefois, cette proposition n’appartient pas au domaine de la loi.
Mme Isabelle Le Callennec. Est-ce une fiche unique, à l’échelle nationale ?
Mme Colette Langlade, rapporteure pour avis. Oui, c’est une fiche commune à tous les élèves de troisième.
La Commission rejette cet amendement.
Article 13
(art. L. 211-2, L. 214-12, L. 214-12-1 et L. 214-13 du code de l’éducation ;
art. L. 4424-1 du code général des collectivités territoriales)
Contrat de plan régional de développement des formations
et de l’orientation professionnelles
L’article 13 simplifie la procédure d’adoption du contrat de plan régional de développement des formations professionnelles tout en enrichissant ses thématiques. Son élaboration s’inscrit dans une logique de négociation quadripartite, les représentants des organisations syndicales de salariés et d’employeurs pouvant en devenir dorénavant signataires.
I. LES CONTRATS DE PLAN VISENT À METTRE EN COHÉRENCE LES STRATÉGIES DE FORMATION PROFESSIONNELLE DES DIFFÉRENTS OPÉRATEURS
A. LE CONTRAT DE PLAN RÉGIONAL DE DÉVELOPPEMENT DES FORMATIONS PROFESSIONNELLES EST UN INSTRUMENT DE PROGRAMMATION PLURIANNUELLE
Prévu à l’article L. 214-13 du code de l’éducation, le contrat de plan régional de développement des formations professionnelles (CPRDFP) a été institué par la loi du 24 novembre 2009 et s’inscrit dans la continuité des plans régionaux de développement des formations (PRDF). Son objet consiste notamment à « définir une programmation à moyen terme des actions de formation professionnelle des jeunes et des adultes » et à « assurer un développement cohérent de l’ensemble des filières de formation ».
Il détermine les objectifs communs aux différents acteurs sur le territoire régional, notamment en termes de filières de formation professionnelle initiale et continue, sur la base d’une analyse des besoins en termes d’emplois et de compétences par bassin d’emploi.
Il est élaboré par la région dans le cadre du comité de coordination régional de l’emploi et de la formation professionnelle (CCREFP). Instituée par la loi du 17 janvier 2002 (64), cette instance, co-présidée par l’État et la région a pour mission de favoriser la concertation entre les divers acteurs afin d’assurer une meilleure coordination des politiques de formation professionnelle et d’emploi. Le comité est notamment chargé des fonctions de diagnostic, d’étude, de suivi et d’évaluation de ces politiques.
Dans ce cadre, le contrat de plan est établi sur la base des documents d’orientation de la région, de l’État, et des organisations d’employeurs et de salariés. Une concertation est également mise en œuvre avec les collectivités territoriales concernées, Pôle emploi et les représentants d’organismes de formation professionnelle.
Le contrat est cosigné par le président de la région, le représentant de l’État dans la région et l’autorité académique et établi après chaque renouvellement du conseil régional. Il fait l’objet d’un suivi et d’une évaluation par le CCREFP.
Enfin, ce document se décline en conventions annuelles d’application, qui précisent, pour l’État et la région, la programmation et le financement des actions de formation professionnelle.
B. LE BILAN CONTRASTÉ DE LA PREMIÈRE GÉNÉRATION DES CONTRATS DE PLAN RÉGIONAL DE DÉVELOPPEMENT DES FORMATIONS PROFESSIONNELLES
Dans un rapport remis en mai 2012, l’IGAS a établi un premier bilan de l’élaboration et la mise en œuvre de ces contrats signés entre juin 2011 et aujourd’hui (65) :
– de l’avis des partenaires des conseils régionaux, l’élaboration des contrats s’est globalement déroulée dans des conditions satisfaisantes même si l’on peut relever la déception des partenaires sociaux de certaines régions quant aux résultats finaux. La formation des salariés n’aurait pas été abordée uniformément dans la mesure où le rôle des partenaires sociaux n’est pas prévu comme signataires du contrat et des engagements qu’il sous-tend.
– au moment de l’enquête, aucune des régions visitées n’avait commencé la négociation des conventions annuelles d’application des CPRDFP prévues par les textes.
Selon les informations transmises à votre rapporteur, certaines régions ont élaboré ces conventions selon des modalités diverses : région Basse-Normandie, région Franche-Comté, région Provence-Alpes-Côte d’Azur ou région Poitou-Charentes. La région Île-de-France n’a pu négocier aucune convention d’application, le CPRDFP n’existant que depuis dix-huit mois. Ce travail de recensement, établi par le conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie, se heurte aux pratiques différenciées des régions, les conventions d’application pouvant porter des noms variés et ne pas couvrir des champs identiques.
L’IGAS relevait également que le pilotage envisagé pouvait se heurter à des problèmes de moyens, notamment pour les partenaires sociaux. En effet, selon l’IGAS, « les perspectives renforcées de coordination politique et opérationnelle ouvertes par les CPRDF se surajoutent à l’existant, pour des partenaires qui manquent souvent de moyens pour prendre des engagements supplémentaires ». Le rapport pointe ainsi « les contraintes des finances publiques, tant pour l’État que pour les collectivités territoriales, la faiblesse constitutive des organisations interprofessionnelles ou professionnelles, patronales et syndicales, les charges des représentants des OPCA en région ».
L’élaboration des CPRDFP a ainsi contribué à dynamiser les partenariats, les partenaires sociaux ayant notamment contribué à une meilleure prise en compte de la réalité économique locale, mais sans savoir s’ils pourront constituer, dans la durée, des instruments de cohérence et de référence pour l’action de chacun des partenaires.
II. L’AMÉLIORATION DU PROCESSUS DE CONTRACTUALISATION
L’article 13 clarifie les compétences exercées par la région en termes d’apprentissage, de formation et d’orientation professionnelles. Il modifie également la procédure d’adoption du contrat de plan régional de développement des formations et de l’orientation professionnelles tout en enrichissant ses thématiques et en l’inscrivant dans une logique de négociation quadripartite.
A. LES COMPÉTENCES EXERCÉES PAR LA RÉGION SONT CLARIFIÉES
Les alinéas 2 à 5 procèdent à une rédaction globale de l’article L. 214-12 du code de l’éducation, préalable indispensable à la clarification des compétences de la région en termes d’apprentissage, de formation et d’orientation professionnelles :
– investie par l’article 12 du présent texte de l’organisation du service public régional de l’orientation (SPRO), la région est également chargée de définir et de mettre en œuvre ce service public. Selon les informations transmises à votre rapporteur, les cahiers des charges régionaux seront ainsi établis à compter du second semestre 2014, en tenant compte des enseignements de l’expérimentation du SPRO, pour une mise en œuvre au plus tard au 1er janvier 2015 ;
– la compétence de principe de la région, relative à la politique d’apprentissage et de formation professionnelle est maintenue. Cette politique s’adresse aux jeunes et aux adultes à la recherche d’un emploi ou d’une nouvelle orientation professionnelle, la notion de « recherche d’un emploi » se substituant à celle de « sans emploi » dans l’actuelle rédaction. La région se voit désormais « chargée » de cette politique régionale alors que l’actuelle rédaction dispose qu’elle la « définit et (la) met en œuvre » ;
– la région élabore désormais un contrat de plan régional de développement des formations et de l’orientation professionnelles (CPRDFOP). Cette nouvelle dénomination prend en compte plus expressément l’orientation et fait du contrat un outil permettant l’articulation entre l’emploi, l’orientation et la formation. Votre rapporteur souhaiterait toutefois souligner que, si la région joue un rôle pivot dans l’élaboration de ce nouveau contrat, elle n’agit pas isolément, mais en lien avec d’autres institutions ou organismes. Il lui semble préférable de compléter la rédaction du dernier alinéa en ce sens, rappelant ainsi que la constitution du plan s’effectue dans les conditions prévues par l’article L. 214-13 modifié. À cet effet, la commission a adopté l’amendement n° AS538 déposé par votre rapporteur.
Cette nouvelle rédaction a le mérite de simplifier l’articulation des responsabilités dévolues à la région en matière d’apprentissage, de formation et d’orientation professionnelles. Elle tend à supprimer par ailleurs des dispositions qui ont par ailleurs été intégrées au sein des articles L. 6121-1 et L. 6121-2 du code du travail modifié par l’article 11 du présent projet de loi :
– la précision apportée par la loi du 8 juillet 2013 relative à l’adoption de la carte des formations professionnelles initiale par les régions est désormais incluse dans le 1° de l’article L. 6121-1 relatif aux missions exercées par la région dans le cadre de sa compétence en matière de politique régionale d’accès à l’apprentissage et à la formation professionnelle ;
– l’alinéa relatif à la validation des acquis de l’expérience, dans sa double dimension territoriale et d’assistance devient désormais le 4° du même article ;
– l’accueil en formation des populations résidant sur son territoire ou dans une autre région et les actions destinées à répondre aux besoins d’apprentissage et de formation en favorisant l’accès équilibré des femmes et des hommes aux différentes filières de formation, sont désormais prévues par l’article L. 6121-2 relatif à l’organisation et au financement du service public régional de la formation professionnelle.
Les alinéas 6 à 9 modifient par ailleurs l’article L. 214-12-1 du code de l’éducation relatif à la formation professionnelle et l’apprentissage des Français établis hors de France qui relève actuellement de l’État. Désormais, et conformément à l’article 11 du présent texte, les actions menées dans ce cadre sont dévolues aux régions. La convention prévue à l’article L. 6121-2 du code du travail définira les modalités d’accès des Français établis hors de France souhaitant accéder au service public régional de la formation.
L’objectif de la loi visant à instituer un bloc de compétences en matière de formation des publics spécifiques, il est proposé de concentrer l’accueil des bénéficiaires sur un nombre restreint de régions présentant à la fois l’offre de formation, les moyens d’accueil et d’accompagnement ainsi que de prise en charge les plus adaptés. Afin de mettre en place ce dispositif une convention sera conclue entre l’État et les régions concernées.
Sont éligibles, sous condition de ressources, les ressortissants français inscrits au registre mondial des Français établis hors de France, âgés d’au moins 18 ans en situation de recherche d’emploi, d’emploi précaire ou en demande de réinsertion, et pour lesquels il est impossible d’apporter une solution locale.
D’après les éléments transmis à votre rapporteur, les populations concernées sont dans leur grande majorité des ressortissants binationaux d’Afrique, de Madagascar et du Maghreb, le plus souvent en situation de précarité ou de grande pauvreté, non qualifiés et ayant majoritairement besoin d’une remise à niveau de base, y compris linguistique.
B. L’EXTENSION DU CHAMP ET DE LA PROCÉDURE D’ADOPTION DU CONTRAT DE PLAN
Les alinéas 10 à 25, qui modifient l’article L. 214-13 du code de l’éducation, instaurent, à la place du CPRDFP, le contrat de plan régional de développement des formations et de l’orientation professionnelles (CPRDFOP) prenant ainsi en compte la question de l’orientation professionnelle. Si l’économie de l’article est revue, les orientations prévues par l’article L. 214-13, dans son actuelle rédaction, sont confirmées et complétées.
En préalable, il convient de préciser que les évolutions opérées par ce projet de loi concerneront la deuxième génération de contrats de plan, dont l’élaboration interviendrait dans la foulée du renouvellement des conseils régionaux, en 2015.
Ainsi le I. de l’article L. 214-13 dispose que, compte tenu de la situation et du développement économique du territoire, le contrat a pour objet « l’analyse des besoins à moyen terme du territoire régional en matière d’emplois, de compétences et de qualification » ainsi que « la programmation des actions de formation professionnelle des jeunes et des adultes ».
Il définit sur l’ensemble du territoire régional et, éventuellement, par bassin d’emploi les objectifs de capacités d’accueil dans le domaine de l’orientation (1°) et en matière de filières de formation professionnelle initiale et continue (2°). Il inclut également un schéma de développement du service public de l’orientation (5°).
La partie du contrat consacrée aux jeunes (3°) prévoit l’établissement d’un schéma de développement de la formation professionnelle initiale, favorisant une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes dans chacune des filières et incluant le cycle d’enseignement professionnel initial dispensé par les établissements artistiques. Ces objectifs restent inchangés au regard de la rédaction actuellement en vigueur. Toutefois, reprenant des dispositions incluses dans le cadre du plan régional de développement des formations professionnelles, outil antérieur au contrat de plan, la nouvelle rédaction dispose que le schéma consacré aux jeunes vaut schéma des formations sociales et des formations sanitaires. Enfin, ce schéma comporte une nouvelle dimension, celle de l’hébergement des jeunes afin de faciliter leur parcours d’insertion. La situation géographique des formations, associée à la précarité des familles, peut expliquer le décrochement de certains jeunes, rendant nécessaire des mesures d’accompagnement. Cet ajout conforte les orientations préconisées par l’IGAS dans un rapport daté d’octobre 2010 (66) aux termes duquel la responsabilité spécifique de l’hébergement des jeunes en formation par alternance devait être dévolue, sur le plan institutionnel, aux conseils régionaux, dans le cadre des contrats de plan régionaux.
Les dispositions relatives aux adultes (4°) ainsi que celles relatives à la validation des acquis de l’expérience (6°) restent inchangées par rapport au droit actuel.
Le II. de l’article L. 214-13 actualise le processus d’élaboration du nouveau contrat qui se déroule au sein du comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles (CREFOP), institution ayant vocation à se substituer à l’actuel CCREFP.
Quatre modifications substantielles peuvent être soulignées :
– le contrat de plan est désormais formellement adopté par le comité régional, renforçant à cet égard l’engagement des parties prenantes dans son application. La rédaction actuelle du L. 214-13 prévoit que le CPRDFP « engage les parties représentées au sein du comité de coordination régional de l’emploi et de la formation professionnelle ». Cette formulation, peu opérante, nécessitait d’évoluer pour rendre le texte plus conforme à la pratique, la nouvelle rédaction permettant d’acter l’approbation des membres du CREFOP qui ne sont pas expressément signataires du contrat ;
– le texte étend la procédure de concertation aux organismes consulaires. La commission a adopté un amendement n° AS313, sous-amendé à l’initiative de votre rapporteur, visant à étendre la procédure de concertation aux représentants des structures d’insertion par l’activité économique ;
– actant la nouvelle dynamique insufflée aux relations entre les institutions, organismes et partenaires sociaux à l’occasion de l’élaboration du CPRDFP, le projet de loi prévoit que, désormais, le contrat est proposé à la signature des organisations syndicales de salariés et professionnelles d’employeurs représentées au sein du comité, donnant ainsi tout son poids au CPRDFOP pour adapter la planification de la carte régionale de formation aux besoins du marché de l’emploi. Cette signature conférera un poids politique supplémentaire et attestera de la qualité de la concertation entre les membres du bureau du CREFOP. En l’absence de signatures de tout ou partie des partenaires sociaux représentés, le contrat de plan pourra tout de même être adopté et mis en œuvre ;
– les modalités de suivi et l’évaluation du contrat seront définies par un décret en Conseil d’État pris après avis du conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles (CNEFOP). Cette modification fait suite au constat de l’IGAS de l’hétérogénéité des modalités de suivi et d’évaluation relatives à la première génération de contrats.
L’article 13 procède enfin à des modifications de coordination.
L’alinéa 1 actualise les dispositions de l’article L. 211-2 du code de l’éducation, pour tenir compte de la nouvelle dénomination du contrat de plan, désormais intitulé contrat de plan régional de développement des formations et de l’orientation professionnelles.
Cet article avait notamment été modifié par la loi du 8 juillet 2013 (67) afin d’investir la région d’un rôle plus actif dans la fixation, par un arrêté des autorités compétentes de l’État, de la structure pédagogique générale des établissements d’enseignement du second degré. Pris après concertation avec les régions et recueil de leur avis, cet arrêté tient notamment compte de la carte régionale des formations professionnelles initiales qui, aux termes de l’article L. 214-13-1, est fixée, après avis du recteur, conformément à la convention annuelle d’application du CPRDFP signée par les autorités académiques et la région. Cette convention formalise notamment les ouvertures et les fermetures de sections de formation professionnelle initiale, en fonction des moyens disponibles.
L’alinéa 26 modifie l’article L. 4424-1 du code général des collectivités territoriales relatif aux compétences reconnues à la collectivité territoriale de Corse en matière d’éducation. Il est précisé que la liste des opérations de construction ou d’extension des établissements des collèges, des lycées, des établissements d’enseignement professionnel, des établissements d’enseignement artistique, des établissements d’éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes, des établissements d’enseignement agricole mentionnés à l’article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime est arrêtée en tenant désormais compte des engagements conclus dans le cadre du CPRDFOP. Cet article avait toutefois déjà été modifié à cet effet par la loi du 8 juillet 2013. Les éléments étant redondants, votre rapporteur propose de ne procéder qu’à la seule actualisation du nom du contrat de plan. Un amendement n° AS542 a ainsi été adopté par la commission.
*
* *
Suivant l’avis du rapporteur, la Commission rejette l’amendement AS360 de Mme Colette Langlade, rapporteure pour avis.
Elle adopte ensuite les amendements de précision AS538 et de correction AS539, de M. le rapporteur.
Puis elle examine l’amendement AS249 de M. Denis Baupin.
M. Christophe Cavard. Il s’agit cette fois encore d’un amendement sur les métiers liés à la transition écologique.
M. le rapporteur. Avis défavorable.
L’amendement AS249 est retiré.
La Commission adopte l’amendement rédactionnel AS540 de M. le rapporteur.
Puis elle examine l’amendement AS313 de Mme Carrey-Conte, faisant l’objet du sous-amendement AS541 de M. le rapporteur.
Mme Fanélie Carrey-Conte. Il s’agit d’associer les représentants de structures d’insertion par l’activité économique à l’élaboration du contrat de plan régional de développement de l’orientation et des formations professionnelles.
M. le rapporteur. Avis favorable, sous réserve de l’adoption de mon sous-amendement rédactionnel.
La Commission adopte le sous-amendement AS541, puis elle adopte l’amendement AS313 sous-amendé.
Elle se saisit alors de l’amendement AS109 de M. Dominique Tian.
M. Lionel Tardy. Nous proposons que le CREFOP consulte la Fédération de la formation professionnelle (FFP), au titre des représentants d’organismes de formation professionnelle. En effet, l’article 13 précise que l’AFPA sera consultée ; il est donc légitime que ses concurrents, regroupés au sein de la FFP, le soient aussi.
M. le rapporteur. Avis défavorable, même si je n’ai rien contre la FFP. L’AFPA n’est pas consultée comme organisme de formation, mais comme opérateur et membre du service public de l’emploi, avec une expertise en matière de certification. On connaît bien la vieille revendication de la FFP, qui n’est d’ailleurs pas la seule organisation qui représente des organismes de formation professionnelle.
La Commission rejette cet amendement.
La Commission examine l’amendement AS250 de M. Christophe Cavard.
M. Christophe Cavard. Nous souhaitons que le dialogue social ait lieu au niveau territorial. L’alinéa 22 précise que « le contrat de plan régional est établi dans l’année qui suit le renouvellement du conseil régional » ; notre amendement tend à le compléter par la phrase suivante : « Il prend en compte un accord régional conclu entre les représentants régionaux des partenaires sociaux. » Le conseil régional devra tenir compte de cet accord pour définir le contrat de plan.
M. le rapporteur. L’alinéa 21 associe déjà à l’élaboration du contrat de plan les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs.
M. Denys Robiliard. Que recouvre l’« accord régional conclu entre les représentants régionaux des partenaires sociaux » ? Est-ce un accord collectif ? Qui sont les partenaires sociaux désignés ? Les organisations interprofessionnelles ? Qui sont les interlocuteurs ? Bref, cet amendement ouvre un dédale de questions auxquelles il me semble difficile de répondre à ce stade.
M. le rapporteur. L’amendement anticipe les enjeux de l’article 14. Il accorde à mon sens trop de pouvoir à ces instances conventionnelles que sont les organisations syndicales et professionnelles ; j’y suis donc plutôt défavorable.
La future gouvernance, quadripartite, associera l’État, la région, les représentants des salariés et ceux des employeurs. Vous souhaitez, en fin de compte, la réduire à une composition tripartite, l’ensemble des partenaires sociaux se trouvant réunis au sein de la Commission paritaire interprofessionnelle régionale pour l’emploi, la COPIRE – à laquelle nous donnerons peut-être un autre nom.
Toutefois, si le texte prévoit une gouvernance formellement quadripartite, il reconnaît à la région un rôle de pilote.
M. Christophe Cavard. C’est la loi, monsieur Robiliard, qui précise les huit partenaires sociaux qui siègent au Centre des relations avec les entreprises et de la formation permanente, le CREFOP.
L’un de nos amendements ultérieurs, monsieur le rapporteur, tend à confier au seul président du conseil régional la direction du CREFOP. Nous ne cessons de rechercher, sur nos territoires, des accords entre les partenaires sociaux : il me semble donc logique de prendre en compte un tel accord pour le contrat de plan régional.
Vous redoutez, semble-t-il, un tête-à-tête entre les partenaires sociaux et la région, mais, dans les faits, ils dialoguent déjà : il ne s’agit que de formaliser cette pratique. Obliger les partenaires sociaux à conclure un accord écrit en ce domaine enverrait de surcroît un signal fort.
La Commission rejette l’amendement.
Puis elle adopte l’amendement de correction AS542 du rapporteur.
Elle adopte ensuite l’article 13 modifié.
Article 14
(art. L. 2, L. 5112-1, L. 5112-2, L. 5312-12-1, L. 6111-1, L. 6123-1, L.6123-2, L.6123-3, L.6123-4, L.6123-5, L.6123-6 et L.6123-7 du code du travail
et art. L. 232-1 et L. 237-1 du code de l’éducation)
Gouvernance – Institutions
L’article 14 simplifie la gouvernance nationale et régionale de la formation professionnelle et de l’emploi :
– au niveau national, il procède à la fusion du conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie et du conseil national de l’emploi, réunis en un conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles ;
– au niveau régional, il procède à la création du comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles, issus de la fusion du comité de coordination régional de l’emploi et de la formation professionnelle avec le conseil régional de l’emploi.
L’article 14 pose également l’existence législative de la gouvernance nationale et régionale des partenaires sociaux représentatifs.
A. LES POLITIQUES DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE FONT L’OBJET D’UNE GOUVERNANCE DISTINCTE
Les politiques de l’emploi et de la formation professionnelle, bien qu’étroitement liées, font l’objet d’un suivi par deux autorités distinctes : le conseil national de l’emploi d’une part, le conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie d’autre part.
1. La gouvernance nationale et territoriale de la politique de l’emploi
Le suivi de la politique de l’emploi est assuré par le CNE, au niveau national, et par le conseil régional de l’emploi, au niveau territorial.
La loi du 13 février 2008 (68) a substitué au comité supérieur de l’emploi (CSE) le conseil national de l’emploi (CNE) dont l’organisation et les missions sont aujourd’hui fixées par l’article L. 5112-1 du code du travail.
Présidé par le ministre chargé de l’emploi, le CNE comprend des représentants des organisations syndicales et des organisations professionnelles d’employeurs, des collectivités territoriales, des maisons de l’emploi, des administrations intéressées et des principaux opérateurs du service public de l’emploi, notamment Pôle emploi, l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage et l’Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, ainsi que des personnalités qualifiées.
Le CNE émet un avis notamment sur les projets de textes législatifs et réglementaires relatifs à l’emploi, sur le projet de convention pluriannuelle d’objectifs et de gestion conclue entre l’État, l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage et Pôle emploi ou sur l’adaptation et la cohérence des systèmes d’information du service public de l’emploi. Le CNE concourt à la définition des orientations stratégiques des politiques de l’emploi et veille, à cet effet, à la mise en cohérence des actions des différentes institutions et organismes investis du service public de l’emploi – services de l’État, Pôle emploi et l’Association nationale pour la formation professionnelle des adultes - et à l’évaluation des actions engagées.
Le même article L. 5112-1 dispose que, dans chaque région, un conseil régional de l’emploi (CRE) est institué. Présidé par le représentant de l’État dans la région, il comprend les représentants des organisations syndicales et patronales, du conseil régional et des collectivités territoriales intéressées, des services déconcentrés, des universités et des représentants des organismes concourant au service public de l’emploi. Le CRE est consulté sur l’organisation territoriale du service public de l’emploi en région et émet un avis sur la convention annuelle régionale, conclue entre l’État et Pôle emploi.
2. La gouvernance nationale et territoriale de la politique de formation professionnelle
Le suivi de la politique de formation professionnelle relève du conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie (CNFPTLV), au niveau national, et du comité de coordination régional de l’emploi et de la formation professionnelle (CCREFP), au niveau territorial.
Institué par la loi du 4 mai 2004 (69), renforcé dans ses missions par la loi du 24 novembre 2009 (70), le CNFPTLV est placé, aux termes de l’article L. 6123-2 du code du travail, auprès du Premier ministre et comprend des représentants élus des conseils régionaux, des représentants de l’État et du Parlement, des organisations professionnelles et syndicales et de personnalités qualifiées.
Ses missions sont précisées par l’article L. 6123-1 du même code. Elles consistent à favoriser la concertation des différents acteurs pour la définition, la mise en œuvre et le suivi des politiques de formation professionnelle initiale et continue, à évaluer ces politiques aux niveaux national et territorial, sectoriel et interprofessionnel, à émettre un avis sur les projets de texte législatif et réglementaire relatifs à ces mêmes politiques et à contribuer à l’animation du débat public portant sur l’organisation et l’avenir du système de formation professionnelle.
L’article R. 6123-1-1 du code du travail précise que le conseil établit notamment un rapport annuel sur l’utilisation des ressources financières affectées à la formation professionnelle, un bilan annuel par bassin d’emploi et par région des actions de formation professionnelle à partir des évaluations transmises par les comités de coordination régionaux de l’emploi et de la formation professionnelle. L’article R. 6123-1-4 dispose qu’il est destinataire des programmes de suivi, d’études et d’évaluation relatifs à son domaine de compétence et élaborés par les administrations, établissements publics de l’État, conseils régionaux, organismes consulaires et organismes paritaires.
Créé par la loi du 17 janvier 2002 (71), le CCREFP, a pour mission « de favoriser la concertation entre les divers acteurs afin d’assurer une meilleure coordination des politiques de formation professionnelle et d’emploi. Il est notamment chargé des fonctions de diagnostic, d’étude, de suivi et d’évaluation de ces politiques », aux termes de l’article D. 6123-18.
L’article D. 6123-19 dispose qu’il est consulté sur les programmes et les moyens mis en œuvre, dans chaque région, par Pôle emploi et par l’Association nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA), sur les projets de conventions tripartites entre l’État, la région et chacun de ces organismes et sur les projets d’investissement et les moyens d’intervention dont disposent les services régionaux de Pôle emploi et de l’AFPA.
L’article D. 6123-20 précise, en outre, qu’il est informé du montant et de l’affectation des sommes collectées au titre de la taxe d’apprentissage et de la contribution au financement des contrats de professionnalisation.
Enfin, aux termes de l’article L. 214-13 du code de l’éducation, le contrat de plan régional de développement des formations professionnelles est élaboré au sein du CCREFP, suivi et évalué par ses soins.
B. LA GOUVERNANCE PARITAIRE NATIONALE ET LOCALE RÉSULTE DES ACCORDS COLLECTIFS
Dans le cadre du suivi des politiques de l’emploi et de la formation professionnelle, les partenaires sociaux se réunissent au sein du comité paritaire national de la formation professionnelle (CPNFP), au niveau national, et de la commission paritaire interprofessionnelle régionale pour l’emploi (COPIRE), au niveau local.
Né de l’accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 entre les partenaires sociaux (72), le comité paritaire national de la formation professionnelle (CPNFP) est une structure d’analyse, de réflexion et de pilotage, destinée à assurer le bon fonctionnement du système de formation professionnelle. Ses missions consistent notamment à informer les salariés et les entreprises sur les dispositions contenues dans l’accord, de procéder aux études et enquêtes qui lui paraissent nécessaires, d’assurer la liaison avec les pouvoirs publics en matière de formation professionnelle, de faciliter la prise en compte de la dimension européenne de la formation et de formuler des propositions à l’intention des parties signataires de l’accord.
Au niveau territorial, la gouvernance est assurée par la commission paritaire interprofessionnelle régionale pour l’emploi (COPIRE), instituée par l’accord du 10 février 1969 (73) et qui n’a été mise en place dans les régions qu’à la suite du protocole paritaire du 6 juillet 1984. Initialement déterminées par les ANI de 1969 et de 1970 (74), les missions en matière de formation professionnelle sont de fait prévues par l’ANI du 5 octobre 2009 (75).
Les COPIRE, en coordination avec le CPNFP, ont notamment pour mission de contribuer à l’organisation et à la diffusion de l’information auprès des entreprises, des salariés et des demandeurs d’emploi sur les dispositions relatives à la formation professionnelle définies par les accords nationaux interprofessionnels, de procéder aux études et enquêtes qui leur paraissent nécessaires ou déterminées par ces accords et de participer à l’évaluation des dispositions relatives à la formation professionnelle des accords nationaux interprofessionnels au niveau régional et territorial, de contribuer à assurer la liaison avec l’État et les conseils régionaux en matière de formation professionnelle, incluant les travaux conduits au sein des comités de coordination régionaux de l’emploi et de la formation professionnelle (CCREFP) ou de formuler tout avis relatif à la définition et à la mise en œuvre des politiques régionales de formation.
C. DES PROPOSITIONS VISANT À AMÉLIORER LA GOUVERNANCE ACTUELLE
Les rapports remis par M. Larcher (76) et par le conseil économique, social et environnemental (CESE) (77) ont notamment souligné les difficultés liées à la gouvernance administrative actuelle, les outils et instances n’étant pas suffisamment performants pour définir précisément les besoins à court, moyen et long terme.
Le CNE et le CNFPTLV travaillent de manière séparée alors que les politiques d’emploi et de formation professionnelle ne peuvent être élaborées et conduites indépendamment l’une de l’autre. Comme le souligne le rapport du CESE précité, le « regroupement des instances nationales et régionales permettrait de renforcer la lisibilité du paysage institutionnel et de renforcer leurs moyens actuellement dispersés et peu efficients ». Le rapport du CESE relève ainsi, qu’au cours de ses auditions, plusieurs interlocuteurs ont déploré l’absence de « pilote dans l’avion », notamment au plan régional.
Au niveau régional, le rapport remis par M. Larcher souligne que le comité de coordination régionale de l’emploi et de la formation professionnelle s’est imposé comme l’instance la plus opérationnelle de consultation et de coordination régionale. Rejoignant les conclusions du CESE, il propose également de fusionner le comité de coordination régionale de l’emploi et de la formation professionnelle avec la CRE.
La fusion des instances de pilotage permettrait de conforter le diagnostic territorial en matière de besoin de formation et d’orientation professionnelles et renforcerait l’adaptation de la planification de la carte régionale de formation continue aux besoins du marché de l’emploi.
L’ANI du 14 décembre 2013, qui prend également acte d’une gouvernance délicate à mettre en œuvre, tend à réorganiser également la gouvernance paritaire interprofessionnelle des politiques de formation professionnelle et d’emploi.
Son article 42 institue le comité paritaire national pour la formation professionnelle et l’emploi (CPNFPE). Il sera chargé de définir les politiques paritaires de formation et d’emploi, d’assurer la coordination de ces politiques avec celles des pouvoirs publics et des acteurs de la formation professionnelle et de l’emploi, de définir les politiques mises en œuvre par le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP), d’élaborer la liste des formations éligibles au compte personnel de formation et de suivre la mise en œuvre de ce dernier.
Ce comité sera décliné en région au travers de conseils paritaires régionaux pour la formation professionnelle et l’emploi (CPRFPE), qui seront mis en place au plus tard le 30 juin 2014. Ces conseils seront chargés d’animer en région le déploiement territorial des politiques paritaires interprofessionnelles définies par le CPNFPE, d’assurer la coordination de ces politiques et d’élaborer la liste des formations éligibles au compte personnel de formation. L’ANI prévoit qu’ils seront chargés de transmettre aux conseils régionaux un avis motivé sur la carte des formations et que ces conseils devront obligatoirement être consultés par les conseils régionaux avant d’adopter cette carte.
II. LA RATIONALISATION DE LA GOUVERNANCE NATIONALE, TERRITORIALE ET PARITAIRE DES POLITIQUES DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
Le I. procède à la création du conseil national de l’emploi, de la formation et l’orientation professionnelles (CNEFOP), du comité régional de l’emploi, de la formation et l’orientation professionnelles (CREFOP) et pose l’existence législative de la gouvernance interprofessionnelle nationale et régionale, entre les partenaires sociaux représentatifs. Le nouveau dispositif est inséré dans le chapitre III du titre II du livre Ier de la sixième partie du code du travail qui se trouve, de ce fait, entièrement remanié :
– les articles L. 6123-1 et L. 6123-2 précisent, au sein d’une section 1, la mission et la composition du CNEFOP, se substituant ainsi aux actuelles rédactions relatives au CNFPTLV. Par coordination, la section unique du chapitre II du titre premier du livre Ier de la cinquième partie et l’article L. 5112-1, instituant le conseil national de l’emploi, sont abrogés ;
– les articles L. 6123-3 et L. 6123-4 précisent, au sein d’une section 2, la mission et la composition du CREFOP, confirmant ainsi la suppression, au plan juridique, du délégué à l’information et à l’orientation ;
– la nouvelle section 3, comprenant l’article L. 6123-5, et la section 4, incluant l’article L. 6123-6, inscrivent, au plan législatif, l’action des deux instances paritaires institués par les partenaires sociaux, le comité paritaire national pour la formation professionnelle et l’emploi et le comité paritaire régional pour la formation professionnelle et l’emploi ;
– la section 5, comprenant l’article L. 6123-7, précise que les modalités d’application du chapitre III seront définies par décret en Conseil d’État.
Les II. et III., tirant les conséquences de l’institution du CNEFOP et du CREFOP, procèdent à diverses mesures de coordination au sein du code du travail et du code de l’éducation. À cet effet, la commission a adopté un amendement n° AS554 complétant ce dispositif.
A. LA CRÉATION D’UNE INSTANCE NATIONALE UNIQUE DE SUIVI DES POLITIQUES D’EMPLOI, DE FORMATION ET D’ORIENTATION PROFESSIONNELLES
Les alinéas 4 à 19 tendent à instaurer le CNEFOP permettant ainsi d’assurer dans des domaines très liés – emploi, formation professionnelle, orientation – une concertation renforcée entre l’État, les collectivités territoriales, les partenaires sociaux et les autres parties prenantes.
L’article L. 6123-1 modifié précise et étend les missions du futur CNEFOP qui correspondent à celles des actuels CNFPTLV et CNE :
– à côté de l’emploi et de la formation, la compétence en matière d’orientation professionnelle est désormais consacrée ;
– le suivi des travaux des CREFOP, de la mise en œuvre des conventions régionales de coordination des contrats de plan régionaux de développement des formations et de l’orientation professionnelles ;
– la mise en réseau des systèmes d’informations dans les domaines de l’emploi, la formation professionnelle et l’orientation fait aussi partie de ses prérogatives. Il s’agit d’assurer une veille permettant d’offrir aux acteurs un espace de connaissance réciproque des systèmes d’information et de favoriser les échanges et la mise en réseau de ceux-ci. Cette fonction permettra notamment d’assurer un rôle d’alerte auprès des pouvoirs publics si un besoin non couvert est identifié. Le périmètre retenu couvre tout le champ de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelle, pour lesquels certains sujets structurants – comme par exemple celui du langage et des référentiels utilisés, de la qualité des informations partagées – pourront faire l’objet de recommandations de la part du CNEFOP ;
– l’élaboration et la diffusion d’une méthodologie commune, concourant à l’établissement de bilans régionaux des actions financées au titre de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles, ressortissent de son action. Cette mission, qui s’inscrit dans la continuité des travaux déjà réalisés par le CNFPTLV en vue d’élaborer des comptes régionaux de la formation professionnelle.
La commission a entendu préciser les missions du CNEFOP, par l’adoption d’un amendement n° AS287 visant à l’extension aux dispositions réglementaires de la procédure de consultation, le texte n’ayant prévu l’émission d’un avis sur les textes législatifs et les décrets. Il s’agit ici de reprendre une disposition similaire mentionnée dans les missions du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie.
Par coordination avec un amendement n° AS491 adopté à l’article premier, la commission a adopté un amendement n° AS544 rectifié, visant à mettre en lumière le rôle du CNEFOP dans le suivi de la mise en œuvre et de l’utilisation du compte personnel de formation.
Enfin, afin d’assouplir les modalités de consultation de cette instance il est prévu que le CNEFOP, en cas d’urgence, puisse être saisi et rendre un avis soit par voie écrite ou électronique, soit par réunion du bureau, qu’il s’agisse, selon l’étude d’impact, d’une consultation écrite ou d’une délibération. Les conditions d’urgence permettant le recours au bureau seront précisées par voie réglementaire.
Cette nouvelle institution, placée auprès du Premier ministre, sera composée, aux termes de l’article L. 6123-2, de représentants élus des conseils régionaux, des représentants de l’État et du Parlement, des organisations syndicales de salariés et professionnelles d’employeurs, représentatives au niveau national et interprofessionnel ou intéressées, ainsi que, sans voix délibérative les principaux opérateurs de l’emploi, de l’orientation et de la formation. À cet égard, trois remarques peuvent être formulées :
– s’agissant des organisations professionnelles d’employeurs, la rédaction ne limite pas le champ de représentation aux seules organisations représentatives au niveau national et interprofessionnel, à savoir le Mouvement des entreprises de France (MEDEF), la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) et l’Union professionnelle artisanale (UPA). Le texte prévoit la présence d’organismes intéressés, ce terme ayant vocation à inclure les organismes ne répondant pas aux critères de représentativité national et interprofessionnel – les hors champ. La Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles (FNSEA), qui siège actuellement au sein du CNFPTLV et du CNE, ou l’Union nationale des professions libérales (UNAPL), qui siège au CNE, pourraient ainsi faire partie du CNEFOP ;
– il ne comprend pas de membres du Gouvernement en son sein. Pour mémoire, le ministre chargé de l’emploi préside l’actuel CNE, le président du CNEFOP étant nommé par décret en conseil des ministres ;
– l’ajout de la mention « sans voix délibérative » pour les opérateurs de l’emploi, de l’orientation et de la formation constitue une évolution par rapport à la situation actuelle. Au sein de l’actuel CNFPTLV, les voix de tous les membres du conseil comptent même si elles font l’objet d’une pondération. Cette évolution est notamment justifiée par la volonté de faciliter la prise de prise de décision. Selon les informations transmises à votre rapporteur, les principaux opérateurs pourraient être Pôle emploi, les missions locales, l’AGEFIPH et le réseau des Cap Emploi, auxquels il conviendrait sûrement d’adjoindre l’APEC et l’Unédic. La préparation du décret en Conseil d’État, mentionné à l’alinéa 43, qui fera l’objet de consultations sera l’occasion de préciser ces hypothèses.
Enfin, un décret en Conseil d’État, mentionné à l’alinéa 43, dont la préparation fera l’objet de consultations, précisera le nombre de membres du CNEFOP. Pour mémoire, les 60 membres composent le CNFPTLV, 28 pour le CNE.
Au regard de ces éléments, votre rapporteur estime que l’ensemble des membres composant notamment l’actuel CNFPTLV a vocation à se retrouver au sein du CNEFOP.
B. UNE GOUVERNANCE RÉGIONALE UNIFIÉE AU SEIN DES CREFOP
Dans le même esprit, les alinéas 20 à 33 tendent à la création des comités régionaux de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles, issus de la fusion des CCREFP avec le conseil régional de l’emploi, dont la présidence sera, comme à l’heure actuelle, assurée conjointement par le représentant de l’État dans la région et le président du conseil régional.
1. La composition des futurs CREFOP
L’article 14 précise que le comité comprendra des représentants de la région, dont le président du conseil régional, et des représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel et intéressées ainsi que, avec voix consultative, des représentants des principaux opérateurs de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles.
Au regard de ces modifications, plusieurs remarques peuvent être formulées.
S’agissant tout d’abord des organisations professionnelles d’employeurs, et comme pour le CNEFOP, la rédaction étend le champ de représentation aux organisations intéressées et pas seulement représentatives au niveau national et interprofessionnel. Le CREFOP concourant à la définition de la stratégie régionale en matière d’emploi, de formation et d’orientation professionnelle, il paraît cohérent de disposer de l’ensemble des organisations syndicales représentatives ou intéressées. Par ailleurs, l’articulation entre le CNEFOP et les CREFOP implique une certaine cohérence de leurs compositions. La rédaction proposée étant cependant source de confusion, la commission a adopté deux amendements identiques n° AS40 et n° AS546, visant à reprendre la formulation retenue à l’alinéa 19 pour la composition du CNEFOP.
Votre rapporteur estime, en outre, que l’ensemble des membres composant l’actuel CCREFP a vocation à se retrouver au sein du CREFOP.
Le comité est, par ailleurs, doté d’un bureau, instance quadripartite resserrée de concertation, dont les compétences seront définies par décret en Conseil d’État. En filigrane, l’exercice du pouvoir au sein des CREFOP relèvera à l’avenir des bureaux, ce qui pourrait faciliter l’exercice de leurs missions.
Le bureau est notamment le lieu de la concertation sur la désignation des opérateurs régionaux chargés du conseil en évolution professionnelle, sur la répartition des fonds de la taxe d’apprentissage non affectés par les entreprises, sur les listes des formations éligibles au compte personnel de formation élaborées par le comité paritaire régional de la formation professionnelle et de l’emploi pour les salariés et les demandeurs d’emploi.
L’étude d’impact précise, en outre, que le bureau est créé afin de permettre aux financeurs des actions de formations mobilisables sur le territoire – État, régions, partenaires sociaux – de se concerter dans une composition resserrée sur différents objets de coordination de leurs engagements financiers respectifs, notamment la formation professionnelle des demandeurs d’emploi, l’accompagnement des mutations économiques, le déploiement du compte personnel de formation et du conseil en évolution professionnelle.
S’agissant du fonctionnement des CREFOP, un secrétariat permanent est généralement institué, majoritairement assuré par les CARIF-OREF, pour faciliter l’organisation et le suivi des réunions. Les CARIF-OREF assurent le secrétariat du CCREFP dans 14 régions (78). Leur mission ne se limite pas au soutien administratif mais couvre une dimension de structuration et de coordination aussi bien qu’un rôle d’animation. Le choix a été fait de ne pas le préciser dans le texte, la mention n’ayant pas été jugé par le Conseil d’État comme relevant de la loi.
Votre rapporteur restera attentif aux dispositions réglementaires censées préciser la composition, le rôle et le fonctionnement de cette instance.
2. La mission des futurs CREFOP
Le CREFOP a pour mission d’assurer la coordination entre les acteurs des politiques d’orientation, de formation professionnelle et d’emploi et la cohérence des programmes de formation dans la région.
À l’appui du CREFOP, le projet de loi instaure des conventions régionales de coordination de l’emploi, de l’orientation et de la formation, signées par le représentant de l’État dans la région et le président du conseil régional avec chacun des représentants régionaux de Pôle emploi, des missions locales et des organismes de placement spécialisés dans l’insertion professionnelle des personnes handicapées.
Elles visent à mieux coordonner, avec chacun des opérateurs, la mise en œuvre opérationnelle des outils employés au regard de la situation locale de l’emploi, les conditions de leur participation au service public régional de l’orientation et leur action au sein du service public de l’emploi. L’évaluation des politiques de l’orientation, de la formation professionnelles et de l’emploi fait également partie des thèmes inclus dans le conventionnement.
Par coordination, l’alinéa 53 dispose que la stratégie nationale coordonnée en matière de formation professionnelle, définie et mise en œuvre par l’État, les régions et les partenaires sociaux, dans le cadre de la concertation au sein du CNEFOP, est déclinée dans chaque région au sein du comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles.
C. UNE GOUVERNANCE PARITAIRE CONSACRÉE PAR LA LOI
Pour ce qui concerne la gouvernance paritaire nationale, les alinéas 34 à 40 intègrent, dans le code du travail, les instances créées par l’ANI, qui se sont vues dotées de missions nouvelles ayant un impact immédiat sur le futur compte personnel de formation. Cette consécration législative se justifie notamment par la responsabilité, incombant aux instances paritaires, de constituer les listes de formation éligibles au compte personnel de formation pour les salariés et les demandeurs d’emploi. L’opposabilité de ces listes justifierait ainsi la création par la loi des autorités chargées de les constituer.
Le comité paritaire national pour la formation professionnelle et l’emploi (CPNFPE), est ainsi constitué des organisations syndicales de salariés et professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel. Il aura pour mission de définir les orientations politiques paritaires en matière de formation et d’emploi, d’assurer leur suivi et leur coordination avec celles des autres acteurs. Le comité devra également élaborer la liste des formations éligibles au compte personnel de formation au niveau national et interprofessionnel.
De même, il est créé au niveau régional un comité paritaire régional pour la formation professionnelle et l’emploi (CPRFPE) qui, à l’image de l’instance nationale, a notamment pour mission d’animer en région le déploiement territorial des politiques paritaires définies par les accords nationaux interprofessionnels en matière de formation professionnelle et d’emploi. Par ailleurs, la loi reprend les dispositions de l’ANI relatives à la consultation du comité sur la carte régionale des formations professionnelles initiales et sur l’établissement des listes des formations éligibles au titre du compte personnel de formation.
Votre rapporteur s’interroge sur la nécessité de consacrer par la loi la gouvernance paritaire. Cette reconnaissance législative présente en effet quelques difficultés.
L’objet du texte est, en effet, de parvenir à une structuration nationale et régionale, transverse, cohérente et opérationnelle permettant aux différents acteurs de se coordonner pour concevoir, appliquer et évaluer une politique d’orientation et de formation professionnelles susceptible de répondre aux aspirations légitimes des publics concernés.
Cette ambition n’est que partiellement satisfaite par ce texte dans la mesure où les structures paritaires, sanctuarisées par la voie législative, n’incluent pas les organisations professionnelles d’employeurs relevant du « hors champ ».
Enfin, à l’initiative de votre rapporteur, la commission a adopté deux amendements n°s AS551et AS552 précisant l’appellation de ces deux nouvelles instances afin qu’elles soient mieux identifiées :
– le comité paritaire interprofessionnel national pour l’emploi et la formation ou CoPINEF ;
– le comité paritaire interprofessionnel régional pour l’emploi et la formation ou CoPIREF.
*
* *
La Commission est saisie de l’amendement AS287 de M. Lionel Tardy.
M. Lionel Tardy. Je me félicite de la fusion du Conseil national de l’emploi et du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie. Je soutiens la rationalisation – malheureusement trop rare – de ce genre d’instances consultatives.
Quitte à ce que le nouveau Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles émette des avis, autant que ce soit sur tous les textes réglementaires, c’est-à-dire pas uniquement sur les décrets, mais également sur les arrêtés. C’est par ailleurs la formulation actuelle retenue pour les missions du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie.
Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement.
Puis elle adopte l’amendement rédactionnel AS543 du rapporteur.
Elle en vient ensuite aux amendements identiques AS38 de M. Gérard Cherpion et AS90 de M. Francis Vercamer.
M. Gérard Cherpion. Notre amendement propose d’intégrer les organismes consulaires au sein du futur Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles.
M. Jean-Patrick Gille, rapporteur. Nous ne pouvons citer dans le texte de loi l’ensemble des personnes siégeant au Conseil. Elles sont néanmoins désignées dans l’article par le terme « intéressées ». La composition du CNEFOP sera par ailleurs la même que celle du CNFPTLV. Avis défavorable.
La Commission rejette les amendements.
Elle examine ensuite l’amendement AS119 de M. Francis Vercamer.
M. Francis Vercamer. Il s’agit de réintégrer le « hors champ » à l’intérieur des instances de pilotage.
M. le rapporteur. Nous souhaitons comme vous que le « hors champ » soit intégré à ces instances et, comme précédemment, le terme « intéressées » peut y renvoyer. Les organisations patronales du « hors champ » et les autres étant par ailleurs parvenues à un protocole d’accord, il sera sans doute possible de le traduire dans la loi. Votre amendement étant satisfait, j’y suis défavorable.
M. Gérard Cherpion. Il est important de se référer spécifiquement dans le texte aux organisations multiprofessionnelles.
M. Arnaud Richard. Je rappelle qu’il n’est pas souhaité que ce soit le CNEFOP qui soit chargé de l’évaluation des politiques publiques.
M. Denys Robiliard. Il semble en effet qu’un accord soit intervenu aujourd’hui entre les organisations patronales, et il est préférable que nous en prenions connaissance avant de légiférer plus avant. Cela ne nous empêche pas d’être, comme vous, favorables à l’implication du « hors champ » dans ces instances : on ne peut pas laisser à la porte des employeurs qui emploient près de 30 % des effectifs salariaux de notre pays ; on ne peut pas non plus leur demander de cotiser sans être présents dans les instances de gouvernance. Je propose donc de reprendre cette discussion lors de l’examen du texte en séance, quitte à déposer pour cela des amendements au titre de l’article 88.
La Commission rejette l’amendement.
Puis elle adopte successivement l’amendement rédactionnel AS555, l’amendement de coordination AS544 rectifié et l’amendement rédactionnel AS545 du rapporteur.
Elle est ensuite saisie de l’amendement AS251 de M. Christophe Cavard.
M. Christophe Cavard. La participation des organisations du « hors champ » aux instances de gouvernance ne peut pas dépendre uniquement de l’accord signé entre les partenaires sociaux. Les parlementaires ont aussi leur mot à dire sur les personnes qui doivent figurer dans ces instances.
M. le rapporteur. Si je suis d’accord avec l’esprit de votre amendement, sa rédaction ne me convient pas. Avis défavorable.
L’amendement est retiré.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette les amendements identiques AS315 de M. Francis Vercamer et AS332 de M. Gérard Cherpion.
Puis elle examine l’amendement AS204 de Mme Ségolène Neuville.
Mme Ségolène Neuville. Nous souhaitons que la parité entre hommes et femmes soit respectée, à une unité près, au sein du CNEFOP. Je suis consciente que cela est compliqué par le fait que les membres de ce conseil sont nommés par différentes organisations. Néanmoins, si chaque organisation nomme plusieurs représentants, il doit au moins être possible que ces nominations respectent la parité.
M. Arnaud Richard. J’avais cru comprendre que chaque nouvelle loi présentée par le Gouvernement intégrait automatiquement cette obligation de parité.
M. le rapporteur. Même si, comme chacun, je suis d’accord sur le principe, je ne suis pas favorable à cet amendement en raison de la difficulté que vous avez soulignée, madame Neuville. La composition du CNFPTLV, sur laquelle sera calquée celle du CNEFOP, ne respecte pas la parité : on y trouve trente-trois femmes pour quarante hommes. Or, dans la mesure où la plupart des organisations ou institutions représentées n’y désignent qu’un membre, le rééquilibrage est difficile. Pour les autres, si le Sénat a été admirable en désignant deux sénatrices et deux sénateurs, je déplore que l’Assemblée nationale n’ait désigné que des hommes. L’État, quant à lui, a respecté la parité, et les régions ont majoritairement désigné des femmes ; si la représentation des organisations syndicales est équilibrée, les chambres consulaires, en revanche, n’ont désigné que des hommes ; les personnalités qualifiées, enfin, sont également toutes des hommes.
Mme Ségolène Neuville. A-t-on une idée du nombre de membres que comportera le CNEFOP ?
M. le rapporteur. Approximativement le même nombre que le CNFPTLV, soit quatre-vingts personnes environ, sachant qu’il faut encore régler la question du poids respectif de chaque collège.
Mme Isabelle Le Callennec. Qui va régler ces questions ?
M. le rapporteur. L’État.
L’amendement est retiré.
La Commission adopte ensuite les amendements rédactionnels identiques AS546 du rapporteur et AS40 de M. Gérard Cherpion.
Puis, suivant l’avis défavorable du rapporteur, elle rejette successivement les amendements AS120 de M. Francis Vercamer et les amendements identiques AS39 de M. Gérard Cherpion et AS91 de M. Francis Vercamer.
L’amendement AS205 de Mme Ségolène Neuville est retiré.
La Commission est saisie de l’amendement AS252 de M. Christophe Cavard.
M. Christophe Cavard. Il s’agit de pousser à son terme la logique décentralisatrice en confiant la présidence du CREFOP à la seule région. Il n’est en effet pas nécessaire que l’État copréside cette instance.
M. le rapporteur. Certes, le pilotage de la formation, de l’orientation et de l’apprentissage est désormais décentralisé et confié à la région, mais, dans le même temps, les instances qui gèrent l’emploi et la formation sont fusionnées. Or l’emploi, c’est l’État. L’aspect le plus innovant de la loi, c’est moins la création du CREFOP que la mise en place d’une « conférence » des financeurs qui réunit l’État, la région et les partenaires sociaux. Je propose que l’on s’en tienne à cet équilibre, dont je vous accorde qu’il peut être problématique en cas de désaccord. Vous préconisez de renforcer le pouvoir de la région. À titre personnel, je n’y suis pas opposé, mais c’est encore prématuré. Avis défavorable.
Mme Isabelle Le Callennec. Pouvez-vous me confirmer, monsieur le rapporteur, qu’il y a bien deux vice-présidences ?
M. le rapporteur. En effet.
M. Arnaud Richard. Quels sont les partenaires sociaux qui siégeront dans les CREFOP ?
M. le rapporteur. Il s’agit des représentants régionaux des cinq organisations syndicales représentatives et des représentants du MEDEF, de l’UPA et de la CGPME. Une autre option aurait consisté à faire siéger dans les CREFOP les représentants des comités paritaires régionaux pour la formation professionnelle et l’emploi institués par ce même article 14.
L’amendement est retiré.
La Commission adopte l’amendement rédactionnel AS547 du rapporteur.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur, elle rejette ensuite successivement l’amendement AS253 de M. Christophe Cavard, et les amendements identiques AS319 de M. Francis Vercamer et AS333 de M. Gérard Cherpion.
Elle examine l’amendement AS208 de Mme Ségolène Neuville.
Mme Ségolène Neuville. Il s’agit d’instaurer la parité entre les femmes et les hommes au sein du bureau du CREFOP, la composition de ce bureau étant fixée par décret en Conseil d’État. On court le risque, si l’on rejette cette disposition, de donner corps à des institutions qui, comme la Haute Autorité de santé, ne comporteront que des hommes.
Mme la présidente Catherine Lemorton. Je partage votre déception au sujet de la Haute Autorité de santé.
M. le rapporteur. Il y aura un CREFOP par région, et le décret du Conseil d’État ne détaillera pas forcément leur composition. Il s’agit d’un lieu de concertation et non d’une instance de décision, ce qui impliquerait de régler précisément le poids des partenaires sociaux par rapport à la région. Quoi qu’il en soit, si la parité est assez aisée à établir concernant les représentants de l’État et de la région, c’est plus compliqué pour les représentants syndicaux. Je suis donc défavorable à votre amendement, et vous suggère d’en déposer un autre, spécifiant que le principe de parité doit s’appliquer aux représentants de l’État et de la région.
M. Arnaud Richard. Je tiens à remercier le rapporteur d’avoir pris le temps nécessaire pour nous expliquer qu’il n’était pas possible d’atteindre la parité en la matière. Toutefois, comme celle-ci paraît indispensable, les députés de l’UDI voteront l’amendement.
Mme la présidente Catherine Lemorton. Le rapporteur n’a jamais dit que la parité n’était pas indispensable : il a expliqué qu’elle serait difficile à mettre en œuvre.
M. Arnaud Richard. Il conviendrait donc de s’incliner devant les difficultés…
M. le rapporteur. Je n’ai pas dit cela.
Mme Ségolène Neuville. Si j’ai bien compris, la parité ne sera pas difficile à atteindre pour les représentants des régions, dont l’élection obéit déjà à ce principe, et pour ceux de l’État : elle le sera en revanche pour les représentants des partenaires sociaux. Je défendrai donc en séance publique un amendement visant à demander aux syndicats d’imposer la parité dans leurs instances.
L’amendement AS208 est retiré.
La Commission adopte l’amendement rédactionnel AS548 du rapporteur.
Elle examine ensuite l’amendement AS159 de Mme Fanélie Carrey-Conte.
Mme Fanélie Carrey-Conte. L’amendement AS159 vise à associer les représentants de l’insertion par l’activité économique (IAE) à l’élaboration de la convention régionale de coordination de l’emploi, de l’orientation et de la formation.
M. le rapporteur. L’IAE n’étant pas regroupée au sein d’un opérateur unique – il existe plusieurs fédérations –, comment choisir ses représentants ? Avis défavorable.
M. Denys Robiliard. Il vous suffirait, monsieur le rapporteur, de modifier la rédaction de l’amendement en proposant d’insérer, après le mot : « locales », les mots : « un représentant des structures mentionnées à l’article L. 5132-4 ».
M. le rapporteur. De plus, la convention régionale est signée avec les opérateurs du service public, alors que l’IAE relève du privé.
Mme Fanélie Carrey-Conte. Le mieux est de retirer l’amendement pour en modifier la rédaction d’ici à la séance publique.
L’amendement AS159 est retiré.
Puis la Commission adopte les amendements rédactionnels AS549 et AS550 du rapporteur.
Elle examine ensuite l’amendement AS551 du rapporteur.
M. le rapporteur. Comme les institutions conventionnelles constituées par les partenaires sociaux seront inscrites dans la loi, ce qui est nouveau – je ne suis pas certain, du reste, que ce soit une bonne idée –, il convient de prévoir un acronyme prononçable. L’amendement AS551 vise donc à transformer le comité paritaire national pour la formation professionnelle et l’emploi en comité paritaire interprofessionnel national pour l’emploi et la formation, dont l’acronyme, légèrement facétieux, sera CoPINEF.
La Commission adopte l’amendement.
Puis, suivant l’avis défavorable du rapporteur, elle rejette l’amendement AS121 de M. Francis Vercamer.
Elle examine ensuite l’amendement AS41 de M. Gérard Cherpion.
M. Gérard Cherpion. Le comité responsable de l’établissement de la liste nationale des formations éligibles au compte personnel de formation doit considérer les besoins de l’ensemble des secteurs professionnels, qu’ils soient intégrés ou non au champ de la négociation nationale et interprofessionnelle.
C’est pourquoi, à défaut d’intégrer les organisations multiprofessionnelles dans la composition même du CPNFPE, l’amendement AS41 vise à organiser la consultation du « hors champ » préalablement à la constitution de la liste nationale d’offres de formation. Il convient en effet de prendre en considération la réflexion des organisations professionnelles représentatives non adhérentes à une organisation interprofessionnelle.
M. le rapporteur. Si je ne suis pas opposé au principe qui préside à votre amendement, il convient toutefois, avant de se prononcer, d’attendre de connaître le protocole établi par le comité paritaire.
M. Gérard Cherpion. L’amendement peut être adopté sous réserve du protocole.
M. Denys Robiliard. Puisque la donne a changé – le fait que le Parlement légifère sur la question a certainement facilité le rapprochement des partenaires –, il serait de bonne méthode que chacun retire les amendements qui portent sur le multiprofessionnel.
Le débat sur la question ne pourra avoir lieu qu’en séance publique.
M. le rapporteur. Si je suis favorable à cet amendement sur le fond – la concertation des partenaires sociaux avec les représentants du « hors champ » serait en effet bienvenue –, je vous demande toutefois de bien vouloir le retirer, monsieur Cherpion.
M. Gérard Cherpion. Je retire l’amendement pour le redéposer en séance publique s’il n’est pas satisfait par le protocole.
M. le rapporteur. Nous le voterons alors, monsieur Cherpion.
Mme Isabelle Le Callennec. Il faudra bien un jour, par souci de précision, trancher entre les mots « hors champ » et « multiprofessionnel ».
M. le rapporteur. Ces mots ne renvoient pas exactement aux mêmes registres sémantiques. Ce qu’on nomme le « hors champ », et qui s’est constitué face au champ de l’interprofession, a réussi à adopter une position commune, bien qu’étant composite – il couvre notamment les travailleurs libéraux et les exploitants agricoles. Un des enjeux du protocole sera de choisir une dénomination définitive, qui sera inscrite dans le code du travail.
L’amendement AS41 est retiré.
Puis la Commission examine l’amendement de précision AS552 du rapporteur.
M. le rapporteur. En cohérence avec l’amendement AS551, l’amendement AS552 vise à transformer le comité paritaire régional pour la formation et l’emploi en comité paritaire interprofessionnel régional pour l’emploi et la formation, dont l’acronyme sera CoPIREF.
La Commission adopte l’amendement.
Puis, suivant l’avis défavorable du rapporteur, elle rejette l’amendement AS122 de M. Francis Vercamer.
L’amendement AS42 de M. Gérard Cherpion est retiré.
La Commission adopte ensuite l’amendement rédactionnel AS553 et l’amendement de coordination AS554 du rapporteur.
Puis elle adopte l’article 14 modifié.
Article 15
Compensation financière des transferts de compétences
opérés en direction des régions
Le présent article tire les conséquences des transferts de compétences de l’État aux régions, opérés, respectivement à l’article 6 du présent projet de loi pour la politique de l’apprentissage et à l’article 11 du présent projet de loi pour la politique de formation professionnelle.
En effet, en vertu de l’alinéa 4 de l’article 72-2 de la Constitution, « tout transfert de compétences entre l’État et les collectivités territoriales s’accompagne de l’attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice. Toute création ou extension de compétences ayant pour conséquence d’augmenter les dépenses des collectivités territoriales est accompagnée de ressources déterminées par la loi ».
Le présent article pose ainsi le principe et les modalités de cette compensation financière, les moyens financiers afférents devant être inscrits dans le projet de loi de finances pour 2015, qui est le seul véhicule adéquat s’agissant de la modification de relations financières entre l’État et les collectivités territoriales dès lors que celle-ci passe par l’affectation d’une ressource fiscale. C’est pourquoi le II du présent article prévoit une entrée en vigueur au 1er janvier 2015 des dispositions relatives à la compensation financière des transferts de compétences aux régions, « sous réserve de l’entrée en vigueur des dispositions relevant de la loi de finances ».
La compensation financière des charges résultant des transferts de compétences de l’État vers les régions doit répondre à plusieurs principes tendant à assurer la neutralité desdits transferts, tant sur le budget de l’État que sur celui des collectivités territoriales bénéficiaires.
La compensation financière est ainsi :
– intégrale, puisque les ressources transférées sont équivalentes aux dépenses effectuées, à la date du transfert, par l’État au titre des compétences transférées, comme le prévoit l’article L. 1614-1 du code général des collectivités territoriales. Toutes les dépenses, directes et indirectes, liées à l’exercice des compétences transférées sont prises en compte. Les ressources transférées évoluent chaque année, dès la première année, comme la dotation globale de fonctionnement. Elles assurent la compensation intégrale des charges transférées ;
– concomitante, dans la mesure où tout accroissement de charges résultant des transferts de compétences est accompagné du transfert concomitant des ressources nécessaires à l’exercice de ces compétences. La compensation financière des transferts de compétences est établie en deux temps, dans le strict respect du principe de la concomitance des transferts de charges et de ressources : dès la loi de finances de l’année du transfert de compétences, des crédits sont inscrits à titre provisionnel pour donner aux collectivités territoriales les moyens financiers d’exercer leurs nouvelles compétences ; lorsque le montant du droit à compensation est définitivement arrêté, il est procédé aux régularisations nécessaires ;
– contrôlée, conformément aux dispositions de l’article L. 1614-3 du code général des collectivités territoriales, parce que le montant des accroissements de charges résultant des transferts de compétences est constaté par arrêté interministériel, après avis de la Commission consultative sur l’évaluation des charges (CCEC). C’est cette commission qui a pour mission principale de contrôler les compensations financières allouées en contrepartie des transferts de compétences. La CCEC est associée à la définition des modalités d’évaluation des accroissements et des diminutions de charges résultant des transferts de compétences entre l’État et les collectivités territoriales. En donnant son avis sur les projets d’arrêtés interministériels fixant le montant de ces compensations, elle veille ainsi à l’adéquation entre les charges et les ressources transférées ;
– conforme à l’objectif d’autonomie financière inscrit à l’article 72-2 de la Constitution, qui dispose que « les recettes fiscales et les autres ressources propres des collectivités territoriales représentent, pour chaque catégorie de collectivités, une part déterminante de l’ensemble de leurs ressources. La loi organique fixe les conditions dans lesquelles cette règle est mise en œuvre ».
Le I du présent article prévoit que la compensation financière du transfert de compétences aux régions opéré par la présente réforme s’agissant de la politique de l’apprentissage et de la politique de formation professionnelle obéit aux principes fixés aux articles L. 1614-1 à L. 1614-7 et L. 4332-1 du code général des collectivités territoriales.
Ces articles garantissent la neutralité des transferts opérés, conformément aux principes d’une compensation financière intégrale, concomitante, contrôlée et conforme à l’objectif d’autonomie financière des collectivités.
Le deuxième alinéa du I prévoit que les ressources attribuées au titre de cette compensation sont, conformément à l’article L. 1614-1, équivalentes aux dépenses consacrées par l’État, à la date du transfert, à l’exercice des compétences transférées, diminuées du montant des éventuelles réductions brutes de charges ou des augmentations de ressources entraînées par les transferts.
Cette précision vise deux cas de figure distincts :
– d’une part, les augmentations de ressources entraînées par les transferts. En effet, le transfert de certains biens représente une charge pour les collectivités territoriales mais peut également leur procurer des ressources, sous la forme par exemple d’une valorisation de ces biens ;
– d’autre part, les réductions brutes de charges, c’est-à-dire les dépenses supplémentaires que doit éventuellement assumer l’État au titre de ce transfert de compétences, par exemple, sous la forme de coûts de pilotage, de suivi, de contrôle qu’il devra désormais exercer dans la mesure même où il délègue la mise en œuvre de cette politique à la région.
Le troisième alinéa du I dispose que le droit à compensation des charges de fonctionnement transférées dans le cadre de la présente réforme est égal à la moyenne des dépenses actualisées constatées sur une période maximum de trois ans précédant le transfert de compétences.
Ces dispositions sont calées sur les modalités d’évaluation des charges qui ont prévalu dans le cadre de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et aux responsabilités locales qui avait, rappelons-le, procédé à l’attribution de la compétence de droit commun à la région en matière de formation professionnelle continue et d’apprentissage.
La compensation des charges résultant du transfert de compétences s’effectue donc au « coût historique » : les charges transférées doivent ainsi être évaluées à partir de la moyenne actualisée des dépenses consacrées par l’État au cours des trois années précédant le transfert.
D’après les informations recueillies par votre rapporteur, ce transfert ne devrait porter que sur des charges de fonctionnement, à l’exclusion de toute charge d’investissement.
S’agissant des modalités qui seront retenues pour assurer la compensation des transferts de charges aux régions, celles-ci pourraient passer par l’attribution de recettes fiscales. Elles n’ont toutefois pas été arrêtées à ce stade. Une compensation par le biais de dotations budgétaires ne saurait donc être totalement exclue.
Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application de cette compensation financière, après avis de la commission consultative sur l’évaluation des charges (CCEC), déjà évoquée. Celle-ci est en effet obligatoirement consultée pour déterminer les montants de la compensation financière afférente au transfert de compétences.
B. L’ÉVALUATION DU TRANSFERT DE CHARGES OPÉRÉ PAR LA PRÉSENTE RÉFORME
1. L’apprentissage
Comme votre rapporteur l’a souligné précédemment, le rôle de la région en matière d’apprentissage a été renforcé par l’article 6 du présent projet de loi, puisque la région pilote les contrats d’objectifs et de moyens (COM) pour le développement de l’apprentissage et se voit transférer l’ensemble des centres de formations des apprentis.
Cependant, comme le souligne l’étude d’impact sur le projet de loi, la suppression des conventions d’objectifs et de moyens (COM) conclues entre le préfet de région et le président du conseil régional n’est pas assimilable à un transfert de compétence tel que défini par l’article 72-2 de la Constitution. En effet, l’article L. 6211-3 du code du travail actuellement en vigueur ne consacre pas de compétence de l’État à proprement parler : elle fonde seulement sa participation, dans un cadre conventionnel, au financement du développement de l’apprentissage, compétence qui demeure du ressort des régions.
En l’absence d’élargissement du public bénéficiaire de l’apprentissage et de modification de la nature et de la finalité de cette compétence, il n’y a pas d’extension de compétence. Ces dispositions s’apparentent à un aménagement de compétences n’ouvrant pas droit à compensation. Elles ne créent au demeurant pas de charges nouvelles. Les régions étaient auparavant parties prenantes de l’élaboration des COM conclus avec l’État, elles exerceront désormais leur compétence dans le cadre de leur libre administration.
En revanche, la régionalisation des centres de formation des apprentis (CFA) à recrutement national correspond à une extension de compétence qui implique un transfert des moyens financiers et de personnels consacrés par l’État à l’exercice de cette fonction.
2. La formation professionnelle
S’agissant des transferts de compétences opérés en matière de formation professionnelle, ils recouvrent :
– la politique de prévention et de lutte contre l’illettrisme et l’organisation des formations visant à garantir l’acquisition pour tous du socle de connaissances et des compétences, pour laquelle 53 millions d’euros sont inscrits dans la loi de finances initiale pour 2014 ;
– la politique de formation professionnelle des personnes sous main de justice et des Français hors de France. À ce titre, la loi de finances initiale pour 2014 a prévu l’ouverture d’une part, de 7 millions d’euros au titre de la participation à la prise en charge des coûts pédagogiques des actions de formation suivies par les détenus et à leur rémunération de stage, et d’autre part, de 17,5 millions d’euros en autorisations d’engagement et de 21,1 millions d’euros en crédits de paiement pour le financement, en 2014, du marché pour la formation des publics spécifiques, qui comprennent, outre les détenus et les Français de l’étranger, les demandeurs d’emploi ultra-marins. Afin de reconstituer le montant des dépenses engagées au titre des deux premiers, il convient donc de retrancher la part de ces sommes affectées à la formation des demandeurs d’emploi ultra-marins. D’après les informations transmises à votre rapporteur, les dépenses consacrées aux personnes détenues ont représenté 9,16 millions d’euros en 2013 au sein du marché exécuté par l’AFPA, pour la rémunération des détenus ayant bénéficié d’une formation, et 4,74 millions d’euros ont été consommés par ailleurs au titre de ce marché. En outre, dans le cadre des actions ciblées à destination des détenus, près de 10 millions d’euros ont été consommés en 2013. Au total, les dépenses en faveur de la formation des détenus représenteraient donc de l’ordre de 24 millions d’euros. S’agissant des Français hors de France, 0,31 million d’euros auraient été consommés en 2013 ;
– la compétence en matière d’accompagnement des candidats à la validation des acquis de l’expérience (VAE) et des actions de sensibilisation et de promotion de la VAE : 6,8 millions d’euros sont prévus à ce titre en loi de finances initiale pour 2014 ;
– le financement de la part aujourd’hui assumée par l’État de la rémunération des différents publics stagiaires en formation (travailleurs handicapés, apprentis dont le contrat est rompu, mais aussi détenus et Français de l’étranger), qui est estimée par l’étude d’impact à plus de 100 millions d’euros.
Au total, les compétences transférées à la région en matière de formation professionnelle représenteraient un coût de l’ordre de 180 millions d’euros, qui leur sera donc intégralement compensé.
*
* *
Le tableau suivant retrace l’évaluation établie à ce jour du coût des politiques transférées aux régions (hors rémunérations de la formation bénéficiant aux personnes détenues). Un travail d’expertise complémentaire doit être mené dans le cadre de la préparation du projet de loi de finances.
ESTIMATION DU MONTANT DE LA COMPENSATION FINANCIÈRE AUX RÉGIONS
ISSUE DU TRANSFERT DE COMPÉTENCES
EN MATIÈRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE ET D’APPRENTISSAGE
(en millions d’euros)
CFA nationaux |
1,5 |
Formations visant à garantir l’acquisition d’un socle de connaissances et de compétences pour les personnes à la recherche d’un emploi |
50 |
Formation des personnes sous main de justice et des Français hors de France |
10 (hors rémunération) |
Accompagnement vers la VAE et promotion de la VAE |
5 |
Prise en charge spécifique de la rémunération des stagiaires handicapés et autres publics spécifiques |
100 |
Total |
166,5 |
Source : DGEFP
*
* *
La Commission examine l’amendement AS399 du rapporteur.
M. le rapporteur. Je retire l’amendement AS399 en raison du retrait de l’amendement AS400 à l’article 6.
L’amendement est retiré.
Puis la Commission adopte l’amendement rédactionnel AS489 du rapporteur.
Elle adopte ensuite l’article 15 modifié.
Chapitre Ier
Représentativité patronale
Article 16
(art. L. 2151-1 à L. 2152-5 [nouveaux], L. 2135-6, L. 2261-19, L. 2261-32 du code du travail)
Réforme de la représentativité patronale
Le présent article porte réforme de la représentativité des organisations d’employeurs, et, en conséquence, renforce les règles de transparence financière, crée un droit d’opposition majoritaire à l’extension des accords collectifs, et dote l’administration d’un nouvel outil de restructuration des branches professionnelles.
I. UN CADRE JURIDIQUE DE LA REPRÉSENTATIVITÉ PATRONALE INSATISFAISANT, QUE TOUS LES ACTEURS APPELLENT À RÉFORMER
La réforme de la représentativité patronale constitue une réforme très attendue, au vu des vives critiques dont fait l’objet le cadre juridique actuel, qui apparaît à la fois insatisfaisant et limité.
Le Gouvernement s’est fortement investi pour que cette réforme puisse être accomplie. Il a, ainsi, souhaité ouvrir ce chantier dès la Grande conférence sociale de juillet 2012, en prévoyant, dans la feuille de route, que la question de la représentativité patronale soit abordée dans l’année en cours sur la base de propositions des organisations d’employeurs. Ces dernières ont donc mené une importante concertation, qui a abouti à la signature d’une position commune le 19 juin 2013, définissant les principes devant guider l’édiction d’un nouveau cadre juridique.
Afin de permettre une mise en œuvre rapide de ces principes, il a été décidé, au cours de la Grande conférence sociale de juin 2013, de mandater le directeur général du travail pour conduire une mission devant déboucher sur un dispositif opérationnel. Ce dernier a rendu ses propositions dans un rapport publié en octobre 2013 (79) et qui a contribué à l’élaboration du présent article.
A. DES DISPOSITIONS TRÈS LIMITÉES, QUI NE CORRESPONDENT PAS AUX NOUVEAUX ENJEUX DU DIALOGUE SOCIAL
Les dispositions régissant actuellement l’établissement de la représentativité patronale demeurent très limitées. Qualifiées de « no man’s land », par le directeur général du travail, celles-ci ne correspondent pas aux nouveaux enjeux du dialogue social. Comme l’indique la feuille de route de la Grande Conférence sociale de juin 2013, la construction d’un cadre juridique solide « constitue un chantier important et désormais prioritaire dans l’équilibre général des règles du jeu de la négociation sociale ».
1. Un principe de reconnaissance mutuelle
La représentativité des organisations d’employeurs repose aujourd’hui sur un principe factuel de reconnaissance mutuelle. Ce principe résulte de la lecture a contrario de l’article L. 2121-2 du code du travail, en vertu duquel « s’il y a lieu de déterminer la représentativité […], l’autorité administrative diligente une enquête ». À défaut d’accord entre les différents acteurs, cette reconnaissance mutuelle s’opère donc sous le contrôle de l’administration ou, le cas échéant, du juge, qui peuvent être saisis par des organisations cherchant à prouver leur représentativité ou contestant celle des autres.
• Le contrôle possible de l’administration et du juge
Le ministère du travail peut, ainsi, décider de lancer une enquête administrative de représentativité, pour établir ou refuser celle-ci à une organisation d’employeurs. D’après les informations transmises par le Gouvernement, en moyenne, une dizaine d’enquêtes administratives de représentativité sont menées chaque année. Il faut signaler, toutefois, que ce nombre varie d’une année à l’autre, et qu’il ne couvre pas l’ensemble des demandes formulées, car le ministère n’y donne pas systématiquement suite.
Les acteurs intéressés peuvent également agir en justice, à titre principal devant le juge administratif et de manière incidente devant le juge judiciaire.
Deux catégories de recours sont ouverts devant le juge administratif. Les parties peuvent, tout d’abord, contester une décision de reconnaissance ou de refus de représentativité, suite à une enquête administrative. En pratique, près de la moitié des enquêtes sont suivies d’un recours contentieux. Elles peuvent également agir devant le Conseil d’État, en premier et dernier ressort, dans le cadre des contentieux formés à l’encontre des arrêtés ministériels portant extension d’accords collectifs.
De manière incidente, le juge judiciaire, compétent en matière d’application des accords collectifs, peut avoir à connaître de questions ayant trait à la représentativité d’organisations d’employeurs, à l’occasion de litiges visant à déterminer si un accord collectif s’applique ou non à une entreprise donnée.
Faute de définition spécifique, l’État ou le juge s’appuient alors sur les critères applicables aux syndicats de salariés, tels que le respect des valeurs républicaines, l’ancienneté, l’influence, ou l’implantation territoriale. Ils examinent également la représentativité de l’organisation sur l’ensemble du champ d’application de la convention collective dans laquelle elle souhaite négocier.
• Un encadrement réduit contribuant à la complexité du monde patronal
L’encadrement juridique de la reconnaissance de la représentativité patronale apparaît donc aujourd’hui très réduit : il s’agit le plus souvent d’une reconnaissance de fait, parfois sanctionnée par l’administration ou la jurisprudence, à l’aune des principes applicables aux syndicats de salariés. La composition de la plupart des collèges employeurs, notamment au sein des branches, découle de la mise en œuvre de ce principe factuel de reconnaissance mutuelle, sans que l’on soit en mesure d’affirmer qu’il corresponde au poids exact de chaque organisation.
Celles-ci apparaissent, d’ailleurs, très nombreuses et diverses : en 2013, on en recense près de 1043, qui obéissent pour deux tiers au statut de syndicat professionnel, et pour un tiers au statut d’association. Les taux d’adhésion aux différentes confédérations patronales ne sont pas aujourd’hui précisément connus : le MEDEF compterait quelque 780 000 entreprises adhérentes, la CGPME 550 000 et l’UPA 300 000, sans que ces chiffres n’aient jamais été certifiés. De plus, parmi les entreprises membres d’une organisation, près d’un quart adhère en réalité à plusieurs organisations. Au global, les adhésions multiples concerneraient environ une entreprise sur dix.
Cette situation contribue à accroître la structure déjà très complexe du monde patronal dans lequel coexistent, selon le rapport du directeur général du travail, trois cercles concentriques de représentation :
– le premier cercle comprend le Mouvement des entreprises de France (MEDEF), la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) et l’Union professionnelle artisanale (UPA), qui se sont vues, en pratique, reconnaître la qualité d’organisations légitimes pour négocier au niveau interprofessionnel ;
– le deuxième cercle comprend l’Union nationale des professions libérales (UNAPL), la Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles (FNSEA), l’Union des employeurs de l’économie sociale et solidaire (UDES) et l’Union des fédérations et syndicats nationaux d’employeurs sans but lucratif du secteur sanitaire, médico-social et social (UNIFED), regroupant les organisations communément dénommées « hors champ » ;
– le troisième cercle comprend les organisations de branche.
2. La nécessité de bâtir un cadre juridique solide
Le droit et la pratique des relations collectives ont bénéficié, en France, d’importantes améliorations, avec une revalorisation forte du rôle des partenaires sociaux, jusqu’il y a peu assez restreint dans le modèle social français, du fait de la prééminence de la loi. Ce changement de paradigme rend nécessaire de bâtir un cadre juridique solide pour établir la représentativité, et donc asseoir la légitimité, des acteurs qui portent le dialogue social. Quatre raisons principales justifient l’évolution des règles actuelles de la représentativité patronale.
Il s’agit, tout d’abord, de l’extension du champ de la négociation collective. Les négociations obligatoires d’entreprise et de branche ont, en effet, connu un élargissement constant de leur périmètre. À l’origine, lors de leur institution par la loi « Auroux » du 13 novembre 1982, le champ obligatoire des négociations annuelles d’entreprise était limité aux salaires effectifs et à la durée effective et l’organisation du temps de travail. Il inclut maintenant, entre autres, l’égalité professionnelle entre hommes et femmes, l’emploi des travailleurs handicapés, la prévoyance maladie, la participation, l’intéressement et l’épargne salariale. De plus, dans les entreprises de plus de 300 salariés et les groupes, ont été imposées des obligations triennales de négocier, par exemple sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC). Le champ des négociations obligatoires de branche s’est aussi fortement élargi. Les branches doivent désormais notamment traiter, chaque année, des salaires, tous les trois ans, de l’égalité professionnelle, des conditions de travail, de la formation professionnelle, et, tous les cinq ans, des classifications et de l’épargne salariale.
Afin d’inciter les partenaires sociaux à assumer leur nouveau rôle dans l’élaboration du droit du travail, le législateur a même instauré des pénalités financières contre les entreprises qui ne respectent pas leurs obligations de négociations sur certains thèmes, ce qui marque une nouvelle étape dans le système de relations collectives français.
Il s’agit, ensuite, du rôle accru que jouent les partenaires sociaux dans l’élaboration de la loi. En effet, la loi « Larcher » du 31 janvier 2007 de modernisation du dialogue social leur a conféré un rôle central dans l’élaboration du droit du travail, en imposant leur consultation préalable avant l’adoption de toute réforme d’importance, qui suppose le dépôt d’un projet de loi. Concernant les propositions de loi, le Sénat, en décembre 2009, et l’Assemblée nationale, en février 2010, se sont dotés de protocoles expérimentaux de consultation préalable d’une même nature.
Il s’agit, également, de faire prévaloir un parallélisme des formes parmi les règles de représentativité applicables aux différents acteurs du dialogue social. En effet, la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, a procédé à la réforme de la représentativité des syndicats de salariés, désormais assise sur des critères clairs. En comparaison, le système en vigueur pour les organisations d’employeurs apparaît insatisfaisant et doit être adapté pour renforcer leur légitimité et tenir compte des évolutions de la structure économique de notre société.
Il s’agit, enfin, de stabiliser le cadre juridique applicable, afin de limiter les recours contentieux en la matière, qui peuvent déstabiliser la tenue et le jeu de la négociation collective. Comme l’indique le rapport du directeur général du travail, près d’une enquête administrative de représentativité sur deux donne lieu à une action judiciaire. Cette réforme devrait également permettre de remédier à l’absence de données transparentes et objectives sur le poids des organisations professionnelles.
La réforme de la représentativité patronale semble, par ailleurs, d’autant plus nécessaire que la reconnaissance de la représentativité emporte d’importantes conséquences, que met en lumière le rapport du directeur général du travail : « de la représentativité dépendent en effet, d’une part, la composition du tour de table de la négociation et, d’autre part, la définition du champ de l’accord en négociation qui, sauf élargissement par le ministère du travail, ne peut aller au-delà des activités dont sont représentatives les organisations patronales signataires ».
B. UNE VOLONTÉ PARTAGÉE DE RÉFORME
L’ensemble des acteurs intéressés s’accorde aujourd’hui sur les importantes limites du cadre juridique en vigueur en matière de représentativité, et partage une volonté de réforme, qui s’est traduite, du côté des partenaires sociaux, par la conclusion d’une position commune le 19 juin 2013, et du côté de l’État, par la mission menée puis le rapport déposé en octobre 2013 par le directeur général du travail.
1. La position commune du 19 juin 2013
La position commune, signée par la CGPME, le MEDEF et l’UPA en juin 2013, produit, tout d’abord, une définition de la représentativité, qui constitue « le corollaire de la liberté d’adhésion des entreprises, et s’entend comme la capacité d’une organisation patronale à s’exprimer au nom et à engager des entreprises qui ne sont pas adhérentes à ladite organisation mais qui présentent les mêmes caractéristiques que les adhérents ».
Elle fixe, ensuite, les principes devant présider à la réforme de la représentativité patronale, qui doit établir :
– une représentativité « montante » fondée sur l’adhésion des entreprises aux organisations, soit mettre en place un système dans lequel la représentativité du niveau supérieur (branche, national et interprofessionnel) est déterminée à partir de celle établie au niveau inférieur (entreprises, branches) ;
– un champ de représentativité correspondant aux activités économiques couvertes par les entreprises adhérentes, en particulier une présence à la fois dans les secteurs du commerce, de l’industrie, de la construction et des services pour le niveau national et interprofessionnel ;
– des critères de représentativité communs avec ceux aujourd’hui applicables aux syndicats, tels que l’ancienneté, l’influence, la transparence financière, l’indépendance, le respect des valeurs républicaines, l’implantation géographique et professionnelle, et la mesure de l’audience de l’organisation à partir des adhésions, appréciée en fonction d’une pondération du poids des entreprises adhérentes ;
– une application pragmatique de ces principes pour ne pas déstabiliser la négociation sociale.
S’agissant de la mesure de l’audience, la position commune précise que, s’il est indispensable de prendre en compte le nombre d’entreprises adhérentes par rapport à celles comprises dans le champ d’activités considéré, il demeure que la représentativité se définissant comme la capacité à engager des entreprises non adhérentes, son attribution requiert que l’organisation qui prétend en disposer puisse justifier, au travers de ses adhérents, d’un poids réel, au vu de la finalité des accords collectifs, au sein du champ d’activités dans lequel elle intervient.
2. Le rapport du directeur général du travail d’octobre 2013
Déclinant les principes arrêtés par la position commune, le rapport du directeur général du travail d’octobre 2013 définit, tout d’abord, les objectifs qui doivent guider la réforme de la représentativité :
– légitimer les acteurs patronaux, pour développer un dialogue social de qualité ;
– construire un nouveau système opérationnel, qui ne déstabilise toutefois pas le jeu de la négociation collective en entraînant la disparition massive d’acteurs historiques ;
– retenir un mode d’établissement de la représentativité patronale transparent et objectif, non seulement aux yeux des organisations d’employeurs, mais aussi pour leurs interlocuteurs syndicaux et le grand public ;
– concilier simplicité et fiabilité, par le recours à un tiers, comme un commissaire aux comptes, chargé de vérifier les données fournies par les organisations patronales ;
– faire prévaloir la spécificité, la symétrie et le pragmatisme, en édictant des règles qui obéissent le plus possible à un principe de symétrie avec les règles applicables à la représentativité des syndicats, tout en ménageant des dérogations que justifient les particularités des organisations d’employeurs.
Il formule, ensuite, des propositions concrètes pour rénover les règles de la représentativité patronale.
Il propose, tout d’abord, de créer un tronc commun de critères identiques à ceux de la représentativité syndicale, en reprenant notamment les critères de l’ancienneté, du respect des valeurs républicaines, de l’indépendance, de la transparence financière et de l’influence.
S’agissant de la mesure de l’audience, il préconise de la fonder sur l’adhésion des entreprises, en retenant comme base de calcul l’ensemble des entreprises adhérant, à jour de leur cotisation, à toutes les organisations professionnelles dans un champ considéré, et en rapportant à ce total le nombre d’entreprises adhérant à chacune des organisations professionnelles, avec un seuil de représentativité fixé à 8 %. Afin de traiter le problème des adhésions multiples, il recommande de laisser les organisations de branche décider de la répartition de leurs adhérents entre les confédérations interprofessionnelles, en fonction de critères objectifs comme la taille, les effectifs et l’activité des entreprises adhérentes.
Au final, le rapport du directeur général du travail se prononce donc en faveur de l’institution d’un ensemble de critères de représentativité communs aux organisations syndicales et patronales, à l’exception de celui de l’audience qui connaîtrait des modalités de mesure différentes, que récapitule le tableau ci-dessous.
PRINCIPE DE SYMÉTRIE DES REPRÉSENTATIVITÉS SYNDICALE ET PATRONALE
Niveau d’appréciation |
Représentativité syndicale |
Représentativité patronale |
Branche et interprofession |
Ancienneté minimale de deux ans | |
Respect des valeurs républicaines | ||
Indépendance | ||
Transparence financière | ||
Influence (activité et expérience) | ||
Effectifs d’adhérents et cotisations |
Audience (effectifs d’adhérents et cotisations : seuil de 8 %) | |
Audience (élections) : seuil de 8 % | ||
Branche |
Implantation territoriale équilibrée | |
Interprofession |
Représentativité dans des branches des quatre secteurs | |
Source : Rapport sur la réforme de la représentativité patronale, M. Jean-Denis Combrexelle, Directeur général du travail, octobre 2013.
Il propose, ensuite, de renforcer l’obligation légale de transparence financière par la certification des comptes, actuellement subordonnée au dépassement d’un seuil de ressources, en imposant cette certification à toute organisation d’employeurs, quel que soit le montant de son budget.
Puis il propose d’adapter les règles de validité des accords de branche et interprofessionnels ayant vocation à être étendus, en créant un droit d’opposition majoritaire à l’extension. Ces accords ne pourraient être étendus qu’en l’absence d’opposition de la part d’organisations patronales représentatives, représentant au moins 50 % de l’audience, mesurée sur le fondement des adhésions mais, dans ce cas, pondérée par les effectifs de salariés.
Il propose, enfin, de doter l’administration d’un nouvel outil d’intervention, reposant sur une base législative, pour lui permettre de procéder à la restructuration d’une branche, lorsque la ou les organisation(s) représentative(s) comptabiliseraient moins de 5 % de la totalité des entreprises du secteur. Cette faculté reconnue à l’État devrait s’exercer, de manière transparente, devant la Commission nationale de la négociation collective. La situation de chacune des branches serait ainsi examinée avec des propositions de décisions qui, au-delà du seul refus d’extension d’accords, pourraient préconiser, voire imposer, des regroupements ou fusions de conventions collectives.
II. LES NOUVELLES RÈGLES DE REPRÉSENTATIVITÉ PATRONALE PROPOSÉES
Le I du présent article vise à compléter le livre Ier, consacré aux syndicats professionnels, de la deuxième partie du code du travail, par un nouveau titre V intitulé « Représentativité patronale ». Ce nouveau titre V comporte deux chapitres, dédiés respectivement aux critères de représentativité, pour le chapitre Ier, et aux règles d’établissement de la représentativité pour chaque niveau de négociation, pour le chapitre II.
A. DES CRITÈRES GÉNÉRAUX COMMUNS DE REPRÉSENTATIVITÉ
Le chapitre Ier du nouveau titre V dresse la liste des nouveaux critères de représentativité des organisations d’employeurs, qui sont, pour la plupart, identiques à ceux applicables aux syndicats de salariés. En effet, le nouvel article L. 2151-1 énonce que la représentativité des organisations d’employeurs serait déterminée d’après les six critères cumulatifs suivants :
– le respect des valeurs républicaines ;
– l’indépendance ;
– la transparence financière ;
– une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation, cette ancienneté s’appréciant à compter de la date de dépôt légal des statuts ;
– l’influence, prioritairement caractérisée par l’activité et l’expérience ;
– l’audience, qui s’apprécierait en fonction du nombre d’entreprises adhérentes et par niveau de négociation selon les règles prévues par deux nouveaux articles L. 2152-1 et L. 2152-2 décrits ci-dessous.
Les cinq premiers critères de représentativité seraient donc communs aux organisations syndicales et d’employeurs.
En revanche, le critère relatif à la mesure de l’audience différerait. En effet, pour les syndicats, la mesure de l’audience s’effectue via les résultats obtenus aux élections professionnelles et aux scrutins concernant les entreprises de moins de 11 salariés et les salariés du secteur agricole, qui sont, ensuite, agrégés aux niveaux des branches et national et interprofessionnel. Le système proposé pour les organisations d’employeurs obéit donc à une logique quelque peu distincte, puisqu’il ne comporterait pas d’élection, mais dépendrait du nombre d’entreprises adhérentes. Plusieurs raisons ont justifié d’écarter la solution de l’élection comme modalité de mesure de l’audience des organisations patronales, sur lesquelles revient le rapport du directeur général du travail et qui sont reproduites dans l’encadré ci-dessous.
Les raisons justifiant d’écarter l’élection comme modalité de mesure
de l’audience des organisations patronales
Sur le principe, la solution de la représentativité fondée sur une élection a le mérite de la logique : la symétrie recherchée avec la représentativité syndicale serait intégralement respectée. Elle présenterait aussi pour ses partisans l’avantage de ne pas tenir compte des adhésions et de régler ainsi certaines difficultés propres à ce régime de représentativité (faible nombre des adhésions dans certains secteurs, multi-adhésions).
À la différence de ce que soutiennent parfois des représentants des organisations d’employeurs, l’élection ne peut être écartée d’un revers de main au nom d’une prétendue spécificité de la représentativité patronale par rapport à la représentativité syndicale.
La seule vraie raison qui conduit à écarter cette solution tient à l’objet même d’une réforme de la représentativité. Sans s’aventurer dans une approche par trop sociologique du sujet, le vote du salarié pour l’élection des membres du comité d’entreprise ou des délégués du personnel est un acte individuel, réfléchi, qui témoigne de la confiance qu’a ce salarié dans une organisation syndicale pour le représenter.
Une organisation syndicale a, par nature, vocation à représenter vis-à-vis des employeurs et vis-à-vis des pouvoirs publics l’ensemble des salariés au-delà de ses seuls militants. La réforme résultant de la loi du 20 août 2008 est la transposition de ce principe.
Le vote d’une entreprise ne revêt pas la même signification. Dès que l’entreprise est une personne morale et ne se confond pas avec la personne du chef d’entreprise, la notion de vote et de volonté individuelle perd une partie de sa signification première. Même si, comme on l’a vu, l’adhésion de l’entreprise à une organisation professionnelle est le plus souvent justifiée par des considérations diverses tenant à la fourniture de services ou à la recherche d’informations, elle traduit mieux que le vote la volonté collective de l’entreprise et ce que les organes dirigeants considèrent comme étant « l’intérêt de l’entreprise ».
Sans vouloir cultiver le paradoxe, on pourrait soutenir que la meilleure expression du vote de l’entreprise est encore la cotisation qu’elle verse à l’organisation par laquelle elle veut être représentée.
À la différence d’une organisation syndicale, une organisation professionnelle représente vis-à-vis des syndicats de salariés et des pouvoirs publics les entreprises adhérentes qui l’ont mandatée à cet effet.
Volontairement, nous aurons écarté du débat les risques de poujadisme que présenterait un système fondé sur l’élection qui permettrait l’émergence d’organisations nouvelles instrumentalisant l’élection de représentativité à des fins politiques très éloignées de toute préoccupation tenant à la négociation des accords collectifs et à la représentation dans la sphère sociale des entreprises. Ce risque existe mais il vaut aussi, dans une certaine mesure, pour les organisations syndicales et il n’a pas été jugé déterminant pour écarter l’élection lors du vote de la loi du 20 août 2008.
Source : Rapport sur la réforme de la représentativité patronale, M. Jean-Denis Combrexelle, Directeur général du travail, octobre 2013.
La prise en compte du nombre d’entreprises adhérentes comme base de la mesure de l’audience explique, par ailleurs, que le critère général relatif aux effectifs d’adhérents et aux cotisations, exigé pour les syndicats à l’article L. 2121-1 du code du travail, ne soit pas repris en tant que tel dans la liste des critères généraux communs de représentativité des organisations patronales.
B. DES RÈGLES PROPRES À CHAQUE NIVEAU DE NÉGOCIATION
Les sections 1 et 2 du chapitre II du nouveau titre V fixent, ensuite, les règles d’établissement de la représentativité propres à chaque niveau de négociation, soit au niveau des branches puis au niveau national et interprofessionnel.
1. Au niveau des branches
La section 1 du chapitre II comporte, tout d’abord, un nouvel article unique L. 2152-1, édictant les règles relatives à l’établissement de la représentativité au niveau des branches. Aux termes de cet article, seraient représentatives, dans les branches professionnelles, les organisations d’employeurs :
– qui satisfont à la liste des critères généraux communs de représentativité précédemment décrite ;
– qui disposent d’une implantation territoriale équilibrée au sein de la branche, soit une exigence semblable à celle imposée aux syndicats souhaitant être reconnus représentatifs au niveau des branches ;
– dont les entreprises adhérentes, à jour de leur cotisation, représentent au moins 8 % de l’ensemble des entreprises adhérant à des organisations d’employeurs de la branche satisfaisant aux quatre premiers critères généraux de représentativité (80) et ayant fait la déclaration de candidature prévue au nouvel article L. 2152-3 décrit ci-dessous.
Le nombre d’entreprises adhérentes serait attesté par un commissaire aux comptes, dans des conditions déterminées par voie réglementaire. D’après les informations transmises par le Gouvernement, le décret nécessaire, pris après consultation des instances compétentes, définirait le champ et les modalités de l’intervention du commissaire aux comptes, la procédure à suivre, ainsi que l’articulation de cette nouvelle mission avec les règles applicables à cette profession.
Le choix d’un seuil minimum d’audience de 8 % répond au principe de symétrie recherché entre les dispositions sur la représentativité applicables aux organisations d’employeurs et aux syndicats, puisque, aujourd’hui, la représentativité des syndicats au niveau des branches se trouve subordonnée au recueil de 8 % de l’ensemble des suffrages exprimés aux élections professionnelles et aux scrutins concernant les entreprises de moins de 11 salariés et les salariés du secteur agricole.
La même logique a guidé le choix de retenir une assiette de calcul resserrée et limitée à l’ensemble des entreprises adhérant à des organisations d’employeurs, et non à l’ensemble des entreprises présentes de la branche. En effet, pour les syndicats, l’assiette de calcul de la représentativité se trouve également limitée aux suffrages « exprimés », et ne prend donc pas en compte l’ensemble des salariés.
Par ailleurs, le champ du seuil de 8 % serait calculé sur l’assiette des organisations d’employeurs qui satisfont au socle minimal des quatre premiers critères généraux de représentativité, afin d’écarter les organisations qui n’auraient manifestement pas vocation à être reconnues représentatives, car, par exemple, elles ne respecteraient pas les valeurs républicaines.
2. Au niveau national et interprofessionnel
La section 2 du chapitre II comporte, ensuite, un nouvel article unique L. 2152-2, énonçant les règles de droit commun relatives à la représentativité au niveau national et interprofessionnel, puis traitant le cas des organisations d’employeurs souscrivant des adhésions multiples.
• Les règles de droit commun
Tout d’abord, aux termes de ce nouvel article, seraient représentatives, au niveau national et interprofessionnel, les organisations d’employeurs :
– qui satisfont à la liste des critères généraux communs de représentativité précédemment décrite ;
– dont les organisations adhérentes sont représentatives à la fois dans des branches de l’industrie, de la construction, du commerce et des services, soit une exigence semblable à celle imposée aux syndicats souhaitant être reconnus représentatifs au niveau national et interprofessionnel ;
– dont les organisations adhérentes, à jour de leur cotisation, regroupent au moins 8 % de l’ensemble des entreprises adhérant à des organisations professionnelles d’employeurs ayant fait la déclaration de candidature prévue au nouvel article L. 2152-3 décrit ci-dessous.
À l’instar des règles prévues au niveau des branches, le nombre d’entreprises adhérentes serait attesté par un commissaire aux comptes, dans des conditions déterminées par voie réglementaire. De la même façon, les choix d’un seuil de 8 % et d’une assiette de calcul resserrée obéissent aux mêmes motifs que ceux précédemment exposés.
• Le cas des adhésions multiples
Puis, le nouvel article L. 2152-2 règle le cas des adhésions multiples. Il prévoit, ainsi, que lorsqu’une organisation professionnelle d’employeurs adhère à plusieurs organisations d’employeurs ayant statutairement vocation à être présentes au niveau national et interprofessionnel, elle devrait répartir entre ces organisations, pour permettre la mesure de leurs audiences respectives, ses entreprises adhérentes.
Toutefois, elle ne pourrait affecter à chacune des organisations, une part d’entreprises inférieure à un pourcentage fixé par décret, compris entre 10 % et 20 %.
La fixation d’un pourcentage plancher de répartition a pour objet de tirer les conséquences de la possibilité pour une organisation de branche d’adhérer à plusieurs organisations nationales et interprofessionnelles. En effet, le choix de la multi-adhésion, qui ne constitue jamais une obligation, s’inscrit dans une logique de fourniture de services, et appelle une contrepartie qui se matérialise ici par un pourcentage minimal d’adhérents à attribuer. Cette disposition répond également à un objectif de pluralisme des organisations nationales et interprofessionnelles.
La répartition définitive des entreprises adhérentes devrait figurer sur la déclaration de candidature de l’organisation d’employeurs, exigée dans le cadre de la procédure formelle de reconnaissance de la représentativité patronale, comme expliqué ci-dessous.
3. La périodicité et l’entrée en vigueur de la mesure de l’audience
S’agissant de la périodicité de la mesure de l’audience des organisations d’employeurs au niveau des branches et au niveau national et interprofessionnel, les nouveaux articles L. 2152-1 et L. 2152-2 proposent de retenir un rythme de 4 ans, soit une périodicité identique à celle applicable à la mesure de l’audience des syndicats de salariés.
Le VI du présent article prévoit, ensuite, que la première mesure d’audience, aux deux niveaux de négociation évoqués, serait réalisée à compter de 2017, soit en même temps que la deuxième mesure d’audience des syndicats de salariés.
Selon le Gouvernement, la mise en place d’un dispositif transitoire d’ici 2017 n’apparaît pas nécessaire, puisque, dans l’attente de la mesure de l’audience, le principe de reconnaissance mutuelle continuera de prévaloir, de même que les critères reconnus et appliqués par l’administration et la jurisprudence en cas d’enquête ou de contentieux sur la représentativité.
Par ailleurs, il faut signaler que l’ensemble du processus préparatoire de la première mesure d’audience sera suivi dans le cadre du Haut Conseil du dialogue social.
C. LA PROCÉDURE DE RECONNAISSANCE DE LA REPRÉSENTATIVITÉ PATRONALE
Les sections 3 et 4 du chapitre II du nouveau titre V précisent, enfin, la procédure formelle de reconnaissance de la représentativité des organisations d’employeurs.
1. La déclaration de candidature
La section 3 comporte, tout d’abord, un nouvel article unique L. 2152-3, qui imposerait aux organisations d’employeurs de se déclarer candidates pour voir établie leur représentativité, dans des conditions déterminées par voie réglementaire. Il les contraindrait également à inscrire, dans leur déclaration de candidature, le nombre de leurs entreprises adhérentes et des salariés qu’elles emploient, ainsi que, le cas échéant, la répartition de celles-ci entre plusieurs organisations, en cas d’adhésions multiples – cette dernière prescription résultant de l’article L. 2152-2 comme indiqué précédemment.
D’après les informations transmises par le Gouvernement, les candidatures seraient déposées sur un portail internet conçu à cet effet. Ce portail devrait permettre aux organisations d’indiquer les branches dans lesquelles elles souhaitent voir leur représentativité reconnue – ou, le cas échéant, le niveau national et interprofessionnel, et de transmettre les éléments nécessaires à l’établissement de leur représentativité et de leur poids respectifs, telles que les attestations des commissaires aux comptes. Il devrait également permettre aux organisations de branche d’indiquer la ou les confédérations nationales et interprofessionnelles auxquelles elles adhèrent, ainsi que la répartition retenue entre les différentes confédérations en cas d’adhésions multiples. La sécurité de la procédure de dépôt de ces informations serait assurée par la délivrance de codes d’accès individualisés. L’ensemble des mesures réglementaires nécessaires serait élaboré en concertation avec le Haut Conseil du dialogue social.
2. L’arrêté du ministre chargé du travail
La section 4 comporte, ensuite, deux nouveaux articles L. 2152-4 et L. 2152-5, ce dernier prévoyant que, sauf dispositions contraires, les conditions d’application du chapitre II du nouveau titre V seraient déterminées par décret en Conseil d’État.
Quant au nouvel article L. 2152-4, il attribue au ministre chargé du travail la compétence d’arrêter la liste des organisations d’employeurs reconnues représentatives par branche et au niveau national et interprofessionnel, après avis du Haut Conseil du dialogue social, à l’instar du dispositif aujourd’hui applicable aux syndicats de salariés.
Mais il lui permet également, après avis de la Commission nationale de la négociation collective et du Haut Conseil du dialogue social, de décider de ne pas arrêter cette liste pour une branche dans laquelle moins de 5 % des entreprises adhéreraient à une organisation d’employeurs et dont l’activité conventionnelle présenterait, depuis la dernière mesure d’audience quadriennale, une situation caractérisée par la faiblesse du nombre des accords ou avenants signés et du nombre des thèmes de négociation couverts par ces accords au regard de ses obligations ou facultés de négocier. Il lui offre cette même faculté s’agissant des listes établissant la représentativité des syndicats de salariés par branche, en opérant un renvoi à l’article L. 2122-11.
Les arrêtés et décisions du ministre chargé du travail pourraient être contestés par les organisations d’employeurs devant le juge administratif. À cet égard, afin d’harmoniser les règles du contentieux de la représentativité syndicale et patronale, il conviendrait que le Gouvernement modifie le décret du 5 octobre 2012 (81), pour confier la compétence de ce contentieux à la cour administrative d’appel de Paris, comme c’est le cas aujourd’hui pour les syndicats.
III. LES ÉVOLUTIONS JURIDIQUES INDUITES PAR LA RÉFORME DE LA REPRÉSENTATIVITÉ PATRONALE
Tirant toutes les conséquences induites par la réforme de la représentativité patronale, le présent article propose trois évolutions juridiques : le renforcement des règles de transparence financière applicables aux organisations d’employeurs, la création d’un droit d’opposition à l’extension d’un accord collectif, et celle de nouveaux outils permettant à l’administration de procéder à la restructuration des branches.
A. LE RENFORCEMENT DES RÈGLES DE TRANSPARENCE FINANCIÈRE
Le II du présent article vise, tout d’abord, à renforcer les règles de transparence financière auxquelles sont assujetties les organisations patronales. Il constitue la déclinaison législative d’un des principes arrêtés par la position commune du 19 juin 2013, qui stipule que, parmi les critères de représentativité, doit figurer « la transparence financière assurée par des comptes certifiés annuels établis suivant des modalités fixées par la loi sur la certification et la publication des comptes de ces dernières ».
1. Une obligation actuelle de certification sous condition de ressources
Aujourd’hui, l’ensemble des organisations d’employeurs, qu’elles soient constituées sous le statut de syndicat ou d’association, ainsi que leurs unions sont soumises à plusieurs obligations en matière de transparence financière, instituées par la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail.
Aux termes de l’article L. 2135-1, elles doivent, tout d’abord, établir des comptes annuels selon les normes définies par l’Autorité des normes comptables, qui peuvent prendre une forme simplifiée pour les organisations dont les ressources sont inférieures ou égales à 230 000 euros. Lorsqu’une organisation contrôle une ou plusieurs autres personnes morales, indépendamment de tout lien d’adhésion ou d’affiliation, elle doit alors choisir d’établir des comptes consolidés ou fournir, en annexe à ses propres comptes, ceux de ces personnes morales. Lorsqu’une organisation entretient des liens d’adhésion ou d’affiliation avec d’autres entités, elle peut également opter pour l’établissement de comptes combinés, si les statuts le prévoient. En vertu de l’article L. 2135-4, les comptes doivent être arrêtés par l’organe chargé de la direction et approuvés par l’assemblée générale des adhérents ou par un organe collégial de contrôle désigné par les statuts.
Aux termes de l’article L. 2135-5, elles doivent, ensuite, assurer la publicité de leurs comptes, sous deux modalités distinctes en fonction du montant de leurs ressources :
– si celles-ci atteignent ou dépassent 230 000 euros, les organisations sont tenues de transmettre à la direction de l’information légale et administrative (DILA), dans un délai de trois mois à compter de l’approbation des comptes, le bilan, le compte de résultat, l’annexe ainsi que, le cas échéant, le rapport du commissaire aux comptes, afin que ces documents soient publiés et consultables sur le site Internet de la DILA ;
– en revanche, si celles-ci demeurent inférieures à 230 000 euros, les organisations sont tenues, dans un même délai de trois mois, soit de mener la procédure précédemment décrite, soit de publier leurs comptes sur leur site Internet, soit de les déposer auprès de la DIRECCTE.
Aux termes de l’article L. 2135-6, les organisations doivent, enfin, nommer au moins un commissaire aux comptes et un suppléant, dès lors que le montant de leurs ressources dépasse 230 000 euros.
Si l’obligation d’établir des comptes annuels a été applicable dès l’exercice comptable 2009, les obligations de publicité et de certification sont entrées en vigueur progressivement : à compter de l’exercice comptable 2010, pour les niveaux confédéral et fédéral des organisations, à compter de l’exercice comptable 2011 pour les niveaux régional et départemental, et à compter de l’exercice comptable 2012 pour l’ensemble des organisations.
D’après le rapport du directeur général du travail, près de 605 organisations professionnelles ont déposé leurs comptes sur le site de la DILA, la totalité des confédérations patronales de niveau national et interprofessionnel ayant rempli cette obligation. Au niveau des branches, les vérifications opérées par l’administration ont, en revanche, montré que la mise en œuvre de cette obligation apparaît variable.
2. L’obligation générale de certification proposée
Conformément à la volonté exprimée dans la position commune du 19 juin 2013, le II du présent article a pour but de poursuivre la dynamique engagée en 2008 et de renforcer les obligations de transparence financière pesant sur les organisations d’employeurs.
À cette fin, il propose une nouvelle rédaction de l’article L. 2135-6, dont le premier alinéa prévoit que l’ensemble des organisations d’employeurs, qu’elles soient constituées sous le statut de syndicat ou d’association, ainsi que leurs unions seraient tenues de nommer au moins un commissaire aux comptes et un suppléant, quel que soit le montant de leurs ressources.
Le second alinéa maintiendrait, ensuite, le cadre légal actuel s’agissant des syndicats de salariés, de leurs unions et des associations de salariés : ces derniers demeureraient soumis à l’obligation de certification des comptes uniquement si leurs ressources dépassent le montant de 230 000 euros.
Cette dualité des règles applicables ne pose pas de difficulté selon le rapport du directeur général du travail, qui indique que « contrairement aux plus petites des organisations syndicales, il est permis de penser que les organisations professionnelles de taille très réduite auront la capacité d’absorber la charge financière que représente cette certification a fortiori si celle-ci s’accompagne de la vérification d’informations sur les adhésions », dans le cadre des nouvelles règles de représentativité.
Afin de permettre aux organisations d’employeurs aujourd’hui non soumises à l’obligation de certification de leurs comptes, de prendre les mesures préparatoires nécessaires, le V du présent article prévoit que la nouvelle rédaction de l’article L. 2135-6 n’entrerait en vigueur qu’à compter de l’exercice comptable 2015.
B. LA CRÉATION D’UN DROIT D’OPPOSITION MAJORITAIRE À L’EXTENSION D’UN ACCORD COLLECTIF
La représentativité constitue l’un des piliers du cadre de la négociation collective et, comme l’indique la feuille de route de la Grande conférence sociale de juin 2013, il convient de mesurer l’incidence de sa réforme, pour les organisations d’employeurs, « sur l’appréciation de la validité juridique des accords ».
1. Les liens entre représentativité et validité des accords collectifs
Les règles régissant la représentativité et les accords collectifs sont liées, comme le soulignait la position commune du 9 avril 2008 sur la représentativité syndicale (82), qui a servi de fondement à la loi du 20 août 2008. Le préambule de cette position commune précise, en effet, que c’est bien « pour renforcer la légitimité des accords signés par les organisations syndicales de salariés dans le cadre de l’élargissement du rôle attribué à la négociation collective », que ses signataires « considèrent qu’il est nécessaire d’actualiser les critères de représentativité des organisations syndicales de salariés ».
En conséquence et suivant les recommandations de cette position commune, la loi du 20 août 2008 a établi de nouvelles règles de validité des accords collectifs s’agissant des syndicats de salariés. Désormais, la validité des accords interprofessionnels et de branche se trouve subordonnée à leur signature par un ou plusieurs syndicats représentatifs ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés aux élections prises en compte pour la mesure de l’audience dans le champ d’application de la négociation, et à l’absence d’opposition d’un ou plusieurs syndicats représentatifs ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés à ces mêmes élections.
Pour les organisations d’employeurs, les règles aujourd’hui applicables diffèrent, car la question ne se pose dans les mêmes termes, la signature d’une organisation patronale n’emportant pas les mêmes effets que celle d’une organisation syndicale. En vertu de l’article L. 2231-1, que ce soit au niveau des branches ou national et interprofessionnel, un accord collectif est considéré comme valable s’il est simplement signé par une organisation d’employeurs, sans autre condition particulière de validité à cet égard.
En effet, l’accord signé par une organisation d’employeurs ne s’applique qu’à ses entreprises adhérentes. Il n’apparaît pas, dès lors, nécessaire d’exiger de celle-ci qu’elle soit représentative. C’est pourquoi le code du travail ne subordonne pas la validité d’un accord collectif à une majorité relative d’engagement ou à une absence d’opposition s’agissant des organisations d’employeurs. En revanche, pour les syndicats, la situation est différente car leur signature rend l’accord applicable à l’ensemble des salariés, qu’ils soient syndiqués ou non, ce qui justifie les règles particulières décrites ci-dessus.
2. Les effets de la procédure d’extension
Les termes du débat changent, cependant, en cas d’extension d’un accord collectif. En effet, l’extension d’un accord rend ses dispositions obligatoires pour tous les salariés et employeurs compris dans son champ d’application. Il s’applique donc à l’ensemble des entreprises de la branche, qu’elles soient adhérentes ou non à une organisation patronale, dans le cas d’un accord de branche, et à l’ensemble des entreprises des secteurs d’activité représentés par les organisations d’employeurs signataires, qu’elles soient adhérentes ou non à une organisation patronale, dans le cas d’un accord national et interprofessionnel.
Dès lors, la question de la représentativité des organisations d’employeurs qui ont signé l’accord collectif ayant vocation à être étendu se pose.
En raison de ses effets, l’extension fait aujourd’hui l’objet d’une procédure encadrée par le code du travail et se trouve soumise à plusieurs conditions de fond. Pour pouvoir être étendu, un accord doit :
– avoir été négocié et conclu par une commission paritaire composée de représentants des organisations syndicales et patronales représentatives dans le champ d’application considéré ;
– comporter toutes les clauses obligatoires, de fond et de forme, énumérées par l’article L. 2261-22, s’agissant des accords de branche ;
– couvrir l’ensemble des catégories professionnelles de la branche, s’agissant des accords conclus à ce niveau de négociation.
Concernant la procédure, celle-ci peut être engagée à la demande d’une organisation syndicale ou patronale représentative ou à la demande du ministre chargé du travail, qui décide de l’extension en prenant un arrêté, après avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (CNNC).
Les pouvoirs du ministre chargé du travail sont importants. Il peut, en effet, exclure de l’extension certaines clauses de l’accord, sous réserve d’avoir recueilli l’avis motivé de la CNNC, voire refuser totalement d’étendre l’accord, pour des raisons de légalité ou pour un motif d’intérêt général. Il peut, également, à l’inverse, décider d’étendre un accord collectif qui ne répond pas à toutes les conditions de fond précitées. Dans ce dernier cas, toutefois, il doit avoir obtenu un avis motivé favorable de la CNNC, n’ayant pas fait l’objet d’une opposition écrite et motivée soit de deux organisations d’employeurs, soit de deux organisations de salariés représentées à cette instance.
En cas d’opposition, le ministre chargé du travail peut consulter à nouveau la CNNC, sur la base d’un rapport précisant la portée des dispositions en cause ainsi que les conséquences d’une éventuelle extension. Il peut, ensuite, prononcer l’extension, au vu du nouvel avis émis par cette instance. Sa décision doit être motivée.
L’opposition écrite et motivée de deux organisations d’employeurs ou de deux organisations de salariés représentées à la CNNC ne fait donc pas obstacle à l’extension de l’accord, mais impose seulement au ministre, s’il entend poursuivre la procédure, de consulter à nouveau cette instance et de motiver sa décision.
3. La création d’un droit d’opposition majoritaire à l’extension d’un accord collectif
Avec l’instauration d’un nouveau cadre de représentativité, cette situation n’apparaît plus satisfaisante. C’est pourquoi le III du présent article propose de créer un droit d’opposition majoritaire à l’extension d’un accord collectif.
À cette fin, il complète l’article L. 2261-19 par deux nouveaux alinéas énonçant que, pour pouvoir être étendus, un accord collectif de branche ou interprofessionnel, ses avenants ou annexes, ne devraient pas avoir fait l’objet de l’opposition d’une ou plusieurs organisations d’employeurs reconnues représentatives au niveau considéré, dont les entreprises adhérentes emploient plus de 50 % de l’ensemble des salariés des entreprises adhérant aux organisations d’employeurs reconnues représentatives à ce niveau. Cette opposition devrait être formulée dans les conditions prévues à l’article L. 2231-8, à savoir être exprimée par écrit, motivée, préciser les points de désaccord, et notifiée aux signataires.
Par ailleurs, le nombre de salariés employés par les entreprises adhérentes serait attesté par un commissaire aux comptes, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État. À cet égard, la prise en compte du nombre de salariés dans le nouveau droit d’opposition à l’extension d’un accord collectif doit être rapprochée de la volonté exprimée par les organisations patronales dans la position commune du 19 juin 2013, qui stipule que « la représentativité se définissant comme la capacité à engager des entreprises non adhérentes, son attribution requiert que l’organisation qui prétend en disposer puisse justifier, au travers de ses adhérents, d’un poids réel ».
La création de ce nouveau droit aurait, de plus, l’avantage de rapprocher les dispositions applicables à la procédure d’extension de celles applicables à la procédure d’élargissement (83). En effet, en vertu de l’article L. 2261-17, le ministre chargé du travail ne peut pas prononcer l’élargissement d’un accord collectif en cas d’opposition écrite et motivée de la majorité des membres de la CNNC.
C. DE NOUVEAUX OUTILS DE RESTRUCTURATION DES BRANCHES
Enfin, face au constat persistant d’un éclatement et d’une multiplicité des branches professionnelles, un problème dénoncé depuis de très nombreuses années, le IV du présent article vise à doter le ministre chargé du travail de nouveaux outils lui permettant de procéder à une restructuration efficace de celles-ci, tout en associant les partenaires sociaux.
1. Le paysage éclaté des branches
D’après le rapport du directeur général du travail, près de 460 branches demeurent actives en 2013, hors domaine de la production agricole. Cela dénote donc d’un relatif progrès, par rapport à la situation constatée en 2009 par le rapport de M. Jean-Frédéric Poisson (84). Ce dernier recensait près de 942 branches, dont 255 relevant de la production agricole.
Toutefois, le nombre de branches apparaît encore trop élevé et leurs caractéristiques trop hétérogènes. Le bilan de la négociation collective en 2011 indique ainsi que sur 700 conventions collectives en vigueur : la moitié a un champ d’application seulement régional ou local ; plus de 60 % des conventions couvrent moins de 5 000 salariés ; plus de 70 % ont été conclues plus de vingt ans auparavant. De plus, l’activité conventionnelle varie fortement selon les branches : si pour 51,2 % des conventions un texte a été produit moins d’un an auparavant, pour 38,5 % d’entre elles le dernier texte date de plus de cinq ans.
Ces difficultés subsistent toujours puisque le rapport du directeur général du travail observe que « à l’exception de quelques dizaines de grandes branches, les autres se caractérisent souvent, côté patronal, par une faiblesse du nombre d’adhérents et des moyens humains et matériels mobilisés pour la négociation collective ».
C’est pourquoi, au cours de la Grande conférence sociale de juin 2013, il a été décidé de mettre en place un comité de suivi de la structuration conventionnelle des branches, sous l’égide de la Commission nationale de la négociation collective (CNNC). Sur le fondement d’un diagnostic partagé, ce comité aura pour mission d’examiner la situation des branches ne présentant plus d’activité conventionnelle depuis plusieurs années, et d’encourager des regroupements de branches ou l’expérimentation de démarches pérennes de négociations interbranches.
2. Des instruments de régulation faibles
La mise en place de ce comité demeure, toutefois, subordonnée à la création de nouveaux instruments de régulation à la disposition de l’administration pour procéder à une réelle restructuration des branches. En effet, ceux dont elle dispose aujourd’hui restent faibles au regard de la nécessité d’une réduction significative du nombre de branches et d’une revitalisation du dialogue social à ce niveau, étant rappelé que les objectifs fixés dans le rapport du directeur général du travail sont de l’ordre de 250 branches d’ici cinq ans, et 100 d’ici dix ans.
Le principal instrument de régulation que peut utiliser l’administration réside dans le pouvoir de refuser l’extension d’un accord collectif pour un motif d’intérêt général. Elle peut s’en prévaloir quand les caractéristiques de la branche ne permettent pas le développement d’une activité conventionnelle réelle et durable, à l’instar des « micro-branches », comme l’a illustré la décision de refus d’extension de la convention collective nationale des agences de recherche privées, en raison du faible nombre de salariés concernés.
Elle peut user, par ailleurs, de persuasion et de pédagogie auprès des partenaires sociaux, notamment au travers de la présidence de commissions mixtes paritaires. À titre d’exemple, l’opération de restructuration la plus notable menée jusqu’ici a été le regroupement des branches professionnelles dans le secteur du spectacle, qui a permis de réduire leur nombre de 40 à 8 entre 2006 et 2013. Cette opération a pu aboutir grâce à une volonté politique forte et une très grande mobilisation de l’administration.
3. De nouveaux outils de restructuration des branches
Face à cette situation, le IV du présent article vise à octroyer à l’administration de nouvelles prérogatives lui permettant d’impulser plus efficacement la restructuration des branches, en concertation avec les partenaires sociaux.
À cette fin, il crée une nouvelle section 8, intitulée « Restructuration des branches professionnelles », au chapitre Ier, consacré aux conditions d’applicabilité des accords collectifs, du titre VI du livre II de la deuxième partie du code du travail. Cette section comporte un nouvel article unique L. 2261-32, qui propose la mise en place de trois outils en faveur de l’administration, dont le dernier alinéa prévoit que leurs modalités d’application seraient déterminées par décret en Conseil d’État.
• Le prononcé d’une mesure d’élargissement
Le premier alinéa du nouvel article unique L. 2261-32 autorise le ministre chargé du travail à élargir à une branche, la convention collective déjà étendue d’une autre branche présentant des conditions sociales et économiques analogues, lorsque :
– moins de 5 % des entreprises de cette branche adhéreraient à une organisation professionnelle représentative des employeurs ;
– son activité conventionnelle présenterait, sur les cinq années précédentes, une situation caractérisée par la faiblesse du nombre des accords ou avenants signés et du nombre des thèmes de négociation couverts par ces accords au regard de ses obligations et de sa faculté de négocier.
La mesure d’élargissement ne pourrait être prononcée qu’après avis de la Commission nationale de la négociation collective (CNNC) et sous réserve que la majorité de ses membres n’aura pas émis une opposition écrite et motivée. Une fois pris l’arrêté d’élargissement, le ministre chargé du travail pourrait rendre obligatoires les avenants ou annexes ultérieurs eux-mêmes déjà étendus.
• La fusion des champs d’application
Dans le même cas d’espèce, le deuxième alinéa du nouvel article unique L. 2261-32 permet, ensuite, au ministre chargé du travail, après avis de la CNNC, de notifier aux organisations professionnelles d’employeurs et de salariés représentatives, le constat de la situation de la branche et les informer de son intention de fusionner le champ de la convention collective concernée avec celui d’une autre branche présentant des conditions économiques et sociales analogues, dans l’hypothèse où cette situation subsisterait à l’expiration d’un délai qu’il fixerait et qui ne saurait être inférieur à un an.
À l’expiration de ce délai, le ministre pourrait prononcer la fusion des champs, après avis de la CNNC et sauf opposition écrite et motivée de la majorité de ses membres. Dans ce cas, il inviterait les partenaires sociaux de la branche concernée à négocier.
• Le refus d’extension
Le troisième alinéa du nouvel article unique L. 2261-32 autorise, enfin, le ministre chargé du travail à refuser d’étendre une convention collective, ses avenants ou ses annexes, après avis de la CNNC, dans les branches où moins de 5 % des entreprises de la branche adhéreraient à une organisation professionnelle représentative des employeurs et dont les caractéristiques, eu égard notamment à leur taille limitée et à la faiblesse du nombre des entreprises, des effectifs salariés et des ressources disponibles pour la conduite de la négociation, ne permettraient pas le développement d’une activité conventionnelle régulière et durable en rapport avec la vocation des branches professionnelles et respectant les obligations de négocier qui leur sont assignées.
*
* *
Lors de son examen du projet de loi, votre commission a adopté les principales modifications suivantes au texte de l’article 16.
À l’initiative du rapporteur, elle a, tout d’abord, adopté un amendement précisant que les missions d’attestation prévues dans le projet de loi et confiées aux commissaires aux comptes, peuvent être réalisées par les commissaires aux comptes actuels des organisations d’employeurs. Cette possibilité permet de réduire le coût de l’attestation pour l’organisation concernée, de favoriser la rapidité du travail du commissaire aux comptes, et de sortir du champ de l’application de l’article L. 822-11 du code du commerce qui subordonne la réalisation, par le commissaire aux comptes d’une entité, de missions distinctes de celle de contrôle légal des comptes à l’élaboration d’une norme d’exercice professionnelle.
Puis, à l’initiative du rapporteur, votre commission a adopté un amendement visant à prendre en compte, pour la mesure de l’audience, les adhésions directes d’entreprises à des organisations d’employeurs de niveau national et interprofessionnel, sans la médiation d’une organisation de niveau intermédiaire, de branche ou territoriale.
Elle a, ensuite, adopté un amendement du rapporteur harmonisant les critères retenus pour la mesure de l’audience au niveau national et interprofessionnel, avec ceux applicables au niveau de la branche. Il s’agit, en effet, d’en écarter, aux deux niveaux de négociation, les organisations d’employeurs qui ne respecteraient pas un socle minimal de quatre critères, à savoir : le respect des valeurs républicaines, l’indépendance, la transparence financière et l’ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation concerné.
Puis, elle a adopté un amendement de précision du rapporteur visant à lever toute ambiguïté sur les éléments que les organisations de branche doivent fournir pour la prise en compte, le cas échéant, de leur adhésion à plusieurs confédérations nationales et interprofessionnelles. En effet, pour la mesure de l’audience, seul le nombre d’entreprises adhérentes compte, et doit être réparti entre les confédérations, sans aucune pondération par les effectifs de salariés que celles-ci emploient.
À cet égard, à l’initiative du groupe UDI, votre commission a adopté un amendement garantissant l’information des entreprises concernées, sur la répartition finale décidée par l’organisation d’employeurs.
S’agissant du nouveau droit d’opposition majoritaire à l’extension d’un accord collectif, votre commission a, ensuite, adopté un amendement du rapporteur prévoyant que la clé de répartition du nombre de salariés employés par les entreprises adhérentes des organisations de branche doit être la même que celle fixée pour la répartition des entreprises adhérentes dans le cadre de la procédure de mesure de l’audience pour la représentativité au niveau national et interprofessionnel. Le code du travail imposerait ainsi une méthode de calcul unique dans ces deux cas distincts, afin de simplifier les nouvelles obligations auxquelles sont soumises les organisations d’employeurs.
*
* *
La Commission adopte l’amendement rédactionnel AS346 du rapporteur.
Elle examine ensuite l’amendement AS123 de M. Francis Vercamer.
M. Francis Vercamer. Depuis plusieurs années, je milite pour une réforme de la représentativité patronale, sur le modèle de la réforme de la représentativité des salariés. Si le projet de loi vise à assurer la représentativité des organisations d’employeurs, le critère de l’adhésion semble trop réducteur. Calcule-t-on la représentativité d’un parti politique en fonction du nombre de ses militants ou de celui de ses électeurs ? Sans adhérer à l’une des organisations patronales, des entreprises peuvent avoir la volonté d’exprimer une proximité avec l’une d’entre elles. Il faut, de plus, prendre en compte les multi-adhésions, c’est-à-dire les cas dans lesquels une organisation d’employeurs présente au niveau d’une branche professionnelle adhère à plusieurs organisations présentes au niveau national et interprofessionnel. Comme on ne saurait calculer la représentativité des organisations d’employeurs en fonction du nombre d’entreprises adhérentes, l’amendement AS123 vise à fonder cette représentativité sur une élection nationale sur sigle.
M. le rapporteur. Vous n’apportez aucune précision sur les modalités d’organisation de cette élection, qui demeure une promesse non tenue de l’ancienne majorité en raison des difficultés liées à sa mise en œuvre.
Je tiens par ailleurs à souligner que les syndicats d’employeurs sont arrivés à une position commune sur le principe de l’adhésion. De plus, le rapport sur la réforme de la représentativité patronale que le directeur général du travail, M. Jean-Denis Combrexelle, a remis au ministre du travail fait la même proposition. Je ne saurais donc être favorable à un amendement qui contredit le dispositif retenu.
M. Francis Vercamer. Un autre défaut de ce dispositif est d’exclure les organismes appartenant au « hors champ », à savoir les entreprises qui ne sont pas adhérentes des structures existantes. C’est une grave erreur de figer la représentativité actuelle.
M. Denys Robiliard. La représentativité patronale n’a rien à voir avec la représentativité salariale, laquelle est calculée sur la base de salariés égaux entre eux – un homme, une voix – et non sur celle d’entreprises inégales entre elles – le garage Renault ne saurait avoir le même poids que les usines Renault. En cas d’élection, du fait du caractère composite de la représentativité patronale – elle est calculée à la fois en fonction du nombre d’entreprises et du nombre de salariés employés –, le poids des grandes entreprises sera écrasant. Il existe de plus différents types d’organisations répondant aux différents types d’entreprises. Le MEDEF est lui-même très composite. Les trois organisations patronales interprofessionnelles permettent de représenter l’ensemble des entreprises, notamment les PME.
S’agissant des organisations appartenant au « hors champ », la question se pose en effet de la représentation des organisations de l’économie sociale et solidaire, des exploitants agricoles et des professions libérales, sans oublier les particuliers.
Il n’existe pas de bon système. Celui qui est proposé dans le texte a le mérite d’être accepté par l’ensemble des organisations patronales, même s’il est très critiqué par les organisations salariales, qui sont favorables à l’élection.
M. Francis Vercamer. Je tiens à rappeler que les membres des chambres consulaires sont élus : la répartition des sièges entre catégories et sous-catégories professionnelles tient compte notamment du nombre de salariés employés. Il serait possible d’adapter ce dispositif électoral aux organisations patronales.
M. le rapporteur. Telle n’est pas l’option retenue par les organisations patronales et reprise par le Gouvernement.
La Commission rejette l’amendement.
Puis elle adopte l’amendement rédactionnel AS344 du rapporteur.
Elle examine ensuite l’amendement AS191 de M. Gérard Cherpion.
M. Gérard Cherpion. Le critère d’accès aux négociations posé par le présent article au niveau de la branche est uniquement fondé sur le nombre d’entreprises adhérentes, sans lien avec le nombre de salariés employés par les entreprises concernées. De grandes entreprises pourraient ainsi être interdites d’accès aux négociations de branche. C’est pourquoi l’amendement AS191 propose de pondérer le critère du nombre d’entreprises par celui du nombre de salariés.
M. le rapporteur. Je rappelle les deux étages du dispositif : si le critère d’accès aux négociations est fondé uniquement sur le nombre d’entreprises adhérentes, en revanche, pour s’opposer à un accord collectif, ce premier critère est pondéré par les effectifs des salariés des entreprises adhérant aux organisations. Ce système équilibré a été élaboré en concertation avec les organisations patronales. Je suis donc défavorable à cet amendement.
La Commission rejette l’amendement.
Puis, suivant l’avis défavorable du rapporteur, elle rejette l’amendement AS192 de M. Gérard Cherpion.
Elle examine ensuite l’amendement AS347 du rapporteur.
M. le rapporteur. L’amendement AS347 vise à lever une ambiguïté en précisant que les missions d’attestation prévues dans le projet de loi et confiées aux commissaires aux comptes peuvent être réalisées par les commissaires aux comptes des organisations professionnelles d’employeurs.
La Commission adopte l’amendement.
L’amendement AS322 de M. Denys Robiliard est retiré.
La Commission examine l’amendement AS350 du rapporteur.
M. le rapporteur. Les entreprises peuvent adhérer directement à des organisations d’employeurs de niveau national et interprofessionnel, sans la médiation d’une organisation de niveau intermédiaire, de branche ou territoriale. Il serait donc cohérent de prendre en compte ces adhésions directes pour le calcul de l’audience des organisations d’employeurs qui prétendent à la représentativité au niveau national et interprofessionnel.
La Commission adopte l’amendement.
Puis, suivant l’avis défavorable du rapporteur, elle rejette l’amendement AS193 de M. Gérard Cherpion.
Elle examine ensuite l’amendement AS349 du rapporteur.
M. le rapporteur. Cet amendement vise à harmoniser les critères pris en compte pour la mesure de l’audience au niveau national et interprofessionnel avec ceux applicables au niveau de la branche. Comme pour la branche, il permet d’écarter du champ de mesure retenu les organisations d’employeurs qui ne respecteraient pas un socle minimal de quatre critères : le respect des valeurs républicaines, l’indépendance, la transparence financière et l’ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation concerné.
La Commission adopte l’amendement.
Elle adopte ensuite l’amendement rédactionnel AS351 du rapporteur.
Puis, suivant l’avis défavorable du rapporteur, elle rejette l’amendement AS194 de M. Gérard Cherpion.
Elle adopte ensuite l’amendement AS352 du rapporteur.
Elle examine ensuite, en discussion commune, les amendements AS354 du rapporteur et AS177 de M. Dominique Tian.
M. le rapporteur. L’amendement AS354 vise à lever toute ambiguïté sur les éléments que les organisations d’employeurs de branche doivent fournir pour la prise en compte, le cas échéant, du fait qu’elles adhèrent à plusieurs confédérations nationales et interprofessionnelles.
Pour la mesure de l’audience, seul le nombre d’entreprises adhérentes se trouve pris en compte et doit être réparti entre les confédérations interprofessionnelles. C’est ce que le présent amendement vise à clarifier.
Le nombre de salariés employés par les entreprises adhérentes demeure, en revanche, utile pour l’appréciation du droit d’opposition majoritaire à l’extension, et a donc vocation à être réintroduit au III de l’article 16.
La Commission adopte l’amendement AS354.
En conséquence, l’amendement AS177 tombe.
La Commission examine l’amendement AS124 de M. Francis Vercamer.
M. Francis Vercamer. Lorsqu’une organisation professionnelle d’employeurs adhérant à plusieurs organisations d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel répartit les entreprises adhérentes entre ces organisations, il est indispensable que les entreprises en question soient informées de l’organisation à laquelle elles sont rattachées et confirment ce rattachement. C’est en effet aux entreprises qu’il revient de choisir en fonction de leur affinité.
M. le rapporteur. Le principe d’un socle minimum a été retenu : une organisation professionnelle ne peut affecter à chacune de ces organisations une part d’entreprises et de salariés inférieure à un pourcentage fixé par décret.
M. Vercamer prend systématiquement le contre-pied du dispositif retenu.
Avis défavorable.
M. Francis Vercamer. L’audience mesurée au moyen des élections me paraît le critère de représentativité le plus juste. Dès lors que l’on a choisi d’apprécier l’audience en fonction du nombre d’entreprises adhérentes, la moindre des choses serait de demander aux entreprises à quelle organisation de niveau national et interprofessionnel elles souhaitent être rattachées, plutôt que de laisser les organisations d’employeurs auxquelles elles adhèrent le décider à leur place.
La Commission rejette l’amendement.
Puis elle adopte l’amendement de cohérence AS355 du rapporteur.
Elle en vient à l’amendement AS125 de M. Francis Vercamer.
M. Arnaud Richard. Il est indispensable que les entreprises soient informées de l’organisation de niveau national et interprofessionnel à laquelle elles sont rattachées.
Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement.
Puis elle examine, en discussion commune, les amendements AS127 de M. Francis Vercamer et AS317 de M. Christophe Cavard.
M. Christophe Cavard. Cet amendement vise à instaurer un dispositif permettant d’établir la représentativité des organisations d’employeurs des secteurs « hors champ », qui devraient pouvoir bénéficier elles aussi des moyens de financement prévus au titre II du projet de loi.
M. le rapporteur. Nous devons attendre de connaître le contenu de l’accord qui a été trouvé.
La Commission rejette successivement les amendements AS127 et AS317.
Puis elle adopte l’amendement rédactionnel AS356 du rapporteur.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur, elle rejette l’amendement AS334 de M. Christophe Cavard.
Elle est ensuite saisie de l’amendement AS358 du rapporteur.
M. le rapporteur. Le pouvoir accordé au ministre de ne pas arrêter la liste des organisations d’employeurs et des syndicats de salariés reconnus représentatifs dans une branche lorsque celle-ci est caractérisée par une activité conventionnelle particulièrement faible doit être inscrit non pas dans l’une des sections relatives à la représentative patronale, mais dans celle qui porte sur la restructuration des branches professionnelles.
La Commission adopte l’amendement.
Elle en vient à l’amendement AS178 de M. Dominique Tian.
M. Lionel Tardy. L’article 16 définit les nouvelles règles applicables en matière de représentativité des organisations d’employeurs, en particulier au niveau national et interprofessionnel. Afin que le nouveau dispositif législatif produise tous ses effets, il serait logique que la répartition des mandats entre les organisations d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel soit établie en fonction du critère d’audience.
M. le rapporteur. Quant à la forme, votre amendement est mal positionné : il insérerait cette nouvelle disposition parmi celles qui sont relatives à l’extension des accords collectifs.
Quant au fond, la répartition des mandats est liée à l’organisation interne de chaque instance et n’a pas vocation à être établie selon une clé de répartition unique fixée par la loi. En outre, votre amendement ne concerne que les organisations patronales, alors que la question se pose aussi pour les syndicats de salariés. Avis défavorable.
La Commission rejette l’amendement.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur, elle rejette l’amendement AS335 de M. Christophe Cavard.
Puis elle examine l’amendement AS359 du rapporteur.
M. le rapporteur. Cet amendement vise à lever toute ambiguïté sur les éléments que les organisations d’employeurs de branche doivent fournir lorsqu’elles adhèrent à plusieurs organisations de niveau national et interprofessionnel. Il précise que le nombre de salariés est pris en compte pour le calcul du poids des signataires en vue de l’extension des accords collectifs. La répartition du nombre de salariés entre organisations de niveau national et interprofessionnel se fera selon les mêmes pourcentages que celle du nombre d’entreprises adhérentes pour l’établissement de la représentativité. En termes de procédure, les organisations d’employeurs devront transmettre ces éléments à l’administration au moment où elles se déclarent candidates pour être reconnues représentatives.
M. Denys Robiliard. Les organisations d’employeurs qui adhèrent à plusieurs organisations de niveau national et interprofessionnel devront répartir de la même manière le nombre d’entreprises adhérentes et le nombre de salariés entre ces organisations. Ainsi, une organisation d’employeurs qui attribue 30 % de ses entreprises adhérentes au MEDEF devra lui attribuer également 30 % des salariés. Il n’aurait pas été sain de permettre une distorsion entre les deux répartitions.
La Commission adopte l’amendement.
Puis elle est saisie de l’amendement AS361 du rapporteur.
M. le rapporteur. Cet amendement vise à préciser que le commissaire aux comptes chargé d’attester le nombre de salariés peut être celui d’une organisation d’employeurs.
La Commission adopte l’amendement.
Puis elle adopte successivement les amendements rédactionnels AS362 et AS364 du rapporteur.
Elle en vient à l’amendement AS323 de M. Denys Robiliard.
M. Denys Robiliard. Il s’agit de préciser que l’avis contraire dont il est question est non pas celui de la majorité des membres de la Commission nationale de la négociation collective, mais celui de la Commission elle-même adopté à la majorité de ses membres.
Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement.
Puis elle adopte successivement l’amendement rédactionnel AS363, l’amendement de précision AS365, les amendements rédactionnels AS366 à AS369, tous du rapporteur.
Elle examine ensuite l’amendement AS164 de M. Hervé Morin.
M. Francis Vercamer. Le nombre de branches professionnelles est très élevé, mais toutes ne se signalent pas par un dialogue social dynamique. Selon les chiffres communiqués par le ministre du travail lui-même lors de son audition, seules 200 branches professionnelles sur 700 fonctionneraient réellement. Certaines couvrent un champ d’activité réduit et n’ont pas les moyens d’organiser un dialogue social de qualité. Avec ce projet de loi, le Gouvernement se donne les moyens de réduire le nombre de branches professionnelles. Cependant, nous souhaitons qu’il précise les objectifs, le calendrier et les critères qu’il se fixe en la matière. À cette fin, nous demandons qu’il remette un rapport au Parlement sur le sujet.
M. le rapporteur. La stratégie du Gouvernement me semble assez claire : je vous renvoie au rapport du directeur général du travail, M. Combrexelle, sur la réforme de la représentativité patronale. En outre, le dépôt d’un rapport spécifique n’apparaît pas nécessaire : les informations relatives au processus de regroupement des branches figureront au bilan annuel de la négociation collective. Avis défavorable.
La Commission rejette l’amendement.
Puis elle adopte l’article 16 modifié.
Chapitre II
Représentativité syndicale
Article 17
(art. L. 2122-3-1 [nouveau], L. 2122-10-6, L. 2143-3, L. 2143-11, L. 2312-5, L. 2314-1, L. 2314-3, L. 2314-3-1, L. 2314-10, L. 2314-11, L. 2314-12, L. 2314-13, L. 2314-20, L. 2314-22, L. 2314-23, L. 2314-31, L. 2322-5, L. 2324-1, L. 2324-2, L. 2324-4, L. 2324-4-1, L. 2324-7, L. 2324-12, L. 2324813, L. 2324-18, L. 2324-20, L. 2324-21 et L. 2327-7 du code du travail)
Représentativité syndicale
Le présent article procède à une série d’ajustements, proposés dans le cadre du premier bilan de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale, qui a profondément transformé les fondements de la représentativité syndicale et a ainsi contribué à renforcer sensiblement la légitimité des organisations syndicales.
La quasi-totalité des mesures proposées par le présent article font l’objet d’un consensus large parmi les partenaires sociaux au sein du Haut conseil du dialogue social (HCDS), à qui la loi de 2008 a confié la mission de dresser un bilan de cette réforme mais aussi de proposer des pistes en vue de son amélioration.
C’est chose faite dans le cadre du présent article.
A. LA LOI DE 2008 COMPLÉTÉE PAR LA LOI DE 2010 : UN NOUVEAU FONDEMENT POUR LA REPRÉSENTATIVITÉ SYNDICALE
La loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail a jeté les nouvelles bases de la représentativité syndicale. À une présomption irréfragable de représentativité, elle a substitué une représentativité reposant sur des critères fiables et objectifs, à travers une audience syndicale mesurée régulièrement.
La loi de 2008 a substitué au principe d’une représentativité « descendante » – présomption de représentativité « historique » des cinq grandes confédérations syndicales (CFDT, CGT, CGT-FO, CFTC, CFE-CGC) - celui d’une représentativité « ascendante » qui fonde désormais la représentativité à tous les niveaux – celui de l’entreprise, de la branche et au niveau interprofessionnel -, sur l’audience électorale.
Au niveau de l’entreprise, l’article L. 2122-1 prévoit que sont représentatives les organisations syndicales satisfaisant aux critères de représentativité par ailleurs énoncés à l’article L. 2121-1 (respect des valeurs républicaines, indépendance, transparence financière, ancienneté minimale de deux ans, influence, et effectifs d’adhérents et cotisations) et ayant recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles, quel que soit le nombre de votants.
Au niveau de la branche, l’article L. 2122-5 prévoit que sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères de représentativité prévus à l’article L. 2121-1, qui disposent d’une implantation territoriale équilibrée au sein de la branche, et ont recueilli au moins 8 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles organisées dans les entreprises relevant de la branche, ces résultats étant comptabilisés au niveau de la branche.
Au niveau interprofessionnel, enfin, l’article L. 2122-8 prévoit que sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont bien aux critères de l’article L. 2121-1, sont représentatives à la fois dans des branches de l’industrie, de la construction, du commerce et des services, et ont recueilli au moins 8 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles, additionnés au niveau national.
La mesure de l’audience à tous les niveaux intervient tous les quatre ans.
Le dispositif de représentativité mis en place par la loi de 2008 ne concerne que les entreprises soumises à l’obligation d’organiser des élections pour la mise en place des instances représentatives du personnel (IRP) : c’est pourquoi, lors de l’adoption de la loi de 2008, il était prévu qu’une loi interviendrait à l’issue d’une négociation interprofessionnelle relative au renforcement de la représentation collective du personnel dans les petites entreprises dépourvues de telles instances, et afin d’envisager les moyens de mesurer l’audience des organisations syndicales dans les branches dans lesquelles plus de la moitié des salariés sont employés dans des entreprises où, en raison de leur taille, ne sont pas organisées d’élections professionnelles. Ces entreprises regroupent en effet autour de 4 millions de salariés ; il ne paraissait donc pas envisageable de les exclure du droit à participer au recueil de l’audience syndicale.
La négociation interprofessionnelle relative aux TPE devait aboutir au plus tard au 30 juin 2009. Son échec a conduit à la reprise de l’initiative législative, qui a débouché sur l’adoption de la loi n° 2010-1215 du 15 octobre 2010, qui institue un scrutin au niveau régional, organisé tous les quatre ans afin de mesurer l’audience des organisations syndicales dans les entreprises de moins de onze salariés, autrement dit, les très petites entreprises (TPE). Les premières élections professionnelles des TPE ont été organisées en 2012 : les résultats de ce scrutin ont été pris en compte pour la première mesure de l’audience syndicale au niveau national et interprofessionnel et au niveau des branches, intervenue au courant de l’année 2013.
La représentativité syndicale repose donc bien sur un système désormais « ascendant », tout dépendant in fine des suffrages recueillis par les organisations syndicales aux élections professionnelles au sein des entreprises. La première conséquence de cette réforme au niveau de l’entreprise réside dans la désormais double fonction des élections professionnelles à ce niveau. Il ne s’agit plus en effet seulement pour les salariés de désigner des représentants du personnel capables de représenter leurs intérêts vis-à-vis de l’employeur, mais aussi de participer à la mesure de l’audience syndicale.
B. LE PREMIER BILAN DE LA LOI DE 2008
L’article 16 de la loi de 2008 a prévu qu’avant le 31 décembre 2013, le Gouvernement présente, après avis de la Commission nationale de la négociation collective, un rapport au Parlement dressant un bilan de la réforme initiée en matière de représentativité syndicale. Parallèlement, le Haut Conseil du dialogue social était chargé de tirer les enseignements de l’application de cette loi.
Annoncé par le Premier ministre dans le cadre de la Grande conférence sociale des 20 et 21 juin 2013, ce travail de bilan doit permettre « d’élaborer des propositions d’amélioration du dispositif ».
Les travaux du Haut conseil du dialogue social se sont déroulés à l’automne 2013. Ils ont porté sur trois volets :
– le bilan de la réforme aux niveaux national, interprofessionnel et de la branche, en particulier, sur la mise en œuvre du système de mesure de l’audience de la représentativité syndicale, connu sous le nom de « MARS » ;
– le bilan du scrutin organisé en direction des salariés des TPE ;
– et enfin, le bilan de la réforme de la représentativité dans les entreprises.
Les mesures incluses dans le présent article sont issues de ce travail de bilan, en particulier de son troisième axe de réflexion. Comme le précise l’étude d’impact, il s’agit essentiellement de dispositions d’ajustement, qui viennent d’une part tenir compte des décisions jurisprudentielles intervenues au cours du premier cycle de la mesure de l’audience syndicale, et, d’autre part, intégrer les propositions consensuelles sur lesquelles les partenaires sociaux se sont exprimés dans le cadre du Haut conseil du dialogue social.
Seules des mesures d’ordre plus structurel, en particulier pour le scrutin organisé dans les TPE, ne figurent pas dans le présent projet, dans la mesure où un travail de concertation complémentaire doit encore être mené sur ce plan.
II. LES AJUSTEMENTS PROPOSÉS DANS LE CADRE DU PRÉSENT ARTICLE
Le présent article apporte une série d’ajustements à la réforme de la représentativité syndicale opérée par la loi de 2008, essentiellement au niveau de l’entreprise. Il convient d’emblée de souligner qu’aucune remise en cause de l’équilibre général de cette réforme n’est envisagée. Les modifications proposées peuvent être regroupées au sein de trois catégories, qui constituent les trois axes d’ajustements suivants :
– la sécurisation du processus électoral dans les entreprises ;
– l’approfondissement du renforcement de la légitimité des organisations syndicales ;
– et enfin, le renforcement de l’action syndicale, par le biais de la clarification du périmètre de désignation des délégués syndicaux.
A. LA SÉCURISATION DU PROCESSUS ÉLECTORAL DANS LES ENTREPRISES
Il s’agit principalement de :
– permettre aux organisations syndicales présentes dans l’entreprise de mieux s’organiser et anticiper les élections professionnelles, une telle préparation étant d’autant plus légitime que ces élections fondent désormais l’audience syndicale ;
– sécuriser les mandats en cours et le processus électoral lorsque l’administration est appelée à arbitrer les désaccords au sein de l’entreprise ;
– harmoniser et clarifier les règles de validité du protocole d’accord préélectoral.
1. Une meilleure anticipation des élections des institutions représentatives du personnel par les organisations syndicales
En principe, tous les quatre ans, – sauf fixation, par accord, d’une durée inférieure, comprise entre deux et quatre ans, aux termes de l’article L. 2314-27 -, l’employeur doit prendre l’initiative d’engager le processus électoral de désignation des représentants du personnel. Celui-ci est également engagé en cas de franchissement des seuils de mise en place des instances représentatives du personnel, par exemple l’élection de délégués du personnel si l’entreprise franchit le seuil des onze salariés ou encore l’élection du comité d’entreprise si l’entreprise franchit le seuil des cinquante salariés.
L’employeur doit prévenir les salariés de l’organisation des élections par voie d’affichage, en précisant la date envisagée pour la tenue du premier tour, celui-ci ne pouvant avoir lieu plus de quarante-cinq jours après le jour de l’affichage : ces dispositions sont prévues à l’article L. 2314-2 pour l’élection des délégués du personnel et à l’article L. 2324-3 pour les élections au comité d’entreprise.
L’employeur invite par ailleurs les organisations syndicales à négocier un protocole d’accord préélectoral : les syndicats qualifiés sont prévenus par voie d’affichage, les syndicats représentatifs sont quant à eux prévenus par courrier.
Le protocole d’accord préélectoral doit permettre de fixer d’un commun accord la répartition du personnel et des sièges dans les collèges électoraux, ainsi que les modalités pratiques du scrutin (vote électronique ou par courrier, date limite de présentation des candidatures, heure et lieu du scrutin).
● S’agissant des élections des délégués du personnel dans les entreprises d’au moins onze salariés (ou sur la base d’un accord dans les moins de onze), c’est l’article L. 2314-3 qui fixe les modalités de l’invitation des organisations syndicales à négocier le protocole d’accord préélectoral.
Aucun délai n’est expressément prévu à ce jour entre la date de l’invitation à négocier et la date de la tenue de la première réunion de négociation.
En cas de renouvellement de l’instance, le troisième alinéa de l’article L. 2314-3 dans sa rédaction actuelle prévoit que « cette invitation est effectuée un mois avant l’expiration du mandat des délégués en exercice », sans toutefois fixer de délai entre la date à laquelle l’invitation à négocier le protocole préélectoral est formulée et la date de la première réunion de négociation dudit protocole, étant entendu que le premier tour des élections a lieu dans la quinzaine précédant l’expiration du mandat.
Autrement dit, dans le cas d’un renouvellement des délégués du personnel, les délais sont aujourd’hui extrêmement serrés, la négociation du protocole d’accord préélectoral pouvant être réduit à moins de quinze jours.
Par un arrêt en date du 25 janvier 2012, la chambre sociale de la Cour de cassation a confirmé la souplesse de la jurisprudence relative à la date d’envoi par l’employeur aux syndicats intéressés de l’invitation à négocier ce protocole d’accord préélectoral. En effet, la Cour refuse de juger que la méconnaissance du délai d’un mois entre l’invitation à négocier et l’expiration du mandat des délégués en exercice comme une cause d’annulation du protocole préélectoral. S’agissant du délai entre l’invitation à négocier et la première réunion de négociation, la Cour se contente de préciser que l’invitation doit être effectuée en temps utile, afin de permettre aux représentants syndicaux de disposer d’un délai raisonnable pour préparer la négociation : en l’espèce, le délai de deux jours est considéré comme raisonnable.
Par cette jurisprudence, la Cour de cassation affaiblit notoirement la portée du délai fixé par la loi.
Afin de permettre une meilleure anticipation par les représentants syndicaux des échéances électorales et de la préparation des élections, le 1° du I du présent article prévoit que l’invitation à négocier le protocole d’accord doit être adressée au plus tard quinze jours avant la date de la première réunion de négociation ; dans le cas du renouvellement de l’institution, le 2° du I dispose que cette invitation doit avoir été adressée quarante-cinq jours avant l’expiration du mandat des délégués en exercice, et non plus un mois comme c’est pour l’heure le cas. En effet, avec l’introduction du délai de quinze jours entre la convocation et la première réunion de négociation, le maintien à trente jours du délai global d’invitation aurait eu pour effet de réduire à seulement quinze jours le délai même de négociation du protocole et d’organisation concrète des élections, en raison de la règle selon laquelle le premier tour du scrutin doit se tenir dans la quinzaine précédant l’expiration des mandats.
L’instauration d’un délai de quinze jours entre l’invitation à négocier et la date de la première réunion de négociation préélectorale devrait permettre au juge d’asseoir son appréciation sur un élément objectif supplémentaire pour s’assurer de l’effet utile des invitations à négocier de l’employeur et de la régularité du processus préélectoral.
● Les 1° et 2° du II du présent article procèdent respectivement aux mêmes modifications que les 1° et 2° du I s’agissant des élections au comité d’entreprise, pour lesquelles les modalités de l’invitation à négocier le protocole d’accord préélectoral sont prévues par l’article L. 2324-4, en fixant à quinze jours le délai entre l’invitation à négocier et la date de la première réunion, et à quarante-cinq jours le délai entre l’invitation à négocier et l’expiration du mandat des membres en exercice du comité d’entreprise.
L’introduction de ces délais a globalement pour objectif de limiter au maximum les cas de carence constatée des organisations syndicales, phénomène qui a pu être mis en évidence depuis l’entrée en vigueur de la loi de 2008, et qui tient vraisemblablement surtout à l’insuffisance du délai imparti aux organisations pour réagir et préparer les échéances électorales dans l’entreprise.
2. Une sécurisation du mandat des élus dans l’ensemble des cas où il est fait recours à un arbitrage par l’autorité administrative
Le processus électoral dans l’entreprise fait l’objet d’un protocole préélectoral, signé par l’employeur et les organisations syndicales, et qui est précisément destiné à en fixer les modalités. Ce protocole préélectoral est d’une importance capitale pour les élections des représentants du personnel, dans la mesure où il scelle l’accord entre l’employeur et les syndicats intéressés sur :
– le nombre et la composition des collèges électoraux pour les élections des délégués du personnel et des membres du comité d’entreprise ;
– la répartition du personnel dans les collèges électoraux et celle des sièges entre les différentes catégories de personnel ;
– les modalités d’organisation et de déroulement des opérations électorales ;
– le cas échéant, le découpage de l’entreprise en établissements distincts, ainsi que la répartition des sièges du comité central d’entreprise entre les établissements et les catégories de personnel ;
– le cas échéant, la composition et le périmètre de l’unité économique et sociale (UES).
Si un tel accord préélectoral est conclu, sa validité est subordonnée à une condition de double majorité, prévue aux articles L. 2314-3-1 pour les élections des délégués du personnel et L. 2324-4-1 pour les élections au comité d’entreprise: l’accord doit d’abord être signé par la majorité des syndicats intéressés ayant participé à sa négociation ; en outre, parmi ces signataires, il doit y avoir les syndicats représentatifs ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ou, lorsque ces résultats ne sont pas disponibles, la majorité des syndicats représentatifs dans l’entreprise.
En cas de désaccord, l’autorité administrative, en l’espèce le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte), peut être saisi pour procéder à un arbitrage.
Le cas de l’élection de délégués de site constitue une situation particulière, dans laquelle l’administration peut intervenir en amont, soit sur auto-saisine, soit sur saisine des organisations syndicales. L’autorité administrative est également susceptible d’intervenir en aval, à défaut d’accord conclu pour organiser les conditions des élections de ces délégués de site, pour fixer elle-même les modalités relatives aux collèges électoraux et aux sièges à pourvoir.
Les dispositions des III à VIII du présent article visent à clarifier le rôle et les compétences de l’autorité administrative lorsqu’elle est appelée à arbitrer les désaccords au sein de l’entreprise, relatifs aux conditions d’organisation des élections des représentants du personnel ; elles ont également pour objectif de préciser les conséquences de l’intervention de l’administration sur les mandats en cours.
Il s’agit d’une part, de préciser le cadre et les conséquences de l’intervention de l’autorité administrative conformément aux clarifications intervenues par voie jurisprudentielle, et d’autre part, de clarifier les conditions dans lesquelles l’autorité administrative est appelée à trancher.
Dans un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 26 septembre 2012, le juge a apporté deux précisions concernant les conditions d’intervention de l’autorité administrative appelée à arbitrer en cas d’échec de la négociation relative au protocole d’accord préélectoral. La Cour de cassation a posé comme principe que, dès lors que l’autorité administrative était valablement saisie d’une demande d’arbitrage, cette saisine avait une double conséquence :
– en premier lieu, elle a pour effet de suspendre le processus électoral jusqu’au rendu de la décision du Direccte, les élections ne pouvant être organisées que conformément à cette décision ;
– en second lieu, elle emporte la prorogation de plein droit du mandat en cours des élus, jusqu’à l’organisation régulière du scrutin et la proclamation des résultats du premier tour de celui-ci.
Cet arrêt « AVIS » a ainsi pour objectif de conférer au pouvoir de décision de l’administration sa pleine étendue, tout en ne faisant pas courir le risque de laisser les entreprises sans aucune représentation élue du personnel durant la période transitoire pendant laquelle l’administration serait en cours d’examen de la situation.
Par ailleurs, le texte propose de limiter le recours à l’administration au seul cas de réel désaccord entre l’employeur et les organisations syndicales. En effet, dans le droit actuel, pour l’ensemble des conditions devant être prévues dans le cadre du protocole d’accord préélectoral et pour lequel, en l’absence d’accord, il est prévu un recours à l’arbitrage par l’autorité administrative, ce recours a lieu quelle que soit la raison de l’absence d’accord, qu’il s’agisse du silence gardé par les organisations syndicales, d’une défaillance de l’employeur dans l’organisation des réunions de négociation, ou d’un échec de la négociation elle-même.
La jurisprudence considère en effet, conformément aux dispositions juridiques actuelles, que c’est l’absence d’accord, quelle qu’en soit la raison, qui conduit l’employeur à devoir saisir la Direccte, et à ne pas organiser les élections en l’absence d’accord préélectoral.
Ainsi, dans un arrêt rendu le 8 novembre 2006, la chambre sociale de la Cour de cassation a jugé qu’à défaut de réponse des organisations syndicales concernées à l’invitation à négocier adressée par l’employeur, ce dernier devait saisir l’inspection du travail (à cette date, compétente en la matière), l’absence de sa saisine conduisant à invalider les élections organisées. Dans un arrêt rendu le 9 novembre 2011, la chambre sociale de la Cour de cassation a, de même, jugé que la défaillance de l’employeur dans l’organisation des réunions de négociation d’un protocole préélectoral et l’absence de saisine de l’autorité administrative en l’absence de la conclusion d’un tel protocole d’accord, était un motif d’invalidité des élections.
Or, comme le précise l’étude d’impact, « le recours à l’administration doit s’analyser comme une demande d’arbitrage entre des positions opposées (…). En cas de carence des organisations syndicales, il n’y a, faute de partenaires, pas de négociation. Il ne peut donc y avoir de constat de désaccord. Il n’y a en conséquence pas lieu à arbitrage, et donc à compétence de l’autorité administrative ». Le texte propose donc de préciser que pour l’ensemble des points pour lesquels un recours à l’arbitrage administratif est prévu, la saisine de l’administration est subordonnée à l’absence d’accord obtenu malgré la réponse adressée par au moins une organisation syndicale à l’invitation à négocier de l’employeur.
Dans la mesure où l’organisation des élections relève de l’entière responsabilité de l’employeur, l’autorité administrative n’a vocation à intervenir, par principe, que de manière limitée et subsidiaire. Dès lors, en cas de carence des organisations syndicales, qu’elle résulte de leur absence de l’entreprise ou d’un désintérêt de leur part, il appartiendra à l’employeur de procéder seul à la répartition du personnel et des sièges ou, en l’occurrence, à la fixation des établissements distincts.
a. L’intervention de l’administration en matière de collèges électoraux
• Pour les élections des délégués du personnel
L’article L. 2314-11 prévoit, s’agissant des élections des délégués du personnel, qu’à défaut d’accord préélectoral portant sur la répartition du personnel dans les collèges électoraux et la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel, la Direccte tranche cette répartition conformément aux règles retenues pour le nombre et la composition des collèges électoraux par convention ou accord (article L. 2314-10), si une telle convention ou un tel accord existe, soit, le cas échéant, conformément aux règles du droit commun prévues à l’article L. 2314-8, c’est-à-dire sur la base de deux collèges : celui des ouvriers et employés d’une part, celui des ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés d’autre part.
Le 1° du IV du présent article propose de préciser les conditions d’une telle absence d’accord préélectoral : il ne suffira plus désormais simplement de constater l’absence d’un tel accord, mais qu’au moins une organisation syndicale ait répondu à l’invitation à négocier de l’employeur.
Dans le droit existant, quelle que soit la raison de cette absence d’accord, l’autorité administrative doit être saisie par l’employeur, qu’il s’agisse d’un défaut de réponse des syndicats à l’invitation de négocier, d’une défaillance de l’employeur dans l’organisation des réunions de négociation, ou encore, d’un pur et simple échec de la négociation menée. La nouvelle condition posée par le présent article conduira à ne saisir l’autorité administrative que dès lors qu’au moins une organisation syndicale aura répondu à l’invitation à négocier, mais que la négociation aura échoué. Autrement dit, en cas de silence gardé par les organisations syndicales, il n’y a pas à proprement parler de compétence de l’autorité administrative pour trancher un désaccord.
Afin de sécuriser les mandats en cours, le 2° du IV propose de préciser que la saisine de l’administration pour fixer les conditions des élections des délégués du personnel suspend le processus électoral et entraîne la prorogation des mandats des élus en cours jusqu’à la proclamation des résultats du scrutin, conformément à la jurisprudence déjà citée de la Cour de cassation du 26 septembre 2012.
• Pour les élections des membres du comité d’entreprise
Les 1° et 2° du VII du présent article procèdent respectivement aux mêmes modifications que les 1° et 2° du IV, s’agissant de l’arbitrage, par l’administration, des règles de répartition du personnel dans les collèges électoraux et de répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel, en l’absence d’accord préélectoral conclu en la matière.
L’article L. 2324-13 prévoit en effet qu’un accord répondant à la condition de la double majorité procède à la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et à la répartition du personnel dans les collèges électoraux. Le recours à l’autorité administrative en l’absence d’accord fait donc l’objet du même encadrement (condition d’une réponse d’au moins une organisation syndicale à l’invitation de négocier un accord préélectoral ; prorogation des mandats en cours jusqu’à la décision administrative).
b. L’arbitrage de l’administration s’agissant de la reconnaissance d’un établissement distinct
L’élection des délégués du personnel a lieu au niveau de l’entreprise composée d’un seul établissement et au niveau de chaque établissement si l’entreprise en comporte plusieurs. De la même manière, lorsqu’une entreprise est composée de plusieurs établissements qui dépassent le seuil de cinquante salariés, un comité d’établissement doit être créé dans chacun d’entre eux, tandis qu’un comité central d’entreprise (CCE) est constitué au niveau de l’entreprise elle-même (article L. 2327-1)
La jurisprudence définit l’établissement distinct permettant l’élection des délégués du personnel comme le regroupement d’au moins onze salariés constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des réclamations communes et spécifiques, et travaillant sous la direction d’un représentant de l’employeur.
Au sein d’une entreprise, le caractère d’établissement distinct et la détermination de leur nombre fait en principe l’objet d’un accord collectif, qu’il soit ou non intégré au protocole d’accord préélectoral, mais qui doit en tout état de cause répondre aux mêmes conditions de majorité (double majorité).
• Intervention de l’administration dans le cas des élections des délégués du personnel
S’agissant des élections des délégués du personnel, aux termes de l’article L. 2314-31, à défaut d’un tel accord, le caractère d’établissement distinct est reconnu par l’autorité administrative, en l’occurrence la Direccte.
Le 1° du V du présent article propose également de subordonner le recours à l’arbitrage de l’autorité administrative pour la détermination de la caractéristique d’établissement distinct à la condition qu’au moins une organisation syndicale ait répondu à l’invitation de négocier, cette négociation ayant échoué.
Le 2° du V du présent article précise que la saisine de l’autorité administrative suspend le processus électoral jusqu’à la décision administrative et entraîne la prorogation des mandats des élus en cours jusqu’à la proclamation des résultats du scrutin. Il s’agit bien là de reprendre les exigences déjà évoquées et posées par la jurisprudence en la matière (Cass, soc, 26 septembre 2012).
Le second alinéa de l’article L. 2314-31 traite de la perte de la qualité d’établissement distinct : « reconnue par décision administrative », celle-ci emporte la cessation des fonctions des délégués du personnel, sauf si un accord contraire, conclu entre l’employeur et les organisations syndicales intéressées, sous la condition de la double majorité déjà évoquée, permet aux délégués du personnel d’achever leur mandat. Cette rédaction laisse entendre que la perte de la qualité d’établissement distinct ne peut résulter que d’une décision administrative : or, tel n’est pas le cas. Dès lors que l’autorité administrative est incompétente en cas de carence des organisations syndicales, la perte de la qualité d’établissement distinct ou la fixation des établissements distincts peuvent résulter d’une décision unilatérale de l’employeur : c’est pourquoi il n’est plus nécessaire de restreindre les conséquences de ces décisions au seul cas de l’intervention de l’administration. Le 3° du V du présent article supprime en conséquence la mention de cette reconnaissance de la perte de la caractéristique d’établissement distinct par décision administrative.
• Intervention de l’administration dans le cas des élections des membres du comité d’établissement
Le VI du présent article s’applique aux élections du comité d’établissement : il procède aux trois mêmes modifications que celles opérées supra, s’agissant de la reconnaissance de l’établissement distinct pour l’élection des délégués du personnel.
• Intervention de l’administration dans le cas des élections des membres du comité central d’entreprise (CCE)
Le VIII du présent article traite des conditions d’intervention de l’administration dans le cas d’une absence d’accord entre l’employeur et les organisations syndicales relativement aux conditions d’organisation des élections au comité central d’entreprise (CCE). L’article L. 2327-7 prévoit que dans les entreprises constituées d’établissements distincts dépassant le seuil de cinquante salariés, pour l’élection du CCE, le nombre d’établissements distincts et la répartition des sièges entre les différents établissements et les différentes catégories font l’objet d’un accord conclu sous la condition de la double majorité. Lorsque cet accord ne peut être obtenu, il incombe à l’autorité administrative de fixer le nombre d’établissements distincts et la répartition des sièges. L’encadrement du recours à l’autorité administrative est calqué sur les conditions prévues par le V pour les élections des délégués du personnel comme par le VI pour les élections au comité d’établissement.
Le texte prévoit également aujourd’hui que la décision administrative est immédiatement exécutoire, sans attendre l’expiration des mandats en cours et sans qu’il y ait lieu d’attendre la date normale de renouvellement de toutes les délégations des comités d’établissement ou de certaines d’entre elles. Cela laisse supposer que seule une décision administrative peut intervenir pour fixer le nombre d’établissements distincts et la répartition des sièges entre eux : or, tel n’est plus le cas, on l’a vu, dès lors qu’en cas de carence des organisations syndicales, la décision est prise unilatéralement par l’employeur. Il est donc indispensable de préciser ce point : c’est ce qu’opère le troisième alinéa du 2° du VIII.
c. Le cas particulier de l’intervention de l’autorité administrative pour l’élection de délégués de site
Aux termes de l’article L. 2312-5, lorsque plusieurs établissements de moins de onze salariés appartiennent à des entreprises différentes mais exercent leur activité sur un même site où sont employés durablement au moins cinquante salariés, l’administration peut décider l’institution de délégués de site, dès lors que la nature et l’importance des problèmes communs aux entreprises du site le justifient.
L’administration impose alors une élection soit de sa propre initiative, soit à la demande des syndicats de salariés.
Les conditions des élections sont définies par accord préélectoral entre l’autorité gestionnaire du site en question ou le représentant des employeurs concernés et les syndicats de salariés, dans le respect des dispositions de l’article L. 2314-3-1, autrement dit, sous la condition d’une double majorité en nombre et en voix (majorité des organisations syndicales ayant participé à la négociation, dont les organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ou, lorsque ces résultats ne sont pas disponibles, majorité des organisations représentatives dans l’entreprise).
À défaut d’accord, il incombe à l’autorité administrative de fixer le nombre et la composition des collèges électoraux ainsi que le nombre de sièges et leur répartition entre les collèges selon les règles habituelles.
Le III du présent article prévoit que dès lors que l’autorité administrative est saisie, que ce soit par les organisations syndicales de salariés ou sur auto-saisine, le processus électoral est suspendu jusqu’à la décision administrative de fixation des règles relatives aux élections. Le mandat des élus en cours est prolongé jusqu’à la proclamation des résultats du nouveau scrutin. Ce cas de figure ne recouvre donc que celui des renouvellements de mandats, et non des créations de délégués de site.
La mise en place de délégués de site est, d’après les informations recueillies par votre rapporteur, une pratique très rare, ne dépassant vraisemblablement pas une dizaine par an. Les saisines de l’administration dans ce domaine restent extrêmement peu fréquentes.
3. Une harmonisation et une clarification des règles de validité des différentes clauses du protocole préélectoral
Rappelons qu’aux termes de l’article L. 2314-3-1 pour les élections des délégués du personnel et de l’article L. 2324-4-1 pour les élections du comité d’entreprise, la validité d’un protocole d’accord préélectoral est soumise à une condition de double majorité, de nombre et de voix :
– il doit être signé, d’une part, par la majorité des syndicats intéressés ayant participé à la négociation ;
– il doit, d’autre part, parmi ces signataires, y avoir les syndicats représentatifs ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ou, lorsque ces résultats ne sont pas disponibles, la majorité des syndicats représentatifs dans l’entreprise.
Dans un arrêt rendu le 6 octobre 2011, la chambre sociale de la Cour de cassation a jugé que cette condition s’applique à l’ensemble des clauses du protocole, sauf disposition légale différente.
Ainsi, par exemple, s’agissant du nombre et de la composition des collèges électoraux, les articles L. 2314-8 et L. 2314-9 pour les délégués du personnel, l’article L. 2324-11 pour le comité d’entreprise, fixent le nombre et la composition des collèges électoraux. La modification de ces règles ne peut intervenir, en vertu de l’article L. 2314-10 pour les délégués du personnel et de l’article L. 2324-12 pour le comité d’entreprise, que par accord signé à l’unanimité des organisations syndicales représentatives existant dans l’entreprise.
Afin de tenir compte de cette jurisprudence, le IX propose de préciser, pour les élections des délégués du personnel, à l’article L. 2314-3-1, comme du comité d’entreprise, à l’article L. 2324-4-1, que la validité du protocole d’accord est soumise à la condition de cette double majorité, « sauf dispositions législatives spéciales ».
C’est en particulier le cas s’agissant, on l’a vu, du nombre et de la composition des collèges électoraux qui ne peuvent être modifiés que par un accord signé par l’ensemble des organisations syndicales représentatives existant dans l’entreprise. C’est le cas également pour déroger, par accord collectif, aux conditions légales applicables à l’électorat ou à l’éligibilité dans le cas des élections des délégués du personnel, sous condition que celles-ci soient plus favorables au salarié : l’accord ainsi prévu par l’article L. 2312-6 pour déroger, de manière plus favorable, aux clauses de désignation et aux attributions des délégués du personnel, est un accord collectif simple. C’est le cas aussi pour déroger à la règle de l’organisation de l’élection des représentants du personnel hors du temps de travail pour laquelle l’unanimité est requise.
Le 2° du IX du présent article précise que la condition de double majorité trouve à s’appliquer, « sauf dispositions législatives spéciales », à l’ensemble des clauses du protocole d’accord préélectoral, qu’il s’agisse des élections des délégués du personnel ou des élections du comité d’entreprise.
Les X et XI du présent article procèdent également par voie de conséquence à une harmonisation des règles applicables à l’ensemble des points négociés dans le cadre du protocole d’accord préélectoral, en précisant que la validité de l’accord conclu sur chacun d’entre eux est soumise à la condition de la double majorité, en nombre et en voix, conformément aux précisions apportées par la jurisprudence. Cette condition de double majorité est donc rappelée :
– s’agissant des élections des délégués du personnel, concernant les dispositions prises par accord pour faciliter, s’il y a lieu, la représentation des salariés travaillant en équipes successives ou dans des conditions qui les isolent des autres salariés (article L. 2314-12). Autrement dit, ces dispositions devront désormais explicitement être prises par un accord signé sous condition de double majorité ;
– s’agissant des élections des délégués du personnel ainsi que des élections au comité d’entreprise, pour proposer, dans les entreprises de travail temporaire, une répartition des sièges destinée à assurer une représentation équitable du personnel permanent et du personnel temporaire (respectivement articles L. 2314-13 et L. 2324-7) ;
– enfin, pour arrêter les modalités d’organisation et de déroulement des opérations électorales (respectivement articles L. 2314-23 et L. 2324-21).
Pour l’ensemble de ces dispositions, la double majorité est désormais explicitement requise dans le cadre d’un accord collectif réglant ces questions.
Le XII du présent article concerne le nombre des délégués du personnel : à cet égard, l’article L. 2314-1 dispose que ce nombre est déterminé compte tenu du nombre de salariés, les articles R. 2314-1 à R. 2314-3 aménageant ces règles.
La jurisprudence reconnaît toutefois la possibilité, par voie conventionnelle, d’augmenter le nombre des délégués du personnel : le juge a, dans un premier temps, reconnu cette possibilité, à condition que le protocole d’accord préélectoral qui le prévoit soit signé par l’ensemble des organisations syndicales. C’est ce qui ressort de l’arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 19 juin 1987. Dans un second temps, le juge a considéré que l’augmentation du nombre des délégués du personnel peut être prévue par un accord préélectoral valable pour l’élection qu’il organise : or, ce protocole d’accord doit bien répondre à la condition de la double majorité.
Le texte prévoit donc, conformément à cette avancée de jurisprudence, qu’une telle modification peut intervenir par voie conventionnelle, mais sous la condition applicable à la conclusion de tout protocole d’accord préélectoral, autrement dit, sous condition d’une double majorité, en voix et en nombre, sans pour autant exiger l’unanimité des organisations syndicales présentes à la négociation.
Cette précision conduit à aligner le régime applicable à l’augmentation du nombre des délégués du personnel sur la procédure applicable en cas d’augmentation du nombre des membres du comité d’entreprise, qui est déjà soumise à la condition prévue pour la conclusion du protocole d’accord préélectoral, autrement dit à la condition de la double majorité.
On notera en revanche que toute diminution du nombre réglementaire des délégués du personnel est interdite, que ce soit par accord collectif, par décision unilatérale de l’employeur ou encore par usage. Ce point a été constamment réaffirmé par la jurisprudence.
Le XIII traite précisément du nombre des membres du comité d’entreprise, prévu à l’article L. 2324-1.
Le comité d’entreprise comprend obligatoirement l’employeur et une délégation du personnel dont le nombre des membres est prévu à l’article R. 2324-1.
Le troisième alinéa de l’article L. 2324-1 précise que le nombre des membres de la délégation du personnel du comité d’entreprise peut être augmenté par convention ou accord entre l’employeur et les organisations syndicales intéressées, conformément à la règle de la double majorité prévue à l’article L. 2324-4-1.
Le texte prévoit, dans le cas du comité d’entreprise, de supprimer la référence à la notion de convention pour procéder à l’augmentation du nombre des membres du comité : cela est vraisemblablement lié au souci d’établir un lien solide entre cette possibilité et le fait qu’elle doive être prévue obligatoirement dans le cadre du protocole d’accord préélectoral soumis à la règle de la double majorité, et non dans le cadre d’une convention collective séparée qui pourrait être adoptée à la majorité simple.
Le XIV du présent article procède à la même suppression à plusieurs occurrences du code du travail, relatives à des modifications pouvant être apportées, par un accord conclu à l’unanimité, à certaines règles relatives aux élections des délégués du personnel et du comité d’entreprise.
Il s’agit d’une part de la possibilité de modifier le nombre et la composition des collèges électoraux. Cette possibilité, prévue à l’article L. 2314-10 pour les élections des délégués du personnel, et à l’article L. 2324-12 pour les élections du comité d’entreprise, est soumise à la conclusion d’une convention, d’un accord collectif ou d’un accord préélectoral qui doit être signé par toutes les organisations syndicales représentatives existant dans l’entreprise.
Il s’agit d’autre part des conditions de tenue de l’élection des représentants du personnel : l’élection a normalement lieu pendant le temps de travail, mais un accord contraire peut être conclu entre l’employeur et l’ensemble des organisations syndicales représentatives existant dans l’entreprise, notamment en cas de travail continu. Cette règle est prévue, s’agissant des délégués du personnel, par l’article L. 2314-22, et s’agissant du comité d’entreprise, par l’article L. 2324-20.
Pour chacune de ces dispositions où l’unanimité est requise, le XIV supprime le renvoi à la notion d’organisations syndicales « existant » dans l’entreprise : en effet, cette notion introduit une confusion, laissant entendre qu’une organisation syndicale représentative dans la branche ou au niveau interprofessionnel, présente dans l’entreprise mais sans y être représentative, pourrait bloquer la conclusion d’un accord modifiant le nombre et la composition des collèges électoraux ou le moment de la tenue de l’élection, pendant ou hors de la durée du temps de travail.
Tel n’est évidemment pas l’esprit de cette règle, qui ne doit logiquement concerner que les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise : la confusion en est ainsi levée. En effet, antérieurement à la loi du 20 août 2008, la représentativité des organisations syndicales s’articulait de manière descendante à partir de la présomption irréfragable de représentativité dont bénéficiaient les cinq grandes confédérations. La représentativité se mesurant désormais à partir des seuls résultats aux élections professionnelles, il paraît indispensable de tenir compte de cette évolution : cette précision permet en effet de lever l’ambiguïté quant à des organisations représentatives dans les branches qui, sans être représentatives dans l’entreprise, y seraient néanmoins présentes.
Pour les mêmes raisons, le XV précise qu’il est bien question des organisations syndicales représentatives « dans l’entreprise » (et non dans la branche ou au niveau interprofessionnel, par exemple) dans le cadre de la procédure qui permet à l’inspecteur du travail d’autoriser des dérogations aux conditions d’ancienneté pour élargir l’électorat ou l’éligibilité aux fonctions de délégué du personnel (article L. 2314-20) ou de membre du comité d’entreprise (article L. 2324-18).
Les conditions relatives à l’ancienneté pour l’électorat et l’éligibilité aux élections des instances représentatives du personnel
S’agissant de l’électorat, les articles L. 2314-15 et L. 2324-14 disposent, respectivement pour les élections des délégué du personnel et du comité d’entreprise, que sont électeurs les salariés âgés d’au moins seize ans, ayant une ancienneté d’au moins trois mois dans l’entreprise, et n’ayant fait l’objet d’aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs droits civiques.
S’agissant de l’éligibilité, les articles L. 2314-16 pour les délégués du personnel et L. 2324-15 pour le comité d’entreprise, disposent que sont éligibles les électeurs âgés d’au moins dix-huit ans, ayant une ancienneté d’au moins un an dans l’entreprise, à l’exception des personnes ayant un lien familial avec l’employeur. Les salariés à temps partiel qui travaillent simultanément dans plusieurs entreprises ne sont éligibles que dans l’une de ces entreprises : ils choisissent celle dans laquelle ils souhaitent faire acte de candidature.
Les articles L. 2314-20 et L. 2324-18 prévoient la possibilité pour l’inspecteur du travail, après consultation des organisations syndicales représentatives, d’autoriser des dérogations pour être électeur, notamment si les conditions applicables conduisent à réduire des deux tiers l’effectif salarié constituant l’électorat, ainsi que des dérogations s’agissant de l’éligibilité, si l’application des conditions de droit commun ne permettait pas l’organisation normale des opérations électorales.
Le XV du présent article a simplement pour objectif de préciser que l’inspecteur du travail consulte bien les organisations syndicales représentatives « dans l’entreprise », et non celles qui sont représentatives à un autre niveau, que ce soit celui de l’établissement, de la branche ou même au niveau interprofessionnel.
B. LE RENFORCEMENT DE LA LÉGITIMITÉ DES ORGANISATIONS SYNDICALES PAR UNE MEILLEURE PRISE EN COMPTE DE L’AUDIENCE ÉLECTORALE AU NIVEAU DE L’ENTREPRISE
Comme l’indique l’étude d’impact associée au présent projet de loi, « la réforme de la représentativité syndicale a conféré une double finalité aux élections professionnelles, puisque celles-ci visent désormais à la fois à élire des représentants au sein des institutions représentatives du personnel et », chose nouvelle, « à participer à la mesure de l’audience syndicale dans l’entreprise, mais aussi au niveau des branches et au niveau national et interprofessionnel ».
Afin que le recueil de l’audience syndicale en soit parfaitement légitimé, il est indispensable de s’assurer que les règles d’affiliation des organisations syndicales présentes dans l’établissement ou l’entreprise soient bien claires, afin de permettre à la fois, sur le terrain, une connaissance exacte par le salarié de l’affiliation de l’organisation syndicale pour laquelle il vote au niveau de son établissement ou de son entreprise, mais également, aux niveaux professionnel et interprofessionnel, que l’audience syndicale soit mesurée de la manière la plus juste possible.
Le XVI du présent article concerne la représentativité syndicale au niveau de l’entreprise et de l’établissement.
Rappelons que l’article L. 2122-1 pose la nouvelle règle de représentativité à ce niveau, celle des 10 % de suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants.
L’article L. 2122-3 prévoit qu’en cas de dépôt d’une liste commune par plusieurs organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée par les organisations concernées au moment du dépôt de cette liste ; à défaut d’indication, la répartition des suffrages est opérée à parts égales entre les organisations concernées.
Le XVI introduit, à cet égard, un nouvel article L. 2122-3-1 pour préciser que lors du dépôt de la liste, le syndicat peut indiquer son affiliation à une organisation syndicale, autrement dit à une fédération ou à une confédération. S’il ne l’indique pas, les suffrages recueillis au niveau de l’entreprise ou de l’établissement par le syndicat ne sont pas pris en compte pour la mesure de l’audience électorale de la confédération syndicale.
Il s’agit là d’inciter les syndicats à déclarer officiellement leur affiliation lors du dépôt des listes électorales dans le cadre des élections professionnelles au niveau de l’entreprise. Une telle « incitation » est partie prenante du « pacte de confiance » des syndicats de l’entreprise avec les salariés, mais elle permet également de fiabiliser le recueil de l’audience syndicale aux niveaux supérieurs.
On constate en effet depuis 2008 un certain nomadisme des syndicats d’entreprise entre les différentes confédérations syndicales, avec de nombreuses désaffiliations puis réaffiliations au gré des événements : c’est l’un des effets de la loi de 2008, qui a donné une importance cruciale aux élections des représentants du personnel au niveau de l’entreprise, lui donnant un rôle de fondement de la représentativité syndicale au niveau national interprofessionnel.
La jurisprudence est ainsi venue clarifier les conséquences d’un tel mouvement amplement constaté : par une série d’arrêts rendus le 18 mai 2011, la chambre sociale de la Cour de cassation a estimé que dès lors qu’un syndicat d’entreprise se désaffilie de sa centrale syndicale pour se réaffilier à une nouvelle confédération, il ne pouvait pas se prévaloir du score obtenu précédemment lors des élections pour le calcul de l’audience électorale de la nouvelle organisation, dans la mesure où sa précédente affiliation constitue un élément essentiel du vote des électeurs. Cette jurisprudence a été réaffirmée par un arrêt rendu le 28 novembre 2012 par la Cour de cassation, dans lequel la chambre sociale juge que l’affiliation confédérale sous laquelle un syndicat a présenté des candidats au premier tour des élections des membres titulaires du comité d’entreprise constitue un élément essentiel du vote des électeurs ; en cas de désaffiliation intervenant après ces élections, le syndicat ne peut plus se prévaloir des suffrages ainsi obtenus pour se rendre représentatif quand bien même la décision de désaffiliation émane de la confédération.
Enfin, dans une série d’arrêts rendus le 12 avril 2012, la chambre sociale a considéré que pour additionner, au niveau de l’entreprise, les suffrages recueillis par plusieurs organisations syndicales affiliées à une même confédération, cette affiliation devait être mentionnée sur les bulletins de vote ou portée à la connaissance des électeurs.
Afin de préserver la liberté syndicale, le texte fait le choix de prévoir une simple faculté pour un syndicat d’indiquer son affiliation lors du dépôt de sa liste aux élections concernées. Toutefois, le fait qu’en l’absence d’indication, les suffrages recueillis ne soient pas pris en compte pour la mesure de la représentativité aux niveaux supérieurs apparaît vraisemblablement suffisamment contraignant pour que les syndicats soient tous amenés à déclarer officiellement leur affiliation lors du dépôt des listes.
Le XVII du présent article prévoit que cette « possibilité » de déclaration d’affiliation entre en vigueur à compter du 1er janvier 2015.
C. LE RENFORCEMENT DE L’ACTION SYNDICALE À TRAVERS LES DÉLÉGUÉS SYNDICAUX
Il s’agit principalement de clarifier le périmètre de désignation des délégués syndicaux, afin qu’il soit le plus proche possible des salariés, d’assouplir les conditions de leur désignation afin de garantir la liberté syndicale et d’assurer une meilleure légitimité aux délégués syndicaux nommés pour siéger aux instances représentatives du personnel, et enfin, de sécuriser le mandat des délégués syndicaux.
1. Préciser le terme du mandat du délégué syndical
Le XVIII du présent article concerne l’arrivée à échéance du mandat du délégué syndical, prévue par l’article L. 2143-11.
Rappelons que les délégués syndicaux ne peuvent en principe être désignés que dans les entreprises ou établissements d’au moins 50 salariés. Toutefois, un accord collectif peut abaisser ou supprimer ce seuil d’effectifs, de même qu’un délégué du personnel peut être désigné comme délégué syndical dans les structures de moins de 50 salariés.
Dans le droit actuel, le mandat du délégué syndical prend fin lors du renouvellement des institutions représentatives dans l’entreprise, et, dans le cas particulier des entreprises de moins de 50 salariés, à chaque nouvelle élection des délégués du personnel. Le mandat du délégué syndical peut également prendre fin :
– lorsque le syndicat ou le délégué syndical y met un terme ;
– en cas de départ du salarié de l’entreprise ou, le cas échéant, de l’établissement distinct où il a été désigné ;
– en cas de modification du cadre dans lequel le délégué syndical a été désigné (disparition d’une unité économique et sociale, de l’autonomie d’un établissement, de la section syndicale, etc.) ;
– en cas de disparition de l’institution, ou de diminution du nombre de délégués, suite à une réduction de l’effectif ;
– en cas de décès du délégué syndical.
La rédaction actuelle du premier alinéa de l’article L. 2143-11 renvoie aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 2143-3 et à celles de l’article L. 2143-6 comme conditions entourant le mandat du délégué syndical. Celles-ci concernant respectivement les modalités de désignation d’un délégué syndical dans les entreprises ou établissements de plus de 50 salariés et dans les établissements de moins de 50 salariés.
La modification proposée consiste à supprimer le renvoi à ces deux articles pour lui substituer un terme plus explicite du mandat du délégué syndical correspondant « au premier tour des élections de l’institution représentative du personnel renouvelant l’institution dont l’élection avait permis de reconnaître la représentativité de l’organisation syndicale l’ayant désigné ».
Il s’agit là de tenir compte de la jurisprudence de la Cour de cassation : en effet, dans un arrêt rendu le 22 septembre 2010, la chambre sociale a jugé que lors du renouvellement des institutions, le syndicat désirant reconduire un délégué syndical dans ses fonctions doit procéder à une nouvelle désignation de l’intéressé, la notification de cette décision à l’employeur et son affichage sur le panneau réservé aux communications syndicales déclenchant le délai de contestation de cette désignation par l’employeur, les syndicats ou par tout salarié.
Notons que la circulaire de la direction générale du travail n° 06 du 27 juillet 2011 répondant aux questions posées dans le cadre de la mise en œuvre de la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail précise également que le seul fait qu’un ancien délégué syndical poursuive ses missions dans l’entreprise ne peut être considéré comme une nouvelle désignation, susceptible d’être purgée de tout vice en l’absence de contestation dans les quinze jours.
La nouvelle rédaction proposée par le présent XVIII, en consacrant les précisions jurisprudentielles, devrait donc contribuer à sécuriser davantage les délégués syndicaux eux-mêmes dans le cadre de leur mandat : en effet, une désignation expresse leur permet de bénéficier de l’ensemble des avantages et de la protection prévus au profit des délégués syndicaux (heures de délégation, droit de participer aux négociations collectives, protection contre le licenciement).
2. L’assouplissement des conditions de désignation du délégué syndical
Le texte cherche également à assouplir les règles de désignation d’un délégué syndical dans les entreprises de plus de 50 salariés. En effet, l’article L. 2143-3 dispose que tout syndicat représentatif qui constitue une section syndicale désigne un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l’employeur. Pour être désigné délégué syndical, le salarié doit avoir été candidat au premier tour des dernières élections, indifféremment au comité d’entreprise, à la délégation unique du personnel (DUP) ou des délégués du personnel, et avoir obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour de ces élections, quel que soit le nombre de votants.
Le XIX du présent article entend apporter certaines modifications aux règles encadrant la désignation des délégués syndicaux, principalement pour tenir compte de la jurisprudence dans ce domaine.
En premier lieu, le 1° précise que, pour être désigné délégué syndical, le salarié doit avoir obtenu, à titre personnel et dans son collège, 10 % des suffrages exprimés au premier tour des élections professionnelles : autrement dit, il n’est pas nécessaire qu’il ait obtenu 10 % de l’ensemble des suffrages exprimés lors de cette élection contrairement à l’interprétation qui pourrait être faite de la lettre de l’article L. 2143-3, mais bien dans le cadre de son seul collège.
C’est ce qui résulte en particulier de la circulaire de la direction générale du travail (DGT) n°6 du 27 juillet 2011 répondant aux questions posées dans le cadre de la mise en œuvre de la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, qui précise que le candidat doit avoir obtenu 10 % des suffrages « sur son nom, c’est-à-dire dans son collège, et non sur l’ensemble de l’entreprise » : on rapporte le nombre de voix obtenues par le candidat au nombre de bulletins valables recueillis pour l’ensemble des listes dans son collège, pour obtenir le pourcentage sur son nom. Peu importe d’ailleurs qu’il soit ou non finalement élu.
Le 2° apporte une précision concernant la possibilité pour une organisation syndicale de désigner un délégué syndical, en l’absence de candidat ayant recueilli au moins 10 % des suffrages : en effet, si, entre deux élections professionnelles, l’organisation syndicale ne dispose plus de candidat remplissant ces conditions, elle peut désigner un délégué syndical parmi ses candidats aux élections n’ayant pas obtenu 10 % des voix, ou bien, à défaut de candidats, parmi ses adhérents au sein de l’entreprise ou de l’établissement.
Dans une série d’arrêts rendus le 27 février 2013, la chambre sociale de la Cour de cassation est venue clarifier l’ordre de priorité de désignation d’un délégué syndical en l’absence de candidat ayant totalisé au moins 10 % des voix sur son nom au premier tour des élections professionnelles. En effet, cette règle ne signifie pas que le syndicat serait tenu de proposer à la désignation les autres candidats qui auraient obtenu 10 % des voix sur une autre liste syndicale, avant de pouvoir désigner l’un de ses propres candidats qui aurait obtenu un score inférieur ou encore, le cas échéant, un salarié simplement adhérent.
La Cour estime en effet que « l’obligation de choisir ce délégué en priorité parmi les candidats qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles n’a pas pour objet ou pour effet de priver cette organisation syndicale du droit de disposer d’un représentant dès lors qu’elle a présenté des candidats à ces élections dans le périmètre de désignation ». Autrement dit, il ne résulte pas de cette règle des 10 % que le score électoral, et donc, la représentativité, prime sur l’appartenance syndicale.
La rédaction proposée par le 2° du XIX consiste à préciser que la possibilité pour un syndicat de désigner un délégué syndical parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi ses adhérents dans l’entreprise ou l’établissement n’est pas seulement ouverte « s’il ne reste (…) plus aucun candidat (…) » qui remplit la règle des 10 % de suffrages, mais aussi simplement « si aucun des candidats présentés par l’organisation syndicale » ne remplit cette condition.
La possibilité de recourir à une telle désignation de substitution est donc désormais explicitement prévue en cas d’absence de candidat, présenté par l’organisation syndicale, ayant recueilli une telle proportion des suffrages, et non plus seulement à la condition qu’il ne reste aucun candidat qui remplit ces conditions. La rédaction actuelle peut laisser penser qu’une organisation syndicale ne peut recourir à cette procédure de désignation par substitution que si aucun candidat n’a obtenu au moins 10 % des suffrages, ce qui laisserait supposer qu’elle désigne en priorité tout autre candidat qui remplirait cette condition. Il est désormais clairement dit que le syndicat peut procéder à une telle désignation de substitution dès lors simplement qu’aucun de ses candidats n’a obtenu un tel score.
3. La déconnexion du périmètre de désignation du délégué syndical et du périmètre de la représentativité
La définition de l’établissement distinct pour la mise en place des délégués du personnel et pour la désignation des délégués syndicaux a été unifiée par deux arrêts de la Cour de cassation, respectivement du 29 janvier 2003 et du 24 avril 2003 : ainsi, un établissement distinct se caractérise à la fois par un regroupement de salariés (onze ou cinquante salariés selon l’institution représentative du personnel concernée), constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres susceptibles de générer des réclamations ou revendications communes et spécifiques et travaillant sous la direction d’un représentant de l’employeur, peu important que celui-ci ait le pouvoir de se prononcer sur ces réclamations ou revendications.
Or, la loi du 20 août 2008 a introduit une mesure de la représentativité au niveau du comité d’entreprise ou, à défaut, au niveau des délégués du personnel. Dès lors, dans une entreprise comportant plusieurs comités d’établissement et par ailleurs de nombreux établissements distincts comportant uniquement des délégués du personnel, la représentativité des syndicats se mesure au niveau des comités d’entreprise. La loi du 20 août 2008 n’a pas remis en cause la définition de l’établissement distinct pour la désignation du délégué syndical, mais la jurisprudence a posé le principe de la coïncidence du périmètre de désignation du délégué syndical et de mise en place du comité d’entreprise ou d’établissement : en effet, en principe, « sauf accord collectif en disposant autrement », le périmètre retenu pour la désignation des délégués syndicaux est le même que celui retenu, lors des dernières élections, pour la mise en place du comité d’entreprise ou d’établissement. C’est ce qui ressort d’un arrêt rendu le 18 mai 2011 par la chambre sociale de la Cour de cassation.
Le texte s’éloigne ici volontairement de la jurisprudence, afin de permettre la désignation d’un délégué syndical sur un périmètre différent de celui sur lequel est organisée l’élection sur laquelle se fonde la mesure de l’audience, pour permettre, comme l’indique l’étude d’impact, « une désignation du délégué syndical au plus près du salarié ».
Ainsi, le 3° du XIX prévoit-il que la désignation d’un délégué syndical peut également intervenir au sein d’un « établissement distinct », quand bien même les élections des institutions représentatives du personnel ont été organisées au sein de l’unité économique et sociale (UES) d’ensemble, regroupant plusieurs établissements. L’objectif est bien d’ouvrir la possibilité de désigner des délégués syndicaux au niveau de mise en place des délégués du personnel, c’est-à-dire au plus près du terrain.
Cette possibilité était jusqu’alors conditionnée à l’existence d’un accord prévoyant explicitement la désignation de délégués syndicaux sur un périmètre plus restreint que le périmètre de désignation du comité d’entreprise ou du comité d’établissement.
Ce changement devrait entraîner, toutes choses égales par ailleurs, une augmentation du nombre de délégués syndicaux, qu’il est toutefois difficile d’estimer : en effet, si le nombre de délégués syndicaux dans les établissements de plus de 20 salariés est aujourd’hui estimé par la DARES à 101 663, on ne dispose pas de la répartition de ces délégués selon le périmètre retenu pour le désigner, qu’il s’agisse des délégués du personnel ou du comité d’entreprise.
Cette modification est jugée souhaitable par la majorité des organisations syndicales, mais n’a pas recueilli les faveurs des principales organisations patronales.
S’agissant des conséquences de cette modification sur la prise en compte des résultats des élections et donc, principalement, de la négociation collective, dès lors qu’on se trouvera sur un périmètre qui comprend à la fois un comité d’entreprise et des délégués du personnel, le niveau de mesure de la représentativité (au niveau du comité d’entreprise) sera distingué du périmètre de la négociation collective (établissement dans lequel un délégué syndical peut être désigné). Les élections prises en compte pour déterminer la validité de l’accord signé au niveau de l’établissement avec des délégués du personnel et un délégué syndical désigné à ce niveau, sera celui qu’a obtenu le syndicat aux élections du comité d’entreprise, et non le poids obtenu au regard des élections des délégués du personnel. Cette modification n’a donc pas pour conséquence de multiplier les négociations obligatoires pour les employeurs car celles-ci sont déclenchées par la présence d’un délégué syndical au niveau de l’entreprise.
4. Le rétablissement des conditions de désignation du représentant syndical au comité d’entreprise antérieures à 2008
Le XX du présent article traite des conditions dans lesquelles les organisations syndicales désignent aujourd’hui un représentant syndical au comité d’entreprise.
Jusqu’en 2008, la désignation d’un représentant syndical au comité d’entreprise était subordonnée à la représentativité des organisations syndicales. La loi du 20 août 2008 est venue modifier ces règles, en instaurant une distinction entre les entreprises de moins de 300 salariés et les entreprises de plus de 300 salariés :
– dans les entreprises de moins de 300 salariés, le délégué syndical est membre du comité d’entreprise de droit ;
– dans les entreprises de plus de 300 salariés, chaque organisation syndicale, même non représentative, peut nommer un représentant syndical au comité d’entreprise si elle y a au moins deux élus.
Le texte rétablit la condition de représentativité de l’organisation syndicale au niveau de l’entreprise ou de l’établissement pour procéder à la désignation d’un représentant syndical. En effet, le système actuel peut conduire, dans les faits, à ce qu’un syndicat représentatif ne puisse pas désigner un représentant syndical au comité d’entreprise, dès lors qu’il n’y aurait qu’un seul élu ou aucun élu. Exclure ainsi la présence de syndicats représentatifs peut avoir des conséquences très dommageables, dans la mesure où ce sont eux qui sont amenés à négocier au nom des salariés. Dès lors qu’ils ne sont pas représentés au comité d’entreprise, cette mission s’avérerait d’autant plus délicate.
5. Introduction d’un critère de transparence financière pour la recevabilité des candidatures au scrutin des TPE
Le XXI du présent article procède à une harmonisation bienvenue s’agissant des critères de représentativité des organisations syndicales dans les entreprises de moins de onze salariés, autrement dit des très petites entreprises (TPE), critères introduits par la loi n° 2010-1215 du 15 octobre 2010 complétant les dispositions relatives à la démocratie sociale issues de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008.
Cette loi a introduit le principe d’une mesure de l’audience des organisations syndicales dans les TPE, sur la base d’un scrutin organisé tous les quatre ans au niveau régional. L’article L. 2122-10-6 qui concerne la candidature des organisations syndicales renvoie aujourd’hui aux critères suivants :
– respect des valeurs républicaines et indépendance ;
– ancienneté d’au moins deux ans ;
– présence dans le champ géographique concerné ;
– ou affiliation à une organisation syndicale représentative au niveau national interprofessionnel.
Pour l’heure, n’est pas exigée de condition de transparence financière.
L’absence de cette condition a conduit à des difficultés dans le cadre du scrutin organisé en 2012, qui a occasionné des contentieux relatifs à la candidature de plusieurs organisations qui ont été finalement écartées du scrutin par le juge.
Le XXI du présent article introduit cette condition qui doit légitimement s’appliquer pour l’ensemble des niveaux de représentations.
*
* *
Lors de son examen du texte, votre commission a adopté deux amendements sur cet article.
Le premier amendement, proposé par M. Denys Robiliard et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen (SRC) est relatif au délai fixé par le texte entre l’invitation à négocier adressée par l’employeur aux organisations syndicales intéressées et la date de la première réunion de négociation du protocole préélectoral. Il prévoit que ce délai de quinze jours court, non pas entre la date à laquelle a été effectuée l’invitation et la première réunion de négociation, mais entre la date à laquelle l’invitation parvient à son destinataire et la date de la première réunion de négociation. Cette modification conduit en réalité à allonger le délai imparti aux organisations syndicales pour leur laisser suffisamment de temps pour se préparer à la négociation du protocole d’accord.
Le second amendement, présenté par M. Gérard Cherpion et ses collègues du groupe de l’Union pour un mouvement populaire (UMP), prévoit de passer d’une simple faculté à une obligation de déclaration de l’affiliation du syndicat présent dans l’entreprise à une confédération syndicale. Il est en effet normal que dès lors qu’un syndicat est affilié à une organisation syndicale, il en fasse la déclaration lors du dépôt de sa liste dans le cadre des élections professionnelles organisées dans l’entreprise. Il s’agit là de garantir que les salariés sont bien informés et votent en tout connaissance de cause.
*
* *
La Commission est saisie de l’amendement AS324 de M. Denys Robiliard.
M. Denys Robiliard. L’invitation à négocier le protocole d’accord préélectoral doit non seulement être envoyée, mais parvenir à ses destinataires au plus tard quinze jours avant la date de la première réunion de négociation.
Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement.
Puis elle examine l’amendement AS43 de M. Gérard Cherpion.
M. Gérard Cherpion. Aux termes de cet amendement, un syndicat aura non plus la faculté, mais l’obligation d’indiquer son affiliation éventuelle à une organisation syndicale pour que celle-ci recueille les suffrages exprimés en sa faveur.
Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement.
Puis elle adopte l’article 17 modifié.
Chapitre III
Financement des organisations syndicales et patronales
Article 18
(Art. L. 2135-9 à L. 2135-18 [nouveaux], L. 2145-2, L. 2145-3, L. 3142-8 et L. 3142-9
du code du travail)
Financement des organisations syndicales et patronales
La loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale a posé le principe de la transparence des comptes des organisations patronales et syndicales, la transparence financière étant devenue un critère commun de représentativité de ces organisations. La publication des comptes a permis de rendre plus visibles leurs sources de financement, sans toutefois permettre de véritablement rendre plus lisibles les origines de ces financements, qui sont aujourd’hui multiples et pour lesquels les circuits de financement sont extrêmement complexes.
En effet, si les organisations sont avant tout financées par les cotisations de leurs adhérents, celles-ci bénéficient, d’ailleurs à juste titre, d’une série de financements au titre des missions d’intérêt général qu’elles assument : elles jouent en effet à la fois un rôle d’appui aux politiques publiques, par le biais du dialogue social ; elles sont également amenées à participer directement à la gestion de certaines politiques publiques, dans les champs de la sécurité sociale, et plus largement de la protection sociale et, éminemment dans le champ de la formation professionnelle. C’est ce que l’on appelle la « gestion paritaire ».
Afin de clarifier les origines de ces financements, leurs modalités d’attribution et les règles de leur répartition, tout en posant en retour des exigences de rendu-compte global de l’usage de ces fonds, le présent article se donne comme le point d’aboutissement naturel de la logique de transparence financière des organisations syndicales et patronales qui a porté la loi de 2008.
A. LES RESSOURCES DES ORGANISATIONS SYNDICALES DE SALARIÉS ET DES ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES D’EMPLOYEURS
Les organisations patronales et syndicales sont financées par trois catégories de ressources :
– leurs ressources propres ;
– les ressources issues du « paritarisme » ;
– et enfin, les ressources issues de subventions publiques.
1. Les ressources propres
Les ressources propres sont avant tout et principalement constituées par les cotisations des adhérents. Celles-ci figurent en effet parmi les critères de représentativité des syndicats – au sein d’un critère qui comprend également les effectifs d’adhérents –, gage de leur autonomie financière. La proportion des cotisations des adhérents dans les ressources globales des organisations est toutefois très variable : si elle se situe en moyenne autour de 30 à 40 % pour les grandes confédérations syndicales représentatives des salariés, elle se révèle plus contrastée pour les grandes organisations patronales, se situant entre 18 % et plus de 80 %, voire 90 % en fonction des organisations.
Les deux tableaux suivants retracent, pour chaque organisation, le montant des ressources issues des cotisations en 2010.
LE POIDS DES COTISATIONS DES ADHÉRENTS DANS LE FINANCEMENT DES SYNDICATS
(en millions d’euros)
Total des ressources issues des cotisations |
Sous-total des ressources issues des cotisations au niveau confédéral |
Part des cotisations dans l’ensemble des ressources au niveau confédéral (en %) | |
CGT |
55,5 |
12,8 |
33 % |
CFDT |
77,6 |
14,1 |
40 % |
CGC-CFE |
5,4 |
4,5 |
26 % |
CGT-FO |
6,8 |
n.c. |
28 %(1) |
CFTC |
1,8 |
13 % | |
Solidaires |
0,23 |
34 % | |
UNSA |
1,4 |
25 % |
(1) Pour la CGT-FO, la collecte des cotisations étant décentralisée, la part des cotisations n’est pas calculée au niveau confédéral.
Source : direction générale du travail.
LE POIDS DES COTISATIONS DES ADHÉRENTS DANS LE FINANCEMENT DES ORGANISATIONS PATRONALES
(en millions d’euros)
Montant des cotisations perçues |
Part des cotisations dans l’ensemble des ressources (en %) | |
MEDEF |
24 |
63 % |
FFSA (assurances) |
15,5 |
97 % |
FBF (banques) |
23,7 |
87 % |
FFB (bâtiment) |
62,7 |
80 % |
CGPME |
1,7 |
19 % |
UPA |
11,44 |
35 % |
UIMM (métallurgie) |
8,3 |
14 % |
FNSEA |
6,2 |
30 % |
Source : direction générale du travail.
Les écarts constatés au niveau des organisations patronales ont plusieurs explications. Ils tiennent en premier lieu au poids financier du secteur d’activité représenté, mais également au degré variable d’attractivité des organisations concernées, qui dépend de leur influence et de leur efficacité supposées. Enfin, le poids relatif des cotisations est moindre lorsque les organisations concernées disposent d’autres ressources propres à des niveaux importants ou encore de réserves financières importantes.
Car parmi les ressources propres des organisations, figurent également les revenus financiers et patrimoniaux ou encore les recettes tirées de leurs publications ou de la commercialisation de services. Certaines de ces ressources peuvent dans certains cas se révéler importantes – par exemple pour certaines organisations patronales dont le patrimoine financier peut parfois représenter un poids prépondérant dans leurs ressources annuelles totales – : c’est le cas de l’UIMM avec une trésorerie de 321 millions d’euros en 2010. Néanmoins, la plupart du temps, la part de ces ressources propres se révèle relativement faible.
2. Les ressources issues du « paritarisme »
Les organisations syndicales et patronales perçoivent des ressources au titre de leur participation à un certain nombre d’organismes gérés paritairement et qui sont chargés de la mise en œuvre de politiques publiques spécifiques. Ces ressources sont généralement affectées à parité aux organisations patronales d’une part, aux organisations syndicales de salariés d’autre part.
Ces organismes se situent pour la plupart dans le champ de la protection sociale. Il s’agit principalement de :
– la sécurité sociale, à travers la participation à la gestion des caisses de sécurité sociale et de l’agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) ;
– l’assurance-chômage, à travers la gestion de l’Unédic ;
– la retraite complémentaire et la prévoyance, à travers l’AGIRC-ARRCO, et les institutions de prévoyance ;
– ainsi que de certains organismes chargés de missions d’insertion sur le marché de l’emploi, que ce soit l’Association pour l’emploi des cadres (APEC) ou l’Association de gestion du fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées (AGEFIPH).
Les organisations syndicales et patronales participent également à la gestion de la politique de formation professionnelle, à travers les organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA) et le fonds national de gestion paritaire de la formation professionnelle continue (FONGEFOR).
Enfin, ces organismes se trouvent également dans le champ du logement, puisque les organisations syndicales et patronales participent à la gestion de l’Union d’économie sociale du logement (UESL), qui assure la mise en œuvre des fonds d’Action Logement, l’ancien 1 % logement.
a. Les « préciputs »
Dans la mesure où elles sont largement sollicitées et associées à la gestion de l’ensemble de ces organismes dans le champ de la protection sociale, de l’emploi, de la formation professionnelle et du logement, assumant ainsi des missions d’intérêt général, les organisations syndicales et patronales perçoivent à ce titre des ressources liées à cette participation, connues sous le nom de « préciputs » et qui correspondent au défraiement des administrateurs qui siègent dans les diverses instances délibératives de ces organismes, à la prise en charge de leurs frais de déplacement, de séjour et de restauration au titre de leur mission, ainsi que, parfois, à la prise en charge de frais de formation ou de frais de secrétariat technique.
En effet, les fonctions exercées au sein de ces organismes ne donnent droit à aucune rémunération : elles sont réputées être assurées à titre gratuit. Néanmoins, les statuts de ces organismes prévoient toujours des modalités de défraiement ou de versement d’une indemnité compensatrice de frais, la plupart du temps forfaitaire, au titre des fonctions exercées.
L’exemple du régime général de sécurité sociale
Le code de la sécurité sociale pose le principe de la gratuité des fonctions d’administrateur de caisse : l’article L. 231-12 dispose en effet que « les organismes de sécurité sociale ne peuvent, en aucun cas, allouer un traitement à leurs membres du conseil ou administrateurs ». Le même article prévoit toutefois « un remboursement de leurs frais de déplacement », ainsi que le remboursement aux employeurs du maintien du salaire de ces membres du conseil ou administrateurs pour leur permettre d’exercer leurs fonctions, ainsi que les avantages et charges sociales afférents. Un mécanisme d’indemnité pour perte de leurs gains est également prévu au profit des travailleurs indépendants.
L’indemnité forfaitaire compensatrice de frais s’élèverait à 20 euros par jour et l’indemnité pour perte de gains des indépendants à 40 euros par jour (arrêté du 14 mars 2002, vraisemblablement non modifié depuis).
Au total, les frais liés aux administrateurs de sécurité sociale auraient représenté 64 millions d’euros en 2010 : on peut raisonnablement estimer que les trois quarts sont liés aux mandats des représentants des organisations syndicales et patronales. Sur ces 64 millions d’euros, les indemnités forfaitaires compensatrices de frais représentent près de 10 millions d’euros, tandis que la compensation des pertes de salaires et de gains s’établit autour de 5 millions d’euros. Le remboursement des frais de déplacement représente plus de 20 millions d’euros.
À l’AGIRC-ARRCO, les frais relatifs au financement du paritarisme s’établiraient à 1,4 million d’euros en 2010, couvrant autant des frais de déplacement et de séjour, que les pertes de salaires, le financement de « conseillers techniques » ou encore des frais de formation et des frais administratifs.
S’agissant de l’Unédic, – et alors que les versements annuels du réseau Unédic-Assédic, avant la fusion avec Pôle emploi, de l’ordre de 10 millions d’euros, avaient été pointés du doigt par la Cour des comptes –, une dotation globale est désormais prévue à ce titre, répartie au prorata des sièges au conseil. Elle a représenté 4,7 millions d’euros en 2010 et 2011.
Si le principe même d’un financement des organisations au titre de leur participation à la gestion du paritarisme n’est guère contestable, en revanche, le système des « préciputs » présente deux inconvénients majeurs, d’ailleurs liés.
Tout d’abord, comme le souligne l’étude d’impact associée au présent projet de loi, « dans la plupart des cas, [ces préciputs] financent aussi directement ou indirectement les organisations syndicales et professionnelles elles-mêmes ». Autrement dit, la principale source de confusion est liée au fait que les sommes afférentes sont la plupart du temps versées aux organisations sous forme de dotation globale annuelle, et non sur justificatifs individuellement adressés par les personnes mandatées pour exercer des fonctions de représentation auprès des organismes concernés.
Ensuite, ces financements sont aujourd’hui disparates et répondent à des règles spécifiques à chaque organisme, ne permettant donc aucune évaluation fiable de leurs montants globaux, ce qui est source d’illisibilité.
b. Le cas particulier de la gestion paritaire de la formation professionnelle
La sphère de la formation professionnelle obéit, quant à elle, à des règles spécifiques, s’agissant du financement du paritarisme. En effet, les organisations d’employeurs et de salariés assurent l’administration du système de financement de la formation professionnelle des salariés à travers les OPCA, et à ce titre, ils bénéficient de deux sources de financement :
– les « préciputs » au titre de la gestion des OPCA ;
– et le produit du Fonds national de gestion paritaire de la formation professionnelle continue, le FONGEFOR.
Les OPCA ont pour mission de collecter les cotisations des entreprises afin d’assurer, de manière mutualisée, le financement de formations au bénéfice des salariés de ces entreprises. La création d’un OPCA résulte d’un accord collectif constitutif, son champ pouvant être professionnel ou interprofessionnel. Autrement dit, l’OPCA est conduit à « reverser » sous forme de « préciput » des sommes aux organisations syndicales et patronales qui en assurent la gestion et qui sont à l’origine de sa création.
L’article R. 6332-43 du code du travail prévoit explicitement que la gestion paritaire des fonds de la formation professionnelle continue par les organisations signataires des accords portant constitution des OPCA peut faire l’objet d’une rémunération au titre des missions et services qui sont effectivement accomplis : « les sommes consacrées à cette rémunération ne peuvent excéder 0,75 % du montant des sommes collectées » par les OPCA. Elles sont a priori partagées à parité entre organisations de salariés et d’employeurs, mais ne bénéficient logiquement qu’aux organisations signataires de l’accord portant création de l’OPCA en question, qui peut par exemple, du côté patronal, n’être qu’une seule organisation. Même dans le cas d’un OPCA interprofessionnel, dont le champ est généraliste, il arrive souvent que la gestion en soit assurée par une seule organisation du côté patronal : c’est par exemple le cas pour la CGPME qui gère seule l’OPCA AGEFOS-PME, tandis qu’OPCALIA est gérée par le seul MEDEF.
Ce système de « préciput » est donc l’équivalent de ce qui existe pour l’ensemble des autres organismes gérés paritairement dans le champ de la protection sociale : il représente, s’agissant des OPCA, de l’ordre de 30 millions d’euros par an, d’après les informations incluses dans l’étude d’impact.
Outre ce financement par le biais des « préciputs », les organisations syndicales et professionnelles bénéficient des financements du Fonds national de gestion paritaire de la formation professionnelle continue, le FONGEFOR : créé par décret en 1996, ce fonds finance les organisations syndicales et patronales au titre de leur participation au développement de la formation professionnelle, et en particulier de leurs missions :
– de participation à l’élaboration et à la mise en place du dispositif interprofessionnel concernant l’emploi et la formation professionnelle ;
– d’initiative pour la mise en œuvre des accords ;
– d’évaluation des conséquences des actions interprofessionnelles sur l’insertion, l’adaptation et la promotion des salariés ;
– d’harmonisation de ces actions et de mise en cohérence du dispositif paritaire de gestion et de promotion de la formation continue ;
– d’action en faveur de la concertation entre les branches professionnelles et l’État ;
– et enfin, de participation aux instances interprofessionnelles de coordination.
Ce fonds est, aux termes de l’article R. 6332-97 du code du travail, alimenté par un prélèvement de 0,75 % sur les sommes collectées par les OPCA du seul champ interprofessionnel autrement dit sur les OPCA dans le champ des accords interprofessionnels, qui correspondent aux secteurs de l’industrie, de la construction, du commerce et des services, à l’exclusion de l’agriculture, des professions libérales et de l’économie sociale.
La répartition du produit de ce prélèvement est effectuée, conformément aux dispositions de l’article R. 6332-99, « à parité entre les organisations syndicales de salariés et les organisations interprofessionnelles d’employeurs représentatives au niveau national ». La ventilation des sommes à l’intérieur des deux collèges, patronal et syndical, est en revanche décidée en interne : elle est aujourd’hui opérée de manière égalitaire entre les cinq organisations représentatives des salariés (CFDT, CGT, CGT-FO, CFTC, CFE-CGC), mais attribuée à 57,5 % au MEDEF, à 32,5 % à la CGPME et à 10 % à l’UPA s’agissant des sommes attribuées au collège patronal.
Pour 2010, la répartition des fonds du FONGEFOR était la suivante.
RÉPARTITION DES FONDS DU FONGEFOR EN 2010
(en milliers d’euros)
MEDEF |
8 344 |
CGPME |
4 716 |
UPA |
2451 |
Total organisations d’employeurs |
14 511 |
CFDT |
2 902 |
CFTC |
2 902 |
CFE-CGC |
2 902 |
CGT |
2 902 |
CGT-FO |
2 902 |
Total organisations de salariés |
14 511 |
Source : FONGEFOR.
Le produit du FONGEFOR représente ainsi de l’ordre de 30 millions d’euros par an.
c. Les accords de financement du dialogue social
Certaines branches professionnelles ont conclu des « accords de financement du dialogue social », qui prévoient une contribution obligatoire des entreprises de la branche, assise sur la masse salariale, afin d’assurer le financement des instances paritaires créées au niveau de la branche. Ces sommes ont concrètement pour objet de couvrir les frais de déplacement et de séjour des membres des commissions paritaires occasionnés par les réunions de ces instances, de rembourser à l’employeur le maintien de la rémunération des salariés qui y participent, d’indemniser les indépendants pour leur perte de gain à ce titre, et, le cas échéant, de couvrir les frais de secrétariat et de formation à la négociation collective.
Ce type de financement est explicitement prévu par l’article L. 2232-8 du code du travail, qui dispose que « les conventions de branche et les accords professionnels comportent, en faveur des salariés d’entreprises participant aux négociations, de même qu’aux réunions des instances paritaires qu’ils instituent, des dispositions relatives aux modalités d’exercice du droit de s’absenter, à la compensation des pertes de salaire ou au maintien de ceux-ci, ainsi qu’à l’indemnisation des frais de déplacement ».
Ce type d’accord a par exemple été conclu dans le secteur agricole, où coexistent :
– une cotisation équivalente à 0,05 % sur la masse salariale des entreprises du secteur au titre du financement du droit à la négociation collective, mise en place par un accord national conclu le 21 janvier 1992, et partagée à parité entre organisations syndicales et organisations patronales ;
– et une cotisation fixée à 0,2 % de la masse salariale pour le financement de la gestion prévisionnelle dans le secteur agricole, créée par accord national du 18 juillet 2002, et dont le produit est attribué à 75 % aux organisations professionnelles d’employeurs représentatives au plan national et signataires de l’accord, et à 25 % à celles des salariés.
Un tel accord relatif au développement du dialogue social a également été conclu le 12 décembre 2001 dans le secteur de l’artisanat, cette fois donc non pas au niveau d’une branche, mais au niveau interprofessionnel. Cet accord met en place une contribution de 0,15 % sur la masse salariale dans les branches de l’artisanat, qui se décompose en :
– une fraction de 0,08 ‰ partagée au niveau interprofessionnel, à parité entre organisations d’employeurs et de salariés ;
– une part de 0,07 % partagée au niveau des branches professionnelles, selon des modalités fixées par accord de branche.
En 2010, le prélèvement résultant de l’accord connu sous le nom d’« accord UPA » a représenté un peu plus de 18 millions d’euros, partagés à parité entre la part employeurs et la part salariés, la première bénéficiant donc à la seule UPA.
3. Les subventions publiques
Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs bénéficient enfin d’un certain nombre de subventions publiques.
Rappelons tout d’abord que, pour les organisations syndicales de salariés, la cotisation des adhérents bénéficie d’un crédit d’impôt (85) à hauteur de 66 % de la cotisation annuelle versée dans la limite de 1 % du salaire brut imposable. Le coût de ce dispositif, qui bénéficie à 1,55 million de ménages, est estimé à 150 millions d’euros pour 2014 (86).
Outre ce financement indirect des syndicats par la collectivité publique, les organisations bénéficient de plusieurs subventions du budget de l’État.
a. Le financement de la formation économique, sociale et syndicale des salariés exerçant des fonctions syndicales
Sur le fondement de l’article L. 2145-3 du code du travail, l’État apporte une aide financière à la formation économique, sociale et syndicale (FESS) des salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales. Cette formation est, aux termes de l’article L. 2145-2, assurée soit par des centres de formation directement rattachés aux organisations syndicales de salariés reconnues représentatives au niveau national, soit par des instituts spécialisés internes aux universités, agréés par le ministère du travail. Les salariés souhaitant participer à ces formations bénéficient, en vertu de l’article L. 3142-7 de congés leur permettant de suivre ces formations.
Une subvention est ainsi aujourd’hui attribuée aux cinq organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel, ainsi qu’à l’Union nationale des syndicats autonomes (UNSA), et à douze instituts du travail, dont dix sont rattachés à des universités. Ces subventions sont, depuis 2005, encadrées par des conventions triennales signées entre le ministère chargé du travail et chacun des organismes.
Pour la nouvelle période de conventionnement 2014-2016, 72 millions d’euros sont prévus en autorisations d’engagement et de l’ordre de 24 millions d’euros en crédits de paiement pour 2014.
D’après les dernières données transmises à votre rapporteur, le nombre de stagiaires ayant reçu une formation dans ces organismes est d’un peu plus de 46 000 en 2012, la grande majorité d’entre eux ayant été formés dans les centres directement rattachés aux organisations syndicales (environ 42 500 stagiaires en 2012).
S’agissant des stages organisés dans les centres intégrés aux organisations syndicales, le nombre de jours de formation s’est établi à 9 225 en 2012, pour 3 359 stages et un coût moyen d’une journée-stagiaire de l’ordre de 219 euros.
S’agissant des stages organisés par les instituts du travail, le nombre de jours de formation s’est établi à 909 en 2012, pour 287 stages et un coût moyen d’une journée-stagiaire de l’ordre de 180 euros.
Dans le secteur agricole, les financements afférents à la formation syndicale s’adressent aussi aux organisations professionnelles d’employeurs, et pas seulement aux organisations syndicales de salariés. Les articles L. 6122-4 du code du travail et L. 718-2-2 du code rural et de la pêche maritime prévoient une participation financière de l’État à ce dispositif de formation, destiné tant aux salariés des exploitations, qu’aux exploitants eux-mêmes, aux aides familiaux et aux salariés et non-salariés des secteurs para-agricoles et agro-alimentaires qui exercent des responsabilités syndicales. Le ministère de l’agriculture finance cette formation à hauteur de 5,7 millions d’euros pour 2014.
b. Le financement de la formation des conseillers prud’hommes
Aux termes de l’article L. 1442-1 du code du travail, l’État organise et finance la formation des conseillers prud’hommes : il agrée à cet effet pour cinq ans des instituts du travail et des organismes rattachés aux organisations professionnelles et syndicales ayant obtenu au moins 150 sièges de conseillers prud’hommes répartis dans au moins 50 départements aux dernières élections prud’homales.
Pour la période 2009-2013, dix-huit structures ont été agréées : six instituts du travail rattachés à des universités, six associations rattachées à des organisations syndicales de salariés et six associations rattachées à des organisations professionnelles d’employeurs.
Des conventions-cadres quinquennales définissent, pour la période couverte, le nombre prévisionnel maximum de jours de formation à organiser, leur répartition par an et le montant de l’aide financière correspondante. Le financement tient compte à la fois des frais variables, engagés pour une session de formation, et des frais fixes, en particulier des frais de structure de ces organismes.
Pour la période 2009-2013, le financement de la formation des conseillers prud’hommes a ainsi représenté un budget de 42 millions d’euros pour l’État.
D’après les informations transmises à votre rapporteur, en 2012, 1 520 sessions de formation ont été organisées, auxquelles ont participé environ 10 000 conseillers : 33 000 journées de formation ont été financées pour un montant total de 7 millions d’euros. Pour 2014, 6,85 millions d’euros sont prévus à ce titre, destinés à permettre le financement de 32 000 jours de formation.
c. Des subventions publiques plus ponctuelles
L’État est amené à apporter un soutien financier ponctuel indirect aux organisations syndicales et patronales à plusieurs titres :
– pour financer les échéances électorales liées au renouvellement des conseillers prud’hommes : à ce titre, 11 millions d’euros en autorisations d’engagement et 7,63 millions d’euros en crédits de paiement sont prévus pour 2014. L’annonce par le Gouvernement de la suppression des élections prud’homales, auxquelles doit se substituer un nouveau mode de désignation des conseillers prud’homaux basé sur la représentativité des organisations syndicales et patronales, devrait conduire à une économie à due concurrence ;
– pour financer les frais engagés au titre des salariés investis de la mission de conseiller du salarié dans les TPE (remboursement à l’employeur du maintien du salaire, des frais de déplacement du conseiller, et versement d’une indemnité forfaitaire annuelle aux conseillers ayant réalisé au moins quatre interventions dans l’année) : l’État apporte ainsi un soutien financier de l’ordre de 1,3 million d’euros à ce titre pour 2014.
– la mesure de l’audience syndicale est également financièrement assumée par l’État : à ce titre, 2,8 millions d’euros sont prévus pour 2014, destinés à régler les dépenses liées à la conduite du projet de mesure de l’audience des organisations syndicales portant sur la période du 2013-2016 (2ème cycle électoral de référence) ;
– enfin, l’État apporte une aide au développement de la négociation collective, à hauteur de 2,43 millions d’euros pour 2014, destinés à financer des actions visant à développer le dialogue social de niveau local ou territorial, notamment pour favoriser la négociation collective là où, du fait de la faiblesse des acteurs locaux, le dialogue social éprouve des difficultés à naître (petites entreprises, artisanat, secteur agricole).
d. Divers financements directs ou indirects
Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs bénéficient enfin d’une série de financements indirects, via leur participation à des instances de réflexion, comme le Conseil économique, social et environnemental (CESE) ou l’Institut de recherche économique et sociale (IRES) ou aux instances consulaires (chambres de commerce et d’industrie, chambres de métiers, chambres d’agriculture). Leur participation à ces instances fait en effet l’objet d’une indemnisation.
On notera en outre que dans le domaine agricole, les organisations syndicales d’exploitants agricoles bénéficient d’une subvention annuelle du ministère de l’agriculture en fonction du nombre de sièges et des suffrages que celles-ci ont respectivement obtenu aux dernières élections aux chambres d’agriculture. Ces montants sont conséquents, puisqu’ils représentent 13,3 millions d’euros pour 2014.
Enfin, les organisations peuvent bénéficier d’un certain nombre de soutiens de la part des collectivités territoriales, qu’il s’agisse de la fourniture de moyens matériels ou de subventions de fonctionnement.
B. UNE OBLIGATION DE TRANSPARENCE DES COMPTES QUI OBLIGE AUJOURD’HUI À CLARIFIER CE FINANCEMENT
À la faveur de la mise en place, par la loi du 20 août 2008, d’une obligation de transparence financière qui s’impose désormais aux organisations syndicales de salariés et aux organisations professionnelles d’employeurs, les conditions actuelles du financement de ces organisations demandent aujourd’hui à être revues.
1. Des organisations aujourd’hui soumises à une obligation de publication et de certification de leurs comptes
Le principe de la transparence des comptes des organisations syndicales et professionnelles a été posé par la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale, puis modifié par la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit qui a allégé ces obligations pour les plus petites d’entre elles.
L’article L. 2135-1 du code du travail soumet en effet les organisations syndicales et professionnelles aux obligations comptables de droit commun prévues à l’article L. 132-12 du code de commerce, autrement dit aux obligations de :
– « procéder à l’enregistrement comptable des mouvements affectant [leur] patrimoine », ces mouvements étant enregistrés chronologiquement ;
– « contrôler, par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l’existence et la valeur des éléments actifs et passifs » de leur patrimoine ;
– et « établir des comptes annuels à la clôture de l’exercice au vu des enregistrements comptables et de l’inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable ».
L’article 44 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011, aménagé par décret, est ainsi venu compléter ces dispositions pour prévoir la possibilité :
– pour les organisations ne dépassant pas le seuil de 230 000 euros de ressources annuelles, d’adopter une présentation simplifiée de leurs comptes, avec la possibilité de n’enregistrer leurs créances et leurs dettes qu’à la clôture de l’exercice ;
– pour les organisations dont les ressources annuelles sont inférieures à 2 000 euros, de tenir simplement un livre enregistrant chronologiquement l’ensemble des mouvements de leur patrimoine.
L’article L. 2135-5 pose le principe de la publicité des comptes de l’ensemble des syndicats, quel que soit le montant de leurs ressources, avec des modalités néanmoins différenciées selon le niveau de ces ressources.
Le tableau suivant, qui figure dans l’étude d’impact, retrace les obligations comptables et de publicité des comptes pesant sur les syndicats en fonction de leur niveau de ressources.
Ressources de l’organisation |
Forme des comptes |
Mode de publication |
Supérieures à 230 000 euros |
Un bilan Un compte de résultat Une annexe |
Site internet dédié de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) |
Entre 2 000 et 230 000 euros |
Un bilan Un compte de résultat Une annexe sous forme simplifiée |
Site internet dédié de la DILA Ou site internet de l’organisation Ou dépôt en Direccte |
Inférieures à 2 000 euros |
Livre mentionnant chronologiquement le montant et l’origine des ressources et des dépenses |
Site internet dédié de la DILA Ou site internet de l’organisation Ou dépôt en Direccte |
Enfin, les articles L. 2135-6 et D. 2135-9 imposent à toute organisation dont les ressources excèdent 230 000 euros par an de désigner au moins un commissaire aux comptes et un suppléant, autrement dit, de faire procéder à la certification de leurs comptes.
Le règlement n° 2009-10 du 3 décembre 2009 du Comité de la réglementation comptable afférent aux règles comptables des organisations syndicales prévoit notamment que les organisations syndicales insèrent, en annexe de leurs comptes, un tableau comprenant le montant des cotisations reçues et des cotisations reversées, ainsi que les subventions perçues, afin de justifier le montant total de leurs ressources. Le règlement précise également que « les mises à disposition de personnes et de biens font l’objet d’une information qualitative : nombre de personnes mises à disposition, fonction et durée ». En vertu de l’article L. 2135-2, le règlement prévoit enfin que s’agissant des entités contrôlées par les organisations syndicales ou patronales (sans lien d’adhésion ou d’affiliation), la méthode de présentation des comptes peut suivre deux options : celle de la consolidation des comptes, ou encore la technique dite de l’« agrafage », qui conduit à fournir, en annexe, les comptes de ces entités, ainsi qu’une information sur la nature du lien de contrôle.
2. Un financement aujourd’hui peu lisible qui demande à être profondément revu
Si l’obligation de transparence financière des comptes des organisations syndicales et patronales a permis d’améliorer la lisibilité de leur financement, des sources de confusion et d’opacité demeurent, qui nuisent grandement aux organisations elles-mêmes. En effet, les financements issus du paritarisme obéissent à des règles aussi diverses qu’il existe d’organismes gérés paritairement, et les fondements juridiques de ces financements sont souvent fragiles, relevant parfois davantage de l’usage que d’une règle solidement établie.
S’agissant spécifiquement des financements issus de la formation professionnelle, le problème est encore plus aigu : comme le note l’étude d’impact, les financements bénéficiant aux organisations syndicales et patronales à ce titre sont directement corrélés au niveau de la collecte « et acquittés selon des proportions inégales entre les entreprises selon leur choix de politique de formation ». « Une telle mécanique génère une imbrication insatisfaisante entre l’intérêt de la politique publique de formation et la dynamique de financement des organisations ».
Des progrès ont indéniablement été réalisés en matière de transparence du financement des missions liées au paritarisme, en particulier à travers l’accord national interprofessionnel du 17 février 2012 relatif à la modernisation et au fonctionnement du paritarisme, qui pose des règles uniformes applicables à l’ensemble des organismes gérés paritairement pour le défraiement des mandataires et le remboursement à l’employeur du maintien de leur rémunération, et qui accroît également les exigences de transparence financière et de contrôle interne.
Un nouveau pas doit néanmoins être franchi, dans la mesure où ces progrès n’ont toutefois pas permis à ce stade d’opérer une réelle déconnexion entre le financement des organisations syndicales et patronales et la gestion paritaire desdits organismes. C’est à l’aune de ce constat qu’il est aujourd’hui proposé la mise en place d’un fonds unique paritaire dédié au financement des organisations syndicales et patronales.
Le but est d’obtenir une meilleure lisibilité avec une distinction opérée, d’une part, entre les ressources propres des syndicats (cotisations des adhérents, autres ressources propres) et d’autre part, le reste des financements, dont la lisibilité sera assurée et contrôlée à travers le fonds.
II. LES NOUVELLES MODALITÉS DE FINANCEMENT : LA CRÉATION D’UN FONDS PARITAIRE AD HOC QUI CENTRALISE L’ENSEMBLE DES RESSOURCES DES SYNDICATS PROFESSIONNELS
Le I du présent article insère une nouvelle section III dans le chapitre V, consacré aux ressources et aux moyens des syndicats, au sein du titre III, qui fixe le statut juridique, les ressources et les moyens des syndicats professionnels, dans le cadre du livre premier de la deuxième partie du code du travail, consacré aux relations collectives du travail, et plus particulièrement aux syndicats professionnels. Cette nouvelle section est consacrée au « financement mutualisé des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs », qui passe principalement par la mise en place d’un fonds paritaire dédié de financement de ces organisations.
L’objectif est bien de fixer un nouveau cadre de financement des organisations syndicales et patronales par la mise en place de ce fonds, en définissant précisément la nature des ressources qui lui sont affectées, ainsi que la gouvernance d’ensemble de ce nouveau système tant dans la répartition des fonds qu’il sera amené à opérer que dans leur contrôle.
A. UN FONDS QUI DOIT, DANS LA MESURE DU POSSIBLE, ÊTRE LE FRUIT DE LA NÉGOCIATION COLLECTIVE
Le nouvel article L. 2135-9 prévoit la mise en place d’un fonds paritaire de financement des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs par le biais d’un accord national interprofessionnel. Cet accord définit l’organisation et le fonctionnement de ce fonds, conformément aux dispositions légales prévues par le présent article.
L’accord portant création du fonds doit être soumis à l’agrément du ministre chargé du travail. Ce n’est qu’à défaut de conclusion d’un accord ou à défaut d’agrément de cet accord par le ministre que la création du fonds et la définition de son organisation et de son fonctionnement a vocation à être fixée par décret.
La nature « paritaire » du fonds, dont la gouvernance fait l’objet de plus amples développements dans la suite du présent commentaire, se justifie par son objet même. On aurait certes pu imaginer de recourir à une structure juridique différente, sous la forme par exemple de la mise en place d’un établissement public ou encore d’une autorité indépendante. Un mode de gouvernance paritaire constitue néanmoins la seule option de nature à garantir l’autonomie des syndicats, ceux-ci disposant, rappelons-le, de la personnalité civile (article L. 2132-1).
C’est aussi ce souhait de préserver l’autonomie des syndicats qui a conduit à confier à la négociation au niveau national et interprofessionnel le soin de créer ce fonds. Il est en effet légitime que les organisations concernées puissent être décisionnaires s’agissant des règles de leur propre financement. Ce n’est que le cas échéant, à défaut d’accord ou en cas de refus du ministre d’agréer un éventuel accord qui serait intervenu à ce sujet, que le pouvoir réglementaire sera amené à intervenir. Cette négociation a néanmoins vocation à intervenir rapidement : le VII du présent article prévoit en effet que le fonds paritaire doit être opérationnel au 1er janvier 2015.
Le nouvel article L. 2135-9 précise que ce fonds assure une « mission de service public » en apportant une contribution au financement des organisations, « au titre de leur participation à la conception, la mise en œuvre, l’évaluation ou le suivi d’activités qui concourent au fonctionnement et au développement du dialogue social ». Autrement dit, le fonds a bien vocation à ne financer les organisations qu’au titre de leur mission de service public, le financement de la représentation des intérêts catégories ayant vocation à demeurer assuré par les cotisations des adhérents.
Le fonds paritaire ne sert que comme outil centralisateur et redistributeur des ressources qui lui sont affectées, à destination des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs. Il n’a donc pas vocation à assurer lui-même une quelconque autre mission que celle du financement des syndicats.
B. LES RESSOURCES ET LES DÉPENSES DU FONDS
1. Les ressources du fonds
Le I du nouvel article L. 2135-10 énumère l’ensemble des ressources affectées au fonds, qui sont au nombre de quatre, dont deux ressources obligatoires et deux ressources « éventuelles ».
Le 1° du I du nouvel article L. 2135-10 prévoit, en premier lieu, que le fonds paritaire est alimenté par une contribution unique des employeurs de droit privé, assise sur la masse salariale. Cette contribution est, plus précisément, assise sur les rémunérations versées aux travailleurs et qui entrent dans l’assiette des cotisations sociales, telle qu’elle est définie à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime. Il s’agit de la mention très classiquement retenue pour viser l’ensemble des salaires, avantages en argent ou en nature, indemnités, etc. qui entrent dans l’assiette des cotisations sociales.
Le taux de cette contribution à la charge des employeurs doit être fixé par l’accord national interprofessionnel portant création du fonds, tel qu’agréé par le ministre chargé du travail ; à défaut d’un tel accord ou à défaut de son agrément par le ministre, ce taux doit être fixé par décret. En tout état de cause, le texte prévoit qu’il ne peut être inférieur à 0,014 % de la masse salariale nationale, ni supérieur à 0,02 %.
Cette contribution des employeurs a vocation à se substituer aux deux ressources actuelles suivantes :
– les sommes issues du FONGEFOR et des « préciputs » versés par les OPCA ;
– le financement, par les entreprises, du congé de formation économique et sociale syndicale des salariés, prévu à l’article L. 3142-1, plus connu sous le nom de « 0,08 », dans la mesure où ce financement est aujourd’hui assuré dans la limite d’un plafond de 0,08 ‰ des salaires versés dans l’année.
À quoi correspond la fourchette comprise entre 0,014 % et 0,2 % de la masse salariale, fixée par le nouvel article L. 2135-10 ?
D’après les informations recueillies par votre rapporteur, elle répond au souhait de laisser les partenaires sociaux libres d’intégrer également dans cette contribution des financements qui auraient demain vocation à se substituer aux actuels financements assumés par d’autres organismes paritaires que les OPCA, par exemple l’Unédic, l’AGIRC-ARRCO, l’UESL, l’AGEFIPH, l’APEC ou encore les caisses de sécurité sociale.
Le taux minimal de 0,014 % de la masse salariale nationale représente un montant d’environ 75 millions d’euros, correspondant d’une part à la somme du FONGEFOR et aux préciputs versés par les OPCA pour un montant d’environ 65 millions d’euros, et d’autre part, à la mutualisation du financement du congé de formation au sein du « 0,08 », qui représente aujourd’hui de l’ordre de 10 millions d’euros. La fixation du taux minimal à 0,014 % de la masse salariale vise donc à garantir aux organisations syndicales et patronales un niveau de financement équivalent à celui qu’elles perçoivent aujourd’hui à partir de ces deux ressources auxquelles la contribution unique des employeurs doit se substituer.
Le taux maximal de 0,02 % de la masse salariale correspond quant à lui à un montant d’environ 110 millions d’euros, ce niveau permettant de laisser une marge de manœuvre suffisante aux partenaires sociaux pour intégrer, s’ils le souhaitent, l’ensemble des « préciputs » versés par les organismes paritaires et ne correspondant pas à des remboursements et défraiements de frais individuels engagés par les personnes mandatées pour siéger au sein de ces instances.
Autrement dit, le texte souhaite laisser aux organisations la possibilité de faire prendre en charge demain, par cette contribution des employeurs, des sommes aujourd’hui acquittées par les instances paritaires elles-mêmes.
En conséquence, le FONGEFOR a vocation à disparaître avec la création du fonds paritaire, de même que le « 0,08 ‰ » au titre du financement par les employeurs du congé de formation économique et sociale syndicale des salariés des entreprises de plus de dix salariés. Aucune disposition législative n’est requise pour la suppression programmée du premier, celui-ci n’ayant d’assise juridique que réglementaire. En revanche, s’agissant du second, l’article L. 3142-8 du code du travail, qui prévoit ce financement par l’employeur, est bien abrogé par le IV du présent article.
Enfin, c’est l’article 5 du présent projet de loi qui tire les conséquences de la mise en place de cette contribution unique des employeurs qui a vocation à « absorber » les financements actuels des organisations syndicales et patronales par les OPCA : en effet, le I de cet article insère un III dans l’article L. 6332-1 relatif aux OPCA, pour poser clairement l’interdiction de tout « financement direct ou indirect des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs » par les OPCA, sous la réserve de la possibilité de rembourser, « sur présentation de justificatifs, les frais de déplacement, de séjour et de restauration engagés par les personnes qui siègent au sein des organes de direction de cet organisme ».
Le 2° du I du nouvel article L. 2135-10 prévoit, en second lieu, que le fonds est « le cas échéant » financé par « une participation volontaire d’organismes à vocation nationale dont le champ d’intervention dépasse le cadre d’une ou plusieurs branches professionnelles gérées majoritairement par les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs ». La liste de ces organismes doit être fixée par l’accord national interprofessionnel portant création du fonds paritaire, ou, à défaut d’accord ou de son agrément, par décret.
La formulation retenue, qui fait de cette participation une participation « éventuelle », est liée à la possibilité, déjà indiquée, ouverte aux partenaires sociaux d’opérer un transfert du financement actuel par les organismes paritaires vers un financement par la future contribution des employeurs. Autrement dit, soit les organisations syndicales et patronales prévoient, dans le cadre de leur accord, un financement supplémentaire au titre de la contribution des employeurs destiné à absorber, en tout ou partie, les actuels financements des organismes paritaires, soit, en l’absence d’une telle intégration, les organismes paritaires seront amenés à contribuer de manière individuelle au financement des organisations syndicales et patronales via le fonds paritaire.
D’après les informations transmises à votre rapporteur, concrètement, les partenaires sociaux seront vraisemblablement amenés, dans le cadre de leur accord, à fixer le taux de la contribution des employeurs en fonction de ce que celle-ci intègrera ou non une partie des actuels financements issus des organismes paritaires. Pour le reste de ces financements, qui ne seraient pas intégrés dans la contribution des employeurs, les partenaires sociaux fixeront le niveau de participation de chaque organisme paritaire, ces financements ayant d’ailleurs vocation à se substituer strictement aux financements actuels à ce titre. La notion de « contribution volontaire » est essentiellement liée au souhait de ne pas faire basculer ces contributions que les organismes paritaires verseraient individuellement au fonds dans la catégorie des impositions de toute nature.
S’agissant de la liste de ces organismes gérés paritairement, si elle n’est pas connue de manière exhaustive à ce stade, elle doit correspondre peu ou prou aux actuelles instances paritaires qui participent au financement des organisations syndicales et patronales, c’est-à-dire essentiellement les caisses de sécurité sociale et l’ACOSS, l’Unédic, l’AGIRC-ARRCO, l’AGEFIPH, l’APEC, l’UESL.
Les conséquences de la mise en place de nouvelles ressources à destination du fonds paritaire : la suppression de tout autre financement, direct ou indirect, des organisations syndicales et patronales par les organismes gérés paritairement
En conséquence des ressources mises en place dans le cadre des 1° et 2° du nouvel article L. 2135-10, le nouvel article L. 2135-17 prévoit de mettre un terme aux modalités de financement actuelles des organisations syndicales et patronales par les organismes paritaires, y compris par le FONGEFOR, qui a vocation à disparaître.
Il consacre l’interdiction pour tout organisme géré paritairement qui figure sur la liste qui sera dressée par accord, ou le cas échéant, par décret, de financer, directement ou indirectement, des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs, dès lors que le conseil d’administration d’un tel organisme a décidé le versement d’une participation volontaire au fonds paritaire.
Ce nouvel article L. 2135-17 précise néanmoins que ces mêmes organismes paritaires peuvent rembourser, sur présentation de justificatifs, les frais de déplacement, de séjour et de restauration engagés par les personnes qui siègent aux organes de direction de ces organismes.
Cette souplesse doit être conservée : en effet, la prise en charge directe de ces frais – sur la base des frais réels – par les organismes paritaires correspond à un besoin d’organisation pratique de leur fonctionnement. Dès lors qu’elle est réalisée ex post, sur la base des frais réellement engagés, une telle procédure de financement direct ne pose pas de difficulté. En outre, ces paiements sont bien destinés aux administrateurs eux-mêmes, intuitu personae, et non à l’organisation syndicale ou patronale à laquelle ils adhèrent. Autrement dit, il ne s’agit pas à proprement parler de financement des organisations. Une telle séparation présente donc également l’avantage de permettre dorénavant de distinguer précisément ce qui relève du financement des organisations et ce qui relève du défraiement des administrateurs. Les sommes qui sont destinées aux organisations recouvriront donc bien les coûts relatifs à la formation des administrateurs, à l’indemnisation de leur perte de salaire, aux frais de secrétariat technique, à l’expertise ou encore à la communication.
Pour rappel, s’agissant des OPCA, cette interdiction de tout financement, direct ou indirect, des organisations syndicales et patronales, hors de la contribution versée au fonds, et hors remboursement des frais directement occasionnés par l’exercice de la mission des administrateurs, est consacrée par l’article 5 du présent projet de loi.
Le 3° du I du nouvel article L. 2135-10 prévoit que le fonds paritaire est également financé par une subvention de l’État.
Celle-ci a vocation à recouvrir les financements actuels de l’État de la formation économique, sociale et syndicale des salariés appelés à exercer des fonctions syndicales, prévue à l’article L. 2145-3, et destinée aux centres rattachés aux organisations syndicales. En effet, la subvention actuelle de l’État finance également pour partie des instituts du travail rattachés à des universités. Ainsi, pour 2014, les financements de l’État à ce titre représentent 22,32 millions d’euros, dont 21 millions d’euros sont destinés aux centres de formation des organisations syndicales et 1,3 million d’euros les instituts internes aux universités. Seule la première dotation, qui en représente cependant l’essentiel, est destinée à être réaffectée au fonds paritaire, le subventionnement des instituts supérieurs demeurant réalisé directement par le ministère du travail sur la base d’un conventionnement.
En conséquence du transfert de cette subvention de l’État au fonds paritaire, le III du présent article propose une refonte de la rédaction de l’article L. 2145-3 déjà cité qui définit la contribution de l’État au financement de ces formations, pour préciser :
– que l’État participe désormais à leur financement via la contribution prévue au 3° de l’article L. 3125-10, affectée au fonds paritaire, ainsi que par une subvention distincte, directement versée aux instituts internes aux universités au titre de cette mission ;
– que cette formation bénéficie également aux « adhérents à une organisation syndicale amenés à intervenir au bénéfice des salariés », cette modification faisant l’objet d’une analyse plus approfondie dans la suite du présent commentaire d’article.
La subvention de l’État au fonds paritaire a néanmoins vocation à être plus importante et à inclure également une nouvelle dotation, destinée à contribuer au financement de la participation des organisations syndicales et patronales à la construction des politiques publiques relevant de la compétence de l’État, notamment dans le cadre des négociations, consultation et concertations menées sous son égide et qui conduisent à solliciter de plus en plus les partenaires sociaux préalablement à l’initiative législative.
D’après les informations contenues dans l’étude d’impact, le montant de la subvention publique de l’État sera déterminé par décret, la charge qu’elle représente pouvant être estimée autour de 5 millions d’euros. Cette charge nouvelle sera financée par réaffectation d’une partie des crédits prévus au titre des élections prud’homales, qui doivent, conformément au projet de loi n° 1722 relatif à la désignation des conseillers prud’hommes, déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale le 22 janvier 2014, être remplacées par un mécanisme de désignation qui permettra de dégager des économies. Rappelons que dans le cadre de la loi de finances pour 2014, 11,1 millions d’euros en autorisations d’engagement et 7,6 millions d’euros en crédits de paiement sont prévus pour financer le marché d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour l’organisation de cette opération de renouvellement des 14 500 conseillers prud’hommes.
Enfin, le 4° du I du nouvel article L. 2135-10 prévoit, « le cas échéant », que le fonds paritaire puisse être financé par « toute autre ressource prévue par des dispositions législatives ou réglementaires, par accord conclu entre les organisations d’employeurs et syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel ou par accord de branche étendu ».
Il s’agit par là d’une part d’aménager le caractère potentiellement évolutif du fonds paritaire, que ce soit par la loi ou sur une base conventionnelle. En effet, il est tout à fait possible de concevoir à l’avenir que les organisations syndicales et patronales soient amenées à voir leurs missions renforcées au titre du dialogue social. Un financement complémentaire spécifiquement prévu par la loi ou par un accord collectif doit par conséquent également pouvoir être envisagé.
D’autre part, cette possibilité de mise en place d’une ressource complémentaire doit permettre aux branches qui ont négocié des accords de financement du dialogue social d’inscrire leur accord dans la mécanique générale du fonds paritaire : c’est, on l’a vu, le cas dans le secteur agricole comme dans celui de l’artisanat. Ces financements pourraient ainsi à l’avenir être « réinjectés » vers le fonds paritaire : le texte en ouvre du moins la possibilité. Un tel basculement aurait l’avantage de contribuer à la lisibilité du financement des organisations, tout en simplifiant la collecte des fonds. Notons que ces financements demeureraient « sanctuarisés » au profit des organisations auxquelles ils bénéficient aujourd’hui, grâce au « fléchage » instauré par le projet de loi (voir infra).
Le II du nouvel article L. 2135-10 précise les modalités de recouvrement et de contrôle de la nouvelle contribution des employeurs mentionnée au 1° du I : il s’agit des modalités de droit commun applicables aux cotisations sociales, qui sont recouvrées par les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) mentionnées à l’article L. 213-1 du code de la sécurité sociale pour le régime général ; par les caisses générales de sécurité sociale mentionnées à l’article L. 752-4 du même code pour les départements d’outre-mer ; et par les caisses de mutualité sociale agricole mentionnées à l’article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime pour le régime agricole.
2. Les dépenses du fonds
Le nouvel article L. 2135-11 précise que le fonds a vocation à financer quatre types d’activités, « qui constituent des missions d’intérêt général » pour les organisations concernées. Il instaure un système de « fléchage », en indiquant, pour chaque catégorie de dépense, la nature de la ou des recettes qui s’y rapporte.
En vertu du 1° du nouvel article L. 2135-11, le fonds a vocation à financer « la conception, la gestion, l’animation et l’évaluation des politiques menées dans le cadre des organismes gérés majoritairement par les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs ». Il s’agit là des missions confiées aux partenaires sociaux au titre de la gestion du paritarisme, c’est-à-dire de l’ensemble des instances à la gestion desquelles ils participent aujourd’hui dans le domaine de la sécurité sociale, de l’insertion professionnelle, de la formation professionnelle, de l’emploi ou encore du logement. Le texte parle des « organismes gérés majoritairement » par les partenaires sociaux et non des organismes gérés paritairement : en effet, pour la plupart d’entre eux, ces organismes ne sont pas rigoureusement « gérés paritairement », puisque siègent également à leurs organes délibératifs des personnalités qualifiées, des représentants du personnel, des représentants de l’État parfois.
Ces actions relatives au « paritarisme » sont financées au moyen de la contribution des employeurs et, « le cas échéant », des participations volontaires versées par les organismes gérés paritairement dont le conseil d’administration aurait prévu un financement spécifique des organisations syndicales et patronales à ce titre.
« L’intégralité de ce périmètre n’a », d’après l’étude d’impact, « pas nécessairement vocation à être inclus d’emblée dans le champ de compétence du fonds paritaire », qui évoque une « approche graduée » qui conduirait au fur et à mesure des concertations menées avec les partenaires sociaux et les organismes concernés à une intégration progressive dans le champ du fonds paritaire des financements actuels.
Le 2° du nouvel article L. 2135-11 prévoit que le fonds finance la participation des organisations « à la conception, à la mise en œuvre et au suivi des politiques publiques relevant de la compétence de l’État, notamment par la négociation, la consultation et la concertation ». Cette mission d’intérêt général et de service public a logiquement vocation à être financée exclusivement par la subvention de l’État.
Les missions des organisations patronales et syndicales à ce titre sont multiples, qu’il s’agisse de la négociation collective préalable à l’initiative législative prévue à l’article L. 1, les concertations formelles et informelles qui sont menées au niveau central comme au niveau local, ou encore la participation des partenaires sociaux à des organismes consultatifs, comme le Conseil économique, social et environnemental (CESE).
Ces missions se sont très largement étendues dans les dernières années, et cette vision extensive du rôle des partenaires sociaux et de la négociation collective a vocation à perdurer, comme en témoigne le souhait de donner au dialogue social une assise constitutionnelle. Or, aucun financement n’est aujourd’hui spécifiquement prévu à cet effet. Ce sera désormais le cas au travers de la subvention de l’État versée au fonds paritaire.
En vertu du 3° du nouvel article L. 2135-11, le fonds paritaire a également vocation à financer la formation économique, sociale et syndicale des salariés appelés à exercer des fonctions syndicales, notamment l’indemnisation des salariés bénéficiant de congés de formation, l’animation des activités des salariés exerçant des fonctions syndicales, ainsi que leur information sur les actions menées paritairement et en appui des politiques publiques.
La formation économique, sociale et syndicale doit être financée par la contribution des entreprises et par la contribution de l’État.
Ce volet de financement de la formation, – qui existe déjà aujourd’hui, et qui est financé essentiellement par l’État, mais également pour partie par les employeurs, sous la forme du 0,08 ‰ s’agissant du congé de formation économique et syndicale des salariés -, doit favoriser le développement des compétences des acteurs syndicaux, enjeu essentiel au regard de l’élargissement permanent du périmètre de la négociation collective qui va de pair avec sa complexification.
Ces actions de formation financées par le fonds paritaire appellent plusieurs remarques.
On remarquera tout d’abord que ce financement doit également concerner la formation économique, sociale et syndicale des « adhérents à une organisation syndicale amenés à intervenir au bénéfice des salariés ». Il s’agit là d’un ajout par rapport au dispositif actuel de financement de la formation des salariés exerçant des fonctions syndicales, destiné à rendre éligibles à ce financement des adhérents non-salariés – retraités ou agents publics - des organisations syndicales, qui peuvent être appelés à exercer des fonctions bénéficiant aux salariés du secteur privé, sous la forme par exemple des conseillers du salarié ou de fonctions de renseignement ou de permanence juridique. Les organisations syndicales sont en effet aujourd’hui confrontées à une pénurie militante dans certains domaines : la possibilité d’assurer la formation de ces adhérents non-salariés peut ainsi répondre en partie à cette difficulté. En conséquence de cet élargissement du financement de la formation syndicale à de simples adhérents non-salariés, le II du présent article modifie le champ de l’article L. 2145-2 relatif à la formation syndicale en précisant que ces nouveaux publics peuvent donc désormais également en bénéficier.
On remarquera ensuite à ce titre que la formation des conseillers prud’hommes n’est pas intégrée dans le périmètre des missions éligibles au financement mutualisé via le fonds paritaire, alors qu’elle relève pourtant incontestablement d’une mission éminente d’intérêt général, par le biais de l’exercice de pouvoirs juridictionnels confiés à des représentants élus des salariés et des employeurs. La formation des conseillers prud’hommes étant assurée majoritairement par des associations, il a été jugé préférable de conserver le système actuel de conventionnement direct avec le ministère chargé du travail pour leur financement, au regard de la mission régalienne attachée à la fonction prud’homale.
S’agissant du congé de formation économique, sociale et syndicale prévu aux articles L. 3142-7 et suivants, il est, comme on l’a dit, aujourd’hui financé par une contribution spécifique des entreprises de plus de 10 salariés, dans la limite d’un plafond fixé à 0,08 ‰ des salaires versés dans l’année par l’entreprise.
On notera que le V du présent article modifie à la marge les modalités du congé de formation économique et sociale et de formation syndicale des salariés, en réduisant de deux jours à une demi-journée la durée minimale de chaque congé. En effet, ce congé n’a aucunement vocation à être supprimé : il sera simplement financé de manière mutualisée par le fonds, par la mobilisation d’une quote-part de la contribution unique des employeurs. Cette modification présente l’avantage d’élargir le financement de ce congé de formation, qui n’est aujourd’hui financé que par les entreprises de plus de 10 salariés au profit des salariés de ces mêmes entreprises.
La diminution de la durée minimale de chaque congé ne modifie en rien la durée du congé elle-même qui est fixée au maximum à douze jours au total (article L. 3142-9) : elle vise simplement à faciliter ses modalités d’exercice en permettant un fractionnement en demi-journées et non plus uniquement en sessions de deux jours. Il sera ainsi plus aisé aux salariés, en particulier ceux des plus petites entreprises, d’organiser un tel congé sans devoir programmer une absence prolongée de leur poste de travail.
Enfin, le 4° du nouvel article L. 2135-11 dispose que le fonds paritaire contribue à financer toute autre mission d’intérêt général à l’appui de laquelle sont prévues d’autres ressources sur le fondement d’une disposition législative ou sur une base conventionnelle. Cette catégorie de dépenses répond, par effet de miroir, à la disposition spécifique prévue s’agissant des ressources du fonds paritaire, et prévoyant qu’à l’avenir, de nouvelles ressources peuvent lui être affectées au titre de missions d’intérêt général qui auront été confiées aux partenaires sociaux par la loi ou par accord national interprofessionnel ou par accord de branche. Il s’agit bien de tenir compte des potentialités d’évolution des missions confiées aux partenaires sociaux. Dans l’hypothèse d’une « remontée » des fonds actuellement collectés en vertu des accords dits de financement du paritarisme, cette ligne de dépense isolée garantira également que ces fonds demeureront sanctuarisés, et continueront de bénéficier aux seules organisations auxquelles ils bénéficient aujourd’hui en application de tels accords, autrement dit, principalement, aux organisations professionnelles du champ de l’artisanat et de l’agriculture.
Au total, on le voit, la configuration budgétaire du fonds est dessinée à travers ce nouvel article L. 2135-11 : le budget du fonds sera vraisemblablement scindé en sections distinctes, chaque type de ressource étant destiné à une ou plusieurs catégories de dépenses, toute fongibilité entre les différentes catégories de dépenses financées par des catégories de ressources différentes étant interdite.
C. LES BÉNÉFICIAIRES DU FONDS PARITAIRE
Le nouvel article L. 2135-12 détermine les catégories d’organisations bénéficiaires des crédits du fonds paritaire, à raison de leur éligibilité à chaque catégorie de dépenses du fonds. Le nouvel article L. 2135-3 fixe les modalités de répartition des crédits du fonds au titre de chaque catégorie de dépenses qu’il est amené à financer.
1. Les missions liées au paritarisme
En vertu du 1° du nouvel article L. 2135-12, sont éligibles au financement par le fonds paritaire les organisations d’employeurs et de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, leurs organisations territoriales, ainsi que celles représentatives au niveau de la branche, à raison de leur mission à ce titre.
Seront donc également financées au titre de cette mission, outre les organisations représentatives au niveau national et interprofessionnel, les organisations représentatives au niveau de la branche, qui ne perçoivent aujourd’hui des financements qu’au titre des « préciputs », et ont donc vocation à être expressément mentionnées ici. En effet, en matière de formation professionnelle, la structuration de l’offre de formation passe principalement par les branches – il existe en effet de nombreux OPCA « de branche » - : le rôle important des branches s’agissant de la gestion paritaire de la formation professionnelle continue justifie à lui seul que les branches soient explicitement bénéficiaires des financements du fonds au titre des missions liées au paritarisme.
Le texte mentionne également les organisations territoriales des confédérations nationales représentatives, dans la mesure où, par exemple, de nombreuses instances paritaires régionales réunissent les représentants syndicaux à ce niveau, l’indemnisation et le défraiement de ces personnes mandatées devant donc intervenir à ce niveau.
La répartition des crédits au titre de ces politiques est opérée, comme en dispose le 1° du nouvel article L. 2135-13, à parité entre les organisations syndicales de salariés d’une part, les organisations professionnelles d’employeurs d’autre part, au niveau national, et au niveau de la branche. Il revient à un décret de fixer les modalités de répartition des crédits au sein de chacun des deux « collèges », selon la règle suivante : au sein du « collège syndical », les fonds sont répartis de façon uniforme entre les différentes organisations, tandis qu’au sein du « collège patronal », la répartition est opérée en fonction de l’audience ou du nombre de mandats paritaires exercés pour les organisations professionnelles d’employeurs.
Le principe du partage « à parité » des financements liés au paritarisme est tout à fait logique. Il s’agit d’ailleurs du principe qui s’applique déjà aujourd’hui au titre des « préciputs » versés par les organismes gérés paritairement, dans la mesure où leurs organes de direction sont tous composés à parité de représentants des employeurs et de représentants des salariés. C’est également le cas pour les « préciputs » versés par les OPCA, de même que pour les fonds répartis par le FONGEFOR.
En revanche, la répartition des sommes entre organisations syndicales d’une part, et entre organisations patronales d’autre part, est aujourd’hui « à géométrie variable », du moins du côté patronal.
Du côté syndical, les sommes font, dans la grande majorité des cas, l’objet d’une répartition uniforme entre les cinq grandes centrales syndicales. Les moyens du FONGEFOR à destination des organisations syndicales sont ainsi répartis à égalité. Le nombre des mandats d’administrateur est quasiment toujours le même pour chaque organisation dans tous ces organismes : c’est le cas à l’AGEFIPH, à l’Unédic, dans la plupart des OPCA – dès lors que l’ensemble des organisations syndicales sont signataires -, à l’ARRCO ou encore à l’UESL. Il faut toutefois évoquer quelques exceptions, non des moindres : si l’AGIRC accorde, pour des raisons légitimes et évidentes, plus de sièges à la CFE-CGC dans ses instances de gouvernance, d’autres organismes privilégient une répartition qui distingue entre trois « grandes » confédérations (CGT, CGT-FO et CFDT) et « deux » plus petites confédérations (CTFC et CFE-CGC) : c’est en particulier le cas des caisses nationales de sécurité sociale, qui accordent chacune trois sièges respectivement à chacun des trois « grands » syndicats, contre deux sièges à chacun des trois « petits » syndicats.
Dès lors, on le voit, le principe de la répartition « uniforme » n’est pas si évident. Il relève d’un choix.
Du côté patronal, la situation est encore beaucoup plus contrastée. En effet, la plupart des organismes confèrent au MEDEF une plus forte représentation au sein de leurs instances de gouvernance par rapport à la CGPME et à l’UPA.
Au sein même des caisses nationales de sécurité sociale, la répartition des sièges diffère selon les caisses. Au conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) et de la Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV), le MEDEF dispose de sept sièges, contre trois respectivement pour la CGPME et l’UPA. Le MEDEF dispose en revanche d’un siège de moins au conseil d’administration de la Caisse nationale d’allocations familiales (CNAF) comme de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS), en raison de la présence à ces instances de l’Union nationale des professions libérales (UNAPL). Les instances de gouvernance de l’AGIRC-ARRCO avantagent également fortement le MEDEF, de même que celui-ci dispose d’une plus forte représentation au conseil d’administration de l’Unédic, avec trois sièges, contre un chacun pour la CGPME et l’UPA. Cette même configuration prévaut au sein de l’AGEFIPH, la situation étant encore plus déséquilibrée à l’UESL, où le MEDEF dispose de quatre sièges, la CGPME d’un siège, alors que l’UPA en est absente.
S’agissant des OPCA, les contrastes tiennent largement au fait que ne sont financées que les organisations signataires de l’accord constitutif de l’OPCA. Quand bien même plusieurs organisations patronales seraient signataires, dans les faits, de nombreux OPCA ne sont gérés que par une seule organisation, qui perçoit donc seule des « préciputs » à ce titre. Ainsi, l’Union des industries et des métiers de la métallurgie (UIMM) est-elle l’unique gestionnaire patronal de l’OPCA du secteur, OPCAIM. C’est le cas également pour l’Union des employeurs de l’économie sociale et solidaire (UDES) avec l’OPCA Uniformation, pour le MEDEF avec OPCALIA et pour la CGPME avec l’AGEFOS-PME.
Enfin, s’agissant du FONGEFOR, on l’a vu, la clé de répartition des fonds à destination des organisations patronales, décidée « en interne », est la suivante : 57,5 % des fonds pour le MEDEF, 32,5 % pour la CGPME et 10 % pour l’UPA.
Du côté patronal, le texte fait le choix d’une clé de répartition alternative : soit la répartition est opérée en fonction de l’audience des organisations d’employeurs, soit elle est répartie en fonction du nombre de mandats paritaires exercés par chaque organisation. Il incombera à l’accord national interprofessionnel de déterminer quelle clé de répartition lui semble la plus légitime. Le fonds devant être opérationnel au 1er janvier 2015, il est clairement impossible d’opter pour une répartition fondée sur la représentativité patronale, dont les résultats ne seront connus qu’aux mois de mai-juin 2017. L’alternative posée par le texte se révèle donc davantage comme une avancée par étapes : dans un premier temps, lors de la création du fonds, et par défaut, en raison de l’absence de disponibilité des données relatives à l’audience des organisations patronales, la clé de répartition se calerait sur la répartition actuelle des mandats au sein des instances délibératives des organismes paritaires concernés, ce qui a également l’avantage d’assurer une stabilité globale des financements par organisation ; une fois que les résultats de l’audience des organisations patronales seront connus, la clé de répartition sera calée sur ces résultats.
Néanmoins, pour la période intermédiaire, les partenaires sociaux devront également régler le cas des fonds issus du FONGEFOR, pour les intégrer dans la clé de répartition « par mandats ».
Dans un second temps, une fois l’audience patronale connue, ces fonds seraient répartis en fonction de ce nouveau critère : en effet, les résultats de l’audience patronale auront également pour effet, potentiellement, de modifier la répartition des mandats des représentants des organisations patronales au sein des organismes gérés paritairement. L’audience sera donc bien, à terme, le critère déterminant, qui a vocation à s’imposer comme le critère ultime de répartition des fonds entre les organisations patronales, s’agissant du moins des missions liées au paritarisme.
2. La mission de participation à la conception, à la mise en œuvre et au suivi des politiques publiques
Le 2° du nouvel article L. 2135-12 déclare éligibles au financement du fonds paritaire, à raison de leur mission à ce titre, les organisations d’employeurs et de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, ainsi que les syndicats de salariés « dont la vocation statutaire revêt un caractère national et interprofessionnel » et ayant recueilli plus de 3 % des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles, additionnés au niveau national et interprofessionnel.
Votre rapporteur s’est interrogé sur ce choix de mettre en place un nouveau critère d’éligibilité aux crédits du fonds paritaire s’agissant de l’appui offert par les organisations syndicales et patronales aux politiques publiques menées par l’État. S’il est tout à fait cohérent que les organisations représentatives au niveau national et interprofessionnel, acteurs du dialogue social national et de ce fait interlocuteurs naturels de l’État dans le cadre de l’actuel article L. 1 du code du travail, soient bénéficiaires des financements du fonds, il serait dommageable d’en exclure purement et simplement les organisations syndicales de salariés qui, sans être représentatives, ont une dimension nationale et interprofessionnelle indéniable et dont le rôle est d’ailleurs tout à fait reconnu par les pouvoirs publics. C’est pourquoi il est fait référence à des organisations à vocation statutaire nationale et interprofessionnelle qui ont en outre recueilli plus de 3 % des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles, additionnés au niveau national. La fixation du seuil à 3 % peut être discutée : d’après les informations transmises à votre rapporteur par le ministère du travail, ce seuil correspond à un niveau suffisamment significatif pour traduire une activité syndicale d’ampleur nationale, dans un nombre de secteur suffisamment diversifié. En pratique, l’UNSA et Solidaires devraient, grâce à la fixation de ces critères, bénéficier des crédits du fonds paritaire au titre de cette mission d’appui aux politiques publiques. En effet, parmi les organisations ayant obtenu une audience inférieure à 8 % au niveau national à l’issue du premier cycle de recueil de l’audience syndicale dont les résultats ont été présentés le 29 mars 2013, ces deux organisations ont respectivement recueilli 4,26 % et 3,47 % des suffrages exprimés.
Conformément au 2° du nouvel article L. 2135-13, la répartition des crédits afférents est opérée sur deux bases forfaitaires identiques, la première s’appliquant aux organisations représentatives au niveau national et interprofessionnel, la seconde s’appliquant, pour un montant inférieur, aux seuls syndicats de salariés ayant une telle ampleur nationale et interprofessionnelle et ayant recueilli plus de 3 % des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles. Ces bases forfaitaires doivent être fixées par décret.
Votre rapporteur n’a obtenu aucune précision, ni même aucun ordre de grandeur s’agissant des bases forfaitaires qui seront respectivement retenues pour les organisations syndicales et patronales représentatives d’une part, pour les organisations syndicales d’envergure nationale et qui ont recueilli plus de 3 % des suffrages aux dernières élections professionnelles d’autre part. D’après le Gouvernement, ces bases forfaitaires « seront d’une ampleur limitée ».
Une telle absence d’éléments est très regrettable, dès lors qu’il s’agit bien ici d’une nouvelle dotation budgétaire, pour laquelle il aurait donc été particulièrement bienvenu que la représentation nationale dispose à tout le moins d’un ordre de grandeur.
La seule certitude concerne donc le principe de cette base forfaitaire unique, à savoir celle d’une somme identique devant bénéficier à chaque organisation représentative au niveau national et interprofessionnel, et, par conséquent, d’une somme identique, mais inférieure, devant bénéficier aux syndicats de salariés non représentatifs, mais dont les résultats aux élections professionnelles et leur envergure statutaire conduit à les rendre éligibles au financement du fonds.
Le problème de la fixation de ce seuil de 3 % réside, d’après un certain nombre de personnes auditionnées par votre rapporteur, dans le fait qu’elle s’apparente à la fixation d’un nouveau seuil de représentativité syndicale : il y aurait en quelque sorte un « degré » de représentativité suffisant pour bénéficier de fonds publics au titre des missions d’intérêt général d’appui aux politiques publiques, sans pour autant que les organisations en question soient représentatives.
3. La mission de formation des acteurs syndicaux
Le 3° du nouvel article L. 2135-12 rend éligibles au financement par le fonds paritaire les seules organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, ainsi que celles « dont la vocation statutaire revêt un caractère national et interprofessionnel » qui ont recueilli plus de 3 % des suffrages aux dernières élections professionnelles, à raison de leur mission à ce titre.
On ne reviendra pas sur le principe du critère d’éligibilité au financement de la formation syndicale d’organisations syndicales non représentatives, mais néanmoins suffisamment reconnues comme telles pour justifier leur éligibilité à ces crédits, dont, rappelons-le, l’UNSA bénéficie déjà aujourd’hui dans les faits, à hauteur d’environ 2 millions d’euros, d’après les informations recueillies par votre rapporteur. L’application de ce critère en matière de financement de la formation syndicale a principalement pour objet de ne pas remettre en cause précisément ces financements déjà existants pour l’UNSA. Il conduira, dans les faits, à rendre également éligible aux crédits du fonds au titre du financement de la formation le syndicat Solidaires. L’objectif est bien de consolider le financement au titre de la formation syndicale d’organisations interprofessionnelles ayant une assise réelle et qui sont pleinement en capacité d’organiser et de structurer une offre de formation syndicale.
Prévue au 3° du nouvel article L. 2135-13, la répartition des crédits afférents est opérée par décret, en fonction de l’audience de chacune des organisations ayant obtenu plus de 3 % des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
Un seul critère prévaudra donc pour la répartition des crédits du fonds au titre de la formation économique, sociale et syndicale des salariés appelés à exercer des fonctions syndicales : celle de l’audience syndicale. Celle-ci est donc la suivante, à l’issue du premier cycle de recueil de l’audience électorale des organisations syndicales au niveau national, tels que publiés le 29 mars 2013.
Organisations syndicales |
Nombre de suffrages valablement exprimés |
Pourcentage des voix obtenues |
Poids relatif (1) |
Organisations ayant obtenu une audience supérieure ou égale à 8 % | |||
CGT |
1 355 927,54 |
26,77 % |
30,62 % |
CFDT |
1 317 111,84 |
26 % |
29,74 % |
CGT-FO |
807 434,60 |
15,94 % |
18,23 % |
CFE-CGC |
477 459,52 |
9,43 % |
10,78 % |
CFTC |
470 824,51 |
9,3 % |
10,63 % |
Organisations ayant obtenu une audience inférieure à 8 % | |||
UNSA |
215 696,14 |
4,26 % |
|
Solidaires |
175 557,67 |
3,47 % |
|
(1) Il s’agit du poids relatif des organisations syndicales sur le seul périmètre des organisations ayant obtenu un score supérieur à 8 % des suffrages valablement exprimés.
La clé de répartition des fonds à ce titre suivra donc le pourcentage de voix obtenues par chaque organisation (jusqu’aux prochains résultats électoraux en 2017), sous réserve de la neutralisation des résultats obtenus par l’ensemble des autres organisations dont les résultats sont inférieurs à 3 %.
*
* *
Le nouvel article L. 2135-14 précise que les organisations représentatives au niveau national et interprofessionnel, ainsi que celles qui sont éligibles au financement du fonds, à certains titres, en raison de leur envergure nationale et de leurs résultats électoraux supérieurs à 3 % des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles, perçoivent les sommes dues aux organisations territoriales et aux organisations syndicales représentatives au niveau de la branche qui leur sont affiliées. Il s’agit là simplement de préciser les circuits de financement : en effet, seules les confédérations seront directement destinataires des crédits du fonds paritaire, à charge pour elles de reverser à leurs structures territoriales ou professionnelles les sommes qui leur reviennent en vertu de leur participation aux différentes missions d’intérêt général au titre duquel elles sont éligibles au financement du fonds.
Le texte évoque les organisations territoriales et les organisations syndicales représentatives au niveau de la branche, afin de tenir compte de la grande diversité de la structuration des grandes organisations syndicales et patronales. En effet, la plupart des organisations syndicales sont constituées d’une part, de fédérations syndicales professionnelles ou de fédérations de branche, et d’autre part, d’unions locales ou départementales, parfois d’unions régionales.
Il incombera aux confédérations d’opérer les versements afférents à chacune des structures territoriales ou professionnelles, au titre de leur participation aux différentes missions financées par le fonds paritaire. Ce choix de centraliser le versement des fonds aura également l’avantage d’inciter à une plus grande structuration des réseaux des syndicats, qui sont parfois très éparpillés et entretiennent des relations parfois très lâches avec leur confédération.
Le texte précise que les confédérations sont responsables du financement de leurs structures territoriales et professionnelles au titre de leur contribution aux missions liées au paritarisme et à l’appui aux politiques publiques : en effet, la troisième mission, de formation syndicale, relève pour sa part principalement d’une compétence confédérale nationale et n’a donc pas vocation à aller financer les structures territoriales et professionnelles.
D. LA GOUVERNANCE DU FONDS PARITAIRE
Le nouvel article L. 2135-15 détermine la gouvernance du fonds paritaire : celui a vocation à être géré par une association paritaire, dotée d’un conseil d’administration composé – à parité, faut-il le préciser – de représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel. Ce modèle d’association paritaire est celui qui prévaut aujourd’hui dans le cadre des accords de financement du dialogue social, qui ont été conclus dans certains secteurs d’activité ou certaines branches, en particulier dans le secteur agricole et dans l’artisanat.
La présidence de l’association est assurée alternativement par un représentant des organisations syndicales de salariés et un représentant des organisations professionnelles d’employeurs représentatives à ce niveau. Cette configuration de présidence tournante se retrouve aujourd’hui dans de nombreux organismes paritaires, comme par exemple à l’Unédic ou encore au FONGEFOR, où une telle rotation prévaut tous les deux ans : elle permet, d’après l’étude d’impact, « d’institutionnaliser un partage des responsabilités entre les partenaires syndicaux et patronaux ».
Le règlement intérieur de l’association fait l’objet d’un agrément par le ministre chargé du travail, qui désigne également un commissaire du Gouvernement auprès de l’association.
Il s’agit, par ces dispositions, d’imprimer à la nouvelle structure son caractère de « mission de service public », en prévoyant que la gouvernance du fonds n’est pas exclusivement paritaire, et qu’elle doit bien « rendre des comptes » à la collectivité. Cette configuration est très répandue dans l’univers des organismes paritaires : ainsi, les caisses nationales de sécurité sociale – qui sont, certes, des établissements publics administratifs -, sont soumises au contrôle de l’État, qui est représenté au conseil d’administration de chacune des caisses par un commissaire du Gouvernement. Une configuration identique existe à l’Unédic, pourtant association sous le régime de la loi de 1901, puisqu’un « contrôleur d’État » siège à son conseil d’administration avec voix consultative.
Dès lors que l’association paritaire de gestion du fonds paritaire a bien vocation à recevoir et à répartir des fonds publics, la présence de l’État au sein de la gouvernance de cette instance est indispensable. Elle est en outre souhaitable dans la mesure où une gestion strictement paritaire des fonds de financement des partenaires sociaux n’aurait pas permis de garantir une transparence suffisante : la présence d’un tiers extérieur, sous la forme du commissaire du Gouvernement, est de ce point de vue également plus que nécessaire.
Dans la mesure où il incombera aux partenaires sociaux de jeter les bases de la gouvernance du fonds paritaire, il était a contrario indispensable que le rôle du commissaire du Gouvernement auprès de l’association de gestion du fonds soit précisé par la loi. Si celui-ci doit pouvoir garantir la transparence des financements accordés aux partenaires sociaux, il est nécessaire que son indépendance et son rôle auprès de l’association paritaire soient clairement définis en amont.
C’est pourquoi le II du nouvel article L. 2135-15 fixe les principes relatifs au rôle du commissaire du Gouvernement auprès de l’association. Il aurait pu être envisagé de lui donner une voix délibérative, ou a minima consultative, au conseil d’administration. Ce n’est pas le choix qui a été fait, et il faut s’en féliciter, car s’il est indispensable d’assurer la transparence financière du fonds, il est également nécessaire de garantir l’autonomie des syndicats, qui passe notamment par leur financement. Le texte retient donc que le commissaire au Gouvernement :
– peut assister de droit aux séances de l’ensemble des instances administratives et délibératives de l’association :
– est destinataire de toute délibération du conseil d’administration ;
– a communication de l’ensemble des documents relatifs à la gestion du fonds.
En outre, une procédure d’alerte ainsi qu’un droit spécifique d’opposition sont instaurés au bénéfice du commissaire du Gouvernement, lui attribuant ce faisant des pouvoirs équivalents à ceux dont il dispose par ailleurs dans d’autres instances.
En premier lieu, lorsque le commissaire du Gouvernement estime qu’une délibération du conseil d’administration ou une décision prise par une autre instance ou autorité interne de l’association n’est pas conforme aux objectifs assignés au fonds par la loi, – autrement dit, à sa mission de service public, -, par l’accord national interprofessionnel qui porte création du fonds ou, le cas échéant, par les dispositions réglementaires qui auront été prises en l’absence d’accord ou en l’absence d’agrément de cet accord, il saisit le président du conseil d’administration de cette situation. Ce dernier lui adresse une réponse motivée.
En second lieu, s’agissant spécifiquement de l’utilisation de la subvention de l’État, lorsque le commissaire au Gouvernement estime qu’une délibération ou une décision d’une instance du fonds n’est pas conforme à la destination fixée à cette subvention publique par la loi, il peut s’opposer à sa mise en œuvre.
Un décret doit intervenir pour déterminer les modalités d’application du nouvel article L. 2135-15, relatif à la gouvernance du fonds paritaire.
E. UN RAPPORT ANNUEL SUR L’UTILISATION DES CRÉDITS DU FONDS PARITAIRE
Le nouvel article L. 2135-16 consacre le principe de ce que l’étude d’impact appelle « le rendu-compte sur l’utilisation des financements », par le biais de la mise en place d’un rapport annuel écrit détaillant l’utilisation faite des sommes perçues de la part du fonds par l’ensemble des organisations syndicales et patronales bénéficiant de ses financements.
Cette obligation de « rendu-compte » est assortie d’une obligation de publicité, qui est seule à même de garantir la transparence financière en la matière : ainsi, l’ensemble des organisations sont-elles tenues de publier ce rapport et de le transmettre au fonds paritaire dans les six mois suivant la fin de l’exercice sur lequel porte le rapport.
La non-transmission de ce rapport annuel dans les délais impartis ou l’insuffisance de justification des dépenses engagées, peut conduire le fonds à suspendre l’attribution de ses crédits à l’organisation concernée ou à réduire le montant. Ce dispositif de « sanction » ne peut toutefois intervenir qu’au terme d’une procédure de mise en demeure de l’organisation concernée de se conformer à ses obligations, non suivie d’effet dans le délai imparti par le fonds – délai qui ne peut être inférieur à quinze jours. Il s’agit par là de garantir qu’aucune sanction financière ne peut intervenir avant une phase « contradictoire », en l’occurrence, d’échanges, entre le fonds et l’organisation concernée par le manquement à ses obligations.
Sur la base de l’ensemble des rapports transmis par les organisations bénéficiaires, le fonds paritaire établit lui-même un rapport général sur l’utilisation de ses financements, qui doit être remis avant le 1er octobre de chaque année au Gouvernement et au Parlement. Les modalités de publication de ce rapport doivent être précisées par voie réglementaire.
Le calendrier doit donc théoriquement être le suivant : au terme de l’exercice N, les organisations syndicales et patronales bénéficiaires du fonds remettent, au cours des deux premiers trimestres de l’année N+1, un rapport au fonds paritaire sur l’utilisation des crédits dont elles ont bénéficié au titre de l’année N. Ces rapports doivent être remis au fonds au plus tard le 30 juin de l’année N+1. Sur la base de ces rapports, le fonds paritaire établit son rapport financier général au cours de l’été, remis au Gouvernement et au Parlement au plus tard le 1er octobre de l’année N+1.
*
* *
Le VII du présent article précise les modalités de l’entrée en vigueur des différentes dispositions prévues dans le cadre de cet article.
– Les dispositions des III et IV du présent article, respectivement relatives aux modifications apportées à l’aide financière de l’État en matière de formation économique, sociale et syndicale, et au 0,08 ‰ acquitté par les entreprises pour financer le congé de formation économique, sociale et syndicale, entrent en vigueur au 1er janvier 2015.
– Les dispositions de l’article L. 2135-10, afférentes aux ressources du nouveau fonds paritaire de financement des organisations syndicales et patronales, entrent en vigueur au 1er janvier 2015, sur la base, s’agissant de la contribution des employeurs assise sur la masse salariale, dont le taux est compris entre 0,014 % et 0,02 %, des rémunérations versées à compter de cette même date.
– En l’absence d’autre précision, entrent en vigueur dès la promulgation de la loi, l’ensemble des autres dispositions relatives au fonds paritaire, tant ses missions, que les organisations éligibles, et les modalités de répartition des ressources du fonds, mais également sa gouvernance et le principe du rendu-compte des financements afférents par les organisations et le fonds lui-même : on rappellera que l’ensemble de ces dispositions sont subordonnées à la conclusion d’un accord national interprofessionnel, et le cas échéant, en l’absence d’un tel accord ou en l’absence d’agrément de cet accord par le ministre chargé du travail, à l’édiction de dispositions réglementaires.
Dans le silence du texte, les autres dispositions relatives à l’élargissement du bénéfice de la formation syndicale aux adhérents intervenant au bénéfice de salariés (II du présent article) et à la durée minimale du congé de formation (V du présent article) entrent en vigueur dès la promulgation de la loi.
*
* *
Lors de son examen du texte, votre commission a adopté, à l’initiative de votre rapporteur, trois amendements destinés respectivement à préciser que les missions financées par le fonds paritaire correspondent bien à celles qui sont définies l’article L. 2135-11 créé par le présent article, que les missions liées au paritarisme ne recouvrent pas seulement la gestion des organismes à laquelle participent les partenaires sociaux mais également les politiques menées paritairement, et enfin, que l’éventuelle opposition du commissaire du Gouvernement à une délibération du conseil d’administration du fonds paritaire doit être motivée.
*
* *
La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels AS423, AS422 et AS421 du rapporteur.
Puis elle est saisie de l’amendement AS416 du rapporteur.
M. le rapporteur. Le fonds paritaire créé par l’article 18 a vocation à financer non seulement les activités qui concourent au fonctionnement et au développement du dialogue social, mais, plus largement, celles qui sont énumérées plus loin, dans le futur article L. 2135-11 du code du travail.
La Commission adopte l’amendement.
Puis elle examine, en discussion commune, l’amendement rédactionnel AS420 du rapporteur, ainsi que les amendements AS318 de M. Christophe Cavard, AS128 de M. Francis Vercamer et AS325 de M. Denys Robiliard.
Elle adopte l’amendement AS420.
Puis, suivant l’avis défavorable du rapporteur, elle rejette successivement les amendements AS318 et AS128.
L’amendement AS325 est retiré.
La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels AS419 et AS425, ainsi que l’amendement de précision AS426, tous du rapporteur.
Puis elle examine l’amendement AS101 de M. Francis Vercamer.
M. Francis Vercamer. L’article 18 prévoit que le fonds paritaire est alimenté par une contribution des employeurs assise sur la rémunération versée aux salariés. L’instauration de cette taxe supplémentaire va à l’encontre de l’objectif de réduction du coût du travail et des charges pesant sur les entreprises qu’ont affiché le Président de la République et le Gouvernement. D’autre part, nous attendons des précisions sur les autres ressources du fonds, tant sur la subvention de l’État que sur la participation des organismes gérés paritairement. En l’absence de telles informations, nous proposons de supprimer la contribution des employeurs.
M. le rapporteur. Avis défavorable. Il ne s’agit pas d’une contribution nouvelle. Le fonds paritaire a vocation à se substituer aux financements actuels issus du fonds national de gestion paritaire de la formation professionnelle continue (FONGEFOR) et des organismes paritaires collecteurs agréés, ainsi qu’à la contribution des entreprises au congé de formation économique et sociale et de formation syndicale équivalant à 0,08 pour mille du montant des salaires. Le taux de la contribution au fonds paritaire sera encadré par une fourchette – entre 0,014 et 0,02 % de la masse salariale – qui doit permettre de couvrir les besoins au même niveau qu’aujourd’hui. Supprimer cette contribution reviendrait à maintenir le système de financement actuel.
La Commission rejette l’amendement.
Puis elle adopte l’amendement rédactionnel AS427 du rapporteur.
L’amendement AS326 de M. Denys Robiliard est retiré.
La Commission en vient à l’amendement AS44 de M. Gérard Cherpion.
Mme Véronique Louwagie. Le taux de la contribution que les employeurs versent au fonds paritaire pourrait être réduit d’un certain pourcentage lorsqu’ils financent déjà le dialogue social au sein de leur entreprise. Tel est notamment le cas lorsque celle-ci est dotée d’institutions représentatives du personnel.
M. le rapporteur. Tout est bon pour exonérer les entreprises ! La contribution des employeurs vise à assurer le financement du paritarisme. Avis défavorable.
M. Gilles Lurton. Cet amendement vise non pas à exonérer les employeurs, mais à réduire leur contribution lorsqu’ils financent déjà le dialogue social.
Mme Véronique Louwagie. En outre, ce dispositif favoriserait le dialogue social, en incitant les entreprises à se doter d’institutions représentatives du personnel.
M. le rapporteur. La présence d’institutions représentatives du personnel au sein des entreprises est régie par le code du travail, qui fixe des seuils en la matière. Elle ne dépend pas de la volonté de l’employeur et n’a donc pas à faire l’objet d’une incitation. Quant à la subvention de fonctionnement au moins égale à 0,2 % de la masse salariale versée par l’employeur au comité d’entreprise, il s’agit là aussi d’une obligation.
D’autre part, le dispositif que vous proposez réduirait la contribution des grandes entreprises et ferait peser le financement du fonds sur les petites entreprises qui sont dépourvues de délégués du personnel.
Mme Véronique Louwagie. Non. Certaines entreprises qui financent déjà le dialogue social seraient exonérées en partie de la contribution.
M. Gérard Cherpion. Il s’agirait de déduire de la contribution non pas la subvention versée au comité d’entreprise, mais les efforts supplémentaires consentis par l’employeur, au-delà de ses obligations, pour assurer le bon fonctionnement des instances paritaires, notamment du comité d’entreprise.
M. Denys Robiliard. Nous ne parlons pas de la même chose ! C’est un peu comme si vous confondiez le financement de l’Assemblée nationale et celui des partis politiques ! Il convient de distinguer ce qui relève des institutions et ce qui relève des syndicats. Les accords collectifs sont signés entre les organisations d’employeurs et les syndicats de salariés, et non par les institutions représentatives du personnel. Le financement du paritarisme n’a rien à voir avec ces dernières. Vous faites un amalgame inacceptable.
M. Arnaud Richard. Cet amendement suscite un débat utile : nous devons savoir qui finance quoi et quelle est la contribution – indispensable – des entreprises au dialogue social.
La Commission rejette l’amendement.
Puis elle est saisie de l’amendement AS179 de M. Dominique Tian.
M. Lionel Tardy. Parmi les ressources du fonds paritaire figure une participation des organismes gérés paritairement par les organisations d’employeurs et les syndicats de salariés. Il convient que le projet de loi affirme clairement le caractère certain et pérenne de cette participation. Le présent amendement vise donc à supprimer l’expression « le cas échéant ».
M. le rapporteur. Je vous concède que la rédaction du projet de loi n’est pas des plus claires sur ce point. La participation des organismes gérés paritairement est prévue seulement « le cas échéant », car les partenaires sociaux seront encouragés à intégrer dans la contribution des employeurs une partie des financements assurés actuellement par les organismes paritaires – les caisses de sécurité sociale et l’UNEDIC, entre autres. Ceux-ci n’abonderont le fonds par une participation spécifique que si cette intégration n’est pas réalisée. Le dispositif prévu est souple : il permet de faire évoluer le système au fur et à mesure des discussions avec les différents organismes. Avis défavorable.
La Commission rejette l’amendement.
Puis elle adopte successivement les amendements rédactionnels AS428, AS429, AS459, AS458, AS430 du rapporteur.
Elle examine ensuite l’amendement AS417 du rapporteur.
M. le rapporteur. Cet amendement vise à apporter une précision : les missions liées au paritarisme comprennent non seulement la gestion des organismes paritaires – caisses de sécurité sociale, UNEDIC –, mais aussi les politiques menées paritairement, par exemple la négociation des règles appliquées par l’UNEDIC.
La Commission adopte l’amendement.
Puis elle adopte successivement les amendements de précision ou rédactionnels AS431 à AS433, AS457, AS434, AS435, AS460, AS440, AS436 à AS438 du rapporteur.
M. Gérard Cherpion. Nous venons d’adopter une série d’amendements rédactionnels. Cela montre que le projet de loi a été rédigé à la hâte et sans beaucoup de soin. Je remercie le rapporteur de l’avoir corrigé.
La Commission en vient à l’amendement AS328 de M. Denys Robiliard.
M. Denys Robiliard. Je propose que les crédits du fonds paritaire soient répartis en fonction d’un critère unique : la représentativité. Certes, une répartition en fonction du nombre de mandats paritaires exercés peut avoir du sens pour certaines organisations, mais l’application de critères différents selon les cas ne se justifie plus. Je suis conscient des implications de mon amendement et suis prêt à le retirer. Mais je le déposerai à nouveau au titre de l’article 88 du règlement : nous devons avoir cette discussion.
M. le rapporteur. Vous proposez en effet un changement radical.
M. Francis Vercamer. Je suis tout à fait d’accord avec M. Robiliard sur le principe : les crédits devraient être répartis en fonction de la seule représentativité. Mais encore faut-il s’entendre sur sa définition. Or la méthode que vous prévoyez pour la mesurer ne va pas dans le bon sens.
L’amendement est retiré.
La Commission est saisie de l’amendement AS180 de M. Dominique Tian.
M. Lionel Tardy. Le passage relatif aux critères de répartition des crédits du fonds paritaire entre les organisations d’employeurs apparaît incohérent. D’une part, on ne peut pas prévoir l’application alternative de deux critères de nature radicalement différente : l’audience ou le nombre de mandats paritaires exercés. D’autre part, dès lors que le projet de loi définit de nouvelles règles de représentativité pour les organisations d’employeurs et qu’il prévoit une mesure de leur audience afin d’attribuer les mandats au sein du collège patronal, il n’est pas légitime de répartir les crédits en fonction du nombre de mandats paritaires exercés actuellement.
M. le rapporteur. Il était indispensable de poser une telle alternative : le fonds a vocation à entrer en vigueur dès janvier 2015, alors que la mesure de l’audience des organisations patronales n’aura pas encore été réalisée – les premiers arrêtés de représentativité au niveau des branches ne devraient pas être publiés avant le début du deuxième semestre 2017. Pendant la période transitoire, il est donc nécessaire d’appliquer le critère du nombre de mandats paritaires exercés. Cependant, à terme, l’idée est bien de passer de ce critère à celui de l’audience. Les deux critères coïncideront alors, car les mandats paritaires auront été redistribués en fonction des résultats de la mesure d’audience. Les crédits seront donc bien répartis en tenant compte de la représentativité des organisations patronales.
M. Denys Robiliard. Si tel est le cas, il conviendrait de l’écrire dans le texte.
La Commission rejette l’amendement.
Puis elle adopte successivement les amendements rédactionnels AS439, AS490, et AS441 à AS443 du rapporteur.
Elle est saisie de l’amendement AS337 de M. Christophe Cavard.
M. Christophe Cavard. Même si l’on attend un accord global sur le « hors champ », il serait bienvenu d’associer d’ores et déjà les organisations multiprofessionnelles à la gestion du fonds.
M. le rapporteur. Il faut assurément traiter cette question et je vous félicite d’avoir déposé cet amendement quand d’autres se contentent de faire des déclarations. Avis défavorable néanmoins.
La Commission rejette l’amendement.
Puis elle adopte successivement les amendements rédactionnels ou de précision AS444 à AS448 du rapporteur.
Elle examine ensuite l’amendement AS418 du même auteur.
M. le rapporteur. Le texte donne au commissaire du Gouvernement le pouvoir de s’opposer à la mise en œuvre d’une décision ou d’une délibération du fonds paritaire concernant l’utilisation de la subvention de l’État. Nous proposons d’ajouter que sa décision doit être motivée, comme il est d’usage en pareil cas.
La Commission adopte l’amendement.
Puis elle adopte successivement les amendements rédactionnels ou de précision AS449 à AS453, AS461 et AS454 du rapporteur.
Elle en vient à l’amendement AS46 de M. Gérard Cherpion.
M. Gérard Cherpion. Cet amendement vise à exclure du dispositif les organisations non comprises dans le champ interprofessionnel.
M. le rapporteur. À la différence de l’amendement AS337 de M. Cavard, celui-ci vise à permettre au « hors champ » de bénéficier du fonds par d’autres procédures. Avis défavorable.
La Commission rejette l’amendement.
Elle examine l’amendement AS47 de M. Gérard Cherpion.
M. Gérard Cherpion. Les organisations syndicales de salariés et professionnelles agricoles ont organisé, depuis leur accord national étendu du 21 janvier 1992, le financement de la négociation collective et du paritarisme en agriculture. Cet accord permet d’ores et déjà une gestion transparente des fonds collectés à cette fin, à travers la gestion par une association paritaire, une certification des comptes par un commissaire aux comptes, ou encore des comptes rendus d’activité auprès de l’administration. Le présent article ne devrait donc pas concerner le secteur de l’agriculture. C’est ce que précise cet amendement.
M. le rapporteur. Avis défavorable, même s’il y a là un vrai problème : si d’aventure on n’arrivait pas à régler la question du « hors champ », le secteur agricole, qui est déjà totalement organisé, se trouverait contraint de faire remonter ses financements sans participer à la répartition.
Soit dit en passant, si des efforts de transparence ont été réalisés dans ce secteur, une seule organisation bénéficie du dispositif pour le moment. Mais c’est un autre débat !
La Commission rejette l’amendement.
Puis elle adopte successivement les amendements rédactionnels AS455 et AS456 du rapporteur.
Elle adopte l’article 18 modifié.
Chapitre IV
Transparence des comptes des comités d’entreprise
Article 19
(Art. L. 2325-34-1 à L. 2325-34-4, L. 2325-45 à L. 2325-55, L. 2327-12-1, L. 2327-14-1 [nouveaux] et L. 2327-16 du code du travail)
Transparence des comptes des comités d’entreprise
Le présent article répond à des attentes certaines : alors que la Cour des comptes a, à plusieurs reprises au cours des dernières années pointé les insuffisances en matière de transparence financière des comités d’entreprise de certaines grandes entreprises publiques ou anciennes entreprises publiques, et alors que le principe de transparence financière des comptes des organisations syndicales et patronales était posé par la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale, il devenait urgent de transposer aux comités d’entreprise ces obligations.
En effet, si le comité d’entreprise n’est pas bénéficiaire d’argent public, les sommes que lui verse l’employeur au titre de ses missions doivent bénéficier à la représentation des intérêts des salariés et même, s’agissant des activités sociales et culturelles du comité d’entreprise, aux salariés. Il est donc normal que celui-ci soit amené à leur rendre des comptes.
Le comité d’entreprise a une double fonction. Il assure d’une part une expression collective des salariés pour toutes les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du temps de travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production. À ce titre, le comité d’entreprise est une instance d’information et de consultation, dont les pouvoirs ont été encore récemment sensiblement renforcés dans le cadre de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi, avec l’institution d’une nouvelle information consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise. Mais le comité d’entreprise peut aussi, d’autre part, assurer ou contrôler la gestion des activités sociales ou culturelles dans l’entreprise. Ces activités recouvrent à la fois des institutions sociales de prévoyance et d’entraide (institutions de retraite, sociétés de secours mutuels), des activités tendant à améliorer les conditions de vie des salariés (cantines, logements, crèches, colonies de vacances), des activités sportives et de loisirs ; ou encore des institutions d’apprentissage et de formation professionnelle, des bibliothèques ou des cercles d’études.
Cette double fonction du comité d’entreprise plaide en faveur de l’application du principe de transparence financière, qui est l’objet du présent article.
A. LES RÈGLES DE FINANCEMENT APPLICABLES AUX COMITÉS D’ENTREPRISES
Le comité d’entreprise est financé d’une part, par une subvention de fonctionnement à hauteur de 0,2 % de la masse salariale brute, et d’autre part, pour le financement d’activités sociales et culturelles, par une contribution spécifique de l’employeur.
L’article L. 2325-43 du code du travail fixe le montant annuel de la subvention de fonctionnement versée par l’employeur au comité d’entreprise, qui doit être équivalent à 0,2 % de la masse salariale brute. Cette subvention s’ajoute à la subvention destinée aux activités sociales et culturelles, sauf si l’employeur fait déjà bénéficier le comité d’une somme ou de moyens en personnel équivalents à 0,2 % de la masse salariale.
Le comité d’entreprise décide librement de l’utilisation de cette subvention de fonctionnement, sous réserve que ses dépenses s’inscrivent bien dans le cadre de son fonctionnement et de ses missions économiques. Dans la mesure où l’article L. 2325-12 dispose que l’employeur a l’obligation de mettre à la disposition du comité d’entreprise un local aménagé et le matériel nécessaire à l’exercice de ses fonctions (lignes téléphoniques, photocopieuse), ces sommes doivent donc lui permettre de financer son propre personnel, des frais de documentation, de papeterie ou encore d’expertises.
L’article L. 2323-83 fixe le principe d’un financement par l’employeur des activités sociales et culturelles du comité d’entreprise. Son calcul obéit à des règles complexes, dont on doit principalement retenir qu’elles ont principalement pour effet une augmentation mécanique, année après année, de la subvention afférente à ces activités, à moins que l’entreprise ne voie sa masse salariale diminuer.
Les règles de calcul de la contribution de l’employeur au financement des activités sociales et culturelles du comité d’entreprise
Il faut distinguer plusieurs cas de figure.
Dans le cas d’un comité d’entreprise qui reprend la gestion d’activités sociales et culturelles précédemment assurée par l’employeur, le montant de la contribution initiale, prévue à l’article L. 2323-86, doit respecter les deux règles suivantes :
– elle ne peut être inférieure au total le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales de l’entreprise atteint au cours de l’une des trois dernières années précédant la prise en charge de ces activités par le comité d’entreprise, à l’exclusion des dépenses temporaires si les besoins correspondants ont disparu ;
– le rapport de cette contribution à la masse salariale brute ne peut être inférieur au même rapport existant pour cette même année de référence.
Par la suite, la contribution à verser chaque année doit respecter ces mêmes minima, en valeur absolue et en pourcentage. En outre, son montant ne peut être inférieur au total le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales de l’entreprise atteint au cours de l’une des trois dernières années (à l’exclusion toujours des dépenses temporaires). Ce montant n’est toutefois maintenu que si la masse salariale reste constante ; si elle diminue, le montant de la contribution suit la même variation.
En l’absence d’existence d’un budget antérieurement consacré aux « œuvres » sociales, l’employeur n’est pas tenu de contribuer au financement de telles activités.
Toutefois, l’employeur peut toujours, par décision unilatérale, accord ou usage, verser une contribution quand bien même il n’y est pas légalement tenu, ou choisir de verser une contribution supérieure au minimum légal. Dans ce cas, le montant de sa contribution annuelle ne peut être inférieur au total le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales de l’entreprise atteint au cours des trois dernières années. Ce montant n’est toutefois maintenu que si la masse salariale est constante ; si celle-ci diminue, la contribution diminue d’autant.
Pour la gestion des activités sociales et culturelles, le comité d’entreprise peut également bénéficier, en vertu de l’article R. 2323-34, d’autres ressources comme des cotisations facultatives des salariés de l’entreprise dont le comité d’entreprise fixe éventuellement les conditions de perception et les effets, mais aussi des subventions accordées par les collectivités publiques ou les organisations syndicales, des dons et legs, des recettes procurées par les manifestations organisées par le comité d’entreprise, et enfin, les revenus tirés des biens meubles et immeubles du comité.
Dans la mesure où le comité d’entreprise est doté de la personnalité civile et gère son patrimoine (article L. 2325-1), il dispose librement des fonds qu’il reçoit dans la limite de ses attributions.
Aux termes de l’article R. 2323-37, le comité d’entreprise est tenu, à la fin de chaque année, de dresser un compte rendu détaillé de sa gestion financière, qui doit être porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur les tableaux réservés aux communications syndicales. Les deux « budgets » du comité d’entreprise – budget de fonctionnement et budget relatif aux activités sociales et culturelles – sont distincts. Le compte rendu doit ainsi retracer le montant des ressources du comité, ainsi que le montant des dépenses respectivement pour son propre fonctionnement et au titre des activités sociales et culturelles dépendant de lui ou des comités interentreprises auxquels il participe, chacune des institutions sociales faisant en outre l’objet d’un budget particulier.
Ce bilan financier établi par le comité d’entreprise est approuvé par le commissaire aux comptes de l’entreprise, auquel renvoie l’article L. 2323-8.
En présence d’une entreprise comportant plusieurs établissements distincts qui excèdent le seuil de 50 salariés, des comités d’établissement et un comité central d’entreprise (CCE) sont mis en place. S’agissant des attributions économiques, le CCE exerce, en vertu de l’article L. 2327-2, celles relatives à la marche générale de l’entreprise et qui excèdent le périmètre des comités d’établissement : il est notamment consulté et informé sur tous les projets économiques et financiers importants de l’entreprise. Les comités d’établissement exercent celles qui n’excèdent pas le champ de l’établissement. Dans la mesure où la compétence du CCE n’est pas exclusive de celle des comités d’établissement, la jurisprudence considère que c’est à leur niveau qu’est versée la subvention de fonctionnement, à charge pour eux, après accord avec le CCE, de lui en rétrocéder une partie. En l’absence d’accord, le juge fixe d’ailleurs lui-même ce montant.
Concernant les attributions sociales et culturelles, en revanche, le montant de la subvention de l’employeur est calculé au niveau de l’entreprise, la répartition entre chaque établissement devant être effectuée en fonction de la masse salariale de chaque établissement. En vertu de l’article L. 2327-16, un accord conclu entre l’employeur et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise peut aménager les modalités d’une gestion par le CCE de tout ou partie des activités culturelles et sociales, ce qui n’a toutefois jamais pour effet, d’après la jurisprudence, de priver l’établissement du droit de percevoir de l’employeur la subvention afférente.
B. DES INCERTITUDES JURIDIQUES ET UN MANQUE DE TRANSPARENCE RÉGULIÈREMENT ÉPINGLÉ PAR LA COUR DES COMPTES
Dans le cadre de la refonte du code du travail opérée, pour la partie réglementaire notamment par le décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail, la rédaction des dispositions relatives à la transparence financière des comités d’entreprises a subi une modification qui entraîne des conséquences très substantielles pour les entités concernées. En effet, l’ancien article R. 432-14 prévoyait que le bilan financier établi par le comité d’entreprise devait « éventuellement » être approuvé par le commissaire aux comptes.
La disparition de cet adverbe de la rédaction de l’article R. 2323-37 conduit à un certain nombre de difficultés, mises en avant par plusieurs organisations syndicales dans un courrier adressé le 7 février 2011 au ministre chargé du travail :
– En premier lieu, cette rédaction conduit à contraindre le comité d’entreprise, dont l’autonomie est reconnue par le code du travail, au commissaire aux comptes de l’entreprise, conformément au renvoi opéré à l’article L. 2323-8 ;
– Deuxièmement, le passage du particulier au général conduit à généraliser le recours à l’approbation des comptes par le commissaire aux comptes pour l’ensemble des comités d’entreprise, quels que soient leur taille et leur budget ;
– Enfin, les syndicats mettaient en avant la persistance d’une ambiguïté relative à la définition de l’organe délibérant du comité d’entreprise en charge d’arrêter les comptes : s’agit-il en particulier de l’ensemble des membres du comité ou des seuls membres élus ?
Outre ces difficultés soulevées par les organisations syndicales, le Haut conseil du Commissariat aux comptes a rendu, le 9 juin 2011, une délibération relative aux diligences du commissaire aux comptes dans les comités d’entreprise, soulevant des incertitudes supplémentaires :
– En premier lieu, le Haut conseil estime ne pas disposer d’une base législative suffisante pour permettre au commissaire aux comptes de mettre en œuvre la procédure d’alerte lorsqu’à l’occasion de sa mission, il relève des faits de nature à compromettre la continuité de l’exploitation du comité d’entreprise. En effet, il ne va pas de soi que les dispositions de l’article L. 612-3 du code de commerce, qui concernent les personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique et s’appliquent notamment aux associations, s’appliquent bien aux comités d’entreprise ;
– En second lieu, le Haut conseil estime que la lecture combinée des articles L. 2323-8 et R. 2323-37 du code du travail que le commissaire aux comptes qui « approuve » le bilan du comité d’entreprise est bien le commissaire aux comptes de l’entreprise, situation qui peut être porteuse de conflit d’intérêts ;
– Enfin, les textes ne permettent pas d’apprécier les modalités de mise en œuvre de cette mission d’« approbation » du bilan du comité d’entreprise, ni d’en comprendre l’articulation avec la mission de certification des comptes du comité d’entreprise. Un commissaire aux comptes n’approuve pas des comptes, il les certifie : dès lors, quelle est sa mission réelle auprès des comités d’entreprise ?
À ces difficultés juridiques se sont ajoutées ces dernières années des mises en cause répétées de la gestion de certains comités d’entreprise, en particulier par la Cour des comptes.
Dans son rapport public thématique de mai 2011 sur les institutions sociales du personnel des industries électriques et gazières (IEG), la Cour des comptes opère un contrôle du suivi des recommandations qu’elle avait formulées à ce titre dans son rapport public thématique d’avril 2007.
Avec une mosaïque d’institutions organisées en réseau sur le territoire – un réseau local de 23 caisses d’activités sociales et 82 antennes, 69 caisses mutuelles complémentaires et d’action sociale, 600 sections locales de vie, etc. –, les institutions sociales des IEG employaient près de 4 800 agents en 2010, alors même que le statut particulier de ces institutions, qui ne relèvent pas du droit commun applicable aux comités d’entreprise, conduit à une absence totale de contrôle, que ce soit de l’État ou de l’employeur.
Concernant la gestion des activités de vacances et des achats de la Caisse centrale des activités sociales (CCAS), la Cour constate la persistance de graves carences dans la gestion de ces institutions, l’absence de stratégie à moyen terme, une gestion à courte vue, une absence quasi-totale de mise en concurrence rigoureuse des partenaires des institutions sociales, la non-application des procédures destinées à encadrer et sécuriser les paiements, et enfin, l’absence de prise en compte des intérêts des électriciens et gaziers dans les décisions d’investissement. En effet, malgré des ressources en progression constante, qui se sont établies à plus de 700 millions d’euros en 2009, les résultats financiers de la CCAS se sont fortement dégradés, en raison d’une participation financière dans des sociétés civiles immobilières déficitaires et de l’acquisition d’une société de gestion de campings jugée par la Cour « inutile et coûteuse ».
Dans son rapport public thématique de novembre 2011, sur les dysfonctionnements du comité d’entreprise de la RATP, la Cour dresse un constat accablant de la gestion des activités sociales et culturelles du comité central d’entreprise de la RATP, dont les moyens sont conséquents, puisqu’il emploie 450 agents en CDI et 600 agents en équivalent temps plein pour des ressources de l’ordre de 83 millions d’euros, dont 53 millions d’euros issus de la subvention annuelle de l’employeur, fixée à 3,11 % de la masse salariale. Le nombre important d’irrégularités financières constatées par la Cour l’ont d’ailleurs conduite à ouvrir une action pénale à ce titre. À cette occasion, la Cour a réitéré une série de préconisations plus générales, dont elle estime qu’elles devraient s’appliquer aux comités d’entreprise.
En effet, la Cour note que, « alors que toutes les entités de droit privé, y compris aujourd’hui les partis politiques et les syndicats, ont l’obligation de publier des comptes annuels et de les faire certifier par un commissaire aux comptes, les comités d’entreprise sont simplement tenus, aux termes de l’article R. 2323-37 du code du travail, d’établir un compte rendu annuel », indiquant les ressources et les dépenses et de les porter à la connaissance des salariés. La Cour préconise de :
– « soumettre les comités d’entreprise au droit comptable avec l’obligation d’établir des comptes annuels au sens du code de commerce, dont l’article L. 612-1 dispose que les personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique doivent établir chaque année, au-delà d’un certain seuil fixé par décret, un bilan, un compte de résultat et une annexe » ;
– « élaborer un référentiel comptable adapté aux comités d’entreprise sous forme d’un règlement de l’Autorité des normes comptables homologué conjointement par le ministre de l’économie, le garde des sceaux et le ministre du budget » ;
– « soumettre les comités d’entreprise à l’obligation de faire certifier leurs comptes, au-delà d’un seuil à déterminer, et d’autres critères le cas échéant, à l’instar des personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité́ économique » ;
– « assurer une large publicité des comptes, des rapports d’activité et du bilan social du comité d’entreprise, et les transmettre au président du comité d’entreprise dans un délai permettant un examen approfondi et un débat en séance ».
II. LE DROIT PROPOSÉ
Après la saisine, déjà évoquée, du ministre chargé du travail par quatre syndicats le 7 février 2011 sur la problématique de la transparence financière des comités d’entreprise, le Gouvernement a décidé en décembre 2011 la mise en place d’un groupe de travail quadripartite présidé par le directeur général du travail (DGT), composé des représentants des partenaires sociaux (l’ensemble des organisations syndicales et patronales représentatives au niveau national et interprofessionnel, ainsi que la FNSEA et l’UNAPL), de la Chancellerie et du ministère de l’économie. Ses conclusions, rendues au début de l’année 2013 et qui rejoignent largement celles formulées par la Cour des comptes, sont fidèlement retranscrites par le présent article.
En outre, les travaux menés par le groupe de travail technique sous la houlette de l’Autorité des normes comptables (ANC) ont permis de dessiner les principaux axes des futurs règlements de l’ANC sur les comptes des comités d’entreprise.
Les dispositions du présent article s’insèrent dans le chapitre 5 du titre II du livre III de la deuxième partie du code du travail, chapitre consacré au fonctionnement du comité d’entreprise. Son I le complète par une nouvelle section 10, consacrée à l’établissement et au contrôle des comptes du comité d’entreprise, tandis que son II insère une sous-section 6 créant une commission des marchés au sein de la section 6 de ce chapitre, consacrée aux commissions du comité d’entreprise.
Le III du présent article rend l’ensemble de ces dispositions applicables aux comités d’établissement et au comité central d’entreprise, dans les entreprises composées d’établissements distincts. Notons à cet égard qu’aucune disposition spécifique n’est nécessaire pour rendre ces règles applicables à la délégation unique du personnel (DUP) qui peut être mise en place dans les entreprises de moins de 200 salariés, l’ensemble des règles applicables aux comités d’entreprise étant également valables pour la DUP. Pas plus n’est-il nécessaire de prévoir de telles dispositions spécifiques pour les comités inter-entreprises, qui n’ont d’existence que réglementaire. Enfin, le comité de groupe, lorsqu’il existe, n’a pas vocation à se substituer aux comités d’entreprise existant dans les entreprises du groupe : aucun budget spécifique ne lui est alloué en vertu des dispositions législatives, celui-ci ayant surtout un rôle d’information. Il n’y a donc pas lieu de lui transposer les obligations de transparence financière prévues par le présent article.
Le IV les rend applicables aux institutions sociales des industries électriques et gazières (IEG), tandis que le V prévoit l’entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions législatives.
A. LA MISE EN PLACE D’UN PRINCIPE DE TRANSPARENCE DES COMPTES ANNUELS DES COMITÉS D’ENTREPRISE
Le principe et les modalités de la transparence des comptes des comités d’entreprise est l’objet du I du présent article : la nouvelle section 10, intitulée « Établissement et contrôle des comptes du comité d’entreprise » comporte ainsi onze nouveaux articles, L. 2325-45 à L. 2325-55.
Le principe de la transparence des comptes des comités d’entreprise est posé par le I du nouvel article L. 2325-45, qui renvoie aux obligations comptables définies à l’article L. 123-12 du code de commerce. Ce dernier, applicable à tous les commerçants, pose trois obligations :
– celle d’un enregistrement comptable chronologique des mouvements affectant le patrimoine de l’entité concernée ;
– celle d’un contrôle par inventaire, au moins une fois par an, de l’existence et de la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de cette entité ;
– celle de l’établissement des comptes annuels à la clôture de l’exercice au vu des enregistrements comptables et de l’inventaire. Ces comptes comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable.
L’objectif est bien de rendre applicables aux comités d’entreprise les obligations comptables « de droit commun », qui s’appliquent aujourd’hui déjà, moyennant certaines adaptations, à la plupart des entités « non commerçantes », comme par exemple les associations. Le I précise ainsi que les modalités d’établissement des comptes applicables aux comités d’entreprise sont définies par un règlement de l’Autorité des normes comptables (ANC). En amont de la présentation des présentes dispositions législatives, un groupe de travail quadripartite qui a travaillé sous l’égide de l’ANC, a adopté les principaux axes du futur règlement comptable qui sera applicable aux comités d’entreprise.
Celui-ci a vocation à s’inscrire en cohérence avec le corpus comptable français, et en particulier avec le plan comptable général applicable à toute structure soumise à l’obligation légale d’établir des comptes annuels. Plus particulièrement, le futur règlement devrait tenir compte des règlements CRC 99-01 et 99-02 relatifs respectivement aux comptes individuels du secteur non capitalistique et aux comptes consolidés. D’après les informations transmises à votre rapporteur, le référentiel comptable applicable aux syndicats a été écarté en raison des difficultés techniques propres qu’il soulève, mais aussi en raison de la nature particulière du comité d’entreprise, qui se rapproche davantage du secteur non lucratif.
1. Des modalités distinctes d’établissement des comptes en fonction de la taille du comité d’entreprise
Si le principe de la transparence financière des comptes doit bien s’appliquer à tous les comités d’entreprise, il est légitime que les modalités d’application de cette exigence de transparence soient adaptées à la taille du comité d’entreprise.
En effet, comme le rappelle l’étude d’impact associée au présent projet de loi, plus de 90 % des comités d’entreprise existants ont moins de 100 000 euros de ressources annuelles. Le nombre des élus au comité reste faible dans les structures petites et moyennes : en effet, dans une entreprise de 50 salariés, le comité d’entreprise n’est composé que de trois titulaires et trois suppléants ; dans une entreprise de 300 salariés, le comité ne dispose que de cinq titulaires et cinq suppléants. Dans la mesure où seuls les élus titulaires disposent d’un crédit d’heures, il est clair que l’assujettissement à des règles très strictes et complexes de transparence financière absorberait l’essentiel du temps imparti aux élus au comité d’entreprise pour l’exercice de leurs fonctions : il est bien évident qu’une telle conséquence n’est pas souhaitable. C’est pourquoi les règles de transparence financière doivent légitimement être allégées pour les « petits » comités d’entreprise, ceux des petites entreprises disposant donc logiquement aussi d’un budget plus faible.
Le II du nouvel article L. 2325-45 et le nouvel article L. 2325-46 adaptent donc les exigences de transparence financière selon la taille du comité d’entreprise.
Conformément aux modalités qui avaient été arrêtées par le groupe de travail piloté par la direction générale du travail, trois modalités d’établissement des comptes sont prévues en fonction de seuils relatifs à la taille du comité d’entreprise.
Les comités d’entreprise disposant de moins de 153 000 euros de ressources annuelles sont soumis à une comptabilité ultra-simplifiée, autrement dit une simple comptabilité de caisse. C’est l’objet du nouvel article L. 2325-46, qui prévoit que le comité d’entreprise pourra, dans ce cas, s’acquitter de ses obligations comptables en tenant « un livre retraçant chronologiquement le montant et l’origine des dépenses qu’il réalise et des recettes qu’il perçoit ». N’est exigé, une fois par an, qu’un état de synthèse simplifié comportant des informations relatives au patrimoine du comité d’entreprise et à ses engagements en cours. Il revient au règlement de l’Autorité des normes comptables de définir le contenu et les modalités de présentation de cet état. Celui-ci a, d’après l’étude d’impact, vocation à recouvrir :
– un état de synthèse simplifié des principaux postes de dépenses et de recettes, reposant sur une distinction entre le fonctionnement et les activités sociales et culturelles ;
– un état patrimonial sommaire, recensant les biens immobiliers et mobiliers, les dettes et créances, ainsi que le solde des comptes bancaires ;
– ainsi que, s’il y a lieu, des informations complémentaires utiles à l’information des salariés (caution, bail, échéance des emprunts, engagements votés pour le prochain exercice, etc.).
Les comités dont les ressources sont supérieures à 153 000 euros et qui ne remplissent pas au moins deux des trois critères suivants :
– 50 salariés en équivalent temps plein ;
– 1,55 million d’euros de bilan ;
– et 3,1 millions d’euros de ressources ;
sont soumis à une comptabilité avec présentation simplifiée. C’est l’objet du II du nouvel article L. 2325-45, qui précise que dans ce cas, le comité d’entreprise est tenu de « n’enregistrer ses créances et ses dettes qu’à la clôture de l’exercice ».
Enfin, les comités remplissant au moins deux des trois critères déjà évoquées sont tenus d’appliquer une comptabilité de droit commun.
Pour l’application des règles de transparence financière aux comités d’entreprise, le choix a été fait de retenir les seuils prévalant pour les associations, tout en les adaptant sur certains points pour tenir compte des spécificités des comités d’entreprise. On peut à cet égard s’interroger sur la non reprise des seuils prévalant pour la transparence financière des syndicats.
Les obligations comptables respectives des syndicats et des associations
● S’agissant des organisations syndicales et patronales
La loi n° 2008-789 du 20 août 2008 a posé les règles de transparence financière applicables aux organisations syndicales et patronales, codifiées aux articles L. 2135-1 à L. 2135-6 du code du travail. La même gradation que celle reprise par le présent article a prévalu s’agissant du degré d’exigence attendue en la matière en fonction de la taille des organisations concernées.
Ainsi, une comptabilité ultra-simplifiée peut être tenue par les organisations dont les ressources annuelles sont inférieures à 2 000 euros (article D. 2135-5), sous la forme d’un livre mentionnant chronologiquement le montant et l’origine des ressources et des dépenses, ainsi que les références aux pièces justificatives. Les ressources en espèces doivent en outre être distinguées des autres ressources.
Les organisations dont les ressources sont inférieures ou égales à 230 000 euros à la clôture de l’exercice sont soumises à une comptabilité simplifiée (article D. 2135-3), sous la forme d’un bilan, d’un compte de résultat et d’une annexe simplifiés. Elles peuvent n’enregistrer leurs créances et leurs dettes qu’à la clôture de l’exercice.
Enfin, au-delà de 230 000 euros de ressources à la clôture de l’exercice, les règles de droit commun de la comptabilité s’appliquent, sous la forme d’un bilan, d’un compte de résultat et d’une annexe, ainsi que par la désignation d’au moins un commissaire aux comptes (articles D. 2135-2 et D. 2135-9).
● S’agissant des associations
Les associations sont régies par deux catégories de règles prévues par les articles L. 612-1 et L. 612-4 du code de commerce.
Les associations dépassant deux des trois seuils suivants :
– 50 salariés ;
– 3,1 millions d’euros de chiffre d’affaires hors taxes ou de ressources ;
– 1,55 million d’euros de total de bilan ;
sont soumises à l’obligation d’établir chaque année un bilan, un compte de résultat et une annexe, et de nommer un commissaire aux comptes.
Des obligations comptables renforcées s’appliquent aux associations qui comptent plus de 300 salariés ou dont le montant du chiffre d’affaires hors taxes ou des ressources est supérieur ou égal à 18 millions d’euros (obligation d’établir une situation de l’actif réalisable et disponible et du passif exigible, un compte de résultat prévisionnel, un tableau de financement et un plan de financement).
Par ailleurs, les associations ayant reçu annuellement des subventions publiques pour un montant supérieur à 153 000 euros sont tenues d’établir des comptes annuels comprenant un bilan, un compte de résultat et une annexe ; elles sont également tenues d’assurer la publicité de leurs comptes et de nommer au moins un commissaire aux comptes.
On le voit, le choix a consisté, pour le premier seuil – celui en deçà duquel il est possible pour un comité d’entreprise de recourir à une comptabilité ultra-simplifiée, de 153 000 euros de ressources annuelles -, à retenir celui qui prévaut aujourd’hui pour les associations recevant le même montant de ressources issues de subventions publiques. Les seuils retenus pour le passage d’une comptabilité simplifiée à une comptabilité de droit commun correspondent quant à eux aux seuils à partir desquels les associations sont aujourd’hui tenues de se soumettre aux obligations comptables de droit commun (en deçà, elles n’y sont donc pas soumises, hors le cas de ressources d’origine publique supérieures à 153 000 euros).
Autrement dit, par comparaison avec les règles applicables aux syndicats, les comités d’entreprise peuvent recourir à une comptabilité ultra-simplifiée jusqu’à des niveaux de ressources beaucoup plus élevés que pour les organisations syndicales et patronales : 153 000 euros pour les comités d’entreprises, 2 000 euros seulement pour les syndicats. Les comités d’entreprise peuvent également tenir une comptabilité simplifiée jusqu’à des seuils beaucoup plus élevés que les syndicats. Le choix d’une souplesse beaucoup plus grande dans les obligations comptables exigibles des comités d’entreprise tient principalement au fait que ceux-ci sont quasi intégralement, pour la plupart, financés par les entreprises elles-mêmes, alors que les organisations syndicales et patronales bénéficient d’un soutien financier public non négligeable.
Cette différence majeure explique l’alignement sur les seuils applicables aux associations, dont le fonctionnement est beaucoup plus comparable à celui d’un comité d’entreprise que ne l’est le fonctionnement d’un syndicat.
Toutefois, la définition et les modalités de calcul des seuils doivent, pour les comités d’entreprise, faire l’objet de quelques aménagements, encore une fois justifiés par leur absence de gestion d’« argent public » en tant que tel, contrairement aux associations.
Ainsi, pour le calcul du seuil d’effectifs de 50 salariés, les dispositions de droit commun du droit du travail (articles L. 1121-1 et L. 1121-2) s’appliqueront pour les comités d’entreprise, alors que dans le cas des associations, ne sont pris en compte que les salariés en CDI. Dans le cadre des travaux du groupe de travail piloté par la direction générale du travail, ce choix de recourir au critère des salariés selon un décompte en équivalent temps plein (ETP) a été opéré à l’unanimité : il s’agit en effet des modalités de calcul qui prévalent également pour la mise en place des institutions représentatives du personnel (IRP)
Par ailleurs, s’agissant du seuil de ressources de 153 000 euros en deçà duquel une comptabilité ultra-simplifiée s’appliquera, les ressources prises en compte pour les comités d’entreprise prennent en compte à la fois la subvention de fonctionnement et la subvention liée aux activités sociales et culturelles, les éventuelles subventions publiques ou syndicales reçues par le comité, les dons et legs, ainsi que les revenus tirés des biens meubles et immeubles du comité. Elles excluent en revanche les recettes mentionnées aux 4° et au 7° de l’article R. 2323-34 et qui recouvrent les cotisations facultatives des salariés de l’entreprise, ainsi que les recettes tirées des manifestations organisées par le comité, qui sont versées par les salariés, et sont particulièrement variables. Ces caractéristiques applicables à la définition des ressources annuelles et à leurs modalités de calcul pour l’appréciation des seuils ont vocation à être spécifiées par décret, comme le prévoit le nouvel article L. 2325-55, qui clôture cette nouvelle section relative à l’établissement et au contrôle des comptes des comités d’entreprise.
Le nouvel article L. 2325-47 prévoit que les transactions « significatives » effectuées par le comité d’entreprise sont retracées soit en annexe de ses comptes, lorsqu’une telle annexe est exigible, autrement dit dans le cas des comités d’entreprise dont les ressources annuelles excèdent 153 000 euros. Pour les comités d’entreprise dont les ressources sont inférieures à 153 000 euros, la présentation des transactions significatives est effectuée dans le cadre du rapport annuel de gestion.
La notion de « transactions significatives » est définie dans un règlement de l’Autorité des normes comptables (ANC). En effet, le décret n° 2009-267 du 9 mars 2009, pris dans le cadre de la transposition de la directive 2006/46 CE du 14 juin 2006 qui concerne les comptes annuels et les comptes consolidés de certaines entités, crée une obligation de communiquer en annexe des comptes individuels et consolidés la liste des transactions conclues avec les parties liées. Ces dispositions, qui figurent aux articles R. 123-197-1 et R. 123-198 du code de commerce, prévoient en effet que les sociétés anonymes doivent mentionner dans l’annexe de leurs comptes la liste des transactions lorsqu’elles « présentent une importance significative et n’ont pas été conclues aux conditions normales du marché ». En application de ces dispositions, le règlement n° 2010-02 de l’ANC définit la transaction présentant une importance significative « si son omission ou son inexactitude est susceptible d’influencer les décisions économiques prises par les utilisateurs se fondant sur les comptes. Le caractère significatif doit s’apprécier en fonction du montant de la transaction et/ou de la nature de la transaction ».
Le nouvel article L. 2325-48 établit les règles applicables en matière de consolidation des comptes pour les comités d’entreprises qui contrôlent une ou plusieurs entités. En effet, conformément à l’article L. 2323-83, certains comités d’entreprise contrôlent, pour la gestion des activités sociales et culturelles, une ou plusieurs entités comme des associations ou des sociétés civiles immobilières (SCI). Les articles R. 2323-22 à R. 2323-27 détaillent les conditions de gestion des activités sociales et culturelles déléguées par le comité d’entreprise à des entités distinctes. Plusieurs cas de figure peuvent ainsi coexister, allant de la participation du comité d’entreprise à la gestion d’une institution sociale pour laquelle au moins la moitié des sièges du conseil d’administration ou des organes de direction de cette institution lui échoient, au contrôle pur et simple de la gestion d’une institution, ce contrôle étant obligatoirement prévu pour les sociétés de secours mutuels et les organismes de sécurité sociale établis dans l’entreprise, ou encore pour les activités sociales et culturelles ayant pour objet d’assurer aux salariés de l’entreprise des logements et des jardins familiaux par exemple.
Le nouvel article L. 2325-48 entend donc préciser les règles applicables en présence de telles entités distinctes, mais contrôlées par le comité d’entreprise, s’agissant des obligations comptables : ainsi, dès lors que l’ensemble constitué par le comité d’entreprise et les entités qu’il contrôle excèdent deux des trois seuils déjà évoqués (50 salariés, 1,55 million d’euros de bilan et de 3,1 millions d’euros de ressources), le comité d’entreprise est tenu d’établir des comptes consolidés.
Ces dispositions appellent deux commentaires.
En premier lieu, la notion de « contrôle » s’apprécie conformément aux règles fixées par l’article L. 233-16 du code de commerce, qui pose l’obligation d’une consolidation des comptes dès lors que les entités contrôlées le sont de manière exclusive ou conjointe, ainsi qu’en cas d’influence notable exercée sur ces entités.
Le contrôle exclusif d’une entité résulte soit de la détention directe ou indirecte de la majorité des droits de vote dans cette entité, soit de la désignation, pendant deux exercices successifs, de la majorité des membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance de cette entité (87), soit du droit d’exercer une influence dominante sur une entité en vertu d’un contrat ou de clauses statutaires, lorsque le droit applicable le permet.
Le contrôle conjoint est le partage du contrôle d’une entité exploitée en commun par un nombre limité d’associés ou d’actionnaires, de sorte que les décisions résultent de leur accord.
L’influence notable sur la gestion et la politique financière d’une entreprise est présumée lorsqu’une entité dispose, directement ou indirectement, d’une fraction au moins égale au cinquième des droits de vote dans cette entreprise.
Les méthodes de consolidation des comptes prévues par ce nouvel article renvoient aux conditions de droit commun prévues par l’article L. 233-18 du code de commerce, qui distingue trois méthodes de consolidation selon le degré de contrôle exercé sur une entité.
Dans le cas d’une entité placée sous le contrôle exclusif du comité d’entreprise, la méthode retenue est celle de la consolidation par intégration globale.
Dans le cas d’une entité contrôlée conjointement avec d’autres actionnaires ou associés par le comité d’entreprise, la méthode retenue est celle de la consolidation par intégration proportionnelle.
Enfin, dans le cas d’une entité placée sous l’influence notable du comité d’entreprise, la méthode retenue est celle de la consolidation par mise en équivalence.
Les prescriptions comptables relatives à ces comptes consolidés sont fixées par un règlement de l’Autorité des normes comptables.
Rigoureusement, cette rédaction conduit à imposer le principe d’une consolidation des comptes et à interdire la méthode dite de l’« agrafage », contrairement à ce qui a été retenu pour les organisations syndicales et patronales, mais aussi contrairement aux conclusions du groupe de travail piloté par la direction générale du travail, qui avait fait le choix d’une liberté laissée en la matière aux comités d’entreprise.
Rappelons que les syndicats dont les ressources sont supérieures à 230 000 euros par an, peuvent procéder, conformément au Règlement n° 2009-10 du 3 décembre 2009 de l’Autorité des normes comptables afférent aux règles comptables des organisations syndicales, s’agissant des entités sous leur contrôle, selon deux méthodes : celle de l’établissement des comptes consolidés ou celle dite de l’« agrafage », qui permet de fournir en annexe des comptes propres, les comptes des personnes modales appartenant au périmètre d’ensemble. Le recours strict au principe de la consolidation des comptes dans le cas des comités d’entreprise, – au lieu de l’alternative entre consolidation et agrafage applicable aux syndicats –, a un double mérite : d’une part, elle permet d’appliquer à l’ensemble des comités d’entreprise dont la taille le justifie l’application des mêmes principes de consolidation et de présentation des comptes, le choix laissé entre les deux méthodes, dans le cas des syndicats, ne permettant aucune comparaison de l’un à l’autre ; d’autre part, la consolidation offre aussi l’avantage d’offrir une vision complète de l’ensemble des activités menées par le comité d’entreprise, alors que dans le cas des syndicats, l’agrafage – lorsque cette méthode est privilégiée – ne permet pas une telle vue d’ensemble.
Le nouvel article L. 2325-49 répond enfin à une ambiguïté qui persistait dans le régime actuel : celle de la définition de l’organe délibérant du comité d’entreprise en charge d’arrêter les comptes, que la rédaction actuelle de l’article R. 2323-37 laisse sans réponse. Ce nouvel article fixe en effet les modalités d’approbation des comptes annuels, précisant que ceux-ci sont « arrêtés selon des modalités prévues par son règlement intérieur par des membres élus du comité d’entreprise désignés par lui et au sein de ses membres élus ».
Ce faisant, deux points en sortent clarifiés :
– d’une part, est consacré le principe selon lequel seuls les membres élus du comité d’entreprise ont un pouvoir de décision sur les budgets du comité d’entreprise. Autrement dit, ni l’employeur, ni les représentants syndicaux au comité d’entreprise ne disposent d’un tel pouvoir. Cette règle est conforme à la jurisprudence : si celle-ci reconnaît bien à l’employeur, en tant que membre du comité d’entreprise, un droit d’accès aux documents comptables (Cass. soc., 19 décembre 1990), elle a eu le loisir de préciser que l’employeur ne participe ni aux votes relatifs à l’utilisation des ressources du comité d’entreprise (Cass. soc., 26 novembre 1987), pas plus qu’à celles consacrées aux activités sociales et culturelles (Cass. soc., 25 janvier 1995).
– d’autre part, le règlement intérieur du comité d’entreprise doit désormais explicitement prévoir les modalités selon lesquelles les comptes sont arrêtés par les membres élus, ce qui est une manière de confirmer le caractère obligatoire de l’adoption d’un règlement intérieur. Si l’article L. 2325-2 dispose d’ores et déjà que le comité d’entreprise détermine, dans un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement et celles de ses rapports avec les salariés de l’entreprise, pour l’exercice des missions qui lui sont conférées, dans les faits, de nombreux comités d’entreprise en restent aujourd’hui totalement dépourvus. La mise en place obligatoire, dans le cadre du règlement intérieur, de règles relatives à l’adoption des comptes par le comité d’entreprise est donc de nature à confirmer son caractère obligatoire.
Le même article L. 2325-49 prévoit que les comptes annuels, ainsi arrêtés, sont le cas échéant mis à la disposition du ou des commissaires aux comptes, conformément aux obligations mises en place par le nouvel article L. 2325-53 pour les comités d’entreprises dépassant deux des trois seuils mis en place (50 salariés, 1,55 million d’euros de bilan et 3,1 millions d’euros de ressources).
Les comptes sont ensuite approuvés par les membres élus du comité d’entreprise réunis en séance plénière, une réunion spécifique devant être consacrée à cette approbation, qui fait également l’objet d’un procès-verbal spécifique. Ici encore, ni l’employeur, ni les représentants syndicaux au comité d’entreprise ne participent à cette réunion d’approbation des comptes, celle-ci étant réservée aux seuls membres élus du comité. Lors de cette réunion, est également présenté le rapport de gestion du comité d’entreprise, codifié au nouvel article L. 2325-50.
Enfin, en l’absence de comptes annuels, autrement dit, dans les comités d’entreprise disposant de moins de 153 000 euros de ressources, la même procédure s’applique pour l’examen et l’approbation des documents comptables exigés pour ces comités d’entreprise de petite taille, à savoir l’état de synthèse simplifié des dépenses et des recettes du comité, l’état patrimonial sommaire et les éventuelles informations complémentaires utiles à l’information des salariés. Au même titre que pour les plus grands comités, lors de cette réunion, est également présenté le rapport de gestion qui comporte des explications qualitatives sur ces documents comptables, prévu au nouvel article L. 2325-50.
2. L’obligation de publication d’un rapport sur les activités et la gestion financière du comité d’entreprise
Le nouvel article L. 2325-50 pose le principe d’un rapport annuel sur les activités et la gestion financière du comité d’entreprise, quelle que soit sa taille. Une telle obligation existe en réalité déjà aujourd’hui, dans le cadre de l’article R. 2323-37, sous la forme d’un compte rendu annuel détaillé de la gestion financière du comité d’entreprise, retraçant le montant des ressources, des dépenses de fonctionnement et des dépenses réalisées au titre des activités sociales et culturelles.
Ce nouvel article L. 2325-50 va cependant plus loin, dans la mesure où il prévoit que les informations données dans le cadre de ce rapport de gestion ont une dimension qualitative susceptible d’éclairer les choix de gestion opérés en cours d’année par le comité d’entreprise. Le contenu obligatoire de ce rapport doit être précisé par décret, qui a vocation à moduler les informations qu’il devra comporter en fonction de la taille du comité d’entreprise.
D’après l’étude d’impact associée au présent projet de loi, ce rapport contiendra, outre une présentation du comité d’entreprise et de ses missions, un bilan de l’exercice passé, avec en particulier la présentation de l’organisation du comité d’entreprise (nombre d’élus, nombre de salariés, organigramme éventuel), les salariés couverts par le comité d’entreprise, un bilan des attributions économique du comité d’entreprise (formation des élus, recours à des experts, communication, réunions avec l’employeur, etc.), un bilan des activités sociales et culturelles et des éventuelles conventions passées en cas de délégation, retraçant :
– les activités menées en rappelant la part subventionnée par le comité d’entreprise, les prestataires auxquels le comité a fait appel, le lieu de réalisation de ces activités, etc. ;
– une présentation des données comptables comparées au budget voté par le comité ;
– des données statistiques de réalisation, par exemple, le nombre de billets distribués, le nombre de participants à un voyage, le nombre de subventions versées.
Enfin, le rapport de gestion devra obligatoirement comporter le bilan financier de l’année, retraçant les dépenses et les ressources du comité d’entreprise. Pour les comités d’entreprise soumis à une comptabilité ultra-simplifiée, le bilan financier consiste à donner des explications qualitatives sur l’état des dépenses et des recettes, l’état patrimonial et l’ensemble des éventuelles informations complémentaires susceptibles d’être utiles à l’information des salariés (échéance des emprunts, bail, etc.).
Les modalités d’établissement de ce rapport de gestion doivent être fixées par le règlement intérieur du comité, confirmant une fois de plus le souhait de rendre désormais l’adoption d’un tel règlement intérieur contraignante.
Lorsque le comité d’entreprise établit des comptes consolidés, le rapport porte bien sur l’ensemble constitué par le comité d’entreprise et les entités qu’il contrôle.
Comme déjà évoqué, ce rapport de gestion est présenté aux membres élus du comité d’entreprise lors de la réunion annuelle plénière d’approbation des comptes.
3. La publicité des comptes et du rapport annuel
Les nouveaux articles L. 2325-51 et L. 2325-52 posent le principe de publicité des comptes des comités d’entreprise, qui est indissociable de l’obligation de transparence financière.
Le nouvel article L. 2325-51 prévoit l’obligation de communiquer l’état des comptes annuels et le rapport de gestion aux membres du comité d’entreprise au plus tard trois jours avant la réunion plénière d’approbation desdits comptes.
Le nouvel article L. 2325-52 prévoit la communication, par tout moyen, de ces mêmes documents (comptes annuels, rapport de gestion ou documents de gestion simplifiés pour les petits comités d’entreprise) aux salariés de l’entreprise. L’actuelle rédaction de l’article R. 2323-37 prévoit déjà que le compte rendu de gestion du comité d’entreprise est porté à la connaissance des salariés « par voie d’affichage sur les tableaux réservés aux communications syndicales ». Désormais, ce sont les comptes annuels et le rapport de gestion qui devront être portés, « par tout moyen », à la connaissance des salariés.
Conformément aux conclusions du groupe de travail mené sous l’égide de la direction générale du travail, le choix a été fait de restreindre la publicité des comptes du comité d’entreprise aux seuls salariés de l’entreprise. Ce choix s’est imposé au regard des missions et de la finalité du comité d’entreprise : contrairement aux organisations professionnelles de salariés et d’employeurs, qui doivent légitimement « rendre des comptes » à l’ensemble de la société, au regard des financements publics dont elles bénéficient, la raison d’être du comité d’entreprise est de représenter les intérêts des seuls salariés de l’entreprise, d’une part en leur assurant une « expression collective » (aux termes de l’article L. 2323-1), s’agissant de ses attributions économiques, au titre des décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production, et d’autre part, en gérant les activités sociales et culturelles de l’entreprise au profit des salariés.
Le rapport de gestion, qui a essentiellement vocation à fournir des informations qualitatives sur les comptes du comité d’entreprise, devrait également contribuer à rendre plus accessibles et compréhensibles ces données financières, que les salariés peuvent avoir des difficultés à s’approprier lorsqu’elles se résument à de stricts tableaux comptables.
B. LA CERTIFICATION DES COMPTES PAR UN COMMISSAIRE AUX COMPTES POUR LES « GRANDS » COMITÉS D’ENTREPRISE
Troisième condition de la transparence financière : la certification des comptes des comités d’entreprise, qui répond à l’une des exigences régulièrement énoncées par la Cour des comptes. Elle fait l’objet du nouvel article L. 2325-53, et est assortie d’une procédure d’alerte en cas de faits de nature à compromettre la continuité de l’exploitation du comité, dans le cadre du nouvel article L. 2325-54.
1. Une obligation de certification des comptes pour les « grands » comités d’entreprise
Le nouvel article L. 2325-53 prévoit que, dès lors que le comité d’entreprise dépasse au moins deux des trois seuils prévus à l’article L. 2325-45 (50 salariés en équivalent temps plein, 1,55 million d’euros de bilan et 3,1 millions d’euros de ressources), il est tenu de nommer au moins un commissaire aux comptes et un suppléant distincts de ceux de l’entreprise.
L’exigence de renforcement de la transparence des comptes des comités d’entreprise doit évidemment être équilibrée et tenir compte d’une certaine « taille critique » des entités concernées, pour deux raisons. La première tient aux masses financières en jeu : plus le comité d’entreprise dispose de ressources importantes, plus le montant et la diversité de ses financements justifient que ses comptes puissent faire l’objet d’un contrôle. La seconde tient au poids d’une réglementation qui ne pourrait être absorbée par de petits comités d’entreprise : outre les obligations comptables qui exigent un degré d’expertise dont ne disposent souvent pas les membres de petits comités d’entreprise, le coût d’une procédure de certification des comptes est élevé : d’après l’étude d’impact, ce coût s’établirait entre 4 000 et 7 200 euros hors taxes pour un comité d’une entreprise de 1 000 salariés, dont le total du bilan s’élèverait à 500 000 euros et les produits d’exploitation à 300 000 euros.
Conformément d’ailleurs aux recommandations de la Cour des comptes de prévoir une telle procédure de certification pour les comités d’entreprise dépassant un certain seuil, le texte fait le choix de ne faire peser cette obligation que sur les « grands » comités d’entreprise, par ailleurs tenus aux obligations comptables de droit commun. Toujours d’après l’étude d’impact, la certification des comptes devrait principalement concerner les comités d’entreprise des entreprises d’au moins 5 000 salariés, ainsi qu’une partie de ceux des entreprises dont les effectifs sont compris entre 2 000 et 5 000 salariés.
Le texte prévoit logiquement que le coût de la certification est pris en charge par le comité d’entreprise sur sa subvention de fonctionnement.
En outre, le texte dispose qu’en présence de comptes consolidés, deux commissaires aux comptes doivent être nommés, conformément à ce qui est prévu par l’article L. 832-2 du code de commerce.
L’obligation de recourir à un commissaire aux comptes pour certifier les comptes des « grands » comités d’entreprise est de nature à garantir une meilleure fiabilité de ces comptes. En effet, l’audit annuel des comptes permet, en dehors même de toute situation d’irrégularité, de diffuser une culture de contrôle interne dans ces structures et d’améliorer progressivement la qualité des comptes et de leur présentation.
Il convient enfin de souligner que le texte précise bien que le commissaire aux comptes désigné est distinct de celui de l’entreprise, répondant en cela aux difficultés soulevées par l’actuelle rédaction de l’article R. 2323-37, qui mentionne pour l’heure le commissaire aux comptes de l’entreprise. Cette précision permet de garantir l’indépendance du comité d’entreprise, doté de la personnalité civile.
2. Une procédure d’alerte en cas de mise à mal de la continuité de l’exploitation du comité d’entreprise
Outre la garantie apportée par cette procédure de contrôle annuel du commissaire aux comptes, il est également indispensable de s’assurer que celui-ci aura les moyens d’intervenir en cas d’identification d’une difficulté qui met en péril la continuité de l’exploitation du comité d’entreprise. C’est l’objet du nouvel article L. 2325-54, qui met en place une procédure d’alerte qui a vocation à être enclenchée par le commissaire aux comptes qui relèverait, « à l’occasion de l’exercice de sa mission, des faits de nature à compromettre la continuité de l’exploitation du comité d’entreprise ».
La procédure d’alerte est composée de plusieurs étapes successives.
Dans un premier temps, dès lors qu’il a connaissance de la nature de tels faits, le commissaire aux comptes en informe le secrétaire et le président du comité d’entreprise, dans des conditions qui ont vocation à être précisées par décret en Conseil d’État. D’après les informations recueillies par votre rapporteur, devraient être retenues les conditions qui s’appliquent aujourd’hui à la procédure d’alerte dans les sociétés commerciales : en l’espèce, dès lors que le commissaire aux comptes relève les faits en question, il en informe sans délai le président du conseil d’administration ou le directoire (article R. 234-1 du code de commerce).
À défaut de réponse du secrétaire dans un délai fixé par décret en Conseil d’État ou si cette réponse ne permet pas au commissaire aux comptes d’être assuré de la continuité de l’exploitation du comité d’entreprise, le commissaire aux comptes établit un rapport spécial et invite l’employeur à réunir le comité d’entreprise afin que celui-ci délibère sur les faits relevés. Une copie de l’invitation adressée à l’employeur est également transmise au président du tribunal de grande instance (TGI) compétent ainsi qu’aux membres du comité d’entreprise.
Le commissaire aux comptes est convoqué à cette réunion, qui se tient dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d’État.
En l’absence de réunion du comité d’entreprise organisée dans les délais impartis, ou en l’absence de convocation du commissaire aux comptes, ou si, à l’issue de cette réunion, le commissaire aux comptes constate que les décisions prises ne permettent pas d’assurer la continuité de l’exploitation, il informe de ses démarches le président du TGI et lui en communique les résultats. Les dispositions de l’article R. 234-7 du code de commerce qui concernent la procédure d’alerte applicable aux sociétés anonymes prévoit que le commissaire aux comptes adresse au président du tribunal la copie de tous les documents utiles à son information, ainsi que l’exposé des raisons qui l’ont conduit à constater l’insuffisance des décisions prises.
Le texte précise que le juge peut convoquer les dirigeants du comité d’entreprise pour envisager les mesures propres à redresser la situation. À l’issue de cet entretien ou si les dirigeants ne se sont pas rendus à sa convocation, le président du TGI peut demander communication de tout renseignement susceptible de lui donner une exacte information sur la situation économique et financière du comité d’entreprise aux commissaires aux comptes, aux membres et représentants du personnel, aux administrations publiques, aux organismes de sécurité sociale et de prévoyance ainsi qu’aux services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement. Cette procédure est entièrement calquée sur celle qui prévaut aujourd’hui dans le cadre de la prévention des difficultés des entreprises à l’article L. 611-2 du code de commerce pour laquelle c’est le président du tribunal de commerce qui est compétent : elle précède généralement la désignation d’un mandataire ad hoc ou le lancement d’une procédure de conciliation.
Dans un délai de six mois à compter du déclenchement de la procédure d’alerte, le commissaire aux comptes peut reprendre le cours de la procédure au point où il l’avait interrompue lorsque, en dépit des éléments ayant motivé son appréciation, la continuité de l’exploitation du comité d’entreprise demeure compromise et que l’urgence commande l’adoption de mesures immédiates.
Le texte prévoit cependant que la procédure d’alerte ne trouve pas à s’appliquer lorsqu’une procédure de conciliation ou de sauvegarde a été engagée, autrement dit, si le comité d’entreprise concerné se trouve en grande difficulté financière.
Cette procédure d’alerte est calée sur celle qui prévaut pour les sociétés commerciales, et plus particulièrement pour les sociétés anonymes à l’article L. 234-1 du code de commerce. Certes, des différences existent, qui tiennent notamment au fait que, s’agissant des sociétés commerciales, deux étapes de convocation se succèdent : celle, en premier lieu, du conseil d’administration, puis celle, en second lieu, le cas échéant, de l’assemblée générale.
La procédure retenue ici pour le comité d’entreprise confirme l’importance du rôle du secrétaire du comité d’entreprise, qui en est le principal représentant, l’employeur se contentant d’en assurer la présidence. Chacun d’eux est informé en amont par le commissaire de l’existence des faits mis en cause, mais une réponse doit bien être apportée par le seul secrétaire, qui est en quelque sorte le « dirigeant » du comité d’entreprise. L’employeur est, en tant de président du comité, informé de la démarche du commissaire aux comptes, mais n’a en réalité aucun « compte à rendre » sur les faits incriminés.
On remarquera en outre que le délai de réponse fixé au président du conseil d’administration ou du directoire, dans le cas d’une société anonyme, est fixé par la loi à quinze jours ; dans le cadre de la procédure d’alerte applicable au comité d’entreprise, ce délai imparti au secrétaire du comité d’entreprise doit intervenir par voie réglementaire.
Enfin, dans le cas des sociétés anonymes, le rapport spécial du commissaire aux comptes n’est rédigé que dans l’hypothèse où le conseil d’administration ou le conseil de surveillance n’a pas été réuni, qu’il n’a pas été convoqué à cette séance ou que les décisions qui y ont été prises ne permettent pas de répondre au problème soulevé, alors que dans le cas du comité d’entreprise, ce rapport spécial est rédigé beaucoup plus en amont, dès lors que le commissaire aux comptes n’aurait pas obtenu de réponse du secrétaire du comité d’entreprise ou que sa réponse apparaîtrait insuffisante pour répondre aux difficultés soulevées.
C. LA MISE EN PLACE D’UNE COMMISSION DES MARCHÉS DANS LES « GRANDS » COMITÉS D’ENTREPRISE
Dans les comités d’entreprises dépassant deux des trois seuils prévus à l’article L. 2325-45, – soit 50 salariés en équivalent temps plein, 1,55 million d’euros de bilan et 3,1 millions d’euros de ressources –, le renforcement de l’exigence de transparence financière conduit le présent texte à imposer la mise en place, au sein du comité d’entreprise, d’une commission des marchés. Ces dispositions sont prévues par les nouveaux articles L. 2325-34-1 à L. 2325-34-4.
En effet, le comité d’entreprise peut, en vertu de l’article L. 2325-22, créer en son sein des commissions pour l’examen de problèmes particuliers, afin de le mettre en mesure de satisfaire aux missions qui lui sont confiées, en particulier s’agissant de ses attributions économiques. Ainsi, la création d’une commission économique est-elle exigée dans toute entreprise de plus de mille salariés, tandis qu’une commission de la formation est obligatoire dès lors que l’entreprise dépasse le seuil de deux cents salariés. Une commission d’information et d’aide au logement est également créée dans toute entreprise d’au moins trois cents salariés, et une commission de l’égalité professionnelle est prévue dans toute entreprise de plus de deux cents salariés. Ces commissions seront désormais complétées par une commission des marchés, obligatoirement créée dans les comités d’entreprise dépassant plus de deux des trois seuils déjà évoqués, aux termes du nouvel article L. 2325-34-1 (rédaction : « au II de l’article L. 2325-45 »).
On remarque qu’il s’agit de la seule commission dont le seuil de déclenchement soit lié à la taille du comité d’entreprise et non aux effectifs de l’entreprise, ce qui s’explique par sa finalité : la commission des marchés n’a de raison d’être qu’interne au fonctionnement du comité d’entreprise.
Le nouvel article L. 2325-34-3 précise que les membres de la commission des marchés sont désignés par le comité d’entreprise parmi ses membres titulaires : autrement dit, seuls les membres élus, qui plus est, titulaires, peuvent être désignés membres de la commission des marchés. En outre, le règlement intérieur du comité d’entreprise fixe les modalités de fonctionnement de la commission, le nombre de ses membres, les modalités de leur désignation et la durée de leur mandat. Cette disposition relative au règlement intérieur renforce bien le caractère contraignant de ce dernier pour les « grands » comités d’entreprise.
Les nouveaux articles L. 2325-34-2 et L. 2325-34-4 détaillent le rôle de la commission des marchés au regard de la politique menée par le comité d’entreprise en la matière. Ainsi, la commission des marchés est-elle chargée de :
– proposer au comité d’entreprise les critères de choix des fournisseurs et prestataires et la procédure des achats de fournitures, de services et de travaux ;
– choisir les fournisseurs et les prestataires, en rendant compte annuellement au comité d’entreprise de ses choix ;
– établir un rapport d’activité annuel, joint en annexe au rapport annuel de gestion du comité d’entreprise.
Le comité d’entreprise se contente, dans ce cadre, d’arrêter les critères de choix des fournisseurs et prestataires et la procédure des achats de fournitures, de services et de travaux, qui lui sont proposés par la commission des marchés, à charge pour cette dernière de réaliser, en avant, les choix les plus avisés sur la base de ces critères. Cette commission des marchés se voit réellement dotée des pouvoirs opérationnels en matière de politique des achats du comité d’entreprise : elle seule sera véritablement décisionnaire en la matière.
Ce rôle important donné à la commission des marchés permet une meilleure responsabilisation des membres du comité d’entreprise, en identifiant plus précisément ceux auxquels il incombe de gérer la politique des achats du comité.
Le rapport annuel d’activité de la commission des marchés a vocation à obéir aux règles de publicité des comptes prévues à l’article L. 2325-52 : dans la mesure où il doit en effet figurer en annexe du rapport annuel de gestion, il devra en effet être inclus dans l’ensemble des documents qui seront portés à la connaissance des salariés.
D. L’APPLICATION DES RÈGLES DE TRANSPARENCE DES COMPTES AU COMITÉ CENTRAL D’ENTREPRISE ET AUX COMITÉS D’ÉTABLISSEMENT
Le III du présent article entend rendre applicables les exigences de transparence des comptes imposées au comité d’entreprise, en présence d’une entreprise comportant des établissements distincts, autrement dit, en présence de comités d’établissement et d’un comité central d’entreprise. Il modifie par conséquent le chapitre VII consacré au comité central d’entreprise et aux comités d’établissement du titre 2 relatif au comité d’entreprise.
Rappelons qu’aux termes de l’article L. 2327-1, en présence d’établissements distincts, il est légalement obligatoire de constituer des comités d’établissement et un comité central d’entreprise (CCE), ce dernier étant constitué d’une délégation élue des comités d’établissement, d’un représentant de chaque organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise, et enfin, en tant que président du CCE, de l’employeur.
Le nouvel article L. 2327-12-1 tire les conséquences, au niveau du comité central d’entreprise, du souhait de donner un caractère véritablement contraignant à l’adoption d’un règlement intérieur du comité d’entreprise : cet article duplique donc mot pour mot, au niveau du CCE, les dispositions de l’article L. 2325-2 applicables au comité d’entreprise, en prévoyant que « le comité central d’entreprise détermine, dans un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement et de ses rapports avec les salariés de l’entreprise, pour l’exercice des missions qui lui sont conférées par le présent titre ».
Le nouvel article L. 2327-14-1 complète la sous-section 3, consacrée au fonctionnement du comité central d’entreprise, pour rendre applicables à ce dernier l’ensemble des dispositions de la nouvelle section 10 créée par le présent article, relative à l’établissement et au contrôle des comptes. Les conditions dans lesquelles les nouvelles exigences de transparence financière seront rendues applicables au comité central d’entreprise doivent être précisées par décret. D’après les informations fournies à votre rapporteur, seule la définition des ressources nécessitera une adaptation s’agissant du CCE, les ressources annuelles du CCE n’étant pas du tout équivalentes, en termes de masses financières, à celles perçues par un comité d’entreprise. En effet, le comité central d’entreprise ne dispose pas de subvention financière spécifique.
Enfin, le texte modifie l’article L. 2327-16, relatif à la gestion des activités sociales et culturelles dans les entreprises pourvues de comités d’établissement et d’un comité central d’entreprise (CCE). En effet, il revient par défaut aux comités d’établissement d’assurer et de contrôler la gestion de ces activités. Il est toutefois possible de confier au CCE la gestion d’activités communes, ce qui, dans les faits, est la solution la plus souvent choisie, dans la mesure où elle permet une plus grande mutualisation. Un tel transfert ne peut cependant pas avoir pour conséquence de priver l’établissement de la subvention de l’employeur au titre de ces activités à laquelle il a droit, sur la base de la masse salariale de l’établissement : autrement dit, en cas de transfert de gestion au CCE, l’employeur continue de verser la subvention au titre des activités sociales et culturelles à chaque comité d’établissement, qui ensuite seulement, en délègue la gestion et en transfère les sommes au CCE.
Les compétences respectives du CCE et des comités d’établissement en matière de gestion des activités sociales et culturelles peuvent en outre être fixées par accord conclu entre l’employeur et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, dans les conditions classiques applicables à ce niveau : un tel accord n’est néanmoins pas obligatoire pour organiser la répartition des compétences entre le niveau de l’établissement et le niveau de l’entreprise pour la gestion des activités sociales et culturelles.
Ces règles posent question au regard des exigences de transparence des comptes. En effet, à quel niveau faut-il comptabiliser les ressources perçues au titre des activités sociales et culturelles ? Au niveau de l’établissement qui en reste le percepteur « physique » ? Au niveau du comité central d’entreprise, qui les perçoit en aval, au titre de la gestion qui lui a été transférée ?
Afin d’éviter que ces ressources ne soient prises en compte par deux fois pour l’appréciation des seuils déclenchant le type de comptabilité et de transparence exigible des comités d’entreprise, le choix a été fait de ne comptabiliser, au niveau des comités d’établissement, que les « ressources nettes », autrement dit les ressources après déduction de celles versées au CCE en vertu d’une convention de transfert de gestion. Afin de garantir les conditions de la transparence financière, autrement dit, de déterminer précisément à quel niveau (établissement ou entreprise) les ressources et les dépenses relatives aux activités sociales et culturelles doivent être prises en compte, le 3° du présent III précise donc que tout éventuel transfert de la gestion d’activités sociales et culturelles fait l’objet d’une convention entre les comités d’établissement et le CCE, les clauses d’une telle convention devant être précisées par décret.
D’après les informations fournies dans le cadre de l’étude d’impact, la convention de transfert de gestion devra au minimum comporter :
– le champ des activités dont la gestion est transférée ;
– les modalités de ce transfert, tant en moyens humains que financiers ;
– les obligations respectives des contractants ;
– la durée de la convention qui ne peut être supérieure à la durée du mandat des membres du comité d’établissement.
Il s’agit donc bien de rendre obligatoires les conventions de transfert de gestion d’activités sociales et culturelles entre le CCE et les comités d’établissement.
E. L’APPLICATION DES RÈGLES DE TRANSPARENCE DES COMPTES AUX INSTITUTIONS SOCIALES DES INDUSTRIES ÉLECTRIQUES ET GAZIÈRES
Le IV prévoit explicitement que l’ensemble des nouvelles dispositions prévues en matière d’exigence de transparence financière par le présent article sont applicables à la caisse centrale d’activités sociales (CCAS), aux caisses mutuelles complémentaires et d’action sociale (CMCAS) et au comité de coordination des industries électriques et gazières, prévues à l’article 47 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz.
Une disposition spécifique est en effet nécessaire pour rendre applicables ces nouvelles règles aux institutions sociales des industries électriques et gazières (IEG), qui recouvrent, en 2011, d’après la Cour des comptes :
– la Caisse centrale des activités sociales (CCAS), qui gère les activités sociales de dimension nationale (vacances et restauration, notamment), et est dotée d’un réseau local de caisses assurant l’accueil et le renseignement des bénéficiaires ;
– les 69 Caisses mutuelles complémentaires et d’action sociale (CMCAS), qui gèrent les activités sociales de dimension locale (activités de proximité pour les enfants, par exemple) et distribuent des prestations sanitaires et sociales ;
– environ 600 sections locales de vie, qui accueillent et renseignent les bénéficiaires ;
– un comité de coordination, qui représente les CMCAS et coordonne leur activité ;
– et enfin, un organisme de formation, l’IFOREP.
L’article L. 2321-1 du code du travail prévoit que les dispositions du titre II, relatives au comité d’entreprise, s’appliquent aux employeurs de droit privé ainsi qu’à leurs salariés. Elles sont également applicables aux établissements publics industriels et commerciaux (EPIC), ainsi qu’aux établissements publics administratifs (EPA) lorsqu’ils emploient du personnel dans les conditions du droit privé, le cas échéant pour ces deux dernières catégories, sous réserve d’adaptations, pour tenir compte du caractère particulier de certains de ces établissements et des institutions représentatives du personnel éventuellement existantes.
Les institutions sociales des IEG ne relèvent pas du droit commun du travail, en dépit du statut d’Électricité de France (EDF) et de Gaz de France (GDF), qui sont des sociétés anonymes depuis la loi du 9 août 2004 : nées en même temps qu’était consacré le statut national du personnel des industries électriques et gazières en 1946, ces institutions ont la particularité d’être « communes à l’ensemble des entreprises de la branche, en lieu et place des comités d’entreprise distincts existant dans les autres branches de l’économie », comme le relève la Cour des comptes dans son rapport thématique de mai 2011 consacré aux IEG.
En réalité, les IEG ne disposent pas des « attributions économiques » dévolues aux comités d’entreprise, mais se contentent de gérer les institutions sociales des personnels de cette branche professionnelle. En raison du rôle historiquement dévolu à l’État, les employeurs ne participent pas aux instances délibératives de ces institutions sociales, qui jouent donc le rôle d’un comité d’entreprise au titre des activités sociales et culturelles, sans néanmoins relever aucunement par ailleurs des dispositions du code du travail applicables aux comités d’entreprise.
C’est pourquoi une disposition juridique spécifique doit être prévue pour appliquer aux institutions sociales des IEG les exigences de transparence financière mises en place par le présent article.
F. L’ENTRÉE EN VIGUEUR DES EXIGENCES DE TRANSPARENCE FINANCIÈRE
Le V du présent article prévoit l’entrée en vigueur :
– immédiate, dès promulgation de la loi, de la disposition relative à l’obligation de conventionnement entre les comités d’établissement et le comité central d’entreprise (CCE), en cas de transfert de la gestion d’activités sociales et culturelles ;
– aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015, s’agissant des obligations relatives à l’application des règles comptables en fonction de la taille du comité d’entreprise, à la publicité des comptes, à la publication d’un rapport annuel de gestion financière, ainsi qu’à la mise en place d’une commission des marchés dans les « grands » comités d’entreprise ;
– et enfin, aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016 s’agissant des obligations pesant sur les « grands » comités d’entreprise en matière de consolidation des comptes et de certification des comptes par un commissaire aux comptes, ainsi que pour l’entrée en vigueur de la procédure d’alerte par le commissaire aux comptes.
*
* *
Lors de son examen du texte, votre commission a adopté une série d’amendement à l’initiative de votre rapporteur. Elle a ainsi souhaité prévoir :
– la désignation obligatoire par tout comité d’entreprise, sans condition de seuil de ressources, d’un trésorier en son sein ;
– la présentation par le trésorier du comité d’entreprise ou, le cas échéant, par le commissaire aux comptes, d’un rapport présentant les éventuels contrats conclus entre le comité d’entreprise et l’un de ses membres, soit directement, soit indirectement, soit par personne interposée. Ce rapport doit être présenté aux membres élus du comité d’entreprise ;
– la conservation pendant dix ans, par le comité d’entreprise, des documents comptables et des pièces justificatives qui s’y rapportent ;
– et enfin, la possibilité de procéder à la passation de marchés sans recourir à la procédure prévue dans le cadre de la commission des marchés, pour les marchés inférieurs à un seuil fixé par décret.
*
* *
La Commission est saisie de l’amendement AS404 du rapporteur.
M. le rapporteur. Dès lors que l’on soumet le comité d’entreprise aux règles comptables du droit commun et à une obligation de transparence financière, il semble indispensable de prévoir la désignation d’un trésorier en son sein, comme c’est la règle dans toute structure associative ayant à gérer des fonds, même peu importants.
M. Gérard Cherpion. S’agit-il d’adjoindre une personne supplémentaire au comité d’entreprise ?
M. le rapporteur. Non, le trésorier serait choisi parmi les membres.
Le meilleur moyen d’assurer la transparence des comptes est de nommer une personne qui en a la responsabilité. La disposition aurait en outre l’avantage d’en finir avec la toute-puissance du secrétaire.
La Commission adopte l’amendement.
Puis elle adopte successivement les amendements rédactionnels ou de précision AS462 à AS470, AS473 et AS471 du rapporteur.
Elle examine ensuite l’amendement AS414 du même auteur.
M. le rapporteur. Il s’agit de prévoir, lors de la réunion d’approbation des comptes, la remise aux membres élus du comité d’entreprise d’un rapport sur les conventions passées directement, indirectement ou par personne interposée entre le comité d’entreprise et l’un de ses membres. Cette mission incomberait au trésorier ou, le cas échéant, au commissaire aux comptes. On compléterait ainsi le processus de transparence financière mis en œuvre par l’article, en levant tout doute quant à d’éventuelles collusions entre les membres du comité d’entreprise et le comité lui-même.
La Commission adopte l’amendement.
Puis elle adopte successivement les amendements rédactionnels ou de précision AS472, AS474 à AS477, AS481, et AS478 à AS480 du même auteur.
Elle en vient à l’amendement AS402 du même auteur.
M. le rapporteur. Je retire l’amendement.
M. Arnaud Richard. Pourquoi ? L’idée paraît intéressante.
M. le rapporteur. L’inscription dans la loi de l’obligation de recourir à un expert-comptable serait, me dit-on, une première. La question mérite vérification.
M. Denys Robiliard. Elle est importante. Si l’on prévoit l’intervention d’un commissaire aux comptes uniquement pour les comités d’entreprise dont les ressources dépassent 3,1 millions d’euros, seuls quelques comités seront concernés. Il en ira tout autrement si un expert-comptable est requis au-delà d’un seuil de 153 000 euros.
Des obligations et des seuils de même nature existent déjà, sauf erreur de ma part, pour les associations.
La profession d’expert-comptable étant réglementée et soumise à une déontologie, cette disposition serait un premier moyen de contrôle. Je souhaite donc que l’amendement revienne en discussion dans l’hémicycle.
Mme Véronique Louwagie. Si les associations doivent avoir recours à un commissaire aux comptes au-delà de certains seuils, aucun texte ne leur fait obligation de s’attacher les services d’un expert-comptable pour la tenue des comptes. S’agissant des comités d’entreprise, en revanche, le code du travail prévoit que l’expert-comptable apporte une expertise technique, par exemple en matière d’analyse des documents prévisionnels et d’orientations stratégiques. Mais la tenue des comptes relève de la liberté contractuelle. Ce que propose l’amendement serait donc une première. Avec un seuil de 153 000 euros, seuls 5 000 des comités d’entreprise – soit 8,63 % – seraient concernés, sachant que nombre d’entre eux ont déjà recours à un commissaire aux comptes.
Je ne voudrais pas que l’on introduise une ambiguïté entre les deux professions. Jusqu’à présent, on a toujours confié les missions d’audit et de contrôle – donc de détection de faits délictueux et d’alerte – aux commissaires aux comptes. Lorsque les comités d’entreprise font appel à des experts-comptables, c’est de manière libre, comme le font les commerçants ou les artisans, et souvent parce qu’ils sont de petite taille et n’ont pas les moyens humains et matériels suffisants. Ce n’est pas le cas de ceux dont les ressources sont supérieures à 153 000 euros, puisque ce seuil correspond à des entreprises d’environ 500 salariés.
L’amendement est retiré.
La Commission est saisie de l’amendement AS403 du rapporteur.
M. le rapporteur. Je propose la mise en place d’une procédure d’archivage des pièces comptables des comités d’entreprise, pour éviter par exemple que les documents ne disparaissent comme par enchantement au lendemain d’une élection.
La Commission adopte l’amendement.
Elle adopte successivement les amendements de précision AS482 et AS483 du rapporteur.
Elle examine ensuite l’amendement AS405 du même auteur.
M. le rapporteur. Il s’agit de restreindre aux marchés dont la valeur est significative la procédure qui requiert l’intervention de la commission des marchés du comité d’entreprise et la justification du choix du prestataire ou du fournisseur. En effet, cette procédure serait très lourde pour la passation de très petits marchés. Il convient aussi de penser aux marchés qui doivent relever du libre arbitre du comité d’entreprise, par exemple le recours à un conseil juridique, à un expert, ou encore le financement de la formation de ses membres élus.
La fixation par décret d’un seuil en deçà duquel il ne serait pas obligatoire de faire usage de cette procédure devrait permettre de régler la plupart des cas dans lesquels le comité d’entreprise a légitimement besoin d’être libre de son choix. Ce seuil pourrait se situer entre 20 000 et 30 000 euros.
La Commission adopte l’amendement.
Puis elle adopte successivement l’amendement rédactionnel AS484 et l’amendement de précision AS485 du rapporteur.
Elle en vient à l’amendement AS45 rectifié de M. Gérard Cherpion.
M. Gérard Cherpion. Lorsque les comités d’entreprise font l’objet de redressements par les URSSAF, les sommes dues sont actuellement supportées par l’entreprise. Étant donné que le projet de loi rend le comité d’entreprise responsable de la certification de ses comptes, y compris en lui en faisant supporter le coût, il paraît opportun, dans la même logique de responsabilité, de faire supporter les coûts d’un redressement URSSAF par le comité lui-même.
M. le rapporteur. Il n’y a aucune raison juridique pour contraindre l’entreprise à payer pour un redressement subi par son comité d’entreprise, même si l’on nous a rapporté des cas où cela s’est fait. Le comité d’entreprise est doté de la personnalité civile. Celle-ci ne se confond pas avec celle de l’entreprise. Nous ne disposons d’aucun élément tangible permettant de justifier le paiement des redressements par cette dernière en lieu et place du comité d’entreprise – sinon, éventuellement, la volonté de passer l’éponge… Avis défavorable.
M. Gérard Cherpion. Pourquoi ne pas inscrire dans le texte qu’il revient au comité d’entreprise de payer les redressements dont il fait l’objet ? Nous lèverions l’ambiguïté.
M. Denys Robiliard. Je sais d’où vient la demande de faire obligation à l’employeur d’acquitter les redressements infligés à son comité d’entreprise. Mais, en l’état et en l’absence de jurisprudence qu’on aurait portée à notre connaissance, nous ne voyons pas ce qui peut le justifier. Quant à l’amendement, s’il faut écrire qu’une personne n’est pas responsable d’une autre quand aucun texte ne laisse à penser qu’elle pourrait l’être, on n’a pas fini de remplir les codes !
La Commission rejette l’amendement.
Puis elle adopte successivement les amendements de précision AS486 à AS488 du rapporteur.
Elle adopte l’article 19 modifié.
TITRE III
INSPECTION ET CONTRÔLE
Article 20
(art. L. 4721-8 ; L. 4722-1 ; L. 4722-2 ; L. 4723-1 ; L. 4723-2 ; L. 4731-1 à L. 4731-5 ; L. 4732-1 à L. 4732-3 ; L. 4741-3 ; L. 4751-1 ; L. 4751-2 ; L. 8111-1 ; L. 8112 -1 à L. 8112-5 [nouveaux] ; L. 8113-4 et L. 8113-5 [nouveaux] ; L. 8113-7 ; L. 8114-1 ; L. 8114-4 à L. 8114-7 [nouveaux] ; L. 8115-1 à L. 8115-8 [nouveaux] ; L. 8122-1 et L. 8122-2 [nouveaux] ; L. 8123-2 ; L. 8123-4 du code du travail ; art. 524 du code de procédure pénale)
Réforme de l’inspection du travail
Le présent article propose une réforme d’ensemble de l’inspection du travail, pour rendre son organisation plus collective et efficace, étendre les pouvoirs d’intervention de ses agents, et améliorer le dispositif de sanction des infractions au code du travail, dans le respect du principe d’indépendance de cette administration.
Il s’inscrit dans le cadre du projet « ministère fort » et accompagne le plan de transformation des emplois, pour redonner à l’inspection du travail les moyens d’action nécessaires pour assurer le respect de l’effectivité du droit du travail dans un contexte économique et social qui a subi de forts changements.
L’organisation actuelle de l’inspection du travail lui permet de plus en plus difficilement de faire face aux nouveaux défis du monde du travail, marqué par l’émergence de nouveaux risques, tels que ceux liés aux nanotechnologies et aux substances cancérogènes, et de formes de plus en plus complexes de fraudes, en matière de travail illégal notamment, devenues plus ardues à identifier avec l’éclatement croissant des lieux de travail et de production.
Les évolutions récentes de l’organisation de l’inspection du travail ont produit des résultats discutés et n’ont pas réussi à enrayer plusieurs problèmes de fond et, en particulier, le sentiment d’isolement éprouvé par les agents. C’est pourquoi le présent article vise à rendre cette organisation à la fois plus collective et efficace, afin que les agents de l’inspection du travail soient mieux armés dans l’exercice de leurs missions quotidiennes.
A. L’ORGANISATION ACTUELLE DE L’INSPECTION DU TRAVAIL
L’inspection du travail est aujourd’hui organisée en quatre échelons hiérarchiques. Les agents se trouvent ainsi sous l’autorité, au niveau national, de la direction générale du travail (DGT), au niveau régional, du directeur de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE), et au niveau local, du responsable de l’unité territoriale puis du responsable de section.
1. L’autorité nationale de la Direction générale du travail (DGT)
La direction générale du travail (DGT) exerce, tout d’abord, la fonction d’autorité nationale et centrale du système d’inspection du travail. À ce titre, elle se trouve chargée de :
– déterminer les orientations de la politique du travail, coordonner et évaluer les actions, notamment en matière de contrôle de l’application du droit du travail ;
– contribuer à la définition des principes de l’organisation du réseau territorial ;
– assurer l’appui et le soutien des services déconcentrés dans l’exercice de leurs missions ;
– veiller au respect des règles déontologiques des agents de l’inspection du travail ;
– coordonner les liaisons avec les services exerçant des fonctions d’inspection du travail relevant d’autres départements ministériels.
Si seule la DGT dispose des prérogatives et du statut d’autorité centrale, d’autres instances participent, au niveau national, à l’animation du système d’inspection du travail. Il s’agit, en particulier, du Conseil national de l’inspection du travail (CNIT), organe consultatif indépendant qui a pour vocation d’apporter une garantie aux agents participant aux activités de contrôle de l’inspection du travail, afin qu’ils puissent accomplir leurs missions telles qu’elles sont définies tant par les conventions de l’organisation internationale du travail (OIT) que par le code du travail.
2. L’autorité régionale de la DIRECCTE
Au niveau régional, le directeur de la DIRECCTE exerce, ensuite, la fonction d’autorité hiérarchique. Dans le cadre des directives de la DGT, il est chargé de :
– mettre en œuvre au plan régional la politique définie par les pouvoirs publics, afin d’améliorer les relations collectives et individuelles et les conditions de travail dans les entreprises ;
– définir les orientations générales des actions d’inspection de la législation du travail, qu’il organise, coordonne, suit et évalue ;
– coordonner l’action de ses services avec les autres services de l’État et les organismes chargés de la prévention ou du contrôle, en matière d’inspection de la législation du travail, de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail ;
– assurer le suivi de la négociation collective dans les entreprises et au niveau territorial ;
– faire le lien avec les autorités judiciaires, sous réserve des attributions confiées par la loi aux inspecteurs du travail ;
– exercer les pouvoirs propres qui lui sont conférés par le droit en vigueur.
Pour mener à bien ses missions, le directeur de la DIRECCTE bénéficie de l’assistance du responsable du pôle « T », soit le pôle compétent en matière de travail, auquel il peut déléguer sa signature.
Au sein de la DIRECCTE, le pôle « T » assume, plus précisément, la charge de l’impulsion, du pilotage et de l’évaluation de la politique du travail. S’agissant de l’inspection du travail, il assure, en particulier, la programmation, le suivi, le bilan et l’évaluation de l’action de contrôle, la cohérence et l’efficacité de l’organisation des sections, les relations avec les partenaires et organismes contribuant à l’effectivité du droit, la mise en œuvre de la protection des agents, et la mobilisation des différentes ressources d’appui en leur faveur.
Les agents de contrôle de l’inspection du travail peuvent, en effet, bénéficier de l’appui technique d’agents régionaux, membres de la cellule pluridisciplinaire du pôle « T », aux missions et compétences spécifiques, tels que les médecins inspecteurs du travail et les ingénieurs de prévention. Depuis plus de dix ans, s’est également développée la fonction « appui-ressources-méthodes » (ARM), pour fournir un soutien aux interventions des agents sur le terrain et capitaliser les expériences et savoir-faire. Si près de 30 % des agents ARM travaillent aujourd’hui dans les pôles « T », la majorité a été affectée dans les unités territoriales, au plus près de l’échelon opérationnel.
3. L’autorité locale de l’unité territoriale
Au niveau local, le responsable de l’unité territoriale de la DIRECCTE assume le pouvoir hiérarchique sur les agents de l’inspection du travail. Il exerce cette prérogative au nom du directeur régional, qui peut lui déléguer sa signature. Il doit veiller à ce que les orientations nationales et régionales soient déclinées au niveau territorial.
Il existe aujourd’hui 102 unités territoriales, dont les pôles chargés du travail regroupent, en général, les sections d’inspection du travail, des agents de renfort et d’appui-ressources-méthodes (ARM), évoqués ci-dessus, un service de renseignement du public, et des fonctions administratives réunies dans une section centrale travail. Dans les plus grandes unités territoriales, un service spécialisé, composé d’agents de contrôle, exerce une compétence départementale, centrée sur la lutte contre le travail illégal.
4. La section d’inspection du travail
La section d’inspection du travail constitue, enfin, l’échelon territorial d’intervention dans l’entreprise. Leur nombre est fixé par le ministre chargé du travail : il en existe aujourd’hui 790. Puis, le directeur de la DIRECCTE décide de leur localisation et de leur délimitation, en tenant compte de la densité des implantations d’établissements et de la population salariée.
Chaque section se compose d’un responsable, le plus souvent un inspecteur du travail, d’un ou plusieurs contrôleurs du travail, et d’assistants. Les contrôleurs du travail exercent leurs missions et compétences sous l’autorité de l’inspecteur du travail, qui organise l’action du service et en rend compte.
Par ailleurs, dans chaque département, une ou plusieurs sections sont chargées du contrôle des professions agricoles. Fin 2012, on en recense 94. Pour le contrôle des activités maritimes, 22 sections spécialisées sont actuellement en activité, dont 7 essentiellement dédiées à ce secteur.
B. UNE ORGANISATION APPELÉE À SE RÉFORMER AU VU DES RÉSULTATS DISCUTÉS DE SES ÉVOLUTIONS RÉCENTES
L’organisation actuelle de l’inspection du travail se trouve, en partie, issue de deux réformes récentes, dont les résultats restent sujets à caution et qui n’ont pas permis de résoudre certaines difficultés prégnantes, tel que les besoins de coordination et de compétence technique accrus face aux changements du monde du travail. C’est pourquoi le ministre chargé du travail, M. Michel Sapin, a proposé un nouveau projet de réforme, dénommé « ministère fort », que le présent article vise à décliner au niveau législatif.
1. Les résultats discutés du plan de modernisation (PMDIT) et de la fusion des services d’inspection
L’organisation de l’inspection du travail a connu ces dernières années deux évolutions majeures, avec la mise en œuvre du plan de modernisation et de développement de l’inspection du travail (PMDIT), puis la fusion des quatre services d’inspection du travail dans le cadre de la révision générale des politiques publiques (RGPP).
Le PMDIT, lancé en 2006, visait, tout d’abord, à renforcer la politique du travail grâce à une valorisation de l’action de contrôle, un meilleur pilotage stratégique et une réévaluation des moyens à hauteur des missions. Le premier axe de ce plan a donc consisté en une augmentation des effectifs de contrôle, avec l’objectif de créer 700 postes budgétaires supplémentaires entre 2007 et 2010. Le deuxième axe avait pour but de structurer les fonctions de pilotage et d’animation de l’activité de l’inspection du travail : il s’est notamment traduit par la création de la Direction générale du travail (DGT), devenue l’autorité centrale du système. Le troisième axe du plan a conduit à l’élaboration de priorités nationales et régionales au travers d’une programmation pour déployer une politique du travail cohérente et unifiée sur le territoire.
En décembre 2007, a ensuite été décidée la fusion des quatre services d’inspection du travail (industrie, commerce et services ; agriculture ; transports ; mer), au sein d’un service unique à compétence généraliste, placé sous l’autorité du ministre chargé du travail. Cette mesure a pris effet le 1er janvier 2009. Par ailleurs, la création des DIRECCTE, en 2010, a entraîné des ajustements de l’organisation de l’inspection du travail, comme pour l’ensemble des administrations de l’État exerçant une compétence économique et sociale.
D’après un rapport parlementaire d’octobre 2011 (88), les résultats tant du PMDIT que de la fusion des services demeurent discutés. Ainsi, si le nombre d’agents de contrôle a augmenté, via la création de plus de 200 sections et 400 postes d’agents, ce rapport souligne que le PMDIT n’aurait pas totalement été réalisé car la hausse des effectifs et des sections a été en partie opérée par le biais des redéploiements permis par la fusion des services d’inspection. En outre, a été observé sur la période une réduction des effectifs de secrétariat des sections.
Concernant les nouvelles modalités de pilotage et de programmation, ce rapport constate également qu’ils n’ont pas suscité pleinement l’adhésion des agents. Ces derniers dénonçaient, en particulier, la difficulté de respecter les normes de répartition des tâches à accomplir, entre le contrôle et l’information des entreprises, ainsi que la lourdeur du processus d’enregistrement informatique des missions menées.
Enfin, s’agissant des conséquences de la fusion des services, ce rapport note un risque de déperdition d’expertise dans des secteurs présentant une grande technicité, tels que les transports.
2. Pour un « ministère fort »
Au-delà de ces critiques, les évolutions récentes de l’organisation de l’inspection du travail n’ont pas permis de résoudre le problème du sentiment croissant de malaise des agents, qui exercent leurs missions dans un contexte social tendu, marqué par la crise et par une recrudescence des incivilités voire des agressions à leur égard.
Ces derniers se trouvent, de surcroît, désormais confrontés à la gestion de nouveaux risques, tels que les troubles psychosociaux, qui nécessitent des interventions requérant un investissement important. Par ailleurs, les infractions au code du travail revêtent des formes de plus en plus complexes, au sein de réseaux, en matière de travail illégal par exemple, qui dépassent souvent le niveau local.
Or l’organisation actuelle de l’inspection du travail, issue du PMDIT et de la fusion des services, ne permet pas de répondre à ces difficultés. Pour y remédier, le ministre chargé du travail, M. Michel Sapin, a décidé de la mise en œuvre d’un plan de réforme de cette administration, dans le cadre du projet « ministère fort », dont la phase opérationnelle a été lancée le 29 octobre 2013, avec l’envoi d’une instruction, après une longue phase de préparation et de concertation avec les acteurs intéressés.
Cette instruction dévoile les trois principales orientations qui doivent guider la rénovation du système d’inspection du travail :
– son organisation et son fonctionnement doivent évoluer pour développer une action à la fois plus collective et efficace, grâce à l’instauration d’unités de contrôles constituées de huit à douze sections ou agents sous l’autorité d’un responsable, à une meilleure intégration des dispositifs d’appui existants, à la création de réseaux sur des risques particuliers, d’unités régionales dédiées à la lutte contre le travail illégal et d’un groupe national de contrôle d’appui et de veille ;
– ses priorités doivent être en nombre limité pour avoir un véritable impact, elles seront donc redéfinies selon un processus associant les agents ;
– ses pouvoirs doivent être étendus, via un élargissement des dispositifs d’arrêt temporaire de travaux, l’institution d’amendes administratives, la facilitation de l’accès aux documents utiles aux contrôles, et l’ouverture du recours à l’ordonnance pénale.
Poursuivant le même objectif de renforcement de l’efficacité de l’action de l’inspection du travail et intervenant en complément du projet « ministère fort », un plan de transformation des emplois a été initié dès septembre 2013. Il vise à la requalification progressive en postes d’inspecteurs, par voie d’examen professionnel, de tous les postes de contrôleurs du travail. Un premier plan triennal de 540 emplois a été acté pour la période 2013-2015. Près de 130 agents ont été admis au premier concours, puis sont entrés en formation en décembre 2013 pour une durée de six mois.
Le présent article offre les mesures législatives nécessaires à la déclinaison du projet « ministère fort » et du plan de transformation d’emploi, pour l’ensemble de leurs volets, qu’il s’agisse de l’organisation du système d’inspection, comme des prérogatives d’intervention et de sanction des agents et de l’administration du travail.
C. LA NOUVELLE ORGANISATION DE L’INSPECTION DU TRAVAIL PROPOSÉE
Le présent article propose donc, tout d’abord, une nouvelle organisation du système d’inspection du travail, selon les principes retenus par le projet « ministère fort » et le plan de transformation des emplois, décrits ci-dessus.
1. L’anticipation de la transformation des emplois de contrôleurs
Il vise à anticiper, en premier lieu, la requalification des postes de contrôleurs du travail en postes d’inspecteurs, une réforme d’organisation interne qui suppose des adaptations législatives.
Le 1° du II rétablit ainsi un article L. 8111-1, au sein du chapitre Ier, consacré à la répartition des compétences entre les différents départements ministériels, du titre Ier du livre Ier, relatif à l’inspection du travail, de la huitième partie du code du travail. Cet article rétabli énoncerait que « les fonctions d’agent de contrôle de l’inspection du travail peuvent être exercées par des agents de contrôle assimilés dans des conditions fixées par voie réglementaire ». Il reprendrait donc la substance de l’actuel article L. 8112-3, qui indique que les attributions des inspecteurs du travail peuvent être exercées par des fonctionnaires de contrôle assimilés lorsque des dispositions légales le prévoient. Par conséquent, le 2° du II procède à la suppression de ce dernier article.
Le 3° du II modifie, ensuite, l’intitulé du chapitre suivant, le chapitre II, aujourd’hui libellé « Compétence des agents », pour le compléter par les termes « de contrôle de l’inspection du travail ». Puis il supprime les deux subdivisions actuelles de ce chapitre, dénommées « Section 1 : Inspecteurs du travail » et « Section 2 : Contrôleurs du travail », pour que l’ensemble des articles figurent directement dans le chapitre II nouvellement intitulé.
Le 5° du II remanie, ensuite, la numérotation des actuels articles L. 8112-1 et L. 8112-2, pour qu’ils deviennent, respectivement, les articles L. 8112-2 et L. 8112-3. Il remplace également, au sein de ces deux articles, les termes « inspecteurs du travail », par ceux de « agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8112-1 », ce dernier article définissant désormais le champ de ce corps de contrôle comme expliqué ci-dessous. Le a) du 6° du I, les a) et b) du 8° du I, le 10° du I, le a) du 9° du II et le 11° du II opèrent des corrections rédactionnelles de même nature au sein des articles L. 4731-1, L. 4731-3, L. 4731-5, L. 8113-7 et L. 8114-1.
Par ailleurs, le c) du 8° du I supprime l’alinéa 3 de L. 4731-3, qui prévoit aujourd’hui que le contrôleur du travail peut « par délégation de l’inspecteur du travail dont il relève et sous son autorité » autoriser la reprise des travaux ou d’une activité ayant fait l’objet d’un arrêt temporaire, l’anticipation du plan de transformation d’emplois rendant la suppression de cette catégorie de dispositions nécessaire. Le b) du 1° du I, le d) du 6° du I, et le b) du 7° du I procèdent à des suppressions de même nature aux articles L. 4721-8, L. 4731-1 et L. 4731-2.
2. Une réforme d’ensemble de l’organisation de l’inspection du travail
Conformément aux orientations fixées par le projet « ministère fort », le présent article propose, en second lieu, une réforme de l’organisation des différents échelons du système d’inspection du travail, du niveau de la section au niveau national.
Le 4° du II insère ainsi un nouvel article L. 8112-1, en remplacement de l’actuel article L. 8112-1 devenu L. 8112-2, qui énoncerait que les agents de contrôle de l’inspection du travail sont les membres des corps des inspecteurs et contrôleurs du travail :
– soit affectés dans une section d’inspection du travail au sein d’une unité de contrôle ou dans une unité régionale de contrôle ;
– soit responsables d’une unité de contrôle ;
– soit membres du groupe national de contrôle, d’appui et de veille de l’inspection du travail.
• La mise en place d’unités locales et collectives de contrôle
Au niveau local, en application du nouvel article L. 8112-1 seraient donc, tout d’abord, créées des unités collectives de contrôle, nouveaux échelons de proximité d’intervention dans les entreprises en remplacement des sections, qui ne subsisteraient que sous une acception géographique ou sectorielle.
Le 6° du II propose, en conséquence, une nouvelle rédaction de l’article L. 8112-4 (89), qui énoncerait que les agents de contrôle de l’inspection du travail exercent leurs missions sur le territoire d’une unité territoriale de la DIRECCTE. Toutefois, lorsque la loi prévoit la compétence exclusive de l’inspecteur du travail, celui-ci l’exercerait dans la ou les sections d’inspection auxquelles il serait affecté de manière permanente ou temporaire, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. À titre d’exemple, la loi donne aujourd’hui compétence exclusive à l’inspecteur du travail pour prononcer le licenciement des salariés protégés.
De la combinaison de ces deux articles, il résulte que, s’agissant des missions de contrôle, le champ d’intervention des agents couvrirait l’ensemble de l’unité territoriale, alors que, s’agissant des décisions administratives qui ne relèvent pas d’une mission de contrôle et qui demeurent la prérogative d’un inspecteur du travail, le champ d’intervention de ce dernier serait limité à la section. En effet, seul l’inspecteur du travail en charge d’une entreprise a le pouvoir de prendre des décisions administratives la concernant. À terme, l’extinction du corps des contrôleurs du travail fera perdre à cette disposition sa valeur de fond, puisque ne subsisteront que des inspecteurs du travail bénéficiant de l’ensemble des compétences de contrôle et de décision. Ils l’exerceront, toutefois, sur des périmètres territoriaux différents, puisqu’il apparaît nécessaire, pour les missions de contrôle, de permettre aux agents de pouvoir intervenir sur tout le territoire de l’unité territoriale de la DIRECCTE, en cas de danger par exemple.
• Le rôle du responsable d’unité locale de contrôle (RUC)
Les nouvelles unités de contrôle seraient placées sous l’autorité d’un responsable, dont le rôle est défini par les deux nouveaux articles L. 8122-1 et L. 8122-2, créés par le 15° du II au sein du chapitre II, consacré aux services déconcentrés du système d’inspection du travail, du titre II du livre Ier de la huitième partie du code du travail.
Le nouvel article L. 8122-1 chargerait les responsables d’unité de contrôle d’assurer, dans la mise en œuvre de l’action collective, l’animation, l’accompagnement et le pilotage de l’activité des agents de contrôle et d’assistance.
Le nouvel article L. 8122-2 préciserait que, au-delà de ces fonctions, les responsables d’unité de contrôle pourraient être affectés dans une section d’inspection du travail, auquel cas ils disposeraient des compétences dévolues aux inspecteurs du travail.
• Le renforcement du contrôle aux niveaux intermédiaires
La nouvelle organisation conduirait, ensuite, à un renforcement des capacités de contrôle de l’inspection du travail au niveau de la région, qui ne jouit aujourd’hui d’aucune structure permanente assumant ces fonctions.
Le 6° du II propose, ainsi, une nouvelle rédaction de l’article L. 8112-5 (90), qui prévoirait deux exceptions au principe légal d’intervention à l’échelon de l’unité territoriale de la DIRECCTE.
Le premier alinéa de l’article L. 8112-5 nouvellement rédigé disposerait, en effet, que les agents de contrôle de l’inspection du travail exercent leurs missions sur le territoire de la région, lorsqu’ils sont affectés à une unité régionale de contrôle ou lorsqu’ils concourent à une mission régionale de prévention et de contrôle de risques particuliers.
S’agissant des unités régionales de contrôle, d’après les informations transmises par le Gouvernement, seraient créées, dans chaque région, une unité permanente dédiée à la lutte contre le travail illégal, composée de 3 à 12 agents en fonction de la taille de la région. Le directeur de la DIRECCTE aurait, par ailleurs, la possibilité de demander au ministre chargé du travail de constituer une unité régionale de contrôle à vocation sectorielle ou thématique, pour répondre à des besoins identifiés. Ces unités régionales spécifiques seraient instituées par arrêté ministériel et revêtiraient un caractère temporaire.
S’agissant des missions régionales de prévention et de contrôle des risques particuliers, selon les informations fournies par le Gouvernement, celles-ci prendraient la forme d’un réseau ayant pour objectif d’améliorer la prise en charge des risques complexes, tels que les risques liés à l’exposition à l’amiante. Ce réseau, de nature temporaire, serait composé d’agents appartenant aux unités locales de contrôles ou à la cellule pluridisciplinaire du pôle « T ».
Le second alinéa de l’article L. 8112-5 nouvellement rédigé prévoirait ensuite, une autre exception au principe légal d’intervention à l’échelon de l’unité territoriale de la DIRECCTE. Il énoncerait, en effet, que les agents de contrôle de l’inspection du travail affectés dans une section d’une unité de contrôle interdépartementale ou interrégionale exercent leurs missions à la fois sur le territoire de l’unité de contrôle et sur le territoire de l’unité territoriale de la DIRECCTE dans laquelle ils ont été nommés.
D’après les informations transmises par le Gouvernement, il existe aujourd’hui une vingtaine de sections interdépartementales, qui permettent la prise en charge cohérente de certains secteurs d’activité, tels que les transports terrestres, maritimes et aéroportuaires. Grâce au nouveau cadre juridique proposé, des sections interdépartementales supplémentaires devraient voir le jour. En revanche, en l’état, la création d’unités de contrôle interrégionales n’est pas envisagée, mais il semble nécessaire d’en ménager la possibilité.
• La création d’un groupe national d’appui
Enfin, au niveau national, le 14° du II propose de créer un nouvel article L. 8121-1, au sein du chapitre Ier, consacré à l’échelon central du système d’inspection du travail, du titre II du livre Ier de la huitième partie du code du travail, pour mettre en place un groupe national de contrôle, d’appui et de veille.
Aux termes de ce nouvel article, ce groupe serait compétent pour des situations qui impliqueraient, sur l’ensemble du territoire national, une expertise particulière, un accompagnement des services, un contrôle spécifique ou une coordination des contrôles.
Selon les informations fournies par le Gouvernement, il s’agirait d’une structure permanente composée d’une dizaine d’agents de l’inspection du travail expérimentés et placés auprès de la direction générale du travail. Ces agents auraient pour mission d’appuyer l’action des unités de proximité, en facilitant éventuellement leur coordination, et d’intervenir sur des situations nationales complexes, dans le cas d’investigations sur des entreprises à établissements multiples par exemple. Ils disposeraient des pouvoirs de contrôle et de constatation des infractions.
II. UNE EXTENSION DES POUVOIRS D’INTERVENTION DES AGENTS DE CONTRÔLE DE L’INSPECTION DU TRAVAIL
Afin de leur permettre d’exercer leurs missions dans de meilleures conditions et conformément aux orientations arrêtées par le projet « ministère fort », le présent article propose, ensuite, d’étendre les pouvoirs d’intervention des agents de contrôle de l’inspection du travail, en accroissant leurs pouvoirs d’enquête, en renforçant leurs prérogatives en cas de danger pour la santé et la sécurité des travailleurs, et en durcissant les peines pouvant être infligées en cas d’entrave à leur action.
A. L’ACCROISSEMENT DES POUVOIRS D’ENQUÊTE
Les agents de contrôle de l’inspection du travail bénéficient aujourd’hui de différents pouvoirs d’enquête pour accomplir leurs missions. Ils jouissent ainsi d’un droit d’entrée dans les établissements et sont habilités à demander aux employeurs et salariés de justifier de leur identité. Ils disposent également d’un droit d’accès aux documents de l’entreprise et du pouvoir de demander à l’employeur de faire procéder à des analyses, deux prérogatives que le présent article vise à accroître.
1. Un meilleur droit d’accès aux documents
En vertu de l’article L. 8113-4, les agents de contrôle de l’inspection du travail bénéficient d’un droit d’accès à l’ensemble des livres, registres et documents rendus obligatoires par le code du travail ou par une disposition légale relative au régime du travail. L’article L. 8113-5 renforce ce droit d’accès s’agissant des discriminations, de l’égalité professionnelle et de l’exercice du droit syndical, en prévoyant que les agents de contrôle peuvent se faire communiquer « tout document ou tout élément d’information, quel qu’en soit le support », qui puisse permettre de constater des infractions en ces matières.
La rédaction actuelle de l’article L. 8113-4 permet donc à des employeurs de s’opposer à certains contrôles, en arguant que les documents exigés par l’agent ne constituent pas des documents rendus obligatoires par la loi, sans toutefois encourir de poursuites pour entrave à l’action de l’inspection du travail. Dans le cadre de l’article L. 8113-5, cette stratégie d’obstruction ne peut pas, en revanche, être mise en œuvre.
Le 7° du II vise à résoudre cette difficulté en remplaçant les deux articles précités par un seul article L. 8113-4, nouvellement rédigé, qui autoriserait les agents de contrôle à « se faire communiquer et prendre copie des documents qui sont nécessaires à l’accomplissement de leur mission, quel que soit leur support », sauf en cas de « secret protégé par la loi ». Il transformerait donc en pouvoir de droit commun, pour l’ensemble des cas de contrôle, le dispositif aujourd’hui prévu par l’article L. 8113-5 pour quelques cas limités. Ce pouvoir connaîtrait, toutefois, une limite, celles des secrets protégés par la loi, tels que le secret médical ou le secret professionnel des avocats. Ainsi, un inspecteur du travail qui effectuerait une enquête sur le stress au travail n’aurait pas accès aux dossiers médicaux du médecin du travail pour les salariés concernés.
2. Un droit de faire procéder à des analyses élargi
Dans le cadre du contrôle des conditions de sécurité et de santé au travail, l’article L. 4722-1 octroie aux agents de l’inspection du travail le pouvoir de demander à un employeur de faire procéder à des contrôles techniques, tels que :
– la mesure de l’exposition des travailleurs à « des nuisances physiques, à des agents physiques, chimiques ou biologiques donnant lieu à des limites d’exposition » ;
– l’analyse « de substances et préparations dangereuses ».
Ce pouvoir permet aux agents d’identifier de potentiels dangers auxquels seraient soumis les salariés et d’éventuelles infractions à la sécurité, dont le constat nécessite un prélèvement et un examen. D’après les informations transmises par le Gouvernement, en 2011, près de 1 300 demandes de cette nature ont été formulées par les agents de contrôle.
Afin d’améliorer la prévention des risques professionnels, un enjeu social essentiel, et au vu des graves dommages que peut entraîner l’exposition à certains produits, le b) du 2° du I propose d’étendre le champ du pouvoir d’ordonner une analyse à « toutes matières, y compris substances, mélanges, matériaux, équipements, matériels ou articles susceptibles de comporter ou d’émettre des agents physiques, chimiques ou biologiques dangereux pour les travailleurs ». Par ailleurs, le a) du 2° du I supprime la mention des « nuisances physiques », considéré redondante avec celle « d’agents physiques ».
Tirant les conséquences de l’extension du champ du pouvoir d’ordonner une analyse, le 3° du I opère une coordination législative à l’article L. 4722-2, puis le 4° du I procède à une clarification législative pour préciser que l’employeur peut bien exercer un recours devant le directeur de la DIRECCTE pour contester les demandes « d’analyse et de mesure » formulées par les agents de contrôle, en complétant l’article L. 4723-1 en ce sens.
B. LE RENFORCEMENT DES PRÉROGATIVES EN CAS DE DANGER POUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ DES TRAVAILLEURS
Au-delà de leurs pouvoirs d’enquête, les agents de contrôle de l’inspection du travail bénéficient de prérogatives leur permettant d’intervenir, en urgence, pour protéger les travailleurs en cas de danger pour leur santé ou leur sécurité. Les employeurs disposent, toutefois, de la possibilité d’exercer des droits de recours, lorsque ces prérogatives sont mises en œuvre. Au vu de la gravité des situations en cause ainsi que des défauts de la législation actuelle, le présent article propose d’étendre le périmètre de la procédure d’arrêt temporaire de travaux, de simplifier celle d’arrêt d’activité en cas de risque chimique, et d’unifier les voies de recours ouvertes.
1. Une procédure d’arrêt temporaire de travaux au périmètre étendu
En vertu de l’article L. 4731-1, les agents de contrôle de l’inspection du travail peuvent aujourd’hui prendre, « sur un chantier du bâtiment et des travaux publics », toutes mesures utiles visant à soustraire immédiatement un salarié qui ne s’est pas retiré d’une situation de danger grave et imminent, constituant une infraction aux obligations en matière de santé et de sécurité. Ils peuvent, en particulier, décider de l’arrêt temporaire des travaux, lorsqu’ils constatent que la cause de danger résulte :
– soit d’un défaut de protection contre les chutes de hauteur ;
– soit de l’absence de dispositifs de nature à éviter les risques d’ensevelissement ;
– soit de l’absence de dispositifs de protection de nature à éviter les risques liés aux opérations de confinement et de retrait de l’amiante.
Les agents de l’inspection du travail mettent régulièrement en œuvre la procédure d’arrêt temporaire de travaux : en 2012, ont été prises 6 223 décisions de cette nature. Comme le souligne l’étude d’impact, ces décisions ne sont, en général, pas contestées par les employeurs, qui, le plus souvent, remédient au danger constaté et sollicitent l’autorisation de reprendre les travaux. Toutefois, lorsque l’employeur ne se conforme pas à l’interdiction et poursuit les travaux, il peut être verbalisé par l’agent de contrôle. En 2011, 119 procédures pénales ont été engagées à ce titre.
Les risques visés par l’article L. 4731-1, telle que la chute de hauteur, deuxième cause mortelle d’accident du travail, ne se trouvent pas limités aux chantiers du bâtiment, privés ou publics. Pour accroître la protection des travailleurs contre ces risques, le a) du 6° du I propose d’étendre la procédure d’arrêt temporaire de travaux à l’ensemble des entreprises, quelle que soit leur activité. À cette fin, il supprime, au sein de cet article, la mention limitative des chantiers du bâtiment et des travaux publics, pour permettre l’arrêt de toutes catégories de « travaux et d’activité », et remplace le terme de « salarié » par celui de « travailleur », pour protéger toute personne présente.
Puis, le b) du 6° du I propose de mieux couvrir les risques liés à l’amiante, l’article L. 4731-1 ne mentionnant que les « opérations de confinement et de retrait », en visant dans cet article les « travaux de retrait ou d’encapsulage d’amiante et de matériaux, d’équipements et de matériels ou d’articles en contenant, y compris dans les cas de démolition, ainsi qu’aux interventions sur des matériaux, des équipements, des matériels ou des articles susceptibles de provoquer l’émission de fibres d’amiante ».
Enfin, le c) du 6° du I propose d’allonger la liste des causes de danger justifiant un arrêt temporaire de travaux ou d’activité, aux risques résultant :
– de l’utilisation d’équipements de travail dépourvus de protecteurs, de dispositifs de protection ou de composants de sécurité appropriés ou sur lesquels ces protecteurs, dispositifs de protection ou composants de sécurité sont inopérants ;
– de travaux ou d’une activité dans l’environnement des lignes électriques aériennes ou souterraines ;
– de contact électrique direct avec des pièces nues sous tension, en-dehors des opérations prévues au chapitre IV, consacré aux opérations sur les installations électriques et dans leur voisinage, du titre IV du livre V de la quatrième partie du code du travail, dédiée à la santé et la sécurité au travail.
Tirant les conséquences de l’extension du champ de la procédure d’arrêt temporaire de travaux à toute activité, le 10° du I procède à une coordination législative nécessaire à l’article L. 4731-5.
2. Une procédure d’arrêt temporaire d’activité en cas de risque chimique simplifiée
Concernant les risques liés à l’exposition à une substance chimique cancérigène, mutagène ou toxique pour la reproduction, les agents de contrôle de l’inspection du travail peuvent aujourd’hui, en vertu de l’article L. 4721-8, lorsqu’ils constatent le dépassement d’une valeur limite de concentration, mettre en demeure l’employeur de remédier à cette situation. Ce constat doit être réalisé par le biais d’une mesure effectuée par un organisme extérieur, sur demande de l’agent de contrôle et dans des conditions fixées par décret.
Si, à l’issue du délai fixé dans la mise en demeure et après vérification par l’organisme extérieur, le dépassement de la valeur limite de concentration persiste, l’agent de contrôle peut ordonner l’arrêt temporaire de l’activité en cause, en vertu de l’article L. 4731-2.
Or, alors même que l’arrêt temporaire d’activité chimique constitue un outil essentiel de protection des salariés, l’étude d’impact observe qu’il n’est presque plus utilisé depuis l’entrée en vigueur du décret du 28 septembre 2007 (91), car la procédure apparaît trop complexe. En effet, selon les informations fournies par le Gouvernement, seules 11 mises en demeures préalables ont été prononcés en 2011 et aucun arrêt temporaire d’activité n’est intervenu.
Le a) du 1° du I vise donc à simplifier cette procédure en modifiant, tout d’abord, l’article L. 4721-8, pour qu’il prévoie désormais que les agents de contrôle peuvent mettre en demeure un employeur, lorsqu’ils constatent qu’un travailleur est exposé à un agent chimique cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction, et qu’il se trouve dans une situation dangereuse avérée résultant de l’une des infractions suivantes :
– le dépassement d’une valeur limite d’exposition professionnelle ;
– le défaut ou l’insuffisance de mesures et moyens de prévention tels que prévus par le chapitre II, consacré à la prévention des risques chimiques, du titre Ier du livre IV de la quatrième partie du code du travail, en ce qui concerne les agents chimiques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction. On peut citer, par exemple, l’utilisation d’un produit chimique nocif par inhalation, pour lequel le dispositif d’aspiration des vapeurs serait inexistant ou insuffisant.
La modification proposée conduit donc à abroger l’obligation aujourd’hui imposée aux agents de contrôle de faire procéder à une mesure par un organisme extérieur de contrôle. Il pourrait, cependant, toujours y recourir, s’ils le souhaitent ou l’estiment nécessaire.
Poursuivant ce même objectif de simplification, le a) du 7° du I supprime ensuite, au sein de l’article L. 4731-2, l’obligation de faire effectuer une vérification par l’organisme extérieur à l’issue du délai fixé dans la mise en demeure, avant d’ordonner l’arrêt temporaire d’activité, pour indiquer que cet arrêt peut être décidé simplement si « la situation dangereuse persiste ».
3. Des voies de recours unifiées
Les deux procédures d’arrêt temporaire actuelles offrent, toutefois, aux employeurs la possibilité d’exercer un droit de recours devant le juge judiciaire, pour contester la réalité du danger ou la façon de le faire cesser, au titre de l’article L. 4723-2, s’agissant de la contestation de la mise en demeure préalable à un arrêt temporaire d’activité pour risque chimique, et de l’article L. 4731-4, s’agissant de la contestation du prononcé d’un arrêt temporaire de travaux ou d’un arrêt temporaire d’activité pour risque chimique.
Le principe de la saisine du juge judiciaire, alors que les décisions de mise en demeure préalables et d’arrêt temporaire constituent des actes administratifs, s’explique pour des raisons historiques. En effet, lors de la création de ces procédures en 1991, le référé devant le juge administratif n’existait pas encore. Au-delà de ce problème de compétence matérielle, la contestation des mises en demeure intervenant sur des questions de santé et de sécurité n’apparaît pas unifiée, puisque l’article L. 4723-1 prévoit un recours devant l’administration pour contester toutes les autres catégories de mises en demeure relevant de ce domaine.
Afin d’unifier le contentieux des actes administratifs et clarifier les démarches des employeurs, le 9° du I transfère donc au juge administratif la compétence pour statuer sur les recours en référé exercés en matière d’arrêts temporaires de travaux et d’activité pour risque chimique, en modifiant l’article L. 4731-4 en ce sens. Puis le 4° du I complète l’article L. 4723-1, pour ouvrir un recours devant l’administration en cas de contestation d’une mise en demeure préalable à un arrêt temporaire d’activité pour risque chimique, et le 5° du I abroge, par conséquent, l’article L. 4723-2.
Au vu de ces changements de compétence juridictionnelle et dans un but de clarté de la loi, le 11° du I porte des précisions rédactionnelles aux articles L. 4732-1 à L. 4732-3, ainsi qu’à l’intitulé du chapitre II du titre III du livre VII de la quatrième partie du code du travail, afin que l’on ne puisse pas confondre les recours ouverts aux agents de contrôle de l’inspection du travail et aux employeurs.
C. LE DURCISSEMENT DES PEINES POUR ENTRAVE
Enfin, en vue d’accroître l’autorité des agents de l’inspection du travail, le 10° du II crée une nouvelle section 1, intitulée « Obstacles et outrages », regroupant les actuels articles L. 8114-1 à L. 8114-3 qui répriment les actes d’entrave et de violence envers ces agents, au sein du chapitre IV du titre Ier du livre Ier de la huitième partie du code du travail.
De plus, le 11° du II durcit les peines sanctionnant les actes d’entrave en portant de 3 750 euros à 37 500 euros le montant maximum de l’amende prévue par l’article L. 8114-1. Cette augmentation permet une harmonisation avec le montant de l’amende applicable en cas d’entrave à l’action des agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), fixée aux articles L. 213-1 et L. 217-10 du code de la consommation.
Il faut rappeler ici que, chaque année, plusieurs dizaines de condamnations pour entrave sont prononcées sur le fondement de l’article L. 8114-1. Ainsi, en 2009, près de 40 condamnations ont été prononcées et, en 2010, près de 35. Il importe, dès lors, de rendre le montant de cette amende plus dissuasif.
III. UNE AMÉLIORATION DU DISPOSITIF DE SANCTION DES INFRACTIONS AU CODE DU TRAVAIL
Comme le souligne l’étude d’impact, le dispositif actuel de sanction des infractions au code du travail repose essentiellement sur le droit pénal. Or, cette voie ne constitue pas nécessairement la réponse la plus adaptée aux manquements constatés, dont certains appellent une régularisation et une répression rapide, que ne permettent pas toujours les délais de traitement judiciaire d’une affaire. Les taux de suite des procès-verbaux dressés par les agents de contrôle de l’inspection du travail apparaissent d’ailleurs relativement faibles : en 2009, seuls 26 % d’entre eux ont fait l’objet de poursuites.
Pour remédier à cette situation, le présent article propose deux évolutions majeures : la création d’amendes administratives et l’ouverture du recours à la transaction et l’ordonnance pénales en matière d’infractions au code du travail.
A. LA CRÉATION D’AMENDES ADMINISTRATIVES
Pour renforcer l’effectivité du droit du travail et les capacités d’action des agents de contrôle, le présent article vise, tout d’abord, à doter l’administration d’un nouvel outil, résidant dans la possibilité d’infliger des sanctions financières pour réprimer certaines infractions ciblées.
À cette fin, le 13° du II crée un nouveau chapitre V, intitulé « Amendes administratives », au sein du titre Ier, dédié aux compétences et moyens d’intervention de l’inspection du travail, du livre Ier de la huitième partie du code du travail. Ce nouveau chapitre V comporterait huit nouveaux articles L. 8115-1 à L. 8115-8.
1. La sanction d’infractions ciblées
Le nouvel article L. 8115-1 définit, tout d’abord, le champ d’application des amendes administratives, qui serait limité aux infractions commises :
– aux dispositions relatives aux durées maximales du travail fixées aux articles L. 3121-34 à L. 3121-36 et aux mesures réglementaires prises pour leur application ;
– aux dispositions relatives aux repos fixées aux articles L. 3131-1, L. 3131-2 et L. 3132-2, et aux mesures réglementaires prises pour leur application ;
– à l’établissement d’un décompte du temps de travail conformément à l’article L. 3171-2 et aux dispositions réglementaires prises pour son application ;
– aux dispositions relatives à la détermination du salaire minimum interprofessionnel de croissance prévues par les articles L. 3231-1 à L. 3231-11, et aux dispositions relatives au salaire minimum fixé par la convention collective ou l’accord étendu applicable à l’entreprise, et aux mesures réglementaires prises pour leur application ;
– aux dispositions prises pour l’application des obligations de l’employeur relatives aux installations sanitaires, à la restauration et à l’hébergement prévues au chapitre VIII du titre II du livre II de la quatrième partie du code du travail, dédiée à la santé et la sécurité au travail, ainsi qu’aux mesures relatives aux prescriptions techniques de protection durant l’exécution des travaux de bâtiment et génie civil prévues au chapitre IV du titre III du livre V de la même partie du code du travail pour ce qui concerne l’hygiène et l’hébergement.
Le champ d’application des amendes administratives concernerait donc les éléments fondamentaux de la législation et du contrat de travail que constituent les temps de travail et de repos, le salaire et les conditions d’hygiène et d’hébergement. Ces éléments se trouvent, d’ailleurs, souvent en cause dans les procédures pénales mises en œuvre aujourd’hui par les agents de contrôle : en 2011, près de 625 procès-verbaux traitent du repos hebdomadaire, 491 de l’hygiène, 383 de la durée maximale de travail, et près de 687 observations ont été adressées en matière de salaire minimum.
Cependant, pour toutes ces matières, la voie pénale n’apparaît pas adaptée, car les manquements commis dans ces domaines requièrent une normalisation de la situation et une sanction rapides de l’employeur, que ne permet pas le droit actuel, au vu des longs délais de traitement judiciaire constatés. La possibilité d’infliger une amende administrative dans ces cas semble une arme plus efficace pour répondre à des situations qui relèvent parfois de l’urgence.
2. La compétence du directeur de la DIRECCTE
Le nouvel article L. 8115-1 octroie, ensuite, la compétence du prononcé de l’amende à l’autorité administrative, soit le directeur de la DIRECCTE. Ce dernier ne pourrait, toutefois, infliger une telle sanction que « sur rapport motivé de l’agent de contrôle de l’inspection du travail ».
La solution retenue permet à la fois de garantir l’impartialité de la procédure, l’autorité responsable du prononcé n’étant pas celle procédant aux constats, et de préserver l’indépendance des agents de contrôle de l’inspection du travail, qui conservent l’initiative du déclenchement de celle-ci par leurs rapports d’enquête.
Aux termes du nouvel article L. 8115-2, un lien devrait, par ailleurs, être établi avec l’autorité judiciaire, puisque le directeur de la DIRECCTE serait tenu d’informer par tout moyen le procureur de la République des suites données au rapport de l’agent de contrôle.
3. Les modalités de fixation du montant de l’amende
Le nouvel article L. 8115-3 arrête, ensuite, le montant plafond de l’amende, qui serait de 2 000 euros maximum, mais pourrait être appliqué autant de fois qu’il y a de travailleurs concernés par l’infraction. Ce montant plafond serait doublé, en en cas de nouveau manquement constaté dans un délai d’un an à compter du jour de la notification de la précédente amende.
Puis, le nouvel article L. 8115-4 précise les modalités de fixation du montant de l’amende : l’autorité administrative devrait prendre en compte les circonstances et la gravité de l’infraction, le comportement de son auteur ainsi que ses ressources et ses charges, conformément au principe de personnalisation et de proportionnalité des peines.
4. Une procédure contradictoire et susceptible de recours
Avant de pouvoir infliger une amende, l’autorité administrative devrait, toutefois, respecter une procédure contradictoire.
Le nouvel article L. 8115-5 énonce ainsi qu’avant toute décision, l’administration devrait informer par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée, en portant à sa connaissance les griefs retenus à son encontre et en l’invitant à présenter, dans un délai d’un mois, ses observations. Passé ce délai, l’autorité administrative pourrait, par décision motivée, prononcer l’amende et émettre le titre de perception correspondant. Le délai de prescription de l’action de l’administration pour la sanction du manquement par une amende, serait fixé à deux années révolues, à compter du jour où le manquement aura été commis.
Aux termes du nouvel article L. 8115-7, les amendes seraient, ensuite, recouvrées selon les modalités prévues pour les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.
Enfin, en vertu du nouvel article L. 8115-6, l’employeur pourrait contester la décision de l’administration devant le tribunal administratif, à l’exclusion de tout recours administratif.
5. Des conditions d’application fixées par décret en Conseil d’État
Le nouvel article L. 8115-8 prévoit, enfin, que les conditions d’application du nouveau chapitre V relatif aux amendes administratives seraient fixées par décret en Conseil d’État.
Par ailleurs, tirant les conséquences de la création d’amendes administratives, le 16° du II procède à une coordination nécessaire s’agissant des compétences des médecins inspecteurs du travail. Il complète ainsi l’article L. 8123-2 pour exclure des prérogatives de ces derniers, les dispositions relatives aux nouvelles amendes administratives. Cet article prive déjà les médecins inspecteurs du travail du pouvoir général de dresser des procès-verbaux et de celui de prononcer, en matière de santé et de sécurité au travail, des mises en demeure.
Le 8° du II opère une autre précision législative nécessaire, en modifiant l’intitulé de la section 4, aujourd’hui libellé « Recherche et constatation des infractions », du chapitre III, consacré aux prérogatives et moyens d’intervention de l’inspection du travail, du titre Ier du livre Ier de la huitième partie du code du travail, pour que cette section soit désormais intitulée « Recherche et constatation des infractions ou des manquements ».
6. Le maintien de l’alternative de la voie pénale
La création d’amendes administratives ne restreindrait pas la liberté de choix et l’indépendance des agents de contrôle de l’inspection du travail quant aux procédures à mettre en œuvre suite à leurs constats. En cas d’infraction à une disposition entrant dans le champ de la procédure d’amende administrative, ils conserveraient, en effet, toujours la possibilité de déclencher l’action publique en passant par la voie pénale, s’ils ne souhaitent pas mettre en œuvre le nouvel outil de sanction proposé.
Pour affirmer clairement ce principe, le b) du 9° du II complète l’article L. 8113-7 par un nouvel alinéa énonçant que, lorsqu’il constate une infraction pouvant donner lieu à une amende administrative, l’agent de contrôle peut, lorsqu’il n’a pas transmis de procès-verbal au procureur de la République, adresser un rapport motivé au directeur de la DIRECCTE, dans le cadre de la nouvelle procédure prévue par le code du travail.
L’agent de contrôle pourrait donc choisir d’agir soit par la voie pénale, soit par la voie de l’amende administrative, chacun de ces choix étant exclusif de l’autre et irrévocable pour l’agent. Toutefois, dans le cas où l’agent de contrôle aurait choisi la voie de l’amende administrative, ce choix ne ferait pas obstacle à la mise en œuvre de la voie pénale par le procureur de la République ou par une partie civile intéressée pour les recours qui leurs sont ouverts.
Par ailleurs, pour l’ensemble des procédures possibles, pénale et administrative, le 17° du II renforce les moyens de preuve à la disposition des agents de contrôle, en modifiant l’article L. 8123-4 pour leur permettre d’intégrer à leurs actes et procédures les constats effectués par les ingénieurs de prévention.
7. Des amendes spécifiques en matière de sécurité au travail
Complétant le dispositif général décrit ci-dessus, le présent article met également en place des amendes administratives spécifiques pour sanctionner les employeurs qui ne se conformeraient pas à certaines décisions prises en matière de sécurité au travail par les agents de contrôle de l’inspection du travail ou le directeur de la DIRECCTE.
Le 13° du I crée ainsi un nouveau titre V, intitulé « Amendes administratives », au sein du livre VII, dédié aux mesures de contrôle, de la quatrième partie du code du travail, relative à la santé et la sécurité au travail. Ce nouveau titre comporterait deux nouveaux articles L. 4751-1 et L. 4751-2.
• Le refus de se conformer à une décision d’arrêt temporaire de travaux ou d’activité pour risque chimique
Le nouvel article L. 4751-1 vise, tout d’abord, à réprimer le refus de se conformer à une décision d’arrêt temporaire de travaux ou d’activité pour risque chimique, prise par un agent de contrôle en application de l’article L. 4731-1 ou L. 4731-2.
Dans un tel cas, le directeur de la DIRECCTE pourrait prononcer une amende administrative au plus égale à 10 000 euros par travailleur concerné par le manquement. Pour fixer le montant de l’amende, il devrait prendre en compte les circonstances et la gravité de l’infraction ayant donné lieu à la décision d’arrêt temporaire de travaux ou d’activité pour risque chimique, le comportement de l’employeur ainsi que ses ressources et ses charges.
Cette amende obéirait, pour le reste, au régime général des nouvelles amendes administratives précédemment exposé, s’agissant de la procédure contradictoire à mettre en œuvre, de son recouvrement et de ses voies de contestation.
Tirant les conséquences de la création de cette amende spécifique, le 12° du I procède à la réécriture de l’article L. 4741-3, qui punit aujourd’hui d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 3 750 euros le fait pour l’employeur de ne pas s’être conformé à une décision d’arrêt temporaire de travaux prise en application de l’article L. 4731-1, un refus d’obtempérer désormais réprimé par voie d’amende administrative. Il remplace ces dispositions par une nouvelle sanction visant une autre catégorie de décisions, à savoir les mises en demeure que peut prononcer le directeur de la DIRECCTE, au titre de l’article L. 4721-1, lorsqu’un agent de contrôle a constaté une situation dangereuse résultant du non-respect par l’employeur des principes généraux de prévention ou d’une infraction à l’obligation générale de santé et de sécurité.
• Le refus de se conformer aux demandes de vérifications, de mesures et d’analyses
Le nouvel article L. 4751-2 vise, ensuite, à réprimer le refus de se conformer aux demandes de vérifications, d’analyses ou de mesures prises par l’agent de contrôle de l’inspection du travail en application de l’article L. 4722-1 et aux dispositions réglementaires prises pour son application.
Dans un tel cas, le directeur de la DIRECCTE pourrait prononcer une amende administrative au plus égale à 10 000 euros. Cette amende serait prononcée et recouvrée et pourrait être contestée dans les conditions prévues par le régime général des nouvelles amendes administratives précédemment exposé.
B. L’OUVERTURE DE NOUVEAUX MÉCANISMES DE SANCTION PÉNALE
Dans le même objectif d’accroître l’effectivité du droit du travail par une condamnation plus efficace des manquements commis, le présent article propose de doter l’administration d’un nouvel mécanisme de sanction, la transaction pénale, et de permettre le traitement judiciaire accéléré des contraventions via la procédure d’ordonnance pénale.
1. La transaction pénale
La transaction pénale constitue un mode d’extinction de l’action publique résultant du pouvoir octroyé à l’administration de renoncer à l’exercice de poursuites contre l’auteur d’une infraction, en le contraignant à verser une somme tenant lieu de pénalité.
Le 12° du II vise à conférer au directeur de la DIRECCTE la possibilité d’utiliser ce mécanisme pour réprimer certaines infractions au code du travail. À cette fin, il crée une nouvelle section 2, intitulée « Transaction pénale », au sein du chapitre IV, relatif aux dispositions pénales, du titre Ier dédié aux compétences et moyens d’intervention des agents de l’inspection du travail, du livre Ier de la huitième partie du code du travail. Cette nouvelle section 2 comporterait quatre nouveaux articles L. 8114-4 à L. 8114-8.
• Le champ d’application de la transaction pénale
Le nouvel article L. 8114-4 définit, tout d’abord, le champ d’application de la transaction pénale, qui serait limité aux contraventions et délits punis d’une peine d’emprisonnement de moins d’un an prévus et réprimés :
– aux livres II, relatif au contrat de travail, et III, relatif au règlement intérieur et au droit disciplinaire, de la première partie du code du travail, consacrée aux relations individuelles de travail ;
– au titre VI, relatif à l’application des accords collectifs, du livre II, relatif à la négociation collective, de la deuxième partie du code du travail, consacrée aux relations collectives de travail ;
– aux livres Ier, relatif à la durée du travail, aux repos et congés, II, relatif au salaire et avantages divers, et IV, relatif aux dispositions pour l’outre-mer, consacrées à la durée du travail, au salaire, à l’intéressement, à la participation et à l’épargne salariale, à l’exception des dispositions mentionnées au nouvel article L. 8115-1 déterminant le champ des infractions pouvant faire l’objet d’une amende administrative ;
– à la quatrième partie du code du travail, consacrée à la santé et la sécurité au travail, à l’exception des dispositions mentionnées au nouvel article L. 8115-1 déterminant le champ des infractions pouvant faire l’objet d’une amende administrative ;
– au titre II, relatif au contrat d’apprentissage, du livre II, relatif à l’apprentissage, de la sixième partie du code du travail, consacrée à la formation professionnelle tout au long de la vie ;
– à la septième partie du code du travail, consacrée aux dispositions particulières à certaines professions et activités.
Pour ces délits et contraventions, le directeur de la DIRECCTE serait désormais habilité à proposer une transaction pénale, tant que l’action publique n’aura pas été mise en mouvement. Il s’agit d’une nouvelle possibilité offerte à celui-ci et, en aucun cas, d’une obligation : le droit commun des poursuites pénales pourra toujours être mis en œuvre et le directeur de la DIRECCTE pourra, d’ailleurs, choisir de ne pas recourir à cette procédure, même si l’infraction constatée entre dans son champ.
D’après les informations transmises par le Gouvernement, la définition du domaine de la transaction pénale a été établie en concertation avec la Chancellerie, avec la préoccupation d’en écarter les infractions susceptibles de générer des constitutions de parties civiles, dont la gravité justifie le renvoi devant le juge pénal ou pour des litiges emblématiques nécessitant un débat public. Dans ce but, en ont été exclues les infractions punies d’une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à un an, portant atteinte à des droits fondamentaux, ayant trait au travail illégal ou constituant des obstacles et outrages à agent.
• Le contenu de la transaction pénale
Le nouvel article L. 8114-5 expose, ensuite, le contenu de la transaction. La proposition de transaction serait déterminée en fonction des circonstances et de la gravité de l’infraction, de la personnalité de son auteur ainsi que de ses ressources et de ses charges.
Elle préciserait l’amende transactionnelle que l’auteur de l’infraction devrait payer, ainsi que, le cas échéant, les obligations qui lui seraient imposées, tendant à faire cesser l’infraction, à éviter son renouvellement ou à remettre en conformité les situations de travail. Elle fixerait également les délais impartis pour le paiement et, s’il y avait lieu, l’exécution des obligations. Par ailleurs, une copie du procès-verbal de constatation de l’infraction devrait être jointe à la proposition de transaction.
• L’homologation du procureur de la République
Aux termes du nouvel article L. 8114-6, un fois acceptée par l’auteur des faits, la proposition de transaction devrait être soumise à l’homologation du procureur de la République, ce qui garantit un contrôle de la procédure par le parquet.
L’acte d’homologation de celui-ci serait interruptif de la prescription de l’action publique. Cette dernière ne serait définitivement éteinte que lorsque l’auteur de l’infraction aurait exécuté, dans les délais impartis, l’intégralité des obligations résultant pour lui de l’acceptation de la transaction.
Si le procureur de la République refusait d’homologuer la transaction, celle-ci deviendrait nulle et sans effet. L’ensemble de la procédure devrait alors être recommencé ou l’action publique enclenchée. Il en irait de même si l’auteur des faits venait à refuser la transaction.
• Des modalités d’application fixées par décret en Conseil d’État
Le nouvel article L. 8114-7 précise, enfin, que les modalités d’application de la nouvelle section 2, régissant la transaction pénale, seraient fixées par décret en Conseil d’État.
2. L’ordonnance pénale
Afin de réduire les délais de traitement judiciaire des contraventions au code du travail, le III du présent article ouvre, ensuite, la possibilité qu’elles soient jugées par la voie de l’ordonnance pénale.
À cette fin, il abroge le 1° de l’article 524 du code de procédure pénale, qui exclut aujourd’hui du domaine de l’ordonnance pénale, les contraventions prévues par le code du travail.
Cette exclusion n’apparaît pas, en effet, justifiée et, selon l’étude d’impact, lors de la création de cette procédure en 1972, aucun argument juridique de fond n’avait présidé à cette décision.
Pour mémoire, l’ordonnance pénale constitue une procédure de jugement simplifiée. Elle permet au ministère public de communiquer par écrit son dossier de poursuite et ses réquisitions au juge du fond, qui statue, ensuite, sans débat public en prenant une ordonnance portant soit relaxe, soit condamnation à une amende. Toutefois, si ce dernier estime que la tenue d’une audience serait utile ou qu’une peine d’emprisonnement doit être prononcée, il peut renvoyer le dossier au ministère public, pour que soit suivie la voie de droit commun.
IV. UNE ENTRÉE EN VIGUEUR PROGRESSIVE DES RÉFORMES PROPOSÉES
Afin de laisser le temps à l’administration de préparer les adaptations nécessaires aux réformes proposées, s’agissant de l’extension des pouvoirs des agents de contrôle de l’inspection du travail et de l’amélioration du dispositif de sanction des infractions au code du travail, ainsi que de permettre aux usagers de s’approprier ces innovations, le VI du présent article prévoit que les dispositions du I et des 7° à 13° et 16° et 17° du II entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2015.
Pour ce qui concerne la réforme de l’organisation du système d’inspection du travail, soit les dispositions des 1° à 6° et des 14° et 15° du II, le VII du présent article établit que celle-ci entrera en vigueur selon des modalités définies par décret en Conseil d’État et au plus tard le 1er janvier 2015. Il semble nécessaire, en effet, que cette réforme ait été accomplie avant que ne deviennent applicables les nouvelles prérogatives octroyées aux agents de contrôle et à l’administration par le présent article.
V. L’HABILITATION DU GOUVERNEMENT À PRENDRE DES MESURES D’ADAPTATION PAR ORDONNANCE
Le présent article vise, enfin, à habiliter le Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures d’adaptation requises par les réformes proposées, tant au sein du code du travail que dans les autres codes concernés.
A. LES ADAPTATIONS REQUISES DANS LE CODE DU TRAVAIL
Le IV du présent article a, tout d’abord, pour objet d’habiliter le Gouvernement, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution (92) et dans un délai de dix mois à compter de la promulgation de la loi, à modifier par ordonnance la partie législative du code du travail afin de :
– déterminer les attributions des agents de contrôle de l’inspection du travail prévues dans le code du travail et adapter en conséquence les dispositions du code qui s’y réfèrent ;
– réviser l’échelle des peines en matière de santé et de sécurité au travail pour en renforcer l’efficacité au regard des infractions concernées, et adapter en conséquence les dispositions du code du travail qui s’y réfèrent ;
– réviser les dispositions relatives à l’assermentation des agents ;
– abroger les dispositions devenues sans objet, adapter le plan du code aux évolutions législatives et réglementaires, assurer la cohérence rédactionnelle des renvois internes au sein du code et codifier des dispositions intervenues depuis janvier 2008.
Le projet de loi de ratification devrait être déposé dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance sur le bureau de l’une ou l’autre chambre du Parlement.
B. LES ADAPTATIONS REQUISES DANS LES AUTRES CODES CONCERNÉS
Le V du présent article a, ensuite, pour objet d’habiliter le Gouvernement, dans les mêmes conditions, à modifier par ordonnance les parties législatives du code des transports, du code rural et de la pêche maritime, du code de la sécurité sociale et du code du travail applicable à Mayotte, afin de :
– rendre applicables et adapter les dispositions du présent article dans les situations prévues par ces codes ;
– harmoniser les dispositions pénales en matière de santé et de sécurité au travail avec celles du code du travail ;
– actualiser les références au code du travail, remédier aux éventuelles erreurs, abroger les dispositions devenues sans objet et adapter le plan des codes aux évolutions législatives et réglementaires.
Le projet de loi de ratification devrait également être déposé dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance sur le bureau de l’une ou l’autre chambre du Parlement.
*
* *
Lors de son examen du projet de loi, votre commission a adopté une modification de fond au texte de l’article 20.
À l’initiative du groupe SRC, elle a ainsi imposé l’information du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ou, à défaut, des délégués du personnel, sur le prononcé d’une amende administrative contre l’employeur, en cas de refus de se conformer à une décision d’arrêt temporaire de travaux ou d’activité pour risque chimique.
*
* *
La Commission est saisie des amendements identiques AS195 de M. Gérard Cherpion et AS269 de M. Christophe Cavard.
M. Gérard Cherpion. On peut s’étonner de la présence de cet article dans un texte dont l’objet est plutôt de retranscrire l’accord national sur la formation professionnelle. J’en propose la suppression, car la mise en œuvre des mesures qu’il introduit est trop dépendante de l’appréciation de la situation par le seul inspecteur du travail, fragilisant ainsi la sécurité juridique des entreprises, en particulier des entreprises artisanales.
M. Christophe Cavard. Le titre III est lourd de conséquences pour l’organisation de l’inspection du travail et pour la réglementation qui la régit. Nous estimons qu’il n’a pas sa place dans le projet de loi. Comme le ministre le reconnaît lui-même, il aurait dû faire l’objet d’un dialogue social beaucoup plus poussé avec les acteurs de l’inspection du travail et avec les usagers. Quelle urgence y avait-il à introduire ici une réforme en gestation depuis des années et portée, il faut le souligner, par la précédente majorité ? En d’autres temps, nous aurions sans doute condamné ces dispositions qui émanent de certains responsables de la direction générale du travail et qui viennent déséquilibrer l’ensemble du texte.
Mme Jacqueline Fraysse. Je m’associe aux propos de M. Cavard. Ces dispositions apportent des modifications très importantes non seulement à l’organisation de l’inspection du travail, mais aussi aux modalités de sanction. Elles n’ont rien à voir avec l’accord sur la formation professionnelle. Mieux vaudrait supprimer l’article et traiter ces questions dans un texte à part, après avoir pris en compte les réactions très vives des organisations syndicales des personnels concernés et des organisations syndicales de salariés face à des dispositions graves de dépénalisation des infractions.
M. Michel Liebgott. Reprendre in extenso les revendications exprimées par les inspecteurs eux-mêmes me paraît un peu excessifs. Je souhaite pour ma part que le débat ait lieu avec le ministre en séance publique. Certains considèrent qu’il y a des avancées, puisque des contrôleurs deviendront inspecteurs et que le travail en brigade sera plus efficace, nous dit-on, que lorsqu’il est accompli par des inspecteurs isolés. Mais on sait aussi que certains agents resteront en rade et que l’on supprimera les concours de recrutement de contrôleurs. Gardons-nous de faire un procès en sorcellerie et attendons que le ministre apporte des réponses à nos questions légitimes sur cet article 20 qui, en l’état, semble faire l’unanimité contre lui.
Sans doute le texte procède-t-il d’un bon sentiment, même s’il est issu, on le voit bien, de travaux qui nous sont étrangers. Mais il faut qu’on nous explique en quoi les inspecteurs du travail seront plus efficaces et tout aussi indépendants.
Mme Isabelle Le Callennec. Je partage les réserves exprimées. Que viennent faire des articles concernant l’inspection du travail dans un texte sur la formation professionnelle ? D’après les auditions que nous avons menées et les nombreux courriers que nous recevons, le dispositif est loin d’être abouti. Avez-vous une idée de la raison pour laquelle on l’a introduit dans le texte, monsieur le rapporteur ?
M. Francis Vercamer. Le groupe UDI votera les amendements de suppression, car cet article, comme le souligne M. Liebgott, fait l’unanimité contre lui.
À l’occasion d’un rapport budgétaire sur l’inspection du travail que j’ai réalisé il y a quelques années, les inspecteurs du travail m’ont fait part de leurs inquiétudes sur la baisse de leurs effectifs et de leur difficulté à remplir les missions qu’on leur demande. Ce corps souffre d’un véritable problème que l’on ne peut traiter à la va-vite, sans demander leur avis aux intéressés.
Avant toute chose, les inspecteurs du travail sont très attachés au respect de leur indépendance. Or ils estiment que celle-ci est attaquée dans ce texte, en violation des conventions de l’Organisation internationale du travail (OIT).
Je propose donc que nous supprimions l’article afin que le Gouvernement présente en séance publique un amendement plus conforme aux attentes des parties prenantes.
M. Denys Robiliard. Les raisons pour lesquelles le groupe écologiste d’un côté, les groupes UMP et UDI de l’autre, souhaitent la suppression de l’article ne sont pas les mêmes.
L’article traite d’abord de l’organisation de l’inspection du travail, ensuite des sanctions.
S’agissant de l’organisation, s’il est un principe sur lequel le Gouvernement ne peut pas revenir, quand bien même il le voudrait, c’est bien celui de l’indépendance des inspecteurs du travail, qui procède de la convention n° 81 de l’OIT. Le Conseil constitutionnel consacre également cette indépendance comme un principe fondamental du droit du travail, tout en précisant que sa mise en œuvre relève du pouvoir réglementaire. De fait, l’organisation actuelle de l’inspection du travail est fixée dans la partie réglementaire du code du travail.
Dans ce cadre, le Gouvernement a décidé de fusionner le corps des inspecteurs du travail et celui des contrôleurs du travail. Jusqu’à présent, une section classique d’inspection était composée d’un inspecteur, de deux contrôleurs et d’une secrétaire. L’idée du ministère du travail est qu’il serait plus efficace de travailler de façon groupée – sans pour autant remettre en cause la notion de section –, les contrôleurs effectuant les mêmes tâches et exerçant les mêmes prérogatives que les inspecteurs. Il est prévu de placer ces nouvelles « unités de contrôle » sous la responsabilité d’un « RUC » (responsable d’unité de contrôle), ironiquement rebaptisé « DUC » (directeur d’unité de contrôle) par les inspecteurs du travail. Ce responsable n’a pas d’autorité hiérarchique : il a une fonction de coordination et d’animation et peut lui-même exercer des responsabilités directes sur une section.
Un autre projet ne figure pas dans le texte qui nous est soumis : la création, au niveau régional, d’équipes spécialisées dans la lutte contre les filières de travail clandestin.
En revanche, le texte prévoit explicitement la création d’une structure nationale restreinte ayant compétence sur des sujets concernant l’ensemble du territoire et sur des sujets internationaux, comme le détachement des salariés en Europe.
En quoi ces dispositions porteraient-elles atteinte à l’indépendance des inspecteurs du travail ? Ceux-ci restent compétents dans leur section, à cette différence près qu’ils n’exercent plus d’autorité hiérarchique sur deux contrôleurs.
Je défends cette réforme, car une politique de contrôle efficace exige une bonne organisation et un travail en commun, alors qu’actuellement chacun travaille en solitaire. En matière judiciaire, il existe des pôles de compétence – le pôle financier ou celui de la santé, par exemple – dans lesquels les juges sont spécialisés, ce qui ne porte pas atteinte à leur indépendance.
Vous dites que tous les syndicats seraient opposés à cette réforme, mais l’UNSA et la CFDT ont affiché leur soutien à ces mesures. Dans les réunions du comité technique ministériel, beaucoup ont voté blanc ou se sont abstenus, ce qui n’est pas la même chose que de voter contre – ce n’est pas l’UDI, qui a déposé une proposition de loi visant à reconnaître le vote blanc aux élections, qui me contredira !
Un inspecteur du travail dispose actuellement de la faculté de saisir le procureur de la République ; en moyenne, un inspecteur établit trois procès-verbaux par an. Ces procès-verbaux sont transmis au procureur de la République, mais il n’y a pas de poursuite en l’absence d’un grave accident du travail. Ces classements sans suite déconsidèrent les procès-verbaux, alors que nous souhaitons que des suites puissent être données en cas d’infraction afin que les choses changent. De ce point de vue, une sanction administrative constitue un bon instrument. Madame Fraysse, aucune dépénalisation n’est instaurée, puisque la seule évolution consiste en la création d’un outil supplémentaire.
Qui doit sanctionner ? L’inspecteur ou le contrôleur dresse le procès-verbal et le transmet aux directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE), chargées de la sanction. Tous les syndicats des inspecteurs du travail sont favorables aux sanctions administratives et à la transaction pénale. Les représentants des employeurs ont exprimé quant à eux des positions beaucoup plus réservées sur ces mesures.
Celui qui constate l’infraction et celui qui la sanctionne ne doivent pas être les mêmes. Le texte établit cette distinction et organise les droits de la défense.
Les critiques de cette réforme me paraissent donc illégitimes. Pourquoi se trouve-t-elle dans ce projet de loi ? De telles dispositions appartiennent à la catégorie des diverses mesures d’ordre social (DMOS), et il est opportun de les insérer dans ce texte consacré à la formation professionnelle, à la démocratie sociale et donc à l’inspection du travail.
M. Christophe Cavard. Monsieur Robiliard, vous ne pouvez pas dire que les personnes souhaitant modifier le texte sont opposées à l’amélioration de l’inspection du travail ! Vous n’êtes pas le seul à vouloir réformer ! Les inspecteurs du travail, y compris ceux appartenant à un syndicat, ne sont pas hostiles à une évolution de leur service, mais intégrer cette question en urgence dans ce texte ne peut que les inquiéter, alors que ce projet de loi est censé promouvoir le dialogue social. Prenons le temps de la discussion pour élaborer une bonne réforme, comprise par la plupart des agents. Nous souhaitons donc la suppression des articles 20 et 21.
M. Arnaud Richard. Ce n’est pas d’un DMOS dont nous débattons et les dispositions relatives à l’inspection du travail n’ont rien à faire dans ce projet de loi. Une telle réforme serait mieux à sa place dans le texte sur les prud’hommes qui est en cours de dépôt. Le dernier plan de modernisation de l’inspection du travail – qui date de 2006 – n’a pas mis fin à la crise de cette profession. Nous voterons ces amendements de suppression.
Mme Jacqueline Fraysse. Il s’agit bien de dépénalisation. L’introduction de sanctions administratives et de transactions pénales ne vise pas à développer une progressivité dans l’échelle des peines, mais à se substituer aux sanctions pénales, y compris dans des secteurs aussi sensibles que le BTP ou dans des situations aussi délicates que l’exposition des salariés à des produits dangereux.
M. Denys Robiliard. Mais tous les syndicats sont favorables à l’arrêt de travaux !
Mme Jacqueline Fraysse. Les syndicats soutiennent-ils l’introduction de sanctions administratives et de transactions pénales ?
M. Denys Robiliard. Oui, et l’arrêt de travaux également.
Mme Jacqueline Fraysse. Le fait de remplacer les sanctions pénales par des sanctions administratives et des transactions pour des sujets aussi graves que ceux que j’ai évoqués ne doit sûrement pas recueillir l’agrément de l’ensemble des syndicats et des agents de l’inspection du travail !
M. le rapporteur. Il était important d’avoir cette discussion. L’article 20 porte une réforme d’ensemble de l’inspection du travail, pour rendre son organisation plus efficace et plus collective. Elle étend les pouvoirs d’intervention de ses agents – mesures soutenues par l’ensemble des représentants des inspecteurs du travail –, améliore les dispositifs de sanction dans le respect du principe constitutionnel d’indépendance de cette administration et de la convention de l’OIT. Je vous invite donc à repousser les amendements de suppression.
La Commission rejette les amendements.
Puis elle adopte successivement les amendements rédactionnels ou de conséquence AS370 à AS373 du rapporteur.
Elle est saisie de l’amendement AS48 de M. Gérard Cherpion.
M. Gérard Cherpion. Le champ du régime des arrêts de chantier ou d’activité, substantiellement élargi, manque de sécurité juridique sur la définition de l’utilisation d’équipements de travail. Cet amendement tend à préciser qu’il peut trouver à s’appliquer lorsque les dispositifs de protection ou les composants de sécurité sont défectueux.
M. le rapporteur. Votre amendement, monsieur Cherpion, propose une restriction considérable du champ de l’arrêt temporaire de travaux tel que défini par le projet de loi, alors que cet arrêt intervient lorsque les salariés se trouvent dans une situation de danger. Je suis donc défavorable à l’adoption de cet amendement.
La Commission rejette l’amendement.
Les amendements AS62 et AS63 de Mme Jacqueline Fraysse sont retirés.
La Commission étudie l’amendement AS260 de M. Christophe Cavard.
M. Christophe Cavard. Dans le cadre du renforcement des pouvoirs de l’inspection du travail, il est important que le choix de s’orienter vers une procédure administrative ou vers la voie pénale appartienne à l’agent de contrôle à l’origine de la décision non respectée par l’employeur.
M. le rapporteur. L’autorité administrative prendra sa décision sur le fondement des constatations de l’agent qui aura observé un refus de l’employeur de se conformer à ses obligations. Imposer à l’agent de transmettre au préalable un rapport motivé ne me semble pas nécessaire. Avis défavorable.
La Commission rejette l’amendement.
Puis elle adopte l’amendement rédactionnel AS374 du rapporteur.
Elle examine l’amendement AS111 de Mme Isabelle Le Callennec.
Mme Isabelle Le Callennec. Dans le cas où l’employeur ne se conforme pas aux décisions préconisées par l’agent de contrôle de l’inspection du travail, l’autorité administrative peut aujourd’hui prononcer une amende pouvant aller jusqu’à 10 000 euros par travailleur concerné par le manquement.
Cet amendement vise à donner le temps nécessaire à l’entreprise pour régulariser sa situation et à ne pas entrer immédiatement dans le champ de la pénalité. Il s’agit en effet, au nom du pacte de responsabilité que prône le Président de la République, de ne pas durcir les relations entre l’administration et les entreprises, mais au contraire de les pacifier. En effet, les entreprises demandent souvent à ce que l’inspection du travail joue un rôle de conseil à leurs côtés. Je propose que ce délai s’établisse à deux mois, mais il pourrait également être fixé par un décret.
M. le rapporteur. Avis défavorable. L’alinéa 39 vise des cas de danger qui nécessitent une régularisation rapide. Par ailleurs, avant de pouvoir prononcer un arrêt temporaire de travaux, l’inspecteur du travail doit mettre en demeure l’employeur en lui fixant un délai pour régulariser la situation.
La Commission rejette l’amendement.
Puis elle aborde l’amendement AS329 de M. Denys Robiliard.
M. Denys Robiliard. La sanction administrative se décide dans le cadre d’un dialogue entre l’employeur, l’inspecteur du travail et le DIRECCTE. S’agissant de sanctions portant sur la méconnaissance de règles d’hygiène et de sécurité, il est nécessaire que les représentants des salariés en soient informés à travers le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement.
Puis elle adopte successivement les amendements rédactionnels ou de conséquence AS375 à AS377 du rapporteur.
Elle examine les amendements identiques AS64 de Mme Jacqueline Fraysse et AS316 de M. Christophe Cavard.
Mme Jacqueline Fraysse. Nous proposons de compléter l’alinéa 52 et, en conséquence, de supprimer les alinéas 53 à 55. Cette partie du texte a pour objet de réunir sous une dénomination commune les inspecteurs et les contrôleurs du travail, et d’indiquer qu’ils peuvent être affectés dans une unité de contrôle, dans une unité régionale ou dans le groupe national d’appui. Ainsi, les contrôleurs du travail, agents de catégorie B, sont transformés en inspecteurs du travail, agents de catégorie A, évolution qui nous agrée.
En revanche, la création des unités de contrôle, des unités régionales de contrôle et du groupe national de contrôle pose problème ; en effet, les compétences de ces différentes structures pourraient se chevaucher. En outre, les agents craignent qu’elles nuisent à leur indépendance et qu’elles permettent d’écarter ceux qui seraient considérés comme trop zélés. Dans le cadre d’une délibération au Parlement européen, l’OIT a récemment rappelé la nécessité de cette indépendance. Le Conseil national de l’inspection du travail a demandé à plusieurs reprises au ministre du travail de clarifier les compétences de chacune des instances mises en place, ainsi que d’expliquer l’articulation de leur action. À ce jour, nous n’avons obtenu aucune précision, et c’est pourquoi nous avons déposé cet amendement.
M. Christophe Cavard. Les représentants des agents de l’inspection du travail, unanimes, déplorent la désorganisation sectorielle qu’instaure ce texte. Cette désectorisation fait courir des risques qu’il convient de prévenir en suspendant cet aspect de la réforme.
De surcroît, le texte prévoit que certaines réorganisations soient menées par ordonnance, ce qui restreint le débat parlementaire.
M. le rapporteur. Ces amendements remettent en cause un point central de la réforme de l’inspection du travail. Les inspecteurs restent affectés à des sections, et le texte se contente d’adapter l’organisation du service aux évolutions de l’économie ; des inspecteurs ont d’ailleurs indiqué souffrir du fonctionnement actuel, qui conduit souvent à leur isolement. La création des unités régionales permettra de moderniser l’organisation du travail des inspecteurs.
L’indépendance des agents n’est pas menacée, et aucun inspecteur ne pourra être dessaisi. J’émets donc un avis défavorable à l’adoption de ces amendements.
La Commission rejette les amendements.
Puis elle adopte l’amendement de précision AS378 du rapporteur.
La Commission examine, en discussion commune, les amendements identiques AS65 de Mme Jacqueline Fraysse et AS259 de M. Christophe Cavard, et l’amendement AS320 de Mme Barbara Romagnan.
Mme Jacqueline Fraysse. Cet amendement vise à inscrire dans la loi l’indépendance des agents de contrôle de l’inspection du travail. Nous ne sommes pas opposés aux réorganisations, mais il convient tout d’abord d’augmenter le nombre d’inspecteurs du travail, aujourd’hui insuffisant. Il y a lieu, en même temps, de veiller à leur indépendance et de préciser l’organisation que le texte maintient dans le flou. Personne ne répond à nos questions, si bien que nos craintes ne se dissipent pas.
M. Christophe Cavard. Cette réorganisation conduira à orienter les inspecteurs du travail vers des secteurs ou vers certains sujets, ce qui remettra en cause leur indépendance, principe fondamental du droit du travail posé par l’OIT dans sa convention numéro 81 – ratifiée par la France en 1950 – et consacré par le Conseil constitutionnel. Des syndicats qualifient cette réforme de menace pour l’indépendance des agents de l’inspection du travail, et l’on crée une insécurité juridique, car les représentants de ce corps ont déjà remporté des victoires contentieuses sur cette question.
M. Denys Robiliard. L’indépendance des inspecteurs du travail est garantie tant qu’ils conservent la liberté de choisir, au sein de leur section, les entreprises qu’ils inspectent et les suites qu’ils donnent à leur action. Elle n’est nullement remise en cause dans le texte puisque, selon la nouvelle rédaction du second alinéa de l’article L. 8112-4 du code du travail : « Lorsque la loi prévoit la compétence exclusive de l’inspecteur du travail, celui-ci l’exerce dans la ou les sections d’inspection auxquelles il est affecté de manière permanente ou temporaire, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. »
J’ajoute que, malgré les craintes qui se sont exprimées, je ne trouve dans le texte aucune disposition qui pourrait fonder une éventuelle intervention du supérieur hiérarchique des inspecteurs du travail, le DIRECCTE.
Je suis, pour ma part, tellement attaché au principe d’indépendance que j’ai cosigné l’amendement de Barbara Romagnan, qui a la même rédaction que le premier alinéa des amendements de Mme Fraysse et de M. Cavard. Je le retirerai cependant, car, à mon sens, il n’a pas sa place après l’alinéa 55 de l’article 20.
M. le rapporteur. Je suis défavorable aux trois amendements. L’indépendance des inspecteurs du travail n’est pas remise en cause par le changement d’organisation proposé. Les inquiétudes dont font état les auteurs des amendements requièrent sans doute que nous réaffirmions le principe d’indépendance que nous défendons tous, mais les rédactions qui nous sont proposées ne sont, en tout état de cause, pas abouties. Je propose que nous poursuivions ensemble la réflexion en séance publique, en présence du ministre.
L’amendement AS320 est retiré.
La Commission rejette les amendements AS65 et AS259.
Elle en vient ensuite à l’amendement AS86 de M. Francis Vercamer.
M. Francis Vercamer. La réforme proposée suscite de nombreuses inquiétudes parmi les inspecteurs du travail, notamment en ce qui concerne les garanties de leur indépendance. Le dialogue social au sein du corps d’inspection constitue l’un des moyens de garantir aux agents de contrôle la poursuite de leur activité dans des conditions permettant l’efficacité, l’autonomie d’action, et la proximité avec les salariés et les entreprises. Il convient donc qu’ils « participent conjointement avec leur hiérarchie, à la définition des priorités d’action de l’inspection du travail ».
M. Denys Robiliard. Il me semble efficace et légitime qu’une politique puisse faire l’objet d’une coordination au niveau national, par exemple en matière de lutte contre le travail clandestin, ou de promotion de l’égalité entre les hommes et les femmes dans l’entreprise – même si les inspecteurs du travail sont statutairement indépendants et qu’ils n’ont pas à suivre les instructions qui leur sont données. L’amendement de M. Vercamer n’intègre malheureusement pas cette dimension.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.
Elle est saisie de l’amendement AS87 de M. Francis Vercamer.
M. Francis Vercamer. L’absence de rencontres entre agents de contrôles et entreprises assujetties aux contrôles en dehors de ces mêmes contrôles nuit à la bonne compréhension des enjeux et des préoccupations de chacun. C’est pourquoi il est proposé de développer les relations de l’inspection du travail avec les partenaires sociaux aux niveaux national et territorial en les associant au dialogue social.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.
Elle examine l’amendement AS261 de M. Christophe Cavard.
M. Christophe Cavard. Afin de respecter les dispositions relatives à la stabilité dans l’emploi de la convention n° 81 de l’OIT, les termes « de manière permanente ou temporaire », relatifs à l’affectation des inspecteurs du travail, ne doivent pas figurer dans le nouvel article L. 8112-4 du code du travail.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.
Elle est ensuite saisie des amendements identiques AS66 de Mme Jacqueline Fraysse et AS262 de M. Christophe Cavard.
Mme Jacqueline Fraysse. Les risques de chevauchement des compétences n’ayant pas été écartés, nous nous opposons à la création d’unités de contrôle à compétence plus large que le département.
M. Christophe Cavard. L’amendement est défendu.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette les amendements.
Elle en vient à l’amendement AS126 de M. Francis Vercamer.
M. Francis Vercamer. Les agents font état d’un nombre toujours élevé de sollicitations individuelles. Cette situation est due au fait qu’il n’existe pas d’autres formes de recours. Il convient donc de travailler sur la manière dont les agents pourraient à la fois être déchargés d’une partie de cette demande sociale et voir leur message mieux relayé au sein des entreprises.
Les agents de contrôle pourraient se voir adjoindre des collaborateurs bénévoles, susceptibles de jouer le rôle de « conciliateurs du travail », comme il existe des conciliateurs de justice. En liaison avec l’inspection du travail, ces derniers joueraient à la fois un rôle de filtre dans les demandes adressées aux agents de contrôle, un rôle de médiation entre salariés et employeurs, tout particulièrement dans les petites et très petites entreprises, et un rôle dans la remontée d’informations vers l’inspection du travail. Ces conciliateurs seraient ainsi des interlocuteurs intermédiaires entre les salariés, les employeurs et l’inspection du travail, répondant aux premiers questionnements des salariés, faisant office de médiateur lorsque cela est possible et collectant des informations utiles pour les agents de l’inspection du travail.
Cette évolution permettrait aux salariés de disposer de référents bien identifiés sur les questions de droit du travail les plus simples qui ne nécessitent pas forcément d’être traitées par l’inspection du travail. Les agents de contrôle pourraient dégager des marges de manœuvre pour se concentrer sur leur fonction première sans toutefois perdre des informations susceptibles de leur être utiles. Cette mission pourrait être exercée de manière bénévole par les actuels conseillers du salarié, voire par les anciens conseillers prud’homaux.
M. le rapporteur. Monsieur Vercamer, votre idée ne manque ni d’originalité ni d’intérêt. Toutefois, sur un tel sujet, une consultation préalable des partenaires sociaux et des représentants de l’inspection du travail me semble nécessaire. Il serait de plus nécessaire d’apporter des précisions sur le statut de ces conciliateurs et la nature de leur mission. En l’état, je ne puis donc qu’être défavorable à votre amendement.
M. Denys Robiliard. La notion de médiation, juridiquement encadrée, figure dans le code de procédure civile : elle peut difficilement être utilisée sans référence à la procédure existante.
De plus, l’amendement de M. Vercamer ne tient pas compte de l’éventuelle présence de délégués du personnel au sein de l’entreprise, car il me semble que le « conciliateur » empiéterait sur leur mission. Pour les entreprises dans lesquelles ces délégués n’existent pas, en particulier dans celles de moins de dix salariés, des précisions doivent être apportées quant à l’articulation des rôles respectifs du « conciliateur » et du conseiller du salarié qui peut intervenir lorsqu’un licenciement est envisagé. Il me semble par ailleurs que, pour les très petites entreprises, la mission de conciliation devrait plutôt revenir aux commissions paritaires territoriales dont les syndicats réclament la création.
La Commission rejette l’amendement.
Elle est saisie des amendements identiques AS138 de M. Dominique Tian et AS196 de M. Gérard Cherpion.
M. Dominique Tian. Aujourd’hui, les inspecteurs du travail ne peuvent exiger de consulter dans l’entreprise que les documents rendus obligatoires par la loi, sans avoir le droit de les copier. Le projet de loi introduit dans le code du travail une disposition générale, que nous souhaitons supprimer, les autorisant à se faire communiquer et à copier tout document qu’ils demanderaient.
Le respect de la liberté du chef d’entreprise interdit de donner à un agent indépendant le droit de tout voir et de tout contrôler ; c’est une question d’équilibre. Avec l’adoption d’une telle disposition, le pouvoir de l’inspecteur du travail, déjà immense, deviendrait démesuré. Sa compétence doit, en tout état de cause, être limitée au domaine du travail ; elle ne saurait être générale. Il convient d’en rester au droit en vigueur.
M. Gérard Cherpion. Cet amendement propose de ne pas modifier l’actuel texte du code du travail qui prévoit que les documents que les agents de contrôle peuvent se faire présenter au cours de leurs visites sont ceux rendus obligatoires par la législation du travail.
Par ailleurs, les nécessités du contrôle n’imposent pas que des copies des documents puissent être emportées par les agents de contrôle qui effectuent aujourd’hui leur mission sur place. Les dispositions que nous entendons supprimer sont beaucoup trop larges, et leur application laisserait place à une appréciation subjective et discrétionnaire de la part des agents.
M. le rapporteur. Avis défavorable. La rédaction actuelle du code permet à certains employeurs de s’opposer au contrôle, sans encourir de poursuites pour entrave à l’action de l’inspecteur du travail, en arguant que les documents demandés ne sont pas rendus obligatoires par la loi. Dans le cadre des renforcements des pouvoirs de l’inspection, l’évolution proposée permettra de résoudre cette difficulté.
Monsieur Tian, des restrictions existent, contrairement à ce que vous affirmez, car les documents concernés devront être communiqués « sauf secret protégé par la loi ».
M. Dominique Tian. Il reste que le pouvoir donné à un fonctionnaire indépendant de consulter « tout document » de l’entreprise me semble beaucoup trop large : cette disposition pose un problème en termes de démocratie.
M. Gérard Cherpion. L’inspecteur du travail obtiendra communication de documents confidentiels relatifs, par exemple, à un marché. Ils pourront être copiés, et sortir de l’entreprise, ce qui me paraît dangereux.
M. Denys Robiliard. Une question relative aux libertés peut être posée, de même qu’il est légitime de s’interroger sur les limites du pouvoir d’un agent de contrôle en mesure de constater une infraction. Je souligne cependant que, contrairement à ce que j’entends, le pouvoir des agents de contrôle en matière d’accès aux documents dans l’entreprise n’est pas sans limites. Ces derniers peuvent « se faire communiquer et prendre copie des documents qui sont nécessaires à l’accomplissement de leur mission ». Monsieur Tian, je ne trouve nulle part les termes « tout document » que vous utilisez ; les documents concernés sont au contraire qualifiés de façon assez précise. En effet, « la mission » de l’inspection du travail étant parfaitement définie, l’agent ne sera fondé à demander que la transmission d’éléments entrant dans ce cadre. Je vous rappelle par ailleurs qu’il ne dispose pas d’un pouvoir de perquisition.
M. Gérard Cherpion. Qui juge de ce qui est « nécessaire à l’accomplissement » de cette mission ?
M. Dominique Tian. La question se pose d’autant plus que nous avons affaire à quelqu’un d’indépendant.
M. Denys Robiliard. La justice exerce son contrôle. À mon sens, si l’inspecteur obtenait communication de documents auxquels il n’aurait pas dû avoir accès, la procédure pourrait être annulée.
Mme Véronique Louwagie. Il me semble que le projet de loi ouvre une possibilité de contrôle trop large. Nous pourrions limiter le champ des documents concernés en autorisant uniquement la consultation de ceux que l’URSSAF est en droit de demander.
M. Dominique Tian. Ce débat touche aux libertés fondamentales. Le pouvoir que nous donnons à l’inspecteur du travail est supérieur au pouvoir de perquisition de l’officier de police judiciaire placé sous le contrôle d’un juge. Il me semble impossible de conférer un tel pouvoir à un agent indépendant non soumis à un pouvoir hiérarchique ; ce n’est pas constitutionnel.
Vous oubliez aussi que l’entreprise évolue dans un univers très concurrentiel. En permettant que des documents confidentiels de toute nature soient copiés et sortent de ses locaux, vous la mettez en danger.
La Commission rejette les amendements.
L’amendement AS49 de M. Gérard Cherpion est retiré.
La Commission adopte ensuite l’amendement rédactionnel AS379 du rapporteur.
Puis elle examine, en discussion commune, les amendements AS67 de Mme Jacqueline Fraysse et AS264 de M. Christophe Cavard.
Mme Jacqueline Fraysse. Nous souhaitons que l’agent ayant constaté une infraction propose la transaction pénale au DIRECCTE, dont je rappelle qu’il est nommé par l’exécutif par arrêté ministériel et qu’il peut subir diverses pressions. J’ajoute que sa mission est davantage liée à la défense de l’emploi qu’à celle de l’intérêt des salariés.
M. Christophe Cavard. Si « l’autorité administrative compétente », le DIRECCTE, décide seule de la mise en œuvre d’une transaction pénale, l’agent contrôleur est dépossédé d’une part de son indépendance et de son pouvoir en matière de sanction.
M. Denys Robiliard. Pour ma part, je ne vois pas d’inconvénient à ce que l’agent propose une transaction pénale, dès lors qu’il oriente déjà la procédure soit vers une sanction administrative, soit vers une sanction judiciaire.
Je rappelle que ne sont concernés que les « contraventions et délits punis d’une peine d’emprisonnement de moins d’un an ». Au regard de l’échelle des peines, il ne s’agit donc pas d’infractions graves – sachant que le vol simple est passible de trois ans de prison.
M. le rapporteur. Avis défavorable. La liberté de choix des agents quant au déclenchement de l’action publique n’est pas remise en cause. Aujourd’hui, sur la base de leurs procès-verbaux, le procureur de la République prend seul une décision en vertu du principe de l’opportunité des poursuites.
Mme Jacqueline Fraysse. Monsieur le rapporteur, vous ne nous répondez pas !
Nous voulons que le choix de proposer une transaction pénale revienne en premier lieu à l’agent de contrôle concerné, et nous souhaitons qu’il soit associé à sa mise en œuvre, y compris pour ce qui concerne le montant de l’amende transactionnelle. Nous proposerons d’ailleurs un amendement AS68 en ce sens. La procédure reste évidemment soumise à l’homologation du procureur de la République.
M. Denys Robiliard. Je ne veux pas anticiper sur l’amendement AS68, mais, pour ce qui concerne le contenu de la transaction elle-même, j’estime que nous devons conserver la rédaction du projet de loi. Il est en effet préférable que la personne qui se prononce soit différente de celle qui a effectué le contrôle. Un deuxième regard n’est pas inutile concernant aussi bien la constitution de l’infraction que la transaction, afin que les décisions prises ne soient pas tributaires des conditions dans lesquelles le contrôle s’est déroulé, car, sur le terrain, les rapports humains peuvent parfois être difficiles, d’un côté comme de l’autre.
M. Christophe Cavard. Voilà un beau cas d’école ! Si je vous entends bien, si je commets une infraction au volant de ma voiture, un policier ne peut pas me dresser un procès-verbal : il faudrait qu’une tierce personne fixe le montant de la contravention. À travers l’autorité administrative, la DIRECCTE, vous introduisez en effet un intermédiaire entre l’agent de contrôle et l’inspection du travail, qui agissent sous le contrôle du procureur. Que vous le vouliez ou non, l’alinéa dépossède le contrôleur de la possibilité de discuter de la transaction, de la mise en règle et de la sanction.
La Commission rejette successivement les amendements.
Puis elle adopte les amendements rédactionnels AS380 et AS381 du rapporteur.
Elle examine, en discussion commune, les amendements AS68 de Mme Jacqueline Fraysse et AS267 de M. Christophe Cavard.
Mme Jacqueline Fraysse. Même argumentation que pour l’amendement AS67.
M. Christophe Cavard. Défendu.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette successivement les amendements AS68 et AS267.
Elle adopte les amendements rédactionnels AS382 à AS384 du rapporteur.
Elle en vient à l’amendement AS 330 de M. Denys Robiliard.
M. Denys Robiliard. Je retire l’amendement, dont je présenterai une autre version. Celle-ci ne tient pas compte du secret de l’enquête judiciaire, alors que la procédure relève du pénal.
L’amendement est retiré.
La Commission adopte les amendements rédactionnels AS385 à AS388, AS390, AS389, AS391 et AS392 du rapporteur.
Elle aborde l’amendement AS331 de Mme Barbara Romagnan.
M. Denys Robiliard. Je retire cet amendement, pour les raisons que je viens d’évoquer.
L’amendement est retiré.
La Commission adopte l’amendement rédactionnel AS393 du rapporteur.
Elle étudie l’amendement AS69 de Mme Jacqueline Fraysse.
Mme Jacqueline Fraysse. Je le retire en vue d’en proposer une nouvelle rédaction.
L’amendement est retiré.
La Commission examine, en discussion commune, les amendements AS300 de M. Christophe Cavard et AS70 de Mme Jacqueline Fraysse.
M. Christophe Cavard. Nous souhaitons supprimer les alinéas 107 à 113, car la mise en place du groupe national de contrôle, d’appui et de veille, ainsi que des responsables des unités de contrôle, empêchera l’inspection du travail d’effectuer correctement ses missions.
Mme Jacqueline Fraysse. Même argumentation. La réorganisation proposée induit un chevauchement.
M. le rapporteur. Avis défavorable. Je ne nie pas le risque de chevauchement, mais le groupe national de contrôle, d’appui et de veille permettra de suivre les affaires sur l’ensemble du territoire, ainsi que certains dossiers spécifiques.
La Commission rejette successivement les amendements.
Elle adopte ensuite l’amendement de précision AS394 du rapporteur.
Puis elle est saisie de l’amendement AS71 de Mme Jacqueline Fraysse.
Mme Jacqueline Fraysse. L’amendement vise à supprimer le recours aux ordonnances sur des sujets aussi importants que les attributions des agents de contrôle ou de l’échelle des peines applicables en matière de santé et de sécurité au travail.
M. le rapporteur. Avis défavorable. Nous interrogerons le Gouvernement à ce sujet lors de la discussion en séance publique.
La Commission rejette l’amendement AS71.
Puis elle adopte successivement l’amendement rédactionnel AS396 et l’amendement de précision AS397 du rapporteur.
Elle en vient à l’amendement AS270 de M. Christophe Cavard.
M. Christophe Cavard. Il s’agit là encore d’éviter le recours aux ordonnances, qui ne s’impose pas pour une telle réforme. Le rapporteur nous répond que nous pourrons interroger le ministre, mais les législateurs que nous sommes peuvent aussi faire entendre leur désaccord quand on cherche à les priver de leurs prérogatives.
M. le rapporteur. Avis défavorable. Cela dit, je vais dans votre sens, puisque je considère que c’est non au rapporteur, mais au ministre de justifier le recours aux ordonnances.
La Commission rejette l’amendement.
Elle adopte ensuite l’amendement rédactionnel AS398 du rapporteur.
Puis elle adopte l’article 20 modifié.
La Commission examine l’amendement AS74 de Mme Jacqueline Fraysse.
Mme Jacqueline Fraysse. Nous proposons de multiplier l’amende de 3 750 euros sanctionnant les infractions relatives aux conditions d’exercice de l’activité de travail temporaire par le nombre de salariés concernés par l’infraction.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.
Elle en vient aux amendements identiques AS72 rectifié de Mme Jacqueline Fraysse et AS290 de M. Christophe Cavard.
Mme Jacqueline Fraysse. Nous souhaitons permettre la reconnaissance par décision administrative des unités économiques et sociales, sur signalement de l’inspection du travail. Il s’agit d’éviter que ces unités, qui rassemblent plusieurs entités juridiques distinctes, mais qui ont une activité complémentaire et une communauté de pouvoir et de direction, se dispensent, du fait de leur dispersion, de créer un comité d’entreprise.
M. Christophe Cavard. Même argumentation. Je précise que les écologistes ne voteront pas les articles 20 et 21.
M. le rapporteur. Avis défavorable. Il n’y a pas lieu de confier la reconnaissance de ces unités, qui est actuellement le fait d’une décision de justice, aux inspecteurs du travail. On contraindrait ceux-ci à rédiger un rapport motivé, ce qui les détournerait de leur mission de contrôle.
La Commission rejette les amendements AS72 et AS290.
Article 21
(art. L. 6252-4, L. 6252-6, L. 6252-7-1 [nouveau], L. 6252-8, L. 6252-9, L. 6252-12, L. 6361-3, L. 6362-2, L. 6263-3 du code du travail )
Renforcement du dispositif de contrôle
de l’apprentissage et de la formation professionnelle
Le présent article vise à renforcer le dispositif de contrôle de l’apprentissage et de la formation professionnelle, deux politiques mettant en jeu des volumes financiers importants dont il convient de s’assurer de la bonne utilisation, tout comme de l’adéquation des actions mises en œuvre au regard des objectifs poursuivis et du levier essentiel que constituent ces deux outils pour le marché du travail.
I. LE RENFORCEMENT DU CONTRÔLE ADMINISTRATIF ET FINANCIER DES ORGANISMES PARTICIPANT À L’APPRENTISSAGE
Le I du présent article concerne, tout d’abord, le contrôle administratif et financier des organismes participant à l’apprentissage, qu’il a pour objet de renforcer, en élargissant son champ et en créant un droit de communication de documents en faveur des agents de l’État qui l’exercent.
A. UN CHAMP DE CONTRÔLE ÉLARGI
Il propose, tout d’abord, un élargissement du champ de contrôle de l’apprentissage, s’agissant des organismes et des sources de financement qui y sont soumis.
1. Un champ de contrôle aujourd’hui incomplet
Aux termes de l’article L. 6252-4, l’État exerce aujourd’hui un contrôle administratif et financier sur :
– les organismes collecteurs de la taxe d’apprentissage (OCTA), en ce qui concerne les procédures de collecte et l’utilisation des ressources collectées ;
– les établissements bénéficiaires de fonds de l’apprentissage versés par les OCTA, le contrôle portant sur l’origine et l’emploi des fonds versés par ces organismes ;
– les dépenses de fonctionnement des organismes gestionnaires de centres de formation d’apprentis prises en charge par des organismes collecteurs paritaires agréés (OPCA).
Or, il apparaît que cette liste ne couvre pas l’ensemble des organismes percevant des fonds destinés à la mise en œuvre de la politique de l’apprentissage, ni, d’ailleurs, l’ensemble des catégories de financements versés. Par exemple, les subventions accordées par les régions n’y figurent pas.
2. Le double élargissement proposé
C’est pourquoi le présent article vise à élargir le champ du contrôle administratif et financier de l’État en matière d’apprentissage. Les a) et b) du 1° du I complètent, à cette fin, la liste énoncée par l’article L. 6252-4, pour qu’elle inclue :
–les organismes gestionnaires de centres de formation d’apprentis (CFA) ainsi que les établissements bénéficiaires de fonds de l’apprentissage et de subventions versées respectivement par les organismes collecteurs de la taxe d’apprentissage et par les collectivités territoriales ;
– les entreprises et les établissements qui concluent une convention de formation, en application des articles L. 6231-2 (93) et L. 6231-3 (94), avec des organismes gestionnaires de CFA ou des établissements bénéficiaires de fonds de l’apprentissage.
Dans ce dernier cas, le contrôle de l’État porterait à la fois sur les moyens mis en œuvre pour assurer les prestations définies par la convention de formation, sur la réalité de l’exécution des prestations, ainsi que sur toutes les dépenses qui s’y rattacheraient et leur utilité. En cas de manquement, il serait fait application du dispositif de sanction établi à l’article L. 6252-12, qui réside dans l’obligation de verser au Trésor public une somme égale au montant des dépenses non justifiées, et rejetées, à ce titre, par l’autorité administrative.
Pour permettre aux agents de mener à bien leur nouvelle mission de contrôle, le 5° du I complète, ensuite, l’article L. 6252-9 par un nouvel alinéa prévoyant que les entreprises et établissements précités seraient soumis à l’obligation de présenter aux agents de contrôle de l’État « tous les documents et pièces relatifs aux moyens mis en œuvre et aux charges concourant aux activités d’enseignement qu’ils assurent et qu’ils facturent à ce titre ».
De la réforme proposée, résulte donc un double élargissement du champ de contrôle des services de l’État, s’agissant des organismes puis des catégories de financement pouvant être contrôlés.
Ainsi, l’extension de la liste des organismes énoncée par l’article L. 6252-4 soumettrait au contrôle de l’État, les entreprises et établissements souscrivant des conventions de formation, ce qui constitue une nouveauté importante. En effet, dans l’état actuel des textes, si les agents de contrôle peuvent examiner les dépenses engagées par un établissement qui perçoit des fonds de l’apprentissage, ils n’ont pas la capacité juridique d’examiner les conditions dans lesquelles un sous-traitant est intervenu, pour assurer une prestation de services ou de formation en lien avec l’activité de cet établissement, alors même que cette prestation peut parfois donner lieu à des dérives en termes de coûts.
Par ailleurs, pour les organismes gestionnaires de CFA et les établissements commanditaires de conventions de formation, les agents des services de l’État seraient désormais habilités à procéder au contrôle des subventions accordées par les collectivités territoriales, cette source de financement étant actuellement exclue du champ de contrôle.
Au final, le double élargissement proposé permettrait d’appréhender l’ensemble de la chaîne du financement de l’apprentissage, qui va de la collecte de la taxe d’apprentissage, en passant par le versement de subventions publiques, jusqu’à la dépense finale engagée, en théorie, pour la formation des apprentis, ce dont il appartient à l’État de s’assurer.
3. Les mesures de coordination nécessaires
Tirant les conséquences des modifications apportées, le présent article effectue les mesures de coordinations nécessaires.
Le 2° du I complète, tout d’abord, les références visées à l’article L. 6252-6, pour que les nouveaux cas de contrôle figurent parmi les prérogatives des agents compétents en la matière. Puis, le 4° du I complète la liste des organismes énumérés à l’article L. 6252-8, pour rendre applicables aux nouveaux cas de contrôle les règles régissant actuellement le déroulement des opérations. Enfin, le 6° du I procède à une coordination identique à l’article L. 6252-12, s’agissant des sanctions applicables en cas de manquements.
B. LA CRÉATION D’UN DROIT DE COMMUNICATION
Pour renforcer les capacités de contrôle des agents de l’État, le 3° du I propose, ensuite, d’instaurer un droit de communication en leur faveur. À cette fin, il crée un nouvel article L. 6252-7-1 imposant aux employeurs, aux organismes de sécurité sociale, aux organismes collecteurs, aux établissements et entreprises visés à l’article L. 6252-4, à Pôle emploi, à l’administration fiscale, aux collectivités territoriales et aux administrations qui financent l’apprentissage, de communiquer aux agents de contrôle les renseignements nécessaires à l’accomplissement de leurs missions.
En effet, comme le souligne l’étude d’impact, ces agents ne disposent pas aujourd’hui d’une telle prérogative : ils ne peuvent solliciter des informations que sur simple demande. Les renseignements obtenus ne sont, dès lors, pas opposables, ce qui peut conduire à l’invalidation de procédures entières. Par ailleurs, en l’état actuel du droit, les agents ne sont pas formellement autorisés à s’adresser à certains organismes, pourtant détenteurs d’informations essentielles, tels que les organismes de sécurité sociale. La création du droit de communication proposée remédierait donc à ces difficultés.
II. LE RENFORCEMENT DES POUVOIRS DES AGENTS DE CONTRÔLE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
Le présent article vise, ensuite, à renforcer les pouvoirs des agents de contrôle de la formation professionnelle à trois égards.
A. LE DROIT DE SOLLICITER L’AVIS D’UN EXPERT
Le 1° du II complète, tout d’abord, l’article L. 6361-3 qui définit les modalités du contrôle administratif et financier des organismes de formation, par un nouvel alinéa prévoyant que les agents de l’État « peuvent solliciter, en tant que de besoin, l’avis ou l’expertise d’autorités publiques ou professionnelles pour les aider à apprécier les moyens financiers, techniques et pédagogiques mis en œuvre pour la formation professionnelle continue ».
L’octroi de cette nouvelle prérogative s’avérerait particulièrement utile pour des secteurs présentant une forte technicité ou exigeant des compétences spécifiques, tels que les domaines de la formation médicale et scientifique ou les professions réglementées, dans lesquels il est parfois difficile pour les agents d’apprécier l’adéquation de programmes et contenus pédagogiques.
B. L’ADAPTATION DU CADRE DE CONTRÔLE
Le 2° du II propose, ensuite, une nouvelle rédaction de l’article L. 6362-2 pour adapter le cadre de contrôle de la formation professionnelle, au vu de la réforme opérée par le présent projet de loi.
La nouvelle rédaction de l’article L. 6362-2 prévoirait que :
– les employeurs doivent présenter aux agents de contrôle les documents et pièces établissant la réalité et le bien-fondé des dépenses qui leur sont désormais imposées ;
– à défaut, ces dépenses seraient regardées comme non justifiées et l’employeur considéré comme n’ayant pas rempli les obligations qui lui incombent.
Le champ de vérification des agents serait donc restreint, puisque l’article L. 6362-2 énonce aujourd’hui que « les employeurs, les organismes de formation, les organismes qui interviennent dans les actions destinées à la validation des acquis de l’expérience et les organismes chargés de réaliser les bilans de compétences présentent aux agents de contrôle (…) les documents et pièces établissant la réalité et le bien-fondé des dépenses ».
En réalité, cette nouvelle rédaction tire les conséquences des évolutions issues de l’accord national interprofessionnel du 14 décembre 2013 qui supprime le plan de formation. L’employeur pouvait ainsi, jusqu’ici, exposer des dépenses de formation liées à l’achat de prestations externes, tels que les bilans de compétences, qui justifiait leur inclusion dans le champ de l’article L. 6362-2.
La nouvelle rédaction prend donc en compte cette réforme et se borne désormais à préciser l’obligation, pour les employeurs, de justifier du respect du versement de la nouvelle contribution unique de 1 %, ainsi que de certaines modalités de son reversement et de sa gestion.
Par ailleurs, la suppression du visa des autres organismes apparaît neutre, compte tenu des obligations de communication de documents et de pièces, ainsi que de justifications des dépenses, auxquelles l’article L. 6362-5 les soumet aujourd’hui.
C. LA SANCTION D’ORGANISMES POURSUIVANT D’AUTRES BUTS QUE LA FORMATION
Enfin, le 3° du II vise à renforcer les outils de lutte contre les organismes poursuivant d’autres buts que la réalisation d’actions de formation, mais recevant des fonds à ce titre.
À cette fin, il propose une nouvelle rédaction de l’article L. 6362-3 pour prévoir que :
– en cas de contrôle d’un organisme de formation, lorsqu’il aura été constaté que des actions financées par des fonds de la formation professionnelle continue ont poursuivi d’autres buts que la réalisation d’actions de formation relevant du champ défini à l’article L. 6313-1, ces actions seraient réputées inexécutées et donneraient lieu à remboursement des fonds auprès de l’organisme ou de la personne qui les a financées ;
– à défaut de remboursement dans le délai fixé à l’intéressé pour faire valoir ses observations, l’organisme de formation serait tenu de verser au Trésor public, par décision de l’autorité administrative, un montant équivalent aux sommes non remboursées.
Serait donc institué un mécanisme de remboursement des sommes reçues, en faveur des financeurs de formations, qui leur permettrait d’agir, par exemple, lorsqu’ils ont été abusés par un organisme qui, sous couvert de formation professionnelle, poursuit d’autres objectifs. Il s’agirait également d’un outil utile pour la lutte contre les dérives sectaires. Enfin, la nouvelle rédaction proposée apparaît plus protectrice que le droit actuel, l’article L. 6362-3 ne prévoyant aujourd’hui qu’un dispositif de remboursement au cocontractant en cas de défaut de justification de l’organisme de formation.
*
* *
La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels AS407, AS406, AS408 à AS411 du rapporteur.
Puis elle adopte l’article 21 modifié.
Article 22
(art. 27 de la loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012 relative à la régulation économique outre-mer
et portant diverses dispositions relatives aux outre-mer)
Habilitation du Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance
diverses dispositions d’application de la législation à Mayotte
Le présent article propose d’autoriser le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance diverses dispositions d’application de la législation à Mayotte.
Le I du présent article a, ainsi, pour objet d’habiliter le Gouvernement, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution (95) et dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, à prendre par ordonnance, « toutes les mesures d’application de la présente loi à Mayotte et à les mettre en cohérence dans les différentes législations applicables à Mayotte ».
Le projet de loi de ratification devrait être déposé dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance, sur le bureau de l’une ou l’autre chambre du Parlement.
Le II du présent article vise, ensuite, à prolonger le délai accordé au Gouvernement pour modifier par voie d’ordonnance, la législation du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle ainsi que la législation des transports, en vue d’en adapter les dispositions et de les rendre applicables à Mayotte.
À cette fin, il complète le premier alinéa de l’article 27 de la loi du 20 novembre 2012 relative à la régulation économique outre-mer et portant diverses dispositions relatives aux outre-mer, pour indiquer que, s’agissant de ces deux domaines du droit, le délai accordé au Gouvernement s’élève à trente mois, au lieu des dix-huit mois initialement prévus.
*
* *
La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels AS412 et AS413 du rapporteur.
Puis elle adopte l’article 22 modifié.
Elle adopte l’ensemble du projet de loi modifié.
*
* *
En conséquence, la Commission des affaires sociales demande à l’Assemblée nationale d’adopter le présent projet de loi dans le texte figurant dans le document annexé au présent rapport.
ANNEXE
LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES
(par ordre chronologique)
Ø Confédération française démocratique du travail (CFDT) – M. Marcel Grignard, secrétaire national, et Mme Marie-Andrée Seguin, secrétaire nationale
Ø Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) – M. Jean-Pierre Therry, secrétaire confédéral en charge de la formation professionnelle, et M. Michel Charbonnier, conseiller politique au cabinet
Ø Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles (FNSEA) – M. Claude Cochonneau, vice-président, et Mme Muriel Caillat, sous-directrice des affaires sociales
Ø Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) – Mme Geneviève Roy, vice-présidente chargée des affaires sociales, et M. Georges Tissié, directeur des affaires sociales
Ø Association des régions de France (ARF) – M. François Bonneau, président du Conseil régional Centre, accompagné de Mme Caroline Paris, conseillère au cabinet de M. Bonneau, Mme Isabelle Gaudron, première vice-présidente du Conseil régional Centre, Mme Pascale Gérard, vice-présidente du Conseil régional Provence-Alpes-Côte d’Azur – Délégation Formation professionnelle et apprentissage, et Mme Anne Wintrebert, conseillère sur l’emploi, la formation professionnelle, l’économie sociale et solidaire
Ø Fédération syndicale unitaire (FSU) – MM. Stéphane Tassel, Thierry Reygades, secrétaires nationaux, et M. Noël Daucé, membre
Ø Union nationale des professions libérales (UNAPL) – M. Michel Chassang, président, M. Philippe Gaertner, vice-président, et M. Romain Mifsud, délégué général
Ø Fédération française du bâtiment (FFB)i – M. Didier Ridoret, président, M. François Falise, directeur de la formation, et M. Benoît Vanstavel, directeur des relations institutionnelles
Ø Union nationale des syndicats autonomes (UNSA) – M. Luc Bérille, secrétaire général, M. Jean Grosset, secrétaire général adjoint, et M. Jean-Marie Truffat, secrétaire national
Ø Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie (CNFPTLV) – Mme Danielle Kaisergruber, présidente
Ø Mouvement des entreprises de France (MEDEF)* – Mme Florence Poivey, présidente de la commission Éducation, formation et insertion, M. Antoine Foucher, directeur des relations sociales, de l’éducation et de la formation, et M. Guillaume Ressot, directeur des affaires publiques
Ø Force Ouvrière (CGT-FO) – M. Stéphane Lardy, secrétaire confédéral en charge de la formation professionnelle, Mme Marie-Alice Medeuf Andrieu, secrétaire confédérale, Mme Sandra Mitterrand, conseillère technique, et M. Nicolas Faintrenie, conseiller technique
Ø M. Jean-Marie Luttringer, conseiller en droit et politique de formation
Ø M. Jean-Pierre Willems, consultant en droit social et ressources humaines
Ø Groupe de concertation quadripartite – M. Jean-Marie Marx, président et directeur général de l’APEC
Ø Inspection générale des affaires sociales (IGAS) – M. Philippe Dole, inspecteur général, et M. Laurent Caillot, inspecteur
Ø Opcalia – M. Yves Hinnekint, directeur général
Ø Agefos PME – M. Philippe Rosay, président, et M. Joël Ruiz, directeur général
Ø Uniformation – M. Robert Baron, président
Ø Intergros – M. Michel Mourgue-Molines, directeur général, représentant le président, M. Richard Burgstahler
Ø Syndicat national unitaire Travail emploi formation économie-Fédération syndicale unitaire (SNUTEFE-FSU) – Inspection du travail – M. Francois Stehly, inspecteur du travail, Bas-Rhin, M. Pierre Mériaux, inspecteur du travail, Isère, et M. Dominique Maréchau, directeur du travail, Tarn
Ø Syndicat national travail emploi formation-Confédération française démocratique du travail (SYNTEF-CFDT) – M. Frédéric Laisné, secrétaire général, et M. Henri Jannes, membre associé du bureau national
Ø Confédération générale du travail-Travail-emploi-formation professionnelle (CGT–TEFP) – Mme Sylvie Denoyer, secrétaire générale, et Mme Martine Corneloup, membre du Conseil national de l’inspection du travail (CNIT)
Ø Force Ouvrière-Travail-emploi-formation professionnelle (FO-TEFP) – Mme Florence Barral-Boutet, secrétaire générale
Ø Union nationale des syndicats autonomes-Inspection du travail, de l’emploi, de la formation et administration (UNSA-ITEFA) –M. Michel Zeau, expert juridique
Ø Union syndicale solidaires (SUD-travail) – M. Yves Sinigaglia, Mme Myriam Chalouin, M. Olivier Monnin, membres du conseil national
Ø Agefa PME – M. Jean-Jacques Dijoux, directeur général, et M. Philippe Moreau
Ø Les compagnons du devoir – M. Jean-Claude Bellanger, secrétaire général
Ø Union inter-professions enseignement (UNIPE) – M. Jean-Pierre Hulot, président et M. Hervé Boulben, directeur
Ø Association nationale pour la formation automobile (ANFA) – M. Pierre Rousseau, président, et M. Patrick Omnes, délégué général
Ø Alliance pour l’enseignement professionnel des jeunes (AEPJ) – M. Jean Herlin, administrateur délégué général de l’Association interprofessionnelle pour le développement de l’apprentissage (AIDA)
Ø Comité national des entreprises d’insertion (CNEI) – M. Olivier Dupuis, secrétaire général
Ø COORACE – M. Alexandre Bonjour, secrétaire général, et Mme Elena Poirier, responsable formation professionnelle
Ø Union des employeurs de l’économie sociale et solidaire (UDES) – M. Alain Cordesse, président, M. Michel Guernion, vice-président en charge de la formation professionnelle, M. Sébastien Darrigrand, délégué général, M. Robert Baron, président d’Uniformation, et M. Jean-Marie Poujol, membre du bureau du Syneas et président d’Unifaf
Ø Fongecif Ile-de-France – M. Vincent Pigache, président (CFDT), M. Patrick Frange, vice-président (MEDEF), et M. Laurent Nahon, directeur général
Ø Chambre de commerce et d’industrie de France (CCI de France)* – M. Pierre-Antoine Gailly, 2e vice-président et président de la CCI Paris-Île-de-France, Mme Danièle Dubrac, élue de la CCI Paris-Île-de-France, M. Patrice Guezou, directeur Formation, et M. Jérôme Pardigon, directeur des relations institutionnelles
Ø Association française des entreprises privées (AFEP) – M. François Soulmagnon, directeur général, et M. Pierre-Aimery Clarke de Dromantin, directeur des affaires sociales
Ø Fédération de la formation professionnelle (FFP) – M. Jean Wemaëre, président, M. Jacques Bahry, vice-président, M. Pierre Courbebaisse, vice-président, Mme Emmanuelle Peres, déléguée générale, et M. Olivier Poncelet, chargé de mission
Ø Fédération nationale des Unions régionales des organismes de formation (UROF) – M. Michel Clézio, président
Ø Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) – M. Olivier Faron, administrateur général
Ø Association nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) – M. Yves Barou, président et M. Christophe Donon, directeur de la stratégie
Ø Conférence des Présidents de l’Université – M. Christian Forestier, recteur et consultant pour la CPU et M. Karl Stoeckel, conseiller parlementaire
Ø Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP), M. Eric Dumartin (Medef), président, M. Michel Fortin (CGT-FO), vice-président, et M. Bernard Abeillé, directeur général
Ø Cabinet du ministre de l’éducation – M. Daniel Assouline, conseiller auprès du ministre, orientation, enseignements professionnel, technologique et agricole, et formation continue des adultes
Ø Ministère de l’Éducation nationale – Direction générale de l’enseignement scolaire (DGESCO) – Mmes Maryannick Malicot et Stéphanie Roucou
Ø Ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social – Délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle (DGEFP) – Mme Emmanuelle Wargon, déléguée générale, et M. Jean-Marc Huart, sous-directeur des politiques de formation et du contrôle
Ø M. Jean-François Césaro, professeur à l’Université Panthéon-Assas, Paris II, et M. Antoine Lyon-Caen, professeur à l’université de Paris Ouest-Nanterre La Défense, directeur d’études à l’École des hautes études en sciences sociales
Ø Confédération générale du travail (CGT) – Mme Agnès Le Bot, secrétaire confédérale, M. Eric Lafont, secrétaire confédéral, Mme Catherine Perret, membre de la commission exécutive confédérale, Mme Anne Braun, conseillère confédérale et M. Djamel Teskouk, conseiller confédéral
Ø Groupe Alpha – M. Pierre Ferracci, président, ancien président du Groupe multipartite sur la formation professionnelle, et Mme Carine Seiler, directrice de la formation
Ø Ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social – Direction générale du travail (DGT) – M. Jean-Denis Combrexelle, directeur général, Mme Amel Hafid, cheffe du bureau des relations collectives du travail et M. Yves Calvez, directeur-adjoint au directeur général du travail
Ø Fédération nationale des associations régionales de directeurs de centres de formation d’apprentis (FNADIR) – M. Gilles Langlo, président
Ø Assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat (APCMA)* – M. Alain Griset, président, M. François Moutot, directeur général, Mme Véronique Matteoli, directeur adjoint des relations institutionnelles
Ø Pôle Emploi – M. Jean Bassères, directeur général, Mme Dominique Delaite, directrice-adjointe en charge de la sécurisation des parcours professionnels, et Mme Garance Yayer, chargée de mission
Ø Haut Conseil du dialogue social (HCDS) – Mme Yannick Moreau, présidente, et Mme Amel Hafid, chef du bureau des relations collectives du travail à la direction générale du trésor
Ø Conseil supérieur de l’ordre des experts-comptables – M. Joseph Zorgniotti, président
Ø Compagnie nationale des commissaires aux comptes (CNCC) – M. François Hurel, délégué général, M. Yannick Ollivier, membre du bureau, Mme Chantal Edery, conseillère technique, et M. Gérard Lejeune, président du GT Syndicat
Ø Union professionnelle artisanale (UPA) – M. Pierre Burban, secrétaire général, et Mme Caroline Duc, chargée des relations avec le Parlement
Ø Confédération française de l’encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) – Mme Dominique Jeuffrault, déléguée nationale secteur Emploi formation, M. Jean-Michel Pecorini, secrétaire national secteur Développement syndical et dialogue social, M. Christophe Mickiewicz, directeur financier, et Mme Anne Lecrenais, conseillère technique
1 () Par exemple, Conseil national de la formation professionnelle continue tout au long de la vie. Réflexions sur la création d’un compte individuel de formation. Rapport au ministre en charge de la formation professionnelle, mars 2013.
2 () Rapport d’information au nom de la commission des finances du Sénat sur la répartition du produit de la taxe d’apprentissage par M. François Patriat, du 27 mars 2013
3 () Loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013.
4 () Dans sa décision, le Conseil constitutionnel a estimé que l’article 60, s’il pouvait renvoyer au pouvoir règlementaire l’affectation précise des recettes de la nouvelle taxe d’apprentissage, aurait dû encadrer cette affectation. En l’absence de cette précision dans la loi s’agissant du « quota », le Conseil a censuré, dans la mesure où le législateur a méconnu l’étendue de sa compétence, toutes les dispositions de cet article relatives aux règles d’affectation du produit de la taxe d’apprentissage, c’est-à-dire la fraction régionale, le quota et le hors-quota.
5 () Loi n° 2013-04 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi.
6 () Le groupe quadripartite a été présidé par M. Jean-Marie Marx, président de l’Association pour l’emploi des cadres (APEC) avec l’appui de membres de l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS).
7 () Descamps, Renaud. Le DIF : la maturité modeste. Centre d’étude et de recherche sur les qualifications (CEREQ), Bref n°299-2, mai 2012.
8 () Le salarié perçoit dans ce cas une allocation de formation, égale à la moitié du salaire de référence. Les montants des allocations de formations versés hors temps de travail au titre du DIF s’établissent à 10,6 millions d’euros en 2010 et 8,1 millions d’euros 2011.
9 () GEMELGO, Paulo, KARVAR, Anousheh, VINCENT, Bruno, BREGER, Adrien, Évaluation partenariale de la politique de formation professionnelle des demandeurs d’emploi, IGAS, Modernisation de l’Action Publique, Août 2013.
10 () Il s’agit des facteurs identifiés par les partenaires sociaux figurant dans le projet d’accord du 16 juillet 2008 à savoir :les manutentions manuelles de charges lourdes, les postures pénibles définies comme positions forcées des articulations, les vibrations mécaniques, les agents chimiques dangereux, y compris les poussières et les fumées, les activités exercées en milieu hyperbare, les températures extrêmes, les bruits, le travail de nuit, le travail en équipes successives alternantes et le travail répétitif.
11 () Loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l’orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie.
12 () Accord national interprofessionnel du 5 octobre. 2009 sur le développement de la formation tout au long de la vie professionnelle, la professionnalisation et la sécurisation des parcours professionnels.
13 () MM. Gérard Cherpion et Jean-Patrick Gille, Rapport d’information déposé en application de l’article 145-7, alinéa 1, du règlement par la commission des affaires sociales sur la mise en application de la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l’orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie, Assemblée nationale, XIIIe législature, n° 3208, 9 mars 2011.
14 () Cour de cassation, chambre sociale, 5 juin 2013, N° 11-21255.
15 () Conseil d’État, 8e/9e ssr, 20 décembre 1985, n° 40755.
16 () « Le plan de formation dans les entreprises : de la formalité a l’outil stratégique », SEMAPHORES, juin 2013.
17 () Loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale
18 () Loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi.
19 () Loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social.
20 () Loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l’orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie.
21 () Bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA), de l’allocation de solidarité spécifique (ASS) et de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).
22 () « Le contrat de professionnalisation en 2012 », DARES Analyse, n° 075, décembre 2013.
23 () Loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011 pour le développement de l’alternance et la sécurisation des parcours professionnels.
24 () Cette qualification est soit enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles, soit reconnue dans les classifications d’une convention collective nationale de branche, soit ouvre droit à un certificat de qualification professionnelle.
25 () Loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011 pour le développement de l’alternance et la sécurisation des parcours professionnels.
26 () Loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011 pour le développement de l’alternance et la sécurisation des parcours professionnels.
27 () Par exemple, Cass, Chambre sociale, 5 juin 2013, n° 11-21-255, publié au Bulletin.
28 () C’est le cas d’UNIFAF, AFDAS, UNIFORMATION, FAF TT, OPCALIM et FAFSEA.
29 () L’AGECIF CAMA et l’UNAGECIF.
30 () « L’évaluation des politiques publiques en faveur de la mobilité sociale des jeunes », rapport du Comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques présenté par MM. Régis Juanico et Jean-Frédéric Poisson (n° 1613, 5 décembre 2013).
31 () Loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013.
32 () Loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale.
33 () Loi n° 2011-900 de finances rectificative du 29 juillet 2011.
34 () Mme Annie Fouquet, M. Hayet Zeggar et M. Hervé Leost, « Bilan-évaluation du contrat d’objectif et de moyens (COM) pour le développement et la modernisation de l’apprentissage », Inspection générale des affaires sociales (septembre 2009).
35 () Selon le Préambule de la Constitution de 1946 « la Nation garantit l’égal accès de l’enfant et de l’adulte à l’instruction, à la formation professionnelle et à la culture. L’organisation de l’enseignement public et laïque à tous les degrés est un devoir de l’État. »
36 () L’article L. 132-2 du code de l’éducation dispose que l’enseignement est gratuit pour les élèves des lycées et collèges publics qui donnent l’enseignement du second degré, ainsi que pour les élèves des classes préparatoires aux grandes écoles et à l’enseignement supérieur des établissements d’enseignement public du second degré.
37 () Le tribunal de grande instance était saisi par un apprenti, le syndicat national des personnels de l’enseignement et de la formation privée (SNPEFP) et l’union départementale CGT des travailleurs de la Loire qui demandaient la restitution, par l’association gérant le CFA, de la participation financière demandées aux apprentis afin de couvrir les frais de gestion administrative (carte d’étudiant, carnet de liaison, bulletins semestriels, affranchissement, utilisation des équipements informatiques …).
38 () Circulaire n° 2001-256 du 30 mars 2001 sur la mise en œuvre du principe de gratuité de l’enseignement scolaire public.
39 () Le matériel d’enseignement à usage collectif, les fournitures à caractère administratif, la production de photocopies à destination des élèves et de leurs familles, les frais de correspondance adressée aux familles, les frais de téléphone et de télématique
40 () Parmi ces frais figurent les frais de restauration ou d’hébergement, frais de transport du domicile au CFA, frais d’achat de matériel, de fourniture et d’équipement, à l’exception des matériels de sécurité notamment et de l’achat de matières premières nécessaires pour la réalisation de la formation, frais d’adhésion facultative à une association comme l’adhésion à une association d’anciens apprentis, frais d’inscription aux tests ou aux examens autres que ceux se rapportant à la formation suivie, frais afférents aux sorties culturelles ou de loisir facultatives, frais de transport et d’hébergement exposés dans le cadre de l’organisation d’un séjour à l’étranger présentant un caractère non obligatoire.
41 () Dispositions relatives à la formation, l’exécution et la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
42 () « L’évaluation des politiques publiques en faveur de la mobilité sociale des jeunes », rapport du Comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques présenté par MM. Régis Juanico et Jean-Frédéric Poisson (n° 1613, 5 décembre 2013).
43 () Rapport d’information fait au nom de la commission des finances sur le répartition du produit de la taxe d’apprentissage par M. François Patriat (n° 455, 27 mars 2013).
44 () Loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.
45 () En sont exonérés les entreprises employant des apprentis et dont la base d’imposition (l’ensemble des rémunérations) ne dépasse pas six fois le smic annuel, les sociétés civiles de moyens, sous certaines conditions, lorsque leur activité est non commerciale, les sociétés et personnes morales ayant pour objet exclusif l’enseignement et les groupements d’employeurs composés d’agriculteurs ou de sociétés civiles agricoles bénéficiant eux-mêmes de l’exonération.
46 () Loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013.
47 () Dans sa décision, le Conseil constitutionnel a estimé que l’article 60, s’il pouvait renvoyer au pouvoir règlementaire l’affectation précise des recettes de la nouvelle taxe d’apprentissage, aurait dû encadrer cette affectation. En l’absence de cette précision dans la loi s’agissant du « quota », le Conseil a censuré, dans la mesure où le législateur a méconnu l’étendue de sa compétence, toutes les dispositions de cet article relatives aux règles d’affectation du produit de la taxe d’apprentissage, c’est-à-dire la fraction régionale, le quota et le hors-quota.
48 () Loi n°71-576 du 16 juillet 1971 relative à l’apprentissage.
49 () Articles 10 et 20 du Décret n°72-283 du 12 avril 1972 relatif à la taxe d’apprentissage et portant application des dispositions de la loi n. 71-578 du 16 juillet 1971 relative à la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles.
50 () Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale.
51 () Rapport d’information fait au nom de la commission des finances sur la répartition du produit de la taxe d’apprentissage par M. François Patriat (n° 455, 27 mars 2013).
52 () Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale.
53 () Il s’agit essentiellement des OCTA régionaux du BTP, des 4 OCTA de la métallurgie et des 4 MEDEF régionaux.
54 () En vertu de l’article 14 du présent projet de loi, le comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles a pour mission d’assurer la coordination entre les acteurs des politiques d’orientation, de formation professionnelle et d’emploi et la cohérence des programmes de formation dans la région.
55 () Cet article est aujourd’hui relatif au délégué à l’information et à l’orientation, celui-ci étant supprimé. De plus amples précisions sont apportées à ce sujet dans le cadre du commentaire, inclus dans le présent rapport, relatif à l’article 14 du projet de loi.
56 () « Évaluation de l’action du groupement d’intérêt public Agence nationale de lutte contre l’illettrisme », IGAS/IGAENR, 2012.
57 () Avis n° 08-A-10 du 18 juin 2008 relatif à une demande d’avis présentée par la Fédération de la formation professionnelle (FFP).
58 () Décision n° 2010-67/86 QPC du 17 décembre 2010.
59 () Enquête de la Cour des comptes sur l’AFPA, rendue aux Commission des Finances et des Affaires sociales du Sénat, et publiée en décembre 2013, dans le cadre du rapport d’information n° 298, présenté par M. Claude Jeannerot, janvier 2014.
60 () Loi n° 2013-04 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi.
61 () Loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l’orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie.
62 () Inspection générale des affaires sociales, « Le service public de l’orientation : état des lieux et perspectives dans le cadre de la prochaine réforme de décentralisation », janvier 2013.
63 () Amendement n° 5444 (rect.) présenté par M. Gille, Mme Iborra, Mme Carrey-Conte, M. Sebaoun, M. Robiliard, Mme Romagnan, M. Paul, M. Philippe Baumel, Mme Biémouret, Mme Bouziane, Mme Laurence Dumont, M. Ferrand, Mme Hélène Geoffroy, Mme Guittet, M. Hammadi, Mme Sommaruga, M. Thévenoud et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen adopté lors de la deuxième séance du jeudi 4 avril 2013.
64 () Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale.
65 () Inspection générale des affaires sociales, « Évaluation du pilotage de la formation professionnelle par les conseils régionaux », mai 2012.
66 () Inspection générale des affaires sociales, « Hébergement des jeunes en formation par alternance : Comment investir dans des solutions adéquates ? », octobre 2010.
67 () Loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République.
68 () Loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l’organisation du service public de l’emploi.
69 () Loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social.
70 () Loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l’orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie.
71 () Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale.
72 () Accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 relatif à la formation et au perfectionnement professionnels.
73 () Accord national interprofessionnel du 10 février 1969 sur la sécurité de l’emploi.
74 () Accord national interprofessionnel du 9 juillet 1970 sur la formation et le perfectionnement professionnelle.
75 () Accord national interprofessionnel du 5 octobre 2009 relatif à l’accès des salariés à la formation professionnelle tout au long de la vie professionnelle.
76 () M. Gérard Larcher, « La formation professionnelle : clé pour l’emploi et la compétitivité », document remis à Monsieur Le Président de la République, avril 2012.
77 () M. Yves Urieta, « 40 ans de formation professionnelle : bilan et perspectives », avis du Conseil économique, social et environnemental, Mandature 2010-2015, Séance du 13 décembre 2011.
78 () Il s’agit des régions Basse-Normandie, Bourgogne, Champagne-Ardenne, Corse, Franche-Comté, Guadeloupe, Languedoc-Roussillon, La Réunion, Limousin, Martinique, Nord Pas de Calais, Pays de la Loire, Poitou-Charentes et Provence-Alpes-Côte d’azur.
79 () Rapport sur la réforme de la représentativité patronale, M. Jean-Denis Combrexelle, Directeur général du travail, octobre 2013.
80 () Pour mémoire, les quatre premiers critères généraux de représentativité énoncés par le nouvel article L. 2151-1 sont : le respect des valeurs républicaines ; la transparence financière ; une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation, cette ancienneté s’appréciant à compter de la date de dépôt légal des statuts.
81 () Décret n° 2012-1130 du 5 octobre 2012 modifiant l’attribution des compétences au sein de la juridiction administrative en matière de représentativité des organisations syndicales.
82 () Position commune du 9 avril 2008 sur la représentativité, le développement du dialogue social et le financement du syndicalisme, signée par deux organisations syndicales de salariés (CFDT, CGT) et deux organisations d’employeurs (CGPME, MEDEF).
83 () En cas d’absence ou de carence des organisations de salariés ou d’employeurs se traduisant par une impossibilité persistante de conclure un accord dans une branche ou un secteur territorial, le ministre chargé du travail peut procéder à un élargissement, c’est-à-dire rendre obligatoire dans la branche ou le secteur territorial considéré un accord de branche ou interprofessionnel déjà étendu à une branche ou un secteur territorial différent.
84 () Rapport sur la négociation collective et les branches professionnelles, de M. Jean-Frédéric Poisson, parlementaire en mission, remis au Premier ministre en avril 2009.
85 () La loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 a transformé la réduction d’impôt afférente en crédit d’impôt.
86 () Ces données sont issues du tome II des « Voies et moyens » annexées au projet de loi de finances pour 2014.
87 () Cette désignation est présumée avoir été effectuée dès lors que 40 % des droits de vote étaient détenus, directement ou indirectement au cours de ces deux exercices, et qu’aucun autre associé ou actionnaire ne détenait, directement ou indirectement, une fraction supérieure à la sienne.
88 () Avis n° 3811-Tome VI sur le projet de loi de finances pour 2012, de M. Francis Vercamer, député, au nom de la Commission des affaires sociales, octobre 2011.
89 () L’article L. 8112-4 énonce aujourd’hui qu’« un décret détermine les modalités de contrôle de l’application des dispositions du présent code aux salariés des offices publics et ministériels, des professions libérales, des sociétés civiles, des syndicats professionnels et associations de quelque nature que ce soit », une disposition devenue obsolète depuis l’abrogation du décret du 22 juillet 1941 par la suppression de l’article R. 611-5 de l’ancien code du travail lors de la recodification.
90 () L’article L. 8112-5 énonce aujourd’hui que « les contrôleurs du travail chargés de contrôles, d’enquêtes et de missions dans le cadre de l’inspection du travail exercent leur compétence sous l’autorité des inspecteurs du travail », une catégorie de disposition dont l’anticipation du plan de transformation des emplois rend la suppression nécessaire, ce qu’opère le présent article en en proposant une nouvelle rédaction sans reprise de l’actuelle.
91 () Décret n° 2007-1404 du 28 septembre 2007 relatif à l’arrêt temporaire d’activité.
92 () Pour mémoire, l’article 38 de la Constitution énonce que : « Le Gouvernement peut, pour l’exécution de son programme, demander au Parlement l’autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi. // Les ordonnances sont prises en Conseil des ministres après avis du Conseil d’État. Elles entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n’est pas déposé devant le Parlement avant la date fixée par la loi d’habilitation. Elles ne peuvent être ratifiées que de manière expresse. // A l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article, les ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans les matières qui sont du domaine législatif ».
93 () Pour mémoire, l’article L. 6231-2 énonce que : « un centre de formation d’apprentis peut conclure avec une entreprise habilitée par l’inspection de l’apprentissage, dans des conditions déterminées par décret, une convention aux termes de laquelle cette entreprise assure une partie des formations technologiques et pratiques normalement dispensées par le centre de formation d’apprentis ».
94 () Pour mémoire, l’article L. 6231-2 énonce que : « un centre de formation d’apprentis peut conclure avec des établissements une convention aux termes de laquelle ces derniers assurent tout ou partie des enseignements normalement dispensés par le centre de formation d’apprentis et mettent à disposition des équipements pédagogiques ou d’hébergement.
De telles conventions peuvent être conclues avec :
1° Un ou plusieurs établissements d’enseignement publics ou privés sous contrat ;
2° Des établissements d’enseignement technique ou professionnel reconnus ou agréés par l’État ;
3° Des établissements habilités à délivrer un titre d’ingénieur diplômé ou des établissements de formation et de recherche relevant de ministères autres que celui chargé de l’éducation nationale. »
95 () Pour mémoire, l’article 38 de la Constitution énonce que : « Le Gouvernement peut, pour l’exécution de son programme, demander au Parlement l’autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi. // Les ordonnances sont prises en Conseil des ministres après avis du Conseil d’État. Elles entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n’est pas déposé devant le Parlement avant la date fixée par la loi d’habilitation. Elles ne peuvent être ratifiées que de manière expresse. // A l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article, les ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans les matières qui sont du domaine législatif ».